Panorama du cinéma nigérien 2140313135, 9782140313134
Cet ouvrage est consacré à l'histoire du cinéma produit au Niger. Il se veut une vue d'ensemble et s'appu
185 66 18MB
French Pages 226 [217] Year 2023
Polecaj historie
Citation preview
Malgré l’ancrage du cinéma nigérien dans la sous-région, au Niger, on note peu d’écrits scientifiques pour suivre son évolution d’où son choix, qui se justifie tout d’abord, par l’importance du cinéma sur le plan social, des rapports qu’il entretient avec les autres arts, de son ancrage sur le continent africain à travers la production des années 60-80, les distinctions des films nigériens, les participations aux festivals et l’organisation des rencontres cinématographiques au Niger.
Titulaire d’un doctorat unique en Arts (études cinématographiques), réalisateur, producteur TV, Youssoufa Halidou Harouna est journaliste professionnel et critique de cinéma. Enseignant en cinéma et audiovisuel dans plusieurs universités et instituts du Niger, il est le fondateur de l’Association Nigérienne des Ciné-clubs et Critiques de Cinéma (ANCCCC) et Délégué Général de Toukountchi Festival de Cinéma du Niger.
Youssoufa Halidou Harouna
Panorama du cinéma nigérien est un ouvrage consacré à l’histoire du cinéma produit au Niger. Il se veut une vue d’ensemble et s’appuie sur sa genèse et son évolution à partir d’un corpus de films représentatifs dans lesquels on retrouve les films des pionniers comme Moustapha Alassane, Oumarou Ganda et ceux de la nouvelle génération tel Moussa Hamadou Djingarey.
Études africaines
Série Cinéma
Youssoufa Halidou Harouna
PANORAMA DU CINÉMA NIGÉRIEN
PANORAMA DU CINÉMA NIGÉRIEN
PANORAMA DU CINÉMA NIGÉRIEN
Études africaines Série Cinéma
Préface de Harouna Niandou
Illustration de couverture : © freepik - Jalka Studio
ISBN : 978-2-14-031313-4
24 €
9 782140 313134
PANORAMA DU CINÉMA NIGÉRIEN
Youssoufa HALIDOU HAROUNA
PANORAMA DU CINÉMA NIGÉRIEN
Préface de Harouna Niandou
© L’Harmattan, 2023 5-7, rue de l’École-Polytechnique ; 75005 Paris http://www.librairieharmattan.com ISBN : 978-2-14-031313-4 EAN : 9782140313134
Dédicace À mon père, Halidou Harouna, qui m’a quitté très tôt, que son âme repose en paix. À ma mère, Hadjara Souley, pour m’avoir tout donné depuis ma naissance.
7
Remerciements C’est un grand honneur de pouvoir témoigner ici ma gratitude envers toutes les personnes et les institutions qui ont contribué d’une façon ou d’une autre dans la conduite ou l’aboutissement de ce travail de recherche. Je remercie l’Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM) qui m’a permis d’entreprendre mes travaux d’étude et de recherche au sein de sa structure. Je remercie mon école doctorale ED/ LASHS (Lettres, Arts, Sciences de l’Homme et de la Société, qui, par les formations dispensées et par les colloques auxquels elle m’a permis de prendre part en vue de faciliter l’enrichissement de mes connaissances, a densifié mes aptitudes scientifiques et méthodologiques. Je tiens à remercier ma directrice de thèse, Docteur Antoinette TIDJANI ALOU, qui, par son expérience et sa disponibilité, a toujours su, depuis 2012, me prodiguer des conseils, m’encourager me guider à rectifier, de temps à autre, certains tirs. Sans son soutien permanent ce travail n’aurait jamais vu le jour. Je pense également à Dr KOUAWO CANDIDE Achille, qui a toujours su me motiver dans mon parcours pendant bientôt dix (10) ans. À mon ami monsieur THIERNO DIA Ibrahima, pour ses nombreux conseils, Aux Professeurs Sada NIANG et Hélène TISSIERES, dont leur apport était capital pour la finition du document, À Ibrahim HAMIDOU, Issa HASSANE et Habila Amadou ADAMOU DIALLO pour leurs contributions multiformes, À la Confédération Suisse, à travers le Projet PADEC pour le soutien financier à la filière Art et Culture de l’Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM). Je n’oublierai pas ma femme Maimouna ATTININE, mes trois (3) enfants, Aichatou, Chirine Fatima, Ismael, ainsi que toute ma grande famille (mes frères et sœurs) pour leurs encouragements infaillibles. J’exprime ma gratitude aux membres du jury qui ont accepté de participer à la soutenance de cette thèse.
9
Sigles et abréviations ACCT : ACN : ANCCCC : AOF : CCFN : CCOG : CEDEAO : CIDC : CIPROFILMS : CIRTEF : C: CMA : CM : CMD : CMF : CNC : CNCN : CNRS : COMACICO : FAC : FCFA :
Agence de Coopération Culturelle et Technique (actuelle OIF) Association des Cinéastes Nigériens Association Nigérienne des Ciné-clubs et Critiques de Cinéma Afrique Occidentale Française Centre Culturel Franco Nigérien Jean Rouch Centre Culturel Oumarou Ganda Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest Consortium Interafricain de Distribution Cinématographique Consortium Interafricain de Production de Films Centre International des Radios et de Télévisions d’Expression Française Couleur Court Métrage Animation Court Métrage Court Métrage Documentaire Court Métrage Fiction Centre National de Cinéma et de l’Image Animé ((France) Centre National de la Cinématographie du Niger Centre National de la Recherche Scientifique Compagnie Africaine Cinématographique Industrielle et Commerciale Fonds d’Aide à la Coopération Francs des Comptoirs Français d’Afrique/Communauté Financière d’Afrique
11
FAHMA : FAFD : FEPACI : FESPACO : FIFEN : FIFIDHO : IDH : IFAN : INA : IRSH : LMD : LMF : MMD : MMF : MRC/A/MS : OCAM : OCIC : OIF : ORTN : RFI : SCCN : SECMA : SOCOFILMS : TFCN : UEMOA : UNESCO :
Festival de Films d’Animation Hommage à Moustapha Alassane Forum Africain du Film Documentaire Fédération Panafricaine des Cinéastes Festival Panafricain du Cinéma de la Télévision de Ouagadougou Festival International du Film d’Environnement Festival de Film sur les Droits de l’Homme Indice de Développement Humain Institut Français pour l’Afrique Noire Institut National d’Audiovisuel Institut de Recherche en Sciences Humaines Long Métrage Documentaire Long Métrage Fiction Moyen Métrage Documentaire Moyen Métrage Fiction Ministère de la Renaissance Culturelle des Arts et de la Modernisation Sociale Organisation Commune Africaine et Malgache Organisation Catholique Internationale pour le Cinéma Organisation Internationale de la Francophonie Office de Radiodiffusion et Télévision du Niger Radio France Internationale Semaine de la Critique du Cinéma Nigérien Société d’Exploitation Cinématographique Africaine Société Commerciale de Films Toukountchi Festival de Cinéma du Niger Union Economique Monétaire Ouest Africaine Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
12
SOMMAIRE Préface .............................................................................................. 15 Introduction générale........................................................................ 17 PREMIÈRE PARTIE : AVENEMENT DU CINEMA........................................................ 41 Chapitre 1 : De l’origine du cinéma au Niger ...................................................... 43 Chapitre 2 : Le circuit de la production : le financement, la réalisation la distribution, les salles de projection et les télévisions au Niger ....... 73 DEUXIÈME PARTIE : LES FILMS FICTIONS ET DOCUMENTAIRES AU NIGER 95 Chapitre 3 : Analyse de quelques fictions ............................................................ 97 Chapitre 4 : Analyse de quelques documentaires............................................... 123 TROISIÈME PARTIE : RAPPORT ENTRE CINÉMA, CULTURE NIGÉRIENNE ET LES AUTRES ARTS.................................................................... 153 Chapitre 5 : Le cinéma et les autres arts............................................................. 155 Chapitre 6 : Le Niger dans les rencontres cinématographiques et les perspectives ........................................................................................................ 181 Conclusion...................................................................................... 203 Bibliographie .................................................................................. 213 Table des légendes.......................................................................... 223 Table des matières .......................................................................... 225
13
Préface Porté par une immigration positive et une farouche détermination de quelques hommes et femmes que le destin a réunis, le cinéma a connu un rapide et retentissant début au Niger. Il s'est fait distinguer dès les premières heures des rencontres cinématographiques, d'abord pour porter le Festival Panafricain de Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO) sur les fonts baptismaux, ainsi que les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) de Tunisie, ensuite au moment des débats en vue d'une promotion efficace du 7 ème Art en Afrique. Point n'est besoin de trop épiloguer sur la question . Il suffit , pour s'en convaincre , de se reporter aux différents palmarès, et d' apprécier, à sa juste valeur , le combat mené par nos cinéastes dont Moustapha Alassane, Oumarou Ganda. Loin de nous l'idée de nous complaire dans un triomphalisme sans lendemain, bien que nous ayions des raisons de le faire. Mais nous avons décidé, à juste titre, me semble-t-il, de saisir avec ferveur et espoir, l"avènement de l'ouvrage de notre collègue, le Dr Youssoufa Halidou Harouna pour regarder, ensemble, dans le rétroviseur, et envisager l'avenir avec sérénité. Le contenu de ce livre donne un éclairage saisissant sur l'histoire du cinéma au Niger, ses acteurs et leurs conditions d'existence souvent difficiles. Il nous replonge dans les fondements de notre culture et le rayonnement de celle-ci, et nous renvoie notre propre image. Certes , ici et là on peut trouver des écrits sur le cinéma au Niger: des articles de presse, des revues, des mémoires d'écoles, des conférences, des bandes magnétiques enregistrées, des bouts ou des fragments de documents de tradition orale. Mais les exigences de notre siècle nous poussent à regrouper tous ces éléments en un document de référence. D'où la rédaction et la publication du livre que vous tenez entre vos mains. Pour qui, comme moi, à l'époque reporter au célèbre et inoubliable quotidien, "Le Temps du Niger" a suivi les cinéastes nigériens par monts et vallées, de festival en festival en Afrique et dans le reste du monde, il sait que les films de nos réalisateurs traitent de tous les thèmes, de toutes nos préoccupations du passé et du 15
moment : les anciens combattants, les problèmes sociaux et culturels, la lutte contre le colonialisme, l'immigration, la situation de la femme et de l'enfant, la promotion des langues nationales, la corruption, les passe-droits, et même les changements de régimes. Bref, ces « ambassadeurs de l'Afrique » auprès du reste du monde ne se sont pas uniquement contentés de présenter des lettres de créance. Ils ont agi fort bien en dépit du manque criant de moyens. Engagé, combattant, innovateur, précurseur, militant et j'en passe , tous ces qualificatifs conviennent au cinéma nigérien. Pourquoi alors ne pas le dire à la face du monde? C'est du reste, la raison profonde qui me pousse à exalter nos cinéastes à rechercher sans cesse la voie de l'excellence. Nous devons être tous fiers du travail abattu par le Dr Youssoufa Halidou Harouna. Non seulement il exerce dans le domaine de la critique cinématographique, mais il a aussi créé une association dans ce domaine. Et, suprême consécration, il est promoteur d'un des festivals de cinéma au Niger. Grâce à sa détermination, à sa conviction et son espoir en l'avenir, il a pu maintenir la périodicité de Toukountchi (récompense) dont nous avons célébré la 6ème édition en décembre 2021. Sans essoufflement, ni découragement ! Un vrai militant au service d'une noble cause. Au surplus, l'ouvrage de Youssoufa analyse les rapports étroits existant entre le cinéma et les autres Arts. la musique, le théâtre, le dessin animé, la littérature. Mes derniers mots sont un cri de ralliement à l'endroit de tous les cinéastes nigériens : soyez unis comme les fibres unitives du coeur. C'est à ce prix que le 7ème Art nigérien triomphera ! Niamey, 30 octobre 2022 Harouna Niandou Grand Croix de l'Ordre National du Niger Ancien Ministre Président du Conseil d'Administration du Centre National de la Cinématographie Président de l'Association des Cinéastes Nigériens Premier Président du jury de la Critique Internationale au FESPACO (1972)
16
Introduction générale De tout temps, on a toujours voulu exprimer son vécu, ses sentiments, ses désirs, ses rêves, ses aspirations de tous genres. Pour certains, l’expression se fait dans des journaux intimes, dans des romans, dans du théâtre. Pour d’autres, le vécu, les émotions sont matérialisées dans le cinéma, cet art formidable qui allie son et image pour toucher un public large. Au Niger, le septième art a vu le jour et a connu une évolution assez significative du fait de son implantation conséquente malgré la fréquentation d’un public jadis quelque peu éloigné des salles de cinéma. Dès lors, n’est-il pas intéressant de se pencher sur la question afin de tenter d’apporter un éclairage sur le cinéma nigérien et de contribuer à alimenter la réflexion sur la pratique de cette forme d’expression dans ce contexte national ? Le sujet Panorama du cinéma au Niger des origines à nos jours est consacré à l’histoire du cinéma produit au Niger. Il se veut une vue d’ensemble et s’appuie sur sa genèse et son évolution à partir d’un corpus de films représentatifs de la production cinématographique au Niger. L’étude vise, à préserver et à archiver ce patrimoine. Une partie des films retenus dans notre corpus fut tournée en format 16 mm en vidéo, soit en analogique, qui ne filme pas en haute définition ; le reste du corpus étant tourné en numérique, qui permet d’obtenir une qualité de vidéo supérieur. Afin de mener une étude minutieuse et fine de l’évolution du cinéma au Niger, le modèle de l’analyse de contenu est retenu dans cette recherche. Ce modèle d’analyse de contenu appelé aussi, analyse de film ou théorie de film consiste à présenter le film à travers son esthétisme. Il permet de mieux appréhender la portée du film. L’analyse nous permettra de donner un aperçu clair sur le cinéma au Niger, à partir des instruments de ce modèle dont : le décor du film qui peut être naturel ou construit pour le tournage. Il doit être réaliste en lieu avec l’écriture du scénario. La forme et l’espace sont aussi importants pour la crédibilité du décor. La couleur, elle, sert à identifier un personnage et à caractériser un objet. Elle véhicule un choix esthétique et une fonction interprétative, symbolique, dramatique ou narrative. La couleur est fonction d’une culture donnée ;
17
le mouvement de la caméra est utilisé pour décrire les lieux et même les personnages. Il s’obtient par la rotation sur un axe ou par le déplacement dans l’espace de la caméra ; l’image du film est une transposition ou une représentation d’une personne ou d’une chose. A partir de plusieurs représentations le réalisateur arrive à raconter les évènements ; le jeu des acteurs ou l’interprétation réelle ou fictive d’un personnage est une activité qui permet à un acteur de jouer ou de se mettre dans la peau d’un personnage; le récit filmique qui permet de conduire l’histoire du film ; le montage qui consiste à agencer les images dans un tout cohérent pour qu’elles soient digestes ; les effets spéciaux qui sont des techniques pour animer le film à travers des fondus, etc. ; le langage cinématographique qui se décompose en valeurs de plans (images) et thématiques des films. Cette analyse permet d’analyser des films et suivre l’évolution. Malgré l’ancrage du cinéma nigérien dans la sous-région, au Niger, on note peu d’écrits scientifiques pour suivre son évolution. Cette opposition est peut-être dû par plusieurs raisons dont : l’absence de formation en recherche dans les métiers de cinéma et des cinéastes presque tous sont des autodidactes. L’absence de revues spécialisées dans le cinéma est compensée par les journaux, en particulier Le Sahel et Sahel Dimanche, deux journaux de l’État qui suivent de près l’évolution de ce cinéma. En témoignent, des articles divers qui sont autant des critiques de cinéma, que des dossiers allant des années 1960 à nos jours. Certains des rédacteurs de ces articles, qui furent des promoteurs du cinéma nigérien, sont toujours en vie. Et, ils continuent d’animer les rubriques sur le cinéma. L’un des pionniers, Harouna Niandou venait d’être nommé comme Président du Conseil d’Administration du Centre National de la Cinématographie. Il a fallu attendre 1991, pour voir le premier ouvrage1 sur le cinéma nigérien2, alors que les tous premiers films dans ce pays, dataient
1
Maizama, Issa. Un Regard du dedans : Oumarou Ganda, cinéaste nigérien. Dakar : ENDA, 1991. 2 Cinéma nigérien ou cinéma du Niger est le cinéma produit par des structures nigériennes et réalisé par des cinéastes nigériens. Le cinéma au Niger englobe toutes les
18
respectivement de 19253, 19364 et 19475. Faire une étude panoramique du cinéma au Niger est de voir la pluralité des genresfilmiques des acteurs nigériens, et, des étrangers qui ont réalisé des films au Niger sur les populations nigériennes. C’est de montrer sa vivacité et contribuer à la recherche et à la valorisation de cet art. Cette vivacité se voit à travers les distinctions internationales des films nigériens et la participation aux différents festivals. Ainsi, le 1 er prix de l’Etalon de Yennega dans l’histoire du FESPACO revient en1972, au film Le Wazzou polygame d’Oumarou Ganda du Niger. D’autres films seront primés lors des différentes éditions du festival. Le film FVVA : Femme, Villa, Voiture, Argent de Moustapha Alassane, a reçu le prix l’OCAM 1972. Le Prix de la critique 1976 revenait à Paris, C’est Joli de Inoussa Ousseini, le prix de la ville de Ouagadougou 1976 au film L’étoile noire de Djingarey Maiga. Il faut souligner aussi, qu’à toutes les éditions du FESPACO, le Niger était représenté dans une des catégories du festival. Le film Koukan Kourcia ou le cri de la tourterelle de Sani Magori, est distingué par l’Union Economique et Monétaire Ouest- Africaine (UEMOA). En 2013, le film Hawan Idi de Amina Abdoulaye Mamani est primé dans la catégorie « Film des écoles » En 2015, le Niger est à nouveau présent avec trois films. En 2017, cinq œuvres sont nominées dont deux films de femmes : le premier long- métrage Zin’naariyâ! De Rahmatou Keïta, primé pour sa meilleure image. Et L’Arbre sans fruit de Aicha Macky, sélectionné dans la catégorie « Documentaire ». En 2019, le Niger était présent avec trois documentaires et fiction. Il faut noter que dans cette recherche, nous évoquerons plus le cinéma nigérien, ce cinéma fait par des nigériens. Le cinéma témoignage vivant, de ce qu’il y aurait à prendre ou à laisser à une génération, est la mémoire d’un peuple. À travers lui, les jeunes générations voient, de façon imagée, les différentes mutations de leur communauté. Le cinéma présente un avantage majeur. C’est un art qui ne passe pas par la case école. Sembene Ousmane souligne que : « Mon ambition n’est pas de confectionner des produits qui se vendent et se consomment. Je vis dans, et je participe à une société donnée ; la société africaine qui se trouve dans un tournant décisif de son histoire. réalisations nationales et étrangères d’inspiration nigérienne tournées au Niger et sur des nigériens. 3 La Croisière Noire (1925) de Léon Poirier, cinéaste français. 4 La Grande Caravane (1936) de Jean Marie d’Esme, français. 5 Rouch, Jean. Au Pays des Mages Noirs. Paris, 1947.
19
Mon ambition comme artiste et surtout cinéaste, c’est de faire des filmslivres, des films-écoles, ou cours d’alphabétisation fondamentale. »6. Bien auparavant, Oumarou Ganda note que : « Le cinéma, c’est le livre qui se lit par excellence par tout le monde on a pas besoin d’aller à l’école pur apprécier un film7 » Les deux cinéastes s’accordent que le cinéma est un moyen d’éducation qui se consomme sans un quelconque parcourt éducatif diplômant. Il faut noter que, Sembène Ousmane et Oumarou Ganda étaient des autodidactes au début de leur carrière cinématographique, mais que leurs œuvres continuent à contribuer à l’éducation des populations. Dynamique à ses débuts, le cinéma nigérien connait, par la suite, une certaine léthargie. En effet, les structures (Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN), Consortium Inter Africain de Distribuions de Films (CIDC régional) qui soutenaient la production disparurent, de même que les circuits de distribution de films (Consortium Inter Africain de Distribuions de Films (CIDC représentation nationale), SONEXI). Cette disparition des structures est dû d’une part, par l’inconséquence des États membres du Consortium International de Distribution Cinématographique, lesquels, ne payaient plus leur côté part pour son fonctionnement. D’autres part, il y’a eu un effet d’entrainement dans les Etats membres, en occurrence le Niger. Avec la disparition du CIDC, les structures nationales ferment à leur tour, car le CIDC, qui distribuait les films n’existe plus. Nous pouvons souligner une troisième raison, celle de la concurrence des sociétés étrangères de distribution, qui étaient mieux organisées dans leur activité. Le choix de notre sujet, se justifie tout d’abord, par l’importance du cinéma sur le plan social, de son ancrage sur le continent africain à travers la production des années 60 - 80, les distinctions des films nigériens, les participations au festival et l’organisation des rencontres de réflexion sur le cinéma. Je peux citer le 1 er colloque sur la production cinématographique en Afrique, tenu à Niamey du 1er au 04 mars 1982. Ce colloque était l’occasion aux cinéastes africains de faire des recommandations pour la bonne marche du cinéma africain. C’est ainsi que nous pouvons voir au 4 ème principe des conclusions du colloque que : « Au stade actuel, du développement de l’audiovisuel 6
Niang, Sada. Littérature et cinéma en Afrique francophone : Sembène Ousmane et Asia Djebar. Paris : Harmattan,1996, p. 121. 7 Harouna Niandou in Nigérama, n° 3, p.13
20
dans le monde et en Afrique, la pleine viabilité de la production cinématographique ne pourra se faire sans le concours des télévisions des pays concernés.8 » Pour mémoire, il est intéressant d’évoquer le parcours de ce cinéma. Justement, c’est en 1962 que le cinéma nigérien entre dans l’histoire cinématographique de l’Afrique de l’Ouest avec les tous premiers films du réalisateur Moustapha Alassane. De quatre courts métrages la même année, dont Aouré9 et la Bague du Roi Koda10, il réalisa La mort de Gandji en 1965, premier film d’animation sur l’oralité, primé à la première édition du Festival Mondial des Arts Nègres qui a eu lieu l’année suivante. Il faut souligner que dès 1961, Moustapha Alassane réalisa Le, premier film d’animation sur le continent africain. Suivra d’autres films d’animation dont Bon Voyage Sim en 1966. Ce film met en lumière la mésaventure d’un Président qui est détrôné en rentrant d’un voyage. Son film Le retour d’un aventurier (1966), premier film, western à l’africaine, est un véritable chef-d’œuvre. Critiqué par les cinéastes africains à sa sortie, Djingarey Maiga, acteur principal du film affirmait que : « le film a été interdit au Cameroun parce qu’il ne reflétait pas les réalités africaines. Personne n’osait toucher le chapeau du roi à plus forte raison le porter. Les festivals comme les JCC et le FESPACO ont refusé sa projection de manière officielle, tellement les cinéastes ne se retrouvait pas dans ce film11 ». Le film fera l’objet d’une analyse dans la deuxième partie de cette thèse. Le pays poursuit dans la production cinématographique dans les années 60 -70 à travers plusieurs films primés. Nous pouvons citer Cabascabo (1968) d’Oumarou Ganda avec un prix spécial en 1969 à Moscou, le Tanit de bronze à Carthage, un prix des ciné-clubs en Espagne. Entre les années 80 aux années 90, la production des films des réalisateurs indépendants au Niger était timide, alors qu’une masse importante de films documentaires (sensibilisation et de propagande) sont réalisés et diffusés sur la chaîne de la télévision nationale, Télé Sahel. Cela est dû par le fait que beaucoup des réalisateurs indépendants étaient mis à la disposition des structures étatiques. Les cinéastes 8
Le Sahel du vendredi 05 mars 1982. Primé en 1962 au Festival du Film Africains et Malgache 10 Mention spéciale au Festival des Peuples en 1964, Florence, Italie. 11 Entretien Maiga Djingarey et Halidou Harouna Youssoufa, le 22 juillet 2020. 9
21
indépendants comme Moustapha Alassane, Oumarou Ganda, Djingarey Maiga, Moustapha Diop, Zalika Souley étaient reversés à des structures de ‘Etat. Aussi, des recrutements des jeunes d’alors comme Mamane Bakabé ou Souleymane Mahaman ont été effectués. De 2000 à 2010, le cinéma nigérien sort de sa dormance avec une production régulière, avec de jeunes réalisateurs indépendants qui font des films d’auteur. Ici, nous définissons le film d’auteur comme étant une réalisation écrite et qui reflète la personnalité artistique de son auteur. Il faut souligner que cette période coïncide avec l’accès à moindre coût des matériels numériques de réalisation dans le pays. On peut aussi noter à ce niveau, l’arrivée de partenaires financiers comme l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à faire du cinéma un outil d’éducation. Le public fait ainsi la connaissance de réalisateurs tels qu’Arimi Abba Kiari12, Kandine Aborack13. Mallam Saguirou14, Moussa Hamadou Djingarey15. Les films de ces deux derniers réalisateurs figurent dans notre corpus, donc feront l’objet d’une analyse complète. Depuis 2010, le paysage cinématographique voit l’apparition d’une génération de cinéastes et de vidéastes qui s’adonnent à une production régulière, sans financement des autorités. La qualité de ces productions se constate à travers plusieurs distinctions. Les réalisatrices Amina Weira, Ramatou Keita et Aicha Macky en sont des illustrations parfaites. Rien que le film L’arbre sans fruit de Aicha Macky a reçu une quarantaine de prix au national comme à l’international en 2 ans. Nous pouvons citer le trophée francophone, discerné par l’association qui porte le même nom. Un retour sur l’histoire du cinéma au Niger nous fait remarquer que, de 1960 à 1970, le financement de la production était l’apanage des 12
Aba Kiari Arimi ( Passagers (2013), Série Hannunka Mai Sanda (2014), La colère dans le vent (2016) coproduit par Arimi Abba Kiari ; Delou (2016) produit par Arimi Abba Kiari. 13 Quelques films de ABORACK Kandine De la mode au Hip-Hop ; Menace au sahel, Le fleuve Niger se meurt. 14 Quelques films MALLAM Saguirou ( Le chasseur de vent (2005) ; Le prix d’un plat (2005), Un africain à Annecy (2006) ; La robe du temps (2008). 15 Quelques films HAMADOU DJINGAREY Moussa (La mystérieuse croix d’Agadez (2005) ; Tagalakoy (2006) ; Un casting pour un mariage (2008) ; Hassia , amour ou châtiment (2010) : Le retour au pays (2012) ; Le pagne (2016).
22
services de coopération au Niger, avec en tête, la France. Des structures telles que le Centre Culturel Franco- Nigérien, L’Institut de Recherche en Sciences Humaines, à travers l’implication de Jean Rouch, ont joué un rôle déterminant dans la production et le rayonnement de ce cinéma sur le continent africain. Dès 1965, l’État du Niger crée le Centre National Audiovisuel (CNA) et le Service du cinéma au Ministère de l’information. D’autres structures nationales vont suivre. Nous pouvons citer la Direction du Cinéma et de l’Audiovisuel, le Centre National de la Cinématographie, le Bureau National des Droits d’Auteur16, la Direction de la Créativité Artistique et Littéraire. Ces entités sont créées pour encadrer et développer la production cinématographique et littéraire. La loi d’orientation relative à la culture17, l’adoption des statuts du Centre National de la Cinématographie du Niger18 et de l’atelier de validation d’un projet de loi sur le cinéma19, sont des mesures qui doivent favoriser le septième art au Niger. Mais, les moyens de l’État ne suivent pas. En 2018, le budget annuel du CNCN n’excède pas 78 720 000 FCFA comparativement à ceux d’autres pays ouest-africains (Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali). Pour le Sénégal le budget annuel en 2018 était d’un milliard de FCFA. Il est aussi important de noter que plus de 50% du budget du CNCN est alloué aux charges de fonctionnement et à la masse salariale, ce qui limite les aides ou une politique pérenne du financement de la production. Deux hypothèses sous-tendent le présent travail La première est que la culture nigérienne est présente dans les films au Niger à travers les langues, vêtements, les proverbes, les chants, les danses, la musique, les gestuelles et le quotidien des populations. Nous pouvons dès lors affirmer que les films au Niger reflètent et s’inspirent de la culture nigérienne. Ensuite, le cinéma au Niger est fortement appuyé par la coopération française. En somme, il faudrait retenir, que presque toute la production cinématographique de l’Afrique Occidentale Française (AOF) à l’époque des indépendances, était financée, distribuée et exploitée par les structures occidentales.
16
BNDA : pour que les cinéastes bénéficient du droit d’auteur de leurs œuvres artistiques. 17 La loi d’orientation relative à la culture adoptée en 2009. 18 Statuts du Centre National de la Cinématographie du Niger adoptés en 2010. 19 Atelier de validation de projet de loi sur le cinéma au Niger en 2018.
23
Quel est le reflet de ce cinéma dans les écrits au Niger et ailleurs ? On rencontre difficilement des écrits scientifiques de nigériens sur ce cinéma et si l’on rencontre, ils sont l’apanage des cinéastes euxmêmes20. Le rapport présenté au colloque international sur la production et la distribution à Niamey en 1982 par Inoussa Ousseini21 qui soulève « La stratégie pour le développement d’une industrie cinématographique africaine » est un exemple. Dans ce rapport, il ressort qu’ « il ne peut y avoir de cinématographie viable en Afrique que sur le seul plan national, mais seulement sur le plan régional et interafricain(…) en intégrant le cinéma aux politiques et aux ensembles de développement économique mis sur pied à l’échelle régionale et interafricaine22». En plus de la charte de la Fédération Panafricaine des Cinéastes (1975), on constate que les cinéastes de cette époque-là, prônaient, la synergie des actions pour une industrie cinématographique africaine. Plus de 30 ans après, peut-on réaffirmer cette vision de coproduction entre les pays, si l’on regarde l’industrie cinématographique du Nigéria ? Il faut noter, que les mêmes recommandations (création d’un fond d’aide, encadrement du secteur, formation, etc.) du colloque de 1982 surgissent de nos jours au dessein les cinéastes et le Centre National de la Cinématographie du Niger. Sur les écrits de Nigériens, le livre, Un Regard du Dedans sur la Société en Transition est une première. Ce mémoire de maîtrise (1988) de Maizama Issa, édité en 199123, fait découvrir le cinéaste Oumarou Ganda à travers le livre. Nous y découvrons l’humanisme du cinéaste, qui se caractérise par sa volonté de défendre les plus faibles et mettre l’humain au centre des films. Il n’est pas rare de voir dans les réalisations d’Oumarou Ganda dans cet ouvrage, l’intérêt qu’il accorde à la tradition, fondement de toute culture. Issa Maizama soulève l’importance du vivre ensemble, de la sociabilité au sein de la communauté chez Oumarou Ganda, lequel, n’hésite pas à dénoncer les problèmes de sa société. Les pratiques immorales des marabouts, des devins, des grands commerçants sont mises à l’écran 20
Il faut noter que l’essentiel des critiques de cinéma dans les années 60 aux années 2010 ont une formation en journalisme, en droit ou en lettres modernes. 21 Inoussa Ousseini : Premier Directeur Général du Consortium International de Distribution Cinématographique (CIDC) 1979-1985, réalisateur nigérien, actuel Représentant du Niger auprès de l’UNESCO. 22 Une des recommandations dans le rapport final du colloque sur la production et la distribution, Niamey, 1962 par Alexis Gnonlonfoun dans Afrique Nouvelle. 23 MAÏZAMA, Issa, Un Regard du Dedans sur la Société en Transition. Dakar :ENDA, 1991.
24
pour interpeller le conscient des populations. Issa Maïzama dans l’ouvrage fait une analyse thématique détaillée des films Le wazzou polygame (1970) et Saïtane (1972), tout en évoquant de manière succincte les autres films de Ganda. Nous apprenons de même dans l’ouvrage, le côté panafricaniste d’Oumarou Ganda concernant la façon dont il aimerait voir le cinéma africain. « J’estime tout d’abord que le cinéma qui se fera en Afrique francophone devra (comme c’est le cas dans mon film) parler une langue africaine … Quand je dis que les films africains devront parler africain, je veux dire qu’on devra y parler la langue du pays où il sera réalisé24.» Un cinéaste qui s’interroge sur les pratiques de sa société dans ses films dont les plus célèbres sont Cabascabo (1968), Le Wazzou polygame (1970), Saïtane (1972) et L’exilé (1980). Cela semble suivre la trajectoire de plusieurs films de cinéastes de l’Afrique de l’Ouest dont Sembène Ousmane et Djibril Diop Mambety. Revenons un peu sur le premier film de Ganda, Cabascabo. Le film en langue zarma est l’histoire réelle du combattant de guerre en Indochine Oumarou Ganda, au service de l’armée française dans les années 50, dès l’âge de 17 ans. Dans un flash-back, qui dit long sur sa maîtrise du langage cinématographique, le réalisateur dans le film, nous amène à vivre avec lui comme si on était, à quoi se résume la vie d’un « combattant colonisé » au front et comme démobilisé dans sa société. En fin connaisseur du terrain de guerre, Oumarou Ganda a su choisir le décor filmique qui reflète et transpose son parcours de combattant. Du terrain de guerre avec les troupes en situation de combat, des morts par-ci et par-là dans les champs de rizières, des tirs des armes, des explosions, de la tenue des combattants, des tensions entre éléments de la troupe parfois, juste pour l’orgueil et de la distraction des combattants dans de maison de « passe », autant d’éléments qui nous révèlent l’ambiance qui peut régner dans un bataillon en temps de guerre. Un film plein de sens sur un pan de l’histoire de la colonisation au Niger, qui donne à voir l’effort des populations dans la conquête aux territoires pour la France et le traitement d’humiliation réservé à certains démobilisés. Nous nous rappelons, 20 ans après le film Cabascabo, de Camp de Thiaroye (1988) de Sembène Ousmane, qui met aussi en lumière, cette 24
Ibid., p.71.
25
fois-ci le sort sanglant réservé par la France aux démobilisés africains pendant la seconde guerre mondiale. Oumarou Ganda le « cabascabo » qui veut dire le caïd, depuis son tendre âge dans sa vie en société n’admet l’injustice sociale et défend les plus faibles. Son caractère d’« homme au sang chaud » le conduit à revenir aux travaux champêtres de la famille, comme le dit l’adage « la terre ne ment pas » Il faut souligner que l’ouvrage de Maizana Issa fait des analyses surtout thématiques du cinéma de Oumarou Ganda. Un ouvrage majeur, pour ceux qui n’ont pas eu la chance de connaitre le réalisateur. L’ouvrage traite aussi de l’évolution du cinéma au Niger et ses quatre sources d’inspirations, que sont les réalités sociales, la littérature orale, la religion, et l’histoire des héros nigériens. On apprend dans cet ouvrage que le véritable cinéma d’inspiration nigérienne est né en exil, en parlant bien sûr du film Moi, un noir (1957) de Jean Rouch dont l’acteur principal était Oumarou Ganda. Maïzama Issa, dresse de même, l’ébauche du cinéma nigérien, qui se situe avec les premiers films de Jean Rouch dès 1947, et de la période de crise, qui coïncide avec la mort d’Oumarou Ganda en 1981. Plusieurs tendances se dégagent dans le cinéma nigérien à la lecture de l’ouvrage dont la tendance politique, moraliste et la réhabilitation ou la valorisation culturelle. Un ouvrage intéressant sur seulement le cinéma d’Oumarou Ganda. Un autre ouvrage est Le Cinéma au Niger25 d’Ousmane Ilbo. Quant à lui, l’auteur fait le portrait de quelques pionniers du cinéma nigérien, dont Moustapha Alassane, Moustapha Diop, Djingarey Maiga, Yaya Kossoko, Mariama Hima, Inoussa Ousseini. L’auteur du livre est journaliste de formation. Il a su décrire les premiers films sur les populations nigériennes. L’approche du livre sur l’histoire du cinéma au Niger est de voir l’évolution du cinéma au Niger de Jean Rouch aux cinéastes des années 90, à travers le financement cinématographique, audiovisuelle, la distribution et la diffusion. Ilbo souligne l’apogée et le déclin de ce cinéma, en faisant appel aux activités cinématographiques des pionniers. Aussi, nous pouvons voir à travers l’ouvrage plusieurs étapes qui ont caractérisé le cinéma au Niger. Dans un premier temps Ilbo, évoque la grande époque de ce cinéma avec Jean Rouch, l’initiateur. On apprend dans cet ouvrage qu’« à l’instar de l’économie 25
Ilbo, Ousmane. Le cinéma au Niger. Bruxelles : OCIC, 1993.
26
de marché, le cinéma est l’une des valeurs occidentales introduites en Afrique dans l’optique du transfert des sensibilités par les chercheurs occidentaux. Au Niger, l’un des premiers parmi ces occidentaux, qui introduit le cinéma fut le français nommé Jean Rouch ». Dans un second temps l’auteur du livre souligne le démarrage du cinéma au Niger, toujours avec Jean Rouch et son disciple et ami Moustapha Alassane. On apprend que Jean Rouch réalisa son premier film en 1947, avec le film ethnographique Au pays des mages noirs. C’est un court métrage en noir et blanc, qui montre un village zarma sur le fleuve Niger dans lequel, Rouch nous fait découvrir leurs pratiques culturelles et cultuelles. Dans le film les savoirs faire des populations dans la confection des harpons et de pirogue, la chasse à l’hippopotame et tout le rituel avant, pendant et après la chasse ne sont plus des secrets pour le téléspectateur. Dès les premières images Rouch notait : « Le chasseur d’images qui, au centre de l’Afrique noire, a réussi à filmer la vie publique et sécrète d’un village du Niger, a dû, en raison de leur caractère sacré prendre les plus extrêmes précautions pour enregistrer les scènes saisissantes de la danse de la possession ». D’ailleurs, presque tous les films de Rouch abordaient les mêmes thématiques sur le culte songhay. On peut citer entre autres : Les magiciens de Wanzerbé (1948), Initiation à la danse des possédés (1949), Yennendi ou les hommes qui font la pluie (1951), La chasse au lion à l’arc (1965) et Les Maîtres fous (1954). Ce dernier film a fait l’objet de critiques acerbes par les cinéastes africains sur Jean Rouch. Toujours dans la connaissance de la communauté songhay, Rouch a soutenu sa thèse de doctorat en 1952, intitulée : La religion et la magie songhay. Une thèse dans laquelle, on retrouve même des incantations pour demander des faveurs aux dieux. Dans cette thèse, les analyses détaillées sur la production cinématographique nigérienne peuvent améliorer les apports des ouvrages qui existent déjà. Quelques mémoires de l’Institut de Formation aux Techniques de l’Information et de la Communication, évoquent des aspects de l’industrie cinématographique. C’est le cas du mémoire d’Aliou Ousseini26 sur « La problématique de la distribution cinématographique 26
Aliou, Ousseini. La problématique de la distribution cinématographique au Niger . Niamey : IFTIC, 2000.
27
au Niger », dans lequel il fait une analyse fine de l’évolution de ce cinéma, tout en mettant l’accent sur les salles de cinéma et les maisons de distribution et d’exploitation au Niger. En classifiant les salles de cinéma, Aliou Ousseini nous donne à voir dans quel décor les cinéphiles visionnaient les films. Nous pouvons dire, malgré la qualité des données sur les productions des films nigériens, des salles de cinéma et leur exploitation, ce mémoire, plus de 15 ans ne prend pas tous les aspects de cette problématique de la distribution dont les nouvelles formes (internet, téléphone, plateformes, etc.). Le mémoire de Soumana Kambeidou, le tout premier mémoire sur l’évolution du cinéma au Niger prend en compte tous les secteurs d’une industrie de cinéma, mais l’application n’était pas au rendez-vous. Ce mémoire évoque la production filmique du Niger et de manière critique. Nous pouvons lire que : « les œuvres de Inoussa Ousseini sont fortement marquées par sa formation de sociologie27. Pourtant, le film Paris, C’est Joli de Inoussa Ousseini est un film dont la thématique centrale, continue de parler d’elle en Europe. Il s’agit des conséquences de la migration que vivent les africains en France. Le réalisateur montre les vices de la société française, qui se résument à l’escroquerie, la prostitution, le matérialiste de l’humain et le problème de logement des migrants. Kambeidou a su relater le fonctionnement du cinéma dans les deux (2) régimes, qui le premier va de 1960 à 1974, régime de la première République et le second de 1974 à 1987, régime d’exception détenu par les militaires. Ce mémoire de Kambeidou a nourri le Séminaire de Tillabéri du 22-30 juillet sur le document de la première politique culturelle au Niger. Ce séminaire trace les grandes lignes pour le développement de l’industrie cinématographique au Niger. L’auteur du mémoire, était directeur de la culture à l’époque du séminaire et se trouva parmi les membres de la commission d’élaboration. Trente-six (36) ans après, les recommandations de ce mémoire doivent être actilisées pour sa pertinence et l’améliorer pour tenir compte des mutations dans le secteur du septième art au Niger. Le rapport28 de Marie France L’Heriteau, nous renseigne sur les activités cinématographiques et de la gestion des Maisons des Jeunes et 27
Kambeidou, Soumana. Essai de contribution à la politique cinématographique au Niger , Ibid., p.15. 28 Rapport sur les Maisons des Jeunes et de la Culture au Niger d’octobre 1986 de Marie France L’Heriteau, chercheure française.
28
de la Culture en octobre 1986. Ce rapport est commandé par le régime d’exception d’alors pour voir le fonctionnement des Maisons des Jeunes dans la contribution au développement culturel national. Le rapport nous donne, une idée de l’engagement politique du régime en place pour la culture dans son ensemble. Des propositions pour une meilleure fréquentabilité des lieux de loisir pour les cinéphiles étaient les mesures phares. Car, avec la disparition des salles de cinéma et l’avènement des nouvelles formes de diffusion (internet, téléphone, plateformes de visionnement) le mode de visionnement amène à une nouvelle réorganisation de la distribution et de la diffusion. Des articles journalistiques (entretien, compte rendu, reportage, éditorial, etc.) ont largement contribué à la promotion de ce cinéma. Des journalistes nigériens, tels que Harouna Niandou, Souley Manzo, Oumarou Ali faisaient les couvertures médiatiques. On peut voir à travers la parution N°3 de l’année 1972, entièrement consacrée au cinéma nigérien, les illustrations (photos de cinéastes à la page de garde, séquences de films à l’intérieur du journal, photos des personnes interviewées) la taille des titres (attractive) voire la mise en page, l’interview des cinéastes est le genre dominant dans la revue. Avec l’interview, le lecteur a les propos des interviewés sans tournure du journaliste. Cela nous donne tout de suite envie de découvrir le journal. Le titre de cette parution est révélateur : « le cinéma nigérien en devenir ». En effet, nous sommes plus ou moins dans la période faste du cinéma nigérien. À la page 3 de Nigérama n°3, nous avons un éditorial de Harouna Niandou, qui traite entre autres de l’importance du cinéma dans le concept de développement. Aussi y écrit-il : « C’est conscient de leur rôle d’éducateurs (…) que les cinéastes nigériens ont entrepris une sorte de croisade tous azimut par le film. Estil besoin pour un nigérien d’aller à l’école pour apprécier un film nigérien, réalisé avec des acteurs nigériens, parlant en langues nationales ? Lorsque nos ciné-bus ambulants servaient encore, lorsque des services comme l’information et la jeunesse et les Sports organisaient des soirées populaires de cinéma dans nos quartiers et dans certaines de nos villes, on a pu mesurer, à bon escient, la portée de ces séances et leur impact extraordinaire sur la masse. L’Association des Cinéastes Nigériens s’emploie fébrilement à obtenir que cette action bénéfique en faveur de nos populations « culturellement » handicapées soit reprise et rendue plus dynamique et populaire ». 29
Dès le premier article, Harouna Niandou prépare le lecteur. Il donne des arguments en faveur du 7ème art et valorise les cinéastes. Pour lui, ‘’un cinéma proche’’ de la population ne peut qu’être apprécié par tous. Il faut comprendre par ‘’un cinéma proche’’ les films des réalisateurs qui reflètent les cultures locales à travers les langues parlées dans les films, les acteurs qui les ressemblent dans les films et les autorités qui sont chargées de diffuser les films. Si toutes ces conditions sont réunies, la population cinéphilique va suivre la cadence. Je me rappelais d’un moment marquant vécu lors de la projection du film « Fêtes de l’indépendance du Niger29 » en décembre 2019 au Centre Culturel Franco-Nigérien – Jean Rouch. Un film qui célèbre l’an 1 de l’indépendance du Niger. Dans une salle à moitié pleine, composée de cinéphiles, d’étudiants en audiovisuel, de cinéastes, de coopérants français nous avions assisté à un défilé des différentes corporations et couches sociales du Niger dans des tenues qui reflètent la culture de chaque région. Mais le moment le plus important, c’est lorsque le Président Diori Hamani avait pris la parole pour parler dans deux langues locales, le haoussa et le Zarma. Dès les premiers mots prononcés par le Président, de tonnerre d’applaudissements et de cris de joie avaient retenti dans la salle. Ainsi, pour dire le public s’est senti fier du discours en langues nationales du Président. Ce jour-là, c’était comme si nous étions dans une assemblée parlementaire pour défendre une cause nationale. Le magazine Nigérama30 est le lieu d’expression des différents acteurs du 7ème art : interviews des cinéastes comme Oumarou Ganda, Moustapha Alassane, Dingarey Abdoulaye Maiga ; interviews du technicien Moussa Hamidou, d’un propriétaire de salle, d’un gérant de salle. On note également la publication de la rédaction de Nigérama de la réponse de Allolo Abdoulkader31 sur la question : que se passe- t-il dans nos salles de cinéma ?. Il y a une certaine ambiance dans le 7ème art nigérien qui est recréé dans le journal. De la production, à la réalisation en passant par l’actorat, la distribution et l’exploitation, les cinéastes se donnent à cœur joie pour 29
Fêtes de l’indépendance du Niger, coréalisé par Rouch et Louis Civate en 1961. NIGERAMA n° 3, magazine trimestriel à thématique, édition du Ministère de l’Information du Niger, 1972. 31 Allolo Abdoulkader: membre de la commission nationale de censure cinématographique. 30
30
évoquer leurs métiers dans les moindres détails. L’actualité cinématographique nigérienne, à elle seule, prend une trentaine de pages. Cette actualité se résumait autour de la participation du Niger au FESPACO 1972 avec les acteurs qui étaient aux premiers rangs à ce festival (Moustapha Alassane, Inoussa Ousseini, Yaya Kossoko,Zalika Souley, Mounkaila Adamou, Djingarey Maiga, Harouna Niandou, Moussa Hamidou, Oumarou Ganda). Dans un article de ce Nigerama, à la page7, on voit une interview sur Moustapha Allassane, titrée : Un pionnier : Moustapha Alassane. L’article présente d’abord Moustapha Alassane comme étant un autodidacte, ayant fait plusieurs stages de formation en France et au Canada. Sur une question du journaliste à Moustapha Alassane portant sur la contribution du cinéma dans le développement de la culture nigérienne, Moustapha Alassane répond à ces termes : « Pour nous cinéastes, le processus que nous avons engagé pour faire connaître la culture nigérienne et les résultats que nous avons obtenus à travers le monde confirment l’excellence du processus. Mais force est de reconnaitre que tous seuls, les cinéastes nigériens ne peuvent rayonner la culture nigérienne. Il leur faut une aide efficace. Tout le monde connait la place que notre cinéma occupe en Afrique et dans le monde. Mais le cinéma étant une industrie, il conviendrait donc de nous faire sortir de ces tâtonnements, de ne plus nous laisser dans cette situation de francstireurs ». Cette revue, nous apprend aussi comment Oumarou Ganda est arrivé au cinéma et pourquoi la réalisation de son tout premier film, Cabascabo. Dans les premières lignes de l’interview Oumarou Ganda note : « Je suis né en 1935 à Niamey, après des études primaires, je me suis engagé dans l’armée française, à l’âge de17 ans. J’ai passé 2ans et un mois en Indochine dont six à la frontière. (..) Jean Rouch m’a proposé de jouer un petit rôle dans un film qu’il allait intituler « Zazouman de Treichville ». C’est avec ce film que je suis venu en 1957 au cinéma. Par la suite, ce film de 15 minutes a été repris en long métrage avec comme titre : « Moi un Noir ». La revue nous fait découvrir la distribution et l’exploitation des films au Niger à travers M. Tomassi, gérant des salles de cinéma Rex, Vox, Studio installées à Niamey par la COMACICO et la SECMA, deux sociétés de distribution et d’exploitation de films de droit français en Afrique.
31
Harouna Niandou nous livre un article sur Zalika Souley. Il l’a titré : Zalika Souley : Devant la caméra, de la reine christine… A la coépouse jalouse. Dans un passage de l’article, le journaliste souligne : « Zalika Souley est une « star » du cinéma nigérien. Sa passion pour le 7ème Art et surtout sa prestance en font une actrice émérite. Elle a du talent et tous ceux qui l’ont vue à l’écran conviendront que c’est une actrice avec laquelle il faut compter ». D’autres interviews nous apprennent encore l’arrivée et les problèmes de financement que vivent les réalisateurs. C’est ainsi que nous apprenons comment Inoussa Ousseini est arrivé au cinéma. Il l’évoque en ces termes : « Au lycée de Niamey nous avons, des amis et moi, fondé un ciné-club. C’est dans ce cadre que nous avons vu un film du cinéaste français Serge-Henri Moati (qui travaillait alors au Niger) : « Les cow-boys sont noirs » (il s’agissait d’un reportage sur le premier moyen métrage de Moustapha Alassane : « Le Retour d’un aventurier », une parodie de western). Nous avons été impressionnés par ce film et avons alors plusieurs à décider que nous ferions, nous aussi, du cinéma. Nous avons voulu tourner un court métrage intitulé « Jeunes gens et jeunes filles de Niamey », mais nous nous sommes rendus compte que nous manquons de formations technique ». Le Sahel hebdo, actuel Sahel Dimanche, est une publication hebdomadaire de l’Office National d’Édition et de Presse. Hebdomadaire de l’État nigérien, il complète le quotidien qui parait quatre fois dans la semaine. En parcourant les lignes des publications de cet hebdomadaire, nous trouvons de l’actualité cinématographique. En effet, on peut lire en tête de rubriques de certaines publications « cinéma », comme c’est le cas pour la parution N°315. Pendant la même année, nous avons également des dossiers cinéma, à l’exemple de la parution n° 315 du lundi 10 mai 1982 où nous avons retrouvé un dossier de 4 pages titré : « CIDC-CIPROFILM : le second souffle ». Nous avons trouvé dans ce dossier des reportages sur les missions du CIDC, les problèmes du CIPROFILM, le portrait d’Inoussa Ousseini, une enquête sur les efforts consentis par Inoussa Ousseini pour la marche de ces structures à travers les différentes rencontres dans les représentations nationales du CIDC. Le titre d’un article à la « une » a retenu notre attention : « Il faut encourager la production nationale pour ne pas consommer des navets 32
» (parution n°318 du 31 mai 1982). L’article dénonce la mauvaise qualité des films projetés ou diffusés dans les salles de cinéma et à la télévision nationale et encourage le développement du cinéma nigérien dans son ensemble à travers la production de films, le financement et la formation. Comme autre exemple, dans la rubrique poème, des vers de Hassane Guingareye à l’endroit du cinéaste et réalisateur nigérien Oumarou Ganda. Nous lisons : « Il était une fois, un légendaire héros qui s’appelait Oumarou Ganda, cinéaste de profession végétant dans du terreau qui s’élevait (…). Digne fils d’Afrique, valeureux nigérien (…) En admirant ses œuvres, abandonnées toutes récentes, Nos yeux tous ensemble, s’imbibent, et versent des larmes drues ». (Sahel hebdo n°302 du lundi 25 Janvier 1982). Il s’agit de l’hommage rendu à Oumarou Ganda pour son apport à l’édification du cinéma nigérien. En découvrant plus en profondeur le poème, on se rend compte que la valeur donnée au personnage tire sa substance dans ses œuvres cinématographiques. A cette période où le cinéma nigérien présente déjà des signes de léthargie, causés par certains aléas dont le manque de financement du CIDC par le fait des egos des Etats, qui ne payaient plus les subventions, notait Inoussa Ousseini dans l’émission Patrimoine Ciné n°9 sur Dounia Tv. Mais aussi du fait que la coopération française ne s’intéressait plus au financement de ce cinéma avec l’avènement du CIDC en 1979. Enfin, la mort d’Oumarou Ganda en janvier 1981 a donné un coup sanglant à la promotion de ce cinéma, car il était le moteur du septième Art nigérien, reconnait Harouna Niandou. Avec tous ces aléas en défaveur du cinéma nigérien, la presse, ici Le Sahel hebdo, veut continuer à lui donner la voix, malgré son agonie, à travers des articles qui sont faits sur les acteurs de l’industrie cinématographique. A l’instar du Sahel hebdo, Le Sahel fait également la promotion du ème 7 art. C’est le quotidien étatique. Les illustrations qui suivent remontent au passé et démontrent l’engagement du journal, Le Sahel, dans la promotion du 7ème art. Nous retrouvons des critiques de films dans la rubrique « commentaire du jour », nous sommes en 1968. Nous lisons ceci, dans la critique cinématographique du 29 mars 1968 (n°618) : « Le film de Maurice Regamey (« Petit monstre ») déclenche un fou rire, dès le 33
début. Le scénario est simple et bien conçu. ». Dans un autre article du même genre, nous lisons : « La mise en scène est bien faite. (Le Temps du Niger du 2 avril 1968, n°621). Nous observons que les journalistes nigériens commentent aussi les films étrangers qui sont diffusés au Niger. Ils s’attardent à la qualité technique du film et à la réception du public. Cette démarche donnerait une ouverture d’esprit au public et surtout aux cinéastes de capitaliser des expériences dans l’écriture filmique. Après lecture de ces critiques, le lecteur peut développer, un sens critique dans le visionnement des films et de se procurer et de suivre ces films. Les critiques peuvent également aider à faire un choix entre plusieurs films. Le Sahel N° 2181 du 7 juillet 1981, parle des films de Oumarou Ganda, qui étaient distingués mondialement. Oumarou Ganda fut en général un grand ambassadeur des cinémas d’Afrique. Dans un encadré titré « Premier Prix Debrix à Oumarou Ganda » à la page 10 : « Cela montre une fois de plus les frontières franchies par les œuvres de Cabascabo (…) Oumarou Ganda a honoré le Niger, mais également toute l’Afrique. Là où il y a eu cinéma africain, il y a eu l’Exilé et vice versa ». Les œuvres du réalisateur nigérien, Oumarou Ganda sont ici valorisées. Dans Le Sahel du 18 Juillet 1996 à la rubrique « culture », nous retrouvons une interview du réalisateur du film « Wadjibi » : Harouna Coulibaly. Grâce à cette interview, nous découvrons le film et même le réalisateur. En effet, c’est un film qui dénonce l’incivisme fiscal, la corruption. Le journal mentionne également que le film sera couronné par l’ambassade des États-Unis et par des officiels nigériens. La valeur du cinéma nigérien se situe non seulement par les thématiques des films qui montrent les réalités sociales, mais aussi la liberté d’expression des cinéastes qu’on retrouve dans le traitement des films. Nous voyons que les questions, mêmes les plus dérangeantes pour les autorités (traditionnelle et politique) sont portées à l’écran. De l’abus de pouvoir des forces de l’ordre à une justice corrompue, en passant par la prostitution en milieu urbain, des meurtres prémédités, des révoltes de jeunes contre le pouvoir traditionnel, de viol par le prince, violenter le roi, sont montrés sans censure de l’autorité dans les réalisations des cinéastes nigériens.
34
La promotion du cinéma à travers les journaux est réelle. Du quotidien au magazine en passant par l’hebdomadaire, de la critique cinématographique à l’interview, le cinéma faisait l’actualité. On peut rencontrer des écrits sur le cinéma nigérien dans les revues étrangères animées par des universitaires, tels que Pierre Hafter, André Gardies et des critiques de cinéma français dont Guy Hennebelle, Cathérine Ruelle. Le travail le plus récent sur le cinéma qui touche le Niger est celui de Maria Loftus, une thèse intitulée : Le cinéma documentaire en Afrique noire : du documentaire colonial au documentaire africain (1899-1985). Malgré le fait que cette thèse évoque, entre autres, le cinéma ethnographique de Jean Rouch, c’est un travail qui prend en compte un seul genre cinématographique, le documentaire, tout en omettant le premier film documentaire réalisé au Niger et sur des nigérien32. Cette thèse contribuera sans nul doute à connaitre davantage le cinéma nigérien, va fournir des références, d’encourager la jeunesse d’embrasser les métiers du cinéma et d’inciter l’État à intégrer le cinéma dans les politiques éducatives. Pour mener cette thèse la méthode de l’analyse de contenu est le plus adéquat. L’objectif est de porter un éclairage afin que les films soient mieux compris. Le but de l’analyse est de faire mieux connaitre, juger ou apprécier l’œuvre en la faisant mieux comprendre. Pour parler de l’analyse de contenu, Jacques Aumont souligne : « Il peut aussi être un désir de clarification du langage cinématographique, avec toujours un présupposé valorisant vis-à-vis de celui-ci33». Ainsi à travers nos 32
La Croisière noire (1925) de Léon Poirier, un film ethnographique dans lequel les communautés djerma, touareg et haoussa d’Agadez, dans leurs plus beaux vêtements défilent et montrent une maitrise dans le harnachement des chevaux. La séquence la plus spectaculaire dans ce film, est là où un petit enfant dresse un chameau, sous les yeux bienveillants d’une foule de femmes et d’hommes. Nous pouvons dire que ce film est une réalisation qui va à la découverte du beau dans l’organisation sociétale des communautés du Niger, comparativement au film Au Pays des Mages Noirs (1947) de Jean Rouch, sur les abords du fleuve Niger qui retrace la vie des populations, mais axé plus sur le sacré. Nous n’oublions pas non plus, le film La Grande caravane (1936) de Jean Marie d’Esmeraud, qui montre le trajet des caravaniers vers les grottes de sel. Il faut souligner que les deux derniers films reflètent la vie réelle des populations de manière linéaire. Tandis que les films de Jean Rouch sont presque tous des films d’auteur. Des films qui reflètent sa personnalité artistique, ayant un style nouveau et singulier. Certains l’appellent même l’homme à la caméra à l’épaule. 33 Aumont, Jacques et Michel, Marie. L’analyse des films. Paris : Fernand Nathan, 1988. p8.
35
analyses, il peut arriver d’exprimer certaines notions du langage cinématographique que les réalisateurs ont emprunté dans leur récit filmique. Cette démarche d’analyse fera mieux comprendre le sens d’une séquence à une autre en passant par des techniques comme ; l’ellipse, le flash- back ou les effets spéciaux. L’’analyse prend aussi d’autres aspects comme les thématiques développées dans le film, nous évoquerons à travers notre corpus les thématiques des films, qui pour nous, vont confirmer les objectifs de cette thèse, qui sont : la préservation du patrimoine cinématographique du Niger et l’archivage des films. De même, les plans utilisaient dans les films seront comprises dans nos analyses de films. Le choix d’une image n’est pas fortuit dans un film. « Un signe n’est « signe » que s’il « exprime des idées », et s’il provoque dans l’esprit de celui ou de ceux qui le perçoivent une démarche interprétative34». Et, dans notre corpus, les signes ou les images sont parlantes. Ce travail se compose de trois parties. La première, intitulée « L’avènement du cinéma », se penche sur l’origine du cinéma au Niger, son circuit de production. Dans cette première partie, nous nous proposons de faire un exposé succinct sur l’historique du cinéma, à partir de la création du cinématographe. Une invention des frères lumières voit le jour en 1895, Auguste et Louis de nationalité française, de la province de Lyon en sont les brevetés. Aussi, Nous évoquerons de manière chronologique, la venue du cinéma au Niger, un avènement lié à l’histoire coloniale à travers Léon Poirier et Jean Rouch. Mais qui est Léon Poirier ? Homme de théâtre, créateur des salles « Le théâtre » et « La Comédie des Champs Élysées », Léon Poirier est Français de nationalité, il fut le tout premier à réaliser un film sur le territoire nigérien. Ce film titré « La Croisière Noire » ou « l’Expédition Citroën Centre Afrique » a été produit par André Citroën pour promouvoir sa marque Citroën. Le film est projeté pour la première fois le 2 mars 1926 à l’Opéra de Paris. Un film muet, en pleine colonisation des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Dans les séquences tournées au Niger, le réalisateur, fait découvrir la chefferie de Tessaoua et des manifestations culturelles des communautés qui vivent à Agadez. A travers cette réalisation, nous affirmons que l’avènement du
34
Joly, Martine. Introduction à l’analyse de l’image. Paris: Armand Colin, 2006. P. 22.
36
cinéma en Afrique est une arme de propagande, car il permet la visibilité des produits commerciaux du pays colonisé. Il faut souligner que Léon Poirier fut un officier comme Jean Rouch dans l’armée coloniale. Justement que vient faire Jean Rouch dans le cinéma au Niger ? Il faut le dire que la venue de Jean Rouch au Niger est liée à la colonisation. Il est mobilisé en tant qu’ingénieur des travaux publics dans l’armée française, pour la construction des infrastructures routières au Niger, afin de faciliter le service colonial (acheminement des troupes coloniaux, de matériels armés et le transport des matières premières vers la France). Mais, très vite en contact avec le peuple colonisé, Rouch s’est émerveillé pour les pratiques cultuelles. La familiarité avec le peuple croisé au Niger a conduit les autorités coloniales à le démobiliser. Mais, il est revenu une deuxième fois, avec cette fois-ci, pour connaître profondément ce peuple sous un regard ethnographique avec la caméra en 1947. Le cinéma nigérien est parti de là, avec le premier assistant de Rouch, Damouré Zika pour les films d’inspiration nigérienne. Ces films tournés au Niger sont conçus, financés, réalisés et montés par des non nigériens. On peut les classer dans le cinéma au Niger. Jean Rouch occupe la première place dans les réalisations des films d’inspiration nigérienne. Grâce à Rouch, à travers l’IFAN, l’IRSH, le CCFN, les premiers cinéastes ont pu embrasser les métiers de cinéma au Niger. Nous verrons de même, comment se faisait dans les années 50 aux années 80 la production cinématographique au Niger au sens large. Cela voudrait dire que, nous parlerons du financement, de la réalisation, de la genèse et de l’évolution de la distribution des films produits au Niger. Malgré que plusieurs travaux scientifiques lui ont été consacrés, comme l’ouvrage « Jean Rouch » de Maxime Scheinfeigel35, il serait important de souligner, l’apport de Jean Rouch dans le développement du cinéma produit au Niger et sur les bases de la filière cinématographique. Nous allons aussi souligner en amont que l’histoire cinématographique de Jean Rouch est liée à l’histoire culturelle du Niger. Dans le chapitre 2, nous évoquerons les différentes étapes du circuit de production pour mieux les cerner. Pour Sorlin Pierre : « C’est un processus incluant l’ensemble des facteurs sociaux qui accompagnent la mise en chantier, la construction, la circulation des 35
Scheinfeigel , Maxime. Jean Rouch. Paris : CNRS, 2008.
37
objets : la fabrication n’est que le stade matériel de la production. Les bobines de pellicules résultant de plusieurs manipulations- tournage, tirage, montage, mixage, etc. – sont également un « produit » intégré à un circuit économique36». Nous verrons donc, comment se finançait le cinéma au Niger avant et après l’indépendance du Niger. Était-il organisé ce financement ? Qui pouvait bénéficier de financement pour réaliser des films et voir un jour, le succès de ces films dans les salles de projection et sur les chaînes de télévision au national comme à l’international ? La deuxième partie intitulée, « Les films fiction et documentaire dans le cinéma au Niger » porte sur trois types de films (documentaires, fiction et dessin animé), choisis parmi tant d’autres. Précisons là, qu’il s’agira d’examiner certains des films les plus représentatifs produits des débuts du cinéma nigérien dans les années 60 jusqu'à nos jours. Le choix de cette limitation se justifie par le fait, qu’à travers les films à analyser, nous allons traiter des films des pionniers qui avaient réalisé ces genres de films en Afrique et au Niger. Nous nous pencherons également sur les thématiques qui portent plus sur l’oralité du Niger. Dans ce choix, on retrouve quelques films des pionniers et également certains de la nouvelle génération. Nous aborderons, dans cette partie, à son chapitre premier, des genres fictionnels qu’on retrouve au Niger. La fiction dans le vocabulaire du cinéma37 est « un discours construit sur un simulacre du monde perçu comme tel par son récepteur en mettant en scène des personnages et des actions qui n’ont pas de réfèrent dans l’ordre de la réalité (même s’ils s’inspirent parfois de personnages ou d’actions réels) ; ils n’existent que dans l’imaginaire de l’auteur et par la suite, du lecteur ou spectateur. La définition de la fiction a toujours constitué un problème, et les critères permettant de la différencier du documentaire manquent de rigueur et de pertinence». Cette difficulté de situer la fiction et le documentaire se vit dans les films africains, car les réalisateurs, pionniers comme de la jeune génération usent des outils de la fiction pour nourrir les films documentaires, vice versa. Jean Rouch notait : « Il n’est pas possible d’établir une frontière très nette entre les films commerciaux et les documentaires, les films à
36 37
Sorlin, Pierre. Sociologie du cinéma. Paris : Editions Aubier Montaigne, 1977. P 77. Journot, Marie-Thérèse. Le vocabulaire du cinéma. Paris :Armand Colin, 2011.
38
scénario et les films ethnographiques, les genres se trouvant le plus souvent mêlés depuis le début du cinéma africain38 ». Nous traiterons aussi, du documentaire, un genre cinématographique très répandu au Niger, avec plusieurs composantes dont le documentaire dit de création. Toujours dans le vocabulaire du cinéma, le documentaire, renvoie au réel, en restitue l’apparence, qu’il soit un reportage, un film d’art, un film scientifique, il arbore le plus souvent un caractère didactique et informatif qui vise à donner les choses au monde tels qu’ils sont. La troisième partie intitulée « rapport entre cinéma, culture nigérienne et les autres arts », propose, à travers les genres de films, de trouver les liens entre le cinéma, la littérature, la musique et le dessin animé. Nous remarquons, de prime à bord, qu’un lien étroit existe entre ces formes d’art au Niger. Ce sont des arts qu’on retrouve dans le cinéma nigérien. C’est l’occasion pour nous de voir aussi, les liens qui existent entre le cinéma et les médias au Niger. Nous essayerons de répondre à plusieurs questions relatives à la promotion du cinéma nigérien et à sa préservation. Quelle prise en charge des médias dans la promotion du cinéma nigérien ? Quel avenir pour le cinéma nigérien ? Quelle place du cinéma nigérien dans les rencontres et festivals au national comme à l’international ? Quels films pour les cinéphiles nigériens ? Quelle politique nationale pour le cinéma nigérien ? Autant de questionnement qui permettront de mieux cerner le cinéma au Niger.
38
Rouch, Jean. « Rapport situation et tendances actuelles du cinéma africain ». Paris: UNESCO, 1961.
39
PREMIÈRE PARTIE : AVENEMENT DU CINEMA « Le cinéma est né de la rencontre d'innovations dans le domaine du support photographique et dans celui de la synthèse du mouvement utilisant la persistance rétinienne39. (…) en 1891, Thomas Edison crée la cinétographie, première caméra de prise de vue. Les films tournés n'étaient pas projetés mais regardés à travers une visionneuse baptisée Kinétoscope. La date de l'invention d'Edison ne peut pas être considérée comme date de naissance du cinéma car le Kinétoscope ne permet pas de projeter le film. 40». Un constat est là, dès les premières heures de l’invention du cinématographe des Frères Lumières, la notion de cinéma est liée à l’association de plusieurs facteurs. Ainsi, pour les uns, évoquer le mot cinéma, signifierait la présence du matériel de projection, d’une équipe de projection, d’un public pour visionner le film dans un lieu de projection. Avec cette définition, la paternité de l’invention est accordée aux Frères Lumières. Mais, pour les autres, comme Edisson, l’inventeur du kinétoscope en 1891, bien avant l’invention du cinématographe la projection tuerait rapidement l'intérêt du public pour l'invention. Donc l’aspect salle de cinéma avec un public dédié n’est pas important dans la diffusion. L’appréhension des frères Lumières vient tout révolutionner dans l’acception du mot cinéma. Mais, plus de 100 ans après le cinématographe, avec l’évolution des sociétés, on aperçoit le bouleversement des systèmes de visionnement qui tend vers l’individualisation de visionnement des films (téléphone, ordinateur, plateformes de visionnement, etc.) comme le perçoit l’invention d’Edisson.
39
Persistance rétinienne ou persistance de vision est le phénomène attribuant à l’œil une image rémanente ou une illusion optique durant 1/25 de seconde sur la rétine. 40 http://www.musee -virtuel.com/histoire -cinema.htm, consulté le 20 octobre 2017.
41
Chapitre 1 : De l’origine du cinéma au Niger Ce chapitre traite de la notion du cinéma, pour éviter toute confusion, pour ensuite évoquer la naissance du cinéma et son expansion au Niger. Il existe plusieurs définitions possibles du cinéma que nous essayons de confronter. Pour les uns « Le cinéma est un procédé permettant l’enregistrement et la projection animée de vues, accompagnée ou non de son41 ». Pour les autres comme le dictionnaire Internaute42, plusieurs sens possibles du cinéma dont : Le sens 1 définie le cinéma comme : « un art de concevoir et réaliser des films. Appelé le septième art. » Dans le sens 2, le cinéma est un procédé d’enregistrement et de projection de photographies animées sur un écran. Pour le sens 3, le cinéma est : « Une salle dans laquelle sont projetés des films.» La définition qui englobe tous les aspects des autres définitions citées plus haut est donnée par Journot Marie Thérèse qui note que : « le terme est très polysémique, désigne à la fois le procédé technique, la réalisation de films (faire du cinéma), leur projection (séance de cinéma), la salle elle-même (aller au cinéma) l’ensemble des activités de ce domaine (l’histoire du cinéma) et l’ensemble des œuvres filmées classées par secteurs : le cinéma américain, le cinéma muet, le cinéma de fiction, le cinéma commercial, etc.43 ». Cette définition prend en compte la projection du film au public dans une salle comme le pensent aussi les frères Lumières44, alors que pour Edison, la projection enlève au public très vite l’intérêt pour la création.
41
https//www.cnrtl.fr/definition/cin%C3A9ma, consulté le 02juin 2020. https//www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/définition/cinema/, consulté le 02 juin 2020. 43 Journot, Marie-Thérèse. Op. Cit, 22. 44 http://www.musee -virtuel.com/histoire -cinema.htm, consulté le 20 octobre 2017. 42
43
1.1. NAISSANCE DU CINEMA De sa création en 1895 jusque dans les années 1920, l’Europe et les États- Unis furent les plaques tournantes du cinéma mondial. Les USA ont mis et continus de mettre des moyens colossaux pour faire du cinéma un secteur qui compte dans son produit intérieur brut (PIB). D’ailleurs, on a attribué l’invention du cinématographe aux frères Lumière, originaires de l’une des provinces de la France, Lyon. Avec les toutes premières projections publiques de 1895, le cinéma utilisé comme un divertissement, et aussi scène de vie : (témoignage du quotidien), va vite gravir les échelons pour devenir une création artistique. La naissance du cinéma a été abordée par plusieurs chercheurs dont Maria Loftus, qui, dans sa thèse, a traité du cinéma documentaire en Afrique Noire en 2012. Dans sa partie introductive, elle a souligné l’invention du cinématographe et les raisons de l’expansion coloniale de la France, liées à l’histoire coloniale de l’Europe en général et de la France en particulier, Elle note clairement que l’année 1895 est celle de l’invention cinématographique, qui est liée à l’histoire coloniale de l’Europe : « Après la guerre franco-prussienne de 1870 à 1871 et la conférence de Berlin de 1884 à 1885, l’Europe commence une course à la conquête de l’Afrique, marquant le début de l’expansion coloniale. Ces conquêtes ont lieu surtout en Afrique, continent qui a eu très peu de colonies officielles jusqu’aux années 1880, bien que le continent ait été sous « l’influence occidentale » depuis un siècle. C’est en outre aux alentours de 1895, un an après la création du ministère des Colonies, que la France obtient la plupart de ses colonies en Afrique de l’Ouest : le Sénégal, le Soudan Français, la Côte d’Ivoire, La Haute Volta, la Guinée Française et le Dahomey, La Mauritanie et le Niger sont inclus dans l’Afrique occidentale française respectivement en 1903 et 1904, la consolidation de l’Afrique équatoriale française s’est faite à elle entre 1885 et 189145 ». Loftus va jusqu’à souligner les raisons principales de l’expansion coloniale qui se justifient du fait que les colonies sont des grands pourvoyeurs de matières premières pour l’industrie française. Et, il était 45
Loftus, Maria. Le Cinéma Documentaire en Afrique Noire : Du Documentaire Colonial au Documentaire Africain (1895-1985). Thèse de doctorat : Littérature françaises, générale et comparée et art du spectacle.
44
surtout question de remobiliser les troupes françaises à la suite de la défaite Franco-prussienne de 1870. Conquérir l’Afrique sous équipé en arme, pourrait faciliter des victoires à l’armée française, qui était sortie d’une défaite armée. La conquête se justifiait dans les colonies par la mission civilisatrice de la France sur les peuples des colonies. En ce qui concerne la France, les autorités ont laissé les réalisations filmiques aux firmes privées de la France dans la production des images coloniales jusque dans les années 40. Pour Youssef El Ftouh et Manuel Pinto le cinéma produit pour l’Afrique affirme l’idéologie selon laquelle, l’Afrique est sans culture. Ils notent : « En effet, le cinéma colonial n’a eu de cesse de traduire l’idéologie d’une France venant « civiliser » un continent de « sauvages » et de « barbares ». La représentation de la « civilisation » d’un côté, et de la « barbarie » de l’autre recoupe l’opposition entre le Blanc et le Noir46». Pour Manthia Diawara : « In 1884, the European countries met in Berlin for the “scramble of Africa” To justify themselves morally, they argued that they had a duty to civilize Africans. Most of the pioneers who introduiced film production to Africa used the same argument.47” La mission civilisatrice était le maitre mot pour toutes les opérations qui venaient de l’occident. Des cinéastes aux coopérants et des missionnaires à l’armée française, tous, en fonction de leur spécialité dans l’administration coloniale ont contribué à faire la propagande de la puissance armée de la France et de sa culture. Déjà dans les années 30, les pays tels que l’URSS, les USA, la France commencèrent à considérer l’image comme étant d’une grande importance. Le cinéma devenait de plus en plus un enjeu culturel et politique. Culturel parce qu’il permet de voir les pratiques d’une société ; politique parce que le pouvoir peut faire de l’image, un outil de propagande pour défendre une cause. S’agissant de la France, on peut lire chez Charlotte Meyer que :
46
Ruelle, Catherine et Al. Afriques 50 : singularités d'un cinéma pluriel. Paris : Harmattan, 2005,p.33. 47 Diawara, Manthia. African Cinema, Politics and culture. Bloomington: Indiana University press, 1992 , p1.
45
« C’est dans un contexte d’indifférence générale que les partisans de l’expansion coloniale cherchent à fabriquer une image (un imaginaire) des colonies françaises justifiant leur présence outre-mer. A cet effet, toute une propagande est mise en place, véhiculée par le discours des hommes politiques (notamment du parti colonial), les journaux d’information, les cartes postales, les caricatures, les livres scolaires, les films coloniaux, et les exposions coloniales48 ». Certains de ces éléments de propagande se voient actuellement dans le système éducatif, en particulier au Niger, où dans les manuels scolaires, l’histoire de l’Europe est très présente au détriment de l’histoire du Niger. En effet, dans les programmes scolaires au secondaire, les manuels d’histoire et de géographie sont élaborés en français. Ainsi, dans le programme, l’élève apprend les régimes politiques de la France du 17ème au 18ème siècle, la démographie aux USA, etc., Un exemple palpable, au cours de notre examen du baccalauréat en 2001, certains sujets portaient sur les USA. A l’université dans le cycle de la licence en Lettres Modernes, les étudiants découvrent la littérature occidentale du 17ème au 20ème siècle. Des auteurs comme Jean Jacques Rousseau, Arthur Rimbaud, Albert Camus et bien d’autres écrivains et philosophes français sont dans le programme. Alors que peu d’auteurs nigériens sont dans le programme éducatif. Cependant l’Afrique tente à se défaire de tous les éléments du fondement du cinéma en Afrique, malgré le fait qu’il soit très difficile de se départir de cette culture cinématographique, héritée. Pour y arriver, les thématiques des films des cinéastes africains sont axées sur les traditions, qui transposent des pratiques des sociétés. Pour Denise Brahimi : « Le versant positif du nationalisme consiste en une volonté de s’affirmer contre les images mensongères et les clichés qui ont été notamment le fait du cinéma colonial. Affirmer son identité, tel a été le grand mot d’ordre, dont on peut dire qu’il correspond au désir le plus fréquemment exprimé par les créateurs des pays d’Afrique pendant une vingtaine d’année.49 » Les cinéastes pionniers en Afrique comme de la
48
Meyer, Charlotte. Les naissances du cinéma francophone subsaharien : les regards croisés de Jean Rouch et Ousmane Sembène. Mémoire de Maîtrise, Etudes littéraires. Québec : 2004, p15. 49 Brahimi, Denise. Cinémas d’Afrique Francophone et du Maghreb. Paris: Nathan, 1997, p9-10.
46
jeune génération dans les films parlent de leur tradition. Ils réhabilitent les cultures africaines. A la fin des années 50, c’est avec l’apparition de la Nouvelle Vague où la nouvelle génération de cinéastes que le cinéma s’impose comme véritable art, une source parmi les sources de l’histoire. Cette Nouvelle Vague est un mouvement de contestation de jeunes cinéastes en France. Ces jeunes ont décrié les grosses productions de films et souhaitent un changement radical. Dans le groupe, on retrouve François Truffaut, Claude Chabrol, Eric Rohmer, Jean Luc Godard, Jacques Rivette et Alain Resnais, tous des grands noms du cinéma français. Il faut noter qu’André Bazin à travers les Cahiers de Cinéma50 a joué un rôle pas des moindres dans l’accompagnement de ce groupe de jeunes progressistes. Ils prônent le cinéma d’auteur. De la critique cinématographique, ils se retrouvent derrière la caméra avec moins de conformisme des grandes productions tels que les décors soignés, une équipe considérable. Ces jeunes font appel à l’improvisation avec un budget de production peu considérable. Il faut souligner aussi dans les années 60 que le matériel de production (caméra, pellicule) est bon marché. Ce mouvement, malgré une courte expérience (1958-1965) a changé tous les codes classiques de cinéma. Ils ont apporté un autre regard (le cinéma amateur) sur la façon de produire en France. Nous pouvons citer Jean Rouch, certes qui ses œuvres ont précédé La Nouvelle Vague, mais, a contribué à la démystification des grosses productions dans le monde. Ferro notait que: « Le film aide ainsi à la constitution d’une contrehistoire, non officielle, dégagée pour partie de ces archives écrites qui ne sont souvent que la mémoire conservée de nos institutions51 ». Pour Balufu : « Le cinéma, moyen d’expression artistique et technique, est une vision imagée, subjective, objective, poétique, ou codifiée, des choses et des êtres. Il relève le regard qu’une personne pose sur le monde. Autrefois, il fut l’un des moyens les plus importants que certains systèmes politiques utilisèrent pour abrutir les masses, les conformer, et imposer leur domination ainsi que leurs images magnifiées aux colonisés 52 ». Par cette citation, on peut comprendre que le cinéma, s’il est bien maîtrisé peut-être pris pour un média manipulable pour un but 50
Cahiers du cinéma, revue critique de cinéma, créée en 1951. Marc, Ferro. Cinéma et Histoire. Paris : Gallimard, 1993, p.13. 52 FEPACI, L’Afrique et le Centenaire du Cinéma. Africa and the centunary of Cinema. Paris: Présence Africaine, 1995, p25. 51
47
bien déterminé. Ce media peut traiter partiellement ou impartialement les sujets abordés. Et, parfois, l’interprétation des images peut prêter à confusion aux moins avertis. D’un côté le cinéma pour les Occidentaux, était un outil de propagande, de diffusion de la culture occidentale, comme le notent certaines élites africaines des années 60-70 dont Ferid Boughedir53. Mais, aussi, le cinéma a permis, un éveil de conscience des peuples africains dans la réhabilitation de leurs pratiques sociales. Les films des pionniers montrent l’appropriation des cultures locales. Cette appropriation de la culture se retrouve dans les écrits des écrivains africains. N. Franck Ukadike soulignait que : « Pour les pionniers du cinéma Africain des années 60 et 70, le film était un exercice culturel et politique. Les cinéastes montraient la vraie image de l’Afrique qui avait été victimisée par les caricatures hollywoodiennes entre autres 54. » Et, c’est précisément cela qui pourrait nous conduire à parler de rapport entre Cinéma et Histoire, qui est un aspect central de notre recherche. On note plus souvent que les personnes d’une société se reconnaissent à travers un film. Le film Si les Cavaliers de Mahamane Bakabé, qui est une adaptation de l’ouvrage Si les cavaliers avaient été là … de l’historien nigérien André Salifou, retrace la conspiration de la chefferie traditionnelle de Zinder pour faire partir le colonisateur qui bafoue les droits élémentaires de la population. La réception chez les spectateurs affirme l’appartenance à une nation. Lorsque que nous échangeons avec les cinéphiles de nos ciné-clubs dans les établissements scolaires, leurs réactions en témoignent. Dans l’ouvrage Cinéma et Histoire, l’auteur Marc Ferro soulève la question du cinéma comme source de l’histoire. Mais, ce cinéma a été longtemps ignoré, car perçu comme une source non crédible à l’apposé des documents, des témoignages, des autres arts, etc. Marc Ferro disait à ce titre « Au milieu du siècle, l’image n’avait qu’une légitimité contestée ; seule sa haute aristocratie - la peinture, les musées, les collections franchissait les portes du monde cultivé, ou celui du pouvoir55. ». Petit à petit, dans les années 30, les pays tels, l’URSS, commencèrent à considérer l’image comme d’une grande importance. Il a fallu, dans les 53
Boughedir, Férid, cinéaste Tunisien. FEPACI. L’Afrique et le Centenaire du Cinéma. Africa and the Centenary of Cinema. Paris : Présence Africaine, 1995.Ibid., p67. 55 Marc, Ferro. Cinéma et Histoire.Op., cit., p.11. 54
48
années 60, avec l’apparition de la Nouvelle Vague que le Cinéma s’impose comme véritable Art, une source parmi les sources de l’histoire. Ferro soulignait, « Le film aide ainsi à la constitution d’une contre- histoire, non officielle, dégagée pour partie de ces archives écrites qui ne sont souvent que la mémoire conservée de nos institutions56 ». En effet, tantôt critiqué parce qu’on peut manipuler les images, tantôt intégré comme une source de l’histoire parce que considéré comme un progrès scientifique, le cinéma dans les années avant, pendant et après les deux guerres mondiales était considéré aux USA, en Allemagne, en URSS, en France, au Japon comme une arme de propagande à la fois politique, culturelle et une arme de contre-pouvoir, donc lié aux rapports sociaux. Et, c’est précisément cela qui pourrait nous conduire à parler de rapport entre Cinéma et Histoire, car les personnes d’une société peuvent se reconnaitre à travers un film. Pour se faire, il est donc intéressant de se pencher sur les relations entre Cinéma et histoire à travers les cinq parties de l’ouvrage que sont : le film comme document historique, le film comme agent de l’histoire, les modes d’action du langage cinématographique, film et société et l’histoire au cinéma. Le film, document historique Ses mots qui suivront de Marc Ferro démontrent la longue lutte du film pour pouvoir s’imposer, car le film a été longtemps trainé dans la boue avant de se positionner comme document historique, « Ainsi pour les juristes, pour les gens instruits, pour la société dirigeante, pour l’Etat, ce qui n’est pas écrit, l’image n’a pas d’identité : comment les historiens pourraient-ils s’y référer, même la citer ? Sans foi ni loi, orpheline, se prostituant au peuple, l’image ne saurait être une campagne pour ces grands personnages que constitue la société de l’historien : articles de lois, traités de commerce, déclarations ministérielles, ordres opérationnels, discours57». Cela montre clairement que « la haute catégorie sociale » a préféré l’écrit au film, malgré que l’écrit, lui-même a subi une critique féroce et ardue, jusqu’à la censure à ses débuts. Etapes que le film est entrain de suivre. Au début, Le film devenant de plus en plus gênant, car échappant à la maîtrise des pouvoirs (Eglise,
56 57
Marc, Ferro. Cinéma et Histoire. Ibid., p.13. Marc, Ferro. Cinéma et Histoire. Ibid., p.36.
49
bourgeoisie, Etat, etc.) ceux-là, au lieu de s’en servir, il lui advient d’en accuser la dérision disait Ferro. L’auteur souligne aussi l’importance du film comme document, qui à une richesse et des significations qui, sur le moment, ne sont pas perçues. Ici, on peut comprendre, que le film peut servir à avoir une idée sur la sociologie d’une population, les idéologies des réalisateurs, des politiques, de la bourgeoisie, etc. On sort du cadre du film comme distraction, mais, pour entrer dans le cadre du film, comme document, archive, pour être consulté à des fins anthropologiques, culturelles, politiques, etc. Marc Ferro disait à ce titre qu’ « Il ne suffit pas de constater que le cinéma fascine, qu’il inquiète : les pouvoirs publics, la puissance privée pressentent qu’il peut avoir un effet corrosif ; ils s’aperçoivent que, même surveillé, un film témoigne. Actualité ou fiction, la réalité dont le cinéma offre l’image apparaît terriblement vraie ; on s’aperçoit qu’elle ne correspond pas nécessairement aux affirmations des dirigeants, aux schémas des théoriciens, à l’analyse des opposants58 » Qu’ils soient film d’actualité, fiction ou film de propagande, l’historien peut s’en servir pour analyser des faits sociaux, reconnaitre les infrastructures d’une période passé, des monuments, etc. Pour l’illustrer, l’auteur donne l’exemple de quelques films Russes dont, une contre analyse de la société, un film de Podovkine portant sur la grève des ouvriers d’une usine en Russie, dans lequel il relève la non solidarité des ouvriers, des antagonismes liés à la fonction dans l’usine, à un conflit de génération, en gros un reflet des comportements de la société. Le film, agent de l’histoire Dans cette deuxième partie de l’ouvrage, l’auteur soulève trois éléments que sont les critiques d’authenticité, d’identification et d’analyse qui permettent de reconnaitre un document d’actualité (film documentaire). La manière pour l’historien de déterminer si un document d’actualité a été reconstitué ou pas. L’auteur souligne des techniques (présence de plans-séquences, plans très longs, l’angle de prise de vues, distance aux différentes images d’un même plan, le degré de lisibilité des images et d’éclairage, le degré d’intensité de l’action représentée dans les images, le grain de la pellicule) pour reconnaitre si un document d’actualité est authentique ou 58
Marc, Ferro. Cinéma et Histoire. Ibid., p.39.
50
a été reconstitué. Il prend plusieurs exemples de films dont le film Un jour de combat sur le front de l’Ouest dans lequel, son analyse aboutit à une reconstitution du film alors que le film offre toutes les apparences de l’authenticité. Ferro souligne aussi, le fait de prévenir les acteurs d’un film peut-il enlever l’authenticité au film ? Il donne l’exemple du film Les Maîtres fous de Jean Rouch, ou les participants ont été prévenus des enjeux du film. Tout au long de cette deuxième partie, l’auteur nous démontre comment une même actualité peut avoir plusieurs interprétations d’un pays à un autre et aussi comment lors des années 20,30 l’Allemagne, l’URSS, la France ont su donner à la population une autre vision de l’image. Marc Ferro disait à cet effet, « Révélateur sans équivalent, qu’aucun document écrit ne permet de saisir, l’image témoigne ainsi d’une autre réalité que celle qui émane des sources traditionnelles59». L’auteur soulève aussi, combien il est problématique de parler des histoires parallèles. Cette manière comparative d’évoquer, des thématiques, des réalités vécues entre les pays, qui peuvent faire l’objet de critique acerbe en fonction du côté dans lequel on se situe. Car les uns et les autres n’assument pas leur histoire. Dans sa réponse à Hector Yankelevich, Marc Ferro souligne « (…) j’ai reçu des lettres d’insultes. En 1990, comme on montrait les actualités allemandes assez souvent – car elles sont souvent les plus complètes et les meilleures --, on m’a dit : « Vous faites un travail ignoble, vous reproduisez la propagande nazie, et comme elle est plus forte que vous, vous rendrez les gens nazis !60 ». Il poursuivit pour dire que c’était pareil, des insultes et des agressions lorsqu’il a commencé son séminaire sur le Cinéma et l’Histoire, en analysant et montrant le film Juif Süss. L’auteur s’interroge sur le fait que « montrer ou de dire » apparaît-il comme une légitimation et une justification ? A travers la démarche de Ferro, on observe que chaque régime, chaque opposant d’un régime… ont une manière de diffuser à travers les médias des informations pour faire de la propagande à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, cela, parfois dans le but de cacher la vérité à la population. Aussi le film sert pour dénoncer des comportements sociétaux, etc. Pour Ferro, il est nécessaire pour comprendre l’histoire à travers ses émissions télévisées de passer par les images. Car, l’image 59 60
Marc, Ferro. Cinéma et Histoire. Ibid., p.117. Marc, Ferro. Cinéma et Histoire. Ibid., p.126.
51
accompagnée des commentaires permet d’étayer la crédibilité théorique d’un propos historique. Les modes d’action du langage cinématographique L’auteur nous montre comment l’art, c'est-à-dire, ici, le savoir-faire dans son métier peut permettre de mieux comprendre un fait, un phénomène dans l’enchainement des images ou même à travers d’autres modes d’action du langage cinématographique, comme l’interview. Mais, le montage, les effets spéciaux d’un film peuvent ressortir une certaine idéologie voulu ou pas du réalisateur. Marc Ferro donne l’exemple du film Juif Süss , après analyse, il conclut que « Ainsi, examiné sous la forme d’une série, le choix dans l’utilisation des fondus enchaînés prend une signification idéologique ; car, réunis, ces quatre effets forment une structure, un condensé de la doctrine nazie61. » L’auteur souligne aussi, le rôle important de l’interview, en ce sens que l’interview permet de confronter un personnage du présent avec son propre passé, il confronte la représentation que le témoin a dû passer avec la réalité de ce passé et l’historien qui s’efface devant les témoins, devant la société, devant le témoignage du passé. Marc Ferro ajoute qu’ « En l’absence de cette médiation, l’explication historique apparaît terriblement authentique, comme, dotée d’un supplément de vérité62.» A travers ces propos, on voit combien, certains historiens dont Ferro essayent de donner une méthode d’analyse historique, pour peut-être minimiser les dérives. Société qui produit, société qui reçoit Ici, l’auteur évoque le pouvoir d’un réalisateur, de jouer sur le rôle qu’il veut donner à chaque acteur dans un film. Marc Ferro analyse quelques films dont Le troisième homme (1949) et La grande illusion (1937). Il fait ressortir des comportements ambigus des personnages, l’anticommunisme, l’antisémitisme, Les rivalités sociétales entre les populations des alliés dans les deux films. Marc Ferro soulignait que « Ces observations avaient seulement pour objet de montrer le parti que peut offrir une information sur la réception d’un film à deux époques différentes et seulement cela63.» Comme dit, plus haut, le cinéma a 61
Marc, Ferro. Cinéma et Histoire. Ibid., p.161. Marc, Ferro. Cinéma et Histoire. Ibid., p.163. 63 Marc, Ferro. Ibid., p 190. 62
52
longtemps été contesté par la bourgeoisie, le pouvoir, avant de s’imposer comme une source de l’histoire. Comme le note Marc Ferro, « Dans la Russie « attardée » comme en Europe « avancée », le cinéma est apparu, dès sa naissance comme une invention perverse qui subvertirait l’ordre établi64. ». On voit à travers cette citation que dès sa naissance, le cinéma n’était pas le bienvenu dans un monde où la bourgeoisie détenait le pouvoir. Cependant, l’auteur en empruntant les propos de Lénine de 1917, sur le rôle à venir du cinéma, il estimait que : « le jour où il serait entre les mains des masses et des vrais chantres d’une culture socialiste, il constituerait le plus puissant instrument des lumières65. » Ici, on peut noter déjà, que le cinéma est en train de sortir de son cadre premier, qui est la distraction, pour prendre un aspect éducatif que l’Etat pense contrôler, gérer, etc. Spécialiste de la Russie, Marc Ferro, n’a pas hésité de parler des courants cinématographiques de ce pays. Parmi lesquels, on peut voir, Eisenstein, Dziga Vertov, Kulesov, Pudovkin, etc. L’Histoire au cinéma Par cette dernière partie de l’ouvrage, Marc Ferro soulève la problématique des films de fiction dont les informations traitées sont inventées et souvent considérées comme des réalités vécues. L’auteur disait à ce titre, en évoquant le film « Le Cuirassé Potemkine » d’Eisenstein : «Ainsi avec des faits imaginaires, l’artiste retranscrit le vrai, rend l’Histoire intelligible, ce qui pose le problème de la fiction, de l’imaginaire comme d’investigation historique, scientifique66. ». Ici, on voit, apparaître une nouvelle mode d’analyse historique à côté des plus anciennes que sont la philosophie politique, l’érudition. Avec l’évolution du monde, la faillite des idéologies, la renaissance des nations excolonisées disait l’auteur, le désir d’avoir sa propre mémoire, sa propre histoire, on assiste à la faillite des modèles classiques d’analyse historique et l’apparition de nouvelles formes d’histoire dont la fiction. Cette fiction qui prend une place pas moins importante, car les faits inventés dans le cadre du film occupent souvent la mémoire collective, individuelle et tend vers une création artistique. Marc Ferro soulignait à 64
Marc, Ferro. Cinéma et Histoire. Ibid., p 191. Marc, Ferro. Cinéma et Histoire. Ibid., p 192. 66 Marc, Ferro. Cinéma et Histoire. Ibid., p 212. 65
53
cet effet, « (…) tout ce que dit Shakespeare sur Jeanne d’Arc est inventé, et pourtant, malgré les travaux des historiens, c’est bien la Jeanne d’Arc de Shakespeare que les Anglais ont en mémoire, et plus le temps passe, moins les historiens y changeront rien67.». L’auteur rajoute que « C’est qu’à la différence d’une œuvre d’Histoire, qui change nécessairement avec le recul et le progrès des analyses, l’œuvre d’art se perpétue, immuable68.». On note, de même que, quel qu’en soit l’analyse historique, l’historien hiérarchise ses informations dans son travail en fonction de ses objectifs et en les adaptant. Le traitement des informations, le principe d’organisation, la fonction des œuvres varient lorsqu’on est en face d’une histoire-mémoire, d’une histoire générale, d’une histoire scientifique, d’une histoire expérimentale ou de la fiction. Malgré qu’on note un aspect didactique du livre Cinéma et Histoire, s’il y a une seule critique générale à faire, ce serait le regret que l’auteur a survolé le cinéma et l’histoire de l’Afrique dans ses choix, alors qu’il y’avait de la matière dans les années de l’édition du livre. En somme, un livre dans lequel on observe que, derrière tout film se cache une certaine idéologie militante active ou passive. Le document soulève aussi les fractures sociales, politiques et culturelles entre les pays occidentaux (alliés ou pas des deux guerres), la distinction des genres filmiques dans les pays avec une compréhension différente dans l’interprétation des faits sociaux sur des mêmes thématiques. D’ailleurs l’auteur se pose la question, « Avec la possibilité de consulter les mêmes sources, les historiens ont-ils tous écrit la même histoire de la Révolution69 ? ». Pour faire le lien entre la fiction et l’histoire, je finirai par ces propos, « une histoire c’est un récit, ce peut être vrai ou faux, à base de « réalité historique » ou purement imaginaire, ce peut être un récit « historique » ou une fable70.». Toutes ces thématiques, nous donnent une vue d’ensemble sur l’utilisation du film dans la vie quotidienne des sociétés dans les années 20 -50 où l’État, la bourgeoisie, l’église… voulaient une main mise absolue sur la population dans l’espoir de les soumettre à la pensée 67
Marc, Ferro. Cinéma et Histoire. Ibid., p 218. Marc, Ferro. Cinéma et Histoire. Ibid., p 218. 69 Marc, Ferro. Cinéma et Histoire. Ibid., p 37. 70 Le Goff, Jacques. Histoire et mémoire. Paris: Gallimard, 1988,p180. 68
54
unique des plus forts sur les plus faibles, des minorités sur la majorité, etc. Du divertissement populaire à la création artistique, le cinéma jusque dans les années 50 était vivant en Europe et aux États-Unis, avec Hollywood, la plus grande production filmique au monde. L’apparition de la couleur au lendemain de la seconde guerre et du son au lendemain de la première guerre mondiale, va permettre aussi, l’émergence d’autres pays européens comme l’Italie et la réalisation de films d’auteur. L’Afrique dans les années 50, va faire parler d’elle dans le cinéma avec des jeunes comme Paulin Soumanou Vieyra Moustapha Alassane, Oumarou Ganda Sembène Ousmane et bien d’autres. Les tous premiers films africains comme Afrique sur Seine (1955) parlent des africains. C’est le cas du Niger où les romans et les films des réalisateurs prennent leurs inspirations dans les réalités de la société. Plusieurs films intéressants ont été réalisés dans ce sens. Une production de films avec l’appui de la France à travers le service de coopération Français, des structures sous la tutelle de la France (CNRS, IFAN, CCFN, IRSH) et des sociétés de production Françaises (Argos Films). Nous citerons les exemples des films réalisés par Moustapha Alassane (Aouré (1962), La bague du roi Koda (1962), Le piroguier (1962), La mort de Gandji (1965)). Nous avons les films de Oumarou Ganda (Cabascako (1968), Le wazzou polygame (1970), Saïtane (1972)). La Réussite de Mei Thèbre (1970) de Yaya Mali Kossoko, etc. Certains films ont retenu notre attention. On peut parmi tant de films : FVVA (Femme Villa Voiture Argent) réalisé en 1972 par Moustapha Alassane. Un film dans lequel, l’acteur principal, Ali, obéit au choix des parents dans son premier mariage. Alassane, lui-même dans un entretien accordé à Guy Hennebelle et Catherine Ruelle, dit vouloir à travers le film s’attaquer à « l’arrivisme de la nouvelle classe au pouvoir ». Il souligne aussi que : « (…) mon propos n’était pas d’accabler de façon systématique et négative la société nigérienne mais d’amener les gens à se poser des questions sur certaines de nos mœurs71. » Il y’a également Le Waazou Polygame (1970) de Oumarou Ganda, où la famille de la jeune mariée cède à la pression économique de El Hadj. Achille Kouawo souligne à cet effet : 71
Ruelle, Catherine, T. Clément et S. Alessandra. Afriques 50, singularités d’un cinéma pluriel. Paris : Harmattan, 2005, p 195.
55
« À l’image de son premier film où il s’inspirait de sa propre vie, Oumarou Ganda, un bon observateur de sa société, s’est inspiré d’un fait réel pour écrire le scenario de Wazzou polygame. A travers ce film, Ganda dénonce la polygamie, mais aussi ceux qui détiennent ou pensent détenir d’une manière ou d’une autre le pouvoir. Il savait qu’attaquer les El Hadj de front, n’est pas facile72. » Le film met en lumière les étapes du mariage en zone zarma et toutes les conséquences qui sont liées à la polygamie. Des conséquences d’exode, de prostitution, de meurtre et de frustration sociale. De même, on retrouve d’autres pratiques culturelles de la société nigérienne dans le film Koukan Kourcia (2010) de Sani Magori, un long métrage dont la principale thématique porte sur les raisons de l’exode dans la région de Tahoua. Le réalisateur met en lumière les causes et conséquences de l’exode, du fait des chants de la cantatrice Zabaya, qui a le pouvoir de faire partir et faire revenir les bras valides de la migration. 1.2. EXPANSION DU CINEMA EN AFRIQUE Le cinéma en Afrique peut se subdiviser en trois pôles. Le pôle des pays africains (Anglophones, Francophone et Lusophone). La production cinématographique dans ces pôles varie en fonctions des pays colonisateurs (France, Angleterre, Portugal, Belgique, etc.). Si nous suivons les travaux de Manthia Diawara sur la production cinématographique africaine, la distribution dans les trois pôles existent, mais contrôlée par les pays colonisateurs. Le dénominateur commun qui lie ces trois pôles dans les années 70 est la distribution des films étrangers, en occurrence, les films indiens et chinois. Le Nigéria comme les pays Francophones, malgré la colonisation des écrans à travers les films étrangers, arrivent à porter à l’écran des thématiques sur leurs réalités. C’est ainsi qu’on peut voir des films en langues Haoussa, Yorouba, Ibbo, etc. Dès l’avènement du cinéma, les Africains ont découvert le cinéma à travers la projection des films dans les colonies françaises. Le cinéma est alors connu en Afrique à ses débuts à travers la distribution et la diffusion des films occidentaux. Deux éléments essentiels dans la commercialisation des films. Parlant de la distribution, Le professeur 72
Ruelle, Catherine, T. Clément et S. Alessandra. Ibid., p 282.
56
Claude Forest notait : « Une fois le film achevé, un intermédiaire devient indispensable pour favoriser l’accès de l’œuvre aux salles et valoriser sa commercialisation : le distributeur73.» Partant de cet esprit mercantiliste nous pouvons considérer que le cinéma très tôt est devenu un business pour les créateurs et ses acteurs. L’Afrique noire est un endroit de prédilection pour sa commercialisation. Sada Niang, note les fondements même de l’avènement du cinéma en Afrique. « L’invention du cinéma (1895) a coïncidé avec le partage de l’Afrique par les puissances coloniales à la conférence de Berlin (18851886). Une nouvelle ère s’annonçait où, en plus de servir d’outil de propagande pour la supériorité culturelle occidentale, l’image de l’Afrique offerte aux Européens allait pouvoir "documenter" la "barbarie" de ces hommes et femmes de couleur, "illustrer" la géographie "monstrueuse" des espaces qu’ils occupaient, et fonder une sémiotique du moi sur la négation du type ‘‘humain’’ et spatial africain. Se déclenche alors un processus d’invention ontologique mu et nourri par une recherche et un refus de l’altérité. Toute différence y était à proscrire, présentée de manière négative et juxtaposée à un idéal d’être, de bien, de raffinement, de civilisation européenne. L’horreur, la peur, le dégoût servirent de sèmes organisateurs aux récits des voyageurs, explorateurs, médecins et soldats de l’Europe coloniale74». Nous notons que l’expansion du cinéma dans les pays de l’Afrique Occidentale Française s’est faite de manière progressive en fonction de la forte présence de la France dans les colonies. L’exemple du Sénégal est donné par Paulin Soumanou Vieyra, qui souligne que le film L’arroseur arrosé de Louis Lumière fut l’un des tous premiers films à être projeté. Dakar, notait Vieyra, était à l’époque « capitale fédérale abritant les organismes fédéraux, se trouvait être le centre de toutes les décisions qui concernaient l’Afrique Occidentale Française (AOF). Le cinéma s’est donc fixé à Dakar pour l’essentiel de ses activités, qu’elles soient de distribution-exploitation ou de production75».
73
Forest, Claude. L’argent du cinéma : L’introduction à l’économie du septième art. Belin-SUP, 2002, p116. 74 Niang, Sada. Djibril Diop Mambety : un cinéaste à contre-courant. Paris : Harmattan, 2002, p40. 75 Vieyra, Paulin Soumanou. Le Cinéma au Sénégal. Paris : Harmattan, 1983, p18.
57
On ne peut évoquer le cinéma nigérien et sa naissance sans une prise en compte de l’histoire coloniale, avec la course impérialiste aux territoires, en Afrique comme ailleurs. De même, on ne peut ignorer l’influence des années des indépendances en Afrique, qui a conduit l’Occident à penser à une autre forme de colonisation sans arme à feu, mais à travers d’autres moyens telle la diffusion de leur culture. Pour faire face à cette idéologie de suprématie, d’aliénation culturelle, les voix de l’intelligentsia africaine commencèrent à s’entendre, pour dénoncer les pratiques occidentales en Afrique, conscientiser les populations et réhabiliter leur histoire. Clément Tapsoba souligne : « Le cinéma africain avait un double défi à relever. Le premier consistait à restituer l’image dénaturée des noirs à travers les images faites sur eux par le colonisateur dans le but de servir ses desseins hégémoniques et d’acculturation. L’autre défi consistait pour le cinéma africain à sensibiliser, à éduquer les populations (…) La fonction sociale et politique du cinéma s’est donc imposée au cinéma africain dans un contexte historique.76» Les élites africaines des années 60-70 justifient cette manipulation pour des raisons d’ordre économique, politique, culturelle77. D’où une idéologie commune de ces élites africaines des années des indépendances à prôner une histoire vue, écrite et défendue par les Africains. C’était un moment où les Africains luttaient pour s’approprier de leur identité culturelle, de leur mémoire individuelle78. A celle-là, s’ajoute leur mémoire collective79, celle-ci, très répandue dans les sociétés à forte oralité, dont l’Afrique. 76
FEPACI. L'Afrique et le centenaire du cinéma. Africa and the centenary of cinema. Paris : Présence Africaine, 1995, Op., cit., p157. 77 Boughedir, Ferid. Le rôle du Cinéaste africain dans l’éveil d'une conscience de civilisation noire. Paris : Présence Africaine, 1974, p.125. 78 Une mémoire individuelle « permet la construction de l'identité d'un individu, grâce aux sensations vécues par chacun de ses sens, par le corps et par l’esprit. Ces sensations émanent dans un premier temps de sa famille, puis peu à peu l’individu choisit les sensations qu’il souhaite recevoir, même si la vie lui en impose aussi en parallèle, lui donnant de la joie comme de la douleur.» 79 Mémoire collective « est la mémoire d’une communauté ou d’un peuple. Elle rassemble le vécu commun d’un groupe en le gardant au présent. La mémoire collective peut se construire sous forme d’un Mémorial, d’un musée où le passé d’un peuple est retracé.»
58
Au Niger le cinéma y était par le documentaire d’inspiration nigérienne. Et, précisément d’aucuns situent l’arrivée de ce cinéma en 1925 avec le film La Croisière Noire de Léon Poirier80, sur la traversée des voitures de la marque Citroën dans le désert. Un film dans lequel, le réalisateur porte à l’écran l’organisation sociétale des communautés (Djerma. Haoussa et Touareg et du Kanem Bornou) vivant à Agadez. Le film La Grande Caravane (1936) de Jean Marie Henri81 entre, aussi, dans l’histoire du cinéma au Niger. Entre rituel et souffrance, le réalisateur nous amène à voir le trajet des dromadaires vers les mines de sel d’Agadez jusqu’à Bilma. Mais avec toute cette prédisposition naturelle du Niger dans laquelle les humains et les dieux sont en contact régulier pour le mieux-être des communautés, nous pouvons dire que le cinéma au Niger a trouvé sa place dans le concert des nations en 1947 avec le film Au pays des Mages Noirs de Jean Rouch. Film, qui retrace l’histoire des populations du fleuve Niger avant les indépendances en Afrique. Le réalisateur nous montre un paysage magnifique du Niger. Le savoir-faire traditionnel dans la poterie, la pêche et la chasse est mis en lumière. Il sera également intéressant, d’évoquer la docufiction Moi, un Noir (1957), dix (10) après le tout premier film de Rouch sur le Niger. Une manière de voir le traitement et la cohérence du réalisateur à travers ses deux (2) films. Moi, un Noir, met en lumière les immigrants nigériens qui vivent en Côte d’Ivoire, un film qui annonce l’avenir du cinéma nigérien, avec l’acteur principal du film Oumarou Ganda, dit Robinson. Ces deux films sont considérés comme étant des films ethnographiques, « qui se fixent pour mission de « révéler le conditionnement culturel » en explorant les différences culturelles et mettant en valeur des cultures distinctes ». Le Niger devient très vite pour Rouch et ses disciples comme Olivier de Sardon, un lieu de prédilection cinématographique à travers la richesse culturelle des Djerma-Songhay. Ces deux films sont aussi intéressants, en ce sens qu’on peut situer l’avènement du cinéma nigérien à travers des Nigériens, qui avaient donné de leurs corps et temps dans les réalisations de Jean Rouch. On peut citer Damouré Zika82. 80
Poirier, Léon : réalisateur français. Henri D’Esmeraud DJean Marie : journaliste et écrivain français. 82 Zika Damouré : Assistant réalisateur de Jean Rouch dès 1948. Acteur dans Jaguar tourné en 1954 et finalisé en 1967, coréalisateur du film Petit à petit (1977), Preneur de son du film Les Maîtres fous (1954), etc. 81
59
Les premiers films de l’Afrique noire se situent dans les années 40, précisément en 1946, avec les réalisations de films documentaires au format 35 mm. Les travaux de Jean Rouch pour l’UNESCO83 mettent en lumière ces documentaires. Jacques Dupont, en fait quatre documentaires (Noirs et blancs, Danses congolaises, Au pays des pygmées, Pirogues sur Ogooué) sur des pratiques culturelles au Congo. Il va s’en suivre d’autres films comme Autour de Brazzaville, Amitié noire de Jacques Villiers. Des films certes réalisés par des étrangers mais, qui sont d’inspiration africaine. C’est-à-dire dont les thématiques traitent des histoires des pays où les films sont réalisés. Il faut souligner aussi que Jean Rouch réalise son tout premier film. En Afrique subsaharienne, les premiers films réalisés peuvent être classés en cinq temps. Ainsi, on peut voir dans un premier temps les films qui montrent l’Afrique sauvage et ses croyances occultes. Rouch souligne qu’à cette époque l’Afrique : L ' Afrique, comme avant la guerre, n’y sera qu’un décor et les africains que de malheureux figurants qu’on n’hésitait pas à habiller de costume de fibres venus d’Outre Atlantique et à peindre des tatouages effrayants et qui feront davantage « couleur locale (…) L’Afrique sera un pays de bêtes et d’hommes sauvages juste à la mesure de l’aventure blanc84». Dans un second temps, dans les 40-50, les films ethnographiques voir le jour. Les cultures africaines sont montrées à l’écran. Les chercheurs dans les sciences sociales (Marcel Griaule, Jean Rouch, etc.) deviennent des cinéastes et font du cinéma, un outil de travail pour anthropologie visuelle. Le film L’Afrique 50 du réalisateur français René Vauthier entre dans le troisième temps. Un temps où la colonisation commence s’essouffler et des luttes politiques par les africains au quotidien. Les films qui montrent les réalités africaines sont censurés les autorisations de tournages sont refusées. Vient, ensuite le temps des premières tentatives filmiques sur les problèmes qui minent le continent, avec les tous premiers films en Afrique du Sud et les films de Jean Rouch. Mais il faut noter que dans toutes les périodes précitées, les films étaient réalisés par des étrangers. Avec les tendances là, moins glorieuses pour les africains, car, ils 83 84
Rouch, Jean. Op., Cit., p.11. Rouch, Jean. Ibid.., p11.
60
avaient toujours un rôle non reluisant dans les films exotiques, cela, a poussé les africains dès, les premières tentatives filmiques à réhabituer sa culture. Et, aussi un regard des autorités africaines à accompagner le cinéma, par des fonds ponctuels et la création des festivals nationaux comme le FESPACO. Le cinquième temps, est l’époque où les cinéastes africains commencent les films en terre africaine. Et, l’un des premiers était Paulin Soumanou Viéyra au Sénégal et Moustapha Alassane au Niger. Il faut cependant, souligner qu’en Afrique, on trouve les films des pays anglophones (Nigéria, Ghana, Kenyan, Sierra Leone, Afrique du Sud.) et ceux des pays francophones (Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, etc.). Cette répartition s’explique de par la colonisation en Afrique. Les Britanniques ont su à travers la compagnie : British Colonia Film Unit (1939) produire des films dans ses colonies. Dès 1929, ils ont réalisé un film sur le paludisme à Lagos au Nigeria et bien d’autres films d’éducations par la suite. Quant aux films dans les pays africains francophones, la France très tôt, avait une main mise sur le cinéma. Le Niger en 1959, signe une convention de coproduction avec le Canada pour la réalisation des fêtes de l’indépendance. On peut retenir des deux pôles (Francophone et Anglophone) que les pays africains, parlant l’anglais, étaient dotés du matériel adéquat de diffusion par rapport aux pays africains de langue Française. Jean Rouch observe à cet effet que : « En 1957, la Côte d’Ivoire, qui sur le plan économique, pouvait se comparer, à son voisin, le Ghana, n’avait à aligner contre la flottille d’une vingtaine de cinémas mobiles du Ghana, qu’un malheureux Power-wagon presque définitivement inutilisable, et un vieux projecteur 16 mm appartenant au Centre Culturel, dont la mise en marche était fatale aux copies qu’il projetait.85».
85
Rouch, Jean. Ibid., p24.
61
1.3. JEAN ROUCH ET LE CINEMA AU NIGER « Ingénieur des Ponts et Chaussées converti à l’anthropologie africaine en assistant pour la première fois à un rituel de possession. C’est Jean Cocteau qui découvre le ton particulier de ses premiers essais documentaires et introduit le jeune anthropologue dans les milieux du cinéma d’avant-garde par le premier festival de Biarritz86. » Le parcours professionnel de Rouch au Niger est intéressant à évoquer. A Niamey, très vite des liens forts ont été créés entre le peuple colonisé et Rouch. Ce rapprochement n’est pas vu de bon œil, Rouch se voit sommer par sa hiérarchie. Il souligne à cet effet : « Les devoirs professionnels et, surtout, l’hostilité que ce genre de recherche éveilla dans la haute administration locale, aurait dû, normalement, m’éloigner à tout jamais de l’ethnographie. Pourtant, la certitude que ces modestes enquêtes étaient alors la seule activité valable, me poussa, malgré l’opposition souvent brutale des chefs de ce moment à continuer 87.». En fin 1942, Rouch est démobilisé par l’administration coloniale. Mais, il revient en juillet 1946, cette fois-ci sous la casquette d’expéditeur ethnographique, avec deux de ses amis, Jean Sauvy et Pierre Ponty. Après huit (8) mois de tournage, la sortie du film Au pays des mages noirs, en avril 1947. Le film commenté par Jean Rouch, met en lumière l’organisation des « sorkos » du Niger dans une chasse sur le grand fleuve. De la fabrication des pirogues et des harpons, de la chasse à l’hippopotame et le partage des morceaux de viande de l’hippopotame chassé, enfin à la danse de possession, Rouch arrive à maintenir le spectateur à travers des vives actions des scènes du film. Un film documentaire d’inspiration nigérienne. Rouch traite de quelques pratiques culturelles et cultuelles de la communauté Songhay au Niger.
86
Scheinfeigel, Maxime. Jean Rouch. Op., Cit., p2. Rouch, Jean. La religion et la magie songhay. Bruxelles : Université de Bruxelles, 1989.p13.
87
62
Figure 1: Des sorkos à la chasse d’un hippopotame.
Suivront d’autres films de Rouch, d’inspiration nigérienne, avec des assistants réalisateurs nigériens. Rouch soulignait que : « J’eus la chance aussi de trouver parmi le personnel des Travaux Publics, des informateurs, puis des amis dont l’aide me fut la plus précieuse. Je pense tout spécialement ici à Damouré Zika qui me conduisit le premier aux cérémonies des pêcheurs88 ». En 1948, Jean Rouch, Damouré Zika et Ibrahima Dia Lam, un autre nigérien, après un tournage dans la région de Tillabery , réalisent quatre films (Circoncision, Initiation à la danse des possédés, Les magiciens de wanzerbé ). Cette année 1948 est l’année des tournages de films, véritablement d’inspiration nigérienne avec des techniciens nigériens, Damouré et Lam assistaient Rouch dans ses réalisations. Dans d’autres films documentaires comme fictions de Rouch, les nigériens devenaient même des acteurs. Les plus notables sont les films : Bataille sur le grand fleuve (1951) dans lequel Damouré jouait avec le petit hippopotame et Moi un noir (1957) où Oumarou Ganda racontait son histoire d’ancien combattant de l’armée coloniale. Ce dernier film était réalisé à Abidjan en Côte d’Ivoire.
88
Rouch, Jean. Ibid., p13.
63
Figure 2: Un prêtre holley avec son fils.
Le plus souvent, la caméra à l’épaule dans ses prises de vue, laquelle devient un personnage à part entière dans les réalisations de Rouch. A travers sa voix off, sa proximité avec les personnages dans le cadre de sa caméra, Rouch saisi de très près les vives actions des possédés et de l’arène dans lequel se déroule les manifestions. C’est ainsi que dans le film Les Magiciens de Wanzerbé (1948-1949) de Rouch, la caméra est liée au corps de Rouch, surement pour vivre de près les gestuelles des possédés sur la scène. Il faut dire que, beaucoup de mouvement, de déplacement et des imprévus s’entrechoquent au cours de cette célébration. Et, avec une caméra fixe, on peut rater certaines actions des plus essentielles dans le rituel. Donc, suivre les actions de près est peutêtre pour Rouch, une manière d’imposer sa présence en tant que véritable témoin. On vit les actions avec des sensations fortes avec une caméra portative. Sans cette présence physique, la musique, la danse et les incantations qui sont des éléments cumulatifs et intégrants le rituel des possédés, peuvent ne pas être saisis avec une caméra fixe. Dans un rituel de possédés, la musique est un canal que les acteurs utilisent pour s’exprimer et faire passer des messages. Dans cette société traditionnelle 64
Songhay, la musique s’accompagne d’instruments à caractère traditionnel (tam-tam, flute, calebasses renversées) et de pas de danse. En effet, la danse est une pratique qui véhicule des valeurs et des savoir-faire des sociétés. Chaque société à ses pas de danse qui permettent de l’identifier. La danse est un art qui permet au corps de se mouvoir sous le rythme de la musique. Dans cette communauté des possédés, la musique tout comme la danse ont une fonction, non pas de divertissement mais spirituelle en témoigne le film Yennendi, les hommes qui font la pluie (1950-1951) de Jean Rouch. Un film dans lequel les devins organisent un rituel pour implorer les dieux de leur donner la pluie.
Figure 3: Les outils de la musique holley.
Il ressort que les films de Rouch au Niger offrent au spectateur des connaissances anthropologiques sur le type de société concerné. Ce milieu dans son grand ensemble donne des connaissances sur une culture ou une civilisation donnée. On remarque que les films dégagent un lien étroit dans la transmission de l’identité culturelle des zarma- songhay au Niger. Le cinéma « Rouchien » devient dès lors à travers une restitution fidèle des pratiques culturelles, un dépositaire crédible des traditions orales aux cotés des maitres de la parole, les griots. On note également que cette société est imprégnée de valeurs sociales et spirituelles assez 65
conséquentes car fidèles et sincères en parole et en actes. Ainsi à travers les films de Rouch au Niger, ce sont des traditions africaines qu’on apprécie à sa juste valeur. Elle montre à quel point l’Afrique est un continent où les valeurs traditionnelles étaient fondamentales et essentielles. L’étude de ces œuvres filmiques nous a permis d’étudier les relations humaines spirituelles et culturelles à travers les caractéristiques de la société. Rouch a été d’un apport pour le cinéma au Niger et pour la préservation du culte songhay. A travers des institutions comme le Musée National, l’Institut de Recherche en Sciences Humaines, le Centre Culturel Franco-Nigérien et l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN) où il était responsable d’une manière et d’une autre. Les premiers cinéastes nigériens (Damouré Zika, Ibrahim Dia Lam, Moustapha Alassane, Oumarou Ganda, Moussa Hamidou, Djingarey Maiga) ont embrassé une carrière cinématographique grâce à Rouch. Il faut souligner de même que les films de Rouch au Niger ont influencé certains films des pionniers du cinéma nigérien. C’est ainsi que nous pouvons voir des similitudes dans certains récits de films de Rouch chez Moustapha Alassane, Oumarou Ganda, Djingarey Maiga et Inoussa Ousseini, mais dans un regard diffèrent. Le film Les Maîtres fous (1954) de Jean Rouch qui est un documentaire sur les haoukas du Niger au Ghana. U, film dans lequel, certaines scènes sont d’une cruauté absolue à l’instar de la scène montrant les haoukas se précipitant pour se désaltérer du sang chaud d’un chien égorgé dans le cadre du rituel. Ce qu’on ne voyait jamais dans le culte songhay. Car, dans le culte songhay, sacrifié un chien n’avait jamais été dans le rituel. L’objet de notre analyse ne se situe pas à cette scène qui a été l’objet de beaucoup de polémiques à la sortie du film. Mais, une scène qu’on retrouve dans le film Wasan Kara (1980) de Inoussa Ousseini. A la fin du film Les Maîtres fous, Rouch présentait les mêmes haoukas qui étaient en transe la veille à leur lieu de travail. Ce que nous retrouverons dans Wasan Kara, qui est aussi un documentaire, cette fois, pas avec des scènes choquantes du film Les Maîtres fous, mais avec une parodie jouée par des acteurs, qui miment un évènement de l’histoire locale. Dans Wasan Kara, il était question de représenter, par des comédiens non professionnels, la visite du Président du Nigeria au Niger avec tout le protocole qu’on voit dans les cérémonies des visites des Chefs d’Etat dans la réalité à nos jours. A la fin du film Inoussa Ousseina empruntait la même méthode que Rouch pour présenter les 66
imitateurs dans leur vie active, qui certains sont de maçon ou de sans emploi. Nous avons aussi le film Au pays des mages noirs (1947) dans lequel Rouch met en lumière une chasse à l’hippopotame avec des harpons traditionnels. Djingarey Maiga en a réalisé un film dans ce sens Autour de l’hippopotame (1979) où les mêmes techniques sont utilisées pour chasser avec des harpons ce gros animal du fleuve Niger. Enfin, nous avons les films fictions, Toula (1973) et Le Wazzou polygame (1970) dans lesquels, les deux réalisateurs montraient la force mystique, le pouvoir que détenait le devin dans la société. La séquence du film Le wazzou polygame où le Zima par des incantations fait sortir dans du sable de billet d’argent en est une illustration. De même que dans Toula où à travers un rituel le devin fait venir un dieu (une statuette). Toutes ces scènes sont accompagnés d’un cérémonial comme nous pouvons le voir dans le film Au pays des mages noirs. Il ressort dans ces deux films, une certaine finesse par rapport aux films de Rouch sur le culte songhay, Pas de baves sur les possédés ni d’agitation des acteurs sur la scène. Mais, il est intéressant de noter les risques qui sont prises par Jean Rouch dans ses films. Des risques qui peuvent conduire à la mort. C’est le cas dans le film La chasse au lion à l’Arc (1965), où le lion avait attaqué les habitants qui étaient présents au tournage dont Rouch, qui d’ailleurs avait laissé la camera tournée pour pouvoir se protéger.
Figure 4: Des arcs et des chasseurs en action
67
Signalons que les pionniers du cinéma nigérien dont Moustapha Alassane, Oumarou Ganda, Djingarey Maiga, Moustapha Diop, Mamane Bakabé, Yaya Kossoko, Inoussa Ousseini ont tous travailler avec les appareils de leur époque, les 35mm et les 16mm. Avec l’évolution de la technologie ces anciens appareils ont laissé la place aux appareils numériques de prises de vues. Certains de ces pionniers qui sont actuellement en activité utilisent ce matériel numérique. C’est le cas de Djingarey Maiga, Moustapha Diop et Mamane Bakabé. Parmi les cinéastes qui viennent après les pionniers, Souleymane Mahamane, Aliou Ousseini ont pu utiliser aussi, le 16mm. Mais de nos jours, rares sont ceux de la nouvelle génération, qui ont connu le 16 mm. De l’image fixe de la photographie à l’image en mouvement en 1885, de la première caméra avec une image bande en 1888 au film avec une meilleure stabilité en 1889 pour arriver au cinématographe en 1895, l’évolution du matériel de prise de vue n’est pas restée là, car, nous avons assisté successivement à l’invention de la couleur en 1908, à la création de la caméra avec plusieurs modèles de formats : des pellicules 35mm, 16mm, 8mm (1932), du super 8 (1965) et de nos jours avec la caméra vidéo (1970) qui prend des cartes mémoires miniaturées. Ont suivi des supports (DVD, CD, DVCAM, etc.) audiovisuels qui permettent l’enregistrement de toutes les données qui servent à une diffusion audiovisuelle. ➢
Quelques captures d’écran films tournés en 16 mm
Figure 5: L’actrice principale en colère
68
Figure 6: Les enfants à l’école de la chasse
Figure 7: Initiation du médecin à la médecine traditionnelle
69
Figure 8: Le roi chez le devin
Figure 9: Casbascabo sur le terrain de guerre
70
Figure 10: Parure d’une femme possédée
De son invention à nos jours, le cinéma a subi beaucoup de métamorphoses dans son évolution. En effet, la technologie fait du cinéma un art vivant, qui n’est pas fixe et qui s’adapte en fonction des critères de diffusion des télévisions, etc. Dans les grands festivals comme les Oscars du cinéma Américain, jusqu’à maintenant, seuls les films sur support 35mm sont autorisés, une manière de conserver le cinéma dans tous ses aspects premiers qui se résument à la production 35 mm, qui coûte excessivement cher par rapport à la vidéo et au numérique. Peut-être aussi, une manière de préserver les métiers du cinéma. Cette professionnalisation est axée sur toute la chaîne de fabrication du film jusqu’ à son exploitation. Cette restriction exclut d’office les petites productions à faible budget, donc les productions surtout de l’Afrique francophone qui n’arrivent même pas à boucler le budget de réalisation du film. De par le conservatisme hollywoodien, le cinéma nigérien est en deçà des normes au regard de l’inexistence de certains métiers professionnels (cascadeur, ensemblier, décorateur, costumier, étalonneur numérique, etc.,), de 71
l’absence de matériel adéquat de réalisation. Cela peut nous interpeller aussi sur la sélection des festivals, des télévisions qui exigent un certain nombre de critères (format de la vidéo 16/9, 4/3, etc.), à remplir avant l’acceptation du film pour compétition ou pour diffusion. Il est aussi intéressant de poser les questions ci-après aux autorités des Etats de l’Afrique : Est-ce que l’Afrique francophone compte dans le cinéma mondial ? Comment promouvoir sa culture sans un espace d’exploitation comme Hollywood, Cannes ou même les chaînes cryptées internationales ?
72
Chapitre 2 : Le circuit de la production : le financement, la réalisation la distribution, les salles de projection et les télévisions au Niger En Afrique, au Sud du Sahara, la distribution et l’exploitation des films avaient commencé avec les firmes françaises. Les films réalisés sur l’occident étaient projetés dans les colonies. Le système de distribution en France et aux USA se faisait à travers la vente sur les supports d’enregistrement (bande et cassette) avant de devenir une distribution par location. Très tôt l’industrie cinématographique au niveau de l’occident en particulier celui de la France est mise sur place. La chaîne de cette industrie (production, distribution et exploitation) est aussitôt opérationnelle, avec l’Etat français au premier rang. Pour Paulin Vieyra : « Au niveau de Dakar se trouvait un Service Cinéma fédéral, qui était le relais de ce qu’on avait coutume d’appeler « la rue Oudinot » parce que s’y trouvait, à Paris, le siège du Ministère des colonies. L’administration française, par ce service de cinémas, produisait des documentaires sur les actualités de le Fédération, notamment les déplacements des Gouverneurs Généraux (…) Ce service gérait une cinémathèque qui envoyait des films dans les autres territoires89. » Dès l’année de création du cinématographe, l’Afrique devient un marché pas des moindres pour d’abord diffuser les efforts de la France en Afrique et la culture occidentale avant d’apprendre aux africains la fabrication de films. L’apport de la France était considérable dans la production filmique en Afrique. On observe que la politique d’aide au cinéma en général, en Afrique noire et en particulier au Niger, était basée sur les relations entre d’un côté les responsables des différentes représentations des services culturels français et les tous premiers cinéastes du Niger. Un phénomène qui continue jusqu’à nos jours.
89
Vieyra, Paulin Soumanou. Le Cinéma au Sénégal. Op., Cit., p 18.
73
Mais cette politique est bien réfléchie pour sauvegarder les intérêts de la France sur le plan économique et l’implantation de la culture française en Afrique en général. La stratégie de la France est de fournir de l’assistance conditionnée aux pays qui en demandent, de techniciens audiovisuels qui sont prises en charge totalement pendant leur séjour par le pays demandeur. A travers ce système de monitoring, le formateur bénéficie de frais de déferlement, lesquels frais qui partent en France pour booster l’économie française. Aussi, le matériel audiovisuel de formation est de marque française, donc cela permet de faire la publicité aux marques françaises et valoriser sa technologie. De même, la formation est faite en langue française, donc de promouvoir la culture française. Enfin, les vêtements du formateur contribuent également à la visibilité des stylistes de la France. Une stratégie qui se veut payante, non seulement pour la visibilité de la France mais aussi pour la promotion de sa culture. En mesurant les efforts, nous pensons que le pays qui accueille le formateur donne plus qu’il en reçoit. Mais, on peut dire que, malgré cette stratégie de la France, le Niger est arrivé à produire des films dans les années 60, qui ont été vus dans plusieurs pays du monde (Russie, Nigéria, Ghana) et parfois ces films ont remporté des trophées régionaux, mais sans grand impact économique pour l’État du Niger et ni pour les cinéastes eux-mêmes. Qu’à cela ne tienne, les films réalisés par les cinéastes nigériens des années 60 -70, parcouraient les festivals en Afrique (JCC, FESPACO) et étaient même primés. Mais essayons de comprendre la notion de production. La définition donnée par Forest est intéressante et peut permettre de mieux voir les acteurs quand on évoque le mot producteur dans le cinéma. En effet, pour Forest :« le producteur est la personne (physique ou morale) qui prend l’initiative et la responsabilité de l’exécution de l’œuvre. Il réunit et assemble les moyens humains, financiers, commerciaux, artistiques et techniques adéquats pour la réalisation d’un film afin d’en assurer la viabilité90 ». 2.1. LA PRODUCTION : 1960 A NOS JOURS Dans ce sous point, nous soulignons les partenaires qui ont soutenu le cinéma nigérien. Ces partenaires sont du public comme du privé.
90
Forest, Claude. L’argent du cinéma. Belin-SUP, 2002.Op., Cit., p87.
74
2.1.1. La production de 1960 à 1980 Selon Paulin Soumanou Vieyra « la production relevait, elle, presqu’uniquement du gouvernement français91. », Malgré l’indépendance du Niger en 1960 et la création du Centre National de la Cinématographie du Niger en 2008, la production cinématographique nigérienne n’a toujours pas un budget qui lui est affecté. Néanmoins, La politique culturelle a toujours été aux agendas des différents régimes politiques qui se sont succédé au Niger. Cependant, nous pouvons souligner des différences d’appréhension, dans la pratique que nous avons relevé dans les documents administratifs. Dès juin 1960, Niamey, abritait des rencontres sur le cinéma africain. Pour Jean Rouch : « Le service de l’information du Niger ne dispose encore que d’un embryon de Centre de cinéma (spécialisé dans l’actualité politique) un effort considérable a été fait par la République du Niger dans le domaine de l’éducation populaire par le cinéma, en liaison avec le Musée du Niger et l’Institut de Recherches (IFAN). Au point de vue de la production, il a été fait appel à des réalisateurs ou des producteurs étrangers. (…). Avec l’aide de l’UNESCO un Centre Audiovisuel92 est en cours d’organisation dans le cadre de l’Institut de Recherches, prévoyant la construction en 1962 d’un théâtre-cinéma populaire de 4000 places93». Partant de la compréhension de la politique culturelle, qui se traduit par des priorités culturelles d’une cité, au sens politique du terme, d’un ensemble de citoyens constituant une commune, certains hommes de culture tels que Harouna Niandou94 et Kambeidou Soumana notent que le cinéma est le parent pauvre de la culture par rapport au théâtre et à la musique. En 1985, dans le bilan de l’action menée de 1960 à 1974 par le ministère de la Culture, il est noté que : 91
Vieyra Paulin Soumanou, Le Cinéma au Sénégal, Op., Cit., p 18. Centre Audiovisuel : crée à Niamey par l’UNESCO en 1965. 93 Rouch, Jean. Rapport de l’UNESCO. Op., Cit., p 10-11. 94 Niandou, Harouna: Ancien ministre, journaliste, critique de cinéma. Premier Directeur de l’Information du Niger et Premier Rédacteur en Chef de la Télévision Nationale en 1965. 92
75
« À l’évènement de l’indépendance, l’aspect culturel n’était pas au nombre des préoccupations. Des actions sporadiques liées à quelques manifestations folkloriques étaient les seuls aspects positifs. A partir de 1964, les Orientations Générales du plan décennal, prévoyaient la restructuration de la Jeunesse en Jeunesse du Parti. En tant qu’élément fondamental de l’Unité Nationale et fer de lance du régime en place. Le bureau politique institua une semaine artistique, qui constitue un cadre de manifestations pour qu’elle s’épanouisse95». La première République a posé des jalons pour faire de la culture, un véritable moyen de développement et de cohésion sociale. Cependant, comme certains l’ont eu à le souligner, le secteur de la culture n’était pas noté institutionnellement et le cinéma en particulier, à l’agenda au niveau politique. Avec le renversement du régime de la première république par des militaires, un changement radical s’opère dans la promotion de tous les arts. Ainsi, à quelques mois de la prise du pouvoir, le 15 avril 1974, le Conseil Militaire Suprême organise l’architecture culturelle pour une meilleure prise en charge des arts, en particulier le cinéma dans les actions publiques. Est-ce pour des raisons propagandistes ou, juste pour l’éveil de conscience des populations dans la préservation et la valorisation de la culture ? En tout cas, le décret96 déterminant les attributions du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture note clairement dans ses compétences en matière de cinéma plusieurs actions qui peuvent booster et professionnaliser le cinéma nigérien, parmi lesquelles: Une aide à l’initiative et à la création cinématographique ; le recensement du patrimoine cinématographique, sa conservation, sa protection, son enrichissement, sa promotion, sa diffusion , son contrôle, la coordination de l’aide aux associations à caractère culturel, la formation et le perfectionnent du personnel en charge de l’éducation artistique. Ce régime d’exception n’est pas resté là, car dès 1980, une période quinquennale97 relative à l’encadrement et à la promotion a été définie pour la période 1979-1982. Nous pouvons lire : - la création d’un office nigérien du cinéma ; 95
Bilan de l’action menée de 1960 à 1974, document du Ministère de la Culture et des loisirs, 1985. 96 Décret n° 76/146/PCMS/MJS/C du 05 août 1976, déterminant les attributions du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. 97 Kambeidou, Soumana. Essai de contribution à la politique cinématographique au Niger. Op., Cit., p32.
76
- une aide financière plus soutenue aux cinéastes pour la production ; - l’adoption d’une législation pour la distribution ; - la participation du Niger à la création d’un Consortium International de distribution Cinématographique (CIDC). En dépit de tous les textes de loi d’encadrement et de soutien au cinéma, c’est tout autre chose dans la pratique. Car les intentions qui y étaient contenues n’étaient pas suivies d’effets notables d’après certains pionniers du cinéma nigérien dont Djingarey Maiga, Harouna Niandou, Mamane Bakabé, Yaya Kossoko, Zalika Souley. Pour Djingarey Maiga, le cinéma nigérien se finançait par des réseaux d’amis, surtout de la coopération française et que pour l’État du Niger, le cinéma n’était pas une priorité98. La première République nigérienne (1960-1974) n’accordait pas un intérêt réel à cet art, d’après Djingarey Maiga. C’est Rouch, qui venait avec son matériel, il filmait et retournaient en France pour le développement. Il n’y avait pas un budget dédié pour le cinéma. A partir de l’avènement du régime d’exception, l’Etat s’était intéressé au cinéma en mettant les moyens de manière non formelle à l’endroit de quelques cinéastes pour la réalisation des films. Tout semble se préciser avec la création de la Télévision nationale et avec les premières productions. C’est au tour de Moustapha Diop d’aller dans le sens de son ami Djingarey Maiga pour dire : « L’aide de la coopération Française a depuis le début de sa mise en place en 1960 revêtu plusieurs aspects. Au départ Moustapha Alassane, comme Oumarou Ganda, recevaient des aides directement sans critères, sans même passer par l’intermédiaire des gouvernants. Cette forme d’aide est née du désir de promouvoir le cinéma africain en général et nigérien en particulier. Jean René Débrix s’y était consacré avec plus de cœur que de méthode, c’était à l’époque où le cinéma africain était presque balbutiant99 ». Des années 80 à 2000, une nouvelle stratégie politique de la France entre en vigueur. Pour Moustapha Diop, cette stratégie permet de traiter 98
Entretien Djingarey Maiga avec Youssoufa Halidou Harouna, dans l’émission Patrimoine Ciné n°1 de juillet 2016. 99 Ilbo, Ousmane, Quels impacts la politique de coopération cinématographique française a t-elle eu sur le développement du cinéma au Niger de 1960 à 1990 ? Op., Cit , pp.102-103.
77
directement avec les structures dédiées au cinéma et à l’autorité de tutelle. Comme c’est le cas au Niger par le Centre Culturel Français. Malgré les difficultés d’ordre technique et financier dans les années 60 -80, les films nigériens ont contribué à animer les premiers festivals en Afrique. C’est peut-être, ce qui a poussé à réorienter la politique culturelle à travers le Séminaire National de la Définition d’une politique Culturelle100. Quelques diagnostics dans le document de la SNDPC nous renseignent que le cinéma doit jouer un rôle prépondérant dans le développement du pays. Après avoir constaté les atouts que peut offrir le cinéma dans le progrès économique et social, le développement culturel, la préservation et la promotion du patrimoine, dans l’éducation et la sensibilisation populaire, il était nécessaire de réhabituer et de redynamiser la production du cinéma nigérien à partir d’un financement national. Ces constats avaient permis au sortir du séminaire de prononcer des recommandations qui peuvent relancer ce cinéma. Parmi lesquelles, on trouve la nécessité d’avoir un centre national pour encadrer le cinéma, et, qui sera doté d’un fonds d’aide à l’Industrie Cinématographique. Pour encourager la promotion de ce cinéma, il est formulé la détaxation à l’importation du matériel d’équipement des points de projection et d’encourager l’investissement dans la construction des salles par une exonération temporaire des droits et taxes, la mise à disposition ou de don de terrains par les Collectivités Territoriales et défendre un statut pour les cinéastes. Toutes ces mesures et la volonté politique des autorités à faire du cinéma un moteur de développement ont eu peu d’impact dans la production cinématographique. Plusieurs raisons peuvent l’expliquer, des raisons qui se situent à 4 niveaux : ✓ Beaucoup de cinéastes n’avaient pas reçu de formation diplômante dans le cinéma. Ils ne peuvent donc pas contribuer à la création d’une industrie cinématographique. On peut voir au Niger, qu’un cinéaste à plusieurs casquettes dans la chaine de production. Sur un film, ce cinéaste est producteur, réalisateur, cadreur, monteur, distributeur et même
100
Séminaire National de la Définition d’une politique Culturelle du 22 au 30 juillet 1985.
78
journaliste culturel. Tout ceci ne peut encourager une industrie cinématographique où la séparation des métiers est un gage de réussite ; ✓ la désunion et le clanisme des cinéastes. Les cinéastes ne sont pas organisés en corporation pour défendre leur intérêt. Les uns préfèrent faire des démarches individuelles pour trouver de financement à la Présidence de la République et les autres défendent leur intérêt en fonction de leur ethnie, ✓ le reversement des réalisateurs au profit de la télévision nationale, ✓ la non application de toutes les recommandations sorties des rencontres cinématographiques ni des textes et lois en vigueur. Du manifeste de Niamey en 1982, au Séminaire de Tillabéry de 1985, de la déclaration de la politique culturelle en 2009 à la création du CNCN en 2010, plusieurs mesures phares assorties, qui peuvent tendre vers une industrie cinématographique nigérienne. Nous pouvons citer des mesures comme la création du fonds d’aide au cinéma, lequel fonds qui n’a jamais été alimenté, l’obligation aux différents corps de métiers du cinéma de s’organiser en association, qui jusque-là n’est pas encore effective. Tableau 1 : Situation de la production des films nigériens de 1962 à 1980. Date Film Réalisation Production 1962
Le Piroguier
Moustapha Alassane
Ministère Coopération France
1965
La Mort de Gandji
Moustapha Alassane
ONF Canada
1966
Bon Voyage Sim,
Moustapha Alassane
Ministère Coopération France
1968
Cabascabo
Oumarou Ganda
1969
Les Contrebandiers
Moustapha Alassane
Argos Films de la France Ministère Coopération France
79
1970
Le Wazzou Polugame
Oumarou Ganda
Niger et Argos Films de la France
1970
La Reussite de MeiThebre
Kossoko Yaya
Ministère Coopération France
1972
Synapse
Diop Moustapha
Ministère Coopération France
1972
Femme, Villa, Voiture, Argent
Moustapha Alassane
Niger et Burkina Faso
1972
Saïtane
Oumarou Ganda
1973
Toula
1974
Paris, C’est Joli
Moustapha Alassane Inoussa Ousseina
Ministère Coopération France RFA (Allemagne)
1975
Ganga
Inoussa Ousseina
1975
L’Etoile Noire
Djingarey Maiga
1975
Samaria
1976
1976
Issoufou Madougou Tambours et Violons De Korgou de la Mort Claude François Médecines et Médecins Lutte Saharienne
Inoussa Ousseina
1979
Autour de l’Hippototame
Djingarey Maiga
1979
Nuages noirs
DjingareyMaiga
1977
Inoussa Ousseina
80
Ministère Coopération France Ministère Coopération France Ministère Coopération France IRSH Niger IRSH/Niger, Télévision scolaire Niger, Ministère Coopération France IRSH NIGER Ministère Coopération France Films du Village de la France et Ministère Coopération France Djingarey Maiga
On observe dans le tableau que sur la vingtaine de films, plus de 70% ont été produits par des structures publiques et privées de la France, 15% seulement par des structures du Niger et 15% par le reste du monde. Soit 85 % du financement du cinéma nigérien vient des partenaires extérieurs. Il faut souligner, malgré ce financement extérieur, presque toutes les thématiques des films des années 60-70 sont axées sur les réalités que vivent les populations nigériennes. Les réalisateurs s’interrogent sur le fonctionnement de leur société. Deux films sortent du lot pour évoquer les problèmes que vivent les migrants africains en France, qui sont confrontés à une intégration difficile. Il s’agit des films Synapse (1972) de Moustapha Diop et Paris, C’est Joli (1974) d’Inoussa Ousseini. Aussi, jusqu’aux environs de 1980, la distribution des films au Niger est détenue par deux sociétés françaises installées à Monaco : la Société d’Exploitation Cinématographique Industrielle Africaine (SECMA) et la Compagnie Africaine Cinématographique Industrielle et Commerciale (COMACICO) qui seront plus tard rachetées par la Société de Participations Cinématographiques Africaines (SOPACIA). Les films hors circuit et de très basse qualité étaient achetés à des prix dérisoires par des sociétés intermédiaires : l’Importex (Sodetex) pour la COMACICO, la COGECI (héritière et de la Cofinex) pour la SECMA, puis projetés dans les salles de cinéma de leur circuit de distribution. On dénombre quarante-deux101 films nigériens, des fictions en grand nombre dont six (6) longs métrages entre 1962 et 1979. Soit une moyenne de 2 films l’année. C’est suffisamment significatif pour parler du cinéma nigérien dans les grands festivals et rencontres en Afrique. Trente-deux (2) films sont produits entre 1980 et 2000 dont neuf (9) longs métrages. Ceci se justifie peut-être par le retrait du premier partenaire financier, la France, et surtout le reversement de plusieurs réalisateurs indépendants à la télévision nationale dont Moustapha Diop. 2.1.2. La production des années 80 à nos jours La création du Consortium interafricain de distribution cinématographique (CIDC), dirigé par le nigérien Inoussa Ousseini, en 1979, et du Centre interafricain de production des films (Ciprofilm) a 101
ALIOU, Ousseini. Problématique de la distribution cinématographique au Niger. Op., Cit., p21.
81
permis l’émergence du cinéma africain avec des financements propres aux pays africains. Ces deux structures, pourvues de moyens matériels (laboratoires, auditorium, tirages de copies), ont vu le jour pour se départir de l’hégémonie occidentale, pour bien gérer la production cinématographique africaine et pour garantir l’appui aux cinéastes à travers des subventions ou des coproductions. Mais, après seulement cinq (5) ans de gestion ces structures seront confrontées à d’énormes difficultés dues à l’égoïsme des pays membres, soulignait Inoussa Ousseini102. Les Etats signataires, ne parvenaient plus à payer les cotisations annuelles pour permettre au CIDC-CIPROFILM d’atteindre les objectifs assignés dont le principal est de : « libérer les écrans africains colonisés jusque-là par les sous-produits de la sous-culture étrangère103 ». Mais, très vite le CIPROFILM est paralysé par l’insuffisance d’apport en capital. Sur un capital de 500 millions de francs CFA, seuls 130 millions ont pu être recouvrés en trois ans. En 1984, le financement du cinéma en Afrique, en particulier au Niger obéit aux dictats des partenaires financiers (O.I.F, France, Suisse, Canada, Allemagne, Belgique...). Idi Nouhou104 et Aicha Macky105 avaient souligné ce fait et le justifie par le fait qu’une personne qui tend une main se soumet aux exigences du donateur106. En effet, pour octroyer du financement, les pays du Nord ont progressivement mis en place un système de guichet unique de financement avec des critères qui sont bien définis pour y avoir accès. Parmi ces financements extérieurs, on peut citer le Fonds Sud créé par la France en 1984 pour favoriser le développement d’une collaboration avec les réalisateurs des pays du Sud. Et, l’implication d’une société de production étrangère est obligatoire pour tous les projets de films présentés. L’utilisation de l’aide accordée se fera par l’intermédiaire d’une société de production française au vu du contrat de coproduction établi avec la société étrangère. Ce contrat devra être 102
Entretien Inoussa Ousseini et Youssoufa Halidou dans Patrimoine Ciné n°9. Inoussa Ousseini dans Le Sahel du 25 janvier 1982, Rubrique Cinéma, article de Amadou Ousmane. 104 Nouhou Idi : réalisateur, scénariste et écrivain nigérien. Auteur de plusieurs films dont : Chronique dessiné pour le petit peuple (2012). 105 Macky Aicha : réalisatrice nigérienne. Son célèbre film L’arbre sans fruit (2016) est distingué plus de 35 fois de par le monde. 106 Patrimoine Ciné n° 6 et 30 sur Dounia TV, émission réalisée par Youssoufa Halidou Harouna. 103
82
enregistré au registre public du cinéma et de l’audiovisuel (RPCA) ainsi que les contrats conclus entre les deux sociétés pour l’œuvre considérée. Les projets doivent être tournés dans les zones géographiques des pays bénéficiaires, la langue de tournage doit être en grande majorité une des langues nationales de ces pays, ou le français107. A travers ce nouveau partenariat, les partenaires financiers mettent des critères de financement. Les producteurs et réalisateurs des pays du Sud, doivent se conformer au règlement. Il est alors demandé avant tout dépôt de dossier, que les concernés soient en règle vis-à-vis de la législation en vigueur des pays d’origine. Un constat est bien là, depuis les années où le fond Sud a été mis en place, les partenaires financiers ne traitent plus directement avec les réalisateurs. Ces réalisateurs étaient obligés de faire appel à une société qui est constituée dans les normes prévues par l’Etat ou de créer leur propre société. Les éléments de la constitution de dossier pour l’autorisation d’exercice de société sont les suivantes au Niger (source : Chambre du Commerce d’Industrie, d’Agriculture et d’Artisanat du Niger Septembre 2017). Entreprise individuelle : - demande de Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) à la Chambre de Commerce, - certificat de nationalité, - carte d’identité ou passeport, - 2 Photos, - certificat de résidence, - timbre fiscal de 15 000F CFA, - frais de dossier de 2 000 F CFA, - contrat de bail du lieu d’exercice. SARL, S. A : demande de RCCM à la Chambre de Commerce, certificat de nationalité, - carte d’identité ou passeport, 107
Fougea, Jean-Pierre , Rogard, Pascal. Les aides au financement. Paris : DIXIT , 2007.
83
- P.V. conseil d’administration, - statuts, - certificat de résidence, - timbre fiscal de 15 000F CFA, - frais de dossier de 2 000 F CFA, - contrat de bail du lieu d’exercice. Les éléments de la constitution de dossier pour le Numéro d’identification fiscale : demande à la DGI ; certificat de RCCM ; fiche de repérage (DGI) ; statut si SARL, SA ; timbre fiscal de 1 500 F CFA. Dans le cadre du cinéma, une fois la société constituée, les promoteurs doivent se conformer à l’article 19 de la Secction1 du chapitre II de l’ordonnance n°2010 -046 du 29 juillet 2010 relatif aux conditions d’exercice dans les secteurs et métiers de la profession cinématographique et vidéographique, qui dispose que : « Aucune entreprise appartenant à l’un des secteurs de l’industrie cinématographique et vidéographique ne peut exercer ses activités qu’après l’obtention préalable d’une autorisation d’exercice délivrée par le Directeur du Centre National de la Cinématographie du Niger. » Il s’agit notamment des : - producteurs de films ; - importateurs de films cinématographiques et vidéographiques ; - importateurs distributeurs de supports enregistrés ; distributeurs de films cinématographiques et vidéographiques ; - exploitants de salles de spectacles cinématographiques ; - exploitants de cinéma ambulant commercial ou non ; - exploitants de vidéoclubs ; - exploitants d’un vidéoclub ambulant ; - entrepreneurs des industries techniques ; - fabricants de matériel et de fournitures cinématographiques et vidéographiques. 84
Avec l’ère du numérique, beaucoup d’aspects qui entrent dans les métiers techniques du cinéma et de la vidéographie ne figurent pas dans cette loi, comme par exemple les films vus sur les téléphones portables, les bouquets de chaînes, la VOD (vidéo-on-demand) qui permet de regarder les films sur les sites internet ou à partir d’un ordinateur. Ceci dénote l’avancée rapide des supports cinématographiques et vidéographiques. Ainsi, une réactualisation de la réglementation en vigueur s’avère nécessaire pour suivre cette évolution. Avec une insuffisance de financement au national comme à l’international et pour subvenir à leurs besoins (social, production), les producteurs et réalisateurs de la nouvelle génération, qu’ils soient du public ou indépendants, font beaucoup de films de commande pour les institutions de la place. Malgré ce manque de financement, la jeune génération, ceux arrivés au cinéma de 2000 à nos jours réalisent des films d’auteurs même si, au niveau de la qualité technique, a ils ont besoin d’appuis (formation, aide financière, etc.). A titre d’exemple, les réalisateurs nigériens, au titre de l’année 2015 et 2016, ont réalisé plus d’une trentaine de films dont 23 films enregistrés à Toukountchi Festival de Cinéma du Niger en décembre 2016. Ce chiffre est sous-estimé car, toutes les télévisions produisent des films qui ne sont pas pris en considération dans ce décompte. Le problème de conservation des films pose problème à tous les niveaux. Dans plusieurs de nos entretiens dans l’émission Patrimoine Ciné sur Dounia Tv, avec les réalisateurs (Djingarey Maiga, Moussa Hamadou Djingarey, Sani Magori, Mahaman Bakabé, Abba Kiari Arimi, Rahmatou Keïta, etc.) qui sont aussi des producteurs et des distributeurs de leurs propres films, il ressort que les films ne peuvent être vus sans un canal de distribution organisé. Alors qu’au Niger, jusqu’à cette année 2020, il n’y’a aucune structure nationale (publique ou privée) de distribution de films. Difficilement, un cinéphile peut se procurer des films produits du Niger sur le marché. Il lui faut passer forcement par le réalisateur du film. Djingarey Maiga, plus de 50 ans dans le cinéma a cédé finalement les droits de diffusion de ses films à You Tube en 2017. Le réalisateur de la télévision nationale, Moussa Abdou Saley, ancien directeur de la télé, 57 ans, à son actif, plusieurs réalisations documentaires, évoque le problème du cinéma et de son financement. Il se pose des questions à savoir: comment l’ORTN peut- il être efficace dans la réalisation de ses objectifs s’il n’a pas la politique de ses moyens ? Pour compenser les limites dans la production cinématographique, 85
Moussa Abdou Saley, souligne : « Nous arrivons à faire des coproductions et à participer aux résidences d’écritures. Ces systèmes d’accompagnement ouvrent les portes aux réalisateurs, qui côtoient les producteurs, les scénaristes de par le monde pour des nouveaux projets. » Pour que l’ORTN soit crédible et autonome dans la diffusion des films, l’ORTN doit soumettre des candidatures aux partenaires financiers, comme le font les cinéastes indépendants, et encourager la production indépendante qui est aussi une autre façon de voir les choses sur le petit écran. Mahamane Bakabé disait à cet effet que, vu le laxisme des cinéastes nigériens, les réalisateurs du Nigeria s’appuient sur la majeure partie des réalités du Niger pour fabriquer leurs films. Les jeunes cinéastes nigériens d’aujourd’hui, ils se débrouillent mieux que les pionniers. Ces jeunes (Boureima Soumaila, Ramatou Doula, Amina Weira, Linda Diatta, Abdoul Wahab Moustapha Alassane, Mohomed Moussa Saley, Idi Nouhou, Mahaman Siradji, Abdoul Moumouni Bakabé, Boka Abdoulaye, Na Hadiza Alkawala, Mallam Saguirou etc.) sont formés dans les grandes écoles d’Afrique et d’Europe, et certains bénéficient des formations de stage de perfectionnement. Ils essaient de se conformer aux conditions d’exercice du métier (autorisation d’exercice, registre du commerce, le couple producteurréalisateur…) des partenaires internationaux pour l’attribution des financements et surtout se conformer à la réglementation du Niger pour pouvoir soit produire des films avec leurs propres apports ou bénéficier de l’aide de l’État ou des commandes de films des institutions. Les jeunes cinéastes, de nos jours, déplorent le fait que le financement du cinéma passe toujours par les relations et non par une organisation véritable de la filière comme l’avaient prôné les pionniers du cinéma nigérien. Est- ce là, la même pratique des années 60 qui a plongé le cinéma du Niger à une léthargie récurrente ? De nos jours, la législation en vigueur, rendant obligatoire la création de boîte de production, nous ne pouvons dénombrer qu’une vingtaine de maisons de production indépendante. Certains préfèrent ne pas rendre public les noms des sociétés, car très souvent, Ils sont des producteurs fonctionnaires. L’Etat interdit toute activité parallèle d’un agent de la fonction publique. Ici la question mérite d’être analysée. Pourquoi un
86
réalisateur produit ses propres films ? Y’a-t-il un souci de confiance entre producteurs et réalisateurs ? Notez qu’« Aux débuts du spectacle cinématographique, le producteur – souvent lui-même réalisateur – vendait des copies aux organisateurs de spectacles (forains, etc.) et exploitait quelquefois directement ses films108 ». Aicha Macky et plusieurs autres réalisateurs, soulèvent la question de l’arnaque de certains producteurs, qui engrangent des sommes importantes sur leurs réalisations. Donc pour ces jeunes réalisateurs, la meilleure façon de préserver les droits et de générer de ressources pour produire d’autres films, c’est la création de leur propre société de production. On observe aussi, que toutes les télévisions produisent aussi des films pour nourrir leur programme. Au Niger quinze (15) télévisions de nationalité nigérienne (ORTN, Tal Tv, RTT, Dounia Tv, Canal Tv, Tambara Tv, Labari Tv, Liptako Tv, Sarraounia Tv, Fidélité Tv, Bonferey Tv, Anfani Tv, Niger 24, Gaskia Tv, Espérance, Canal 3 Monde) sont en activité et constituent un cadre idéal pour la production et la diffusion du cinéma nigérien. Tableau n°2 : Quelques réalisateurs qui ont créé des maisons de production ;
108
Réalisateur
Maison de Production
Djingarey Maiga
D.A.M Production
Mamane Bakabé
Intermedia Studio
Malam Saguirou
Dangaram Production
Moussa Hamadou Djingarey
MD Production
Sani Magori
Maggia Images
Beidari Yacouba
Beid Production
Anatovi Serge Clement
A.T.Com
Rahmatou Keita
Sonraï Empire Production
CLAUDE, Forest. L’argent du cinéma. Belin-SUP, 2002, Op., Cit., p116.
87
Dans ce tableau, on note que les réalisateurs sont aussi des producteurs et cela n’épargne pas les pionniers comme la nouvelle génération. Le Centre National de la Cinématographie n’arrive pas à maitriser le nombre de sociétés de production au Niger. Ce qui nous amène à dire que toutes les maisons de production non enregistrées au CNCN ne sont pas en règle vis-à-vis des textes qui régissent le cinéma au Niger. 2.2. LA DISTRIBUTION ET LA DIFFUSION : SALLES ET TELEVISIONS Le cinéma dès sa naissance en 1895 est destiné à être vu publiquement. Avec l’évolution de la technologie, voir un film n’est plus l’apanage des salles de cinéma qu’on a connues dans les années 1900. D’autres formes de diffusion ont vu le jour, dont les plateformes de diffusion sur internet, la Vidéo Sur Demande (VOD) et la télévision qui ont profondément bouleversé le système classique de diffusion (salles de cinéma). Ces formes de diffusion jouent un rôle, et pas des moindres, dans la disparation des sall es de cinéma en Afrique en général. « Sur le continent africain, elles sont nombreuses les salles de cinéma qui ont fermé leurs portes à partir des années 1980, pour devenir des garages automobiles, des supermarchés, des restaurants, des églises... Des centaines de cinéma ont ainsi fermé leurs portes : seuls subsistaient quelques écrans privés et les salles d'organismes culturels internationaux, comme les instituts français109 ». Au Niger, effectivement, les salles privées de cinéma ont subi le même sort. On retrouve des anciennes salles de cinéma qui sont vendues et sont devenues des lieux de culte, des lieux de distraction et de commerce. Certains nigériens expliquent la disparition des salles par une production faible au Niger comme dans les pays de la sous-région. Par une fiscalité assez lourde pour les exploitants des salles de cinéma et le matériel de projection non adaptée, car les exploitants des salles de cinéma de Niamey, ne parviennent pas à s’équiper en projection 16mm. Ce qui empêche la projection des films africains ou nigériens sur nos écrans, pour la simple raison qu’ils sont tournés en 16mm. Un autre problème apparaît, celui de gonfler les films africains
109
https://information.tv5monde.com/afrique/la-renaissance-des-salles-de-cinemas-enafrique-201077, consulté le 13 juin 2020.
88
en 35mn, et pour le CIDC, c’est une opération très couteuse. La solution est que les exploitants se dotent de projecteur 16mm. Parmi les causes de la disparition des salles au Niger, il y’a la colère des cinéphiles qui déplorent les films de Karaté et les films érotiques, qui faisaient susciter un engouement à une certaine époque. Y. Siddo soulignait : « Même les cinéphiles qui vont au cinéma par souci de tuer le temps que par plaisir, hésitent et ils le disent eux -mêmes. Ils ne cachent plus leur ras-le-bol devant ces navets que représentent les films indiens et chinois qui n’apportent rien de culturel à notre société sinon que la violence et le romantisme110 ». Dès les années 40, la distribution est réglementée en Europe : « Sont considérés comme activités de distribution et de location de films, toutes celles comportant disposition des droits d’exploitation économique d’un film en vue de sa diffusion commerciale sur un marché déterminé et la cession à titre temporaire des droits de représentation publique à tous ceux qui agissent directement de telles représentations111». Un certain nombre de personnes s’engage dans ce processus de distribution. Il faut noter aussi, que l’aspect commercial est très déterminant dans ce processus pour que le producteur puisse entrer dans ses droits. L’exploitant qui peut être ici le diffuseur joue un rôle de premier plan. 2.2.1. La Distribution en Afrique Occidentale Française (A.O.F.) La Compagnie Africaine Cinématographique Industrielle et Commerciale (COMACICO) et la Société d'Exploitation Cinématographique Africaine (SECMA) basées à Monte-Carlo en France, étaient les deux (2) compagnies de distributions et d’exploitation à l’époque. Elles n'achètent pas directement les films aux producteurs mais par l'intermédiaire de deux sociétés : l'IMPORTEX et la COGECI dans quelques pays de l’Afrique. Elles détenaient les salles de cinéma à travers ses leurs représentations (Comacico Dahomey ; Comacico Mali, Comacico Guinée, Abidjan, Bamako, Brazzaville, Dakar et Niamey).
110 111
Sahel Hebdo du 1er mars 1982, article de Y.Siddo dans Dossier cinéma nigérien. Forest, Claude. L’argent du cinéma. Belin-SUP, 2002, Op., Cit., p117.
89
Vu le marché florissant, les États-Unis ne sont pas restés sans action. La Motion Picture Export Association of America (MPEAA) crée pour l'Afrique une société de distribution l'AFRAM FILM INC. Au Niger, la distribution et l'exploitation des films relevaient totalement du domaine du privé, notamment des maisons COMACICO (Compagnie Marocaine de Cinéma Commercial), ARCHAMBAULT, et SECMA (Société d'Exploitation Cinématographique Malgache et Africaine). La COMACICO et la maison ARCHAMBAULT s'installèrent en Afrique au sud du Sahara en 1926. Quant à la SECMA, elle s’y installa en 1939. En 1976, la SOPACIA (Société de Participations Cinématographiques Africaines) qui est une société française, a pris la relève. La SOPACIA opérait par l'intermédiaire de ses filiales qu'elle avait reprises aux anciens réseaux COMACICO et SECMA. 2.2.2. La Distribution et la diffusion de l’indépendance du Niger à nos jours Le CIDC (Consortium Interafricain de Distribution Cinématographique) né en mars 1976, est une structure sous régionale créée sous l'égide de l’Organisation Commune Africaine et Mauricienne (l'OCAM). Elle assurait la distribution dans quatorze pays africains répartis en trois secteurs : - 1er secteur : Sénégal, Mali, Mauritanie, Guinée ; - 2e secteur : Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina Faso alors Haute Volta, Niger, Togo ; - 3e secteur : Cameroun, Congo, Gabon, République Centre Africaine, Tchad. En moins d’une dizaine d’années d’action, le CIDC, représentation du Niger, disparait pour laisser la place à la Société Nigérienne de Distribution et d'Exploitation Cinématographique (SONIDEC), créée par des Nigériens qui sont les exploitants eux- mêmes : messieurs Lawali Dan Azoumi, Mounkaila Yacouba, Hamidou Dourfaye, Atta Ayé,
90
Moustapha Alassane112. Confrontée à des problèmes de finance la SONIDEC ferme également en 1988. D’autres distributeurs voient le jour dont ANASHUA, une société créée en avril 1988. Elle s'intéresse à la culture en général et à la distribution des films en particulier. Son directeur fondateur est un Nigérien, M. Mounkaila Hassane, représentant du CIDC Niger. ANASHUA disparait en1998. Avec le même objectif que ANASHUA, Niger Culture Communication se crée en 2000 pour plus de visibilité des films dans les salles. Afram Niger créée en 1998 est une succursale d’Afram USA, une compagnie américaine qui fait la promotion des films américains. Elle coopérait dans la diffusion avec le palais des congrès et les salles de cinéma de la place (Vox, JAN GORZO, BAWA JAN GARZO et le HD). Avec des problèmes de partenariat, Afran Niger se transforme en GED (Groupement d’entreprise de distribution) pour renouer avec les anciens partenaires. Nous pouvons observer, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes113, que l’État du Niger, avait une politique culturelle, concernant le cinéma et le problème de distribution des films. Dès les années 60, l’Etat du Niger avait créé des Maisons de Jeunes, des lieux de projection filmique et de loisirs. Pour pallier à la disparation progressive des salles privées de cinéma, les Maisons de Jeunes de l’Etat servaient ponctuellement de lieux de projection, avec une gestion qui laisse à désirer. Cela pourrait se justifier par un personnel n’ayant pas les compétences nécessaires pour animer les projections des films. Les chaînes de télévision au Niger : Seize (16) chaînes de télévision de nationalité nigérienne diffusent sur le territoire national. Certains sont des chaînes présentent sur les bouquets Canal+ ou sur des satellites (Télé Sahel, Dounia TV, Bonferey TV, Liptako TV, Espérance TV, Canal 3 Monde, Tal TV), d’autres (Sarraounia TV, Labéri Tv, Fidélité TV, Canal 3, Niger 24, Tambara TV) ont des fréquences plus courtes car elles opèrent la plupart dans la capitale Niamey avant l’avènement de la Télévision Numérique Terrestre (TNT). Et, une dernière catégorie qui 112
Aliou, Ousseini. Problématique de la distribution cinématographique au Niger . Op., Cit., p25. 113 Document du Séminaire National de la Définition d’une politique Culturelle, Tillaberi juillet 1985 et Décret n°2008-051/PRN/MCAL/PEA portant approbation du document de Déclaration de la Politique Culturelle Nationale.
91
diffuse dans des régions ciblées. Ce sont le cas de Anfani TV (Diffa, Maradi et Zinder), RTT (Dosso, Niamey), Gaskia TV (Zinder). Télé Sahel, la télévision nationale est la première télévision en matière de production et diffusion des films nigériens. Cela peut s’expliquer par les moyens de fonctionnement que l’État du Niger met à sa disposition. Notons bien que la redevance télé est prélevée mensuellement sur chaque facture de la Nigelec (la Nigérienne d’Électricité) chez les particuliers, les sociétés qui disposent de compteur d’électricité, versée dans les caisses de Télé Sahel en vue de contribuer à son bon fonctionnement. Depuis l’avènement des télévisions privées, des voix s’élèvent pour revendiquer l’élargissement du partage de cette redevance télé à toutes les télévisions, car elles contribuent aussi à la promotion de l’audiovisuel. Le montant de la redevance avoisine 2 milliards de FCFA en 2015. Les télévisions et les Maisons de Jeunes peuvent être une solution alternative de diffusion des films nigériens avec la disparation des salles de cinéma classiques. Les télévisions (privées et publiques) au Niger sont des tremplins pour la diffusion de l’image, en particulier dans la promotion de la culture du Niger, d’abord localement, ensuite au niveau international. Mais, il est aisé de constater qu’elles sont mal encadrées, avec une législation qui ne peut encourager ces télévisions à plus d’engagement dans la diffusion des productions locales et même de la production dans son ensemble. Elles préfèrent contracter avec des distributeurs étrangers pour avoir des films ou des séries pour remplir leur cahier de charge. Cela n’est pas sans conséquence sur les films nigériens et la culture nigérienne dans son ensemble. Les films locaux ne sont pas soutenus par l’achat des diffuseurs.
92
Figure 11: Devanture de la Radiotélévision du Niger (ORTN)
Au sein de cette structure nationale se côtoient deux chaînes de télévision : Télé Sahel et Tal Tv avec deux (2) programmes différents dans les émissions. Au niveau du journal télévisé, les équipes se partagent les informations recueillies sur le terrain. Pour une production indépendante et d’auteur, le Niger pourrait s’appuyer sur le système de Nollywood à court terme, le système de production, d’exploitation, de distribution et de diffusion du Nigéria. Dans ce pays voisin du Niger, avec qui il partage la même culture (langue, histoire, frontière), la production annuelle avoisine les 1500 films, en 2015 par exemple. Le système de production du Nigéria dénature tous les systèmes classiques de production. Des militantes de Nollywood se font découvrir à l’instar de Nadia Denton qui a créé Beyond Nollywood et voit en cela : « l'avenir du cinéma nigérian et
93
certainement comme le contenu le plus susceptible de se croiser et d'avoir un impact international114.» Les distributeurs ne se contentent d'ailleurs pas de distribuer. Ce sont eux, le plus souvent, qui passent commande aux réalisateurs. Une ou deux stars, une histoire bien pimentée, une avance de démarrage et un calendrier de tournage draconien. L'argent de cette « industrie » connaît un « turn-over » ultra-rapide souligne Pierre Barrot.
114
Entretien Nadia Denton et Youssoufa Halidou Harouna, pour AWOTELE, la revue Panafricaine de la critique cinématographique juin 2019.
94
DEUXIÈME PARTIE : LES FILMS FICTIONS ET DOCUMENTAIRES AU NIGER Le but de l’analyse est de faire mieux aimer l’œuvre en la faisant mieux comprendre. Il peut aussi être un désir de clarification du langage cinématographique, avec toujours un présupposé appréciatif vis-à-vis de celui-ci115.
115
Aumont, Jacques et Michel, Marie. L’analyse des films. Op., Cit., p8.
95
Chapitre 3 : Analyse de quelques fictions Dans ce chapitre, il sera question de découvrir les films (fiction, documentaire et animation) retenus dans notre corpus. Des films les plus représentatifs dans l’histoire du cinéma nigérien en termes de créativité, de nouveauté, de portée et aussi du renon des réalisateurs. Des films en couleur dont une partie est tournée au format 16 mm et l’autre partie en vidéo. Nous proposons une analyse filmique, un modèle qui permettra d’évoquer les instruments du langage cinématographique comme : le mouvement de la caméra, le décor, le jeu des acteurs, le récit filmique et surtout les thématiques développées qui nous permettent de voir les ancrages socio-culturels de ce cinéma. Antoinette Tidjani Alou souligne : « Nous avons voulu souligner, par des moyens peut- être fastidieux, que la tâche de la critique n’est pas arrêtée d’avance, d’une part, et que son regard et ses choix «jouent» aussi dans sa lecture de la théorie comme dans sa méthode d’analyse, de l’autre116 ». Le premier film est un court métrage : Un Casting pour un mariage (2008). Une fiction du réalisateur Moussa Hamadou Djingarey. Il est l’auteur de plusieurs films documentaires et de fictions. Le deuxième film, Le Wazzou Polygame (1970), parle de la société traditionnelle nigérienne. C‘est l’œuvre de Oumarou Ganda. Un film dans lequel plusieurs thématiques (mariage arrangé, migration, chant, religion, etc.) sont développées. Le troisième film est Aube Noire (1983) de Djingarey Maiga. Un film moralisateur sur les conséquences du mariage arrangé. Le réalisateur donne à voir comme dans Le Wazzou polygame ou presque tous les films des pionniers, la place de la religion et de la femme dans la vie de la société. Enfin, le quatrième film est un western, un autre genre cinématographique dans la fiction, réalisé par Moustapha Alassane. Il s’agit du film Le retour d’un aventurier (1966). Une
116
TIIDJANI ALOU, Antoinette. « Sarraounia et ses intertextes : identité, intertextualité et émergence littéraires ». article consulté le 11 février 2018 sur http://www.sudlangues.sn/IMG/pdf/doc -102.pdf.
97
première dans l’histoire des cinémas d’Afrique. Un film dans lequel règne la violence et le désordre dans cette société. 3.1. UN CASTING POUR UN MARIAGE (2008) DU REALISATEUR MOUSSA HAMADOU DJINGAREY Très souvent considéré comme le fils du doyen Djingarey Maiga, le cinéaste des fameux films aux séries noires, Moussa Hamadou Djingarey est né le 09 juillet 1973 à Zinder. Il est le fils d’un gardien de la paix. Après son baccalauréat, il s’était intéressé à l’audiovisuel, disaitil par hasard117, lorsqu’il travaillait en tant que manœuvre en Arabie Saoudite. Mais, la rencontre avec un Libanais lui avait permis d’embrasser la carrière cinématographique. De la maintenance audiovisuelle au cadrage, en passant par le montage, MD comme on l’appelle, s’était très vite passionné pour les images numériques. Il réalisa une centaine de courts-métrages (sketchs) de sensibilisation sur des thématiques diverses pour des Organisations Non Gouvernementales (ONG). Moussa Hamadou Djingarey est le premier jeune réalisateur à être décoré par l’État du Niger pour son travail en 2010. Auteurs de plusieurs films, surtout des fictions, dont Mon retour au pays, 2012 ; Hassia, amour ou châtiment, 2010 ; La mystérieuse croix d'Agadez, 2005. Son tout dernier film, Le Pagne (2016) avait reçu quatre nominations aux AMAA 2016 (African Movies Academy Awards Lagos) dans les catégories meilleur film fiction, meilleur réalisateur, meilleur son et meilleur acteur (pour Yacouba Beidari). Il a reçu aussi une nomination au Fespaco 2017. Toujours égal à lui-même, à travers les thématiques qu’il développe dans ses films axés sur la dénonciation des vices de sa société, telles que : le mariage précoce et forcé, l’abus dans la chefferie traditionnelle et des porteurs de tenue, la prostitution, la famille, la justice, l’autorité patriarcale, la santé, l’éducation, la trahison, les religions, mais surtout l’intégrité de certaines personnes face à une décadence sociétale, Moussa Djingarey dans le film Le pagne, nous donne à voir de manière esthétique la place de la femme dans la société. Une place peu louable, vue l’irresponsabilité des hommes, qui ont droit de vie ou de mort sur les femmes. Cette place se manifeste dans Le 117
Patrimoine Ciné n ° 17 sur Dounia TV du Niger, entretien Moussa Hamadou Djingarey et Youssoufa Halidou.
98
pagne par le silence de la femme. Une femme qui est marginalisée dans sa société. Plusieurs séquences de l’actrice principale en témoignent. À l’instar de la séquence de son viol par le prince héritier, dont le roi ne peut douter de la loyauté. Le réalisateur va plus loin, en mettant à l’écran de manière ironique, le comportement de certains individus de la société nigérienne. Ainsi, on peut voir Yacouba Beidari, jouant le rôle du père adoptif de la fille de l’actrice principale, prendre le transport en commun du village, et, quand on parle de véhicule de transport en commun dans les régions du Niger, on pense directement à un brassage de personnes « entassées » dans un camion non sécurisé, car, surchargé de biens et de personnes. A sa descente du camion, Yacouba beidari, avec mépris, essuie ses vêtements. Beaucoup de scènes émouvantes pour provoquer une prise de conscience sur certains comportements de la société. Un film, certes dramatique, mais aussi, beaucoup d’espoir, en ce sens que la fille de l’actrice principale, malgré son statut, a reçu de la part de ses parents adoptifs, une éducation réussie, qui l’a conduite à finir une formation qualifiante. Le pagne, du titre du film, nous montre le sens de prévision et d’organisation de la femme dans la vie, car, ce pagne légué a permis à cette fille, après la mort de sa mère de découvrir la vérité. Ce film a beaucoup de similitudes avec certains films des pionniers du cinéma nigérien dans l’organisation des procès. En témoignent, les séries noires de Djingarey Maiga. Le film Un Casting pour un mariage, est une comédie. Réalisé en 2008, il met à l’écran l’histoire d’un futur gendre et son beau-père. Cette mise en scène reflète en partie la réalité de la « fada »118. Ici le réalisateur évoque le comportement de jeunes, qui racontent leurs aventures ou mésaventures autour du thé. Et, l’on voit à travers le film, comment les parents des futurs époux se préoccupent du mariage de leurs enfants, en utilisant parfois des stratagèmes pour se rassurer de l’amour de leur futur gendre à l’endroit de leur fille. D’ailleurs, la thématique du mariage a été largement abordée par les pionniers du cinéma nigérien dont Moustapha Alassane, avec ses films Aouré (1962) et (FFVA) Femme Voiture Villa Argent (1973). Ce qui nous amène à dire que le cinéma nigérien s’appuie largement sur sa culture d’où la permanence des thèmes. Denise Brahimi note à cet effet que : « La principale caractéristique des cinémas d’Afrique est justement la
118
Causerie autour du thé des jeunes à la devanture ou à l’intérieur de la maison.
99
permanence des thèmes qu’ils développent et des problèmes qu’ils dénoncent119 ». Un Casting pour un mariage est un film dans lequel plusieurs plans sont utilisés. C’est ainsi que, dès les premières images du film, le réalisateur, en plein jour, nous présente un décor dans lequel les personnages centraux du film discutent de l’aventure de l’acteur principal Malick. Ce dernier qui, dans son jeu de rôle bien maîtrisé, par sa gestuelle et la manière de raconter son histoire, capte l’attention. Il échappe au piège de son beau-père et finit par avoir l’autorisation d’épouser sa fille, Malika. Un film, jalonné de plusieurs intrigues. La séquence chez les parents de la fiancée de Malick démontre par l’usage d’un flash-back, cette manière d’aller dans le passé ou de revivre des événements passés. On voit, la belle sœur qui demande son beau-frère de l’aider dans les préparatifs du mariage au domicile parental, afin de tester la fidélité de son beau-frère. Malgré le fait qu’il est tenté par ses pulsions, Malick, sort au bon moment de la chambre où le papa les écoutait à travers la porte pour voir si son futur gendre cédera aux avances sexuelles de la sœur de sa future femme.
Figure 12: 3 acteurs discutent autour du thé.
Sur ce plan d’ensemble, on voit Malick, partager avec ses amis son aventure avec la famille de sa fiancée. 119
Brahimi, Denise. Op. Cit, p9.
100
Figure 13: un champ contre champ d’une discussion
Par rapport au champ-contrechamp, le montage est souvent utilisé pour filmer une conversation. Pour y arriver on change d’angle de prise à la camera. On voit successivement de face un interlocuteur puis l’autre120. » Le film Un Casting pour un mariage, dénonçant l’infidélité d’un couple (des deux sexes) est un film pédagogique, qui peut être montré à un large public. Il a été produit par la maison de production du réalisateur MD Production. Ici, on peut se poser la question du financement du cinéma des jeunes réalisateurs nigériens, qui arrivent à trouver de financement localement. Cela, nous éloigne du système de financement des films des pionniers.
120
Journot, Marie-Thérèse. Op. Cit, p28.
101
Quelques réalisations de Moussa Hamadou Djingarey121.
Figure 14: Moussa Hamadou Djingarey dans Patri Ciné
3.2. LE WAZZOU POLYGAME (1970), D’OUMAROU GANDA Le film Le Wazzou Polygane d’Oumarou Ganda, d’une durée de 50 minutes continue de marquer l’histoire du cinéma africain en général et nigérien en particulier. Le réalisateur est décédé le 1er janvier 1981 au moment où le Niger avait besoin de son talent pour l’émergence du cinéma nigérien. Cinéaste nigérien dont le Centre Culturel (CCOG) porte le nom. Dans le sahel quotidien122, Omar Ali le decrit ainsi : « Ganda est de taille très moyenne, qualifié de franc et d'honnête, de direct et de simple mais d'exigeant d'après ceux qui l'ont connu, Oumarou Ganda est l'archétype des enfants des quartiers pauvres de Niamey où il naquit en1935. ''Déscolarisé dès le primaire'' pour certains, ''il n'a jamais mis pied à l'école'' selon d'autres, le jeune Ganda n'a pratiquement rien de significatif devant lui. Ainsi naissent souvent les grands hommes que la providence se charge de combler. D'ailleurs, elle ne tardera pas à se manifester. En 1951, alors qu'il n'avait que 16 ans, il est engagé dans le 121 Filmographie de Moussa Hamadou Djingarey : Le pagne (2015) ; Koré (2013) ; Le retour au pays (2012) ; Hassia (2010) ; Le chemin de l'intégration (2010) ; Djamma, Madame Courage (2010) ; Un casting pour un mariage (2008) ; Sorkos (2008) ; Lutte contre la désertification au Niger (2006) ;Tagalakoy (2006). 122 http://www.lesahel.org/index.php/culture/item/12893-cin%C3%A9manig%C3%A9rien--oumarou-ganda-cet-immortel consulté le 12 janvier 2018.
102
corps expéditionnaire français en Indochine. De retour au Niger en 1955, il devient enquêteur-statisticien durant un an. Insatiable, il claque la porte et ''s'exile'', à Abidjan (Côte-d'Ivoire) devenu après le Ghana le nouvel Eldorado des migrants issus du Soudan français. Assistantréalisateur à la section cinéma du centre culturel français de Niamey, il est auteur de plusieurs fictions et documentaires123. » Oumarou Ganda est un acteur né, tellement il maîtrise le jeu de rôle. Il n’hésite pas à jouer dans ses propres films. C’est le cas de Cabascabo (1968) où il raconte sa propre histoire sur la guerre d’Indochine. Notons déjà, Qu’Oumarou Ganda a joué en 1957, son premier rôle d’acteur dans un long métrage, Moi, Un Noir de Jean Rouch. Un film qui retrace la vie difficile des migrants nigériens à Abidjan. Avec plusieurs distinctions à l’international dans les festivals de cinéma dont les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), le Festival Panafricain de Cinéma de la Télévision de Ouagadougou, le Festival de Cannes en passant par l’Espagne et la Russie, Oumarou a su représenter le Niger et sa culture. Justement c’est de cette culture que traite le film Le Wazzou Polygame. Film en couleur, réalisé en 1970 par Oumarou Ganda, nigérien de nationalité, d’origine Djerma, Le Wazzou polygame est produit par Argos Films, une société française de production filmique. Ce film a obtenu de nombreux prix dont le grand prix l’Etalon de Yennenga au Fespaco 1972 au Burkina Faso. Oumarou Ganda est auteur de plusieurs films dont : L’Exilé (1980), Saïtane (1972), Cabascabo (1968). Le Waazou Polygane (1970), montre la puissance de l’argent à travers le marabout El Hadj, qui prend en seconde épouse Satou, sans son consentement, pourtant fiancée à Garba, qui n’arrive pas à compléter la dot pour son mariage. Un drame s’en suit, avec le meurtre pour cause de jalousie de la première femme de El Hadj. Ce qui amène l’exode de Satou et Garba. Un film dont les thématiques (religion, exode, famille, mariage) sont d’actualité et qui traite de la modernité en opposant : (Village-Ville, mariage-prostitution, tenue traditionnelle et moderne…), le tout accompagné par les chants des femmes et la musique traditionnelle. Pour son deuxième film de sa filmographie, nous constatons la maîtrise du jeu de rôle par les acteurs. À l’instar de El Hadj le commerçant, qui amène le téléspectateur à travers sa tenue 123
http://www.lemonde.fr/archives/article/1981/01/03/mort-du-cineaste-nigerienoumarou- ganda_2718924_1819218.html, consulté le 21 juillet 2019.
103
traditionnelle, sa manière de parler, sa gestuelle, la sagesse apparente à voir devant soi un El Hadj comique, avec lequel plusieurs personnes de la société peuvent se reconnaitre. Dans une séquence du film Le Wazzou polygame, on voit El Hadj déambulant sur son fauteuil « royal », écoute les griots dans les tenues traditionnelles des années 70, chantant ses louanges. Des tenues d’alors qu’on retrouve dans la population actuelle, plus de quarante (40) ans après.
Figure 15: Une actrice du film Le Wazzou Polygame (1970)
Satou, l’actrice principale, la future épouse de El Hadj, est exceptionnelle dans son rôle de fiancée de Garba ensuite épouse de El Hadj. Elle se métamorphose en fonction de la situation dans laquelle elle se trouve. Très souvent, une grande partie des pionniers du cinéma nigérien dont Moustapha Alassane, Djingarey, Mamane Bakabé, etc. font appel à des actrices, dans leurs films, qui ne sont pas des têtes d’affiches. Et, à la fin, le jeu d e rôle des acteurs est réussi.
104
Figure 16: Satou dans Le Wazzou Polygame
Aussi, Ganda met en scène avec des gestuelles parfois ironiques qu’on rencontre chez les devins lorsque les clients les consultent. Réalisateur du film, il a joué le rôle du devin dans Le wazzou polygame. Un devin, qui n’hésite pas à toucher sa cliente dans les moments de la consultation. Il faut souligner que la case dédiée à la consultation, donc son lieu de travail renferme plusieurs objets mystiques. Parfois, ce lieu de travail fait peur, tellement que l’on n’est pas habitué à son décor.
Figure 17: Le devin et sa cliente dans le film Le Wazzou Polygame
105
Dans le film le réalisateur montre des pratiques qui tendent à disparaitre dans cette communauté. C’est le cas, lorsqu’un homme aime une femme. L’homme amoureux, se fait accompagner par ses amis chez la jeune fille. Une fois chez les futurs beaux-parents, ils sont accueillis et s’assoient sur des nattes, sous lesquelles, ils laissent des billets d’argent qui symbolisent l’attachement du prétendant à leur fille.
Figure 18: visite de El Hadj et ses amis chez sa future épouse
Le Wazzou Polygame est un film où les décors sont bien choisis en fonction du contenu des séquences. Un film qui montre la cohabitation des hommes et ce que la nature leur offre. Le réalisateur n’a pas hésité à mettre en lumière les pratiques traditionnelles des communautés qui vivent au bord du fleuve. Dans tout le film, la culture zarma- songhay est présente à travers l’esthétique des tenues traditionnelles, les jeunes filles à travers leurs parures et surtout les chants et les danses rythmés avec le claquement des mains ou des tamtams. Un film plein d’intrigue, où des scènes de joie, de tristesse, de drame s’entrechoquent sous des belles images. Dans ce film, le travelling ou le mouvement de la caméra est plusieurs fois utilisé, et cela donne une certaine force et qui retient le spectateur à l’écran. Sur l’image du piroguier conduisant des jeunes filles sur le fleuve, en tenue traditionnelle, qui chantent en proférant des proverbes de la contrée, on voit un pan de la culture Zarma, magnifiée par les femmes. La caméra suit l’action dans plusieurs variations de plans (gros plan, plan d’ensemble, plan poitrine, plan panoramique, etc.).
106
Figure 19: femmes en chant dans un pirogue sur le fleuve
Figure 20: Femme qui se baigne au fleuve
Père de quatre enfants, Oumarou Ganda, avait une fille qui disait qu’après sa mort, sa famille ne bénéficiait pas des œuvres de son père.
107
Aucune retombée économique de ses films en ce qui concerne les ayant droits, ni même la valorisation des œuvres par les autorités124. Filmographie de Oumarou Ganda125.
Figure 21: Oumarou Ganda dans le film Saïtane (1972)
3.3. LONG METRAGE, AUBE NOIRE (1983) DE DJINGAREY MAIGA De père cultivateur, Djingarey Abdoulaye Maiga est né à Ouatagouna au Mali. Il a fait ses études primaires à Asongo de 1945 à 1951 au Mali. Il est de l’ethnie songhaï de la 8ème dynastie des Askia Mohammed,
124
Entretien Fatouma Oumarou Ganda et Youssoufa Halidou dans l’Emission Patrimoine Ciné n°27 sur Dounia Tv. 125 Filmographie de Oumarou Ganda : Cabascabo (1968) ; Le Wazzou Polygame (1970) ; Saïtane (1972) ; Galio (1973) ; Cock Cock Cock (1977) ; Le Niger au Festival de Carthage (1980) ; L’exilé (1980).
108
souligne-t-il dans l’émission Patrimoine Ciné n°1 sur Dounia TV. Son observation de l’humain a été un facteur important dans sa réussite126. Son intérêt pour le cinéma remonte à la fois où il a acheté le journal Cinémonde127 à Niamey, qui se vendait dans un kiosque de la rue Rivoli, un quartier commercial dans les années d’avant l’indépendance du Niger. Dès lors disait-il, tous les lundis, il s’activait pour acheter le journal, tellement il était « fou du cinéma128». Après avoir rencontré Moustapha Alassane et parlé de cinéma avec lui, Djingarey Maiga est devenu son assistant au niveau de l’Institut de Recherche en Sciences Humaines (IRSH). Acteur principal dans son film Le retour d’un aventurier (1966), Djingarey Maiga n’a plus arrêté de jouer des rôles dans le cinéma. Et en 1972, il réalisa son tout premier film, Le Ballon, un docu-fiction de 35 minutes sur le football. Avec ce film, il gagne 135 000 FF, somme qu’il trouvait importante à cette époque. Et, cela lui a permis de réaliser L’Etoile Noire (1975), un des neuf (9) films à la série noire. D’ailleurs, pour la première fois lors du Festival de Films d’Animation Hommage à Moustapha Alassane (FAHMA) en décembre 2015, il donna les raisons de l’usage du mot noir placé dans ses films. Il notait, que c’était une promesse faite en 1970, à l’occasion de la conférence de l’ACCT (Agence de Coopération Culturelle et Technique) à Niamey, Aimé Césaire, en visitant l’IRSH avec Jean Rouch et un certain « Fourkougnonli », lui a demandé, étant assistant de Feu Moustapha Alassane de ne pas oublier de mettre le mot "noir" dans les films qu’il réalisera, « négritude, c’est notre couleur » disait Aimé Césaire d’où les fameux noirs dans ses films129. Djingarey Maiga est certainement le plus productif des cinéastes nigériens et africains en termes de fictions longs métrages130. En plus des films documentaires classiques et institutionnels comme « Femmes et développement », « La danse des dieux », Djingarey Maiga est à son 10ème long métrage La femme noire du village, en finition. Au Niger, 126
Entretien Djingarey Maiga et Youssoufa Halidou dans Patrimoine Ciné n°1. Op., Cit., Dounia Tv. 127 Revue de cinéma hebdomadaire française, parue de 1928 à 1971. 128 Entretien Djingarey et Youssoufa Halidou, Ibid., Dounia Tv. 129 http://www.clapnoir.org/spip.php?article1110 consulté le 22 janvier 2018. 130 Quelques films de Djingarey Maiga : Le Ballon (1972) ; L’Etoile Noire (1975) ; Nuage Noir (1979) ; La danse des dieux (1982) ; Aube noire (1983) ; Le Miroir noir (1994) ; Vendredi Noir (1999) ; Quatrième nuit noire (2009) ; Au plus loin dans le noir (2014) ; Le Cerveau Noir (2016) ; Un coin du ciel noir (2018) ; La femme noire du village (2020).
109
des pionniers du cinéma comme Moustapha Alassane, Oumarou Ganda, Moustapha Diop, Inoussa Ousseini, Mahamane Bakabé à la jeune génération comme Moussa Hamadou Djingarey, Rahmatou Keïta, aucun d’eux n’a eu à réaliser autant de longs métrages de fiction. Dans les pays de l’Union Economique Monétaire Ouest Africain (UEMOA), les cinéastes de renom comme Ousmane Sembène du Sénégal, Kaston Kaboré du Burkina Faso, Idrissa Ouédraogo, Souleymane Cissé du Mali, leur nombre de films fictions n’égalent le nombre de films fiction de Djingarey Maiga. Les thématiques des films sont des reflets de la vie sociale, c’est peutêtre cela qu’apprécie les cinéphiles, de voir leur réalité transposée sur le petit écran. D'aucuns diront que les films de Djingarey Maiga ne sont pas professionnels. Pierre Barrot en comparaison au cinéma de Nollywood131 aborde le cinéma de Maiga en ces termes : « Voulonsnous un cinéma qui plait aux populations, qui éduque son continent à travers ses réalités, ou bien voulons-nous des films dont les critères de commercialisation sont dictés par l’industrie cinématographique mondiale ? » Pour le journaliste et critique de cinéma nigérien Albert Chaibou, "sur le plan des thématiques qu'il aborde, les gens sont attachés à ses films parce qu'ils dénoncent un certain nombre de choses qui se passent dans la société, les travers de la société. C'est avec un regard très critique qu'il fait ses films "132. Djingarey Maiga raconte la vie quotidienne des gens avec qui il vit et qui sont de toute l'Afrique Noire. Nous donnerons trois exemples allant dans ce sens. Le premier exemple est celui du scénario du film La 4ème nuit noire (2009). Une histoire réelle qui lui a été racontée en 1980 par un de ses amis du Mali. C’était le coup d’Etat de Moussa Traoré, lorsque les militaires avaient pris le pouvoir avec Modibo Keïta. Le deuxième film est Aube noire (1983), là aussi le scénario est inspiré d’une histoire de couple, une de ses assistantes. Le troisième film est Vendredi noir (1999) dans lequel il a porté à l’écran les problèmes de société de l’époque. Les étudiants s’intéressent aux films de Djingarey Maiga dans les mémoires de fin de cycle. Kadidjatou Mounkaila y a consacré son mémoire de maîtrise, en 2015, à l'Université de Niamey. Dans ce 131
Barrot, Pierre. Nollywood : le phénomène vidéo au Nigeria. Paris : Harmattan, 2005, p8-16. 132 Entretien Djingarey Maiga et Youssoufa Halidou dans Patrimoine Ciné n°1. Op., Cit., Dounia Tv.
110
mémoire, à travers une critique littéraire, elle interprète et met l’accent sur les thématiques développées dans une tendance moraliste par Djinagrey Maiga. Scénariste, acteur, cadreur, preneur de son, monteur, producteur et réalisateur, Djingarey Maiga a marqué le cinéma africain par son style avec neuf (9) longs métrages. Avec plus de cinquante ans de carrière cinématographique, Djingarey Maiga, continue de produire des films. Son film Le cerveau noir (2016), nominé au Fespaco 2017 est un long métrage133 en couleur, qui soulève plusieurs thématiques touchant les sociétés africaines en général et celle nigérienne en particulier. Parmi ces thématiques, nous pouvons noter la gestion du pouvoir étatique dans les régimes d'exception qui se manifestent par les abus et l'amateurisme des militaires en place. Cet amateurisme peut se voir dans la séquence où le Commandant Guézibo vient colporter à son Général l'organisation d'une mutinerie par le Lieutenant Zeini. Ce dernier met en avant son intégrité face à ceux qui préparent un coup d'État. Ici l'amateurisme du Général est mis en évidence, pour dénoncer la confiance aveugle de certaines autorités. On y retrouve les thématiques chères au réalisateur comme la famille, la femme, la religion, la justice, la santé et le village, qui reviennent dans la fameuse série noire des films qui impose le style de Djingarey Maiga au national comme à l'international. En effet, depuis la fin des années 70, il accole le mot "noir" au titre de ses films, tel qu’Aube Noire, objet de notre étude. Aube Noire, un film en français et zarma relate l’histoire d’un jeune couple et de leur enfant. Omar jeune émigré nigérien, diplômé, vivait au Togo avec sa femme togolaise et son fils, en harmonie. Tout bascule, lorsqu’ils décident de venir vivre au pays. Une fois au pays, les problèmes d’ordre social et culturel surgissent. Omar qui aime sa femme de religion chrétienne, est influencé par sa famille qui le pousse à prendre une deuxième épouse dans sa communauté. Les raisons avancées sont : « Ta femme n’est pas des nôtres, c’est une chrétienne, nous sommes des musulmans ». Omar divorce de sa femme pour un mariage arrangé avec Habi. Le problème qui surgit, Habi n’est pas vierge. La société d’alors tient à cette tradition. À la nuit de noce d’un mariage, même de nos jours, un rituel à suivre. Cette pratique démontre l’éducation parentale. Une fille sans sa virginité la nuit de noce, 133
Ordonnance n°2010-046 du 29 juillet 2010 à son article 33 sur la durée des films.
111
déshonore sa famille. Une pratique qui reste toujours dans la culture nigérienne, surtout celle de la société zarma.
Figure 22: L’acteur principal et l’actrice principale en causerie
Sur ces images, l’actrice principale Habi assise dans un canapé chez son futur mari Omar. Coiffée à l’occidentale, on sent une certaine liberté. Le décor nous laisse présager une vie bourgeoise. Les tableaux fixés sur le mur, le téléphone, la statuette posée sur le buffet sont autant d’éléments qui peuvent décrire la personnalité de Omar, l ’acteur principal du film. Un homme réaliste, qui parle bien la langue de Molière et disposé à servir son pays. Dans un jeu de rôle, comme celle de la séquence qui montre les tourtereaux se draguaient dans le bureau d’Omar. Les deux amoureux captent l’attention du téléspectateur du début à la fin du film. Les intrigues surgissent d’une séquence à l’autre. L’histoire qui reflète la réalité de la société des années 80 et même celle de nos jours. Le film soulève certaines questions sur le mariage interculturel et le poids de la famille sur toutes les décisions de leurs filles et fils. L’autorité patriarcale est très développée dans cette société. Dans le film, le mariage voulu par la famille d’Omar a échoué. Car sa dulcinée, son épouse d’une « nuit » était enceinte d’un autre homme. Le mariage arrangé finit par devenir un conflit interne entre la même famille. Sept mois après sa répudiation, Habi accouche d’un petit garçon et commet un infanticide, qui la conduit en prison. Son cousin et ex-mari Omar retourne auprès de son ex-femme pour la ramener au foyer, mais cette dernière a rejeté son offre. La famille d’Omar s’accuse de l’échec du mariage dans lequel elle l’avait poussé.
112
Entre autres thématiques, dans tous les films des séries noires, la justice a une place prépondérante chez Djingarey Maiga. Il n’est pas rare de voir dans ses films, un procès en direct pour sanctionner publiquement les fautifs dans une affaire. On constate par cette image, que les procès actuels n’ont pas changé. Les mêmes pratiques de délibération demeurent dans les tribunaux, avec la même disposition des juges, des accusés, de la défense, du procureur du ministère public et le public qui se déplace pour écouter l’audience.
Figure 23: Au procès de Habi
La culture nigérienne et particulièrement Zarma dans ce film est très présente. En témoignent les images ci-dessous. Des tenues portées par les femmes pendant les cérémonies, la danse traditionnelle, les chansons, la religion à travers la consultation des dieux sont très fréquentes. Ce sont autant d’éléments qui fondent la culture nigérienne, et qui perdurent à ce jour.
113
Figure 24: Captures d’écran du film Aube Noire (1983) de Djingarey Maiga : la famille de la jeune mariée en tenue traditionnelle
À travers ce film, Djingarey Maiga, loin d’être un moralisateur, a tenté de soulever les maux de la société africaine. On note aussi dans tous les films de Djingarey, la présence des femmes, qui jouent des rôles importants. Il souligne : « Moi, j’ai réalisé ces séries noires pour montrer le rôle de la femme, comment elles sont traitées par les hommes et pour les soutenir. J’ai étudié d’abord, avant d’écrire les scénarios134 ». 134
Entretien Djingarey Maiga et Youssoufa Halidou dans Patrimoine Ciné n°1. Op., Cit., Dounia Tv.
114
Figure 25: Djingaarey Maiga dans Patri Ciné
3.4. LE RETOUR D’UN AVENTURIER (1966) DE MOUSTAPHA ALASSANE Originaire du Nigéria, Yoruba, Moustapha Alassane a fait toute sa vie avec ses parents, qui étaient naturalisés Nigériens. Il nous a quittés le 17 mars 2015 à Ouagadougou juste quelques jours après le Fespaco à l’âge de 73 ans, après une longue maladie. Apprenti chauffeur de son père, dessinateur, bricoleur avant d’embrasser le cinéma comme métier, Moustapha Alassane a représenté partout le Niger, brillamment, remportant plusieurs prix à l’international dont le plus célèbre : l’antilope d’argent au premier Festival des Arts Nègres à Dakar en 1966 pour son film La Mort de Gandji, un film d’animation, réalisé en 1965. Des prix, et pas des moindres, ont fourni le palmarès de ce pionnier du cinéma dans le monde. On peut citer le film d’animation Bon voyage Sim, réalisé en 1966 qui reçoit un prix au Festival d’Animation d’Annecy et fut diffusé sur la chaîne de télévision Canal Plus. Il est auteur de différents genres filmiques (fiction, documentaire, dessin animé) tels que Aouré en 1962, un court métrage sur une histoire d’amour. Le film primé au festival Saint-Cast en 1963 qui porte sur le mariage dans une famille zarma, La Bague du Roi Koda avec une Mention Spéciale à Florence Festival des Peuples 64 et Femme Villa Voiture Argent (FVVA) sorti en 1972 avec le prix OCAM du Fespaco 115
1972. Autant de prix pour ce grand homme de culture. D’ailleurs, pour parler de son renom, lors des rencontres professionnelles sur le cinéma, les cinéphiles et cinéastes ne cessent d’évoquer le nom de Moustapha Alassane, surtout avec ses films de dessin animé. Une tendance qui revient chez certains jeunes réalisateurs africains. A la 24ème édition du Fespaco les films d’animation entrent dans la
programmation pour la 1ère fois. Moustapha Alassane n’est pas seulement cinéaste, il est aussi formateur, animateur dans les cinés clubs et encadre les jeunes nigériens aux métiers du cinéma d’animation dans son studio Ader Film de Tahoua. Créé en 1997, ce studio a permis de numériser le film d’animation Kokoa (1985) la création du film Les magiciens de l’Ader. Une formation de 3 mois en conception de film d’animation est organisée en fin 2012, où un de ses fils avait participé. Il faut souligner que Moustapha Alassane utilise des marionnettes qu’il conçoit et des dessins dans ses productions d’animation. Nous avions réalisé un film Hommage à Moustapha Alassane, en 2017, dans lequel, nous avions recensé ce qui restait dans le Studio Ader et faire une exposition dans le film, du matériel de travail restant de Moustapha Alassane dont mes marionnettes, à ses petits-fils, Au plus fort de sa maladie, Mahamadou Saley, un ancien formé du Studio Ader, nous racontait, qu’au cours de la 24ème édition du Fespaco
à Ouaga, quand il a rendu visite à Moustapha Alassane, dans un quartier de Ouaga, malgré sa souffrance, dès qu’on lui parlait de cinéma, il se redressait pour en parler. Il a marqué l’histoire de cet art à l’échelle mondiale à travers ses productions filmiques, dont les films d’animations (dessins et marionnettes). Mais, il est peu connu par la jeune génération nigérienne. Ses œuvres ne font pas l’objet d’une promotion véritable pour préserver le patrimoine cinématographique au Niger. Le retour d’un aventurier (1966). Un film Western135 qui est le premier film du genre en Afrique136, dans lequel on voit jouer des 135
Western est un film d'aventures dont l'action se passe dans le Far West, film qui raconte la vie et les aventures mouvementées des pionniers, des cow-boys à l'époque de la conquête de l'Ouest américain. Le western est un film mouvementé, basé dans une certaine mesure sur des données historiques telles que la Marche vers l'Ouest et la ruée vers l'or, mais dramatisé et romancé suivant les formules très simples d'une confection en série. On y retrouve invariablement l'héroïne, le héros, le vilain, et des péripéties (chevauchées, poursuites, fusillades) 136 (Cf) Les cowboys sont noirs de Serge H. Moati, 1967, 2’25’’.
116
cowboys noirs. Le film retrace l’histoire de sept (7) jeunes cowboys nigériens. Chacun de ces jeunes incarnait un acteur de films américains. Boubacar Sounna, alias John Kelly ; DjingareyMaiga, alias Jimi ; Moussa Harouna, alias John Roberson, casse tout ; Zalika Souley, alias Reine Christine ; Ibrahim Yacouba, alias Black Cooper et Abdou Nani alias Billy Walter. Un film dans lequel des jeunes gens veulent changer le fonctionnement classique de leur société. Sur les images tirées du film et à travers plusieurs variations de plans, on observe les cow-boys dans la cour du roi, qui se comportent de manière irrespectueuse à l’endroit du souverain. L’un des cow-boys enlève le chapeau du roi, pour le porter. Le crâne rasé du roi tout nu devant les représentants de sa cour sous le regard provocateur des autres cowboys, éclaire sur le comportement d’une jeunesse désœuvrée. Une jeunesse qui bouscule la tradition. Une jeunesse qui veut de changement dans les pratiques locales de gestion de la cité. Une jeunesse qui veut faire partir des prises de décisions qui concernent sa société, une jeunesse dont les paroles comptent.
Figure 26: un cow-boy qui porte le chapeau du roi
Film, techniquement, donne à voir et à entendre les effets spéciaux du montage, que sont les bruitages des tirs des revolvers, de celles des bouteilles lors de la bagarre entre cow-boys, des bruits de galops des chevaux, des pas des acteurs, ce qui montre la maîtrise du langage 117
cinématographique par le réalisateur. Moustapha Alassane, scénariste du film expose une problématique générationnelle, civilisationnelle, mais aussi criminelle dans le film. Très souvent, la présence de plusieurs éléments entrent dans le récit filmique des westerns. Dès qu’on parle de film western, le spectateur voit déjà une dimension épique, un paysage assez vaste dans lequel un héros venu d’ailleurs, défend la justice sur des scènes qui montrent le vol de bétail, s’en suit une course poursuite, le plus souvent violente, qui conduit à des tueries et au final l’amour entre le héros et l’héroïne. Ce qui est intéressant dans ce film, c’est que le réalisateur a su adapter les mêmes réalités qu’on retrouve dans les films cow-boys américains, où la violence à travers les armes, une héroïne, le vilain, le héros et le pouvoir central se côtoient et s’affrontent pour délimiter leur espace. Au final, le pouvoir prend le dessus et neutralisent, les cowboys.
Figure 27:: Les six (6) cow-boys dans Le retour d’un aventurier
Dans ce film, Le retour d’un aventurier, plusieurs éléments caractérisent les jeunes cow-boys. Ils sont considérés comme des bandits dans le village, ils volent, ils frappent des innocents, ils se bagarrent et s’entretuent Moustapha Alassane a su montrer de manière ironique les cow-boys noirs qui vivent au Niger, influencés de par les films américains à travers lesquels ils s'identifient. C’est particulièrement le 118
cas de Zalika Souley alias, reine Christine, la seule fille dans le groupe des cow-boys. Elle manie le revolver et monte à cheval comme les hommes. On peut se rappeler le film Sarraounia137, où la reine pendant la colonisation, montait à cheval pour combattre l’ennemi. Il ressort de ce film, un conflit de génération dans le village. D’un côté le chef et les parents qui luttent pour défendre la tradition et de l’autre côté les guerriers, cowboys qui jouent avec la vie, sans retenue, cassent tout sur leur passage. Ils ne respectent plus leur tradition. Le respect des anciens est révolu. On peut le constater dès le début de la première séquence par l'attitude des jeunes qui menacent le vieil homme qui intervenait dans la dispute de la jeune « cowgirl ». Aussi cela est bien visible quand les cowboys jouent avec le chapeau du chef de village. Si on s'en tient aux réalités nigériennes, on ne peut s'amuser à toucher le chapeau du chef dans la cour royale et on ne désobéit pas non plus aux parents. L’objectif du réalisateur est d’interroger sa société sut les travers de sa société. Nous soulignons, avec les rencontres que nous avions eues dans la famille (femme, frères, enfants, amis, collègue) de Moustapha Alassane à l’occasion de la réalisation de notre film sur lui, tous les discours sur Moustapha ressortent qu’il un conservateur de sa tradition. Pour mettre fin aux dégâts des cowboys, le conseil de la cour monte une stratégie qui les pousse à s’entretuer. Moustapha Alassane met en scène ces jeunes cowboys pour montrer à sa population que tout c’est un film fiction, donc de l’imagination, de la création. D’ailleurs plusieurs historiens dont Jacques Le Goff, Marc Ferro ont écrit sur les récits imaginaires des films fictions. Moustapha Alassane est présent tout au long du film à travers sa voix off. Parler des cowboys noirs est peut-être pour lui, une façon d’honorer son pays et montrer l’esprit créatif du Noir. Mettre à l’écran la place parfois mitigée de la chefferie traditionnelle dans les années 60, est une grande prouesse, venant d’un cinéaste pendant le règne du parti unique. L’esprit créatif ici est le fait de transposer avec ses semblables, de récit, qui dans la réalité est difficile à réaliser. Moustapha Alassane à transposer le décor western à l’Américain dans son film, le paysage du Western, les chevaux, des tenues de cowboys, des revolvers, des fausses balles. Il utilise un décor naturel afin de donner à son film un espace réel plus vivant. Les cases, les tenues 137
Hondo, Med. Sarraounia, Paris : Les Films du Soleil, 1986.
119
traditionnelles, la nature, les champs, le fleuve, les montagnes, la chefferie traditionnelle et la cour, sont autant d’éléments qui reflètent la culture nigérienne. Aussi à travers quelques décors tels que l'avion, la ville, les bars, les voitures, l'habillement de cowboys et les revolvers, il met en rapport tradition et modernité. On remarque également dans ce film la place de la femme à travers la reine Christine. Une femme aux cotés de l’homme pour l’accompagner dans ses projets d’avenir. Une femme qui motive, galvanise le groupe pour atteindre un objectif. Une femme à la libre parole comme on le voit dans la séquence où la reine Christine dit la vérité à James Kelly, qui venait de tuer un des amis. Sur le plan technico- artistique, la musique est créée spécialement pour le film. On remarque une certaine complicité entre le réalisateur, le cameraman et les acteurs, notamment les cowboys qui jouent. Moustapha Alassane utilise un mélange de langue pour faciliter la compréhension aux téléspectateurs, à travers le zarma, le haoussa et le français. Pour l’évolution de son film, il utilise plus le traveling avant et arrière, des plongés ainsi que des panoramiques, des plans de coupe de la ville et du village. Le décor de la séquence où James Kelly arrache le cheval du père de Black Cooper, la séquence de la chasse aux girafes et la présence des marres nous font dire que le film a été tourné pendant et après les récoltes.
Figure 28: Captures d’écran d’un cow-boys du film Le retour d’un aventurier
120
Quelques films de Moustapha Alassane138.
Figure 29: Moustapha Alassane
Nous retiendrons pour ce chapitre que les films fictions servent aussi pour nourrir l’histoire d’un pays. En illustre, Le retour d’un aventurier, où il est question de conflits générationnelle, civilisationnelle et criminelle. En Afrique, en particulier au Niger, tous les genres filmiques, chacun dans sa réalisation use des techniques de l’un comme de l’autre. Un cinéma qui prend en compte les réalités de la société.
138
Quelques films de Moustapha Alassane : Aouré (1962) ; La Bague du Roi Koda (1662) ; La pileuse du mil (1962) ; Le Piroguier (1962) ; Samba le Grand (1977) ; Kokoa (1985) ; Dan Zairaidou (2009) ; La Geste de Fanta Ma (2009) ; Le Roi cherche un gendre (2009).
121
Chapitre 4 : Analyse de quelques documentaires Le film joue un rôle important dans l’éducation d’un peuple. Considéré comme un art, souvent porté sur un récit filmique, le cinéma a toujours été un vecteur de diffusion et de propagande de la culture d’une personne, d’une communauté ou d’un État. La charte de la FEPACI (Fédération Panafricaine des Cinéastes) soulève la problématique de propagande qui passe par le cinéma. On peut lire dès les premiers paragraphes de cette charte que : « Les canaux principaux par lesquels passe cette domination sont fournis par les nouvelles technologies de la communication : livre, audiovisuel et tout particulièrement le cinéma. Ainsi, la mainmise économique sur nos pays se double d’un phénomène d’aliénation idéologique dû à l’injection massive des sous-produits culturels que les publics africains sont poussés à consommer massivement. Ainsi, face à cette situation de domination et d’extraversion culturelle, est-il nécessaire et urgent de reposer en terme libérateurs la problématique interne du développement et du rôle que doit jouer dans cette démarche globale et multidimensionnelle la culture, et plus particulièrement le cinéma139». Justement, c’est tout cela que nous allons tenter de parcourir à travers les films documentaires choisis à cet effet. Un genre filmique dans lequel on sent l’empreinte de l’auteur. Et, le plus souvent le documentaire restitue ou fait découvrir un patrimoine. A ces débuts, le documentaire est accompagné de voix off. C’est un media qui contribue à éduquer et sensibiliser sur des enjeux de la société, mais il permet de dénoncer des travers de la société, tout en découvrant son patrimoine culturel. Il faut souligner que la majeure partie, des premiers documentaires des réalisateurs nigériens s’identifient à travers les titres, qui sont en langues locales. Ces premiers films documentaires dataient des années 60. Nous pouvons citer le films : L’arachide de Sanchira (1966), Deela ou El Barka le conteur (1969), Shaki (1973) de Moustapha Alassane ; Galio de l’Aïr (1973) et Cock Cock, Cock (1977) d’Oumarou Ganda ; 139
Charte de la FEPACI du 18 juin 1975.
123
Ganga (1975), Une jeunesse face à la culture (1977), Fantasia (1980), Le soro (1980), Wasan Kara (1980) d’Inoussa Ousseini ; Gossi (1980) et Hommage à Oumarou Ganda de Gatta Abdourahmane ; Ouatagouna (1980), Les rendez-vous du 15 avril, et La danse des Dieux (1982) de Djingarey Maiga . Ce dernier film « La danse des dieux » illustre bien des pratiques ancrées dans la culture nigérienne. Le film montre un rite de possession dans un village peulh, orchestré par les maîtres « haouka» qui appellent les dieux Holey pour danser aux rythmes des battements des calebasses et des violons, sous le regard des spectateurs. Ce film nous rappelle les films sur le culte songhay de Jean Rouch, tels que : Initiation à la danse des possédés et Yennedi ou les hommes qui font la pluie. Beaucoup de similitudes se dégagent dans le rite qui conduit à l’appel des dieux dans La danse des dieux de Djingarey Maiga et les films précités de Jean Rouch. Un autre film qui transpose la culture nigérienne est le film Fantasia d’Inoussa Ousseini. Le film Fantasia met en lumière une pratique culturelle des plus jouissives du magani du Niger dans la région de Diffa. Une cérémonie célébrée à l'occasion des fêtes religieuses, mariage et intronisation. La magnificence dans le film de la prestation des cavaliers avec les chevaux est un art plein de poésie. Un moment important dans cette communauté, qui affirme une certaine cohésion sociale et une fraternité légendaire entre les chefferies de la grande région de Bornou. Jouer la musique, chanter et danser à cheval de manière harmonieuse, élégante et de douceur donne à voir tout un côté esthétique à travers la complicité entre le cavalier et son compagnon, le cheval. Comme de coutume accompagné de sa cavalerie (notables de la cour, hommes, femmes, jeunes et enfants) à l'événement de réjouissance, au cours duquel, le chef monte sur son cheval harnaché et au galop, en accomplissant des gestes avec sa lance à la main, pour témoigner toute sa compassion, ses remerciements aux festivaliers venus nombreux. Le film Fantasia est aussi l’occasion pour vivre l'ambiance de l'instrument traditionnel de musique ''Algaïta''. De même, de voir le déhanchement des filles et des hommes dans un mouvement d'ensemble pour donner encore du rythme à l'Algaïta, au grand bonheur du public, parmi lequel les femmes aux belles tresses locales. On peut s'imaginer à un défilé de mode de Alphadi. Dans le film Fantasia en langue kanouri, en empruntant sa voix en français pour situer le décor des séquences, le 124
réalisateur, qui est aussi cadreur amène à suivre la place du cheval dans la vie de la chefferie et de toute la communauté. En outre, le cheval occupe une place de premier rang dans toutes les cérémonies chefferales du Niger et dans le sport roi du pays, le championnat de lutte traditionnelle, qui, dans les récompenses du champion, en plus du sabre national figure un beau cheval bien gras. Le réalisateur, Inoussa, sociologue de formation et acteur, a su très tôt user du cinéma pour préserver certaines traditions qui perdurent encore. Il s'interroge de fois dans ses films, sur le fonctionnement d'autres sociétés. Dans notre corpus, nous avons préféré analyser les films des documentalistes de la jeune génération, car nous avions constaté que les thématiques développées ont trait sur la culture nigérienne comme dans les documentaires des pionniers de ce cinéma. Ainsi, le premier film est Hawan Idi (2012). Un court métrage de 13 minutes, qui nous amène à voir la portée du cinéma pour accompagner la culture dans sa promotion, surtout l’identité locale et nationale gérée, très souvent, par les chefs coutumiers. Le deuxième film retenu est La colère dans le vent (2016), un moyen métrage, réalisé par Amina Weira. Ce film donne la parole aux habitants de la zone minière (uranium) d’Arlit, au nord du Niger exploité par Areva, une compagnie française. Un film dans lequel, la réalisatrice a donné la parole aux habitants, anciens miniers et miniers en activité. Ils ont dénoncé la mauvaise gestion de cette société qui est liée aux discriminations des salaires entre salariés expatriés et nigériens, la prise en charge sanitaire et le bien-être des salariés nigériens et leurs familles. Quant au troisième film, réalisé par Malam Saguirou, il montre une pratique culturelle, la chasse. À travers la communauté des chasseurs, on note que le métier de chasseur est une affaire de famille, qui se transmet de génération en génération dans la région de Zinder. Enfin, Koukan Kourcia ou le cri de la tourterelle du réalisateur Sani Magori est un documentaire dit de création. Un genre dans le documentaire que les adeptes distinguent du documentaire classique. Ce genre fait appel à des mises en scène, à une technique de la fiction. Une hybridation du documentaire classique et de la fiction140. Dans ce film, il est question de l’exode des bras valides nigériens, surtout de la région de Tahoua vers les pays de la sous-région. 140
Entretien Sani Magori et Youssoufa Halidou dans le n° 35 Patrimoine Ciné sur Dounia Tv.
125
4.1. HAWAN IDI (2012) DE AMINA ABDOULAYE MAMANI Hawan Idi est un film d’école, réalisé par Amina Abdoulaye Mamani141, dans le cadre de la Licence professionnelle à l’Institut de Formation aux Techniques de l’Information et de la Communication (IFTIC) du Niger. C’est un film documentaire qui a les caractéristiques d’un film ethnographique, dans lequel les traits culturels et les coutumes locales sont montrés. Le film met à l’écran, une pratique festive annuelle, de rencontre dans la communauté zinderoise, à sa tête le sultan. Le film Hawan Idi est l’occasion pour le sultan de renouveler ou pas, sa confiance à certains notables de la cour. La réalisatrice est native de cette région, Zinder. Hawan Idi, est un mot haoussa, qui veut dire en français la montée à cheval du sultan et son trajet de la cour à la place de la grande prière, dans un esprit festif et bon enfant. À travers cette manifestation, le sultanat de Zinder avec l’adhésion totale de toutes les couches sociales de la contrée fait montre d’un esprit de solidarité et de cohésion sociale. Une véritable identité locale de par les festivités qui est organisée par le sultanat de Zinder au Niger. Dans le film Hawan Idi, la place du sultan, du début à la fin, dans toutes les manifestations festives donne une particularité à cet événement. C’est l’occasion pour le sultan de célébrer dans l’humilité avec ses sujets, et de peser dans le cœur de sa population, car sans ce moment de Hawan Idi, d’ordinaire, l’accès à la cour royale est très difficile, à plus forte raison approcher de près le sultan ou le sultanat. Le film Hawan Idi est une transposition des faits, tels qu’ils se passent le jour même de la fête. Le film évoque l’histoire du sultanat et de la ville de Zinder. La réalisatrice a mis en lumière les activités festives du sultanat, les symboliques porteuses de l’identité locale dans, des éléments de symbolique sociale et la représentativité des arts, des fiertés locale et nationale. Enfin, nous parlerons du cinéma nigérien dans son aspect identité nationale à partir de la pluralité des facteurs d’identité locale, qui trouvent leur manifestation dans la religion, la montée à cheval, la danse, les chants.
141
Filmographie de Amina Abdoulaye Mamani : Sur les traces de Mamani Abdoulaye (2019) ; Le silence des papiers (2014) ; Hawan Idi (2012).
126
- Le sultanat et la ville de Zinder, l’histoire d’une identité locale Le Sultanat de Zinder, est le reflet d’une histoire mythique, qui date de 1736, donc, bien avant la révolution française de 1789. D’après les dires, lors de la construction du sultanat, étaient emmurés trois (3) jeunes filles et quatre (4) corans sur recommandation des marabouts et des chasseurs de la cité. L’emplacement actuel du sultanat, une forteresse architecturale spécifique, date de 1812. Il est construit par le sultan Souleymane Dan Tanimoune. Une ville, fondée sur les bases islamiques. Sur la photo ci-dessous, de la façade du sultanat, on observe une architecture aux nombreuses formes géométriques et des inscriptions arabes, preuves d’une islamisation poussée, qui peut se comprendre par la présence des arabes à travers le commerce.
Figure 30: Façade du sultanat de Zinder
Zinder, avant la colonisation, est un lieu de passage et d’échange du commerce des caravanes transsahariennes. Zinder est un lieu de brassage des cultures (haoussa, kanouri, peulh, touareg). Elle fut la capitale du Niger de 1922 à 1926. Zinder est une histoire de guerriers. Les photos montrent l’armée traditionnelle du sultanat à gauche. Des bras valides de Zinder qui portent des tenues, dédiées à cet effet, avec des carabines en main. Et sur la droite, on voit sur le mur, un sabre et un bouclier en peau de bélier. Des outils de défense en cas de combat ou d’attaque de l’ennemi. 127
Figure 31: La devanture du sultanat et sa branche sécuritaire
Le film Hawan Idi donne l’occasion aux cinéphiles et à toute la population de voir une réalité de la société zinderoise, qu’est la fête du jour de ramadan ou Hawan Idi. Véritable réservoir de la préservation des valeurs ancestrales, Hawan Idi, est une fête qui consiste à donner aux représentants de toutes les catégories socioprofessionnelles de la cité, l’occasion de s’affirmer dans leur fonction de tous les jours, à commencer par le Sultan. Sur la photo du cheval harnaché, monté par le sultan protégé par les baroudeurs, on observe le point de la main fermée du sultan en direction de la foule, signe d’assurance et d’adhésion à la cérémonie. Et, l’autre photo montrant plusieurs personnes qui représentent les différentes couches sociales de la cité. À l’intérieur du sultanat, ils viennent saluer le sultan. Une coutume qui date de plusieurs décennies, en signe de reconnaissance au chef traditionnel.
Figure 32: Le sultan à cheval et ses notables
128
Cette fête montre une tradition locale des zinderois, « Et, parmi lesquels sont évoqués la langue, le costume, les fêtes, mais aussi les activités sportives traditionnelles ». Et, justement le film Hawan Idi illustre dans sa totalité ces propos. L’importance de cette fête traditionnelle est un moment de préservation et transmission des valeurs traditionnelles de génération en génération, de convivialité, de cohésion sociale, de paix sociale, de brassage culturel, de confiance renouvelée entre le sultan et les sujets dans leurs rangs respectifs. C’est aussi un moment où les différents corps qui composent cette chefferie prêtent allégeance au chef traditionnel, lui-même prêtant allégeance à son Dieu. C’est une identité locale qui se prolonge dans une identité nationale, à travers la religion musulmane, pratiquée par plus de 95% de la population nigérienne. Et avec des couleurs spécifiques, des costumes, etc. ➢ Des symboliques porteuses de l’identité locale Au début du film, une voix off nous présente Zinder en ses termes : « Zinder est une ville construite autour d’énormes massifs granitiques. (…) Constituée de Haousa, peulh, touareg et de Kanouri, le Damergaram est une des plus grandes villes du Niger. Berceau d’une civilisation et d’une histoire riche et conservée par la tradition orale. Elle est aussi, une ville de rayonnement islamique qui représente des faits historiques et culturels incontestables ».
Figure 33: Les notables sur des chevaux qui prêtent allégeance au sultan.
129
Des identités locales dans les festivités sportives traditionnelles se côtoient, dont le Hawan kawo, le fakka et le Shoro. Notons aussi l’accompagnement du sultan par toute la population à la grande prière, une identité locale, encadrés par les baroudeurs qui représentent l’armée traditionnelle du sultanat. Les louanges des griots aux notables sont également de la partie, pour rendre plus vivante la cérémonie.
Figure 34: expression de l’art oratoire des griots
➢ Des éléments de symbolique sociale La fonction commémorative de Hawan Idi, apparait comme un processus symbolique de lutte collective et comme facteur d'identité locale et contribue à la réussite de la fête. Aussi le sultan, met toute sa présence dans les manifestations avec toute sa grandeur de chef. Le culte de l'indépendance de la cité du sultan donne à la population la force de sortir en masse pour célébrer le Hawan Idi, fêter dans la joie et l’allégresse.
130
Figure 35: Des moments forts de Hawan Idi
Une fierté locale dans toutes les activités festives, qui sont réputées les plus belles qui se déroulent une fois dans l’année. Un engouement de la population se voit dans le film à travers les différents corps sociaux, qui travaillent plusieurs jours avant le jour de la fête Hawan Idi. ➢ La représentativité des arts, des fiertés locale et nationale Le film met en lumières des savoirs faire magnifiés le jour de Hawan Idi. Ainsi on peut voir le « Hawan Kao » ou la tauromachie, une pratique qu’on voit chez des bouchers. C’est un art qui permet d’affronter un taureau surexcité. Ce qui est intéressant dans cette représentation publique, ce qu’elle fait appel à des potions mystiques prises par les initiés avant l’affrontement. En langue Haoussa, cette pratique d’initiation s’appelle « Boudé Kounné » c'est-à-dire la préparation rituelle, avec l’eau mystique à base de racines et d’herbes, de plantes, préparée à cet effet, qui rend invulnérable les toreros. Un torero, sur une question sur les risques de cette pratique, rétorque : « C’est mon art, c’est mon travail à tout moment d’affronter un taureau, même au marché. ». Cette assurance dans la tradition avec la jeune génération est peut-être une façon de réaffirmer son appartenance à sa culture. 131
Figure 36: une scène de Hawan Kao
De même, toujours dans Hawan Idi, on montre dans le film, une activité sportive festive, du nom de « Fakka », un jeu qui se fait entre deux braves hommes de clans différents. Ils viennent en courant à toute vitesse pour une collision des hanches ou de dos pour combattre son adversaire sous les yeux de la communauté.
Figure 37: Image tirée du film Hawan Idi : une scène de Kaffa.
132
Nous avons aussi, le shoro, une compétition qu’on retrouve chez les peulhs. Il consiste à un affrontement entre deux hommes de clans différents. Un défi pendant lequel des coups de bâton sont donnés pour montrer la bravoure et la forte détermination des hommes. Historiquement, ceux qui reçoivent les coups de bâton cette année-là, en donneront l’année suivante. Cela est bien souligné dans le film. Une pratique qu’on retrouve dans presque toutes les contrées peulh du Niger, lors des manifestations annuelles. ➢ Pluralité des facteurs d’identité locale vers une identité nationale dans le cinéma nigérien Plusieurs facteurs d’identité locale tendent vers une identité nationale dans le cinéma nigérien. Ainsi, peut être vue, dans presque tous les films nigériens la thématique de la religion musulmane comme facteur d’identité nationale, car pratiquée par plus de 95% de la population.
Figure 38: Une prière collective
La religion apparait comme l’élément le plus traité dans le film Hawan Idi. Est-ce que s’est voulu par la réalisatrice ou c’est du fait de la forte présence de l’islam dans le quotidien des Nigériens ? Nous remarquons dans les films des pionniers comme les films de la nouvelle génération les réalisateurs ne manquent pas de recourir aux symboles de 133
l’Islam. On voit dans le film Hawan Idi, le sultan se rend à la grande prière pour le respect des principes sacrosaints de la religion musulmane.
Figure 39: Le sultan assiste au « Idi »
Le politologue Pr Tidjani Alou l’a relevé dans le film en soulignant : « Que le sultan, le jour de la fête se rende à la grande prière à cheval avec tous ses notables, quelque part c’est aussi une façon de montrer à la population qu’il adhère. Mais qu’il maintient aussi le côté traditionnel de la chose. Parce qu’il aurait pu au fond aller en voiture, il aurait pu aller à pied mais nous le voyons habillé dans une tenue qui semble comporter deux dimensions : une dimension guerrière, où on le voit habillé en guerrier avec son épée, où son cheval est harnaché de façon spéciale et une autre dimension qui rend compte, je dirai, et de son pouvoir temporel et de son adhésion à la religion avec la « altchalba » qu’il porte. Et vous voyez bien, quand il arrive au lieu de la prière, il enlève ses bottes, ensuite, il enlève son sabre, il devient un croyant ordinaire, qui vient prier. Mais qui est prédisposé. Ça signifie que le pouvoir existe, mais que le pouvoir adhère à la religion, parce qu’il prie derrière l’iman ». Le pouvoir temporel cède la place au pouvoir divin, pour un temps, malgré le fait qu’avant la prière à la grande mosquée, le sultan a affirmé son pouvoir temporel, en renouvelant sa confiance à certains notables de
134
la cour royale. Un symbole fort de la forte islamisation du sultanat et de la ville de Zinder. On peut voir, aussi dans le film Wazou polygame (1970) réalisé par Oumarou Ganda, la présence de la religion tout au long du film. Ainsi dans la séquence de la célébration du mariage entre El Hadj et Tallou, la récitation coranique est au cœur de cette cérémonie. Il est de même dans le film Si les cavaliers… (1981) de Mamane Bakabé, où, on observe qu’à chaque début de rencontre des sages, une fathia est dite et cela perdure même dans les activités politiques et dans toutes les manifestations sociales au Niger. Outre la religion dans le film Hawan Idi, cette fête annuelle donne l’occasion de voir les vêtements de toutes les couches socioprofessionnelles au service du Sultanat. Une identité qui dépasse la seule identité locale pour tendre vers l’identité nationale. En effet, il n’est pas rare de voir les mêmes vêtements chez tous les chefs des bouchers au Niger. De même le vêtement des guerriers du sultan, des notables dans leur rang respectif et même le vêtement des sultans au Niger s’apparentent. Dans Le film Koukan Kourcia, les médiatrices (2014), de Sani Magori, on peut voir dans la séquence de la cérémonie de réconciliation, les mêmes tenues que portent les chefs traditionnels, lesquels chefs sont accompagnés toujours d'une armada de notable et de serviteurs.
Figure 40: Le sultan avec des notables en tenue traditionnelle.
135
Un autre facteur d’identité nationale est l’utilisation du cheval dans le cinéma nigérien. Qu’ils soient des cinéastes pionniers ou de la jeune génération, et dans tous les genres filmiques (documentaire, fiction, animation) au Niger, le cheval joue un rôle important dans les festivités nationales, dans le fonctionnent de la chefferie traditionnelle et chez les hommes les plus aisés. Le cheval, synonyme de richesse et d’élégance accompagne les sultans dans toutes les cérémonies du sultanat. Chez Mahamane Bakabé, dans le film Si les cavaliers…, le cheval est utilisé par les dignitaires de la tradition pour servir de véhicule urbain, de moyen de transmission des messages et moyen de conquête des territoires. Pour Moustapha Alassane, le cheval est moyen de transport (conquête et transport urbain). On le voit dans les films La mort de Gandji (1965), Le retour d’un aventurier (1966) et Dan Zaraidou (2009). La plupart du temps, la chefferie a un lien profond avec le cheval, lequel est bien gras. Dans le film Le retour d’un aventurier, le cheval dans un premier temps est monté par les dignitaires avant que les cow-boys ne prennent la monture des mêmes chevaux, pour les actions de rébellion qu’ils menaient. Cette fois, le cheval avec les cow-boys symbolisaient vitalité et, qui est à la portée de tous. Comme le souligne le commentateur : « A Zinder, le Hawan idi est marqué par la sortie du sultan sur son cheval extrêmement bien harnaché à la dimension de l’événement, l’élégance nonchalante, accompagné par toute la population pour le idi ». On note aussi la fantasia, organisée pour la circonstance à cette fête hawan idi, qui permet aux notables de la cour de prêter allégeance et fidélité au sultan. Elle consiste à défiler sur les chevaux harnachés devant le sultan. Les notables viennent sur leurs chevaux en courant avec une lance, et à quelques mètres du sultan, s’arrêtent en tapant le sol avec la lance.
136
Figure 41: Le chef des bouchers avec son cheval
Enfin, des éléments de la culture nationale qui contribuent à raffermir l’identité nationale sont la danse, les chants, les tambours, des identités locales
Figure 42: Des manifestations des artistes
¾
La culture nigérienne, havre de paix et de socialisation
De part et d’autres de ses frontières, le Niger présente l’art et la diversité qui tendent vers une identité collective, donc nationale. Il sera important de les répertorier et qu’à travers les ministères en charge de la culture et de la communication ces patrimoines culturels puissent être préservés par les cinéastes et les télévisions pour la transmission de la culture aux générations à venir.
137
4.2. LA COLERE DANS LE VENT (2016) DE AMINA WEIRA La Colère dans le vent Amina Weira livre aux cinéphiles de belles images, avec des chansons locales et la musique traditionnelle des femmes targui.
Figure 43: Des femmes targui jouent la musique traditionnelle
C’est un film tourné en langue haoussa. La réalisatrice se filme, on la voit saluer respectueusement les personnes âgées comme le veut la tradition nigérienne. Il est rare au Niger de voir, une femme qui dénonce l'impérialisme par le biais du cinéma. Le propos du film est clairement éducatif pour la population sur les enjeux de l’exploitation uranifère. À la question de savoir pourquoi le choix du titre du film, Amina Weira, explique que ça vient d’un constat avec des revendications des ouvriers de la mine, qui ne sont pas prises en compte par le groupe Areva, qui exploite la mine. À Arlit, il y a de nombreuses tempêtes de sable et ces colères partent dans ce vent de sable. Aujourd’hui, des déchets radioactifs sont exposés à l’air libre dit Amina Weir. Et en même temps ce vent de sable, transporte toutes ces particules radioactives. Elles
138
contaminent l’air aujourd’hui. L’air, a fait indirectement propager cette radioactivité dans la ville d’Arlit, qui grandit de plus en plus142.
Figure 44: Des jeunes débattent sur les questions sanitaires
De manière méthodique, la réalisatrice recueille auprès de la population des informations sur la mauvaise gestion de la compagnie Areva. Elle crée une sorte de micro trottoir, un procès social public en pleine rue avec des jeunes, des femmes et des anciens miniers à la retraite. Elle aide à comprendre pourquoi ces témoins évoquent les conséquences néfastes de la présence d'Areva à Arlit. Elle a préféré donner la parole aux habitants et écarter celle des autorités.
142
Entretien Amina Weira et Youssoufa Halidou dans le n° 29 Patrimoine Ciné sur Dounia Tv.
139
Figure 45: Des femmes se plaignent de cette exploitation de l’uranium à Arlit.
Le patriotisme de la réalisatrice l'amène à poser la question des injustices dans la gestion de l'exploitation uranifère et à affirmer sans ambigüité sa fierté d'être Nigérienne. Le film La colère dans le vent est une métaphore sur la difficulté de communication. En témoigne la séquence du film où Amina Weira interroge un homme à propos du silence des autorités sur la protection de la population par rapport à cette exploitation d'uranium. Malgré l'effort de communication de la réalisatrice, cet homme - vivant seul dans une position stratégique de la ville - garde le silence avec un regard moqueur. Sa réaction en dit long sur son désarroi. C'est un film engagé comme les films des pionniers africains à l'instar de Cabascabo (1968) d'Oumarou Ganda, Camp de Thiaroye (1988) de Sembène Ousmane, voire La Bataille d'Alger (1966) de l'Italien Gillo Pontecorvo, adaptation du livre de Yacef Saadi, également producteur. Ces trois films dénoncent des traitements difficiles que subissent les colonisés. La réalisatrice Amina Weira a évoqué beaucoup d’obstacles pendant la production du film à Arlit avec les personnes ressources qui la décourageaient, la gendarmerie et la police qui étaient à la trousse de l’équipe de tournage, malgré l’autorisation de tournage délivrée légalement par le Centre National de la Cinématographie du Niger. Pour dire qu’il y a des sujets sensibles que certains dépositaires de la loi préfèrent taire. Amina Weira est native du département d’Arlit, une 140
étudiante, produit de l'Institut de Formation aux Techniques de l'Information et de la Communication (IFTIC) où elle décroche une licence en montage et un master 1 en réalisation documentaire de création, avant de poursuivre son master 2 en réalisation à l'Université Gaston Berger de Saint- Louis au Sénégal en 2013. Elle est auteure de trois autres films réalisés dans le cadre de ses formations en réalisation. Ces films sont : La musique des films (2011) qui parle de l’importance du son dans le cinéma ; Des études aux miels (2012), qui traite des vertus du miel pour la santé, en particulier dans le traitement de la tension ; et, enfin, C’est possible (2005) qui montre le fonctionnement d’un ferme agropastoral au Sénégal. On note depuis cinq ans l'émergence de réalisations des femmes dans le cinéma nigérien. Ainsi, le film Hawan Idi d'Amina Abdoulaye Mamani avait été primé à la 23ème édition du FESPACO (2013) dans la catégorie meilleur film d'école. En 2015, deux films de deux réalisatrices ont été nominés à la 24ème édition du FESPACO (2015). Il s'agissait des films : La croix d'Agadez de Paraiso Charifatou et L'Alliance de Rahmatou Keita. D'autres femmes sont aussi actives dans les réalisations filmiques au Niger comme Ramatou Doulla avec son tout dernier film De la vie à la mort (2015) et tout récemment le film L'Arbre sans fruit de Aicha Macky, primé aux AMAA au Nigéria. 4.3. LE CHASSEUR DU VENT (2005) DE MALAM SAGUIROU Né un 15 avril 1979, Malam Saguirou est considéré comme le premier jeune documentaliste indépendant au Niger. L’un des premiers documentalistes qui s’identifie au « documentaire dit de création ». Il est venu au cinéma par hasard, disait-il, en 2000, à cause des turbulences qui ont eu lieu à l’université Abdou Moumouni de Niamey143. Pour compenser l’absence de cours due aux grèves, il se met à l’écriture d’un scénario. Il se forme à l’écriture cinématographique à travers des ouvrages sur le cinéma, et aussi en prenant des conseils auprès de Djingarey Maiga et Souleymane Mahaman. Il participe pour sa première expérience dans le monde du cinéma avec un atelier d’écriture à l’initiative de Contre Champs au sein de l’IFTIC. Son projet de film sur l’histoire d’une communauté de chasseurs de Zinder, a attiré l’attention 143
Entretien Malam Saguirou et Youssoufa Halidou dans le n° 15 Patrimoine Ciné sur Dounia Tv.
141
des formateurs qui lui ont proposé sa première résidence en écriture à l’Île de Gorée au Sénégal. Par la suite Malam Saguirou a eu l’occasion de suivre plusieurs formations sur le cinéma. Il a actuellement une dizaine de films documentaires d’auteur à son actif. Avec son tout dernier film Solaire Made In Africa (2017), Malam Saguirou retrace le parcours d’Abdou Moumouni Dioffo, premier agrégé en physique en Afrique Noire. Un film documentaire de 67 minutes qui dévoile les faces cachées de la France contre l'indépendance énergétique du Niger. Le documentaire rassemble les témoignages de la famille (Aïssata Moumouni), des villageois et des collaborateurs d'Abdou Moumouni Dioffo. Parmi ces derniers, il y a le Pr Albert Wright (Niger, Ingénieur héliotechnicien à la retraite et ancien Directeur Général de l'Office de l'Energie Solaire du Niger, ONERSOL), le scientifique français Jean-Pierre Girardier né en 1933, qui a obtenu son doctorat en physique à l'université de Dakar en1963, et pionnier du solaire thermodynamique en Afrique, il a créé en 1973 la Société française d'études thermiques et de l'énergie solaire, Sofretès ; Issoufou Djermakoye, le sultan de Dosso (Niger) et le Pr Abdoussalam Ba (Niger), directeur du Centre National d'Energie Solaire (CNES). Ce dernier, physicien de renom formé à l'Université de Niamey et à l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis, est né en 1939 ; dans des propos sans équivoque, il accuse la France de ne pas vouloir exploiter l'énergie thermodynamique au Niger, pour conserver ses intérêts. Le film nous amène à découvrir les stratégies françaises pour anéantir l'émergence technologique de ses anciennes colonies. Contrairement aux autres films nigériens alarmistes sur le quotidien des Nigériens, Solaire Made in Africa de Malam Saguirou, nous donne à voir un autre Niger. Ici, à travers Abdou Moumouni Dioffo, le documentaire montre qu'un fils du pays a apporté au monde une connaissance et un savoir-faire dans les sciences dans les années 60-70. C'ést un pays qui prenait son destin en main, avec les moyens à sa portée. Les Nigériens étaient fiers de consommer les produits d’un des leurs à l'instar de la séquence du film qui montrait les festivités de la fondation Abdou Moumouni Dioffo. Un méchoui avait été préparé dans un four solaire, fabriqué par des jeunes lycéens. Dès les premières images, à travers la séquence montrant des femmes rurales, on commence à découvrir Abdou Moumouni Dioffo. Les élèves du lycée Korombé témoigne du service qu’il a rendu à sa nation :
142
« Dès le lendemain des indépendances en Afrique, il s'engage sur les terres soviétiques pour une spécialisation en énergie solaire, afin de pouvoir convertir en énergie consommable les implacables langues de feu de notre ardent soleil (…) Afin de se mettre au service de sa nation ». L'Université de la capitale nigérienne, Niamey, porte le nom du brillant chercheur. Malam Saguirou, nous donne à voir un autre Niger sans misère, un Niger où il y a des créateurs, des inventeurs et une culture ancrée dans la tradition depuis la nuit des temps. On peut alors se poser la question de savoir si le cinéaste n’est pas un dépositaire de la tradition, un griot des temps moderne. C’est d’ailleurs ce que soulève Abdelkader BENALI : « Le cinéaste : nouveau griot ? Par un tel rapprochement entre l’oralité comme fait culturel et le cinéma comme système de communication de masse, le cinéaste africain apparaît lui-même comme un griot moderne dont la fonction principale est de restituer par l’image les enjeux d’un patrimoine jusqu’ici véhiculé par les moyens de l’oralité… 144» Le film Le chasseur du vent en est une illustration parfaite. Le tout premier documentaire du réalisateur en 2005 dure 53’37’’. De quoi parle ce film exactement ? Mille et une questions peuvent se poser à partir du titre du film. Est-ce qu’on peut chasser le vent ou est-ce juste une métaphore du réalisateur ? L’histoire des chasseurs à Zinder le fascinait depuis longtemps. Il notait que : « Les chasseurs sont des grands maîtres parleurs, ils te racontent des histoires, tu as peur. Ils sont capables de prendre le lion, de le tuer, de faire ceci, de faire la guerre, alors qu’officiellement, le sultanat de Zinder n’était jamais en guerre. Mais, eux en fait, ils te racontent du réel ». Sur l’image ci-dessous, on voit le chef chasseur au milieu, accompagné de sa garde rapprochée à gauche et, comme dans la société traditionnelle, la présence du griot à droite de l’image, pour chanter des louanges au chef.
144
BENALI, Abdelkader . « Oralité et cinéma africain francophone ; une parenté esthétique et structurelle ». In Notre Librairie n° 149, p.23.
143
Figure 46: Un chef chasseur accompagné de ses compagnons
D’ailleurs sur ce plan d’ensemble, on peut lire la traduction du griot sur l’image : « C’est toi qui peux tuer dix lions, dix biches et dix léopards. », alors qu’à faire une analyse avec les propos du réalisateur, on croit être dans un autre monde, qui n’est pas ce monde dans lequel les personnages vivent. Un monde où l’humain et les animaux sont toujours en interaction. Les chasseurs du vent, ici sur ce plan général, assurent la sécurité du sultan à toutes les sorties dans des fêtes, organisées par le sultanat. Très souvent habillés dans une tenue de couleur rouge, avec des bonnets sur la tête. Ils sont les vrais gardes rapprochés du sultan. Armés de gourdins, de lance, de sabre ou même de fusils traditionnels, ils sont prêts à les utiliser sur autorisation du sultan. Le sultan est encerclé et accompagné par les chasseurs. L’image illustre l’organisation de ce corps de métier du sultanat.
144
Figure 47: une vue d’ensemble d’une scène de Hawan Id
Le film est rempli de symboles guerriers, que les protagonistes n’hésitent pas à déclamer à la moindre occasion. Un métier de chasseur où les adeptes sont fiers d’exercer et de défendre. Chez les femmes aussi, on retrouve, des guerrières. Elles ont à leurs têtes « Sarkin Baka» Reine des chasseuses, au service du sultan. Ces deux images, montrent combien, l’engagement est total. Ici dans la traduction, on lit : « Quand le sultan sort nous lui jurons allégeances. Lorsqu’il nous ordonne de trancher même si c’est une tête animale ou humaine, nous obéirons ».
145
Figure 48: La reine des chasseuses
Ici, la reine des chasseuses, une guerrière, montre dans le film la manière dont elle utilise l’épée. Au Niger, depuis longtemps, l’histoire nous apprend la place des femmes guerrières ou des femmes qui sont proches des guerriers. C’est le cas de Kassaï, la sœur de l’empereur Sonny Ali Ber. Edouard Lompo145 a créé une pièce de théâtre, qui met en exergue cette figure féminine. Kassaï, la magicienne, la prêtresse, la grande dame, n’hésitait pas à se sacrifier pour que le royaume tienne146. Une autre illustration est celle de l’héroïne, Sarraounia dont l’histoire a fait l’objet d’une adaptation filmique de l’œuvre de Abdoulaye Mamani147. Sarraounia dans le film est une guerrière qui n’hésite pas à être au front pour galvaniser sa troupe au combat. Dans le cinéma nigérien, très souvent, le patrimoine culturel est mis en exergue en vue de sa préservation et d’une résilience pour le bien de toute la communauté.
145
Edouard Lompo Amadou : écrivain, scénariste et réalisateur nigérien. Portrait d’Amadou Edouard Lompo dans le journal Le Sahel n°9387 du 30 août 2017 du Niger, réalisé par Youssoufa Halidou Harouna. 147 Mamani Abdoulaye : auteur de plusieurs ouvrages dont Sarrounia (1980). 146
146
4.4. KOUKAN KOURCIA OU LE CRI DE LA TOURTERELLE (2010) DE SANI MAGORI Sani Magori soulève des problématiques de la société et met en lumière le quotidien des populations à l’instar du film Koukan Kourcia ou le cri de la sauterelle, qui a reçu le prix de l’intégration de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) au Fespaco 2011, à sa 23e édition. À travers la cantatrice « Zabiya », le réalisateur va à la rencontre des Nigériens, en particulier son père qui émigre en Côted’Ivoire dû aux chansons de la Zabiya, qui poussent jeunes et moins jeunes de la région à l’exode. Les causes de cet exode peuvent être lues dans l’ouvrage de Halidou Sabo qui souligne qu’: « Au Niger, l’exode rural et surtout l’exode vers les pays côtiers constitue une réalité permanente. Ainsi chaque année, après les récoltes et même parfois avant, plusieurs de nos régions se vident de leurs bras valides. Ceux-ci, pensent fuir la misère du terroir natal, partent en quête de lendemains meilleurs vers les villes de la côte africaine148». La thématique des causes et des conséquences de la migration se retrouvent dans les films des pionniers comme de la jeune génération. C’est le cas des films : Le retour d’un aventurier (1966) de Moustapha Alassane ; Le Wazzou Polygame (1970) de Oumarou Ganda ; Paris c’est joli (1974) d’Inoussa Ousseini ; Aube Noire (1983) de Djingarey Maiga ; Le médecin de Gafiré (1983) de Moustapha Diop et Mon retour au Pays (2012) de Moussa Hamadou Djingarey. Phénomène social et culturel au Niger, la migration, véritable source économique et d’intégration des peuples de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a permis, d’une part, le pouvoir économique de certains migrants de retour dans leur pays, et d’autre part, une intégration des peuples. Dans le cinéma nigérien des années 60 jusqu’ à nos jours la migration est une réalité au Niger. Le film Koukan Kourcia 1 ou le cri de la tourterelle149, place au cœur de l’histoire, l’exode et les conséquences liées à la migration dans la région de Tahoua, qui sont parfois fâcheuses.
148
HALIDOU Sabo, Mahamadou. Aboki ou l’appel de la côte. Paris: NEAS, 1978. MAGORI, Sani. Koukan Kourcia ou le cri de la tourterelle . Niamey : Maggia Images, 2010.
149
147
Ce film montre comment les jeunes gens quittent les villages et reviennent de l’exode grâce aux chansons de cette cantatrice la zabaya Oussey, à la voix envoutante. Cette migration est d’une grande dame aux mille secrets, la cantatrice Zabaya Oussey. Originaire de la région de Tahoua, plus précisément de Guidan Magagi, village près de Galmi, à 82 ans, elle sait toujours influencer les migrants par ses chansons.
Figure 49: La Zabaya Husssey
Elle a commencé à chanter, plus de 50. Le réalisateur, Sani Magori, la sollicite pour faire revenir à travers ses chansons les migrants nigériens de la Côte d’Ivoire dont le Papa du réalisateur. À travers l’usage de proverbes, la Zabaya Hussey, pousse les jeunes gens à la migration. Le film Koukan Kourcia 1, d’une durée de 62 minutes, permet de situer cette migration dans la région de Tahoua. L’originalité de ce film, vient de la zabaya en question, qui témoigne sur ce fait. Dans les échanges avec la cantatrice dans Koukan Kourcia 1, le réalisateur souligne : « Ce qui m’amène c’est que je veux t’amener à Abidjan pour chanter (…) pour que tu demandes à nos pères de revenir à la maison, parce que je sais que c’est toi qui les a poussés à partir ! S’ils t’entendaient le soir (…) ils partaient la nuit même. » Sur ces paroles du réalisateur, la cantatrice reconnait en disant : 148
« Ils quittaient tous sans un sou, c’est vrai qu’ils partaient sans rien, ils travaillaient en chemin pour se payer le voyage. Personne ne résistait à ma chanson ! Même des gens que je ne connaissais pas. Quand je chantais à des cérémonies, les hommes qui m’écoutaient entraient en transe, et ils partaient ! Je n’étais même pas au courant ! C’était tout le temps comme ça ! ». Partant de cet échange entre la cantatrice et le réalisateur du film, on note en profondeur les raisons de la migration (économique, sociale et culturelle) au Niger en général et en particulier dans la région de Tahoua. Ce qui est impressionnant dans les propos de la zabaya, c’est lorsqu’elle indique que les personnes quittaient parfois sans un sou ou entraient en transe. Ce pouvoir se vérifie lorsque la cantatrice a chanté à Abidjan pour un retour au bercail des migrants nigériens. L’aspect culturel de la migration est incarné par la Zabaya, à la voix magique, en langue (haoussa) nationale. Le film nous donne à voir et à écouter les témoignages patents de ceux qui avaient vécu cette situation et, ceux qui subissent les conséquences de cet appel à la migration. Il s’agit là, des filles et fils des migrants, qui n’avaient plus revu leurs parents depuis leur tendre âge. Certains, il y a plus de vingt (20) ans. Dans la séquence de la chanson de retour au bercail, des mots forts avaient été prononcés pour inciter les migrants à revenir au pays. Ainsi, on peut écouter : « C’est le jour de la vérité, je vous somme de retourner au Niger. Où est-il l’homme qui a laissé sa femme enceinte et qui n’a plus vu son enfant grandir ? (…) Nous sommes ici pour ramener ceux qui ne sont jamais retournés au Niger (…) Ouvrez-vous bien les oreilles : C’est la Zabaya Hussey qui m’envoie. Que vous ayez vécu 40 ou 100 ans ici, on va vous ramener150. ». C’est un film, où la femme incarne la conservation des valeurs de la famille dans cette société. Quarante jours après le chant de retour en Côte d’Ivoire, me père du réalisateur était revenu dans son village151. Dans certaines séquences à Abidjan, nous observons une forte communauté de Nigériens, surtout des jeunes. La majeure partie est née pendant le séjour des migrants nigériens, d’il y a 10 à 30 ans. Les photos donnent à voir déjà l’effet, que procure le chant de la cantatrice à travers 150
Magori Sani. Koukan Kourcia ou le cri de la Tourterelle, Op., Cit., 2010. Emission, Entretien Sani Magori et Youssoufa Halidou Harouna dans Patrimoine Ciné n° 34 sur Dounia Tv.
151
149
ses proverbes, que seuls les initiés doués d’intelligence peuvent comprendre, notait Sani Magori152. Dans une de ces chansons, la cantatrice résume la douleur d’une jeune femme, dont son mari était en exode en ces termes : « Kado, fils du paysan, le jour, où tu m’as abandonné, j’aurais été moins malheureuse, si une rivière m’avait emporté, ou si j’étais tombé dans un puit plein de cobras ». Dans ces propos, on ressent la frustration et la désorientation de cette femme de subir l’absence de son mari. Elle aurait voulu être mordu par des cobras ou être emportée par une rivière pour expliquer la peine causée par le départ de son amoureux.
Figure 50: La cantatrice chante me retour au bercail des exodants
Le cinéma documentaire fait sa bonne marche depuis une dizaine d’années. Pour faire vivre les réalités des sociétés. Certains de ces films documentaires sont primés un peu partout dans le monde. C’est le cas du film L’Arbre sans fruit (2015) d’Aicha Macky, titulaire d'une maîtrise en sociologie, d'un Master 1 et 2 en Réalisation et documentaire de création, respectivement de l'Université Abdou Moumouni de Niamey et 152
Emission, Entretien Sani Magori et Youssoufa Halidou Harouna Ibid., Patrimoine Ciné n° 34 sur Dounia Tv du Niger.
150
de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Elle a réalisé deux films lors de ses études, Moi et ma maigreur en 2011 sur la tyrannie exercée sur le corps de la femme nigérienne, qui doit être bien enrobée afin de répondre aux exigences sociales. Savoir faire le lit (2013) décrit la transmission de l'art de la séduction et du sexe entre mère et fille au Sénégal. Son tout premier film professionnel, L’Arbre sans fruit nominé au Fespaco 2017, ne cesse de faire parler de lui, avec une quarantaine de récompenses au national comme à l’international. Dans son pays, elle se distingue avec le prix du public et le prix du meilleur film Technicoartistique à Tounkountchi Festival de Cinéma du Niger en décembre 2016 et à l’international, distingué en juin 2016 aux African Movies Academy Awards (AMAA) au Nigeria, dans la catégorie meilleur film documentaire. Le film se dresse contre certaines barrières de la société, à savoir l’absence de la parole de la femme dans l’espace public. Le scénario est bien construit, avec des scènes de joie, de tristesse et de solidarité, abordant des thématiques diverses (famille, religion, tradition et modernisme) accompagnées de musique. Un film émouvant, avec la séquence des deux femmes infertiles depuis plus de dix (10) ans qui s'apitoient sur leur sort et se consolent mutuellement. La religion occupe une place importante dans le film. La séquence de la visite d’Aicha chez le devin en témoigne. Ce dernier, après consultation de la terre, c'est-àdire des divinités, livre le verdict pour solutionner le problème d'infertilité d’Aicha. Elle doit forcément faire un sacrifice. Cette recommandation des dieux, est donnée presque à toute personne qui fréquente ce milieu lors des consultations. Désespérée, désorientée et mécontente de ces pratiques religieuses, Aicha interpelle sa défunte mère sur son sort. Volontairement ou pas, la réalisatrice réaffirme ses valeurs ancestrales D'une durée de 52’, L’Arbre sans Fruit, nous amène à voir la double souffrance de la réalisatrice qui aborde sa propre histoire. D'une part, c'est une histoire partagée par le mal-être des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfant après plusieurs années de mariage au foyer. D'autre part, l’œil accusateur de la société face à cette situation et la place de la religion tout au long du film sont présents. De jour comme la nuit, la réalisatrice met à l'écran le comportement patriarcal des parents, à l'instar du père d'Aicha Macky. Ce dernier était arcbouté par rapport aux principes comme "la femme ne devrait pas filmer dans un cimetière et de surcroit rendre visite aux morts au cimentière". Mais Aicha a bravé 151
cet interdit et nous montre en plongée le cimetière où repose sa mère, qui a perdu la vie, en voulant donner la vie. L'émergence des femmes dans le cinéma nigérien se traduit par des films nominés et primés. C’est le cas du film Hawan Idi d'Amina Abdoulaye Mamani, qui avait été primé à la 23ème édition du FESPACO (2013) dans la catégorie, meilleur film des écoles. En 2015, aussi, deux films de deux réalisatrices ont été nominés à la 24ème édition du Fespaco (2015). Il s'agit des films : La croix d'Agadez (2014) de Paraiso Charifatou et L'Alliance (2014) de Rahmatou Keita. D'autres femmes sont également actives au national dans les réalisations filmiques, telles que : Ramatou Doulla avec son tout dernier film De la vie à la mort (2015) et tout récemment le film La Colère dans le vent d’Amina Weira, primé au festival Vues d’Afriques au Canada, avec le Prix meilleur court et moyen métrage attribué par l’Organisation Internationale de la Francophonie dans la section Afrique Connexion, et le prix développement durable attribué par l’Institut de la Francophonie pour le Développement durable - IFDD. La doyenne des femmes, Rahmatou Keita décrocha pour son film Zin’ Naarryia à la 25e édition du Fespaco, le prix de la meilleure image. Cette période (2012 à 2017), sort le cinéma nigérien de sa léthargie et pousse de plus en plus les jeunes nigériens à embrasser la carrière cinématographique, parfois sans formation diplômante en cinéma, mais par motivation, engagement et envie d’apprendre.
152
TROISIÈME PARTIE : RAPPORT ENTRE CINÉMA, CULTURE NIGÉRIENNE ET LES AUTRES ARTS
Dans cette partie, nous nous intéressons à la présence d’autres formes d’art pour construire le film. « Cet art de l’espace et du temps n’est pas sans relation avec ses ainés. Le cinéma fait appel à la peinture pour la composition des images, il se souvient de la musique pour trouver un rythme, il observe le roman pour établir un récit, il va chercher des acteurs du théâtre pour les faire vivre à l’écran. C’est donc dire que le cinéma est en rapport constant avec ces arts.153 »
153
https://www.erudit.org/fr/revues/sequences/1958-n14sequences1159036/52230ac.pdf consulté le 29 janvier 2018 à 0940.
153
Chapitre 5 : Le cinéma et les autres arts Ce chapitre analyse les liens qui existent entre ces arts que sont le théâtre, la musique, le roman et le dessin animé pour donner une appréciation objective des films choisis. Notez que tous ces arts se trouvent dans le cinéma nigérien, des années 60 jusqu’à nos jours. C’est pour nous une manière de découvrir en profondeur ce cinéma vieux de 55 ans dont les thématiques des films sont actuelles. Dans un premier point, nous allons essayer de voir le rapport entre le cinéma nigérien et les littératures. Ces littératures peuvent être écrite ou orale. Ainsi le film Toula (1973) de Moustapha Alassane nous permettra d’analyser ce rapport entre le cinéma et les littératures. Le second point va mettre en exergue le cinéma et le théâtre à travers le film Si les cavaliers… (1981) de Mahamane Bakabé. Le film La Mort de Gandji (1965) de Moustapha Alassane montrera le rapport entre le cinéma et le dessin animé et enfin la musique et le cinéma fera l’objet du quatrième point partant des films de notre corpus. 5.1. CINEMA ET LITTERATURES Ce point se propose d’analyser le rapport qu’entretient le cinéma nigérien avec la littérature orale et écrite dans le but de montrer comment le cinéma nigérien s’est ressourcé, bon gré mal gré des formes, des thématiques et des moyens logistiques de l’oralité et de l’écrit ; ce cinéma est hérité de la colonisation dans les années 40. Très tôt avec l’indépendance politique retrouvée des pays africains dans les années 60, une course à la réhabilitation des valeurs africaines, longtemps bafouées par le colonisateur, est mise en scène par les africains. Ainsi dès 1962, des adaptations filmiques sur l’oralité africaine (contes et légendes) voient le jour en Afrique de l’Ouest et Centrale. Les auteurs, qu’ils soient de la littérature écrite, des romanciers de l’Afrique francophone ou même des pays anglophones, la majeure partie
155
sont influencés par la littérature orale, à travers une démarche qui tend selon Ursula et Jean à : « mettre en scène une fiction d’énonciation orale de leur narration: formules introductives ou clausulaires empruntées à la tradition canonique de genres oraux, narrateur personnage, mise en scène d’un narrataire fictif avec lequel s’instaure un dialogue interactif, représentation textuelle de la voix et du corps154. » Et très tôt avec les indépendances africaines, on voit des adaptations de films par des auteurs comme Sembène Ousmane, qui entre 1962 et jusqu’en 1968 « produisit quatre films Borom Sarret (1962), Niaye (1964), La Noire de… (1966) et enfin Le Mandat (1968) qui viennent tous de ses « textes littéraires retravaillés et reprennent des expériences de la vie quotidienne155.» En plus, on peut voir chez les écrivains en Afrique, des femmes engagées pour la préservation de l’oralité à travers leurs romans. Ainsi Ngozi Adichie et Flora Nwapa, toutes du Nigéria voisin, n’hésitaient pas à user des contes pour bâtir leurs romans. Dans le chapitre 16 d’Idu (1970) de Flora par exemple, on notait: « il est « entièrement consacré à une soirée conviviale en famille dans l’attente du retour du père, offre, une série de devinettes, deux contes dont un entièrement chanté156. Et Efuru (1988) de Flora toujours « présente une variante du conte de la fille difficile, dit lors d’une nuit de pleine lune et qui se termine par la mort de l’esprit aux mains de la jeune fille157». Et même, Ngozi Adichie « son premier roman, qui met en scène la double existence d’un notable igbo, comporte lui aussi un conte, entrecoupé, à la façon traditionnelle.158» Au Niger, on peut citer les ouvrages : Contes et Légendes (1972) de Boubou Hama adaptés à l’écran par Moustapha Alassane (Toula, 1973), Dan Zaraïdou (2009) une adaptation filmique d’un conte africain d’Albarka Tchibaou. « Si les cavaliers avaient été là » une pièce de théâtre d’André Salifou et les pièces de théâtre d’Harouna Coulibaly : Barrira, adaptée en film avec pour titre Awa, Le devoir (1995) adaptée en film, avec pour titre Wadjibi (1995). Pour Harouna Coulibaly, ses 154 Baumgardt, Ursula et Derive, Jean. Littérature africaine et oralité. Paris : Karthala, 2013, p6. 155 Vieyra, Paulin Soumanou. Cinémas d’Afrique. Op. cit. , p10. 156 Baumgardt, Ursula et Derive, Jean. Littérature africaine et oralité. Ibid., p59. 157 Baumgardt, Ursula et Derive, Jean, Jean. Littérature africaine et oralité. Ibid. p59. 158 Baumgardt, Ursula et Derive, Jean. Littérature africaine et oralité. Ibid. p59.
156
adaptations filmiques : « C’est uniquement dans un but de mieux faire passer mon message ! Je n’oublie pas que j’ai écrit pour un public majoritairement analphabète et qui adore les pièces de théâtre diffusées à la radio ou à la télévision ! J’ai donc opté pour les pièces de théâtre afin de mieux faire passer mes messages. Chemin faisant, je me suis encore rendu compte qu’il faut un artiste pour mettre l’œuvre en scène. Afin de transcender l’écran noir de la communication entre moi et mon public, j’ai donc préféré opter pour le langage des images, c’est-à-dire le 7ème art, en m’affublant d’une seconde casquette, celle d’écrivaincinéaste159». On rencontre très souvent dans la production filmique du Niger, cette oralité qui se traduit par des proverbes, les contes, les accoutrements, les lieux de mémoire, dans les gestuelles des acteurs, cette oralité qui se vit de nos jours dans la société, malgré le fait qu’on note les effets de l’impérialisme culturel (tenue vestimentaire occidentalisée, langue française, enseignement en français) et les séquelles du colonialisme qui se résument par : « la parole du blanc est une vérité ». Ce qui est plus intéressant, les traditions locales sont retrouvées chez certains cinéastes de la nouvelle génération et chez certains écrivains. Ainsi, on peut voir chez Moussa Djingarey, le cinéaste le plus régulier dans la production filmique ces cinq dernières années avec la réalisation d’un film chaque année, le recours dans ses films aux pratiques mystiques, lesquelles pratiques offrent la latitude à un personnage de consulter les divinités pour un bien ou un mal, au maraboutage. Notons aussi la présence du village, surtout le village nigérien, réservoir de l’oralité, des accoutrements liés à telle ou telle ethnie, le décor filmique, etc. - Le côtoiement entre l’oralité et la littérature écrite du Niger. Dans le même ordre d’idées, Abdoul Aziz Issa Daouda soulignait le rapprochement qu’on retrouve entre les cultures locales, la littérature et beaucoup de films de Nigériens dans son ouvrage La double tentation du roman nigérien. On peut retenir : « La littérature nigérienne, à l’instar de toute la littérature africaine, accorde une grande place à la thématique. L’écriture devient dans les mains des écrivains un instrument de lutte à travers lequel ils 159
Le Sahel du 15 mars 2014.
157
s’identifient à leur peuple en prenant en charge ses préoccupations, ses joies, ses angoisses et ses espoirs. Cette fonction de la littérature n’est pas nouvelle en Afrique, car avant même l’avènement de l’écriture, la littérature orale était le miroir de la collectivité, en ce sens qu’elle véhicule toutes les idées nécessaires à l’évolution harmonieuse du peuple (…) Ceux-ci rendent compte des préoccupations des populations ; de leurs joies et espérances, de leurs angoisses, voire de leur sens de l’échec… » Ce souci de « refléter la société » africaine se rencontre chez les créateurs « modernes», à travers leur peinture des sociétés africaines coloniales et post coloniales. Il n’est donc pas étonnant que la critique de cette littérature adopte une perspective militante. « Classique », elle opte souvent pour une approche thématique et se penche essentiellement sur la période coloniale (dans le cas des œuvres anti-coloniales engagées) et sur la période post-indépendance (en ce qui concerne les œuvres plus contemporaines, dites « du désenchantement160 ». Le Niger n’est pas laissé à la traîne dans cette histoire de réappropriation de l’image exacte, de cette tradition qu’André Salifou161 appelle l’éducation précoloniale, basée sur une organisation de la société sur les aspects éducatif, culturel, économique et politique propres à l’Afrique en général et au Niger en particulier. Ainsi, on retrouve des ouvrages adaptés à l’écran de 1968 à 2010162. C’est ainsi qu’on peut voir Moustapha Alassane le pionnier du cinéma user de l’écrit, lequel écrit est inspiré par l’oralité pour produire ses films. Avec des thématiques multiformes telles que : la femme protectrice, la famille, le village, la royauté et la bravoure. Pour Ursula Baumgardt et Jean Derive : « le critère de l’oralité a été convoqué dès l’origine par la critique comme l’un des critères d’approche possibles – et même privilégiés – de la production littéraire africaine163. » En Afrique noire, les enfants sont bercés au son des contes et les plus jeunes par des histoires fabuleuses autour d’un grand feu par les connaisseurs de cette tradition orale. Depuis plus de cinquante ans, l’arrivée du cinéma en Afrique a contribué à propager la culture africaine en général, et nigérienne en particulier hors de ses frontières à
160
Issa Daouda, Abdoul-Aziz, La double tentation du roman nigérien. Paris : Harmattan, 2006, p37. 161 André Salifou : Pr Emérite et homme politique nigérien. 162 FEPACI. L’éducation africaine traditionnelle, Dakar : Présence Africaine, 1974. 163 Baumgardt, Ursula et Derive, Jean. Littérature africaine et oralité. Op. cit., p5.
158
travers des histoires de certains héros, comme Sarraounia164 ou même Kassaï165, la sœur de l’empereur Sonni Ali Ber. Cette tradition orale se trouve dans les ouvrages de certains hommes de culture, dont le précurseur Boubou Hama, qui veulent préserver et transmettre les valeurs culturelles aux générations qui se succéderont. Véritable outil de transmission et de préservation, le film joue un rôle important dans l’éducation d’un peuple. Dans la charte de la Fepaci, la portée éducative et la créativité à travers le cinéma est soulevé en ces termes : « Dans cette perspective, le cinéma a un rôle primordial à jouer parce qu'il est un moyen d'éducation, d'information et de prise de conscience, et également un stimulant de créativité. La réalisation de tels objectifs suppose une interrogation du cinéaste africain sur l'image qu'il se fait de lui-même, sur la nature de sa fonction et de son statut social et d'une façon générale sur sa situation au sein de sa société166» La littérature orale est très présente dans le quotidien des Nigériens. C’est le cas du conte et de la légende, qui se définissent comme étant des histoires parfois fabuleuses qui plaisent, et peuvent être vraies ou fausses dans un but de distraire ceux qui écoutent et de transmettre les pratiques ancestrales. Justement, Moustapha Alassane, nous donne toutes les raisons de croire, que pour raconter un conte ou une légende, il faut nécessairement des prédispositions pour capter l’attention de l’auditoire. Au-delà même de cette création littéraire, nous pouvons évoquer la création artistique avec les films de Moustapha Alassane. Ses films répondent aux caractéristiques d’un conteur. Le conte relate des faits passés comme l’histoire d’ailleurs mais ils sont tournés vers la transmission des savoirs au présent et au futur. Dans Contes et légendes du Niger (1972) de Boubou Hama, on retrouve des histoires africaines dont Toula. Un conte qui est adapté en film par Moustapha Alassane en 1973. Moustapha Alassane, de manière artistique pose la problématique de la gestion de la famine dans un contexte politique de parti unique. Il reproduit l’écrit, très souvent inaccessible à la majeure partie des populations. Il Intitulait le film Toula ou le génie de l’eau. 164
Mamani, Abdoulaye, Sarraounia. Paris : Harmattan, 1980. Edourd Lompo, Amadou, Kassaï, la sœur de l’empereur. Paris : Harmattan, 2015. 166 Charte de la FEPACII du 18 juin 1975. 165
159
Dans Samba le grand (1977) un autre conte adapté par Moustapha Alassane, la reine, malgré les défis lancés à Samba Gana, que ce dernier a gagné, reste toujours insatisfaite. Samba Gana lui demanda « Pourquoi ne ris-tu pas ? ». Elle répondit « Anyatoubari c’est vrai, j’ai maintenant tout ce que je voulais et tout le monde me respecte. Mais je ne peux pas rire, je ne peux pas rire devant la souffrance de mon peuple ; je ne peux pas rire parce que le serpent Issa Béri nous demande trop pour nous donner de l’eau. Une fois, chaque année, il nous demande une fille et c’est seulement après ce sacrifice qu’il nous permet de prendre l’eau, tant que ce serpent Issa Béri vivra, je ne pourrai pas rire167. » Dans ce film, comme d’ailleurs dans Toula ou le génie de l’eau, le roi et la reine sont les protecteurs de leurs communautés. On peut aussi voir une continuité de Toula dans le film Samba le grand. A la fin du film Toula, on voit la nièce du roi se faire engloutir par le serpent, acte après lequel le village retrouva la pluie et la prospérité. Le dénouement dans Samba le grand se fait lorsque la princesse, après la mort de son père, s’est fait venger par un héros, qui tua le serpent Issa Béri au bénéfice des villageois. Mais le film a une fin dramatique car la princesse et le héros se tuèrent, en laissant des marques aux villageois. Ces deux films (Toula, et Samba le Grand), nous apprennent l’importance du don de soi pour le bien commun. Dans les deux films, un sacrifice, certes dramatique a sauvé tout le village de la famine et du manque d’eau. On voit aussi, que les sacrifiés sont consentants du sort qui leur arrive. La séquence de l’affrontement imaginaire dans un esprit de vengeance d’Ado le fiancé de Toula contre le grand Babouri, le géomancien, le devin, le féticheur montre l’échec de l’individu à faire changer des pratiques ancrées dans la société. Dans une voix off, on entend dire : « Ado a voulu tuer le féticheur, Ado a voulu tuer la tradition qui a tué son amour, mais la tradition était aussi puissante que son courage. » L’acteur se résigne aux lois de la société pour le vivre ensemble.
167
ALASSANE Moustapha, Samba le Grand, Animation, 16mm, couleur, 1977.
160
Figure 51: Le devin en consultation
Sur l’image, on voit le féticheur pour certains le devin qui est en train d’invoquer les divinités dans sa demeure. Dans le plan d’ensemble plusieurs objets (statuettes) évoquent la grandeur de ce devin à craindre. Le film étant tourné en 1973, donne à voir la culture nigérienne dans tout son esthétisme et surtout la place des divinités dans la vie sociale de l’époque. Au Niger, même à nos jours, le devin occupe une place importante dans la société. Les politiques, les fonctionnaires, les salariées, le citoyen ordinaire fait appel aux services du devin pendant des moments difficiles de leur vie ou même, lorsqu’ils veulent que leurs activités prospèrent. Dans le film, nous voyons que le devin est au service du roi qui n’hésite pas à le consulter pour des questions de sa société. Les images ci-dessous montrent combien la place du devin est importante. A la demande du roi, Babouri le féticheur dans une chorégraphie bien orchestrée avec des pas de danse, du chant et du tamtam, incontournables pour la circonstance, est arrivé à faire venir le dieu pour l’écouter sur l’inquiétude du roi. Pour le dieu, il faut un sacrifice humain pour faire revenir la pluie et l’abondance de la culture.
161
Figure 52: Le devin et sa parure
Le roi n’a que deux solutions, soit obéir aux recommandations de la divinité et faire partir la souffrance de ses sujets, soit la disparation totale du village. Dans une technique cinématographique, à travers des effets spéciaux, Moustapha Alassane fait voir des images illusoires, qui projettent l’avenir du village. La mare se remplit, les champs cultivés, les greniers remplis, les cultures en abondance, les troupeaux bien gras. Tout ceci n’est que mirage. Mais, on note que dans le film, le roi et ses sujets ont cru aux doléances des dieux pour atténuer la souffrance des villageois, en leur donnant la pluie et en éloignant la sècheresse qui a décimé les troupeaux. Le film est aussi l’affirmation de plusieurs identités locales à travers les tenues vestimentaires des hommes et des femmes. De même, très souvent, les réalisateurs font recours à une identité culturelle locale comme les scarifications artificielles, qui peuvent orienter certaines personnes au Niger identifier l’ethnie de telle ou telle personne à partir de ses traits physiques. Il est important, voire nécessaire d’approfondir les recherches sur la connaissance des ethnies du Niger, en recensant et en mettant l’accent sur le gestuel, l’accent et bien d’autres éléments de la culture. Cela peut se faire à travers le cinéma, surtout les films d’avant la 162
colonisation et des années 60 -70 pour préserver et valoriser les patrimoines culturels du pays. Le film Toula ou le génie de l’eau, est ancré dans l’esprit de nombre de Nigériens. Moustapha Alassane à l’époque veut peut-être montrer l’appartenance de la société à ses traditions, qui concourent à la cohésion sociale. Pour Pr Antoinnette Tidjani Alou : « Cette figure mythisée a inspiré au Niger des ballets folkloriques168 ». Mais aussi des chansons, dont celle de Mali Yaro169. Sur ces images tirées du film Toula (1973), la beauté de la femme et les tenues traditionnelles sont mises en valeur. Comme, du reste, dans toutes les grandes manifestations. Des tenues qui souvent s’identifient à des régions ou des ethnies du Niger.
Figure 53: Toula dans une parure traditionnelle
On remarque aussi un style vestimentaire, qui, de nos jours, tend à disparaitre ou à être remplacé par les tenues exportées. En regardant les tenues, c’est qu’on constate une certaine liberté dans l’habillement comparativement aux tenues de nos jours qui couvrent totalement le 168
Tidjani Alou, Antoinette, Sarraounia et ses intertextes : identité, intertextualité et émergence littéraires, article consulté le 11 février 2018 sur http://www.sudlangues.sn/IMG/pdf/doc-102.pdf. 169 Abdoulaye Maiga dit Mali Yaro, Artiste musicien, auteur, compositeur nigérien avec 3 albums à son actif.
163
corps. Celles d’aujourd’hui sont recommandées dans la culture musulmane qui prend de plus en plus de place dans la société nigérienne et avec lesquelles, cette société s’adapte sans complexe. A travers les films des années 60 -70, voir le corps (visage, bras, etc.) de la femme n’est pas un tabou. Même à la cour royale.
Figure 54: Toula et ses amies
5.2. CINEMA ET THEATRE Considéré comme un genre littéraire, le théâtre est d’abord un texte avant de faire appel à des comédiens pour restituer ce texte. L’ouvrage De l'écrit à l'écran : les réécritures filmiques du roman africain francophone relève les relations qui existent entre la littérature et le cinéma en Afrique, dans le traitement des thèmes, des pensés et à travers la part, plus grande, faite des tradition s orales dans les adaptations de l’écrit aux images, accompagnées par les techniques cinématographiques (montage, ellipse, plongée, insert, etc.). Souvent comme l’a souligné Alexie Tcheuyap, la réécriture filmique était très critiquée par des penseurs. Il a fallu attendre 1959, pour qu’André Bazin ouvre le débat en démontrant : « qu’il ne saurait exister 164
un quelconque cloisonnement entre les arts, lesquels s’impliquent fatalement les uns aux autres ». En Afrique, plusieurs pièces de théâtres ont été adaptées au cinéma. Nous l’avons évoqué plus haut, qu’Harouna Coulibaly adapte ces pièces de théâtre au cinéma. Pour Alain Garcia, l'adaptation peut prendre jusqu’à trois tendances, celle qui « trahit le cinéma en étant trop près de la littérature», l'adaptation libre qui « trahit le roman en prenant trop de distance vis-àvis du roman », puis la transposition qui, elle, « ne trahit ni l'un ni l'autre en se situant aux confins de ces deux formes d'expressions artistiques170». On note qu’en Afrique comme ailleurs lorsqu’il s’agit d’une réécriture, le récit est reconstruit. Les cinéastes transposent librement le texte initial, malgré le fait qu’ils en conservent, le plus souvent, l’esprit. Med Hondo, à travers son adaptation filmique de l’ouvrage Sarraounia d’Abdoulaye Mamani, qui porte le même nom du film, a su transposer dans le film, les grandes étapes de la pénétration coloniale de la France au Niger. Mais c’est tout autre au Niger où on voit des hommes et des femmes de Lettres défendre le cinéma comme le moyen le plus adéquat pour porter un discours. C’est le cas de Professeure Antoinette Alou Tidjani171, qui s’adonne aux métiers du cinéma. Elle est scénariste et réalisatrice dans les films de ses étudiants. Une manière de dire que ce positionnement du théâtre n’a plus sa raison d’être avec cette forte industrialisation du cinéma. Jadis, on peut regarder le théâtre que sur scène. Maintenant les gens de théâtre, essaient de créer d’autres appellations pour ne pas se sentir « ridiculisés » par les cinéastes. On entend chez ces gens de théâtre dire : théâtre filmé ou même théâtre documentaire. Au lieu de se fondre dans le cinéma, il y a toujours un alibi pour avoir un pied dans leur théâtre et nier totalement la grandeur du cinéma comme étant un art englobant, un art pur. Au Niger, certains écrivains, comme Harouna Coulibaly172 n’hésitent pas à scander avec joie leur statut de cinéaste. On peut, aussi, voir des
170 Tcheuyap, Alexie. De l'écrit à l'écran : les réécritures filmiques du roman africain francophone. Ottawa: Presses de l'Université́ d'Ottawa, 2005, p20. 171 Tidjani Alou, Antoinette : universitaire actuellement à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et responsable du Laboratoire d’Etude et de Recherche pour la Valorisation du patrimoine (Lervap). 172 Coulinaly, Harouna : fiscaliste, écrivain, dramaturge et cinéaste nigérien.
165
pièces de théâtre adaptées au film. C’est le cas de Si les cavalier… de Mahamane Bakabé qui fait partie de notre corpus. Si les Cavaliers avaient été là173 est une pièce de théâtre d’André Salifou, une histoire pendant l’occupation française au Niger, à partir de 1906. Mahamame Bakabé174 l’a adaptée au cinéma. Le film retrace l’histoire du Niger pendant la période coloniale où la chefferie traditionnelle occupe une place très importante dans la destinée des populations. Dès les premières séquences, on voit des hommes âgés en boubous175 jouer avec des instruments de musique traditionnelle à la devanture du sultanat et le sultan de Zinder dans sa cour avec un honorable.
Figure 55: Le sultan et un des notables
Ces hommes constituent une population qui vivait de l’agriculture et vivait dans l’harmonie. Dans le film, le réalisateur montre une scène de récolte de mil où les cultivateurs sont armés de force et de courage pour 173
Si les cavaliers avaient été là : Pièce de théâtre écrit en 1975 par André Salifou. Bakabé, Mahaman : ancien instituteur et retraité de l’Etat. Réalisateur et producteur. Il crée une école en audiovisuel : Studio Inter Média. 175 Boubou est une tenue traditionnelle qu’on retrouve au Niger et dans plusieurs pays de ‘Afrique de l’Ouest à dominance musulmane. 174
166
cette tâche. Pour encourager ces jeunes travailleurs, un homme chante et danse aux rythmes du tam-tam, les galvanisant. Les jeunes filles apportent des calebasses remplies de boule. Certaines filles vont jusqu’à essuyer le visage de leur bien aimé. La société est organisée socialement et ses pratiques sont ancrées dans les mœurs. L’arrivée des tirailleurs français va bouleverser toute une tradition. Ainsi, commence l’organisation coloniale avec les tirailleurs africains, d’abord par l’implantation d’un camp de militaire, le Fort Cajemazou. Ce camp militaire est le référant du Camp de Tcharoye (1987) au Sénégal, avec les tirailleurs africains revenant de la seconde guerre mondiale, dans ce film de Sembene Ousmane. Une seule identité frappante dans les deux films, la présence du drapeau tricolore hissé en haut de la compagnie, pour signifier le territoire français. Pour renforcer le camp, les blancs envoient les tirailleurs nigériens à la chasse des bras valides. Ainsi commence le désordre dans tout le village. Dans la troisième séquence, un groupe de six (6) tirailleurs nigériens qui chantent et dansent dans les ruelles, fait fuir les enfants en direction de leurs concessions. Les soldats profitent de leur statut pour semer la pagaille, à l’instar de cette séquence qui les montre au marché en train de piller les biens des marchands. Les Tirailleurs violent les femmes des citoyens et ne rendent compte à personne. Les villageois sont victimes de travaux forcés.
Figure 56: Les tirailleurs nigériens en patrouille
On les voit dans plusieurs séquences à travers des scènes. Certains extrayaient péniblement de grosses pierres qu’ils concassaient à l’aide de 167
gros marteaux, d’autres peinaient à prendre des gros bois, le tout sous la surveillance des tirailleurs, leurs congénères. Un peuple sous le joug de l’administration coloniale.
Figure 57: Les bras valides au service du colon
Ces images, montrent le non-respect de la dignité de l’être noir. Des écrivains nigériens en ont fait l’objet d’écrit, à l’instar de Mahamadou S. Halidou dans son œuvre Caprice du destin176. Dans cet ouvrage il nous offre de larges fresques de notre histoire coloniale. Les tirailleurs africains maltraitent leurs frères. Malgré la souffrance endurée, les villageois, continuent à travailler sous l’autorité musclée de leurs frères tirailleurs. Dans ce roman nous avons l’exemple de Kafi Rana Zahi, qui a une attitude tout à fait démoniaque vis-à-vis de ses frères avec sa chicote qu’il appelait sa maza goudou. Dans l’œuvre Sarraounia, Abdoulaye Mamani, l’auteur, retrace aussi l’époque coloniale, il privilégie la satire anticoloniale. En effet, Mamani expose la mission Voulet et Chanoine sur le territoire nigérien. Pour mener à bien leur mission, ils ont formé une troupe de tirailleurs nigériens qui combattent à leur côté. On constate la fureur des Africains avec des armes en mains capables de toutes les exactions sur leurs frères noirs. Tous au service des maîtres blancs. Certains vont jusqu’à colporter des informations pour leur gagne-pain. Le rôle de Kandé dans le film Si les cavaliers… en témoigne. Elle collecte des informations auprès des mendiants et des amies avant de les rapporter aux Blancs. Zalika Souley 176
Mahamadou Sabo, Halidou. Caprices du destin. Niamey : INN, 1981.
168
qui jouait Nana la commère, a parfaitement joué son rôle, en courant, en se voilant, prête à tout pour avoir des informations. Du côté de la chefferie, le roi et les notaires cherchent une solution pour mettre fin aux désordres et vaincre les « mécréants ». Comme à l’accoutumée le roi fait appel au grand géomancien du village. Une scène montre le géomancien devant le roi assis avec une calebasse pleine de sable, interpréter les recommandations des dieux. De l’autre côté, dans la nuit, autour du thé, d’autres fils du village réunissent leur force à la demande du roi pour associer d’autres chefs de villages voisins à leur cause. Tous pour vaincre l’ennemi commun. Car comme dit l’adage : « si tu vois la barbe de ton voisin prendre feu il faut mouiller la tienne, car le feu n’est pas très loin ». Ainsi, la culture est très valorisée dans le film, pour donner du sens à la chefferie traditionnelle. Et c’est le cas de la place du griot dans la société traditionnelle, la manière de saluer les nobles, la chanson traditionnelle (tamtam, musique traditionnelle) et surtout le rôle que joue l’islam à côté de l’animisme. Les femmes sont presque toujours avec la calebasse en main. La calebasse occupe une place importante dans la société traditionnelle nigérienne, elle symbolise le ventre d’une femme enceinte. C’est aussi un matériel qu’on utilise pour donner à manger et à boire aux hommes. Beaucoup de symbolique dans ce film de Mamane Bakabé pour porter à l’écran un pan de l’histoire du Niger. Mais l’union n’a pas suffi dans le film pour faire partir le colon. Car il a été plus stratège : il a utilisé des nigériens pour s’implanter et détourner toutes les adversités de la chefferie traditionnelle. 5.3. CINEMA ET DESSIN ANIME « Le dessin animé ou dessin sur film ou film d’animation est une : « technique d’animation, où s’est illustré McLaren, il consiste à dessiner, prendre, graver « graffiter » sur la pellicule, sans caméra177 ». Justement, Moustapha Alassane, pionnier de ce genre cinématographique au Niger, l’avait appris avec McLaren au Canada au cours d’un stage, où il a réalisé le tout premier dessin animé d’un africain en 1961 : D’autres films d’animation suivirent dont La mort de Gandji. Un très court métrage de 8 minutes, dans lequel Moustapha Alassane relate l’histoire 177
Journot, Marie-Thérèse. Op. Cit, p33.
169
d’un village crapaud menacé par un monstre. Rien qu’à travers le deuxième mot du titre, le film demande beaucoup d’attention. Gandji en langue zarma, veut dire Diable. Pourquoi le choix d’un mélange de la langue française et du Zarma, très tôt dans le cinéma ?
Figure 58: Image dans le générique de début du film La Mort de Gandji
La traduction en français explicitera la mort du Diable. Déjà dans les années 60, on peut dire que la promotion et la valorisation des langues locales étaient une priorité pour Moustapha. On se rappelle du film Aouré, (1962), sa toute première fiction, dont le titre est en haoussa. Il est important de noter qu’il n’est pas rare aussi, d’entendre dans les contes et légendes en Afrique et précisément au Niger, le lien entre la vie des hommes en communauté et la vie des animaux, comme l’a souligné Mariama Hima : « En Afrique comme ailleurs, dans les contes, les animaux sont assimilés aux hommes. Ils n’ont d’animal que leurs noms respectifs car les rapports qu’ils entretiennent sont des rapports humains. Sous le couvert du lion, du lièvre, de l’hyène, de l’araignée, le conteur, la grand-
170
mère présente des institutions et des comportements sur lesquels chacun peut s’exprimer librement178». Moustapha Alassane, nous amène à suivre, à la manière dont racontent les savants, les contes aux enfants et aux jeunes, le film réalisé lors d’un stage au Canada en 1964. À l’entame de la première séquence, il commence par : « Dans un petit village, vivait une société paisible des crapauds L’un d’entre eux, nommé Abdou était en promenade, par malheur, il se trouva devant un animal étrange qui faisait terriblement peur179. Un gros monstre qui fait fuir Abdou le villageois et le représentant du chef de village, envoyé pour confirmer le dire d’Abdou. » En l’absence du feu allumé la nuit pour écouter un conte, le téléspectateur se retrouve dans la forme classique de conter une histoire. L’on s’imagine en face du conteur. Une façon plus agréable de passer des messages à travers le cinéma, surtout avec les connaisseurs des contes qui se font rares de nos jours. Nous nous rappelons que, dans les années 80-90, pour écouter un conte, une personne âgée, assise devant nous, nous narrait le conte. On s’imagine dans un film d’action où parfois le conteur en fonction de la partie de l’histoire utilise une voix grave, moins grave, moyennement grave et parfois même les mains pour jouer et faire semblant de casser des branches. Nous pouvons noter aussi, à travers le film La mort de Gandji, l’organisation du village autour de leur chef, qui se préoccupe de la vie de la communauté pour le meilleur et pour le pire. Bien d’autres films d’animation ou de fiction de Moustapha Alassane réservent une place pas des moindres à la chefferie et au héros. Héros qui peut mourir dans le film. Sur ce plan d’ensemble de cette image du film, on observe les villageois venus écouter le chef pour trouver une solution à un problème d’intérêt général.
178 179
Notre Librairie. Op. cit. , p40. Alassane Moustapha, La Mort de Gandji, Montréal : ONTC, 1965.
171
Figure 59: Une cérémonie à la cour royale du village des crapauds
Au service de sa communauté, le roi, dans l’esprit de Moustapha Alassane, reste à l’écoute de son peuple ; un roi qui s’informe sur tout ce qui touche à son royaume. Les films de Moustapha Alassane, donnent un aperçu du roi idéal. Le cinéaste nous le montre à travers des actes magnanimes du roi dont la récompense des plus méritants du village, qui font montre de bravoure ou qui se distinguent en fonction de telles ou telles attentes du roi. Ainsi, on peut voir dans le film Dan Zairaidou (2009), un autre film réalisé par Moustapha Alassane, l’acteur principal s’adjuger la sympathie du chef à travers sa bravoure, lors d’une attaque de l’ennemi. Cet acte a généré la satisfaction du roi qui, en reconnaissance, affranchit Dan Zairaidou, « Prisonnier », qui retrouve sa liberté en récompense pour son courage. Il regagne alors son village pour reprendre le trône. Dans le film La Mort de Gandji, le roi récompensa la mante religieuse, qui, par un stratagème, tua le monstre du village. La mante religieuse épousa la fille du chef du village en guise de récompense. Ici, il faut noter la proximité du chef du village avec son peuple et surtout la place du méritant dans le cœur du monarque. Ce sont des films, qui, certes, s’apparentent plus à des dessins animés, mais qui véhiculent des idéologies que le réalisateur veut faire passer. Le dernier film cité est un film engagé, qui s’i l est réalisé de nos jours avec des acteurs 172
professionnels entrerait dans la catégorie des films tellement critiques qui se verraient censurés au Niger. Mais c’était le cinéma à ses débuts au Niger portant encore les marques de l’oralité. Au Niger, par exemple, la culture, est de plus en plus dans les débats, les radios, les télévisions ou même au niveau politique. Les uns et les autres espèrent et demandent une reconversion des mentalités à travers un retour aux principes qui ont fondés la société. Des principes de cohésion sociale, de solidarité, des principes qui reposent sur le vivre ensemble, que les contes et légendes nous enseignent. Se réapproprier sa culture devient de plus en plus une nécessité au regard surtout des images moralement déviantes qui inondent les télévisions africaines en général et nigériennes en particulier. Dans ce sens, le Centre d’études linguistiques et historiques par traditions orales (CELHTO) et beaucoup d’universitaires sont les portes flambeaux et les conservateurs de l’oralité en Afrique. Reste à présent, la vulgarisation à travers des supports légers, libres et faciles d’accès afin de consolider les cultures africaines et donc nigériennes et pour renforcer le brassage culturel des peuples d’Afrique. Les films de Moustapha Alassane proposent une façon de transmettre la culture africaine à travers des canaux souples, qui permettent de vendre les valeurs des sociétés de l’Afrique dans sa totalité. Le cinéma devient dès lors un conservateur et un véhicule de la tradition orale au même titre que ses autres socles et canaux. Le Niger a une pluralité culturelle qui renferme un grand potentiel économique et social. La diversité culturelle fait du Niger un espace sur lequel toute action de transmission est possible. Les ethnies se parlent, se taquinent. Le mariage interethnique est une réalité. Cela cimente les couches sociales et ethniques consolide la paix et préserve la quiétude de la communauté. Tous ces aspects sont gagés du raffermissement d’une culture basée sur l’oralité porteuse de valeurs d’une société où chacun joue son rôle à l’image du griot, dépositaires de la parole et des savoirs séculaires qu’elle contient. Le griot joue, en effet un rôle prépondérant dans la transmission des messages et la préservation de la parole. Dans les films nigériens, pour mobiliser, la population et pour partager, le griot est au premier rang. Tous les films de Moustapha Alassane rendent hommage à cette classe socio culturelle.
173
Figure 60: Les crapauds jouent avec les tambours
Il est aussi important de relever la place du cheval, animal de prestige, dans la vie du roi ou du chef dans les films. Cette tradition est encore observée de nos jours dans les différentes chefferies ; une pratique ancrée dans la société au Niger. Le cheval symbolise l’élégance, la richesse et le pouvoir. Très souvent dans les fêtes nationales (lutte traditionnelle, anniversaire de la proclamation de la République, etc.) le cheval harnaché est toujours présent et monté par des dignitaires., Également donné en cadeau chaque année au champion national du sabre ou même à certaines autorités politiques d’Afrique et d’ailleurs, le cheval est toujours un présent de prestige et de grande estime vis -à-vis de celui à qui on l’offre. Sur cette image, on voit le chef entouré de sa garde rapprochée avec un parasoleil pour le protéger des rayons de cet astre ; ce qui est réellement observé dans les cours royales du Niger lors des sorties du chef. Selon monsieur Boulama Aldoulkarim180, le cheval est un héritage de l’islam. Il symbolise le prestige. Il préparé mystiquement et entretenu pour accueillir le sultan. On peut dire que le cinéma nigérien, même dans les films fictions, reflète la réalité de sa société. Plusieurs films documentaires classés comme fictions de ce corpus montrent les traditions nigériennes dans leur ensemble.
180
Boulama, Adoulkaim : Secrétaire du sultanat de Zinder, entretien téléphonique du 21 février 2018 à 15h29mn.
174
Figure 61: Le roi crapaud à cheval avec 2 gardes
Le dessin animé pratiqué au Niger comme par Moustapha Alassane est un moyen efficace de contribuer à la valorisation du patrimoine culturel du Niger à travers ses contes et légendes. Dès lors le cinéma devient le dépositaire de la tradition le plus efficace et le plus accessible pour sa transmission, surtout si on l’on considère le taux d’analphabétisme au Niger. Car En effet, le film ne demande pas un niveau d’instruction poussé pour comprendre et tirer profit des messages qu’il transmet. 5.4. CINEMA ET MUSIQUE En marge des images, il n’est pas inintéressant de se pencher sur l’apport de la musique dans les films des réalisateurs nigériens. Il faut, tout d’abord, noter que la musique joue un rôle pas des moindre dans la conduite séquentielle d’un film. Elle capte l’attention du spectateur. Certaines musiques de films peuvent exprimer les sensations des personnages et d’orienter le spectateur de la suite d’une séquence.
175
Le film et la musique ont un lien qui date depuis le cinéma muet. En effet les réalisateurs illustraient à cette époque, le récit filmique par la musique, parfois jouée en direct. « La musique entre dans la constitution d'un film au même titre que le scénario, la réalisation, le jeu des comédiens, la photographie et le montage. Elle a d'ailleurs toujours été associée aux images animées projetées sur écran bien avant que les notions de structure dramatique, de mise en scène, de direction d’acteur, de traitement de la lumière et de découpage d'une scène en plusieurs plans apparaissent181 ». Pendant le cinéma muet, les réalisateurs ont fait recours à la musique pour donner un tempo aux films182. On constate très souvent que la musique du film donne une information avant même de voir un plan ou une séquence sur un aspect donné. La musique structure le film pour intéresser davantage le spectateur. « Le compositeur Aaron Copland aimait dire que la musique de film est "la petite flamme placée sous l’écran pour l’aider à s’embraser". La "petite flamme" dont parle Aaron Copland peut changer toute la luminosité et la chaleur d’un film. Parfois, le feu se transforme en incendie. Surtout lorsque le réalisateur décide sciemment d’amplifier la flamme par ses propres moyens. La musique devient alors plus forte que la direction d’acteur ou que les intentions de montage. Bref, elle prend le pas sur le film lui-même183 ». Ainsi, très tôt dans le cinéma nigérien, les pionniers de cet art ont fait appel à la musique pour accompagner le film. Cette musique du film est de deux types. C’est ainsi qu’on peut voir dans les films de Moustapha Alassane des compositions originales spécialement conçues pour le film. C’est le cas du film Le retour d’un aventurier (1966) et tous ses films d’animation. D’ailleurs historiquement, les films d’animation d’autres cinéastes, tels que Djingarey Maiga, Mahamane Bakabé, Oumarou Ganda et même de la nouvelle génération, n’hésitent pas à faire recours à cette musique tradi-moderne du terroir. La musique essaie de contenir
181 https://www.universalis.fr/encyclopedie/cinema-realisation-d-un-film-musique-defilm/#i_17191, consulté le 21 février 2018. 182 Ibid., Consulté le 21 février 2018. 183 http://www.france24.com/fr/20130321-quatre-mariage-siecle-entre-musique-cinemalimites- indiasong-duras-kubrick-odysseeespace-lelouch-lai-trintignan-legand, consulté le 15 février 2018.
176
l’ouïe du spectateur, certains cinéphiles se retrouvent dans leur culture à travers des compositions musicales qui agrémentent le film. « La musique ne se contente pas d’accompagner en imitant. Elle peut commenter, conforter, compléter ou contredire le discours des images et des dialogues. Déjà, certaines imitations en porte à faux sont des commentaires. Mais la partition musicale suit le mouvement du film de deux façons : soit elle appuie ou souligne le sens déjà présent (Michel Chion dit que cette musique est « empathique ») ou, au contraire, elle la contredit ou, du moins, elle exprime autre chose (musique « anempathique »). Ces musiques qui accompagnent le récit peuvent aller jusqu’à l’organiser (C’est le cas du Prélude, Choral et Fugue de César Franck, dans Sandra) ou à le piloter entièrement, comme dans certains musicaux. Les ruptures (anempathiques) sont devenues très nombreuses au cinéma184.» Le film Wadjibi ou le devoir (1996) de COULIBALY Harouna répond bien à ces caractéristiques. Certaines séquences du film sont accompagnées d’une mélodie en fond sonore ou même d’une composition musicale jouée en direct dans le film. Les exemples des séquences où El Hadj Karanbani avait organisé un dîner avec l’Inspectrice des Impôts et celle du medley de chansons jouaient en direct par des artistes musiciens nigériens dont Adams Junior, Fati Mariko, Moussa Poussi, avec un orchestre, en sont des illustrations. Dans ce film, la musique est prise comme un personnage à part entière. Tout au long du dîner « amoureux », le réalisateur a préféré un fond sonore qu’aux paroles du couple qui marchait, causait et dînait dans une ambiance d’un restaurant V.I.P, avec des serveurs en service.
184
http://books.openedition.org/pur/739?lang=fr , consulté le 21 février 2018.
177
Figure 62: Le commerçant avec une inspectrice au restaurant
Dans la séquence du medley de chanson, tout se déroulait sur la scène du bar dancing. On voit des femmes qui dansent au rythme de la musique, les invités qui papotent et boivent dans l’ambiance musicale.
Figure 63: Des musiciens jouent au bar dancing
178
La musique n’a pas écarté le thème du film qui porte sur le devoir de payer les impôts. Elle l’a accompagné au point d’en ressortir un lien étroit. Sur la scène de la musique, les uns sont contents de vivre l’ambiance, mais El hadj Karambani malgré qu’il soit avec sa femme et quelques amis semblent être inquiet à entendre les conseils de son ami commerçant, relatifs aux non payements de ses impôts.
Figure 64: Des fêtards au bar dancing
Il faut noter une évolution dans la relation cinéma et musique. Cette dernière fut tour à tour : « servante, accompagnatrice puis enfin collaboratrice et même inspiratrice. Un couple pas toujours en phase, mais un couple où la musique peut se mettre en contrepoint de l’image pour mieux servir l’histoire du film185». Tous les films de notre corpus répondent à un aspect de cette citation, soit dans les génériques ou dans la narration du film. Ceci, pour souligner que le cinéma nigérien suit la marche cinématographique mondiale. Mais la question qui se pose ici est : le cinéma nigérien 185
Guiraud, Bernard. La musique au cinéma et dans l’audiovisuel . Nice : Baie des Anges, 2014.
179
évolue-t-il ? Mais en faisant appel à des professionnels de tous les métiers du cinéma, on tend forcement vers une qualité dans les productions filmiques et cela avantage une industrie cinématographique. Ce chapitre nous a permis de voir les rapports entre le cinéma et les autres arts. Ce sont des rapports qui ne sont pas toujours dénués de tensions, si on s’en tient aux discours des hommes de théâtre, qui trouvaient que le cinéma est un art impur. Mais il faut noter tout de suite que le cinéma et la musique se sont acceptés dans une relation d’égalité. Et, de nos jours cette relation permet de voir dans les films, des figures emblématiques de la musique. Nous pouvons citer Angélique Kidjo186, qui est l’actrice principale dans le film The CEO187. Les littéraires eux voient très tôt que le cinéma est un outil qui va permettre de transmettre un message à la plus grande masse et le cinéma puise encore dans l’oralité et les récits pour fabriquer de films. Enfin, le lien entre le dessin animé et le cinéma n’a posé aucune difficulté par les acteurs des deux parties. Au contraire, le dessin animé bénéficie du septième art pour sa promotion. Voilà en somme, ce qu’on peut retenir des rapports entre le cinéma et les autres arts.
186 187
Angélique Kidjo : Actrice, zuteure et composteuse béninoise. Film sorti en 2016 et réalisé par le réalisateur nigérian Kunle Afolayan.
180
Chapitre 6 : Le Niger dans les rencontres cinématographiques et les perspectives Le cinéma est un témoignage vivant, de ce qu’il y aurait à prendre ou à laisser à une génération. C’est la mémoire d’un peuple. À travers lui, les jeunes générations voient, de façon imagée, les différentes mutations de leurs civilisations. C’est un art qui transcende les pesanteurs de l’analphabétisme. Prestigieux au départ, le cinéma nigérien a connu une évolution en courbe. La production (financement, réalisation, exploitation) dans les années 60-70 était gérée par les structures étrangères (COMACICO SECMA) en Afrique Occidentale Française (AOF). Elles sont héritées de la colonisation. Avec un désir de s’approprier du circuit de la filière cinématographique, les cinéastes africains ont exprimé le désir de la création des structures africaines. Mais, très vite ces structures (CIDC-CIPROFILMS) qui sont créés par les Etats pour accompagner la production et la distribution des films africains seront confrontées à des difficultés d’ordre financier. En cinq années d’exercice, toutes les stratégies du CIDC-PROFIMS tombent à l’eau et dans les années 80, entrainent, les structures de distribution des Etats membres. Les télévisions nationales de ces pays membres dont l’ORTN ont pris la relève dans la production et la diffusion avec la réalisation des films de sensibilisation. Et, depuis les années 2000 à nos jours, une nouvelle vague de cinéastes nigériens arrivent sur la scène cinématographique. Les rencontres cinématographiques (festivals, résidences d’écritures, etc.) se multiplient pour accompagner les efforts des jeunes cinéastes. Il faut aussi souligner une forte utilisation des plateformes de diffusion comme You tube, pour parler de diversification de diffuseurs. L’exemple de la production du Nigeria est aussi, un modèle efficace de diffusion depuis les années 2000. Le système de la vidéo au Nigéria, qui est basé sur des supports sous forme de CD ou DVD. Ce modèle est dédié spécialement pour une consommation locale, hors des chaînes des diffuseurs classiques (salles de cinéma et télévisions).
181
6.1. LES RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES Par rencontre cinématographique, il faut entendre les activités qui touchent le domaine du cinéma dans le cadre de sa préservation ou de sa promotion. Parmi elles il faut citer : les festivals nationaux, les festivals internationaux, les résidences d’écritures, les formations de post productions, les rencontres avec les partenaires nationaux et internationaux, etc. Au plan national, la manifestation la plus célèbre organisée au Niger est la rencontre des cinéastes africains en 1982, d’où est sorti le manifeste de Niamey; un des évènements historiques du cinéma africain sur la production et la distribution cinématographique en Afrique. A l’issue de ce colloque, plusieurs résolutions et recommandations sont prises en faveur de l’industrie du cinéma africain. Après, des initiatives sont prises dans le sens de redynamiser le film nigérien : ➢ La Semaine Oumarou Ganda initiée par le Ministère de la Culture est créée par arrêté en 1985 pour rendre hommage à l’illustre disparu en 1981. Cet événement cinématographique est mis en veille par les autorités de tutelle au bout de 2 éditions seulement. Pour l’ancien directeur du Cinéma et de l’Audiovisuel du Ministère de la Culture Razak Mamane, cette Semaine Oumarou Ganda existe toujours à travers les textes qui l’avaient créée. ➢ Des initiatives privées tentent d’appuyer la promotion du cinéma au Niger. Ousmane Ilbo a créé, en 1994, les Rencontres du Cinéma Africain au Niger (RECAN). Les objectifs de cet évènement se veulent des échanges entre professionnels, de formation et des projections de films en présence du public. Son promoteur, journaliste de formation, après un Master Recherche en France, poursuit des études doctorales sur le cinéma au Canada. ➢
Nous avons aussi, le Forum Africain du Film Documentaire, initié par Inoussa Ousseini en 2006 et qui a vu sa 11ème édition en novembre 2019. L’une de ses principales missions est la promotion des films documentaires au Niger à travers des projections, des formations, des conférences sur des thématiques diverses sur le cinéma. Le festival est annuel. 182
➢ Le Festival International du Film d’Environnement (FIFEN) créé en 2004. C’est un lieu d’intégration et de mises en réseau des professionnels de l’audiovisuel, du cinéma et de l’environnement, afin de faciliter la production, la réalisation, la circulation et la diffusion de films sur l’environnement et le développement durable. Ce festival est l’œuvre de la primature, mais il est très vite enterré pour faute de suivi. ➢ Le Festival International des Films sur les Droits de l’Homme (FIFIDHO) initié par Yacouba Hamani Beidara a vu sa cinquième édition en novembre 2018. Ce festival est un festival à thématique, axé uniquement sur les films engagés, très souvent des films qui dénoncent les abus des pouvoirs en place. À sa 5ème édition, le promoteur annonce que le festival serait à partir de sa 6ème édition, bisannuel, au lieu de chaque année, par le passé. Cela est dû à la rareté des partenaires financiers. ➢ Le Festival de Films d’Animation en Hommage à Moustapha Alassane (FAHMA), crée en 2015 par l’Association Nigérienne des Ciné-clubs et Critiques de Cinéma (ANCCCC). Le festival est bisannuel et couplé avec la Semaine de la Critique du Cinéma au Niger. ➢ La Semaine de la Critique Cinématographique créée en décembre 2016 est une activité de l’Association Nigérienne des Cinéclubs et Critiques de Cinéma (ANCCCC) qui se passe tous les deux ans. Au cours de cette Semaine, il se déroule des conférences-débats, des projections de films et de formation sur le cinéma. ➢ Le plus jeune des festivals au Niger, Toukountchi Festival de Cinéma du Niger dont le fondateur et Délégué Général est Youssoufa Halidou Harouna. Le festival est initié en 2016 par l’Association Nigérienne des Ciné-clubs et Critiques de Cinéma (ANCCCC). C’est un festival annuel, ouvert dès sa deuxième édition en octobre 2017 à tous les films du monde. Le festival a noué des partenariats avec d’autres festivals en Afrique, dont le Festival Panafricain de Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou. Plusieurs associations ont été créées pour la promotion du cinéma nigérien. Nous citerons celles qui ont des arrêtés ministériels, donc légalement reconnues. Il s’agit de : l’Association des Cinéastes du Niger (1971), Hikima Matassa (2012). Cinéma Numérique Ambulant (2010), 183
Focus (2012), l’Association Nigérienne des Ciné-clubs et Critiques de Cinéma (ANCCCC, 2015). D’autres associations se sont créées et sont en attente de l’autorisation officielle. Nous pouvons noter celles des cadreurs, des monteurs, des producteurs et des acteurs. Il est important de souligner que la Fédération des Associations des Cinéastes du Niger a été créée le 11 novembre 2017 pour contribuer à encadrer le cinéma au Niger.
Figure 65: Festivaliers à la 3ème édition Toukountchi à Niamey
Le dernier né des festivals est celui crée par le Centre Culturel Américain, dénommé Festival du Très court Métrage, sa première édition a lieu en janvier 2018, festival entièrement financé par l’Ambassade des États-Unis au Niger pour contribuer à l’éveil de consciences à travers le cinéma. Les films en compétions sont tous financés par le Centre Culturel Américain (CCA). Notons aussi que les films doivent répondre à certaines thématiques imposées par l’ambassade, telles que : l’égalité des sexes, l’éradication ou la prévention de l’extrémisme violent. Les structures d’encouragement du cinéma nigérien Sous la tutelle du Ministère de la Renaissance Culturelle des Arts et de la Modernisation Sociale (MRC/A/MS) le Centre National de la 184
Cinématographie du Niger (CNCN) est opérationnel depuis 2008. Ce centre a vu le jour, grâce au fond d’un montant de 300 millions débloqué par le gouvernement de l’époque, en vue de promouvoir le cinéma. Mais son budget annuel depuis trois (3) ans ne sert qu’à son fonctionnement. Il n’arrive pas à asseoir une politique véritable pour la relance cinéma. Les missions du centre sont nombreuses. Le statut assigne au Centre National de la Cinématographie du Niger (CNCN) vingt-deux (22) missions. On peut citer quelques-unes qui ont une importance capitale, à savoir : développer l’industrie cinématographique et vidéographique nigérienne ; organiser la formation professionnelle et technique pour les métiers artistiques du cinéma et de la vidéographie nigérienne etc. Ce qui est remarquable dans la gestion du CNCN, c’est la place des professionnels qui siègent à son sein, avec douze (12) représentants, de façon paritaire. Le service public dispose de six (6) administrateurs et les professionnels du cinéma ont six (6) représentants. Mais la présidence du conseil laisse beaucoup d’inquiétudes, car elle n’est pas laissée à l’appréciation des professionnels. « Le président du conseil d’Administration est nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la culture pour une durée n’excédant pas celle de son mandat d’administrateur »188. Son mandat est renouvelable une (1) seule fois. Pour être président du conseil d’Administration il faut avoir un niveau équivalent à la catégorie A1 de la Fonction Publique et une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans à un poste de responsabilité dans le secteur public, parapublic ou privé. Ce qui montre les gardes fous mises par l’autorité de tutelle pour que le cinéma ne soit pas géré par des amateurs. On l’observe aussi, lorsque le législateur précise le pouvoir du Directeur Général du Centre. Ainsi on peut lire que : « Le Centre est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministère chargé de la culture »189 La nomination du Directeur Général est basée sur la charge d’un cahier préalablement établi. Son mandat est de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. Un Secrétaire Général nommé par arrêté du Ministre chargé de la culture assiste le Directeur Général dans l’exercice de ses fonctions. Selon l’article 21 du même statut du CNCN : « le Directeur Général est investi des pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion et la direction du CNCN dans la limite des pouvoirs 188 189
« Art 18 » statut du CNCN (P7) « Article 20 » statut du CNCN (P7)
185
délégués par le Conseil d’Administration »190. Aussi le Directeur Général assure plusieurs missions à savoir : « exercer l’autorité hiérarchique sur le personnel du centre ; gérer le patrimoine du centre et préparer le budget ainsi que le compte administratif de fin d’exercice qu’il soumet au conseil d’administration. Il contrôle aussi tous les services du centre, il représente le Centre National de la Cinématographie du Niger vis-à-vis de l’État, auprès de toutes les administrations publiques et privées et des tiers etc. »191 Le Conseil d’Administration, conformément à la réglementation, fixe sa rémunération. Le législateur a doté, de même, le Centre National de la cinématographique du Niger (CNCN) des moyens pour atteindre ses objectifs en mettant à sa disposition son propre patrimoine et de l’autonomie financière. Les ressources financières du Centre National de la Cinématographie du Niger (CNCN) proviennent de plusieurs sources : une dotation annuelle de fonctionnement et d’équipement du budget de l’État, les fonds de concours de l’État, des collectivités publiques et tout organisme à caractère public ou privé. On a aussi les fonds d’aide extérieurs, les produits de l’aliénation des biens meubles et immeubles. Nous avons les revenus éventuels des services rendus et, à la fin, les ressources résultant de l’exploitation du centre. Ce ministère a créé d’autres directions dont les cahiers de charge concourent à la promotion du cinéma nigérien. C’est ainsi que la Direction du cinéma et de l’Audiovisuel joue un rôle de conseil et d’administration au sein du ministère sur des questions qui touchent le cinéma. 6.2. MEDIAS ET PROMOTION DU CINEMA L’absence de revues spécialisées dans le cinéma est couverte au Niger par les télévisions et journaux de la place, en particulier Le Sahel, quotidien étatique qui a suivi de très près l’évolution de cet art. En effet, des articles divers qui sont autant de critiques de cinéma, des dossiers remontant aux années 1960 l’attestent. Certains des rédacteurs de ces articles, qui furent des promoteurs du cinéma nigérien, sont toujours à l’Office National d’Édition et de Presse, l’ONEP. Ils sont donc des témoins vivants de son parcours. 190 191
« Article 21 » statut CNCN (P7) « Article 21 » statut CNCN (P8)
186
Les médias écrits (presse écrite) et audiovisuels (radios et télévisions) au Niger, malgré le fait qu’ils ne sont pas tous spécialisés dans le cinéma, ont certains, une rubrique culture qui prend en compte les films des réalisateurs sortis en avant-première ou même font des portraits de cinéastes. Ce qui montre un intérêt de ces médias pour le cinéma au Niger, malgré que la couverture est liée en fonction de l’actualité sur le cinéma. La presse écrite s’inscrit, à l’instar des autres médias, comme un support pour la promotion du cinéma. Autrement dit, elle concourt à faire connaître, à valoriser et à soutenir l’industrie cinématographique. Cela implique qu’elle dispose de moyens pour y arriver, et parmi lesquels la valeur promotionnelle en matière de cinéma qui diffère selon le média. Des articles mettant en exergue le cinéma nigérien, intègrent des comptes rendus, de portraits et des interviews. En général, c’est suite à un événement cinématographique que le media publie des articles sur le cinéma nigérien. Ainsi, les périodes de publication des articles sur le cinéma nigérien sont relatives aux événements cinématographiques. Un journal sort du lot. C’est Le quotidien le Sahel, qui était conditionné par le factuel. La promotion qu’il ferait au cinéma est relative à la périodicité c'est-à-dire, il fait la promotion du cinéma, si ce dernier lui fournissait des éléments d’actualité et spécifiquement, des faits nouveaux. Après lecture des différents articles il ressort que Le Sahel et les autres médias ont couvert pratiquement tous les événements cinématographiques: le Forum Africain du Film Documentaire, des activités du Centre National de la Cinématographie du Niger (CNCN), la projection de films de réalisateurs nigériens au Centre Culturel Franco Nigérien (CCFN), au Centre Culturel Oumarou (CCOG), à la Maison des Jeunes Djado Sékou, au Festival de Films sur les Droits de l’Homme (FiFiDHO), à Toukountchi Festival de Cinéma du Niger (TFCN), au FESPACO, pour ne citer que ceux-là. Chaque fois qu’il y a un événement cinématographique, nous en sommes informés à travers quelques médias. Nous retenons que quelques médias ont une véritable politique cinématographique. Ils couvrent chaque événement à l’intérieur du Niger comme à l’extérieur, lorsque le Niger est représenté. Nous notons cette valorisation à travers les œuvres mais aussi les personnes, acteurs de l’industrie cinématographique. Nous avons également découvert la valorisation du cinéma nigérien dans des articles et des reportages. Le contenu de ces articles met en 187
exergue le cinéma nigérien à travers des genres comme le compte-rendu, le portrait, le reportage. Par l’évocation de films primés ou non, des scénarios des cinéastes nigériens, on peut y déceler le désir de rehausser l’image du cinéma nigérien, de donner du crédit à ce cinéma en pleine renaissance. Nous retrouvons à l’intérieur des articles des mots ou expressions, des phrases qui valorisent le cinéma nigérien. A titre d’exemple nous lisons dans le n° 7759 du Sahel du 20 juillet : « À la fin de la projection, des applaudissements ont couvert le générique ». Il s’agit de la projection des films de Moustapha Alassane au PANAF, en Algérie. Comme le titre l’indique dans le journal, le public est émerveillé. Et nous pouvons encore lire dans le même article : « Je trouve que vos films ont beaucoup de valeur. Bravo ! ». Tels sont les propos d’une réalisatrice que le journal a voulu rapporter. Le journaliste se sert à plusieurs reprises d’instruments comme les propos de cette réalisatrice ou les applaudissements du public pour valoriser ou montrer que l’œuvre de Moustapha Alassane est de qualité. Outre ces exemples, nous pouvons encore citer : « La volonté et la pertinence des thèmes mises en scène par ces jeunes cinéastes méritent bien évidemment d’être accueillies par les promoteurs des œuvres cinématographiques ». Dans cet article de la parution n° 7678 du Sahel du 25 février, le journaliste prend position et dit clairement qu’il faut promouvoir ce film. Il s’agit d’un film d’Edouard Lompo dont la substance coïncide bien avec la réalité de plus d’une personne. Et, le journaliste touché par la pertinence du thème met en valeur le scénario et incite les personnes en charge de la promotion des œuvres cinématographiques à réagir. Le Sahel fait aussi mention d’une nomination importante dans sa parution du 10 mars 2009 : « le Niger était aussi à l’honneur à travers le premier congrès constitutif de la Fédération Africaine de Critique Cinématographique (FACC) avec l’élection de notre compatriote Sani Soulé Manzo comme Secrétaire de ladite Fédération ». Le Niger tout comme le cinéma nigérien est honoré pour cette responsabilité attribuée au Nigérien Soulé Manzo. La valeur que Le Sahel accorde au 7ème art, en particulier le 7ème art nigérien, le pousse à aller en terre étrangère, refusant de ne pas se contenter de dépêches d’agences. Ainsi, il couvre des grands évènements cinématographiques comme le FESPACO où le Niger n’est
188
pas est bien représenté. Les médias redessinent l’image du 7ème art nigérien, confiné, après la période faste dans la léthargie, en sensibilisant les lecteurs, les auditeurs et les téléspectateurs sur les avancées, la relance ou les possibilités de la relance du cinéma nigérien. C’est en cela que nous voyons encore, la contribution des médias dans la promotion du ce cinéma. Dans quelques articles, nous avons identifié ce souci de relance. Nous pouvons donc mentionner entre autres : « redoré le cinéma de ces palmes d’or » (Le Sahel n°7678 du mercredi 25 février 2009). De cet exemple, il ressort que le cinéma nigérien n’a pas toujours été tel qu’il se présente actuellement. En effet, il était dans une sorte de léthargie. Des efforts devront être consentis, pour le repositionner, le relancer. Dans ce passage, le journaliste incite à faire redémarrer le cinéma nigérien. Nous voyons en cet appel à l’action une façon de promouvoir le 7ème art nigérien. Dans la parution du journal Le Sahel du jeudi 3 décembre 2009, nous lisons : « J’invite les organisations socioprofessionnelles du secteur audiovisuel à s’y impliquer, puisque sans cela notre stratégie de relance cinématographique ne peut être efficacement opérationnelle (…) je saisis cette heureuse occasion pour inviter les cinéastes nigériens à poursuivre ce dialogue à travers le Centre National de la Cinématographie du Niger (…) et à l’Ordonnance portant loi d’orientation relative à la culture récemment prise par Son Excellence Monsieur le Président de la République(…) répondent à l’impérieuse nécessité de doter notre pays d’une véritable politique du cinéma» . Ce compte rendu reprend les paroles de l’ex ministre de la culture et des arts, Mr Oumarou Hadary, pour montrer l’effort du gouvernement et les stratégies mises en œuvre pour la relève du cinéma nigérien. Dans l’article, le journaliste s’emploie à véhiculer cette image de relance du cinéma nigérien. L’interview du directeur de la cinématographie du Niger nous donne un autre élément d’appréciation dans Le Sahel n°7688 du 17 mars 2009, « Nous comptons beaucoup sur l’arrivée de cette nouvelle génération de cinéastes qui a des projets ». C’est une génération à encourager et à soutenir. Le Sahel fait la promotion du 7ème art nigérien. Il publie à chaque événement cinématographique nigérien, ou simplement lorsque le Niger
189
est impliqué. Cependant, nous observons que les articles sur le cinéma nigérien sont peu nombreux. Certes, nous pouvons parler de promotion. En effet, en analysant les articles du quotidien le Sahel, nous avons pu déceler des éléments qui montrent la valorisation du cinéma nigérien, le regain d’espoir que le journal veut insuffler à ses lecteurs quant à ce cinéma, mais aussi la fidélité du journal par rapport au 7 ème art nigérien. Cela l’amène d’ailleurs à franchir les frontières du Niger. Mais, des efforts doivent être consentis de la part du journal pour aller au-delà, parce que l’état actuel du cinéma ne lui permet pas de fournir régulièrement des éléments d’actualités. Le journal ne peut pas persévérer uniquement dans le compte rendu et espérer donner une image forte de la promotion du cinéma. Il doit faire également de l’investigation, observer le terrain pour véritablement porter haut le cinéma nigérien. Au niveau des médias audiovisuels, seule la Télévision Dounia à une émission consacrée uniquement au cinéma. L’émission s’appelle Patrimoine Ciné192. Elle donne la parole aux acteurs de cinéma (producteur, réalisateur, scénariste, cameraman, preneur de son, acteur, décorateur, critique de cinéma, monteur, exploitant, etc.). L’émission est bimensuelle avec trois (3) rediffusions. Elle se veut de préserver et promouvoir le cinéma nigérien dans tous ses aspects. D’une durée de 60 mn, Patrimoine Ciné a reçu une trentaine de cinéastes, des pionniers comme Djingarey Maiga193, Feu Abdoua Kanta194, Moustapha Diop195, Mahamane Bakabé196 et ceux de la jeune génération tels que : Aicha Macky197, Mallam Saguirou198, Sani Magori199, Jaloud Zenou200 Tangui 192
Patrimoine Ciné : Une émission conçue et réalisé par Youssoufa Halidou Harouna depuis juillet 2016. 193 (Cf) Patrimoine Ciné n° 1 de juillet 2016, entretien Abdoua Kanta avec Youssoufa Halidou sur Dounia Tv. 194 (Cf) Patrimoine Ciné n° 5 de septembre 2016, entretien Djingarey Maiga avec Youssoufa Halidou sur Dounia Tv. 195 (Cf) Patrimoine Ciné n° 2 d’août 2016, entretien Moustapha Diop avec Youssoufa Halidou sur Dounia Tv. 196 (Cf) Patrimoine Ciné n° 7 d’octobre 2016, entretien Mahamane Bakabé avec Youssoufa Halidou sur Dounia Tv. 197 (Cf) Patrimoine Ciné n° 6 d’octobre 2016, entretien Aicha Macky avec Youssoufa Halidou sur Dounia Tv. 198 (Cf) Patrimoine Ciné n° 2 de mars 2017, entretien Mallam Saguirou avec Youssoufa Halidou sur Dounia Tv. 199 (Cf) Patrimoine Ciné n° 34 de janvier 2018, entretien Sani Magoriavec Youssoufa Halidou sur Dounia Tv.
190
et Amina Weira201. C’est la seule émission critique, au cours de laquelle, de manière professionnelle, les acteurs dénoncent les limites de ce cinéma et proposent des stratégies pour son émergence. À travers cette émission les extraits des films de l’invité sont diffusés pour vivre ou se remémorer des bons moments des films. Au niveau du web, on dénombre Clab Noir, association française qui est une structure co-créée par un nigérien Dr Achille Kouawo202 et un français Benoit. T. pour promouvoir les cinémas d’Afriques en général et nigérien en particulier. A travers le web (internet) elle informe le public de tous les événements cinématographiques en Afrique. Dr Achille a couvert plusieurs événements cinématographiques africains dont le FESPACO. Il a de même encadré plusieurs mémoires sur le cinéma à l’Institut de Formations aux Techniques de l’Information et de la Communication (IFTIC). 6.3. PERSPECTIVES POUR LE CINEMA NIGERIEN Avec une politique affirmée des autorités sur la promotion de la culture en général et du cinéma en particulier et avec les nouvelles richesses qu’engendrent la production du pétrole et l’exploitation de l’uranium par des sociétés internationales depuis fin 2011, un espoir pour le financement du cinéma au Niger peut bien être possible. Avec l’adoption de la Politique Culturelle Nationale par DECRET N°2008 - 051/PRN/MCAL/PEA du 28 février 2008, portant approbation du document de Déclaration de Politique Culturelle Nationale, le Niger s’est doté d’un grand instrument de promotion de la création artistique. On peut lire dans l’objectif de cette Déclaration de Politique Nationale: « Faire de la Culture un moyen d’affirmation de notre identité, de notre refondation et un puissant levier de développement durable, ainsi qu’un facteur incontournable d’intégration et de lutte contre la pauvreté203 ». Ici, la culture dans son ensemble est prise comme un facteur 200
(Cf) Patrimoine Ciné n°31 d’octobre 2017, entretien Jaloud Zainou Tangui avec Youssoufa Halidou sur Dounia Tv. 201 (Cf) Patrimoine Ciné n° 29 de septembre 2017, entretien Amina Weira avec Youssoufa Halidou sur Dounia Tv. 202 (Cf) Patrimoine Ciné n° 35 de janvier 2018, entretien Dr Achille Kouawo avec Youssoufa Ha lidou sur Dounia Tv. 203 Politique Culturelle du Nationale par DECRET N°2008-051/PRN/MCAL/PEA du 28 février 2008.
191
d’épanouissement économique et social. Le document va plus loin en énumérant plusieurs objectifs qui concourent à l’encadrement et à la réalisation des acteurs culturels. Ainsi, les objectifs de la politique culturelle reposent sur plusieurs axes : « La participation à la vie culturelle, tant pour la communauté artistique que pour la population, doit être la finalité de notre politique culturelle nationale ; cet idéal incarne les valeurs de démocratie, de pluralisme et d’ouverture de la société nigérienne ». - la création d’une conscience nationale inspirant toutes les composantes de la population ; - la préservation, la protection, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel ; - la sauvegarde et la restauration de notre environnement ; - la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ; - l’intensification de l’action culturelle par tous les moyens permettant d’assurer une large diffusion de la culture, y compris les technologies de l’information et de la communication ; - l’accès et la participation des populations à la vie culturelle ; - le soutien à la création et aux créateurs ; - la promotion de l’éducation artistique ; - la promotion de la recherche et de la formation ; - la promotion de la décentralisation culturelle ; - la promotion et le développement des industries culturelles et la facilitation de leur accès au marché national, régional et international ; - l’entretien, le renforcement et le développement de la coopération culturelle. Une Loi d’orientation relative à la culture fut adoptée en mars 2009 et a pour objet de fixer le cadre juridique de la Politique Culturelle nationale. A son article 2, plusieurs définitions ont été données pour éclairer les citoyens : Art : expression désintéressée et idéale du beau et, en même temps, ensemble des activités humaines créatrices qui traduisent cette expression.
192
L’art est également l’expression d’un sentiment à travers une œuvre d’art. C’est aussi l’ensemble des œuvres artistiques d’un pays, d’une époque. Arts appliqués : vaste secteur d’activités de l’Artisanat d’Art et du design qui couvre trois domaines : - Design de produit notamment les vêtements et accessoires de l’habillement, du maquillage et des effets spéciaux, mobilier et décor de la maison, art ménager, art de table, automobile, facture instrumentale ; - Design de Communication tels que le logo et le visuel publicitaire, le conditionnement, la signalétique, l’image de marque, l’illustration, la bande dessinée, la typographie, la photographie, le cinéma et l’audiovisuel, l’infographisme ; - Design d’Espace comme l’environnement architectural et l’urbanisme, l’agencement d’espace, l’étalagisme, l’art funéraire, la scénographie, le décor de théâtre et de cinéma. - Artisanat d’art : création des objets pour sa clientèle qui nécessite la maîtrise de plusieurs compétences liées à la connaissance indispensable des technologies de fabrication. Il est aussi un artisanat de production au sens de l’article 5 de l’Ordonnance N° 92-026 du 07 Juillet 1992 portant orientation de la politique de développement de l’Artisanat au Niger qui comporte des activités manufacturières de création d’œuvres d’arts. - Artiste : toute personne qui crée ou participe par son interprétation à la création ou à la recréation d’œuvres d’art, qui considère sa création artistique comme un élément essentiel de sa vie, qui contribue ainsi au développement de l’art et de la culture et qui est reconnue ou cherche à être reconnue en tant qu’artiste, qu’elle soit liée ou non par une relation de travail ou d’association quelconque. - Culture : ensemble des pratiques productives, valeurs sociales, actions, comportements, attitudes et schèmes idéologiques en même temps que l’ensemble des réalisations et institutions sociales, par lesquels un peuple donné assure son existence, organise sa vie et témoigne de son identité. - Design : créations esthétiques industrielles appliquées à la recherche de nouvelles formes et adaptées à leur fonction particulièrement pour les objets utilitaires, les meubles mais aussi l’habitat. Il est un domaine visant à la création d’objets, d’environnements ou 193
d’œuvres graphiques, à la fois fonctionnels, esthétiques et conformes aux impératifs d’une production industrielle. - Diversité culturelle : multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre eux. La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles quels que soient les moyens et les technologies utilisés. - Expressions culturelles : manifestations qui résultent de la créativité des individus, des groupes et des sociétés et qui ont un contenu culturel. - Entreprises culturelles : la notion d’entreprise culturelle peut être considérée de façon étroite ou large. Dans le premier cas, elle représente essentiellement les établissements et les entreprises de production et de diffusion consacrés aux arts et aux lettres : - arts d’interprétation tels que le théâtre, la musique, la danse, l’opéra, le cirque ; - arts visuels comme galeries d’art, musées ; - bibliothèques et patrimoine. Dans le deuxième cas, elle comprend les industries culturelles notamment les films, les CD, les spectacles de variétés, l’édition, les métiers d’art et les médias dont la radio, la télévision, les journaux et périodiques. - Identité culturelle nationale : marque culturelle distinctive d’un peuple. Elle se caractérise par un ensemble de valeurs à travers lesquelles les différents groupes et communautés s’identifient. - Industries culturelles : ensemble des structures et mécanismes technologiques mis en œuvre, ainsi que les biens culturels qu’ils permettent de produire à l’échelle industrielle notamment les productions audiovisuelles, l’artisanat, le livre, le film, le disque, les cassettes, les diagrammes, les cartes postales. - Musée : institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public et qui fait des 194
recherches concernant les témoins matériels et immatériels de l'homme et de son environnement (éléments de valeur culturelle, collection d’objets artistiques, historiques, scientifiques et techniques, jardins botaniques et zoologiques, aquariums), il acquiert ceux-ci, les conserve, les communique et notamment les expose à des fins d'études, d'éducation et de délectation. - Patrimoine culturel : patrimoine culturel matériel tel qu’il est défini par la Convention de l’UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel mais aussi le patrimoine culturel immatériel au sens de la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Ainsi sont considérés comme patrimoine culturel : - les monuments, œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science ; - les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science ; - les sites : œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique. - Le patrimoine culturel immatériel s’entend des pratiques et représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que des savoirs, savoir-faire, instruments, objets, artefacts et lieux qui leur sont associés - qui sont reconnus par les communautés et les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel et qui sont conformes aux principes universellement acceptés de droits de l’homme, de l’équité, de la durabilité et du respect mutuel entre communautés culturelles. Ce patrimoine culturel immatériel est constamment recréé par les communautés en fonction de leur milieu et de leur histoire, et leur procure un sentiment de continuité et d'identité, contribuant ainsi à promouvoir la diversité culturelle et la créativité humaine. - Le patrimoine culturel immatériel couvre les domaines suivants : 195
- les expressions orales (formes d’expression orale) ; - les pratiques sociales, rituels et événements festifs ; - les connaissances et pratiques concernant la nature ; - les arts interpretation. Ainsi, le patrimoine culturel immatériel englobe les expressions du folklore telles qu’elles sont définies dans l’ordonnance N° 93-27 du 30 mars 1993 portant sur le droit d’auteur, les droits voisins et les expressions du folklore. - Politiques et mesures culturelles : politiques et mesures relatives à la culture, qu’elles soient centrées sur la culture en tant que telle ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et la distribution d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accès à ceux-ci. - Technologies de l’information et de la communication (TIC) : convergence numérique de la technologie informatique, avec les moyens de télécommunications et l’audiovisuel, elles regroupent les technologies et équipements utilisés dans le traitement et la transmission de l’information et principalement : les matériels et logiciels informatiques, Internet, la radio, la télévision et la téléphonie fixe et mobile et autres supports électromagnétiques et numériques nécessaires pour les convertir, les stocker, les gérer et les retrouver. On peut regrouper les TIC par secteurs suivants : - l’équipement informatique, serveurs, matériel informatique ; - la microélectronique et les composants ; - les télécommunications et les réseaux informatiques ; - le multimédia (Internet, médias électroniques, CD Rom, etc.) ; - les services informatiques et les logiciels. - Tourisme culturel : circulation volontaire dans le but de mieux connaître les réalités socioculturelles et d’établir des rapports interindividuels ou intergroupes. Il est un domaine visant à la création d’objets, d’environnements ou d’œuvres graphiques, à la fois fonctionnels, esthétiques et conformes aux impératifs d’une production industrielle.
196
- Traditions orales : façon de préserver et de transmettre l'histoire, la loi et la littérature de génération en génération dans les sociétés humaines (peuples, ethnies, etc.) qui n'ont pas de système d'écriture. Malgré toute cette législation pour la préservation et la promotion de la culture il y’a dix (10) ans de cela, les acteurs culturels se plaignent de manque d’organisation des métiers artistiques dont les métiers du cinéma. D’ailleurs la Loi d’orientation dans sa section 2 stipule : Politique de cinéma et d’audiovisuel, toute une stratégie est pensée pour encadrer ce secteur. Dans son article 11, on trouve la politique nationale du cinéma et de l’audiovisuel qui repose sur la création d’un cadre et d’un environnement à même de permettre le rétablissement du cercle vertueux de toute industrie cinématographique : « Production, diffusion, production ». Ces axes majeurs suivants permettent l’éclosion de ce secteur : - la formation continue et la formation diplômante pour mettre les cinéastes en activité au diapason des mutations technologiques ; - la mise en œuvre d’un programme d’éducation à l’image de masse ; - la création d’un cadre financier incitatif de soutien à l’industrie cinématographique et audiovisuelle ; - la structuration des filières ; - la production et la diffusion ; - les infrastructures et équipements. Mais, il reste la mise en œuvre de toute cette déclaration de politique culturelle accompagnée de ses lois d’application qui trainent à être opérationnelles. Pour un début, afin qu’il y ait une relance au niveau de la production des films qui tendrait plus tard vers une industrialisation, l’État peut s’appuyer sur le modèle du Nigéria qui marche très bien dans la sousrégion avec une production régulière d’environ 1500 films par an. Cette politique de production a permis au Nigéria de valoriser sa culture et de rehausser le pouvoir d’achat de certaines catégories de la population avec la création d’environ 300 000 emplois. Il faut aussi, s’appuyer sur le modèle Français, en tenant compte des réalités du pays, lorsque la relance du cinéma au Niger prendra la forme d’une industrialisation. Pour les fondements d’un cinéma émergent basé sur le modèle du Nigéria voisin, à court terme, l’État doit réaliser ou mettre en place : - Des mesures incitatives pour l’autorisation et l’ouverture des structures indépendantes de production à la nigériane (production 197
vidéographique en abondance sans ingérence des autorités avec une fiscalité négligeable) ; - Des aides à l’écriture dans les lycées et les quartiers pour les cinéphiles ; Il doit également : - organiser des concours des meilleurs scénarios des jeunes talents (écoles, quartiers, communes, régions) ; - favoriser L’émergence de réalisateurs nouveaux ; - soutenir le seul institut de formation aux métiers de réalisation avec un cahier de charge bien déterminé ; - inciter les professionnels pour la création des instituts privés ; - octroyer des bourses de formation pour les métiers du cinéma ; - subventionner les outils à la production cinématographique ; - encadrer de manière à faciliter la réalisation des films à moindre coût ; - promouvoir les jeunes réalisateurs en finançant leurs projets de films ; Il doit veiller à : - une autonomie de gestion décentralisée d’aide aux financements de la production cinématographique ; - la création de centres de formation professionnelle assurant la formation en commun des techniciens de cinéma et de la télévision pour permettre leur libre emploi dans les deux secteurs ; - la création des salles de cinéma, la réhabilitation des anciennes salles et la rénovation de nouvelles aux normes internationales ; - l’aide aux indépendants diffuseurs pour les encourager dans la promotion du cinéma nigérien et appui aux festivals de cinéma. Il doit également : - assurer la formation de titulaires à tous les postes non techniques tournant autour de la production cinématographique, y compris des juristes, économistes spécialisés, gestionnaires des ressources humaines, des directeurs de production- gestionnaires, etc. La formation des acteurs techniques ou autres concernés par le cinéma doit se faire préférentiellement dans les centres créés à l’échelle nationale, et de façon pratique, au sein de toute activité cinématographique se déroulant au Niger en faisant appel aux experts étrangers si possible. Et, le plein emploi de techniciens nigériens devrait également avoir pour finalités de rapatrier les Nigériens travaillant à l’extérieur du pays. Au niveau de la 198
distribution, assurer la formation de programmateurs, attachés de presse et tous métiers relatifs à l’exploitation. Au niveau de l’exploitation, assurer la formation des projectionnistes, gérants de salles et métiers relatifs à l’exploitation. Au niveau de la sensibilisation du public à la production nigérienne, assurer la formation de critiques et d’animateurs cinématographiques dans le sens d’un dialogue permanent entre les créateurs, les animateurs, les spectateurs et les autorités de tutelle ; - permettre et assurer par des textes de loi, la participation des télévisions (une dizaine au Niger) au financement de la production de films cinématographiques, qui alimenteront les programmes télévisuels. Une participation directe des télévisions (les annonceurs) sous forme de coproduction ou de production de films avec le secteur du cinéma ; - mettre en place un cadre réglementaire pour imposer aux télévisions des quotas quantitatifs et en nationalité dans la diffusion des œuvres cinématographiques et les contraindre à investir une part de leur ressource dans la production ou le préachat de films nigériens ; - instituer une législation en faveur de financement par année du cinéma par les sociétés exploratrices du pétrole (SORAZ, SONIDEP …), de l’uranium (AREVA, SOMAÏR, COMINAK…), de l’or (société Canadienne) et toutes les grandes sociétés de la place pour sensibiliser les populations sur les dangers écologiques liés à leurs activités et sur la protection des populations riveraines ; - assurer un achat à tarif promotionnel de films nationaux pour contribuer à leur amortissement ; - promouvoir une législation d’encouragement à l’investissement pour appel des capitaux privés non cinématographiques placés par des hommes d’affaires et autres opérateurs économiques et cela par la création des exonérations diverses en faveur des investissements et réinvestissements dans la production cinématographique ; - instaurer des crédits bancaires à faibles taux d’intérêt en faveur de la production cinématographique garantis par le CNCN à travers un fond de soutien alimenté par le cinéma ; - instaurer l’avance sur recettes pour favoriser le renouvellement de la création en encourageant la réalisation de premiers films et soutenir un cinéma indépendant, audacieux au regard des normes du marché et qui ne peut sans aide publique trouver son équilibre financier. Ces 199
avances sont des prêts sans intérêt, remboursables en général selon des schémas : soit l’établissement d’un couloir de remboursement sur les recettes au premier franc CFA ou au prélèvement sur le soutien financier généré par le film ; - mettre en place un système de crédit d’impôt au bénéfice des producteurs délégués, au titre de dépenses effectuées au Niger pour la production de films. C’est une façon aussi de lutter contre les délocalisations pour avoir un soutien financier de la production ; - instaurer des accords- cadres de la production au niveau bilatéral des commissions mixtes entre Etats au niveau régional et interafricain ; Aussi, l’État du Niger, pour un cinéma de commercialisation, doit imiter dans la mesure du possible et en tenant compte des spécificités nigériennes le système français relatif aux producteurs indépendants pour favoriser une concurrence positive pour le développement du cinéma ; Nous préconisons, à ce titre, que l’Etat forme des directeurs de production dans les grandes écoles ou universités du monde, dans le cadre d’une bonne compréhension du cadre cinématographique au niveau des exploitants et des distributeurs. Dans un monde globalisé et pour faire face à de nombreux obstacles, nous appelons à un collectif de réalisateurs et de techniciens professionnels qui entendent produire et diffuser le plus librement possible un cinéma qui reflète une réalité sociale car celle-ci contribuera à influencer une certaine évolution ; Avec une dizaine de chaînes privées sur satellite au Niger, les producteurs doivent composer avec le système télévisuel pour exister en tant que structure de production dans le paysage audiovisuel comme partenaires et interlocuteurs principaux. C’est un paysage nécessaire avant la distribution en salle ; Favoriser le partenariat entre diffuseurs du Niger et diffuseurs du Sud et du Nord, sera une façon de montrer et de vendre notre culture ; La spécialisation des sociétés de production dans leur intervention sur des projets de films (court, moyen et long), de genres annexes (documentaire, animation ou fiction) permettra aux réalisateurs et aux partenaires un repérage facile dans le cadre d’un éventuel partenariat ; Il faudra également pérenniser les structures de production, en les formant à la gestion entrepreneuriale, car on sait bien, surtout en Afrique 200
que le cinéma n’est pas porteur d’une économie considérable. Parfois les producteurs et réalisateurs sont aidés par leur famille ; Le cinéma nigérien était le moteur du cinéma ouest africain dans les années 60 -70 disait Okioh François Sourou204. Ce dernier se posait la question de savoir pourquoi la dynamique a cessé à un moment de son histoire ? Avec une vingtaine de salles de cinéma entre 1960 et 1990, et un fonds de plusieurs films d’auteurs, les cinéastes et les autorités ont assisté, impuissants, à la disparation progressive du circuit de distribution cinématographique au Niger. On ne parlait plus de la chaîne vertueuse (Production, réalisation et distribution) du septième art au Niger. À partir des années 90, la télévision nationale qui assurait la fonction de diffusion se limitait à des productions de sensibilisation (recherche et éducation) comme les films théâtralisés où les comédiens parlaient en langue locale. Les Nigériens étaient des grands amateurs de cette manière de passer des messages sur le petit écran. On note aussi, que les critiques du cinéma jouaient pleinement leur rôle dans la découverte des films des cinéastes. Malgré le fait que la plupart des critiques restent seulement descriptifs. Les médias, surtout la presse écrite, couvraient régulièrement et accompagnent les cinéastes dans les rencontres internationales en Afrique comme en Europe souligne Harouna Niandou.205
204
Entretien Okioh François Sourou, cinéaste bèninois avec Youssoufa Halidou dans Patri Ciné n° 38 sur Dounia TV Niger. Il notait être formé par les pionniers du cinéma nigérien dont Oumarou Ganda, Moustapha Alassane et Djingarey Maiga. 205 Entretien Harouna Niadou (critique de cinéma) avec Youssoufa Halidou dans Patrimoine Ciné n° 11 sur Dounia TV Niger.
201
Conclusion Ce travail s’est donné pour tâche de produire « un panorama du cinéma nigérien des origines à nos jours ». Il s’est agi, chemin faisant, de montrer la vivacité de ce cinéma, au pays de Moustapha Alassane, et de contribuer à la recherche et à la valorisation de cet art. Le sujet nous a semblé important car le Niger avait occupé, par le passé, une place de choix dans le cinéma d’Afrique francophone. On sait aussi que cet art est entré dans ce pays, comme ailleurs, par le biais de la colonisation. Le sujet, historique, au départ, devient aussi politique et social, sans oublier l’esthétique. Ces nombreuses pistes possibles ont posé un défi que j’ai tenté de relever de mon mieux. La production cinématographique au Niger a connu un départ assez encourageant, suivi, pendant plusieurs décennies, par une baisse de température, avant de redémarrer avec une nouvelle génération de réalisateurs. Dans cette renaissance, on note un passage de la fiction au documentaire. On remarque aussi la présence féminine qui monte. Le moment semble propice pour un tour d’horizon, un « panorama », un essai de bilan. Cela nous a semblé important en raison de la rareté de recherche sur le cinéma nigérien. En, effet, comme nous l’avons noté dans notre introduction, il a fallu attendre 1991, pour voir paraître le premier ouvrage sur le cinéma au Niger, alors que les tous premiers films dans ce pays, dataient respectivement de 1925, 1936 et de 1947. Faire une étude panoramique du cinéma au Niger revient à considérer la pluralité des genres filmiques des acteurs nigériens, ainsi que celle des étrangers qui ont réalisé des films au Niger, portant sur les populations nigériennes. L’histoire du cinéma est relativement récente, en Afrique comme ailleurs. Comment oublier que cet art est né en même temps que le système colonial ? On ne peut pas non plus oublier son usage raciste dans ce contexte historique. Diffusé par le monde occidental, le cinéma était devenu cette merveille, cette magie blanche des lumières que le continent noir découvrait, ébloui, avant de, vite, l’apprivoiser. Au Niger, cette impression d’émerveillement du début est immortalisée dans le roman autobiographique, L’Aventure de Bi Kado de Boubou Hama (1971), comme nous le rappelle Antoinette Tidjani Alou, dans un article intéressant intutilé : 203
« Comment peut-on être écrivain au Niger ? Histoire coloniale, marginalité et magie de l’écriture littérature ». Les africains ont fini par succomber, activement, aux charmes du cinéma, par la création. Le Niger fait figure de pionniers dans le domaine de cet art nouveau. Ce travail est donc revenu sur le fait que ce pays est devenu, dès les années 1920 et jusqu’à 1940, un lieu de tournage de films, par les étrangers d’abord. Le pays est capté par un regard extérieur, cet œil magique qui avait tant fasciné Boubou Hama, qui devenu majeur et homme politique, en projetait dans son village, comme en témoigne son autobiographie, Bi Kado. Ainsi, les premiers réalisateurs ayant travaillé au Niger sont venus d’ailleurs pour filmer ce qu’ils voyaient comme les réalités - et la magie du pays. Léon Poirier, Jean Marie d’Esme et Jean Rouch ont immortalisé des pratiques traditionnelles des populations nigériennes, menacées de disparition. Les regards ethnographique et muséographique de ce premier cinéma, sur le Niger, abordent le pays à travers l’évocation exotique de fêtes traditionnelles, de la chefferie traditionnelle, de rites, de cultes, de tenues vestimentaires, de la chasse, etc. Ce cinéma, qui n’était pas celui des nigériens eux-mêmes, qui appartient à l’époque coloniale, fait tout de même partie de l’histoire du cinéma nigérien, comme nous avons voulu le montrer, en cooptant des acteurs, en leur donnant une formation sur le terrain, en faisant naître, par l’opportunité et l’expérience, des envies et des vocations. Bénéficiant de toutes les facilités de production cinématographique du système colonial, y compris celle de la recherche, la conquête du continent, sa « connaissance », a été aussi le produit de ce cinéma étranger qui pouvait s’appuyer sur des financements de sociétés d’exploitation et de distribution du « métropole » (Gaumont), des sociétés commerciales comme Citroën, voire même des centres de recherche (CNRS). Bien de réalisateurs, français, notamment, s’étaient servis des opportunités de l’époque pour produire une filmographie importante qui rend compte de la vaste et riche culture de nos pays, suivant des goûts et des intérêts tout à fait personnels. Jean Rouch par exemple, dans sa production au Niger (et sur le Niger) s’est intéressé essentiellement à la communauté zarma-songhay. Sous un angle mythique, magique, Rouch conte et peint de manière souvent pittoresque les pratiques socioculturelles des sociétés traditionnelles du pays, les croyances séculaires, les pratiques culturelles et artistiques. Par les opportunités qu’il a offertes pour jouer des rôles, de prendre le son, de voyager à 204
l’intérieur du pays et à l’extérieur (au Gold Coast, en France) ; par les relations très spéciales qu’il a liées sur le longues périodes, Jean Rouch est important pour le cinéma nigérien, même si de futurs cinéastes comme Moustapha Alassane et Djingarey Maïga, ont frayé ensuite leur propre chemin, de manière indépendante. Des films documentaires de Jean Rouch ont été tournés au Niger avec des acteurs nigériens qui, poussés par cette découverte du cinéma, s’étaient passionnés pour cet art. Nous l’avons dit. Comment ne pas relever la vocation de tous ces premiers techniciens du cinéma nigérien qui sont Damouré Zika et Lam Dia qui, par leur jeu naturel, ont su donner au cinéma de Rouch toute sa beauté ? Enfin, ce cinéma semblait avoir emballé toute une génération. Dans l’entourage de Rouch, diverses vocations sont nées (assistants, coscénaristes, preneurs de son, coréalisateurs et acteurs), comme nous l’avons mentionné. Rouch pouvait alors compter sur une diversité des talents, à portée de main. Le concours de ces circonstances historiques privées a permis au Niger de devenir un pionnier du cinéma en Afrique Noire. La découverte du cinéma, dans le sillage de Jean Rouch a permis à certains nigériens de découvrir les subtilités de cet art et de se donner une vocation pour le cinéma, dans les années 60-70. Nous pouvons citer, entre autres : Oumarou Ganda, qui était l’acteur principal du film Moi, un noir (1957), Moustapha Alassane, Djingarey Maiga et Inoussa Ousseini, qui nous a quitté très récemment. Il faut rappeler que, de manière intéressante, les premiers films nigériens n’étaient pas des documentaires mais plutôt des fictions et des films d’animation. En cela, le cinéma nigérien n’a pas suivi l’histoire générale du cinéma où le documentaire ethnographique était le premier genre d’un cinéma très préoccupé par l’histoire. Par une certaine manière de voir l’histoire et qui n’était pas flatteuse pour les africains et pour les peuples colonisés. Le cinéma nigérien, qui n’a jamais atteint le niveau d’une industrie, était relativement florissant, en termes de réalisations, entre 1962 et les années 1970. Il faut souligner ici qu’à l’instar de tous les pays de l’Afrique Occidentale Française (AOF) devenus indépendants, dont le Sénégal qui a connu très tôt la pratique cinématographique avec les premiers films de Sembène Ousmane (Borom Sarret en 1963, Niaye en 1964), la filière cinématographique nationale, dans l’ensemble de ces anciens pays de l’AOF, était embryonnaire. Les compétences nationales dans plusieurs métiers du cinéma n’existaient quasiment pas (cameraman, preneur de 205
son, monteur, distributeur). Le cinéma local ne pouvait donc fonctionner que dans le cadre de partenariats, notamment dans le cadre de la coopération occidentale, des systèmes nationaux de financement du cinéma étant non-existants. Le circuit de la commercialisation des films (de distribution) était l’apanage de structures occidentales que sont la COMACICO et la SECMA. L’Afrique n’avait donc pas les moyens de produire un cinéma qui pouvait être libre de sa création, étant donné ces dépendances financements et techniques sur l’extérieur. C’est à partir de 1966 qu’on a pu accueillir les premiers films documentaires de Moustapha Alassane et d’Inoussa Ousseini. Cependant, des années 80 à nos jours, la production d’images documentaires au Niger était due à : des réalisateurs travaillant à la télévision nationale, et à des jeunes réalisateurs formés dans les écoles de cinéma (Sani Magori, Idi Nouhou, Samri Abdoulaye, Lawal Boubacar, Mahamadou Moussa Saley, Bawa Kadadé, Abdoul Wahab Moustapha Alassane, Moumouni Mahaman Bakabé, Siradji Bakabé, Jaloud Zennou Tangui, etc.) et à l’arrivée d’une nouvelle génération de jeunes réalisatrices de l’époque (Rahmatou Keïta, Ramatou Doulla, Aicha Macky). On peut également ajouter à cette liste un certain nombre de jeunes cinéastes autodidactes (Moussa Hamadou Djingarey, Kadri Koda, Boubacar Djingarey Maiga, Serge Clément Anatovi, etc.) qui réalisent des films (fiction, documentaire). Plusieurs films de ces réalisateurs ont été nominés et primés dans des festivals et diffusés sur des chaînes de télévision locales, voire internationales : L’Arbre sans fruit de Aicha Macky, La colère dans le vent de Amina Weira, Zin’narriya de Rahmatou Keïta, Solar made in Niger de Mallam Saguirou, etc. Lors des journées dédiées au cinéma nigérien par TV5, il y a eu des diffusions de films des pionniers du cinéma nigérien comme Moustapha Alassane, Oumarou Ganda et Moustapha Diop et même des films de réalisateurs de la jeune génération tels que Jaloud Zennou Tangui, Mallam Saguirou, Adamou Sadou et Sani Magori. Tout ceci est encourageant non seulement pour la production dans son ensemble, mais surtout pour la visibilité de ce cinéma. On assiste donc à un tournant dans l’histoire du cinéma au Niger, marqué par la montée en nombre des réalisateurs, par l’importance donnée à la formation, par leur visibilité grandissante et par leur réputation nationale et internationale.
206
Une autre transformation visible est l’émergence des femmes dans le cinéma nigérien. Cette émergence impacte les thématiques des films qui portent sur les conditions de vie des femmes et de la société. Ce sont des thèmes fréquents, comme on peut le voir dans les films de Djingarey Maïga (de manière très critique et moralisatrice) et dans le cinéma de Moustapha Alassane (de manière bien plus subtile). La différence majeure chez les réalisatrices est le fait que ces questions de genre ou de société sont portées à l’écran par des femmes artistes, avec leur regard personnel et leur propre voix. Au Niger, la réalisatrice devient ainsi une actrice de premier plan dans le cinéma. De plus, elle fait connaitre le Niger sur le plan mondial et dans de grandes rencontres du cinéma. D’autre part, ce travail a essayé de mettre en lumière des films qui continuent à marquer le cinéma nigérien sur plusieurs plans : sur celui de la qualité du film en termes d’expression ou moyen de communication pour mieux élucider les thématiques développées ; deuxièmement en termes d’époque, d’histoire, vu sous l’angle des réalisateurs et de leur itinéraire, troisièmement en termes de créativité dans le genre et, enfin, en termes de diffusion aux plans national et international. Sur les plans technique et artistique, on note une maîtrise du langage cinématographique chez tous les réalisateurs. Par exemple, dans le film Le Retour d’un aventurier, le réalisateur a fait un appel marqué au bruitage (galop des chevaux, bruits des revolvers et des bouteilles), aux plans (d’ensemble, moyen et américain), aux cadrages (plongées, contreplongées), aux mouvements de la caméra qui permettent à la camera de se déplacer à travers des rails ou sur une voiture pour suivre son sujet. Ces plans font vivre les actions des personnages en mouvement. La séquence où les cowboys, lancés, poursuivent les girafes pour le plaisir est une illustration parfaite de la liberté et de la fantaisie poétique qui se développent chez ce cinéaste. Dans le film Un casting pour un mariage des angles et cadrage variés dont le champ/contre champ sont utilisés en plus des plans (gros plan, plan poitrine, etc.). Ces cadrages consistent soit à changer de place à la caméra soit à faire un zoom pour entraîner le spectateur dans l’intensification d’un regard subjectif. Les films des pionniers du cinéma nigérien mettent en lumière et diverses pratiques culturelles et vécus sociaux. Moustapha Alassane est le premier cinéaste africain à réaliser des westerns d’Afrique et des films d’animation. Son film, Le Retour d’un aventurier est à ce titre un film illustratif d’un mélange de rêves et de commentaires sur l’histoire postcoloniale. Moustapha Alassane y propose un écran jeune, ludique et 207
innovant. Bien que le commentaire sur la chefferie et sur le conflit des générations y occupent une place de choix, on voit les jeunes s’échapper, le temps d’un rêve, des contraintes d’un quotidien peu héroïque. Même si le rêve tourne court. Avec le cinéma de Oumarou Ganda, par contre, on n’est pas loin d’un « cinéma traditionnel et cultuel », où la culture nigérienne et le culte zarma-songhay sont omniprésents. Djingarey Maïga, nous offre, pour sa part, un cinéma un « cinéma critique social » amer et pessimiste (le noir est omniprésent dans ses titres). Ce cinéma dénonce la violence faite aux femmes, la corruption dans l’administration publique, la stigmatisation des certaines classes sociales (castes), les travers de la polygamie et ceux de la famille. Concernant les films documentaires de notre corpus, nous pouvons relever deux esthétiques. La première est ce qu’on peut appeler un « cinéma autobiographique ou subjectif », où, tout au long du récit filmique, le réalisateur s’impose physiquement ou autrement. Des films illustratifs sont La colère dans le vent d’Amina Weira et Koukan Kourcia ou les cris de la tourterelle de Sani Magori. On peut noter aussi une esthétique plus collective, dans ce qu’on pourrait appeler un « cinéma communautaire » où les réalisateurs portent à l’écran une histoire de leur région. Deux exemples en sont Hawan Idi de Amina Mamani et Le chasseur de vent de Mallam Saguirou. Nous pouvons noter que les mêmes thématiques reviennent, avec un traitement différent dans tous les films, qu’il s’agisse de fictions ou de documentaires. A titre d’exemples, à des décennies de distance et dans des styles et des genres très différents, Le Retour d’un aventurier (1966) de Moustapha Alassane et Hawan Idi (2012) d’Amina Mamani reviennent sur des motifs et des symbolismes similaires (le sultan, le cheval, la hiérarchie et les rites sociaux). Ceci reste vrai malgré le fait que dans Le Retour d’un aventurier le roi est contesté tandis que dans Hawan Idi, on prête allégeance au sultan, on lui voue respect et considération. Il faut souligner, tout de même, que la frontière entre documentaire et fiction reste très poreuse dans le cinéma nigérien. Les documentaristes empruntent les outils (mise en scène, histoire tirée d’un fait réel, etc.) de la fiction et vice versa. Cela est visible aussi dans presque tous les cinémas d’Afrique. Pour ce qui est de notre corpus, pour les films de fiction, nous avons préféré trois œuvres de pionniers du cinéma nigérien (Oumarou Ganda, Moustapha Alassane et Djingarey Maiga). Il s’agit d’une manière de leur 208
rendre hommage et surtout de faire découvrir leurs créations parfois innovantes qui ont parcouru le monde entier, primées dans les festivals, diffusées sur les télévisions du monde et projetées dans les salles de cinéma. Le choix du film Casting pour un mariage s’est opéré en raison du genre : la « comédie ». La scénarisation y est bien conduite et le réalisateur compte parmi les cinéastes de la jeune génération avec une production régulière presque tous les ans. Pour le choix des films documentaires, il faut dire que les films retenus ont marqué l’histoire du documentaire au cours des dix dernières années au Niger. Ils ont été nominés dans les festivals et diffusées sur plusieurs chaînes de télévision. Il s’agit donc d’œuvres de bonne facture. Deux de ces films (Koukan kourcia et Hawan Idi) furent primés au FESPACO en 2011 et 2013, respectivement. Les deux autres (Le chasseur de vent et La colère dans le vent) ont reçu des prix en France, en Italie, au Canada et au Niger. Les critères de choix ont été la qualité (image, son et montage) des films et les thématiques, qui sont toujours d’actualité. Il semble important de revenir ici sur la question de l’esthétique, étant donné que notre corpus relève du septième art. Dans le cinéma nigérien, les pionniers ont puisé dans d’autres arts (ancestraux, oral, littéraire). Ici comme ailleurs, la frontière entre les arts reste ouverte et il aura été intéressant de creuser davantage ces comparatismes, et d’autres aussi. C’est intéressant d’observer, par exemple, que des pièces de théâtre nigérien aient été adaptées au cinéma. Tel est le cas le cas de la pièce Si les cavaliers avaient été là, une pièce de l’historien et personnalité publique, André Salifou. La pièce et le film racontent la cohabitation historique conflictuelle entre les populations et l’administration coloniale. Des adaptations filmiques à partir des ouvrages qui inspirent le cinéma sont aussi des preuves vivantes de la relation entre le cinéma et la littérature. Nous nous rappelons la légende de Toula, écrite par Boubou Hama et adaptée par Moustapha Alassane. Ce dernier, dès les années 60, a réussi à se servir de l’oralité africaine dans l’animation, ce qui était novateur, presque révolutionnaire, dans l’esthétique du cinéma africain. Il aurait été passionnant d’explorer ces relations. Ce sera partie remise, malheureusement. Le cinéma nigérien a donc émergé sous l’impact de l’histoire coloniale, porté notamment, par le réalisateur autodidactique, conteur, aventureux : Jean Rouch. Des personnalités cinématographiques indépendantes sont détachés rapidement de cet avant- coureur, et après 209
une période de déprime, le cinéma nigérien se trouve de nouveau en développement, dans le contexte complexe de contraintes financières, de la montée du documentaire, des jeunes et des femmes. Ces différentes émergences font espérer, sinon rêver d’un avenir positif. Les perspectives sont prometteuses malgré le manque de financement venant de l’Etat du Niger, en dépit de la bonne volonté qui se lit dans les textes. La volonté politique, matérialisée dans la politique culturelle nationale, à travers le DECRET N°2008 - 051/PRN/MCAL/PEA du 28 février 2008, portant approbation du document de Déclaration de Politique Culturelle Nationale, peine à se mettre en œuvre. Si la loi était effectivement appliquée, les artistes trouveraient leur « salut » dans la création artistique sur les plans politique, économique, social et culturel. Il est vrai que dans les textes politiques au Niger, la culture, dont le cinéma, donne lieu à une idéologie positive, éloignée de l’application. La loi de Politique Culturelle Nationale déclare que : « La culture est un facteur d’expression de la liberté et de la démocratie. Elle est le ciment de l’unité nationale. Elle favorise le développement de la coopération internationale à travers les échanges culturels. Les autorités de tutelle reconnaissent l’importance de la culture, car elle est source de création d’emploi, de revenus et contribue ainsi à l’amélioration de la qualité de vie. Le soutien à la création artistique favorise le développement des industries culturelles. Le Niger, il faut le rappeler, a des dispositifs (centres de jeunes) dans toutes les régions et certains départements qui permettent de voir les films nigériens pour compenser le vide créé à la suite de la disparition de la vingtaine de salles de cinéma au Niger. Cette situation n’est d’ailleurs pas propre qu’au Niger. Dans beaucoup de villes africaines, les salles de cinéma ont disparu depuis quelques années. » Les textes semblent dire que la culture est primordiale, que le cinéma connaît un sort peu favorable, mais que ce n’est pas seulement chez nous, qu’on tente de « combler le vide (de cinéma) » par d’autres offres, dans des structures comme les « maisons des jeunes ». De sorte que, si l’espoir est permis c’est sans compter actuellement sur l’Etat. Pour autant, nul n’ignore les conditions qui devraient se réunir : si, d’abord, le CNCN était doté d’un budget conséquent, et unissant tous les cinéastes à travers des projets nationaux pour une production de quantité et de qualité du film nigérien. Si on encadrait les métiers du cinéma, créait les conditions d’aide à la production pour des films et, surtout, facilitait aux cinéastes les coproductions dans la sous- région et au-delà. On n’est pas ingrat : on 210
se réjouit d’assister aujourd’hui à l’émergence de nouveaux canaux de relais, de visibilité Le cinéma nigérien peut compter désormais sur une quinzaine de chaînes de télévisions au Niger, réunies sur un bouquet national (la TNT). Certaines de ces chaînes sont sur satellite, notamment sur les bouquets de Canal plus. Même si ce ne sera pas dans des conditions idéales du grand écran et de la salle sombre, on peut avoir accès désormais aux films nigériens. Malgré tout, pour la pérennité du septième art au Niger, la salle de cinéma, ciment social, un endroit du mieux vivre ensemble dans la diversité culturelle, doit être réhabilitée, réinventée. C’est la fermeture des salles qui a fait baisser l’intérêt pour le cinéma et qui a entraîné la baisse de la production de films de qualité que l’on constate partout en Afrique, sous les effets conjugués de la baisse du pouvoir d’achat et de la précarité économique. Pour une partie de la société, selon certains préjugés, le cinéma conduit à une dépravation des mœurs qui peut impacter la société. Mais le cinéma est aussi la victime de la télévision, du piratage intensif des films réalisés et de leur diffusion illégale généralisée « sur le trottoir » (les petits commerces qu’on retrouve dans les coins de rue des quartiers. A-t-on le droit d’espérer quand une seule salle (privée) se trouve au Niger dans la capitale ? Il s’agit de Canal Olympia du Groupe Bolloré, ouverte en janvier 2017. Il nous semble que nous sommes en droit d’espérer que l’initiative dure avec une programmation attentive à la production africaine et nigérienne, aussi. Car, on le sait, le grand écran est indispensable pour le cinéma. Certains cinéastes, malgré la disparation des salles, refusent de se résigner, comme ils refusent d’admettre que les films puissent trouver leur plein épanouissement par la diffusion télévisuelle simplement. Avec la pandémie due à la Covid-19, en effet, cette question a été remise en discussion puisque plusieurs chaines de télévision, en collaboration avec les réalisateurs, ont fait des efforts pour adoucir les effets du couvre-feu, mis en place par le gouvernement, par la diffusion gracieuse des films à la télévision. La COVID a permis donc une belle visibilité et a allumé ou a rallumé des rêves. Et si le cinéma pouvait se faire sans grands moyens ? Les téléphones mobiles, en partenariat avec des créateurs de plateformes de vidéo sur demande (VOD), ont permis de partager et de visionner des films. Et si, par cette démarche, si, encadrée, une économie réelle se dégageait au bénéfice de notre cinéma, vu l’utilisation galopante de smartphones 211
connectés aux réseaux de téléphonie mobile ? Que penser à ce sujet du cas de Netflix avec des millions d’abonnés ? Cette plateforme injecte de l’argent pour produire des films sur le continent. De la diffusion au financement, Netflix alimente sa grille avec des films qu’il produit pour satisfaire sa clientèle. Nous notons aussi, des plateformes mondialement connues comme Youtube qui donne l’opportunité de visionner les films, parfois en libre accès, moyennant seulement une connexion internet. Mais peut-on parler alors de cinéma ? Les puristes disent que non. Les réalisateurs aventureux expérimentent. Les appels à projet de films encouragent. Pour revenir au Niger, l’espoir paraît être permis avec des lieux de visionnement dans plusieurs quartiers de la ville de Niamey (Taweydo, Francophonie, IFTIC, Ciné-Vif du CCFN, etc.) grâce à l’initiative des cinéastes, des cinéphiles ou des artistes. Comme pour dire que certains continuent de croire au cinéma, celui des salles de cinéma ou du grand écran, dans des espaces de communion et de partage, où les émotions à vivre, projetées, sur un grand écran, captivent, à un niveau si - différentes des possibilités de la télévision. Malgré les difficultés, il est possible que quelque chose soit en train de bouger. L’espoir semble permis avec l’émergence des femmes, le regard des jeunes, des thématiques « jeunes » et urbaines. Des festivals de cinéma se créent aussi, nourrissant cet espoir qui, pour nous, est tout à fait fondé. Ces festivals sont des espaces qui permettent non seulement de voir les films, mais aussi de maintenir le brassage culturel à travers les rencontres professionnelles. Les ciné-clubs sont ainsi à valoriser car ils servent d’espaces culturels et intellectuels adéquats pour inciter le public à regarder davantage de films, afin d’avoir une culture cinématographique. Il est possible de susciter ainsi des vocations de cinéaste ou de critique. Force est de constater que le Niger a un patrimoine cinématographique intéressant, œuvre d’abord de réalisateurs étrangers, puis de réalisateurs nationaux (les pionniers et les générations qui les ont suivis). Ces jeunes réalisateurs prennent la relève et partent à la conquête du cinéma mondial en participant à des festivals et à des rencontres de cinéma. De sorte que ce dont il est question ce n’est pas d’un cinéma mort, mais d’un cinéma en développement, riche de promesses quoique demandeur de ressources et d’investissements, national aussi bien qu’international.
212
Bibliographie ADAMOU, Idé. La Camisole de paille. Niamey : I.N.N, 1987. ALI, Saoudé. Le proverbe haussa : forme et sens. Paris : Inalco, 2001. ALIOU, Ousseini. La problématique de la distribution cinématographique au Niger. Mémoire de licence. Niamey : 2000. AMADOU, Diado. Maimou ou le drame de l’amour. Niamey : Édition du Niger, 1977. AMOUZOU, Essé. L’impact de la culture occidentale sur les cultures Africaines. Paris : Harmattan, 2009. ANDRE, Salifou. Le Niger. Paris : Harmattan, 2002. --Le fils de Sogolo ; Si les cavaliers avaient été là… Niamey: L.E.P. ISSA BERI, 1985. ANTA DIOP, Cheick. Nations Nègres et Culture : De l'antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui. Paris: Présence Africaine, 1979. ANTHONY, Guneratne et WIMAL, Dissanayake. Rethinking Third Cinema. Routledge : 2003. ARMES, Roy. Third World Film making and the West. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 1987. Association des trois mondes. Dictionnaire des cinéastes maghrébins. Paris : Karthala, 1996. --Dictionnaire des cinéastes maghrébins. Paris : Karthala, 1991. AUMONT, Jacques et MICHEL, Marie. L’analyse des films. Paris : Nathan, 1988. BACHY, Victor. Le Cinéma au Mali. Bruxelles : OCIC, 1982. BARLET, Olivier. Les cinémas d’Afrique des années 2000 : Perspectives critiques. Paris : Harmattan, 2012. -- Cinéma : l’exception africaine. Paris : Harmattan, 2002. -- Le regard occidental sur les images d’Afrique. Paris : Thionville, 1998. -- Les cinémas d’Afrique noire : le nouveau malentendu. Paris : Cinémathèque, 1998. -- Les Cinémas d’Afrique noire : le regard en question, Paris : Harmattan, 1996. BARROT, Pierre. Nollywood : le phénomène vidéo au Nigéria. Paris : Harmattan, 2008. BARTHES, Roland. Critique et vérité. Paris : Seuil, 1964. BAUMGARDT, Ursula et DERIVE, Jean. Littérature africaine et oralité. Paris : KARTHALA, 2013. BLANCHARD, Pascal et BARLET, Olivier. Cinéma colonial : l’impossible tentation, Culture coloniale 1871-1931. Paris : Autrement, 2003.
213
BENALI, Abdelkader. « Oralité et cinéma africain francophone, une parenté esthétique et structurelle », in Notre Librairie n0 149. BEN JEMA, Abderrazek. Contribution à une mise à niveau du cinéma Tunisien. Luxor : Ariana, 2008. BOUGHEDIR, Ferid. Le cinéma africain de A à Z. Bruxelles : OCIC, 1987. BRAHIMI, Denise. Cinémas d’Afrique Francophone et du Maghreb. Paris: Nathan, 1997. CESAIRE, Aimé. Cahier d'un retour au pays natal. Paris : Présence Africaine, 1960. CHALAYE, Sylvie. Du Noir au nègre : l’image du Noir au théâtre (15501960). Harmattan, 2006. --Nègres en Images. Paris : Harmattan, 2001. CHAM, Mbye. “Filming the African experience” in FEPACI. Paris : Présence Africaine, 1995. CHANTRAND-LA PORTE, Catherine et ABADIE, Karine. L’encre et l’écran à l’œuvre : Interactions et échanges entre littérature et cinéma [en ligne]. [S1], 2013. [Consulté le 3 octobre 2015]. Disponible à l’adresse: http://www.interferenceslitteraires.be CLAUDE, Forest et Al. Etats et cinéma en Afriques francophones. Paris : Harmattan, 2020. --Festivals de cinéma en Afriques francophones. Paris : Harmattan, 2020. --« Penser l'économie du cinéma ». [En ligne], 2009, 12 /08/ 2013. [Consulté le 01 octobre 2017]. Disponible à l’adresse : URL : http://map.revues.org -- « Le cinéma en Afrique : l’impossible industrie », [En ligne]. 30 /08/ 2012. [Consulté le 01 octobre 2017]. Disponible à l’adresse : URL : http://map.revues.org --L’argent du cinéma. Paris : Belin-SUP, 2013. --Les dernières séances. Cent ans d’exploitation des salles de cinéma. Paris : CNRS, 1995. CLEDER, Jean. Entre littérature et cinéma, les affinités électives. Paris : Armand Colin, 2012. CRETON, Laurent. Économie du cinéma : perspectives stratégiques. Paris : Armand Colin, 2009. --Cinéma et stratégies : économie des interdépendances. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2008. --Le Cinéma à l'épreuve du système télévisuel. Paris : CNRS, 2002. --Cinéma et (in)dépendance : une économie politique. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 1998. CRETON, Laurent et Al. Les producteurs : enjeux créatifs, enjeux financiers. Paris : Nouveau Monde, 2011. DABLA, Séwanou. Nouvelles écritures africaines. Paris : Harmattan, 1986.
214
DIAWARA, Manthia. African Cinema, Politics and culture. Bloomington: Indiana University press, 1992. DELMAS, Laurent. Cinéma : la grande histoire du 7éme art. Paris: Larousse, 2017. DULUCQ, Sophie. « Le cinéma négro-africain entre mémoire et quête identitaire (années 1950- 1990) » in Chrétien, Jean-Pierre, and Jean-Louis Triaud, Histoire d’Afrique : les enjeux de mémoire. Paris : Karthala, 1999. DUPRE, Colin. Le Fespaco, une affaire d’Etat (s) 1969-2009. Paris : Harmattan, 2012. EDMOND SERE, De Rivières. Histoire du Niger. Paris : Berger Levrault, 1965. Encyclopedies. Histoire du cinéma. Paris : National Geographic, 2015. FANON, Frantz. Les damnés de la terre. Paris : La Découverte, 2002. FEPACI. L’Afrique et le Centenaire du Cinéma. Africa and the Centenary of Cinema. Paris : Présence Africaine, 1995. -- L’éducation africaine traditionnelle. Paris : Présence Africaine, 1974. --Le rôle du Cinéaste africain dans l’éveil d'une conscience de civilisation noire . Paris : Présence Africaine, 1974. GARDIES, André. Cinéma d’Afrique noire francophone : l’espace-miroir. Paris : Harmattan, 1999. -- Le récit filmique. Paris : Hachette, 1993. GARDIES, André et HAFFNER, Pierre. Regards sur le cinéma négro-africain. Bruxelles : OCIC, 1987. GADO, Boubé. Le Zarmatarey : contribution à l’histoire des populations d’entre Niger et Dallol Maawri. Niamey : IRSH, 1980. GIGNOUX, Anne-Claire. Initiation à l’intertextualité. Paris : Ellipses, 2005. GUIRAUD, Bernard. Le son au cinéma et l’audiovisuel. Nice : Baie des Anges, 2018. --La musique au cinéma et dans l’audiovisuel. Nice : Baie des Anges, 2014. GUY, Hennebelle et RUELLE, Catherine. Cinéastes d’Afrique noire. Paris : L’Afrique Littéraire et Artistique, 1978. GUY, Hennebelle. « Le cinéma nigérien, grand vainqueur à Ouagadougou ». In L’Afrique Littéraire et Artistique, n°22, 1972. GUY BEAUDELAIRE, Tegomo. L’impact du cinéma dans le roman francophone d’Afrique Noire. Thèse de doctorat : Littérature comparée. Kingston, 2010. HAFFNER, Pierre. Palabres sur le Cinématographe. Paris : Les Presses Africaines, 1978.
215
HALIDOU HAROUNA, Youssoufa, KOUAWO Candide Achille Ayayi, « L’État et le cinéma au Niger de 1960 à nos jours », dans Etats et cinéma en Afriques francophones. Paris: Harmattan, 2020. HALIDOU HAROUNA Youssoufa, « Les festivals de cinéma au Niger. Cas de Toukountchi dans Festivals de cinéma en Afriques francophones ». Paris : Harmattan, 2020. -- Le financement du cinéma au Niger. Mémoire de Master recherche : Cinéma. Université Michel Montaigne de Bordeaux, 2012. HAMA, Boubou. L’Aventure Extraordinaire de Bi-kado, fils de noir. Paris : Présence Africaine, 1971. --Contes et Légendes du Niger. Paris : Présence Africaine, 1971. -- Kotia Nima. Paris : Présence Africaine, 1969. --« L’art total ». In Sahel Dimanche n°110 du 15/02/1987. --« Le cinéma nigérien en devenir : Succès du cinéma nigérien ». In Nigerama n°3. Niamey, 1972. IMBERT, Henri-François. Samba Félix Ndiaye : cinéaste documentariste africain. Paris : Harmattan, 2007. ISSA DAOUDA Abdoul-Aziz. La double tentation du roman nigérien. Paris : Harmattan, 2006. JEAN-LOUIS, Hebarre. « Nécessité d’une politique de l’information dans les territoires d’outre-mer », in Politique Etrangère n° 2, mars avril, 1956. JOLY, Martine. Introduction à l’analyse de l’image. Paris : Armand Colin, 2006. JOURNOT, Marie-Thérèse. Le vocabulaire du cinéma. Paris : Armand Colin, 2011. KANE DESIRE, Momar. Marginalité et errance dans le cinéma et la littérature africaine francophones : Les carrefours mobiles. Paris : Harmattan, 2004. KINDO PATTENGOUH, Aissata. « La création littéraire au Niger: cas du roman ».Tydskrifvir Letterkunde, 2005. p280-298. KODJO, François. « Les cinéastes africains face à l'avenir du cinéma en Afrique », in Tiers- Monde, 1979, tome 20 n°79. Audio-visuel et développement (sous la direction d'Yvonne Mignot-Lefebvre) pp. 605-614. LE GOFF, Jacques. Histoire et mémoire. Paris : Gallimard, 1988. LE CORFF, Isabelle et BOURHIS, Véronique. « Kirikou et la sorcière, de l’écran à l’encre ». Dans Interférences littéraires/Literaire interferenties, n° 11, « L’encre et l’écran à l’œuvre », s. dir. Karine Abadie & Catherine ChartrandLaporte, octobre 2013, pp. 115-129. LEQUERET, Elisabeth. Le Cinéma Africain : un continent à la recherche de son propre regard. Paris : Les Cahiers du cinéma, 2003.
216
LOFTUS, Maria. Le Cinéma Documentaire en Afrique Noire : Du Documentaire Colonial au Documentaire Africain (1895-1985). Thèse de doctorat : Littérature françaises, générale et comparée et art du spectacle. Strasbourg : 2012. MAHAMADOU HALIDOU, Sabo. Aboki ou l’appel de la côte. Dakar : Nouvelles Editions Africaines du Sénégal, 1978. --Caprices du destin. Niamey : I.N.N, 1981. MAIGA TOURE, Zalia. Les femmes face aux traditions dans les littératures et cinémas contemporains de l’Afrique francophone. Thèse de doctorat. Arizona : 2010. MAIZAMA, Issa. Un Regard du dedans : Oumarou Ganda, cinéaste nigérien. Dakar : ENDA, 1991. MAMANI, Abdoulaye. Sarraounia. Paris : Harmattan, 1980. MARC, Ferro. Cinéma et Histoire. Paris : Gallimard, 1993. MARIO CORCUERA, Ibanèz. Tradition et Littérature Orale en Afrique Noire : Parole et Réalité. Paris : Harmattan, 2009. MENGUE NGUEM, Régina-Marciale. La représentation des conflits chez Ahmadou Kourouma et Alain Mabanckou. Thèse de doctorat : Cergy-Pontoise, 2009. MERLE DES ISLES, Marie-Isabelle. Jean Rouch : Alors le Noir et le Blanc seront amis. Paris : Mille et une nuit, 2008. MEYER, Charlotte. Les naissances du cinéma francophone subsaharien : les regards croisés de Jean Rouch et Ousmane Sembène. Mémoire de Maîtrise, Etudes littéraires. Québec : 2004. MIRCEA, Eliade : Aspects du Mythe. Paris : Gallimard, 1963. MURPHY, David. “Africans filming Africa: questioning theories of an authentic African cinema”. Journal of African Cultural Studies. Vol.13, N°2, Dec, 2000. NIANDOU, Harouna et MAIZAMA, Issa. Oumarou Ganda : cinéaste de la révolte des pauvres. Niamey : Gashingo, 2019. NIANG, Sada. Djibril Diop Mambety : un cinéaste à contre-courant. Paris : Harmattan, 2002. -- Littérature et cinéma en Afrique francophone : Ousmane Sembène et Assia Djebar. Paris: Harmattan, 1996. NWACHUKWU FRANK, Ukaduke, Questioning African Cinema: Conversations with Filmmakers. Minnesota: University of Minnesota Press, 2002. --Black African Cinema. California: University of California Press, 1994. OKALA, Jean-Tobie. Les télévisions africaines sous tutelle. Paris : Gallimard 1999.
217
OUSMANE, Ilbo, Quels impacts la politique de coopération cinématographique française a-t- elle eu sur le développement du cinéma au Niger de 1960 à 1990 ? Mémoire de Master. Toulouse, 2009. --Le cinéma au Niger. Bruxelles : OCIC, 1993. --OUSSEINI, Inoussa. « Problématique de la création cinématographique nigérienne ». Séminaire National sur la définition d’une politique culturelle au Niger ». Tillabéry : 1985, 16p. -- « La fiscalité cinématographique en Afrique noire ». In Film Echange. Paris : 1982, pp.37- 49. --« Les problèmes de la production cinématographique en Afrique ». Colloque. Niamey: 1982. --« Note de présentation du rapport d’activité du directeur du CIDC ». Ouagadougou : 1982. --« Projet d’organisation d’une industrie cinématographique au Niger rapport du CIDC ». Ouagadougou : 1982. --« Stratégie pour le développement d’une industrie cinématographique en Afrique ». In Sahel Hebdo n°308. Niamey : 1982. --« Evolution de la distribution cinématographique en Afrique noire francophone, rôle du CIDC ». Ouagadougou : 1980. -- « Vers une économie affranchie ». In Le Monde / Diplomatique. Paris : 1979. OTTEN, Rik. Le cinéma au Zaïre, au Rwanda et au Burundi. Bruxelles: OCIC, 1984. STOLLER, Paul. The cinematic griot: The Ethnography of Jean Rouch. Chicago: The University of Chicago Press, 1992. PFAFF, Françoise. Á l’écoute du cinéma sénégalais. Paris: Harmattan, 2010. --History on film/film on history. England: Longman/Pearson, 2006. --Focus on African films. Indianapolis: Indiana University Press, 2004. --Revisioning history: film and the construction of a new past. Princeton: Princeton University Press,1995. --Twenty-five Black African filmmakers: a critical study, with filmography and bio-bibliography, New York: Greenwood Press, 1988. PREDAL, René. Jean Rouch : un griot gaulois. Paris : Harmattan, 1982. PORCILE, François et GAREL, Alain. La musique à l’écran. Paris : Charles Corlet, 1992. ROUCH, Jean. Rapport sur la Situation et Tendances Actuelles du Cinéma Africain. Paris : UNESCO, 1961. -- Essai sur la Religion Songhay. Paris : Presses Universitaires de France, 1960. RUELLE, Catherine et Al. Afriques 50 : singularités d'un cinéma pluriel. Paris : Harmattan, 2005.
218
SAIBOU ADAMOU, Amadou. Expression de l’identité dans la parole de Tombokoye Tessa, gawlo songhay-zarma du Niger (Lecture pragmatique et interprétation d’un discours oral) . Thèse de doctorat. Ouagadougou : 2008. SOULEY, Manzo. « Au chevet d’un cinéma ». In Sahel Dimanche n°236. Niamey : 28/7/89, pp.16-17. SOUNA, Saley. Etudes sur le cinéma nigérien de 1960 à 1993. Mémoire de Licence. Bamako : 1984. SCHEINFEIGEL, Maxime. Jean Rouch. Paris: CNRS, 2008. SHERMAN, Rina. Dans le sillage de Jean Rouch : Témoignages et essais. Paris: FMSH, 2018. SHERZER, Dina. Cinema, colonialism, postcolonialism: perspectives from the French and francophone world. Austin: University of Texas Press, 1996. SIGNATE, Ibrahima. Med Hondo : Un cinéaste rebelle. Paris: Présence Africaine, 2001. SILOU, Osange. Le Cinéma dans les Antilles Française. Bruxelles : OCIC, 1991. SORLIN, Pierre; The Film in History: Restaging the Past. Ottawa : 1980. --Sociologie du cinéma, Paris : Aubier Montaigne, 1977. SPAAS, Lieve. The Francophone Film: A Struggle for Identity. Manchester: Manchester University Press, 2000. STAM, Robert et RAENGO, Alessandra. “Oral, Traditions, Literature, and Cinema in Africa”. In Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation. Malden: Blackwell, 2005, 295-312. TCHEUYAP, Alexie. Postnationalist African cinemas. Manchester: Manchester: University Press, 2011. --De l'écrit à l'écran : les réécritures filmiques du roman africain francophone. Ottawa : Presses de l'Université́ d'Ottawa, 2005. TIDJANI ALOU, Antoinette, « Sarraounia et ses intertextes : identités, intertextualité et émergence littéraire », Sud Langues, revue électronique internationale des sciences du langage, n°5. Consulté 15 novembre 2018 sur : http://www.sudlangues.sn//spip:.php, article 91. -- « Comment peut-on être écrivain au Niger ? Histoire coloniale, marginalité et magie de l’écriture littéraire » Annales de l’Université Abdou Moumouni de Niamey, Tome VI11, 2006, p.1-24. TOURE, Mounir. Introduction à la méthodologie de la recherche. Paris: Harmattan, 2007. VIEYRA, Paulin Soumanou. Le Cinéma au Sénégal. Bruxelles : OCIC, 1983. --Le Cinéma africain des origines à 1973. Paris : Présence Africaine, 1975. --Le Cinéma et l’Afrique. Paris : Présence Africaine, 1969. VINCENT, Pinel. Dictionnaire technique du cinéma, Paris : Armand Colin, 2012.
219
WANONO, Nadine. Tradition orale, transmission et création dans l’œuvre de Jean Rouch. Paris : CNRS, 2007. YVES, Chevrel. La Littérature Comparée. Paris : Presses Universitaires de France, 1989. Webographie http://blogs17.ac-poitiers.fr/circo-lrs/files/2012/03/histoire-des-artspremiers.pdf, consulté le 8 mai 2016. http://cinema.anthropologie.free.fr/cinema-africain.html, consulté le 25 mars2017. https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Cinéma/Définition, consulté le 8 octobre 2015. http://web.acreims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/ecole_et_ cinema/ 2016_2017/160916_histoire_du_cinema/histoire_du_cinema.pdf, consulté le 20 mai 2018. http://www.bibliotheque-charavines.fr/IMG/pdf/cine.pdf, consulté le 14 mars 2015. http://www.cinemafrancais-fle.com/Histoire_cine/naissance_cinema.php, consulté le juin 2016. http://www.corlet-editions.fr/site/telechargements/CinemAction142sommaire.pdf, consulté le 13 janvier 2017. https://www.erudit.org/fr/revues/cine/1996-v6-n2-3cine1500561/1000969ar.pdf, consulté le 27 décembre 2017. https://www.erudit.org/fr/revues/sequences/1958-n14 sequences1159036/52230ac.pdf, consulté le 9 novembre 2018. http://www.lesahel.org/index.php/culture/item/12893-cin%C3%A9manig%C3%A9rien--oumarou-ganda-cet-immortel, consulté le 4 novembre 2018. http://www.livres-cinema.info/livre/5893/cinema-des-origines-a-nos-jours, consulté le « avril 2017. http://www.musee-virtuel.com/histoire-cinema.htm, consulté le 11janvieer 2014. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/cinema-aspectsgeneraux histoire/, consulté le é septembre 2016. http://www.corlet-editions.fr/site/telechargements/CinemAction142sommaire.pdf, consulté le 29 avril 2018. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/cinema-aspects-generaux-lindustrie-du- cinema/, consulté le 14 janvier 2018. Pierre-Jean BENGHOZI, Daniel SAUVAGET,
220
« CINÉMA (Aspects généraux) - L'industrie du cinéma », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 17 juin 2017. URL :http://www.universalis.fr/encyclopedie/cinema-cinemas-parallelesle-cinema-d- avant-garde/, consulté le 10 juillet 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001842/184262fb.pdf, consulté le 26 mars 2018. Filmographie ALASSANE, Moustapha. Dan Zaraidou. Niamey: CELHO, 2009. --Kokooua. Paris: Images Sud-Nord,, 1985. --Samba le grand. Paris: Images Sud-Nord,, 1977. --Toula. Niamey: MA, RFA,1973. --FVVA (Femme Villa Voiture Argent). Niamey : MA, 1972. --Le retour d’un aventurier. Niamey: IFAN, 1966. --Bon voyage Sim. Paris : Images Sud-Nord, 1966. --La Mort de Gandji. Montréal : Office National du Film du Canada, 1965. --La bague du roi Koda. Niamey: SMADJA Myriam, 1962. Aouré. Niamey: SMADJA Myriam, 1962. BAKABE, Mahamane. Si les Cavaliers… Niamey: ORTN, 1981. BREGSTEIN, Philo. Jean Rouch et sa caméra au cœur de l’Afrique. Niamey: IRSH, 1978. DIABATE, Idriss. Jean Rouch, cinéaste africain. Niamey: FAFD, 2017. DIOP, Moustapha. Le Médecin de Gafiré. Niamey: Dipka Film, CNPC Mali, 1983. DJINGAREY, Moussa. Hassia « Amour ou Châtiment. Niamey : MD PROD, 2010. --Mon Retour au Pays. Niamey: MD PROD, 2013. -- Casting pour un mariage. Niamey : MD PROD, 2008. --Le pagne. Niamey : MD PROD, 2016. GANDA, Oumarou. L’exilé. Niamey : Argos Films, 1980. --Cock cock cock. Niamey : Argos Films, 1977. --Saïtane. Niamey : Argos Films, 1972. -- Le Wazzou Polygame. Niamey: Argos Films France, 1970. -- Cabascabo. Niamey: Argos Films France, 1968. HALIDOU HAROUNA, Youssoufa, Hommage à Moustapha Alassane. Dounia TV Niger, 2017.
221
KEÏTA, Rahmatou . Zin’ narriyâ ou l’alliance d’or. Niamey: Songhay Empire Productions, 2016. --Al’ lèèssi. Niamey: Songhay Empire Productions, 2003. MACKY, Aicha. L’arbre sans fruit. Nantes: Les Films du Balibari 2016. MAIGA, Djingarey. Un coin du ciel noir. Niamey: DAM, 2018. --Le cerveau noir. Niamey: DAM, 2016. --Au plus loin dans le noir. Niamey: DAM, 2014. --4ème nuit noire. Niamey: DAM, 2009. --Vendredi Noir. Niamey: DAM, 1999. --Miroir Noir. Niamey: DAM, 1994. --Aube Noire. Niamey: DAM, 1983. --La danse des dieux. Niamey: DAM, 1982. --Nuages Noirs. Niamey: DAM, 1979. --Etoile Noire. Niamey: DAM, 1975. MAMANI ABDOULAYE, Amina. Hawan Idi . Niamey: IFTIC, 2012. MAGORI, Sani. Koukan Kourcia, les médiatrices. Niamey: Maggia Images, 2014. --Koukan Kourcia ou le cri de la tourterelle. Niamey: Maggia Images 2010. MALLAM, Saguirou . Solar made in Africa. Niamey: Dangarama, 2017. --La robe du temps. Niamey: Dangarama, 2008. Le chasseur de vent. Niamey: Dangarama, 2005. OUSSEINI, Inoussa. Wasan Kara Niamey : IRSH, 1980. --Fantasia. Niamey: IRSH, 1980. --Soro. Niamey: IRSH, 1980. --Pari, C’est Joli. Paris : Les Films du Centaure, 1974. VAUTIER, René. Afrique 50. Paris : Les Films de l’an II, 1950. VEDRINE, Laurent. Jean Rouch cinéaste aventurier. Paris : ARTE, 2017. WEIRA, Amina. La colère dans le ven. Niamey : AES, 2016. ZISCHLER, Hanns. Jean Rouch, ingénieur, aventurier, ethnologue, cinéaste. Berlin : 1977.
222
Table des légendes Figure 1: Des sorkos à la chasse d’un hippopotame. .................................. 63 Figure 2: Un prêtre holley avec son fils. ..................................................... 64 Figure 3: Les outils de la musique holley. .................................................. 65 Figure 4: Des arcs et des chasseurs en action ............................................. 67 Figure 5: L’actrice principale en colère ...................................................... 68 Figure 6: Les enfants à l’école de la chasse ................................................ 69 Figure 7: Initiation du médecin à la médecine traditionnelle...................... 69 Figure 8: Le roi chez le devin ..................................................................... 70 Figure 9: Casbascabo sur le terrain de guerre ............................................. 70 Figure 10: Parure d’une femme possédée ................................................... 71 Figure 11: Devanture de la Radiotélévision du Niger (ORTN) .................. 93 Figure 12: 3 acteurs discutent autour du thé. ............................................ 100 Figure 13: un champ contre champ d’une discussion ............................... 101 Figure 14: Moussa Hamadou Djingarey dans Patri Ciné.......................... 102 Figure 15: Une actrice du film Le Wazzou Polygame (1970) ................... 104 Figure 16: Satou dans Le Wazzou Polygame ............................................ 105 Figure 17: Le devin et sa cliente dans le film Le Wazzou Polygame ........ 105 Figure 18: visite de El Hadj et ses amis chez sa future épouse ................. 106 Figure 19: femmes en chant dans un pirogue sur le fleuve ....................... 107 Figure 20: Femme qui se baigne au fleuve ............................................... 107 Figure 21: Oumarou Ganda dans le film Saïtane (1972) .......................... 108 Figure 22: L’acteur principal et l’actrice principale en causerie .............. 112 Figure 23: Au procès de Habi ................................................................... 113 Figure 24: Captures d’écran du film Aube Noire (1983) de Djingarey Maiga : la famille de la jeune mariée en tenue traditionnelle .............................. 114 Figure 25: Djingaarey Maiga dans Patri Ciné........................................... 115 Figure 26: un cow-boy qui porte le chapeau du roi .................................. 117 Figure 27:: Les six (6) cow-boys dans Le retour d’un aventurier ............ 118 Figure 28: Captures d’écran d’un cow-boys du film Le retour d’un aventurier .................................................................................................. 120 Figure 29: Moustapha Alassane ................................................................ 121 Figure 30: Façade du sultanat de Zinder ................................................... 127 Figure 31: La devanture du sultanat et sa branche sécuritaire .................. 128 Figure 32: Le sultan à cheval et ses notables ............................................ 128 Figure 33: Les notables sur des chevaux qui prêtent allégeance au sultan. .................................................................................................................. 129 Figure 34: expression de l’art oratoire des griots...................................... 130 Figure 35: Des moments forts de Hawan Idi ............................................ 131 Figure 36: une scène de Hawan Kao ........................................................ 132 Figure 37: Image tirée du film Hawan Idi : une scène de Kaffa. .............. 132 Figure 38: Une prière collective ............................................................... 133
223
Figure 39: Le sultan assiste au « Idi » ...................................................... 134 Figure 40: Le sultan avec des notables en tenue traditionnelle................. 135 Figure 41: Le chef des bouchers avec son cheval ..................................... 137 Figure 42: Des manifestations des artistes ................................................ 137 Figure 43: Des femmes targui jouent la musique traditionnelle ............... 138 Figure 44: Des jeunes débattent sur les questions sanitaires .................... 139 Figure 45: Des femmes se plaignent de cette exploitation de l’uranium à Arlit. .......................................................................................................... 140 Figure 46: Un chef chasseur accompagné de ses compagnons ................. 144 Figure 47: une vue d’ensemble d’une scène de Hawan Id ........................ 145 Figure 48: La reine des chasseuses ........................................................... 146 Figure 49: La Zabaya Husssey.................................................................. 148 Figure 50: La cantatrice chante me retour au bercail des exodants .......... 150 Figure 51: Le devin en consultation ......................................................... 161 Figure 52: Le devin et sa parure ............................................................... 162 Figure 53: Toula dans une parure traditionnelle ....................................... 163 Figure 54: Toula et ses amies ................................................................... 164 Figure 55: Le sultan et un des notables ..................................................... 166 Figure 56: Les tirailleurs nigériens en patrouille ...................................... 167 Figure 57: Les bras valides au service du colon ....................................... 168 Figure 58: Image dans le générique de début du film La Mort de Gandji 170 Figure 59: Une cérémonie à la cour royale du village des crapauds ......... 172 Figure 60: Les crapauds jouent avec les tambours ................................... 174 Figure 61: Le roi crapaud à cheval avec 2 gardes ..................................... 175 Figure 62: Le commerçant avec une inspectrice au restaurant ................. 178 Figure 63: Des musiciens jouent au bar dancing ...................................... 178 Figure 64: Des fêtards au bar dancing ...................................................... 179 Figure 65: Festivaliers à la 3ème édition Toukountchi à Niamey ............ 184
224
Table des matières Dédicace ............................................................................................. 7 Remerciements ................................................................................... 9 Sigles et abréviations........................................................................ 11 Sommaire.......................................................................................... 13 Préface .............................................................................................. 15 Introduction générale........................................................................ 17 PREMIÈRE PARTIE : AVENEMENT DU CINEMA.......................................................... 41 Chapitre 1 : De l’origine du cinéma au Niger ...................................................... 43 1.1. NAISSANCE DU CINEMA .............................................................44 1.2. EXPANSION DU CINEMA EN AFRIQUE.....................................56 1.3. JEAN ROUCH ET LE CINEMA AU NIGER ..................................62
Chapitre 2 : Le circuit de la production : le financement, la réalisation la distribution, les salles de projection et les télévisions au Niger ....... 73 2.1. LA PRODUCTION : 1960 A NOS JOURS .................................74 2.1.1. La production de 1960 à 1980 ..................................................75 2.1.2. La production des années 80 à nos jours ..................................81 2.2. LA DISTRIBUTION ET LA DIFFUSION : SALLES ET TELEVISIONS.........................................................................................88 2.2.1. La Distribution en Afrique Occidentale Française (A.O.F.).....89 2.2.2. La Distribution et la diffusion de l’indépendance du Niger à nos jours 90
DEUXIÈME PARTIE : LES FILMS FICTIONS ET DOCUMENTAIRES AU NIGER ...... 95 Chapitre 3 : Analyse de quelques fictions ............................................................ 97 3.1. UN CASTING POUR UN MARIAGE (2008) DU REALISATEUR MOUSSA HAMADOU DJINGAREY.....................................................98 3.2. LE WAZZOU POLYGAME (1970), D’OUMAROU GANDA ........102 3.3. LONG METRAGE, AUBE NOIRE (1983) DE DJINGAREY MAIGA...................................................................................................108 3.4. LE RETOUR D’UN AVENTURIER (1966) DE MOUSTAPHA ALASSANE ...........................................................................................115
225
Chapitre 4 : Analyse de quelques documentaires............................................... 123 4.1. HAWAN IDI (2012) DE AMINA ABDOULAYE MAMANI.........126 4.2. LA COLERE DANS LE VENT (2016) DE AMINA WEIRA........138 4.3. LE CHASSEUR DU VENT (2005) DE MALAM SAGUIROU.......141 4.4. KOUKAN KOURCIA OU LE CRI DE LA TOURTERELLE (2010) DE SANI MAGORI................................................................................147
TROISIÈME PARTIE : RAPPORT ENTRE CINÉMA, CULTURE NIGÉRIENNE ET LES AUTRES ARTS ............................................................................. 153 Chapitre 5 : Le cinéma et les autres arts............................................................. 155 5.1. CINEMA ET LITTERATURES......................................................155 5.2. CINEMA ET THEATRE.................................................................164 5.3. CINEMA ET DESSIN ANIME.......................................................169 5.4. CINEMA ET MUSIQUE.................................................................175
Chapitre 6 : Le Niger dans les rencontres cinématographiques et les perspectives ........................................................................................................ 181 6.1. LES RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES ........................182 6.2. MEDIAS ET PROMOTION DU CINEMA ....................................186 6.3. PERSPECTIVES POUR LE CINEMA NIGERIEN .......................191
Conclusion...................................................................................... 203 Bibliographie .................................................................................. 213 Table des légendes.......................................................................... 223 Table des matières .......................................................................... 225
226
Structures éditoriales du groupe L’Harmattan L’Harmattan Italie Via degli Artisti, 15 10124 Torino [email protected]
L’Harmattan Sénégal 10 VDN en face Mermoz BP 45034 Dakar-Fann [email protected] L’Harmattan Cameroun TSINGA/FECAFOOT BP 11486 Yaoundé [email protected] L’Harmattan Burkina Faso Achille Somé – [email protected] L’Harmattan Guinée Almamya, rue KA 028 OKB Agency BP 3470 Conakry [email protected] L’Harmattan RDC 185, avenue Nyangwe Commune de Lingwala – Kinshasa [email protected]
L’Harmattan Hongrie Kossuth l. u. 14-16. 1053 Budapest [email protected]
L’Harmattan Congo 219, avenue Nelson Mandela BP 2874 Brazzaville [email protected] L’Harmattan Mali ACI 2000 - Immeuble Mgr Jean Marie Cisse Bureau 10 BP 145 Bamako-Mali [email protected] L’Harmattan Togo Djidjole – Lomé Maison Amela face EPP BATOME [email protected] L’Harmattan Côte d’Ivoire Résidence Karl – Cité des Arts Abidjan-Cocody 03 BP 1588 Abidjan [email protected]
Nos librairies en France Librairie internationale 16, rue des Écoles 75005 Paris [email protected] 01 40 46 79 11 www.librairieharmattan.com
Librairie des savoirs 21, rue des Écoles 75005 Paris [email protected] 01 46 34 13 71 www.librairieharmattansh.com
Librairie Le Lucernaire 53, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris [email protected] 01 42 22 67 13
Malgré l’ancrage du cinéma nigérien dans la sous-région, au Niger, on note peu d’écrits scientifiques pour suivre son évolution d’où son choix, qui se justifie tout d’abord, par l’importance du cinéma sur le plan social, des rapports qu’il entretient avec les autres arts, de son ancrage sur le continent africain à travers la production des années 60-80, les distinctions des films nigériens, les participations aux festivals et l’organisation des rencontres cinématographiques au Niger.
Titulaire d’un doctorat unique en Arts (études cinématographiques), réalisateur, producteur TV, Youssoufa Halidou Harouna est journaliste professionnel et critique de cinéma. Enseignant en cinéma et audiovisuel dans plusieurs universités et instituts du Niger, il est le fondateur de l’Association Nigérienne des Ciné-clubs et Critiques de Cinéma (ANCCCC) et Délégué Général de Toukountchi Festival de Cinéma du Niger.
Youssoufa Halidou Harouna
Panorama du cinéma nigérien est un ouvrage consacré à l’histoire du cinéma produit au Niger. Il se veut une vue d’ensemble et s’appuie sur sa genèse et son évolution à partir d’un corpus de films représentatifs dans lesquels on retrouve les films des pionniers comme Moustapha Alassane, Oumarou Ganda et ceux de la nouvelle génération tel Moussa Hamadou Djingarey.
Études africaines
Série Cinéma
Youssoufa Halidou Harouna
PANORAMA DU CINÉMA NIGÉRIEN
PANORAMA DU CINÉMA NIGÉRIEN
PANORAMA DU CINÉMA NIGÉRIEN
Études africaines Série Cinéma
Préface de Harouna Niandou
Illustration de couverture : © freepik - Jalka Studio
ISBN : 978-2-14-031313-4
24 €
9 782140 313134



![panorama des littératures [3]](https://dokumen.pub/img/200x200/panorama-des-litteratures-3.jpg)

![Panorama des littératures [1]](https://dokumen.pub/img/200x200/panorama-des-litteratures-1.jpg)
![Panorama des littératures [2]](https://dokumen.pub/img/200x200/panorama-des-litteratures-2.jpg)
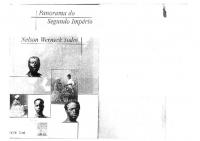
![Panorama [3 ed.]
9789754705638](https://dokumen.pub/img/200x200/panorama-3nbsped-9789754705638.jpg)

