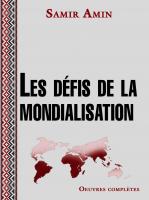Les défis de la mondialisation 9782370153876
Peut-on sortir des contraintes imposées par le système économique mondial ? Le tenter ne conduit-il pas nécessairement à
230 95 2MB
French Pages [402] Year 1996
Polecaj historie
Citation preview
Les défis de la mondialisation
Samir Amin
Les défis de la mondialisation Publié par
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA) 65-66, rue Lib 29, Résidence Machala Nord Liberté 6, BP 25231 Dakar Fann, Dakar, Sénégal Division commerciale de SENERVERT, SARL au capital de 1 300 000 FCFA. RC : SN DKR 2008 B878. www.nena-sen.com / http://librairienumeriqueafricaine.com / [email protected] Date de publication : 2015 Collection : Littérature d’Afrique ISBN 978-2-37015-387-6 © 2015 Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA).
1
Licence d’utilisation L'éditeur accorde à l'acquéreur de ce livre numérique une licence d'utilisation sur ses propres ordinateurs et équipements mobiles jusqu’à un maximum de trois (3) appareils. Toute cession à un tiers d'une copie de ce fichier, à titre onéreux ou gratuit, toute reproduction intégrale de ce texte, ou toute copie partielle sauf pour usage personnel, par quelque procédé que ce soit, sont interdites, et constituent une contrefaçon, passible des sanctions prévues par les lois de la propriété intellectuelle. L’utilisation d’une copie non autorisée altère la qualité de lecture de l’oeuvre.
2
Sommaire Préliminaires L’auteur Résumé
Présentation Chapitre I Les systèmes régionaux anciens 1 - La spécificité du contraste capitalisme / formes sociales antérieures 2 - La spécificité de la mondialisation capitaliste 3 - La transition mercantiliste en Europe 1500 - 1800 4 - Les systèmes arabo-islamique et méditerranéen antérieurs 5 - Peut-on parler d’un système mondial tributaire ? 6 - Critique de l’évolutionnisme 7 - Le schéma du système mondial tributaire Bibliographie
Chapitre II Le rôle de l’Asie centrale dans le système tributaire de l’ancien monde Bibliographie
Chapitre III Capitalisme et système-monde 1 - La spécificité du monde capitaliste moderne. 2 - La polarisation dans le système capitaliste mondial. 3 - La question des cycles longs dans l’expansion capitaliste. 4 - La rivalité des puissances dans l’expansion capitaliste et la question des hégémonies mondiales. 5 - Polarisation, cycles et hégémonies dans les systèmes antérieurs au capitalisme.
3
6 - La formation historique du capitalisme. 7 - L’avenir du capitalisme. Bibliographie :
Chapitre IV L’avenir de la polarisation mondiale Rappel bibliographique
Chapitre V Mondialisation et financiarisation I - Repères pour une définition du défi II - Marx, Polanyi, Braudel et la question de la nature du capitalisme III - Les enjeux de la mondialisation dans l’histoire : empires, hégémonies, financiarisation. IV - Les enjeux de la mondialisation aujourd’hui : mondialisation débridée ou contrôlée ? Bibliographie
Chapitre VI L’Europe au défi 1 - Les choix de l’après-guerre et la création de la C. E. E 2 - Bilan de la C. E. E 3 - L’Europe : une construction économique limitée 4 - La crise et l’élargissement vers L’Est, des défis nouveaux 5 - L'U.E. dans la tempête; le défi véritable : un espace commercial ou une intégration politique et sociale Bibliographie
Chapitre VII Le projet de la chine post-Maoïste Note
4
Chapitre VIII La Russie dans le système mondial géographie ou histoire ? Notes
Chapitre IX La recompradorisation du monde arabe Note
Chapitre X Aux origines de la catastrophe économique de L’Afrique Chapitre XI Pour une stratégie de la libération 1 - Les trois contradictions fondamentales du capitalisme 2 - L’histoire n’a pas de fin 3 - Dépasser le capitalisme : comment ? 4 - La diversité culturelle; l’impasse du culturalisme 5 - Sortir de la crise ou bien gérer la crise ? 6 - Les diverses régions du monde face au défi : des potentiels inégaux : 7 - La longue transition du capitalisme au socialisme Bibliographie
Conclusion Retour sur la question de la transition socialiste 1 - Mode de production capitaliste, capitalisme mondial réellement existant, les trois contradictions fondamentales du système 2 - L’histoire n’a pas de fin; le capitalisme doit être dépassé, à défaut... 3 - La transition pacifique au socialisme, la révolution mondiale, la construction du socialisme dans les pays libérés : trois conceptions du socialisme et de la transition à remettre en question. 4 - Retour à la question du socialisme 5 - Premières propositions pour une nouvelle conception de la transition
5
Préliminaires L’auteur ***
Résumé Peut-on sortir des contraintes imposées par le système économique mondial ? Le tenter ne conduit-il pas nécessairement à la terne stagnation du « socialisme des casernes » ? Quelle est la marge de manœuvre dont dispose un quelconque État du tiers monde ? Est-il condamné à la dépendance ? L’auteur du Développement inégal, du Matérialisme et la loi de la valeur, de Classe et nation dans l’histoire et la crise contemporaine et de L’avenir du maoïsme défend dans ce nouveau livre la thèse d’un « décrochage » non seulement possible mais nécessaire de la logique centre/périphérie. La déconnexion — concept stratégique proposé en complément de celui de développement autocentré national et populaire — s’impose avec force aux peuples du tiers monde qui veulent éviter les réajustements dramatiques provoqués par la crise, telle la famine ou la guerre. Mais elle concerne tout autant les États du Nord, en redéfinissant les règles du jeu planétaire. L’auteur voit d’ailleurs dans les mouvements « Verts » européens comme dans le regain du fait religieux dans le monde entier les signes de la nécessaire réadaptation des stratégies et des tactiques politiques œuvrant pour un autre développement.
6
Approche globale et renouvelée des grandes mutations du système mondial contemporain, ce livre offre aussi au lecteur une présentation claire et synthétique des concepts-clé de l’œuvre de Samir Amin, devenus objet de débats et de controverses dans le monde entier.
7
Présentation J’ai réuni dans cet ouvrage onze articles écrits récemment, portant tous sur quelque aspect de la mondialisation. Les deux premiers chapitres nous rappelleront que la mondialisation n’est pas nécessairement quelque chose de nouveau dans l’histoire de l’humanité. Les trois chapitres suivant précisent ce que le capitalisme a inauguré de réellement nouveau dans cette dimension (chapitre III), particulièrement dans sa phase actuelle de crise structurelle et dans ses perspectives (chapitre IV et V). Les cinq chapitres qui suivent considèrent les défis particuliers que la mondialisation représente pour différentes régions du monde, et les réponses adéquates ou non - que les systèmes en place apportent à ces défis, pour l’Europe (chapitre VI), la Chine (chapitre VII), la Russie (chapitre VIII), le monde arabe (chapitre IX) et l’Afrique (chapitre X). Le dernier chapitre ouvre la discussion sur l’alternative qu’on peut définir dans les termes suivants : à quelles conditions la mondialisation peut être associée à des projets sociétaires de libération et de progrès humain ?
8
Chapitre I Les systèmes régionaux anciens Le monde moderne a produit une image de l’histoire universelle selon laquelle le capitalisme (européen) aurait été le premier système social qui ait unifié le monde. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette opinion commune simplifie outrageusement la réalité. Elle constitue à mon avis un produit typique de l’eurocentrisme dominant. En réalité, les sociétés antérieures au XVIème siècle n’étaient nullement isolées les unes des autres mais en concurrence au sein de systèmes régionaux (et peut-être même d’un système mondial). Sous-estimer ce fait, c’est se condamner à ne pas comprendre la dynamique même du changement au sein de ces sociétés. Simultanément, je maintiens que le capitalisme représente une coupure qualitative dans l’histoire mondiale, amorcée vers 1500. Aussi j’insiste sur la distinction qu’il faut faire entre la structure intégrée du système capitaliste mondial et les éléments proto-capitalistes que l’on retrouve dans les sociétés antérieures, parfois depuis des temps très anciens. J’insiste également, pour cette même raison, sur la spécificité du contraste centres / périphéries propre au capitalisme mondial, différent qualitativement des formes antérieures de polarisation.
1 - La spécificité du contraste capitalisme / formes sociales antérieures C’est ici que se situe, à mon avis, l’apport théorique décisif du concept (de Marx) de mode de production capitaliste, dont la dilution éventuelle (à la mode aujourd’hui bien sûr) n’aide pas à clarifier les problèmes. Le M. P. C. implique la propriété privée de moyens de production qui sont eux-mêmes le
9
produit du travail (machines), ce qui suppose à son tour un niveau de développement des forces productives supérieur (par rapport à l’artisanat et à son outillage) et, sur cette base, la division de la société en deux classes fondamentales, ce qui suppose que le travail social revête la forme de travail salarié libre. Le marché capitaliste généralisé constitue alors le cadre dans lequel opèrent les lois de l’économie (la « concurrence ») devenues des forces qui agissent indépendamment des volontés subjectives : l’aliénation économiste et la dominance de l’économique en sont l’expression. Aucune société antérieure aux temps modernes n’était fondée sur ces principes. Par contre, toutes les sociétés évoluées antérieures au XVIème siècle étaient d’une nature identique. En les qualifiant de tributaires, je souligne ce fait qualitatif essentiel, à savoir que le surplus est directement ponctionné sur la paysannerie par des moyens transparents associés à l’organisation de la hiérarchie du pouvoir (le pouvoir est source de richesse, alors que dans le capitalisme c’est l’inverse qui constitue la règle). La reproduction du système exige alors la dominance idéologique - religion d’Etat qui opacifie l’organisation du pouvoir et la légitimise (par opposition à l’idéologie économiste du capitalisme qui opacifie l’exploitation économique et la légitimise par ce moyen, en contrepartie de la transparence relative des rapports politiques, elle-même condition de l’émergence de la démocratie moderne). Ayant pris position sur quelques-uns des débats du matérialisme historique, je crois utile d’en rappeler ici mes conclusions essentielles, ne serait-ce que parce que celles-ci commandent mes suggestions concernant la question de la nature du (ou des) systèmes pré-modernes. J’ai refusé la version dite marxiste des « cinq stades », c’est-à-dire plus précisément refusé (i) de considérer l’esclavage comme une étape nécessaire par
10
laquelle seraient passées toutes les sociétés qui sont allées au-delà; (ii) de considérer le féodalisme comme l’étape nécessaire qui succède à l’esclavage. J’ai refusé également la version dite marxiste des « deux voies », c’est-à-dire plus précisément refusé de considérer que seule la voie « européenne » (esclavage-féodalité) ouvrait la perspective de l’invention du capitalisme, tandis que la voie « asiatique » (le prétendu mode de production asiatique) aurait constitué une impasse, incapable d’évoluer par elle-même. J’ai qualifié ces deux interprétations du matérialisme historique de produits de l’eurocentrisme. Je renvoie donc, pour ce qui est de mes propositions alternatives, à Classe et Nation. J’ai donc suggéré la succession nécessaire de deux « familles de modes de production » : la famille communautaire et la famille tributaire. Cette proposition procède de la mise en relief de deux ruptures qualitatives dans une évolution générale : (i) dernière en date : la rupture qualitative dominance de l’instance politico-idéologique (Etat plus idéologie métaphysique) dans l’étape tributaire / dominance de l’instance économique (marché généralisé et idéologie économiste) dans l’étape capitaliste. (ii) antérieurement la rupture qualitative absence d’Etat et idéologie de la parenté dans l’étape communautaire / cristallisation du pouvoir social dans la forme étatique-idéologiquemétaphysique dans l’étape tributaire. Cette proposition impliquait, entre autre, le repérage des formes diverses de chacune des deux étapes et, plus particulièrement, la définition des formes « centrales / périphériques » de l’étape tributaire qualifiant précisément le féodalisme de forme tributaire périphérique. Pour certains, les formes que j’appelle « tributaires » ne constitueraient pas « un » mode de production, au sens de ce que, selon eux, le concept de mode de production implique dans le marxisme. Je ne reviens pas sur ce débat (de
11
marxologie). Si cela « gêne » je suis prêt à troquer le terme de « mode de production tributaire » contre le terme, plus large, de « société tributaire ». Bien entendu, mes propositions restent dans un cadre dominé par la recherche de « lois générales ». Entre autre, sur la base des conceptualisations que je suggère, pour les mêmes raisons, leur « transition » vers le capitalisme, marquée par le développement des éléments « proto-capitalistes ». Mais bien entendu, il existe un courant - qui a le vent en poupe à notre époque - qui refuse toute recherche de lois générales et s’attèle à mettre en relief, au contraire, la spécificité « irréductible » des différents parcours évolutifs. Je tiens cette orientation épistémologique pour un produit de l’eurocentrisme, préoccupé avant tout de légitimer la « supériorité » de l’Occident.
2 - La spécificité de la mondialisation capitaliste J’entends par mondialisation capitaliste que les évolutions qui commandent le système pris dans sa globalité déterminent le cadre dans lequel opèrent les « ajustements » locaux. Autrement dit, ce point de vue systémique relativise la distinction « facteurs externes / facteurs internes », puisque tous les facteurs sont internes à l’échelle du système mondial. Est-il nécessaire de préciser que ce point de vue méthodologique nous sépare des courants dominants (bourgeois et même marxistes) selon lesquels les facteurs internes seraient décisifs au sens que les spécificités de chaque formation nationale (« développée » ou « sous-développée ») tiendraient principalement de ces facteurs « internes », disons « favorables » ou « défavorables » par exemple au développement capitaliste ?
12
Mon analyse est, par ailleurs, fondée sur la distinction qualitative - que je crois décisive - entre les sociétés du capitalisme, dominées par l’économique (la loi de la valeur) et les sociétés antérieures, dominées par le politico-idéologique. Il existe une différence fondamentale entre le système mondial (capitaliste) contemporain et tous les systèmes précédents (régionaux et tributaires), qui appelle un commentaire concernant la loi de la valeur qui commande le capitalisme. J’ai exprimé mon point de vue dans les termes de ce que j’ai appelé « la loi de la valeur mondialisée ». D’une manière générale la loi de la valeur suppose un marché intégré des produits du travail social (qui deviennent alors des marchandises), du capital et du travail. Elle entraîne alors une tendance à l’uniformisation dans l’espace où elle opère, des prix identiques des marchandises et des rémunérations du capital et du travail (sous la forme salariale ou sous celle de la rémunération du petit producteur marchand). Cette approximation correspond bien à la réalité empirique dans les formations capitalistes centrales. Mais à l’échelle du système capitaliste mondial la loi de la valeur mondialisée opère sur la base d’un marché tronqué qui intègre bien le commerce des produits et les mouvements du capital mais en exclut la force de travail. La loi de la valeur mondialisée tend alors à uniformiser les prix des marchandises mais non les rémunérations du travail dont l’éventail de la distribution mondiale est infiniment plus ouvert que celui de la distribution des productivités. La puissance polarisante qui s’exprime à travers la loi de la valeur mondialisée est sans commune mesure qualitativement, quantitativement et par l’espace sur laquelle elle opère (la planète entière) avec les tendances limitées à la polarisation au sein des systèmes tributaires (régionaux) antérieurs.
13
Dans ce cadre, la coupure qualitative que représente le capitalisme conserve sa validité entière; elle se manifeste par un renversement fondamental : la dominance de l’économique se substitue à celle du politico- idéologique. C’est pourquoi le système capitaliste mondial est différent qualitativement de tous les systèmes antérieurs qui sont forcément régionaux, quelle qu’ait été la densité des rapports qu’ils aient pu entretenir les uns avec les autres. Tant que ce renversement n’est pas opéré on ne peut parler que d’éléments proto-capitalistes, quand ils existent, soumis à la logique tributaire dominante. C’est pourquoi je ne suis pas convaincu de l’utilité d’une vision théorique qui, supprimant cette coupure qualitative, confond dans le même continuum dont l’origine se perdrait dans le passé le plus lointain de l’histoire d’un « système mondial » prétendument éternel. On ne peut donc sous-estimer l’importance de la coupure qualitative du capitalisme. Mais alors, en la reconnaissant, on dévoile sa portée historiquement limitée, comme on la dépouille de l’habillement sacré dont l’idéologie bourgeoise l’a vêtu. On ne peut plus écrire ces équations simples et rassurantes, comme capitalisme (aujourd’hui « marché ») = liberté et démocratie, etc. Pour ma part, avec Karl Polanyi, je donne à la théorie marxiste de l’aliénation économiste une place centrale. Avec Polanyi donc j’en conclus que le capitalisme est de ce fait, par nature, non pas synonyme de liberté, mais d’oppression. On restitue à l’idéal socialiste, qui est de libérer de l’aliénation, toute la portée dont on voudrait le vider. La critique de l’eurocentrisme n’implique en rien le refus de reconnaître la coupure qualitative que représente le capitalisme et - le mot lui aussi n’est plus à la mode - le progrès (bien que relatif et historiquement limité) qu’il inaugure. Il n’implique pas non plus un « acte de contrition » par lequel les Occidentaux renonceraient à qualifier cette invention d’européenne. Se
14
situant ailleurs, cette critique est centrée sur les contradictions que l’ère capitaliste ouvre : ce système conquiert le monde, mais il ne l’homogénéise pas; au contraire, il y opère la plus phénoménale polarisation qui puisse être. De ce fait, il ne peut pas être dépassé si l’on renonce à l’exigence d’universalisme qu’il inaugure. Et pour résumer ici en une phrase la critique que j’ai proposée dans l'Eurocentrisme, je dirai : à l’universalisme tronqué de l’économisme capitaliste, forcément eurocentrique, il faut substituer la perspective de l’universalisme authentique d’un socialisme nécessaire et possible. Autrement dit, la critique de l’eurocentrisme ne peut pas être passéiste, faire « l’éloge de la différence » comme on dit.
3 - La transition mercantiliste en Europe 1500 - 1800 Le système mondial n’est pas la forme relativement récente du capitalisme, remontant seulement au troisième tiers du XIXe siècle lorsque se constituent « l’impérialisme » (au sens que Lénine a donné à ce terme) et le partage colonial du monde qui lui est associé. Au contraire, nous disons que cette dimension mondiale trouve son expression d’emblée dès l’origine et demeure une constante du système à travers les étapes successives de son développement. En admettant que les éléments essentiels du capitalisme se cristallisent en Europe à partir de la Renaissance, la date de 1492 - amorce de la conquête de l’Amérique - serait la date de naissance simultanée du capitalisme et du système capitaliste mondial, les deux phénomènes étant inséparables. Quelle est donc la nature de la « transition » 1500 - 1800 ? Diverses qualifications ont été proposées, fondées sur les normes politiques dominantes de l’époque (« l’Ancien Régime » ou « le temps des monarchies absolues ») ou sur la nature de son économie (le mercantilisme). Car certes, confrontées aux critères définissant le mode de production capitaliste, les sociétés mercanti-
15
listes de l’Europe atlantique et ses prolongements vers le centre et l’est du continent posent problème. Ce que l’on repère ici c’est seulement la réunion d’un certain nombre d’éléments préalables à la cristallisation du M.P.C., principalement : (i) l’extension marquée du champ des échanges marchands qui s’emparent d’une bonne part de la production agricole; (ii) l’affirmation de formes modernes de la propriété privée et le respect de ces formes par la loi; (iii) l’extension marquée du travail salarié libre (dans l’agriculture et l’artisanat). Cependant, du fait que le développement des forces productives n’a pas encore imposé « l’usine » comme forme principale de la production, l’économie est plus mercantile (dominée par le « commerce », « l’échange ») que capitaliste. Il s’agit donc presque d’évidence, de formes de la transition. Je ferai deux observations supplémentaires à cette conclusion : Première observation : les formes en question - que certains ont qualifiées de proto-capitalistes (pourquoi pas) - ne sont pas nées miraculeusement et brutalement à partir de 1492. On les retrouve dans les siècles antérieurs. On les trouve dans la région, sur le pourtour méditerranéen, depuis fort longtemps, notamment dans les villes italiennes et de l’autre côté de la mer, dans le monde arabo-musulman. On les trouve également dans d’autres régions et depuis fort longtemps : en Inde, en Chine, etc. Alors pourquoi faire commencer la transition au capitalisme en 1492 et pas en 1350, ou en 900, ou plus en arrière ? Pourquoi ne parler de transition au capitalisme que pour l’Europe et ne pas qualifier les autres sociétés (arabo-islamique, chinoise, etc.) où se retrouvent ces éléments de proto-capitalisme, de sociétés également en transition vers le capitalisme ? Pourquoi ne pas abandonner l’idée de transition dans ces conditions pour lui substituer celle d’une évolution continue d’un système existant depuis fort longtemps et où les éléments de proto-capi-
16
talisme sont également présents depuis des temps très anciens ? Ma seconde observation, qui suit, explique, en partie mon refus de suivre les suggestions exprimées ci-dessus. Seconde observation : la colonisation de l’Amérique accélère d’une manière exceptionnelle l’expansion des éléments proto-capitalistes signalés. Au point que le système social des trois siècles en question soit dominé par ces éléments. Jusqu’alors, et ailleurs, il n’en est pas ainsi; à l’inverse, les segments proto-capitalistes de la société restent enserrés dans un monde dominé par les rapports sociaux tributaires (féodaux en Europe médiévale). Dans la région (Méditerranée-Europe) le réseau dense des villes italiennes ne constitue-t-il pas un « système proto-capitaliste » ? Sans aucun doute les formes proto-capitalistes sont ici, au niveau de l’organisation sociale et politique de ces villes, dominantes. Mais peut-on séparer les villes italiennes (et même d’autres, en Allemagne du Sud, les villes de la Hanse, etc.) de l’ensemble de la chrétienté médiévale ? Or cet ensemble reste, lui, dominé par la vie rurale féodale, avec ses prolongements au plan politique et idéologique : le droit coutumier, l’émiettement des pouvoirs, le monopole culturel de l’Eglise, etc. Dans cet esprit, il me paraît essentiel de donner toute sa place à l’évolution du système politique de l’Europe « proto-capitaliste » du XVIe au XVIIIe siècle. L’évolution qui conduit de l’émiettement féodal du pouvoir médiéval à la centralisation de la monarchie absolue se produit ici précisément concomitamment à l’accélération des développements proto-capitalistes. Cette spécificité européenne est remarquable puisqu’ailleurs -en Chine ou dans le monde arabo-islamique par exemple - nous n’avons pas connu l’équivalent de l’émiettement féodal : l’Etat (centralisé) est antérieur au proto-capitalisme.
17
J’ai attribué cette spécificité européenne au caractère « périphérique » de la société féodale - produit d’une greffe de la formation tributaire méditerranéenne sur un corps encore largement attardé au stade communautaire (l’Europe des Barbares). Or la cristallisation - tardive - de l’Etat, sous la forme de la monarchie absolue, impliquait, dès le départ, des rapports de celui-ci avec les différentes composantes de la société différents de ceux qui gèrent les rapports de l’Etat tributaire central avec celles-ci. L’Etat tributaire central se confond avec la classe dominante tributaire, qui n’a pas d’existence en dehors de lui. L’Etat de la monarchie absolue se construit, au contraire, sur les décombres du pouvoir de la classe tributaire de la modalité périphérique et, pour ce faire, s’appuie fortement sur les éléments proto-capitalistes de la ville (la bourgeoisie naissante) et de la campagne (la paysannerie engagée dans une évolution marchande). L’absolutisme résulte de cet équilibre entre les forces proto-capitalistes nouvelles en essor et les vestiges de l’exploitation féodale. L’écho de cette spécificité se retrouve au niveau du contenu idéologique qui accompagne la formation de l’Etat de l’Ancien Régime, de la Renaissance aux Lumières du XVIIIe siècle. J’insiste sur la spécificité - et avancée à mon avis - de cette idéologie qui rompt avec l’idéologie tributaire. Cette dernière fonde la dominance de l’instance politique sur la base économique sur la prédominance de la vision métaphysique du monde. Je précise, pour éviter tout malentendu, que la métaphysique n’est pas synonyme « d’irrationalité » (comme les courants radicaux des Lumières l’on dépeinte), mais cherche à concilier Raison et Foi (Cf. mes développements sur ce thème dans L'Eurocentrisme). La révolution idéologique de la Renaissance aux Lumières ne supprime pas la métaphysique (le besoin métaphysique), mais elle libère les sciences de leur soumission à celle-ci, ouvrant par là même la voie à la consti-
18
tution d’un champ scientifique nouveau, celui des sciences de la société. En même temps bien entendu, la concomitance (qui n’est pas de hasard) entre les pratiques de l’Etat nouveau (de l’Ancien Régime) et ces développements dans le champ de l’idéologie stimule l’expansion proto-capitaliste. Ainsi va-ton voir les sociétés européennes s’acheminer rapidement vers la « révolution bourgeoise » (1688 en Angleterre, 1776 en Nouvelle Angleterre, 1789 en France) et remettre en question le système absolutiste qui a servi de piédestal aux avancées proto-capitalistes pour inaugurer les concepts nouveaux de la légitimation du pouvoir par la démocratie (fut-elle censitaire). J’insiste aussi sur la dimension « prise de conscience » de cette spécificité par les Européens eux-mêmes. Avant la Renaissance, les Européens (de la chrétienté médiévale) se savent « non supérieurs » (en puissance potentielle) aux sociétés avancées de l’Orient, même s’ils croient leur religion « supérieure » (ce que les autres leur rendent bien !). A partir de la Renaissance, ils savent qu’ils ont acquis une supériorité (potentielle au moins) sur toutes les autres sociétés et pourront désormais conquérir à leur profit la planète entière (ce qu’ils firent).
4 - Les systèmes arabo-islamique et méditerranéen antérieurs Chacun sait que la région arabo-islamique du monde méditerranéen et moyen-oriental a connu des siècles de civilisation brillante, avant même l’explosion des villes italiennes. Ce monde arabo-islamique constitue-t-il un système proto-capitaliste ? Les formes proto-capitalistes y sont présentes et, à certaines époques et dans certaines régions, animent une civilisation brillante. Les réflexions que j’ai avancées dans ce domaine (Cf. La Nation Arabe, L’Eurocentrisme), rejoignent celles offertes par Fawzy Mansour (L’impasse du monde arabe) comme, par certains aspects, les travaux du regretté Ahmad Sadek Saad. Au-delà de diver-
19
gences possibles - ou de nuances -nous sommes de l’avis commun que le système politique arabo-islamique n’est pas dominé par les forces proto-capitalistes (mercantilistes) mais qu’à l’inverse, les éléments proto-capitalistes restent soumis à la logique du pouvoir tributaire dominant. En fait, le monde arabo-islamique a constitué, selon ma thèse, un sousensemble de ce que j’appelle le « système méditerranéen ». J’ai proposé (dans L’Eurocentrisme) de dater l’acte de naissance du « système méditerranéen » par la conquête d’Alexandre le Grand (trois siècles avant J. C) et de voir une seule longue période historique allant de cette date à la Renaissance, englobant d’abord l’Orient ancien (autour du bassin oriental de la Méditerranée) puis la Méditerranée toute entière et ses prolongements arabo-islamique et européen. J’ai proposé à ce sujet une thèse selon laquelle nous aurions affaire ici à un (seul) système tributaire s’étendant de 300 av. J. C. (l’unification de l’Orient par Alexandre le Grand) à 1492. J’entends par là qu’il s’agit d’une seule « aire culturelle » dont l’unité s’est manifestée dans une formulation métaphysique profondément commune (idéologie tributaire de la région), par delà les expressions successives de cette métaphysique (hellénistique, chrétienne d’Orient, islamique, chrétienne d’Occident). Dans cette aire tributaire, je crois utile la distinction que je propose entre ses régions centrales (l’Orient méditerranéen) et ses régions périphériques (l’Occident européen). Au sein de cet ensemble, les échanges de toutes natures ont (presque toujours) été d’une forte densité et les formes proto-capitalistes qui leur sont associées, remarquablement avancées, particulièrement évidemment dans ces régions centrales (notamment aux époques de l’Islam dans sa première grandeur : VIIIe à XIIe siècles, et en Italie pour les siècles successifs). Ces échanges ont été le support d’une redistribution importante du surplus. Cependant la centralisation éventuelle du surplus s’y est trouvée, pour l’essen-
20
tiel, associée à la centralisation du pouvoir politique. Et de ce point de vue, l’ensemble de l’aire culturelle n’a jamais constitué un seul « Etat impérial unifié » (sauf pour les deux courtes périodes de l’Empire d’Alexandre puis de l’Empire romain, couvrant alors l’ensemble des régions centrales du système). D’une manière générale, la région périphérique de l’Occident européen est demeurée émiettée à l’extrême, sous la forme féodale (et c’est là même l’expression de son caractère périphérique). La région centrale elle-même a été partagée entre l’Orient byzantin chrétien et les Empires arabo-islamiques (omeyyade puis abbasside de la première époque), soumis à des forces centrifuges internes, puis réunifiés seulement dans l’Etat ottoman tardif, dont la constitution coïncide avec la fin de la période et la périphérisation globale de la région au bénéfice du transfert du centre vers la région antérieurement périphérique de l’Europe atlantique. Ce « système » méditerranéen pourrait-il être qualifié de proto-capitaliste ? En faveur de cette thèse, on signale la présence d’éléments proto-capitalistes indiscutables (propriété privée, entreprise marchande, travail salarié) qui traversent toute la période, s’épanouissent en certains lieux et temps (notamment dans la région islamique et en Italie), s’étiolent en d’autres (notamment dans l’Europe barbare du premier millénaire). Mais à mon avis, cette présence ne suffit pas à caractériser le système. Car, au plan décisif de l’idéologie, je vois au contraire que ce qui s’élabore dès la phase hellénistique de cette période (de 300 av. J. C. aux premiers siècles de notre ère), puis s’épanouit dans les formes chrétiennes (orientale puis occidentale) et islamique, c’est bel et bien l’idéologie tributaire, avec sa caractéristique fondamentale majeure : la prédominance de la préoccupation métaphysique. Il y a donc bien à mon avis « système », mais non « système proto-capitaliste » (forme de la transition rapide de la société tributaire à la société capitaliste). Il
21
y a « système tributaire ». Je dis bien système et non simple juxtaposition de sociétés tributaires (au pluriel) autonomes, quand bien même auraient-elles partagé quelques éléments communs (comme la religion par exemple, ou l’intégration - fut-elle de durée limitée - dans un Etat impérial, comme ceux de Rome, de Byzance, des Omeyyades et des Abbassides). La distinction implique à mon avis un certain degré de centralisation du surplus. Ce que je précise néanmoins ici c’est que ce surplus est de nature tributaire et non, comme dans le capitalisme, de celle du profit du capital. Le moyen normal de centralisation de ce surplus tributaire est donc la centralisation politique, qui opère au bénéfice des capitales impériales (Rome, Byzance, Damas, Bagdad). Bien entendu, cette centralisation reste aussi fragile que l’est celle du pouvoir. Byzance, Damas et Bagdad ne peuvent éviter que les relais (Alexandrie, Le Caire, Fès, Kairouan, Gênes, Venise, Pise, etc.) parviennent souvent à s’autonomiser. Le pan entier de la chrétienté barbare (le premier millénaire en Occident) échappe à cette centralisation. Parallèlement, la logique de la centralisation par le pouvoir stimule les rapports proto-capitalistes au point que la mercantilisation partielle du surplus n’a jamais disparu dans la région. Je lui ai même donné une grande importance pour certaines régions et époques : les siècles brillants de l’Islam, les villes italiennes, à partir des Croisades. J’ai qualifié, sur cette base, les formations du monde arabe de formations tributaires-mercantiles. Cet angle de vision que je développe m’amène effectivement à conclure que le capitalisme « pouvait » naître ici. Là encore, je renvoie aux débats animés sur cette question auxquels je me suis associé. S’il n’est pas né ici, c’est qu’il est apparu d’abord en Europe atlantique et que, de ce fait, les processus d’évolution vers le capitalisme ont été brutalement arrêtés dans leur développement ailleurs. Quant à la raison pour laquelle l’évolution vers le capitalisme s’est
22
accélérée en Occident atlantique (transférant le centre de gravité du système des bords de la Méditerranée à ceux de l’Océan), elle tient, selon moi, principalement à la colonisation (de l’Amérique puis de la planète entière) et, accessoirement, au caractère périphérique du féodalisme occidental.
5 - Peut-on parler d’un système mondial tributaire ? Mon hypothèse méthodologique me conduit à regarder les autres « aires culturelles » comme d’autres systèmes tributaires autonomes. En particulier, il me semble que le système tributaire chinois - confucéen - constitue un monde par lui-même et en lui-même, avec son propre centre (la Chine) caractérisé par une centralisation politique forte (même si celle-ci, soumise à des forces centrifuges internes, éclate de période en période, mais est toujours reconstituée), et ses périphéries (notamment le Japon), dans un rapport à la Chine très analogue à celui de l’Europe médiévale à l’Orient civilisé. Je laisse en pointillé la question de savoir si l’aire culturelle hindouiste a bien constitué un (seul) système tributaire. Cela étant, la question qui se pose ici est de savoir si le système méditerranéen était isolé, ou en rapport étroit avec d’autres systèmes asiatiques et africains ? Au-delà de la région méditerranéenne et antérieurement à sa constitution, peut-on affirmer l’existence d’un système mondial permanent, en évolution continue ? L’intensité des rapports d’échange entre la Méditerranée protocapitaliste, l’Orient chinois et indien et l’Afrique sub-saharienne, et peut-être même l’importance des échanges entre ces diverses régions de l’ancien monde à des époques antérieures, ont suggéré à certains (notamment A. G. Frank) une réponse allant dans ce sens. Pour ma part, je ne crois pas que dans l’état actuel des connaissances on puisse répondre à cette question. Il n’en est
23
pas moins utile de la poser, en vue de susciter l’échange de vues systématique sur ce que l’on peut déduire de nos connaissances, les hypothèses qu’elles peuvent inspirer et les directions de recherche qu’elles invitent à poursuivre pour la vérification de ces hypothèses. Je ne souhaite pas substituer aux résultats éventuels de ces débats mes propres intuitions. Je les soumets ici seulement à titre provisoire, pour amorcer la discussion. Je proposerai donc les thèses (provisoires) suivantes. Premièrement : l’humanité est une depuis ses origines. On commence à connaître l’itinéraire du peuplement de la planète Terre à partir du noyau d’Hominidés apparus en Afrique Orientale, descendant le Nil et peuplant l’Afrique, traversant la Méditerranée et l’isthme de Suez pour conquérir l’Europe et l’Asie, passant le détroit de Behring et peut-être traversant le Pacifique pour s’installer (à l’époque la plus récente) dans les Amériques. On commence à savoir dater ces conquêtes successives des terroirs de la planète. La question pertinente qui se pose à cette occasion est peut-être la suivante : la dispersion a-t-elle entrainé une diversification des lignes d’évolution des différents groupes humains, installés dans des milieux géographiques d’une diversité extrême et donc confrontés de ce fait à des défis de natures différentes ? Ou bien, au-delà de cette diversification, des lignes d’évolution parallèles imposeraient la conclusion que l’humanité, dans son ensemble, et restée commandée par des « lois » d’évolution de portée universelle ? Et, en complément de cette question, on peut se demander quelle a été l’importance des relations entre les peuplements humains dispersés de la sorte et, par conséquent, l’intensité et la rapidité des transferts de connaissances, d’expériences et d’idées ?
24
Intuitivement, on peut imaginer que certains groupes humains se sont retrouvés relativement isolés dans des conditions particulièrement difficiles et que, de ce fait, ils ont relevé le défi par des adaptations particulières peu aptes à évoluer d’elles-mêmes. Ces groupes seraient donc enfermés dans des impasses, contraints de reproduire leur organisation propre sans que celle-ci n’ait donné les signes de son propre dépassement. Parmi eux peut-être les sociétés (toujours très émiettées) de chasseurs / pêcheurs / cueilleurs de l’Arctique, de la forêt équatoriale, des petites îles et de certaines côtes... Mais d’autres groupes se sont retrouvés dans des conditions moins difficiles qui leur ont permis d’avancer simultanément dans la maîtrise de la nature (passage à l’agriculture sédentaire, invention d’outillages plus efficaces...) et dans l’organisation de sociétés plus denses. C’est à propos de ceux-ci que se pose la question des lois éventuelles de l’évolution sociale à portée universelle et de la place des relations extérieures dans cette évolution. Deuxièmement : à propos des sociétés qui ont visiblement « avancé », peuton retrouver des étapes-stades analogues franchies par toutes, fût-ce à des rythmes plus ou moins rapides ? Toute notre science sociale s’est construite sur cette hypothèse, conçue comme nécessaire. Pour la satisfaction de l’esprit ? Comme moyen de légitimation d’un système de valeurs universaliste ? Les formulations de cette « évolution nécessaire » se succèdent au XIXe siècle, fondées soit sur la succession des modes d’exploitation du sol et des outillages mis en œuvre (du type âge paléolithique, âge néolithique, âge des métaux, etc.), soit sur la succession des formes sociales de l’organisation (du type âge sauvage, âge barbare, âge civilisé...). Diverses évolutions dans des domaines particuliers sont greffées sur ces tendances générales considérées comme fondamentales. Par exemple, la succession matriarcat-patriarcat, la succession des âges de la pensée philosophique (âge primitif animiste, âge métaphy-
25
sique, âge positiviste à la Auguste Comte), etc. Je ne discuterai pas ici ces théories, presque toujours plus ou moins abandonnées par la recherche ultérieure. J’en signale seulement l’existence comme témoignage de la persistance du besoin de généraliser, par-delà l’évidente diversité, qui est le propre de la démarche scientifique. Il me semble que la formulation la plus sophistiquée de toutes les théories de l’évolution générale a été celle proposée par le marxisme, axé sur les concepts synthétiques dits de modes de production, eux-mêmes fondés sur une conceptualisation des éléments de base de cette construction (forces productives, relations de production, infrastructure et superstructure, etc.), et enrichis par la greffe de théories particulières articulées à celles des modes de production (comme la théorie de la famille, celle de l’Etat, etc.). Ici encore, je ne discuterai pas la question de savoir si ces constructions marxistes sont bien celles de Marx lui-même, ou le produit d’interprétations ultérieures, cohérentes ou non avec l’esprit du marxisme de Marx, pas plus que je ne discuterai les questions relatives à la validité de ces théories confrontées à l’amélioration de nos connaissances concernant la réalité des sociétés du passé. Encore une fois, je signale ces formulations comme l’expression de ce même besoin de comprendre, qui implique la possibilité de généraliser. Troisièmement : sur la base des conceptualisations proposées, on repère sans difficulté un certain nombre de sociétés tributaires parvenues plus ou moins au même âge de développement général : techniques productives, outillage, gamme de produits, formes d’organisation du pouvoir, systèmes de connaissances et d’idées, etc. On repère de surcroît un tissu relativement dense d’échanges de toutes natures entre ces sociétés : échanges de produits, de connaissances, de techniques et d’idées. Cette densité d’échanges permet-elle de parler d’un seul système mondial (fut-il qualifié de tributaire) - au
26
singulier ? A. G. Frank nous propose ici un critère précis : il y a un système intégré lorsque les influences réciproques sont « décisives » (A ne serait pas ce qu’il est sans les relations qu’il entretient avec B). Soit, mais la question reste entière : ces relations étaient-elles ou non « décisives » ? Cependant, l’université des lois de l’évolution sociale n’implique en aucune manière la mondialisation. Il s’agit là de deux concepts distincts. Le premier fait référence au fait que des sociétés distinctes - séparées par la distance géographique ou le temps - ont pu évoluer de manière parallèle pour les mêmes raisons profondes. Le second implique que ces sociétés ne seraient pas distinctes les unes des autres mais constitueraient des éléments de la même société mondiale. Dans l’évolution de celle-ci - globale par la force des choses - les lois en question sont inséparables des effets de l’interaction entre les différentes composantes de la société mondiale. Je ferai sur ce plan deux observations liminaires : (i) les échanges économiques ne constituent pas nécessairement un élément décoratif dont l’existence n’aurait aucune influence marquante sur le mode de production et par delà, le niveau de développement. L’échange peut être un moyen important de redistribution du surplus, décisif pour certains segments des sociétés mises en rapport. La question n’est pas de principe, mais de fait. L’étaient-ils ? Où et quand ? Je me méfie ici de toute généralisation hâtive, concluant soit qu’ils l’étaient toujours (ou généralement) soit qu’ils ne l’étaient jamais (sauf rares exceptions). Dans le cas de la région arabo-islamique par exemple, j’ai dit que les échanges étaient ici importants au point de marquer la formation d’un caractère tributaire-mercantile essentiel à la compréhension de son histoire, notamment de la succession (involutive) d’une phase brillante suivie d’une décadence, comme du déplacement des centres de gravité de la richesse et du pouvoir dans cette région. J’ai dit aussi que la formation proto-capitaliste de
27
l’Europe mercantiliste (XVII-XVIIIe siècles) avait franchi rapidement cette étape vers le capitalisme grâce à ces échanges, dominés par elle. Mais les échanges ont-ils occupé une place symétrique en Chine, en Inde, dans l’Empire Romain, etc. Je n’en sais personnellement rien. ii)les échanges en question ne doivent pas être réduits aux seuls échanges économiques. Loin de là. L’historiographie, d’ailleurs, met davantage l’accent, pour ce qui est des époques antérieures au capitalisme, sur les échanges culturels (et notamment l’expansion des religions) et militaro-politiques (construction et dislocation d’Empires, invasions barbares, etc.), tandis que l’accent est mis sur la dimension économique dans les rapports au sein du système mondial moderne. A-t-elle tort ? Je ne le crois pas. Je crois au contraire que, ce faisant, elle a saisi - fût-ce intuitivement - le renversement des dominances, du politico-idéologique à l’économique qui est l’axe central de ma thèse. Or, sur ce plan, peut-on parler d’un seul système mondial politico-idéologique tributaire ? Je ne le crois pas et j’ai préféré, pour cette raison, parler « d’aires culturelles » tributaires distinctes fondées précisément sur les grands systèmes de références -religieuses le plus souvent - particulières : confucianisme, hindouisme, islam, christianisme... Bien entendu, il y a une certaine parenté entre ces différentes métaphysiques puisqu’elles expriment l’exigence fondamentale du même type de société -tributaire. Cette parenté facilite à son tour les emprunts mutuels. Pour avancer donc dans la réponse à la question posée (un ou des systèmes ?), il faut combiner trois éléments : la densité des échanges économiques et des transferts de surplus redistribué par leur canal, le degré de centralisation du pouvoir politique, la diversité / spécificité relative et, partant, l’autonomie des systèmes idéologiques.
28
L’autonomie des différents systèmes tributaires n’exclut pas des relations d’échanges économiques et autres entre eux, ni même que ces échanges aient pu être importants. On comprendrait mal beaucoup de faits et d’évolutions historiques sans référence à ces échanges : les transferts de technologies de toutes sortes (la boussole, la poudre à canon, le papier, la soie qui a donné son nom aux routes en question, l’imprimerie, les pâtes alimentaires chinoises devenues italiennes... !), les migrations d’idées religieuses (le bouddhisme se transférant de l’Inde à la Chine et au Japon, l’Islam voyageant jusqu’en Indonésie et en Chine, le christianisme jusqu’en Ethiopie, en Inde du Sud et en Asie centrale, etc. Mais au-delà de ces échanges qui ont pu fonder ici et là des formes protocapitalistes vivaces reliées entre elle (de la Chine et l’Inde au monde islamique, sahélien africain et médiéval européen) et, par leur moyen, des transferts de surplus - peut-être même décisifs dans les nœuds principaux du réseau des échanges - il n’y a certainement pas de centralisation du surplus au niveau d’un système mondial comparable à celle qui caractérise le monde moderne. La raison en est que la centralisation du surplus opère à cette époque principalement en association avec celle du pouvoir et qu’il n’y a aucune forme d’un « Empire-monde » ou même d’un « pouvoir-monde » comparable à ce que deviendra l’hégémonie britannique au XIXe siècle ou celle des Etats-Unis à notre époque. Ainsi n’y a-t-il rien de comparable au plan de la polarisation à l’échelle globale entre les époques anciennes (tributaires) et celle du monde capitaliste moderne. Les systèmes antérieurs, en dépit des effets importants tenant aux échanges entre eux, ne sont pas polarisants à l’échelle mondiale, même s’ils l’ont été à des échelles régionales, au profit des centres de ces systèmes régionaux (par exemple Rome, Constantinople, Bagdad, les villes italiennes, la
29
Chine, l’Inde, etc.). Par contre, le système capitaliste est bel et bien polarisant à l’échelle globale et, de ce fait, mérite seul d’être qualifié de système mondial au sens plein du terme. Cela étant, la méthodologie proposée en ce qui concerne l’analyse des interactions entre les systèmes tributaires invite à réviser peut-être les jugements traditionnels suggérés par l’historiographie concernant les fameux « barbares » qui occupent les espaces interstitiels séparant les grandes aires culturelles tributaires. Le rôle de ces « barbares » est-il bien celui que l’on a voulu leur conférer ? Un rôle purement négatif de destructeurs ? Ou bien leur fonction active dans les échanges inter-tributaires leur a-t-elle donné une certaine vocation à prendre quelques initiatives décisives, qui expliqueraient entre autres, soit leur succès (pas seulement militaire) à unifier des territoires immenses (l’Empire de Gengis Khan), soit leur capacité à se hisser rapidement à des positions centrales dans un système tributaire (le rôle brillant du Khorezm dans les premiers siècles de l’Islam), etc. Une dernière réserve concernant la systématisation de l’hypothèse de l’existence d’un seul système mondial à travers l’histoire. Antérieurement aux VeIIIe siècles av. J. C. peut-on parler de systèmes tributaires et de réseaux d’échanges significatifs entre eux ? Je ne le crois pas, au moins pour les trois raisons suivantes : (i) parce que les systèmes sociaux de la majeure partie de l’humanité étaient encore attardés au stade que j’ai qualifié de communautaire; (ii) parce que les îlots de civilisation parvenus au stade où l’Etat y est la forme reconnaissable de l’expression du pouvoir n’ont pas encore trouvé une expression idéologique tributaire achevée (Cf. mes développements sur ce point, concernant l’idéologie du monde antique dans l'Eurocentrisme); (iii) parce que la densité des rapports d’échanges entre ces îlots demeure encore
30
faible (cela n’exclut pas quelques emprunts - technologiques par exemple -qui ont pu parcourir des distances insoupçonnées).
6 - Critique de l’évolutionnisme La thèse selon laquelle toutes les sociétés humaines auraient, de tout temps, constitué un système mondial intégré en évolution permanente sans que le capitalisme n’ait constitué dans cette évolution une coupure qualitative, propose une philosophie de l’histoire finalement fondée sur le concept de compétition. Certes elle procède bien d’une observation réaliste des faits, à savoir que toutes les sociétés de la planète, à toutes les époques, sont d’une certaine manière en compétition les unes avec les autres. Il n’importerait pas qu’elles en aient conscience, du fait des relations qu’elles entretiennent entre elles ou pas. Nous savons que le plus fort doit l’emporter et s’imposer. A ce niveau d’abstraction il y a bien un seul monde, parce qu’il y a une seule humanité. On pourrait même peut-être ajouter que les sociétés plus ouvertes, entretenant des rapports denses avec les autres, ont davantage de chances de prendre la mesure de cette compétition et de pouvoir y faire face plus efficacement; a contrario, que ceux qui refusent cette compétition et cherchent - en s’enfermant sur eux-mêmes - à perpétuer leur façon d’être risquent d’être dépassés par les progrès réalisés ailleurs puis, de ce fait, ultérieurement marginalisés. Ce discours n’est pas erroné, mais il est simplement situé à un niveau d’abstraction trop élevé, qui rabote la question véritable qui est de savoir comment se manifeste cette compétition. Deux historiens bourgeois - philosophes de l’histoire eux aussi - se sont situés délibérément à ce niveau de l’abstraction la plus générale (pour réfuter Marx). Arnold Toynbee suggère, dans cet esprit, un modèle opératoire réduit à deux termes : le « défi » et la
31
« réponse au défi ». Valable pour tous les temps et tous les lieux, je dirai que ce modèle ne nous apprend rien qui ne soit déjà évident car Toynbee ne propose pas une loi quelconque qui expliquerait pourquoi le défi est relevé ou ne l’est pas. Il se contente de rendre compte du fait au cas par cas. Un parallèle s’impose ici presque naturellement avec le contraste qui oppose les axiomes de l’économie bourgeoise dite néoclassique définis en termes qui se voudraient valables pour tous les temps (la rareté, l’utilité, etc.) à la vision historique de modes de production successifs qualitativement différents, déterminant des cadres institutionnels spécifiques dans lesquels s’expriment la « rationalité éternelle des êtres humains ». Jacques Pirenne, à mon avis très supérieur à Toynbee, propose plus finement un contraste permanent entre sociétés ouvertes (maritimes) et sociétés fermées (continentales) et n’hésite pas à qualifier les premières de capitalistes (Sumer, la Phénicie, la Grèce, l’Islam des premiers siècles, les villes italiennes, l’Occident moderne) les secondes de féodales (de la Perse antique au Moyen-âge européen). Il n’a jamais hésité à donner à ce que j’appelle éléments proto-capitalistes la place déterminante dans les avancées des sociétés ouvertes, faisant d’elles le moteur du développement des forces productives. Il n’a jamais non plus caché que sa thèse visait aussi à disqualifier les expériences fermées de l’Union Soviétique et à valoriser le dynamisme du monde atlantique. Ainsi, à la lutte des classes Pirenne parvient-il à substituer - avec talent certainement - la lutte permanente entre la tendance capitaliste et la tendance féodale au sein des sociétés humaines. Je crois toujours que la méthode de Marx est supérieure, précisément parce qu’elle situe l’abstraction au niveau qu’il convient. L’idée de modes de production restitue à l’histoire sa dimension concrète réelle. A ce niveau on découvre l’importance et la nature de la coupure capitaliste. Celle-ci est telle qu’il ne me
32
paraît pas possible de traiter de la même manière la compétition entre les sociétés d’autrefois et celle qui règne au sein du système mondial moderne. D’abord parce que la compétition d’autrefois parvient rarement à franchir le seuil de la conscience et que chaque société se croit supérieure à sa manière, « protégée par ses dieux », même lorsqu’une proximité agressive permanente imposerait une meilleure conscience (comme entre Musulmans et Croisés). D’ailleurs, l’écart entre les grandes sociétés précapitalistes tributaires n’est pas tel que la supériorité de l’une sur l’autre soit évidente : elle est toujours conjoncturelle et relative. Rien de comparable à la supériorité désormais écrasante des sociétés capitalistes sur les autres. C’est pourquoi j’attribue à la prise de conscience de cette supériorité une importance décisive et date, de ce fait, les débuts du capitalisme à l’an 1492. A partir de ce moment les Européens savent que désormais ils peuvent conquérir le monde et qu’ils vont le faire (Cf. mes développements sur ce point dans l'Eurocentrisme). Nous savons a posteriori - mais les acteurs de l’époque l’ignorent - que le plus fort est celui qui est passé à un mode de production qualitativement supérieur - le capitalisme. J’ajouterai que, dans la compétition d’autrefois, la distance opère pour en atténuer l’acuité. Quelle qu’ait pu être l’intensité des échanges entre Rome et la Chine, j’ai de la difficulté à croire que ce facteur « externe » ait pu avoir une importance similaire à celle des écarts de productivité de notre époque. Je crois que cet éloignement relatif donnait aux facteurs strictement internes un poids relatif considérablement plus décisif. D’ailleurs, cette raison est ellemême largement responsable de la difficulté que les uns et les autres ont éprouvée à prendre conscience des rapports de forces véritables. Tout autre est, me semble-t-il, la compétition au sein du système mondial moderne, dont la conscience est si aiguë qu’elle revient comme une litanie lancinante dans le discours quotidien des pouvoirs.
33
7 - Le schéma du système mondial tributaire Le schéma joint illustre la conception que je me fais du « système mondial ancien » (réduit aux sociétés de l’hémisphère dit oriental : Eurasie-Afrique), pour les époques couvrant les dix-huit siècles qui séparent la formation du système hellénistique au Moyen Orient (300 av. J. C.), la constitution de l’Etat Han en Chine (200 av. J. C.), celle des Etats Kouchan et Maurya en Asie Centrale et en Inde (200 av. J. C.), de la Renaissance européenne, soit de 300 av. J. C. à 1500 ap. J. C. J’en résumerai les caractères dans ce qui suit.
34
Tableau I L'incubation (des origines à 200 AV. J. C.)
Premièrement : toutes les sociétés de cette époque sont, comme je l’ai déjà dit, de nature tributaire. On distingue néanmoins, parmi toutes ces sociétés, celles que je qualifie de « tributaires centrales » de celles qui sont « tributaires périphériques ». Les premières sont caractérisées par une centralisation du surplus à l’échelle de l’Etat relativement forte et sa redistribution sous son contrôle, tandis que dans les formations périphériques, le caractère embryonnaire de l’Etat (voire son inexistence, ou presque) entraîne un émiettement extrême de la répartition du surplus accaparé par les « féodalités locales ». L’opposition centres / périphéries n’est pas ici l’analogue de celle qui caractérise le monde capitaliste (moderne). Dans ce dernier le rapport en question
35
est un rapport de domination économique des centres sur la périphérie (associé à la dominance de l’économique). Il n’en est pas de même dans le rapport ancien. Dominées par l’instance idéologique, les formations tributaires sont centrales ou périphériques selon le degré d’achèvement de la centralisation du pouvoir et de son expression par une religion d’Etat. Dans les formations centrales celle-ci prend la forme d’une religion ou d’une philosophie d’Etat à tonalité religieuse, à vocation universelle -qui rompt avec les religions de terroir spécifiques des époques antérieures que j’ai qualifiées de « communautaires » (Cf. Classe et Nation). La concomitance est frappante entre la constitution des grandes sociétés tributaires dans leur forme achevée et la naissance des grands courants religieux et philosophiques qui domineront les civilisations pendant les deux mille ans qui suivent : l’hellénisme (300 av. J. C.), le christianisme oriental, l’Islam (600 AD), Zoroastre, Boudha et Confucius (tous trois 500 av. J. C.). Cette concomitance - qui n’exclut nullement les emprunts réciproques véhiculés par les rapports que toutes les civilisations tributaires entretenaient entre elles - n’est pas pour moi un hasard, mais au contraire l’une des bases cohérente avec ma thèse du mode tributaire dominant. La constitution des grands mouvements philosophiques et religieux, associée à la formation des systèmes tributaires, représente la première grande vague des révolutions de l’histoire universelle, qui s’exprime par une vision à vocation universaliste dépassant les horizons de la pensée de terroir des époques antérieures. Cette révolution fonde le système tributaire, comme système général à l’échelle de l’humanité entière - ou presque -, pour 2 000 à 2500 ans. La seconde vague des révolutions de portée universelle, qui ouvre la modernité capitaliste et son dépassement socialiste éventuel, et marquée par la Renaissance (et la révolution dans le christianisme qui lui est associée) puis par
36
les trois grandes révolutions modernes, la française, la russe et la chinoise (Cf. L’Eurocentrisme). Le « modèle » par excellence de ce mode tributaire me paraît fourni par la Chine qui, sans incubation longue semble-t-il (un millénaire seulement sépare les Shang et les Zhou de la formation de la dynastie Han), se cristallise dans une forme qui n’évoluera pas fondamentalement, ni au plan de l’organisation des forces productives et des rapports de production, ni à celui de l’idéologie (le tandem confucianisme-taoïsme, remplacé un moment seulement par le Bouddhisme), ni à celui des concepts du pouvoir, pendant les deux mille ans qui séparent la dynastie Han de la révolution de 1911. La centralisation du surplus est ici maximale, à l’échelle d’une société énorme, non seulement pendant les périodes brillantes où l’unité politique est réalisée, ou presque, à l’échelle de ce pays-continent par les grandes dynasties (Han, Tang, Song, Yuan, Ming et Qing) mais même pendant les périodes de troubles interdynastiques où le pays est partagé entre quelques royaumes dont la taille est néanmoins considérable pour l’époque. Aux lisières de la Chine, la Corée et le Vietnam se constituent également au cours du premier millénaire de notre ère en systèmes tributaires analogues, qui d’ailleurs, en dépit de leur indépendance politique vis-à-vis de la Chine, lui empruntent son modèle d’organisation et son idéologie confucéenne. Au Moyen-Orient, le système tributaire prend sa forme achevée à partir de la conquête d’Alexandre le Grand. J’ai proposé (Cf. L'Eurocentrisme) de lire dans ces termes la signification des élaborations philosophiques et religieuses successives de l’hellénisme, du christianisme oriental et de l’Islam. Cependant, dans cette région, la période d’incubation plonge des racines lointaines, antérieures de trente siècles pour l’Egypte et la Mésopotamie, dix siècles pour la Perse, la Phénicie, etc., cinq siècles pour la Grèce. L’hellénisme, le christianisme et l’Islam produiront d’ailleurs une synthèse qui emprunte des éléments déci-
37
sifs à chacune de ces composantes antérieures et même, à travers la Perse, à l’Inde. Là aussi, la centralisation du surplus pour les 2 000 ans qui suivent est remarquable. Sans doute la région sera-t-elle partagée, après l’unification politique précaire du temps d’Alexandre; mais elle le sera en royaumes de tailles considérables pour l’époque. Partagés par la suite entre des Empires encore plus vastes - celui de Byzance (300 à 1400 AD) et celui des Sassanides (200 à 600 AD), puis réunifiés progressivement par l’expansion du khalifat musulman, formé dès le VIIe siècle AD qui conquiert Constantinople à la fin de notre période - en 1453 -, les espaces de centralisation du surplus sont toujours soit gigantesques (pendant les trois premiers siècles de khalifat), soit tout au moins considérables, après l’éclatement du khalifat à partir de l’an 1 000, au bénéfice de dynasties arabo-berbères en Afrique du Nord et turcopersanes au Mashreq et en Asie centrale occidentale. L’Empire romain d’Occident trouve sa place dans cette lecture de l’histoire comme expression d’une expansion du modèle tributaire vers les rivages de la Méditerranée occidentale. D’une importance seconde à l’échelle de l’histoire universelle, l’Empire romain tient sa place au fait qu’il a précisément transmis l’idéologie tributaire - sous la forme du christianisme occidental - à la périphérie européenne. La lecture eurocentrique de l’histoire (Cf notre critique dans l'Eurocentrisme) en a, de ce fait, défiguré les réalisations qui, au-delà de la péninsule italienne, n’ont pas résisté à la féodalisation barbare (c’est-à-dire à l’émiettement du système tributaire). Un troisième centre tributaire achevé se constitue sur le continent indien 200 ans av. J. C., dès l’époque Maurya, suivi des Etats Kouchan (à cheval sur l’Asie centrale méridionale) et Gupta, après la longue période d’incubation qui démarre avec les civilisations de l’Indus (Mohendjo-Daro et Harrap - 2500 av. J. C.). La conquête musulmane à partir du XIe siècle, succédant à une période de
38
pulvérisation (des VIII et IXe siècles), rétablit, avec les Ghaznévides, les Sultanats de Dehli (1200-1500 AD) puis l’Empire Moghol (1500-1800 AD), une centralisation tributaire à une échelle énorme, tandis que les Etats hindouistes du Dekkan, tributaires également, représentent tout également des royaumes considérables pour l’époque. Trois zones apparaissent sur notre schéma, dont le caractère périphérique pendant la totalité, ou presque, de la période considérée (de 300 av. J. C. à 1500 ap. J. C.) est frappant. L’Europe (au-delà de la région byzantine et de l’Italie), c’est-à-dire finalement l’Europe « barbare », est le produit d’une greffe tributaire (transmise par l’idéal de l’Empire romain et l’universalisme chrétien) sur un corps social encore largement organisé sur des bases communautaires dégradées. Je renvoie ici à l’analyse que j’en ai proposée en ces termes (Cf. Classe et Nation) qui rend compte simultanément de l’émiettement dans le contrôle des surplus, qui définit le féodalisme (forme inachevée - périphérique - du système tributaire), et de l’effondrement du système étatique, compensé partiellement par l’Eglise. L’Europe évolue lentement vers la forme tributaire, dont témoigne la constitution des monarchies absolues (en Espagne et au Portugal après la Reconquista, en Angleterre et en France à partir de la Guerre de Cent ans); mais ce retard a constitué -selon ma thèse - l’avantage décisif qui a facilité le saut qualitatif précoce de la Renaissance et du capitalisme (Cf. Classe et Nation). Le Japon constitue, à l’autre extrémité du continent eurasiatique, un mode tributaire périphérique dont l’analogie avec l’Europe m’avait frappé, avant même que Mishio Morishima ne vienne confirmer ma thèse. La forme dégradée du confucianisme japonais, l’émiettement féodal qui précède la
39
formation tardive d’une centralisation monarchique à partir de l’Etat Tokugawa (1600 AD) témoignent de ce caractère périphérique (Cf. L’eurocentrisme) qui, ici également, rend compte de l’aisance remarquable avec laquelle le Japon passe au capitalisme au XIXe siècle. L’Afrique sud-saharienne constitue la troisième périphérie. Celle-ci est encore très largement attardée au stade communautaire en évolution vers des formes tributaires. A ce stade les centralisations tributaires du surplus n’opèrent encore que sur des sociétés de taille fort limitée. L’émiettement demeure donc la règle. Le statut de l’Asie du Sud-Est est ambivalent. Il me semble que l’on peut reconnaître ici des formations tributaires de type central - même si elles ne couvrent que des espaces plus modestes que celles des autres grandes formations asiatiques -et des zones périphériques (définies par l’émiettement du surplus). Au premier type appartient l’Empire Kmer, puis ses successeurs thaï, birman et cambodgien, à partir du VIe siècle, et peut-être en Indonésie le royaume Majapahit à partir du XlIIe siècle. Par contre, les sociétés organisées de Malaisie et d’Indonésie qui se cristallisent en Etats sous l’influence de l’hindouisme (à partir du Ve siècle) puis de l’Islam, me paraissent appartenir à la famille périphérique, émiettées par l’éparpillement du surplus collecté à l’échelle d’Etats de tailles très modestes, relativement nombreux et fragiles. Le statut de la région de l’Asie centrale est particulier. La région elle-même reste moins définie dans ses frontières que les autres. Des Etats d’une taille importante s’y sont constitués à une époque précoce - comme l’Empire Kouchan - reliant d’un trait continu le Moyen-Orient hellénistique et sassanide puis islamique à l’Inde et à la Chine. La région est elle-même devenue le centre de gravité d’un immense Empire -à l’époque de Gengis Khan (1300
40
AD). Avant comme après cette dernière cristallisation, elle était entrée dans l’orbite islamique. Ses modes d’organisation sont de nature tributaire, tantôt ici ou là avancée (lorsque l’expression du pouvoir centralisé sur une grande échelle le permet), tantôt retombant dans l’émiettement « féodal ». Mais la grande particularité de la région est que, par sa position géographique même, elle est la zone de transit obligé des échanges Est-Ouest (Chine, Inde, Moyen-Orient et au-delà vers les périphéries du système). En concurrence avec la voie maritime aussi loin que l’on remonte dans le temps, la voie continentale ne perdra définitivement son importance que tardivement, à partir du XVIe siècle. Dans le schéma joint, les centres sont indiqués par des rectangles, les périphéries par des cercles. Deuxièmement : pendant toute la période des dix-huit siècles considérés, toutes les sociétés représentées sur notre schéma non seulement connaissent leur existence mutuelle, mais encore entretiennent des rapports d’échanges de toutes natures (commerce et guerre, emprunts technologiques et culturels), beaucoup plus intenses qu’on ne le croit généralement. Dans ce sens très général, on peut parler de « système mondial », sans bien sûr être obligé d’en confondre la nature avec celle du système mondial (capitaliste) moderne. Dans le schéma, j'ai représenté ces rapports par 11 flèches. Bien entendu, l'intensité des flux que chacune de ces flèches représente a varié d'une manière considérable dans le temps et dans l'espace. Mais surtout - et j'insiste sur ce point - leur articulation avec la dynamique interne propre aux différents systèmes tributaires qu'elles relient, non seulement est fondamentalement différente de celle qui caractérise les « rapports internationaux » dans le
41
système mondial moderne, mais encore a opéré de manière différente d'une formation tributaire à l'autre.
Pour y voir clair, je propose de distinguer quatre ensembles de rapports : i)
Les rapports que les trois grands centres (A - Rome et Byzance - l'Empire Sassanide - le Khalifat; B - la Chine; C l'Inde) ont entretenus entre eux sont marqués par les flèches 1 (Moyen-Orient - Chine à travers l'Asie centrale septentrionale). 2 (Moyen-Orient - Inde à travers l'Asie centrale méridionale) et 3 (Moyen-Orient - Inde par la voie maritime). Ces rapports ont été
42
sans doute les plus intenses de tous, compte-tenu simplement de la richesse et de la puissance relative des centres en question, au moins dans les périodes brillantes de leur histoire. ii) Les rapports que le centre arabo-persan islamique a entretenu avec les trois périphéries (Europe, Afrique, Asie du Sud-Est) sont indiqués par les flèches 4 (voie maritime Moyen-Orient - Malaisie, Indonésie), 5 (voie transsaharienne Afrique du Nord - Sahel africain), 6 (voie maritime MoyenOrient -Côte orientale Swahili d'Afrique) et 7 (Khalifat et Byzance -Europe). Les échanges en question sont moins intenses que les précédents (du fait de la pauvreté relative des périphéries) mais surtout asymétriques (concept que je ne confonds pas avec l'inégalité spécifique des rapports centres / périphéries du monde moderne), dans ce sens qu'ils ont peut-être été relativement neutres dans leurs effets sur le centre mais décisifs pour l'évolution des périphéries. Ces rapports ont accéléré considérablement la constitution des Etats dans le Sahel africain et en Afrique orientale (Cf. Classe et Nation) comme en Malaisie et en Indonésie et, par là même, ouvert la voie à l'islamisation de ces régions (l'Islam se substitue alors aux religions de terroir antérieurs, en vertu d'une nécessité propre aux monde tributaire). Ils ont également animé la renaissance des villes commerçantes italiennes, et, à travers elles, accéléré la progression des infiltrations marchandes à travers toute l'Europe féodale. iii) Les rapports que le centre chinois a entretenu avec la périphérie japonaise (flèche 8) et celle du Sud-Est asiatique (flèche 9) sont de même nature que les précédents. Je signale ici la flèche 11 qui indique une communication directe établie entre la Chine et l’Europe, empruntant bien sûr les voies de l’Asie centrale mais sans passer par le canal du cœur du Khalifat islamique. Cette relation directe n’a opéré que durant une période relativement
43
courte dans le cadre de la paix mongole (l’Empire de Gengis Khan au XIIIe siècle). Mais elle a été décisive pour l’histoire ultérieure car elle a permis à l’Europe de faire des emprunts technologiques importants à la Chine (poudre à canon, imprimerie, boussole, etc.), parce que l’Europe était mûre pour le faire et effectuer le saut qualitatif du système tributaire périphérique (féodal) au capitalisme. D’ailleurs, peu de temps après, l’Europe substituait la voie maritime dominée par elle à toutes les formes antérieures de transport à longue distance, établissant par ce moyen des rapports directs entre elle et chacune des autres régions du monde (Afrique, Inde, Chine, Asie du Sud-Est), découvrant, puis conquérant, l’Amérique par la même occasion. iv) Les rapports que le centre indien (bouddhique et hindouiste) a entretenus avec ses périphéries du Sud-Est asiatique (flèche 10) qui sont d’une nature analogue à celle des rapports Chine-Japon. Il apparaît d’évidence que l’intensité des flux extérieurs par rapport aux différentes masses constituées par les formations régionales considérées varie considérablement d’une région à l’autre. Les trois régions centrales clés A, B et C (Moyen-Orient, Chine, Inde) représentaient, en termes de poids économique, un multiple de ce que constituait chacune des autres régions. Si donc le volume du surplus centralisé dans chacune de ces régions centrales clés est mesuré par l’indice 1 000, il ne devait guère dépasser l’indice 100 pour chacune des autres régions (Europe, Afrique, Japon, Asie centrale, Asie du Sud-Est). De surcroît, une partie seulement, et probablement relativement mineure (10 à 20 % peut-être), de ce surplus pouvait être l’objet d’échanges à longue distance.
44
Les quatre flèches qui concernent la Chine (la majeure 1, les mineures 8 et 9 et l’épisodique 11) pouvaient par exemple représenter une valeur indice de l’ordre de 100 (10 % du surplus produit en Chine). Les trois flèches qui concernent l’Inde (les deux majeures 2 et 3 et la mineure 10) ne pouvaient guère dépasser l’indice 50 ou 70. Tous les historiens ont fait remarquer ce fait que les échanges extérieurs de ces deux masses continentales étaient marginaux par rapport au volume de leur production. Par contre, le poids des échanges extérieurs paraît plus marqué pour la région A qui est la seule qui soit en rapport direct avec toutes les autres. Aux flèches majeures 1, 2 et 3 représentant les échanges de A avec B et C (valeur indice totale : 115 dans notre hypothèse) s’ajoutent les échanges de la région avec les périphéries Europe (flèche 7), Afrique (flèches 5 et 6) et Sud-Est asiatique (flèche 4), un total peut être de l’ordre d’une valeur indice 25. Au total alors les échanges extérieurs auraient représenté ici une valeur indice de 140 (20 % du surplus ?). Pour chacune des périphéries également la contribution des échanges extérieurs apparaîtrait relativement forte : indice 20 pour l’Europe, 10 pour l’Afrique, 20 pour l’Asie du Sud-Est et 20 pour le Japon, soit 20 % à 30 % des surplus générés dans ces régions. De même les flux transitant par l’Asie centrale (flèches 1, 2 et 11), de l’ordre d’un indice 100, auraient pu représenter un volume supérieur, même à celui du surplus généré localement ! Les valeurs indices attribuées tant aux volumes du surplus généré dans chaque région qu’aux volumes des échanges symbolisés par chacune des flèches sont, bien entendu, construites par nous pour suggérer des ordres de grandeur relatifs. Il appartient aux historiens d’en établir de meilleurs. À défaut (et nous n’avons rien trouvé dans ce domaine), les chiffres que j’indique consti-
45
tuent des ordres de grandeur qui me paraissent plausibles et que l’on peut résumer dans le tableau ci-dessous : Surplus généré localement (1) Moyen-Orient Chine Inde Europe Afrique Japon Asie du Sud-Est Asie centrale
Flux extérieurs (2)
800 1 000 1 000 100 50 60 60 60
140 100 60 20 10 20 20 100
% 2/1
20 % 10 % 6% 20 % 20 % 30 % 30 % 150 %
La géographie a donné à la région centrale clé A un rôle exceptionnel, sans concurrent possible jusqu’aux temps modernes, lorsque l’Europe, par la domination des mers, en a contourné les contraintes. Cette région est en effet directement en contact avec toutes les autres (Chine, Inde, Europe, Afrique) et elle est la seule à l’être. Elle a été pendant deux millénaires le lieu de passage forcé pour aller d’Europe en Chine, en Inde ou en Afrique. Par ailleurs, la région n’a pas d’homogénéité relative analogue à celle de la Chine ou de l’Inde, ni au plan géographique (s’étendant des rivages marocains de l’Atlantique à la Mer d’Aral, au Pamir et à la Mer d’Oman, elle n’a pas la consistance d’un bloc continental comme la Chine et l’Inde), ni à celui des peuples dont elle est constituée, issus eux-mêmes du pullulement précoce des civilisations les plus anciennes (Égypte, Sumer, Assyrie, Mésopotamie, Iran, Hittites, Phéniciens et Grecs), parlant des langues de familles diverses (sémitiques, hamitiques, indo-européennes). La conquête d’Alexandre et le triomphe de la
46
synthèse hellénistique amorcent une prise de conscience collective renforcée ultérieurement par le christianisme oriental (limité par la frontière Sassanide) puis et surtout l’Islam. L’une des clés du succès de l’Islam tient, à mon avis, à cette réalité; et la région se constitue dans sa forme définitive dans le temps court des trois premiers siècles de l’Hégire. Elle se constitue alors des trois strates superposées des peuples islamisés : les Arabes de l’Atlantique au Golfe, les Persans du Zagros au Pakistan, les Turcs en Anatolie et dans l’ensemble du Turkestan, de la Caspienne à la Chine propre. Ainsi, l’Islam n’a pas seulement unifié les peuples de l’Orient dit classique mais annexé simultanément l’Asie centrale, lieu de passage forcé vers la Chine et l’Inde septentrionale. Je crois que ce succès doit être associé au fait que, en dépit de tous les conflits locaux d’intérêts politiques dont l’histoire témoigne ici comme ailleurs, il a créé une certaine solidarité et renforcé le sens d’une identité particulière face aux autres, c’est-à-dire précisément aux Chinois, Indiens, Européens et Africains que l’Umma musulmane côtoie sur chacune de ses frontières. En Asie centrale, le succès de l’Islam crée l’unité régionale absente jusqu’alors. Car la civilisation dans cette région, par laquelle transite des valeurs supérieures probablement à celles produites au titre du surplus généré localement, dépend de la capacité à capter au passage une partie de ces flux de transit. L’importance des rapports avec les autres, pour toute la région centrale clé A et son annexe d’Asie centrale, donne à son système social un caractère particulier que j’ai qualifié pour cette raison de tributaire-mercantile, marquant par là même l’importance des formes proto-capitalistes (rapports marchands, travail salarié, propriété privée) dans les sociétés tributaires du monde islamique arabe, persan et turc. D’ailleurs l’expansion de l’Islam au-delà de cette région, c’est-à-dire sa conquête progressive des périphéries africaines et du
47
Sud-Est asiatique, est, elle également, à mettre en rapport étroit avec son dynamisme mercantile (Cf. La Nation arabe, Classe et Nation). Troisièmement : le système mondial écrit ci-dessus pour la période des dix-huit siècles qui précèdent la Renaissance n’est pas l’analogue du système moderne qui lui succédera (dans le temps). Parler du système ancien dans sa globalité spatiale et temporelle, ou même dans sa composante arabo-islamique, comme de l’ancêtre du système moderne est trompeur. Car ou bien il ne s’agit là que d’une platitude - la succession dans le temps sans plus -, ou bien on sous-entend qu’il n’y a pas eu de rupture qualitative mais seulement développement quantitatif et déplacement du centre de gravité du système de la rive sud de la Méditerranée à sa rive nord (villes italiennes) puis aux rivages atlantiques, ce qui revient à gommer l’essentiel, qui est précisément le changement qualitatif dans la nature du système : 1a loi de la valeur est seule responsable de la constitution d’un seul antinomisme opérant désormais à l’échelle globale (un centre - fût-il même composé de centres nationaux historiquement constitués comme tels - et des périphéries toutes économiquement dépendantes de ce centre) générant une différenciation grandissante d’époque en époque entre le centre et les périphéries, durant toute l’histoire des cinq siècles du capitalisme et pour tout l’horizon visible ou imaginable dans le cadre de ses lois immanentes. Il n’y a rien de comparables avec l’équilibre relatif durable (durant 2 000 ans !) entre les régions centrales clés de l’époque tributaire.
48
Tableau II. - Les systèmes tributaires (300 av. J. C. - 1500 ap. J. C.)
Cette différence qualitative interdit de parler de l’interdépendance - fût-elle inégale - des différentes composantes du système ancien dans des termes analogues à ceux qui gouvernent le monde moderne. Les régions clés A, B et C sont certainement en relation les unes avec les autres (et avec les autres régions); il reste à démontrer que cette interdépendance aurait été essentielle. Le parallélisme dans leur évolution n’est pas la preuve de la nature décisive de leurs relations; il reflète seulement le caractère général des lois commandant l’évolution sociale de toute l’humanité (situant à leur place les spécificités). La concomitance éventuelle des avancées et des reculs, l’essor et le déclin des États du passé sont loin de s’imposer comme des évidences. Un coup d’œil sur le tableau II retraçant l’histoire parallèle des trois centres clés et
49
des autres régions montre que cette concomitance est simplement de pur hasard. Pirenne avait déjà noté - ce que reprend A. G. Frank - la concomitance entre le déclin de l’Empire romain et celui de la dynastie Han. Mais le déclin romain est relayé par l’essor de Byzance, des Sassanides, de l’État Kouchan, tandis que le déclin des Han est relayé dès l’an 600 (pleine période barbare en Occident) par l’essor des Tang, et, trois siècles plus tôt, par celui des Gupta dont le déclin coïncide (hasard également) avec l’essor de l’Islam. Rien ne permet de dégager des cycles généraux d’essor et de déclin. Le terme même de déclin est d’ailleurs ici trompeur, il s’agit de déclin d’une forme d’organisation étatique dans une région donnée, tandis que, dans la majorité des cas, au plan du développement des forces productives, il n’y a rien de tel. Je suis plutôt frappé par l’inverse, c’est-à-dire par la continuité de ces longues histoires parallèles : de Rome-Byzance-Sassanides-Islam aux Ottomans et aux Séfévides, de la dynastie Maurya à celle de l’État Moghol, de la dynastie Han aux Ming et Qing, peu de changements qualitatifs, mais un progrès quantitatif sur les mêmes bases organisationnelles (tributaires). Cela n’exclut pas que, dans l’examen des évolutions locales on puisse expliquer tel ou tel essor politique (ou déclin) - toujours relatif -par une conjoncture particulière dans laquelle des relations extérieures ont pu occasionnellement jouer un rôle. Encore une fois, rien d’analogue aux cycles de l’économie capitaliste, dont la portée est réellement mondiale du fait de la mondialisation de la loi de la valeur, fondement de l’économie capitaliste moderne. La cristallisation de la modernité nouvelle en Europe, qui se réalise dans un temps court (de l’essor des villes italiennes à la Renaissance : 3 ou 4 siècles), n’est pas la répétition d’un phénomène général dans la catégorie duquel on regrouperait pêle-mêle la naissance des civilisations (Égypte, Sumer, Harappa, Shang) et la constitution d’Empires (Achéménide, Alexandre, Rome, Byzance,
50
Sassanide, Omeyyade, Abbasside, Ottoman, Séfévide, Maurya, Gupta, État Moghol, Han, Tang, Song, Ming, Qing, empire de Gengis, Khan). J’ai proposé (Cf. Classe et Nation) une explication de ce fait, à savoir que le saut qualitatif se réalise en premier dans une périphérie tributaire (l’Europe) et non dans l’un de ses centres (A, B ou C) - puis se répète dans une autre périphérie (le Japon) - en fondant mon explication sur le contraste flexibilité des périphéries / rigidité des centres, c’est-à-dire en restant dans le cadre de la logique du caractère général des lois d’évolution des sociétés (le « développement inégal » forme générale d’une évolution identique dans sa direction). Je crois cette explication plus satisfaisante que celles proposées par les différentes visions eurocentriques dominantes (Cf. L’Eurocentrisme). Je la crois également plus satisfaisante que la thèse de Pirenne dont je rappelle qu’elle est fondée sur la permanence du contraste capitalisme (synonyme d’ouverture, particulièrement maritime) / féodalisme (synonyme de fermeture, particulièrement continentale). Cette thèse, avatar de la déformation eurocentrique (elle explique le miracle européen par l’ouverture maritime de la région), comme celle d’A. G. Frank (qui lui est proche à l’extrême), sont l’une et l’autre fondées sur la négation de la spécificité de la modernité capitaliste. Bien entendu, la cristallisation du capitalisme en Europe a une histoire (elle ne se fait pas par coup de baguette magique, en 1493 par exemple) et entraîne des conséquences spécifiques pour l’évolution ultérieure des autres régions. L’essor des villes italiennes qui est, bien entendu, à l’origine de cette cristallisation est, à son tour, un produit de l’essor tributaire-mercantile de la région arabo-islamique. Mais c’est parce qu’il s’opère dans une zone périphérique (l’Europe féodale) que cet essor italien met le feu à la prairie et accélère les rythmes de l’évolution au point de créer en Europe un système supérieur
51
qualitativement à celui des sociétés tributaires plus avancées antérieures. Je me suis exprimé en détail sur cette dynamique qui met en rapport la faiblesse de l’État, créant un espace d’autonomie à une véritable classe nouvelle - la bourgeoisie - l’alliance de l’État avec celle-ci pour dépasser l’émiettement féodal, créant un État absolutiste mercantiliste nouveau, etc... (Cf. Classe et Nation). La conséquence générale de la nouvelle cristallisation de l’Europe (capitaliste et non plus tributaire) est évidente : elle a bloqué les évolutions des autres sociétés du monde, progressivement périphérisées dans le système nouveau. Mais de surcroît, la cristallisation capitaliste européenne a entraîné une hostilité particulière à l’égard de la région arabo-islamique. Nous retrouvons ici l’observation que j’ai faite plus haut concernant la position spécifique du monde islamique dans le système ancien. L’Europe, pour établir à son profit des rapports directs avec le reste du monde, devait briser la position de monopole, d’intermédiaire obligé, dont bénéficiait le monde islamique. De la tentative précoce des Croisades, suivie immédiatement par l’établissement de la route Europe-Chine ouverte par la paix mongole à l’époque de Gengis Khan, cette hostilité se poursuit jusqu’à nos jours, se traduisant par une attitude particulière - presque névrotique - à l’égard des Musulmans, entraînant à son tour une réponse de même nature en sens inverse. C’est finalement pour briser ce monopole de zone intermédiaire obligée que les Européens se lancent sur les mers. Ce choix n’était pas « inscrit dans la géographie », comme Pirenne le pensait. Quatrièmement : les observations faites à propos du bimillénaire tributaire ne sont pas valables pour les périodes antérieures : d’une part les sociétés civilisées connues pour ces périodes - a fortiori les sociétés barbares - sont parfois organisées différemment de celles de l’époque tributaire; d’autre part, le
52
réseau des rapports qu’elles entretenaient entre elles étaient également différent de celui que nous avons représenté par nos schéma et tableau II. Sans doute les connaissances scientifiques du passé dont nous disposons sontelles d’autant moins solides que l’on recule dans le temps. Il me semble néanmoins que l’on peut distinguer deux lignes de pensée (philosophies de l’histoire) relatives aux époques prétributaires. La thèse de Pirenne - analogue sur ce point fondamental aux points de vue défendus par A. G. Frank - ne reconnaît pas de coupure qualitative, ni autour de 300 av. J. C. ni autour de l’ère chrétienne ou de la fin de l’Empire romain (la fin de l’Antiquité selon les manuels courants), pas plus qu’elle ne reconnaît de coupure qualitative séparant les temps modernes des époques antérieures. Selon Pirenne, en effet, le même contraste (sociétés ouvertes, maritimes et capitalistes versus sociétés fermées, continentales et féodales) caractérise toutes les époques de l’histoire humaine. Sumer, la Phénicie, la Grèce antique par exemple appartiennent à la première catégorie, l’Égypte, la Perse à la seconde. Par ailleurs, Pirenne insiste -comme A. G. Frank - sur les relations d’échange que les sociétés ont entretenues entre elles à toutes les époques, aussi éloignées soient-elles (par exemple sur les échanges Sumer -civilisation de l’Indus, Egypte - Crète - Phénicie - Grèce). La thèse de Pirenne - comme celle d’A. G. Frank - se fonde sur une philosophie de l’histoire linéaire : le progrès est quantitatif et continu, sans changements qualitatifs, c’est la « cumulation of accumulation » dans la langue de Frank. La thèse du marxisme « conventionnel » distingue par contre trois étapes de la civilisation qualitativement différentes : l’esclavage, la féodalité, le capitalisme. Je ne discute pas ici, sur le terrain de la marxologie, la question de savoir si cette thèse est réellement celle de Marx (et d’Engels) - et dans quelle
53
mesure - ou si elle est seulement celle de la vulgate marxienne ultérieure. Selon cette thèse, en tout cas toutes les sociétés inscrites dans notre tableau II sont féodales : pour l’Europe à partir de la fin de l’Empire romain, pour le Moyen-Orient byzantin et islamique dès leur constitution, pour l’Inde à partir de la dynastie Maurya et pour la Chine depuis l’époque Han. Antérieurement, par contre, elles auraient toutes passé par une étape esclavagiste, dont l’existence évidente et indiscutée serait témoignée par la Grèce et Rome. À mon avis, par analogie on avance dans cet esprit la thèse d’une étape esclavagiste en Chine (des Shang aux Han), en Inde (les civilisations de l’Indus et celles des Aryens), au Moyen-Orient (en Mésopotamie). L’existence de l’esclavage repérée ailleurs et plus tard, en concomitance avec la désagrégation des formes sociales communautaires dans certaines régions d’Afrique constituerait la preuve que le passage par une étape esclavagiste répondrait à une exigence générale. Je ne partage pas ce point de vue (Cf. Classe et Nation) et lui ai opposé une thèse selon laquelle : (i) la forme générale de la société de classes qui succède aux formes communautaires antérieures est celle de la société tributaire; (ii) la forme féodale n’est pas la règle générale mais seulement la forme périphérique du mode tributaire; (iii) les modalités de la forme tributaire générale sont diverses (castes, Etats au sens européen des temps féodaux, Stande, communautés paysannes soumises à une bureaucratie d’Etat, etc.); (iv) la forme esclavagiste ne répond à aucune exigence générale, elle est absente dans la plupart des trajectoires historiques (Egypte, Inde, Chine); elle ne connaît guère de développement important que lorsqu’elle s’articule à une économie marchande et de ce fait, se retrouve à des âges très différents du développement de forces productives (esclavages gréco-romain et esclavage en Amérique jusqu’au XIXe siècle).
54
Les temps antérieurs à la coupure tributaire marquée dans notre tableau II ne se distinguent-ils pas alors de la suite de l’histoire antécapitaliste ? L’Egypte, en particulier par exemple, offre l’exemple d’une société tributaire - qui ignore pratiquement l’esclavage - dont l’histoire s’amorce 3 000 ans avant la cristallisation hellénistique. L’Assyrie, la Babylonie, l’Iran des Achéménides et probablement l’Inde pré-Maurya et la Chine pré-Han ont parfois pratiqué l’esclavage, mais sans que celui-ci n’ait constitué la forme principale de l’exploitation du travail productif. Il reste que, selon ma thèse, la société tributaire n’est véritablement cristallisée dans sa forme achevée que lorsqu’elle a eu produit une idéologie-religion universelle fondée sur des valeurs éthiques dépassant les idéologies de la parenté et les religions de terroir, propres au stade communautaire antérieur. Dans cette perspective, Zoroastre, Boudha et Confucius annoncent la cristallisation tributaire. Jusque-là, je préfère parler d’incubation, ou, si l’on veut, de transition des formes communautaires à la forme tributaire. Cette transition est peut-être relativement simple et rapide en Chine, rendue plus complexe en Inde du fait de l’invasion aryenne détruisant les civilisations de l’Indus. Au Moyen-Orient, la diversité des peuples et des trajets, mais aussi l’influence réciproque des uns sur les autres, obligent à considérer la région comme un « système ». Je replace dans ce cadre la maturation tributaire précoce de l’Egypte, le caractère mercantile marqué de la Grèce esclavagiste, donnant par là même une importance particulière à la synthèse hellénistique, prélude aux révolutions chrétienne et musulmane qui assumeront effectivement l’unification de la région. La densité des relations d’échange entre les sociétés de ces époques lointaines permet-elle de parler d’un « système » ? J’en doute, du fait que les sociétés civilisées, c’est-à-dire avancées dans la transition à la forme tributaire, demeurent encore des îlots dans l’océan des modes communautaires. Les trajec-
55
toires, même quand elles sont parallèles, ne prouvent pas que les sociétés en question constituent un système, mais établissent seulement la validité des lois générales de l’évolution.
Bibliographie – Samir AMIN, La nation arabe, nationalisme et luttes de classes, Minuit, 1976; en arabe Al Umma al Arabia, Le Caire, 1988. – Samir AMIN. Classe et Nation dans l’histoire et la crise contemporaine, Minuit, 1979. – Samir AMIN. La déconnexion, La Découverte, 1985. – Samir AMIN. L’Eurocentrisme, Economica, 1988. – Samir AMIN. La faillite du développement en Afrique et dans le tiers-monde, L’Harmattan, 1989. – Samir AMIN. Nahw nazariya lil thakafa, Beyrouth, 1989. – Samir AMIN. L’Etat et le développement, Socialism in the world, n° 58, 1987. – Samir AMIN. La révolution et le tiers monde, Sociologie et Sociétés, Montréal 1990. – Samir AMIN, L’Europe et les rapports Nord-Sud, L’événement européen, n° 7, août 1989. – Samir AMIN, La question démocratique dans le tiers monde contemporain, Africa Development, n° 2, 1989. – Samir AMIN, On Blaut, Colonialism and Capitalism, Science and Society, n°54, 1, 1990. – Samir AMIN, Hawl al rasmalia fi Misr, Qadaia Fikria, n° 2, 1987.
56
– Samir AMIN, Tarikh al Arab al Ijtimai, Al Wihda, n° 42, 1988. – Samir AMIN, Azma al Istiraqia, Al Moustaqbal al arabi, n°114-1988 et 1261989. – Samir AMIN et Fayçal YACHIR, La Méditerranée dans le monde moderne, La Découverte, 1988. – Mansour FAWZI, Al Rasmalia fi Misr, Qadaia Fikria, 1986. – Sadek Saad AHMAD, Tarikh Misr al Ijtimai, Le Caire, 1985. – André Gunder FRANK, Towards a historical materialist political economy of our 500 year old world system, mimeog, 1989. – Janet Abu LUGHOD, Before European Hegemony, The World system AD 1250. 1350, Oxf. U. Press, 1947. – Martin BERNAL, Black Athena, London, 1987. – Christopher Chase Dunn, Rise and demise : world Systems and modes of production, inédit. – Kajsa EKHOLM, On the limitation of civilisation : the structure and dynamics of global Systems, Dialectical Anthropology. – William Mac NEILL, The rise of the West, Chicago U. Press, 1964. – David WILKINSON, Central Civilisation, comparative civilizations, Review, 1987. – Marshall HODGSON, The Venture of Islam, Chicago U. Press, 1974. – Arnold TOYNBEE. A Study of History. Londres, 1947. -Jacques PIRENNE, Les grands courants de l’histoire universelle, Albin Michel, 1947. – Karl POLANYI, La liberta in una societa complesa, Boringheri, 1987.
57
– ETIEMBLE, L’Europe chinoise, Gallimard, 1988. – Fawzy MANSOUR, L’impasse du monde arabe, les racines historiques, L’Harmattan, 1990.
58
Chapitre II Le rôle de l’Asie centrale dans le système tributaire de l’ancien monde Au chapitre I, j'ai proposé de considérer les sociétés de l’ancien monde pour toute la période des vingt siècles considérés comme un ensemble de sociétés présentant des caractéristiques communes, que j’appelais les formes centrales et périphériques du mode de production tributaire, articulées entre elles dans un système par des échanges intenses de toutes natures. J'y renvoie le lecteur pour ce qui est des systèmes conceptuels proposés pour l’analyse de la spécificité de ce mode tributaire, par contraste avec celle du capitalisme moderne, comme pour l’analyse de la fonction des échanges interrégionaux. J’avais résumé mes conclusions dans un schéma et deux tableaux. Les volumes des échanges entre les centres et les périphéries désignées dans ce schéma et celui du transit par l’Asie Centrale (« Les Routes de la Soie ») avaient été estimés pour chacune des grandes routes utilisées, signalées par les onze flèches du schéma. La période décrite s’étend sur près de 20 siècles, au cours desquels, d’évidence, le poids relatif de chacune des régions définies (les centres A, B et C, les périphéries) a évolué, de même donc que leurs échanges extérieurs. Les indices retenus tant pour le volume du surplus généré dans la région et des échanges que pour la répartition de ceux-ci selon les flèches indiquées dans le schéma ont varié au cours du temps. Je donnerai donc dans ce qui suit la justification des moyennes retenues pour décrire l’ensemble de ce long temps historique.
59
1) La Chine représente tout au long de ces vingt siècles le centre non seulement certainement le plus important, mais encore celui dont le développement a été le plus continu, en dépit des désordres qui se reproduisent dans les périodes inter-dynastiques. La population de la Chine est de 70 millions d’habitants au moment de l’ère chrétienne (28 % de la population du globe à l’époque, 250 millions). Elle s’accroit régulièrement pour atteindre 200 millions en 1700 (toujours 28 % de la population mondiale estimée à 680 millions). Entre 1700 et 1800 le mouvement démographique s’y accélère, la population de la Chine passe à 330 millions, qui représentent 35 % de la population mondiale, estimée à 950 millions. La Chine est, tout au long de cette longue histoire, la région la plus avancée sur tous les plans : elle dispose en moyenne de la plus forte productivité agricole par tête, du plus grand nombre de villes abritant une population administrative éduquée et artisanale qualifiée, qui est estimée par tous un peu comme le « modèle » : les Européens, quand ils la découvrent au XVIIIe siècle, qui est le siècle de sa plus grande splendeur, tentent de s’inspirer d’elle (cf. Etiemble, L'Europe chinoise). Beaucoup plus tôt les peuples du Moyen Orient connaissaient sa richesse et sa puissance (cf. le hadith du Prophète Mohamed : « allez chercher la science en Chine »). J’ai choisi pour cette raison l’indice 100 pour désigner le volume des échanges extérieurs de la Chine tout au long de cette période. Dans l’hypothèse où ces échanges auraient porté sur 10 % du surplus généré en Chine, celui-ci pourrait être évalué à l’indice 1 000 (pour une population qui croit régulièrement de 50 à 330 millions). 2) La Chine a, tout au long de cette période, entretenu des relations étroites, continues et denses avec le centre moyen oriental (hellénistique, puis by-
60
zantin et islamique - arabe, persan et turc). J’ai proposé d’estimer ce volume des échanges aux deux tiers (65 %) de l’ensemble des échanges chinois pour toute la période, contre 20 % pour les échanges avec le Japon, 5 % avec l’Asie du Sud-est et 10 % avec l’Europe. Quels sont les indices sur lesquels j’ai fondé ces estimations ? Le centre que représente le Moyen Orient a connu une évolution historique fort différente de celle de la Chine. En 200 avant Jésus-Christ il a une population équivalente à celle de la Chine (50 millions) et probablement un niveau général de développement au moins égal. Mais au moment de l’ère chrétienne sa population est seulement de 35 millions (contre 70 millions pour la Chine) si l’on retient une définition restreinte de la région (Grèce-Anatolie, Egypte, Syrie-Irak-Iran) et, si on lui ajoute l’Italie et le Maghreb qui constituent son prolongement vers l’ouest associé à la construction de l’empire romain, une population de 50 millions. Pour les siècles qui suivent la population du centre Moyen Oriental (Byzance plus le Khalifat) reste relativement stagnante. La population des héritiers de l’Empire Ottoman à partir de 1500, l’empire perse et les émirats et Khanats d’Asie centrale turque, ne dépasse guère 50 millions contre plus de 200 millions pour la Chine et autant pour l’Inde en 1700. Le déclin de la position relative au Moyen Orient est pratiquement continu depuis l’ère chrétienne, en dépit des moments brillants - mais courts - de ses tentatives de renouveau (l’époque de Justinien, les deux premiers siècles abbassides). Par contre la position relative du Moyen Orient dans les temps plus anciens était dominante à l’échelle mondiale. Au cours des deux millénaires qui précèdent l’ère chrétienne sa population représentait peut-être 30 % de la population mondiale (qui croit très lentement de 100 à 250 millions au cours de cette période) contre seulement 18 % au moment de l’ère
61
chrétienne et 7 % en 1700. L’Egypte antique avait une population qui avait dépassé la barre des 10 millions; or la population de ce pays était tombée à 2 millions en 1800, pour ne retrouver son niveau pharaonique qu’à l’époque contemporaine, au XXe siècle. Ce n’est pas ici le lieu de discuter des raisons éventuelles de ce déclin relatif précoce et tenace, mais on ne peut manquer de mentionner son accentuation par les gigantesques dévastations en Asie centrale, Iran et Irak occasionnées par les invasions turcomongoles, réduisant l’Iran et la Mésopotamie, l’un des berceaux de la civilisation universelle, à une steppe désertique. La Russie et l’Orient islamique ont été les victimes principales de ces invasions, la Chine ayant été infiniment plus capable d’y résister. Toujours est-il que jamais, à partir de l’ère chrétienne, le centre moyen oriental n’a témoigné d’un dynamisme comparable à celui de la Chine. Les échanges Chine-Moyen-Orient ont, de ce fait, été relativement plus intenses dans les périodes anciennes, déclinant en termes relatifs par la suite, le relai étant pris - pour la Chine -par l’intensification de ses rapports avec la Corée et le Japon, le Viet Nam et l’Asie du Sud-est, enfin l’Europe, d’abord par la route mongole (XIIIe siècle) puis par les voies maritimes (aux temps modernes). La stagnation relative du Moyen-Orient signifie que si le surplus généré dans cette région était comparable à celui de la Chine aux débuts de la période considérée (à partir de 50 av J. C), il n’en représente guère plus d’un tiers vers 1300-1500, compte tenu de l’évolution du rapport des chiffres des populations concernées. La médiane entre ces deux indices extrêmes 1 000 et 350 - autour de 700, est légèrement inférieure au chiffre indice retenu dans notre schéma pour toute la période (800).
62
La position déclinante du Moyen-Orient a été néanmoins partiellement compensée par sa position géographique qui est celle d’une plaque tournante, s’imposant comme intermédiaire obligatoire pour presque tous les échanges transcontinentaux des époques pré-modernes. Cela s’est traduit par un degré de commercialisation de l’économie et un volume des échanges extérieurs relativement plus marqués : de l’ordre de 20 % peutêtre, contre 10 % pour la Chine. Cette proportion - du simple au double est cohérente avec les estimations comparatives des échanges entre la région Moyen Orient d’une part et les autres régions du monde prémoderne d’autre part (voir plus loin). L’importance des échanges Chine-Moyen Orient, bien que déclinante en termes relatifs, reste le fait majeur qui caractérise le système des relations entre les régions du monde prémoderne. Ces transferts de marchandises, de technologies, d’idéologies et de religions ont, par l’intermédiaire du Moyen Orient, permis la diffusion - notamment vers l’Europe - de la science et des techniques chinoises plus avancées. La voie empruntée, immuable, connue sous le nom de la « route de la soie », sortait de Chine par le corridor du Gansu, passant au sud de la chaine du Tian Shan, longeant le désert de Taklamatan soit par le nord (Hami-Aksu-Kashgar) soit par le sud (Kokand-Kashgar) pour ensuite se diriger vers la Perse à travers le sud de l’ex-Asie centrale soviétique (Samarkand-Bokhara-Khiva). La permanence de cette route vitale rend compte de bien des phénomènes peu explicables autrement, comme la pénétration précoce et profonde des religions en provenance du Moyen-Orient, le Nestorisme chrétien, le manichéisme après le zoroastrisme, (on oublie souvent que l’Asie centrale a été chrétienne avant les tribus germaniques), puis l’Islam (qui fonde immédiatement des bases solides dans cette région - dans le Kho-
63
rezm) ou de l’Inde (le Bouddhisme). Cette pénétration accompagne une sédentarisation précoce des populations locales : dès le IXe siècle le Turkestan oriental (Ouigouristan) est intégralement sédentarisé. Des frontières de la Chine propre à celle de la Perse la route est parsemée de grandes villes commerçantes, centres d’activités intellectuelles, entourées de zones d’agriculture irriguée intensive. On comprend alors que le conflit géostratégique principal des temps prémodernes ait porté sur le contrôle de cette voie. A ce propos on est frappé de constater que la frontière militaire entre la zone sous contrôle chinois et celle sous celui du Moyen-Orient (le Khalifat et la Perse) est demeurée d’une stabilité remarquable, à peu de chose près elle est celle des frontières actuelles de la Chine. On est frappé par le fait qu’en dépit de l’islamisation le Turkestan oriental a toujours été sous le contrôle politique et militaire chinois, l’occidental sous celui du Moyen-Orient (quand il ne s’empare pas du pouvoir dans celui-ci) avant d’être conquis par les Russes. 3) Le déclin relatif des échanges Chine-Moyen-Orient est relayé par l’essor, tardif mais puissant, des rapports avec la Corée et le Japon, le Viet Nam et l’Asie du sud-est. A l’aube de l’ère chrétienne ces régions sont encore fort peu peuplées (un million pour la Corée et le Japon, 6 pour l’Asie du sudest, au total moins de 10 % de la population chinoise de l’époque), et il faut attendre la seconde moitié du premier millénaire pour voir s’y constituer des Etats centralisés, inspirés d’ailleurs par le modèle chinois. Mais les progrès sont ici rapides, même si la croissance démographique reste inférieure à celle de la Chine. Si l’on retient l’hypothèse d’un volume d’échanges croissant parallèlement aux chiffres des populations concernées on parviendra vers la fin de la période (qui se prolonge ici au delà de 1500 jusque vers 1850) à un indice égal à celui des échanges Chine-Moyen-
64
Orient. D’autre part on notera que ces derniers rapports s’étalent sur les 20 siècles considérés (déclinant progressivement en termes relatifs) tandis que les premiers se développent au cours des six derniers siècles de la période tributaire. Leur indice moyen est donc de l’ordre du tiers de celui affecté aux premiers, soit 25 (contre 65), distribués principalement au bénéfice du Japon (20), accessoirement de l’Asie du sud-est (5). L’indice retenu pour les échanges Chine-Europe (sans passer par l’intermédiaire du Moyen-Orient) - soit 10 - sera justifié plus loin. 4) L’Inde constitue le second centre de concentration humaine et de civilisation, après la Chine. Elle démarre très tôt dans la civilisation, au cours du troisième millénaire avant Jésus-Christ, c’est-à-dire à la même époque que l’Egypte et la Mésopotamie, avec laquelle d’ailleurs les civilisations de l’Indus sont peut être en rapport. Comme la Chine, et en contrepoint avec le Moyen-Orient, l’Inde fait preuve d’un dynamisme continu depuis les origines jusque vers 1700 : elle compte 45 millions d’habitants à l’aube de l’ère chrétienne, 200 en 1700 (autant que la Chine d’alors). Mais elle entre en crise à partir de cette époque, en 1800 elle piétine autour de 200 millions, et ne reprendra que plus tardivement, au XIXe siècle. Le continent indien constitue encore aujourd’hui la région de concentration humaine la plus forte après la Chine. Pour la période considérée (depuis 500 avant Jésus-Christ, période où apparait Bouddha, jusqu’au XVIe siècle, quand s’amorce le contrôle maritime européen de l’Océan indien) on peut donc accepter l’hypothèse d’un surplus généré dans la région équivalent à celui produit en Chine (le même indice 1 000), du fait de la forte productivité de son agriculture et de l’état florissant de ses villes.
65
Il reste que l’histoire de l’Inde est plus chaotique que celle de la Chine : fréquemment envahie (toujours par l’Ouest), difficilement unifiée (elle ne l’est guère qu’à la période ancienne des Maurya, à l’aube de notre période), elle parait, de l’avis de tous les historiens, moins ouverte aux échanges extérieurs que la Chine. Ceux-ci se font d’ailleurs surtout avec le Moyen-Orient, partie par la voie terrestre Iran-Afghanistan, partie par la voie maritime. Quant aux échanges avec l’Asie du sud-est, ils ne prennent de l’importance qu’à l’époque de l’hindouisation de celle-ci entre l’an 600 et l’an 1 000, le relai étant pris ensuite par l’islamisation de l’IndonésieMalaisie et l’intensification de la pénétration chinoise. Si, comme on le justifiera plus loin, l’indice des échanges Inde-MoyenOrient peut être évalué à 50 pour toute la période considérée (partage pour moitié entre chacune des deux voies terrestre et maritime), et celui des échanges Inde-Asie du Sud est à 10, on aurait au total un pourcentage de commercialisation externe du surplus égal à 6 %, inférieur à celui de la Chine, qui est rappelons-le, de 10 %. Ce résultat est cohérent avec l’observation des historiens rappelée plus haut. 5) L’Europe n’intervient dans le développement général du système pré-moderne que très tardivement, après l’an 1 000. Jusqu’alors elle reste une périphérie attardée et barbare. A l’aube de l’ère chrétienne la population de l’Europe, Italie incluse, est de l’ordre de 20 millions (8 % et la population mondiale, moins de 30 % de celle de la Chine, la moitié de celle du Moyen-Orient), dont la moitié en Italie et dans les Gaules. Le démarrage de l’Europe sera très lent, puisqu’en l’an mil l’Europe, Italie incluse, n’a encore guère que 30 millions d’habitants. Ce démarrage se fait néanmoins entre l’an 1 000 et 1350 : sa population passe alors à 80 millions (18 % de la population mondiale esti-
66
mée à 440 millions), pour redescendre à 60 millions en 1400 (par suite de la peste noire), mais atteindre 120 millions en 1700 (18 % de la population du monde : 680 millions) et 180 en 1800 (19 % de la population mondiale, 950 millions). L’envolée démographique européenne est amorcée, elle explosera au XIXe siècle. Jusqu’en l’an 1 000 la productivité de l’agriculture européenne reste largement inférieure à celle des régions civilisées de Chine, Inde et du MoyenOrient, et le continent est encore vide de villes. Le décollage est cependant rapide à partir de l’an mil et deux siècles plus tard l’Europe est couverte de villes actives et de monuments qui témoignent de l’ampleur de la croissance du surplus que son agriculture génère. Pour les deux ou trois derniers siècles de la période considérée, qui se clôture en 1492 par l’amorce de l’hégémonie mondiale de l’Europe moderne et capitaliste, l’Europe représente un centre nouveau en gestation d’un poids relatif égal à la moitié de celui de la Chine, et déjà le double ou le triple de celui du Moyen-Orient, si l’on accepte l’hypothèse, vraisemblable, de productivités agricoles et de degrés d’urbanisation équivalents. Par contre durant les quelque 15 siècles qui précèdent l’Europe ne représente à peu près rien dans le système mondial de l’époque car la faible productivité de son travail interdit de dégager de ceux-ci un surplus significatif : l’indice de ce surplus pourrait être voisin de zéro, à peine existant, tandis qu’il s’élève rapidement à l’indice 350 (un tiers de la Chine) pour les siècles 1200-1500. La médiane (ou moyenne pondérée) de 100 retenues dans le schéma pour l’ensemble de la longue période pourrait être ici, comme pour le Japon et l’Asie du Sud-est, trompeuse, et même davantage que pour ces derniers, puisqu’elle prétend illustrer un essor rapide mais tardif.
67
Le volume des échanges extérieurs de l’Europe, estimé par l’indice 20, ne concerne en fait que la période des quatre siècles 1100-1500, les échanges concernant les périodes antérieures étant négligeables. A cette époque la population de l’Europe représente entre le tiers et la moitié de celle de la Chine. Il est donc possible que cet indice soit quelque peu sous-estimé si l’on ne considère que la période des quatre siècles en question. Mais en contrepartie il est très certainement fortement surestimé si l’on considère l’ensemble de la longue période de 300 avant Jésus-Christ à 1500 après Jésus-Christ. L’essentiel de ce commerce passait par le Moyen-Orient, même si beaucoup des produits importés par l’Europe provenaient de plus loin, de Chine et d’Inde, et ne faisaient que transiter par le Moyen-Orient. Au XIIIe siècle par contre, pour la première fois, un contact direct entre l’Europe et la Chine est établi par la route terrestre mongole, évitant le MoyenOrient. Or cet effet des conquêtes de Gengis Khan survient à un moment où précisément l’Europe à décollé et rattrape rapidement les régions plus avancées constituées par les trois centres orientaux. Les échanges EuropeChine sont, de ce fait, intenses bien que la période au cours de laquelle la route mongole a été utilisée ait été extrêmement brève - moins d’un siècle. Au demeurant, à partir de 1500, la voie maritime supplante les anciennes routes terrestres. L’indice retenu pour ces échanges (10) est certainement surestimé si l’on devait en établir le volume sur l’ensemble de la longue période considérée. De ce fait l’appréciation portée aux conquêtes de Gengis Khan est déformée chez les Européens qui découvraient l’existence de la Chine. C’est pourquoi le discours dominant, eurocentrique comme toujours, attribue à l’Empire Mongol un rôle positif dans l’établissement d’une liaison Est-Ouest, qui, en fait, existait depuis longtemps, même si les Européens l’ignoraient. Par contre l’effet négatif des
68
conquêtes turco-mongoles, qui ont appauvri les partenaires des échanges anciens principaux, par les destructions massives occasionnées en Chine du Nord, en Asie centrale du Sud-ouest, en Iran et en Irak, comme en Russie, est toujours, dans cette perspective eurocentrique, sous-estimé. En définitive les conquêtes mongoles ont été plutôt négatives que positives en ce qui concerne les échanges Est-Ouest pris dans leur ensemble. Même au cours des derniers siècles de la longue période considérée le retard de l’Europe, périphérique dans le système ancien, demeure. En témoigne le fait que la balance commerciale européenne est toujours fortement déficitaire, ce continent n’ayant pas grand-chose à offrir tandis qu’il importe les produits de luxe et les technologies de l’Orient, contraint de régler son déficit par des exportations de métal. 6) L’estimation proposée pour les indices des volumes de surplus généré dans les périphéries de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie du Sud est fondée sur les estimations des chiffres de la population de ces régions : la moitié environ de la population européenne à l’aube de l’ère chrétienne, une démographie peu dynamique, une productivité agricole faible et aucune urbanisation digne de ce nom, comme en Europe jusqu’à l’an mil. Comme pour l’Europe nous considérons que la faible productivité signifie que le surplus généré est comparativement aux régions plus avancées moins que proportionnel aux chiffres de la population. Par contre, précisément parce que le surplus modeste est échangé contre des produits de luxe étrangers à la production locale, le degré de commercialisation extrême de ce surplus est plus élevé : les échanges lointains sont relativement plus importants que ceux à courte distance. C’est pourquoi ce degré est situé ici autour de 20 % (contre 10 % pour la Chine et 6 % pour l’Inde) pour l’Europe (surplus : 100, échanges extérieurs : 20), l’Afrique subsaha-
69
rienne (surplus : 50, échanges extérieurs : 10), et même 30 % pour l’Asie du Sud-est (surplus : 60, échanges extérieurs : 20). L’Afrique subsaharienne n’est pas, comme en témoignent les écrits arabes, une périphérie plus misérable que l’Europe avant le XIe siècle. Le retard de l’Afrique apparait plus tard, par comparaison avec l’Europe lorsque celle-ci décolle. Ce retard sera rapidement aggravé par les destructions massives occasionnées par la traite négrière atlantique, non seulement par ses effets dévastateurs sur la démographie du continent, mais encore par les dégradations politiques qui lui sont associées (destruction des grands Etats en formation et substitution à ceux-ci d’Etats militaires prédateurs). L’Asie du Sud Est partait, au départ de notre longue période, d’une position périphérique comparable à celle de l’Europe et de l’Afrique subsaharienne. Elle amorce un progrès certain plus tôt que l’Europe, avec son hindouisation (à laquelle succède l’islamisation), à partir du VIIe siècle, qui s’accompagne d’échanges intenses avec l’Inde, plus modestes avec la Chine et le Moyen-Orient. Cet essor ne sera brutalement interrompu qu’à partir du XVIe siècle, lorsque l’hégémonie maritime européenne brise les relations anciennes. Cependant, peut-être parce qu’elle n’a pas subi les ravages de l’esclavage comme l’Afrique, sa position ne se dégrade pas comme celle du continent noir. 7) Nous pouvons revenir au Moyen-Orient, plaque tournante des échanges pré-modernes, pour y récapituler les flux qui le concernent dont les indices sont alors les suivants : échanges avec la Chine (65), l’Inde (50), l’Afrique noire (10), l’Europe (10) et l’Asie du Sud-est (5). Le montant total de ces flux - 140 - représentait 20 % du surplus généré localement, si l’indice 800 est retenu. Si cet indice est trop fort, compte tenu de la stagnation relative de la région par opposition aux dynamismes permanents de la Chine et de
70
l’Inde et à l’essor tardif mais marqué de l’Europe, le pourcentage du surplus commercialisé dans les échanges avec l’extérieur serait encore plus élevé. En fait ce rapport est forcé puisqu’une partie des échanges représentent du transit. Aux époques anciennes, lorsque le Moyen-Orient représente un centre comparable par son poids à la Chine et l’Inde, l’essentiel des échanges (et il s’agit alors de l’essentiel des échanges à l’échelle mondiale) n’a pas la nature d’un commerce de transit. Par contre lorsque l’Europe amorce son décollage après l’an 1 000 certainement une bonne partie des échanges en provenance de Chine et d’Inde ne fait que transiter par le Moyen-Orient. 8) Ce que nous venons de dire du Moyen-Orient est vrai à une échelle encore plus forte si l’on considère la région « Asie centrale », dont la position n’est ni celle d’un centre, ni celle d’une périphérie. Région de passage obligé entre les centres principaux du monde pré-moderne, reliant notamment la Chine au Moyen-Orient, l’Asie centrale à toujours été peu peuplée, ne produisant donc par elle-même de ce fait qu’un surplus sans doute négligeable. Notre indice 60, purement indicatif ici, est probablement surestimé, même si, à certaines époques la région du Turkestan occidental méridional, autour des voies d’eau du Syr et de l’Amou Daria, a connu un développement brillant. Les flux d’échange qui transitent par la région sont néanmoins considérables, comme l’indique la somme des indices qui les concernent (100). Plus qu’aucune autre région du monde, l’Asie centrale a tiré bénéfice de ce transit, une fraction de sa valeur, sans doute impossible à estimer mais non négligeable, étant récupérée sur place. Il importe néanmoins d’éviter les généralisations trop abusives concernant cette région qui n’a jamais été ni homogène, ni réductible au nomadisme.
71
En fait l’Asie centrale est partagée en gros par la chaine du Tian Shan en une région méridionale - la véritable route de la soie - et une région septentrionale qui n’a jamais été que marginale dans les rapports Est-Ouest, intenses depuis au moins le VIe siècle avant Jésus-Christ. La partie méridionale de la région est elle même visiblement composée de trois sous régions distinctes : le Turkestan oriental (la province chinoise du Sinkiang), le Turkestan occidental au sud du Kazakstan actuel, l’Afghanistan. Les deux tiers des flux d’échange transitant par l’Asie centrale, correspondant aux échanges Chine-Moyen orient, ont toujours emprunté la même route passant par le Sinkiang et les vallées du Syr et de l’Amou Daria. Les variantes de cette route, évitant le désert du Taklamatan par le nord ou le sud, choisissant la route de Dzoungarie ou les cols conduisant au Fergana, se situent toutes dans le faisceau régional considéré. La partie orientale de cette Asie centrale méridionale (le Sinkiang) est particulièrement sèche, parsemée seulement d’oasis, interdisant un peuplement important, sauf urbain, quand les villes oasis en question pouvaient être ravitaillées à la fois par les petites zones d’irrigation possibles à leur proximité immédiate et par le transit du commerce à longue distance. Il n’a donc jamais été question dans cette région d’une formation sociale à dominante nomade. La dominante dans cette formation est urbaine-mercantile. Mais il va alors de soi que cette formation locale n’a pas d’existence en dehors du rapport Est-Ouest sur lequel elle est greffée. Que les pouvoirs locaux aient à tel moment bénéficié d’une autonomie proche de « l’indépendance » ou qu’à tel autre moment ils aient été étroitement soumis au pouvoir chinois ne change rien au fait que la formation sociale n’est qu’un sous-système d’articulation entre les formations tributaires de
72
Chine et du Moyen-Orient. Cette dépendance objective ne réduit en rien l’importance de la région et le brillant de sa civilisation, marquée par une sédentarisation totale précoce (remontant au plus tard au IXe siècle) et par la vie intellectuelle de ses centres urbains ouverts (qui, de ce fait, adoptent avec aisance des formes religieuses avancées à vocation universaliste comme le nestorianisme, le manichéisme, le bouddhisme ou l’Islam). A l’Ouest de la barrière montagneuse qui sépare le Sinkiang du Turkestan occidental, les conditions géographiques permettaient soit une population nomade des steppes plus nombreuse soit une agriculture irriguée autour des fleuves Syr et Amou Daria. Prolongement en quelque sorte du plateau iranien et du massif afghan, la région est par excellence celle du contact sédentaires (agriculteurs et urbains) / nomades. Selon les aléas de l’histoire la dominance dans les formations sociales de la région a donc été soit urbaine-mercantile (soutenue par une agriculture d’irrigation) soit nomade. Il va de soi que le commerce Est-Ouest était plutôt stimulé dans le premier cas, gêné dans le second. Les invasions turco mongoles n’ont jamais, contrairement à un préjugé répandu, constitué un facteur favorable à ce commerce. L’Afghanistan occupe une place particulière dans ce système régional. L’Inde a toujours entretenu des rapports étroits avec le Moyen-Orient, qui, outre la voie maritime, empruntait une route passant par le nord du massif afghan, rejoignant ainsi sur l’Amou Daria la voie Chine-Moyen Orient. En ce lieu de contact tripartite (Moyen-Orient-Inde-Chine) des civilisations de synthèse particulièrement intéressantes (comme l’Etat Kouchane) ont donc pu s’épanouir. Les échanges entre l’Inde et la Chine passaient également par ce point, évitant la barrière infranchissable de l’Himalaya et du
73
Tibet, contournée par l’Ouest. Telle a été la route empruntée par le bouddhisme. La moitié septentrionale de l’Asie intérieure correspond en gros à l’actuelle Mongolie (au nord du Tian Shan) et aux steppes du Kazakstan (au nord de la mer d’Aral et du Syr Daria), lesquelles se prolongent sans obstacle jusqu’au centre de l’Europe, en passant au nord de la Caspienne et de la mer Noire. Cette région n’a joué qu’un rôle mineur dans les relations Est-Ouest, au moins pour deux raisons : le retard de l’Europe jusqu’à l’an mil, la dominance de populations de nomades des steppes turbulents. Comme on l’a vu cette route nord n’a été empruntée que durant la courte période qui sépare l’essor européen, à partir du XIIe siècle, de la conquête des mers, à partir du XVIe siècle, moment qui a correspondu à la conquête de toute la région par Gengis Khan. La formation sociale dominante dans la région diffère de celles qui ont prévalu dans sa moitié méridionale. Ici le nomadisme, prédominant par le nombre, s’articulait sur des rapports marchands pauvres, sans comparaison avec l’intensité de ceux-ci le long de la véritable « route de la soie ». La Mongolie reste vide de traces de villes importantes, et même à l’époque de Gengis Khan la capitale Karakorum reste un bourg (5 000 habitants ?). Rien de comparable avec les villes d’Asie centrale méridionale, car les échanges Est-Ouest principaux ne passaient pas par là. Par ailleurs les échanges entre la Chine et les régions situées au Nord du Tian Shan - la Mongolie et la Sibérie - demeuraient limités à l’extrême, pratiquement réduits à l’importation par la Chine des chevaux et des fourrures. Il reste que le contrôle de ces échanges par la Chine des Qing, après l’effondrement de la Mongolie Gengis Khanide, a construit une articulation nouvelle nomadisme - féodalisme bouddhiste -mercantilisme chinois, dominante du
74
XVIe siècle au XXe siècle. Simultanément l’expansion russe en Sibérie entraînait un nouveau conflit de contrôle géopolitique, opposant ici Russes et Chinois. La Russie, néanmoins, ne représentait pas à cette époque - il s’agit déjà des temps modernes - le cœur de l’Europe capitaliste, mais une semi-périphérie pauvre. Ses échanges extérieurs étaient de ce fait secondaires. L’allusion faite ici à la place du bouddhisme dans la formation mongole soulève un problème qui mériterait plus ample étude. On est en effet frappé par l’échec du bouddhisme dans les centres des civilisations asiatiques : en Inde, son pays d’origine, et en Chine, où l’hindouisme et le confucianisme reprennent rapidement le dessus, sur les routes de la soie où l’Islam s’impose. Par contre le bouddhisme s’établit définitivement dans les deux régions marginales du système de l’Asie centrale, au Tibet et en Mongolie. A l’ouest de la Mongolie la région d’Asie intérieure septentrionale reste, comme on l’a dit, sans limites précises, englobant le Kazakstan et la Russie méridionale. C’est dans cette région que se sont opposés directement les envahisseurs nomades, progressivement tous - ou presque - islamisés (mais sans que cette conversion, tardive n’ait eu d’effets culturels profonds) et les non moins envahisseurs russes. 9) La structure globale du système tributaire pendant les vingt siècles considérés présente des caractéristiques d’une stabilité remarquable, ce qui donne au schéma sa légitimité comme illustration de cette stabilité. Cela étant l’importance relative de chacun de blocs régionaux - en population et en richesse - a été l’objet d’évolutions qui ont progressivement bouleversé les rapports entre ces blocs et fabriqué la structure nouvelle caractéristique du capitalisme moderne. Au risque de me répéter je rappellerai
75
donc que les chiffres-indices par lesquels j’ai quantifié les flux d’échanges répertoriés sont des moyennes pour la longue période considérée, qui ne correspondent donc rigoureusement à aucune des sous-périodes constitutives de celle-là. Pour chacune de ces sous-périodes nous aurions donc un système de chiffres indices particulier, illustrant l’importance relative des régions à cette époque. Je résumerai les caractères les plus significatifs de cette évolution comme suit : i)
Tout au long des vingt siècles considérés la progression de la Chine est soutenue et continue. Ce pays continent conserve donc une position remarquable (mais non dominant, voir infra) et stable dans le système de l’ancien monde tributaire. Il en est de même, bien qu’à un degré moindre, de l’Inde, le second pays continent du système.
ii) En contre-point la stagnation du Moyen-Orient tout au long de cette période était fatalement porteuse d’une régression marquée de sa position dans le système. iii) L’évolution la plus marquante concerne l’Europe. Périphérie marginale pendant quinze siècles, l’Europe connait au cours des cinq siècles qui précèdent la révolution capitaliste une progression gigantesque en termes de rythmes. Ce bouleversement s’accentuera encore davantage dans les deux siècles qui suivent la période étudiée, par la conquête et le façonnement de l’Amérique par l’Europe, inaugurant la transformation d’un système qui n’avait concerné jusque-là que l’ancien monde en un système planétaire total. iv) Les évolutions qui concernent les autres régions (Japon, Asie du Sud-Est, Afrique) préparent également, à leur manière, la constitution du nouveau système capitaliste et planétaire.
76
v) Le système capitaliste qui se met en place à partir de 1500 AD est qualitativement différent du précédent. Il ne s’agit pas seulement de bouleversements dans les positions relatives des régions concernées, au bénéfice de l’Europe. Celle-ci se constitue en centre dominant à l’échelle planétaire, un centre qui sera augmenté par l’expansion européenne en Amérique du Nord et par l’émergence du Japon. Le concept de domination qui caractérise désormais le nouveau système mondial n’avait pas d’existence dans le système tributaire antérieur. En association avec cette transformation j’ai souligné l’importance d’une autre transformation non moins qualitative : le transfert de la dominance dans le système social de l’instance politicoidéologique à l’économique. vi) L’Asie centrale avait été une région clé dans l’ancien système, la zone de passage obligé reliant les régions les plus avancées des époques anciennes (Chine, Inde, Moyen-Orient, auxquelles s’ajoute tardivement l’Europe). Les études concernant cette région ont mis en relief l’importance décisive des interactions et des échanges commerciaux, scientifiques, technologiques qui ont transité par cette région clé. L’Asie centrale perdra ces fonctions dans le système capitaliste mondial et y sera, de ce fait, définitivement marginalisée.
Bibliographie Abu-Lughod, Janet. Before European Hegemony. The World System A. D. 1250-1350. New York : Oxford University Press, 1989. Amin, Samir. L’eurocentrisme. Critique d’une idéologie. Paris : Anthropos, 1988.
77
Arrighi, Giovanni, The Long Twentieth Century, Verso, London-New York, 1994. Ashtor, E. A. Social and Economic History of tyhe Near East in the Middle Ages. London : Collins, 1976. Beckwith, Christopher. The Tibetan Empire in Central Asia : Princeton University Press, 1989. Bartjold, W, Histoire des Turcs d’Asie centrale, Maisonneuve, Paris 1947. Bernai, Martin. Black Athena. The Afroasiatic Roots of Classical Civilization. New Brunswick : Rutgers University Press, 1987. Blaut, J. M. Colonialism and the Rise of Capitalism, Science and Society, 1990. Blaut, J. M. Fourteen Ninety Two, 1991. Braudel, Fernand, Civilisation matérielle, économie et capitalisme XV-XVIIe siècle, Paris, Armand Colin, 3 vol, 1979. Ceodes, G. Les Etats hindouisés d’Indochine et d’Indonésie, Paris, Ed. de Brocard, 1948. Chase Dunn, Christopher et Thomas D. Hall (éd.). Core / Periphery Relations in Precapitalist Worlds, Westview Press, 1991. Chase Dunn, Christopher et Thomas D. Hall (éd.), World System and Modes of production, ISA, Vancouver, 1991. Chaudhuri, K. N. Trade and Civilization in the Indian Ocean. An Economic History from the Rise of Islam to 1750, Cambridge University Press, 1985.
78
Ekholm, Kajsa, Capitalism, Imperialism and Exploitation in Ancient World Systems, Review, vol. VI, n° 1, 1982. Etiemble, L’Europe chinoise, Gallimard, Paris 1988. Fitzpatrick, John, Wars, States and Markets in North East Asia 800-1400 AD. ISA, Vancouver, 1991. Frank, André Gunder, World Accumulation 1492-1789, Monthly Review Press, 1978. Frank, André Gunder, Transitional Ideological Modes : Feudalism, Capitalism, Critique of Anthropology, Beverly Hills, Sage, 1978. Frank, André Gunder, A Theoretical Introduction to 5 000 years of World Systems History Review, vol. XIII. n° 2, 1990. Friedman, Edward (éd.), Ascent and Decline in the World System. Beverly Hills, Sage, 1982. Gernet, Jacques. A History of China. Cambridge University Press, 1985. Ghurshman, R. Iran. Pelican Penguin Books, 1954. Gills, B. K. and A. G. Frank. The Cumulation of Accumulation : Theses and Research Agenda for 5 000 Years of World System History Dialectical Anthropology, Vol. 15, N° 1, July, 1990, pp. 19-42. Also in Core / Periphery Relations in Precapitalist Worlds. C. Chase-Dunn & T. Hall, Eds. Boulder : Westview Press 1991.
79
Goldstein, Joshua S. Long Cycles. Prosperity and War in the Modem Age. New Haven : Yale University Press, 1988. Grousset, René, L'Empire des Steppes, Payot, 1947. Hodgson, Marshall G. S. The Venture of Islam. 3 vols. Chicago : University of Chicago Press, 1974. Humphreys, S. C. History, Economics and Anthropology : The Work of Karl Polanyi. London : Routledge and Kegan Paul, 1978. Kohl, Philip L. The Balance of Trade in Southwestern Asia in the Mid-Third Millennium. Current Anthropolgy 19 : 3, 1978. The Ancient Economy, Transferable Technologies and the Bronze Age World-System : A View from the Northeastern. Frontier of the Ancient Near East. In Michael Rowlands, Mogens Larsen and Kristian Kristansen, Eds, Centre and Periphery in the Ancient World. Cambridge University Press, 1987. The Use and Abuse of World Systems Theory : The Case of the Pristine West Asian State. In. C. C. Lamberg- Karlovsky, Ed. Archaeological Thought in America. Cambridge University Press, 1990. Kwanten, Luc. Imperial Nomads. Leicester University Press, 1979. Liu, Xinru. Ancient India and Ancient China : Trade and Religious Exchanges AD 1600. Delhi : Oxford University Press, 1988. Liverani, Mario. The Collapse of the Near Eastern Regional System at the End of the Bronze Age : The Case of Syria. In Michael Rowlands, Mogens Larsen and Kristian Kristansen, Eds. Centre and Periphery in the Ancient World. Cambridge University Press, 1987.
80
Lombard, Maurice. L’Islam dans sa première grandeur, Flammarion, Paris 1971. Mc Neill, William, The Rise of West. A History of the Human Community. University of Chicago Press, 1963. The Pursuit of Power : Technology, Armed Force and Society since AD 1 000. Oxford : Blackwell. Marfoe, Léon, Cedar Forest to Silver Mountain : Social Change and the Development of Long-distance Trade in Early Near Eastern Societies. In Michael Rowlands, Mogens Larsen and Kristian Kristansen, Eds. Centre and Periphery in the Ancient World. Cambridge University Press, 1987. Melko, Matthew, State System in Harmonious Conflict, Paper presented at the Annual Meeting of the Japan Society for the Comparative Study of Civilizations. Kokugaluin University, Tokyo, December, 1990. Modelski, George, Long Cycles in World Politics. London : Macmillan Press, 1987. Oates, Joan, (comment on Philip Kohl) The Balance of Trade in Southwestern Asia in the Mid-Third Millennium. Current Anthropolgy 19 :3, September, 1978. Oppenheim, A. Leo and Erica Reiner, Ancient Mesopotamia. University of Chicago Press, 1977. Palat, Ravi Arvind and Immanuel Wallerstein, Of What World System was pre1500 « India » a Part ? Paper presented at the International Colloquium on « Merchants, Companies and Trade, Maison des Sciences de l’homme, Paris, 30
81
May-2 June, 1990. Pirenne, Jacques; Les grands courants de l’histoire universelle, Albin Michel, Paris 1947. Polanyi, Karl, Trade and Markets in Early Empires, Glencoe, The Free Press, 1957. Rossabi, Morris, China Among Equals : The Middle Kingdom and its Neighbors 10-14 centuries. Berkeley : University of California Press, 1982. Rostovtzeff, M. The Economic and Social History of the Hellenistic World. Oxford University Press, 1941. Roux, Georges. Ancient Iraq. Harmondsworth : Pelican. Rowlands, Michael, Mogens Larsen and Kristian Kristansen, Eds. 1987. Centre and Periphery in the Ancient World. Cambridge University Press, 1966. Silver, Morris. Economic Structures of the Ancient Near East. London : Croom Helm, 1985. De Ste. Croix, G.E.M. The Class Struggle in the Ancient Greek World. Duckworth, 1981. Suziki, Chusei. Chinas Relations with Inner Asia : The Hsiung-nu, Tibet. In John King Fairbank, Ed. The Chinese World Order. Traditional Chinas Foreign Relations, Harvard University Press, 1968. Teggart, Frederick. Rome and China. A Study of Correlations in Historical Events. Berkeley : University of California Press, 1939. Tharpar. Romila. A. History of India 1. Harmondsworth : Penguin Books, 1966.
82
Toynbee, Arnold, A Studyof History, 6 vols, Oxford Press, 1947 Vladimisrstov, B, Le régime social des Mongols, Le féodalisme nomade, Maisonneuve 1948. Vernardsky, Georges, A History of Russia, Malev. Press 1952. Je signalerai également les trois sources principales à partir desquelles j’ai retenu les chiffres de population signalées dans l’étude : Jean Claude Chesnais, La population du monde, de l’Antiquité à 2050, Bordas, Paris 1991. Jacques Vallin, La population mondiale, Coll. Repères, La Découverte, Paris 1989. Tertius Chandler and Gérald Fox, 3 000 years of Urban Growth, Academic Press, New York 1974.
83
Chapitre III Capitalisme et système-monde 1 - La spécificité du monde capitaliste moderne. J’ai fait, sur ce thème, trois propositions complémentaires. Première proposition : le mode de production capitaliste représente une rupture qualitative avec les systèmes qui l’ont précédé, dans ce sens précis que la loi de la valeur ne commande pas ici seulement la vie économique mais bel et bien tout le système social du monde moderne (capitaliste), c’est-à-dire qu’elle commande le contenu de l’idéologie spécifique propre à ce système nouveau (« l’économisme » ou mieux « l’aliénation économiste »), comme elle commande les rapports nouveaux et spécifiques entre la base économique du système et sa superstructure politique et idéologique (la « domination de l’économique », la « politique est de l’économie en comprimé », ou encore la « richesse commande le pouvoir » alors que jusqu’alors « le pouvoir commandait la richesse »). Ce système est supérieur non pas seulement par le développement prodigieux des forces productives qu’il a permis, mais encore par ses autres aspects, opérant aux plans politique et idéologique (le concept moderne de démocratie). Simultanément la croissance exponentielle qui le caractérise est le produit nécessaire et fatal de la domination de tout le système social par la loi implacable de l’accumulation. Mais, comme l’observe Wallerstein, la croissance exponentielle est celle du cancer : elle conduit nécessairement à la mort. L’intuition géniale de Marx est précisément d’avoir compris que, pour cette raison, le capitalisme doit trouver une fin, être remplacé par un système qualitativement nouveau soumettant le
84
développement des forces productives à une logique sociale maîtrisée et non plus à la seule logique mécanique de l’économique aliéné. Deuxième proposition : le système moderne - capitaliste -est mondial et il est le premier système à l’être. Toutes les parties intégrées dans ce système le sont par le biais de leur participation à une division mondiale du travail qui porte sur des produits essentiels pour la consommation de masse ou sa production, en parallèle avec un degré de commercialisation (marchandisation) de la production sans commune mesure avec celui des époques antérieures. Sur ce plan il se présente comme un système d’économie mondiale régi par ce que j’appelle la loi de la valeur mondialisée. Troisième proposition : la loi de la valeur mondialisée engendre nécessairement la polarisation, expression de la paupérisation associée à l’accumulation à l’échelle mondiale, qui est un phénomène nouveau, sans précédant dans l’histoire antérieure. Elle commande tous les conflits majeurs qui occupent le devant de la scène : ceux qui procèdent de la révolte des peuples de la périphérie et ceux qui opposent les centres en rivalité pour la domination de ce système mondial, comme elle commande l’efficacité des stratégies qui se proposent éventuellement le dépassement du système. La critique socialiste du capitalisme s’est constituée pour l’essentiel comme critique du mode d’exploitation du travail par le capital, et des effets sociaux de l’accumulation du capital qui gouverne le système (l’aliénation marchande devenue valeur suprême etc.). Cette critique s’est progressivement élevée du plan du refus moral à celui d’une compréhension plus scientifique des mécanismes et des lois du système, de ses contradictions et partant des moyens de le dépasser, qui culmine avec l’expression marxiste de la critique socialiste. Il s’agit là, à mon avis, d’une critique essentielle, fondamentale, incontournable.
85
Cependant la critique socialiste est demeurée - marxisme historique inclu relativement peu élaborée en ce qui concerne l’autre dimension du capitalisme, c’est-à-dire son déploiement comme système mondial fondé sur la polarisation du système. Les analyses du capitalisme proposées dans une perspective mondialiste ont contribué à corriger les insuffisances du socialisme historique en mettant précisément le doigt sur le caractère mondial du système capitaliste et son effet polarisant à cette échelle. Dans ce sens elles sont irremplaçables. Dans son expression immédiate le système capitaliste apparaît bien comme une « économie-monde » opérant dans le cadre politique d’un système organisé d’Etats souverains. Il faut dire cependant que l’opposition « économie monde » / « empire monde » renvoie nécessairement à l’opposition qualitative mode de production capitaliste (dans lequel l’économie non seulement commande en dernier ressort les rapports sociaux mais encore opère comme instance dominante, les évolutions de la politique et de l’idéologie apparaissant comme contraintes de s’ajuster aux exigences autonomes de l’accumulation du capital) / modes de production antérieurs (dans lesquels les lois de l’économie ne s’affirment pas comme des manifestations autonomes de la nécessité, mais au contraire comme des expressions de l’ordre politique et idéologique; parce que ce caractère est partagé par toutes les formes d’organisations sociales antérieures j’ai estimé utile de leur donner une qualification commune - celle de mode tributaire - qui en souligne l’opposition qualitative au mode capitaliste). Les centres capitalistes dominants ne cherchent pas à étendre leur pouvoir politique par la conquête impériale parce qu’ils peuvent effectivement exercer leur domination par des moyens économiques, les Etats des époques antérieures n’ont pas la garantie des bénéfices de la dépendance économique de leurs périphéries éventuelles tant que celles-ci demeurent
86
hors du champ de leur domination politique. J’insiste sur cette analyse du contraste qualitatif sans laquelle la perception du capitalisme comme système mondial demeure descriptive et phénoménale. Les élaborations théoriques et idéologiques qui se sont constituées comme réponses au défi de la critique socialiste du système, et singulièrement comme des « réponses à Marx » passent sous silence le contraste qualitatif exprimé ici, et de ce fait cherchent aux innombrables plans possibles de l’appréhension immédiate des caractéristiques spécifiques de la modernité. Max Weber est un bel exemple de cette tentative. Weber oppose le monde ancien, « patrimonial », au système de la modernité, « objectif, légaliste et bureaucratique ». Ce contraste prétendu est sans fondement scientifique : le mode tributaire est, dans ses formes développées, précisément « légaliste et bureaucratique », comme la « bureaucratie Céleste » l’illustre, et n’est d’apparence patrimonial que dans ses formes marginales et périphériques (comme l’Europe du haut moyen-âge); le mode capitaliste est dans son contenu bourgeois démocratique, et seulement dans sa forme apparente bureaucratique, même si la forme l’emporte sur le contenu dans les formes pauvres du développement capitaliste (comme l’Allemagne bismackienne a pu l’être en comparaison des évolutions radicales de l’Angleterre et de la France). La théorie Weberienne n’est donc, selon moi, qu’une extrapolation abusive de la spécificité germanique. Non moins superficielles sont les autres propositions concernant le contraste « tradition » / « modernité ». L’accent mis par exemple sur le contraste « privé / public » est un bel exemple de projection de la perception idéologique du capitalisme qui se voit comme tel (c’est-à-dire le triomphe du « privé » sur « l’Etat »). L’accent mis sur la démocratie comme concept moderne mêle le vrai et le faux de la même manière. Car s’il est exact - selon
87
ma construction théorique - que le concept moderne de la démocratie est effectivement le produit nécessaire du renversement de la dominance de l’idéologie / politique au profit de l’économique, il est doublement faux d’en déduire l’équation réversible capitalisme = démocratie. Car d’une part la démocratie en question reste séparée de la gestion de l’économique commandée par des lois en apparences « naturelles », et d’autre part elle reste confinée géographiquement aux centres du système mondial par le fait de la polarisation. On pourrait multiplier les exemples : chaque fois qu’une forme phénoménale est coupée de ses racines qu’elle plonge dans la logique du mode capitaliste, cette forme devient l’objet de malentendus inévitables elle est difficile à généraliser dans le capitalisme réellement existant d’une part, facile à extrapoler en arrière d’autre part. L’analyse phénoménale aplatit l’histoire, porte le débat à un niveau d’abstraction trop élevé et de ce fait trivialise les propositions qu’on peut en déduire, lesquelles deviennent à leur tour, toujours en partie vraies, en partie fausses. Si, comme je le prétends - avec la tradition marxiste - le capitalisme se définit d’abord par son mode de production spécifique, il faut attendre la « révolution industrielle », c’est-à-dire la dominance de la « grande industrie » fondée sur le salariat ouvrier, pour pouvoir parler de mode capitaliste dans sa forme achevée. Les trois siècles du « mercantilisme » européen (de la Renaissance à 1800) sont alors seulement ceux d’une transition au capitalisme n’apparaissant comme telle qu’à posteriori. On reconnaît alors, a posteriori, les ruptures qui permettent de qualifier la période de transition effective : le renversement de la préoccupation métaphysique propre à l’idéologie tributaire, le renforcement de la Monarchie absolue fondée sur l’équilibre des forces sociales féodales anciennes et de la bourgeoisie, l’expression démocratique des révolutions anglaise et française etc.
88
Cela étant les « régions » (Empires vastes ou seigneuries modestes) constitutives du monde tributaire des périodes antérieures ne sont pas nécessairement isolées les unes des autres; au contraire toute la recherche historique démontre l’intensité - souvent insoupçonnée - de leurs rapports. Cependant la nature de ces rapports est différente de celle qui qualifie les connexions au sein du système capitaliste mondial. Il s’agit certes dans tous les cas de rapports marchands, « d’échanges ». Mais la critique marxiste de la distinction nécessaire entre le « marché » d’une part et le « marché capitaliste » (qui implique que l’échange soit fondé sur la production capitaliste) d’autre part garde ici toute sa validité. L’importance du marché et l’intensité des échanges, repérables ici et là à travers les temps et les espaces, n’est pas synonyme de capitalisme. Ils témoignent seulement que le dépassement du système tributaire - c’est-à-dire le passage au capitalisme -étaient bien ici et là, depuis longtemps, à l’ordre du jour et que, en conséquence, la transition mercantiliste européenne n’est pas le produit d’une loi spécifique de l’évolution qui aurait été propre à l’Europe, mais l’expression d’une loi générale de l’évolution de toutes les sociétés humaines. L’opposition de l’analyse en termes de mode de production et celle en termes de système mondial n’est donc pas fondée; au contraire ces deux directions de l’analyse sont complémentaires. Cependant, faute de l’avoir formulé sans ambiguïté, l’analyse en termes de système mondial devait conduire à un véritable dérapage, qui consiste en une extrapolation en arrière des conclusions de l’analyse portant sur le capitalisme mondial. Le malentendu domine les débats concernant la nature et la définition conceptuelle du système mondial moderne (capitaliste) et - si cela a un sens du système mondial des époques antérieures. La raison ultime de ce malentendu vient de ce que le capitalisme ne peut pas être défini par la simple asso-
89
ciation de trois ordres de phénomènes : la propriété privée, le travail salarié et l’extension des échanges marchands. Cette méthode empiriste occulte l’essentiel, à savoir que le capitalisme n’existe que lorsque le niveau de développement des forces productives implique l’usine moderne, laquelle met en œuvre un équipement mécanique lourd et non plus un équipement artisanal. La combinaison propriété privé-travail salarié-production marchande précède effectivement le capitalisme non seulement dans l’Europe mercantiliste et même féodale mais ailleurs, à travers le monde entier et durant des siècles, parfois des millénaires. Cette combinaison constitue la très longue préhistoire du capitalisme. Ce n’est qu’avec le capitalisme dans sa forme achevée qu’apparaissent les deux caractéristiques fondamentales du monde moderne. La première est l’urbanisation massive qui conduit à un changement qualitatif, puisqu’elle impliquait une révolution agricole (machinisme et chimie), condition d’une productivité qui est devenue un multiple de ce qu’elle avait été à travers les millénaires antérieurs, elle même inconcevable sans l’industrie capable de lui fournir ses inputs. La seconde est le caractère désormais exponentiel de la croissance de la production, qui implique non seulement que la recherche du profit soit devenue le moteur de la décision économique mais encore que cette recherche du profit opère sur la base de moyens matériels ayant dépassé le stade de l’outillage artisanal. Le système mondial moderne est un système mondial capitaliste parce qu’il est fondé sur le capitalisme entendu comme je viens de le définir. On peut alors reprendre chacune des caractéristiques phénoménales de la modernité et leur donner, sur cette base, un sens intelligible et précis. Sans cette référence les phénomènes en question demeurent l’objet de malentendus répétés. L’accumulation « sans répit » et la croissance exponentielle auxquels
90
se réfère Wallerstein par exemple demeurent incompréhensibles en dehors de la référence à la loi de la valeur (c’est-à-dire non pas à l’extension des rapports marchands - terminologie trop vague - mais à l’extension de ceux-ci sur la base d’une production capitaliste au sens donné ci-dessus) et au fait que la loi de la valeur capitaliste ne commande pas seulement la vie économique mais en réalité soumet toutes les autres dimensions de la vie sociale à la loi implacable de l’accumulation du capital. De même l’extension et la généralisation du marché qui englobe désormais la production essentielle des biens et des services, le travail et la terre, n’acquièrent leur sens moderne - c’est-à-dire leur mise au service de l’accumulation du capital - que si l’on saisit leur fonctionnement dans le cadre de la production capitaliste. Car le marché des productions, du travail et de la terre existent avant le capitalisme, en Chine par exemple, mais ne fonctionnent pas alors comme moyens d’accumulation du capital. Dans la tradition marxiste, parfaitement justifiée, la richesse n’est capital que si elle est réinvestie en vue d’une production élargie. Accumulation de richesses et accumulation de capital ne sont pas synonymes. Si le capitalisme est un système mondial, c’est parce que l’économie mondiale qui le sous-tend est, dans sa globalité, régie par ce système de production capitaliste. Avec Wallerstein et Chase Dunn je considère que l’économie du capitalisme est mondiale parce que la division du travail sur la base de laquelle sont organisées les productions essentielles est une division mondiale du travail. Dans les époques antérieures l’échange « lointain » porte souvent sur des biens de prestige, qui sont certes des éléments importants pour la compréhension de la reproduction des sociétés en question, mais qui n’opèrent pas de la même manière dans ces sociétés dont la reproduction est commandée par des logiques différentes. Ces échanges antérieurs au capitalisme moderne peuvent même dans certaines circonstances avoir concerné des
91
biens « essentiels » (matériaux de construction, métaux, textiles de grande consommation etc.), mais ils ne portent pas sur des produits provenant de l’industrie capitaliste au sens précis du terme, rappelé plus haut, et cela constitue une différence gigantesque. L’extrapolation en arrière - avant 1800 - du concept de système capitaliste mondial implique toujours un refus de reconnaître l’importance du saut qualitatif que représente le passage à l’industrie capitaliste moderne, un refus qui aplatit l’histoire réelle. Ce refus trouve son explication dans la réaction des analyses en termes de système mondial aux blocages de celles qui s’étaient fixées exclusivement sur la théorie des logiques immanentes des différents modes de production. Car il est vrai que dans une interprétation du marxisme que j’ai qualifié de livresque, un dogmatisme s’était constitué qui a longtemps prétendu que la spécificité de chacun des modes de production constituait toute la réalité. Dans cette dogmatique chaque société était forcément étudiée en isolement et l’idée même de l’existence possible d’un système plus large refusée. Entre autre, concernant le monde capitaliste moderne, celui-ci était réduit aux dimensions d’une juxtaposition de sociétés capitalistes locales (nationales), définies exclusivement par leur structuration sociale interne. Le concept même de polarisation au sein de ce système mondial était alors éliminé par avance du champ de l’étude. Or l’analyse en termes de système mondial partait précisément d’une tentative de répondre à cette question : pourquoi la polarisation mondiale ? Mais il n’était pas nécessaire de jeter le bébé avec l’eau du bain, c’est-à-dire de dévaluer le concept de mode de production (capitaliste entre autres) pour ne plus voir que le système mondial (moderne et capitaliste en l’occurrence). Il fallait au contraire renforcer l’analyse du monde moderne en termes de spécificité du mode de production capitaliste en la complétant par celle de sa
92
dimension systémique mondiale. Les définitions proposées parfois pour le système de l’économie monde capitaliste souffrent de ce préjugé hostile au concept de mode de production. Elles sont alors forcément trop vagues; et c’est le cas lorsque l’on définit l’économie monde en question comme l’association d’un système politique inter Etats et d’une économie qui dépasse les Etats (mais de quelle « économie » s’agit-il alors ?). Le pendule allait trop loin, la voie était ouverte pour une extrapolation en arrière de la théorie du système mondial. Ce qui est bien arrivé.
2 - La polarisation dans le système capitaliste mondial. J’ai proposé, sur le sujet de la polarisation dans le système mondial moderne, les thèses suivantes : Premièrement la polarisation est une loi immanente de l’expansion mondiale du capitalisme. Le capitalisme réellement existant, phénomène mondial, n’est pas réduisible au mode de production capitaliste et ne tend pas même à le devenir. Car le mode de production capitaliste suppose un marché intégré tridimensionnel (marché des marchandises, du capital et du travail) qui définit la base de son fonctionnement. Or cette intégration, qui a été effectivement construite dans le cadre de l’histoire de la formation des Etats nationaux bourgeois centraux (Europe occidentale et centrale, Etats-Unis et Canada, Japon, Australie) n’a jamais été étendue au capitalisme mondial. Le marché mondial est exclusivement bidimensionnel dans son expansion, intégrant progressivement les échanges de produits et la circulation du capital, à l’exclusion du travail dont le marché reste cloisonné. J’ai prétendu que ce fait était en lui même suffisant pour engendrer une polarisation inévitable, dont on peut démontrer sans difficulté le mécanisme
93
cumulatif, tant par le moyen de l’outillage marxiste (on parlera alors de la loi de la valeur capitaliste mondialisée, en complément à l’analyse fondamentale de la loi de la valeur capitaliste) que même au moyen de l’outillage de l’économie conventionnelle néoclassique. Cette proposition se situe à un niveau élevé de l’abstraction, ni plus, ni moins que celui qui caractérise les propositions concernant la loi de la valeur en général, le marché dans chacune de ses dimensions, les classes sociales fondamentales qui correspondent à la logique du mode de production etc. Ma proposition définit abstraitement le capitalisme mondial, tout comme celles concernant la loi de la valeur définissent le mode de production capitaliste. Bien entendu l’abstraction n’est pas plus ici qu’ailleurs négation du concret, mais au contraire l’expression de la diversité de celui-ci. Les conditions historiques qui expliquent la formation de l’Etat national bourgeois à un pôle et son absence à l’autre illustrent la diversité concrète qui caractérise ce que j’ai donc appelé les périphéries - toujours au pluriel - par opposition au centre, que l’on peut conjuguer au pluriel lorsqu’on s’occupe de restituer l’histoire de sa constitution, ou au singulier lorsqu’on met l’accent sur la tendance à l’homogénéisation des sociétés nationales qui le composent - ici effective - ou sur la nature de ses rapports aux périphéries. Deuxièmement la définition du contenu essentiel des deux concepts de centre et périphéries est de nature économique. Il ne s’agit pas là d’un choix arbitraire mais de l’expression de la dominance de l’économique dans le mode capitaliste, et de la soumission directe du politique et de l’idéologique aux contraintes de l’accumulation du capital. De ce fait les rapports centre / périphéries sont d’abord de nature économique. Par contre si dans les époques antérieures des phénomènes de polarisation, au sens courant du terme, sont
94
également repérables, ceux-ci ont une nature et une dynamique différentes, parce qu’ils opèrent dans le cadre de sociétés non capitalistes. Troisièmement la polarisation dans sa forme moderne apparaît avec la division du monde en pays industrialisés par opposition aux pays non engagés dans l’industrialisation. Elle est donc un phénomène relativement récent, qui se constitue au XIXe siècle. Cela étant le contraste industrialisation / non industrialisation n’est pas la forme éternelle et définitive de la polarisation capitaliste. Dominant de 1800 à 1945, il s’estompe progressivement après la seconde guerre mondiale avec l’industrialisation des périphéries, tandis que le critère de la polarisation se déplace alors sur des terrains nouveaux. L’émergence du concept de la polarisation capitaliste mondiale a son histoire propre, bien entendu. Comme il était naturel le débat s’est ouvert à partir de considérations concrètes et spécifiques, marquées par l’époque. Certaines de ces considérations ont donc mis l’accent sur le contraste industrie / absence d’industrie, puisque la polarisation s’exprimait effectivement à travers lui. L’industrialisation devenait dès lors le moyen du « développement » dont l’objectif historique était supposé être l’abolition de la polarisation (« le sousdéveloppement »). En rapport direct avec ce contraste l’analyse s’est portée sur le champ des échanges internationaux et de la division internationale du travail. Les propositions avancées dans le débat sur l’échange inégal doivent être lues en gardant à l’esprit ce rapport étroit à la réalité concrète de la forme historique de la polarisation en question. Les ambiguïtés du débat provenaient du non dit des uns et des autres, ou du non exprimé en termes conceptuels abstraits. En fait derrière les propositions faites se cachait un clivage théorique peu, ou mal, exprimé. Pour les uns le capitalisme était en lui même polarisant. Mais il fallait, pour l’établir, s’élever
95
au niveau de l’abstraction définie plus haut à savoir le caractère tronqué du marché mondial par rapport à l’intégration tridimensionnelle propre au concept de mode capitaliste. Pour les autres, l’argumentation en termes historiques concrets n’établissait pas la proposition générale que le capitalisme mondial est nécessairement polarisant. Aussi cette polarisation était-elle saisie comme phénoménale et non essentielle, produite par l’histoire concrète et non les lois de l’accumulation du capital. Dans ces conditions l’intégration des analyses économiques spécifiques, des considérations concernant la formation d’une bourgeoisie ou les handicaps rencontrés par celle-ci, ou culturelles (les disponibilités idéologiques potentielles portées par les différentes « cultures ») ne pouvaient pas trouver sa solution. Dans sa contribution à l’ouvrage collectif Le grand tumulte, G. Arrighi avance une thèse théorique importante. Il rappelle que selon Marx l’accumulation du capital entrainait deux effets complémentaires / contradictoires : d’une part le renforcement du pouvoir social de l’armée active (la classe ouvrière industrielle organisée), d’autre part la paupérisation de l’armée de réserve passive (chômeurs, marginalisés, travailleurs des secteurs de production d’allure précapitaliste, à faible productivité etc). Cette observation fine me paraît non seulement correcte au sens que c’est bien là ce que Marx a dit, mais encore, comme G. Arrighi le constate aussi, confirmée par l’histoire. Mais le marxisme historique, parce qu’il n’avait pas vu l’importance de la polarisation mondiale (c’est-à-dire la localisation de l’armée active et de l’armée passive en des lieux géographiques politiquement séparés - le centre et la périphérie), supposait que le va et vient continuel des mêmes individus prolétarisés entre les deux armées considérées assurerait l’unité du front anticapitaliste et partant le succès rapide de son action globale. La polarisation explique qu’au contraire, cette unité brisée, deux stratégies anticapitalistes se sont dégagées en
96
contraste progressif : la stratégie social démocrate dans les classes ouvrières des centres, celle de la révolution léniniste (puis maoïste) chez les peuples de la périphérie (c’est-à-dire l’armée passive à l’échelle mondiale). L’industrialisation progressive récente des périphéries, même inégale bien entendu, doit contraindre à repenser la polarisation pour la dépouiller de son expression historique dépassée. Certes la polarisation continuera à être produite par la non intégration tridimensionnelle du marché capitaliste. Mais le marché capitaliste lui même ne peut être analysé dans les termes conventionnels de la « concurrence ». Baran, Sweezy et Magdoff ont démontré, à mon avis, que les lois du marché (je dirai plus exactement des deux marchés, nationaux intégrés tridimensionnellement d’une part, et mondial, tronqué, d’autre part) du capitalisme des monopoles sont qualitativement différentes de celles qui régissaient les marchés capitalistes du XIXe siècle. Cette analyse, rejetée par beaucoup de théoriciens se réclamant également du marxisme, me paraît par contre essentielle, parce qu’elle définit une dynamique du surplus autre que celle des profits. Je pense seulement qu’il faut aller aujourd’hui plus loin dans les propositions concernant l’accumulation à l’échelle mondiale opérant dans un monde qui tend à devenir globalement industrialisé. A ce propos G. Arrighi note que l’échange inégal ne révèle que le sommet de l’iceberg : l’échange portant sur des produits dans lesquels sont cristallisés des travaux dont la rémunération est plus inégale que l’écart des productivités ne le suggère. Arrighi signale trois mécanismes de la polarisation opérant en dehors de tout échange : (i) la fuite des capitaux des périphéries vers les centres; (ii) la migration sélective des travailleurs dans le même sens (même si cette migration, par la définition même de sa sélectivité, exclut la formation d’un marché mondial du travail); et (iii) les positions de monopole occupées
97
par les sociétés centrales dans la division mondiale du travail. J’ajoute le contrôle par les centres de l’accessibilité aux ressources naturelles de la Terre toute entière. Je n’ai pas de difficulté à intégrer les deux premiers mécanismes dans ma conceptualisation abstraite et générale de la polarisation : ils en sont des expressions évidentes. Il en est de même du quatrième élément que j’ai signalé. Par contre le concept de monopole auquel il est fait référence ici reste, à mon avis, flou et mal défini. Arrighi reprend à ce propos la proposition faite naguère par Harrod, distinguant la « richesse oligarchique », fondée sur l’exclusion, de la « richesse démocratique », dont la conquête est en principe ouverte « à tous ». Soit, mais quelles sont les mécanismes exacts de l’exclusion ? L’analyse concrète des situations modernes indique deux directions dans lesquelles on peut rechercher cette exclusion : le monopole des technologies et celui des finances mondialisées. L’industrialisation périphérique peut devenir, dans ce cadre, une sorte de système moderne de putting out, contrôlé par les centres financiers et technologiques. Il reste que tant que ces éléments de la construction d’ensemble ne seront pas articulés les uns aux autres, le concept même de monopole restera intuitif et la dynamique du système difficile à dégager. Le concept de polarisation est essentiel dans ce sens précis qu’il interdit de concevoir l’avantage des centres sans référence à leur situation dans le système mondial. J’en dérive au moins les propositions qui suivent : (i) l’exploitation du travail dans les périphéries est, en général, beaucoup plus intense que dans les centres (le différentiel des rémunérations du travail - salarié et autre - est plus écarté que celui des productivités). Le produit de cette surexploitation au bénéfice du capital dominant l’ensemble du système, est, en partie, transféré vers les centres par l’échange, renforcé par les migrations de
98
capitaux et de travail. Le discours dominant qui cherche à nier, ou à minimiser, les effets de ce transfert, n’est rien de plus qu’une légitimation idéologique destinée à occulter les liens immanents entre le capitalisme et la polarisation; (ii) le transfert de valeur au détriment des périphéries est, à lui seul, une force capable de reproduire et d’approfondir la polarisation par le poids négatif gigantesque qu’il représente pour les périphéries, même si -statistiquement il pourrait parfois paraître mineur par rapport au surplus généré dans les centres mêmes; (iii) les avantages dont les sociétés du centre bénéficient ne sont pas produits exclusivement, ni même principalement par l’organisation plus efficace de leur travail (des productivités du travail beaucoup plus élevées); ils sont tout autant produits par les monopoles que les centres exercent dans la division mondiale du travail. Les évolutions récentes doivent être analysées par référence au cadre proposé ci-dessus. Par exemple la « désindustrialisation » (relative) des centres, en parallèle à l’industrialisation des périphéries, ne prend de sens que par référence au transfert du monopole des centres de l’activité industrielle propre au contrôle des technologies, finances et accès aux ressources naturelles. Si les périphéries se conjuguent toujours au pluriel c’est, selon ce que j’ai avancé, parce qu’elles n’admettent qu’une définition négative : les régions du système mondial qui ne se sont pas constituées en centres. La diversité des fonctions qu’elles remplissent dans le système mondial est alors la règle. La tentation a toujours été très grande, du fait de cette diversité, de classer les périphéries. Ainsi le vocable de « quart monde » a été forgé récemment pour le distinguer du tiers monde en voie d’industrialisation. Cet usage n’est pas inoffensif dans l’esprit de ceux qui le proposent : il suppose que le tiers monde des NICs est en train de « rattraper » (ou le peut), tandis que le quart monde
99
« sombre ». C’est oublier que l’industrialisation n’est plus le fondement de la polarisation. Je préfère donc dire que le cœur de la périphérie de demain - en formation - est constitué par les pays qui rempliront la fonction essentielle de fournir des produits industriels; et que le « quart monde » illustre le caractère destructif de l’expansion capitaliste, ce qui n’est pas nouveau, mais a toujours accompagné l’histoire réelle du capitalisme. Quant au classement purement quantitatif - celui de la pyramide des PIB per capita de la Banque Mondiale - il est le plus superficiel de tous. Suggérant qu’un émirat pétrolier puisse se placer avant la Suède, il veut par là même légitimer la division internationale du travail et les soi-disant avantages comparatifs. Dans ce domaine Arrighi analyse le système mondial comme une combinaison stable de trois ensembles (centres, semi-périphéries et périphéries) dont il fait apparaître l’existence en dégageant la médiane de chaque groupe respectif constitué par les pays dont le PIB par tête se situe dans les tranches élevée, moyenne et basse de la classification pyramidale. J’observe immédiatement que la construction est artificielle dans ce sens qu’en définissant a priori deux groupes seulement (centres et périphéries) ou quatre par exemple, on aurait obtenu deux ou quatre médianes dont l’évolution comparée aurait donné des résultats analogues. Cet artifice n’élude donc pas la difficulté d’une définition qualitative de chacun des groupes, car la « semi-périphérie » reste ce que son nom indique sans plus, à mi-chemin entre le premier et le troisième groupe, que cela soit en termes de PIB per capita, de niveau d’industrialisation ou de presque tout autre critère quantifiable. D’ailleurs les périphéries (selon la définition d’Arrighi), se présentent elles mêmes d’une manière analogue au plan descriptif, c’est-à-dire comme un mélange de caractères typiques du centre et d’« autres » caractères, la présence des premiers, même faible en termes qualitatifs, témoignant simplement que toutes les sociétés considérées
100
sont bien intégrées dans le système mondial et nullement exclues. Ces caractères - la présence minimale d’entreprises modernes, de salariés et d’entrepreneurs capitalistes, de rapports marchands étendus, d’institutions financières (banques) fonctionnant comme ailleurs, d’un Etat d’apparence moderne gérant, par le moyen d’un budget, un certain nombre de services comme ailleurs etc. - sont toujours présents, des centres les plus développés aux périphéries les plus archaïques. L’intérêt de l’exercice réside ailleurs, dans la mise en relief de l’étonnante stabilité à long terme de chacun des groupes et de la distance relative qui les sépare. Mais encore une fois le classement en deux ou quatre groupes aurait révélé la même stabilité, qui signifie bien alors que la polarisation ne peut jamais être surmontée parce qu’elle fait partie du système dans ce qu’il a de plus essentiel. Par contre en choisissant de distinguer les semi-périphéries des périphéries, Arrighi introduit une dose d’arbitraire inutile, que le classement en termes de PIB per capita qui constitue son fondement rend inévitable. Pour moi il ne fait pas de sens de considérer que le Ghana aurait fait partie de la semi-périphérie, comme l’Italie et le Japon, sauf que le Ghana aurait vu sa position se dégrader, l’Italie et le Japon se hissant par contre au rang de partenaires centraux. En adoptant le critère sociopolitique que je propose - la cristallisation d’un Etat national bourgeois ou son absence - on comprend que, s’améliorant ou se détériorant en fonction de facteurs externes, le Ghana a toujours appartenu à la périphérie, tandis qu’un espace existait dans le cas de l’Italie et du Japon qui a permis une amélioration de leur position dans la hiérarchie internationale. Cet espace dans lequel ont opéré les facteurs internes - en conjonction avec les facteurs extérieurs - n’existe que si la formation locale est bourgeoise nationale.
101
D’ailleurs le malaise créé par la classification tripartite est ressentie par Arrighi lui même, qui est alors contraint d’introduire des nuances additionnelles, pour rendre compte des situations particulières de ce qu’il appelle alors « les périmètres du centre » et « les périmètres de la périphérie ». On se retrouve proche de la structure pyramidale continue. Je ne vois donc pas d’avantages particuliers à la répartition tripartite proposée par Arrighi. Je préfère analyser le système mondial dans le terme univoque de polarisation, qui signifie que les centres produisent ce système dans son ensemble en façonnant la modernité subalterne des périphéries, étant entendu que cette expansion mondiale n’est pas seulement synonyme de développement hiérarchisé de la modernité mais simultanément processus de destruction des parties devenues dysfonctionnelles ou sans fonction dans sa logique globale. Périphérisation et dévastation vont alors de pair et rendent compte de la différenciation permanente des périphéries reproduite dans des formes en évolution continue. En association avec cette théorisation globale du capitalisme mondial, les analyses concrètes de chaque cas, et non de groupes artificiels, fournissent la base à partir de laquelle la théorie abstraite et générale est construite. L’analyse proposée par G. Arrigni révèle effectivement l’extraordinaire stabilité des hiérarchies, qui signifie que l’objectif de « rattraper » est illusoire. Arrighi a montré même que cette loi s’appliquait tout autant aux régimes dits socialistes qu’à ceux de la périphérie capitaliste. J’en conviens. Je fais observer seulement que les pays dits socialistes se proposaient, avec beaucoup de confusion, à la fois de « rattraper » et de faire autre chose (« construire le socialisme »), et qu’ils avaient effectivement largement déconnecté - au sens que j’ai donné à ce concept, c’est-à-dire soumis leurs relations extérieures à la logique de leur développement interne. Les aspects positifs de leurs réalisations (un étatisme paternaliste sans doute, mais quand même social, garantis-
102
sant la sécurité de l’emploi et un minimum de services sociaux, par contraste avec le capitalisme sauvage des périphéries capitalistes) proviennent de leur origine (une révolution populaire anticapitaliste) et de leur déconnexion; tandis que ses impasses traduisent l’illusion du « rattrapage », qui implique largement l’adoption des critères du capitalisme. Ce contraste renvoie à ce que j’ai dit plus haut des limites du marxisme historique ayant ses origines dans la sous-estimation du caractère polarisant du capitalisme mondial. Il en résulte que si les pays de l’Est reconnectent et retournent au capitalisme, ils ne progresseront pas plus vite dans l’effort de rattrapage, mais au contraire, subiront, comme toutes les périphéries, les effets régressifs du capitalisme sauvage. L’autre conclusion d’Arrighi - qu’aucune périphérie n’est parvenue à rattraper dans le cadre du capitalisme - rejoint évidemment la mienne.
3 - La question des cycles longs dans l’expansion capitaliste. Aucun phénomène social, et peut-être même naturel, ne se développe d’une manière régulière, continue et indéfinie. Il en est de même, forcément, de l’expansion capitaliste dont les phases de croissance rapide sont nécessairement suivies de moments de réajustement difficiles, offrant au lecteur des séries historiques, l’impression d’une évolution par longues vagues. Admettre ce fait pose immédiatement deux séries de questions : i)
Les phases successives sont liées entre elles et s’expliquent l’une par l’autre : les contradictions accumulées dans la phase d’essor explosent dans une crise qui contraint à des réajustements permettant un nouvel essor.
ii) L’expansion capitaliste ne doit pas être réduite à la dimension décrite conventionnellement par les grandeurs économiques (productions, prix, revenus, profits, commerce extérieur etc.). Les conflits sociaux, les guerres,
103
les vagues d’innovation constituent des dimensions du système non moins internes. Les difficultés réelles qu’on rencontre quand on se donne l’objectif ambitieux d’intégrer l’ensemble de ces dimensions dans une seule théorie ne doivent pas conduire à y renoncer et le matérialisme historique ne doit pas être réduit à une économie politique. Cela étant, reconnaître la succession des phases telles que je viens de les définir n’est pas nécessairement admettre une théorie du cycle. Car si les mots ont un sens on ne doit parler de cycle que si des mécanismes définis en reproduisent le mouvement d’une manière monotone. Il faut de surcroit que l’articulation des différentes dimensions de la réalité (les flux économiques, les innovations technologiques, les conflits sociaux et politiques etc.) opère d’une manière identique d’un cycle à l’autre. L’adhésion au principe selon lequel le capitalisme doit être analysé comme système mondial n’implique en aucune manière le principe que l’expansion capitaliste serait soumise à une loi de développement cyclique. L’analyse de la dimension économique propre dans l’évolution sociale générale trouve, dans le capitalisme, sa justification spécifique tenant au fait que précisément ce système est commandé dans son ensemble directement par les lois de son développement économique dont il importe alors de définir avec précision la nature, les mécanismes, le temps (court ou long) de leur déploiement. On saisit alors mieux la relativité de l’autonomie de l’économique, c’està-dire les limites que lui impose l’interaction entre le déploiement de ses lois d’une part et les réactions qu’elles suscitent dans le milieu social dans lequel elles opèrent d’autre part. J’ai proposé, dans ce cadre, les deux thèses suivantes :
104
i)
On peut sans grande difficulté construire un modèle économique auto-générateur d’un cycle monotone, en mettant en œuvre les deux mécanismes connus du multiplicateur (un revenu additionnel distribué génère une série de revenus induits) et de l’accélérateur (la demande occasionnée par un revenu distribué génère un investissement plus que proportionnel). On peut améliorer le modèle en y greffant un cycle des réponses du crédit et des variations relatives du salaire réel et du profit. On peut exprimer ce modèle dans le cadre d’une économie nationale fermée ou ouverte, ou dans celui de l’économie mondiale. On peut formuler ce modèle, soit dans les termes purement empiriques de l’économie conventionnelle, soit dans ceux de la loi de la valeur au sens marxiste du concept. Tous ces exercices d’économique, ou d’économie politique, sont conçus dans le cadre abstrait rigoureux du mode de production capitaliste, condition nécessaire et suffisante de leur validité. Il est intéressant de noter que les résultats obtenus par ce moyen décrivent bien l’ossature réelle du cycle court (de 7 ans en moyenne) qui jalonne effectivement le long siècle 1815-1945. Après la seconde guerre mondiale un degré de maîtrise plus marqué de la conjoncture paraît s’être imposé, par une intervention plus active de l’Etat, le contrôle du crédit, de la répartition du revenu, de la dépense publique etc. Parallèlement on peut, sans plus de difficulté, construire des modèles de fluctuations plus courtes, axées sur les mouvements des stocks, qui correspondent eux aussi aux déroulements réels de la vie économique du capitalisme industriel moderne.
ii) La réflexion sur les tendances plus profondes du système économique du capitalisme est davantage l’objet de controverses. Les théories concernant les « cycles longs » (dits de Kondratieff) se situent dans ce plan. Or ici je partage avec quelques autres (Baran, Sweezy, Magdoff) une thèse dont je
105
suis conscient qu’elle est tout à fait minoritaire, étant rejetée (ou ignorée) par toute l’économie conventionnelle, les analyses du système-monde (qui, toutes, me semble-t-il, admettent le « cycle long ») et les courants dominants du marxisme. La thèse que je défends est fondée sur l’idée que le mode de production capitaliste s’exprime dans une contradiction sociale qui lui est immanente, laquelle entraine à son tour une tendance permanente du système à « produire plus qu’on peut consommer » : la pression sur le salaire tend à générer un volume des profits, voués à l’investissement par la concurrence, toujours relativement trop grand par rapport aux investissements nécessaires pour faire face à la demande finale. La menace de stagnation relative est, dans cette optique, la maladie chronique du capitalisme. Ce n’est pas la « crise » qui doit être expliquée par des raisons particulières, c’est au contraire l’expansion qui est le produit de circonstances spécifiques à chacune des phases de celle-ci. Je prétends que cette contradiction est immanente au mode de production capitaliste au sens plein du terme, c’est-à-dire encore une fois réalisé à travers l’industrie moderne. Je ne propose certainement pas de projeter en arrière cette loi spécifique, ni bien entendu aux époques anciennes, ni même à la transition du capitalisme mercantiliste (1500-1800). Il n’y a aucune tendance à la surproduction dans une société antérieure au capitalisme industriel moderne. J’accepte également la thèse de Baran, Sweezy et Magdoff que dans le capitalisme des monopoles cette tendance impose l’introduction du concept spécifique de surplus et des formes d’absorption de celui-ci (le département III du modèle économique, dans une construction où le département I considère la production de moyens de production et le département II celle des biens de consommation). J’ajoute que cette contradiction mérite d’être examinée à l’échelle du système capitaliste mondialisé : la répartition
106
mondiale inégale du revenu (au sens que les rémunérations du travail sont plus inégalement réparties que les productivités) donne un excédant potentiel permanent de profits qui doivent être gaspillés d’une manière ou d’une autre; l’exploitation du travail (et sa surexploitation à la périphérie) est en définitive l’obstacle fondamental à un autre développement des forces productives. Dans le cadre de cette théorie fondamentale du mode de production capitaliste la discussion des cycles apparents prend une allure toute différente de celle produite par les auteurs de l’école du système monde. Dans le domaine strict défini par l’économie conventionnelle (productions, investissements, prix, revenus) on repère effectivement des « vagues longues ». Les indices de prix marquent en effet une tendance à la baisse de 1815 à 1850; à la hausse de 1850 à 1865; la baisse de 1865 à 1900 et la hausse de 1900 à 1914. Or dans ce domaine j’avance une explication qui n’a rien à voir avec le concept même de cycle. Les dates tournantes de 1850 et 1900 correspondent en effet à la mise en exploitation de nouveaux gisements aurifères riches, en Amérique du nord puis en Afrique du Sud. Or j’ai prétendu que dans un système monétaire fondé sur la convertibilité en or (qui est le cas de 1815 à 1914) l’évolution des prix absolus était commandée par une tendance longue à la baisse, par l’amélioration de la productivité du travail. Cette tendance est contrariée par l’amélioration éventuelle de la productivité du travail dans la production de l’or, ce qui s’est bien produit brutalement en 1850 et en 1900, avec l'exploitation de nouveaux gisements exceptionnels, l’effet de la hausse conséquente des prix s’épuisant en une quinzaine d’années, laissant alors la tendance longue à la baisse reprendre sa place dominante.
107
L’examen des cycles longs affectant les taux de croissance de la production à laquelle est forcément associé étroitement le mouvement des investissements n’exige pas davantage l’adhésion à une théorie quelconque du « cycle ». Ici on repère, selon les synthèses des travaux proposées par Joshua Goldstein, quatre vagues d’un demi-siècle chacune qui sont les suivantes : 1) 1790-1814 Essor..... 1814-1848 Crise 2) 1848-1872 Essor..... 1872-1893 Crise 3) 1893-1914 Essor..... 1914-1945 Crise 4) 1945-1968 Essor..... 1968 Crise Ici comment ne pas faire immédiatement remarquer que chacune des phases successives d’essor correspond très exactement à la fois à la mise en œuvre d’un système d’innovations majeures et à des évolutions politiques de nature à élargir les marchés ? Successivement : (i) la première révolution industrielle, les guerres de la Révolution et de l’Empire; (ii) le chemin de fer, les unités allemande et italienne; (iii) l’électricité, l’impérialisme colonial; (iv) la reconstruction et la modernisation de l’Europe et du Japon, la civilisation de l’automobile. Cela étant je ne me range pas du côté de Trotsky dans sa polémique contre Kondratieff. Trotsky, en considérant que les innovations, l’exploitation de nouvelles ressources, les guerres et l’expansion extérieure, et même les résultats des luttes de classes sortent du domaine de la causalité d’une théorie du cycle économique, séparait artificiellement l’économie politique du champ plus vaste du matérialisme historique. Kondratieff avait, à mon avis, l’intuition forte qu’il fallait, dans l’esprit du matérialisme historique, relier plus
108
étroitement les phénomènes économiques au sens strict du terme et les évolutions s’exprimant dans les autres champs de la réalité sociale. Avec Kondratieff, je prétends donc que ces aspects de la réalité sont aussi des expressions de l’accumulation du capital. Cependant leur relation n’inspire aucune théorie du cycle. La preuve en est que, selon les synthèses proposées par Goldstein, tandis que la concomitance des évolutions des grandeurs économiques strictes est bien établie, les autres aspects de la réalité sociale ne sont pas soumis aux mêmes rigidités apparentes : le groupement des innovations dans les phases A ou B du cycle est douteux, il en est de même des tendances concernant les salaires réels etc. La dynamique du commerce mondial, dans laquelle s’exprime entre autre l’expansion extérieure de centres rivaux, ne suit pas davantage de règle rigide. L’innovation n’est certainement pas socialement neutre; car sa mise en œuvre est soumise à la logique du profit. Sa permanence est non moins réelle, car elle résulte de la concurrence des capitaux (parcellisés), qui est-elle même la loi du système capitaliste. La percée d’innovations majeures peut déclencher un processus d’essor long; mais pas « forcément ». Par exemple tandis que le chemin de fer ou l’urbanisation organisée autour de l’automobile impliquaient des investissements lourds massifs, refaçonnant la géographie industrielle, il n’est pas dit que la vague actuelle d’innovations centrées sur l’informatique ait un effet analogue. Ici encore je partage, avec Sweezy et Magdoff, une opinion qui n’est pas communément admise, à savoir que la révolution technologique contemporaine n’apporte pas de solution à l’excédant du surplus, dont la fuite dans la spéculation financière s’explique de cette manière. Dans les périodes de crise, l’innovation se poursuit, par une concur-
109
rence aiguisée qu’impose la réduction des coûts. C’est pourquoi les phases B du cycle apparent sont caractérisées elles aussi par un taux de croissance positif, même s’il est inférieur à celui réalisé au cours des phases A. L’incertitude des résultats des luttes sociales, en réponse non seulement aux conjonctures des phases du cycle, mais également à des déterminations plus fondamentales (luttes permanentes des salariés pour une meilleure part du produit social, alliances historiques diverses du capital dominant, par exemple avec la paysannerie, en réponse au défi socialiste etc.), rend illusoire une théorisation du cycle qui, par son mécanisme inévitable aplatit le matérialisme historique aux dimensions d’un économisme élémentaire. Quant aux effets de la rivalité des centres en compétition et à leurs succès et échecs dans leur expansion extérieure, ils ne sont pas davantage réduisibles à une mécanique. J’ajouterai pour conclure que la projection en arrière - avant 1800, a fortiori avant 1500 - d’une théorie du cycle implique des amalgames encore plus désastreux et une réduction vulgaire de la conception des rapports entre la base économique et la superstructure politique et idéologique.
4 - La rivalité des puissances dans l’expansion capitaliste et la question des hégémonies mondiales. Le moins qu’on puisse dire est que la rivalité des formations politiques - étatiques, à contenu national ou impérial, ethniques ou tribales etc. - est une réalité autant permanente dans l’histoire que les conflits sociaux à l’intérieur de ces formations. Au point que, en contraste avec l’affirmation de Marx selon laquelle l’histoire était avant tout celle de la lutte des classes, certains ont proclamé que l’histoire était avant tout celle de la lutte des peuples et des
110
nations. Est-il possible d’établir un pont entre ces deux affirmations d’apparence exclusives l’une de l’autre ? Selon différents auteurs de l’école du système mondial l’histoire du capitalisme - à partir de 1500 selon les uns, peut-être de 1350 selon d’autres - devrait être relue comme celle d’une succession d’hégémonies exercées par une puissance particulière sur l’économie-monde capitaliste. Ici encore, faisant la synthèse des travaux proposée dans cet esprit, Goldstein conclut que le « cycle politique des hégémonies » serait de 150 ans (contre 50 pour le cycle économique long de Kondratieff). Le capitalisme achevé (industriel) ayant à peine un âge supérieur à un siècle et demi, la discussion des questions posées par la rivalité des puissances nous entraine fatalement sur le terrain de la longue période, au moins des cinq siècles du capitalisme historique (à partir de 1500). Les quatre cycles d’hégémonie proposés dans ce cadre théorique sont les suivants : 1) De 1350 à 1648, hégémonie vénitienne, contestée par les Habsburg, culminant dans la guerre de Trente ans (1618-1648), conclue par le traité de Westphalie (1648) qui consacre la consolidation des centres européens principaux et leur expansion américaine. 2) De 1648 à 1815, hégémonie hollandaise, contestée par la France, culminant dans les guerres de la Révolution et de l’Empire (1793-1815), conclues par le Congrès de Vienne (1815) qui consacre l’équilibre européen et la maîtrise des mers par la Grande Bretagne.
111
3) De 1815 à 1945, hégémonie britannique, contestée par l’Allemagne, culminant dans les deux guerres mondiales (1914-1945), conclues par les accords de Yalta (1945) qui consacre la bipolarité Etats-Unis-URSS. 4) A partir de 1945, l’hégémonie américaine. L’analyse des cycles économiques apparents, mis en évidence par Braudel, conduit à une périodisation sans rapport avec la précédente. Ces cycles sont en effet considérablement plus brefs, toujours de l’ordre de 50 ans, répartis comme suit : 1) 1509-1529 Essor 1529-1539 Déclin 2) 1539-1559 Essor 1559-1575 Déclin 3) 1575-1595 Essor 1595-1621 Déclin 4) 1621-1650 Essor 1650-1689 Déclin 5) 1689-1720 Essor. 1720-1747 Déclin 6) 1747- 1762 Essor. 1762-1790 Déclin Il ne s’agit évidemment, selon Braudel, que d’une périodisation fondée sur les taux de croissance de la production (à l’époque principalement agricole, fautil le rappeler). Quelle signification pourrait avoir, éventuellement, cette périodisation ? J’avoue ne pas être convaincu de celle-ci, compte-tenu des conditions de l’époque : aléas climatiques, luttes sociales locales, guerres etc. Tout cela n’a rien à voir avec les mécanismes de l’accumulation du capital. Certaines théories greffées sur ces périodisations ne sont cependant pas sans exercer un attrait évident. Parmi celles-ci je citerai celle proposée par Albert Bergesen associant les périodes d’hégémonies à la décolonisation (1820-1870;
112
à partir de 1945), et celles de rivalité aux expansions coloniales (1500-1815; 1870-1945). Je dois néanmoins dire qu’aucune de ces grandes propositions de philosophie de l’histoire, même réduite à sa période moderne, a fortiori lorsque projetée en arrière comme on le verra plus loin, n’entraîne ma conviction. Elles n’ajoutent rien à ce que l’analyse concrète, fondée sur les concepts du matérialisme historique, nous apporte. Par exemple les ouvrages remarquables de Braudel et de Wallerstein qui rendent compte, parfaitement à mon goût, des faits essentiels : le déplacement du centre de gravité du capitalisme naissant de la Méditerranée à l’Atlantique, le conflit continental européen (France-Habsbourg), le conflit maritime franco-anglais, l’essor de nouveaux centres (Prusse, Russie) et le déclin d’autres (Autriche, Espagne...). D’une manière générale la thèse du système mondial a trop fait pencher le balancier dans le sens auquel son option de principe appelait; à savoir la détermination des parties (les Etats) par le tout (l’économie-monde). Je préfère - avec Szentes - mettre l’accent sur la dialectique de la contradiction interne (national) / externe (système mondial). Cette attitude conduit immédiatement à nuancer fortement les réponses proposées à la question des hégémonies, qui se succèdent mais ne se ressemblent pas. D’abord, bien entendu, l’hégémonie prétendue dans l’économiemonde du capitalisme n’est pas une hégémonie mondiale. Le monde ne se réduit pas, du XVI au XIXe siècle, à l’Europe et à son appendice américain. Dire que Venise ou la Hollande sont « hégémoniques » n’a pas beaucoup de sens à l’échelle réelle de l’époque. Le dire trop rapidement invitait naturellement au dérapage qui fait dire que Damas, Bagdad, Le Caire, et d’autres capitales marchandes de l’Orient indien et chinois, ou même antérieurement
113
l’Egypte, la Mésopotamie, la Phénicie, la Grèce, ont été en leur temps « hégémoniques ». Le terme n’a plus de sens précis. Mais même à l’échelle de l’économie-monde capitaliste européenne dont je souligne le caractère en formation pour les trois siècles de la transition mercantiliste, je ne vois pas comment on peut qualifier Venise ou les Pays-Bas « d’hégémoniques ». Centres commerciaux et financiers remarquables, certes; mais bel et bien contraints de compter avec le monde rural féodal qui les enserre de tous côtés et avec les équilibres politiques qu’il implique, à travers le conflit des grandes monarchies. Le traité de Westphalie, en 1648, ne consacre pas une hégémonie hollandaise, mais un équilibre européen qui l’annule. Je conteste même que l’on puisse parler d’une hégémonie britannique au XVIIIe siècle. L’Angleterre conquiert alors des positions avantageuses sur les mers, au détriment de son concurrent français. Mais elle n’est encore ni capable d’affirmer une puissance particulière dans les affaires du continent européen, ni même de dominer véritablement les périphéries potentielles d’outremer. Son hégémonie ne sera acquise que fort tardivement, après que la Chine et l’Empire ottoman aient été « ouverts » (à partir de 1840), après que la révolte indienne des Cipayes ait été surmontée (1857). L’avance industrielle et le monopole financier de la Grande Bretagne, réels à l’époque, n’entrainent pas de véritable hégémonie. Car cette hégémonie dite mondiale est contrainte de faire avec l’équilibre européen, que l’Angleterre ne domine pas. A tel point qu’à peine l’hégémonie de la Grande Bretagne était-elle constituée (à partir de 1850-60) que celle-ci allait être mise en question par la montée de ses concurrents, l’Allemagne et les Etats-Unis, à partir de 1880, aux plans industriel et militaire, même si Londres conserve beaucoup plus longtemps une position financière privilégiée.
114
Je conclurai de ces remarques que l’hégémonie, loin de constituer la règle dans l’histoire de l’expansion capitaliste mondiale, est plutôt l’exception, de courte durée et fragile. La loi du système est plutôt la rivalité durable. Les choses ont-elles changé depuis ? Ou sont-elles en passe de changer réellement ? Par certains aspects l’hégémonie des Etats-Unis après 1945 est effectivement réellement d’un caractère nouveau. Les Etats-Unis ont, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, des moyens militaires d’intervention (fût-ce par la destruction et le génocide) de dimension planétaire. Limités de 1945 à 1990 par la bipolarité militaire partagée avec l’URSS, les Etats-Unis sont peut-être devenus, ou en voie de devenir, ce qu’avant eux nul n’avait été, sauf Hitler en imagination : les maîtres (militaires) du monde... Mais pour combien de temps ? Le discours sur les hégémonies est aujourd’hui à la mode, comme il fallait s’y attendre. Selon le libéral américain Robert Keohane l’hégémonie procure la stabilité par le respect des « règles du jeu » qu’elle impose. J’analyse tout autrement le projet du « nouvel ordre mondial » que la guerre du Golfe, venue immédiatement au lendemain de l’amorce de la désintégration soviétique - et pas par hasard - annoncerait. Je l’analyse dans les termes d’un nouvel Empire du chaos, d’une instabilité maximale, appelé à être traversé de contradictions violentes : d’un renouveau de rivalités inter-centres et d’explosions dans les périphéries du Sud et demain de l’Est.
115
5 - Polarisation, cycles et hégémonies dans les systèmes antérieurs au capitalisme. J’aborderai les questions énumérées dans le titre de cette section en me limitant aux systèmes antérieurs à 1500, réservant la discussion des spécificités de la transition du capitalisme mercantiliste (1500-1800) à la section suivante : Certaines ambiguïtés exprimées dans la ligne de pensée de l’économie monde concernant la définition précise du capitalisme devaient par la force des choses inspirer un dérapage en direction d’une projection en arrière des caractéristiques du monde moderne. Les plus extrémistes (A. G. Frank par exemple) vont jusqu’à prétendre que l’idée même de spécificités propres aux différents modes de production est sans fondement, qu’il n’y a aucune différence entre le capitalisme et de prétendus systèmes antérieurs (dans tous les systèmes des éléments capitalistes et d’autres se mélangeraient de la même manière), et que les sociétés de la Planète ont toujours été toutes intégrées dans un seul système mondial qui remonte aussi loin qu’on puisse en retrouver la trace. Ils rejoignent par là la longue tradition des philosophies bourgeoises de l’histoire, préoccupées d’établir l’éternité du système et la vanité des efforts pour le changer. Sans doute en se situant à un niveau d’abstraction élevé on pourra toujours repérer des analogies plus ou moins marquées à travers les âges puisque, après tout, il s’agit de l’histoire de l’humanité qui, par certains aspects anthropologiques fondamentaux, reste identique à elle même à travers les temps historiques. L’usage par la pensée sociale des mots du langage commun tend à renforcer l’illusion de ces analogies. J’ai moi-même utilisé les termes de centres et de périphéries dans les analyses que j’ai proposées pour les époques antérieures au capitalisme. J’ai cependant estimé nécessaire de préciser le
116
contenu différent de ces concepts appliqués à des systèmes sociaux euxmêmes variés. Je soutiendrai donc que l’amalgame des époques procède de l’appauvrissement des concepts : le capitalisme est confondu avec les rapports marchands auquel il est réduit, les rapports base économique - superstructure politique et idéologique sont interprétés en termes économicistes unilatéraux immuables etc. Toutes ces théories sont fondamentalement mécanistes et économicistes, à l’opposé du matérialisme historique, accusé à tort de l’être ! La querelle opposant les partisans d’une théorie fondée sur l’originalité des différents modes de production et ceux qui avancent une théorie fondée sur une combinaison permanente de structures mercantiles et de structures de pouvoirs sociaux transcendant les modes de production procède, à mon avis, d’une question mal posée, parce que ses termes sont mal définis. Le matérialisme historique, tel que je le comprends, a répondu correctement je dirai même définitivement - à une question, et en a laissé trois en suspens. Marx a, selon moi, jeté la lumière sur la spécificité du mode de production capitaliste, qu’on ne peut plus réduire après lui à une combinaison de propriété privée, salariat et rapports marchands. Mais le matérialisme historique a laissé ouvert trois séries de questions non moins importantes. La première concerne les « modes de production antérieurs ». J’ai critiqué l’interprétation dominante multipliant la série des modes antérieurs et proposé en contrepoint un seul mode, qualifié de tributaire, parce qu’il met l’accent sur l’identité du rapport pouvoir-extraction du surplus dans toutes les formes antérieures, par opposition au contraste qui, dans le capitalisme, sépare formellement le pouvoir de l’extraction du surplus, soumis à la loi de la valeur. La seconde concerne le capitalisme comme système mondial, dont j’ai déjà dit qu’elle n’avait pas été réellement traitée par le marxisme historique. La troi-
117
sième question ouverte concerne le degré et les formes de l’interdépendance régionale - voire mondiale -dans les époques antérieures. Dans l’opposition entre « substantivistes » (selon lesquels les rapports marchands sont insérés dans des structures sociales) et « formalistes » (selon lesquels le marché exprime la logique immuable de l’homo economicus) les observations que j’ai faites ci-dessus sont gommées. Karl Polanyi n’en est certainement pas responsable, car il faisait référence aux rapports marchands des époques anciennes (qu’il ne confondait pas, lui, avec la loi de la valeur capitaliste), effectivement soumis à des logiques de pouvoir extra-économiques. Les anthropologues « primitivistes » et « modernistes » qui ont animé la querelle en question, n’avaient pas toujours une connaissance profonde de la culture marxiste, comme Polanyi. La confusion entre rapports capitalistes et rapports marchands et même la réduction de ceux-là à ceux-ci, est, à mon avis, responsable du dérapage et de la projection en arrière des observations faites à propos du monde moderne. Je ne reviendrai pas sur l’analyse que j’ai proposée concernant les systèmes antérieurs, que j’ai qualifiés de tributaires depuis les révolutions qui les ont fondé (500 à 300 Av. J. C.) parce que définis par les grandes aires des idéologies tributaires - hellénistique, hindouiste, confucéenne - soulignant la dominance idéologique dans les systèmes antécapitalistes. C’était d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai parlé ici de trois régions et non de quatre comme le suggèrent ceux qui distinguent le Proche Orient (devenu arabe) de l’Asie centrale iranienne (jusqu’aux invasions turques). Car l’histoire se lit en remontant le temps : à la veille de l’apparition du capitalisme il y a bien une seule région islamique qui englobe les mondes arabe, iranien et turc. Ce monde s’est constitué par vagues successives à partir de l’hellénisme et j’ai soutenu
118
que l’Islam s’était constitué comme la forme dernière de l’idéologie tributaire pour cette région. C’est aussi pourquoi je considère l’Europe - chrétienne comme une périphérie de cette même région, la même idéologie tributaire (ici le Christianisme) opérant sur un substrat d’émiettement (« féodal ») du pouvoir. Mais bien entendu avant Alexandre il n’y a pas de région « Proche Orient-Asie centrale » mais davantage des pôles tributaires distincts (l’Egypte, la Mésopotamie et l’Iran achéménide). Alexandre a amorcé l’unification de la région mais il n’y est pas réellement parvenu, et Rome a reculé davantage, l’Iran sassanide (et son extension en Asie centrale) étant resté hors de sa conquête. L’Islam constitue la troisième vague qui a effectivement unifié la région. D’une manière générale plus on remonte le temps plus le nombre des pôles tributaires d’origine se multiplie. Cette thèse pourrait être rapprochée par certains aspects de celle de David Wilkinson qui met en avant l’œuvre conquérante et unificatrice des « civilisations centrales », procédant par fusion (Egypte-Mésopotamie, puis Proche Orient-Grèce, puis héritiers de l’Empire Alexandrin-Rome-Europe etc.). A cela près que la conquête culturelle de l’ensemble de la Planète ne pouvait être que l’œuvre du capitalisme moderne, que cette conquête reste toujours inachevée et suscite sans arrêt la renaissance de différenciations (parce que le capitalisme se heurte à la résistance - fut-elle culturelle - des victimes de son expansion polarisante). La thèse a néanmoins l’avantage de mettre le doigt sur cette contradiction spécifique que représente l’universalisme tronqué offert par le capitalisme qui est aussi européen, contradiction que j’ai tenté d’analyser dans l’Eurocentrisme. La constitution des grandes régions tributaires n’implique pas leur unification en un système étatique unique. Au contraire, comme le suggère Michael Mann les aires définies par les réseaux d’organisation des pouvoirs politiques
119
et militaires, d’échanges économiques, de diffusions idéologiques et religieuses, ne correspondent généralement pas. Leur combinaison, plus ou moins heureuse, définit des sociétés différentes, les unes capables de durer et de s’épanouir, voire de s’ouvrir et de conquérir, les autres s’enfermant dans des impasses mortelles. Dans ce cadre les concepts de « centres » et « périphéries » et celui d’hégémonie peuvent s’avérer féconds, à condition toutefois de ne pas les définir - par assimilation au contraste moderne - en termes d’exploitation économique. Dans ce cadre la prise en considération des réseaux d’échanges et d’interactions - beaucoup plus vastes qu’on ne l’imagine souvent - peut permettre de parler de « systèmes régionaux », à condition aussi de ne pas confondre les effets fortement sélectifs de ces échanges avec ceux infiniment plus structurants du système mondial moderne qui, pour cette raison, est seul à mériter ce qualificatif. La lecture de l’histoire montre, au contraire des affirmations des extrémistes du « système mondial », l’extraordinaire durabilité de l’équilibre des grands pôles des mondes anciens. Durabilité n’est pas synonyme d’état statique. Tous les systèmes anciens sont au contraire en mouvement permanent, sous l’impulsion d’une contradiction fondamentale identique qui les caractérise. Cette contradiction oppose la logique dominante du pouvoir tributaire aux exigences du développement des forces productives, qui s’exprime dans la tendance à l’autonomisation des rapports marchands. Les travaux remarquables de Janet Abu Lughod, de K. N. Chaudhuri, John Fitzpatrick, G. Coedes, entre autres, mettent en évidence cette contradiction en Orient islamique, en Inde et en Chine, en tous points analogue à celle qui opérait dans le moyen âge européen et pendant les siècles du mercantilisme de la transition capitaliste. Le rôle des villes marchandes maritimes et continentales des « routes de la soie », de France, d’Allemagne, d’Italie, de l’Orient
120
islamique, d’Asie centrale, de Malacca, du Sahara, de la Côte africaine orientale, des mers de Chine et du Japon, est partout analogue : on y produit en masse pour l’exportation (mais dans le cadre soit de manufactures, soit du système du putting out) des produits qui ne sont pas toujours seulement de « prestige », mais parfois d’usage courant, même s’il est réservé aux classes aisées. On peut donc parler ici de capitalisme marchand. Marx le fait d’ailleurs. Le conflit entre celui-ci, ses aspirations à s’autonomiser vis-à-vis du pouvoir tributaire, les expansions maritimes qu’il suscite, ne sont pas spécifiques de l’histoire européenne. On les retrouve en Chine, où le transfert du centre de gravité de l’économie du pays du Nord « féodal » au sud « maritime » était en passe de faire éclater l’Empire confucéen en une constellation d’États dont certains de structure typiquement mercantile auraient pu construire en Mer de Chine et dans le Pacifique ce que le mercantilisme a réalisé plus tard en Méditerranée et dans l’Atlantique. Le coup d’arrêt donné par les Ming, comme les invasions turco-mongoles au Proche orient peuvent, de ce fait, apparaître comme des accidents de l’histoire, qui ont donné à l’Europe sa chance. Le capitalisme aurait pu naître ici; il n’est pas le produit d’une exception européenne à la règle, comme le suggère l’idéologie eurocentrique, mais au contraire l’issue normale à la contradiction fondamentale de tous les systèmes tributaires. Reconnaître ce fait ne signifie cependant nullement que le capitalisme était déjà là présent, ni que la raison pour laquelle il apparaîtra précisément dans cette région périphérique du monde tributaire - l’Europe - n’appelle pas une analyse particulière de ce fait, ni que par conséquent la période mercantiliste européenne n’apporte rien de nouveau qu’on ait déjà vu avant et ailleurs. De la même manière l’intensité des rapports entre les villes marchandes du réseau mondial des époques tributaires ne permet pas de parler d’un système
121
mondial intégré comme le sera celui construit par le capitalisme moderne. Oublier que ces villes sont manufacturières et marchandes et non industrielles, qu’elles sont insérées dans un monde rural dominant et sont la proie facile des pouvoirs tributaires, c’est aplatir l’histoire. Nous pouvons maintenant reprendre les questions relatives aux inégalités de développement, aux polarisations et aux hégémonies qui leur sont attachées, aux cycles éventuels des périodes anciennes dans le cadre des principes précisés. Dans une analyse remarquable par beaucoup de ses aspects, Kajsa Ekhom avance les conclusions suivantes : (i) qu’on peut distinguer, même dans la plus haute antiquité (mésopotamienne par exemple) des Etats fondés sur le contrôle de la production agricole de ceux qui se sont construits sur la maîtrise de réseaux plus vastes de marchés; (ii) que le surplus agricole (en céréales) ne peut pas être transformé en bronze, textiles, palais, bijoux et armes si le pouvoir local n’a pas accès aux matières premières nécessaires pour ces productions et que de ce fait il peut être amené à les chercher au-delà de ses frontières politiques; (iii) que les échanges dans ce cas ne peuvent être considérés comme portant sur des « biens de prestige », mais bel et bien sur des biens fondamentaux. Kajsa Ekholm distingue, à partir de là, les classes dirigeantes des centres qui éclatent en factions en conflit (aristocraties foncières, bureaucrates, marchands) se livrant à l’exploitation des classes populaires dans des formes variées (tribut, esclavage, travail salarié), de celles des périphéries réduites à une élite de chefferies « féodales » médiatrices dans l’exportation de leurs matières premières et contrôlant les importations. Je n’ai rien à reprocher à toutes ces propositions, sauf qu’il ne s’agit pas de capitalisme existant déjà au sein de sociétés précapitalistes. D’ailleurs Kajsa
122
Ekholm reconnaît la vulnérabilité de ces rapports centres / périphéries, toujours soumis aux aléas de l’évolution des pouvoirs politiques et militaires. Le recueil d’études publié par Michael Rowlands se propose d’ouvrir le débat sur les concepts de centre et périphérie dans le monde antique. Je note ici les observations tout à fait fondamentales faites par Phil Kohl : (i) que souvent les zones les plus avancées (les villes commerçantes d’Asie centrale par exemple) ne contrôlent pas les techniques fondamentales (le travail des métaux, l’élevage des chevaux), ôtant au rapport centre / périphérie son caractère d’exploitation économique, (ii) que généralement ces techniques sont encore trop simples pour pouvoir être monopolisées par des centres hégémoniques comme l’est la technologie moderne. Je note aussi l’observation de Liverani qui insiste sur les aspects communs du système idéologique qui relient les centres et les périphéries d’une même région, rejoignant par là mon observation sur la dominance idéologique dans les systèmes tributaires. Je note enfin que les cycles d’expansion et de crise politique observés en Egypte, en Mésopotamie et dans tout le Proche Orient par Marfoe, Moorey et Larsen sont produits par le conflit entre la logique tributaire et les tentatives d’autonomisation des éléments marchands de la société, c’est-à-dire précisément par la contradiction fondamentale du mode tributaire. Il n’y a, à la vérité, qu’un seul exemple d’exploitation économique « extérieure » massive dans le monde antique étudié dans ce recueil : celui de Rome (traité par Daphné Nash), dont l’oligarchie sénatoriale et l’ordre équestre des publicains qui lui est associé pillent les provinces par le tribut et à travers des relations marchandes monopolisées. Mais l’Empire romain est, comme l’Empire ottoman, un Etat prédateur dont, pour cette raison, l’apogée a été d’une extrême brièveté, suivie d’un long déclin. J’ai considéré que, pour cette raison, le rapport centre-périphérie était ici inversé : les provinces pillées économiquement sont les centres
123
de la culture dominante (hellénistique à Rome, arabe et persane dans l’Empire turc).
6 - La formation historique du capitalisme. Tous les systèmes tributaires avancés (l’Orient islamique, l’Inde, la Chine) étaient, à l’aube de la conquête de l’Amérique par l’Europe, agités par la même contradiction fondamentale qui ne pouvait être surmontée que par l’invention du capitalisme. Il reste que l’émergence de cette réponse en Europe doit être expliquée à son tour concrètement, comme doivent l’être les raisons pour lesquelles le développement du capitalisme en Europe a arrêté l’évolution possible dans cette même direction dans les autres régions du monde, voire les a engagées dans des involutions régressives. Il ne s’agit pas là pour moi de questions nouvelles, puisqu’elles constituent l’essentiel de mes préoccupations et de mes écrits depuis 1957. Mes réponses se situaient d’ailleurs d’emblée sur le terrain même qui sera celui de l’approche de l’école du capitalisme-système mondial. Je me contenterai donc de rappeler brièvement mes conclusions. i)
La transition mercantiliste européenne, par contraste aux situations rencontrées ailleurs et avant, est singulière. Cette singularité réside dans le fait que l’Etat absolutiste de l’époque mercantiliste européenne n’est pas le prolongement du pouvoir tributaire féodal émietté de l’époque antérieure (qui pour cette raison, est une forme périphérique de l’Etat tributaire), mais sa négation, alors qu’ailleurs et avant (en Orient islamique, en Inde, en Chine) l’Etat tributaire revêt une forme achevée (que je qualifie alors de centrale) et la conserve.
124
ii) Durant la phase 1150-1300 le féodalisme européen connait une expansion soumise à sa logique propre du pouvoir, par défrichement de terres nouvelles. Cette expansion s’épuise au cours de la phase suivante (1300-1450), marquée par des rendements décroissants; mais le système du pouvoir reste inchangé (féodal). Ces deux phases sont donc d’une nature tout-àfait différente de celles des phases ultérieures d’expansion et de crise capitalistes. Le mécanisme propre à ces dernières, considéré plus haut, ne se retrouve pas ici. C’est alors que le caractère périphérique de la formation tributaire européenne révèle une flexibilité qu’on peut opposer à la rigidité relative des formes tributaires centrales avancées. La crise du système féodal est surmontée par l’émergence de l’Etat absolutiste qui, par le moyen de la conquête de l’Amérique, crée une économie monde mercantiliste au service duquel il se place. iii) Le concept selon lequel l’Etat absolutiste serait féodal de nature, parce que, par essence même l’Etat capitaliste devrait être libéral, est une déformation produite par l’idéologie bourgeoise. Celle-ci en a d’ailleurs produit d’autres, non moins trompeuses. Par exemple que l’avantage de l’Angleterre sur son concurrent principal français aurait tenu à son système politique (l’amorce du libéralisme au XVIIIe siècle), ou à son idéologie (le protestantisme), ou à une supériorité technologique. En fait cet avantage provenait de la position privilégiée de l’Angleterre dans le système d’exploitation des périphéries américaines. iv) La mise en place d’un système nouveau de rapports centres-périphéries entre l’Europe atlantique et l’Amérique n’est pas la répétition des rapports - inégaux ou non - fondés sur l’extension géographique des échanges marchands dans les époques antérieures. L’Amérique ne « commerce » pas avec l’Europe; elle est façonnée pour être intégrée
125
comme périphérie exploitée économiquement par l’Europe mercantiliste. Parmi les auteurs de l’école du système-monde, J. M. Blaut a mis l’accent, à juste titre, sur l’importance extraordinaire de cette exploitation qui s’est traduite entre autre : (i) par un flux d’or et d’argent considérable, renforçant la position sociale des nouveaux capitalistes marchands dans la société européenne et leur donnant un avantage décisif sur tous leurs concurrents (ils peuvent offrir partout dans le monde de meilleurs prix); (ii) par un volume gigantesque des profits tirés des plantations américaines : en 1600 les exportations de sucre du Brésil représentent le double des exportations totales de l’Angleterre etc. v) Les deux cycles, d’expansion (1450-1600) puis de réajustement (1600-1750) de l’économie monde mercantiliste ont également, de ce fait, leur nature propre, différente par essence de celles des cycles ultérieurs du capitalisme achevé. vi) Dans la naissance du capitalisme européen, les deux facteurs (la flexibilité du mode tributaire périphérique féodal; la construction d’une économie monde mercantiliste et le façonnement de la périphérie américaine dans ce cadre) sont donc indissolublement liés, inséparables. J’ai opposé cette analyse que j’ai qualifiée de développement inégal (le saut qualitatif en avant se produit à partir des périphéries du système antérieur) - aux arguments culturalistes du « miracle européen », dominant à travers la déformation eurocentrique de l’idéologie occidentale que j’ai critiquée : le recours à l’ancêtre grec mythique, la christianophilie, le racisme. vii) Le caractère capitaliste de la transition mercantiliste s’exprime dans la rupture idéologique qui accompagne la formation de l’Etat absolutiste : l’abandon de l’hégémonie métaphysique.
126
7 - L’avenir du capitalisme. La polarisation immanente au capitalisme mondial, ignorée délibérément par l’idéologie dite libérale, enlève tout leur sens aux propositions de celle-ci. L’intégration dans le système mondial crée en effet, de son fait, une contradiction insurmontable dans le cadre de la logique de l’expansion du capital, puisqu’elle rend illusoire toute tentative pour les périphéries - dont les peuples représentent au moins les trois quarts de l’humanité - de « rattraper », c’est-à-dire d’assurer à ces peuples des niveaux de vie comparables à ceux de la minorité privilégiée des centres. L’idéologie libérale n’aurait de sens que si elle osait proclamer l’abolition totale des frontières, c’est-à-dire les ouvrir aux migrations de travailleurs comme elle appelle à les ouvrir aux échanges et aux flux de capitaux. Alors effectivement elle serait logique avec elle même, proposant par la voie capitaliste l’homogénéisation des conditions sociales à l’échelle mondiale. Cette ouverture n’est pas à l’ordre du jour, simplement parce que le fait national en interdit la perspective. Que les raisons invoquées à ce titre soient acceptables ou non - aux plans politiques, idéologiques et culturel - n’est pas la question. Le fait est là. Les défenseurs de l’idéologie libérale diront alors que l’ouverture aux flux d’échanges et aux capitaux est un second best. Cela n’a pas beaucoup de sens puisque l’ouverture dans ces conditions limitées est la cause de la polarisation, qui est inacceptable. Autant dire que la mort est le second best après la vie ! L’idéologie libérale est donc une supercherie pure et simple. Car le second best véritable doit être défini sur la base du critère de sa capacité de réduire la polarisation. Dans cet esprit la logique veut que si les flux migratoires doivent être contrôlés, l’ouverture aux échanges et aux flux de capitaux doit l’être en parallèle. C’est pourquoi la « déconnexion » est incon-
127
tournable, et définit l’une des conditions essentielles simultanément pour un dépassement du capitalisme et une réduction progressive de la polarisation. La thèse selon laquelle aucune société ne peut échapper au défi permanent de la mondialisation (capitaliste), que le « développement » n’est rien d’autre que le développement au sein de ce système et qu’il n’y a pas de « développement autonome » possible en dehors de lui, s’attache au seul fait réel -c’est-à-dire que le développement capitaliste est bien ainsi -, mais renonce d’emblée à l’idée qu’il soit possible de « changer le monde ». Parce qu’il est nécessaire de distinguer ces deux plans j’ai proposé de ne pas confondre les deux concepts d’expansion capitaliste et de développement, même si dans l’usage courant la confusion est hélas fréquente. L’expansion capitaliste est par nature polarisante. Le développement doit être, par définition, d’une nature différente de manière à surmonter cette polarisation. Le concept de développement est par essence, selon moi, un concept critique du capitalisme. L’idéologie du développement qui a dominé la scène de l’après seconde guerre mondiale n’a pas fait clairement cette distinction. Pour les uns - les bourgeoisies nationales du tiers-monde de l’ère de Bandoung (1955-1975) - le « développement » avait pour objectif de « rattraper » en restant dans le système mondial, par le moyen de politiques d’Etat adéquates (nationalisations, industrialisation etc.). Pour les autres - les Etats dits socialistes ce même objectif (« rattraper », qui implique des similarités évidentes) était mêlé à des lambeaux de l’objectif contradictoire de construire une « autre société ». Par ailleurs, la croissance exponentielle incontrôlable produite par la logique du mode de production capitaliste est, comme l’ont redécouvert les écolo-
128
gistes, suicidaire. Le capitalisme à la fois comme mode de production et système mondial est donc simultanément suicidaire et criminel, impliquant éventuellement des génocides massifs dans ses périphéries appelées à la révolte.
Bibliographie : Cet article prolonge l’analyse proposée au chapitre I a) ouvrages et articles mentionnés dans l’étude : – Janet Abu Lughod : Before European Hegemony, The world system AD 1250-1350, Oxf. Univ. Press 1989. – Giovanni Arrighi : The development illusion : A recon-ceptualization of the Semi peripheries (in Semi peripheral States in the world Economy) Sage, 1985. Le grand tumulte : La Découverte 1991, chap. 2. World Income Inequalities and the Future of Socialism (Binghamton, unpubl.). The Three hegemonies of Historical Capitalism, Review, vol XII, N° 3, 1990. – Albert Bergesen : Studies in the Modem World System (ed.) Acad. Press 1980. Where is the World system headed ? Sociological Perspectives 1991. – J. M. Blaut : Colonialism and the Rise of Capitalism, Science and Society, 1990. – Fernand Braudel : Civilisation matérielle, Economie et capitalisme XVXVII siècles, 3 vols, Armand Colin 1979.
129
– Christopher Chase Dunn and Thomas D. Hall : Core / Periphery Relations in Precapitalist Worlds, ed., Westview Press 1991, contribution de A. G. Frank. World System and Modes of production, ISA, Vancouvert 1991, unpubl. – G. Coedes : Les Etats hindouisés d’Indochine et d’Indonésie, Ed. de Broccard, Paris 1948. – K. N. Chaudhuri : Trade and Civilization in the Indian Ocean, An Economic History from the Rise of Islam to 1750, Cambridge Univ. Press, 1985. – Kajsa Ekholm : Capitalism, Imperialism and Exploitation in ancient World Systems, Review, VI N° 1, 1982. – John Fitzpatrick : Wars, States and Markets in North East Asia 800-1400 AD (ISA, Vancouver 1991, unpubl.) – André Gunder Frank : World Accumulation 1492-1789, Monthly Review Press 1978. Transitional Ideological Modes : Feudalism, Capitalism, Socialism, Critique of Anthropology Sage 1991. A Theoretical Introduction to 5 000 years of World System History, Review, vol XIII N° 2, 1990. – Joshua Goldstein : Long Cycles, prosperity and War in the Modem Age, Yale Univ. Press, 1988. – Robert Keohane : The Theory of Hegemonic Stability and Changes in International Economic Regimes 1967-1977, in Ole Holsti (ed.), Change in the International System, Westview Press 1980. – William Mac Neil : The Rise of the West, Chicago Univ. Press – Michael Mann : The Sources of Social Power, vol. I, to 1760, Cambridge, Univ. Press, 1986.
130
– Karl Polanyi : Trade and Markets in Early Empires, The Free Press, Glencoe, 1957. – Michael Rowlands (ed.), Centre and periphery in the Ancient World (Camb. Unv. Press 1987); Contributions de Phil Kohl (Asie Centrale) Marfoe, Moorey, Larsen, Zaccagnini, Liverani (Proche Orient), D. Nash (Rome) C. Hasekgrove, L. Hedeager (Germanie). – Tamas Szentes : Theories of World Capitalist Economy, Budapest Akademiaikiado, 1985. – Immanuel Wallerstein : The Modem World system, vol. I, II and III, Academic Books 1974, 1981, 1989. L’Occident, le Capitalisme et le système monde moderne Sociologie et Sociétés, vol XXII, N° 1, 1990. Système mondial contre Système monde, le dérapage conceptuel de A. G. Frank, Sociologie et Sociétés vol XXII, N° 2, 1990. The Concept of national Development 1917-1989, Elegy and Requiem (unpubl.) – David Wilkinson : Central Civilization, Comparative Civilization Review, N° 17, 1987. Cities, Civilizations and Oikumnes (ISA, Vancouver 1991, unpubl.) – En outre, le texte fait référence explicite ou implicite à des études publiées dans Review (Fernand Braudel Center, Binghamton, USA), paraissant depuis 14 ans (Sage pour les 8 premiers, puis Greenword Press); et aux 14 volumes annuels publiés par le centre : Social Change in the Capitalist World-Economy ed. by Barbara Hockey Kaplan. The World System of Capitalism : Past and Present ed. by Walter L. Goldfrank. Processes of the world System ed. by Terence K. Hopkins and Immanuel Wallerstein.
131
Ascent and Decline in the World System ed. by Edward Friedman. Crise in the World System ed. by Albert Bergesen. Labor in the Capitalist world Economy ed. by Charles Bergquist. States versus Markets in the World System ed. by Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer and Evelyne Huber Stephens. Crises in the Caribbean Basin : Past and Present ed. by Richard Tardanico. Retinking the Nineteenth Century : Contradictions and Movements ed. by Francisco O. Ramirez. Racism, Sexism and the world System ed. by Joan Smith, Jane Collins, Terence K. Hopkins and Akbar Muhammad. Revolution in the World System ed. by Terry Boswell War in the World System ed. by Robert K. Schaeffer. Semiperiphera States in the World Economy ed. by William G. Martin. b) Point de vue de l’auteur : Classe et Nation dans l’histoire et la crise contemporaine, ed. de Minuit 1979, notamment chap. III (les formations tributaires), IV (la transition capitaliste). Impérialisme et sous développement en Afrique, nouvelle édition Economica 1988, Première partie, chap. II et III (présentation des 2 vol. de Wallerstein), pp. 63-75. On trouvera dans notre Thèse (Paris 1957) les développements concernant le cycle économique et les mouvements de longue durée (cf L’Accumulation..., Le développement inégal, p. 77 et suivantes).
132
On se reportera, pour ce qui est des points de vue théoriques de base concernant l’aliénation économiste, la loi de la valeur etc. à La loi de la valeur et le matérialisme historique, Minuit 1977. L’Eurocentrisme, Economica 1988. L’Empire du Chaos, Harmattan, 1991. Particulièrement chap. II (La mondialisation capitaliste), chap. III (La crise du socialisme) et chap. IV (Le défi démocratique). Modes of production : History and unequal development, Science and Society, vol. 49, N° 2, 1985. A propos of colonisalism and the Rise of Capitalism, Science and Society, vol. 54, N° 1, 1990. Voir également, pour une excellente présentation des thèses de Baran, Sweezy et Magdoff : John Bellamy Foster, The Theory of Monopoly Capitalism, M. R., New York 1986.
133
Chapitre IV L’avenir de la polarisation mondiale 1) L’inégalité dans le développement des sociétés humaines marque toute l’histoire connue depuis la plus haute antiquité. Mais c’est seulement à l’époque moderne que la polarisation devient le produit immanent de l’expansion mondiale d’un système qui a, pour la première fois dans l’histoire, intégrée dans une même logique économique, celle du capitalisme, l’ensemble des peuples de la planète. La polarisation moderne (capitaliste) a revêtu des formes successives, en rapport avec l’évolution du mode de production capitaliste lui-même. i)la forme mercantiliste (1500 - 1800), antérieure à la révolution industrielle, commandée par l’hégémonie du capital marchand des centres atlantiques dominants, et le façonnement des périphéries de l’époque (les Amériques) en fonction de leur soumission intégrale à la logique de l’accumulation de ce capital marchand. ii)la modalité qu’on pourrait qualifier de « classique » s’organise à partir de la révolution industrielle qui définit désormais les formes centrales du capitalisme, tandis que les périphéries (progressivement toute l’Asie - Japon excepté - et l’Afrique, qui s’ajoutent à l’Amérique latine) restent rurales, non-industrialisées, et, de ce fait, spécialisées du point de vue de leur participation à la division mondiale capitaliste du travail dans les productions agricoles et minérales. Ce trait majeur de la polarisation s’accompagne d’une seconde caractéristique du système, non moins importante : la cristallisation des systèmes industriels centraux comme systèmes nationaux autocentrés, construits parallèlement à l’édification de l’Etat national bourgeois. Pris ensemble, ces deux caractéristiques
134
rendent compte des dimensions dominantes de l’idéologie de la libération nationale constituée en réponse au défi de la polarisation : (i) l’aspiration à l’industrialisation, synonyme de progrès libératoire et moyen du « rattrapage », (ii) l’aspiration à la construction d’Etat nationaux à l’instar des modèles centraux. L’idéologie de la modernisation est définie par ce contenu essentiel de la conception de la modernité. Les formes classiques de la polarisation définissent le système mondial de la révolution industrielle (à partir de 1800) à l’après seconde guerre mondiale. iii)La période de l’après-guerre (1945-1990) est celle de l’érosion progressive des deux caractères définis ci-dessus. Elle est en effet celle de l’industrialisation des périphéries - inégale certes mais facteur dominant en Asie et en Amérique latine -que le mouvement de libération nationale s’emploie à accélérer dans le cadre des Etats de la périphérie ayant à peu près tous récupéré leur autonomie politique. Elle est simultanément celle du démantèlement progressif des systèmes productifs nationaux autocentrés centraux et de leur recomposition en tant qu’éléments constitutifs d’un système productif mondial intégré. Cette double érosion est la manifestation nouvelle de l’approfondissement de la mondialisation. iv)L’accumulation de ces transformations débouche sur l’effondrement des équilibres caractéristiques du système mondial de l’après-guerre. Elle ne conduit pas d’elle même à un nouvel ordre mondial caractérisé entre autre par des formes nouvelles de la polarisation, mais à un « désordre mondial ». Le chaos qui marque notre moment provient du triple échec du système : a)qui n’a pas développé des formes nouvelles d’organisation politique et sociale transgressant l’Etat national, une exigence nouvelle de la mondialisation du système productif; b)qui n’a pas défini des systèmes de rapports économiques et
135
politiques adéquats conciliant l’effort de l’industrialisation des nouvelles périphéries d’Asie et d’Amérique latine compétitives sur le marché mondial et la poursuite d’une croissance globale; c)qui n’a pas défini de rapports avec les périphéries d’Afrique non engagées dans une industrialisation compétitive autres que des rapports d’exclusion. Ce chaos se manifeste dans toutes les régions du monde et se déploie dans toutes les dimensions de l’expression politique, sociale et idéologique de leur crise. Il est à l’origine des difficultés de la construction européenne qui paraît soudain incapable de poursuivre l’intégration de ses marchés et le développement parallèle de formes politiques intégrantes à l’échelle européenne. Il est à l’origine des convulsions qui frappent toutes les périphéries, de l’Europe de l’Est, de l’ancien tiers monde semi industrialisé, du nouveau quart monde marginalisé. Loin de soutenir la progression de la mondialisation, le chaos actuel en manifeste l’extrême vulnérabilité. v)L’aspect chaotique dominant propre à notre moment ne doit pas interdire qu’on réfléchisse aux différentes évolutions possibles qui conduiraient à un « nouvel ordre mondial », même si, précisément parce que ces évolutions sont multiformes, différents types d’ordres mondiaux d’avenir sont possibles. L’objet de ma réflexion ici est d’appeler à la discussion de ces questions, évacuées par le discours de la mondialisation -incontournable qui affiche son triomphalisme au moment même où tous les faits illustrent sa précarité. Le lecteur aura sans doute vu que la méthode proposée par cette analyse de l’histoire du capitalisme mondial n’est pas centrée sur la question des « hégémonies ». Je ne suis pas la méthode qui propose la lecture de cette histoire comme celle d’hégémonies successives. Le concept de l’hégémonie -toujours défini d’une manière floue selon
136
moi, et pour cela peu scientifique et souvent stérile - ne me paraît pas devoir constituer le centre du débat. Au contraire j’ai développé l’idée que l’hégémonie, loin de constituer la règle, était l’exception dans l’histoire réelle, marquée d’une manière dominante par le conflit des partenaires mettant en échec l’hégémonie elle-même. L’hégémonie des Etats-Unis, qui paraît dans notre moment s’imposer - peut-être seulement faute d’alternative dans le chaos - reste donc, comme la mondialisation dans les formes par lesquelles elle opère, fragile et précaire. 2) Le débat doit, selon moi, s’ouvrir par la discussion approfondie de ce qu’il y a de nouveau dans le système mondial, produit par l’érosion du système antérieur. Sur ce terrain je répète que les éléments nouveaux sont dans mon esprit, au nombre de deux : i)l’érosion de l’Etat national autocentré et la disparition qu’elle entraîne de la concomitance entre l’espace de la reproduction de l’accumulation et celui de sa gestion politique et sociale, qui a été jusqu’ici défini précisément par les frontières de cet Etat national autocentré; ii)l’érosion du contraste centres = régions industrialisées / périphéries = régions non industrialisées et l’émergence de dimensions nouvelles de la polarisation. La position d’un pays dans la pyramide mondiale est définie par le niveau de la capacité compétitive de ses productions sur le marché mondial. La reconnaissance de ce truisme n’implique en aucune manière qu’on partage le point de vue banalisé de la vulgate économiste bourgeoise, à savoir que cette position est conquise par la mise en œuvre de politiques économiques « rationnelles », dont la rationalité est précisément mesurée à l’aune de sa soumission aux
137
prétendues « lois objectives du marché ». Tout à fait à l’opposé de ces billevesées admises comme allant de soi, je prétends que la « compétitivité » en question est le produit complexe d’un ensemble de conditions opérant dans le champ d’ensemble de la réalité économique, politique et sociale - et que, dans ce combat inégal, les centres mettent en œuvre ce que j’appelle leurs « cinq monopoles » articulant l’efficacité de leurs actions. Ces cinq monopoles interpellent donc la théorie sociale dans sa totalité et sont, à mon avis : i)les monopoles dont bénéficient les centres contemporains dans le domaine de la technologie; des monopoles qui exigent des dépenses gigantesques, que seul l'Etat - le grand et riche Etat peut envisager de soutenir. Sans ce soutien - que le discours libéral passe toujours sous silence -, et singulièrement le soutien aux dépenses militaires, la plupart de ces monopoles ne pourraient être maintenus. ii)les monopoles opérant dans le domaine du contrôle des flux financiers d’envergure mondiale. La libéralisation de l’implantation des institutions financières majeures opérant sur le marché financier mondial a donné à ces monopoles une efficacité sans précédant. Il n’y a pas encore longtemps la majeure fraction de l’épargne dans une nation ne pouvait circuler que dans l’espace - généralement national - commandé par ses institutions financières. Aujourd’hui il n’en est plus de même : cette épargne est centralisée par l’intervention d’institutions financières dont le champ d’opération est désormais le monde entier. Elles constituent le capital financier, le segment le plus mondialisé du capital. Il reste que ce privilège est assis sur une logique politique qui fait accepter la mondialisation financière. Cette logique pourrait être remise en cause par une simple décision politique de déconnexion, fut-elle limitée au domaine des transferts financiers.
138
Par ailleurs les mouvements libres du capital financier mondialisé opèrent, il faut le savoir, dans des cadres définis par un système monétaire mondial que j’estime désormais caduc. Ce système est fondé sur le dogme de la libre appréciation de la valeur des devises par le marché (conformément à une théorie selon laquelle la monnaie serait une marchandise comme les autres) et sur la référence au dollar comme monnaie universelle de facto. La première de ces conditions est sans fondement scientifique et la seconde ne fonctionne que faute d’alternative. Une monnaie nationale ne peut remplir les fonctions d’une monnaie internationale d’une manière satisfaisante que si les conditions de la compétitivité internationale produisent un excédent structurel d’exportation du pays dont la devise remplit cette fonction, assurant le financement par ce pays de l’ajustement structurel des autres. C’était le cas de la Grande Bretagne au XIXe siècle. Ce n’est pas le cas des Etats-Unis aujourd’hui qui, au contraire, financent leur déficit par leurs emprunts qu’ils imposent aux autres. Ce n’est pas non plus le cas des concurrents des Etats-Unis, les excédents du Japon (ceux de l’Allemagne ayant disparu après l’unification) étant sans commune mesure avec les besoins financiers que l’ajustement structurel des autres exige. Dans ces conditions la mondialisation financière, loin de s’imposer « naturellement », est au contraire d’une fragilité extrême. A court terme elle n’engendre qu’une instabilité permanente et non pas la stabilité nécessaire pour que les processus d’ajustement puissent opérer efficacement. iii)les monopoles opérant dans l’accès aux ressources naturelles de la planète. Les dangers que l’exploitation insensée de ces ressources font désormais courir à la planète, et que le capitalisme - qui est fondé sur une rationalité sociale à court terme sans plus - ne peut surmonter, renforcent la portée du monopole des pays déjà développés, qui s’emploient à simplement éviter que leur gaspillage ne s’étende aux autres.
139
iv)les monopoles opérant dans les champs de la communication et des médias qui non seulement uniformisent par le bas la culture mondiale qu’ils véhiculent, mais encore ouvrent des moyens nouveaux à la manipulation politique. L’expansion du marché des médias modernes est déjà l’une des composantes majeures de l’érosion du concept et de la pratique de la démocratie en Occident même. v)enfin les monopoles opérant dans le domaine des armements de destruction massive. Limité par la bipolarité de l’après guerre, ce monopole est à nouveau l’arme absolue dont la diplomatie américaine se réserve seule l’usage, comme en 1945. Si la « prolifération » comporte des dangers évidents de dérapage, à défaut d’un contrôle mondial démocratique d’un désarmement vraiment global il n’y a pas d’autre moyen par lequel ce monopole inacceptable peut être combattu. Pris ensemble ces cinq monopoles définissent le cadre dans lequel la loi de la valeur mondialisée s’exprime. Loin d’être l’expression d’une rationalité économique « pure », qu’on pourrait détacher de son cadre social et politique, la loi de la valeur est l’expression condensée de l’ensemble de ces conditionnements. Je soutiens ici que ces conditionnements annulent la portée de l’industrialisation des périphéries, dévaluent le travail productif incorporé dans ces productions tandis qu’elles surévaluent la prétendue valeur ajoutée attachée aux activités par lesquelles opèrent les monopoles nouveaux au bénéfice des centres. Ils produisent donc une nouvelle hiérarchie dans la répartition du revenu à l’échelle mondiale, plus inégale que jamais, subalternisent les industries de la périphérie et les réduisent au statut d’activités de sous-traitance. La polarisation trouve ici son fondement nouveau appelé à commander ses formes d’avenir.
140
3) En contrepoint du discours idéologique dominant, je soutiens que la « mondialisation par le marché » est une utopie réactionnaire contre laquelle on doit développer théoriquement et pratiquement l’alternative du projet humaniste d’une mondialisation s’inscrivant dans une perspective socialiste. La réalisation d’un tel projet implique la construction d’un système politique mondial, non pas « au service » du marché mondial mais définissant le cadre d’opération de celui-ci, comme l’Etat national a représenté historiquement non pas le champ de déploiement du marché national mais le cadre social de ce déploiement. Un système politique mondial aurait donc des responsabilités majeures dans chacun des quatre domaines suivants : i)l’organisation d’un désarmement global aux niveaux appropriés, libérant l’humanité de la menace d’holocaustes nucléaires et autres. ii)l’organisation d’un accès équitable, de moins en moins inégal, à l’usage des ressources de la planète, et la mise en place de systèmes mondiaux de décision dans ce domaine, y inclus une tarification des ressources qui impose la réduction du gaspillage et la répartition de la valeur et de la rente allouée à ces ressources, amorçant par là même les éléments d’un système fiscal mondialisé. iii)la négociation de rapports économiques souples ouverts mais contrôlés, entre les grandes régions du monde, inégalement développées, réduisant progressivement les monopoles technologiques et financiers des centres. Cela implique bien entendu la liquidation des institutions chargées actuellement de la gestion du marché mondial (Banque dite mondiale, FMI, OMC, etc.) et la création d’autres systèmes de gestion de l’économie mondiale. iv)l’organisation de négociations permettant une gestion correcte du conflit dialectique mondial / national dans les domaines de la
141
communication, de la culture et de la politique. Cette gestion implique la création d’institutions politiques permettant la représentation des intérêts sociaux opérant à l’échelle mondiale, en quelque sorte l’amorce d’un « Parlement mondial », dépassant le concept des institutions inter-états en vigueur jusqu’ici. 4) Il est plus qu’évident que les tendances du monde actuel ne vont pas dans le sens indiqué ci-dessus et que les objectifs du projet humaniste évoqué ne constituent pas les enjeux des conflits en cours. Je ne suis pas étonné, et serais même surpris qu’il en fût autrement. L’érosion du système ancien de la mondialisation ne préparait pas par elle-même son propre dépassement mais ne pouvait déboucher dans l’immédiat que sur le chaos. Les forces dominantes inscrivent leur action dans ce chaos, cherchant seulement à tirer la couverture pour leur bénéfice à court terme, aggravant par là même le chaos. Leur tentative de légitimer leurs choix par l’idéologie plate du marché « autorégulateur », par l’affirmation « qu’il n’y a pas d’alternative », ou par le cynisme pur et simple, n’est pas la solution du problème; mais fait partie du problème à résoudre. Les réponses immédiates des peuples à la dégradation de leurs conditions ne sont pas davantage nécessairement positives; dans le désarroi des réponses illusoires, comme les repliements fondamentalistes ou chauvins, peuvent mobiliser des forces importantes. Il appartient à la gauche - c’est sa vocation historique - de construire en théorie et en pratique les conditions de la réponse humaniste au défi. A défaut et jusqu’à ce qu’il en soit ainsi, des involutions régressives - et criminelles - restent à l’ordre du jour du plus probable. Les difficultés auxquelles le projet européen est aujourd’hui confronté constituent une belle illustration de l’impasse de la mondialisation par le marché. Or ces difficultés, qui, dans l’enthousiasme que le projet avait suscité, n’avaient pas été imaginées, étaient parfaitement prévisibles et ont
142
été prévues depuis longtemps par ceux qui, comme moi, n’ont jamais cru que le marché commun créerait par lui-même l’Europe. Nous disions donc qu’un projet aussi ambitieux que celui-ci ne pouvait être porté que par une gauche européenne capable d’inscrire la construction du marché unifié dans un projet social et culturel progressiste, sans lequel elle resterait fragile et même réversible au moindre accident sérieux. Il fallait donc que les gauches européennes imposent que chaque étape de l’intégration des marchés soit accompagnée d’une double série de mesures, d’une part assurant que le bénéfice de l’opération revienne aux travailleurs, renforçant par là même leur pouvoir social et leur unité, et d’autre part amorçant la construction d’un système politique transgressant les Etats nationaux qui est la forme politique nécessaire pour une gestion efficace du marché élargi. Il n’en a rien été. Le projet européen a été porté par la droite, réduit à sa dimension mercantile, tandis que les gauches ralliaient, tôt ou tardivement selon le cas, le modèle proposé sans imposer leurs conditions. Le résultat est là devant nos yeux : le retournement de la conjoncture mondiale a mis les partenaires européens en position d’adversaires qui ne peuvent imaginer soulager leurs difficultés propres (notamment le chômage) qu’au détriment les uns des autres, et encore sans disposer des instruments efficaces pour pouvoir le faire. Démunis de moyens capables d’encadrer les logiques immédiates du marché, ils seront de plus en plus tentés par des repliements involutifs. La volonté de les éviter, proclamée peut être même très sincèrement par des hommes politiques importants chez les deux partenaires allemand et français, à droite et à gauche, ne relève dans ces conditions que de la méthode incantatoire. Or les difficultés de la « petite Europe » (de la CEE) éclatent au même moment où la grande Europe donne au défi des dimensions nouvelles. L’occasion s’offrait de repenser à gauche le projet européen dans son ensemble
143
et d’amorcer la construction d’une grande Europe économique et politique (« confédérale ») ancrée à gauche par la reconstruction de l’unité des forces du travail à cette échelle. On a laissé passer l’occasion et, au contraire, on a soutenu les forces de droite pressées de tirer profit de l’effondrement du système soviétique par la substitution à celui-ci d’un système capitaliste sauvage. Il est évident que ce projet de « latinoaméricanisation » de l’Europe de l’Est ne peut qu’affaiblir les chances de la recomposition d’un projet européen ancré à gauche, et que ce projet ne peut qu’accentuer les déséquilibres au sein de l’Europe des Douze au bénéfice du seul partenaire capable de capitaliser cette évolution à son profit : l’Allemagne réunifié. La crise du projet européen constitue un des défis majeurs auquel la construction d’une nouvelle mondialisation est confrontée. Mais l’Europe n’est certainement pas le lieu exclusif de manifestations involutives, réponses inadéquates et tragiques au défi de la construction d’un système mondial renouvelé. A travers tout l’ancien tiers monde, singulièrement dans ses régions marginalisées par l’effondrement de la mondialisation ancienne (dans les aires islamique, arabe et africaine), mais aussi dans le nouveau tiers-monde de l’Est (comme on le voit dans l’ex-URSS et l’ex-Yougoslavie), les involutions autodestructives l’emportent de loin sur l’amorce -inexistante jusqu’ici - de réponses à la hauteur du défi. 5) L’analyste qui prétend vouloir être réaliste imagine donc, à partir des configurations actuelles des forces en conflit, les différents scénarios possibles. J’en examinerais quelques-uns pour montrer que tous ces scénarios restent en deçà des exigences de la construction d’un ordre mondial stable et acceptable, et que par conséquent ils ne permettent pas de sortir du chaos.
144
La question européenne est au centre de l’imaginaire concernant l’avenir de la mondialisation. Le projet européen en panne, menacé de désintégration, les forces qui sont attachées à l’idée européenne pourraient croire utile et possible leur repliement sur ce qui parait être le second best, c’est-à-dire l’Europe allemande. Fondée sur l’expansion allemande dans une Europe de l’Est latino américanisée (poursuivant donc la tradition de Bismark à Hitler), ce projet ne tolérerait l’association de la France, de l’Italie et de l’Espagne que dans la mesure où celle-ci ne gêne pas l’action de l’Allemagne. Il y a tout lieu de penser que, dans cette hypothèse, le vaisseau de la Grande Bretagne naviguerait au large des côtes américaines, prenant ses distances à l’égard de l’Europe continentale. Nous sommes bel et bien engagés sur ces rails et on a même déjà trouvé une légitimation à ce choix, par la priorité qu’on croit devoir donner dans ce modèle de la construction européenne à une « gestion monétaire neutre » (un concept technocratique fondé sur l’ignorance du sens politique de la gestion de la monnaie), confié à la Bundesbank évidemment ! Je ne crois pas que cette caricature du projet européen d’origine puisse être véritablement stable, car à la longue ni la Russie, ni la France n’accepteront l’érosion de leurs positions qu’il implique. De surcroît le scénario soit de l’Allemagne faisant cavalier seul, soit de l’Europe allemande, ne remettrait pas en cause les fonctions privilégiées des Etats-Unis. Car il est plus qu’évident que dans aucun des domaines définissant les cinq monopoles dont j’ai signalé le rôle décisif ce projet ne serait équipé pour faire face aux positions américaines. L’Europe allemande est contrainte ici de rester dans le sillage américain. A partir de là on passe graduellement aux caractères du second scénario, celui d’une seconde édition de l'hégémonie américaine, faute d’alterna-
145
tive. Ce scénario lui-même admet beaucoup de variantes, dont la plus probable comporterait un certain degré de « partage du fardeau » associé à une régionalisation néo-impérialiste, attelant l’Amérique latine au char américain, l’Afrique au char germano-européen (les miettes pour la France) - mais pas la région du Golfe pétrolier et le « marché commun du Moyen Orient », qui restent le domaine des Etats-Unis, présents directement par l’occupation militaire du Golfe et indirectement par leur alliance israélienne - et, par symétrie pourrait-on dire, octroyant l’Asie du sud est à l’expansion nipponne. Mais ce partage n’implique pas d’égalité entre les trois centres considérés; les Etats-Unis restent dans ce cadre privilégiés. Là encore je ne crois pas que des options néo-impérialistes de ce genre garantissent la stabilité du système. Elles sont remises en question ici et là par la révolte de l’Amérique latine, de l’Asie et de l’Afrique. Notre attention doit donc se porter sur l’Asie, largement à l’écart du conflit euro-américain. On a souvent fait observer que, dans la crise globale actuelle, l’Asie faisait figure d’exception enregistrant tant au Japon qu’en Chine communiste, en Corée et à un degré moindre dans quelques pays d’Asie du sud est (Singapour, la Thaïlande et la Malaisie) et même en Inde, des succès incontestables, en terme de croissance et d’efficacité (mesurée par la compétitivité sur le marché mondial). De là à conclure que la prochaine hégémonie reviendrait à l’Asie, il n’y a qu’un pas, qu’on franchit souvent trop vite. Car l’Asie dans ce concept globalisant, c’est plus de la moitié de la population du monde ! Celle-ci est répartie en nations distinctes. Au concept flou d’hégémonie on pourrait substituer celui de l’Asie devenant la région principale de l’accumulation capitaliste. Encore faudrait-il préciser comment fonctionnerait cette accumulation, comment elle articulerait les différentes nations de la région entre elles et avec le reste du monde. Ici les variantes prennent tout leur sens. La plus commune
146
à imaginer - la domination de l’impérialisme nippon sur la région - est, à mon avis, la moins plausible. La vulnérabilité du Japon reste un handicap trop souvent sous estimé par les admirateurs de ses succès récents. Et c’est pour y palier que le Japon reste dans le sillage des Etats-Unis. La probabilité que la Chine, et même la Corée, acceptent de lui être subalternisées est elle même sans fondement sérieux. Dans ces conditions la gestion de l’équilibre inter-asiatique appellera l’intervention d’autres puissances extérieures à la région et ici encore seuls les Etats-Unis sont candidats à ce rôle, qui prolongerait leur primauté sur la scène mondiale. Il reste que dans tous les cas le renforcement des positions des pays d’Asie dans le système mondial - en premier lieu la Chine - bénéficie d’une haute probabilité. Comment les Etats-Unis réagiront-ils à cette évolution ? A mon avis toute la stratégie des alliances mondiales des uns et des autres tournera autour de cette question. Car il va de soi presque que le développement de la Chine remettrait bel et bien en question tous les équilibres globaux. Et c’est pourquoi ce développement sera finalement ressenti aux Etats-Unis comme une « menace ». Aussi à mon avis, les grands conflits de l’avenir opposeront Américains et Chinois. Quelle sera l’attitude de l’Europe dans ce conflit ? Difficile à dire aujourd’hui. 6) Les différents scénarios possibles que les évolutions en cours pourraient dessiner s’inscrivent tous dans des perspectives qui ne remettent pas en cause la polarisation « Nord-Sud ». La logique qui commande le système capitaliste perpétue la polarisation centres / périphéries en renouvelant ses modes d’opération, appelés à être fondés dans l’avenir sur les cinq monopoles autour desquels j’ai construit mon raisonnement. On observera qu’il n’y aurait rien de bien neuf dans cette perspective, la polarisation faisant partie presque de l’ordre naturel des choses. Je ne conclus pas
147
sur cette note parce que précisément ce qui a changé au cours des cinq derniers siècles réside précisément ici : les peuples périphérisés par l’expansion capitaliste mondiale, qui ont semblé accepter leur sort pendant longtemps, ne l’acceptent plus depuis une cinquantaine d’années et l’accepteront de moins en moins à l’avenir. L’aspect positif de l’universalisation que le capitalisme a inauguré - et que dans la version tronquée qu’il engendre il n’est pas capable de dépasser - est le ver dans le fruit. Ce qui a été amorcé avec les révolutions russe et chinoise - le projet d’aller au delà de ce système à partir des révoltes des peuples de la périphérie - se poursuivra sous de nouvelles formes. La raison ultime de l’instabilité des « systèmes mondiaux » en construction trouve ici sa cause essentielle. Bien entendu ces conflits qui occuperont le devant de la scène dans l’avenir seront de portées inégales, comme dans le passé. Mon intuition me conduit à donner aux conflits qui opposeront les peuples de l’Asie au système dominant une place déterminante dans le déroulement de l’histoire à venir. Cela n’exclut pas la participation des autres à cette révolte généralisée contre la polarisation, comme cela n’exclut pas des avancées et des transformations à partir des centres du système. Je me suis exprimé ailleurs sur cet aspect de la problématique de la transformation socialiste du monde et n’y reviendrai pas. Comme cela n’exclut pas les échecs, fussent-ils dramatiques, de peuples qui s’enfermeraient dans le refus d’une perspective universaliste. Je l’ai également dit ailleurs. Le projet d’une réponse humaniste au défi de la mondialisation inauguré par l’expansion capitaliste, ce projet « idéaliste » à l’extrême tel qu’il a pu paraître au lecteur de ce texte, n’est donc pas « utopique ». Il est au contraire le seul projet réaliste possible, dans ce sens que l’amorce d’une évolution allant dans son sens devrait rallier rapidement des forces sociales puissantes dans toutes les régions du monde, capables d’en imposer la logique.
148
Aller dans ce sens, c’est pour moi renouveler la perspective d’un socialisme mondial. En préparer les conditions, c’est d’abord recomposer les forces idéologiques et politiques capables de combattre les cinq monopoles par lesquels se reproduit la polarisation capitaliste et imposer, par ce combat, un « ajustement mutuel » en lieu et place de l’ajustement unilatéral préconisé par la logique capitaliste. Sur le front idéologique et culturel ce combat impose qu’on reprenne des débats qui me paraissent fondamentaux : (i) la dialectique de l’universel et du particulier; (ii) le rapport de la démocratie politique et du progrès social; (iii) la dialectique de l’efficacité dite économique (et des moyens à travers lesquels elle peut s’exprimer : le « marché ») et des valeurs d’égalité et de fraternité : (iv) la définition de l’objectif socialiste mondial à la lumière des réflexions précédentes. Sur le front de la politique mondiale il impose qu’on fasse avancer des formes d’organisation du système mondial plus authentiquement démocratiques et par là même capables de réorganiser les rapports économiques sur des bases de moins en moins inégales. Dans ce cadre la réorganisation du système global à partir de la constitution de grandes régions rassemblant les morceaux épars des périphéries actuelles me paraît devoir bénéficier de la plus haute priorité. La constitution des régions latino-américaine, arabe, africaine, sudest asiatique, aux côtés de la Chine et de l’Inde (les seuls pays continents de notre planète), trouve ici sa place. Je propose que cet objectif constitue la priorité première d’un agenda renouvelé du « Mouvement des non alignés ». Ces régionalisations n’en excluent pas d’autres, comme celle de l’Europe ou de l’ex-URSS. La raison de cette exigence est simple : les cinq monopoles en question dans notre analyse ne peuvent être combattus efficacement qu’à cette échelle. A partir de là, la constitution d’un système économique et finan-
149
cier réellement mondial, comportant ses étages propres (nationaux, régionaux, mondiaux) deviendrait possible à son tour. Bien entendu la transformation du monde commence toujours par le développement des combats à sa base. Sans l’amorce de la transformation des systèmes idéologiques, politiques et sociaux dans leurs bases nationales, le discours sur la mondialisation et la polarisation restera celui d’analystes opérant post mortem.
Rappel bibliographique Ce texte reprend dans une forme condensée des conclusions dont le lecteur trouvera des argumentaires plus détaillés dans : – L’Empire du chaos; Harmattan 1992 – Itinéraire intellectuel; Harmattan 1993 – L’ethnie à l’assaut des nations; Harmattan 1993 – Mondialisation et accumulation; Harmattan 1993 – La gestion capitaliste de la crise; Harmattan 1995
150
Chapitre V Mondialisation et financiarisation I - Repères pour une définition du défi 1) Sans doute existe-t-il un accord de vues assez large concernant quelquesunes des caractéristiques principales du défi auquel sont confrontées les sociétés de notre époque, au moins autour des quatre points suivants : i)Le système économique est entré depuis le début des années 1970 dans une phase longue de stagnation relative (par comparaison avec la phase de croissance exceptionnelle de l’après guerre). Qu’on qualifie notre époque de phase B d’un cycle Kondratieff ou autrement, on s’accordera sur le fait essentiel que les taux de croissance et d’investissement dans l’expansion des systèmes productifs sont largement inférieurs, pour les vingt cinq dernières années, à ce qu’ils avaient au cours des deux décennies antérieures. L’installation du système dans une stagnation tenace a mis un terme aux illusions que l’expansion avait nourries dans la phase antérieure : celle du plein emploi et de la croissance indéfinie à l’Ouest, celle du développement au Sud, celle du rattrapage accéléré par le socialisme à l’Est. ii)Le système économique de notre époque est beaucoup plus mondialisé qu’il ne l’était il y a une trentaine d’années. Au sens que les acteurs économiques dominants - les grandes firmes multinationales - sont capables de développer des stratégies qui leur sont propres et les émancipent largement de la tutelle des politiques nationales des Etats, dont l’impuissance est constatée par tous, qu’on le regrette ou qu’on s’en réjouisse. iii)Les préoccupations financières ont pris graduellement le pas sur
151
celles concernant la croissance économique et l’expansion des systèmes productifs. Pour les uns cette « financiarisation » du capital donne l’avantage à des comportements usuraires et rentiers négatifs du point de vue du développement économique et social. Elle est alors largement responsable de la ténacité de la stagnation et de la sévérité du chômage, parce qu’elle enferme les politiques économiques dans une spirale déflationniste. Pour les autres celle-ci est nécessaire et positive parce qu’elle conditionne la restructuration des systèmes productifs et prépare ainsi une nouvelle phase d’expansion. iv)Enfin, aux plans idéologiques et politiques les concepts fondamentaux d’une alternative socialiste, meilleure socialement et au moins aussi efficace économiquement, fondée sur une sortie du système mondial (la « déconnexion ») sont remis en question, qu’on le déplore et n’attribue l’échec de l’expérience qu’à des erreurs de sa mise en œuvre (tandis que les principes qui fondaient celle-ci resteraient sains), qu’on fasse une critique beaucoup plus radicale de la tentative et considère qu’en tout état de cause la stratégie qui la définissait ne correspond plus au défi de notre époque, ou qu’on s’en réjouisse parce que l’échec conforterait l’idée que toute tentative de sortir du capitalisme est utopique. Les trois premières caractéristiques de la crise en cours ne sont pas tout à fait chose nouvelle. On a déjà vu dans l’histoire du capitalisme des phases longues de stagnation, des moments de financiarisation intensifiée, et même la mondialisation conçue comme le fait que des agents de la vie économique actifs au delà des frontières de leur pays d’origine échappent à la loi des Etats; rien de cela n’est sans précédant. On verra plus loin dans quelle mesure néanmoins ces caractéristiques présentent aujourd’hui des aspects nouveaux. Bien entendu par contre la quatrième de ces caractéristiques est évidemment nouvelle.
152
2) Mais s’il y a accord sur ce qu’on peut appeler les grands faits qui caractérisent notre époque, brossés à grands traits ici, il y a certainement des divergences fondamentales dès lors qu’on aborde les analyses relatives à ces phénomènes, et les perspectives qu’ils ouvrent (ou ferment). Ces divergences non seulement séparent la gauche (qui inspire les courants réformistes sociaux, keynésiens et autres et tous ceux qui se réclament du marxisme) de la droite (définie par son adhésion aux thèses fondamentales de l’économie néo-classique), mais traversent tout autant et la gauche et la droite elles-mêmes. Comme toujours, mise au défi par des évolutions qui transforment qualitativement les structures et modifient de ce fait les comportements fondamentaux, la pensée sociale est contrainte elle même de se redéfinir, de repenser les paradigmes dans le cadre desquels elle situait les rapports entre les lois économiques (et leur nature contraignante objective) et le mouvement d’ensemble de la société. La pensée sociale vulgaire dominante est économiciste en ce sens qu’elle part de l’idée qu’il existe des lois économiques « incontournables », pour utiliser le qualificatif passé dans la langue de la mode, que ces lois commandent le fonctionnement des systèmes productifs dont elles déterminent le mouvement et « le progrès », qu’entre autre elles imposent l’intensification de l’interdépendance à l’échelle mondiale des sous-systèmes nationaux. Mais cette pensée va plus loin : en lisant (à tort ou à raison) ces réalités économiques comme résultantes de forces qui s’imposent dans l’histoire qu’on le veuille ou pas, elle appelle à s’y soumettre. On dit que les politiques d’Etat doivent - ou devraient - s’ajuster aux stratégies des firmes privées, se soumettre à la logique de leurs intérêts qui transgressent les frontières d’Etat. C’est le sens donné aujourd’hui à la contrainte de la mondialisation par ses hérauts. Les optimistes diront alors que le politique et le social « s’ajustent » d’eux-mêmes - ou finissent par le faire - à ces exi-
153
gences, et que ceci est pour le meilleur, les pessimistes que le conflit entre l’objectivité économique qui s’impose et l’autonomie du politique et du social (culturel, idéologique et religieux inclus) peut conduire la société à l’impasse ou même à l’autodestruction dans certains cas. L’économicisme a toujours dominé la pensée sociale de droite, dans une version d’ailleurs d’optimisme auto-encensant le système. Les imperfections, voire les désastres sociaux, sont alors le produit soit d’un refus de s’ajuster (« le politique a tort ») soit des accrocs transitoires, qui finiront par être dépassés (la philosophie du trickledown pour utiliser l’expression anglaise qui traduit à la perfection cet optimisme de commande, lequel dispense de l’analyse critique du système). Mais l’économicisme a toujours eu également son versant de gauche, et il y a toujours eu une lecture économiciste du marxisme lui même. Je prétends que l’existence même de celui-ci démontre, comme Marx lui même le disait que « l’idéologie de la classe dominante est l’idéologie dominante dans la société ». Et j’ai, pour ma part, avec d’autres, rapporté l’aliénation économiciste - contenu essentiel de l’idéologie bourgeoise -à une réalité objective : l’autonomisation de la loi économique par rapport à son encadrement par le politique-idéologique, propre à tous les systèmes antérieurs. La version économiciste de gauche - marxisme vulgaire inclus - est néanmoins toujours réformiste dans le sens qu’elle appelle non à l’ajustement par soumission aux exigences de la gestion capitaliste au profit unilatéral du capital, mais à l’encadrement de la nécessité économique (le développement des forces productives) par des réformes y compris des réformes radicales modifiant les rapports sociaux et singulièrement de propriété, permettant de mettre le progrès des forces productives au service des classes travailleuses. Aujourd’hui donc ces courants auront ten-
154
dance à partager avec les opinions dominantes l’idée que « la mondialisation est incontournable ». Dans les débats sur la construction européenne, le libéralisme sans frontières, on retrouve évidemment ces questions fondamentales. Ce survol rapide des attitudes de la pensée sociale invite également, d’évidence, à comprendre pourquoi, face au défi du monde moderne, les réponses (« que faire » ?) seront divergentes, allant de la soumission à l’ajustement par la réforme au refus, révolutionnaire (prétendant aller dans le sens de l’histoire) ou réactionnaire (prétendant faire marcher en arrière la machine de l’histoire). 3) L’objet de ce travail n’est pas d’ouvrir le dossier de la pensée sociale dans toute son ampleur. Il est beaucoup plus modeste. Je me situerai donc d’emblée à gauche, au sens que je ne considère ni que le capitalisme constitue la fin de l’histoire, ni même qu’il soit capable de surmonter les contradictions qui le caractérisent spécifiquement (et dont j’essayerai de préciser la nature). Je tenterai alors de proposer une lecture du défi en question dans le cadre de ce paradigme fondamental. Je le ferai en m’appuyant sur une lecture du marxisme - que je partage certes avec d’autres mais dont je reconnais qu’elle n’est certainement pas la seule, et que je ne chercherai même pas à légitimer ici. Mais je le ferai aussi en prenant tout à fait au sérieux des apports - qui me paraissent décisifs - de pensées qui ne se sont pas nécessairement inscrites dans la méthode marxiste, l’ont parfois été, mais se sont parfois situées hors du champ de la problématique marxiste. J’entends ici tout particulièrement les apports de Karl Polanyi, de Braudel et du courant du système de l’économie-monde.
155
II - Marx, Polanyi, Braudel et la question de la nature du capitalisme 1) J’aborderai la discussion des questions que j’ai posées plus haut en revenant sur les apports de l’analyse conduite dans le cadre du paradigme de l’économie-monde. Je pourrai ici être bref, m’étant exprimé sur ces sujets avec quelque détail dans le chapitre trois. J’en rappelle donc seulement celles des conclusions qui sont nécessaires pour la suite de notre discussion. i)Le capitalisme est un système dont la spécifité, par opposition aux systèmes antérieurs, réside précisément dans la dominance de l’instance économique. La loi de la valeur n’y commande pas seulement la vie économique mais tous les aspects de la vie sociale (c’est le sens de l’aliénation marchande). Ce retournement qualitatif des rapports économie / politique et idéologie interdit, à mon avis, de projeter en arrière, avant le capitalisme, des lois qui seraient valables pour l’histoire moderne. Il y a une discontinuité historique qui interdit ce genre de généralisation. Le pouvoir commandait la richesse, c’est désormais la richesse qui commande le pouvoir. ii)Le capitalisme ne prend sa forme achevée qu’avec la constitution de la machino-facture au XIXe siècle (l’industrie moderne), base nécessaire pour que se déploie la loi de la valeur spécifique du mode de production capitaliste. De ce fait les trois siècles qui précèdent cette véritable révolution industrielle constituent une transition, qu’on a qualifié à juste titre de mercantiliste. iii)La loi de la valeur doit être saisie au niveau le plus élevé de son abstraction, celui du mode de production capitaliste (lequel implique un marché intégré dans ses trois dimensions : marché des produits, du capital et du travail) et au niveau de l’abstraction qui définit le système capitaliste mondial (qui se déploie sur la base d’un
156
marché intégré tronqué, réduit à ses deux premières dimensions). La distinction que je fais entre le concept de loi de la valeur et celui de loi de la valeur mondialisée est essentielle dans la méthode d’analyse que je propose, parce que seule la seconde explique pourquoi le capitalisme comme système mondial est par nature polarisant. La polarisation capitaliste moderne en question n’apparaît donc qu’à partir de la coupure de 1800 lorsque le capitalisme prend sa forme achevée; à partir de là elle revêt des formes historiques successives, d’abord celle du contraste centres industrialisées / périphéries non industrialisées puis celle (en formation) du contraste fondé sur les « cinq monopoles » des centres. La polarisation centres / périphéries n’est ni synonyme du contraste métropoles / colonies, ni particulière à l’étape qualifiée d’impérialisme par le léninisme (définie par la constitution des monopoles au centre). iv)Les questions relatives à l’histoire du capitalisme, des péripéties de la phase de sa transition mercantiliste (1500-1800), des racines plus lointaines éventuelles de l’amorce de son apparition (avant 1500 en Europe et / ou ailleurs), des raisons pour lesquelles il s’est cristallisé en Europe (et pas plus tôt ou simultanément ailleurs), des phases de son expansion à partir de 1800, doivent être discutées, à mon avis, à la lumière des concepts définis dans les trois paragraphes précédents. Cette remarque méthodologique concerne tant la discussion de « cycles longs » que celle de la succession des éventuelles hégémonies et des rivalités et partant, des formes et contenus de l’inégalité (terme plus large que celui de polarisation que je réserve aux effets de la loi de la valeur mondialisée) entre les pays et les régions concernés par l’expansion progressive du système. Je propose à cet effet d’approfondir la connaissance des caractéristiques de ce que j’appelle la succession de phases de l’accumulation, en mettant l’accent sur la spécificité de chacune de ces phases, en évitant donc de généraliser trop vite pour retrouver des sortes de lois générales qui s’exprimeraient sur le mode de la
157
répétition (le cycle au sens rigoureux du terme). Cette méthode exige d’emblée qu’on situe le débat sur son terrain véritable, qui implique l’analyse de l’articulation entre les différences strates proposées par Braudel (voir plus loin), c’est-à-dire en reconstituant l’unité contradictoire de l’économique et du politique (ou, en d’autres termes, en refusant la vision économiciste - bourgeoise ou autre - qui suppose que l’économique agit seul, selon ses lois propres et que le politique s’y ajuste, ou le « reflète »). Déjà le concept même de loi de la valeur mondialisée, distinct de la loi de la valeur, impliquait cette appréhension totale du capitalisme puisque le caractère tronqué du marché mondial (par opposition au caractère complet des marchés nationaux) intègre le politique (les Etats, forts ou faibles, métropoles et colonies, définis par leurs logiques sociales) et l’économique. Pour chacune des phases de l’accumulation repérée de la sorte on devrait se proposer l’objectif de définir les modes de sa (ou ses) régulation, aux échelles locales (nationales) et globale (mondiale). L’analyse de l’expansion, puis de l’épuisement de ces phases d’accumulation successives, de la crise des modes de leur régulation et de la cristallisation des conditions d’apparition d’une phase nouvelle d’accumulation, devrait alors permettre de situer exactement le fonctionnement des rivalités (compétitions économiques, suprématies politiques) et d’éventuelles hégémonies (terme dont je me méfie parce que trop vague) et par conséquent de comprendre a posteriori pourquoi et comment dans l’histoire réelle le capitalisme global s’est sans cesse construit, déconstruit et reconstruit. Sa flexibilité est, pour moi, synonyme de cette histoire. La Théorie est Histoire. La théorie n’est pas la découverte de lois historiques antérieures à l’histoire elle même. La méthode, d’évidence, met alors en garde contre les tentations de généralisations trop rapides, qui s’expriment par des propositions concernant la succession de « cycles » (y compris de « cycles d’hégémonies ») donnant à celle-ci une régularité apparente à
158
laquelle on ne parvient qu’en forçant la dynamique des évolutions réelles. v)Le courant de pensée regroupé sous le nom collectif de « systèmemonde » ne propose pas - heureusement - une théorie exclusive de l’histoire du capitalisme, à laquelle il faudrait se rallier ou qu’on devrait rejeter intégralement. Les éléments fondamentaux du paradigme qui réunit des thèses différentes produites dans ce cadre sont aussi les miens : d’une part l’accent mis sur l’interdépendance qui opère au niveau global (en contrepoint des visions dominantes qui regardent le système mondial comme constitué de formations nationales juxtaposées), d’autre part l’accent mis sur le caractère total du capitalisme (en contrepoint des visions dominantes qui privilégient son versant économique et subalternisent celui de sa politique). Accepter ces deux fondements de la méthode n’implique en aucune manière l’adhésion à une théorie du cycle. Les critiques que j’ai adressées à celle-ci (ou celles-ci plus exactement), fréquente au sein du courant de l’économie-monde, ont été suffisamment argumentées plus haut pour n’y pas revenir ici. 2) La contribution de Braudel à notre méthode d’analyse de l’expansion du « capitalisme historique » est reconnue de tous. Comme on le sait, Braudel définit trois strates de la réalité sociale : (i) à la base l’ensemble des structures élémentaires qui encadrent la « vie matérielle » au quotidien, en particulier l’organisation du travail et de la subsistance au sein de la famille; (ii) au niveau médian le « marché », c’est-à-dire l’ensemble des structures au sein desquelles opèrent les échanges commandés par la division sociale du travail; (iii) enfin au niveau supérieur le pouvoir, c’est-à-dire un « anti-marché » où opèrent les grands prédateurs dans la jungle de la politique locale et mondiale.
159
La formule, si concise soit-elle, permet de comprendre que Braudel refuse d’emblée l’économisme, qui se définit par sa fixation exclusive sur le niveau médian. Comme elle permet de saisir pourquoi Braudel refuse la synonymie commune « capitalisme = marché », qui domine la pensée vulgaire, particulièrement la mode dominante de nos jours. Pour Braudel au contraire l’existence du niveau supérieur définit la spécificité du capitalisme historique. Selon lui « l’économie de marché » (la division du travail et les échanges) est bien antérieure au capitalisme qui n’apparait que lorsque se constitue précisément, au-dessus du marché, cet anti-marché (pouvoir véritable) dont l’histoire façonnera à son tour celle du capitalisme. Quels sont les outils conceptuels à partir desquels on pourrait tenter à la fois de préciser la nature des structures qui définissent chacune de ces strates et la dialectique de leurs rapports, conflictuels et complémentaires ? Le partage académique des tâches a artificiellement créé des spécialisations propres à chacune des trois strates considérées. Sans trop caricaturer on peut dire que les sociologues s’occupent de la base, les économistes de la strate médiane, les politologues et les historiens de la strate supérieure. Cela dit il faut savoir aussi qu’avant Braudel tous les grands penseurs de la société se proposaient immanquablement de transgresser ces clivages artificiels. Par leur nature même les idéologies dominantes des mondes antérieurs au capitalisme, que j’ai proposé de qualifier d’idéologies tributaires fondées sur l’aliénation métaphysique, généralement religieuses dans leur expression (cf L’Eurocentrisme), les ignoraient. Leur discours avait à la fois la prétention d’expliquer l’histoire et la nature (fut-ce par les mythes de la créa-
160
tion), et celle de formuler les règles du comportement nécessaire à tous les niveaux de la société, de la gestion familiale à celle des échanges et du pouvoir. Les intégrismes religieux contemporains ne font rien d’autre que prétendre restaurer cet ordre. Pour ma part je prétends que cette page est tournée définitivement, précisément par le triomphe du capitalisme, substituant l’aliénation économiste à la métaphysique et par là même fondant la séparation des trois niveaux, et du coup l’autonomie de l’économique et sa dominance. C’est même là la raison pour laquelle je considère la coupure de 1500 comme une transformation qualitative du système. La philosophie des Lumières, qui exprime cette vision nouvelle du monde, constitue le socle sur lequel a pu se constituer la « science économique » autonome ultérieure. Mais la philosophie des Lumières ne se résume pas dans cette économique, elle la transgresse et offre simultanément ce qu’elle croit être une science de la société, de la base aux sommets du pouvoir. Cette philosophie des Lumières, comme la science économique dont elle a stimulé la constitution, n’ont pas été acceptées par tous les courants de la pensée sociale, même si celles-ci fournissent jusqu’à nos jours l’essentiel de la pensée dominante. Le projet de Marx, parti de la découverte (et de la dénonciation) de l’aliénation marchande (et donc du refus de considérer le capitalisme comme la fin de l’histoire), se proposait de construire un matérialisme historique dont le nom même traduit la préoccupation de transgresser l’économique et de rétablir l’unité des trois niveaux décrits ultérieurement par Braudel. 3) Cette observation nous permettra de situer chacun des livres du Capital dans la construction de ce projet. Le livre I parle essentiellement de la base - de l’aliénation marchande -. Mais il ne situe pas celle-ci hors du rapport
161
de production fondamental qui définit le capitalisme. Au contraire il la situe au cœur de ce rapport d’exploitation du travail par le capital (et de destruction de la nature par le capital, un aspect largement méconnu des lecteurs de Marx et encore plus de ceux qui l’ignorent). Le livre II propose ensuite - et sur cette base -l’analyse de l’économie du système, c’est-à-dire l’économique du mode de production capitaliste (la loi de la valeur) saisi à son niveau d’abstraction le plus élevé. La dynamique de l’équilibre des productions des deux départements qui produisent les éléments matériels constitutifs de la domination du capital sur le travail et les éléments de la consommation matérielle qui permet la reproduction de la force de travail, constitue l’objet même du livre II. Mais le projet de Marx ne s’arrêtait pas là. Au-delà de cette économique, qu’on pourrait appeler « pure » proposée en contrepoint de l’autre « économie pure », l’économie classique fondée sur la Philosophie des Lumières, puis - après Marx en réponse à son projet - l’économie néo-classique, qualifiée de vulgaire à juste titre parce qu’elle ne questionne pas l’aliénation économiste, Marx se proposait de hisser l’analyse au niveau supérieur - tel que Braudel le définit par la construction d’un appareil d’analyse du pouvoir et du système mondial. L’œuvre de Marx est resté inachevée, et sans doute même -comme toute œuvre humaine - est-elle imparfaite. Je résumerai mes observations sur ces thèmes dans les quatre points suivants : i)Dans le livre I du Capital la préoccupation exclusive de découvrir les racines de l’exploitation capitaliste conduit Marx à séparer le système de l’échange (des produits, mais aussi de la vente de la force de travail) de ce qui se situe apparemment en dehors de lui - le système de satisfaction des besoins par la production de subsistance, et surtout celui de l’organisation de la famille. Cette dernière critique a été rappelée à juste titre par la découverte féministe des
162
limites de Marx - homme du XIXe siècle. Cela étant le marxisme historique ne s’est pas royalement désintéressé du niveau élémentaire de la construction sociale, comme on le dit parfois trop facilement. Le livre I du Capital ne doit pas être lu dans l’ignorance des écrits philosophiques (mettant l’accent sur l’aliénation) de Marx et des marxistes ultérieurs (qui ont parfois tenté de prolonger le projet pour intégrer la science psychologique dans la construction sociale d’ensemble), ou dans celle des écrits traitant directement de la famille et des rapports hommes-femmes. Quoiqu’on puisse penser des conclusions tirées à l’époque par Engels (dans L’origine de la famille, reliée précisément à celle de la propriété privée et de l’Etat), cette initiative a ouvert la voie à une anthropologie marxiste qui a donné par la suite des résultats, partiels et discutables certes, mais importants. Je dirai donc qu’il n’est pas établi qu’une construction matérialiste historique qui intègre mieux le niveau élémentaire en question soit impossible. Je dirai même que les efforts de la sociologie conventionnelle (Weber inclus) dans ce sens n’ont donné que des résultats encore plus partiels et discutables, comme il fallait s’y attendre, parce que le préjugé antimarxiste les a conduit à vouloir analyser ce niveau sans retenir les exigences de son rapport à l’économique et au pouvoir. Mais je ne dirai pas non plus que nous disposons d’un corpus de thèses établies (fut-ce provisoirement) fondées sur la méthode du matérialisme historique qui nous permettait soit d’être satisfaits, soit de conclure que le matérialisme historique est déjà dépassé. Il faudra encore développer beaucoup les travaux sur ces terrains avant d’être parvenu aux limites des capacités potentielles du matérialisme historique. ii)Les rapports société-nature n’ont pas été ignorés par Marx. Cependant ils n’ont pas été traités suffisamment systématiquement, mais seulement « au passage », notamment dans le Capital (où les allusions et références à la destruction de la base naturelle sur laquelle l’expansion du capital se fonde ne manquent pas), et dans
163
des écrits ultérieurs du marxisme. Là encore il faut aller plus loin, stimulés comme nous devrions l’être par le défi écologiste, même si jusqu’ici l’apport des analyses développées par ce courant de pensée reste mince. Mais il faut reconnaître aussi qu’en fait le marxisme historique a largement gommé cette problématique particulière. iii)Les rapports concernant le pouvoir et donc l’intégration du niveau supérieur tel que Braudel le définit à la construction d’ensemble constituent, à mon avis, le domaine le plus mal connu jusqu’ici. Je l’ai déjà dit (cf L’Eurocentrisme). Certes des constructions importantes à ce sujet existent, qui ne doivent pas être négligées, ni celles de Marx et d’Engels (dans leurs écrits politiques), ni celles des marxistes (notamment dans les théories de l’impérialisme, de Lénine, Boukharine et autres), ni celle de Braudel (concernant la transition mercantiliste). Il reste qu’à mon avis des questions fondamentales restent sans réponse jusqu’à ce jour, celles que j’ai qualifiées de questions relatives aux aliénations propres au pouvoir. Comme, même en ce qui concerne l’époque moderne du capitalisme (de la transition mercantiliste et du capitalisme achevé), les questions relatives à l’articulation pouvoir politique - pouvoir économique et financier constituent l’un des domaines les plus faiblement argumentés. Il existe bien sûr de grandes thèses à ce sujet. Les thèses antimarxistes partent généralement de l’hypothèse d’une quasiindépendance de l’instance politique et parfois de sa suprématie (pendant nécessaire de l’économisme). Je ne les discuterai pas. D’autres thèses, marxistes ou non, ont, à l’opposé, réduit le politique au reflet des exigences de l’économique. La thèse de la domination de l’Etat et de l’économie par le capital financier au stade des monopoles et de l'impérialisme se situe dans cet éventail. Bien entendu on a fait observer l’existence de variantes correspondant aux spécificités des différents pays concernés - l’opposition bien connue entre la forme allemande analysée par Hilferding et la forme britannique qui a inspiré Hobson -, ce qui n’a pas empêché parfois
164
les généralisations abusives (auxquelles Lénine n’est pas étranger). D’autres thèses concernent plus spécifiquement les rapports pouvoirs - « haute finance » des époques mercantilistes. Les travaux de Braudel et ceux qu’il a inspiré dans l’école de l’économie monde (notamment le dernier ouvrage de Giovanni Arrighi, The Long XXth century) fournissent également sur ce terrain des propositions d’une grande importance théorique. Je reviendrai sur ces débats qui tournent autour du rapport entre le pouvoir économique capitaliste dominant et la dimension « territorialiste » du capitalisme (l’expansion politique), parce qu’ils sont essentiels pour le sujet qui nous occupe ici, celui de la nature du système mondial. Mais je reste méfiant à l’égard de propositions trop générales avancées par les uns ou les autres -comme la thèse léniniste de l’impérialisme, de surcroit simplifiée ultérieurement, ou la thèse du caractère profondément non territorialiste des hégémonies capitalistes, qui inspire Braudel et Arrighi - parce que je crois que la connaissance des articulations politique / économique est encore balbutiante. iv)La faiblesse majeure dans l’œuvre de Marx et dans le marxisme historique subséquent concerne le rapport mode de production capitaliste - mondialisation capitaliste. Or cette faiblesse concerne directement notre sujet et constitue aussi la dimension la plus forte des défis réels auxquels les sociétés du monde moderne sont confrontées. C’est donc la question politique majeure. La thèse que j’ai développée sur ce sujet (cf Itinéraire intellectuel) est que Marx lui-même puis surtout le marxisme historique ont conçu la mondialisation comme à peu près synonyme de l’expansion mondiale du mode de production capitaliste. La perspective d’une homogénéisation progressive du monde que cette réduction implique exclurait d’emblée une appréhension correcte des raisons de la polarisation produite par l’expansion mondiale du capitalisme. Cette vision n’a été que partiellement corrigée par Lénine dont la thèse - la révolution commence par la périphérie mais s’étend
165
rapidement au centre -témoigne de l’erreur. Le contraste centre / périphérie n’a jamais pu, dans ces conditions, être pleinement perçu avec toute la puissance théorique que ce défi impose, et, de ce fait, est confondu - ou réduit - par exemple au contraste métropoles / colonies. Cette faiblesse du marxisme historique ne pouvait qu’entraîner des conséquences tragiques dont la moindre n’est pas l’impasse dans laquelle s’est enfermée la révolution russe. Il reste que le marxisme historique partage cette bévue majeure avec tous les courants politiques de la gauche - social démocrate et démocratique bourgeoise - et rejoint sur ce plan la pensée bourgeoise vulgaire qui n’a jamais été capable de traiter de l’inégalité autrement que comme expression du « retard ». Ma conclusion est donc que le marxisme historique et la gauche en général sont mal équipés pour faire face au défi de la mondialisation. C’est leur talon d’Achille. Et c’est comme on le verra, le cœur du défi auquel les sociétés modernes sont confrontées. 4) Certains contributions importantes, prolongeant les outils d’analyse produits par le marxisme, ont peut être corrigé ou amorcé la correction des insuffisances du marxisme historique identifiées ici. Si je situe au premier rang de ces contributions celle de Karl Polanyi (La Grande Transformation, 1944), c’est parce qu’elle se place parmi les rares tentatives de prendre en compte sérieusement la dimension mondiale du capitalisme. La thèse de Polanyi est, comme on le sait, fondée sur le rejet de l’idée que le marché pourrait être autorégulateur. Elle s’attaque par là même au fondement de l’économisme bourgeois, triomphant de nos jours plus que jamais. Polanyi démontre que la « marchandisation » de la force de travail, de la nature et de la monnaie ne peuvent créer que le chaos et l’insupportable socialement. Cette utopie poursuivie par le capital chaque fois que la conjoncture politique le lui permet n’est jamais parvenue, pour cette raison, à
166
s’imposer durablement. Je renvoie ici à ce que j’ai écrit sur ce sujet dans La gestion capitaliste de la crise. Les trois thèmes pris en compte par Polanyi sont déjà dans Marx, tout particulièrement l’aliénation du travail sur laquelle je ne reviendrai pas. Polanyi explicite, sur le thème de la nature, ce qui n’était pas suffisamment systématiquement développé chez Marx (et encore moins dans le marxisme historique). La question de la monnaie avait par contre fait l’objet de longs développements dans le livre III, à propos du crédit, des crises, et des échanges internationaux, et, à travers ces analyses, Marx avait proposé une problématique du rapport monnaie / pouvoir et une réflexion sur le fétichisme monétaire. Sur ce dernier plan Marx était allé très loin. Il avait démontré comment le cycle de l’argent pouvait se « libérer » en apparence du passage forcé par la production, en opposant le cycle productif A-P-A’ dans lequel le capital argent s’immobilise un moment dans la production capitaliste c’est-à-dire l’exploitation du travail créateur de la plus value, au cycle de l’argent-usurier-rentier AA’, à travers lequel s’exprime la forme suprême du fétichisme de l’argent. On aura l’occasion de revenir sur ce point, essentiel à mon avis pour analyser la nature de la crise contemporaine et les moyens de sa gestion. Concernant le rapport argent-pouvoir, Marx fournit également l’équipement conceptuel qui permet de saisir comment l’argent - symbole d’un pouvoir d’achat - devient symbole du pouvoir tout court. La monnaie ne peut donc être traitée comme une marchandise quelconque, comme le propose l’économisme vulgaire dans ses versions les plus misérables, comme celles qui dominent de nos jours (l’école dite monétariste, le libéralisme tel qu’il est compris etc.). J’avais donc tenté de mon côté de proposer une analyse du rapport monnaie-pouvoir plaçant l’accent sur la gestion nécessaire de la monnaie et
167
du crédit par l’Etat, agissant ici comme le capitaliste collectif transgressant les conflits qui opèrent sur le marché, et explicité dans ce cadre les fonctions de cette gestion dans la régulation concurrentielle du XIXe siècle, la régulation monopolistique et fordiste du XXe siècle et la régulation considérée dans sa dimension mondiale (cf Itinéraire intellectuel). Ce que Polanyi nous a offert ici, c’est un tableau magistral des développements de l’utopie libérale de la fin du XIXe siècle à la catastrophe finale à laquelle elle conduisait - le fascisme et la seconde guerre mondiale - en reliant les dimensions nationales du fonctionnement destructeur (et non autorégulateur) des marchés du travail, de la terre et de la monnaie à leur dimension mondiale. En dessinant les lignes de force des positions prises en contrepoint par les sociétés au sortir du désastre, Polanyi nous a fourni les moyens permettant de comprendre comment le miracle de la croissance de l’après guerre a pu fonctionner : les limites imposées à la marchandisation du travail par le compromis historique social démocrate capital-travail, la régulation de la monnaie par l’Etat aux échelles nationales et par les institutions de Bretton Woods au niveau international. J’ai pour ma part produit une lecture de cet après guerre en fin de parcours qui complète l’amorce proposée par Polanyi quarante ans plus tôt, à la veille de son démarrage, replaçant ce que j’ai appelé les trois piliers du système mondial (le compromis historique social démocrate, le soviétisme, le projet national bourgeois de Bandoung) dans ce cadre. Cette lecture doit donc beaucoup à la méthode proposée par Polanyi. Certes le succès de ce modèle de l’après guerre, aux échelles nationales et à celle du système mondial, avait ses limites. Entre autre parce que rien n’a été fait dans son cadre pour limiter les ravages de la marchandisation de la nature, en dépit de l’alarme dont Polanyi avait tiré la sonnette. Ce n’est donc pas par hasard si la question de l’environnement a, dans ces conditions, éclaté
168
comme une bombe à retardement vers la fin de la période. On aurait dû s’y attendre. Cette phase de l’expansion de l’après guerre est aujourd’hui épuisée, avec l’effondrement des trois piliers sur lesquels elle reposait. Le retour de manivelle en force de l’utopie libérale (la triple marchandisation en question opérant librement à l’échelle mondiale, la prétention de légitimer ces politiques par le caractère autorégulateur attribué au marché) ne devrait donc pas surprendre. Mais elle n’est pas par elle même capable de définir une nouvelle phase d’expansion capitaliste, elle n’en est que la gestion de la crise (titre même de mon livre récent) sur laquelle on reviendra. Malheureusement, comme je l’ai dit, la gauche et le marxisme historique sont mal équipés pour relever le défi. D’autant plus que dans l’après guerre la sclérose du marxisme dogmatique nous avait privé des moyens de comprendre véritablement les mécanismes, les contradictions et les limites des trois modèles considérés (social démocrate, soviétique, du tiers monde nationaliste), substituant dans ce domaine un discours idéologique simplifié et manipulé à l’analyse sérieuse. Je reviens alors maintenant à Braudel dont on pourra peut être apprécier la contribution au regard de ce qui a été rappelé concernant le marxisme. Très certainement la lecture de l’œuvre magnifique de Braudel est toujours gratifiante. Je connais peu de lectures qui procurent autant de plaisir que celles qui concernent « la vie matérielle », c’est-à-dire la description précise de la strate de base de la construction sociale. Il reste que la présentation généreuse de Braudel n’articule pas les systèmes de la vie matérielle à ceux qui commandent les niveaux supérieurs de l’organisation sociale, peut être parce que, soucieux de ne pas céder à la tentation marxiste, Braudel a voulu ignorer les concepts de rapports de reproduction et la théorie de l’aliénation. A la
169
décharge de Braudel on peut faire observer que ses travaux portent sur la période mercantiliste, c’est-à-dire avant que ne se cristallise le rapport d’exploitation propre au capitalisme achevé. L’analyse des caractères propres à la strate médiane - celle des échanges contribue également, à mon avis, à une meilleure compréhension de la transition mercantiliste - à laquelle Braudel consacre ses travaux - plus qu’à celle du capitalisme industriel. Analyser ce système comme un système d’échanges est largement suffisant tant que - comme il en était pour la période 1500-1800 (ou 1350-1800) - dominent le capital marchand et les formes de l’exploitation du travail artisanal et manufacturier qui leur sont associées. Je persiste à penser que cette analyse est insuffisante pour la suite de l’histoire. Ce n’est pas seulement que le domaine des échanges prend à partir de 1800 une ampleur inconnue jusqu’à la révolution industrielle (les échanges antérieurs ne peuvent concerner qu’une fraction limitée de la production et de la force de travail). C’est aussi et surtout qu’ils sont désormais soumis à la dominance du capital industriel et à la subordination du capital marchand. Ce n’est donc pas un hasard si Braudel ignore la loi de la valeur, une faiblesse que malheureusement après lui beaucoup d’auteurs de l’école du système monde perpétuent (Arrighi lui-même ignore dans son dernier livre superbe et la loi de la valeur en général et la loi de la valeur mondialisée). Ce n’est donc pas un hasard non plus si ces auteurs dévalorisent systématiquement le concept de révolution industrielle. La question n’est pas ici, à mon avis de savoir, si cette révolution a été aussi rapide qu’on l’a parfois dit ou non, si elle a été mise en œuvre par l’effet du jeu de « facteurs internes » ou si l’asymétrie des positions définies par le contraste centres / périphéries propre à l’étape mercantiliste a été motrice dans le changement (ces débats ont, à mon avis, leur valeur et intérêt propres). Elle est tout simplement de savoir si oui ou non l’industrie
170
nouvelle représente un saut qualitatif dans l’organisation profonde du système. Convaincu sur ce dernier point de vue qu’il en est ainsi, j’en tire deux conséquences à mon avis majeures. La première est que le système centres / périphéries propre au capitalisme achevé (après 1800) est différent dans sa nature même de celui qui caractérise la transition mercantiliste. La seconde est que voir ce niveau médian après 1800 comme « un système d’échanges » aplatit l’analyse, l’appauvrit et la réduit, qu’on le veuille ou non, à la vision bourgeoise conventionnelle du « monde vu comme un marché ». La contribution majeure de Braudel pour la compréhension de ce qu’est le capitalisme vient donc de l’accent qu’il place sur le troisième niveau de la réalité : « l’anti-marché » (le pouvoir) dont l’existence même comme tel est exclue par la pensée sociale économiciste dominante qui refuse de considérer son caractère décisif dans la définition propre du capitalisme. Sans doute personne de sensé n’ignore que l’Etat et la politique existent. Mais « le monde vu comme un marché » impliquerait un concept de l’Etat bien différent de celui dont l’histoire réelle nous enseigne l’existence. J’ai fait une incursion dans ce domaine en reprenant la thèse de Walras, le plus pur des économicistes, prenant au sérieux l’aspiration à construire le monde comme un marché (cf Itinéraire intellectuel). Walras démontre alors que la loi du marché ne pourrait s’imposer comme une force autorégulatrice donnant des résultats optimaux qu’à la condition que soit abrogée la propriété privée, et que l’Etat - s’y substituant - mette systématiquement aux enchères la disponibilité du capital. Cette perspective d’un « capitalisme sans capitalistes », forme suprême de l’aliénation économiciste, a été, dans mon interprétation de l’histoire soviétique, le guide de la stratégie qualifiée improprement de construction du socialisme. Le socialisme mondial serait alors aussi, dans cette perspective, un marché mondial parfaitement intégré dans toutes ses dimen-
171
sions, abolissant les Etats pour leur substituer un Etat mondial gérant ce marché parfait. Bien entendu cette vision et ce programme non seulement sont parfaitement utopiques au sens plat du terme, mais encore ignorent superbement la réalité et la théorie de l’aliénation. Ni Marx, ni Braudel ne conçoivent le rapport économie / pouvoir de cette manière. On peut donc revenir à Braudel qui nous propose une explication lumineuse de la naissance du pouvoir capitaliste, non comme le produit spontané du marché, mais au contraire en dehors et au dessus des contraintes qu’il impose. Braudel qualifie la transformation qualitative qui se cristallise en Europe à la fin du Moyen Age de passage d’un pouvoir émietté et éclaté en un pouvoir concentré, dont les villes italiennes d’abord, les Provinces Unies au XVIIe siècle, l’Angleterre à partir de 1688 constituent les modèles successifs. C’est cette transformation qui signale l’apparition du capitalisme et le définit, non l’existence d’échanges marchands qui lui est bien antérieure. Cette thèse rejoint, comme on le voit, la mienne (cf L’Eurocentrisme) : je situe en effet la spécificité de la forme féodale européenne du mode tributaire dans ce caractère émietté du pouvoir par opposition à sa forme concentrée qui caractérise les modes tributaires ailleurs (en Chine par exemple) et définis par cette différence le contraste formes périphériques / formes centrales du mode tributaire. Je situe dans ce contraste les raisons du succès du passage rapide au capitalisme en Europe (tributaire périphérique) par opposition aux avortements successifs d’une évolution comparable ailleurs (dans les formes tributaires centrales). En Europe la concentration du pouvoir coïncide en effet avec l’acquisition par celui-ci d’un contenu capitaliste, alors qu’elle le précède ailleurs. Les villes italiennes et les Provinces Unies, gouvernées par de véritables conseils d’administration de leurs grands capitalistes, plus tard les Etats mercantilistes (l’Angleterre et la France en particulier) n’ont pas leurs sembla-
172
bles ailleurs. La formation et le triomphe du capitalisme ne sont donc pas le produit d’une évolution linéaire de l’expansion des marchés mais celui d’une interaction entre celle-ci et des facteurs internes spécifiques et propres à la forme périphérique du mode tributaire en Europe. En ce sens alors la transition mercantiliste (1500-1800) apparait bien, a posteriori comme une transition au capitalisme achevé et, de ce fait, mérite à son tour d’être qualifiée de capitaliste. Je rejoins ici le point de vue du courant du système-monde qui qualifie de capitaliste toute l’histoire moderne, à partir de 1500. Cette adhésion n’implique pas qu’on gomme l’importance de la transformation qualitative qui permet l’industrie moderne à partir de 1800.
III - Les enjeux de la mondialisation dans l’histoire : empires, hégémonies, financiarisation. 1) La discussion de l’outillage conceptuel disponible proposée dans la section précédente devrait nous aider à clarifier la question centrale - qu’est-ce que la mondialisation ? Quels sont ses enjeux ? Quels sont les défis auxquels les sociétés sont confrontées de par son fait. Ou tout au moins devrait nous aider à préciser d’une part les thèses acquises à ce sujet (relativement et provisoirement bien sûr, comme toujours) et les questions qui restent pratiquement sans réponse convaincante, au point que des hypothèses les plus contradictoires sont avancées ici (il s’agit donc d’hypothèses et non de thèses reposant sur un socle paradigmatique et conceptuel satisfaisant pour rendre compte des faits). Le terme de mondialisation (ou globalisation, par traduction littérale de l’anglais) est, comme cela est souvent le cas dans les sciences sociales, utilisé dans des acceptions très différentes. Selon les points de vue on entendra donc par mondialisation la formation d’un marché mondial des biens
173
et des capitaux, le caractère universel des technologies compétitives, la progression en direction de la constitution d’un système productif mondial, le poids politique que le système mondial exerce dans la compétition pour les hégémonies globales ou régionales, l’aspect culturel de l’universalisation etc. On retient donc des définitions plus ou moins larges, plus ou moins exigeantes. De ce fait les théories concernant la nature plus ou moins contraignante de la mondialisation en question, de sa stabilité (ou de son instabilité), de sa progression, continue ou saccadée et des phases éventuelles dont elle se constitue, varient selon les définitions conceptuelles retenues. La dérégulation, qui est tout de même une politique voulue et consciemment mise en œuvre et non un fait naturel qui s’impose par lui même, permet aux stratégies des grandes firmes d’échapper aux contraintes que pourraient représenter les politiques d’Etat, en son absence. Cependant les faits montrent que ces stratégies indépendantes des firmes privées ne constituent pas un ensemble cohérent garantissant la stabilité d’un nouvel ordre. Elles engendrent au contraire le chaos et révèlent par là même la vulnérabilité de cette mondialisation qui sera de ce fait probablement remise en question. Dans son acception la plus large la mondialisation fait référence à l’existence de relations entre les différentes régions du monde et à l’influence réciproque que les sociétés exercent les unes sur les autres de ce fait. Dans cette acception j’ai moi même proposé un schéma descriptif de « l’ancien système monde », celui de l’époque tributaire - de 500-300 Avant J. C. à 1500 A. D. - mettant en rapport les trois centres tributaires majeurs durant ces deux millénaires (la Chine, l’Inde, le Moyen Orient) et les périphéries (l’Europe, l’Afrique, l’Asie du Sud Est, la Corée, le Japon), en définissant les
174
concepts spécifiques de centres et de périphéries propres à ce passé antécapitaliste. Ces concepts sont définis dans la sphère dominante de l’organisation du pouvoir et non de l’économique comme il en est dans le capitalisme (on évite donc la projection en arrière des concepts propres au capitalisme, malheureusement fréquente chez certains théoriciens des système-mondes). L’analyse que j’ai proposée de ce système ancien (cf chapitre I) me conduisait à une conclusion qui me parait importante à signaler ici : à savoir que l’ancien système n’était pas polarisant par nature, mais au contraire favorisait les « rattrapages » (de retards historiques) dont celui de l’Europe, se hissant en un temps historique bref de positions périphériques à celle du centre nouveau (à travers le passage du féodalisme aux monarchies absolues) en transition vers le capitalisme, devenant de ce fait le centre (au singulier) à l’échelle mondiale, pour la première fois dans l’histoire. Arrighi illustre ce caractère non polarisant du système ancien par l’analyse qu’il en propose du comportement, d’apparence curieuse, de la Chine des Ming qui, tout à fait capable d’exercer la maîtrise des mers, s’en abstient. La Chine est alors plus avancée que l’Europe, n’a donc rien à lui acheter et de ce fait ne se préoccupe pas de contrôler la route maritime vers l’Occident. Elle laisse donc les Européens - Portugais et Hollandais, puis Anglais et Français - établir leur contrôle sur la route maritime vers l’Est (pour eux), ce qui les aidera à rattraper leur retard. Le système mercantiliste que les Européens mettent en place à partir de la conquête de l’Amérique et de son façonnement comme périphérie de type nouveau, soumise à la logique économique dominante de l’accumulation du capital, est d’un type qualitativement nouveau et différent. Le nouveau système mondial mercantiliste s’érige sur les mines de l’ancien
175
système qu’il détruit méthodiquement, réorganisant les flux d’échanges au bénéfice du centre européen en construction. Dans ce sens évidemment 1500 signale un tournant historique majeur. Lu a posteriori, à partir de notre angle de vision moderne, la période mercantiliste (1500-1800) apparaît alors comme un moment de transition au capitalisme, si on définit la forme achevée de celui-ci à partir du moment où se constitue l’industrie moderne, où le capital industriel impose la logique de son accumulation au capital marchand antérieur. Bien entendu, s’il en a été ainsi, c’est bien parce que les formes de la mondialisation mise en place par le mercantilisme se sont articulées d’une manière particulière sur des facteurs internes de la transformation, propres à l’Europe (que j’ai proposé d’analyser en termes d’hégémonie bourgeoise opérant dans le cadre de l’organisation du pouvoir des monarchies absolues) différente des hégémonies tributaires achevées. Dans ce sens aussi, 1800 signale un second tournant historique majeur. A la différence du système mondial tributaire, non polarisant par nature, le système mercantiliste est au contraire fondé sur la construction d’une polarisation de type nouveau. Celle-ci prendra sa figure achevée à son tour à partir de 1800, dans le cadre du système mondial du capitalisme achevé (industriel). En 1800 les différences de niveaux de développement des principales différentes grandes régions du monde étaient encore peu marquées, comme l’a établi Paul Bairoch. Les écarts se sont creusés au cours du siècle et demi 18001950, dans le cadre de la nouvelle polarisation capitaliste, dans laquelle l’opposition centres-périphéries était pratiquement synonyme de pays industrialisés / pays non entrés dans la révolution industrielle, au point d’être devenue d’apparence insurmontable. Cette mondialisation nouvelle et - l’histoire l’a prouvé - polarisante, ne répond certainement pas à un schéma simple, passe partout, valable pour toute cette longue période
176
et pour toutes les régions concernées. Les fonctions diverses des différentes périphéries - à conjuguer toujours au pluriel - la dialectique contraintes extérieures / réponses internes, les stratégies propres aux différentes métropoles en concurrence inégale, les phases du développement capitaliste au centre lui même (et notamment le passage de la concurrence aux oligopoles vers 1880), l’évolution des systèmes de la régulation de l’accumulation (la régulation concurrentielle, celle du compromis historique capital-travail et de la gestion keynésienne etc.) dans les centres et à l’échelle mondiale, invitent à repérer des phases distinctes dans la longue période 1800-1950, et des modèles centres-périphéries présentant des particularités significatives. Mais au delà de toutes ces spécificités, la loi de l’accumulation à l’échelle mondiale - que j’ai cru utile de formuler dans les termes d’une loi de la valeur mondialisée spécifiant le fonctionnement de la loi de la valeur à l’échelle du système global - devait engendrer la polarisation par sa dynamique propre. J’ai attribué ce caractère polarisant de cette loi au fait qu’elle opère dans un marché bidimensionnel (marché des produits et du capital, tendant à être intégré à l’échelle globale) tronqué par comparaison au marché intégré tridimensionnel (intégrant également le marché de la force de travail), propre aux constructions nationales bourgeoises historiques et fondement de la loi de la valeur. Je ne reviens pas ici sur ce point central dans mon analyse. J’aborderai par ailleurs dans la section suivante les questions relatives à la mondialisation après la seconde guerre mondiale et à ses perspectives contemporaines. Je discuterai ici des questions relatives à l’interprétation de la mondialisation « moderne » (mercantiliste et industrielle) : questions relatives aux cycles, aux hégémonies, au territorialisme éventuel associé à l’expansion capitaliste, à la « financiarisation » du capital.
177
2) Je me suis exprimé ailleurs avec suffisamment de détail concernant mon point de vue pour ne pas revenir ici sur la question des « cycles ». Il y a dans l’histoire des dates tournants majeures (pour moi 1500, 1800 en sont); il y a entre ces tournants d’autres dates sans doute qui permettent d’identifier des sous-phases particulières (pour moi 1880 et 1920 en sont par exemple, 1945 - ou 1950 - et 1980 ou 1990 également, peut-être d’un statut différent de coupures majeures). Mais cela n’implique en aucune manière l’adhésion à une théorie du cycle long. Encore moins de chercher à repérer des « récurrences » transcendant chacune des grandes phases définies, proposant une philosophie de l’histoire où la répétition - fut-ce sur un trend ascendant - prend le pas sur l’identification des transformations qualitatives. La projection en arrière - par exemple de ce qui est nouveau avec le capitalisme industriel (la tendance inhérente à la surproduction et les crises par lesquelles elle se manifeste) à la période mercantiliste antérieure, ou de ce qui est nouveau avec le capitalisme (l’hégémonie du marché et de l’économisme) aux périodes antérieures (tributaires, commandées par d’autres lois organisatrices du rapport pouvoir-économie) m’est toujours apparue comme un dérapage aplatissant l’histoire réelle. Une adhésion à l’idée d’un système monde ne l’exige pas. En place et lieu de ces propositions de théories du cycle j’ai cru plus fécond de centrer l’objectif des analyses sur l’identification de « phases de l’accumulation ». Cela permet à la fois de respecter les spécificités de l’économique de chaque phase (éviter de confondre rapports marchands et rapports propres au capitalisme industriel etc.) et de relier l’économique en question et le politique (mode d’opération du pouvoir, blocs sociaux hégémoniques etc.). On reviendra sur cette relation essentielle. 3) Je ne reviendrai pas davantage sur la question des hégémonies et la théorie des hégémonies successives (villes italiennes, Pays Bas, Grande Bre-
178
tagne, Etats-Unis) avancée par certains. Je garde toutes mes réserves à l’endroit de la méthodologie qui commande ces théories. L’hégémonie m’est apparue dans l’histoire l’exception et non la règle. Parler de l’hégémonie des villes italiennes ou des Pays Bas, quelque brillantes aient pu être les sociétés en question, c’est à mon sens employer le terme dans un sens vague qui fait fi des réalités commandant l’insertion de ces pays dans les systèmes (régional et en partie mondial) de l’époque. L’hégémonie britannique elle même, que je ne situe pas avant la révolution industrielle, se déploie grâce à la conjonction exceptionnelle du monopole de la technologie industrielle nouvelle (érodé à partir de la seconde moitié du XIXe siècle), du pouvoir financier de Londres (qui se prolonge jusqu’en 1930), d’un Empire colonial énorme, peut-être le seul digne de ce nom, associant des colonies d’exploitation (l’Inde) et des colonies de peuplement antérieures ou postérieures à la période concernée (dont la moindre n’est pas les futurs Etats-Unis, assurant par la suite l’extraordinaire domination mondiale de la langue anglaise). Cependant, en dépit du caractère phénoménal de cette hégémonie, celle-ci avait des limites considérables. Elle n’opérait que partiellement sur le continent américain indépendant, sur la Chine, le Japon et l’Empire Ottoman etc. Elle était contrainte de faire faute d’une hégémonie militaire (sauf navale) - avec l’équilibre européen, un équilibre entre des nations fortes (Allemagne, France, Russie), limitant entre autre l’hégémonisme culturel anglais (qui ne se déploiera qu’avec celle des Etats-Unis) comme son hégémonisme politique, de ce fait incapable d’éviter la montée des nouveaux impérialismes concurrents (Allemagne, Japon, Etats-Unis, France). Le modèle de l’hégémonisme britannique a néanmoins inspiré ses concurrents, notamment dans sa dimension coloniale (où seule la France, les
179
Pays-Bas et la Belgique sont parvenus à quelques résultats, fort modestes comparativement). D’autres n’ont pu le faire (Allemagne), ou disposaient d’une alternative (l’expansion continentale pour les Etats-Unis, à comparer à celle de la Russie). Il reste aussi que dans deux domaines décisifs - la compétitivité industrielle et le pouvoir militaire - la Grande-Bretagne a été vite distancée par ses concurrents. Elle a conservé néanmoins longtemps un avantage financier sur la portée duquel on reviendra. L’hégémonie des Etats-Unis procède, après la seconde guerre mondiale, d’une conjonction différente de facteurs de puissance. Ici la formidable avance industrielle s’est avérée largement le produit de circonstances passagères (l’état du monde en 1945) et a été érodée rapidement par le redressement européen et japonais. L’avantage financier par contre, comme pour le cas de la Grande-Bretagne, parait pouvoir se prolonger au-delà du déclin relatif de la compétitivité industrielle. Et si les Etats-Unis n’ont pas rompu avec leur tradition dite « anticoloniale » (leur faible propension à la conquête coloniale), c’est parce que leur puissance militaire absolue, sans commune mesure avec ce qu’il en avait été des puissances militaires antérieures, un moment seulement (de 1945 à 1990) limitée par la seule autre superpuissance de cet ordre, aujourd’hui en lambeaux, les en a libéré. C’est aussi par son rayonnement propre que les Etats-Unis ont fait de la langue anglaise ce qu’elle est aujourd’hui, ce qu’elle n’était pas et ne pouvait être au XIXe siècle. 4) Ce que l’on a parfois appelé le « territorialisme », c’est -à-dire la propension à étendre la zone commandée par un centre politique unique, entretient avec l’expansion capitaliste des rapports tout à fait complexes. La
180
question interpelle aussi celle qui concerne d’une manière plus générale le rapport politique / économique propre au capitalisme. Deux positions extrêmes sur la question du territorialisme me paraissent stériles. La première est celle qui voit dans le capitalisme un système par nature « territorialement désincarné ». Quelle que soit l’élégance de cette définition du capitalisme qui, il est vrai, implique toujours des relations extérieures - économiques entre autres - sortant du cadre de l’Etat (petit ou grand), importantes par leur effet sur « l’intérieur », à un degré jamais vu dans les époques antérieures, elle n’en demeure pas moins trompeuse. Le capitalisme réellement existant a géré le rapport espace de sa reproduction économique / espace de sa gestion politique d’une manière qui ne peut être saisie si on gomme de sa nature la question du territorialisme. Les villes italiennes, certes, rayonnaient loin au delà de leurs frontières, les Provinces Unies étaient un petit grand pays. Il existe toujours des Etats modernes de taille diverse et les petits ne se portent pas nécessairement plus mal que les grands dans leur insertion mondiale. Certains micro-Etats (Luxembourg, Lichenstein, Bahamas, Emirats pétroliers, Singapour) ont trouvé des créneaux juteux dans cette insertion. Les Etats-Unis et la Russie sont des Etats-continents sans colonies extérieures (l’Empire russe et l’Union Soviétique sont multinationaux et non coloniaux). Mais à l’inverse l’insertion mondiale de la Grande Bretagne ne peut être comprise sans son empire colonial, ni même celle de la France entre 1880 et 1960 (depuis la France a choisi d’opérer son insertion mondiale à travers la construction européenne et non plus sa zone d’influence néocoloniale). Pourquoi ces différences ?
181
La variété des situations - dans l’espace et le temps -interdit donc de faire l’équation centres / périphéries = métropoles / colonies. Malheureusement cette équation est populaire, et a été populaire entre autre par une simplification outrancière des thèses Hobson-Hilferding-Lénine concernant l’impérialisme moderne. La mode est aujourd’hui au gommage de toutes ces spécificités - pourtant majeures à mon avis. On parle ainsi, à tort et à travers à mon sens, des « Empires », en mélangeant pêle-mêle l’Empire romain, le byzantin, le khalifal et l’ottoman, le chinois, l’austro-hongrois, le russe, le britannique ou le français. Or il s’agit de formations non seulement totalement différentes dans leurs structures internes, mais encore dans leur mode d’insertion dans la mondialisation. L’oppression n’est certainement pas un phénomène nouveau dans l’histoire, ni même ce qu’on peut appeler les oppressions racistes, ethniques, culturelles, ou nationales. Mais l’exploitation capitaliste et la polarisation centres / périphéries, sa forme coloniale éventuelle, sont des réalités particulières à l’époque moderne et à des formes particulières d’insertion dans la mondialisation. Encore une fois l’Empire russe (puis soviétique) peut bien avoir été une prison des peuples. Il n’était pas un Empire colonial organisé comme le fût le britannique. Dans l’Empire soviétique les transferts économiques se font du « centre » russe vers les « périphéries » asiatiques, à l’opposé de ce qu’ils étaient dans l’Empire britannique (cf S. Amin, L’ethnie à l’assaut des nations). Le rapport du capitalisme au territorialisme en question interpelle la question du pouvoir dans le capitalisme. Ici aussi la thèse simplificatrice, que le pouvoir est celui du capital point final, même si elle révèle un noyau de vérité utile à reconnaître, n’aide pas beaucoup à comprendre la variété des situations. Je reviens ici sur ce qui a été dit plus haut concernant la des-
182
cription braudelienne des trois niveaux de la réalité capitaliste. Le capitalisme n’est pas « le marché », mais « le marché + l’anti-marché qui s’exprime dans l’action du pouvoir politique ». Ce pouvoir de la « hautefinance » (laquelle est en fait un conglomérat mercantile-artisanal et financier dans l’étape mercantiliste) est le fondement de la construction des premiers véritables Etats capitalistes : les villes italiennes, les Provinces Unies. Et ici Arrighi attire utilement l’attention sur le fait qu’aucun pouvoir n’a été aussi proche du modèle extrême de l’Etat gouverné par un Conseil d’administration des grandes affaires que celui de ces modestes politis. Mais la cristallisation d’une association pouvoir politique / espace économique capable de devenir le lieu du saut qualitatif que l’industrialisation a représenté pour l’achèvement du mode de production capitaliste ne s’est pas faite là. Elle s’est faite dans les grands Etats mercantilistes l’Angleterre d’abord, la France ensuite - inventant les Etats nationaux bourgeois modernes, la construction économique autocentrée (fut-elle ouverte bien entendu) et donc la coïncidence entre l’espace de l’accumulation et celui de la gestion politique. Ce modèle a été reproduit, en Allemagne et ailleurs, parce qu’il répondait réellement aux exigences de l’expansion capitaliste de l’époque. A ses exigences fondamentales tout au moins puisque, avec colonies (Angleterre, France) ou sans (Allemagne), les résultats en termes de construction économique compétitive à l’échelle globale n’ont pas été différents. Ce modèle a donc fait l’objet d’une véritable idéologisation, établissant l’équation entre son achèvement et le progrès de la modernité. Bien entendu il est impossible de saisir tout le sens de l’efficacité de cette histoire sans mettre en œuvre des analyses et une théorie des hégémonies sociales sur lesquelles s’est fondé « le pouvoir du capital », les alliances sociales (avec l’aristocratie, ou la paysannerie, plus tard le compromis social capital / travail etc.) qui l’ont permis etc.
183
Marx après tout avait fait ce travail, très concrètement, pour son époque. Des marxistes de qualité -Gramsci entre autre - ont poursuivi l’effort. L’expansion coloniale ou semi-coloniale s’est greffée sur cette histoire. Elle peut donc être lue comme un appendice des hégémonies sociales spécifiques à tel pays dans telle phase de son développement capitaliste. Par exemple, l’articulation expansion de l’industrie cotonnière anglaise et destruction de celle de l’Inde, l’articulation spécialisation industrielle anglaise et importations agricoles des Etats-Unis et des grands futurs dominions de peuplement, l’articulation médiocrité de certains secteurs de l’industrie et de l’agriculture française et marchés coloniaux réservés (mise en relief par l’ouvrage de Marseille) etc. On comprend alors que les colonies ne sont pas une exigence « absolue » de l’expansion du capital, mais seulement une exigence du fonctionnement de certains types d’hégémonies sociales dans cette expansion. La propension à l’expansion coloniale parait néanmoins se généraliser ou presque, à partir de 1880 (les Empires coloniaux existant à cette date avaient été largement hérités des constructions mercantilistes antérieures à 1800 - l’Inde, l’Indonésie etc.). Cela n’était pas le produit d’une exigence absolue de l’accumulation interne, comme on l’a souvent dit dans des analyses superficielles et rapides, c’était le produit d’une concurrence aiguisée entre les nouveaux oligopoles même si, évidemment, le capital national dominant a su tirer profit de la colonisation. Lénine n’avait pas dit autre chose, même si on le lui a fait dire par la suite. Le succès - ou l’échec - dans cette expansion coloniale ont d’ailleurs eu des effets complexes, positifs et négatifs du point de vue de l’accumulation elle même, tantôt mettant à la disposition de son accélération les ressources du pillage et de la surexploitation, tantôt au contraire retardant la conversion de segments productifs
184
arriérés. Le Portugal et les Pays-Bas sont l’exemple classique de ces effets négatifs. Mais pour la France et même l’Angleterre qui avait si bien su exploiter la colonisation de l’Inde dans un premier temps, ces effets négatifs n’ont pas été absents dans l’évolution ultérieure de la concurrence mondialisée. D’autres facteurs de succès ou d’échecs - au delà même de la maîtrise nationale du progrès technologique - comme le contrôle des processus de financiarisation, sur lesquels je reviendrai, ne me paraissent pas avoir été moins importants, loin de là. Le territorialisme dans la transition mercantiliste ne peut être analysé par la même méthode qu’à la condition aussi de saisir dans tout son sens la différence entre l’hégémonie du capital mercantile (marchand-financier) de 1500 à 1800 et celle du capital industriel (industriel-financier) à partir de 1800. Je ne développerai pas ici de considérations sur ce terrain, me contentant plus loin de proposer quelques réflexions qui concernent le sujet, analysé sous l’angle particulier de la « financiarisation » dans le mercantilisme. La seconde position, tout aussi stérile - et même davantage - est celle qui, à l’opposé, ne voit dans le capitalisme (qu’il soit mercantiliste ou industriel) quoique ce soit de nouveau, et qui analyse le rapport politique / économique dans des termes équivalents pour les temps anciens et modernes. La théorie du renversement du rapport de dominance politique / économique dans les systèmes tributaires et économique / politique dans le capitalisme, que j’ai proposée ailleurs, interdit de traiter de la question du rapport entre l’espace de la gestion politique et celle de la reproduction de la vie économique (le concept d’accumulation n’a pas de sens pour les périodes antérieures au capitalisme) de la même manière « à travers l’histoire ».
185
Dans les systèmes tributaires la vie économique reste parcellisée dans l’espace, même lorsque les échanges marchands y compris ceux du commerce à longue distance exercent des effets importants sur la société. L’espace politique par contre tend à être plus vaste dans les modèles tributaires achevés (modèle : la Chine), tandis qu’il demeure parcellisé presque à l’échelle des espaces de reproduction de la vie économique dans les modèles périphériques les plus primitifs (Haut moyen-âge européen, Afrique subsaharienne) et se situe dans une moyenne entre ces deux extrêmes dans les cas intermédiaires (Moyen Orient et monde islamique, Europe de la fin du Moyen Age, Inde). 5) Ce qu’on peut appeler la « financiarisation » du système (moderne, capitaliste) est un processus par lequel s’affirme la domination du capital-argent, financier, sur le capital productif. Dans les termes mêmes proposés par Marx la dominance du procès direct A-A’ sur les procès productifs A-P-A’. Certainement, comme beaucoup d’autres phénomènes, celui-ci s’est répété fréquemment dans l’histoire du capitalisme, au point qu’Arrighi y voit non la « phase ultime » de celui-ci (comme le suggèrent les thèses sur « l’impérialisme stade suprême » de Hobson, Hilferding et Lénine) mais un phénomène récurrent. Reste à savoir si la récurrence est régularité - de forme cyclique - et s’il est fécond de mettre l’accent sur celle-ci, en gommant les spécificités de la financiarisation aux différents stades du développement capitaliste. Je préfère mettre l’accent sur ces spécificités. Par exemple le procès productif A-P-A’ analysé par Marx est propre au capitalisme achevé, industriel. P suppose l’achat de force de travail et son exploitation dans les formes de la soumission formelle au capital (incarné dans les moyens de production indus-
186
triels appropriés privativement). Dans la transition mercantiliste le procès d’accumulation majeur est de la forme A-E-A’ où E exprime la dominance de l’échange marchand -achat et vente de produits. Bien sûr les marchandises échangées doivent être elles mêmes produites. Mais elles le sont par le moyen de la production paysanne et artisanale, précisément ici dominées par leur soumission réelle et non formelle (au sens que Marx donne aux deux formes) au capital marchand. Je prétends que cette différence qualitative donne à la financiarisation qu’on retrouve ici et là des contenus différents. Dans son bel ouvrage, Arrighi nous offre un tableau saisissant de « cycles » conduisant ce qu’il considère comme ayant été les centres du système à différentes époques (les villes italiennes : Florence, Venise, Milan, Gênes; les Provinces Unies) de la suprématie en termes de compétitivité à la financiarisation et au déclin. Il reste qu’il serait important de préciser chaque fois le sens de la compétitivité en question. Celle-ci se situe bien au niveau de la production dans certains cas, par exemple l’artisanat et la manufacture des textiles à Florence, la construction navale dans les Provinces Unies. Mais sa forme dominante - cohérente avec la nature du mercantilisme - est la supériorité commerciale. Celle-ci à son tour est le produit d’un complexe de facteurs : connaissance des routes et maîtrise (y compris militaire) de celles-ci, efficacité du système des paiements (la lettre de change qui évite les transports de numéraire), supériorité des moyens de transport (flottes), prix d’offre. Sur ce dernier point Wallerstein a bien montré comment l’exploitation des mines d’Amérique a bouleversé les rapports commerciaux en faveur des Européens, capables de proposer des prix meilleurs que ceux de tous leurs concurrents dans l’ancien système monde tributaire. C’est par l’ensemble de ces moyens que le mercantilisme a effectivement détruit l’ancien système monde tributaire (non polarisant par nature) pour lui substituer le système monde
187
mercantiliste fondé sur la polarisation, créant les conditions du système monde capitaliste achevé ultérieur, polarisant par nature. La financiarisation d’un segment du système mercantiliste s’articule alors avec le façonnement de systèmes productifs adéquats, fondement de l’expansion du capital à cette étape. Par exemple Arrighi nous donne ici l’exemple magnifique de clarté de la financiarisation de Gênes, articulée sur la conquête et l’exploitation de l’Amérique. Gênes, devenue le banquier de la monarchie espagnole, gagne évidemment beaucoup plus en s’inscrivant dans cette évolution qu’en restant une simple ville marchande. De la même manière Florence passe du statut de ville artisanale et commerçante à celui de banquier des Etats absolutistes européens en construction. Elle se financiarise. Les Provinces Unies, à l’origine transporteurs et marchands, s’enrichissent également lorsqu’ils captent et constituent le capital-argent disponible à travers une bonne partie de l’Europe et du monde pour se faire à leur tour les banquiers de l’Europe. Mais comme toujours la financiarisation n’enrichit les uns qu’au détriment des autres; seul le progrès de la production permet de sortir de ce jeu à somme nulle. Le cycle A-A’ est toujours dans ce sens facteur d’intensification de l’inégalité des revenus au profit des rentiers-usuriers dominants. Cet enrichissement s’épuise s’il ne se constitue pas quelque part une base élargissant la sphère productive. Or celle-ci justement se constitue généralement hors du centre financiarisé et implique, à ce stade, la mise en œuvre efficace de dominations politiques sur des territoires importants. Le territorialisme s’associe ici à la concurrence de centres nouveaux montants, défiant les centres anciens financiarisés, qui entrent alors en déclin. La base de l’élargissement de la sphère productive a été ici historiquement double : d’une part celle associée au façonnement des Amériques (la production des mines et des plantations -
188
notamment de sucre), d’autre part celle résultant de la constitution de l’espace des grandes monarchies absolutistes (base de la grande manufacture, ancêtre de l’industrie). Les meilleures performances dans cette situation ont été celles des Etats qui ont à la fois dominé politiquement leur espace « national », les colonies (Amérique, plus tard Inde et Indonésie) et les réseaux marchands permettant de transférer à leur profit les surplus extraits des productions dominées. Mais il n’y a jamais eu de fatalité simple opérant dans ce cadre, et l’avantage d’une financiarisation trop précoce est devenue un handicap, surtout si la cohésion politique (produite par une hégémonie sociale adéquate, ce qui implique qu’on articule les facteurs internes sur les mécanismes de la mondialisation) ou la puissance militaire venaient à manquer. C’est ainsi que l’Espagne - qui possède l’Amérique - ne parvient pas à en conserver le profit de l’exploitation. Les Provinces Unies parvenues au sommet de leur richesse financière se sont également épuisées faute d’être parvenues à construire à leur bénéfice un espace mercantiliste suffisant. Leur repliement ultérieur sur leur colonie - l’Indonésie - a été, comme on le sait associée à un déclin de leur position en Europe. Deux succès. D’abord celui majeur de l’Angleterre, non financiarisée à l’époque, dont l’empire colonial est plus tardif (et ne prend une importance majeure qu’avec la conquête de l’Inde au XVIIIe siècle). En second, mais loin derrière, la France. C’est ce progrès du mercantilisme productif qui prépare la révolution industrielle dont il a créé les conditions. L’analyse concrète superbe qu’Arrighi nous donne de l’histoire du mercantilisme illustre bien le fonctionnement de l’articulation financiarisation-territorialisme dans la création des conditions du progrès des forces productives. La financiarisation des Pays Bas n’a pas constitué un tremplin efficace stimulant le progrès dans ce pays. En dépit de son rôle de banquier des coalitions dynas-
189
tiques qui ont liquidé le système médiéval et créé le système inter-états moderne (qu’on peut dater du traité de Westphalie - 1648), la Hollande n’a jamais pu gouverner le système qu’elle avait contribué à créer. Il appartenait à l’Angleterre et à la France de le faire, en inventant le mercantilisme, c’est-àdire à la fois le nationalisme économique (le Colbertisme, le Navigation Act), l’esclavage colonial et les colonies de peuplement. Il leur fallait pour cela un espace territorial suffisant. Le pays rentier financier doit-il donc toujours être finalement victime de sa richesse artificielle et vulnérable, battu par d’autres centres plus productifs, plus actifs, plus inventifs ? On retrouvera cette question pour les époques ultérieures. L’histoire de la financiarisation ne se répète pas, en dépit des apparences. Le système monde industriel nouveau - avec sa polarisation sans précédant centres industrialisés / périphéries qui ne le sont pas - est construit au XIXe siècle, d’abord sous la houlette de la Grande-Bretagne associant comme je l’ai fait observer l’initiative technologique, la maîtrise du commerce, l’exploitation coloniale et la domination du nouveau système financier mondial. L’idéologie du commerce libre (free trade) sur laquelle est fondée l’hégémonie britannique associe en fait le cosmopolitisme d’un capitalisme transnational à un territorialisme impérial sans pareil. La Grande-Bretagne perd rapidement son avantage technologique relatif certain dès 1880, face à ses deux concurrents, les Etats-Unis et l’Allemagne. Mais elle garde l'avantage dans le domaine financier jusqu’en 1945. A partir de cette date, par le moyen des institutions de Bretton Woods, les Etats-Unis lui arrachent ce monopole. La Grande-Bretagne, largement financiarisée à partir de la fin du XIXe siècle, reste « riche » de ce fait, en dépit de son déclin industriel relatif. Elle a même fait le choix de « s’installer dans ce créneau » à l’intérieur de la construction
190
européenne et de son mode nouveau d’insertion mondiale. Je doute que ce choix puisse être, à terme, efficace. Face à cette installation dans une financiarisation confortable, l’espace productif s’élargit et s’approfondit ailleurs, singulièrement aux Etats-Unis et en Allemagne. Mais ce progrès ne donne pas les mêmes résultats ici et là. Arrighi signale ici l’échec allemand, dont il analyse l’évolution en mettant l’accent - d’une manière fort convaincante - sur les facettes de cet échec non vues jusqu’ici. Tandis que les taux du progrès de la productivité industrielle ont été en Allemagne entre 1870 et 1914 trois fois supérieurs à ceux de la Grande-Bretagne, en termes de revenus per capita le rattrapage allemand est lent et modeste. La différence illustre fort la thèse qu’Arrighi et Braudel défendent, à savoir que le capitalisme n’est pas réductible au marché (ou à la production derrière le marché); les bénéfices tirés des monopoles de pouvoir et le pouvoir financier en est un - sont majeurs. Mais ils ont aussi leur fragilité comme on le verra plus loin. Les Etats-Unis par contre ont parfaitement réussi à supplanter la Grande-Bretagne. Ils n’ont pourtant pas bénéficié d’un avantage, financier ou autre, associé à une insertion dominante dans le système mondial, jusqu’en 1945. Ils se sont construits par une organisation de leur espace productif - agricole et industriel - autocentrée à un degré que ne pouvait connaître aucun autre pays à l’époque. Repliés sur un espace continental, riche en ressources de toutes natures, bénéficiaires du flux migratoire mondial dominant, ils ont construit, d’abord chez eux, les formes d’une organisation plus efficiente de la production qui ont constitué plus tard le fondement de leur hégémonie mondiale. Ici encore Arrighi met l’accent à juste titre sur le fait que la grande entreprise moderne - la future multinationale - a d’abord été (et reste souvent) une grande entreprise intégrée américaine. L’analogie entre cette forme de construction - expansion et celle de la Russie
191
est frappante. L’Empire russe puis l’URSS se construisent également comme un immense espace autocentré, à une distance certaine du système monde. L’échec n’est pas dû à ce choix, analogue à celui des Etats-Unis, mais simplement, à mon avis, aux facteurs internes - l’arriération de la Russie impériale, la nature du soviétisme et ses limites - et au conflit du siècle (1880-1980) entre la Russie et l’Allemagne puis la Russie et les Etats-Unis (et à nouveau, pour demain, entre Russie et l’Allemagne ?). L’apparence d’une financiarisation générale du système mondial qui se déploie à partir des années 1880 du siècle dernier, est un phénomène distinct. La période 1873-1896 est celle d’une stagnation relative dans les progrès de la production qui, associée à la tendance permanente à la centralisation du capital, fait basculer le système productif de sa forme concurrentielle, dominante jusqu’alors, à la forme oligopolistique nouvelle. Hobson, Hilferding, Lénine ont chacun à sa manière fait ressortir l’importance de ce changement qualitatif qui m’amène - avec eux - à voir en 1880 une date-tournant. La grande dépression (1873-1896) frappe les vieux centres industriels (la GrandeBretagne, la France, la Belgique) tandis que la croissance de la production industrielle se poursuit dans les centres nouveaux (Allemagne, Etats-Unis), tout comme aujourd’hui la crise frappe la triade (Amérique du Nord, Europe, Japon à un degré moindre et avec retard) tandis que l’industrialisation s’accélère en Asie de l’Est (Chine, Corée et Asie du Sud-Est). Les vieux centres se replient sur la position confortable de banquiers du monde qui financent une espèce de délocalisation (surtout en direction de la Russie, de l’Autriche Hongrie, de l’Empire ottoman, de l’Amérique latine et des Dominions blancs, par le moyen de l’endettement, moins en direction de leurs propres colonies sur lesquelles ils se replieront contraints et forcés plus tard). On retrouvera à notre époque des phénomènes un peu analogues avec l’endettement du tiers
192
monde et des pays de l’Est. Il reste que la délocalisation, si importante au cours des années 1970 qu’on pouvait croire qu’elle allait transformer la carte géographique mondiale des implantations industrielles (cf Otto Kreye), s’est avérée de faible portée et d’une durée brève. Dès les années 1980 la recentralisation opère au bénéfice des centres anciens de l’accumulation (mais à un rythme qui ne permet pas de sortir de la dépression longue). On notera également que l’essor parallèle accéléré de l’Asie de l’Est doit peu quantitativement aux investissements étrangers (bien que ceux-ci jouent un rôle important dans le transfert de technologie). On comprend alors que la financiarisation de la fin du XIXe siècle ait revêtu des formes différentes d’un pays à l’autre. Pour la Grande-Bretagne et la France elle prend la forme d’un capitalisme financier cosmopolite (type le réseau Rotschild) qui s’autonomise vis-à-vis de l’Etat, comme Hobson le fait remarquer. Il reste que cette autonomie n’est que relative car l’une des sources majeures de l’excédant d’épargne collecté par ce capital financier et placé à l’extérieur provient du tribut colonial. Boukharine et Lénine théorisent ce comportement de « rentiers » et proposent sur cette base une lecture critique de la nouvelle science économique « subjectiviste ». Par contre en Allemagne le capital financier s’articule sur l’industrie qui poursuit son essor. Hilferding fait donc observer que cette fusion banques-industries permet de gérer le pays comme une entreprise unique intégrée, qu’on pourrait appeler si on veut capitalisme monopoliste d’Etat, ou Germany Incorp, comme plus tard on a parlé de Japan Incorp. Dans les faits du capitalisme de l’époque cette oligopolarisation cristallise les conflits que Lénine qualifie à juste titre d’inter-impérialistes (à ne pas réduire à celui des Empires coloniaux) et dont les deux guerres mondiales témoignent de la réalité. C’est parce que Lénine pensait que le prolétariat ne supporterait pas ce conflit et que de ce fait la
193
révolution socialiste mondiale (au sens au moins européenne) était à l’ordre du jour, qu’il a qualifié ce stade impérialiste de « suprême ». L’histoire ne lui a donné raison qu’en partie : la révolution a bien eu lieu dans une semi périphérie, la Russie (le « maillon faible »), mais elle ne s’est pas étendue à l’Europe, mais vers l’Est, dans d’autres périphéries, sous une forme radicale (Chine) ou atténuée (le mouvement de libération nationale de l’Asie et de l’Afrique), se déployant ainsi de 1917 à 1975 (la fin de l’ère de Bandoung, comme je l’ai écrit ailleurs). Mais l’impérialisme - dans cette forme - ne s’est pas révélé entré dans sa phase ultime. Il survécu et s’est redéployé dans des formes nouvelles. Or la période de stagnation relative (la grande crise des années 1873-1896) qui précède la première guerre et se prolonge dans l’entre deux guerres, est de ce fait, un moment de financiarisation généralisée. J’entends par là que celle-ci n’est pas le fait d’un segment localisé géographiquement (comme le furent les villes italiennes et les Provinces Unies) mais celui de l’ensemble des sociétés du centre développé. Un phénomène analogue à celui qui se déploie de nos jours, à partir de 1980, associé ici encore à une stagnation dans l’expansion des systèmes productifs. Je reviendrai sur cette situation nouvelle plus loin, mais je répète ici ce que j’ai dit plus haut du contraste procès A-A’ / procès A-P-A’. Le premier est toujours signe de crise, c’est-à-dire de stagnation relative de P. Il donne toujours des résultats intenables à terme, parce qu’il accélère les inégalités d’une manière si rapidement désastreuse qu’il est remis en question par les luttes sociales et politiques, inévitables. La financiarisation est-elle néanmoins une étape « nécessaire ». J’entendrai par là qu’elle serait un moment nécessaire pour que se recristallisent les conditions d’une nouvelle étape d’expansion du système productif. C’est le discours que nous entendons répéter à satiété de nos jours : « l’ajustement structurel »
194
passerait nécessairement par la financiarisation. Je ne partage pas ce point de vue. Je dis au contraire que la financiarisation est un mode de gestion de la crise, non de préparation de son dépassement. Cette gestion, loin de créer les conditions d’une reprise, en éloigne l’horizon. Celle-ci se cristallise alors parfois ailleurs, mais relativement loin d’elle. La financiarisation de l’Europe de 1880 à 1945 ne l’a pas aidé à sortir de sa crise. C’est aux Etats-Unis, un peu à l’écart de cette financiarisation, désastreuse, que se sont cristallisées les forces du progrès industriel renouvelé. Assistera-ton aujourd’hui à un développement contradictoire analogue : les Etats-Unis, le Japon, l’Europe, entrainant derrière eux l’Amérique latine, l’Afrique, le Moyen Orient, s’installant dans à la fois la stagnation et la financiarisation tandis que l’Asie de l’Est, un peu à l’écart de cette dernière, deviendrait le lieu de la prochaine expansion du système productif ? Je discuterai cette hypothèse plus loin. Enfin pour conclure sur ce chapitre, au risque de nous répéter, j’appelle l’attention sur la différence qualitative qui sépare l’articulation contradictoire financiarisation-système productif dans les étapes mercantiliste et industrielle. A l’étape mercantiliste le commerce est moteur, son expansion crée les conditions d’une expansion de la production. A l’étape industrielle la causalité est inversée - n’en déplaise aux thuriféraires néolibéraux du GATT - c’est l’expansion de la production qui permet celle des échanges. A l’étape mercantiliste les profits tirés du commerce sont réinvestis tant que cela est possible (c’est-àdire tant que par ailleurs l’expansion de la production se poursuit) dans le commerce, et quand ils ne peuvent plus l’être, dans la financiarisation (qui s’accompagne alors de stagnation). A l’étape suivante les profits industriels sont réinvestis dans l’industrie et c’est lorsque cette opération perd sa raison d’être (sa rentabilité) que le repli financier s’impose, accompagné de stagna-
195
tion. Plutôt donc de « cycles de financiarisation » je préfère parler ici de phases d’accumulation spécifiquement différentes.
IV - Les enjeux de la mondialisation aujourd’hui : mondialisation débridée ou contrôlée ? 1) Si j’ai retenu la date de 1945 (ou de 1950) comme une date-tournant c’est parce que précisément les formes de la mondialisation qui se déploient dans l’après-guerre constituent une rupture qualitative avec celles qui prédominaient depuis 1880, par certains aspects depuis 1800 même. Je me suis suffisamment étendu sur les particularités de la phase 19451990 pour ne pas y revenir ici. Je rappelle donc seulement que j’ai attribué la forte croissance relative qui a caractérisé toutes les régions du monde pendant cette période à la nature des trois projets sociétaires sur lesquelles l’essor de l’après-guerre a reposé, à savoir : (i) le compromis historique capital-travail, géré dans le cadre de l’Etat national développé par la pratique du keynésianisme; (ii) le projet soviétiste dit de construction socialiste, autocentré et déconnecté du système mondial (que j’ai analysé dans les termes d’un projet de construction « d’un capitalisme sans capitalistes »); et (iii) le projet national bourgeois moderniste et développementaliste du tiers-monde (que j’ai qualifié de « projet de Bandoung » pour l’Asie et l’Afrique, reprenant l’expression de desarrollismo pour l’Amérique latine) inscrivant l’industrialisation des pays concernés dans une interdépendance mondiale négociée et révisée. Au delà des particularités évidentes propres à chacun de ces trois piliers du système monde de l’après-guerre, j’ai fait observer deux caractères qu’ils présentaient en commun. Le premier est que chacun de ces projets sociétaires s’écarte de l’économisme libéral extrême pour associer des tâches et
196
des objectifs d’efficacité économique (dans une interdépendance mondiale plus ou moins contrôlée) à l’affirmation d’un cadre social permettant de maîtriser les marchés. Cette affirmation, définie par des hégémonies sociales particulières à chacun des trois groupes de pays, procède donc d’un refus de l’idée que les marchés sont autorégulateurs et confirme la critique que K. Polanyi, après Marx et Keynes, adressent à l’utopie du marché. Le second est que la mise en œuvre des politiques et stratégies efficaces et convenables dans ce cadre, est conçue d’abord comme relevant de la responsabilité nationale, de l’Etat et de la société civile, même lorsque ces stratégies restent ouvertes sur l’extérieur bien entendu. L’hégémonie des Etats-Unis, que j’ai caractérisée plus haut, opérait dans ce cadre et avec les limites qu’il imposait donc. Sa dimension strictement économique - c’est-à-dire l’avance technologique des Etats-Unis - est rapidement érodée par son succès même, l’expansion des formes d’organisation de la « multinationale » reproduites en Europe et au Japon. Progressivement donc les trois autres aspects associés à cette hégémonie - le contrôle du système monétaire et financier mondial, la supériorité militaire, le déploiement culturel et linguistique de l'american-way-of-life - prennent une importance relative accrue. La première de ces nouvelles dimensions de la mondialisation s’épuise dans ses contradictions, conduisant, avec l’affaiblissement de la croissance, à la financiarisation stagnationiste qui s’établit à partir de 1980 (une autre date tournant donc). En effet l’élément dominant de la mondialisation se superposant aux politiques nationales désignées plus haut était représenté à l’origine par le système organisé des changes fixes et de l’étalon dollar. Les progrès de la construction européenne et l’essor du Japon ne pouvaient pas ne pas remettre en question cette facette de l’hégémonie
197
américaine, même si comme je l’ai écrit ailleurs, aucune alternative n’a pu être trouvée à l’étalon dollar et que la gestion de la crise, s’installant aux commandes à partir de 1980, a remis à plus tard la réponse à cette contradiction. La seconde - la militarisation du système - n’appelle guère de commentaires, tant elle est évidente. J’ai fait seulement remarquer que ce keynésianisme militaire a joué un rôle essentiel dans le maintien de la croissance forte, américaine et globale. Mais elle n’a pu devenir l’instrument le plus efficace de l’hégémonie américaine que lorsque l’adversaire soviétique a été abattu, c’est-à-dire alors que la période était elle même close. Il reste que cette nouvelle suprématie est sans pareille dans l’histoire : jamais auparavant dans l’histoire les armes en général et le pouvoir d’une puissance en particulier n’avaient permis d’envisager l’intervention militaire efficace - fut-elle destructrice au point extrême - à l’échelle de la planète entière. La troisième dimension de la mondialisation nouvelle, qui concerne les aspects culturels, pose dans des termes nouveaux des questions passablement anciennes. Le système monde tributaire était partagé entre des aires culturelles qui conservaient leurs caractéristiques propres; et on ne peut guère parler d’universalisme pour ces époques, en dépit de la dimension universaliste de principe des grandes religions et philosophies qui fondaient ces cultures. L’universalisme apparait en 1500, avec la Renaissance puis plus tard les Lumières, bien que dans la forme tronquée et déformée de l’eurocentrisme qui accompagne le façonnement inégal du nouveau système par son centre européen. Mais cet universalisme, appelé à fonder les valeurs du monde moderne -positives, comme la démocratie, ou négatives, comme l’aliénation économiste - ne gomme pas la diversité à l’intérieur de l’Europe. L’hégémonie britannique contrainte de s’accommoder
198
de l’équilibre européen, ne s’accompagne donc pas d’une expansion linguistique de l’anglais par exemple. Dans l’après deuxième guerre, en dépit du caractère marqué de l’hégémonie américaine, le contenu national fort des stratégies qui définissent l’époque maintient la conciliation entre l’universalisme - visible dans les trois projets sociétaires de la phase en question - et la diversité, politique et culturelle. La contradiction propre à la dimension culturelle de la mondialisation capitaliste n’a donc éclaté au grand jour que récemment. On l’attribue souvent à la puissance des médias modernes, responsable du rétrécissement du monde devenu un « village planétaire », comme on dit. Cette réalité ne doit certainement pas être gommée du tableau de la mondialisation. Mais elle ne fait que révéler ce qui était déjà là depuis longtemps : que les anciennes cultures (tributaires, y compris la ou les cultures européennes médiévales) ont bel et bien disparu, dissoutes par la culture capitaliste, définie par son contenu essentiel - l’aliénation économiste - et non par son origine et sa forme européenne. Néanmoins cette culture universelle capitaliste n’est jamais parvenue à établir à son bénéfice une légitimité universelle, parce qu’elle accompagne et sous-entend un système monde polarisé. L’accentuation de son affirmation -grâce aux médias modernes - jointe à l’aggravation de la polarisation après que les projets sociétaires de l’après-guerre aient épuisé leur potentiel ont fait surgir la « question culturelle » et des affirmations désespérées de recherche de l’identité dans le tiers-monde. La forme linguistique dominante de cette expression de la domination de la culture capitaliste, produite par l’hégémonie américaine, se heurte à des résistances en Europe même, particulièrement en France. Dans l’analyse que je propose pour le système de l’après guerre tant dans sa phase ascendante que dans celle de sa crise -toujours en cours - ni la structure du système dans son ensemble, ni celles de ses parties consti-
199
tuantes, ni une éventuelle hégémonie ne sont déterminés intégralement ou même principalement par la « compétition des firmes sur le marché » comme l’idéologie économiciste dominante le prétend. Ces structures ne concernent pas le niveau médian au sens braudélien considéré en lui même; avec Marx, Polanyi, Braudel et d’autres je les considère comme le produit simultané du fonctionnement des deux niveaux médian et supérieur. La compétition est autant celle qui oppose les Etats que les entreprises puisque le capitalisme est inséparable de l’Etat moderne; ils ont pris consistance et se sont développés simultanément et commandent ensemble les structures de l’accumulation. Dans cet esprit, comme l’écrit Arrighi, si le territorialisme consiste à agrandir la sphère dominée par un capitalisme particulier (une composante du système mondial), il existe simultanément des modes d’action qui permettent la densification de l’accumulation dans une zone restreinte (le contrôle du commerce, de l’innovation technologique, la supériorité militaire, le rayonnement culturel, la financiarisation sont ces modes d’action). La combinaison variable de ces deux modes d’opération de l’accumulation explique pourquoi des petits Etats (les villes italiennes, les Pays-Bas) sont parvenus à occuper une grande place dans le système monde (mais à mon sens n’ont jamais été hégémoniques), pourquoi des grands Etats n’y sont pas parvenus et se sont même souvent effondrés, tandis que l’hégémonie reste l’exception de ceux qui ont articulé efficacement ces deux modes. Comme l’écrit Vergopoulos ce qui paraît être une compétition entre firmes est largement une compétition entre systèmes nationaux à partir desquels ces firmes prennent leur essor (ces systèmes façonnent des capacités productives commandées par les niveaux de formation des travailleurs et bien d’autres choses sans lesquelles la compétitivité marchande ne pourraient exister).
200
L’économique est inséparable du politique. Les événements de tous les jours le confirment d’une manière plus qu’évidente. On a du mal par exemple à imaginer le Japon devenant hégémonique, en dépit de l’efficacité de ses entreprises, compte-tenu de sa vulnérabilité militaire et de son absence de rayonnement culturel. Ainsi a-t-on vu les excédents financiers du Japon prêtés aux Etats-Unis et leur service remboursé en dollars dévalués à partir de 1985, l’opération se soldant donc par une énorme ponction transférant ce surplus du Japon à son concurrent (Arrighi). Ainsi voiton le déficit de la balance extérieure des Etats-Unis absorber l’excédent des capitaux à l’échelle mondiale, asséchant les moyens que les nations du tiers-monde tentent en vain d’attirer vers elles pour participer à leur propre développement. On a même vu les pétroliers riches du Golfe contraints de financer leur conquête militaire par Washington ! Il y a peu d’espoir que les placements financiers de ces pays sur les marchés extérieurs puissent jamais être récupérés. Par contre pendant les deux guerres mondiales les Etats-Unis ont renversé leur position financière - de débiteur à créancier - en s’appropriant effectivement les avoirs de leurs concurrents (Grande-Bretagne, France et autres). Le système mondial est donc structuré par ces rapports inter-états autant que par le jeu des concurrences marchandes des firmes. Il tend peut être même à l’être de plus en plus. Par exemple tandis que les systèmes monétaires antérieurs (l’étalon Sterling par exemple) étaient largement gérés par la haute finance privée, Bretton Woods place la « production de monnaie » sous le contrôle d’un réseau d’agences gouvernementales y compris de statut international (le FMI), elles mêmes chapeautées par le Federal Reserve System. Il est vrai que ce mouvement d’étatisation croissante peut être inversé. Il l’a été en l’occurrence à partir des années 19681973 lorsque les eurodollars autonomisent à nouveau les flux financiers,
201
prélude à la grande reprivatisation sur la base de laquelle la financiarisation actuelle a décollé (à partir de 1980). Mais comment ne pas observer que ce retournement correspond à un affaiblissement politique des EtatsUnis, leur défaite au Viêt-Nam, encourageant le tiers monde à prendre l’initiative de l’offensive dont l’OPEC a été l’exemple le plus illustre ? Comment aussi ne pas observer que le succès de la contre-offensive américaine visant à rétablir leur hégémonie est fondé en grande partie sur leur suprématie militaire (face au succès de la Guerre du Golfe, à l’effondrement soviétique, les Européens par exemple ne démontrent-ils pas chaque jour qu’ils ne peuvent rien faire, ni en Yougoslavie ou dans l’ex-URSS ni même en Somalie, sans les Etats-Unis ?) C’est grâce à cette supériorité que les Etats-Unis sont parvenus à imposer l’étalon dollar, en dépit du déclin de leur efficacité marchande. La relation firmes-Etats n’est cependant pas linéaire, elle fonctionne dans les deux sens, dans certaines phases en dominance dans une direction, dans d’autres phases dans l’autre. Par exemple dans l’impérialisme de l’époque de Lénine les « monopoles » sont bien par certains aspects les instruments d’expansion des Etats, comme le seront les firmes multinationales américaines après la seconde guerre mondiale. Dans la phase actuelle par contre, à partir de 1970 environ, ces firmes s’émancipent des pouvoirs d’Etat et en limitent l’efficacité des interventions. Est-ce là une caractéristique structurelle de la mondialisation nouvelle, apte à se stabiliser comme telle ? ou est-ce là une caractéristique conjoncturelle de crise ? L’institutionnalisation de l’organisation du système mondial n’est pas chose tout à fait nouvelle. Je partage ici le point de vue général de l’école du système-monde qui y voit une caractéristique essentielle du capitalisme historique (celui que j’appelle le capitalisme réellement existant, par
202
contraste avec le capitalisme-idéal type de l’imaginaire idéologique). Du traité de Westphalie (1648) qui en fixe les premières règles, renouvelées au Congrès de Vienne (1815) et au traité de Versailles (1919) -qui fait un pas de plus dans la voie de l’institutionnalisation en créant la S. D. N. - puis et surtout à la création de l’O. N. U. (1945), cette institutionnalisation est en progrès constant. Quand elle paraît paralysée par l’incohérence des politiques, que la crise aiguise, comme aujourd’hui, depuis 1980, ne voit-on pas immédiatement apparaître la tentative de surmonter ces incohérences ? Le G7 n’a-t-il pas cette fonction ? Même si, comme je l’ai proposé dans mon analyse de la gestion de la crise, les disfonctionnements sont tels que l’instrument paraît bien être incapable de relever le défi. La phase de l’après-guerre n’est évidemment pas homogène, constituée d’une phase ascendante (1945-1968), puis de crise longue (à partir de 1971), si l’on fixe l’attention sur les rythmes de la croissance. La sous-période de transition 1968 (événement politique majeur) - 1971 (suppression de la convertibilité or du dollar) s’impose. La financiarisation décolle plus tard, vers 1980, en conjonction avec une transformation politique que Reagan et Thatcher inaugurent. Les années 1985-1990 constituent une autre coupure (l’effondrement du soviétisme) comme les années 1975 (le projet de « Nouvel Ordre International » proposé par le tiers-monde) 1982 (première crise financière du Tiers-Monde, éclatée au Mexique) marquaient la fin du projet de Bandoung et l’offensive de recompradorisation des périphéries. Il reste difficile, à mon sens, de préciser le statut exact de ces dates tournantes; les événements sont trop proches pour qu’on puisse voir, avec suffisamment de recul, leur signification profonde. Définissentelles donc la fin d’une longue phase (1800-1950) ? Ou seulement le passage d’une sous-phase à une autre ? Le jugement qu’on devra se faire
203
concernant les avenirs possibles dépend des réponses qu’on donnera à ces questions, à travers l’analyse de la crise et de sa gestion. 2) Quoiqu’il en soit la mondialisation « contrôlée » de la phase 1945-1990 est aujourd’hui dépassée par l’épuisement de la phase d’accumulation qui la sous-tendait. J’ai tenté d’analyser ailleurs, avec quelque détail, les processus par lesquels l’érosion, puis l’effondrement, des trois piliers sur lesquels reposait cette phase d’accumulation révolue a conduit à la crise actuelle. Dans cet esprit j’ai cru utile de mettre l’accent sur les caractères nouveaux du système productif - en passe de devenir mondialisé (par opposition à internationalisé) et sur la contradiction nouvelle qui surgit de ce fait, produite par la mondialisation de l’espace de l’accumulation nouvelle alors que les espaces de sa gestion politique et sociale restent limités par les frontières politiques des Etats. Il n’est pas dit qu’une mondialisation économique débridée - que prône l’idéologie néolibérale extrême - puisse s’imposer et vaincre les résistances du politique, contraint de s’y soumettre - on dit « s’ajuster ». Au contraire j’ai développé la thèse que cette forme nouvelle de l’utopie économicisme du capitaliste était vouée à l’échec. Ne parvenant donc pas à créer les conditions de la mise en place d’un nouveau système d’accumulation, la mondialisation débridée que les pouvoirs en place tentent d’imposer réduit en fait les politiques économiques au statut de politiques de gestion de la crise. J’ai proposé de lire l’ensemble des « recettes » mises en œuvre - la libéralisation sans frontières, la mondialisation financière, les changes flottants, les taux d’intérêts élevés, le déficit de la balance extérieure des Etats-Unis, la dette extérieure des pays du Sud et de l’Est, les privatisations -comme un ensemble parfaite-
204
ment cohérent de mesures de gestion de la crise, offrant aux capitaux en excédant n’ayant pas de débouché rentable dans l’expansion du système productif celui de placements financiers, évitant de la sorte la dévalorisation massive de ces capitaux. Il s’agit donc d’un procès de financiarisation massive, le procès A-A’ en expansion se substituant au procès A-P-A’ en panne. La financiarisation contemporaine est donc, une fois de plus, le signe de crise de l’accumulation. Elle n’en est pas la solution. Cependant, par son caractère tout à fait généralisé, embrassant le système mondial dans tous les segments qui le composent, la financiarisation acquiert de ce fait une dimension nouvelle, sans précédent. Quel avenir pourrait alors se dessiner derrière le rideau de fumée qu’elle dégage ? Quel nouveau système d’accumulation se met - ou ne se met pas - en place ? Nous sommes ici dans un domaine où toutes les hypothèses - ou presque - sont possibles, tous les scénarios imaginables, tant l’avenir est incertain et les éléments de connaissance concernant la recomposition du monde fragiles. L’avenir de la mondialisation reste une grande inconnue. Trois approches peuvent être - et sont - mises en œuvre pour explorer cet avenir incertain. La première - à la mode - se fonde sur les théories du chaos. Il n’y a pas de doute que le progrès dans les mathématiques des fonctions non continues a permis de découvrir la possibilité que des différences minimes dans les paramètres de certaines de ces fonctions entrainent des différences gigantesques dans leur déploiement ultérieur. Cette découverte heurte certainement l’intuition spontanée, selon laquelle de petites différences au départ ne peuvent engendrer de grandes différences dans l’évolution. Les fonctions chaotiques expliquent des phénomènes naturels qu’on ne pou-
205
vait expliquer autrement. Est-ce à dire que ces découvertes peuvent aussi intéresser la science sociale ? Sans doute des fonctions de ce type pourraient elles contribuer à l’analyse de phénomènes économiques et sociaux partiels, présentant de grandes analogies avec d’autres phénomènes naturels. On conçoit que les marchés spéculatifs par exemple présentent des structures chaotiques de nature analogue ou voisine. Mais je reste de l’opinion philosophique que le mouvement d’ensemble de la société ne peut pas être étudié à l’aide d’un outillage conceptuel de ce modèle. La philosophie de l’histoire, le matérialisme historique entre autre, restent irremplaçables. La seconde approche est celle des historiens du capitalisme, notamment dans le courant du système-monde, qui mettent l’accent soit sur les récurrences, soit sur la flexibilité de ce système, soit - en général - sur les deux. J’ai quelque réserves sur ce plan, ayant préféré mettre l’accent sur ce qui est nouveau qualitativement après chaque date tournant, reléguant donc les récurrences au statut d’apparences, souvent donc trompeuses, et rejetant de ce fait l’idée de « cycles ». Or le fait est qu’aucun avenir n’a jamais pu être prédit correctement au moment des tournants décisifs qui paraissent tels a posteriori seulement. Pouvait-on espérer qu’un marchand de Venise en 1350 ait pu répondre à la question : êtes-vous en train de construire le capitalisme ? Il me semble donc que si 1990 (ou 1980) constitue une nouvelle date tournant - et c’est là mon intuition, rien de plus - il est bien difficile de savoir comment le monde se recomposera à partir de cette date. Il faut pourtant tenter de le faire, parce que l’action nécessaire pour façonner l’avenir - le propre de l’être humain - l’impose. Quitte à risquer l’erreur.
206
Je mettrai donc en œuvre à cet effet une méthode que je crois toujours « non dépassée », celle du matérialisme historique. Je tirai la conclusion de l’examen a posteriori de la phase 1945-1990 que l’ancienne forme de la polarisation (le contraste centres industrialisés / périphéries qui ne le sont pas, dominant de 1800 à 1950) avait été précisément dépassée progressivement par l’industrialisation des périphéries - l’Est et le Sud -quelqu'inégale que celle-ci ait été. Dans ces conditions la loi de la valeur mondialisée définie pour la phase 1800-1950 doit être révisée en fonction de cette transformation qualitative. Je l’ai fait en proposant un cadre nouveau pour son opération, défini par ce que j’ai appelé les cinq monopoles fondant les formes nouvelles de la polarisation (les monopoles financiers, technologiques, dans le contrôle des ressources du globe, des media, des armements de destruction massive). J’y renvoie donc le lecteur. Cela étant il n’est pas dit que la structure nouvelle d’un système mondial polarisé fondé sur la mise en œuvre efficace de ces cinq monopoles puisse être effectivement construite. Tous les problèmes associés à l’avenir de la recomposition (ou décomposition) de l’ex-URSS, de l’essor de l’Asie de l’Est (Chine en premier lieu), de la stagnation du monde occidental et de ses appendices américains et africains, de la recomposition (ou de l’échec) de l’Union Européenne, trouvent ici leur place. Il n’est pas de mon intention de revenir ici sur l’ensemble des évolutions qui ont conduit le système de l’après-guerre à sa crise, ni sur les interprétations diverses de ces événements. Je renverrai plutôt le lecteur ici à quelques-uns des ouvrages majeurs sur le sujet, notamment à François Chesnais (La Mondialisation du capitalisme, Syros 1994), Giovanni Arrighi (The Long XXth century, Verso 1994), Michel Beaud (L’économie mondiale dans les années 80, La Découverte, 1984), aux articles de Kostas Vergopou-
207
los. Je partage trop largement les points de vue d’ensemble développés dans ces travaux pour estimer utile d’en répéter les arguments. J’y ajouterai seulement mes propres ouvrages sur la question : L’Empire du chaos, La gestion capitaliste de la crise. Le point de vue adverse - la défense de la financiarisation - est développé ad nauseam dans la littérature dominante. Dans ce registre le seul ouvrage auquel je voudrais faire référence ici, dont l’argumentation fine pose des questions réelles qu’on ne peut ignorer, est le livre d’Olivier Pastré (Les nouveaux piliers de la finance, La Découverte 1992), auquel j’ajouterai quelques articles de Michel Aglietta. S’il fallait donc simplement rappeler brièvement ce qui me parait être des acquis solides de la réflexion sur les caractéristiques importantes nouvelles du système de l’après-guerre je signalerai ici : i)L’approfondissement indéniable de l’interdépendance non seulement - au-delà des échanges commerciaux - dans l’organisation des procès de production, mais encore son extension à des domaines jusque-là plus éloignés de ceux-ci, comme les services. Cependant si la tendance est bien au démantèlement de la cohérence des systèmes productifs nationaux sur la base desquels le capitalisme historique avait été construit, on est loin, comme Vergopoulos le note, de leur avoir substitué la cohérence d’un système productif mondialisé. Aussi faut-il prendre conscience que, de ce fait, la mondialisation telle qu’elle est aujourd’hui reste fragile, vulnérable et que si son évolution n’est pas maîtrisée par la mise en place d’un cadre social progressiste capable d’opérer avec efficacité et cohérence à tous les niveaux, du national au mondial, des régressions de toutes natures sont non seulement possibles, mais encore probables. Loin de conduire à une sorte de super impérialisme intégré à la Kautsky la mondialisation accuse les conflits potentiels, décompose et recompose le paysage dans lequel les Etats et les firmes se confrontent. On peut se demander si le capitalisme sera capable de
208
faire face à ce défi. ii)L’apparition de formes nouvelles de l’organisation de l’entreprise et de son rapport à son environnement économique : la sous-traitance sous des formes multiples, le leasing ont enrichi la gamme des stratégies de firme comme on ne l’avait jamais vu jusqu’ici. Plus tard dans la phase de l’après-guerre, avec la crise et la financiarisation, cette transformation du potentiel des options stratégiques des firmes a réduit la portée de la distinction jusqu’alors bien établie entre les agents financiers et les agents industriels. Les firmes développent des stratégies mixtes, productives et financières. C’est là une des dimensions majeures de ce que je qualifie de financiarisation généralisée. iii)Les tendances fortes mises en mouvement par les évolutions qualitatives signalées ici opèrent comme des forces excluant, allant de l’exclusion à l’intérieur même des sociétés les plus riches (sociétés à « multiples vitesses ») à l’exclusion à l’échelle mondiale de pans continentaux entiers du système-monde (comme la « quart mondialisation » de l’Afrique). Face à ces défis nouveaux, les pouvoirs dominants n’ont apporté que des réponses qui en aggravent les conséquences négatives. Avec l’érosion des trois modèles d’encadrement du marché (local et mondial) de l’après-guerre, que j’ai analysés ailleurs (cf Les conditions d’une relance du développement) en la qualifiant d’épuisement de l’idéologie antifasciste, les conditions ont été recréées pour que le capital dominant tente d’imposer la logique unilatérale utopiste de la « gestion du monde comme un marché », par l’ensemble des politiques de dérégulation à la mode. Comme on l’a dit la mondialisation sert à démanteler les contrats sociaux nationaux produits par des siècles de luttes sociales sans leur substituer un contrat social de portée mondiale ou même régionale (à l’échelle de l’Union européenne par exemple).
209
Comme moi même (cf La gestion de la crise) et d’autres (par exemple Chesnais) l’ont abondamment écrit, cette réponse qui n’en est pas une a conduit à la financiarisation globale. La dépression s’exprime dans la croissance gigantesque d’un surplus de capitaux qui ne trouvent pas de débouché rentable dans l’expansion du système productif. La préoccupation majeure - peut être exclusive - des pouvoirs en place est alors de leur trouver des débouchés financiers, pour éviter la catastrophe (pour le système) de leur dévalorisation massive. J’ai proposé de retrouver dans cet esprit la cohérence d’ensemble des politiques mises en œuvre aux échelles nationales et mondiales : les privatisations, les dérégulations, les taux d’intérêt élevés, les changes flottants, les politiques américaines de déficit extérieur systématique, l’endettement du tiers-monde etc. Je n’y reviens donc pas. A son tour cette financiarisation globale enferme dans une spirale de régression. Par son mouvement propre le système donne au capital-financier-rentier la possibilité de faire prévaloir son intérêt particulier sur tous les intérêts généraux, quelqu’en soit le coût pour l’économie -nationale et mondiale. L’inégalité fabuleusement croissante dans les répartitions du revenu, à tous les niveaux du local au mondial, produite par la ponction croissante de la rente financière sur un produit relativement stagnant, exprime toute l’irrationalité du système. Les contrefeux proposés pour « limiter les dégâts » sont-ils efficaces ? Le principal de ces contrefeux semble être la régionalisation dont les vertus sont mises à la mode par les médias, qu’il s’agisse de l’incontournable construction européenne ou d’autres initiatives (ALENA, projet Asie-Pacifique etc.). J’ai proposé une lecture critique de ces projets à laquelle je renvoie. Concernant le projet européen il m’est apparu qu’il entrait désormais dans une zone de turbulence qui pourrait remettre en question sa progression, non seulement par
210
suite du déséquilibre interne créé par l’unification de l’Allemagne, mais encore et surtout parce que, conçu par la droite, le projet européen reste un projet de marché intégré sans dimension sociale susceptible de mettre en place à l’échelle de l’Union européenne l’équivalent de ce que furent les compromis historiques nationaux capital-travail. Dans le même esprit j’ai proposé des lectures critiques des projets d’intégration par le marché propres à d’autres régions du monde (cf Les conditions d’une relance du développement). L’avenir est donc bien incertain. 3) Pour explorer les alternatives concernant cet avenir incertain, en conclusion de ce débat sur la mondialisation, il me paraît nécessaire de revenir sur la question centrale de méthode définie dès le départ de notre propos : la question de la loi de la valeur et du rapport loi économique du système capitaliste / fonctionnement de son politique. La loi de la valeur considérée à son niveau le plus élevé de l’abstraction ou au niveau d’abstraction définissant le statut de sa forme mondialisée, opère au niveau médian dans le langage de Braudel, (c’est-à-dire dans le cadre du marché). Dans la conceptualisation de Marx elle définit la dominance de l’économique, qu’elle ne sépare pas du social, politique et culturel, mais qu’elle domine néanmoins. La loi de la valeur ne commande pas seulement la vie économique du monde capitaliste, elle y commande tous les aspects de la vie sociale, ai-je dit. Elle plonge donc ses racines dans le niveau élémentaire de Braudel, qu’elle façonne, et se projette au niveau supérieur du pouvoir. Mais domination d’une instance ne signifie pas suppression des autres. Sans quoi le monde serait effectivement réductible au « marché » (ou aux firmes et au marché), ce que l’idéologie dominante propose et encense. Le système des prix, qui commande la répartition de la richesse, est nécessairement différent du système des valeurs. Non pas
211
seulement du fait des imperfections du marché, mais essentiellement du fait de l’interférence marché-pouvoir, niveau médian - niveau supérieur, instance économique - instance politique. Parce que cette dialectique ne les intéresse pas, tous les empiristes de tempérament ignorent la valeur, ne veulent pas y voir autre chose que du brouillard qui cache la seule réalité qu’ils veulent connaître - l’immédiate. Le livre d’Arrighi nous donne des exemples éclatants de la distance qui sépare la production de la valeur de la répartition de la richesse dans l’histoire. Il décortique le système et nous fait comprendre alors pourquoi et comment l’Allemagne industrialiste n’arrache pas son opulence à l’Angleterre financière, comment plus tôt les villes italiennes et les Pays-Bas avaient accaparé la richesse mondiale, comment plus tard les Etats-Unis font face avec succès aux offensives du Japon etc. Dans une étude concernant la mondialisation de l’industrie de la chaussure Grefferi et Korzeniewiez montrent que la part qui revient aux producteurs - délocalisés - est fragile au regard de celle qu’accaparent les « marchands de renommée » (les marques de fabrique qui dominent les circuits commerciaux). Quel bel exemple de la distance entre la répartition de la valeur, créée par les producteurs, et celle de la richesse, commandée par les prix, les profits et les rentes ! J’ai moi même, dans l’analyse que j’ai proposée de « l’avenir de la polarisation » exprimé l’idée que par le moyen des cinq monopoles du centre (technologie, finances, accès aux ressources, culture, armements) l’industrialisation des périphéries pourrait ne se solder que par un approfondissement de la polarisation de la richesse. Or les cinq monopoles en question sont d’évidence des expressions du pouvoir - politique et social, culturel et idéologique - non du marché.
212
J’envisagerai alors d’explorer les possibilités concernant l’avenir en mettant en œuvre ce système conceptuel, que je crois constituer l’essentiel du projet de matérialisme historique (non économiciste). Il y aurait alors deux scénarios possibles, extrêmes à leur manière, ou plus exactement deux familles de scénarios présentant une gamme de modalités diverses au sein de chacune d’elles. Il y aurait aussi, naturellement, le métissage possible, le plus probable dans l’histoire réelle. Le mauvais scénario est celui qui prolongerait le système dominant tel qu’il est, ou à peu près, et s’accommoderait de variantes seulement partiellement correctives. La caractéristique majeure est ici que les entreprises (le capital) s’émanciperaient du pouvoir qu’elles parviendraient à instrumentaliser ou au moins à neutraliser. Arrighi rappelle ici que les multinationales d’aujourd’hui échappent à la loi des Etats comme les rapports marchands dans les foires du Moyen-âge échappaient aux lois féodales locales. Je crois pour ma part qu’un tel ordre n’est pas durable parce qu’il ne génère que le chaos (titre de mon livre) et que ses effets sont si désastreux qu’ils ne peuvent pas ne pas entraîner des réactions sociales suffisamment fortes pour y mettre un terme. Sur le ton de la polémique, je reprendrai donc les termes mêmes d’Arrighi : si cette gestion doit marginaliser des continents entiers, réduire à la misère la majorité de l’humanité, qu’est-ce qui est superflu (« redundant ») : les peuples ou les lois du capital ? Les modalités d’un tel schéma de chaos durable peuvent être facilement imaginées : le repliement sur la triade (Amérique du nord, Europe, Japon) et l’apartheid généralisé, assaisonnée de génocides pratiqués de temps à autre pour maintenir l’ordre, sécuriser les nantis et protéger leurs forteresses. Mais
213
même dans ce cas extrême, la triade ne serait-elle pas appelée à son tour à s’entredéchirer ? La permanence d’une sorte d’hégémonie - et on ne voit pas laquelle serait imaginable en dehors de celle des Etats-Unis - serait nécessaire, si l’on veut éviter le conflit intra-triade, et même le renouveau de conflits intra-européens. La règle du « chacun pour soi » ne crée pas par elle même le compromis et l’harmonie, mais plutôt leur contraire. Le schéma dessiné ici constituait bien le rêve de Reagan. Dans un temps record il paraît déjà relever du passé; une « belle époque » de courte durée comme l’écrit Arrighi. Une modalité possible dans ce cadre serait celle de l’installation de l’Occident dans ce confort illusoire à terme, tandis que l’Asie orientale poursuivait sa progression, un peu à l’écart de cette forme saugrenue de la mondialisationexclusion. L’Asie orientale en question inclurait peut-être le Japon, « retourné à ses sources », assis sur son avance technologique, qui se réarticulerait alors sur la Chine et quelques autres pays industrialisés de la région. Ou bien le Japon resterait dans la sphère de la triade occidentale, parce que la Chine poursuivrait sa progression sans chercher à s’intégrer dans la sphère japonaise. Quant au projet des Etats-Unis d’intégrer les uns et les autres, c’est-àdire le Japon, la Corée etc. dans leur sphère rénovée sous le nom d’Asie-Pacifique, il ne dépasse pas le stade des vœux pieux à mon avis et ne pourrait opérer en fait que comme une force supplémentaire séparant la Chine du Japon. Dans tous les cas où conduirait l’industrialisation nouvelle de l’Asie (audelà de l’Asie orientale, l’Asie du Sud-est et l’Inde) ? Nous retrouvons ici la loi de la valeur, les cinq monopoles et la polarisation nouvelle, si cette Asie reste dans le système mondialisé. Ou bien elle s’en isole - même relativement - c’està-dire déconnecte au sens que j’ai donné au terme. Pas impossible. Dans tous ces schémas il y a tout de même trop de laissés pour compte pour croire en la solidité des structures qu’ils véhiculent. Les Africains, les Arabes et
214
les Musulmans, les latino-américains devraient bien, un jour ou l’autre, découvrir les moyens de rappeler efficacement leur existence. Les Européens et les nord Américains, qui n’ont pas prouvé dans l’histoire être des moules inertes, qui ne sont dénués ni de sens de l’initiative ni de générosité, n’accepteront pas davantage, à mon sens, le sort que le schéma d’un nouveau Moyen-âge leur réserverait, et surtout réserverait à leurs propres classes populaires, fatalement progressivement elles aussi exclues du confort. Mais si la gauche n’est pas présente pour les mobiliser autour d’un programme d’étape crédible et possible, leur révolte peut les faire dévier à droite, vers un néofascisme. C’est aussi déjà arrivé dans leur histoire. On ne peut donc pas éluder la question politique concernant les stratégies d’étape qu’il faut développer pour faire face au défi. La mondialisation implique que si le problème est mondial, sa solution doit l’être aussi. Reconnaître ce fait est une chose, préconiser la soumission passive aux exigences de la mondialisation dans la forme où elle s’impose, en attendant... Godot (la « révolution mondiale » ? l’achèvement du progrès miraculeux qu’elle véhiculerait à terme ?), est tout autre chose. Ma thèse est simple : la mondialisation avance progressivement, mais selon les modalités diverses que les luttes sociales et politiques lui imposent. Elle peut donc être mise sur des rails conduisant progressivement à la solution des problèmes qu’elle pose, ou sur d’autres conduisant à l’impasse et aux désastres. Le propre de la stratégie politique est de s’emparer des marges d’action possibles, si minces soient-elles, pour élargir l’espace d’autonomie des choix futurs. Dans cette perspective pourrait-on définir l’étape immédiate à venir en acceptant certains des aspects du libéralisme en cours, voire même de la financiarisation ? Sans renoncer pour autant à l’objectif lointain défini en termes de l’utopie créatrice du socialisme mondial ? G. Arrighi et O. Pastré
215
paraissent l’un et l’autre, en termes différents, l’imaginer. Le premier en insistant sur le caractère récurrent des moments de « libéralisation » (au sens de l’affaiblissement de l’efficacité étatiste), de mondialisation, voire même de financiarisation laquelle, même si elle est associée d’un certain point de vue à la crise du système (d’une phase d’accumulation qui a épuisé son potentiel), est aussi, d’un autre point de vue, une transition nécessaire vers une autre phase d’accumulation. Le second en plaçant l’accent sur les recompositions sociales progressistes possibles qui pourraient non seulement s’accommoder des structures nouvelles qui se profilent derrière la financiarisation mais même mobiliser celle-ci au bénéfice d’un contrat social renouvelé. Je prends tout à fait au sérieux cet argument libéral d’apparence, mais tout autant social (au sens sérieux de progressiste socialement). Pastré imagine ici - pour la France - un contrat social encadrant l’intervention financière décisive des « investisseurs institutionnels » (les fameux « zinzins » que constituent les fonds gérant l’épargne statuaire, la sécurité sociale et les retraites etc.), et l’action du capitalisme privé et des entreprises publiques et mixtes. Prenant la relève des formes du contrat social propre à la régulation dite fordiste (syndicats ouvriers, patronat et Etat), cette dialectique sociale renouvelée garantirait le succès dans la compétitivité, grâce entre autre à la place qu’elle pourrait assurer au progrès de l’éducation et de la recherche. Je ne verrais pour ma part aucune objection de principe à opposer à ce projet d’étape, que je qualifierais de « nouvelle social-démocratie » (laquelle, comme toute social-démocratie peut se concevoir elle même comme une fin en soi, ou comme une étape vers l’objectif socialiste plus lointain). Mais je crois utile de préciser les conditions de son succès, qui sont loin d’être réunies. A l’échelle même de la France - puisqu’il s’agit de ce pays, objet de la réflexion en question - le projet implique des évolutions politiques et idéologiques qui
216
ne sont pas celles qui se dessinent dans le chaos actuel. De surcroit, acceptant l’insertion dans la construction européenne, le projet implique des évolutions analogues à l’échelle de tous les partenaires principaux de celle-ci. La nouvelle social-démocratie doit être européenne, ou ne pas être. C’est ce que j’appelle donner au projet européen la dimension sociale qui lui manque, et dont la stratégie produite spontanément par le capital dominant ne veut pas. Cette contradiction est, à mon avis, tout à fait capable d’enliser la construction européenne et finalement de briser les espoirs placés en elle. Par ailleurs le projet dessiné par Pastré, acceptant la mondialisation dans son principe, implique à son tour l’organisation des rapports entre l’Europe et les autres partenaires du système monde (les Etats-Unis, le Japon, les gigantesques périphéries des trois continents) qui soutiennent le déploiement de sa logique socialement progressiste et non pas qui en minent les chances. C’est ce que j’appelle la construction d’un monde pluricentrique, laquelle appelle une réorganisation des marchés mondiaux de capitaux capable d’en orienter les placements en direction de l’expansion des systèmes productifs. Or cette réorganisation entre en conflit avec les principes de la financiarisation débridée telle qu’ils sont à l’œuvre. A mon avis, qu’on le veuille ou non, cette financiarisation - liée à la crise de l’accumulation, et même largement produite par elle -ne prépare pas par elle-même la sortie de la crise, mais au contraire en approfondit les contradictions. De la même manière cette réorganisation implique la négociation des parts de marché ouvertes aux industrialisations nouvelles des régions périphériques. Elle entre donc en contradiction avec les principes qui, au nom du libéralisme, protègent en fait les monopoles en place, hostiles aux changements. Enfin elle implique une réorganisation des systèmes monétaires, qui est en conflit, qu’on le veuille ou pas, avec les principes sur la base desquels fonctionne la financiarisation en place (les changes flottants, la libéralisation financière à l’échelle mondiale etc.). L’ensemble des
217
réorganisations que le succès même du projet de Pastré impliquerait constitue ce que j’appelle la construction d’un monde polycentrique. A cause des difficultés gigantesques auxquelles ces réorganisations nécessaires se heurtent dans le monde actuel, je crois que l’aspect « financiarisation mode de gestion de la crise » l’emporte sur les dimensions potentielles qui lui permettraient de devenir le moment d’une transition vers un mode d’accumulation plus progressiste socialement, localement et mondialement. Alors ? La perspective d’un autre système social, sacrifiant la sacro sainte propriété privée, d’une autre mondialisation, refusant la polarisation, reste la seule alternative humaine. L’achèvement du projet n’est certainement pas pour demain, et pourrait paraître si éloigné qu’on le qualifiera aisément d’utopique. Je ne suis pas de cette opinion. Je crois même qu’on peut déjà dessiner les lignes directrices de politiques qui constitueraient une première étape dans cette longue marche. J’ai qualifié cette étape de construction d’un monde polycentrique permettant de reconstruire des contrats sociaux progressistes encadrant la gestion du marché. Il s’agit d’une vision de la « transition au socialisme mondial » bien différente de la perspective traditionnelle des Internationales successives. J’y renvoie le lecteur. L’histoire n’est pas façonnée unilatéralement par la loi de l’accumulation. Son cheminement est façonné par le conflit entre cette loi et la logique de sa négation.
Bibliographie i)
Cette étude fait directement référence aux thèses développées dans les chapitres I, III et IV. Voir également : – L’Empire du chaos, L’Harmattan 1991, particulièrement chap. I et II.
218
– Iténaire intellectuel, L’Harmattan, 1994; particulièrement les chapitres 7 (la critique du soviétisme) et 8 (la théorie de la régulation). – La gestion capitaliste de la crise, L’Harmattan 1995; particulièrement première partie (la gestion mondiale de la crise, Banque Mondiale, FMI, GATT) et troisième partie (les conditions d’une relance du développement). – S. Amin, P. G. Casanova et all, Mondialisation et Accumulation, L’Harmattan, 1993, particulièrement Introduction et Conclusion. – S. Amin, L'Eurocentrisme, Economica-Anthropos, 1988. – S. Amin, L’Ethnie à l’assaut des Nations, L’Harmattan 1994. ii) Cette étude est dans une large mesure un dialogue avec quelques auteurs dont les ouvrages récents me sont apparus importants dans l’analyse de la mondialisation et des défis qu’elle constitue. En particulier : – Giovanni Arrighi, The Long XXth Century, Verso 1994. – François Chesnais, La Mondialisation du capital, Syros 1994. – Michel Beaud, L’économie mondiale dans les années 1980, La Découverte, 1989. – Olivier Pastré, Les nouveaux piliers de la finance, La Découverte 1992. Par ailleurs des références implicites sont faites dans le texte à de nombreux auteurs de l’école du système monde (une bibliographie de ces écrits est donnée aux chapitres I et III, à des études relatives au rôle des institutions de Bretton Woods (bibliographie rappelée dans La gestion capitaliste de la crise), à des articles de Kostas Vergopoulos et de Michel Aglietta (publiés entre autre dans Marx-Actuel et dans Futur Antérieur). J’ai fait également fait référence à :
219
– Paul Bairoch, Mythes et Paradoxes de l’histoire économique, La Découverte 1994. – Otto Kreye, Folker Fröbel, Jürgen Henrichs, The New International Division of Labour, Cambridge U. Press, 1980. – Gary Grefferi and Miguel Korzeniewiez, Commodity Chains and The Footwear Industry, in, N. G. Martin (ed), Semi-periphery State in the World Economy, Greenwood Press. – Jacques Marseille, Empire colonial et capitalisme français, Albin Michel 1984. Les références à Marx, Braudel et Karl Polanyi (La Grande Transformation, 1944), n’ont pas besoin d’être davantage explicitées.
220
Chapitre VI L’Europe au défi L’après deuxième guerre mondiale a été une période faste dans l’histoire de l’Europe occidentale. En quelques décennies les pays qui la composent gommaient les retards qu’ils avaient accumulés depuis 1913 pour rattraper comme on dit - les Etats-Unis, jusque là bénéficiaires exclusifs des deux guerres mondiales. Les haines nationales ancestrales paraissaient même devoir disparaître pour faire place avec la nouvelle génération à un sens commun de l’européanité démocratique. Dans cette perspective la construction progressive de la Communauté Economique Européenne semble bien avoir rempli avec efficacité des fonctions utiles; et son bilan est indiscutablement positif. Puis la « crise » est survenue, les taux de croissance élevés sans antécédents historiques se sont essoufflés, la progression continue des niveaux de vie a perdu sa crédibilité et le chômage, disparu pendant trente ans, a fait une réapparition brutale, massive et durable. Au moment même où l’Union Européenne est pressée de s’élargir vers l’Est, fasciné par le bilan de son succès, saura-t-elle faire face aux défis nouveaux auxquels elle est confrontée ? A quelles conditions ?
1 - Les choix de l’après-guerre et la création de la C. E. E Au lendemain de la seconde guerre mondiale les peuples de l’Europe entière sont confrontés à des défis gigantesques qui alimentent toutes sortes de peurs, fondées ou produites par l’illusion.
221
L’Europe est coupée en deux. Mais si dans l’imaginaire partagée chacune de ses moitiés paraît menacer l’autre, en fait il n’y avait rigoureusement aucun risque d’agression militaire. L’après-guerre a été une période de paix et devait l’être. Une paix qui n’était pas seulement le produit du parapluie nucléaire américain et de l’équilibre par la terreur - des deux super puissances, comme l’opinion le croit trop souvent jusqu’à présent. Car cet équilibre militaire n’a été réalisé que fort tardivement - à partir de 1970 - c’est-à-dire alors que la reconstruction était achevée depuis près de vingt années et que le miracle européen qui lui avait succédé commençait à s’essouffler (sans qu’on y prête grande attention). En fait la protection militaire américaine paraissait à certains désormais abusive. Si le pouvoir soviétique avait eu l’intention d’envahir l’Europe occidentale il en aurait donné les preuves plus tôt. Il ne l’a jamais envisagé, n’étant jamais sorti de son attitude défensive traditionnelle de « pays encerclé » depuis 1917. Et Staline, qui n’était certes pas un grand démocrate socialiste mais qui n’était pas fou (comme Hitler l’était) ne désirait pas plus qu’un « glacis protecteur », conçu il est vrai dans les termes d’une stratégie militaire désormais dépassée. Les Etats-Unis de leur côté n’envisageaient un éventuel « roll back » que progressif, sans agression militaire dont ils mesuraient également les dangers. Leur vision de leur hégémonisme mondial - dont ils restent imprégnés - ne procède pas davantage de la méthode criminelle et folle d’Hitler ! Aussi a-ton vu - sans que cela ne soit surprenant - l’URSS s’abstenir de soutenir les Communistes grecs entre 1945 et 1947 et Washington d’intervenir dans les affaires hongroises en 1956. Les seuls pays qui s’étaient libérés de la tutelle de Moscou, la Yougoslavie dès 1948 puis l’Albanie à partir de 1960, l’avaient fait
222
seuls, sans soutien occidental, pas même les marques d’une sympathie débordante. Mais s’il n’y avait pas de danger de guerre, il y avait peut-être celui de « révolutions »; du moins le croyait-on dans les deux camps entre lesquels l’opinion se partageait, en France et en Italie au moins. Double illusion également sans doute, comme l’histoire devait le montrer. Mais si la reconstruction avait piétiné nul ne saurait dire comment les peuples auraient réagi. Peutêtre, encore imprégnés de l’esprit antifasciste dominant alors et n’ayant gardé des régimes de l’entre deux guerres qu’un souvenir méprisant, auraient-ils été convaincus par ce qui leur était présenté comme l’amorce victorieuse à l’Est d’une construction socialiste ? Non seulement j’en doute, mais encore s’ils avaient franchi ce pas, que les forces conservatrices locales et les armées américaines aient été placées devant le fait accompli et l’aient accepté (on sait que par leur accord secret ces forces ne l’acceptaient pas et avaient envisagé de répondre par le coup d’Etat à une victoire communiste, fut-elle électorale), Moscou aurait été bien gêné par ce cadeau encombrant qui risquait de remettre en question ses propres conceptions du « socialisme ». Par ailleurs je ne crois pas que toutes ces hypothèses un peu extravagantes méritent davantage notre attention. Il n’y avait pas de raisons que la reconstruction ne se fasse pas vite et bien. Et, conscients du défi, les Etats-Unis se sont portés à son secours par le Plan Marshall. Une autre crainte, dont on a tendance aujourd’hui à oublier l’importance à l’époque, préoccupait les opinions dans toute l’Europe de l’immédiat après guerre : celle d’une renaissance de la puissance industrielle et militaire allemande. Staline voulait son glacis pour y faire face. L’Angleterre optait pour une alliance perpétuelle et inconditionnelle dans le sillage des Etats-Unis. La France, dont la position de grande puissance relevait désormais du passé, était
223
particulièrement sensible à cette menace potentielle. Comment la contourner ? On avait renoncé à démanteler l’Allemagne, un moment envisagé. De Gaulle, qui était passé par les fourches caudines de l’allié subalterne, gardait des sentiments mitigés à l’égard du protecteur américain. En contre point une alliance avec Moscou risquait de renforcer la position des communistes. L’idée nouvelle qui s’est alors frayé son chemin était de neutraliser l’Allemagne en l’absorbant dans une construction européenne. Cette idée rencontrait la préoccupation d’enraciner la démocratie à l’Est du Rhin. Elle rencontrait aussi celle d’une ouverture des marchés dont l’hégémonisme américain avait besoin pour se déployer. Pour mettre un terme aux tendances sinon autarciques tout au moins fortement protectrices qui caractérisaient l’Europe de l’entre deux guerres, le Plan Marshall s’assignait donc l’objectif de soutenir l’intensification des échanges intra européens, prélude à l’ouverture sans rivages de l’Europe reconstruite. Choix qui est exactement à l’opposé de celui fait un demi siècle plus tard au regard de l’Europe orientale puisqu’ici l’intervention des puissances occidentales et des organisations qu’elles inspirent s’est immédiatement donné l’objectif de démanteler les interdépendances créées au sein du Comecom (dont le nom officiel est comme on le sait le CMEA), fût ce détriment de la « reconstruction » à l’Est. Le projet de Communauté Européenne est né dans cette ambiance. Il fallait le rappeler pour en comprendre l’évolution ultérieure. Pour la petite histoire on sait que le projet européen a connu sa première expression dans la création de la CECA (Communauté du Charbon et de l’Acier) en 1951, par laquelle Jean Monnet répondait aux craintes de son pays (la renaissance du complexe militaro-industriel de la Rhur) en absorbant ces industries allemandes de base dans une construction européenne. Par contre le projet parallèle de neutralisation de l’armée allemande par son intégration
224
dans une force européenne (par la création d’une Communauté Européenne de Défense) a capoté en 1954. L’armée allemande reconstituée est encore et jusqu’aujourd’hui il est vrai limitée dans trois dimensions : (i) par la participation de l’Allemagne à l’OTAN, (ii) par l’absence de son armement nucléaire, (iii) par les dispositions constitutionnelles (fort critiquées aujourd’hui) qui limitent son intervention éventuelle hors de ses frontières. Il reste que la question militaire allemande est demeurée préoccupante, et que c’est cette même crainte qui a sans doute amené de Gaulle à saboter l’Euratom (créé en 1957), donnant dans ce domaine sa préférence au soutien du Commissariat (français) à l’Energie atomique et à l’accession de la France au club nucléaire. Toujours est-il que la petite histoire fait parfois la grande. Le succès de l’institution économique (la CECA), même s’il devait être provisoire (du fait que l’acier et le charbon ont perdu les fonctions motrices qu’ils avaient dans les systèmes économiques du passé), et l’échec de la dimension politique du projet (la CED), conjugués avec l’arrivée de De Gaulle au pouvoir en France, ont orienté la construction européenne à partir du traité de Rome (1957), et jusqu’à ce jour, dans la direction prioritaire de l’intégration économique, tandis que celle des pouvoirs politiques, sans être totalement oubliée, prenait beaucoup de retard. Ce déséquilibre est aujourd’hui au cœur du défi européen. Peut-on le combler en accélérant la construction d’une Europe politique ? Le veut-on ? Est-ce souhaitable ? Est-il possible, sans elle, de consolider définitivement les acquis dans le domaine économique ? Autant de questions sur lesquelles on reviendra. La construction économique de l’Europe impliquait elle même des choix décisifs par leur portée à plus long terme. Cette construction vise-t-elle seulement
225
à créer une zone de libre échange renforcé ouverte sur un système mondial qu’on s’efforcerait d’ouvrir lui même au maximum ? Ou bien la conçoit-on comme une structure capable de résister par elle même aux influences de l’extérieur lorsque celles-ci sont jugées négatives (cette conception n’est pas nécessairement celle -extrémiste - de « l’Europe forteresse ») ? Autrement dit Europe complémentaire ou concurrente des Etats-Unis et du Japon ? Ce choix, latent à chaque étape et dans chaque grande décision, n’est, à mon avis, pas fait clairement et ne peut l’être, compte-tenu des opinions divergentes qui non seulement opposent parfois certains Etats membres à d’autres, mais traversent également les opinions nationales. Quoiqu’il en soit, même si - comme c’est le cas - le volet politique de la construction est encore au stade de ses premiers balbutiements et par conséquent reste sans capacité d’influer fortement sur les décisions prises au niveau de l’intégration économique, toujours est-il que les choix économiques supposent implicitement des options politiques cohérentes avec eux. Le conflit est ici clairement entre la perspective d’une Europe politiquement intégrée (ce qui implique un pouvoir supranational, quelle que soit sa dénomination) ou celle d’une « Europe des Nations » - pour reprendre la formule gaulliste qui est aussi le point de vue britannique persistant - n’envisageant guère plus qu’une coordination des politiques nationales. Et ici également - pouvoir européen ou coordination des pouvoirs nationaux européens - pour quoi faire ? Dans une perspective qui demeure, en parallèle avec celle de l’OTAN, celle d’un ensemble Nord-atlantique solidaire ? Ou dans celle d’un concurrent indépendant qui, sans nécessairement dire son nom, pourrait être la perspective d’un néo-impérialisme européen ? En évacuant ou en retardant la décision au plan des perspectives politiques, l’Europe choisissait en fait d’avancer dans le seul domaine de la construction
226
d’un marché commun (potentiellement, mais pas encore unique, malgré son nom). Un choix qui de ce fait s’inscrivait sur la ligne de moins grande résistance, celle du dénominateur commun minimal. C’était, je dirai, une option de droite par sa portée à plus long terme. Je ne veux pas dire par là que c’était le choix de la droite européenne (conservatrice et libérale) par opposition à la gauche (socialiste). Car l’adhésion au projet européen ou les réticences à son endroit traversent l’une et l’autre. Le rejet total ou presque est maintenant minoritaire - mais menace de prendre de l’ampleur. Il n’en a pas toujours été ainsi. Les réticences l’ont emporté pendant longtemps chez certains des membres plus récents (les Scandinaves). L’idée européenne est étrangère aux extrêmes droites fascistes (qui n’osent pas le dire, mais le pensent). Les partis communistes étaient opposés au projet de cette « Europe des marchands » par principe, puis l’ont rejoint, sans bien entendu être en mesure de négocier leur ralliement. La droite dans son ensemble a toujours rassemblé des intérêts économiques divergents. Des segments du grand capital modernisé et compétitif (dans l’industrie, l’agro industrie, les finances) préfèrent presque toujours l’ouverture des marchés. D’autres branches industrielles, souvent celles en déclin, ont évidemment besoin de s’accrocher à des protections nationales éventuelles. La droite a donc toujours été nuancée, voire divisée selon les questions concrètes en discussion à Bruxelles. Il en est de même de la gauche. Même si l’on fait l’hypothèse que celle-ci est moins sensible aux intérêts de patronats divers (ce qui n’est pas nécessairement vrai), la gauche est sensible aux intérêts des travailleurs, non moins divergents. Les modalités concrètes de l’expansion du marché mises en œuvre opéreront-elles en faveur d’une homogénéisation vers le haut, par une sorte de « retombées » (trickle down effect), favorisant la hausse des salaires et l’amélioration des avantages sociaux dans les aires
227
défavorisées ? Ou bien au contraire elles pèseront en faveur d’une homogénéisation vers le bas, en accentuant la concurrence entre les travailleurs, surtout en période de crise ? Les opinions sont toujours divisées sur ces terrains et varient évidemment selon les champs d’action et les modalités des décisions en question. Par ailleurs les perceptions idéologiques ne sont jamais absentes, ni à droite (où le nationalisme est fréquent mais où également l’hostilité à l’égard du « communisme » - de l’Est - était maximale), ni à gauche (où l’on est en principe plus favorable à des perspectives internationalistes, mais où le nationalisme n’est pas non plus absent). Ce que je veux dire donc ici, c’est que l’avancée du projet sur sa ligne de moindre résistance permettait à l’ouverture simple des marchés de prendre son élan tandis que dans les domaines de la gestion sociale et politique l’Europe hésitait toujours à toucher aux structures nationales en place. On le verra plus précisément dans l’examen du bilan des réalisations qui suit. Or la simple ouverture des marchés par nature renforce le capital, et contribue donc à améliorer sa position dans son rapport antagonique avec le travail. L’équilibre ne peut être maintenu que si des mesures sociales d’encadrement du marché sont prises simultanément, qui au moins reproduisent à l’échelle du marché élargi (européen) les conditions de fonctionnement du rapport capital / travail qui opérait à l’échelle antérieure des marchés plus restreints (nationaux).
2 - Bilan de la C. E. E Toujours est-il que, à ce jour, le bilan de la C. E. E. au plan du développement économique (et même social) est indiscutablement positif.
228
La véritable question est de savoir pourquoi en a-t-il été ainsi. Un économiste néolibéral dogmatique dirait très simplement que ce résultat était inscrit dans l’ouverture des marchés qui stimule toujours la croissance, et que celle-ci, par ses effets de retombées (trickle down), bénéficie toujours à l’ensemble de la population (aux travailleurs comme aux entrepreneurs). Je crois erronées les deux thèses libérales concernant le rapport de causalité marché-expansion d’une part (je prétends que c’est l’expansion qui ouvre les marchés et non l’inverse), les effets de répartition du revenu d’autre part (je prétends qu’il n’y a d’effets de retombées que dans l’imagination néolibérale et que celles-ci, quand elles existent, sont le produit de conquêtes sociales arrachées contre la logique unilatérale du marché). Je ne reviens pas ici sur ce point de théorie sur lequel je me suis expliqué ailleurs. Le bilan positif est donc dû à tout autre chose. Le véritable moteur de la croissance forte que les pays européens ont connue dans l’après guerre était le compromis social capital / travail, produit de la victoire antifasciste, qui avait créé un rapport plus favorable aux travailleurs qu’il ne l’avait jamais été jusque-là dans l’histoire du capitalisme. Ce Welfare State, construit sur les assises solides de ce que d’autres ont appelé le « fordisme », se généralisant à l’Europe, a été la base de la croissance exceptionnelle de l’après guerre. L’ouverture des marchés bien entendu était dans cette conjoncture non seulement possible, facile, mais encore un moyen de renforcer le potentiel d’expansion du modèle. Par contre dans l’hypothèse (devenue d’école) d’une ouverture sans ce moteur interne actif que constituait le Welfare State, le résultat aurait presque fatalement été inverse : la dégradation des productions (c’est le cas aujourd’hui des effets de l’ouverture imposée au tiersmonde africain, arabe et latino-américain). Mais le Welfare State en question était national, dans le sens qu’il fonctionnait par le moyen de politiques d’Etat
229
strictement nationales soutenant le « contrat social » capital / travail qui le caractérisait (dont le contenu essentiel était d’assurer une croissance des salaires à l’échelle nationale parallèle à celle de la productivité). L’efficacité des politiques nationales d’Etat en question est également la raison pour laquelle l’ouverture des marchés ne s’est pas soldée par une aggravation des inégalités au profit des pays les plus dynamiques, mais au contraire a réduit celles-ci. L’exemple le plus évident est ici celui de l’Italie qui a grimpé dans l’échelle européenne, par ses taux de croissance exceptionnels. Grâce à la C. E. E. ? Certes la C. E. E. a contribué à cette réussite, non seulement en ouvrant à l’industrie du Nord italien le vaste marché européen, mais encore en soutenant l’effort de modernisation du Sud italien. Encore que, dans ce domaine, cette contribution ait été accessoire, l’effort principal venant d’une redistribution interne par l’Etat italien. L’Espagne, avant d’adhérer à la C. E. E., avait elle aussi enregistré des taux de rattrapage. C’est dire l’importance décisive des politiques nationales (ici du Welfare State, fut-il version pauvre, et du fordisme) dans le succès attribué à la C. E. E. En l’absence de contrepoids sociaux organisés et de politiques d’Etat puissantes pour les soutenir, l’ouverture des marchés a toujours par elle même un effet polarisant et non réducteur des inégalités. Au-delà de la croissance exceptionnelle que l’Europe a connu au cours des trois décennies 1950-1980, la C. E. E. compte à son actif quelques réalisations remarquables. La principale de celle-ci est, à mon avis, la Politique Agricole Commune. En déconnectant les prix agricoles communautaires (par la fixation de prix d’intervention plus élevés que ceux du marché dit mondial, assurant aux exploitants agricoles des revenus comparables à ceux du monde urbain et la
230
protection par les prélèvements sur les importations agricoles pour les mettre au niveau des prix communautaires), la C. E. E. se donnait l’instrument efficace qui a permis un prodigieux progrès de son agriculture, au point non seulement que l’Europe assure désormais son autosuffisance mais qu’elle est devenue à son tour un gros exportateur. Ce succès fait désormais problème puisque les stocks de surproductions invendables s’accumulent, en dépit du soutien apporté aux exportateurs par la restitution qui leur est faite de l’équivalent des prélèvements. Ce succès obtenu, la C. E. E. est désormais en mesure, s’il le faut, d’abaisser graduellement ses prix d’intervention. Il est déplorable que l’Europe, qui a mis en pratique ici le principe fondamental de la déconnexion, nie au pays du tiers-monde le droit d’en faire autant ! Le succès du système monétaire européen, conçu pour protéger la C. E. E. des fluctuations aberrantes du dollar depuis 1972, a donné des résultats favorables évidents à partir de la fin des années 1970. La raison réelle de ce succès reste néanmoins le sujet d’un débat nécessaire, malheureusement éludé par la domination des dogmes monétaristes absurdes à la mode. Tient-il au principe même du système, ou à une conjoncture qui inspirait des politiques économiques générales (et pas seulement monétaires) parallèles dans les principaux Etats membres ? Je penche personnellement pour cette seconde explication. Aussi le système reste-t-il fragile, comme on en aurait dû s’en apercevoir avec les crises qui se succèdent depuis 1992. C’est que dans ce domaine, l’Europe n’a pas opté pour la déconnexion comme elle l’a fait dans celui de l’agriculture. La libéralisation mondialisée des mouvements de capitaux, principe auquel l’Europe a adhéré derrière les Etats-Unis, en conjonction avec l’effondrement de la croissance dans les années 1980, réduit l’efficacité de la protection collective des monnaies européennes et par ricochet celle de leur relative solidarité. Cette fragilité imposera à terme, et presque fatalement,
231
l’adoption de politiques économiques et monétaires divergentes par les Etats membres. Et, à mon avis, le seul moyen de se protéger contre cette évolution qui réduirait considérablement la portée du « grand marché » et les perspectives d’intégration économique - est ici également de déconnecter, c’est-à-dire de se doter, au niveau de la C. E. E. (ou à défaut à celui des Etats), des moyens de réglementer les transferts de capitaux en vue de réduire les effets dévastateurs de la spéculation financière. La réduction remarquable des écarts de développement (et de niveaux de vie) entre l’Europe méditerranéenne (Italie et Espagne) et l’Europe du nord - la France occupant une position intermédiaire et la Grande-Bretagne étant confrontée à son déclin historique -, des écarts encore gigantesques avant et au lendemain de la seconde guerre mondiale, doit-elle être portée au crédit de la construction européenne ? J’ai déjà dit que ces succès devraient être portés au crédit autant des politiques nationales efficaces de la France, de l’Italie et de l’Espagne notamment qu’aux opportunités offertes par l’élargissement du marché. Quant à la politique spécifique de la C. E. E. en la matière (les subventions aux pays et régions déshéritées) elle n’a joué qu’un rôle d’appoint. Ces subventions dont bénéficient comme on le sait l’Irlande, le Portugal, la Grèce, le Midi italien et l’Allemagne de l’Est, ne sont certes pas négligeables. Mais, au moins en ce qui concerne l’Italie du Sud et l’Allemagne de l’Est, le succès ou l’échec de leur reconstruction économique dépendra davantage des stratégies politiques et des actions des Etats italien et allemand. Il n’est pas non plus établi que ces subventions, dans le cas de la Grèce, aient été nécessairement positives. Elles ont peut être contribué à leur manière à enfermer ce pays dans l’impasse, peut être parce qu’il a rejoint trop tôt la Communauté, avant d’avoir acquis une capacité compétitive suffisante, et se retrouve, de ce fait, marginalisé dans des fonctions subalternes (comme
232
le tourisme). Ce problème, qui relève de la problématique plus générale des effets dévastateurs de l’intégration des régions du capitalisme périphérique dans les marchés mondiaux, pourrait être demain celui des pays de l’Est également pressés de rejoindre la C. E. E. L’illusion, entretenue par l’idéologie dominante qu’il vaut mieux s’intégrer dans les ensembles constitués autour de pôles développés que de rester en dehors d’eux, s'exprime naïvement chaque fois qu’on dit - et on l’entend dire fréquemment - « qu’on peut toujours tirer profit d’une dépendance à l’égard d’un centre développé » - est pourtant cruellement démentie par l’histoire (Haïti ne dépend-il pas des EtatsUnis ?). S’il existe des effets d’entraînement, il existe également des effets de dévastation que les adversaires dogmatiques de la déconnexion veulent ignorer par principe. Par ailleurs si l’on regarde de plus près ce qui s’est passé en Europe dans la grande période d’essor 1950-1980, on voit que si, en gros, l’inégalité entre les pays a plutôt été réduite, à l’intérieur des Etats les inégalités régionales ont au contraire souvent été accentuées. La C. E. E. n’est certainement pas responsable de ces évolutions, produites naturellement par l’expansion capitaliste et dont seules des politiques nationales plus hardies auraient pu combattre les effets. En dépit des réalisations à l’actif de la C. E. E., le marché unique n’est pas encore une réalité achevée. L’énergie et les transports échappent encore largement à la logique communautaire et relèvent de logiques nationales spécifiques et de ce fait en partie au moins conflictuelles. La Communauté s’est néanmoins engagée dans la voie de leur intégration dans le marché unique, par le moyen de dérégulations et de privatisations en cours. Ces options sont, à mon avis, négatives parce que, s’agissant de secteurs oligopolistiques (ou même monopolistiques) par leur nature même (et c’était là le
233
motif des nationalisations dominantes ici) elles substituent des oligopoles privés aux monopoles publics sans pour autant garantir que les logiques propres du privé donneront ici, des résultats cohérents avec les exigences du développement optimal de l’espace européen dans son ensemble. Au contraire il est à craindre que la logique du profit à court terme n’accentue ici les inégalités dans ce développement. L’alternative eut été celle d’une coordination planifiée par la communauté des Etats. Les préjugés idéologiques dominants et la soumission des gouvernements aux exigences du capital financier à la recherche de placements juteux sont ici responsables de ces choix malheureux. Plus grave encore à mon avis est le fait que l’Europe n’a pas développé des politiques industrielles communautaires. Les Etats l’ont fait parfois, mais ont eux mêmes tendance à y renoncer pour se conformer à l’air du temps, libéral antiétatique. Dans le domaine de la recherche-développement, considérée par tout le monde aujourd’hui comme décisive, l’Europe reste en retard sur les Etats-Unis et le Japon. Et les projets de la Communauté pour pallier les insuffisances nationales demeurent ici fort limités par leur ampleur et leur portée. On verra donc que, en dépit du bilan positif de la C. E. E., l’Europe n’est pas encore véritablement engagée sur une voie qui permettrait, au-delà de la construction d’une zone de libre échange (pseudo marché unique), de parfaire une intégration économique véritable. Celle-ci supposerait qu’un système productif européen se substitue graduellement aux systèmes productifs nationaux hérités du passé. On verra que le saut qualitatif que cette progression représenterait implique la solution de problèmes politiques encore à peine posés.
234
Dans ces conditions on se gardera de donner à la croissance des échanges intra communautaires la portée que les discours triomphalistes lui donnent. Il est vrai que les échanges intra communautaires sont passés de 25 à 40 % pour les différents Etats membres vers 1960 (chiffres peu différents de ceux d’avant 1913 et d’avant 1939) à des pourcentages qui se situent aujourd’hui entre 50 et 60 %. Mais à lui seul ce progrès, s’il témoigne bien d’une préférence communautaire de fait désormais établie, n’est pas synonyme de système productif intégré. On conclura cette présentation critique des réalisations économiques de la Communauté par celle de son budget, qui en résume bien la nature, la portée et les limites. Le budget communautaire bien que non négligeable, reste fort limité : 2, 4 % de l’ensemble des budgets des Etats membres. Ses ressources proviennent des droits de douane (18 %) -comme il convient dans toute union douanière -, des prélèvements sur les importations agricoles (3 %) - en régression du fait même du succès de la P. A. C. -, de prélèvements sur la T. V. A. (51 %) et de cotisations des Etats membres en proportion de leur PNB (27 %). Le souci d’assurer des conditions de concurrence dites normales est bien sûr à l’origine de l’effort d’harmonisation fiscale poursuivi par la C. E. E. Conformément à la doctrine financière conventionnelle dominante selon laquelle seuls les impôts indirects entrent dans la formation des prix, il a donc été convenu que la T. V. A. - de loin la principale des taxations formatrices des prix - serait relativement harmonisée, par l’adoption d’un taux plancher de 15 % (mais ses taux varient de 15 à 25 % selon les pays). Par contre, en conformité avec la doctrine, on a considéré que les impôts sur les revenus ne devaient pas nécessairement l’être. Je ne crois pas cette doctrine très solide; et
235
elle mériterait d’être relativisée, à mon avis. Car la structure de la répartition du revenu (et celle-ci est affectée par l’impôt sur les revenus) est l’un des déterminants du vecteur des prix relatifs et par là même agit sur les conditions de la concurrence. Une intégration économique forte exigera l’harmonisation de cette imposition. Mais on est loin de l’accepter dans les opinions européennes. En dépenses le budget communautaire est affecté au soutien de la P. A. C (50 % des dépenses), aux aides régionales (30 %), aux aides au tiers-monde (5 %) et à la recherche-développement (4 %). On remarquera que du fait même du succès de la P. A. C. et des difficultés que l’Europe rencontre à exporter les surplus qu’elle produit, la part du soutien accordé aux exportations agricoles a tendance à la réduction - de 80 % il y a encore quelques années seulement à 50 % aujourd’hui. Les soutiens accordés aux régions déshéritées ont par contre été brutalement augmentés du fait de l’unification allemande. L’opinion dans de nombreux pays européens admet parfois difficilement que l’Allemagne n’assume pas seule le coût de cette décision éminemment politique qui par ailleurs renforce sa position de puissance majeure dans la Communauté. En contrepoint l’assistance aux pays du tiers-monde fait pâle figure (un sixième des aides octroyées aux périphéries européennes pour des populations de dix à vingt fois plus nombreuses !). Par la modestie de son volume elle parait relever de la charité plus que de la solidarité internationale. En tout cas elle n’atteint pas le seuil minimal qui pourrait en faire un instrument de construction d’un espace régional euro-africain. Ce fait traduit une réalité qu’on ne reconnait pas toujours : qu’en dépit des conventions d’association C. E. E. - A. C. P. il n’y a pas de vision politique des relations entre l’Europe d’une part, le monde arabe, l’Afrique subsaharienne et le tiersmonde en général d’autre part. Il n’est même pas sûr que les Etats membres -
236
ou certains d’entre eux - aient un concept de ces relations et des questions de régionalisation à l’échelle mondiale qu’elles impliquent.
3 - L’Europe : une construction économique limitée Le bilan des réalisations de la C. E. E. fait bien ressortir la caractéristique majeure de la construction européenne. Jusqu’ici celle-ci s’est presque strictement limitée à bâtir un espace commercial ouvert, pas même encore un espace économique sur la voie de l’intégration. Jusqu’ici toutes les tentatives d’aller plus loin ont buté sur l’absence d’un concept politique de l’Europe. Tous les Européens sont parfaitement conscients de ce fait, et le déplorent en général. Des instruments de la construction politique ont été d’ailleurs créés, comme on le verra. Mais on est encore très loin de savoir ce qu’on veut en faire. Or l’absence de vision politique et de son complément nécessaire au plan de la perspective sociale réagit à son tour sur l’infrastructure économique commune construite. Elle laisse ouverte la question de savoir comment l’Europe et les Etats qui la composent entendent situer leur projet (ou leurs projets) dans le système mondial, économique et politique. L’avenir de la construction européenne reste donc tout à fait ouvert. Celle-ci pourrait évoluer dans le sens de son approfondissement au point de devenir un sujet politique et social nouveau, mais elle pourrait tout autant stagner, être marginalisée, et même se dégrader et perdre la portée qu’elle a acquise. L’Europe n’est pas devenue une réalité historique irréversible. Chaque fois donc que le projet européen se heurtait au risque de remise en cause de ce qui est considéré comme relevant éminemment de la souveraineté nationale on a eu l’impression qu’il atteignait les limites du possible. Et
237
cette frontière n’était pas franchie. J’en donnerai ici quelques exemples parmi bien d’autres sans doute : i)
la recherche - développement relève pour l’essentiel de la responsabilité nationale et le transfert de celle-ci à des autorités communautaires est étroitement limité, sans portée décisive. N’est-ce pas entre autre parce que la recherche-développement est fortement reliée au développement du potentiel militaire, comme l’exemple de l’Euratom le rappelle ?
ii) les marchés publics ne sont pas soumis jusqu’à présent à une véritable concurrence ouverte à l’échelle communautaire. Par des moyens divers et parfois détournés les Etats évitent que la transparence ne remette en question dans ces domaines la préférence nationale qu’ils associent ici à l’exercice de la souveraineté. iii) le droit commercial - et singulièrement celui des sociétés - reste l’affaire des Etats. Et les projets concernant son unification - une exigence presque évidente pour l’émergence de multinationales « européennes » (et non plus allemandes ou britanniques ou françaises) - ne parviennent pas à aller au-delà du discours de pure rhétorique ou des études académiques. iv) les productions du cinéma et de la télévision ont été exclues du domaine soumis à la concurrence commerciale au nom de « l’exception culturelle ». La France, plus sensible que les autres pays aux dangers que constitue l’invasion culturelle américaine, s’est portée à l’avant-garde de ce combat et a invoqué ici, à juste titre à mon avis, le rapport étroit que l’indépendance culturelle entretient avec l’indépendance politique tout court. La Communauté n’étant pas un Etat, pas même jusqu’ici l’embryon d’un Etat, dès lors que se pose un problème de souveraineté, elle se retire pour laisser les
238
Etats européens mener ensemble, ou en ordre dispersé, la bataille (ou l’évacuer). Or les problèmes concernant l’avenir de la Communauté -évoluera-t-elle vers le statut d’Etat, fut-il multi et supra national bien entendu - sont d’autant plus difficiles à identifier que le rapport Etat-intégration économique est lui même bouleversé par l’évolution récente du monde (et non de la seule Europe). Jusqu’ici il n’y a jamais eu d’intégration économique véritable autre que dans l’espace défini par la souveraineté nationale. L’histoire de la formation des Etats-nations modernes (bourgeois) a été celle de la construction simultanée d’un espace économique autocentré intégré, c’est-à-dire d’un système productif national, et d’un système politique national (fut-il dans quelques cas plurinational). Cette concordance a fourni le « modèle » que les pays venus plus tard à la modernité ou à l’indépendance tentent de reproduire. Les exceptions apparentes confirment la règle. Les Empires coloniaux étaient des espaces hiérarchisés mais organisés autour de la métropole autocentrée; et si, aujourd’hui les Etats-Unis et le Canada constituent un espace presque parfaitement intégré, cela tient au déséquilibre entre ces deux puissances, le Canada ayant accepté d’être en fait la province extérieure des Etats-Unis. Les « hégémonies », régionales (comme celle des Etats-Unis en Amérique latine ou celle de l’Europe en Afrique...) ou mondiales (comme celle de la GrandeBretagne au XIXe siècle ou des Etats-Unis après 1945) n’opèrent pas dans un espace économique intégré, loin de là; elles organisent la hiérarchie des régions constitutives du système. D’aucun prétendent que, puisque cette concordance Etat-espace économique intégré est en voie de dépassement, nous connaîtrons à l’avenir des espaces économiques intégrés sans qu’ils ne constituent un seul Etat, ou à défaut
239
s’organisent dans une constellation d’Etats autour d’une puissance dont ils accepteraient le leadership, pour ne pas dire l’hégémonie. L’Europe fournirait l’exemple de cette évolution en cours. Elle s’intégrera comme entité économique, dit-on alors (tout au moins la poursuite de cet objectif est souhaitable et possible), sans que ne se constitue un Etat-communauté ni que ne soit accepté le leadership d’un de ses Etats membres (qui ne pourrait être que l’Allemagne bien entendu). D’autres voient que la concordance Etat-espace économique intégré continuera à s’imposer et que, de ce fait, ou bien l’Europe construira son Etat communautaire, ou bien elle acceptera la formule de « l’Europe allemande », ou bien elle éclatera. Les deux écoles admettent que l’approfondissement de la mondialisation conduit fatalement au démantèlement des systèmes productifs nationaux, que la construction d’un système productif mondialisé - dont les sous espaces régionalisés pourraient constituer une étape et devenir des éléments constitutifs - est nécessaire, inévitable et qu’il faut gérer politiquement et socialement cette évolution, par ailleurs souhaitable. S’opposer à ce mouvement c’est s’accrocher à un passé révolu, refuser le progrès avec toutes les conséquences généralement dramatiques que cette stratégie, à terme vouée à l’échec, implique. Refuser simultanément « l’Europe allemande », serait en fait accepter que la mondialisation se poursuive dans le cadre d’une planétarisation diffuse et de l’hégémonie américaine. L’image de ce monde futur est alors celle d’un système de pouvoirs émiettés et impuissants (on ose à peine continuer à les appeler des Etats) soumis aux exigences du marché omniprésent, c’est-à-dire aux logiques particulières propres aux segments durs d’un système productif mondialisé, les « multinationales ». Le gendarme de ce monde serait - ne peut être - que les Etats-Unis, c’est-à-dire un pouvoir militaire exclusif, le seul « Etat » au sens plein du terme, même si cet Etat et ce
240
pouvoir militaire acceptaient d’opérer sous le drapeau d’une vague organisation politique mondiale (l’O. N. U.). Pour certains cette perspective est parfaitement acceptable, voire un progrès souhaitable dans l’évolution globale, non seulement de l’économie, mais aussi de la société qu’elle contribuerait à démocratiser. Pour d’autres elle ne l’est certainement pas. Pour moi elle est une utopie irréalisable en tout état de cause. On est alors renvoyé à la question européenne qui ne peut être évacuée. D’où part-on ici ? Je dirai que nous partons d’une Europe « réellement existante » qui présente les caractères suivants : i)
elle ne constitue pas un espace économique intégré, mais seulement approximativement un grand marché préférentiel; il n’y a pas de système productif européen, il n’y a pas d’entités productrices « européennes », pas de « multinationales européennes ». L’érosion des systèmes productifs nationaux, néanmoins incontestable, opère dans ces conditions non pas au bénéfice d’une recomposition européenne préférentielle, mais par l’arrachage de lambeaux raccordés à des segments de systèmes productifs mondialisés. Le choix britannique est, dans ce sens, très éclairant. La finance britannique, le vestige plus brillant de l’héritage du passé (et c’est cette position de Londres dans le système financier mondialisé qui permet à la Grande-Bretagne de se maintenir en dépit de son déclin), donne sa préférence aux impératifs de la mondialisation plutôt qu’à ceux d’une éventuelle construction financière européenne. L’industrie anglaise à son tour fait un choix analogue, comme l’a montré l’exemple de l’installation de l’industrie automobile japonaise dans les îles britanniques. Mais on aurait tort de croire que la Grande-Bretagne constitue l’exception. Les comportements effectifs dans l’industrie allemande, française, italienne, ne sont pas différents.
241
ii) elle n’est pas fondée sur un quelconque projet sociétaire commun. Pour se convaincre que ce jugement sévère est bien confirmé par la réalité, il suffit, à mon avis, de voir combien la « dimension sociale » n’occupe qu’un strapontin dans les réglementations communautaires. Je ne sous-estime pas ici l’importance de certains principes, désormais acquis à l’échelle de l’opinion dominante dans toutes (ou presque) les sociétés européennes et, de ce fait, réaffirmés par la Communauté. L’égalité de traitement des femmes et des hommes appartient à ces conquêtes nouvelles du progrès, comme aussi la préoccupation écologiste - au niveau de son principe général. Mais à part cela le dénominateur commun pris en compte par la Communauté se réduit à peu de choses : les conditions de travail, le droit syndical etc. sont déjà des acquis anciens dans les principaux Etats membres. Mais ni la question essentielle de la propriété sociale (une question qui dépasse le débat restreint propriété privée / propriété publique), ni celle de l’avenir du travail et de sa place dans la société (au delà des platitudes vagues concernant la « consultation » des travailleurs) ne sont à l’ordre du jour des décisions communautaires. Il est vrai qu’ils ne le sont pas non plus dans les Etats membres. Car depuis que le Welfare State national - qui a été le grand projet sociétaire dominant la scène pendant un demi-siècle - a épuisé son potentiel, les sociétés européennes n’ont plus de projet sociétaire leur permettant d’aller de l’avant. Cette carence n’est pas seulement le produit d’une gestion des affaires courantes dominée par les droites européennes classiques, dont elle a d’ailleurs facilité l’accès au pouvoir. Car ces mêmes droites classiques avaient été contraintes dans le passé à gérer le Welfare State, en alternance avec les gauches de l’époque. La carence concerne aujourd’hui tout autant la gauche européenne. Et le dénominateur commun de la pratique démocratique dans la gestion de la vie politique ne compense
242
pas, à lui seul cette carence. Il risque même, si l’on s’en tenait à lui, de s’éroder à son tour. iii)elle ne constitue pas un ensemble ayant une vision commune (ou même, si l’on veut être plus sévère une vision quelconque) de son rapport aux autres régions de la planète. Cette absence de vision ne concerne pas seulement le domaine de l’économique puisque, comme je l’ai dit, les Européens (les Etats, les partis, les opinions) n’ont pas choisi entre l’intégration dans la mondialisation ou la préférence pour une intégration communautaire réellement préférentielle (qui impliquerait une dose de « déconnexion » à cette échelle; et le terme de « déconnexion » est banni comme on le sait). Elle concerne aussi le volet politique de la question. Les Européens veulent-ils intégrer l’Europe orientale et l’ex-URSS ? ou la « latino américaniser » ? Conçoivent-ils sortir de la tradition coloniale ou quasi dans leurs rapports avec l’Afrique et le monde arabe ? Et face à l’Asie qui se « développe », loin de l’Europe (quelque soit l’appréciation qu’on peut avoir du sens, de la portée et de la qualité de ce « développement » - et mon jugement est sévère à son endroit) les Européens nourrissent-ils d’autres sentiments que ceux que la crainte leur inspire ? Combien de fois verra-t-on répéter que le déficit du commerce de tous les Etats européens avec tous les pays de l’Asie (Japon, Chine et « Dragons ») est inacceptable ? Tandis que des déséquilibres en sens inverse avec d’autres régions seraient-elles - parfaitement acceptables ! L’absence de visions européennes - au-delà de celles, médiocres, liées à la gestion courante de petits intérêts ayant jeté leur ancre ici ou là - a pourtant une conséquence majeure, celle de laisser aux Etats-Unis le monopole d’une « conception du monde » et les moyens (militaires) de tenter de la gérer. Tout ce qui vient d’être dit n’échappe certainement pas aux Européens, qui sont parfaitement conscients de leurs faiblesses. Ils se sont même donné quel-
243
ques instruments pour défricher le terrain et préparer l’avenir. Mais, comme on le verra, les réponses qu’ils paraissent vouloir apporter au défi auquel ils sont confrontés sont, à mon avis, inadéquates. Le citoyen européen moyen sait parfaitement ce que représentent pour lui le Conseil Municipal, le Parlement, le Gouvernement. Il est totalement perdu dans le labyrinthe des institutions communautaires. C’est pourtant en commençant par analyser ce que celles-ci sont et font qu’on pourra avancer dans le débat concernant la nature des défis et les moyens d’y répondre. La « Commission » n’est pas un conglomérat hétéroclite de services gérés, comme ailleurs, par des « technocrates ». Elle n’est pas non plus un gouvernement (supranational) puisque les Commissaires sont responsables non d’une aire définie comme elle l’est généralement dans la répartition des tâches entre les ministères (l’Agriculture, l’Industrie, les Finances etc.) mais de tâches spécifiques déléguées à la Communauté. Elle n’est pas même un embryon de gouvernement puisqu’aucune des responsabilités dans les domaines d’exercice de la souveraineté (la Police, l’Armée, les Affaires étrangères, la Justice etc.) ne lui a été déléguée. On sait même à quel point cette carence risque de devenir dangereuse puisqu’une « Europol » par exemple échapperait alors à toute transparence pour ne relever que des collaborations entre polices, loin des regards du public... Et c’est pourquoi aussi le président de la Commission n’est pas un Premier ministre, ayant la responsabilité de définir une politique générale et de coordonner à cet effet l’activité de ministres qui sont ses subordonnés. Les tâches de définition des politiques et de délégation et organisation des pouvoirs pour les mettre à exécution sont donc remplies, hors de la Commission, par le Conseil. On devrait dire les Conseils, c’est-à-dire les réunions des
244
ministres des Etats concernés. On a souvent attiré l’attention sur les incohérences que ce type d’organisation entraînait. Les ministres des Finances prenant une décision en conflit avec celle prise par ceux de l’Agriculture par exemple. Aux niveaux nationaux de telles incohérences sont évitées par l’existence d’un Conseil des ministres et d’un Premier ministre, ici absents. Le Parlement en est-il un ? ou tout au moins l’embryon d’une Assemblée européenne véritable ? Les jeux sont loin d’être faits dans ce domaine. L’approbation du budget (mais celui-ci est pratiquement déterminé à l’avance par les décisions du Conseil) et du choix des Commissaires reste donc formelle, vide de responsabilité. Par ailleurs l’idée que les députés européens soient élus par l’ensemble des Européens (sur des listes nécessairement alors plurinationales) ne parait pas mûre dans la conscience politique et culturelle du continent. Le statut des institutions communautaires est donc finalement celui de services chargés de l’exécution de la politique d’un gouvernement inter-états qui ne dit pas son nom. Or ce dernier ne peut adopter une stratégie perspective claire sur les problèmes fondamentaux, ne serait-ce que parce que les gouvernements européens changent au gré des majorités dans les nations qu’ils représentent et qu’il n’y a pas de coïncidence entre ces majorités - de droite ou de gauche - à l’échelle européenne. Mais plus important encore est le fait qu’il n’y a pas de vision prédominante identifiable dans chacun des Etats membres. Il n’y a pas de « concept allemand » ou « français » ou « britannique » de l’avenir de la construction européenne, même si à un moment donné il y a bien entendu une position du gouvernement de chacun de ces pays sur des questions définies à l’ordre du jour. Il n’existe pas même des visions contrastées générales qui départageraient la droite et la gauche. Des points de vue passablement différents, parfois fondamentalement diver-
245
gents, se retrouvent au sein de la droite et de la gauche dans chacun des Etats. Les opinions concernant l’avenir de l’Europe constituent donc un véritable puzzle pour l’analyste et le politicien européen. Cela ne constitue ni un avantage ni un inconvénient pour le fonctionnement du projet au stade actuel, puisque les institutions européennes n’ont que des responsabilités d’exécution parfaitement définies.
4 - La crise et l’élargissement vers L’Est, des défis nouveaux L’Europe est confrontée aujourd’hui à un défi double et nouveau : (i) celui de la « crise », (ii) celui de son élargissement en direction de l’Est européen. Or si dans le cadre restreint de l’Europe occidentale, constituée pour l’essentiel de pays relativement proches en termes de développement, et dans un temps de croissance économique facile parce que fondée sur le fonctionnement efficace du projet de Welfare State, l’ouverture du marché -conçue comme l’axe presque exclusif de la construction communautaire - ne posait pas de problèmes graves, que les difficultés que cette ouverture entrainait ici ou là n’étaient jamais que sectorielles et mineures et pouvaient donc être surmontées sans grand sacrifice, il n’en est plus de même dans les conditions d’aujourd’hui. Le chômage massif, tenace et probablement durable si des formules radicales ne viennent pas renouveler les concepts fondamentaux du travail social, joint aux niveaux de développement fort inégaux des pays concernés par un élargissement de la communauté - fut-il graduel - à l’ensemble du continent, constituent des défis au regard desquels les réponses en termes d’ouverture des marchés perdent toute efficacité et deviennent des formules de magie plus que douteuses.
246
L’Europe est de ce fait confrontée à trois ordres de problèmes qui lui imposent de faire des choix certainement objectivement difficiles. i)
Le choix de la vision finale de la construction politique européenne ne peut pas être indéfiniment retardé, ou même éludé. Sans trop simplifier on peut définir ce choix dans les termes suivants : veut-on parvenir finalement à un pouvoir politique supranational (dans le jargon « européen » on qualifie généralement cette option de « fédéraliste ») ? Ou conçoit-on seulement une « Europe des nations » (parfois qualifiée de « confédéraliste » dans le jargon en question) - c’est-à-dire une Europe constituée d’Etats qui restent les seuls pouvoirs souverains au plan politique. Les partisans de ce choix pensent qu’il est compatible avec une intégration économique parachevant et renforçant le marché unique. J’ai pour ma part exprimé plus haut mes doutes concernant le réalisme de cette seconde option, dans ce sens que je ne crois pas qu’une intégration économique poussée soit possible sans la construction d’un pouvoir politique commun. Sans celle-ci donc le volet économique du projet ne pourra progresser que fort difficilement au delà du marché unique et les acquis obtenus dans ce domaine resteront eux mêmes fragiles et réversibles. En tout état de cause, même dans l’hypothèse la plus « européaniste » possible, il serait bien illusoire et dangereux d’ignorer la solidité des attachements à des réalités nationales fortes construites par l’histoire. Il faudra donc faire preuve d’une grande imagination dans la conception des formes institutionnelles adéquates capables de concilier ces attachements et une éventuelle « européanité » commune. Aucun modèle - fédéral ou confédéral - fourni par l’expérience historique de l’Europe ou d’autres régions du monde - ne répond à ce défi particulier et nouveau.
247
Quelle que soit l’option, il resterait probablement qu’une construction « à plusieurs vitesses » ne peut être évitée. C’est évident dans l’hypothèse « fédéraliste ». Mais même dans l’option « confédérale » qui ne remet pas en question l’intégralité des souverainetés politiques nationales, le même « système économique unique » ne pourra pas être imposé à l’ensemble des sociétés européennes - surtout si la Communauté doit s’élargir vers l’Est - encore moins être imposé « rapidement », sauf à définir ce système économique unique par son dénominateur commun minimal, celui d’un grand marché ouvert sans plus. Une progression à plusieurs vitesses s’imposera donc en tout état de cause. Cela dit je répéterai ici ce que j’ai formulé dans le paragraphe précédant : la tentative d’aller au delà du marché commun en direction d’une intégration économique réduite au « noyau dur » de la C. E. E. sans pouvoir politique commun est, à terme, vouée à l’échec. ii) Le continent européen, qui a probablement vocation (par son « européanité » ?) à constituer un ensemble régional dans le monde de demain, est loin d’être homogène. Ce n’est pas seulement qu’il est constitué de nations dont la réalité ne saurait être gommée (et pour beaucoup, cette universalisation par le rabotage des différences n’est pas même souhaitable), c’est aussi que les structures et les niveaux du développement de ses parties constitutives sont différentes et inégales. Il n’est pas difficile de tracer la frontière du « noyau » des régions qui, bien qu’appartenant à des nations distinctes, partagent des caractéristiques communes fortes et des niveaux de développement comparables. Mais au delà de cette frontière dans la direction des quatre points cardinaux vers le Sud ouest, le Nord ouest, le Sud est et l’Est, les défis auxquels les sociétés
248
sont confrontées aujourd’hui, et pour un temps à venir encore certainement long, sont de natures différentes. Un projet efficace, fut-il strictement économique, qui voudrait englober le noyau et ses périphéries, ne peut être fondé sur l’ignorance des problèmes que pose cette hétérogénéité. Même un strict marché commun simple n’est pas nécessairement souhaitable pour tous. L’exemple de la Grèce l’illustre déjà à mon avis, et l’adhésion éventuelle d’autres pays de l’Est aggravera les distorsions produites naturellement par le fonctionnement des lois du marché si des garde-fous appropriés ne sont pas systématiquement mis en place. A fortiori évidemment si le projet économique vise davantage, en direction d’une plus grande intégration économique. iii) Le plus inquiétant à mon sens n’est pas que les problèmes évoqués ici n’aient pas été vus par les Européens (ils ont parfaitement été identifiés), mais que l’amorce des solutions préconisées engage le projet dans l’impasse, à mon avis. Comme on le sait le traité de Maestrich qui a institué la nouvelle « Union Européenne » a évacué le défi politique majeur auquel l’Europe est confrontée. Ayant donc éludé la difficulté, il a engagé la construction européenne non pas sur une voie de garage, mais dans ce que je considère une impasse. Comme on le sait ce traité a donné la priorité à la progression de la Communauté en direction de la création d’une monnaie unique (l’Euro). Autrement dit le choix a été fait de poursuivre le projet d’une intégration économique franchissant un pas décisif (la monnaie unique) avant et sans que les perspectives politiques de l’Union n’aient été définies. Le raisonnement sur lequel se fonde ce choix est connu : la garantie simultanée du marché unique, de la liberté du mouvement des capitaux et de la
249
stabilité des changes exigerait une politique monétaire commune (à la limite donc une monnaie unique). Je crois que ce raisonnement est erroné, parce qu’il est insuffisant sur deux plans : a) Les trois objectifs ne peuvent être conciliés que si, bien au delà d’une politique monétaire commune, les politiques économiques et sociales mises en œuvre dans les Etats membres sont parallèles. Je veux dire par là qu’il est nécessaire, pour que le système fonctionne, que les politiques des Etats membres (en matière de ponction fiscale, dépense publique etc.) soient identiques, que les stratégies des segments du système productif (les groupes d’entreprises par branches et secteurs etc.) soient parallèles, que les stratégies des acteurs sociaux (notamment les syndicats) le soient également etc. b) Il est difficile - et impossible en temps de crise - de formuler une politique européenne cohérente et efficace garantissant simultanément « l’ouverture intérieure » et « l’ouverture extérieure » (des marchés et des flux de capitaux). Il faut choisir. La garantie prioritaire de l’ouverture intérieure implique des garde-fous qui la protègent de l’extérieur. Mais encore une fois le concept de déconnexion est banni. Ce choix malheureux est, à mon avis, le produit de la domination de l’idéologie monétaire à la mode, et rien de plus. On admet qu’une entité sociale quelconque - Etat ou Communauté - peut pratiquer une « gestion neutre de sa monnaie », selon ses propres termes. Je crois pour ma part que ce concept, purement idéologique, n’a pas d’existence historique réelle durable. Cette gestion neutre n’existe en apparence que dans les moments où la société, n’ayant pas de projet social, se soumet à la loi unilatérale du marché. Mais l’histoire montre que ces moments sont des moments de transitions chaotiques vers un ordre social nouveau, défini par un projet sociétaire. A ce
250
moment la monnaie redevient ce qu’elle est par sa nature même, non pas une marchandise comme une autre comme le prétend l’idéologie libérale à la mode, mais un instrument d’opération de la volonté collective. L’Europe a donc choisi de recourir à un « remède miracle », la libérant de la tâche difficile de trancher dans les domaines des choix politiques auxquels elle est confrontée. Cependant la poursuite d’une « politique monétaire neutre » par la Bundesbank et derrière elle quelques autres banques centrales européennes n’est pas appelée à être durable. Cette politique sera poursuivie tant que les forces conservatrices qui ont la responsabilité de la gestion des affaires s’entêteront à gérer la crise de la manière dont elles le font, c’est-à-dire au prix d’une spirale descendante qui en aggrave toujours plus l’ampleur. Mais gageons que les orages sociaux que cette politique produit - déjà visibles - y mettra un terme plus vite que prévu. Déjà l’horizon 1996 planifié pour la création de l’Euro a été reporté à 1999. Il sera bientôt remis aux calendes.
5 - L'U.E. dans la tempête; le défi véritable : un espace commercial ou une intégration politique et sociale Engagé dans une impasse par la priorité malheureuse donnée à la création d’une monnaie commune, la construction européenne est entrée dans la zone des tempêtes. Ce choix conforte les forces les plus conservatrices attachées à une forme de gestion de la crise sans issue. La protestation sociale contre les conséquences fatales de cette gestion, déjà bruyante, s’amplifiera très certainement. En liant le projet européen à une politique néolibérale extrême le choix en question pourrait inverser plus rapidement qu’on ne le pense l’opinion générale et la dresser contre l’idée européenne elle même. Les acquis encore fragiles, favorables à la mise en œuvre graduelle de cette idée, seraient eux mêmes rapidement érodés.
251
Scénario catastrophe. Les optimistes de tempérament diront que l’Europe en a vu d’autres dans l’histoire et a toujours fini par relever le défi. Il est vrai que les sociétés de ce continent n’ont certainement pas à rougir de leur histoire et qu’elles ont toujours fini par ouvrir la voie au progrès. Mais le prix qu’elles ont dû payer pour qu’il en soit ainsi a été parfois fort sanglant, comme l’illustre le combat de la démocratie contre le fascisme. L’Europe n’est pas menacée de l’extérieur. Elle ne l’était pas de 1945 à 1990, même si certaines forces politiques ont mobilisé une crainte de l’U. R. S. S. et du « communisme » largement illusoire. Dire qu’elle pourrait l’être aujourd’hui par les peuples et Etats du Sud, et singulièrement par le fondamentalisme islamique, frise le grotesque. Les options malheureuses qui pourraient triompher ici et là dans le Sud ne feront de victimes que dans leurs propres peuples et nations, dont elles contribueront à accentuer le retard, donc la faiblesse sur la scène mondiale. L’Europe est menacée de l’intérieur. Pour sa partie occidentale la menace paraît ne pas pouvoir atteindre le seuil de l’intensité dramatique. Les conflits classés traditionnellement dans la rubrique des « conflits nationaux » - ou communautaires, bien connus (Irlande, Espagne, Belgique en constituent les théâtres principaux), ne sont pas nécessairement appelés à s’aggraver ou à ne pas trouver de solutions. On a quelque difficulté à imaginer que les conflits majeurs qui ont opposé dans le passé les puissances de la région (GrandeBretagne, Allemagne, France) puissent renaître et prendre la forme de nouvelles guerres intra-européennes. A l’Est par contre le seuil du drame est franchi. L’absurdité des politiques néolibérales imposées pour la « reconversion » est génératrice d’une catastrophe sociale et économique, qui remet en question la crédibilité même de l’acquis démocratique (lequel paraîtrait alors a posteriori purement conjoncturel). Des forces politiques locales
252
sont certainement responsable en premier lieu des crises violentes qui secouent la région en réaction à la spirale involutrice dans laquelle sont engagés leurs pays. Mais elles partagent cette responsabilité avec les Etats de l’Ouest européen : jetteront-ils de l’eau ou de l’huile sur le feu ? Jusqu’à ce jour ils ont plutôt choisi la seconde réponse, en fait, sinon en intention (pour tous). En soutenant les tendances centrifuges, inévitablement produites par le chaos néolibéral, les diplomaties occidentales ont jeté de l’huile sur le feu, encouragé les démagogues aux abois à la recherche d’une base nouvelle qui pourrait fonder la légitimité de leur pouvoir - la base « ethnique ». Il était évident qu’on ne fait pas éclater des constructions historiques comme la Yougoslavie ou l’U. R. S. S. sans déclencher à coup sûr des conflits meurtriers. Il était évident que les premières « élections » confuses ne traduisaient rien de plus que le désarroi. L’Europe n’a pas choisi d’aider les forces qui voulaient faire triompher la patience, souvent capable d’atténuer la violence des premières réactions. Je note ici que l’Allemagne paraît avoir joué le rôle de la locomotive dans l’intervention destructrice. Elle reconnaissait unilatéralement « l’indépendance » de la Slovénie et de la Croatie, un mois plus tard la Communauté entérinait la décision. C’est sans doute là le signe indicateur qu’il existe bien un projet à l’œuvre (allemand ? ou européen ?) : celui de latino-américaniser l’Est européen. A court terme ce projet de démantèlement national et de désagrégation sociale est bien celui, à l’échelle mondiale, de la vision utopique de la « gestion du monde comme un marché » : émietter au maximum les pouvoirs, priver les pouvoirs d’Etat de toute efficacité, face à un « marché » omniprésent. Mais depuis qu’il n’existe plus de rideau de fer, les évolutions dans une moitié de l’Europe ont des effets directs dans l’autre. Et, comme on le sait, le mauvais
253
exemple est souvent plus fort que le bon. Associés à l’approfondissement de la crise à l’Ouest, les néofascismes de l’Est encouragent ceux, renaissants, de l’Ouest. Mais au delà même de ce danger, qui fort heureusement n’est encore que marginal, le chaos suscite la renaissance des nationalismes d’Etat. Si les pays de l’Europe, ensemble, n’ont rien à offrir de convaincant, la tentation sera renforcée de chercher des réponses nationales, et nationalistes. On serait alors revenu, sans l’avoir toujours voulu, à l’Europe du XIXe siècle, celle où « le conflit des nations » occupait le devant de la scène tout autant que la « lutte des classes ». Car il n’y a pas plus de fatalité de la construction européenne qu’il n’y a de fatalité de l’unité arabe, du triomphe du panafricanisme ou de l’intégration latino-américaine. Les tendances centrifuges existent et opèrent également en Europe, occidentale incluse. Et il existe pour chaque nation européenne d’autres options possibles que celle de l’unité du continent. La Grande-Bretagne était restée longtemps plus centrée sur le maintien des liens du Commonwealth - héritage de son hégémonie impériale - que sur son intégration éventuelle à l’Europe. A partir de 1945 elle a fait un choix auquel elle n’a jamais renoncé, celui de donner la priorité à son alliance inconditionnelle avec les Etats-Unis. Jusqu’ici ce choix a pu être concilié avec son ralliement européen. Mais quid de l’avenir, si la concurrence Europe-Etats-Unis s’aiguisait ? Ou si l’Europe volait en morceaux ? Ou si l’Allemagne dominait l’Europe ? La France avait envisagé, en 1945-1946, la rénovation de son Empire dans un cadre « associationiste » (l’association de nations indépendantes, ou appelées à le devenir au sens sérieux du terme). Les forces colonialistes ont vidé le projet de son intention rénovatrice potentielle, perpétué les rapports colo-
254
niaux jusqu’au moment où la transformation des rapports à l’intérieur du capitalisme français - au détriment des vieux intérêts coloniaux déclinants et au bénéfice de secteurs dynamisés par des politiques de modernisation efficaces - faisait culbuter la France en direction de l’intégration européenne. La France n’a aujourd’hui plus d’autre choix possible. Mais c’est là un élément de sa faiblesse, précisément parce que la puissance européenne principale l’Allemagne - bénéficie d’une marge de manœuvre beaucoup plus grande. L’Allemagne, depuis 1871, avait développé son projet propre - le « Drang Nach Ostern » (Poussée vers l’Est). Y a-t-elle renoncé ? Certes l’Allemagne est devenue une démocratie à l’instar de la Grande-Bretagne et de la France, ce que ni le Second Reich (de Bismark) n’était réellement, encore moins évidemment l’odieux Troisième Reich hitlérien. Parce qu’elles sont conscientes que cet acquis est essentiel, les forces démocratiques en Allemagne sont convaincues que « l’Allemagne européenne » doit être préférée à « l’Europe allemande » pour reprendre leurs propres termes. Il reste que le Quatrième Reich est déjà là, comme le démontre son intervention en Yougoslavie, l’inquiétante résurrection de la « question des Sudètes » et bien d’autres signes. Un Quatrième Reich démocratique est-il possible ? Pourquoi pas. Les impérialismes britannique et français s’étaient bien déployés sans remettre en question la démocratie dans leurs métropoles. Un Quatrième Reich démocratique pourrait même reprendre les objectifs du Drang Nach Ostern sans que cet expansion n’apparaisse intolérable aux peuples de l’Europe de l’Est : une hégémonie régionale qui fonctionnerait par les moyens de l’économie comme celle des Etats-Unis à l’échelle mondiale (et les Etats-Unis sont également une démocratie que cette hégémonie n’a pas ruiné). La marge de manœuvre dont dispose l’Allemagne est alors grande : elle poursuivrait sa politique propre vers l’Est sans remettre en cause la construction européenne,
255
ses partenaires (la France en premier lieu) étant contraints d’entériner ses initiatives. C’est évidemment « l’Europe allemande », dans un « univers américain », parce que l’Allemagne ne commettrait pas l’erreur (qui fut fatale à Hitler) de vouloir avaler plus qu’elle ne peut digérer. Les choix éventuels des autres pays de la Communauté sont, pour le moment, moins décisifs par leur portée perspective. Mais il paraît bien que l’Italie, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et les pays Scandinaves accepteraient l’« Europe allemande » sans grande difficulté, surtout si l’Allemagne conduit sa stratégie sans renoncer à la démocratie. La Russie et ceux des pays de l’ex-U. R. S. S. qui seront (et sont) l’objet de sa convoitise et de celle des autres (l’Allemagne en direction des Etats baltes et de l’Ukraine), pourront-ils être indéfiniment tenus à l’écart ? Ici encore cette option fait à court terme le jeu du Drang Nach Ostern, l’Allemagne n’envisageant dans un premier temps qu’une expansion limitée en direction de l’Autriche (déjà intégrée de fait dans son espace), la République tchèque (en voie de compradorisation), la Slovénie, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, les Etats baltes et l’Ukraine. Je conclurai sur ce scénario catastrophe en disant qu’il me paraît contraint de ressusciter une Europe du XIXe siècle et soit une alliance anglo-franco-russe pour contenir les ambitions allemandes, soit un nouveau partage germanorusse, qui achèverait d’isoler la France. Fort heureusement le scénario catastrophe n’est pas le seul imaginable. Un scénario progressiste l’est également, même si les exigences de son succès sont sévères.
256
Le projet européen ne peut se satisfaire de la seule « gestion de la démocratie dans un espace plurinational ». Ce dénominateur commun minimal est tout à fait insuffisant et incapable même de protéger les acquis, tant communautaires (au plan économique) que simplement démocratiques. La crise - qui n’est pas une « récession » mais une crise structurelle sociétaire et pas seulement économique - peut éroder gravement la légitimité de la tradition démocratique européenne elle-même. Le projet européen ne trouvera de réponses aux défis auxquels il est confronté (quel développement pour l’Europe ? Comment concilier celui-ci et la mondialisation ? Comment concilier en Europe nations et supranationalité ?) que s’il produit un véritable projet sociétaire à la hauteur des problèmes de notre temps. J’énumèrerai donc ici en conclusion les dimensions diverses qu’un projet sociétaire digne de ce nom implique. i)
Un projet sociétaire est d’abord une vision sociale, une vision des rapports sociaux. Celle-ci ne peut être simplement implicite, produite par la reproduction du système productif. Elle doit être explicitée dans le champ propre des rapports sociaux, lesquels sont en partie (pour leur noyau dur) des rapports de classe opérant sur la base des systèmes productifs, mais aussi au delà des rapports sociaux se déployant dans des champs divers de la réalité (comme les rapports hommes / femmes). On peut bien qualifier de « contrat social » cette procédure d’explication. Je n’y vois pas d’inconvénient particulier. Nous en avons d’ailleurs connu un antécédent historique dont le déploiement a fondé le miracle européen (et américain) : le compromis historique national capital / travail qui supposait trois partenaires, l’Etat - incontournable - étant le lieu de la négociation et l’instrument de la mise en œuvre du compromis en question. Il ne s’agit pas de produire un « remake » de ce modèle, dépassé définitivement, ne serait-
257
ce que par le mouvement de la mondialisation et la construction européenne elle-même. En tout cas le contrat social vient avant, et non après, les stratégies économiques qui se déploient dans son cadre et sur sa base. Les économistes conventionnels ont de la difficulté à accepter cet ordre de préséance. Ils ont toujours pensé - aliénation économiste oblige - que l’économie décidait de tout. Il n’est pas non plus utile de coller sur les rapports sociaux qui définissent le projet l’épithète de « capitaliste » ou de « socialiste ». Non que les deux concepts n’aient pas de sens, ou ait perdu leur portée historique. Ils la gardent pleinement. Simplement la longue transition du capitalisme mondial au socialisme mondial implique la coexistence conflictuelle d’éléments de logiques capitalistes (le marché, le calcul du profit, la hiérarchie dans le travail...) et de logiques anticapitalistes (l’équité, la démocratie ne sont pas les produits naturels de l’expansion capitaliste mais ceux du combat des peuples contre la logique unilatérale de l’accumulation du capital). ii) Au delà même du « contrat social » qui régule les conditions de reproduction du système productif un projet sociétaire à la hauteur des exigences de notre temps implique une vision de l’avenir de notre civilisation technologique. La question de l’avenir du travail est posée. Après l’ouvrier masse de la période fordiste, le travailleur - citoyen - intellectuel qui tend à constituer la nouvelle « masse » dans le système productif de demain, fondé sur des technologies informatisées et automatisées et sur ce qu’elles impliquent d’interdépendance entre tous les segments du système, interpellant les formes de la loi de la valeur dominantes jusqu’ici (ce que les économistes formulent avec la naïveté qui les caractérisent en découvrant que « le facteur technologique » est le déterminant principal et ultime de la productivité), n’appelle-t-il pas la substitution d’un « revenu de citoyenneté » au salaire ? Il va de soi également que la prise en compte du
258
défi écologique, qui ne peut être internalisé dans le calcul conventionnel des coûts, fondé sur le court terme, pose également en termes nouveaux les problèmes d’organisation de la décision économique. Il va de soi que la « participation à la gestion », ou la « cogestion » à l’allemande sont loin de répondre à ces défis civilisationnels. L’avenir de la propriété et au delà des formes nouvelles vers lesquelles on devrait en orienter l’évolution interpelle la pensée et l’action sociales dans toutes leurs dimensions. iii) Faut-il rappeler que les concepts historiques sur lesquels la solidarité nationale a été construite sont eux mêmes remis en question par le défi de la « supranationalité », dans la construction européenne certes, mais ailleurs également ? Comment dans ce cadre repenser la différence, la spécificité et l’universalisme ? iv) Le projet européen est, au plan directement politique, confronté à la question des rapports Europe-Etats-Unis, toujours jusqu’ici encadrés par l’alliance militaire qu’est l’O. T. A. N. L’adversaire supposé contre lequel cette alliance avait été forgée ayant disparu, à quoi répond la survivance de l’O. T. A. N. ? A un adversaire nouveau, qu’on doit fabriquer de toutes pièces (l’Islam, les Asiatiques ?) et dont on recherche fébrilement à établir l’existence par la construction hâtive d’une théorie du « conflit des cultures » qui n’emporte la conviction que de ceux qui en sont déjà convaincus ? Et cela bien que cet adversaire ne représente aucun danger militaire ? Dire, comme on l’entend souvent, que l’O. T. A. N. est devenue l’instrument de la démocratisation du monde, son fer de lance, rappelle tant le discours de la « mission civilisatrice » qu’on devrait y répondre par un rire spontané. Et en rire davantage encore quand on regarde sans naïveté infantile ce que sont les interventions militaires de nos jours (la guerre du Golfe pour la démocratie au Koweit !). En fait l’O. T. A. N. fait
259
partie de la panoplie indispensable de la gestion politique du chaos généré par le volet économique de sa gestion capitaliste. Et dans ce sens, tant que l’Europe n’envisage pas de se situer au delà de cette crise, elle ne peut qu’accepter de passer par les fourches caudines de l’hégémonie militaire américaine. Du coup, en perpétuant cette hégémonie globale, cette option annihile en grande partie la portée que l’on donne à la nouvelle compétition économique Europe-Etats-Unis, annihile en grande partie le rêve européen « d’indépendance ». v) Le projet européen, faut-il le rappeler, est en conflit direct avec celui de la latino-américanisation de la moitié orientale du continent. J’ai essayé plus haut d’expliquer pourquoi et comment le second fera éclater le premier. vi) Enfin le projet européen peut-il ignorer le Sud et emboîter le pas du discours creux des économistes obnubilés par les apparences de la « marginalisation » du tiers-monde ? Au moment même où l’accès aux ressources naturelles de la Planète toute entière et devenue plus que jamais vital pour la survie de « l’Occident » ? La question de cet accès pourrait, il est vrai, être réglée par un néo-impérialisme global. Outre que ce colonialisme global serait nécessairement le meilleur moyen de perpétuer l’hégémonie du soi-disant concurrent américain, peut-on penser un moment qu’il serait viable ? Comment, en contrepoint, penser les articulations nécessaires entre les grandes régions (l’Europe, l’Amérique latine, l’Afrique, le monde arabe) et les puissances continentales (Etats-Unis, Chine, Inde) dans une interdépendance favorable à leur développement, susceptible de réduire les effets de la polarisation inhérente à la mondialisation par le marché ? J’ai développé ailleurs des propositions concernant ces questions. Je n’y reviens pas ici.
260
En résumé et en conclusion, si l’on convient que les six thèmes évoqués ici constituent un agenda s’inscrivant naturellement dans la tradition de la pensée de gauche, celle du mouvement et du progrès, l’Europe sera de gauche ou ne sera pas.
Bibliographie La documentation concernant le développement des Communautés européennes remplirait à elle seule une bibliothèque. Une bonne synthèse est fournie par : Robert Toulemon, La construction européenne, Livre de Poche, Références 1994. Voir également : Louis Cartou, Communautés européennes, Précis Dalloz Laurent CohenTanugi, L'Europe en danger, Fayard 1992 Yves Doutriaux, Le traité sur l'Union européenne, Armand Colin 1992 Pierre Gerbet, La construction de l'Europe, Imprimerie nationale, 1982.
261
Chapitre VII Le projet de la chine post-Maoïste Depuis une quinzaine d’années la Chine est entrée dans une période de croissance économique accélérée - 10 % l’an - qui, à l’échelle de ce pays de 1 200 millions d’habitants, est évidemment appelée à modifier tous les équilibres internationaux fondamentaux. De surcroit cette évolution se déploie au moment même où l’Occident capitaliste (et derrière lui une bonne partie du tiers-monde) souffre d’une stagnation tenace, tandis que les pays de l’exmonde soviétique sont entrés dans un cycle involutif dont l’issue reste inconnue. Pourquoi donc ce que l’on qualifie généralement d’option capitaliste de la Chine post maoïste donne-t-elle des résultats apparemment aussi rapides et brillants alors que la conversion de l’Europe de l’Est et de l’ex-URSS au capitalisme est-elle si douloureuse et peu efficace ? Pourquoi les structures de l’essor de la Chine contemporaine sont-elles aussi différentes qu’on peut le constater de celles de l’URSS à l’époque de l’essor stalinien ? Les éléments de réponse qu’on peut donner à ces questions sont de natures diverses et se situent sur des plans différents, les uns directement liés aux politiques économiques immédiates mises en œuvre par les forces politiques en place, les autres faisant appel à un détour par la géopolitique. En effet le système mondial lui-même est coupé en deux. Les pays situés dans ce qu’on pourrait appeler sa moitié occidentale, comprenant tout le continent américain, toute l’Europe (de l’Atlantique à Vladivostock), toute l’Afrique, et toute l’Asie occidentale, sont, à des degrés divers, en crise depuis vingt-cinq ans. A
262
l’Est par contre, toute l’Asie orientale - Japon, Chine, Corée, Taïwan plus toute l’Asie du Sud-est ne connait pas de crise. Au contraire tandis que celle-ci s’approfondissait dans cet Occident élargi défini plus haut, l’Asie orientale entrait dans une phase de croissance très forte. Celle-ci semble appelée à se poursuivre, sauf sans doute au Japon qui paraît entrer à son tour dans la crise. On peut donc se poser la question de savoir s’il y a un lien entre ce contraste et celui qui oppose les évolutions et les mutations en Europe orientale d’une part et en Chine d’autre part. 1) Je commencerai par aborder une première série de questions, relatives à la comparaison des concepts politiques et économiques propres au monde ex-soviétique et à la Chine post maoïste. Je résumerai cette comparaison par l’affirmation tranchante qui suit : en Europe orientale (et dans l’exURSS) il n’y a pas de conception de la mutation entreprise, il n’y a pas de projet de société. Il y a bien une idéologie, certes, celle du capitalisme vulgaire, mais il n’y a pas de projet cohérent qui cherche à mettre en place dans ses divers aspects la société nouvelle, fut-elle capitaliste. Par contre en Chine il y a un projet tout à fait cohérent. A mon avis ce n’est certainement pas un projet socialiste, et je le qualifierai de projet capitaliste national et social. La gauche socialiste chinoise se propose de moduler ce projet du pouvoir en place pour l’inscrire dans une longue transition socialiste. En disant national, j’entends par là un projet qui est fondé sur la conviction profonde que l’intégration dans le système mondial n’est jamais pacifique, mais toujours violente et conflictuelle. Toute la classe dirigeante chinoise et au-delà même la société chinoise d’une manière générale partagent cette conviction. Ici on ne croit pas du tout, par exemple, au genre de discours que Gorbatchev avait développé en son temps, et auquel adhère, semble-t-il, une bonne partie des classes dirigeantes et des politi-
263
ciens des pays de l’Est européen. Selon ce discours en effet il y aurait convergence naturelle entre la logique de l’expansion du capitalisme à l’échelle mondiale et les logiques de l’insertion des différents pays dans cette expansion. En contrepoint la classe dirigeante chinoise voit les EtatsUnis comme l’adversaire, un adversaire qui sera appelé à devenir de plus en plus dur au fur et à mesure des succès de la Chine. Sur ce plan j’ai fait référence ailleurs à l’article fameux de S. Huntington (The Clash of civilizations), dans lequel cet idéologue au service de la CIA tente de justifier l’option politique américaine appelée à devenir de plus en plus ouvertement antichinoise, la Chine étant menaçante non par l’exemple de son socialisme, mais tout simplement parce qu’elle est une grande puissance ascendante. Concernant la dynamique de la croissance économique de la Chine, et sans entrer dans des détails d’ailleurs connus, je rappellerai d’abord que ses taux sont relativement fabuleux, même s’il faut en rabattre - notamment dans l’agriculture où certaines croissances se font au détriment du plus long terme. L’important à mon avis est de comprendre que, contrairement à ce qu’on dit souvent, cette croissance n’est pas tirée - pour l’essentiel par les exportations. Le taux de croissance des exportations a été de 11, 5 % l’an pour la décennie des années 1980, contre 9, 7 % pour celui du PIB. Or dans les pays donnés en exemple par la Banque Mondiale comme ayant « réussi parce qu’ils ont donné la priorité aux productions d’exportation » le taux de croissance des exportations a été en général double de celui du PIB. Il y a d’autres caractéristiques de la croissance chinoise qui font contraste avec celles propres au reste du tiers-monde. L’inflation est demeurée modeste en Chine (5, 8 % l’an pour les années 1980) par comparaison à ce
264
qu’elle a été en moyenne dans tout le tiers-monde (des taux allant de 14,9 % en moyenne annuelle pour les pays pauvres stagnants à 73 % pour les pays à revenus moyens, souvent donnés en exemple par la Banque Mondiale !). De même l’endettement extérieur de la Chine est resté très inférieur à ce qu’il est pour toutes les autres régions du tiers-monde. La part du service de la dette par rapport aux recettes d’exportation est certes passée de 4, 6 % en 1980 à 9, 8 % en 1990 pour la Chine; mais ces pourcentages respectifs ont été pour l’Inde de 9,1 % et 26,4 %, pour les autres pays pauvres de 11,4 % et 27,4 %, pour les pays à revenus moyens de 26,1 % et 23,1 %. Ces quelques données globales illustrent certainement le « succès » du projet chinois de développement, qui soutient favorablement la comparaison avec ceux du reste du tiers-monde, sans pour autant nous permettre encore ni d’en qualifier la nature (« capitaliste » ou « socialiste ») ni d’en discuter des perspectives et des limites historiques possibles. Revenons maintenant à la comparaison Chine-URSS. Nous avons ici incontestablement des éléments communs, tenant à un héritage commun, celui que la Ille Internationale (le bolchevisme, le marxisme-léninisme) a construit; mais aussi des différences qui tiennent aux conditions historiques du développement des deux partis communistes et des deux révolutions. En Russie la question centrale autour de laquelle les débats ont tourné à partir de 1917 était celle de l’alliance ouvrière et paysanne, condition et moyen d’un développement des forces productives qui s’inscrive éventuellement dans la perspective d’une construction socialiste. De la réponse à cette question dépendaient, plus que le succès ou l’échec en soi de la modernisation d’un pays arriéré à dominante paysanne, le contenu social de
265
ce succès éventuel et, les perspectives qu’il pouvait ouvrir ou fermer. J’ai écrit ailleurs que l’option faite finalement à partir de 1930 - fondée sur une forme de collectivisation qui brisait cette alliance - non seulement a mis un terme aux espoirs d’une perspective socialiste (en renforçant l’autocratie, base de la reconstruction d’une classe aspirant à devenir bourgeoise), mais encore a probablement limité les possibilités du développement des forces productives. J’ai également écrit que ce choix malheureux était le produit de l’idéologie ouvriériste - anti-paysanne héritée de l’histoire de la classe ouvrière de l’Europe occidentale bourgeoise (et de la Ile Internationale) partagée par Lénine (même si celui-ci en a corrigé les effets par son alliance avec les Socialistes Révolutionnaires, dominants dans les campagnes en 1917) avant d’être reprise par Staline. Le cas chinois est très différent. A l’origine le Parti communiste est en Chine, comme en Russie, plus « intelligentsiste » qu’ouvrier, opérant dans les conditions où la classe ouvrière est encore plus minoritaire. Mais l’un comme l’autre sont des partis intelligentsistes qui ont été capables de mobiliser la classe ouvrière et d’y conquérir une influence très forte. La différence est que, tandis que le Parti communiste russe n’avait pas construit de soutien à la campagne avant 1917, la guerre conduite à partir de 1930 dans les campagnes chinoises a permis à son Parti communiste de construire celui-ci. Aussi par la suite la révolution chinoise, en dépit des vicissitudes qui caractérisent son évolution de 1949 à ce jour, a résolu la question de « l’alliance ouvrière - paysanne » moins mal que d’autres, et que l’URSS notamment. Les termes de l’échange internes agriculture / industrie n’ont jamais connu en Chine les évolutions catastrophiques qui marquent l’histoire de l’URSS.
266
Une autre différence importante sépare les deux révolutions. Celle de la Russie avait totalement éliminé la bourgeoisie. Le cas chinois est différent. La guerre contre l’impérialisme japonais a fait que le parti communiste a exercé une attraction très forte, à partir des années 1930, sur toutes les forces de résistance nationale, bourgeoisie incluse. Le ralliement massif d’intellectuels et de bourgeois au Parti communiste a été déterminé par ce motif plus que par tout autre. La conjugaison de l’ensemble de ces facteurs historiques rend compte de la force avec laquelle s’est cristallisé en Chine un projet de société moderniste, national et social. National est ici un qualificatif positif non seulement parce qu’il implique une vision réaliste (c’est-à-dire anti-impérialiste) du capitalisme mondial réellement existant, mais aussi parce qu’il oblige à concevoir la construction de la légitimité du pouvoir sur des bases qui impliquent sa responsabilité sociale. Je ne dis pas socialiste - ce qui à mon sens implique une transformation radicale des rapports de production et des rapports sociaux comme Marx les avaient analysés - mais social au sens que le développement est conçu comme devant être fondé sur une solidarité sociale véritable, obtenue par des politiques systématiques qu’on pourrait qualifier de « justice sociale » (emploi, services sociaux, redistribution du revenu etc.). Le projet national social chinois est sur ce plan un peu l’analogue de ce que sont les projets sociaux démocrates de l’Occident. Cette préoccupation explique que la théorie libérale n’exerce qu’un attrait limité en Chine. Personne ici ne croit bêtement que « le marché résout naturellement tous les problèmes ». Il y a ici un paradoxe amusant : là où la présence de la bourgeoisie est plus forte (comme en Chine) l’idéologie libérale est moins facilement admise que là où elle est plus faible (en Europe de l’Est) ! Mais ce paradoxe n’est que d’apparence à mon avis, car la
267
différence s’expliquerait assez naturellement par l’articulation idéologie / classes et intérêts sociaux réels. De la même manière en effet en Asie orientale capitaliste (où la bourgeoisie est plus forte) l’idéologie libérale n’est admise qu’à moitié, alors qu’elle s’impose dans les régions du tiersmonde dont les bourgeoisies sont les plus chétives ! Cela étant le dénominateur commun est loin d’être négligeable. C’est en gros non seulement l’héritage de la Ille Internationale, mais, par delà celle-ci, celui de tout le mouvement ouvrier européen, notamment du marxisme historique et de la Ile Internationale (d’avant 1914). J’ai rappelé à plusieurs reprises qu’Engels, faisant la critique de ces conceptions du mouvement ouvrier, concluait qu’elles inspireraient plus la construction d’un « capitalisme sans capitalistes » que celle du communisme. Les concepts relatifs à la neutralité des techniques de production, au rôle d’« avant-garde » du parti et aux rapports Etat-parti-classe-peuple et bien d’autres choses représentent cet héritage commun. L’URSS ne l’a jamais remis en question. Mao a tenté de le faire par la révolution culturelle, au moins sur deux points essentiels : la neutralité des technologies, remise en question, le parti autocratique désigné comme la forteresse au sein de laquelle se reconstituait la bourgeoisie. Mais la révolution culturelle a échoué, sans doute parce qu’elle n’est pas parvenue à découvrir et construire l’agent social capable de conduire son action et lui a substitué la catégorie floue des « jeunes ». 2) Toujours est-il que la Chine post Mao, si elle a reculé par rapport aux objectifs socialistes de Mao, est resté attachée à un projet national et social, sans grande illusion sur le « marché » et le « capitalisme mondial ». Lorsque donc on dit - comme la Banque Mondiale et les médias dominants - que le « succès » de la Chine depuis 1980 est dû au fait qu’elle a renoncé
268
au socialisme, ce qui lui a permis de sortir de la « stagnation maoïste » etc. non seulement on simplifie les choses outrageusement, mais encore on s’interdit de comprendre les raisons véritables de ce « succès ». Car sans l’infrastructure économique, politique et idéologique construite par les trente ans de maoïsme (1950-1980), on comprendrait mal la nature de l’accélération des quinze dernières années. Car en termes de croissance il ne s’agit que d’accélération. La Chine avait déjà enregistré dans la période 1957-1975 un taux de croissance de 5, 3 % du PIB, soit 3, 3 % du PIB per capita (contre moins de 2 % pour le reste du tiers-monde), avait déjà enregistré des taux de croissance records dans l’industrie légère (11, 2 %) et lourde (8, 3 %) dès cette époque, avait déjà mis en place des structures sociales garantissant une répartition du revenu infiniment meilleure (c’est-àdire moins inégale) que partout ailleurs, en Inde, en Afrique ou en Amérique latine. Sans ces réalisations le « miracle » contemporain eut été impensable. D’ailleurs parce que précisément elle n’a pas bénéficié de reconstructions analogues l’Inde, bien que capitaliste et ouverte au système mondial plus encore que la Chine, faisait et continue à faire moins bien, sur tous les plans, en terme d’efficacité comme de justice sociale ou d’indépendance. La Chine de Deng, si elle a bien décidé de « réintégrer le système mondial » a rejeté catégoriquement cette fameuse thérapie de choc qu’on peut sans doute résumer en trois termes : privatisations à outrance, liberté sans entraves aux marchés, ouverture extérieure sans contrôle. L’Europe orientale, dont la classe dirigeante issue de l’ex-nomenklatura s’était convertie aux thérapies de choc est entrée, comme on le sait, dans une involution dont elle n’est pas prête de sortir. La Chine a rejeté la formule même si pour des raisons de « représentation » vis-à-vis de l’extérieur, elle ne le dit pas toujours.
269
La privatisation à la chinoise est en fait une déconcentration de la propriété publique. Tandis qu’en 1981 encore l’Etat dominait la scène (répartition de la propriété : Etat 78 %, coopératives 21 %, privé : négligeable), en 1990 la part de l’Etat est réduite à 54, 5 % mais au profit de la propriété des collectivités (Provinces, villes, groupements syndicaux, coopératives : 35, 7 %) plutôt qu’à celui du privé dont la part ne dépasse pas 5, 4 %. Le système des prix mélange d’une manière qui se voudrait rationnelle (mais qui ne l’est pas toujours) le principe de la concurrence sur le marché (et donc de la liberté pour l’entreprise de fixer ses prix d’offre) et celui de la planification (fixation autoritaire du prix ou intervention d’organismes publics sur le marché). Ici aussi, tandis qu’en 1978 un système « à la soviétique » dominait la scène (encore que le système chinois n’avait jamais été aussi outrancier que celui de l’URSS et avait toujours largement tenu compte de l’offre et de la demande sur le marché), dès 1990 les prix libres commandent la moitié des marchés des produits agricoles et industriels de consommation (mais seulement 36 % de ceux concernant les biens d’équipement et les matières premières). Selon la formule d’usage en Chine les « quatre modernisations » (formulées en leur temps par Chou Enlai) sont mises en œuvre par une politique dite des « trois positifs » qui concernent la justice sociale, l’équilibre régional et la maîtrise des relations avec l’extérieur. Et il faut reconnaître que les politiques mises en œuvre jusqu’à ce jour ont été plus ou moins effectives dans ces trois domaines. Il y a certes en Chine des « nouveaux riches » dont la fortune est parfois (mais pas toujours !) associée à des initiatives économiques performantes, des inégalités nouvelles difficiles à justifier en termes d’efficacité économique (par exemple entre les salaires des cadres des entreprises privées as-
270
sociées au capital étranger et ceux des autres secteurs), mais il demeure également - par la logique des prix et des salaires - une structure massive polydimensionnelle qui assure une redistribution gigantesque du revenu à l’échelle de 1200 millions de personnes, qui n’a d’équivalent dans aucune autre économie du monde. Le résultat est visible : en dépit de toutes les difficultés et de la pauvreté du pays il n’y a pas de « nouveaux pauvres », en tout cas rien de comparable avec ce qu’on connait dans le tiers-monde capitaliste, avec ou sans croissance économique, ou avec ce qui se développe au galop en Europe de l’Est. Par ailleurs il y a en Chine une conscience forte des menaces que le développement inégal des régions fait peser sur l’avenir de l’unité du pays. Il ne s’agit pas seulement de conscience. Des politiques sont mises en œuvre, grâce à la centralisation des moyens encore importante (le budget de l’Etat est loin d’être négligeable), qui visent à articuler des interdépendances nouvelles entre les provinces côtières à croissance forte et celles de l’intérieur. La région de Shanghaï entre autre table systématiquement sur ces politiques et intègre par là même toute la Chine centrale intérieure jusqu’au Sze Chuen. Par contre la région Amoy-Canton reste beaucoup plus « export oriented ». Ces politiques sont en partie au moins efficaces puisqu’on ne trouve pas une seule province chinoise dont le taux de croissance ne soit positif et supérieur à celui de sa démographie, même parmi les plus pauvres. Bien entendu ces progrès restent fort modestes en comparaison des taux de 20 ou 25 % réalisés dans les régions les plus favorisées. Le troisième « positif » concerne l’ouverture extérieure, qui demeure raisonnablement contrôlée par l’Etat. En fait n’importe qui n’importe pas n’importe quoi librement en Chine. Et lorsque les Etats-Unis accusent ici la
271
Chine de « tricher avec les règles du GATT », ils n’inventent rien. Il reste évidemment à savoir s’il n’est pas juste, tant qu’on ne peut rejeter officiellement l’injustice des règles en question, de les contourner autant qu’on le peut. Cependant j’ajouterai pour ma part un quatrième - et grand - « négatif » aux trois « positifs » rappelés ci-dessus : la classe dominante paraît convaincue que les objectifs définis dans les trois positifs en question peuvent être atteints par les seules vertus du bon fonctionnement de l’Etatparti tel qu’il a été construit, sans intervention autonome des classes populaires. Pour ma part je crois que c’est là une grande illusion comme l’histoire de l’URSS l’a amplement démontré. 3) Nous sommes peut-être maintenant outillés pour revenir à notre question de départ : y a-t-il un projet chinois ? quelle est sa nature sociale ? (capitaliste, socialiste, étape dans la voie socialiste), comment s’articule-t-il avec l’économie mondiale et celle de la région ? Oui il y a un projet de la classe dominante chinoise. Pour ma part, tenant compte justement des trois positifs et du négatif mentionnés, je le qualifierai de projet national et social. Mais alors quelles sont ses contradictions, ses problèmes, ses possibilités de succès et ses risques d’échec, sur quel avenir s’ouvre-t-il ? Une certaine tradition s’emploie à analyser les problèmes de la Chine en termes de « conflits régionaux ». Et d’une certaine manière on peut associer régions et modes de production (et donc classes dominantes locales) : le Nord « féodal et bureaucratique », Shanghaï capitaliste national, Canton compradore. Le projet chinois en cours associerait ces trois composantes en préservant le rôle directeur de la bureaucratie de l’Etat-parti. Il n’est pas dit qu’il y
272
parvienne indéfiniment. La bourgeoisie nationale ne parviendra-t-elle pas à pénétrer l’appareil - par sa collusion avec les « bureaucrates affairistes » corrompus - au point de faire de l’Etat son Etat ? La marginalisation de l’intervention autonome des classes populaires n’est-elle pas de nature à faciliter cette évolution vers des formes plus franches de capitalisme ? On peut même imaginer un scénario d’évolution encore plus désagréable. Si les inégalités de développement régional continuaient à s’amplifier, n’y aurait-il pas là la base pour l’éclatement du pays (ce qui est déjà arrivé dans sa longue histoire; et il ne faut pas l’oublier) On imagine alors un sud est articulé autour de Canton-Hong Kong-Taïwan, ouvert sur le Pacifique et les Chinois d’outre-mer, largement compradore par leur histoire. Cette région trouvera-telle son complément, ou son concurrent, dans la Chine centrale de ShanghaïWuhan ? On imagine des provinces du nord ouest marginalisées, un Tibet et un Sinkiang « indépendants ». Or ce projet de démantèlement de la Chine est à l’ordre du jour : c’est l’agenda de la politique des Etats-Unis et du Japon, pour lesquels la Chine grande puissance (fut-elle capitaliste) constitue une perspective inacceptable. Evidemment la Chine unie ou démantelée occupera dans l’ensemble Asie orientale, et par delà dans l’économie mondiale des places différentes, soit que la Chine devienne un pôle d’attraction majeur, soit que ses provinces participent à l’essor d’une région certes dynamique mais non susceptible de faire contrepoids à l’hégémonie des Etats-Unis au niveau global. Mais on peut imaginer aussi une évolution plus favorable au progrès du socialisme, en Chine et dans le monde. Les autorités officielles de la Chine ne qualifient d’ailleurs pas leur propre projet de « capitaliste » (fut-il national), mais de « socialisme de marché ». L’important ici n’est ni de poursuivre une
273
enquête approfondie concernant la subjectivité des sujets en question (leur honnêteté etc.), ni de développer un discours sémantique ou métaphysique concernant la définition du socialisme. Je proposerai une méthode d’analyse différente qui d’une part met l’accent sur les luttes sociales, politiques et idéologiques qui se déploient en Chine même, d’autre part porte le débat au plan de la discussion des défis de la « longue transition du capitalisme mondial au socialisme mondial ». Il n’y a aucune raison d’ignorer systématiquement la dynamique des luttes qui se déploient en Chine. Sans doute les faits les plus visibles - surtout à l’observateur étranger - sont-ils presque toujours associés à la « montée de la bourgeoisie » : scandales, enrichissement, corruption, association avec le capital étranger, dégradation morale ou culturelle etc. Dans un autre ordre les media internationaux éclairent de leurs pleins feux les prises de position favorables à la démocratie politique comme on l’entend en Occident (droits de l’homme, pluripartisme). Ici on peut se demander si cette revendication, dans cette forme, intéresse plus que des individus, puisque la bourgeoisie chinoise ne paraît guère tenir à la démocratie (pas plus que celles de l’Asie orientale capitaliste dans son ensemble), tandis que les débats et les actions populaires se situent, semble-t-il, à la fois sur le terrain différent des droits et bénéfices sociaux et parfois sur celui plus avancé de la perspective de la démocratie socialiste. L’essentiel est à mon avis ce qui se passe réellement sur ces terrains. Néanmoins on ne peut en rester là. Je veux dire que la discussion concernant l’avenir du socialisme en Chine ne peut être isolée de celle concernant la perspective mondiale. La tradition de la IIIe Internationale avait défini à sa manière les termes du défi et répondu par une théorie de la construction du socialisme dans un seul pays et dans un délai historique court. L’histoire a
274
démontré que cette construction restait pour le moins ambiguë dans sa nature et parfaitement réversible. J’ai donc proposé de reprendre le débat concernant la longue transition (séculaire) du capitalisme mondial au socialisme mondial en en redéfinissant les termes. J’ai proposé de regarder la longue tradition non comme une période caractérisée par la juxtaposition (géographique) de systèmes sociaux différents mais comme caractérisée par le conflit, interne à toutes les sociétés, entre des éléments de système puisant leur rationalité dans la logique capitaliste et d’autres faisant progresser d’autres critères de rationalité sociale, de nature socialiste. Un peu comme le capitalisme s’est développé dans le féodalisme avant d’en rejeter la coquille, le socialisme se développerait dans un premier long temps au sein du capitalisme. Dans cette perspective évidemment les projets - chinois entre autre - de « socialisme de marché » (quel que soit l’opinion qu’on puisse avoir du choix des termes peut être malheureux) prendraient une dimension intéressante.
Note Les informations statistiques reprises ici sont tirées des Rapports Annuels de la Banque Mondiale (1983 et 1991); du State Statistical Bureau, 1991, pp 33, 55 et 79; de P. Li, Price Reform... (Beijing Review, vol. 35, N° 18, 1992, p. 17); de Nolan and Dong, The Chinese Economy, Camb. Polity Press 1990, p. 143. Développées tout à fait séparément, l’analyse que je propose ici (rédigée en novembre 1994) et celle de Lin Chun (Situating China, UNAM, Mexico, 1994) se rejoignent sur quelques points centraux. Dans ce texte j’ai fait allusion : – à la thèse du « conflit des cultures » que j’ai critiquée (Towards a theory of liberation, al Ahram weekly, N° 253, déc. 1995, Le Caire). Cf chap. XI.
275
– aux développements que j’ai consacré aux origines du soviétisme et à la théorie de la transition socialiste (Itinéraire intellectuel, L’Harmattan, Paris 1993 pp 161-182). – aux divers scénarios concernant l’avenir de l’Asie orientale. (Cf. chapitre V). Voir également Françoise Lemoine, La nouvelle économie chinoise, Repères, La Découverte, 1994 Diana Hochraich, La Chine de la Révolution à la Réforme, Syros, 1995
276
Chapitre VIII La Russie dans le système mondial géographie ou histoire ? 1) Le double effondrement du soviétisme comme projet social distinct du capitalisme et de l’URSS - voire de la Russie -comme Etat interpelle toutes les théories qu’on a pu proposer tant dans le domaine du conflit capitalisme / socialisme que dans l’analyse des places et fonctions des différents pays et régions dans le système mondial. Ces deux axes d’analyse - le premier privilégiant l’histoire, le second la géographie - se sont le plus souvent exclus l’un l’autre. Dans la tradition du marxisme historique, et singulièrement dans sa version prédominante dans l’ex-URSS, le seul grand problème du monde contemporain reconnu digne de traitement scientifique était celui du passage du capitalisme au socialisme. A partir de Lénine une théorie de la révolution et de la construction socialistes est formulée progressivement, dont je résumerai les thèses dans les termes suivants : (i) le capitalisme doit être finalement renversé partout dans le monde par le moyen de la lutte des classes conduite par le prolétariat, (ii) la révolution socialiste a commencé dans certains pays (la Russie, plus tard la Chine) plutôt que dans d’autres parce que les premiers constituaient, pour des raisons diverses, des « maillons faibles » de la chaîne du capitalisme mondial, (iii) dans ces pays la construction du socialisme est possible en dépit de leur retard de développement, (iv) la transition du capitalisme au socialisme se manifeste donc dans et par la compétition de deux systèmes d’Etats, les uns devenus socialistes, les autres restés (provisoirement) capitalistes.
277
Dans ce type d’analyse l’histoire - qui commande les particularités sociales et politiques dont sont constituées les différentes sociétés du monde moderne (et entre autres les « maillons faibles ») - est privilégiée, au point que la géographie du système mondial, dans laquelle s’expriment les places et fonctions diverses de ces sociétés, lui est intégralement soumise. Bien entendu le retournement de l’histoire, renversant « le socialisme irréversible » pour ramener au capitalisme, interpelle la théorie de la transition et de la construction socialiste en question. Dans ce qui pourrait être une analyse du mouvement de l’histoire moderne inspirée du principe fondamental qui est à la base de ce qu’on appellera, pour être bref, le courant de pensée du système et de l’économiemondes, la géographie prend une autre dimension. Ce qui se passe au niveau de tout (le système monde) commande l’évolution des parties qui le constituent. Les rôles tenus par l’Empire russe et par l’URSS s’expliqueraient alors par l’évolution du système mondial et c’est celle-ci qui rendrait intelligible l’effondrement du projet soviétique. De même que les extrémistes du marxisme historique ne connaissent que la lutte des classes pour rendre compte de l’histoire, il existe une interprétation extrémiste possible du système monde qui élimine pratiquement celle-ci, puisqu’elle serait incapable de modifier le cours imposé par l’évolution du système dans sa globalité. Je rappellerai également ici que des théories rapportant la spécificité de l’Eurasie à sa place particulière dans le système mondial avaient précédé les formulations du système-monde de plusieurs décennies. Dans les années vingt déjà des historiens russes (Troubetskoï et d’autres) avaient fait des propositions dans ce sens, enfouis dans l’oubli par le conformisme soviétique officiel, ressuscitées au cours des dernières années.
278
Je plaiderai ici en faveur d’une synthèse des deux types d’analyse proposés, en le faisant justement sur le cas russe-soviétique, ayant par ailleurs déjà défendu en termes plus généraux cette même perspective, enrichissante pour le marxisme à mon avis (cf. chap. III). 2) Le système du monde, saisi entre l’an mil et l’an 1500, est visiblement composé de trois blocs principaux de sociétés avancées (la Chine, l’Inde, le Moyen orient) auquel s’ajoute désormais, progressivement mais à un rythme de développement rapide à l’extrême, un quatrième pôle -l’Europe. Or c’est précisément dans cette région marginale jusqu’à l’an mil que se cristalliseront les transformations qualitatives de toutes natures qui inaugureront le capitalisme. Entre l’Europe et l’Asie orientale - des frontières de la Pologne à la Mongolie - s’étend l’océan eurasiatique dont la position dans le système global de l’époque dépendra largement de l’articulation des quatre pôles dans ce que j’ai appelé le système de l’ancien monde (précapitaliste, ou tributaire si l’on accepte ma qualification des systèmes sociaux qui le composent). Il me paraît impossible de donner une lecture convaincante de la naissance du capitalisme sans répondre simultanément à deux ordres de questions concernant : (i) les dynamiques des transformations locales en réponse aux défis auxquelles les sociétés sont confrontées, en particulier les dynamiques des luttes sociales; (ii) l’articulation de ces dynamiques qui s’exprime dans l’évolution du système de l’ancien monde pris dans sa globalité, en particulier la transformation des rôles des différentes régions qui le composent (et donc pour ce qui nous occupe directement ici des fonctions de la région eurasiatique). 3) Prendre en considération le point de vue global, et relativiser de ce fait les réalités régionales, c’est d’abord reconnaître que jusque fort tardivement
279
dans l’histoire les deux blocs asiatiques (la Chine et l’Inde) concentrent la grande majorité de la population civilisée de l’ancien monde. De surcroit on est frappé par la régularité de la croissance de ces deux blocs, qui grimpent en population de 50 millions d’habitants environ chacun deux siècles avant J. C. à respectivement 330 et 200 millions en 1800 et 450 et 300 en 1850. Cette progression fabuleuse doit être comparée à la stagnation du Moyen Orient à partir justement de l’époque hellénistique. La population de cette dernière région atteint probablement son maximum - 50 millions - à cette époque pour décliner ensuite presque régulièrement et se stabiliser autour de 35 millions à la veille de la révolution industrielle et de la pénétration européenne (se rappeler également, par exemple, que la popularisation de l’Egypte qui avait été de 10 à 14 millions d’habitants à certaines époques de l’Antiquité pharaonique a moins de 2 millions d’habitants en 1800, et que le déclin de la Mésopotamie et de la Syrie a été du même ordre). Elle doit être également comparée à la stagnation de l’Europe barbare jusqu’à l’an 1 000 (de 20 millions d’habitants deux siècles avant J. C. à probablement moins de 30 vers l’an 1 000), puis à l’explosion européenne (180 millions d’habitants en 1800, 200 en 1850). On comprend alors que l’Europe, lorsqu’elle prendra conscience d’ellemême, sera véritablement obnubilée par la poursuite de l’objectif d’entrer en relations, voire de conquérir, ce fameux Orient. Jusque tardivement dans le XVIIIe siècle l’Empire chinois demeure pour les Européens la référence suprême, la société la plus policée, la mieux administrée, ses technologies sont les plus fines et les plus efficaces. Sa puissance est d’ailleurs telle que c’est seulement à partir de la fin du XIXe siècle qu’on ose s’y attaquer. Par contre l’Inde, plus fragile, avait bien été conquise, et sa colonisa-
280
tion avait joué un rôle décisif dans l’avancée britannique du XIXe siècle. Des Croisades, du voyage de Marco Polo au XIIIe siècle à la découverte - en passant - puis conquête des Amériques qui absorbera les énergies européennes pendant trois siècles, l’attirance de l’extrême Orient est le ressort principal des initiatives de l’Europe. La fonction de l’Eurasie doit être placée dans cette perspective. Le Moyen Orient, que je définis comme la région héritière de l’hellénisme (qui fait la synthèse de cinq cultures : l’Egypte, la Mésopotamie, la SyriePhénicie, la Grèce-Anatolie, l’Iran), constitue un troisième pôle de civilisation avancée. L’intensité des échanges entre ces trois pôles commande donc naturellement la dynamique de l’ancien monde. Ces « routes de la soie », comme on les a appelé, traversaient la région méridionale de l’Eurasie, l’Asie centrale, de la Caspienne à la Chine, au Sud de la steppe kazakh, du Tian Shan et de la Mongolie (cf. chap. I). Cependant la stagnation relative du pôle moyen oriental (pour des raisons dont l’analyse ne relève pas de cette étude) se solde par un déclin progressif de ces échanges. Cette évolution aura au moins deux conséquences importantes. La première est que l’Europe, en en prenant conscience à partir des Croisades, verra dans le Moyen Orient non pas la région riche à conquérir pour elle même mais la zone de transit à traverser ou à contourner pour atteindre les véritables régions intéressantes de l’Asie. La seconde est que la Chine et l’Inde détourneront progressivement leurs regards de l’Ouest vers l’Est, pour se constituer les périphéries qui les intéresseront véritablement en Corée, au Japon, au Viêt-Nam et dans l’Asie du Sud-est. Les deux pôles orientaux ne seront donc pas intéressés par la recherche active de rapports avec le Moyen Orient en déclin, encore
281
moins avec l’Europe. L’initiative se trouvera donc concentrée dans les mains des Européens. L’océan eurasiatique et l’océan maritime seront alors les deux moyens de passage en concurrence pour permettre aux Européens d’aller en Asie. 4) L’Europe est comme nous l’avons déjà dit marginale jusque vers l’an mil. Comme l’Afrique - qui le demeurera après l’an mil - elle constitue une zone de mouvance dans laquelle les peuples ne se sont encore ni véritablement fixés, ni constitués en sociétés étatiques tributaires. Mais cette périphérie pauvre du système ancien va décoller soudainement, dans la structure particulière qui associe la forme tributaire périphérique féodale (l’émiettement des pouvoirs) et l’universalisme européen de la Chrétienté romaine. Dans la marche qui va conduire finalement à en faire le centre du monde capitaliste et industriel à partir du XIXe siècle, on peut distinguer des périodes successives, qui définissent à leur tour les rôles que l’Eurasie remplira dans la dynamique accélérée de ce système. Les Croisades (1100-1250) constituent le premier moment de cette évolution rapide. L’Europe occidentale (« franque ») cherche alors à briser le monopole du Moyen Orient, passage obligé (et coûteux) dans ses rapports avec l’Asie orientale. Ce monopole est d’ailleurs commun et partagé entre la Byzance chrétienne orthodoxe et le Khalifat islamique arabo-persan. Les Croisades sont dirigées contre ces deux adversaires et non pas seulement l’infidèle mahométan comme on le dit trop souvent. Mais finalement expulsés de la région, les Européens seront amenés à chercher à contourner l’obstacle. Pour le Moyen Orient les Croisades constitueront un accélérateur de son déclin, détournant encore davantage l’intérêt des Chinois pour l’Occident. Les Croisades facilitent en effet la « turquisation » du Moyen Orient, c’est-
282
à-dire le transfert accentué des pouvoirs à des tribus militaires turcomanes appelées à cette fin, et par là même préparent la destruction simultanée de Byzance et du khalifat auxquels se substituera à partir de 1450-1500 l’Empire Ottoman. Par ailleurs les Croisades enrichissent les villes italiennes, leur donnent le monopole de la navigation en Méditerranée, et préparent leur rôle actif dans la recherche des moyens de contourner le Moyen-Orient. Il est intéressant donc de noter ici que les deux océans sont ouverts par des Italiens : Marco Polo qui traverse l’océan eurasiatique russo-mongol et, deux siècles plus tard, Christophe Colomb qui ouvre la voie atlantique. 5) L’Eurasie entre dans l’histoire à ce moment, entre 1250 et 1500 précisément, c’est-à-dire au cours de la seconde phase de l’histoire en question. Cette entrée dans l’histoire marginalise les anciennes « routes de la soie » qui reliaient le Moyen-Orient à la Chine et à l’Inde par le Sud de l’Asie centrale au profit d’une liaison directe Europe-Chine, passant plus au nord, par l’Eurasie de l’Empire de Gengis Khan (précisément la route de Marco Polo). Elle ouvre à son tour la lutte séculaire entre les Russes de la forêt et les Turco-Mongols des steppes pour le contrôle de l’Eurasie. La formation de l’Etat moscovite, sa libération du joug mongol, puis son expansion accélérée à travers la Sibérie, sa conquête militaire des steppes du Sud jusqu’aux mers Noire, Caspienne et d’Aral et au Caucase, enfin celle de l’Asie centrale méridionale elle même et de la Transcaucasie, constituent les étapes de cette progression prodigieuse. L’Eurasie acquiert dans cette histoire des caractères particuliers qui la différencient fortement des formations européennes comme de celle de la Chine. Non pas comme on l’a dit souvent un peu trop superficiellement qu’elle soit devenue (ou reste) « mi-asiatique » (et l’expression a évidem-
283
ment un sens péjoratif). Elle est en réalité trop éloignée du modèle chinois pour mériter cette qualification. Mais elle ne se constitue pas non plus en Etat dense et homogène comme l’Europe le deviendra graduellement avec les monarchies absolues puis ensuite dans la forme modèle des Etats nations bourgeois modernes. L’occupation d’un territoire aussi vaste qu’un océan atténue ces caractères, en dépit de la volonté du pouvoir de St Petersbourg à partir de 1700 d’imiter l’absolutisme européen. Dans l’Empire russe le rapport entre les Russes et les peuples turco-mongols de la steppe n’est pas non plus celui que les Européens développeront dans la colonisation d’outre-mer. Les premiers « n’exploitent pas » le travail des seconds comme les Européens le feront dans leurs colonies; le pouvoir (russe s’entend) contrôle l’espace occupé par les uns et les autres. Cette spécificité se perpétuera à sa manière dans l’URSS où les Russes dominent en termes politiques et culturels mais n’exploitent pas économiquement les autres (au contraire les flux de valeur vont ici de la Russie à l’Asie centrale). Il aura fallu la vulgarisation des media à la mode pour confondre ces systèmes profondément différents sous le vocable commun, et superficiel, d’« Empire » (cf. chap. V) L’Eurasie n’aura cependant rempli la fonction d’océan reliant l’Europe à la Chine que pendant un court moment, entre 1250 et 1500, de surcroît à une étape où l’Europe n’a encore pas une capacité d’absorption suffisamment forte pour donner à la fonction de transitaire de l’Eurasie le lustre lucratif que le commerce maritime aura plus tard. Dès 1500 en effet la voie Atlantique - Océan indien se substitue à la longue traversée continentale. Or la substitution n’est pas seulement géographique. Sur leur chemin par l’Ouest les Européens ont découvert l’Amérique, conquise et transformée en périphérie de leur capitalisme naissant, un sort auquel l’Eurasie avait échappé et qui ne pouvait pas lui être imposé. Par là même les Européens
284
ont appris également à coloniser (transformer en périphéries du capitalisme mondial) l’Asie (en commençant par l’Inde, les Indes néerlandaises et les Philippines) puis l’Afrique et le Moyen Orient, dans des formules qui ne sont pas celles que l’expansion russe en Asie avait inventées. 6) La voie maritime « remarginalise » l’Eurasie à partir de 1500 et jusqu’à 1900 et même au delà. Or les Russes ont répondu à ce défi d’une manière originale et, par bien des aspects brillante. On observera qu’en 1517 précisément le moine Philopheus proclame Moscou troisième Rome. Observation qui mérite de retenir effectivement l’attention puisque, se situant peu de temps après que la voie maritime ait été ouverte, elle offre à la Russie une perspective alternative, un rôle exclusif dans l’histoire. Certains - comme Berdiaev par exemple - feront observer que le communisme soviétique poursuit cet objectif du rôle messianique de la Russie dans la progression de l’humanité toute entière. La Russie se construit donc à partir de là en faisant une synthèse efficace du repliement sur elle même et de l’ouverture sur l’Occident. La première dimension, celle de sa construction autocentrée, situe donc son modèle aux antipodes même de ce qu’est la périphérisation dans le capitalisme mondial. Elle n’a de pareil que dans la construction autocentrée des EtatsUnis poursuivie de leur indépendance à 1914 ou même 1941. Voici deux espaces qui s’organisent comme des continents autocentrés, obéissant à un pouvoir politique unique. Il n’y en a pas eu d’autres, sauf la Chine à partir de 1950. On ne manquera néanmoins pas de comparer les résultats médiocres obtenus par la Russie-URSS face à ceux, brillants, des Etats-Unis. Il existe une explication conventionnelle de ce fait, qui contient une grande part de vérité : l’avantage que constituait aux Etats-Unis l’absence d’un héritage féodal (argument que je renforce en faisant observer que la
285
Nouvelle Angleterre ne s’était pas constituée comme périphérie du capitalisme). Mais il faut y ajouter que, « isolés » sur le continent américain, les Etats-Unis sont libérés des vicissitudes de la politique européenne et n’ont qu’un adversaire - le Mexique - trop faible pour être autre chose qu’une proie dont ils s’empareront de la moitié du territoire. Par contre la Russie n’évite pas les conflits européens et a dû faire face à des concurrents de l’Europe occidentale et centrale, a été de ce fait envahie par les armées de Napoléon, a subi l’affront de la guerre de Crimée, puis a été à nouveau envahie deux fois en 1914 et 1941. Cette interférence continuelle entre l’histoire de la Russie et celle de l’Europe était d’ailleurs en partie le résultat du choix russe - puis soviétique de ne pas s’enfermer en Eurasie mais de rester, ou de devenir, aussi moderne - c’est-à-dire européen -que possible. C’est le choix de l’Empire St Petersbourgeois, symbolisé par l’aigle bicéphale dont une tête regarde vers l’Ouest. Mais c’est aussi le choix de l’URSS qui inscrit son idéologie dans la tradition du mouvement ouvrier européen. Le rejet total qu’elle proclame des idéologies slavophile et eurasienne qui avaient toujours survécu dans l’Empire russe en dépit de son option officielle occidentaliste en est une conséquence évidente. 7) La révolution russe ne me paraît pas du tout avoir constitué un épiphénomène qui n’aurait en définitive guère infléchi le cours de l’histoire, une fois la parenthèse soviétique fermée. Je ne vois pas d’autre explication convaincante de cette révolution qu’en faisant intervenir simultanément l’histoire (les contradictions nouvelles introduites par le capitalisme) et la géographie (la position de la Russie dans l’économie monde capitaliste). Car le capitalisme introduit bien un défi nouveau à toute l’humanité, aux peuples de ses centres avancés ou de ses périphéries attardées. Sur ce
286
point essentiel je reste intégralement marxiste. Au sens que le capitalisme ne peut pas se poursuivre « indéfiniment » : l’accumulation permanente et la croissance exponentielle qu’elle entraîne conduisent l’humanité à la mort certaine. Son dépassement par une autre forme de civilisation, plus avancée, nécessaire, est d’ailleurs préparé lui-même par l’extraordinaire bond en avant des moyens d’action de l’humanité que l’accumulation aura permise (et c’est une parenthèse dans l’histoire) et par le mûrissement éthique et culturel qui l’aura accompagné. La question que les Russes se sont posés en 1917 n’était donc ni artificielle, ni le produit curieux de leur prétendu « messianisme », ni particulière aux circonstances du pays. C’est une question qui reste posée à l’humanité toute entière. Les seules questions qui nous interpellent sont donc à mon avis les suivantes : (i) pourquoi ce besoin de dépasser le capitalisme s’est manifesté avec tant de force ici, en Russie, puis ensuite en Chine et pas dans les centres capitalistes avancés; (ii) pourquoi l’URSS a-t-elle échoué à transformer ce besoin en un levier de transformation progressiste irréversible. Dans ma réponse à la première question la géographie du système mondial intervient certainement d’une manière décisive. La formulation léninienne en termes de « maillon faible » est d’ailleurs à mon avis une première tentative d’explication qui allait dans ce sens que Mao généralisera pour les périphéries du système dans la théorie de la révolution continue par étapes à partir de la Démocratie Nouvelle. Il s’agit d’une explication qui prend en considération la polarisation produite par l’expansion mondiale du capitalisme, bien qu’elle ne le fasse que d’une manière imparfaite, comme on peut le voir aujourd’hui. J’observerai ici que la Russie qui
287
croit « amorcer la révolution mondiale » n’est pas une périphérie. Elle a la structure autocentrée d’un centre, mais attardé, ce qui explique la violence des conflits sociaux qui s’y déploient. J’observerai également que la seconde grande révolution - celle de la Chine - se développe dans le seul grand pays qui ne soit pas véritablement et totalement périphérisé comme le sont l’Amérique latine, l’Afrique, le Moyen Orient, l’Inde et l’Asie du Sud-est, n’ayant jamais été colonisé. A la formule du marxisme chinois bien connue - un pays « mi-féodal, mi-colonial » - je substituerai donc une formule qui me paraîtrait plus correcte - un pays « aux trois quarts tributaire, au quart colonial » alors que les autres périphéries sont « au quart tributaires (ou féodales si on le veut) et aux trois quarts coloniales » ! La seconde question appelle une réponse qui précisément parte de la remise en cause de la théorie de la « transition socialiste » esquissée plus haut. Celle-ci me paraît inexacte tant au plan de l’histoire qu’à celui de la géographie du capitalisme. Elle procédait d’une sous-estimation de la polarisation (géographique) centres / périphéries, ayant manqué de voir qu’il ne s’agissait pas là du produit des circonstances historiques particulières (la tendance « naturelle » de l’expansion capitaliste étant alors d’homogénéiser le monde) mais du produit immanent de cette expansion elle-même. Elle manquait donc de voir que la révolte des peuples victimes de ce développement forcément inégal doit se poursuivre aussi longtemps que le capitalisme existera. Elle procédait par ailleurs de l’hypothèse que le mode de production nouveau (socialiste) ne se développe pas au sein de l’ancien (capitaliste), mais à côté, dans des pays ayant rompu avec le capitalisme. Je substitue à cette hypothèse celle que, tout comme le capitalisme s’est d’abord développé au sein du féodalisme avant d’en briser la coque, la « longue transition » du capitalisme mondial au socialisme mondial est
288
elle aussi définie par le conflit interne à toutes les sociétés du système entre les tendances et forces de reproduction des rapports capitalistes et les tendances et forces (anti-systémiques) dont la logique procède d’autres aspirations, celles qui définissent précisément le socialisme. Bien que cela ne soit pas ici le lieu de développer ces thèses nouvelles concernant la « longue transition », il fallait que je les rappelle, parce qu’elles constituent l’explication de l’échec soviétique, à mon avis. 8) On peut maintenant conclure en posant les questions susceptibles d’éclairer le débat concernant l’avenir non seulement de la Russie mais également du système mondial. L’échec soviétique ne ramène pas la Russie, ni au XIXe siècle, ni - comme on le suggère parfois - à la période moscovite près St Petersbourgeoise. Parce que pas plus pour la Russie que pour quelqu’autre pays le retour en arrière n’a de sens en histoire. Plutôt donc que de se livrer à ce genre d’exercice superficiel je préfère regarder l’avenir en partant de l’analyse du présent et ce qu’il révèle de nouveau par rapport au passé. Comment sortir du capitalisme, aller au delà de celui-ci, reste la question centrale pour les Russes, les Chinois et tous les autres peuples du monde. Si l’on accepte la thèse de la longue transition esquissée ici, l’étape immédiate qui constitue le défi auquel nous sommes aujourd’hui tous confrontés serait définie par la construction d’un monde pluripolaire permettant dans les différentes régions qui le composent un développement maximal des forces antisystémiques. Cela implique pour les Russes et les autres peuples de l’Eurasie (ex-URSS) non pas un développement capitaliste illusoire mais la reconstruction d’une société capable d’aller au-delà de celui-ci. Les Chinois sont confrontés au même problème. Et tous les autres peuples également. Savoir si
289
les Russes ou les Chinois seront capables de le faire dans l’avenir immédiat, ou si d’autres peuples le feront moins difficilement, constitue une série de problèmes qui sortent des limites de cette étude.
Notes – Etiemble, L’Europe chinoise, Gallimard 1988. – Une bonne bibliographie des débats russes sur l’histoire de la Russie se trouve dans George Vernadsky, A History of Russia, Yale University, Press, 1952. – On lira sur le sujet des peuples de la Steppe : Anatoly Liberman, N. S. Trubetzkoy, the legacy of Genghis Khan and Other Essays on Russia's Identity, ed. A. Liberman, U. of Michigan Press, Ann Arbor, 1993. N. S. Trubetzkoy, Letters and Notes, Mouton, La Haye, 1975. W. Bartjold, Histoire des Turcs d'Asie centrale, Maisonneuve, Paris 1947. B. Vladimirtsov, Le régime social des Mongols, le féodalisme nomade, Maisonneuve, Paris 1948.
290
Chapitre IX La recompradorisation du monde arabe 1) Les quantités macro-économiques propres à de nombreux pays du tiersmonde, dont les pays arabes, doivent être manipulées avec précaution, tant les statistiques qui les sous tendent sont approximatives, parfois carrément trompeuses. Elles indiquent néanmoins le sens des évolutions générales, constatées par ailleurs parfois de visu et confortées par d’autres indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Pour les 25 dernières années celles-ci apparaissent bien dans l’ensemble parallèles pour l’ensemble des pays arabes autres que ceux dont l’économie toute entière se réduit presque à l’exploitation du pétrole et à la dépense de sa rente (les pays du Golfe et la Lybie). Les taux de croissance du PIB, en termes réels, sont demeurés modestes par comparaison à ceux de l’Asie orientale et du sud-est (de l’ordre de la moitié de ces derniers), mais surtout présentent une évolution parallèle évidente : à l’essor de la décennie des booms pétroliers (1973-1984) succède une stagnation tenace au cours de la décennie suivante. Les taux records que l’Egypte, la Syrie et la Jordanie ont enregistré au cours de la décennie des années 1970 (8 % pour l’Egypte, 10 % pour la Syrie et la Jordanie) ont fait place à des taux modestes au cours de la décennie suivante (5 % pour l’Egypte et 3 % pour la Syrie qui paraît néanmoins remonter la pente à partir de 1990) ou même se sont effondrés au point d’annuler en quelques années les progrès antérieurs (le taux de la Jordanie, négatif, culmine autour de - 12 % l’an !). Le Liban, victime de la guerre civile depuis 1975, est aujourd’hui confronté aux problèmes plus
291
urgents de sa reconstruction. Quant à l’Irak, il avait enregistré une croissance probablement supérieure à celles des autres pays (de l’ordre de 8 %) en dépit de la première guerre du Golfe (qui occupe toutes les années 1980), avant de s’effondrer bien entendu avec la seconde guerre du Golfe. En Tunisie la baisse du taux de croissance est régulière, de 9 % pour les années 1970-1974 à 3 % pour les années 1985-1989 (mais ce taux s’est peutêtre un peu amélioré au cours des dernières années). En Algérie la croissance, déjà modérée jusqu’en 1985 (5 % l’an) s’effondre pour devenir négative au fur et à mesure que ce pays s’enfonce dans sa crise politique. Seul le Maroc paraît démentir la tendance générale, maintenir à peu près régulièrement un taux modéré de 5 %. Quant aux pays de la périphérie arabe (Mauritanie, Soudan, Somalie et Yémen) ils sont confrontés aux menaces de décomposition sociale (déjà une réalité évidente en Somalie et au Soudan) qui n’est plus du ressort de l’analyse économique. S’il y a d’évidence quelques événements politiques majeurs qui expliquent certains retournements de tendance (la guerre du Golfe pour ce qui concerne l’Irak et la Jordanie, la crise algérienne, le blocus de la Lybie), le mouvement général a cependant été pour les pays du Mashrek largement tributaire de celui de la rente pétrolière des pays du Golfe (et de la Lybie) redistribuée en partie par le flux des capitaux publics et les transferts de la main-d’œuvre émigrée (égyptienne, syrienne et palestino-jordanienne). L’effet pétrole a été moins marquant au Maroc et en Tunisie. L’effritement de la croissance de ce dernier pays traduit alors l’épuisement rapide du modèle d’industrialisation de sous-traitance pour l’exportation choisi par ses responsables, un épuisement moins spectaculaire jusqu’ici dans le cas du Maroc.
292
Confronté aux faits, le discours idéologique du libéralisme qui a le vent en poupe résiste fort mal. Les options favorables au libéralisme triomphant, « l’ouverture » (en arabe Infitah) aux capitaux étrangers, les privatisations, les remises en ordre des finances publiques et les dévaluations pratiquées dans le cadre des programmes dits d’ajustement structurel, n’ont pas donné un coup de fouet à la croissance. Au contraire ces politiques en ont rendu les conditions plus difficiles - sans même mentionner les conséquences politiques et sociales catastrophiques de ces options dites libérales. Dans l’ensemble les taux de croissance enregistrés au cours de la période précédente, celle de l’essor des mouvements nationalistes (le nassérisme, le baasisme, le boumediennisme) avaient été supérieurs, et même parfois largement. Et si les pays arabes concernés ont enregistré des taux de croissance relativement favorables dans le premier temps du néo-libéralisme, avant de s’effriter ou de s’effondrer, ce fait doit être rapporté principalement, comme on l’a déjà dit, à la rente pétrolière des années 1973-1984. Tous les Arabes paraissent souffrir d’un mal commun : la faible efficacité de leurs investissements. Car, face à des taux de croissance modestes ou catastrophiques, l’effort d’investissement accompli est demeuré toujours important, parfois même a été relevé à des niveaux exceptionnels, précisément grâce à la rente pétrolière. Le rapport investissement / PIB s’est toujours situé entre 24 et 28 % et même culmine au taux de 39 % pour l’Algérie. Il avait presque partout crevé le plafond de 30 % dans les années du boom pétrolier. Il s’agit donc de taux d’investissement forts, qui parfois n’ont pas grand-chose à envier à ceux qui caractérisent les économies performantes d’Asie orientale et sud orientale. Mais leur efficacité est étonnamment faible, comme en témoigne le coefficient marginal de capital qui se situe autour de 12 pour les pays du Maghreb et de 5 pour ceux du Mashrek (comparez avec le taux moyen de 2 à 4 pour les pays d’Asie). De
293
surcroît évidemment dès lors que la croissance s’est effondrée alors que l’effort d’investissement était maintenu, ces coefficients se sont élevés à des niveaux insoupçonnés; 26 pour les pays du Maghreb et 9 pour ceux du Mashrek pour le quinquennat 1985-1989. Encore une fois le libéralisme n’a pas suscité, comme il le prétend, un choix des investissements plus judicieux et plus efficace. Comme les coefficients de capital de la période antérieure d’essor nationaliste étaient moins mauvais (ils se situaient entre 4 et 8 au lieu de 5 et 12), on doit en conclure que le libéralisme gaspille les ressources rares encore plus que le nationalisme. Il n’y a pourtant rien qui puisse étonner ici : l’inégalité grandissante dans la répartition du revenu et la détérioration des services sociaux associés au libéralisme ont prouvé une fois de plus qu’ils avaient des effets économiques négatifs, quand bien même ils ne se soldent pas toujours et immédiatement par une crise sociétaire catastrophique comme en Algérie. L’examen des sources et formes du financement de l’économie - de sa croissance ou des déficits associés à sa stagnation - permet de mieux saisir les mécanismes du gaspillage. L’apport extérieur net, constitué par la somme des prêts et dons au titre de l’aide étrangère publique, des transferts des émigrés et des investissements directs étrangers, dont on déduit le service de la dette, l’accumulation des réserves monétaires en devises et la fuite des capitaux, a toujours été important pour les pays arabes concernés, représentant, en moyenne pour les vingt années 1970-1990, 16 % du PIB pour les pays du Mashrek (deux tiers environ de leurs investissements) et 5 % pour ceux du Maghreb (mais il s’agit là d’une moyenne non significative comme on le verra). Les trois pays concernés du Mashrek (Egypte, Syrie et Jordanie) ont vécu, de ce point de vue, des histoires parallèles semblables : ils ont largement
294
bénéficié de la manne pétrolière (sous forme de transferts publics et d’apports des émigrés), qui a porté la proportion de l’apport extérieur net autour de 20 % de leur PIB durant la décennie du boom pétrolier. L’Irak a reçu à cette époque des sommes mal connues mais certainement encore plus importantes en volume et en proportion du PIB. Mais cet apport a été affecté à la couverture des coûts de la première guerre du Golfe plus qu’au soutien de la croissance. Au Maghreb par contre la situation est restée contrastée du fait que l’Algérie a longtemps été un prêteur net de capitaux à l’extérieur, grâce à ses ressources pétrolières, avant de devenir, avec son endettement lourd, un exportateur net de capitaux au titre du service de la dette. La Tunisie et le Maroc ont été par contre des bénéficiaires plus marqués de l’apport net extérieur, qui a été pour eux de l’ordre de 12 % de leur PIB (soit environ 50 % de leurs investissements). Cet apport est néanmoins ici largement alimenté par les transferts des émigrés - en l’occurrence vers l’Europe, donc non concernés par les fluctuations de la rente pétrolière. D’une manière générale si l’on définit l’apport net en termes qui ne font pas intervenir les transferts des émigrés, c’est-à-dire comme le solde des apports de capitaux publics et privés, après déduction du service de la dette, des transferts de profits et de la fuite des capitaux, on constate que la situation de tous les pays arabes concernés s’est détériorée progressivement au cours des deux décennies 1970 et 1980. Pour les pays du Mahsrek le solde de la balance des capitaux, qui représentait 6 % du PIB durant les années 1970, est certainement devenu négatif à partir de la seconde moitié des années 1980, lorsque l’apport des pays pétroliers se réduisait au moment même où le service de la dette prenait des dimensions dramatiques. Pour la Tunisie et le Maroc le mouvement a été identique, en partant d’un apport extérieur plus modeste (de l’ordre de 3 % du PIB) dans
295
les années du boom pétrolier dont ces pays ont moins bénéficié. Pour l’Algérie le retournement a été encore plus dramatique puisque ce pays, naguère pourvoyeur d’aide extérieure, succombe aujourd’hui sous le poids du service de sa dette extérieure. Encore une fois les promesses du discours libéral, selon lequel l’ouverture facilite l’entrée des capitaux étrangers dont on a besoin pour le financement des investissements, se trouvent démenties dans les faits. Les entrées de capitaux étrangers sont demeurées moins que modestes sinon négligeables : les investissements étrangers directs se mesurent en millions de dollars alors que le service de la dette se mesure en milliards. L’aide extérieure occidentale annoncée avec fanfare ne s’est pas matérialisée sauf par des crédits militaires américains à des conditions onéreuses. L’aide publique est demeurée ici principalement intra-arabe et donc tributaire de la rente pétrolière. Par contre le libéralisme a favorisé en un temps record l’accumulation d’une dette extérieure colossale : 8 milliards de dollars pour la Tunisie, 9 pour la Jordanie, 17 pour la Syrie, 21 pour le Maroc, 28 pour l’Algérie et 41 pour l’Egypte (chiffres de 1991). Cette dette, qui oscillait entre 70 % des exportations pour l’Algérie et 155 % pour l’Egypte en 1970, varie en 1985 entre 130 % pour l’Algérie et 400 % pour le Maroc. Les stratégies d’investissement pratiquées par les régimes nationalistes à l’étape antérieure de leur essor n’avaient jamais entraîné un tel endettement extérieur massif. La détérioration des conditions du financement de l’économie est encore plus marquée si l’on tient compte de la fuite massive des capitaux que le libéralisme a permis. Alors qu’en moyenne pour les 15 années 1970-1984 ces fuites de capitaux représentaient 1,4 % du PIB pour le Maroc, 0,6 % pour la Tunisie, 2, 4 % pour l’Algérie, 3, 2 % pour la Jordanie et 5,1 %
296
pour la Syrie, ces mêmes pourcentages ont tous augmenté au cours des cinq années 1985-1989 pour devenir respectivement 2,5 %; 1, 4 %; 2,7 %; 4,9 % et 6,3 %. Dans le seul cas de l’Egypte le pourcentage de la fuite des capitaux paraît stable, autour toutefois de la proportion catastrophique de 9 % du PIB (un tiers des investissements !). L’équilibre économique - en stagnation- est donc de plus en plus réalisé grâce à des apports fragiles et non développants, ceux du tourisme et les transferts des émigrés. Ces derniers étaient déjà une donnée ancienne pour les pays du Maghreb dont l’émigration vers l’Europe remonte aux décennies de l’essor général de l’après seconde guerre mondiale. Ils représentent aujourd’hui - pour la moyenne des 5 années 1985-1989 : 8,3 % du PIB du Maroc, 4,9 % de celui de la Tunisie et 1, 4 % de celui de l’Algérie (contre il est vrai 4,4 % pour les années 1970-1974, l’effondrement des transferts étant dû à la crise politique algérienne). Par contre les pays du Mashrek ne connaissaient qu’une émigration très limitée (et presque exclusivement en direction du Golfe) jusqu’au boom pétrolier. L’apport de ces transferts ne représentait encore que 1,2 % du PIB de l’Egypte, 0,8 % de celui de la Syrie, mais déjà 3,0 % de celui de la Jordanie pour les années 1970-1974. Il dépasse aujourd’hui 10 % pour l’Egypte, 3 % pour la Syrie et 14 % pour la Jordanie (avant la seconde guerre du Golfe). 2) La conclusion évidente qu’on doit tirer de l’analyse de l’évolution économique des pays arabes au cours des 25 dernières années est l’échec de leur insertion active dans le système capitaliste mondial. Celle-ci avait pourtant été préparée, dans la phase antérieure de l’essor nationaliste, par l’amorce d’une industrialisation et d’une modernisation de l’Etat, assise sur des transformations sociales (réformes agraires, progrès de l’éducation etc.) qui avaient à la fois réduit les inégalités dans la répartition du revenu et
297
élargi la base sociale des couches moyennes, assurant par là même la cohésion de la société et son adhésion au projet sociétaire de modernisation. L’intervention active de l’Etat - les nationalisations en ont été l’expression la plus avancée - avait rempli des fonctions essentielles dans la mise en œuvre de ce projet de « rattrapage dans l’interdépendance négociée »; elle en avait constitué la condition préalable incontournable. Certes le projet lui même était loin d’être exempt de contradictions internes graves qui devaient en limiter la portée et en épuiser le potentiel plus rapidement qu’on le pensait généralement à l’époque. La raison en était, pour l’essentiel à mon avis, que le projet était dans son essence même un projet national bourgeois. Les méthodes de la gestion politique populiste du système, la dépolitisation des classes populaires auxquelles le droit d’organisation et d’initiative était refusé, l’arrêt du débat sur les thèmes idéologiques et culturels (notamment sur la question des rapports Etat-religion) qui avait pourtant façonné les clivages au sein de la droite (« féodale » et « libérale ») et entre celle-ci et la gauche (marxiste et nationaliste) au cours des décennies successives depuis la Nahda du XIXe siècle, en somme l’absence de démocratisation de la société et de la politique, sont l’expression des limites historiques de ce projet. Par ailleurs, cristallisé à l’origine comme projet défini dans le cadre de chacun des Etats arabes (en arabe « qutri »), le nationalisme arabe ne devait prendre conscience de sa dimension unitaire pan arabe (en arabe « qawmi ») que progressivement, même si, dans le Croissant fertile, les origines idéologiques de cette affirmation ont été plus anciennes. La perspective unitaire - qui aurait évidemment résolu de nombreux problèmes et donné un souffle nouveau à la poursuite du développement - n’a cependant jamais réussi à s’imposer, même à l’échelle des régions comme le Maghreb ou le Croissant
298
fertile, parce qu’elle est restée fondée sur le principe non démocratique d’une unité imposée par la conquête à partir d’une « province base » et autour d’une personnalité charismatique. Dans cette logique la conquête-libération trouvait sa légitimité et sa prétention à l’efficacité dans la thèse d’une nation arabe préexistante, qui n’attendait que son libérateur pour imposer son existence. Il faut ajouter que ce projet national bourgeois arabe a été combattu systématiquement par les forces extérieures dominantes - les puissances occidentales. L’alliance passée par le mouvement national arabe avec l’Union Soviétique n’était nullement la cause de cette hostilité, mais au contraire la réponse à celle-ci. Les raisons véritables de l’hostilité occidentale tenaient aux craintes que l’Etat arabe modernisé et unitaire, riche de ses ressources pétrolières, situé sur le flanc sud de l’Europe, devienne un partenaire dans le système mondial avec lequel il aurait fallu compter. Israël a été mobilisé à cet effet comme l’instrument militaire d’une agression permanente qui a joué un rôle important dans le renversement des pouvoirs nationalistes arabes. Quoiqu’il en soit cette page est aujourd’hui tournée. Le discours libéral prétend que les politiques nouvelles dites « d’ouverture » sont venues pour mettre un terme aux « errements du passé », et permettre donc le démarrage d’un développement véritable, dit « sain ». Comme on l’a vu il n’en est pas ainsi. Tout au contraire ces politiques brisent l’élan du développement, cassent le monde arabe et accentuent les rivalités en son sein, pour finalement plonger la région dans un désastre social anéantissant son potentiel de renaissance. La recompradorisation des pays arabes, qui est l’objectif véritable de la stratégie des Etats-Unis et - derrière eux de l’Europe - comporte différents volets
299
économiques, politiques et stratégiques. Cette stratégie s’emploie à casser la région arabe en trois sous-régions distinctes, soumises à des logiques de compradorisation qui leur sont particulières. La région du Golfe pétrolier (Arabie Séoudite, Koweit, Qatar, Emirats et Oman) est placée directement sous la coupe de l’occupation militaire des Etats-Unis et, de ce fait, a perdu toute marge éventuelle d’action autonome, politique et financière. Elle est désormais séparée du monde arabe. Les pays du Maghreb sont, quant à eux, abandonnés aux aléas d’une négociation éventuelle de leurs rapports avec l’Europe, l’adhésion pure et simple de ces pays à l’Union Européenne étant exclue bien entendu. On ne peut donc ici parler que de projets qui restent vagues à l’extrême, bien qu’un discours soit développé ici ou là, de temps à autre, sur la question de l’opportunité d’un « projet méditerranéen », plus ou moins complémentaire de l’Union Européenne. On connait la formule dite du 5 + 5 (les cinq pays de l’Union maghrébine : la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Lybie, et les cinq pays méditerranéens de l’Union européenne : le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie et la Grèce); mais la formule reste vide de toute précision quant à la nature des rapports économiques privilégiés considérés éventuellement, leur compatibilité avec le traité de l’Union Européenne etc. Il ne s’agit donc que d’une formule d’attente puisqu’aussi, par ailleurs, bien des questions concernant la région sont loin d’être réglées : l’avenir de l’Algérie, celui de la Lybie toujours soumise au blocus imposé par les Etats-Unis, la question du Sahara occidental. Le Mashrek arabe est l’objet d’un projet américano-israélien dit « projet Moyen oriental » en cours d’exécution. Il s’agit de créer ici une économie totalement intégrée associant trois partenaires - Israël, les Territoires occupés dont
300
l’avenir est conçu comme celui d’un Bantoustan non souverain, la Jordanie - à laquelle seront rattachés ultérieurement le Liban, la Syrie et l’Egypte. Le projet vise essentiellement à créer un espace d’expansion économique pour Israël, protégeant les exportations israéliennes contre la concurrence extérieure de pays beaucoup plus compétitifs sur les marchés mondiaux. On observera ici qu’Israël est, sur ce plan, un échec économique, n’étant pas parvenu pas plus que les pays arabes - à acquérir une compétitivité raisonnable pour ses productions manufacturières. En contradiction ouverte avec les principes du multilatéralisme et de l’ouverture mondiale prônés par l’Organisation Mondiale du Commerce (faisant suite au GATT) et la Banque Mondiale, le projet fait une exception destinée à alléger la crise de la société israélienne. C’est pourquoi aussi, dans cet esprit, les accords de Madrid et d’Oslo concernant l’avenir des territoires occupés et la paix israélo-arabe, sont interprétés d’une manière unilatérale, en contradiction avec les résolutions des Nations Unies concernant l’Etat Palestinien et le droit de retour des réfugiés, dont les principes ont pourtant été réitérés dans les accords mentionnés. Les politiques mises en œuvre ici cherchent seulement à consolider le statut de Bantoustan construit systématiquement dans les territoires occupés par les autorités militaires, qui se sont employées à détruire les activités productrices dans ces territoires (en privant leur agriculture d’accès aux ressources hydrauliques, en réquisitionnant des terres, en détruisant des villages, en soumettant les activités économiques à des surimpositions au profit du trésor israélien, en détruisant physiquement les infrastructures de transport et les services sociaux etc.). Par ces moyens les autorités occupantes ont contraint la population active arabe à se transformer massivement en travailleurs migrants quotidiens, fournissant à l’économie israélienne sa main-d’œuvre à bon marché. Au plan politique le projet ne conçoit pas la reconnaissance d’un Etat palestinien souve-
301
rain, et donc maître de sa politique douanière, fiscale et monétaire. Il ne reconnait pas non plus le droit au retour des réfugiés palestiniens, pourtant réitéré dans les résolutions des Nations Unies. Ce projet demeure, quoiqu’on en dise, fragile, ne serait-ce que parce que la lutte du peuple palestinien se poursuivra tant que ses droits légitimes ne seront pas reconnus. Par ailleurs le projet marginalise davantage encore le rôle de l’Egypte dans la région et dans le monde arabe, et rien ne dit que le pouvoir égyptien l’acceptera indéfiniment. Le discours entretenu par les médias, selon lequel cette « paix » - dans ces formes - doit ouvrir une ère de prospérité, est lui même totalement démagogique. Le projet, s’il venait à être imposé, se solderait par un recul de l’activité économique dans les pays arabes concernés. Il les enliserait davantage dans leur « quart mondialisation ». Les illusions entretenues à cet égard ne pourront donc résister à l’épreuve des faits. Le projet américain pour le monde arabe laisse d’ailleurs sans réponse des questions aussi importantes que celle de l’avenir de l’Irak, soumis à l’érosion destructive du blocus imposé par Washington, dont l’Europe n’ose pas se dissocier, ou celle de la place et du rôle de la Turquie et de l’Iran dans la région. Il ne concerne pas non plus le quart monde arabe (Mauritanie, Soudan, Somalie et Yémen) totalement marginalisé pour le moment. L’ensemble des projets proposés au nom du libéralisme ne se sont jamais donné l’objectif de sortir le monde arabe de son enlisement. Il s’agissait, comme ailleurs, de politiques à courte vue de gestion de la crise, et rien de plus; il ne s’agissait pas d’établir un ordre mondial nouveau stable au delà de la crise. D’ailleurs la prospérité des années fastes de la rente pétrolière (19731984) était fondée sur l’illusion de la consommation, sans que la base produc-
302
tive n’ait été renforcée à cette occasion. Certes cette illusion a rempli des fonctions politiques décisives, à l’époque celles de donner un semblant de légitimité à l’« infitah », d’y faire adhérer de larges opinions. Cependant, comme il fallait s’y attendre, l’illusion devait être sans lendemain. Reprenant l’offensive, les Etats-Unis ont imposé leur diktat en réduisant drastiquement la rente pétrolière, soumis les Etats du Golfe au statut de protectorats occupés militairement, séquestré leur fortune placée sur les marchés financiers, imposé à la Lybie un blocus dévastateur. La régression économique que ces politiques de gestion de la crise a entraînée pour l’ensemble du monde arabe fait de lui un candidat à la « quart mondialisation », c’est-à-dire à la marginalisation dans le système mondial, aux côtés de l’Afrique subsaharienne et de certains pays d’Asie (Iran, Afghanistan, Pakistan et Bengladesh).
Note – Pour aller au delà de ces réflexions générales concernant l’ensemble du monde arabe, il est nécessaire de regarder de plus près comment se sont articulés les mécanismes économiques propres au système global et aux soussystèmes locaux, les logiques internes du pouvoir et celles des luttes sociales, les interventions extérieures. Les ouvrages du Forum du Tiers-Monde-Dakar qui concernent l’Algérie, la Tunisie, l’ensemble maghrébin, l’Egypte, le Soudan, les pays du Levant (Syrie, Liban, Palestine et Jordanie) et ceux du Golfe, en cours de publication, donnent des illustrations convaincantes de ce qu’on peut tirer de cette méthode d’analyse. – Toutes les données utilisées dans ce texte sont empruntées aux documents de la Banque Mondiale, faute de mieux, notamment au rapport Ishac Diwan, Lyn Squire intitulé « Economic Development and Cooperation in the Middle East and North Africa » (novembre 1993). Toutes ces données embel-
303
lissent la situation, surestiment les chiffres de la croissance, pour justifier les politiques en cours. En dépit de cette déformation systématique l’image qu’elles donnent - pour qui sait les lire - est celle que nous avons résumée dans ces quelques pages : l’image d’un désastre. – Concernant la thèse de la « gestion à courte vue de la crise » je renvoie ici à mon ouvrage récent « La gestion capitaliste de la crise » (L’Harmattan, 1995). Cette étude ne traite directement que de l’aspect économique de la compradorisation. Les relations qui s’établissent entre celle-ci d’une part, la politique et la culture arabes et islamiques d’autre part, ont fait l’objet d’autres travaux de l’auteur, particulièrement (en français) : – S. Amin, La Méditerranée dans le système mondial, in S. Amin et F. Yachir, même titre, La Découverte 1988. – S. Amin, préface, in Michel Capron (éd.), L’Europe face au Sud, L’Harmattan 1991. – S. Amin, La géopolitique de la région Méditerranée-Golfe, in S. Amin et all, Les enjeux stratégiques en Méditerranée, L’Harmattan 1992. – S. Amin, Présentation, in F. Charaffeddine, Culture et idéologie dans le monde arabe, L’Harmattan 1994. – S. Amin, Etat et Politique dans le monde arabe, in P. G. Casanova (ed.), Etat et Politique dans le Tiers Monde, L’Harmattan 1994.
304
Chapitre X Aux origines de la catastrophe économique de L’Afrique Au terme des quatre décennies du développement de l’après-guerre le bilan des résultats est si fortement contrasté qu’on est tenté de renoncer à l’expression commune de tiers-monde pour désigner l’ensemble des pays qui ont été l’objet des politiques de développement de ces décennies. On oppose aujourd’hui, non sans raison, un tiers monde nouvellement industrialisée, compétitif, au quart-monde marginalisé, auquel appartient l’Afrique dans son ensemble. On fait remarquer, non sans arguments, que le premier groupe de ces pays n’est pas frappé par la crise générale du capitalisme contemporain, qu’on y enregistre des taux de croissance élevés, particulièrement en Asie orientale, tandis que le second groupe, frappé par la crise, paraît incapable de répondre aux défis auxquels il est confronté. 1) L’objectif des politiques de développement déployées en Asie, en Afrique et en Amérique Latine au cours de toute l’après-guerre, à partir de 19481950, ou de 1960 pour l’Afrique subsaharienne - date de l’accès à l’indépendance de la plupart des Etats qui la constituent - a été rigoureusement identique pour l’essentiel, en dépit des différences du discours idéologique qui les a accompagné. Il s’est agi partout d’un projet nationaliste qui s’est assigné l’objectif d’accélérer la modernisation et l’enrichissement de la société par son industrialisation. On comprend sans difficulté ce dénominateur commun si l’on rappelle simplement qu’en 1945 pratiquement tous les pays d’Asie (Japon excepté), d’Afrique (y compris l’Afrique du Sud) et - bien qu’avec quelques nuances -d’Amérique latine étaient encore dépourvus de toute industrie digne de ce nom - sauf d’extraction mi-
305
nière ici ou là -, largement ruraux par la composition de leur population, régis par des régimes archaïques (les oligarchies latifundiaires d’Amérique, les monarchies sous protectorat de l’Orient islamique, la Chine etc.) ou coloniaux (l’Afrique, l’Inde, l’Asie du Sud-Est). Par delà leur grande diversité tous les mouvements de libération nationale s’assignaient les mêmes objectifs de l’indépendance politique, de la modernisation de l’Etat, de l’industrialisation de l’économie. Il ne serait pas correct de dire qu’ils ne l’ont pas tous tenté, dès qu’ils ont été en mesure de le faire. Certes les variantes ont été pratiquement aussi nombreuses que les pays, et il demeure légitime, de ce fait, de tenter de les classer en modèles qui les regroupent. Mais on risque alors d’être victime de critères choisis en fonction, sinon nécessairement de préférences idéologiques, du moins de l’idée qu’on se fait, ou plutôt qu’on se faisait à l’époque, du déroulement des expériences en question, des possibilités et des contraintes externes et internes. Au contraire, en mettant l’accent sur le dénominateur commun qui les réunit, j’invite à prendre quelque distance à l’égard de ces classifications et à voir l’histoire à partir d’aujourd’hui, à relire donc ce qu’elle fut à la lumière de ce à quoi elle a conduit. Industrialiser impliquait avant tout de construire un marché intérieur et le protéger des ravages de la concurrence qui en empêcherait la formation. On partait, pour ce faire, d’observations de bon sens : on disposait ici de matières premières, d’origine agricole (le coton, des produits alimentaires, le bois etc.) ou minière, de ressources naturelles déjà connues et exploitées, ou mal connues, qui permettraient la production d’énergie, de matériaux de construction, d’acier, de produits chimiques essentiels, comme on avait déjà un marché -interne - alimenté par des importations de produits manufacturés de consomma-
306
tion courante (textiles, ameublement, ustensiles et appareils etc.). Il n’y avait aucune raison de ne pas mettre à profit ces potentialités pour refaire ce que les Occidentaux avaient fait en leur temps : une révolution industrielle. Les formules pouvaient varier selon les circonstances - la taille du marché intérieur, les disponibilités en ressources - ou même selon des thèses plus ou moins théoriques, ou idéologiques, donnant la priorité à la production rapide d’industries légères de consommation ou à celle de biens permettant plus tard d’accélérer la première (comme le proposait la thèse des « industries industrialisantes » qui rationalisait le modèle soviétique). L’objectif final était identique. Ce même bon sens, exprimé dans le langage commun de tous les technocrates de l’époque, inspirait des choix pragmatiques analogues dans une large mesure. La technologie nécessaire à l’industrialisation ne pouvait être qu’importée, mais il n’était pas nécessaire pour le faire d’accepter la propriété des installations à construire par le capital étranger. Cela dépendait du pouvoir de négociation dont on disposait, ou croyait pouvoir disposer. Du capital financier devait donc à son tour être soit invité à s’investir dans le pays, soit être emprunté. Ici encore la formule - propriété étrangère privée, financement public assuré grâce à l’épargne nationale, à l’aide extérieure en dons et crédits - pouvait être ajustée à l’estimation qu’on se faisait des moyens et des coûts. Les besoins d’importation que ces plans d’accélération de la croissance par l’industrialisation impliquaient fatalement ne pouvaient être couverts dans un premier temps - que par les exportations traditionnelles connues, qu’il s’agisse de produits agricoles ou miniers. Aucune stratégie de développement connue n’a été d’emblée orientée vers l’exportation, c’est-àdire déterminée principalement par des objectifs de percée sur le marché
307
mondial par l’affirmation de prétendus avantages comparatifs. La lecture que la Banque Mondiale propose aujourd’hui, associant le succès des uns à un choix « ouvert à l’exportation » et l’échec des autres à leur repliement sur le marché interne, est une lecture a posteriori qui n’a pas été faite à l’époque, ni par les autorités locales responsables des choix en question, ni par la Banque Mondiale elle même (ou d’autres lecteurs, plus futés, de ces politiques). L’attention première était, dans tous les cas, le marché interne; les exportations un moyen nécessaire pour financer les importations. L’expérience démontrait d’ailleurs que le raisonnement était efficace. Dans une phase de croissance générale comme l’était l’après-guerre la demande de presque tous les produits possibles était elle même en augmentation continue, qu’il s’agisse d’énergie, de matières premières minérales ou de produits agricoles spécifiques. Les termes de l’échange fluctuaient, mais n’annulaient pas systématiquement par leur détérioration les effets de la croissance des volumes exportés. L’avantage comparé « naturel », assis sur les ressources minérales ou la spécificité agricole, avait un sens. Plus que cela d’ailleurs l’expansion des marchés mondiaux ouvrait des créneaux permettant d’exploiter « l’avantage » de la main-d’œuvre à bon marché dans certaines gammes de production manufacturière pour ceux qui ne disposaient pas d’avantages fondés sur leurs ressources naturelles. Les multiplications des zones franches à la fin de la période de l’essor de l’après-guerre témoigne de la réalité de ces calculs, à l’époque réalistes. La construction du marché interne, axe de toutes les politiques de développement de l’époque, n’est pas synonyme de stratégie d’industrialisation par substitution d’importations, comme on l’a trop souvent dit, trop vite, pour l’opposer à une stratégie orientée vers l’exportation qui n’existait pas. L’industrie envisagée s’ouvrait à elle même son propre marché autant qu’elle remplaçait des importations antérieures. A la demande de
308
consommation finale, elle même en expansion, s’ajoutait toujours celle de biens intermédiaires, parfois de biens d’équipement simples dont on pouvait envisager la production locale, enfin celle occasionnée par la dépense publique courante et les travaux d’infrastructure. La modernisation, bien qu’axée sur l’industrialisation, ne se réduisait pas à celle-ci. L’urbanisation, les travaux d’infrastructure de transports et de communications, l’éducation et les services sociaux avaient certes pour objectifs, en partie, de servir l’industrialisation en moyens et en maind’œuvre qualifiée convenablement. Mais ces objectifs étaient également poursuivis pour leurs fins propres, pour construire un Etat national et moderniser les comportements comme on le disait dans le discours du nationalisme, transethnique par nature presque à l’époque. Bien entendu également, à l’époque, l’opposition qu’on fait aujourd’hui si souvent entre « l’intervention de l’Etat » - toujours négative parce que par essence en conflit avec ce qu’on prétend être la spontanéité du marché et « l’intérêt privé » - associé aux tendances spontanées du marché n’avait pas cours. Cette opposition n’était ni faite, ni même remarquée. Au contraire le bon sens partagé par tous les pouvoirs en place voyait dans l’intervention de l’Etat un élément essentiel de la construction du marché et de la modernisation. La gauche radicale -d’aspiration socialiste dans sa propre lecture idéologique -associait certes l’expansion de cet étatisme à l’expulsion graduelle de la propriété privée. Mais la droite nationaliste, qui ne s’assignait pas cet objectif, n’en était pas moins interventionniste et étatiste : la construction des intérêts privés qu’elle proposait exigeait selon elle, et à juste titre, un étatisme vigoureux. Les billevesées dont se nourrissent les discours dominants aujourd’hui n’auraient eu aucun écho à l’époque.
309
La tentation est donc grande, aujourd’hui, de lire cette histoire comme celle d’une étape de l’expansion du capitalisme mondial, qui aurait accompli, plus ou moins bien, certaines fonctions attachées à l’accumulation primitive nationale, créant par là même les conditions de l’étape suivante, dans laquelle on rentrerait maintenant, marquée par l’ouverture au marché mondial et à la compétition sur ce terrain. Je ne proposerai pas de céder à cette tentation. Les forces dominantes dans le capitalisme mondial n’ont pas « spontanément » créé le - ou les -modèles du développement. Ce « développement » s’est imposé à elles. Il a été le produit du mouvement de libération nationale du tiers monde de l’époque. La lecture que je propose met donc l’accent sur la contradiction entre les tendances spontanées et immédiates du système capitaliste, qui sont toujours guidées par le seul calcul financier à court terme qui caractérise ce mode de gestion sociale, et les visions à plus long terme qui animent les forces politiques montantes, en conflit par là même avec les premières. Certes ce conflit n’est pas toujours radical; le capitalisme s’y ajuste, avec profit même. Mais il s’y ajuste seulement, il n’est pas à l’origine de son mouvement. J’ai donc, pour cette raison, proposé de qualifier la période de l’après-guerre - notamment pour les deux décennies 1955-1975 - de période de « l’idéologie du développement », ou encore de celle du projet national bourgeois de Bandoung (par référence à la Conférence de Bandoung qui inaugure la période). Dans ce cadre le conflit entre les forces dominantes du capitalisme mondial et celles qui ont animé le projet « développementaliste » de Bandoung a été plus ou moins radical selon que l’étatisme mis en œuvre était envisagé comme devant supplanter le capitalisme ou le soutenir. L’aile radicale du mouvement se ralliait à la première thèse, et, de ce fait, entrait en conflit avec les intérêts immédiats du capitalisme dominant, notamment par les nationalisations et l’exclusion de la propriété étrangère.
310
L’aile modérée par contre acceptait de concilier les intérêts en conflit, offrant par là même des possibilités plus grandes à l’ajustement. Au plan international cette distinction épousait facilement les termes du conflit EstOuest entre le soviétisme et le capitalisme occidental. Nous retrouvons sur ce terrain à la fois les éléments du dénominateur commun du projet national bourgeois de développement et les caractéristiques de l’opposition entre ses tendances radicales et modérées. Tous les mouvements de libération nationale en Afrique ont partagé cette vision moderniste, par là même capitaliste et bourgeoise. Cela n’implique en aucune manière qu’ils aient été inspirés, encore moins dirigés, par une bourgeoisie, au sens plein du terme. Celle-ci n’existait pas, ou à peine, à l’heure des indépendances et, trente ans plus tard, n’existe encore qu’à l’état embryonnaire, dans l’hypothèse la plus favorable. Mais l’idéologie de la modernisation par contre existait bel et bien et constituait la force dominante donnant un sens à la révolte des peuples contre la colonisation. Cette idéologie était porteuse d’un projet, que je propose de qualifier du nom - curieux à première vue - de « capitalisme sans capitalistes ». Capitalisme par la conception qu’elle se faisait de la modernisation, appelée à reproduire les rapports de production et les rapports sociaux essentiels et propres au capitalisme : le rapport salarial, la gestion de l’entreprise, l’urbanisation, l’éducation hiérarchisée, le concept de citoyenneté nationale. Sans doute d’autres valeurs, caractéristiques du capitalisme évolué, comme celle de démocratie politique, faisaient cruellement défaut, ce qu’on justifiait par les exigences du développement initial préalable. Tous les pays de la région - radicaux et modérés - optaient pour la même formule du parti unique, des élections-farces, du leader-fondateur de la Patrie etc. Sans capitalistes dans la mesure où, en l’absence d’une
311
bourgeoisie d’entrepreneurs, l’Etat - et ses technocrates - était appelé à s’y substituer. Mais aussi parfois dans la mesure où l’émergence de la bourgeoisie était tenue suspecte, du fait de la primauté que celle-ci donnerait à ses intérêts immédiats sur ceux du plus long terme en construction. La suspicion devenait, dans l’aile radicale du mouvement de libération nationale, synonyme d’exclusion. Cette aile radicale concevait alors naturellement que son projet était celui de la « construction du socialisme ». Elle retrouvait alors le discours du soviétisme. Celui-ci était lui aussi parvenu, par ses dynamismes propres, au projet d’un « capitalisme sans capitalistes », ayant fait de l’objectif de « rattraper » le monde occidental développé l’essentiel de ses préoccupations. En Afrique les mouvements de libération nationale se partageaient, comme ailleurs, entre des tendances à la radicalisation dite « socialiste » et des tendances à la modération. Cette coupure, franche et tranchée dans certains cas, traversait un mouvement unifié d’apparence dans d’autres. L’opposition se fondait sur un ensemble complexe de causes, tenant pour les unes aux classes sociales sur lesquelles s’appuyait le mouvement - paysans, monde urbain populaire, classes moyennes, classes favorisées - pour les autres aux traditions de leur formation politique et organisationnelle (partis communistes métropolitains, syndicats, Eglises). La précipitation avec laquelle les deux puissances coloniales principales en Afrique -l’Angleterre et la France - ont conçu le projet de « décolonisation » de 1960, a accentué cette opposition dans l’immédiat. L’Afrique comme on le sait se partageait en 1960 en deux blocs, le groupe de Casablanca, rallié derrière les drapeaux du nassérisme, du FLN algérien et du N’kmmahisme, le groupe de Monrovia, constitué en premier lieu par les plus fidèles élèves de la France gaulliste et de l’Angleterre libérale (la Côte d’ivoire, le Kenya etc.). Lumumba, au Congo de l’époque, se rattachait au premier groupe,
312
mais des forces importantes du mouvement dans son pays sympathisaient davantage avec le second groupe. Les atermoiements du pouvoir belge, qui avait refusé jusqu’à la dernière minute de tirer la leçon dont la France et la Grande-Bretagne avaient fait l’analyse, ont été largement responsables du report de ce conflit sur le terrain congolais lui-même. En réponse à l’établissement fragile d’un pouvoir lumumbiste à Léopoldville - puis à Stanleyville - les forces « modérées » optaient, soutenues par Bruxelles et d’autres -notamment l’Afrique du Sud - pour la sécession du Katanga et du Kasaï. Mis en place à Léopoldville, d’abord dans l’ombre de Kasavubu, Mobutu, réconcilié avec Tschombé et « l’empereur » Kalonji du Kasaï, jouait la carte de la réconciliation à laquelle ses maîtres avaient finalement décidé de se rallier. L’exemple congolais allait donc inspirer une politique nouvelle, appelée à polir les angles dans un premier temps, rapprocher les camps radicaux et modérés, pour user progressivement les premiers. Le génie de l’empereur Haile Selassié a été de comprendre que le moment était venu de sceller la réconciliation entre les groupes de Monrovia et de Casablanca par la création à Addis Abeda, précisément dès 1963, de l’Organisation de l’Unité Africaine. Le rapprochement créait des conditions nouvelles pour le déploiement du projet de Bandoung en Afrique. Formellement tous les Etats s’y ralliaient, devenant par là même membres du mouvement des « Non alignés », même lorsqu’ils restaient dans le giron des puissances occidentales et même sous leur protection militaire directe dans certains cas. Mais du coup ils acquéraient une certaine capacité de manœuvre, non envisagée au départ dans le schéma néocolonial. Ce fait explique qu’après les initiateurs du « socialisme africain » - Ghana, Guinée, Mali -des générations successives de radicalisation de la même inspiration aient pu se succéder en Afrique (Congo-Brazzaville, Bénin, Tanzanie etc.). Fait curieux compte-te-
313
nu de la fragilité des Etats de ce continent face aux pressions impérialistes. Cela explique aussi qu’un Mobutu ait pu disposer d’une marge permettant des extravagances nationalistes qu’on a de la difficulté à comprendre autrement. 2) Quel qu’aient été les objectifs - communs - de l’ère de Bandoung, de son idéologie du développement, de son projet national et bourgeois de « capitalisme sans capitalistes », des modalités de sa mise en œuvre, des vicissitudes de ses rapports au conflit des superpuissances, les résultats n’en sont pas moins différents parfois à l’extrême d’un groupe de pays à l’autre. L’appréciation des résultats est évidemment fonction des critères choisis pour définir le « développement », un concept idéologique dont le contenu reste toujours vague. Si l’on retient le critère du mouvement de libération nationale, c’es-à-dire la « construction nationale », les résultats restent dans l’ensemble discutables. La raison en est que tandis que le développement du capitalisme dans les temps antérieurs soutenait l’intégration nationale, la mondialisation opérant dans les périphéries du système, à l’opposé, désintègre les sociétés. Or l’idéologie du mouvement national ignorait cette contradiction, étant restée enfermée dans le concept bourgeois du « rattrapage d’un retard historique » et concevant ce rattrapage par la participation à la division internationale du travail (et non sa négation par la déconnexion). Sans doute, selon les caractères spécifiques des sociétés précoloniales précapitalistes, cet effet de désintégration a été plus ou moins dramatique. En Afrique, dont le découpage colonial artificiel n’a pas respecté l’histoire antérieure de ses peuples, la désintégration produite par la périphérisation capitaliste a permis à l’ethnisme de survivre, en dépit des efforts de la
314
classe dirigeante issue de la libération nationale d’en dépasser les manifestations. Lorsque la crise est survenue, annihilant brutalement la croissance du surplus qui avait permis le financement des politiques transethniques de l’Etat nouveau, la classe dirigeante elle même a éclaté en fractions qui, ayant perdu toute légitimité fondée sur les réalisations du « développement », tentent de se créer des bases nouvelles associées souvent à un repli ethniciste1. Si l’on retient par contre les critères du « socialisme » les résultats sont contrastés davantage. Bien entendu il faut entendre ici par « socialisme » celui que l’idéologie populiste radicale s’en faisait. Il s’agissait d’une vision progressiste, mettant l’accent sur la mobilité sociale maximale, la réduction des inégalités de revenus, une sorte de plein emploi en zone urbaine, en quelque sorte un Welfare State version pauvre. De ce point de vue les réalisations d’un pays comme la Tanzanie par exemple offrent un contrat saisissant avec celles du Zaïre, de la Côte d’ivoire ou du Kenya, où les inégalités les plus extrêmes se sont accusées continuellement depuis trente ans, tant dans les moments de croissance économique forte que par la suite, dans la stagnation. Mais le critère conforme à la logique de l’expansion capitaliste - un concept différent de celui, idéologique, de développement - est celui de la capacité d’être compétitif sur les marchés mondiaux. De ce point de vue les résultats sont contrastés à l’extrême et opposent brutalement le groupe des principaux pays d’Asie et d’Amérique latine, devenus exportateurs industriels compétitifs, à celui de l’ensemble des pays africains, qui restent cantonnés dans l’exportation de produits primaires. Les premiers constituent le nouveau tiers-monde (la périphérie de demain dans mon analyse), les seconds ce qu’on appelle désormais le 1. S. Amin, L'Ethnie
à l’assaut des nations, L’Harmattan, Paris 1993. 315
« quart monde », qu’on dit appelé à être marginalisé dans la nouvelle étape de la mondialisation capitaliste2. L’explication de l’échec de l’Afrique dans son ensemble, doit mettre en œuvre toute la complexité des interactions entre les conditions internes spécifiques et la logique de l’expansion capitaliste mondiale. Parce que ces interactions sont trop souvent ignorées, les explications courantes - tant celles avancées par les économistes de « l’économie internationale » conventionnelle que par les nationalistes du tiers-monde -restent superficielles. Les premiers mettent l’accent sur des phénomènes qu’elles isolent de la logique d’ensemble du système, comme la corruption de la classe politique, la fragilité de ses fondements économiques, la productivité très faible de l’agriculture, demeurée en deçà de l’âge de la traction animale, l’émiettement ethnique etc. Présentées de la sorte ces analyses appellent inexorablement à préconiser leur solution par une plus grande insertion dans le capitalisme mondial. L’Afrique aurait besoin de « vrais » entrepreneurs capitalistes, il faudrait briser le carcan de l’autosuffisance du monde rural par la promotion systématique d’une agriculture commerciale etc. Il s’agit de raisonnements courts parce qu’ils font abstraction du système d’ensemble dans le cadre duquel les réformes proposées opéreraient. Ils ignorent par exemple que la voie capitaliste dans l’agriculture produirait des masses gigantesques de populations excédentaires, qui, dans l’état actuel des technologies, ne pourraient pas être employées dans l’industrie, comme elles le furent au XIXe siècle en Europe. L’histoire ne se répète pas. 2. Cf Bernard Founou-Tchuigoua, Afrique subsaharienne : la quart mondialisation en crise, in S. Amin et all, Mondialisation et Accumulation, L’Harmattan, Paris 1993. Voir également, dans cet ouvrage, pp 10 à 19.
316
Les secondes mettent l’accent sur d’autres phénomènes, non moins réels, comme le fait que les prix des matières premières dont dépendent les capacités de financement au décollage se détériorent systématiquement. Les nationalistes du tiers-monde invoquent aussi, à juste titre, les innombrables interventions politiques, et même parfois militaires, des puissances occidentales, toujours hostiles aux forces du changement social progressiste, toujours venues au secours des forces réactionnaires et archaïques. Mais ces arguments ne sont pas structurellement reliés à la logique des conflits internes et de la sorte, opposent « l’extérieur » à la « nation » dont on escamote les contradictions. L’analyse de l’échec que je propose rappelle les responsabilités de la colonisation et de la poursuite de son projet par les classes dirigeantes associées au néocolonialisme, et intègre les considérations de géostratégie globale de l’impérialisme. La division internationale du travail qui crée le contraste inégal entre les centres industrialisés et les périphéries non industrialisées remonte à la révolution industrielle des débuts du XIXe siècle en Europe. Elle implique que les dernières participent au commerce mondial par l’exportation de produits pour lesquels elles disposent d’un avantage fondé sur la nature et non sur la productivité de leur travail. La règle vaut alors pour l’Afrique, à partir de sa colonisation à la fin du siècle dernier, comme pour les autres périphéries de l’Asie et de l’Amérique latine, qui, de ce point de vue, ne s’en distinguent pas jusqu’à la seconde guerre mondiale. On comprend alors pourquoi les puissances européennes partent à l’assaut du continent africain qu’elles se partagent à la Conférence de Berlin (1885). Il ne s’agit pas, comme on l’a dit trop souvent, d’un calcul « erroné », dont l’histoire aurait démontré ultérieurement l’absurdité, l’Afrique n’ayant pas - selon
317
cette analyse - contribué à la richesse de l’Europe mais au contraire constitué un poids mort pour les puissances colonisatrices. Il s’agissait simplement, pour les puissances qui le pouvaient, d’acquérir un droit de préemption sur les richesses naturelles du continent. Une fois conquise, il fallait bien « mettre en valeur » l’Afrique en question. A ce point interviennent à la fois les logiques du capitalisme mondial (de quelles ressources naturelles disposent les différentes régions du continent ?) - et celles de l’histoire antérieure des sociétés africaines. Il m’est apparu que, dans ce cadre d’analyse, on pouvait comprendre ce que furent chacun des trois modèles de la colonisation : l’économie de traite incorporant une petite paysannerie dans le marché mondial des produits tropicaux en la soumettant aux diktats d’un marché de monopoles contrôlés permettant de réduire les rémunérations du travail paysan au minimum et de gaspiller les terres; l’économie des réserves de l’Afrique australe organisée autour de l’extraction minière, alimentée en maind’œuvre à bon marché par la migration forcée en provenance précisément de « réserves » insuffisantes pour permettre la perpétuation de l’autosubsistance rurale traditionnelle; l’économie de pillage à laquelle les compagnies concessionnaires se sont livrées par l’imposition sans contrepartie d’une dime de produits de cueillette ailleurs, là où ni les conditions sociales locales ne permettaient la mise en place de la « traite », ni les richesses minières ne justifiaient l’organisation de réserves destinées à fournir une main-d’œuvre abondante. Le bassin conventionnel du Congo appartenait à cette troisième catégorie pour l’essentiel3. Cependant le statut même de la colonie belge, à l’origine propriété privée de son Roi, comme l’ouverture de ce petit pays européen, plus marquée que celle des 3. S. Amin, Le développement inégal, Minuit, Paris 1973, pp 278 à 296. S. Amin et C. Coquery Vidrovitch, Histoire économique du Congo 1880-1968, Anthropos, Paris 1969.
318
grandes puissances, associés à la richesse minière du Katanga, ont permis un développement colonial qualifié de « brillant » par ses promoteurs - et bénéficiaires - le capital belge et les capitaux étrangers associés. Pourtant au delà des apparences, les résultats de ce mode d’insertion dans le capitalisme mondial allaient s’avérer catastrophiques pour les peuples africains. La mise en valeur coloniale est en effet responsable des deux faiblesses majeures qui pèsent jusqu’à ce jour sur les destinées du continent. D’abord elle a retardé - d’un siècle - toute amorce de révolution agricole. Un surplus pouvait ici être extrait du travail des paysans et de la richesse offerte par la nature sans investissements de modernisation (ni machines, ni engrais), sans payer véritablement le travail (se reproduisant dans le cadre de l’autosuffisance traditionnelle), sans même garantir le maintien des conditions naturelles de reproduction de la richesse (pillage des sols agraires et de la forêt). Dans les régions où a opéré l’économie de pillage les régressions occasionnées par ce mode de « mise en valeur » ont été maximales. Cet effet destructif a néanmoins été compensé partiellement au Congo belge par la création d’un embryon industriel plus précoce qu’ailleurs. Je fais ici référence aux industries de substitution d’importations établies à Kinshasa (à l’époque Léopoldville) après la seconde guerre mondiale, qu’on doit expliquer par l’ouverture de la Belgique à la concurrence étrangère, à un moment où la France et l’Angleterre s’en protègent. L’histoire ultérieure devait néanmoins démontrer qu’il ne s’agissait là que d’un embryon fragile, pas même de l’amorce d’une révolution industrielle. Simultanément ce mode de mise en valeur des richesses naturelles, exploitées dans la cadre de la division mondiale du travail inégale de l’époque, a exclu la formation d’une bourgeoisie locale quelconque. Au contraire
319
chaque fois que celle-ci amorçait le processus de sa formation, les autorités coloniales s’empressaient d’y mettre un terme4. Les faiblesses du mouvement de libération nationale et des Etats héritiers de la colonisation remontent à ce façonnement colonial. Elles ne sont donc pas les produits de l’Afrique précoloniale antérieure, disparue dans la tourmente, comme l’idéologie du capitalisme mondialiste tente d’y trouver sa légitimité - en déployant alors son discours raciste habituel. Les « critiques » de l’Afrique indépendante, de ses bourgeoisies politiques corrompues, de l’absence de sens de l’économique, de la ténacité des structures rurales communautaires oublient que ces caractères de l’Afrique contemporaine ont été forgés entre 1880 et 1960. Nul étonnement alors que le néocolonialisme ait perpétué ces caractères. Les équipes politiques qui se sont trouvées responsables de l’Afrique indépendante n’étaient pas nécessairement artificiellement constituées d’agents d’exécution même parmi celles qui acceptaient l’option néocoloniale. Leurs faiblesses étaient celles du capitalisme périphérique tel qu’il avait été forgé ici. Il n’empêche que la responsabilité des métropoles demeure majeure. Car lorsque, en dépit des faiblesses de la société coloniale, le mouvement de libération avait produit des élites potentiellement capables d’aller plus loin, tous les efforts ont été conjugués pour faire échouer ces chances pour l’Afrique de sortir de l’ornière. La forme que cette faillite a prise est toute entière définie par les limites de ces fameux accords de Lomé qui ont lié - et continuent à lier - l’Afrique subsaharienne à l’Europe de la C. E. E. Ces accords ont en effet perpétué l’ancienne division du travail, reléguant l’Afrique indépendante dans les 4. S. Amin, L’Afrique de l’Ouest bloquée, Minuit, Paris 1971. S. Amin, Le monde des affaires sénégalais, Minuit, Paris 1969.
320
fonctions de production de matières premières, au moment même où - à l’époque de Bandoung (de 1955 à 1975) - le tiers-monde s’engageait ailleurs dans la révolution industrielle. Ils ont fait perdre à l’Afrique une trentaine d’années à un moment décisif du changement historique. Certes les classes dirigeantes africaines ont ici leur part de responsabilité dans ce qui allait amorcer l’involution du continent, particulièrement lorsqu’elles se sont rangées dans le camp néocolonial contre les aspirations de leur propre peuple, dont elles ont exploité les faiblesses. La collusion entre les classes dirigeantes africaines et les stratégies globales de l’impérialisme est donc, en définitive, la cause ultime de l’échec. On retrouve alors, dans le fonctionnement de ces collusions, toutes les dimensions des préoccupations de la stratégie des impérialismes dans l’après-guerre (1945-1990), en particulier sa dimension géostratégique. Appartenant par le Katanga à l’ensemble de l’Afrique australe, le Zaïre a, de ce fait, payé le prix de la géostratégie des impérialismes de l’aprèsguerre. La région tout entière, du Katanga (aujourd’hui Shaba), des Rhodésie du Nord (Zambie) et du Sud (Zimbabwe) à l’Afrique du Sud - constituait pour le camp américain de la guerre froide une zone stratégique unique, importante par ses ressources minérales (dont les minerais rares et l’or d’Afrique du Sud) et par sa localisation, contrôlant les communications entre l’Atlantique sud et l’Océan indien. L’URSS de l’époque a cherché à briser ces positions de l’adversaire en faisant alliance avec les mouvements de libération nationale africains, notamment les plus radicaux d’entre eux, en Angola, au Mozambique, au Zimbabwe et en Afrique du Sud5. Les puissances occidentales ont répondu par leur soutien, pratiquement sans condition, aux régimes de Mobutu au Zaïre, de Banda au Malawi, de Ke5. S. Amin, Itinéraire intellectuel, L’Harmattan, Paris 1993, chap. V (déploiement et érosion du projet national bourgeois dans le tiers-monde 1955-1990).
321
nyatta puis de Moi au Kenya, en dépit de leur corruption notoire et de leurs pratiques antidémocratiques à l’extrême, comme elles soutiennent Savimbi en Angola (jusqu’aujourd’hui), le Renamo au Mozambique et poussent au compromis fédéral en Afrique du Sud, fut-ce au détriment d’une solution démocratique véritable6. En même temps évidemment ces considérations géostratégiques de Washington, sur lesquelles les Européens se sont toujours alignés, donnaient à Mobutu une liberté de manœuvre - plus apparente que réelle que celui-ci a exploité -à travers son discours « nationaliste » de « l’authenticité », parfois même par l’adoption de mesures de nationalisations (« zaïrisation ») qui, en fait, ne gênaient pas l’essentiel des intérêts impérialistes7. Ce sont des considérations géostratégiques analogues qui expliquent l’hostilité des puissances occidentales aux bourgeoisies du nord du continent et du Moyen-Orient, c’est-à-dire du monde arabe. Ici l’importance de la région tenait à sa richesse pétrolière et à sa position géographique située sur le flanc sud de l’URSS de l’époque. Ces stratégies ont eu également leur part de responsabilité dans l’échec arabe. En sens inverse les considérations géostratégiques ont contraint les impérialistes occidentaux à soutenir, ou tout au moins à tolérer, les initiatives des bourgeoisies de l’Asie orientale, ce qui explique en partie tout au moins les « succès » de cette région dans la période de l’expansion capitaliste de l’après-guerre. Mais aujourd’hui la page est tournée. Les préoccupations de géostratégie antisoviétique n’ont plus de raison d’être. L’heure de la recompradorisa6.
Mondialisation et Accumulation, op cit, chap. IV (l'Afrique du Sud au sein du système global
ou les enjeux de la lutte pour la démocratisation). 7. Fayçal Yachir, Enjeux miniers en Afrique, Karthala, Paris 1987.
322
tion de l’ensemble des périphéries, mettant un terme aux illusions de l’ère de Bandoung, a sonné. Cette recompradorisation opère néanmoins sur des terrains devenus différents du fait même des résultats inégaux au terme du déploiement du projet de Bandoung. 3) Une nouvelle étape de la polarisation capitaliste mondiale est désormais amorcée, dans laquelle la logique de l’expansion du capital voudrait que le quart monde africain soit provisoirement « marginalisé ». Aussi le débat concernant ces formes nouvelles de la polarisation doit-il, selon moi, s’ouvrir par la discussion de ce qu’il y a de nouveau dans le système mondial, produit par l’érosion du système antérieur, celui de l’après-guerre (19451990) décrit plus haut. Je renvoie donc ici le lecteur au chapitre IV de cet ouvrage. La logique des intérêts dominants n’a pas de réponse à la dégradation continue des conditions matérielles et morales dans lesquelles elle enferme les majorités populaires des périphéries du système. L’ajustement structurel qu’elle inspire est tout simplement l’ajustement unilatéral des périphéries aux exigences de l’expansion mondialisée au bénéfice du capital central, alors que nous aurions besoin d’ajustements mutuels articulant les grandes régions du monde, inégalement développées, fondés sur des négociations collectives modulant les interdépendances globales en les soumettant aux exigences de stratégies nationales et régionales tenant compte des inégalités héritées de la polarisation. Si certains pays du tiers-monde peuvent encore se nourrir de l’illusion que l’ajustement structurel tel qu’il est mis en œuvre dans cette logique capitaliste dominante leur permettrait de poursuivre leur ascension dans le système mondial, parce que ces pays ont une certaine capacité de négociation, pour
323
ceux du quart-monde cet ajustement ne peut qu’accélérer l’involution en direction d’une paupérisation et d’une marginalisation aggravées. L’ajustement en question ne peut en effet se solder par une quelconque reprise de la croissance, mais au contraire conduit au désinvestissement, au démantèlement de leurs rares industries, sans pour autant créer des conditions favorables au démarrage d’une révolution agricole. La stagnation - voire la régression - de la productivité de l’agriculture (en dépit du potentiel gigantesque que l’agriculture tropicale humide offre en théorie) entraîne à son tour une accélération de la migration vers les villes, sans que celles-ci soient en mesure de financer un développement industriel quelconque. L’érosion des acquis de l’indépendance - dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’administration - sont alors inévitables. La poursuite d’un équilibre des finances publiques et de la balance extérieure -seuls objectifs de l’ajustement - devient illusoire; cet objectif n’est jamais atteint dans la spirale involutive qu’il entraîne. Les processus d’ajustement conformes à cette logique dominante créent néanmoins les conditions politiques qui contribuent à les perpétuer. Dans les pays du tiers-monde les plus fortunés ils renforcent les positions d’une bourgeoisie compradore qui bénéficie effectivement de son insertion dans le capitalisme mondialisé. Mais si dans ceux du quart-monde ils y parviennent à peine, ils créent néanmoins des conditions défavorables à la cristallisation de réponses populaires appropriées. Ces involutions alimentent alors des explosions qui s’inscrivent presque naturellement dans l’émiettement du pays, son éclatement en régions ethniques ou pseudo-ethniques, produites par l’éclatement du bloc social dominant jusqu’ici et la perte de légitimité de l’Etat. L’Afrique donne déjà quelques exemples de cette tragédie, au Tchad, en Somalie, au Libéria, au Rwanda et au Burundi. D’autres pays ne sont peut-être pas loin d’entrer à leur tour dans ce type d’involution. La marginalisation
324
accentuée par laquelle celle-ci se solde n'est malheureusement dramatique que pour les peuples concernés; elle ne « menace » pas « l’ordre mondial ». L’alternative existe néanmoins, même si la réalisation de ses conditions reste difficile. Celle-ci implique d’abord à la base dans les pays concernés, la constitution d’un front national, populaire et démocratique digne de ce nom. Mais elle implique aussi, au niveau du système mondial, que les évolutions que j’ai décrites plus haut soient amorcées, en direction de la construction d’un monde pluricentrique, de manière à alléger les contraintes qui, dans l’état actuel du monde, pèsent de tout leur poids contre la cristallisation de l’alternative populaire démocratique.
325
Chapitre XI Pour une stratégie de la libération 1 - Les trois contradictions fondamentales du capitalisme Le système économique et social moderne est confronté depuis ses origines à des contradictions qu’il n’est jamais parvenu à supprimer. Au contraire cellesci se sont toujours progressivement approfondies au fur et à mesure des succès enregistrés par le capitalisme en termes de développement. Sa flexibilité, c’est-à-dire son adaptation à l’invention sociale de variantes qui se sont parfois même posées en alternatives à sa logique, lui a certes permis de surmonter les crises occasionnées par l’explosion de ces contradictions. Néanmoins ces solutions partielles déployées en réponse aux défis ont toujours, à plus long terme, accentué la violence des contradictions propres au capitalisme. La logique dans le cadre de laquelle se déploie l’accumulation du capital se heurte sur trois plans aux intérêts sociaux fondamentaux de la majorité de l’humanité. La première de ces contradictions est celle qui oppose les exigences incontournables en matière de subordination des travailleurs que la rentabilité impose et l’aspiration de ceux-ci à être les maîtres de leur destin humain. Par leurs luttes les travailleurs et les peuples ont imposé l’adaptation du capitalisme à cette logique propre de leurs intérêts sociaux - en conflit avec celle du capital, sur un double plan. A celui de la répartition des fruits de la croissance économique en imposant la croissance des rémunérations du travail, individuelles et
326
collectives, en parallèle à celle de sa productivité. A celle des principes de la démocratie, en promouvant leur mise en œuvre dans des domaines sociaux pour lesquels ils n’étaient pas destinés à l’origine. Les réponses démocratiques et réformistes sociales au défi - qui ne sont pas le produit naturel de la logique de l’expansion capitaliste mais au contraire qui se sont imposées contre cette logique - loin d’avoir définitivement réglé la question, en ont au contraire approfondi la radicalité. Les peuples aspirent désormais à beaucoup plus qu’à de meilleures conditions matérielles et au respect de droits humains; ils veulent tout simplement être les maîtres de leur société, autrement dit se libérer de l’aliénation économique fondamentale à laquelle ils sont soumis. Or sans cette aliénation le capitalisme ne peut plus fonctionner. Ses critères et références, comme la rationalité économique, n’ont en effet de sens théorique et pratique que si la société est aliénée économiquement (au sens que Marx donne au concept d’aliénation). La seconde contradiction immanente du capitalisme est celle qui oppose son principe de calcul économique dit rationnel, forcément limité au court terme (qui ne saurait imaginer de choix au delà de quinze ou trente ans) et les exigences de sauvegarde de l’avenir de la vie de la Planète. Par sa nature même cette contradiction reste sans réponse dans le cadre de la logique qui le caractérise comme système historique. Aucune méthode « d’intériorisation des coûts externes » n’est à la hauteur de ce défi, d’autant que précisément le développement des forces productives (et donc simultanément destructives), c’est-à-dire le succès même du capitalisme, a donné aujourd’hui à ce défi des dimensions sans commune mesure avec ce qu’il avait pu être dans le passé. La troisième contradiction immanente du capitalisme est celle qui s’exprime par le contraste grandissant entre ses centres opulents et ses périphéries misérables. Cette polarisation n’est pas le produit de circonstances et de conditions
327
particulières aux différentes régions du monde, comme les idéologies dominantes le prétendent, mais celui de la logique spécifique du capitalisme, opérant sur la base de la mondialisation des échanges et du capital et de la segmentation nationale du marché du travail. Mise en place par les politiques de la transition mercantiliste (1500-1800) qui s’emploient systématiquement à détruire les formes antérieures d’interdépendance pour leur substituer une hiérarchisation au service de l’accumulation du capital, la polarisation se déploie dans la dimension tragique qu’elle a acquise au XIXe siècle à partir de l’industrialisation des centres. Est-elle en voie de résorption, au fur et à mesure que les périphéries entrent à leur tour dans la révolution industrielle ? En fait les modes d’opération des « cinq monopoles » qui définissent la hiérarchie capitaliste nouvelle (le contrôle des technologies, des systèmes financiers, de l’accès aux ressources naturelles, des communications et médias, des armements de destruction massive) donnent à la loi de la valeur mondialisée une portée polarisante redoublée. Cette troisième contradiction est celle qui a provoqué les réactions politiques les plus importantes au défi de l’expansion capitaliste. Toutes les révolutions socialistes jusqu’à ce jour ont été avant tout des mouvements de peuples victimes de la polarisation capitaliste mondiale.
2 - L’histoire n’a pas de fin Le discours idéologique dominant doit ignorer, par principe, les contradictions spécifiques du capitalisme, celles qui ne peuvent trouver de solution sans remettre en cause la logique du système. Les reconnaître ferait perdre à ce discours sa fonction dans la reproduction du système, puisque cela reviendrait à reconnaître le caractère historique du capitalisme. Or toutes les idéologies
328
de pouvoir doivent nécessairement sortir des normes de l’historicité pour adopter le langage des valeurs morales transhistoriques. L’expression de cette idéologie transhistorique peut prendre des formes d’une naïveté étonnante, comme c’est le cas par exemple chez Francis Fukuyama, qui écrit sans en voir le ridicule « we have reached the end point of mankind’s ideological evolution » (« l'humanité est parvenue au terme de son évolution idéologique »), « the western liberal democracy is the final form of human government » (« la démocratie libérale occidentale est la forme finale du gouvernement des hommes... « ). Se proclamant hégélien, Fukuyama ne pense pas une minute que le fait que son illustre inspirateur avait décrété, lui, que l’Etat prussien constituait la forme finale de l’évolution politique posait quelque problème à la méthode qui l’avait conduit à cette conclusion. Sans donc jeter un regard sur la réalité de ce monde, fut-ce un regard rapide, Fukuyama décrète que « no fundamental contradiction cannot be resolved in the context of modem liberalism » (« il n'y a pas de contradiction qui ne puisse être résolue dans le cadre du libéralisme moderne »). L’arrogance fait oublier à notre fonctionnaire du gouvernement des EtatsUnis que l’idée de « fin de l’histoire » qu’il croit originale est en réalité vieille comme le monde. Les idéologies dominantes sont par nature conservatrices : pour se reproduire, toutes les organisations sociales ont besoin de se percevoir comme éternelles. Les idéologies de la parenté dans les sociétés du premier stade (celles que j’appelle communautaires), celles de la religion dans les sociétés tributaires (du second stade) sont aussi, par nature, des idéologies fondées sur l’idée de fin de l’histoire. Chaque religion n’est-elle pas, dans la perception qu’elle a d’elle même, la « réponse définitive » ? Légitimitée par la religion hier, l’idée
329
de fin de l’histoire recherche aujourd’hui - dans le monde capitaliste - la source de sa légitimité dans l’efficacité économique (celle du « marché » dans le langage vulgaire qui est celui de toute idéologie dominante). Mais Fukuyama comme d’autres ne se rend pas même compte que ce transfert de la source de légitimité est lui même parallèle à la transformation que le capitalisme a représenté par rapport au système tributaire antérieur, au renversement des rapports économie / idéologie qui fonde cette transformation, l’aliénation économique (« l’économie commande tout ») se substituant à l’aliénation religieuse (« la religion commande tout »). Encore une fois avec une naïveté étonnante Fukuyama découvre l’aliénation économique, qu’il croit être une caractéristique fondamentale du « marxisme » (en fait Fukuyama ne connait de celui-ci que sa version vulgaire telle que les media le connaissent et le présentent), dans la méthode du « Wall Street Journal ». Il ne lui vient pas à l’idée de se demander si cette observation n’indiquait pas quelque chose d’important concernant la nature de l’idéologie dominante du capitalisme : justement qu’elle était fondée sur l’aliénation économique ! La première démarche de la pensée scientifique consiste précisément à chercher à aller au delà de la vision que les systèmes sociaux ont d’eux mêmes, à ne pas se satisfaire de l’explication que la société communautaire donne d’elle même par les règles de la parenté, la société tributaire par la religion, la société moderne par les lois du marché, - à chercher pourquoi la parenté, la religion, l’économie remplissent les fonctions qu’elles ont dans ces systèmes successifs. Le discours conservateur dominant n’acquiert sa force que par la pratique vulgaire de l’amalgame des « valeurs » qu’il prétend être celles qui régissent le monde moderne (et qu’il défend). Dans cet amalgame on jette pêle-mêle des principes d’organisation politique (l’Etat de droit, les droits humains, la
330
démocratie), des valeurs sociales (la liberté, l’égalité, l’individualisme), des principes d’organisation de la vie économique (la propriété privée, les « marchés libres »). L’amalgame laisse entendre que ces valeurs constituent un tout indissociable, relevant d’une seule et même logique; il associe donc capitalisme et démocratie, comme si cela allait de soi. L’histoire montre plutôt le contraire, que les avancées démocratiques ont été conquises et ne sont pas le produit spontané, naturel, de l’expansion capitaliste. L’analyse critique permet alors de préciser les contenus historiques réels des valeurs en question - la démocratie par exemple - donc leurs limites et contradictions, les moyens de les faire avancer.
3 - Dépasser le capitalisme : comment ? Le capitalisme devra donc être dépassé. Faute de quoi il ne deviendrait la fin de l’histoire qu’en mettant un terme à l’histoire de l’humanité et de la planète par leur destruction ! Contrairement aux systèmes antérieurs qui se sont déployés sur des millénaires avant d’avoir épuisé leur potentiel historique, le capitalisme pourrait apparaître finalement comme une brève parenthèse dans l’histoire générale, au cours de laquelle les tâches élémentaires de l’accumulation auront été accomplies, préparant ainsi un ordre social ultérieur, d’une rationalité désaliénée supérieure et fondée sur un humanisme planétaire authentique. Autrement dit le capitalisme a en fait épuisé son potentiel historique positif très tôt; a cessé d’être le moyen -fut-il « inconscient » - par lequel le progrès se fraie son chemin (la vulgate idéologique dominante fonde de cette manière sa légitimation du capitalisme comme système « définitif »). Il est au contraire devenu l’obstacle au progrès, défini donc non comme le produit involontaire associé l’expansion du capital, mais par des critères définis en contraste avec les produits réels de celle-ci (qui
331
sont l’aliénation économique, la destruction écologique et la polarisation mondiale). C’est pourquoi l’histoire du capitalisme est constituée dès l’origine de moments successifs contrastés, les uns au cours desquels la logique de son expansion s’impose dans son déploiement comme une force unilatérale, les autres au cours desquels l’intervention de forces antisystématiques impose des formes d’expansion du capital moins destructives. Le XIXe siècle avec le déploiement inégal de la révolution industrielle, la prolétarisation et les colonisations, relève du premier mode d’expression de l’expansion capitaliste. Mais en dépit des hymnes à la gloire du capital, la violence des contradictions réelles du système conduisait l’histoire réelle non à sa fin annoncée dans les proclamations triomphalistes de la « belle époque », mais aux guerres mondiales, aux révolutions socialistes et à la révolte des peuples coloniaux. Rétabli dans l’Europe de l’après première guerre, amputée de la Russie soviétique, le libéralisme triomphant aggravait le chaos et ouvrait la voie à la réponse illusoire et criminelle que le fascisme allait lui donner. Ce n’est donc qu’à partir de 1945, après que la faillite de ce dernier ait été consommée, que s’est ouverte une phase d’expansion civilisée par les trois compromis historiques que le soviétisme, la social-démocratie et le mouvement de libération nationale lui imposaient. Aucun de ces compromis ne rompait intégralement avec les logiques du capitalisme, pas même celui issu de la révolution russe, en dépit de la fausse conscience de sa nature propre qu’il a produite; mais tous imposaient à la logique unilatérale du capital le respect des considérations formulées par les mouvements issus de l’explosion de la première et de la troisième contradiction du capitalisme signalées plus haut. Dans le moment de leur déploiement les logiques de ces compromis ont effectivement atténué les effets dévastateurs de l’aliénation économique et
332
de la polarisation. Cependant, progressivement érodées par leurs succès, même partiels par nature, ces logiques ont sombré avec l’effondrement des systèmes qu’elles avaient légitimités. Le retour au discours triomphaliste du libéralisme se prenant une fois de plus pour la fin de l’histoire annonce-t-il seulement la tragique répétition de la succession des scènes du drame ? N’a-til pas déjà, dans un temps record par sa brièveté créé le vide idéologique, amplifiée le chaos des politiques, réuni les conditions d’une polarisation renforcée ? Les peuples - victimes de ce système - réagiront certainement. Ils le font déjà. Mais quelles seront les logiques qu’ils développeront en contraste avec celle du capital ? Quels types de compromis imposeront-ils à ce dernier ? Ou même, dans les hypothèses les plus radicales, quels systèmes substitueront-ils au capitalisme ? Faute de renouvellement pour répondre à ce que les défis permanents du capitalisme comportent de nouveau, les stratégies autour desquelles les mobilisations populaires s’étaient faites dans la période précédente (le socialisme et la construction nationale) ont aujourd’hui perdu leur crédibilité. Et on voit déjà ce qui paraît s’y substituer : soit le thème de la démocratie, associé à des formes de communautarismes (ethniques entre autres) dont la reconnaissance est légitimée par le « droit à la différence » et parfois l'écologisme; soit le thème de l’originalité culturelle et singulièrement religieuse.
4 - La diversité culturelle; l’impasse du culturalisme L’idée que les différences culturelles sont non seulement réelles et importantes mais encore fondamentales (dans ce sens qu’elles réduisent alors à néant ou presque le commun dénominateur transculturel permettant de
333
parler de l’humanité en général), que ces différences sont permanentes et stables, c’est-à-dire transhistoriques, n’est pas nouvelle. Elle est au contraire à la base du préjugé commun courant de tous les peuples et de tous les temps. Entre autre; toutes les religions se sont définies de cette manière comme la fin de l’histoire, la réponse définitive. Les progrès de la réflexion historique et sociale critique, les avancées universalistes, la construction des sciences de la société ont toujours été réalisés, de tous temps, par une lutte systématique contre le préjugé culturaliste fixiste. La question n’est donc pas de démontrer une fois de plus que cette vision du monde est démentie par l’histoire réelle. Elle est d’abord de savoir pourquoi cette idée absurde se présente aujourd’hui avec tant de force convaincante; ensuite à quoi conduirait son succès politique. Les questions posées ici n’appellent pas de réponses directes simples, auxquelles une théorie des cultures pourrait fournir l’outillage conceptuel d’analyse. Car ces questions interpellent le fonctionnement de ces sociétés dans leur ensemble et dans leur interaction mutuelle. Elles articulent donc les dimensions culturelles de la vie sociale aux autres. Les théories de la spécificité culturelle sont toujours décevantes parce qu’elles partent du préjugé que les différences seraient toujours décisives, tandis que les ressemblances ne relèveraient que du hasard, et définissent à priori sur cette base leur programme. Les différences recensées trahissent alors la banalité de la réflexion. Dire comme par exemple Huntington que ces différences sont fondamentales parce qu’elles touchent aux domaines définissant « les rapports de l’être humain à Dieu, à la Nature, au Pouvoir », c’est à la fois enfoncer des portes ouvertes, réduire les cultures aux religions, supposer que celles-ci développent nécessairement des concepts spécifiques à chacune d’elles, et différents d’une manière significative, des rapports en question. Or
334
l’histoire montre que ces concepts sont plus flexibles qu’on le croit souvent, et qu’ils fondent des systèmes idéologiques qui s’inscrivent dans des évolutions historiques différentes ou semblables selon des circonstances indépendantes d’eux. De mauvais culturalistes - mais y en a-t-il de bons ? - ont expliqué hier le retard de la Chine, aujourd’hui son développement accéléré, par le même confucianisme. Le monde islamique du Xe siècle est apparu à bien des historiens non seulement plus brillant mais encore plus porteur de progrès potentiel que l’Europe chrétienne de la même époque. Qu’est-ce qui a changé et pourrait expliquer le renversement des positions : la religion (plus exactement son interprétation par la société), autre chose, ou les deux à la fois ? Et comment ces différentes instances de la réalité ont-elles réagi les unes sur les autres ? Lesquelles ont été motrices ? Autant de questions auxquelles le culturalisme - même dans des formulations plus savantes que celle de Huntington, particulièrement grossière -reste insensible. Les cultures sont les cultures, elles sont spécifiques et différentes, un point c’est tout. Mais de quelles cultures s’agit-il ? De celles définies par les aires religieuses, celles des langues, des nations, des régions économiques homogènes, des systèmes politiques ? Huntington a choisi apparemment la « religion » comme fondement des « sept groupes » qu’il définit : Occidentaux (Catholiques et Protestants), Musulmans, Confucéens (bien qu’il ne s’agisse pas là d’une religion !), Japonais (Shintoïstes ou Confucéens ?), Hindoux, Bouddhistes et Chrétiens Orthodoxes. Huntington s’intéresse d’évidence à des aires culturelles qui offriraient un découpage significatif pour le monde actuel. C’est pourquoi sans doute a-t-il besoin de séparer les Japonais des autres Confucéens, les Chrétiens Orthodoxes des Occidentaux (parce que dans la stratégie de la C. I. A. pour le compte de laquelle Huntington travaille l’intégration possible de la Russie
335
dans l’Europe est un véritable cauchemar ?), d’ignorer les Africains qui, fussent-ils Chrétiens, Musulmans ou Animistes ont tout de même quelques singularités (mais cette ignorance révèle peut-être seulement l’insouciance scientifique et le préjugé raciste banal qui fait manquer de la voir), et même les Latino Américains (parce qu’ils sont chrétiens sont-ils autant occidentaux que les occidentaux ? Et alors pourquoi sont-ils sous-développés ?). On n’aura jamais fini de signaler les absurdités de ce travail de classement mal fait, de cette page d’eurocentrisme de troisième ordre mal rédigée. Tout cela pour parvenir à la découverte surprenante que six de ces sept groupes ignorent totalement toutes les valeurs occidentales, parmi lesquelles on retrouve pèle mêle comme toujours dans ce genre les concepts définissant le capitalisme (le « marché ») et la démocratie (qu’on associe donc par décret posé à priori, en dépit des faits historiques). Mais le marché fonctionne-t-il plus mal dans le Japon non occidental qu’en Amérique latine ou en Afrique subsaharienne ? Le marché et la démocratie ne sont-ils pas récents en Occident lui-même ? Le Christianisme du Moyen Age ne serait-il reconnu dans ces valeurs dites occidentales ? Les idéologies - et les religions en particulier - sont certes des choses importantes. Mais le dire n’est rien d’autre que platitude. Une analyse qui situe leurs fonctions dans une époque historique définie (le stade que j’ai qualifié de tributaire -antérieur au capitalisme) aide à découvrir, dans ce cadre, les analogies - au delà des spécificités - dans les fonctions en question. Les « aires culturelles » tributaires définies dans ce cadre n’ont pas « complètement » disparu, loin de là. Mais elles ont été profondément transformées de l’intérieur par le capitalisme moderne (ce que Huntington appelle improprement la « culture occidentale »). Je suis parvenu à la conclusion que cette culture du capitalisme (et non de « l’Occident ») dominait mondialement et que cette
336
domination avait largement vidé de leur contenu les cultures tributaires anciennes. Là où le capitalisme a pris ses formes centrales développées la culture capitaliste moderne s’est pratiquement intégralement substituée aux cultures anciennes, y compris à celle du Christianisme médiéval (en Europe et en Amérique du Nord) et à celle du Japon (confucéen à l’origine). Par contre dans les périphéries capitalistes la domination de la culture capitaliste n’est pas parvenue à transformer radicalement et à instrumentaliser intégralement les cultures locales anciennes. Cette différence ne tient pas aux caractères propres des cultures tributaires diverses mais aux formes de l’expansion capitaliste, centrales et périphériques. Dans son expansion mondiale le capitalisme a fait apparaître la contradiction entre ses prétentions universalistes et la polarisation qu’il produit dans la réalité matérielle. Vidées de tout contenu, les valeurs invoquées par le capitalisme (l’individualisme, la démocratie, la liberté, l’égalité, la laïcité, l’Etat de droit etc.) apparaissent alors aux peuples victimes du système comme des mensonges, ou des valeurs propres à la « culture occidentale ». Cette contradiction est évidemment permanente, mais chaque phase d’approfondissement de la mondialisation - comme la nôtre - en accuse la violence. Le système découvre alors, par le pragmatisme qui le caractérise, les moyens de gérer cette contradiction. Pour cela il suffit en effet que les uns et les autres acceptent leur « différence », que les opprimés cessent de revendiquer la démocratie et l’individualisme, la liberté et l’égalité, pour leur substituer leurs valeurs prétendues « propres », c’est-à-dire en général le contraire des premières. Ils intériorisent alors leur statut subalterne et permettent à l’expansion capitaliste de se déployer sans que le renforcement de la polarisation qu’elle entraîne ne rencontre d’obstacle sérieux.
337
Impérialisme et culturalisme font toujours bon ménage. Le premier s’exprime dans la certitude arrogante que « l’Occident » est parvenu au terme de l’histoire, que ses formules de gestion de l’économie (la propriété privée, le marché), de la politique (la démocratie), de la société (la liberté individuelle) sont définitives et indépassables. Les contradictions réelles observables sont décrétées imaginaires ou produites par des résistances absurdes à la soumission à la raison capitaliste. Pour tous les autres peuples le choix est simple : accepter les valeurs de l’Occident, ou s’enfermer dans leurs spécificités culturelles propres. Si, comme il est probable, la première de ces options s’avère impossible, refusée, alors le conflit des cultures occupera le devant de la scène, puisque les sociétés de l’Occident sont définitivement pacifiées de l’intérieur. Mais dans ce conflit les dès sont pipés : l’Occident l’emportera nécessairement, les autres seront toujours battus. C’est pourquoi l’option culturaliste de ces derniers peut être non seulement tolérée, mais voire même encouragée. Elle ne menace que les peuples qui sont ses victimes. En contrepoint aux discours mythologiques sur la « fin de l’histoire » et le « conflit des cultures », l’analyse critique cherche à définir les enjeux et les défis véritables : traversé de contradictions qui ne peuvent être surmontées sans sortir de sa logique propre, le capitalisme n’est qu’une étape dans l’histoire; dans les formes de leur formulation les valeurs qu’il proclame évacuent les questions relatives à ses propres limites et contradictions. Le discours d’autosatisfaction de l’Occident ne répond pas à ces défis, puisqu’il les ignore délibérément. Mais le discours cuhuraliste du refus des victimes les évacue tout autant puisqu’il transfère le conflit hors du terrain des enjeux véritables, qu’il abandonne à l’adversaire, pour se réfugier dans l’imaginaire des cultures. Qu’importe alors que l’Islam par exemple soit installé aux postes de commande de la société locale, si dans la hiérarchie de l’économie
338
mondiale les règles du système enferment les sociétés islamiques dans la compradorisation de bazar ? Comme le fascisme hier, les culturalismes aujourd’hui fonctionnent au mensonge : car ils sont en fait des moyens de gestion de la crise, en dépit de leur prétention à constituer la réponse à celleci. Regarder devant soi, ni derrière, ni à ses pieds, implique qu’on réponde aux questions évacuées précisément par ces deux discours symétriques : comment réellement combattre l’aliénation économique, le gaspillage des ressources, la polarisation mondiale, comment donc créer les conditions permettant de faire avancer les valeurs universalistes au delà de leur formulation par le capitalisme historique. Simultanément la critique de l’héritage culturel, de tous les héritages culturels, s’impose toujours. La modernisation de l’Europe aurait été impensable sans la critique préalable à laquelle les Européens ont eux mêmes soumis leur propre passé et leur religion. Celle de la Chine aurait-elle été amorcée, comme il le semble, sans la critique du passé et notamment de l’idéologie confucéenne à laquelle le maoïsme s’est consacré ? Par la suite, certes, l’héritage - chrétien ici, confucéen là - a pu être réintégré dans la culture nouvelle, mais après avoir été radicalement transformé par la critique révolutionnaire du passé. Par contre dans le monde islamique le refus tenace de toute critique du passé - et singulièrement de la religion - accompagne - sans doute pas par hasard - la dégradation continue de la place des pays de cette aire culturelle dans la hiérarchie du système mondial.
5 - Sortir de la crise ou bien gérer la crise ? Il est normal qu’après avoir analysé une situation on se préoccupe de réfléchir sur les évolutions possibles dont elle peut être l’objet. A cet effet la méthode courante - dite des scénarios - consiste à recenser les forces actives qui occu-
339
pent le terrain (blocs d’intérêts économiques, politiques ou idéologiques), leur imaginer des objectifs cohérents avec leur nature, puis, à partir de l’intervention de l’une d’elles qui déclenche le mouvement, à suivre le déroulement des actions et des réactions de chacune d’entre ces forces diverses. Cette méthode permet d’expliciter ce qui est contenu dans les prémisses de départ, ce qui est certainement utile. Mais elle se donne trop de degrés de liberté dans l’identification des groupes en présence et en conséquence permet mal de prévoir les coagulations et les transformations qui, à travers le déroulement des conflits, modifient la carte des forces en activité, leurs objectifs et finalement les résultats. Je lui préfère donc une méthode moins rigoureuse en apparence, mais qui capitalise mieux les « leçons de l’histoire » et les synthèses intuitives que celleci suggère. Il s’agit de développer l’analyse en trois temps successifs qui sont : i)
l’identification des objectifs stratégiques des forces dominantes dans les structures et la conjoncture particulières à la phase en cours, et des moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs;
ii) l’analyse des réponses des différentes forces populaires et autres victimes des stratégies dominantes, de leurs perceptions des défis, de leur intervention, des contradictions et conflits qu’elles provoquent, des coagulations d’alliances qu’elles favorisent ou excluent de ce fait; (iii) enfin à partir de là l’ouverture d’un débat sur ce que pourraient être des stratégies populaires - « anti-systémiques » - efficaces, les objectifs d’étape qu’elles pourraient s’assigner, les moyens qu’elles devraient mettre en œuvre à cet effet etc. Je renverrai ici le lecteur aux analyses que j’ai proposées ailleurs tant celles qui concernent le système de l’après-guerre (cf Itinéraire intellectuel, Regards sur
340
le demi-siècle 1945-1990) que celles qui traitent de son érosion, effondrement et du chaos qui en est résulté (cf L'Empire du chaos). Dans cet esprit j’ai cru nécessaire d’analyser les politiques mises en œuvre par les pouvoirs non comme des stratégies durables d’expansion capitaliste mais simplement comme des pratiques de gestion de la crise à court terme, tant dans sa dimension économique (cf La gestion capitaliste de la crise) que dans certaines de ses dimensions politiques (cf L’Ethnie à l’assaut des Nations). L’érosion graduelle des compromis sur la base desquels s’était déployée l’expansion capitaliste de l’après-guerre a ouvert une phase nouvelle dans laquelle le capital, libéré de toute entrave, tente d’imposer l’utopie de la gestion du monde conformément à la logique unilatérale de ses intérêts financiers. Cette première conclusion m’amenait à identifier les deux objectifs nouveaux de la stratégie des pouvoirs dominants : approfondir la mondialisation économique, détruire les capacités politiques de résistance des Etats, des nations, des peuples. « Gérer le monde comme un marché » implique l’émiettement maximal des forces politiques, c’est-à-dire pratiquement la destruction des pouvoirs d’Etat (un objectif que l’idéologie anti-Etat tous azimuts cherche à légitimer), l’éclatement des nations au bénéfice de communautés infranationales (ethniques, religieuses ou autres), leur affaiblissement au bénéfice de solidarités idéologiques supranationales (notamment d’intégrismes religieux) etc. Pour cette gestion l’idéal est qu’il n’y ait plus qu’un seul Etat (et surtout pouvoir militaire) digne de ce nom - les Etats-Unis devenus seul gendarme du monde -tandis que tous les autres pouvoirs seraient confinés dans les tâches modestes de la gestion du marché au jour le jour. Le projet européen lui même est alors conçu dans cet esprit comme la gestion communautaire du marché, sans plus, tandis qu’au delà de ses frontières, l’émiettement maximal (autant de Slovénie, de Macédoine, de Tchétchénie
341
qu’il est possible...) est recherché systématiquement. Les thèmes de la « démocratie » et du « droit des peuples » sont mobilisés pour obtenir les résultats annulant la capacité des peuples de faire usage de la démocratie et des droits au nom desquels on les a manipulés. L’éloge de la spécificité et de la différence, la mobilisation idéologique autour d’objectifs infra nationaux (ethnismes) ou supranationaux (culturalismes), favorisant des communautarismes impuissants, font déraper les luttes sur les terrains de la purification ethnique ou du totalitarisme religieux... Dans le cadre de cette logique - et de ces objectifs stratégiques - le « conflit des cultures » devient possible, souhaitable même. A mon avis l’intervention de Huntington sur le sujet doit être lue de cette manière. Car l’auteur en question n’est pas un intellectuel mais un fonctionnaire chargé de légitimer les stratégies politiques des Etats-Unis (en particulier de la C.I.A). Comme naguère il avait produit les textes qui légitimaient le soutien aux dictatures du tiers-monde au nom de la priorité du « développement » (avant que le thème de la démocratie ne prenne la relève comme moyen de gestion de la crise), il produit aujourd’hui le texte qui donne leur légitimité aux moyens déployés pour gérer la crise par la polarisation des conflits autour des « incompatibilités culturelles ». Il ne s’agit de rien de moins que d’une stratégie qui impose un terrain de conflit qui garantit la victoire de « l’Occident », comme je l’ai déjà signalé ! Les événements paraissent bien, dans l’immédiat, démontrer - par la multiplicité des conflits ethniques et religieux - l’efficacité de la stratégie choisie par l’adversaire. Mais donnent-ils pour autant raison à la thèse du conflit « naturel » des cultures ? J’ai exprimé de grandes réserves à ce sujet. Les affirmations violentes sur le sujet de la « spécificité » sont rarement le produit spontané des prétendus peuples intéressés eux mêmes. Elles sont presque
342
toujours formulées par des minorités dirigeantes ou aspirant à le devenir. Les moyens sont mobilisés pour créer des situations qui font accepter, voire largement soutenir, les objectifs visés par ces politiques de pouvoirs (l’épuration ethnique, la dictature au nom de la religion etc.) Je constate également que les classes dirigeantes les plus fragilisées par l’évolution globale du système sont celles qui recourent davantage à ces stratégies culturalistes ou ethnicistes. C’est le cas des pays de l’Est européen, frappés par un cataclysme institutionnel peu commun. Mais c’est aussi le cas du monde islamique et de l’Afrique subsaharienne exclus de la liste des producteurs industriels compétitifs et donc marginalisés dans le système global. Par contre les régions qui ont su mieux répondre au défi de la mondialisation vivent leur « spécificité » sans névrose et n’en font pas l’axe central de leur affirmation idéologique et de la légitimation de leurs choix politiques. C’est le cas de la Chine - confucéenne certes - mais qui n’éprouve aucune gêne à emprunter à l’Occident, parfois même à songer aller plus loin dans les directions qu’il a ouvertes. Cela n’affaiblit pas son nationalisme. Mais il s’agit alors d’un nationalisme positif au sens qu’il est dirigé contre les Puissants du système (les Etats-Unis en particulier). Par contre les nationalismes invoqués par les classes dirigeantes aux abois se définissent contre d’autres faibles (par exemple le nationalisme croate antiserbe), jamais contre les Puissants dans la hiérarchie du système mondial (ici l’Allemagne et les Etats-Unis). Ces nationalistes négatifs sont tout à fait fonctionnels dans l’optique de la gestion capitaliste de la crise, les premiers ne le sont pas du tout. Les cultures locales, dans leur spécificité, leur rapport au système mondial et à la culture dominante du capitalisme, ne se présentent pas selon un schéma unique qui permettrait d’en déduire une théorie générale comme le culturalisme le suppose. Les variables clés qui paraissent pouvoir expliquer les diffé-
343
rences entre les régions du monde se situent hors du champ des cultures. Il n’y a pas de conflit systématique des cultures; il y a des conflits fondamentalement d’une autre nature, dont certains comportent un volet culturel.
6 - Les diverses régions du monde face au défi : des potentiels inégaux : Revenant donc à la mondialisation telle qu’elle nous est proposée par les pouvoirs en place à l’heure actuelle - c’est-à-dire « la mondialisation par le marché » - j’en avais souligné l’extrême vulnérabilité (cf Mondialisation et Accumulation). Cette thèse est d’évidence diamétralement opposée à celle implicite dans le discours dominant, selon laquelle « il n’y a pas d’alternative et qu’il faut donc s’ajuster à la mondialisation par le marché, quel qu’en soit le prix ». Ce discours dominant mobilise à son profit des jugements de bon sens apparent que les media présentent sans les discuter, bien qu’il s’agisse en fait d’arguments d’une grande légèreté. On fait comme s’il y avait déjà un système productif mondialisé, qui aurait donc déjà disqualifié toute possibilité de politiques nationales efficaces. On fait comme si ce système était déjà intégré dans toutes ses dimensions - ou en voie de l’être rapidement - la décentralisation mondialisée de la production commandée par les possibilités de l’informatique se substituant aux transferts massifs de facteurs de la production (singulièrement aux migrations de travailleurs) naguère nécessaires, désormais caduques. On fait comme si la concurrence sur le marché n’était plus encadrée par le conflit des Etats mais opérait exclusivement par le moyen de groupements d’intérêts de capitaux à géométrie variable. On fait comme si ce nouveau monde sans Etats (et sans nations, un concept dépassé dit-on) était compatible avec le renforcement de la démocratie - puisque
344
celle-ci serait anti Etat par définition implicite - et serait particulièrement agréable pour les « petits pays » toujours victimes dans le système des Etats. Aucun de ces arguments ne résiste à l’épreuve de l’observation et de la réflexion. Il n’existe pas de système productif mondialisé, même si déjà l’efficacité des systèmes productifs nationaux est érodée, précisément par les politiques de soutien à la mondialisation incontrôlée. Les intérêts en conflit sur les marchés font appel à l’autorité des Etats pour les soutenir; et les Etats « forts » par leur position dans le système mondial (les Etats-Unis, le Japon, l’Allemagne) ne se privent pas d’user de cette autorité. La mondialisation par le marché n’est pas synonyme d’intégration de celui-ci dans toutes ses dimensions et les créations d’emplois qu’on peut imaginer dans les hypothèses les plus favorables ne sont pas à la hauteur des problèmes et n’offrent aucune perspective d’absorption de l’armée de réserve dans les périphéries. Certains petits Etats espèrent, en s’agglomérant à des pays plus puissants, voir leurs conditions matérielles s’aligner sur celles de leurs partenaires. On donne ici en exemple les succès de la Tchéquie, en voie d’être absorbée par l’Allemagne. Mais outre que l’alignement en question reste l’exception et non la règle (on voit mal quel profit Haïti tire de son intégration dans l’espace nord américain !), son prix politique doit-il être totalement passé sous silence (l’avenir de la Tchéquie rappellera-t-il le sort du protectorat de BohêmeMoravie destiné à être germanisé ?). Bien entendu les comportements compradore ont toujours soutenu le point de vue des pouvoirs dominants, c’est leur définition même. La crise de la démocratie en Occident même n’estelle pas précisément la conséquence de la perte de sens produite par l’annihilation des pouvoirs d’Etat, par lesquels les peuples peuvent éventuellement s’exprimer ? Ce nouveau Moyen Age fait de « communautés » juxtaposées, incapables de voir au delà des murs des ghettos dans lesquels on les enferme,
345
sans « Etat » (mais avec beaucoup de police), sans capacité d’agir sur le système économique, en quoi serait-il favorable au progrès de la démocratie ? A ce discours purement idéologique - au sens le plus péjoratif du terme j’oppose donc une analyse du système mondial que je crois infiniment plus réaliste (cf Mondialisation et Accumulation). Dans cette analyse je propose donc de distinguer trois catégories de sociétés capitalistes (centrales, périphériques intégrées, périphériques marginalisées) associant le degré de leur compétitivité sur les marchés mondiaux à la proportion que l’armée active occupe dans leur force de travail (et en conséquence à celle de l’armée de réserve non employée dans les segments du système productif capables d’affronter la mondialisation). Le premier groupe est celui des centres historiques (Etats-Unis-Canada, Europe occidentale et centrale, Japon) renforcée par les « cinq monopoles » qui commandent la polarisation mondiale de demain (cf chapitre IV). Le second groupe est constitué par les pays de l’Europe de l’Est, de l’ex-URSS, de l’Asie orientale (Chine, Corée) et du Sud-est, de l’Amérique latine (en dehors des Caraïbes et de l’Amérique centrale) et en partie de l’Inde. Ce pays fait la jonction avec le groupe des pays marginalisés : l’Afrique, les mondes arabe et musulman. Dans la même analyse je propose également de mettre en relief la coupure Est-Ouest qui partage le système mondial en deux groupes de pays face à la crise actuelle. A l’ouest l’ensemble des centres anciens (Amérique du Nord et Europe) et des périphéries associées (Amérique latine, Afrique, Moyen Orient, Europe de l’Est et ex-URSS) pratiquent des politiques identiques de gestion de la crise, s’inscrivant dans la ligne néolibérale. Ces politiques enferment les centres en question dans une stagnation opiniâtre et condamnent les périphéries associées aux involutions brutales que les politiques d’ajustement (et
346
les thérapies de choc) y entraînent. A l’Est l’Asie, qui refuse dans les faits de se conformer aux prescriptions de « l’utopie du marché sans Etat », réalise des taux de croissance qui interdisent de parler ici de crise, mais au contraire en font la zone privilégiée de l’accumulation à l’échelle mondiale. Lorsque l’on croise ces deux classements on découvre qu’il n’y a pas « un défi » de la mondialisation, mais « des défis » qui s’expriment de manière fort différente d’une région à l’autre. C’est pourquoi le titre retenu pour cet ouvrage a choisi le pluriel. Car en parlant « du » défi de la mondialisation, on accepte d’entrer dans le débat totalement idéologique, non réaliste, de l’utopie du marché. Le lecteur aura d’ailleurs certainement remarqué que lorsque j’envisageais, dans chacun des chapitres IV, V, VI, VII, VIII, IX et X différents scénarios et évolutions possibles pour l’Europe ou l’Asie, la Chine ou la Russie, le monde arabe ou africain, j’analysais les choix auxquels sont confrontés les pays et régions considérés en termes qui leur sont particuliers et ne sont jamais réduisibles à « accepter ou refuser la mondialisation » comme on le propose dans le débat idéologique dominant. On peut donc ici, en conclusion, revenir sur ces examens régionaux, en faire ressortir davantage les contrastes. De toutes les périphéries intégrées - dans le sens donné à ce terme, c’est-àdire capables d’être compétitives dans les productions autres que primaires l’Asie orientale est celle qui par son dynamisme actif échappe à la crise générale. Région d’accumulation accélérée, largement centrée sur elle-même (au sens double que la Chine est centrée sur elle même et que les échanges internes de la région totalisent désormais 60 % du commerce extérieur des pays concernés), bien qu’ouverte l’Asie orientale est peu vulnérable aux pressions de l’extérieur.
347
L’Asie orientale n’a pas d’abord conquis des positions compétitives sur le marché mondial comme le proposent les partisans du néo-libéralisme avant de se « replier » sur le régionalisme. Elle s’est construite par le renforcement simultané des bases nationales, de l’interdépendance régionale et de l’ouverture extérieure contrôlée. Le poids de la Chine, renforcé par celui de sa diaspora qui constitue l’épine dorsale du développement économique en Thaïlande, Malaisie et Indonésie, sans parler des régions et villes chinoises de Taïwan, Hong Kong et Singapour, rend plausible la perspective d’une Asie orientale organisée autour de la Chine plutôt que du Japon. Cette puissance économique, plus fragile qu’on ne l’a souvent cru, n’a guère de choix autre que de jouer la carte de l’éclatement de la Chine de concert avec les EtatsUnis. L’Amérique latine, bien qu’ayant acquis un niveau d’industrialisation compétitive non moins respectable, reste prisonnière de la stagnation imposée par le leadership de Washington et son modèle néolibéral. Son intégration régionale a certes progressé - puisqu’elle fait désormais 22 % de son commerce extérieur avec elle-même - mais sur un fond de crise et de relative stagnation. Les termes de l’alternative pour ce continent sont donc les suivants : l’Amérique latine donnera-t-elle sa priorité à une conception de sa propre intégration aussi autonome que possible vis-à-vis des Etats-Unis, ou accepterat-elle - comme le Mexique l’a fait en entrant dans l’ALENA - une intégration continentale de l’Alaska à la Terre de feu, évidemment commandée par Washington ? Cette seconde option, dite de « l’intégration libérale » ouverte sur la libéralisation mondialisée - est certainement, à l’heure actuelle, celle des classes dirigeantes en place. De par son poids spécifique et sa location géographique l’Inde bénéficie d’une marge d’autonomie qui lui a permis jusqu’ici de poursuivre une crois-
348
sance non négligeable et de renforcer ses capacités compétitives. Elle reste cependant handicapée par ses structures sociales; et de ce fait il est difficile de donner aux différents scénarios de son avenir possible (révolution, éclatement, progrès soutenu...) des coefficients de probabilité fondés sur une appréciation réaliste des rapports de force opérant dans ce pays continent. L’effondrement des systèmes soviétiques en Europe de l’Est et dans l’ex-URSS a été trop brutal et est encore trop récent pour qu’on voit se dégager la ligne de force du repositionnement de cette région dans le système mondial. Soumise aux « thérapies de choc », celle-ci est entrée dans une phase d’involution et de grand chaos dont on peut imaginer toutes les sorties possibles, sans ici non plus savoir si les classes dirigeantes et les peuples concernés seront ou non capables de mobiliser à leur profit leur potentiel compétitif réel. L’opposition reste ranchée entre toutes ces situations - en dépit de leur diversité - et celles qui caractérisent les périphéries marginalisées : l’Afrique, les mondes arabe et islamique, demeurés dans le champ de la division du travail dépassé ailleurs. Exportateurs pauvres de produits agricoles ou miniers ou riches bénéficiaires de la rente pétrolière, ces pays restent tous incapables jusqu’ici de définir des stratégies d’insertion dans le système mondial qui leur soient propres. C’est pourquoi ici c’est le Nord qui impose ses initiatives, à travers les accords d’association que l’Union Européenne impose à l’Afrique (accords de Lomé) ou les initiatives de Bruxelles en direction de la « Méditerranée » comme à travers le projet américain de « construction d’un Moyen Orient intégré autour d’Israël ». Le retard historique de ces régions, qui n’ont pas acquis de compétitivité réelle sur le marché mondial, explique aussi l’absence de base pour des initiatives de construction régionale à l’instar de celles en progrès en Asie et en Amérique latine. Simultanément j’ai développé la thèse que l’absence de conflits sur les terrains réels de l’économie (les
349
options concernant la stratégie à long terme d’insertion dans le système mondial) et de la politique (les options concernant la gestion des systèmes nationaux) entrainait ici les transferts du conflit au plan superstructurel des options illusoires qui sont à la base des fondamentalismes religieux ou ethniques. Au delà donc des possibilités fort diverses qui s’ouvrent, ou se ferment, pour ces régions différentes, on peut identifier les termes de l’alternative à partir des conceptions de la « régionalisation » qui les commandent. Régionalisation conçue comme la forme adéquate d’une déconnexion - c’est-à-dire d’une maîtrise de l’ouverture - adaptée aux évolutions produites par le succès des périphéries « intégrées » ? Ou régionalisation conçue comme un niveau intermédiaire dans la perspective libérale de la mondialisation ? Les termes de l’option rejoignent ceux d’un autre choix de principe : régionalisations autour de centres déterminants (Etats-Unis - Amérique latine, Union Européenne Europe de l’Est - Afrique - Monde arabe, Japon -Asie du Sud-est) ou régionalisations indépendantes de ceux-ci ? Je renvoie ici le lecteur à l’analyse que j’ai proposée des options concernant les différentes formes de régionalisations possibles (cf Regionalization in the Third World). Une ligne médiane entre ces deux positions extrêmes conduirait à imaginer un monde reconstruit sur la base d’une quinzaine de régions organisées autour de pouvoirs hégémoniques ou tout au moins déterminants locaux (comme par exemple l’Afrique australe derrière l’Afrique du Sud, le Moyen Orient derrière Israël ou le tandem Israël-Egypte, l’Asie centrale derrière la Russie ou la Turquie, ou l’Iran, le Cône sud de l’Amérique derrière le Brésil, l’Europe de l’Est derrière l’Allemagne, l’Asie du Sud-est derrière la Chine) eux mêmes en rapports étroits avec les centres du Nord. Cette ligne médiane, qui paraît avoir la plus forte probabilité de commander l’évolution à moyen terme, peut à son tour
350
s’inscrire dans un système global caractérisé par l’accentuation de la compétition intra Nord. Elle présente aussi l’avantage de renforcer les chances de cristallisation de nouveaux centres, qui est l’objectif final des projets nationaux à l’œuvre (comme en Chine ou à un degré moindre en Inde et en Amérique latine) ou pourraient l’être (comme en Russie, ou, avec des handicaps plus sérieux, dans le monde arabe et africain). Les pronostics les plus réalistes d’apparence concernant l’avenir visible s’inscrivent dans cette logique. Dans l’hypothèse où la crise actuelle du capitalisme serait dépassée sans effondrement majeur, on peut imaginer sans difficulté une nouvelle étape de l’expansion capitaliste mondiale fondée précisément sur l’accélération de l’accumulation dans les périphéries intégrées ou dans certaines d’entre elles. Celle-ci commanderait à son tour une expansion des échanges entre les centres anciens et ces périphéries. On retournerait donc à un modèle du type de celui qui se déployait au XIXe siècle caractérisé par l’expansion horizontale (géographique) du système et une croissance du commerce mondial marquée, en général plus forte que celle du PIB dans les parties prenantes du système global. On fera observer que ce modèle faisait contraste avec celui qui a dominé au XXe siècle, marqué par des ruptures de « l’interdépendance mondialisée » (la déconnexion des systèmes socialistes, le renforcement des contrôles des relations extérieures dans les pays du tiersmonde engagés dans le projet national bourgeois de Bandoung) et partant par une sorte de repliement partiel des centres sur eux mêmes, une expansion verticale intensifiée dans ces régions et une expansion des échanges NordNord au détriment des échanges Nord-Sud. Il resterait à saisir évidemment si la nouvelle expansion horizontale autoriserait la cristallisation de nouveaux centres, comme ce fut le cas au XIXe siècle, et donc une sorte de « rattrapage dans le système », ou si les monopoles dont
351
bénéficient les anciens centres en place ne conduiraient pas à une polarisation nouvelle dont j’ai dessiné les lignes au chapitre IV. Il resterait également à savoir si l’expansion accélérée dans les nouvelles périphéries intégrées sera suffisante pour y absorber l’armée de réserve ou si, n’en étant pas capable, elle produira des mouvements sociaux qui remettent en question les logiques exclusives de l’accumulation capitaliste. Cette intervention des peuples dans l’histoire qui les concerne ne doit évidemment jamais être négligée. Elle concerne également d’une manière peu discutable non seulement les périphéries intégrées en question ici, mais également les peuples des centres plus avancés que d’autres sur certains terrains de l’idéologie et de la culture anti-systémiques - et ceux des périphéries désespérément enfermés dans une marginalisation criminelle.
7 - La longue transition du capitalisme au socialisme Pour définir une stratégie de lutte populaire on doit partir de l’analyse des contradictions du capitalisme et des formes qu’elles revêtent dans la phase particulière qui est la notre. Cette stratégie est donc par nature avant tout un combat contre l’aliénation économique, le gaspillage des ressources et la polarisation mondiale. En déployant ces luttes aux différents niveaux, locaux, nationaux, régionaux et mondiaux, il est nécessaire de s’assurer de la cohérence des actions, ce qu’on a parfois résumé dans la phrase « pensez mondialement, agir localement » (« think global, act local »). Chercher à concilier le réalisme - l’efficacité immédiate de l’action - et la perspective à long terme (les objectifs de libération dérivés de l’analyse des contradictions essentielles du capitalisme) implique qu’on se libère de l’opposition formaliste, trop largement abstraite, entre « réforme » (par définition dans le système, notamment dans sa dimension mondiale) et « révolution » (ou sortie du système à la fois
352
donc du capitalisme et du système mondial tant que celui-ci reste fondé sur les principes du capitalisme). La poursuite de cette conciliation aide à mettre l’accent sur la recherche de ce qu’on pourrait qualifier de « réformes radicales » qui sans rompre intégralement avec les logiques du système dans toutes leurs dimensions, en transforment néanmoins la portée et préparent ainsi leur dépassement de l’intérieur du système. L’objet de cette étude n’était pas de définir des stratégies concrètes de libération, ce qui au demeurant n’aurait eu de sens que pour un pays singulier et dans un moment particulier de son évolution. Plus modestement il était de proposer un cadre de réflexion pour le débat sur ces stratégies. J’en tirerai donc seulement quelques conclusions de principe concernant quatre des défis majeurs auxquels les peuples sont confrontés : i)
Le défi du « marché » : il ne s’agit ni de rejeter par principe toute forme d’économie dite de marché pour lui substituer une planification générale, centralisée et bureaucratique (laquelle au demeurant n’avait aucun caractère socialiste), ni de soumettre la reproduction sociale aux contraintes du marché (comme le propose l’idéologie dominante et les politiques mises en œuvre en son nom). Il s’agit de préciser les objectifs et les moyens (juridiques, administratifs, organisationnels, sociaux et politiques) permettant d’encadrer le marché et de le mettre au service d’une reproduction sociale assurant le progrès social (le plein emploi, la plus grande égalité possible etc.). Dans ce cadre l’association de formes diverses de la propriété - privée et publique, d’Etat et de coopératives etc. -s’imposera certainement encore longtemps.
ii) Le défi de « l’économie-monde » : il s’agit de sortir du faux débat - accepter l’insertion dans le système mondial et tenter seulement d’améliorer sa propre position dans la hiérarchie qu’il organise; ou en sortir définitive-
353
ment - pour lui substituer une discussion des contraintes réelles incontournables que la mondialisation imposerait aujourd’hui à des politiques autonomes de développement social national et populaire. Autrement dit il s’agit d’utiliser les marges qui permettent d’inverser le rapport intérieur / extérieur, de refuser l’ajustement unilatéral aux contraintes extérieures pour obliger le système mondial à s’ajuster, lui, aux exigences de notre propre développement. Ce que j’appelle déconnexion définit précisément l’un des champs d’action majeurs de mise en œuvre des réformes radicales nécessaires. iii) Le défi de la « démocratie » : il ne s’agit ni de voir dans les formes de la démocratie bourgeoise (dite libérale) contemporaine le terme de l’histoire, ni de lui substituer la pratique du populisme. Yves Bénot observe, à juste titre, que la séparation entre la catégorie des droits juridiques de celle des droits dits sociaux doit être rejetée. Refondus dans l'unité qui est la leur, ils expriment ensemble le « droit de vivre » dont la société doit assurer la permanence (« les hommes ne naissent pas seulement libres et égaux, ils le demeurent ») par des droits spécifiés à l'instruction, au travail, à la santé, à la retraite etc. Ainsi seulement peut-on assurer la non contradiction entre le principe de liberté et celui d'égalité, l'opposition entre eux étant précisément à la fois le fondement de l'idéologie bourgeoise et celui de la version populiste et stalinienne des « droits sociaux ». Dans la gestion actuelle de la crise le capital se propose d'abolir pratiquement ces droits au nom de l'individualisme, tout en gardant les apparences de la démocratie formelle. On doit lui opposer une conception progressiste des droits qui précisément définissent les règles d'encadrement du marché. iv) Le défi du « pluralisme national et culturel » : il ne s’agit ni de faire d’une communauté homogène ou prétendue telle (la nation, ou l’ethnie, ou la
354
communauté religieuse) le cadre exclusif nécessaire de l’exercice du pouvoir, ni de nier que le pluralisme dans ces domaines exige du pouvoir démocratique le respect des spécificités et différences. Organiser la coexistence et l’interaction des communautés les plus diversement définies dans le cadre du plus grand espace politique possible doit être l’objectif des stratégies de libération. Comme on peut le voir l’ampleur des marges d’autonomie que les forces populaires peuvent et doivent mobiliser à leur bénéfice et celle des réformes radicales qui peuvent être mises en œuvre dans leur cadre, dépendent des conditions concrètes tant locales (le degré d’isolement possible des groupes compradore, courroies de transmission des logiques réactionnaires dominantes mondialement) que régionales (succès dans la reconstruction de fronts du Sud en conflit avec les logiques de la mondialisation) et mondiales (succès dans l’isolement de la puissance hégémonique - les Etats-Unis - et de ses alliés majeurs). Il appartient aux luttes populaires d’élargir progressivement l’ampleur de ces marges. La mise en œuvre de stratégies d’action politique prenant au sérieux les quatre ensembles de défis formulés ici conduit directement à ré-ouvrir le débat sur la transition du capitalisme au socialisme. Sur ces questions le marxisme de Marx ne connaissait que l’expérience de la Commune de Paris, dont il a effectivement tiré des leçons essentielles. Par la suite, le marxisme de la Ile Internationale a développé une vision évolutionniste linéaire de l’expansion mondiale du capitalisme capable tendanciellement au moins d’homogénéiser les conditions d’exploitation du travail et par là même de préparer une révolution mondiale. La théorie léninienne des maillons faibles à partir desquels s’ouvre l’époque des révolutions socialistes
355
amorçait la critique de cette vision. Les contraintes de l’histoire (le retard dans l’expansion de la révolution hors de Russie) allaient progressivement imposer une théorie de la construction du socialisme dans les pays libérés du joug capitaliste dans le cadre de ce qui devenait la forme « marxiste-léniniste » du marxisme historique. Le maoïsme s’est inscrit dans cette perspective qu’il a renforcée par une thèse de la révolution dans les conditions du capitalisme périphérique (la révolution ininterrompue par étapes) et par une critique de la théorie et pratique soviétiques de la construction du socialisme assimilées à juste titre à un projet du « capitalisme sans capitalistes ». La théorie générale de la transition du capitalisme au socialisme qui s’est dégagée de l’expérience historique du XXe siècle reposait donc sur deux piliers fondamentaux : i)
La vision d’un contraste absolu entre les sociétés capitalistes et les sociétés socialistes, et partant le rejet absolu et total de l’idée que des éléments de la nouvelle société puissent se développer au sein même de la société capitaliste.
ii) La conception qui s’en suivait que la transition au socialisme à l’échelle mondiale prendrait la forme d’un conflit entre le « camp des pays socialistes » et celui des pays demeurés provisoirement capitalistes, quand bien même ce conflit aurait-il été inscrit dans le cadre de la coexistence compétition pacifique. L’effondrement des systèmes soviétiques d’une part, l’abandon du projet maoïste de construction socialiste en Chine et la substitution à celui d’un projet de développement capitaliste national d’autre part interpellent les dogmes du marxisme léninisme concernant la transition et le caractère prétendu irréversible de la construction socialiste.
356
En contrepoint de ces théories invalidées par l’histoire je proposerai quatre thèses complémentaires à partir desquelles le débat concernant la transition au socialisme à l’échelle mondiale pourrait être ouvert à nouveau. i)
Le capitalisme n’est pas un système viable à long terme. Il est basé sur trois fondements fragiles et dangereux : a)l’aliénation du travail qui vide les aspirations démocratiques et humanistes de leur potentiel d’épanouissement : b)la polarisation qu’il entraîne dans son expansion mondiale qui condamne la majorité des peuples du monde à ne pas pouvoir bénéficier des niveaux de vie qu’il offre à la minorité : c)le calcul économique à court terme qui ruine tout espoir de prise en considération sérieuse des exigences de l’écologie et de la survie du globe dans le cadre des logiques de l’accumulation. Aussi l’accumulation permanente et la croissance exponentielle qu’elle entraine conduisent l’humanité à la mort certaine. Le dépassement du capitalisme est nécessaire. D’ailleurs il est préparé par l’extraordinaire bond en avant des moyens d’action de l’humanité que l’accumulation aura permise (et celui-ci apparaîtra alors comme une parenthèse dans l’histoire) et par le mûrissement éthique et culturel qui l’aura accompagné.
ii) Le capitalisme a déjà mondialisé la civilisation, bien que d’une manière inégale et inacceptable. Le socialisme qui devra lui succéder ne sera une civilisation supérieure que s’il est lui aussi mondial, et corrige dans cette dimension les inégalités propres à sa forme capitaliste. La construction du socialisme à l’échelle mondiale devra donc nécessairement s’inscrire dans une vision longue de la transition.
357
iii) Le socialisme, puisqu’il renverse les trois fondements sur lesquels repose l’expansion capitaliste est véritablement une civilisation nouvelle; il ne peut pas être réduit à une espèce de « capitalisme sans capitalistes », analogue au capitalisme par ses concepts essentiels relatifs à la technologie, à l’organisation du travail et de la vie, qui se contenterait seulement de corriger les « injustices sociales », notamment par la substitution de formes de propriété collective à la propriété privée. Sa construction est donc un processus historique long. Proclamer cette construction achevée en quelques années comme cela a été le cas en URSS et en Chine n’a pas de sens. iv) On savait que le capitalisme avait pris naissance et s’était développé pendant longtemps au sein du féodalisme avant d’en faire éclater la coque et de s’en débarrasser. Le développement du socialisme ne doit-il pas lui aussi emprunter une voie analogue par certains aspects ? Dans cette hypothèse la longue transition serait caractérisée par le conflit interne à toutes les sociétés du monde, entre les forces et logiques reproduisant les rapports sociaux capitalistes et les forces et aspirations fondées sur des logiques antisystémiques, anticapitalistes, préparant l’avenir socialiste du monde.
Bibliographie 1) Références concernant les auteurs critiques dans ce chapitre : Francis Fukuyama, The End of history, The National Interest, summer 1989, Washington, pp 3-18. Samuel P. Huntington, The clash of civilization ? Foreign Affairs, summer 1993, Washington, pp 22-49. 2) Quelques uns des aspects importants des problèmes soulevés dans cette étude de synthèse ont été développés ailleurs avec davantage de détail.
358
– Sur la théorie de la culture et les aires culturelles : L’Eurocentrisme, Economica, 1988, chap. I. – Sur la démocratie et les conflits régionaux : L’Empire du chaos, L’Harmattan, 1991. Chap. IV, Le défi démocratique chap. V, Les conflits régionaux, apaisement ou intensité redoublée ? – Sur la dimension nationale et ethnique : L’Ethnie à l’assaut des Nations, L’Harmattan, 1994. – Sur les perceptions et politiques stratégiques des Etats-Unis. Samir Amin et all, Les enjeux stratégiques en Méditerranée, L’Harmattan, 1992. Première partie : la géopolitique de la région... pp 11-112. – Sur le défi de l’environnement : Can Environment Problems be subject to Economic calculations ? World Development vol XX, N° 4, pp 523-530, 1992, Washington. – Sur le bilan de l’après-guerre pour le tiers-monde, les performances de ses diverses régions, les caractères de la nouvelle mondialisation et les options en matière de régionalisation : S. Amin, La Faillite du Développement en Afrique et dans le Tiersmonde, L’Harmattan 1989. S. Amin et all, Mondialisation et Accumulation, L’Harmattan 1989; principalement pages 17, 38 à 42, 345 à 353, 355, 357 à 365. S. Amin, Itinéraire intellectuel, Regards sur le demi-siècle 1945-1990, L’Harmattan 1993, principalement pages 125-128. S. Amin, L’Empire du chaos, L’Harmattan 1991; pages 17-26, 33-50, 5460. S. Amin, La Gestion Capitaliste de la crise, L’Harmattan 1995, pages 116118.
359
S. Amin, Regionalisation in the Third World, in response to the polarisation in the global system; WIDER-UNU, Helsinki, à paraître. – Sur la question de la transition du capitalisme au socialisme -La problématique nouvelle : Révolution ou Décadence (rappelée dans Classe et Nation. Ed. Minuit, 1979, La thèse de la phase nationale, populaire et démocratique; le monde polycentrique : –La Faillite du Développement, op cité, pp 252-66, 289-302, 367-372. –Mondialisation et Accumulation, op cité, pp 42-43, 353-55. – .... Itinéraire intellectuel, op cité, pp 152-156, 180-182. – ............................L’Empire du chaos, op cité, pp 73-82. également : Le défi des périphéries à la gauche européenne, Alternatives Sud, Louvain-L’Harmattan, vol I n° 3, 1994, pp 81-112.
360
Conclusion Retour sur la question de la transition socialiste J’ouvrirai ce débat concernant la transition du capitalisme au socialisme par une affirmation d’une évidence qui frise l’extrême banalité : les conceptions qu’on développera concernant cette transition dépendront de celles qu’on a concernant la nature du capitalisme et celle du socialisme. Ceci dit on se rendra compte par ce qui suit que l’accord a toujours été loin d’exister concernant ce qui définit l’essentiel dans le capitalisme comme dans son antithèse, le socialisme. Et je ne parle ici bien entendu que des divergences au sein des gauches historiques se revendiquant du socialisme, et même au sein du seul camp du marxisme historique. Du coup évidemment les conceptions concernant les stratégies de dépassement du capitalisme - celles des social-démocraties de l’Ouest, du bolchévisme et du maoïsme, des fractions radicales du mouvement populaire anti-impérialiste dans le tiers-monde pour ne citer que les courants qui sont peut-être encore, en tout cas ont été, des forces historiques importantes - se sont fortement démarquées les unes des autres. A cette première constatation j’ajouterai une seconde observation d’une égale banale évidence : l’histoire n’a pas démontré la validité de ces différentes thèses concernant la transition, elle les a plutôt toutes infirmées comme l’illustrent l’érosion du Welfare State, l’effondrement des systèmes soviétiques, l’abandon du maoïsme en Chine, la recompradorisation du tiersmonde. De surcroit l’histoire avance toujours, le capitalisme évolue et se transforme. Du coup il n’est pas dit à priori que les définitions concernant le capitalisme ne doivent pas elles mêmes être revues pour tenir compte de ses
361
transformations qualitatives significatives éventuelles, comme par exemple pourrait l’être la nouvelle « mondialisation ».
1 - Mode de production capitaliste, capitalisme mondial réellement existant, les trois contradictions fondamentales du système En me situant aujourd’hui je dirai qu’à mon sens le système capitaliste est défini et caractérisé par trois contradictions fondamentales, qui sont essentielles en ce sens que le système est incapable de seulement penser leur dépassement. Nous verrons ensuite dans quelles (s) mesure (s) les différents courants historiques du marxisme et du socialisme ont partagé les conceptions proposées ici. Cela préparera le terrain pour comprendre, évaluer et discuter les conceptions du socialisme et de la transition à celui-ci que ces différents courants historiques ont développé en théorie et en pratique. Dans leur formulation condensée ces trois caractères fondamentaux sont les suivants : 1) Un rapport de production essentiel (le rapport capitaliste) qui définit un statut particulier de l’aliénation du travailleur et un statut des lois économiques qui est spécifique au capitalisme. 2) Une polarisation à l’échelle mondiale sans pareille dans l’histoire. 3) Une incapacité de mettre un terme à la destruction des ressources naturelles à une échelle qui menace l’avenir de l’humanité. L’aliénation économiste : La première de ces caractéristiques est celle dans laquelle tous les marxistes, à quelque courant qu’ils appartiennent, se retrouvent à l’aise puisqu’elle
362
constitue la définition même du mode de production capitaliste. Mais en dépit de ce dénominateur commun de principe dès lors qu’on précise ce que sont les rapports de production en question, la valeur et la loi de la valeur, les rapports entre le conflit des classes et les lois économiques, les rapports qu’entretient cette base économique avec la superstructure idéologique etc. on prend la mesure de l’ampleur des divergences au sein même du marxisme, à fortiori si l’on considère l’ensemble des gauches anticapitalistes. J’illustrerai l’observation que je viens de faire en rappelant, à titre d’exemple, les formulations essentielles qui me sont propres dans les domaines en question : i)
Le rapport de production capitaliste ne prend sa forme achevée qu’à partir de la « révolution industrielle » lorsque la propriété capitaliste qui exploite le travail salarié est devenue celle de moyens de production eux mêmes produit du travail (les usines) et s’est largement dissociée des formes antérieures de la propriété qui commandent l’accès aux moyens naturels de production (la terre). La période qui précède ce saut qualitatif dans le développement des forces productives (qu’on peut situer autour de 1800) peut être lue a posteriori comme celle de la transition (qualifiée de mercantiliste) au capitalisme.
ii) Ce rapport de production capitaliste achevé constitue le cadre nécessaire dans lequel se déploie la valeur et la loi de la valeur. La société paraît alors s’organiser dans une série de marchés emboîtés qui constituent un marché généralisé intégré tridimensionnel (marché des produits, marché du travail, marché des capitaux). iii) Les marchés en question décrits ici paraissent « fonctionner tout seuls » par eux mêmes. La dynamique qu’ils animent paraît alors obéir à des lois
363
indépendantes de la volonté humaine, qui opèrent donc dans la société comme les lois de la nature opèrent dans celle-ci. Ces « lois économiques » deviennent des forces objectives. Cette qualité nouvelle - dans ce sens qu’il n’y a de lois économiques objectives qui commandent la reproduction sociale qu’à partir du moment où le capitalisme prend sa forme achevée définit l’aliénation économiste propre au monde moderne (et que j’oppose à l’aliénation métaphysique qui commande le fonctionnement des sociétés de classes -tributaires - qui lui sont antérieures). Je formule cette particularité en disant que la loi de la valeur ne commande pas seulement la reproduction du système économique du capitalisme, mais y commande tous les aspects de la vie sociale. iv) L’aliénation du travailleur trouve sa place dans ce cadre, comme expression de l’exigence de fonctionnement de l’aliénation économiste opérant dans le domaine de la régulation du « marché du travail ». Le vendeur de force de travail doit lui aussi vivre son existence comme soumise à des lois objectives qui lui échappent. v) Les rapports entre la base économique, la gestion politique de la société et les formes idéologiques par lesquelles les forces sociales s’expriment trouvent également leur place dans ce cadre. Le capitalisme est un système social qui sépare l’organisation de la vie politique de celle de l’économie, laquelle fonctionne par elle même d’une manière autonome. Cette séparation est également une innovation dans l’histoire, le système (tributaire) antérieur étant défini par la fusion des instances et la soumission de l’économique au politique. J’ai formulé ce renversement en disant que dans le mode tributaire « le pouvoir commande la richesse » tandis qu’à l’inverse dans le mode capitaliste « la richesse commande le pouvoir ». A ce renversement correspond la substitution de l’aliénation
364
économiste (et celle du travail) à l’aliénation métaphysique (la dominance des concepts permettant la reproduction du pouvoir). La séparation des instances économique et politique est également la condition de la formation des systèmes politiques modernes, entre autre de la démocratie bourgeoise. Ce bref exposé à lui seul montrera facilement l’étendue des divergences concernant pourtant cette question essentielle - qu’est-ce que le capitalisme ? Tandis que les concepts que je propose mettent l’accent sur la rupture qualitative qui met en contraste le capitalisme et les systèmes antérieurs, il existe une vision tout à fait opposée qui part de définitions générales des instances communes à toutes les sociétés (la base économique, les rapports de production, l’Etat, les classes et l’instance politique, la superstructure idéologique) et analysent alors le fonctionnement de l’articulation de ces instances de la même manière d’une société à l’autre (par exemple la base économique commande de la même manière toute l’histoire, elle est toujours opérée par des lois objectives, la superstructure est toujours le lieu où se reflètent les exigences de la reproduction de la base etc.). Cette vision tend donc également à atténuer l’importance que les concepts d’aliénation économiste (et du travail) occupent dans mon exposé. N’étant pas de tempérament à accepter l’idée qu’une papauté chargée de délivrer les certificats de marxisme authentique soit d’une utilité quelconque (j’y vois au contraire un danger), je ne discuterai pas ces différentes thèses sur le terrain de la marxologie. J’observerai donc seulement le fait, que je tenterai plus loin d’expliquer : que des conceptions qui sont passablement différentes de celles de mon exposé bref en cinq points ont été et restent largement dominantes dans les gauches historiques anticapitalistes non seulement dans les courants dominants du marxisme historique de la Ille Internationale (le
365
courant soviétique sans aucun doute, mais non pas celui que le maoïsme a représenté, ou voulu représenter, en partie tout au moins), mais a fortiori dans la social-démocratie occidentale et dans l’aile radicale du populisme antiimpérialiste des périphéries, c’est-à-dire dans les deux autres forces principales « anti-systémiques », en partie ou par leurs objectifs proclamés tout au moins. Or les conceptions qu’on a concernant le capitalisme définissent largement celles qu’on se fera de ce que peut être -ou doit être - la société sans classes, supérieure, qu’on propose comme objectif des luttes. Elles exercent à leur tour des influences décisives sur les stratégies de la transition qu’on va développer pour parvenir au socialisme proposé, si tel est le nom qu’on donne à l’objectif des luttes. On verra donc plus loin que ce que j’appellerai la réduction du socialisme à un concept vulgaire de capitalisme sans capitalistes est l’expression de la vision de l’objectif que je critique ici. On verra également que toutes les stratégies de la transition proposées par l’histoire réelle (le « graduellisme » de la social-démocratie depuis Bernstein, la révolution mondiale de la social-démocratie révolutionnaire et plus tard du trotskysme, la construction du socialisme de la Ille Internationale, la révolution ininterrompue par étapes du maoïsme, le socialisme de marché des autogestionnaires marxistes, anarchistes, socialistes et autres, du titisme, de la Chine post maoïste, les « voies non capitalistes » proposées naguère au tiers-monde) partagent, au-delà de leurs divergences profondes, quelques éléments d’un dénominateur commun qu’on ne peut pas découvrir sans aller aux sources des conceptions concernant le capitalisme et le socialisme. La polarisation mondiale : Si j’aborde maintenant la seconde caractéristique du capitalisme on verra qu’elle est l’objet de désaccords encore plus marqués. Jamais dans l’histoire de
366
l’humanité les écarts dans le développement des forces productives, c’est-àdire dans la productivité du travail social, n’avaient été aussi gigantesques qu’ils sont devenus dans le capitalisme. Et si en 1800 les écarts de ce qu’on pourrait mesurer en termes de produit matériel par tête dépassaient rarement le rapport de 1 à 2 pour la plupart des sociétés sorties des étapes premières du développement, ce rapport est aujourd’hui de 1 à 50 ou plus. De surcroit tandis que la tendance dominante à long terme dans les temps anciens était au « rattrapage » (ainsi l’Europe, encore barbare vers l’an 1 000, rattrape-t-elle son retard par rapport à l’Asie entre cette date et 1500), elle est au contraire à l’aggravation permanente depuis que domine le capitalisme. Paradoxe apparent puisque le discours idéologique dominant met l’accent sur la « mondialisation » que la modernisation a inaugurée et sur le potentiel d’accélération du progrès que celle-ci offrirait aux sociétés attardées. Face à un fait majeur de cette taille la pensée sociale reste étonnamment peu convaincante. Dans ses courants dominants elle maintient deux discours principaux parallèles parfaitement contradictoires, sans que cela ne paraisse la gêner. D’un côté elle continue à dire que la mondialisation capitaliste offre à tous les chances du développement (c’est là le contenu essentiel du discours de l’économie conventionnelle). D’un autre côté elle doit expliquer ce fait tout de même curieux que ces chances n’ont jamais été réellement exploitées (puisque l’écart est toujours grandissant). Elle recourt alors à un discours d’où le raisonnement économique est totalement absent, l’argument portant sur les caractères prétendus spécifiques propres aux différentes cultures, religions voire ethnies (qu’on appelait races avant que le terme n’ait été abandonné après que furent commis en son nom les excès que l’on connaît). Les courants de pensée anticapitalistes auraient pu, a contrario, capitaliser à leur bénéfice le fait scandaleux de la polarisation mondiale grandissante qui
367
accompagne l’expansion capitaliste. Pour le faire ils auraient dû précisément porter leur attention sur la relation entre polarisation et capitalisme et proposer une théorie de cette relation. Ils ne l’ont en général pas fait. Ou bien ils ont cru le faire, mais d’une manière et avec des arguments qui me paraissent fort discutables. La pensée sociale, comme la science, restera toujours inachevée, fort heureusement; et le matérialisme historique n’échappe pas à cette règle. Face à la question très générale des lois de l’évolution sociale le matérialisme historique a donc inspiré des thèses divergentes, les unes mettant l’accent sur les lois générales qui seraient valides pour toutes les sociétés, les autres - au contraire - sur les spécificités particulières qui imposeraient des parcours différents. La raison qui rend possible ces divergences est que la théorie de l’articulation des différentes instances reste largement à faire : tandis que, à mon avis, le marxisme a produit une théorie cohérente et holiste du mode de production capitaliste, il n’a pas produit des analyses aussi convaincantes dans le domaine de la théorie du pouvoir et de la culture. Aussi les uns ont-ils pu articuler le fonctionnement des instances de manière à ce que celui-ci produise une histoire universelle (celle des « cinq stades » universels - communisme primitif, esclavage, féodalité, capitalisme, socialisme - en est certainement une formulation caricaturale), les autres de manière à expliquer les retards, blocages et impasses éventuels (comme la théorie du mode de production asiatique), tout en demeurant fidèles à ce qu’ils pensaient - les uns et les autres - constituer le noyau essentiel de la méthode marxiste. J’ai proposé de mon côté un dépassement du conflit de ces deux écoles eurocentriques par une théorisation de l’évolution formulée dans les termes des trois stades, communautaire, tributaire et capitaliste.
368
On ne devrait donc pas s’étonner de voir des divergences aussi considérables apparaître lorsqu’on aborde la même question - c’est-à-dire un problème qui implique l’articulation des instances - dans un champ plus restreint comme celui défini par la polarisation à l’époque moderne. Ici la tendance dominante a toujours, à mon avis, sous-estimé pour le moins qu’on puisse dire l’importance du phénomène. Pourquoi donc ? Pour y répondre il faut remonter à la Philosophie des Lumières, à la constitution de l’idéologie du rationalisme moderne (bourgeois) et à celle du mouvement ouvrier et socialiste, marxisme inclus. Cette histoire est celle de l’expression puissante d’un optimiste certain, qui doit conduire au triomphe de la raison, donc du progrès, c’est-à-dire au gommage progressif des retards éventuels des uns par rapport aux autres - le contraire donc de la polarisation. La pensée bourgeoise en est restée là, comme je l’ai rappelé plus haut. Son économisme trouve son expression naïve dans les « théories économiques du développement » qui supposent que si les choix « corrects » sont faits dans ce domaine, le reste, c’est-à-dire la politique et la culture, s’y ajuste naturellement (ou peut s’y ajuster). Mais Marx partage aussi cet optimisme, avec le socialisme de son temps. N’affirme-t-il pas que la loi de la valeur sortie de la boîte de Pandore devient une force irrésistible qui brise toutes les résistances construites par le passé : ni les nations, ni les Etats, ni les idéologies et la politique, ni même les religions ne pourront résister à ses effets simultanément dévastateurs (elle supprime la paysannerie et l’artisanat, réduit toutes les classes populaires au statut de vendeur de force de travail etc.) et progressistes (libération des forces productives et de l’individu). Le développement inégal, la polarisation, l’écart grandissant ne sont donc que des accidents passagers; la tendance dominante s’imposera tôt ou tard dans l’expansion mondiale du capitalisme et créera à
369
l’échelle mondiale une seule société intégrée, fondée sur la seule contradiction sociale qui oppose bourgeois à prolétaires. Ainsi le capitalisme aura-t-il préparé son propre dépassement par la révolution socialiste mondiale. Entre temps donc, l’histoire du capitalisme aura été celle de la soumission de toutes les instances de la vie sociale aux exigences unilatérales du déploiement de son économie. Ne reconnaît-on pas là le discours tenu aujourd’hui par les néolibéraux en défense du marché ? Si le lecteur de Marx trouvera certainement l’image dessinée ici caricaturale, elle n’en est pas moins à mon avis celle qui s’est imposée dans le marxisme historique, de la IIe et de la IIIe Internationales. Des correctifs ont été apportés, pour tenir compte du fait têtu - la polarisation croissante - mais sans remettre en cause la théorie fondamentale selon laquelle les lois de l’accumulation doivent finir par la supprimer. Le plus important de ces grands correctifs a été apporté par Lénine, systématisant une théorie de l’impérialisme attribuant la polarisation aux transformations récentes du capitalisme passé à l’ère des monopoles à partir de 1880 environ. La remise en cause de ce dogme et la substitution à celui-ci de l’hypothèse contraire (et si la polarisation était le produit de l’expansion du capitalisme et non de la résistance à celle-ci ?) est un phénomène tout à fait récent. Cette hypothèse a constitué le fil conducteur de toutes mes recherches depuis leur origine dans les années 50, elle a été aussi celles des écoles dites de la dépendance en Amérique latine et de l’économie-monde. Les apports des uns et des autres, les dénominateurs communs et les divergences ont été, je crois, l’objet de suffisamment d’attention pour qu’on n’y revienne pas ici. Mais l’important pour notre sujet est de reconnaître qu’il ne s’agit là que de positions théoriques d’intellectuels, qui ne se sont pas emparés de mouvements sociaux historiques en leur fournissant une ossature idéologique, même si des bribes de ces
370
développements ont pu être repris ici et là, dans les discours politiques de la critique de gauche du soviétisme ou dans ceux de la libération nationale radicale. Ce rapport constitue un autre sujet, qui sort du champ du nôtre défini ici. Parce que, comme on va le voir, la réponse implicite à la question de la polarisation a joué un rôle décisif dans les conceptions relatives à la révolution et à la construction socialistes, il me paraît nécessaire, si l’on veut substituer à ces conceptions qui ont fait leur temps (ou fait faillite) une conception différente et nouvelle de la transition au socialisme, de préciser l’essentiel de la théorie de la polarisation capitaliste proposée. Je le ferai en me limitant ici aux propositions auxquelles je suis parvenu aujourd’hui dans ces domaines, sans revenir sur l’histoire de leur constitution ni sur celle de leurs rapports aux théories des écoles signalées plus haut. Je dis donc que la polarisation est produite par le fonctionnement même de la loi de la valeur opérant à l’échelle mondiale. Cette affirmation implique la reconnaissance de la dominance de l’économique, propre au capitalisme, par opposition aux systèmes qui lui sont antérieurs. C’est cette dominance que j’ai exprimée plus haut dans l’identification du premier caractère fondamental définissant le capitalisme. Le marxisme historique ayant accepté également cette thèse de la dominance de l’économique en a néanmoins tiré une conclusion démentie par l’histoire - que la tendance homogénéisante devait l’emporter sur celles qui produisent la polarisation - ou, lorsqu’il acceptait le fait, l’expliquait par une hypothèse contraire à celle de la dominance de l’économique - par la « résistance » victorieuse du politique ou du culturel. Où est donc l’erreur du marxisme historique ? J’ai expliqué cette erreur par la confusion que le marxisme historique a fait entre la loi de la valeur dans sa forme générale et abstraite, qui définit le capi-
371
talisme comme mode de production, et la loi de la valeur mondialisée, qui en est la forme concrète associée à l’expansion mondiale du capitalisme (que j’appelle le capitalisme réellement existant). La première implique l’intégration du marché dans toutes ses dimensions, la seconde le caractère tronqué du marché mondial qui exclut la force de travail. Tandis que le marxisme historique assimilait de ce fait l’expansion mondiale du capitalisme à l’expansion du mode de production capitaliste à l’échelle mondiale, la conceptualisation que je propose permet de les distinguer. On démontre alors facilement qu’à lui seul le fonctionnement de la loi de la valeur mondialisée produit la polarisation, c’est-à-dire rend compte du fait : la polarisation est immanente au capitalisme depuis que celui-ci a pris sa forme achevée (et n’est pas le produit des transformations définissant un stade récent de celui-ci - l’impérialisme), la polarisation s’explique par les lois de l’accumulation capitaliste et non pas la résistance à celle-ci du fait politique ou culturel. La loi de la valeur mondialisée permet même d’aller plus loin dans l’explication des faits, car elle rend compte parfaitement des caractères spécifiques des périphéries capitalistes : désintégration du système productif (par opposition à son caractère autocentré dans les centres), dépendance, reproduction de formes de production anciennes, déformées et soumises aux logiques de l’accumulation (par opposition à la destruction de ces formes qui prédomine au centre), inadéquation du système politique « moderne » - celui de l’Etat de droit, de la démocratie bourgeoise etc. - dans les périphéries etc. Elle rend compte donc des résistances politiques et culturelles, lesquelles loin d’être des vestiges du passé, sont au contraire des réactions au défi de la polarisation capitaliste. Cependant, comme je l’ai dit, les idées développées ici ne sont que des idées. Le mouvement anticapitaliste réel les ignore. Du coup la « transition » a été abordée d’une manière où se sont côtoyés sans discontinuer les théories
372
fausses et les ajustements pragmatiques. La théorie avançait que le capitalisme préparait par sa propre expansion les conditions d’une révolution socialiste mondiale. Ou tout au moins, si l’on conçoit que tous les peuples du monde ne se sont pas encore élevés au niveau de ceux des régions les plus avancées au moment où l’heure de la révolution a sonné, celle-ci se déploie dans l’ensemble des centres développés et entraine derrière elle les périphéries, auxquelles d’ailleurs elle fait rattraper le retard à une cadence qui peut être désormais accélérée comparativement à ce qu’elle était à l’époque capitaliste. Autrement dit la révolution des centres constitue l’optimal de second rang (second best), l’optimal absolu étant la révolution mondiale. Ne reconnaît-on pas ici l’attente de Lénine d’une révolution européenne qui vienne à son secours après qu’elle ait été amorcée dans son maillon faible (la Russie) ? Il est évident également que la vision social-démocrate des progrès dont l’accumulation dans les centres doit finalement conduire au socialisme entrainant alors aussi les périphéries - n’est pas différente dans l’essentiel de sa perception du mouvement. Cependant dans les faits la mise en cause de l’ordre capitaliste ne s’est pas faite selon le schéma théorique : la révolution a commencé dans les périphéries et y est restée enfermée. On s’est alors ajusté, accommodé à la réalité, et on a produit une légitimation théorique de cet ajustement par la théorie de la construction du socialisme. Amorcée sous le label de Léninisme, cette théorie a été développée par Mao dans la formulation de la théorie de la révolution ininterrompue par étapes (dont la parenté à celle de la théorie permanente de Trotsky et même en partie de Lénine est visible). On a même cru pouvoir étendre le champ de validité de cette forme de transition au socialisme en y intégrant les sociétés issues de la révolution de libération nationale, sous les labels de « voie non capitaliste » et autres.
373
La destruction des richesses naturelles : Le troisième caractère fondamental spécifique du capitalisme concerne la destruction de la base naturelle de la production sociale sur laquelle est fondé le calcul économique qui caractérise ce système. Je suis fortement tenté à ce sujet de citer Marx (Le Capital, Livre I, chapitre XV, dernière phrase de la section X Ed. Sociales, Paris, traduction de Joseph Roy revue par Marx, p. 182) : « La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu’en épuisant en même temps les deux sources d’où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur ». Une phrase magnifique - écrite en 1863 ! - qui devrait convaincre les environnementalistes de notre époque qu’ils n’ont fait que redécouvrir Marx, qu’ils n’avaient jamais lu. Je me félicite certainement que ce qui aurait dû passer pour une évidence depuis longtemps ait été enfin redécouvert à notre époque. Marx avait donc compris que la croissance prodigieuse de la production matérielle, sans pareille dans l’histoire avant le capitalisme, était en partie fondée sur la destruction des richesses naturelles, hypothéquant par là même l’avenir de la société. L’économiste marxiste japonais Shigeto Tsuru avait proposé il y a une trentaine d’années de corriger le calcul du PIB et de sa croissance en tenant compte de ce facteur négatif. Il n’a pas été entendu, évidemment. J’ai moi même repris cette discussion en proposant une critique fondamentale du calcul économique, qui est basé sur un concept du temps trop court pour mériter d’être qualifié de « rationnel ». En fait la rationalité économique du capitalisme (du « marché » comme on dit aujourd’hui) est irrationnelle du point de vue des intérêts à long terme de l’humanité et cela indépendamment de son contenu social et donc des effets sociaux de l’exploitation du
374
travail et de l’exclusion de franges entières de la population de toute participation à la production en question. Mais ici aussi il ne s’agit là que d’idées qui n’ont guère de prise sur la conscience sociale organisée. Car il est vrai que le mouvement ouvrier en Occident, « le pouvoir des Soviets » à l’Est, les mouvements de libération nationale dans le Sud ont tous partagé le même culte du « développement des forces productives » pratiquement sans limites. Et aujourd’hui encore les mouvements Verts qui contribuent à faire enfin prendre la mesure de cette dimension destructrice de la « croissance » refusent toujours d’établir la relation entre cette conséquence et sa cause, sans doute parce que la remise en cause du concept même de la rationalité du marché capitaliste fait peur. Réintroduire la prise en compte des richesses naturelles de la Planète contraint à concevoir un autre système de calcul économique que celui fondé sur le temps court de la rentabilité du capital, ce qui implique à son tour une autre civilisation politique et culturelle. Il nous faut savoir calculer sur la base d’un temps long, comme l’ont fait les peuples paysans investissant leurs efforts dans la conservation et même l’amélioration de leur capital foncier pour le bénéfice des générations à venir. Car il est bien évident que si la décision avait été commandée dès l’origine par des experts de la Banque Mondiale, l’humanité ne serait pas encore sortie de ses cavernes. Ni l’amélioration des sols, ni la construction de chemins de fer transcontinentaux, ni aucune des grandes initiatives qui ont transformé le sort de l’humanité n’aurait trouvé de justification dans les termes du « cash flow » enseigné pompeusement à Harvard comme le dernier cri de la science sociale ! Cependant, très évidemment l’humanité n’a jamais agi que dans les limites de ses connaissances scientifiques. On ne prétendra donc pas que les options qui ont été à la base de ses initiatives aient toujours été efficaces du point de vue de
375
la préservation du milieu et des conditions naturelles du développement futur. Loin de là. Il reste que le capitalisme a donné la priorité absolue à cet élément nouveau et systématique - le calcul à court terme - qui est le gage certain de la destruction des conditions en question. Et quelques autres contradictions... Le monde contemporain ne se définit certainement pas exclusivement par les trois caractères retenus ici, qui ne sont à mon avis que les nouveautés essentielles introduites par le capitalisme, par opposition aux systèmes antérieurs. Mais le monde contemporain hérite aussi de caractères qu’il partage avec ses prédécesseurs. Et certains de ces caractères ne sont pas moins décisifs pour comprendre notre époque, la critiquer et concevoir son dépassement. Je pense ici tout particulièrement au patriarcat. Il me paraît en effet évident qu’on ne peut plus conduire à notre époque une réflexion sérieuse quelconque sur la question du pouvoir par exemple sans prendre la mesure de ce que le patriarcat implique dans ce domaine. On verra plus loin que le mouvement social - s’il reste prisonnier de limites trop étroites qui lui interdisent de faire la critique radicale de tous les caractères essentiels de notre société - ne peut imaginer « l’utopie créatrice » nécessaire, qu’on l’appelle socialisme ou autrement. Je montrerai que, parce qu’elles sont demeuré enfermées dans ces limites, les forces anti-systémiques c’est-à-dire anticapitalistes - qui ont effectivement dominé la scène jusqu’à présent et imposé des transformations importantes au monde et au capitalisme lui même, n’ont guère conçu le socialisme autrement que comme l’analogue d’une espèce de « capitalisme sans capitalistes ».
376
2 - L’histoire n’a pas de fin; le capitalisme doit être dépassé, à défaut... La poursuite indéfinie de l’expansion capitaliste est donc impensable. La croissance exponentielle qui en traduit la férocité du mouvement est, comme l’a rappelé Wallerstein, celle du cancer qui se conclut nécessairement par la mort. Entre temps la poursuite de cette expansion produit nécessairement un ensauvagement grandissant de l’humanité puisqu’elle est fondée sur l’aliénation économiciste et celle du travail d’une part, la polarisation mondiale d’autre part. Le premier de ces caractères prive la société de la maîtrise minimale sur son avenir puisque, la responsabilité des décisions est remise aux « automatismes du marché ». Cela détruit à coup sûr le sens de la vie sociale. On ne s’étonnera donc pas ni que la démocratie politique soit alors vidée de toute efficacité, et que sa crise en fragilise les chances de déploiement et d’enrichissement, ni que les peuples répondent parfois à cette démission de la volonté par un repli sur les mystères de l’inconnaissable, que proposent les fondamentalismes religieux, les sectes et les formes diverses de l’affirmation dite « communautaire », c’est-à-dire « instinctuelle ». Le second des caractères de cette expression s’exprime dans la construction d’un monde qui ressemblera de plus en plus à un apartheid généralisé. Plus que jamais donc l’alternative est, comme en son temps Rosa Luxemburg l’avait exprimé, « socialisme ou barbarie ». Et si le capitalisme devait, faute d’être dépassé, constituer la fin de l’histoire, cela se ferait tout simplement en mettant fin à l’aventure humaine par une sorte de suicide collectif ou d’autodestruction inconsciente.
377
Vu avec un recul que nous n’avons pas encore, et dans l’hypothèse optimiste où la raison humaine l’arrête dans son déploiement autodestructeur, le capitalisme apparaîtra comme une parenthèse dans l’histoire, le moment de « l’accumulation », une double accumulation : celle des moyens matériels (connaissances scientifiques, efficacités technologiques, moyens de production et d’action) permettant un degré de maîtrise des forces naturelles sans commune mesure avec celle acquise antérieurement, capable d’assurer un « niveau de vie » acceptable, celle des moyens intellectuels et moraux (les connaissances et les moyens de communication, la libération de l’individu, la démocratie) nécessaire pour aller au delà du capitalisme. Bien entendu la maîtrise des forces naturelles en question reste un concept relatif, permettant d’aller au delà de ce qu’on appelle la pauvreté, la maladie etc. mais toujours limité. On n’abolira ni la mort, ni l’angoisse, ni l’incertitude des décisions et le risque. C’est pourquoi à mon avis l’être humain restera doté de facettes multiples, animal social certes, être individuel, mais animal métaphysique également. Bien entendu également les moyens intellectuels et moraux associés au progrès matériel - et en partie au moins permis par celui-ci -resteront ambivalents : les connaissances pourront toujours servir au mal autant qu’au bien et l’exercice de la liberté par les individus et les sociétés un devoir autant qu’un droit. Mais soyons optimistes et disons que la raison l’emportera. Alors se pose la question, politique, concrète, de la définition de l’alternative (le socialisme) et des stratégies efficaces pour parvenir au but.
378
3 - La transition pacifique au socialisme, la révolution mondiale, la construction du socialisme dans les pays libérés : trois conceptions du socialisme et de la transition à remettre en question. Marx ne s’était pas préoccupé de définir positivement les caractères de la société sans classes - le communisme. Son analyse ayant pour objet de dévoiler les caractères profonds du capitalisme, cachés derrière les apparences immédiates, on pouvait en déduire a contrario ceux de l’objectif si l’on voulait, mais sans plus. Il ne s’était pas davantage préoccupé de proposer une stratégie de transition et de construction du socialisme. Par principe en effet le communisme était dans son esprit le produit du mouvement du prolétariat, non une formule apportée de l’extérieur comme les socialistes utopiques le proposaient. L’attention devait se porter donc exclusivement sur les stratégies de lutte contre le capitalisme. Néanmoins l’histoire allait rapidement proposer une première réponse à la question du socialisme à travers l’expérience réelle et concrète de la Commune de Paris. Marx ne pouvait négliger cet épisode de l’histoire. Tout au contraire il y a immédiatement réfléchi, pour en tirer quelques conclusions remarquables, concernant entre autre le concept de l’Etat prolétarien, de sa dictature démocratique et de son dépérissement. Des leçons que Lénine reprendra à la veille de la Révolution russe, dans l'Etat et la Révolution, avant de se rendre compte qu’il n’était pas possible de mettre en application leurs conclusions. Les faits - la dure réalité - allaient en effet l’obliger à tordre le bâton dans le sens opposé. L’échec de la Commune de Paris devait en tout cas mettre le mouvement ouvrier européen, construit dans la IIe Internationale, sur d’autres rails. Au sein de celle-ci s’opposaient deux lignes, l’une - connue sous le nom de
379
« révisionnisme » bernsteinien - finirait par l’emporter dans la social-démocratie, l’autre - maintenant le thème de la révolution socialiste - allait s’éteindre dans la Ile Internationale pour renaître dans la Ille, mais dans des conditions historiques fort différentes de celles imaginées par les révolutionnaires d’avant 1914. On connaît suffisamment les propositions du révisionnisme de Bernstein pour n’avoir pas à y revenir ici. Ce qui me paraît aujourd’hui important de faire observer à ce sujet c’est que le concept de la société socialiste - l’objectif de l’évolution envisagée - était en fait celui d’un « capitalisme sans capitalistes ». Cette expression a d’ailleurs été utilisée pour la première fois par Engels pour qualifier l’ensemble du projet de la social-démocratie allemande. Aux antipodes des socialistes utopiques qui avaient fait preuve d’une imagination débordante, remettant tout en question dans la civilisation de notre époque le travail, la famille, les rapports entre les sexes, le pouvoir - les sociaux démocrates n’imaginaient rien de bien nouveau. On conserverait presque tout de l’ordre capitaliste depuis son culte des forces productives jusqu’aux moyens mis en œuvre pour en satisfaire l’appétit illimité - l’organisation et la discipline, la hiérarchie, la division du travail. On ferait même mieux, au sens de plus dans le même sens, en réduisant les gaspillages que la propriété privée implique (l’anarchie de la production). Le socialisme se contenterait presque simplement de substituer la propriété de l’Etat à celle des capitalistes. D’ailleurs les monopoles n’y préparaient-ils pas ? Il suffirait de le nationaliser pour faire le saut dans le socialisme. C’est l’ensemble de cette vision qu’il faut qualifier de « capitalisme sans capitalistes ». Or ce modèle n’allait pas être seulement celui des partisans de l’évolution progressive et douce vers le but, il commandait aussi la vision des révolutionnaires. Lénine lui même n’admirait-il pas la centralisation (bureaucratique) de
380
la gestion que les monopoles pratiquaient (comme la Poste en Allemagne !) ? Le modèle pourrait donc exister en deux versions : un « socialisme de marché » dans lequel les entreprises - toutes propriété de l’Etat, des collectivités ou de coopératives - continueraient à acheter et vendre plus ou moins librement les facteurs de la production (dont le travail) et leurs productions ou un « socialisme d’Etat » dans lequel ces entreprises - de la même manière toutes propriétés de l’Etat ou des coopératives -obéiraient aux injonctions d’un plan centralisé à l’extrême. La différence est importante, réelle, mais elle ne gomme pas le dénominateur commun. Revenant à la version évolutionniste il n’entre pas dans mon intention de dénigrer l’importance de ce que la social-démocratie a réalisé non seulement au bénéfice immédiat des classes populaires mais même dans la perspective plus longue du dépassement des strictes logiques du capitalisme. Le Welfare State, dont la formule allait s’imposer et pratiquement se généraliser à l’ensemble des centres capitalistes après la seconde guerre mondiale, n’est pas seulement un compromis historique capital / travail permettant, dans les conditions des pays en question et de la conjoncture de l’époque, l’acquisition de droits sociaux jusque-là inconnus dans la pratique capitaliste; il amorce aussi, de ce fait, la légitimation de logiques sociales autres que celles dérivées de la stricte rentabilité du capitalisme. Il reste que les avancées réalisées par la social-démocratie n’ont été ni le produit exclusif du développement de ses propres forces organisées (comme son appareil politique peut le proclamer), ni celui des conditions et des besoins objectifs de la reproduction du capital (comme une lecture très économique le suggère parfois), mais aussi, en partie au moins, le produit d’un équilibre des forces sociales qui penchait en faveur de la classe ouvrière comme il ne l’avait jamais été dans l’histoire du capitalisme grâce à la défaite du
381
fascisme et à la victoire de l’URSS, c’est-à-dire au fait que l’autre vision de la transition -celle de la voie révolutionnaire - s’imposait tout autant après la seconde guerre mondiale. Nous sommes donc amenés naturellement à considérer l’autre versant de la vision du socialisme et des stratégies pour y parvenir, préconisé par la voie révolutionnaire. Cette perspective avait survécu un temps au sein de la Ile Internationale, dans le cadre de courants minoritaires tolérés, mais toujours impuissants. Comment ne l’auraient-ils pas été puisque ce qu’ils proposaient, eux, différait si peu du « capitalisme sans capitalistes » des autres ? Pourquoi alors privilégier une voie brutale pour parvenir à cette même fin alors que tout indiquait qu’on pouvait y arriver doucement, progressivement ? J’ajoute - en rappelant ce que j’ai déjà dit -que la révolution mondiale en question devenait en fait celle des centres - de l’Europe « civilisée » (l’Allemagne, la France, l’Angleterre, l’Autriche Hongrie, les Pays -Bas et la Belgique, l’Italie...) entrainant les périphéries en retard - des colonies d’ailleurs. Minorisée dans le mouvement ouvrier européen, la conception révolutionnaire du passage au socialisme allait s’affirmer à la marge du continent, en Russie. Mais ici, dès 1905, apparaissent les ambiguïtés et plurivalences du mouvement anti-systémique : révolution pour une démocratie bourgeoise, révolution pour une réforme agraire radicale conduite par des paysans en rébellion, révolution pour une société socialiste ? Cette plurivalence, loin d’être un facteur d’affaiblissement du mouvement, constituait au contraire sa force. Même la vision du socialisme ici, fut-elle circonscrite à un milieu minoritaire, mi intelligentsiste - mi ouvrier, allait au delà de la médiocre perception dominante ailleurs - de l’ordre capitaliste amélioré par la propriété publique. Des accents de la vieille utopie merveilleuse se mêlaient ici aux écrits orthodoxes inspirés par la tradition ouvrière européenne (la tradition récente...
382
celle de la social-démocratie !). Au départ donc le projet n’est pas celui d’un socialisme d’Etat, forme du capitalisme sans capitalistes. Et ce projet devient soudain un possible historique en Octobre 1917. Mais il le devient sans savoir qu’il n’est pas « l’étincelle qui embrasera la plaine », ni la première explosion dans « le maillon faible de la chaîne » appelée à être suivie rapidement dans des pays plus avancés. Il ne sait pas à l’époque qu’il exprime une autre force anti-systémique, celle qui représente le refus des peuples de la périphérie du système de se soumettre aux exigences de la polarisation capitaliste. De la révolution mondiale on passe donc à la construction du socialisme dans un seul pays. Les faits y obligent. Ce qui peut être reproché à Staline n’est certainement pas d’avoir fait ce choix. L’alternative n’existait pas. La théorie disait alors : révolution mondiale ou rien. Il ne restait plus aux Russes alors qu’à se suicider pour avoir cru à une révolution mondiale qui n’était pas à l’ordre du jour. Ce qui pourrait donc lui être reproché, c’est tout autre chose. D’abord d’être resté - ou revenu - dans l’horizon borné du réalisme social démocrate, ne concevant pas autre chose que ce capitalisme sans capitalistes. Les utopistes de 1917 seront donc écartés en faveur des réalistes que la IIe Internationale aurait reconnus comme siens dans d’autres circonstances. Cette évolution commandait toutes les autres : la tâche essentielle devenait celle de « rattraper », c’est à dire d’accélérer les rythmes de l’accumulation. On y soumet l’ensemble du projet socialiste, quitte à ce que celui-ci y perde l’essentiel de son sens. L’exploitation de la paysannerie encadrée dans des coopératives contrôlées par l’Etat sert ainsi à financer « l’accumulation primitive dite socialiste ». Cette rupture de l’alliance populaire ouvrière et paysanne qui avait permis le triomphe de la révolution ouvre la voie à la dictature despotique « au nom » du prolétariat, libère la bureaucratie de tout contrôle, ce qui
383
favorise l’option « autoritaire »).
en
faveur
du
socialisme
d’Etat
(la
planification
Le débat doit donc porter sur la nature et les raisons de ces choix. Pouvait-on faire autrement ? Aller « plus vite » vers le communisme démocratique, voire le dépérissement de l’Etat etc. ? Ou aller « moins vite » et prolonger les compromis avec le capitalisme comme au temps de la NEP ? Ou aller « différemment » c’est-à-dire plus vite par certains aspects et moins par d’autres. L’option en faveur de la construction du socialisme dans un seul pays n’avait jamais fait problème au communisme chinois. Celui-ci s’organisait dès le départ pour faire la révolution en Chine; il n’attendait pas que sa victoire fut confortée par la révolution des prolétaires du Japon et des Etats-Unis qui viendrait alors au secours du peuple chinois pour l’aider à surmonter son retard. Il n’a donc pas connu le temps des hésitations qui ont accompagné la révolution russe dans ses premières années. Au contraire le maoïsme proclamait d’emblée la nécessité et la possibilité de construire le socialisme dans un pays arriéré, par le moyen de la « révolution ininterrompue par étapes » conduisant des réformes radicales bourgeoises de nature (comme la réforme agraire) mais opérées sous « la direction du prolétariat » à la révolution socialiste devenue, ici comme en Russie, synonyme de l’étatisation de la propriété et de l’organisation des coopératives rurales. Et même si ces transformations ont été faites en Chine mieux - ou moins mal -qu’en URSS (et c’est mon avis), elles n’étaient pas de nature fondamentalement différente de celles qu’inspirait le projet de « capitalisme sans capitalistes ». C’est alors que le maoïsme - parvenu à la conclusion qu’en URSS on « construisait le capitalisme et non le socialisme » - s’est posé la question de
384
savoir si une voie différente de celle empruntée par l’URSS n’était pas nécessaire et possible. Le maoïsme a donc voulu « aller différemment », aller moins vite dans certains domaines, plus vite dans d’autres. Moins vite en rythmes d’accumulation pour ne pas briser l’alliance ouvrière-paysanne. Plus vite par d’autres aspects parce que cette exigence ouvrait la voie à la critique du dogme de la « neutralité des technologies », vital pour le succès du modèle du « capitalisme sans capitalistes ». On irait donc plus vite dans les domaines de l’idéologie communiste (c’est le sens du choix en faveur d’une « révolution culturelle ») et de l’organisation du pouvoir politique (ce que le maoïsme a promis mais n’a pas fait). Toujours est-il que le modèle soviétique de la construction du socialisme et les tentatives maoïstes d’en modeler différemment le parcours ont finalement échoué. Je ne reviendrai pas ici sur les causes et les étapes des processus d’érosion et l’effondrement du modèle soviétique, ni sur les raisons de l’abandon du projet maoïste à partir de 1980. L’essentiel aujourd’hui est d’en tirer la leçon majeure : l’histoire a démontré que la construction du socialisme en question n’était pas irréversible, que donc l’étatisme - ce que j’ai appelé un moment le mode de production soviétique - ou le capitalisme sans capitalistes, ne constituaient pas des modèles « stables », mais une transition chaotique et conflictuelle qui pouvait soit évoluer progressivement et lentement vers le socialisme (on reviendra plus loin sur les conditions nécessaires pour que cette évolution favorable puisse être poursuivie), soit aboutir au capitalisme pur et simple, avec capitalistes (ce qui est le cas pour l’ex-URSS et l’Europe de l’Est). Ces échecs ne sont pas les seuls. Les autres concepts de socialisme n’ont pas été mieux traités par l’histoire. Les imitations du modèle soviétique, plus ou
385
moins fidèles (comme au Viêt-Nam ou à Cuba) ou lointaines (comme dans les socialismes d’Afrique et d’Asie), ont été éliminées (sauf jusqu’à présent, en partie les deux premières citées) avant même que l’ordre ne soit renversé à Moscou. Mais le socialisme du Welfare State occidental qui, lui, paraissait ancré à tout jamais dans les consciences et la réalité sociales, est à son tour déstabilisé par l’effondrement du modèle soviétique. Le moment est à l’offensive néolibérale qui se propose, non sans quelques succès jusqu’ici, de ramener en arrière les pendules occidentales. Des échecs aussi graves et généraux interpellent certainement l’idée même de socialisme. S’agit-il d’une utopie au sens vulgaire du terme, qui ne sera jamais possible ? L’humanité est-elle donc condamnée à l’autodestruction par le capitalisme « fin de l’histoire » ? On reviendra sur cette question essentielle. Mais simultanément l’effondrement du soviétisme et l’abandon du maoïsme mettent un terme définitif à un autre aspect de la conception de la transition, qui s’imposait jusqu’alors. La transition était synonyme de la concurrence violemment conflictuelle ou pacifiée par la « coexistence pacifique » - de deux systèmes économiques, politiques et sociaux, incarnés dans deux blocs d’Etats, « deux camps » dira Jdanov dès 1948. Cette page est tournée; et se pose alors la question : qu’est-ce que la lutte entre le socialisme et le capitalisme dans notre monde d’aujourd’hui ?
4 - Retour à la question du socialisme Le socialisme n’a de sens que s’il propose une civilisation autre que celle produite par le capitalisme, c’est-à-dire s’il transgresse les grandes contradictions de notre monde contemporain identifiées plus haut. Dans une formulation condensée à l’extrême je dirai donc que le socialisme doit être fondé sur
386
une civilisation : 1) libérée de l’aliénation économiste et de celle du travail; 2) libérée du patriarcat; 3) maîtrisant son rapport à la nature; 4) développant la démocratie au delà des limites imposées par la séparation des domaines de la gestion économique et de la politique; 5) mondialisée sur une base et dans un cadre ne reproduisant plus la polarisation mais au contraire y mettant un terme. Si tel est l’objectif, j’en tirerai immédiatement une conclusion décisive à mon sens en ce qui concerne les stratégies de lutte pour le socialisme dans le monde actuel. Celles-ci doivent relever quatre des défis majeurs auxquels les peuples sont confrontés. J’ai fait référence à ces défis au chapitre XI de cet ouvrage. Des stratégies d’action efficaces prenant au sérieux ce qui vient d’être décrit comme constitutif des défis à relever impliquent qu’on les inscrive dans une perspective de civilisation qui soit une avancée qualitative transgressant les frontières du capitalisme. Je ne reviens pas sur cette dimension idéologique fondamentale du projet, parce que je crois qu’elle a été explicitée suffisamment plus haut, en proposant notre critique (marxiste je crois) du capitalisme et des tentatives historiques de le dépasser. J’insiste seulement sur l’unité d’analyse nécessaire, capable de fondre dans un ensemble cohérent les exigences de la démocratie, de la liquidation de la séparation politique / économique, d’une maîtrise de la décision intégrant les considérations du long terme, de la mondialisation. Il s’agit d’une idéologie et d’une culture à vocation universelle. Le lecteur retrouvera ici peut -être ce qu’il sait déjà de mon hostilité au « culturalisme », entendant par là justement le rejet de la perspective universelle au bénéfice
387
d’une prétendue diversité forte au point d’impliquer des « parcours » différents pour le développement des communautés diverses. J’ai rejeté tous ces appels fondés sur l’ethnicisme ou la diversité religieuse, à la mode aujourd’hui, profondément réactionnaires à mon avis. Car ils représentent un recul par rapport à ce que le capitalisme a déjà produit en direction de l’universel. La mondialisation qu’il a imposé n’est d’ailleurs pas seulement celle des technologies, des échanges commerciaux, des interdépendances géostratégiques que les militaires connaissent bien. Elle est aussi mondialisation culturelle. C’est la raison pour laquelle j’ai analysé la culture dominante à l’échelle mondiale comme celle du capitalisme et non de « l’Occident » (historiquement européen et chrétien). Si cette mondialisation capitaliste présente certainement des aspects négatifs forts - par la polarisation dans laquelle elle se déploie - elle présente aussi des aspects positifs (la libération des individus et de la société) qui, même s’ils sont encore embryonnaires, inachevés, déformés par les exigences de la logique dominante du capital, n’en sont pas moins déjà présents. Les effets négatifs de la polarisation eux mêmes ne concernent pas seulement l’économique (le contraste peuples riches / peuples pauvres), ils trouvent nécessairement leur complément dans le contraste démocratie politique / impossible démocratisation, dans celui qui associe l’arrogance de l’Occident à la confusion névrotique de la culture capitaliste et de son expression apparente (« européenne et chrétienne »). Ces aspects négatifs de la mondialisation capitaliste ne peuvent pas être supprimés par un retour aux temps anciens et à la diversité des expressions idéologiques dans les sociétés qui composaient l’univers tributaire, pour reprendre mon langage. Ils ne peuvent être supprimés qu’en allant de l’avant dans la construction d’une culture socialiste universelle.
388
Il est inutile de préciser, je crois, que l’universalité du projet n’est pas synonyme de rabotage au dénominateur commun. Cette tendance est celle de l’universalisme capitaliste - le coca-cola pour tous, les haines ethniques et religieuses pour l’accompagner. Elle n’est pas celle de l’universalisme socialiste construit nécessairement par et à partir de la contribution de tous les peuples, faisant de leur diversité un élément d’enrichissement du projet commun. Revenant donc aux tentatives historiques de dépasser le capitalisme, relu du point de vue de leur vision de la culture universelle, je ne conclus pas que leurs contributions aient été insignifiantes ou ridicules. Loin de là. La société construite par la social-démocratie en Occident n’est certes pas la plus odieuse qu’on connaisse. Au contraire c’est la plus avancée, la plus sympathique, la plus humaine, même si ce jugement est celui qu’on peut avoir en la regardant du dedans, et en oubliant que vue de l’extérieur - de la périphérie - elle est souvent largement restée associée à des attitudes impérialistes pures et simples. Et si les sociétés du « socialisme réellement existant » n’ont pas manqué de présenter des caractères odieux par certains de leurs aspects, elles sont aussi celles qui, vues de l’extérieur, ont été les soutiens les plus généreux du combat antifasciste et de la libération nationale des peuples de la périphérie. Les réalisations à porter à leur actif ne sont pas négligeables, et ne se limitent pas au « progrès économique matériel ». La Yougoslavie titiste avait transgressé les hostilités de ses composantes ethniques, les Chinois vivent infiniment mieux que les Indiens, le capitalisme sauvage en Russie est non seulement plus dur par les conditions matérielles qu’il fait aux majorités populaires mais il n’est pas même une garantie de démocratie, les régimes néocompradore du tiers-monde sont pires par bien des aspects que les régimes populistes qui les ont précédés. On pourrait multiplier les exemples à l’infini.
389
Ces faits démontrent que le projet de capitalisme sans capitalistes - version social-démocrate de socialisme de marché ou version étatiste - n’était pas un produit anodin et absurde. En fait il constituait le terme de l’idéologie bourgeoise dans ce qu’elle a produit de plus progressiste. Notre époque n’aime pas beaucoup la Révolution française en général, encore moins le jacobinisme qui a été son avancée la plus forte. La mode réactionnaire est aujourd’hui au culte des spécificités communautaires et à la haine de l’universalisme. Pourtant le jacobinisme représentait une avancée allant au delà des exigences simples de l’établissement du pouvoir de la bourgeoisie. Expression combinée des aspirations du peuple de l’époque - fussent-elles utopiques - et de la réflexion de l’avant-garde des Lumières, le jacobinisme avait inventé l’idée d’une République des citoyens (et non des seuls bourgeois qu’un suffrage censitaire, un Bonaparte ou un Monarque éclairé sans suffrage du tout satisfaisaient largement, comme l’histoire ultérieure allait le prouver en France et dans toute l’Europe du XIXe siècle) et avait même découvert que le libéralisme économique (le « marché » à la mode d’aujourd’hui) était l’ennemi de la démocratie. Le capitalisme sans capitalistes est une expression tardive de cette logique de dépassement du capitalisme imparfaite et fragile. Une expression qu’on aurait pu penser elle même dépassée par l’apport critique fondamental du marxisme. Elle impliquait par la force des choses une intervention puissante de l’Etat, organisateur de la rationalité à portée universelle. Une intervention qui, à son tour, n’est pas à la mode à notre époque de l’offensive réactionnaire anti-Etat tous azimuts. On a vite fait alors de confondre dans la même condamnation facile l’étatisme mercantiliste - Colbert jamais oublié en France - celui de Bismark - l’Etat prussien hégélien -celui de la Russie soviétique - héritière de l’autocratie des Tsars - celui de Mao - héritier de l’Empereur du Milieu etc. Mais par quoi propose-t-on de remplacer l’Etat des citoyens ? Par la Nation ethnique, la communauté religieuse en combinaison
390
avec le marché sans Etat. C’est-à-dire par la jungle pure et simple complétée par la haine mutuelle des communautés en question. Encore faut-il rappeler que cette proposition est elle même une utopie, mais celle-ci réactionnaire, justement parce qu’elle est anti-universaliste alors que le capitalisme qu’elle accepte, et prône même, impose la mondialisation. Si donc l’alternative à la mondialisation sauvage du capitalisme est la construction d’une mondialisation socialiste civilisée, le chemin pour y parvenir sera nécessairement long, puisqu’il s’agit de bâtir une civilisation nouvelle. Le reproche qu’on peut faire alors aux projets historiques de construction du socialisme analysés et critiqués ici c’est précisément d’avoir réduit la tâche à l’accomplissement de quelques réformes - si importantes fussent-elles -, principalement l’abolition de la propriété privée. La révolution russe, après avoir cherché sa voie pendant les années vingt, finit par s’engager dans la construction en question en mettant un terme à la NEP et en décidant la collectivisation en 1930. Six ans plus tard Staline proclame la construction du socialisme achevée. En 1949 l’armée populaire entre dans Pékin, en 1952 s’amorce la réforme agraire suivie immédiatement par la collectivisation et en 1957 on proclame ici aussi la construction socialiste achevée ! Je dis aujourd’hui qu’il aurait dû paraître évident qu’une civilisation nouvelle ne se construit pas en cinq ou dix ans. Dans la longue transition dont nous aborderons maintenant la discussion des stratégies d’étapes nécessaires vont s’imposer. On retrouvera alors à cette occasion quelques-uns des éléments des expériences du passé qui pourraient retrouver une place, éclairée par une perspective nouvelle. Certaines propositions de la social-démocratie conséquente, du socialisme de marché pourraient alors constituer des éléments de ces stratégies d’étape. A quelles conditions ? Discutons-en.
391
5 - Premières propositions pour une nouvelle conception de la transition Les considérations qui précèdent m’ont amené à une conclusion majeure que je formule ici de la manière directe suivante : la théorie selon laquelle le socialisme ne peut pas se développer au sein du capitalisme comme celui-ci l’avait fait au sein du féodalisme, avant d’en faire éclater la coquille et de s’en débarrasser, doit être relativisée. En conséquence de la même manière que les trois siècles du mercantilisme (1500-1800) auront représenté une longue transition du féodalisme au capitalisme, durant laquelle les deux systèmes ont coexisté conflictuellement, nous pourrions avoir affaire à une longue transition du capitalisme mondial au socialisme mondial, durant laquelle les deux logiques - celle qui commande l’accumulation du capital et celle qui procède de besoins sociaux incompatibles avec celle-ci - coexisteront conflictuellement. Cette vision, je le concède, n’était pas celle de Marx qui pensait que le capitalisme accomplirait d’abord, rapidement, sa mission historique - celle d’intégrer toutes les sociétés de la planète dans un système social réduisant progressivement toutes les contradictions à la seule et principale d’entre-elles, celle qui se manifeste dans le conflit bourgeois / prolétaires, sur la base d’un système économique relativement homogénéisé - puis, par là même, aurait préparé le passage de l’humanité dans son ensemble à la nouvelle société sans classes dans un temps historique relativement bref. En d’autres termes Marx pensait le capitalisme et le socialisme comme deux systèmes séparés par une muraille de Chine, celle qu’on peut qualifier de Révolution Socialiste; deux systèmes incompatibles, incapables de coexister, fut-ce conflictuellement, au sein d’une même société. Cette vision n’excluait pas, bien entendu, la coexistence conflictuelle pendant un certain temps de deux ensembles de sociétés,
392
les unes encore capitalistes, les autres déjà socialistes, à condition que ce temps soit relativement court puisque le socialisme achevé ne peut être que mondial. L’analyse du capitalisme réellement existant que j’ai proposée abat cette muraille de Chine. Elle met au contraire l’accent sur le conflit des logiques capitaliste et anticapitaliste - opérant effectivement au sein même du monde capitaliste réellement existant, qui n’est donc pas synonyme de mode de production capitaliste à l’échelle mondiale. Il ne l’est pas non plus au sens banal et courant qui fait la différence entre le concret et l’abstrait, le système réel et l’idéal-type, le premier étant toujours plus complexe que le second. L’absence de cette synonymie doit être comprise dans un sens plus fort dans deux dimensions. La première résulte du fait que le mode de production capitaliste « pur » ne peut pas exister réellement c’est-à-dire que le capitalisme ne fonctionne qu’à la condition que des forces anti-systémiques lui permettent de surmonter sa contradiction immanente. La seconde résulte du fait que le capitalisme mondial, parce qu’il est polarisant par l’effet de sa propre expansion, produit sans arrêt des forces anti-systémiques qui s’érigent contre la polarisation en question. Considérant la première dimension du conflit des logiques systémique / antisystémique, il y a déjà longtemps que j’étais parvenu, analysant la dynamique du mode de production capitaliste, à la conclusion que la reproduction élargie n’était possible que si les salaires réels augmentaient parallèlement à la productivité. Or la logique unilatérale de la suprématie du capital veut qu’il n’en soit pas ainsi, et le capitalisme est de ce fait menacé d’une stagnation permanente qui en ferait un système impossible. Cette contradiction absurde n’est surmontée que grâce soit à des événements extérieurs à sa logique économique (j’ai signalé à ce propos la concomitance entre chacune des
393
grandes phases de l’essor capitaliste avec ces événements : guerres de la Révolution et de l’Empire, unifications allemande et italienne, colonisations, révolutions technologiques successives etc.), soit justement à la logique anti-systémique de la lutte des classes par laquelle la classe ouvrière (mais aussi d’autres segments du monde des producteurs, comme les paysans) impose la croissance des rémunérations du travail. Culminant, à l’époque des monopoles et des systèmes productifs nationaux autocentrés (de 1920 à 1970), avec le compromis historique du Welfare State, cette dialectique qui associe logique de l’accumulation et logique sociale de la répartition du revenu est aujourd’hui en crise, du fait de la mondialisation qui a érodé le caractère autocentré des systèmes productifs nationaux et du fait de l’affaiblissement de la position des classes travailleuses dans l’équilibre politique général. Et l’accumulation capitaliste est alors elle aussi en crise. La seconde dimension du conflit des logiques est le produit nécessaire de cette première contradiction fondamentale. Dans son combat contre les logiques anti-systémiques développées par les classes exploitées, les capitalismes nationaux menacés s’évadent dans l’expansion externe, produisant alors la mondialisation polarisante. Dans cette expansion le capital dominant compense ce qu’il perd dans ses centres plus avancés par ce qu’il gagne en soumettant (et non en détruisant) les formes précapitalistes d’origine qu’il trouve sur son chemin et périphérise de la sorte les zones attardées qu’il soumet à sa logique. Cette expansion crée donc un monde non homogène. Le capitalisme mondial n’hérite pas d’une hétérogénéité d’origine, il la crée, ou la recrée sans cesse à son bénéfice. La loi de l’accumulation - celle que Marx formule dans les termes de la paupérisation - atténuée, voire supprimée, dans les centres avancés se retrouve pleinement réelle à l’échelle du système mondial. Mais à ce niveau - celui du capitalisme réellement existant - la loi de
394
l’accumulation n’opère plus dans le cadre du mode de production capitaliste « pur » mais dans celui de l’ensemble des formations centrales et périphériques qui le constituent. Cette polarisation - paupérisation n’est évidemment ni acceptable, ni acceptée par les peuples qui en sont les victimes. De même que la classe ouvrière au centre, par ses luttes, exprime sa tendance anti-systémique, de même les peuples des périphéries, par leurs luttes (« les libérations nationales » ou les révolutions socialistes), expriment leur tendance anti-systémique. Dans cette perspective théorique je propose de relire l’histoire du capitalisme comme celle de phases successives dans lesquelles tantôt la logique unilatérale du capitalisme l’emporte - et le système connait une expansion mondialisée - tantôt celle de la révolte anti-systémique des périphéries lui impose des replis. J’ai proposé de lire le XIXe siècle comme une longue phase du premier type, le XXe siècle - de 1917 à 1990 - comme du second. La question qu’il est alors légitime de se poser à ce stade de notre développement est la suivante : puisque le capitalisme a cette capacité extraordinaire de « s’ajuster » aux exigences de forces systématiques qui naissent de son propre développement, pourquoi le système ne durerait-il pas éternellement ? En prolongeant très loin cette dynamique de successions phases de croissance des revenus du travail parallèle à la productivité au centre puis arrêt de celle-ci phases de soumission des périphéries à la logique de l’expansion capitaliste mondiale puis rejet de celle-ci et recul de la polarisation, on finirait peut-être par voir le monde s’homogénéiser sur la base d’un capitalisme progressivement plus ou moins également développé. Marx aurait eu raison dans le long terme : la loi de l’accumulation homogénéise le monde. Si ma réponse à cette question est que le système ne peut pas répondre au défi de cette manière, c’est parce qu’il n’y a pas répondu de cette façon jusqu’ici. En effet la polarisation ne s’est pas graduellement atténuée sous
395
l’effet des forces anti-systémiques qui la refusent. Elle s’est aggravée. De la même manière même si les revenus du travail ont effectivement augmenté au rythme de la productivité dans les centres et sur le long terme, les effets de l’aliénation du travail ne se sont pas progressivement atténués mais, au contraire, ils ont pris une vigueur grandissante, comme en témoigne « la crise du travail » dans le monde contemporain. Autrement dit le système ne pourrait poursuivre sa marche indéfinie - indépendamment de savoir si celle-ci est possible ou non du fait de sa troisième contradiction (la destruction de la base naturelle) - que si au cours de ce déploiement historique ses trois contradictions principales s’atténuaient progressivement. Or elles s’aggravent toutes. Le système est donc fatalement condamné à être de plus en plus insupportable et explosif. Insupportable et explosif ne signifie pas qu’il sera dépassé par la réponse rationnelle - le socialisme - qui s’imposerait comme une force de la nature. Je reviendrai donc ici à ce que je proposais il y a une vingtaine d’années concernant la dynamique du dépassement des systèmes historiquement révolus. J’écrivais à ce sujet : révolution ou décadence ? J’entendais par révolution un processus historique (qui n’exclut pas les formes évolutionnistes radicales) dans lequel une conscience lucide des objectifs de la transformation est exprimée par les forces sociales qui conduisent le combat contre le passé révolu. J’en donnais pour exemple le passage des systèmes de l’Ancien Régime en Europe à la modernité capitaliste. Par contre, en l’absence d’une telle intervention de la conscience idéologique et de la volonté politique qui définissent un projet de société nouveau, la transformation n’avance qu’à tâtons, dans le brouillard, ce qui entraine le plus souvent des formes que j’ai qualifiées de décadence par référence à l’exemple du passage de l’Antiquité
396
au féodalisme européen, qui s’est frayé la voie sur les ruines de l’Empire romain décadent. On peut donc se poser ici la question légitime : le capitalisme sera-t-il dépassé par le moyen d’actions lucides proposant un autre projet de société (socialiste) ou par le hasard des résultats de combats partiels, motivés de mille manières différentes et spécifiques, qui ne seront pas nécessairement de ce fait complémentaires mais au contraire seront le plus souvent conflictuels ? La voie de la « décadence » n’est jamais à exclure en principe. Cependant dans le cas qui nous concerne, compte-tenu des capacités de destruction gigantesques à la disposition des systèmes modernes - sans aucune mesure avec celles connues dans le passé - cette voie risquerait fort de se solder par l’autodestruction, ce que j’appelle le suicide collectif. Il ne reste donc plus qu’à faire sa place à l’optimisme de la volonté, comme Gramsci le recommandait. Cela signifie combattre pour équiper le mouvement social de protestation et de refus de ce que le capitalisme réellement existant produit d’inacceptable d’une conscience lucide et de stratégies adéquates. Je n’aurai pas l’outrecuidance de proposer ici ce « plan d’action » (mondial forcément). Je me contenterai d’inviter au débat en proposant quelques réflexions premières concernant le sujet. Le moment de désarroi généralisé que nous traversons ne durera pas. L’absurdité du projet de gestion de la société mondiale comme on gère un supermarché est démontré par les faits : dans un temps record ce projet a produit un maximum de catastrophes et a enfermé les sociétés dans l’impasse de la stagnation et de régressions insupportables. L’arrogance du discours néolibéral a du plomb dans l’aile. Déjà dans nombre de pays de l’Est les ex partis communistes - pour ce qu’ils valent - ont été rappelés au pouvoir par les urnes;
397
en France la gigantesque protestation populaire de décembre 1995 - la première en Occident qui a osé rejeter avec lucidité tous les concepts fondamentaux du discours néolibéral - annonce un retournement possible des opinions dans l’ensemble de l’Europe; dans certains pays du tiers-monde (Brésil, Mexique, Corée, Philippines, Afrique du Sud) des mouvements antisystémiques populaires et démocratiques ont marqué des points et ont peutêtre même déjà le vent en poupe. Mais aussi, parallèlement, les sirènes de réponses illusoires et criminelles n’ont pas cessé d’attirer des pans entiers du mouvement populaire. Raidissements néoconservateurs et fascistes, dérapages dans le délire ethniciste, chauvinismes de repliements nationalistes étroits, réponses à l’illégitimité des pouvoirs en place par la dérive des fondamentalismes religieux sont aussi des réalités de notre temps. Nous allons vers des confrontations violentes droite / gauche. La gauche nouvelle peut gagner la bataille dans beaucoup de pays du Nord et du Sud, mais à la condition qu’elle se recristallise autour de stratégies adéquates, s’inscrivant avec le maximum de lucidité dans la vision d’un projet de société alternatif socialiste. J’examinerai dans ce qui suit les conditions de cette cristallisation dans diverses situations. Pour ce qui est de la périphérie en général, j’avance depuis quelques années la proposition d’une étape que j’ai qualifiée d’« alliance nationale populaire et démocratique ». Sans revenir sur les détails de la proposition j’en rappelle les quatre traits fondamentaux. Premièrement la redéfinition de politiques économiques et sociales anti-compradore, donc nationales au sens qu’elles reconnaissent la réalité du conflit entre leurs objectifs et les logiques dominantes de l’expansion capitaliste mondialisée. Deuxièmement l’identification des forces sociales qui ont en commun un intérêt à la mise en œuvre de ces politiques et simultanément des conflits d’intérêts qui opposent ces forces
398
sociales les unes aux autres (« les contradictions au sein du peuple »). Troisièmement la construction de formes d’organisation démocratiques qui permettent de régler ces conflits au sein du peuple et de mener le combat commun contre l’adversaire principal interne et externe. Quatrièmement le renforcement des fronts intérieurs par la poursuite d’un combat aux plans régionaux et au plan mondial susceptible de contraindre le système global à « s’ajuster » à ces exigences (le contraire donc de ce que le système propose, qui n’est autre que l’ajustement unilatéral aux exigences de la mondialisation capitaliste). Il existe à mon avis déjà plus que des embryons de formulations allant dans ce sens, qui dépassent déjà le débat intellectuel pour devenir des forces matérielles. Le Parti du Travail au Brésil, l’opposition au PRI au Mexique - opposition démocratique et mouvement néo-zapatiste -, les forces démocratiques de masse en action en Corée, aux Philippines et ailleurs, le bloc ANC-PCCOSATU en Afrique du Sud (en dépit du ralliement du gouvernement qui en est issu aux thèses du libéralisme prônées par les puissances dominantes mondialement et par le Parti Nationaliste dans le pays), ont déjà créé des situations où une marge réelle s’offre à l’action de gauches cohérentes et consistantes. J’ai proposé également d’analyser dans ce même esprit les perspectives de la nouvelle politique chinoise. Je mets ici l’accent sur les caractères positifs de l’option « nationale et populaire » post maoïste (les « trois positifs » : maîtrise des relations extérieures, redistribution sociale du revenu, complémentarités interprovinciales renforcées) mais simultanément sur ses faiblesses (le quatrième et grand « négatif » : l’absence d’un concept de démocratie, et l’héritage persistant de la conception de la IIIe Internationale définissant le Parti-Etat). Ces contradictions entrainent des possibilités d’évolution diver-
399
gentes, soit que se renforce le contenu national bourgeois du projet, dans la perspective d’un « rattrapage » faisant de la Chine une grande puissance capitaliste, soit que les stratégies de l’adversaire (Japon-Etats-Unis) l’emportent et désagrègent la Chine, soit que le projet s’installe avec succès dans ce qu’il appelle officiellement « le socialisme de marché ». Dans ce cas cette formule, bien que non définitive (dans la conception du socialisme que j’ai défendue ici), n’en constituerait pas moins une étape stratégique positive de la « longue transition ». La situation dans les pays du centre capitaliste présente des caractères spécifiques évidents, qui ne sont d’ailleurs pas identiques en Europe, en Amérique du Nord et au Japon. Un dénominateur largement commun est probablement le produit simultané de l’usure des partis historiques de la gauche (la social-démocratie et les partis communistes) et de l’explosion de formes nouvelles du mouvement social (dont le féminisme et l’écologisme sont probablement les plus importantes, sans oublier les mouvements de communautés -ethniques et autres - et les renaissances religieuses). Certains de ces mouvements se sont cristallisés en partis politiques parlementaires, comme les Verts dans certains pays européens, sans pour autant que je sois convaincu qu’ils y représentent des forces nouvelles sur l’échiquier (j’ai signalé plus haut la timidité des Verts qui refusent de condamner en principe le capitalisme). D’autres mouvements pourraient soutenir les offensives de la droite. Mais certains - le féminisme en premier lieu - ont une vocation progressiste indiscutable parce qu’ils s’attaquent par principe à l’un des caractères les plus réactionnaires de notre société. Des débats documentés ont confronté les points de vue favorables aux « mouvements » et ceux attachés aux formes d’organisation plus politiques et plus englobantes. On a aussi rappelé, à juste titre à mon avis, que
400
1968 a représenté une date tournant dans l’histoire des sociétés capitalistes avancées, en donnant à la protestation contre l’aliénation du travail une dimension d’une profondeur qu’elle n’a jamais perdue depuis. L’essentiel à mon avis du point de vue qui nous occupe ici est de savoir si l’ensemble des forces qui représentent la gauche dans la société civile occidentale - partis, syndicats, mouvements - sera ou non capable de produire un projet sociétaire nouveau indispensable à la définition de stratégies d’étape adéquates. Pour l’Europe l’axe central autour duquel se cristalliseront les évolutions dans ce sens positif requis, ou échoueront à le faire, est constitué par le projet européen. Les gauches européennes demeureront-elles pour l’essentiel d’entre-elles prisonnières de la vision de droite de « l’Europemarché commun » ou parviendront-elles à produire un projet politique et social intégré et progressiste ? La situation est évidemment différente aux Etats-Unis où la bipolarisation imposée par l’affrontement électoral Républicains-Démocrates ne paraît toujours pas en voie d’être dépassée, et au Japon où le monopartisme conservateur de fait, malgré les signes de décadence qui l’affectent, ne paraît pas avoir ouvert la voie à une alternative quelconque. Dans tous les cas, dans les hypothèses les plus favorables où les gauches nouvelles se cristalliseraient comme on le suggère ici, la question demeure entière : les actions qu’ils pourraient promouvoir avec succès imposeront-elles seulement au capitalisme des ajustements qui le transformeront certes, mais préserveront son essence - et donc ne parviendront pas à renverser le mouvement de ses contradictions qui s’aggravent - ou si justement elles renverseront la tendance. A ce point on pourra dire que le système commence à basculer en direction du socialisme, qu’une coupure qualitative aura eu lieu dans la longue transition au socialisme.
401