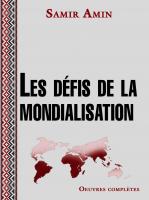Les Empires Coloniaux Dans Le Processus De La Mondialisation 2706816104, 9782706816109
680 35 10MB
English Pages [389] Year 2002
Polecaj historie
Table of contents :
Introduction
1. Signification et origine des empires coloniaux
2. Grandes et petites provinces impériales
3. Organisation et structures politiques : complexité, diversité et ressemblances
4. Structures de l’économie
5. Les populations : les indigènes
6. Les Européens et les autres
7. Fonctionnement social : dualisme et pluralisme
8. Phénomènes d’acculturation
9. Le gouvernement indigène
10. Nationalismes et réformes
11. La montée des périls
Conclusion
Bibliographie
Table des matières
Citation preview
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
CHEZ LE MÊME ÉDITEUR Commandant Lamy. Un officier français aux colonies, Robert Maestri, 2000. Que la France était belle au temps des colonies. Anthologie de chansons coloniales et exotiques françaises, Alain Ruscio, « Actualité de l’histoire », 2001.
DU MÊME AUTEUR La France et l'Islam depuis 1789, PUF, 1991. Les Bureaux arabes dans l'Algérie de la conquête, Denoël, 1993. L ’Afrique à l ’ombre des épées, les territoires militaires en Afrique française (1830-1930), service historique de l’Armée de Terre, 1993-1995,2 vol. Le monde arabe et la sécurité de la France (1958-1991), PUF, 1995. A paraître: De la conquête à la guerre d'Algérie, Économica, 2002. Ouvrages en collaboration : L'Écriture de l ’Histoire, (avec Bernard Valette), Ellipses/Marketing, 1980. Histoire militaire de la France, t. 4. De 1940 à nos jours, sous la direction d ’André Martel, PUF, 1994. L ’exploitation du renseignement, (avec Georges-Henri Soutou et Olivier Forcade), Économica, 2001.
Jacques Frémeaux
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
M aîsonneuve et Larose
Publié avec le concours du C entre N ational du L ivre
Catalogue Electre-Bibliographie Frémeaux Jacques Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation. - Paris : Maisonneuve et Larose, 2002 ISBN 2-7068-1610-4 R ameau : Europe : colonies : conditions économiques : 1900-1945 France : colonies : histoire mondialisation (économie politique) D ewey 909.1 : Histoire du monde. Civilisation. Histoire universelle 325.3 : Migrations internationales et colonisation. Colonisation Public concerné : Public motivé. Niveau universitaire G Maisonneuve et Larose 15, rue Victor-Cousin - 75005 Paris [email protected]
« Des masses d ’hommes inégalement répartis entre continents, entre pays, qui, jadis, s ’ignoraient : maintenant, les voilà porte à porte. Hier, des vases clos; aujourd’hui, des vases communicants. Hier, de tout petits champs de bataille isolés, où le Blanc triomphait sans peine, un contre cent. Aujourd’hui - faut-il dire les secteurs d’un immense front de bataille, que le Blanc lui-même équipe, matérielle ment et moralement, contre le Blanc ? Ou bien le creuset d ’où sortira, plus tard, beaucoup plus tard, par la science ou par la misère, l’unité fraternelle du genre humain ? »*
1. «L’histoire économique et la vie. Les leçons d’une exposition», Annales d ’histoire économique et sociale, janvier 1932, pp. 1-10.
5
Introduction
Les introductions ont souvent quelque chose de prétentieux, car elles pourraient parfois laisser croire que l’auteur, à l’exemple de Rousseau, «form e une entreprise qui n’eut jamais d ’exemple, et dont l’exécution n’aura point d’imitateur », alors que lui-même et ses collègues savent bien qu’il existe déjà d’excellents travaux sur le même sujet, et que, par nature, tout travail scientifique est voué à être dépassé. Le simple bon sens incite aussi à éviter de décevoir d ’autant plus qu’on aura trop promis. Par suite, l’auteur de ces lignes se contente ici d ’indiquer un état d ’esprit qui, par nature, est partiellement subjectif, mais qui sous-tend un ensemble d ’hypo thèses de recherche sans lesquelles le livre présenté ici n ’aurait point été écrit. Les lignes de Lucien Febvre citées en exergue, et écrites en 1932, à l’oc casion de la fermeture de l’Exposition coloniale de Paris, correspondent au sens de notre démarche. D’aucuns ont cru pouvoir affirmer que l’étude de l’histoire de la colonisation était terminée avec la clôture de la période colo niale1. Selon eux, à partir du moment où tout peuple décolonisé récupérerait son histoire singulière avec la maîtrise de son destin, la mission de l’histo rien consiste à contribuer à bâtir ou rebâtir celle-ci, en se spécialisant dans la langue, la culture, le recueil de témoignages émanant du terrain local, régional ou national, et à cesser de raconter l’histoire du point de vue des dominateurs, ce qui ne pourrait que flatter des instincts suspects de néocolo nialisme. Cette position n’est pas la nôtre. Certes, nous sommes pleinement d’accord avec le principe selon lequel il est important d’étudier l’histoire des peuples désormais libres en elle-même, et pas (ou plus) seulement à travers celle de leurs conquérants, militaires, missionnaires ou colons. On cessera ainsi de les faire apparaître comme d’étemels objets passivement soumis aux initiatives venues d’ailleurs, en même temps qu’on élargira le champ de la connaissance proprement dit. Mais, pour autant, il nous apparaît qu’il n ’est pas illégitime de tenter de continuer à faire l’étude historique du phénomène colonial en soi, à condition de le penser, non plus comme une collection d ’expériences hétérogènes, reflétant la diversité des pays non européens1
1. Voir Rivet (D.), «De l’histoire coloniale à l’histoire des États indépendants », in Bédarida (F.), dir., L’histoire et le métier d’historien en France (1945-1995), École des Hautes Études en Sciences sociales, 1995, p. 376.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
auquel il s’appliqua, mais comme une partie importante de l’histoire d’un seul monde dont tous les hommes, d ’où qu’ils soient, sont parties prenantes. Il est permis en effet de se demander si, loin d’être un épisode totalement coupé des réalités d ’aujourd’hui par l’effondrement des empires et l’affai blissement des anciennes métropoles, le fait colonial n’était pas, en réalité, le stade préliminaire à l’accélération de la mondialisation que nous voyons aujourd’hui s’accomplir sous nos yeux. Certes, la colonisation a voulu dire, d’abord, domination, et, parfois, écrasement de peuples ou de cultures proclamés inférieurs ; mais elle a aussi été à l’origine, pour le meilleur et pour le pire, de l’établissement de liens d ’interdépendance mutuelle, et de solidarité objective, sinon ressentie alors, mais dont la conscience finit de s’imposer à tous les hommes quelque peu responsables. C’est, par suite, sur les rapports instaurés entre les hommes dans le cadre d’empires eux-mêmes perméables les uns aux autres, et regroupant des cultures elles-mêmes en relation que nous voudrions mettre l’accent. Un tel travail peut contribuer à mieux comprendre la construction du monde actuel. Contrairement à ce que pourraient laisser croire ceux que le hasard, ou la politique, ou l’un et l’autre, ont mis en mesure de parler de tout et de rien, ce monde n’est apparu ni avec Internet, ni lors de la chute du mur de Berlin, ni même avec la durée préhis torique, puisqu’elle se situe au cours du deuxième millénaire, qui sépare les intellectuels français de mai 1968. Il commence en effet en ce XVIe siècle où les Européens se lancent au-delà des rivages familiers de leur continent, sur toutes les mers du globe, commençant à jeter sur le monde les mailles d’un filet de relations que rien, par la suite, ne pourra déchirer. Il a été donné, depuis cinquante ans, aux États-Unis de mettre la dernière main à cet ensemble, dans lequel, désormais, l’Europe, et notamment la France, se trouve, en dépit de proclamations qui n ’en imposent à personne, objet, et non plus sujet de l’histoire, comme le sont depuis longtemps les peuples d ’outre mer. Situation qu’il faut au moins reconnaître, que l’on ait ou pas la volonté ou les moyens de la faire changer. Plus particulièrement, il nous a paru utile qu’un tableau de cet épisode de leur histoire puisse être livré à l’attention de ceux, Français et Européens, de vieille souche ou issus de l’immigration, que nous voudrions contribuer à relier davantage à leur passé, qui fut et reste l’objet d ’un partage avec celui de nombre de peuples du tiers monde. Nombre de problèmes, qui se posent aujourd’hui dans le cadre français, trouvent leur source dans l’histoire colo niale. Cette préoccupation paraît d ’autant plus indispensable que la construc tion européenne entraîne trop souvent, sous le patronage bruxellois, la réécri ture d ’une histoire de l’Europe aseptisée dans laquelle les descendants des hommes de l’outre-mer ne sauraient trouver leur place, sinon comme objet de la sollicitude de ce qu’on pourrait appeler les «nouvelles dames d ’œuvres », qui ont pris le relais des coloniaux dans un paternalisme plein de bonne volonté, mais singulièrement méprisant pour qui sait lire entre les lignes, ou comme objet d ’interventions humanitaires dont on ne sait trop si elles doivent être l’occasion de faire l’éloge du dévouement de ceux qui y
Introduction
participent ou de critiquer l’inconscience de ceux qui ont laissé venir les choses où elles en sont arrivées. Ce choix « européen » suffirait à lui seul à expliquer pourquoi cet ouvrage ne traitera ni de l’Empire colonial américain, ni de celui de l’Empire russe (puis soviétique), qui logiquement auraient leur place dans une étude comparée des empires coloniaux. De toute façon, il s’agit d’histoires profon dément différentes. L’histoire de l’Empire colonial américain outre-mer proprement dite, qui, pour être fort courte, n’est pas substantiellement dissemblable de celle des empires européens, a un intérêt très faible en comparaison de la vraie histoire de la colonisation qu’est l’histoire de la formation des États-Unis eux-mêmes, indissociable de celle de l’ensemble du Nouveau Monde. De même l’Empire russe, dernier empire colonial contemporain, est très spécifique par ses modes d’expansion, terrestres et non maritimes, et, à l’époque qu’on a choisi d ’étudier, par l’application du modèle soviétique. Il n ’en reste pas moins qu’on doit garder à l’esprit que les Américains comme les Russes partagent avec l’Europe la responsabilité d’avoir conquis et gouverné des peuples non occidentaux au nom d ’une supériorité assumée avec une totale bonne conscience, dont, à l’inverse de celle des Européens, l’outrecuidance est loin de s’être dissipée encore aujourd’hui. On ne s’interdira pas, du reste, quelques références à ces deux expériences en cours de route. La méthode utilisée sera celle de l’histoire comparée. Ce livre n’ambi tionne pas de tracer un tableau exhaustif de tous les pays relevant des empires coloniaux européens dans la période indiquée par son titre. Son auteur courrait alors le risque de faire un catalogue, ou, pire encore, de passer si vite sur chaque fait qu’il semblerait l’esquiver. Ce qui est recherché ici est différent Les pays européens n ’ont pas colonisé de la même façon, influencés qu’ils ont été par leurs propres cultures nationales autant que par la spécificité des pays qu’ils ont occupés. Et pourtant, d ’une manière ou d ’une autre, ils ont participé à la même aventure, avec tout ce que ce mot peut avoir de positif comme de péjoratif. Par ailleurs, les conséquences de leurs actions présentent, en dépit de conditions très différentes, de profondes convergences, qui tiennent au fait que, malgré tout, les puissances coloniales ressortaient au commun patrimoine de l’Europe occidentale. Inversement, tout en conservant leur identité, les peuples dits colonisés ont dû réagir de manière souvent proche à des formes d ’agressions ou à des défis identiques. Une synthèse est donc légitime. Elle est, d ’autre part, rendue possible par la masse de documentation d ’excellente qualité publiée par les historiens, mais aussi par les géographes. Nulle part plus que dans ce type d’études on ne mesure mieux combien est justifiée la tradition française qui associe deux disciplines si complémentaires. La période choisie pour cette étude, qui est celle de l’entre-deux-guerres, correspond, dans une large mesure, à ce qu’on appelle parfois « l’apogée de la colonisation ». Ceci, on le verra, n ’est que très partiellement vrai, ou ne le
9
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
serait (et encore avec des réserves) qu’à un point de vue d’extension spatiale du domaine de l’Europe. Le véritable intérêt est ailleurs. Cette période a l’in térêt d ’être assez proche pour qu’on y voit se développer ce qui nous a paru une dialectique intéressante. D’un côté, jamais une si grande partie du monde n ’a dépendu de ce petit cap de l’Asie qu’est l’Europe occidentale, et par ailleurs, jamais le monde n’a sans doute été si divers, juxtaposant la culture issue de la révolution industrielle à des cultures encore largement inentamées par les contacts. Mais il s’agit d’une situation éminemment précaire : l’Europe des Empires n’a plus alors qu’une trentaine d ’années à vivre ; et les cultures traditionnelles subissent de plus en plus le choc de la culture occidentale. C’est cette position d ’équilibre instable avant le glisse ment qui conduit à nos jours qu’on aimerait ici saisir. Dira-t-on, pour mémoire, qu’on aborde l’étude de cette période sans le moindre préjugé à l’égard du phénomène colonial ? Il n’est pas difficile, plus de trente ans après la grande vague des décolonisations, d’affirmer que rien ne justifiait, sur le plan moral comme sur le plan politique, l’imposition à des peuples de maîtres étrangers à leur société et à leur culture. Comme le disait récemment le secrétaire d ’État au Foreign Office Robin Cook, avec un déli cieux sens de Y Understatement aux représentants de l’Organisation de l’unité africaine, «notre longue histoire commune n’a pas toujours été fondée sur l’équité ». Encore cela mérite-t-il d ’être rappelé à tous ceux qui auraient tendance à sous-estimer le poids du passé, comme à ceux qui pour raient croire que l’auteur de ces lignes éprouve une quelconque nostalgie pour une période révolue. Il n’en est pas moins convaincu que, à l’intérieur d ’un système certes critiquable dans son principe, et dans nombre de ses applications, des hommes de bonne volonté se sont efforcés, à leur manière, de trouver des solutions à des questions dont beaucoup, comme on aura l’oc casion de le voir, se posent encore aujourd’hui. Par ailleurs, l’expérience des temps récents a bien montré que l’exploitation ou l’oppression des mêmes peuples ne se réduisait pas aux rapports coloniaux, et que, en accédant à la souveraineté qui est la reconnaissance formelle et indispensable d ’une dignité, l’Asiatique, l’Africain, ou l’habitant des îles du Pacifique ou des Caraïbes, n’avait pas accédé, ipso facto, à la liberté et à la prospérité. Autant de raisons, s’il en était besoin, pour tenter de mener cette étude avec l’impar tialité de rigueur. On voudrait, pour finir, présenter quelques excuses. Le format réduit de cet ouvrage ne saurait lui donner vocation à traiter à fond un sujet extrême ment vaste. L’auteur a dû, pour mener ce travail, tenter de se familiariser avec l’histoire de certains pays, ou avec certaines questions qu’il ignorait à peu près totalement, et qu’il ne se vantera pas de maîtriser à l’égal des spécialistes dont il n’a pas toujours eu le temps de consulter les ouvrages autant qu’il aurait été nécessaire. En dépit de sa bonne volonté, il n ’a pu s’in téresser assez à quelques sujets importants, mais pour lesquels il n’éprouve pas de dilection, pour en parler autrement que d ’une façon sans doute trop superficielle. Son souci d’éviter la compilation l’amène à bien des omissions,
10
Introduction
qu’il laisse en toute modestie le soin de relever à de plus compétents. Il ne livre ici qu’une synthèse, de forme un peu plus achevée et un peu plus déve loppée que ne peuvent l’être les cours que son métier l’amène à préparer pour ses étudiants, dans le cadre de la licence d ’histoire. Il a voulu aussi éviter de présenter un plan à tiroirs, et chercher à montrer, autant que possible, l’imbrication des problèmes, ce qui ne rendra pas la consultation facile. Qu’on veuille bien lire cet ouvrage comme un essai, ou comme l’état provisoire d ’une recherche, sur laquelle il lui a paru utile de faire le point, ou encore comme une introduction, un guide à une histoire singulièrement riche et variée, et non comme un manuel ou une synthèse définitive. Une conviction, cependant, anime celui qui va désormais s’effacer derrière ses documents : il convient toujours de regarder l’histoire en face. Elle est souvent décevante, et parfois, désespérante ; elle est toujours difficile à comprendre ; elle est même, parfois, carrément incompréhensible ; elle ne donne qu’une seule certitude : c’est que, toujours, ceux qui ont refusé des évolutions inévitables ont été responsables de bouleversements et de déchire ments bien plus graves que ne l’auraient probablement été les conséquences des changements qu’ils prétendaient éviter. Encore convient-il de ne pas se tromper sur le sens de ces évolutions, dont rien ne prouve véritablement qu’elles se confondent avec un progrès autre que technique. Et là encore, l’écriture de l’histoire et la réflexion sur l’histoire, sont une source de médi tation irremplaçable. L’histoire est, aussi, il est vrai, méditation sur la mort, celle des autres, et la sienne, ce qui explique que sa lecture, lorsqu’elle n ’est pas réduite aux états d’âme de telle vedette de la politique ou du journalisme, ou mise au goût du jour par des gens à qui on pardonnera bien volontiers de chercher à vivre de leur plume, n’intéresse pas grand monde. On en sera d ’autant plus reconnaissant à qui aura pris la peine de lire ces choses, et celles qui suivent.
Chapitre 1
Signification et origine des em pires coloniaux
Le terme d ’empire est employé entre les deux guerres pour désigner l’en semble des possessions coloniales d ’un certain nombre d ’États. Mais cette expression est rarement définie. Pourtant, une évaluation de son contenu historique et idéologique peut contribuer à nourrir une première réflexion sur les réalités coloniales. Essai de définition Qu’est-ce qu’un em pire? En 1939, un rédacteur de la revue Affaires étrangères définit ce concept à travers deux déterminations principales. La notion suppose, tout d’abord, l’idée à'imperium, d ’imposition d ’un ordre qui résulte de l’obéissance à une autorité suprême, associant étroitement pouvoir militaire et pouvoir civil. Elle implique, d’autre part, la vocation universelle de ce pouvoir, qui ne peut se limiter à un territoire restreint, ou à une seule nation, mais regroupe, sous une même domination, une juxtaposition de peuples, très différents les uns des autres par leurs langues, leurs traditions, leurs genres de vie, la couleur de leur peau1. On devrait ajouter, pour compléter, que la construction ainsi édifiée est nécessairement opérée, para chevée, et maintenue par l’usage ou du moins la démonstration de la force des armes. Par ailleurs, l’universalisme dont il est question n’a pas seulement une connotation spatiale : la réunion de peuples différents sous une même direction implique leur adhésion, ou du moins leur acceptation, de la supé riorité du système de valeurs du peuple conquérant. Par là, comme le souligne en 1946 l’universitaire britannique Ernest Barker, l’Empire n’est pas seulement une forme de gouvernement, il est aussi porteur de culture (un Français dirait plutôt : de civilisation)12.
1. J.R., « L’idée d’empire », Affaires étrangères, 1939, p. 5-10. 2. Barker (Sir E.), Ideas and ideals of the British Empire, Cambridge, Cambridge Uni versity Press, 1946, p. 20.
13
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
De tous ces points de vue, la Rome antique, si présente encore dans la conscience des classes cultivées de l'Europe et de l’Amérique au début du XXe siècle, où les études latines demeurent encore la base de toute formation, constitue l’archétype de cet empire que, depuis sa disparition, tant d ’hommes d ’État européens ont cherché à ressusciter, de Charlemagne à Napoléon. Aucun chef de quelque niveau appelé à gouverner, au nom de son pays, une terre coloniale, qui ne se soit répété, ou à qui l’on n’ait soufflé, les vers vieux de deux mille ans, du poète Virgile, chantre de la vocation du peuple romain à la domination du monde : « qu’il te souvienne, ô Romain, de régner sur les peuples ; ton œuvre à toi, ce sera d’imposer les règles de la paix, de faire grâce à ceux qui se soumettront, et d ’abattre les orgueilleux ». Tu regere imperio populos, Romane, memento Haec tibi erunt artes pacique imponere morem, Parcere subjectis et debellare superbos3. Cet état d’esprit est repris dans nombre de devises ou de formules qui ont l’ambition de constituer un abrégé des programmes des puissances colo niales. Une des devises des Hollandais aux colonies est par exemple Rust en Orde (« Tranquillité et ordre »). Les Britanniques, plus attachés à la notion de majesté des lois, préfèrent l’expression Law and Order. Quant aux Français, ils tiennent (et c’est tout à leur honneur) à inscrire partout la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » ; faute de pouvoir recourir à la devise d’Auguste Comte « Ordre et Progrès », adoptée par le Brésil, pays de colonisation s’il en fut, et qui eût fort bien convenu à la IIIe République, ils citent souvent la devise du maréchal Bugeaud Ense et Aratro (« Par l’épée et par la charrue »), qui évoque l’image des légionnaires-laboureurs chère à ce peuple demeuré bien plus rural que ses voisins anglais et hollandais, en une belle image qui associe l’acier qui tue et celui qui féconde. Ils doivent cepen dant partager cette référence non officielle avec les Italiens, qui revendiquent l’exclusivité de l’héritage romain. C’est presque la même devise (Ense et aratro, teneo te, Africa) que fait inscrire le maréchal Graziani, chargé par Mussolini d ’achever la conquête de la Libye, sur le fronton de la résidence bâtie au milieu de la concession d’une centaine d ’hectares qu’il a reçue au sud de Tripoli, attention qui fait la délectation des admirateurs français du fascisme4. C ’est dire que l’empire, par définition, ne repose pas sur les principes de liberté et de nationalité qui ont fait la spécificité et la grandeur des institu tions de l’Europe occidentale, singulièrement en France et en GrandeBretagne. Au XIXe siècle, Michelet dénonçait dans « la magnifique et trom peuse unité de l’administration romaine », « la discorde obstinée d’éléments
3. Énéide, livre VI, vers 850-852. 4. Le Houérou (F.), L’épopée des soldats de Mussolini en Abyssinie, 1937-1938, « Les ensablés », l'Harmattan, 1994, p. 54.
14
Signification et origine des empires coloniaux
hétérogènes qui se trouvaient unis par la force »5. Il lui opposait le processus par lequel les royaumes s’étaient individualisés par la volonté de leurs peuples. Et il est vrai qu’on peut lire dans la constitution du Royaume de France, puis d ’Angleterre, puis des Royaumes ibériques, puis des Pays-Bas, puis de la Belgique, puis de l’Italie, une série d ’émancipations successives qu’on appellerait aujourd’hui affirmations identitaires. C’est là un redoutable paradoxe qui sera à retrouver plus tard, tant il est vrai qu’on vient de citer ici les principales puissances coloniales européennes. Inversement n’y figure pas le seul État qui conserva, par-delà les siècles, l’ambition universaliste de l’Empire romain : l’Empire des Habsbourg, détruit en 1919 sans avoir jamais possédé une seule colonie. L’Empire romain, bien qu’on se réfère souvent à lui, offrait pourtant un aspect très différent de celui des empires coloniaux construits par les Européens à l’époque moderne. Il se fondait sur une continuité territoriale, et n’impliquait pas la domination d ’espaces maritimes étendus, les distances entre les rivages du Nord et du Sud de la Méditerranée étant réduites à quelques centaines de kilomètres. Ainsi se présentèrent la plupart de ses contemporains ou successeurs, européens, américains, africains ou asia tiques, de l’Empire de Charlemagne à la Russie des tsars. Les empires colo niaux, au contraire, méritent pleinement le nom d ’empires d’outre-mer. Ils sont formés par des ensembles de territoires éloignés de milliers, voiie de dizaines de milliers de kilomètres, séparés les uns des autres, et séparés de la métropole par l’immensité des espaces océaniques. Alors que les empires non coloniaux apparaissaient comme le résultat d ’une logique de « rassem blem ent» de proche en proche autour d ’un centre, les empires coloniaux sont plutôt la conséquence d’une logique d ’émission d ’antennes le plus loin possible à partir de ce centre. À la métaphore de l’aigle romaine, si commune dans les vieilles héraldiques impériales, dont les ailes se déploient pour couvrir de leur ombre un espace de plus en plus vaste, s’oppose celle de la pieuvre dont les tentacules s’étendent et s’insinuent partout. Remarquons en passant que cette métaphore dévalorisante avait été appliquée par Rome à Carthage, puissance maritime et colonisatrice s’il en fût, et est souvent appli quée par ses adversaires à l’Angleterre, insulaire et sans ambitions continen tales, les Britanniques préférant s’identifier aux Athéniens, dont la culture brillante a su faire oublier l’impérialisme impitoyable. C’est à la colonisation proprement dite qu’il faut attribuer cette forme de croissance, et c’est pour quoi il convient d’expliciter l’emploi du terme « colonial ». Au sens étymologique, le terme de colonie implique, en des pays loin tains, l’installation de colons, constituant autant de reproductions de la mèrepatrie. Mais de ce point de vue, on peut dire que le sens moderne de la notion de colonisation joue sur deux sens, correspondant au terme latin de colonia et au terme grec d ’an o ix ia : l’étymologie latine postulant l’appro-
5. Histoire de France, I, Le Moyen Âge, Lausanne, Rencontres, circa 1970, p. 286.
15
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
príatíon du sol et sa mise en culture par les citoyens de la puissance conqué rante, et l’étymologie grecque mettant plutôt l’accent sur l’expatriation et l’émigration lointaine. La possession de territoires d ’outre-mer n’a jamais été possible sans l'implantation, en dehors de soldats et de fonctionnaires, de ressortissants de la puissance coloniale assurant, par leur présence, la péren nité de la présence de la puissance conquérante, exploitant une partie des richesses locales à leur propre profit et entretenant un courant d ’échanges avec la métropole. Les Européens qui, à une échelle plus modeste, avaient expérimenté ces types de colonisation au Moyen Âge, ont su en faire par la suite un moyen d ’implantation, de contrôle, et enfin de domination6. Dans les années 1930, ce qui pouvait rester des empires « à la romaine » a été emporté par la guerre, qui vit disparaître notamment l’Empire austrohongrois et l’Empire ottoman, au profit d ’États nationaux. L'URSS s’efforce, avec succès dans le camp de l’Internationale, et dans une indifférence teintée de scepticisme en dehors de ce camp, de faire croire que ses principes de gouvernement des « nationalités » sont très éloignés de ceux qui régissaient l’Empire des tsars, en particulier à l’égard de ses « peuples d ’Orient ». Les nazis s'emploient, de la manière diabolique qu’on sait, à dévoyer le véné rable terme de Reich, si cher au cœur de générations d ’Allemands. Par suite, les empires coloniaux sont les seuls à pouvoir revendiquer désormais le titre d ’empire. Ils peuvent aussi apparaître à leurs fondateurs comme les plus belles constructions impériales que le monde ait connues, car non seulement ils réunissent des peuples bien plus éloignés par la distance et la culture que ne l’étaient ceux que sut réunir l’Empire romain, mais aussi ils semblent capables de rapprocher véritablement ces peuples, et ce d'une manière irré versible. Ainsi pourrait, dans l’avenir, se réaliser une synthèse que les empires de l’Antiquité n’ont pas su réaliser, ou n ’ont réalisée que partielle ment. Il s’agit, écrit le Hollandais De Kat Angelino, de « l’incorporation, dans la grande famille des nations et dans la société humaine universelle, des peuples encore jeunes et que leur histoire a isolés »7. Cet effort doit être d ’autant mieux réussi que, comme le remarque l'historien français Georges Hardy, les puissances modernes disposent, pour ce faire, d ’un potentiel tech nique qui fit défaut à l’Empire romain. C’est souligner le dernier élément de la colonisation moderne, inséparable des progrès de l’Europe en direction de l'économie capitaliste, privilégiant l’innovation, l’investissement, et la crois sance, tous concepts inconnus dans l’Antiquité. D’une Europe aussi asso ciant étroitement à ce progrès technique une supériorité intellectuelle et spirituelle, qui permet d ’ajouter aux prétentions d'une domination univer selle celle d ’une domination culturelle, avec une assurance que les conqué-
6. Balard (M.) et Ducellier (A.), dir., Coloniser au Moyen Âge, Colin, 1995. 7. De Kat Angelino (A.), Le problème colonial, La Haye, Nijhoff, 2 vol., 1931-1932, vol. I, p. 256.
16
Signification et origine des empires coloniaux
rants d ’antan n’ont sans doute jamais pu éprouver à un tel degré. H faut noter ici que le terme de colonisation ne s’applique qu’à des pays dont la civilisa tion est non européenne, et de là facilement décrétée inférieure. C’est pour quoi on n’a jamais considéré l’Irlande comme faisant partie des colonies britanniques, ni 1’Alsace-Lorraine comme une colonie allemande, ni la Pologne comme une colonie russe, ces pays se trouvant incorporés dans les empires contre leur volonté, mais à titre de provinces. Dira-t-on que la couleur de peau n’a pas d ’importance dans cette distinction, et qu’il n’y a aucune relation entre la colonisation et la notion de « peuples de couleur» ? Ce serait évidemment se montrer bien naïf, la différence d ’aspect ayant trop souvent facilité l’absence de scrupules à l’égard d ’êtres de langues et de mœurs trop éloignées pour paraître justifier du droit des gens (droit des gens d’ailleurs trop souvent bafoué dans les conflits entre Blancs eux-mêmes). Conquête des espaces océaniques, installation d ’établissements au-delà des mers, recherche du profit, autorisés et légitimés par une supériorité non seulement matérielle, mais spirituelle, cette formule peut, en première approximation, résumer les fondements essentiels de la colonisation moderne entreprise par l’Europe. Mais cette approche déjà trop théorique ne peut suffire à l’historien. C’est dans son déploiement dans le courant du temps que la colonisation européenne doit être perçue et reconstituée, pour permettre d ’en saisir deux éléments importants : sa durée qui en fait, au XXe siècle, un phénomène déjà ancien de plus de quatre siècles ; son carac tère multi-étatique, les Européens ayant réussi, comme ailleurs, à mener une entreprise aux finalités identiques à partir de projets désunis, voire rivaux. L’ancienneté et la form ation L’édification des empires coloniaux, dont on ne souhaite ici qu’indiquer les grands traits, apparaît, dans les années 1930, comme le résultat d ’un processus plusieurs fois séculaire. En 1934, par exemple, le Portugal commémore (avec quelques années de retard) le cinquième centenaire du premier acte de son épopée coloniale, le débarquement de Ceuta, sur la côte méditerranéenne de l’actuel Maroc (1415). La France célèbre, en 1935, le tricentenaire des Antilles françaises. Mais toutes les puissances coloniales européennes qui existent alors auraient pu faire remonter aussi haut les dates de leur histoire coloniale, tant sont nombreux les épisodes qui les ont amenées, fût-ce provisoirement, à prendre possession d ’une terre africaine, américaine, ou asiatique jusque-là indépendante, pour la placer de manière définitive, peut-on croire, sous domination de l’Europe. Cette expansion, il est vrai, n’a pas connu une progression régulière et stable: d ’abord, loin de recouvrir, du début à la fin, des espaces qui se seraient étendus peu à peu, la zone de domination européenne s’est déplacée à la surface du globe, libérant certains pays, et en occupant d ’autres ; par ailleurs, si le mouvement d ’ensemble paraît irrésistible, il a connu, pris dans
17
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
le détail, de nombreuses vicissitudes, le partage du monde qu’il impliquait ayant subi d ’incessants remaniements. Tour à tour, des empires ont été gagnés et perdus par la plupart des puissances, si bien que l’état de fait qu’on peut constater dans les années trente ne constitue que le cliché instantané d’une réalité fugitive, et la mémoire ne le privilégie que parce qu’il corres pond, ce qu’on ignorait bien sûr à l’époque, à l’instant qui précède le reflux ; de même les cartes de l’Empire romain les plus fréquentes représentent celui-ci au IIe siècle de notre ère, lors de sa plus grande expansion. Cette situation n’apparaît pas aux observateurs plus avertis de l’époque comme un quelconque aboutissement, une quelconque « fin de l’histoire » coloniale. On y verrait plutôt une des étapes par lesquelles passe une histoire en perpétuel devenir. Georges Hardy parle ainsi d ’une « stabilisation, au moins provisoire, du tourbillon colonial»8. Rappelons ici les principales étapes de ce processus, en regroupant, autant que possible, les principaux faits par conti nent, pour rendre l’exposé plus facile à suivre. L’histoire des Amériques entre le XVIe et le XIXe siècle est une illustration remarquable de la fragilité, ou plutôt de la fluidité, des constructions colo niales : au nord, on vit naître et se développer entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, un immense Empire français qui s’étendait de l’embouchure du SaintLaurent au delta du Mississippi. Au traité de Paris de 1763, la cession du Canada à l’Angleterre, et celle de la Louisiane à l’Espagne paraissaient assurer la prédominance de la puissance britannique, appuyée sur les colo nies de peuplement de la côte est successivement fondées depuis 1606 (Virginie). Le triomphe britannique fut éphémère : à la suite de la guerre d ’indépendance, l’Angleterre devait accepter à peine vingt ans plus tard l’in dépendance de ses possessions nord-américaines (1783), en ne conservant que le Canada. L’Empire espagnol de l’Amérique centrale et du Sud, œuvre des Cortez et des Pizarre, s’effondrait au début du XIXe siècle au profit de républiques indépendantes, en même temps que l’Empire portugais du Brésil. Désormais, le Canada constitue le seul territoire continental consé quent relevant de l’Europe dans le Nouveau Monde. Pour le reste, celle-ci ne conserve que des possessions de dimensions réduites, très souvent insulaires. La trace des conflits anglo-français reste marquée dans le partage des îles de la mer des Caraïbes, West Indies britanniques, Antilles françaises, mais aussi des Guyanes. Le maintien de quelques possessions hollandaises rappelle que, au XVIIe siècle, la puissance maritime des Provinces-Unies avait ébranlé les empires espagnol et portugais, et fondé la colonie de Nouvelle Amsterdam, devenue New York. Les premières installations en Asie sont contemporaines de la conquête du Nouveau Monde, dues surtout aux Portugais, et secondairement aux Espagnols. Mais ces dominations sont révolues depuis longtemps. Entre les
8. Hardy (G.), La politique coloniale et le partage de la terre aux XIXe et XXe siècles, Albin Michel, 1937, p. 447.
18
Signification et origine des empires coloniaux
deux guerres, en revanche, les Pays-Bas conservent l’Indonésie, arrachée aux Portugais au XVIIe siècle, à partir de l’orgueilleuse Batavia, fondée par eux en 1619, et dont ils ont fait le centre de leurs possessions. Après un inter mède d’occupation britannique à l’occasion des guerres de l’Empire (18111816), ils occupent méthodiquement l’île de Java, après la guerre de 18251830, puis Sumatra et les autres îles. La guerre sanglante menée pour Aceh, engagée en 1873, ne se termine qu’en 1908. L’occupation de Bali, Lombok, Bornéo, ne s’opère définitivement qu’au début du XXe, puisque le dernier soldat hollandais ne quitte Bali qu’en 1914. L’Empire britannique des Indes s’est créé véritablement au XVIIIe siècle. C’est en 1757 que Robert Clive remporte sur les armées du souverain du Bengale la célèbre victoire de Plassey, qui assure à la Compagnie anglaise des Indes le contrôle du delta du Gange. C ’est en 1763, à l’issue de la guerre de Sept ans que la grande rivale, la Compagnie française des Indes, est définitivement écartée, après une série de vingt ans de campagnes. Un siècle plus tard, l’écrasement de la grande révolte dite des Cipayes (1857) paraît assurer définitivement la domination du sous-continent. Dans la première moitié du XIXe siècle sont consolidés les abords : Birmanie à l’est, Cachemire au nord. La progression en Malaisie, puis à Sarawak et à Bornéo à partir de l’occupation de Singapour (1819), ouvre la voie vers la Chine, où la « guerre de l’opium » place Hongkong sous la souveraineté britannique (1841). Les Français, en revanche, n’ont acquis leurs possessions d ’Indochine qu’à partir de 1863 (occupation de la Cochinchine avec Saigon, protectorat sur le Cambodge). C’est plus de vingt ans après que la Convention de HenTsin (1885), imposée à la Chine après une courte guerre, permet la conquête totale du pays. Ce n’est qu’au début du XXe siècle, de toute façon, que les dernières campagnes militaires permet tent aux Français de considérer leurs conquêtes comme totalement assurées. Le XIXe siècle (et en particulier sa deuxième moitié) fut celui du partage de l’Afrique, où la présence européenne s’était réduite, jusque-là, à une série de comptoirs, si l’on excepte la colonie du Cap, fondée en 1652 par des colons hollandais, suivis de quelques huguenots français. En 1930, la France célèbre bruyamment le centenaire de l’occupation d’Alger, tandis que les Boers commémorent tout aussi bruyamment en 1934 le « grand trek » qui amena leurs chariots au-delà du fleuve Orange. Mais le partage du nord de l’Afrique ne s’opère que dans les années 1880 pour l’Égypte et la Tunisie, en 1912 pour le Maroc et la Libye. Les grands partages d ’où résulte l’installa tion des Belges au Congo, des Français en Afrique occidentale, équatoriale et à Madagascar, des Britanniques en Afrique australe, centrale, orientale (mais aussi la constitution de la Gold Coast ou du Nigeria) remontent à moins d ’une cinquantaine d’années (1885-1900). Si les Portugais peuvent se vanter d ’avoir été des pionniers en Afrique, ils ne conservent que quelques lambeaux de cette aventure : les îles du Cap-Vert, de Sào Tome et Principe, ou encore le fort de Sao Joño Baptista d’Adjuda (Ouidah), sur le littoral de la colonie française du Dahomey, ñs n’ont opéré la conquête effective de leurs grandes colonies continentales qu’au prix d’une suite ininterrompue de campagnes militaires, qui ne s’achèvent à peu près totalement que dans les
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
années 1920 (Mozambique entre 1895 et 1899; Angola de 1907 à 1914; Guinée en 1916). La Première Guerre mondiale a amené des remaniements qui achèvent de définir la carte de la colonisation. Les colonies allemandes ont été partagées après 1918 sous forme de mandats, la plus grande partie du Cameroun et du Togo étant attribuée à la France, le reste allant à l'Angleterre ; celle-ci, en revanche, reçoit à l’est l'administration du Tanganyika, qui permet d'effec tuer (sur la carte au moins) la fameuse jonction du Cap au Caire dont rêvent les impérialistes britanniques depuis le grand Cecil Rhodes. Les Belges ont de leur côté reçu le Ruanda-Urundi, et l’Union sud-africaine le Sud-Ouest africain, les Portugais devant se contenter du « triangle de Kionga », au nord du Mozambique. L’éphémère occupation de l’Éthiopie par l’Italie (19361941) vient mettre une dernière retouche à cette carte. Beaucoup plus discrète reste la chronique de l’occupation des terres de l’Océanie et du Pacifique, reconnues entre autres par les célèbres explora tions d ’un James Cook ou d’un Dumont d’Urville. L’histoire de leur peuple ment fut essentiellement une aventure des Britanniques, dont les colons commencèrent à s’installer en Australie et en Nouvelle-Zélande dans la première moitié du XIXe siècle. Plus modestement, la France prit possession de Tahiti en 1843 (annexion accompagnée de celle des îles Marquises et Touamotou), puis de la Nouvelle-Calédonie en 1853, les Britanniques agis sant de même avec les Fidji (1874). Une série de partages, intervenus entre 1885 et 1898, achève la répartition des différents archipels entre Anglais (Salomon, îles Gilbert et Ellice, îles Tonga), Français (Gambier, Wallis, îles Sous-le-Vent), mais aussi de nouveaux venus, Allemands et Américains (Hawaii, Guam, 1898). La guerre amène, comme en Afrique, une nouvelle répartition, les Japonais recevant une partie des dépouilles allemandes sous forme de mandats (Mariannes, Marshall, Carolines, Palaos), le reste allant à l’Australie (partie orientale de la Nouvelle-Guinée et archipel Bismarck) et à la Nouvelle-Zélande (Samoa)9. Le Moyen-Orient arabe, conquis au XVIe siècle par les 'Hires, constituait en 1914 l’essentiel des possessions non turques de l’Empire ottoman. L’entrée en guerre de celui-ci aux côtés de l’Allemagne et de l’Autriche en novembre 1914 est l’occasion de nouveaux remaniements dans cette région où les Européens s’en étaient tenus jusqu’alors à une pénétration écono mique et culturelle. Dès la déclaration de guerre, les Anglais proclament leur protectorat sur l’Égypte, qui était toujours dépendante en droit, sinon en fait, de Constantinople, rompant ainsi la fiction d ’une souveraineté musulmane, sinon égyptienne, sur le pays. Surtout, la victoire des Alliés est l’occasion du partage de ces régions convoitées. Ce partage, obtenu à l’issue d ’âpres marchandages, permet à la France de devenir puissance mandataire en Syrie
9. Ibid.,?.308-319.
20
Signification et origine des empires coloniaux
et au Liban tandis que les Britanniques prennent au même titre le contrôle des territoires destinés à former l’Irak, la Transjordanie et la Palestine. Il permet aussi aux immigrants sionistes, encouragés par la déclaration Balfour de 1917, par laquelle les Anglais se sont engagés à favoriser la création d ’un « foyer ju if » en Palestine, d ’accélérer ce que les Arabes vont considérer, non sans raison, comme une véritable colonisation du pays. Ainsi, loin d ’être l’histoire d ’une progression linéaire, le récit de la formation et de la transformation des empires européens est celle d ’un labeur sans cesse repris. L’Empire britannique lui-même, le plus illustre et le plus puissant de tous, n’a pas connu une irrésistible ascension : les historiens opposent souvent au « vieil Empire », essentiellement fondé sur les Amé riques, et largement perdu avec l’indépendance des États-Unis, « l’Empire moderne » fondé au XIXe siècle en Asie, en Afrique, et dans le Pacifique. Il en va de même d’autres grandes puissances coloniales. C ’est véritablement un nouvel Empire colonial français qui se crée au XIXe siècle et au début du XXe siècle. La France ne conserve de son empire d ’Ancien Régime que quelques possessions dites « vieilles colonies » qui remontent au XVIe ou au XVIIe siècle : Saint-Pierre-et-Miquelon, Antilles, Guyane, île de la Réunion, les comptoirs de l’Inde, soit moins de 100000 km2 et un peu plus d ’un million d ’habitants, ce qui représente moins de 1 % de la superficie et environ 1,5 % de la population totale de l’Empire. La même constatation peut se faire pour le Portugal. Pour les historiens portugais, l’Empire, essentiellement afri cain, fondé sur l’occupation de l’Angola et du Mozambique dans les années 1895, est le « troisième Empire », le premier ayant été celui des Indes orien tales, conquis, comme on l’a vu, par les Hollandais, et le second celui du Brésil, devenu indépendant Des immenses territoires occupés dans les siècles précédents en Asie ne subsistent que des lambeaux (outre Goa, en Inde, la partie orientale de l’üe de Timor, partagée avec les Indes néerlan daises, et Macao, en Chine) : au total 1 % de sa superficie et 13 % de sa popu lation vers 1930. Les Hollandais, bien qu’ils aient constamment conservé leurs précieuses possessions d’Asie, n’ont pu remplacer les Portugais au Brésil ni sur la côte occidentale d’Afrique. S’ils ont conservé quelques Antilles, dont Curaçao et ses voisines, Saint-Martin, partagée avec la France, et surtout une des Guyanes (Surinam), ils se sont tout de même vus priver par les Britanniques de conquêtes comme celles de Ceylan ou du Cap. Si, du moins, pour ceux-ci, la nostalgie des territoires perdus est atténuée par les éclatantes réussites du présent, il n’en va pas de même pour d ’autres, auxquels le présent ne fait pas oublier le passé et appelle à des reprises futures. Des immenses possessions des origines, l’Espagne, privée en 1898 des Philippines, de Cuba et de Porto Rico par les États-Unis, ne conserve que ses présides de la côte marocaine (Ceuta, Mellila) remontant au XVe siècle, plus les îles de Fernando Po et d ’Annobon dans le golfe de Guinée, conquises sur le Portugal à la fin du XVIIIe. Le reste n ’a été acquis qu’au début du XXe siècle : le Rif, c’est-à-dire la côte méditerranéenne du Maroc, Ifrii et le Rio de Oro, actuel Sahara occidental, ainsi que le Rio Muni, petit
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
territoire sur la côte africaine, coincé entre Gabon et Cameroun, dit aussi Guinée espagnole. Mais les milieux nationalistes espagnols ne perdent pas tout espoir de relancer, un jour, l’expansion en Afrique du Nord. D’autres pays, tout aussi revendicatifs, disposent de moyens plus convaincants pour les faire aboutir : c’est le cas de l’Allemagne, privée de ses colonies au traité de Versailles, mais aussi de l’Italie, et du Japon, qui s’estiment insuffisam ment pourvus en fonction de leurs aspirations à la puissance et de leurs besoins, grave problème qui sera traité plus loin101. L’histoire de ces formations et transformations aboutit, à la fin des années trente, à une extension sans précédent des dépendances coloniales. À l’excep tion des États américains, seule une poignée de peuples est encore indépen dante vers 1939. En Afrique, après l’occupation de l’Éthiopie par les Italiens en 1936, il n’y a plus que le minuscule Liberia (100000 kilomètres carrés, sans doute moins d ’un million d ’habitants) pour échapper à l’emprise euro péenne. Encore, cette exception n’est-elle due qu’à la protection des ÉtatsUnis, et le pouvoir appartient-il aux descendants des Noirs américains installés dans le pays à partir de 1847 plus qu’aux autochtones. En Asie occi dentale et centrale, la Turquie de Mustapha Kemal, l’Iran de Reza Chah Pahlavi et l’Afghanistan du roi Amanullah doivent leur liberté à des chefs énergiques, mais aussi à leur habileté à manœuvrer entre les ambitions de la Russie des Soviets au nord et des Anglais au sud. Dans le monde arabe, l’Arabie Saoudite (selon la terminologie officielle adoptée en 1932), et le Yémen de l’Imam Yahia sont à peu près dégagés de la domination étrangère, mais ils restent très marginaux et vulnérables, soumis à la pression britan nique, mais aussi aux ambitions italiennes, dont la confrontation leur sera, finalement, bénéfique. L’indépendance récente de l’Égypte (1922, 1936), comme celle de l’Irak (1932) impose à ces deux États de nombreuses contraintes, et maintient une tutelle britannique encore pesante. En ExtrêmeOrient, la chance du Siam (qui prend le 1er juillet 1939 le nom de Thaïlande) a surtout été de constituer un État-tampon entre Birmanie britannique et Indochine française. Quant à la Chine, si ses dirigeants ont pu réduire les privilèges obtenus par les Européens depuis la « guerre de l’opium » de 1841 et la série de « traités inégaux » qui ont suivi, ils n’ont pu empêcher le main tien des points d’appui européens dont le symbole est le port de Hongkong. Parmi les quarante-cinq canonnières qui croisent encore sur les grands fleuves du pays, et qui sont devenues comme le symbole d’un interventionnisme exercé au mépris de toute souveraineté, vingt-six sont européennes (dont dixhuit britanniques et cinq françaises), contre dix américaines et douze japo naises1!. Des troupes européennes tiennent encore garnison dans les conces sions. À partir de 1937, l’invasion du pays par les armées japonaises qui, en 1940, ont achevé de se rendre maîtresses des territoires les plus riches et les plus peuplés, fait peser sur l’avenir une menace autrement plus grave. 10. Voir ci-dessous, chapitre 11. 11. Estival (B.), «Les canonnières de Chine», Revue internationale d’Histoire militaire, n°75,1995, p. 97-109.
22
Signification et origine des empires coloniaux
Remarquons enfin que le confinent européen n’est pas exempt de dépen dances coloniales : il s’agit essentiellement de trois possessions anglaises, Gibraltar, tenu depuis 1713, Malte, depuis 1800, et Chypre, depuis 1878 (bien que l’annexion officielle ne date que de 1937), mais également des îles du Dodécanèse (Rhodes et Léros notamment), conquises par les Italiens à l’issue de leur conflit contre les Dires en 1912, en même temps que la Libye. Pays exigus ou peu riches, ils comptent surtout comme points d ’appui des flottes de guerre. Les populations locales diffèrent, par leur langue, la reli gion, et la culture, de celles de la métropole: si à Malte, et surtout à Gibraltar, l’empreinte britannique est assez forte, les influences respectives de l’Angleterre et de l’Italie sur les populations de Chypre ou du Dodécanèse à population à majorité grecque sont beaucoup plus limitées, et on peut véri tablement parler de situation coloniale. Cette sorte d’épanouissement de la colonisation peut apparaître comme une consécration dans les manuels scolaires ou les hagiographies coloniales qui continuent à fleurir à l’époque. Jamais la domination de l’Europe sur le reste du monde n ’a été aussi étendue et n’a porté sur des populations aussi nombreuses. Il n ’est pas sans intérêt de s’arrêter quelque peu sur la dimen sion, absolue et relative du phénomène de « partage de la terre » tel qu’il se présente alors. Les chiffres avancés ici sont souvent très approximatifs : les espaces ne sont pas toujours exactement mesurés, vu l’imprécision de certaines frontières ; le dénombrement rigoureux des hommes est impossible, étant donné la légèreté des cadres administratifs, voire leur absence totale, sans compter, souvent, la résistance des populations aux opérations de dénombrement ; quant aux agrégats économiques, ils donnent tout au plus des ordres de grandeur. Mais l’intérêt de ces évaluations est moins dans leur précision que dans la possibilité d’en tirer des comparaisons globales, si grossières soient-elles. Le tableau (voir page suivante) est loin de rassembler tous les pays euro péens. Le cas de l’Allemagne et de l’Autriche a déjà été évoqué. Les Suisses n’ont jamais eu de véritable activité coloniale, bien que nombre d ’entre eux aient émigré dans les colonies européennes. Depuis le XIXe siècle, les pays Scandinaves ont renoncé à leurs possessions d’outre-mer. La Suède a aban donné en 1877 sa dernière possession coloniale, l’île antillaise de SaintBarthélémy, vendue à la France ; dans la même région, le Danemark a cédé les îles Vierges aux États-Unis en 1917. Les possessions de ces pays, non négligeables, n’intéressent plus que les régions polaires (Groenland, Islande et Iles Féroé pour le Danemark ; Spitzberg et une partie de l’Antarctique pour la Norvège). Il n’en sera pas question ici. Les pays d ’Europe orientale et balkanique, dominés par leurs puissants voisins pour la plupart, n’ont jamais été associés à l’aventure. On voit aussi que ce tableau est loin de rassembler des États exclusive ment européens. Trois pays, l’URSS, les États-Unis et le Japon ont créé ce qu’on peut appeler des empires coloniaux, qui regroupent des peuples extra-
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Superficie, peuplem ent, ressources Superficies et peuplements comparés Ils peuvent être présentés dans le tableau suivant :
Étal Belgique (1937) Espagne France (1935) Grande-Bretagne (1939) Italie (1939) Pays-Bas (1936) Portugal (1936) Total Monde % États-Unis (1940) Japon (1940) Russie Total
Superficie (km2)
Population (hab)
2 385000 350000 11841000 34363000 3480000 2079000 2098000 56596000 134600000 42%
10000000 1000000 66000000 500000 000 13000000 66000000 10000.000 666000000 2116000000 31%
1843000 298000 4000000 6 141000
18000000 32000000 35000000 85000000
Pour l’Italie, Albanie non comprise, Éthiopie comprise.
européens conquis au XIXe siècle : habitants du Caucase et de l’Asie centrale à majorité musulmane pour l’URSS ; hispanophones des Philippines et de Porto Rico, Polynésiens et Chinois des Hawaii pour les États-Unis ; Coréens et bientôt Mandchous pour le Japon. Dans un classement comprenant dix puissances coloniales, l’URSS arrive au 4e rang pour la population, derrière la Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas, le Japon et les États-Unis respectivement aux 5e et 6e rangs pour la population, devançant ainsi l’Italie, la Belgique, le Portugal et l’Espagne. Certes, il est permis de nuancer l’appli cation du terme de « colonial » aux possessions de ces pays. Le projet révo lutionnaire bolchevique est moins colonial qu’impérial, au sens jacobin du terme. Aux États-Unis, l’impérialisme colonial a surtout permis de se doter des signes et des instruments d ’une grande puissance, en acquérant des posi tions stratégiques importantes pour le contrôle des Caraïbes et du Pacifique. L’Espagne a fait les frais de cette politique aux ambitions territoriales limi tées. Le cas du Japon est différent : pour ce pays insulaire, l’expansion impé rialiste doit nécessairement se confondre avec une expansion coloniale, et celle-ci, outre la Chine, ne peut que viser les possessions européennes et américaines d ’Asie et du Pacifique. La Russie en 1905, puis l'Allemagne en
24
Signification et origine des empires coloniaux
1914, en ont subi les conséquences. Mais les ambitions japonaises sont loin d'être assouvies. Le phénomène colonial n'est pas exclusivement européen, comme tâche et tâchera de le faire croire une propagande hypocrite éhontée de la part de Moscou et de Tokyo, plus insidieuse de celle de Washington. Il reste cepen dant très majoritairement européen. En superficie, le domaine colonial de l’Europe prise dans son ensemble devance de loin celui des États non euro péens, puisqu’il regroupe près des neuf dixièmes de la superficie des terri toires coloniaux. La population coloniale sous contrôle européen peut être évaluée à 88 % de la population coloniale totale du monde contre 12 % pour la Russie, les États-Unis et le Japon. Si on soustrayait du total la population indienne (environ 380 millions), on arriverait encore à 76 %. D faut ajouter que la possession de ces empires amplifie considérablement le champ d'influence de l’Europe en extension comme en peuplement Les colonies européennes représentent près de la moitié des terres émergées et près du tiers de la population du monde. Si on ajoutait le chiffre de population des métropoles, on atteindrait respectivement le total de 43% et de 40% , chiffres qui sont en eux-mêmes, impressionnants et masquent les difficultés d'une Europe pourtant sévèrement frappée par la Première Guerre mondiale, puis la crise des années 30. Le tableau suivant permet de mesurer cette sorte « d’effet multiplicateur». On remarque qu’il est particulièrement sensible pour l’Empire britannique, environ dix fois plus peuplé et cent quarante fois plus étendu que le territoire métropolitain, et pour celui des Pays-Bas, huit fois plus peuplé et soixante fois plus vaste. La disproportion est moindre ailleurs, notamment en ce qui concerne les populations : bien qu’occupant des superficies beaucoup plus grandes, celles des empires belge, français et portugais ne dépassent que relativement peu celles des territoires européens respectifs de ces trois États. Quant à l’Italie et surtout à l’Espagne, la possession de colonies ne modifie que très marginalement leur puissance en terme d’espace et de peuplement. Métropoles et colonies : superficies et peuplement comparés Pays Belgique Espagne France Italie Pays-Bas Portugal Grande-Bretagne Total
Population (millions) 8 25 42 45 8 7 47 182
% par rapport à l’Empire 80% 2500% 63% 346% 12% 70% 9%
Superficie (km2)
% par rapport à l’Empire
30000 504000 551000 310000 35000 92000 244000
13% 144% 5% 9% 2% 4% 0,7%
1766000
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Certes, ces chiffres mériteraient bien des commentaires. Le premier serait naturellement qu’ils ne correspondent pas à la hiérarchie des puissances européennes, ni d ’un point de vue démographique, ni d ’un point de vue économique, ni d’un point de vue militaire. Au niveau des puissances princi pales, l’absence de l’Allemagne dans ce tableau (mais elle n’était que fort peu pourvue avant 1914) et même de l’Italie contraste avec la position de l’Angleterre, de la France, et plus encore de la Hollande et de la Belgique, pour ne pas parler du Portugal, alors un des pays les plus pauvres d ’Europe. En fait, la logique est surtout, au départ, géographique : les puissances colo niales européennes ont été depuis le début, et sont encore, presque unique ment, des puissances d ’Europe occidentale, et plus spécifiquement atlan tiques. Sauf quelques exceptions peu significatives, ni les pays d ’Europe du Nord, autour de la Baltique, ni ceux de l’Europe méditerranéenne, n’ont été attirés, au moins durablement, par le grand large atlantique et pacifique. Cette attirance pour les mondes lointains est née parmi les peuples des « grands estuaires » de la Tamise, du Rhin, de la Meuse et de l’Escaut, de la Seine, de la Loire, du Tage et du Guadalquivir, d ’où partirent la plupart des initiateurs de l’expansion coloniale. Aucun de ceux qui ne prirent pas part à cette phase initiatrice n’a pu, par la suite, rattraper son retard. Tout au plus la persistance des liens avec le Levant a-t-elle permis à des pays méditerra néens de participer à la conquête des pays d’Afrique du Nord et du MoyenOrient. Au XXe siècle, trois puissances se situent au premier rang des puissances coloniales: la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la France, qui totalisent 85 % de la superficie et 96 % des populations relevant des possessions colo niales de l’Europe. Entre les compétiteurs tentés par les espaces de l’outre mer, c’est essentiellement la capacité à mobiliser les ressources du grand commerce maritime, puis celles de la première révolution industrielle, qui ont fait la différence. Ces peuples de marins, de marchands, mais aussi de banquiers et d ’industriels que sont les Britanniques et les Hollandais ont su, plus tôt et mieux que les Français, édifier des constructions appuyées sur des courants d ’échanges et des flux d ’investissements, grâce à leur capacité à tirer parti des marchés les plus favorables. La place, malgré tout enviable, de la France, s’explique par ce curieux attelage de volonté gouvernementale, de dévouement militaire, d ’initiatives capitalistes, et de rayonnement culturel qui a caractérisé ce pays depuis Richelieu, en passant par Colbert, Napoléon m et Jules Ferry, et l’a maintenu au rang des grandes puissances. Les posses sions de la Belgique sont le fruit de l’alliance d’une économie prospère et de la volonté politique du roi Léopold II (1865-1909), qui fit de la conquête du Congo une entreprise personnelle. Quant aux Empires italien, portugais et espagnol, ils apparaissent, plus ou moins, comme une colonisation de « parents pauvres », née du désir des dirigeants politiques de faire figurer leurs pays au rang des puissances qui ont un rôle à tenir dans les affaires du monde. Les Italiens, dont le jeune État a fêté le cinquantenaire de son unification en 1920, ont voulu faire la preuve de son ascension au rang de grande puissance ; pour les Espagnols et les Portugais, il fallait au contraire
Signification et origine des empires coloniaux
démontrer que leurs peuples avaient conservé, en dépit des siècles et des revers, l’esprit des conquistadores. Mais même au sein du groupe des trois États coloniaux les mieux pourvus, la Grande-Bretagne se détache bien en avant, et ce depuis longtemps, comme aide à le comprendre une lecture attentive de la mappemonde. Représentation cartogrctphique Dans l’espace, l’aspect de ces empires est assez différent. Seul, l’Empire britannique mérite véritablement le nom d ’universel, bien représenté qu’il est sur les cinq continents. Plus vaste assemblage de terres et de peuples que l’histoire ait jamais connu, ses maîtres peuvent le qualifier avec orgueil d ’empire sur lequel le soleil ne se couche jamais (de mauvaises langues, britanniques aussi, ajoutent: parce que Dieu, qui considère les Anglais comme des enfants vicieux, ne veut pas les laisser jouer dans le noir). Le tableau suivant illustre en chiffres cette disposition équilibrée.12 L’Empire britannique : répartition territoriale
Europe Afrique Amérique Asie Océanie
Superficie (km2)
Superficie continent
Pourcentage
314907 9803 916 10294711 5 765 772 8 524 744
11400000 30100000 42900000 41600000 8600000
27 32 23 14 99
L’Empire britannique : répartition des populations12
Europe Afrique Amérique Asie Océanie
Population (millions)
Population continent
51 60 14 420 10
526 151 266 1142 11
Pourcentage 10 40 6 36 90
12. Keith (A.B.), The British Commonwealth of Nations, Londres, Longman, 1944, p. 12.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Les autres empires sont beaucoup plus concentrés géographiquement. En dépit de possessions sur tous les continents (ce qui lui permet de faire le tour des 24 fuseaux horaires), l’Empire fiançais est africain pour plus de 90 % de sa superficie. La France est d ’ailleurs la première puissance en Afrique pour l’étendue de ses territoires. Il en va de même du Portugal, l’Angola et le Mozambique constituant, comme on l’a vu, la presque totalité de ses terri toires d ’outre-mer. L’Italie et l’Espagne n’ont pas de possessions en dehors de l’Afrique, et le Congo et le Ruanda-Urundi constituent l’exclusivité du domaine colonial belge. Ainsi, pour quatre empires sur sept, « les colonies » évoquent, d ’abord, l’Afrique, et singulièrement l'Afrique noire. Seuls les Pays-Bas font exception, puisque l’Indonésie constitue l’essentiel de leur Empire, au demeurant extra-africain dans sa totalité, et essentiellement asia tique, la capitale des Indes néerlandaises, Batavia, peuplée d ’un demimillion d ’habitants, n ’étant pas à moins de 18 000 kilomètres d ’Amsterdam, sans qu’il existe aucune possession hollandaise entre ces deux points. Bien que différente de la répartition spatiale, la répartition des popula tions de l’Empire britannique fait apparaître aussi de solides positions sur les cinq continents : 90 % de la population de l’Océanie, plus du tiers de la population de l’Asie, 40 % de celle de l'Afrique, relèvent de sa mouvance, mais seulement 6 % de celle du continent américain. Pour ce qui concerne l’Empire français, les populations africaines (une quarantaine de millions d ’habitants, inférieure aux soixante millions de sujets africains de l’Empire britannique), en représentent un peu plus de 60% , un tiers vivant en Indochine. Quant aux autres empires, la répartition démographique ne diffère guère de la disposition sur la mappemonde. La répartition équilibrée des positions britanniques mérite un commen taire, qu’on peut emprunter au grand géographe Albert Demangeon. Celui-ci remarque judicieusement en 1927 que le centre de gravité de l’Empire se situe dans l’Océan Indien, véritable « Méditerranée britannique », dont on peut faire le tour sans quitter les territoires sous contrôle de Londres. « De la colonie du Cap à l’Égypte en passant par l’Arabie, la Mésopotamie, la Perse, l’Inde et la Péninsule malaise, de l’Insulinde à la Tasmanie par l’Australie, on ne sort pas de l’Empire britannique»13. Si le jugement porté par le géographe sur le degré de dépendance de la Perse se montrera excessif dans les années suivantes, l’emprise britannique se révèle bien plus forte sur la rive sud du golfe arabo-persique : une série de traités remontant au XIXe siècle lui assurent la prépondérance sur le Koweït, la Côte dite de la Trêve (toujours appelée par les Français Côte des Pirates), Qatar, Bahreïn, Oman et Mascate. Cette situation n’est évidemment pas le fait du hasard, mais résulte de deux axiomes: aucune grande puissance ne doit posséder de port de guerre dans cette zone ; la Grande-Bretagne doit contrôler les passages vers
13. Demangeon (M.), Les îles britanniques, in Vidal de la Blache (dir.). Géographie universelle, A. Colin, 1927, p. 293.
28
Signification et origine des empires coloniaux
les autres océans14. Aden, au débouché de la Mer Rouge, Le Cap, à l’entrée de l’Atlantique sud, Singapour, au débouché de la mer de Chine, mais aussi Trincomalee, dans File de Ceylan, constituent les principaux points d’appui de ce dispositif. Mais bien d’autres possessions signalent les grandes routes maritimes. La célèbre route des Indes par Port-Saïd et Suez est ainsi jalonnée en Méditerranée par Gibraltar, Malte, Chypre et Alexandrie. Les routes de l’Atlantique nord sont contrôlées par Halifax, en Nouvelle Écosse, et par les Bermudes, sur la route de Plymouth au canal de Panama; celles de l’Atlantique sud par Sainte-Hélène, de sinistre mémoire, et Ascension, ainsi que par les îles Falkland, célèbres pour la défaite infligée en décembre 1914 par la Royal Navy à l’escadre allemande de l’amiral Von Spee. Bien que certains Français, comme le ministre Gabriel Hanotaux, n’aient pas craint d ’employer l’expression de « puissance planétaire » à propos de la France, l’Empire français apparaît, par comparaison, comme la réalisation imparfaite d ’un dessein ambitieux, mais que l’écartèlement de ce pays entre les ambitions continentales et les ambitions maritimes a contraint à aban donner. Les écrivains Marius et Ary Leblond le dépeignent en 1934 comme un « domaine dégingandé », « vaste et trop dépeuplé, éparpillé sur les cinq parties du monde, reliques d ’anciens douaires dilapidés mal attachés à un faisceau hâtif de conquêtes involontaires »15. L’élément qui en paraît le plus solide est ce «bloc africain français» formé avec les possessions du Maghreb, de l’AOF et de l’AEF, qui, avec la métropole, semble pouvoir constituer un ensemble solide. Si nul ne nie la prospérité de l’Indochine, beaucoup voient déjà ce pays se détacher de l’ensemble français, faute de pouvoir être défendu efficacement, par suite aussi de l’attraction des écono mies du Sud-Est asiatique. «Lâchons l’Asie, prenons l’Afrique», écrivait déjà le géographe français Onésime Reclus en 1904. Les Français se conso lent en soulignant avec Hanotaux que leur Empire est « un élément d’équi libre planétaire », et empêche, par sa seule existence, d ’atroces conflits entre des puissances prêtes à se déchirer pour l’Indochine ou l’Afrique16. Est-il même le deuxième du monde, comme l’affirment invariablement après les hommes politiques, les manuels français de géographie? Leurs homologues hollandais, placés à la tête d ’un empire pratiquement aussi peuplé et sans doute plus riche, n’hésitent pas à revendiquer la même place, non sans arguments, comme on le lira plus bas. De toute façon, avec les Indes néerlandaises, les Pays-Bas sont une véritable puissance impériale. Si on peut encore parler d ’empires pour les possessions italiennes et portu gaises, suffisamment vastes et peuplées, ce terme est plus difficilement appli cable aux possessions belges, constituées d ’un seul territoire, et moins
14. Royal Institute of International Affairs, Political and Strategic Interests of the United Kingdom, an Outline, Oxford, Oxford University Press, 1939, p. 247. 15. Leblond (Marius-Ary), Madagascar, créationfrançaise, Plon, p. 250. 16. L’Empire colonialfrançais, Plon, 1929, p. XL.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
encore aux possessions espagnoles, qui seraient plus justement qualifiées, sans vouloir faire preuve de ce mépris mal placé dont trop de Français ont fait preuve à l’égard de leur voisin d ’outie-Pyrénées, de lambeaux d ’em pire. Cette comparaison géographique en appelle d ’autres, portant sur la richesse relative des constructions impériales, telles du moins que peuvent les apprécier quelques spécialistes de l’époque. On y retrouvera à la fois l’expression et l’explication de la part prépondérante de la Grande-Bretagne. La richesse : commerce et investissements La notion de «richesse» d ’un empire est naturellement vague. L’ex primer a du moins le mérite, particulièrement à l’époque contemporaine, de souligner que les ressources mobilisables pour un projet impérial ne dépen dent que très indirectement de la superficie des possessions du colonisateur, et pas seulement du nombre des hommes soumis à sa loi, même si la mesure de ce nombre permet d ’évaluer un réservoir possible de main-d’œuvre et un marché éventuel de consommation. Ces ressources reposent bien plus sur les potentialités naturelles, et sur la capacité de mobiliser hommes et capitaux pour les mettre en valeur, de manière à accroître la puissance de l’État colo nial par des prélèvement sur les flux ainsi créés, et la prospérité de sa métro pole, grâce à la priorité donnée aux entreprises métropolitaines dans la créa tion, le maintien et le développement de ces flux. C’est dans cette mesure, en effet, que peut s’évaluer la prospérité des empires. Les montants du commerce et des investissements peuvent, de ce point de vue, être retenus. Ces deux indicateurs permettent en effet de donner un clas sement relatif de la prospérité et des virtualités estimées des différents empires, prospérité évaluée évidemment du point de vue des milieux d ’affaires. L’évaluation du commerce indique l’importance des ressources produites ou échangées dans un ensemble de pays, et les investissements l’attrait pour les potentialités économiques connues et susceptibles d ’être développées, mais aussi le degré d ’équipement des pays d ’outre-mer. La combinaison de l’un et des autres permet donc une première approximation de ce que l’on appelle alors « mise en valeur», ou, pour parler le langage d’aujourd’hui, l’effort de développement, mais aussi du poids des différents empires dans l’économie mondiale, évaluation d ’autant plus nécessaire que, sauf exception, la notion de PNB ou de PIB ne donne guère lieu à des statis tiques à l’époque considérée. Certes, les estimations faites ici ne peuvent être qu’extrêmement gros sières. À l’hétérogénéité des séries, qui diffèrent à la fois par leur fiabilité et par les modes de calculs utilisés, modes qui restent le plus souvent inconnus, en particulier pour ce qui est de la prise en compte des investissements privés ou publics, il faut ajouter, dans la période qui nous occupe, les fluctua tions considérables des changes à partir de la dévaluation de la livre sterling
30
Signification et origine des empires coloniaux
en 1931. C’est ainsi que, entre 1925 et 1939, la valeur du franc français par rapport à cette devise a varié de 125 à 180. Il est donc bien évident que les chiffres indiqués ou calculés ici ne doivent être pris que comme donnant des ordres de grandeur, et que nombre d ’entre eux appelleraient des rectifications ou des révisions. Flux commerciaux et investissements Le tableau suivant donne, pour l’année 1938, les montants (en millions de dollars des États-Unis) des échanges commerciaux des principales puis sances coloniales, comparés au montant du commerce mondial et à ceux des échanges des métropoles17.
États
Exportations (f.o.b.) 21027
Commerce mondial total Royaume-Uni Empire britannique Pays-Bas Possessions néerlandaises France Empire français Belgique Congo belge Portugal Possessions portugaises Total des dépendances coloniales
Importations (c.a.f.) 23 709 4600
2 764 3 712 594
3 829 803
567
508 1324
881
384
398 765
733
35
50 51
102 31
23 4 750
4 787
Il faut d’abord observer qu’il ne s’agit pas de montants négligeables, puisqu’au total les empires représentent près de 23 % du commerce mondial aux importations, et 20 % aux exportations. Même en réduisant ces chiffres par le fait qu’un certain nombre de possessions (notamment Hong Kong, Singapour et les Antilles hollandaises) ont un commerce fondé sur la redistri bution, on reste à des pourcentages élevés, égaux ou peu inférieurs à 20 %. Ce tableau fait apparaître l’importance écrasante de la mouvance britan nique : les quatre Dominions (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Union sud-africaine), l’Inde, la Malaisie et Singapour, Hong Kong, l’Égypte, les
17. Woytinsky (W.S. et E.S.), World Commerce and Governments, Trends and Outlook, New York, The Twentieth Century Fund, 19SS, notamment p. 55-57. Voir aussi INSEE, Quelques aspectsfondamentaux de l’économie mondiale, lmp. Nat & PUF, 1951, p. 323-324.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
possessions d ’Afrique, assurent, en 1938, environ 15 % des exportations et des importations mondiales, chiffres qui s’ajoutent à ceux du commerce extérieur du Royaume-Uni proprement dit (respectivement 13 et 19 %). Les possessions françaises (un peu moins de 2 % du commerce mondial) n’arri vent que loin derrière, juste après les territoires hollandais (un peu plus de 2 %). Ces pourcentages correspondent à peu près à la place des deux pays dans le commerce mondial (5 % aux importations et 4 % aux exportations pour la France, 3 % pour les Pays-Bas). Ceci souligne la prospérité (de ce point de vue), des possessions hollandaises, par rapport aux possessions françaises. On peut suggérer ici l’idée que l’Empire français est fort plus par l’addition de territoires que par la détention de territoires très prospères. L’écart est aussi très grand avec les possessions belges, malgré l’importance du Congo, et portugaises. On n’a pas fait figurer ici des chiffres relatifs à l’Italie encore que les chiffres des importations éthiopiennes (24 millions de dollars) se comparent avantageusement à ceux des possessions portugaises. Ceux des possessions espagnoles sont négligeables. Un tableau du commerce par tête donne quelques indications sur l’inten sité des échanges, en montrant qu’il y a, au total, peu de différences entre les principaux empires, la prospérité hollandaise étant néanmoins assez nette.Il État Belgique Pays-Bas Grande-Bretagne France
Population (millions d’habitants) 10 66 500 66
Exportations/ t£te($)
Importations/ t£te($)
5 8 7 6
4 8 7 7
Il est extrêmement hasardeux d ’aborder la question des investissements, dont les modes de calculs, selon les différentes sources, sont encore plus difficiles à apprécier que ceux du commerce, selon qu’ils retiennent ou non ou plus ou moins partiellement, l’investissement des administrations, les emprunts publics, qu’ils prennent ou non en compte les fluctuations moné taires, et qu’ils explicitent ou non leurs calculs. Il faut penser, de toute façon, que plus on procède à des évaluations globales, plus la marge d ’erreur s’étend. Cependant, là encore, les chiffres, si imparfaits soient-ils, permettent de réfléchir à la fois sur l’attraction qu’ont pu exercer les territoires colo niaux sur les milieux d ’affaires, et sur les efforts des métropoles pour déve lopper leurs possessions. Sauf mention contraire, les chiffres qui ont été retenus ici sont ceux des investissements directs à long terme.
32
Signification et origine des empires coloniaux
Investissements à long terme d’origine extérieure dans les empires coloniaux (1938)18 Pays
Investissements (millions de dollars)
Grande-Bretagne Pays-Bas France Belgique Italie Portugal
17001 2483 1231 428 201 184
Les chiffres, comme on pourrait s’y attendre, font apparaître une très nette supériorité britannique. En 1938, la Grande-Bretagne a investi dans son Empire environ six fois plus que les Pays-Bas, ou dix fois plus que la France n’ont fait dans le leur. Cette hiérarchie reflète en partie celle des investisseurs internationaux, au rang desquels la Grande-Bretagne vient en premier, avec plus de 43 % de l’investissement mondial, contre 21 % aux États-Unis, 9 % aux Pays-Bas, et 7 % à la France, pays qui ne se classe plus, en 1938, qu’au quatrième rang mondial pour les investissements à long terme. Il n’est pas impossible, cependant, que la forte dépréciation du franc par rapport à la livre et au dollar en 1938 amène à une sous-estimation du montant des capi taux français à l’étranger. L’effort italien en faveur de l’Empire apparaît assez considérable. Les capitaux portugais, en revanche, s’investissent très majoritairement en dehors des possessions africaines. L’investissement par habitant au sein des Empires est également intéres sant à connaître : État Grande-Bretagne France Italie Belgique Pays-Bas Portugal
Investisse ment total
Superficie (km2)
Population (millions)
Investissement/tête ($)
17001 1231 201 428 2483 184
34 363000 11841000 3480000 2 385000 2079000 2098000
500 66 13 10 66 10
34 19 15 43 37 18
hvestissement/km2 ($) 498 104 81 179 1194 87
Ces chiffres confirment l’intérêt de la concentration des capitaux investis dans les possessions des Belges et des Hollandais, mais aussi des18 18. Woytifisky, op. cit., p. 213-214.
33
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Britanniques, qui pourtant disposent de territoires beaucoup plus vastes et peuplés. En revanche, le domaine de la France n 'a pas suscité beaucoup plus d'intérêt, dans son ensemble, que celui du Portugal et de l’Italie. Mais il est vrai que, comme on le verra plus loin, seules quelques possessions françaises exercent un véritable pouvoir d ’attraction. La hiérarchie qui s'établit à partir des données sur le commerce et les investissements est facile à établir. Au premier rang, et de très loin, figure l’Empire britannique. Mais la valeur des possessions des Pays-Bas doit être également soulignée; bien moins étendues et dispersées que celles de l’Empire français, mais aussi peuplées, elles représentent un potentiel commercial plus important et une mobilisation de capitaux à peu près double, ce qui signifie une mise en valeur plus intensive. L'Empire français, en dépit ou à cause de son étendue et de son peuplement, ne vient qu’au troi sième rang selon ce classement purement économique. Viendrait ensuite le Congo belge, objet d ’un développement remarquable. Même si le potentiel total des possessions italiennes ou portugaises n’est pas équivalent à celui des autres empires, ces territoires ne font pourtant l’objet, comme le démont rent les chiffres des investissements par tête ou par kilomètre carré, d ’une mise en valeur moins insignifiante qu’on a eu trop tendance à le croire en France. Ces appréciations d ’ensemble ne sont pas, au total, très flatteuses pour l'amour-propre national. Intérêts des métropoles pour leurs colonies Il importe de situer ces échanges et ces investissements dans l’activité économique d ’ensemble des différentes puissances, pour bien en mesurer l’importance, qui a tendance à être souvent, soit surestimée, soit négligée. Il est évident que, parmi les moteurs de la colonisation, ont toujours figuré trois éléments conjoints : se procurer des matières premières, s’ouvrir des débou chés, et aussi trouver de nouvelles occasions de placements pour des capi taux. Telle était déjà, notamment, l’ambition des grandes compagnies consti tuées deux siècles plus tôt en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en France. Quels sont les résultats, entre les deux guerres, de cette incessante activité ? En ce qui concerne l’activité commerciale, on peut retenir les indications fournies par le tableau suivant, qui donne le pourcentage des exportations et des importations des métropoles avec leurs colonies. On a choisi d ’indiquer des données antérieures et postérieures à la crise économique des années 1930, qui a entraîné des modifications qui seront commentées plus loin, mais qu’il convient de remarquer dès maintenant. Tel qu’il est, ce tableau suffit à montrer qu’il existe deux catégories d'États coloniaux : ceux pour lesquels l’empire représente un champ d’ex pansion important, et ceux pour lesquels ce champ, pour n’êtie pas négli geable, est tout de même d'une valeur relative. Dans le premier, il faut placer la Grande-Bretagne et la France ; dans le second, les Pays-Bas, le Portugal et
34
Signification et origine des empires coloniaux
la Belgique. On doit tout de même observer que, même lorsqu’il est impor tant, ce champ n’est nullement exclusif. Ceci est dû au fait que, alors comme aujourd’hui, l’essentiel des échanges s’opère entre pays développés, ce qui explique d ’ailleurs les pourcentages importants des échanges de l’Angleterre avec son Empire, dans lequel figurent des pays en progrès rapide, en particu lier les Dominions.
Pays
% Exportations avant crise
Belgique France Pays-Bas19 Portugal Royaume-Uni20
% Exportations après crise
2,6% 20% 9% 11% 42%
1% 33% 8% 12% 49%
% importations avant crise
% importations après crise
2,9% 12% 5% 7% 28%
7% 27% 8% 12% 39%
Mais ces chiffres rendent seulement compte de la proportion des échanges qui s’opèrent à partir des métropoles. Si l’on inverse la perspective, et qu’on s’intéresse aux échanges du point de vue des empires coloniaux, on s’aperçoit de la situation de dépendance des colonies, notamment en ce qui concerne les possessions belges et françaises.
Pourcentage du commerce des principales colonies avec leur métropole (1938)21 Colonies
Congo belge Colonies françaises Colonies britanniques Colonies portugaises Indes néerlandaises
Pourcentage des importations en provenance de la métropole
Pourcentage des importations à destination de la métropole
68 65 42 35 19
53 62 41 14 19
19. Statesman’s Year Book, Londres, MacMillan, 1928,p. 1115-1116; 1938,p. 1166-1167. 20. Havinden (M.) et Meredith (D.), Colonialism and development, Britain and its tropical colonies, 1850-1960, Londres, Routledge, 1993, p. 191. 21. Chiffres donnés dans Woytinsky, p. 671. Pour les colonies hollandaises, chiffres donnés par Vandenbosch (A.), The Dutch East Indies, Its Government, Problems, and Politics, University of California Press, Berkeley, 1944, p. 433-436 pour l’année 1937 ; Hailey (Lord), The Future of Colonial Peoples, Londres, Oxford University Press, 1944, p. 32.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Le détail présente évidemment des variations : ainsi, dans le cas français, en 1936, l’Algérie et la Tunisie réalisent près de 75 % de leur commerce avec la métropole, l’Afrique noire 62 %, l’Indochine 47 %, et le Maroc 42 %. Les chiffres britanniques sont comparables : 49 % pour l’Afrique de l’Ouest, 45 % pour les West Indies, 40 % pour la Rhodésie22. Avec les Dominions, qui ne sont pas compris dans ce tableau, les chiffres sont plus élevés, puisque la Nouvelle-Zélande réalise 65% de son commerce avec le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud 53 %, l’Australie 50 % ; seul le Canada est nettement audessous (28 %) ; 30 % du commerce de l’Inde, malgré une nette régression, en particulier en ce qui concerne le poste des exportations, se fait encore avec la Grande-Bretagne. Mais le cas n’est pas applicable à toutes les puis sances. Les Indes néerlandaises en particulier (environ 70 % des importa tions et 80 % des exportations totales de l’Empire hollandais) ne font qu’un peu moins du cinquième de leur commerce avec les Pays-Bas23. Dans l’ensemble, les échanges entre territoires d’un même empire sont beaucoup moins importants: c’est ainsi qu’en 1937, ils sont évalués à 157 millions de livres pour l’ensemble de l’Empire britannique hors Royaume-Uni, alors que l’ensemble des échanges de celui-ci seul s’élèverait à environ 700 millions, soit 22 %24*. Mais ce pourcentage est probablement bien plus élevé que pour les autres empires. En 1936, les ventes des colonies françaises à l’Indochine ne représentent qu’un total de 30 millions sur un total de 974 millions (3 %) ; les achats des mêmes colonies ne se montent qu’à 104 millions sur 1,7 milliard (6% ). L’Algérie est le principal fournis seur, avec 21 millions (surtout des vins et des cigarettes) ; les principaux acheteurs sont en revanche les colonies d’Afrique (56 millions), la Réunion (20 millions), et Madagascar (10 millions), l’Algérie ne venant que loin derrière (4 millions)23. Dans le cas du Maghreb même, l’Algérie voisine vient bien au second rang des importations tunisiennes, mais avec 8 % du montant total. Mais elle ne figure pas parmi les principaux clients ; elle n’est pas davantage un partenaire important du Maroc. On peut donc constater un phénomène général de mainmise, certes non totale, des métropoles sur le commerce des territoires coloniaux. La situation relative aux investissements est comparable. La totalité des investissements dans les colonies n’est pas exclusivement métropolitaine. Dans chaque possession, des fonds issus d ’un autre pays que la métropole peuvent trouver à se placer. Une mise en perspective chiffrée aboutit aux résultats suivants :
22. Calcul fait d’après Woytinsky, op. cit., p. 672-673. 23. Calculé d’après Statesman's Year Book, 1940. 24. Ameiy (L.), My Political Life, vol. 3, Londres, Hutchinson, 19SS, p. 91. 23. Bulletin du Comité de l ’Asiefrançaise, 1938, p. 82-83.
36
Signification et origine des empires coloniaux
Investissements originaires des principales puissances coloniales en 193826 Montant (millions de dollars) Grande-Bretagne Pays-Bas France Belgique Italie Portugal
22905 4818 3 859 1253 424 394
Montant et pourcentage investi dans l’Empire 11590 1956 1 171 355 201 90
49% 40% 30% 28% 47% 23%
On voit d ’après ces données que les dépendances impériales représentent entre 50 et 30% de l’investissement extérieur des principales puissances coloniales. Ces chiffres permettent de dire que les empires constituent des champs privilégiés des capitalismes nationaux, ce qui n ’était pas le cas pour tous, et notamment pour celui de la France, avant la Première Guerre mondiale, époque à laquelle il ne représentait qu’environ 10 % de l'investis sement français. L’intérêt des capitaux français pour l’Empire parait tout de même plus faible que celui des Britanniques et des Hollandais, sans doute parce que cet empire offre moins de potentialités que les deux autres. Comme dans le cas du commerce, les placements de capitaux originaires des métropoles sont très largement prédominants dans les investissements opérés dans leurs colonies. Si on prend le cas des Indes néerlandaises, on constate par exemple qu’environ 75 % des capitaux sont d’origine hollandaise. Ce chiffre varie d’ailleurs en fonction des activités. Par exemple, les capitaux hollandais investis dans les plantations de caoutchouc de ce territoire repré sentent environ la moitié du total, suivis par les capitaux britanniques, fian çais, belges, américains et japonais. En revanche, l’industrie sucrière est totalement sous contrôle néerlandais2627. D’une manière générale, les capitaux britanniques, français, belges et néerlandais sont très largement prédomi nants dans les territoires dépendant de chacune de ces puissances, On voit cependant que chaque puissance coloniale ne détient pas l’exclu sivité des investissements dans son empire28. Les capitaux des autres puis sances peuvent s’y investir. Il arrive même que, dans certains cas, la prépon dérance politique ne s’accompagne pas d ’une prédominance financière. En
26. Woytinsky, op. cit., p. 213. 27. De Kleick (E.S.), History of the Netherlands East Indies [1938], Amsterdam, B.M. Israel NV, 1975, p.571 ; Van Asbeck (Baron), «Les responsabilités néerlandaises dans le Pacifique », Questions élu Pacifique, Centre Européen de la dotation Carnegie, 1939, p. 203. 28. The Colonial Problem, Report by a Study Group of Members of the Royal Institute of International Affairs, Londres, Oxford University Press, 1937, p. 281.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
particulier, les investissements des États-Unis au Canada, évalués à près de quatre milliards de dollars, sont nettement supérieurs à ceux de la GrandeBretagne, qui s’élèveraient à moins de deux milliards. À une échelle plus modeste, la prépondérance politique et militaire britannique en Égypte, n’a pas vraiment remis en cause l’importance des investissements français, évalués à environ trois cinquièmes des investissements étrangers en 1939, soit près de 300 millions de dollars, ce qui serait considérable par rapport aux investissements dans l’Empire, les investissements britanniques étant bien inférieurs. Le Conseil d’administration de la Compagnie de Suez, tel qu’il est composé en 1937, comprend dix-neuf Français, dix Britanniques, deux Égyptiens et un Hollandais. Dans les possessions portugaises, les capi taux d ’origine anglo-saxonne, mais aussi belge, représentent sans doute plus de 50 % des fonds engagés. Il convient enfin de noter qu’il existe, pour les capitaux des pays coloni sateurs, bien d’autres terrains d’action que leurs empires coloniaux. C’est ainsi qu’environ trois milliards et demi de dollars ont été investis par la Grande-Bretagne en Amérique du Sud, où elle demeure le premier investis seur étranger devant les États-Unis. Ses seuls investissements en Argentine sont du même ordre que ceux qui ont été opérés au Canada, en Inde, ou dans toute l’Afrique, Union sud-africaine comprise. L’investissement français dans la seule Europe (1 035 millions) ou dans le seul continent américain (1 825 millions) dépasse largement l’ensemble des investissements dans l’Empire. Les pays d ’Europe, d ’Amérique du Nord et d ’Amérique du Sud représentent près de la moitié du total. Si on compare ces pourcentages à ceux qui concernent les flux commer ciaux, on voit que, pour les Pays-Bas et la Belgique, leurs empires sont plus intéressants comme placement de capitaux qu’ils ne le sont du point de vue des échanges, alors que, pour la France et la Grande-Bretagne, l’intérêt paraît équivalent. Ceci s’explique sans doute par le fait que, cinq ou six fois moins peuplés, et dotés d ’un marché plus limité, Belgique et Pays-Bas ont surtout développé leurs possessions pour l’exportation internationale, ce qui les a conduits à de bons résultats, comme on l’a vu. Dans l’ensemble, les empires coloniaux sont, pour leurs métropoles, des partenaires commerciaux et financiers non négligeables, et leur existence constitue une des données fondamentales des réalités économiques du temps. La manière dont ils sont reliés aux métropoles permet, là encore, de distinguer une hiérarchie, ou au moins de discerner différents degrés de dynamisme. Les transports Flottes et marines L’histoire de la colonisation est inséparablement liée à la grande aventure des Européens sur les Océans. Il serait superflu de rappeler que c’est grâce à l’amélioration des techniques de navigation, mais aussi de la fiabilité et de la
38
Signification et origine des empires coloniaux
capacité des navires qu’il a été possible de transporter, à des coûts toujours plus bas, des quantités de plus en plus grandes de produits, de manière à rendre de plus en plus rentables des mouvements d ’échanges de plus en plus variés, et donc de susciter un intérêt croissant des capitalistes pour les inves tissements lointains. En même temps, et parallèlement, c’est la puissance accrue des marines de guerre qui a donné aux forces armées des conquérants ce qu’on appellerait aujourd’hui des moyens de projection accrus. Matelots, fusiliers marins et infanterie de marine (qui a pris en France le nom d’infan terie coloniale en 1900) ont constitué l’essentiel des premiers échelons de débarquement, et, souvent, le noyau européen des troupes d’occupation. La navigation à vapeur s’est imposée partout, à quelques exceptions près. Les vieux cargos non spécialisés (tramps), de faible tonnage (3 000 tonnes), sont en recul, au profit d ’unités plus importantes, dont une partie se compose de cargos dits mixtes, qui transportent aussi les passagers, mais, de plus en plus, de pétroliers, bien réduits selon les normes actuelles (10000 tonnes en lourd au maximum). Le trafic avec les colonies voit apparaître aussi des bateaux affectés au transport de denrées périssables, qui nécessitent un transport rapide, comme les bananiers29. C’est encore la marine marchande britannique qui assure la plus grande partie des échanges, avec 30% du tonnage mondial en 1931, soit 20 millions de tonneaux, et près de 9000 bateaux; les autres puissances coloniales européennes viennent loin derrière (France 1500 unités, Italie, et Pays-Bas, un millier chacune), après même le Japon (3e rang après les États-Unis) et l’Allemagne. Les années suivantes, marquées par la crise, soulignent la stagnation de la marine marchande britannique, qui conserve néanmoins son rang, et le déclin fran çais. La Grande-Bretagne et ses Dominions assurent encore en 1936 40 % du commerce maritime mondial, et représentent 36% du tonnage. En 1938, la flotte française ne vient plus qu’au 6e rang mondial pour le tonnage, loin derrière l’Italie, et à égalité avec les Pays-Bas. Ses navires sont, dans l’en semble, vieillis et d’un entretien dispendieux. Ils ne peuvent assurer que 43 % des importations nationales, ce qui est naturellement un handicap pour une puissance coloniale, et place la France de ce point de vue dans une position bien inférieure à celle de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas, qui disposent de navires beaucoup plus modernes. En 1929, un armateur français soulignait combien ces derniers avaient axé leur activité maritime sur leurs possessions des Indes, la route reliant la Hollande aux Indes néerlandaises constituant « l’épine dorsale» de leur commerce30. Pour les autres puis sances coloniales, qui ont des marines de volume réduit, la dépendance est la règle : sur vingt-six compagnies qui desservent le Mozambique en 1935, seulement deux sont portugaises ; quant à l’île de Timor, elle dépend des navires néerlandais pour son approvisionnement31.
29. Masson (Ph.), Marines et océans, lmp. Nat., p. 198-199. 30. Introduction à L'Empire colonialfrançais, p. 193. 31. Annales de Géographie, 1933, p. 428-433.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Fort logiquement, ce ne sont pas les routes purement coloniales qui rassemblent la plus grande partie du trafic. La route de l’Atlantique nord voit passer 70 % du trafic mondial. Mais celles de la Méditerranée et de l’Océan Indien sont très fréquentées : le grand axe Mer du Nord/Manche se dirige par Gibraltar vers l’Afrique du Nord, Port-Saïd, Suez, et la Mer Rouge (Aden). De là, les pétroliers se dirigent vers le Golfe, les paquebots ou cargos vers Bombay, Colombo, Singapour, Shanghai, Hong Kong, Yokohama. Les grands ports européens (Londres, Southampton, Marseille, Anvers, Rotterdam) bénéficient largement de ce trafic. C’est encore sous la dépendance de la Grande-Bretagne que se trouvent les gigantesques emporia de Hong Kong et de Singapour, qui redistribuent l’essentiel des productions de l’Insulinde et de l’Extrême-Orient. Singapour, par exemple, n’accueille pas moins de 13000 bateaux marchands en 1935, pour un tonnage de 30 millions de tonnes et une valeur totale (importations et exportations) de 600 millions de dollars. Hong Kong reçoit plus de 20000 bateaux, dont 12000 chinois, pour un tonnage de 20 millions de tonnes qui le classe au 6e rang mondial. Ces ports méritent toujours, dans les récits des voyageurs, des phrases enthou siastes : « Par le va-et-vient de tous ces amoncellements de charbon, de bois, de minerais, des produits les plus divers, on admire l’harmonie et le bienfait des relations de peuple à peuple, on comprend la beauté du travail et pour quoi l'industrie et le commerce sont des arts, non moins nobles, non moins grandioses que tous les autres arts », s’extasie, à propos d ’Alger, l’écrivain Jean Mélia32. Pour le transport des hommes, le règne du paquebot reste incontesté. Les grandes compagnies, déjà anciennes, font retentir leurs noms prestigieux : Peninsular and Oriental, fondée en 1837 ; Messageries maritimes, établie en 1851 ; Compagnie générale transatlantique, créée en 1851 ; Chargeurs réunis (1872) ; Amsterdam Nederland (1870), Rotterdamisches Uoyd (1883) ; Compagnie belge maritime du Congo (1895) qui absorbe en 1930 le Lloyd Royal belge pour former la Compagnie maritime belge. La colonie s’atteint, sauf exception, au cours d ’un voyage de plusieurs jours dans un de ces navires qui se succèdent, par exemple, à l’entrée du canal de Suez, et dont Paul Morand, grand écrivain-voyageur (en première classe) déroule la litanie : « Le Victoria du Lloyd Triestino, le Strathmore du P&O avec sa clientèle de rajahs ; VOrion de l ’Orient Une, aimé des grands colons austra liens, qui essaye en vain de ravir le ruban bleu indien ; les deux belles unités japonaises toutes neuves, le Terukumi Maru et le Yusukumi Maru, frères des hollandais de la Nederland et du Rotterdam Uoyd, Le Johann Van Odenhartenvelt et le M amix Van Suit Adegonde, spécialisés dans les croi sières de B ali; les allemands Schamhorst et Gneisenau, orgueils de la marine hitlérienne d ’Extrême-Orient (et qui, dit-on, peuvent être transformés très facilement en croiseurs auxiliaires), les Wouvermann, qui raflent la plus belle clientèle de l’Afrique du Sud, les transports italiens avec leurs prison-
32. Mélia (Jean), La ville blanche, Plon, 1921, p. 118.
Signification et origine des empires coloniaux
niers abyssins... et nos paquebots des messageries qui circulent aussi par ici quand Marseille veut bien ne pas faire grève... »33. Les débuts de l ’aviation À la fin des années trente, en dépit de sensibles gains de vitesse, la plupart des colonies restent fort lointaines : c'est ainsi que, par la route de Suez, Plymouth est à 21 jours de mer de Bombay, à 27 jours de Singapour, à 32 jours de Hongkong, à 38 de Sydney ; par la route du Cap, il convient d’ajouter une dizaine de jours. En direction de l'ouest, Saint-Nazaire est à 11 jours de Pointe-à-Pitre, et à 20 jours de la Guyane. Rien à voir, évidem ment, avec l’Afrique du Nord, puisqu’Alger n’est en 1930 qu’à un peu plus de 24 heures de Marseille, et à environ 36 heures de Tunis. L’aviation, perfectionnée durant le premier conflit mondial, semble apporter une solu tion partielle à cet éloignement. Les spectaculaires accidents de dirigeables, comme celui du R101, qui devait relier l’aéroport britannique de Cardington à Karachi, et s’écrasa lors de son voyage inaugural, près de Beauvais, le 5 octobre 1930, avec une cinquantaine de personnes à bord, ont définitive ment assuré le succès de ce qu’on appelle encore l’aéroplane. Les avions ou hydravions, dont les records sont soigneusement notés, y compris dans des revues universitaires comme les Annales de Géographie, achèvent de s’im poser comme moyen de déplacement rapide. En 1919, les aviateurs austra liens Ross et Keith Smith ont mis 28 jours pour inaugurer la ligne de Londres à Darwin, par Karachi, Singapour et Batavia. L’année suivante, les Sud-africains Van Rynevled et Brand n ’ont pu faire la première liaison Londres-Le Cap qu’en 45 jours3435. Mais les progrès sont spectaculaires. Dès 1935, il ne faut plus que 3 jours et quinze heures pour relier Paris à Saigon, et à peu près le même temps pour joindre Londres au Cap. Les lignes impériales commencent à sillonner le monde. Celles, d’abord, des Imperial Airways, fondées en 1922, et dont le réseau atteint déjà 35000 km en 1937. Mais aussi celles de la KLM néerlandaise (1928), de la Sabena belge ou d’Air-France (1933), héritière de lignes prestigieuses comme YAéropostale illustrée par Mermoz, Saint-Exupéry, et tant d’autres. En 1938, la ligne commerciale met Saigon à cinq jours et demi de Paris, par Tripoli et Calcutta, Bruxelles à trois jours de Léopoldville. En 1939, trois vols par semaine joignent La Haye à Bandung. Paul Morand, «homme pressé » s’il en fut, voit déjà les quais de Marseille désertés par les voyageurs au profit de l’aéroport de Marignane, et le célèbre hôtel de Noailles, sur le haut de la Canebière, vide de colons ou de maharadjahs en transit entre Paris, Vichy et l’Orient33. Ces appréciations sont encore très excessives, l’incon fort, et surtout la très faible capacité des appareils (une douzaine de places au
33. Morand (P.), La route des Indes [1936], Arléa, 1989, p. 91. 34. Nevin (D.), Les pionniers, Amsterdam, Time-Life, 1980. 35. Morand (P.), La route des Indes, p. 26-27.
41
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
maximum) en limitant l’emploi autant que le prix, à quelques dizaines de milliers de passagers, qui renoncent aux plaisirs de la vie de société à bord des paquebots au profit de l’efficacité. Tous ne sont pas occidentaux : en 1938, la compagnie égyptienne Misr Airways transporte pour la première fois des pèlerins à La Mecque36. Les télécom m unications Tout autant que le transport des marchandises compte celui de l’informa tion. Si l’essentiel de celle-ci est toujours transportée par courrier postal qui voyage essentiellement en bateaux, et partiellement par avion, le télégraphe permet depuis la fin du siècle précédent des communications très rapides. Dans ce domaine, encore, la Grande-Bretagne possédait, au XIXe siècle, une supériorité comparable à celle de sa flotte de commerce. Les câbles sousmarins posés pour l’essentiel entre les années 1860 et 1900 sous la responsa bilité des compagnies britanniques font véritablement le tour du monde. Il suffit d’en suivre le réseau décrit dans la Géographie universelle à la fin des années 1920 : pas moins de douze câbles joignent alors Valentía, au sudouest de l’Irlande, au Canada; le Canada est relié à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande par le all red line (allusion à la couleur rouge qui, sur les cartes, désigne les territoires britanniques), long de 11785 km, de l’île de Vancouver à Brisbane et à Sydney par l’île Fanning, les Fidji et l’île de Norfolk ; un câble relie Perth, en Australie, par l’archipel des îles Cocos et l’île Maurice, à Durban, en Afrique australe; du Cap, un câble rejoint l’Angleterre, par Sainte-Hélène, Ascension, Saint-Vincent et Madère. Depuis plus longtemps encore, Londres est relié à Bombay par Gibraltar, Malte, Alexandrie, Port-Saïd, Aden. « Un circuit de fils complet entoure ainsi la terre : les pensées et les ordres du monde britannique peuvent s’échanger et circuler librement à travers l’univers»37. Ce commentaire d ’Albert Demangeon insiste très justement sur cet aspect trop souvent négligé de la puissance impériale britannique au début du siècle. Il oppose cette supério rité à la faiblesse des Français: ceux-ci, à la fin de la Première Guerre mondiale, ne disposent de liaison directe qu’avec l’Afrique ; en revanche, pour les relations avec l’Indochine, Madagascar ou la Nouvelle-Calédonie, ils doivent avoir recours à des branchements sur le réseau britannique38. En revanche, les Japonais ont hérité de l’essentiel du réseau câblé allemand dans le Pacifique. Mais ce monopole (plus de 50 % du réseau mondial en 1923) est déjà largement dépassé. La prédominance britannique n’a jamais convenu aux
36. Montagne, La civilisation du désert. Hachette, 1947, p. 181. 37. Demangeon (A.), Les îles britanniques, p. 298 ; Headrick (D.R.), The Invisible Weapon, Telecommunications and International Politics (1851-1945), Oxford University Press, 1991. 38. Demangeon (A.), La France, 2e partie, La France économique et humane, T. I, in Vidal de la Blache, Géographie universelle, A. Colin, 1946, p. 72.
42
Signification et origine des empires coloniaux
dirigeants des autres puissances. Le développement de la radio (encore appelée télégraphie sans fil ou TSF) commence à jouer un rôle croissant, battant largement en brèche la suprématie britannique dans le domaine des câbles télégraphiques. Les Pays-Bas ont été le premier pays d ’Europe à établir des communications pratiques avec ses colonies en recourant à ce vecteur. À partir de 1923, ils disposent, dans l’île de Java, avec la station de Malabar, qui domine Bandung, à 1300 mètres d ’altitude, d ’un des émetteurs les plus puissants du monde3940. Les Français ne sont pas en reste, d ’autant qu’ils disposent d ’une expérience déjà ancienne en la matière. Le corps expéditionnaire de Casablanca de 1907 était ainsi en relation avec Paris par un système mis au point par le général Ferrié, un polytechnicien pionnier dans ce domaine. Par la suite, l’installation, dès les années vingt, de puissants émetteurs (Saint-Assise, près de Melun, puis Beyrouth, Saigon, Bamako, Tananarive) permet à la métropole de communiquer rapidement et librement avec les territoires d ’outre-mer. Les Britanniques, en revanche, ont pris un net retard, qu’ils tentent de rattraper en profitant de la révolution introduite par l’utilisation des ondes courtes. Us chargent le célèbre Guglielmo Marconi de mettre en place un « réseau impérial », à ondes courtes, dont la réalisation est parachevée en 1928. La puissante station à ondes longues de Rugby, indispensable pour communiquer avec l’ensemble des bâtiments de la Royal Navy, y compris les sous-marins, n’en est pas moins achevée. En 1932 est inauguré un puissant émetteur à ondes courtes à destination des Dominions et des colonies'10. Les Français se dotent d’un réseau analogue, d ’autant plus que les systèmes à ondes courtes se révèlent d ’installation et d ’entretien bien moins coûteux. Tout ceci, qui est imité par les autres puissances, sert évidemment de base au développement de réseaux de radio à destination des auditeurs des colonies, dont il sera question plus bas. Par ailleurs, les grandes marines sont dotées, depuis longtemps, de réseaux hertziens susceptibles de relier les navires sur toutes les mers du globe. Essai de comparaison La position privilégiée de l’Angleterre n’est évidemment que la consé quence de la prépondérance mondiale dont elle a joui depuis la Révolution française. Le dynamisme de son commerce, puis de son industrie ; sa vitalité démographique, capable d’alimenter une forte émigration outre-mer ; enfin et surtout, son statut de première puissance maritime, tant par le nombre de ses navires marchands que par la supériorité de ses vaisseaux de guerre, ont permis à ses dirigeants d’imposer leur volonté et leurs arbitrages dans la plupart des conflits coloniaux. Cette supériorité incontestée n’a pas poussé ses gouvernants, cependant, à se réserver l’exclusivité de l’occupation des territoires d ’outre-mer. On peut même dire qu’elle les a dissuadés longtemps,
39. Asselin (H.), La Hollande et le monde, Perrin, 1931, p. 219. 40. Huth (A.), La radiodiffusion, puissance mondiale, Gallimard, 1937, p. 113,420.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
au XIXe siècle, d’accroître leur domaine colonial, dans la mesure où elle leur garantissait une expansion commerciale qui paraissait suffire à leur prospé rité. C 'est, par exemple, grâce à la bonne volonté des Anglais que la France a retrouvé, en 1815, ses vieilles colonies des Antilles et du Sénégal, et que les Hollandais ont réoccupé leurs anciennes possessions en Insulinde (à l’excep tion de Ceylan). Ce n’est qu’à la fin du siècle que renaît véritablement un impérialisme territorial britannique très agressif, mais aussi soucieux de trouver des compromis avec les autres puissances coloniales, ne serait-ce que pour se ménager des appuis sur le continent européen. C’est l’assentiment britannique qui a permis à la France de se lancer à la conquête de la Tunisie (1881), puis du Maroc (1912), en échange de la renonciation française à l’Égypte. De même, ce sont des traités passés avec la Grande-Bretagne qui ont commandé l’expansion française en Afrique occidentale ou à Madagascar. Quant à l’Empire portugais d ’Afrique, sa réalisation et même sa conservation ne s’expliquent que par la volonté de la Grande-Bretagne, et peu s’en est fallu avant 1914 qu’il ne soit sacrifié au profit des bonnes rela tions de Londres avec Berlin. Après la guerre encore, le partage du Proche-Orient se fait essentielle ment en fonction des ambitions du gouvernement de Londres, qui accepte cependant, bien que de mauvaise grâce, de laisser une part aux Français. «L ’Angleterre sait bien, déclare André Siegfried dans une conférence prononcée en 1936, qu’elle est une puissance mondiale, et qu’elle est une puissance mondiale par l’Empire». Il s’empresse de dire qu’il lui paraît souhaitable de la voir conserver ce rôle mondial qui constitue, pour lui, « sa raison d ’être», ce qu’on traduirait aujourd’hui en disant qu’il la croit indispensable à l’équilibre géopolitique de la planète41. En 1939 encore, l’appui ou au moins la neutralité bienveillante de la Royal Navy, qui reste la première flotte de guerre du monde par le tonnage, et qui a fait montre, vingt ans plus tôt, de sa supériorité en bloquant la flotte allemande dans ses ports pendant toute la durée du conflit, reste nécessaire à la plupart des puissances coloniales pour garantir leurs communications avec leurs territoires d ’outre mer, et même la possession de ceux-ci contre les convoitises des « révision nistes » que sont l’Italie, l’Allemagne et le Japon. C’est l’époque où l’Ami rauté britannique achève la restauration du Victory, le vaisseau-amiral de Nelson ; c’est aussi le temps où l’écrivain C.S. Forester, avec les premiers volumes des aventures du commandant Horatio Homblower qui traverse avec bravoure, efficacité et panache, (et la petite dose de perfidie nécessaire), les guerres de la Révolution et de l’Empire, fait, avec le chauvinisme de rigueur, l’éloge de cette marine, « gardienne des libertés du monde » contre la tyrannie42.
41. « Transformations de l’Empire britannique», in Lacaze (vice-amiral) et alii, Problèmes britanniques, Alcan, 1936, p. 93,109. 42. The Happy Return (1937), A Ship on the Line (1938), Flying Colours (1939).
44
Signification et origine des empires coloniaux
Ce retour sur le passé, régulièrement magnifié par le vieil hymne Rule, Britannia, écrit par le poète James Thomson deux siècles plus tôt (1740), ne peut-il être considéré comme exprimant les angoisses du présent? L'Angleterre peut-elle encore demeurer le policeman o f the world, et veiller sur 100000 miles (180000 km) de routes maritimes vitales, avec une marine qui ne dispose plus de la marge écrasante de supériorité que la volonté de ses dirigeants, autant que l’importance de ses ressources, lui avait permis de conserver jusqu’en 1919 ? En renonçant, à la Conférence de Washington de 1925, au principe du Two Powers Standard (disposer d ’une flotte d ’un tonnage égal à l’addition des tonnages des deux plus grandes flottes rivales) et en acceptant la parité avec les États-Unis, la Grande-Bretagne marque l’impossibilité de continuer à entretenir un instrument naval dont le coût est au-dessus de ses moyens. Le relais ne paraît guère en mesure d’être pris par une autre puissance coloniale. Dans les années trente, un grand stratège fran çais, l’amiral Castex, s’exprime à peu près comme Onésime Reclus. Selon lui, le gouvernement français ne saurait organiser une défense indépendante et crédible de l’ensemble des rivages (40000 kilomètres) et des lignes de communications incluant la totalité de l’Empire43. Demangeon, déjà cité, fait remarquer que, contrairement aux Anglais, « les Français sont les usagers de routes dont les carrefours ne leur appartiennent pas. Ils ont leurs étapes en terre étrangère »44. On ne peut en excepter que les relations avec l’Afrique du Nord. L’Italie, dotée d ’une marine puissante et d’une aviation moderne, paraît dans une situation comparable. Le problème ne se pose évidemment ni pour la Belgique, ni pour les Pays-Bas, ni pour le Portugal. Le caractère limité de leur puissance militaire et navale leur interdit d’envisager d'assurer seuls la sécurité de n’importe lesquelles de leurs lignes de communications, et même de défendre très longtemps leurs possessions par leurs propres moyens. L’Empire portugais, notamment, dont la plus grande partie des fron tières sont communes avec des possessions britanniques (100% pour le Mozambique, 60% pour l’Angola), ne paraît subsister que par la bonne volonté de celui-ci45. Se situant à un second plan, les Pays-Bas et la France n’en sont pas moins deux très grandes puissances coloniajes. La puissance des Pays-Bas repose essentiellement sur la mise en valeur économique et commerciale fondée sur l’expérience d ’un vieux pays de marchands, de banquiers et de marins. Celle de la France repose, autant que sur les ressources de la révolution indus trielle, sur une puissance navale respectable et sur une vieille tradition étatique. Il semble bien que la France compense par la politique la relative faiblesse de ses efforts financiers, et que, appliquant à de vastes territoires ces facteurs immatériels, elle ait pu ainsi continuer à rivaliser avec d’autres,
43. Meunier (A.), « Sur le développement des côtes maritimes françaises », La Géogra phie, 1936 (I), p. 365-374. 44. Demangeon (A.), 2e partie, La France économique et humaine, T. 1,1946, p. 38. 43. Böhm (E.), La mise en valeur des colonies portugaises, PUF, sd. [1934], p. 61.
45
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
globalement plus efficaces ou plus riches. Mais on voit que nous avons dépassé ici les limites de ce que peut fournir une consultation des très grands chiffres, et qu’il convient maintenant de procéder à des interrogations plus fouillées.
46
Chapitre 2
Grandes et petites provinces im périales
On ne peut naturellement se contenter de présenter les empires par une suite de généralités. À côté des principaux territoires, dont la population et la richesse peuvent faire l’orgueil de la métropole, il existe des possessions éloignées, isolées, exiguës, sans ressources, « terres d’empires » dont seule l’histoire peut expliquer la présence, et dont la conservation s’explique parfois, par le souci de ne pas amener le drapeau sur des conquêtes natio nales, plus souvent par l’idée que, inutiles aujourd’hui, elles peuvent, demain, rendre des services. Il convient de donner un aperçu d ’ensemble de cette disproportion, qui explique bien des choix politiques ; après quoi c’est à une tournée quelque peu systématique de ces possessions grandes et petites que nous convierons le lecteur. Importance relative des différentes possessions Il convient de partir, comme on l’a fait au chapitre précédent, d ’un certain nombre d ’éléments chiffrés, qui permettent une première série de constata tions. Données concernant le commerce et les investissements On peut d ’abord classer les diverses possessions en fonction du montant de leurs échanges commerciaux. Les douze plus importantes dépendances européennes, en fonction du total des importations et des exportations, sont respectivement1:1
1. Source, Woytinsky, op. cit.
47
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Pays
Commerce en 1938 (millions de dollars)
Canada Indes Australie Union sud-africaine Malaisie/Singapour Indes néerlandaises Antilles néerlandaises Nouvelle-Zélande Hong Kong Algérie Birmanie Ceylan
1712 1 1% 1093 664 642 633 440 430 373 304 260 190
On peut ensuite faire un autre classement en fonction du montant approximatif des capitaux investis dans les différents territoires coloniaux. Des différences très nettes aussi apparaissent quant à l’effort de mise en valeur par les investissements2.
Pays Canada Australie Indes, Birmanie, Ceylan Indes néerlandaises Afrique britannique Afrique française Nouvelle-Zélande Congo belge Afrique portugaise
Investissements ($) 6 628 3 730 3113 2 378 1914 754 720 428 184
Population (millions)
Investissement par tête
10 7 400 65 60 30 1.5 10 10
662 532 8 36 32 25 480 48 18
Il est évident qu’il ne s’agit là que de considérations très générales, qu’il conviendra de nuancer par des notations plus précises, lorsque seront présentés les différents territoires. On voit, malgré tout, encore une fois, la supériorité des grandes possessions britanniques, et des Indes néerlandaises. Dans l’Empire français, les investissements les plus importants auraient été effectués en Afrique du Nord, où ils dépasseraient les 500 millions de dollars, ce qui ne mettrait pas ces trois pays bien en avant du Congo belge, tandis qu’en Afrique noire, ils n’atteindraient que 250 millions, ce qui, pour l’inves
2. Source des chiffres des investissements : Woytinsky, op. cit., p. 213-214.
48
Grandes et petites provinces impériales
tissement par tête, les situe au niveau des territoires portugais. La différence s’explique largement, il est vrai, par le fait que les ressources minières des territoires français sont limitées, alors que la mise en valeur du sous-sol suscite les plus gros appels de fonds. D’après une étude britannique de 1936, l’investissement extérieur par tête en Afrique, abstraction faite de l’Afiique du Sud, était trois fois plus élevé en Rhodésie qu’au Congo belge, quatre fois plus qu’en Angola et au Mozambique, cinq fois plus qu’en Afrique orientale et en Afrique de l’Ouest britanniques, et dix fois plus qu’en AOF3. Même en grande partie discutables, ces tableaux aident du moins à prendre conscience des pays coloniaux qui pèsent le plus lourd dans l’éco nomie mondiale. La plupart, on le voit sans surprise, sont britanniques, mais les Hollandais tirent brillamment leur épingle du jeu, grâce non seulement aux Indes, mais aussi aux Antilles. La France ne dispose que d’un partenaire important, qui est l’Afrique du Nord, et en particulier l’Algérie, l’Indochine venant très loin derrière, ce qui confirme l’intérêt économique secondaire du deuxième empire colonial du monde en termes de superficie. Le poids économique des principales possessions pour les métropoles Après cette étude selon les poids relatifs, il est intéressant de jeter un premier coup d ’œil sur la répartition des ressources à l’intérieur des empires. Montant et part des principales possessions britanniques dans le commerce de la Grande-Bretagne avec une partie de son Empire (1937)4 Pays
Total général Total Empire Canada Australie Inde Nouvelle-Zélande Afrique du Sud Malaisie Ceylan Afrique centrale
Montant des importations britanniques (en milliers de livres)
% des importations depuis chaque colonie (arrondi)
Montant des exportations britanniques (en milliers delivres)
% des exportations vers chaque colonie
403 162 326547 88 386 71 805 64820 49 890 17 956 13 160 11619 8911
100 80 22 18 16 12 4 3 3 2
232110 185261 27 562 37 531 39104 20 253 41432 11473 3 923 3 983
100 73 11 15 15,5 8 16 4,5 1,5 1,5
3. Frankel (S.H.), Capital Investment in Africa, Londres, Oxford University Press, 1938, p. 170. Conversion en dollars sur base de 3 dollars pour une livre. 4. Statesman's Year Book, 1938, p. 39-60.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Les quatre Dominions et l’Inde représentent environ deux tiers du commerce britannique avec l’Empire (72 % des importations et 65 % des exportations). La part des colonies proprement dites est réduite à peu près à un tiers. On constate un déséquilibre analogue dans le tableau du commerce colonial français. Montant et part des principales colonies dans le commerce de la France avec son Empire (1938)5 Pays
Algérie Tunisie Maroc Indochine AOF Madagascar Total Autres Total général
Montant des importations depuis la France (en millions de francs) 3 532 966 733 1015 959 454 7659 983 8642
% des importations de chaque colonie 40 11 8 12 11 5 87 55
Montant des exportations vers la France (en millions de francs)
% des exportations de chaque colonie
4171 756 676 1346 1 123 642 8714 1470 10184
40 7 7 13 11 6 84 63
Le poids de l’Afrique du Nord, qui représente près de 60 % du commerce colonial aux importations, et 54 % aux exportations, est évidemment à noter immédiatement, bien avant l’Afrique, dont les chiffres globaux ne seraient que de peu supérieurs à ceux de l’Indochine, même en y ajoutant l’AEF, le Togo et le Cameroun. Il est inutile de faire des tableaux pour ce qui est des autres empires, dans la mesure où ils ne comprennent qu’un nombre très limité de possessions. On peut noter, toutefois, que les Indes néerlandaises représentent l’essentiel des importations, et des exportations totales des Pays-Bas avec leurs posses sions coloniales, les ports des Antilles néerlandaises jouant principalement, comme il sera vu plus bas, un rôle de redistribution des produits pétroliers du Venezuela. On retrouve évidemment, à l’intérieur des empires, la même diversité pour les investissements. Dans l’Empire colonial britannique, c’est encore la supériorité des Dominions qui est écrasante, par rapport aux autres terri-5 5. Hoffherr (R.) et Bousser (M.), « L’Afrique du Nord et les colonies », France écono mique, 1938, p. 426-438, tableau p. 432.
Grandes et petites provinces impériales
toires. Ils absorbent en 1939 environ deux tiers de l’investissement total des Anglais dans leur Empire, position analogue à celle des échanges commer ciaux. Si on y ajoute l’Inde, on obtient un total de 83 %. Les autres territoires sont réduits à 17 %, dont 7,5 % pour l’Afrique (sans l’Afrique du Sud), et à peu près la même valeur pour l’Asie du Sud-Est (Malaisie, Birmanie, Ceylan, Hong Kong)6. En ce qui concerne l’Empire français, en utilisant les travaux de Jacques Marseille, qui se fondait, entre autres, sur une enquête officielle de 1943, on note qu’environ 60% des investissements vont à l’Afrique du Nord, 17% à l’Indochine, 14% à l’Afrique occidentale, le reste, soit à peu près 7 % se partageant entre Madagascar et les autres terri toires, les pays sous mandat, il est vrai, étant exclus de l’enquête7. Ceci confirme l’importance pour la France de ses territoires africains, qui repré senteraient environ trois quarts du total de ses placements de capitaux, ce qui sous-estime peut-être, d ’ailleurs, les placements effectués en Indochine. La logique géographique est sans doute celle qui permet le mieux de donner un aperçu des différentes possessions, en cherchant, comme on l’a fait au chapitre précédent, à mesurer les éléments qui en font, dans une logique coloniale, l’importance: population, ressources, prospérité, intérêt géostratégique, mais, aussi, attachement historique pour des lieux qui évoquent des épisodes ou des acteurs de la grande aventure des nations euro péennes. On mettra à part les Dominions britanniques, créations originales, et qui méritent d ’être présentés ensemble. On fera aussi un sort spécial à l’Empire des Indes, continent (ou sous-continent), à lui seul. On ne se dispensera pas, çà et là, de quelques notes impressionnistes empruntées aux clichés coloniaux du temps, mais qui peuvent aider à reconstituer une atmosphère.
Tournée dans les Empires Les Dominions Ces États méritent une mention particulière, car ils apparaissent comme la plus belle réussite de la colonisation britannique. Aucune autre puissance coloniale ne possède l’équivalent de cet ensemble, dont l’appui est ressenti à Londres comme d ’autant plus précieux qu’il est celui de pays prospères, dont la culture, les populations, les genres de vie, présentent de profondes affinités avec celles de la métropole, et dont les institutions sont à peu près identiques. Ils diffèrent en cela de colonies dont le loyalisme, même s’il existe, ne peut être de même qualité, dans la mesure où il ne peut reposer sur les mêmes sympathies, au sens fort du terme.
6. Rippy (J.F.), British Investment in Latin America, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1959, p. 185 sq. 7. «L’investissement fiançais dans l’Empire colonial: l’enquête du gouvernement de Vichy (1943) », Revue historique, 1974, p. 409 sq.
51
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
L’expression de « Dominion », à peu près intraduisible (« domination », « possession »), a été utilisée pour la première fois en 1867, lors de l’établis sement de la fédération canadienne, dotée d’institutions représentatives qui en faisaient un État autonome, sous le sceptre de la monarchie britannique. Elle aurait été choisie de préférence à celle de « royaume » qui aurait choqué la sensibilité républicaine des États-Unis très vivante à cette époque. Par la suite, la création du Canada a été suivie de celle d’autres fédérations: Australie (1901), Nouvelle-Zélande (1907) et Afrique du Sud (1910). Il existe, depuis 1921, un cinquième Dominion, l’Irlande, qu’on ne cite ici que pour mémoire, non pas que ce pays ne puisse figurer dans une histoire de l’Empire britannique, comme c’est généralement le cas chez les auteurs anglophones, mais plutôt parce qu’on ne saurait sans abus de langage assi miler ce pays à un « outre-mer ». Ce sont, d ’abord, de véritables colonies de peuplement. Aucune des dépendances d ’une autre puissance européenne ne regroupe un ensemble aussi important de populations d ’origine européenne. Le total de ces popula tions, environ 20 millions d ’habitants (10,5 au Canada, 7 en Australie, 1,6 en Nouvelle-Zélande et 2 millions en Afrique du Sud), n’est certes pas très impressionnant. Les colons originaires des îles britanniques, Anglais, Écos sais et Irlandais n’en représentent pas la totalité, les trois quarts au maximum. Ces quelque 15 millions sont issus, directement ou indirectement, du courant qui, en un siècle, a dirigé définitivement au-delà des mers une population qu’on peut évaluer à 6 ou 7 millions d ’hommes. Ils constituent « le trait original de l’Empire britannique quand on le compare aux autres empires : la multitude des immigrants qu’il a reçus de la mère-patrie et qui, dans les immenses espaces libres des continents nouveaux, constitueront des Angle terre nouvelles »8. Le nombre, à lui seul, n’est pas suffisant pour expliquer cette capacité à modeler des pays neufs à l’image, sinon à l’imitation, de la métropole. La nature des pays colonisés, vastes, peu peuplés, aux climats favorables à la transplantation de pionniers originaires d’Europe, a constitué un élément décisif, qui ne se retrouve pratiquement dans aucune autre possession colo niale. Ces facteurs ont donné toute sa portée à des conditions qui se retrouve raient ailleurs : la position prédominante qu’a value aux colons l’appui de la métropole, la solidarité créée par les institutions, la religion, le loyalisme envers la couronne, les capacités techniques et intellectuelles. L’Angleterre y a ajouté le souci de doter ces pays des institutions les plus proches possible de celles dont jouissaient les citoyens britanniques, atmosphère de libéra lisme politique et économique qui ne se retrouve pas vraiment ailleurs. Il faut bien avouer aussi que l’installation massive des colons a coïncidé avec le refoulement systématique des populations indigènes, pour lesquelles il n’a jamais été question de tels droits, et dont ne subsistent plus que quelques débris, sauf en Afrique australe. 8. Demangeon (A.), L'Empire britannique, A. Colin, 1923, p. 51.
52
Grandes et petites provinces impériales
Certes, des nuances seraient à apporter. Au Canada, la communauté québecquoise francophone et catholique demeure réticente à la fusion avec les Anglo-Saxons protestants, tandis que l’influence économique et culturelle des États-Unis va croissant. En Afrique du Sud, les souvenirs de la guerre des Boers, vieux de moins de trente ans, amènent la majorité blanche afri kaner d’origine hollandaise à manifester un nationalisme qui va jusqu’à la franche hostilité. Les gouvernements nationalistes exigent et obtiennent, en 1927, que le drapeau sud-africain bleu, blanc et orange, soit arboré aux côtés de VUnion Jack, et que l’hymne afrikaner (Die Stem van Suid Afrika, litt. L ’appel de l ’Afrique du Sud) coexiste avec le God Save the King. Leurs pasteurs ou juristes préfèrent les universités de théologie ou de droit hollan daises comme celle de Leyde, d ’Utrecht ou d ’Amsterdam (où existe une chaire de culture afrikaner), à celles de Grande-Bretagne9. Malgré tout, la puissance britannique tend à minorer ces oppositions. En revanche, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, aux populations plus homogènes, plus isolées aussi, ne connaissent pas les mêmes réserves, et leur fidélité à la mère-patrie est proverbiale. L’économie, par ailleurs, constitue un facteur de cohésion. Le niveau de développement dépasse largement le concept de « mise en valeur » couram ment appliqué aux colonies et aux pays neufs. Canada, Australie et Nouvelle-Zélande comptent parmi les plus gros exportateurs mondiaux de produits alimentaires, tandis que les ressources minières font la prospérité de l’Afrique du Sud. Leurs populations (blanches du moins) jouissent d’un niveau de vie élevé. Ces pays attirent, comme on a pu le voir plus haut, la plus grande partie des capitaux britanniques outre-mer, et figurent au premier rang des partenaires commerciaux de la Grande-Bretagne. Ces courants sont assez forts pour créer de solides liens d ’intérêt. La raison des chiffres vient ainsi compléter les élans du cœur, voire pallier leurs intermittences. Les Dominions constituent, aussi, des relais indispensables de la puis sance britannique dans le monde. Leur force militaire, économique et morale est devenue assez importante pour qu’il paraisse tout simplement impossible de s’engager dans une épreuve de force majeure sans leur accord. Depuis 1887, des Conférences impériales réunissent leurs Premiers Ministres autour de celui de la Grande-Bretagne. Leur appui fut décisif lors de la Première Guerre mondiale. On en a encore bien vu l’importance en septembre 1922, à propos de la crise qui opposait l'Angleterre et le gouvernement turc de Mustapha Kémal. Le veto de coopération de l’Australie, de la NouvelleZélande et de l’Afrique du Sud qui ont refusé d’engager leur diplomatie et leur armée dans un conflit qui ne leur apparaissait pas comme d ’une impor tance vitale, a obligé les Britanniques à évacuer la zone des Détroits, que ses troupes occupaient depuis octobre 1918, et donc à renoncer à imposer leur politique de démembrement des territoires turcs. Preuve d’une émancipation croissante, dont il sera reparlé plus bas. 9. Haley (K.H.D.), The British and the Dutch, Londres, George Philip, 1988, p. 229.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
L ’Empire des Indes Le gouvernement britannique des Indes (souvent désigné du terme local de Raj), occupe une place à part, incomparable en superficie et en population à n’importe quel territoire colonial, avec ses 4 67S 000 km2 et ses 380 mil lions d ’habitants. Les plus peuplées des onze provinces, le Bengale, Madras, et les Provinces unies d ’Agra et d ’Oudh sont chacune plus peuplée que la Grande-Bretagne (une cinquantaine de millions d ’habitants). Le plus impor tant de ces États princiers, le Hyderabad, représente quinze millions d’habi tants, soit l’équivalent de l’Afrique du Nord française. Son souverain, le Nizam, parent par alliance du dernier sultan ottoman, dont la fille a épousé l’héritier du trône, passe pour l’un des hommes les plus riches du monde. Il a droit au salut de 21 coups de canon, comme le Roi-Empereur George lui-même. Mais ici l’infiniment petit se juxtapose à l’infiniment grand, car le plus grand nombre des princes n’administre que de très petits territoires, allant de la taille du Luxembourg à celle de Monaco, voire de simples villages. À côté de cette immensité, les débris des empires plus anciens en terre indienne ne représentent plus grand-chose. C ’est d ’abord Goa, ancienne capitale de l’Empire portugais d ’Asie, et ses dépendances de Damao et Diu (3 800 km2 et 600 000 habitants). Ce sont encore les « cinq comptoirs » fran çais de Pondichéry, Chandernagor, Yanaon, Mahé et Karikal (au total 500 km2 et moins de 300 000 habitants), mais aussi des « loges » de Mazulipatam, Balassore, Cassimbazar, Dacca, Surate, Calicut. Éparpillés, démilita risés en vertu des conventions imposées par l’Angleterre en 1814, les comp toirs comptent bien moins dans leurs échanges avec la France que l’île de la Réunion, et leur fonction se réduit trop souvent à fournir l’occasion d ’un exercice mnémotechnique (non exclusif de «poésie pure») aux écoliers français. Quant aux loges, on en ignore même assez largement la superficie, et les limites exactes, quand ce n’est pas l’emplacement10. La diversité s’ajoute à l’immensité. La variété des types physiques, des ethnies, des langues (une vingtaine de langues principales, mais 1652 seront recensées en 1971), des coutumes, des religions, des castes, atteint une complexité qui n’a sans doute d ’équivalent dans aucune autre construction politique. Il n’est donc pas étonnant que l’Inde constitue un Empire à elle seule, et, de ce point de vue, la proclamation de Victoria comme impératrice des Indes en 1877 n’a fait qu’entériner un état de fait. Cet empire est bien, concrètement, l’héritier de la Compagnie anglaise des Indes orientales, qui avait conquis puis administré le territoire depuis le XVIIIe siècle jusqu’à la révolte des Cipayes de 1857, dont elle fut jugée en partie responsable, ce qui précipita sa dissolution. Il n’en est pas moins vrai que les souverains britan
10. Weber (J.), Pondichéry et les comptoirs de l’Inde après Dupleix, Denoël, 19%; Dianoux (H.-J. de), Les loges françaises aux Indes et au Bangladesh et les îles Spratly, Académie des Sciences d’outre-mer, 1986.
54
Grandes et petites provinces impériales
niques peuvent apparaître aussi comme les successeurs de la grande dynastie musulmane des empereurs moghols, maîtresse de la plus grande partie du pays depuis le XVIe siècle, et réduite depuis par les succès anglais, à un rôle de pure représentation, avant de voir son dernier représentant déposé en 1858, pour connivence avec les rebelles. Ce n’est pas par hasard, du reste, que les autorités britanniques ont choisi en 1911 de faire construire la nouvelle capitale destinée à remplacer Calcutta tout à côté de l’ancienne Delhi, lieu de la résidence de ces monarques. « Aussi longtemps que nous gouvernerons l’Inde, déclarait en 1901 Lord Curzon, son dernier grand vice-roi d ’avant la guerre mondiale, nous serons la plus grande puissance mondiale. Si nous la perdons, nous tomberons directement au rang d ’une puissance de troisième ordre »u . Rien d ’étonnant dans cette affirmation, si l’on songe que les Indes représentent, à elles seules, huit fois la population de la métropole, trois quarts de la population de l’Empire britannique, et plus de la moitié de la population de l’ensemble des empires européens. Un colonisé sur deux vit aux Indes. À la possession d ’un véritable sous-continent s’ajoute l’intérêt de la position géostratégique de celui-ci, relais vers la Chine, l’Asie du Sud-Est et l’Océanie. Le souci de protéger l’Inde, et ses abords explique bien des efforts expansionnistes britanniques. La protection des frontières terrestres, outre l’occupation de la Birmanie, a entraîné un quasi-protectorat sur le Tibet (1904) et des combats incessants avec les tribus de la frontière afghane, marqués notamment par les deux grandes guerres de 1836-1841 et 1878-1880. Elle impose aussi une surveillance constante à l’égard des Russes, maîtres de l’Asie centrale. Depuis 1907, un accord de partage divise la Perse en zones d’influence, Moscou se réservant la partie nord, Londres la partie sud. Ainsi se complète la surveillance des accès maritimes de l’Inde par le golfe arabo-persique, l’autre accès, par le canal de Suez, étant assuré par l’installation en Égypte. Ces charges ont une contrepartie : la disposition d ’un réservoir apparemment inépuisable de troupes utilisées sur tous les fronts. Mais les arguments économiques pèsent aussi très lourd. Que l’Inde ait été, depuis sa conquête, un élément essentiel de la prospérité britannique est une évidence. Ce fiit notamment le cas au XIXe siècle, où le pays constitua un marché privilégié pour les industries anglaises, et notamment celle des cotonnades, mais aussi la métallurgie (création d ’un des plus longs réseaux ferrés du monde), et l’argent-métal, très recherché en Inde comme moyen de paiement. Dans le sens inverse, les productions locales (coton, jute, thé, indigo, mais aussi opium) achevaient de faire la fortune des négociants et des marins. En même temps, les placements de la métropole affluaient, attirés par des rendements avantageux, eux-mêmes garantis par une gestion financière rigoureuse, assurée par une administration efficace. Certes, depuis1
11. Judd, Empire, the British Imperial Experience from 1765 to the Present, Londres, Harper & Collins, 1996, p. 32S.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
le début du siècle, cette situation s’est modifiée et les positions de la GrandeBretagne ont été peu à peu rognées par la concurrence étrangère et par la naissance d ’une industrie indienne. Cependant, Inde et Ceylan demeurent en 1937 les premiers clients de la Grande-Bretagne, dont ils absorbent encore plus de 8 % des exportations, devant les Dominions et les États-Unis, tandis qu’ils se placent au troisième rang de ses fournisseurs (7,5 % de ses importa tions). Ils sont le troisième champ d ’investissements britanniques à l’exté rieur, avec 406 millions de livres, derrière l’Australie (522 millions), à peu près à égalité avec le Canada (395 millions) mais devant l’Argentine et les États-Unis. Les transferts de capitaux représentent encore environ 15 % des revenus invisibles de la balance des paiements britannique. L’Inde est d’ailleurs un exportateur important de matières premières : elle fournit la presque totalité de la production mondiale de jute ; elle est le deuxième producteur et le deuxième exportateur mondial de coton, après les ÉtatsUnis, et le premier exportateur de thé (60 % des exportations avec Ceylan). L’attachement à l’Inde est aussi, dans une large mesure, sentimental. L’Inde apparaissait au début du siècle comme « le plus noble trophée du génie britannique, et le plus splendide apanage de la Couronne impériale »,2. La fierté d’avoir soumis et unifié un pays plus vaste et plus peuplé qu’il n’en fut jamais dans l’histoire, reste toujours bien vivante. Il s’y ajoute souvent l’idée d ’avoir, plus qu’ailleurs dans ce pays, contribué à susciter la rencontre de deux civilisations et de deux cultures, celle de l’Occident et celle de l’Orient. Ce sentiment est d’autant plus aigu que, comme on le verra, dans aucune colonie, britannique, française ou autre, n’est posée depuis aussi longtemps et de manière aussi nette la question, qui paraît partout ailleurs bien prématurée à l’époque, de l’émancipation et de l’indépendance. L'Asie du Sud-Est Peut-on, à propos des Indes néerlandaises, éviter le cliché, reproduit dans toute étude coloniale qui se respecte, et dont on retrouve encore l’écho dans les guides touristiques contemporains, de « ceinture d ’émeraude qui serpente le long de l’équateur », tirée de l’écrivain hollandais Multatuli, qui ne s’in terdit pas pour autant, d’ailleurs, de dénoncer en son temps (vers 1860) l’ex ploitation du pays ? Sans doute pas, faute de manquer un trait de l’imaginaire de l’époque. Deux fois et demie moins étendues, six fois moins peuplées que les Indes anglaises, les Indes néerlandaises font, plus qu’elles peut-être, l’ad miration des spécialistes des autres puissances coloniales pour leur organisa tion et leur mise en valeur. « D’autres empires l’emportent sur celui-ci par leur dimension et leur variété, écrit ainsi en 1940 le géographe français Charles Robequain ; il n’en est point qui offrent un exemple plus impression nant du fait colonial»1213. Les réalisations des Hollandais dans ces «îles 12. Curzon (G.-N.), Russia in Central Asia in 1889 [1889], Londres, Frank Cass, 1967, p. 14. 13. Robequain (Ch.), « Problèmes de colonisation dans les Indes néerlandaises », Annales de Géographie, 1941, p. 37-57,114-136,180-195.
56
Grandes et petites provinces impériales
bénies » (René Maunier), ont fait, en particulier, l’objet d’un examen attentif de la part des fondateurs de l’Indochine française voisine, Paul Bert et son gendre, Joseph Chailley, deux grands animateurs du « parti colonial » fran çais. On s’y tend encore entre les deux guerres comme à « la Mecque de la politique coloniale », pour y prendre, selon l’expression de Paul Reynaud, ministre français des Colonies de passage à Java en 1931, des «leçons» de ces «grands maîtres en colonisation» que sont les Hollandais1*. Les pratiques suivies à l’égard des indigènes même paraissent particulièrement scientifiques. L’attitude à l’égard des musulmans, qui représentent la majo rité écrasante de la population, a bénéficié, notamment, des conseils du grand islamologue Snouck Hurgronje (1857-1936), qui y séjourna de 1889 à 1906. Mais c’est surtout la richesse de la colonie qui frappe. Des Britanniques comme Lord Hailey n’hésitent pas à considérer le pays comme la plus riche des dépendances coloniales existantes. Les investissements hollandais ont quintuplé entre 1900 et 1929. Le développement du pays peut apparaître comme un compromis harmonieux entre Européens et indigènes, la grande entreprise européenne prédominant dans l’exploitation minière, mais coexis tant avec la production indigène dans la production de denrées agricoles d’exportation. Le pays est ainsi le deuxième réservoir mondial de denrées tropicales, après l’Empire britannique. Le territoire produit notamment un tiers du caoutchouc, un tiers du copra, 17 % de l’étain (îles de Banka, Biliton et Singkep), la presque totalité du poivre consommés dans le monde1415. Une recherche agronomique particulièrement poussée améliore sans cesse la qualité des produits, et les agronomes tropicaux du monde entier viennent s’instruire dans les instituts de recherche installés sur place, comme l’Institut sucrier de Pasaeroan. « Le paradis, écrit un voyageur, se trouve au jardin botanique de Java », à Buitenzorg (aujourd’hui Bogor), qui a servi de modèle à de nombreux jardins d ’essais des pays coloniaux, et, sur une centaine d’hectares, ne réunit pas moins de 15 000 essences du monde entier16. La production pétrolière indonésienne, dominée par les intérêts britanniques, avec la Royal Dutch Shell (57% de la production en 1940), vient au cinquième rang mondial. Bien que cette production représente moins de 3 % du total mondial, elle vaut par sa position stratégique, car le pays est le seul grand producteur de la zone Asie-Pacifique, bien avant la Birmanie, ce qui n’est pas sans éveiller les convoitises japonaises. Bien que moins étendue (132 000 km2) et moins peuplée (5 400 000 habi tants), la Malaisie britannique peut apparaître, à bien des égards, comme une rivale en prospérité. Le cuivre, l'étain, le caoutchouc, en font une source de
14. Reynaud (R), Mémoires, t.1, Flammarion, 1960, p. 313, 316; voir aussi Wesseling (H.-L.), «Le modèle colonial hollandais dans la théorie coloniale française, 1880-1914», Revuejrançaise d'histoire d ’Outre-mer, 1976, p. 223-254. 15. Purcell (V.), « L’Asie sud-orientale », in Toynbee (A.), ed., Le Monde en mars 1939, Gallimard, 1958, p. 128-129. 16. Eliade (M.), L’Inde, L’Herne, 1988, coll. Méandres, p. 116.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
matières premières également notable, sans parler de l’importance de ses plantations d ’ananas, qui viennent immédiatement après celles de l’Amé rique centrale pour les exportations. Surtout, en dépit d ’un certain déclin, Singapour demeure le carrefour commercial de toute la région. Le port franc fondé en 1819 sur cette petite île située au sud du détroit de Malacca reçoit tous les produits de l’Asie du Sud-Est (et en particulier ceux des Indes néer landaises) pour les réexpédier vers le Japon, l’Europe et les États-Unis, notamment le caoutchouc, le pétrole et l’étain. L’importance de ce commerce classe la Malaisie au premier rang des colonies britanniques pour les expor tations (derrière l’Inde). Preuve de cette prospérité : la contribution du pays à la construction de la grande base navale appelée à constituer le pivot de la présence militaire anglaise dans l’Asie et le Pacifique (12 millions de livres sur un coût total de 20 millions)17. De la Birmanie voisine, enfin (604000 km2, 16 millions d ’habitants), les Britanniques ont fait le « bol de riz de l’Asie », en particulier dans le grand delta de l’Irrawaddy, dont ils ont encouragé la mise en valeur à partir de la fondation de Rangoon (1872). Ce pays, grâce à la densité relativement faible de la population, dispose de surplus qui lui permettent d ’exporter à lui seul 28 millions de tonnes de riz en 1932, soit plus que les deux plus grands exportateurs suivants, le Siam (15 millions) et l’Indochine française (11 millions)18. Deux tiers de cette production sont exportés vers l’Inde et Ceylan. Une exploitation de pétrole déjà ancienne représente, quoique faible, le deuxième poste des exportations en valeur. Face aux possessions hollandaises et britanniques, qui forment un ensemble beaucoup plus vaste et peuplé, cette «France d ’Asie» qu’est l’Indochine française ne fait pas mauvaise figure, avec ses 740 000 km2 et ses 23 millions d ’habitants. Quatrième producteur mondial de riz, le pays en est, comme on vient de le voir, le troisième exportateur, grâce essentielle ment à la mise en valeur de la province de Cochinchine, qui correspond au delta du Mékong. Il est un des grands producteurs mondiaux de caoutchouc (loin, il est vrai, derrière les colonies citées plus haut), et de jute. La région est le sixième fournisseur et le huitième client de la France en 1936, et son deuxième partenaire colonial, après l’Afrique du Nord. Elle est, comme on l’a vu, le deuxième foyer de placement des investissements français dans l’Empire, loin, il est vrai, derrière le Maghreb. Un excellent réseau routier y a été construit, orgueil de la colonisation française. On rêve autour du surnom de la RC (route coloniale) n° 1, la « route mandarine », célébrée par l’écrivain Roland Dorgelès, qui forme l’épine dorsale du système, en joignant sur 2 600 km les quatre capitales de Hanoi, Hué, Saigon et Phnom Penh. Le chemin de fer du Yunnan, qui relie, depuis 1910, Hanoi à Yunnan Fu (aujourd’hui Kun Ming) et s’est poursuivi par le Transindochinois qui achève de joindre Hanoi à Saigon à la veille de la guerre, est aussi une belle réalisation. Le Nord connaît un début de développement industriel, avec une
17. Purcell (V.), art. cit., p. 127. 18. Annales de Géographie, 1934, p. 333.
Grandes et petites provinces impériales
production charbonnière notable (anthracite de Dong Trieu, dont une partie est exportée), des filatures, des industries alimentaires. Cette importance est aussi géopolitique. À ceux qui objectent l’éloigne ment et la difficulté de défendre ce territoire éloigné, les responsables fiançais, comme le gouverneur général Merlin, répondent que, grâce à cet établissement « la France est en mesure de suivre, et de suivre de près, tous les événements qui peuvent se dérouler en Extrême-Orient et dans le Paci fique »19. Comment d’ailleurs, souligne cet administrateur, ne pas être attaché à ces pays aux paysages splendides, aux cultures anciennes et raffinées, qu’é voquent les palais et les parcs de Hué ou les temples d ’Angkor, aux popula tions, laborieuses autant que déconcertantes ? N’y aurait-il pas là, pour les Français, l’équivalent de ce que sont les Indes pour les Britanniques ? Les approches de la Chine Indochine française et Birmanie avaient été conçues, lors de leurs occupa tions, comme des moyens d ’accéder à l’immense marché chinois, en remon tant vers le nord. En fait, les espoirs d’un accès facile par les grands fleuves, notamment ceux nourris par les Français dans l’exploration du Mékong et du Fleuve Rouge ont été déçus. Le chemin de fer du Yunnan, déjà cité, n’a qu’un impact tardif et limité, faute d ’un prolongement jusqu’au Yang Tse. En fait, l’ouverture (forcée) de la Chine s’est faite essentiellement par des implantations sur les points les plus intéressants de ses façades maritimes. Ces implantations n’ont que très rarement abouti à de véritables colonies. La plus importante est Hong Kong, qui apparaît, avec Singapour, comme le pivot de la puissance britannique en Asie. Premier port chinois, ce territoire d ’un millier de km2 alors peuplé de moins d ’un million d ’habitants est, en 1938, le deuxième pays du monde pour le commerce en dollars par tête d ’habitant, derrière les possessions hollandaises des Caraïbes, et le premier en dollars par km220. On décrit déjà avec lyrisme l’impression de puissance et de prospérité qui se dégage des massives maisons à arcades de Victoria, des énormes buildings qui escaladent la montagne, des longs quais de granit21. En revanche, la rive opposée de la rivière des Perles, la vieille possession de Macao, occupée depuis 1557 par les Portugais, paraît tombée en léthargie. Les Français, de leur côté, possèdent à bail, à environ 500 km plus à l’ouest, le territoire de Kouang-Tchéou-Wan, cédé en 1899 dans les mêmes condi tions que les « nouveaux territoires de Hong Kong », et qui n’a pu, malgré les espoirs, concurrencer la grande colonie britannique22. Par ailleurs, Européens et Américains continuent à bénéficier, dans les ports importants,
19. L’Empire colonialfrançais, 1929, p. 99. 20. INSEE, Quelques aspects fondamentaux, p. 325-326. 21. Sion (J.), L’Asie des moussons, in Vidal de la Blache, Géographie universelle, A. Colin, 1928, p. 137. 22. Pondeveaux (L.), «La situation des établissements français de l'Océanie», La Géographie, janvier-juin 1938, p. 272-275.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
de « concessions », c’est-à-dire de quartiers dont ils assurent l’administration et la police, et où ils peuvent éventuellement entretenir des troupes. Si quelques-unes d’entre elles ont été rendues à la Chine (Hankou par l’Angle terre en 1927), la majorité, dont les plus importantes (Tien-Tsin, Canton, Shanghai), existent toujours. Shanghai, peuplée de trois millions et demi d ’habitants, avec ses deux concessions, internationale au nord, (qui résulte de la fusion des concessions anglaise et américaine), et française au sud, est le principal centre du commerce européen en Chine. Dans les années trente, cette ville concentre le tiers de l’industrie chinoise, et le tiers des investisse ments étrangers (mais l’essentiel des investissements français)23. C ’est aussi un des principaux foyers de rayonnement de la culture occidentale en Chine. Il faut signaler enfin que les Européens continuent à bénéficier en Chine de l’exterritorialité, c’est-à-dire qu’ils échappent à la juridiction des tribunaux chinois. Ces possessions asiatiques ne sont pas détenues sans angoisse par l’Europe. Depuis l’entrée fracassante du Japon dans le club des grandes puis sances, à l’issue de la guerre victorieuse sur la Russie en 1905, suivie de la révolution chinoise de 1911, nombre d ’essayistes évoquent la perspective d’un réveil de l’Asie, qui balayerait les colonies étrangères. Ces craintes, qu’a exprimées le fantasme de « péril jaune », n ’ont pas cours en ce qui concerne les autres continents, dont la possession paraît plus assurée. L ’Afrique au sud du Sahara Face à ces pays prospères et peuplés, l’Afrique noire souffre encore, en Europe, d ’une image négative, trop souvent misérabiliste. La difficulté des accès terrestres et maritimes, l’absence de produits susceptibles d ’attirer le grand commerce, la réputation de « barbarie » des habitants, ont exercé un effet répulsif durable. Jusqu’au début du XIXe siècle en fait, le seul trafic qui y fut envisagé fut l’abominable traite des hommes, menée sur une échelle et avec des moyens différents par les Européens et par les Arabes. Ce n’est, comme on l’a vu plus haut, que très tardivement que le phénomène de conquête coloniale, succédant à la simple implantation de comptoirs, a provoqué le partage du continent. La place de celui-ci dans l’économie mondiale reste globalement bien limitée par rapport à celle de l’Asie. Certes, comme partout, les réalités sont très diversifiées. La partie dont la contribution à l’économie globale est la plus importante est sans doute formée par l’Afrique australe et ses abords. La pièce maîtresse de cet ensemble est constituée par l’Afrique du Sud, dont l’économie fut successi vement portée par les deux booms rapprochés du diamant (1867), puis de
23. Lassalle (J.M.), « L’aménagement et le développement économique de la Concession française de Shangaï », Là France en Chine (1843-1943), Presses académiques de l’Ouest/ Ouest Éditions, 1997, p. 224.
Grandes et petites provinces impériales
Tor (1886). Autour de cet ensemble, le plus anciennement mis en valeur, gravitent la Rhodésie du Nord et du Sud, et le Congo belge, avec la province du Katanga ainsi que les possessions portugaises, (Angola et Mozambique). Outre l’or déjà cité, dont la Rhodésie du Sud et le Congo belge sont aussi des fournisseurs importants, ces pays produisent des matières premières essen tielles à l’industrie mondiale, par exemple le cuivre de Rhodésie du Nord et du Katanga, respectivement premier et deuxième producteurs africains, qui assurent près de 40% de la production mondiale; ou des métaux rares, comme le chrome et le cobalt. Le Congo belge, l’Angola, et l’Union sudafricaine sont, avec la Gold Coast, les premiers producteurs mondiaux de diamants. L’agriculture spéculative connaît également un certain développe ment : grands domaines du Haut Veld de l’Afrique du Sud pratiquant l’éle vage, mais aussi la culture des céréales, notamment du maïs ; plantations de cultures tropicales variées, souvent encore embryonnaires, notamment dans les territoires portugais, mais déjà développées dans les territoires britan niques et belges (tabac, coton, canne à sucre, palmiers à huile, cacao, mais aussi élevage). Ce ne sont pas seulement les activités économiques, qui reposent avant tout sur l’exploitation minière, qui rapprochent ces pays. Ils constituent un marché de main-d’œuvre partiellement intégré, les colonies portugaises exportant notamment une partie de leurs travailleurs vers l’Afrique du Sud et le Congo belge. Les investissements effectués le sont de manière prépondé rante à l’initiative des mêmes grands groupes capitalistes anglo-saxons (126 millions de dollars d ’investissements britanniques, essentiellement dans les installations du port de Beira et les chemins de fer d’Angola, sur 167 millions de capitaux privés)24. Ils sont également rapprochés par un réseau de chemins de fer qui représente près de deux tiers de la longueur totale du réseau exploité au sud du Sahara, et se trouve totalement intercon necté à la veille de la guerre. Les débouchés en sont les ports du Cap, de Durban en Afrique du Sud, de Lourenço-Maïquès et de Beira au Mozam bique, de Lobito en Angola. Au total, ces pays apparaissent remarquablement équipés par rapport au reste du continent noir, ce qui ne coïncide pas forcé ment avec le bonheur des populations. Ailleurs, la production de matières premières ou de produits alimentaires tropicaux (arachides, cacao, huile de palme, café, sisal) demeure la seule ressource pour des économies encore fort peu développées, et où, faute de ressources minières équivalentes à celles de l’Afrique centrale ou australe, continue à prédominer l’économie dite «de traite», qui consiste dans l’échange de produits agricoles indigènes contre des objets fabriqués, les uns et les autres étant de faible valeur. Là encore, les territoires britanniques sont beaucoup plus prospères, avec le Nigeria, et la Gold Coast en Afrique occi dentale. La Gold Coast assure alors un tiers de la production mondiale de
24. Hailey (Lord), The Future of Colonial Peoples, p. 36.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
cacao, mais est aussi le deuxième producteur de diamants du monde, et un producteur notable d ’or. Le Nigeria avec un territoire grand comme le tiers de l’Empire des Indes, et une population évaluée à près de 20 millions d’ha bitants, rassemble près de 45 % des sujets africains de la Grande-Bretagne, Afrique du Sud non comprise. C’est un gros producteur d ’huile de palme et d ’étain. Le territoire français le plus important, l’AOF, presque six fois plus vaste que le Nigeria (4754000 km2 contre 800000), est moins peuplé (15 millions d’habitants), et son commerce global en 1938 est de presque moitié inférieur, comme l’est d ’ailleurs le montant total des investissements effectués25. Il faut dire que, en dépit de leur aspect impressionnant sur la carte, les territoires français sont handicapés par l’immensité d ’espaces dont une bonne partie chevauche la bordure méridionale du Sahara, parfait exemple de ces «terres légères» dont, ironisait le ministre des Affaires étrangères britannique Lord Salisbury à l’issue d ’un célèbre traité signé en 1890, le coq gaulois aime gratter le sol de ses ergots. L’AOF comporte cependant deux territoires dont les ressources sont importantes : à l’ouest, le Sénégal ; à l’est, la Côte-d’Ivoire, dont les économies sont respectivement fondées sur les exportations d ’arachides (40 % des exportations en valeur de l’AOF) et de cacao. Le contrôle des territoires sous mandat du Togo et du Cameroun, qui avaient fait l’objet d ’une mise en valeur allemande non négli geable, ajoute à la valeur de cet ensemble. Étalée sur 27 degrés de latitude, entre le désert du Fezzan au nord et la basse vallée du Congo au sud, l’Afrique équatoriale française est, entre les deux guerres, l’exemple le plus marquant d ’un groupe de colonies attardées, au point qu’on la surnomme couramment « cendrillon coloniale ». Ce groupe de possessions, dont l’histoire fut « courte et mélancolique », selon l’expres sion du plus marquant des hommes politiques français spécialistes des ques tions coloniales, le radical Albert Sarraut, sort tout juste de l’état de misère dans lequel l’a plongé le système dit des « grandes compagnies concession naires ». Le transfert de la mise en valeur du pays à des sociétés privées, pourvues du monopole du commerce d ’importation et d’exportation, s’est traduit, essentiellement entre 1899 et 1914, par une économie de pillage des ressources végétales locales et par l’exploitation des populations. Tandis que près de 10000 navires, d ’un tonnage de 11 millions de tonnes, ont desservi l’AOF en 1936, en débarquant pour plus d ’un milliard de francs de marchan dises, le chiffre se réduit, pour l’AEF, à environ 700 navires, pour un tonnage et une valeur dix fois moindre. La seule exportation importante est celle du bois. Le Voyage au Congo suivi de Retour du Tchad, d ’André Gide, parus en 1927 et 1928, le reportage d ’Albert Londres Terre d ’ébène (1929), ou encore les pages de Céline dans son Voyage au bout de la nuit (1932) achèvent de lui valoir une triste réputation. Les efforts financiers consentis n’ont pourtant pas manqué, dont le meilleur exemple est le chemin de fer Congo-Océan. Il
25. Statesman’s Year Book, 1939 ; The Colonial Problem, p. 280 (chiffre des investisse ments de 1934).
62
Grandes et petites provinces impériales
faudra l’odyssée de la France libre, qui fera, pour un temps, de Brazzaville sa capitale, pour donner à ces pays une image moins négative, au prix, il est vrai, de très grands sacrifices exigés des populations. L’Afrique orientale est essentiellement sous contrôle britannique. Les trois principaux territoires, le Kenya, l’Ouganda et le Tanganiyka (1700000 km2, douze millions d ’habi tants), ont, dans l’économie coloniale, un rôle important, si l’on en juge par le montant de leurs échanges commerciaux, équivalent à celui du Ghana ou du Nigeria. En l’absence de produits minéraux importants, on y a développé essentiellement les produits végétaux (sisal, coton, et café). La « Grande fie » de Madagascar (616 000 km2, 4 millions d ’habitants), exportatrice non seule ment de produits de luxe (sucre), mais aussi de produits de consommation plus courante (riz et viande), apparaît comme une réussite agricole peut-être moins brillante, mais comparable. Mais les Français en apprécient aussi la valeur stratégique, puisque, flanquée au nord par les Comores, à l’est par la Réunion, elle donne à la France un balcon important sur l’Océan indien. La come de l’Afrique est encore une zone stratégique, où les puissances coloniales, au début des années trente, occupent des territoires destinés à contrôler la rive sud du détroit de Bab el-Mandeb, avec un regard sur le Yémen et l’Arabie, au nord, l’Éthiopie au sud: d’ouest en est Éiythrée italienne, Côte française des Somalis avec Djibouti, Somaliland britannique, et Somalie italienne comptent moins de deux millions d ’habitants. Seule l’Érythrée a connu un début de mise en valeur ; Djibouti, grâce au chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba, est le poumon des échanges éthiopiens, ce qui lui vaut un commerce faible, mais non négligeable. La question essen tielle est celle des ambitions de Rome sur la région, constantes depuis l’oc cupation de l’Érythrée, puis de la Somalie par l’Italie (1889-1891), et l’occu pation manquée de l’Éthiopie après la sanglante bataille d ’Adoua en 1896. Autant qu’un pays de ressources effectives, l’Afrique, encore peu déve loppée, apparaît comme une terre de promesses. À la fin de son remarquable ouvrage sur les investissements en Afrique, le professeur Frankel, de l’uni versité de Johannesburg, écrit : « si l’expérience du XXe siècle en Afrique a prouvé quelque chose, c’est que les richesses de l’Afrique sont encore à peine découvertes, simplement parce qu’elles gisent dans le sol africain luimême. Elles n’en sortiront que par l’effort conjoint des Africains et des Européens... le rideau ne fait que se lever sur la scène africaine - la pièce reste à jouer »26. Cette phrase, qui vaut pour les réalités économiques, vaut aussi pour les réalités politiques. C’est sans doute en Afrique que les puis sances coloniales paraissent le plus solidement installées, en dépit de signes encore peu perceptibles à la plupart des Européens.
26. p. 429.
Frankel (S.H.), Capital Investment in Africa, Londres, Oxford University Press, 1938,
63
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Le monde arabe Au nord du continent africain, l’ensemble qui s’étend de l’Atlantique au canal de Suez appartient, historiquement et culturellement, au monde arabe et musulman, fils de la Méditerranée et de l’Islam. Bien plus proche de l’Europe, il participe plus étroitement de sa vie économique et de son histoire. a) L’Afrique du Nord et l’Égypte L’Afrique du Nord, Algérie, Tunisie et Maroc, vaste de 750 000 km2, non compris le Sahara, peuplée d ’environ 17 millions d ’habitants, située à une journée de mer de Marseille, est considérée comme le fleuron de l’Empire colonial français. Elle apparait comme l’achèvement d’un projet politique poursuivi avec constance par tous les régimes qui se sont succédés depuis 1830, ébauché avec la conquête d ’Alger par la Restauration, puis de l’Algérie sous la Deuxième République et le Second Empire, auxquels se sont ajoutés successivement les deux protectorats de la Tunisie et du Maroc sous la IIIe République. Le coût en hommes et en argent de ces efforts font de l’Afrique du Nord, d’un point de vue sentimental, l’équivalent de l’Inde pour les Britanniques, à une différence d’échelle à laquelle les Français sont naturellement peu sensibles. Il est vrai qu’ils y ont cherché un enracinement tout autre. Premier partenaire commercial de la France, ces pays déroulent la richesse de leurs vignobles, de leurs champs de céréales, de leurs planta tions d’arbres fruitiers, d ’oliviers, d ’agrumes, et de primeurs : les quelque 60 000 hectares de vignes de la Mitidja, les 900 000 palmiers de l’oued Djerid, les quatre millions d ’oliviers de l’olivette de Sfax, figurent au nombre des plus grandes fiertés de la colonisation française. On s’extasie sur la beauté des villes blanches, éclatantes de modernisme, baignées par la Méditerranée, pleines de vie et d ’activité, dont les quartiers indigènes fournissent sans risques aux touristes un exotisme facile, sans parler d ’amours tarifées, masculines et féminines. On magnifie le courage et l’énergie du peuple nouveau que constituent les Français d ’Algérie, « race vigoureuse et saine, trempée par le rude climat ». On célèbre à l’envi le loyalisme des popula tions envers la métropole, manifesté par la conduite des Zouaves et des Tirailleurs, dont, avec ceux des troupes de Marine et de Légion, les drapeaux figurent parmi les plus décorés au cours du conflit mondial. Il est vrai que, selon tous les plans élaborés par les États-majors, l’Afrique du Nord doit fournir, en cas de conflit européen, grâce à la mobilisation des colons et des indigènes, un appoint militaire indispensable à la Défense nationale. Cette admiration s’adresse, notamment, au Maroc, qui, sous la direction du maréchal Lyautey, a vu, depuis 1912, son économie s’ouvrir sur l’exté rieur et se développer d’une façon spectaculaire, et qui fascine les spécia listes du monde entier, avec ses grands ports, ses plantations qui en font une « Californie africaine ». D’aucuns, comme le jeune Brasillach, dont le père y
64
Grandes et petites provinces impériales
fut tué en 1914, y voient « la terre même de la jeunesse de la nation ». Les Anglais même sont sensibles à cette réussite. Le « grand colonial » britan nique que fut Lord Milner, organisateur de l’Union sud-africaine après la guerre des Boers, ne s'exclamait-il pas en 1925 : « Qu’avons-nous à montrer de comparable au développement du Maroc sous la direction brillante et énergique du général Lyautey ? »27. On sait comment, la même année, deux torpilleurs britanniques fuient dépêchés pour rendre les honneurs au Maréchal, lors du passage au large de Gibraltar du paquebot qui le ramenait du Maroc, alors qu'une manœuvre politicienne sans grandeur l’avait amené à rentrer en France. Malgré tout, l'Algérie, grâce à sa position centrale, qui fait la jonction entre Maroc, Tunisie et AOF, à l'ancienneté de l’implantation française, à l’importance de ses échanges avec la France et à son statut de groupe de départements français, demeure la clé de voûte du système, non seulement maghrébin, mais africain. Un adage fréquemment rapporté sou ligne que « s’il n'y avait plus d’Algérie française, il n 'y aurait plus d ’Afrique française». À l’Afrique du Nord française ne peut en réalité se comparer que l’Égypte. Ce pays a bénéficié d’une politique de réformes juridiques et d ’une série de modernisations économiques amorcées par le Pacha Mohammed Ali (1805-1849) et ses successeurs depuis le début du XIXe siècle, et poursuivie par les occupants britanniques, sous l’impulsion notamment de Lord Cromer, qui l'adm inistra de 1883 à 1907. L’Égypte est le plus peuplé des États du monde arabe (peut-être 17 millions d’habitants). C ’est sans doute alors aussi le pays le plus riche. La production cotonnière, introduite et développée grâce à une utilisation systématique des eaux du Nil, la place encore au sixième rang dans le monde, mais toujours au premier rang pour la qualité, grâce à son « Jumel longues fibres », qui a pris le nom de l’ingénieur français qui en imposa la culture. Le canal de Suez, qui fête ses soixante-dix ans en 1939, et voit passer environ 6000 navires par an, pour un tonnage de 30 millions de tonnes et un nombre de passagers proche de 300 000, est une artère vitale du commerce mondial, et un élément fondamental de la puis sance navale britannique, dans la mesure où il permet la circulation rapide des flottes (y compris les unités de très gros tonnage), mais aussi des troupes de l’Empire entre l’Atlantique et l’Océan indien. On a calculé notamment qu’il abrégeait de 40 % la durée du trajet maritime entre Liverpool, Bombay ou Singapour. 44 % des actions du capital de cette société, de droit égyptien, et à direction française, sont contrôlés par le gouvernement britannique, à la suite d’une initiative du Premier ministre Disraeli en 1876, qui s’est alors porté acquéreur de la part de l’État égyptien, corrigeant ainsi la négligence de ses prédécesseurs pour l’œuvre de Ferdinand de Lesseps. Ajoutons que, par le Soudan dit « anglo-égyptien » (deux millions et demi de kilomètres carrés, près de six millions d ’habitants), qui relève de la 27. p. 174.
Halpéiin (V.), Lord Milner et l'évolution de l’impérialisme britannique, PUF, 19S0,
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
souveraineté conjointe de la Grande-Bretagne et de l’Égypte («condomi nium ») mais est en fait administré par eux seuls, les Britanniques réalisent la jonction de l’Égypte avec l’Afrique des Grands Lacs, et s’assurent ainsi la maîtrise des sources du Nil. Ils augmentent en même temps leurs ressources en coton, dont ils implantent la culture au sud de Khartoum. Cette situation ne sera menacée qu’à partir de 1935 par l’occupation italienne de l’Éthiopie, qui crée un voisinage dangereux. Ceci explique que, bien que le protectorat britannique sur l’Égypte soit terminé depuis 1922, et que, à ce titre, elle ne fasse plus partie de l’Empire, la présence britannique y soit très pesante. Cette situation n’a d ’équivalent que la présence des États-Unis dans la zone de Panama, autre route vitale du commerce maritime mondial. Entre ces deux ensembles de possessions riches et peuplées, la Libye italienne (1754000 km2, 800000 habitants), fait assez pâle figure, bien que le fascisme consacre des moyens importants à l’implantation de colons destinés à y enraciner solidement la présence européenne, et à démontrer le dynamisme du régime. Il faut attribuer ce fait au caractère généralement désertique de cet immense territoire, peu peuplé et alors de faibles res sources, mais aussi au fait que la présence italienne, qui remonte à 1912, a été presque totalement balayée par la Première Guerre mondiale, ce qui a entraîné, depuis 1922, une véritable conquête du pays, alors tout juste achevée. b) Le Moyen-Orient Ce nom est d ’origine britannique. D’un point de vue anglais, en effet, à prédominance géostratégique, les pays situés entre l’Égypte et le Golfe cons tituent un « Orient du milieu », entre la Méditerranée et les Indes. Pour les Français, au contraire, cette région est demeurée le « Levant » ou le ProcheOrient ; autrement dit un Orient familier, fréquenté depuis les Croisades par le commerce français, et où les élites arabophones s’expriment souvent en français. Outre le contrôle de la route des Indes par Suez, déjà évoqué, les Britan niques se sont assurés celui de la route terrestre qui, de la Méditerranée, permet l’accès au golfe arabo-persique. Maîtres depuis le XIXe siècle des côtes arabes allant des embouchures du Chott el-Arab (protectorat sur le Koweit en 1899) jusqu’à Oman, ils occupent, depuis la Première Guerre mondiale, la Palestine, la Transjordanie et l’Irak. Les Français, faute d ’avoir pu jouer un rôle militaire suffisant dans cette région pendant la guerre de 1914-1918, ont dû se contenter de la Syrie et du Liban, auxquels les liens commerciaux et culturels traditionnels, que leurs responsables étaient dési reux de conserver, les attachaient plus particulièrement. Les deux ensembles représenteraient respectivement 550 000 km2 et un peu plus de cinq millions d ’habitants pour les territoires sous contrôle britannique, et 200000 km2 et trois millions et demi d’habitants pour ceux qui sont sous contrôle français. Le potentiel économique de ce « croissant fertile », de mise en valeur agri cole ancienne, doté d’un réseau urbain conséquent, et dont les besoins en
66
Grandes et petites provinces impériales
équipements de toute sorte ne sont pas niables, paraît justifier de grandes espérances, d ’autant plus que les élites locales paraissent fort désireuses de modernité et de progrès. Là encore, les Britanniques se sont taillé la part du lion. L’activité commerciale des territoires placés sous leur influence est incomparablement plus grande, notamment grâce au dynamisme de la colonie juive en Palestine ; l’Irak est alors le principal producteur de pétrole du monde arabe. Certes, la production de la région est encore relativement faible, avec un total de moins de six millions de tonnes en 1938 (2 % du total mondial), dont un peu plus de quatre millions en Irak, et un million pour Bahreïn, ce qui représente l’équivalent de la production des Indes néerlandaises ; l’Arabie produisant moins de 70000 tonnes. Mais à cette production s’ajoute celle, voisine, et un peu plus ancienne, des champs pétrolifères d ’Iran (10 millions de tonnes par an), exploités dès avant la guerre, dans une région proche de la frontière avec l’Irak et le Koweït. Les espoirs fondés sur des réserves dont on connaît ou dont on pressent déjà l’importance, la possibilité d ’exporter la quasi-totalité de la production, vu l’insignifiance de la consommation locale, et la proximité du marché européen (importations globales de 40 millions de tonnes) rendent la région particulièrement attractive. Déjà s’affirme sur place la prépondérance des grands groupes anglo-saxons. L’exploitation est contrôlée essentiellement par des compagnies où prédominent les capitaux anglais, Royal Dutch Shell et Anglo-Iraman Co. Mais la France, aux côtés des compagnies anglaises et américaines, occupe une place non négligeable en Irak, grâce à la part importante des capitaux français dans l’IPC (23,75 %). L’Irak est d ’ailleurs depuis 1935 le premier fournisseur de la France en pétrole brut28. Comme en Inde, la question qui se pose le plus gravement dans cet ensemble, est celle de son émancipation politique. C’est le cas au MoyenOrient, dont le partage en 1919 a suscité colère et déceptions au sein des classes dirigeantes, et où achève de se mettre en place l’explosive question de la Palestine. C’est aussi, à un moindre degré, le cas au Maghreb, où les accents triomphalistes des autorités ne suffisent pas à masquer un réel malaise, à la fois politique et économique. Amériques Si l’on excepte le Canada, il ne reste plus grand-chose de la présence européenne en Amérique du Nord: citons la grande île de Terre-Neuve (110000 km2, plus de 400000 avec le Labrador, moins de 300000 habi tants), qui symbolise à elle seule une rivalité franco-anglaise vieille de trois siècles. La prise de possession au nom du roi de France François Ier remonte
28. 157.
J.G., «Le pétrole en Asie sud-occidentale», Annales de Géographie, 1940, p. 154-
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
à 1527, mais l’île revendique le titre de plus ancienne colonie britannique, puisque la première installation de colons originaires de ce pays remonte à 1583. Si le territoire relève de Londres depuis le traité d ’Utrecht de 1713, les Français ont conservé des droits de pêche sur la côte occidentale, et celui d ’y créer des établissements destinés à traiter le poisson pêché, et notamment la morue, droits confirmés par le traité d'Entente cordiale de 1904. Au sud de Terre-Neuve, les îles Saint-Pierre-et-Miquelon, également consacrées à la pêche, subsistent comme seuls et minuscules vestiges de l’occupation fran çaise (250 km2, 4000 habitants). Des possessions plus conséquentes se trou vent plus au sud, aux latitudes tropicales. Une partie des archipels de la mer Caraïbe, arc de cercle entre la pénin sule mexicaine du Yucatán et le delta de l’Orénoque, au Venezuela, consti tuent un premier ensemble de possessions. Ces îles, dont la plus vaste est la Jamaïque anglaise, furent, au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, au cœur de la grande histoire coloniale, et même mondiale, lors de l’affrontement des grandes puissances maritimes pour le contrôle des communications vers l’Amérique du Centre et du Sud, et pour la mainmise sur la production mondiale de sucre. Bien que la part de ces régions ne représente plus qu’une proportion très faible de la production de cette denrée, leur économie reste fondée avant tout sur la monoculture sucrière. C’est ainsi qu’en Martinique, le sucre et le rhum représentent trois quarts des exportations en valeur en 1935, le reste consistant essentiellement en bananes. Certaines cependant jouissent d’une nouvelle prospérité, fondée sur l’activité pétrolière. C’est le cas de la colonie anglaise de Trinidad, qui produit à l’époque la quantité non négligeable de deux millions et demi de tonnes par an. Sa capitale, Port of Spain, dispose d ’une industrie de raffinage, tout comme les îles hollandaises de Curaçao et d'Aruba, où est raffinée une partie du pétrole du Venezuela29. Les Guyanes représentent un second ensemble. La partie la plus pauvre est certainement la Guyane française, que les bagnes de Cayenne et de SaintLaurent du Maroni continuent à auréoler d’une fort sinistre réputation (5 620 déportés en 1936 sur 30 876 habitants). Ce n’est qu’en 1937, à la suite d’une série de campagnes de presse inaugurée en 1923 par les repor tages d’Albert Londres et dénonçant la condition inhumaine des prisonniers, que le gouvernement français prend un décret de fermeture qui ne sera d’ailleurs exécuté que dix ans plus tard. Ce pays malsain, qui « a dévoré ses habitants », n’exporte qu’un peu d ’or et quelques bananes. Il souffre de la comparaison avec ses deux voisines hollandaise (Surinam) et britan nique (Guyana), beaucoup plus peuplées, respectivement de 170000 et 350 000 habitants. Ce sont également des pays dotés de ressources non négli geables, quatrième et sixième producteurs mondiaux de bauxite, dont l’es sentiel est exporté vers les États-Unis, et notables producteurs d ’or, mais
29. Sorte (M.), Mexique, Amérique centrale, in Vidal de la Blache (dir.), Géographie universelle, A. Colin, 1928, p. 211.
Grandes et petites provinces impériales
également de produits tropicaux. Pourtant, en 1938, invité à assister à une conférence tenue à Londres sur la Guyane hollandaise, l’ambassadeur des Pays-Bas avoue ne pas pouvoir dire grand-chose de ce pays, preuve d ’une méconnaissance, assez générale en Europe, des problèmes coloniaux qu’on retrouvera plus tard30. Malgré tout, l’ensemble des possessions britanniques dans la région représentent, en 1936, moins de 1 % des importations, 2 % des exportations, et 1 % des investissements de la Grande-Bretagne, ce qui est très peu à côté de ses intérêts en Amérique du Sud31. La puissance politique de l’Europe est, elle aussi, en déclin. L’Angleterre fut, depuis le XVIIIe siècle, la puissance maritime dominante dans l’hémisphère, au point d ’y garantir, dans les années 1820, l’indépendance toute fraîche des colonies espagnoles et portu gaises. Mais elle s’est effacée devant les États-Unis, maîtres, depuis 1898, de Porto Rico, et, depuis 1914, du canal de Panama, ouvert la même année. Fait significatif, l’escadre qui stationnait aux Caraïbes a été retirée dès 1903. En revanche, la flotte britannique conserve, comme on l’a évoqué plus haut, un réseau de positions essentielles pour le contrôle des routes commerciales de l’Atlantique nord, mais aussi de celles qui se dirigent vers l’Amérique du Sud. Il ne faut pas oublier que l’Atlantique représente à cette époque environ 70 % du trafic maritime mondial. Là encore, un intérêt sentimental s’attache à ces vieilles terres, ces «bijoux de fam ille», selon une expression de Paul Reynaud, liées aux débuts de l’épopée coloniale, qui évoquent la fortune de mer, la flibuste, mais aussi la nonchalance d ’une vie rêvée dans le lent balancement des palmes agitées par la brise, la luxuriance des fleurs et l’abondance des fruits. Les Français, incurables nostalgiques, se délectent, même quand ils sont républicains, aux souvenirs d’une société créole qu’illustra l’impératrice Joséphine ; les Anglais, plus réalistes, évoquent le temps où l’on disait « Rich as a West Indian ». L’imagination des uns et des autres a tendance à oblitérer ce qui fut le pivot de ces sociétés, c’est-à-dire la traite et l’esclavage. Bien des inégalités sociales et bien des discriminations raciales ont survécu à leur abolition, qui remonte alors à tout juste un siècle pour les Britanniques (1833), un peu moins pour les Français (1848), et tout juste trois quarts de siècle pour les Hollandais (1860 pour les Indes néerlandaises et 1863 pour les possessions des Caraïbes). Le Pacifique Sud Le Pacifique, mis à part l’Australie et la Nouvelle-Zélande, reste, à bien des égards, un ensemble d ’archipels ignorés ou méconnus.
30. Sanderson (Y.), «A journey in Dutch Guiana», Royal Geographical Society, 1939, p. 465-490. 31. Political and Strategie Interests, p. 236.
69
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Pas plus que les autres, pourtant, les régions dites des « Mers du Sud » n’ont échappé à l’emprise de l’Europe, « au contact des baleiniers, des plan teurs, des trafiquants, comme des missionnaires, des savants, des administra teurs et des marins ». C’est le cas, à l’ouest, de la « Méditerranée mélané sienne », qui s’étire de l’énorme Nouvelle-Guinée (775 000 km2) partagée entre la Hollande, l’Australie et la Grande-Bretagne aux îles Fidji britan niques en passant par la Nouvelle-Calédonie française ou le condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides. Mais il en va de même, au centre, de la Micronésie, partagée entre Anglais (Nauru), Français (Tahiti), Américains (Hawaii), Néo-Zélandais (Samoa), Japonais (Mariannes) et Chiliens (île de Pâques). Peu peuplées (moins de deux millions d ’habitants), dispersées sur peut-être cent millions de km2, ces terres sont d’un apport très marginal pour le capitalisme mondial, même si certains pays mieux partagés que d’autres, connaissent un développement économique plus actif (canne à sucre aux Fidji, copra aux îles Salomon). Les paysages merveilleux et la douceur des populations insulaires, popularisés avant la guerre par les écrits d ’un Stevenson et d ’un Loti ou les peintures de Gauguin, cachent une réalité beaucoup plus décevante32. À l’immensité des distances (dix jours de bateau entre Nouméa et Papeete), s’ajoutent les rigueurs d ’un climat sujet à des «déchaînements d ’une violence exceptionnelle»: éruptions volcaniques, tremblements de terre, raz-de-marée, inondations ou, au contraire, longues sécheresses33. Petit cabotage, petites exploitations coloniales, ou délais sement complet sont le lot habituel. Selon un jugement de 1930, «les indigènes, peu nombreux, sauvages ou demi-civilisés, paresseux, et les Européens, en petit nombre également et paralysés par le manque de main-d’œuvre, n’y ont créé qu’un faible courant commercial»3435. Les territoires britanniques représentent moins de 3% des échanges de la Grande-Bretagne avec l’Empire. Le cas des terres françaises est aussi carac téristique : l’Océanie française, organisée autour de Tahiti, ou bien la Nou velle-Calédonie (pourtant deuxième producteur mondial de nickel, avec, il est vrai, 8 % seulement de la production mondiale, contre 88 % au Canada), présentent des chiffres de population, des budgets et des chiffres de mouve ment commerciaux qui ne les placent guère devant la Guyane française, comme en témoigne le tableau suivant :
Guyane Nouvelle-Calédonie Océanie
Population
Budget
Commerce
30000 33000 43000
17 millions 30 millions 14 millions
67 millions 113 millions 73 millions
(chiffres de 1936)3S. 32. Stevenson (R.L.), lit the South Seas (voyages de 1888-89) ; Gauguin, Noa Nou, 1901. 33. Doumenge (F.), L’Homme dans le Pacifique Sud, Société des Océanistes, 1966, p. 3-6. 34. Privat-Desvchanels (P.), L’Océanie, in Vidal de la Blache (dir.), Géographie univer selle, A. Colin, 1930, p. 278. 35. L’Année coloniale, 1936, Revue d’histoire des Colonies, 1938.
70
Grandes et petites provinces impériales
H faut dire qu’à cette époque, « le Pacifique, comparé à la Méditerranée ou à l’Atlantique, est dans son ensemble désert », le trafic entre la côte ouest des États-Unis et l’Asie étant relativement faible, et plus encore celui entre Pacifique nord et Pacifique sud36. La croissance du Japon, celle de la côte ouest des États-Unis sont loin d ’avoir atteint le niveau qui, cinquante ans plus tard, ajoutée à celle des « dragons asiatiques », en fera une des zones les plus actives du globe. Des évaluations américaines de l’époque estiment la valeur des échanges au cinquième du commerce mondial. Ces îles consti tuent cependant des escales sur les routes maritimes, et des relais nécessaires à la pose de câbles télégraphiques transocéaniques, comme les îles anglaises évoquées plus haut. Ceci seul suffirait à en justifier l’occupation. Autres terres On n’a parlé plus haut que des principaux territoires. Mais il faudrait un livre entier pour présenter l’ensemble des terres que, avec un appétit insa tiable, ou bien avec une minutie de collectionneurs, les puissances coloniales ont ajouté à leur patrimoine foncier et humain. Il y a, d ’abord, ce qu’on pourrait appeler les terres inconnues, ou plutôt négligées et oubliées. Si l’on peut supposer que la majorité des Britanniques ont entendu parler de l’île de Sainte-Hélène, qui a une base militaire depuis l’exil de Napoléon, on peut se demander si beaucoup d ’entre eux ont entendu parler de ses dépendances, les îlots de Tristan da Cunha, Nightingale, Gough et Inaccessible Island la bien nommée, situés à 2 000 km plus au sud. Lequel d’entre eux pourrait situer l’îlot de Pitcairn, sur lequel vivent toujours environ 200 descendants des mutinés du Bounty (quelques milliers vivant dans d’autres îles, notamment Norfolk), sinon par le film de Frank Lloyd produit par la MGM en 1935, et dans lequel s’affrontent Clark Gable et Charles Laughton? Quel Français (à part les marins) connaît l’îlot de Clipperton, situé dans le Pacifique à 1 300 km des côtes mexicaines, en dépit de l’arbitrage de 1931 qui en a confirmé la possession à la France au détri ment des revendications du Mexique ? Ou bien encore, à part quelques diplo mates spécialisés, qui est au courant des prétentions françaises sur la baie de Cheikh Saïd, en face de Djibouti (1 622 km2, un millier d’habitants), occupée en fait par les Yéménites, prétentions qui n’ont d’ailleurs pour objet que d ’écarter les ambitions des Italiens installés en Érythrée ? Et combien de terres vides, minuscules, éparpillées aux quatre vents des océans ! À côté de ces océans marins, il faudrait évoquer, aussi, ces véritables océans terrestres que sont les déserts. Le plus remarquable est sans doute l’immense Sahara, vaste de huit millions de km2, environ trois fois l’étendue de la Méditerranée. L’essentiel revient à la France, avec cinq millions de km2, partagés entre l’Algérie, l’AOF et le Tchad, qui ne représentent pas moins de
36. J.-R., « Les routes maritimes de l’Empire », Annales de Géographie, 1939, p. S0.
71
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
40% de la superficie de l’Empire colonial. Conquis, pour sa plus grande partie, entre 1900 et 1914, peu peuplé (peut-être un peu plus d ’un million d’habitants), encore peu exploité, il apparait surtout comme un espace de jonction pour l’Empire français. Cette jonction est potentielle plus que réelle, car, bien que pacifié par les méharistes des Compagnies sahariennes, traversé par des pistes « impériales » que parcourent des services réguliers d ’autocar ou de camion, et survolé par des lignes aériennes, le Sahara n’est pas parcouru par des courants d’échanges comparables à ceux qui contournent l’Afrique par la voie de mer. Le seul axe de pénétration demeure donc, à l’est, la vallée du Nil, rouverte en 1898 par les armées du sirdar Lord Kitchener, qui permet aux Britanniques une liaison facile entre l’Égypte et le Soudan. Moins gênant, parce que moins étendu, le Kalahari, qui occupe la plus grande partie du Sud-Ouest africain et du Bechuanaland, ou encore ces grandes forêts tropicales et équatoriales, comme les jungles d ’Asie ou les forêts denses d’Afrique, ou bien encore, les énormes massifs montagneux du nord de l’Inde, vides ou peu peuplés. Faute d’attirer alors beaucoup d ’hommes et de capitaux européens, ces pays sont le lieu d’élection d’une poignée de militaires chargés d ’y affirmer la souveraineté de leurs pays, et surtout des aventuriers, explorateurs, prospecteurs, chercheurs d ’or, ou coupeurs de bois. Ainsi définie, la vision de la carte des empires précise-t-elle les ensembles les plus importants au regard de la situation, des ressources, des liens poli tiques, et partant, du surcroît d ’importance qu’ils confèrent à leurs métro poles, dans une perspective mondiale : les quatre Dominions, l'Empire des Indes, les Indes néerlandaises, pourraient être considérés comme les sept grands de cet ensemble, suivis, à des places honorables, par l’Afrique du Nord française, l’Égypte, l’Asie du Sud-Est, puis encore, par le Congo belge et l’Afrique de l’Ouest britannique. Le reste des territoires est bien en arrière. Aucun, pourtant, ne paraît suffisamment dépourvu d ’intérêt pour être abandonné. Il y a toujours une ressource, une position, un noyau de popula tion, voire le souvenir d’un sacrifice, qui justifie un maintien. Surtout, on a de la peine à imaginer, alors qu’on commence tout juste à s’interroger sur l'opportunité de donner l'indépendance à des territoires riches et peuplés, qu’on puisse le faire à l'égard de pays pauvres, et moins encore de terres désolées, dont on saisit mal comment elles pourraient assumer leur destin par leurs propres moyens.
72
Chapitre 3
Organisation et structures politiques : com plexité, diversité et ressem blances
Ces empires sont, par définition, unis sous une autorité commune, qui les dote d'une certaine personnalité. Tout se décide en dernier ressort dans la capitale de la métropole, sous l'impulsion des pouvoirs métropolitains, gouvernements, parlements, et aussi tribunaux de suprême instance. Mais les empires frappent aussi par le manque d ’homogénéité de leur oiganisation. Sauf exception, le caractère disparate de possessions acquises à des époques différentes, à l’issue de traités qui ont imposé des exigences diverses, occu pées et mises en valeur sous l'effet de doctrines qui ont varié, et peuplées d'hommes appartenant à des sociétés et à des cultures profondément dissem blables, a conduit à des constructions complexes. Ceci est naturellement d'autant plus vrai que les empires sont anciens dans le temps et étendus dans l’espace. C’est de cette complexité qu’il convient de rendre compte ici, en même temps que des éléments, concrets ou symboliques, destinés à cimenter cet ensemble ou à faire croire à sa cohésion. Principes juridiques Complexité des régimes politiques Un premier élément à remarquer est le peu de fondement politique du terme d’empire lui-même. Quoique couramment utilisé pour parler des possessions coloniales de telle ou telle puissance, le terme d ’empire n’a, le plus souvent, qu’un très faible contenu juridique. L’expression de British Empire, utilisée depuis le milieu du xvn* siècle, figure sur nombre de docu ments officiels, mais il n’y a pas pour autant d ’empereur, ni de constitution d ’Empire, tout au plus des oiganismes de coordination, mis au point pour la plupart au début du XXe siècle. Ce qu’écrivait en 1885 l’historien britannique John Robert Seeley, à propos de l’Empire des Indes, est valable pour l’en
73
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
semble des possessions: «nous le tenons à distance de manière que sa destinée n'est pas mêlée trop étroitement à la nôtre »*. L’habitude de parler « d ’Empiie français », singulièrement depuis la fin de la guerre mondiale, n’implique aucun changement dans les institutions de la m c République, dont la Constitution d ’ailleurs ne fait nulle part mention des colonies. Il n’en va guère différemment en Italie, même si Mussolini s’empresse de pro clamer, dans le célèbre discours qu’il prononce au balcon de la place de Venise le 9 mai 1936, après l’occupation d ’Addis-Abeba par ses troupes, « la réapparition de l’Empire sur les collines sacrées de Rome ». Le terme générique de « colonie », employé par facilité, est juridiquement inadéquat. Pour qualifier les statuts juridiques des différents territoires, on doit recourir au moins à quatre concepts : Dominion, colonie, protectorat, et mandat. En gros, et sans prétendre ici faire autre chose qu’aborder la ques tion, on peut dire que les Dominions sont des territoires dont la population est majoritairement anglo-saxonne ; les colonies, des possessions de peuplement à majorité indigène, sur lesquels la souveraineté européenne est totale ; les protectorats, des pays dont les institutions traditionnelles ont été maintenues, en échange de la soumission à une puissance européenne. Quant aux mandats, ils sont une création toute récente. Ils ne relèvent pas de la souve raineté d ’une puissance coloniale quelconque, mais de la Société des Nations, qui en a confié la gestion à des puissances dites « mandataires », mais conserve un droit de contrôle sur leur administration. Ils se subdivisent entre mandats A (Irak, Jordanie, Palestine, Syrie et Liban), B (Togo, Cameroun, Tanganyika), selon que la mission du mandataire est d ’exercer une tutelle indirecte et transitoire jusqu’au moment où ces pays « seront capables de se conduire seuls » (mandats A), ou bien d ’en assumer l’administration plus directement en raison de leur moindre degré de développement politique moyennant quelques limitations, notamment l’égalité commerciale. Pour mémoire, il existe aussi des mandats C, encore moins contraignants que les mandats B, puisque « ils ne sauraient être mieux administrés que sous les lois du mandataire, comme partie intégrante de son territoire » ; ils sont respecti vement placés sous la tutelle de l’Union sud-africaine (Sud-Ouest africain), de l’Australie (Nouvelle-Guinée) et le la Nouvelle-Zélande (Samoa). Si, bien évidemment, tout empire relève politiquement et administrative ment d ’une métropole, il s’en faut que tous les territoires qui le composent soient toujours rattachés à une même et seule administration. C’est vrai, surtout, des deux empires les plus vastes, français et britannique. L’Empire britannique ne relève pas, en 1939, de moins de cinq ministères : le Colonial Office, le Dominion Office, VIndia Office, le Burma Office, et le Foreign Office. Le Colonial Office, dont la fondation remonte à 1853, a vocation à exercer son action sur l’ensemble des colonies. Mais cette règle souffre deux grandes exceptions. Tout d ’abord, l’Empire des Indes n’a jamais relevé de ce1 1. Seeley (J.R.), L’expansion de l’Angleterre, traduit par Baille (J.B.) et Rambaud (A.), Colin, 18%, p. 363.
Organisation et structures politiques : complexité, eliversité et ressemblances
départem ent Depuis 1858, et la disparition de la Compagnie des Indes, un ministère particulier, Y India Office, a la responsabilité de l’ensemble des possessions indiennes, à l’exception de Ceylan. Ce n’est qu’en 1937 que la Birmanie en est détachée pour dépendre d ’un ministère particulier. Ceci reflète la très large autonomie du régime politique d ’un pays où les fonction naires britanniques sont, en théorie, employés au service d ’un État indien, et non des représentants de l’État anglais. D faut observer que les relations avec les voisins immédiats de l’Inde relèvent largement des autorités britanniques de ce pays, soit qu’elles aient une autorité directe sur eux, ce qui est le cas d ’Aden et des émirats protégés du Golfe (Bahreïn, Koweït), soit qu’elles fournissent les personnels en poste dans ces pays, lors même qu’ils relèvent du Foreign Office (Afghanistan, Népal, Tibet, mais aussi Perse et Arabie Saoudite). Après divers remaniements, ce n’est qu’à la veille de la guerre (1937), qu’Aden, détachée de VIndia Office, devient colonie de la Couronne, et que les protectorats sont rattachés au Foreign Office, changement qui est sans doute en relations avec l’évolution du sous-continent vers une plus grande autonomie. Par ailleurs, du Dominion Office, séparé en 1925 du Colonial Office, dépendent non seulement l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l’Union sud-africaine et l’Irlande, mais aussi la Rhodésie du Sud, largement autonome, ainsi que certains protectorats de l’Afrique australe (Bechuanaland, Swaziland, Basutoland). Quant au Foreign Office, il a la charge des affaires de l’Égypte et du Soudan, pays dont le premier est en théorie un État indépendant depuis 1922, et dont l’autre est un « condomi nium » relevant de la souveraineté conjointe de l’Égypte et la GrandeBretagne. Il supervise de la même manière les relations avec l’Irak, indépen dant depuis 1932, comme on l’a vu, mais étroitement lié à l’Empire par des accords de défense qui impliquent une occupation militaire. L’Empire français dépend, de même, de trois ministères: l’Intérieur (Algérie), les Affaires étrangères (Maroc, Tunisie, Syrie, Liban), et les Colo nies. Ces affectations révèlent des différences de statut : l’Algérie n’est pas exactement une colonie, puisqu’elle se compose en droit de trois départe ments français, ce qui, autant que la proximité de la métropole, justifie ce statut particulier. En revanche, la Tunisie et le Maroc restent des États souve rains qui ont accepté, en vertu de traités de droit international (signés respec tivement en 1881 et 1912), de déléguer leur défense, leurs relations exté rieures, et plus généralement les réformes destinées à moderniser leurs structures, à l’État français. Le statut mandataire, essentiellement provisoire, on l’a vu, de la Syrie et du Liban justifie leur rattachement à un ministère qui, de plus, a toujours eu un intérêt spécial pour les questions du Levant, qu’il s’agisse du défunt Empire ottoman ou de l’Égypte. Tous les autres terri toires relèvent du ministère des Colonies, créé en 1894, pour soulager de cette mission le ministère de la Marine, qui était traditionnellement depuis l’Ancien Régime investi du gouvernement de l’outre-mer. Les essais de regroupement sous une même direction se sont révélés infructueux. En 1929, le ministre des Colonies André Maginot demande en
75
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
vain l’institution d’un « ministère de la France extérieure » ; quant à l’essai de créer un grand ministère de l’Outre-mer, coiffant les territoires dépendant des Colonies, de l’Intérieur et des Affaires étrangères, et confié à un techni cien plutôt qu’à un politique, l’ambassadeur Henry de Jouvenel, il ne dure que le temps du gouvernement Daladier, formé le 29 janvier 1934 et démis sionnaire après l’émeute du 6 février, soit moins de dix jours2. Tout au plus le terme de France d ’outre-mer remplace celui de « colonial » pour désigner l’École coloniale, devenue École nationale de la France d ’Outre-mer, et le Conseil supérieur des Colonies, rebaptisé Conseil supérieur de la France d ’Outre-mer3. Il est vrai que dans ces établissements siègent des représen tants d ’autres ministères que celui des Colonies. À un niveau régional, le projet de créer un ministère de l’Afrique du Nord n’a jamais vu le jour ; tout au plus des «Conférences nord-africaines» réunissent-elles régulièrement les représentants des trois dépendances françaises au Maghreb. On trouve moins de complexité dans les autres empires, étant donné leur moins grande étendue et leur plus faible dispersion géographique : au Portugal, en Belgique, de même que les possessions néerlandaises, un seul ministère, dit ministère des Colonies, englobe l’ensemble des possessions coloniales. Encore le régime des possessions hollandaises est-il, depuis une réforme de 1922, qui les a proclamées « partie intégrante » du royaume, tout en leur reconnaissant une large autonomie de gestion, plutôt proche de celui des Indes britanniques que de celui des colonies proprement dites. Depuis avril 1937 et l’occupation de l’Éthiopie, la dénomination de ministère de l’Afrique italienne a remplacé celle de ministère des Colonies, le Duce prenant personnellement la direction de ce département En Espagne, le vieux ministère de Y Ultramar, dont le nom évoquait les temps glorieux de la conquête des Amériques, a été supprimé après l’effondrement de 1898, et remplacé par une simple Direction du Maroc et des colonies, placée sous l’autorité des Affaires étrangères, avant de revenir, à l’occasion de la guerre du Rif, sous l’autorité directe du Président du Conseil, mesure imposée par le dictateur Primo de Rivera et maintenue jusqu’en 1956. Les dénominations ne doivent pas abuser: ces ministères eux-mêmes peuvent regrouper, à l’intérieur d ’un même empire, des territoires de statut fort différent. L’exemple du Colonial Office britannique est le plus frappant, puisque ses services ont à superviser simultanément l’administration de colo nies, mais aussi de protectorats, et de territoires sous mandat. Les colonies proprement dites, appelées plus précisément colonies de la Couronne (Crown colonies), constituent, comme leur nom l’indique, des possessions au sens littéral, totalement soumises à l’Empire de la législation votée par le Parlement de Londres, et où le pouvoir est exercé directement par des fonc tionnaires britanniques. Ce sont, le plus souvent, des territoires peu étendus, 2. Bulletin du Comité de l’Afrique française, 1929, p. 38 ; voir aussi Dictionnaire des Parlementairesfrançais (1889-1940), PUF, 1960-1977. 3. Décrets du 21 décembre 1934 et du 26 décembre 1933.
76
Organisation et structures politiques : complexité, diversité et ressemblances
comme les Antilles, les îles du Pacifique, Chypre ou encore des ports et de bases (Singapour, Malte, Gibraltar, Hong Kong) ; mais c’est le cas aussi de Ceylan, de la Rhodésie du Sud, du Kenya, de la Gold Coast. Les protectorats sont eux-mêmes de deux sortes: ceux dans lesquels la souveraineté est exercée par la Couronne britannique, qui laisse cependant l’exercice de l’au torité aux dynasties locales ; et ceux qui conservent leur souveraineté, tout en déléguant à la puissance coloniale, représentée par un résident, une partie de leurs prérogatives, en matière de relations extérieures, de défense. Si le premier système est le plus étendu (en Afrique notamment, avec en particu lier les grands émirats musulmans du Nord Nigeria, mais aussi l’Ouganda et Zanzibar), le second connaît une grande extension en Orient, et notamment en Malaisie4. Le mandat sur la Palestine relève aussi de ce ministère. On retrouve la même juxtaposition de statuts au sein du ministère français des Colonies, qui regroupe les vieilles colonies, les colonies proprement dites, et des protectorats et des mandats A et B. On peut dire que, contraire ment au système britannique, le statut de colonie est le plus fréquent. Certains protectorats peuvent cependant se comparer, en droit, sinon en pratique, à ceux des Britanniques sur les souverains asiatiques: ce sont essentiellement l’Annam et le Cambodge, dont les souverains ont signé avec la France des traités dits de «droit interne», qui n’impliquent que leurs signataires. Ils ne relèvent pas du droit international, à l’encontre de ceux qui ont été conclus avec le bey de Tunis, et avec le sultan du Maroc, dont on a vu que, tout en imposant la tutelle française, ils laissent subsister de façon effec tive la souveraineté des États protégés. À la différence des mandats A, les mandats B (Togo et Cameroun) dépendent aussi de ce département, ce qui souligne la volonté de les réunir étroitement aux possessions françaises d’Afrique noire, bien qu’ils ne soient rattachés ni à l’AOF, ni à l’AEF, qui regroupent les colonies de la zone. À l’intérieur même des ensembles régionaux désignés d ’un même nom, et relevant d ’une même autorité, on ne saurait guère parler d ’uniformité non plus. C ’est, bien sûr, le cas du gigantesque Indian Empire. Celui-ci juxtapose des régions qui relèvent de statuts différents. La partie la plus importante est la British India, formée essentiellement de onze provinces dont l’administra tion s’apparente à celle de colonies, et qui sont placées sous l’autorité directe de hauts fonctionnaires britanniques: vallée de l’Indus, du Gange, péri phéries côtières et une vaste zone centrale (un peu plus de la moitié de la superficie, trois quarts de la population). Viennent ensuite 564 États princiers (Indian Native States), dont le statut correspond, au moins pour les plus importants, à celui de protectorats, et dont les souverains sont assistés par des résidents britanniques. Une troisième partie (Balouchistan et North West Frontier, au contact des belliqueux Afghans ; îles Andaman et Nicobar, sur la
4. p.309.
Keith (A.B.), The governments of the British Empire, Londres, MacMillan & Co, 1935,
77
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
rive occidentale du golfe du Bengale, au laige des côtes birmanes et malaises) est administrée par l'arm ée, qui peut veiller ainsi sur les approches les plus vulnérables du pays. Le cas indien, sans doute le plus frappant, n’est pas isolé. Parmi les possessions asiatiques de la Grande-Bretagne, la Malaisie comprend les Straits Settlements (Singapour et Malacca), colonies de la Couronne, et un ensemble de protectorats, les quatre Federated Malay States (FMS), placés sous la direction d'un Chief Secretary (puis Federal Secretary) installé à Kuala-Lumpur, et les cinq États non fédérés, tous gouvernés par des sultans, assistés de résidents britanniques (British Advisers). Ajoutons que tous ces territoires (auxquels il faut ajouter les possessions de Bornéo, avec les sulta nats de Brunei et de Sarawak, et le nord du pays, contrôlé par une compagnie à charte) sont placés sous la responsabilité du gouverneur des Straits Settlements. Les Indes néerlandaises comprennent deux groupements : Java et Madura, d'une part ; et d'autre part les Territoires extérieurs (Sumatra, Bornéo, les Célèbes, les Moluques, B ali); elles comptent de nombreux protectorats, gouvernés par des « Régents » indigènes, notamment à Java et à Sumatra. Cette situation n’est pas limitée à l’Asie. Le Nigeria juxtapose une colonie côtière, correspondant à la région de Lagos, et une série de protecto rats, en particulier les émirats musulmans du nord, Kano et Sokoto. Cette variété se retrouve ailleurs. L’Algérie compte trois départements français et les Territoires du Sud, administrés par l’armée. Mais le territoire départemental se subdivise lui-même en communes de plein exercice, où les représentants de l’État sont des maires élus, selon la loi municipale française, et les communes mixtes, dirigées par des administrateurs nommés. L’Indo chine, ou, à plus proprement parler, l’Union indochinoise, se compose d’une colonie, la Cochinchine (capitale Saigon), et de trois protectorats (Annam, Cambodge et Laos), où subsistent des souverains locaux. Mais ce tableau d ’ensemble mérite d ’être complété: en 1897, la province du Tonkin a été détachée de l’Annam pour être administrée directement par un résident fran çais, ce qui lui confère un statut de quasi-colonie. Par un traité de 1901, l’Annam a cédé en toute propriété à la France les ports de Hanoi, Haiphong et Tourane, qui constituent des « concessions françaises ». C’est aussi du gouverneur général de l’Indochine, en résidence à Hanoi, que dépend le territoire à bail de Kouang-Tchéou-Wan, indiqué plus haut5. Les territoires sous contrôle de l’Espagne offrent la même diversité : la région du Rif au nord du Maroc « français », mais aussi la zone de Tarfaya au sud, relèvent du régime du protectorat, et continuent à relever en droit de la souveraineté marocaine, tandis que le Rio de Oro, Ifni et la Guinée espa gnole sont des colonies, et les présides sont considérés comme territoire national, à instar de l'archipel des Canaries. Les possessions belges juxtapo
5. Dareste (P.), Traité de droit cobnial, T. I, Paris, 1931, p. 34.
78
Organisation et structures politiques : complexité, diversité et ressemblances
sent au Congo les deux mandats B du Ruanda et de l’Urundi, qui représen tent moins de 2 % de la superficie totale, mais le quart de la population (trois millions et demi d’habitants contre une dizaine pour le Congo). En revanche, les territoires sous domination portugaise, tous placés sous le même statut, ainsi que les territoires italiens, témoignent d’un plus grand souci d ’unifor misation, auquel le caractère récent des occupations n ’est sans doute pas étranger. Cette variété de statuts justifie en partie celle des législations, qui s’ex plique aussi par la diversité des pays et des cultures auxquels s’applique une seule domination. Mais cette variété s’explique également par les différences qui existent entre les sensibilités nationales des différents pays occidentaux, tous attachés à légiférer et à réglementer, par besoin de faire acte de maîtres autant que par la conviction de détenir des principes supérieurs. Le principe d'autorité Sans vouloir se lancer ici dans un cours de « droit colonial », il est utile de souligner les principes et les pratiques en fonction desquels les différentes puissances imposent leurs principes aux populations, mais aussi composent avec elles. On aboutit ainsi à des réalités fort différentes de celles des métro poles. Tout d ’abord, il faut noter que, dans l’ensemble, les législations colo niales échappent très largement au contrôle des Parlements. En théorie, ceuxci peuvent toujours intervenir pour imposer leur volonté, du moins dans les métropoles dotées d’institutions démocratiques. En réalité, leur intervention est très limitée. Le fait est très notable dans le système fiançais, qui place la plupart des colonies sous le régime des décrets signés par le Président de la République, ce qui revient à dire que l’intervention des Chambres dans les affaires coloniales constitue l’exception, et la réglementation établie par les ministres et leurs hauts fonctionnaires la règle. Cette situation, à l’époque où nous nous plaçons, est exactement inverse à celle qui prévaut en métropole, dans la pratique de la IIIe République, où l’ensemble des domaines relèvent du domaine de la loi, votée par le Parlement. Il faut voir dans cette spéci ficité le souci de renforcer les pouvoirs du gouvernement et de l’administra tion aux colonies. Il est piquant d’ailleurs de constater que la base juridique de ce régime n’est autre que le sénatus-consulte de 1854, héritage de l’Empire autoritaire de Napoléon III. Lors même que le Parlement français légifère en matière coloniale, ses décisions font (sauf en Algérie) l’objet d’une adaptation, puisqu’elles ne s’appliquent de plein droit qu’en vertu d ’arrêtés du gouverneur, agent local de l’exécutif, qui est chargé aussi de la réglementation locale. La pratique belge est assez proche de la pratique fran çaise, depuis la promulgation de la Charte coloniale de 1908, qui a mis fin au système d ’union personnelle du royaume de Belgique et de l’État indépen dant du Congo, sous le sceptre du roi Léopold II, en faisant du second une colonie du premier. Le roi, assisté par un Conseil colonial de 14 membres,
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
est le législateur ordinaire en matière coloniale; le Parlement, autorité de contrôle, n ’intervient que peu fréquemment, « répondant en cela aux inten tions du Constituant belge »6. Le système britannique parait, à première vue, d’inspiration totalement opposée, puisqu’il préfère, au renforcement du pouvoir réglementaire, l’éta blissement de législatures locales, chargées de légiférer sur les affaires de la colonie. En théorie, le Parlement de Londres, qui dent le rôle (et assume le titre) de « Parlement impérial », conserve des prérogatives législatives illimi tées, sauf à l’égard des Dominions. Sa prépondérance est cependant bornée par nombre de pratiques. D’abord, fort logiquement, il répugne à s’opposer aux assemblées locales quand elles sont suffisamment représentatives, le souvenir de la révolte des colonies américaines restant vivace ; surtout, à l’instar du Parlement français, son grand aîné britannique ne s’intéresse guère aux questions coloniales, qui ne font l’objet que de débats peu fréquents, et s’en remet de confiance aux autorités sur place. En fait, comme en France, le rôle de l’exécutif reste prépondérant, et peut s’exercer de bien des façons. Il peut passer par les pouvoirs de législation dévolus à l’exécutif et à ses représentants. Au plus haut niveau, ce pouvoir s’exprime par la procédure des Orders in Council, souvent utilisés pour réorganiser les insti tutions législatives locales, mais aussi pour faire passer certaines mesures : c’est ainsi qu’est imposé à Ceylan, en 1934, un quota limitant l’entrée des textiles japonais bon marché au profit des cotonnades anglaises plus coûteuses, au détriment du niveau de vie des populations7. Ce dernier pouvoir ne s’exerce pas, il est vrai, dans les Dominions, ni dans l’Inde, ni dans un certain nombre de possessions d ’Amérique latine (Bahamas, Bermudes, Barbade, Honduras, Leeward Islands)8. Il est possible aussi, pour imposer des mesures, d ’utiliser le biais des « majorités officielles », c’est-àdire la présence, dans les assemblées législatives, d ’une majorité ou d’une forte proportion de fonctionnaires ou de notables non pas élus mais nommés, et donc forcément soumis aux directives du gouvernement. De plus, il faut noter que, dans les protectorats ou dans les mandats, qui, en droit, ne sont pas territoire national, le rôle des parlements métropolitains n’a pas de raison d’être, ce qui, en l’absence d ’autorités locales suffisamment fortes pour s’imposer, et, le plus souvent, d’organes représentatifs locaux, rend l’administration européenne, aussi puissante, voire plus puissante, que dans les colonies. Au Maroc, par exemple, le maintien des institutions tradi tionnelles, qui réservaient au sultan le pouvoir législatif, a permis à l’autorité française dite « de contrôle » de confisquer ce pouvoir à son profit exclusif. Aux Indes, les réformes votées de 1919 à 1933 pour établir un régime plus
6. Le Congo belge. Office de l’information et des relations publiques pour le Congo belge et le Ruanda-Urundi, Bruxelles, 1958, p. 131. 7. Havinden (M.) et Meredith (D.), Colonialism and development, p. 190. 8. The British Empire, a Report on its Structures and Problems, by a group of Members of the Royal Institute of International Affairs, Londres, Oxford University Press, 1937, p. 203.
80
Organisation et structures politiques : complexité, diversité et ressemblances
représentatif ne s'appliquent pas aux États princiers, généralement dociles aux directives britanniques. Ainsi, les colonies sont, par définition, à la discrétion des autorités gouvernementales. Le pouvoir y est un pouvoir fo rt Ceci est encore plus vrai, évidemment, dans les pays dépourvus ou privés d ’institutions démocra tiques. Il n’est pas question dans l’Italie de Mussolini, le Portugal de Salazar ou bien l’Espagne de Franco, d’autre chose qu’une confusion des pouvoirs exécutif et législatif entre les mains du dictateur, qui la délègue, sous la même forme, aux ministres responsables des départements coloniaux. Sur place, les ministres sont représentés par de très hauts fonctionnaires. Ceux-ci portent parfois, comme en Inde depuis 1858, et en Éthiopie depuis 1936, le titre de vice-roi. La plupart du temps, il s’agit d ’un gouverneur général pour un groupe de colonies (AOF, Indochine, Indonésie) ou une grande colonie (Algérie), ou un simple gouverneur pour un territoire moins important. En pays de protectorat de droit international ou de mandat, on parle de résident (Maroc et Tunisie) ou de haut-commissaire (comme au Cameroun et au Levant); mais le terme de haut-commissaire s’applique aussi dans les possessions portugaises ; en revanche les mandats du Ruanda et du Burundi sont placés sous l’autorité d’un vice-gouverneur général, qui dépend du gouverneur général du Congo belge. Ces titres varient en même temps que la situation au regard du droit international : ainsi l’Égypte a-t-elle vu se succéder à la tête de l’administration britannique un consul général (1882-1914), un haut-commissaire (1914-1936), et un ambassadeur. Ces changements de dénominations sont dus au passage du pays, dans la période correspondante, du statut de vassal de l’Empire ottoman à celui de protec torat, puis d ’État indépendant, ce qui n’a pas d’ailleurs réduit sinon la théorie, du moins la réalité du poids du représentant de Sa Majesté au Caire. Dans les Dominions, en 1938, le représentant du roi au Canada, en Australie et en Afrique du Sud porte le titre de haut-commissaire, ce qui souligne l’ab sence à peu près totale de sujétion ; en Nouvelle-Zélande il reste gouverneur général, les Néo-Zélandais tenant à souligner particulièrement l’étroitesse de leurs relations avec la métropole. Dans l’ensemble, la répartition des pouvoirs entre les autorités de la métropole et leurs représentants outre-mer est plutôt favorable à ces derniers. Si les ministres et les ministères sont chargés de définir les grandes orienta tions, sous la conduite des chefs de gouvernements, la réalité des choses appartient aux hommes de terrain. L’étendue des pouvoirs des gouverneurs, résidents ou hauts-commissaires le prouve. Leurs compétences varient en fonction des institutions représentatives du pays, mais sont toujours extrême ment étendues. Représentants de la métropole, et plus particulièrement du chef de l’État, roi ou président, ils sont les chefs des colonies, ce qui leur confère la haute direction de l’administration, ainsi que des relations exté rieures; ils sont responsables de l’ordre, ce qui inclut non seulement la police, mais l’emploi des forces armées en général. Ils sont chargés aussi de
81
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
la préparation du budget, de la levée des impôts, du contrôle de la justice. Ils disposent très fréquemment du droit de refriser l’accès de la colonie à qui bon leur semble ou de l’en faire expulser (en s’appuyant, en territoire fran çais, sur un édit d’Ancien Régime, qui remonte à 1778). Ils exercent enfin une surveillance active sur la vie religieuse, qu’il s’agisse des cultes indi gènes, ou des cultes chrétiens, implantés par les missionnaires9. Ce n’est que dans les Dominions que ce pouvoir est désormais, comme on le verra, de plus en plus symbolique, ce qui ne veut pas dire vide de sens. Bien que la tendance soit à conférer ces responsabilités à des civils, les militaires sont parfois appelés à exercer ces fonctions en période de conquête ou en période de tension, ce qui accroît la concentration des pouvoirs dans les mêmes mains. Après le départ de Lyautey, en 1925, la résidence au Maroc n ’est confiée à des civils que pour douze ans ; dès 1937, elle revient au général Noguès, investi du commandement en chef des troupes, d ’abord seulement sur place, puis pour toute l’Afrique du Nord. Le vice-roi des Indes sera, de 1943 à 1945, le maréchal Wavell, ancien commandant en chef en Égypte, puis dans le Sud-Est asiatique. Aux Bermudes, point stratégique essentiel pour le contrôle des communications transatlantiques, le gouver neur est toujours un militaire de haut rang. L’importance des responsabilités qui incombent aux gouverneurs s'ex plique en partie par un vieil héritage historique: pendant longtemps, en raison des distances et de la lenteur des moyens de communication, il fut pratiquement impossible de ne pas laisser une large initiative aux fonction naires locaux. Malgré la révolution des transports et des transmissions, cette situation n’est pas totalement abolie, au moins dans les esprits, et souvent encore, en réalité, les réseaux très rapides (avion, TSF), étant encore fort peu denses. Mais il faut compter aussi avec une réelle volonté de faire des personnages placés à la tête des colonies de véritables « patrons ». Une tradi tion interdit ainsi au ministre des Colonies des Pays-Bas de se rendre aux Indes néerlandaises, pour ne pas faire ombrage au gouverneur général. Celui-ci peut être, pendant les cinq ans de son mandat, le véritable maître du pays. Sans être aussi impérative ailleurs, la pratique s’inspire du même prin cipe, et il est extrêmement rare qu’un gouverneur soit désavoué. D’autres liens, de nature régalienne, lient aussi la métropole avec ses colonies. Il faut évoquer d ’abord le rattachement des monnaies à la monnaie de la puissance coloniale. À la diversité qui avait eu cours jusqu’au début du XIXe siècle, et qui laissait subsister, aux côtés des monnaies des colonisa teurs, des devises locales de plus ou moins grande valeur, comme les douros espagnols en Afrique du Nord, ou les thalers de Marie-Thérèse d ’Autriche en Afrique orientale et dans la péninsule arabique, les colonisateurs s’efforcent
9. Fumivall (J.S.), Netherlands India : a study ofplural economy [1944], Amsterdam, BM Israel BV, 1976, p. 378.
82
Organisation et structures politiques : complexité, diversité et ressemblances
de substituer un système unifié. Il peut arriver que la devise de la puissance coloniale s'impose exclusivement, mais aussi, comme c'est le cas le plus fréquent, que la monnaie locale soit liée par une parité fixe, imposée par la puissance coloniale, à la devise nationale, et ainsi relève de la même zone monétaire. C’est ainsi que dans l’Empire fiançais, le franc est la monnaie unique, bien que les pièces et les billets qui circulent, émis par des banques locales, comme la Banque de l’Algérie et de la Tunisie, ne soient pas admises à circuler en métropole ; il faut en excepter l’Indochine, où la piastre est maintenue, mais alignée à partir de 1930 au taux de 10 francs101. Dans l’Empire britannique, la roupie indienne (dont le champ d ’action s’étend au golfe arabo-persique, en particulier au Koweït et à Bahreïn) et la livre égyptienne sont définies par rapport à la livre. La seule exception de taille concerne le Canada, qui, en dépit de ses liens politiques avec la GrandeBretagne, gravite dans l’orbite monétaire des États-Unis. Il faut enfin rappeler que le système des douanes est contrôlé par la métropole. Ceci confère évidemment à celle-ci de puissants leviers sur la politique écono mique, comme on le verra notamment lors de la grande crise des années trente. Mais, ici encore, l’exception britannique est notable, les Dominions, et le gouvernement de l'Inde à un moindre degré, bénéficiant d’une grande indépendance sur ce chapitre. Les deux domaines les plus importants restent, néanmoins, la défense et les relations extérieures, qui demeurent l’apanage de la puissance coloniale. Dans les colonies françaises, les forces armées sont totalement intégrées dans le dispositif d ’ensemble, sous le contrôle des ministères de la Défense, de la Marine et de l’Air, à partir de la création de celui-ci en 1933. Le système britannique est plus souple, puisque chaque Dominion, ainsi que l’Empire des Indes, a ses propres forces armées. Dès avant la Première Guerre mondiale ont été mis sur pied un État-major général impérial (1909), chargé d ’harmoniser les matériels, l’entraînement et l’organisation des unités, et un Comité de défense impérial (1911), qui doit discuter des poli tiques de défense. Mais la disproportion écrasante des forces britanniques, notamment dans le domaine vital de la Marine, limite très fortement cette autonomie, en particulier au niveau de la conduite des opérations. Il en va de même dans le domaine des relations extérieures. Là encore, les Dominions jouissent d’une large autonomie (le Canada et l’Union sud-africaine se dotant même de représentations diplomatiques à l’étranger), mais agissent en concertation étroite avec le Foreign Office. Tant il est vrai que, comme l’écrit Charles de Gaulle à cette époque (1934) « l’épée est l’axe du monde et la grandeur ne se divise pas »u . Sous ces grandes structures, les empires peuvent accepter une diversité de lois et de pratiques bien différentes de celles des métropoles.
10. Dareste, op. cit., t D, p. 590-611. 11. Dernière phrase de Vers l'armée de métier.
83
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Particularismes des législations Certes, comme on pouvait s’y attendre, l’influence du propre droit occi dental a, dans tous les cas, profondément influencé les législations locales, ne serait-ce qu’en les uniformisant. Mais il est loin d ’en résulter une unification de celles-ci. Chaque territoire, en même temps qu’il subit, avec d ’autres, la loi d’une même puissance, est soumis à des dispositions particu lières, héritées de sa tradition. Deux tendances contradictoires inspirent en effet le comportement des autorités coloniales en matière de droit. La première est la tendance à intro duire partout des pratiques uniformes, inspirées du droit métropolitain. Les principes de Common Law britannique, du Code civil français, mais plus encore des Codes de commerce, et des Codes pénaux européens, influencent d ’autant plus largement les législations coloniales qu’ils concernent des affaires inconnues avant la colonisation, ou nécessaires à l’établissement de celle-ci. Par ailleurs, les tribunaux des colonies sont généralement rattachés aux degrés suprêmes de la magistrature métropolitaine, ce qui est d ’abord une marque de souveraineté, mais peut aussi avoir des effets concrets. Ainsi, en Grande-Bretagne, le Judicial Committee o f the Privy Council, formé de juges de haut rang représentant la Grande-Bretagne, les Dominions et l’Inde, joue le rôle de cour d ’appel suprême, avec des limitations en ce qui concerne les Dominions, notamment au pénal. Naturellement, les possessions relevant du Foreign Office sont exclues du domaine de l’application. À l’égard des tribunaux relevant des colonies françaises, la Cour de Cassation peut généra lement être saisie, de même que, en matière de contentieux administratif, le Conseil d ’État, dont quelques-uns des arbitrages, émis à propos des colonies, font toujours jurisprudence de nos jours. L’arrêt dit Bac d’Eloka (1921), ou encore l’arrêt Couitéas (1929), font toujours partie du parcours obligé de nos étudiants en droit public, quoique la Côte-d’Ivoire et la Tunisie, sur le terri toire desquelles se produisirent les affaires qui furent à l’origine de cette jurisprudence, soient indépendantes depuis une quarantaine d ’années. Mais ce souci d’étendre le champ des lois européennes se complète et se complique par la volonté, pour paraphraser une formule de Bonaparte en Égypte, de «gouverner les hommes comme le plus grand nombre veut l’être ». Entendons qu’il n’est pas question de bouleverser des législations ou coutumes locales. Ainsi, « le principe... de la soumission des indigènes à leur loi particulière, autrement dit le principe de la loi personnelle, a été proclamé par le législateur français dans toutes les colonies»12. On pourrait croire qu’il y a là une contradiction, mais ce n’est pas vraiment le cas, le souci d ’imposer le droit européen ou de respecter les lois locales s’exerçant diffé remment en fonction des domaines envisagés. Le sociologue finançais du droit René Maunier juge ainsi qu’aucun État n’a été si loin dans l’assimila
12. Dareste (R), T. Il, p. 37S.
Organisation et structures politiques : complexité, diversité et ressemblances
tion législative que les Hollandais, qui ont imposé aux indigènes leur droit pénal, leur droit fiscal, et même leur législation du travail ; mais en même temps aucun n’a poussé si loin le respect du statut personnel, collationné dans les trente volumes du Pandecten der Adatrecht (Pandectes du droit coutumier)13. Ce comportement n ’est pas un cas isolé. Dans l’ensemble des territoires, le principe du respect du statut personnel, celui qui régit le statut de la famille, la filiation, le mariage, les successions et partages, la condition de la femme, a été proclamé. Les populations, il est vrai, sont d’autant plus attachées à ce statut qu’il se confond très fréquem ment avec l’appartenance religieuse. C’est ainsi qu’aux Indes britanniques, le statut personnel des musulmans et des hindous, mais aussi des parsis, des jaïns et des bouddhistes fait l’objet d ’un traitement particulier14. Il en va de même dans les Établissements français de l'Inde, où les dispositions de la monarchie française sur ce point ont servi de modèles aux régimes succes seurs pour l’ensemble de l’Empire, et notamment à l’égard des musulmans de l’Afrique du Nord et de l’Afrique occidentale. Ceux-ci continuent à relever des dispositions juridiques tirées des droits, doctrines et jurispru dence en vigueur dans leur pays avant la conquête, et appliquées par des tribunaux composés en général de juges indigènes, plus ou moins contrôlés par des fonctionnaires européens. Mais, pour autant, les autorités européennes ne se sentent pas tenues de n’opérer aucun changement. Elles se soucient, par exemple, de mettre en forme les textes d ’origine locale en les adaptant à leurs habitudes formelles et à leurs propres exigences. C’est ainsi qu’un code civil nouveau est promulgué au Tonkin en 1933. Il affirme, dans ses premiers articles, les grands principes du code civil français, mais maintient nombre de disposi tions issues de la législation impériale (notamment celui de l’empereur Gia Long, remontant à 1812), et les complète même par la reconstitution de textes plus anciens (notamment le code de la dynastie des Lê, reconstitué par les soins de l’École française d’Extrême-Orient)15. En Égypte et en Tunisie, les autorités européennes de tutelle ont poursuivi l’œuvre de réforme commencée dès le milieu du XIXe siècle sous la direction des souverains locaux. Là où il n’existait pas de droit écrit, les Européens se sont contentés le plus souvent de mettre en forme les dispositions en vigueur avant leur arrivée. Toute une série de codes ou de coutumiers particuliers ont ainsi été établis. C’est, par exemple, le cas des coutumiers kabyles et berbères d’Algérie et du Maroc, qui ont été recueillis et collationnés par des officiers, de façon à permettre d ’en surveiller l'application.
13. Maunier (R.), Des comptoirs aux Empires, histoire universelle des colonies, Sirey, 1941, p. 179. 14. Keith (A.B.), The governments, p. 601. 15. Dureteste (A.), Cours de droit de l’Indochine, Laiose, 1938.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
0 convient d ’ajouter que le passage de nombre de territoires d ’une domi nation coloniale à l’autre a laissé aussi des traces. Les Britanniques, en parti culier, ont rarement voulu abolir les législations mises en place par les puis sances européennes auxquelles ils ont succédé. Par exemple, deux anciens territoires français, annexés en 1814, l’île antillaise de Sainte-Lucie, et l’île Maurice dans l’Océan indien, restent régis, l’un par un droit d ’Ancien Régime, la Coutume de Paris, l’autre par le Code civil16. Ailleurs, en particu lier en Afrique du Sud, mais aussi à Ceylan, les Anglais ont respecté le droit hollandais (dit Roman-Dutch law). Les Français sont beaucoup plus intolé rants sur ce point, car ils sont convaincus, comme le leur reprocha un jour Jules Ferry, que leurs lois ont la vertu magique de coloniser les pays où elles sont transportées. Ils n’en conservent pas moins certains ménagements à l’égard de leurs devanciers : c’est ainsi que, au Togo et au Cameroun, la législation allemande, remplacée par la législation française, « doit pourtant être considérée comme subsistante, partout où elle n’a pas été abrogée... et où elle n’est pas incompatible avec le nouveau régime ». Par ailleurs, les actes et contrats passés sous l’empire de cette législation demeurent valables17. Il n’en va pas exactement de même en matière de justice pénale, où doit s’exprimer davantage la volonté du pouvoir souverain, exercée par la puis sance occupante, appliquée uniformément à tous, et n’admettant pas des usages jugés barbares, choquants ou contraires aux droits de l’homme tels qu’ils sont entendus en Europe. Dès les années 1860, les Britanniques ont établi pour l’Inde un code pénal, un code de procédure pénale, ainsi qu’un code des contrats. Le code pénal, notamment, qui se serait largement inspiré, outre de la loi anglaise, du code pénal français, mais aussi du code de Louisiane, a été adopté dans d ’autres possessions britanniques, en Afrique notamment (Zanzibar, Afrique orientale, Soudan anglo-égyptien)18. Bien des spécialistes britanniques le jugent supérieur au droit anglais, considéré comme complexe et désuet. Il réprime l’esclavage, le mariage précoce (la législation la plus récente, celle de 1925, imposant quatorze ans minimum pour les garçons et treize ans pour les filles), il autorise les veuves à se rema rier, et interdit la pratique, relativement peu fréquente, mais particulièrement choquante, de l’immolation des veuves {sait) ; en revanche il proscrit toutes peines qui frappent les transfuges, à la différence des coutumes ou lois jusque-là en vigueur, chez les musulmans, à l’encontre des « apostats », ou chez les hindouistes, à l’encontre de ceux qui tentent de changer de caste. De même, la législation française concernant l’Afrique réprime ce qu’elle qualifie de « pratiques révoltantes », telles que « les mutilations corporelles,
16. Keith (A.B.), The Governments, p. 488. 17. Dareste, tome I, p. 257. 18. O’Malley (L.S.S.), ed., Modem India and the West, Oxford University Press, 1941, p. 113 ; voir aussi Bleuchot (H.), Les cultures contre l’homme ? Essai d’anthropologie histo rique du droit pénal soudanais, Presses universitaires d’Aix-en-Provence, 1994.
86
,
Organisation et structures politiques : complexité diversité et ressemblances
le poison d’épreuve, et même l’anthropophagie»19. Dans un tout autre domaine, les codes commerciaux, qui régissent les transactions entre Européens et indigènes, sont le plus souvent repris sans grande modification des législations nationales des puissances coloniales, dans le but de faciliter la pénétration économique des pays conquis ou soumis. Au total, l’ensemble de ces mesures vise à obtenir, selon la formule de l’historien et penseur Thomas B. Macaulay (1800-1859), appelé aux Indes en 1834 pour inspirer la politique à suivre, toute 1’uniformité possible, toute la diversité indispensable, mais en tout cas la certainty, c’est-à-dire l’assurance d ’un texte précis et s’appliquant également à tous20. On ne peut qu’être impressionné de cet effort de rationalisation, même si l’on peut estimer que, en obligeant les indigènes à renoncer à une partie de leurs lois et coutumes, il dut être considéré par nombre d’entre eux comme une abominable tyrannie. En général, d’ailleurs, les Européens pensent qu’un mouvement irréversible doit rapprocher les hommes. En 1937, dans un ouvrage sur l’Inde, un juriste britannique reproduit comme exemplaire le jugement, formulé vingt ans plus tôt par Snouck Hurgronje, selon lequel une évolution inévitable finira par faire reléguer les vieilles lois, même d’origine divine, dans un musée d ’anti quités. Cette évolution, dans son esprit, ne saurait évidemment se faire qu’au profit des principes européens, étant donné le souci des élites indigènes de chercher ¡’émancipation dans l’adoption des institutions occidentales. L’exemple de la Turquie, mais aussi de la Perse, de l’Irak, de l’Égypte et de la Syrie lui paraît encourageant en ce sens21. Il omet d’indiquer pourtant que c’est dans un cadre indépendant de l’Europe (et en particulier dans l’Empire ottoman des grandes réformes ou Tanzimât) que ces pays ont commencé à se transformer. Le fait d’être des étrangers et surtout de relever d’une autre reli gion amène en effet, comme on l'a vu dans quelques cas, les autorités colo niales à se montrer, finalement, plus pusillanimes en matière de réformes du droit que des gouvernements nationaux, dont l’orthodoxie religieuse est moins discutable. En Algérie en revanche, le projet de code du statut personnel préparé au début du siècle par le doyen de la faculté de droit d’Alger, Marcel Morand, ne reçoit jamais de sanction officielle, tout en étant fréquemment utilisé par les magistrats français. L’énoncé de ces principes généraux ne doit pas masquer l’existence d ’un certain nombre de fantaisies occidentales, c’est-à-dire d’exigences exces sives, ou au contraire d ’un laxisme étonnant. Deux exemples, relevés à propos de l’Empire français, en témoignent. C’est ainsi qu’en Polynésie française, les sports et les danses traditionnels, mais aussi le port du paréo sont strictement interdits sous prétexte « d’immoralité » par l'administration, influencée il est vrai par les missionnaires. Le célèbre navigateur Alain
19. Dareste, Traité de droit colonial, T. I, p. 358. 20. O’Malley, Modem India, p. 621. 21. O’Malley, Modem India, p. 137.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Geibault, auquel sa qualité de « Français » permet un comportement anti conformiste fait scandale en se promenant dans cette tenue dans les rues de Papeete, voire même en assistant ainsi vêtu (ou dévêtu) aux réunions officielles. Il est vrai que beaucoup lui reprochent sans doute de porter atteinte, ce faisant, au prestige des Européens. En revanche, le comptoir fran çais de Chandernagor « s’est fait une spécialité de mariages entre vieillards et fillettes de cinq à huit ans », proscrits, comme on l’a vu, dans l’Empire des Indes22. Signes, symboles et discours Nul sans doute mieux que les Britanniques, avec l’expression Greater Britain, titre d ’un ouvrage de Charles Dilke publié en 1866, reprise littérale ment par les Français sous la IIIe République avec la formule de « La plus grande France », n’ont su trouver de slogans plus heureux pour manifester l’ambition de faire de l’Empire une amplification, en même temps qu’une magnification, de la métropole23. Mais l’unité, pour être vécue, doit s’ap puyer sur un certain nombre de représentations ou de manifestations qui la rendent plus visible et en appellent au sentiment plus qu'à la raison, aux images plus qu’aux arguments. Références communes C’est d ’abord à partir des chefs d’État que s’opère une certaine person nification des empires. C’est sans doute, de ce point de vue, en GrandeBretagne que cette carte a été la mieux jouée. La monarchie offre, en la personne du souverain, hautement vénéré et au-dessus des querelles poli tiques, un symbole apparemment inaltérable. Roi de Grande-Bretagne, Roi des quatre Dominions « au-delà des mers » (l’Irlande étant une république depuis 1937), Empereur des Indes, Défenseur de la Foi, le souverain réalise, en sa personne, l’union que les institutions seraient insuffisantes à démontrer ou à garantir. Le grave et austère George V (1910-1936), dont les derniers mots auraient été « How is the Empire ?» a su tenir pleinement son rôle dans la perpétuelle orchestration de la grandeur impériale et royale. Son fils aîné le prince de Galles, futur éphémère Édouard VIII, infatigable voyageur, est décrit comme faisant merveille, partout où il passe, par son charme et sa bienveillance. Certains vont jusqu’à écrire que, si d ’aventure, la monarchie était abolie en Grande-Bretagne, la conséquence en serait inévitablement la dissolution de l’Empire, car les Dominions ne sauraient témoigner au Président d ’une république la loyauté qu’ils manifestent envers le roi24. Le grand sceau du Royaume authentifie, avec la signature royale, les actes les 22. Weber (J.), Pondichéry, p. 342. 23. Julien (Qi.-A.), « Impérialisme économique et impérialisme colonial », Fin de Vire coloniale ?, Chemins du Monde, V, Paris, Éditions de Clermont, 1948, p. 30. 24. Southgate (G.W.), The British Empire, Londres, J.M. Dent & Sons, 1939, p. 319.
88
Organisation et structures politiques : complexité, diversité et ressemblances
plus importants de la vie institutionnelle des territoires de l’Empire (constitu tions, nominations des gouverneurs généraux). Le titre de sujet (British-bom subject), utilisé de préférence à celui de citoyen, jette heureusement le flou sur l'inégalité des droits politiques, en paraissant courber toutes les têtes sous une même allégeance que des républicains appelleraient servitude, mais qui est vécue comme un lien d ’hommage, au vieux sens féodal, qui honore à la fois le suzerain et le vassal. Avec plus de modestie, mais non sans efficacité, le roi Albert Ier de Belgique (1909-1934), affirme son intérêt pour les possessions africaines, en visitant personnellement le Congo en 1928, et y délègue à deux reprises (1925 et 1933), son fils, le duc de Brabant, futur Léopold IB, avec mission de présider à des commissions d ’études. On peut penser que le « roi-soldat » n’oublie pas que son oncle, Léopold B, a été l’artisan de la constitution de cette colonie25. Le prince visite aussi les Indes néerlandaises, l’Indochine française (où une route conservera le nom de son épouse Astrid, plus tard tragiquement disparue) et les Philippines. Le 25 juillet 1933, à l’occasion des vingt-cinq ans du rattachement du Congo à la Belgique, il est chargé de prononcer, devant le Sénat belge, un discours appelé à demeurer le véritable programme colonial de son pays jusqu’à l’indépendance26. Plus discrète ment, la monarchie hollandaise, représentée par la reine Wilhelmine, est le symbole de l’union des Pays-Bas avec les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao, pour lesquels le terme de colonies n’est plus employé depuis la révision constitutionnelle de 1922, bien que ces pays continuent à dépendre, comme on l’a vu plus haut, d ’un ministère des Colonies. La monarchie italienne est moins heureuse. En dépit des efforts de Mussolini pour ressusciter YImperio romano et du titre d’Empereur d’Éthiopie arboré par Victor-Emmanuel IB (1900-1947), la démesure fasciste ne saurait atteindre aux pompes britanniques, appuyées sur une ancienneté et une richesse, mais aussi des cérémonials sans rivaux. Pourtant, lorsque le duc d’Aoste Amédée de Savoie, est élevé en 1937 à la dignité de vice-roi d’Éthiopie, d'aucuns voient dans la nomination de cet homme jeune et brillant, chef de la branche cadette de la maison royale italienne, une opéra tion politique destinée à rénover la monarchie au détriment de la branche aînée. Ces espérances seront cruellement déçues: fait prisonnier par les Alliés qui ont occupé l’Éthiopie en 1941, le duc mourra peu après en capti vité à Nairobi. Leurs alliés allemands auront pu compter, de leur côté, sur le souvenir du voyage du Kaiser Guillaume B à Damas et à Jérusalem en 1898, soigneusement entretenu par les représentants du BIe Reich, et qui est demeuré vivant dans l’opinion arabe.
25. Keyes (R.), Un rêve brisé, Léopold III, 1901-1941, Duculot, 1985. 26. Labouret (H.), « La tradition coloniale dans la famille royale de Belgique », Bulletin du Comité de l’Afriquefrançaise, 1933, p. 436-440.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Dans un tout autre esprit, les républicains français ont su créer un esprit impérial, fondé sur l’allégeance à cette personne qui transcende la simplicité, voire la banalité démocratique du personnel politique, et qui n’est autre que la France elle-même, tendre, généreuse, compatissante, celle qui, comme l’écrira de Gaulle, n’est jamais responsable de la médiocrité ni des fautes des Français. Comme le roi, la République ne meurt jamais et la République ne saurait se tromper. Les indigènes des colonies ne sont pas les derniers, dans l’expression de leurs revendications, à en appeler à la « vraie France », géné reuse et compatissante, contre les excès ou les abus de ses représentants, fonctionnaires et colons. Les présidents de la République, incarnations du pouvoir civil et laïc, placés au-dessus de la vie politique, suffisent à conférer à des réalités compliquées une image qui se veut intègre, rassurante, voire débonnaire, comme celle du brave Gaston Doumeigue, « le sage de Toumefeuille » qui préside à Alger les fêtes du Centenaire de la conquête. Dans un État de nature bien différente, le docteur Salazar, le discret maître du Portugal depuis 1928, délègue le président de la République, le général Carmona, pour une tournée solennelle en Angola, effectuée en 1938. Qui dira, aussi, le rôle du drapeau ? La république portugaise a adopté, en 1911, une bannière riche de références aux grands souverains conquérants de la Renaissance, Jean II et Manuel, tandis que le vieil emblème des Provinces-Unies flotte toujours sur les possessions néerlandaises. Comme les trois couleurs françaises, belges ou italiennes timbrées des armes de la Casa Savoia, ou encore Y Union Jack britannique, ou le sang et or des Espagnes, elles sont arborées dans tous les ports, sur tous les postes de brousse, où elles sont montées et descendues religieusement chaque jour, en un culte perma nent, qui suit la course du soleil autour de la terre. C’est un hommage, dira l’ethnologue Marcel Griaule « au petit génie hargneux qui claque dans les plis de l’étoffe »27. Le célèbre ethnographe entend par là que, par leur seule présence, qui signifie une revendication de droits, elles peuvent engager des États aux prétentions volontiers ombrageuses dans d ’interminables controverses. Us figurent au cours des revues en tête des régiments formés d ’indigènes, et nombre de ceux-ci se feront tuer pour les défendre avec un dévouement admirable. Les paviUons des grandes marines, au premier rang desquels figure le White Ensign de la Royal Navy, dont les vaisseaux purent apparaître au XIXe siècle comme l ’ultima ratio de la politique coloniale, sont arborés avec la même signification. Mais d’autres symboles sont aussi employés, par exemple le timbre, qui comme la monnaie, présente une iconographie à forte signification. Non seulement ils portent, à côté du nom de la colonie, la marque de son allé geance (RF pour la France), mais ils en illustrent un certain nombre d ’aspects. Un auteur français écrit: «nos timbres coloniaux, aussi bien d ’Afrique que des autres parties du monde, font connaître, dans des petits
27. Griaule (M.), La peau de l’ours, Nrf, 1936, p. 20.
90
Organisation et structures politiques : complexité, diversité et ressemblances
tableaux souvent de haute valeur, tantôt les produits et les richesses de leur sol, tantôt les caractéristiques de leurs habitants ou des animaux qui peuplent leur région, souvent les sites les plus séduisants, les monuments les plus curieux, enfin parfois les effigies des grands colonisateurs tant militaires que civils auxquels nous sommes redevables de la conquête de ces Terri toires »28. Dans l’Empire britannique, l’effigie du souverain rivalise évidem ment avec ces représentations à caractère documentaire, comme le fait celle de Marianne dans l’Empire français. Mais d ’autres initiatives seraient à signaler: le Canada a ainsi émis en 1928 une vignette représentant un planisphère avec la devise « we hold a waster Empire than has been ». Les Allemands recourent aussi à cette médiation : dans un but revendicatif cette fois : en 1935, ils émettent des timbres coloniaux d’avant-guerre encadrés de noir et l'inscription « l’Allemagne n ’oublie pas ses colonies »29. On entre ici dans le domaine de la propagande. Propagande Les grandes manifestations sont souvent utilisées pour magnifier l’idée impériale. Dans la France républicaine, revues et défilés du 14 juillet, dans lesquels paradent, aux côtés des troupes de Métropole, les contingents de l’armée d ’Afrique et des troupes coloniales, sont destinés à inspirer au spec tateur confiance et fierté. Les badauds parisiens sont habitués à voir les spahis en burnous rouge, caracolant sur leurs petits chevaux barbes, servir d’escorte au Président de la République et aux chefs d’État en visite officielle, concurremment avec les casques à crinière de la Garde républi caine. Les Fêtes du Centenaire de l'Algérie en 1930, organisées sur place en commémoration du débarquement du 14 juin 1830, sont l'occasion d ’une série d ’inaugurations, dont celle du monument de Sidi-Ferruch, qui rappelle que c’est ici que « l’armée française vint arborer ses drapeaux, rendre la liberté aux mers, donner l’Algérie à la France»; une cinquantaine de congrès, nationaux ou internationaux, sont organisés ; à la revue navale, que le Président contemple du croiseur Duquesne, s’ajoute un défilé des troupes de l’armée d ’Afrique en costumes d ’époque. Les autres pays ne sont pas en reste. En Grande-Bretagne, le 24 mai, anniversaire de la naissance de la reine Victoria, est demeuré « The Empire Day » depuis 1902, et donne lieu à des manifestations qui sont l’occasion d’entonner le fameux Recessional, l’hymne composé par Kipling à l’occa sion du Jubilé royal de 1897. Au printemps de 1935 est solennellement fêté le King’s Silver jubilee, autrement dit les vingt-cinq ans de règne de son arrière-petit-fils George V, en présence des princes indiens, des Premiers ministres des Dominions et des gouverneurs des colonies. Deux ans plus
28. Fluty (P.), « Le timbre-poste africain français », Bulletin du Comité de l’Afrique fran çaise, 1933, p. 300. 29. Fayet (J.), « Un programme de propagande impériale », Outremer, 1937, p. 23.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
tard, le couronnement de son successeur George VI, après le fâcheux inter mède d ’Édouard VIII, est l’occasion de nouvelles et solennelles démonstra tions d’allégeance. Entre-temps, en 1936, a été célébré le centenaire de la naissance de Joseph Chamberlain, le grand inspirateur de l’impérialisme britannique au début du siècle. En Italie, Mussolini a organisé, plusieurs années de suite, à partir de 1926, une «journée coloniale », à la date du 21 avril, qui n’est autre que le jour anniversaire traditionnellement supposé de la fondation de Rome, en 754-753 avant notre ère. En Allemagne, dès la République de Weimar est fêté le 24 avril, qui commémore la proclamation du protectorat sur le Sud-Ouest africain (1884), date retenue comme anniver saire du début de la colonisation30. Après comme avant la guerre, les expositions internationales sont aussi matière à propagande. En 1924, s’est tenue à Wembley une British Empire Exhibition, sur une centaine d’hectares, autour du site sur lequel a été inau guré, un an plus tôt, le célèbre stade de football31. C’est une manifestation purement britannique, qui doit constituer, selon Lord Milner, un solide rempart contre l’affaiblissement de l’Empire. En 1931 s’ouvre l’Exposition coloniale internationale organisée par la France à la Porte de Vincennes, et dont le commissaire général est le maréchal Lyautey. Les responsables britanniques, alléguant les économies que leur impose la gravité de la crise économique qui sévit dans leur pays, ne s’associent que très modestement à cette manifestation, où leur Empire n ’est représenté que par un pavillon dit de l’Hindoustan, et un autre de la Palestine. Le ministre des Colonies fran çaises, Paul Reynaud, y accueille cependant le grand Kipling, alors âgé de 66 ans, en l’honneur duquel est donné un banquet. En revanche les colonies belges, italiennes, néerlandaises, portugaises, et même celles des États-Unis y sont représentées, ainsi que les missions catholiques et protestantes. L’Exposition de 1937 accorde aussi une place notable aux colonies, et notamment aux activités artisanales, présentées à l’île des Cygnes. Après une exposition tenue à Porto (1934), le Portugal tient, en 1940, en association avec le Brésil, une exposition du monde portugais, qui est organisée à Belem, d ’où partirent les premières caravelles32. Ces manifestations drainent des foules nombreuses : 27 millions de billets vendus à Wembley, 33 mil lions à Vincennes. Même fortement réduit du fait que la fréquentation de l’ensemble des attractions offertes exigeait l’achat de plusieurs tickets, le nombre de visiteurs demeure impressionnant : environ 7 millions à Paris33. Elles ont pour but de donner un résumé des ressources des colonies, de leurs arts, et des genres de vie de leurs habitants, mais elles se présentent aussi comme les ancêtres de nos modernes parcs d ’attraction : il y a du Disneyland
30. Metzger (G), l’Europe et l'Afrique de 1914 à 1970, SEDES, 1994, p. 16. 31. Judd (D.), Empire, p. 273 sq. 32. « Le Portugal », Cahiers du Sud, juillet-aoflt 1940, p. 111-112. 33. Voir les pages consacrées au sujet par C. Coquery-Vidrovitch in Histoire de la France coloniale, 1914-1990, par Ageron (Ch.R.), Coquery-Vidrovitch (C.)... et al., A. Colin,. 1990, p. 213-225.
92
Organisation et structures politiques : complexité, diversité et ressemblances
avant la lettre dans la possibilité de visiter des villages indigènes, de faire une promenade en pirogue, de contempler des groupes de danseurs, ou bien d ’assister à des feux d ’artifices. Ces efforts de propagande sont soutenus par nombre d ’associations. Royal Empire Society, British Empire Union, Empire Day Movement, British Empire League, Overseas League, Victoria League, Patriotic League o f Britons Overseas, sont quelques-uns des organes qui s’adonnent à cette tâche en Grande-Bretagne3435. Du côté français, des sociétés comme la Ligue mari time et coloniale, ou V Union coloniale jouent un rôle analogue. Les Italiens s’appuient sur la vieille société Dante Alighieri, reprise en main par des cadres fascistes. Les Allemands même ont ajouté à leurs anciennes associa tions, comme la Société coloniale allemande CDeutsche Kolonialgesellschaft), fondée en 1882, et qui célèbre solennellement son cinquantenaire en 1932, de nouvelles sociétés (en 1922 celle des Anciens Combattants colo niaux, en 1925 la Ligue académique coloniale). Hitler les regroupe en 1933 dans une Ligue coloniale, présidée par le général Franz Ritter Von Epp, dont il fera l’instrument de ses revendications en ce domaine33. En Belgique, à l'Union coloniale belge, créée en 1912, s’ajoutent une vingtaine d ’autres associations, allant de la Fraternelle des troupes coloniales à VAssociation des artistes et écrivains coloniaux, en passant par la Ligue pour la protection de l ’enfance noire et le Cercle colonial ardennais36. Tous ces mouvements s’efforcent d ’agir sur l’opinion, notamment par des conférences ou des arti cles publiés dans la presse. La radio devient aussi un instrument de propagande, de la métropole en direction du réseau de stations qui se montent dans tous les continents, et notamment de ceux des colonies. Les Français ont, à l’occasion de l’Expo sition universelle de 1931 créé une station, dite Radio-Colonial, qui diffuse, le 6 mai 1931, le discours inaugural de Lyautey, président de l’Exposition37. Lointain ancêtre de Radio-France international, le poste prend le nom de Paris-Mondial en 1938. Les Britanniques ne sont pas en reste. La BBC, fondée en 1926, a réalisé sa première émission mondiale à l’occasion de l’inauguration par George V de la Conférence navale de Londres (21 janvier 1930). 242 stations, dont 125 hors d ’Europe ont retransmis et relayé le discours royal. La transmission radiodiffusée par la BBC du premier « message de Noël » du King-Emperor à l’Empire (25 décembre 1933) restera légendaire. C ’est la même année que la radiodiffusion belge commence à émettre de façon régulière en direction du Congo38. U faut noter, cependant, 34. Porter (B.), The Lion's Share, A Short History o f British Imperialism, Longman, 1984, p. 283. 35. Maroger (G.), La question des matières premières et ¡es revendications coloniales. Centre d’études de politique étrangère, 1937, p. 33. 36. Vanderlinden (J.), Pierre Ryckmans, p. 234. 37. Brunquell (F.), Fréquence monde, du Poste colonial à RFI, Hachette, 1992, coll. Pluriel, p. 12-28. 38. Vanderlinden (J.), P. Ryckmans, p. 239.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
que les colonies ne disposent que d’un nombre très réduit de postes de radio à l’époque, essentiellement à la disposition des Européens: 155000 en Afrique du Sud, 50 000 en Algérie, moins de 40 000 aux Indes néerlandaises, un peu plus de 30000 en Inde, alors qu’ils dépassent les cinq millions en Grande-Bretagne, les deux millions en France ou au Japon39. Associer le goût de produits exotiques (dits « coloniaux »), à l’idée d’em pire apparaît comme une manière particulièrement habile de promouvoir celui-ci, même si l’entrée de ces produits sur la table des consommateurs européens est bien antérieure, et n’est pas liée automatiquement à la posses sion de colonies. Cacao et café, fruits exotiques, mais aussi huiles végétales (huile d’arachide ou margarine) ont commencé depuis longtemps à occuper une place croissante dans les budgets familiaux40. Mais c’est sans doute dans cette période de l’entre-deux-guerres, marquée, comme on le verra, par le souci des États de chercher dans les ressources des empires des palliatifs à la crise, que des offices de promotion poussent les consommateurs à acheter des produits « nationaux », et, ce faisant, insistent indirectement sur les liens qui unissent métropole et colonie. C’est ainsi qu’en 1931 le gouvernement de coalition britannique présidé par le Premier ministre travailliste Ramsay Mac Donald organise une grande campagne sur le thème « Buy British ». Dans un esprit moins directement mercantile, Leo Amery, détenteur du portefeuilles du Colonial Office de 1924 à 1929, au sein du gouvernement conservateur, avait fait placarder une série d’affiches dont l’une, intitulée «Bâtisseurs d’Empire» (Builders o f Empire), montrait à droite et à gauche de grandes figures des marins, soldats et hommes d’État, tandis qu’on voyait au centre des dockers qui déchargent des denrées en provenance de l’Empire ; une autre représentait la carte des grandes routes de l’Empire. Beaucoup ont servi à orner les salles de classe, achevant d’illustrer les ensei gnements des manuels scolaires41. « Sens de l'Empire » et « conscience » impériale Toutes ces tentatives ont-elles beaucoup de succès ? Certes, nombreuses sont les déclarations qui soulignent le développement d’une « conscience coloniale » dans l’opinion publique. Les Français, impressionnés par l’œuvre coloniale britannique, l’attribuent à la solidité et à l’ancienneté de l’état d’esprit des Anglais qui les a accoutumés à penser en termes d’outre-mer, à avoir la «tête impériale». Selon Georges Hardy, par exemple, l’opinion publique britannique « communie dans la religion de l’Empire ». Il est vrai que le terme d’empire est utilisé depuis longtemps, et couramment. Les grandes entreprises britanniques ne sont pas les dernières à entretenir cette idée, d’une manière qu’on pourrait dire, dans le jargon d’aujourd’hui, subli minale. Mainte grande entreprise s’affiche fièrement comme « impériale », 39. Huth (A.), La radiodiffusion, puissance mondiale, p. 72 et passim. 40. Flandrin (J.L.) et Montanari (M.), Histoire de l'alimentation. Fayard, 1996. 41. Amery (L.), My Political Life, vol. 2, p. 332.
94
Organisation et structures politiques : complexité, diversité et ressemblances
telle Imperial Tobacco ou Impérial Chemical Industries, ou encore Imperial Airways. Mais cet état d ’esprit ne parait pas limité à la plus prestigieuse des puis sances coloniales. En France, où les partisans de la colonisation avaient dû lutter avec énergie, notamment dans les années 1880, sous la direction de Gambetta et Ferry, pour imposer leur point de vue, l’évolution paraît iden tique, et notamment chez les jeunes générations, soit qu’elles aient été plus marquées par les célébrations et les commémorations, soit que le simple fait d’avoir connu l’Empire colonial à leur naissance, et d ’en avoir plus ou moins entendu parler à l’école les a accoutumées à le prendre comme un donné aussi stable (?) que les 4 807 m du Mont Blanc ou les 551000 km2 du terri toire national. Le maréchal Lyautey proclame, à l’occasion du premier congrès international d ’histoire coloniale tenu lors de l’Exposition de Vincennes qu’il avait longtemps fallu cacher les progrès de la conquête au Tonkin ou à Madagascar, tant « l’esprit était anticolonial ». Mais, proclamet-il, « il ne l’est plus »42. À peu près à la même époque, l’article « colonisa tion» paru dans l’Encyclopédie italienne de 1931, sous la signature du professeur Gennaro Mondaini, décèle une évolution analogue dans son pays. Tel « colonial » belge, en voyage au Portugal, à l’occasion d ’une réunion de la Société de Géographie de Lisbonne, décrit «une foule unanimement passionnée de son passé - et aussi de son avenir colonial »43. Mais bien des nuances sont à apporter à ces déclarations, dont beaucoup relèvent large ment, de la propagande, de l’invocation, ou bien encore du désir de faire naître chez ses compatriotes un esprit d ’émulation en opposant à leur inertie l’esprit d ’entreprise des pays étrangers. On note d’abord, dans l’ensemble, une très grande ignorance des réalités les plus élémentaires. On prétend qu’il arriva au futur Édouard VIII, pourtant grand voyageur, de placer la Nouvelle-Zélande à l’ouest de l’Australie. L’ensemble des Britanniques auraient été encore plus ignorants, puisque, selon un sondage de 1948, 51 % ne pouvaient citer le nom d ’une colonie britannique, et 75% ignoraient la différence entre un Dominion et une colonie44. Un groupe de responsables constitué par le Royal Institute o f International Affairs note, en 1938, que, «bien qu’il accepte l’Empire d’outre-mer presque comme une partie de son propre pays, l’Anglais moyen ne connaît pas grand-chose de la géographie et/ou des structures constitu tionnelles de l’Empire »45. Un auteur croit devoir citer une formule selon laquelle « l’Orient ennuie profondément le public britannique »46. On serait 42. Revue d’histoire des Colonies, 1931, p. 480. 43. Vanderlinden (J.), Pierre Ryckmans, p. 238. 44. Ageron (Ch.-R.), La décolonisation française, A. Colin, 1991, p. 107 ; Goldsworthy (D.), Colonial Issues in British Politics, Oxford, Clarendon Press, 1971, p. 399-400. 45. The British Empire, A Report..., p. 16. 46. Simey (T.S.), «Social Advance in Non-Autonomous Territories», Principles and Methods o f Colonial Administration, Colson Papers, Londres, Butterworths Scientific Publications, 1950, p. 216.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
tenté de dire qu’il en va de même dans l’Empire français. Une légende, rappelée comme telle par Paul Reynaud dans ses mémoires, voulait que les ministres des colonies françaises prennent connaissance du nombre et des noms des territoires placés sous leur autorité en même temps que possession de leur bureau dans lequel figurait, en bonne place, une mappemonde ; quant aux Français en général, d ’après une enquête rapportée par Charles-Robert Ageron, seulement 28 % seront capables, en 1949, d ’indiquer cinq colonies ou plus, 19 % ne pouvant en citer aucune, et il n’y a guère de raison de penser que ces pourcentages auraient été très différents dix ou vingt ans plus tôt. Il est vrai que, le plus souvent, l’étude des colonies est placée en fin des programmes scolaires, et donc nécessairement sacrifiée. Mais cette ignorance s’explique en partie par le désintérêt. Dans bien des pays, on se plaint du manque de curiosité des populations de la métropole pour l’œuvre coloniale. Paul Reynaud, en préparant l’Exposition de 1931, pense que « les Français savent qu’ils ont un Empire, mais ils ne le sentent pas »47. Les espoirs mis par le ministre dans l’Exposition pour promouvoir ce sentiment ont-ils été exaucés ? Non, s’il faut en croire le Bulletin du Comité de VAfrique française de 1933, qui estime que « tout reste à entre prendre pour faire l’éducation de ce pays qui a reconstitué un Empire depuis plus d ’un siècle et n’en a encore pris aucune conscience précise»48. Ce désenchantement n ’est pas seulement français. Le Hollandais De Kat Angelino regrette, de son côté, le manque « d ’enthousiasme national » pour l’œuvre coloniale, et déclare que « il est nécessaire d ’éduquer notre peuple, dans sa totalité, pour qu’il se hausse jusqu’au sentiment conscient de sa responsabilité ». Il en appelle à un vaste effort de propagande pour popula riser l’idée d’une « solidarité pannéerlandaise »4950. Quant à l’écrivain britan nique Noël Coward, soulignant que, plus que le désir de s’instruire, c’était l’attrait de l’amusement qui avait entraîné les foules aux grandes expositions, il met dans la bouche d’un père qui a accompagné son fils à l’Exposition de Wembley : « je t’ai emmené voir les merveilles de l’Empire, et tout ce que tu veux, c’est aller aux autos tamponneuses » ^ D faut dire que le co-fondateur de la WGTW (Won’t Go to Wembley Society) n’était pas, à l’image du poète André Breton, fondateur d ’une association assez comparable lors de l’Exposition de Vincennes, un chaud promoteur de la grandeur impériale. Si le peuple est peu passionné, les colonies ne suscitent guère plus d ’intérêt dans la classe politique. Là même où un régime parlementaire permet un contrôle effectif, les occasions de débat sont relativement peu fréquentes. Entre 1934 et 1939, la Chambre des Communes britannique n’aurait évoqué que neuf fois des questions coloniales (Inde non comprise), la Palestine l’ayant occupée quatre fois. Fumivall, ancien fonctionnaire
47. Reynaud (R), Mémoires, 11, p. 301. 48. Ageron (Ch.R.), France coloniale ou parti colonial ? PUF, 1978, p. 254. 49. De Kat Angelino (A.), Le problème colonial, vol. D, p. 759. 50. Morris (J.), Farewell the Trumpets, Penguin Books, 1978, p. 302.
96
Organisation et structures politiques : complexité, diversité et ressemblances
spécialiste des questions birmanes, note que la Birmanie n’a suscité l’atten tion qu’une fois tous les dix ans51. On pourrait en dire autant de toutes les colonies. Certes, cette situation est, autant qu’une marque directe de peu d’intérêt, le résultat d ’un système qui, nous l’avons vu, ne postule qu’exceptionnellement l’intervention des élus métropolitains. Mais cet état de fait n’est-il pas en lui-même significatif? Il faut ajouter que les hommes poli tiques de la métropole ont rarement le désir de se rendre compte sur place. Quand Paul Reynaud décide de faire une tournée de trois mois dans l’Empire, entre septembre et décembre 1931, il est le Premier ministre en exercice à s’aventurer au-delà du canal de Suez, et cela ne va pas d ’ailleurs sans de vertes critiques de ceux qui lui reprochent de gaspiller les deniers de l’État. Un tel voyage reste d ’ailleurs un cas isolé. Seule l’Afrique du Nord est régulièrement visitée par des missions parlementaires ou ministérielles. Encore ces déplacements concernent-ils le plus souvent des spécialistes, toujours les mêmes. Bien peu des habitants des métropoles, a fortiori, peuvent avoir une expé rience directe des colonies. La difficulté et la longueur des voyages ont tendance à distendre, voire à supprimer les liens des communautés euro péennes émigrées avec les métropoles. Le tourisme, certes, se développe. En Afrique du Nord, par exemple, les initiatives de John Dal Piaz, président de la Compagnie générale transatlantique, amènent la fondation des hôtels Transat. Mais il ne touche encore que des groupes peu nombreux. Au Maroc, en 1934, on ne dénombre encore que 60000 touristes, ce qui est peu, même si ce chiffre est dix fois supérieur à celui de 1929, et même s’il semble que la crise n’ait pas contrarié ce mouvement52. À Bali, où on parle d’un afflux de touristes, on n’en compte guère plus d ’une centaine par jour. En Indonésie, ils ne dépassent pas 20000, et on en compte à peu près le même nombre en Indochine53. Comment s’en étonner, alors que la France reçoit alors moins d’un million de touristes par an ? Ces voyages exigent en effet loisirs et ressources financières : par exemple, les croisières proposées en 1937 par les Messageries maritimes en Méditerranée, Indochine et Madagascar exigent respectivement vingt-cinq, quatre-vingts et soixante-cinq jours, à des prix variant entre 4 500 et 5 500 francs, sommes qui représentent la moitié du salaire annuel d ’un petit employé, c’est-à-dire environ 50000 francs d ’au jourd’hui54. Les voyageurs ne constituent guère plus que ce qu’on appelle rait, dans le jaigon d’aujourd’hui, une jet-set cosmopolite. On trouve parmi eux des hommes politiques, dont le plus célèbre est sans doute Winston Churchill, qui fréquente l’hôtel de la Mamounia à Marrakech, ou encore des
51. Fumivall (J.S.), Colonial Policy and Practice, : a comparative Study in Burma and Netherlands India, Cambridge, Cambridge University Press, 1948, p. 522. 52. Courdurié (M.) et Miège (J.-L.), dir., Marseille colonial face à la crise de 1929, Chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence, 1991, p. 65 (Histoire du commerce et de l ’industrie de Marseille, tome VI). 53. Revue du Pacifique, 1936, p. 657. 54. Bulletin du Comité de l’Asiefrançaise, 1937 (Encart publicitaire).
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
groupes d ’intellectuels et d ’artistes, assez nombreux. Par exemple à Bali, toute une petite société se constitue sous le patronage de l’exilé russe Walter Spies, installé dans l’île en 1927, et chargé à partir de 1932 d ’organiser le musée local, mais aussi une école de peinture et des ballets traditionnels. Il reçoit des personnages aussi différents que l’ethnologue Margaret Mead, le dramaturge Noël Coward, Miguel Covarrubias, auteur du classique Island o f Bali, publié en 1937, et bien d ’autres. Pendant ce temps, des Américains ouvrent le premier hôtel sur la (pas encore) célèbre plage de Kuta5556. En Afrique, les grandes chasses attirent les amateurs de safaris, comme Ernest Hemingway qui publie en 1936 Green Hills o f Africa. Le passage ou la présence de « coloniaux » au pays sont peut-être plus importants dans la mesure où, comme on le verra, les implantations défini tives d ’Européens outre-mer sont assez rares. Marins, soldats, marchands, fonctionnaires affectés dans les colonies, effectuent un certain nombre d’allers-retours entre métropole et outre-mer. Nombre d’entre eux passent ainsi l’été dans les villes d ’eaux. Ils achèvent le plus souvent leur vie dans leur patrie, où leur nombre n’est pas aussi négligeable qu’on pourrait le croire. Selon Amry Vandenbosch, qui écrit en 1940, environ 60000 habitants de La Haye, ville alors peuplée de 300 000 habitants, auraient vécu aux Indes néerlandaises36. Mais on peut se demander si les objets, les anecdotes, les bribes de savoir pratique qu’ils rapportent entretiennent autour d ’eux, et notamment chez les plus jeunes, les seuls qui ont le loisir de les écouter, autre chose que le mythe de vies extraordinaires, au milieu de peuples étranges ; pour autant du moins que vieux colonels, vieux administrateurs, et, plus souvent, vieux sous-officiers et vieux employés n’agacent pas leurs voisins avec des souvenirs perpétuellement ressassés, Au total, le citoyen ordinaire, absorbé par ses préoccupations quoti diennes, singulièrement à partir de la crise des années 1930, voire par la hantise d ’un conflit en Europe, ne semble guère s’intéresser à son Empire. Pour beaucoup, les colonies restent le lieu de l’aventure, de l’exotisme, de l’inconnu, et c’est en cela qu’elles fascinent l’homme de la rue. Quelques mots, quelques images, quelques scènes conservées de la lecture d ’un roman ou de la vision d’un film, suffisent à évoquer un univers : douceur des îles inconnues, bercées du balancement des palmes, sous les branches chargées de fruits, de fleurs et d ’oiseaux ; âpreté des déserts, hantés par les tambours des sables, pays de la soif et de la mort ; touffeurs de la forêt vieige, lieu des poisons et des sortilèges ; splendeurs des maharadjahs, avec leurs carrosses d’or massif, leurs serviteurs vêtus de brocards, leurs parures de pierres précieuses et de diamant, et, faisant flotter là-dessus un parfum d ’héroïsme et d ’aventure, les grandes figures coloniales, les Brazza, les Marchand, les Pavie, les Gordon, les Kitchener, les Lawrence, les Boumazel... Pour d ’autres,
55. Lyon (J.) et Wheeler (W.), Bali et Lombok, Lonely Planet, 1997, p. 141-142,182. 56. Vandenbosch (A.), The Dutch East Indies, p. 70.
,
Organisation et structures politiques : complexité diversité et ressemblances
ces contrées constituent une réserve d ’hommes, de matières premières, de débouchés, d ’espace même, dont on éprouve le sentiment confus qu’ils contribuent à la puissance et à la prospérité nationale. Mais il s’agit, le plus souvent, d ’un sentiment assez vague, qui n’implique guère de connaissance précise des colonies elles-mêmes et de leurs problèmes. Les colonies sont des pays lointains et différents, et bien peu, sans doute, se sentent, en dépit des campagnes diverses, une véritable affinité avec les hommes qui les peuplent, y compris à l’égard de leurs compatriotes émigrés. Mais au fond tout cela n’a guère d ’importance. L’essentiel est que l’Empire ne paraisse pas susciter de trop lourdes charges aux yeux de l’opinion publique. C’est, comme nous le verrons, le cas pendant la plus grande partie de la période. De toute façon, l’état d’esprit qui anime les décideurs est sans doute la tendance à accepter la colonisation comme un donné, et cette conception, étayée par des arguments apparemment solides, constitue le fondement d ’une véritable idéologie « impériale ». Idéologies Dans les années trente, le temps des grands débats sur le bien-fondé des occupations, leur utilité pour la métropole, leur apport réel à la prospérité des habitants parait dépassé, au profit de l’acceptation lucide d ’une situation qu’il ne paraît plus au pouvoir de personne de changer. Comme l’écrit le Belge Pierre Ryckmans, gouverneur du Congo, « l’occupation des territoires coloniaux fut-elle dans son principe moralement justifiée ? C ’est une ques tion qui ne se pose pas, du point de vue de la politique pratique. La colonisa tion moderne s’impose à nous avant tout comme un fa it Légitime ou non, elle existe, il faut en tenir compte »S758. Pourtant, la thématique qui domine alors est le plus souvent désignée par ceux qui ont étudié le sujet comme un « humanisme colonial ». Plus que jamais, les interprètes des colonisateurs ont tendance à mettre en sourdine les réels enjeux, économiques, politiques et culturels, qui justifient le maintien de la domination, et à souligner le caractère, sinon totalement désintéressé, du moins très généreux, d’une mission qui transcende largement les intérêts purement nationaux. Un rapport britannique de 1922, cité par le gouverneur Alan Bums dans son ouvrage sur le Nigeria proclame ainsi que « c’est la mission de la Grande-Bretagne que de travailler continuellement à la forma tion et à l’éducation des Africains, pour les amener à un niveau intellectuel, moral et économique plus élevé que celui qu’ils avaient atteint quand la Couronne a assumé la responsabilité de l’administration de ce territoire »ss. Dix ans plus tard, Paul Reynaud, avec des accents plus spiritualistes encore, déclare : « nous croyons que le gain n’est pas le but essentiel de la colonisa
57. Vanderlinden (J.), Pierre Ryckmans, 1891-1959. Coloniser dans l’honneur, Bruxelles, De Boeck-Université, 1994, p. 265. 58. Bums (A.), History of Nigeria, Londres, George Allen and Unwin, 1963, p. 232.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
tion, et que c’est seulement dans la pénétration des âmes des peuples qui vivent à l’abri de notre drapeau que nous pouvons arriver à harmoniser des civilisations différentes sans les blesser »59. En même temps, l’idée selon laquelle la contrepartie du droit de conquête réside dans un devoir pour le conquérant achève de s’imposer. Beaucoup souscriraient à la parole de Montesquieu, écrivant : « C ’est à un conquérant de réparer une partie des maux qu’il a faits : je définis ainsi le droit de conquête : un droit nécessaire, légitime et malheureux, qui laisse toujours à payer une dette immense, pour s’acquitter envers la nature humaine»60. L’image du « fardeau de l’homme blanc » de Kipling, risquant sa vie et sa santé au-delà des mers pour mener à bien une tâche providentielle dont nul ne lui saura le moindre gré, symbolise cette attitude oblative, dont on crédite le soldat, le missionnaire, et même le simple et pauvre colon. D’aucuns évoquent même, citant l’Évangile selon saint Luc, la notion de «service inutile », selon laquelle nul ne doit revendiquer le moindre mérite pour la tâche que sa conscience lui impose d ’accomplir. Dominer et Servir est le titre d’un ouvrage publié en 1931 par Pierre Ryckmans, l’année même où paraît, sous la plume d ’Albert Sarraut, Grandeur et servitude coloniales. Cette doctrine est souvent présentée comme en continuité avec une tradi tion. Selon l’auteur britannique O’Malley, on trouve dès 1833, dans un rapport parlementaire, l’idée selon laquelle les intérêts des Indiens doivent être pris en compte en priorité, toutes les fois qu’ils entrent en conflit avec les Européens ; O’Malley souligne le caractère précoce de l’expression de ce principe, dont il est le premier à reconnaître qu’il demeura longtemps sans réelle application, mais qu’il s’impose désormais61. Pour les Français, il leur est facile de se réclamer (pour le moins) de l’héritage de Jules Ferry, qui exaltait « l’œuvre civilisatrice qui consiste à relever l’indigène, lui tendre la main, le civiliser »62. Pour leur part, les Hollandais, longtemps réputés pour leur âpreté dans l’exploitation de leurs colonies, se sont prononcés au début du XXe siècle, en faveur d ’une « politique éthique » qui mettait l’accent sur une plus grande considération de la condition des indigènes, appelés à être associés plus largement à l’administration du pays, et à voir s’améliorer leurs conditions de vie. Bien que cette formule, dans la terminologie de laquelle se discerne l’influence d’un protestantisme particulièrement sensible aux valeurs de moralité, soit limitée aux Pays-Bas, elle ne serait pas déplacée ailleurs. De son côté, le futur Léopold III cite en 1933 une instruction de son grand-oncle, Léopold II, fondateur du Congo, écrite trente-six ans plus tôt (1897), selon laquelle le but de la Belgique en ce pays n’était autre que le
59. Reynaud (R), Mémoires, 1.1, p. 305. 60. Montesquieu, L’Esprit des Lois, Livre X, chapitre IV, Gallimard, 1995, p. 305, coll. Folio-Essais. 61. O’Malley, Modem India, p. 800. 62. Discours au Sénat, 6 mai 1891, Ageron (Ch.-R.), France coloniale ou parti colonial ?
Organisation et structures politiques : complexité, diversité et ressemblances
« libre épanouissement de la population native » et sa « régénération maté rielle et morale »63. Cette mission n’apparait pas seulement comme un acte unilatéral. L’action «civilisatrice se fonde aussi, partiellement, sur un sentiment de gratitude à l’égard des colonies pour leur coopération à la prospérité de la métropole. S’agit-il d ’une reconnaissance sincère, ou d ’une propagande destinée à convaincre les opinons de l’intérêt de posséder des colonies ? L’un et l’autre, sans doute. Vers 1900, le Hollandais Van Deventer, un ancien avocat à Semarang, rentré en Hollande et devenu défenseur des populations javanaises, parlait d’une «dette d ’honneur{eereschuld) », due par la Hollande aux Indes, dont les ressources avaient contribué à enrichir la métropole. En France, après 1918, c’est d ’une considération de la participation des colonies à la Grande Guerre, et notamment du sacrifice de leurs soldats, que se nourrissent souvent les projets de politique coloniale. Le président de la République Alexandre Millerand déclarait, lors de son élection (septembre 1920), dans un message aux Chambres, que « Notre Algérie, nos pays de protectorat, nos colonies, dont l’admirable accroissement atteste le génie et la ténacité d ’hommes d ’État républicains, ont payé laigement et sous toutes les formes leur dette à la métropole. Elle saura reconnaître à son tour ce qu’elle leur doit en les associant de plus en plus intimement à sa vie poli tique et morale »64. Sur deux points, cependant, les auteurs des années trente croient devoir insister sur la répudiation d ’errements passés. On orchestre d’abord largement le thème selon lequel la page des conquêtes, avec ses épisodes sanglants, est définitivement tournée. Nul n’a plus que Lyautey fait passer dans le vocabulaire courant des termes comme « pénétration pacifique ». On préfère, au moins, au mot de conquête, celui de pacification, qui insiste sur le résultat plus que sur les méthodes. C’est sous le titre de « conquête et pacification » que le général Paul Azan publie, en 1931, son histoire des opérations militaires en Algérie de 1830 à 1857. Cette pacification est présentée comme devant nécessairement mener au rappro chement des conquis ou des conquérants, dans la mesure où elle ne serait pas, par essence, acte de violence, mais effort nécessaire pour briser la cara pace d ’incompréhension qui amenait l’indigène à refuser les bienfaits de la colonisation. La soumission marquerait ainsi ce que Lyautey appelait « la fin d’un malentendu». En 1923, le même général Azan avait sous-titré sa biographie (par ailleurs excellente) d ’Abd el-Kader de la formule « du fana tisme musulman au patriotisme français ». L’itinéraire authentique qui avait fait du chef vaincu dans la guerre contre la France un homme de paix et de dialogue, mort à Damas en 1883, décoré du grand cordon de la Légion d ’honneur était ainsi interprété dans le sens très favorable (et probablement abusif) d ’une identification à une nouvelle mère-patrie. Le souvenir des
63. Labouret (H.), « La tradition coloniale », art. cit., p. 439. 64. Sarraut (A.), La mise en valeur des coloniesfrançaises, Payot, 1922, p. 81.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
épisodes sanglants ou douloureux des conquêtes, lorsqu’il n’est pas édulcoré, est présenté comme la rançon nécessaire du progrès. L’Autrichienne Vicki Baum, après avoir décrit longuement la révolte de Bali de 1906, se dit tentée de penser que « le sacrifice fait jadis par tant de Balinais avait un sens profond, et qu’il a enseigné aux Hollandais à gouverner ce peuple d ’insu laires doux et orgueilleux avec la prudence dont ils font preuve, et à nous conserver ainsi en Bali le paradis que cette île est restée »65. La seconde remise en cause concerne ce qu’il est convenu d ’appeler la « mise en valeur ». Les Français, notamment, adeptes du protectionnisme, soulignent que la vieille notion de « Pacte colonial », ou de « mercantilisme » selon laquelle les colonies devaient être exploitées au pur profit de la métro pole, n’est plus de saison depuis longtemps ; les Britanniques, plutôt libreséchangistes, tiennent à indiquer qu’il n’est plus question de s’exposer aux reproches formulés jadis à l’encontre d ’une politique qui a ruiné les indus tries traditionnelles indiennes en imposant l’entrée sans contrôle des produits industriels anglais. «À l’heure actuelle, écrit en 1931 l’écrivain colonial français André Demaison, coloniser veut dire : faire commerce d ’idées et de matières, non point avec des êtres grevés de misère physique et morale, mais avec des gens aisés, libres et heureux »66. On verra plus bas les raisons, les applications et les limites de cette attitude. Contentons-nous à ce point de notre étude, d ’en relever la fréquence dans le discours officiel. La contribution la plus importante à l’élaboration d ’une doctrine colo niale entre les deux guerres est sans doute celle de double mandat, formulée par Lord Lugard, (1838-1945), organisateur du Nigeria entre 1912 et 1918. Son Dual Mandate in British Tropical Africa, publié en 1922, est devenu, pour bien des années, un ouvrage de référence. Selon ce « grand colonial », ¡’Angleterre a été investie en Afrique d ’une double mission : à la fois à l’égard des peuples soumis, dont elle a le devoir d ’améliorer les conditions de vie, et à l’égard de l’humanité, pour le bénéfice de laquelle elle doit déve lopper les ressources du pays. L’intérêt que doit retirer l’Angleterre de cette politique ne doit lui être donné, en quelque sorte, que par surcroît67. La puis sance coloniale exercerait, en ce sens, la charge de fondé de pouvoir, ou de curateur (terme traduit de l’anglais trustee, la notion de trusteeship, qui peut d’ailleurs se traduire par mandat, impliquant une notion de foi jurée plus forte qu’en français). Ces considérations rencontrent une grande faveur. Vingt ans plus tard, Ernest Barker y décèle même le décalque logique aux colonies d ’une tradition britannique selon laquelle, depuis le XVIIIe siècle, le Roi et le Parlement ne sont que les tuteurs chargés de gérer au mieux le patri moine du peuple anglais. Cette généalogie, qui paraît quelque peu forcée, a
65. Baum (V.), Sang et volupté à Bali [1937], ed.10/18, p. 11. 66. Exposition coloniale internationale. Paris 1931. Guide officiel, Mayeux, s.d., p. 20. 67. Crowder (M.), «The Economie exploitation of Africa» in Gifford (P.) and Roger Louis (WM), France and Britain in Africa, Yale University Press, New Haven et Londres, 1971, p. 593-662.
,
Organisation et structures politiques : complexité diversité et ressemblances
le mérite de rendre la colonisation moderne compatible avec les exigences d’une démocratie, en soulignant en particulier les potentialités d ’une évolu tion des dépendances coloniales vers des libertés et des institutions représen tatives analogues à celles dont l’Angleterre s’enoigueillit à juste titre68. Lugard reprochait à la France de se comporter d ’une façon différente, en cherchant à exploiter ses colonies pour son seul bénéfice. Pourtant Albert Sarraut, auquel on peut le comparer, ne tient pas un autre langage dans La mise en valeur des colonies françaises, un livre publié la même année que celui de Lugard. « La France qui colonise, écrit-il, ne travaille pas pour elle ; son avantage se confond avec l’avantage du monde ; son labeur doit, autant qu’à elle-même, profiter aux colonies, dont elle assure l’accroissement économique, et le développement humain »69. Dans une sorte de réponse à Lugard, il croit devoir dénoncer de son côté « la politique monétaire étroite » et le « détachement égoïste » des nations anglo-saxonnes, et déclare mettre ses espoirs dans une coopération internationale, que paraît encourager la naissance de la toute récente Société des Nations. Le baron Van Asbeck, ancien haut fonctionnaire du gouvernement des Indes néerlandaises, et membre de la Commission permanente des mandats de la SDN, en visite à Paris en 1939 écrit de même « les responsabilités d’une puissance coloniale portent en tout premier lieu sur des intérêts d ’autrui, ceux d ’une commu nauté autre que la sienne propre et dont la charge lui incombe »70. Certes, cette évolution est en grande partie le fruit d’une transformation historique qui a profondément modifié les conditions de la domination colo niale. Les périodes de conquête, marquées par l’esprit d ’aventure, les actes d’héroïsme, mais aussi la violence et les abus de toute sortes, peuvent être considérées comme terminées à peu près partout ; l’essentiel des ressources jugées de bon rapport sont passées sous le contrôle d’entreprises euro péennes; des administrations civiles sont partout en place. Dès lors, gouverner les populations en s’assurant, le plus possible, de leurs sympa thies, est une conception qui s’impose à tout responsable de bon sens. De même, il semble absurde, alors qu’on s’efforce d ’établir un nouvel ordre mondial, et d ’écarter le spectre d ’un nouveau conflit, de revenir à des riva lités coloniales qui ont contribué, pour le moins, à accroître les tensions en Europe avant 1914. Cependant, comme on le verra, cet accent mis sur le caractère constructif de l’œuvre de colonisation, à l’égard des peuples soumis comme à l’égard de l’humanité en général traduit, aussi, la nécessité d’une justification de la détention d ’immenses territoires, face à des voix, de plus en plus nombreuses, qui contestent ce contrôle. Ce n’est pas par hasard si la doctrine du « double mandat » émane de la plus grande des puissances coloniales. Il s’agit en effet de répondre à deux types de critiques radicales apparues après la guerre. 68. Barker (E.), Ideas and ideals, p. 66. 69. Sarraut (A.), La mise en valeur, p. 19. 70. Van Asbeck, « Les responsabilités néerlandaises... », art. cit., p. 189.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Le premier élément nouveau réside dans les principes introduits par le président américain Woodrow Wilson à l’occasion de la participation de son pays à la guerre mondiale aux côtés des Alliés en 1917, et surtout aux négo ciations de paix qui suivent les armistices de l’automne 1918. Nul n’ignore, sinon le texte, du moins la substance de deux des Quatorze points proclamés par lui en janvier 1918 : le devoir, en ce qui concerne l’avenir des colonies allemandes, de considérer les intérêts des populations autant que l’équilibre des puissances ; l’assurance, pour les pays non turcs de l’Empire ottoman, d ’un « développement autonome ». Il pose ainsi les bases, au moins théo riques, du droit des peuples à disposer d ’eux-mêmes, allègrement foulés aux pieds lors de l’expansion coloniale, y compris, d ’ailleurs par son propre pays. Par ailleurs, l’article 119 du traité de Versailles, qui enlève ses colonies à l’Allemagne, repose, pour Wilson, sur un fondement de morale internatio nale : « les colonies doivent être enlevées à l'Allemagne parce qu’elle les utilisait comme un objet d ’exploitation»71. Français et Anglais, de leur côté, reprennent avec chaleur l’argument selon lequel par sa « barbarie », sa « tyrannie », son « indifférence pour l’intérêt et le développement des races indigènes », l’Allemagne a perdu le « droit » de posséder des colonies72. Le fait que les dépouilles des Empires allemand et ottoman ne soient pas attri buées aux États vainqueurs en toute souveraineté, mais leur soient seulement confiées par la SDN à titre de mandats, constitue, sinon une application directe, du moins une concession importante aux exigences du président américain. Même si cela n’est pas toujours bien perçu à l’époque, l’âge des annexions pures et simples est terminé. L’application des idées wilsoniennes suppose aussi la notion d ’un contrôle international. Une commission permanente de la SDN est chargée de la supervision des mandats, exercée essentiellement à partir de rapports annuels, mais éventuellement de missions sur place, et du recueil de pétitions émanant des représentants des populations. En 1922, Albert Sarraut affirme : « un contrôle international nouveau fixe aujourd’hui sur le fait colonial des regards autrement vigilants que jadis »73. Quelques années plus tard, certains milieux coloniaux français dénoncent la tendance de la SDN à se transformer en un «super É tat», ambitionnant d ’exercer un droit de regard non pas seulement sur les mandats, mais même sur l’ensemble des colonies, au mépris de la souveraineté des États74. Ces craintes sont bien excessives. Mais il est vrai aussi que la colonisation doit légitimer sa présence par les progrès qu’elle suscite dans les pays conquis. En proposant un plan d’équi pement des colonies dont il sera parlé plus loin, Sarraut fait remarquer à ses
71. Metzger (G), L'Empire colonialfrançais dans la stratégie du Troisième Reich, 19361945, Thèse d’histoire. Université Paris-IV, 1998, p. 27. 72. Déclaration de Lord Curzon à la Chambre des Lords, 11 février 1919, Bulletin du Comité de l’Afriquefrançaise, 1919, p. 13. 73. Sarraut (A.), La mise en valeur, p. 29 ; voir aussi Boutant (C.A.), Les mandats interna tionaux, Syrey, 1936. 74. Bulletin du Comité de l’Afriquefrançaise, 1929, p. 268-269 et passim.
Organisation et structures politiques : complexité, diversité et ressemblances
compatriotes qu’il ne s’agit pas seulement d ’un devoir de progrès ou d ’hu manité, mais bien aussi de la nécessité pour la France de ne pas se voir contester par d’autres la possession « d’immenses étendues de terres sans culture, des mines sans exploitations, des voies d ’eau sans aménagement ». Cette inquiétude ne peut que se renforcer par la suite75. Vers 1930, certains proposeront, en se fondant sur cette aigumentation, un transfert des colonies portugaises à la SDN, en déclarant ce pays incapable de mettre en valeur son immense empire76. La répartition en faveur de la Grande-Bretagne et de la France est fréquemment dénoncée, par les représentants de trois puissances, Allemagne, Italie et Japon, qui y voient l’occasion de remettre en cause l'ordre mondial instauré par les traités de paix de 1919. On aura l’occasion de retrouver ces questions plus loin. L’inquiétude ne vient pas seulement des prises de position américaines. Face aux déclarations de Wilson en faveur d’un nouveau droit international se dresse, depuis 1917, l’exigence d ’une impitoyable justice révolutionnaire exercée par le prolétariat mondial. Le programme qui postule le principe du droit des colonies à l’autodétermination, sur les bases de la déclaration du gouvernement soviétique du 15 décembre 1917 relatif aux droits des peuples de Russie, répond exactement, dans son affirmation radicale, aux souhaits d’émancipation. L’affirmation du triomphe inévitable de la cause de l’éman cipation des peuples, qui doit être le finit des contradictions inévitables du capitalisme comme de la lutte des militants, agit comme un puissant stimu lant. Surtout, la fondation du Komintern en 1919 fournit aux résistances anti coloniales des appuis et une audience internationale. La 8e des 21 conditions imposées aux partis socialistes désireux d’adhérer à la IIIe Internationale souligne le devoir de « dévoiler impitoyablement les prouesses de [« leurs »] impérialistes aux colonies, de soutenir, non en paroles, mais en faits, tout mouvement d’émancipation dans les colonies, d ’exiger l’expulsion des colo nies des impérialistes de la métropole, de nourrir au cœur des travailleurs du pays des sentiments véritablement fraternels vis-à-vis de la population labo rieuse des colonies et des nations opprimées, et d’entretenir parmi les troupes de la métropole une agitation continue contre toute oppression des peuples coloniaux ». Des colonisés apparaissent au premier rang des chefs de la m e Internationale, comme l’Indien Roy, qui proclame la priorité de faire triompher la révolution en Orient, en soulevant les masses paysannes contre l’exploitation bourgeoise et impérialiste, comme condition préalable à la révolution mondiale. En septembre 1920, le Congrès des peuples d ’Orient tenu à Bakou manifeste les ambitions anticolonialistes du mouvement communiste. En décembre, au Congrès de Tours qui fonde le PCF, le jeune Nguyen Ai Quoc, le futur Ho Chi Minh, souligne l’importance des colonies dans le combat pour la révolution. Autant de menaces pour des empires où l’établissement du capitalisme moderne, garanti par l’ordre colonial, ne se fait pas sans douleur. 75. Sarraut (A.), La mise en valeur, p. 33. 76. Böhm (E.), La mise en valeur des colonies portugaises, PUF, s. d. [1934].
C hapitre 4
Structures de l ’économ ie
La persistance évidente des sociétés traditionnelles et de leurs modes de vie en cette première moitié du XIXe siècle a amené souvent à parler pour les territoires coloniaux d ’économie duale, qui opposerait un secteur moderne, capitaliste, européen, et ouvert sur les échanges extérieurs, à un secteur tradi tionnel, pré-capitaliste, clos, statique, indifférencié et autosuffisant. Cette observation est trop schématique, car, depuis longtemps déjà, et de plus en plus, des transformations profondes sont à l’œuvre et continuent à rappro cher des mondes qui n’ont jamais été véritablement séparés. De ces change ments, la colonisation est évidemment un facteur puissant, puisqu’elle associe pour la première fois dans les pays concernés le pouvoir politique et les intérêts capitalistes, conçus comme un élément essentiel de prospérité et de développement Si cette association est aujourd’hui à peu près générale dans le monde, la spécificité du phénomène colonial réside dans le fait que, en pays colonisé, le pouvoir et les intérêts en question sont aux mains d ’inté rêts étrangers, ce qui en accentue sans doute l’aspect oppressif. Comme l’écrivait à juste titre Fumivall, « quand le Dominateur est en même temps Marchand, la contrainte ne connaît pas de bornes »*. Une première conséquence de cette situation est évidemment la participa tion des colonies à l’édification d ’un marché mondial des matières premières et des produits alimentaires, rendu possible par l’établissement déjà évoqué d’un réseau de transports et de communications. Certains pays atteignent déjà un degré élevé de spécialisation. Mais cette ouverture paraît masquée, voire retardée, par les conséquences de la crise des années 1930. À cette situation difficile, les empires, à tout le moins les plus importants, réagissent en cherchant à resserrer leur cohésion. Jamais, sans doute, la possession d ’un empire ne sera apparue, sinon comme un facteur essentiel de prospérité, du moins comme un recours indispensable en période de crise. En même temps, les difficultés économiques et sociales auront suscité des réflexions et de nouvelles perspectives.I.
I. Fumivall (J.S.), Netherlands India, p. 116. Voir aussi Colonial Policy, p. 304.
107
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Présence européenne et capitalism e L’intervention de l’Europe dans l’économie des pays colonisés peut s’évaluer au sens large par les chiffres d ’investissements et du commerce extérieur déjà considérés plus haut Mais, pour en prendre une mesure plus précise, il faut tenter d ’en saisir, au moins partiellement, les effets induits au sein des différents secteurs d ’activité. Les transports locaux Les ports ont toujours été les têtes de ligne de la pénétration étrangère. Pourtant, ils ne bénéficient pas toujours d ’installations remarquables. À des escales très bien outillées comme Port-Saïd, Dakar ou Singapour, s’opposent les wharfs de la plupart des côtes de l’Ouest africain, au large desquels stationnent les navires, tandis que des pirogues font l’aller-retour en bravant la barre. Quelques-uns font exception, comme Takoradi en Gold Coast, inau guré solennellement en 1928, dû à l’opiniâtreté de Gordon Guggisbeig, gouverneur de la colonie et ancien du Royal Engineer2. Nul ne peut supposer alors le rôle que ces ports africains joueront dans la stratégie alliée à partir de 1942. C ’est en effet en partant de Takoradi que les avions de combat ou de transport montés sur place et destinés à renforcer les troupes britanniques confrontées à l’offensive de YAfrika Korps de Rommel atteindront l’Égypte, après escale à Fort-Lamy et iUiartoum. Preuve de l’importance de la voie aérienne ouverte dès 1936 par les Imperial Airways. Sur place, l'outillage en chemins de fer constitue, sinon la seule, du moins la plus spectaculaire des infrastructures. La France s’enoigueillit du chemin de fer du Yunnan, de 8S9 km de long, avec ses innombrables ouvrages d ’art : en territoire chinois, de Lao-Kay à Kun-Ming, sur 465 km, on ne compte pas moins de 155 tunnels, 3 400 ponts et viaducs en maçon nerie, 22 ponts et viaducs métalliques, dont le pont « en dentelle » du km 83 et le pont « en arbalétrier » du km 114, « sorte de tour Eiffel couchée audessus d ’un néant fabuleusement étroit et enfoncé »3. D’autres réalisations sont célèbres : en décembre 1929, la gare d ’Addis-Abeba a été inaugurée solennellement en présence du Négus (non encore couronné) Haïlé Sélassié, du maréchal Franchet d ’Esperey, du duc des Abruzzes et du duc de Glou cester, ce qui parachève la construction de la ligne, établie pour l’essentiel entre 1897 et 1917, sur 783 km4. Le célèbre Congo-Océan, de Brazzaville à Pointe-Noire, inauguré en 1934, a exigé 10 millions de mètres cubes de terrassements, 12 tunnels, 82 ponts et 82 viaducs sur 511 km5. Certains
2. Annales de Géographie, 1929, p. 294. 3. Lartilleux (H.), Géographie universelle des transports, terres lointaines, Chaix, 1949, p. 108. La citation est tirée de L. Bodard, Lefils du consul. Grasset, 1975, p. 136. 4. Van Gelden de Pineda (R.), Le chemin defer de Djibouti à Addis-Abeba, l'Harmattan, 1995. 5. Lartilleux (H.), ibid., p. 79-81.
108
Structures de l ’économie
projets utopiques, voire fantaisistes, continuent même de hanter les esprits. Le projet du chemin de fer transsaharien, lancé en 1879 par l’ingénieur Duponchel, et régulièrement rappelé depuis, ne dépasse guère le stade des études préliminaires, vu les énormes obstacles techniques, et le faible intérêt économique d ’une voie traversant des régions désertes. De toute façon, il faut bien reconnaître que les chemins de fer coloniaux français n’accèdent pas aux records de vitesse qui sont signalés pour ceux d ’autres pays : Calcutta-Bombay-Manikpur (2 170 km) à 57 km/h de moyenne, Javia-Batavia-Surabaya (826 km) à 67 km/h en 1932. En dépit de la dénomination pompeuse de « ligne impériale » donnée à la grande rocade qui joint Casablanca à Alger et Tunis (2 200 km), les trains n ’y dépassent guère la moyenne de 45 km/h6. De même, le prestige des ponts du chemin de fer du Yunnan n’égale pas celui du viaduc construit sur le Zambèze au débouché des célèbres Victoria Falls, et aux confins des deux Rhodésies : le train de la ligne Le Cap-Elizabethville le traverse dans le scintillement des embruns, sur une longueur de 200 mètres au-dessus des tourbillons écumants du Boiling Pot. Mais bien d’autres moyens de transports se développent : depuis longtemps, les grands fleuves sont parcourus par des bateaux à vapeur qui en desservent les rives; l’automobile et le camion commencent à parcourir des pistes que les administrations coloniales s’efforcent d ’amé nager, pour remplacer le portage. Malgré tout, il s’agit ici d ’un maillage extrêmement lâche. L’étude des chemins de fer est caractéristique. En Afrique qui possède 5 % seulement de la longueur mondiale, le seul réseau conséquent est celui qui s’oiganise autour des activités minières de l’Afrique australe, l’Union sud-africaine représentant à elle seule 25 000 km ; secondairement, l’Afrique du Nord, avec 5000 km, a une densité respectable. En Asie, le réseau indien, le troisième du monde, qui, avec 70000 km, représente pourtant 50% du total asiatique, est très peu dense ; l’Indochine ne possède qu’un peu plus de 3000 km, guère plus que le Siam voisin; aux Indes néerlandaises, seule Java est bien équipée, avec environ 7 000 km7. Cela n’a rien d ’étonnant, les investissements importants étant essentiellement liés à l’exploitation des ressources locales, et notamment minières, ou aux besoins des voyageurs aisés, essentiellement européens. L’implantation d ’infrastructures de transports n’a pas seulement une fonc tion économique. La présence des grandes balafres que les voies ferrées ouvrent à travers la brousse, la steppe ou la savane, symbolise une supério rité technique de l’Europe, mais aussi une domination politique. On peut dire la même chose de bien des questions économiques, et en particulier de la
6. Lartilleux (H.), Géographie universelle des transports, Afrique du Nord, Chaix, 1949, p. 19-24. 7. Woytinsky, op. cit., chapitre 7, p. 307 sq.
109
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
question des tenes, la possession du sol manifestant une relation particulière ment étroite à un pays. Les terres et l ’exploitation du sol Le problème de l’attribution du sol ne se pose pas partout de la même façon. Là où la colonisation de peuplement européenne est forte, sa pression mène à l’acquisition de vastes domaines fonciers, au détriment des indi gènes. Cela est vrai dans les zones tempérées, soit par leur latitude, soit par leur altitude. En Algérie, en 1930, la propriété européenne occupe près de deux millions et demi d’hectares, contre environ neuf millions pour la propriété musulmane, soit plus de 20 % du total ; mais ce pourcentage est sans doute plus élevé si on tient compte du fait qu’une plus grande partie de la propriété indigène se compose de terres de parcours, quelquefois biens collectifs de tribus, sans grande valeur. Dans la Tunisie voisine, en 1950, les Européens disposent d ’environ 800000 hectares sur un total de quatre millions de terres cultivables, soit une proportion équivalente à celle de l’Algérie ; au Maroc, où la colonisation est plus récente et le patrimoine foncier plus étendu, les Européens exploitent en 1937 315000 hectares, soit le dixième de la superficie exploitée par les Marocains, mais l’étendue des terres à la disposition des colons est nettement plus importante. En Palestine, les colons juifs (environ 66000 personnes) ont pu constituer, à la veille de la guerre, un patrimoine foncier représentant à peu près 140000 hectares, ce qui représente, si on admet que les terres cultivables constituent environ le cinquième des 27 000 km2 du pays, 20 % de la surface agricole utilisable8. La superficie laissée aux populations indigènes d ’Afrique du Nord paraît cependant très généreuse par rapport à ce qu’on observe dans d’autres situa tions : en Afrique du Sud, une série de lois dites Native Land Acts limite les terrains laissés aux Africains à seulement 12,9% du territoire, alors qu’ils représentent près de 70 % de la population. Une situation analogue, mais à une autre échelle, se rencontre en Nouvelle-Calédonie, où une trentaine de milliers de Mélanésiens de la Grande-Terre (soit la moitié de la population) ont été réduits à des réserves qui représentent 126000 hectares sur une superficie totale de 1 700 000. Les terres de colonisation sont trois fois plus étendues9. En Rhodésie du Sud, en vertu du Land Apportionment Act de 1930, 60000 Européens ont à leur disposition 185000 km2 ouverts à la colonisation, tandis que 115000 km2 sont «réservés» aux indigènes. Le prétexte, sinon l’excuse, de cette pratique, provient sans doute de la plus faible densité des autochtones, et de leur moindre capacité de résistance, qui a facilité ces cantonnements massifs. 8. Guerrier (E.), dir., Algérie et Sahara, T. I, Encyclopédie de l’Empire français, 1948, p. 241 ; L'Année coloniale 1936, p. 60 ; Poncet, (J.), La population et l ’agriculture européenne en Tunisie depuis 1881, Mouton, 1962, p. 330 ; INSEE, La Palestine, Mémento économique, PUF, 1948, p. 52. 9. Faivre (J.P.), Poirier (J.), Routhier (P.), Géographie de la Nouvelle-Calédonie, Nouvelles Éditions latines, 1955, p. 223 (chiffres de 1945).
110
Structures de Véconomie
Ces chiffres sont à majorer du fait que ces superficies sont, le plus souvent, concentrées en très grands domaines répartis entre un très petit nombre d ’exploitants, personnes privées ou sociétés. En Algérie, par exemple, 5 400 exploitants se répartissent 1 700 000 hectares, soit plus de 3 000 hectares par exploitation. À l’autre extrémité, 434000 familles musul manes se partagent une superficie équivalente, ce qui donne 4 hectares à chacune. En Afrique du Sud 25 000 fermes de plus d ’un millier d ’hectares, représentant le quart des exploitations européennes, occupent plus de 75 % du sol réservé aux Blancs101. Par ailleurs, la constitution du patrimoine foncier s’effectue sur les meilleures terres, zones particulièrement arrosées, ou plaines irrigables : Jean Poncet remarque ainsi que les exploitations euro péennes représentent 30 à 40 % des terres cultivées dans la région centrale de la Tunisie correspondant à la basse vallée de la Medjerda (triangle Medjez el-Bab/Tunis/Zaghouan)11. On pourrait dire la même chose des terres acquises par les colons juifs en Palestine : près de la moitié est concentrée dans la plaine côtière entre Jaffa et Haïfa, où leur superficie dépasse celle des exploitations arabes. Elles sont nombreuses aussi en Galilée, sur l’axe qui relie Haïfa au lac de Tibériade, puis au nord de celui-ci, dans la haute vallée du Jourdain. Cette disposition permet évidemment un meilleur contrôle stra tégique du pays « utile ». De Bugeaud à Lyautey, les généraux français en Afrique du Nord n’ont pas sous-estimé l’importance des fermes coloniales pour affermir l’occupation. Les dirigeants sionistes sont encore plus cons cients de l’importance de cet enracinement, poursuivi jusqu’à nos jours. La situation est différente dans les pays tropicaux proprement dits, où le problème est moins d ’obtenir la propriété des terres que de posséder de quoi défricher des terres vierges et les mettre en valeur, et où la pression de la population européenne est moins forte. Malgré tout, la propriété étrangère peut y être étendue. Les Hautes Terres (White Highlands) du Kenya font une transition avec les situations précédentes. Dans ces régions élevées (plus de 1600 m), 3 300000 hectares de bonnes terres d ’origine volcanique, bien arrosées, bien desservies par le chemin de fer, sont réservés à environ 20000 colons européens, qui n’en cultivent en fait qu’un vingtième, au détriment des populations indigènes, dont le nombre dépasse les trois millions, et auxquels ne sont laissés que 10800000 hectares de réserves12. Sans atteindre de pareilles disproportions, on trouve néanmoins des chiffres non négligeables aussi à Madagascar, où, en 1948, on évaluait à 70000 hectares la colonisation non autochtone, contre 1200 000 hectares exploités par les Malgaches, soit 6 % du sol cultivable (alors que la population européenne représente moins de 30000 habitants sur près de 4 millions, c’est-à-dire 0,7 %). Il faudrait y ajouter un certain nombre d ’hectares concédés à des
10. Cavelli (M.), Étude de ¡a population rurale en Algérie, Alger, Heintz, 1935, p. 167 ; Frankel (S.H.), Capital Investment p. 129-130. 11. Poncet (J.), La population et l ’agriculture européenne en Tunisie, p. 319. 12. Gourou (P.), Les pays tropicaux, PUF, 1947, p. 156.
111
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
titres divers, évalués à 500000 hectares en 193113. Au Congo belge, on estime la superficie aliénée à 9 % de la surface totale, mais il est probable qu’une partie est consacrée aussi à des activités minières, comme c’est le cas de 5 % du sol de Gold Coast. En Malaisie, en 1939, les aliénations de terre atteindraient 19% du sol, contre 9% aux îles Fidji1415. En Indonésie, Robequain évalue la superficie des terres à la disposition des Européens (l’essentiel étant d ’ailleurs constitué non de propriétés, mais de locations à bail de 75 ans) à plus d ’un million d ’hectares à Java, et un million et demi dans les Possessions extérieures. De ces superficies, seulement la moitié est réellement mise en culture, soit 550000 hectares de plantation à Java (moins de 15 % de la surface cultivée), 500000 à Sumatra, et 60000 à Bornéo. La plus grande partie du sol reste donc à la disposition des indigènes. Il en va de même en Indochine, où un million d ’hectares ont été concédés à des Européens, dont 300 000 hectares de rizières sur environ 4 millions13. Il y a en général, parmi les colons, une bonne conscience totale. « Les colons kenyans n ’ont rien de commun avec les maniaques qui ont colonisé la Nouvelle Angleterre, ou avec les criminels et les vauriens qui se sont installés en Australie... On ne saurait les présenter comme des pirates et des voleurs de terres », écrit Evelyn Waugh16. Cette bonne conscience puise à plusieurs sources. La première est celle de l’ignorance. Par exemple, bien peu de colons fiançais d ’Algérie connaissent la manière, souvent discutable, dont ont été acquises les terres dites de « colonisation » : pour la colonisation dite officielle, organisée par l’État, constitution d ’un Domaine public par reconnaissance des terres de l’État turc, et aussi confiscations à la suite de révoltes ; pour la colonisation privée, application d ’une législation française facilitant la licitation de la propriété indigène, et son rachat par des Européens. Il est vrai que l’essentiel de ces pratiques remontent aux années 1870-1880, et que les colons propriétaires ou exploitants ont rarement été les artisans de la première transaction qui a fait passer les terres des indigènes aux Français, par l’intermédiaire de fonctionnaires indifférents ou de spécu lateurs. Une bonne partie des terres a été ainsi acquise et payée par des procédures parfaitement correctes et légales. De même, nombre de colons juifs de Palestine ont été installés sur leurs terres par l’intermédiaire du Fonds national juif (KKL), qui a procédé à des achats parfaitement réguliers auprès des grands propriétaires fonciers arabes, absentéistes pour beaucoup, et dont certains résident même en dehors des limites du territoire, en Syrie et au Liban en particulier. Peu de ces colons sont sensibles au sort des tenan ciers ou des usagers des terres qu’ils expulsent pour les mettre eux-mêmes
13. Robequain (Ch.), Madagascar et les bases dispersées de l’Union française, PUF, 1958, p. 118,213 (chiffres de 1948). 14. Hailey (Lord), The Future of Colonial Peoples, p. 51. 15. Robequain (Ch.), «Problèmes de colonisation», a it cit, p. 114; L’Indochine fran çaise, A. Colin, 1935, p. 152. 16. Waugh (E.), Hiver africain, [1931], Quai Voltaire, 1991, p. 225.
112
Structures de l ’économie
en valeur ; ceux même qui en sont émus choisissent de faire taire leurs scru pules au nom de la priorité de leur projet17. Au nombre des arguments en faveur de la propriété européenne, il faut aussi faire sa part à une doctrine plus ou moins implicite de la « vivification » des terres, selon laquelle il y aurait un « droit » pour le colon qui a mis en valeur, au prix d ’un travail pénible et d ’investissements difficiles à amortir, une terre pas, ou peu, ou mal cultivée par ses prédécesseurs, à s’en pro clamer le propriétaire. Il est tout à fait vrai qu’une partie des plantations a été gagnée sur une forêt totalement inexploitée, ou sur des zones de marais tota lement insalubres, ce qui a évité toute forme d ’expropriation. On insiste aussi sur les difficultés de la vie des fermiers européens en Afrique du Nord ou du Sud, occupés à « parier avec Dieu », selon une expression de la roman cière Doris Lessing, sur l’absence de sécheresse, ou de nuages de sauterelles. On dépeint les améliorations, réelles, apportées par eux à l’agriculture, et dont l’irrigation est le meilleur exemple. Le Water Supply « Gouverner, c’est pleuvoir », proclame un jour, paraît-il, Théodore Steeg, gouverneur de l’Algérie de 1921 à 1925, puis résident général au Maroc de 1925 à 1929. Il entend par là que la pluie, synonyme de bonnes récoltes, a toujours suffi à éviter au Maghreb troubles et émeutes de la faim, et débar rasser ses dirigeants de tout souci. C’est donc au nom de préoccupations politiques autant qu’économiques qu’il associe son nom à la construction d’une série de huit grands barrages, destinés à améliorer l’irrigation en Algérie, construits avec des techniques remarquables pour l’époque, comme l’utilisation de béton précontraint pour les conduites forcées. Mais bien d ’au tres auraient pu dire la même chose, tant la politique de l’eau est associée à la colonisation, qu’il s’agisse d ’irriguer ou de drainer. Barrages, digues, canaux, ont, depuis le XIXe siècle, mobilisé les efforts des ingénieurs euro péens et ceux de milliers de travailleurs locaux. En 1939, l’Exposition inter nationale de Liège, organisée sur le thème de l’eau, fait une large place à « l’eau coloniale »18. L’Asie et le Moyen-Orient ont toujours constitué des champs d ’action privilégiés. Les Britanniques se rappellent que, dix ans avant l’inauguration du canal de Suez, l’ingénieur Cantley ouvrit solennellement le canal du Gange, à l’origine d ’un réseau de 6 400 kilomètres de canaux d ’irrigation19. Dans le Penjab, les surfaces cultivées ont plus que quintuplé entre 1887 et
17. Bethell (N.), The Palestine Triangle, the Struggle between the British, the Jews and the Arabs, 1935-1948, Londres :A.Deutsch, 1979, p. 25-26. 18. Bulletin du Comité de l ’Afrique française. Renseignements coloniaux, 1939, p. 161162. 19. Demangeon (A.), L’Empire britannique, p. 100-101.
113
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
1935, pour dépasser cinq millions d ’hectares20. En six ans, le seul ingénieur Fergusson, responsable des irrigations dans l’état de Jodhpur, a plus que triplé la fourniture d ’eau, au point de s’être vu décerné par les Radjput le sobriquet de « Pani ke Bap » (le père des eaux). En Égypte, les ingénieurs britanniques ont, depuis 1882, achevé la construction de neuf barrages destinés à relever le niveau du Nil, le principal étant le barrage d’Assouan, terminé en 1902, et surélevé en 1912 et 1934, ce qui a quintuplé le volume de la retenue. Ainsi ont-ils mené à bien l’œuvre amorcée au temps de l’indé pendance par Méhémet-Ali (1805-1849) et ses successeurs. Par la suite, ils s’emploient à une tâche analogue, en amont, faisant de la Gezireh, c’est-àdire de la vaste presqu’île constituée par le confluent du Nil bleu et du Nil blanc au sud de Khartoum, capitale du Soudan, une zone modèle de produc tion cotonnière. Dès 1934 plus de 350000 feddans (soit 125000 hectares) ont été plantés en coton. « Nous ne sommes pas seulement une grande race colonisatrice, nous sommes aussi une grande race irrigatrice (irrigating race)» , proclame, en 1939, le field-Marshall Philip Chetwode21. Les Français peuvent, de leur côté, tirer orgueil des drainages de Cochinchine, où le dragage d ’un réseau de canaux de 1500 km pour les artères principales a permis de faire passer l’étendue de la rizière de 400000 ha en 1880 à deux millions en 193322. Certes, on aurait tort de parler uniformément de réussite. Le Français Émile Bélime entreprend, avec plus de sens de la publicité que de réussite, dans la vallée du Niger d ’obtenir des résultats analogues à ceux des Anglais sur le Haut-Nil. L’Office du Niger, créé en 1932, prévoit de mettre en culture près d ’un million d’hectares pour la production de riz et de coton. En réalité, une faible partie seulement est exploitée en 1938, malgré des investissements importants et un lourd effort imposé aux populations. Il y a, de même, beau coup à dire sur la politique des grands barrages en Afrique du Nord, destinés essentiellement à la grande culture, et conçus avec un souci insuffisant de l’érosion de nature à en abréger la durée par un comblement rapide. En Inde même, certains ingénieurs britanniques reconnaissent avoir trop fait porter l’effort sur les grands projets, plus propices à augmenter les revenus fiscaux, plutôt que sur des travaux plus modestes, mais finalement plus profitables aux villages, consistant à consolider, à agrandir ou à créer de petits réservoirs nombreux. D’autres observent qu’on a excessivement pompé dans la nappe phréatique23. Au Soudan même, le choix de la monoculture du coton, destinée à satisfaire les besoins de l’Empire, de même que le financement par l’emprunt, ne sont pas sans risques. Il reste que ces critiques devraient s’adresser, plus qu’à la colonisation, à une pensée du temps peu soucieuse de ce qu’on n’appelle pas encore écologie, qui a engendré aussi bien les
20. Gourou (P.), L’Asie, Hachette, 1953, p. 412. 21. Geographical Journal, octobre 1939, p. 289. 22. Robequain (Ch.), L’Indochinefrançaise, p. 140. 23. Fergusson (F.-F.), « Famine and water supply in Western Radjputana, », Geographical Journal, janv-juin 1939, p. 39-51.
114
Structures de Véconomie
programmes de barrages hydroélectriques d'Europe que les imposantes réali sations de la Tennessee Valley Authority ou, dans des conditions bien pires, les aménagements pharaoniques de la Volga. Quoi qu’il en soit, ces travaux d'irrigation sont la marque de deux carac tères essentiels des colonies : la nécessité de nourrir des populations, et le souci aussi de développer certaines cultures d’exportation comme le coton ou le riz. Cette réflexion nous introduit à des considérations sur les systèmes productifs dans leur ensemble. L’économie d ’exportation et le développement industriel Que les ressources des pays coloniaux telles que les ont développées les Européens soient avant tout des produits alimentaires et des matières premières est une évidence. En 1937, l'o r représente, en valeur, 70 % des exportations de l’Afrique du Sud, les produits minéraux dans leur ensemble 75 %, et les produits agricoles 20 %24. Dans les exportations algériennes en 1935, la part de l’agriculture est de 89 % (celle du vin à elle seule étant de 34 %, 37 % avec les alcools), celle des minéraux de 6 %, et celle des produits fabriqués de 5 %25. L’idée prédominante reste que les colonies doivent demeurer des réservoirs de matières premières et des débouchés privilégiés pour l'industrie nationale. Le secrétaire d ’État britannique Leo Amery déclare en 1929 devant les Communes que « les colonies sont essentielle ment agricoles et productrices de matières premières. Il n’est pas très sûr, ni, certes, très souhaitable, dans l’intérêt des populations elles-mêmes, que le développement industriel y doive être encouragé »26. L’artisanat local tradi tionnel a été frappé de plein fouet depuis le XIXe siècle. Des activités autre fois florissantes ne subsistent plus qu’au titre d’encouragement au maintien de traditions locales, sans plus jouer un véritable rôle économique. Il s’ensuit que la plus grande partie des industries relèvent du secteur de transformation des produits alimentaires et des matières premières. L’essen tiel de cette production est destinée à l’exportation : raffinage de la canne à sucre, déjà ancien, rizeries, semouleries, huileries. Il faut aussi y ajouter le travail de différents minerais (fonderie d ’étain de Pulau Brani, près de Singapour), ou le raffinage de pétrole. Mais il s'agit, le plus souvent, d ’une première transformation : c’est ainsi que la plus grande partie du minerai de cuivre du Katanga ne subit sur place qu’un processus de concentration par grillage, à Panda et Elizabethville ; c’est près d ’Anvers, à Oolen, qu’il est traité et raffiné27. L’industrialisation n’est d ’ailleurs pas un phénomène irré versible : depuis 1933, l’étain des Indes néerlandaises, fondu jusque-là à
24. Frankel, (S.H.), Capital Investment, p. 107. 25. L’Année coloniale 1936, p. 50-51. 26. Havinden (M.) et Meredith (D.), Colonialism and Development, p. 170. 27. Van de Velde, Économie belge et Congo belge, thèse pour le doctorat en droit, Univer sité de Nancy, 1936, p. 86.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Singapour, est de plus en plus traité à Amhem, d ’où il est réexporté dans le monde entier28. Il faudrait ajouter aussi des productions destinées à la consommation locale, souvent au profit de la colonie européenne : cimente ries, manufactures de tabac ou d’allumettes, brasseries, biscuiteries, torréfac tion du café ou fabrication de pâtes alimentaires. L’Indonésie commence tout juste à produire, outre des pneus, des articles à bon marché comme le verre, les tissus, les bicyclettes, le tout à une échelle qui reste très modeste, et ne contribue que peu à réduire sa dépendance par rapport aux importations. La Birmanie est dans l’impossibilité de subvenir, en cas de conflit, aux besoins de Singapour29. L’Égypte ne dispose que de moins de 100 000 broches dans ses filatures de coton, cent fois moins que les Indes, alors que sa production de fibres s’élève au tiers de celle de ce pays. Le développement industriel reste encore largement limité aux Domi nions britanniques. Si l’on considère notamment la sidérurgie, industrie de référence d’alors, la Nouvelle-Zélande ne produit pas moins d ’un million de tonnes d’acier par an en 1938, et l’Afrique du Sud 300000 tonnes. En 1939, il n’y a pas en Union sud-africaine moins de 2S0 000 personnes employées dans l’industrie pour une population totale de 10 millions d ’habitants. Aux côtés de ces pays, l’Inde connaît cependant des débuts prometteurs. Depuis 1913, des barrières douanières élevées (11 % de droits à l’importation en 1921,25 % en 1931) lui ont permis de commencer à édifier une industrie qui satisfait déjà, en 1936, la totalité des besoins locaux en ciment, sucre raffiné, allumettes, 80 % des besoins en cotonnades, 70 % des besoins en fonte et en acier (environ un million de tonnes produites en 1939). Mais ces activités n’intéressent qu’une main-d’œuvre de trois millions et demi de personnes30. Les investissements restent relativement faibles : entre 1930 et 1938, l’Inde n’importe que pour 900 millions de roupies en machines de toutes sortes, contre 155 millions en boissons alcoolisées31. Le cas des possessions françaises est aussi éloquent. L’Afrique noire fran çaise ne possède pas une seule huilerie avant la guerre. Pendant le deuxième conflit mondial, on ne pourra trouver en Algérie, coupée partiellement, puis totalement, de la France, ni tissus, ni chaussures, ni verres à boire, ni une serrure ou une clé, ni essence, ni métal, ni chaux ou ciment, ni un outil métallique, ni même de la ficelle ou une épingle32. Les industries existantes (alimentaires, engrais...) n ’emploient guère que 50000 personnes, pour une population totale d ’un peu moins de huit millions d’habitants. En dépit d ’une
28. Juglas (J.J.), Géographie économique, Foucher, 1946, p. 221. 29. Havinden (M.) et Meredith (D.), Colonialism and development, p. 195. 30. « L’industrie moderne aux Indes britanniques », Annales de Géographie, 1939, p. 567580 31. Rothermund (D.), An Economie History of India, Londres, Croom Helm, 1988, p. 117. 32. B. Lavergne cité par D. Lefeuvre, L’industrialisation de l ’Algérie (1930-1962), Thèse université de Paris L 1994, T. I, p. 266.
116
Structures de l*économie
production importante de minerai de fer (trois millions de tonnes), et de la facilité d’importer du coke à bon marché, aucune sidérurgie ne voit le jour. L’impossibilité, pour l’Afrique du Nord, d ’accueillir, équiper, entretenir et soutenir une armée moderne, faute de toute base industrielle (et évidemment de tout arsenal digne de ce nom) n’est pas une des moindres considérations qui ont servi à influencer le choix de l’armistice de 1940, de préférence à la continuation de la lutte. En Indochine, une faible partie des capitaux s’est dirigée vers les activités industrielles. L’existence d ’établissements relative ment importants, comme les filatures de Nam-Dinh, au sud de Hanoi, dont les tissus habillent nombre de paysans du delta tonkinois, n’empêche que l’essentiel des matières premières et du charbon produit font l’objet d ’expor tations, au lieu d ’être transformés ou utilisés sur place. Les projets et les propositions n’ont pourtant pas manqué. En 1938, par exemple, Paul Bernard, administrateur délégué d ’une grande compagnie financière opérant en Indochine, fait l’éloge de la politique d ’industrialisation indienne. Il observe que par là, les Britanniques trouvent à placer avantageusement leurs capitaux, et créent dans leur Empire un pouvoir d ’achat susceptible de provoquer de nouveaux débouchés aux exportations de la métropole. Mais ces idées ne trouvent guère d ’écho33. Ces limites n’empêchent pas le capitalisme colonial de comporter nombre de groupes puissants, capables de distribuer des dividendes substantiels à leurs actionnaires, et de constituer, sur place, des puissances avec lesquelles il faut compter. En Afrique du Sud, De Beers, fondée par Cecil Rhodes, occupe une place majeure dans la production mondiale de diamants, et riva lise dans les productions minières avec YAnglo-American d ’Ernest Oppen heimer ; en 1932, six groupes au total contrôlent les 37 compagnies minières productrices d ’or (ces 57 étant les survivantes des 576 créées depuis 1887) ; deux groupes bancaires, la Standard Bank o f South Africa et la National Bank o f South Africa, ensuite reprise par Barclays, dominent le secteur du crédit34. Au Congo belge, en 1932, 75 % du capital des principales sociétés est contrôlé par quatre groupes financiers, la Société Générale de Belgique, le Groupe Empain, la Cominière, et la Banque de Bruxelles, la Société Générale en détenant à elle seule près de la moitié, investi à la fois dans les chemins de fer, l’énergie (électricité), les banques, les entreprises minières, les plantations, le commerce, et même l’immobilier35. La principale compa gnie minière, Y Union Minière du Haut-Katanga (UMHK), annonce un bénéfice de 500 millions de francs belges, alors que le budget de la colonie s’équilibre autour de 700 millions36. Bien d’autres sociétés financières jouis sent, dans d ’autres territoires, d’une prépondérance comparable : au Maroc, la Banque de Paris et des Pays-Bas ; en Indochine, la Banque de l ’Indo
33. Hardy (A.), « Les opinions de Paul Bernard sur l’Indochine coloniale », Revue fran çaise d’histoire d ’Outre-mer, n° 308,1995, p. 297-338. 34. Frankel (S.H.), Capital Investment, p. 84. 35. Frankel (S.H.), Capital Investment p. 292. 36. Vanderlinden, Pierre Ryckmans, p. 603, p. 351.
117
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
chine, qui bénéficie aussi du privilège de l’émission, et la Société financière française et coloniale (SFCC). Mais le phénomène de domination n’est pas seulement régional. Les restructurations nées des vicissitudes de la vie économique ont parfois conduit à construire des groupes de taille mondiale. Ce n’est pas seulement le cas des entreprises qui dominent le marché de l’or et du diamant. Dans le secteur des pétroles, il faut citer VAnglo-Persian, créée en 1909 comme filiale de la Burmah Oil, et devenue en 1935 Anglo-Iranian, puis British Petroleum en 1955 (depuis 1914 l’État britannique, qui désirait s’assurer une produc tion indépendante pour l’approvisionnement de sa marine de guerre, détient 55 % du capital) ; la Royal-Dutch Shell, fusion en 1907, sous l’impulsion de l’entreprenant Henri Deterding, de la Royal Dutch hollandaise et de la Shell Transport and Trading britannique, avec 60 % d ’intérêts hollandais et 40 % d ’intérêts britanniques. Ces deux groupes méritent de figurer au nombre des sept « majors », aux côtés des puissantes compagnies américaines, que des accords dits de la « ligne rouge », autant qu’une conjoncture économique peu porteuse empêchent de se lancer dans une exploitation à grande échelle du pétrole du Moyen-Orient. En 1929, la fusion de la société britannique Lever et de la société hollandaise Margarine Unie (la plus importante survenue dans le monde avant la Deuxième Guerre mondiale) donne naissance à Unilever, qui est, en particulier, le plus gros acheteur d ’huile de palme d’Afrique, directement ou à travers ses filiales comme la Société des Huileries du Congo belge, qui contrôle 80 % de la production de ce terri toire37. Tous ces groupes réalisent-ils de confortables profits ? Certains chiffres paraissent colossaux. Dans la période allant de 1887 à 1932, les mines d ’or du Witwatersrand, pour 148 millions de livres de capitaux investis, avaient distribué 244 millions de livres de dividendes, selon Frankel, à leurs action naires. En revanche, elles avaient versé à l’État plus de 100 millions de livres. Il est vrai que les taux de taxation étaient particulièrement élevés, doubles par exemple de ceux de la Rhodésie, triples de ceux de l’Afrique de l’Ouest. D’après le gouverneur Ryckmans, l’ensemble des sociétés de capi taux congolaises avaient, de 1927 à 1939, réalisé 7 835 000000 de francs de bénéfices nets, pour 7 239 000 000 de capitaux investis, y compris les primes d ’émission. Elles avaient dans le même temps versé 5 366000000 de divi dendes aux actionnaires belges, et payé moins de 835 000 francs d ’impôts38. Mais il ne s’agit que d ’exemples isolés, relatifs à de très grosses entreprises. Quant aux taux de profit, ils sont difficiles à connaître. Il est évident que la période étudiée dans ce livre oppose à la dépression de la première moitié des années trente des périodes de profits importants, accompagnés de forts investissements entre 1920 et 1930, puis de nouveau à l’approche de la 37. Chandler (A.D.), Organisation et performances ties entreprises, T. 2, La GrandeBretagne 1880-1948, Les Éditions d’organisation, 1993, p. 109,232. 38. Vanderlinden, Pierre Ryckmans, p. 603 ; Frankel (S.H.), Capital Investment, p. 95.
118
Structures de l ’économie
guerre, et encore plus pendant celle-ci. Ainsi, dans une conjoncture de guerre, plutôt favorable, vu la montée des cours des matières premières, les taux du profit des investissements dans le Commonwealth auraient été de 5,4 % en moyenne, particulièrement élevés en Afrique (8,7 %, et plus de 10 % en Afrique du Sud), et en Asie (près de 8 % aux Indes). Ils seraient comparables à ceux qui proviennent des capitaux engagés aux États-Unis, mais bien supérieurs à ceux des capitaux engagés dans le reste du monde39. Ces chiffres ne permettent pas, cependant, d ’aller beaucoup plus loin. Par ailleurs, ils reflètent davantage les soucis des entrepreneurs coloniaux que ceux des producteurs indigènes. Place et problèmes de la production indigène Comme on peut le supposer de ce qui précède, la production indigène est encore essentiellement agricole, et concerne la masse des petits paysans qui forme l’essentiel de la population active des colonies. Très souvent, elle peut apparaître comme une agriculture de subsistance, ou du moins destinée à la consommation locale, face à l’agriculture surtout spéculative des Européens. En Malaisie, par exemple, les Européens possèdent, selon les régions, de 80 % à 66 % des grandes plantations de caoutchouc (plus de 40 hectares), qui représentent elles-mêmes 3/5®* de la production, et l’essentiel des exporta tions40. On peut en rapprocher la situation de l’Indochine, où les Français exploitent environ 500000 hectares en tout, dont 125000 hectares en hévéas, et 300000 en rizières, en particulier en Cochinchine, auxquels on doit la plus grande partie des exportations41. Mais il ne s’agit pas toujours de produits exotiques à proprement parler : le cas est flagrant, par exemple, en Algérie, où le vin, qui assure le tiers en valeur des exportations, est une culture presque exclusivement européenne. Mais on se tromperait si on confondait systématiquement exploitation indigène et production vivrière : dans les Indes néerlandaises, ce sont les plantations européennes qui fournissent sucre, huile de palme, écorces de quinquina, sisal, tabac, thé, soit 53% des exportations en valeur; en revanche, la production indigène assure l’essentiel de la production de poivre, de copra, deux tiers de celle de café, et la moitié de celle de caout chouc (47 % des exportations en valeur)42. Dans certains pays tropicaux, même, la production est une exclusivité indigène : tel est le cas de l’arachide au Sénégal, dont la culture est organisée par la confrérie musulmane des Mourides, ou du thé à Ceylan, ou bien encore du cacao en Afrique occiden tale. Pour ce dernier cas, U s’agit d ’un phénomène récent, puisque la région, qui ne fournissait que le quart de la production mondiale en 1905, en produit
39. Rippy (J.F.), British Investment, p. 188. 40. King (A.W.), « Plantations and agriculture in Malaya», Geographical Journal, 1939, p. 136-148. 41. Robequain (Ch.), L’Indochinefrançaise, p. 132-153. 42. Robequain (Ch.), « Problèmes de colonisation », art. cit., p. 114.
119
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
près de 70 % trente ans plus tard, dont 40 % pour la seule Gold Coast43. L'aspect de ces exploitations n’est évidemment pas le même. Robequain oppose, en Indonésie la grande plantation européenne, « s’étendant souvent sur plus de 100 hectares, parfois sur plusieurs milliers, alimentée par des capitaux lointains, profitant de toutes les expérimentations agronomiques, de toutes les découvertes des laboratoires, de la connaissance profonde des marchés, employant une main-d’œuvre d ’ouvriers abondante, sous la direc tion d ’un état-major blanc », à la poussière de petits producteurs indigènes44. Il cite la plantation de caoutchouc dite Amsterdam Rubber, qui à elle seule n’exploite pas moins de 75 000 hectares. Au Congo belge, la Compagnie des huileries contrôle 750000 hectares pour la récolte du palmier à huile, concédés, comme on l’a vu, à la société Lever, une des puissances du pays. La situation de l’agriculture indigène parait, dans l’ensemble, plutôt difficile. Certes, le tableau n ’est pas uniformément sombre. Comme on l’a vu plus haut, des terres nouvelles ont pu être conquises par défrichement, drai nage ou irrigation, dont une partie au profit des indigènes. Comme on vient de le voir également, le développement de cultures d ’exportation a créé de nouvelles ressources, à partir desquelles ont pu se développer des paysanne ries vigoureuses. Mais, dans l’ensemble, ces considérations atténuent, plutôt qu’elles ne renversent, un jugement généralement plutôt négatif. Derrière le fatalisme trop facilement dénoncé par bien des esprits superficiels, se cache une résignation à l’inévitable : faute de capitaux, de crédits, de formation, et bien souvent de conseils, il est bien difficile au petit paysan indigène de sortir d ’une routine qui l’oblige à un travail dur et parfois intensif, pour des résultats médiocres. La terre, traditionnellement mal répartie, et quelquefois confisquée partiellement au profit de grandes exploitations européennes, doit faire vivre une masse croissante de personnes, étant donné l’accélération de la croissance démographique. La part de plus en plus grande faite aux produits d ’exportations rend les économies plus sensibles à la conjoncture. Enfin, l’accès au crédit, nécessaire aux paysans comme à bien des artisans, est particulièrement onéreux. Comme le dira un peu plus tard un administra teur français, « en quelques années les valeurs économiques ancestrales se sont effondrées et ont été remplacées par d ’autres qu’il était singulièrement malaisé d ’acquérir puisque les colonisateurs s’en étaient assurés le monopole (meilleurs terres dans les colonies de peuplement, ressources minières et commerce un peu partout) »45. La fourniture de main-d’œuvre constitue une participation tout aussi importante des populations indigènes à la production tournée vers l’exporta tion. Le secteur minier est sans doute un des plus demandeurs de main-
43. Pahl (W.), La lutte mondiale pour les matières premières, Payot, 1941, p. 301-306. 44. Robequain (Ch.), « Problèmes de colonisation », ait. cit., p. 120-124. 45. Alduy (P.), ancien directeur de cabinet du gouverneur général de l’Algérie, « La nais sance du nationalisme outie-mer», Principles and Methods of Coloidal Administration, p. 126.
120
Structures de l ’économie
d’œuvre. Vers 1930, environ 115000 habitants de Rhodésie du Nord sont ainsi employés, dont 77 000 dans le territoire, et 38 000 au dehors, surtout dans des activités minières. Les mines d ’Afrique du Sud n ’emploient pas moins de 424000 travailleurs noirs en 193946. Pour une population totale évaluée à moins d’un million et demi d ’habitants, cela représente une proportion très élevée des hommes adultes, un homme sur deux dans certains villages47. En 1937, les mines d’anthracite de Dong Trieu, proches de la baie d ’Along, emploient environ 40000 personnes. Mais la demande en maind ’œuvre dans les plantations ou les fermes est également très importante. En Algérie, l’agriculture emploie environ 450000 ouvriers agricoles pour une population active totale de deux millions et demi d ’ouvriers agricoles en 1930, soit 18 %48. Vers 1930, à peu près 350000 Africains sont employés en Afrique du Sud sur les terres d ’Européens4950. C ’est par centaines de milliers que se comptent les ouvriers agricoles qui travaillent dans les plantations des hides néerlandaises. Si on considère que ces gens, comme les petits paysans qui travaillent pour l’exportation, sont les seuls à disposer de revenus moné taires, on peut juger de ¡’engagement déjà notable de bien des sociétés colo niales dans l’économie mondiale, engagement que souligne la crise de la première moitié des années trente, qui s’est traduite, en 1938, par une baisse du commerce mondial de 10 % en volume par rapport à 1929 (après une chute de 25 % en 1933), et de 60 % en valeur*. L’interdépendance L'ampleur de la crise et le repli commercial sur les empires Les conséquences de la crise montrent la sensibilité du système à la conjoncture internationale. Les difficultés se manifestent d ’abord, comme on sait, par l’effondrement des cours des matières premières et des produits alimentaires. Les produits spéculatifs sont évidemment les plus touchés. La baisse du cours du caoutchouc est de 95 %, celle du sucre et du thé de 66 %, celle de l’étain de 50% . Mais on pourrait multiplier les exemples: en Algérie, le cours du quintal de blé tendre tombe de 180 francs en 1926 à 60 francs en 1935 ; celui du degré hectolitre de vin passe de 13 francs à moins de 5 francs51. La crise est aussi une crise du système financier qui, de proche en proche, amène l’augmentation des taux d ’intérêts.
46. The Cambridge History o f Africa (1905-1940), Cambridge University Press, 1986, p. 589. 47. « La main-d’œuvre indigène en Rhodésie du Nord », Revue internationale du travail, 1933, p. 737-738. 48. Berque (J.), Le Maghreb entre-deux-guerres, Seuil, 1962, p. 249. 49. Frankel, (S.H.), Capital Investment, p. 12. 50. Woytinsky, p. 39. 51. Yacono (X.), Histoire de l’Algérie, Éditions de l’Atlanthrope, 1993, p. 321.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Or, les entreprises coloniales vivent très largement sur le crédit, néces saire pour équiper les mines ou les exploitations agricoles, et pour assurer leur trésorerie courante (salaires, en particulier). Que les cours s’effondrent, et bien des entreprises se trouvent en difficulté, voire en faillite, les petites affaires étant d ’évidence les plus touchées. En Afrique du Sud, les dures conditions climatiques, la faible productivité, mais aussi le maintien d ’une poussière de petites exploitations, rendent très incertain l’avenir de la coloni sation agraire, et imposent de très fortes subventions32. En Afrique du Nord, l’évolution paraît, de même, condamner les petits domaines européens, dont le nombre décroît fortement. La situation est encore plus dramatique pour les petits producteurs indigènes, qui arrivent tout juste à subsister en temps normal et sont très souvent endettés à des taux usuraires, dont la condition sera étudiée plus loin. Les conséquences sont variables. La réduction de la production en est souvent la conséquence. Elle résulte tout à la fois des faillites et de l’effort des entreprises pour réduire leurs frais généraux, en particulier l’emploi de la main-d’œuvre. Des accords de cartels, locaux ou internationaux, visent aussi à freiner la baisse des cours. Ils se mettent en place, en ce qui concerne des pays colonisés, pour l’étain et le caoutchouc, mais aussi le thé et le sucre, productions particulièrement atteintes, comme on l’a vu. Les conséquences sont souvent impressionnantes. À Java, la superficie cultivée en canne à sucre tombe de 200000 à moins de 85 000 hectares entre 1930 et 1932 ; en 1936, seules 79 raffineries sur 179 continuent à fonctionner; la maind ’œuvre européenne employée tombe de 4 300 à environ 1000 personnes. Les finances publiques en sont lourdement affectées, car la culture sucrière représente alors sous des formes diverses (impôts sur le revenu, taxes sur les sociétés, droits à l’exportation), 48 % des rentrées budgétaires de la colo nie33. Il faudrait noter cependant que, si la baisse des ressources est générale, elle ne s’accompagne pas forcément d ’une baisse de la production. En général, les mouvements en quantité ont été plus modérés que les mouve ments en valeur. Souvent même, la réaction contre la chute des cours a consisté dans une augmentation de la production destinée à compenser, au moins partiellement, la diminution des prix de vente34. Les chiffres du commerce, présentés plus haut, quoique grossièrement approximatifs, sont significatifs. Ils montrent que l’importance du commerce des colonies avec leurs métropoles s’est renforcée à la faveur de la crise. Comme on le sait, un des effets de celle-ci a souvent abouti, faute d ’un accord sur une organisation mondiale des échanges, à la recherche de solu tions nationales, en particulier monétaires et douanières, aux difficultés rencontrées. Il n’en va pas différemment dans les différents empires colo niaux, considérés comme des prolongements économiques des métropoles.5234 52. Frankel (S.H.), Capital Investment, p. 119 sq. 53. De Klerck (E.S.), History of the Netherlands East Indies, p. 580-581. 54. De Kleick E.S.), History of the Netherlands East Indies, p. 588.
Structures de l ’économie
Mais ce renforcement est très inégal. Un examen attentif des pourcentages présentés dans le tableau de la page 32 montre que ce changement est surtout massif pour les échanges de la France. L’Algérie, notamment, n’était que le 4e des clients de la France en 1927, le 3e en 1929, le premier en 193255. Il l’est déjà moins pour les pays de l’Empire britannique, assez peu pour ce qui est des dépendances hollandaises, belges et portugaises. Il faut tout d ’abord noter que le resserrement des liens s’est fait dans un cadre de commerce en contraction, ce qui signifie une stagnation, et même, souvent, un recul des échanges, du moins en valeur. Le cas français, étudié par Jacques Marseille, est sans doute le plus éloquent : entre 1930 et 1936, la valeur totale des exportations françaises baisse de moitié ; les exportations en valeur de la France vers les colonies ont régressé de 20 %, alors que les exportations vers l’étranger s’effondraient de près de 60 %. Le phénomène est différent pour une valeur des importations en baisse plus faible, il est vrai (un peu plus du tiers) : diminution de 43 % pour les importations en prove nance de l’étranger, augmentation de 49 % pour les importations en prove nance des colonies. L’Empire a servi, dans une certaine mesure, de débouché de substitution à l’industrie française ; inversement, la métropole a absorbé une partie de la production de l’Empire, à des prix supérieurs à ceux du marché mondial56. Le repli britannique apparaît comme nettement moins brutal et moins ample. La baisse des exportations est, entre 1929 et 1937, de 30 %, et celle des importations de 15 %. Les exportations vers l’Empire ont baissé de 22 % et les importations, en revanche, ont crû de 4 %57. Cette exception française s’explique par l’application de tarifs douaniers prohibitifs, destinés à réserver à la métropole le débouché colonial et à assurer aux colonies l’accès au marché métropolitain, en garantissant aux uns et aux autres des prix supérieurs aux cours mondiaux. Une bonne partie des tarifs appliqués dans les possessions françaises sont alignés sur ceux de la métropole, fortement relevés à la suite de la crise ; il s’y ajoute une série de contingentements qui touchent deux tiers des produits. C’est le cas de l’Algérie, considérée comme territoire national, mais aussi des colonies dites « assimilées », qui comprennent notamment l’Indochine et Madagascar. Ces trois pays à eux seuls représentent l’essentiel du commerce français (60 % des importations en provenance des colonies et 64 % des exportations en 1936). Le régime de l’AOF, mais aussi celui de la Tunisie, sont assez favo rables eux aussi aux intérêts de la métropole. Mais l’exemple de l’Empire français ne doit pas tromper. L’abandon du libre-échange par la GrandeBretagne en 1931 n’a donné aux partisans du protectionnisme qu’une satis faction très partielle. Les importations de la métropole ne sont soumises qu’à
55. Demangeon (A.), La France, 2e partie, France économique et humaine, T. I, p. 62. 56. Marseille (J.), Empire colonial et capitalisme français, histoire d’un divorce, A. Michel, coll. Points-Histoire, p. 44,48. 57. Cain (RJ.) and Hopkins (A.G.), British Imperialism, Crisis and Reconstruction, Londres, Longman, 1993, p. 80.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
un taux moyen relativement bas (10 %) et ne s'appliquent qu'à une partie des produits (coton et pétrole, par exemple, en sont exclus)58. Le dispositif dit de « préférence impériale », mis en place à partir de la Conférence d'Ottawa (1932) , qui a contribué à abaisser les droits des produits britanniques entrant dans les Dominions, l'Inde et les Colonies, et réciproquement ceux des produits de l’Empire entrant en métropole (car le libre-échange britannique postulait l’entrée en franchise des produits étrangers et coloniaux en GrandeBretagne, mais n'interdisait ni aux Dominions ni aux colonies d'en établir pour leur compte) n 'a pas eu non plus d'effets spectaculaires. Il faut ajouter qu’un certain nombre de conventions internationales ont empêché la mise en place d'un système protectionniste hermétique entre la métropole et la totalité de ses dépendances d ’outre-mer. En vertu de l’Acte de Berlin de 1885, l’ensemble de l'Afrique centrale (Congo français, Congo belge, Kenya, Tanganyika, nord de l’Angola et nord du Mozambique) est ainsi régi par le régime de la « Porte ouverte ». C ’est le cas aussi des pays du golfe de Guinée soumis à une convention de 1898 (Nigeria, Gold Coast, Côte-d’Ivoire, Dahomey). Un régime analogue est imposé au Maroc en application de la Convention d’Algésiras de 1906, que le protectorat français n’a pas remise en question. Enfin, le même régime s’applique aux territoires placés sous mandat de la SDN (Togo, Cameroun, essentiel du MoyenOrient). On calcule ainsi que, sur les 68 millions d’habitants des territoires placés sous l’autorité du Colonial Office, A l millions et demi relèvent du libre-échange59. Mais la politique douanière n’est pas la seule à jouer un rôle pour expli quer le redéploiement commercial sur les empires. On doit évoquer, aussi, le rôle de la politique monétaire, décidée par les grands États. Cette politique vise d ’abord à défendre la monnaie, élément essentiel de la sécurité des placements ; puis, à partir de la dévaluation de la livre de 1931, elle s’efforce de réduire la charge des dettes et de faciliter la compétitivité des produits sur le marché mondial, ce qui entraîne les dévaluations successives du dollar (1933) , du firanc belge en 1935, du franc français en 1936, suivies de celles des autres monnaies. Ces mesures, prises sans concertation, accentuent les clivages entre zones monétaires, qui s’ajoutent à celui qui oppose « devises fortes» (livre, dollar, franc français et belge, florin) et «devises faibles» (lire, mark), entendons devises convertibles et non convertibles, et sont autant d’entraves au commerce. Cette chronologie contribue à expliquer aussi la situation fiançaise : il a fallu attendre 1938 pour voir le fianc dévalué à un taux comparable à ceux de la livre et du dollar. Ceci démontrerait l’ina nité d’une politique économique trop centrée sur l’Empire, au point de négliger les échanges mondiaux. L’attitude de la France a été d’autant plus
58. Havinden (M.) et Meredith (D.), Colonialism and Development, p. 187 sq. 59. Lord Hailey, « Les revendications coloniales de l’Allemagne et la Grande-Bretagne », L’Esprit international, 1939, p. 21-39, p. 25.
Structures de Véconomiee
grave qu’elle ne disposait pas de partenaire du poids de l’Australie, des Indes ou de l’Afrique du Sud. Il faut également indiquer le privilège que confère aux entreprises qui veulent opérer dans le territoire contrôlé par une puissance coloniale le simple fait d ’être originaire de la même métropole. Les autorités locales, publiques ou privées, en fonction des affinités de langue, d ’éducation, et du sens de la solidarité nationale, facilitent naturellement leur tâche, quand elles ne les avantagent pas, dans l’acquisition d’autorisations nécessaires, l’attri bution de marchés, ou le recrutement de main-d’œuvre. Des réglementations peuvent consolider cette situation: ainsi, aux termes de sa concession, l’UMHK s’est engagée à se procurer en Belgique 60 % de son matériel60. Comme l’écrit l’économiste Moritz J. Bonn en 1936 : « Quelque internatio nale que soit la finance, la puissance qui règne sur son siège social et au lieu de son activité a généralement le dernier m ot»61. Cet élément est évidem ment bien antérieur à la crise. L’économiste Paul Leroy-Beaulieu soulignait, dès 1874: « il n’est pas besoin de pacte colonial pour assurer les relations régulières de la métropole et des colonies. L’on n’a que faire, dans ce cas, de mesures artificielles. Les liens naturels du langage, de la race, de la commu nauté d ’éducation, d ’idées, de mœurs, l’analogie des besoins et des goûts, ce sont là les meilleures garanties »62. Mais évidemment l’argument de l’intérêt national ne peut que prendre de l’importance à l’occasion de la crise, et on peut d ’ailleurs se demander si, bien que non mesurable, il ne constitue pas, en tout état de cause, un élément déterminant. Sur un plan pratique, les limites de cette politique de repli se manifestent aussi, en effet dans le tableau des besoins en importations des États colonisa teurs. L’idée d ’une complémentarité globale entre métropoles et colonies, celles-ci fournissant les produits fabriqués, celles-là les matières premières, relève plus des clichés que des réalités. Par exemple, en 1936, la France demeure tributaire de l’étranger pour la moitié de ses achats de matières premières chimiques et textiles. Son empire ne lui fournirait que 10 % de ses matières premières et produits alimentaires63. Dans le détail, l’Empire n’as sure la totalité des importations que pour des produits comme les bananes (contre seulement 6 % en 1930), le cacao, le poivre, la vanille ou le riz. Que le pourcentage soit de 67% des importations de viande, 83% de celles d’œufs, 77 % des farineux et légumes n’a qu’un intérêt pourrait-on dire anec dotique, la métropole n’ayant guère de problèmes de production en ce
60. Hoffherr (R.), « Une méthode de collaboration internationale aux colonies et dans les pays neufs, les compagnies internationales de mise en valeur », Annales de ¡’économie collec tive, 1938, p. 30-43, p. 41. 61. Bonn (M.J.), « La portée internationale du problème colonial », L’esprit international, 1936, p. 207-235, p. 222. 62. Leroy-Beaulieu (P.), De la colonisation chez les peuples modernes, Guillaumin et Cie, 1874, p. 524. 63. Hailey (Lord), The Future of Colonial Peoples, p. 30.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
domaine. En revanche, la proportion des importations de charbon, pétrole, minerai de fer, laine et coton d ’origine coloniale est très faible. « Nous ne voyons ici rien de comparable à la solidarité qui unit la Grande-Bretagne à son Empire », écrit Demangeon. Encore faut-il ici émettre des réserves. La Grande-Bretagne ne trouve dans son empire une véritable autosuffisance que pour le thé, le cacao, le caoutchouc, l’étain, et une part notable de la laine et du coton. Mais la divergence des intérêts, en dépit des affirmations célébrant la « préférence impériale », reste grande. Bien des produits sont concurren tiels. Les textiles indiens, par exemple, menacent, moins il est vrai que ceux du Japon, mais notablement tout de même, les cotonnades britanniques. Inversement, si les empires peuvent, en temps de crise, aider au maintien d ’une certaine activité commerciale, leur possession ne saurait être un remède à des déséquilibres structuraux. On remarque ainsi que l’apport de l’Empire n’a pas suffi à combler le déficit de la balance commerciale fran çaise, fondé sur la faible compétitivité des produits industriels fournis par la métropole. Tout au plus la solidarité monétaire a-t-elle pu permettre à la métropole de se fournir dans ses colonies sans avoir besoin de se procurer à l’étranger d ’autres devises, en un moment de très forte baisse des exporta tions. De manière conjoncturelle, il ne peut être question de voir des pays en général peu développés, à l’exception des Dominions, se substituer à des partenaires européens et plus encore aux États-Unis, au commerce en pleine déroute. Il faut observer que, par exemple, en 1938, en dollars courants, les importations américaines étaient globalement inférieures de deux milliards à celles de 1929, alors que le marché indien n ’atteignait pas, globalement, les 500 millions, ou que le marché algérien était de 140 millions. La dépendance des colonies Avec la politique de resserrement du commerce sur les empires, la dépen dance des échanges de celles-ci a tendance à s’accentuer. On peut évidem ment se demander si l’affermissement de ces liens est favorable ou non aux colonies. Il va de soi que le paysage qui résulte de la mise en parallèle de la situation de pays différents ne peut qu’être très varié. Il est certain que la fixation de cours de matières premières supérieurs à ceux du marché, mais aussi la politique des contingentements, a pu avan tager certains producteurs locaux, et ainsi amortir certains effets de la crise. Un exemple spectaculaire est l’essor de la banane de Côte-d’Ivoire, dont la production quintuple entre 1931 et 1938, tandis que les exportations sont multipliées par quinze. En Indochine, la production de caoutchouc est passée de moins de 10000 tonnes en 1930 à 65000 tonnes en 1939, grâce à des dérogations qui lui ont réservé un marché français consommateur d ’environ 70 000 tonnes64. Mais cette aide aurait été sans grand intérêt sans le maintien 64. Bulletin du Comité de l’Asie française, 1938, p. 123-125 ; voir aussi l’article de M. Trentadue sur la production bananière en Guinée in « L’Afrique et la crise de 1930 », Revuefrançaise d'histoire d ’Outre-mer, 1976, p. 585-589.
Structures de l ’économie
d’une ouverture extérieure, car il s’avère qu’en 1938 le marché français n’absorbe que 18 000 tonnes sur 58 000 exportées, le reste allant au Japon ou aux États-Unis63. Quand une extension n’est pas possible, on se trouve en situation difficile : en 1938, les bananes des colonies françaises saturent le marché métropolitain. Les agrumes et les vins algériens suscitent l’inquié tude des producteurs fiançais, qui demandent même pour ces derniers (sans l’obtenir) le contingentement. Cette politique n’a d ’ailleurs pas été suivie, en particulier lorsque le marché colonial ne représente qu’une faible part du commerce national. C ’est ainsi que les douanes des Pays-Bas perçoivent un droit d ’entrée de 300 % sur le thé en provenance des Indes néerlandaises, et le sucre est pratiquement exclu au profit des producteurs hollandais de bette rave6566. Le souci même des métropoles de maintenir et de développer les exporta tions coloniales a coïncidé, le plus souvent, avec une baisse du pouvoir d’achat des colonies. On peut expliquer cette baisse par le fait que la prime donnée par la politique douanière aux produits métropolitains, au détriment de produits étrangers moins coûteux, comme on le verra, a provoqué le renchérissement de la valeur relative des importations. Dans un article publié en 1937, le professeur Hall, directeur de l’Institut national d ’études écono miques et sociales de Londres, proposait même de renoncer à « l’exclusion » douanière si l’on voulait améliorer véritablement le pouvoir d’achat des populations67. Mais ce plaidoyer d ’inspiration libérale avait peu de chance d’être entendu alors. Il faut aussi tenir compte du fait que l’effort pour augmenter la production n’a pas toujours suffi à compenser la baisse plus ou moins grande des cours, et dans un certain nombre de cas, la valeur globale des exportations est en régression par rapport aux années d ’avant la crise. L’exemple des Indes néerlandaises est intéressant de ce point de vue : les importations en valeur ont baissé entre 1928 et 1934 de près de 70 %, et de 50 % en poids ; en revanche les exportations ont baissé de 25 % en valeur, alors qu’elles s’élevaient en tonnage d ’environ un tiers. Le résultat, peut-être inattendu, est que la crise peut se traduire par un excédent des balances commerciales des différents pays coloniaux dans leurs échanges avec les métropoles. C’est ainsi que le commerce de l’Algérie, qui enregistrait en 1929 un déficit de deux milliards de francs, les importations dépassant les exportations de 50% , est équilibré à partir de 1931. Certains peuvent bien se féliciter de ce fait, au nom du préjugé qui assimile déséqui libre à déficit, et déficit à faillite programmée. En réalité, ce rééquilibrage s’effectue dans des conditions qui sont généralement loin d ’être favorables. Un excédent, comme le remarque le géographe Fernand Maurette à propos
65. De La Brosse (P.B.), « Fiscalité et production indochinoises », Bulletin du Comité de l’Asiefrançaise, 1939, p. 235-238. 66. De Klerck (E.S.), History o f the Netherlands East Indies, p. 593. 67. Compte-rendu par Edgar Milhaud, Annales de ¡’Économie collective, 1938, p. 143-
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
du Congo belge, « n’est pas forcément un signe de prospérité, la diminution des importations pouvant simplement marquer l’incapacité d ’acheter le matériel indispensable pour compléter l’outillage nécessaire à tout pays neuf »68. Il faudrait noter enfin que le rattachement des devises locales à celle de la métropole, remède ou palliatif au manque de moyens de paiement, a pu contribuer aussi à créer des difficultés. C ’est le cas notamment en Indochine. «L ’Indochine aux finances prospères, à la balance commerciale des plus satisfaisantes, verra-t-elle sa monnaie entraînée par une chute possible de la monnaie de la métropole, au budget obéré d ’un lourd déficit, et à la balance des comptes très défavorable ? », écrit P.B. de La Brosse en 193769. Si les dévaluations ont pu alléger les dettes intérieures et faciliter les exportations, certains peuvent observer à la fin des années 30 que, vu les excédents commerciaux réalisés, une stabilisation à un taux plus élevé serait sans danger et faciliterait les achats à l’étranger, donc les investissements. Inversement, nombre de critiques sont adressées aux autorités monétaires britanniques des Indes, qui se voient reprocher de maintenir la roupie à un taux trop élevé, ce qui rend les exportations de produits indiens peu compéti tifs face en particulier à ceux du Japon, et facilite au contraire les importa tions de produits étrangers, en particulier de produits anglais. Les mêmes se plaignent de voir aussi que le maintien de ce taux de change élevé entraîne un flux d ’or en direction de la Grande-Bretagne : cette politique a un effet déflationniste qui rend plus lourd le poids des dettes, et oblige les débiteurs à régler leurs dettes en vendant leurs bijoux, placement de sécurité des familles indiennes ; l’or ainsi mobilisé est attiré par la place de Londres, où la dévaluation de la livre l’a amené à s’apprécier de 20 %, alors que son abondance le déprécie aux Indes; les autorités monétaires britanniques encouragent l’Inde à constituer des réserves en livres70. Un phénomène analogue pourrait s’être produit aux Indes néerlandaises, où De Klerck estime à 140 millions de florins (soit au taux de 1938 environ 14 millions de livres) l’or qui a été fondu et a quitté Java depuis 192971. Il faut observer, cependant, que la durée de la crise n’est pas extrêmement longue. Un redémarrage s’observe à partir de 1936. Aux Indes néerlandaises, on observe ainsi une augmentation en valeur de 75 % des exportations entre 1935 et 1937, grâce à une hausse conséquente des prix72. Mais, malgré tout, ses effets psychologiques sont sans doute plus durables. Cette évolution a eu
68. Maurette (F.), Afrique équatoriale, orientale et australe, in Vidal de la Blache (dir.). Géographie universelle, A. Colin, 1938, p. 79. 69. « La dévaluation du franc et de la piastre indochinoise », Bulletin du Comité de l'Asie française, 1937, p. 274-276. 70. Cain (P.J.) and Hopkins (A.G.), p. 171-194 ; Rothermund (D.), An Economie History of India, p. 102-107. 71. De Klerck (E.S.), History of the Netherlands East Indies, p. 584. 72. De Klerck (E.S.), History of the Netherlands East Indies, p. 5%.
128
Structures de l ’économie
pour effet d ’achever d ’attirer l’attention des dirigeants sur l’importance de leurs empires. Outre les mesures d ’urgence, les difficultés, dues sans doute aussi à des causes structurelles, suscitent ou du moins accélèrent des programmes de réformes adaptés. Les responsabilités économiques Les plans d ’investissements La notion de responsabilité économique des États colonisateurs par rapport à leurs possessions n’est pas une innovation des années trente. Une des justifications de la constitution d ’empires coloniaux résida, en tout cas au XIXe siècle, dans la préoccupation d ’assurer, par la conquête et l’occupation, la sécurité des communications et la liberté des transactions jugées néces saires aux intérêts européens. Dès le tournant du siècle, l’accent commença à être mis sur la nécessité pour l’État de donner son appui aux entreprises économiques jugées indispensables, soit en garantissant les opérations des investisseurs européens, soit en se faisant lui-même investisseur, en particu lier dans le domaine des infrastructures, chemins de fer, routes, ponts, ports. Au Royaume-Uni, le grand ministre des Colonies Joseph Chamberlain, détenteur de ce portefeuille de 1895 à 1903, se fit le chaud défenseur de cette conception, qu’il résumait dans la formule: «nous sommes les maîtres (landlords) d ’un grand domaine ; le devoir d ’un maître est de mettre son domaine en valeur »73. Cependant, toutes ces ambitions n’excèdent pas les limites de l’interven tion de l’État en régime libéral. Il est admis depuis longtemps que le budget de la métropole doit assumer au moins une partie des dépenses dites « de souveraineté » (salaires et soldes des Européens, matériels militaires), néces saires à l’occupation. Mais abstraction faite de ces réserves, toute idée de solidarité financière entre colonies et métropole est exclue. On préfère compter sur les ressources douanières et fiscales des colonies elles-mêmes pour financer les dépenses locales, soit par un prélèvement direct, soit indi rectement, par le remboursement de la charge d ’emprunts. Peu de responsa bles sont prêts à concevoir qu’un transfert de ressources du budget métropo litain aux budgets locaux puisse s’opérer pour favoriser le développement des possessions d ’outre-mer. Les hommes politiques, dans l’ensemble, sont sensibles en effet aux réserves des représentations nationales des métropoles, où un nombre important de voix est toujours prêt à opposer le coût des entre prises coloniales effectuées aux frais des contribuables aux incantations des partisans d ’une expansion présentée, pour reprendre une expression de Jules Ferry, comme un placement « des plus avantageux ».
73. Havinden (M.) et Meredith (D.), Colonialism and development, p. 88.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Dans les années 1910, époque à laquelle la montée des dépenses mili taires obère la plupart des budgets européens, ce principe est érigé en loi, qui rend les dépenses coloniales susceptibles d ’un étroit contrôle parlementaire. C’est ainsi que, dans les territoires français, la loi du 13 octobre 1912 pose le principe de l’autonomie financière, en disposant que « les colonies doivent pourvoir sur leurs propres ressources à la totalité de leurs dépenses de fonc tionnement et de développement ». Il en est de même au Congo belge depuis la «charte coloniale» du 18 octobre 1908, qui fait succéder la tutelle du Parlement à la simple union personnelle instituée par le roi Léopold II, et aux Indes néerlandaises depuis 1912. La valeur de ce principe semble confirmée par les embarras financiers des possessions portugaises, dont le budget central a longtemps accepté de couvrir les déficits; à partir des années trente, le gouvernement de YEstado Novo se rallie au principe de l’autonomie financière, et s’emploie à équilibrer les budgets locaux74. Dans les territoires britanniques, Chamberlain n’a pu imposer ses conceptions, et l’idée d ’autonomie financière continue à inspirer une pratique qui correspond d ’ailleurs à celle d’un assez large contrôle financier par des législatures locales, au détriment de celui du Parlement britannique75. Le modèle de développement, dans ces conditions, consiste largement, pour les responsa bles des colonies, à stimuler la production locale, seule capable de fournir une matière imposable, par la taxation des échanges et celle du travail, et de rémunérer les investissements privés. Comme l’écrit un spécialiste de l’éco nomie des Indes néerlandaises, « il faut qu’elles exportent vers le monde entier, car l’énorme investissement de capitaux doit trouver une rémunéra tion adéquate et l’intérêt de la dette et les pensions de retraite doivent être payés. La question est de savoir si la rémunération des capitaux est excessive ou non »76. La crise des années 1930 souligne les limites de cette conception d ’un développement autonome des colonies. Les investissements privés, qui jusque-là ont connu des taux de croissance très satisfaisants, connaissent un très net ralentissement, conséquence de la difficulté à écouler les produits coloniaux à des prix rémunérateurs. Par ailleurs, la crise diminue d’abord les ressources locales, et notamment les droits de douanes prélevés sur les échanges commerciaux, mais aussi la partie des impôts sensible à la conjoncture. En revanche, les emprunts contractés représentent un montant difficilement compressible, et qui peut même s’accroître d ’appels supplé mentaires. Les inégalités sont grandes, cependant. La variation des ressources fiscales est ainsi de près de 25 % aux Indes néerlandaises entre 1928 et 1939 (544 à 402 millions de florins courants, après une chute à 300 millions en 1932)77. Au Congo, la charge de la dette passe de 20 % des
74. Böhm (E.), La mise en valeur, p. 135-139. 75. Evans (E.W.), « Principles and Methods of Administration in the British Colonial Empire », Principles and Methods of Colonial Administration, p. 13. 76. Van Asbeck, « Les responsabilités néerlandaises... », art. cit., p. 206. 77. Vandenbosch, (A.), The Dutch East Indies, p. 300.
Structures de l ’économie
dépenses ordinaires en 1921 à 80 % en 1932. En Algérie, d'après un rapport de 1937, le pourcentage dépasse les 30 %78. Il représente 40 % des dépenses du budget général de 1*AOF, 80 % de celui de l’AEF. La situation des colo nies britanniques est moins alarmante, mais préoccupante cependant, puisque le pourcentage dépasse 30 % au Nigeria et au Kenya79. Aux Indes néerlandaises, il ne dépasserait pas 23 % en 193780. Ces différences ont plusieurs origines. Tout d ’abord, les recettes sont inégalement sensibles à la conjoncture, comme l’impôt de capitation, ou bien encore les impôts fonciers, voire certains impôts sur la consommation (sel, alcool), bien que les difficultés des populations aient amené l’administration à accorder des dégrèvements, mais souvent avec retard et parcimonie. D’autre part, le poids du remboursement de la dette n’est pas égal partout Lorsque les crédits ont été obtenus sur le marché boursier, la charge, qui consiste en dividendes, varie en principe avec le cours de matières extraites, et par conséquent ne pèse pas, en cas de crise, sur les ressources budgétaires. C’est le cas en Malaisie, par exemple, où l’exploitation du caoutchouc a été développée essentiellement par un financement en bourse, ou bien encore en Afrique du Sud, où les investissements miniers reposent essentiellement sur ce système81. Il faudrait enfin prendre en compte le poids des dévaluations. Les emprunts étant libellés le plus souvent dans la monnaie du pays coloni sateur, la charge de la dette n’est vraiment allégée que dans le cas où une partie notable des recettes d ’exportations est libellée en devises étrangères, ce qui avantage les pays qui font une partie importante de leur commerce avec d ’autres partenaires que la puissance coloniale, qui se trouve en même temps principal partenaire commercial. Cela avantage notamment les Indes néerlandaises. Face à des déficits budgétaires croissants, les gouvernements coloniaux cherchent à réduire au maximum leurs dépenses. Dans les colonies tropicales britanniques, les dépenses publiques auraient connu une baisse certes variable, allant de 5 % (Jamaïque) à 50 % (Federated Malay States) entre les années 1920 et les années 193082. Aux Indes néerlandaises, entre 1929 et 1933, la chute est de près de 42 %, et en 1938 l’équilibre n’est rétabli qu’aux alentours de 75% du budget de 1929 (en florins courants)83. Selon De Klerck, les dépenses d ’administration, mais aussi d ’éducation et de santé ont diminué de 40 %, les dépenses d ’agriculture, de commerce et d’industrie de 23 %84. La situation budgétaire ne peut suffire aux besoins de dévelop
78. Berque (J.), Le Maghreb, p. 309. 79. Frankel (S.H.), Capital Investment, p. 343,351. 80. Vanderlinden, Pierre Ryckmans, p. 240 ; De Klerck, (E.S.), History of the Netherlands East Indies, p. 587. 81. Frankel (S.H.), Capital Investment, p. 180. 82. Havinden (M.) et Meredith (D.), Colonialism and development, p. 177. 83. Vandenbosch (A.), The Dutch East Indies, p. 298-309. 84. De Klerck, (E.S.), History of the Netherlands East Indies, p. 587.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
pement, au moment où les capitaux privés, essentiels dans des économies demeurées fondées sur le système libéral, font de plus en plus défaut. Des inquiétudes se manifestent. Pierre Ryckmans écrit, en dénonçant la politique suivie au Congo : « Sans sacrifice de la Métropole, pas de Colonie. Il faut choisir : ou mériter le Congo, ou le perdre. Pour le moment, avec un budget comme celui de 1932, nous ne le méritons certes pas - et nous sommes en train de le perdre »85. Pourtant, les autorités coloniales ne restent pas inactives. Ailleurs, et notamment dans les possessions africaines de la France, l’augmentation des subventions du budget français ont sans doute limité la baisse des ressources. Le budget du Congo reçoit également des subventions pour équilibrer son déficit, tandis que la dévaluation s’accompagne d ’une modification des revenus douaniers, l’essentiel frappant désormais non plus les importations (renchéries par la dévaluation), mais les exportations (qui bénéficient au contraire de celles-ci). De même, des droits de 4,5, puis de 7,5 % sont mis sur les exportations de charbon indochinois86. Aux Indes néerlandaises, des conversions de rente sont opérées pour diminuer la charge de la dette, et, en 1936, le gouvernement hollandais procède au versement de 25 millions de florins, utilisés pour l’amélioration de l’agriculture, ce qui coïncide avec la dévaluation pour alléger le fardeau. Par la suite, la remontée des cours permet de revenir à des finances plus équilibrées. Mais le grand intérêt de la période aura été d’amener les autorités coloniales à une réflexion sur les implications des métropoles dans le développement de l’outre-mer. Pendant et surtout après la Première Guerre mondiale, des argumenta tions se sont développées, qui donnaient à l’État la mission d ’accélérer le développement grâce à des subventions du budget métropolitain. En France, c’est au président Albert Sarraut que revient, dès 1921, l’initiative de présenter devant le Parlement un programme d ’outillage des colonies, programme défendu et illustré dans l’ouvrage intitulé La mise en valeur des colonies françaises, qui énumère une liste d ’équipements prioritaires. Il faut pourtant attendre 1929 pour voir le ministre des Colonies André Maginot déposer un projet de loi sur de grands emprunts d ’investissements. Simulta nément en Grande-Bretagne, l’ambitieux Leo Amery soutient, à partir de 1925, une politique de subventions du développement des ressources des possessions tropicales, et parvient à faire voter un Colonial Development Act en ce sens (juillet 1929). Ces plans insistent l’un et l’autre sur les avantages économiques que peuvent retirer les métropoles d ’un accroissement de la production outre-mer, susceptible de réduire les importations de matières premières étrangères, et d ’augmenter le pouvoir d’achat des colonies ; ils apparaissent comme une réponse aux difficultés passagères de la France au début des années vingt, et aux difficultés plus durables de la GrandeBretagne tout au long de ces années. 85. Vanderlinden (J.), P. Rickmans, p. 233. 86. Bulletin du Comité de l ’Asie française, 1939, p. 199.
Structures de l*économie
La crise qui se révèle brutalement au mois d ’octobre 1929 ne modifie pas ces projets. Celui de Leo Amery, voté peu avant les élections de 1929, est poursuivi sous ses successeurs travaillistes ; les lois proposées par André Maginot sont votées en 1931, à l’initiative de Paul Reynaud. Mais les crédits ainsi dégagés paraissent modestes, eu égard à l’ampleur des problèmes, structurels autant que conjoncturels. Les fonds consacrés au développement des colonies britanniques ne dépassent guère un million de livres de 1929 (soit 125 millions de ñancs par an) entre 1929 et 1939, soit un total de 8,87 millions, dont 30 % ont été aux communications, et 5 % aux ports87. Notons à titre de comparaison que le total des dépenses inscrites au seul budget de 1929 dépassait 800 millions de livres. La proposition de la confé rence économique française et coloniale de 1934, formulée notamment à l’initiative de Sarraut, d ’imiter le Development Fund britannique reste sans suites. Pourtant, les subventions directes de l’État français à l’équipement ne sont pas négligeables, puisqu’elles se montent à près de deux milliards de francs-or entre 1931 et 1939, soit environ 20 milliards de francs de 1936, et en moyenne deux milliards par an, à rapprocher d ’un budget des dépenses de 45 milliards en 1929. Cette différence se retrouve dans certains chiffres d’en semble. C ’est ainsi que, en Afrique noire, dès le début des années 1930, Frankel évaluait respectivement le pourcentage du capital public par rapport aux capitaux investis respectivement à 61 %, 48 % et 25 % pour les terri toires d ’ensemble des Français, des Britanniques et des Belges en Afrique noire88. Ces investissements avaient porté, en particulier, sur les ports et les infrastructures ferroviaires, mais parfois aussi sur de grands travaux destinés à permettre le développement de certaines matières premières, comme par exemple le coton. Tous ces. investissements, effectués surtout au profit des colons ou de l’exportation, ne se révèlent pas toujours des plus opportuns : Frankel note ainsi que, en Afrique, les chemins de fer ne sont véritablement rentables que pour le transport des minerais ; autrement, le fret est insuffisant (en particu lier à la remontée des ports vers l’intérieur, vu la faiblesse relative des importations, qui dépendent de la consommation locale, ainsi que le nombre de passagers. Les tarifs de transports sont élevés, étant donné la nécessité de rembourser les emprunts ; parfois, la garantie d’intérêt donnée aux investis seurs, voire même des dégrèvements d’impôts, se révèlent onéreux pour la colonie, comme le souligne, en 1935, un rapport du Sénat belge à propos des chemins de fer du Congo89. Malgré tout, on peut dire que s’opère, dans ces années, une prise de conscience nouvelle des responsabilités des métropoles. La crise a souligné aussi la nécessité de modifier les perspectives de la production coloniale, en soulignant les limites d ’une conception trop souvent fondée sur la combinaison du capital européen et du travail indigène. 87. Ageron (Ch.R.), La décolonisation française, p. 115-116; Porter (B.), The Lion’s Share, p. 279-280. 88. Frankel (S.H.), Capital Investment, p. 170. 89. Frankel (S.H.), Capital Investment, p. 409-410.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Le producteur indigène Il ne faudrait pas imaginer un désintérêt total des colonisateurs pour la production agricole indigène, au détriment de celle des Européens. L’intérêt se limite trop souvent, il est vrai, à organiser la contrainte. Les Pays-Bas avaient ainsi organisé aux Indes néerlandaise un régime de cultures forcées connu sous le nom de « système Vandenbosch », à l’origine de nombreux abus, largement dénoncés par les Hollandais eux-mêmes, auxquelles ils mirent fin dès 1870. Ailleurs, en exigeant le paiement en argent des impôts fixés, non pas seulement en fonction du patrimoine foncier, mais aussi par individu adulte et valide, sous forme de capitation, on espérait obliger l’indi gène à produire et à vendre. La théorie de ce système, faite par Gallienià Madagascar au début du siècle, est encore bien vivante. Comme l’écrit encore un spécialiste de l’Indochine en 1939, « le malheur de l’administra tion est qu’elle ne possède pas d ’innombrables moyens de pousser l’indigène au travail ; mais si elle n’en a qu’un, il est bon : il réside dans une augmenta tion raisonnable du taux de l’impôt personnel â90. Il est vrai que tout ne se réduit pas à des mesures coercitives. Certaines législations se sont efforcées de protéger le patrimoine foncier des indigènes : en Indonésie, par exemple, une loi de 1875 interdit aux indigènes d ’aliéner leurs terres aux Européens, Chinois, ou autres étrangers, autorisant seulement la location par des baux à long terme, à des prix fixés par l’État, de terres impropres aux cultures vivrières. Il faut observer aussi, que lors qu’ils produisent des denrées destinées à l’exportation, pour lesquelles sont imposées des normes de qualité exigeantes, les indigènes bénéficient souvent de conseils. C ’est encore aux Indes néerlandaises que l’effort est le plus grand, avec un réseau d ’inspecteurs et de conseillers agricoles européens, assistés par des conseillers-auxiliaires indigènes, formés à l’École de Buitenzoïg, et auxquels il n’est reproché que leur interventionnisme jugé excessif. Ce n’est pas toujours le cas, il faut l’avouer, des productions vivrières, qui ne connaissent que bien peu d ’améliorations. Le cas de l’Algérie est un des plus flagrants. Les moyens du petit fellah, comme le remarque Xavier Yacono, n’ont guère varié depuis 1830, et les rendements à l’hectare sont deux fois moins élevés que ceux de l’exploitation européenne, pourtant extensive (4,71 en moyenne contre 8,83, sur la décade 1930-1939). La plupart des nouvelles espèces introduites l’ont été par les Européens et à leur profit, même si les indigènes ont su exploiter quelques opportunités, comme le tabac. Depuis longtemps, des observateurs de bon sens ont estimé que la coloni sation agricole européenne ne pouvait avoir, même pour des raisons pure ment économiques qu’une place très limitée, car elle exige des capitaux difficiles à réunir, et une rentabilité forte, en dépit des variations très impor 90. De La Brosse (P.B.), « L’Indochine et la défense de l’Empire », Bulletin du Comité de l ’Asie française, 1939, p. 197-203.
Structures de Véconomie
tantes du climat et du marché. Pour réaliser des profits, elle compte plus sur des salaires bas, ce qui ne motive guère les travailleurs et oblige parfois à utiliser la contrainte à leur égard, que sur les accroissements de productivité. D’autres font remarquer d ’ailleurs que cette agriculture européenne ne peut subsister en cas de crise sans des aides du gouvernement, au total beaucoup plus onéreuses que celles qui s’adressent aux indigènes: c’est le cas en Afrique du Sud, mais aussi en Afrique du Nord au début des années trente. Des observateurs de l’époque font observer que, avec des conseillers euro péens, les indigènes peuvent produire dans des conditions moins dispen dieuses : la production de l’arachide du Sénégal, du cacao de Gold Coast ou de Côte-d’Ivoire, les progrès de la culture du coton par les Africains en Ouganda, apparaissent aussi comme tout à fait encourageants. Des enquêtes montrent aussi, que dans certains cas, la productivité du travailleur indigène approche ou dépasse celle de l’Européen : au Maroc, par exemple, c ’est le cas pour le blé dur, l’orge et le maïs91. Ainsi, de plus en plus, l’idée prévaut de compter avant tout sur le produc teur indigène, considéré comme le moyen le plus efficace et le plus écono mique de mise en valeur. Certains y voient une meilleure soupape de sûreté contre la crise, mais aussi la possibilité d ’une véritable réforme de structure. Comme le dit Léopold III dans le discours-programme de 1933, l’avenir appartient aux colonies où l’exploitation du sol « se fera dans les conditions les plus économiques, et ceci ne peut avoir lieu que par l’entreprise de l’indi gène »92. Le problème n’est pas perçu seulement dans sa dimension écono mique, mais aussi dans sa dimension sociale: le développement de la production locale est seul à avoir un véritable effet d ’entraînement sur le bien-être social, l’accroissement des revenus étant seul de nature à inciter les indigènes à modifier leurs conditions de vie. Cette solution est, par exemple, préconisée par le travailliste Edmund Motel dans son livre intitulé, d ’après Kipling, The White M an’s Burden, publié en 192093. Elle peut paraître appli cable sans trop de difficultés aux pays tropicaux africains, relativement souspeuplés, où le patrimoine foncier inexploité est important. Elle paraît beau coup moins applicable ailleurs, où les problèmes sont, comme on pourra le voir, beaucoup plus sociaux qu’économiques, la question de la répartition des ressources ayant tendance à prendre le pas sur celle de leur production. La crise attire aussi l’attention sur les dangers d ’une économie trop centrée sur l’exportation, à laquelle a été sacrifiée une partie des productions destinées traditionnellement à l’autoconsommation villageoise. Un rapport sur les West Indies britanniques, établi par la commission Moyne après de sérieuses agitations, en particulier à la Barbade, à Trinitad, en 1937, puis à la Jamaïque en 1938, dénonce le délabrement d ’une économie fondée essentiel
91. Berque (J.), Le Maghreb, p. 245. 92. Labouret (H.), « La tradition coloniale », art. cit., p. 439. 93. Partha Sarathi Gupta, Imperialism and the British Labour Movement, 1914-1964, Londres, MacMillan, 1975, p. 32-33.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
lement sur l’exportation de produits tropicaux (sucre notamment), et à la démission de l’administration, dans des pays surpeuplés, qu’ont ravagé presque tous les ans des cyclones particulièrement dévastateurs. Il souligne, notamment, le caractère malsain d’une situation qui amène à importer viande et lait en conserve, ou céréales de pays tempérés à des prix qui restent soutenus, et à exporter du sucre déprécié sur un marché mondial complète ment engorgé. Les produits alimentaires représentent près de la moitié des importations de ces pays, où le pain coûte plus cher qu’en Angleterre. D préconise le développement du maïs et des légumineuses, destinés à l’autoconsommation94. Mais ces conditions ne s’observent pas partout. La plupart du temps, la production pour l ’autoconsommation paysanne reste prédomi nante, même si la vente est le seul moyen de se procurer la quantité de monnaie nécessaire au paiement des impôts et à l’achat des suppléments indispensables ; parfois, l’organisation sociale conforte cette situation : en particulier, en Afrique noire, l’essentiel de la production vivrière, assuré par le travail des femmes, qui ne sont pas employées sur les chantiers, échappe à la logique du marché. Il va de soi que l’ensemble de ces fonctionnements et dysfonctionne ments s’accompagnent de difficultés sociales graves, qui elles-mêmes ne peuvent être dissociées de l’ensemble des rapports sociaux engendrés par la législation et les pratiques d ’un système colonial discriminatoire.*92
94. Moyne (Lord), «The West Indies in 1939 », The Geographical Journal, 1940, p. 8592.
136
Chapitre 5
L es populations : les indigènes
Diversité et différence La notion de contraste est peut-être aux origines de « l’aventure colo niale ». Celle-ci a consisté, à une échelle inconnue jusque-là, en tout cas des Européens, à mettre en contact des régions affectées d ’une polarité diffé rente, pour créer des courants égalisateurs entre les unes et les autres. Certes, cette mise en contact affecta d’abord des produits, en offrant au commerce de nouvelles perspectives. Mais ce processus purement matériel, et soumis en cela aux lois de l’économie, s’accompagna nécessairement d’un pro cessus de représentation mentale. Les découvertes signifiaient en effet, pour les colonisateurs, une sorte de rajeunissement, et, pourrait-on dire, de renou vellement du monde, limité jusque-là à l’Europe, mais aussi d ’enchantement, d’émerveillement, au moins au sens de curiosité, devant des spectacles inconnus. Au XXe siècle, cet aspect n’a pas disparu. Les impressions des nouveaux venus, transmis par les récits de voyage, les peintures, ou, de plus en plus, les films et les photographies, nourrissent une série de représenta tions sans doute plus superficielles et vagues que vraiment fausses : la fraî cheur et la douceur des pays tempérés par rapport aux excès des climats des Tropiques ; la maîtrise d ’une végétation contrôlée face à l’exubérance d ’une végétation « vierge » ; la pâleur de l’épiderme des « Blancs » opposée aux teints plus foncés, voire tout à fait noirs, de ceux des hommes dits «de couleur » ; et la profonde « étrangeté » des lois et coutumes de ceux-ci. Le contraste se dissout en une infinité de facettes, qui font jaillir de chaque rencontre une nouvelle image. George Orwell, qui séjourna en Birmanie entre 1922 et 1928, indique comment, en s’élevant de Mandalay, dans la vallée de l’Irrawady, et Maymyo, sur le rebord du plateau Shan, on passe « de l’atmosphère typique d ’une cité orientale : le soleil torride, les palmiers poussiéreux, les odeurs de poisson, d ’ail, d ’épices, les fruits pulpeux des tropiques, les visages sombres des passants », à « un air frais qui pourrait être celui de l’Angleterre, de vertes prairies, des fougères, des sapins, et des femmes des collines aux joues roses, qui vendent des paniers de fraises » '.
1. O rw ell (G .), Homage to Catalonia [1938], Penguin B ooks, 1987, p. 103.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Étant donné la simple extension des empires, la variété des pays colonisés est inépuisable : pratiquement toutes les latitudes, tous les climats, toutes les espèces de végétations y sont représentés, des pôles à l’équateur, des déserts de glace aux déserts de sable, des toundras aux forêts denses. On doit noter cependant la forte prépondérance des pays situés entre ou aux abords des tropiques : mis à part le Canada, une partie de l’Australie, les façades mari times de l’Afrique du Nord et de l’Afrique du Sud, toutes les possessions coloniales relèvent de types de climat et de végétations subtropicales, tropi cales ou équatoriales. Dès lors, les différents aspects de la nature des pays coloniaux portent la marque de la chaleur, sèche ou humide. Parler de colo nies, c’est évoquer le sirocco, la mousson, le cyclone ; c’est évoquer à la fois le désert, la steppe, la brousse, la jungle ou la savane, ou la grande forêt équatoriale qui se répartissent entre les vingtièmes parallèles nord et sud. S’il y en avait un, l’arbre symbolique des colonies serait sans doute le palmier, dont la famille a essaimé dans l’ensemble de cet espace, des cocotiers des plages d ’Océanie aux dattiers des oasis sahariennes, en passant par le palmier à huile ou le palmier à vin de la forêt congolaise. La diversité des hommes et des genres de vie est encore plus grande, s’il est possible, au moins pour celui qui est incapable de reconnaître, sous le chatoiement des apparences, l’application de la logique qui, depuis les origines, s’impose aux organisations sociales : survivre, se reproduire, trans mettre des savoirs, rendre compte du sens de la vie. Mais il est vrai que la diversité des langues, des costumes, des types physiques, amène facilement à succomber à la tentation. Teints diversement colorés ; taille allant du géant au pygmée ; têtes rondes ou allongées ; populations vivant sous la tente, dans une maison de terre, ou sous une hutte de branchages, de roseaux ou de bam bous ; pasteurs, cultivateurs itinérants, ou véritables sédentaires ; mangeurs de patates, de blé, de mil, de riz, voire de maïs ; hommes allant presque nus, ou au contraire vêtus d ’amples robes, habillés de cuir, de laine, de coton ou de soie; la liste serait infinie, comme celle des innombrables langues et ethnies, comme aussi celle des religions, et plus encore des pratiques reli gieuses, qui font, par exemple, que l’islam arabe n ’est pas exactement l’islam indien ni l’islam indonésien. Plus que les descriptions précises et fidèles, ce sont les sensations, réelles ou virtuelles, qui comptent. Les peintres des écoles orientalistes, qui foison nent à partir du XIXe siècle, mais gardent au XXe une solide postérité, ont imposé la vision d’une gamme étendue de couleurs, ivoire, bronze, cuivre ou ébène des peaux, mais aussi rouge, vert, jaune ou vieil or des costumes. Tout se résume dans le spectacle de rues «grouillantes», peuplées de «foules bigarrées », avec leurs « bazars » proposant invariablement « tout ce qui peut se vendre ou s’acheter », dans une débauche d’odeurs, flatteuses ou non, où l’on côtoie les « races » les plus diverses, reconnaissables à leurs costumes ou à leurs types physiques. Cette vision, qui vaut surtout pour les cités d ’Orient et du monde arabe, aux fortes traditions urbaines et commerciales, est, abusivement, étendue à l’ensemble des «colonies». En revanche, les
138
Les populations : les indigènes
notations désespérantes qui présentent les colonies comme des terres de dégénérescence, de fièvre et de morts, sont plus rares, semble-t-il, qu’au siècle dernier. C’est le finit de réels progrès en matière d ’hygiène, mais sans doute aussi de l’avènement d’une représentation plus optimiste. La vision n’est pas purement esthétique ou impressionniste. Constatations et commentaires sur la diversité des hommes, reconnus en tant que tels, remontent à la Renaissance, et Montaigne a écrit à ce sujet des pages qui sont toujours à relire aujourd’hui2. Depuis longtemps, les savants européens, géologues, zoologues, botanistes, ont commencé l’inventaire de ces diffé rents milieux. À leur suite, ou en même temps, la géographie humaine s’est efforcée de répertorier les formes par lesquelles les hommes des différentes contrées s’étaient, à chaque fois, accoutumés à tirer partie du milieu où ils étaient établis ; cependant que l’ethnologie a commencé à décrire les cultures que leur imagination les avait amenés à élaborer, et par lesquels ils organi saient et se représentaient leurs rapports entre eux et leur rapport à l’univers. Cette quête de savoir, qui annonça, accompagna, et souvent, favorisa la conquête coloniale, sera dénoncée, par la suite, comme la forme de conquête la plus insidieuse : celle qui consiste à prétexter une recherche purement idéaliste pour préparer une exploitation très matérialiste, en cherchant à connaître les sociétés pour mieux les dominer ; celle qui consiste à s’appro prier ce qu’il y a, dans les peuples, de plus irréductible et de plus génial, pour en faire des objets de musée, exhibés à la curiosité, fût-elle admirative, des Européens ou des Américains. Il n’empêche que cette entreprise restera, pour tous les hommes à venir, un acquis incomparable, de nature à les aider, s’ils le veulent, à mieux s’accepter et à mieux se comprendre. Elle est d ’au tant plus précieuse que le monde sur lequel elle a accumulé les documents est aujourd’hui très largement disparu ou en voie de l’être. Les savoirs ainsi constitués sont, le plus souvent, des collections de monographies, portant sur des groupes géographiquement et démographiquement très délimités et souvent fort réduits, et dont l’ambition n'est certes pas de présenter une synthèse de « l’homme colonial». Mais c’est aussi, malheureusement, de cette connaissance de ces sociétés, forcément partielle, que découle, simplifiée, schématisée, voire même abâtardie et caricaturée, une représenta tion des groupes constitutifs des constructions impériales rassembleuses et en ce sens - et trop souvent en ce sens seulement - compréhensives de peuples. La constatation de ces différences implique-t-elle un racisme ? Il ne faut pas chercher à employer ce mot à tout prix. Le recours fréquent au terme de race, rejeté aujourd’hui pour avoir été dévoyé par de détestables idéologies, ne doit pas abuser, car il est encore souvent employé alors, de façon plus neutre, pour désigner des groupements humains définis par une langue ou une culture jugées spécifiques par rapport à celles de groupes voisins. Plutôt
2. Des cannibales, Essais, Chapitre XXXI.
139
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
qu'au terme de racisme, on serait tenté de recourir plutôt à celui de racialisme, qui commence à être employé aujourd’hui pour désigner des théories tendant à expliquer le monde en fonction de la diversité des cultures, tenta tive qui, en soi, n’a rien d ’illégitime. On risque, il est vrai, de donner à cette différence, souvent trop superficiellement perçue, un caractère trop figé et trop essentiel. De fait, la classification la plus élémentaire à l’époque demeure celle qui range les peuples en fonction de leur couleur de peau, critère biologique abusivement surdéterminé (c’est le cas, notamment, des manuels de géographie). Par ailleurs, de l’idée de différence, on arrive trop facilement à celle de hiérarchie, dont la civilisation occidentale, et son repré sentant, l’homme blanc (blond de préférence), occuperait le sommet ; repré sentation, sinon ouvertement avouée, du moins presque toujours présente chez les Européens. Certes, ce faisant, ceux-ci ne font que céder à un penchant universellement répandu à se prendre pour référence en matière d ’humanité. Mais c’est justement parce qu’ils prétendent dépasser les pré jugés communs pour s’élever à une raison universelle que leur engluement dans ces préjugés paraît moins excusable. Il faut dire aussi que cette attitude n’est pas sans conséquence : elle justifie, implicitement, la colonisation, dans la mesure où l’ordre que celle-ci établit paraît correspondre à la hiérarchie des cultures. Des penseurs marxistes y verront même un pur produit idéolo gique du rapport d ’exploitation impliqué par la colonisation, ce qui est probablement excessif. Cette attitude peut être illustrée par l’exemple de Georges Hardy, auteur déjà amplement cité, pour son remarquable ouvrage sur la Politique colo niale. Universitaire, haut fonctionnaire de l’Instruction publique, très lié à des milieux coloniaux français profondément imbus d ’idéologie républi caine, il récuse expressément les théories de l’inégalité des races dont se réclament les disciples de Gobineau, voire même les doctrines de « l’homme primitif » tirées de la lecture du sociologue Durkheim. Il n’en écrit pas moins que, «même si les races humaines sont dans leur tréfonds parfaitement semblables, on est bien obligé d’admettre qu’il subsiste entre elles, pour le moment, des différences singulièrement ancrées... ». Il lui paraît évident, par suite, de présenter les peuples colonisés selon une sorte de hiérarchie montante, qui sera reproduite ici pour deux raisons : la première, tout simple ment, parce qu’elle donne une bonne idée de la diversité que recouvre l’ex pression de colonisés ; et la seconde, parce qu’elle correspond aux idées les plus répandues chez les Européens des classes un peu cultivées, les seuls sans doute qui aient le loisir d ’éprouver un certain intérêt pour ces questions coloniales3. Georges Hardy évoque d’abord les « types d’humanités tout à fait élé mentaires » que seraient les Pygmées d ’Asie et d’Océanie, qui vivent essen tiellement de chasse, de pêche et de cueillette, ou encore ceux d ’Afrique,
3. Hardy (G.), La politique coloniale, p. 121-132.
140
Les populations : les indigènes
pratiquement « en marge de la colonisation ». Il place au-dessus des précé dents les Mélanésiens, puis les Polynésiens, puis les Noirs d ’Afrique, chez lesquels l’agriculture est déjà plus développée, au point que ces derniers sont de véritables paysans. Plus « haut » encore se situeraient les peuples nomades, éleveurs, commerçants et guerriers, Arabes du désert, Maures, Touareg, Peuls, Masaï, Hottentots et Cafres. Au-dessus enfin, de vieilles civi lisations, « qui n’ont eu, d ’un point de vue pratique, que le tort de s’attarder dans les formules du passé»: Inde, Chine, Annam, Laos, Cambodge, Insulinde, mais aussi l’Asie sémitique des Syriens et des Arabes, ainsi que la « Berbérie », entendons l’Afrique du Nord, sans oublier les royaume Hova de Madagascar et l’Abyssinie. Le même esprit classificateur se retrouve chez les géographes: Pierre Gourou oppose ainsi les «évolués» d ’Indonésie (Malais, notamment), aux «attardés» de l’intérieur. Il rappelle que « la chasse aux têtes était encore pratiquée à la fin du siècle dernier par les Alfour de Céram et d ’Halmaheira, les Dayak (Bornéo), les Batak (Sumatra), les Toradja (Célèbes) »4. Les critères de ce classement sont, d’abord, la capacité de dominer le milieu pour en tirer une subsistance assurée, plutôt que d ’être asservi aux seules ressources de la nature ; puis aussi la capacité de création artistique, et, au-dessus, de création littéraire, l’écriture étant un important facteur de hiérarchisation. Au sommet, enfin, se situerait, dans cette conception, la capacité à créer des États. Mais, quel que soit leur degré de progression dans ce schéma, il paraît évident que tous les peuples coloniaux sont attardés dans un état d ’immaturité politique et social qui, après avoir justifié leur conquête, interdit, ou du moins retarde, leur émancipation. Ils sont des sortes de «peuples-enfants», sans doute perfectibles mais seulement au bout d’un long processus d ’éducation. Comme l’a écrit Charles-André Julien «Le préjugé raciste fait corps avec l’impérialisme... Il se confond avec le senti ment d ’une désarmante candeur qu’il suffit d ’être né Européen pour être supérieur à un autochtone »5. Cette candeur se retrouve même dans l’expres sion de bonnes intentions, comme celles d ’Albert Demangeon qui parle de « faire pénétrer dans la politique indigène la voix longtemps méconnue des races inférieures »6. Certes, certains facteurs subjectifs ont tendance à troubler le jeu. Dans l’ensemble, les conquérants ont tendance à valoriser les peuples guerriers, qui ont forcé leur estime en leur opposant une résistance farouche. De ceuxlà, des jugements de portée éthique aussi bien qu’esthétiques, célèbrent l’élé gance, le mépris du danger, le goût des grands espaces. C ’est notamment le cas en Afrique, où les peuples pasteurs, Maures, Touareg, Peuls, Masaï, sont particulièrement valorisés par rapport à leurs voisins sédentaires. Joseph
4. Gourou (P.), L’Asie, p. 348. 3. Julien (Ch.A.), « Impérialisme économique et impérialisme colonial », art. cit, p. 27. 6. Demangeon (A.), La France, 2e partie, France économique et humaine, T. I, p. 64.
141
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Kessel écrira par exemple, en 1954 que, « hommes et femmes, planteurs, chasseurs et fonctionnaires, les Anglais étaient amoureux des Masaï », pour la beauté et la bravoure de ces guerriers, qui n’hésitaient pas à combattre un lion en combat singulier, avec une lance pour seule arme, et un bouclier de cuir pour toute défense, leur tête couronnée, comme un défi à la crinière de la bête, d ’un immense cimier de plumes d ’autruche7. Par ailleurs, c ’est véritablement à partir des années 1930 que des ethnolo gues commencent à révéler la richesse des cultures dites « primitives », qui se révèle dans tous les domaines, depuis l’organisation sociale et familiale jusqu’à à la création artistique. Cette richesse peut résider par exemple dans la capacité de production linguistique, comme chez ces populations de la côte nord de la Nouvelle-Guinée dont « il semble que la capacité d ’invention ait été entièrement consacrée au langage », puisque celui-ci ne compte pas moins de onze genres, et vingt-deux pronoms de troisième personne, sans compter une infinité de pluriels irréguliers8. Ce peut être aussi la richesse des mythes et des représentations. À la suite des travaux de la mission qu’il a dirigée entre 1931 et 1939 chez les Dogons de la falaise de Bandiagara au Mali, jusque-là connus sous le nom de Habés et décrits de manière très néga tive, Marcel Griaule ne craindra pas d ’écrire que « ces hommes vivent sur une cosmogonie, une métaphysique, une religion qui les met à la hauteur des peuples antiques, et que la christologie elle-même étudierait avec profit »9. C’est le temps aussi où un autre ethnologue, Maurice Leenhardt, souligne la complexité de la mythologie canaque, et l’importance de son étude pour la compréhension de la fonction du mythe dans les sociétés, aussi bien euro péennes qu’océaniennes, ce qui remet en cause des notions comme celles de Lévy-Bruhl sur la « mentalité primitive » qui caractériserait les peuples de civilisations faussement dites « arriérées ». Ainsi, comme l’écrit en 1921 Maurice Delafosse, « nous nous apercevons qu’il n’y a pas au monde que la France et la civilisation française, ni même que l’Europe et la civilisation européenne, et que ces civilisations, pour excellentes qu’elles nous apparaissent, à nous qui les avons faites pour nous et à notre mesure, ne sont pas « la civilisation», et n’en constituent que quelques aspects à côté de quelques centaines ou de milliers d ’autres »10. Mais il n’est pas certain que ces notions aient réussi à remettre en question les mentalités collectives de l’Européen moyen, même cultivé, tant elles sont encore l’apanage d ’un milieu restreint. Les ethnologues même ne sont pas uniformément élogieux à l’égard de tous les peuples qu’il leur est donné d ’étudier. À côté de peuples qui les enchantent par leur capacité créative,
7. Kessel (J.), La piste fauve, Gallimard, 1954, p. 299. 8. Mead (M.), Écrits sur le vif. Lettres, 1925-1975, Dcnoël-Gonthier, 1980, p. 81 [écrit en 1932]. 9. Griaule (M.), Dieu d ’eau. Fayard, 1948, rééd., 1966, p. 4. 10. Delafosse (M.), « L’orientation nouvelle de la politique indigène en Afrique noire », Bulletin du Comité de l'Afrique française, Renseignements coloniaux, juillet 1921, p. 146.
142
Les populations : les indigènes
d'autres se révèlent décevants. Que penser en effet de ces peuplades décrites comme formées d’indigènes «cannibales, chasseurs de tête, infanticides, incestueux et plaisantins», dont la langue se révèle «ridiculement peu compliquée », avec une grammaire « à peu près inexistante » ?u La variété, cependant, ne doit pas empêcher de noter une ressemblance, qui mérite d'être mentionnée en dépit de son caractère trop évident Sans tomber dans un modèle d'explication mécaniste, il faut noter que bien des particularités des sociétés des pays coloniaux s’expliquent par la prédomi nance de conditions de production fondées essentiellement sur l’exploitation des ressources du sol, du mode de la cueillette à l’exploitation complexe de la rizière, sans en exclure les cultures itinérantes ou le pastoralisme. En bref, le monde auquel ont affaire les colonisateurs reste essentiellement, en effet, un monde rural. L’AOF, avec ses quinze millions d ’habitants, comprend près de cinquante mille villages. Les Indes, en dépit d’un relatif développement industriel, comptent moins de quatre millions d ’ouvriers. Huit cent mille villages y abritent, au bas mot, neuf dixièmes de la population. Les fellahs de la vallée du Nil, les nha quê du Tonkin, ou encore ces Paysans noirs que l’administrateur Robert Delavignette présente en 1931 au public français, ne sont que quelques-unes des modalités variées d ’une société demeurée partout essentiellement et fondamentalement agraire. L’horizon de tous ces hommes reste borné à la survie quotidienne, aux rythmes et aux caprices de la nature. S’il est vrai que le paysan manque souvent d ’initiative, la raison en est due le plus souvent à la difficulté qu’il trouve à s’élever au-dessus des nécessités de la vie quotidienne, faute d ’éducation, de crédits, de moyens aussi de faire prévaloir ses droits les plus élémentaires face aux notables qui ont l’oreille de l’administration. En revanche, il se livre souvent à un labeur épuisant, soit par sa durée, soit par son intensité. Ceux-là même qui paraissent moins atta chés à la terre, comme ces Bédouins qui se croiraient déshonorés s’ils touchaient à une pioche ou une charrue, n’en doivent pas moins, dans une situation de sous-alimentation chronique, faire cultiver des champs par des populations vassales, se déplacer en nomadisation permanente avec leurs troupeaux, employer leurs chameaux aux transports caravaniers. Ces obser vations sont d ’autant plus importantes que ces hommes constituent l’écra sante majorité des populations coloniales. La démographie Réalités et croissance Que les indigènes aient représenté, toujours et presque partout, la grande masse des populations des possessions européennes, son écrasante majorité, est une constante de l’histoire coloniale. Comme on le verra plus bas, les1
11. Mead, Écrits, p. 103.
143
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Européens ne représentent que 4 % de la population globale des empires. Cette réalité ne fait que se renforcer à partir du début des années 20. Les chiffres des Indes sont très caractéristiques. Entre 1881 et 1921, le taux brut de mortalité se situait autour de 45 p. 1000, le taux de natalité autour de 46 p. 1000. Tandis que le taux de natalité se maintient au-dessus de 45 p. 1000, le taux de mortalité passe à 40 p. 1000 vers 1930, et continue à baisser régulièrement. Il atteindra 27 p. 1000 à la fin des années 40. Cela explique la croissance rapide de la population: alors que celle-ci avait augmenté de 20 millions d’habitants dans les vingt premières années du siècle (284 à 306 millions entre 1901 et 1921), elle s’accroît de 80 millions dans les vingt années suivantes (306 à 389 millions de 1921 à 1941). Ce cas n’est pas isolé. La population des West Indies est passée de 1,7 à 2,5 millions d’habitants en quarante ans (1896-1936), et sa croissance annuelle tend déjà vers 2 % 12. En 1939, le géographe Émile-Félix Gautier parle du «pullule ment » de la population musulmane en Algérie13. Certes, les chiffres sont encore inférieurs à ce qui se constatera plus tard. La hausse de la natalité, et plus encore la baisse de la mortalité, n’ont pas fait sentir tous leurs effets, qui se marqueront surtout dans les années 1940-1955, et amèneront les réalités à anticiper sur bien des prévisions. C ’est ainsi qu’une projection de 1940 évalue la population des Indes néerlandaises à 116 millions d ’habitants en l’an 2000, chiffre qui sera atteint en fait dès 1970; et en l’an 2000, les 200 millions seront largement dépassés14. De même, c’est en 1975 et non en 2024, comme le prévoyait Pierre Gourou en 1947, que l’ensemble des territoires composant l’ancienne Inde britannique atteindra les 750 millions d ’habitants15. D’ailleurs, cette croissance ne concerne pas également l’ensemble des possessions coloniales. Beaucoup de pays d ’Afrique paraissent encore ne connaître que peu de progrès. C’est ainsi que, entre 1920 et 1940, la population de l’Afrique noire est passée de 94 à 115 millions d’habitants, soit 22 %, à raison de 1 % par an, mais cette croissance est très inégale, et souvent mal mesurée, en l’absence d ’un nombre de fonctionnaires suffisant pour opérer des recensements fiables. En 1952 encore, les responsables de l’AEF se demandent si la population connaît un accroissement ou une diminution16. Bien plus grave que celle des Africains paraît la situation de nombre de populations océaniennes, dont beaucoup, minées par les épidémies et l’alcool, paraissent en situation très précaire, qu’il s’agisse des Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie ou des habi tants des Marquises, voire des Malgaches. Même si, depuis les années 20, on assiste à une stabilisation, puis à un redémarrage, ceux-ci sont loin d ’avoir fait sentir leurs effets. Par exemple, la population de la Grande-Terre de
12. Moyne (Lord), « The West Indies in 1939 », art. cit., p. 89. 13. Gautier (E.-F.), L’Afrique blanche. Fayard, 1939, p. 261. 14. Robequain (Ch.), « Problèmes de colonisation », art. cit, p. 133. 15. Gourou (P.), Les pays tropicaux, p. 153. 16. Hailey (Lord), An African Survey. Revised 1956, Londres : Oxford University Press, 1957, p. 119-134.
144
Les populations : les indigènes
Nouvelle-Calédonie paraît avoir, jusqu’en 1936, tout juste stabilisé sa chute démographique (environ 17 000 ou 18 000 Mélanésiens contre près de 30000 en I860)17. Les causes de cette croissance sont naturellement très diverses : le recul de la mortalité tient d ’abord, sans doute, à l’absence (très globalement parlant), de grands conflits, inévitablement accompagnés de famines. « L’éta blissement, sous l’autorité britannique, d ’un niveau de sécurité inconnu auparavant, du moins pendant plusieurs siècles, suffirait à expliquer la possi bilité d ’une croissance même en l’absence d ’un développement économique spectaculaire », écrit un économiste britannique à propos de l’Inde18. D’autres insistent sur les ressources nouvelles offertes aux populations par la « mise en valeur » agricole et minière, le développement des transports, facteur qui paraît moins décisif que le précédent. Il faut surtout faire sa part à la mise au point d ’un système de contrôle sanitaire qui s’avère efficace pour empêcher les grandes épidémies, en particulier dans les ports, où l’application systéma tique de la quarantaine diminue les risques d ’épidémie ; à l’application des vaccins mis au point dans les Instituts Pasteur ou à la London School o f Hygiene and Tropical Medicine, et à l’application de programmes destinés à éradiquer des endémies comme la fièvre jaune, la variole et la maladie du sommeil. La vaccination antivariolique toucherait déjà vers 1930 environ 41 % de la population indochinoise19. Par ailleurs, les autorités coloniales implantent, dans les colonies, un réseau d'assistance médicale, contrôlé, à l’image de l’administration, par des médecins la plupart du temps européens, assistés de médecins indigènes, et appuyés sur un petit personnel local d’infirmiers qui dispensent des soins élémentaires dans des dispensaires locaux, sédentaires en général, mais quelquefois mobiles (ainsi les tribal dressers au Soudan anglo-égyptien). Les pionniers de cette action furent des militaires, et plus encore des missionnaires ou des religieuses ; les uns et les autres continuent dans les années trente à occuper une place importante, notamment dans les campagnes. Il est vrai qu’un nombre croissant de méde cins et des personnels médicaux sont formés sur place, dans des établisse ments comme l’École de médecine de Hanoi, créée en 1902, ou l’École de médecine de Dakar, ou la Kitchener School o f Medicine de Khartoum, encore à la STOVIA de Batavia. D’autres sortent des Facultés de médecine d’Europe ou des États-Unis. Certes, toute cette œuvre n’est pas désintéressée : la politique sanitaire est d’abord une condition nécessaire de la mise en valeur économique, dans la mesure où elle permet d ’assurer la régularité des échanges internationaux et intérieurs, et assure la disponibilité et la productivité de la main-d’œuvre locale, et aussi de meilleures conditions à la mise en valeur. C’est ainsi que en 1924 Daladier, alors ministre des Colonies, préconise un plan pour lutter 17. Doumenge (F.), L’Homme dans le Pacifique Sud, p. 157,169. 18. O’Malley, Modem India, p. 276. 19. Brocheux (P.), Indochine, la colonisation ambiguë, La Découverte, 1995, p. 251.
145
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
contre « la déchéance des races indigènes ». À peu près à la même époque, son homologue britannique Leo Amery proclame que le Colonial Office est avant tout, pour les pays tropicaux, un ministère de la Santé. Le Colonial Development advisory Committee souligne en 1939 que, si Ton souhaite élever le niveau de vie des populations, et donc leur pouvoir d ’achat, l’éradi cation des maladies est une priorité20. Mais il serait faux de réduire la politique sanitaire à ces considérations mercantiles. Les soins donnés aux populations apparaissent comme un des devoirs de la puissance colonisatrice, et une justification de sa domination. Ils suscitent des vocations qui doivent peu au machiavélisme. Un Alexandre Yersin (1863-1943), qui fut le premier à isoler le bacille de la peste à Hong Kong en 1894, puis à mettre au point un vaccin contre ce virus, un Émile Jamot, qui attacha son nom à la lutte contre la maladie du sommeil, essen tiellement en AEF et au Cameroun, méritent toujours d ’être qualifiés de bienfaiteurs de l’humanité, auprès d ’une quantité d ’autres21. Et il faut recon naître que l’opinion indigène est à peu près unanimement portée à exprimer sa confiance et sa reconnaissance. Comme le remarque un auteur britannique à propos de l’Inde, les critiques les plus sévères de la domination anglaise sont les premiers à exprimer leur estime pour l’œuvre de leurs médecins. Certes, cette unanimité n’est pas totale: Gandhi, notamment, a très tôt dénoncé la médecine européenne. Mais il a été peu suivi et d ’ailleurs, sa critique visait plus une idéologie médicale qui, selon lui, prétend préserver le malade des conséquences de ses excès alimentaires ou génésiques, et l’inci terait ainsi à se dispenser d’une véritable hygiène de vie, que l’œuvre chari table qu’elle représente pour l’humanité souffrante. Il est vrai que, faute de crédits, les moyens restent trop souvent inférieurs aux besoins : pour un médecin pour 1 500 personnes en France, et un pour 1000 en Grande-Bretagne, on en compte par exemple, un pour 8000 à 9000 personnes en British India (ce qui représente 30000 à 35000 méde cins de niveau occidental). Ces moyennes sont proches de celles de l’Algérie (un médecin pour 7 600 habitants), et bien supérieurs à ceux des autres colo nies (un pour 25 000 au Congo belge, un pour 40000 en AEF, un pour 65000 en Indochine)22. Dans les Indes néerlandaises, 600 médecins sont affectés aux services sanitaires, soit un pour 100000 habitants23. Mais les chiffres ne sont pas comparables. En Inde, la plupart des médecins exercent dans les villes. Les campagnes sont abandonnées aux médecins traditionnels ou aux rebouteux24. Il en va de même en Algérie, où les médecins travaillent
20. Amery (L.), My Political Ufe, vol. 2, p. 343 ; Havinden (M.) et Meredith (D.), Colo nialism and Development, p. 167. 21. Mollaret H.) et Brossolet (J.), Alexandre Yersin ou le vainqueur de la peste. Fayard, 1985. 22. UNO Statistical Yearbook, 1949-1950, p. 479. 23. De Kat Angelino (A.), Le problème colonial. Vol. II, p. 386. 24. O’Malley, Modem India, p. 643.
146
Les populations : les indigènes
en majorité pour la population urbaine, donc européenne, et où les docteurs de campagne sont finalement peu nombreux. La moyenne est donc, le plus souvent, de plusieurs dizaines de milliers de patients potentiels par médecin. Quoiqu’il en soit, la croissance démographique est souvent mise en avant comme le meilleur argument justifiant a posteriori l’œuvre coloniale, face à ses détracteurs. « Cette augmentation même suffirait à prouver, écrit l’histo rien Georges Yver en 1937 à propos de l’Afrique du Nord, que les consé quences de la domination française ont été moins désastreuses que ne le prétendent des détracteurs systématiques»23. De Kat Angelino tient les mêmes propos au sujet de la croissance de la population des Indes néerlan daises : il est indubitable, écrit-il, que cette croissance, dans la proportion où elle s’est produite, surtout depuis les vingt ou trente dernières années, « est une preuve de la sollicitude constante et active des gouvernements »2526. Cet argument est d ’autant plus utilisé qu’il est un des rares à pouvoir être démontré, de manière à peu près indubitable, par des chiffres. Pourtant, cette situation d ’expansion n’est pas sans aggraver, sinon créer, des situations déjà tendues. La surcharge démographique Une des conséquences les plus dramatiques de la croissance démogra phique est sans doute la surcharge des campagnes asiatiques: 400, voire 1000 habitants par km2 dans le delta du Tonkin, le Bengale, ou l’île de Java (1 638 habitants au km2 dans le district d ’Adiwemo, sur la côte nord)27. Certes, cette surcharge n’est pas entièrement nouvelle ; elle est due à des facteurs extrêmement anciens, et en particulier la mise au point d ’une agri culture intensive fondée sur le production de riz irrigué. Mais ce phénomène ne se limite pas à l’Asie. Dans la vallée du Nil, les densités sont compa rables : de 200 à 750 habitants au km2. D’autres densités sont aussi inquié tantes : à la Barbade, on atteint 450 habitants au km2, et plus de 650 habi tants par rapport aux terres cultivables. Le phénomène atteint aussi des régions qui, traditionnellement, n’ont rien de comparable aux vieilles « four milières » d ’Asie ou du pays des Pharaons. L’Afrique du Nord, en particu lier, commence à connaître les mêmes transformations, naturellement diffé rentes selon les régions. La densité moyenne de population peut paraître faible : 6 habitants au kilomètre carré. Mais ce chiffre a peu de sens, car il tient compte de la superficie du Sahara (2 millions de km2 pour la seule Algérie, soit deux tiers de la superficie totale). Rapportées aux plaines et aux massifs montagneux bien arrosés qui s’allongent le long des côtes atlan tiques et méditerranéennes, les densités se situent entre 20 et 40 habitants au kilomètre carré. Mais ces moyennes sont facilement dépassées : en Kabylie, 25. Albertini (E.), Marçais (G.), Yver (G.), L'Afrique du Nord française dans Vhistoire, Aichat, 1937, p. 326. 26. De Kat Angelino (A.), Le problème colonial, vol. I, p. 326. 27. Gourou (P.), Les pays tropicaux, p. 123-132.
147
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
il arrive que la densité atteigne les 400 habitants au kilomètre carré. La maîtrise de cette croissance préoccupante paraît irréalisable. En 1939, le professeur français Georges-Henri Bousquet, à Tissue de son étude sur l’Indonésie, juge que le phénomène est irréversible, étant donné que « il est impossible humainement de ne pas maintenir et développer les services d ’hygiène et les bienfaits matériels de la colonisation » ; par ailleurs, toute politique malthusienne est inapplicable, étant donné les comportements traditionnels des indigènes, conformes du reste aux principes proclamés par les chrétiens hollandais, au pouvoir dans la métropole28. D’aucuns pensent à soulager la pression par l’émigration. Les habitants de Java et de Madura commencent à émigrer en direction des îles moins peuplées de la périphérie. Mais ils ne sont qu’en petit nombre, quelques milliers peut-être par an, ce qui est tout à fait insuffisant alors que la popula tion de Java s’accroît annuellement de 600000 personnes. Quant aux plans grandioses pour installer des colons algériens musulmans grâce aux irriga tions prévues par l’Office du Niger, voire à Madagascar, en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, ils restent à l’état de pures utopies29. Il n’en va pas différemment des projets d ’émigration des Annamites du Tonkin vers l’Afrique française. Dans ces deux cas, d ’ailleurs, les besoins locaux en maind ’œuvre (ou la nécessité de faire pression sur les salaires) paraissent assez grands aux milieux économiques locaux pour les amener à déconseiller une émigration de travailleurs30. De même, les populations des Antilles ne sauraient trouver à s’installer en Guyane et au Honduras. On voit aussi apparaître les premiers immigrants d ’outre-mer en Europe. C ’est le cas en particulier en France, où la contribution de la main-d’œuvre d’outre-mer a été notable pendant les années 1914-1918. Selon les statis tiques officielles, 55 000 Malgaches, 42 000 Indochinois et 132 000 Maghré bins, auxquels il faudrait ajouter 140000 Chinois, dont 100000 recrutés par les autorités britanniques, ont alors été employés en métropole. Ces chiffres sont importants, même s’ils sont gonflés par le fait qu’un même individu peut avoir été pris en compte plusieurs fois à l’occasion de plusieurs allersretours31. Après la fin du conflit, le mouvement se maintient pour les Algériens, dont on évalue le nombre à environ 120000 (essentiellement des Kabyles) en 1931. Dans les années d ’avant-guerre, certains n’excluent pas de voir le Sud de la France accueillir une partie de l’excédent de leur popula tion32. Mais pour l’instant, il s’agit essentiellement d ’une immigration
28. Bousquet (G.H.), La politique musulmane et coloniale des Pays-Bas, Hartmann, 1939, p.98. 29. Lefeuvre (D.), L’industrialisation de l’Algérie, p. 126-130. 30. Bulletin du Comité de l ’Asie française, 1938, p. 323. 31. Schor (R.), Histoire de l’immigration en France, Colin, 1996, p. 41. 32. Montagne (R.), « L’évolution politique des pays arabes depuis un an », in Entretiens sur l’évolution des pays de civilisation arabe. Centre d’Études de politique étrangère, 1938, p. 16.
148
Les populations : les indigènes
masculine, concentrée dans la région parisienne, le Nord, l'E st et les Bouches-du-Rhône, l'ouvrier envoyant à sa famille demeurée en Algérie l'essentiel de sa paye, et y retournant au bout de quelques années. Le cas français parait d'ailleurs assez isolé. D'après des chiffres donnés par Henri Massignon, on n'aurait compté, vers la fin des années 20, qu'un peu moins d'une dizaine de milliers de Maghrébins (Marocains en majorité), en Belgique et au Luxembourg, et une trentaine de milliers d'Arabes, Malais et Somalis, employés comme dockers dans des ports comme Cardiff ou South Shields (Newcastle)33. Ce sont des pourcentages bien inférieurs à ceux de la France, où la précocité du phénomène s'explique par des besoins de maind'œuvre plus importants, qui résultent de la combinaison d'une démographie particulièrement mauvaise (baisse de la fécondité notable depuis la fin du XIXe siècle, à laquelle s'est ajoutée l'abominable saignée de 1914-1918), et d'une croissance économique très soutenue jusqu'au début des années 30. Encore faut-il noter que l'immigration d'outre-m er ne représente en France qu'une faible partie de l'immigration totale (peut-être 4% du total vers 1931)34. Il s'en faut, cependant, que la question de la croissance démographique soit considérée partout comme un problème. Dans un certain nombre de cas, cette croissance peut apparaître comme un simple rattrapage après des années d'effondrement ; dans la plupart, elle n 'a pas atteint le caractère aigu que, trente ou quarante ans plus tard, tous les Etats du tiers-monde seront forcés, bon gré ou mal gré, de reconnaître, pour tenter de contribuer à son ralentissement; souvent, elle paraît insuffisante par rapport aux besoins. L'Afrique noire, en particulier, ou bien encore les Provinces extérieures des Indes néerlandaises, sont jugées en état de sous-peuplement eu égard aux nécessités de développer le marché du travail comme celui des consomma teurs, dans des pays vastes, où la densité de la population reste faible. Le souci des dirigeants coloniaux est alors plutôt de réunir une main-d'œuvre jugée rare pour les activités minières, de plantations et de création d'infras tructures, sans bouleverser la vie du pays. L'exemple de l'Afrique équatoriale est particulièrement éclairant. Au Congo belge, un calcul simple montre que l'em ploi de 400 000 hommes dans les mines équivaut déjà à environ un sixième (17 %) de la population adulte masculine. Dans certains districts du Gabon, dépendant de l'AEF, qui ne compte que 400 000 habitants pour une étendue égale à la moitié de celle de la France, près d'un homme sur trois, voire sur deux est engagé sur les chan tiers de bois3S. Ces chiffres sont à comparer à ceux que les administrations belges et françaises, après 1943, considéreront comme une limite à ne pas dépasser: 12 à 15% des hommes adultes36. Au-dessus de ce chiffre, on 33. Massignon (L.), Annuaire du Monde musulman, 1954, PUF, 1935, p. 420-421. 34. Schor (R.), Histoire de l’immigration, p. 38. 35. Sautter (G.), De l’Atlantique aufleuve Congo, Imprimerie nationale, 1966, p. 834. 36. Labouiet (H.), Colonisation, colonialisme, décolonisation, Larose, 1952, p. 173-174.
149
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
compromet la production du pays en produits alimentaires, mais surtout l’équilibre social du pays, en maintenant trop longtemps des hommes loin de chez eux, et en n’y laissant que des femmes, des enfants et des vieillards. On compromet aussi l’avenir démographique, les chiffres paraissant démontrer en outre que la natalité de la population des centres urbains (ou vaguement urbanisés) est plus faible que celle de la brousse37. D’aucuns voient déjà se dessiner un redoutable mouvement de ciseaux: baisse de la production vivrière d ’abord, menacée par la diminution du nombre de bras (notamment pour les défrichements, indispensables en agriculture tropicale) ; hausse de la consommation globale ensuite, le travail intensif exigé par les méthodes modernes réclamant des rations de nourriture bien plus élevées que celles dont se contentaient les paysans africains. À ces soucis de développement, les responsables de la défense nationale française ajoutent celui du recrute ment : confrontés, à partir de 1934, au problème des « classes creuses », ils comptent, plus que jamais, sur leurs colonies pour compenser l’infériorité numérique face à l’Allemagne. Le seul remède à ces difficultés semble résider dans une population plus nombreuse. « Faire du Noir », selon une expression répandue, dont la paternité est souvent attribuée au gouverneur français Carde, et qui ne fait pas honneur à ceux qui l’emploient, y demeure le souci lancinant. Comme on le voit encore une fois, la question de la démo graphie est étroitement liée à celle de la main-d’œuvre.
La main-d’œuvre indigène Le mot « d ’exploitation», employé de façon polémique, a souvent été utilisé pour décrire et condamner la condition des indigènes des colonies. Il mérite d ’être examiné précisément, pour en délimiter et en préciser la portée, ce qui ne revient évidemment pas à diminuer les responsabilités des puis sances coloniales ou de leurs ressortissants. L ’esclavage La répression de l’esclavage fut, en Afrique, un des arguments importants de la conquête. Cinquante ans avant l'entre-deux-guerres, des hommes comme Livingstone ou Brazza se sont illustrés dans ce combat, et leur action reste commémorée comme la preuve du caractère humanitaire de l’œuvre coloniale. Bien que solennellement condamné par la Convention internatio nale de Genève du 25 septembre 1926, l’esclavage n’a pas complètement disparu. La traite, d’abord, n’a pas été totalement extirpée de la corne de l’Afrique. En particulier, des razzias faites en Éthiopie alimentent un certain trafic qui, par les territoires français, mais aussi italiens, de la côte des Somalis, aboutit
37. Vanderlinden (J.), Pierre Ryckmans, p. 353.
150
Les populations : les indigènes
à la péninsule arabique. La France se trouve plusieurs fois, en particulier dans les années 20, mise en accusation, pour l’inefficacité de la répression. Celle-ci, en dépit de mesures prises, n ’est jamais totalement efficace, en raison de la modicité des moyens par rapport à l’immensité des espaces à surveiller. Mais, plus généralement, des formes de l’esclavage traditionnel subsistent un peu partout. Les notables de la Mauritanie française, par exemple, ont tous sous leur dépendance ce que l’administration désigne pudiquement sous le nom de « captifs ». Les autorités, tout en essayant de réprimer l’abus de ces pratiques, et notamment, les mauvais traitements, ne songent pas à les interdire, car elles sont considérées comme des privilèges qui contribuent au prestige des chefs, et aussi un élément essentiel de leur train de vie. Elles correspondent à un état social qu’il paraîtrait dangereux de modifier, d ’autant que la condition des «captifs» s’apparente à celle de domestiques, destinés à demeurer à l’intérieur du groupe familial, ou de paysans tributaires attachés à la terre par une sorte de servage (de « patro nage », selon une expression de Lyautey), et n ’a pas grand-chose à voir avec celle des esclaves de plantation des anciennes colonies américaines. Il paraît plus sage d ’attendre leur extinction, provoquée par la fin de la traite et la modification des genres de vie, en acceptant de donner suite aux plaintes des serviteurs, voire en obligeant les maîtres à les libérer en cas de mauvais trai tements. Si de tels errements ne portent pas atteinte à la réputation de la France, ou des autres puissances européennes, il n ’en va pas de même pour l’Éthiopie. Ce pays a aboli officiellement l’esclavage en 1924, ce qui a facilité son admission à la SDN. Mais il est évident qu’une tradition millénaire ne peut s’abandonner en quelques années, surtout lorsqu’elle correspond à une orga nisation qui recueille l’adhésion plus ou moins résignée des captifs euxmêmes, la condition d ’esclave n’étant, au reste, par forcément dépourvue d’occasions d ’ascension sociale. Par ailleurs, en dépit d ’efforts sincères du gouvernement du Négus Haïlé Sélassié pour abolir la traite, celle-ci n’a pas disparu. Les dirigeants italiens, exploitant la documentation que leur fournit la Società antischiavistica italiana, en feront un argument de poids en faveur de la conquête destinée à mettre fin à un état de « barbarie ». Dans le mémo randum du 4 septembre 1935 destiné à justifier l’invasion, deux des six points résumant les griefs italiens sont consacrés à ce sujet. Cela ne va pas sans embarrasser nombre d ’Européens dans la défense de la cause de l’Éthiopie, en dépit d ’argumentations comme celle de Marcel Griaule, qui souligne combien il est absurde de se scandaliser d’une situation dont il juge que les autorités légitimes du pays sont les mieux à même de la faire évoluer dans le sens souhaité par les partisans des droits de l’Homme38. Il eût pu faire remarquer aussi que l’indignation des Italiens était bien sélective, les États arabes de la Mer Rouge, en excellents termes avec Rome constituant les principaux marchés d ’esclaves. Le royaume d ’Arabie, par exemple,
38. Griaule (M.), La peau de l’Ours, p. 208-216.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
attendra 1960 pour abolir effectivement l’esclavage, qui, au reste, n’est pas plus condamné par le Coran que par la Bible. Mais ces polémiques ne doivent pas dissimuler des questions plus importantes. Le travail forcé Pour les territoires coloniaux, la question du travail forcé est bien davan tage d ’actualité. Il s’agit, comme son nom l’indique, du recrutement de contingents indigènes forcés, sous peine d ’amende ou de prison, à travailler sur des chantiers publics ou privés, en échange d ’un salaire forfaitaire. Les raisons du travail forcé sont multiples : le manque de main-d’œuvre volon taire, provenant du faible attrait des paysans pour des travaux salariés qui les éloignent de chez eux et les amènent à négliger leurs obligations familiales et sociales pour des revenus dont ils ne voient pas l’intérêt ; les besoins, au contraire, de construire les infrastructures indispensables à la colonisation, mais aussi de lancer la « mise en valeur » en produisant des denrées d ’expor tation ou en exploitant des ressources locales jusque-là négligées. Pour les colonisateurs, imbus d ’une idéologie qui correspond trop à leurs intérêts pour qu’on puisse la juger philanthropique, ce travail forcé doit aussi revêtir un aspect formateur. Il consisterait en effet à inculquer aux populations indi gènes jugées trop souvent « apathiques », peu portées à effectuer des efforts au-delà de leurs besoins immédiats, et pas toujours disposées à observer la sainteté des contrats, le sens du travail considéré comme une valeur néces saire à tout progrès social. Beaucoup le proclament même, à l’exemple des Portugais, indispensable au progrès « moral et intellectuel » des indigènes39. Il s’en faut cependant que de telles conceptions s’imposent dans l’en semble du domaine colonial. L’Afrique du Nord française n’a pratiquement pas connu ces procédés. Aux Indes, en Malaisie, en Birmanie, et aussi en Indochine française prédomine le système du salariat. Aux Indes néerlan daises, le travail forcé ne s’applique plus qu’au quart de la population, et est rachetable en argent. Le souci de laisser le champ libre aux entreprises privées, en leur permettant de recruter librement une main-d’œuvre contrac tuelle, autant que l’abondance du réservoir de main-d’œuvre, paraît avoir été déterminant40. L’introduction d’impôts de capitation perçus en espèces, par exemple à Madagascar ou en Nouvelle-Calédonie, doit suffire à obliger les populations à proposer leur force de travail pour se procurer les fonds néces saires. C’est sur le continent africain que les premières années du siècle ont vu se développer des pratiques de travail forcé encore plus condamnables, en particulier en Afrique équatoriale. Le recours aux réquisitions, pour les 39. Nùftez (B.), Dictionary of Portuguese Civilisation, Londres, Hans Zell Publishers, 1995-19%, T. I,p. 31. 40. Fumivall (J.S.), Colonial Policy, p. 342-344; Vandenbosch (A.), The Dutch East Indies, p. 293.
Les populations : les indigènes
besoins des transports ou de l’exploitation des ressources naturelles, effec tuées au profit de l’administration, mais, très largement aussi, des entreprises privées, celles-ci recevant le concours de celle-là, sembla ressusciter les pires horreurs des temps de l’esclavage. Le Congo belge reste l’exemple le plus célèbre d ’une série d ’exactions, dénoncées dans la presse internationale, qui justifièrent en 1908 la suppression de « l’État indépendant », attribué à titre personnel au roi Léopold, pour le plus grand bénéfice de celui-ci et des compagnies constituées à son instigation, et la reprise en main du pays par l’État belge. Bien qu’infiniment moins génératrice de profits, l’exploitation du Congo français par les compagnies à charte n’a pas grand-chose à envier à ce triste tableau, dont la vue déchira le cœur de Savorgnan de Brazza, qui put constater, peu avant sa mort, à l’occasion d ’une mission d’enquête, la faillite du rêve d ’émancipation qu’il avait nourri au cours de ses célèbres campagnes d ’exploration, vingt ans auparavant. La Première Guerre mondiale a entraîné aussi des recrutements forcés massifs, destinés à assurer les transports des colonnes anglaises, françaises et belges, en opération contre les troupes allemandes de l’Ouest et de l’Est africain. Le Gabon a ainsi fourni entre 50000 et 60000 porteurs, pour une population masculine d’environ 256 000 personnes41. Certes, entre les deux guerres, l’évolution généralement défavorable au travail forcé se poursuit L’introduction de certains progrès techniques amène quelques transformations. Le portage à dos d ’hommes commence ainsi à reculer. L’amélioration des réseaux de transports, notamment un certain développement de la piste, parcourue par des camions, l’explique pour l’es sentiel. En Asie, la pratique ne se maintient que dans des régions peu acces sibles et sous-peuplées. On ne le retrouve en Indochine qu’au Laos, dans les hauts plateaux de l’Annam, du Tonkin et du Cambodge, où l’on s’efforce de le faire disparaître. C’est ainsi que le futur général Salan, résident à Muong Sing, sur le Haut Mékong, réussit à remplacer les porteurs par des chevaux de bât, fournis par de petits entrepreneurs birmans42. Dans l’ensemble aussi, l’entrée, plus ou moins relative, mais graduelle, des populations dans une économie marchande amène celles-ci à livrer sans contrainte leurs produc tions sur le marché, ce qui rend la contrainte mutile. Comme le dit Fumivall, le boutiquier incite mieux les indigènes au travail que le percepteur (surtout, pourrait-on ajouter, quand ce boutiquier pratique également l’usure). La tendance, remarquée plus haut, à favoriser le producteur indigène va dans le même sens. La législation internationale se montre hostile, d ’ailleurs, à l’existence même du travail forcé. Une convention internationale signée à Genève en 1930, à l’initiative du Bureau international du Travail (BIT) et ratifiée par les puissances coloniales (par la France en 1937), interdit d ’y avoir recours, et en prévoit la disparition totale. Dans un ordre d ’idées
41. Dubois (C.),.Le prix d ’une guerre. AEF (1911-1923), Université de Provence, s.d., p. 218. 42. Salan (général R.), Mémoires, fin d’un Empire, Presses de la Cité, 1970, p. 42.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
voisin, les États-Unis, par un amendement à leur législation douanière dit Blaine Amendment, ont décidé d ’interdire en 1930 toute importation d ’une denrée produite sous contrainte pénale, ce qui vise, notamment, le tabac des Indes néerlandaises, qui concurrence leur propre production nationale. Preuve de cette combinaison intelligente d ’exigence morale et d ’intérêt bien compris qui caractérise la diplomatie outre-Atlantique. Il ne faut pas cependant surestimer la portée de ces changements, en Afrique en particulier. La période de l’entre-deux-guerres n’a pas mis un point final aux « affaires ». La plus tristement célèbre est celle de la construc tion du chemin de fer Congo-Océan, de Brazzaville à Pointe-Noire, réalisée entre 1921 et 1934. On évalue à 17000 morts sur 60000 employés (plus du quart) les pertes provoquées par une négligence crim inelle: désordre du service de ravitaillement, qui provoque la perte de marchandises mal stockées; méconnaissance des habitudes ou des tabous alimentaires des travailleurs ; absence de service de santé. Malgré tout, le directeur respon sable des travaux dans la région du Mayumbé, rencontré par le géographe Weulersse en mai 1929, n’hésite pas à invoquer « l’inconcevable fragilité » du Noir. Il pourrait tout aussi bien dénoncer l’incroyable lenteur des méthodes françaises, tant il est vrai que, alors que le Congo-Océan progresse de 25 à 30 kilomètres par an, le chemin de fer belge destiné à relier le Katanga à la mer jusqu’au port angolais de Lobito progresse à la moyenne de 225 kilomètres par an, soit dix fois plus vite, en terrain beaucoup plus facile, il est vrai, mais avec la célérité que peut susciter un projet économiquement beaucoup plus attrayant, puisqu’il est destiné à fournir un débouché aux richesses minières de l’intérieur43. Peut-on, cependant, généraliser à partir de cette gestion particulièrement odieuse d ’une opération de développement mal menée ? Le système des grandes concessions, générateur d ’abus, n’a pas totale ment disparu, même si des motifs de rationalité économique poussent à son remplacement par d ’autres modes d ’exploitation. La dernière des compa gnies de l’AEF ne voit sa concession expirer qu’en 1929, la plupart se bornant désormais à pratiquer le commerce. Bien que la charte nationale des droits des indigènes de 1933 ait prévu la disparition de la Compagnie du Mozambique, qui administre les districts de Manica et Sofala, soit près de 135000 km2 et 350000 habitants (soit 18 % de sa superficie et 8 % de sa population, mais correspondant à l’hinterland des chemins de fer menant vers la Rhodésie et du Nyasaland), celle-ci n’en subsiste pas moins jusqu’en 194144. Au Congo belge, Ryckmans découvre en 1930 bien des abus dans le gestion de la main-d’œuvre des huileries, notamment dans la province du Kasai : recrutement en fait forcé, les indigènes s’étant vus imposer le départ sans aucune information sur les conditions du contrat, voire même de leurs 43. Weulersse (J.), Noirs et Blancs, À travers l’Afrique nouvelle de Dakar au Cap, Édi tions du CHTS, 1993 [1931], p. 96-109. 44. The colonial Problem, op. cit., p. 148.
Les populations : les indigènes
salaires; conditions de voyage, puis de logement et de nourriture très insuffisantes, avances de tissus qui sont l'objet de retenues exorbitantes sur les salaires, voire encore usage de la « chicotte » de triste mémoire43. Par ailleurs, il s'en faut de beaucoup que les réformes juridiques aient fait disparaître le travail obligatoire. Les conventions signées sous l'égide du BIT admettent un certain nombre d'exceptions, qui se rattachent pour la plupart à la notion d'utilité publique (participer à l'entretien des chemins, à la lutte contre les incendies, à la destruction des sauterelles ou des sites à anophèles ou à mouches tsé-tsé...). Elles n'excluent pas des obligations civiques, comme le service militaire obligatoire, facile à détourner, comme on le sait depuis l'Antiquité, de son objectif premier. De même, certains impôts, dits « prestations », sont perçus non pas en argent, mais sous forme de travail obligatoire et non rémunéré (entre quinze et quatre jours par an). Il faut ajouter que dans certains territoires, les chefs sont autorisés à imposer des corvées à leurs sujets, ce qu'on appelle parfois « travail coutumier obli gatoire », dans la mesure où il arrive (mais pas toujours) qu'elles correspon dent à des avantages attribués traditionnellement aux dirigeants avant l'occu pation coloniale. C 'est toujours en Afrique, où la densité moyenne des populations est plus faible qu'ailleurs, que le recours à de telles méthodes paraît le plus déve loppé entre les deux guerres. Il ne faut donc pas s'étonner d 'y voir les Français y recourir largement. Entre autres formules, une partie des conscrits reconnus « bons pour le service » ne portent pas les armes, mais constituent «la deuxième portion du contingent», qui peut être réquisitionnée pour travailler sur des chantiers d'intérêt public, en particulier au Soudan et à Madagascar (Service de la main-d'œuvre d'intérêt général ou SMOTIG, à partir de 1926). Les quelques atténuations introduites par le Front populaire sont de peu de portée, et, la Deuxième Guerre mondiale se marquera par une recrudescence en la matière, l'abolition totale n'étant décidée qu'en 1946, bien en avance, il est vrai, sur les Portugais, qui attendront 1962. Au Congo belge, le gouverneur Ryckmans, qui se déclare personnellement hostile au travail forcé, ne le juge pas moins, en 1935, provisoirement indispensable. Il souligne que c'est grâce à lui qu'est assurée notamment la production de coton, mais aussi le portage4546. Les Britanniques de l 'Afrique de l'O uest utili sent le travail forcé pour leurs chemins de fer et leurs routes, mais, semble-til, de moins en moins à partir des années 30. Il faut remarquer aussi que, en général, l'administration ne se gêne pas pour encourager par des pressions qui peuvent aller jusqu'à l'amende l'introduction et le développement de cultures d'exportation comme le coton ou le café, jugées indispensables à la prospérité de la colonie. La guerre signifiera, sur ce point comme sur beau coup d'autres, une régression, car les nécessités de mobilisation économique
45. Vanderlinden (J.), Pierre Ryckmans, p. 205-218. 46. Vanderlinden (J.), Pierre Ryckmans, p. 309.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
se traduiront par des exigences accrues à l’égard des populations, en particu lier dans les territoires sous contrôle français. Le recours aux corvées exigées non plus par les fonctionnaires européens, mais par les chefs indigènes, paraît aussi se pratiquer à grande échelle. Il s’agit, là encore, pour les administrés, de participer à l’entretien des chemins ou à d ’autres travaux d ’intérêt local47. En Ouganda, les chefs peuvent ainsi requérir leurs administrés pour une durée de trente jours. Mais, souvent aussi, les autorités coloniales leur ont permis, en tout cas aux plus presti gieux d ’entre eux, détenteurs du pouvoir bien avant les débuts de la colonisa tion, d ’exiger de leurs sujets des prestations en nature. Celles-ci sont jugées conformes à la tradition et au prestige de ces grands personnages ; elles sont présentées aussi comme la contrepartie de leurs charges administratives, politiques, voire sociales, car ils ont traditionnellement à pratiquer une large hospitalité et à exercer une sorte de charité publique envers les faibles. Beaucoup de chefs, outre les présents qu’ils exigent de leurs administrés, leur imposent aussi des corvées illégales, pratiques sur lesquelles les auto rités coloniales ferment souvent les yeux. Nombreux seront les témoignages qui dénonceront les excès de ces « grands féodaux », dont l’archétype, pour la France, reste les caïds du sud de l’Atlas, avec le plus célèbre d ’entre eux, Si Thami el-Glaoui, pacha de Marrakech. Il arrive aussi que certains groupes soient ainsi asservis aux autres. Par exemple, tel grand chef bantou du Bechuanaland utilise les Bushmen, placés sous son autorité et considérés comme un peuple inférieur, comme gardiens de ses troupeaux, et il leur impose de chasser pour son compte. Mais on est bien loin ici du système européen. Le travail libre par contrat Ces aspects sont-ils cependant les plus importants? Pour ce qui en regarde la partie qui relève de la production proprement dite, ce n’est pas certain, car le travail forcé paraît concerner, comme on vient de le voir, plutôt l’Afrique que les autres continents. Si l’on parle du monde colonial dans son ensemble, la charge du travail induit par la présence européenne passe, de plus en plus, par le salariat, et le travail dit « libre » est la pratique de très loin la plus répandue dans les mines, les manufactures, sur les chan tiers ou dans les plantations. Quelles sont les conditions de vie cette main-d'œuvre ? La propagande bolchevique a beau jeu de brosser des tableaux peu reluisants de la condition ouvrière dans les colonies. Le cas des travailleurs recrutés en Afrique du Sud par la puissante WNLA (Witwatersrand Labour Association) dont l’action s’étend jusqu’au Mozambique est caractéristique. Ces immenses armées de
47. 209.
Crowder (M.), West Africa under colonial Rule, Londres, Hutchinson, 1968, p. 208-
Les populations : les indigènes
travailleurs, soumis à des règlements sévères, peu payés, entassés dans les compounds où les concentre la compagnie qui les emploie, licenciés en période de crise, constituent une illustration parfaite de la condition proléta rienne, la masse de manœuvre par excellence, espèrent les uns et redoutent les autres, du communisme international. Mais les exemples de situations intolérables, au moins eu égard aux exigences telles que les conçoivent les dirigeants européens des mouvements ouvriers, sont nombreux. En 1926, par exemple, le scandale dit des « jauniers » révèle les conditions inhumaines de recrutement et d’utilisation de la main-d’œuvre annamite originaires du Tonkin et du Nord-Annam, employée pour la mise en valeur des plantations d’hévéas, en Cochinchine, ou au-dehors (Nouvelles-Hébrides, Tahiti). La législation sociale est en effet très insuffisante. «L e gouvernement hollandais est si étroitement impliqué dans les intérêts du capital que tout effort pour résister aux empiétements des capitalistes en matière de protec tion des travailleurs doit apparaître de toute nécessité comme anticapitaliste et anti-hollandais », écrit Fumivall48. On est tenté d ’étendre ce jugement à l’ensemble des États. Comme lors des débuts de la Révolution industrielle en Europe, les contrats ne sont pas toujours laissés à la libre discussion des ouvriers et de l’employeur. C ’est ainsi que, aux Indes néerlandaises, une ordonnance de 1880 dite «Ordonnance sur les coolies» impose pour les contrats à long terme (deux à trois ans) des sanctions pénales (amendes et emprisonnement) en cas de rupture de contrat. Cette mesure, il est vrai, peut être présentée comme destinée à protéger les indigènes, recrutés et trans portés loin de chez eux, de l’abandon et de la misère où les plongeraient des licenciements abusifs, car les peines s’appliquent aussi aux employeurs. Il n’en reste pas moins que cette «clause pénale» fournit aux planteurs, comme le reconnaît De Kat Angelino, pourtant plutôt bien disposé à son égard, «des moyens d ’action vis-à-vis des ouvriers dans une mesure qui dépassait les intentions du législateur». Une série de scandales, notamment entre 1902 et 1920, révèle des cas de véritable exploitation, qui se traduit par des conditions de vie misérables, mais aussi des sévices et des brutalités49. Le suivi des travailleurs est assuré par des méthodes de police comme le livret ouvrier, dont les autorités françaises s’emploient à faire respecter l’usage au Tonkin. La grève est souvent assimilée à un mouvement insurrec tionnel et réprimée en conséquence. L’activité syndicale est en général inter dite. Pour compléter ce tableau peu flatteur, il faut noter enfin que beaucoup de travailleurs ne sont pas embauchés directement, mais par le biais d ’entrepre neurs indigènes, qui passent un contrat global avec l’entreprise, à charge pour eux d ’assurer la paye. Ce système est fréquemment employé en Inde. Le recruteur, labour contractor ou labour jobber, qui souvent est un chef
48. Fumivall (J.S.), Netherlands India, p. 350. 49. De Kat Angelino (A.), Le problème colonial, vol. II, p. 611-612.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
d ’équipe, et garde la direction des ouvriers qu'il a engagés, dispose sur eux d ’un pouvoir que lui garantit sa position d ’intermédiaire nécessaire entre eux et un patronat blanc peu accessible. En retour de sa protection, il en exige des cadeaux, voire une part des salaires, ce qui réduit d ’autant la paye effec tivement touchée. C ’est le cas dans la construction du chemin de fer de la région de Satikona, en Inde, au début des années 3050. Mais les « kanganies » ou « maistries » ou, plus humblement « sardars » remplissent le même office dans le recrutement des employés de plantations51. Pourtant, on peut dire que, dans l’ensemble, on constate une amélioration par rapport aux époques précédentes. Le souci de ménager la main-d’œuvre et de donner une image plus positive amène les autorités coloniales à édicter un certain nombre de mesures, avec l’encouragement des organismes inter nationaux. Certes, les peuples des colonies ne sont pas directement repré sentés au sein du BIT, à l’exception de l’Inde, qui dispose d ’un délégué permanent, et dont un représentant, Attul Chatterjee, préside même la confé rence de 1927. Du moins leurs intérêts paraissent-ils y être pris sérieusement en compte par la «section des travailleurs indigènes»52. Par ailleurs, les syndicats, fondés presque toujours à l’origine par des Européens, commen cent à se constituer. Bien que la création de nombre d ’entre eux soit anté rieure à la guerre mondiale, les années d’après-guerre sont partout favorables à leur développement. En 1919, par exemple, l’union centrale des syndicats indigènes de Java comptait ainsi 22 syndicats et 72000 membres, et le nombre passe à 106 avec 113000 membres en 193153. Us sont éventuelle ment capables d ’organiser des mouvements de masse. L’action des partis socialistes ou des syndicats de métropole peut aussi s’exercer. C’est à la suite d ’une interpellation du gouvernement par le leader socialiste belge Émile Vandervelde au mois de mars 1930 qu’est confiée à Ryckmans la mission d ’enquête au Congo évoquée plus haut54. La présence au pouvoir de gouver nements élus sur des programmes socialistes faciUte certaines mesures sociales : ainsi le gouvernement du Front populaire impose-t-il un double ment des salaires en Indochine, y limite le travail à huit heures par jour, étend à la colonie le bénéfice des congés payés et des indemnités en cas d ’accident du travail55. Les entrepreneurs eux-mêmes ne sont pas toujours hostiles aux réformes. Dans le secteur minier, la rationalisation de l’exploitation exige pour obtenir des rendements corrects, que la main-d’œuvre bénéficie d ’un régime alimen
50. Goetel (F.), Voyage aux Indes, Gallimard, 1937, p. 247. 51. Rajani Kanta Das, «Le travail des enfants dans l’Inde», Revue internationale du travail, 1933, p. 839-877. 52. Scelle (G.), L’organisation internationale du travail et le BIT, Rivière, 1930. 53. Furnivall (J.S.), Netherlands India, p. 356. 54. Vanderlinden (J.), Pierre Ryckmans, p. 187 sq. 55. Isoart (P.), Le problème national vietnamien. Librairie générale de droit et de jurispru dence, 1961, p. 267.
Les populations : les indigènes
taire et de conditions sanitaires propres à exiger d’elle une meilleure produc tivité. De telles méthodes sont systématiquement employées dans les mines du Congo belge par l’UMHK : le travailleur fait l’objet d ’un suivi médical attentif ; il est correctement nourri, vêtu et logé, lui et la famille qu’on l’en courage à constituer en l’aidant à réunir une dot pour se procurer une épouse ; les missionnaires se chargent de l’instruction de ses enfants. En contrepartie, la vie dans les camps où est regroupée cette main-d’œuvre est étroitement contrôlée, selon un modèle paternaliste extrêmement pesant. Les grandes sociétés qui exploitent le Copperbelt de Rhodésie du Nord prati quent de la même façon. Ces méthodes sont, il faut le signaler, appliquées aussi par des grands patrons indiens, comme les grands sidérurgistes Tata, dans leur centre de Jamshedpur, créé en 1911 à environ 300 kilomètres à l’ouest de Calcutta. Le même souci de rendre plus acceptables les conditions de travail s’ap plique également aux plantations. À la suite de l’affaire des « jauniers », des mesures prises sous l’impulsion du gouverneur général Varenne établissent une réglementation plus stricte des contrats d ’embauche, et un contrôle des conditions de travail par un corps d ’inspecteurs spécialisés. Les Britan niques, de leur côté, s’efforcent de réglementer le recrutement des tra vailleurs indiens employés dans les plantations de thés de l’Assam, en Inde même, mais aussi à Ceylan. Le plus souvent, les travailleurs reçoivent un logement, où ils s’installent avec leur famille, une ration de nourriture, des soins médicaux, et quelquefois un lopin de terre. D’ingénieux planteurs, comme ceux du Surinam, qui emploient des Malais et des Indiens, voient dans cette dernière attribution un moyen souple de gestion de leur personnel : en cas de crise, ils peuvent mettre au chômage sans salaire une partie des employés, en leur laissant la disposition de leur lopin pour y cultiver de quoi se nourrir56. Au Congo, des conditions plus strictes sont imposées aux concessionnaires: salaires minimum, soins médicaux aux travailleurs, construction d ’une école par cercle. Dans l’ensemble, d ’ailleurs, les Belges préfèrent attribuer des concessions plus petites (2 000 hectares)57. Ces modifications sont, pourtant, loin de triompher partout. Beaucoup de réformes ne sont que partiellement, voire pas du tout, appliquées. L’inspec tion du travail est souvent confiée à l’administration, déjà surchargée de missions. Lorsqu’il existe des inspections du travail spécifiques (Indochine, 1927), les contrats et les réglementations, faute de personnel suffisant et d’information des indigènes, ne sont pas toujours respectés. Quant aux syndicats, ils ont rarement droit de cité. La Grande-Bretagne, qui accorde le droit syndical en Inde dès 1918, n’accepte de le reconnaître en Afrique qu’à la fin des années 30 (1937 au Kenya, 1938 en Afrique de l’Ouest). Dans les territoires français, il faut attendre le Front populaire pour que ce droit soit
56. Revue internationale du travail, 1933, p. 738-739. 57. Labouiet (H.), « La tradition coloniale », art. cit, p. 438.
159
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
proclamé en Afrique noire pour les « Français et assimilés », ce qui pennet d’y introduire libéralement les indigènes ; en revanche, Im plication de la mesure est retardée en Indochine38. Quant à des pays comme le Maroc, le prétendu respect de la souveraineté marocaine, bien commode pour refuser d ’étendre dans le pays les dispositions en vigueur en France, est appelé à l’appui d ’un refus catégorique. Ainsi est-il possible de constater bien des irrégularités par rapport aux exigences des législations. C’est le cas notamment du travail des enfants, employés dans d ’innombrables fabriques, et dans bien des plantations, à partir de l’âge de six ans39. D’aucuns font remarquer que l’abandon des traditions locales, et notamment des prescriptions religieuses a, bien souvent, amené la dégradation des conditions de travail : par exemple, l’année éthio pienne ne comprenait pas moins de 220 jours fériés avant l’occupation italienne. On peut dire la même chose à propos des sanctions pénales rela tives aux ruptures de contrat. Cette législation n’est totalement abolie aux Indes néerlandaises qu’en 1941. Ailleurs, la situation est variable selon les pays : par exemple, dans les possessions anglaises, les sanctions pénales n’existent plus en droit depuis 1926 ; mais elles paraissent se maintenir en Afrique, où nombre d ’entreprises ont l’oreille de l’administration585960. Au total, et bien que le sens général paraisse orienté très positivement, on est loin, cependant, d ’un alignement sur les exigences européennes, elles-mêmes d ’ailleurs rarement très satisfaisantes dans les années 30. Comme il va de soi en régime ultra-libéral, la stabilité de l’emploi est rien moins qu’assurée. Après des années où le travail était relativement facile à trouver, la crise des années 30 voit se développer le chômage sur une grande échelle. En 1935, les exploitations sucrières de Java, les plus touchées, emploient 800000 saisonniers de moins. La superficie cultivée passe de 194000 à 29000 hectares, la production est divisée par 6. À Ceylan, les grandes compagnies qui assurent la production de thé renvoient le quart de leur personnel permanent ; les salaires de ceux qui restent sont réduits entre un quart et un tiers61. Alors que 114000 salariés originaires de Rhodésie du Nord étaient employés, sur place ou au-delà des frontières, en 1930, ils ne sont que 83 000 en 1933, soit une baisse de 27 %. 250 000 travailleurs tonki nois sont licenciés au total, parmi lesquels un certain nombre, qui travaillaient en Annam, Cochinchine, ou en Nouvelle-Calédonie, sont rapa triés62. Forcés de recourir à des avances, les ouvriers sont aussi la proie des usuriers, dont certains vont les attendre à la sortie des usines pour prélever
58. Coquery-Vidrovitch (C), L’Afrique noire, permanences et ruptures, Payot, 1985, p. 329,334,364. 59. Revue internationale du travail, 1933, p. 513. 60. Fumivall (J.S.), Colonial Policy, p. 347-348. 61. Meyer (E.), « L’impact social de la dépression et la théorie du dualisme, le cas du Sri Lanka », Revue française d ’histoire d’Outre-mer, 1977, p. 232-234. 62. « Le régime du travail en Indochine », Revue internationale du travail, 1933, p. 82-86.
160
Les populations : les indigènes
leur dû sur la paye. Il est vrai que le retour à une situation plus prospère permet une diminution du nombre des travailleurs désœuvrés. Le sort des paysans La condition paysanne De toutes façons, ce n’est qu’assez exceptionnellement que ces questions intéressent une grande masse des populations. Des multitudes de paysans, assurant tout juste leur subsistance, dans un cadre qui paraît inchangé depuis des siècles, ordre étemel des champs, des rizières, des brousses ou des savanes, dans un respect, au moins apparent, des traditions, tel est le tableau qui paraît encore, pour quelque temps, prédominer aux yeux des observa teurs des réalités de l’outie-mer, et en particulier des ethnologues. Que la pauvreté soit le lot du plus grand nombre est un fait avéré. Ce que l’ethnologue Germaine Tillion, spécialiste de l’Aurès, écrit des paysans qu’elle a rencontrés lors de ses premières enquêtes, menées avant 1939, pourrait, sans trop de risques d’erreur, être étendu à la plupart des territoires. « Lorsque je les ai vus pour la première fois, ils étaient tous très pauvres - ils l’ont toujours été. Après quatre ou cinq années consécutives de sécheresse, leur situation pouvait devenir précaire (et il arrivait parfois que l’adminis tration soit amenée à faire des distributions gratuites de céréales), mais normalement ils avaient - tout juste - le nécessaire pour manger... ». Cette pauvreté se combine avec la vision de sociétés fortement intégrées, où le sens des solidarités familiales, claniques ou tribales, cimentées par les cultes, les mythes, la religion, le respect des anciens, vivants et morts, l’emporte sur l’individualisme qui s’est épanoui dans les sociétés d’Europe avec l’esprit de libre examen, l’idéal de réussite personnelle, et le culte du progrès. Germaine Hllion écrit encore : « Les bonheurs individuels et privés étaient, me semblet-il, plus rares encore que chez nous. En compensation, je n’ai jamais rencontré alors ces malheurs profonds, irrémédiables dont les grandes civili sations ont le secret »63. Comment apprécier, globalement, le sort des populations, et en particulier l’évolution des conditions de vie depuis l’avènement du régime colonial ? Rien n ’est évidemment plus variable que les situations qui peuvent être cons tatées, en fonction des pays parcourus, dont les conditions naturelles, humaines et économiques diffèrent du tout au tout, et aussi en fonction des observateurs. Par exemple, Fumivall, qui parcourt l’Indonésie dans les années 30, y remarque qu’on n’y voit pas de mendiants, que la plupart des toits sont couverts de tuiles, que beaucoup de maisons sont garnies de quelques meubles à l’européenne, que les boutiques des villages sont bien
63. T illion (G .), L ’Algérie en 1957, É ditions de M inuit, 1937, p. 23-26.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
fournies en objets de consommation variés, et que, dans l’ensemble, la popu lation est correctement vêtue. Mais cette vision favorable lui paraît démentie par des statistiques qui semblent prouver que la situation ne s’améliore guère depuis le début du siècle. D’autre part, il note que certaines réalisations relè vent plus de l’action administrative que d’un accroissement de la prospérité : la mendicité est interdite ; quant aux toits de tuiles, ils ne résultent pas d ’un désir spontané de mieux-vivre favorisé par une plus grande aisance, mais de normes imposées par l’administration64. Dans les dernières années de la crise, De Klerck émet un diagnostic assez pessimiste sur le même pays. Selon lui, la majorité de la population s’est appauvrie, ce qui lui paraît attesté par la baisse constante du rapport de la rente foncière, par le chiffre d’af faires des crédits populaires et des établissements gouvernementaux de prêts sur gages, et par le nombre croissant d ’expropriations et de ventes de terres, sans exclure la sous-alimentation fréquente, qui contraste avec la prospérité d ’avant la crise. Seule la solidarité traditionnelle des paysans a permis aux plus démunis de subsister, ce qui peut être une manière de dire que l’action du colonisateur a été insuffisante65. Mais quelques éléments paraissent indé niablement aller dans le sens de difficultés croissantes. Tout d’abord, les conséquences de la croissance démographique se font terriblement sentir sur des superficies déjà surexploitées. Le morcellement des terres atteint des proportions presque hallucinantes dans bien des pays d ’Asie : à Java, par exemple, Robequain évalue la superficie cultivée à 18 ares (1 800 m2) par tête. En Algérie, environ 1 300000 exploitations indi gènes se partagent sept millions et demi d ’hectares, mais la majorité sont de petits ou très petits propriétaires, disposant en moyenne de S hectares et demi, superficie très insuffisante étant donné des rendements très faibles, et des terres en général de mauvaise qualité. En Égypte, deux millions de fellahs ne disposent que d’un million d’hectares, soit un feddan (demihectare) en moyenne, pas plus que 22 000 propriétaires grands ou moyens, dont chacun détient 45 hectares. Une cinquantaine de très grands proprié taires, dont la moitié sont étrangers possèdent environ 2500 hectares chacun66. La proportion de paysans sans terres peut aussi être très élevée : 40 à 60 % dans le delta du Tonkin, d ’après le rapport d ’une commission d’enquête de 193067. Aux West Indies, nombre de cultivateurs ne sont que des tenanciers rétribués par 50 % de la récolte, sans aucune garantie de stabi lité. Le rapport Moyne souligne un chômage endémique qui touche jusqu’au tiers de la population68.
64. Furnivall (J.S.), Netherlands India, p. 401-402. 65. De Klerck (E.S.), History of the Netherlands East Indies, p. 585. 66. Ayrouth (H.-H.), Mœurs et coutumes des fellahs, Payot, 1938, p. 44. 67. Brocheux (P.), « Les communistes et les paysans dans la révolution vietnamienne », Histoire de l’Asie du Sud-Est, révoltes, réformes, révolutions, Presses universitaires de Lille, 1981, p. 250. 68. Moyne (Lord), « The West Indies in 1939 », ait. cit.
162
Les populations : les indigènes
Un autre très grave problème est sans doute celui du crédit. Souvent le paysan, simple tenancier, soumis aux exigences des propriétaires, auxquelles s’ajoutent celles du fisc, en butte aux aléas climatiques et aux problèmes de « soudure », ne subsiste que grâce aux avances du prêteur-usurier de village, généralement un commerçant. Il tâche de le rembourser en acceptant de céder une partie de sa récolte à un prix inférieur à celui du marché ; l’usurier peut ainsi réaliser un important bénéfice, sur lequel il rembourse à son tour la banque qui lui avance les fonds nécessaires à son activité. Le fait est très notable en Inde, notamment là où les propriétaires absentéistes (pour lesquels s’est imposé le terme générique de zamindar, valable en fait pour l’Inde orientale), louent des terres à des chefs de village, qui eux-mêmes les sous-louent à des paysans pauvres, auxquels ils consentent des prêts de nour riture et de grain. Dans ce cas, le paysan doit au grand propriétaire 40 % de sa récolte, tandis que 8 à 10 % servent à rembourser ses dettes. Si le paysan est lui-même un petit propriétaire, sa charge, moins écrasante, reste lourde, puisqu’il doit 10 % de sa récolte au fisc, et entre 10 et 15 % à l’usurier, qui, en cas d’accumulation de la dette, finit par acquérir la terre donnée en garantie69. Les gouvernements coloniaux sont loin d’avoir ignoré la gravité du problème. Les Français sont particulièrement fiers de l’institution des SIP (sociétés indigènes de prévoyance), créées à destination des indigènes, en Algérie d ’abord, puis au Maghreb et en AOF, ou des SICAM (caisses indi gènes de crédit agricole mutuel) établies en Indochine, et perfectionnées lors de la crise. Mais ces institutions sont loin d ’apporter des solutions suffi santes, car elles se révèlent surtout utiles aux grands et moyens propriétaires indigènes, qui seuls paraissent fournir des garanties suffisantes. Une partie des fonds est d ’ailleurs détournée à des usages non agricoles. Dans les Indes néerlandaises, où un dispositif perfectionné a été mis sur pied dans les premières années du siècle, seulement le cinquième des sommes prêtées va à des paysans, la plus grande partie est destinée au petit commerce70. L’absence ou l’insuffisance de moyens de crédits pour les petits paysans, remarquée plus haut, s'est révélée particulièrement grave à l’occasion de la crise des années trente. C’est ainsi que les petits planteurs d ’hévéas et de cocotiers de Ceylan, écrasés de dettes contractées auprès des usuriers, doivent liquider leurs biens au profit de plus grands propriétaires, les usuriers n’acceptant plus des produits trop dépréciés pour leur permettre de rentrer dans leurs frais, et exigeant le remboursement en espèces. Un mécanisme analogue se constate aux Indes71. On observe des transferts de terres encore plus considérables en Birmanie, comme dans le delta de l’Irrawady, où la majorité des rizières passe ainsi aux mains des prêteurs chinois. Les poli tiques menées pour lutter contre la crise au moyen de la politique douanière ont eu, parfois, des effets pervers. Si les cours ont pu être artificiellement maintenus, en revanche, les prix plus élevés à l’importation destinés à 69. Philip (A.), L’Inde moderne, le problème politique et social, Alcan, 1930, p. 46. 70. Fumivall (J.S.), Netherlands India, p. 361. 71. Rothermund (D.), An economic history of India, p. 94-102.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
soutenir la production métropolitaine ont pu freiner la consommation à la fois dans les métropoles et dans les colonies. Il est certain par exemple que l’imposition des quotas aux produits de consommation japonais, exportés jusqu’en Afrique, n ’a pu que s’exercer au détriment des niveaux de vie locaux, en interdisant à la population de bénéficier des bas prix de ces produits, comme l’ont fait remarquer nombre de responsables des colonies, notamment ceux des colonies britanniques. Comme le disait un responsable hollandais, « la population a dû supporter un sacrifice pour éviter une cata strophe »72. Mais les difficultés à exporter n’ont pas eu seulement des effets négatifs. Pierre Gourou rapporte que, pendant la chute des exportations du caoutchouc (1930-1933), la situation alimentaire des pays exportateurs d’Asie s’est plutôt améliorée, les populations ayant consacré plus de travail et d ’espaces aux cultures vivrières ; « de même en Gold Coast, quand les prix du cacao sont hauts, la production locale de denrées alimentaires diminue et la qualité de l’alimentation s'abaisse»73. De ces éléments variés et sans doute contradictoires ressort un bilan plutôt grisâtre. La misère On se contentera d’un seul exemple, emprunté à Xavier Yacono dans sa thèse sur la plaine du Chélif, région de grande colonisation de l’Algérie. Il note, à la fin des années 1930, bien des signes décourageants : le remplace ment des tentes en poil de chèvre par des gourbis en terre couverts de roseaux, ce qui ne signifie pas une amélioration du confort; l’absence fréquente de l’adduction d’eau la plus élémentaire, au point que le grand marché d ’Orléansville ne dispose pas d ’une borne fontaine en 1937. En 1946, on dénombrera, dans la commune mixte du Djendel, 70 % de popula tion très pauvre, et 20 % de pauvres ; dans celle, voisine, de la commune mixte du Chélif, 42 % ne possèdent pas les dix hectares de terres nécessaires pour faire vivre leur famille ; quant au pouvoir d ’achat des ouvriers agri coles, il ne s’améliore guère : si la journée d’un ouvrier est passée, en francs constants, de moins de deux francs en 1913 à 6 à 7 francs en 1935, le prix du quintal de blé est passé, dans le même temps, d’environ 23 francs à 60 francs74. La conséquence de cet état de fait est l’état sanitaire très précaire d ’une grande partie des populations paysannes. Dans une intervention au Sénat, l’ancien gouverneur général Maurice Viollette faisait observer que, en 1930, sur un échantillon de 28 000 conscrits algériens, 9 000 seulement avaient été déclarés bons pour le service, près de 6 000 définitivement réformés, et le reste, soit plus de 13000 ajournés pour insuffisance de taille ou de poids75. Même si on doit rappeler que seulement une fraction du contingent indigène
72. Van Asbeck, « Les responsabilités néerlandaises... », art. cit., p. 227. 73. Gourou (P.), Les pays tropicaux, p. 87. 74. Yacono (X.), La colonisation des plaines du Chilif, Alger, Imbert, 1955-1956, p. 337 sq. 75. Martin (J.), L'Empire triomphant, 1871/1936, T. 2, Denoël, 1990, p. 489.
Les populations : les indigènes
était appelée à servir, ce qui pouvait rendre les militaires français exigeants sur la qualité, et que, d ’autre part, les critères du service armé peuvent rejeter des hommes plus solides qu’ils n’en ont l’apparence, ces chiffres restent significatifs. L’espérance de vie, à cette époque, s’établit à trente ans pour le fellah maghrébin767. Il faut ajouter que les disettes n’ont pas disparu, plus ou moins circonscrites, et donc plus ou moins aperçues ; l’Afrique du Nord en connaît en 1921 et 1937 ; c’est en juin 1939 qu’Albert Camus signe une série d’articles consacrées à la «M isère de la Kabylie» dans le quotidien de gauche Alger-Républicain11. La situation de l’Algérie n’est pas unique. Le rapport Moyne dénonce la malnutrition, l’insalubrité des conditions de logement, la destraction des structures familiales (60 % de naissances illégitimes) qu’entraîne la misère. Pour éviter de le voir servir d’aliment à la propagande nazie, il ne sera rendu public qu’en 1945. La situation de colonies voisines, comme le Surinam, qui a connu, à la même époque, des troubles analogues, et où les autorités hollandaises commencent à envisager de remédier à une situation sociale alarmante, ne paraît pas substantiellement différente78. Bien des faits témoi gnent que l’alimentation est souvent insuffisante dans les colonies, à la fois en quantité et en qualité. Une enquête générale du Colonial Office, publiée en 1936, à la suite de plusieurs études menées sous l’égide de la SDN, conclut que « les régimes alimentaires dans les colonies sont souvent bien inférieurs aux besoins d’une alimentation optimale. Ceci doit nécessairement peser dans la fréquence non seulement de maladies de carence spécifiques, mais aussi d ’un grand nombre de troubles de santé, d ’un abaissement du seuil de résistance à d’autres maladies, et d ’une altération du bien-être et du rendement *79. Sur des populations affaiblies, les épidémies sont particuliè rement redoutables. C’est ainsi qu’une épidémie de malaria qui suit une mauvaise récolte due à la sécheresse à Ceylan fait en trois mois (octobre 1934-décembre 1935) plus de 100000 victimes80. La misère de ces êtres émeut les Européens comme leurs compatriotes. On citera, entre autres, les souvenirs publiés en 1940 par l’Égyptien Tewfik el-Hakim, et qui décrivent la pitoyable condition du paysan de la vallée du Nil, opprimé par le grand propriétaire, et incapable de trouver auprès d ’une administration dépassée, vénale ou totalement acquise aux puissants, la moindre protection81. Certes, dans cette situation, la pression démographique tient sa place. L’aggravation de la situation s’explique par le surpeuplement, qui frappe la
76. Escallier (R.), « Populations et systèmes migratoires du monde arabe », in Troin (J.-E), dir., Maghreb Moyen-Orient, mutations, SEDES, 1996, p. 189. 77. Berque (J.), Le Maghreb, p. 324. 78. Goslinga, The Dutch in the Caribbean and in Surinam, 1791/1942, Assen/Maastricht, Van Goicum, 1990, p. 654. 79. Havinden (M.) et Meredith (D.), Colonialism and development, p. 197. 80. Meyer (E.), « L’importance sociale de la dépression », art., cit., p. 232-234. 81. El-Hakim (T.), Un substitut de campagne en Égypte, Plon, 1974, coll. Terre humaine.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
grande majorité des paysanneries des pays coloniaux. Mais bien des auteurs insistent sur le fait que l’inégale répartition du sol ne peut qu’aggraver la situation des petits paysans par rapport aux grands propriétaires fonciers. Lord Moyne évoquait, dans son rapport, la nécessité d ’une réforme agraire aux West Indies. Certains même vont, sans doute avec excès, jusqu’à attri buer l’ensemble des difficultés à un système économique injuste. «L e remède, écrit un auteur égyptien, n’est pas dans le malthusianisme, comme le réclament des observateurs superficiels, mais dans une politique de répar tition, de distribution et de surproduction »82. Quoi qu’il en soit, le principe même de ces réformes va à l’encontre du dogme de la propriété privée en vigueur dans les métropoles même, et qui est considéré comme un des fondements de ce droit occidental que les Européens se sont efforcés d ’étendre. De plus, elles ne peuvent s’accomplir que contre les collabora teurs traditionnels des puissances coloniales, propriétaires fonciers euro péens ou indigènes. Comment attirer les capitaux sans la bonne volonté des premiers, et assurer l’ordre sans la coopération des seconds ? Ceci explique l’absence de réformes en profondeur, dont la responsabilité sera léguée, le plus souvent, aux gouvernements nationaux issus de la décolonisation. Les puissances coloniales ont cherché plutôt la solution à la misère dans la politique de développement des ressources susceptibles de fournir aux populations du travail et des revenus supplémentaires. On a mentionné plus haut les principaux de ces plans de développement, qui comprenaient, d'ailleurs, à côté des investissements économiques, des dépenses de santé et d’éducation, susceptibles d’améliorer les capacités de la main-d’œuvre. Mais, comme on l’a vu, les dépenses en faveur de ces programmes ont été relativement limitées. Dans le domaine britannique, les mesures sérieuses ne sont engagées qu’à la veille de la guerre, (Colonial Development and Welfare Act de 1940). Dans le domaine français, pour des raisons trop évidentes, ce n’est qu’à partir de la guerre que sera adoptée une politique de transferts massifs (création du Fonds d ’Investissement et de Développement écono mique et social ou FIDES en 1946). Quant aux perspectives ambitieuses que prône le gouvernement Salazar, désireux de justifier le « droit » de son pays à être une puissance coloniale, elles restent à peu près lettre morte, faute de moyens dans ce pays dont le niveau de vie reste un des plus faibles d’Europe, et, sans doute aussi, du peu de goût des entreprises européennes, généralement non portugaises, pour prendre des initiatives en matière sociale. De toute façon, comme on l’a suggéré, les politiques coloniales ne se déterminent pas uniquement en fonction des problèmes indigènes. Les popu lations européennes pèsent d ’un poids au moins égal dans les préoccupations des gouvernements coloniaux et dans le choix des politiques suivies.
82. Ayrouth (H.-H.), Mœurs et coutumes des fellahs, p. 33.
Chapitre 6
L es Européens et les autres
Qu’est-ce qu’un Européen ? La question n’est pas si simple, car ce groupe comprend à la fois des hommes nés en Europe et des autochtones dont les origines européennes peuvent remonter, chez les Boers d ’Afrique du Sud ou les Canadiens, à plusieurs générations. Cette définition recouvre en fait deux critères, l’un racial, l’autre culturel ; le premier est évidemment la couleur de peau ; le second est l’appartenance à la culture européenne. Un Européen est, presque partout, un « Blanc » par opposition aux populations locales ; mais cette appellation n’a guère de sens en Afrique du Nord (dite d ’ailleurs «Afrique blanche») et dans le monde arabe, voire même à l’égard de certaines populations des Indes, dont la blancheur de peau en remontrerait aux peuples du sud de l’Europe ; ici, les nuances statistiques d ’aspect comp tent beaucoup moins que le comportement, voire le simple costume. Mais ceci ne remet pas les distinctions fondamentalement en cause, car intervient alors un élément tout aussi important que l’apparence, qui est la référence culturelle, d ’abord linguistique, mais aussi religieuse : le fait d ’avoir pour langue maternelle une langue occidentale (par opposition aux langues dites « orientales »), mais aussi d ’être issu de la tradition religieuse du christia nisme occidental, avec toutes ses variantes, est déterminant. Cette spécificité culmine dans le fait d ’être citoyen d ’une puissance occidentale, qui résume tous ces critères, et confère des privilèges dont on reparlera. Pour les Orientaux ou les Africains, d ’ailleurs, les Européens se ressemblent tous, avec leur teint uniformément blafard (ou rougeâtre), et leurs costumes iden tiques, soumis à la double tyrannie de la mode et des considérations d ’hy giène (en particulier pour ce qui est du port du casque colonial), avec, aussi, leur culture technique, leurs croyances dont les rivalités ne réussissent pas à effacer la référence commune, et leurs étranges manières et manies. Le phénomène de création des empires coloniaux n’a que très partielle ment été fondé sur une dense implantation de colons. Le plus souvent, c’est avant tout en s’attribuant l’exercice de la puissance souveraine, sinon la souveraineté elle-même que les puissances européennes se sont arrogées le statut de métropoles. Les expressions, qui appartiennent à la terminologie de l’époque, de colonies de peuplement et colonies de cadres, établissent une
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
distinction tout à fait adéquate aux réalités coloniales. Dans tous les pays d ’outre-mer, des Européens sont aux leviers de commande ; mais selon que le peuplement représente une proportion plus ou moins conséquente des populations, ces dirigeants constituent, soit la caste dirigeante d ’une société européenne assez diversifiée, soit la poignée d ’hommes nécessaires à assurer les fonctions indispensables à la pérennité de la domination économique et politique.
Le nombre Les Européens ont pour caractéristique de constituer, presque partout, une très faible minorité. Si on évalue, d ’après le tableau général présenté plus haut, la population totale des territoires des dépendances européennes, à environ 660 millions d ’habitants, ils n’en représenteraient que vingt-cinq millions, soit moins de 4 %. Encore faut-il procéder à d ’importantes distinc tions. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, sept pays (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Algérie, Tunisie et Maroc) représentent à eux seuls un chiffre de presque vingt-trois millions de personnes, soit environ neuf dixièmes des Européens des «terres d ’em pires». Au premier rang de ce classement (purement arithmétique), trois terri toires (Australie, Nouvelle-Zélande et Canada) abritent la grande majorité des Européens installés outre-mer (respectivement 6,8, 1,6 et 11,3 millions d ’habitants, soit près de vingt millions ou 80 %). Le cas de ces territoires, véritables colonies de peuplement, s’apparente plus à celui de la plus grande partie des États-Unis, dans lesquels des vagues d ’envahisseurs blancs ont submergé, inexorablement, des populations autochtones peu nombreuses, réduites par la maladie, le refoulement, voire le massacre, qu’à celui des autres colonies, les Maoris de Nouvelle-Zélande constituant la seule excep tion notable à cette disparition généralisée. Ailleurs, pour des raisons diverses qui tiennent à la difficulté de faire vivre des Européens sous des climats difficiles, à la capacité de défense des populations, trop nombreuses et parfois trop guerrières pour être détruites par la force, voire à la simple humanité, domaine dans lequel les Européens n’ont jamais eu de peine à dépasser leurs cousins d ’outre-Atlantique, la population dite « blanche » n’a jamais été très nombreuse. Mais, là aussi, il faut opérer des distinctions. Une deuxième catégorie est représentée en effet par des pays où la popu lation européenne, pour être minoritaire, est néanmoins suffisamment impor tante pour lui permettre de marquer ces derniers d ’une profonde empreinte, qui leur fait tenir le milieu entre les « pays neufs » que sont les États précé dents, et les colonies proprement dites. Il en va ainsi d ’un quatrième Dominion britannique, l’Afrique du Sud, où les Blancs représentent environ 2 millions de personnes sur un total d ’un peu moins de dix millions en 1936, soit près de 21 % de la population. Cette situation est assez proche, et, en
168
Les Européens et les autres
quelque sorte, symétrique, de celle de l’Afrique du Nord française, où on comptabilise environ 1,2 million d ’Européens. La proportion est surtout élevée en Algérie, où elle atteint 13% en 1931, contre 8% pour toute l’Afrique du Nord. On peut faire le rapprochement, vu la contiguïté géogra phique, avec les 120000 Italiens de Libye (16 %). En troisième position par le nombre, on trouve la minorité juive de Palestine, dont les effectifs dépas sent 450 000 personnes, soit un peu moins de 30 % de la population du terri toire (un million et demi d ’habitants pour 27 000 km12). Ailleurs, on peut avoir des pourcentages très élevés, ou du moins notables, mais ils ne portent que sur des nombres très faibles. L’un des plus importants est celui des 17 000 Blancs de Nouvelle-Calédonie, qui forment environ 32 % de la popu lation, face aux 29 000 indigènes (54 %) et aux 7 000 immigrés par contrat. En Rhodésie du Sud, les 55 000 Blancs ne constituent que 5 % de la popu lation, évaluée à un million d ’habitants. La proportion est analogue dans les West Indies britanniques. On peut citer aussi, pour mémoire, le SudOuest africain, dont 8 % des habitants sont européens (31000 habitants sur 359000). En fait, dans la grande masse des possessions d ’Asie, d'Afrique ou d’Océanie, on ne trouve que peu de «colons». Dans les colonies britan niques d ’Asie (mandat palestinien non compris), il y a moins de 200 000 Euro péens, dont 120000 dans tout l’Empire des Indes. Il n’en va guère diffé remment des possessions françaises. Les Européens ne sont guère que 21000 dans toute l’AOF, et moins de 5 000 en AEE En Indochine, leur nombre dépasse légèrement les 30000. Pour ce qui est des possessions hollandaises, le nombre d ’Européens est plus élevé, avec 250 000 personnes dans la future Indonésie, mais il comprend environ 150000 Eurasiens. Il y a moins de 200000 Espagnols dans les possessions d ’outre-mer (Canaries exclues), l’essentiel vivant dans la zone espagnole du protectorat marocain, et dans les villes de souveraineté {présides de Ceuta et Mellila). Le nombre des Italiens n’atteint pas 200000 en Afrique orientale (Érythrée, Somalie et Éthiopie), ce qui ne représente que 1,5 % de l’ensemble des habitants1 ; les Portugais ne sont guère plus d ’une petite centaine de milliers dans leurs colonies ; il n’y a qu’une vingtaine de milliers d ’Européens au Congo belge. Dans tous ces pays, l’Européen est véritablement ce qu’on pourrait appeler une « denrée rare », et ne peut guère se sentir autre chose qu’un étranger, bien incapable de contribuer à fonder quelque chose qui ressemblerait à une Europe nouvelle. L’historien d’art Élie Faure remarque en 1931 que, en dépit des réalisations considérables des Britanniques en Inde (cités modernes, routes, chemins de fer, électrification, bateaux, usines), «les Anglais y paraissent campés. On ne les aperçoit pas derrière ce rideau de fer. On en rencontre peu dans les villes, pas du tout dans les campagnes »2.
1. Miège (J.-L.), l’Impérialisme colonial italien de 1870 à nos purs, SEDES, 1968, p.250. 2. Faure (É.), Mon périple, Seghers/Archimbaud, 1987, p. 142.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Les observateurs de l’époque évoquent fréquemment l’image d ’une « pellicule » ou d ’un « vernis », de colonisation. Mais ces métaphores même, qui évoquent une couche uniforme, fût-elle très mince, sont fort éloignées de la réalité. En réalité, il faudrait opposer une série d'établissements euro péens, généralement urbains, qui rassemblent l’essentiel des « colons », à des arrière-pays où ne vit qu’une minorité de fermiers, de fonctionnaires, ou d ’aventuriers. Cette observation vaut aussi bien pour les pays où la propor tion des colons est importante que là où elle est faible. Quelques exemples suffisent à illustrer ces considérations : 70 % de la population européenne d'Algérie vers 1931 vit dans des villes, (dont un quart rien qu’à Alger), et 63 % de celle de l’Union sud-africaine (Witwatersrand avec Johannesburg, Le Cap, Durban). Mais c’est vrai aussi de 90 % des Européens de Java et de Madura, et de 60 % de ceux des Territoires extérieurs. On voit encore que la moitié des Blancs d’AOF vit à Dakar. Inversement, bien sûr, des régions entières sont vides d’Européens : en Algérie, dans l’ensemble, ils ne consti tuent que 5 % de la population rurale, et ils sont absents de la plupart des régions montagneuses de l'A tlas tellien, comme l’Aurès ou l’Ouarsenis, ou encore les Hauts Plateaux du sud ; on pourrait dire la même chose des zones tropicales du sud-est de l’Afrique du Sud, de Port-Elizabeth à la frontière du Mozambique, et du massif du Basouto3. Selon l’expression utilisée par une commission anglaise, le Blanc est aussi difficile à trouver dans ces régions qu’une aiguille dans une botte de foin. Dans l’ensemble, cette concentration urbaine s’accentue, par suite des conditions de vie précaires des petits exploitants agricoles, victimes au surplus de la crise économique. En Algérie, alors que 66 centres avaient été créés ou agrandis entre 1921 et 1931, non sans difficultés, on n ’en compte plus que 4 entre 1931 et 19374. Types de colonies et variété du peuplem ent La faiblesse du peuplement coïncide avec la notion de «colonie de cadres ». Là où les Européens sont peu nombreux, ils sont essentiellement chargés de fournir des chefs à l’administration, à l’armée, au transport, au commerce, aux activités agricoles ou minières. Ils se cantonnent, le plus souvent, dans des fonctions dirigeantes relativement élevées : gouverneurs, chefs de services, directeurs d'agences bancaires, de centres miniers, de plantations, à l’exclusion des emplois médiocres de bureau ou des fonctions de contremaîtres, laissées le plus souvent à des non Européens. Fumivall note qu’aux Indes, la population britannique forme « une seule caste, dominée par la tradition des Public Schools », entendons par l’éducation des classes supé rieures de la société5. De fait, selon une enquête de 1941, sur 75000 civils européens, 12000 sont des fonctionnaires civils, dont 800 appartiennent à
3. Maurette (F.), Afrique équatoriale, orientale et australe, p. 326. 4. Fritsch (S.), La colonisation agraire en Algérie entre les deux guerres, maîtrise, ParisIV, 1998, p. 29. 3. Fumivall (J.S.), The Netherlands India, p. 247.
Les Européens et les autres
YIndian C ivil Service, qui fournit les cadres supérieurs de l’administration6. Cette situation se vérifie ailleurs, comme le confirme une statistique plus précise portant sur 85000 actifs européens aux Indes néerlandaises en 1930 (soit la très grande majorité des actifs)7 :
Secteur d’activité
Pourcentage de la population active européenne
Production de matières premières Administration Transport Commerce Professions libérales Industrie
23 23 11 11 11 6
Certes, même dans ce type de colonies, l’Européen n’occupe pas unique ment des fonctions bien rétribuées de direction. Les villes peuvent abriter des personnages plus modestes, comme des garagistes, des cafetiers, ou des agents de maisons de commerce besogneux. Italiens et Grecs ont souvent occupé ces fonctions en Afrique noire. Mais ils sont trop peu nombreux pour constituer vraiment un « petit peuple ». Cela n’est pas le cas des colonies de peuplement, comme l’Afrique du Nord ou l’Afrique du Sud, où les popula tions d ’origine européenne constituent un ensemble suffisamment complexe pour que la notion de classe sociale n’y soit pas dépourvue de sens. Si ces pays comptent des grands patrons et de grands propriétaires, on y trouve aussi une classe moyenne, entrepreneurs, membres de professions libérales, commerçants, de petits artisans, de petits paysans, des ouvriers et de petits employés, dont une partie très modeste, voire pauvre, selon les critères des métropoles. Il faut observer que, dans l’ensemble des territoires relevant des empires, les Européens ne sont que partiellement des ressortissants de la puissance occupante. C’est vrai de la plupart des colonies dites de peuplement. Seuls les deux Dominions d’Australie et de Nouvelle-Zélande ont été peuplés essentiellement par des colons britanniques, Anglais, Écossais ou Irlandais. Au Canada, en revanche, les populations d ’origine française représentent environ un tiers de la population, tandis qu’en Union sud-africaine 60 % des Blancs descendent des colons hollandais. Pour les possessions françaises, l’exemple de l’Afrique du Nord est tout aussi frappant : en Algérie, la vague d’immigration latine (espagnole, italienne, maltaise) a menacé à la fin du XIXe siècle de submerger le peuplement d ’origine métropolitaine ; en Tunisie, Italiens et Maltais ont été jusqu’aux années trente plus nombreux que les
6. Barker (E.), Ideas and ideals, p. 115. 7. The Colonial Problem, p. 420.
171
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Français ; et, dans les deux cas, la victoire finale de la francité n ’a été assurée que par une vigoureuse politique d ’assimilation, dont la naturalisation dite «autom atique», l’école, le service militaire furent les principaux outils. Dans les années trente, la fusion en cours est loin d ’être totale pour tous ces éléments. Elle ne l’est pas non plus pour les communautés juives, immigrées ou autochtones. La situation n’est pas très différente dans les colonies de cadres: en dehors de l’administration, réservée aux nationaux, le besoin de personnel aboutit à faire bon accueil à tout homme jugé compétent et travailleur. En Égypte, les Britanniques ne sont qu’une petite minorité : peut-être 30000 en 1939 sur moins de 200000 nationaux européens, face à près de 70000 Grecs, 50 000 Italiens, 20 000 Français. Encore, d ’après certains auteurs, dénombret-on comme britanniques des Maltais, Chypriotes ou Indiens, ou comme Français des Algériens musulmans8. Paul Morand peut écrire du canal de Suez que « son armée est anglaise, sa classe ouvrière grecque, ses chefs de gare italiens et son administration française »9. André Siegfried précise que la direction locale est à 60 % française, le tiers restant étant composé d ’Italiens, de Grecs et de Britanniques ; Italiens et Grecs forment l’essentiel du personnel d ’encadrement, et un peu moins de la moitié des ouvriers, les autres étant égyptiens101. De même, les Indes néerlandaises accueillent toutes les nationalités: Allemands surtout (environ 7000 vivent dans le pays), mais aussi Britanniques (2 500), et quelques centaines de Belges, de Français, mais aussi de Suisses, Scandinaves, Russes, Américains, Autri chiens, Hongrois, Italiens, Arméniens, ou Japonais. Ce n’est qu’entre les deux guerres que les Belges commencent à représenter la majorité des colons du Congo, qui avait attiré jusque-là Blancs d’Afrique du Sud, Grecs ou Portugais, mais aussi exilés de Russie. Dans le centre diamantifère de Dundu, en Angola, en 1929, si l’administrateur est portugais, le directeur de la mine est américain, et l’ingénieur est anglais11. Et on n’ignore pas que c’est la Danoise Karen Blixen, qui a le plus contribué à faire entrer le Kenya dans le domaine des lettres anglaises, après y avoir géré une plantation de café jusqu’à 1931. Il faut rappeler aussi que, dans les territoires enlevés à l’Allemagne en 1919, les sujets allemands demeurent nombreux. Il y aurait ainsi, dans les Hautes Terres du Kilimandjaro, au Tanganyika, 1400 colons allemands contre 3 000 Anglais ou Boers, venus d ’Afrique australe12. Cette dernière observation doit amener à souligner que, pour certains pays européens, l’aventure de l’émigration ne coïncide guère avec la consti tution de leur empire colonial, dans la mesure où l’émigration dans les colo
8. Mansfield (P.), The British in Egypt, Victoria (Modem History) Book Club, Newton Abbot, 1973, p. 270. 9. Morand (P.), La route des Indes, p. 84. 10. Siegfried (A.), Suez, Panama et les routes maritimes mondiales. Colin, 1940, p. 71. 11. Weulersse (J.), Noirs et Blancs, p. 128. 12. Maurette (F.), Afrique équatoriale, orientale et australe, p. 140.
172
Les Européens et les autres
nies n’a représenté qu’une faible partie du total des départs, voire s'est faite dans des colonies étrangères. Même après la conquête de l’Éthiopie, qu’estce que l ’Afrique italienne, par rapport aux dix millions d’Italiens établis ailleurs, aux États-Unis, ou en Amérique latine, ou en France, voire même en Afrique du Nord française (où les Italiens sont plus nombreux qu’en Libye) ou en Égypte ? De même, le peuplement espagnol, essentiellement dirigé vers l’Amérique du Sud, a constitué une composante essentielle de la coloni sation de l’Algérie, où il se fond rapidement dans le creuset français. En 1939 encore, en dépit de l’action de lois de naturalisation à l’œuvre depuis cinquante ans, le seul département d ’Oran compterait 93 000 Espagnols et 36 000 naturalisés sur environ 400 000 Européens13. Les territoires coloniaux espagnols ne pouvaient constituer qu’un bien maigre débouché. Quant à l’émigration portugaise, elle ne se dirige que très peu vers l’Afrique : entre 1923 et 1930, par exemple, elle ne dépasse pas quelques centaines de personnes par an, sur un total qui varie entre 20 et 40000 émigrants, attirés notamment par le Brésil, aux perspectives plus séduisantes14.
Le devenir des m igrations du Vieux Continent Non seulement les Européens ne sont nulle part très nombreux, mais ils ne peuvent guère compter, entre les deux guerres, sur une forte immigration originaire d ’Europe pour venir renforcer leurs rangs. Le courant qui fut toujours le principal, et qui se dirigeait vers les Dominions, se maintient pourtant pendant les années vingt. De 1921 à 1931, on évalue à un million le nombre d ’émigrants ayant quitté les îles britanniques, dont environ un tiers ont bénéficié des aides financières accordées par le gouvernement britan nique au titre de YEmpire settlement Act, voté en 1922 pour quinze ans, et reconduit par la suite. Ceci renforce le peuplement européen en Australie (bénéficiaire de la moitié de ce courant), au Canada et en NouvelleZélande15. Mais ce courant s’effondre à partir des années 1930. En 1933, seulement 25000 émigrants quittent la Grande-Bretagne. Bien plus, les courants de retour vers la métropole sont supérieurs aux départs : entre 1931 et 1933, le solde en faveur des territoires de l’Empire vers la GrandeBretagne aurait été de 83 000 personnes16. Ce n’est pas un cas isolé : la population européenne du Congo belge diminue, en quatre ans, de plus du quart (25000 à 18000 personnes entre le 1er janvier 1931 et le 1er janvier 1935)17. Elle sera encore inférieure à 30 000 personnes en 1940.
13. Catala (M.), Les relations franco-espagnoles pendant la Deuxième Guerre mondiale, L’Hannattan, 1997, p. 104. 14. Böhm (E.), La mise en valeur, p. 183. 15. The British Empire, a report, p. 297 ; Masson, Marines et Océans, p. 213. 16. Bonn (MJ.), «.La portée internationale du problème colonial », art. ciL, p. 220. 17. Vanderlinden (J.), Pierre Ryckmans, p. 291.
173
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Bien des facteurs expliquent ce changement. C ’est d ’abord, sans doute, la fin du dynamisme démographique de la population européenne, brisé par la guerre. De 18 % de la population mondiale évaluée en 1650, la proportion de la population européenne (Russie comprise) a atteint les 25% dans les années vingt, pourcentage inégalé depuis18. Certes, on ne peut imaginer qu’il sera abaissé à 15 % en 1995, mais en Grande-Bretagne, on prévoit une stabi lisation de la croissance, voire une régression, dans un bref délai; en Allemagne et en Italie, seules de vigoureuses politiques natalistes enrayent momentanément le déclin, tandis que la situation française paraît encore plus incertaine qu’avant 1914. Mais il faut surtout invoquer les conséquences de la crise économique, qui, comme on le verra, frappe sévèrement les pays d ’outre-mer, où elle entraîne, comme partout, l’extension du chômage. L’attrait des pays d’accueil cesse, ceux-ci n’ayant plus à offrir les mêmes perspectives d ’avenir que précédemment, et adoptant en outre des politiques de plus en plus restrictives, comme c’est en particulier le cas des Dominions. Aucun courant nouveau ne vient corriger ces tendances. Les propositions formulées dans certains pays, comme en Suisse, de favoriser l’émigration pour lutter contre le surpeuplement ne sont guère suivies d ’effets. L’ambiance de plus en plus tendue des relations internationales dissuade les États coloniaux de pratiquer une politique d ’appel, en faveur, par exemple, des Italiens, dont on craint qu’ils ne servent de masse de manœuvre aux revendications territoriales du fascisme, ou encore des Japonais, dont on redoute qu’ils ne précèdent les armées nippones. Enfin, bien des projets concernent des régions éloignées, de climats peu attirants, ce qui explique leur échec : c ’est le cas de ceux qui consistent à installer, à partir de 1927, des colons venus de Hollande (où pourtant la croissance de la population est forte, environ 100000 habitants par an), au nord-ouest de la NouvelleGuinée, ou encore des tentatives pour favoriser l’immigration dans la province du Kivu, au Congo belge, où l’on ne peut introduire qu'un petit nombre de colons. Dans l'ensemble, ce déséquilibre tend à s’accroître, en raison de l’ac croissement démographique plus rapide des populations indigènes. Si le phénomène n’a guère de conséquence pour ce qui concerne les colonies de cadres, il remet en cause l’avenir des colonies de peuplement, ou, pour le moins, la nature de cet avenir, conçu jusque-là comme fondé sur une crois sance plus rapide de la composante européenne. C’est le cas en Algérie. Le taux de natalité européen s’abaisse à 18 p. 1000 en 1937, le flux d'immigra tion se tarissant, alors que, dans le même temps, celui des indigènes se relève de 35 à 42 p. 1000, ce qui, en dépit d ’un taux de mortalité nettement plus élevé (20 p. 1000 contre 12 p. 1000), signifie un accroissement naturel trois fois plus fort. L’augmentation de la colonie européenne, qui avait été de 36 % entre 1896 et 1921, n’est que de 18 % entre 1921 et 1948. Inversement,
18. Demangeon (A.), «La question du surpeuplement». Annales de Géographie, 1938, p. 114.
174
Les Européens et les autres
le nombre d ’indigènes, qui avait augmenté d ’environ 25 % entre 1896 et 1921, fait plus que doubler (56 % entre 1921 et 1948)19. Minoritaires dans le pays (ils forment environ un sixième de la population), les Européens sont appelés à le devenir de plus en plus. « L’Algérie restera-t-elle française ? » s’interrogent les Annales coloniales en 193620. Par « Algérie française », il faut entendre autant que «Algérie sous la dépendance de la France», « Algérie organisée selon les vues des représentants des Français d ’Algérie ». Désormais en effet, pour bien des observateurs impartiaux, la question qui prédomine est celle de la condition des populations indigènes : « Bien loin d’envisager la colonisation de l’Afrique du Nord avec des Blancs d ’Europe, il faut à présent donner aux autochtones des terres nouvelles ou des moyens d’existence matérielle qui permettent à leurs enfants de vivre », écrit en 1938 Robert Montagne, un des meilleurs spécialistes français de sociologie musul mane21. Mais il existe deux exceptions notables à ces tendances d ’ensemble. La plus marquante, et la plus durable, est celle de la Palestine, où le mouvement d’immigration des colons juifs, amorcé depuis les années 1880, et stimulé depuis 1897 par le mot d’ordre d ’État Juif, a reçu l’appui pendant la guerre des autorités britanniques. Malgré tout, l’immigration a été relativement limitée entre 1919 et 1929, puisqu’elle n’a pas dépassé 100000 personnes (chiffre net, compte non tenu des départs), et s’effondre, comme partout, à partir de 1929. L’arrivée des nazis au pouvoir amène une nouvelle grande vague entre 1933 et 1935 (environ 145 000 personnes)22. À la veille de la guerre, l’immigration combinée à une vigoureuse démographie a permis à la minorité juive de passer de 83 000 personnes en 1922 à 463 000. Mais on ne saurait non plus ignorer les efforts du fascisme italien, qui ont abouti, à la veille de la guerre, à établir une population européenne d ’environ 300000 personnes en Libye et en Éthiopie, chiffres d ’autant plus remarqua bles qu’ils ont été obtenus en un temps très court, puisqu’en 1934 le total de cette population ne dépassait pas 70000 personnes. En Libye, on est passé de 50000 à 120000 colons. En Éthiopie, le régime réussit à retenir une partie des soldats italiens, et à attirer une population d’immigrants, pour un total d ’environ 100000 personnes23. Bien que naturellement elles relèvent d’un état d ’esprit et de circonstances fort différents, ces deux expériences n’en ont pas moins un point commun, qui en explique le succès, mais aussi le caractère isolé : l’une et l’autre reposent davantage sur une volonté poli tique, soutenue par une forte idéologie, que sur des considérations de démo graphie ou des conditions économiques particulières.
19. Yacono (X.), Histoire de l ’Algérie, p. 171,344. 20. Lefeuvre (D.), L’industrialisation de l ’Algérie, p. 80. 21. Montagne (R.), « L’évolution politique des pays arabes depuis un an », ait. cit., p. 16. 22. Wasserstein (B.), The British in Palestine, the Mandatory Government and the ArabJewish Conflict, 1917-1929, Londres, Royal Historical Society, 1978, p. 160; Bethell (N.), The Palestine Triangle, p. 25 ; INSEE, Mémento, La Palestine, p. 38. 23. Miège, L’impérialisme colonial italien, p. 1% et p. 250.
175
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Il faut remarquer pour finir que l’extension maximale des empires colo niaux entre les deux guerres ne coïncide pas partout avec le maximum de présence européenne outre-mer, qui, dans bien des cas, sera atteint dans les années 1950, en relation avec les difficultés de la reconstruction des écono mies européennes d ’après-guerre, et un développement économique sans précédent. Ce sera notamment le cas des pays tropicaux, dont on verra s’ac croître les besoins en cadres, mais aussi de pays particulièrement dyna miques, comme le Congo belge ou le Maroc, ce décalage contribuant sans doute à expliquer certaines des difficultés des décolonisations. Comme leurs prédécesseurs, ces derniers immigrants auront subi l’attraction d ’une vie meilleure, dont il convient maintenant de se demander en quoi elle consista vraiment.
Le style de vie européen Des privilégiés ? D’une manière qu’on peut qualifier de globale, la misère, ou du moins la frugalité des populations indigènes, et en particulier des paysans, contraste avec le niveau de vie des Européens aux colonies. La nourriture en est un aspect des plus criants. Est-il vrai que les Anglais, surnommés par les Italiens (dont la consommation de viande est environ cinq fois inférieure) « il popolo dei cinque pasti », sont d’énormes mangeurs, comparés à d ’autres colonisateurs ? Peut-être24. « Un peuple mal nourri ne se serait pas établi aussi flegmatiquement aux quatre coins de la terre», observe Albert Demangeon, qui remarque que, sous toutes les latitudes, le Britannique est resté fidèle à son breakfast, à son lunch et à son five o'clock tea (pour arriver à cinq, il faut ajouter, avant le breakfast, le paùmtcha ou « thé au lit », et le dîner). En bon Français, il ajoute naturellement que, si les Anglais mangent beaucoup, il est impossible de dire qu’ils mangent bien25. La profusion, imitée, il est vrai, de celle des aristocraties locales, s’étale aussi dans les banquets. Les régimes alimentaires influent sur le poids et la taille des popu lations, et ne sont pas un des éléments les moins importants de la supériorité supposée des Européens. Un Britannique ou un Hollandais pèserait en moyenne 70 kg et un Français 64 kg, contre 60 à 50 kg pour un Indien, et 50 à 55 kg pour un Indochinois26. Cette différence, au moins d ’aspect (les guerres contre le Japon révéleront l’endurance et le courage des «petits hommes jaunes ») rend insupportable le spectacle d ’un Blanc ventripotent tiré par un frêle pousse-pousse, même si ce moyen de transport n’est pas
24. Huxley (A.), Jesting Pilate, 1926, trad. fr. Le monde en passant, Vemal/Ph.Lebaud, 1988, p. 164. 25. L’Empire britannique, p. 141-142, Lévi-Strauss (G), Tristes Tropiques, Plon, 1955, p. 158. 26. Sorre (M.), Fondements biologiques de la géographie humaine, A. Colin, 1943, p. 286.
176
Les Européens et les autres
réservé aux Européens, pas plus, d’ailleurs, que le fait d’avoir, comme on dit dans les pièces de Pagnol, « le gros ventre », qui est partout encore un signe d'honorabilité. Mais, même des Européens qui mangent raisonnablement, mais sans excès, comme les Français d ’Algérie, qui ont conservé en général la frugalité des peuples méditerranéens, et dont le niveau de vie moyen est plutôt infé rieur à celui de leurs compatriotes de Métropole, peuvent exciter l’envie ou un sentiment d ’injustice. Messali Hadj, garçon d ’épicerie à Tlemcen, décrit ainsi les « gros achats » des Européens, qui pouvaient demander en une seule fois «un kilo de sucre, une demi-livre de café moulu, deux paquets de beurre, un quart de fromage, deux paquets de chocolat, deux paquets de macaroni, deux boîtes de sardines et des bonbons acidulés pour les enfants », alors que les Algériens se contentent de semoule, et de sucre, huile et sel par toutes petites quantités, souvent à crédit27. Ces scènes, il est vrai, datent de 1916, qui fut une époque de pénurie particulièrement aiguë, mais il n'est pas sûr que la disproportion ait beaucoup changé par la suite, pour la majorité du moins. L’inégalité est particulièrement sensible aussi dans les salaires. En 1935, l’ensemble des salaires distribués à 329000 travailleurs africains dans le secteur minier d ’Afrique du Sud s’élèverait à près de 9 millions de livres ; en face, 35000 travailleurs d ’origine européenne auraient reçu plus de 11 millions de livres. Cela signifie un écart de revenu de 1 à 11,6. Cette différence ne s’explique que partiellement par le degré de qualification, dans la mesure où tout est fait pour interdire aux Noirs d ’accéder à des fonctions qualifiées28. Cet écart ne fait que se creuser, car les salaires des Africains ne subissent pratiquement pas de relèvement, au contraire de celui des ouvriers blancs, dont les organisations, officiellement toujours reconnues, ont plus facilement l'oreille de l’administration. En Palestine, des ouvriers syndiqués juifs font pression sur un employeur de leur communauté pour qu’il n’em ploie pas des Arabes qui se contentent de 12 piastres par jour, là où les Juifs exigent 30 piastres29. D’autres éléments, plus généraux, permettent de souligner l’inégalité : à Java et Madura, en 1929, sur environ 40 millions d ’habitants, seulement 3 % sont assujettis à l’impôt sur le revenu, dont 80 % pour un revenu annuel infé rieur à 300 florins. Inversement, sur 250000 Européens, la proportion d ’as sujettis est de 28 %, dont deux tiers déclarent plus de 5 000 florins, et un tiers plus de 20000. Les mêmes contribuent pour trois quarts à la taxe sur les automobiles30. On trouverait, en Algérie, des réalités analogues : selon une
27. Les mémoires de Messali Hadj, J.-C.Lattès, 1982, p. 81. 28. Jagerschmidt (A.), « La population et la question indigène en Afrique australe britan nique », La Géographie, 1937-1938, p. 102. 29. Bethell (N.), The Palestine Triangle, p. 25. 30. Fumivall (J.S.), Netherlands India, p. 348.
177
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
enquête de 1921, la part des indigènes dans les impôts ne se monte qu’à 27 % du total, alors qu’ils représentent environ 87 % de la population, les Européens contribuant, pour leur part, à hauteur de 73 %31. Certes, ces chif fres peuvent aider les défenseurs de la colonisation à montrer que la fiscalité n’a pas pour fonction d ’exploiter la masse des populations à l’avantage de la colonie, en organisant un transfert massif des ressources indigènes au profit des intérêts européens. Cette remarque mérite d’être retenue, à condition de se rappeler que la fiscalité indigène repose plus sur les droits fonciers, les impôts indirects, ou la capitation, que sur les impôts directs, ce qui en limite la portée. Il reste que de telles données soulignent un profond déséquilibre. Les difficultés de la vie Par-delà les statistiques, les « coloniaux » ont-ils réussi à élaborer un de ces «bonheurs de vivre» auquel la décolonisation prêtera un parfum si enivrant qu’il éveillera, chez les uns, la nostalgie d ’un paradis perdu, et pour les autres, le regret un peu frustrant d ’une société dont, tout en condamnant vertueusement le principe, ils regrettent, dans un petit coin de leur mauvaise conscience, de n’avoir pu profiter. Mais, naturellement, il ne s’agit là que de fantasmes. Certes, la vie des Européens aux colonies s’est bien améliorée depuis les époques pionnnières, et les organismes officiels, soucieux de rassurer les émigrants, le soulignent volontiers. Selon les autorités militaires françaises, «les grandes villes d’Afrique du Nord, d’Indochine et de Madagascar et même d ’Afrique occidentale soutiennent sans désavantage la comparaison avec les cités les plus progressistes d’Europe quant à l’état sanitaire des habi tants ; quant aux petites résidences, aux postes lointains, le nouvel arrivant trouvera dans ses connaissances acquises, dans les documents publiés par les services locaux, les moyens de se défendre contre les influences destractrices du climat »32. Pour une association féminine, « ... les données de l’hygiène, l’oiganisation de plus en plus parfaite des services de santé, en particulier la création des Instituts de recherches, ont transformé les conditions de la vie dans ces régions lointaines, et aujourd’hui les femmes peuvent si bien y vivre qu’elles y ont colonisé, fondé des familles, élevé leurs enfants »33. Cette amélioration est un fait récent. En 1925, par exemple, Doigelès remarquait à propos de l’Indochine : « la colonie a plus évolué en quinze ans que l’Europe en un siècle »34. Somerset Maugham, auteur, en particulier dans les années 20, d ’une série de nouvelles qui se déroulent en Malaisie,
31. Goinard (R), Algérie, l’œuvrefrançaise, Laffont, 1984, p. 360. 32. Ministère de la Guerre, Manuel à l’usage des troupes employées outre-mer, Imprimerie nationale, 1925, p. 240. 33. Fédération française de l’enseignement ménager, La Vie aux colonies, Larose, 1938, p.8. 34. Doigelès (R.), Sur la route mandarine, [1925], Kailash, 1995, p. 39.
178
Les Européens et les autres
remarque que, dès avant la guerre, l'avion a bien changé les conditions de la vie aux colonies. Il a aussi, selon lui, modifié, dans beaucoup de cas, la rela tion au pays: «Jadis, ces gens-là s'attendaient à passer toute leur vie jusqu'au moment de la retraite, par exemple dans l'É tat de Sarawak ou dans celui de Selangor : l'Angleterre était aux antipodes, et, quand ils y retour naient, ils s'y sentaient de plus en plus étrangers : leur foyer véritable, leurs amis proches se trouvaient dans le pays où ils passaient le meilleur de leur vie». Désormais, au contraire, la plus grande facilité à quitter la colonie permet de resserrer les liens avec la métropole35. Il s'en faut, cependant, que les conditions sanitaires soient partout excel lentes. Le taux de mortalité des colons de Boufarik en Algérie, dans les années 1840, est resté légendaire, et a fait de l'Algérie, jusqu'aux années trente, un laboratoire pour l'étude du paludisme, conjointement avec l'Inde. En 1935, d'ailleurs, le professeur Edmond Sergent, directeur de l'institut Pasteur d'Alger, est élevé à la présidence de la Commission du paludisme de la SDN. Bien qu'éradiqué sous ses formes mortelles, cette affection continue à soumettre la population européenne de certaines régions, à des pénibles accès de fièvre. En 1932 encore, un colon de la Mitidja se voit obligé d'abandonner son exploitation pour s'établir dans une région montagneuse36. Plus généralement, le taux de mortalité infantile des enfants d'origine euro péenne est le double de celui de métropole (130/140 p. 1000 vers 1930 contre 65 p. 1000), faute d'un encadrement médical suffisant3738.Bien évidem ment, les conditions sanitaires demeurent encore plus précaires sous les climats tropicaux. «Personne ne vient là pour son plaisir», écrit le géographe Charles Morazé dans un article sur Dakar publié en 1936. « Les risques du climat font qu'on n'y vient qu'obligé... ». La chaleur et l'hum idité éprouvent fortement les organismes des Blancs, et cet affaiblissement les rend plus vulnérables aux agressions des maladies tropicales, auxquelles ils paraissent plus sensibles que les indigènes. Cette insalubrité impose une grande hygiène de vie, « au total, un régime de vie assez artificiel, compor tant des interdits et des prohibitions sévères, très différent de la libre activité des contrées tempérées »3S. Le port du casque colonial, la nécessité de la moustiquaire, la surveillance constante de l'eau de boisson, une hygiène rigoureuse, un régime alimentaire strict, une grande régularité de travail, de manière à éviter le surmenage, la sieste obligatoire, tels sont les conseils dont la non observation peut mener d'autant plus facilement à la fatigue, à la maladie, voire à la mort, qu'on est éloigné d'un grand centre disposant de médecins et d'hôpitaux.
35. Maugham (S.), Œuvres complètes, les Quatre Hollandais et 29 autres nouvelles, Julliard, p. 7-8 (trad. J. Dobrinsky). 36. Sergent (Edmond et Étienne), Histoire d’un marais algérien, Institut Pasteur d’Alger, 1947, p. 111. 37. Reinhard (M.) et alii, Histoire générale de la population mondiale, Montchrestien, 1968, p. 553. 38. Sorre (M.), Fondements biologiques, p. 104.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Ces difficultés de vie expliquent, en grande partie, la faible proportion de femmes et d ’enfants européens. Si le temps n’est plus où, par exemple, les consommateurs des terrasses de café de la rue Paul Bert de Hanoi ou de la rue Catinat de Saigon « se levaient pour voir passer une femme blanche », la population coloniale des régions tropicales reste en grande majorité formée d’hommes adultes. Quelques chiffres relatifs au Congo belge sont caractéris tiques de la portée des transformations. Il y avait à Léopoldville au début des années vingt seulement 600 femmes sur environ 3 000 personnes. Pour l’en semble du pays, sur une trentaine de milliers d ’Européens, on recense un peu plus de 7 000 femmes et de 4000 enfants en 1939, soit environ un tiers du total39. Aux Indes, la proportion serait à peu près la même. Pour tous, le séjour régulier en Europe tous les trois ou quatre ans, au cours d ’un congé de plusieurs mois avec séjour obligatoire dans une ville d’eaux, est, non pas une mode, mais une nécessité. Les « coloniaux » fondent ainsi partiellement la prospérité de Vichy. À défaut, les stations d’altitude permettent sur place d ’échapper aux rigueurs climatiques, en particulier à la saison sèche. Aux Indes, les Anglais ont choisi depuis longtemps les pentes du versant sud de l’Himalaya : Simla (2200 m), à 360 km au nord de Delhi, voit s’installer chaque année depuis 1865, entre mars et octobre, le vice-roi et tous les services impériaux, ce qui en fait une véritable capitale; Daijeeling, au sud du Sikkim (2185 m), à 700 km au nord de Calcutta, dominée par la chaîne de l’Everest. Les Hollandais utilisent la station de Bandung, à 170 km de Batavia, à laquelle un chemin de fer la relie en trois heures, dans un paysage de moyenne montagne, particulièrement sain, à 750 m d ’altitude. En Indochine, Dalat, à 1500 m, en pays moï, joue un rôle comparable. D’abord fréquentée par les Européens de Saigon, qui ont coutume d ’y passer les mois de février à mai, puis par les classes aisées, française ou indigène, de l’Indochine, elle commence à attirer des touristes ou estivants étrangers, Britanniques et Américains. En Afrique, de telles créations ne paraissent pas avoir eu d ’équivalent, peut-être parce qu’il existe peu de régions de milieux climatiques différents assez proches pour permettre des déplacements faciles. L’ambition du baron Empain de faire de Goma, au Congo belge, à l’extrémité nord du lac Kivu, une nouvelle Héliopolis, analogue au quartier résidentiel, construit à son initiative, de la banlieue du Caire, n’a pas connu de succès avant la guerre. En dépit de la salubrité due à l’altitude, au panorama de la chaîne des volcans Virunga, le centre n ’a que cinq maisons (dont l’hôtel des Volcans) en 193640.
39. Dorgelès (R.), Sur la route mandarine, p .37; Gondola (Ch.-X).). «Oh, RioMa ! Musique et guerre des sexes à Kinshasa », Revuefrançaise d'histoire d'Outre-mer, 1997, p. 56 ; Eynikel (H.), Congo belge, portrait d ’une société coloniale, Bruxelles, Duculot, 1984, p.253. 40. Danloux-Dumesnil (M.), «Les centres urbains d’Afrique», La Géographie, 1937, p. 73-85.
180
Les Européens et les autres
Les inégalités sociales La société européenne des colonies n’ignore pas les hiérarchies sociales. Pour jouir pleinement des privilèges liés à la condition de « colonisateur », il est indispensable de disposer d’une position élevée et de quelque fortune, sous peine d’être rejeté dans les ténèbres de la médiocrité, voire du proléta riat.. Les fastes qui ont marqué la chronique impériale sont réservés, comme partout, aux grands personnages. Tel est le privilège, en particulier, du viceroi de l’Inde britannique, toujours issu d ’une illustre lignée, paradant en grande tenue devant un parterre de maharajas constellés de pierreries, ou entouré des escadrons de lanciers du Bengale, à l’occasion de somptueux durbars (nom donné aux cérémonies d ’hommage au souverain). On peut lui comparer ce très haut fonctionnaire qu’est le gouverneur général des Indes néerlandaises, qui se partage entre son palais de Buitenzorg (« Sans-souci »), à côté du merveilleux jardin botanique évoqué plus haut, et sa résidence d ’été de Tjipanas (Cipanas), distante de seulement une trentaine de kilomè tres, mais située en altitude, au pied du col de Puncak, dans un paysage de collines couvertes de conifères. Il ne reçoit pas moins de 32 000 dollars de traitement, plus 100000 dollars de liste civile en 1929. Mais les Français font de leur mieux, en dépit de la simplicité inhérente à une République où l’habit noir affecte une sévérité démocratique, pour s’entourer d ’une certaine pompe. Jusque dans les îles perdues du Pacifique, la visite du gouverneur est toujours l’occasion de cérémonies accompagnées de musique et de danses, proposées plus ou moins spontanément par les populations. Les militaires sont passés maîtres dans la mise en œuvre de ces festivités, capables d’ama douer les civils réticents. Un Lyautey, grâce à la complaisance des grands chefs marocains, se révèle metteur en scène autant que grand chef, déroulant devant des invités éblouis les prestiges intéressés d ’une hospitalité orientale. Mais partout, le chef européen peut avoir l’impression d ’être un grand personnage: ainsi Raoul Salan, simple lieutenant de vingt-cinq ans, de passage à Vientiane en 1924, participe à la cérémonie du Basi, cérémonie d ’accueil dans laquelle de belles jeunes femmes, élégamment drapées dans des tissus filés d ’or et d’argent, la chevelure ornée de fleurs de frangipaniers, « prennent des fleurs et des fils de coton, vont à genoux vers nous, mettent les fleurs à nos pieds et nous entourent les poignets de ces fils de coton en murmurant des souhaits aimables et souvent pleins d ’humour». Il sera ensuite reçu par le roi de Louang Prabang, chef du « royaume du Million d ’éléphants et du parasol Blanc »4I. Derrière cet aspect officiel, retenu par les actualités cinématographiques, se déroule, pour les plus aisés, une vie facile qui affecte souvent, au moins au travers de la mémoire, une apparence féerique. La chronique du Kenya a
41. Salan (général R.), Mémoires, fin d’un Empire, p. 37.
181
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
retenu le nom de la Happy Valley, terme employé pour désigner Muthaïga, ce quartier de Nairobi où se mélangent, dans un tourbillon de chasses et de fêtes, rejetons de la haute aristocratie britannique et aventuriers, qui se retro uvent au bar du célèbre Muthaiga Club ou au Torr Hôtel, buvant d ’innom brables cocktails, perdant des sommes considérables aux courses ou au jeu, dans une liberté de mœurs qui n’est qu’une partie du savoir-vivre, Au total, comme l’écrit non sans ironie Salvador de Madariaga, ils offrent l’image « d’un monde paisible et agréable pour les gens fortunés, et par conséquent pour les autres, dont le désir le plus vif consisterait à les regarder et à les admirer »42. Des épisodes émouvants viennent lester de romantisme ce qui, autrement, pourrait paraître bien frivole. Karen Blixen a narré elle-même la fin tragique de sa relation avec Denys Finch-Hatton, «dont la colonie ressentit la mort comme une perte irréparable » ; Joseph Kessel s’est fait le mémorialiste de la liaison entre lady Diana Broughton et Josslyn Victor Hay, vingt-deuxième comte d ’Erroll, qui s’acheva par l’assassinat de l’amant, et le suicide du mari43. Mais il ne s’agit là que d ’une minorité. À l’autre bout de l’échelle sociale, il faudrait décrire le petit peuple européen de ces villes méditerranéennes où les seuls bonheurs, vécus dans une atmosphère qui choquera bien des aristo crates de l’esprit tels Pierre Bourdieu ou Pierre Nora, sont l’anisette du soir, la partie de pêche du dimanche, ou le pique-nique du lundi de Pâques. Ses soucis sont analogues à ceux des couches populaires d ’Europe, et se résu ment en trois mots : travailler pour survivre, sous la menace de la maladie ou du chômage, à moins qu’un conflit mondial n’envoie les hommes mourir loin de chez eux, mêlés à leurs camarades musulmans. Il n’en va guère diffé remment des « Blancs-matignon » de la Guadeloupe, vivant difficilement sur de minuscules exploitations, ou des pêcheurs d ’origine normande de SaintBarthélémy, ou de ces Européens indigents des îles du Pacifique surnommés en anglais beachcombers (littéralement « peigneurs de plages »). Et que dire de la misère de ces petits fermiers d ’Afrique du Sud, chassés de leur terre par l’impossibilité de produire à des prix assez rémunérateurs, illettrés, ne parlant que le dialecte boer, réduits à la mendicité, masse de manœuvre toute désignée pour les théoriciens de l’apartheid ? Vers 1930, on évalue la propor tion de ces « Blancs pauvres » (Poor Whites) à 22 % du total de la population blanche44. Il faut remarquer que cette situation, cependant, est surtout apparente dans les colonies de peuplement, où la société européenne est très diversi fiée, et où les Européens nés sur place rencontrent les mêmes difficultés qu’en Europe à trouver et à garder un travail. Elle est moins fréquente dans les colonies de cadres, où, la plupart du temps, les Européens viennent avec
42. Revue du Pacifique, 1934, p. 130. 43. Dinesen (I.), Out o/Afiica [1937], New York, Vintage Books, 1983, p. 144; Kessel (J), La piste fauve, p. 224-252. 44. Danloux-Dumesnil, « Les centres urbains d’Afrique », art. cit., p. 12.
182
Les Européens et les autres
un métier, pour accomplir une tâche précise pour un temps limité. Mais, même pour les castes supérieures, la vie reste difficile. Posséder une entre prise commerciale, une exploitation agricole ou une plantation outre-mer exige éneigie, activité et présence incessante sur le terrain. La grande vie menée dans les centres européens ou les villes d ’eaux n’est, pour de tels individualités, qu’une détente dans une existence absorbée par des préoccu pations quotidiennes. Cette détente, d ’ailleurs, se combine souvent avec la nécessité de solliciter banques et autres organismes de crédits indispensables à la poursuite des affaires. D’où, souvent, un sentiment d’incompréhension à l’égard d ’une opinion métropolitaine portée à considérer la vie d ’outre-mer, et en particulier sous les tropiques, comme une vie de rêve, ou à surestimer des fortunes qui sont généralement bien inférieures à celles des métropoles. Des aventuriers aux petits-bourgeois Au milieu des années 1930, le mythe de l’outre-mer, largement développé dans les générations précédentes, n ’est pas mort : les paysages grandioses, forêts secrètes et somptueuses, déserts sans limites, montagnes indomptées, mais aussi peuples aux mœurs étranges et barbares, continuent à faire rêver. Ce désir d’aventure est inséparable d ’un souci de se libérer de toutes les entraves de la « civilisation », des règlements ou des contraintes morales qui brident la volonté d ’accomplissement, de réussite, ou, simplement, d’enri chissement rapide. Même si, pour la plupart, cette tentation reste une velléité, une poignée de non-conformistes continuent à concrétiser leurs désirs. Seuls leur conviennent les pays dans lesquels ils côtoient à la fois la nature et ces peuples qui paraissent se confondre avec elle par la simplicité de leurs besoins, par leur indifférence face à la mort et à la souffrance, par leur respect des vertus élémentaires de l’homme. Ces «solitaires» bénéficient encore de la sous-administration, partielle ou totale, et de l’état de guerre plus ou moins larvé de ce qu’on n’appelle pas encore les « zones grises ». Les uns ont trouvé leur affaire aux milieux des peuples à peine contrôlés des grandes forêts tropicales, des déserts, ou bien des montagnes, plus ou moins improbables Kafiristans où ils rejouent, consciemment ou non, la nouvelle de Kipling L ’homme qui voulut être roi. Il existe toujours de ces personnages hors série, explorateurs, chasseurs ou guides de chasse, coupeurs de bois, ou chercheurs d ’or. D’autres ont choisi plutôt les ports comme Shangaï, « le prodigieux carrefour d ’aventureuse humanité, inépui sable repaire d ’hommes de forte trempe, de très grands fauves taillés dans cette rare matière qui s’appelle énergie », mais aussi de « belles aventurières, implantées d’Europe ou de Russie blanche, et portant haut l’arrogance de leur conquête d ’honorabilité »4S.
45. Saint-John Perse, « Lettre à Joseph Conrad, 1921 », Œuvres complètes, La Pléiade, 1972, p. 885-889.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Mais on aurait tort de ne voir dans ces non-conformistes que les margi naux, exerçant de fascinantes, mais coupables industries, comme le trafic de drogues, d ’armes, ou de chair humaine, à la manière d ’Henri de Monfreid. On rencontre parmi eux une majorité de personnages parfaitement respecta bles, au premier rang desquels figurent nombre d ’officiers et d’administra teurs chargés d ’opérer sur les marches des empires. Ou encore cet adminis trateur Maclatchy qui aida les Français libres au Gabon en 1940. « Dégoûté des fauves et de l’éléphant», écrit Larminat, « il ne chassait plus que le buffle, ce qui demande des nerfs solides et un coup d’œil sûr. À ma connais sance, il vivait avec une paire d ’espadrilles, un pantalon et une chemise effrangés, et un boy pour lui retirer, tous les soirs, les chiques des pieds » ^ On peut évoquer aussi les pilotes d ’estuaires des grands fleuves chinois, « nantis de comptes en banque et de larges relations sur mer, tous hommes d’Europe et recrutés parmi des Écossais », qui vivent aux côtés de la faune cosmopolite de Shangaï. Tous ces gens sont soutenus, autant que par la passion de l'aventure, par le sentiment de faire leur devoir. « Le métier ! ou pour mieux dire, l’amour du travail ou l’amour de leur profession ! Il faut peut-être quitter les frontières de l’Europe pour comprendre l’influence déci sive de ce facteur sur la vie de l’homme blanc ». Ces lignes sont écrites par un voyageur plein d ’admiration pour les efforts d ’un ingénieur russe qui dirige un chantier de chemin de fer en pleine jungle de l’Inde centrale4647. Mais il s’en faut de beaucoup que tous les Européens aient l’envie ou les moyens de s’affranchir ainsi de toutes les barrières. Il est assez exceptionnel qu’ils vivent isolés les uns des autres. Ils se concentrent le plus souvent, de quelques milliers à quelques dizaines, dans des centres administratifs ou miniers, où la vie est au contraire beaucoup plus étriquée : le milieu, d ’abord, est très hiérarchisé, dans la mesure où il regroupe des militaires, fonction naires, ou employés souvent d ’une même firme. L’état d'esprit est souvent très conformiste. Bien des visiteurs se sont cruellement employés à en relever les expressions les plus fréquentes, qui paraissent également parta gées par les ressortissants de toutes les pays européens : nécessité de traiter les indigènes par la manière forte ; insistance sur leur indolence et leur fata lisme ; et idée que la vie coloniale n ’est plus ce qu’elle était depuis les récla mations des nationalistes... ou depuis l’arrivée des épouses légitimes à la colonie48. Faut-il en conclure que la bêtise est une production coloniale ? On hésite à croire que les métropoles, dans ce domaine comme dans d’autres, aient accepté de se laisser distancer dans cette discutable compétition. Mais il est vrai que, comme aux villes de provinces, il a souvent manqué aux cités coloniales cette ouverture sur le monde, et, partant, sur les idées qui n’exis tent que dans quelques grandes capitales.
46. Larminat (É. de), Chroniques irrévérencieuses, Plon, 1962, p. 192. 47. Goetel (F.), Voyage aux Indes, p. 245. 48. Faure (É.), Mon périple, p. 175.
Les Européens et les autres
En dépit de ces points communs, les tempéraments nationaux introduisent des nuances dans les comportements. Deux types s’opposent, selon les récits de voyageurs, dans un contraste qui culmine à la fin de la journée de travail. L’Anglais joue au cricket sous un soleil impitoyable, puis revêt l’obligatoire smoking noir, «uniforme funèbre de l’Empire britannique», d ’après la formule d ’Huxley, avant de se rendre à son club, pour y boire d ’innombra bles whiskies49. A l’inverse, le Français, poussif et bedonnant, coiffé de son casque colonial, est assis en débraillé à la terrasse du café où il boit force apéritifs, sorte de personnage à la Dubout sous le soleil des tropiques. Ce dernier tableau est souvent injuste. Dans bien des colonies françaises, le tennis, le golf, l’équitation ou la natation fournissent un exercice que la mode autant qu’une meilleure conception de la santé rendent plus souhai table. Ceci n ’empêche pas la vie de paraître extrêmement monotone à beau coup de voyageurs. « Personne, écrit Evelyn Waugh, ne peut savoir ce qu’est réellement l’ennui avant d ’être allé sous les tropiques »50. Les aventuriers éprouvent, pour ce style de vie, autant et plus de mépris que pour celui des villes d'Occident.. «Je détestais, écrit le Britannique Wilfred Thesiger, officier et explorateur, en reconstituant ses impressions de 1935, les villas proprettes, les routes goudronnées, et les rues méticuleusement alignées d’Omdurman ; je haïssais les poteaux indicateurs et les WC publics »51. En fait, le seul véritable agrément de cette vie est celui de pouvoir être facilement servi par une domesticité nombreuse, car peu payée, et bien forcée d ’être docile, masculine le plus souvent (le terme de boy est passé dans le français colonial courant, avec de curieux dérivés comme celui de boyerie qui désigne le lieu où les boys sont logés). Ceci permet de changer souvent de vêtements, de recevoir, de faire entretenir une maison ou un jardin. Le petit bourgeois peut ainsi échapper aux difficultés d’un style de vie étriqué, tandis que le haut fonctionnaire peut vivre dans un palais hérité des fastes des cours orientales. Mais il s’agit plus d ’un privilège d ’apparence que d’un véritable avantage matériel. Il est vrai que, dans les sociétés coloniales, comme d ’ailleurs dans celles d ’Europe, ce que Pascal appelait les grandeurs d’établissement compte autant que les véritables supériorités.
Une m entalité d’assiégés Courage et peur En Europe, jamais, tant du moins qu’un des deux conflits mondiaux ne fait pas mourir les hommes par centaines de milliers, la sûreté des personnes et des biens n’a été si grande. Il n’en va pas exactement de même aux colo nies, où bien des colons, plus ou moins minoritaires, vivent avec l’impres
49. Huxley (A.), Le monde en passant, p. 131. 50. Waugh (E.), Hiver africain, p. 141. 51. Thesiger (W.), Le désert des déserts, Plon, 1978, coll. Terre humaine, trad, fr., p. 33.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
sion de chevaucher un tigre. Certes, rares sont les observateurs qui ne décri vent pas la masse des populations comme paisible et pacifique. Parmi les témoins qui ont vécu des enfances coloniales, rares sont ceux qui ne se sont pas sentis en parfaite sécurité au milieu des indigènes. Mais en revanche, chez les adultes, des souvenirs lancinants reposent dans toutes les mémoires, que ravive toute agitation. Aux Indes, c’est avant tout celui de la grande mutinerie de 1857 ; en Algérie, c’est celui de l’attaque des établissements de la Mitidja en 1839, ou de l’insurrection de la Grande Kabylie en 1871, avec ses images de fermes prises d ’assaut et brûlées, d’hommes décapités, de femmes et d ’enfants tués ou enlevés. Des monuments commémorent d ’ailleurs ces faits, comme celui de St James’s Church de Delhi, ou, plus modestement, celui de Palestra, qui rappelle au passant le massacre de 50 colons lors de la révolte kabyle. Peu importe que plus personne ne connaisse les causes de ces événements, et plus encore la responsabilité des autorités coloniales dans leur déclenchement ; peu importe encore que des indigènes aient sauvé des Européens au péril de leur vie ; peu importe enfin que les troupes britanniques ou françaises aient exercé de sanglantes repré sailles. Toutes ces considérations s’effacent devant la hantise d ’une « barbarie » toujours prête à se ranimer, et qu’entretiennent les échauffourées ou les émeutes, relativement fréquentes, comme on le verra, et dont les Européens peuvent être victimes, ou bien encore, à une autre échelle, les innombrables vols ou chapardages au détriment des Européens, dont la richesse, au moins relative, éveille les convoitises des pauvres. Ainsi la sécu rité n ’est-elle jamais un acquis. À cette situation, la plupart répondent par l’une ou l’autre de deux atti tudes, qui ne sont au fond que deux expressions opposées d ’une même sensi bilité angoissée. Alexandra David-Néel, célèbre pour ses voyages, spirituels autant que matériels, au cœur des civilisations bouddhistes, se souvient: «L es étrangers, en majorité des Anglais, qui vivaient dans l’Inde, ont toujours été remarquables par une qualité: ils étaient braves. Quelque frivoles ou même parfois fois blâmables que fussent leurs mœurs, le danger les trouvait toujours calmes... Que leur orgueil de « Blancs », leur mépris invétéré des indigènes (des Natives, comme ils disaient avec dédain) les aient aidés à conserver cette attitude, c’est très possible ; il n’en convient pas moins d ’inscrite leur bravoure en face des fautes qu’on a pu leur reprocher»32. Albert Camus, petit citadin d ’une modeste famille d ’Alger, avant de devenir l’écrivain humaniste traumatisé par la guerre d ’Algérie, écrit de même, vers 1960, en parlant du pays de son enfance que « seul le courage permettait d ’y vivre »5 . Mais ce courage est avant tout destiné à en imposer. Il n’est pas celui de soldats dont le devoir consiste à se faire tuer sur place. Il n’exclut pas la panique, qui se traduit par la tentation de la répres sion aveugle, ou, lorsque les cordons de troupes ou de police ont été balayés523
52. David-Néel (A.), L’Inde où j ’ai vécu, Plon, 1951, p. 282. 53. Camus (A.), Le premier homme, Gallimard, 1994, p. 258.
186
Les Européens et les autres
par l’émeute, quand rien ne semble pouvoir arrêter le déferlement des indi gènes vers les quartiers européens, la fuite éperdue. Cette dernière attitude sera surtout fréquente lors des périodes de décolonisation ; elle est relative ment rare entre les deux guerres, où la puissance des appareils répressifs coloniaux est à son zénith, comme on le verra plus bas. Mais il est rare que la majorité des Européens ne soient pas persuadés que l’indigène ne comp rend que la force. Témoin cette citation relevée par Georges-Henri Bousquet dans un journal des Indes néerlandaises : « Il faut traiter un chien comme un chien... un coolie comprend la cravache, qu’on lui en donne »5456. Cette atti tude sommaire paralyse bien des tentatives de compromis. La simple évoca tion de l’indépendance d ’une colonie de sa métropole, même dans un délai très éloigné, suscite une levée de boucliers. Des hommes de bonne volonté comme le gouverneur général de l’Indochine Alexandre Varenne, qui avait osé envisager, sans en préciser la date, un jour où les peuples de la région n’auraient plus avec la France « d ’autres liens que de gratitude et d ’affec tion » l’apprennent à leurs dépens35. Le culte de la Patrie Chez tous ces gens, quel que soient leur milieu social ou leurs origines, le loyalisme envers la métropole ne se discute pas. Certes, celle-ci est souvent une princesse lointaine. On n’y est pas toujours né. On ne s’y rend que rare ment, pour des voyages de repos, ou pour prendre sa retraite, ou encore en vacances. La seule exception (relative) concerne l’Afrique du Nord, proche de la métropole : en 1932, près de 100 000 Algériens y ont pris des congés. Encore faut-il noter que le petit peuple n’a eu d’autre occasion de connaître la France que lorsque ses hommes adultes y ont été envoyés lors de la récente guerre mondiale36. On ne se sent pas forcément à l’aise dans une Europe qu’on décrit volontiers comme routinière, arriérée, étriquée, face à l’aventure de l’outre-mer. On n’est pas prêt à se soumettre à des dispositions prises par les parlements des métropoles et jugées dangereuses à la sécurité interne ou attentatoire aux libertés locales : les projets de réformes en faveur des indigènes, comme les sacrifices envers la défense nationale ou impériale en temps de paix sont systématiquement rejetés. La lointaine Patrie n’en est pas moins un objet de vénération, lieu de toutes les perfections, géographiques, climatiques, économiques, culturelles et spirituelles. Comment ne serait-ce pas le cas, alors que pouvoir se réclamer de son droit de cité vaut protection, considération et privilèges ? Pour le Français implanté depuis des générations en Afrique du Nord, aux Antilles ou ailleurs, la France reste la Patrie, même si son pays est l’Algérie ou la Martinique. Beaucoup font d ’ailleurs remarquer que leurs colonies sont
54. Bousquet (G.H.), La politique musulmane, p. 77. 55. Isoait (R), Le problème national vietnamien, p. 219. 56. Demangeon (A.), La France, 2e partie, France économique et humaine, T. I, p. 62.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
plus anciennes que certaines provinces de la métropole : les constitutions des West Indies sont à peu près aussi anciennes que l’union (qui ne fut d ’ailleurs guère moins imposée) de l’Angleterre avec l’Écosse (1707) ; l’Algérie fut française trente avant la réunion définitive de Nice et de la Savoie, pour ne pas parler des « vieilles colonies » : l’occupation de la Martinique, par exemple (1635), est antérieure à l’annexion à la France de Lille ou de Strasbourg. Batavia, capitale des Indes néerlandaises, fut fondée en 1619, quelques années avant l’occupation de Maëstricht par les Provinces-Unies (1632). C’est dans les guerres que s’affirme ce discours filial. Venir au secours de la Métropole, pour les Français ou Anglais d’au-delà des mers, est plus qu’un devoir: c’est la confirmation du pacte qui lie la Métropole et ses colonies. Cette fierté, quelquefois un peu ostentatoire, est symbolisée par le message que Londres aurait reçu de la Barbade, « the oldest and the most English colony », peuplée seulement de 7% de Blancs (15000 sur 200 000 habitants, représentant la majorité des 5 000 électeurs de l’île, il est vrai), au cœur de ce sombre été 1940 au cours duquel la menace d ’invasion, oubliée depuis Bonaparte, planait sur les îles britanniques: « Carry on, Britain ! Barbados is behind you ! »57. De manière analogue, l’hymne, C ’est nous les Africains, célébrera, en 1944, la fierté des Français d ’Algérie (qu’on n’appelle pas encore « pieds-noirs ») d ’avoir constitué, avec les musulmans, la majeure partie des troupes françaises qui ont contribué à la libération de la métropole en 1944, rôle que l’historiographie officielle s’obstine encore à méconnaître. Cet attachement, il est vrai, exige, en contrepartie, une sollici tude constante de la métropole, et un dévouement total à ses enfants d’outre mer. Cette exigence, qui coïncide avec l’idéologie impériale, ne gêne pas pour lors les responsables politiques de la métropole, qui célèbrent à l’envi le rôle des colons dans la mission civilisatrice et l’expansion du pays, flatterie intéressée qui tend à exagérer une fierté qui tourne trop souvent à la déme sure. Elle paraîtra bien encombrante aux heures des décolonisations. Mais, dans l’analyse de cet état d’esprit, il faut sans doute distinguer celui des cadres, envoyés remplir des fonctions de direction, et celui des véritables colons des colonies de peuplement. Les premiers n’ont guère, la plupart du temps, la possibilité ni le désir de séjourner sur place. Le plus souvent, le « colonial » regagne son pays d ’origine, une fois son contrat ou sa carrière finie. La formule de l’orateur britannique du xvm* siècle Edmund Burke, selon laquelle il y a une chose qu’on ne voit jamais en Inde, c’est un Anglais à tête grise, reste valable pour ces territoires. C’est ce qui explique que, même lorsqu’il a apprécié la colonie, et qu’il en rapporte plateaux, tapis, meubles, statues, trophées de chasse naturalisés, voire qu’il se fait construire une villa mauresque, son départ n’est pas un véritable arrachement. C’est seulement une partie de sa vie qui est révolue, et il regrette moins la colonie
57. Morris (J.), Farewell the Trumpets, p. 432.
Les Européens et les autres
que le temps de sa jeunesse. La situation est très différente dans les colonies dites de peuplement, où se sont constituées, dans des conditions climatiques meilleures, ce que Fernand Braudel a appelé de «vivantes et fragiles Europes », fondées sur la succession de plusieurs générations sur un sol que les caveaux de famille commencent à jalonner comme autant de signes de la prise de possession. Cet enracinement crée un fort attachement au pays, auquel n ’est évidemment pas étranger la difficulté à s’installer dans une Europe inconnue et souvent peu compréhensible. Rien d’étonnant si leur acharnement à défendre une société et un mode de vie, y compris dans ce qu’ils ont de moins acceptable, est plus grand. Des colons du Kenya, Evelyn Waugh écrit : « On les entend se plaindre des difficultés commerciales, du gouvernement local et du gouvernement britannique, mais on les entend rarement dénigrer le pays où ils vivent, comme les Anglais le font si volon tiers où qu’ils se trouvent à l’étranger »S8. Les colonies indigènes Les phénomènes migratoires ne concernent pas les seuls Européens. Sous leur contrôle, bien d ’autres mouvements de population, aussi importants, voire plus, se poursuivent ou s’amorcent, et ces modifications contribuent à renforcer la diversité des paysages humains. Qu’on se contente ici de citer le cas de la colonie hollandaise de Surinam en 1930: pour 133000 habi tants, elle comptait moins de 2000 Blancs dont la moitié de Hollandais, 60000 Créoles, descendants des esclaves africains, et 35000 Indiens origi naires des Indes britanniques, et 30000 Javanais, appelés comme travailleurs à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Les quelques milliers restants se répartissent entre les populations amérindiennes résiduelles et les Bush Negroes, c’est-à-dire les descendants d ’esclaves enfuis en brousse, où ils ont constitué des villages59. Le plus ancien des bouleversements est celui qui a conduit, à travers la traite des esclaves, à l’implantation forcée dans les colonies européennes des Amériques de populations d ’origine africaine, qui forment depuis longtemps le fond du peuplement des îles des Caraïbes, et une bonne partie de celui des Guyanes. Ce qu’on pourrait appeler les migrations intercontinentales de main-d’œuvre n ’ont pas cessé avec la fin de ce trafic justement qualifié « d’immonde » bien avant d’être devenu « illicite ». À partir de l’abolition de l’esclavage, au milieu du XIXe siècle, la traite des Noirs a été remplacée par le coolie trade. On désignait ainsi le recours, pour les plantations en général, mais aussi pour les grands travaux (chantiers de chemin de fer), à une maind’œuvre asiatique immigrée, laborieuse, peu exigeante et souvent mal traitée. Si nombre de ces travailleurs sont des célibataires, beaucoup aussi
58. Waugh (E.), Hiver africain, p. 219. 59. Goslinga, The Dutch in the Caribbean, p. 515,521.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
constituent des communautés familiales, dont une partie s’installe de façon permanente. Ce phénomène, plus ou moins durable, s’est combiné avec celui, aux origines plus anciennes, qui poussait des populations traditionnel lement orientées vers les activités commerciales à étendre leurs affaires à une aire géographique de plus en plus vaste ; les communautés ainsi expa triées ont su profiter des opportunités fournies par la sécurité garantie aux transactions par les colonisateurs, et ont participé ainsi à leur côté à la mise en valeur, le tout ajoutant d ’autres dimensions à la variété du paysage humain des colonies. Dans ces mouvements, certains groupes s’imposent plus que d ’autres, en particulier les ressortissants de l’Empire chinois et de l’Empire des Indes. L ’importance de la diaspora chinoise « Abolissez les Chinois, et la colonisation deviendra impossible », écri vait Huxley60. Partout, les observateurs impartiaux font l’éloge de leur fruga lité, de leur esprit d’entreprise, de leur capacité à s’adapter à la fois à la demande locale en produits de consommation, (et à la susciter), et à celle des pays européens en produits tropicaux, qui a permis de multiplier les transac tions, et faciliter le passage d ’une économie de troc à une économie moné taire. Il pense, non seulement à la main-d’œuvre, mais aussi aux capitaux investis dans l’économie. Nulle part, sans doute, les Chinois émigrés ne tiennent une place aussi importante que dans l’Asie du Sud-Est, où leur masse bien implantée de 8 à 9 millions d ’habitants s’oppose à quelque 300000 Européens instables. L’importance relative des communautés de Chinois, enfin, est différente selon les régions. C’est seulement en Malaisie que leur poids démographique est important, puisque les Straits-bom Chinese ou Peranakan représentent en 1941 43 % de la population de la Malaisie et 80 % des 600000 habitants de Singapour. Ailleurs, les Chinois ne constituent que des minorités numéri quement peu importantes, mais concentrées dans les villes. Ils ne sont que 200000 en Birmanie, soit environ 1,3% de la population, mais ils consti tuent près de 10 % de la population de Rangoon. En Indochine, ils ne sont proportionnellement guère plus nombreux, puisqu’ils constituent une communauté de plus de 400000 personnes, installés pour l’essentiel en Cochinchine, où ils ont créé et développé, bien avant l’occupation française, au nord-ouest de Saigon, le quartier de Cholon, et au Cambodge. Les Chinois des Indes néerlandaises ou Babas ne constituent qu’environ 3 % de la population totale (1,2 million de personnes). Bien d ’autres régions ont attiré les émigrants chinois. Leurs commu nautés ont essaimé aussi à Bornéo, et dans les îles de l’Océanie. Ils représen tent ainsi 6000 des 35000 habitants des Établissements fiançais en 1931.
60. Huxley (A.), Le monde en passant, p. 198.
Les Européens et les autres
Des groupes notables existent aussi à la Réunion et à Madagascar, au Mozambique, ainsi qu’à l’île Maurice britannique. Ailleurs en Afrique, la présence de Chinois a été temporaire, la plus importante ayant été celle de 80000 travailleurs recrutés en 1906 pour les mines d ’Afrique du Sud, mais rapatriés après l’expiration de leur contrat. À titre anecdotique, les Italiens ont encore fait venir, après l’occupation de l’Éthiopie, des ouvriers destinés à l’exploitation des carrières de pierre à savon. Le continent noir, comme on va le voir, apparaît comme beaucoup plus ouvert aux migrations venues des Indes. C’est un groupe d’une grande diversité. Ils représentent une population originaire de régions très variées, qui ont souvent besoin d ’interprètes pour se comprendre. C’est le cas des deux groupes les plus nombreux de Singapour, originaires respectivement des régions de Amoy et de Canton. Leur diversité sociale est très grande aussi, car ils sont représentés à tous les niveaux de l’échelle, «coolies de plantations, marchands ambulants de soupe, ouvriers d ’usines, artisans, cuisiniers, mineurs ; par-dessus tout, bouti quiers, négociants; milliardaires, propriétaires de plantations, de mines d’étain, d ’usines »6I. Les formes d ’activités évoluent dans le temps : aux Indes néerlandaises, les activités traditionnelles de prêt sur gage ou de vente d’opium sont supplantées par la prise d ’intérêt dans les productions agricoles et les activités bancaires. La durée de l’installation varie aussi, les simples ouvriers, recrutés par contrats, étant beaucoup moins implantés que les commerçants, installés sur place depuis plusieurs générations. De nombreux témoignages insistent sur la prospérité de ces commu nautés. Si le centre de Singapour a une apparence coloniale anglaise, la plus grande étendue de la ville révèle la prépondérance chinoise : « rues banales, immeubles médiocres, multitude de colporteurs »62. Papeete fait à certains un effet analogue : « les magasins chinois y dominent ; c’est le Chinois qui est presque toujours tailleur, cordonnier, coiffeur. Il laisse la culture de la vanille à l’autochtone, mais prépare la gousse pour l’expédition »63. Certains vont très loin dans l’appréciation de la puissance chinoise. À Singapour, d ’aucuns parlent de «colonie chinoise administrée par les Anglais»64. En 1905, le romancier Claude Farrère, en référence à leur puissance commerciale, les qualifiait de « silencieux conquérants de l’Indochine »6S. Charles Robequain décrit en 1934 « leurs maisons blanches à étage, aux boutiques profondes que ferment la nuit de lourds vantaux », dominant les pauvres paillotes des revendeurs et des colporteurs annamites, et s’alignant orgueilleusement le long des grandes routes et des quais66. Cette vision est sans doute excessive :
61. Gourou (P.), L’Asie, p. 293. 62. Gourou (P.), L’Asie, p. 339. 63. Robequain (Ch.), Madagascar et les bases dispersées de l’Unionfrançaise, p. 504. 64. Michaux (H.), Un Barbare en Asie [1933], Gallimard, 1967, p. 177. 65. Farrère (G), Les Civilisés [1905], in Un rêve d ’Asie, Omnibus, 1995, p. 366. 66. Robequain (Ch.), L’Indochinefrançaise, p. 126-127.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
s’il existe de très grosses fortunes, comme celle de Lee Kong Chian, le roi du caoutchouc et de l’ananas en Malaisie dans les années trente, on peut penser, comme le suggère Vandenbosch à propos des Indes néerlandaises, que leur importance réside surtout dans leur fonction d’intermédiaires et de petits commerçants67. Le rôle des Indiens On pourrait reprendre, quant à la diversité du groupe originaire des Indes, les observations qui ont été faites à propos des Chinois. Les Indiens ont commencé à immigrer dès le milieu du X IX e siècle dans tout l’Océan Indien, et jusqu’aux Antilles (Maurice, Trinidad, Guyane), mais aussi en Océanie, comme travailleurs sous contrat destinés à suppléer le tarissement de la maind ’œuvre africaine par suite de l’abolition de la traite. À la fin des années 1920, ils ne sont pas moins de 125 000 en Guyane britannique sur une popu lation de 300000 habitants68. Excellents agriculteurs, ils ont notamment mis en valeur les environs de la capitale, Paramaribo. Ils constituent, avec une colonie forte de 90 000 personnes, 43 % de la population des îles Fidji69. En Afrique australe, Cap, Natal et Transvaal, ils sont environ 250 000 en 1939. D’abord recrutés pour la construction des chemins de fer, les mines et les plantations (en particulier la canne à sucre du Natal), ils se concentrent de plus en plus dans les villes, où ils sont commerçants et employés, ou maraî chers. Leur rôle est aussi très important en Afrique orientale, britannique ou portugaise, de Zanzibar à la région des Grands Lacs : au Kenya, Ouganda, Tanganyika et Nyasaland, on évalue leur nombre à 100000 (contre 50000 Européens et environ 14 millions d ’Africains)70. Après être venus nombreux pour travailler à la construction du chemin de fer de Mombasa à Nairobi, au Kenya, ils ont tendance à monopoliser le commerce de détail et une bonne partie de l’artisanat. Le Gujarati, langue de la province dont la majorité est originaire, rivalise dans les ports avec le swahili, dont il sera ques tion plus loin. Certains mauvais esprits vont jusqu’à écrire à propos de cette dernière région : « nous sommes venus pour fonder une civilisation chré tienne, et nous avons presque donné naissance à une civilisation hindoue »71. Us ne limitent pas d ’ailleurs leurs affaires aux colonies britanniques : une des grandes fortunes de Djibouti, à la tête d’une puissante maison d ’importexport, représentant d ’entreprises britanniques et américaines, l’Indien MohammedaUy est assez riche pour louer un wagon de luxe (et un fourgon pour sa suite), lors du couronnement du Négus à Addis-Abeba en 193072.
67. Huff (W.G.), The Economie Growth of Singapore, Cambridge University Press, 1994, p. 221-222 ; Vandenbosch (A.), The Dutch East Indies, p. 24. 68. Denis (P.), L’Amérique du Sud, in Vidal de la Blache (dir.). Géographie universelle, A. Colin, 1927, p. 87. 69. Lasker (B.), Les peuples de l’Asie en mouvement, Payot, 1946, p. 193. 70. Frankel (S.H.), Capital Investment, p. 236. 71. Waugh (E.), Hiver africain, p. 204. 72. Dubois (C), Djibouti 1887-1967, l'Harmattan, 1997, p. 167.
192
Les Européens et les autres
Mais ce sont les grands pays de plantations qui environnent l’Inde qui les attirent le plus, en particulier Ceylan, où les Tamoul, originaires de la région de Madras, sont près de 800000 en 1929, et la Malaisie, où on en compte près de 500000, y compris à Singapour. Ils sont aussi très nombreux en Birmanie, où on évalue leur nombre à un million (sur 15 millions d ’habi tants), dont la majorité est installée à Rangoon, où ils constituent les deux tiers de la population à la veille de la guerre. La plupart travaillent dans les ports, sur les chantiers, où ils entrent en concurrence avec la main-d’œuvre birmane, ainsi que dans les mines ou dans les champs. Mais par ailleurs, ils s’assurent un quasi-monopole dans les professions libérales et aussi l’admi nistration ; il faut souligner aussi la part croissante prise par les usuriers indiens, désignés le plus souvent, d ’après le nom de leur caste, du terme de chettyars. Originaires, le plus souvent, de la côte de Coromandel, ils ont réussi à acquérir environ le quart des terres du pays73. Le Chetty (version française du même terme), joue un rôle analogue en Cochinchine, où les Indiens portent le nom générique de « Malabars ». Il faut observer que c’est souvent à l’étranger que les Indiens ont pris conscience de ce qui pouvait les rapprocher en dépit des clivages de castes et des clivages religieux. Il suffit de rappeler que c’est au cours de plus vingt ans passés en Afrique du Sud (1893-1914) que Gandhi a mené ses premières actions visant à restaurer la dignité des Indiens, en appliquant le principe de non-violence (satyagraha) auquel il ne cessera jusqu’à sa mort de se référer. Mais on pourrait en dire autant des Chinois. Ceux-ci, entre les deux guerres, ont tendance à affirmer de plus en plus une identité d ’ailleurs toujours vigou reusement ressentie, ce qui s’exprime par le développement d ’une presse et par la création d’écoles. Autres mouvements Le rôle de commerçants est plutôt tenu, dans les possessions d ’Afrique occidentale, par les « Syriens » (en fait Libanais en presque totalité, chrétiens le plus souvent, mais musulmans, et notamment chiites en nombre de plus en plus grand), qui sont plus de 5 000 dans l’Afrique occidentale française vers 1936, la moitié étant installée au Sénégal, et plus de 3 000 dans les colonies britanniques, essentiellement en Nigeria. Ils ont le plus souvent commencé par être des agents des grandes compagnies de traite, dont ils s’émancipent graduellement, pour pratiquer pour leur compte le commerce de détail, voire pour créer eux-mêmes des maisons de commerce concurrentes, et com mencer à participer directement aux activités agricoles. Ils ne bornent pas leurs activités aux colonies d ’Afrique, puisque certains d ’entre eux sont installés dans les Guyanes. L’émigration syrienne, qui trouve son origine dans l’ouverture sur l’Occident de la montagne libanaise au XIXe siècle, et a été surtout dirigée 73. Fisher (C.), South East Asia, Londres, Methuen & Co, 1964, p. 183.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
vers les Amériques, pourrait être considérée comme une des manifestations parmi d ’autres, et la plus tardive, du grand mouvement migratoire qui, depuis le Moyen Âge, a amené des colonies arabes à essaimer en Afrique, dans l’Océan Indien. Ils y ont fondé une série de comptoirs, points de départ, non seulement d ’une activité commerciale, mais aussi d ’une diffusion de la langue arabe et d’une expansion de la religion musulmane. Les plus impor tants sont l’île de Zanzibar, vue par les Anglais comme « un État arabe sous protection britannique », auxquels font face, sur le continent, Tanga et Dar es-Salam, au Tanganiyka, et, plus au nord, Mombasa au Kenya. Le swahili (littéralement « parler de la côte »), langue de type bantou, mais largement pénétrée d’arabe, s’est imposé comme une lingua franca dans toute l’Afrique orientale et australe. D’abord écrit en caractères arabes, il est trans crit en caractères latins, et fait l’objet, à partir des années trente, d ’un travail d ’unification. Il deviendra langue nationale au Kenya et au Tanganiyka. Mais on trouve d’autres colonies arabes jusqu’en Indonésie. Par exemple, à la fin des années 30, une quarantaine de milliers d ’Arabes, originaires pour la plupart de la région du Hadramaout, sont installés à Java, mais continuent à entretenir des liens étroits avec leur patrie d ’origine, entretenus par de fréquents voyages7475. D’autres mouvements se poursuivent sous la domination européenne. Chinois et Indiens ne sont pas les seuls peuples d ’Extrême-Orient à envoyer des hommes au-delà des mers. Dans les Indes néerlandaises, des Javanais commencent à s’installer dans les Provinces extérieures, où ils s’emploient d ’abord comme travailleurs temporaires sur les plantations, avant de faire venir leurs familles. Ils s’implantent notamment à Sumatra, mais aussi à Bornéo et aux Célèbes. D’autres ont émigré en Nouvelle-Calédonie, où ils représentent environ S 000 personnes en 1936, et où ils côtoient 2 500 Anna mites. Mais on en retrouve dans la province sud-africaine du Cap, ou encore dans la colonie hollandaise du Surinam. Si, comme on l’a vu, des Annamites sont employés en Océanie (un peu moins de 20000 auraient émigré entre 1920 et 1930), les Français ont surtout encouragé, par l’extension des travaux de dragage du delta du Mékong, une émigration déjà ancienne (accompagnée de conquête avant l’occupation coloniale) en direction de la Cochinchine, riche et sous-peuplée, où ils achèvent de submerger les Cambodgiens73. Les déplacements touchent aussi des populations africaines. Les indigènes du Cap-Vert sous domination portugaise travaillent ainsi comme ouvriers du bâtiment sur la côte occidentale d ’Afrique. En 1931, la Gold Coast, peuplée de moins de 3 millions d ’habitants, n’accueille pas moins de 300000 immigrants, dont deux tiers sont originaires des territoires français de l’AOF. La prospérité indéniable de la colonie n’explique pas tout Les départs ont aussi pour objet de fuir les charges (taxes, corvées, conscrip
74. Bousquet (G.H.), La politique musulmane, p. 40-41. 75. Robequain (Ch.), L’Indochinefrançaise, p. 176-177.
Les Européens et les autres
tion militaire) plus lourdes en AOF que dans les pays voisins76. La guerre contribuera cependant à fixer sur place une partie de ces populations. La cohabitation des « colons » européens et des autres immigrants avec des populations indigènes qui, on Ta vu, sont loin d ’être elles-mêmes homo gènes, implique des formes de fonctionnement social profondément diffé rentes de celles qui constituent alors, sinon toujours la réalité, du moins la norme dans les pays d’Europe occidentale.
76. Crowder (M.), West Africa, p. 339.
195
O rin i
I frn m
Chapitre 7
Fonctionnem ent social : dualism e et pluralism e
Remaniements coloniaux et traditions locales On a pu voir suffisamment, au cours des chapitres précédents, que ce sont des populations très différentes, au surplus très éloignées géographiquement, que les vicissitudes des conquêtes ont amené à regrouper sous une même drapeau, pour faire des empires coloniaux des sortes de kaléidoscopes. Les empires, de ce point de vue, méritent bien l'expression de Mirabeau de «conglomérats de peuples désunis », rassemblés par la logique de la volonté impériale, mais n’ayant, au total, pas grand-chose en commun, chacun vivant très largement sa vie propre, avec sa culture particulière, marquée par ses pratiques religieuses, ses conceptions artistiques ou esthétiques, ses struc tures familiales, ses coutumes. Il est évident que la solidité de l’ensemble ne s’explique que par la capacité du centre à s’imposer à la périphérie, capacité elle-même fondée sur une puissance matérielle et une volonté politique. Au surplus, l’expression de juxtaposition n’est qu’une vision partielle de la réalité, si elle évoque l’image de peuples homogènes vivant séparés sur des territoires bien délimités. Elle vaut, bien évidemment, en approximation grossière, pour indiquer la situation de groupes géographiquement et cultu rellement éloignés, et pourtant réunis sous la domination coloniale, comme les Kabyles et les Annamites de l’Empire français, ou bien encore les Cingalais et les Chypriotes de l’Empire britannique. Mais, sur un même espace, la complexité est beaucoup plus grande. En effet, à l’intérieur des différentes entités géographiques et administratives régionales qui compo sent un empire colonial, des groupes différents vivent côte à côte, d ’une manière complémentaire, mais en gardant chacun sa spécificité. Au surplus, les populations sont souvent très mêlées. Il n'existe guère de circonscription qui se caractérise par une uniformité totale du peuplement. L’établissement de colons occidentaux ou orientaux est venu ajouter une communauté supplémentaire à cette situation de « bigarrure » humaine, si différente de l’homogénéité (au moins relative) des peuplements des métropoles. Cette situation implique des contacts ou des échanges qui méritent d ’être étudiés.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Le dualisme juridique Comme on vient de le voir, les sociétés regroupées dans les empires sont, par définition, multiples. Mais il n ’existe pas moins, entre les différents habi tants des colonies, un clivage fondamental, qui découle de la nature même de la domination politique et économique de l’Europe, et qui oppose les Européens et les indigènes, d ’une manière si radicale qu’il est aisé d ’en tirer des caricatures. Le statut des uns et des autres, à l’égard des lois, des règle ments et des pratiques, en constitue l’aspect fondamental, bien avant l’ex posé des conditions matérielles évoquées plus haut Toutes les législations font une différence entre les ressortissants euro péens de la puissance coloniale et les indigènes, nés dans les pays qui en dépendent. Le statut juridique des indigènes des colonies, considérées comme des extensions du territoire de l’État, nation ou royaume, est celui de sujets de la puissance coloniale. Ceci revient à dire qu’ils ont la nationalité de celle-ci, française, britannique, néerlandaise, etc., à l’instar des habitants de la métropole. Les ressortissants des protectorats ou des mandats ont, quant à eux, le rang de protégés, c’est-à-dire qu’ils conservent la qualité de sujets de leur souverain ou de nationaux de leur État, tout en pouvant se prévaloir à l’étranger de la protection de la puissance de tutelle. Dans l’Empire des Indes, les habitants des provinces ont ainsi la qualité de sujets britanniques, alors que ceux des États princiers ont celle de protégés. Les uns et les autres voyagent cependant avec des passeports britanniques1. Les auteurs de l’époque ont tendance à insister sur la générosité de cette façon de faire. Il est vrai que la possibilité, pour des voyageurs ou des commerçants, de se prévaloir de l’appartenance à une grande puissance, et de pouvoir s’ap puyer sur le réseau de ses consulats à l’étranger n’est pas sans valeur. Mais il faut bien reconnaître qu’il s’agit là d ’une contrepartie normale à la conquête, qui a privé les peuples de leur indépendance. Le geste n’est pas, d ’ailleurs, totalement désintéressé, car il a le double avantage d’empêcher les revendi cations d ’autres puissances sur ces peuples, et de permettre d ’exiger leur obéissance et leur loyalisme envers la métropole, au nom de leur solidarité avec elle. Les Français, si critiques à l’égard de la manière dont l’Allemagne a imposé sa nationalité aux Alsaciens-Lorrains en 1871, ne songent guère à faire de rapprochement entre cet épisode et la pratique de leur propre poli tique outre-mer. Il va de soi, fort logiquement, que la condition de protégé n’implique pas de droits politiques particuliers vis-à-vis de la métropole, puisque les protégés gardent une nationalité qui est celle de leur pays ou la qualité de sujets de leur souverain. Dans aucun de ces pays n’existaient, n ’ont subsisté ou n’ont été mises en place des institutions de style démocratique telles
1. Jones (J. Merwyn), British Nationality, Law and Practice, Oxford, Clarendon Press, 1947, p. 297.
198
Fonctionnement social : dualisme et pluralisme
qu’on les entend en Europe. La longue liste des mandats et protectorats réduit ainsi singulièrement le nombre d ’indigènes qui pourraient aspirer à des droits analogues à ceux des métropolitains. Mais même dans des terri toires qui sont considérés de plein droit comme français ou britanniques, nationalité n’implique pas citoyenneté. Les habitants des colonies qui n ’ont pas acquis la nationalité par une filiation métropolitaine ou par les modes de naturalisation individuelle prévue pour les étrangers ne peuvent en principe jouir dans leur propre pays des droits politiques qui sont attachés à la recon naissance de cette nationalité. De ce point de vue, leur condition peut être assimilée à celle de mineurs (catégorie qui inclut les femmes dans la France d'avant 1945). Il n ’est pas possible au sujet africain ou asiatique de Sa très Gracieuse Majesté de dire fièrement Civis Britannicus Sum, à l’instar du sujet anglais, écossais, gallois, voire même irlandais, pas plus que des Blancs des Dominions. Les indigènes occupent ainsi une situation qui est présentée par les juristes comme intermédiaire entre celle des citoyens de la puissance coloniale et les étrangers, ce qui cache le fait que la barrière passe plutôt, en fait, entre les Européens (ou assimilés) et les autres. De cette situation découle, évidemment, la place subalterne qui est faite aux populations indigènes dans le système de gouvernement de leur pays. On ne peut parler de démocratie et d ’émancipation véritable que pour une vingtaine de millions d ’habitants, ceux du Canada, d ’Australie et de Nouvelle-Zélande, population d’origine européenne qu’on ne songerait pas à qualifier de Natives. Dans tous ces pays existe un gouvernement responsable devant un parlement élu au suffrage universel. Encore faut-il éviter de poser la question des populations autochtones «résiduelles», Indiens et abori gènes. Ailleurs, même lorsque des institutions représentatives existent, celles-ci se trouvent doublement limitées dans leurs pouvoirs, par les attribu tions du gouverneur, mais aussi par la place qui est donnée aux représentants de la communauté européenne, toujours bien supérieure à son importance numérique, sinon à sa fonction économique, tandis que, la plupart du temps, les indigènes sont nommés, quand ils ne sont pas purement et simplement représentés par des fonctionnaires européens. N’échappent à ce régime que de petites minorités (environ un million d’habitants), situées le plus souvent dans les territoires français : Antillais, Réunionnais, Guyanais, résidents des « quatre communes du Sénégal », des comptoirs de l’Inde, ou habitants de Tahiti, dont les habitants disposent du droit de vote intégral, mais dans lesquels la puissance de l’administration coloniale reste grande. Encore, dans les comptoirs de l’Inde, les élections aux conseils locaux ont-elles lieu sur deux listes différentes, Européens et indigènes nommant chacun un nombre égal de représentants ; de plus, ils ne peuvent voter, comme les Sénégalais du reste, en dehors de leur colonie. Cette différence par rapport aux ressortis sants des Antilles vient du fait que, à l’inverse des premiers, ils ont conservé leur statut personnel. Inversement, la représentation des territoires des empires au sein des institutions électives de la métropole est très faible : dans l’Empire français,
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
en 1931, seule l'Algérie, les vieilles colonies et la Cochinchine envoient quelques députés et sénateurs au Parlement à Paris, qui ne représentent réel lement que moins de deux millions de Français résidant outre-mer, soit à peu près 3 % ; du moins siègent-ils dans des assemblées dotées de réels pouvoirs, ce qui n ’est pas le cas des quelques députés (blancs) des territoires d ’Afrique portugaise qui siègent dans une Assemblée nationale de Lisbonne réduite au rôle de chambre d’enregistrement Ce type même est absent des institutions britanniques ou hollandaises, même si, parfois, on y voit siéger quelques représentants des colonies, élus par des électeurs de la métropole. Le cas le plus célèbre est celui de Dadabhai Naoroji, « le grand vieillard de l’Inde », ancien président du Parti du Congrès, envoyé en 1892 comme député du parti libéral par les électeurs de la circonscription de Finsbury au Parlement britannique2. La seule véritable représentation reste celle des hauts fonction naires installés sur place, et en premier lieu des gouverneurs, ou des repré sentants des ministères, qui n’hésitent pas, du reste, à faire valoir leur point de vue, mais se placent, au mieux, en position d ’arbitres. L’absence ou le caractère limité du droit de vote reconnu aux «indi gènes » est sans doute ce qui frappe le plus un observateur de nos jours. Cette situation a ceci de critiquable, voire de scandaleux aux yeux d ’un démocrate qu’elle nie le principe de la souveraineté nationale, et interdit toute évolution vers l’indépendance. Ceci est du reste bien conforme à l’état d ’esprit, au moins officiel, d ’une époque où la décolonisation paraît loin taine, voire impossible. Mais il ne faut peut-être pas en exagérer la portée. Pour la masse de la population d ’abord, l’exercice d’un droit de vote à l’oc cidentale n’apparaît pas forcément une priorité. La manière dont s’exprimait traditionnellement la confiance des populations à leurs chefs ou à leurs anciens empruntait d ’autres voies que celle du suffrage universel. La trans mission respectueuse, mais plus ou moins véhémente, des doléances, aux autorités, la lenteur calculée des communautés rurales à s’acquitter de leurs obligations, l’émeute, voire la révolte armée constituaient partout, comme dans la société française d ’Ancien Régime, autant de degrés de résistance aux injonctions du pouvoir, dont celui-ci était forcé de tenir compte. Ces formes d ’expression des besoins ou des mécontentements n’ont pas disparu avec la colonisation, et les responsables de l’ordre public, surtout ceux du terrain, administrateurs ou District Officers, qui seront étudiés plus bas, y sont très sensibles. Il faut penser, par ailleurs, que les territoires coloniaux n’ont pas des institutions aussi démocratiques que celles en vigueur dans la mère-patrie. En général, l’organisation des pouvoirs donne l’essentiel de l’autorité à l’ad ministration, ce qui revient à dire que les assemblées élues n’ont guère d ’im portance, et que le fait de ne pas pouvoir y siéger, bien qu’humiliant, est rela
2. Fischer (L.), The Ufe of the Mahatma Gandhi, Londres, Harper & Collins, 1997 [1951], p. 103.
Fonctionnement social : dualisme et pluralisme
tivement de peu de conséquence. La question ne se pose, paradoxalement, que lorsque les institutions se veulent calquées sur celles de la métropole : les Européens se voient alors dotés de pouvoirs considérables, aux dépens des indigènes, peu ou pas représentés, ce qui crée une situation plus discri minatoire que là où des autorités coloniales issues de la métropole gèrent le pays de manière autoritaire. De ce point de vue, on pourrait dire que, para doxalement, il y plus d ’inégalités entre des Algériens ou des Noirs d'Afrique du Sud par rapport aux Français ou aux Afrikaners, qu’entre les Portugais et les Noirs de l’Angola, ou les Italiens et les Libyens, que les régimes dictato riaux {vivent à peu près également d ’un libre droit de représentation. Le statut de sujétion apparaît bien plus évident en matière de règlements de police et de libertés individuelles. En aucun domaine, il ne paraît y avoir plus de contradiction entre la proclamation, en territoires britannique et fran çais notamment, d’un principe qui souligne l'égale dignité de tous les sujets de l’Empire, et la restriction de son application. Partout, les indigènes sont soumis à une véritable «tyrannie administrative» qui se traduit par la soumission à une réglementation spéciale qui constitue ce que les Français appellent «statut de l’indigénat». Des dispositions applicables aux seuls indigènes permettent aux fonctionnaires européens, mais aussi aux chefs coutumiers, de leur infliger amendes et peines de prison de leur propre chef, sans aucune procédure judiciaire. Cela a pour but de renforcer leur autorité, mais aussi de pouvoir réprimer des délits inconnus dans le droit pénal des métropoles : dans les colonies françaises, il est ainsi possible de punir les «procédés irrespectueux» ou les «manœuvres destinées à surprendre la bonne foi des autorités ». Des peines sont infligées aux indigènes qui sont inapplicables aux Européens : en particulier, les châtiments corporels, géné ralement abolis en droit, restent appliqués en fait ; dans les colonies britan niques, comme la Birmanie, le fouet est d’ailleurs encore officiellement appliqué. La liberté de circulation est strictement limitée, l’exemple le plus extrême étant celui du régime des laissez-passer (Passes) imposés en Afrique du Sud depuis le XIXe siècle, et régulièrement alourdi par la suite. Toutes ces dispositions représentent l’expression d ’un régime très inégalitaire, qui contribue à réduire très fortement les libertés fondamentales comme celles d’expression, de réunion ou d ’association, qui sont, il est vrai, très réglemen tées dans les colonies, sans regard d ’origine, cette fois. Certes, la condition d’indigène ou de Native n’est pas exclusive de certaines garanties. Par exemple, le montant des amendes ou la durée des peines infligées par l’admi nistration est limité (quinze jours et 100F en territoire français), les peines plus lourdes étant du ressort de tribunaux constitués avec des garanties suffisantes. Elle reste, malgré tout, synonyme de statut inférieur par rapport à celui du citoyen originaire de la métropole.Il Il faudrait aussi indiquer enfin que les prestations demandées aux indi gènes sont rarement analogues à celles qui incombent aux Européens. Comme on l’a montré plus haut, il a paru, en effet, légitime aux maîtres des colonies d ’exiger de la population autochtone une participation à la « mise
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
en valeur», soit privée, soit publique, alors que celle-ci ne voyait guère (et à juste titre), l’intérêt de sortir de ses traditions, sous forme de travail obliga toire ou d ’impôts incitatifs. Les Européens, en revanche, sont dispensés de toute prestation sous forme de travail, de même que des impôts dits « indi gènes ». Même si l’évolution paraît en faveur de l’alignement (suppression des « impôts arabes en Algérie en 1919 ; fin du monopole de l’alcool en Indochine) des différences très nettes subsistent à la veille de la guerre, notamment en ce qui concerne les impôts dits de capitation. La discrimination, enfin, vise les fonctions dites en France « d’autorité ». C’est moins la compétence intellectuelle qui fait problème que le risque que ferait courir à la domination l’exemple du ressortissant d ’une colonie admis à y exercer un commandement, alors que sa condition est celle d ’un sujet. Il est impossible de placer, en théorie, un Européen, sous les ordres d ’un indi gène. C’est le cas de toutes les fonctions impliquant une haute responsabilité politique, depuis le gouverneur jusqu’aux chefs de circonscriptions régio nales, dont il sera question plus bas. C’est le cas aussi des armées. Les officiers sont très rares, et cantonnés le plus souvent dans des fonctions subalternes. Les grades d ’officiers restent accordés avec parcimonie, d’au tant plus facilement, d’ailleurs, que la majorité des notables indigènes n’est pas attirée par le service des armes tel que l’entendent les Européens, jugé trop asservissant pour un homme de distinction. On ne compte qu’une poignée d ’officiers indigènes aux Indes, en dépit de la création du Prince o f Wales’ Royal Indian Military College de Dehra Dun en 1932, dont les promotions ne forment qu’une soixantaine d ’officiers par an. En France, ce n’est qu’en 1938 que, par un décret du ministre des Colonies Geoiges Mandel, les indigènes d ’Indochine se voient reconnaître le droit de se présenter aux écoles militaires françaises, dont disposaient déjà depuis peu de temps les Africains3. C’est malgré tout dans le groupe limité de ses citoyens d’origine africaine ou afro-américaines que la France peut s’enoigueillir de faire accéder des gens de couleur à des responsabilités dévolues, en principe, à des Blancs. Parmi les plus célèbres, on peut citer les Martiniquais René Maran ou Félix Éboué, né en Guyane, tous deux administrateurs des colonies. Si le premier, après avoir obtenu en 1925 le prix Goncourt avec son Batouala, doit quitter ses fonctions à la suite de publications polémiques jugées incompatibles avec sa qualité de fonctionnaire, le second, comme on sait, sera nommé gouverneur du Tchad en 1938, et, après son ralliement à la France libre, terminera sa carrière comme gouverneur général de l’AEF (1940-1944). Certains d ’entre eux occupent même des fonctions gouvernementales: successivement, le Sénégalais Biaise Diagne en 1931, le Guadeloupéen Gratien Candace en 1932, et le Guyanais Gaston Monnerville en 1937 sont sous-secrétaires d’État aux Colonies, position évidemment modeste, mais
3. Bulletin du Comité de l ’Asie française, 1939, p. 27.
Fonctionnement social : dualisme et pluralisme
qui a de quoi faire rêver bien des hommes de couleur dans les autres empires ou aux États-Unis. Il faut remarquer que le statut « d ’indigène» suit l’autochtone d’une colonie en-dehors de celle-ci, non seulement dans les autres possessions de la puissance dont il est le sujet, mais dans celles des autres puissances colo niales. Il est, par suite, soumis aux mêmes contraintes que dans son pays d’origine, alors que les étrangers d ’origine européenne, ou encore, depuis la fin du XIXe siècle, les Japonais, forts de la puissance de leur État, en sont dispensés. Il est amusant de voir, dans une statistique de Nouvelle-Calédonie de 1936, les 1430 Japonais résidant alors dans le pays comptabilisés avec les 17 384 habitants dits de « race blanche », ce qui confirmerait, s’il en était besoin, que ce concept n’a guère, en l’espèce, de réalité biologique4. Le gouvernement chinois s’efforce d ’obtenir les mêmes avantages pour ses ressortissants, mais sans beaucoup de succès, faute de parler au nom d ’une puissance suffisamment redoutable. En revanche, un indigène établi en métropole ou dans un pays étranger d ’Europe ou d ’Amérique peut jouir, ipso facto, de droits politiques beaucoup plus étendus que chez lui, ne serait-ce que parce que, par définition, la condition d ’indigène n’y est pas réglementée en tant que telle. Bien des jeunes africains ou asiatiques émigrés, par exemple, en France ou aux États-Unis, seront sensibles à cette atmosphère de liberté, même si elle ne va pas jusqu’au droit de vote. L’égalité complète des indigènes avec les Européens dans leur propre pays leur est très difficile à acquérir, car, en bonne logique, ils devraient prouver qu’ils sont devenus semblables à ces derniers. Cette assimilation totale est à peu près invraisemblable pour les Britanniques et les Hollandais, qui ne semblent pas s’être posés la question. En revanche, les pays latins ont envisagé cette éventualité, mais elle demeure largement théorique. Dans les territoires portugais, par exemple, pour être reconnu comme civilizado, ce qui permet d ’échapper au code indigène, il est exigé la pratique du portugais parlé et écrit, qui n’est pas demandée aux Blancs, dont près de la moitié pourtant sont analphabètes. Ceux-là même qui remplissent cette exigence sont peu nombreux à voir aboutir leur démarche. En 1961, date de l’abolition de ce régime, moins de 2 % des Noirs jouiront de ce statut, accordé par ailleurs à moins de 50 000 métis. Les Espagnols appliquent des dispositions analogues, en instaurant, à partir de 1928, un statut d ’émancipé, qui est accordé plus libéralement, en particulier aux habitants de Fernando Po, qui ont subi une forte empreinte des missions catholiques. De manière analogue, les dispositions qui permettent à un « sujet français « d’acquérir la citoyenneté pleine et entière constituent autant de filtres qui ne laissent passer que bien peu de postulants. Le principe, fondé sur la tradi tion jacobine, consiste à imposer la renonciation au statut personnel comme
4. Bulletin du Comité de l ’Asie française, 1938, p. 101.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
préalable à l’octroi des droits civiques. Ceci suffirait déjà à écarter nombre de ressortissants des colonies dont la plupart restent fortement attachés à leurs lois et à leurs coutumes, souvent inextricablement mêlées à la foi reli gieuse, comme les musulmans. Mais, même pour ceux qui seraient décidés à faire ce pas, cette renonciation n’a pas d ’effet automatique. La jouissance des droits civiques ne peut en effet intervenir qu’à l’issue d ’une procédure si exigeante qu’elle est fréquemment désignée du nom impropre de « naturali sation». Il faut attendre le gouvernement du Front populaire pour voir prendre en compte des projets qui visent à attribuer automatiquement la citoyenneté à des élites intellectuelles (diplômés) ou à de loyaux serviteurs de la France (anciens combattants décorés). Des mesures sont prises en ce sens en Indochine, à Madagascar et en AOF ; mais elles ne peuvent guère y avoir d’importantes conséquences politiques, étant donné le faible rôle qu’y occupent les institutions électives et le fait que les autorités conservent le droit de refuser d’inscrire ceux qui, par actes, écrits ou paroles, ont manifesté des intentions hostiles contre la France, constitue toujours une condition diri mante3. Quant à l’Algérie, l’échec est total, devant l’opposition des représen tants des colons, que le gouvernement n’ose pas affronter. Ces difficultés sont à opposer à la facilité avec laquelle, grâce l’application des lois de natu ralisation, un fils d ’immigrant originaire d ’Espagne, d ’Italie ou d ’un autre pays européen et installé en Algérie peut devenir français à sa majorité.
Il est certain que l’opposition entre Européens et indigènes constitue la distinction fondamentale de la plupart des sociétés coloniales. Il importe cependant de beaucoup nuancer. Tout d ’abord, cette opposition n’est pas, ou pas seulement, une conséquence du mode d ’exploitation coloniale, comme pourrait le faire croire un marxisme un peu court. Elle résulte largement des structures de fonctionnement auxquelles elle se surimpose, fût-ce, diraient ses adversaires, pour les pervertir. D’autre part, elle n’exclut pas certaines formes de rapprochement. Là encore, on doit s’interdire de généraliser, aucune situation n’étant totalement comparable à une autre. Pour mieux comprendre les réalités du fonctionnement d’une société coloniale, il convient de recourir au concept de plural societies, terme qu’on traduit souvent de nos jours par « sociétés plurielles », mais pour lequel il paraîtrait préférable de conserver la nuance théorique de « sociétés plurales», qui implique non pas seulement une constatation, mais une logique de fonctionnement Ce terme, appelé de nos jours à tant de fortunes, bonnes ou mauvaises, paraît avoir été forgé en 1938 par l’administrateur britannique Fumivall, dans son livre devenu classique sur les Indes néerlan daises. Il entend par là une société composée de différents groupes vivant
5. Bulletin du Comité de l ’Asie française, 1937, p. 250.
204
Fonctionnement social : dualisme et pluralisme
côte à côte, mais séparément, au sein de la même entité politique. Les popu lations, « se mêlent mais ne fusionnent pas ». Chaque groupe a sa propre reli gion, sa propre culture et sa propre langue, ses idées et ses coutumes particu lières. Les échanges matrimoniaux sont pratiquement inexistants. U y a des contacts individuels, mais « seulement sur la place du marché, pour vendre et acheter »6. L’auteur souligne que ce type de société n’est pas propre au pays étudié mais est « typique des dépendances tropicales où les gouvernants et les gouvernés sont de races différentes », mais aussi de l’Afrique du Sud, du Canada, de l’Irlande, et des États-Unis7. Ce modèle, comme on le verra, décrirait assez bien l’attitude des Européens à l’égard des indigènes pour tout ce qui concerne, en tout cas, le refus de tout mélange. Mais il contribue à rendre compte, plus largement, du fonctionnement des sociétés coloniales, dans lesquelles se juxtaposent, comme on l’a vu, bien des groupes différents. Il faut noter, en effet, que le refus de ceux-ci de se fréquenter au-delà de certaines limites est bien anté rieur à la colonisation, dans la mesure où ce modèle était celui que connais saient, traditionnellement, toutes les constructions impériales. Par exemple, dans l’Empire ottoman, l’organisation des populations non musulmanes (chrétiens des différentes obédiences et juifs) reposait sur la notion de millet, terme qui servait à désigner les diverses communautés religieuses, dont les représentants jouissaient du statut d’intermédiaires officiels avec les agents de l’État. Les membres des différents millet étaient régis chacun par son statut personnel particulier. Le terme millat est encore employé dans l’Inde, au XXe siècle, pour désigner la minorité musulmane. Même s’il ne repose pas sur une base raciale, comme l’affirme, par exemple, Michel Leiris, ce qui serait d ’ailleurs à prouver dans chaque cas, ce qu’on pourrait appeler le « marquage identitaire » n’en est pas moins vigou reux. Il ne fait que traduire le souci d ’assurer la pérennisation d ’une tradition jugée indispensable, par la reproduction à l’identique d’une forme d’éduca tion véhiculant les savoirs et les valeurs considérés comme les seuls vala bles. D’où le refus d ’accueillir des femmes extérieures au groupe, et plus encore de donner ses filles à des « étrangers », ou bien encore de se mêler trop étroitement à eux. Il ne s’agit pas seulement d ’un attachement senti mental à des traditions ; il s’agit d ’abord d ’éviter de laisser se dissoudre, par négligence, tout ce qui distingue un homme lié à ses ancêtres et à ses dieux par un langage spécifique, fait de rites, de coutumes et de comportements dont aucun n ’est spontané, d ’autres hommes qui pratiquent autrement, ces pratiques étant pratiquement toujours estimées moins bonnes que celles du groupe, qui se considère lui-même comme le centre du monde.
6. Fumivall (J.S.), Colonial Policy. Voir Tarling (N.), ed., The Cambridge History of Southeast Asia, vol. 2, Cambridge University Press, 1992, p. 109. 7. Fumivall (J.S.), Netherlands India, p. 447.
205
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Cette attitude est particulièrement répandue chez les fidèles des deux reli gions qui, à elles seules, représentent la grande majorité des populations coloniales, à savoir l’islam et l’hindouisme. L’une et l’autre ont considéra blement entretenu le sens du pur et de l’impur, de l’interdit et du licite, plus en tout cas que chez les sectateurs de la religion chrétienne, dont l’influence en Europe est de plus en plus combattue par le rationalisme ou l’utilitarisme. Un musulman orthodoxe selon la forme traditionnelle ne peut avoir avec des « infidèles » que des rapports limités, puisqu’il ne peut ni manger leur nourri ture, ni épouser leurs femmes. Les « gens du Livre » (chrétiens, juifs, zoroastriens) ne sont acceptés, en théorie, que comme «dhim m is», c’est-à-dire protégés, tolérés, mais avec un statut inférieur. Chez les hindouistes, le système des castes avec ses quatre vanta et son infinité de Jâti, et ses cinquante millions de parias, hors-castes ou «intouchables», divise la société en une série de groupes fermés et généralement endogames. La vue seule, par des « impurs », de la nourriture d ’un brahmane, suffit à souiller celle-ci. Le mépris des castes supérieures à l’égard des castes inférieures, et la servilité de celles-ci à l’égard de celles-là, révélées, entre autres, par Mulk Raj Anand en 1935, dans son roman Untouchable, paraissent insupportables même à un anthropologue comme Claude Lévi-Strauss, plus porté par métier à l’analyse qu’au jugement8. Les efforts faits pour revaloriser la condition des «intouchables», soit par des leaders politiques comme Gandhi (qui voyait dans cette condition un «crim e contre l’humanité») soit par des «intouchables» organisés en associations, n’ont que des résultats très partiels. Leur admission dans les écoles, voire même leur présence dans les salles des tribunaux, ne vont pas sans problèmes. Chez les hindouistes comme chez les musulmans, la vie sociale de la femme se limite aux autres femmes et aux hommes de sa famille. Aux Indes, la pratique du purdah en fait un être cloîtré. Cela interdit toute véritable sociabilité entre ces groupes, y compris celui des Européens, que cela renforce dans leurs propres préjugés. Par exemple, bien des Européens d ’Afrique du Nord refusent de recevoir des jeunes hommes musulmans à leurs bals en arguant du fait que les jeunes filles musulmanes sont tenues par leurs pères et leurs frères à l’écart des jeunes des autres communautés. Par bien des côtés, en effet, tout se passe comme si les Européens consti tuaient une communauté parmi d ’autres, soumise, en tant que telle, aux mêmes phénomènes de mise à distance qui règlent le fonctionnement des sociétés dans leur ensemble. Se référant au Marchand de Venise de Shakespeare, O’Malley écrit « l’attitude de l’Hindou orthodoxe est la même que celle que le dramaturge attribue à Shylock envers les chrétiens : il achè tera avec eux, vendra avec eux, parlera avec eux, marchera avec eux, mais il ne mangera pas avec eux, ne boira pas avec eux, et ne priera pas avec eux »9. Par bien des côtés, leur attitude de rejet leur paraît le juste retour de l’attitude
8. Lévi-Strauss (G), Tristes tropiques, p. 156. 9. O’Malley, Modem India, p. 582 ; Shakespeare, The Merchant of Venice, acte I, scène 3.
206
Fonctionnement social : dualisme et pluralisme
exclusive des groupes voisins à leur égard. Dans les colonies d ’Afrique orientale britannique, bien que généralement peu considérés par les Anglais les Indiens n’en ont pas moins tendance à partager leur mépris vis-à-vis des « primitifs », Africains par exemple, avec lesquels ils sont rarement disposés à se solidariser. C ’est à la langue arabe, par le détour du swahili, que les Blancs d ’Afrique du Sud ont emprunté le terme de Kafir (litt, incroyants) employé dans un sens purement racial à l’égard des Noirs. Les Européens ne connaissent pas (à l’exception des juifs) d ’interdits rituels. Mais le souci d ’hygiène, renforcé par les souvenirs récents de la forte mortalité des premiers colons, en tient largement lieu. « Au point de vue des relations courantes, écrit un médecin français dans un ouvrage destiné aux futurs « coloniaux », il faut se rappeler que, quand on a été en contact avec des milieux indigènes, il faut faire attention, en revenant chez soi, aux para sites... Ne pas laisser les enfants aller dans ces milieux est très important si on veut les garder en bonne santé »101. Il serait absurde de réduire au racisme cette forme de prophylaxie, qui constitue un obstacle trop réel au contact, même si médecins, missionnaires, et agents administratifs, voire simples civils compatissants ont, le plus souvent, le courage de l’ignorer, non sans risques pour leur propre santé. Mais elle contribue à renforcer les conduites d’éloignement. Beaucoup considèrent avec dégoût, par exemple, la coutume des paysans indiens qui purifient le sol de terre battue de leur maison avec de l’urine de vache après l’avoir balayé11. On peut aboutir, à l’extrême, à justifier la ségrégation par un ensemble d ’impératifs sociaux et sanitaires, dont témoigne la citation tirée d ’un certain Lord Olivier, rapportée par le géographe Alain Jagerschmidt en 1938, s’exprimant au nom des Blancs d’Afrique du Sud : « Les Blancs ne veulent pas de familles cafres au voisi nage de leurs habitations ; ils ne veulent pas de la malpropreté des indigènes, de leurs bruits, de leurs odeurs. Ils détestent que leurs enfants deviennent familiers avec eux ; ils ne veulent pas être infestés de leurs vols, de leurs chiens pirates, de leurs chèvres maigres et voraces, de leurs moutons galeux, de leurs troupeaux de porcs, de leurs bœufs, de tout ce bétail errant autour de leurs domaines »12.
Relations des Européens avec les indigènes Le sentiment d ’être un homme important n ’entre pas pour peu de chose dans l’attrait de la vie aux colonies. Le caractère réduit de la communauté européenne permet d’y jouir d’une certaine notoriété, en même temps que le seul fait d ’appartenir à la nation colonisatrice, minoritaire, mais dominante,
10. Docteur Tanon, « L’hygiène individuelle devant la menace des maladies », La Vie aux colonies, p. 349. 11. David-Néel (A.), L’Inde où j ’ai vécu, p. 53,297. 12. Jagerschmidt (A.), « La population et la question indigène en Afrique australe britan nique », art cit, p. 223.
207
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
confère une supériorité sur la masse de la population. « On n’est pas sur le même plan ! Et cette supériorité, impossible de nous la contester. Nous la portons sur notre visage. Elle ne nous quitte jamais », proclame un des héros du romancier Eugène Pujamiscle. Parole d ’autant plus significative que ce « héros » pitoyable est un aventurier détruit par l’alcool et l’opium13. Cette conscience sert de prétexte ou de toile de fond à bien des comportements. Éloignement Un fait marquant est enregistré par les observateurs de l’époque: les contacts entre les indigènes et les Européens ont tendance à se raréfier. On a coutume d ’opposer le «vieux colonial» isolé au milieu de populations autochtones, dans le bled, la brousse, ou la jungle, au nouvel arrivant, installé dans une cité moderne, et travaillant au milieu d’autres Européens. Le premier, bon gré mal gré, partageait la vie des autochtones, se nourris sant, se logeant, et parfois s’habillant comme eux, et se mettant souvent en ménage avec une femme du pays. L’autre, qui jouit de la possibilité de vivre dans des conditions proches de celles de l’Europe, parmi d ’autres Européens, n’éprouve guère le besoin de connaître la population locale autrement que très superficiellement. Marié à une Européenne, qui se soucie le plus souvent de reconstituer aux colonies une vie sociale calquée sur celle de l’Occident, il n’est pas question pour lui d ’avoir ce qu’on appelait «une épouse indigène », comme cela se pratiquait ouvertement dans les périodes précé dentes, évolution dans laquelle les « vieux coloniaux » voient une décadence, la femme blanche aux colonies, selon eux, ne pouvant que jeter le trouble par ses exigences et ses complications chez les pudiques et virils bâtisseurs d’empire. Certes, il y a beaucoup de schématisme dans ce tableau, car, nombre des anciennes pratiques se maintiennent, en particulier dans les arrière-pays, là où des Blancs isolés vivent au milieu des autochtones. Le thème de la relation avec une femme indigène est encore fréquent dans la littérature coloniale, chez Somerset Maugham, par exemple, qui traite notamment le sujet dans sa nouvelle The Force o f Circumstance. Malgré tout, ces pratiques sont désormais de plus en plus éloignées de la norme. La méconnaissance des langues indigènes est, aussi, un réel handicap. Comme pour le reste, la pratique a tendance à régresser à mesure que les Européens s’urbanisent et se mettent à vivre de plus en plus entre eux. A côté de quelques linguistes qui font l’honneur des Écoles dites « orientalistes », seule parle les dialectes locaux une minorité de plus en plus réduite de fonc tionnaires militaires ou civils, de colons ou de planteurs vivant au milieu de la population. Dans l’ensemble, c’est par l’intermédiaire d ’interprètes, par le truchement des anciens élèves des écoles françaises, ou, de manière plus rudimentaire, à travers le vocabulaire sommaire acquis par le petit peuple appelé à vivre à leur contact, que passent les échanges des Européens et des
13. Pujamiscle (E.), Le bonze et le pirate [1929], Kalash, 1996, p. 1S3.
208
Fonctionnement social : dualisme et pluralisme
indigènes. Ceci ne peut que réduire singulièrement la sensibilité au milieu. Les conséquences sont plus graves dans certains territoires que dans d’autres. Le cas de l’Algérie est sans doute le plus caricatural, puisque le français y est la seule langue officielle, à l’exclusion de l’arabe. Au contraire, les indigènes qui vivent au contact des Européens sont capables de s’ex primer dans la langue du pays colonisateur, avec une variété de degrés qui vont de la maîtrise acquise dans les établissements d ’enseignement supé rieur, aux quelques mots nécessaires aux échanges quotidiens. Cet effort leur vaut rarement un surcroît de considération : alors que les premiers se font souvent accuser de prétention, les autres suscitent un sentiment de supério rité peu justifié, et font rire par leur maladresse. Le progrès même des techniques diminue encore les occasions de rencontre. L’ethnologue Paul Mus, fort d ’une expérience inégalée de l’Indo chine, observe, en 1952, après bien d ’autres, comment l’automobile, et son corollaire, la belle route goudronnée aux tournants relevés, a contribué à séparer deux humanités : d ’un côté, les fonctionnaires ou cadres fiançais, allant rapidement d ’un point à un autre ; de l’autre, les paysans vietnamiens, apparemment englués dans la boue des rizières. Mais cette observation a été faite ailleurs : en Afrique du Nord, par exemple, il a été bien souvent déploré l’abandon des anciens moyens de transport, cheval ou chameau, qui emprun taient les itinéraires traditionnels, obligeaient à de fréquentes haltes, et permettaient la rencontre permanente du petit peuple des fellahs, ou des tribus à la recherche de pâturages, et une lente appropriation du paysage, gagnée dans l’effort physique. Beaucoup de propriétaires fonciers européens ont cessé aussi de résider sur leurs domaines, pour leur préférer une habita tion en ville. De là, une vision du pays qu’on dirait aujourd’hui purement virtuelle : « Faute, en un mot, d ’une commune mesure humaine avec le pays, écrit Paul Mus, on n’en saisissait plus le sens qu’avec le regard : une image chasse l'autre. On en gardait, au mieux, la curiosité. Mais on avait moins que jamais accès à son esprit retrait et silencieux»14. Nombre d ’observateurs hollandais, dont Fumivall se fait l’écho, estiment de même que le fossé entre les Européens et les indigènes est devenu économiquement et socialement de plus en plus large: l’urbanisation, mais aussi la nature des emplois des Européens, de plus en plus hautement qualifiés, les éloignent des masses. Ségrégation, mépris et racisme Dans l’ensemble, les Européens ne se mêlent pas aux indigènes, et refu sent que ceux-ci se mêlent à eux. Bien des Anglais aux Indes ont dénoncé la memsahib (entendons la femme européenne, à laquelle ses domestiques s’adressent selon cette formule de respect), attachée jusqu’à la hantise à veiller à ce que les indigènes « restent à leur place ». Cette attitude connaît cependant, un certain nombre de nuances. À l’attitude des Anglo-Saxons, on
14. M us (P.), Viêt-nam, sociologie d ’une guerre. Seuil, 1952, p. 151.
209
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
oppose souvent celle des Latins, Français, mais aussi Portugais, Espagnols et Italiens. D’après un rapport de source anglaise de 1937, «aucune puissance latine n’a de préjugé de couleur aussi fort que celui qui existe dans les colo nies britanniques »1S. Il est vrai que le sens de la séparation est particulièrement poussé chez les Britanniques. La ségrégation est de règle dans les clubs, les chemins de fer, et jusque dans les toilettes. Elle est moins sensible au peuple, dépourvu de toute manière des ressources nécessaires pour accéder à des services coûteux, qu’aux bourgeoisies indigènes évoluées, qui se sentent tenues à l’écart au nom de critères exclusivement racistes. Le refus de se mêler aux indigènes s’étend en effet à toutes les catégories de Natives. H faut attendre 1933 pour que trente Maltais soient élus « à cette institution, britannique entre toutes, Y Union Club, tandis que trente Anglais entraient au Casino maltese », les candidatures individuelles s’étant jusque-là heurtées à un impi toyable blackboulage16. Leur froideur, proverbiale, qui fit dire à l’Américain Ralph W. Emerson, au milieu du XIXe siècle, que chacun de ces insulaires était une île à lui seul, se renforce encore aux colonies. Élie Faure rapporte ce souvenir d ’un voyage en Inde : « Dans une gare, un Hindou... m’adresse la parole : « vous n’êtes pas Anglais, monsieur ? - Non, monsieur, à quoi le voyez-vous? - Vous avez souri en regardant cet enfant»17. Il se trouve d ’ailleurs des étrangers pour admirer cette attitude de retenue, qui permettrait aux Anglais d ’être respectés, et donc obéis, l’autorité n’allant pas sans le prestige, et le prestige sans l’éloignement. Selon l’écrivain Paul Morand, le Français se déconsidère par sa trop grande familiarité, allant jusqu’à serrer la main à tout le monde18. Geste d ’autant plus imprudent, comme le font remar quer des habitués des pays musulmans, que dans ces pays il arrive qu’on leur tende la main gauche en signe d ’insulte, cette main servant aux ablutions intimes, et étant donc considérée comme impure. Il ne faut pas s’étonner de voir Mussolini, soucieux de restaurer le prestige de la « race », donner les Anglais en modèle aux Italiens trop enclins à se mêler aux populations locales. L’attitude et la pratique des Français sont plus supportables que le régime de ségrégation qui s’applique dans nombre de territoires sous domination anglo-saxonne. Aucune réglementation n’empêche Européens et indigènes de se mêler dans les transports ou les établissements publics. Au nom d ’une « fraternité » républicaine fréquemment invoquée, les écoles leur sont égale ment ouvertes. Ils se côtoient même au sein des régiments dits « indigènes », qui comprennent toujours un certain nombre de troupiers européens. De même, dans les territoires sous domination portugaise ou espagnole, il n’existe, en principe, aucune autre barrière que celle de la fortune et du degré
15. The Colonial Problem, op. cit., p. 270. 16. Monroe (E.), Les enjeux politiques en Méditerranée, Colin, 1939, p. 45. 17. Faure (É.), Mon périple, p. 140,175. 18. Morand (P.), Hiver caraïbe, Flammarion, 1929, p. 153.
210
Fonctionnement social : dualisme et pluralisme
d'éducation. Fréquenter un indigène ne fait pas l'objet d’une interdiction, mais est laissé, en principe, à l’appréciation de chacun. Ceci ne suffit évidemment pas à annuler les conséquences de l’inégalité de statut, mais contribue au moins à créer des occasions de rapprochement ou à rendre ceux-ci moins exceptionnels. Il ne faudrait sans doute pas pousser les différences à l’extrême. C’est dans un ouvrage officiel français de 1925 qu’on peut lire que « Les Euro péens et les indigènes constituent deux «castes» absolument différentes qu’il ne convient pas de mélanger, qu’il faut même maintenir distinctes, en dehors des circonstances exceptionnelles»19. Inversement, l’attitude des Britanniques à l’égard des « Natives » n’est pas toujours celle de la sépara tion radicale. À la Jamaïque, par exemple, il n’y pas de ségrégation dans les lieux de spectacles ou les transports publics; un Blanc peut être traduit devant un magistrat de couleur (comme aux Indes, du reste). Observons aussi que les comportements racistes ne sont pas l’apanage des puissances coloniales européennes. On les trouverait chez la plupart des ressortissants des États européens non pourvus de colonies (en Allemagne, par exemple, sans même parler des nazis), et, bien plus encore, chez les citoyens blancs des États-Unis. Dans ce dernier pays, l’attitude des King George’s Niggers, originaires des Antilles, toujours prêts à réclamer la protection de leurs consuls, et n’hésitant pas à revendiquer, impressionne les Noirs autochtones, alors tenus le plus souvent à une humilité servile, et parfois les irrite par sa prétention20. De même, c ’est sans doute en référence à l'occupation améri caine d ’Haïti (1915-1934), et à celle de Saint-Domingue (1916-1924), où les Yankees sont loin d ’avoir laissé de bons souvenirs, que le représentant d’Haïti à la SDN prononce, en 1935, un éloge de la France pour la manière dont elle traite ses peuples de couleur21. Il reste que c’est dans un territoire de l’Empire britannique que continue à se mettre en place, sous sa forme la plus extrême, une ségrégation poussée dans ses conséquences les plus extrêmes. Bien que la doctrine de l’apartheid n’entre officiellement en vigueur qu'en 1948, les éléments essentiels sont déjà en place, grâce à la mainmise croissante des extrémistes afrikaners sur les institutions. Il en va de même dans l’Éthiopie de l’occupation italienne, champ d ’application du racisme que le régime fasciste introduit dans sa politique à partir de 1936, par une tendance inévitable d ’un nationalisme exacerbé, pour lequel il est facile de passer de l’idolâtrie de la nation à celle de la race, autant que par la trouble fascination exercée sur Mussolini par l’Allemagne nazie, école de cette virilité dont les Italiens lui paraissent encore dépourvus. Le régime mussolinien, qui vient de proclamer, le
19. Ministère de la Guerre, Manuel des troupes employées outre-mer, deuxième partie (Indochine), Imprimerie nationale, 1925, p. 131. 20. Lara (O.D.), Caraïbes en construction : espaces, colonisation, résistances, CERCAM, 1992, p. 679. 21. The Colonial Problem, op. cit., p. 119-120.
211
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
14 juillet 1938, le « manifeste de la race », s’efforce d ’introduire en Afrique orientale une législation raciale rigoureuse, exclut les Éthiopiens des hôtels, restaurants, cafés et de tous lieux de réunion, instaure une séparation stricte dans les cinémas, les autobus et les trains, institue l’obligation de vivre dans des quartiers à part, et punit les manquements à ces règles par lesquels les Européens compromettraient leur dignité de «race supérieure»22. Il est interdit aussi aux Italiens de pratiquer des métiers jugés humiliants, comme celui de cireurs, ou bien aux chauffeurs de taxis italiens de transporter des Éthiopiens. Même si, comme il le paraît, ces mesures n ’ont pas été appli quées avec rigueur, le peuple italien étant réfractaire à ces pratiques, leur proclamation ne manque pas de choquer profondément les Africains. Racisme au quotidien L’attitude des Européens, enfin, est trop souvent empreinte de racisme. Il ne s’agit pas ici de théories, au demeurant cultivées plus par de prétendus penseurs racistes des métropoles que dans les colonies, mais plutôt de réac tions collectives fondées sur la prétention à se situer bien au-dessus de popu lations jugées irrémédiablement inférieures et incapables de se diriger ellesmêmes. Leur sentiment de supériorité est tel qu’il faut, bien souvent, leur rappeler qu’ils n’ont pas été seuls à faire la colonie, et qu’ils ne sauraient se passer du travail et des impôts des autres habitants. Lorsqu’une commission britannique déclare, à propos de l’Afrique australe: « la prospérité de la communauté blanche est liée à celle de la communauté noire par des liens indissociables et permanents ; la colonisation et les intérêts des Blancs ne peuvent subsister que grâce à la coopération des races indigènes », elle est loin d ’énoncer une vérité d ’évidence23. Ces sentiments ont tendance à colorer nombre de comportements, ressentis par les indigènes comme autant d ’insultes, ou d ’humiliations. Alors que les Européens exigent des indigènes des formules de respect, les noms qui servent à désigner les indigènes, et qu’on préfère ne pas repro duire ici, pour éviter de contribuer à leur donner une pérennité qu’ils ne méritent pas, sont une marque de mépris fréquemment utilisée. Il est souvent reproché aux francophones de se comporter avec les indigènes avec une familiarité blessante, notamment en usant systématiquement du tutoiement à leur égard. Ceci peut, à la rigueur, être acceptable dans les échanges avec l’homme du petit peuple, qui, lorsqu’il s’exprime en français, use souvent lui-même, par ignorance, du tutoiement envers son interlocuteur, mais devient intolérable à l’égard des personnes passées par l’école française, et qui parfois s’expriment dans une langue plus correcte que celle des « colons », bons Français mais parfois pittoresques francophones, notamment 22. Del Boca (A.), « I crimini del colonialismo fascista », in Del Boca (A.) dir., Le guerre coloniali dell’Italia fascista, Roma-Bari, Lateiza ed., 1991, p. 247. 23. Report of the Commission on the Closer Union of the Dependencies of Eastern and Central Africa, cité par Frankel (S.H.), Capital Investment, p. 258.
Fonctionnement social : dualisme et pluralisme
dans cette Afrique du Nord où la langue de Cagayous a plus de rapport avec celle des Hires du Bourgeois gentilhomme qu’avec celle de l’Académie. Les autorités, conscientes du problème, tentent parfois d ’y porter remède. Ainsi, en 1941, un arrêté de l’amiral Decoux, alors gouverneur général, proscrit le tutoiement envers les indigènes en Indochine24. Mais la pratique n ’en est pas sérieusement affectée. La patience à l’égard des indigènes n’est guère de mise. André Gide, lors de son voyage au Congo, en 1926-1927, se demande pourquoi presque tous les Blancs, fonctionnaires et commerçants, hommes et femmes, «croient devoir rudoyer leurs domestiques, en paroles tout au moins, même alors qu’ils se montrent réellement bons envers eux »25. Théodore Monod, grand humaniste s’il en fût, écrit, avec franchise : « Je circule en Afrique depuis 26 ans, j ’y habite depuis 10 ans, et je n’ignore pas combien nos plus géné reux partis pris d ’humanité et de bonne humeur cèdent aisément devant les mille petites irritations quotidiennes qu’il faut avouer et qu’éprouve celui qui doit, parce que c’est, à tort ou à raison, la raison d ’être de sa présence, obtenir de ses collaborateurs africains un certain rendement, en quantité comme en qualité»26. De même, si la brutalité n’est pas aussi fréquente qu’on l’écrit quelquefois, frapper un indigène est rarement considéré aussi sévèrement que frapper un Européen. Selon certains, la monnaie courante des marques de mépris à l’égard des indigènes est souvent d’autant plus fréquente que l’Européen est d ’humble origine. Aldous Huxley n’hésite pas à écrire que, dans la formation de la haine qui résulte de ces mille insultes, « les Européens les plus vulgaires et les moins cultivés ont plus que leur juste part »27. « Moins le Blanc est intel ligent, plus le Noir lui paraît bête », a écrit férocement André Gide. Alain Gerbault dénonce, lui aussi, « ce sentiment de supériorité imaginaire », qu’il explique, par « un complexe d ’infériorité de Blancs de basse extraction »28. En réalité, ces derniers, mêlés surtout au petit peuple, ont du mal à imaginer la culture, le raffinement, et la distinction des notables indigènes des classes supérieures, connues seulement des hauts fonctionnaires ou des Européens des classes élevées en contact avec eux. Sont-ils assez sensibles à la misère des populations ? Beaucoup d ’entre eux ont tendance à la considérer comme une chose naturelle. Ils se conten tent de penser que leurs besoins sont plus faibles, et qu’elles ne connaissent pas d’autre façon de vivre. Ils ont tendance à voir aussi dans cette pauvreté la conséquence du fatalisme ou de la paresse des Orientaux, que seul pourrait secouer la direction ferme et énergique des Européens. Ces clichés rassu-
24. Brocheux (P.), Indochine, la colonisation ambiguë, p. 186. 25. Gide (A.), Voyage au Congo [1927], Gallimard, coll. Idées, p. 129, note 1. 26. Monod (Th.), « Le meilleur et le pire », Fin de l’ire coloniale ?, op. cit., p. 55. 27. Huxley (A.), Le monde en passant, p. 80. 28. Gerbault (A.), îles de beauté, [1941], Hoëbeke, 1995, p. 60.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
rants, empruntés à une vision trop rapide de la plèbe indigène des villes, souvent formée de chômeurs, sont évidemment peu conformes à la réalité. Très peu sont gênés de se faire transporter en pousse-pousse par de frêles coolies, (sauf, sans doute, les autorités hollandaises, qui en ont proscrit l’em ploi à Batavia), ou de faire cirer leurs chaussures par des enfants, ou bien, lorsque leur bateau fait escale dans un port, de jeter à la mer des pièces de monnaie que des enfants vont chercher en plongeant. Il est vrai que la pitié n ’est pas toujours facile. Les plus compatissants des Européens doivent opposer un refus imperturbable aux innombrables mendiants, de peur d’être assiégés par leur foule. Bien peu osent se dire, comme Aldous Huxley, que, s’il est vrai que les pauvres des colonies, habitués à cette vie, paraissent « incroyablement résignés », « ce n’en est que plus honteux pour les hommes et le système qui les ont réduits à une telle existence, et les maintiennent dans l’ignorance d ’une vie meilleure »29. Pourtant, tout est moins uniformé ment négatif qu’on ne pourrait le penser. Les contacts nés de séjours dura bles peuvent faire naître aussi certains réflexes de compréhension. Des échanges humains On ne compte pas les gestes gratuits accomplis au nom de l’hospitalité, ou, simplement, du sens de l’entraide, entre gens que presque tout contribue rait, semble-t-il, à séparer. Dans les campagnes notamment, bien des femmes européennes donnent des soins aux blessés et aux malades. Ces attitudes existent aussi chez les indigènes, qui apprennent par exemple à supporter sans s’inquiéter les sautes d’humeur des Européens, peu courantes dans des cultures où la retenue et la maîtrise de soi sont, en général, beaucoup plus en honneur, et souvent incompréhensibles. Les fêtes religieuses des colonisa teurs et des colonisés peuvent donner lieu à des échanges de friandises ou de petits cadeaux. Les enfants, notamment, sauf lorsque règne une ségrégation rigide, se mêlent, ou peuvent s’aventurer au milieu des adultes de l’autre communauté. Les tableaux d ’enfances africaines, d ’enfances indiennes, ou d ’enfances chinoises, dus à des écrivains français ou anglo-saxons, montrent combien souvent fut fort l’attrait de cultures étrangères sur des esprits trop jeunes pour être soumis aux préjugés ou aux croyances de leur milieu. Souvent aussi colons et indigènes partagent un même attachement, au pays natal, devenu pour bien des colons un pays d'élection, et même si la diffé rence de cultures, d ’histoire, de sensibilité, suggère qu’il n’y a pas identités de représentation. Charles-André Julien écrit du Français d’Algérie : « Sur le pavé parisien, si le colon aperçoit un burnous, il court vers lui. Alors, les hostilités locales s’effacent. Il se sent plus près de l’Arabe, pour les concep tions de la vie, que de ses compatriotes devenus si lointains, et avec qui il a perdu les contacts que maintenaient les premiers immigrants v30. Plus ou moins volontairement, il sait mettre, quand il le veut, dans son comporte
29. Huxley (A.), Le monde en passant, p. 31. 30. Julien (Ch.-A.), L’Afrique du Nord en marche, Julliard, 1972, p. 42.
Fonctionnement social : dualisme et pluralisme
ment de quoi éviter de blesser l’autre, ce que le métropolitain même bien intentionné ne saura pas faire. D en va de même des amitiés ou de l’estime mutuelle qui peuvent se nouer à l’école, ou au sein de certains milieux professionnels, et notamment de l’armée. Karen Blixen, pourtant pleine de préjugés, essaye, avec maladresse, d ’expliquer les liens, tout platoniques, mais très forts, qui l’uni rent à son homme de confiance, le Somali Farah, qu’elle n’hésite pas à qualifier de Gentleman, ce qui a son prix en terre britannique, et dont elle écrit : « Je lui parlais de mes soucis comme de mes succès, et il savait tout de ce que je faisais et de ce que je pensais »31. Ces attitudes sont évidemment d’autant plus faciles que l’existence de barrières n’est pas officialisée, ou institutionnalisée. Le leader nationaliste algérien Ferhat Abbas écrira, en 1945, dans des circonstances difficiles : « Oui, nous avons beaucoup d ’amis français, auxquels nous sommes très attachés, parce que nous les connais sons ». Et d ’opposer tel médecin français dévoué à tel commerçant musul man indélicat, tel colon qui ferme les yeux sur des vols de blé, par pitié pour les affamés, à tel grand propriétaire indigène qui préfère laisser son entou rage mourir de faim32. À défaut d’être bien traités dans les colonies, la récep tion qu’ont connue, en France pendant la guerre, bien des combattants colo niaux, suscite, chez certains de ceux-ci, une reconnaissance profonde, en même temps que de nouvelles aspirations. Ces échanges, qu’on pourrait dire sur base de réciprocité, ne sont pas sans valeur d ’humanité, et soulignent le fait que, dans un cadre peu fait pour l’ad mettre, il put y avoir un début de reconnaissance d ’individu à individu qui constitue un motif d’espoir dans un avenir plus fraternel. Malgré tout, ils demeurent bien limités, dans la mesure où ils ne pénètrent pas les noyaux durs des différentes cultures, c’est-à-dire les familles, et ne peuvent donc établir que des relations bien fragiles. Comme l’écrit sans doute assez juste ment Karen Blixen, les indigènes ne jouent pas un plus grand rôle dans la vie des Blancs que les Blancs n’en jouent dans la leur33. Il n ’en va pas exacte ment de même de toute une série d ’autres influences qui, à la différence de celles qu’on vient de voir, travaillent les sociétés des colonisés dans leur ensemble.
Les désirs réciproques, enfin, existent toujours, et même là où on s'y attendrait le moins, s’il faut en croire la psychanalyse, pour laquelle, dans le rejet même de l’Autre réside un profond et violent désir. Si bien que les cas
31. Dinesen (I.), Out ofAfrica, p. 407. 32. Abbas (F.), « Mon testament politique », (présenté par Ch.-R. Ageron), Revue fran çaise d ’histoire d’Outre-mer, 1994, p. 193-197. 33. Blixen (K.), Out o f Africa, p. 275-276.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
de relations plus ou moins durables, de simples liaisons, ou d ’attirance, sont beaucoup plus nombreux que ne le diraient les statistiques. Le métissage des populations est un phénomène évident dans toutes les sociétés des colonies. Les peuples indigènes l’ont plus ou moins largement pratiqué, avec des résultats particulièrement visibles au contact des populations à peau noire et blanche, entre Afrique du Nord et Sahara, ou bien encore dans le sous-continent indien. Mais, partout, la difficulté des tenants de l’anthropologie à découvrir des « races pures » montre bien le caractère général de ce compor tement. Ce type de métissage ne parait pas avoir retenu l’attention des auto rités coloniales, sans doute parce que les enfants nés de ces unions trouvent une place, plus ou moins bonne, dans les organisations sociales indigènes, et ne constituent nulle part un groupe susceptible d ’un traitement particulier, n n’en va pas tout à fait de même pour les enfants nés d ’une union impliquant un ou une européenne, sans doute parce que leur présence contribue à brouiller une distinction à la fois opératoire et rassurante des sociétés colo niales. C’est ce seul aspect qu’on étudiera ici. Comme on l’a suggéré plus haut, les unions entre Européens et indigènes restent le plus souvent temporaires. Les Européens qui manifestent leur volonté de les pérenniser ont le plus souvent tendance à quitter leur milieu d ’origine pour se fondre dans le milieu indigène, ce que les Britanniques appellent go Native. Bien peu voient dans cette démarche autre chose qu’un lamentable échec, qui marque l’abandon des valeurs occidentales pour la chute dans la « barbarie » ou « l’ensauvagement », et fait de ceux qui s’y abandonnent des «invertis moraux»34. C’est bien rarement que certains acceptent de lire dans ces destins le libre choix « de ne plus être un civilisé qui se croit le premier homme du monde, mais se reconnaît ému par une chanson, et se met en route riche de sa simplicité et ému de son ignorance », comme l’écrit, dans son roman Retour à l ’argile, l’archéologue Georges Groslier, qui voua son existence à la préservation des richesses des temples d ’Angkor35. Encore moins est-il question de véritables mariages dits «m ixtes» ou encore «interethniques». Quant aux unions entre femmes européennes et maris indigènes, beaucoup plus rares, elles encourent une réprobation encore plus grande. Ce n’est pas par hasard qu’à Simla, le prin cipal carrefour s’appelle Scandai Point, en souvenir de la fuite d’une jeune fille britannique avec un prince indien. Mais là encore, il ne faut pas systé matiser. Dans ses mémoires, le leader nationaliste Messali Hadj, pourtant sans indulgence pour les Français d’Algérie, reconnaît que, en voyage en Algérie avec son épouse française, en 1925, « personne, ni Français ni Juif, n’a fait directement de réflexion désobligeante à notre égard »36. Il est vrai qu’il a épousé une métropolitaine, la communauté des Français d’Algérie
34. Maunier (R.), Sociologie coloniale, T. III, Le progrès du droit, Domat-Montchrestien, 1936, p. 181. 35. Groslier (G.), U retour à l'argile [1928], Kailash, 19%. p. 181-182. 36. Les mémoires de Messali Hadj, p. 144.
Fonctionnement social : dualisme et pluralisme
étant très hostile à tout « mélange », selon une logique partagée d ’ailleurs avec la communauté musulmane et la communauté juive. Du moins, dans la plupart des colonies, la réprobation des unions mixtes reste-t-elle confiée pour l’essentiel à la censure sociale, exercée, le plus souvent, par les épouses légitimes européennes. L’exception majeure concerne l’Afrique du Sud, où une loi de 1927 (dénommée vertueusement Immorality Act) proscrit les relations sexuelles entre Blancs et Noirs. Mais l’Italie, dont on a vu plus haut l’attirance pour les doctrines racistes, agit de même dans ses colonies. La législation proscrit non seulement le mariage, mais même le fait de vivre maritalement avec des Éthiopiennes (« madamisme»). Le régime prétend même pourfendre le mythe de la «belle Abyssine » dont une chanson très en vogue dans l'arm ée italienne célébrait le charme, sous la forme abâtardie, mais positive, du Nigra sum sed formosa du Cantique des cantiques (facetta nera). La seule beauté qui doive captiver le conquérant forgé à la dure et virile discipline fasciste ne peut être que celle d’un visage blanc, et non pas celle d ’un visage noir37. Le résultat de ce qu'on pourrait appeler « l’éloignement social» dans lequel Européens et indigènes vivent généralement est que, dans l’ensemble, il n’y a pas de véritables mélanges de population. Les Européens en Asie et en Afrique s’avèrent incapables de faire ce qu’ont su faire les Espagnols et Portugais en Amérique latine, les Arabes en Méditerranée et au MoyenOrient, ou bien encore les Turcs en Inde: faire souche dans le pays de manière à s’y intégrer comme membres de la communauté, quelque ambiguë et imparfaite que soit cette intégration, comme l’histoire le montre tous les jours. Ils n ’ont su ou voulu créer de ces «colonies composites dans lesquelles un petit nombre de colons remplit les classes supérieures et quel quefois les classes moyennes de la société, tandis que la masse comprend les sang-mêlés et les indigènes »38. C ’eût été en effet le seul moyen de s’associer au destin des peuples, au lieu de stationner au milieu d ’eux en conquérants. On peut certes se dire que le temps a manqué pour cette fusion, qui eût demandé plusieurs siècles. Mais il est vrai que nul ne l’a jamais encouragée. Le métissage, pourtant, n’est pas absent, notamment en Asie. On a eu l’occasion de noter que les Eurasiens (ou Indos) formaient, à Java, les trois quarts de la communauté hollandaise. Depuis le milieu du XIXe siècle, ils sont considérés comme citoyens des Pays-Bas. Si la majorité occupe des emplois relativement modestes (conducteurs de locomotives, garagistes, petits employés), une minorité notable accède à des postes de responsabilité à égalité avec leurs compatriotes d ’origine purement européenne39. Ils forment la plus grande partie de ceux qu’on appelle les blijvers ou résidents
37. Le Houérou (F.), L’épopée des soldats de Mussolini en Abyssinie, p. %. 38. Bonn (M.J.), La portée internationale », art cit, p. 219. 39. Fisher (G), South East Asia, p. 269.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
permanents, par opposition aux trekkers, les résidents temporaires40. De la même façon, à Tahiti les métis ou « demis » (environ 10 % selon les statis tiques), occupent déjà des positions importantes dans la vie économique, sociale et politique41. Il faut dire que la plupart jouissent des droits de citoyens français, puisque descendant à la fois de Français et d ’anciens sujets du roi Pomaré V, devenus citoyens lorsque celui-ci céda ses États à la France en 1880. La législation française reconnaît, à partir de 1930, la qualité de citoyens aux enfants reconnus par un père ou une mère française, le premier cas étant le plus fréquent. Le sort des enfants qui ne bénéficient pas de ces dispositions est variable. Dans le meilleur des cas, le mari européen se contente de laisser à sa femme et à ses enfants les moyens de vivre correctement selon les normes locales. Les enfants sont alors repris par le milieu indigène dans lequel ils s’intég rent. Quelquefois, cependant, leur double origine est reconnue comme inter médiaire entre celle des Européens et celle des indigènes. Ils occupent alors des positions médianes entre les cadres supérieurs européens et la maind ’œuvre locale. Ceux qu’on commence à partir des années 1914 à appeler Anglo-Indiens en Inde (terme jusque-là réservé aux seuls Européens qui rési dent dans le pays) occupent ainsi une place importante dans les services administratifs. Au début des années 20, on considère qu’on ne saurait se passer d ’eux dans l’exploitation du réseau ferroviaire, où ils sont omnipré sents, dans les chemins de fer, comme agents de conduite aussi bien que comme inspecteurs42. Cette situation indispensable, mais subalterne, est celle des Eurasiens en Indochine (dont le nombre est évalué à 6000 environ), où ils sont appelés à fournir nombre de petits cadres de la police, de l’adminis tration, des usines ou des plantations. De même, le sort des mestizos des colonies portugaises est extrêmement précaire, à peine supérieur à celui de la masse indigène, ce qui correspond à la réalité historique selon laquelle la seule fonction du métissage était avant tout de surimposer une caste de chré tiens à l’ordre social traditionnel, et non pas de créer de nouveaux Portu gais43. Le sort des enfants nés après le passage de colonnes européennes (dans certaines oasis du Sahara au début du siècle), ou bien d’amours plus ou moins vénales est évidemment le plus misérable, ils sont abandonnés pure ment et simplement : il y en aurait eu à Léopoldville une centaine en 1932, près du double en 193444. Les malheureux sont en butte au mépris des habi tants de toutes origines. Il n’est pas étonnant que les métis soient très mal considérées par les partisans de théories racistes. Les nazis opèrent la stérilisation forcée de tous 40. Fumivall (J.S.), Netherlands India, p. XXI-XXII. 41. Doumenge (F.), L’Homme dans le Pacifique Sud, p. 188. 42. O’Moore Creagh (général), Indian studies, Londres, Hutchinson & Co, s. d. (vers 1919), p. 77. 43. Fumivall (J.S.), Netherlands India, p. 46S. 44. Gondola (Ch.-D.), « Oh, Rio-Ma ! Musique et guerre des sexes à Kinshasa, 19301990 », art., cit, p. 51-81.
Fonctionnement social : dualisme et pluralisme
les « bâtards nègres » nés de la présence de contingents coloniaux africains ou maghrébins sur la rive gauche du Rhin de 1919 à 1931. La législation fasciste refuse aux enfants de père italien et de mère africaine la nationalité italienne. La réprobation morale de pays moins extrémistes n'est pas moins forte. Un Anglais qualifie de « péché » le spectacle d ’une très jeune fille noire et de son enfant, visiblement métis (l’expression anglaise est halfbreed ou half-caste), rencontrés au détour d’une rue misérable de Villa Luzo, en Angola45. Cette attitude n’est pas sans conséquences. Conscients de l’image défavorable que de telles familiarités leur confèrent chez les AngloSaxons, les autorités portugaises se défendent de favoriser ces pratiques : en 1950, le futur président Marcelo Caetano soulignera que les populations métisses ne forment que de très petites minorités en Angola et au Mozam bique, qui constituent, comme celles des autres colonies, et notamment du Cap, l’héritage d ’une période révolue, celle où l’absence de femmes blanches faisait des relations sexuelles interraciales « une nécessité »46. La doctrine officielle d ’assimilation, pourtant prônée par le même politicien quelques pages plus tôt, où il a fait l’éloge de la société brésilienne, ne le conduit, pas plus que les Français d’ailleurs, à prôner le rapprochement des populations par des contacts autres que ceux que médiatise la culture ou les échanges monétaires. L’idée absurde selon laquelle un métis présente « les défauts des deux races », est alors monnaie courante, bien opposée à l’idée actuelle (d’un point de vue scientifique tout aussi absurde, puisqu’elle postule, autant que la première, l’idée de races plus ou moins pures, mais qui a du moins le mérite de la générosité) selon laquelle ils représenteraient l’ad dition de leurs qualités. Pour certains groupes, il y a même recul d’un statut relativement privi légié. C’est le cas en Afrique du Sud des métis de la province du Cap, qui doivent leur ascendance à des mélanges entre les premiers habitants du pays (Bushmen et Hottentots), des esclaves africains, des immigrants malais, et les premiers colons blancs. Ces Cape coloured, qui le plus souvent utilisent le dialecte afrikaner et sont en majorité chrétiens, possèdent depuis 1853, date à laquelle une constitution a été octroyée par la Grande-Bretagne à la colonie du Cap, le droit confirmé lors de la fondation de l’Union Sud-afri caine en 1909, de voter sur des listes communes avec les Européens. Cette faculté, pourtant limitée par des exigences de revenu et d ’instruction, paraît intolérable aux Afrikaners, qui y voient, non sans raison, une porte ouverte au suffrage universel. Us n’ont de cesse d ’y mettre fin, ce qui est fait en 1936. Mais ces positions ne résultent pas seulement d’une vision dévalorisante de groupes humains s’opposant les uns aux autres au nom d’une cohésion idéale autant que réelle. Elles sont entretenues, aussi, par des rivalités écono 45. Weulersse (J.), Noirs et Blancs, p. 134. 46. «Principles and Methods of Portuguese colonial administration», Principles and Methods of Colonial Administration, p. 90.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
miques qui tiennent à la position des uns et des autres dans la champ de la production des biens, et aux rivalités qui s’ensuivent.
Concurrence entre les groupes Européens et indigènes La question de la concurrence économique ne se situe pas au niveau de la domination des grands intérêts économiques et financiers. Ce n’est que dans le discours politique que les revendications nationalistes s’emploient à dénoncer le contrôle, par des intérêts à prédominance étrangère, des richesses nationales. Pour les salariés européens, comme pour la masse des indigènes, il s’agit là d ’intérêts qui se jouent bien au-dessus de leurs têtes. La question essentielle a été bien définie par l’économiste Herbert Frankel ou par le géographe Pierre Gourou : l’émigration ne se justifie que par la recherche d’un meilleur niveau de vie. Or, dans tous les pays colo nisés, la main-d’œuvre européenne se trouve placée en concurrence avec la main-d’œuvre indigène, paysans acceptant de vivre dans des conditions très frugales, et bien adaptés (en tout cas mieux que les Européens) aux condi tions climatiques, ou prêts à s’exiler plus ou moins temporairement pour travailler à des salaires très bas dans des chantiers, des fermes ou des planta tions. Il ne reste aux Européens que des fonctions d ’entrepreneurs, qui exigent des capitaux, et d ’encadrement. Il est impossible, comme ce fut le cas dans les « pays neufs », à un homme travailleur et courageux d ’espérer « faire fortune » en partant de très bas, et en s’élevant de quelques degrés dans l’échelle sociale. Certes, il n’en a pas toujours été de même partout. Dans les colonies dites de peuplement, il est des périodes où les Européens pouvaient occuper un certain éventail d’emplois, y compris ceux de manœuvres en bâtiment, d’ou vriers d ’ateliers ou d’ouvriers agricoles, de transporteurs, voire de vendeurs de lait de chèvre, comme les Maltais en Afrique du Nord. D’autres ont pu également se voir attribuer des lots de terres réduits, pour y vivre en exploi tation familiale. Mais ce système lui-même, peu tenable dans le long terme, atteint rapidement ses limites. Les petits colons, si endurants soient-ils, n ’ont pas l’attachement à la terre et l’esprit de solidarité qui lie les Africains au sol. Les difficultés économiques les repoussent dans les villes, en particulier les « Blancs pauvres » d ’Afrique du Sud, frappés par la crise des années trente. En milieu urbain aussi, les indigènes, dont une partie acquiert la formation élémentaire aux techniques occidentales, font concurrence aux Européens. Au-delà, le développement d ’élites indigènes, passées par un enseignement moderne, contribue à fragiliser la position des cadres à tous niveaux, en commençant par les plus modestes. Nombre de responsables coloniaux poussent d’ailleurs en ce sens. C’est ainsi que pour une commission belge qui rend en 1936 un rapport sur le
Fonctionnement social : dualisme et pluralisme
Congo, « rien de ce qui peut être fait par un Noir ne doit être confié au Blanc... Le but fondamental de notre entreprise africaine reste donc, non point d ’installer au Congo le plus grand nombre possible d ’Européens, mais de créer entre la population de la Métropole et celle de la Colonie, considé rées toutes deux dans leur ensemble, des relations économiques aussi éten dues, aussi intenses et aussi profondes que possible »47. Deux séries de moti vations justifient cette attitude. La première est le souci de ne pas laisser se constituer en Afrique un prolétariat européen, qui n’est pas toujours insen sible aux sirènes révolutionnaires, plus perceptibles par lui, au demeurant, que par les indigènes; la seconde, de susciter au contraire aux Noirs des ressources propres, destinées à promouvoir un niveau de vie correct. Beaucoup aussi jugent qu’il ne faut pas compromettre le prestige de l’Européen en le laissant occuper des places inférieures, état d’esprit particu lièrement répandu dans les colonies britanniques. Seule la volonté politique peut, dans une certaine mesure, corriger ces tendances. En Afrique du Nord, elle consiste à réserver les places de fonc tionnaires, même très modestes, aux Européens, citoyens français ; des voya geurs s’étonnent ainsi de les voir à des places de petits employés qui, en Egypte, par exemple, seraient tenues par des indigènes. La proclamation, en 1919, du principe d ’égalité d ’accession à tous les emplois en Algérie (sauf fonctions dites « d ’autorité »), ne s’est pas traduite par de profonds change ments. En Afrique du Sud, l’application de la Colour Bar, instaurée à partir de 1911, et constamment durcie jusqu’en 1924-1926, interdit au Noir l’ac cession aux emplois d ’ouvriers qualifiés dans les mines et l'industrie. Mais il va de soi que ces pratiques sont de plus en plus menacées par la pression constante des indigènes qui sont en état de revendiquer l’accès à ces qualifications. Cette situation, qui s’ajoute à tous les autres facteurs d ’oppo sition entre indigènes et Européens, est rarement surmontée. Rares sont les mouvements sociaux ou syndicaux qui peuvent regrouper Européens et indi gènes. En Afrique du Nord, la majorité des employés dépendent de secteurs publics et semi-publics (fonctionnaires, postes, transports,...) où les indi gènes sont très m inoritaires; en Afrique du Sud, la division syndicale recoupe en grande partie la division imposée par la ségrégation entre Blancs et Noirs. Les tentatives menées au début des années vingt, par des leaders ouvriers stimulés par l’élan communiste restent sans lendemains. Certains pourtant, en-dehors même des rangs des partisans d ’une entente des travailleurs, restent persuadés que l’avenir même de l'œuvre coloniale, et partant, des populations européennes de ces pays, est fondé sur le progrès rapide et notable des conditions matérielles des indigènes : comment espérer, font-ils remarquer, maintenir des services en relation avec le niveau de vie et les exigences des colons alors que leur petit nombre interdit toute véritable
47. Rapport de la Commission des Colonies pour le Congo belge, 1936, Frankel (S.H.), Capital Investment, p. 290-291.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
rentabilité? Faute d’une immigration suffisante, on ne peut espérer une augmentation de la demande globale que de la population indigène, car seul un pouvoir d ’achat accru peut permettre aux chemins de fer, aux commerces, aux industries de toute sorte, mais aussi à l’État, de répartir les charges fixes sur un plus grand nombre de consommateurs48. D’autres font valoir que seule la fin des rigidités entre deux systèmes de salaires, européen et indigène, peut permettre le développement global de l’économie. Attirer un nombre croissant d ’indigènes par des salaires plus élevés dans des branches plus productives que les tâches inférieures de l’agriculture et des mines aurait pour effet d’exercer un effet à la hausse sur les salaires des secteurs de moindre productivité, soumis à la concurrence, ce qui pousserait ces salaires, à leur tour, vers le haut, et obligerait les secteurs retardés à une plus grande productivité, ce qui amènerait leur disparition ou leur modernisation. Ce raisonnement, développé par Frankel est sans doute trop schématiquement libéral49*. Comme tout raisonnement économique, il postule toutes choses égales par ailleurs, et néglige bon nombre d ’aspects, en particulier la ques tion de la pression démographique sur les salaires. Mais il souligne bien une difficulté majeure du développement colonial: pour être réalisable, ce programme exigerait à la fois une acceptation par les Européens d’une égali sation de leur condition avec celle des indigènes, ce qui est rien moins qu’é vident; et, d ’autre part, il impliquerait une véritable diversification des productions, alors que tous les projets des gouvernement coloniaux s’obsti nent à mettre l’accent sur le secteur primaire, mines et produits alimentaires. De tels raisonnements ne sont guère entendus. Il faut dire que tout ne se résout pas dans l’opposition des intérêts entre Européens et indigènes. À ces rivalités s’ajoutent celles qui opposent Européens, indigènes et représentants des diverses minorités, généralement immigrées, qui ont été présentées plus haut. Problèmes des diasporas Tous les groupes d ’immigrés non européens ne se trouvent pas toujours, eux non plus, dans une position facile. Leur dynamisme même leur suscite bien des ennemis. Les positions acquises par eux dans le domaine du commerce et du prêt à intérêt sont un premier sujet de rancœur. Cette attitude peut être celle de concurrents européens, incapables de se mesurer aux Chinois, Indiens ou Syriens, faute de disposer d’aussi solides réseaux d’entraide, et de se contenter de revenus aussi médiocres. Demangeon cite le cas d ’une localité d ’Afrique du Sud où, vers 1920, il n’y a plus que quatre épiciers européens contre vingt-sept Indiens30. Elle est surtout celle des paysans indigènes, 48. Frankel (S.H.), Capital Investment, p. 243-24S. 49. Frankel (S.H.), Capital Investment, p. 138-146. 30. Demangeon (A.), L’Empire britannique, p. 219.
222
Fonctionnement social : dualisme et pluralisme
obligés de passer par leurs conditions, particulièrement en cas de mauvaises récoltes, pour obtenir de quoi faire la «soudure» jusqu’à des temps meilleurs. Ces ressentiments s’adressent, comme toujours, moins aux déten teurs de très grosses fortunes, dont la domination est, en quelque sorte, invi sible, et dont beaucoup vivent en parfaite intelligence avec les capitalistes européens, qu’à leurs relais sur le terrain, le petit détaillant ou l’usurier local, directement exposé à la vindicte populaire en cas de troubles. La Birmanie connaît de sérieuses émeutes anti-indiennes en 1924, 1930, 1938 et 1939. Certains attribuent même à ce sentiment de xénophobie la relativement grave rébellion de 1931, bien que des Indiens aient participé à la révolte, celle-ci étant en partie fondée aussi sur des revendications agraires51. En Afrique occidentale, au début des années 1920, les Syriens sont victimes de troubles à Freetown, en Sierra Leone, et des voix s’élèvent même parmi les Africains pour demander leur expulsion52. La concurrence avec le travail indigène constitue un autre sujet de tension, au moins dans certaines régions, le «travail à bon marché» {Cheap Labour), étant redouté autant par les travailleurs blancs que par les autochtones. Il paraît en effet, à juste titre, pouvoir être utilisé comme une arme aux mains des entrepreneurs pour imposer des conditions plus dures, par le recours aux nouveaux venus comme briseurs de grèves. L’inverse, cependant, peut être vrai. En Birmanie, par exemple, l’appel aux Birmans est pratiqué pour briser les grèves des dockers indiens53. La question de la place des immigrants non-européens dans la vie poli tique des colonies se pose également. Dans les territoires britanniques, les Indiens sont souvent très entreprenants. Leur activité économique, leur formation, leur maîtrise de la langue anglaise, et, bien sûr, l’influence des mouvements nationalistes qui se développent aux Indes, les amènent à réclamer, dans la gestion des pays où ils constituent des communautés en nombre conséquent, une place aux côtés des Européens. Ils peuvent aussi jouir de l’appui de YIndia Office et des services du vice-roi, qui interviennent à plusieurs reprises, avant et après la guerre, pour attirer l’attention sur l’in térêt porté par l’opinion indienne au sort des compatriotes émigrés dans les autres dépendances de la Couronne. Ils obtiennent souvent satisfaction, notamment en Afrique orientale, où les autorités locales doivent leur faire une place aux côtés de la minorité blanche : au Kenya, sur une trentaine de membres, dont deux tiers sont des fonctionnaires, la réforme de 1927 réserve cinq sièges électifs au conseil consultatif aux 23000 Indiens, contre onze aux 10000 Européens, et un aux Arabes, les deux millions et demi d’Afri cains n’étant représentés que par un, puis deux Européens nommés ; pour protester contre la discrimination à leur égard par rapport aux Européens, les représentants indiens refusent cependant d ’occuper leurs sièges jusqu’en
51. Fumivall (J.S.), Colonial Policy, p. 197. 52. Desbordes (Jean-Gabriel), L’immigration libano-syrienne en AOF, Poiriers, 1938 ; Crowder (M.), West Africa, p. 286,426. 53. Fumivall (J.S.), Netherlands India, p. 410 ; Colonial Policy, p. 199.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
1933. Par la suite, ils s’élèvent contre les dispositions qui leur interdisent l’achat de terres et la colonisation des Highlands. Leurs revendications ne se limitent pas aux territoires britanniques : au Congo belge, ils réclament, ainsi d ’ailleurs que les Chypriotes Grecs, l’appui du consulat de Grande-Bretagne dans les affaires de justice auxquelles ils sont partie prenante54. Il n’y a pas, pour les gouvernements coloniaux, une question chinoise analogue à ce qu’est pour la Grande-Bretagne la question indienne, pour la simple raison que la Chine, à l’inverse de l’Inde, n’est pas une colonie. Par suite, les Chinois, à l’inverse des Indiens, ne peuvent ni ne veulent revendi quer des droits en tant que sujets d ’une puissance européenne. Ils n’en gardent pas moins une forte spécificité, marquée par le développement d’un système scolaire propre, d ’une presse spéciale. Leur gouvernement prétend continuer à exercer sur eux sa souveraineté, par exemple aux Indes néerlan daises, où les autorités tiennent au contraire à les traiter comme des sujets hollandais, ce qui n ’est pas sans susciter des difficultés. Plus tard, ils sont évidemment très hostiles aux agressions du Japon contre la mère-patrie, et ils tentent de réagir dans la mesure de leurs moyens. C ’est ainsi qu’à plusieurs reprises les Chinois de Singapour ont refusé de débarquer les produits japo nais, ou que ceux des Indes néerlandaises ont refusé de les consommer. Us multiplient aussi les collectes publiques pour subventionner l’effort de guerre. Cette attitude, bien qu’objectivement favorable au maintien de la présence européenne, n’est pas sans susciter d’inquiétude aux dirigeants des puissances coloniales, et en particulier aux HoUandais, soucieux de conserver de bonnes relations avec le Japon. Le fait même de l’immigration d ’origine extra-européenne, enfin, est discuté. Les personnels dirigeants des Dominions « blancs », appuyés sur une opinion publique facilement xénophobe, redoutent que l’affiux massif d ’Asiatiques ne remette en cause la composition majoritairement européenne de leur peuplement. Dans les années vingt, des auteurs s’inquiètent devant « le flot montant des peuples de couleur», d ’après le titre d ’un ouvrage publié en 1920 par l’Américain Lothrop Stoddard. Le titre complet est encore plus explicite (Le flo t montant des peuples de couleur contre la domi nation mondiale des Blancs)55. Lothrop Stoddard souligne que la population blanche ne représente que la moitié de la population mondiale, et que ce déséquilibre ne peut que s’accroître, étant donné le ralentissement de la croissance des « Blancs », atteinte au surplus par la saignée du récent conflit mondial, en faveur des «R ouges», des «Jaunes», des «B runs», et des « Noirs ». Selon lui, il faut prévoir une émigration massive des terres surpeu plées de l’Asie vers les pays conquis par les Européens, colonies euro péennes, Dominions, et Etats-Unis compris, et tenter d ’élever des digues
54. Vanderlinden (J.), Pierre Ryckmans, p. 412. 55. Stoddard (L.), Le flot montant des peuples de couleur contre la suprématie mondiale des Blancs, traduction française, Payot, 1925.
Fonctionnement social : dualisme et pluralisme
contre elle. Même s’il s’agit là des fantasmes d ’un écrivain raciste, envers exact des utopies bien-pensantes également en vogue outre-Atlantique, il y a bien là l’impression d ’une vague angoisse. Toutes ces difficultés amènent les pays concernés à pratiquer une poli tique migratoire de plus en plus restrictive pour éviter de voir menacer des équilibres considérés, à tort ou à raison, comme essentiels. Dès avant la guerre, l’Australie, en 1912, l’Afrique du Sud en 1913 avaient adopté des mesures destinées à interdire l’immigration de couleur, essentiellement chinoise dans le premier cas, indienne dans l’autre. Ces décisions particu lières ont fait l’objet d ’une convention plus générale, une conférence impé riale de 1918 ayant autorisé les gouvernements des Dominions à adopter des mesures restrictives, permettant seulement aux Indiens déjà établis de faire venir leur femme (une seule femme, est-il précisé) et leurs enfants mineurs. Mais cette politique vise aussi à satisfaire certaines demandes d ’origine locale. Certains plans ont visé, après la Première Guerre mondiale, à implanter plusieurs millions d ’indiens dans l’Irak fraîchement occupé, où l’administration britannique envisage de les employer à de grandioses projets de mise en valeur. La révolte de 1920 autant que le bon sens amènent à renoncer à ces déplacements massifs, qui ne sauraient que jeter le trouble parmi des populations mal soumises. La Malaisie interdit l’immigration indienne en 193856. La Birmanie suit en 1941. À partir de la fin de 1941, l’occupation japonaise pèsera lourdement sur les communautés chinoise et indienne d ’Asie du Sud-Est Un demi-million d ’indiens fuiront la Birmanie pour éviter le massacre ; certains seront spoliés de leurs biens et privés de leurs titres de créance par les occupants, désireux de s’attacher les faveurs populaires ; il est vrai que d ’autres, à l’inverse, seront recrutés dans « l’armée nationale indienne » de Chandra Bose, un des anciens leaders du Congrès rallié à l’Axe dès 1941, qui se battra sous le commandement japonais. En Malaisie, on assistera au massacre de nombreux Chinois, notamment ceux de Singapour57. Si la responsabilité des conquérants est naturellement majeure, les ressentiments des indigènes à l’égard des victimes se sont souvent donné libre cours à l’occasion de ces déchaînements de violence.
Villes et cam pagnes, la juxtaposition spatiale De tout temps, les rapports ethniques et sociaux se sont projetés dans la disposition topographique de l’habitat. La chose est particulièrement vraie en terre de colonisation. Dans les campagnes, là où l’implantation européenne est significative, on voit s’édifier, côte à côte, fermes ou villages européens et villages indigènes. C’est notoirement le cas en Afrique du Nord, où à côté de
56. Dennery, « L’émigration indienne », Annales de Géographie, 1928, p. 328-353. 57. Tarling (N.), The Cambridge History of Southeast Asia, p. 336.
225
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
la ferme française à toit de tuiles rouges domine les modestes constructions indigènes de terre à toit de chaume ou de roseaux, tandis que le plan géomé trique des villages de colonisation s’oppose aux ruelles tortueuses des villages indigènes aux toits en terrasse. Sous les tropiques, romans et nouvelles ont popularisé le bungalow (originaire du Bengale, comme l’in dique l’étymologie), répandu sous l’influence des Anglais à des milliers d’exemplaires, parce que paraissant le mieux correspondre aux besoins tropi caux : large toit protégeant de la chaleur, un ou deux étages, large véranda, souvent sur trois côtés, grandes portes-fenêtres munies de persiennes, cabinet de toilette avec bac de ciment pour le tub ou la douche avec tuyau d ’évacua tion. Le plus souvent, la cuisine et les communs, domaine de la domesticité indigène, en sont séparés, pour des raisons de distances sociales autant que pour celle, souvent alléguée, de limiter les risques d ’incendie. Mais la ville est sans doute ce sur quoi les Européens ont le mieux imprimé leur marque, notamment dans les bâtiments publics. Presque toujours, les villes fondées par les Européens s’apparentent à celles du pays d ’origine, même quand les architectes ont tenté die s’inspirer du style local. Bombay possède ainsi, dans les années trente, un hôtel de ville, déjà centenaire, une université achevée en 1874, un palais de Justice, achevé en 1879, une bibliothèque, un bureau des postes, une gare (la gare Victoria), et deux grands Hôtels, le Majestic et le Taj Mahal. Tous les styles s’y côtoient : style classique pour l’hôtel de ville, avec colonnades doriques et fronton; style plutôt moyenâgeux pour les constructions de l’époque victorienne ; inspiration de style musulman pour l’hôtel Majestic, et indienne pour l’hôtel Taj Mahal5®. À Batavia, les bâtiments principaux se groupent autour de la Place royale, dans le quartier de Weltevreden. L’essentiel de l’architecture est européenne : bâtiments officiels du début du XIXe siècle en style néo-classique ; hôtels ou immeubles du début du XXe siècle de style composite, décorés de sculptures ou de mosaïques. Des maisons du XVIIe ou XVIIIe siècle, caractérisées par des toits de tuile aux extrémités relevées, parfois empilés en retrait les uns sur les autres, à la manière asiatique, subsis tent plus au sud, dans le vieux quartier hollandais de Kota, construit en bordure de la mer, sur des canaux, mais en grande partie démoli pour des raisons d’insalubrité5859. Outre ces formes architecturales, d ’innombrables signes rappellent, de manière obsédante, la domination coloniale. Citons, entre autres, les statues des conquérants, de Bugeaud à Alger à Cecil Rhodes au Cap, de Ferdinand de Lesseps à Port-Saïd à Stamford Raffles à Singapour, en passant par Charles Gordon à Khartoum. Pour sceller définitivement la présence britannique sur le sol soudanais, le plan de cette ville, imposé par Lord Kitchener, reproduit le dessin de YUnion Jack (cas malgré tout isolé). Les noms de rues ont la même fonction, les chefs d ’État, souverains, dicta teurs ou présidents de la République étant naturellement les plus honorés. 58. Huxley (A.), Le monde en passant, p. 19-20. 59. Lombard (D.), Le carrefour javanais, essai d ’histoire globale, École des Hautes Études en Sciences sociales, 1990,3 vol., LI, Les limites de l'occidentalisation, p. 148 sq.
226
Fonctionnement social : dualisme et pluralisme
Le style de vie s’efforce, lui aussi, de se conformer aux exigences de la bourgeoisie européenne. « Les Européens à Java, écrit Fumivall, et spéciale ment à Batavia, en sont venus à jouir des agréments de l’Europe à un degré qui rend la vie sociale presque européenne aux visiteurs venus de l’Inde britannique ». On peut s'y procurer les derniers livres parus, y faire l’acquisi tion de tableaux de valeur, et y écouter de la bonne musique60. Il regrette cependant que, faute d’une base sociale assez large, la culture résulte moins d’un mouvement de création spontané, et qu’elle soit plutôt « provinciale » et « imitative ». Ce jugement est sans doute assez vrai, et vaudrait pour l’en semble des grandes villes coloniales. Mais, à part quelques grandes métro poles, où la polarisation de la création artistique coïncide avec celle du pouvoir politique et économique, en va-t-il différemment en Occident, où la norme est bien plus ces petites villes et ces bourgs où, faute de moyens, on ne peut que copier les modes de la grande cité ? Là où les Européens sont encore majoritaires, leurs villes se présentent avec l’orgueil des fondations du Nouveau Monde. Loin d ’être « une de ces villes orientales féériques, mythologiques, quelque chose tenant le milieu entre Constantinople et Zanzibar», comme se le figurait déjà naïvement Tartarin, le héros du célèbre roman de Daudet, en 1860, l’Alger des années trente, qui regroupe près du quart des Français d’Algérie, s’apparente, à l’ex ception du quartier de la Casbah, à une ville française, dont les habitants vantent l’urbanisme moderne, quelque chose tenant le milieu, dira-t-on, entre Nice et Marseille, avec, en plus, une université dont ne disposent alors ni l’une ni l’autre de ces deux villes. Les seuls rappels de la culture locale sont les bâtiments de style néo-mauresques édifiés, non sans goût, dans les années 1900. Le site inspire à Le Corbusier des plans d'urbanisme grandioses, qui ne verront pas le jour. Les Oranais reprochent aux Algérois leur prétention, peutêtre parce que les quartiers populaires y sont moins visibles que dans leur cité, à l’atmosphère plus chaleureuse. Oran s’apparenterait plus à des villes méditerranéennes comme Tunis ou Alexandrie, avec leurs foules bruyantes et colorées, où la communauté immigrée la plus nombreuse met une note particulière : espagnole à Oran, italienne et maltaise à Tunis, grecque à Alexandrie. À l’autre extrémité du continent, Johannesburg, avec son plan orthogonal, ses blocs d ’immeubles de 10 étages, les trains de banlieue qui, le matin, y déversent des foules d ’employés qui se dispersent dans le quartier des affaires, est surnommée par un voyageur « le Chicago de l’Afrique »61. Dans les pays où les Européens sont moins nombreux, certaines villes leur sont parfois réservées. C ’est ainsi que sous la responsabilité de Lyautey, des villes modernes, dessinées selon les plans de l’architecte Henri Prost, se juxtaposent aux vieilles médinas du Maroc, qui échappent de la sorte à la démolition. À côté de la ville indigène, avec ses quartiers spécialisés par
60. Fürnivall (J.S.), Netherlands India, p. 458. 61. Danloux-Dumesnil, « Les centres urbains d’Afrique », art. cit., p. 17.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
profession, Hanoi possède sa ville européenne, dont l’axe est marqué par la rue Paul-Bert, bornée à une extrémité par le théâtre, et de l’autre par le parc du petit lac, avec ses îlots ornés de pagodes, dont l’une reste fréquentée par les fidèles. Les Anglais, de leur côté, poursuivent l’édification de New Delhi, au sud de l’ancienne capitale des empereurs moghols, sur les plans pharao niques de l’architecte Luytens. La cité reste encore laigement administrative. Le palais du vice-roi, qui occupe, avec trois cent trente pièces, ses jardins et ses dépendances, environ 130 hectares, les résidences prévues pour les grands dignitaires et les fonctionnaires, les bâtiments des grands services publics, des églises, des monuments, constituent encore, au milieu des années trente, l’essentiel des constructions. Peu de locaux d ’habitations, de boutiques, et énormément de terrains vagues, dans cet immense espace. Les Indiens préfèrent continuer à loger dans la ville ancienne, et les Européens dans les anciens quartiers proches des barracks, les camps militaires, au nord62. Là même où la population européenne ne forme qu’une petite minorité, elle se regroupe dans des quartiers spéciaux, où les indigènes ne sont repré sentés que par le personnel domestique. Dans la plupart des colonies, de peuplement ou non, les centres des villes, bruyants ou insalubres sont, d ’ailleurs, de plus en plus, désertés par les familles aisées au profit de quar tiers aux avenues calmes, presque désertes, où de blanches villas s’enfouis sent au milieu des fleurs et de la verdure, ignorant la poussière et la promis cuité du petit peuple, européen ou indigène, qui n’y pénètre guère qu’à titre de domestique. Ainsi, par exemple, le quartier d ’Anfa près de Casablanca. Des courts de tennis, des terrains d ’équitation, de football ou de cricket, des piscines, fournissent l’exercice indispensable, et constituent aussi des lieux de réunion, auxquels s’ajoutent des hippodromes (celui de Darjeeling s’enor gueillit d’être le plus élevé du monde), voire, comme à Elizabethville, un vélodrome, sans doute reflet lointain du prestige des grands pisteurs belges. Dans ces cités, les influences européennes sont fortement colorées par les traditions nationales des métropoles. Un observateur britannique remarque, en 1939 : « Malte a des public houses et non des cafés ; on y boit, debout, de la bière et non, assis, des apéritifs *6364. Paul Morand, encore plus systéma tique, juge non sans caricature que Port of Spain, la capitale de l’île de la Trinité « ressemble à Vancouver, à Ceylan, à Hong Kong, à toutes les colo nies anglaises, qui elles-mêmes ressemblent à l’Angleterre. Routes asphal tées, magasins fermés à quatre heures, parc anglais, tennis, bible, jardin zoologique. Coolies hindous Jean Monnet, installé pour affaires dans la concession française de Shanghai en 1935, écrit que « les Français avaient l’art de reconstituer des sous-préfectures dans les établissements les plus lointains. Les tramways, les restaurants, les loteries, donnaient l’atmosphère 62. Goetcl (F.), Voyage aux Indes, p. 117-118. 63. Monroe (E.), Les enjeux politiques en Méditerranée, p. 42. 64. Morand (P.), Hiver caraXbe, p. 54.
228
Fonctionnement social : dualisme et pluralisme
provinciale. Mais, de l’autre côté de la rue, la concession anglo-américaine contrastait par son activité, ses grandes firmes d ’import-export, ses entrepôts remplis de cotonnades et ses flottilles de bateaux sur le Yang-Tsé... Sans doute, les capitaux français étaient présents, mais invisibles, et brassés par les entreprenants Chinois et Anglais »M. Comment s’étonner que ces villes alimentent, chez les autochtones, les rêves les plus naïfs, les plus fous, mais aussi les plus ambitieux ? Nelson Mandela raconte: «on m’avait toujours décrit Johannesburg comme une ville de rêve, un endroit où un pauvre paysan pouvait se transformer en un homme riche à la mode... Je me souvins des histoires que Banabakhe nous avait racontées à l’école de circoncision, les immeubles si haut qu’on ne pouvait en voir le sommet, les foules parlant des langues qu’on n ’avait jamais entendues, les jolies femmes et les gangsters audacieux. C ’était Goli, la ville de l’or, où j ’allais habiter »6566. Même si les réalités démentent très vite les espoirs, il n’en reste pas moins que très rares sont les déçus qui repren nent les chemins des campagnes. Ils trouvent malgré tout, dans les cités, des ressources, régulières ou non, inexistantes dans les villages, et la possibilité d’échapper au poids de structures traditionnelles, appuyées sur le pouvoir colonial, qui paraissent trop pesantes, l’exploitation traditionnelle du pays pesant avant tout sur les paysans. À cette attraction s’additionne le problème du surpeuplement, évoqué plus haut. Dans tous ces pays, le problème de l’exode rural commence en effet à se poser, avec la naissance des zones d ’habitat précaire (mais non temporaire) qui ceinturent les villes coloniales. Tunis et Alger ont leurs « Bidonvilles », Casablanca ses « Carrières centrales ». Simultanément, l’habitat traditionnel ancien se dégrade, comme le centre de la Casbah d ’Alger, où des immigrants kabyles s’entassent dans les anciennes demeures où ils remplacent les vieux citadins, attirés par des modes de résidence plus modernes. La vie est proba blement encore plus difficile dans les townships surpeuplés du Witwatersrand sud-africain, dont le plus vaste, le South Western Native Townships est appelé à devenir plus tard mondialement connu sous l’abréviation de Soweto. Misère, entassement, manque d’eau potable, mainmise de la pègre caractérisent ces quartiers. Cette évolution n’est pas sans inquiéter. Au Congo belge, la création des centres dits extra-coutumiers place les popula tions des zones urbanisées sous le contrôle d ’administrateurs européens, assistés d ’un «comité protecteur» formé de fonctionnaires et de mission naires. En Afrique du Sud, les gouvernements blancs durcissent leur législa tion : en 1923, le Native Urban Area Act tend à réglementer l’immigration dans les villes, et à organiser strictement la ségrégation67. Il n’en reste pas moins que la quiétude des cités coloniales est menacée.
65. Monnet (J.), Mémoires, 1.1, Fayard, 1976, p. 160, Le livre de Poche. 66. Mandela (N.), Un long chemin vers la liberté, Fayard, 1995, p. 68. 67. Hailey (Lord), An African Survey, 1956, p. 159,
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
L’effort pour maintenir une séparation n’est-il pas, d ’ailleurs, en partie annulé ou rendu obsolète par les rapprochements dus aux influences réci proques, et, singulièrement, à celles qu’exercent les cultures de l’Europe ?
230
Chapitre 8
Phénom ènes d ’acculturation
À travers les diverses formes de contacts ou d’influences se sont mises en marche, depuis longtemps, une série de transformations sociales. On peut les résumer sous le terme d ’acculturation, non pas inventé, mais consacré en 1935 dans un mémorandum du Social Science Research Council pour dési gner « les phénomènes qui résultent du contact direct et continu entre des groupes d ’individus de cultures différentes, avec des changements subsé quents dans les types culturels originaux de l’un des deux groupes »*. Avec plus de précision, Malinowski parlait de « l’impact d ’une culture supérieure, active, sur une culture plus simple, plus passive ». Le terme d ’acculturation sera critiqué par la suite, comme supposant une supériorité de la culture ou des cultures occidentales par rapport aux cultures des pays colonisés. Dès la fin des années trente, certains, comme l’Africain Ousmane Socé, préféraient parler de « métissage culturel », utilisant dans un sens d ’ailleurs restreint à la culture littéraire et artistique, une expression largement répandue aujour d’hui, et employée en général dans un sens positif, quoique vague12. Il est évident qu’une société agit toujours sur une autre, même en cas de séparation plus ou moins stricte, comme celle que nous avons vue plus haut. Certains, devant les difficultés des rapprochements humains, voient dans les échanges intellectuels, et évidemment ceux qui passent par l’école, la seule possibilité de rapprochement réelle, qui amène les colonisés à partager, au moins, un certain nombre d ’idées empruntées par les seconds aux premiers. D’autres constatent aussi combien, de manière plus ou moins invo lontaire, bien des modes de vie ou des pratiques d ’origine extérieures, issus de la culture matérielle de l’Occident industrialisé, s’imposent dans les pays colonisés, même pour y subir certaines transformations qui montrent la spécificité des groupes indigènes.
1. Herskovits (M.-J.), Les bases de l ’anthropologie culturelle, Payot, 1967, p. 216 2. Lusebrink (H.-J.), « Métissage culturel et société coloniale », Métissages, LittératureHistoire, T. II, Université de la Réunion/L’Harmattan, 1992, p. 108-118.
231
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
La transm ission des modes de vie Quelques habitudes communes L’habitude de vivre côte à côte implique certaines coutumes communes. Celles-ci sont, souvent, d ’abord, culinaires : la nourriture coloniale intègre des plats locaux, aux goûts et aux odeurs inconnus en Europe, avec l’addi tion d ’ingrédients comme le curry, ou d ’innombrables épices, dont le piment en quantité insupportable aux gosiers européens. Du célèbre couscous, le regretté Jacques Berque écrit dans son Maghreb entre-deux-guerres que ce mets « ralliait les suffrages. En lui, tous les allogènes savouraient l’offrande de cette terre apprivoisée. Le couscous constitue la seule unanimité, peutêtre, de l’Afrique du Nord »3. Les Hollandais, de leur côté, ont popularisé le rijstaffel (« table de riz »), débauche de nourriture consistant en une intermi nable série de mets (viandes, poissons, légumes, bananes...) servis avec du riz. En Europe même, l’entrée massive des produits tropicaux habitue les Européens à des saveurs ou à des habitudes alimentaires nouvelles. Un certain nombre de termes sont empruntés à des réalités coloniales, de la cagna annamite au caïd arabe, en passant par le pyjama des Indes. L’orien talisme n ’est pas mort, et continue à produire tableaux et meubles d’inspira tion exotique; dans une certaine mesure, l’apport culturel de l’Afrique commence à être apprivoisé soit directement, notamment à travers les expo sitions d ’art africain, soit par la médiation afro-américaine du jazz, plus apprécié en France qu’en aucun autre pays, y compris son pays natal. S’agitil seulement de ce que Maunier appelle des emprunts divisés, c ’est-à-dire « l’emprunt isolé d ’un trait singulier?»4. L’ensemble ne dépasse pas la culture superficielle, mais prépare l’arrivée, alors peu imaginable, de popula tions d ’outre-mer. Inversement, le style occidental est de plus en plus emprunté par les élites locales. Pour les hommes, surtout, le costume européen s’impose, à des rythmes différents, quelquefois corrigés par un détail tel le tarbouche ou fez, qui s’est imposé à la fin du XIXe siècle (Uns l’Empire ottoman, et est encore largement porté dans les pays arabes du Moyen-Orient comme en Égypte et en Afrique du Nord. Pour les femmes, en revanche, ce n’est que très timide ment encore que (à l’exclusion des écoles, notamment religieuses), s’intro duisent les modes étrangères, souvent par le truchement de certaines cérémo nies comme le mariage, où commencent à s’imposer robes blanches et grands voiles pour les mariées. Les élites urbaines ont commencé à quitter les maisons traditionnelles pour se faire bâtir des demeures plus vastes, de style européen, où salons ou salles à manger copient ceux de la bourgeoisie occidentale. Les manières de tables incluent couteaux et fourchettes. En revanche, l’aspect de la masse des populations change peu. Celles-ci demeu-
3. Berque (J.), Le Maghreb, p. 319. 4. Maunier (R.), Sociologie coloniale, T. III, Le progrès du droit, p. 181.
232
Phénomènes d ’acculturation
rent généralement fidèles à leur façon de se vêtir et à leur habitat tradi tionnel. Les masses sont touchées par des influences plus diffuses. L’application de la législation occidentale, l’introduction des techniques sont parmi les principaux vecteurs, «les véritables missionnaires de l’Occident», selon l’expression d ’Henri Michaux5. Le cinéma, en particulier hollywoodien, commence à envahir la planète, contribuant à donner à la civilisation « blanche » les couleurs séduisantes et perverses du « mirage américain ». Le jeune Soekarno, né avec le siècle, avouera, bien des années plus tard, son culte pour les Tom Mix, Mary Pickford, et autres stars du muet, dont il collectionne les portraits qu’il trouve dans les paquets de cigarettes Westminster6. Mais les productions britanniques, françaises sont également répandues. Le cinéma indien, qui a déjà derrière lui des structures solides, ou le cinéma égyptien commencent à se faire connaître en dehors de leur pays d’origine. Des rudiments de langues européennes continuent à s’introduire, et donnent lieu à des emprunts variés, mais aussi à des déformations pitto resques (sabirs d ’Afrique du Nord, Pidgin-English), dans la tradition des différents parlers créoles des vieilles colonies françaises ou portugaises, en particulier les îles du Cap-Vert. Des éléments de la civilisation matérielle, de toute cette « moraine hétéro clite d ’ustensiles» dont parle Jacques Beique, contribuent aussi à une certaine uniformisation. Les marchés aux puces sont florissants aux abords des grandes villes, approvisionnés par les rebuts des privilégiés, européens et indigènes. Les vieux vêtements, moins coûteux que les vêtements tradition nels, viennent vêtir les plus pauvres, comme cette vieille veste de soldat, « râpée et verdie », qui se retrouve sur les épaules d ’un berger du MoyenAtlas. C ’est là aussi que des chefs de familles modestes, par besoin, mais aussi par goût de la nouveauté, se fournissent en pendules plus ou moins détraquées, en chaussures en plus ou moins bon état. Un exemple d ’emprunt élémentaire est fourni par le sociologue René Maunier : l’usage du bidon métallique à pétrole diffusé partout par les grandes compagnies pétrolières américaines, Standard Oil en tête. Celui-ci est utilisé en Égypte et au Maghreb, d ’abord en remplacement des jarres à porter l’eau, sur les têtes de femmes et l’échine des bourricots, mais aussi, à l’aide de découpages adaptés, comme godet à noria, comme four à faire cuire les aliments (iqanoun), ou encore comme lanterne. Aplati à coups de masse, il sert, avec d’autres matériaux de récupération, à édifier les constructions sauvages qui commencent à s’édifier aux abords des grandes cités, en particulier celles d’Afrique du Nord, où le néologisme de « bidonville » pourrait être apparu7.
5. Michaux (H.), Un Barbare en Asie, p. 103. 6. Soekarno (A.), An Autobiography as told to Cindy Adams, The Bobbs-Merril C \ New Yoik, 1965, p. 27. 7. Maunier (R.), Sociologie coloniale, T. I, Introduction à l’étude du contact des races, Domat-Montohiestien, 1932, p. 130 ; T. Ill, Le progrès du droit, p. 171.
233
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Mais les amoureux des traditions déplorent de voir la tôle remplacer les toitures végétales traditionnelles jusque dans les îles lointaines du Pacifique. Aucun pays du monde n’échappe à cette invasion : l’ethnologue Bronislaw Malinowski note que, dans les années 1920 en Nouvelle-Guinée, il n’arrivait que difficilement à retrouver des groupes humains qui n’aient subi aucune influence occidentale, les îles du Pacifique occidentale où il avait travaillé étant déjà envahies par les produits de la Standard Oil, les cotonnades, voire les journaux ; cette quête était devenue encore plus difficile dans l’Afrique des années 30 où il avait ensuite vécu. C’est à partir de ce constat, d ’ailleurs, qu’il réoriente ses recherches en direction de ce qu’il appelle l’étude du changement culturel8. L’influence des sports est un autre bon exemple de l’attrait des pratiques de l’Occident. Un exemple : le sport Les sports européens s’imposent largement partout. Ils ont d ’abord touché les élites, dans la mesure où le sport, notamment dans les territoires britanniques, est indissociable d ’une éducation accomplie. De jeunes souve rains abandonnent volontiers leurs costumes hiératiques pour se livrer au pilotage automobile, au tennis ou à la natation, accompagnant ainsi un mouvement largement répandu dans les bourgeoisies dites « indigènes ». Les Indiens ont adopté depuis longtemps le hockey, sport dans lequel ils domi nent déjà l’élite mondiale ; en tennis, leurs équipes participent à la Coupe Davis. Le cricket a beaucoup de succès dans les possessions anglaises, des Indes aux Caraïbes. Il arrive même à mêler Blancs et hommes de couleur : Élie Faure rapporte qu’il a vu, sur un paquebot à destination de l’Europe, des Anglais et des Indiens jouant ensemble à ce jeu. Quant au polo, dont les origines orientales se perdent dans la nuit des temps, et que les officiers britanniques ont emprunté aux cavaliers moghols, il continue à opposer équipes régimentaires de l’armée des Indes et équipes des États princiers dans des tournois comme la Prince o f 'Wales Cup, créée en 1921 ; mais il s’est répandu rapidement dans les populations blanches de l’Empire, ainsi qu’aux États-Unis. En 1930, les premiers Empire Games sont organisés à Hamilton au Canada. Le sport touche aussi les masses, attirées par le spectacle, mais au sein desquelles il suscite d ’innombrables vocations. Les militaires, les mission naires, en particulier, en ont été les principaux propagateurs. Si les gentlemen indiens excellent au cricket, le jeu est populaire dans les campagnes, et tel observateur note que les paysans dans les villages des alentours de Bombay s’y adonnent avec une « adresse surprenante »9. Le football, de préférence au
8. Leclerc (G.), Anthropologie et colonialisme, Fayard, 1972, p. 80. 9. O’Malley, Modem India, p. 586.
Phénomènes d'acculturation
rugby, s’est développé très tôt en Algérie et en AOF (où le premier match officiel aurait eu lieu en 1913). Alain Gerbault se fait à la fois le propagateur de ce sport et l’interprète des vœux des indigènes de Polynésie auprès de l’administration pour la création de stades, encore qu’il préférerait leur enseigner le rugby, qu’il trouve mieux adapté à leurs qualités propres. Les autorités sont quelque peu partagées quant aux encouragements à donner aux sports indigènes. S’ils paraissent devoir contribuer à la formation et à la distraction des populations, selon le vieux principe romain du Panent et Circenses, l’organisation d ’associations sportives, susceptibles de servir de paravent à des organisations politiques, comme le discrédit qui serait censé atteindre le prestige des Européens en cas d ’une supériorité trop évidente de leurs « sujets », font hésiter bien des responsables. Les autorités françaises elles-mêmes s’intéressent aux athlètes africains. En 1928, l’Algérien Boghera el-Ouafi remporte la médaille d ’or du marathon des Jeux d ’Amster dam, et bien des responsables sportifs jugent que l’appel aux colonies et notamment à l’Afrique pourrait servir à relever le niveau médiocre des équipes françaises dans la compétition internationale, lointain objectif qui ne se concrétisera totalement qu’une cinquantaine d ’années plus tard, dans des circonstances fort différentes, il est vrai. Les tentatives pour organiser des compétitions régionales ont plus ou moins de succès. Si des Jeux d’ExtrêmeOrient ont lieu à Shanghai en 1921, le baron de Coubertin, qui s’est défini lui-même comme un « colonial fanatique », ne réussit pas à organiser des Jeux Africains, définitivement annulés en 1929101. Il faut remarquer que l’attrait de la civilisation matérielle s’exerce égale ment de manière très forte sur les plus pauvres. La plus étrange expression de cet état d ’esprit est sans doute ces croyances dénommées «cultes du cargo», apparues dès les années 1870 chez des insulaires des mers du Sud, en particulier chez les Papous de Nouvelle-Guinée. Selon ces derniers, les produits d’Europe ne sont pas le fruit du travail des Blancs, qu’ils n’ont jamais rien vu produire dans leurs îles. En réalité, les Blancs ont réussi, par des sortilèges soigneusement dissimulés, à s’assurer le monopole de richesses d ’origine divine, autrefois dévolues aux ancêtres des Papous euxmêmes. Il convient donc de s’en assurer de nouveau la jouissance. D’où des mouvements subversifs, qui expliquent la répression exercée contre ces cultes11. Certes, il s’agit là d’une situation très particulière. Mais ne traduitelle pas, sous une forme mythique, le désir de retrouver les richesses natio nales qui s’exprime, ailleurs, sous des formes rationnelles ? On peut se le demander. Mais on touche ici à un tout autre domaine.
10. Deville-Danthu (B.), Le sport en noir et blanc. Du sport colonial au sport africain dans les anciens territoires français d'Afrique occidentale (1920-1965), L’Harmattan, 1997, p. 62-64. 11. Lawrence (P.), Le culte du cargo, Fayard, 1964.
235
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
La transm ission des idées Une différence importante, souvent soulignée par les observateurs du temps, réside dans le schéma de reproduction qui est sous-jacent aux repré sentations des différents colonisateurs à l’égard des changements qui se produisent à l’intérieur des sociétés qu’ils contrôlent, et sur lesquelles ils pensent pouvoir disposer d ’une certaine capacité d'action. Nul n’a mieux que Thomas Edward Lawrence, le célèbre agent britannique au MoyenOrient lors de la révolte arabe de 1916-1918, opposé la manière dont les Britanniques et les Français considèrent les emprunts faits à leur culture par les indigènes. D’après lui, les Anglais «conseillent aux autres d ’être les meilleurs des hommes après eux. Dieu ne leur a pas donné d ’être Anglais : leur devoir reste d ’être de bons exemplaires de leur race... ». Les Français au contraire «sont partis d'une doctrine analogue (dogme plutôt que secret instinct) qui fait du Français la perfection humaine : mais ils n’ont pas cessé d ’encourager leurs sujets à les imiter. Évidemment, pensent-ils, un indigène n’atteindra jamais leur niveau, mais sa valeur sera d ’autant plus grande qu’il en approchera davantage. Nous voyons dans l’imitation une parodie ; les Français y voient un compliment »l2. Sous l’humour qui renvoie dos à dos la vanité des deux peuples colonisa teurs est bien résumée la différence dans laquelle on s’accorde alors, de part et d ’autre, à opposer les visions des deux plus grandes puissances coloniales : c’est plus ou moins l’assimilation, c’est-à-dire la disparition, en quelque sorte, de l’indigène dans une communauté française où ses particu larités se réduisent à de pures nuances folkloriques, qui apparaît aux respon sables français comme l’idéal de la colonisation. Le programme officiel d ’as similation a bien pu être remplacé au début du siècle par celui d ’association, qui prend en compte la différence de cultures et postule qu’il serait absurde d’espérer faire des indigènes des Français comparables à ceux de métropole ; l’association est, pour beaucoup de Français, notamment à gauche, un aveu d ’échec, ou bien un refus de reconnaître les indigènes comme de véritables égaux, sous prétexte de respecter leurs différences. Cet idéal n’est pas celui des Français seulement : il est aussi inscrit dans les conceptions coloniales portugaises. « Tant que le Noir est un sauvage, nous le traitons en sauvage ; dès qu’il est civilisé, nous le traitons en civilisé, c’est-à-dire comme l’un des nôtres », affirme un administrateur portugais à Jacques Weulersse, lors de son passage à Vila Luzo, en Angola. Quelque temps plus tôt, un administra teur britannique interrogé par lui se félicitait au contraire que son pays n’ait pas cherché à faire des indigènes des « singes d ’Européens »13. De même il s’agit, pour les Belges, «de produire de meilleurs Africains, et non des copies d ’Européens », qui ne sauraient jamais être qu’une troisième catégorie
12. Lawrence (T.E.), Les Sept piliers de Jd sagesse, [1926], trad., fr. de Ch. Mauron, Payot, 1969 (1*" éd.1936), t. Il, p. 55-56. 13. Weulersse (J.), Noirs et Blancs, p. 136,179.
236
Phénomènes d ’acculturation
d’humanité14. Quant aux Hollandais, Bousquet, à l’issue de sa longue enquête, nourrie de vastes lectures, les juge étrangers au désir de répandre leur civilisation chez leurs sujets des Indes néerlandaises15. Ces apprécia tions d ’ensemble appellent évidemment des précisions. Formation et enseignement Dans l’ensemble, les Anglais ont été convaincus, non seulement de la supériorité de leur culture, mais aussi de la nécessité de la répandre. Dès 1835, par exemple, le gouvernement britannique proclamait, sous l’influence de Thomas B. Macaulay, membre du conseil du gouverneur général, Lord William Bentinck, que « le principal but du gouvernement anglais devait être de contribuer à l’avancement de la littérature et de la science européennes parmi les nations de l’Inde»16. Ces principes ont pu être sérieusement discutés par la suite, en particulier pour ce qui est du caractère prioritaire du but, et aussi de l’extension à donner à l’avancement en question. On a pu sans invraisemblance faire observer que, pour Macaulay, il s’agissait d ’abord de donner la priorité à l’anglais sur les langues alors répandues au sein des castes dirigeantes indiennes (l’arabe ou le sanscrit comme langues reli gieuses, le persan comme langue de gouvernement). Ils n’ont jamais pu être totalement remis en cause, dans la mesure où le souci de faire progresser l’éducation constitue, en fin de compte, un des meilleurs arguments en faveur de la colonisation, qui peut ainsi se prévaloir d ’offrir à des pays « pri mitifs» ou «arriérés» ou «endorm is» l’héritage des «lum ières» détenu depuis le xvn* siècle par les élites européennes, et que, depuis le XIXe siècle, un effort de scolarisation sans précédent s’efforce d’étendre aux classes populaires. Tous les gouvernements ont-ils développé des idéologies identiques ? Il n’y a guère de doute à émettre quant à l’unanimité qui peut se faire à propos de la « science », c’est-à-dire, plus simplement, de l’éducation moderne de type occidental, mais il n’en est pas forcément de même à propos du langage. Si les Britanniques sont très attachés à répandre le leur, c ’est encore plus vrai des Français, pour lesquels, dans la lignée du célèbre Discours sur Vuniversalité de la langue française, le rayonnement culturel, indissociable de la pratique de la langue, a toujours constitué un précieux capital à sauve garder. Avec moins de moyens, les autres puissances latines, Italie, Portugal et Espagne, ont une sensibilité analogue. En revanche, si les Hollandais ont fait un effort réel dans le domaine scolaire, le souci de faire progresser la connaissance de leur propre langue ne parait pas les avoir préoccupés ; quant aux Belges, leurs propres problèmes linguistiques ne leur laissent guère la
14. Hailey (Lord), An African Survey, 1956, p. 1209. 15. Bousquet (G.H.), La politique musulmane, p. 161. 16. Morisou (Sir Th.), « Le développement politique de l’Inde », Problèmes britanniques, p. 179.
237
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
possibilité de développer une idéologie. L’affirmation de principes, d ’ailleurs, n’entraîne pas, mécaniquement, tel ou tel type de politique, d ’au tant plus que les États ne sont pas seuls impliqués dans ces formes d ’influences, les Églises chrétiennes occupant aussi une place importante dans l’effort qui vise à transformer les populations. Comme en Europe, la question de l’enseignement populaire doit être ici distinguée de celle des élites, le second des deux termes étant, comme on le verra, particulièrement vague. a) Enseignement populaire Bien que peu encouragé, l’enseignement traditionnel, le plus souvent à fondement religieux, subsiste encore largement : en Inde se juxtaposent ainsi écoles coraniques, hindouistes (fois) et bouddhistes. En Algérie, bien que très déchu, il continue, dans certaines régions rurales, à faire que le nombre de lettrés en arabe soit plus élevé que celui de lettrés en fiançais17. En AOF, il toucherait 64000 enfants en 1938 environ, à côté des 68000 qui suivent l’enseignement français, les mêmes élèves pouvant suivre conjointement ou successivement les deux enseignements, comme le prouvent nombre d ’exemples. L’éducation d ’Afrique noire traditionnelle, qui ne passe pas par l’école, mais par des apprentissages qui culminent dans l’initiation, est encore bien vivante ; elle a pour objet à la fois de former le caractère, d ’ins crire le jeune dans son groupe d’âge, et de lui enseigner les techniques nécessaires et, pourrait-on dire, le sens de la vie. Ces types de formation sont-ils menacés? Des Algériens musulmans, observant que l’enseignement religieux traditionnel a été largement réduit par la confiscation des fondations religieuses, qui servaient à entretenir les écoles coraniques, en soulignent les graves conséquences pour l’instruction populaire dans son ensemble. Des responsables politiques de l’Inde comme Gandhi, soutiennent également qu’il y a eu recul de l’instruction depuis la conquête coloniale. Mais ces remarques ne sont pas celles des seules natio nalistes. Fumivall croit pouvoir appliquer des observations analogues à l’Indochine française, aux Indes néerlandaises, ou à la Birmanie, où les écoles bouddhistes sont en décadence18. Ces observations sont loin d ’être dépourvues de vraisemblance, mais ont contre elles de ne pouvoir s’appuyer sur des statistiques, les sociétés précoloniales en ayant été à peu près totale ment dépourvues. De toute façon, elles n ’ont guère de poids aux yeux de la majorité des responsables des services d ’éducation, qui, alors comme aujour d ’hui, dénoncent le caractère souvent excessivement formaliste, sclérosé et peu efficace des méthodes et des contenus traditionnels, sans chercher à s’in terroger sur leurs propres préjugés. On ne peut guère admirer, comme le disait avec mépris Macaulay, « des doctrines médicales qui feraient honte à un maréchal-ferrant anglais, une astronomie qui ferait rire les jeunes filles
17. Yacono (X.), La colonisation des plaines du Chétif, op. cit., p. 347. 18. Fumivall (J.S.), Colonial Policy, p. 401.
238
Phénomènes d 9acculturation
d’une école anglaise, une histoire qui abonde en rois de trente pieds de haut et en règnes de trente millénaires, et une géographie qui consiste en mers de mélasse et de beurre »19. L’avenir appartient à un enseignement « moderne », dont le modèle est celui de l’enseignement primaire d ’Occident, et qui se fonde essentiellement sur l’apprentissage de ce que les anglophones appel lent les « Trois R » (Reading, wRiting, aRithmetic, soit lecture, écriture et calcul). Cependant, l’affirmation de cette conviction ne suffit pas à imposer une large diffusion de ces « contenus », comme on dit de nos jours. Il faut observer en effet que la scolarisation ne touche qu’une partie de la population, avec beaucoup d ’inégalités d ’ailleurs. Dans les Indes néerlan daises, 40 % des enfants seraient scolarisés, ce qui est un record, seulement atteint peut-être à Ceylan, et peut-être dépassé en Birmanie20. Cette situation peut être rapprochée de celle de Madagascar ou de l’Indochine, dans lesquelles vers 1930 respectivement 33 % et 20 % des enfants seraient scola risés21. En Inde, le chiffire s’élèverait aux environs de 12 millions, pour 53 millions d ’enfants entre 6 et 14 ans, pour ce qui est des onze provinces qui constituent la British India, soit 22 % ; mais les États princiers sont très en retard sur ces chiffres, si bien que le pourcentage global vers 1930 ne serait guère que de 10 %22. Les chiffres sont beaucoup plus bas ailleurs, en particulier en Afrique : 5 % des enfants kenyans sont scolarisés vers 1938, et entre 10 et 15% des enfants nigérians. L’Algérie même n ’atteint que la proportion de 10 %, ce qui est comparable, voire inférieur, au pourcentage de l’Égypte23. Encore la proportion est-elle bien plus faible dans les campagnes, où les centres de colonisation sont à peu près les seuls à être pourvus d ’une école, dans laquelle, d ’ailleurs, les enfants indigènes constituent une écra sante majorité. La réussite de l’enseignement paraît bien meilleure dans certaines petites colonies, assimilées depuis plus longtemps, que ce soient les Antilles (sans doute plus d ’un enfant sur deux) ou Pondichéry (environ un enfant sur trois)24. Ces chiffres restent, de plus, très difficiles à apprécier et à comparer. Les plus optimistes sont souvent à minorer par des considération précises : en Indonésie, le cycle n’est que de trois ans d ’études (entre six et neuf ans) ; en Indochine, moins d’un dixième des enfants suivent un cycle primaire complet. Ils cachent, au surplus, un profond déséquilibre entre sexes, la grande majorité des élèves étant des garçons. Au total, et malgré une certaine amélioration, les pourcentages de personnes capables de lire et écrire sont peu élevés : guère plus de 16 % des hommes et 3 % des femmes dans l’Inde de 1930 ; à la même époque, seulement 6,3 % de la population des Indes
19. Morison (Sir Th.), « Le développement politique de l’Inde », art. ciL, p. 179. 20. Bousquet G.H.), La politique musulmane, p. 134. 21. Bouche (D.), Histoire de la colonisationfrançaise. Fayard, 1991, p. 263. 22. O’Malley, Modem India, p. 178. 23. UNO statistical Yearbook, 1949-1930, p. 486. 24. Weber (J.), Pondichéry, p. 351.
239
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
néerlandaises est alphabétisée, presque exclusivement des hommes; à ce rythme, il faudrait 167 ans pour espérer l’extinction de l’ignorance25. Au total, comme l’écrit Xavier Yacono, « l’analphabétisme est une véritable plaie sociale *26. Cette situation peu enviable s’explique par bien des facteurs. Un haut fonctionnaire britannique souligne un élément essentiel, l’inadéquation entre des «rêves occidentaux» et «des budgets orientaux»27. Les moyens, en effet, sont souvent très insuffisants. Les budgets locaux, alimentés par les seules ressources du pays, ne permettent guère de dégager des sommes importantes en faveur de l’éducation. C ’est ainsi qu’en AOF, sur un budget de dépenses prévisionnelles de 664 millions de francs pour 1936, seulement un peu plus de 3 millions, soit 2,1 %, sont affectés à ce chapitre28. Là où ces ressources existent, une grande partie peut être absorbée par l’enseignement primaire de type européen, difficile à suivre par des enfants indigènes, comme en Algérie, ou qui leur est totalement fermé, comme en Afrique du Sud. En dépit de toutes les déclarations faites sur la nécessité d ’élever le niveau de « civilisation » des populations, et donc de transmettre une culture, tout se passe comme si, pour [’ensemble des responsables des colonies l’édu cation populaire généralisée n’était pas une priorité. En fait, elle poursuit un double but : répondre aux besoins de la colonie en petits employés de l'adm i nistration et des entreprises ; rendre plus efficaces les travailleurs de la ville et des champs, en facilitant la transmission des informations par un usage plus répandu de la langue et de l’écrit, et par des rudiments de formation professionnelle. Cet état d’esprit nuit aux efforts réels, toujours méritoires, et souvent remarquables, d ’instituteurs ou de missionnaires, européens, et parfois indigènes, pour adapter leur enseignement et leurs méthodes d ’édu cation à leurs élèves. Le reproche de transmettre un savoir purement et simplement démarqué des programmes des métropoles est souvent adressé aux colonisateurs fran çais. Alain Gerbault porte ainsi un regard très sévère sur les écoles de Tahiti : à Bora, il remarque que « la classe était faite uniquement en français, que leurs manuels étaient des manuels faits en France et imprimés pour les enfants de France, qu’on leur apprenait l’histoire de la France, des animaux et des plantes de France, et rien de leur propre pays. Le résultat était navrant Au bout de sept ou huit ans passés à l’école, ils ne savaient rien du français et ne savaient pas lire ou écrire correctement le tahitien »29. Des citations telles que celle-ci doivent cependant être examinées avec prudence. Il faut en effet dissocier le cas de la langue d ’enseignement et celui de ses contenus ; d ’autre part, il convient aussi de nuancer un certain nombre d ’idées reçues.
25. O’Malley, Modem India, p. 459 ; Vandenbosch (A.), The Dutch East Indies, p. 216. 26. Yacono (X.), La colonisation des plaines du Chétif, p. 347. 27. Cunningham ((J.R.), « Education », in O’Malley, Modem India, p. 163. 28. Frankel (S.H.), Capital Investment, p. 344. 29. Gerbault (A.), îles de beauté, p. 210.
240
Phénomènes d ’acculturation
Il est vrai que, l’attitude française apparaît particulièrement insupportable dans le cas algérien. Dans ce pays, la fiction de départements français et la priorité donnée à l’assimilation des différentes composantes de la commu nauté européenne par l’école ont conduit à faire de l’arabe une langue étran gère (qui n’est d ’ailleurs introduite qu’en 1918 comme option aux examens du baccalauréat)30. C ’est pour réagir contre cette tendance que sont créées par des réformateurs musulmans inspirés de l’exemple égyptien des écoles qui dispensent un enseignement en arabe. Plus généralement, le monopole du français s’exerce surtout dans des contrées dépourvues de cultures écrites aussi prestigieuses, voire même de culture écrite. C’est essentiellement le cas de l’Afrique noire, où cette mesure doit permettre, non seulement de rapprocher les peuples du peuple français, mais aussi les peuples entre eux. On peut citer, à cet égard, comme un aboutissement la recommandation de la Conférence de Brazzaville de 1944 demandant que l’emploi «des dialectes locaux parlés » soit absolument interdit, aussi bien dans l’enseigne ment privé que dans l’enseignement public31. Dans l’ensemble, les autorités portugaises marquent la même intention de donner un monopole à la langue lusitanienne. Mais, contrairement à ce qu’on croit trop souvent, la langue française n’a pas partout cette position exclusive. En Indochine française, le quoc ngu, transcription en alphabet latin de la langue vietnamienne, œuvre des Jésuites portugais au XVIIe siècle, imposé par décret au début du XXe, demeure seul employé dans les premières classes du primaire, les autorités françaises ayant jugé inutile et excessivement coûteux d ’imposer à l’ensemble de la population une langue étrangère32. Au Cambodge, les « écoles de pagode » rénovées avec l’appui d ’administrateurs intelligents dispensent aux enfants un enseignement dans leur propre langue. À Madagascar, une place est faite à l’enseignement de la langue malgache, anciennement dotée d’une écriture par les missionnaires européens. De même, l’arabe est enseigné dans les écoles de Tunisie et du Maroc, qui ont gardé un enseignement distinct de celui de la France, et, a fortiori, dans les mandats de Syrie et du Liban. Mais il est vrai que les Français trouvaient, dans ces pays, des langues bien établies, ayant déjà une littérature, manuscrite et imprimée, et le prestige d’une culture non seulement populaire, mais aussi savante et aristocratique. Leur choix de favoriser celles-ci n’est pas toujours conforme, d’ailleurs, aux réalités locales, car il s’agit de la langue de la majorité de la population, ou de la langue de culture, ce qui laisse entières des questions comme celle du berbère en Algérie, ou des langues des peuples montagnards en Indochine.
30. Le Pautremat (P.), Le rôle de la Commission interministérielle des Affaires musul manes dans l’élaboration d ’une politique musulmane de la France, Thèse Université de Nantes, 1998, p. 312. 31. Lemesle (R.-M.), La Conférence de Brazzaville : contexte et repères, CHEAM, 1994, p.59. 32. Bulletin du Comité de l’Asie française, 1937, p. 121-122 ; Jacques (R.), « Le portugais et la romanisation de la langue vietnamienne », Revue française d’histoire d’Outre-mer, 1998, p. 21-54.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Cette façon de faire est beaucoup plus proche de celle des Britanniques. Ces derniers, dans l’ensemble, jugent préférable que l’enseignement à desti nation des classes populaires s’effectue en priorité, sinon exclusivement, dans les langues vernaculaires. L’application de ce principe est faite en parti culier aux Indes à partir du milieu du XIXe siècle, et reçoit plusieurs confirmations officielles au XXe. Outre sa plus grande facilité d’enseigne ment, elle offre aussi l’avantage, comme le remarque Alan Bums, de respecter l’indigène, l’anglais appris dans le primaire étant rarement correct, et le rendant plutôt ridicule. Elle s’étend à des langues comme le swahili, qui est plutôt une langue véhiculaire, mais bien implantée au Tanganyika et au Kenya. Bien entendu, il ne s’agit pas d ’imposer une seule langue: en Malaisie, à côté des écoles malaises, il existe des écoles indiennes (où est enseigné le tamoul), et des écoles chinoises33. Mais d’autres peuples coloni sateurs en usent de même à l’égard des populations. Aux Indes néerlan daises, le «bas-m alais», écrit en caractères latins, est enseigné comme langue commune, à partir de la troisième année d’études (comme d ’ailleurs dans les États malais de la mouvance britannique). Au Congo belge, l'ensei gnement primaire est donné dans les principales langues locales, en particu lier le Lingala, le Luba, le Kongo, et la forme locale de Swahili, le Kingwana. Du moins, les Britanniques et les Belges se proposent-ils d'introduire dans leur enseignement pour les uns, l’anglais, pour les autres, successive ment, le français, puis le flamand. Il n’en va pas exactement de même des Hollandais, qui, pendant longtemps, n’ont pas encouragé les indigènes à utiliser leur langue34. Seuls l’apprennent les enfants admis à suivre les cours d ’écoles spéciales dites « hollando-chinoises » et « hollando-indigènes », fréquentées respectivement par 25 000 et 70 000 élèves (contre 40 000 Euro péens dans leurs propres écoles), et destinées à fournir le personnel indispen sable aux relations entre les populations et les gouvernants35. Le caractère totalement ou du moins très largement européocentrique des contenus de l’enseignement n'est pas l’apanage de la République française et de ses redoutables « hussards noirs ». Ryckmans, qui effectue une tournée au Ruanda-Urundi se désole en lisant une dictée (pourtant faite en swahili), qui énumère les productions de la mère-patrie : tôles ondulées à Charleroi, tissus à Venders, sucre à Anvers, papier à Nivelles...36 Une commission britan nique soulignera de la même manière l’absurdité d ’obliger des jeunes Africains à apprendre comme des perroquets (parrot-like) une histoire et une géographie étrangères37. Mais il ne faudrait pas croire que l’imposition de savoirs concernant l’Europe soit forcément mal accueillie, la curiosité éprouvée par les enfants des colonies, Européens ou indigènes, pour les pays des colonisateurs étant souvent très grande, dans la mesure où ils leur prêtent
33. Windham (H.A.), Native education, Londres, Oxford University Press, 1933, p. 215. 34. Bousquet (G.H.), La politique musulmane, p. 124 sq. 33. Vandenbosch (A.), The Dutch East Indies, p. 214. 36. Vanderlinden (J.), Pierre Ryckmans, p. 416. 37. Burns (A.), History of Nigeria, p. 271.
Phénomènes d'acculturation
l’attrait du merveilleux, par rapport à une réalité banale. Quel enfant africain n’a pas rêvé en imaginant des paysages sous la neige, tandis que des enfants européens rêvaient de jungles ou de savanes ? En fait, bien d ’autres obstacles freinent le développement de l’école. Il faut tout d ’abord évoquer le niveau des formateurs. Si l’on s’accorde à souligner la qualité de l’enseignement organisé dans les pays de langue annamite, fondé sur un véritable bilinguisme, et servi par un personnel compétent, force est de reconnaître qu’il n’en va pas de même partout : à côté de maîtres bien formés, européens ou indigènes, laïcs ou missionnaires, européens ou non, on compte beaucoup d ’enseignants de village, mal payés et peu considérés, qui n’en savent parfois pas beaucoup plus que leurs élèves. C ’est trop souvent le cas aux Indes, en dépit d ’efforts considérables effectués notamment depuis le début du siècle en matière de formation et de relèvement des salaires. Les défenseurs de ce système font cependant remar quer qu’il a l’avantage d ’être peu coûteux, élément indispensable en pays pauvre, et que les écoles de cette espèce n ’en sont pas moins, tout arriérées qu’elles soient, «des avant-postes du progrès», qu’il importe d ’encou rager38. Une telle « offre » n’est guère adaptée à la « demande » globale. La majo rité des familles jugent préférable, selon la vision qui prévaut dans les milieux ruraux traditionnels, de faire travailler les enfants le plus tôt possible, une éducation leur paraissant du temps perdu : par exemple en Inde, les efforts pour établir l’obligation scolaire rencontrent peu de succès, les parents n’étant pas prêts à assumer à la fois le manque à gagner que représente le fait de se priver des services d’un enfant et la charge, même modeste, que représentent les fournitures et les vêtements nécessaires, et aussi, souvent, la rétribution du maître. Pour eux, l’instruction ainsi conçue est une sorte de luxe qu’ils ne peuvent se permettre. D’autres, ou les mêmes, redoutent l'influence morale ou spirituelle des idées inculquées à l’école du colonisateur, que celui-ci, d’ailleurs, soit un instituteur laïc ou un mission naire. Certains aussi estiment nocif de voir se mélanger sur les mêmes bancs leurs enfants et ceux appartenant à des tribus ou à des castes jugées infé rieures. C ’est par exemple, le cas aussi bien des Touareg ou des Maures par rapport à leurs tributaires ou à leurs captifs, que des Indiens des castes supé rieures par rapport aux intouchables. Certains, pourtant, et de plus en plus nombreux, conçoivent déjà l’école comme un moyen de promotion et d ’émancipation sociale. Mais leur demande n’est pas forcément mieux accueillie par les milieux coloniaux, car pour la majorité de ces familles modestes, il s’agit (toujours comme en Europe d ’ailleurs) d ’échapper aux contraintes de la vie paysanne, et surtout au travail manuel imposé par les conditions de l’économie coloniale. Pour
38. Cunningham (J.R.), « Éducation », art. cit, p. 175-177.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
beaucoup de dirigeants européens, au contraire, cette vision ne peut être adaptée aux besoins réels du pays. Ils souhaitent plutôt susciter, avant tout, une éducation pratique, qui, sans exclure la lecture et récriture, fasse une place aux techniques agricoles, à l’initiation aux lois du marché, de façon à éviter d’être la proie des intermédiaires, mais aussi à l’artisanat, à l’hygiène personnelle et collective. Mais il n’est pas facile, comme le déplorent nombre de responsables, rejoignant ainsi un discours bien connu en Europe, de persuader les populations de la dignité du travail des champs sans leur promettre pour autant une vie plus facile. Déjà, d ’ailleurs, beaucoup de nationalistes protestent contre le petit nombre d’établissements modernes, et dénoncent les «écoles au rabais», « écoles gourbis », ou écoles enseignant en langues vernaculaires, qui, selon eux, n ’ont d ’autre but que de maintenir les peuples dans l’obscurité, et de les cantonner dans des tâches subalternes en leur refusant l’accès au savoir moderne, et en leur interdisant la maîtrise de la langue du colonisateur. D’une manière qui n’est paradoxale qu’en apparence, ces tenants de l’iden tité nationale exigent donc un enseignement calqué sur celui des écoles euro péennes, seul capable de leur donner les moyens de prendre leur pays en main. Pour lutter contre l’absentéisme, ils demandent, et obtiennent parfois, comme dans certaines provinces des Indes, à partir de la fin des années 20, la proclamation du principe de l’instruction obligatoire. Mais ce discours ne touche encore qu’une minorité, qui forme ou aspire à former les élites du pays, et qui a inscrit cette revendication dans ce programme. b) Enseignement pour élites S’il ne mord que très légèrement sur l’ensemble de la population, l’ensei gnement européen n’enregistre pas moins des succès remarquables à l’inté rieur d ’une minorité. Une partie des élites locales traditionnelles est depuis longtemps ouverte sur l’Occident ; d ’autres familles ont été amenées, depuis la colonisation, à se rapprocher de plus ou moins bonne grâce des Euro péens ; des individus, même à la suite de trajectoires individuelles, subissent l’attraction d ’un univers si différent du leur. Pour eux, les formes de culture traditionnelles, même s’ils les jugent respectables, ne suffisent plus à elles seules. Une compétence, une légitimité, la prétention à un magistère moral, intellectuel ou politique, ne peuvent se justifier que par des études approfon dies selon les normes occidentales, couronnées par un diplôme. Les colonisateurs n’ignorent pas cet état d ’esprit, auquel ils ne réagissent pas négativement. Non seulement ils n’interdisent pas en général aux indi gènes d ’accéder aux degrés plus élevés d’enseignement, mais encore ils ne manquent pas d’encourager un certain nombre à y aspirer. Cette attitude est conforme à la volonté affichée de diffusion de la culture occidentale, non seulement au nom du principe de la «m ission civilisatrice», mais aussi parce que la complexité croissante de l’administration coloniale exige un nombre grandissant de personnels indigènes bien formés, recrutés sur place, donc moins coûteux. Quelle que soit, en particulier, la place reconnue aux
244
Phénomènes d'acculturation
langues nationales ou vernaculaires, il n’en reste pas moins que, dans toutes les possessions européennes, la langue du colonisateur s’impose, au moins aux degrés supérieurs de l’administration, ainsi que dans les forces armées. Sur place, les enfants issus de familles indigènes accèdent à un enseigne ment secondaire et supérieur dans lequel la langue du colonisateur est privi légiée, mais où l’emploi des langues locales n’est pas exclu. Les pays arabes connaissent depuis longtemps, et généralement depuis un temps bien anté rieur à l’occupation, un enseignement bilingue, fort utile aux élites tuni siennes, marocaines, libanaises ou syriennes. Les Français ont ainsi main tenu le collège Saddiki de Tunis, créé avant le protectorat, et Lyautey oiganise, sur le même modèle, des établissements destinés à la jeunesse marocaine. Le système des Britanniques (Middle Schools, High Schools et Colleges) est répandu aux Indes, où, en 1927, on compte déjà près d ’un million d ’élèves, qui fréquentent entre autres le collège musulman d ’Alighar fondé en 1875 près de Delhi. En Afrique noire, l’effort est quelquefois aussi ancien, puisque la fondation du collège de Fourah Bay, en Sierra Leone, remonte à 1845. En 1924, sous l’impulsion du gouverneur de Gold Coast, Gordon Guggisbeig, a été créé le Prince o f Wales College à Achimota en Gold Coast, près d ’Accra. Subventionné par l’État, il a été pourvu d ’une direction anglo-africaine, et de professeurs issus des meilleures universités anglo-saxonnes. Selon un des fondateurs, l’Africain James Kwegyir Aggrey, il se préoccupe d ’établir entre Noirs et Blancs une complémentarité aussi nécessaire que celle qui existe entre les touches noires et blanches d ’un piano. Des établissements analogues (Saint-John’s College, Yaba Higher College fondé en 1934 près de Lagos, en Nigeria, Colombo, Makerere en Ouganda, en 1937) existent ailleurs39. Dans les Federated Malay States, le Sultan Idris Training College forme des enseignants pour le pays. H faut ajouter que, la plupart du temps, les élèves indigènes qui satisfont aux exigences de niveau et de ressources ont le droit de fréquenter les établissements destinés aux enfants européens. C’est la voie principale (quoique étroite) offerte aux meilleurs éléments des colonies hollandaises et françaises. Par exemple, dans les Indes orientales, dans le secondaire on compte 6694 Européens fréquentant l’enseignement secondaire de type hollandais, mais aussi 7768 indigènes et 2012 asiatiques40. Les grands lycées français, comme le lycée Bugeaud d’Alger, le lycée Carnot de Tunis, ou le lycée Albert Sarraut de Hanoi, le lycée Chasseloup-Laubat de Saigon, comptent parmi leurs anciens élèves une minorité non négligeable de fils d’autochtones, dont certains poursuivent leurs études dans les classes prépa ratoires aux grandes écoles, voire dans ces grandes écoles elles-mêmes. Les plus modestes même peuvent compter sur des bourses ou se former dans des séminaires. Au Congo belge, les grands séminaires catholiques sont même la
39. Hailey (Lord), An African Survey, 1956, p. 1180. 40. Fumivall (J.S.), Netherlands India, p. 370.
245
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
seule forme d’enseignement supérieur accessible aux populations, les auto rités locales s’étant toujours montrées peu disposées à permettre aux Africains de s’élever au-dessus de l’enseignement primaire, et ayant privi légié, à l’issue de celui-ci, des enseignements professionnels. L’enseignement supérieur dans les colonies même n’est pas inconnu. En Inde, dès le milieu du XIXe siècle, trois universités ont été créées à Calcutta, Bombay et Madras. Il y en a dix-huit en 1941, dont onze créées entre 1916 et 192641. Dans les territoires sous contrôle fiançais, les plus notables sont les universités catholique et protestante de Beyrouth, ou l’université d'Alger, ou encore celle d ’Hanoi. Les étudiants indonésiens peuvent aussi fréquenter les Européens dans des établissements d’enseignement supérieur créés après la guerre : le plus célèbre est l’Institut de Technologie de Bandung, fondé en 1919, et devenu public en 1924, destiné à la formation d ’ingénieurs ; mais il existe aussi une école de Droit et une école de Médecine42. Il est possible aussi de faire des études en Europe, y compris dans les institutions les plus prestigieuses, comme Oxford, Cambridge, ou la Sorbonne, voire, pour les Africains anglophones, les universités noires américaines. Loin de leur pays, les étudiants originaires des colonies trouvent une atmosphère intellectuelle plus stimulante, et, souvent aussi, les moyens de mener librement un débat politique pour le moins bridé dans leur pays natal, dans une atmosphère qui est généralement (États-Unis mis à part) égalitaire et exempte de racisme. Mais les capitales coloniales peuvent aussi servir à nouer des contacts entre colonisés : ainsi Paris pour les étudiants maghrébins, futurs animateurs des mouvements pour l’indépendance, au sein de l’AEMNA (Association des étudiants musulmans nord-africains) ; ou Londres pour ceux de l’Afrique de l’Ouest britannique (WASU, West African Students Union). Il va de soi que cet accès ne peut être que parcimonieux : aucun de ces enseignements n'étant gratuit, ces possibilités ne sont ouvertes qu’à des jeunes issus de milieux très favorisés, ou à quelques individus particulière ment méritants pour bénéficier de subventions, payées le plus souvent sur les fonds du budget de la colonie. La seule exception, peut-être concerne l’Inde, où la seule université de Calcutta, qui est la plus importante, compte, à elle seule, en 1936, 30000 étudiants, ce qui est considérable, même en tenant compte du gigantisme démographique. Il n’est pas étonnant que ce pays puisse déjà s’enorgueillir de deux prix Nobel, l’un en littérature et l’autre en sciences. En général, les effectifs se comptent en effet plutôt par centaines. Il y aurait, aux Indes néerlandaises, environ 500 étudiants indonésiens sur un peu plus d ’un millier43. Le collège d ’Achimota ne compte, en 1938, pas moins de 700 élèves, (dont 232 filles). Il y a, à la fin des années 30, une centaine d ’étudiants musulmans inscrits à l’université d ’Alger, soit moins de 5 % du total, auxquels il faudrait ajouter une trentaine en métropole, aux 41. O’Malley, Modem India, p. 178,6S6. 42. Furnivall (J.S.), Netherlands India, p. 373. 43. Bousquet (G.H.), La politique musulmane, p. 137.
246
Phénomènes d 9acculturation
côtés d ’une centaine de Tunisiens et d’une vingtaine de Marocains*4344. Ces chiffres, qui peuvent paraître ridiculement faibles, rapportés à la population totale, doivent être rapprochés du petit nombre de cadres européens qui assu rent la direction des services publics et des activités privées d ’une colonie : ils apparaissent alors non négligeables, dans la mesure où ils signifient la possibilité d ’une relève des Européens par des indigènes, mais aussi, en cas de refus de ceux-ci, le danger de voir se constituer un groupe de sans-emploi. De fait, la liste des personnalités qui ont suivi cette filière est impression nante, au point qu’on peut dire qu’elle constitue la voie royale de l’accès au pouvoir. Pratiquement, en effet, tous les cadres des pays devenus successive ment indépendants auront suivi cette formation. Les rejetons de la classe dirigeante indienne ont pris depuis longtemps l’habitude de faire une partie de leurs études en Angleterre. Mohandas Gandhi, après avoir fréquenté la Alfred High School de Rajkot, a pris ses grades à l’université de Londres (1888-1891), d ’où il est sorti avocat. Son cadet Jawarhlal Nerhu a séjourné en Angleterre de sa seizième à sa vingt-troisième année (1907-1914), d’abord au collège de Harrow, puis au Trinity College de Cambridge, puis à Ylnner Temple de Londres. Le leader cinghalais Bandaranaïke a suivi des études à Oxford. Faute d ’avoir pu, comme il le souhaitait, faire des études en Hollande, Soekarno est un ancien élève de l’Institut de Technologie de Bandung. En Égypte, Saad Zaghloul, le chef du parti Wafd, né en 1858, a eu une formation arabe classique à l’université d’al-Azhar, mais a appris le français pour obtenir le diplôme de l’École de droit du Caire, nécessaire pour embrasser la carrière d ’avocat, le français jouant à cette époque le rôle de langue quasi officielle en Égypte. En dépit de l’atmosphère raciste qui sévit dans l’Union sud-africaine, le jeune Nelson Mandela, issu de l’aristocratie xhosa, après l’école de village, peut fréquenter le collège de Healdtown, puis l’Université noire de Fort Hare, dans la province du Cap, avant de suivre des cours du soir à Johannesburg pour obtenir une licence en droit. Mais les espoirs ne sont pas interdits aux rejetons de familles plus modestes : Kawe N’Nkrumah, fils d ’un forgeron, a suivi des études dans une école de mission catholique, avant d’entrer au collège d ’Achimota, près d’Accra, et d ’enseigner lui-même. En 1935, à l’âge de vingt-six ans, il part pour les États-Unis, où il fréquentera les universités noires de Lincoln et de Pennsylvanie, le système universitaire américain restant fondé, comme en Afrique du Sud, sur la ségrégation. Le leader indonésien protestant Amir Sjarifuddin, né en 1907, a fréquenté une école pour enfants européens, puis est envoyé, à 14 ans, en Hollande pour y faire ses études secondaires ; il s’inscrit à son retour à l’École de droit de Batavia45. Une voie analogue sera
44. Pervillé (G.), Les étudiants algériens de l’université française (1880-1962), CNRS, 1984, p. 29-30 ; Ageron (Ch.-R.), « L’Association des Étudiants musulmans en Fiance entre deux guerres », Revuefrançaise d’Histoire d ’Outre-mer, 1983, p. 26-27. 43. Leclerc (J.), « La clandestinité et son double », in Brocheux (P.), Histoire de l’Asie du Sud-Est, p. 222-246.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
empruntée en Afrique par Barthélémy Boganda, ordonné en 1938, fondateur de la République centrafricaine, et par Fulbert Youlou, premier président du Congo-Brazzaville, tous deux sortis du séminaire de Yaoundé, où le second fut l’élève du premier. Léopold Sédar Senghor a été, comme on sait, élève de première supérieure au lycée Louis-le-Grand, ce qui le mènera à l’agrégation de grammaire. Même sans bénéficier de ces enseignements, d ’autres auront pu, par leur effort personnel, accéder au savoir grâce à des fondations de culture populaire. Aux Indes néerlandaises un bureau spécial dit de « lecture populaire » favorise la rédaction et la traduction d ’ouvrages en malais et leur mise à disposition par la création d’un réseau de bibliothèques. Près de trois millions d ’ouvrages ont été empruntés en 1919. Même si les publications, de toute évidence, sont soigneusement expurgées, on peut penser que leur impact n’est pas nul ; de même, une statistique nous apprend que, en 1936, la bibliothèque publique de Tananarive a enregistré 22000 consultations de lecteurs malgaches sur un total de 29 000. Tout cet enseignement peut apparaître, souvent, comme jouant un rôle assimilateur, qu’il soit totalement européen, comme dans les grands lycées français, ou que, comme dans les Colleges créés par les Britanniques, il s’ef force de donner un enseignement plus conforme aux traditions locales. Il a, en effet, contribué à diffuser la langue, mais aussi une bonne partie des valeurs du colonisateur. Nelson Mandela note, à propos de son séjour dans le collège de Healdtown : « L’Anglais éduqué était notre modèle ; nous aspi rions à devenir des « Anglais noirs », comme on nous appelait parfois par dérision. On nous enseignait - et nous en étions persuadés - que les meilleures idées étaient les idées anglaises, que le meilleur gouvernement était le gouvernement anglais, et que les meilleurs des hommes étaient les Anglais »46. Nehru écrira même : « en dépit de tout, je suis un fervent admi rateur des Anglais, et dans de nombreux domaines j ’ai l’impression, même maintenant, qu’un Anglais peut mieux me comprendre que l’Indien ordinaire »47. Essayant d ’expliquer à ses élèves le comportement d’Attale, fils du roi du Pont Prusias, et fervent collaborateur des Romains, dans le Nicomède de Corneille, un professeur de la khâgne de Louis-le-Grand leur déclare : « c’est un fils de rajah qui a fait ses études en Angleterre, et qui revient persuadé que rien n’est meilleur que l’armée anglaise, la diplomatie anglaise, la prudence anglaise et le plum-pudding anglais »48. Cette vision du vieux maître est juste, mais partielle, car, pour qui lit la pièce jusqu’à la fin, Attale se révélera l’allié de Nicomède, le chef du parti de l’indépendance, et refusera, à son exemple, de se soumettre à la loi de Rome. Il n’y a pas, en effet, dans ces attitudes, qu’on pourrait multiplier, qu’une admiration béate. Se mettre à l’école du colonisateur revint, parfois, dans la période qui précéda la conquête européenne, à essayer, en modernisant son 46. Mandela ((N.), Un long chemin vers la liberté, p. 45. 47. Note à Gandhi, novembre 1921, Lecomte (F.), Nehru, Payot, 1994, p. 39. 48. Brasillach (R.), Notre avant-guerre, Plon, 1941, p. 12.
Phénomènes d'acculturation
pays, de conserver son indépendance, comme ce fut le cas dans l’Empire ottoman, et avec plus de succès, au Japon. C ’est désormais, une fois ce pays tombé sous la domination coloniale, se donner les moyens d'être reconnu par le même colonisateur, et à travers ses propres valeurs, comme son égal en dignité. Attitude d’autant plus compréhensible que, dans ce cas, le colonisé en appelle aux plus vénérables principes de la culture occidentale, et à ses plus hautes consciences, contre les pratiques en vigueur dans la colonie. Au total, on pourrait généraliser ce que disait un Britannique de l’influence de l’enseignement anglais aux Indes en 1938 : « il a brisé l’isolement mental de l’Inde, et l'a mise en contact avec les idées occidentales... Il a produit, on l’a dit, une armée de clercs, mais il a aussi donné à l’Inde les chefs de la plupart des mouvements politiques, sociaux et humanitaires qui y sont apparus »49. Les étudiants sont, depuis le début du siècle, à la pointe des mouvements de revendication. Les Européens n ’ont pas toujours tendance à voir cette évolution d’un œil favorable, car ils discernent bien que ces aspirations n’ont pas forcément pour conséquence, comme on avait pu au départ en caresser le projet, de produire des hommes capables de s’identifier à l’idéal de la colonisation. Très peu semblent avoir tenu compte d ’un avertissement de Lyautey formulé dès 1920 à propos de l’avenir du Maroc. Le maréchal soulignait alors que se formait « une jeunesse qui sent vivement et veut agir, qui a la goût de l’ins truction et des affaires », et souhaitait que l’accès à de larges responsabilités lui fût largement ouvert, faute de quoi, elle « chercherait sa voie ailleurs â50. Mais cet appel n’est encore que bien rarement entendu. Dans l’ensemble, l'administration coloniale a plutôt tendance à faire le procès d ’une instruc tion trop libéralement répandue, en particulier dans des familles d ’origine modeste. Un jeu de mots anglais leur reproche, par exemple, de considérer le savoir (learning) comme un instrument de gain (earning). On dénonce, pêlemêle, la tendance qui amène les étudiants à rechercher un diplôme, et donc à privilégier la réussite à un examen, fût-il de bas niveau, bien plus que la véri table instruction; un certain désintérêt pour les études techniques et la formation professionnelle, jugées dégradantes ou inutiles; l’exigence de trouver un emploi à la sortie de l’université, en dépit d ’une formation géné rale, en lettres ou en droit. On évoque volontiers, par exemple, « ce flot de juristes indigènes sous lequel l’Inde britannique est submergée »51. Une certaine méfiance s’exprime aussi à l’égard de l’indigène qui se flatte d’une éducation européenne. Il est soupçonné d’avoir perdu l’essentiel des traditions de son peuple, et en particulier ses valeurs spirituelles et morales, tandis qu’à l’Occident, il n ’aurait emprunté qu’un vernis d ’instruction, un verbiage ratiocineur, ce qui en fait un demi-instruit, cible rêvée des mouve
49. O’Malley, Modem India, p. 662. 50. Circulaire du 18 novembre 1920. 51. Fumivall (J.S.), Netherlands India, p. 37S ; O’Malley, Modem India, p. 6S7.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
ments révolutionnaires de tout poil, ou du moins un aigri, inutile à son pays. On craint toujours que ce « déraciné », à l’exemple de Racadot, le héros du roman de Barrés, ne se transforme en assassin faute d ’avoir trouvé dans la société la place de choix qu’il croyait légitimement devoir lui revenir ; à tout le moins en assassin de la colonisation. Si tout n ’est pas injustifié dans ces reproches, ils passent trop souvent sous silence les responsabilités coloniales dans le manque de débouchés offerts dans leur propre pays, aux hommes de talent ou d ’ambition, issus des sociétés indigènes. Ainsi les plus remarqua bles réussites ne suscitent que trop rarement l’enthousiasme, et plus fréquemment la crainte. Il en va souvent de même de l’expansion des idées originaires d ’Europe. La transmission des croyances S’il est bien un cliché de l’histoire coloniale, c’est celui du prêtre accom pagnant le marchand et le soldat, quand il ne les précède pas. Comme toujours, les choses ne sont pas si simples. Il a souvent été observé, et à juste titre, que la volonté de prêcher l’Évangile à toutes les nations avait compté au nombre des moteurs importants de l’expansion coloniale, animant à la fois aussi bien les protestants que les catholiques. Barker rappelle ainsi que le premier des objectifs affichés de la Compagnie de Virginie, créée en 1606, était la propagation de la Bonne Nouvelle52. Le sentiment d ’être le peuple de la Bible apparaît aussi consubstantiel à l’idéal britannique que la vocation de « fille aînée de l’Église » à l’expansion française, et plus, peut-être, la notion de laïcité n’ayant guère eu droit de cité dans un pays dont le souverain reste le Défenseur de la Foi réformée, aux dépens même des convictions d ’une partie de ses sujets. Bien plus, il a toujours paru utile aux gouvernements de favoriser, le plus possible, dans leurs colonies, des missionnaires de leur propre nationalité, dans la mesure où ils pouvaient attendre de ceux-ci une plus grande loyauté à leur cause. On voit bien, par exemple, que partout, dans les anciennes colonies allemandes placées sous mandat français après 1919, les missionnaires allemands sont remplacés par des prêtres ou des pasteurs français. Mais cette vision, qui n’est pas fausse, mérite cependant d ’être nuancée, tant du point de vue des États que de celui des Églises missionnaires elles-mêmes. Tout d ’abord, il ne s’agit plus, depuis longtemps, pour les États, de forcer les conversions. Ils se croient obligés, au contraire, de proclamer la liberté de conscience. C ’est ainsi qu’une déclaration de la reine Victoria après la grande mutinerie de 1857 signifiait à tous ses sujets indiens qu’il était hors de question de leur imposer la religion que professaient les Anglais, et à laquelle elle réaffirmait sa fidélité. Les Français n’avaient pas agi autrement lors de la capitulation d’Alger en 1830, lorsque le maréchal de Bourmont avait pris, au nom du roi Très-Chrétien Charles X« l’engagement sur l’hon
52. Barker (E.)t Ideas and ideals, p. 58.
250
Phénomènes d'acculturation
neur» de respecter la religion musulmane. Cette tolérance à l’égard des cultes locaux correspond, bien évidemment, à la diffusion en Europe de l’esprit dit des « Lumières », qui a condamné les persécutions religieuses. Mais elle n ’est pas dictée par la seule largeur d’esprit Les dirigeants des États, et bien plus encore les hommes de terrain estiment que les religions constituent le ciment traditionnel des sociétés indigènes, et cautionnent en général le pouvoir des chefs, rois, sultans ou autres notables, dans la mesure où ceux-ci sont aussi, au moins partiellement, responsables de l’ordre du sacré aussi bien que de l’ordre social, l’un et l’autre ne se distinguant que très imparfaitement. Leur idéal est, au fond, celui qu’avait exprimé si bien Napoléon: gouverner les hommes «comme le plus grand nombre veut l’être », et, en reconnaissant les cultes, chercher par là, si nécessaire, à les contrôler à toutes fins utiles du pouvoir. L’attitude des puissances vis-à-vis des missions est généralement encou rageante, mais s’exprime différemment. La tradition la plus libérale est sans doute celle de la Grande-Bretagne. Dans les territoires britanniques, la tradi tion est dans l’indépendance, par rapport à l’État, des prêtres et des ministres des différents cultes chrétiens, ce qui n’interdit pas le versement de subven tions pour l’éducation ou l’assistance médicale, décidées au niveau des auto rités locales, chefs ou administrations provinciales, et, naturellement, une surveillance politique. Une attitude tout autre est représentée par la Belgique et le Portugal. Le Concordat de 1906 appliqué au Congo donne un statut spécial à l’Eglise catholique. L’État s’est déchargé de l’enseignement officiel sur des écoles catholiques subventionnées (dites « subsidiées »), aux termes du Concordat de 1906. La suggestion formulée en 1938 par le gouverneur Ryckmans d ’étendre le régime de la subvention aux autres écoles de mission est enterrée à la suite de fortes pressions de la hiérarchie catholique53. De même, des 1926, le pouvoir portugais reconnaît aux missions catholiques un rôle prépondérant dans l’éducation comme dans l’œuvre civilisatrice et assimilatrice en général, toutes dispositions sanctionnées en 1940 par un Concordat et un Statut spécial des missions catholiques portugaises aux colonies54. La situation de la France et des Pays-Bas constitue deux cas particu liers. Le régime de la séparation, tel qu’il a été institué par la loi française de 1905, n’a pas été transporté ipso facto aux colonies, sauf aux Antilles et à la Réunion, mais adapté aux réalités locales. En principe, les cultes restent placés sous le contrôle étroit du gouverneur, et l’ouverture et le fonctionne ment des missions et de leurs écoles sont contrôlés par l’administration. En revanche, les subventions sur deniers publics sont, en principe, interdites, bien que cette règle souffre des exceptions. Dans les Bides néerlandaises,
53. Vanderlinden (J.), Pierre Ryckmans, p. 370. 54. Rosas (F.) et Brandao de Brito (J.M.), Dicionario de Historia do Estado Novo, Portugal, Bertrand Ed., 1996, p. 602.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
l’Église indienne, qui fédère les différentes confessions protestantes, jouit jusqu’en 1935 d ’un statut de religion d ’État. La séparation qui intervient alors lui permet de régler librement ses affaires internes, et notamment les nominations de personnels, mais ne réduit que très peu le contrôle d’en semble de l’État sur les activités missionnaires des différentes sociétés protestantes ou catholiques, qu’il reste maître d ’autoriser ou d ’interdire, et qu’il encourage par ses subventions33. Au total, la place de l’enseignement religieux dans les territoires colo niaux est extrêmement importante. En Inde, on estime qu’environ un quart de l’enseignement est assuré par des écoles et des collèges rattachés à des œuvres missionnaires36. D’apiès un calcul de 1945, plus de % % des enfants suivant l’enseignement primaire dans l’Afrique tropicale britannique sont inscrits dans des écoles de missions37. En 1948, sur un peu moins d ’un million d ’enfants recensés dans les écoles du Congo belge, un tiers fréquente les écoles catholiques subventionnées, un autre tiers les autres écoles de missions catholiques, et un tiers les écoles protestantes ; les écoles publiques ne reçoivent que 4% des élèves38. À Java, l’essentiel de l’enseignement primaire est dispensé dans des écoles gouvernementales, alors que la moitié des établissements secondaires ou supérieurs sont des écoles confession nelles subventionnées. Le Français Georges-Henri Bousquet regrette, avec une ferveur puisée dans l’école de la République, qu’on ne puisse « voir la jeunesse des Indes néerlandaises... assise sur les mêmes bancs et profitant d ’une même école où, avec le respect des croyances de chacun, on enseigne rait l’amour de la mère-patrie au-dessus de toutes les mesquineries de chapelle »39. Pourtant, si le système français donne, au contraire, la priorité aux écoles d ’État, il s’en faut de beaucoup que l’enseignement confession nel en soit absent. En AOF en 1938, il représente environ 18% du total (12000 élèves sur 68000, dont la grande majorité des filles), mais plus d ’un tiers des 175000 élèves de Madagascar, et plus de la moitié des 21000 élèves d ’AEF55678960. À cet effort d ’enseignement, il faudrait ajouter l’influence des mouvements de jeunes qui s’expriment à travers le scoutisme (qui fait d ’ailleurs des émules chez les non-chrétiens, notamment chez les musulmans), ou les associations d ’entraide diverses. Cet attrait indéniable pour l’enseignement religieux n’a pas pour consé quence, comme on avait pu l’imaginer, un mouvement équivalent de conver
55. De Kleick (E.S.), History o f the Netherlands East Indies, p. 514,518. 56. Mayhiew (A.I.), «The Christian Ethic and India», in O’Malley, Modem India, p. 328. 57. Hailey (Lord), An African Survey, 1956, p. 1135. 58. Hailey (Lord), An African Survey, 1956, p. 1209; Malengreau (G.), «La politique coloniale de la Belgique », Principles and Methods of Colonial Administration, p. 47. 59. Bousquet (G.H.), La politique musulmane, p. 136. 60. Coquery-Vidrovitch (G), L’Afrique colonûde au temps des Français, La Découverte, 1992, p. 26 ; Hailey (Lord), An African Survey, 1956, p. 1197, 1203 et 1207 ; Bouche (D.). Histoire de la colonisation française, p. 265.
Phénomènes d'acculturation
sions à la foi chrétienne. Beaucoup de parents, en effet, tout en étant sensi bles à la qualité de l’enseignement des missionnaires, n’entendent pas que leurs enfants en retirent au chose qu’un savoir limité à des contenus extra religieux. Malgré tout, l’action missionnaire n’est pas sans effets, surtout lorsqu’elle a pu s’exercer sur une assez longue durée. La communauté catho lique indochinoise, importante surtout au Tonkin et en Cochinchine, est évaluée à près de deux millions de personnes, ce qui représenterait environ 8 % de la population61. À Madagascar, les communautés chrétiennes repré sentent peut-être deux cinquièmes de la population totale (d’environ quatre millions d ’habitants), partagées par moitié entre catholiques et protestants62. Les conversions ont également bien réussi en Afrique. Vers 1930, on évalue le nombre de chrétiens à une vingtaine de millions, sur environ 120 millions d’habitants au sud du Sahara, soit environ 16 %63. Mais ces proportions couvrent de grandes disparités. Le nombre de convertis au Congo belge dans les années 1940 est par exemple, évalué à deux millions et demi de catho liques et 500000 protestants, sur onze millions d ’habitants, soit 27 %64. H serait encore plus élevé en Afrique du Sud, toutes églises confondues. Il est vrai que l’effort qui est fait dans l’ensemble du continent est particulièrement important. En 1933, on compte plus de 3 500 missionnaires catholiques en Afrique noire, Européens pour plus de 90 %, Français pour 30 %, et Belges pour 17 %65. Il faudrait y ajouter plus de 2 000 religieux, et 8 000 religieuses (dont 2 000 Africaines). Cependant, deux ensembles se sont montré à peu près imperméables aux tentatives de conversion : les hindouistes et les musulmans, dont on peut évaluer le nombre respectif à 250 millions chacun, ce qui signifierait à peu près trois quarts de la population de l’ensemble des empires. Aux Indes, l’en semble des chrétiens (chrétiens de l’église indigène dite de Syrie compris) est évalué à 6 millions dans les années trente (soit moins de 2 % de la popu lation), qui sont surtout nombreux dans le sud du pays (État de Travancore, Goa), et à Ceylan. Le refus paraît encore plus explicite dans les pays à prédominance musulmane. Dans les Indes néerlandaises, l’activité des missions a dû se limiter aux Territoires extérieurs non islamisés. Le nombre total de chrétiens est malgré tout assez faible (environ 650 000 protestants et 360000 catholiques), qui se regroupent dans des zones bien délimitées : les Moluques, le nord des Célèbes, et le pays Batak de Sumatra sont en majorité chrétiens, et surtout protestants ; Timor (partagée avec les Portugais) essen tiellement catholique66. Dans tous ces pays, les autorités coloniales dissua dent d ’ailleurs l’action missionnaire, jugée dangereuse pour l’ordre public,
61. Bouche (D.), Histoire de ta colonisation française, p. 224. 62. Delacroix (Mgr.), Histoire universelle des Missions catholiques, T. 4, Grund, 1959, p. 168. 63. The Cambridge History of Africa (1905-1940), p. 141. 64. Malengreau (G.), « La politique coloniale de la Belgique », ait. cit., p. 52. 65. Delacroix (Mgr.), Histoire universelle des Missions catholiques, T. 4, p. 121. 66. De Klerck (E.S.), History of the Netherlands East Indies, p. 523*524.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
tout prosélytisme, réel ou imaginaire, courant le risque de se heurter à des réactions violentes. En dehors des colonies européennes, la présence chré tienne reste limitée aux Églises orientales, maronites du Liban ou coptes d ’Égypte. Pour ceux-ci (comme d ’ailleurs pour les juifs), la présence de l’Europe a signifié une véritable émancipation, en imposant l’abolition du statut traditionnel, protecteur, mais souvent humiliant, et en favorisant l’accès à l’instruction, donnant ainsi des chances de promotion saisies avec enthousiasme. Au sud du Sahara, les progrès de l’islam sont spectacu laires, bien que la coexistence soit moins difficile. Les seuls succès massifs des missionnaires sont enregistrés au Soudan, qui comptera en 1950 400 000 chrétiens sur 8 millions d’habitants67. S’il est indéniable que la diffusion du christianisme accompagne ou a accompagné l’expansion de l’Europe, il n’est pas évident qu’elle se confonde avec elle. Les Églises chrétiennes ne rapprochent guère les chré tiens sur place. En Afrique du Nord, notamment, les aspects souvent triom phalistes d ’un catholicisme européen très lié à la vie de la communauté fran çaise ne laissent pas de choquer nombre de musulmans, pour de bonnes raisons, le respect de leur foi, et de moins bonnes, le désir de revenir à l’an cienne suprématie de l’islam. Le Congrès eucharistique international de Carthage (mai 1931), puis celui d’Alger (mai 1939), sont l’occasion de célé brer une Église d ’Afrique qui revendique de façon imprudente son enracine ment antique, et a renoncé à toute vocation missionnaire. Les Églises réfor mées d ’Afrique du Sud ne témoignent pas d ’un esprit particulier d ’ouverture vis-à-vis des Noirs, fussent-ils chrétiens. La qualité de chrétien, d ’ailleurs, n’entraîne pas une faculté particulière à accéder à un statut privilégié, proche de celui des Européens, et moins encore un accès privilégié à la société des colons. Tout au plus peut-elle permettre, comme en Inde, aux intouchables d ’échapper aux contraintes les plus lourdes de leur condition, ou d ’accéder plus facilement à quelques postes subalternes, encore que, dans ce dernier cas, la prime est donnée à l’instruction plus qu’à la foi. Inversement, les Églises conservent avec le pouvoir colonial un certain nombre de distances. Certes, elles se sont étroitement associées à l’expan sion coloniale, et ces aspects n ’ont pas totalement disparu. En 1937, dans sa lettre Spectat ad Romanian Pontifieem, le pape Pie XI juge que l’occupation de l’Éthiopie par l’Italie a établi «un état de choses qui semble devoir apporter aux missions catholiques de grands développements et faire porter au ministère apostolique des fruits abondants »68. Cependant, leurs dirigeants ne peuvent qu’être sensibles aux évolutions des aspirations des populations indigènes, et de plus en plus mal à l’aise avec l’idée de maintenir des peuples dans la sujétion sous le prétexte de fraternité évangélique. Cela est d’autant plus vrai que nombre d’entre eux, par le biais de leurs écoles, collèges ou
67. Massignon (L.), Annuaire du monde musulman, 1954. 68. Documentation catholique, 1937, p. 587.
Phénomènes d'acculturation
universités, sont appelés à former les futures élites autochtones. C ’est notoi rement le cas de l’Église catholique. En 1919, le pape Benoit X, dans son encyclique Maximum Illud, invite, après d’autres, les missionnaires à « bannir tout exclusivisme national » ; il n’hésite pas à dire que le fait, pour eux, de donner la priorité aux intérêts de « leur patrie d ’ici-bas » serait pour leur apostolat «comme une peste affreuse». Surtout, il incite les évêques des colonies à former un clergé local69. Le même message est repris, peu de temps après, par son successeur Pie XI, dans l’encyclique Rerum Ecclesiae (1926). Le pape souligne le danger qu’il y aurait à ne confier la cause de l’Église qu’à des missionnaires majoritairement européens, et même, le plus souvent, originaires de la puissance occupante. Au cas, en effet, où les popu lations coloniales, « voulant jouir d ’une pleine indépendance », expulseraient brutalement tous les cadres étrangers, les missionnaires devraient accompa gner la retraite des fonctionnaires et les soldats européens, ce qui entraînerait la ruine de leur œuvre70. Ces proclamations mettent l’accent sur un effort qui a commencé bien antérieurement, et qui s’accentue entre les deux guerres. Des clergés asia tiques ont été formés très tôt. Dès 1880, il y a une majorité de prêtres indiens aux Indes, et les premiers évêques sont formés en 1926-1928. Le premier évêque catholique de rite indien est consacré en 1912, de rite catholique romain en 1923, de rite méthodiste en 1930. Mais ces progrès ne sont pas les mêmes partout : en 1933, les prêtres européens en Afrique sont dix fois plus nombreux que les prêtres africains (3 339 pour 281), alors qu’en Asie près de la moitié des prêtres (4216 sur un total d’un peu moins de dix mille, dont 1500 au futur Viêt-nam) sont originaires du pays71. Si le premier évêque vietnamien est consacré dès 1933, le premier évêque catholique en Afrique (Ouganda), ne le sera qu’en 1940, et il faudra attendre 1956 pour voir un tel événement se produire au Congo belge72. Plus difficile à apprécier, le rôle des Églises protestantes est analogue, d ’autant plus que des pasteurs origi naires des États-Unis occupent une place importante dans l’œuvre mission naire, y compris, en Afrique, des pasteurs noirs. Enfin, la naissance et le développement d ’un christianisme indigène sont toujours parallèles à l’existence du christianisme européen. Particulièrement intéressant est, de ce point de vue, le cas du continent africain. Des cultes syncrétiques amènent la naissance de cultes originaux, comme les Églises ¿tes éthiopiennes, ou les Églises « sionistes » nées à la fin du XIXe siècle en Afrique du Sud ; une secte comme le Watch Tower (Témoins de Jéhovah) se développe sous le nom de Kitawala, d ’abord en Rhodésie, puis au Congo belge où elle s’introduit par les migrations de travailleurs ; des prophètes
69. Documentation catholique, 1919, p. 802-807. 70. Documentation catholique, 1926, p. 1411-1426. 71. Delacroix (Mgr.), Histoire universelle ties missions catholiques, T. 4, p. 134. 72. Neill (S.), éd., Concise Dictionary of the Christian World Missions, Londres, Lutter worth Press, 1970, p. 271-273, p. 142.
255
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
inspirés par le message des évangiles, interprété en dehors des dogmes des églises établies, prêchent des religions nouvelles, comme William Harris, Simon Kimbangu au Congo belge, ou encore André Matswa au Congo fran çais. Les autorités coloniales ont tendance à surveiller étroitement, sinon à réprimer ces mouvements, bien que, pour la plupart, ils n’incitent pas leurs adeptes à la rébellion à l’ordre établi. Il est vrai qu’ils contribuent à créer une culture autonome, qui, en revendiquant son authenticité africaine, suscite un esprit d ’émancipation. Par ailleurs, ces nouvelles Églises constituent des structures capables d’orchestrer des mouvements de révolte ou de résistance. En 1920, les fidèles de l’Église éthiopienne des «enfants d ’Israël » sont chassés manu militari d ’une terre qu’ils prétendaient occuper : la fusillade de Bulhoek ne fait pas moins de deux cents tués. Les adeptes du Kitawala sont poursuivis à la suite d ’émeutes survenues dans le Copperbelt en 1935, mais aussi d ’agitation au Katanga entre 1932 et 1939. La plupart des prophètes sont arrêtés et étroitement surveillés, comme Kimbangu par les Belges ou Matswa par les Français. Le caodaïsme apparu en Indochine entre les deux guerres, et qui se réclame aussi, partiellement, du message chrétien, suscite également l’inquiétude, en particulier par les liens de certains de ses chefs avec des associations religieuses japonaises. Il faut ajouter que l’influence chrétienne n’est pas seule à s’exercer. L’islam fait des progrès considérables au sud du Sahara, où, comme par le passé, il se répand par l’intermédiaire des Africains islamisés des pays du Sahel. Les idées morales et politiques Il serait évidemment absurde de réduire l’influence des idées occidentales à celle de la religion, même si celle-ci en est un vecteur im portant La trans mission de toute une série de valeurs mériterait d ’être aussi développée. La principale consiste dans l’adhésion d ’un nombre croissant d ’indigènes à l’idée de progrès, scientifique et technique, mais aussi institutionnel. Il faut y voir l’effet d’une conviction sincère, sans doute, mais aussi de la certitude que seul un nouvel état d ’esprit peut donner aux peuples conquis les moyens de s’émanciper de l’emprise européenne. Le cas du Japon au XIXe siècle, et celui, contemporain, de la Turquie de Kémal Atatürk, paraissent être là pour l’attester. Certes, l’admiration n’est pas unanime. Gandhi est sans doute l’un des critiques les plus radicaux de cette civilisation jugée par lui destructrice à la fois de la moralité de l’âme et de la santé du corps. Il se refuse à imiter la voie suivie par le Japon, qui aboutirait à imposer à l’Inde « la loi anglaise sans les Anglais »73. Mais, au fond, il sera fort peu suivi par le personnel politique, en dépit de l’admiration et de l’attachement qu’il a suscités, comme tous les hommes dont l’idéal est trop élevé pour la plupart. Même si beaucoup entendent rester fidèles aux valeurs religieuses ou culturelles fondamentales, il n’est pas question pour eux que cette quête se confonde
73. Mukherjee (R.), ed., The Penguin Gandhi Reader, Penguin Books, 1993, p. 12.
256
Phénomènes d*acculturation
avec un retour au passé, comme en témoigne le roi d'A rabie Abd el-Aziz Ibn Séoud, que son rigorisme islamique affiché n'empêche pas d'introduire dans son pays l’avion, l'automobile et la TSF. La domination coloniale, d’ailleurs, se voit autant reprocher par ses adversaires de maintenir les pays dans l’ar riération que d ’en avoir saccagé la culture traditionnelle, dénonciation qui n’est qu’en apparence contradictoire. Les idées politiques européennes exercent aussi un effet non négligeable. Le premier vecteur en est tout simplement l’enseignement. Le Premier ministre britannique Stanley Baldwin déclare, lors du débat sur YIndia Act de 1935 : « Il est impossible de donner à des gens une littérature qui leur parle de Hamden, Burke, Fox, Shelley, Mazzini, et Lincoln, et d ’espérer qu’ils seront disposés à supporter l’oppression »74. Il suffirait de remplacer ces noms par ceux de Voltaire, Rousseau, Garibaldi, ou Victor Hugo pour attribuer le même effet à l’école de la République française. Paul Reynaud raconte comment il avait assisté, au Lycée de Saïgon, à une leçon d ’histoire, où on enseignait que « on fait la révolution pour obtenir la liberté et l’égalité, et pour chasser les privilégiés ». Ce républicain modéré se scandalisait de cette éducation, qui risquait de « faire des dégâts irréparables dans l’âme du jeune asiatique »7S. Il se trouvait d’accord avec le monarchiste Jacques Bainville, une des grandes figures de l ’Action française, qui avait écrit quelques années plus tôt : « une des plus graves erreurs où le monde occi dental soit tombé, c’est de s’imaginer qu’en accédant à son genre de civilisa tion, les peuples de couleur se rapprocheraient de lui. Ils y ont seulement pris l’idée que les Jaunes et les Noirs valaient bien les Blancs, et devaient s’af franchir d ’une domination injustifiée et injustifiable »76. Beaucoup, en particulier, sont attirés par le marxisme, sous ses formes diverses, socialiste ou communiste. L’analyse de l’impérialisme colonial comme fruit du capitalisme financier avait été largement développée par des théoriciens comme le Britannique Hobson, auteur en 1902 de Imperialism, a study. Celui-ci reste, entre les deux guerres, un conseiller écouté du Labour Party. En France, Jaurès s’était distingué par ses attaques contre l’expansion au Maroc, accusée de faire le jeu des grands intérêts financiers. Mais c’est Lénine qui, dans sa célèbre brochure de 1916, Impérialisme, stade suprême du capitalisme, intègre ses idées à son arsenal de prise du pouvoir, dans un texte où, comme toujours chez lui, la charge révolutionnaire le dispute au sectarisme et à l’imprécation : c’est pour satisfaire à l’esprit de rapine d’une poignée de grands financiers que les armées coloniales se sont abattues sur les peuples d ’outre-mer pour en piller les richesses, en forçant les popula tions à travailler pour eux dans la privation de toute liberté et des conditions de vie de plus en plus précaires. « Cependant des hommes travaillaient à la
74. Lord Butler, The Art of the Possible, Londres, Hamish Hamilton, 1971, p. 58. 75. Reynaud (P.), Mémoires, T. I, p. 329-330. 76. Bainville (J.), Journal (1919-1926), Plon, 1949, p. 262. Le propos est de 1926.
257
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
chaîne. Cependant des policiers marchaient dans les rues, des hommes mouraient en Chine de mort violente, dans la Haute-Volta, le travail forcé abattait les Noirs comme une épidémie *77. Des jeunes Français comme Paul Nizan, l’auteur de ces lignes, ont été tourmentés par de telles images. Combien plus ont-elles touché de jeunes intellectuels des pays colonisés ! Si la diffusion des idées par l’école et la lecture a occupé une place de premier plan dans la transformation des idéologies, la part des Européens dans l’initiation à l’action politique n’a pas été négligeable. Elle passe d ’abord par l’exemple des Européens, qui usent largement de leurs droits d ’expression. Un peu scandalisé, Fumivall note à propos des Indes néerlan daises que, à l’inverse de ce qui se passe aux Indes anglaises, des Européens de statut social élevé, y compris des hauts fonctionnaires, ont la liberté de professer des opinions libérales, voire socialistes, sans passer pour des excentriques ou des marginaux, et peuvent diffuser leurs idées dans l’opinion par l’intermédiaire de la presse78. Une douzaine de partis politiques euro péens y sont représentés, y compris des partis révolutionnaires. Il eût pu dire la même chose de l’Afrique du Nord, où la liberté d ’expression des journaux européens dégénère souvent en licence, au grand dam de l’image de l’auto rité. Quant aux plus humbles, ils ont transporté avec eux leur syndicalisme, qui constitue souvent la matrice des syndicats indigènes indépendants, par exemple en Afrique. Le rapprochement se fait souvent au sein des sociétés de pensée ou des partis politiques. Même si, comme les Églises, les loges européennes aux colonies témoignent fréquemment de la réticence à recevoir des indigènes, un certain nombre d’entre eux s’affilient aux loges maçonniques. D’autres se rapprochent des différents partis des métropoles, mais le poids faible, inexis tant des électeurs des empires n’en fait guère des interlocuteurs importants aux yeux des leaders de ces partis. Avec le bolchevisme, en dépit de ses aber rations, les militants coloniaux ont souvent, en revanche, le sentiment d ’en trer dans une véritable fraternité. Aux niveaux les plus humbles, la camara derie prolétarienne avec des militants de toutes races tranche favorablement sur l’attitude souvent distante de bien des notables, seuls interprètes jusquelà des aspirations populaires. Selon Nelson Mandela, son premier ami blanc aurait été un militant communiste, rencontré vers 1940 dans le cabinet d’avocat où il était employé79. C’est, de même, au parti communiste qu’Albert Camus, qui y milite de 1935 à 1937, prend véritablement conscience de la situation des Algériens musulmans, pour lesquels il ne cessera jusqu’à la guerre de demander justice, notamment dans son enquête sur la Kabylie publiée en juin 1939 dans le journal Alger-Républicain.
77. Nizan (R), Aden-Arabie, [1932], Maspero, 1960, p. 59. 78. Fumivall (J.S.), Netherlands India, p. 24,283. 79. Mandela (N.), Un long chemin vers la liberté, p. 82-83.
258
Phénomènes d'acculturation
Toutes ces idées sont diffusées par le livre, et aussi par une presse qui a pris son essor au XIXe siècle, et utilise à la fois langues européennes et langues locales. Aux Indes, on recenserait ainsi plusieurs milliers de jour naux et périodiques (entre 3 000 et 4 000), publiés en dix-sept langues diffé rentes. En Indochine, en 1939, 48 journaux et 68 bulletins et revues ont été édités dans la seule langue vietnamienne80. Certes, ce mouvement reste limité : par exemple, en 1927, al-Ahram, le vénérable quotidien égyptien fondé en 1875, et le plus diffusé dans le monde arabe, et même au-delà, ne tire qu’à 35 000 exemplaires. Par ailleurs, beaucoup de petites feuilles beso gneuses ne peuvent vivre que d ’expédients, et leur parution se réduit parfois à quelques numéros. Elles ne suscitent pas moins un mouvement non négli geable. C ’est en s’appuyant sur son journal, le West African Pilot, que Nnamdi Azikiwe commence au Nigeria, à la fin des années trente, une carrière qui en fera à la fois le chef d ’un important groupe de presse et un des leaders du mouvement indépendantiste81. Limites du rapprochement Ces modifications des idées et des genres de vie conduisent-ils à un rapprochement ? Certes, ils traduisent, à long terme, un certain nombre de tendances à une uniformisation des genres de vie, et des besoins. Mais ces accommodements, faute d ’atteindre la masse des populations, ne font qu’es quisser ceux qui sont constatables de nos jours, à une tout autre échelle, et demeurent pourtant très relatifs, faute de toucher au cœur des mentalités de communautés denses et vigoureuses, ou de pouvoir relever substantiellement le dynamisme de communautés déstructurées. Il n’est pas évident, de toute façon, que ces échanges ou ces apports, plus que les précédents, contribuent à une meilleure compréhension. Parfois, les emprunts sont tellement réinterprétés par les sociétés locales, que les Européens sont portés, le plus souvent, à voir de grotesques caricatures dans les indigènes influencés par leur contact. Au mieux, l’évolution tend à atté nuer certains obstacles ou à dissiper certains préjugés, mais n’est pas assez forte pour mettre fin aux barrières entre communautés. Il se constitue bien, remarque O ’Malley à propos des Indes, une société indienne moderne, mais celle-ci n’a guère besoin de contact avec les Européens, étant assez nombreuse pour former un milieu à elle seule, le nombre de ceux-ci étant de toute façon, comme on l’a vu, ridiculement bas. L’inverse peut être tout aussi vrai : Fumivall écrit que « l’Européen qui s’est « indigénisé » (gone native), est souvent le plus acharné contre les indigènes, et semblablement l’Oriental le plus occidentalisé est souvent le plus anti-Européen82. Pour l’Européen, 80. Wordsworth (W.C.), « The Press », in O’Malley, Modem India, p. 188 ; Isoart, (P.), Le problème national vietnamien, p. 279. 81. Crowder (M.), West Africa, p. 471-472. 82. Fumivall (I.S.), Netherlands India, p. 420.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
vivre comme les indigènes ne doit pas le réduire à être traité comme Tun d ’entre eux, et à renoncer à son statut, lors même que celui-ci n ’est plus justifiable par autre chose que la naissance. Pour l’Oriental, en revanche, vivre comme l’Européen rend insupportable de continuer à être traité comme un indigène, et donc amplifie ses revendications à l’égalité qui lui est déniée. Le rapprochement culturel, quand il existe, conduit en effet à souhaiter une émancipation conforme aux idéaux politiques des grandes démocraties britannique et française. Les leaders indigènes, même très marqués par l’Occident, sont loin, pour la plupart, de souhaiter s’assimiler totalement à lui. Le plus souvent, ils sont plus impressionnés par les aspects techniques et scientifiques, dont la conquête a montré l’efficacité, que par les aspects moraux, intellectuels ou artistiques, qui, par essence, relèvent de valeurs universelles, mais aussi d ’une éducation du jugement et de la sensibilité qui sont à pratiquer de part et d ’autre. D’ailleurs, il faut le reconnaître, les vérita bles savants, penseurs ou créateurs occidentaux n ’ont jamais cessé de témoi gner un grand respect aux cultures indigènes, et d ’y puiser des sujets d ’études ou d ’inspiration. Cette façon de présenter l’ensemble des rapports entre communautés ne doit pas induire en erreur. Deux éléments contribuent à cimenter ces cons tructions : le premier consiste dans l’établissement de liens entre les diffé rentes communautés, qui met un peu de liant dans le jeu des relations sociales ; le second est l’imposition d ’un ordre qui oblige la majorité à la soumission. Ces deux aspects seront étudiés successivement
Chapitre 9
Le gouvernem ent indigène
Comment la colonisation s’est-elle établie, et surtout comment a-t-elle pu durer ? Comment de faibles cohortes d ’hommes d ’Europe ont-elles pu imposer leur domination (une domination souvent très dure) à des peuples si nomb reux ? La première explication qui vient, et très justement, à l’esprit, est celle d’un régime imposé par la violence, et maintenue par elle. À l’inverse, les thuriféraires de la colonisation avancent l’idée, bien trop flatteuse, d’une capacité à gouverner qui a su rallier le suffrage des populations indigènes. Tout est, comme toujours en histoire, beaucoup plus complexe, et il vaudrait mieux parler, avec Lyautey, d’une combinaison de force et de politique, tout l’intérêt étant de réfléchir sur la composition respective et de s’interroger sur le dosage de ces deux ingrédients. Il est évident que l’emploi de la force fut un facteur déterminant de la constitution des empires, en dépit du relief donné à l’image de « conquérants pacifiques », comme Livingstone ou Brazza. Elle ne paraît pas moins essen tielle pour les conserver. En 1897, dans son Recessional, Kipling implorait le dieu (tes Armées de continuer à veiller sur l’Empire1. La plupart des coloni sateurs souscriraient sans doute à ce qu’écrivait, en 1910, le diplomate fran çais Jules Harmand : « suivant les lieux, les circonstances et les procédés, la force peut être plus ou moins effective ou modérée, patente ou dissimulée, mais son emploi ne peut jamais disparaître... Le conquérant ne doit donc se faire aucune illusion. Quelles que soient sa sagesse, son expérience, l’habi leté de sa conduite, il n’inspirera jamais à ceux qu’il prétend diriger, après les avoir vaincus et soumis, les sentiments d ’affection instinctive et de soli darité volontaire qui font une nation... Même après une occupation séculaire, après que des périodes prolongées de paix et de sécurité auront amené les transformations désirables et désirées, et lié, dans toute la mesure où ils peuvent l’être, les intérêts des deux communautés juxtaposées, ce serait folie au conquérant de penser qu’il puisse être aimé, de s’aveugler au point de
1. James (L.), The Rise and Fall of the British Empire, Londres, Abacus, 1994, p. 214.
261
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
croire que la société dominée subira sa direction avec satisfaction et s’y abandonnera avec une entière confiance »2. Mais ce type d’explication paraît insuffisant, même à des adversaires résolus de la colonisation. Gandhi, commentant la citation d ’un gouverneur général de la première moitié du XIXe siècle, Lord Ellenborough: « c ’est par l’épée que nous avons conquis l’Inde, c’est par l’épée que nous la garderons », se montre fort sévère pour ses compatriotes. Il conteste en effet que la force soit du côté des Britanniques, mais juge que la seule « épée » de ces derniers est l’esprit de soumission des Indiens, qui sont les seuls respon sables de leur situation. Il ne fait que reprendre ce qu’écrivait, quelques années plus tôt, un professeur de l’université de Cambridge, qui déclarait : « on ne peut... guère prétendre que l’Inde a été conquise par des étrangers. Elle s’est plutôt conquise elle-même »3. Une dizaine d ’années plus tard, un Américain souligne encore la faiblesse de la barrière qu’oppose aux masses du pays une poignée d ’habits noirs et d ’habits rouges, entendons quelques dizaines de milliers de fonctionnaires et les soldats anglais4. Toutes ces cita tions font allusion à la manière dont les colonisateurs ont su détourner et utiliser à leur profit nombre de forces vives du pays, en l’absence de solida rités capables d'organiser une opposition unifiée.
La force Les armées coloniales Une des compétence généralement reconnue aux organisateurs des armées aux colonies est en effet d’avoir été capables d'employer largement dans leurs rangs des contingents indigènes qui constituent un réservoir de forces indispensable. Dans l’ensemble, ces troupes se composent de contin gents de métier, endurants et dévoués. Si les désertions peuvent être relative ment nombreuses, les mutineries sont extrêmement rares, peut-être parce que ces unités sont composées de professionnels, qui ont choisi de leur plein gré, pour la plupart, la carrière des armes, et se satisfont des avantages matériels qui leur sont offerts (nourriture, solde, retraite) ; peut-être aussi parce que des techniques d’encadrement éprouvées permettent aux officiers et sousofficiers européens de créer un véritable esprit de corps. La discipline de fer des armées occidentales n’exclut pas le respect des traditions indigènes: respect des interdits alimentaires, autorisation pour les soldats de vivre en famille, en particulier. Au besoin s’y ajoutent des auxiliaires, quelquefois aussi appelés «partisans», recrutés pour satisfaire à des nécessités très temporaires, le plus souvent pour une ou deux campagnes, et ensuite renvoyés chez eux.
2. Harmand (J.), Domination et colonisation, Flammarion, 1919 [l*1*éd. 1910], p. 153-154. 3. Seeley (J.R.), L’expansion, p. 242. 4. Stoddard (L.), Le flot montant des peuples de couleur, p. 77.
Le gouvernement indigène
Dans ces années, l’autorité des officiers européens est indiscutée. Les sous-officiers, gradés et soldats indigènes, d ’origine paysanne, sont vite rompus à une obéissance à laquelle le respect traditionnel des simples envers les notables les a préparés, et qui éprouvent, dans un monde si nouveau pour eux, à la fois du désarroi et une certaine fierté de se battre dans les meilleures armées du monde, avec les meilleurs fusils. Ainsi se sont créées, depuis le XIXe siècle, des unités dont la solidité et le loyalisme sont proveibiaux: fantassins, comme les tirailleurs d’Afrique du Nord ou les tirailleurs sénéga lais dans l’Empire français ; Gurkhas du Népal, Radjpout ou Jat du Penjab ; Sikhs enfin, dans l’Armée des Indes. Certes, leur vocation est d’abord la conquête et l’occupation des territoires coloniaux. Mais leur qualité a été prouvée par leur emploi pendant la Première Guerre mondiale, où elles ont combattu sur tous les fronts: les Balkans, la Palestine et la Syrie, la Mésopotamie, l’Afrique, mais aussi et surtout en France, où leurs noms sont associés à ceux de toutes les grandes batailles. Les aspects financiers de ces questions ne doivent pas être sous-estimés. La situation varie avec le degré d ’indépendance : ainsi, dans l’Empire britan nique, les Dominions assument l’essentiel de leurs fiais de défense (compte tenu du fait qu’ils peuvent s’épargner l’essentiel de l’effort naval, grâce à la suprématie de la Royal Navy) ; l’Inde elle-même pourvoit en quasi-totalité (97 %) aux dépenses des troupes indigènes et britanniques qui y sont station nées. Ceci représenterait en 1938 environ 23 % des revenus du pays (près de 460 millions de roupies, sur un total de 2 milliards), pourcentage passé à 38 % en 1939s. En revanche, pour le cas où des détachements indiens sont employés au-dehors ils sont pris en charge par le budget britannique. Même là où, comme dans le système fiançais, les dépenses des troupes régulières émargent au budget de l’État, les finances locales sont appelées à apporter leur participation. En 1939, la contribution indochinoise à la défense est fixée à 130 millions de francs, à comparer à un budget général de près de 900 millions (89 millions de piastres), sans préjudice d ’un emprunt de défense nationale de 440 millions en 193856. À cette époque, la contribu tion des Indes néerlandaises à la défense serait de 100 millions de florins pour un budget évalué à 414 millions, soit le quart des dépenses ordinaires7. Ainsi, les métropoles peuvent-elles faire assumer par les contribuables locaux (dont une partie, il est vrai, sont des colons), les dépenses d ’ordre intérieur pour une bonne partie, et, pour une partie non négligeable, les frais de défense. Certes, ces contingents ne sauraient suffire à eux seuls à porter le poids des opérations outre-mer. Ils se composent essentiellement d ’infanterie et de cavalerie, les armes savantes (artillerie, génie) ou modernes (blindés, avia tion), étant réservées, autant par souci de sécurité que par faiblesse du degré
5. Political and Strategie Interests, op. cit., p. 263,295. 6. Bulletin du Comité de l’Asie française 1939, p. 198 ; 1938, p. 88.
263
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
d’instruction de la grande majorité des soldats indigènes, à des Européens. Des unités européennes, comme en France les Troupes de marine et la Légion étrangère (imitée en Espagne par le Tercio Estranjero), ou en Grande-Bretagne les Régiments écossais, constituent, en tout état de cause, une réserve aussi vitale que la Garde l’était pour Napoléon. Mais ils ne représentent que des effectifs réduits. En 1938, les détachements britan niques dans l’Empire sont évalués, pour l’armée de terre, à environ 108 000 hommes (sur un total de 232 000). La majeure partie est employée à tenir garnison dans les bases importantes, et en particulier celles qui s’égrè nent le long de l’axe vital qui mène à Suez, Singapour et Hongkong, ce qui ne les rend que marginalement opérationnelles pour le contrôle des territoires et des populations, leur mission essentielle étant tournée vers la défense extérieure78. Aux Indes, où les unités britanniques sont les plus nombreuses, le total des troupes ne représente en 1938 que 60 000 soldats britanniques environ. Légèreté du dispositif militaire On est surpris, au regard des chiffres, de voir que la domination militaire occidentale ne paraît reposer que sur des effectifs permanents d’un volume très réduit, dont la grande majorité se compose de contingents indigènes. S’ils le souhaitaient, les 3S0 millions d ’indiens ne pourraient-ils pas rendre la vie insupportable à ce faible contingent, qui garde le pays de concert avec environ 200 000 hommes de troupes indiennes ? Le rapport de l/5e entre troupes européennes et troupes indigènes est bien inférieur à celui d ’un contre deux et demi que, depuis la grande mutinerie de 1857, les militaires britanniques avaient cru devoir maintenir pour la sécurité de leurs posses sions, surtout si l’on songe qu’il faut ajouter aux 200000 soldats environ 200000 policiers, également indiens9. La situation n’est pas différente ailleurs. La Frontier Force de l’Afrique occidentale britannique compte moins de 10 000 hommes pour 20 millions d’habitants. Ces dispositions sont imitées par les autres puissances. Au Maroc, en 1932, une armée française de 72 000 hommes (dont 38 % d ’Européens, 47 % de Marocains, et 15 % de soldats d ’autres colonies) suffit à tenir un pays d ’environ six millions d ’habitants, fraîchement conquis. Il n’y a en Indo chine en 1936, toutes armes confondues, que 10000 hommes de troupes européennes, pour une population totale de 23 millions d’habitants. En Afrique noire, il en va de même. Une Force publique de 16000 hommes encadrée de quelques centaines d ’officiers et sous-officiers européens suffit aux Belges pour tenir l’immense Congo. En Angola portugais, il n’y a pas plus de 5 000 hommes, dont moins de 500 officiers et sous-officiers euro
7. Van Asbeck, « les responsabilités néerlandaises... », art. cit, p. 233. 8. Political and Strategie Interests, p. 279-283. 9. Statesman’s Year Book, 1939, p. 123-124 ; Dear (I.C.B.), The Oxford Companion to the Second World War, Oxford University Press, 1995, p. 563-564.
264
Le gouvernement indigène
péens101. Dans les vastes espaces de l’Insulinde ne stationnent en 1930 que moins de 10000 Européens sur un total de 35000 hommes qui forment l’Armée Royale des Indes néerlandaises (ou KNIL). Quant aux colons, en dépit d ’un comportement volontiers agressif, ils ne sont guère en mesure, vu leur petit nombre, d’être d ’une aide considérable. Les milices qu’ils peuvent constituer en cas d ’émeute sont souvent, par leur nervosité, plus gênantes qu’utiles. Pour contenir la masse des indigènes, la puissance coloniale ne peut compter, selon une expression de Lyautey, que sur « une mince et fragile pellicule d ’occupation». Il faut dire que, en cas d ’insurrection, les puis sances coloniales sont capables d’agir rapidement et massivement. La capacité d'action Bien des événements sollicitent le renforcement des contingents colo niaux. Tout d’abord, les conquêtes ne sont pas finies dans l’entre-deuxguerres. Français et Britanniques ont dû procéder, non sans difficultés, à l’occupation militaire des mandats du Proche-Orient. La conquête de la Libye par les Italiens ne s’achève qu’en 1931. Celle du Maroc par les Français ne se termine qu’en 1934, et entre-temps les Espagnols à partir de 1921, puis les Français, à partir de 1925, ont eu à combattre les révoltes d’Abd el-Krim dans le Rif. C ’est seulement de la même année 1934 qu’on peut dater la dernière disparition des résistances au Sahara. Quant à la conquête de l’Éthiopie par l’Italie fasciste, elle n’a rien eu d ’une promenade militaire, et ne peut être considérée comme achevée en 1939. Mais le recours à la force n’est pas limité à ces opérations de grande enveigure. Des foyers d’insurrection, plus ou moins durables, peuvent en effet s’allumer çà et là, exigeant des réponses militaires. Parmi les foyers permanents qui préoccupent les responsables britan niques figure en premier lieu la province de la frontière du nord-est des Indes. Cette véritable « marche » militaire, au contact de l’Afghanistan, sert surtout à contrôler la célèbre Khyber Pass, la route des invasions empruntée par tous les conquérants depuis Alexandre, sur laquelle pèse, depuis la fin du XIXe siècle, la menace des armées russes présentes aux confins nord du pays. Elle est aussi destinée à se prémunir contre les raids des tribus monta gnardes. Dans cette région, théâtre, entre 1919 et 1921, de la «troisième guerre afghane», l’insécurité est permanente. En 1931, les voitures ne sont autorisées à franchir la Khyber Pass, ses kilomètres de défilés et ses trentesept tunnels, sur la route de Peshawar à Kaboul, qu’entre 7 heures du matin et 7 heures du soir11. Au sud, la région du Waziristan, occupée par les troupes britanniques seulement en 1921-1922, est l’objet de plusieurs expéditions dites « punitives »notamment en 1923 et 1936-1937. À la veille de la guerre, la surveillance de la frontière (dite « ligne Durand ») demeure une préoccu
10. Statesman’s Year Book, 1938, p. 1259. 11. Le Fèvre (G.), La croisière jaune, l’Asiatbèque, 1990, p. 66.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
pation pour les autorités britanniques, pour lesquelles un soulèvement des tribus qui pourrait être stimulé par la propagande bolchevique n’est pas impossible. Un autre sujet de préoccupation est la sécurité de la Palestine, où le soulèvement armé arabe qui se développe à partir de 1937 à la fois contre les colons juifs et contre les occupants britanniques succède à une suite de conflits entre colons et indigènes. Au cours de la seule année 1938, on comp tabiliserait 69 Britanniques tués, 292 Juifs, et 1600 Arabes. D’autres événements, plus sporadiques, semblent démontrer la nécessité d’une vigilance permanente. La mutinerie des tirailleurs du 2e bataillon annamite de Yen-Bay, au mois de février 1930, se traduit par la mort de deux officiers et quatre sous-officiers, et déclenche une série de mouvements aux confins de l’Annam et du Tonkin, mais également en Cochinchine. Moins célèbres, des révoltes éclatent çà et là, entraînant des guerres lointaines sans doute, guerres ignorées ou vite oubliées des Européens, mais plus marquantes dans les mémoires des populations : la révolte paysanne dirigée par Saya San en Birmanie, dans le delta de l’Irrawady, en 1931-1932, dont la répression fait une centaine de morts dans l’armée britannique, et 2000 parmi les insurgés ; ou bien encore la guerre dite du Kongo-Warra (du nom du bâton de commandement de Kamou, le chef de la révolte), qui soulève l’Oubangui-Chari et les régions avoisinantes entre 1928 et 1933. Sans même parler de révoltes à main armée, l’histoire de la période est riche en agita tions qui s’accompagnent souvent de violentes manifestations. On en trou vera des exemples plus bas. À chaque fois, les Européens sont capables de réunir des effectifs bien plus importants que ceux des garnisons ordinaires. Ainsi, en 1921, les Britanniques engagent-ils 100 000 hommes pour venir à bout de la révolte de l’Irak. Lors de la guerre du Rif de 1925, les Français n’ont pas mis en ligne moins de 300 000 hommes appuyés par les matériels les plus modernes de l’époque (chars, avions, artillerie), sous le commandement du maréchal Pétain, alors au faîte de sa gloire, tandis que près de 50000 hommes se battent contre les insurgés syriens sous les ordres du général Gamelin, alors connu pour avoir été le bras droit de Joffre pendant la guerre. Lors de l’occu pation de l’Éthiopie, Mussolini a pu engager près de 400 000 hommes, dont 87 000 soldats indigènes (ascari somaliens, érythréens ou même libyens)12. Le gros de la conquête de l’Éthiopie étant achevé, 300000 hommes sont maintenus sur place, dont les Africains forment les deux tiers13. Plus modestes, certains efforts méritent néanmoins d’être mentionnés. Au Waziristan, grand comme les deux tiers du Pays de Galles, il n ’a pas fallu envoyer moins de 40000 hommes. Le bilan s’établit à 183 tués dans l’armée britannique, et 700 chez les indigènes. La situation en Palestine impose une
12. Rochat (G.), «Le guerre coloniali del fascismo», in Del Boca (A.) dir., Le guerre coioniali, p. 183. 13. Le Houérou (F.), L’épopée des soldats de Mussolini en Abyssinie, p. 109.
266
Le gouvernement indigène
forte garnison de 25 000 hommes à la veille de la guerre, avec le tiers des cadres disponibles (dont le futur maréchal Montgomery), pour une popula tion d ’un million et demi d ’habitants. Le résultat de ces campagnes n’est pas douteux : elles se traduisent inévi tablement par la victoire des troupes européennes. Le cas de la bataille d’Anoual (juillet 1921), où la défaite d ’une armée d ’environ 20000 Espa gnols s’est traduite par un très lourd bilan (près de 9000 morts, 4500 blessés, 600 prisonniers), est exceptionnel. Il est souvent rapproché de celui d’Adoua, un quart de siècle plus tôt, où les Italiens furent écrasés par l’armée du Négus (4000 Italiens tués, 2000 prisonniers sur 10000 ; 4000 soldats indigènes pris ou tués sur 7000), ce qui entraîna la ruine des ambitions italiennes sur l’Abyssinie. Ces catastrophes qui apparaissent comme d ’ab surdes anomalies aux spécialistes de la guerre aux colonies, s’expliquent par l’incompétence du chef européen, aventurant ses troupes sur un terrain mal connu, plus que par la supériorité de ses adversaires. Ceux-ci, en effet, n’ont que bien peu à opposer à l’organisation des armées coloniales. La supériorité technique Cette supériorité, comme celle de toutes les grandes puissances, réside dans ce qu’on nomme aujourd’hui capacité de projection. Depuis le XIXe siècle, les Occidentaux sont capables de projeter et de ravitailler au-delà des mers des colonnes de plus en plus puissamment armées composées de troupes de métier supérieurement entraînées et manœuvrantes. Français et Britanniques, notamment, peuvent concentrer, comme on l’a vu, des forces considérables, grâce à la supériorité d ’une logistique qui utilise les transports maritimes, mais aussi, grâce aux progrès de l’occupation, les chemins de fer (notamment en Inde britannique), puis le camion empruntant un réseau de routes ou de pistes constamment amélioré. Ils bénéficient de l’amélioration des transmissions grâce à un usage généralisé de la TSF. Ils peuvent aussi avoir recours aux armes mises au point à l’occasion du récent conflit mondial: mitrailleuses ou fusil-mitrailleurs, mais aussi artillerie à longue portée, automitrailleuses, chars, avions. L’aviation en particulier, en dépit de ses limites techniques (rayon d ’action encore faible, vulnérabilité à basse altitude, sensibilité aux conditions atmosphériques, inaptitude aux interven tions de nuit) donne aux Européens une capacité d ’action inconnue jusquelà. Aux missions de reconnaissance s’ajoutent celles de mitraillage et de bombardement. Des essais de transport de troupes par air ont été faits avec succès. L’aviation permet aussi l’évacuation sanitaire rapide des blessés, ce qui influe favorablement sur le moral des combattants. Si toutes les puissances ont recours à l’aviation, c’est en GrandeBretagne, sous l’impulsion de YAir Marshall Hugh Trenchant, vétéran de la guerre des Boers, et ancien de la West African Frontier Force, qu’a été élaborée une doctrine dite de «contrôle par l’A ir» (Air Control). Cette doctrine postule que les escadrilles de la RAF doivent systématiquement se
267
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
substituer aux lourdes colonnes d ’infanterie pour écraser les tentatives de soulèvement. L’Air Control a pour lui son caractère peu dispendieux pour les finances britanniques. Les Anglais y ont recours, notamment, pour achever, en 1921, l’écrasement de la révolte menée contre eux en Ogaden depuis plus de vingt ans par Mohammed ben Abdallah (le Mad Mullah). À cette occa sion, une douzaine d ’avions détachés par Churchill, alors secrétaire de l’Air, appuyés par deux bataillons et un corps méhariste suffisent pour écraser la révolte pour le coût minime de 77000 £, là où des moyens classiques auraient exigé deux ou trois divisions et l’établissement d’une voie ferrée1415. Les ambitions des Saoudiens sur la Transjordanie (1922) puis sur l’Irak (1927-1928) sont pareillement découragées. Aden et l’Hadramaout sont défendus de la même façon contre les Yéménites en 1928-1934. En 1932, la garnison britannique en Irak ne dépasse pas les 2000 hommes, affectés à la garde et à la maintenance de quatre groupes d ’aviation complétés par deux bataillons de Levies (formations auxiliaires) et une compagnie de voitures blindées13. Sur un millier d ’appareils de la RAF, le quart est affecté dans l’Empire, dont une centaine aux Indes et une centaine en Égypte et en Irak16. Ceci ne va naturellement pas sans dommage pour les populations civiles. Au Maroc, après la reddition d ’Abd el-Krim, il faut une série de dures campagnes pour soumettre les massifs montagneux de l’Atlas. Le blocus des massifs montagneux, qui les réduit à la famine, les tirs d ’artillerie destinés à empêcher l’usage de terrains de parcours, les bombardements aériens amènent à nuancer fortement le slogan de «pénétration pacifique». En Palestine, les villages arabes accusés d’avoir donné asile aux rebelles sont frappés collectivement d ’amendes, voient l’accès de leurs champs interdits ou leurs troupeaux frappés de séquestre, quand ils ne sont pas obligés d ’en tretenir à leurs frais un poste destiné à assurer la garde des lieux. Dans des cas plus graves, le village est partiellement ou totalement dynamité, selon un procédé qui sera repris plus tard par les Israéliens. Les insurgés eux-mêmes sont emprisonnés, fouettés ou pendus (une centaine de pendaisons)17. Les Italiens avaient, de même, pendu en 1931 le chef de la résistance en Tripolitaine, Omar el-Mokhtar, après l’avoir fait prisonnier. Lors de la révolte de Yen-Bay, dans la seule province du Nghê Tinh, la répression se traduit par 1252 morts, plusieurs milliers d’arrestations et 3 000 condamna tions18. Sans diminuer les responsabilités françaises ou britanniques, il semble que les méthodes employées par le gouvernement fasciste soient encore plus
14. Amery (L.), My Political Ufe, vol. 2, p. 201-202. 15. Jovelet (Louis), « L’évolution sociale et politique des pays arabes », Revue des Études islamiques, 1933, p. 425-644 (p.447); Sluglett (P.), Britain in Iraq 1914-1932, Londres, Ithaca Press, 1976, p. 270. 16. Morris (J.), Farewell the Trumpets, p. 316. 17. Bethell (N.), The Palestine Triangle, p. 36, p. 54-55. 18. Brocheux (P.), Indochine, la colonisation ambiguë, p. 309.
268
Le gouvernement indigène
systématiques. La résistance acharnée des populations de Cyrénaïque à l’invasion italienne n’est brisée que par la déportation et l’internement de 80000 personnes (sur 400000), et l’érection d ’un barraje de 270 km de long à la frontière égyptienne19. Pour la soumission de l’Ethiopie, les chefs fascistes n’hésitent pas à recourir au gaz ypérite, répandu par avion, arme dont l’emploi a été parfois évoqué, mais écarté dans les autres conflits colo niaux de l’époque. La prise d ’Addis-Abeba ne signifie pas la fin des résis tances locales, qui se poursuivront sans interruption jusqu’à la capitulation de l’armée italienne devant les Britanniques et les Forces françaises libres en 1941. Ces résistances sont férocement réprim ées: à la tentative d ’attentat dans la capitale contre le vice-roi Graziani, qui a fait trois morts et 49 blessés dans la capitale, les autorités italiennes répondent par des représailles qui, d’après leurs propres chiffres, auraient fait au moins 3000 morts (février 1937)20. À défaut de l’usage de la force, l’étalage de celle-ci est permanent pour dissuader les soulèvements, en application d ’un vieil adage popularisé en France par Lyautey dans la célèbre formule « montrer sa force pour ne pas avoir à s’en servir». Défilés des troupes et prises d'arm es, survols des villages par l’aviation, démonstrations navales sont fréquents. Le vacarme des cuivres ou des bag-pipes, le martèlement des tambours, les ordres hurlés par les sous-officiers et instantanément exécutés par des soldats changés en automates, le scintillement de l’acier des baïonnettes, contribuent à accré diter l’idée d ’une puissance invincible. Qu’importe si les matériels ne sont pas des plus modernes, comme ces vieux chars Renault F l 7 de la guerre précédente, déclassés depuis longtemps en Europe, ou les vieux avions Potez 25 TOE (théâtres d ’opérations extérieurs), dont la carrière se poursuit jusqu’aux années 1940, mais qui ne dépassent pas 210 km/h. Face à ces moyens, même vétustes, les autochtones n’ont en effet guère de ressources. Leur dilemme est le même que celui de toutes les révoltes paysannes depuis l’Antiquité : ils sont trop pauvres pour lutter seuls contre une petite troupe de professionnels armés : et, groupés, ils offrent une cible facile aux fusils à tir rapide, aux mitrailleuses et aux canons. Ils ne peuvent guère compter sur l’appui de conseillers militaires étrangers, ni sur l’envoi d’armes. L’URSS, seule puissance qui pourrait être éventuellement une aide, n’a, à supposer que ses maîtres en aient le désir, guère de moyens à mettre au service d ’éventuels soulèvements. La solidarité des puissances occidentales est suffisante pour empêcher, aux frontières des pays soulevés, la création de « sanctuaires » sur les territoires coloniaux voisins. Le blocus des marines européennes dissuade efficacement les trafics d ’armes. Dans le meilleur des cas, les combattants indigènes ne peuvent opposer aux troupes européennes que des fusils de guerre, achetés en contrebande, ou récupérés sur l’ennemi
19. Rochat (G.), « Le guerre coloniayli del fascismo », art cit. 20. Le Houérou (F.), L’épopée des soldats de Mussolini en Abyssinie, p. 80.
269
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
en cas d ’embuscade, comme dans le cas des Rifains après Anoual (129 canons, 400 mitrailleuses et surtout 20000 fusils). Encore l’absence de personnels compétents et de stocks de munitions réduit-elle considérablement l’usage de ces armes modernes. Le plus souvent, ils doivent se contenter de matériels anciens, aux munitions rares et inefficaces. Leurs combattants ne sont ni payés, ni équipés, ni entraînés, ni nourris, et forment plutôt des bandes qui ne peuvent se rassembler que très exceptionnellement, sous peine de manquer de ravitaillement, et de fournir une cible facile à la puissance de feu adverse. Le premier soin des Européens est d’ailleurs de confisquer les armes des vaincus, et d ’interdire totalement ou de réglementer sévèrement le port d ’armes à feu. À tout cela, il faut ajouter les souvenirs douloureux des époques de conquête, ou les répressions de révoltes marquantes, dont un certain nombre sont assez récentes. On peut rappeler ici un épisode connu de peu de Français, qui se passa le 20 septembre 1906, à Denpasar, aujourd’hui capi tale de Bali. Ce jour-là les princes locaux et leurs gens, hommes armés de lances et de javelots, femmes et enfants, se sont jetés sous le feu des soldats hollandais, et ont tous péri dans cette sorte de suicide rituel (puputan). Cet épisode connaît pourtant en 1937 un regain de notoriété, grâce au roman historique publié par Vicki Baum, la célèbre romancière autrichienne réfu giée aux Etats-Unis, sous le titre Amour et mort à Bali (que la traduction française édulcore avec le titre retenu)21. D’autres massacres analogues ont eu lieu dans l’île voisine de Lombok. Plus tard, de tels épisodes pourront être repris et magnifiés à l’occasion des combats pour les indépendances. Le leader nationaliste Achmed Soekarno, particulièrement, aimera à rappeler que son grand-père maternel fut l’un des martyrs de Bali22. On peut penser que, pour l’instant, les peuples restent sous le coup de la défaite infligée par une force impitoyable et écrasante. Ainsi toute révolte armée paraît très difficile. L’anticolonialiste français Félicien Challaye expose une opinion très répandue lorsqu’il souligne qu’un soulèvement des populations indigènes contre la colonisation n ’aboutirait qu’à « l’inutile massacre de leurs élites j»23. On peut dire, sans risque d ’er reur, que la plus grande partie des populations, des plus humbles aux nota bles, ne pensent guère autrement, ce qui incite en général les peuples à la soumission, et pousse les responsables à éviter ou à empêcher des heurts qui ne conduiraient qu’à une répression accrue.
21. Baum (V.), Sang et volupté à Bali. 22. Soekarno (A.), An Autobiography, p. 19. 23. Challaye (F.), Souvenirs sur la colonisation, Picait, 1933, p. 202.
270
Le gouvernement indigène
Police, gouvernem ent et commandement L'appareil répressif Il ne faudrait pas croire que les missions courantes dites « d ’ordre public » soient toujours assurées par l’armée. La police coloniale, en effet, suffit le plus souvent à faire régner l’ordre, dans les villes en particulier. Encadrée par des Européens, appuyés par une nuée d ’indicateurs, elle bénéficie de la situation juridique minorée des « indigènes », et de l’absence de libertés dans la colonie, qui permet de suspendre ou de supprimer les journaux, d ’interdire les réunions, les associations ou les partis politiques. Une répression bien dosée, utilisant, selon la gravité du délit ou le degré social du coupable, les coups, l’amende, l’exil, la résidence surveillée ou l’emprisonnement, pourchasse les adversaires. Des services de renseigne ment peu nombreux, mais bien organisés, et qui recrutent largement parmi les indigènes, se chargent de contrôler, répertorier, ficher, pour prévenir les troubles. Évidemment, la situation diffère selon les pays. Là où les mouve ments subversifs paraissent particulièrement dangereux, le système répressif est mieux organisé et plus puissant. La police de sûreté générale de l’Indochine, dirigée par Paul Amoux, acquiert ainsi, dans les années trente une sinistre réputation auprès des militants nationalistes, tant par les arresta tions qu’elle opère parmi eux que par ses méthodes d ’interrogatoire. Entre les deux guerres, cette façon de procéder aux colonies n’a rien, pour ce qui concerne le Portugal et l’Italie, pour la différencier vraiment des pratiques des métropoles, l’absence de toute garantie pour l’opposition étant la norme dans ces deux dictatures. C ’est surtout dans les possessions des pays d ’Europe occidentale, et singulièrement dans ces deux pays de liberté que se veulent la Grande-Bretagne et la France, que le paradoxe paraît le plus scandaleux. Orwell stigmatise ainsi « la position morale équivoque de la Grande-Bretagne, avec ses phrases démocratiques et son Empire de coolies »24. Les dérogations au droit commun sont souvent justifiées, dans ces deux pays, par l’urgence et l’état d ’exception. C’est ainsi que les auto rités coloniales recourent fréquemment à la loi martiale ou à la proclamation de l’état de siège pour réprimer émeutes et insurrections, en s’appuyant sur le vieil adage Salus Reipublicae suprema lex esto. Selon ces principes, il n’est pas illégal de tuer des individus qui prennent part à une insurrection, ou de les emprisonner. La constitution de partis politiques est interdite ou restreinte. Dans la plupart des territoires français, par exemple, les associa tions sont soumises au régime de l’autorisation préalable, par exception à la loi du 1er juillet 1901 ; il est par ailleurs facile ailleurs d ’interdire un parti nationaliste pour non respect de la même loi, dont l’article 3 déclare frappée de nullité toute association ayant pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire. Même sans condamnation, la pratique de l’internement par mesure
24. Orwell (G.), Homage..., p. 24S.
271
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
administrative, en usage dans les colonies françaises, mais aussi aux Indes néerlandaises, permet de détenir sans jugement les personnalités jugées dangereuses. Si les leaders jouissent, en général, d’un régime de relative faveur, il n’en va pas de même des militants plus humbles, qui se retrouvent emprisonnés dans des conditions souvent difficilement supportables. De la répression qui frappe lourdement les chefs nationalistes, les exem ples abondent. Aldous Huxley remarque que, parmi les chefs du mouvement national indien dont les physionomies lui paraissent particulièrement intelli gentes ou énergiques, presque tous ont au moins six mois de prison à leur actif25. Nehru, par exemple, entre 1922 et 1935, a été détenu cinq fois, pour une durée totale de près de cinq ans, et presque sans interruption entre décembre 1931 et septembre 1935. Dans le domaine colonial hollandais, Soekarno, après un premier emprisonnement de 1929 à 1932, est placé en résidence surveillée à Ende, sur la côte sud de l’île de Flores, à près d ’un millier de kilomètres de Java, en 1933, et n’en sortira qu’en 1942, à la faveur de l’occupation japonaise. Messali Hadj, qui a bénéficié d’une relative indul gence, est arrêté en août 1937, incarcéré, jugé et condamné à deux ans de prison, à laquelle s’ajoute la privation de droits civils et politiques. En mars 1941, un tribunal militaire le condamnera à 16 ans de prison, 20 ans d’inter diction de séjour, à la dégradation civique et à la confiscation de ses biens (ce qui marque tout de même la différence entre République et régime de Vichy). D’autres sont contraints à l’exil. Toute l'ambiguïté de ces mesures est qu’elles considèrent les indigènes comme coupables d ’actions de guerre civile, et donc les traitent comme des nationaux révoltés, alors qu’euxmêmes se perçoivent comme des patriotes luttant dans un combat légitime contre une domination étrangère. Il faut dire enfin que les autorités coloniales n'hésitent pas à user de méthodes brutales même contre de simples démonstrations populaires. À l’occasion des simples émeutes, la troupe n’hésite pas à charger et à ouvrir le feu, avec sans doute d ’autant plus de bonne conscience que ces méthodes n’ont pas totalement disparu en Europe. Le soulèvement contre le protectorat britannique en Égypte de mars 1919, réprimé, notamment, par des troupes australiennes, n’aurait pas fait moins de 1500 tués en huit semaines. Un mois plus tard, la fusillade d ’Amritsar, dans la province indienne du Penjab, en avril 1919, fait près de 400 morts et des centaines de blessés, et scandalise une partie de la population britannique. Le responsable, le général Dyer, est démis de ses fonctions, tant il apparaît à la commission d ’enquête qu’il a donné à ses soldats l’ordre de tirer contre une foule désarmée, à qui on pouvait seulement reprocher d ’avoir participé à une manifestation interdite, mais dont il n’était pas certain qu’elle ait été informée de l’interdiction. Le Roumain Mircea Eliade, qui a assisté à des scènes de répression de manifes tations en Inde par des cavaliers armés de gourdins appelés lathis, écrit :
25. Huxley (A.), Le monde en passant, p. 94.
272
Le gouvernement indigène
« des crânes fêlés et des membres brisés, on en voit partout Mais c’est seule ment dans l’Inde britannique qu'on voit des enfants piétinés par les chevaux, écrasés à coup de sabots, ensanglantés par des matraques j»26. En dépit de tout ce qui vient d'être dit, la contrainte entre-t-elle seule en ligne de compte lorsqu’il s’agit d ’expliquer la conquête et le maintien de la colonisation? La réponse est probablement négative. Tout d ’abord, les libertés ne sont pas totalement absentes : même menacées, une presse, une vie politique, une activité syndicale peuvent se développer, en contact avec les Européens ou à leur exemple, comme on l’a vu. Le ton des articles, des discours, des campagnes est souvent très dur et très revendicatif vis-à-vis de la puissance coloniale. De ce point de vue, l’atmosphère des pays coloniaux est celle de régimes autoritaires, évoquant, mutatis mutandis, ou l’Empire dit « autoritaire », ou le régime tsariste d ’avant 1914, plus que des régimes tota litaires. Si l’arbitraire est fréquent, la liquidation physique définitive est rare, du moins pour les notables des partis. Si la justice est souvent partiale, elle n'est pas inexistante. En règle générale, les conditions d ’interrogatoire (qui prennent parfois l'aspect de tortures) et celle d ’emprisonnement des oppo sants, particulièrement nationalistes, ne sont pas comparables à celles qui se rencontrent alors dans les caves de la Gestapo ou du KGB, ou dans les camps de concentration où nazis et communistes russes envoient leurs adver saires. Même si les noms des bagnes comme celui de Poulo-Condore en Indochine évoquent moins une fort dure réalité, au moins les détenus poli tiques ne sont-ils pas astreints au travail forcé et peuvent lire les journaux français27. Il faut ajouter que la politique des États coloniaux n ’est pas marquée par une sévérité constante. La succession des gouvernements des métropoles, des ministres, des majorités, et, partant, des gouverneurs est à l’origine de changements de lignes qui font alterner intransigeance et compromis. La législation même, en dépit de sa partialité et de nombreuses entorses, continue à donner certaines garanties. C ’est elle, par exemple, qui permet à Gandhi de pratiquer avec succès sa doctrine de non-violence. La désobéis sance civile à laquelle il recourt est naturellement punissable, mais, n ’étant pas accompagnée d ’actes contre les biens ou les personnes, ne l’expose pas à la répression qui punit organisateurs d ’émeutes ou de mouvements armés. Son initiateur même proclame son respect pour la loi, et souligne le caractère exceptionnel de son illégalité. Par ailleurs, même trop souvent indifférentes, les métropoles ne sont pas totalement inaccessibles. Nombre d ’hommes poli tiques ou d’écrivains, de journalistes, de syndicalistes et de militants des partís ont à cœur de dénoncer les injustices qu’ils constatent, même si leur revendication va rarement jusqu’à approuver les programmes d’indépen dance. Cela permet du moins aux leaders nationalistes de continuer leur
26. Eliade (M.), L’Inde, p. 239. 27. Isoart (P.), Le problème national vietnamien, p. 291.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
combat avec l’espoir de voir leurs idées triompher au sein même des métro poles. Beaucoup d ’entre eux, il faut le dire, sont loin de refuser tout compromis avec une puissance coloniale dont ils admirent souvent, comme on l’a vu, la culture et les institutions. Ceci contribue, peut-être autant que la conscience des moyens de l’Occident, à explorer la voie de la négociation plus que celle de la révolte ou de la révolution. Mais surtout, la cohésion de cet ensemble, qui en fait l’efficacité, ne peut s'expliquer que par la maîtrise de certaines pratiques « impériales », qu’il convient maintenant de présenter. De l ’art de gouverner Bon nombre de ressortissants des pays colonisateurs ont développé un discours relatif à une capacité éminente, et pourrait-on dire, essentielle, de leur nation à exercer les responsabilités coloniales et impériales. On ferait un florilège de toutes les déclarations magnifiant le «génie colonisateur» de chaque nation, et dues, généralement, à des ressortissants de la nation célé brée, ce qui, de nos jours, ne peut qu’en affaiblir la crédibilité, mais ce qui n’était pas forcément le cas à l’époque. C’est naturellement chez les Français et les Britanniques qu’on trouve le plus fréquemment des citations dont on ne sait s'il faut saluer le patriotisme ou dénoncer le chauvinisme et l’autosatisfaction. « Nous, Anglais, nous nous appelons insulaires, mais en vérité nous sommes la seule race qui soit capable de produire des hommes capables de s’identifier aux autres peuples ». Ainsi s’exprime John Buchan, auteur à succès de romans impériaux, avec des titres comme Le royaume du prêtre Jean ou Le Prophète au manteau vert, mais surtout membre de l’équipe de Lord Milner, et futur gouverneur général du Canada (1936-1940)28. Un officier français écrit, en écho: «Le Français sait s’expatrier et il sait surtout coloniser. Il comprend l’indigène mieux que tout autre Européen, a le don de s’adapter, et sans fierté, sans orgueil, sans dureté, il obtient des résultats que sans conteste peuvent lui envier les nations européennes dont les pavillons flottent aux quatre coins du monde»29. Ceci n’empêche pas, d ’ailleurs, bien des spécialistes français d’admirer l’efficacité des Anglais ou des Hollandais. Mais les ressortissants des autres puissances ne sont pas en reste. L’expression d’une fierté analogue se retrouve sous la plume du ministre belge Paul-Henri Spaak: «La Belgique a fait preuve des plus grandes aptitudes colonisatrices: elle a réalisé en Afrique une œuvre qui, tant au point de vue économique qu’au point de vue administratif et social, fait l’admiration de tous ceux qui la
28. Buchan (J.), Le Prophète au manteau vert [1916], trad. M. Logé, Librairie des ChampsElysées, 1995, p. 148. 29. Maire (colonel), Nouveaux souvenirs sur la Légion étrangère, Albin Michel, 1948, p. 167.
Le gouvernement indigène
connaissent»30. Les dirigeants portugais vont plus loin encore, puisque l'Acte colonial promulgué le 8 juillet 1930 sous l'autorité de Salazar, alors titulaire du portefeuille des Colonies, et intégré par la suite dans la Constitution de 1933, stipule en son article 2 que « la fonction historique de posséder et de coloniser des territoires d'outre-m er et de civiliser les popula tions qui y vivent relève de l'essence organique de la Nation portugaise »3I. De même, le programme de la phalange espagnole affirme que « la plénitude historique de l'Espagne est l'Empire »32. Des Européens nostalgiques d'une indépendance perdue expriment aussi leur capacité colonisatrice, comme l'Écossais Andrew Dewar Gibb, selon lequel ses compatriotes, moins férus de leur supériorité que les Anglais, et moins méprisants à l'égard des gens de couleur, sont bien plus aptes à coloniser, comme le prouveraient, entre autre, les noms de Gordon ou de Livingstone33. Un Corse aurait pu dire la même chose des compétences colonisatrices de son peuple. La possession de ces qualités intrinsèques est d'autant plus difficile à démontrer qu'elle se confond avec celle des colonies. Il est certain en revanche que les puissances coloniales ont su, à force d'expériences, mettre en place une administration efficace, capable d'établir sur le pays un système de contrôle satisfaisant, au moins dans certaines conditions. L’efficacité administrative Autant que par les effectifs réduits des armées d'occupation, on est frappé par le petit nombre de cadres avec lesquels est tenu un pays. Le cas extrême est peut-être celui de Y Indian Civil Service, qui, vers 1930, n'emploie que 12000 fonctionnaires, dont 3500 seulement occupent des postes supé rieurs34. L'administration française en Indochine, qui a besoin de 5 000 fonc tionnaires français pour encadrer une population environ 10 fois plus faible que celle des Indes, paraît, en comparaison, presque pléthorique. Quant à celle des Indes néerlandaises, avec près de 30000 Européens pour gouverner 60 millions de personnes, elle paraîtrait, n'était son efficacité, frappée d'hy pertrophie35. Des exemples plus précis, empruntés au continent afficain, illustrent à satiété cette conception. En 1931, le Nigeria, peuplé de 20 mil lions d'habitants, est administré par seulement 431 fonctionnaires britan
30. Académie royale de Belgique, Documents diplomatiques belges (1920-1940), t. V, Bruxelles, Palais des Académies, 1966, p. 130. 31. Léonard (Y.), «Salazarisme et lusotropicalisme, histoire d’une appropriation», Lusotopie, 1997, p. 214. 32. Hermet (G.), La politique dans l'Espagne franquiste, Colin, 1971, p. 13. 33. Dewar Gibb (A.), Scottish Empire, Londres, Alexandre Maclehose & Co, 1937, p.309. 34. Bernard (J.A.), De l'Empire des Indes à la République indienne, Imprimerie Natio nale, 1994, p. 17. 33. O’Malley, Modem India, p. 379 ; Isoart (P.), Le problème national vietnamien, p. 200 ; Vandenbosch (A.), The Dutch East Indies, p. 172.
275
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
niques, assistés d’une police encadrée par 80 officiers blancs. Environ 550 Européens du Soudan Political Service suffisent en 1939 pour contrôler le Soudan anglo-égyptien, moins peuplé (6 millions d'habitants) mais vaste de 2,5 millions de km2. Il y aurait eu, à la même époque, environ 2 000 fonc tionnaires au Congo belge. Le petit nombre de fonctionnaires paraît, il est vrai, compensé par leur qualité, souvent remarquable. La réputation des fonctionnaires britanniques de Y Indian Civil Service, mis sur pied à partir de la fin du XVIIIe siècle, et parfois surnommé le «cadre d ’acier» (steel fram e), de l’occupation, fut longtemps proverbiale. Au début du siècle, l’accès aux postes supérieurs est réservé aux rejetons des meilleures famille, sélectionnés par concours. Le Colonial Service, dont la responsabilité s'étend aux autres colonies, et notamment à l’Afrique tropicale, un peu négligée jusque-là, s’améliore, sous l’impulsion de Ralph Furse, responsable du recrutement durant près de trente ans (1910-1948). Les jeunes gens aspirant à ces fonctions sont désignés par entretien, parmi les candidats issus des Public Schools et des grands collèges d ’Oxford et de Cambridge, avant de suivre une formation spéciale dans quelques grandes universités. C ’est également dans les universités (à Leyde exclusivement, puis aussi à Utrecht à partir de 1925) que se forment les administrateurs néerlandais pour l’Indonésie. Le système français compte plutôt sur ce mélange spécifique de méritocratie et de sélection sociale que constitue le système des grandes Écoles. L’École coloniale de Paris, fondée en 1889, devenue en 1934 École nationale de la France d ’outre-mer (ENFOM), forme des administrateurs civils pour l’ensemble des colonies et pour l’Algérie. Les Portugais en 1906, et les Belges en 1911 ont créé des établissements comparables, ces derniers à Anvers. L’administration italienne en Éthiopie souffre, en revanche, de l’improvisation qui amène à confier le pays à des personnels non formés, choisis surtout selon ce critère du clienté lisme de parti qui caractérise le fascisme. Comme on a eu l’occasion de l’observer plus haut, la transmission de ces fonctions à des indigènes est très rare. La seule exception notable est celle de l’Inde. Il faut dire que, dès 1834, une déclaration du Parlement avait stipulé qu'aucun indigène ne pourrait, en raison de sa naissance, de sa descendance ou de sa couleur, être écarté de n’importe quel poste, office ou emploi de la Compagnie des Indes orientales. Ce principe a survécu à la disparition de ladite Compagnie, et a été réaffirmé par la suite à plusieurs reprises. Avec acrimonie, Jules Harmand dénonçait dans ce texte «une véritable charte révolutionnaire », qui n’était pas loin, selon lui, de valoir « les contresens politiques les plus célèbres des révolutionnaires français Reproche bien excessif, car, comme le fait remarquer en 1936 un haut fonctionnaire britan nique, la pratique a consisté pendant longtemps à ne pas écarter systémati quement les Indiens des grands services publics plutôt qu’à leur en faciliter
36. Harmand (J.), Domination et colonisation, p. 172-173.
276
Le gouvernement indigène
l’accès, l’anglais étant la langue des examens et la plupart de ceux-ci se passant en Angleterre37. Depuis longtemps, les sujets britanniques peuvent se trouver soumis à la juridiction de magistrats indiens, armés de tout l’apparat de la justice insulaire. Les réformes engagées à partir de 1919, qui postulent une « indianisation » croissante des cadres, mais aussi un rôle plus grand des organes provinciaux élus au détriment de l’administration, amènent d’ailleurs une certaine désaffection pour YIndian Civil Service, dans l’entredeux-guerres, ce qui profite au Colonial Service. Tous ces gens portent des titres différents, selon le pays qui les emploie : District officers britanniques, appelés parfois aussi District Commissioners ou Political Officers, Administrateurs français, désignés dans les protectorats du titre de Contrôleurs civils, Résidents, Assistants résidents et Contrôleurs hollandais. Résidents italiens, Chefes do Posto portugais. Mais bien des traits les rapprochent. Tout d ’abord, ils ont pour eux la polyvalence : ils sont tout à la fois responsables de la police, de la justice, des impôts, de la santé, de 1’enseignement, des travaux publics. Ils sont, la plupart du temps, d ’excel lents connaisseurs du terrain. C’est surtout parmi eux que l’on trouve la pratique la plus fréquente des langues ou dialectes locaux. Celle-ci n ’est pas partout la même : obligatoire dans les Indes britanniques et néerlandaises, très fréquente dans les pays arabes, où Français et Anglais entretiennent de bons spécialistes, elle est moins répandue en Afrique, où elle concerne quelques langues véhiculaires comme le bambara (langue des tirailleurs sénégalais), le haussa ou le swahili, ou les langues principales du Congo belge38. Beaucoup apportent d ’utiles, voire brillantes, contributions à l’eth nographie locale. La plupart sont passionnés par ces vastes responsabilités, qu’ils exercent au prix d ’une activité débordante. Pierre Ryckmans écrit en 1920, à l’issue de son séjour comme gouverneur de l’U rundi:«... j ’ai, depuis 10 mois que je suis Résident, couvert 2000 kilomètres à cheval... ; j ’ai recensé 250000 habitants pour ma part; vacciné quelques milliers de gens; tracé une centaine de kilomètres de route nouvelle à travers la brousse ; et noirci du papier à rendre un journaliste jaloux. En outre, j ’ai dirigé les labours d ’une quarantaine d ’hectares, planté 10000 arbres - Et pendant le temps où ces à-côtés me laissaient tranquille, j ’ai tranché les pala bres des chefs qui remplissaient mon bureau »39. Ce n’est là véritablement qu’une citation parmi d ’autres. Les deux termes qui pourraient résumer leur doctrine sont « humanisme et commandement ». « Mettre en lumière et éradiquer les oppressions qui sont dommageables aux pauvres et font injure au gouvernement ; déployer ces principes nationaux d ’honneur, de bonne foi, de droiture et de modestie qui devraient toujours accompagner le nom d’un Anglais, inspirer ces idées à
37. Morison (Sir Th.), « Le développement politique de l’Inde », ait. ciL, p. 190. 38. Hailey (Lord), An African Survey, p. 90-92. 39. Vanderlinden (J.), Pierre Ryckmans, p. 91.
277
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
l’individu le plus humble et faite passer le cœur du Ryot [le paysan contri buable] de l’oppression et du découragement à la joie et à la confiance, voilà les résultats que notre nation peut attendre d’une conduite prudente et avisée de notre part... », ces lignes tirées des instructions du Conseil de Calcutta, et qui remontent à 1769, sont reproduites en exetgue d ’un ouvrage de 1935 sur l’administration britannique du Soudan40. En substituant à « un Anglais » les mots désignant une autre nationalité, ce discours pourrait être revendiqué par un fonctionnaire de n ’importe laquelle des puissances coloniales. Mais ces hommes de pouvoir ont, par éducation, par vocation et par mission, le sens de l’État, et le goût de l’autorité. Par ailleurs, le caractère encore très lent des communications les dote d ’une large liberté de manœuvre par rapport à leur hiérarchie.Ce sont de petits «rois de la brousse», des «comm andants» (« mon commandant » est d ’ailleurs la formule usitée dans l’Empire français pour s’adresser à eux), « les vrais chefs de l’Empire »41. On peut considérer que, dans l’ensemble, ils effectuent leur mission avec compétence, cette mission consistant évidemment à perpétuer le système colonial. Comme il en va pour l’armée, le système serait incapable de fonctionner sans un recours massif à des fonctionnaires autochtones. Ceux-ci sont jugés indispensables à la fois pour des raisons d ’économie, par leur connaissance des langues du pays, et sans doute aussi pour leur plus grande docilité, puisque la plupart sont soumis aux contraintes du statut de l’indigénat. Ils constituent, par exemple, 80 % des fonctionnaires des Indes néerlandaises42. L’Afrique du Nord française, où la majorité des petits cadres est recrutée parmi les Européens, constitue une exception, qui vient de la situation parti culière de colonie de peuplement. S’ils fournissent évidemment la masse des petits employés, le degré auquel ils peuvent s’élever est variable. Aux Indes britanniques, l’administration fonctionne presque entièrement, et à tous les niveaux, avec des indigènes, les Européens ne pouvant exercer qu’un contrôle très lointain. En Afrique noire au contraire, les indigènes sont surtout employés à des tâches subalternes, le haut responsable européen étant bien plus présent. Il n’y a rien d ’étonnant à cela, puisqu’un District Magis trate aux Indes règne couramment sur un million d ’habitants ou davantage, alors que, en moyenne, un administrateur français d’AOF a dans sa dépen dance 130000 personnes43. Tous ces petits personnels ne sont pas exempts de reproches : leur forma tion est souvent sommaire, leur intégrité parfois discutable. Mais il faut reconnaître que, la plupart du temps, ils sont capables de donner aux rouages 40. Hamilton (ed.), The Anglo-Egyptian Sudan from within, Londres, Faber & Faber, 1935. 41. Delavignette (R.), Les vrais chefs de l’Empire, Gallimard, 1939 ; Deschamps (H.), Roi de la brousse : mémoires d’autres mondes, Berger-Levrault, 1975. 42. Kossmann (E.H.), The Low Countries, 1780-1940, Oxford, Clarendon Press, 1988, p. 669. 43. Bernard (J.A.), De ¡’Empire des Indes à la République indienne, p. 23-24. ; Delavi gnette (R.), Les vrais chefs, p. 130.
278
Le gouvernement indigène
de la vaste machine le minimum d ’impulsion. D’ailleurs, l’extension, même timide, de l’instruction permet graduellement d ’en relever le niveau en puisant dans le vivier des diplômés formés par l’enseignement local. Parmi les diverses nations coloniales, les Hollandais sont sans doute ceux qui ont fait preuve de la sollicitude la plus grande pour la formation de ces person nels : écoles d’administration, de police, de travaux publics, d’eaux et forêts, d’agronomie, sont destinées à leur donner la meilleure préparation possible dans leur spécialité44. Mais l’efficacité du système repose aussi sur l’adéqua tion d ’une forme de gouvernement à un certain type de sociétés locales, l’adaptation de l’une à l’autre reposant à la fois sur des réalités historiques et sur un certain nombre d ’ajustements imposés par le colonisateur, mais aussi acceptés, au moins momentanément, par une partie des populations, à tout le moins par leurs notables.
Une vision politique im périale Comme on l’a déjà suggéré, la spécificité de la situation des empires coloniaux est d ’appliquer des principes contraires à ceux dont se réclament les métropoles. Depuis longtemps, les peuples d ’Europe occidentale ont connu un processus qui en a fait des groupements dont les membres, à l’inté rieur d ’un même espace, et dans le cadre d ’un même État, se sont senti soli daires entre eux et différents des peuples voisins. Il faut ajouter que ce processus s’est accompagné, à partir de la Révolution française, d ’un vigou reux essor du nationalisme. Le sens du « génie de la race », de la grandeur de la patrie, du dévouement à ses lois, de l’impossibilité pour un individu ou une société de pourvoir, en-dehors du cadre de l’État-Nation, à ses besoins essentiels (sécurité, prospérité, éducation), constituent ce qu’on appellerait de nos joins une «pensée unique». La tradition impériale reprend au contraire, comme on l’a déjà souligné plus haut, une tradition qu’on pourrait appeler pluriethnique, étrangère à l’Europe occidentale, mais pratiquée par les Empires austro-hongrois, russe, et ottoman, et qui, dans une certaine mesure, reprend les aspirations des « sociétés plurielles » telles qu’elles ont pu être présentées plus haut : s’imposer, à la fois comme chef et comme aibitre, à des groupes différents et qui refusent de fusionner. Ne peut-on pas penser que cet état d ’esprit prépare mal à assumer des responsabilités impériales ? Cette remarque serait valable, sans doute, pour les Pays-Bas ou le Portugal, de peuplement depuis longtemps très homogène ; elle vaudrait aussi pour la France, dont la tradition politique, empreinte d ’un fort esprit centralisateur, tend à nier, au moins officiellement les pluralismes provinciaux au profit d’un assimilationnisme niveleur. La politique fasciste prétend, dans un tout autre état d ’esprit, mener une entre prise de même nature. En revanche, bon gré mal gré, d’autres puissances
44. Fumivall (J.S.), Netherlands India, p. 374.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
coloniales ont à gérer chez elles des questions qui, tout bien pesé, peuvent leur rendre sensible le problème de la coexistence. C’est le cas de la Belgique, avec une opposition entre les communautés flamande et wallonne qui tend à se systématiser avec l’affirmation de la division linguistique à partir de 1932, et la création de régiments flamands et wallons séparés dans l’armée. C’est surtout celui de la Grande-Bretagne, qui n ’est, à proprement parler, que l’union de quatre nations sous le sceptre de la dynastie des Windsor. Et il est vrai que la compétence reconnue des Britanniques en matière coloniale doit sans doute beaucoup à cet état de fait, encore que les échecs de la question d ’Irlande soulignent les limites de la souplesse du système. Mais, au fond, ces différences de sensibilité n’affectent pas ou peu les comportements des gouvernements. Toutes les puissances coloniales s’emploient à pratiquer cet art impérial qui consiste d ’abord, comme le remarquait le gouverneur Robert Delavignette, à « faire vivre ensemble des peuples différents ». Divisions ethniques On pourrait même aller plus loin, et dire que l’exercice du pouvoir appa raît avant tout comme une pratique de la différence, fondée sur une ethno logie empirique. Inventorier les peuples, en connaître les coutumes, les genres de vie, les hiérarchies sociales, doit permettre de les gouverner sépa rément, chacun en fonction de ses traditions, et donc de satisfaire leurs aspi rations élémentaires, en évitant de les coaliser dans un commun rejet. L’intérêt des cadres coloniaux pour le fonctionnement des sociétés sur lesquelles ils exercent leur autorité apparaît ainsi comme un des éléments de leur mission, et entraîne des liens étroits avec nombre de chercheurs. C ’est ainsi que YInstitut international pour les langues et les cultures africaines, créé en 1926 pour favoriser les recherches en ethnologie de ce continent, est présidé par Lord Lugard, dont on a déjà évoqué le rôle, assisté du Français Maurice Delafosse, également issu de l’administration coloniale, et, à partir de 1932, du Belge Pierre Ryckmans. La valeur des travaux entrepris sous leur direction est tout à la fois le fruit de leur expérience et un moyen d ’ac croître encore cette compétence. Certains gouvernements (Gold Coast, en 1920) s’attachent même les services d ’anthropologues, ou donnent à certains de leurs agents une formation en ce sens43. À partir de cette connaissance peut se développer une action dont le prin cipe a été remarquablement exposé par le général Gallieni, alors gouverneur de Madagascar, dans ses Instructions de 1898 : « s’il y a des mœurs et des coutumes à respecter, il y a aussi des haines et des rivalités qu’il faut savoir démêler à notre profit, en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les premières pour mieux vaincre les secondes »4546. Cette citation souligne 45. Hailey (Lord), An African Survey, 1956, p. 55. 46. Deschamps (H.) et Chauvet (P.), Gallieni pacificateur, écrits coloniaux de Gallieni, PUF, 1949, p. 239.
Le gouvernement indigène
combien, de la reconnaissance de différences réelles, revendiquées par les populations colonisées elles-mêmes, et qu’il est indispensable de connaître, il est facile pour les colonisateurs de passer à l’idée que la diversité assure leur autorité, en rendant difficile ou impossible tout soulèvement d ’ensemble contre eux, ou au moins en les rendant indispensables pour assurer des arbi trages. On n ’est plus loin, dès lors, d ’être tenté d ’appliquer le vieux principe romain du divide ut imperes. Il est vrai que les colonisateurs ont tendance à regrouper les possessions qu’ils contrôlent en des ensembles très hétérogènes. Le cas de l’Empire des bides, évoqué plus haut, est le plus caractéristique, mais il n’est pas le seul. L’énorme Nigeria, constitué en 1914 sous la direction du gouverneur Lugard, regroupe une dizaine d ’ethnies différentes, avec trois traditions politiques principales : au sud-ouest, les royaumes organisés dès le Xe siècle par les Yorubas; au nord, des émirats musulmans, peuplés essentiellement de Haoussas et de Fulanis ; de part et d ’autre du delta du Niger, les Ibos, peuple de la forêt, dépourvus de pouvoirs centralisés, à l’inverse des deux autres. En Indonésie, la masse de la population de Java (environ deux tiers de la popu lation en 1940 sur un quinzième de la superficie totale) se compose de Malais, presque tous musulmans, dont une forte majorité de Javanais ; dans les archipels, la variété est beaucoup plus grande (on ne recense pas moins de 250 idiomes, et les modes de vie vont du stade de la cueillette à celui de la riziculture irriguée). Au Moyen-Orient, le gouvernement britannique, en présidant, en 1920, à la création de l’Irak, donne ainsi naissance à un État partagé entre musulmans sunnites, musulmans chiites, et une forte minorité kurde. Le « Grand Liban », établi par les Français à la même époque, est à l’inverse plutôt favorable à une majorité de chrétiens, parmi lesquels prédo minent les maronites catholiques, sur les musulmans des diverses obé diences. En Asie, les grandes cités commerçantes ont toujours été, par essence, cosmopolites ; à côté des grands groupes, il existe des minorités, comme les montagnards du Haut Tonkin (Tho ou Thaï, Man et Méo), dont le nombre, quelques centaines de milliers, est faible par rapport à celui des millions d ’Annamites, mais qui méritent intérêt vu leur situation dans des zones souvent frontalières, et peu contrôlées47. Il arrive, à l’inverse, que les vicissitudes des politiques coloniales aient abouti à scinder des populations très proches: les Annamites, autrefois réunis sous le même sceptre, dépendent ainsi, respectivement, de la Cochinchine, de l’Annam et du Tonkin ; une partie des Touareg sont ratta chés à l’Algérie, une autre au Soudan français, et une partie encore au Niger ; du moins relèvent-ils tous de la même souveraineté ; ce n’est pas la situation des Ewe, séparés par la division du Togo allemand entre Togo sous mandat français et Togo sous mandat britannique, administrativement
47. Ministère de la Guerre, Manuel des troupes employées outre-mer, deuxième partie (Indochine), p. 125.
281
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
rattaché à la Gold Coast. Lors du découpage du Moyen-Orient, bien des voix s’élèvent contre la division entre Syrie, Liban et Palestine, et réclament la constitution d ’une «Syrie intégrale» regroupant en un seul État tous les Arabes de la région. Mais il faut noter que ce travail de regroupement, si discutable soit-il, n’est pas une innovation des empires coloniaux. À vrai dire, tous les États précédents qu’on pourrait dire « indigènes », ont procédé de la sorte, plaçant sous leur autorité des hommes relevant de cultures, de langues ou de reli gions différentes, le plus souvent par droit de conquête. Comment faire autrement, d ’ailleurs, alors que se côtoient souvent, sur les mêmes terroirs, des populations très hétérogènes ? Dans les pays arabes du Moyen-Orient, longtemps réunis sous la domination ottomane, musulmans et chrétiens d ’obédiences différentes, mais aussi juifs, constituent des communautés ayant un sens très fort de leur identité. Les schémas ne font que reprendre, à une échelle réduite, la formule de coexistence de minorités au sein de l’Empire défunt, schéma d ’ailleurs analogue à celui sur lequel se construit la Yougoslavie indépendante d ’après la guerre. En Afrique, la notion d ’ethnie conserve une grande partie de sa valeur, en dépit du caractère exagérément systématique par lequel trop de fonctionnaires européens opèrent la réparti tion des populations entre les différentes dénominations repérées par eux, et d’une certaine dérive vers des conceptions qui commencent à la rapprocher de la notion européenne de nation. Certes, les exemples ne manquent pas, qui montrent que la reconnaissance des ethnies s’accompagne d ’une systématisation de leurs différences au-delà de ce qu’en éprouvaient les populations dans les périodes précoloniales, tandis que des éléments réels d’unité ont tendance à être niés. Par exemple, bien que Lyautey ait écrit que la France avait trouvé au Maroc « un État et un peuple », des tendances très nettes existent dans l’administration française en faveur d ’une « politique berbère » visant, non pas seulement à préserver l’ori ginalité indéniable des populations, mais aussi à opposer un Maroc berbère à un Maroc arabe, pour le plus grand profit du protectorat Cette conception repose sur une vision de la « berbérité » très systématique, qui fait du berbère un allié potentiel de la colonisation, ce que démentira la suite de l’histoire. A une tout autre échelle, les Britanniques, à plusieurs reprises, donnent l’im pression de s’appuyer sur la méfiance de la minorité musulmane à l’égard de la majorité hindouiste en Inde, notamment en imposant en 1905 la partition du Bengale entre une province musulmane et une province hindoue, et surtout en instituant à partir de 1909 un électorat séparé pour les musulmans. Le découpage du Moyen-Orient au lendemain de la guerre, et notamment la création de la Palestine par les Britanniques et celle du Liban par les Français ont été attaqués comme une atteinte au désir des nationalistes arabes de créer une « Grande Syrie ». Plus largement, beaucoup de représentants des puis sances coloniales ont longtemps tiré, du spectacle de la diversité des popula tions des empires, l’idée que tout mouvement de masse y était impossible : c’est ainsi que Seeley écrivait en 1882, à propos des Indes : « une simple
282
Le gouvernement indigène
masse d ’individus, que n’unissent entre eux ni des sentiments ni des intérêts communs, est facilement subjuguée, parce que les individus peuvent être amenés à agir les uns contre les autres »48. Comme on vient de le voir, le danger pour la domination qui pourrait résulter de l’insurrection massive d’un territoire ne s’est d ’ailleurs pas concrétisé entre les deux guerres. Cette politique est notamment sensible dans le recrutement des armées coloniales, où les Européens jouent largement sur les clivages ethniques : par exemple, le recrutement de l’armée des Indes s’opère surtout dans les popula tions à tradition guerrière du Nord, fières de leur supériorité, mais souvent hostiles les unes aux autres, au point qu’il paraît impossible, au début des années vingt, de mettre des soldats pathans sous les ordres d ’un officier sikh49. Les troupes locales, même, sont souvent recrutées parmi des minoritaires : les Hollandais ont largement recours, en Indonésie, à des chrétiens originaires des Moluques (Amboine) ou du nord des Célèbes (Manado). En Birmanie, les Karen (moins de 10% de la population) représentent près de 38% des 4000 hommes recrutés en Birmanie en 1939, les Kachin (1 %) et les Chin (2,3 %), plus de 22 % chacun, alors que les Birmans (75 % de la population) ne représentent que 12 % des recrues ; de toute façon, l’essentiel des garnisons stationnées dans le pays est constitué d’unités indiennes50. Les Indiens comme les Sénégalais sont appelés à tenir garnison en dehors de leur pays, dans des contrées si éloignées des leurs à tout point de vue que toute connivence éven tuelle avec les autochtones est à la fois impensable et impossible. Il en va fréquemment de même du personnel des autres services colo niaux, et en premier lieu de celui de la police. Par exemple, celle des posses sions britanniques d ’Asie est souvent composée d ’anciens soldats sikhs, solides gaillards dont seule la force surhumaine du jeune reporter Tintin (relire le Lotus Bleu) est capable de venir à bout. Celle de Palestine compte dans ses rangs non seulement des Juifs et des Arabes chrétiens ou musul mans, mais aussi des Druzes, des Soudanais et des Circassiens51. Pour former leurs unités auxiliaires d ’Irak (les Levies), les Anglais ont largement recruté parmi les chrétiens assyriens. Dans l'administration, si une partie des fonctionnaires se recrute sur place, beaucoup viennent d ’autres possessions. Ainsi, dans les Straits Settlements, en 1931, sur 5000 fonctionnaires, on compte 9% d ’Européens, 45% de Malais, 33% d ’indiens, et 10% de Chinois52. Ce n’est point là un cas isolé : en 1929, près de la moitié des fonc tionnaires du mandat syrien sont des Arabes chrétiens ; les Hollandais ont volontiers recours aux minorités chrétiennes dans l’administration des Indes. Des Algériens sont appelés à fournir une bonne partie du petit personnel du protectorat du Maroc à ses débuts. Les Pondichériens (natifs des Cinq
48. Seeley (J.R.), L’expansion, p. 276. 49.0 ’Moore Creagh, (général), Indian studies, p. 274. 50. Furnivall (J.S.), Colonial Policy, p. 184. 51. Wasserstein, The British in Palestine, p. 168. 52. The Colonial Problem, p. 422.
283
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
comptoirs) sont très présents dans les services administratifs (postes, douanes, justice), ou le personnel des sociétés privées de l’Indochine fran çaise. Les originaires de Sierra Leone peuplent les bureaux du Nigeria. Mais la diversité ethnique, religieuse ou linguistique n’est pas le seul facteur de division. Un autre facteur, social, celui-là, entre en considération, qui est la capacité des puissances coloniales de s’assurer la coopération des classes dirigeantes traditionnelles, et de s’appuyer ainsi sur un réseau de « chefs indigènes ». Clivages sociaux Il convient de revenir un moment sur les conditions dans lesquelles se sont opérées les conquêtes. Les colonisateurs n’ont eu à affronter, le plus souvent, que de vieux États appauvris, aux institutions peu efficaces, comme l’Empire moghol des Indes, ou comme le Maroc, ou des États en ascension peut-être, mais encore insuffisamment organisés, comme ceux fondés par les Zoulous en Afrique du Sud, ou par Samori en Afrique occidentale. Parfois même, ces États n’existaient pas à proprement parler, comme dans certaines régions de l’Afrique équatoriale. Des troupes peu nombreuses, mais bien armées, bien organisées, correctement ravitaillées, et très mobiles, ont pu suffire à écraser les contingents indigènes, incapables, faute de ressources, de mener une guerre longue, et s’assurer ainsi l’effectivité du pouvoir. Il est apparu cependant très vite aux conquérants que, sauf cas très excep tionnels, ils ne pouvaient administrer directement aucun territoire. Cela aurait impliqué, en effet, d’implanter, à tous les niveaux des groupements sociaux, un personnel européen. Les charges financières imposées par l’em ploi de celui-ci paraissaient prohibitives étant donné les ressources de la fiscalité locale ; et d ’autre part, il n’était pas sûr que l'omniprésence de ces petits employés disciplinés, mais portés au formalisme plus qu’à l’apprécia tion de la spécificité des situations, aurait été bien acceptée des indigènes. H paraissait bien préférable de s’assurer, en les faisant contrôler par des fonc tionnaires européens, de l’appui des notables locaux, dont les familles étaient le plus souvent détentrices du pouvoir avant l’occupation coloniale. L’avantage pour ces derniers serait de trouver, dans cette collaboration, la garantie de leur position sociale et de leur patrimoine. Cette façon de faire est désignée généralement sous le nom « d ’administration indirecte» ou Indirect Rule. Le régime dit des « contrats courts », sous lequel la plupart des principautés indigènes des Territoires extérieurs des Indes néerlandaises sont placées, depuis le début du siècle, mérite d ’être rappelé, car il résume en trois points la quintessence de ce qui est demandé aux chefs dans tous les pays coloniaux. Ils doivent reconnaître la domination de la puissance colo niale, ne pas entrer en relations avec des puissances étrangères, et se sou mettre à toutes les demandes de l’administration53. S3. Fumivall (J.S.), Netherlands India, p. 237.
Le gouvernement indigène
n semble qu’aucune puissance coloniale ne puisse revendiquer la pater nité de cette doctrine. Certes, les Britanniques occupent, dans son applica tion, mais aussi dans sa formulation, une place particulière. Lugard symbo lise, entre les deux guerres, non seulement la théorie du double mandat, mais aussi celle de Y Indirect Rule. Les méthodes qu’il a préconisées durant son gouvernement en Nigeria du Nord sont systématiquement appliquées par ses disciples : notamment Donald Cameron au Tanganiyka (1922), et John Maffey au Soudan (1926). Elles intéressent aussi nombre d ’administrateurs français, par exemple Félix Éboué. Mais il existe aussi une doctrine française en la matière. Bugeaud écrivait déjà, en 1844, que « la bonne politique exigera peut-être toujours que, dans les fonctions secondaires, nous laissions commander les Arabes par des Arabes, en laissant la haute direction aux commandants français... »54. Sous le nom de « politique des races », formule due au gouverneur général de l’AOF William Merlaud-Ponty, une doctrine analogue a été appliquée dans les colonies françaises d ’Afrique depuis le début du XXe siècle. De même, il n’a jamais été question pour les Hollandais de se passer du concours des notables locaux. Snouck Hurgronje déclarait en 1908 que les peuples orientaux n ’étaient pas différents des Irlandais, des Finlandais ou des Polonais ; ils préféraient être gouvernés par des gens de chez eux, avec leurs défauts, que par des étrangers. Et pour S. De Graaf, ministre des colonies néerlandaises de 1919 à 1925, «une poignée d’Euro péens ne gouverne pas trente millions d ’indigènes avec des subordonnés purement décoratifs ou dépourvus d ’efficacité »5S56. Vu sous un autre angle, ce respect du commandement indigène est l’exacte contrepartie du principe juridique qui consiste, comme on l’a vu plus haut, à respecter les coutumes et traditions locales. Entre les deux guerres, l’accent est mis sur les potentialités que ce système ouvre aux perspectives de progrès. De préférence à un changement brutal, imposé de ¡’extérieur, Ylndirect Rule doit conduire à une transformation lente, qui permette à l’indigène, comme disait Lyautey, d’évoluer « dans sa norme », sous la protection rassurante de ses cadres sociaux traditionnels. On peut y voir une application de la doctrine du double mandat, dans la mesure où ce système associe les indigènes au gouvernement du pays, et contribue à les former à prendre eux-mêmes les affaires en main. Ces considérations reçoi vent l’approbation d ’autorités scientifiques. En 1929, le célèbre anthropo logue Malinowski y voit tout à la fois le moyen de développer la vie écono mique, de permettre un meilleur exercice de la justice, et d ’améliorer l’éducation, en même temps que de susciter l’épanouissement d ’un art, d ’une culture, d ’une religion authentiquement locaux36. On se défend ainsi que le principe du quieta non movere, que les Britanniques traduisent par to let well alone, entraine une vision exagérément conservatrice de la société. 54.Fiémeaux (J.), Les Bureaux arabes dans l ’Algérie de la conquête, Denoël, 1993, p.290. S3. Fumivall (J.S.), Netherlands India, p. 268. 56. Simey (T.S.), « Social Advance in Non-Autonomous Territories », art. cit. p. 212.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Quelle est la nature des notables choisis ? On a vu plus haut que la popu lation des pays colonisés étaient essentiellement rurale. La structure de base en est la collectivité villageoise, peu portée à dépasser le cadre de sa vision régionale, souvent très méfiante à l’égard des collectivités voisines, guère plus capable de s’opposer aux nouveaux maîtres. Cette communauté, c’est par exemple le douar d ’Afrique du Nord, la dessa d’Indonésie, avec ses cultes particuliers (culte des ancêtres et des génies du sol, rites d ’initiation, mythes fondateurs), son espace bien défini, même en l’absence de limites linéaires à l’occidentale, qui cimentent la collectivité du groupe. Les rela tions, en l’absence de moyens de transport faciles, sont le plus souvent réduites aux voisins. « Quand vous voyagez en Algérie, écrit une journaliste américaine en 1939, les diverses parties du territoire vous semblent autant de planètes différentes. Quelques heures de car et vous voilà dans un autre monde »S7. Après la conquête, les Européens ne peuvent faire autrement que de reconnaître ces communautés, en établissant des contacts avec leurs petits notables traditionnels, chefs des familles les plus importantes, dont l’autorité se fonde sur une certaine assise foncière, mais aussi une expérience reconnue, et un accès privilégié aux rites. De tout temps, ces notables, outre la direction des affaires communes, ont représenté leur collectivité auprès des collectivités voisines et ont servi d ’in termédiaires obligés avec le pouvoir central, quand il y en a un, jouant tout à la fois le rôle de maire, de juge de paix, de collecteur d’impôts, et, si néces saire, de chef de guerre. Il suffit aux colonisateurs de reprendre ce dispositif en le systématisant, et parfois en conservant les termes traditionnels. On parle ainsi de cheikh en Afrique du Nord, de ly truong en Annam, de mekhum au Cambodge ; en Afrique noire, en revanche, les Français usent du nom de « chef de terre », qui insiste sur l’assise paysanne de ce commande ment. À partir de ces cellules de base est maintenue ou édifiée une pyramide de circonscriptions emboîtées les unes dans les autres, et dont la gestion est également confiée à des chefs indigènes. La différence majeure réside dans l'importance des territoires et des populations laissés à ces chefs, et c’est peut-être le domaine dans lequel on pourrait noter la plus nette différence entre l’esprit des Britanniques, d'une part, et celui des Français, des Hollandais et des Portugais d ’autre part. Dans l’ensemble, les Britanniques acceptent de laisser subsister des chefs importants, qui régnent sur de vastes territoires et des populations nom breuses. Cette façon de faire ne se limite pas au cas des grands Maharajas des Indes britanniques, dont certains, on l’a vu, gouvernent des États d ’une dizaine de millions d ’habitants. Ainsi, vers 1937, l'ém ir de Kano, en Nigeria du Nord, règne sur un pays vaste comme la Belgique, et peuplé de plus de deux millions d’habitants. Lui et ses ministres ont de véritables pouvoirs en matière de justice, de police et de finances, comme le souligne une revue
57. Monroe (E.), Les enjeux politiques en Méditerranée, p. 107.
Le gouvernement indigène
coloniale française38. On pourrait lui comparer le roi (kabaka) du Bouganda en Ouganda. A Sarawak (500 000 habitants), on a la curieuse situation d ’un rajah anglais, protégé de l’Angleterre, Charles Vyner Brooke, petit-neveu de James Brooke, qui avait obtenu la principauté de son ancien possesseur, le sultan de Brunei, en 1841, curieuse situation qui ne prendra fin qu’en 1946. Ce choix repose, pour Fumivall, sur une tradition particulière à la GrandeBretagne, qui est « de maintenir la loi et l’ordre, et ne pas intervenir au-delà plus que nécessaire »5859. Selon lui, le Civil Servant britannique est d ’abord un magistrat qui s’efforce de faire respecter la loi, et dont les pouvoirs de police sont limités à la prévention ou à la recherche de la délinquance ou du crime, ce qui laisse de larges attributions aux chefs indigènes. Les Français au contraire morcellent généralement les grands commande ments, pour aboutir à des chefferies beaucoup plus réduites : en Afrique noire, on ne dépasse guère le niveau du canton, groupement de plusieurs villages ; en Afrique du Nord, la cheville ouvrière du système est le caïd, qui a sous sa responsabilité plusieurs douars. Au niveau supérieur, les responsa bilités passent, sauf de rares exceptions, aux autorités françaises. Dans l’en semble, la tendance est à « fonctionnariser » ces chefs, considérés, non pas comme des notables, responsables des collectivités qu’ils représentent autant qu’ils les dirigent, mais comme de simples agents d ’exécution des ordres en tout genre, notamment en matière de fiscalité et de prestations diverses. Lors même que subsistent des États centraux anciens et prestigieux (Maroc, Tunisie, Annam, Cambodge), l’administration de contrôle les réduit à ne faire que de la figuration. Nul plus que Lyautey ne s’est fait l’accusateur de ces pratiques, notamment dans une célèbre circulaire de 1920, dans laquelle il écrit: «nous avons l’administration directe dans la peau». Mais, de manière paradoxale, cet homme passionné de commandement a été large ment responsable, au Maroc du moins, des errements qu’il dénonçait. Il faudra la conjonction de l’action des jeunes nationalistes et de l’intelligence politique du jeune Mohammed Ben Youssef, futur Mohammed V, désigné par le choix du résident Steeg en 1927, de préférence à deux frères plus âgés, pour maintenir à la dynastie alaouite un prestige qui lui permettra de survivre à l’indépendance. L’empereur d’Annam Bao Daï, appelé à régner en 1932, après dix ans d ’études en France, et très vite découragé par les autorités coloniales de prendre toute initiative personnelle, aura, on le sait, une fortune toute contraire. Le système hollandais laisse subsister des chefs indigènes fort importants, comme les soixante-seize Régents (bupatis) de Java, représentants des familles de l’aristocratie dite priyayi, et placés au-dessus des chefs de districts ou de villages. Se succédant héréditairement, ils ne peuvent être
58. Labouret (H.), « La politique indigène en Afrique tropicale », Bulletin du Comité de l’Afriquefrançaise, 1937, p. 203-207. 59. Fumivall (J.S.), Netherlands India, p. 291.
287
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
entendus ou poursuivis en justice sans l’accord du gouverneur général60. Un certain nombre d ’entre eux portent d ’ailleurs l’ancien titre de sultan. Malgré tout, la présence hollandaise est très pesante. À l’opposé de l’administrateur britannique, l’administrateur hollandais a tendance à se mêler de to u t Fumivall, pour opposer les deux méthodes, évoque l’apologue des deux «B abous»: le fonctionnaire anglais est un baboo, c’est-à-dire un demiinstruit indien, rond-de-cuir et prétentieux ; le fonctionnaire hollandais est une baboe, c’est-à-dire aux Indes néerlandaises une bonne d ’enfants. Dans cette colonie, une infinité de règlements enserre les indigènes, et leur indique jusqu’à la manière dont ils doivent planter leur riz. C ’est que, selon lui, le Civil Servant hollandais a pour première mission, non pas de faire respecter la loi, mais de faire appliquer la politique du gouvernement, selon une tradi tion qu’il juge venir en ligne directe du droit romain61. En cela, les Hollandais ne seraient-ils pas plus proches des Français ? Selon GeorgesHenri Bousquet, qui parle même de « tyrannie administrative » à propos des méthodes néerlandaises, l’administration française en Afrique du Nord est « intermédiaire entre celle de la Grande-Bretagne et celle de la Hollande, mais certainement plus près du libéralisme anglais », et on ne saurait imposer aux paysans kabyles les dispositions tatillonnes en vigueur dans les posses sions bataves62. La question mériterait d’être approfondie, mais on peut souligner que Bousquet, spécialiste réputé de droit coranique, mérite d ’être pris en considération. Les dispositions prises par les autres puissances coloniales paraissent peu différentes. Seul, le gouvernement fasciste parait résolument et doctrinairement hostile aux commandements indigènes. Il faut, déclare Mussolini aux dirigeants de la colonie éthiopienne, gouverner non pas, avec les chefs ou contre les chefs, mais sans eux. Mais re p lic a tio n de ce principe vise surtout les anciens grands chefs locaux, les Ras, privés de l’essentiel de leurs pouvoirs, et dont la plus grande partie est exilée en Italie ou mise en rési dence surveillée. Pour tenir le pays, il est indispensable de compter sur un réseau de petits chefs, les chefs de districts. L’administration portugaise s’ap puie, de même, sur un réseau de petits chefs, les regedores ou reguíos. La seule exception marquante est, en Angola, celle des rois du Kongo, repré sentée entre les deux guerres par Pedro VII (1923-1953), héritier d ’une longue lignée de souverains remontant au XIVe siècle, mais dont le rôle est très réduit. Les relations entretenues entre les chefs et les autorités européennes ne sont pas simples, puisque les chefs sont à la fois les représentants des collec tivités indigènes et des agents du pouvoir colonial. Certes, la conscience
60. Meijer (D.H.), « Dutch Colonial Policy », Principles and Methods of Colonial Admi nistration, p. 65. 61. Fumivall (J.S.), Netherlands India, p. 261. 62. Bousquet (G.-H.), La politique musulmane, p. 88-91.
288
Le gouvernement indigène
d'un rapport de force désavantageux n’est jamais totalement absente. Les chefs, même les plus prestigieux, descendants des familles les plus illustres, sont toujours sous le coup d ’une possible déposition. Mais le plus souvent, la pression peut se contenter d'être beaucoup plus discrète ; c’est ce que les Hollandais appellent zachte dwang, traduisant l’expression indigène prentah abus, qui pourrait se comprendre aussi par «contrainte déguisée»63. Les autorités coloniales, dispensatrices de passe-droits, d ’évaluations bienveil lantes dans l’estimation des fortunes, et donc des impôts, des places dans l’administration, des licences commerciales, de l'appréciation des délits ou des amendes, au bénéfice des chefs ou des fonctionnaires indigènes n’ont guère besoin de textes pour obtenir des corvées, des produits frais, pour ne pas parler de services plus intimes. En général, l'attitude des chefs donne satisafction. Beaux et dignes, dans leur apparat de grands seigneurs et leurs habits de cour, les grands chefs savent admirablement flatter la vanité de leurs hôtes, en partageant avec eux, selon les règles d ’une vieille courtoisie, la connivence des maîtres envers le peuple, connivences acquises parfois sur les bancs des mêmes établissements d’enseignement, et prolongée dans la même assiduité, délicatement ignorée par une presse déjà respectueuse de la vie dite privée, des nuits des grandes capitales d ’Europe. Par leur profonde connaissance du pays, leur maîtrise d’un réseau étendu de relations, d ’alliances familiales ou matrimoniales et de clientèles, leur fortune bien souvent, ils sont d ’ailleurs loin d ’être dépourvus d’influence sur l’administration. Les plus humbles, simples chefs de villages, n’ont évidemment pas les mêmes ressources, mais leurs bonnes dispositions ne sont pas moins essentielles que celles des premiers pour assurer la tran quillité et le bon ordre. Bien des critiques, de source indigène, mais aussi européenne, ont tendance, au contraire, à dénoncer les abus des chefs, et l’indulgence que ceux-ci rencontrent auprès d'une administration portée à faire prévaloir l'ordre sur la justice. Le pacha de Marrakech apparaît comme le symbole de ces divergences d’interprétation : grand guerrier, politique avisé, traitant en grand seigneur ses hôtes européens, il fait régner dans les territoires à lui confiés une discipline de fer, chèrement payée par des administrés privés de tout recours. Certains maharadjahs suscitent aussi le scandale par leurs dépenses excessives, leurs fantaisies sexuelles, ou par des comportements cruels ou sadiques. L’opinion britannique est ainsi très choquée d’apprendre que le maharadjah d’Alwar, Jey Singh Kachwaha, n’hésite pas à punir les poneys de polo dont les performances l’ont mécontenté en les faisant arroser d’essence et brûler vifs64. D’autres critiquent le fait que nombre de petits chefs n’aient qu’une apparence de pouvoir qui en fait, selon l’expression de
63. Bousquet, La politique musulmane, p. 92. 64. Copland (I.), The Princes of India in the Endgame of Empire, 1917-1947, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 4-5.
289
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Robert Delavignette, non des chefs de village, mais des « chefs de paille », simples prête-noms de la colonisation65. Mais ces appréciations négatives noircissent sans doute exagérément le tableau. Les notables reconnus par les Européens ne méritent ni plus ni moins d ’éloges que la majorité des hommes de pouvoir en place sous n’im porte quelle latitude, dès lors que leur autorité repose sur une position acquise selon les critères reconnus par l’ensemble de la société, et non sur une usurpation violente. « On ne peut être qu’impressionné par la personna lité de nombre d ’Émirs et de chefs, et de la dignité et du sens de l’ordre dont est empreinte leur conduite des affaires », est-il dit à propos des notables nigérians66. Bien loin d’être tous des obscurantistes et des rétrogrades, certains apparaissent fort ouverts au progrès, comme le maharadjah de Travancore, qui a établi un système de représentation électif (avec droit de vote des femmes), et consacre le cinquième du budget de ses États à l’éduca tion, ce qui aboutit à des taux d ’alphabétisations plus élevés que la moyenne indienne6768. La plupart ne sont pas des autocrates, mais gouvernent en fonc tion des coutumes locales, assistés par d ’autres notables du pays, souvent organisés en conseils. Celui de Lukiko, au Bouganda, a souvent été décrit comme un « Parlement africain »6S. Pour beaucoup, il importe plus de relever la condition des chefs les plus modestes que de les supprimer, ou de les remplacer par des fonctionnaires. Il faut aussi donner plus de poids aux conseils de villages, créés un peu partout, et susceptibles d ’initier les popula tions à une véritable vie municipale. Telles sont notamment les idées que le gouverneur Bourdillon en Gold Coast, ou le gouverneur Éboué en AEF tenteront de populariser au cours de la guerre.
L’opinion indigène La discipline et le loyalisme Quoiqu’il en soit, cette manière de contrôler le pays paraît assez large ment fonctionner. C’est que, outre la force dont elle dispose, comme on l’a suffisamment souligné, elle coïncide plus ou moins avec les structures sociales et les institutions locales. Mais un autre élément d’explication doit être également avancé, qui, semble-t-il, a échappé à l’attention de beaucoup d ’observateurs : sans qu’ils en aient forcément conscience, la puissance colo niale peut apparaître aux populations comme, dans une certaine mesure, tuté laire. Les membres des collectivités rurales ne sont pas indifférents à ce que peuvent leur apporter les Européens : justice coutumière, aménagement des communications, sécurité. Le poids qui s’exerce sur eux est moins représenté
65. Delavignette (R.), Les vrais chefs, p. 124. 66. Hailey (Lord), An African Survey, 1957, p. 456. 67. O’Malley, Modem India, p. 606. 68. Barker (E.), Ideas and ideals, p. 149.
290
Le gouvernement indigène
par l’administration européenne que par ces chefs qui ont pour eux la tradi tion, la capacité de jouer double jeu, le monopole des relations. C ’est souvent contre ces derniers que sont dirigées les colères des paysans. Les armées européennes elles-mêmes, une fois la conquête finie, ne sont pas purement oppressives. On leur doit, même si c ’est à un prix très lourd, la suppression de la traite des esclaves, celle du brigandage, ou de la piraterie. Leur présence empêche des armées d ’invasion, toujours plus exigeantes, de venir piller les récoltes des paysans, et prendre leurs femmes, selon des exemples dont la mémoire de tous les pays a conservés, y compris en Europe. Si dure qu’elle puisse paraître, la Pax britannica, la Pax gallica ou la Pax neerlandica est, du moins, une paix. Cette situation induit-elle, de la part des populations, des sentiments autres qu’une certaine crainte révérencieuse? Il est bien difficile de répondre, faute de consultation des populations de la part du pouvoir colo nial, tradition que ses successeurs n’auront d ’ailleurs que trop tendance à reprendre. Un poncif des discours officiels consiste à célébrer l’attachement des populations. Les Français sont peut-être ceux qui ont le plus tenté de jouer sur cette corde, ce qui les a fait accuser d ’hypocrisie, alors qu’il n’y avait pour eux, dans cette façon de s’exprimer, qu’une application méca nique du discours unanimiste des républicains radicaux. Mais, pour qui regarde les textes de près, le patriotisme dont se félicitent chefs d ’États et ministres est, en général, celui des populations européennes, appelées à continuer l’œuvre coloniale. À l’égard des populations indigènes, ils évoquent plutôt le loyalisme. Pour Georges Hardy, la notion de « miracle de la tendresse française », qui aurait en quelque sorte « apprivoisé » les popula tions indigènes des colonies, est pour le moins simpliste et peu vérifiable69. Pour sa part, Lord Linlithgow, alors vice-roi des Indes, écrit en 1939 : « L’Inde et la Birmanie ne sont pas associées par nature à l’Empire, auquel elles sont étrangères par la race, l’histoire et la religion, et pour lequel ni l’une ni l’autre n’ont aucune affection naturelle ; l’une et l’autre sont dans l’Empire parce que ce sont des pays conquis qu’on y a fait entrer par force et qui par la suite se sont accommodés de notre protection »70. Solidarités anciennes et nouvelles Au fond, ces masses restent radicalement étrangères au colonisateur, qui ne les voit le plus souvent qu’à travers l’écran des chefs. Les solidarités qui les lient entre elles, sont, en revanche, plus solides qu’il ne le croit, en parti culier dans les vieux États, soumis mais non disparus, mais aussi là où une religion peut accroître le sentiment de confraternité. Trop de Britanniques, par exemple, impressionnés par la diversité de l’Inde, ont tendance à négliger l’unité que confère le sentiment d’histoire commune, parachevée
69. Hardy (G.), Les Éléments de Vhistoire coloniale. Renaissance du Livre, 1921, p. 106. 70. Cité par James (L.), The Rise and Fall of the British Empire, p. 425.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
par une colonisation britannique qui a encore contribué à rapprocher les populations. Les Hollandais n ’ont guère de mal à souligner la diversité des Indes néerlandaises ; pourtant, de bons observateurs n’hésitent pas à montrer, d’une part, que ce n ’est pas par hasard que ces territoires coïncident exacte ment avec la sphère d ’influence du royaume hindouiste de Madjapahit, lors de sa plus grande extension au XIVe siècle71. Il est certain que le caractère récent, voire contemporain des luttes contre l’occupation ne peut que nourrir les ressentiments. Les héros de la résistance à l’occupation ne sont pas oubliés, qu’il s’agisse de souverains comme Abd el-Kader en Algérie, vaincu en 1847, Samori au Soudan, fait prisonnier en 1898, ou comme l’empereur d’Annam Ham Nghi, déporté en Algérie en 1889 après avoir animé la «révolte dite «des lettrés», ou de plus humbles combattants, dont les descendants entretiennent pieusement la mémoire. Mais des souvenirs plus anciens nourrissent la personnalité nationale:au Maroc, écrit Robert Montagne, « partout, dans les contes et récits populaires, se trouve la légende du Sultan Noir, le souvenir de la puissance de Moulay Ismaïl, contemporain de Louis XIV, dont la vie se passa en chevauchées pour maintenir les armes à la main les tribus dans l’obéissance »72. On aurait tort, d ’autre part, en se fondant sur ce qui a été dit plus haut, de croire que les colonisateurs s’en soient toujours tenus purement et simple ment à la règle « diviser pour régner». Tout d ’abord, ils sont conscients des risques qu’il y aurait pour la tranquillité des colonies à encourager des discordes qui pourraient se terminer en explosions de violence. Par ailleurs, semblant avoir entendu le mot attribué à Catherine de Médicis, un certain nombre de responsables coloniaux tiennent autant à recoudre qu’ils ont tenu à couper. « L’idéal du gouvernement ne consiste pas seulement à tenir la balance égale entre une série d’intérêts, indigènes ou non, mais à travailler pour le bien de la collectivité dans son ensemble. En fait, le développement du sentiment de la collectivité est une tâche essentielle. »73 Ce principe, exprimé en 1925 par une commission britannique traitant des problèmes de l’Afrique orientale, pourrait être étendu aux autres colonies. Il consiste, bien évidemment, à amener les indigènes à se sentir solidaires de l’ensemble de l’Empire, et, en cela, il vise à consolider la domination. Mais il vise aussi à créer une solidarité entre les groupes constituant les nouvelles constructions politiques. En même temps, l’imposition des cadres coloniaux tend aussi à conférer aux habitants d’une même entité le sens d ’une solidarité de destin à l’inté rieur d ’un même ensemble, dont le colonisateur a défini les contours, en lui imposant des frontières, et parfois un nom, un meilleur réseau de communi cations, un responsable unique (le gouverneur), un même budget. Même forcée, même soumise aux exigences du pouvoir colonial (et peut-être pour 71. Bousquet (G.-H.), La politique musulmane, p. 67. 72. Montagne (R.), Révolution au Maroc, France-Empire, 1953, p. 376. 73. The British Empire, a Report, p. 143.
Le gouvernement indigène
cela), cette pratique n’est pas dépourvue de conséquence. Le cas de l'A lgérie est éloquent : si ce pays n ’a pas été une « création française », il est certain que c’est la conquête qui en a achevé, au moins formellement, l’unité ; d ’une manière qui n’est qu’apparemment paradoxale, les gouvernants français de l ’Algérie n ’ont pas été les derniers à prêcher la personnalité du pays, et sa solidarité avec ses voisins d’Afrique du Nord. Mais on pourrait en dire autant de l’Empire des Indes, dont l’intégrité (à leur profit) fut toujours le souci des Anglais. Il faudrait souligner aussi combien la recherche archéolo gique et historique menée par les Européens contribue à donner aux peuples le sens de la grandeur de leur passé. C ’est notamment le cas en Asie ou en Égypte. Ainsi les populations coloniales prennent une conscience croissante et nouvelle de leur solidarité. En Afrique, souvent considérée comme en retard de ce point de vue, Delavignette note l’émergence, encore timide, « d ’un nouveau monde africain où la race est dépassée, où les indigènes de toutes les races animent et font craquer les cadres coloniaux » : il tire cette conclu sion du fait que, dans un recensement du cercle soudanais de BoboDioulasso, une personne s’est intitulée «Sénégalais» et non, comme on aurait pu s’y attendre, Sérère, Ouolof ou Lebou74. Le phénomène est particu lièrement sensible dans les villes, dans la mesure où elles rapprochent les indigènes issus d ’ethnies différentes dans une communauté de vie et de problèmes. Évoquant sa vie vers 1941, Nelson Mandela rappelle : «M algré son aspect misérable, le township d ’Alexandra était aussi une sorte de paradis. C ’était un des rares endroits du pays où les Africains pouvaient devenir propriétaires et diriger leurs propres affaires, où les gens n ’avaient pas de courbettes à faire devant la tyrannie des autorités municipales blan ches, une terre promise urbaine, la preuve qu’une partie de notre peuple avait rompu les liens avec des régions rurales pour devenir des habitants perma nents de la ville... La vie urbaine tendait à estomper les distinctions tribales et ethniques, et au lieu d’être des Xhosas, des Sothos, des Zoulous ou des Shangaans, nous étions des Alexandriens »75. Une plus grande familiarité avec les Européens aide enfin les colonisés à acquérir une meilleure perception des discriminations du système colonial, et surtout des droits que celui-ci, en dépit de ces discriminations leur confère, ce qui les amène à se montrer moins « dociles » que par le passé. Ce n’est pas seulement le cas des intellectuels. Pierre Ryckmans observe qu’un ancien boy, un ancien soldat, un ancien travailleur rentrés dans leur chefferie, mais aussi les chrétiens sont la terreur des chefs indigènes. Plus familiers avec les Européens et avec les pratiques européennes, ils n’hésitent pas en particulier à s’adresser au fonctionnaire, à l’officier ou au missionnaire quand ils se sentent lésés76. Commentant un article publié en ce sens par une revue 74. Delavignette (R.), Les vrais chefs, p. %. 75. Mandela (N.), Un long chemin vers la liberté, p. 95. 76. Vanderlinden (J.), Pierre Ryckmans, p. 101.
293
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
britannique, l’administrateur français Henri Labouret note que « c’est proba blement une utopie de chercher à reconstituer, avec des éléments anciens, datant de l’âge du fer, les pièces d ’une machinerie moderne appelée à fonc tionner dans le monde d’aujourd’hui *77. Tout ceci favorise évidemment le développement de courants nationa listes, dont il ne faut pas s’empresser d ’exagérer l’importance, en anticipant abusivement sur une évolution future alors peu discernable, mais dont l’ap parition et le développement constituent au moins une série de symptômes de remise en cause.
77. Labouret (H.), « Protectorat ou administration directe», Bulletin du Comité de VAfriquefrançaise, 1934, p. 289.
Chapitre 10
N ationalism es et réform es
La m ontée des nationalism es L'esprit et la form e des revendications C’est avant tout dans le domaine politique que vont agir les hommes dési reux de travailler à ce qui ne peut plus être que la libération de leur pays. Proclamer l’identité nationale, c’est opposer à la puissance colonisatrice une figure familière, digne de reconnaissance, et ainsi la mettre au défi d ’appli quer ses propres valeurs ou de se renier ; c’est unifier l’ensemble des popula tions dans un même combat, au-delà des particularismes et des divergences de classes ; c’est enfin assumer la revendication de la modernité, l’idée géné ralement exprimée étant que la colonisation, faite au nom du progrès, freine celui-ci, ou du moins empêche la population de profiter de ses fruits, en arbi trant en fonction d’intérêts extérieurs à ceux de la nation. C’est sans doute à cause de cette priorité de l’idée nationale qu’on utilise, pour désigner les mouvements qui visent à l’émancipation, le terme de nationalisme plutôt que celui d ’indépendantisme, qui ne remplacera le précédant que dans les années 1980, l’expression de nationalisme ayant achevé d’être discréditée comme contraire aux grands principes de fraternité humaine défendus avec cons tance, sinon toujours avec succès, par les oiganisations internationales. Les nationalismes se sont développés dès avant la guerre. Il est certain que, sans être déterminante, la victoire des Japonais en 1905 dans leur conflit avec la Russie, a été un puissant stimulant en Asie et au-delà. Dès 1906 se constitue en Birmanie le YBMA (Young Men's Buddhist Association) ; c’est dès 1908 que le Parti du Congrès indien, fondé en 1885, mais jusque-là plutôt organe de coopération des notables avec les autorités britanniques, exige le Home Rule (traduit par le terme indien swaraj) ; en 1909 que s’orga nise aux Indes néerlandaises le Sarikat Islam ; à la même époque, de jeunes lettrés vietnamiens réclament des réformes ; certains s’exilent à Canton, où ils côtoient les nationalistes chinois partisans de Sun Yat Sen, fondateur du Kuomintang. La guerre a soulevé aussi l’intérêt dans le monde turc et arabe. La Révolution des Jeunes Tùrcs de 1908, qui se présente d ’abord comme un mouvement de rénovation, dirigé par des jeunes officiers et des intellectuels, doit faire de la Turquie, selon certains de ceux-ci, le Japon du Moyen-Orient.
295
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Cette action inspire nombre de revendications dans le monde arabe, renfor çant le nationalisme égyptien, qui réclame la fin de l’occupation britannique, et encourageant les revendications réformistes des Jeunes Algériens et Jeunes Tunisiens. Jusqu’à l'Afrique du Sud où en 1912 apparaît YAfrican National Congress (ANC), émanation des élites noires. En 1914, pourtant, les puissances coloniales paraissent assez fortes pour maîtriser l’avenir. Mais les bouleversements qu’a entraînés la guerre mondiale, les efforts demandés aux populations, les difficultés économiques, mais aussi l’enrichissement de certains groupes sociaux indigènes portés à demander plus de droits ont suscité des mécontentements que les mouve ments nationalistes peuvent grouper en de larges mobilisations. Aux Indes, le Congrès relance son mouvement de revendication à partir de la fin de 1916, sous l’impulsion de Gandhi, de retour d ’Afrique du Sud. En Égypte, au sein de formidables manifestations pour l’indépendance, on voit s’imposer le parti Wafd et son leader. Tandis que les jeunes Tunisiens fondent le parti Destour, en Algérie l’émir Khaled, petit-fils d ’Abd el-Kader et officier fran çais, adresse au président américain Wilson un appel en faveur de l’indépen dance. Au Moyen-Orient, les espoirs mis dans un état arabe, imprudemment promis par les Alliés, sont déçus par les traités par lesquels Anglais et Français se partagent le pays. Certes, l’ordre paraît rétabli dans les années 20. Mais la volonté d ’émancipation nationale s’exprime partout et ne cessera plus de se faire entendre. Sans doute ces années sont-elles marquées par le rapprochement entre les masses et les élites, ou plus exactement la découverte des masses par les élites. Les leaders des grands partis nationalistes, issus le plus souvent de familles riches ou aisées, ressentent l’ivresse du contact avec le peuple. Nehru, qui parcourt en 1921 les campagnes de l’Inde, raconte : « J’éprouvais le frisson du sentiment de masse, le pouvoir d ’influencer les masses. Je commençais à comprendre un peu la psychologie de la foule, la différence entre les populations urbaines et rurales, et je me sentais chez moi dans la poussière et l’inconfort, la presse et la bousculade des vastes rassemble ments... Et il ajoute un peu plus loin : « ... ils étaient là ces gens, levant des yeux brillants, pleins d ’affection, avec des générations de pauvreté et de souffrance derrière eux, offrant malgré tout leur gratitude et leur amour, et ne demandant pas grand-chose en retour, si ce n’est un peu d ’amitié et de sympathie » . Il n ’est évidemment pas le seul à faire cette expérience. De véritables tribuns populaires se révèlent, sur le modèle de Zaghloul en Égypte, dont le mérite essentiel est de savoir s’adresser, en leur langue, à leurs compatriotes, pour leur faire prendre conscience d ’une idée simple qui est, pour eux, une idée neuve : ce ne sont pas les fonctionnaires étrangers, mais eux, qui sont la source du pouvoir.1
1. Lecomte (F.), Nehru, p. 38. 2. Lecomte (F.), Nehru, p. 62.
296
Nationalismes et réformes
Comme pour lancer un défi à la symbolique impériale, les manifestations d’unité populaire et nationale se multiplient. Aux Indes, le Parti du Congrès décrète, le 26 avril 1930, une journée de l’Indépendance, à l’occasion de laquelle les populations sont invitées à approuver une motion exigeant la fin immédiate de l’occupation. Au Maroc, les nationalistes instituent à partir de 1933 une fête du Trône, occasion de rassemblements annuels qui donnent au peuple le sentiment, sinon de sa force réelle, du moins de son importance numérique. La puissance de mots arabe comme Istiqlal, ou hindi Puma Swaraj, (indépendance) pénètre les masses. Des drapeaux, des hymnes, qui exaltent la nation et son unité commencent à devenir populaires, ainsi en Indonésie le drapeau blanc et rouge et l’hymne Indonesia Raya (la grande Indonésie), ou en Inde Bande Mataram ou Jana-Mana-Gana (ce dernier écrit par Tagore et chanté dès 1911) ; ou encore le drapeau vert et blanc en Algérie, où Moufdi Zakaria, futur auteur de l’hymne national algérien, compose des chants à l’usage des scouts musulmans. Les nouveaux leaders se montrent, dès le milieu des années 30, de dangereux rivaux pour le système des chefs qui offrait jusque-là, comme on l’a vu plus haut, un enca drement satisfaisant des populations pour le plus grand bénéfice des adminis trations coloniales. Les encouragements extérieurs. La HP Internationale Après 1918, les espoirs mis dans les États-Unis par les mouvements d’émancipation sont tiès forts. L’appel de Khaled à Wilson, évoqué plus haut, n ’est pas isolé : les Arabes de Tunisie, de Syrie, d ’Irak, même, envoient des lettres au président américain, en lui demandant d'agir en faveur de leur indépendance, ou du moins d ’assumer leur tutelle, préférée à celle de l’Angleterre et de la France. Mais ces espoirs ne se concrétisent pas. La disparition de Wilson de la scène politique (septembre 1919) marque le triomphe de l’isolationnisme dans la diplomatie de Washington. Même si le courant hostile à la colonisation européenne subsiste aux États-Unis, le mélange de bonne conscience émancipatrice et de diplomatie du dollar qui caractérise la politique étrangère de ce pays n’exercera pas d ’effet avant la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains bénéficient cependant, sur les Européens, de l’avantage de principes d ’émancipation énoncés très tôt. Les Philippines, en particulier, dotées dès 1917 d ’une large autonomie interne, se voient, en 1934, promettre l’indépendance pour 1946 au plus tard. Ces promesses, accompagnées, il est vrai, de solides garanties, militaires et éco nomiques, assurées à la puissance coloniale, contrastent avec la lenteur de l’évolution dans les territoires français, hollandais, et même avec les ater moiements de la politique des Britanniques aux Indes, les uns et les autres se heurtant, il faut le reconnaître, à des difficultés autrement plus grandes. De toute façon, quels que soient les effets à long terme des principes de Wilson et des pratiques américaines, ceux-ci paraissent bien faibles compa rativement aux effets de ce qu’un livre français de l’époque appelle « l’arai gnée bolcheviste ». La manière dont beaucoup de responsables politiques
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
européens ont tendance à privilégier l’action du communisme dans tous les mouvements subversifs conforte d ’ailleurs indirectement la foi dans la puis sance de celui-ci. Il suffit de rappeler le discours tenu à Constantine par Albert Sarraut, alors ministre de ¡’Intérieur, le 22 avril 1927, qui contient la célèbre formule « Pour le Gouvernement et le Parlement, comme pour les masses laborieuses, le mot d ’ordre doit rester le même : le communisme, voilà l’ennemi ! ». La même année, le maréchal Lord Milne, chef de l’étatmajor impérial, proclame que le communisme constitue la plus grave menace militaire que connaisse alors l’Empire britannique3. Il faut dire que l’action de la IIIe Internationale est souvent spectaculaire. En 1925, le PCF s’est lancé ainsi dans une violente campagne contre la guerre du Rif, dans laquelle s’est distingué Jacques Doriot, alors tribun adulé du Parti. Certes, pas plus que dans la plupart des pays, les partis communistes ne sont représentatifs de l’ensemble de la population. Le plus souvent, dans les colonies, ils se réduisent à un noyau de militants qui doivent se contenter de servir de force d ’appoint aux forces nationalistes ; mais leur influence n’en est pas moins très forte. Ils s’efforcent, en effet, d ’organiser des mouvements qui ne se réfèrent pas directement à leur doctrine, mais à une idéologie anti impérialiste plus vague, l’accent étant mis sur la volonté d ’émancipation plus que sur la révolution sociale. C’est en coopération avec eux que se fonde, notamment, en 1926, VÉtoile nord-africaine, à la tête de laquelle s’impose Messali Hadj. Inversement, nombre de notables religieux appuient l’action du PKI aux Indes néerlandaises, ce qui donne au mouvement une dimension populaire parmi les paysans. Leur caution n ’est pas négligeable non plus dans le monde arabe, en dépit de la réticence des nationalistes à l’égard de l’athéisme, et du fait que, dans beaucoup de pays, le recrutement essentiel de ces partis s’opère au sein des minorités, en particulier coloniales. Elle s’exerce aussi dans une série de mouvements d ’émancipation des Noirs, comme la Ligue de défense de la race nègre, créée en France et où s’illust rent des leaders comme le Malien Tiémoro Garan Kouyaté, qui sera exclu du parti communiste en 1933. George Padmore, natif de Trinidad, s’avère un agent actif du Komintern, au sein des mouvements africains, et notamment en Europe. C ’est souvent également à l’instigation de militants communistes que peuvent se rencontrer et se côtoyer les militants de tout pays. Geoiges Hardy note qu’aux rêves nationaux qui prennent pour fondement l’idée impériale s’oppose, de plus en plus, « une sorte d ’internationalisme indigène »4. Des congrès internationaux se tiennent notamment à Genève, à Bruxelles. Ainsi, au Congrès contre l’oppression coloniale et l’impérialisme, organisé dans cette ville en 1927, se rencontrent le Sénégalais Lamine Senghor, l’Indoné
3. Gautherot (G.), Le bolchevisme aux colonies et l'impérialisme rouge, Alexis Redier, 1930, p. 11 ; James (L.), The Rise and Fall of the British Empire, p. 373. 4. Hardy (G.), Les Éléments de l’histoire coloniale, p. 188.
Nationalismes et réformes
sien Mohammed Hatta, et l’Algérien Messali Hadj, ainsi que l’épouse du dirigeant chinois Sun Yat Sen. L’Indien Jawaharlal Nehru est élu président de la Ligue, et de Bruxelles se rend à Moscou, d ’où il reviendra avec une grande admiration pour l’URSS. Ces succès n’amènent nulle part de véritable victoire communiste. On peut certes l’expliquer par les effets d ’une répression qui s’adresse en prio rité aux membres de l’Internationale. Mais il faut aussi faire sa part au choix stratégique arrêté lors du VIe Congrès du Komintern (juillet-août 1928), qui a décidé, au nom d ’une stratégie dite « classe contre classe » de radicaliser les luttes, quitte à effrayer les nationalistes modérés des colonies, et les partis de gauche des pays colonisateurs, confondus dans une même opprobre avec les « bourgeoisies réactionnaires». Cette décision se révèle suicidaire. Le PKI, qui a tenté à la fin de 1926 de soulever les populations de l’ouest de Java et de la partie voisine de Sumatra est anéanti par les autorités des Indes néerlandaises en 1927 ; en 1929, les dirigeants britanniques arrêtent et font juger pour complot 31 dirigeants du PC indien ; en 1931, Roy, revenu clan destinement d ’Europe, est également appréhendé ; les uns et les autres sont condamnés à de lourdes peines de prison ; en 1934, l’interdiction du parti est prononcée. Le PC indochinois est démantelé par la Sûreté française en avril 1931 ; en juin, Ho Chi Minh est arrêté par les autorités britanniques de Hong Kong. Avec l’écrasement des mouvements communistes en Chine par le Kuomintang, dans les villes (1927-1928), puis dans les campagnes (1934), la révolution en Asie semble écrasée pour longtemps. Pourtant, les partis communistes ne disparaissent pas. La stratégie des fronts populaires amène les partis communistes à mettre en sourdine leur anticolonialisme, au profit de la construction d ’une vaste alliance antifasciste unissant l’URSS aux démocraties occidentales. Ce virage tactique ne passe pas inaperçu. Revenant sur le célèbre discours anticommuniste prononcé dix ans plus tôt, Sarraut déclare que « le parti communiste est devenu national et ne saurait faire naître en nous les inquiétudes d ’autrefois»5. Nombreuses alors sont les voix qui dénoncent la collusion du communisme avec le colo nialisme, au nom des intérêts supérieurs de l’URSS. Orwell accuse ainsi les communistes espagnols de s’être refusés à proclamer l’indépendance du Maroc, ce qui aurait sapé les bases arrière de Franco6. Albert Camus est exclu de sa cellule du PCA pour avoir critiqué l’intransigeance du parti à l’égard des nationalistes de Messali Hadj. Inversement, ce n’est pas sans l’arrière-pensée de jeter le trouble chez leurs adversaires que l’Allemagne, le Japon et l’Italie ont conclu, en novembre 1937, le Pacte anti-komintem. La reconstruction des partis communistes s’opère avec un souci plus grand de s’associer à un nationalisme en progrès. En Indochine, l’écrasement 5. Oved (G.), La gauche française et le nationalisme marocain, l'Harmattan, 1987, t. 2, p. 183. 6. Orwell (G.), Homage, p. 69.
299
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
des nationalistes du VNQDD après la révolte de Yen-Bay permet aux communistes de chercher à reprendre à leur compte le combat pour l’éman cipation, avec un discours qui reste modéré. Encore en juillet 1939, Ho Chi Minh invite ses partisans à se rapprocher de la « bourgeoisie nationale », mais aussi des « Français progressistes » de la colonie, et à entretenir des relations étroites avec le Front populaire français», pour s’opposer aux « fascistes japonais ». Les seuls adversaires à ne pas ménager sont les trots kistes, éliminés également en Espagne, et dont le leader sera bientôt assas siné7. En Indonésie, les communistes, après la suppression de leur parti, jouent un rôle important dans la fondation du Parti national (PN1), dont Soekarno prend la direction, puis après les poursuites contre celui-ci, du Partindo ; d ’autres communistes s’efforcent, depuis 1935, de reconstruire un parti dans la clandestinité. Surtout, même privés de l’appui du Komintern, voire en rupture avec lui, les militants formés au cours des années vingt continuent à réclamer l’indépendance totale, ce qui peut paraître bien utopique alors. Les mouvements religieux. L ’islam L’islam constitue une réalité religieuse et idéologique essentielle dans le monde colonial, dans la mesure où on peut estimer très approximativement qu’il ne regroupe pas moins du tiers des populations autochtones des colo nies. Inversement, sur 250 millions de musulmans évalués dans le monde à cette époque, environ 160 millions, soit près de deux tiers, sont sous domina tion coloniale européenne8. Vers 1929, les musulmans représentent en parti culier l’écrasante majorité de la population de l’Empire hollandais (45 mil lions sur 50), plus du tiers de la population de l’Empire français (20 millions sur 55), le quart de la population de l’Empire britannique (environ 95 mil lions sur 400). Certes, ces musulmans sont loin d’avoir une identité culturelle homogène : dans l’Empire français, ce sont essentiellement des Arabes (14 millions, soit 7 0 % ); dans l’Empire britannique, des Indiens (68 millions, soit 71 %), quoique la majorité des Arabes soient sous domi nation britannique (environ 20 m illions); dans l’Empire hollandais, des Javanais (23 millions). Il n ’empêche que la référence à une même religion avec ses rituels communs, la pratique d ’une même langue sacrée, constituent un facteur important de rapprochement entre des peuples qui s’étendent, sans solution de continuité, des rivages africains de l’Atlantique à l’Insulinde. Le pèlerinage à La Mecque ne concerne encore qu’un très petit nombre de personnes: 120000 en 1929, moins de 25000 en 1933, sous l’effet de la crise économique, 65000 en 1938, avec 16000 pèlerins originaires de Java et de la Malaisie, 15000 des Indes, et 10000 Égyptiens9. Il n’en joue pas
7. « Rapport à l’Internationale communiste », Ruscio (A.), Ho Chi Minh, Textes, 19411969, L’Harmattan, 1990, p. 97-98. 8. Voir notamment Massignon (L.), Annuaire du Monde musulman, Ernest Leroux, 1929, passim. 9. Bulletin du Comité de l'Asie française, 1938, p. 96.
300
Nationalismes et réformes
moins un rôle extrêmement important, en mettant en relations les plus pieux, les plus riches et donc les plus influents de ceux qui s’appellent eux-mêmes les Croyants. Les rumeurs, mais aussi les mouvements d ’idées, se propagent d’une manière qui surprend parfois les occidentaux : c’est ainsi que, au début du XIXe siècle, les succès éphémères des Wahhabites d ’Arabie ont suffisam ment impressionné les pèlerins indonésiens pour que ceux-ci tentent d ’im poser à leurs compatriotes une réforme puritaine de l’islam inspirée du zèle iconoclaste des ancêtres du roi Ibn Séoud101. Les puissances coloniales ont toujours accordé une attention particulière à l’islam, non seulement en raison de l’importance numérique des fidèles, mais aussi en raison de l’étroite imbrication du politique et du religieux qu’il suppose, puisque c’est de la religion que le pouvoir tire sa légitimité et que la société reçoit ses lois. Les Français et les Hollandais tiennent à exercer un strict contrôle. En Tunisie et au Maroc, la surveillance des cultes et l’exis tence d ’un budget destiné à leur entretien sont d ’autant plus faciles qu’il n’y a jam ais eu de séparation, le pouvoir central étant, comme dans tout pays musulman, le défenseur de l’islam. En Algérie, selon des décrets de 1907 le gouverneur général nomme et salarie les desservants des mosquées, et les enseignants des principaux établissements d ’enseignement coranique, mais aussi les prêtres des paroisses catholiques, ainsi que les rabbins et les pasteurs. En Indonésie, le gouvernement général exerce également une surveillance active sur la vie religieuse des indigènes, l’islam n ’étant pas subventionné, mais placé sous le contrôle étroit d ’un Bureau des Affaires indigènes, formé de spécialistes, de formation orientaliste11. Les Britan niques, en revanche, n’éprouvent pas le besoin de services analogues. Bousquet s’étonne que, en dépit de l’importance de la question musulmane aux Indes, aucun service central du vice-roi n ’y soit expressément consacré12. Ceci dénote sans doute une différence de méthode plus qu’un manque d ’intérêt. Une première préoccupation commune des autorités coloniales est repré sentée par l’unité de la communauté, susceptible de donner naissance à des mouvements d'ensemble. Bien que le sultan ottoman n ’ait revendiqué que tardivement le primat religieux en prenant le titre de Calife, les fidèles sunnites ont toujours, à l'occasion de la prière du vendredi, prononcé une formule de prière attirant sur lui la bénédiction divine (khotba). Cette ferveur n’a fait que s'accroître au cours du XIXe siècle, où elle touche les musulmans de l’Inde, après la disparition des empereurs moghols (le dernier héritier étant mort en 1862), et même les Indes néerlandaises. Au cours de la guerre mondiale, beaucoup de musulmans ont suivi avec angoisse la guerre entre le sultan et les Alliés, et sont très émus par sa défaite. Selon l’État-Major fran
10. Tarling (N.), The Cambridge History o f Southeast Asia, p. 210. 11. Fumivall (J.S.), Netherlands India, p. 378 12. Bousquet (G.H.), La politique musulmane, p. 45-46.
301
Les empires cobniaux dans b processus de mondialisation
çais, celle-ci a provoqué la « mélancolie » des Algériens et Tunisiens, même des plus loyalistes13. Les Indiens créent en septembre 1919 la Ail India Khilafat Conference, pour soutenir le sultan-calife face aux prétentions du roi du Hedjaz, Hussein, chérif de La Mecque, sur lequel comptent alors les Anglais pour étendre leur influence à l'ensem ble du Proche-Orient arabe. A défaut de faire renaître la gloire ottomane, la résistance des officiers turcs aux projets de partage de l'Anatolie conçus par les chancelleries ranime les enthousiasmes. Messsali Hadj rapporte que, lors des grandes batailles entre Grecs et Tûtes (été 1921), « les gens portaient dans leur portefeuille la photographie des héros turcs, Mustapha Kémal et Ismet Pacha. Des voya geurs venant de Tunis racontaient que, là-bas, on avait promené dans les rues l'effigie de Mustapha Kémal, tandis que la population l’arrosait de parfum et lui envoyait des fleurs... On disait qu'en Inde, les musulmans et les non musulmans priaient toute la journée pour la victoire totale des armées turques». Simultanément, l’insurrection d'A bd el-Krim et sa victoire d'Anoual sur les Espagnols provoquent la même ferveur14. Le choc causé par l’abolition du Califat par Mustapha Kémal en 1923 amène à d ’autres rapprochements. Si elles n'aboutissent pas à rétablir le Califat, les confé rences qui se tiennent en 1926 au Caire et à La Mecque soulignent, une fois de plus, une solidarité. La question des lieux saints agite aussi la communauté musulmane. Il s'agit d'abord de La Mecque et de Médine, sur lesquelles Ibn Séoud, qui s’en est rendu maître en 1925, finit par imposer sa qualité de protecteur, grâce à sa position de souverain indépendant, que ne peut revendiquer alors aucune des grandes collectivités du monde musulman. La question de Jérusalem, au contraire, ne fait que gagner en acuité, étant donné les émeutes sanglantes dont elle est régulièrement le théâtre. En 1938, le secrétaire d ’État à VIndian Office, Lord Zetland, souligne combien l’opinion des musulmans est émue par le sort des Arabes du pays, non seulement en Inde même, mais aussi en Afghanistan, où on avait paru peu s'y intéresser jusque-là. Des quêtes sont organisées dans les milieux musulmans pour acheter des terres et s'opposer ainsi aux progrès de la colonisation sioniste. Le panarabisme ajoute sa tonalité particulière à cette sensibilité musul mane. H se développe depuis le XIXe siècle, suscité tout à la fois par les réac tions aux dominations européennes et la participation au courant des nationa lités qui incite à retrouver les grandeurs d ’un riche passé, et à relever les défis de la modernisation. La division du Moyen-Orient après la guerre, sous contrôle européen, alors que les promesses alliées, notamment britanniques, avaient fait naître les espoirs d ’un grand État arabe, a fait naître bien des
13. Mahjoubi (A.), Les origines du mouvement national en Tunisie (1930-1934), Tunis, Publications de l’Université, 1982, p. 190. 14. Les mémoires de Messali Hadj, p. 113.
302
Nationalismes et réformes
frustrations. Les tentatives du roi d ’Irak Fayçal de créer une fédération au Moyen-Orient échouent, par suite de l’opposition française, qui ne tient pas à voir des frères du monarque s’installer sur le trône de Syrie, mais aussi par suite des réticences de l’Egypte. Fayçal du reste meurt en septembre 1933, ce qui prive le monde arabe d ’un homme d ’État de valeur. Mais la volonté de rapprocher les Arabes dépasse les simples négociations diplomatiques et les contacts entre États. Cet état d ’esprit est représenté et illustré par Chékib Arslan, issu d ’une grande famille druze du Liban, et son journal, la Nation arabe, qui paraît à Genève à partir des années 30. Il popularise les résis tances, de celle des Jeunes Marocains contre le dahir berbère à celle des Arabes de Palestine, en passant par l’action de Messali Hadj. En 1932, Abd er Rahman Azzam Bey, égyptien de naissance, mais qui a combattu pour l’indépendance libyenne aux côtés des H ues, puis des tribus arabes, contre les Italiens, publie Les Arabes, peuple de l'avenir. Dans cet article, ce futur président de la Ligue arabe souligne la capacité des Arabes à suivre l’exemple des Allemands ou des Italiens pour construire leur unité nationale. Des mouvements divers cherchent à exalter la grandeur passée, et à célébrer un avenir radieux : tel est le cas des mouvements de jeunesse, notamment des scouts, qui sont, partout, des vecteurs de l’idée nationale. En Syrie, ils entretiennent le souvenir des victoires de Saladin contre les Croisés, ou bien se proposent d ’accomplir un voyage au « pays de la gloire perdue », enten dons l’Andalousie conquise par les Rois Catholiques en 149215. En même temps, la diffusion de l’arabe littéraire modernisé, par l’intermédiaire de la presse, de la radio et du cinéma, facilite les rapprochements. Il faut remarquer, d ’ailleurs, qu’il n ’y pas à cette époque de véritable antagonisme entre islam et nationalisme, étant donné la primauté du combat émancipateur. Si les leaders des partis nationalistes, issus généralement d’une bourgeoisie aisée, ont pour idéal la création d ’États modernes, dotées d’institutions parlementaires, administratives et judiciaires copiées sur celles de la France ou de l’Angleterre, ils ne voient pas d ’opposition entre ces idéaux et la pratique, tant publique que privée, de la religion musulmane. De même, la revendication d ’États-nations souverains ne semblent en contradic tion ni avec la fraternité arabe, ni avec la fraternité musulmane. Le cas de l’Arabie, où Ibn Séoud, appuyé sur les docteurs wahhabites, a instauré ce que le sociologue Robert Montagne appelle une « théocratie bédouine » (le terme de régime islamiste étant inconnu alors), paraît explicable par l’histoire particulière de la région ; tandis que peu d ’observateurs portent beaucoup d ’attention à l’association des Frères musulmans qu’un obscur instituteur, Hasssan el-Banna, vient de créer en Égypte, à la fois contre l’occupation britannique et un régime monarchique dénoncé comme cor rompu et vendu aux intérêts étrangers. Ce n’est que cinquante ans plus tard que les Européens découvriront dans ce mouvement l’ancêtre des islamistes radicaux alors en plein essor.
15. Jovelet (Louis), « L’évolution... », p. 488.
303
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
Mais l’islam n'est pas seulement ce qu'on pourrait appeler une compo sante du nationalisme arabe. Il est aussi un ferment actif au sein du nationa lisme indonésien. Parmi les mouvements les plus anciens, le Sarekat Islam, s’est d ’aboid voulu une simple association commerciale ; mais en 1917, il formule un programme politique, qui vise notamment l’établissement dans les Indes néerlandaises d ’un véritable régime représentatif. Affaibli après les troubles de la fin des années 20, il se voit concurrencé par des partis plus actifs, dans lesquels la part du nationalisme paraît de plus en plus grande. En revanche, des associations comme la Mohammaddyya se proposent d ’amener les masses à une conception plus rigoriste de la religion, de façon tout à fait comparable à ce qui s’opère dans l’Algérie de l’époque, sous l’influence du mouvement des Uléma, qui lancent le slogan célèbre, « L’islam est ma reli gion, l’arabe est ma langue, l’Algérie est ma patrie». La priorité est ici donnée à la construction d ’une identité par rapport à l’exigence d ’émancipa tion. Il s’en faut cependant que l’islam agisse toujours comme facteur d ’unification. Même si trop de Britanniques, impressionnés par la diversité de l’Inde, ont tendance à négliger l’unité que confère le sentiment d ’une histoire commune et de modes de vie très voisins, ils n’ont pas tort de souli gner l’opposition entre les élites musulmanes, souvent nostalgiques de l’Empire moghol, et les hindouistes, conscients de représenter le nombre. Gandhi, qui plaide infatigablement pour l’entente des uns et des autres, connaît l’importance de l’enjeu pour l’avenir. Dans un premier temps il lui paraît possible de réaliser dans le pays même l’unité qu’il avait su concré tiser chez ses compatriotes d ’Afrique du Sud. La partition du Bengale imposée par eux en 1905, entre une province musulmane et une province hindoue, avait entraîné, dans toutes les communautés, une agitation dans laquelle le Mahatma avait vu le premier stade du processus d ’indépendance, au point que, avec son habituel sens de l’humour, il avait remercié le vice-roi de l’époque, Lord Curzon, de son initiative. Les émotions de 1919 semblent pousser dans le même sens. Le parti du Congrès adhère à la Ail India Khilafat Conference, hindouistes et musulmans s’entendant pour adhérer au mouvement dit de « non coopération » dirigé contre les Britanniques. Mais ce rapprochement est peu durable. Le choix, par les Britanniques, de collèges séparés, à partir des réformes de 1909, choix toujours repris depuis, n’est pas sans confirmer et approfondir cette évolution. Au fur et à mesure que les réformes mettent en place un self-government, la menace d ’un pouvoir central fort, qui serait naturellement aux mains du Congrès, dominé par les hindouistes, joue de plus en plus comme un élément de divi sion. La Ligue musulmane, fondée en 1906, d’abord purement culturelle, entretient avec le parti du Congrès des relations de plus en plus orageuses. En 1928, Mohammed Ali Jinnah, devenu son leader, fait connaître une liste de quatorze garanties, comprenant la création de provinces à majorité musul mane, et l’attribution d ’un tiers des sièges aux musulmans dans les assem blées centrales. Les musulmans ne participent que peu aux mouvements de
Nationalismes et réformes
désobéissance civile qui se déroulent à partir de 1930. En 1930, les émeutes de Calcutta, provoquées par le refus de marchands musulmans de se joindre à un hartal (arrêt de travail) ne font pas moins de quatre cents morts dans leurs rangs. En 1930, le théoricien Mohammed Iqbal suggère l’idée d ’un « foyer » pour les musulmans. C’est en 1933, semble-t-il, qu’apparaît dans les écrits d ’un obscur étudiant du Penjab, Rahmat Ali, le nom de Pakistan (« pays de la pureté », mais aussi correspondant aux initiales des provinces à majorité musulmane du Penjab, Afghanistan, Kashmir, Sind et Baluchistan). En mars 1940, Jinnah accuse les Britanniques d ’avoir maintenu et de vouloir continuer à maintenir artificiellement l’unité de l’Inde par la force, au mépris de la volonté des hindous et des musulmans16. Autres revendications C’est plutôt dans la solidarité des Noirs, trop longtemps asservis par les Blancs, que les revendications des colonies américaines et africaines de l’Europe trouvent leur expression. Le panafricanisme, qui vise à retrouver, de part et d ’autre de l’Atlantique, la fraternité de peuples séparés par la traite et l’esclavage, en est une des expressions majeures. Ses fondateurs, qu’on n’appelle pas encore des Afro-Américains, sont essentiellement des origi naires des États-Unis et des West Indies. L’Américain William E.B. DuBois, figure notable de la NAACP (National Association fo r Advancement o f Colored People), préside depuis 1900 une série de conférences panafri caines. Le flamboyant et contesté Jamaïcain Marcus Garvey (1887-1940), soulève l’enthousiasme dans les années 20, en s’efforçant de créer une nébu leuse d ’entreprises à capitaux « noirs » couvrant l’Amérique, les Caraïbes et l’Afrique, et surtout en célébrant la « puissante race » (Mighty Race) noire, et en popularisant la devise de « l’Afrique aux Africains ». De futurs leaders marquants des indépendances, comme Kawe N’Krumah ou Jomo Kenyatta qui publie, en 1937, son ouvrage ethnographique, Facing Mount Kenya, subissent l’attraction de ce mouvement Les colonies françaises sont peu touchées par cette sensibilité essentielle ment anglophone, même si elles ne l’ignorent pas, grâce notamment à la médiation d ’intellectuels antillais. Ouverts aux valeurs de la culture et de la République françaises, jugés universelles, ces Noirs, citoyens ou sujets fran çais, ne revendiquent pas moins une égalité fondamentale, fondée sur une égale valeur humaine. Leur activité s’exprime dans une infinité de petites revues, par exemple en 1935 l'Étudiant noir. En 1939, le thème de la « négritude », qui exalte l’apport spécifique des Africains à la culture univer selle, est lancé conjointement par un agrégé de grammaire, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, et un ancien normalien, Aimé Césaire. Celui-ci fait paraître en 1939, dans la revue Volontés, des fragments de ses Cahiers d ’un
16. Adresse à la Conférence de la Ligue musulmane, Lahore, in Dommergues (A.), Le Commonwealth, histoire et civilisation. Presses Universitaires de Nancy, 1991, p. 192-193.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
retour au pays natal, où la colonisation se trouve violemment condamnée. Sur place, comme dans les territoires britanniques, les contestations restent timides, dénonçant les abus de l’administration coloniale plus que le fait colonial lui-même. À tous ces mouvements, les autorités opposent des politiques variées, faisant alterner ou combinant répressions et réformes, sans qu’il paraisse bien possible alors de prévoir le sens général de l’évolution. Les perspectives des responsables coloniaux Dans l’ensemble, les dirigeants européens se défendent depuis toujours de pratiquer une politique d’immobilisme, qui serait d ’ailleurs contraire à la profession de foi dans le progrès qui a toujours accompagné les conquêtes coloniales. Cet état d’esprit leur donne souvent l’audace intellectuelle d ’en visager avec sérénité jusqu’à l’émancipation des colonies. Le président Sarraut s’exprime, sur ce point, avec des accents qui annoncent le général de Gaulle de la décolonisation : « ne serait-ce donc rien d ’avoir modelé dans le limon obscur des humanités attardées, le visage lumineux et frémissant de nations nouvelles ? Serait-ce aussi un faible avantage que d ’avoir créé outre mer des États ou des sociétés où persisteraient, élargissant leur influence chaque jour, la langue, la tradition, les leçons, le souvenir, l’âme même de la France ? Et ne serait-ce point pour la mère-patrie le meilleur des résultats, nous allions dire la meilleure opération, que d ’avoir ainsi noué, avec ses enfants adultes, par les liens durables de la gratitude et de l’intérêt, des rapports économiques et politiques dont la métropole resterait la bénéficiaire privilégiée, sans supporter les charges ou les responsabilités d'autrefois ? *1718. Cette déclaration, publiée, à cinq ans de distance, dans deux livres différents, n’est pas sans rappeler un discours de Macaulay devant le Parlement britan nique en 1813, et dont on comprend que ses héritiers continuent à se préva loir : « Avoir trouvé un grand peuple plongé dans les ténèbres de l’esclavage et la superstition, et l’avoir gouverné de manière à le rendre désireux et capable de jouir de tous les privilèges de la citoyenneté serait un titre de gloire pour nous-mêmes »1S. De telles audaces restent intellectuelles. Sur un ton plus réaliste, les diri geants coloniaux ne sont pas avares de professions de foi qui affirment leur souci de prendre en compte les aspirations des peuples. Dès 1922, le prési dent Millerand en visite à Alger déclare, à propos des réformes politiques en Algérie : « Aucune solution ne saurait être a priori exclue. U est, au contraire, profondément souhaitable que tous ceux qui ont donné de si indiscutables témoignages de loyalisme et d ’attachement à la grande patrie soient, de plus en plus, étroitement associés à nos préoccupations nationales, à nos devoirs 17. Sarraut (A.), La mise en valeur, p. 127 ; Grandeur et servitudes coloniales, Éditions du Sagittaire, 1927, p. 279. 18. O’Malley, Modem India, p. 149.
Nationalismes et réformes
et à nos droits»19. Van Asbeck n’hésite pas à citer comme l’expression toujours valable de la doctrine hollandaise en matière coloniale les propos tenus par le ministre des Colonies en 1915 : « faire appel aux forces natio nales indiennes pour le développement des ressources du pays, élever la population à un niveau où elle puisse s’occuper de ses propres intérêts et gouverner son propre pays, et ce faisant poser les bases d ’une autonomie complète »20. Quelques années plus tôt, De Kat Angelino, ancien directeur du département de l’Éducation des Indes néerlandaises, n ’hésitait pas à écrire que la tâche des autorités des Indes néerlandaises consistait à diriger les habitants du pays dans les voies qui les conduiraient à « la victoire sur le fanatisme et la superstition, afin qu’ils connaissent un jour les bienfaits du progrès et de l’émancipation complète »21. Mais cette issue n’est pratiquement jam ais conçue comme devant être très proche. Sarraut pense que le problème ne saurait se poser qu’à « nos petitsneveux », ce qui signifierait, au bas mot, une durée de quarante ans, c’est-àdire presque l’éternité pour un homme politique. Ce jugement pourrait bien, globalement, être partagé par ses collègues étrangers. Si, comme on le verra, les Britanniques acceptent une quasi-indépendance des Dominions et une large autonomie de l’Inde, ils n ’envisagent pas une évolution aussi rapide dans les autres possessions. Rien, disait Millerand, ne serait plus dangereux, pour les Français comme pour les indigènes, « que d ’aller trop vite dans la voie où nous nous sommes engagés et où nous ne nous arrêterons pas »22. Dans l’ensemble, en effet, les colonisateurs ont tendance à placer très haut la barre de l’émancipation, au nom d ’arguments qui ne sont pas tous méprisa bles. La « franchise politique complète », comme disent les Anglais, c’est-àdire la liberté politique accompagnée du droit de vote, ne saurait s’obtenir que par l’élargissement progressif du droit d ’expression et un long entraîne ment à l’art de gouverner. La première série d ’arguments opposés à une émancipation rapide est économique et sociale. De Kat Angelino définit un ensemble de conditions qui pourraient, selon lui, autoriser une émancipation : disparition de l’anal phabétisme ; organisation d ’un système communal efficace ; formation d ’un peuple prospère et d ’une classe moyenne vigoureuse. Il est évident que, consciemment ou non, il brosse ici les grandes lignes du modèle européen (idéal en tout cas), selon lequel se sont construits les États occidentaux, et notamment les Pays-Bas: culture, richesse, et construction de solides communautés urbaines et rurales23. D’autres insistent davantage sur la néces sité d ’une éducation susceptible de donner aux peuples la maturité nécessaire à l’exercice de la vie politique. Il paraît évident en effet que l’indépendance
19. Le voyage du président Millerand dans le Nord Africain, Hachette, 1922, p. 84-85. 20. Van Asbeck, « Les responsabilités néerlandaises... », art. ciL, p. 210. 21. De Kat Angelino (A.), Le problème colonial, Vol. n, p. 417. 22. Le voyage du président Millerand, p. 93. 23. De Kat Angelino (A.), Le problème colonial. Vol. I, p. 465.
307
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
ne peut consister en autre chose que dans la transmission du pouvoir aux représentants des indigènes, désignés selon un système inspiré de l'O ccident Un colonel français, membre de la Commission des Affaires musulmanes, jugeait en 1923 qu'il ne fallait pas « se faire d ’illusions sur l’évolution des indigènes ; les races actuelles n’évoluent guère ; elles produisent simplement quelques individus exceptionnellement intelligents qu’elles ne produisaient pas autrefois»2425. Amery, dans ses mémoires publiées en 1953, écrira, à propos des Africains, à peu près la même chose, en jugeant que, si l’acquisi tion de savoirs par des individus peut être aussi rapide, voire plus rapide que chez les Européens, créer dans les masses un esprit démocratique ne peut être que le résultat d ’une éducation portant sur des générations23. Pour certains, seul un pouvoir d ’origine étrangère est capable d’assurer, par son arbitrage, un équilibre qui permette de triompher des déséquilibres qu’impliquent les diversités ethniques ou religieuses. Selon De Kat Angelino, un gouvernement à base indigène devrait pouvoir compter, pour réussir, sur une vraie solidarité nationale, et cette solidarité ne peut s’imposer par un simple décret. Il ne bénéficierait pas de l’autorité spirituelle qui, à défaut de sentiment national, nourrissait souvent le loyalisme aux anciens souve rains26. De son côté, Leo Amery redoute, que dans bien des cas, les clivages raciaux et religieux ne soient assez profonds pour empêcher les votes de se déterminer, en quelque sorte, transversalement aux groupements communau taires27. La loi du nombre, par le biais des élections, peut aboutir à favoriser systématiquement les communautés les plus nombreuses, alors que jusquelà, et depuis des siècles, la loyauté au souverain suffisait à garantir les privi lèges des sujets, même si certains pouvaient être placés en situation d ’infé riorité par rapport à d ’autres. On assisterait alors à l’éclatement de la « société plurielle », au profit d ’une oppression permanente de la minorité, où, en cas de refus de celle-ci, d ’un désordre permanent, ce qui rendrait inconcevable toute vie démocratique. À la suite de ces auteurs, bien des dirigeants européens envisagent sous de sombres auspices toute évolution qui négligerait ces considérations. Lord Hailey, par exemple, se montre sensible à ce que deviendrait alors la position des minorités européennes. Comment accepter que l’indépendance puisse donner aux indigènes « dont un grand nombre conservent un caractère prim itif et tribal», la prédominance politique sur la communauté euro péenne, jugée seule capable d ’assurer, pendant longtemps, la prospérité ? Mais il prévoit bien d ’autres problèmes. Selon lui, « Il y a, en Asie du SudEst et en Afrique, beaucoup de territoires qui ne sont que des unités adminis tratives artificielles, habités par des communautés pour cette raison hostiles
24. Le Pautremat (P.), Le rôle de la Commission interministérielle des Affaires musul manes, p. 311. 25. Amery (L.), My Political Life, vol. 2, p. 359. 26. De Kat Angelino (A.), Le problème colonial, vol. I, p. 69. 27. Ameiy (L.), My Political Ufe, vol. 2, p. 363.
308
Nationalismes et réformes
les unes aux autres, et présentement dépourvues de tout sens d ’intérêt commun ou de conscience nationale »28. La formule de multiconfessionnalisme, inaugurée au Liban par la Constitution de 1926, œuvre du résident Henri de Jouvenel, très critiquée sur place même, ne parait guère devoir faire école. Comment, par exemple, établir un self-government en Malaisie, où les autochtones sont dépassés en nombre par les Chinois et les Indiens, avec lesquels leurs rapports sont mauvais ? Comment régler la question de l’oppo sition entre hindous et musulmans aux Indes ? Ainsi il ne saurait être ques tion, en vertu même de la mission de tutelle qui incomberait aux colonisa teurs, d ’abandonner à eux-mêmes des peuples incapables d ’assurer leur avenir par leurs propres moyens. Les événements qui ont suivi la décolonisa tion ont prouvé que nombre de ces appréhensions n’étaient pas dénuées de fondement, même si, là encore, on ne saurait exonérer les anciennes puis sances coloniales de toute responsabilité. Au total, conscientes de l’évolution des esprits, les autorités coloniales ne s’efforcent pas moins de répondre à un certain nombre de demandes poli tiques, mais avec beaucoup de lenteur, d ’une manière très diversifiée, et qui ne peut donner qu’a posteriori le caractère d ’un processus inéluctable. On peut présenter ici quelques-uns des traits principaux de ces changements.
Les évolutions politiques Entre les deux guerres, l’évolution de l’Empire britannique paraît bien en avance sur celle des autres empires. Le changement des dénominations officielles qui intervient en 1931 traduit une évolution. À côté du Colonial Empire, qui groupe les colonies proprement dites, il existe, un British Commonwealth o f Nations qui regroupe les Dominions. Ceux-ci ont reçu la totalité des instruments politiques de leur indépendance. Mais ils ne sont pas seuls à bénéficier de cette évolution. Certaines indépendances sont acquises en théorie : c’est le cas de plusieurs pays arabes ; d ’autres avancent à grand pas, comme celle de l’Inde. La formule coloniale paraît, dans bien des cas, dépassée. Les Dominions, modèle britannique Le cas des Dominions symbolise la souplesse proverbiale des institutions anglaises. Le modèle imaginé en 1867 pour donner satisfaction aux revendi cations des colons canadiens, et les dissuader de subir l’attraction des ÉtatsUnis, a été étendu par la suite aux autres pays à prédominance blanche. Il s’est traduit, d ’abord, par l’établissement dans chaque colonie de régimes parlementaires calqués sur le modèle britannique, et dotés d ’une autonomie interne de plus en plus large {self-government), puis par l’organisation de
28. Hailey (Lord), Thefuture o f Colonial Peoples, p. 52.
309
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
fédérations regroupant ces colonies selon une logique régionale. Ces fédéra tions ont été considérées, très rapidement, non plus comme des dépendances, mais des partenaires de l’Empire, en particulier à partir de la Conférence impériale de 1907, destinée à coordonner les politiques étrangères, et qui regroupe, sous la présidence du Premier Ministre britannique, les Premiers ministres des Dominions, traités sur pied d ’égalité. Loin d ’avoir affaibli la solidarité avec la métropole, cette politique généreuse, jam ais appliquée par aucune autre puissance à l’égard de ses colonies, paraît plutôt l’avoir renforcée, comme l’a démontré l’épreuve de la Première Guerre mondiale. Le couronnement de cette évolution réside dans le Rapport Balfour de 1926, selon lequel « la Grande-Bretagne et les Dominions sont des groupe ments autonomes dans le cadre de l’Empire britannique, égaux en statut, et qui ne sont subordonnés les uns aux autres sous aucun aspect de leurs affaires intérieures ou extérieures, quoique unis par une allégeance commune envers la couronne et librement associés comme membres du Common wealth des Nations britanniques w29. Le Premier Ministre d ’Afrique du Sud, le très sourcilleux nationaliste Afrikaner Hertzog, paraît avoir tenu un rôle important dans la rédaction de ce texte qui proclame l’égalité et la souverai neté totale des Dominions et du Royaume-Uni30. Ce rapport est la base du Statut de Westminster, voté par le Parlement britannique en 1931. Le texte achève de distinguer les Dominions des colonies, en précisant bien que l’expression de «colonie» employée dans une loi ne peut concerner un Dominion. Il prévoit qu’aucun acte du Parlement britannique ne pourra s’ap pliquer aux Dominions, sauf demande de leur part ; le Validity Act de 1865, qui annulait toute disposition législative d ’un Dominion contraire à la légis lation britannique, est aboli. L’appel aux instances judiciaires britanniques est, de manière générale, rendu facultatif. La souveraineté en matière de politique étrangère s’exprime par la possibilité (utilisée immédiatement par le Canada et l’Union sud-africaine) de disposer de leur propre représentation diplomatique à l’étranger. La représentation diplomatique à Londres est assurée non par des ambassadeurs, mais par des hauts-commissaires (contre partie à la présence de hauts-commissaires britanniques dans la plupart des Dominions, comme on l’a vu plus haut). Les liens politiques formels qui subsistent sont légers, mais néanmoins non négligeables. L’allégeance à la Couronne britannique, représentée par un gouverneur, mais qui est désormais exclusivement représentant de la Couronne, peut paraître largement symbolique. C ’est oublier un peu vite que la monarchie reste la clé de voûte du système politique anglais. Il est d’ailleurs prévu que toute modification de la loi successorale ou de la titulature royale exigera l’accord des Dominions. C ’est ainsi que leurs Premiers Ministres sont appelés en consultation dans la crise de 1936, à l’issue de
29. Halpérin (V.), Lord Milner, p. 218 sq. 30. Amery (L.), My Political Life, vol. 2, p. 382-385.
310
Nationalismes et réformes
laquelle une majorité se refuse à accepter le mariage du souverain avec Wallis Simpson. Ils appuient la position du Premier Ministre conservateur Stanley Baldwin, contribuant ainsi à l’abdication du roi, mais soulignant leur volonté de sauvegarder le caractère indiscutable de l’institution monar chique. Les Parlements des Dominions sont appelés à donner leur accord à cette décision. Des organismes communs viennent s’ajouter aux déjà anciennes Conférences impériales, tenues tous les quatre ans : le Comité économique impérial, créé en 1925, YEmpire Marketing Board, Ylmperial Shipping Comminee (1920), et bien sûr le Comité permanent de défense impériale, sont chargés de coordonner les efforts, sans que rien du reste ne soit imposé31. Dans le domaine économique, la Conférence d ’Ottawa de 1932 a bien marqué les limites d ’une étroite coopération. Comme le remarque Barker, il n’existe pas d ’organisme chargé des Affaires étrangères, chargé de coor donner en permanence la politique extérieure, ce qui paraîtrait aux Domi nions impliquer des engagements trop contraignants pour eux. Quant au Comité permanent de Défense, c’est essentiellement une institution britan nique, auxquels les représentants des Dominions ne participent qu’épisodiquement. Avec cette formule, les Britanniques ont la chance de disposer d ’un modèle susceptible d ’être étendu à d ’autres territoires, et qui permet d ’envi sager sans véritable angoisse, quand il apparaît nécessaire, le relâchement des liens politiques. Certains même, comme le leader travailliste Attlee, pensent que le Commonwealth pourrait offrir au monde entier le modèle d’une fédération conforme aux principes de la SDN, fondée sur la coopéra tion économique et la sécurité collective32. Les Français sont, de leur côté, bien moins partagés que leurs voisins d ’outre-Manche. La participation des indigènes aux affaires dans les colonies françaises passe forcément par l’oc troi de la citoyenneté, qui apparaît à l’idéologie républicaine comme le don suprême que les peuples placés sous la tutelle de la France puissent recevoir. Ce don a été fait très généreusement, il faut le reconnaître, aux Européens des colonies françaises, et la pratique apparaît globalement comme une réus site. Mais il n’a jam ais postulé une quelconque marche vers l’autonomie sous la direction de ces derniers. Il n’a jam ais été sérieusement question, par exemple, de faire de l’Algérie l’équivalent politique de l’Afrique du Sud, ne serait-ce que par le louable désir de ne pas laisser les colons maîtres de l’avenir des indigènes. Est-il possible cependant d ’accorder rapidement et massivement cette citoyenneté à ces derniers ? De ce point de vue, les Français ont un état d’esprit qui ne diffère pas de celui des autres puissances coloniales. Outre les 31. The British Empire, a Report..., p. 191-193. 32. Attlee (C.R.), The Labour Party in perspective, Londres, Victor Gallancz, 1937, p.233.
Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation
arguments évoqués plus haut relatifs à l’immaturité des colonisés, certains font observer qu’il y aurait une aberration à admettre au Parlement français des représentants des colonies à proportion de l’importance numérique de celles-ci, ce qui reviendrait à leur donner la majorité. Ceci conduirait inévita blement, remarque un des rédacteurs de l'Asie française, à ce que la France soit « gouvernée par ses sujets ». Et il prophétise des situations à la fois aber rantes et burlesques. « On verra d ’abord les Arabes décider du statut en France de la femme mariée, puis les Annamites réglementer la culture de la betterave dans la métropole, les Soudanais décider du régime de la pêche sur les côtes bretonnes, les Malgaches fixer le nombre des chaires au Collège de France et les élus du Congo, par l’appoint de leurs votes, rétablir quelques préfectures en des bourgs pourris». Il y a là, certes, une bonne dose de mauvaise foi. Mais il y a aussi la conscience que l’assimilationnisme radical est voué à l’échec. « Le véritable progrès, écrit le même auteur, est que tous ces peuples, sous la haute tutelle de la France, parviennent à s’administrer eux-mêmes, et non pas qu’ils nous commandent »33. C ’est justement ici que l’absence d ’un modèle évolutif se fait sentir. Le système français, estiment des commentateurs britanniques, peut satisfaire certaines élites franco phones, qui accèdent ainsi à un statut de parfaite égalité avec les Français ; en revanche, il impose aux peuples d ’outre-mer d’en accepter les charges (notamment le service militaire), et de renoncer plus ou moins totalement à leur identité ethnique, ce qui n’a rien de séduisant34. Mais l’extension même du statut de Dominion ne va pas de soi. En pratique, celui-ci a été réservé à des pays de population à majorité d ’origine européenne, et même anglo-saxonne, ou, du moins à forte minorité de Blancs autochtones, comme en Afrique du Sud. Lorsqu’il est envisagé d ’en étendre le bénéfice, c’est à l’égard de dépendances où régnent des situations analogues. Seule, en fait, l’Inde connaît des transformations qui semblent mener vers le statut de Dominion, réformes imitées plus timidement aux Indes néerlandaises. En revanche, il n’est guère envisagé de changements dans le Dependant Empire, qui est aussi un Coloured Empire, où la situation est comparable à celle qu’on observe dans les possessions françaises, les systèmes belges et portugais étant, avec un esprit différent, figés dans un immobilisme encore plus grand. Enfin, l’Angleterre et la France comptent sur d ’autres procédés pour transformer leurs liens avec les pays arabes sous mandat. Des Dominions avortés Le statut de Dominion est envisagé par les Britanniques à trois reprises, en Rhodésie du Sud, au Kenya, mais aussi en Palestine. Dans ces trois pays, une colonisation agressive réclame le droit à des institutions politiques 33. De La Brosse (P.-B.), « Un grave problème national devant la conscience française », Bulletin du Comité de l’Asie française, 1937, p. 106-108. 34. The Colonial Problem, p. 270-271.
Nationalismes et réformes
émancipées du contrôle de la puissance tutélaire. Certes, les situations ne sont pas les mêmes. L’idéal des cultivateurs de Rhodésie, ou des planteurs des White Highlands du Kenya, soucieux de gérer leurs affaires selon les principes de libéralisme économique et politique des institutions britan niques, n’a pas grand-chose à voir avec celui des immigrants sionistes, animés par la mystique de l'É tat ju if et volontiers imprégnés d ’idées socia listes. Quoiqu’il en soit, aucun de ces trois groupes ne peut obtenir une satis faction totale, les autorités britanniques, quelles que soient leurs sympathies, souvent profondes, pour les colons, étant obligées de tenir compte de la présence massive des populations autochtones. Les plus heureux sont les colons de la Rhodésie du Sud. Largement indé pendants sous le règne de la British South Africa Company, dissoute seule ment en 1922, ils obtiennent l’année suivante, un quasi-statut de Dominion, avec une Assemblée législative aux larges pouvoirs, à peu près totalement entre leurs mains. Si dans l’immédiat, aucune suite n’est donnée au projet d’une Fédération d ’Afrique centrale qui leur permettrait de prendre le contrôle des richesses minières de la Rhodésie du Nord, ces ambitions ne sont pas découragées par nombre de responsables conservateurs. Au Kenya, les planteurs, moins nombreux il est vrai, voient leurs ambitions bloquées par les fonctionnaires du Colonial Office, mais aussi par les revendications de la minorité indienne, soutenue par les fonctionnaires du puissant India Office. Une déclaration célèbre du secrétaire d ’État conservateur aux Colonies, le duc de Devonshire, proclamant en 1923 que les droits des Africains doivent primer, en cas de conflit, ceux des Européens (concept du native paramountcy), ruine en partie leurs ambitions, d ’autant plus que ce principe est réaffirmé en 1930 par le travailliste Lord Passfield. Dans le même esprit, les autorités britanniques s’opposent aussi au transfert des protectorats du Bechuanaland et du Swaziland à l’Union sud-africaine. Bien peu sont ceux qui, à la suite de Leo Amety, jugent que, même exclus du pouvoir politique et marginalisés sur le plan économique par le syndicalisme européen, les Noirs d ’Afrique du Sud progressent tout de même plus vite que sous le contrôle de fonctionnaires bienveillants. Il est vrai qu’il faudra attendre 1990 et la fin du White Power au Cap pour que cette phrase prenne toute sa signification33. En Palestine, le souci de pacifier le pays, ébranlé par de graves émeutes en 1920,1921 et 1929, mais aussi de ménager l’opinion arabe et musulmane de l’Empire, amène les autorités anglaises à s’opposer à faire de la Palestine un État (