Egypte et Méditerranées 2738471277, 9782738471277
Trois articles consacrés à l'Egypte ancienne et un à la Mésopotamie, quatre autres contemporains, pour conduire la
110 66
French Pages 180 [181] Year 1998
Polecaj historie
Table of contents :
Cover
ÉGYPTE ET MÉDITERRANÉES
Sommaire
Editorial
Citation preview
PubUée
Revue de l'association Méditerranées avec le concours de l'Université de Paris X
- Nantene
N° 17 - 1998
~
L'Harmattan 5-7. rue de l'École-Polytechnique 75005 Paris FRANCE
-
L'Harmattan Ine 55. rue Saint-Jacques Montréal (Qc) - CANADA H2Y lK9
L'illustration de couverture est extraite de l'Hypnerotomachia PoliphUi (le songe de PoliphUe) l, ouvrage de Francisco Colonna, écrit en 1467 et imprimé par le Vénitien Alde Manuce en 1499. @L'Harmattan, 1998 ISBN: 2-7384-7127-7 ISSN: 1259-1874
l
Curieuse fantaisie allégorique. en un mélange de latin et d'italien (avec des passages en grec et en hébreu) ; l'ouvrage. illustré de belles gravures sur bois d'un artiste inconnu. est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs livres illustrés de la Renaissance.
Membres
Comité
d'honneur : Guillaume CARDASCIA (professeur émérite d'Histoire Jean GAUDEMET (professeur émérite d'Histoire Jean IMBERI' (membre de l'Institut)
- Université
Paris II
- Assas)
du Droit
- Université
Paris II
- Assas)
de rédaction:
Responsable de la publication: Jacques BOUINEAU (professeur d'Histoire Comité
du Droit
de lecture: Jacques PHITILIS (professeur Eric BOURNAZEL (professeur Jacques LAFON (professeur Sophie LAFONT
du Droit
- Université
Paris X - Nanterre)
d'Histoire
du Droit
- Université
de Limoges)
d'Histoire
du Droit
- Université
Paris X
d'Histoire du Droit
- Université
- Nanterre)
Paris I - Panthéon-Sorbonne)
(professeur d'Histoire du Droit - Université de Versailles-Saint-Quentin) Jean-Louis GAZZANIGA (professeur d'Histoire du Droit - Université de Toulouse) Bernadette MENU (directeur de recherches au C.N.R.S) Jean-Marie DEMALDENT (professeur de Sciences Politiques - Université Paris X - Nanterre) Marie-Luce PAVIA (professeur de Droit Public - Université de Montpellier I) Pierangelo CATALANO (professeur de Droit romain - Université "La Sapienza" de Rome) Jeanne LADJILI (maître de conférences d'Histoire du Droit - Université de Tunis) Secrétaire de rédaction: Philippe-Jean QUILLIEN (chercheur)
.Am:ouw eL; (l!éAJj~
!7OtM'/de-llLCtk/ IY;ymdaie/lL, ~ la k£l-la-é7LeI~ cP ()/h
~/ WYflLé7
/.
J'/ 'elWOlYlUf
. /, ,,/I;, .rOttJ'/ {mi CI£t/ tZOftf/ (UlL,
à tl'aOel~f/t~ 0elta /lot/. L'article 7 ne prévoit de traitement de l'Etat qu'en faveur du clergé chrétiens. Sur la portée de ces textes voir P. Bastid, Les institutions de la parlementaire française (1814-1848), Sirey, 1954, pp. 366-369.
15
Le député du Jura, Bouvier, devait demander à la Chambre des députés de supplier le roi de déposer un projet de loi devant cette dernière sur l'observance extérieure du repos dominical. Séance de la Chambre des députés du 30 juin 1814, Moniteur universel du 1er juillet 1814, p. 724. 11 devait assez curieusement légitimer le repos dominical en citant le contrat social de Rousseau: «Jamais Etat ne fut fondé que la religion ne lui servit de base >, séance de la Chambre des députés du 5 juillet 1814, Moniteur universel du 6 juillet 1814, p. 745. La question revînt devant la Chambre à cause d'une pétition de deux négociants qui contestaient la validité de deux ordonnances du directeur général de la police qui leur avait imposé le respect d'un règlement de 1782 sur la fermeture le dimanche. La commission de la Chambre alerta contre de tels errements et demanda le dépôt, par le roi, d'un projet de loi sur le repos dominical, séance de la Chambre des députés du Il juillet 1814, Moniteur universel du 12 juillet 1814, pp. 769 et ss. Finalement le projet royal sera déposé et adopté sans discussion après le rapport de la commission de la Chambre des députés, séance du 8 octobre 1814, Monüeur universel du 9 octobre 1814, pp. 1137-1138 ainsi que séance de la Chambre des députés du 14 octobre 1814, Moniteur universel du 15 octobre 1814, pp. 1161 et ss. La proposition du roi devait être adoptée par la Chambre des pairs, séance de la Chambre des pairs des 27 juillet 1814 et 9 et 16 août 1814, Moniteur universel du 4 septembre 1814, p. 993.
du 7 thermidor
an VIII (26 juillet prévoit
simplement
1800), Duvergier, que le repos
op. cit.. vol XII,
des fonctionnaires
sa religion L'article 6 la religion des cultes monarchie
141
Olivier Tholozan
d'Etat, pour prescrire les marques extérieures de respect que les citoyens de tous les cultes lui doivent »16. Pourtant, ce texte devait être un compromis entre les groupes catholiques et libérauxl7. Il frappait, comme le texte révolutionnaire, les activités visibles par le publicl8. Les contrevenants s'exposaient à une punition qui pouvait aller jusqu'au maximum des peines de policel9. Mais les exceptions au principe étaient plus nombreuses que dans la loi révolutionnaire sur les décadis20 et visaient surtout à préserver le monde rural des risques de l'incroyance21. Pourtant, la pratique dominicale, que la loi visait à encourager, devait diminuer dès la monarchie de juillet22. A partir de ce moment là, les pratiquants avouent de plus en plus, lors d'enquêtes faites par des évêques, qu'ils violent l'obligation du repos dominical23. Cette désaffection religieuse est essentiellement le fait des hommes24. Le monde ouvrier n'est pas systématiquement soumis au travail dominical. Ce demier est surtout le fait de la grande industrie dans laquelle le repos est le lundi25. Parfois, sans qu'il y ait travail à proprement parler, la coutume est, notamment dans le nord, de
16 17 18
Séance de la chambre des députés du 14 octobre 1814, Moniteur universel du 15 octobre 1814, p. 1161. R. Beck, op. cit.. pp. 159-167. L'article 2 de la loi visait à masquer à la vue du public toute activité marchande ou à proscrire toute transaction commerciale sur la voie publique. Il frappait les marchands, colporteurs et étalagistes, artisans et ouvriers ainsi que les voituriers et charretiers.
19 L'article 6 de la loi le prévoyait en cas de récidive. 20 Les exploitants de débits de boissons et de salles de jeux n'étaient
21
soumis à la loi que dans les villes de cinq mille habitants ce qui excluait les grandes villes (article 3 de la loi). La loi ne s'appliquait pas aux marchands de comestibles de toutes natures, voituriers de commerce, chargements de commerce maritimes, aux usines dont le service ne pouvait être interrompu sans dommage, aux postes, métiers du service de santé, aux travaux urgents de l'agriculture. Surtout l'autorité administrative pouvait également étendre les exceptions à la loi ne se fondant que sur les usages locaux. Le fait que la loi ne vise que les cabaretiers et tenanciers de salle de jeux des villes de moins de cinq mille habitants (cf. note supra) est très révélateur. D'ailleurs le député Bouvier avait déposé un projet abandonné, qui visait à toucher les cabaretiers et salles de jeux des villes de plus de 10000 habitants, ref. cil..
22
L'appréciation de cette baisse de la pratique religieuse est différemment appréciée selon les auteurs. Pour certains il s'agit d'une chute très progressive, J. Le Goff et R. Rémond (sous dir. de), Histoire de la France religieuse. XVIIf'"'e_X/X."'"" siècle, Paris, Seuil, 1991, T. III, p. 241. Mais R. Beck parle dès 1830 d'une« explosion du travail dominical», op. cit., p. 181.
23
Voir les enquêtes in F. Boulard, Matériaux pour l'Histoire religieuse du peuple Français,
24 25
J. Le Goff et R. Rémond,
op. cit., p. 240.
R. Beck,
et ss.
142
2 tomes, ed. de l'EHESS, F.N.S.P.. ed. du CNRS, 1982, T. I et 1987, T. II. Dans le tome I : Diocèse de Blois, p. 73 : Diocèse de Laval, p. 330 : Diocèse du Mans, p. 340 ; Diocèse de Luçon (qui semble le moins mal loti bien que les enquêtes utilisent des qualificatifs modestes pour parler de la pratique dominicale), pp. 364-365. Dans le tome II : Diocèse de Coutances, p. 69 : Diocèse de Metz, p.143 ; Diocèse de Saint-Dié, p. 169; Diocèse de Strasbourg, p. 550. op.
cil.,
pp.
186
Le débat juridique
sur le repos dominical
dans la France duXIXI11C siècle (1830-18801
procéder, le dimanche, au nettoyage des machines26. Le travail dominical touche également les activités des transports des services27 et du commerce28. Dans les campagnes, la violation du repos le dimanche arrive régulièrement29. Mais cette tendance ne s'étendra au monde rural que sous la seconde république30. L'Eglise de France est bien consciente du problème de la déficience de la pratique dominicale, comme en témoigne l'oeuvre du repos du dimanche créée en 1854 qui possède un bulletin «l'observateur du dimanche .31. Le clergé va alors mener une véritable «croisade religieuse. pour le respect du dimanche32. Certains en ont parfois conclu que la loi de 1814 ne devait plus être appliquée après la restauration33. Les tables décennales des recueils de jurisprudence Dalloz et Sirey témoignent pourtant du contraire34. Cette obligation ne sera en fait définitivement abrogée qu'en 188035, au début de la période de combat pour la laïcisation républicaine. Pourquoi entre 1814 et 1880 le droit s'est-il imposé à l'encontre de la pratique sociale? Pour comprendre ce contraste entre la vie quotidienne et la régulation juridique, il faut retracer la mise en place du débat juridique sur la 26 27 28 29
30 31 32 33
P. Pierrard, L'église et les ouvriers en France (1840-19401, Hachette, 1987, p. 57. R. Beck, op. cit., p.191. Ibid., p. 195. Sur le respect limité du repos dominical dans le monde rural voir G. Duby et A. Wallon (sous dir. de), Histoire de la France mrale. Apogée et crise de la civilisation paysanne 1789-1914, Paris, Seuil, 1976, T. III, pp. 334-335. R. Beck, op. cü., p. 183. P. Pierrard, op. cü., p. 56. R. Beck, op. cit.. pp. 246 et ss. Voir en ce sens H. Cazenave, op. cit., p. 13; G. Friedel, « Les vicissitudes du principe et plus du repos hebdomadaire', Droit social, Décembre 1967, n° 12, pp. 616-624 récemment G. Aubin et J. Bouveresse, Introduction historique au droit du travail, P.U.F/Droit fondamental, 1995, p. 117, n0137; R. Beck, op. cit., pp. 165-167. D'autres auteurs remarquent la persistance de la loi après 1830 sans véritablement l'expliquer. Ainsi, P. Bastid note la résistance de la Cour de cassation à la pression pour l'abrogation de la loi après 1830, cf. P. Bastid, op. cit.. p. 370. P. Barreau n'hésite pas à critiquer l'attitude partiale des juges et à considérer que la loi de 1814 devait être abandonnée dès la seconde république, tout en reconnaissant que des poursuites
sporadiques auront lieu sous le second empire, P. Barreau, « Naissance mouvementée du droit au repos hebdomadaire », Cahiers de l'Institut régional du travail, Université 34
d'Aix-Marseille 11, 1993, n04, pp. 3-23. Verbo Jours férié. Même s'il est vrai qu'au cours du XIXème siècle la jurisprudence s'amenuise, il n'en demeure pas moins que jusqu'en 1880 la loi de 1814 fait l'objet de décisions de justice favorables à son maintien. Au demeurant, les poursuites n'étaient pas toujours mues par un civisme exemplaire. 11 devait arriver, comme en témoigne l'exemple d'Arles, que la loi de 1814 fût utilisée pour chasser les marchands ambulants
qui pouvaient faire ombrage aux commerçants
locaux. Voir Michel Baudat,
fêtes publiques à Arles au XIXème siècle', à paraître dans rmmicipa1es d'Arles. Je remercie Michel Baudat de m'avoir version dactylographiée de son texte.
35
Loi du 12 juillet
le Bulletin amicalement
« Religion
et
des archives donné une
1880.
143
Olivier T/wlozan
licéité
du
expliquer
repos
dominical
la persistance
de son importance
pour
(1ère partie) et en la monarchie de juillet (Hèmepartie). La question, au delà 1848 et 1880
sous
entre
comprendre
certain pour celui qui s'intéresse code du travail selon lequel:
le XIXème siècle français,
à la genèse de l'article Le repos hebdomadaire
recèle
un intérêt
L. 22 I -5 de l'actuel doit être donné le
dimanche.
I. La mise en place du débat juridique sous la monarchie de juillet A) La contestation
du repos
sur le repos dominical
dominical
La charte de 1830 devait abandonner le statut de religion d'Etat en faveur du catholicisme. Dans son article 5, elle rappelait l'égalité de protection des cultes. Cependant l'article 6 ne parlait de rétribution de l'Etat qu'à l'égard du catholicisme, « religion de la majorité des Français ", et des autres cultes chrétiens. Dupin aîné, l'un des promoteurs du nouveau texte, interprétait
cette expression
comme un rétablissement
«
des termes du Concordat
de
l'an IX et de la loi organique de la loi de germinal an X ,,36. Une telle solution aurait dû aboutir, au minimum, à abroger les dispositions de la loi de 1814 qui imposaient le repos dominical aux particuliers et ne permettre le maintien de ce texte qu'à l'égard des autorités constituées et des fonctionnaires publics, comme sous la fin du consulat et le premier empire. D'autant que les articles 59 et 70 de la charte prévoyaient l'abrogation implicite des lois et ordonnances passées, contraires aux nouvelles dispositions de la charte. La solution n'aurait pas été incompatible avec l'hostilité religieuse de la monarchie de juillet puis la neutralité des débuts du nouveau régime37. D'ailleurs, la thèse de l'abrogation implicite de la loi de 1814 parut si évidente, que le tribunal de police de Laon la consacra, dès 1831, alors qu'il se prononçait sur le cas d'un marchand qui exposait ses marchandises à la vue du public un dimanche. Le juge devait estimer que la charte de 1814 avait conféré à la religion catholique « un droit, un privilège" en la reconnaissant comme la religion de l'Etat. L'article 7 de la charte de 1830 en supprimant cet
avantage, avait implicitement abrogé la loi de 1814 qui rompait cultes ,,38. Mais en l'espèce, 36
elle allait encourager
les libéraux
« l'égalité
des
anticléricaux
à
37
2ème série. T. LXIII, p. 56. En fait la monarchie Archives parlementaires, de juillet devait aller plus loin en subvenant aux besoins du culte israélite (loi du 8 février 1831), P. Bastid, op. clt.. p. 370. P. Bastid, op. cit., pp. 369-370 ; B. Basdevant-Gaudemet. Lejeu concordataire dansla
38
France du ~me siècle. Paris. P.U.F.. 1988. p. 10 ; G. Choh'Yet Y-M Hilaire. Histoire religieuse de la France contemporaine 1800/1880, Toulouse, Privat. 1985. vol. J, p. 34. Trib. de police de Laon. 8 mars 1831. (Rondeau), S. 1831. 2. 93-94.
144
Le débat juridique
sur le repos dominical
dans la France du XJXème siècle (1830-1880)
combattre ce qui pouvait leur apparaître comme le demier vestige d'une quelconque préséance catholique. Ainsi en 1832, le député Auguste Portalis, hostile dès la Restauration à toute religion d'Etat39, devait proposer à la chambre l'abrogation de la loi de 1814 qu'il qualifiait sarcastiquement de «loi qui oblige tous les habitants, quelles que soient leurs croyances, à rester dans l'oisiveté, sous peine d'amende et de prison, les jours de dimanche et fêtes »40. Ce parlementaire devait faire remarquer que la loi ne pénalisait que certains travailleurs. Elle ne touchait pas les avocats, médecins ou hommes de lettres qui pouvaient continuer leur travail chez eux, à l'abri du regard public que la loi cherchait à contrôler4l. Le député Parant confortait la thèse de l'abrogation de l'obligation du repos le dimanche, en rappelant que le samedi était le jour de repos des israélites et que la loi gênait le respect de ce culte42. Quant à Dupin aîné, il devait renforcer le camp des partisans de la suppression de la loi de 1814. Il allait tirer les conséquences de son interprétation concordataire de l'article 7 de la charte de 1830. Il prônait la suppression des seules dispositions de la loi de 1814 qui visaient à interdire le travail dominical aux autres personnes que les autorités constituées et les fonctionnaires43. Quant à Garnier Pagès, il devait tenter une réinterprétation de la notion de majorité qui fondait la préséance catholique. Revenant sur le mythe rousseauiste de l'infaillibilité de la volonté générale, il devait opposer les majorités «morales », vertueuses,
favorables à l'égalité des cultes, toujours préférables aux majorités « réelles» strictement démographiques 44. Cette demi ère argumentation allait être prise à contre-pied. Le gouvemement, en la personne de Montalivet, alors ministre de l'instruction publique et des cultes, était réticent à la suppression du
39
Auguste Portalis (1801-1855), neveu du ministre napoléonnien. En 1831. il siège à l'extrême gauche de la chambre des députés, Procureur général près de la Cour d'appel de Paris après 1848, Fimin Didot Frères, Nouvelle Biographie UniverseUe, Paris, 1866, Vol. 40, p. 858. Il devait rédiger en 1826 un opuscule hostile à la religion d'Etat intitulé «
Mémoire en faveur de la liberté des cultes », Paris, 1826. Ce dernier avait obtenu le
prix du comte de Lambrechts décerné au meilleur mémoire favorable à la liberté des cultes devant la société de la morale chrétienne, grâce à un rapport de Guizot. Dans cet
ouvrage l'auteur démontrait
que la liberté des cultes était un
« droit
naturel»
que tout
gouvernement légitime devait protéger, op. cit. p. 22. Il devait faire preuve d'un antirousseauisme en écrivant: «Je ne reconnais pas la loi faite dans l'intérêt d'une majorité quelque grande qu'elle puisse être... Ceux qui ne craignent point d'accorder à la majorité le droit d'oppression approuvent donc le massacre de peuples entiers», ibid.. pp. 25-26. Il en tirait comme conséquence le rejet de la religion d'Etat, ibid., pp. 29 et ss. 40
Séance de la Chambre 1832,p.426
41 42 43 44
Ibid. Eod. loe... Ibid., p. 427-428. Séance de la chambre 1832, p. 428.
des députés
du Il février 1832, Moniteur
universel
du 12 février
des députés
du Il février
Universel
du 12 février
1832, Moniteur
145
Olivier T/wlozan
dimanche chômé. Il faisait valoir deux arguments. D'abord, la nécessité de la loi lui paraissait découler d'une réalité statistique: la majorité des Français était bien catholique. Dès lors, Montalivet estimait que la loi de 1814 était un « ménagement.. du sentiment religiewc45. Ensuite, il s'appuyait sur le fait que la loi n'imposait pas aux citoyens de célébrer le culte catholique le dimanche. Ceci l'amenait à conclure que le repos dominical pouvait être également conçu comme une simple obligation civilé6. La proposition d'abrogation explicite de la loi de 1814 n'aboutit pas. Mais le débat de 1832 encourageait certains juristes à défendre la thèse de l'abrogation implicite. C'est dans ce sens que devaient se prononcer aussi bien un conseiller de la cour de cassation comme M. Carnot en 183647 que des auteurs de la doctrine pénaliste aussi éminents que Chauveau et Hélie en 1837 dans leur «Théorie du Code Pénal..48. en invoquant notamment le problème du repos des israélites49. Quant à Duvergier, il devait conclure sans hésitation à l'abrogation de la loi de 1814 en se fondant sur la décision du tribunal de Laon50.
B) Le maintien
de l'obligation
du repos dominical
Finalement, la Cour de cassation fut saisie du problème en 1838, à propos d'un cas classique d'un cabaretier contrevenant au repos dominical et qui avait été relaxé par le tribunal de police. Le pourvoi introduit par le ministère public visait à fIxer le droit en la matièreSl. L'avocat général HelIo devait prononcer un chaud réquisitoire en faveur de l'abrogation implicite52. Il soutenait que la charte de 1830 avait reconnu le « devoir constitutionnel de protéger les cultes... Celui-ci impliquait pour HelIo que l'Etat assure une «réciprocité d'égards.. et empêche tout «privilège pour un seul culte... L'abrogation implicite découlait pour le magistrat de la disparition des
circonstances
qui avaient suscité le vote de la loi de 1814 et de la
constitutionnelle.. ayant inspiré la charte. Pourtant, les magistrats de la Cour de cassation devaient maintien de la loi sur le dimanche chômé. Ils considéraient
dispositions de la loi de 1814 pouvaient 45 46 47 48 49 50 51 52
146
« facilement
« raison
décider le que les
se concilier.. avec l'article
Ibid. p. 426. Ibid.. p. 427. M. Carnot. Commentaire sur le code pénal, 2émeed.. T. 1.. pp. 714 et 720. A. Chauveau et F. Hélie. Théorie du code pénal. Paris. 1837. T. IV. p. 512. A. Carnot. op. cit.. p. 720 et A. Chauveau op. cit.. p. eod. loco J-B. Duvergier. op. cit..(1827 sic). T. XIX. p. 239-240. note 2. Crim.. 23juin 1838 (Vitrac). S. 1838.1. 502 et D. P. 1838. 1. 267. Texte du réquisitoire in ref. précitée. Charles Guillaume HelIo (1787-1850). Député à la chambre des cents jours. Avocat général puis conseiller à la Cour de cassation ainsi que député du Morbihan sous la monarchie de juillet. M. Prévis et Roman d'Amat. Dictionnaire de biDgraphiefrançaise. Paris, 1951, T. XVIII. p. 863.
Le débat juridique
sur le repos dominical
dans la France dlL ~me
siècle (1830-18801
5 de la charte de 1830, rejetant ainsi l'opinion de Chauveau et Hélie selon laquelle ces deux textes affirmaient «deux principes contraires, qui ne »53. peuvent vivre ensemble, dont l'un doit absorber l'autre De plus, la Cour estimait que la protection des cultes n'excluait pas «le respect dont la loi civile est partout empreinte pour le culte de la majorité des Français ». Cette assertion se fondait sur une assimilation contestable. La Cour soutenait, en effet, que l'interdiction du travail dominical faite aux fonctionnaires, ainsi que les dispositions des codes de procédure civile et de commerce qui interdisaient tout acte judiciaire le dimanche, avaient le même caractère que la prohibition de la loi de 1814. Au fond, la Cour niait la distinction opérée par le concordat entre repos dominical obligatoire pour les autorités constituées, les fonctionnaires et la suspension facultative du travail pour les citoyens le dimanche, tant prôné par les tenants de l'abrogation implicite. Pourquoi cette réticence ? Il faut d'abord rappeler que par crainte de bouleverser de manière trop brusque la législation, la Cour de cassation s'opposera, tant sous la restauration que sous la monarchie de juillet, à l'abrogation implicite d'autres lois anciennes pourtant non conformes au principe de l'égale protection des cultes garanti par l'article 5 des chartes de 1814 et 183054. En ce qui conceme la loi de 1814, l'inertie de la chambre des députés en 1832 a certainement dissuadé les juges de se prononcer là où le législateur n'avait voulu rien faire. Surtout, les magistrats de la Cour de cassation devaient craindre de susciter un bouleversement qui aurait remis en cause la tentative de la monarchie de juillet de rapprochement du régime vers la religion, à l'approche des années 184055. De fait, la cour de cassation a voulu, en 1838, éviter un bouleversement trop révolutionnaire de la législation alors que les gouvemants de la monarchie de juillet étaient préoccupés par l'obsession du siècle: arrêter la Révolution56. Pourtant, la décision de la Cour de cassation ne devait pas clore le débat. De fait le repos dominical était également une mesure de protection socialeS7. Aussi, la question de la conformité de la prohibition du travaille 53 54
55 56 57
Op. cit.. p. 513. J-L Mestre, «La Cour de cassation et le contrôle de la constitutionnalité. Données historiques ", La Cour de cassation et la constitution de la république, Actes du colloque des 9 et 10 décembre 1994 organisé par la Cour de cassation et le Groupe d'Etudes et de Recherches sur la justice constitutionnelle de l'Université de Droit, d'Economie et des Sciences d'Aix-Marseille, P.U.A.M. pp.49-55. G. Cholvy et Y. M. Hilaire, op. cit.. p. 35. Sur ce thème comme explication de l'instabilité constitutionnelle au XIXème siècle, voir F. Furet, La Révolution (1770-18801, Paris, Hachette, 1988, 2 vol. Cette idée se retrouve tant chez des hommes que l'on pourrait classer à gauche comme Sismondi ou Proudhon (R. Beck, op. cit., pp. 256-259) que chez ceux de droite comme le libéral C. Renouard, cf. son rapport sur la loi de 1841 sur le repos des enfants, séance de la chambre des députés du 25 mai 1840. Moniteur universel 1840. pp. 1292 et ss..
147
Olivier T/wlozan
dimanche, par rapport aux principes de la charte de 1830, devait resurgir en 1840, lors du débat parlementaire sur la loi du 22 mars 184158 relative à la limitation du travail des enfants59. En effet, l'article 4 du texte prévoyait que les enfants au -dessous de seize ans ne pourraient être employés les dimanches et les jours de fêtes reconnus par la loi. Le rapporteur Renouard avait avoué s'inspirer de la loi de 181460. Cette disposition avait d'abord suscité l'opposition du député Luneau. Ce demier rappelait que la charte ayant supprimé la religion d'Etat, l'imposition du dimanche comme jour chômé devait être rejetée. Il devait proposer une formulation de l'article 4 plus neutre: « Les enfants de moins de seize ans ne pourront être employés plus de six jours par semaine ,,61. Il était soutenu par A. Portalis qui rappelait son action en faveur de l'abrogation de la loi de 181462. Le ministre de la justice et des cultes, Martin du Nord, hostile à l'amendement, devait alors faire valoir que bien que le repos dominical gênât la religion hébraïque, celle-ci était minoritaire en France63. Cette position allait recevoir l'appui inattendu du député Fould d'origine
israélite. Ce demier devait ainsi se prononcer:
«
La charte de 1830 a donné
aux cultes dissidents toutes les garanties qu'ils pouvaient désirer, et quant au culte dont je fais partie, il s'estime heureux des changements qui ont été apportés dans la législation... Nous habitons un pays où le dimanche est férié, c'est à nous à suivre les usages. Le dimanche est fêté par la plus nombreuse partie de mes coreligionnaires; tous ceux qui ont reçu quelque éducation religieuse et morale comprennent que fêter la divinité le samedi ou le dimanche est indifférent ,,64. Cette déclaration devait entraîner le rejet de l'amendement Luneau. Pourtant, ce n'était que la déclaration d'un notable israélite65 qui, à l'image de son groupe social, devait témoigner une
58
Duvergier,
59
Sur cette inflexion
op. cit., vol XLI, p. 46.
idéologique
que représentait
du 22 mars 1841. Un débat parlementaire:
60 61 62 63 64 65
148
la loi voir l'étude
de P. Sueur,
«
La loi
l'enfance protégée ou la liberté offensée
_,
Histoire du droit social. Mélanges en hommage à J. Imbert, Paris, P.U.F., 1989, pp. 494 et ss. Sur la bibliographie relative à ce texte voir en sus de l'étude de P. Sueur, G. Aubin etJ. Bouveresse, op. cit., p.165-166, n° 202. Rapport Renouard, ref. précit. Voir son intervention, Séance de la Chambre des députés du 26 décembre Moniteur universel des 26 et 27 décembre 1840, pp. 2526-2527.
1840,
Ibid.. p. 2527. Eod. loco Eod. loco Achille Fould, (1800-1867), Banquier puis député des hautes Pyrénées en 1842, Ministre d'Etat sous le second Empire, M. Mourre, Dictionnaire encyclopédique d'histoire, D-H, Bordas, 1996, p. 2182.
Le débat juridique
indifférence pour totale rupture66. Finalement définitivement
le respect le
acquis
dans la France duXIX."'"e siècle (1830-18801
sur le repos dominical
maintien malgré
de sa religion de
sans
l'obligation
l'opinion
partagée
pour du
autant repos
de la doctrine
aboutir
à une
dominical
était
sur le sujet67.
La chambre
des députés comme celle des pairs devait admettre l'application de la loi de 181468. solution confirmée en 1845 par la cour de cassation69.
II. La persistance 1848 et 1880 Al La seconde
réémergence
de l'obligation
du débat
sur
du repos
le repos
dominical
dominical
entre
sous
la
république
Le débat devait rebondir sous la seconde république. C'est que dès 1848 la monde rural. majoritaire dans la France du milieu du XlXèmesiècle, allait basculer dans le camp de ceux qui travaillent le dimanche70. Cette évolution de la mentalité devait être rapidement prise en compte par le pouvoir. En effet, dès le gouvemement provisoire. une circulaire du 24 mars 184871du ministre de l'intérieur Ledru Rollin remettait en cause la solution dégagée par la Cour de cassation sous la monarchie de juillet. Le ministre demandait aux préfets de ne pas appliquer la loi de 1814. Il affirmait que cette 66
G. Cholvy et Y-M Hilaire. op. cit.. pp. 216-219. fait mais depuis la restauration la population législation dérogatoire,
67
En faveur de la thèse de l'abrogation implicite de la loi de 1814 voir la note hostile de Villeneuve sous l'arrêt Vitrac. S. 1838. 1. 510, ainsi que les opinions d'un maître des requêtes au Conseil d'Etat, C. A de Vuillefroy. Traité de l'Administration du culte catholique, Paris. 1842, pp. 390-391 ; G. Massé. Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil, Paris, 1845, T. II. n° 407 ; D. Serrigny (Professeur de droit administratif à la Faculté de droit de Dijon), Traité de droit public des Français. 1846, T. I. p. 582 et ss. ; L. Charles François Dufour (fils de G. Dufour, avocat général à la la Cour impériale de Bordeaux) Traité de la police extérieure des cultes, Paris. 1847, vol I. p. 313 et celle de l'avocat N. M. Le Senne, Condition civile et politique des prêtres, Paris, 1847. pp. 263, 280-281.
L'Alsace faisait exception à cet état de juive de cette région bénéficiait d'une
Pour des opinions défavorables à l'abrogation implicite voir la note du recueil Dalloz sous l'arrêt Vitrac, D.P. 1838. 1. 267 ; Mgr Affre, Traité de l'administration temporelle des paroisses. Paris, 1842, p. 448; Foucart (Professeur à la Faculté de droit de Poitiers), Eléments de droit public et administratif, Paris, Videcoq. T. l, n° 57 ; A. Morin, De la discipline des Cours et des tribunaux, éd. Cosse et N. Delamote, Paris, 1846, T. II, Le droit civil ecclesiastiquefrançais, ancien et moderne, n° 611 ; Gilbert de Champeaux, Paris, 1848, T. II, p. 472.
68
69 70 71
L'attitude des deux Chambres devait être fixée lors de plusieurs pétitions de citoyens qui se plaignaient que la loi de 1814 fût trop souvent ignorée, séance de la Chambre des députés du 19 février 1842, Moniteur universel du 20 février 1842, p. 345 et séance de la Chambre des pairs du 3 juin 1843, p. 1356, séance de la Chambre des pairs du 28 février 1844, Moniteur universel du 29 février 1844, pp. 441-442. Crim.. 6 décembre 1845 (Subra) et (Théron). DP. 1846. 1.27-28. et S. 1846. 1. 38. R. Beck. op. cit., p. 183. D.P. 1848.3.81-82.
149
Olivier Tholozan
religion d'Etat ». Il devait estimer que ce texte était incompatible avec « le régime de la demière
avait
été prise
sous
un gouvemement
qui prônait
« la
liberté des cultes» qui permettait aux citoyens « de travailler lorsqu'ils le jugent à propos ». Certainement sensibilisé par la crise économique qui régnait alors, le ministre devait également invoquer la contradiction entre la loi de 1814 et le principe de la liberté de l'industrie72. Les défenseurs du dimanche chômé vont rapidement réagir en déposant devant le comité du travail de l'assemblée nationale législative des propositions visant à interdire le travail dominical. Le gouvemement devait alors répondre prudemment sans vraiment revenir sur sa position. Une circulaire du ministère de l'agriculture et du commerce du 18 septembre 1848 enjoignait aux préfets de lancer une enquête sur le maintien ou la modification de la loi de 181473. L'attitude des constituants ne permettait pas d'infirmer cette position gouvemementale. L'article 7 de la constitution du 4 novembre 1848 prévoyait l'égale protection des cultes. Mais les constituants de la seconde république devaient adopter une rédaction plus libérale que ceux de la monarchie de juillet puisqu'ils prévoyaient que l'Etat octroierait un traitement aux ministres des cultes reconnus actuellement ou à l'avenir par la loi. Cette rédaction avait visé à contenir les prétentions de ceuxqui souhaitaient la suppression de la notion de culte reconnu ou une séparation de l'Église et de l'Etat74. Quoiqu'il en soit, elle témoigne d'un souhait de l'Etat de témoigner un égal égard à l'encontre de tous les cultes. La loi de 1814 n'était-elle pas un frein à une telle aspiration? La position du pouvoir sur la question allait rapidement l'indiquer. Dès 1849, une circulaire du ministère des travaux publics devait décider que les ouvriers des ateliers nationaux ne travailleraient pas le dimanche75. Ce texte, combiné avec la circulaire de 1848 du ministère de l'intérieur, montrait que le gouvemement de la seconde république avait adopté une position typiquement napoléonienne en matière de repos dominical. Cette position ne devait pas être démentie par l'assemblée nationale législative. Cette demière ne donnait pas suite à la proposition de Montalembert sur le rétablissement de l'obligation du repos dominical faite à tous les citoyens, pour obvier à l'inapplication de la loi de 181476. 72 73 74 75 76
150
Le ministre parle "des entraves au libre exercice des professions utiles eod. loco " Circulaire du ministère de l"agriculture et du commerce du 18 septembre 1848. D.P., 1848. 3. 99. P. Bastid. Doctrines et Institutions politiques de la Seconde République, Paris, Hachette, 1945, T. II, p. 88. Circulaire
du 20 mars
1849, D.P. 1849. 3.46.
Voir le rapport Montalembert, séance de l"Assemblée nationale législative du 10 décembre 1850, Moniteur universel du 10 décembre 1850, pp. 3530 et ss.. Cette proposition prévoyait des innovations importantes. Notamment, l"article 4 du texte de Montalembert prévoyait la prohibition d'une clause d'un contrat par laquelle le patron stipulerait la continuation du travail le dimanche et les jours fériés. Montalembert écartait le principe de la liberté des contrats, qui prévalait alors, en invoquant l"ordre
Le débat juridique
sur le repos dominical
dans
la France du x.JXè"'e siècle (1830-1880)
Pourtant, la Cour de cassation ne devait pas suivre la position gouvemementale en se prononçant, en 1850, dans le cas d'une cabaretière contrevenante à l'interdiction du travail le dimanche, relaxée par le tribunal
de police
77,
Les juges devaient à nouveau rejeter la thèse de l'abrogation de la loi de 1814, interprétant l'article 7 de la constitution de 1848, Ils estimaient, à nouveau de manière contestable sur le plan de la logique juridique, que la loi de 1814 qui consacrait« le respect dû aux cultes chrétiens» n'empêchait point « le libre exercice des autres cultes ». Au surplus, les juges de cassation devaient revenir sur l'interprétation du ministère de l'intérieur de 1848. Les magistrats affirmaient que le repos dominical n'entravait point la liberté du commerce visée par l'article 13 de la constitution de 1848, reprenant une solution admise par la chambre des pairs était au demeurant conforme de la monarchie de juillet 78, Cette interprétation à l'idée que se faisaient les révolutionnaires et les hommes du XIXèmesiècle de cette liberté. Celle-ci amenait l'Etat à interdire la reconstitution d'entités comparables aux corporations d'ancien régime79, tout en encadrant l'activité de l'industrie pour qu'elle ne porte pas atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs80. La Cour devait également rejeter un argument plus fantaisiste selon lequel la loi de 1814 portait atteinte au droit de s'assembler, visé à l'article 8 de la constitution de 184881 ; de fait la loi n'interdisait pas à des buveurs de se réunir pour se laisser aller aux joies de l'alcool. mais ne visait que le travail de la cabaretière le dimanche. Cette nouvelle réticence de la Cour de cassation à l'égard de la thèse de l'abrogation de la loi de 1814 semble d'abord s'expliquer par le manque de clarté de l'assemblée nationale législative quant au sort à réserver à cette loi.
77 78
79
80 81
public et la limitation nécessaire de la liberté du travail, ibid, p. 3533. Montalembert voulait également appliquer l'interdiction du travail dominical aux villes de 3000 âmes pour récupérer les campagnes au profit du catholicisme, eod. loc, Crim., 21 décembre 1850 (Laviec), D.P. 1851.1. 280etS. 1851. 1. 459. Voir l'intervention du rapporteur de la commission des pétitions de la Chambre des pairs, séance de la Chambre des pairs du 28 février 1844, Moniteur universel du 29 février 1844, p. 442. A Plessis (sous dir.), Naissance des libertés économiques. Liberté du travail et liberté d'entreprendre: le décret d'Allarde et la loi Le Chapelier, leurs conséquences, 1791:fin du XJXi'me siècle, Institut d'histoire de l'Industrie-Ministère de l'industrie, P,A.U., 1992, voir en particulier les communications de J. Imbert sur le décret d'Allarde et de A Lefèbvre-Teillard qui montrent le contrôle de l'Etat sur les sociétés anonymes, voir également sur ce point, du même auteur, La société anonyme au XJXi'me siècle, Paris, P.U.F., 1985. Sur le contrôle de l'Etat sur l'industrie. voir G. Aubin et J. Bouveresse. op. cit.. p, 88, n° 101. La Cour devait parler improprement de principe de la libre association. Cette erreur provient du fait que l'article 8 de la constitution de 1848 prévoit le droit de s'assembler juste après la libre association. 151
Olivier T/wlozan
Ainsi, les juges devaient invoquer le fait que ce texte n'avait été" ni expressément ni tacitement abrogé ». Au demeurant, la cour devait être impressionnée par la déférence que le régime conservait à l'égard du catholicisme, vraisemblablement issu tant du ralliement de l'Eglise catholique à la république conservatrice après les joumées de juin82 qu'au retour des monarchistes à l'assemblée après les élections de 1849. L'assemblée monarchiste, issue des élections de 1849, devait conforter la position de la Cour de cassation. Le législateur allait inscrire dans la loi du 22 février 1851 sur le contrat d'apprentissage que" le dimanche et jours de fêtes reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession »83. Le rapporteur Callet devait soutenir que cet article n'était que la reprise de la disposition de la loi de 1841 sur la protection des enfants84, dont la double vocation religieuse et de protection sociale était avérée.
B) De I'hésitation
aux certitudes
sur le repos dominical:
du
second empire à 1880 Le coup d'Etat du 2 décembre 1851 ne devait pas inciter la Cour de cassation à changer sa jurisprudence. Ayant à se prononcer quatre jours après, elle faisait prévaloir la même solution85. Au demeurant la constitution du 14 janvier 1852 n'apportait pas d'éléments nouveaux. Son article 1 se référait elliptiquement" aux grands principes proclamés en 1789... base du droit public des Français ». L'article 26 de la constitution prévoyait que le Sénat s'opposait à la promulgation des lois contraires ou qui porteraient atteinte" à la religion... à la liberté des cultes ». Une telle formulation semblait bien être une reprise de l'équilibre entre le catholicisme majoritaire en France et la liberté des autres cultes. Au demeurant, l'entente cordiale qui devait s'instaurer entre l'Etat et le clergé catholique au début du second empire86 ne laissait pas augurer une remise en cause de la loi de 1814. Pourtant, le pouvoir devait adopter une attitude ambiguë en la matière, vraisemblablement pour éviter une remise en cause du bel unanimisme qui avait accompagné l'accession du second Empire.
82
A. Dansette, pp. 275-280.
83 84
Duvergier,
85 86
152
Histoire
religieuse
de la France
contemporaine,
Paris,
Flammarion,
1965.
du 3 février
1851,
Crim.. 6 décembre 1851 [Vuillemin). D.P. 1852. 1. 189 et S. 1852. 1. 373. J. Maurain, La politique ecclésiastique du Second Empire de 1852 à 1869, Lettres. Paris. 1930.
Thèse
op. cü., T. LI, p. 85.
Intervention de Callet, séance de l'assemblée Moniteur universel du 4 février 1851, p. 363.
nationale
législative
Le débatjwidique
sur le repos dominical
dans
la France duXIX"me siècle (1830-1880)
Ainsi, une note du Ministre de l'instruction publique et des cultes de 185287 dénonçait les affirmations des journaux qui prêtaient « au gouvernement le projet de proposer une loi pour interdire le travail et même la vente le dimanche". Le ministre devait soutenir qu'il n'appartenait « au pouvoir civil d'intervenir que par l'exemple qu'il donne dans une affaire de conscience ", rappelant la position prise sous le 1er empire. Cette position du gouvernement devait être réïtérée en 1854 par une note qui précisait que la «
question
conscience maintenir
de l'observance" qui n'admet la loi de 1814
du repos ni contrainte
dominical
était
ni intimidation
« une question de libre ,,88. Fallait-il en ce cas
?
Face à ce flou juridique la Cour de cassation devait continuer d'appliquer ce texte89. Elle devait s'en expliquer en 1855, sans viser de dispositions précises, en soutenant que la loi de 1814 n'avait été abrogée « par ,,90. aucune disposition législative ou constitutionnelle Pourtant certains membres de la doctrine contestaient le bien fondé de la loi. Ainsi, en 1862, Chauveau et Hélie devaient maintenir leur opinion sur l'illégalité constitutionnelle de la loi de 181491. Le libéral Ch. Renouard, alors conseiller à la Cour de cassation, devait défendre l'abrogation de la loi sur le repos dominical devant l'Académie des sciences morales et politiques92. Il soutenait que la violation du dimanche chômé n'était pas une infraction pénale car ce comportement ne constituait pas la « lésion d'un droit appartenant à une personne individuelle" autre que celle du contrevenant93.
Elle n'était que l'un des
« manquements
à la morale" étranger au domaine des
lois positives94. Mais la Cour de cassation allait rester inflexible. Saisie en 1866, elle conclut à la compatibilité du repos hebdomadaire tant avec la liberté des cultes qu'avec le principe de la liberté de l'industrie si chère au décollage économique du second empire95. Les juges devaient reprendre un argument invoqué sous la monarchie de juillet. Il devaient affirmer que ces principes constitutionnels n'excluaient pas « le respect dont la loi civile est partout
87
Note du Ministre de l'instruction universel du 9 juin 1852, p. 854.
88 89
Note du gouvernement du 5 juillet 1854. Moniteur universel du 6 juillet 1854, p. 733. Crim., 16 février 1854 (Min. pub./Deschamps), D.P., 1854. 1. 198. et Crim.. 2 juin 1854 (Blanchard). D.P.1854. 1. 260, ainsi que pour les deux arrêts S. 1854. 1. 588.
90 91
Crim.. 28 juillet 1855 (Chrétien Wehrun), D.P. 1855. 1. 360. Chauveau et Hélie, Théorie du code pénal, Paris, 1862. T. III. pp. 251 et ss.
92
C. Renouard,
93 94 95
l'Académie des Sciences morales et politiques. Compte rendu, 1865, T. IV. pp. 5-36. Ibid.. p. 28. Ibid.. p. 29. Crim.. 20 avril 1866 (Paris), D. P. 1866. 1. 187 et S. 1867. 1. 45.
«
Chômage
publique
des dimanches
et des cultes
et jours
fériés',
du 9 juin
Séances
1852,
Moniteur
et travaux de
153
Olivier Tholozan
empreinte pour le culte chrétien ». Cet argument un peu court masquait mal le malaise de la Cour face à un problème éminemment politique. Les commentateurs avaient ressenti cela. Aussi, l'arrêt devait donner lieu à la résurgence d'une vive opposition amorcée dès la monarchie de juillet, entre les deux grands recueils de jurisprudence de l'époque96. Dans le recueil Sirey, l'auteur du commentaire était favorable à l'abrogation implicite et la décision de la Cour était vivement critiquée97. Inversement le commentateur du Dalloz louait la position des juges en soutenant que la loi de 1814 était
justifiée par
« un
intérêt social de premier ordre», à savoir la moralisation des
classes laborieuses98. La conférence de Renouard de 1865 devant l'Académie des sciences morales et politiques devait servir de base à la discussion de ces deux juristes. La loi de 1814 posait, sans conteste, un problème juridique et politique. Aussi, le pouvoir n'allait pas être en mesure d'éviter de prendre position sur la question. Interrogé devant le corps législatif, quelques mois après la décision de la Cour de cassation, le ministre Rouher devait admettre, non sans quelques embarras que l'abrogation de la loi de 1814 n'était pas possible sauf à risquer des troubles politiques99. L'effondrement du régime n'allait pas entraîner l'abandon du débat. Mais si l'Empire avait été une période de doute à l'égard du repos dominical, la mème république allait être le moment des certitudes. Lors de la mise en place de la république, alors que le régime est aux mains des monarchistes, la validité du chômage le dimanche ne suscitait aucune hésitation. Ainsi l'abscence de référence à une déclaration de droits dans les quelques textes consitutionnels allait conforter la position de la Cour de cassation; En 1872, elle maintint sa jurisprudence favorable à la loi de
1814100 en précisant simplement que ce texte n'avait été « abrogé par aucune disposition législative ». L'assemblée monarchiste, favorable à l'église catholique allait conforter la position de la Cour. La loi du 19 mai 1874, sur le travail des enfants et des filles mineures travaillant dans l'industrie, prohibait dans son article 5 le travail le dimanche pour les enfants de moins de seize ans et les filles de 96
Voir l'opposition
97
Parlant de la loi de 1814le commentateur devait écrire: « Existe-t-elle encore? C'est ce dont il nous paraît au moins permis de douter, en présence de la situation que nous
entre le recueil Sirey et Dalloz à propos
de l'arrêt Vitrac note 67.
révèlent et les attaques persévérantes dont elle a été l'objet, surtout depuis 1830, de la part d'un grand nombre de publicistes et de jurisconsultes et les hésitations que semblent éprouver ceux là mêmes qui sont chargés d'en assurer l'exécution, et jusqu'aux notes officielles S. 1867. 1. 45. '. D. P. 1866. 1. 187.
98 99 Séance du corps législatif du 13 juin 1866. Moniteur universel du 14 juin 1866, p. 748. 100 Crim.. 19 décembre 1872 (Théroulde), D.P.. 1872.5.280. Le texte complet de l'arrêt est au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle, Paris. Imprimerie nationale, 1872. T. LLXXVII. p. 554-556. n° 328. 154
Le débat juridique
sur le repos dominical
dans la France du XJX.è"'csiècle (1 B30-1 BBO)
moins de vingt-et-un ans lOI. Au cours de la discussion de ce texte devant la chambre des députés, le rapporteur avait soutenu que l'article tenait sa raison d'être tant de la. loi religieuse que de l'intérêt matériel et économique »102. Pourtant cet article devait faire l'opposition d'un député de la gauche républicaine d'origine israélite Edouard Adrien Bamberger103. Ce demier, rejetant l'ancienne position de Fould104, affirmait qu'il parlait du . point de vue des israélites... dans l'intérêt des Français qui professent des cultes autres que les cultes chrétiens» 105. Il souhaitait que les enfants du culte hébraïque ne soient pas soumis au repos le dimanche mais le samedi. Bamberger devait invoquer, malgré l'absence de texte constitutionnel approprié, le principe de l'égale protection des cultes, dont il allait proposer une interprétation. Ainsi, il devait affirmer que la France ne connaissait plus . la religion d'Etat ». Il admettait que. la majorité des Français professe la religion catholique» mais il refusait d'. admettre qu'il en résulte une défaveur pour ceux qui ne professent pas cette religion »106. La position de Bamberger allait être appuyée par une lettre des membres du consistoire central israélite 107. Cependant cette argumentation ne devait pas émouvoir l'assemblée. Les rapporteurs opposaient ainsi à l'argumentation de Bamberger le dogme de la généralité de la loi qui interdisait des exceptions au principe du repos dominical1 08. Pour mieux renforcer cette position, les rapporteurs rappelaient que la loi de 1814 était toujours en vigueur et que le texte qu'il proposait n'était qu'un complément à cette législation 109. La nouvelle majorité républicaine à la chambre des députés allait renverser les certitudes en matière de jours chômés. Les républicains virent dans l'abrogation de la loi de 1814 un début de combat pour la laïcité. Aussi, malgré les récriminations des députés royalistes, robligation du repos dominical, à l'égard des particuliers, fut définitivement abrogée par une loi du
101 Duvergier, op. cit., vol LXXIV, p.152. 102 Rapport de Tallon, J.O. du 30 mai 1872, annexe n° 1132, p. 3610. 103 (1825-1910), d'origine israélite, Médecin, vice président de la ligue de l'enseignement, député en 1870 de la Moselle, M. Prévis et Roman d'Amat, Dictionnaire de biographie française, Paris, 1951, T. V, p. 46. 104 Voir les propos durs de Bamberger sur l'ancienne position de Fould que les membres de l'assemblée lui avait opposée, J.O. du 6 février 1873, p. 876. 105 Ibid., p. 874. 106 Ibid. p. 875. 107 J.O. du 19 mai 1874, p. 3357. 108 Voir la réponse de Tallon, J.O. du 6 février 1873, p. 875 et celle du comte de Melun J. O. du 19 mai 1874, p. 3357. 109 Le rapporteur Tallon affirme: «l'obligation du repos du dimanche n'est pas inscrite d'aujourd'hui dans notre législation", J.O. du 6 février 1873, p. 875. Le comte de
Melun plus précis dit cassation
« la
loi de 1814 a plusieurs
fois été reconnue
par la Cour de
comme étant encore en vigueur. En outre, notre loi va plus loin... ", ibid., p. 876.
155
Olivier T/wlozan
12 juillet 1880110. Le rapporteur à la chambre des députés, Casimir Fourrier, devait traduire la pensée libérale et anticlérical de la nouvelle majorité. Il reprenait en s'y référant explicitement l'arrêté du 7 thermidor an VIII pris sous le consulat III. Paradoxe les républicains se référaient à un exemple historique d'une république autoritaire pour faire prévaloir, en cette fin de XIXèmesiècle, la liberté des cultes.
Conclusion Immédiatement après sa suppression, le repos dominical devait être la revendication d'un véritable mouvement social. Ce dernier, d'abord composé par des groupes chrétiens et philanthropiques, puis des grandes instances de l'organisation du monde du travail, devait trouver l'appui des grands socialistesl12 qui agirent au sein de la chambre des députés pour faire voter la loi du 12 juillet 1906113 rétablissant le principe du repos dominical. Au fond, le dimanche chômé était devenu une pratique sociale que la culture catholique avait contribué largement à inculquer aux Français. Mais le dimanche avait perdu de sa connotation religieuse. Il n'était désormais que le lieu privilégié d'une nouvelle utilisation du temps: les loisirs que les congés payés devaient encourager. La séquence 1830-1880 prend alors tout son sens dans l'histoire du repos hebdomadaire. Elle est une période de gestation. Celle-ci traduit bien une difficulté de la société française à penser un changement d'habitude sociale. La réalité mentale a subi, en matière d'aménagement du temps, une évolution plus lente que les transformations socio-économiques. Cette lenteur s'explique par le fait que l'élaboration de l'image mentale que se fait une société d'elle-même évolue selon un rythme proprel14 ; c'est qu'elle touche à l'ordre du symbolique, aux rêves des sociétés. Au XIXème siècle, l'histoire s'accélère et les hommes, émerveillés, sont trop intimidés pour en imaginer toutes les conséquences. Olivier THOLOZAN ATER à la Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille m 110 III 112 113
D. P. 1880. 4. 57. P. Barreau, op. cit. R. Beck, op. cit., pp. 298 et ss. Voir l'étude de P. Barreau précitée et R. Beck, op. cit., pp.309 et ss.. 114 G. Duby, « Histoire sociale et idéologies des sociétés ", J. Le Goff et P. Nora (sous la dir.), Faire de l'histoire. Nouveaux problèmes, Paris, Gallimard, 1974, Vol. 1, pp. 203230. Sur la place spécifique de l'Histoire du droit comme discipline autonome et complémentaire de l'Histoire des mentalités voir P. Ourliac, «L'objet de l'Histoire des Institutions", Revue historique de droit français et étranger, 1955, pp. 282-293 et B. Biancotto, O. Tholozan, E. l'illet, «Variations sur les concepts juridico-politiques en Histoire ", Revue de la recherche juridique. Droit prospectif, 1996-4, pp. 1085-1099. 156
e/V~
Introduction L'idée de laïcité est le moteur de la modernité occidentalel. Elle entraîne une profanation généralisée de la société holiste antérieure, en consacrant la rupture de l'individu avec le bloc socio-religieux dans lequel il était inclus. De manière concomitante, l'essor de l'Etat lui est lié et, comme organe gouvernant la société civile désormais déconfessionnalisée, il s'installe sur les ruines de la féodalité, des communautés traditionnelles et de l'Eglise. L'idée de laïcité est évidemment bien plus ancienne que la Déclaration de 1789, mais c'est dans ce texte juridique d'une grande ampleur que les constituants ont inscrit la nouvelle revendication, en donnant à chacun un droit naturel égal à celui des autres. C'est donc ici-bas que la rationalité
impose que les
« hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits
..
(article premier). Ainsi, dès le début, la laïcité implique la démocratie juridique. En effet pour que, par un retour des choses, le nombre ne retombe pas de tout son poids sur l'individu, G. Gurvitch, après B. Constant et A. de Tocqueville, nous
enseigne que droit
..
« la
démocratie n'est pas le règne du nombre, c'est le règne du
et pas nécessairement
celui des droits subjectifs.
Après la grande Déclaration contestée de commencer revenu à la mème République Sur la définition de la modernité. Jean-Marie Domenach. Ellipses.
durant à réaliser
l'on se reportera
le XIXème siècle, il est cette relation entre la
à : Approches
de la modernité
de
157
Marie-Luce
Pavia
laïcité et le système de droit positif, en mettant l'accent, avant la séparation de l'Eglise et de l'Etat, sur l'école, Cependant, la laïcité étant un tout, il convient aussi que tout le droit s'en imprègne, De ce point de vue globalisant, c'est la Constitution actuelle qui réalise ce type de droit. De 1789 à aujourd'hui, le processus juridique qui permet le passage de la laïcité à la positivité est donc long, Comme une valse lente, il est en trois temps: la DDHC contient une nouvelle conception de l'homme: celle du sujet laïque (I). Pour qu'il advienne à la réalité juridique, presque un siècle plus tard, un choix stratégique est effectué: l'école laïque en devient le lieu d'apprentissage privilégié (II). Enfin, encore approximativement un siècle plus tard, le droit républicain tout entier s'imprègne de la laïcité (III).
I - A partir de 1789 : le primat du sujet laïque. Une confidence de Charles de Gaulle à Georges Pompidou2 résume la situation: «Depuis 1789, il n'y a plus de légitimité admise -, Sans doute un mouvement ne se réduit pas à une date, mais la DDHC cristallise le foisonnement intellectuel que l'on appelle les « Lumières - et que l'on résumera en deux éléments qui paraissent essentiels pour notre propos: la laïcité correspond à une nouvelle philosophie juridique, qui place au centre du cosmos juridique le sujet du droit,
A - La laïCité ou la décoWJerte d'une
nouvelle philosophie juridique
Dans l'ancienne société, le tout s'imposant aux parties, l'inégalité paraissait normale. L'on pouvait rejeter les non-chrétiens dans l'enfer, parce qu'ils n'étaient pas faits à l'image de Dieu. L'ébranlement de cette conception d'une société gouvemée par l'Eglise3 va être symbolisé, dans la première moitié du XVIèmesiècle, par Charles Quint qui, sous l'influence de Las Casas, fera interdire les expéditions de conquête des Espagnols en Amérique, Il est revenu à Francisco de Vitoria d'expliquer le décret impérial en jetant, dans les célèbres leçons extraordinaires qu'il a prononcées à Salamanque en 1539, les bases de cette nouvelle philosophié, qui conceme l'individu laïcisé. La conquête posait en effet une question très simple dans sa formulation, mais d'une incroyable complexité: si avec les Maures, les Espagnols pouvaient toujours dire qu'ils avaient les premiers pris les terres,
ce qui justifiait une 2 3
4
-, au nom de quoi pouvaient-ils justifier une
G. Pompidou:
Pour rétablir la vérité, Flammarion.
Déjà en 1315, toutefois sans geste, encore généraliser en
un chirurgien de Bologne avait disséqué deux cadavres publiquement, oser encore ouvrir les têtes, de peur de commettre un péché mortel. Ce timide, est le symbole d'une profanation de la société, qui va se passant de la physique à la physique sociale,
L'argumentation « Nature,
158
« reconquête
qui va être ici développée
est empruntée
à Pierre-François
Culture, Histoire -, Cf. Histoire des idéologies, Hachette, tome 3.
Moreau,
in :
La laïcité en droit républicain
français
conquête.. et le fait qu'ils agissaient autrement qu'avec les peuples chrétiens " d'Europe? Dans le fond, la découverte de l'Amérique entraîne la découverte des Indiens, ce qui entraîne à son tour une interrogation centrale: les Indiens sont-ils des hommes, ont-ils des droits? La réponse de Vitoria est positive, puisque, explique-t-il, il y a en tout homme, sous les différences de la foi, de statut ou de morale, une nature unique qui est humaine. Il s'agit d'une leçon immense, dont nous sommes, aujourd'hui, les héritiers. En effet, avant Vitoria, l'on pensait l'homme tout d'une pièce, c'est-àdire que l'on pouvait être chrétien avant d'être espagnol ou français. Désormais, l'on est homme avant d'être chrétien. Avec Vitoria, l'on passe de cet homme là .. à l'" humanité.. et l'on introduit une unité des hommes, mais " une unité laîcisée qui ne passe plus par la chrétienté. L'idée de l'homme a donc radicalement changé. Dans la société holiste, le devoir être se déduisait de l'être: on agissait dans le cadre d'un système hiérarchique dont la nature était prescriptive et où chacun savait ce qu'il devait faire selon les normes de la communauté. Dans la société moderne, chaque homme a, en lui-même, les fondements d'un" droit naturel... C'est bien le sens de l'article 1 déjà cité de la DDHC. Ainsi, l'avènement de l'individu laîque fait changer la position de l'homme dans l'univers. Autorisée par la première révolution copernicienne, la seconde consiste à le désorbiter, pour qu'il devienne le centre du cosmos social et qu'il ne trouve plus désormais sa légitimité en Dieu. Mais, le processus juridique ne s'arrête pas là. En droit, ce n'est pas l'" individu.. qui advient, c'est le" sujet.. ou, pour reprendre une expression de Marcel Gauchet5, l'on" est passé du droit de Dieu au droit du citoyen ". B - Le sujet
au centre
du cosmos
juridique
laïcisé
En effet, si, avec la laïcité, l'homme est isolé, le droit laïque le reconstruit - ou le saisit - non pas dans son individualité naturelle, mais comme sujet capable en raison de se déterminer lui-même. Autrement dit, l'être en droit se décline sur le mode du devoir être. Il en résulte que la théorie du sujet en même temps qu'elle détruit les totalités antérieures, élabore aussi une" nature humaine.., qui, elle, est loin d'être naturelle. Cette reconstruction passe par des phases complexes: état de nature, droit naturel, pacte, état social, loi positive. Alors que tout est atomisé, tout commence par l'individu et y revient par une série de déplacements intellectuels, qui, quel que soient les variations, s'articulent autour d'un invariant: le vouloir être et le devoir être. Ainsi, tout doit s'écrire sur le mode de l'impératif.
5
ln : La révolution
des droits de l'lwmme,
NRF, Gallimard. 159
Marie-Luce
Pavia
A l'origine, l'homme est séparé des autres, mais il « doit» créer le lien qui l'unit aux autres. L'état social « doit» ressembler à l'état naturel et la loi positive « doit» refléter la loi naturelle. Il en résulte que la loi, en qui se résume le droit, « doit» être ce qui, dans le sujet, fonde sur la nature humaine les lois positives. L'on comprend aussi que l'Etat « doive» advenir et que, dans
une certaine mesure, il aura toutes les qualités du sujet et il « devra» prendre en charge les fonctions assumées antérieurement par l'Eglise. C'est donc après avoir abstrait tout le poids collectif des institutions, des traditions historiques, des coutumes qui auraient pu déterminer le sens concret de l'individu, que surgit le pur sujet6 ou, si l'on préfère, l'affirmation de l'être humain comme sujet du droit et des droits l'homme. L'on comprend, sur la base de ces prémisses, que le droit est au sujet ce que la force est à l'individu et si tous les individus n'ont pas tous la même force, le droit est le même pour tous. Cette volonté de transgresser les différences naturelles est au coeur du raisonnement d'E. Sieyès, qui démontre que: « les avantages par lesquels les citoyens diffèrent entre eux sont au-delà du caractère du citoyen. Les inégalités de propriétés et d'industrie sont comme les inégalités d'âge, de sexe, de taille, etc. Elles ne dénaturent point l'égalité de civisme »7. Par conséquent, il y a donc un saut qualitatif qui est accompli par l'individu qui, dans le domaine juridique, acquiert le statut moral de sujet. Il en est de même de l'Etat qui n'est là que pour prendre en charge le bien commun ou l'intérêt général. Cette moralité, c'est la rationalité débarrassée de toutes les histoires particulières, de tous les mobiles et les motifs entremêlés dans la conduite humaine. Et comme la raison est, pense-t-on, la faculté par laquelle l'on est homme, elle a une dimension universelle et elle fonde, en nous-mêmes et en autrui, la volonté d'agir et la volonté d'obéir. Voilà la nouvelle loi universelle qui ne trouve plus sa source dans la théologie. Le résultat est bien là : la laïcité imprègne le système de droit et elle assure, dans le respect du principe d'égalité, la garantie des droits de l'homme, y compris de la liberté religieuse. Dans ce domaine si sensible, la
DDHC indique bien que
«
Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même
religieuses...» (article 10). Logiquement, la liberté religieuse, désormais rabattue dans la sphère de la vie privée, est préservée par la laïcité. Celle-là n'est nullement en opposition avec celle-ci. Cependant, l'on doit constater que la fondation sociale et politique entreprise par la Révolution française ne s'est pas imposée immédiatement en droit positif. Avant que la séparation de l'Eglise et de l'Etat soit posée par la loi du 9 décembre 1905, la laïcité déploie ses conséquences dans un secteur 6
Sur cette transmutation. du droit, PUF.
7
ln : Qu'est-ce
160
on lira avec profit:
que le Tiers Etat?
Alain Renault
et Lukas
Sosoe : Philosophie
La laïcité en droit républicain
français
particulier: celui de l'enseignement dans l'école publique et laïque et qui est considérée comme l'instance privilégiée pour instuire le sujet-citoyen et lui inculquer l'obeïssance à la loi, donc à l'Etat.
II - A partir de 1879 : l'école publique et laïque, comme lieu d'apprentissage de l'homme-citoyen. ont une conviction: ils sont les Les Républicains de la meme République Xvmeme siècle8. Ils ont aussi une méthode: le héritiers de la philosophie du positivisme qui, après avoir permis d'acquérir une connaissance valable en matière de sciences exactes, finira par découvrir les lois qui gouvernent l'organisation de la société. Leur point d'ancrage stratégique est l'école9 qui, par la diffusion du savoir qu'elle doit assurer, séparera, mieux que par la force, l'Eglise et l'Etat. Un lien est, par conséquent, établi entre l'école et la religion. Celle-là faisant dépérir sûrement celle-ci qui, en quelque sorte, tomberait comme un fruit mûr. Il est revenu à Paul Bert et à Jules Ferryl0 de mettre en place ce programme, qui commence par l'adoption de deux projets de lois déposés le
15 mars 1879 et qui sont adoptés. Le premier supprime le « banc des évêques» au sein du Conseil supérieur de l'instruction publique. Le second interdit aux congrégations non autorisées de participer à l'enseignement. De plus, par la loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux « cesse d'être à la charge de l'Etat, l'instituteur public ne le dispense pas, il n'est pas donné dans les locaux de l'école» primaire. Le principe, qui commande depuis ces dates l'enseignement public en France, résulte de ce nouveau dispositif législatif et est traduit, sur le plan juridique, par ce que l'on appelle la neutralité. Ne concernant que l'enseignement primaire et secondaire, il s'applique aussi bien aux maîtres, qu'aux élèves (A). 11pose aussi le problème épineux de sa conciliation avec la liberté religieuse, que l'on peut analyser à deux niveaux: d'une part, en ce qui concerne la liberté cultuelle des élèves (B) et, d'autre part plus récemment, en ce qui concerne le port de signes d'appartenance religieuse (C). 8
De ce dernier point de vue, le projet républicain se veut le continuateur de Condorcet qui voyait dans la généralisation de l'instruction le moyen «des progrès futurs de
l'esprit humain niveau
social
_.
est
De plus. pour le penseur, la relation entre l'instruction étroite
et réciproque.
historique des progrès de l'esprit humain:
9
Ainsi, « Si
écrit-il,
dans
l'instruction
l'Esquisse
publique et le d'un
tableau
est plus égale. il en naît une
plus grande égalité dans l'industrie, et dès lors dans les fortunes; et l'égalité des fortunes contribue nécessairement à celle de l'instruction -. Voir l'article « Condorcet par M-C. Royer. in Dictionnaire des oeuvres politiques, sous dir. F. Châtelet, O. Duhamel, E. Pisier, PUF. en 1871, la Commune de Paris avait souhaité Déjà à l'aube de la meme République, l'institution
d'une
école
gratuite.
publique
et laïque.
Cependant.
l'on sait
que cette
expérience ambiguë ne durera que le « temps des cerises -. 10
Sur la laïcisation de l'école. l'on doit se reporter Bouineau : Histoire des institutions - 1750-1914.
à Romuald Litec.
Szramkiewicz
et Jacques
161
Marie-Luce
Pavia
A Dans la neutralité: -
l'interdiction
pour tous de toute propagande
Pour les enseignants dans l'enseignement public primaire, c'est la loi du 30 octobre 1886 qui dispose que: « l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque ". Cette loi n'a jamais été depuis remise en cause. Par contre, la situation est plus confuse dans l'enseignement secondaire. Si le ministre a le pouvoir de refuser la possibilité de passer le concours d'agrégation de philosophie aux prêtres (arrêt « Abbé Bouteyre ", CE 10.05.1912), le juge cependant prononce l'illégalité du refus d'admettre un ecclésiastique à participer à l'agrégation d'anglais (TA de Paris « Spagnol du " 07.07.1970). Dans un avis du 21 septembre 1972, le CE affirme aussi que la «
neutralité
de l'ensemble
service de l'enseignement elles-mêmes à ce que
membres
du clergé
des services
publics
et en particulier
la neutralité
du
à l'égard des religions,... ne mettent obstacle pas par des fonctions de ces services soient confiées à des
".
Par ailleurs, la neutralité s'entend évidemment comme une interdiction faite aux enseignants d'influencer les enfants par des prises de position idéologiques ou religieuses ou par l'enseignement d'une doctrine officielle. En outre, la neutralité concerne aussi les élèves de l'enseignement public primaire et secondaire. Indépendamment de leurs idées ou de leurs origines ethniques, ils ont le droit d'accéder à cet enseignement et d'exiger des outils pédagogiques également neutres. A leur tour, les élèves ne peuvent exercer les droits qui leur sont reconnus (dans les lycées: libertés de presse et d'association et dans les lycées et les collèges: libertés d'expression et de réunion), qu'à condition de respecter la neutralité de l'enseignement public. En 1990, confronté à des revendications communautaires, Lionel Jospin, ministre de l'Education nationale résume bien la neutralité qui s'impose
déclare: religieuses"
aux «
enseignements
la neutralité
et aux
utilisateurs
est le refus des propagandes
du
service
politiques,
public,
lorsqu'il
idéologiques
et
11 .
B - Dans la neutralité:
le respect de la liberté cultuelle des élèves
Comme le rappelle la loi dite Debré du 31 décembre 1959, c'est l'Etat l'enseignement public, « prend toutes les dispositions utiles pour
qui, dans
assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et Ainsi, dans l'école primaire, depuis la loi du 28 mars l'instruction religieuse ". 1882, un jour par semaine, outre le dimanche, est accordé aux enfants qui souhaitent recevoir une éducation religieuse en dehors des locaux scolaires. Le ministre de l'éducation nationale rappelle également régulièrement que les enfants peuvent avoir des autorisations d'absence pour les fêtes
Il 162
ln : Le Monde
du
29.03.
1990.
La laïcité en droit républicain
français
religieuses juives et musulmanes, lorsque ces élèves appartiennent à ces religions. Sur la base de la loi du 9 décembre 1905 et de la jurisprudence administrative, la création d'aumôneries est obligatoire dans les établissements de l'enseignement secondaire qui accueillent des intemes. Il apparaît donc que la liberté cultuelle des élèves est convenablement garantie. Mais, la situation est devenue plus incertaine dans les années 1980, à propos de la manifestation de ses convictions religieuses par le port de signes distinctifs.
C - La neutralité
et le port de signes d'appartenance
religieuse
En dehors de l'enseignement supérieur où ces manifestations sont admises, il est également toléré dans l'enseignement primaire et secondaire que les enfants puissent porter des signes discrets, surtout si ces enfants se conforment par ailleurs à la discipline et à la neutralité de l'établissement. Néanmoins, le problème a surgi, en 1989, à propos de ce que l'on a appelé l'" affaire du foulard islamique ». Trois collégiennes de religion musulmane ont voulu porter ce voile dans leur établissement, même pendant les cours. Le principal du collège s'est opposé à ce port et a refusé de les laisser entrer dans les salles de classe. Embarrassé, le ministre de l'éducation nationale a d'abord consulté le Conseil d'Etat qui a rendu un avis le 27 novembre 1989, puis a signé une circulaire interprétative le 12 décembre suivant. Prenant appui sur l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Haute instance administrative tente de concilier la liberté de manifester sa religion, avec la laïcité de l'enseignement public. En premier lieu, le droit de porter des signes religieux distinctifs (croix, étoiles de David, voiles islamiques) est affirmé, mais, en second lieu, trois limites sont définies. D'un côté, ce droit ne doit pas porter atteinte à l'obligation d'assiduité, ce qui interdit aux jeunes musulmanes de se soustraire à la pratique du sport en invoquant le fait que leur religion leur impose de ne pas se dévêtir. D'un autre côté, le port des signes ne doit pas non plus constituer un acte de provocation ou de prosélytisme, ni troubler le fonctionnement normal du service public. Enfin, la manifestation de sa religion ne doit pas faire "obstacle à l'accomplissement des missions dévolues par le législateur au service public de l'éducation, lequel doit notamment... favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes ». Une fois ces principes posés, le Conseil d'Etat renvoie alors aux autorités scolaires le soin de fixer les modalités de leur application, en tenant compte de la situation particulière de chaque établissement. Dans sa circulaire, le ministre de l'éducation nationale accentue les limites au droit de porter des signes d'appartenance religieux, en précisant: lorsqu'un conflit surgit à propos du port (de ces signes)... le dialogue doit " 163
Marie-Luce
être
Pavia
immédiatement
engagé
avec
le jeune
et ses
parents
afin
que,
dans
l'intérêt de l'élève et le souci de bon fonctionnement de l'école, il soit renoncé au port de ces signes ". lei, il ne s'agit plus de permettre de porter, sauL., mais a priori d'empêcher. Contre cette attitude rigide du ministre12, relayée sur le terrain par des enseignants, le Conseil d'Etat, cette fois-ci en tant que juge de la légalité des actes administratifs, a appliqué l'esprit de l'avis de 1989, en annulant des exclusions injustifiées, ainsi que des règlements scolaires qu'il pense être intolérants. Ce problème du port des signes est symbolique de l'équilibre fragile entre la neutralité de l'enseignement public et la liberté religieuse13. A travers lui, s'affrontent à nouveau deux conceptions de la laïcité en France: l'une combative et l'autre intégratrice14. Au-delà de l'école qui reste un point de fIXation sensible dans ce pays depuis la meme République, la laïcité logiquement ne se réduit pas à ce seul domaine. Elle doit devenir le principe directeur de tout le droit républicain. Cette étape va être franchie par la Constitution de la verneRépublique.
III - A partir de 1995, la laïcité cimente
le droit républicain
La démocratie constitutionnelle s'étant acclimatée en France, ne convient-il pas de regarder avec un oeil neuf le principe de laïcité dans le nouveau droit constitutionnel? L'on constate alors que, dans l'écriture même de la norme fondamentale, la place de la laïcité a changé (A). Cette modification ne peut pas ne pas avoir de sens en ce qui conceme sa portée, qui s'est élargie (B).
A - La laïcité inaugure
la Constitution
de la ""meRépublique
du 4 août 1995, la laïcité n'était Avant la révision constitutionnelle qui contenait les cinq alinéas inscrite qu'à l'article 2 de la Constitution, suivants: « La France
est une République indivisible, laïque, démocratique
Elle assure l'égalité devant la loi de tous d'origine, de race ou de religion. Elle respecte
et sociale.
les citoyens sans distinction toutes les croyances.
12
Cette rigidité
13
En 1984, le projet de loi relatif aux rapports entre l'Etat. les communes. les départements, les régions et les établissements privés fait défiler dans les rues un million de personnes au nom de la liberté de l'enseignement et de la liberté religieuse. Sous la pression du Sénat, François Mitterrand retire son projet de révision de l'article Il de la Constitution. Il se serait agi d'intégrer dans le texte de cet article la possibilité. pour le président de la République. de soumettre au référendum un projet de loi « concernant les garanties fondamentales des libertés publiques...
14
Sur ces conceptions,
dans la circulaire
Bayrou
du 20 septembre
1994.
.
02.11.1992 164
se retrouve
«
Kherouaa
l'on peut se reporter
., Les
Petites Affiches.
à la note de Gilles Lebreton sous: 24.03.1993.
CE
La laïcité en droit républicain
« L'emblème «
national
est le drapeau
tricolore,
bleu, blanc,
français
rouge.
L'hymne national est la « Marseillaise.
« La
devise de la République est:
« Son
peuple
principe est:
« Liberté,
le gouvemement
Egalité, Fratemité.
du peuple, par le peuple et pour le
».
Comme on le constate, l'ensemble du texte est hétérogène et difficile à interpréter. Si l'on se reporte à la période d'élaboration de la Constitution en 1958, plusieurs arguments peuvent être avancés, qui n'apportent pas vraiment de certitude. L'avant projet préparé par le gouvemement, non modifié par le Comité consultatif constitutionnel, mêlait dans un article premier les deux premiers articles de la Constitution du 27 octobre 1946, soulignant ainsi la qualité laïque de la République. Sur le fond et étant donné le poids politique déterminant de la SFIO et du PCF au début de la IVme République, la laïcité avait été inscrite en référence à la loi de séparation du 9 décembre 1905. Le MRP, de son côté, I
réussissait à faire mentionner le principe de dignité, afin de protéger la liberté de l'enseignement. Mais en 1958, la référence n'~st plus la même. En effet, il apparaît que, lors des travaux préparatoires de la Constitution, la laïcité a été mise en rapport avec la diversité culturelle et religieuse de la France hors métropole15. Dans le corps même du texte, peut-on admettre que la laïcité doive être mise en rapport avec l'enseignement public? La réponse négative s'impose d'évidence pour deux raisons. D'une part, l'article 34, qui définit la compétence du législateur, énonce que la.« loi détermine les principes
fondamentaux...
de l'enseignement...
»
sans qualifier ce demier. D'autre part
et si le Préambule réaffirme les principes contenus dans le Préambule de la Constitution de 1946 - il proclame: «La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat» -, l'on sait qu'il faudra attendre 1971 pour qu'il ait une portée juridique positive. Il ne faut pas oublier non plus que, lors de la formation du premier gouvemement, Michel Debré, premier ministre, met la question du régime de l'enseignement privé au nombre des problèmes à résoudre de manière urgente. Ainsi, la loi du 30 décembre 1959 sera un grand texte de pacification des esprits en établissant des rapports de coopération entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé participant au service public de l'éducation. La loi affirme aussi les obligations réciproques des deux types d'enseignement. Dans les établissements publics, il s'agit classiquement de respecter la liberté religieuse des lycéens par l'intermédiaire des aumôneries. 15
Cf. Documents pour seroir à l'histoire de l'élaboration de la Constitutlon du 4 octobre 1958, La Documentation française. 165
Marie-Luce
Pavia
Quant aux établissements privés intégrés ou ayant passé un contrat avec l'Etat, leur organisation s'aligne sur celle des établissements publics et ils doivent respecter la liberté de conscience de leurs élèves. L'incertitude16 qui pèse donc sur l'article 2 originaire est, par contre, levée depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995. Le premier alinéa de l'ancien article 2 est devenu l'article premier. Quant aux autres dispositions, elles sont désormais situées dans un nouvel article 2. Cette réécriture isole mieux la définition de la République, notamment dans son aspect laïque, ce qui se répercute sur la signification de ce dernier et oblige à s'interroger sur les liens juridiques entre laïcité et République.
B - Laïcité et République
sont consubstantielles
Déjà, sous la mème République et à propos des rapports entre l'Eglise et l'Etat, la laïcité, dans sa forme radicale, apparaît plus comme une ligne de partage idéologique et politique, que juridique. Elle trace la limite entre la famille républicaine et les autres familles politiques. C'est. le sens de l'apostrophe de Raymond Poincaré à Charles Benoist qui, faisant remarquer qu'il n'existait pas de différence sensible entre eux, reçoit cette réponse: « Entre vous et moi, il y a toute l'étendue de la question religieuse ". Or, l'étude des débats qui ont précédé l'adoption de la loi de séparation en 1905 démontre l'affaiblissement des groupes extrêmes au cours de la 17 discussion et la reconnaissance, par l'opposition de droite, du libéralisme contenu dans le projet de la Commission. Ainsi, le député Legrand admet que: «lui et ses amis ont voté le passage à la discussion des articles, mais que le caractère libéral vient des amendements qu'ils ont déposés... ,,18. Le durcissement lors du vote sur le projet traduit par conséquent plus une tactique
politique
- refuser
de cautionner
une
majorité
républicaine
opposition sur le fond de la loi. D'ailleurs, après la loi de séparation, le combat juridique Le célèbre arrêt «Abbé Olivier ", rendu par le Conseil d'Etat
-
qu'une
s'essoufflera. le 19 février
16 Pour une interprétation plus récente de l'article 2, cf. J. Morange: «Le régime constitutionnel des cultes en France in : Le statut constitutionnel des cultes dans les " pays de l'Union européenne, Litec. 17 A l'extrême gauc?e, le député Dumont déclare que le rapporteur de la Commission,
Aristide Briant, n'est pas fidèle aux idéaux de la « vraie gal1che
.
et, lors de la séance du
22 avril 1905, il estime: «la droite suit la Commission parce qu'elle compte sur l'ardeur du clergé pour prolonger contre la Répubique, contre nos idées, une lutte qui est dans (sa) tradition, puisqu'elle (lui) est une obligation de conscience» (J.O. Déb. Ass.. p. 1674). Quant à l'extrême droite monarchique, elle refuse toute adhésion à la cause séparatiste. Le marquis de Rosanbo, lors de la même séance, précise que « comme
le principe quelconque 18 166
Séance
catholique et comme Français je suis obligé de repousser d'une façon absolue même de la loi: il serait donc illogique des articles. (J.O. Déb.Ass.. p. 1661).
du 22 juillet
1905, J.O. Déb. Ass., p. 2686.
que je consente
à discuter
l'un
La laïcité en droit
républicain
français
190919, est le signe de l'oeuvre pacificatrice entreprise par la haute juridiction administrative. Comme à propos des processions et des sonneries de cloches, le Conseil recherche une conciliation, parfois délicate, entre la liberté religieuse et l'ordre public. On le constate, plus que l'aspect juridique, c'est le souvenir de la surenchère politique sur la laïcité qui reste présent dans les mentalités collectives, souvenir qui se perdurera longtemps encore. L'on retrouve donc ce vèrneRépublique. même décalage sous la Nèrne République, ainsi que sous la En 1951, le débat se noue à nouveau sur la question scolaire, la laïcité et la liberté religieuse, à travers les établissements privés d'enseignement confessionnel. Comme le remarque René Rémond20, l'approche des élections
législatives
« d'une
part réveille les compétitions préélectorales et inspire au RPF
et aux indépendants, une grande envie de déborder le MRP dont les responsabilités gouvernementales restreignent la liberté de manoeuvre; d'autre part elle rend de la vraisemblance aux espoirs de modifier la législation». De son côté, le PCF a tout intérêt à dénoncer la tiédeur laïque de la SFIO, Après des discussions passionnées, un problème très vaste est abordé: celui de l'aide générale que l'on doit apporter à l'enseignement privé primaire. Ceci reproduit la collusion des extrêmes, qui seront à nouveau marginalisés, pour permettre l'adoption de la loi Barangé du 28 septembre 1951, qui encore une fois apaisera les esprits21,
Sous la
yèrne
République et malgré l'importance du débat politique sur
l'école, le nouvel article premier de la Constitution ne permet plus de s'en tenir aux seules relations de l'Eglise et de l'Etat, à travers la liberté religieuse ou à la liberté de l'enseignement22.
19
20
Réfutant les arguments du maire à propos de son arrêté interdisant «toutes manifestations religieuses et notamment celles qui ont lieu sur la voie publique à l'occasion des enterrements », le Conseil d'Etat considère « qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi de 1905 sur les pompes funèbres, que J'intention du législateur a été spécialement... de respecter le plus possible les habitudes et les traditions locales et de n'y porter atteinte que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l'ordre
public », Voir:« Laïcité et question scolaire », dans La laïcité, PUF, L'on peut se reporter aussi à : Jean-Jacques Chevallier: Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 à nos Jours, Dalloz.
21
La nouvelle réglementation repose sur le principe suivant: l'Etat républicain, placé devant le respect de la liberté de l'enseignement, doit permettre à celle-ci de s'épanouir dans des conditions équitables et, en conséquence, les pouvoirs publics sont tenus à accorder une aide certaine à ce type d'enseignement. Il en résulte que, d'un côté, la loi met à la disposition de tout chef de famille une allocation trimestrielle par enfant scolarisé dans l'enseignement primaire, quelque soit sa nature. D'un autre côté, pour éviter de paraître fournir ainsi une aide directe, l'on prévoit un système d'attribution indirecte. Dans le cadre de l'enseignement public, l'allocation est mandatée à la Caisse départementale scolaire gérée par le Conseil général. Pour l'enseignement privé, elle est attribuée à l'Association des parents d'élèves de l'établissement intéressé.
22
Voir l'excellent article de G. Koubi : « La laïcité dans le texte de la Constitution
», R.D.P.,
5 - 1997. 167
Marie-Luce
Pavia
Il est déjà intéressant de noter que, à propos du port des signes religieux et de l'obligation d'assiduité des élèves dans les établissements scolaires, le Conseil d'Etat au contentieux élargit le domaine d'application de la laïcité, en considérant que" le principe de la laïcité de l'enseignement public est un élément de la laïcité de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics 1)23. La Haute juridiction administrative a raison de procéder ainsi, tant il est vrai qu'aujourd'hui l'article 1 de la Constitution implique au moins trois séries de conséquences. D'une part, c'est parce que la République est, tout à la fois, "indivisible, laïque, démocratique et sociale I) (1 ère phrase), qu'elle
assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens...
I) (2ème phrase).
La laïcité est mise en relation directe avec le principe d'égalité, qui est le coeur battant de tous les droits de l'homme. D'autre part, dans le domaine des religions, la laïcité est mise aussi en relation directe avec la 3èmephrase de l'article 1, qui énonce: (la République)
"
respecte toutes les croyances
I).
Ainsi, la laïcité implique qu'il" n'y ait pas de
religion d'Etat, non plus qu'une religion dominante ou privilégiée. En conséquence, elle n'est pas" contre I) les croyances, mais elle est positive et elle respecte leur pluralisme. Dans le domaine scolaire en particulier, la liberté de l'enseignement est devenue un principe de valeur constitutionnelle et l'existence des établissements d'enseignement publics et privés confessionnels ou non est constitutionnellement garantie. Elle entraîne aussi la sauvegarde du caractère propre des établissements privés liés à l'Etat par un contrat d'association et elle impose que la liberté de conscience des maitres de ces établissements soit respectée (décision du Conseil constitutionnel n° 77-87 DC du 21 novembre 1977). Plus largement, l'article 1, commandant le texte de la Constitution, doit être mis en relation avec tous les autres articles. Or, l'article 89, qui clôt la norme fondamentale, énonce dans son cinquième et dernier alinéa que: La "
forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision
I).
Et
l'on sait que cette interdiction est empruntée à la Constitution de 1875, mais révisée en 1884, c'est à dire lorsque la mème République fut devenue la République des républicains. Si l'on revient à cette date, la grande question de la révision de 1884 a été aussi l'oeuvre de Jules Feny - qui avait fait voter déjà le 28 mars 1882 la charte " I)
de la neutralité à l'école primaire - laïcisation des prières publiques Assemblées (article du 16 juillet 1875)
23
168
- et il en a choisi lui-même les points :
institutions constitutionnelles par la suppression des qui appelaient le secours de Dieu sur les travaux des 4 de la loi de 1884 qui abroge l'article premier de la loi ;
C.E., 10.03.1995 «Aoukili - et C.E.. 14.04.1995. Israélites de France et autres - et « M. Koen -.
2 espèces:
«Consistoire
central
des
La laïcité en droit
républicain
français
- interdiction du retour à la monarchie qui modifie le paragraphe 3 de l'article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics et qui précise que: «la forme républicaine du gouvemement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision. Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République ». Après les épreuves de la seconde guerre mondiale, la République quatrième du nom inscrit dans l'article premier de la Constitution du 27 octobre 1946: «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. ». Quant au dernier article 95, il énonce: «La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision. Dans une certaine mesure, la révision constitutionnelle du 4 août 1995 renoue la chaîne des temps républicains en établissant une relation essentielle et étroite entre la laïcité et l'organisation des pouvoirs publics et, donc, avec la forme républicaine du gouvernement. C'est donc tout le droit républicain qui est laïque. Dès lors, toute l'activité de production des règles de droit et toutes les procédures de contrôle sont tributaires de la compréhension du principe de laïcité. Ce principe est source d'une « règle» de droit constitutionnel; il ne saurait se définir comme une «valeur », ce serait aussi le déprécier que de le présenter comme un simple principe de valeur constitutionnelle; le principe de laïcité surdétermine les autres principes, ils les structure, il les encadre, il les transcende »24. «
S'il en est bien l'idée de laïcité
ainsi, nous sommes parvenus au terme peut donc (provisoirement) conclure. et l'on
du parcours
de
Conclusion A l'origine et comme fondement de la modernité, idée dé-régulatrice et re-régulatrice, la laïcité entraîne une sécularisation totale de la société, en mettant le sujet au centre du nouveau cosmos juridique, débarrassé de la référence à Dieu. S'ouvre alors une formidable question: puisqu'il n'y a plus de principe extérieur, comment légitimer le nouveau pouvoir, pour qu'il puisse assurer les grandes fonctions sociales assumées jusque là par l'Eglise? En démocratie et au-delà du système électif, il faut donc quelque chose en plus, c'est-à-dire: une instance juridique qui puisse réguler et assurer la cohésion. Pour réaliser la laïcité dans sa totalité, le mouvement du droit français donne à voir une sorte de syllogisme juridique. La majeure date de 1789, lorsque la DDHC énonce: «Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution» (article 16). La Déclaration annonce bien le règne du droit. 24
Geneviève
Koubi, op. cit. 169
Marie-Luce
Pavia
Cependant, la République française, qui s'est faite contre la Monarchie et, on l'oublie trop souvent, contre les juges, s'est installée avec une grande violence. Cette histoire particulière pennet alors de comprendre que la laïcité, pendant longtemps, a été une fracture douloureuse sur les plans idéologique et politique. Toutefois, sur le terrain juridique, la laïcité accomplit son oeuvre, au premier chef, dans le cadre de l'école publique dès 1879, - école conçue comme un véritable outil de promotion républicaine -, puis viendra la séparation de l'Eglise et de l'Etat en 1905. Sur cette base et pendant longtemps encore la laïcité va se comprendre dans les rapports qu'elle entretient avec les religions. Il s'agit ici de la mineure du syllogisme. Il faut néanmoins remarquer que les grandes lois de la méme République ont été voulu par des républicains qui ont su isoler les extrêmes politiques et rallier la droite modérée à leur projet laïque. Par ailleurs, le juge administratif a toujours arbitré dans un sens modérateur, en tentant de concilier la laïcité et le respect de la liberté religieuse. Aujourd'hui, dans le nouveau droit constitutionnel qui est né en 1958, la laïcité est devenue le principe de base ou le fondement du droit républicain et démocratique tout entier. Il est vrai aussi que la société française s'est habituée à l'Etat de droit et à l'instauration d'un pouvoir juridique arbitral, que le Conseil constitutionnel symbolise au niveau de l'organisation constitutionnelle des pouvoirs publics. Dans une certaine mesure, l'on peut admettre que c'est la conclusion du syllogisme. Ainsi, la boucle est en quelque sorte bouclée: après les méme et IVéme Républiques, la véme République, si contestée à ses débuts, ne réalise-t-elle pas, dans le droit positif, la fonnidable intuition de la Déclaration de 1789 ? Marie-Luce PAVIA Profess~ur de Droit Public Université de Montpellier I
170
L'association suivantes:
MEDITERRANÉES échange sa revue avec les publications
AFRICA ROMANA (Sassari ANALISE SOCIAL (Lisbonne
- Italie) - Portugal)
ARCHIVIO STORICO SICILIANO (Palerme ARCHIVO ESPANOL DE ARQUEOWGIA
- Italie) (Madrid - Espagne)
BULLETIN d'ETUDES ORIENTALES (Damas - Syrie) LES CMIIERS CENTRE de RECHERCHES (Bruxelles - Belgique)
en HISTOIRE du DROIT et des INSTITUTIONS
CUADERNOS INFORMATIVOS DE DERECHO HISTORICO PROCESAL y DE lA NAVEGACION (Malaga - Espagne) INSTITUCION FERNANDO el CATOLICO (Saragosse JOURNAL of MEDITERRANEAN STUDIES (Msida REVUE d'ETUDES ANDAWUSES
(Tunis
PUBLICO,
- Espagne) - Malte)
- Tunisie)
RIVE (Rome-Italie)
171
N° 17 IÇINDEKlLER Jacques
BOUINEAU BayyazL
Sydney
H. AUFRÈRE Esld Misirlilar ve Kadim
Marcella
KavramlarL
Geçmlyin Arkeolqji ve Tarish BUimsel Bir ArayiyL
TRAPANI
Hz. Isa'dan Bernadette
lid Binli YUlarda Misir'da Asya
once
MENU Esld Misir'da lkiisadi
Varligina Ili~'kin Kani/lar.
Sistem
Péter VARGYAS
Mezapotamya Edonomisi ve Astranoik Levhalar. Marie-Bernadette
BRUGUIÈRE
.
Dinden DOnme, A$k ve lhanet : Sancia di Castiglia" da Oranj'in AlinmasL Jacques
LAFON
Bab-i
Âli
ve Hiristiyanlar.
Olivier THOLOZAN
X1Xnou YüzyU Fransasi'nda pazar TatUi Hakkinda Hukuld Bir Tart~~ma. Marie-Luce
PAVIA Fransiz
Cumluniyeti
Hukukunda
Laiklik.
WERREJ Sydney
Aufrère:
MarnDa
"L-Egizzjaui
Trapani:
tal-Qedem
"Tifkiriet
Ii jum
a kifkienu
Ii J..Aijatiéi
jabsbuba kienu
fuq il-Qedem"
I-Egittu
fit-tieai
elf sena
qabel
Krista" Bemardette
Mena:
Peter Varygas:
"Is-sistema
ekonomika
"L-ekonomija
fl-Egittu
tal-Mesopotamja
taJ..Qeclem"
u !-werreüa
&ejkna
gbat-tisjib
u tradiment:
minn Il-Qbid
taI-
kwiekeb" Marie-Bemadette
Bruguière:
sa &mga Jacqaes
Olivier
Lafon:
172
"!I-'Bieb
Tbolozan: Dsatas"
Marie-Luce
"Apostasija,
imhabba
III' OtvuIge
ta' KllStilja"
Pavia:
Ewlieni'
('Sublimi':
"It-ti1wim garidika
"LajCiimu
fil-ligi
oar
Istanbul)
u I-Insara"
il-mistrieh
repubblikana
franata"
taI-Hadd
fi Franza
tu-Seklu
6POJ 17
CA,IJ;PJKAJ
?Kille liYHHO
Pc.. ype.aHHlCa
CHlIHH X. OcJIep
CT.pH Ernp".HH R II>H"OIl noj.M a.pRBe. Jea.tD apxeo,lloUIKo H HCTOpHOrp.cjJCICO npODlJlOCTH
HCTp.XCHllaa.c
MapcVl.
Tpa"aHH
CIle.aO".HCTBS .JlljaTcKor MlfJleHRjYMY ope Xp~Ta
npHC)'CTB8 Y ErHnTY
l>cP""/le'f
MeRH
npHapeARH
Ero'RTO
nnap
Bapljaw
CHCTeM e07por
nplfBpe.aa
aCTpOIlOMClCe
MceoDOTaMHje
y ApyroMe
786J1nue
"
MapH -liepH8IIeT I.pHTHjep "
AnoeTau, yGaB H B'Aaja : OAY3HMa...a nOMOpaHl,leAO KaCTH cICcC8J1KIIHjC "
malC .!IsellOH
.RHeOKS nopTa
OJlHaR,ie TOJlo.all
npaaHH'IICa XIX BeKa
MapH
-
H ][pAwliaHII
pampan
0 Hf;JIeJI>HOMO,llMOpy
.JIanUHTeT y ",paHUYtKOM
J1HCnaBHja
penyllJlHIUIKtKOM
y \..,.d\ -:
"
~\S'
...,1 4;1.,.,
"JI
JI41.r.!I..i".:.\".:f:
~~IJ
)~r. ..,..J-\
';;"':.>U;...)....
. ~\ -;
.;J~IJ
JIa!I -:
\ ~ JI ~ i)l J W}
.
174
.;J~'./.:J~ W\
~lj,J"
WJI
J ~..ûl '::"11-1)1 J".. iJJil.iiJ1J~I .:
~,,-iI1 ...)~I.;JJi\A)I
I.!..:.1"J...)v.
J" ï..;WAI\"
Membres d'honneur Guillaume
CARDASCIA (professeur
Jean GAUDEMET (professeur Jean IMBERT (membre
I. Bureau Président:
émérite
émérite
d'Histoire
d'Histoire
Paris II - Assas) Paris II - A






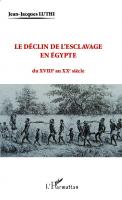


![Plutarchus Vitae Parallelae, vol. I, fasc. 1: Theseus et Romulus, Solon et Publicola, Themistocles et Camillus, Aristides et Cato maior, Cimon et Lucullus [5th Revised ed.]
3598716729, 9783598716720](https://dokumen.pub/img/200x200/plutarchus-vitae-parallelae-vol-i-fasc-1-theseus-et-romulus-solon-et-publicola-themistocles-et-camillus-aristides-et-cato-maior-cimon-et-lucullus-5th-revised-ed-3598716729-9783598716720.jpg)
