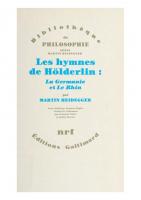La physiocratie sous les ministères de Turgot et de Necker (1774-1781)
326 53 10MB
French Pages [385] Year 1950
Polecaj historie
Table of contents :
LA PHYSIOCRATIE
LA PHYSIOCRATIE
de Turgot et de Meeker
(1774-1781)
Paul MANTOUX
J· CONAN
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE 108, Boulevard Saint-Germain, PARIS
PRÉFACE
AVANT-PROPOS
L’ÉCOLE ET LE PARTI
I. — Les forces du parti
II. — Les forces de l’opposition
III. — Les conséquences de la disgrâce de Turgot
LA PRODUCTIVITÉ EXCLUSIVE DU SOL ET DES EAUX, LE PROGRAMME AGRICOLE
I. — La grande et riche agriculture
II. — Pour la continuité de la culture et l’affranchissement de la propriété terrienne
III. — Pour l’immunité de la culture l’impôt territorial unique
LE PROGRAMME COMMERCIAL
I. — Le Bon Prix des productions agricoles
II. — Le bon marché des produite manufacturés
POLITIQUE ET PHILOSOPHIE DES PHYSIOCRÀTES
I. — Principes du « droit social »
II. — Principes du gouvernement
III. — Constitution du Corps politique
IV. — Philosophie des Physiocrates
ATTAQUE ET DÉFENSE DU SYSTÈME
I. — Le véritable intérêt des propriétaires fonciers
II. — Le véritable intérêt des finances royales
III. — L’opposition manufacturière et commerçante
IV. — L'intérêt du peuple
V. — Discussions de philosophie sociale et scientifique
L’ÉCOLE ET LE PARTI
LA RÉAFFIRMATTON DES PRINCIPES LE PROGRAMME AGRICOLE
I. — La grande et riche agriculture
IL — Continuité, individualité, liberté de la culture et levée dee servitudes terriennes
LE PROGRAMME COMMERCIAL
I. — Le Bon Prix des productions agricoles
II. — Le bon marché des produite de l'industrie
POLITIQUE ET PHILOSOPHIE DES PHYSIOCRATES
I. — L'Individualisme social
(5) Ibid., p. 51. Cf. Labrouquère, passim.
Π. — L’Ordre politique
III. — Philosophie des Physiocrates
ATTAQUE ET DÉFENSE DU SYSTÈME
I. — Le véritable intérêt des propriétaires
IL — Le véritable intérêt des finances royales
III. — L’opposition manufacturière et commerçante
IV. — L’intérêt du peuple
V. — Discussions théoriques : propriété et valeur
PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
TABLE DES MATIÈRES
Citation preview
LA PHYSIOCRATIE SOUS LES MINISTÈRES
DE
TURGO T
ET DE NEC K ER (1774-1781)
Ouvrage publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique
GEORGES WEULERSSE
LA PHYSIOCRATIE sou s le s in i ui stère*
de Turgot et de Meeker ( 1774-1781) PRÉFACE DE
Paul MANTOUX Ancien élève de VÉcole Normale Supérieure Professeur honoraire au Conservatoire des Arts et Métiers Directeur de l'Institut des Hautes Études Internationales, à Genève
AVANT-PROPOS DE
J· CONAN Professeur au Lycée Condorcet-Nanterre Diplômé de l'École des Hautes Éludes Historiques
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE 108, B o u l e v a r d S a i n t -G e r m a in , PARIS
DÉPÔT LÉGAL 1Γβ é d i t i o n ...................... 4e trimestre 1950 TOUS DROITS de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays COPYRIGHT by Presses Universitaires de France, 1950
CE L IV R E E ST DÉDIÉ A LA MÉM OIRE DE MON F IL S JACQUES W EU LERSSE (1905-1946)
PRÉFACE
Je revois Georges W eulersse tel q u ’il était quand nous sommes entrés en même tem ps à l’École Normale. Le sérieux de son expression e t sa barbe précoce l’au raien t fait p araître plus vieux que son âge, n ’eû t été la douceur, la sincérité juvénile de son regard, derrière les verres q u ’il ne q u itta it jam ais. Il se fit d ’emblée la réputation d ’un trav ailleu r acharné, avec le prestige particulier que lui donnait, parm i des jeunes gens d ’opi nions moins formées, une couleur politique bien marquée. Socialiste comme son oncle Georges R enard, il p artag eait avec trois de nos cam arades une salle de travail qui fut aussitôt surnom m ée la lurne rouge. Comme ils étaient et se sont m ontrés différents ! Péguy, un prophète, absorbé déjà et comme soulevé p ar sa révélation per sonnelle ; A lbert Lévy, dont la violence révolutionnaire devait, plus ta rd , se to u rn er en exaltation patriotique ; Mathiez, bouillant des passions de 1793, revivant de to u t son être l’époque tum ultueuse dont il allait devenir le grand historien. Au milieu de ces ardeurs qui s’échauffaient ju sq u ’au fanatism e, W eulersse éta it l’image du calme et de l’équi libre. Sa conviction raisonnée é ta it celle d ’un esprit à la fois généreux et mesuré, à qui la lecture de Marx ne faisait pas renier la trad itio n française de 1848. E t il ne trav aillait pas non plus avec l’em portem ent d ’un Mathiez, mais avec une assiduité m éthodique et tra n quille. Un an après l’agrégation, la fondation des bourses de voyage A lbert-K ahn lui offrit l’occasion de sortir des livres pour faire la connaissance du vaste monde. Il la saisit avec em pressem ent, et il voyagea longuement,
X
PRÉ F A CE
attentivem ent, m énageant avec soin les ressources mises à sa disposition pour faire durer le plus possible une expérience si précieuse. Il visita l’E xtrêm e-O rient, après avoir traversé les États-U nis, observant avec soin, avec pénétration ces pays, ces peuples qui nous paraissaient encore si lointains. Il en rap p o rta la m atière de deux livres, La Chine ancienne et moderne, et Le Japon d'au jourd'hui, qui nous restent comme des témoignages réfléchis sur une époque décisive. C’était presque au lendemain de la victoire du Jap o n sur la vieille Chine impériale. Le prem ier se révélait comme une grande puissance, se transform ant rapidem ent à l’aide de la technique occidentale ; l’autre, en plein désarroi, parais sait près de se désintégrer, et réagissait p ar des im pul sions désordonnées contre les em piètem ents de l’étran ger : la révolte des Boxers empêcha notre jeune voyageur d ’arriver à Pékin. Un monde antique sur le seuil de l’ère moderne, quel objet d ’observation et de m éditation pour un historien dans son apprentissage, particulièrem ent intéressé aux problèmes sociaux, et qui av ait été initié aux éléments de la géographie hum aine p ar Vidal de La Blache. C’est dans son enseignem ent que se fit sentir to u t le bénéfice de ce q u ’il av ait appris p en d an t ce voyage si bien employé. Il é tait professeur dans l’âme, et de ceux dont l’autorité morale a u ta n t que la haute intelligence, nourrie p ar un labeur incessant, laisse sur l’esprit de leurs élèves une em preinte ineffaçable. D octeur dès 1910, il ne voulut pas q u itter pour une chaire d ’Université ses classes du Lycée Carnot, ni su rto u t l’École Normale Supérieure de l’Enseignem ent Prim aire d o n t il a été si longtemps un des piliers les plus solides. A Saint-Cloud, l’auditoire auquel il s’adressait é ta it un des plus a tta chants que puisse souhaiter un professeur pensant, comme lui, rem plir p ar l’enseignem ent une fonction sociale de grande portée. Il av ait d ev an t lui des jeunes gens d ’élite, la p lu p a rt d ’origine populaire, ardents au travail et destinés eux-mêmes à form er des m aîtres par qui leur influence devait s’étendre sur to u te notre popu-
PRÉFACE
XI
lation scolaire. P ar eux, c'étaien t les masses laborieuses de notre pays que W eulersse atteig n ait, auxquelles il donnait le m eilleur de son savoir et de sa conscience. Mais l'effort exigé p ar un enseignem ent si chargé de responsabilité ne l'em pêchait pas de tro u v er du tem ps pour continuer les trav a u x qu'il av ait entrepris dès le début de sa carrière. Lorsqu'il était encore à l’École Normale, son a tten tio n s 'é ta it portée sur les doctrines qui, dans l'ordre économique, avaient contribué à p ré parer la R évolution française. De plusieurs années de recherches é ta it sorti l'ouvrage im posant sur le Mouve ment physiocralique en France, dont il fit sa thèse de doctorat. Ce n 'é ta it que la première partie d'une œ uvre dont to u te l’am pleur n ’ap p araît que m aintenant, résu ltat d ’un effort poursuivi à trav ers to u te une vie, et mené à son aboutissem ent grâce aux loisirs de la retraite. A ujourd'hui, nous pouvons lire la seconde partie de ce grand ensemble, où l'histoire des idées se combine avec celle des événem ents. Après la Physiocratie sous les ministères de Turgot et de Necker, deux autres volumes, encore en m anuscrit, conduisent ju sq u 'à la période révo lutionnaire. C'est un véritable m onum ent, édifié sur un terrain à peine reconnu a v a n t lui, que nous laisse cet homm e d ont la m odestie n 'a v a it d'égales que sa puis sance de trav ail, la vigueur de sa pensée, et sa profonde hum anité. A la veille d'une m o rt que rien ne faisait prévoir si proche, W eulersse eu t la satisfaction de voir achevée, sinon publiée, l’œ uvre conçue dès sa jeunesse. La perte douloureuse d ’un fils qui, après avoir comme lui, fait le to u r du m onde, s’é ta it signalé p ar des trav a u x d ’un grand m érite, n 'a v a it pas ralenti son activité, qui fut toujours pour lui un besoin et un devoir. 3 ao û t 1950. Paul M a n t o u x , Ancien élève de VÊcole Normale Supérieure, Professeur honoraire au Conservatoire National des Arts-et-Métierst Directeur de VInstitut des Hautes Éludes Internationales à Genève.
AVANT-PROPOS
Quand Georges W e u l e r s s e , en 1910, soutint brillamment devant la Faculté de Paris, ses thèses de doctorat ès Lettres sur Le Mouvement physiocraiique en France de 1756 à 1770 (1), il n’était ni le premier, ni le seul qui s’intéressât à l’histoire des fondateurs de l’Économie politique. Eugène D a ir e avait donné, dès 1846, une nouvelle édition des principaux écrits de l’École ; Auguste O n c k e n , en 1888, avait réuni les œuvres économiques et philosophiques de Quesnay (2) ; d’autres érudits s’attachaient aux hommes, aux œuvres ou aux thèmes que la « Secte » avait illustrés et fournissaient à la bibliographie physiocratique une contribution déjà considé rable. L’heure était venue de faire le point. Georges W e u l e r sse s’en acquitta magistralement. Sa thèse principale analyse minutieusement les idées des Physiocrates après avoir exposé l’historique de l’École, année par année et presque jour par jour. Elle passe en revue le programme économique, la politique et la philosophie du système, en suit la réalisation partielle, dénombre les obstacles et les adversaires et en attribue l’échec à l’intérêt du peuple qui se trouvait sacrifié aux vues capitalistes de ses promoteurs. Les historiens les plus autorisés ont été unanimes à louer la valeur de cette « Somme ». Le maître Philippe S agnac la qualifie à plusieurs reprises d’ « ouvrage capital ». * * * Georges W e u l e r s s e fait partir de 1756 le mouvement physiocratique : c’est l’année où François Quesnay rédige pour YEncyclopédie son premier écrit économique, l’article Fermiers. (1) Thèse principale : Le Mouvement physiocratique en France de 1756 à 1770, Paris, Alcan, 1910,2 vol. in-8°, xxxiv-617 et 768 p. — Thèse complé mentaire : Les Manuscrits économiques de François Quesnay et du marquis de Mirabeau aux Archives nationales, Paris, Geuthner, 1910, in-8°, vii-150 p. (2) Œuvres économiques et philosophiques de François Quesnay, Paris et Francfort, 1888, in-8°.
XIV
AVANT-PR OPOS
Il y expose les linéaments d’une doctrine que l’article Grains, publié l’année suivante, reprendra en les précisant. Le doc teur noue alors des relations avec le marquis de Mira beau, porté subitement au pinacle par le succès de l'Ami des hommes. Au cours d’une entrevue célèbre, mainte fois racontée, il convertit à ses idées le fougueux marquis, jusqu’alors populationniste convaincu, nourri comme il l’était de la pensée de Cantillon. De ce moment, comme son maître, Mirabeau professera le dogme de la productivité exclusive de l’agri culture. Mais la visée de Quesnay, c’est la restauration des finances de l’État, la régénération agricole n’étant que le moyen — à la vérité essentiel — d’y parvenir. Aussi, après avoir tracé dans le Tableau économique le schéma de la circulation des richesses, se tourne-t-il vers son premier objectif : la réforme fiscale. La méditation commune des deux hommes aboutit, en 1760, à la Théorie de l'impôt, publiée sous la responsabilité du seul marquis, qui en escompte au moins le contrôle général. Mais l’ouvrage attaque sans ménagement les fermiers géné raux qui se vengent én obtenant l’emprisonnement de Mira beau et son exil momentané dans sa propriété du Bignon. Cet accident n’arrête pas l’élan de la pensée physiocratique. Bien plutôt, par une sorte de sublimation, lui confèret-il cette tendance à l’universalisme qui lui sera si souvent reprochée. Dès lors, l’École, sans s’interdire de participer aux discussione plus pragmatiques sur la liberté de commerce des grains ou le taux de l’intérêt, va élaborer une philosophie, voire une métaphysique, fondées sur la précellence de l’agri culture. D’où le titre de Philosophie rurale, choisi par Mirabeau pour l’espèce de catéchisme social qu’il propose en 1763 aux méditations de ses concitoyens et que Grimm traitera irrévé rencieusement de « Pentateuque de la nouvelle Secte ». 1763 est une année malheureuse pour la France. Les défaites diplomatiques et militaires, la pénurie croissante du trésor sèment l’inquiétude dans les esprits et les orientent vers des questions qu’on n ’avait pas accoutumé de voir débattre sur le forum. Quantité de projets plus ou moins fantaisistes sont avancés pour secourir l’État. Celui du conseil ler Roussel de la Tour, qui recommande une sorte de capita tion progressive généralisée, obtient une audience, au reste imméritée. En le réfutant brillamment, Dupont de Nemours, encore obscur, attire l’attention de Quesnay qui s’attache ce jeune homme plein d’avenir. Désormais l’Ecole est formée :
AVANT-PR OPOS
XV
elle a son penseur, son rédacteur en chef et son secrétaire. Bientôt, Le Mercier de La Rivière la dotera de sa politique et elle disposera pour les débats publics et les problèmes du jour d’une équipe de journalistes, sinon toujours spirituels, du moins fort combattifs, parmi lesquels brilleront : Roubaud, Le Trosne et surtout l’abbé Baudeau qui, sitôt converti, met à sa disposition la revue qu’il dirige, les Éphémérides du citoyen. De plus, des. alliés plus ou moins déclarés, tels Turgot et Morellet, ne laisseront pas d’apporter un concours appré ciable. Mais les Physiocrates manquent de mesure dans l’exposi tion de leurs thèses ; surtout, ils bravent le ridicule à une époque où il est encore capable de tuer et suivent obstinément leur route, suscitant de solides inimitiés qui n’auraient sans doute pas suffi à les abattre, si la conjoncture économique n’avait été constamment défavorable à leur propagande au cours des années 60. Ils réclament, en effet, pour le blé un « bon prix », c’est-à-dire, à leur sens, un prix de vente qui rémunère largement la peine du cultivateur et fournisse par surcroît une marge bénéficiaire substantielle, un produit net, source unique destinée à alimenter l’impôt. Or, une succession de mauvaises récoltes a pour effet de faire hausser d’une manière catastrophique le prix des grains, sans que cette hausse, due à la pénurie, soit un signe de prospérité, bien au contraire. Jouant sur les termes « bon prix » et « cherté », leurs adversaires les rendent responsables d’une crise dans laquelle les éléments seuls ont joué un rôle actif. De plus, leur théorie politique du despotisme légal est rejetée par les meilleurs esprits à une époque où l’aspiration à la liberté est unanime. Aussi le discrédit atteint très vite les Physiocrates et le public s’est déjà détaché d’eux quand le ministère revient aux mesures protectionnistes. Après la chute de Choiseul, c’est, pour l’École, une éclipse presque totale. Pourtant, si le mouvement physiocratique s’arrête, l’idée continue et son développement variait la peine d’être retracé. * «* Quesnay ne meurt qu’en 1774, mais, depuis 1768, il a cessé toute participation active aux travaux de 1 École qu’il a formée, pour se consacrer à des recherches mathématiques
XVI
AVANT-PR OPOS
qui dénotent d’ailleurs un affaiblissement de ses facultés. Dupont de Nemours, harcelé par une censure de plus en plus hostile, s’essouffle à rédiger presque seul les Éphémérides du citoyen qui disparaissent au printemps de 1772, en dépit de l’aide momentanée que lui apporte Baudeau, revenu de Pologne avec le titre de prévôt mitré de Widziniski, malheu reusement dépourvu de bénéfice. Turgot, de son intendance limousine, adresse au coryphée de la Physiocratie des encou ragements et, à l’occasion, des blâmes, car il demeure un allié très libre de la Secte. Aussi, à son tour, Dupont s’exilet-il et, quittant Paris, délaissant l’enseignement par corres pondance au prince héritier de Bade et les relations épistolaires avec le roi de Suède, accepte-t-il le secrétariat de la Commission d’Éducation de Varsovie, où l’appelle le prince Adam Czartoryski. Il ne faudra rien de moins que l’élévation de Turgot au Contrôle général pour le décider à revenir en France, au poste d’inspecteur général du Commerce. * * 4e C’est à ce moment que s’ouvre l’ouvrage que nous présen tons aujourd’hui. Pour diverses raisons, les éditeurs ont pré féré publier d’abord l’histoire de la Physiocratie de 1774 à 1781, c’est-à-dire pendant la période qui couvre les minis tères de Turgot et de Necker. Les manuscrits laissés par le regretté Georges W e u l e r s s e , entièrement rédigés et complétés par un Index extrêmement utile, permettront de pousser l’étude des destinées de l’École physiocratique jusqu’aux premières années de la Révolution et de combler d’abord la lacune 1770-1774 par un volume intitulé : La Physiocralie à la fin du règne de Louis X V . Enfin, un autre volume prendra la suite de celui-ci et comportera un Épilogue qui conduit jusqu’en 1792. Tous ceux qui s’intéressent à l’histoire des faits et des idées économiques du x v m e siècle accueilleront avec faveur la suite — mûrie au cours d'une laborieuse retraite — de l’œuvre de jeunesse de ce grand historien. J . Co n a n ,
Professeur au Lycée Condorcei-Nanlerre, Diplômé de VÊcole des Hautes Études historiques.
PREMIÈRE PARTIE
LA PHYSIOCRATIE SOUS LE MINISTÈRE DE TURGOT (1774-1776)
G . W EU LERSSE
1
Ch a p it r e P r e m ie r
L’ÉCOLE ET LE PARTI I. — Les forces du parti Quesnay va terminer sa longue existence, si bien remplie ; mais, jusqu'au dernier moment, « vieillard vénérable, caduc par le corps, mais toujours unique par la tête » (1), il aura, dans la retraite que lui avaient imposée les circonstances, « donné, sans ostentation comme sans faiblesse, le rare exemple de la seule bonne conduite, qui consiste à éluder et à amortir la persécution, sans lui faire tête ni la fuir » (2). Et il n'avait cessé de prodiguer à ses disciples d’utiles conseils. Mirabeau est resté jusqu'au bout son élève personnel et docile. Dans le soi-disant Avis de VÉditeur du Supplément anonyme à la Théorie de l'Impôt — lequel est en réalité du marquis lui-même — il rappelle, ce qu'il avait déjà indiqué dans son Éloge de Vauban (1772), pourquoi dans l'ouvrage primitif de 1760 il « avait pris [passé] condamnation sur la franchise des biens d'Église et des biens nobles, exception absolument anti-économique et contraire à l'ordre naturel... C'est que son maître en science économique, qui le lui avait demandé, avait alors des espérances fondées de voir le cabi net (3) tourner vers ce plan... Lorsqu'il fut question de cette exception, il se défendit tant qu'il put de l'admettre, mais son maître n'en voulut jamais démordre, disant opiniâtrement qu'il ne fallait pas attaquer tant de gens à la fois. Il ajouta que c’eût été chose singulière pour un tiers de voir, d’un côté celui qui était de l'ordre des privilégiés vouloir les saper à toute force, et l’autre, dans le cas contraire, en être l'invincible (1) M. au Margrave, 10 janvier 1775 ; Knies, t. I, p. 85. (2) M., Éloge funèbre. Cf. Oncken, OE. Q.t p. 10-11. (3) S’agit-il de Silhouette, contrôleur général du 4 mars au 21 octo bre 1759, ou de Bertln son successeur ? Cf. Mouv. P k g s 1.1, p. 67, 76 et 78.
4
LA P H Y S I O C R A T ! E SOUS LE M I N I S T È R E
DE T URGOT
soutien ». Le marquis avait donc cédé « à la nécessité, se réser vant toutefois de la faire un jour connaître ». Insoucieux d'un opportunisme politique désormais périmé, le disciple profitait donc de la disparition du maître pour libérer son intransigeante conscience. Mais ce qu'il ne révèle pas, c'est que, à l'égard du Supplément lui-même, composé dès 1774, le vieux docteur avait rempli une dernière fois son rôle de censeur doctrinal. Il ne se borne pas à corriger quelques inadvertances matérielles (1) ; il signale certaines bizarreries de style, se demandant, par exemple, si le lecteur comprendra bien que l’expression « associations marchandes » désigne de véritables puissances telles que la Hollande, Tyr, ou les Hanséatiques (2). Il dénonce avec un fin bon sens l’outrancier optimisme du marquis affirmant que « pour les actions et conventions pri vées, tout peut aller de soi-même, sans intervention d'aucune autorité » : celle-ci serait encore nécessaire, lui oppose-t-il, « pour empêcher les effets de la mauvaise foi » (3). De même, quand Mirabeau va jusqu’à prétendre que « au moyen du calcul des avances et de l’ordre naturel des dépenses on peut, chez une nation agricole, faire exactement cette année-ci l'a/manach des produits de Vannée prochaine » (4) ; ne faudrait-il pas ajouter, insinue-t-il, que « c'est sauf les cas fortuits, que je sais devoir être bien plus rares et moindres dans leurs effets, mais qui existeraient cependant ! » (5). Les tendances anti-cléricales de Quesnay, quand il exprime franchement sa véritable pensée, sont toujours plus accentuées que celles de Mirabeau. « Faire que'la Société entière devienne Eglise et que l’Église devienne Société » : cette double et équivoque formule choque le docteur selon qui « le mot d’église a trop changé de signification dans l’esprit de tous, par l’abus » (6). Le marquis n ’avait cependant pas manqué de stigmatiser les empiètements du clergé : « Dans la confusion des idées fiscales anti-naturelles..., dans les arrangements successifs et fortuits de nos sociétés aventurières, on a voulu faire la part aux prêtres ; et les prêtres ont fait comme les souverains, et comme les sujets, et comme tout le monde, là où les lots sont brouillés ; ils ont fait ce qu’on exprime bien (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Cf. A. N., M w , K. 883, n° 1, p. 26, § 3. Ibid., chap. I, p. 4, S 2. Ibid., chap. I, p. 2, § 5. C’bst Quesnay qui souligne. Ibid., chap. 1, p. 4, § 3. Chap. 4, p. 30, § 5.
L’É COLE
et
le
parti
5
par le proverbe, peut-être trop populaire, qu'il faut garnir son assiette et manger au plat. » Le critique redouble de vio lence : « Les idées fiscales anti-naturelles sont fort postérieures aux usurpations de toute espèce, plus fortes de la part du clergé parce que les moyens étaient plus forts, plus odieux... aussi plus fripons... plus criants d’efTrontée hardiesse. Ils allaient diamétralement contre les principes qu’ils prêchaient. Les usurpations ont pris leur source dans Terreur où on tombe en payant en terres les services quelconques, même celui du représentant de la force publique, c’est-à-dire du souverain, au lieu de le rendre copropriétaire des fruits, comme l’auteur l’indique. Les friponneries des courtisans et des prêtres l’eurent bientôt dépouillé des terres, ne lui donnant aucune facilité pour exercer police et administration... (1). » Sur la participation des dignitaires ecclésiastiques, en tant que tels, aux Assemblées de propriétaires fonciers que préco nise le Supplément, une vive controverse s’engage. « Toute terre dans l’É tat devant l’impôt au souverain, avait écrit assez nettement l’auteur, il ne sera plus question de terre sacerdotale (ou noble). » Mais Mirabeau avait commis l’impru dence d’accorder aux représentants du haut clergé un droit de présence et une influence personnelle : « Quant à ce qui est, pour les dignitaires de TÉelise, d’être suspects au peuple comme redevables et voués au gouvernement, ou dépourvus d’intérêt à la chose comme étrangers, cela suppose l’ancienne opposition entre le père et la famille, et nous avons vu que l’instruction et l’authenticité avouée de la loi fiscale ne doivent plus laisser de trace de cet esprit. La qualité d’étranger pareil lement cessera d’être suspecte... parce que l’opinion générale concevra facilement que le vrai régnicole est celui qui a son revenu dans l’État, dans la Province, et que l’admission d’un étranger, loin d’être nuisible, est avantageuse, parce que s’il ignore ce que vous savez, en revanche il sait ce que vous igno rez ; s’il est plus indifférent ici, il est plus attaché ailleurs, et toutes les connaissances se tiennent et s’entr’aident. La partie du corps clérical vouée à l’instruction journalière ne peut vaquer sans doute à d’autres soins. Mais... s’il est à la tête de ce corps des chefs qui n’en aient que l’inspection et la juridic tion, et qui possèdent d’ailleurs de grands domaines selon les lieux et usages des nations..., nous ne voulons — concluait le marquis — proscrire que ce que Tordre naturel proscrit impé(1) Ibid., cf. 4, p. 30, § 6.
6
LA FH Y SI OCR ATI E SOUS
LE M I N I S T E R E
D E TURGOT
rieueement lui-même : ce serait mal fait de leur donner l'exclu sion à la confiance publique, et par là même de les désinté resser sur le bien du pays (1). » — « N’en déplaise à l’auteur, s'insurge l irascible et méfiant Docteur, si, dans ces paragraphes il n ’a pas fait comme dans la Théorie de Vlmpôi, où il n ’ose pas dire tout pour des raisons qu il explique dans cet ouvrage-ci, ... je crois qu’il se trompe sur le clergé admissible aux Assemblées. L’ordre naturel rendra les hommes moins méchants, il ne les rendra point parfaits. Je n ’y voudrais de préposé du souverain que comme une sentinelle, c’est-à-dire pour empêcher qu’on ne fît rien contre l’ordre. Mais il lui serait prohibé de dire un seul mot et de montrer son avis sur ce dont il serait question. » Pourquoi cela ? C’est qu’un homme a assez d’une fonction ; celle des prêtres est trop grande, trop élevée, pour en ajouter une autre. Le prêtre d’aujourd’hui, et celui qu’il y aura dans mille ans, l’ordre naturel étant suivi partout, croira encore que toute juridiction et toute immunité lui est due. L’orgueil ne mourra pas tant qu’il y aura des prêtres. Le plus humble pour lui-même a de l’orgueil pour le sacerdoce. Le clergé en impo serait, lors même qu’il ne le voudrait pas, et certainement il le voudrait. « De plus, s’ils ont songé à leurs fonctions et s’ils s’y sont appliqués, ils ne savent rien de l’agriculture et du commerce. Moïse leur donna des villes à habiter, des dîmes pour vivre, mais point de terrain. Son exemple serait bon en cela. Car, pour remplir une fonction publique, il faut être payé de son labeur, et de ce qu’on ne peut veiller à sa chose propre. Les terres des prêtres sont encore une loupe à déraciner. Je n ’exclu rais pas un prêtre qui aurait des terres patrimoniales, non plus qu’un capitaine de dragons ; mais je ne voudrais pas plus de prêtres ès qualité, et comme archevêque, primat ou pape, dans les Assemblées, que des capitaines, colonels, officiers généraux comme tels, quoiqu’ils puissent y avoir entrée comme pro priétaires. Il faut que l’homme qui y est ne se regarde que comme citoyen. » Mirabeau ne retranche rien de ce qu’il avait écrit ; mais, non sans embarras, il ajoute en marge : « Principe général et certain, c’est que, dans tout É tat bien constitué, la loi natio nale doit prohiber que qui que ce soit puisse posséder deux charges, ce qui suppose deux emplois, et par conséquent plus (1) Ibid., chap. II (II® Partie), p. 47, § 2,
l 'é c o l e e t l e p a r t i
7
qu’un homme n’en peut faire. L’assistance aux Assemblées nationales économiques n’est pas précisément un emploi, puisqu’elles n’ont ni autorité ni permanence ; mais il y aura toujours assez de propriétaires hommes privés, pour ne pas les remplacer par ceux qui ont d’autres fonctions publiques dans l’É tat ; et la sorte d’autorité et d’influence que les foncsions entraînent peut devenir très dangereuse dans des assem blées où tout doit respirer la confiance et la liberté. » Sur l’épineuse question des dîmes, Mirabeau s’était expli qué avec une suffisante clarté : « Elles peuvent être une charge sur les terres comme toutes autres redevances qui se trouvent établies par le laps de temps et par les conventions successives entre les propriétaires et les colons ; si dans ces conditions se trouve l’entretien des églises, sacristies, desservants, etc., ce sont des traces des temps d’embarras où l’ordre particulier tâchait de sortir de dessous les ruines du désordre général... Mais enfin, sans tomber dans les détails, disons, puisque l’ordre le dit, que les dîmes sont portion du revenu des propriétaires ; que le souverain a sa part sur ces revenus, et que les revenus particuliers ne sauraient faire partie des fonds destinés par l’ordre à l’instruction. » Quesnay ne contredit pas ; mais il envisage pour l’avenir la suppression radicale de cet impôt irrégulier, et tant qu’il subsistera, il insiste sur la nécessité immédiate d’en réformer l’assiette : « Si les terres des proprié taires payent des dîmes, c’est une charge de plus. Il semble qu’elles ne devraient payer qu’au roi, qui se chargerait des prêtres — sauf dans les pays où les dîmes sont féodales et font partie des revenus et droits du seigneur. Mais, de quelque manière qu’on fasse, les dîmes sacerdotales doivent être fixées relativement au produit net (1). » Mirabeau sur le dernier point est d’accord : « Si les ecclé siastiques prétendent que leurs dîmes sont attributives du sacerdoce comme de droit divin, voilà ce que Dieu réprouve, puisque l’ordre naturel les rejette comme un impôt sans règle et sans mesure, qui se lève sur le produit total sans aucun calcul ni détraction des avances. » Mais il déclare « louable et utile » la désignation personnelle, pour certains emplois gra tuits, de représentants qualifiés des deux ordres privilégiés : « comme volontaires à l’armée, administrateurs d’œuvres pies sans salaire, magistrats sans attributions, etc. ». Cette dernière formule suffit à échauffer la bile du docteur contre toute la (1) Ibid., cf. 4, p. 31, § 2.
8
EA P H Y S 1 0 CR ATIE SOUS LE M I N I S T E R E D E T U R ü O T
magistrature : « Cela aurait l’air d’une ironie ; car l’attribution est nécessaire à un magistrat pour être tel, et un magistrat inutile est beaucoup plus qu’inutile. » Le marquis s’est contenté de spécifier dans son texte : « sans attributions pécuniaires » (1). L ’intraitable réformateur cependant revient à la charge contre cette institution, détestée à l’égal du fisc dont elle est le suppôt : « Attendu l’abus du produit de l’impôt et l’arbitraire de sa source et de sa perception, si j ’étais Robin Quesnay, Je, chancelier, je regarderais le mépris qu’on a pour les huissiers et les records comme une juste critique de l’iniquité des juges et de la forme judiciaire (2). » Dans sa revue des divers types de gouvernement, Mirabeau caractérisait sévèrement l’aristocratie comme la réunion d’un certain nombre de volontés expertes et privilégiées qui étei gnent toutes les autres ; « ... genre de pouvoir qui n’a de territoire que des rues, et d’affaires que des services, des tracas et des plaisirs. C’est un Conseil sage si l’on veut, à cela près qu'il désintéresse les peuples ; et auquel il manque un Chef ; institution qui n’a ni force, ni vrai courage, ni consti tution agricole ; car la plus petite entreprise d’agriculture demande un entrepreneur en chef ». Quesnay laisse deviner à quelle vindicte s’expose ce téméraire censeur des constitu tions plus ou moins oligarchiques : « Gare les Bernois ! » s’écrie-t-il avec un familier humour (3). Son heure venue (16 décembre 1774), le chef de l’École était mort avec la sereine dignité d’un sage. « Comme son domestique auprès de lui pleurait, il lui dit : « Est-ce que tu « crois que je ne suis pas né pour mourir ? Regarde ce por« trait ; lis en bas la date de ma naissance ; juge si je n’ai « pas assez vécu (4). » Les honneurs rendus à sa mémoire allaient, momentanément du moins, resserrer les liens qui unissaient entre eux les membres de la petite communauté. Grimm ne manque pas de railler cette cérémonie de « canoni sation », cette « apothéose » du 20 décembre, et la « dévotion religieuse dont fut empreinte l’oraison funèbre prononcée par Mirabeau », « mouvement ridicule élevé au fanatisme et à l’esprit de parti » (5). U Éloge public, peu après, par le comte d’Albon, s’il ne débordait point comme le précédent d’effu(1) (2) (3) (4) (5)
Ibid., cf. 4, p. 31, § 1.
Ibid., cf. 1, p. 3, § 2. Ibid., p. 70, chap, dernier. Laboulaye, Rev. Cours Litt., 23 sept. 1865. Quesnay avait 80 am. Corresp., fév. 1775, t. X I, p. 39.
L ECOLE ET LE PARTI
9
sions lyriques, témoignait, lui aussi, d’une admiration exaltée : n’y lisait-on pas qu’en « métaphysique le Docteur avait égalé les Locke, les Clarke, les Malebranche, et qu’en philosophie il avait été l’émule de Descartes » (1) ? L’auteur cependant était un disciple assez hétérodoxe, se réclamant de l'Ami des Hommes autant que du Tableau, se prononçant sans doute pour un impôt territorial unique, mais l’envisageant comme progressif plutôt que strictement proportionnel, et l’accompa gnant de taxes spéciales sur les célibataires et sur les million naires, inspirées d’un certain esprit populationniste et social étranger aux purs Physiocrates (2). En célébrant pieusement les mérites de son fondateur, en renouvelant le serment de fidélité à ses premiers principes, le parti essayait de raffermir ses forces. Les Maximes générales, avec la fameuse devise : Ex nalurà jus, ordo et leges, étaient reproduites en tête du premier numéro des Nouvelles Êphémérides. Mieux que cela, par les soins de Quesnay le fils, cet « Alcoran » allait être réimprimé à part, « avec approbation et privilège, sur une feuille in-folio toute bordée de festons, de guirlandes et de vignettes rustiques, et que Ton vendait dans un cadre doré sous glace au Palais-Royal et aux Tuileries » (3). Plus n’était besoin de placer l’œuvre du Maître sous le patro nage rituel et quelque peu désuet de Sully. De Mirabeau les Lettres sur la Législation étaient publiées en volume en 1775 ; mais elles avaient déjà été insérées dans les Éphémérides avant 1770. En revanche son important Supplément ne paraissait que deux ans après sa rédaction, en 1776. Ses Assemblées « devenaient chaque jour plus nom breuses » (4). Il y avait dix ans (1767) que « ce Club, ou pour parler plus vrai cette École économique parisienne, avait été constituée ; ses réunions seules ont fait force, corps et émula tion, se soutenant pendant ce temps contre vents et marées (1) Nouvelles Êph., 1775, n° 5, p. 167. (2) Cf. Observations d'un Citoyen sur un nouveau Plan d'imposition, nov. 1774, p. 1-2. (3) Voir Grimm, Corresp., sept. 1775, t. XI, p. 127-128, et Linguet, Journal poL et lilt., n° 24, 25 août 1775, t. II, p. 502. Cf. Corresp. Métra, t. II, p. 101 : « Tout bon Sulliete doit avoir au chevet de son lit cette image encadrée ; et si jamais des Colbertistes s'échauffaient au point de voir renouveler, pour des systèmes économiques, les scènes fanatiques qu'on a vues pour les opinions de croyance religieuse, elle serait le signe de rédemp tion, au cas que les Sullistes l'emportassent. » (4) M. au Margrave, 10 janv. 1775; Knies, t. I, p. 85. Cf. au même, 6 avril 1775, p. 87.
10
LA P H Y S IO C R A T!E SOU6 LE M I N I S T È R E D E TURGOT
par le poids des mœurs et de l’indépendance... En un siècle décousu et débridé surtout comme celui-ci, c’est miracle de voir la divergence des parties huileuses qui, suivant nos bien faisants philosophes, constituent ce qu’on appelle l’dme..., je fis donc un ensemble... je les encourageai, les maintins, les purgeai surtout de cette détestable teinte de philosophie tant à la mode, tant intrigante et usurpatrice, qui veut tout détruire... La vogue, le concours des honnêtes gens, des curieux, des étrangers, tout nous soutint. Il eût fallu cesser au moment où Turgot vint au ministère ; je le dis à ma famille, à nos amis ; mais pour cela, il eût fallu que je demeurasse l’hiver à la campagne ; je le désirais fort, mes affaires ne le permirent pas... » (1). L’honneur des hautes distinctions accor dées au chef par des princes étrangers, Margrave de Bade, Grand-Duc de Toscane, roi de Suède, rejaillissait sur l’ensemble d un parti, dont le crédit grandissait autant et plus au delà des frontières qu’en-deçà. Dans l’Épître dédicatoire du Sup plément, s’adressant au souverain Scandinave, l’auteur se félicite de « porter depuis longtemps sur la poitrine l’emblème et la devise du règne : l’abondance, la réunion et la force ali mentaire, la Gerbe » (2). Le propre fils aîné du marquis, le comte de Mirabeau, dans son Essai sur le Despotisme (1774-1776), citant le Droit naturel, rend hommage à cet « auteur méthodique et lucide, l’immortel Quesnay » (3) ; il célèbre cette « science simple et profonde qu’on a appelée économique, et qui de nos jours les a démontrés enfin, ces principes si longtemps ignorés, si longtemps inconnus. Les citoyens vraiment utiles qui s’en sont occupés ont été tournés en dérision par toutes les plumes mercenaires du gouvernement. Persécutés depuis, forcés au silence, ils auront du moins la consolation d’avoir fait le métier d’homme et de citoyen ; et ce sont eux qui ont vraiment mérité qu’on pensât de leurs travaux ce qu’un Ancien disait de la philosophie : que les hommes ne seraient heureux qu'alon qu'elle se serait familiarisée avec les rois. Toutes les choses (1) M. à Longo, 19 janvier 1777. Mss, Aix, XVI, p. 64. (2) Mss. cil., p. vi. (3) Essai sur le Despotisme, p. 39. — « L’ouvrage devait s’imprimer lorsque Louis XV est mort ; ... mais l’auteur, espérant que Louis XVI réparerait les maux du règne de son aïeul, avait suspendu son projet... Il est daté de 1775 : mais la difficulté de trouver des presses pour de pareils livres... en a vraisemblablement retardé la publicité. Il est encore fort rare, et mérite d’être plus connu. » Bachaumont, t. IX, p. 157, 22 juin 1776.
l ’é c o l e e t l e p a r t i
11
ont changé depuis que la nation est conduite par des ministres honnêtes et instruits... (1). Les écrivains économistes... ont établi et détaillé avec méthode des vérités trop négligées... pour en déduire les conséquences qui forment le véritable système de Téconomie politique » (2). Suit une longue censure du règne de Louis XIV, directement inspirée de la Théorie de ΓImpôt, où l’on dénonce « les rapines de la fiscalité protégée et perfectionnée par ce Colbert si longtemps encensé... Tout le royaume alla s'engloutir dans les impôts... ou dans les manu factures, autre manie destructive de ce siècle d’illusion » (3). Revenu de Pologne en simple particulier, après avoir en vain essayé de faire sa rentrée en France comme Résident de la République royale par la grâce du prince-évêque palatin de Vilna, l’abbé Baudeau, dès le mois d’octobre 1774, annonce la réapparition des Êphémérides (4), dont la publication reprendra effectivement, grâce aux subsides du ministère, en janvier 1775 (5) ; et dès le mois de septembre le ministre l’avait employé « à examiner bien des choses, notamment l’établissement de la Caisse de Poissy » (6). Entre temps il donne son Avis au Peuple sur Γimpôt forcé qui se percevait dans les halles et marchés sur les blés et les farines (8 octobre 1774), et ses Lettres et Mémoires à un Magistrat du Parlement de Paris sur VArrêt du 13 septembre 1774 ; puis un Mémoire sur les Corvées, réplique à leurs apologistes (1775) ; sans parler des Questions posées à Monsieur Richard des Glanières sur son Plan d'imposition soi-disant économique (1774) et des Éclaircisse ments demandés à Monsieur Necker (1775). Cette brillante acti vité lui vaut un vrai panégyrique du marquis : « Doué de la plus grande aptitude à tout genre de travail, vous avez voué votre temps et vos peines à l’instruction populaire et générale sur le premier besoin de l’homme ; à lui procurer le grain, la moùture, la pâte, le pain. Vainement les détracteurs prétendraient-ils qu’il ne peut s’élever, et que le genre familier est son talent exclusif ; qu’ils voient la préface des premières Êphémé rides... (7). D’avoir été leur premier instituteur et d’être leur régénérateur aujourd’hui, ce titre suffira pour vous attirer la Ibid., p. 56. Ibid., p. 104, n. 2. Ibid., p. 153-154 et p. 172. Sous le titre Nouvelles Êphémérides, cf. p. 419. (δ) Cf. Loménie, t. II, p. 397. (6) Hardy, Journal, 7 octobre 1774, t. II, p. 426. Cf. p. 419. (7) Cf. Mouv. Ph., I, 126.
(1) (2) (3) (4)
12
LA P H Y S IO C R A T IË SOUS LE MINIS i'E R E D E TURCiOl
reconnaissance et l’amour de l’humanité ; en attendant, apte à tous les calculs, hors ceux de votre intérêt propre, il est des moments où vous pourriez craindre le sort de l’astrologue ; mais vous pratiquez la justice et nondum vidi justum dere lictum (1). » Peu après, il est vrai, il faut déchanter : la réédition plus qu’à demi manquée des Économies royales de Sully attire à l’auteur tant vanté plus de reproches que de compliments : « Il est, certes, zélé, ardent, V bon économiste, mais un peu étourdi et prompt à se rebutei dans les ouvrages de longue haleine (2)... Avec un talent primesautier, comme dit Mon taigne, c’est une tête légère quant à l’application suivie..., à cela près il serait capable de tout, et il est impossible d’avoir plus d’aptitude et de talent dans le génie. Son plan d’abord fut le plus beau du monde... il devait mettre en ordre les matériaux et y joindre ses observations. Cet ouvrage seul demandait un homme rassis tout entier, et indépendamment de ce que l’abbé prend à toute idée, les consultations sans nombre qui l’accueillent tous les matins, comme étant incom parable en affaires, suffisaient à le faire tourner à tous les vents. Le premier volume paru... je vis que le drôle allait s’établir éditeur de lambeaux tirés des Mémoires du temps, rafraîchis par quelques aspects et ornés de réflexions de son genre... ; tout son travail se bornerait là. et encore n’y serait-il poussé que par le débit et la nécessité de fournir ; il n’y songerait que la veille ; ce serait de la besogne croquée. Le deuxième volume justifia cet horoscope, et la publication s’arrêta, dès 1775. Dans ses Êphémérides mêmes, son inconséquence montrait l’oreille bien souvent (3). » L’abbé Roubaud demeure à la Gazette du Commerce et l’on peut « espérer beaucoup de la semence qu’il jette éparse ça et là » (4). On lui doit « deux feuilles par semaine de la plus sail lante, de la plus exacte et utile instruction ; c’est la manne sans cesse renouvelée pour le peuple dans le désert. Là les autorités, le gouvernement et les administrations quelconques trouvent une dénonciation respectueuse, appel de la voix intérieure qui s’éveille et prononce tu es ille vir... E t cet homme, attaché à un travail de dépouillement aussi fatigant pour lui (1) (2) (3) (4)
M., Discours de rentrée, 1775-1776, M. 780, n° 6, M ss.y p. 29. M. à Longo, 16 mare 1777, Mss. A ixy XVI, p. 38. Ai. à Longo, 28 août 1777, ibid.y p. 77. M. au Margrave, 10 janvier 1775 ; Knies, t. 1, p. 85.
l ’é c o l e e t l e p a r t i
13
qu’il devient facile et agréable pour nous,... se dévoue au sort du feu Saint-Elme, qui ne peut brûler que dans la tempête, et semble attirer l’orage alors même qu il relève l’espérance du nautonier » (1). % Mercier de La Rivière avait en vain demandé à figurer parmi les collaborateurs de Turgot, quand celui-ci n’était encore que ministre de la xMarine. Baudeau l’eût préféré voir aux Finances, sinon comme contrôleur général, ainsi que quelques honnêtes gens l’auraient pensé (2), du moins comme procureur général du Tribunal supérieur du contentieux (3). Il donne en 1775 un livre sur VInstruction Publique que lui avait demandé le roi de Suède. Le Trosne composait déjà ses grands ouvrages sur Y Intérêt Social, sur YOrdre social, qui ne devaient paraître qu’en 1777. Durant la courte, mais très pleine période qui nous occupe, il semble n’avoir publié que des opuscules : la Lettre des Laboureuses (1775), et son Discours préliminaire, couronné par l’Académie de Toulouse (1776). Bien que lié d’amitié avec Turgot, il ne fut point non plus appelé dans les bureaux du ministère. Dupont était loin de la France, en Pologne, lors de l’arri vée de Turgot aux Finances : instamment rappelé par le ministre, « selon la parole donnée », il était rentré dès le 20 novembre 1774. Aussitôt nommé inspecteur général des manufactures, il s’installait au contrôle général, aux côtés de l’ami dont il va devenir le collaborateur le plus intime ; il sera de moitié dans la préparation de presque tous ses Édits ou Mémoires, et aux heures difficiles il lui prêtera un concours plus actif encore, qui ne se démentira jamais (4) ; « à la révolte de 1775, comme il a du courage, il servira le ministre avec beaucoup d’intégrité » (5). Butré ne pouvait jamais être qu’un auxiliaire. Quesnay et Mirabeau auraient voulu le voir affecté au cadastre ; le marquis sollicita même indirectement pour lui la création d’une chaire (1) M ., Discours de rentrée, 1775. M ss., M. 780, n° 6, p. 27-28. (2) Chronique secrète, 2 août 1774. (3) Cf. B., Chronique secrète, 9 juin 1774. — Un autre « colonial », défenseur de la nouvelle doctrine, reçoit de Turgot, à défaut d’une part quelconque de pouvoir, une avantageuse marque d’estime : l’intendant Poivre bénéficie, à partir de 1775, d ’une pension de 12.000 livres. (4) Il fut « le bras droit de Turgot lors de l’expulsion de M. Lenoir ». Ai. au bailli, 7 août 1779, Cf. Mém. Montigny, t. II, p. 316. Cf. infra. (f>) M. à Longo, 25 nov. 1777, Mss. Aix, XVI, p. 95.
14
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS LE M I N I S T E R E D E TURGOT
d’Économie politique, plus précisément de Statistique fon cière, mais sans succès. De l’aveu même de son protecteur, le laborieux « calculateur » de la Théorie de V Impôt n’était qu’un habile et honnête expert, « aide unique pour les vérifications rurales et les taxations qui s’ensuivent, travaillant comme un cheval... mais un cheval aveugle, qui tire bien pourvu qu’on sache l’employer ; bon gentilhomme campagnard, mais tête faible, susceptible d’exaltation... » (1). Cet homme p. 933. Cf. Lebeau, p. 425. Ai., Disc, de rentrée, 1776, Mss., p. 59-60. Ai., Disc, de rentrée, 4 déc. 1776, p. 6 et p. 11. Ibid., p. 59-60. Af. au Bailli, 29 mai 1775, citée par Loménie, t. II, p. 404.
24
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS LE M I N I S T È R E D E TURGOT
pouvaient témoigner à l’École un d’Alembert (1) par exemple ou un Condorcet, Diderot achève de se détacher d’elle. De quel ton dégagé il parle des « visions politiques de cette classe d’honnêtes gens qui s’est élevée parmi nous et qui nous fera beaucoup de bien ou beaucoup de mal b (2) ! E t quels éloges exaltés du nouvel ouvrage de Necker ! « C’est la défense de la nation contre les nations rivales ; c’est l’apologie du travail contre l’oisiveté, et de l’indigence contre la richesse (3). » Un autre grand écrivain, qui n’était pas, lui, un Encyclopédiste, témoigne plus que de l’indifférence, un violent mépris pour les disciples de Quesnay : c’est Buffon, qui avait d’ailleurs des raisons personnelles d’en vouloir aux adversaires du protec tionnisme industriel ; critiquant un opuscule de Condorcet, il les appelle des c demandeurs d ’aumônes b , et qualifie leur style de « jargon d’hôpital b (4). Parmi les adversaires déclarés, il faut compter, malgré certaines apparences, Mably, qui publie alors son traité De la Législation. Sans doute vante-t-il la supériorité morale de l’agriculture et déplore-t-il la misérable condition du plus grand nombre des paysans : « Je serais tenté de croire que les peuples ne jouiront de tous les avantages de la société que quand leurs modestes magistrats seront tirés de la charrue. C’est alors que les lois seraient justes et impartiales et les campagnes florissantes... Elles ne sont couvertes que d’hommes livides et décharnés, à qui il ne reste que leurs bras pour faire vivre à moitié une famille malheureuse, b Mais l’utopie perce sous le vague de telle suggestion idyllique : « Le travail qui accable les laboureurs ne serait qu’un amusement délicieux si tous les hommes le partageaient, b Le Philosophe condamne d’ailleurs expressément les réunions de fermes : c’est au menu peuple des journaliers qu’il s’intéresse, non à la bourgeoisie rurale : t Pour s’agrandir on n’a pas craint d’acheter le patri moine de malheureux paysans et de les condamner à une pau vreté plus dure que celle de l’ancienne servitude. (5) b II12345 (1) D'Alembert sous l'anagramme de Bertadlaem, est compté comme un Économiste, au même titre que Condorcet, dans le Songe de Maxirepas, p. 28. (2) Plan d'une Université pour le gouvernement de Russie (Œ.t t. III, p. 491). (3) Lettre à Necker, 2 juin 1775. Œ. T., t. XX, p. 69. Voltaire lui-même avait, vers cette époque, appelé un jour les Économistee « les convulsion naires des Encyclopédie tes ». Cf. J.-N. Moreau, Souvenirs, t. II, p. 253-255. (4) Biographie de Condorcet, Œ., éd. O. Connor, t. I, p. lxxvui. (5) Législation, p. 39 et 149.
l ’é c o l e
et
le
pa rti
25
rendait hommage au désintéressement et à la bonne foi d’Eudoxe, en qui il personnifiait les apôtres de la liberté des blés : « car il n fa pas un pouce de terre ou un grain de blé à vendre » ; il signalait tout de même avec une malicieuse ironie les étranges paradoxes, les contradictions inconscientes du personnage : « Il voit enchérir avec joie le pain, parce qu’il imagine que c’est la plus grande base de l’État. Il ne conçoit pas comment le peuple est assez sot pour vouloir vivre à bon marché ; et, fou de son despotisme légal, il ne veut de liberté que dans le commerce, et surtout dans le commerce des grains (1). » Linguet avait réussi à lancer sa venimeuse Théorie du Libelle, et le temps que le gouvernement avait pris pour l’inter dire, 4.000 exemplaires s’en étaient vendus, rien qu’à Paris (2). Comme le comte d ’Albon, sur le frontispice de son Éloge, s’était intitulé membre « de la Société économique de Berne et de celle des Économistes de Paris », le polémiste se permet tait de demander quelles lettres-patentes avaient autorisé cette dernière (3). Le jour même où éclatait la « guerre des farines » (3 mai 1775), Necker publiait son grand ouvrage Législation et Commerce des grains (dont Turgot se faisait scrupule de gêner le moins du monde la diffusion) ; et il suffit de rappeler en quels termes Grimm en salue l’apparition pour comprendre combien rude était ce nouveau coup porté à la politique du parti : t Depuis Montesquieu, s’écrie-t-il, nous ne connaissons point de livre où l’on ait... discuté les questions les plus importantes à la prospérité de l’É tat avec autant d’étendue et de profondeur », et il promet à ce « chef-d’œuvre, aussi vigou reux que sage et modéré, une gloire capable de survivre aux querelles de l’époque » (4). Innombrables étaient les pamphlets, les chansons, plus ou moins anonymes, où l’on prenait à partie, en même temps que le ministre des Finances, « cette secte qui l’avait choisi pour son chef... et dont les principes d’administration n’étaient qu’un tissu d’ignorances, de sophismes et de préjugés » (5) ; « ces hommes sans aucun caractère public, qu’entraînait (1 ) Du commerce des grains, écrit en 1775, publication posthume, t. X III, p. 242. (2) Mém. secreiSy 12 mars 1775, t. VII, p. 338. (3) Journ. po/. ei litt., n° 36, 25 déc. 1775, t. III, p. 5 4 2 . (4) Corresp., avril et décembre 1775 (Œ.t t. XI, p. 59 ©t 106). (5) Lettre contre Turgot supposée écrite par l'abbé Terray et répandue en manuscrit à la Cour au début de 1776. Cf. Soulavie, t. III, p. 432.
26
l a p h y s i o c r a t i e s o u s l e m i n i s t è r e de: t u r o o t
Tamour des nouveautés, que séduisait l'espérance de se faire un nom et une fortune » (1). On les assimilait aux FrancsMaçons, et Ton imaginait plaisamment que « la Franche Loge des Économistes voulait faire agréer à Sa Majesté ses instituts pour les faire succéder à ceux de la Compagnie de Jésus, attendu l’intimité et les rapports qui se trouvent entre les principes d’Ignace et ceux des Frères Économistes » (2). On les traitait d’Alchimistes obstinés à la poursuite de la pierre philosophale (3) ; le Dialogue d'un Philosophe et d'un Homme de bien taxait de naïf orgueil ces Bienfaiteurs du Monde, Ces Sages, ces Savants, ces grands Calculateurs, De Tunique Science uniques inventeurs (4) ; et ces Messieurs encouraient le ridicule de « faire rechercher et proscrire avec beaucoup de sévérité cette facétie, assez mor dante pour qu’on l’attribuât à Palissot, assez spirituelle pour qu’on la comparât aux satires de Voltaire, et qui était de François de Neuchâteau (5). Albert Premier, en dépit, ou à cause de la « longue audience économiste » qui remplissait le troisième acte, avait langui dès la sixième représentation » (6). L’opinion, même quand elle était sympathique, demeurait hésitante, chancelante. Si au moins l’éducation économique du public qualifié avait fait quelque progrès ! Mais non ; il suffit qu’un certain Richard des Glanières propose de renverser l’administration fiscale existante, fût-ce pour la remplacer par un système de fantaisie et que son Plan d'impositions économiques paraisse avec privilège (13 octobre 1774) pour produire aussitôt — comme en 1763 La Richesse de l'Etat — « une sensation prodigieuse » ; jusqu’au moment où l’abbé Baudeau, tout en se modérant, « pulvérise » cette merveille (7). Mirabeau constate avec mélancolie que, quinze ans après la Théorie de l'Impôt, il a pu « se trouver au milieu d’un monde de raisonneurs érudits sur cette matière, dans des circonstances qui y ramènent toutes les volontés, sans que pas un d’eux ait1234567 (1) Mém. secrets, 30 avril 1776, t. IX, p 110. (2) Novembre 1775. Cf. Foncin, p. 358. (3) Tifaut de La Noue, Réflexions philosophiques, p. vu-vin. (4) P. 11. (5) Mém. secrets, 8 juin 1775, t. V III, p. 79 et 83. (6) Cf. Grimm, Corresp., février 1775, t. X I, p. 42. (7) Mém. secrets, 16 oct. 1774, t. VII et Grimm, loc. cit. Cf. Hardy, 13 octobre 1774, et B., Chronique secrète, p. 14.
l ’é c o l e
et
le
parti
27
ouï parler » de son livre (1). « On n’a sur tout cela que des semi-idées... Rien n’est mûr encore... et j ’ai fixé à six généra tions, y compris celle qui existe, le temps où l’ordre naturel sera connu et son régime établi (2). » En dépit de « quelques jeunes gens qui s’essayaient avec zèle aux dernières lectures des Assemblées », les Économistes ne constituaient pas une force (3), du moins capable de « terrasser » la coalition formée contre eux (4). La politique économiste irritait « le premier étage de la ville, les bons bourgeois qui croient que le gouvernement ne saurait trop s’occuper du soin de les nourrir, c’est-à-dire les gens attachés aux vieux usages, et ceux des gens en place qui craignent pour leurs vitres » (5). Et, à l’autre extrémité de la nation, elle ameutait « la basse populace » (6). Les chefs du parti furent même un moment menacés. « Je me rappellerai longtemps, écrit Mirabeau, certain mercredi de la guerre de Paris·: je vis arriver plusieurs de nos amis chez moi comme venant aux nouvelles, et je n’ai su qu’après qu’ils avaient la bonté d’y venir comme craignant que la populace n’y fît insulte (7). » Mais plus redoutables que le bas-peuple des villes en lui-même, étaient les gens qui avaient intérêt à flatter ses préjugés pour s’en faire un appui ; entendons les banquiers, « les remueurs d’argent, qui se croient le talent de gouverner des empires parce qu’ils ont eu l’habileté de faire fortune et dont l’esprit, rapetissé par l’habitude d’un obscur agiotage, ne peut avoir que des vues étroites et une politique ram pante » (8) ; et surtout les fermiers généraux, ces « publicains » qu’on appelait naguère « les colonnes de l’É tat », et qui « ont tremblé dans leur repaire d’un frémissement qui ne les quittera qu’au terme prochain de leur pouvoir » ; ces « accaparateurs »,12345678 (1) Discours de rentrée, 1775, Mss., p. 2. — « Quand Turgot arriva aux finances, j ’étais aux eaux du Mont-Dore ; ... on m'y fêtait en gens de province qui voient et palpent un être imaginaire ; mais là pas plus qu’à Paris et ailleurs, personne ne s’avisa que ce même ouvrage eût ci-devant paru ; il faut avoir été témoin de la folie de faveur qui l’accueillit en son temps pour bien sentir cette leçon; et pourtant j ’avais toujours travaillé depuis, j ’avais fondé une école, eUe était alors dans sa plus forte vogue... » M . à Longo, 30 août 1785, Mss. A ix , XVII, p. 229. (2) M. à Butré, 10 déc. 1775. Cf. Reuss, p. 26. (3) Expression de Mirabeau, lettres au Bailli des 3 et 7 mai 1775. (4) Cf. Chronique secrète, 3 juillet 1774. (5) Condorcet, Lettres sur le Commerce des grains, p. 15-17. (6) Chronique secrète, 22 septembre 1774. (7) Discours de rentrée, 1776, Mss., p. 60. (8) Condorcet, loc. cit. Allusions transparentes à Necker.
28
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS LE M I N I S T E R E D E TURGOT
auxquels on promet que « leurs petits-fils porteront la mandille s’ils n’ont d’autre savoir que celui qui passagèrement enrichit leur maison » (1) ; ces financiers « que l’on traduit en public comme des sangsues et des avaleurs de petits-enfants » (2). « Dans cette ville entière qui ne vit que de monopole ét ne s’enrichit que du désordre fiscal... sitôt qu’il a paru que sous un nouveau règne les finances semblaient être confiées à un homme qui avait avoué nos principes, on s’est braqué de toutes parts pour les attaquer par les conséquences, et nous par le ridicule, les calomnies et tout le train... En attendant ce que le ministre ferait, les pierres venaient à nous (3). » A peine ressuscité, le Parlement de Paris ne manquait pas de s’ériger en défenseur intraitable des vieilles traditions. Avant même qu’il fût rétabli, et Turgot nommé ministre, Baudeau avait prévu que « les Saint-Fargeau, les Montblin et autres pareils crânes donneraient de la peine » à l’artisan des réformes (4). Le 30 janvier 1776, un jeune conseiller « qui en voulait depuis longtemps aux Économistes », Duval d’Éprémesnil, profite de la publication des Réflexions sur les Corvées de Condorcet pour dénoncer a cette secte d’enthou siastes qui cherche, non seulement à combattre les préjugés et à renverser les formes sagement établies, mais à détruire les lois les plus anciennes, les principes les plus avoués », et qui risquerait de soulever le peuple contre les magistrats en leur attribuant des « vues criminelles et intéressées » ; l’ouvrage et l’auteur sont condamnés au mépris (5). Un peu plus tard, requérant contre un opuscule de Boncerf sur les droits féodaux, l’avocat général Seguier « se perd en déclamations et en injures contre les économistes, qu’il désigne, sans les nommer, pour les perturbateurs de l’É tat » (6). Le livre est condamné au feu, une information est ouverte contre l’auteur, et le censeur, Leroi de Senneville, en effet tout dévoué à la « cabale », décrété d ’arrestation (7). Il suffit qu’un livre « respire le système des Économistes pour que la cour le fasse lacérer et brûler » (8).12345678 (1) M., Rentrée, 1775, Mes., p. 126 et 128. (2) Grimm, Corresp., octobre 1774, t. X, p. 506. (3) M. au Margrave, 5 avril 1775. Cf. Knies, t. I, p. 87. (4) Chronique secrète, 3 juillet 1774. (5) Mém. secrets, 5 février 1776, t. IX, p. 40. Cf. Flammermont, t. III, p. 276, et J.-N. Moreau, t. II, p. 253-255. (6) Mém. secrets, 2 mars 1776, t. IX, p. 63. (7) Ibid., 3 mars, p. 66 et J.-N. Moreau, loc. cil. (8) Ibid., 6 mai, p. 117.
l ’é c o l e
et
le
pa rti
29
Nombre d’intendants s’étaient toujours montrés hostiles à la nouvelle politique ; tels les deux Bertier, de la généralité de Paris (1), résolus à maintenir l’ancienne police des grains ; Le Flessel de Lyon (2), Le Calonne de Metz (3), Le Terray de Montauban (4). A la Cour, dans les salons, le prince de Conti ne manquait pas une occasion de « persifler la secte et son système. Dans une assemblée de Paris, comme il était à prendre le thé auprès de la cheminée, un chien qui s’était introduit dans ce lieu fit ses ordures en présence de son Altesse sérénissime... Un huis sier veut le battre, le chasser à coups de baguette : « Arrêtez, « lui dit le prince ; liberté, liberté, liberté tout entière (5) ! » Et le 1er avril 1776 paraissait : Le Songe de Maurepas ou les Mannequins du gouvernement français, un pamphlet dont l’opinion attribuait la paternité à Monsieur lui-même, sans que celui-ci s’en défendit. Or rien n’y était épargné pour rendre à la fois odieux et ridicules et le ministre et la secte dont on voulait à toute force qu’il fût l’émanation » (6). Pourquoi faisait-il précéder ses Édits de préambules si longs et si diffus ? C’était « pour initier imperceptiblement les sots aux mystères de la science et les rendre économistes sans qu’ils s’en doutas sent » (7). Lui-même, « rêvant nuit et jour Philosophie, Liberté, Produit net... était prôné, célébré par cette troupe auda cieuse » (8). Dans son officine « s’élève un vaste alambic d’où l’on extrait à froid un sel neutre qu’on nomme Gazette d'agri culture... Là s’élabore un orviétan périodique appelé Éphèmérides du Citoyen qui, pris à forte dose, entête, enivre, passionne, fait des enthousiastes et des énergumènes. D’ailleurs ce labo ratoire tient par un conduit souterrain au foyer encyclopé dique, et le Mannequin (c’est-à-dire Turgot lui-même), placé au lieu de communication, reçoit de l’un et de l’autre une direc tion combinée » (9). L’administration centrale ne se montrait pas moins hostile.j123456789 (1) Le père et le Uls. (2) Le futur Prévôt des marchands de Paris. (3) Le futur Contrôleur général. (4) Le neveu de l'ancien contrôleur, Chronique secrète, 14 septem bre 1774. Voir aussi 19 et 20 juin. (5) Mém. secrets, 18 février 1776, t. IX, pîl 50. (6) Ibid., 30 mars 1776, t. IX, p. 136. (7) Ibid., p. 33. (8) Ibid., p. 17. (9) Ibid., p. 14-15. Cf. p. 28 : « La phalange encyclopédique et écono mique réunie sous le drapeau de Turgot. »
30
LA P H Y S I O C R A T I E SOUS
LE M I N I S T È R E
D E TURGOT
Baudeau s’élève contre « le despotisme subalterne des bureaux » (1). A la veille de l'arrivée de Turgot aux Finances, Bertin dissimulait mal son opposition à la liberté des grains ; le marquis d’Astorg, au nom de la Société d’agriculture d’Auch, ayant renouvelé sa protestation contre l’Arrêt prohibitif du 23 décembre 1770, le ministre lui répondait qu’ « il y avait vu l’intérêt majeur des propriétaires et des colons bien traités, mais seulement quelques traits indirects à l’intérêt opposé des non-propriétaires ; comme cet intérêt est celui qu’il faut balancer avec le premier, il aurait été à propos de le traiter plus nettement de façon qu’il ne parût pas oublié » (2). Le garde des sceaux, Hue de Miromesnil, est presque par destina tion un adversaire déclaré. Sartine, quand il n ’était encore que lieutenant de police de la capitale, avait fait observer avec une extrême rigueur les règlements de marché ; devenu ministre de la Marine, il reste, bien entendu, partisan d’un régime réglementaire, et il paraît bien n ’être pas demeuré entièrement étranger à la guerre des farines. Malesherbes lui-même repro chait au contrôleur général de « ne douter de rien » (3). Et ce Maurepas, dont Mirabeau avait affecté de célébrer sans arrièrepensée la rentrée en faveur, ne l’avait pas longtemps trompé : « le vieux ministre, auquel un très jeune roi se livrait sans l'avoir jamais vu jusque-là », n’était pas pour sortir le nouveau régime de la « vieille ornière » (4) ; il « se riait de tout » (5), et «r depuis qu’au Sacre le contrôleur général avait travaillé avec le Roi, il s’était promis de s’en débarrasser » (6). Entre les Physiocrates eux-mêmes et Turgot les relations n ’étaient pas aussi intimes, ni même toujours aussi amicales, que leurs ennemis communs le prétendaient, et qu’il semblait qu’elles auraient dû l’être. Suivant Mirabeau « cet homme avait un faible, que l’on a vite découvert et nourri, en lui per suadant qu’on attribuerait aux Économistes tout ce qu’il ferait de bien » ; aussi le marquis s’était-il fait une règle de « ne point le voir du tout » (7), Des chefs de l’École, Dupont fut le seul qui eût « auprès de lui accès privilégié, et par là1234567
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Chronique secrète, 4 juin 1776. H. 1508, pièce 9. J.-N. Moreau, t. II, p. 153. Disc, de rentrée, 1776, M ss.y p. 8. Au dire de Malesherbes lui-même. Cf. J.-N . Moreau, toc. ciL Chronique secrète, 4 juin 1776. M . au Bailli, 5 avril 1775.
L ’ECOL E
ET LE PARTI
31
une influence réputée décisive sur ses opérations » (1) ; encore en était-il réduit le plus souvent, « sous de belles apparences, au sort du R at de la Fable, qui ronge les chaînons du rets qui enlace le lion » (2). Puis, dès son avènement, le ministre avait été considéré comme un représentant des Encyclopédistes autant que des Économistes (3) ; et Tun des panégyristes de Quesnay avait dû reconnaître que c'était un esprit « supérieur à toutes les sectes, choisissant dans chacune les semences éparses de la raison universelle, et dont la modération aurait créé l'éclectisme » (4). Turgot, écrira plus tard Marmontel, « avait autour de lui des hommes studieux, qui, s'étant adonnés à la science économique, formaient comme une secte, estimable sans doute quant à l'objet de ses travaux, mais dont le langage emphatique, le ton sentencieux, quelquefois les chimères enveloppées d'un style obscur et bizarrement figuré, donnaient prise à la raillerie. Turgot les accueillait et leur témoignait une estime dont ils firent eux-mêmes trop de bruit en l’exagérant. Il ne fut donc pas difficile à ses ennemis de le faire passer pour le chef de la secte, et le ridicule attaché au nom d'économiste rejaillissait sur lui » (5). Il y eut pis. Dès le début, tout en rendant hommage « aux excellents principes, à la probité, à la droiture inflexible », du ministre, Baudeau lui avait reproché de vouloir « trop bien] faire », de « lanterner », d ' « aller trop doucement en besogne », en un mot « d’avoir peur » des mesures expéditives (6). Mais^ lui-même, « homme d'esprit, mais d'un esprit léger » (7), ne craignait pas les imprudences. Au lendemain de la guerre des farines, il trouva a le moyen de faire passer au Roi un mémoire dans lequel il accusait M. de Sartine d'avoir été l'artisan secret des émeutes et offrait d’en administrer la preuve... Le Roi chargea donc M. de Maurepas de voir l'abbé. Celui-ci com mença par nier le mémoire ; il l’avoua ensuite, et tira comme preuves des lettres anonymes dont il prétendait connaître les auteurs comme gens dignes de foi » (8). Mais sommé de pré senter ses garants, il se déroba en prétextant « que la chaîne12345678 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
M ., Disc, de rentrée, 1775, p. 129. Ibid., p. 127. Cf. Mém. secrets, 6 septembre 1774, t. VII, p. 234. G.-H. Romance, Éloge, p. 96. Mémoires, Liv. X II, t. II, p. 197. Chronique secrète, 23 juin, 21 juillet, 16 septembre 1774. Hardy, 7 octobre 1774, Journal, t. II, p. 426. J.-N. Moreau, t. II, p. 210.
32
LA P H Y S I O C R A T lE SOUS LE M I N I S T È R E D E TURCOT
était coupée, vu la mort- prématurée d'un certain quidam intermédiaire... M. de Maurepas rendit compte de tout cela au Roi, qui remit le mémoire à M. de Sartine en lui recom mandant de faire passer l’auteur par quelques mois de Bicêtre » (1). « L’opinion générale était que l’abbé n ’avait pu communi quer ce mémoire au Roi sans que le contrôleur général le sût (2). » Aussi Turgot crut-il devoir aller trouver son collègue, et lui déclarer combien il était irrité « de l’audace criminelle de cet économiste » ; celui-ci, d’ailleurs s’en repentait amère ment et était disposé à subir la peine qu’on voudrait lui infliger... Le secrétaire d’É tat à la Marine a reçu le contrôleur général avec hauteur, et lui a répondu qu’ « il se regardait comme fort au-dessus des injures et des calomnies de cet abbé, qu’il le méprisait et l’abandonnait à ses remords » (3). En fait, Baudeau n ’alla ni à Bicêtre, ni à la Bastille ; cette indulgence, que l’opinion désapprouva fort, au dire de Mairobert, semblait indiquer que le folliculaire avait réellement agi suivant le? instructions du ministre, mais qu’il était allé beaucoup trop loin (4). On comprend aisément que Turgot ait désormais « fermé sa porte à cet économiste fougueux et indiscret » (5), et qu’il ait été « monté contre ce qui touchait à la Société au point de battre froid pendant quelque temps à Dupont lui-même » (6). Cette affaire était déjà assez fâcheuse en soi : « Croyez-moi. pouvait écrire Galiani, les économistes casseront le col à M. Turgot (7). » Mais Baudeau allait encore aggraver son cas par une odieuse palinodie : « furieux de n ’être plus consulté au contrôle général, il se jeta dans les bras de M. Necker, compo sant pour lui, et pour le petit Pezay, des mémoires contre Turgot, que ce dernier remettait au Roi... Il en envoyait d’autres à M. de Maurepas, charmé de pouvoir dire au Roi et à tout le monde que les amis même de M. Turgot blâmaient1234567 (1) Mém. secrets, t. V III, p. 52, 27 mai 1775. (2) J.-N. Moreau, loc. cit. (3) Mém. secrets, loc. cit. Cf. Corresp. MÜra, t. Il, p. 17 : Turgot aurait dit à Sartine : · Je voue abandonne l'économiste, et s'il est coupable, qu’on le mette à la Bastille. » Quant à Sartine, il se « trouva vengé par la Lettre d'un profane à l’abbé Baudeau, où de Vaines, le premier commis de Turgot, était violemment pris à partie ». Cf. Hardy, 21 oct. 1775. (4) Cf. Foncin, p. 211-212. (5) M ära, t. II, p. 28. (6) Cf. Schelle. Dupont, p. 187. (7) A Mme d’Epinay, 29 août 1775, t. II (éd. Asse), p. 208.
L’é c o l e
et
le
pa rti
33
ses projets... » (1) ; et il avouait « insolemment cette incroyable trahison » (2). Consulté par Maurepas, en même temps que Necker, il avait comme le banquier genevois, déclaré que, d’après les prévisions pour l’année 1776, « la situation des finances était alarmante » (3). C’était cependant le même Baudeau qui s’érigeait en gardien jaloux de l’orthodoxie physiocratique : « Il voit, disait-il, des écrivains qu’on appelle économiques et qui ne sont pas des Économistes... Ils ont à la vérité quelques idées conformes à certaines déductions de la doctrine... Mais le maître, la science, les livres, les formules leur sont totalement étrangers, ils diffèrent essen tiellement de nous sur les articles les plus fondamentaux de la théorie... (4). » Morellet s’était, lui aussi, rendu coupable de plus d’une indiscrétion au sujet des grandes réformes que préparait Turgot ; de concert avec Baudeau, il avait, en pleine guerre des farines, « commis l’imprudence d’annoncer que le ministre comptait supprimer les jurandes, projet qui offensa le prince de Conti... » (5). Aussi le contrôleur général, s’il avait, à ce moment, refusé à Linguet la permission de réimprimer ses ouvrages contre les Économistes, et prié le pamphlétaire tout au moins d’attendre, avait-il également invité Morellet « à se tenir tranquille » (6). L’abbé en avait profité pour aller en Alsace prendre possession d’un bénéfice de 6.000 livres de rente : « surcroît de fortune, », qui, comme celui que Baudeau avait su trouver en Pologne (7), avait provoqué des réflexions désobligeantes. « Au moins, disait-on, M. l’abbé ne dissertera pas, comme quelques autres, sur la cherté des grains avec l’estomac vide (8). » Enfin les Économistes, tous autant qu’ils étaient, avaient la mauvaise réputation d’être des faiseurs de projets, et c’était là, avait dès le début déclaré Maurepas au contrôleur général, « une espèce d’hommes qu’un ministre12345678 (1) D. au prince de Bade, 1er février 1783. Cf. Knies, t. II, p. 370. (2) Cf. Schelle, Dupont. Baudeau serait devenu, d'autre part, l'amant de Mme de Pailly, la maîtresse du marquis de Mirabeau son bienfaiteur. Ibid., p. 96. (3) Cf. Schelle, Œ. T ., t. V, p. 2. (4) Observations économistes à Monsieur de Condillac (Niles Êph., avril 1776). (5) D. au Margrave. Cf. Schelle, Œ. 7\, t. IV, p. 53. (6) D. au comte Scheffer, 8 sept. 1779, ibid., p. 62. (7) Cf. La Harpe, Vers à deux amis qui étaient allés le voir à la campagne (Corresp. M ära, 18 mars 1775, t. I, p. 281). (8) Ibid., t. I, p. 426. 3 O . W EU LERSSE
34
LA
P H Y S IO C R A T IE SOUS LE M I N I S T È R E DE TURC.OT
,doit éloigner » (l). Turgot ne pouvait-il pas, en effet, redouter les excès de leur humeur autoritaire et les manifestations de leur irascibilité (2) ? Aussi se décida-t-il, surtout après la publication des grands Édits de février 1776, à tenir à l’écart la plupart d’entre eux, et à modérer le zèle intempestif de quelques-uns. Il ne reçut, paraît-il, le marquis de Mirabeau qu’une fois, et encore très froidement (3). L’abbé Roubaud travaillait de son mieux à « avertir les peuples de ce qu’une administration propice a fait et voudrait faire en ce pays où tout intercepte les rayons de la vigilance, où tout fait place aux griffes de la rapacité » (4). Mais le ministre, qui n ’avait jamais que médiocrement apprécié les louables intentions de ce journaliste (5), « en vint à lui demander en grâce de quitter la Gazelle d'Agriculture» : vaine ment l’éditeur avait-il promis de « voiler à la recommandation du pilote, celui-ci le faisait échouer avant même que le temps eût changé (décembre 1774) » (6). U « repoussa » les Êphémèrides aussi, et alla jusqu’à se plaindre de vous autres, comme il disait, jusqu’à laisser étouffer les presses ». N’avait-il pas dû calmer jusqu’aux impatiences de Dupont (7) : « Je pense comme vous sur la nécessité d’agir, écrivait-il à son collabo rateur à propos du Mémoire sur les Municipalités, le 11 sep tembre 1775 ; mais il faut pourtant de la mesure et de la pré cision dans les mouvements ; il faut répondre aux objections, et le seul résultat ne suffit pas. C’est quand on est maître que votre principe est vrai. » A propos de ce même Mémoire, n’avait-il pas dû résister à la tendance dont ne pou vait se défendre son ami de lui imposer toutes faites ses propres conceptions ? « Je suis fâché, lui mandait-il le 23 sep tembre, que vous ayez perdu du temps à rédiger vos vues avec une perfection superflue. Je n ’avais besoin que d’un canevas. J ’ai trop réfléchi sur cette matière depuis une quin zaine d’années pour n ’avoir pas une foule d ’idées que vous n ’aurez pu deviner ; et ce serait un beau hasard que nous nous fussions rencontrés en tout. Il suit de là que la1234567 (1) Ibid., 7 décembre 1774, p. 126. (2) Foncin, p. 429. (3) Cf. Schelle, Turgid, p. 231. (4) M ., Disc. de rentrée, 1775, Mes., p. 27-28. (5) V. supra... et SçheUe, loc. cil. (6) M., Disc, de rentrée, 1776, Mss., p. 61-62 et p. 7-8. (7) M ., op. cil., p. 61-62. Cf. Lettres de Baudeau aux Archives Natio nales de Suède. Schelle, Œ. T., t. V, p. 12.
l ’é c o l e e t l e p a r t i
35
rédaction définitive sera vraisemblablement à refaire... (1). » « Quel triste personnage, pouvaient dès lors gémir les Physiocrates, étions-nous forcés de faire ! Dénoncés de toutes parts comme boutefeux, on nous imputait tous les torts d’un ministre en faveur de qui l’on en inventait sans cesse ; tandis que lui-même, harcelé par des gens qui craignaient qu’il n’employât ses vrais amis, et que des plumes habituées à fixer l’attention ne dévoilassent leur propre perfidie, se laissait dire, et répétait sans cesse, que les Économistes le per daient... (2). E t nous, où que nous portassions nos pas dans une ville ameutée, par les monopoleurs de tous les genres... partout de l’aigreur, des mots couverts, et souvent très décou verts, contre les gens à système ; partout le déchaînement, les exagérations et souvent les injures indirectes. Elles ne le furent pas trop dans les lieux même les plus respectables, et ceux de Messieurs du Parlement les plus irréprochables et honorés jusque-là qui furent atteints ou seulement soupçonnés d’être dans ces principes, n’auraient pas eu à se louer de la retenue et de la décence de leurs improbateurs (3). » Ainsi donc, il était bien vrai, les Économistes ne consti tuaient pas « une force » ; et Turgot, non seulement n’était pas « le maître », mais « il était bien seul » ; que pouvait son « courage indomptable » (4) ? Tout dépendait finalement de la fermeté du jeune roi. Celui-ci, quelque temps, avait apprécié et soutenu son ministre (5) ; au début de 1776 encore, peut-être « était-il convaincu qu’il y avait cabale contre lui et que sa besogne était bonne » (6) ; mais la coalition l’emportait. Les remontrances de la Cour des Aides du 6 mai 1775, le lit de justice du 12 mars 1776 n’avaient été que des succès d’appa rence et éphémères. Malesherbes, plus sensible que résolu, s’était ouvertement et de longue main préparé à abandonner une position qui devenait de jour en jour plus intenable.123456 (1) Cf. ScheUe, Œ. T., t. IV, p. 676. (2) t U n ’a cessé pendant tout son ministère de prétexter qu’il n’était point de cette école : vérité que ses deux panégyriques ont imprimée depuis sa mort ; que tous ses amis et toutes ses amies avaient tan t répétée pendant son administration, à laquelle nul des vrais Économistes (exclu sion voulue de Dupont) n ’eut aucune part depuis le moiede décembre 1774 jusqu’à son renvoi. » £., Réflexions, 1787, III· Partie, p. 17-18. (3) M .y Disc, de rentrée, 1776, Mss., p. 61-62. (4) M. au Bailli, 3 et 7 mai 1775 (Méni. Montigny, t. III, p. 159). (5) Cf. M. au Bailli, 9 mai 1775 : « Nous n’avons pour le bien que le roi et Turgot. » (6) J.-N. Moreau, Souvenirs, t. II, p. 253.
36
LA P H Y S IO C R A T !E SOUS LE M I N I S T E R E D E TURGOT
Encouragé par la duchesse d’Anville, Turgot tint bon jusqu'à l'extrême limite, jusqu’à l'inévitable renvoi, éclatant et brutal, des ministres réformateurs : il survint le 12 mai 1776. III. — Les conséquences de la disgrâce de Turgot La chute de Turgot et celle des Économistes ne pouvaient aller l’une sans l’autre. La coalition victorieuse se répand contre la secte en cris de triomphe. « Les Parlements veulent, à ce qu’ils disent, anéantir et proscrire jusqu’à leur nom, comme Xerxès voulait fouetter la mer... (1). » Mirabeau était malade lors de l’événement ; quelqu’un le dit au Parlement : € Il ne Ve$i pas autant que ses principes, dit un jeune homme en grande charge... (2). »U n certain abbé Faucher, prédica teur à ses débuts, « commençait à faire du bruit par son affec tation à glisser la morale économique avec la morale évangé lique... M. Turgot était un des Saints que cet orateur glori^t le plus » ; l’archevêque de Paris eut vite fait de l’interdire (3). Il n’en fallait pas douter : « la revirade était complète » (4). De nouvelles disgrâces allaient, en effet, affliger le parti, déjà languissant. Le marquis nous raconte comment il allait être dès la fin de 1776, contraint de transformer ses fameuses assemblées en simples réunions privées : < Un homme puissant et à qui je fus dès longtemps obligé (5) m’a fait dire, commt ami et non comme ministre, qu'il me conseillait de les inter rompre. Je répondis que ce qui se passait chez moi ne devait aucun compte à la justice, ni à l’autorité ; qu’ainsi donc, je n’aurais rien à répondre au ministre ; mais que, par égard pour l’ami sage et bien intentionné, je fermerais ma porte pré cisément les mardis aux étrangers et autres qui n’y venaient que pour les assemblées sans y avoir aucun droit, et même aux visites. Mais que, quant à mes amis accoutumés à me voir ce jour-là, et à ceux qui s’occupent des mêmes objets qui firent de tout temps mon étude, dont je ne me cache pas, ils avaient droit à ma maison, et moi à leur compagnie : qu’il n’y en avait pas de meilleure dans Paris et qui pût être moins suspecte (6). »123456 (1) M . au BailU, 17 mal 1776. Citée par Loménie, t II, p. 408. (2) Λ#., Disc, de rentrée, 1776, M ss.t p. 62, et lettre au Bailli, 4 juil let 1776, Loménie, p. 409. (3) Mém. secrets, 20 mai 1776, L IX, p. 128. (4) Lettre du 17 mai citée ci-demus. (5) Peut-être Berlin ? (6) Λ/., Disc, de rentrée, 1776, M ss.t p. 64.
L’ÉCOLE ET LE PARTI
37
Il y eut encore quelques lectures... mais désormais c’était un nouvel ordre de choses, et, tout était dit ; la ville et les Tribu naux sont butés. La science a germé dans les terres étrangères ; ici Ton empêche toute communication de lumières. On multi plie avec affectation les journaux, almanachs, fadaises ; les affiches, feuilles... ; jeux publics, spectacles, tripots, bou cans, etc. ; l’axiome divide et impera, tout vivant, a changé d’agent et s’opère par la gangrène... (1). E t quel terrible scandale domestique éclatait en même temps sur la tête de l’amphitryon des glorieux mardis, désor mais condamné au huis clos ! La marquise plaidait contre le marquis, et son avocat'ue s’était paô fait faute de « prouver que frère Mirabeau était le plus mauvais mari du monde, le père de famille le plus dérangé, l économiste le moins économe, le plus méchant calculateur, le fermier le plus ignorant, etc. ». Grimm, sous couleur de défendre le vieil Ami des hommes, achevait de l’accabler. Comment l’avoir « accusé, lui et ses disciples, de préférer la richesse à la population » ? Quelle calomnie ! Non seulement il a fait 11 enfants à sa femme ; mais, à la manière des anciens patriarches, il a encore entretenu chez lui plusieurs femmes étrangères, dans la vue d’augmenter le nombre de sa famille (2) ! La chute de Baudeau fut plus retentissante encore ; cette fois-ci d’ailleurs très honorable. « En 1768 il avait composé un mémoire sur les inconvénients de la Caisse de Poissy... qui avait été imprimé alors contre son aveu ; et ce n’était qu’en rendant compte de l’Édit d’abolition (en 1775), qu’il s’était permis de l’insérer dans un des derniers volumes de ses Êphémérides (3). » « Je ne sais quel malin démon, voulant jouer un tour à la cohorte fiscale, a inspiré aux anciens fermiers de la défunte Caisse de l’attaquer en réparation d’honneur sur ce qu’il les avait taxés d’usure, etc. (4). Ce lièvre levé dans les derniers temps de Turgot (5) eût dû être oublié maintenant (juillet 1776), si dans le fait on l’eût regardé comme le patron 12345 (1) M. à Longo, 19 janvier 1777, Mss. A ix , XVI, p. 64. (2) Grimm, Cörresp., septembre 1776, t. IX, p. 349. (3) Cf. Afém. eecretSy 19 juillet 1776, t. IX, p. 188. (4) Ne pouvant s'attaquer aux rédacteurs de l'Édit, les fermiers prirent le parti de dénoncer l’abbé comme calomniateur : ils réclamaient outre une réparation publique, la condamnation à une amende et l’obli gation d’insérer dans son propre journal le jugement prononcé contre lui. Ibid. (5) Le mémoire des plaignants parut le lendemain même du renvoi du ministre.
38
LA
p h y s i o c r a t i e sou s
le m i n i s t è r e
d e turc .ot
de la chose économique ; mais ce sont les ouvriers que ! avait en vue. Les traitants ont choisi un avocat de réputati quant aux talents, et nul quant à la délicatesse. Cet homt croyant foudroyer un prestolet, a commencé avec assez j d’avantage ; l'abbé est arrivé ; jamais homme d’abord n’< autant l’esprit des affaires, et le tour dangereux même pour revirer. Mais il ajouta à cela un à-propos, un enthousiasme et feu bien rares ; il a enlevé les auditeurs par son plaidoyer et | la bonté de sa cause : il a tout dit et fait plus de prosélytes deux heures qu’en écrivant dix ans. Le transport d’applaud sements et d’éloges fut une fureur (1). » Les Mémoires sect confirment le témoignage de Mirabeau : « M. l’abbé B. écn absolument l’avocat Gerbier, au point que celui-ci est hué ( qu’il ouvre la bouche. Il est vrai qu’il a le beau rôle et f des explosions terribles contre les financiers (2). C’est peut-èi la première fois, avoue Grimm, que la confrérie des Écoi mistes sut mettre les rieurs de son côté. L’abbé prouva q tous les faits (qü’il avait allégués) étaient attestés de la mani< du monde la plus authentique, et déclara hautement que papiers d’où il avait tiré ses preuves avaient été mis sous yeux mêmes du Roi. Après une longue délibération, l’alfa fut renvoyée hors de Cour, ainsi qu’il l’avait demandé Frère B. fut ramené chez lui dans une espèce de triomp! suivi de tous les bouchers mécontents de la Caisse, de pl sieurs frères de l’Ordre, et de toute la populace du Palais ( 3 j Mais le vainqueur allait payer cher cette trop belle ap théose. La « cabale des financiers » était trop puissante, et nouveau ministère ne pouvait pardonner au publiciste « i éloge trop outré de M. Turgot, et cette assertion injurieu qu’un royaume devait s’estimer trop heureux de trouver i ministre honnête homme dans un siècle » (4). Aussi les impi meurs reçurent-ils défense de publier ses plaidoyers (5). Li même, « dès l’après-midi du premier jour, fut appelé chez lieutenant de police qui lui redemanda de la part du Roi privilège des Éphémérides et lui défendit d’écrire désorma sur les matières du gouvernement » (6). L’audacieux rédactei avait osé insérer dans son numéro de juillet un Mémoire si123456 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
M. à Longo, 16 juillet 1776, M m . A ix , XVI. 19 juillet, t. IX, p. 188. Grimm, août 1776, t. IX, p. 314. Mém. secrets, 13 août 1776, t. IX t p. 210. Ibid.y 12 et 25 juillet. Ai., loc. cil.
L’ÉCO LE ET LE PARTI
39
les affaires extraordinaires de finances faites en France pen dant la dernière guerre de 1756 à 1763 ? On y voyait, « par le relevé des divers objets formant ces levées de deniers d'aug mentation, qu'ils subsistaient presque tous en tout ou en partie, à la charge des sujets ». Le gouvernement « trouva mauvais qu'un journaliste révélât aussi publiquement les secrets du ministère » (1). C’était le moment précis où les colons anglais d'Amérique proclamaient leur indépendance, et Vergennes préparait la guerre contre l’Angleterre : « Maurepas, il est vrai, y répugnait, et les gens sages annonçaient qu’il en coûterait plus de 1.200 millions de dépenses extraordinaires, outre les revenus courants, et plus de 60 millions de nouvelles rentes, à payer pour des succès douteux, probablement très médiocres... » Rappeler les charges qu'avait entraînées la guerre de Sept Ans, c’était au moins une indiscrétion, et l’instant était bien mal choisi ; « après une scène très vive du magistrat qui régissait la police et la librairie, c’en fut fait du journal » (2). Le terrible abbé s’était d’ailleurs attiré bien d’autres inimitiés personnelles. Déjà, au mois de juillet 1775, les deux Compagnies des Munitionnaires des vivres des Troupes du Roi s’étaient plaintes à Turgot des calomnies que renfermaient les Éclaircissements demandés à Monsieur N . ; d’après les Mémoires secrets « le contrôleur général leur avait fait simplement témoi gner qu’il désapprouvait les imputations hasardées de l’écri vain ». Dans les Éphémérides d’avril 1776, il venait de faire paraître un article du colonet Saint-Maurice de Saint-Leu dont le titre anodin : Réflexions historiques sur les Écoles militaires cachait de nouvelles attaques, des plus violentes, contre ces fournisseurs de l’armée. « Déjà, y était-il dit, l’âme du soldat s’élève ; son noble état cesse d’être avili par l’affreuse misère : et la moitié de son pain — et quel pain avait-il ! — ne sera plus dévorée par des harpies sacrilèges (3). » Au mois d’août, « les deux Compagnies du Nord et du Midi se disposaient à intenter à leur accusateur un procès en diffamation » ; déjà elles avaient fait imprimer un Mémoire à consulter « dans le goût de celui de la Caisse de Poissy », lorsque le nouveau contrôleur général, Clugny, estima plus prudent d’étouffer cette nouvelle (J) Ibid., 1er août, p. 197 et 6 août 1776, p. 201. (2) P., Réflexions d'un citoyen presque sexagénaire (1787), II· Partie, p. 22-23. (3) Mém. secrels, 14 octobre 1776. t. IX, p. 266.
40
LA P H Y S IO C R A T !E SOUS LE M I N I S T E R E D E TURGOT
affaire, et de se débarrasser en même temps du redoutable journaliste (1). L’abbé, pressentant l’orage, avait en vain annoncé qu’il allait retourner en Pologne ; on jugea préférable de l’expédier en Auvergne : « il reçut l’ordre de se transporter à Riom et d’y prendre, ajoute Grimm, toutes les distractions que son état pouvait exiger, pour ne pas s’exposer aux suites d'un dérangement plus funeste » (2). On profita de l’occasion pour envoyer le même jour dans le même exil l’abbé Roubaud, « qui ne plaidait contre per sonne » (3). « C’était un garçon d’un talent rare et d’un zèle et d’un mérite peu communs. Il avait tenu à peu près le même langage sous l’odieux Terray que sous Turgot. Aujourd’hui (mars 1776) il ne recevait que du dégoût du ministère. 11 allait cependant son chemin malgré les cris des financiers et les remontrances de leur patron soi-disant bien intentionné. Alors, il taquinait, se retournait. On lui défendait de parler grains, il parlait subsistances ; on lui rognait une phrase, il la remplaçait six ou sept fois, toujours pis ; il en cherchait le texte dans l’Écriture, arguant le censeur de blasphème ; enfin de guerre lasse, il se faisait laisser... (4). » Il devait en juin 1776 inter rompre ses fonctions de rédacteur de la Gazette pour vaquer à son voyage d’Italie ; mais, dégoûté des changements survenus dans le ministère, il parut y renoncer tout à fait (5). « On n’a pu trouver à son exil de motif que celui d ’avoir l’air de généra liser ce qui sans cela aurait paru une suite du procès... Le fait est que le gouvernement veut la paix, que le Parlement, franche cohue quand il se passionne..., à part la gaucherie turgotine, a* pris l’économie politique en aversion, et qu’il faut lui complaire en quelque chose ; et qu’on a pris ces deux hommes comme ayant écrit, quoique jamais sans approbation du censeur (6). » Arraché au repos nécessaire à sa santé, Rou baud bénéficia seulement d ’un exil plus doux, en Normandie; et à la demande de Turgot, Trudaine lui promit une indem nité (7). Il s’était bien élevé quelques clameurs de haro; les ordres particuliers signifiés aux deux abbés avaient en effet ému l’opinion, et un membre de la I IIe Chambre des enquêtes1234567 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Ibid.y 29 septembre, p. 251-252. Corresp.y août 1776, t. X I, p. 312-313. M.y Discours de renlréCy 1776, Mss., p. 62-63. M. à Longo, 16 mars 1776, Mss. A ix t t. XVI, p. 37. Mém. secrdSy 3 juin 1776, t. IX, p. 188. M. à Longo, 31 août 1776, Mss. A ix t XVI, p. 48. C. ScheUe, Œ. Γ., t. V, p. 502.
l ’é c o l e e t l e p a r t i
41
de Paris protesta contre cette « interversion de l’ordre de la justice » ; mais, malgré cette chaleureuse protestation, le Par lement refusa d’intervenir (1). Ainsi « les deux plus vigoureux et renommés athlètes du parti étaient poursuivis, attaqués, exilés, opprimés même sans réclamation ; et cette réclamation, dénoncée par d’imprudents amis au tribunal soi-disant ennemi du pouvoir arbitraire, n ’en avait obtenu qu’approbation de ces mêmes actes, et anathème injurieux » (2). D’autres attaques contre l’École, moins ouvertes, n’étaient peut-être pas moins dangereuses. « La sœur d’un de nos meil leurs, déclarait Mirabeau, lui écrivant dernièrement pour quelques discussions de famille, répondait à l’offre qu’il lui faisait... pour éviter de plaider » : « Toutes vos libéralités ne valent pas le plaisir que j ’aurai de tympaniser MM. les Écono mistes dans un Mémoire qui comparera leur conduite à leurs principes sur la propriété (3). » Dupont enfin était contraint de se retirer dans sa propriété de Chevannes, en Gâtinais, à une demi-lieue du Bignon, que Mirabeau lui avait fait acheter avant son départ pour la Pologne, Clugny voulut même lui enlever sa place d’inspecteur des manufactures : heureusement pour lui, le duc de Niver nais et le comte d’Angiviller (4), devenu le mari de Mme de Mar chais, expliquèrent à Maurepas quels avantages l’Économiste avait sacrifiés (5), et comment il s’était endetté de 30.000 livres pour revenir servir son pays. Le vieux courtisan se laissa tou cher et promit de lui conserver son emploi ; mais Necker, qui se rappelait la campagne menée naguère par les Éphémérides contre le privilège de la Compagnie des Indes, allait refuser, tout d’abord, de tenir la promesse du premier ministre. Quant à Albert, dès le mois de juin, il avait été renvoyé de son poste de lieutenant de police, que Lenoir avait immédiatement réoccupé (6).123456 (1) 19 août 1776. Cf. Flammermont, Remontrances, t. III, p. 386. (2) M., op. cil., p. 1-2. (3) M., toc. cil. (4) Cf. Schelle, Duponl, p. 203. (5) « Dupont était en Pologne secrétaire général du Conseil de l’Instruc tion Publique, avec 24.00(1 livres d’appointements, deux carrosses à ses ordres, et une terre en France déjà en partie payée par le roi. »J.-N. Moreau, p. 257. (6) « On l’avait surnommé Albert t Honni parce que sa police était mal faite, que les rues de la ville étaient sales, aussi parce qu’on lui reprochait d’avoir laissé paraître des pamphlets abominables contre la reine. » Ibid.
42
LA P H Y S lO CR A TIIi SOUS LE M I N I S T È R E
DE TURGOT
Il ne restait aux Physiocrates qu’à philosopher sur causes de leur déconvenue et de leur insuccès. Sans doute, même lorsque « la catastrophe » fut arrivée, ] d’entre eux ne poussa l’injustice jusqu’à méconnaître éminentes qualités de l’homme d’É tat sur lequel ils avaient un instant compter pour assurer le triomphe de leur Éc< l’application immédiate, sinon complète, de leur prograrai « Mirabeau était à Versailles le jour de la disgrâce de Turg< il observait dans un morne silence la joie des courtisans. L d’eux, frappé de ce contraste, lui demanda sur quoi il médit si gravement. Je me représente, répondit-il, en élevant la vc l’image d’une troupe de brigands rassemblés dans la fo de Bondy, à qui l’on vient d’annoncer que le Grand Pré est renvoyé (1). » Jamais le marquis ne cessa de rendre k mage à « cette âme incorruptible », à cette politique « si b intentionnée, patemment équitable, populaire et anti cale » (2). Mais quelle « ignorance des hommes »! Et « qui crainte de se noyer à chaque pas » ; quel « souci mesquin d’cq librer les recettes et les dépenses, qui est le nec plus ultra pilotes côtiers... et le mérite du caissier d’une grande ir son » (3) ! « Ses Réflexions sur la dislribulion des richesses, c un morceau parfaitement bien fait... ; l’ouvrage d’un hom dont c’était la vraie vocation et le véritable emploi, et non j celui de gouverner les hommes (qu’il n ’avait jamais vus ( dans sa tête ou dans ses sociétés gâle-enfanl, vu ses adhéren trompeuses) et les choses, qui veulent être prévues et non imaginées. Il avait d’ailleurs une préférence puérile pour purisme qui ne convient, à cet excès, qu’à un vérificate et qui, je crois, contraste avec le génie, même dans le cabin et à plus forte raison dans le roulis des affaires (4). » Bref, comme Malesherbes, « un cœur droit, mais un esf gauche » (5). Avec cela, lorsqu’il était question d’écrire et faire, « lent et musard » (6), déclarent à l’envi Baudeau Morellet. Enfin, suivant le mot du premier de ces deux abt « un bon outil sans manche » (7). Dans son œuvre, de1234567 (1) Recueil complet des ouvrages pour el conlre Monsieur Necker (I 1» 39, 293A), 17S2, t. III, p. 67. (2) M., Disc, de rentrée, 1776, M s s p. 60-61. (3) Ibid., p. 58. (4) M. à Longo, 18 mars 1788, M ss. A ix y p. 12. (5) Ibid., p. 62, cf. même expression dans une lettre à Lougo 31 août 1776, Mém. Montigny, t. III, notice p. 160. (6) MoreUet, Mémoires, t. 1, p. 15. Cf. Chronique secréte, 23 juin Γ (7) Sénac de Meilhan, Du gouvernement el des mœurs, note, p. 173.
L ECOLE ET LE PARTI
43
parties : « des systèmes allant à tout confondre », produit d’une tête fêlée, philosophique à la mode « de ces Messieurs » ; de l’autre, un plan fiscal, mais qui « n’était pas de lui, et sa manière, dédaigneuse et butée de le conduire, l’aurait reculé de cent ans s’il était possible ». Ce n’était donc « qu’un vrai casse-col » (1). En juillet 1776 Mirabeau n’avait pu s’empêcher d’adresser à Turgot une lettre dont celui-ci avait déclaré qu’ « il ne tenait qu’à lui d’être gravement offensé ; mais il fallait en regarder [l’auteur] comme un malade ; elle était très propre à guérir de la rage des sectes » (2). Tout de même, dès août 1775, les Économistes s’étaient élevés à des considérations anticipées plus larges sur les divers aspects de leur propagande et de leur action. « Il s’agissait surtout de justifier leur science même de cet air d’enthousiasme qu’on pouvait l’accuser d’inspirer à ses adeptes. Autre chose est ceux qui n’ont rien à perdre et qui sont pour ainsi dire destinés à crier du haut des minarets ; autre chose encore, ceux qui, dans les premiers temps, ne pouvaient se faire écouter qu’à force de poitrine. Mais autre chose aussi, ceux qui ont des ménagements à garder, à ensei gner même par leur exemple ; car avant tout, il faut s’entendre, et c’est pourquoi le premier des biens pour la société humaine, c’est la charité, la paix. Qui aurait devant les yeux les conseils que j ’ai donnés aux recteurs d’humains de tous les genres, serait éloigné de penser que je réprouve les [précautions] pour la partie sensible de l’homme, Vopinion. « A plus forte raison faut-il tenir compte des autres avantages plus personnels, plus particuliers, plus palpables ; tout cela mérite d’être extrêmement ménagé ; et croyez que si dans les pays où l’on est attentif et conséquent, nous parais sons avoir cassé les vitres, il faudrait, pour en bien juger, se mettre à notre point d’optique ; car les objets ne sont que ce que les fait être le point d’où l’on les voit. Ici, en France, l’on laisse tout dire, et presque tout faire, sans conséquence, sauf à n ’y pas prendre garde ; et en effet nous embrassons trop d’étendue pour ne pas échapper à des regards si inappli qués. Je ne sais où vont tes économistes, disait il y a quelques années un docteur en Sorbonne ; mais ils me paraissent fonder bien profondément. « C’est le point auquel il faut tenir. Je ne peux souffrir les démolisseurs en aucun genre, et il en est un,12 (1) Lettre au Bailli, 29 août 1778,. citée par Loménie, t. II, p. 411. (2) r. à D.y 20 juillet 1776. Cf. Schelle, Œ. T.t t. V, p. 500.
44
LA P H Y S I O C R A T I E SOUS LE M I N I S T È R E
DE TURGOT
fort à la mode de notre temps, que je trouve de la plus prande importance. Il est difficile de réunir et d’exciter des esprits remuants sans en trouver plusieurs qui méditent l’indépen dance absolue..., mais quand j ’ai parlé à des esprits raison nables et mûrs, je me suis contenté de leur dire : Messieurs, labourez bien profond; ce qui n'a pas de profondes racines tombera et séchera de lui-même; le reste, ce serait dommage de l'extirper. » Aux fondateurs une longue patience est nécessaire. « Je ne suis pas dupe de ces moments de dégoût que donne... l’inattention humaine. Sans doute les premiers mouvements sont vifs. J ’ai souvent écrit qu’il fallait répéter sans cesse et en cent manières ; je me suis mille fois impatienté en répé tant... A la réflexion, je me suis dit que toutes les impatiences et afflictions humaines étaient dç petits essais du crime de Satan... ; et tout regret de l’homme, un dépit de n’être pas dieu ; quant à nous, le fiat lux est notre prétention impérieuse, et nous nous rebutons quand cela ne va pas. Nulle leçon n’ai-je autant répétée à nos confrères que celle-ci : Celui qui sème le gland ne doit pas voir la poutre qui en sortira. » « Toutefois, les progrès de la Science, qui depuis la construc tion du Tableau Économique n’a que seize ans d’ancienneté, m’étonnent moi-même. Le grand et excellent roi de Suède la fait professer à l’Université d’Upsal et, de là, dans toutes les écoles de son royaume. Le Salomon de notre siècle, le GrandDuc de Toscane, sans paraître prendre couleur, marche à pas continuels vers la pratique absolue des principes. Le prince régnant de Bade, aussi bon économiste que moi, a fait des essais et n’estime que cela ; et vous Monsieur [Longoj, qui êtes au timon des opinions dans la plus plantureuse des contrées [le Milanais], vous éprouvez la vérité du proverbe chinois, qui dit : le meilleur moyen d'apprendre est d'enseigner (1). » Moins d’un an plus tard, quand Turgot a entraîné dans sa chute tant d’espoirs, le même Mirabeau se réconforte à la perspective, désormais prochaine, d’une plus grande et cette fois salutaire catastrophe. « Voyant l’opposition générale de tout ce qui parle, on croit avoir droit de parler, mais vous oubliez le proverbe : on ne fait pas boire un âne s'il n'a soif. E t c’est fort bien fait, dans les sermons — dans notre mission économique même, à nous autres les premiers instituteurs — de tonner, de confondre, d’anathématiser, puisque nous1 (1) M. à Longo, 2 août 1775, Mss. A ix , X VI, p. 17.
L ’ÉCOLE ET LE PARTI
45
n’avons pas le droit de contraindre, ni d’y prétendre ; mais l’autorité marque sa propre faiblesse alors qu’elle abonde en paroles... « Partout, ou chez nous du moins, il y a toujours une sorte d’opposition entre l’opinion publique et le gouvernement, opposition qui a contrarié même nos meilleurs rois et nos meilleurs ministres, et embarrassé les meilleures opérations. De mon temps, je l’ai toujours vu. D’où suit que, quand le gouvernement se retourne, le public se retourne aussi, et comme à la fin c’est toujours lui qui s’en fait accroire, tandis qu’à l’extérieur toutes choses seront déménagées, les bons principes, déjà fort établis dans les opinions — si ce n ’est prédominantes, du moins prépondérantes — font leur chemin, et peut-être nous donneront-ils encore dans quelque temps quelque reprise d’essais maladroits. Toujours faut-il compter sur une chose, c’est la révolution générale instante, et à laquelle nous n ’éhapperons pas. Celle-là, je la calcule sur le physique ; et quand je tiens cette mesure, je me sens fort. « Je vous ai dit il y a du temps : Corrupta est omnis caro ; et j ’y tiens ; mais je ne suis pas aussi effrayé de cet amas d’élé ments hétérogènes que le serait un autre... La vertu d’un jour de dernière cocagne, le droit des gens de cette société amoncelée, est de courir sus. Jusque-là tout est bien ; mais la banqueroute générale est imminente. L’Angleterre, la première et la plus noble des créancières, perd son avoir... Toutes les banques, tous les fonds publics, se tiennent par la main... Toutes ont de l’eau jusqu’à la gorge, toutes vont à peu près verser à la fois. Voilà donc les révolutions et disso lutions sociales calculées... Voilà le fond physique des choses. » « Quand la grêle des mécomptes et des quittances aura bien passé sur tous, qu’ils verront qu’ils ont plus perdu qu’il ne leur reste à perdre, ils se revireront pourtant, et se rappel leront que nous* leur avons donné une manière claire et sûre de se raccrocher... Voilà du moins ma manière de jongler ; mais, d’ici là, nous en verrons de drôles... (1). ». Et, quelques mois plus tard, regardant plus loin encore dans l’avenir, distinguant plus nettement du destin du parti celui de la doctrine, l’orateur inspiré voyait poindre à l’horizon1 (1) M . à Longo, 16 juillet 1776, Msa. Atic, XVI, p. 43. Cf. déjà 16 mare 1776 : · Tout cela crèvera un jour ; maie ils n’en savent rien ; le courant entraîne tout. » Ibid., p. 37.
46
LA PH Y S I OC R ATI E SOUS LE M I N I S T È R E D E
TURGOT
pour VÉconomisme une glorieuse et sereine revanche : « Que la secte fût définitivement ruinée » (1), il fallait bien l’admettre, a Si c’est notre amour-propre personnel qui s’intéressait à avoir raison dans le fait comme dans le droit, et que cette raison nous fût attribuée, et que le service de l’avoir fait connaître nous fût préconisé, je crois que nous sommes, et nous et notre mémoire, à jamais frustrés de cette espérance. Toujours le plus grand nombre, même en suivant nos principes et profitant de nos travaux, dira que les Économistes furent une secte de gens dangereux à force de zèle mal entendu et à contretemps, de présomption et d’opinion de l'infaillibilité de leurs principes ; gens à imagination et à système, qui éblouirent et firent illusion à force de se l’être fait à euxmêmes ; gens incapables de laisser aller le monde comme il va, et moins encore capables de le mener à leur manière; qui ne firent que troubler les sociétés et qui rendirent de bons principes dangereux en leur donnant la livrée de leur enthou siasme, incapables de ménagement et de jointure. Ils diront cela, Messieurs, et ils n ’auront point tort. . « Et cependant, nous aurons eu raison, parce que nous aurons fait connaître les bons principes au point qu’ils ne pourront plus être étouffés ; et l’humanité en profitera ; et tout à l’heure elle en profite, et même de bien des restes des essais du boute-en-train, d’ailleurs respectable, dont je viens de croquer l’administration (2). » , (1) Comme le proclamait avec joie l'impitoyable Galiani. Lettre à Mme d'Épinay, 1er juin 1776, éd. Asse, t. II, p. 228. (2) Disc, de rentrée, 1776, Mm., p. 42-143. Cf. p. 133 : l’avènement de Turgot, « époque que l’on crut nous devoir être favorable, que je pensait pouvoir l’être, ou plue tôt ou plus tard, à la chose ; mais non à nous, que je vis généralement dévoués à l'animadversion publique ».
C h a p it r e II
LA PRODUCTIVITÉ EXCLUSIVE DU SOL ET DES EAUX, LE PROGRAMME AGRICOLE Sans renier le moins du monde leur principe initial de la productivité exclusive de l'agriculture, les Physiocrates par lent beaucoup moins de la stérilité des autres « soi-disant » sources de richesses et de revenus. E t malgré la faiblesse d'arguments rétrospectifs qu’une évolution économique récente a déjà pu frapper de caducité, les Économistes ÿ recourent cependant pour repousser l'accusation d’être des novateurs révolutionnaires, comptant sans doute que la gravité de la situation présente rendra force et prestige aux traditions d’un âge révolu (1). « L’agriculture est la chose la plus nécessaire pour entretenir tout le corps d’une république », avait écrit au xvie siècle Michel de Castelnau ; « c’est donc ainsi, s’écrie Baudeau, que pensaient encore sous Charles IX les plus vieux et les plus sages conseillers des rois ; notre doctrine n ’est donc pas aussi nouvelle que les Colbertistes voudraient le persuader » (2). Ou bien on se rejette sur les exemples fournis par l’actua lité étrangère : le même Baudeau se répand en éloges sur cer tains articles de la nouvelle Constitution suédoise d’août 1772, relatifs à l’Ordre des paysans. Ou bien encore, pour flatter le romanesque rustique de l’époque, Le Trosne fait parler les Laboüreuses de la région parisienne à la jeune reine. « Le Roi a aujourd’hui autre chose à faire que d’aller à la char rue (3)... ; sa charrue, c’est son royaume, et laissons-le faire... Il sait que c’est nous qui faisons tout aller, que c’est123 (1) B., Disc. Prél. de l’éditeur des Économies royales de Sully (Niles Ê ph., 1775, η® 12, p. 134). (2) Note, Nlles Éph.t déc. 1774, p. 45. (3) Allusion au « labourage » du dauphin, futur Louis XVI, en 1768. Cf. Mouv. Ph.f t. 1, p. 161.
48
la p h y s i o c r a t i e sou s l e m i n i s t è r e
DE TURGOT
notre travail et la bénédiction de Dieu qui entretiennent tout le peuple, et qui nourrissent les riches comme les pauvres ; que ce ne sont pas les marchands et ouvriers de Paris qui font bouillir la marmite ; pas plus que le travail de tous les chevaux qui battent le pavé de Paris, qui mangent et puis c'est tout ; à la différence des nôtres, qui tirent de la terre de quoi tout nourrir et tout payer. Il sait que toutes ces belles marchandises qu’on trouve à Paris sont bonnes pour donner envie de dépenser, mais ne donnent pas de quoi dépenser ; et que tous ces bras resteraient vacants si les nôtres ne les faisaient aller. C/est pourtant en maniant la charrue qu’il a appris tout cela, ce dont tant d’habiles gens ne se doutent pas (1). » La sèche précision de Bœsnier de L’Orme et même de Condorcet n’est guère moins simpliste, ni moins outrancière, s’embarrassant peu d’une inconsciente pétition de principes. « La valeur des denrées rend à celui qui les vend un prix bien au-dessus de ses avances, puisqu’il doit lui servir en outre à payer tous les travaux utiles ou agréables aux hommes réunis en société ; au lieu que la valeur des marchandises ouvrées n ’offre que le remboursement des frais qu’elles occa sionnent (2) ; si le fabricant fait quelque profit au delà, ce profit est pour lui, et non pour la nation... ; le superflu [du laboureur! est par conséquent la seule richesse. Cette démons tration me paraît évidente (3). » « Il importe donc à toute société... que ce superflu soit considérable... ; c’est le revenu disponible qui doit circuler, qui doit stipendier toutes les autres classes ; c’est ce qu’on appelle le produil net, et c’est de l’abondance de ce produit net qu’un empire peut tirer son bonheur et sa force (4). » « Les profits de l’industrie et du commerce appartiennent également à tous les peuples : le produit des terres est la seule propriété vraiment nationale (5). > « Une nation aurait beau épargner des millions par le négoce,12345 (1) Lettres des Laboareuses, p. 8-9. (2) Cf. Bœsnier de L’Orme, Gouv. écon., p. 322-324. (3) Condorcet, Comm. Blés, p. 28-30. (4) Ibid., p. 10-12. Cf. Nlles É ph., 1775, n° 1, p. 175. L’auteur réédite encore en faveur de l’agriculture les vieux argumenta d'ordre physiolo gique ou moral : « Elle est la mère des hommes robustes et vertueux »; ou bien d’ordre politique et militaire : « Elle avantage la nation devenue grâce à elle maîtresse de sa subsistance. » Comm. Blés (Œuvres, t. XI, p. 157 et 119). (5) Bœsnier, loc. cil.
LA P R O D U C T I V I T É E X C L U SIV E DU SOL ET DES E AUX
49
elle n’aurait pas pour cela un revenu propre et réel, elle ne subsisterait toujours que précairement du revenu des autres... Un négociant anglais part pour l’Inde ; au bout de 10 ans il revient avec une fortune de plusieurs millions... : ce ne peut être regardé comme un revenu de l’Angleterre, parce qu’enfin cet accroissement peut cesser d’un moment à l’autre par les circonstances (1). » En y réfléchissant d’ailleurs, il faut bien reconnaître qu’ « un négociant qui a 100.000 écus dans son commerce, et qui gagne annuellement 15 à 20.000 francs par son industrie, n ’est à cet égard qu’un salarié de la même classe que l’ouvrier qui ne gagne que 20 sols par jour... Car, autre ment, il faudrait aller dans tout ceci sans principes, sans règles et sans mesure ; et, sans respect du droit de propriété, prendre simplement à qui paraîtrait avoir plus, et renverser tous les fondements de la société » (2). Il en est du commerce comme de l’industrie ; de son immunité, déclarée inévitable et nécessaire, on peut conclure à sa stérilité intrinsèque. Dans tout acte de commerce il ne peut jamais y avoir au fond qu’un échange de valeur contre valeur égale : « il ne peut y avoir de gain net — ni de perte réelle — pour per sonne » (3). Avec plus de finesse et de prudence, mais non sans désin volture, Condillac se borne à prononcer « qu’il n’y a, en général, que deux classes de citoyens : celle des propriétaires, à qui toutes les terres et toutes les productions appartiennent ; et celle des salariés qui, n ’ayant ni terres ni productions propres, subsisted avec les salaires dus à leur travail » (4). Beaucoup plus réservé, Voltaire se contente de formules d’approbation encore moins compromettantes : « Oui, Mon sieur, l’agriculture est la base de tout, comme vous l’avez dit, quoiqu’elle ne fasse pas tout. C’est elle qui est la mère de tous les arts et de tous les biens (5). » En ce qui touche les immeubles des villes, la logique physiocratique, par sa pente naturelle, est conduite à ramener la productivité des batiments à celle des terrains qu’ils occupent. « Ce n’est pas un bien productif qu’une maison, c’est une commodité dispendieuse. valeur est principalement celle (1) Bœsnier, op. cil., p. 327-328. Cf. p. 159 ; les profits énormes sont compensés par des risques qui n i le sont pas moins. (2) Ibid., p. 364-365. # (3) Ibid., p. 257. (4) Condillac, Commerce el Gouvernement, p. 355. (5) Diatribe à Vauteur des Êphémérides (Œuvres (éd. 1853), t. V, p. 472). G. W E U L K R S S E
4
50
LA PH YSI OC R ATI R SOUS
LE M I N I S T E R E D E TURGOT
du capital employé à bâtir ; soïi loyer n’est en plus grande partie que l’intérêt plus ou moins fort de ce capital... et ee capital, ainsi que l’intérêt, sont périssables par la nature même de la maison... C’est donc à la valeur du terrain que se réduit le véritable et solide bien du propriétaire (1). » L’assi milation implicite et forcée avec une terre cultivée empêche les Économistes même d’entrevoir le phénomène de la rente foncière urbaine, si caractéristique, et si gênant pour toute leur théorie justificatrice de la propriété terrienne en général Obéissant à la même logique interne, les Économiste* renouvellent leur critique de la gabelle en faisant ressort» quelle perte entraîne pour les producteurs de sel le monopole de la Ferme : « faute de concurrence d’acheteurs, elle est double, portant à la fois sur la quantité et le prix de la denrée » (2). Les marais salants sont considérés comme des sortes de biens-fonds, participant à la productivité réelle et perpétuelle des eaux marines. A plus forte raison, reprenant une analyse technique et sociale fort poussée dès l’origine par Quesnay (3), Baudeau proclame avec une précision accrue la productivité des grandes pêcheries maritimes : leurs armateurs sont « de vrais entrepreneurs en chef », et peuvent être comparés aux propriétaires des fonds de terre cultivés à moitié ; ne fournissent-ils pas des « avances primi tives — grandes, moyennes et petites barques »? Et des « avances journalières : agrès de ces bâtiments ; lignes, filets, sel, tonneaux, paniers, etc. ; et les subsistances des matelots, leur entretien total, et les autres objets de consommation» (4)? I. — La grande et riche agriculture La prospérité de l’agriculture française est loin d’être pleinement rétablie. « Combien encore de malheureux colons offrent le coup d’œil de galériens de terre ferme : le produit de leurs frais et de leurs sueurs semble ne leur être laissé que par charité, comme le seraient les profits du glanage (5). i Il s’en faut que la plaie du métayage indigent soit guérie : « Le maître fournit des bestiaux et toutes les avances, place12345 (1) (2) (3) (4) (5)
D., Mém. Municip., Knies, t. I, p» 268. ß., Niles Éph., 1775, n 4, p. 75-83. 1757, cf. Μ. ΡΛ., t. I, p. 278-279. ß., Niles Êph., 1775, n° 4, p. 181-183. Ai., Supp. Th. Imp., p. 44-49.
LA P n O D U C T I V IT K E X C L U S I V E DU S O L ET DES E A U X
51
dans son bien une famille de pauvres paysans, qui jamais n’imaginera payer un salaire, avoir un domestique, ni un journalier. Le meilleur métayer fera travailler tous ceux de sa famille qui sont en âge ; s’il lui en meurt deux, la culture dépérira de deux... E t quelle culture 1 Tout est léthargique ; la charrue, attelée pendant 4 heures des plus longs jours, paraît immobile et pétrifiée. Ces gens ne sèment que le moins qu’ils peuvent de grains, et de la plus basse qualité, puisqu’ils n’ont en vue que leur subsistance, et nullement aucune sorte de vente. Tout le reste, et les meilleurs fonds, est en pacages, clos de haies incultes et garnies dans la saison de branches de bois coupées à la forêt et partout ; là sont épars quelques chétifs bestiaux, dont le croît est tout l’espoir du domaine pour payer l’impôt... A la récolte, le maître arrive, prend la moitié du grain, qu’il est obligé de restituer presque à poignées dès l’entrée de l’hiver, s’il ne veut pas que ses gens mettent la clef sous la porte. Pendant ce temps le colon fait de nuit le plus qu’il peut de voitures avec ses bestiaux pour gagner quelque petite chose, pour avoir du sel, et les bâtiments tombent, et les ronces couvrent tout... (1). » Dans beaucoup de provinces, telles que le Maine, l’Anjou, le Limousin, le Bourbonnais, rares sont les grandes fermes qui font dire : « Optima stercoratio gressus domini : les pas du maître sont un excellent engrais (2). » « Deux à trois domaines de 30 à 40 arpents sont séparés par des centaines et des milliers de terrains en friche qu’occupent des broussailles, des landes et des bruyères (3). » Même, dans beaucoup d’en droits, au dire de Mirabeau, « les simples vignerons sont tous les jours plus misérables, plus endettés, moins en état de soutenir leur culture, et ils diminuent, ainsi que leurs fonds » (4). — E t cependant, dans mainte région, la régénéra tion commencée en 1764 se poursüit lentement : « Les trou peaux se multiplient ; la marne tirée du sein de la terre est répandue pour échauffer sa surface ; la charrue fend des terres qui depuis un siècle n’avaient pas senti l’impression du soc... (5). » Pour hâter cette restauration agricole, sur quels points12345 (1) Ibid., p. 186-187. (2) Ibid., p. 44. (3) B., Jéclaircissements y p. 48 et suiv. (4) M., op. ci/., p. 185. (5) L . T., Discours prononcé au bailliage d'Orléans le 10 juin 1775. O. social, p. 478. Cf. M . P h.
52
[.A P H Y S I OC.R A T IE SOUS LE M I N I S T E R E DE TURGOT
essentiels porter l'effort ? D’abord continuer de mettre 1 grande culture à l’honneur : Cent arpents défrichés ! Un bois planté, deux marais desséchés I Attendez-en la juste récompense. s’écrie Albert Premier félicitant le bon fermier. A qui doit-on plus de reconnaissance Qu’à ces travaux, la source des vrais biens ? Et se tournant vers les courtisans, l’empereur d’ajouter Oui, ce sont là les premiers citoyens ; Je les honore. Une erreur trop cruelle Les dégradait, et leur utile zèle Peut seul du trône assurer la grandeur (1). Développer aussi l’assistance médicale dans les campagne Les « boîtes à remèdes » avaient commencé de s’y répand] dès 1728 ; après l’Arrêt du 1er mars 1769, le nombre des dos< distribuées par le gouvernement s’était élevé de moins ( 200.000 à près de 1 million ; un nouvel Arrêt du 9 février 177 rendu sur la proposition de Turgot, triple encore ce chiffre (2 Favoriser l’activité des Sociétés d’agriculture : ma l’absolutisme administratif s’effarouchait et s’irritait d moindres critiques. La Société d’Auch s’était permis, 22 juin 1774, d’adresser directement au roi des représentatioi sur l’Arrêt prohibitif du 23 décembre 1770, « au nom du peup et du général de la province, comme si elle était chargée < ses intérêts ». Le 7 juillet, Bertin s’étonne de cette démarch aussi indiscrète qu’insolite, et renvoie la pétition à l’intendaD comme étant le plus juste arbitre entre propriétaires et no propriétaires. Le 25 juillet, celui-ci, à son tour, déclare la péi tion irrecevable : car « ces Sociétés n ’ont été établies que poi apprécier des découvertes et non pour examiner les régi ments » (3). L’étroitesse jalouse de cette tutelle administrate n’avait pas peu contribué au demi-échec de l’institutio « Ici pas plus qu’ailleurs [à l’étranger], on ne les suit ni ne I écoute. Quand la providence, rappelle Mirabeau, voulut que123 (1) Acte III, se. 2, p. 72-73. (2) Cf. Ardascheff, p. 264 et 265, e t A. de Calonne, p. 243 244. An Aisne, C 21 ; Somme, C 27. (3) H. 1508, pièces 9 et 21.
LA P R O D U C T IV IT E E X C L U SIV E DU SOL ET DES EAUX
53
fusse en vogue et que [j’aie] ouvert la voie à une nouveauté en vantant l'agriculture, ce fut, comme dans la fable de Mercure, à qui aurait perdu sa cognée. Parmi les aventuriers de la mode, quelqu’un proposa ces Sociétés et le gouvernement, qui n’aimait pas les lumières, se mit à la tête et en forma qu'il fit présider par ses intendants. Dès lors chacun les vit comme suspectes et s’en retira ; et il n’en est demeuré que les grattepapier (1). » Les avantages offerts aux défrichements sont maintenus et précisés. « Sous le règne précédent, et particulièrement par les soins de feu M. d’Ormesson, plusieurs exemptions, entre autres celle des dîmes, leur avaient été accordées pour un cer tain nombre d’années. Mais combien de ceux qui se préten daient dans le cas d’en jouir étaient troublés par des procès portant soit sur la quantité des terres par eux défrichées, soit sur la qualité de terres incultes que les décimateurs ou habitants contestaient aux terres nouvellement mises en valeur (2). » Or, écrira Condorcet, « un procès que le décimateur pouvait intenter... était un mal plus grand que la dîme » elle-même (3). Les lettres-patentes du 7 novembre 1775 réduisent à six mois le délai dans lequel pourront être contre dites les déclarations de défrichement à compter du procèsverbal d’affiche (4). Inspiré en partie par les mêmes intérêts, et accepté « avec empressement » par Trudaine (de Montigny), l’Arrêt du 6 février 1776 ramène à 42 pieds la largeur des routes princi pales « qu’une fausse idée de magnificence avait augmentée jusqu’à 60 aux dépens de la culture » (5). — Le remembrement des domaines agricoles demeurait au programme de l’École. Turgot projetait l’abolition complète des droits sur les échanges parcellaires, lesquels nuisaient « à la distribution la plus avantageuse des propriétés et à la réunion des héritages en grandes pièces, si favorable à l’agriculture » (6). Mais, pour être efficaces, toutes ces mesures supposaient que les ressources disponibles du royaume se concentrassent davantage sur la mise en valeur des terres, soit par afflux12345 (1) M. à Longo, 5 septembre 1775, M ss. A ix , XVI, p. 25. (2) D., Mém. Turgot (1782), I I e Partie, p. 120. (3) Vie de Turgot (Œ., Schelle, t. V, p. 78-79). (4) Analyse par Boncerf, Mém. Soc. Agric. Paris , 1788, trim, été, p. 83. (5) Cf. Mém. Ac. Sc ., 1777, p. 87. Cf. Œ. T., t. II, p. 466. Cf. D., Mém. Turgot, IIe Partie, p. 227. (0) Ζλ, Mém. Turgot, I I e Partie, p. 216.
54
LA PH YS1 OCR ATI E SOUS L E M I N I S T È R E DE TURGOT
direct et spontané des capitaux privés, soit du fait d’une poli tique financière et bancaire convenable. « Ghoiseul est agri cole et Voltaire est fermier », avait dit l’abbé Delille en plein Académie lors de la réception de Malesherbes le 15 jan vier 1775. Voltaire reprend cette formule dans son poème d Temps présent (1), et la commente d’un ton semi-plaisant « Il semble que je sois le fermier de M. le duc de Choiseul Plût à Dieu que je le fusse ! je lui rendrais bon compte je tiens la condition de son fermier pour une des meilleures d ce monde (2). » Mirabeau ne cesse de vitupérer contre « ce châteaux fastueux qui font aux campagnes comme des talon rouges... et tout l’embarras du luxe asiatique de la Cour, di Prince... ; élégances ruineuses d’un peuple de saltimbanque et de fols » (3). — Bien précaire aussi la prospérité d’un Eta fondée sur le pur trafic : -11G.
58
la
PH Y S IO C R A TIE s o u s
LE M I N I S T È R E D E TURGOT
surcens, corvées, etc. ; les droits de lods, de relief, de champart ; les banalités plus chèrement encore. Un seigneùr retirerait de la vente de ses droits plus qu’il ne vendrait toute sa terre, conclut non sans exagération Boncerf..., il les remplacerait par l’acquisition de fonds à sa convenance. Cet affranchisse ment se ferait sur le pied du droit brut, c’est-à-dire tel que le vassal le paie, tandis que le seigneur ne peut le compter dans ses recettes qu’après les déductions et frais... Outre cette aug mentation de revenu, il serait soulagé dans la même proportion des dépenses de régie et d’administration (1). » Turgot déclare Dupont, « croyait servir la noblesse, en lui préparant cette ressource à tirer de droits qui ne sont presque d’aucun produit pour elle... Et il comptait employer avec elle les encouragements personnels, en proposant au Roi de remettre aux seigneurs qui relèvent de lui et qui voudraient affranchi] leurs propres vassaux des droits féodaux, ceux qu’il a lui même à prétendre sur eux » (2). Mais surtout, et c’est ce qui intéressait le plus vivemenl les Physiocrates, l’exploitation agricole en eerait toute rénovée Tous ces droits réels et fonciers sont des copropriétés qu gênent le travail du possesseur... Cette communauté dans 1< bénéfice décourage celui qui est seul à faire les mises de 1; culture et des semences. « Les communautés de biens même le: plus égales ont été répudiées dans tous les temps...»,etBoncer de citer Loisel et le Code Théodosien (3). « Les Romains si gardaient bien d’introduire des contrats tels que l’inféodation qui donnait et retenait à la fois le même fonds... L’Angleterr avait au xvie siècle affranchi les terres dépendant de TÉgfo et des moines, et ç’avait été une des principales causes de sι prospérité... » [En France même] « l’avantage de la libert des fonds peut s’établir par la comparaison des cantons ei franc-alleu avec les autres... La différence est frappante » (4' E t combien les « particuliers aisés qui, pour se soustraire au: servitudes féodales, se retirent dans les villes, qu’ils surchar gent et où ils se corrompent, reviendraient par millions (sic habiter les campagnes, au grand profit de l’agriculture ! » (5! La société tout entière bénéficierait donc de cette sort de révolution : car « son vœu est la meilleure culture possible12345 (1) (2) (3) (4) (5)
Inconvénients, p. 30-32. Mém. Turgot, II« Partie, p. 218-219. Boncerf, Inconvénients, p. 46. Ibid., p. 45 et 41. Ibid., p. 33.
la
p ro d u c tiv ité
e x c lu siv e
du
SOL
ET
DBS
EAUX
l>9
la propriété la plus parfaite, la tranquillité la plus profonde »( 1). Les finances publiques s’en ressentiraient aussitôt, car « la confusion de tant de droits sur un seul fonds préjudicie à tous les copropriétaires, par conséquent à l’État. E t c’est bien le droit de celui-ci de régler la forme des propriétés » (2). U semblerait que Turgot eût voulu surseoir au rachat des bana lités, péages et droits sur les échanges ; pour le reste des charges fiscales, il prévoyait deux modalités : dans le domaine royal, on procéderait par conversion en une redevance annuelle et régulière ; sur les terres seigneuriales, des facilités seraient offertes aux racheteurs, ou bien interviendrait une « conver sion amiable et de gré à gré ; l’on réformerait par un Édit les dispositions de quelques coutumes qui s’y opposent ». De toute façon, « on ouvrait au peuple une porte qui devait à la longue conduire à la libération des héritages... Chacun étant devenu par la suite pleinement propriétaire de son bien, tous les patrimoines eussent été améliorés, et le Roi qui, par les impositions de toute espèce (3), jouit d’une part de tous, aurait vu ses revenus augmentés par la suite du bonheur général » (4). Servitudes administratives. — L ’interdiction récente de planter des châtaigniers en Corse est rapportée par Arrêt du 30 septembre 1774 : « ils sont un moyen nécessaire de subsis tance pour certaines parties de l’île dans les temps de disette, et dans tous les temps le commerce met un prix avantageux à cette production de pays » (5). « Ce n’est pas assez, déclare Tifaut, pour le citoyen d’avoir le droit de posséder, il faut encore qu’on le maintienne dans la liberté de jouir. Le premier objet veut, de la part de l’État, le respect pour la propriété ; le second demande pour le possesseur le droit d ’user de son fonds comme il lui plaît (6). » L’intendant d’Alençon, Jullien, ayant cru bon de porter « défense de laisser les charrues dans123456 (1) Ibid., p. 44. (2) Ibid.y fin. C’est peut-être cet intérêt fiscal qui a provoqué la satire suivante : Riez, chantez, peuples de France Fc prince en garde la finance, Vous recouvrez la liberté ; Et de ce fortuné bienfait Quant à votre propriété, Zéro sera le produit net. Mém. secrets, IX, p. 86, cité par Gomel, p. 210, note.
(3) (4) (5) (6)
En attendant sans doute la réalisation de l’impôt unique. D., M ém . Turgot, II« Partie, p. 218-219. Cf. Foncin, p. 191, Code Corse, II, 398. Réflexions, p. 1-2.
LA PH Y S IO C R A TIE SOUS LE M I N I S T E R E
60
D E TURGOT
les champs, » Turgot le blâme discrètement de cette interven tion aussi tatillonne que bien intentionnée. « On peut abuser de tout ; et on en viendrait à tout défendre ; l’agriculture, comme le commerce, a besoin essentiellement de liberté (1). » Sous prétexte d’approvisionner d’urgence les marchés, les règlements obligeaient les cultivateurs à battre leurs grains presque aussitôt après la moisson ; il en résultait que leur paille était foulée et faisait dépérir les bestiaux (2). Condor cet (3) et la Société d’agriculture de Limoges (4) réclament la suppression « des fêtes qui ne sont pas trop solennelles » de manière à réduire dans les campagnes le chômage obligatoire. Servitudes domaniales. — Les terres du domaine royal étaient théoriquement inaliénables ; « la Couronne ne peut cependant jouir elle-même de leur propriété dans toute leur étendue, les régir avec une sage économie, ni les porter à leur véritable valeur » (5). La ferme générale « n’est pas (non plus) propre à une administration terrienne, et les Domaines avaient été par elle fort négligés ; on n’avait pas mis l’atten tion nécessaire & la recherche des titres en passant des sousbaux » (6). « La Domanialité, pouvait proclamer Boncerf ne vaut pas mieux que la Féodalité ; le roi tirerait plus des impôts ordinaires que supporteraient les domaines aliéné* qu’il ne tire du revenu des fonds (7). » On avait bien pratiqué des demi-aliénations. Bail emphy téotique, par exemple ? Mais « l’afTection qui résulte de l’espril de propriété, qui est l’âme de la culture et des améliorations lui manque totalement » (8). Ou bien bail à rente foncière ) Mais, sans parler des frais d’une administration vexatoire la crainte perpétuelle d’une reprise incite à une exploitatioi paresseuse ou désastreuse (9). Les divers contrats d’engage ment n’étaient pas plus avantageux. Il faut recourir à l’alié nation « sans aucune réserve », à la propriété privée « sam mélange » (10), par une adjudication, dont ne seraient pa1234567890 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Cf. Schelle, Œ. T., t. IV, p. 242. L ettre du 12 novembre 1774. Cf. Condorcet, Commerce blés, chap. X X L Ibid., p. 84. 4 janvier 1776. D ., M ém. Turgot, p. 243. Ibid., II® Partie, p. 20. Inconvénients , p. 43. Ibid., p. 85. Ibid., no® 88-91. Ibid., p. 102 et 122.
LA P R O D U C T I V I T É E X C L U SIV E DU SOL ET DE S E A U X
61
même exclus les étrangers désireux de devenir régnicoles (1). « Si les impôts ont suppléé le Domaine, celui-ci doit rentrer dans le commerce, être livré à la culture économique de la propriété et supporter sa portion des charges publiques (2). » « Même la crainte de voir dévaster les forêts domaniales par les particuliers qui les auraient acquises, est vaine » selon Boncerf ; car des coupes excessives entraîneraient une baisse des prix, et l’exploitation abusive, risquanjb de se ruiner, s’arrêterait d’eile-même... (3). Baudeau apporte à ces projets l’approbation explicite de l’École : « Le souverain d’un E tat aussi grand que la France est sans contredit le plus mauvais propriétaire particulier que puisse avoir un fonds cultivable, de quelque espèce qu’il puisse être... Donnez à ce fonds, au lieu d’un régisseur toujours étranger, ou même à la place d’un simple engagiste qui ne l’occuperait qu’à titre précaire, un bon et réel propriétaire dont il forme le patrimoine et l’héri tage à perpétuité ; bientôt vous y verrez faire les bonnes et solides avances particulières que ne font jamais les autres ; la production totale et le produit net augmenteraient de jour en jour (4). » Servitudes communautaires. — La Société d’agriculture de Limoges n ’envisageait, sauf à titre d’essai, et sur la demande de l’intendant, aucun partage définitif de communaux dans les paroisses de l’arrondissement ; « il n’en existait que de petits... ; les habitants se les partageaient quelquefois entre euf sans formalité suivant que le progrès de l’agriculture rendait le terrain plus précieux ; mais ils n’étaient composés que des terres les plus stériles... » (5). En revanche, en Artois, « dès que les États eurent obtenu [en 1769] l’administration et la juridiction des marais, iis secondèrent les vues du gou vernement [qui étaient celles de l’École]... savoir la mise en culture des terrains humides... Mais les paysans voulaient conserver leurs marais, où ils trouvaient sans effort le tourbage, le rouissage du lin et la pâture des bestiaux. Ceux de Hesdin ne servaient cependant qu’au pâturage des oies ou autres animaux nuisibles à la reproduction des herbes : une assemblée délibérera sur la manière la plus utile de régir les12345 (1) (2) (3) (4) 102). (5)
a . p. 125.
Ibid., p. 58, cf. p. 75. Ibid., p. 63. B., Disc, prélim. Économies Sully (NUes Éph.9 1775, n® 12, p. 101A. Leroux, Choix documents, p. 271.
62
LA P H Y S I O C R A T S SOUS
LE M TNlSTfeR E D E T U n G O Î
fruits et revenus de ces marais demeurant indistinctemenl .communs ; ou sur leur partage méthodique en portions propre au tourbage, au pâturage ou à la culture » (1). III. — Pour l’immunité de la culture l’impôt territorial unique Le9 Physiocrates entendaient que le cultivateur n’eût plus à souffrir des abus du droit de chasse comme de l’inetïi* cacité de la police rurale, et que sa personne fût exempte de toute réquisition comme ses récoltes de toute imposition. Louis XVI avait, à son avènement, « déclaré qu’il ne chasr serait que deux jours par semaine, comme feu Henri IV » ; mais, ce soi-disant remède ne serait-il point pire que le mal ? « Il fallait détruire les lapins, et laisser les cultivateurs maîtres de leur fourrage, au lieu de le sacrifier aux œufs des per drix (2). » « La gent lapine surtout était devenue envahissante ; cet animal coûte un louis pièce à raison des dégâts qu’il fait, et il ne le vaut pas, à beaucoup près (3). » Ce gibier s’était « tellement multiplié dans les forêts de S. M. qu’il occasionnait des dommages immenses dans les terres environnantes dont lee propriétaires sont dans l’alternative ou de les laisser entièrement incultes, ou de voir leurs moissons dévastées ». L’Arrêt du 21 janvier 1776 ordonne la destruction de ce fléau, non seulement aux lisières des forêts royales et des grands bois, mais dans toute l’étendue des capitaineries (4) :*le jeune monarque l’avait rédigé de sa main et c’est un dee traite qui lui ont fait décerner, un peu facilement, par Michelet, le beau titre de roi fermier : mais c’est « un monument de l’intérêt que doit inspirer à un prince et à un homme la conservation de la subsistance du peuple et des revenus des Propriétaires et de l’É tat » (5). La mendicité rurale dégénérait souvent en brigandage. Dans le Soissonnais par exemple, « pauvres réels ou imagi naires assiègent journellement les fermes et vont insolem ment par troupes demander aux fermiers le pain qu’ils ne veulent pas gagner » : ils refusent tout travail et, si on les12345 (1) (2) (3) (4) (5)
Fion, Étals d'Artois , p. 94, 24 novem bre 1776. B ., Chronique secrète, 29 m ai 1774. Mém . secrets, 28 novem bre 1775, t. V III, p. 301. Œ. T .y t. II, p. 234. D., Mém. Turgot, U* P artie, p. 121.
LA P R O D U C T I V I T É E X C L U S IV E DU SOL ET DES E A U X
63
éconduit, menacent de mettre le feu ; il en passerait « jusqu’à 400 à 500 par semaine » ; et dans le nombre, se trouveraient même des petits propriétaires assez à l., Mém. Turgot, p. 91-92. (3) L ettre de T. du 30 ju ille t 1774. (4) Cf. F. Dumas, p. 298-301. (5) P. 10. (6) Lettre d'un cultivateur de province, avril 1776, p. 31.
LA P R O D U C T I V I T É E X C L U S IV E DU SOL ET DES EAUX
65
Mémoire : « Que diraient les maîtres artisans, si on venait leur enlever leurs ouvriers (1) ? » Même les jours fériés, ici, n’étaient pas respectés (2). Turgot consulte d’abord les intendants par la circulaire du 28 juillet 1775 ; à quelques rares exceptions près, comme celle de l’intendant du Poitou de Blossac, les réponses sont favo rables à la suppression. Même assentiment des quatre inspec teurs généraux des Ponts et Chaussées (3). L’Édit d’abolition est rendu en février 1776 ; le préambule, très développé, précise qu’il s’agit « des corvées exigées des sujets, et même de la portion la plus pauvre, sans aucun salaire. Enlever forcément le cultivateur à ses travaux, c’est toujours lui faire un tort réel... Les opérations de la culture sont si variées, si multipliées, qu’il n ’est aucun temps entièrement sans emploi... L’erreur d’un administrateur peut faire perdre aux cultivateurs des journées dont aucun salaire ne pourrait les dédommager. Prendre leur temps sans les payer est un double impôt, et hors de toute proportion lorsqu’il tombe sur le simple journalier... * : c’est le point de vue physiocratique, quelque peu élargi dans le sens social. Suivent quelques considérations, d’ordre psychologique et professionnel ; t l’homme qui travaille par force et sanç récompense travaille avec langueur et sans intérêt ; U fait, dans le même temps, moins d’ouvrage, et son ouvrage est plus mal fait. Les corvoyeurs, obligée souvent de faire 3 lieues ou davantage pour se rendre è l’atelier, autant pour retourner chez eux, perdent, sans fruit, une grande partie du temps exigé d’eux... Ainsi l’ouvrage coûte au peuple et à l’État, en journées d’hommes et de voitures, deux et souvent trois fois plus qu’il ne coûterait s’il s’exécutait à prix d’argent... » « ... Ainsi sera rendue aux hommes qui s’occupent de la culture la libre disposition de leurs bras et de leur temps, sans qu’aucune contrainte puisse désormais les enlever à leurs travaux ( 4 ). » Outre la sécurité et l’immunité en quelque sorte person nelle de la culture et du cultivateur, il fallait réaliser leur immunité fiscale. L’École renouvelle sa critique des impôts existants. S’il n’en est pas un seul qui ne présente à ses yeux un vice rédhibitoire, il ne restera qu’à justifier une fois de (1) B .t Afim . sur les Corvées, passim (1775). (2) Vues ultérieures, Chestellux, t. II, p. 250, éd. 1822. (3) Lettre de Trudaine à T., de janvier 1776. Cf. Duerocq, p. 18, et p. 21, n. 6. (4) Œ. T., t. II, p. 466. O . W B lT L E R tS B
5
66
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS
LE M I N I S T È R E D E TURGOT
plus positivement, et à tenter d'organiser, l'impôt territorial unique. Contre la dime, les Économistes ne cessaient de pronon cer une condamnation absolue : car « elle se lève, non sur le produit net des terres, mais sur leur produit physique ; non sur la part du propriétaire, mais sur les sueurs et les travaux du laboureur ; elle eût presque enlevé le profit entier des défrichements... » (1). C’est « une vraie spoliation, puisque même dans les grandes terres à blé qui exigent le moins d’engrais et de frais d'exploitation, il est prouvé qu’elle excède en valeur la moitié du revenu du propriétaire, encore chargé de payer sur ce qui reste les vingtièmes, les répara tions et les non-valeurs » (2). Les impôts de consommation dans leur ensemble sont condamnés, surtout en raison de l’énormité des frais et fauxfrais qu’ils comportent. D’après Baudeau, les gabelles coû taient à la nation, du fait de la moindre consommation et du moindre prix en première main, 120 millions, et en rappor taient au Trésor moins de 40 ; les aides, respectivement 300 millions et moins de 30 ; les tabacs, 40 millions et moins de 24 : soit, au total, une perte sèche de 374 millions — sans parler de la contrebande, et des pertes de temps, des frais de justice subis par les consommateurs (3). La Cour des Aides proteste avec véhémence contre l'excessive complication, onéreuse pour le peuple et ruineuse pour le Roi, d’une telle fiscalité ; contre les abus d ’autorité des percepteurs subal ternes ; contre les difficultés qu’éprouvent les contribuables lésés pour obtenir justice (4). C’est à cet art désastreux de travailler un royaume en finances que Voltaire consacre un de ses mordants contes en vers (5) : « il y présente rapidement dit Bachaumont, l’esquisse du roman politique que les Écono mistes ont mis plusieurs fois en œuvre, pour peindre en action et plus énergiquement les suites affreuses de ce système » (6). Même en cas de guerre, plutôt qu’à des surtaxes sur la consom mation, mieux vaudrait encore recourir aux emprunts : la charge en retomberait directement sur les propriétaires,123456 (1) Condorcet, Vie Turgot (Œ. Γ., p. 78-79). Cf. Réflexions, Comm. Blés, notes, p. 176-177. (2) Extraits Registres Soc. A g r. Rouen , 1775, H. 1507, pièce 256. (3) Profit du Peuple (Nlles Ê ph ., 1775, n° 4, p. 60-^4 et p. 83-87). (4) Remontrances, 6 m ai 1775. (5) Les Finances (Œ . Voltaire, t. X , p. 57). (6) Mém. secrets 28 ju in 1776 t. IX , p. 163.
la
PRODU CTIVITÉ
e x c l u s iv e
du
sol
et
DES
eaux
67
ceux-ci pourraient la supporter en hypothéquant leurs biens, et le commerce général se trouverait moins dérangé (1). L’École enregistre sur ce point un succès local. Au pays de Gex, la frontière était si artificielle et si enchevêtrée que la perception des droits de consommation y était plus vexatoire et plus onéreuse que partout ailleurs, n’exigeant pas moins de 78 commis ! Sur les instances du seigneur de Fernay, Trudaine, en parfaite entente avec Turgot, en prépare la suppression. Les lettres-patentes du 22 décembre 1775 déclarent le Pays réputé étranger, ce qui entraînait l’affranchissement de la Ferme générale pour les aides et les traites, ainsi que de la Régie Royale pour le sel et le tabac. L’indemnité de remplace ment, chiffrée d’accord avec les États à 30.000 livrée, devait être « levée sur les biens-fonds et proportionnée à leur valeur réelle, que les possesseurs fussent des privilégiés ou non, sans excepter les propriétaires non-résidents » (2). On put dire que « M. Turgot avait proposé au Roi de charger M. de Voltaire de diriger un essai de l’impôt unique » (3). Le philosophe, en effet, salue la réforme avec joie et la célèbre comme une victoire pour la nouvelle doctrine : « Il faut absolument que je vous dise, écrivait-il à M. de Vaines, au nom de dix à douze mille hommes, combien nous avons d’obligations à M. Turgot, à quel point son nom nous est cher, et dans quelle ivresse nage notre province. Je ne doute pas que ce petit coin de liberté et d’impôt territorial ne prépare de loin de plus grands événe ments (4). » L’expérience très particulière pouvait paraître assez concluante pour qu’il fût question d’en élargir le champ. En mai 1776, Trudaine, accompagné de sa femme, de sa belle-sœur Mme d’Invau, et du poète Delille, se rendit sur place pour s’entretenir avec le patriarche instigateur. L’oppo sition cependant ne devait pas tarder à se manifester contre l’assiette exclusivement foncière de la taxe de substitution (5). La taille personnelle, essentiellement arbitraire, était la négation même de l’immunité du cultivateur, et comportait pour lui le risque d’un perpétuel désastre. « Lorsqu’elle est venue, avec tous les impôts, fondre sur la tête du raalheu-12345 (1) Cf. Bceanier, Gouv. 1icon., p. 350. (2) Œ. 7\, t. II, p. 413. (3) Correap. Métra , t. II, p. 259, 3 décembre 17?6. Cité p ar Fonrin, note, p. 330. (4) L ettre du 11 janvier 1776. (5) V. infra , p. n.
68
LA P H Y S I O C R A T I E SOUS LE M I N I S T E R E D E TURGOT
reux métayer, toute égalité dans le partage a été rompue, e! il a dû être réduit à la plus grande misère. Sa ruine a été plut ou moins entière suivant les différents degrés de fécondité des terres, le plus ou moins de dépense qu’exige la culture, le plus ou moins de valeur des denrées (1).» Le fermier n’est pas plus protégé que le colon : « É tant seul sur le rôle, c’est contre lui seul que peuvent être dirigées les poursuites ; c’est lui qui supporte tous les frais... Impossible pour lui de faire exacte ment, avant de fixer les conditions de son bail, le calcul des charges qu’il sera dans le cas de supporter... (2). » Et les fermiers riches auxquels l’École s’intéressait spé cialement sont les plus menacés, du fait des contraintes solidaires qui pèsent sur les quatre plus haut taxés de la paroisse. « Ceux-ci sont les cultivateurs ordinairement les plus intelligents, les plus avantageusement laborieux. Il ne faut pas croire, parce qu’ils sont aisés, qu’ils aient beaucoup d’argent dans leurs caisses. Ils l’emploient, à mesure qu’ils en ont, à augmenter le nombre de leurs bestiaux etc... Si ces hommes précieux sont mis en prison à cause d’un déficit qu’ils ne pouvaient prévoir ni empêcher dans les paiements de leur paroisse, tous leurs travaux sont suspendus, et tout le profit qu’en retirait la nation cesse d’avoir lieu. Si, pour n’être pas enlevés à leur famille, ils tâchent de payer, la chose ne leur est possible que par la vente précipitée, à grande perte, d’une partie de leur bétail ou de leurs animaux de labour. Le remboursement éventuel l’année suivante n ’est qu’une très insuffisante compensation, 1° parce qu’en leur rendant leur déboursé, on ne leur rend pas leurs pertes... ; 2° parce qu’on ne peut leur rendre, ni à la nation, les productions qu’ils auraient fait naître si l’on n ’eût pas dérangé leurs travaux... (3). » Par contre « les bonnes exploitations faites par ces hommes les plus riches et les plus instruits, n ’ayant éprouvé aucune secousse ni souffert aucune interruption, augmenteront pro gressivement d’année en année la richesse de ces entrepre neurs qui en font un si bon emploi... » (4). Cette forte argu mentation contre toute solidarité fiscale, si profondément imprégnée de l’esprit physiocratique, est couronnée de succès: la Déclaration du 3 janvier 1775 abolit & ces poursuites1234 (1) (2) (3) (4)
Γ., R ip. aux 06#. du garde des sceaux (CE. 7\, t. II, p. 259). Ibid., p. 260. 7\, Mém. au Roi, 3 janvier 1775 (CE. 7\, t. II, p. 377-378). Ibid.
LA P R O D U C T I V I T É E X C L U SIV E DU SOL ET DE S E AUX
69
rigoureuses qui découragent l'agriculteur, l’objet le plus digne de notre protection et de nos soins » (1). Le Trosne relève ces dernières expressions : « Ce ne sont pas des compli ments comme on nous en a fait si souvent en nous étranglant, s'écrient les Laboureuses. C’est qu'il fait [le Roi] comme II dit... Il ne veut pas qu’on travaille son peuple, parce qu’il voit bien qu'il se ruinerait en le laissant ruiner (2). j> La taille cependant, en elle-même, était susceptible d’amé liorations intrinsèques. L’intendant de la généralité de Paris, Bertier de Sauvigny, avait « inventé un nouveau et ingénieux système de répartition de l’impôt sur les terres » (3) qui comportait deux éléments : 1° « La taille dite personnelle, correspondant à la fois à la taille de propriété et à la partie de la taille reposant sur l’industrie et sur le commerce, était fixée invariablement à 1 sol par livre de revenu » (4). Turgot, qui dans son Instruction pour les Commissaires, jointe aux lettres-patentes du 1er janvier 1775, avait adopté la réforme, eût sans doute souhaité que les fermiers fussent exempts de cette première charge ; mais il était gêné par l’immunité traditionnelle des ordres privilégiés : « Les fermiers seront donc imposés pour le bénéfice de leur exploitation, attendu que, ne l’étant point pour les arpents de terre qu’ils cultivent que dans la même proportion que les autres exploitants, et même ceux qui n'ont aucuns moyens de culture, il est juste qu’ils contribuent personnellement aux charges de l’É tat pour les fonds qu’ils emploient, comme un commerçant a raison des fonds qu’il met dans son commerce ; sans quoi ils seraient effectivement traités comme les privilégiés, qui sont exempts de la taille personnelle et ne contribuent qu'à la taille d’exploi tation. » Les Physiocrates, nous le constaterons tout à l'heure, continuaient à condamner absolument toute imposition sur les entrepreneurs de culture, fût-ce d’une partie seulement de l'impôt foncier. 2° « La taille dite réelle (correspondant à la taille d’exploitation) variait suivant la fertilité des terres : 24 classes étaient dtetinguées^ javec détermination pour chacune d’un revenu imposable gradué. La quotité de l’impôt, très faible pour la première classe (3 deniers par livre de revenu imposable), afin d’encourager la culture des terres1234 (1) (2) (3) (4)
Ibid., p. 380. P. 9-10. Montyon, p. 238. Marion, Impôt sur revenu, p. 73.
70
LA P H Y S IO C R À T IE SOUS LE M I N I S T È R E D E TURGOT
même les plus médiocres, s’élevait jusqu’à 4 sols pour 1 9e classe, taux qui demeurait ensuite identique jusqu’à la class la plus élevée (1) (2). » Cette graduation des contribution! proportionnée à la qualité des terres, et plus forte que 1 proportion arithmétique, introduite dans toute la généralit avait en fait favorisé la culture d’une manière si sensible qu dans cette province l’exploitation des mauvaises terre n’avait pas été abandonnée ; et même « un assez grand nombr de friches avaient été mises en valeur ; le recouvrement de impôts avait été plus facile et plus prompt, et les contrainte plus rares » (3). La procédure d’application, confiée à un personnel d’élite comprenait déclaration contradictoire, débat sur pièces enfin, s’il y avait lieu, arpentage aux frais du perdant (4 C’est ce qu’on appelait « le cadastre mobile de Paris », plu sage, plus juste, au dire de Montyon, que ceux de la Silésie du Milanais, du Piémont « les plus renommés de l’Europe »(5 La question dJun cadastre général du royaume n’était pa sans intéresser vivement l’opinion ; la Correspondance Mût distingue un petit écrit de sieur Bernard, ci-devant intendan des Postes du roi de Prusse, qui annonce « de bonnes vue sur sa nécessité et sur les avantages qui en résulteraient »(6 et Bœsnier de L’Orme fait appel à Turgot pour la réalisatio de cette grande entreprise (7). — La Cour des Aides elle aust proposait un Cadastre, mais dressé par les contribuable eux-mêmes, sans arpentage de détail jugé superflu (8). Mais le contrôleur général envisageait une véritable révc lution fiscale, beaucoup plus proche du programme des Phy siocrates. Il voulait, d ’après Dupont, « éviter dans la répai tition tout arbitraire et toutes les vexations dont cet arbi traire était souvent la cause inévitable » ; il préparait un Déclaration qui transformait de fond en comble et la natur et l’assiette de l’impôt foncier. S’il n ’en faisait pas, suivant 1 vœu de l’École, ofc pur impôt de quotité, il instituait pourl répartition paroissiale ces Municipalités, destinées à préveni12345678 (1) Instruction pour la confection du rôle des tailles, 1er janv. 1775.
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Marion, p. 72-73. Montyon, ibid. Cf. Stourm, Finances Anciens Régime, t. I, p. 75. Montyon, p. 363. 2 janvier 1775, t. I, p. 157-158, et. Foncin, p. 172. Gouv. Êcon. (fin), p. 435-436. Mém. pour servir à Vhistoire du droit public , p. 677.
LA P R O D U C T I V I T É E X C L U S IV E DU SOL ET DES EA U X
71
« tout murmure et toute injustice », dont nous reparlerons puisqu’elles amorçaient une véritable transformation adminis trative, sinon politique (1). Quant à l’assiette, et à la respon sabilité, sur ce point capital, il était en plein accord avec les Économistes : « Dorénavant toutes les impositions connues sous le nom de laille d'exploitation, taille personnelle, et accessoires de celles-ci, demeureront réunies sous le titre et la qualité de taille réelle... E t le propriétaire seul, de quelque qualité qu’il soit, sera tenu, comme il l’est déjà indirectement, de les acquitter ; ce qui ne déroge point aux privilèges de la noblesse ni des autres privilégiés, puisque leurs privilèges ne se sont jamais étendus aux terres affermées. En consé quence, et dans la vue d’empêcher aussi que les travaux de l’agriculture, destinés à mettre l’abondance dans le royaume, puissent jamais être interrompus, ce ne seront plus les richesses d’exploitation, ou les richesses mobilières des culti vateurs, mais la valeur même des héritages qui répondra du paiement de l’impôt (2). » Le Vingtième, cependant, n’offrait-il pas aux novateurs plus ou moins hardis un point de départ de réforme fiscale plus favorable ? Fidèle aux appréciations premières de l’École (3) Baudeau y découvre tous les avantages de prin cipe d’une « perception directe, se faisant immédiatement sur le territoire » (4), et Turgot l’acceptera comme base de répartition de la taxe remplaçant la corvée. Mais dans la pratique, ce n’était, il l’avoue lui-même, qu’un « pis-aller très médiocre et tout provisoire » (5) ; car « sa répartition est encore dans un état d’imperfection extrême », « elle comporte des vices sans nombre ». Au même instant, en effet, la Cour des Aides, non contente de réclamer le retour à la fixité de son produit total, conforme aux engagements royaux de 1763 qu’avait cessé de respecter Terray, se répandait en énergiques remontrances contre l’arbitraire de ses « préposés » : « il occasionnait plus de frais, plus de despotisme, et plus d’injustices de tous les genres qu’aucune espèce de répar tition » (6). On sait, écrira plus tard Dupont, que la * pro-123456
(
(1) (2) (3) (4) (5) (6) p. 48.
D., Mem. Municip. (Œ. 7\, t. II, p. 542-544). Vide, infra , V. Ibid. Cf. Mouv. Phy ., I, p. 469. B., Profit du Peuple (Nlles Éph ., 1775, n° 4, p. 58). T., Mém. au Roi, janvier 1776 (Œ . T., t. II, p. 240). Rép. au garde des sceaux, op. cil., p. 280. D., Mém. Turgot, IIe Partie,
72
la p h y s i o c r a t i e s o u s
le m in ist è re
DE TURGOT
portion de cet impôt avec le revenu des terres n’est que nomi■ riale. Les petites propriétés sont taxées à la rigueur ; aucune des grandes ne l’est à son véritable taux... ce qui est visible ment contraire à toute justice et à toute saine politique »(l· Le moment décisif semblait donc venu pour les Phyeio crates de publier à nouveau, non plus seulement « en raasw [comme en 1760], mais avec quelque détail, puisque mainte nant on pouvait écrire » (2), leur plan fiscal définitif. Tel est l’objet du Supplément donné par Mirabeau, quinze ans après, à sa Théorie de VImpôt, Le projet d’impôt territorial unique que l’École présente donc avec un renouveau d’insistance comporte un « moyen d’estimation légal, éminemment simple », fondé sur la généralisation de raffermage. < Oc afferme [déjà] des vignobles aux portes des villes qui 1« consomment, j ’en ai d’affermés auprès de Marseille ; el l’impôt unique une fois établi selon l’ordre, on les afferme« partout. Il en est de même dee vergers, des potagers, des ruches, des bateaux fixés sur les rivières, et servant, commet la Chine, de domicile entouré d’accints productifs quoique basés sur la planche et sur l’eau ; tout — dis-je — même ur pot à œillet, est matière de revenu, sitôt qu’il renferme un fonc productif... Partout il y aura des baux, et c’est sur le pied des baux les plus solides de chaque genre en chaque canton qu< l’impôt de tout le reste sera porté. Les pots-de-vin disparaî tront d’eux-mêmes, à cause de la publicité des opérations, deh bonne foi nouvelle du fisc, et enfin de la prospérité générale (3).: La perception s’accomplira de même très simplemenl t avec le concours du peuple rural » lui-même (4). « J ’assembl» les Syndics des Propriétaires de chaque province, élus pai cantons, et leur attribue la fonction de répartir et de lever k part du fisc dans le territoire dont ils sont députés. Je Ii fais, parce que la Nature l’a fait, et qu’elle est un guide inf&il lible vers le bon Ordre. Rien n ’est plus analogue à l’esprit d< famille, qui est le véritable esprit national, et le seul qui soi conforme à l’Ordre naturel (5). » Quant à l’universalité d., Mém. Turgot, II· P artie, p. 48. (2) Supp. Th, lm p,, p. 40. (3) M ., Supp. Th. lm p., p. 224-227. (4) Ibid., p. 40. (5) Ibid., p. 230 et 233-234. Il ne s’ag it pas de l’ancien esprit de faraift de caractère féodal, que le m arquis a v a it exclu du nouvel ordre politiqu (cf. 1, p. 5) ; mais, dans l’ordre fiscal, de la bonne entente entre adminh tr a teure e t adm inistrés, fraternellem ent solidaires.
LA P R O D U C T I V I T É EX CL U SIV E DU SOL ET DES E AUX
73
cet impôt unique, elle va de soi, le marquis l’avait toujours acceptée, réclamée : « Toutes les prétendues franchises territoriales tomberont d’elles-mêmes. » Tel est le programme strict de l’École, formulé par celui qui est le plus autorisé de ses membres, et après la mort du fondateur, son principal chef. Mais Dupont et Turgot, travaillant ensemble au ministère à la rédaction de leur Mémoire sur les Municipalités, doivent prévenir immédiate ment certaines objections, désarmer d’avance certaines oppo sitions. Ils rééditent donc avec force la thèse de la retombée universelle et avec surcharge des impôts quelconques sur les propriétaires fonciers ; c’est le moyen d’obtenir de ceux-ci une franche adhésion à l’application effective des principes d'uniquité comme d'universalité. « Si les droits sur les cuirs, sur les boucheries, sur le commerce des bestiaux, enlèvent une partie du prix que devraient naturellement tirer les vendeurs de bœufs et de vaches... et par conséquent le revenu des prairies, le dommage en retombe évidemment sur les nobles et sur les ecclésiastiques, comme sur le reste des pos sesseurs de prés. Il retombe même presque en entier sur les deux classes privilégiées, attendu qu’elles se sont réservé la plus grande part des prés, comme le bien le plus facile à faire valoir, et que plus des 4/5 de ceux-ci leur appartiennent. — Si les vins pareillement sont soumis à des droits d’entrée dans les villes, à des droits de détail, et à une inquisition sévère et dispendieuse chez les débitants, on ne s’informe pas pour cela sur quelles terres ils ont été recueillis, et ceux qui proviennent des terres' épiscopales ou des duchés-pairies les acquittent comme ceux du dernier vigneron... (1). » t II en est de même de toutes les autres impositions indi rectes », poursuit le Mémoire, dont le ton devient plus véhé ment : « Et c’est une chose si honteuse et si odieuse que de se targuer de sa dignité pour refuser secours et service à la patrie... qu’il faut peut-être s’abstenir de blâmer ceux qui, n’osant lutter contre les prétentions orgueilleuses et avides de la noblesse et du clergé, ont imaginé de les éluder ainsi. » Finalement, en raison des faux-frais et des répercussions multiples, « la noblesse et le clergé souffrent infiniment plus1 (1) Ibid., p. 205. Cf. B. : « Comment pourrait-nn soulager la Nation du poids des impôts, et en même tem ps enrichir le Trésor Royal ? — En trou v ant un moyen praticable de transform er successivement et dans l’ordre convenable tous les impôts indirects en une perception directe des revenus du Roi. » Êph., 1775, n° 4, p. 57.
74
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS LE M IN IS T E R E D E TURGOT
par la diminution de leurs revenus qui en résulte, qu’ils ne l’auraient tait par une contribution régulière et propor tionnée à leurs richesses, si les dépenses, les jouissances, le travail, le commerce, l’agriculture fussent restés libres et florissants » (1). En attendant toutefois l'effet de ces considérations et objurgations, comme il est « dans le caractère du Roi de vou loir arriver à ce terme heureux par des faveurs faites au peuple et non par des atteintes aux exemptions actuelles de la noblesse et du clergé », force est bien de distinguer, dans chaque Municipalité villageoise, « une petite assemblée, où Ton ne traiterait que de la répartition des impositions aux quelles le Tiers-État était seul soumis [p. ex. la taille et ses accessoires] ; une moyenne, pour celles que la noblesse paie ainsi que lui [p. ex. le Vingtième] ; une grande, pour les affaires ou répartitions communes à tous ceux, de quelque état qu’ils soient, qui ont des biens ou des revenue sur la paroisse [p. ex. travaux publics, police des pauvres] ». (2)· De même, en attendant que le nouvel impôt territorial ait atteint son plein rendement et que la prospérité de la nouvelle agriculture ait assuré le relèvement des finances royales, le Mémoire prévoyait une taxe secondaire de complé ment. « Je penserais », continue Dupont faisant parier Turgot, « qu’on doit être soumis aux contributions, non seulement en raison des revenus effectifs qu’on possède, mais encore en raison des terres employées en jardins de décoration »: et le caractère moral et social de cette sorte de taxe sur la ΙηΤΓί ftfltfûer. fort hétérodoxe aux yeux Je la pure Physiocratie, apparaît bien dans ce qui suit : « Ces jardins seraient estimés sur le pied du plus haut revenu que la même étendue de terre pourrait donner dans les meilleurs fonds de la paroisse... Dans le cas où il faut fournir aux besoins de l’É tat en soulageant néanmoins le peuple, il parait que la contribution extraordinaire sur les riches, lorsqu’elle aurait une base sûre de répartition, serait ce qu’on peut employer de moins mauvais... D’aiUeurs. le propriétaire fastueux sacrifie à son plaisir une famille, que, en être sensible et en patriote, il devrait à l’humanité et à l’É tat ; c’ést une légère peine pour une telle faute... (3). » La nouvelle subvention (1) Œ . T ., M ém , M unicipalités, K nies, L· 1, p . 250-261. (2) /6M ., p. 261-262. (3) M émoire, K nies, L I, p . 263-26ς.
LA P R O D U C T IV IT E
E X C LU S IV E
DU
SOL E T D E S E A U X
75
territoriale, ainsi aménagée, devait remplacer les 2/20 et les 4 sols par livre du premier dès octobre 1775, si l’exécution de ce grand projet n ’avait été suspendue — et pratiquement abandonnée — du fait de la guerre des farines (1). Chose assez curieuse, la réforme de l’impôt foncier obte nait d’un demi-adversaire comme Condillac plus qu’une adhésion de principe : « En Angleterre, écrit-il, les impôts ne doivent être mis que sur le produit net des terres, et on éva luait ce produit de la manière la plus favorable aux cultiva teurs. Un fermier savait ce qu’il devait payer ; assuré qu’on ne lui demanderait jamais au delà, il vivait dans l’aisance ; on lui laissait toutes les avances nécessaires pour cultiver ses champs et les améliorer ; et jamais l’impôt, sous quelque prétexte que ce fût. ne pouvait être pris sur ces avances (2). » La bataille finale, bataille de doctrines, allait se livrer sur le taxe en remplacement de la corvée des routes. En janvier 1776, à la veille de la grande décision, Turgot concluait que l’axiome des Économistes relatif à l’universelle incidence des impôts sur la propriété foncière était désormais «l’opinion de toutes les personnes ayant réfléchi » (3) ; tout homme, à ses yeux, « qui croyait de bonne foi l’impôt territorial impraticable ou injuste, ne pouvait avoir de véritables lumières en admi nistration » (4). Seulement ici, le ministre ajoute des observations qui, échappant à la rigueur de la théorie, en compromettant même l’équilibre logique, l’élargissaient singulièrement au contact des réalités sociales : « La corvée est un impôt injuste qui écrase encore plus les non-propriétaires ; de ce que le proprié taire reçoit le coup de la ruine de son fermier, il ne s’ensuit pas que le fermier ne soit encore plus malheureux que son maître lui-même ; quand un cheval de poste tombe excédé de fatigue, le cavalier tombe aussi, mais le cheval est encore plus à plaindre. Les propriétaires font vivre par leur dépense les hommes qui n’ont que leurs bras, mais les pro priétaires jouissent pour leiir argent de toutes les commo dités de la v ie.. Le journalier travaille et achète à force de sueurs la plus étroite subsistance ; mais quand on le force de travailler pour rien, on lui ôte même la ressource1234 (1) (2) (3) (4)
D., Mém. Turgot, II« Partie, p. 48. Comm. et Gouv., p. 437. Œ. 7\, t. II, p. 260. Condorcet, Vie de Turgot, note, p. 172 (Œ., t. V).
76
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS LE M I N I S T È R E D E TURGOT
de subsister de son travail par la dépense du riche (1). » Dans le préambule du grand Édit de février, Turgot y revient avec plus de franchise encore, et non sans témérité. « Le poids de la corvée ne tombe et ne peut tomber que sur la portion la plus pauvre des sujets, sur ceux qui n’ont de propriété que leurs bras et leur industrie, sur les cultivateurs et sur les fermiers. Les propriétaires, presque tous privilégiés, en sont exempts ou n’y contribuent que très peu. Cependant c’est aux propriétaires que les chemins publics sont utiles, par la valeur que les communications multipliées donnent aux productions de leurs terres. Ce ne sont ni les cultivateurs actuels, ni les journaliers qu’on y fait travailler, qui en pro fitent. Les successeurs des fermiers actuels paieront aux pro priétaires cette augmentation de valeur en augmentation de loyer. La classe des journaliers y gagnera peut-être un jour une augmentation de salaires proportionnée à la plus grande valeur des denrées, elle y gagnera de participer à l’augmenta tion générale de l’aisance publique ; mais la seule classe des propriétaires recevra une augmentation de richesse prompte et immédiate, et cette richesse nouvelle ne se répandra dans le peuple qu.’autant que ce peuple l’achètera encore par un nouveau travail. C’est donc la classe des propriétaires qui recueille le fruit de la confection des chemins, c’est elle qui doit seule en faire l’avance, puisqu’elle seule en retire les intérêts. Comment pourrait-il être juste d’y faire contribuer ceux qui n’ont rien à eux ; de les forcer à donner leur temps et leur travail sans salaire ; de leur enlever la seule ressource qu’ils aient contre la misère et la faim, pour les faire travailler au profit de citoyens plus riches qu’eux ! (2) » Après ces déclarations hardies, de résonance égalitaire, le philosophe économiste change encore de ton, et offre à cette même classe dont il pressent la résistance, à titre de compensation surérogatoire, les avantages, les redressements de tort que lui apporte la partie commerciale — déjà en partie12 (1) Ibid.y p. 256. Trudaine reprochait presque à Turgot d'y insister « La corvée est par elle-même injuste, elle est fort onéreuse aux peuples principalement aux pauvres ; les pauvres ne font pas usage des chemins ieur principal but est, en favorisant le débouché des denrées, d’augmente! le produit des terres au profit des propriétaires. Ils y ont donc de l'intérêt c'est à eux à les payer. Il me semble que ces vérités sont à la portée de tou le monde, et elles ne vous seront contestées par personne... » Arch. Trav Publics, Mss. cité par Choulier, Les Trudaine, p. 27-28. (2) Cf. quelques lignes plus loin : « Il n'est pas juste de demander ui impôt aux pauvres pour en faire profiter les riches. »
LA P R O D U C T I V I T É
E X C L U S IV E DU
SOL ET
DES
EAUX
77
réalisée — de son programme d’ensemble. « Une erreur tout opposée a souvent engagé l’Administration è sacrifier les droits des propriétaires au désir malentendu de soulager la partie pauvre des sujets, en assujettissant par des lois prohi bitives les premiers à livrer leur propre denrée au-dessous de sa véritable valeur. Ainsi, d’un côté, Ton commettait une injustice contre tous les propriétaires pour procurer aux simples manouvriers du pain à bas prix ; et de l’autre, on enlevait à ces malheureux le fruit légitime de leurs sueurs et de leur travail... C’était blesser également les propriétés et les libertés des différentes classes de sujets. » Enfin, la contribution nouvelle « ayant pour objet une dépense utile à tous les propriétaires, nous voulons que tous les propriétaires, privilégiés et non privilégiés, y concourent, ainsi qu’il est d’usage pour toutes les charges locales ; et pour cette raison nous n’entendons pas même que les terres de notre Domaine en soient exemptées, ni en nos mains, ni quand elles en seront sorties, à quelque titre que ce soit ». En vertu donc de l’article 2 de l’Édit, y seront assujettis « tous les proprié taires de biens-fonds ou de droits réels sujets aux vingtièmes [ce qui impliquait l’exemption des terres du clergé] (1), sur lesquelles la répartition en sera faite à proportion de leur contribution aux rôles de cette imposition ». L’Édit publié ne fut envoyé, en dehors du Parlement de Paris, qu’à quelques Parlements des provinces ; Toulouse, Pau, Rouen et Metz. Le premier seul (saisi le 21 avril) ordonne l’enregistrement immédiat dès le 24, en demandant même que les terres du clergé fussent soumises à l’impôt de rempla cement comme l’avait primitivement voulu le ministre lui-même et comme il ressortait de l’esprit et de la lettre du préambule. La corvée n ’avait d’ailleurs pas dans le Languedoc le même caractère que dans l’ensemble du royaume. Le Parlement de Pau remontra qu’il existait dans le Béarn un système particulier qui donnait satisfaction (2). Le Parlement de Rouen (27 juin) tout en réclamant lui aussi contre cette nouvelle immunité accordée aux biens de main-morte, refuse l’enregistrement, mais en se prononçant surtout, ainsi que celui de Metz (3 juin) — nous le verrons plus tard — contre12 (1) Cette exemption avait été arrachée au contrôleur général par Miromesnil, et surtout Maurepas. Cf. Mém. au Roi, janv. 1776 (Œ . T .9 t. II, p. 240, 241 et 280). (2) Cf. Ducrocq, p. 27 et Vignon, t. III, p. 99-94.
78
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS LE M I N I S T È R E DE TURGOT
l’immunité bien plus nouvelle et bien plus étrange accordée aux commerçants et aux financiers (1). Le Parlement de Paris avait fondé sa protestation principalement sur ce même motif, dans ses Remontrances arrêtées le 9 mai et présentées le 19 (2). Les lettres-patentes du 22 décembre 1875, relatives au pays de Gex, comportant cette même immunité, n’avaient été enregistrées par le Parlement de Dijon, le 5 février 1776, qu’après une vive protestation à ce même sujet (3). Ainsi, avant même que Turgot fût renvoyé (12 mai) ou dès le lende main de sa chute, la campagne contre l’impôt territorial unique s’était puissamment développée. Le nouveau contrôleur général Clugny avait donc beau jeu pour détruire la timide amorce de révolution fiscale des Physiocrates. Des deux principes sur lesquels elle se fondait : celui de l’égalité des Ordres devant l’impôt — et celui de l’assiette exclusive sur la classe des propriétaires fonciers—ce n’était pas tant, semblait-il, le premier que le second, qui était la cause avouée de ce retentissant rejet — d’autant plue grave ainsi pour la nouvelle École. C’était le second — bien plus que le premier — qu’invoquaient les cinq intendants de Paris, de Lorraine, de Grenoble, de Moulins et d’Auch, dans leurs réponses à la consultation ministérielle du 16 juin 1776 (4). Nous verrons bientôt ce que fut la Déclaration finale du 11 août (5). Les Économistes durent se contenter, bien pauvre ment, de la demi-réforme de- Rertier, confirmée par cette même Déclaration ; et de la recommandation inscrite dans VInstruction aux Contrôleurs du 25 août, de défalquer, dans l’établissement du vingtième, les frais de culture, jusqu’à concurrence de la moitié du produit brut (6).123456 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
a . Vignon, p. 94-95. Cf. Remontrance*s, t. III, p. 379-382. a . Œ. Γ., t. II, p. 414. Cf. Vignon, p. 98. V. infra, op. II, et Marion, Impôt sur revenu, p. 72-73. B.-N. Manuscrit n° 2, 536. Fonds Joly de Fleury.
C h a p it r e III
LE PROGRAMME COMMERCIAL I. — Le Bon Prix des productions agricoles Le « bon prix » des grains a cessé de constituer pour l’École l’article presque exclusif de son programme commercial ; il en demeure cependant le principal. « Le Roi sait bien, décla rent les Laboureuses de Le Trosne, que le blé ne vient pas comme les champignons ; qu’il coûte bien 12 francs le setier à faire venir ; de sorte que si on ne le vendait que 12 francs, il n’y aurait rien pour lui ni pour tout le monde, ni pour ceux à qui appartient la terre, qui n’ont rien à voir sur la part du laboureur... Aussi veut-il que le laboureur puisse vendre son blé là où il veut, et quand il veut, sans que personne y contredise (I). » Le premier point est donc que cette production majeure soit affranchie de la servitude des marchés, qui dérange la culture et détourne pour des transports improductifs les atte lages du fermier ; et Condorcet d’ajouter ce commentaire psychologique : « Les cultivateurs, accoutumés à une vie dure et frugale, ont peu de besoins, et par conséquent peu d’activité. La moindre gêne les dégoûte, la moindre discussion les fatigue. Opprimés toutes les fois qu’ils ont des intérêts à démêler avec une autre classe de la société, les mots de vexation et de règlement sont synonymes pour eux ; et tant que le commerce des grains serait gêné, ils demanderont à la terre de quoi vivre, et non de quoi s’enrichir (2). » Le seigneur de Ferney plaide la même cause, en merveilleux avocat. « Nous gémissions depuis quelques années sous la nécessité qui nous était imposée de porter notre blé au marché de la chétive habitation qu’on nomme Gex. De 20 villages, les seigneurs,12 (1) P. 10-11.
(2) Lettres Comm. grains, p. 10.
80
la
p h y s io c r a t ie
so u s
l e
m in is t è r e
DE
TURGOT
les curée, les laboureurs, les artisans étaient forcés d’aller ou d’envoyer à grands frais à cette capitale : si on vendait chez soi à un voisin un setier de blé, on était condamné à une amende de 500 livres ; et le blé, la voiture et les chevaux étaient saisis au profit de ceux qui venaient exercer cette rapine avec une bandoulière. Tout seigneur qui, dane son village, donnait du froment ou de l’avoine à ses vassaux était exposé à se voir punir comme un criminel : de sorte qu’il fallait que ce seigneur envoyât ce blé à 4 lieues au marché, et que le vassal fit 4 lieues pour le chercher, et 4 lieues pour le rapporter à sa porte, où il l’aurait eu sans frais et sans peine ; on sent combien une telle vexation révolte le bon sens, la justice et la nature. Je ne parle pas des autres abus attachés à cette effroyable police (1)... Je prends la liberté de dire à M. Necker que, ni en Hollande, ni en Angleterre, ni à Rome, ni à Genève, ni en Suisse, ni à Venise, les citoyens ne sont obligés d’acheter leur nourriture au marché... La loi générale de la police de tous les peuples est de se procurer le nécessaire où l’on veut... une loi contraire ne serait admissible qu’en temps de peste, ou dans une ville assiégée (2). » Le préambule de l’Arrêt libérateur du 13 septembre 1774 s’intéresse plus particulièrement au sort des négociants, qui sont malgré tout les agents nécessaires de la plupart des libres transactione locales : « L’obligation imposée à ceux qui veulent entreprendre ce commerce de se faire inscrire sur les registres de la police flétrit et décourage les gens par la défiance qu’une telle précaution suppose de la part du gouvernement ; par l’appui qu’elle donne aux soupçons injustes du peuple; surtout parce qu’elle tend à mettre continuellement la matière de ce commerce, et par conséquent la fortune de ceux qui s’y livrent, sous la main d’une autorité qui semble e’être réservé le droit de les ruiner et de les déshonorer arbitraire ment. » — « ... Je vois avec surprise, déclamera l’Empereur Albert I e* : Que le commerce est encore trop gêné ; Tout ce profit doit être abandonné A l’homme actif dont l’heureuse industrie Fait circuler le sang de la patrie (3).123 (1) Diatribe à Vauteur dee Êphéméridee. (2) Petit Écrit sur VArrêt du 13 septembre 1774. Cf. Tlfaut, Réflexions, p. 1-2. (3) Acte III, se 2., p. 81.
LE
PROGRAMME
81
C O M M ER C IA L
« Le Roi doit donc à ses peuples, reprend le ministre légis lateur, d’honorer, de protéger, d’encourager d’une manière spéciale le commerce des grains, comme le plus nécessaire de tous... La défense de vendre ailleurs que dans les marchés surcharge, d’autre part, sans aucune utilité, les achats et les ventes des droits de hallage, magasinage et autres également nuisibles au laboureur qui produit et au peuple qui consomme... Ces considérations mûrement pesées ont déterminé S. M. à remettre en vigueur les principes établis par la Déclaration du 25 mai 1763 (1), et à délivrer ce commerce des formalités et des gênes auxquelles l’avait depuis assujetti... l’Arrêt du 23 décembre 1770 (2). » C’était pour les Économistes une éclatante revanche. « 11 paraît enfin, s’écrie Baudeau, l’Arrêt qui libère les grains dans l’intérieur... Il est très bien fait ; il est reçu par le public avec beaucoup d’applaudissements. Les ennemis du bon Turgot sont un peu sots de la sagesse des principes qu’il explique de la manière la plus claire... Au reste, je crois que le ministre a bien pris les mesures pour empêcher la loi de manquer son effet (3). » La victoire était cependant moins complète que l’abbé pouvait le croire. Sans doute, les règle ments de la Ville et Police de Paris sont « formellement abrogés, et c’est un coup de partie. Paris sacrifiait tout le royaume à son approvisionnement prétendu, c’est-à-dire dans le fait aux droits des officiers de la Halle ». Mais les lettres-patentes correspondantes du 2 novembre suivant annonçaient l’inten tion du gouvernement « de statuer incessamment par d’autres sur ces règlements (4) ». L’abrogation effective n’eut lieu que par la Déclaration de février 1776, qui ne fut enregistrée qu’en lit de justice, on peut bien dire in extremis, le 12 mars 1776 (5). Restaient, d’ailleurs, les droits de marché seigneuriaux, tels ceux des mesureurs de grains. L’Arrêt du 10 août 1768 en avait bien prescrit la suppression par remboursement ; mais la liquidation avait traîné et les droits continué d’être perçus. Par Arrêt du 13 août 1775, Turgot ordonnait la reprise de l’opération ; mais il y travailla jusque dans les dernières semaines de son ministère sans parvenir à l’accélérer sensible(1) (2) (3) (4) (5)
Cf. Mouv. ΡΛ., II, 208. Voir art. I et II de l’Arrêt du 13 septembre 1774. Chronique secrète, 21 et 22 septembre 1774. Œ. T.t t. II, p. 177-178. Cf. op. cil., p. 213-223.
G. W E ULEH SSE
6
82
LA P H Y S I O C R A T I E
SOUS
LE
M IN IST ÈR E
D E TURGOT
ment. Il avait pourtant spécifié que le paiement de ces dre était « au préjudice des consommateurs dans les temps cherté, et des laboureurs dans les temps d’abondance » (1). Les octrois municipaux frappant les grains se distinguai« mal des droits de marché ; ils prêtaient aux mêmes critiqi et auraient appelé la même réforme. Reprenant à ce su les principes qu’il avait déjà formulés dans sa lettre à Ten du 9 novembre 1772, Turgot signalait dans sa Circulaires intendants du 28 septembre 1774 que « presque tous les bo geois des villes auxquelles on a cru pouvoir accorder < octrois ont trouvé le moyen de s’affranchir de la contribut aux dépenses communes, pour la faire supporter aux moind habitants, aux petits marchands, et aux propriétaires ου fl pauvres des campagnes... ». Il fallait au moins « vérifier li perception et la régler d’une manière moins onéreuse fl ruraux » (2). L’Arrêt du 13 septembre proclamait avec plus d’éc que jamais la liberté de circulation inter-provinciale. « C' l’unique moyen de prévenir, autant qu’il est possible, inégalités excessives dans les prix, et d’empêcher que r n’altère le prix juste et naturel que doivent avoir les subi tances suivant là variation des saisons et l’étendue des besoin La liberté de cette communication est nécessaire à ceux i manquent de la denrée, puisque, si elle cessait un mome ils seraient réduits à périr. Elle est nécessaire à ceux i possèdent le superflu, puisque sans elle le superflu n’aui aucune valeur, et que les propriétaires ainsi que les labourei avec plus de grains qu’il ne leur en faut pour se nour seraient dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins, à le dépenses de toute espèce, et aux avances de la culture, i est salutaire pour tous puisque ceux qui dans un momi se refuseraient à partager ce qu’ils ont avec ceux qui n’ont p se priveraient du droit d’exiger les mêmes secours lorsq leur tour ils éprouveraient les mêmes besoins... De ce libre et mutuelle intercommunication l’abolition de la serviti des marchés était d’ailleurs la condition préalable; car n ’était pas possible d’y faire aucun achat considérable & y faire hausser extraordinairement les prix et y produire vide subit, qui, répandant l’alarme, soulève les esprits12 (1) Cf. Œ. T., t. Il, p. 205. Cf. Arrêts des 8 février, 24 a et 10 mai 1776. (2) (E. Γ., t. II, p. 434-437. Cf. p. 197-198.
l e
p r o g r a m m e
c o m m e r c ia l
83
peuple. En vain ΓArrêt du 23 décembre 1770 avait-il prétendu maintenir la liberté du transport de province à province ; il y mettait un obstacle tellement invincible que depuis cette époque le commerce a perdu toute activité ». Sous les coups d’une si frappante logique les adversaires de la réforme durent, avec un embarras évident et une réti cence secrète, désarmer pour le moment. « J ’ai lu l’édit, écrit Galiani ; je n’ai rien trouvé qui contrariât en rien la moindre phrase de mes Dialogues. J ’ai été le plus ardent prédicateur de la liberté et de la circulation intérieure. J ’ai dit que l’expor tation devait y être subordonnée. Pourquoi donc dit-on chez M. Turgot que mon livre est dangereux ?... (1). J ’ai toujours eu, croyait-il devoir ajouter, la plus haute estime pour Turgot : pourquoi se faire économiste? Que diable allait-il faire dans cette galère (2) ? » Huit ans après l’événement, avec le recul nécessaire, Dupont apporte à ces assertions gênées la juste contrepartie : « M. l’abbé Galiani et les écrivains qui ont adopté ses principes, ou renouvelé son système, n’ont porté leurs déclamations que contre la liberté d’exporter. Et, en effet, on se serait moqué d’eux s’ils eussent prétendu que les habitants d’une province du royaume ne devaient pas être libres de secourir leurs compatriotes d’une autre province... Or, l’Arrêt du 13 septembre a laissé l’exportation aussi interdite qu’elle l’avait été par M. l’abbé Terray. Il ne semble rait donc pas qu’on eût dû faire tant de bruit, ni témoigner tant de véhémence contre cette loi (3). » La liberté de la circulation intérieure, en tout cas, entraîne au bout d’un an celle du cabotage, également supprimé en fait par Terray ; et cela pour des raisons d’ordre nettement physiocratique, quand l’abondance générale revenait et que la menace de surproduction, au moins dans le Languedoc, reparaissait. « Les formalités rigoureuses auxquelles le trans port [par mer] est assujetti, déclarait l’Arrêt du 12 octo bre 1775, réformant celui du 14 janvier 1773, ... peuvent faire rester, au préjudice des propriétaires, les grains dans les provinces où iis seraient surabondants, pendant que d’autres qui auraient des besoins en seraient privés... Tous les ports du royaume doivent également participer à la liberté, qu’ils aient ou non un siège d’amirauté, sans limitation de quantité ;123 (1) Lettre à M. de Bombelles, 29 octobre 1774, éd. Asse, t. II, p. 163-164. (2) A Mme d’Épinay, 3 juin 1775, ibid,, p. 201. (3) D., Mém. Turgot, IIe Partie, p. 11-13.
84
l a p h y s ï o c r a t i e s o u s l e m i n i s t è r e d e tu r o .o t
et les armateurs ne doivent pas être rendus responsables de Teilet du mauvais temps (1). » Un autre obstacle au débit, et par conséquent au bon prix des grains, une autre enfreinte, indirecte mais des pins graves, à la liberté de leur commerce intérieur, résidait dans les récents monopoles d ’É tat plus ou moins ouvertement organisés. Il ne Suffira pas que « tout le monde puisse en vendre et en acheter en liberté » ; il faudra qu’en soit excepté «le Roi lui-même, qui promet bien de ne jamais s’en mêler, car il a bien vu toutes les friponneries qui se sont faites à la suite sur son peuple » (2). Parmi ces monopoleurs attitrés, Baudeau distingue d’abord « les Permissionnaires » permanents, tels que les Munitionnaires des Troupes, ou les Marchands titrés de la Ville de Paris, sans compter les privilégiés d’occasion; puis les « Commissionnaires » qui, non seulement pouvaient seuls [avec les précédents] acheter hors des marchés, ou s'y faire servir par priorité, mais étaient assurés par le Trésor royal d’un droit de commission sur leurs diverses opérations, et mieux encore, d’une indemnité quand elles se soldaient par un déficit ; toutes conditions éminemment propres à décourager le commerce des petits « Blatiers », intermédiaires très économiques entre cultivateurs et citadins, dont la libre concurrence, sans nuire aux seconds, assurait constam ment aux premiers un cours rémunérateur (3). Dupont signale accessoirement « le danger des entreprises d’approvisionne ments auxquelles se livraient en province maints Corps muni cipaux déterminés à perdre eux-mêmes sur leurs fournitures et à faire perdre les négociants sur les leurs » (4). Après avoir rappelé les énormes faux-frais qui grevaient la gestion des entrepôts royaux [défaut d’économie, de soin et même d’honnêteté du personnel] l’Arrêt du 13 septembre précisait ce point, qui pour l’École était capital, que « lorsque le gouvernement se charge de pourvoir à la subsistance des peuples en faisant le commerce des grains, il fait seul ce commerce, parce que, pouvant vendre à perte, aucun négo ciant ne peut sans témérité s’exposer à la concurrence ». L’article 3 fait « très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de se dire chargées de faire de semblables (1) Œ. 7\, t. Il, p. 208-211. (2) L. Γ., LnbourenseSy p. II. (3) B .%N lies É p h 1775, n° 8, p. 116 et Lettres et Mémoires surl'fiM du 13 septembre, p. 48-49 et p. 81. Cf. Afanaselev. (4) D.y Mém. Turgot y II® Partie, p. 60. Cf. Phys.y 71-74.
LE PROGR AM ME COMMERCIAL
85
achats pour Sa Majesté et par ses ordres, se réservant dans le cas de disette de procurer à la partie indigente de ses sujets les secours que les circonstances exigeront ». Au bout d'un an Mirabeau pouvait s'enthousiasmer sur « les premiers actes de souveraineté du nouveau Roi » ; ils portent désormais leur véritable enseigne : la paix, la liberté. Cette liberté sainte est descendue sur nos campagnes ; je vois finir le premier des monopoles contre lequel nous combattîmes si longtemps : sternitur exanimisque tremens. Nous t'offrons cette première victoire, Grand Ordre, objet de nos vœux : E t mes derniers regards verront fu ir les traitants (1)
Le fait est que, dans le Languedoc tout au moins, d’accord avec le Parlement, la liquidation des approvisionnements d'ordonnance s’effectua rapidement et sans incident, par les soins de la Commission des blés qu'avait instituée l’intendant Terray, le propre neveu de l’ancien contrôleur général (2). L’Arrêt de septembre 74, dans son article IV stipulait que « S. M. n'entendait pas statuer, quant à présent, sur la liberté de la vente hors du royaume ». Cet ajournement était « pour des motifs de prudence » renouvelé par l’Arrêt du 14 janvier 1775 (3) ; cependant il ne s'agissait que d'une mesure provisoire, « que S. M. Vvait déjà annoncé devoir cesser, lorsque des circonstances favorables le permet traient » (4). Chose en apparence surprenante, dès le début de cette période d'expectative, le ministre avait cru devoir supprimer les états annuels de récolte institués par Terray en 1773, pour ces deux raisons qu'ils ne pouvaient jamais être exacts, et qu'il serait dangereux d’en tirer des consé quences (5). C’est qu'il préférait, sans doute, à un opportu nisme tâtonnant et à demi aveugle, fondé sur les données de statistiques incertaines ou même truquées, un franc statu quOy en attendant l'heure espérée de rétablir une liberté qui, elle aussi, serait alors franchise complète. Tandis que Bertin, au contraire, qui l’avait « exhorté à mettre dans sa marche12345 (1) M., M. 780, n° 6, Discours de rentrée de 1775, Af*e., p. 39. (2) Cf. Viala, p. 85. (3) Autorisant l’introduction dee grains nationaux dans la Provence en passant par le port de Marseille. Œuvres, t. II,. p. 178* (4) Arrêt du 12 octobre 1775. (5) Lettre à l’intendant de Bordeaux, Esmangard,. 27 septembre 1774. Cf. Foncin, Pièce justif., n° 2.
86
LA PH YSI OCR ATI E SOUS
LE M I N I S T È R E DE TURCOT
toute la lenteur de la prudence » restait fidèle à la clause de sauvegarde d’un taux prohibitif qu’il eût voulu même placer un peu plus bas qu’en 1764 ; « on l’eût taxé alors è 25 livres [au lieu de 30] ce qui était absolument égal aux négociants et au commerce, je vous assure que tout était dit, et pour toujours ; et qu’on l’aurait ensuite porté plus haut, plus bas, comme on aurait voulu, .sans que le peuple y eût pris garde » (1). Quelle était à cet égard l’attitude de l’École ? A cette date la libre exportation pouvait n ’être plus, à ses yeux, qu’un « épouvantail à chenevière pour le peuple » (2). L’expor tation effective serait beaucoup plus réduite qu'une dizaine d’années auparavant ; « nous avons même trop peu de ble depuis 10 ans, et vous en êtes d’accord », déclare Baudeau à Necker dans ses Éclaircissements. Dans ce domaine comme dans les autres, « le commerce extérieur n ’est qu’un supplément à l’autre, un pis-aller dans toute la force du terme i 3 Cependant la liberté de cette exportation demeurait néces saire, ne fût-ce que pour maintenir un prix moyen et uni forme » (4) et corriger la « variation dans le produit annuel des terres » (5). « Sans doute tel Agriculteur de province se féliciterait de voir la France en état de ti|pr de ses blés les avantages qu’eD retire la Pologne, qui n’a presque que cette source de subsis tance (6). » E t c’est bien une exportation effective considérable que réclame la Société d ’agriculture d’Auch quand elle « représente que cette généralité produit dans les années ordinaires beaucoup plus de grains qu’il ne lui en faut pour sa consommation et même pour prévenir une disette, que les grains sont son unique richesse et que l’exportation est le seul moyen de se défaire du superflu » (7). La Déclaration du 10 février 1776 rétablit dans le ressort du Parlement de Toulouse et du Conseil du Roussillon les dispositions de l’Édit de juillet 1764 concernant l’expédition des grains à l’extérieur. Mais les circonstances générales ne sont plus les mêmes qu'à (
),
(1) Lettre de Bertin à T., 1774 (F» 265). Cf. Œ. T.91. IV, p. 200. (2) B., Chronique secrète, 21 septembre 1774. (3) P. 206-209. (4) D.y Mém. Turgot, II · Partie, p. 11-13. (5) Bœsnier, p. 135. (6) Lettre, p. 14. (7) Cf. A. N.-H. 1511, pièce 137, 5 mars 1775, et H. 1508, pièce 4. 2 janvier 1776.
LE PROGRAMME COMMERCIAL
87
cette époque, et il s'agit d'une mesure d’ordre strictement régional et temporaire, comportant d’ailleurs des restrictions que la doctrine physiocratique n’admettait guère, telles que l’interdiction des vaisseaux étrangers et le jeu automatique d’un taux prohibitif, contre lesquelles le Parlement intéressé protesta lui aussi en vain (24 avril). Cette sortie locale des blés fut en fait suspendue dès l’année suivante (1). De même pour la Provence (2). A l’égard des productions du sol national autres que les céréales, le problème général du bon prix par la liberté du commerce se posait dans des conditions plus ou moins différentes. Le grand fléau des vignobles était, selon l’expression de Mirabeau, « la dévastation des Aides » (3). Double est la « disproportionnalité » de l’impôt sur les vins : 1° suivant les années ; si le vigneron récolte 20 pièces au lieu de 10, l’impôt double, et cependant le prix ayant à peu près baissé de moitié, son revenu est identique, et il a plus de frais ordinaires ; le remède serait précisément, ici encore, l’égalisation des cours par la continuité du débouché ; 2° suivant la qualité du pro duit : « Un arpent produisant beaucoup de gros vin paie davantage qu’un autre produisant peu de vin excellent, quoique le revenu soit le même ; d’où l’abandon des terrains médiocres (4). » « La France produirait plus de vin sans les droits de consommation (5). » Par son Édit quasi testamentaire d’avril 1776, Turgot garantit aux viticulteurs français « la liberté de faire circuler leurs vins dans tout le royaume, de les emmagasiner, de les vendre en tous lieux et en tout temps, et de les exporter en toute saison, par tous les ports, nonobstant tous privilèges particuliers et locaux. — La liberté seule assurera aux culti vateurs la juste récompense de leurs travaux et aux proprié taires un revenu fixe... Les vins sont la richesse du royaume ; iis sont presque l’unique ressource de plusieurs provinces qui n’ont pas d’autre moyen d’échange pour se fournir de grains, et ils procurent la subsistance journalière à une population immense... ; ils forment pour le royaume l’objet12345 (1) (2) (3) (4) (5)
Cf. Viala, p. 92-93. Cf. Des Cilleuls, Rev. gin. administ., t. III, 1897, p. 145. Af., Supp. Th. Impôts p. 185. Bœsnier, Gouv. Écon.y p. 374-375 et 378-80. Cour des Aides, 6 mai 1775.
88
LA P I I Y S I O C H A T I E S O U S
LE
M IN IST È R E
D E TURGOT
d’exportation Le plus étendu et le plus sûr » (1). Sont abolis b tyranniques privilèges de la sénéchaussée de Bordeaux. «Le Languedoc, le Périgord, l’Agenais, le Quercy et toutes les provinces traversées par cette multitude de rivières navi gables qui se réunissent sous les murs de la ville, non seulement ne pouvaient vendre leurs vins à ses habitants, mais pas même user librement de cette voie que la nature leur offrait pour communiquer avec toutes les nations commerçantes »; et cela jusqu’au 1er décembre et même jusqu’à la Noël... « Ainsi les propriétaires de vins du haut pays ne pouvaient profiter de la saison la plus avantageuse pendant laquelle les négociants étrangers sont forcés de presser leurs achats pour approvi sionner les nations du Nord avant que les glaces en eussent fermé les ports... L’exécution de cet assemblage de réglementa, combinés avec le plus grand art pour assurer aux bourgeois de Bordeaux, propriétaires des vignobles de la sénéchaussée, l’avantage de vendre leur vin plus cher au préjudice des propriétaires de tous les autres vignobles des provinces méri dionales... s’appelait dans cette ville la police des vins. De même à Marseille, défense aux navires de quitter le port avec, d’autre vin que celui acheté dans la ville... Ainsi les riches propriétaires, toujours dominants dans les Assemblées [muni cipales] s’occupaient du soin de vendre seuls à leurs conci toyens les denrées que produisaient leurs champs et d’écarter toute autre concurrence... Αφ&ί les propriétaires et les culti vateurs étrangers au territoire privilégié sont injustement privés du droit le plus essentiel de la propriété... C’est l’inté rêt du royaume entier que nous avons à peser, ce sont les intérêts et les droits de tous les sujets, comme vendeurs et comme acheteurs ; c’est l’intérêt du corps de l’État, dont la richesse dépend du débit de plus étendu des produits de la terre et de l’industrie, et de l’augmentation des revenus qui en est la suite. » L’Édit fut enregistré sans difficulté à Toulouse, à Grenoble et en Roussillon ; il ne le fut que plus péniblement à Aix et bien entendu à Bordeaux. « Il augmentera peut-être, écrit postérieurement Dupont, d’un million d'âmes la population des provinces auxquelles il a été accordé ; on peut spéculer sans crainte d’erreur que, la paix établie, il assurera è la nation un commerce de plus de 60 millions d’exportation annuelle, et un tel commerce ne se fait pas au dehors sans (1) Œ. T., t. Il, p. 344-357.
LE PROGR AM ME COMMERCIAL
89
occasionner au dedans des travaux et des profits au moins doubles de sa valeur (1). » Les expéditions pour l’intérieur se multiplièrent vers Lyon et Paris par la voie du Rhône ; et les exportations, par Sète, vers l’Italie et vers l’Angleterre. La production s’accrut à tel point que dès 1780 apparaîtra un nouveau risque de mévente ; ainsi se dessinaient déjà, pour toute une partie de la France, les destinées prochaines. Mirabeau lui-même, qui prétendait en 1776 que la population vigneronne avait par endroits diminué des 2/3, devait avouer qu’elle atteignait encore « un nombre prodigieux » (2). En faveur des eaux-de-vie de marc, l’abbé Rozier récla mait dans les Nouvelles Êphémérides la liberté de fabrication : « Laissons donc faire le cultivateur ; il choisira sans se tromper ce qui augmentera son bien-être, et sous quelque point de vue qu’on envisage cette distillation, elle ne peut que lui être avantageuse, tandis que la prohibition lui occasionne une perte réelle, sans parler de celle qui résulte pour l’État (3). » La Société d’agriculture de Rouen sollicitant de son côté la libre exportation des eaux-de-vie de cidre et de poire, affran chie du monopole clandestin des Fermiers des Aides (4). D’après Baudeau, les restrictions imposées par la Régie aux plantations de tabac entraînaient une perte sèche de revenu net qu’il évaluait à 12 millions (5). — En faveur de la garance nationale, Turgot stipule, non seulement la franchise de cir culation, « y compris celle du ciÿ de l’île de Corse », mais un véritable droit protecteur de 25 sous par quintal (6). L’élevage du gros bétail n’était pas l’objet d’une sollicitude moins vive. La Caisse de Poissy était « très onéreuse aux provinces nourricières de la Ville de Paris » (7). « Les marchands forains, les propriétaires ou fermiers d’herbages, les nourrisseurs, la reconnaissent pour ruineuse et vexatoire, et ils en citeront pour preuve la retraite des marchands, la perte des fermiers, la dégradation des fonds sur lesquels se faisaient les engrais (8). » La Société d’agriculture de Rouen renouvelait1 (1) £)., Mém. Turgoly I I e Partie, p. 237, 1782. (2) Ai., loc. cit. (3) Nile* Êph.y 1775, n° 10, p. 20. (4) Extraits des Registres, 1775 et 1776, A. N.-H. 1507, pièces 256 et 257. (5) Profit du Peuple (Ê p h 1775, n° 4, p. 90). Cf. Cour des Aides, 6 mai 75. (6) 7\, Œ.j t. II, p. 226. (7) B., Êph.y 1776, n 2, p. 175 et 181. (8) B., Éph ., 1776, no 2, p. 187-188.
90
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS LE M I N I S T È R E DE TURGOT
en 1775, contre cette malheureuse institution, ses attaques de 1765 (1). L’Édit de suppression était enregistré le 9 février 1776, et Mirabeau pouvait, avec un peu d’exagération, proclamer, vers la fin de l’année, que « de tous les monopoles ci-devant autorisés qu’avait tués le défunt [Turgot renvoyé en mai], celui-là seul ne se relevait pas » (2). La marque des cuirs était également funeste aux éleveurs. Il peut arriver que les tanneurs soient les premières victimes de cet impôt, et de sa forme désastreuse ; mais les proprié taires et les fermiers se ressentent nécessairement de cette ruine des tanneries. « Que l’on fasse porter la taxe sur les cuirs ou sur les bœufs vivants ; n ’est-ce pas toujours la terre et son revenu qui supportent seuls cette charge ? » : n’était-il pas plus simple de la lever directement sur le revenu territo rial (3) ? Turgot n’eut le temps que de « préparer un arrange ment qui eût été d’un avantage inestimable pour l’agricul ture » (4). Pour le développement dn petit bétail, c’était surtout le débit intérieur des laines nationales qu’il fallait élargir. « Madame, nous prierions le Roi de nous faire un plaisir, écrivent les Laboureuses à Marie-Antoinette ; ce serait de ne plus porter que des habits de laine de France... S’il faisait entendre qu’on lui ferait plaisir d’en faire autant, qui peut dire la richesse qui en reviendrait à son peuple ?... La soie serait pour les dames ; il y en a bien assez qui en portent aujourd’hui. Nous avons vu de ces petites chenilles qui font la soie ; la nièce de notre curé en nourrit tous les ans : le jeu n’en vaut pas la chandelle ; ce petit bétau-là n’est bon à rien ; et c’est de la bagatelle que tout cela. Vivent les moutons ; tout en est bon, la chair, la peau, la laine, et le fumier qui fait le bon laboureur... Si on pouvait leur donner du sel, la toison de nos brebis serait plus fine et on en perdrait moins par la pourriture dans les années humides... Depuis que tous les riches se sont mis à porter des habits de soie et de laine de hors pays, bien des pauvres ont été réduits à ne porter que de la toile, et ils n’en ont pas plus chaud en hiver... » Et quel encouragement encore aux campagnes si la reine voulait bien mettre à la mode les plumes de France au lieu des plumages (1) (2) (3) (4)
Cf. A. N.-H. 1507, pièces 256 et 260. M., Discours de rentrée de 1776, Mss., p. 62. B., N lies Éph.f 1775, 41, p. 47. D.y Mém. Turgoty II« Partie, p. 201.
LE PRO GRAMME COMMERCIAL
91
exotiques (1) ! Ainsi « parmi les arts nous donnons la préfé rence à ceux qui servent le plus généralement ; parmi les manufactures, aux plus communes, qui fournissent des habits, des meubles, des vêtements au peuple ; et parmi toutes les sortes de commerces, à celui qui se fait dans l’intérieur du royaume entre ses habitants » (2). Dans l’intérêt des propriétaires de bois, c’est surtout l’affranchissement des servitudes industrielles, métropoli taines ou provinciales, que l’on réclame. « Je vous avoue, écrit Turgot, que je compterais bien plus sur les spéculations libres du commerce que sur tous ces règlements qui destinent à l’approvisionnement de Paris une partie des bois situés sur la Seine... qui me paraissent contraires aux premiers prin cipes de propriété et de liberté (3). » Un arrêt du 4 mars 1776 rend effectivement la liberté aux propriétaires forestiers de la Franche-Comté, rançonnés par les maîtres de forges, les exploiteurs de salines, et les fabricants de verrerie ; et la province en est « soulagée » (4). La grande pêche était accablée par les droits énormes qui grevaient le poisson dans la capitale et par les profits des trop nombreux intermédiaires que cette taxation entraînait. « L’armateur, le maître de l’équipage, et les matelots, qui sont les vrais producteurs du poisson, ne retiraient pas plus de 100 francs de la marée fraîche qui charge un chariot pour Paris et qui se paye 900 livres par le consommateur... Les avances des armateurs sont considérables ; ils ne les feront qu’après avoir obtenu la certitude absolue d’un meilleur produit (5). » Même les taxes perçues sur le poisson de luxe comme le turbot rejaillissent cruellement parfois sur les producteurs : « sans ces droits la marée serait moins chère à Paris, et il y aurait à Dieppe beaucoup plus de pêcheurs » (6). La Déclaration du 8 janvier 1775 les reconnaissait « nuisibles à l’une des branches d’industrie les plus utiles au royaume et la véritable école des matelots » ; une réduction de moitié était accordée pendant le carême, que l’Arrêt du 13 avril1 (1) P. 12-13.
(2) B., Éclaircissements, p. 185-186. (3) Γ. à Moreau de Beaumont, 8 février 1776. A. N.-F.ie, 152. Cf. Œ. 7\, t. V, p. 344. (4) Cf. D.t Mém. Turgot et Œ. Γ., t. Il, p. 324 (arrondissements de Salins et de Montmorot). (5) B., NUes Éph., 1775, n° 4, p. 202 et 226. (6) Bœsnier, p. 388.
92
LA P H Y S I O C R A T I E
SOUS
LE
M IN IST È R E
D E TURGOT
suivant étendait à Tannée entière (1). Un Arrêt du 19 mai de la même année renouvelle la gratification de 25 sous par quintal de morue sèche de pêche française exporté dans les Iles (21 Les voies et moyens de communication. — Il subsistait d’innombrables péages sur les voies de terre, et plus encore sur les voies d’eau. « Il est extrêmement fâcheux, écrit un Citoyen de Lyon, qu’un des plus beaux fleuves du royaume, et celui dont on pourrait tirer* le plus d ’avantages, en procure d’aussi peu considérables... alors que Ton s’empresse de former des rivières artificielles, comme des canaux, partout où on en peut pratiquer. La navigation y est presque abandonnée pour la route de terre, où les péages sont moindres, mais qui cause un grand gaspillage de personnel. Il faudrait supprimer ceux qui ne seraient pas fondés sur titres authentiques, et réduire les autres. Ils ont été établis : 1° pour la sûreté des chemins ; 2° pour leur réparation et entretien. Si les seigneurs ont été dispensés depuis longtemps des précautions ou de la police, ils ne l’ont jamais été du reste ; il est clair comme le jour que lesdits propriétaires ou leurs fermiers doivent, ou pourvoir aux frais, ou abandonner leurs droits, conformément à l’article 14 de la Déclaration du 31 janvier 1663. Supprimer les péages, après avoir donné les indemnités légitimes, c’est le meilleur moyen de favoriser le commerce. Il n’est point d’ornière, point de précipice comparables (3) ! » Turgot projeta, en effet, de supprimer purement et simple ment tous les péages dans les domaines royaux, et de racheter les droits des seigneurs. Il s’efforça même d’obtenir de ces derniers des suppressions volontaires, « à la sollicitation et à l’exemple du Roi, et pour mériter ses bontés. Il y en a eu quelques exemples pour ce motif, combiné sans doute avec un sentiment de patriotisme et de bienfaisance : MM. de Laoerdy et de Barenlin, sur leurs terres de Gambais [S.-et-O.j et de Hardivilliers [Oise] (4) ». Quant au développement matériel des communications, Necker lui-même m ettait « un canal creusé, une rivière rendue plus navigable,... au rang des moyens immanquables pour exciter la culture » (5). Les Nouvelles Êphémérides publiaient (t) Cf. D., Mém. Turgot, II* Partie, p. 14. (2) Œ. T., t. II, p. 227. (3) Nlles Êph.y 1775, n® 9, p. 26,29, 30, 39 et 43. Cf. 1775, n* 5, p. 142. Cf. Stourm, t. I, p. 473. (4) Ζλ, M é m . Turgol9 I I e Partie, p. 217. (5) Leg. C om m , grains (Mélanges, t. II, p. 242-243).
LE
PR O G R A M M E C O M M ER C IA L
93
un Mémoire pour la liberté et l'organisation du flottage des bois sur les rivières de France, notamment de la Dheune (1). Par Arrêt du 11 décembre 1775, d’autre part, Turgot réunis sait au Domaine les privilèges des coches et diligences d’eau : « ces établissements, en effet, pouvaient encore se perfection ner, si S. M. faisait rester dans sa main les privilèges en vertu desquels lesdites voitures ont été établies et n’en formait qu’une seule exploitation, attendu les obstacles inséparables d’entreprises de cette espèce, que des particuliers surmontent difficilement, et qui s’aplaniraient d’eux-mêraes si lesdites voitures étaient confiées à une administration royale (2). » De telles organisations de service public pouvaient rentrer dans les attributions de l’État physiocratique. Pour les voies de terre, si l’on continue, cela va de soi, de s’intéresser aux chemins vicinaux (3), l’attention se concentre encore sur les routes. « Leur utilité pour faciliter le transport des denrées a été reconnue de tous les temps... Jamais ces travaux importants n’ont été suivis avec autant d’ardeur que sous le règne de feu roi... Plusieurs provinces en ont recueilli les fruits par l’augmentation rapide de la valeur des terres. La protection que nous devons à l’agriculture qui est la véri table base de l’abondance et de la prospérité publique, et la faveur que nous voulons accorder au commerce comme le plus sûr encouragement de l’agriculture, nous feront chercher à lier de plus en plus par des communications faciles toutes les parties de notre royaume, soit entre elles, soit avec les pays étrangers... (4) » C’était le langage même de la Physiocratie. Autant qu’on en peut juger pendant une période aussi brève, continuait de s’affirmer cette hausse du revenu agricole — et par suite du prix des terres — qu’avaient souhaitée les Physiocrates. « Car enfin, il faut observer en finissant que les 3 livres 8 sols d’augmentation par setier [de blé] sur les prix moyens du producteur-vendeur, sont, pour les seigneurs et les propriétaires, presque un doublement de produit net... Il ne faut pas croire que sur les 21 livres moins quelques sols qui formaient ce prix, il y eût plus de 3 livres de net. Les intérêts des premières avances, la reprise de celles qui se font tous les ans, les frais et les faux-frais, surtout l’impôt qui va sans1 (1) (2) (S) (4)
1776, n° 2, p. 1-39. Œ. T., t. II, p. 428.
Cf. p. ex. Chastellux, cité par Sicot. Préambule de l’Édit de février 1776 supprimant les corvées.
94
LA
P H Y S IO CRATI E SOUS
LE
M IN IST ÈR E
D E TURGOT
cesse croissant, prenaient environ 17 livres de cette recette. Aussi les fermiers assurent-ils tous, et avec vérité, qu’à moins de 17 livres ils sont évidemment en perte... Le nouvel accroisse ment a donc bien été presque un doublement... (1). » « Je suis persuadé, écrit Voltaire à la fin de 1775, parlant il est vrai spécialement du pays de Gex, que nos terres doubleront de prix dans un an. Elles commencent déjà à valoir beaucoup plus qu’on ne les estimait auparavant. Ce seul mot de liberté du commerce réveille toute l’industrie, ravive l’espérance, et rend la terre plus fertile (2). » E t en pleine Assemblée du Clergé, le 13 juillet 1775, le duc de La Vrillière peut proclamer, sans s’exposer à aucun démenti, que « la liberté du commerce a donné à la plus abondante des productions de la terre une valeur qui augmente le revenu des propriétaires n (3). « Nous ne devons point oublier, reconnaîtra Afanassief, un facteur important des progrès accomplis : nous voulons parler de l’influence des publicistes (4) ; ils avaient préparé la tâche, éclairé la question, augmenté le nombre des partisans de la liberté. » Au premier rang de ces publicistes réformateurs figurent les Physiocrates. II. — Le bon marché des produite manufacturés A la réforme du régime corporatif l’École s’intéressait plus activement qu’elle ne l’avait jamais fait. L’abbé Beaudeau prenait bien soin de publier en 1775 l’Essai sur la liberié du Commerce et de VIndustrie que feu le président aux Requêtes à Rouen, Bigot de Sainte-Croix (5), avait composé en 1767, lorsqu’il avait été chargé par Laverdy « d’examiner l’état des Corps et Métiers, Corporations et Jurandes » : cet ouvrage est en effet tout imprégné du pur esprit physiocratique. « On n’a pas été jusqu’i l assez convaincu de la nécessité de baisser les prix des travaux et des ouvrages de l’industrie. On a confondu l’intérêt particulier du commerçant avec l’inté rêt public : comme si l’intérêt d’une nation agricole dépendait uniquement de la richesse de ses commerçants et de la classe ouvrière et commerçante... (6). » 1° Moins il en coûte pour les1 (1) (2) (3) (4)
Lettres et Mémoires, 13 septembre 1774, p. 144-145.
Lettre à Morellet, du 23 décembre 1775. P. V. des Assemblées du Clergé, cité par Foncin, p. 298. P. 422. (5) a . M. ΡΛ., t. I, p. 200. (6) Essai, p. 5-6.
LE
PROGRAMME
CO M M ERCIA L
95
façons et les ouvrages de l'industrie, et plus on est en état d’acheter et de consommer... De là l’encouragement des travaux productifs de la culture et l’accroissement du revenu territorial. 2° La diminution des frais et le bon marché des tra vaux de l’industrie procureraient aux cultivateurs une grande épargne sur les avances de la culture. Moins il leur en coûte pour les dépenses d’exploitation et plus ils font de profits... Cette économie, en répandant plus d’aisance sur les cultiva teurs, tournerait nécessairement au profit des propriétaires, dont la richesse est la richesse fondamentale de la nation. 3° Enfin la classe ouvrière et commerçante éprouverait elle-même une épargne sur le prix de ses achats et de ses consommations... qui deviendrait [à son tour] une nouvelle source du bon marché des salaires et des ouvrages (1). « La loi de la concurrence est la seule qui puisse réduire les profits, énormes des agents de commerce et de l’industrie, e f remettre leurs gains au niveau des moyens du consommateur et des revenus du propriétaire (2). » Prise sous un angle différent, plus large, nous le verrons, Turgot fait sienne cette doctrine de l’École. L’Arrêt du 24 juin 1775 déclarant libre l’art de polir les ouvrages d’acier, souligne que « la concurrence multipliera la main-d’œuvre et produira le meilleur marché de la marchandise » (3). Reprenant une disposition de l’Arrêt du 3 mars 1767 qui avait déjà ouvert les corps et métiers aux étrangers, l’article premier du grand Édit de février 1776 spécifie que ceux-ci jouissent désormais, au même titre que les régnicoles, de la liberté entière d’exercer leur art, même s’ils ne sont pas natu ralisés (4). Il convient plus que jamais d’encourager cette immigration : « S’il y a un moment où l’on puisse espérer d’attirer en France beaucoup d’ouvriers anglais, et avec eux une multitude de procédés utiles inconnus dans nos fabriques, c’est bien celui de la guerre anglo-américaine (5). » Le perfec tionnement technique, le « progrès des arts » sera une consé quence non négligeable de cette liberté générale de l’industrie. Les anciens inspecteurs des manufactures, libérés de leur tâche ingrate et funeste de contrôle, « occupés désormais d'instruction, seront très utiles : on espère que leur emploi1 (1) (2) (3) (4) (5)
Essai, p. 109-110. Ibid., p. 5. Œ. Γ., t. II, p. 228. Cf. Essai, p. 62. 7\, Mém. au Roi, janvier 1776 (Œ . 7\, t. II, p. 249).
9G
LA PH YSIOCR ATIE SOUS LE MINISTÈRE DE TURGOT
sera bientôt réduit à cette honorable fonction de l'autorité souveraine » (1). Les Nouvelles Êphémérides annoncent avec beaucoup de détails la prochaine fondation, à Paris, (Tune Société d'Émulaiion pour l’encouragement des inventions sur le modèle de celle de Londres (2). Toutes ces mesures d’affran chissement et de réorganisation intérieure de l’industrie nationale constituent autant de moyens de parvenir au bon marché de ses produits. Mais, pour atteindre un tel but, il ne faut point redouter la concurrence des produits manufacturés étrangers, « En interdire l’entrée pour favoriser celles de ce pays, c’est établir un monopole en faveur des fabricants contre tous les autres citoyens ; c’est priver ceux-ci d ’une partie des jouissances auxquelles ils ont droit de prétendre, pour enrichir les autres... Ou en serions-nous si nos négociants et nos fabricants n’avaient pas à craindre cette concurrence qui les force d ’user d’épargne et d’économie dans toutes leurs entreprises (3) ? » Bœsnier de L ’Orme ne fait ici, en substituant à l’intérêt terrien (auquel d’ailleurs nous, allons le retrouver particulièrement attentif) l’intérêt public général, qu’élargir l’orthodoxie physiocratique. Il y demeure, par contre, strictement fidèle quand il réclame la franchise d’importation des produits fabriqués étrangers même sans réciprocité. « En accroissant dans un État l’entière liberté du commerce, on ne pourrait sans doute empêcher qu’il ne souffrît de l’interdiction où ses manufactures seraient soumises chez les autres ; mais on gagnerait au moins l’avan tage de se procurer tous ses besoins au meilleur marché possible par la plus grande concurrence possible de vendeurs (4). » « L’étranger, déclare à l’unisson le magistrat anonyme colla borateur des Nouvelles Êphémérides, ne peut avoir parmi nous la préférence sur nos manufactures qu’autant que ses mar chandises ou leur prix sont plus avantageux à la nation (5). » A plus forte raison l’exportation manufacturière apparaît-elle comme inutile, et même dangereuse. « Rien n’indique la nécessité d’un tel commerce extérieur de main-d’œuvre ; le travail des manufactures semble n ’avoir naturellement d’autre objet que de favoriser la consommation des subsis tances nationales, en fournissant en même temps aux autres1 (1) (2) (3) (4) (5)
B ., Éph., 1775, n° 7, note, p. 70. É ph., 1775, n° 9. Gouu. Écon.j p. 219-220. Ibid., p. 221-222. Nlies Éph., 1775, n° 3, p. 29-30.
LE
97
PR O G R A M M E CO M M ER C IA L
besoins de la société, et que de laisser une classe de citoyens occupée pendant la paix de fonctions que l’on peut suspendre jusqu’à un certain point pendant la guerre, pour en employer les hommes à la défense de l’État, plutôt que de distraire les cultivateurs de leurs travaux et de nuire à la reproduction des terres, qui ne peut jamais souffrir ni suspension ni diminu tion (1). » Le danger est que le désir d’encourager cette expor tation en quelque sorte artificielle conduit aisément à une politique d’avilissement des productions agricoles nationales. « En supposant que les denrées et matières premières puissent se soutenir à bas prix tandis que les ouvrages de manufactures se vendraient le prix qu’elles valent à peu près en général dans les .autres pays de l’Europe, l’État perdrait nécessaire ment dans tout ce commerce avec l’étranger... Un aune de drap, par exemple, ne représenterait chez l’étranger qu’une quantité de blé et d’autres denrées beaucoup moindre que celle qui y serait entrée réellement... On ne pourrait pas dire que, les fabricants et négociants vendant leurs manufac tures au même prix que celles de l’étranger malgré le bas prix des denrées, l’É tat ne perdrait jamais rien dans ces échanges : car les fabricants, ouvriers, négociants, achetant les denrées à plus bas prix que les étrangers, travailleraient moins, épargneraient moins les frais, feraient plus de dépenses, gagneraient plus que ces derniers, et ne rétabliraient ainsi l’équilibre qu’aux dépens des propriétaires des productions et des matières premières (2). » Et il ne serait pas indifférent aux propriétaires de payer cher ou bon marché les services de l’industrie, parce que celle-ci ferait des consommations en proportion ; car les mêmes consommations peuvent avoir lieu pour une plus ou moins grande quantité de services ; il est toujours par conséquent de l’intérêt des propriétaires de ne donner « que la moindre quantité de subsistances qu’il leur est possible » (3). Comme on comprend la véritable haine, souvent aveugle, parfois aussi clairvoyante, que l’École porte à Colbert. Baudeau va jusqu’à le mettre au-dessous, non pas seulement de Sully, mais de Mazarin, qui aurait « beaucoup plus ménagé le peuple et mieux administé le Trésor » (4). Avant Colbert, « on n’avait imaginé de taxes qu’en faveur (1) Gouv. 1icon., p. 135-136. (2) Gouv. Écon ., p. 181-183. (3) Ibid., p. 364.
(4) Éclaircissements, p. 60. G . U E U I .E K S S E
7
98
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS LE M I N I S T È R E D E TURGOT
du Roi, des courtisans et des financiers ; il en imagina de plus en faveur des marchands... Lia Dime des Manufactu riers ! » (1). En termes plus mesurés, mais non moins nets, Turgot prononce contre ce « Colbertisme » la même condamnation ; « L'étranger ne livrant sa marchandise à aucune nation qu’au prix que lui en donnent les autres, le droit d'entrée sur ses manufactures reste nécessairement à la charge de la nation qui l'a établi ; et en croyant encourager les manufactures [nationales] par des droits diversement combinés sur les marchandises fabriquées et les denrées du crû, on ne favorise les manufacturiers qu’aux dépens des cultivateurs (2). « En application de ces principes, qui sont exactement ceux de l’Ecole, il aurait, suivant Dupont, pendant son court passage au ministère de la Marine, projeté de faire construire au dehors une partie des vaisseaux du roi : « Tout en sentant la nécessité d’avoir des magasins bien approvisionnés qui missent à portée de réparer les flottes et même de multiplier les constructions en temps de guerre, et lorsque les dangers de la navigation ne permettraient pas aux matériaux d’arriver, il savait l’avantage qu’on pouvait trouver à faire faire les constructions habituelles en Suède d’après les plans et sous la direction de constructeurs français... Il avait calculé que l’épargne du fret dispendieux qu’exige toute la partie du bois qu’il faut ensuite réduire en copeaux, celle de la refonte du cuivre pour les pièces de bronze dans un pays qui le tire de l’étranger et où le charbon est rare et cher ; et enfin la dif férence du prix des subsistances et de la main-d’œuvre en Suède et en France, pouvaient procurer une économie des 2 /5 (3). Et, ministre des Finances, il aurait envisagé de faire frapper au Pérou directement en écus du Roi les monnaies d’argent, et en Suède les pièces de cuivre, afin de diminuer le coût de l’opération (4). » A l’égard des entreprises de trafic, même programme de libre concurrence, tan t intérieure qu’extérieure. Baudeau se scandalise des avances de fonds consenties par Colbert è des Compagnies de commerce pourvues d’un privilège exclusif (δ) ;1 (1) Ibid., p. 164. (2) 7\, Rapport... sur les droits perçus à Lyon sur deux balles de soie (Œ. T., t. II, p. 360). (3) £>., Mém. Turgot, IIe Partie, p. 124. (4) Op. cit.t II· Partie, p. 206. (5) Éclaircissements, p. 164.
LE PROGRAMME COMMERCIAL
99
il faut d’abord, dit Bœsnier, maintenir l’égalité entre les négociants nationaux (1) ; Turgot s’oppose énergiquement à ce qu’on rétablisse le monopole de la Compagnie des Indes : « Dans le dernier Conseil, écrit la Correspondance Métra le 16 octobre 1774, il a mis sous les yeux du Roi un état de comparaison de plusieurs vaisseaux revenus de la Chine et de l’Inde, où ils avaient été expédiés par des particuliers, avec une pareille quantité de marchandises expédiées par l’ancienne Compagnie. Il paraît en résulter : 1° que la vente des envois de l’armateur s’est faite avec un avantage bien supérieur ; 2° que les retours ont été beaucoup plus prompts ; 3° que les marchandises de retour ont été vendues à un prix plus modéré, parce que la feue Compagnie imposait une taxe onéreuse et arbitraire sur les importations. De là M. Turgot est parti pour demander au Roi sa parole que d’ici à trois ans au moins ce commerce serait encore libre..., et 3. M. y a accédé (2). » Il combat de même la création de toute Société privilégiée pour le transport des marchandises de Marseille dans l’inté rieur du royaume : « Vous sentez sûrement comme moi, écrit-il à Bertin le 11 avril 1775, combien une pareille conces sion serait préjudiciable au bien du commerce... ; je ne doute pas assurément de vos principes sur une matière si impor tante. » Dans la question des Messageries, le ministre paraît un peu plus embarrassé. Un Arrêt du 7 août 1775 distrait du bail des Postes et réunit au Domaine pour être exploitées par lui Messageries et Diligences. « Sans la nécessité de conserver les revenus que S. M. en tirait, Elle aurait eu le désir de suppri mer le privilège exclusif accordé à la nouvelle administra tion... ; dès que le service en sera entièrement et solidement établi, Elle pourrait la soustraire audit privilège (3). » D’après le commentaire rétrospectif de Dupont, « il était en effet à redouter que l’établissement de voitures publiques [sans privilège aucun, de Ferme, ni d’État] ne se fît qu’avec lenteur, dans un pays où l’habitude de n’avoir presque jamais de commerce libre faisait exagérer la crainte de la concur rence... ». Mais, attaquée par qui l’on devine, la Régie des Messageries Royales fut mal défendue par quelques-uns des ΊΓΛΪ5’dîl riWhistre auxquels « cette opération parut n’être pas1 (1) Gouu. Écon.t p. 122-123. (2) Corresp., t. I, p. 101. Cité par Foncin, p. 87-88. (3) A. N.-F.12 151, cité par Foncin, Pièces justiflcatives, p. 26.
100
LA P H Y S I O C R A T I E SOUS LE M I N I S T È R E DE TURGOT
au niveau des grandes vues qu’on lui connaissait » (1) ; parmi ces impatients amis ne doit-on pas compter les gardiens sévères de l’orthodoxie physiocratique, inquiets d’un p jg n p pole d’État, même direct, même provisoire ? En tout cas l’inau guration le 1er avril 1776 des Turgotines, ainsi appelées par raillerie, malgré les avantages qu’elles ollraient, ne fut pas sans contribuer à une disgrâce déjà imminente (2). Pourtant, en faisant exercer un privilège exclusif pour le compte du Roi, on le rendait en soi moins onéreux et plus favorable aux com munications ; on se donnait les moyens de perfectionner plusieurs branches d ’administration et de les rendre m oins coûteuses ; et même on préparait les voies par lesquelles on pourrait le supprimer un jour. Quant au trafic extérieur, « une Nation agricole [et Tifault ajoute : manufacturière] occupe trop de bras dans ses campagnes — et dans ses ateliers — pour pouvoir se livrer à ce commerce qui ne saurait être avantageux s’il n’est considérable. Elle doit s’en tenir à exporter, ou bien vendre chez elle-même à l’étranger, ses denrées superflues, et les chefs-d’œuvre de son industrie ; et à importer en droiture pour son usage les denrées qu’elle ne récolte point, les matières premières qui lui manquent, et les ouvrages étrangers qui lia séduisent » (3). « L’Angleterre, prétend Bœsnier, perd annuellement près de la moitié du revenu que pourrait lui produire son territoire également bien cultivé... N’est-ce pas évident que c’est aux profits du commerce que ce revenu est sacrifié ? Est-il clairement démontré que des profits, quels qu’ils soient, dédommagent de ce sacrifice (4) ? » En tout cas, tout privilège exclusif accordé, à la marine nationale est onéreux : « Ne paraltrait-il pas plus sûr et plus avantageux de favoriser la navigation extérieure par la facilité des commu nications intérieures ? Un pays dont toutes les provinces seraient, autant qu’il est possible, coupées, entourées et tra versées de canaux navigables, ne semblerait avoir de plus grands avantages pour la navigation même extérieure que tous ceux qu’il pourrait retirer des gênes et des prohibitions imposées à ses voisins. Il est vrai qu’il est moins coûteux de faire des îôtrque de creuser des canaux : mais les lois qui favo-1 (1) (2) (3) (4)
Mém. Turgot, p. 90.
Cf. Cavaülès, p. 156. Tifault, p. 50. Oouu. Leon., p. 153.
LE
PROGRAM M E
CO M M ERCIA L
101
risent particulièrement la navigation nuisent particulièrement à l’agriculture ; les canaux favoriseraient également l’une et l’autre (1). » Le monopole des négociants commissionnaires entraîne parfois des abus éhontés ; tel « le prétendu droit d’étape des bourgeois de Dantzig, qui force tous les étrangers à leur vendre 1’ « universalité » des marchandises qui doivent entrer en Pologne, et pareillement les Polonais à leur vendre le total des denrées qu’ils doivent exporter », comportant en chaque sens pour les intermédiaires un bénéfice de 15 % ; « cette vexation abominable, des malotrus de commis des affaires étrangères ont l’audace de la soutenir à la face de l’Europe, et les badauds de Paris s’y laissent prendre » (2). « Un peuple est dans l’erreur s’il croit travailler pour lui, lorsqu’il sacrifie tout à ses négociants. En excluant ceux des autres nations, il vend scs marchandises à plus bas prix, et il achète au plus haut les marchandises étrangères... ; il n’y a que la concurrence de tous les négociants qui puisse faire fleurir le commerce à l’avantage de chaque peuple (3). » Les profits de trafic qu’assurent aux négociants de la métro pole les privilèges du pacte colonial sont fort loin d’être tout bénéfice pour celle-ci. « Il est vrai que si elle n’avait point de colonies, ou si leur commerce était ouvert à tous, les étrangers auraient pu gagner une partie des frais de transport que la nation paye aujourd’hui à ses [propres] négociants ; et ce qu’elle eût payé est une chose qu’elle épargne, si elle ne la gagne pas. Mais si les marchands nationaux font, en vertu de leur privilège exclusif, payer ce service plus cher à la nation qu’elle ne l’eût payé aux étrangers, il faut retrancher de l’épargne de la nation l’excès de leur gain (4). »1 Ibid ., p. 124 et p. 287. Baudeau, Chronique secrète, 18 juillet 1774. Condillac, Commerce et gouvernement, p. 429. Turgot, Mémoire sur la manière dont la France et VEspagne devaient envisager les suites de la querelle entre VAngleterre et ses colonies, 6 avril 1776 (CE. T., t. II, p. 560-561). (1) (2) (3) (4)
C h a p it r e IV
POLITIQUE ET PHILOSOPHIE DES PHYSIOCRÀTES I. — Principes du « droit social » « La distinction et définition de la propriété personnelle, de la propriété mobilière, de la propriété foncière est reçue partout aujourd’hui, proclame Mirabeau ; elle est due aux économistes (1). » La propriété foncière, bien que naturellement la dernière à apparaître dans l’évolution des société humaines primitives, continue d’être investie dans les sociétés modernes d’une sorte de primauté. Elle porte en effet, plus fortement encore empreinte que les deux autres, ces deux caractères essentiels : l’individualité et l’hérédité. Dupont dégage le premier à propos notamment du projet de Turgot d’aliéner la totalité des biens-fonds du domaine royal (2). E t Condillac donne du second la justification psychologique la plus simple : « Quel est l’homme qui s’occuperait des moyens de donner à une terre une valeur qu’elle n’aura qu’après lui, s’il ne lui est pas libre d’en disposer en faveur de ceux qu’il veut en faire jouir ? Dira-t-on qu’on y sera porté par l’amour du bien ? Mais pourquoi ôter au citoyen un motif qui le détermine plus sûrement ? L’intérêt qu’il prend à ses enfants ou aux personnes qu’il aime (3). » Condorcet reproche à Necker, quand il se montre si respec tueux de la propriété mobilière, d’attenter si délibérément à la propriété foncière ; il dénonce dans une telle politique un véritable contre-sens, mais il précise aussitôt « qu’il n’est pas plus permis de faire banqueroute aux rentiers que de vexer (1) A/., Critique de la Déclaration des Droits de Virginie , M. 784, n° 1, M ss ., p. 11. (2) D., Mém. Turgot, I I e Partie, p. 243-244. (3) Comm. et Gouv.f p. 283.
PO L IT IQ U E
ET
PH IL O SO PH IE
D E S P H Y S I OCR AT F S
103
les propriétaires de fonds par des lois prohibitives, quoique Tun soit plus nuisible que l’autre ». Toutes les espèces de pro priétés doivent être également sacrées (1). Plutôt mourir de faim que de commlttre le crime de vol : « Il n’appartient qu’au brigand des forêts de comparer la mort sur l’échafaud à la mort que ferait souffrir le besoin... Anathème à quiconque enlève à son frère le prix de son travail... (2). » « La qualité d’enthousiastes que l’on donne aux Économistes, écrit le Magistrat anonyme collaborateur des Nouvelles Êphémérides, véritablement je crois bien qu’ils la méritent un peu. Quelquesuns d’entre eux me disaient un jour : «Si Von pouvait person nifier la loi de propriété avec tous les avantages qui en résultent, il faudrait mettre au bas de son portrait les deux vers que M. de Voltaire mit au bas d'un portrait de l'Amour : Q ui que tu sois , voici ton maître ; I l Vest, le fu t, ou le doit être (3). »
« II est impossible, conclut Mercier de La Rivière, d’ima giner un droit qui soit autre chose qu’un développement, une conséquence, une application du droit de propriété. Otez le droit de propriété, il ne reste plus de droits (4). » Toute expropriation pour cause d’utilité publique se trouve-t-elle donc interdite ? Il s’en faut bien, même quand il s’agit de propriété foncière. Mais « le même esprit de justice qui nous engage à supprimer la corvée et à charger de la construction des chemins les propriétaires qui y ont intérêt, nous détermine à statuer sur l’indemnité légitime due aux propriétaires d’héritages, qui sont privés d’une partie de leur propriété, soit par l’emplacement même des routes, soit par l’extraction des matériaux qui doivent être employés. Si la nécessité du public les oblige à céder leur propriété, il est juste qu’ils n’en souffrent aucun dommage, et qu’ils reçoivent le prix de cette cession » (5). Ainsi légifère Turgot, et Dupont nous révèle que « les économies réalisées dans la construction et l’entretien des chemins par la diminution notable de leur surface devaient précisément permettre... d’indemniser les expropriés » (6). Quand il s’agit de redevances, telles que les1 (1) Reflex. Comm. Blés (CE., t. X I, p. 170). (2) Ibid., p. 88 et. 00. (3) Nlles É p h ., 1775, t. II, p. 10. (4) Mém. Insl. Pub. (Nlles Éph., 1775, n° 9, p. 166). (5) Préambule de VÉ dit de février 1776 abolissant la corvée, in fine. (6) Mém. Turgot, II« Partie, p. 228.
104
LA
PH Y S I OC R A T I E S O U S
LE
M IN IST È R E
D E TU R G O T
droits féodaux, Condorcet distingue entre celles qui sont naturelles, correspondant à un loyer annuel, et celles qui sont simplement conventionnelles. Des premières, la société peut favoriser, non imposer le rachat (1) ; m a ires autres ne doivent pas être confondues avec la propriété d’une terre, d’un meuble : le droit de propriété territoriale ou mobilière est antérieur à la société, qui a été établie pour l’assurer ; la puissance législative ne peut donc y porter atteinte. [En revanche] rétablissement d ’un droit, d’une charge, d’une corporation, est postérieur à la société, l’effet d’une loi, et par conséquent peut être détruit par une autre loi » ; le rachat d’office, dans ce cas, est toujours légitime moyennant une indemnité égale au revenu (2). Pour ce qui est du fondement agricole de la propriété foncière, les Économistes jugent superflu désormais d’y revenir autrement que par des allusions grandiloquentes. Tel célèbre en elle « le germe moral de l’abondance » (3) ; La Rivière, poussant jusqu’aux extrêmes limites la doctrine, soutient que « si ce droit féconde la terre, il féconde aussi le génie ; il en déploie toutes les ressources, il en excite l'industrie, il en peut monter au plus haut degré les talents et l’activité «(4), « La liberté et la sûreté sont des annexes inséparables de la propriété. Mais nous ne les tenons pas de la nature comme elle. C’est à l’homme à se les procurer. La sûreté n’eet autre chose que l’assurance de nos propriétés et de nos jouissances. La liberté est une faculté absolument étrangère à l’homme physique, qu’il ne peut acquérir que par la société, et par la force de la société, c’est-à-dire par l’association avec ses semblables (5). » — « Quels efforts n ’a-t-il pas fallu, s’écrie un Cultivateur de province, admirateur de l’œuvre de Turgot, pour briser les entraves, et pour amener peu à peu la liberté s’asseoir à côté de la propriété, et les faire s’entr’aider l’une par l’autre (6) ! » Liberté du commerce, et tout d’abord du commerce inté rieur. « Il n’y a qu’une véritable valeur relative des denrées, c’est celle que déterminent les circonstances naturelles du commerce. Il n’est point de vraie propriété, là où le gouverne-1 (1) p. 72. (2) (3) (4) (5) (6)
Réflex. sur Corvées [Œ. , t. X I, p. 63-86). Cf. L. Cahen, Condorcet, Réfl. Comm. blés (Œ., t. X I, p. 244-245). Nlles É p h 1775, n° 3, p. 22. Mém. Inst. Publ. {NUes Éph., 1775, n° 9, p. 165). A/., Disc. Ouv. Assemblées, 1774, Knies, t. Il, p. 320. Lettre, p. 33.
P O L I T I Q U E ET P H I L O S O P H I E DES P H Y SIOCRA TE S
105
ment peut changer ou altérer cette valeur par des lois parti culières »(1); les prohibitions sont comme des émissions de fausse monnaie. La concurrence doit s’exercer entre toutes les classes, entre tous les individus, et dans toutes les espèces d’échanges... Ces formules se retrouvent désormais couramment dans les préambules des actes officiels, tel l’Arrêt du 13 septem bre 1774. « Les plans les plus propres à rendre la subsistance des peuples moins dépendante des vicissitudes des saisons se réduisent à observer l’exacte justice, à maintenir les droits de propriété et la liberté légitime des sujets». La seule nuance est que le législateur se place autant et plus parfois au point de vue du consommateur, qu’à celui du producteur : « Le droit de se procurer par son travail et par l’usage légitime de ses propriétés les moyens de subsistance préparés par la Provi dence à tous les hommes ne peut être sans injustice ôté à per sonne (2). » Mais c’est bien aux agriculteurs et aux commerçants en denrées agricoles qu’est faite cette promesse : « S. M. veut s’interdire à elle-même et à ses officiers toutes mesures contraires à la liberté et à la propriété. » Liberté même du commerce de l’argent : « Le placement le plus sûr étant en acquisition de terres, ce doit être aussi celui pour lequel les capitaux produisent le plus faible intérêt ; mais s’il peut être convenable de fixer les intérêts courants en justice sur le pied du produit des terres, il n’en résulte aucune raison de gêner la liberté des conventions pour les intérêts courants dans le commerce (3). » J A l’égard du commerce extérieur, même libéralisme résolu. «Il faut examiner si les fabricants d’un É tat ont le droit d’inter dire aux propriétaires des terres et à leurs représentants d’user de manufactures étrangères et d’exporter les produc tions de leurs fonds ; si les armateurs d’un État ont droit d’interdire aux autres habitants de faire transporter leurs marchandises sur des vaisseaux étrangers ; si les lois à cet égard blessent le droit de propriété des uns ou des autres ; s’il est quelquefois utile de blesser le droit de propriété... (4). »1 (1) Bœsnier, Gouv. Écon ., p. 84-85. (2) Cf. Bigot, E ssai , p. 1-3. (3) Mém. Turgoly p. 104. Cf. Corresp. AfÆra, I, 108, à propos de cet Arrêt de septembre : « Enfin la nation a lu avec transport dans cet édit les mots de propriété et de liberté retranchée depuis longtemps du dictionnaire de nos rois. » Cité par Gomel, Turgoly Neckery p. 131. (4) Bœsnier, Gouv. Écon.y p. 118-119.
106
LA P H Y S I O C R A T I E SOUS LE M I N I S T È R E D E TURGOT
« Nul ne peut acheter s'il ne veut vendre. Les ventes se payent par les achats et les achats par les ventes. Il n’y aurait pas moyen d’entretenir autrement le commerce entre les nations, non plus qu’entre les particuliers (1). » Condillac, comme Bœsnier, en arrive à célébrer l’idéal du parfait libre-échange : « Comme nous diminuons le nombre de ceux qui nous vendent et que nous achetons tout à plus haut prix, lorsque nous défendons l’importation, de même nous diminuons le nombre de ceux qui achètent de nous, lorsque nous défendons l’expor tation ; c’est-à-dire que nous ne sommes jamais au vrai prix. Nous sommes au-dessus pour acheter cher, et au-dessous pour vendre bon marché. Certainement ce n ’est pas le moyen de faire un commerce avantageux (2). » Turgot, dans un Rapport officiel, abonde dans le même sens : « Les prétendus avantages de ces combinaisons de droits en faveur du com merce national sont illusoires, tous leurs désavantages sont réciproques et accrus les uns par les autres... Cette politique nuit à tous les États, sans être utile à aucun... ; l’intérêt de tous les peuples serait que le commerce fût partout libre et exempt de droits... ; la première nation qui donnerait aux autres l’exemple de cette politique éclairée et humaine s’élèvera rapidement à la plus haute prospérité et forcera bientôt les autres nations à l’imiter, au grand avantage de l’humanité entière (3). » Selon Dupont, la France se présentait sur le marché international, d ’abord comme venderesse : « La nation a si grand besoin que les peuples étrangers aient le désir et surtout le moyen de lui acheter, qu’elle doit saisir avec empressement toutes les conjonctures qui peuvent la mettre à portée d’ouvrir avec eux de nouvelles branches de commerce ; car il n ’y en a point qui ne soient réciproques et à l’avantage des deux contractants... M. Turgot n’était point effrayé lorsqu’il trouvait que ses vues d’économie générale pouvaient être liées à quelque portion de dépenses faite chez l’étranger ; il savait que le commerce ferait toujours tourner ce gain de l’étranger en profit pour la nation même (4). » Et, sans réciprocité même au dire de Condorcet, il aurait été partisan d’une liberté de commerce unilatérale : « Quand même les autres nations rejetteraient les denrées de cette1 (1) Ibid., p. 189. (2) Comm. et Goav., p. 328. (3) Rapport sur les droits perçus à Lyon sur deux balles de soie [Œ> T t. II, p. 360-361). (4) Mém. Turgot, II· Partie, p. 206 et note, p. 208.
P O L I T I Q U E ET P H I L O S O P H I E DE S P H Y S IO C R A T E S
107
nation hardie, lui fermeraient leurs ports, son intérêt serait encore que les siens leur restassent ouverts : une réciprocité de prohibitions ne servirait qu’à la priver du secours des étrangers et la condamner à payer plus cher pour ses besoins (1). » Liberté de l’industrie, tout aussi bien, si l’on considère ses propres agents ; c’est-à-dire liberté du travail (2). Turgot y insiste plus que les purs Physiocrates, avec des arguments et d’un ton qui ne sont pas tout à fait les leurs. « Dieu en donnant à l’homme des besoins, déclare-t-il dans les considé rants de l’Édit de suppression des Jurandes, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes » ; c’est un droit « naturel et commun » ; c’est le droit « inaliénable de l’humanité ». Inégalité de fait, égalité de droit. — L’inégalité entre les hommes est un fait, et suivant l’École, un fait non seulement naturel, mais nécessaire ; les Physiocrates persistent à le justifier. Chez G. H. Romance, la justification est simple : «la nature, en nous faisant le présent de l’existence, a modifié ce bienfait comme elle a voulu... elle a eu pour cela des raisons que nous ne pouvons connaître. L ’ordre de la nature est des dieux, disait Hippocrate ; ils font tout, et tout ce qu’ils font est bien » (3). Mais cette résignation aveugle pouvait soulever, à l’époque, de vives contradictions, voire de violentes colères. Mercier de La Rivière juge prudent de s’en expliquer mieux : « Il est assurément aisé de faire comprendre aux hommes que ni dans l’ordre de la nature, ni dans l’ordre de la société, ils ne peuvent être égaux dans le fait, puisqu’ils sont naturelle ment inégaux en talents, en force, en facultés du corps et de l’esprit ; puisqu’ils sont encore sujets à une multitude d’acci dents qui ne sont pas les mêmes pour chacun d’eux ; puis que enfin il n’est pas possible que, dans la société, chacun possède la même fortune, respire le même air, habite le même climat, suive la même profession, remplisse les mêmes fonc tions, exerce la même autorité (4). » Il y a plus : une égalité1 (1) (2) (3) (4)
Vie de Turgot, p. 201. Cf. Bigot, loc. cil. Éloge de Quesnag, p. 60-61. Mém. Instr. Publique (Êph., 1775, n° 9, p. 170-171).
108
LA P H YSI OCR ATI E SOUS
LE M I N I S T È R E D E TURGOT
sociale, même relative, serait au premier chef anti-économique: « Les législateurs des anciennes républiques, trop épris de la chimère de l’égalité naturelle entre les hommes, regardèrent le maintien de cette égalité comme le terme du bonheur de la société. Ils en firent l’unique but de leur politique. Par là ils confondirent toutes les idées. Ils ne virent d ’autres moyens de conserver la liberté des citoyens que de leur inspirer l’amour de la pauvreté, le mépris des richesses et du travail qui les donne. » Pis encore : « Ce préjugé d’égalité parfaite n’est pas moins contraire aux vrais principes de la morale qu’à ceux de la politique. Voulez-vous avoir quelque idée de ce qu’on appelle devoir ? Il faut nécessairement vous représenter deux êtres, l’un faible et l’autre fort. Il faut voir le besoin d’un côté, et le secours de l’autre. Le rapport d’égalité exclut tout autre rapport. Il n’y a plus ni père ni fils, ni époux ni épouse, ni ami ni ennemi, ni parent ni étranger'(1). » Pour aboutir à une solution concevable et acceptable, il faut transposer le problème. « Pour intéresser l’amourpropre à l’observation et au maintien d’un ordre public établi sur le droit de propriété, la première chose... est de convaincre les hommes que cet ordre les rend tous égaux entre eux autant qu’il leur est possible de l’être... Ce qu’ils ne peuvent être dans le fait, ils doivent l’être dans le droit; chacun doit être également protégé par la loi de propriété, également indépendant de toutes les volontés contraires à cette loi, également libre dans l’exercice de ses droits de pro priété. Voilà la véritable égalité sociale (2). » Les Économistes sont « trop judicieux pour trouver mauvais que... sans chercher à rendre les conditions égales... on fasse tous les hommes jouir également d’un même droit commun, d’un droit qui protège également toutes les prétentions légitimes » (3). Donc « tout ce que le gouvernement doit à chaque citoyen, c’est la sûreté des'propriétés et autres avantages que chacun peut obtenir dans la société, à proportion de son travail, du mérite de son industrie, et de l'importance de ses services... La sûreté du droit de propriété, en opérant l’accroissement de toutes les richesses, assure en même temps la vraie force nationale par leur juste distribution et leur juste répartition... La justice du gouvernement en rendant le faible utile au fort,1 (1) Bqesnier, Gouv. Écon.y Disc, p r é l i m p. 3-4 et p. 9-10. (2) M. D. L. H.y loc. cil. (3) Nlies Êph.t 1775, n· 3, p. 24-25.
P O L I T IQ U E ET P H I L O S O P H I E DES PHYSIOCRA TES
109
comme le fori utile au faible, en les rendant également heureux l’un et l’autre chacun à leur manière, établit l’égalité qui doit exister réellement entre les hommes » (1). II. — Principes du gouvernement C’était un axiome chez les Physiocrates — et non des moindres — « que les lois politiques doivent s’accommoder aux rapports économiques ; et non les rapports économiques céder aux lois politiques. Les premiers sont établis par la nature ; les dernières sont bien plus l’ouvrage des hommes, et trop souvent celui de leurs passions et de leurs erreurs. Le défaut de cette considération est peut-être la cause du vice fondamental qu’on pourrait reprocher à l’immortel ouvrage de Montesquieu » (2). « Otez la loi de propriété, il ne reste plus de lois, prononce Mercier de La Rivière ; État gouvernant, É tat gouverné, tout tombe nécessairement dans l’arbitraire ; abîme, chaos affreux, où les prétentions s’entre choquent sans cesse... (3). » « La puissance souveraine n’est elle-même établie que pour la maintenir », avec la liberté économique dont elle découle (4). Faites une constitution simple ; « il s’agit uniquement d’être charpentier d’Ê tat et de construire un édifice politique dont chaque membre prête au tout et en reçoive sa solidité » (5). « En cette matière toute complication est effrayante. Plus il y a de ressorts qui font aller une machine, plus elle est usée de frottements. Vouloir varier les lois selon les circonstances, c’est vouloir multiplier à l’infini les ressorts de l’adminis tration. Il faudra créer des législateurs exprès pour cette partie. Un moment suffira pour changer toutes les délibéra tions. E t l’on croit que le commerce pourra se mener de cette manière ?... Il s’arrête au premier nuage qu’il voit passer sur la liberté... (6). Faisons dépendre le moins qu’il est possible de ceux qui sont à la tête de l’administration tout ce qui regarde le bonheur des hommes. La nature, qui au moins à peu près égalise les mauvaises et les bonnes récoltes, place autour des rois beaucoup plus souvent des hommes cupides1 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Goav. écon., p. 55-56. Bœsnier, Gouv. Écon., p. 319. Mèm. Instr. pub. (Éph., 1775, n° 9, p. 166). Bigot, Essai, p. 3. M. à Longo, 5 septembre 1775, Mss. A ix, XVI, p. 24. Condorcet, Comm. Blés, p. 53.
110
LA P H Y 8 I O C R A T I E SOUS LE M I N I S T È R E
DE TÜRGOÎ
que des ministres sages et vertueux ; profitons de la loi à jamais mémorable que notre nouveau roi a accordée à tous les désirs des bons citoyens (1). » Condillac imagine volontiers une société économique idéale sans gouvernement (2). De là, ches les Économistes, la persistance d’une certaine indifférence théorique à l’égard des diverses formes politiques. « Ceux qui ont dit les premiers que les principes de l’adminis tration devaient être les mêmes dans les monarchies et dans les républiques ont été utiles aux hommes en leur apprenant que leur bonheur était plus près d’eux qu’ils ne pensaient (3). » E t Chastellux fait chorus à Condorcet : « Il est des bases essentielles de la félicité publique qui sont communes à tous les gouvernements ; tous peuvent s’accorder à maintenir la propriété des biens et des personnes. C’est là le terme où l’on doit tendre de toutes parts, et, pourvu qu’on y soit arrivé, il n ’importe guère quel chemin on a pris. Le meilleur des gouvernements est celui qui maintiendra le mieux la paix intérieure et extérieure (4). » Mais cette sorte d’éclectisme transcendant à l’égard de divers types de gouvernements n ’empêche pas les Physiocrates de marquer dans la pratique une préférence très nette entre les régimes opposés que leur offre le présent ou le passé. Mirabeau répudie sans ambages la souveraineté du peuple ; « il croirait dire mal, sinon blasphémer » ; suivre l’exemple contemporain de la Virginie serait « justifier dans tous les temps les émotions séditieuses » (5). La populace, en effet, forcée d’autoriser les magistrats, croit conserver le pouvoir parce qu’elle le rend précaire, incertain, variable ; tout cela ne vaut rien. Il faut dans toute société que le plus grand nombre possible vaque à ses affaires particulières, parce que le bien général n’est que cela. « Tout bon gouvernement consiste k ce qu’il y ait le moins d’affaires publiques possible ; et la Démocratie fait affaire publique de tout (6). » Avec cela, pour maintenir entre les citoyens la plus grande égalité de fortune, les républiques antiques prêchèrent, sous le nom de123456 (1) Il s’agit de l’É dit du 13 septembre 1774, ibid., p. 54-55. (2) Chap. I, II et III de la I I e Partie du Comm. et Gouv. Cf. Hector Denis, p. 253 (Philosophie positive, t. 25, juillet-décembre 1880). (3) Condorcet, cité par L. de Lavergne, Écon. /r., p. 195. (4) Vues ultérieures, p. 273, cité ibid., p. 303. (5) Ai., Critique de la Déclaration des Droits de Virginie, M s s M. 784, n° 1, p. 11-12. (6) Ai., Supp. Th. Imp., p. 263-264.
P O L IT IQ U E
ET P H I L O S O P H I E
DES PHYSIOCRATES
111
« vertu » par excellence, la renonciation à la jouissance des richesses. Ainsi fondaient-elles leur liberté politique sur les ruines de la « liberté naturelle », entendons la liberté écono mique (1). L'absolutisme monarchique, en revanche, conserve toute la faveur de l'École. Pour assurer l’universelle propriété privée, « par son essence l’autorité doit être absolue... Par la raison qu’elle doit être absolue, il faut aussi nécessairement qu’elle soit unique : deux autorités égales, ne pouvant rien l’une sans l’autre, ne seraient autorité ni l’une ni l’autre. Or, l’unité d ’autorité requiert l’unité personnelle... ; les Éco nomistes se sont ouvertement prononcés pour le gouvernement d’un seul... » (2). « Le meilleur de tous les gouvernements agricoles, tels que la France, est l’É tat monarchique (3). » Mais qu’on ne le confonde pas avec « le Despotisme, monstre de construction moderne dont on a fait peur aux petits enfants, et qui n ’est autre chose que le régime d’une société où tout le monde est devenu si apathique et si bête que l’habitude y fait l’opinion, et celle-ci la loi. On a voulu dire que la crainte était le ressort de ce gouvernement-là ; c’est tout le contraire. La crainte fait fuir ou révolte ; elle effraye, mais ne soumet pas » (4). Quant à l’expression de Despotisme I légal, tout malentendu est désormais dissipé, du moins | Mirabeau le croit-il ; « le temps n ’est plus où les hommes, encore offusqués d ’opinion politique, furent effrayés de nos propositions nouvelles et malsonnantes, et nous les repro chèrent... On sait maintenant que ce n ’est autre chose que l’autorité absolue de la loi et que la copropriété du souverain à toutes les propriétés foncières de l’É tat n ’implique aucun droit de juridiction... » (5). Il arrive à Turgot de parler le 1 même langage : « Votre Majesté, tant qu’elle ne s’écartera pas I de la justice, peut se regarder comme un législateur absolu » (6) ; 1 le ministre avait prévu l’opposition des Parlements à ses 1 réformes et s’était montré hostile à leur rétablissement (7). Les finances de l’É tat physiocratique reposent tout 1234567 (1) Bœsnier, Disc, prélim., p. 4. (2) Éph., 1775, n« 3, p. 47-48. (3) Article (Tun officier général, inséré avec éloges par Baudeau. Éph., 1775, n» 1, p. 173. (4) Supp. Th. lm p.9 p. 266. (5) Ibid., p. 72-73. (6) Œ. T. (Mém. M unicip t. II, p. 503). (7) Cf. Gomel, Turgot et Necker, p. 139.
112
LA P H Y S I O C R A T I E SOUS LE M I N I S T È R E D E TURGOT
entières sur l'impôt foncier unique, proportionnel au revenu net des terres, dont le taux normal est en quelque sorte fixé par la nature elle-même. Il ne doit pas plus être consenti que perçu arbitrairement : « Toute assemblée qui peut refuser et contester l’impôt tient de la République, levain mortel pour la Monarchie ; comme aussi toute Autorité qui peut quêter sur ses sujets, pour quelque cause qui ce puisse être, tient de près à l’Autocratie, au pillage, à l’invasion, ravage et désola tion des États, destruction des empires, extinction de l’huma nité (1). » Cette ressource exclusive du souverain doit être considérée comme son vrai « domaine inaliénable », et c’est une grave « méprise » de jamais l’engager ; tandis que les propriétés foncières soi-disant royales sont ressources du Prince, et non de l’É tat ; il faut donc revenir sur « Terreur commise, tirer tout le parti que Ton peut de ces possessions privées pour dégager l’impôt » (2). Mirabeau développe sa critique en règle des institutions militaires de l’époque. Point de ces grandes armées de métier en permanence : « Tout cela n ’est bon qu’à multiplier l’oisiveté disciplinée, offrir aux notables des moyens de piller l’État; les accoutumer à négliger leur propre patrimoine ou le devoir de s’en faire un^ pour quêter toute la vie une subsistance et des avantages précaires. On sait que c’est la solde qui fait les armées, en cas de besoin, et que le moyen d’en manquer alors, c’est de la dissiper en ostentation et appas militaires de parade. Mieux vaut un simple corps d’élite de troupes réglées, bien soudoyées, bien entretenues, honorées comme gardiennes du bon ordre intérieur (3). » La Rivière imagine une véritable garde nationale « composée principalement de tous ceux qui, possédant les biens-fonds de la nation, ont reconnu que leurs vrais intérêts personnels sont inséparable ment attachés à l’intérêt commun de la nation » (4). En cas de grand péril, reprend le marquis, « grâce au consentement universel, de nouvelles et promptes levées ameutées, instruites et bientôt animées de l’esprit des vieilles légions, dont on tirerait leurs chefs et officiers de détail, seraient aussitôt prêtes à entrer en campagne, aussitôt façonnées aux rigueurs des saisons, aux travaux des marches forcées, etc. ; et plus123 (1) M., Supp. 77t. Imp., p. 177. (2) Cf. D., Mém. Turgot, II* Partie, p. 243. Cf. Boncerf, Aliénabilité et aliénation du domaine, p. 102. (3) M., Supp. Th. Imp., p. 134-141.
P O L I T IQ U E
ET P H I L O S O P H I E DE S PHYSIOCRA TES
113
tôt sans doute, sortant de leurs ateliers ruraux, que ne seraient nos soldats de paix, exercés et encasematés dans les villes, lissés et poudrés au dehors et énervés au dedans ». Point de gaspillage non plus en fortifications démesurées : « Un État n’est jamais entamé que par lui-même ; s’il est en force et bien gouverné, tout est digue et barrière en son sein. Les haies, les fossés et les cassines présentent de toutes parts un coupe-gorge à l’ennemi. » Pour la défense maritime « nos cons tructions navales sont plus chères que faites par des négociants qui armeraient pour leur compte des vaisseaux de même force avec l’activité et les soins de l’intérêt particulier » (1). En revanche, grande nouveauté d’hier et impérieuse nécessité d’aujourd’hui, il faut organiser l’Instruction publique, « dans l’état d’ignorance, les hommes ne sont point vérita blement hommes, ils n’ont qu’une simple aptitude à le deve nir » (2) ; et « l’homme n ’a besoin d’être gouverné que parce qu’il a besoin d’être instruit. Le droit et le devoir de gouverner entraînent le droit et le devoir d’instruire » (3). Il ne s’agit pas seulement d’établir entre gouvernants et gouvernés la « confiance générale », telle qu’elle règne par exemple dans la famille entre le père et les enfants, mais plus précisément, de réaliser le « concours des opinions et des vues » (4). « L’ins truction sociale, affirme le préambule de l’Édit de septem bre 1774, peut dissiper les inquiétudes que le peuple conçoit si aisément sur la liberté du commerce des grains. » Or, si « l’opinion est bien au fond la puissance dominante parmi les hommes, sa domination n ’est solide et durable qu’en proportion de ce qu’elle s’accorde avec les lumières de la raison » (5). Le pouvoir des lois humaines se fonde sur « la raison universelle éclairée » (6) ; « la souveraineté réside dans la raison publique » (7). Il faut donc répandre « la connais sance générale des lois de l’Ordre, d’où résulte celle des droits et des devoirs de l’homme » (8), comme l’avait déjà spécifié la deuxième des Maximes de Quesnay : « C’est le vrai palla-12345678 (1) £>., Mém. Turgot, ρ. 122-123. (2) Μ. D. L. R., Mémoire (Éph., 1775, η° 9, ρ. 131). (3) Μ., Supp. Th. Imp., ρ. 54. (4) Ibid., ρ. 19 et 29. Cf. comte de Mirabeau, Essai sur le despotisme, p. 102-103 et 106 : < Des souverains pères de leurs sujets, sublime et douce chimère ! » (5) M., Critique Déclaration de Virginie. Mss., p. 11. (6) M., Supp., p. 72. (7) Déclaration, p. 12. (8) Supp., p. 19. G. W EU LEK SSE
8
114
la
P H Y S ï O C R À TIE SOUS
LE M I N I S T È R E D E TURGOT
dium selon les Économistes (1). » « L’instruction publique, en définition, aura pour but d ’attacher les hommes à leurs devoirs réciproques de citoyens, en les éclairant sur la néces sité de ces devoirs par leurs vrais intérêts (2). » C’est un pro gramme basé sur une philosophie morale mi-rationaliste, mi-sensualiste, sur laquelle nous reviendrons tout à l’heure. E t ce sont aussi les maximes que Turgot prête au roi quand il déclare toujours à propos des dispositions de l’Édit de sep tembre, que « S. M. ne leur a donné la sanction de son autorité qu’après avoir vu qu’elles ont pour base immuable la raison et l’utilité reconnue ». Le comte de Mirabeau s’accorde ici avec le marquis : « L'instruction générale... deviendrait la boussole invariable de nos jugements, nous apprendrait à assigner aux noms, aux idées, aux choses, leur véritable valeur... Si chaque volonté arbitraire, chaque brigandage en finance, chaque coup d’auto rité portait en lui l’idée d’un forfait social aussi direct qu’un incendie volontaire, tout s’opposerait à son exécution (3). » Mais voici que cette logique s’échauffe au point de prendre le ton d’une objurgation passionnée au souverain : « Bien petite est la différence d’homme à homme ; au moins n’en existe-t-il aucune dans la distribution des droits relatifs à la liberté, ou, ce qui revient au même, relatifs au respect gu'exige toute sorte de propriété. La nature les a dispensés avec la plus par faite impartialité... Le peuple auquel vous commandes n’a pu vous confier l’emploi de ses forces que pour son utilité... Vous ne lui avez pas arraché l’exercice de ses droits, car il était le plus fort avant qu’il vous eût créé le dépositaire de sa force. Il vous a rendu puissant pour son plus grand bien. Il vous respecte et vous obéit pour son plus grand bien. Parlons plus clairement ; il vous paye, et vous paye très cher, parce qu’il espère que vous lui rapporterez plus que vous ne lui coûtez... » Et peu à peu s’élève une éloquence révolution naire qui dépasse toutes les hardiesses de l’École : « Le véri table secret d'Êlal consiste uniquement à rendre les hommes heureux, et par conséquent à les laisser et maintenir paisibles possesseurs de leurs travaux et de leur liberté. Nul homme n’a le droit d’assigner les circonstances où l’on peut permettre de violer la propriélé, cette base unique de toute société, à123 (1) Déclarai.y loc. cil. (2) Mém. Jnstr. Pub.y p. 131. (3) Essai sur le despotisme y p. 64-65.
P O L I T I Q U E ET P H I L O S O P H I E DE S P H Y S IO C R A T E S
115
moins d'un délit social qui rende le malfaiteur indigne d’être citoyen. 11 n’est point de propriété plus claire et plus sacrée que celle de la liberté personnelle... ; si un seul homme réveille d’autres hommes de l’assoupissement de l’esclavage, vous serez dès ce moment [voué Prince] le plus faible comme le plus détesté de tous les êtres malfaisants, et vous deviendrez la victime publique comme vous étiez le véritable ennemi national (1). » A la tête de l’Enseignement Public sera donc placé un « Conseil souverain », tel que celui qui venait d’être créé en Pologne et dont Baudeau reproduit avec complaisance les statuts (2) ; un « Conseil de l’Instruction nationale, selon l'expression plus modeste proposée par Turgot ou Dupont. L’étude des devoirs du citoyen, membre d’une famille et de l’État, sera le fondement de toutes les autres, rangées dans l’ordre d’utilité dont elles pourront être à la société... Cette instruction morale et sociale exige des livres faits exprès, au concours ; et un maître d’école dans chaque paroisse, qui l’enseigne aux enfants avec l’art d’écrire, de lire, de compter, de toiser, et les premiers principes de la mécanique ». Au premier degré, cet enseignement devra être universellement suivi : « Point de doute qu’il ne faille établir des écoles gra tuites en nombre suffisant pour que personne ne soit privé de l’instruction. Toute terre qui ne reçoit jamais les influences du soleil est frappée de stérilité ; elle ne porte du moins que des fruits malsains, et ses exhalaisons sont pernicieuses. Il en est ainsi de nos âmes : l’instruction est leur soleil... (3). » « Le corps politique prendra de justes mesures pour contraindre ses membres à profiter de cette instruction sans cependant user de violence ni offenser leur liberté (4). » Le résultat de ces études sera contrôlé et sanctionné : « Le bon ordre veut que personne ne soit inscrit dans la classe des citoyens, ne soit admis à jouir des droits attachés à cette qualité, qu’après avoir été publiquement reconnu suffisamment instruit des devoirs qui en sont inséparables (5). » « Le souverain qui nomme à tous les emplois ne pourra choisir que dans les grades, et les grades ne dépendront que du concoursde plus scrupuleux (6). »123456 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Ibid., p. 98-100. M ém. M unicip., sept. 1775, voir Knies, t. I, p. 247-249. Mém. Instr. pu b . {Éph., 1775, n° 10, p. 129). Op. cil. (É p h ., 1775, n° 9, p. 133). Op. cil. (Éph., 1775, n° 10, p. 135.) M . à Longo, 5 septembre 1775, M ss. A ix , XVI, p. 24-26.
116
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS L E M I N I S T È R E DE TURGOT
I
Cette École sera, sinon investie d’un monopole par l’État, du moins placée sous son contrôle étroit. « Il faut que les connaissances nécessaires à l’état de citoyen y soient ensei gnées en langue vulgaire, ...et on n’y doit donner d’autres leçons que celles qui sont prescrites par le gouvernement. Cette dernière condition est bien essentielle... Les règles de conduite auxquelles chaque citoyen est tenu de se confor mer n’ont certainement rien d’arbitraire, certainement elles sont des vérités immuables : toutes le9 personnes préposées pour les enseigner doivent donc avoir les mêmes principes, parler le même langage... ; un catéchisme civil et politique exposera purement et simplement les fondements naturels de l’ordre social et de la morale universelle (1). » Dans l’ordre social comme dans l’ordre politique, cet enseignement civique sera empreint d'une sorte de conser vatisme réformiste. Son premier objet sera de convaincre les hommes que la seule égalité de droit « les rend tous égaux entre eux autant qu’il leur est possible de l’être » (2). Après avoir tracé l’esquisse connue de la sauvagerie des paysans du Mont-Dore, Mirabeau ne peut se défendre d’une inquiétude : de pareilles gens, si on continue de les tracasser, n’hésiteront pas à se rebeller ; mais il se rassure, ou du moins se console, en pensant qu’il a « consacré toute sa vie à prêcher la nécessité du soulagement du pauvre et de l’instruction générale, et à désigner ce qu’elle doit être pour former la seule barrière possible entre l’oppression et la révolte ; le seul, mais infail lible traité de paix entre la force et la faiblesse. Autrement, écrit-il à la comtesse de Rochefort, le colin-maillard, poussé trop loin, finira par la culbute générale ! » (3). De même Chastellux et Condorcet voient dans la diffusion de la nouvelle doctrine parmi le peuple le plus efficace préservatif contre une révolution politique : « De quoi devons-nous nous occuper ? se demande le premier. D’améliorer, plutôt que de renverser pour édifier (4). » « Ce n ’est pas, déclare le second, en bouleversant le monde, mais en l’éclairant que les hommes peuvent espérer de trouver le bien-être et la liberté ( 5). » II est significatif que les Physiocrates, dès ce moment, ne12345 (1) (2) p. 42. (3) (4) (5)
Op. ciL (Êph.t 1775, η» 10, p. 130-131). Mém. Jnstr. pub. (Êph., 1775, n° 9, p. 170). Cf. ci-dessus, A/»., Cf. Mém. de Montigny, t. II, janvier 1777.
Vues ultérieures, p. 273. Cf. Lavergne, p. 195.
P O L I T IQ U E ET P H I L O S O P H I E DE S PH Y S IO C R A TE S
117
revendiquent guère pour la presse une action effective, qui en ferait l’organe d’une opposition régulière au pouvoir. La Rivière ne fait qu’effleurer la question (1), et Baudeau, tout journaliste qu’il est, en parle assez légèrement : « Dans un petit écrit de deux pages intitulé La Pierre de touche, j ’ai proposé qu’on envoie à l’imprimerie tous les projets et mémoires qu’on donne par milliers sur toutes les parties du gouvernement, avec la condition que l’auteur et l’imprimeur se nomment, afin que l’écrivain connu soit puni s'il dit des sottises... Il est évident qu’il n ’y aurait aucun inconvénient ni pour le prince, ni pour la nation (2). » L’abbé ne fournit de détails sur cette procédure que lorsqu’il s’agit de la Suède (3). III. — Constitution du Corps politique « Un véritable Corps politique est un composé d’une multitude d’hommes, mais tellement unis entre eux que, n’ayant qu’une seule et même volonté, qu’une seule et même direction, ils ne forment plus qu’une seule et même force, et ne semblent ainsi constituer qu’un seul et même individu... Cette unité ne peut avoir d’autre principe qu’un intérêt commun parfaitement connu, ce qui suppose nécessairement l’unité d’opinion (4). » Nous venons de voir comment l’unité de l’instruction publique contribuerait à créer celle-ci ; il semblait même qu’elle y pût suffire, si l’on s’en tenait à cer taines déclarations du systématique auteur de YOrdre Naturel : nantis de leur certificat d’études civiques, les membres de la cité physiocratique, pour y être définitivement admis, n’auraient plus qu’à « prêter serment, à l’exemple des Athé niens, de remplir fidèlement et constamment leurs devoirs envers elle ; en effet le contrat social est un contrat synallag matique — do ut des — qui ne doit être réputé valable que par le consentement exprès des parties contractantes » (5). Mais l’ensemble des Physiocrates ne se contente pas de cette unité morale ou juridique et en quelque sorte pédago gique, où se trahirait l’influence de quelques formules de J.-J. Rousseau ; il faut naturellement « mettre l’État dans une société complète, proportionnelle et visible, d’intérêt1234 (1) (2) (3) (4)
Éph., 1775, n° 10, p. 139. Chronique secrète, 28 mai 1774. Êph.y décembre 1774. M. D. L. /?., Mém. Instr. pub. (Éph.t 1775, n° 9, p. 144-146).
118
LA P H Y S I O C R A T I E SOUS L E M I N I S T E R E D E TURGOT
avec tous les propriétaires » (1) ; il est strictement a composé des propriétaires fonciers » (2) ; ceux-ci sont « les seuls vrais, je ne dis pas citoyens, car ce mot vient des cités et des répu bliques, mais régnicoles et nationaux » (3). « Avec les culti vateurs, ils sont plus intéressés que les autres à ce que le pays, qu’ils ne peuvent quitter, soit gouverné par des bonnes lois ; il faut les favoriser dans les lois politiques en les regar dant comme plus véritablement citoyens que les autres, et ils le sont en effet (4). » Les négociants, eux, n ’appartiennent proprement à aucun pays. « Ils forment une nation qui est répandue partout, qui a ses intérêts à part (5). » Condillac ne fait ici que reproduire une opinion assez répandue, semble-t-il, et reprendre les déclarations multipliées de l’École. « Il serait plaisant, lit-on dans les Nouvelles Éphémérides de 1775, que le proprié taire d’une maison regardât l’argent comptant de ses loca taires comme un accroissement de sa fortune... Une fois qu’il aurait affiché cette ridicule prétention, argent, locataires, tout fuirait avec sa prétendue opulence... Telle serait pourtant la manie d’une nation si, quand ses marchands s’enrichissent, elle croyait s’enrichir réellement et pouvoir disposer de leur argent pour les besoins de l’É tat (6). » A plus forte raison, « l’argent qui dort dans les coffres-forts des capitalistes n ’appartient-il point du tout à l’É tat sur le territoire duquel ils demeurent » (7). « L’intérêt des différentes classes au bon heur général de la société est en raison inverse de la facilité qu’on y a de changer de patrie. Il cesse presque absolument pour le propriétaire d’argent qui, par une opération de banque, devient en un instant Anglais, Hollandais ou Russe (8). » « Les fortunes précaires m ettent dans les pays d’empfunte, de monopole fiscal ou mercantile, d ’agio, etc., passagèrement toute l’influence dans les mains de cet ordre d’hommes qui n’ont de régnicole que le nom... Là, personne ne tiendra la12345678 (1) Γ. D., Mém. M unicip. (Œ . Γ., t. II, p. 548). (2) B., Discours préliminaire à ΓÉdition des Économies de Sully (Éph., 1775, η® 12, p. 114). (3) M.y Supp. Th. Im p., p. 34. (4) Condorcet, Rèflex. comm. blés (CB., t. X I, p. 119 et p. 170). (5) Comm. et gouv., p. 129. (6) Éph., 1775, no 3, p. 32-33. (7) B ., Éclaircissements, p. 187. (8) Condorcet, op. cil., p. 171.
P O L I T I Q U E ET P H I L O S O P H I E DE S P H Y SIOCRA TE S
119
chose ; la considération sociale n’est plus qu’avec son porte feuille, ou réel tel que les billets au porteur, ou idéal tel que les grades, les profits..., les intérêts publics n ’ont aucune influence, même apparente... En Angleterre tous voyaient clairement qu’en poussant les Américains on perdait la patrie ; mais les uns avaient intérêt à vendre leur [voix ?], les autres aux emprunts, les autres aux armements, etc. ; et chacun a égorgé le public, non par passion, mais par calcul. Ici l’on vous parlera sérieusement guerre, et quand vous demanderez : Avec qui donc ? on vous citera de sangfroid le Portugal et la Russie. Je vous demande, quand ces deux seraient dans le cas de quelque union et de donner quelque ombrage, ce qu’elles [sic] seraient aux yeux d’un conseil terrien ! Mais il s’agira d’avancements, de titres, de sursis, d’intérêt dans les entreprises, etc. E t les officiers, les agioteurs et les valets décident ; et quand tout le monde a tort, tout le monde a raison ; et le monde, pour les princes, est ce qui bourdonne autour d’eux, et l’agio ne va jamais mieux que dans les banqueroutes ; et voilà comment le destin des États est à la merci des émigrants, tandis que les vrais régnicoles gémissent inutilement... Au reste les petites mutineries passagères des scribes et des pharisiens de ville ne sont pas plus capables d’étouffer les principes économiques que le dérangement des fours d’Égypte où l’on couve les poulets, ne peut éclipser le soleil... Peu importe à la terre de nourrir des chèvres ou des hommes ; c'est aux hommes à faire leur compte, leur gîte et leur lit (1). » Les villes devront cesser d’opprimer les campagnes. « Un échevin calque ses ordonnances prohibitives sur celles de l’ancienne Rome ; il traite les campagnes voisines comme Rome traitait les nations vaincues ; et le bourgeois, devenu une espèce de petit tyran pour le pays qui l’environne, chérit le magistrat qui flatte son avidité et son orgueil (2). » « Chaque ville en France a formé longtemps une république à part qui, sous la protection du gouvernement, avait ses lois, sa police, ses usages, ses privilèges. Comme elles appartenaient au rôi ou aux grands vassaux, et que la noblesse occupait la cam pagne, toute la protection était pour les villes, qui, d’ailleurs, étaient plus riches et pouvaient mieux se faire entendre. Telle fut l’origine de ces lois municipales qui défendaient aux 12 (1) Μ . à Longo, 31 août 1776, M ss. A ix, XVI, p. 49. (2) Condorcet, art. Monopole (Œ., t, X I, p. 46-47).
120
LA P H Y S I OCR ATI E SOUS
LE M I N I S T È R E D E TURGOT
campagnards d’acheter du pain à ces mêmes marchés où on les forçait d’apporter du blé q u ’ils avaient recueilli (1). * Les Parisiens en particulier « croient que le laboureur n’est fait que pour eux ; ils voudraient que, lorsqu’il a peu récolté, on l’obligeât par toutes sortes d’inventions de vendre à sa perte... Ces bonnes gens de Paris ne voient pas plus loin que le bout de leur nez ; et hors de leurs boutiques, de leurs pape rasses ou leurs rentes, ils raisonnent comme des dindons... Il ferait vraiment beau prendre leur avis et les laisser gouver ner » (2). Les affaires proprement citadines devraient être gérées par les possesseurs de terrains, bâtis ou non bâtis, lesquels d ’ailleurs acquitteraient la totalité des taxes urbaines. « On aurait dû voir que le droit de cité était [là comme ailleurs] inhérent au sol et qu’il n ’était que l’équivalent de l’espèce de servitude qu’ils avaient contractée en renonçant à la faculté de transporter leur propriété avec eux... ; qu’ils étaient [par conséquent] plus intéressés que qui que ce soit à l’adminis tration municipale, et qu’ils ne sauraient trop se hâter de réclamer d’en être seuls chargés (3). » Ils constitueraient l’élé ment stable par excellence de cet « état mitoyen », placé à égale distance de la Cour ou des grands bourgeois et de la populace, où se sont réfugiées « les lumières et la vertu ; un bon gouvernement, et une bonne instruction qui en est la suite, tendent à retrancher de plus en plus aux extrêmes, et à grossir cette classe moyenne », approbatrice de l’Arrêt du 13 septembre (4). D’autant, précise Turgot, que ce qu’on appelait l'intérêt des villes n ’avait été, le plus souvent jus qu’ici, que « l’intérêt de quelques particuliers riches de quel ques villes » (δ). L ’É tat physiocrate doit-il posséder des colonies ? Non, si c’est pour les exploiter par le pacte colonial ; car « le monopole des négociants nationaux coloniaux est au préjudice à la fois des propriétaires de la nation et de ceux des colonies » (6) ; des premiers surtout, puisqu’ils « font la plus grande partie des frais pour leur conservation par les impôts qu’ils payent k raison des dépenses de marine, etc. » (7). Si, d’autre part,1234567 Condorcet, Lib. Comm. Grains, p. 27-28. L. 7\, Laboureuses, p. 11-12. Réflexions d'un Citoyen (Éph.t 1775, n° 4, p. 16 et 20). B., Chronique secrète, 22 septembre 1774. (5) Édit d’avril 1776 sur la liberté des vins, Œ. Γ., t. II, p. 357. (6) Bœsnier, p. 267. (7) Ibid., p. 289.
(1) (2) (3) (4)
P O L I T IQ U E ET P H I L O S O P H I E DES P H Y S lO C R A T E S
121
on lève les servitudes traditionnelles, comme alors « le culti vateur et le manufacturier flamand ou suisse vendent aussi bien leurs denrées dans nos colonies, comme ils se procurent celles de TAmérique à un taux aussi avantageux, on peut en conclure que les producteurs et les consommateurs étrangers profitent des colonies autant que ceux de la nation qui croit les posséder exclusivement » (1). « Ce n’est pas qu’il faille les abandonner, mais on doit les considérer comme des provinces extérieures ; que Ton regarde une colonie comme unie au corps de l’État, ou qu’elle en soit séparée, le9 principes de commerce à son égard sont absolu ment les mêmes (2). » « Le commerce des colonies ne peut pas plus être exclusivement utile à la métropole que le commerce de ses autres provinces, sans causer leur affaiblissement. Si l’on voulait rendre le commerce de la Normandie exclusive ment utile aux autres provinces de France, bientôt la Nor mandie ne pourrait plus être utile ni à la France ni à ellemême (3). » « Ces établissements lointains peuvent fournir un asile et du travail à l’excès de la population de l’État qui les forme, lorsqu’il est en effet surchargé, et un emploi aux capi taux qui n’en trouveraient pas un suffisamment profitable dans l’exploitation des terres et le commerce du pays. Mais leur prospérité exigeait qu’ils jouissent de la liberté du commerce et qu’on ne leur demandât d’autres impositions que celles qui seraient absolument nécessaires aux frais de leur propre administration (4). » L’île de Bourbon pourrait devenir la plus belle « colonie agricole qui ait jamais existé et dont on puisse concevoir même l’idée ». Mais pas de simples comptoirs ; à moins que ce soient des entrepôts francs, destinés à réduire les frais et les risques d’une trop longue navigation. L’île de France, par exemple, pourrait être la plus belle « colonie d’entrepôt, car les vaisseaux européens n ’auraient plus eu que ce voyage â faire, ils seraient revenus dans la même année ; la précieuse espèce de nos matelots eût été conservée, les dépenses du commerce de l’Inde réduites de moitié » (5). Les grandes colo-12345 (1) T.y Mém. sur la manière dont la France el ΓEspagne devaieni envieager les suites de la querelle entre l'Angleterre et ses colonies, 6 avril 1776 (Œ. T.y t. II, p. 560). (2) Bœsnier, p. 262. (3) Ibid., p. 270. (4) D. T., Mém. Turgot, p. 126-129. (5) Ibid., p. 136-137.
122
LA PH YSI OCR ATI E SOUS L E M I N I S T È R E D E TURGOT
nies territoriales, enrichies par le libre développement de leurs richesses propres, pourraient, d’ailleurs, sans inconvé nient, se transformer en États indépendants, restant amis et alliés de leur ancienne métropole. Encore faudrait-il les défendre. « Un homme célèbre parmi les écrivains Économistes démandait un jour à un homme de lettres ce que c’était qu’une colonie. — C’est, lui répondit-on, une province séparée du corps de l’É tat par une grande rivière. — Avez-vous, dit l’Économiste, un pont sur cette rivière ? — Non, dit l’homme de lettres. — Vous ne pourrez donc pas, dit l’Économiste, protéger cette province, ni en assurer la propriété : d ’où il concluait que cette branche de l’arbre, ne pouvant en recevoir le suc nourricier, devait être abandonnée. — Cependant l’homme de lettres eût pu répliquer qu’une escadre était un pont de communi cation (1). » En dehors du monarque, et à côté de lui, le corps politique aurait-il ses représentants ? Les Économistes semblent là-dessus assez partagés. — Pour Mirabeau, il ne s’agirait que d’un certain contrôle à exercer sur l’administration des avances et des dépenses souveraines, et il imagine une « Constitution d’É tat tellement solide et conforme à l’Ordre qu’elle en demeure immuable et fondamentale » ; c’est à peine s’il entrevoit le besoin de simples « Conseils nationaux, instruits et choisis de manière qu’ils puissent toujours défendre l’auto rité contre les efforts de l’intrigue » (2). Les Assemblées municipales y sont composées de « simples députés de canton, de tout état, de toute profession, pourvu qu’ils soient euxmêmes partie-prenants personnels de l’impôt territorial ». Au-dessus siégeraient de vagues Assemblées provinciales. Mais ni les unes ni les autres ne seraient issues d’aucune élection. Leur compétence serait presque exclusivement fiscale ; mais même en cette matière, elles n’exerceraient « aucune juridiction quelconque ; il n’est pas question de débattre l’impôt ». Elles seraient, pour le reste, purement consultatives : « Il est impossible de bannir du monde la république, écrit curieusement le marquis, ce serait vouloir empêcher les nouvellistes et les rapports. Il est impossible aussi que la république gouverne jamais bien ; mais elle consulte très bien pour un chef absolu ; que la république soit (1) Bœsnier, Gouv. Écon., p. 261-262. (2) Supp. Th. Imp., p. 19.
P O L I T IQ U E ET P H I L O S O P H I E DES PHYSIOCRA TES
123
donc universelle, générale, et toujours subordonnée (1). » Nulle part de députés des villes comme tels : « Car elles ne doivent point faire corps dans l’État, et n’ont pas d’impôt à payer ; et même nul n’y est bourgeois que les propriétaires de maisons (2). » Ancien magistrat, Mercier de La Rivière semble parler un tout autre langage, du moins en thèse générale. Selon lui, « le caractère essentiel du corps politique, celui faute duquel il n’a pas de constitution régulière, c’est [précisément] la faculté vivifiante de s’assembler, de délibérer, d’agir en eorps (3). » Est-ce vraiment un Économiste qui s’exprime ainsi ? ou bien un de leurs adversaires, un disciple de Rousseau et de Mably ? « Les droits de chaque citoyen, écrit encore La Rivière, sont non seulement de pouvoir acquérir et posséder des biens-fonds dans le territoire de la société, mais de pouvoir remplir des offices publics, d’exercer des fonctions publiques, d’être en un mot compté parmi les membres du Souve rain (4). » Mais après ces belles déclarations de principes, qui surprennent de la part d’un Physiocrate de la première heure, et qui ne comportent d ’ailleurs pour le moment aucune appli cation positive, l’auteur s’empresse de mettre le royaume de France hors de cause. « Il est cependant une nation qui doit être regardée comme un véritable Corps politique, quoique depuis longtemps elle n ’ait plus la faculté de s’assembler ; mais elle a des lois fondamentales confiées à la garde de la magistrature, et ses monarques se reconnaissent dans l’heu reuse impuissance de les changer... ; il faudrait qu’elles fussent méconnues, ouvertement attaquées, pour que le besoin [de s’assembler] se fît sentir (5). » L’ancien conseiller au Parlement reparaît pour évoquer vaguement une résurrection des États généraux. Tout cela n’est guère dans la ligne ni de l’École, ni de ses adversaires. Nous nous en rapprochons avec le fameux Mémoire sur les Municipalités composé par Dupont pour Turgot. Les municipalités villageoises — Assemblées représentatives du premier degré — seraient, comme les autres, exclusivement composées de propriétaires fonciers agriculteurs élus par leurs12345 (1) Lettre à Longo, 5 septembre 1775 (Mém. Morüigny, t. III, appendice, p. 479). (2) lbid.9 p. 248-249 et p. 252. (3) Mém. Instr. pub. (Éph., 1775, n° 10, p. 120-121). (4) Ibid., p. 136. (5) Ibid., p. 123-124.
124
la
p h y s io c r a t ie
s o u s
l e
m in is t è r e
d e
TURGOT
pairs. « Les richesses mobilières, en effet, sont fugitives comme les talents, et malheureusement, qui ne possède point de terre ne saurait avoir de patrie? que par le cœur, par l'opinion, par l’heureux préjugé de l’enfance. La nécessité ne lui en donne point. Il échappe à la contrainte, il esquive l’impôt. Quand il paraît le payer, il le passe en compte dans la masse générale de ses dépenses, et se le fait rembourser par les propriétaires des biens-fonds que lui fournissent ses salaires (1). » Ceux-ci, tout au contraire, tiennent au territoire. Ils ne peuvent cesser de prendre intérêt au canton où leur propriété est placée. Ils peuvent la vendre, il est vrai ; mais alors,... leur intérêt passe à leur successeur : « La possession de la terre non seulement fournit par les fruits et les revenus qu’elle produit les moyens de donner des salaires à tous ceux qui en ont besoin, et place un homme dans la classe des payeurs au lieu d’être dans celle des gagistes ; mais c’est elle encore qui, liant indissolublement le possesseur à l’État, constitue le véritable droit de cité (2). » Encore faut-il distinguer entre diverses catégories de propriétaires. « Il n ’est pas naturel que des hommes qui ne tiennent à cette classe que par quelques perches de terre, souvent sans culture et sans valeur, aient voix comme le possesseur de 50.000 livres de rentes en biens-fonds. Il n’est pas naturel qu’on puisse acquérir le droit complet de suffrage, le droit parfait de cité, en achetant un petit terrain sur lequel un citoyen ne peut subsister (3). » A plus forte raison les journaliers ne sauraient-ils être ni éligibles, ni électeurs aux assemblées de paroisse. « Ces gens ont aujourd’hui une habi tation, et demain une autre. Ils sont au service de la nation en général. Ils doivent partout jouir de la douceur des lois, de la protection de l’autorité, de la sûreté qu’elle procure; mais ils n’appartiennent à aucun lieu (4). » On comptera donc comme citoyen à voix entière — franc-tenancier, franc citoyen —, celui qui possédera une propriété foncière dont le revenu suffirait à l’entretien d ’une famille : « soit 600 livres = = 1 voix. Celui qui n ’a que 300 livres de revenu n’est qu’un demi-citoyen ; car il faudra qu’il fasse subsister sa famille au moins à moitié du salaire des arts, des métiers, du corn-1234 (1) (2) (3) (4)
Mém. Municipe Knies, t. I, p. 252 et Œ. Γ., t. II, p. 511. Œ. 7\, p. 512. Ibid., p. 513, Ibid., p. 511.
P O L I T I Q U E ET P H I L O S O P H I E DES PH Y S IO CRA TE S
125
racrce, d’un travail quelconque ». Et ainsi de suite : « 100 livres = 1 /6 de voix ; les citoyens fractionnaires peuvent s’associer pour choisir un mandataire, renouvelé chaque année. En revanche le possesseur de grands revenus aura plusieurs voix : 1.200 livres = 2 voix. On peut avoir voix ou fraction de voix dans chacune des paroisses où Ton est possessionné. « Les rentes foncières, champarts et dîmes sei gneuriales ou ecclésiastiques, étant des revenus de biensfonds, devront donner droit à raison de leur produit, comme les terres mêmes qui payent ces rentes ou redevances, et dont il faudra les défalquer » (1). Avantages secondaires d’une telle organisation. On évi tera les Assemblées trop nombreuses, indisciplinables, comme celles qui reposeraient sur le suffrage universel des chefs de famille : « Une communauté actuellement embar rassante, renfermant une centaine de familles ou plus, se réduirait souvent à 8 ou 10, même à 5 ou 6 personnes portant voix de citoyen ; très peu d’ailleurs entièrement pour leur compte, la plupart d’après la procuration des citoyens frac tionnaires (2). On écartera la masse des ignorants (3) ; « on mettra la pluralité des voix décisives du côté de ceux qui ont reçu plus d’éducation (4). On supprimera le risque de compro mission des propriétaires trop dénués de ressources : « A Dieu ne plaise que je conseille jamais à V. M. d’ouvrir une porte par où la corruption vénale pût pénétrer jusque dans les campagnes. Il en faudrait cent pour qu’elle sortît du reste du pays (5). » Enfin l’amour-propre rival des particuliers les poussera à fournir des déclarations exactes de leurs revenus respectifs (6). A condition de remplir les conditions ci-dessus prescrites, les membres des 3 ordres participeront, cela va de soi, à la constitution et au fonctionnement des municipalités villa geoises : mais nous savons déjà que celles-ci se réuniront en Assemblée petite, moyenne ou plénière, suivant que leurs délibérations intéresseront un seul ordre, ou deux, ou les trois ensemble (7). Mais, « malgré les arrangements qui peuvent1234567 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Knies, t. I, p. 263. Œ. T., p. 515. Ibid., p. 516. Knies, p. 255. Cf. Knies, p. 254. Cf. Œ. Γ., p. 516-517. V. Sup., Il C., p. 38*
126
LA P H Y S IO CRATI E SOUS LE M I N I S T E R E D E TURGOT
être convenables pour ne pas porter atteinte aux privilèges actuels du clergé et de la noblesse, ce n ’est point comme ordres distincts dans l’É tat, mais comme citoyens proprié taires de revenus terriens, que les gentilshommes et les ecclésiastiques en feront partie... Les Assemblées ne sont point des États... » (1), même en miniature. La seule compétence essentielle que leur accordait Dupont de Nemours, se bornait à la répartition des impôts (2) et à l’administration des travaux publics. Il convenait donc, selon l’orthodoxie physiocratique, que leurs membres fussent exclusivement des représentants de la propriété foncière rurale ; ceux-là seuls devant concourir à la répartition fiscale, parce que seuls ils devaient supporter la masse des imposi tions (3) ; de même l'organisation des travaux publics de paroisse les intéressait au premier chef : « Dans l’état actuel, les rues et les abords de la plupart des villages sont imprati cables ; les laboureurs sont obligés de multiplier inutilement et dispendieusement les animaux de trait pour voiturer leurs engrais et leurs récoltes, pour conduire leurs denrées au mar ché, pour tous les charrois qu’exige leur exploitation. Il leur en coûte beaucoup plus pour ces animaux, et pour le temps perdu, ou les harnais brisés, qu’il ne faudrait pour réparer les mauvais pas. E t quelle que soit la pauvreté des campagnes, c’est moins l’argent qui manque pour les chemins vicinaux, puisque leur défaut occasionne plus de dépenses que ne pourrait faire leur réparation ou même leur construction ; ce qui manque, c’est l’esprit public et la forme pour rassembler, notifier et rendre actif le vœu des habitants. L ’assemblée municipale s’occuperait de ces points qui, répétés en chaque lieu, peuvent donner plusieurs millions de profits sur les frais de la culture et sur ceux du commerce (4). E t de même que la nouvelle administration fiscale exigerait la confection d’un terrier général du royaume ou cadastre, l’ouverture des chantiers publics vicinaux impliquerait une rénovation de la police locale des pauvres : l’une et l’autre opération, par une conséquence naturelle, relèveraient des municipalités villa geoises. » Mais les Vues de Turgot dépassaient singulièrement celles1234 (1) Cf. Knies, t. I, p. 263 et Œ. Γ., p. 505. (2) Cf. Œ. X., t. II, p. 544.1)., Lettre au Journal de Paris, 2 juillet 1787. (3) La Cour des Aides réclame également la répartition des impôts par les contribuables eux-mêmes. Remontrances, 6 mai 1775. (4) Œ. X., t. II, p. 518 et Knies, t. I, p. 258.
PO L IT IQ U E ET P H I L O S O P H I E D E S P H Y S lO C R A T E S
127
de la Physiocratie. « Il aurait désiré que Γοη joignît à cette constitution fondamentale des mesures qui donnassent une claire et complète garantie de la liberté des personnes, de celle du travail, de celle du commerce et de toutes les propriétés mobilières, aux natifs et aux habitants non propriétaires, mais dont le bonheur est le seul gage d’une active, d’une effi cace concurrence pour l’exploitation du territoire ; pour les fabriques, pour les manufactures, pour tous les moyens intérieurs et extérieurs de porter le territoire à sa plus grande valeur (1). » « Il croyait utile de leur confier plusieurs brahches de police qui, pouvant toucher à la liberté des trois ordres, demanderaient que le vœu même de ceux qui n’ont point de propriété foncière pût être connu et contribuer à éclairer le gouvernement sur le choix des personnes à qui serait remis l’exercice de cette portion de l’autorité (2). » Les adminis trations municipales auraient ainsi compris, à côté des membres délibérants, des sortes de membres « consultants » élus par un collège beaucoup plus large que l’École ne l’avait jamais envisagé. Le Mémoire Dupont-Turgot comportait, en tout cas, toute une hiérarchie d’Assemblées issues les unes des autres par voie de suffrage : Assemblée du deuxième degré ou d Élection; du troisième degré ou Provinciales, et enfin, au sommet, une Municipalité Royale (3). La Cour des Aides, dans ses Remontrances du 6 mai 1775, réclamait aussi, pour l’assiette et la perception des impôts, la création d’Assemblées provinciales, sinon le retour aux États-Généraux. Ni les Physiocrates, ni Turgot lui-même, ne pouvaient être partisans d’une résurrection de ces derniers, qui pouvait revigorer au profit des privilégiés les distinctions d’ordres et compromettre gravement du même coup, l’absolutisme monarchique. Tout cet échafaudage d’organisations électorales aboutissait toute fois à placer à côté du roi une Assemblée Nationale. Certes, ce n’était encore qu’un corps consultatif, auquel on refusait toute part du pouvoir législatif et le vote de l’impôt ; le roi gardant toute faculté d’en déterminer le montant global. Les ministres y auront séance ; le Roi pourra l’honorer quelquefois de sa présence, assister à ses délibérations, ou lui déclarer ses123 (1) D., Note à Œ. 7\, t. II, p. 550. (2) D., Lettre au Journal de Paris, 2 juillet 1787. Cf. Schelle, Dupont, p. 195, et Ctomel, Turgot et Necker, p. 153. (3) Cf. Knies, t. 1, p. 273-277.
128
LA. PHYSIOC.RA TIE SOUS LE M I N I S T È R E D E TURGOT
volontés. C’était un peu comme une Société centrale des Agriculteurs de France, associée par le roi à l'administration générale du royaume ; point du tout une de ces contre-forces capables de résister à la puissance royale et destinées à la restreindre, que l’École condamnait sévèrement ; simplement un auxiliaire docile, le rouage central d’un mécanisme bien agencé (1). Si limitées que fussent ses attributions, elle devait cependant encourir la réprobation du vieux chef du parti : moins libéral en cette matière que le fondateur lui-même, le marquis de Mirabeau regardait ce système politique comme le produit d’ « une tête fêlée philosophique à la mode de ces Messieurs, et allant à tout confondre » (2). La modeste réforme qu’il avait personnellement esquissée en 1771 était, à son avis, dangereusement dépassée. C’était aussi selon lui une hérésie, que de constituer sur un plan analogue des municipalités urbaines. Pourtant les villes ont leurs prôpriétaires fonciers, les possesseurs des terrains et des maisons, qui se trouvent par là plus ou moins fortement attachés à l’É tat : car ce sont « choses qu’on ne peut pas emporter ». Seulement ce sont aussi richesses très incertaines : « Si la ville prospère et se peuple, les maisons se louent chère ment. Si le commerce n ’y fleurit pas... les hommes et les capitaux vont ailleurs ; les loyers baissent quelquefois au point que l’entretien des maisons devient à charge et qu’on les laisse tomber. » Même en dehors de ces crises, une maison « était par sa nature, périssable ; une famille qui en tire sa subsistance exclusivement n ’est pas une famille fondée dans l’État ; elle n ’y est qu’à terme et à poste. Elle n ’y peut durer que le siècle que durera le bâtiment, et si, pendant le cours de ces cent années, elle n ’a pas acquis ou économisé un nouveau capital égal pour en reconstruire un autre, elle n'a plus d’existence qu’en raison de la valeur du terrain, qui. lui, demeure... C’est donc à la valeur du terrain que se réduit le véritable et solide lien du propriétaire de maison à la patrie, son véritable moyen de faire subsister ses enfants, son véri table droit de cité... » Son cas se trouve alors ramené à celui du propriétaire d’un champ de 600 livres de revenu, lequel peut, à toute force, et dans les plus grandes calamités qui lui12 (1) Esmein, 1904, p. 398-399 et 402-405. « Ce serait, dit Turgot, le faisceau par lequel se réuniraient, sans embarras, dans la main de V. M., tous les fils correspondants aux points les plus reculés et les plus petits de votre royaume. » Ed. Daire, t. II, p. 540. (2) M., lettre au BaiUi, 29 août 1778, cité par Loménie, t. II, p. 411.
P O L I T IQ U E ET P H I L O S O P H I E DES P H Y 3 IO C R A T E S
129
feraient perdre 9es cultivateurs, « devenir cultivateur luimême ; se retirer sur son domaine et y faire subsister de son travail sa famille citoyenne ». Il est par conséquent naturel et juste que, dans les municipalités urbaines, une voix entière — ni plus, ni moins — soit attribuée au possesseur d’un terrain — bâti ou non — dont le revenu agricole éventuel serait de 600 livres, ce qui à 4 % correspond à environ 15.000 livres en capital (1). C’est sur cette base, « en raison de la distribution de leurs voix » que devrait être acquittée par les propriétaires fonciers urbains, par exemple, la taxe en remplacement des octrois (2). Pour se soulager, d’autre part, du poids de leurs dettes, lee villes se procureraient des res sources considérables par la vente de certains immeubles municipaux, tels que les greniers d’abondance devenus inutiles, ou les hôpitaux mêmes, que remplacerait pour la plupart un service médical à domicile (3). IV. — Philosophie des Physiocrates Si l’on s’en rapportait à certaines expressions du marquis de Mirabeau, ce serait une sorte de religion : « Les économistes, déclare-t-il, ont voulu, désiré, recommandé que tout le monde concourût à ce rétablissement de la théocratie bienfaisante et adorable (4). » La Science œconomique n ’est autre chose que la « politique du Ciel » (5). Mais celle-ci n ’eet en fait que la « politique de l’Ordre », de « l’Ordre Naturel » (6) dont les lois sont « simples et immuables ». Lorsqu’on s’en est écarté, c’est encore avec une sage prudence qu’on doit insensiblement y revenir : « Il ne faut jamais causer des ébranlements violents aux corps politiques, non plus qu’aux animaux et aux plantes ; — sans soubresauts et sans efforts, il faut en ramener douce ment les branches, comme il faut plier celles d’un arbre, en laissant à la sève les moyens de prendre la nouvelle direction, avec cette lenteur que Dieu à mise au mouvement géné ral (7). » S’inspirant plus directement encore de Malebranche, Dupont et Turgot peuvent bien assurer le Roi qu’il lui serait (1) B. Γ., Mém. Municip. (Œ. T., t. II, p. 527-530). (2) Ibid., p. 533. (3) CI. op. cil., Knies, t. I, p. 270. (4) Af., Critique de la Déclaration des Droits de Virginie, Mss., M. 784, n° 1, p. 11. (5) Ai., Supp. Th. Imp., Dédicace, p. v i i . (6) Ibid., p. 177. (7) Éph., 1775, n· 1, p. 185. G. W E U L F .R S SE
9
130
la
p h y s io c r a t ie
sous
l e
m in is t è r e
DE TURGOT
loisible de « gouverner comme Dieu par des lois générales » (1). Mirabeau lui-même avoue que « terrestrement parlant, Dieu n’est autre chose que la raison universelle » (2). Cette métaphysique sommaire sert à couronner toute une morale sociale qui est celle de l’intérêt éclairé. Célébrant la mémoire de Quesnay, G. H. Romance met en épigraphe à son Éloge, ce passage de Lucrèce qui dans le Poème de la Nature s’applique à Épicure : « Ce fut lui, le premier, qui trouva ce principe de moralité, et dont la sagacité tira la vie humaine des ténèbres de l’ignorance et des fluctuations de l’opinion, pour lui donner une assiette fixe et invariable, sous l’empire de l’évidence » ; « dans la nuit de l’humanité, abrège Condorcet, Quesnay porta le flambeau de l’intérêt et de l’évidence » (3). Critiquant les moralistes anciens, notamment les Stoïciens, Mercier de La Rivière « ne voit dans leurs écrits sublimes que des maximes abstraites, la plupart imaginées pour d’autres êtres que des hommes ; des règles de conduite tellement étrangères à la nature quelles mettent l’homme perpétuellement en contradiction avec lui-même. S’ils nous ont peint quelquefois de grandes vérités, ils n’ont jamais cherché à nous les rendre sensibles et intéres santes, à les réduire en pratique, en nous prescrivant une méthode sûre pour ne pas nous en écarter. Leurs grands mots vides de sens n’ont rien qui puisse les faire passer de l’oreille au cœur... Quelques éloges qu’ils donnent aux vertus, ils ne nous ont point appris pourquoi elles sont nécessairement vertus ; ils nous laissent ignorer les rapports qu’elles ont avec l’intérêt général ; ils ne nous les présentent point comme étant les seuls et uniques moyens de concilier avec cet intérêt général l’intérêt particulier de chaque individu » (4). « Il n’est pas donné à l’homme, poursuit à l’unissonBœsnier, de connaître l’essence des choses [le Bien en soi que nous proposent Platon et Cicéron] ; il n ’en peut avoir d’idée que (1) Mèm. Municip. (Œ. Γ., t. II, p. 504). (2) M., Lettre à Longo, 5 septembre 1775 (Mèm. Montigny, t. III, appendice p. 479). On retrouve parfois chez Mirabeau comme des survi vances de la morale spécifiquement chrétienne ; par ex. : « De notre temps on a tout tourné vers l’objet de rendre l'éducation moins pénible ; et je n'y voyais, moi, de· bon que la peine, ce substitut du malheur, mattre nécessaire et souvent trop tardif de l’homme. » Lettre à Longo, 5 se p t 1775, Mm. Aix, XVI, p. 26. (3) Commerce des Blés, p. 61. (4) Mèm. Inst. pub. (É ph., 1775, ne 9, p. 173-174). Cf. Chastellux, d’après Sicot, p. 16.
P
o l it iq u e
e t
p h il o s o p h ie
d e s
p h y s io c r a t e s
131
par les effets qu’il en éprouve, que par les relations que les choses ont avec lui. Qu’est-ce donc que le juste ? Qu’est-ce donc que Yhonnête ?... Ce sont les lois nécessaires qui dérivent de la nature de l’homme comme ayant des rapports néces saires avec ses semblables, et comme capable de les sentir par le jeu des sanctions naturelles... Si les philosophes de l’antiquité avaient fait attention à cette dernière vérité, ils auraient reconnu que le juste et Yhonnête sont absolument la même chose que Vutile... ils en auraient conclu que la morale et la politique sont la même science. L ’une est une dépendance de l’autre. Si elles diffèrent entre elles, c’est uniquement en ce que la morale considère l’homme seulement comme être social et intelligent, tandis que la politique le considère en outre comme être physique (1). » Ces derniers mots laissent poindre le caractère original de la morale physiocratique. Encore la question est-elle de savoir comment, dans la pratique, se réalisera cette identification fondamen tale du juste et de l’utile ; sera-ce par l’établissement d’un système d’éducation publique approprié, ou par le simple effet de bonnes institutions ? La Rivière recommande l’un et l’autre moyen. L ’unité de l’instruction est essentielle pour assurer celle du corps politique ; mais il est également indis pensable que « ce corps soit organisé de manière à rendre utile la pratique de la vertu ; que son gouvernement soit assez sagement combiné pour que personne ne puisse devenir vicieux sans se rendre malheureux ; pour que personne encore ne puisse se rendre heureux qu’en devenant vertueux » (2). Selon Condorcet, « c’était dans les mauvaises lois que M. Turgot voyait la source des mauvaises mœurs » (3). Mais, au delà de ces considérations procédant en grande partie d’Helvétius, les plus purs Physiocrates assignaient à leur morale sociale une base d’autant plus solide, pensaient-ils, qu’elle était plus étroite : savoir l’économie politique telle qu’ils l’entendaient, fondée elle-même sur une certaine économie agricole. La prière quotidienne que le propriétaire laboureur en mourant transm et à ses enfants, par la bouche de Mirabeau, est un hymne à la Terre : « Je te salue, ô toi qui me soutiens, me nourris, me réchauffes, organe actif des bienfaits de l’Éternel ; toi que je foulais d’un pied123 (1) Bœsnier, Disc, prélim., p. 11-13. (2) Mém. Inst. Pub.y passim ; notamment Éph., 1775, n° 10, p. 1 09. (3) Vie de Turgot (Œuvres, t. V).
132
LA P H Y 9 I 0 C R A T I E SOUS LE M I N I S T È R E DE TURGOT
méconnaissant, tandis que sur ton sein fécond l’Auteur de la Nature étendait la verdure, dorait les fruits, émaillait les fleurs et souillait l’esprit de la vie... ! Je te salue, et désormais, puisque j ’ai vu l’enchaînement par lequel tous les travaux correspondent à ton culte, je ne m’écarterai jamais de l’Ordre qu’il nous prescrit. C’est à cet ordre que je rapporterai, non seulement mes œuvres, mes dépenses, mais mes opinions, mes recherches, mes découvertes, ma conscience enfin ; c’est dans cet Ordre que je trouverai la solution de tous mes doutes, la règle précise de tous mes devoirs (1). » Bénie soit « cette lumière inextinguible à jamais jetée sur la solidarité physique des hommes... 1 La liberté active, l’équité distributive, la charité fraternelle, l’unité de tous les intérêts, 9ont les quatre vertus... Le calcul et la distinction de9 avances et du produit net ne sont plus un secret pour la pauvre espèce humaine fascinée ; tout tenait à cela... » (2). Mais l’abbé Baudeau, de donner à ces accès de lyrisme religieux et d’enthousiasme idéologique, la sèche contre-partie matérielle, non moins orthodoxe que voici : « Ne savez-vous pas que c’est la terre seule qui doit et qui peut payer toutes les avances, tous les travaux quelconques, depuis ceux du monarque jusqu’à ceux du dernier des plus pauvres manœuvriers... ? Ne voyezvous pas qu’en tout et partout ce sont les hommes et les animaux de service qui font la dépense, et que ce sont les productions inanimées qui fournissent la recette (3) ? » Pour ouvrir la même perspective sociale, à égale distance, pourrait-on dire, de ces deux points de vue spiritualiste et matérialiste, le comte de Mirabeau invoque la psychologie humaine : « Tout individu a des droits et contracte par cela même des devoirs, dont l’existence est de premier intérêt, et du plus évident avantage pour chacun, puisque ses droits y tiennent inséparablement. Droits et devoirs, voilà le balancier de l’humanité. Ce n ’est point un étalage affecté de morale, c’est la base de calcul de la société, et chaque homme trouvera la démonstration de ce principe dans sa propre expérience quand il voudra l’y chercher (4)... Si l’on disait à un souverain qu'il n'est élevé au-dessus des hommes que pour leur avantage, ce serait offrir une vérité également évidente et respectable ;1234 (1) M., J . A., 1774, n· 11, p. 49-50. (2) Ai., Éloge funèbre de François Quesnay, éd. Oncken, p. 6, 9 et 13 (20 décembre 1774). (3) B., Mémoire sur les Corvées, p. 22. (4) Essai sur le despotisme, p. 88-90.
P O L IT IQ U E ET P H I L O S O P H I E DES P HYS IOCRA TE S
133
mais assurément, il ne la croirait pas, et cette moralité l’ennuierait beaucoup, si même elle ne l'irritait pas... Aux rois, qu’im porte la postérité ? Ah ! si vous voulez qu’ils soient justes, démontrez-leur qu’ils ne peuvent cesser de l’être sans risquer de se perdre. Peut-être alors la réflexion balancera-t-elle l’instinct. Croyez que leur intérêt sera toujours leur boussole... Un homme de beaucoup d’esprit a dit : Quand Viniérêl veille dans notre cœur, il y annonce le sommeil de la Nature, ce n’est qu’une pensée très fausse et une phrase brillante. L’intérêt est le premier appétit et le plus sûr mobile de la Nature. Traitons donc les Rois en hommes... (1). » Cette même morale sociale agricole des Physiocrates doit régir aussi les rapports entre nations. « La science économique apprend que la prospérité des États voisins contribue à celle de l’État qu’on gouverne, parce que la prospérité multiplie les hommes, et les consommateurs par conséquent, et que l’agriculture ne fleurit que par la grande consommation (2). Condillac généralise hardiment au delà même des limites de l’École : « Faire et laisser faire », voilà donc quel doit être l’objet de toutes les nations. Un commerce toujours ouvert et toujours libre peut seul contribuer au bonheur de toutes ensemble, et de chacune en particulier (3). » Le point de vue plus proprement technique se précise chez Roubaud. L’abbé trouve mauvais qu’on prétende cacher tel procédé nouveau de fabrication des vins ; « les lumières sont faites pour se répandre indistinctement par delà les frontières ; les manufactures peuvent à la rigueur, et encore ? cacher leurs découvertes : maie l’agriculture ? elle est « à ciel ouvert » ! La libre communication réciproque des méthodes nouvelles assurera le perfectionnement général, il ne faut même pas craindre de livrer ses propres inventions à tels voisins qui vous refusent les leurs ; en restreindre la publicité, c’est s’exposer à s’en priver soi-même, en en compromettant la diffusion de province à province » (4). Élargissant de nouveau l’horizon, tout en restant dans la ligne physiocratique, Condorcet fait ressortir que « la supériorité de population qu’on doit à l’industrie est [souvent] aux dépens de celle des autres pays ; celle qu’on devrait à une plus grande perfec-1234 (1) (2) (3) (4)
Ibid., p. 85 et 87. Êph., 1775, no 1, p. 183. Commerce et gouvernement, p. 429. Ct. B., J . A., 1774, n» 7, p. 8-35.
134
LA P H Y S IO C H A T IE SOUS L E M I N I S T È R E D E TURGOT
tion de l'agriculture serait tout entière au profit de l'espèce humaine ; pourquoi ne préférerait-on pas à une politique qui traite les étrangers en ennemis, celle qui les traiterait comme des frères »? (1). Turgot de son côté, anticipant sur certains plans du futur Saint-Simonisme, envisagerait une libre et harmonieuse distribution internationale des industries, qui éviterait « les pertes onéreuses à l'humanité » qu'entraînent les protections exclusives ou les prohibitions d’ordre national (2). En tout cas, et à tout le moins, les Économistes professent un pacifisme sincère et résolu. Le libre-échange général apaiserait les conflits économiques et coloniaux ; nul n’aura intérêt à attaquer vos colonies si tout le monde peut commer cer avec elles (3). A propos des bruits de guerre dont reten tissait l’Europe vers le milieu de 1774, Baudeau s’en prend aux « tracassiers politiques » de la diplomatie : « Ne laisserezvous jamais en repos ce pauvre genre humain (4) ? » Mais « ils ont beau s'agiter : ils ne feront pas de guerre : les souverains n ’en veulent plus ; elle est trop chère » (δ), n ’assurant la fortune que des commis dilapidateurs. « Ah 1 si nous pouvions avoir longtemps une bonne paix générale (6) ! » « La guerre offensive est le comble de la folie humaine (7). » Mirabeau célèbre l’invincibilité profonde des résistances nationales : « jamais un peuple ne fut conquis qui ne voulait pas l'être » ; ce n'est pas dans un « grand pays agricole, que « l'attaque « extérieure risquerait d'être regardée comme diversion « plutôt qu’ennemie, l'Étranger sachant se montrer moins « fiscal que le Citoyen ». Ainsi point de forces intérieures démesurées : « Jamais une révolution ne se fit que par les moindres armées ; et c'est toujours au plus puissant à désar mer le premier. » « Les expéditions maritimes sont un délire, une ruine et un incendie universel ! Surtout la guerre d’arma teurs, semblable à celle qu'on déclarerait au labourage, doit être plus odieuse à l'humanité que la piraterie du forban, puisque ce dernier s'estime scélérat... au lieu que la contre-1234567 (1) Réfl. Comm. blés (Œ., t. X I, p. 157). (2) D., Mém. Turgot, I I e Partie, p. 206. (3) Ibid., p. 139. (4) Chronique secrète, 25 juin 1774. (5) Ibid., 17 août 1774. (6) Ibid., 20 septembre 1774. (7) Article d'un officier général anonyme, inséré avec éloges par Bau deau, Êph., 1775, n° 1, p. 171-172.
P O L I T IQ U E E T P H I L O S O P H I E DES P H Y S IO C R A T E S
135
marque déshonore les gouvernements... flétrit les nations, et attaque la Nature même (1). » E t le marquis de conclure : « Mon plan roule sur le rapprochement des princes et des peuples. Les royaumes se conquièrent à la pointe de l’épée, quelquefois sans doute ; mais ils ne se fondent et ne se peuvent maintenir qu’à la pointe de l’esprit : l’esprit de bienfaisance. Sans cela, rien ne tient, et la politique méfiante et exclusive est la décevante et fatale médecine des palliatifs (2). » Conformément à la logique de leur science, les Physiocrates considèrent que certains principes régissant les sociétés humaines, ont une valeur et une portée universelles. Il existe, selon eux, des lois fondamentales « convenant égale ment à tous les peuples puisque l’objet de la société est partout le même » (3). « Citoyen de l’Univers, comme l’illustre auteur du Télémaque et l’honnête abbé de Saint-Pierre, je pourrais dire même comme Henri IV — [on ne cite point Montes quieu] — l’Économiste embrasse dans ses vues toutes les nations policées (4). » Il ne s’ensuit pas cependant qu’il ignore les vicissitudes de l’histoire, les contingences des temps et des lieux, ou qu’il se refuse à les confrônter avec ses conclusions dogmatiques. jMirabeau. examine le passé avec indépendance, sinon toujours avec équité, et non parfois sans pénétration ; nous en pouvons juger par telle critique de la grandeur romaine : « Le fisc de Rome, fondé d’abord sur le pillage, ne put jamais prendre d ’autre forme et ne fut jusqu’à la chute de cet Empire déprédateur que rapine et concus sion (5). » Ou bien tel plaidoyer en faveur de la ^Féodalité : « On a pris à tâche, dans ces derniers temps, de livrer à l’ana thème ce gouvernement ; il n ’est écrivailleur, qui à peine en traite l’histoire sur des tables chronologiques, qui ne lui donne son lardon. C’est un préjugé de ces sottes villes, qui ne vivent que de trafic, de chicane, de maltôte ou d’usure, tous objets qui dans les temps de barbarie n’eurent pas à se louer de l’ordre public ; comme aussi le bourgeois, trop humilié dans les temps militaires, cherche à bon droit à prendre aujourd’hui sa revanche sur son palier. J/ordre médiéval ne fut point la barbarieT il aida même en quelque manière T en sortir et empêcha qu’elle ne détruisît tout. Il répara les12345 (1) (2 ) (3) (4) (5)
Af., Supp. Th. /rnp., p. 134-141. Ibid., fin du Discours préliminaire. Condorcet, Vie de TurgoL n 181. Êph., 1775, η« 3, p. 5 7 . F’ Ai., Supp. Th. Im p.9 p. 9 gt
136
la
P H Y S IO C R A T IE SOUS LE M I N I S T E R E D E TURGOT
pertes énormes de la France après les guerres affreuses des enfants de Charlemagne, les ravages des Normands, nos convulsions et nos désastres ; et du tout ensemble, il en fit un corps, bien affaissé sans doute, bien chargé d'humeurs. Mais enfin toute l’Europe était ravagée, partagée, sauvage : chaque contrée actuelle était découpée en petits royaumes ou principautés ; tandis que la France fut un royaume, eut des rois connus par leurs vassaux quoique indépendants, et redou tables au dehors, où seulement ils pouvaient donner des ordres et les faire exécuter. Là fut le seul inlérim qui pût régir un pays de conquête en attendant des lois... (1). » Des événements de la politique contemporaine, lesPhysiocrates continuent de donner une interprétation conforme à leurs principes et propre selon eux à les justifier : deux pays retiennent leur attention, l’Angleterre et la Pologne. « Ruinée par la disproportion et par l’enflure de ses entreprises ; par la défectuosité de ses emprunts, qui hypothèquent le corps de l’État et forcent à l’économie future une nation où toutes les mœurs politiques et privées sont poussées vers l’extrémité contraire ; par le genre de ses impositions, toutes en excises, et par leur effet contraire -au cours naturel des dépenses, toutes dévorantes ; l’Angleterre bénéficie pendant un temps de quelques-unes de ses institutions accessoires, comme Vimmu nité de la charrue, comme la liberté et Vencouragement de Vexporialion. Toutefois, pour le principal, la prospérité de ses campagnes doit être considérée comme celle de la banlieue des grandes villes... Elle apparaît comme le théâtre néces saire de révolutions très prochaines et désastreuses (2). » Quant à la République de Pologne, « Messieurs les Patriciens ont fait de leur roi un Romulus dans la tempête : chacun en a emporté un morceau ; à l’égard du peuple, ils en ont fait du bétail, et puis ils se sont appelés la Nation ». Avec cela, pas plus qu’à ses débuts, l’École ne dédaignait d’appuyer et parfois de modifier ses théories par des calculs tirés de l’observation, tantôt voisine et quotidienne, tantôt plus lointaine et comparée. Faisant allusion aux chiffres cités dans les articles Fermiers et Grains, Mirabeau précise que ce sont là « des données qui, comme de droit, varient selon les lieux, le sol, le climat et les débouchés... Elles valent pour un pays de labourage où le froment est l’unique culture et12 (1) Λί., Discours de rentrée, 1776-1777, M. 780. n° 6, Ai«., p. 32. (2) M. au comte Bathyani, 11 octobre 1775, Mss. A ix, XVI, p. 27.
P O L IT IQ U E ET P H I L O S O P H I E DES P H Y SIOCRA TE S
137
fournit un grand débouché de mangeurs de pain » ; le Milanais de son ami Longo est « un canton de cultures privilégiées, où Ton fait des prairies, du riz, des vergers, des jardins potagers et des cultures à bras pour l’énorme population. Les calculs du Docteur y seraient encore plus défectueux qu’ils ne sont ; et cee jardiniers, s’ils se mettaient des lunettes, diraient que leur patron n’était qu’un sot » (1). Mais « on a reconnu, écrit un obscur disciple à propos du Tableau Économique, par les recherches et les expériences les mieux suivies dans les provinces de Picardie, Normandie, Beauce, Brie et Ile-deFrance, qu’il y a une proportion constante entre les avances primitives et les avances annuelles en raison de 1 à 5 » (2). Ainsi, du faîte, du couronnement, de ce vaste édifice doctrinal, nous redescendons à ses fondations originelles. Car c’est bien une œuvre constructive, cohérente et solide, que les Physiocrates ont accomplie : « Il y a déjà bien des années qu’une dame fort sensée leur avait dit : On esl heureux, Messieurs, que vous soyez arrivés pour montrer Varl , 31 août 1776, M m . A ix, XVI, p. 49.
C h a p it r e
V
ATTAQUE ET DÉFENSE DU SYSTÈME I. — Le véritable intérêt des propriétaires fonciers Des profits résultant à la fois du progrès de l’agronomie et de la hausse des denrées agricoles, les propriétaires fonciers seront-ils les vrais bénéficiaires ? Ne sera-ce pas tout autant, et même davantage, la classe des gros fermiers ? « Le proprié taire, écrit imprudemment Condorcet, ne peut se passer du cultivateur ; et le cultivateur, avec ses bras et le capital de ses avances premières, peut se passer des propriétaires (1). » Mais n’était-ce pas précisément parce que, « grâce à la longueur de leurs baux, les fermiers cultivaient leur ferme avec le même intérêt que si elle eût été à eux, que les propriétaires trouvaient grand avantage à chaque renouvellement de bail, augmentant chaque fois considérablement leur'revenus ? » (2). Ne faut-il pas, cependant, à ces grandes exploitations un minimum de main-d’œuvre ? La suppression des jurandes, que l’École a introduite dans son programme, n ’est pas faite I pour l’assurer. Le Parlement de Paris, dans ses Remontrances du 4 mars 1776, ne manque pas de retourner contre l’essentiel du programme physiocratique un de ses articles de second plan : « Une considération a peut-être échappé à l’adminis tration, c’est que ce système allait contre son objet. Si la liberté [du commerce agricole] pouvait offrir quelque avantage, c’était d’attacher le cultivateur à la glèbe et de ralentir ces émigrations prodigieuses qui se portent vers les villes. Les habitants des campagnes, aujourd’hui séduits par l’espérance d’un petit négoce, ou détournés par des spéculations trom peuses, y afflueront encore davantage (3). » « La législation123 (1) R ifle X. Corn. B lés (Œ ., t. X I, p. 116). (2) Condillac, C om m . et Gouv ., p. 437. (3) Cl. R em ontrances , t. II I, p. 318.
A T T A Q U E ET D E F E N S E DU SY S TE M E
139
nouvelle fera déserter les campagnes, et les travaux de la culture paraîtront une servitude intolérable en comparaison de l'oisiveté que le luxe entretient dans les cités (1). » De même, le rachat des droits féodaux « dégoûtera les seigneurs richfs d’aller porter une partie de leurs dépenses dans leurs habitations, d’où les violences et l’insubordination de leurs vassaux les forceront de s’éloigner » (2) : voulait-on aggraver un Absentéisme qui précipiterait la dégradation des petits fiefs ? omment, par ailleurs, les seigneurs seront-ils indemnisés i perte de leurs droits de halle et de marché ? Baudeau que que « le droit de contraindre l’apport au marché, celitf d’empêcher les ventes faites en dehors, n’existaient pas légalement à l’origine... Et puis les seigneurs en retirent peu, les frais et faux-frais et les bénéfices des régisseurs absorbant presque tout... E t puis les halles et marchés [devenus libres] n’en jseront point pour cela déserts, quoi qu’on affecte d’en dire... Enfin ces mêmes seigneurs n’ont-ils pas des dîmes, des champarts ou terrages, et des lods et ventes, dont le produit s’accroîtra sensiblement ? N’ont-ils pas, surtout, leurs fonds, dont le prix et la location augmenteront en proportion de la liberté, en dehors de toute indemnisation royale ? Ils ne doivent pas regretter la très petite diminution qu’ils subi ront » (3). Il est possible que ces perspectives diverses aient incité les seigneurs à augmenter immédiatement le taux de leurs redevances traditionnelles ; elles ont pu aussi provoquer une certaine agitation parmi des populations « peu enclines à s’embarrasser des formalités d’une réforme graduelle. La brochure de Boncerf, condamnée par le Parlement, vient justement de réaliser les désordres que M. Séguier a présagés dans son réquisitoire. Le marquis de Vibray [Sarthe] ayant voulu faire payer par un de ses paysans un droit de cens qu’il lui devait, ce dernier a refusé ; et sur ce que son seigneur l’a fait mettre en prison, 30 à 40 paysans se sont ameutés pour réclamer leur camarade... Sur un refus, ils se sont pourvus d’armes et sont revenus en force assiéger le château, où ils ont tout saccagé, au point que M. de Vibray a dû céder et même sauver sa vie par la fuite. Cet événement... donnera123
f
(1) D iscours de l'avocat général Ségu ier. Î i t . de justice du 12 mars 1776 (T., t. II, p. 335). (2) R em on trances du 18 avril 1776 sur l’interdiction des poursuites contre Boncerf, Flam m erm ont, t. II I, p. 365.
(3) B., Lettres et Mémoires, p* 144-145.
140
LA P H Y S Ï O C R A T I E SOUS L E M I N I S T È R E D E TURGOT
encore de la tablature à M. Turgot. Un exemplaire de la bro chure, lu dans le village, a occasionné cette rumeui ; et partout où on lira cet écrit, on peut s’attendre que le peuple sera de l’avis de cet écrivain, comme il serait de l’avis de celui qui proposerait de ne plus rien payer au Roi » (1). Si, avec cela, « les Américains se m ettent à vendre leur blé à raison de 15 livres le setier de 240 livres poids de narc, la farine à proportion, en gagnant, tous frais déduits, 20 % sur l’objet de leurs chargements », la liberté absolue du commerce peut, n’être pas toujours à l’avantage des cultivateurs (2). Mais, en tout état de cause, « les 1.500 millions produits par la hausse des blés ne vaudront pas plus pour les propriétaires que 1.000, si les impositions, les travaux et tous les autres objets d’échange haussent en proportion »? (3). Et Mably de retourner, plus fortement encore que Necker, contre l’École sa propre argumentation. « Vous voulez enrichir les propriétaires en ruinant tout le monde ; rien n’est plus ridicule. Ne faut-il pas que des vendeurs trouvent des ache teurs à leur aise ? Plus ceux-ci seront hors d’état d’acheter, moins les autres pourront vendre. Si on voulait faire fleurir l’agriculture d’une manière durable, on devait commencer par assurer la fortune, ou du moins l’aisance, de ce que vous appelez la classe stérile (4). » Autrement, « avant qu’il soit vingt ans, le royaume aura perdu un tiers de ses habitants. La consommation diminuant, le prix des blés doit aussi dimi nuer, et la misère publique vous fera enfin la loi comme vous la lui faites aujourd’hui. Votre situation sera d’autant plus fâcheuse après cette révolution que vous vous serez accoutumée à une plus grande abondance... Ou bien, en supposant que vous vous laissiez toucher par les larmes des malheureux avant que la population soit diminuée... et que vous ayez consenti à donner aux hommes qui travaillent pour vous des salaires proportionnés au prix nouveau des denrées, ayez la bonté de me dire quel sera le résultat avantageux de votre injustice et de toute la peine que vous vous donnez. Vous aurez doublé vos revenus, soit ! mais vos dépenses auront aussi doublé »(5). L’impôt surtout dévorera toute plus-value foncière... «Tout12345 (1) Mare 1775, C orresp . M é tra . Cf. R e m o n tr . P a rlem e n t P a rle, t. II, p. 421. (2) Comte de M a g n ièree (Ê p h ., 1775, n® 12, p. 34). (3) Necker, L é g isL C om m . gra in e , p. 332. (4) C om m . grain e (Œ u vres, t. X I II, p. 258). (5) Ibid., p. 276-277.
ATTAQUE ET D E F E N S E DU SYSTÈ M E
141
le monde ne comprend-il pas que l’opulente prospérité des propriétaires et des fermiers ne peut être que passagère tant que l'État aura des besoins insatiables, et le ministère le pouvoir de lever des impôts arbitraires (1) ? » « Le Roi, va-t-on jusqu’à prétendre, tire [déjà] plus en impôts sur les terres de son royaume que s’il en était Tunique proprié taire. Que doit-on augurer, après cela, d’un avenir où le prétexte d'une nouvelle dépense conduirait à demander de nouveaux secours, et où la moindre guerre les rendrait autant indispensables qu’impossibles.., tandis qu’on s’est fondé sur les besoins de l’É tat pour continuer des impôts qui devaient cesser à la paix [1763], et que depuis on en a établi d’autres, et qu’ils semblent encore insuffisants (2) ? » Et c’est le moment que Ton choisirait pour l’instauration de l’impôt territorial unique ! C’est, plus que jamais, sur ce projet que se livre la prin cipale bataille. On renouvelle, bien entçndu, les objections d’ordre technique : « Demander au particulier d’accuser sa fortune, c’est l’inviter à la fraude, puisqu’on cherche les moyens de redresser son dire par les baux à ferme de ses voisins ; mais croit-on être plus assuré par là ? Le propriétaire s’arrangera avec son fermier, passera un bail simulé, et parta gera avec lui le droit qu’il soustraira ainsi au Trésor public. » Quant au cadastre, « les Économistes n’ont pas observé que c’était une opération longue et coûteuse ; chaque année c’est la source de représentations si multipliées qu’on ne peut décider sur le fond d’une requête, que lorsque celui qui Ta présentée a payé deux ou trois fois la taxe à laquelle il avait été soumis... (3). » Mais surtout, avec plus de véhémence que jamais, on dénonce la violente contradiction qui paraît miner la base même de leur système, et Ton se fait un jeu de retourner contre leur programme fiscal la lettre et l’esprit de toute leur propre doctrine : « La pauvre agriculture, protégée avec tant d’affectation, était réellement sacrifiée au commerce et à l’industrie, qu’on affranchissait partout : cette inconséquence aurait pu déconcerter un logicien scrupuleux; mais il était prouvé que la logique d’un économiste avait des méthodes et des règles supérieures (4). »1234 (1) Mably, op. c il ,, p. 258.
(2) M m ., n° 13.796, p. 79. (3) Tifaut, R éflex io n s , p. 34 e t 26. (4) M an n equ in s , p. 34.
142
LA P H Y S IO C R A TIK SOUS LE M I N I S T È R E D E TURGOT
Est-ce que le propriétaire foncier n ’était pas déjà, en fait, très lourdement grevé ? « C’est sur lui que les impôts de tous genres se trouvent accumulés, s’écrie l’avocat général Séguier ; c’est lui qui paye la taille de son fermier ; qui paye l’industrie ; qui paye la capitation de son fermier, la sienne, et celle de ses domestiques ; enfin c’est lui qui paye les vingtièmes. Si V. M. ajoute à ces différents impôts un nouveau droit pour tenir lieu de la corvée [des routes], que deviendra sa propriété, morcelée en tant de manières ? E t pourra-t-il trouver dans le peu qui lui reste, toutes charges déduites, un bénéfice suffisant pour fournir à sa consommation, à celle de sa famille, à l’entre tien de ses bâtiments, à la culture de son domaine, dont il ne sera plus que le fermier ? (1) » Mais — pouvait-on riposter — est-ce que ce n’était pas le propriétaire qui payait aussi la corvée [des bras] sous la forme d ’une diminution du bail ? Alors ne regagnera-t-il pas le m ontant de la nouvelle taxe sous la forme d’une augmentation du bail que justifiera le soulagement du fermier ? Il y avait aussi la corvée des voitures, distincte de la précédente : très facile d’imaginer... Vous en verrez quelques-uns plus hardis que les autres qui arrheront les grains de tout un canton. Les commerçants voisins... com prendront qu’en voulant aller au secours du peuple vexé, ils123 (1) Chastellux, Vues u ltérieu res , Felic. Publ.,t. II, p. 249-250 (éd. 1822). (2) A lié n a b ilité du D o m ain e , p. 75 et p. 104. (3) Commerce des g ra in s (Œ\, t. X III, p. 263-264 et p. 273.
172
LA
PH Y SIO C R A TIE
SOUS
LE
M IN IS T È R E
DE
TURGOT
mettraient des entraves à leur propre industrie, et la cupidité formera une espèce de ligne offensive et défensive entre tous ces honnêtes gens. Un tel commerce ne doit se faire que par la voie des laboureurs : ce sont des hommes simples, dont les vues ne s’étendent qu’à quelques lieues de leur habitation. N’ayant point l’ambition sublime et vaste des commerçants et des financiers, ils se contenteront d’un profit proportionné aux facultés des acheteurs. Ils sont sans cesse obligés de faire de l’argent pour payer leur maître et les impôts ; et la médio crité de leur fortune ne leur permettra pas de se rendre des tyrans. Avec cela le commerce privé ne doit pas aller au delà de 1 eetier ou 2 ; les marchés publics représentent l’abondance publique (1). » Notre moraliste social ne réclame point de régie royale ; il préfère des régies municipales, avec corres pondance directe entre les greniers des diverses provinces, sans passer par les intendants ; « mieux vaut qu’il se perde un peu de grain que de hasarder là vie des citoyens et la tran quillité publique » (2). On ne devra exporter que des manufac tures ou des denrées de seconde nécessité (3) ; et « vous aurez beau imaginer cent moyens pour rendre aux campagnes une sorte de vigueur, je les croirai très mauvais tan t qu’ils excite ront des plaintes et des murmures dans la partie la plus nombreuse des citoyens. O l’admirable politique, qu’il faut soutenir par des mousquets et des baïonnettes ! » (4). « Si les Économistes continuent à me citer ta n t d’arpents défrichés et mis en valeur, tant de millions rentrés dans le royaume par l’exportation des grains, et les baux de toutes les terres consi dérablement augmentés... Je parlerai de l’augmentation des impôts ; je dirai que dans l’abondance on a éprouvé les inconvé nients de la disette ; je dirai que la charité des paroisses ne peut plus suffire à la multitude des pauvres. » Mêmes conclusions, même ton, moins moralisant, plus politique chez l’auteur anonyme d’un mémoire manuscrit : « Que le Roi consulte le clergé, la noblesse, et tous les grands ou les riches qui l’environnent, il n’en est pas un qui ne sache que la cherté des blés a augmenté ses revenus de moitié ou au moins d’un tiers. Il est si doux de se trouver plus riche, si dur de se prêter à l’être moins, que les propriétaires des1234 (1) (2) (3) (4)
Ibid.y p. Ibid.y p. Ibid.y p. Ibid., p.
267. 269-270. 281. 257-258.
ATTAQUE
ET
DÉFENSE
DU
SYSTÈM E
173
terres craignent peut-être plus la diminution du prix des grains que les peuples n’en redoutent la cherté sous laquelle iis gémissent ; il n’est donc point étonnant qu’il n’y ait aujourd’hui presque plus qu’une voix sur cet objet. Elle est si forte qu’elle étouffe celle des opprimés. Mais la raison, les lois permettent-elles d’en croire ceux qui parlent d'une chose à laquelle ils ont un si grand intérêt (1) ? » Mais voici le candidat ministre, l’anti-Turgot, champion de l’anti-Économisme. Avec mesure l’auteur de la Législation du Commerce des grains dénonce l’outrance de ses adversaires. « Les progrès de l’agriculture ne sont pas attachés strictement à la plus grande étendue du profit des propriétaires de terres ; le gain les excite sans doute à cultiver ; mais là où dix degrés de force suffisent, un demi-degré de plus n’est pas néces saire (2). » « Quant aux négociants, c’est aux chefs de l’É tat à distinguer deux classes d’hommes, qui se confondent sous ce nom ; les uns, citoyens bienfaisants, transportent des blés d’un lieu d’abondance dans un lieu de disette ; les autres, spéculateurs dangereux, rassemblent et gardent cette denrée pour profiter de la cherté, après l’avoir entretenue et peutêtre excitée (3). » « La multitude même des marchands, dans un pareil commerce, n ’est utile qu’aux propriétaires, parce que vis-à-vis de ceux-ci ou de leurs fermiers, ils ne sont qu’acheteurs ; ainsi leur concurrence est utile à ceux qui ont à vendre. Mais alors cette concurrence contrarie encore l’inté rêt des consommateurs ; car plus les marchands, par leur nombre et leur rivalité, ont élevé le prix de la denrée entre les mains des propriétaires, plus ils ont à demander aux consom mateurs en la leur revendant (4). » Entre les revendeurs, il se produit une sorte de coalition spontanée : déjà lorsqu’un propriétaire de blé se trouve être en même temps propriétaire d’argent, il peut remplir une grande partie de ses désirs sans être obligé de vendre les subsistances dont il est le maître ; et c’est ainsi que la richesse des fermiers contribue à soutenir le prix dès grains. Cependant, comme le plus grand nombre de ces fermiers, ainsi que des grands et petits propriétaires, ne thésaurisent pas, et que ceux mêmes qu’on appelle riches n’ont communément qu’une épargne modique ou passagère, par1234 (1) M s s ., n° 13.796, 1774, p. 70-71. (2) Necker, L ib . C v m m . g ra in s (M i l ., t. II, p. 251). (3) I b id ., p. 292. (4) P. 286.
176
LA PH YSIO C R A TIE SOUS LE M I N I S T È R E D E TURGOT
qui a le plus contribué à fomenter en France le désir de l’exportation des blés, c’est la loi d’Angleterre qui allait jusqu’à exciter cette sortie par des sacrifices : Ton s’est ainsi modéré en me demandant que la liberté d’exporter, tandis qu’ailleurs l’usage de cette liberté était un objet de gratification et de récompense... Mais l’Angleterre n’at-elle pas pu se tromper ? Mais les dangers qu’elle a évités, la France pourrait-elle s’en préserver de même ?... Les primes d’exportation sont simplement un moyen imaginé pour faire hausser le prix des grains dans l’intérieur d’un pays ; le renchérissement de cette denrée favorise les pro priétaires... » ; et par un astucieux ricochet l’argument porte contre la doctrine, cependant assez différente, des Écono mistes. A cette opposition, aussi grave dans le fond que modérée dans la forme, on voit se rallier Linguet, qui adopte un ton moins acrimonieux que de coutume : « Je crois une partie des éloges prodigués à la liberté très fondée ; mais je crois aussi son utilité subordonnée aux circonstances ; je la regarde comme l’émétique,... comme tous les spécifiques actifs qui guérissent ou qui tuent, suivant que la main qui les emploie est plus habile, et la préparation qu’ils ont subie plus appro priée aux besoins du malade (1). » Le Parlement de Paris, en ses Remontrances du 4 mars 1776, développe la même thèse avec ampleur : « Plusieurs épreuves infructueuses auraient dû éclairer sur le danger de ce système. Un dépéris sement marqué dans l’agriculture avait engagé François Ier, en 1535, à recourir à la liberté ; une souffrance de 9 années le força à la restreindre de plus en plus en 1544. Des règlements plus ou moins tempérés se succédèrent jusqu’à l’époque de 1601, où Henri IV fit une nouvelle tentative pour établir la liberté ; l’expérience détrompa bientôt ce grand prince. E t de ce moment les règlements se soutinrent sans interruption, parce qu’ils devinrent de jour en jour plus nécessaires à mesure que le commerce, envahissant sur la population des campagnes, livra à la discrétion des marchands de grains la vie d’un grand nombre de citoyens... Quel était le mal en 1764 ? Une culture moins étendue et plus négligée ; c’en eût été un très grand, s’il eût été tel qu’on le dépeignait. L’erreur de tous les partisans de la liberté ne vint que de ce (1) L eü re à l'abbé R o u b a u d bre 1774, t. I, p. 189, en note).
(J o u rn a l p o lit, et littéra tu re ,
n° 5, 5 décem
ATTAQUE
ET
DÉFENSE
DU
SYSTÈM E
177
que 5 ou 6 années d’abondance consécutives avaient accumulé dans les mains du cultivateur des excédents multipliés que la rigueur des règlements existants, ou celle des administrations de plusieurs provinces, condamnait à l’inertie, mais que des règlements seuls pouvaient mettre en activité, afin que l’épui sement ne succédât pas subitement à la richesse... (1). » Suit l’explication financière de l’Édit de 1764, telle que nous l’avons déjà vue présentée par Mably. « Les ressources de (’Administration étaient épuisées ; on ne pouvait plus asseoir un surcroît d’imposition que sur les denrées de luxe ou de fantaisie ; mais c’était les faire tomber. Il restait de l’asseoir sur les denrées de nécessité ; ce qu’on ne pouvait faire qu’en le faisant porter sur les propriétés. Il fallait qu’une secousse les préparât à subir de nouvelles charges ; en soutenant l’augmentation du prix des grains, on amena celle des fermes et du produit des terres. Aussitôt on força arbitrairement la perception des vingtièmes, en augmentant les tailles et la foule d’impôts qui les accompagne. 11 était impossible que le poids de ces nouvelles taxes ne refluât sur toutes les classes de citoyens, parce que le propriétaire, déjà maître du prixj de ses denrées par la liberté, devait leur faire supporter? les surcharges. Bientôt le contre-coup se fit sentir sur toutes | les fortunes (2). » « Les progrès de la culture avaient été sensibles ; les grains n’ayant jamais varié que dans les prix élevés, on devait en conclure que ce système pouvait concilier une plus grande abondance avec les effets de la rareté, ou que cette concur rence qui devait les faire descendre n’était qu’une chimère... Quant à l’exportation, nos ports quelquefois ouverts, pres que aussitôt fermés, ont démontré l’illusion d’un tel trafic ; ce ne pouvait être jamais qu’une branche de commerce incertaine, momentanée, qui pouvait être saisie avec fruit sous l’empire des règlements, mais qui, sous un système des tructeur de toute police, pouvait porter la satiété chez nos voisins et laisser la disette dans nos murs (3). Il y a, Sire, un vice inhérent au commerce des grains, vice qui n’a peut-être pas été assez senti par les partisans du système de la liberté ; c’est que, à la différence de tous les autres commerces, le vendeur fait la loi à l’acheteur, parce qu’ici c’est le besoin (1) Fldmmermont, t. III, p. 294-295. (2) Ib id ., p. 298. (3) I b id ., p. 299. O. W E I'L E R S S E
12
178
LA PH YSl OCR ATI E SOUS
LE M I N I S T È R E D E TURGOT
qui achète, et que le besoin ne calcule plus sur le prix quand il est extrême (1). » L’École ne manque pas de répliquer. — A vrai dire, l’exportation effective des grains a cessé d’être à l’ordre du jour, et quant à la question même de la liberté d ’exporter, les Physiocrates et leurs amis se rabattent sur une position de repli. Condorcet, dans la pratique, se rapprocherait de Necker : « Quelque utile qu’elle soit, la libre exportation n’est pas, comme la libre circulation intérieure, d’une justice indis pensable et rigoureuse. Un souverain doit à chacun de ses sujets la liberté d’acquérir sa subsistance avec de l’argent de la manière la plus indépendante et la plus égale ; il doit à chaque propriétaire la libre disposition de ses denrées. Mais ces principes, qui ne doivent subir aucune exception dans l’intérieur, en peuvent souffrir à l’extérieur, parce que, les États étant restés entre eux dans l’état de nature, et même dans une sorte d’état de guerre, ce n ’est plus d’après les lois de la justfce, c’est d’après celle du bien de l’É tat ou de l’utilité générale des hommes, que les administrateurs doivent se (conduire. Ainsi, tant qu’il y aura des obstacles à l’intérieur, il serait peut-être imprudent de laisser à l’exportation une liberté illimitée (2). » Or, précisément, l’organisation des indispensables réserves intérieures n ’ira pas sans demander du temps et rencontrer des difficultés : « Qu’on ne croye pas, qu’il suffise de donner cette liberté au commerce pour en éprouver les effets. Il faut auparavant qu’il puisse la recevoir, et ce n ’est pas l’affaire d’un moment. Il faudrait qu’un peuple y fût préparé et universellement accoutumé... sans ces circonstances préalables, les essais ne pourront être que dangereux, ne fourniront que de trompeuses expériences, et n’occasionncTont que de faux jugements. Il s’en faut bien qu’il dépende du gouvernement le plus absolu d’établir tout d’un coup ces circonstances. (3) » Bœsnier de L’Ôrme n’en est-il pas venu à parler comme Galiani ? En tout cas, la soi-disant précaution d’un retour automatique à la prohibition dès que le blé atteindrait un certain taux, ne saurait que favoriser les manœuvres des monopoleurs, en restant ellemême inefficace (4).2341 (1) I b id ., p. 304. (2) R éflex , Comm. B lés (Œ., t. IX, p. 223-224). (3) Gouv. ico n ., p. 206-207. (4) Condorcet, C om m . B lés , chap. XX.
ATTAQUE
ET
DÉFENSE
DU
SYSTÈM E
179
Quant à l’importation en cas de disette, les Économistes sont partagés. Au dire de Condorcet, la liberté et l’immunité suffisent et sont mieux opérantes que tout système de primes. « En 1768, l’administration s’écarte un moment de ses prin cipes de liberté... L’on voulut encourager l’introduction des blés étrangers en promettant une gratification assez forte aux importateurs. Cette année-là, il n’entra pas dans le royaume 100.000 setiers... En 1769, on annonça que le minis tère avait le plus grand désir d’empêcher les contraintes ; on supprima en même temps la gratification promise : il y eut plus de 600.000 setiers importés pour le compte de simples négociants (1). » D’autant que, « placée comme l’Angleterre entre le Nord et le Midi, la France peut, comme elle, compenser par l’abondance du Nord la stérilité du Midi, et accroître ses subsistances de la différence de prix des ventes qu’elle fera au Midi avec les achats qui se feront au Nord » (2). Selon Baudeau, par contre, « le gouvernement a un moyen simple et facile d’encourager l’arrivée des blés étrangers^dans une province où l’on ne voudrait pas vendre, c’est d’accorder une bonne récompense à ceux qui les apporteront. Ce remède ne doit être employé que très rarement, parce que la maladie qui le rend nécessaire est elle-même très rare, mais il est connu ; vous venez de le voir mettre en usage ; quoi qu’on puisse dire, il a produit son effet. Peut-être même en a-t-il en trop, et beaucoup trop ; vous m’entendez, sans que je m’explique davantage » (3). En théorie, et du moins jusqu’en octobre 1774, Turgot demeure hostile « aux encouragements qui n’auraient d’autre effet que de porter les étrangers à augmenter le prix de leurs grains en proportion... et dont tout le bénéfice, au lieu de rester dans la nation, refluerait au dehors ». Quant aux bonifications accordées « à des négo ciants particuliers par des conventions secrètes, cela nuirait à la concurrence générale, et loin de multiplier les subsis tances, priverait des secours bien plus étendus de tout le commerce » (4). En aucun cas, point de société privilégiée, telle que la Compagnie royale d’Afrique pour l’importation des blés de Barbarie : Marseille, réputée étrangère depuis 1770 et privée ainsi du secours des blés français, ne pouvait y1234 (1) I b id ., p. 63-64 et p. 81-82. (2) I b id ., p. 14. · (3) É cla ircissem en ts, 1775, p. 283-284. (4) L ettre à M o n sieu r de B eih m an n , confiul impérial et négociant à Bordeaux, 31 octobre 1774. Cité par Foncin, Pièce justificative, n° 1.
180
LA
PH Y SIO C R A T IE
SOUR
LE
M IN IS T È R E
DE
TURGOT
suppléer par l’apport de ceux du Levant, les importations anglaises étant écartées par les prohibitions ; restaient les négociants marseillais eux-mêmes, mais ils furent éliminés par une manœuvre de la Compagnie, qui avait pu se permettre de vendre quelque temps à perte (1), et qui se rendit ainsi maîtresse de l’approvisionnement de la ville. Revenons au problème d’actualité par excellence, celui de la circulation intérieure. Sur ce terrain les Physiocrates sont è Taise pour maintenir les droits élémentaires des producteurs. Dans la généralité de Paris, « on a mis la maréchaussée en campagne, s’écrie Baudeau le 20 juin 1774 ; pour quel crime ? Contre les fermiers et laboureurs, occupés de leurs foins, qui ont l’audace de garder du blé pour leurs semences, pour leur subsistance en cas de mauvaise récolte, et pour vendre au marché Tannée prochaine, si les blés manquent celle-ci, comme le temps le fait craindre. On les force à battre, à perdre leur paille dont ils n’ont que faire en ce temps-ci, pour aile» à la halle... Une fois venus au marché, il faut qu’ils vendent à toute force, après trois marchés consécutifs. Ce qu’il y a de plaisant, c’est qu’on empêche d'acheter dans ces marchés-là, puisqu’on veut qu’il n ’y ait que les boulangers présents en personne, et point de commissionnaires ; ce qui emporte presque une prohibition formelle. Plus de propriété ni de liberté pour les laboureurs, leurs grains à la discrétion de l’intendant, de la maréchaussée et des officiers de police » ! « Bon chemin ! Courage, Messieurs ! Reniez le laboureur, détournez tous les hommes riches et intelligents de cette profession, puis les propriétaires seront ruinés. Mais vous aurez des villes florissantes, à ce que vous croyez, parce que les villes s’enrichissent et subsistent sans les campagnes apparemment. Oh 1 têtes à perruque des cités !... On avait écrit au bas de la statue d’Henri IV au Pont-Neuf, Hesurrexii, sur quoi un homme d’esprit a fait ces deux vers : D’Henri ressuscité j’admire le bon mot ; Mais, pour que je le croie, il faut la poule au pot. Les Bertier y mettront bon ordre à cette poule-là, et même au lard. Ils réduiront bientôt les fermiers au pain bis et aux sabots (2). « Croyez-vous, reprend sur un autre ton Condorcet, qu’il soit impossible de faire sentir au peuple^., que le cultivateur12 ( 1 ) a . Êph.t 1775, n® 11, p. 54-62. (2) B., Chronique secrète, 19 et 20 juin 1774.
ATTAQUE
ET
DÉFENSE
DU
SYSTÈM E
18!
qui a fait venir le blé, le marchand qui Ta payé de son argent, doivent en avoir tous la libre disposition, comme l’homme du peuple dispose de ses habits, de ses meubles ; que toute taxe d’une denrée qui n’est pas l’objet d’un privilège exclusif est un véritable vol ; que le gouvernement enfin n’a point le droit de gêner, entre les concitoyens d’un même Etat, la liberté d’acheter et de vendre une denrée nécessaire ?... Pourquoi ne ferait-on pas entendre à ces gens, qu’il est de leur avantage que le cultivateur soit maître absolu du grain qu’il recueille, afin qu’il soit plus intéressé à augmenter la reproduction... (1) ? » « Le Roi ne veut pas que le blé soit trop cher, ajoute Le Trosne ; et il sait bien qu’il ne sera qu’au prix où il doit être, quand ceux qui l’auront fait venir en seront les maîtres (2). » Il faut renoncer au vieux système d’interventions adminis tratives mal entendues. — Ainsi la Régie du roi, malgré les sacrifices qu’elle exige du Trésor, malgré des moissons abon dantes, n’a pas empêché la disette dans diverses provinces ; et « le pain n ’a pas été à bon marché même à Paris, où deux Compagnies vendaient à perte à qui mieux mieux. Pourquoi ? C’est que les Commissaires du Roi achetaient cher ; c’est qu’il y avait probablement beaucoup de faux-frais et de gaspillages ; c’est que la Compagnie avait intérêt de laisser naître, ou même de faire naître, des disettes locales pour prouver son utilité ». Si les Économistes, comme on le leur reprochait, ne cherchaient jamais que l’intérêt étroit, exclusif et abusif des producteurs, ils auraient presque pu se réjouir d’une telle combinaison ; « car on voyait les prix se soutenir fort haut en première main malgré les bonnes récoltes » (3). Mais l’excellent abbé Baudeau, déclare en termes quelque peu ridicules le marquis de Mirabeau, « fidèle à la voix et à l’exemple de son divin Maître, a constamment appelé le peuple : Sinite parvulos venire ad me pour le bien de l’huma nité » (4). « Les gens de Paris qui ne savent pas que le blé ne vient avec abondance que quand on peut le semer en sûreté et avec profit, ni ce qu’il en coûte pour le faire venir, vou draient voir le pain à 1 sol et crient· toujours famine sur un tas de blé... Pour qu’il n’y ait jamais famine, il faut qu’il n’y1234 (1) Lettre d 'u n laboureur de P ic a rd ie (Œ .y t. XI, p. 11-12). (2) Lettre des L aboureuses , p. 10-11. (3) B ., L ettres et M ém oires, p. 11-12. (4) Ai., D iscou rs de rentrée , 1775-1776, M ss,, M. 780, 0° 6, p. 29.
182
LA P H Y S IO C R À T IE SOUS LE M I N I S T È R E D E TURGOT
ait jamais trop bas prix, et que le laboureur vende plus cher quand il en a moins ; s’il se ruine, sa charrue sera bientôt ren versée, et avec elle toutes les marmites... le laboureur a tant de frais à payer qu'il faut bien qu’il vende à peu près tous les ans, et si quelques-uns ont le moyen de garder, c’est bien le mieux, parce qu’il faut conserver une poire pour la soif (1).» L’obligation de ne vendre et de n’acheter qu’au marché en présence d’un commissaire du roi, effarouche le commerce, et crée le monopole de la cherté (2) ; tandis que « lorsqu’il y aura tant de gens qui voudront essayer d’être monopoleurs, il n’y aura sûrement pas de monopole » (3) ; « les greniers médiocres bâtis, remplis par la liberté, empêcheront les grands magasins de faire la loi au peuple (4) ; « les petits marchands forceront la main aux gros » (5). E t puis, aux frais et fauxfrais de transport dans les deux sens, s’ajoutent les droits perçus sur les marchés même : On a calculé que l’ensemble coûterait plus de 16 millions tous les ans au pauvre peuple sur son pain quotidien. Un pareil règlement exécuté à la rigueur, comme on a voulu le faire partout depuis 1770, serait très évidemment un des plus terribles impôts qu on pût mettre sur tous les habitants des campagnes éloignées de 3 ou 4 lieues des marchés (6). » Quant aux villes, « il était singulier de voir les plus peuplées lever d’une main de très forts impôts sur les grains que les laboureurs et le commerce pouvaient leur apporter, et dépenser de l’autre les revenue municipaux pour acheter des grains et les revendre à perte... » (7). Voltaire soutenait avec une incisive indépendance la même cause. « Plus une denrée est nécessaire, plus le commerce doit être facile... (8) » ; « on découvre plus facilement un monopoleur qu’un voleur de grand chemin » (9). « Les mar chés, comme les foires, n’ont été inventés que pour la commo dité du public, et non pour son asservissement... Il paraît [d’ailleurè] impossible que, dans les gros bourgs et dans les123456789 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Le Trosne, Lettre des L pbou reu ses, p. 11-12. p. 16. Condorcet, Commerce blés , p. 41. I b id ., p. 42. L . T ., op. c il., p. 11-12. B ., op. cit., p. 27-28. D ., M ém . T urgot, II· Partie, p. 59-60. D ia trib e à Vauleur des Ê p h . (Œ ., t. V, p. 475). B ., op. c it.,
P e tit écrit su r V a rrü du 13 septem bre 1774.
A T TA Q U E E T D É F E N S E DU S Y S TÈ M E
183
villes, le laboureur néglige de porter son blé au marché ; car il est sûr de l’y faire emmagasiner en payant un petit droit. Son intérêt est de porter la denrée dans les lieux où elle sera infailliblement vendue et non pas d’attendre souvent inutilement que les paysans ses voisins viennent acheter la sienne chez lui (1). » Condorcet estimait, lui aussi, « que les marchés pouvaient subsister librement ; quel mal, du reste, y aurait-il à ce qu’ils fussent partiellement remplacés par un marché permanent que constitueraient les dépôts libres des commerçants ? (2). » La taxe du pain est censée fixée pour ménager les intérêts du consommateur. Mais « grâce à la crainte que les boulangers savent inspirer à la police [en menaçant de fermer boutique], le prix du pain n’a presque jamais avec celui du blé le rapport qu’il doit avoir naturellement » (3). « La proportion établie presque partout l’est d’une manière très défavorable au peuple. Il en résulte que lorsque 1 abondance fait considéra blement baisser le prix des grains, il paye encore sa subsis tance un prix assez élevé, et que dans les temps de cherté il lui est impossible d’y atteindre (4). » «A cause de l’inquiétude du peuple, la taxe fait toujours vendre le pain au taux le plus fort, ce qui assure la fortune des boulangers ; car cette taxation ne peut se faire à leur perte... Ceux qui avaient fait des amas quand le grain était k bon marché y gagnent beau coup ; les autres moins, mais il faut qu’ils y gagnent. Ainsi le peuple lui-même, par sa frénésie imbécile, empêche qu’on ne prenne des arrangements qui pourraient lui être avan tageux (5). » « Détruisez les banalités... L’adresse avec laquelle les meuniers peuvent, k leur gré, diminuer ou augmenter la quantité ou le poids de farine que rend une même mesure, est une source de voleries si variées, si difficiles à constater, que la liberté en est Tunique remède... (6). » « Le pauvre serait délivré des vexations et du gaspillage que ces fripon neries occasionnent (7). » « La simple négligence des meuniers1234567 (1) Ibid. (2) Cf. Commerce blés, chap. X X I.
(3) Condorcet, Lettres commerce grains, p. 13. (4) Lettre de Turgot à M. d’Aine, intendant de Limoges, septem bre 1775, CE. 7\, t. II, p. 207. (5) Tifaut, Béflex. philosophy notes, p. 196-197. (6) Condorcet, Lettre d'un laboureur de Picardie (CE., t. XI, p. 25). (7) Condorcet, Lettres sur les grains, p. 13.
184
LA P H Y S I O C R A T I E SOUS
LE M I N I S T È R E D E TURÜOT
mal organisés et qui moulent mal leur grain est aussi répré hensible que celle des propriétaires qui cultivent mal leurs terres (1). » L ’Édit donné à Reims en juin 1775, concernant la ville de Rouen, pouvait servir de règle pour « la suppression de toute banalité dont on croirait devoir l’anéantissement au bien public » ; il spécifie que seul doit donner lieu à une indem, nité pour le propriétaire « le surplus de salaire qui est l’effet du privilège exclusif » (2). Puis intervient un second monopole, celui des boulangers. « Déjà la liberté du commerce des farines, conséquence de la destruction du droit de banalité, perm ettrait au petit peuple d’épargner le profit que ceux-ci réalisent (3). Le prix du pain peut en tout cas être égal à celui de la livre de blé... Si les jurandes des boulangers sont un obstacle à la [juste] propor tion, ce sera une raison de plus pour hâter le moment ou l’on rendra à cette profession une liberté nécessaire au soula gement du peuple (4). » E t qu’on ne vienne pas dire que la multiplication artificielle des privilèges en rend le privilège moins onéreux ; c’est tout le contraire. Bigot reprend cette démonstration : « Dans un bourg où la concurrence est libre, il n’y a que 4 boulangers par exemple, si la consommation du lieu n’exige que ce nombre, et leurs profits sont à peu près égaux. Dans une ville où il y a Corps de boulangers en titre et jurande, ils sont 20 à 30 ; un petit nombre s’enrichit, quelques autres se soutiennent, et le reste languit ou meurt de faim. Il faut bien qu’ils cherchent à se sauver par des fraudes ou des manœuvres. Ce sont ces derniers qui, dans tous les Corps ou Communautés, forment le plus grand nombre et soutiennent la cherté (5). » * *
*
La liberté et la franchise générale du commerce intérieur des grains, des farines et du pain, devaient donc déjà assurer, en même temps que la régularité de l’approvisionnement, une réduction du profit des divers intermédiaires, capable de compenser dans une certaine mesure pour le public l’accrois-12345 (1) (2) (3) (4) (5)
Cf. Baudeau, Éph., 1775, n° 10, p. 154. D.t Mém. Turgol, II· Partie, p. 64 et 66. Cf. Condorcet, Lettre*, ibid. Turgot, Œ.y t. II, p. 207-208. Estai, p. 18.
AT TAQUE ET D É F E N S E DU S Y 6TÈ M E
185
sement de prix dont bénéficiaient les premiers et seuls réels producteurs. Mais, si l’on considère plus attentivement les résultats de l’égalisation des prix des blés, entre les années, on retrouve cet argument triomphant de la défense des Physiocrates : savoir qu’il en découlait ipso fado une aug mentation du revenu des propriétaires en même temps qu’une diminution dans la dépense corrélative des consommateurs. « La liberté, se demande Baudeau, rendra-t-elle le blé plus cher ? Le rendra-t-elle meilleur marché ?... Notre réponse est double ; nous disons oui et non, parce que telle est la vérité, tel est l’ordre de la nature. C’est oui pour l’acheteur consommateur des villes. C’est non pour le vendeur producteur des campagnes. Par elle, il y a profit pour l’un et pour l’autre ; l’un achète moins; et l’autre vend plus. Ceci à l’air d’un para doxe, mais ce paradoxe est la clef de tout... Voilà le point fondamental de toute notre doctrine... la source de toute lumière, l’anéantissement de toutes les difficultés (1). » Suit une reproduction des tableaux classiques, d’où il ressort que, pour un bénéfice au producteur de 3 livres 8 sols par setier, [’augmentation pour l’acheteur ne sera que de 16 sols; « c’est là où réside précisément toute la question de commerce des blés » (2). L’ancien régime des grains était celui d’un « monopole très profitable aux intéressés, mais très préju diciable aux producteurs et aux consommateurs ». C’est ce qui explique que le prix puisse augmenter pour les premiers sans qu’il augmente pour les seconds, si même il ne baisse (3). Un autre avantage du consommateur naîtra de la conservation du blé, « puisque cette denrée n’est gaspillée que lorsqu’elle tombe à bas prix » (4). L’Économiste mathématicien finit par convenir, il est vrai, que le prix [en fait], année commune, deviendra, sans excès, plus considérable ; mais c’est tant mieux pour tout le monde. « Cette augmentation de cherté, année commune, est précisément ce qui donnera un nouveau zèle pour la culture, et il n’en résultera ni souffrances, ni morta lité ; mais au contraire on verra naître et une plus grande population et la prospérité générale, et particulièrement celle du commerce et des arts (5). » « Le propre effet de la liberté, conclut non moins strictement Le Trosne, n’est pas d’occa-12345 (1) B., Lettres et Mémoires, p. 105-106. (2) Ibid., p. 134-135. (3) B., Éclaircissements (Êph., 1775, n° 8, p. 111). (4) Condorcet, Biflez. Comm. blés (Œ ., t. XI, p. 138-141). (5) Condorcet, Du commerce des blés, p. 23.
186
LA P H Y S I O C R A T I E SOUS LE M I N I S T È R E D E TURGOT
sionner un prix de cherté, mais de maintenir un juste milieu entre les deux extrémités, également fâcheuses soit pour la culture, soit pour le peuple (1). » Quelle était donc, lors de l'arrivée de Turgot au contrôle général (24 août 1774) l'exacte situation alimentaire du royaume et l’état des esprits ? Au mois de juin, la récolte de blé s’annonçait mauvaise, et bien que, d’après Baudeau, « le plus beau blé fût tombé à Paris à 15 et 18 livres [le setier] », les Bertier avaient écrit à tous les procureurs du roi de la généralité pour forcer les laboureurs à garnir les marchés, et déjà leurs ordres étaient venus jusqu’à Provins (2). Le 16 juin, à Choisy, « des blés avariés vendus au-dessus du nouveau prix fixé depuis la mort du Roi » avaient été jetés à la rivière (3). Le 7 juillet, « sur un mémoire donné par des paysans du canton au duc d’Orléans contre un fermier général pour avoir dans son château, près de Saint-Cloud, un magasin de blés très considérable, le prince en ayant parlé au Roi, S. M. avait fait notifier à ce riche financier qu’il eût à envoyer incessamment tout son blé au marché, à moins qu’il ne voulût s’exposer à être emprisonné et à avoir ses greniers enfoncés par des cavaliers de maréchaussée » (4). Le 10 août, à Ver sailles, le pain de 12 livres est augmenté de 2 sols ; « celui qui devait être chargé de publier cette augmentation à son de tambour refuse de prêter son ministère, attendu la disposition des esprits, d’autant plus échauffés que le jeune Roi leur avait lui-même promis de faire manger le pain à bon marché ». De même, à Paris, le pain de 4 livres est augmenté de 2 liards : « Le peuple ne pouvait qu’être très indisposé d’être frustré des espérances données aussitôt après la mort du Roi (5). » Le 21 août, on apprenait « que le Roi, pendant son voyage de Marly, avait annoncé que son intention était qu’à l’avenir le pain du pauvre ne se vendît que 1 sol 6 deniers la livre, et le pain bourgeois 2 sols. Que tous ses ministres actuels, qui étaient encore ceux du feu Roi son aïeul, ainsi que Mesdames ses tantes, Madame Adélaïde en tête, avaient entrepris de lui démontrer la nécessité de laisser les choses comme elles étaient pour des raisons d’É tat » ; ce qui avait, disait-on, donné lieu à la reine de s’exprimer d’une manière assez remarquable,12345 (1) Ordre eocial, p. 463 et note, p. 468-472. (2) B., Chronique secrâe, 20 juin 1774.
(3) Hardy, t. Il, p. 363. (4) Hardy, II, 373. (5) Ibid,, p. 394.
ATTAQUE ET D É F E N S E DU SYSTÈ M E
187
et qui annonçait même du génie : « Je sais bien, Sire. auraitelle dit au Roi, que nous sommes trop jeunes pour régner par nous-mêmes (1). » Le 28 août, quatre jours après l’entrée en fonctions du nouveau ministre, on apprend que « le Sr. Brochet de Saint-Prest, maître des requêtes et intendant du commerce, venait de perdre sa place et d’être exilé, comme étant du nombre de ceux qui avaient la plus grande part au commerce des grains soi-disant pour le compte du roi..., ce nouveau coup, qui paraissait être une suite de celui qu’on venait de frapper sur le contrôleur général Terray, annonçait qu’on s’occupait à la cour des moyens de démonter la cabale formée pour faire manger le pain cher au pauvre peuple » (2). Le 5 sep tembre, à Saint-Cloud, on craignait bien que le pain n’aug mentât dès que le roi aurait quitté Versailles pour se rendre à Fontainebleau (3). « Hors d’état de payer les impôts, les malheureux manquent de subsistance et ne peuvent en fournir à leur femme et à leurs quelques enfants. Leurs corps s’affai blissent, leurs cerveaux débiles s’échauffent ; le désespoir les ranime un instant, quelques furieux les attroupent ; ils s’égaient dans les campagnes sans dessein, sans réflexion, les uns écumant de rage, les autres entraînés par l’exemple, et tous mettent peu de différence entre la mort ou du pain (4). » Telle était la bonté aveugle du monarque, tel l’embarras de la Cour ; et tel aussi l’esprit de révolte qui couvait dans la partie misérable du peuple, lorsque fut rendu par Turgot, trois semaines après son avènement, le grand Arrêt du 13 sep tembre 1774. La liberté du commerce intérieur des grains y est célébrée avec un magistral éclat, non pas seulement comme répondant au vœu légitime et à l’intérêt majeur des propriétaires et culti vateurs — ainsi que nous l’avons antérieurement montré (5) ; mais tout aussi bien comme assurant dans les meilleures conditions possibles la subsistance du peuple. « Le transport et la garde des grains sont, après la production, les seuls moyens de prévenir la disette, parce que ce sont les seuls moyens de communication qui fassent du superflu la ressource du besoin. La réflexion et l’expérience prouvent également que la voie du commerce libre est pour fournir aux besoins12345 (1) (2) (3) (4) (5)
Ibid., t. II, p. 400. Hardy, II, 407. Ibid., p. 412. M ss., n° 13.796, p. 72. Voir ci-dessus. III.
188
la
P H Y S I O U R A T IE SOUS
LE M I N I S T È R E
D E TU RliO T
du peuple la plus sûre, la plus prompte, la moins dispendieuse et la moins sujette à inconvénients. Les négociants, par la multitude des capitaux dont ils disposent, par l’étendue de leurs correspondances, par la promptitude et l’exactitude des avis qu’ils reçoivent, par l’économie qu’ils savent mettre dans leurs opérations, par l’usage et l’habitude de traiter les affaires du commerce, ont des moyens et des ressources qui manquent aux administrateurs les plus éclairés et les plus actifs. Leur vigilance, excitée par l’intérêt, prévient les déchets et les pertes ; leur concurrence rend impossible tout monopole ; et le besoin continuel où ils sont de faire rentrer leurs fonds promptement pour entretenir leur commerce, les engage à se contenter de profits médiocres... » « Au contraire, lorsque l’administration est seule chargée de remplir le vide des récoltes, elle ne le fait qu’en y consacrant des sommes immenses sur lesquelles elle fait des pertes inévi tables. L’intérêt de ses avances, le m ontant de ses pertes forment une augmentation de charges pour l’État, et par conséquent pour les peuples, et deviennent un obstacle aux secours bien plus justes et plus efficaces que le roi, dans les temps de disette, pourrait répandre sur la classe indigente de ses sujets... Se charger de tenir les grains à bon marché lorsqu’une mauvaise récolte les a rendus rares, c’est promettre au peuple une chose impossible, et se rendre responsable à ses yeux d’un mauvais succès inévitable. Il est impossible que la récolte d’une année, dans un lieu déterminé, ne soit pas quelquefois au-dessous du besoin des habitants, puisqu’il n ’est que trop notoire qu’il y a des récoltes fort inférieures à la production de l’année commune, comme il y en a de fort supérieures. Or, l’année commune des productions ne saurait être au-dessous de la consommation habituelle... Le prix des grains serait [alors] tellement bas que le laboureur retire rait moins de ses ventes qu’il ne dépenserait en frais... Non seulement le renchérissement est inévitable, mais il est l’unique remède possible de la rareté en attiran t la denrée par l’appât du gain. Car, puisqu’il y a un vide, et que ce vide ne peut être comblé que par les grains réservés des années précédentes ou apportés d’ailleurs, il faut bien que le prix ordinaire soit augmenté des frais de garde ou de celui du transport... Si par des moyens forcés le gouvernement réussit à retarder cet effet nécessaire, ce ne peut être que dans quelque lieu parti culier, pour un temps très court ; et en croyant soulager le peuple, il ne peut qu’assurer et aggraver ses malheurs. Les
AT TAQUE ET D E F E N S E DU SY S TÈ M E
189
sacrifices faits par l’administration pour procurer le bas prix momentané sont une aumône faite aux riches au moins autant qu’aux pauvres, puisque les personnes aisées consomment, soit par elles-mêmes, soit par les dépenses de leurs maisons, une très grande quantité de grains. La cupidité sait s’appro prier ce que le gouvernement a voulu perdre, en achetant au-dessous de son véritable prix une denrée sur laquelle le renchérissement, qu’elle prévoit avec une certitude infaillible, lui promet des profits considérables. Un grand nombre de personnes, par la crainte de manquer, achètent beaucoup au delà de leurs besoins, et forment ainsi une multitude d’amas particuliers de grains qu’ils n’osent consommer, qui sont entièrement perdus pour la subsistance des peuples, et qu’on retrouve quelquefois gâtés après le retour de l’abon dance. Pendant ce temps les grains du dehors, qui ne peuvent venir qu’autant qu’il y a du profit à les apporter, ne viennent point. Le vide augmente par la consommation journalière ; les approvisionnements par lesquels on avait cru soutenir le bas prix s’épuisent ; le besoin se montre tout à coup dans toute son étendue, et lorsque le temps et les moyens manquent d’y remédier... c’est alors que les administrateurs, égarés par une inquiétude qui augmente encore celle des peuples, se livrent à des recherches effrayantes dans les maisons des citoyens, se permettant d'attenter à la liberté, à la propriété, à l’honneur des commerçants, des laboureurs, de tous ceux qu’ils soupçonnent de posséder des grains. Le commerce vexé, outragé, dénoncé à la haine des peuples, fuit de plus en plus; la terreur monte à son comble, le renchérissement n’a plus de bornes, et toutes les mesures de l’administration sont rompues. Le gouvernement ne peut donc se réserver le trans port et la garde des grains sans compromettre la subsistance et la tranquillité des peuples. C’est par le commerce seul, et par le commerce libre, que l’inégalité des récoltes peut être corrigée... Les règlements de police, en forçant les vendeurs et les acheteurs à choisir pour leurs opérations les jours et les heures de marché, peut les rendre tardives, au grand préjudice de ceux qui attendent avec toute l’impatience du besoin qu’on leur porte la denrée. » En dehors du rétablissement de la liberté pleine et entière du commerce intérieur des céréales (art. 1 et 2), l’Arrêt ne prévoit d’autre mesure particulière que quelques faveurs à l’importation éventuelle. « Désirant assurer le secours à ses pepples, S. M. permet à tous ses sujets (et aux étrangers) qui
190
LA PH YSI OCR ATI Ε SOUS
LE M I N I S T È R E
D E TURGOT
auront fait entrer des grains dans le royaume d'en faire telles destinations et usages que bon leur semblera, même de les faire ressortir sans payer aucun droit ; se réservant au surplus de leur donner des marques de sa protection spéciale (art. 4). » Selon Baudeau, l'Arrêt du 13 septembre 74 aurait, malgré la mauvaise récolte, interrompu le renchérissement du blé et même déterminé une certaine baisse. Le commerce intérieur se serait ravivé, et du même coup celui d’importation : assuré que le Roi « n ’approvisionnerait » plus, et que l’admi nistration ne forcerait plus à garnir les marchés, M. de Montaudouin, de Nantes, avait fait venir des blés étrangers (1). A Necker « qui se plaignait de la suppression des marchés au blé », Voltaire répliquait, qu’à Gex tout au moins ils n’étaient nullement supprimés : « La petite ville est aussi bien fournie qu’auparavant ; le laboureur a gagné sans que personne ait perdu ; c’est ce que j ’atteste au nom de 20.000 hommes (2). » A Paris, dans l’abbatiale des Prémontrés, rue Hautefeuille, on vendait du Pain (Economique, vrai pain de ménage, pain complet de pur froment, où étaient toutes les farines fine fleur, farine blanche, bis blanche, et bis, qui avait été imaginé et façonné par la Société des Philosophes Économistes; l’abbé Baudeau, qui demeurait là, présidait à cette distribution et y adjoignait des prospectus de propagande sans approbation du censeur ni permis de police ; les boulangers disaient fran chement « qu’ils étaient fichus par ce nouvel arrangement » (3). E t Linguet lui-même était contraint de reconnaître que « pen dant quelque temps l’augmentation du pain avait été conte nue » (4). Cependant il suffisait qu’à Metz les blés manquassent à la halle pour qu’un marchand de grains fût tué dans sa maison, et l’intendant Galonné menacé ; 5.000 hommes de troupes avaient dû être mis sur pied pour réfréner cette « émotion » populaire (5). A Rouen, le Parlement, rétabli dès octobre 1774, n’enregistra l’Arrêt de septembre « qu’en y ajoutant des dispositions antilibérales ». Quant à la Chambre de commerce, on la voit opposer à l’irritable ardeur du ministre le ton sceptique d’hommes d’affaires pour qui une première expé-12345 (1) Lettres et Mémoires , p. 16 et 43. (2) Petit écrit sur VArrêt du 13 septembre. (3) Hardy, 15 octobre 1774, t. II, p. 430. (4) Lettre à l’abbé Roubaud, Journal pot. et litt., n° 6, 15 décem bre 1774, t. I, p. 236. (5) Hardy, 4 octobre 1774, t. II, p. 425.
A T T A Q U E ET D É F E N S E DU SY S TÈ M E
191
rience compte, et que seul mène l’intérêt personnel. Pour toutes sortes de raisons, dont quelques-unes d’ordre technique, il ne pouvait y avoir en Normandie de grand courant d’impor tation de grains : la Chambre, en réclamant la construction aux frais du roi de vastes magasins pour les blés importés, montrait à quel degré elle était restée « interventionniste » (1). Le Parlement de Paris, rétabli le 12 novembre 1774, enregistra, toutes chambres assemblées, sans aucune modification ; mais « cet enregistrement n ’avait passé que de 2 voix, et ce nonobstant toutes les représentations faites par plusieurs membres, qu’il allait exciter les clameurs d’une certaine portion du public, portée à soupçonner les magistrats d’avoir part au monopole des blés et d’y trouver leur compte. On avait même jugé à propos, disait-on, de faire un arrêté secret, portant en substance que si l’on s’était décidé à enregistrer purement et simplement, c’était moins par pleine conviction de l’utilité réelle desdites Lettres-Patentes (du 2 novembre), que par la confiance qu’inspirait la bonté du Roi, qui lui ferait prendre tous les moyens de remédier aux inconvénients immanquables. E t ce qui avait déterminé le plus grand nombre, c’était la promesse du Sr. Turgot d’envoyer incesamment un règlement dont il promettait qu’on aurait lieu d’être satisfait » (2). En 1775, apparaissent deux causes nouvelles d’une cherté cette fois étendue à toute l’Europe : la Pologne était ruinée par la guerre ; les colonies anglaises d’Amérique allaient entamer les hostilités contre leur métropole (3). A Paris, « le pain qui depuis près de 8 ou 10 mois s’éjtait soutenu dans les marchés sur le pied de 11 sols les 4 livres — le 8 mars 1775 — est porté à 11 sols 1 /2, ce qui contristait tout le monde dans l’appréhension où l’on était pour le pauvre peuple qu’il ne vînt à augmenter encore, et que les esprits ne vinssent à s’échauffer contre le gouvernement » (4). « Le 15 mars, le pain est à 12 sols ; on entendait le peuple dire déjà assez haut dans les marchés : Quel fichu règne ! On espérait à peine que le parti pris par le gouvernement de faire venir des blés de Barbarie... couperait court à la cupidité des monopoleurs (5). » « Le 12 avril, le pain est à 12 sols 1 /2 dans les marchés de12345 (1) (2) (3) (4)
Valmont, Subsistances en Normandie au X V I I I 9 siècle, p. 5. Hardy, 20 décembre 1774, t. II, p. 484. Condorcet, Commerce des grains, p. 81. Hardy, t. III, p. 44.
(5) Ibid., p. 45.
192
LA
PH Y SIO C R A T IE
SOUS
LE
M IN IS T È R E
DE
TURGOT
Paris, tandis que les boulangers en boutique le vendent 13 sols... ; le 15 avril, encore une augmentation de 2 liards ; et les boulangers, qui disaient ne savoir comment s’y prendre pour se procurer du blé jusqu’à la moisson, annonçaient qu’il pourrait monter à 16 sols. On débitait que le gouvernement se trouvait forcé d’avoir recours à cette cherté du pain pour acquitter les dettes du feu Roi (1). » Le 22 avril, l’agitation grandissant en Bourgogne décide le ministre à y appliquer les premières mesures de compensa tion et de soulagement prévues. « Les droits établis sur les grains et farines (octrois, minages et hallages, etc.) à l’entrée de plusieurs villes et dans les marchés les y rendent plus rares et par conséquent plus chers ; le droit lui-même opère un renchérissement ; mais une cherté· encore plus grande naît de l’effet produit sur le commerce ; ... il craint même l’inquiétude de la perception ; aussi il ne se détermine à venir dans les lieux sujets à des droits que lorsqu’il y est appelé par la plus grande cherté ; il n’y apporte ses denrées que successi vement, par parcelles, et toujours au-dessous du besoin; dans la crainte que, les grains restant invendus, ou la cherté venant à diminuer, le paiement des droits ne demeure à sa charge et ne l’expose à des pertes. » « La circulation ne pourra donc être établie avec égalité dans tous les lieux du royaume que lorsque S. M. aura pu affranchir ses peuples de droits si nuisibles à sa subsistance ; mais, en attendant qu’elle puisse accorder ce bienfait à tout son royaume, elle se détermine à en faire, dans le moment, jouir les lieux où des circonstances particulières exigent d’accélérer cette exemption... » Les droits sont donc immédia tement suspendus à Dijon, Beaune et Saint-Jean-de-Losne, pleine indemnité étant accordée, d’après les baux, aux proprié taires qui les avaient affermés. « L’intendant de Bourgogne est autorisé à ordonner ladite suspension dans toutes les autres villes et lieux de ladite province où il le jugera néces saire ou utile (2). » « L’émeute de Dijon, où l’hôtel d’un ancien magistrat Maupeou passant pour monopoleur avait été envahi et où 40 personnes avaient été arrêtées (3) ; l’intelligence établie entre nombre de gros fermiers de diverses provinces pour123 (1) Ib id ., p. 53. (2) T ., Œ ., t. II, p. 183-18Γ». (3) Cf. H ardy, t. I l l , p. 55.
At
t a q u e
e t
d é f e n s e
d u
s y s t è m e
193
faire monter le prix des blés à un taux si haut qu’on spéculait que dans deux mois le pain coûterait 5 à 6 sols la livre, et l’espèce de fermentation qu’on remarquait dans plusieurs grandes villes telles que Rouen, Lyon, etc. » (1), décident Turgot à prendre presque aussitôt d’autres mesures de précau tion, fussent-elles contraires à ses stricts principes, tout en étant conformes à l’évolution de certains Physiocrates. « Vers la fin avril, le pain valait déjà 13 sols et 6 deniers les quatre livres sur les marchés de Paris, et l’on assurait que dans cer taines provinces il se vendait 4 sols ,6 deniers la livre, et que nombre de personnes s’y trouvaient dans le cas d’en manquer et de mourir de faim (2). » Les choses en étaient venues à ce point dans la généralité de Montauban que l’intendant Terray aurait donné l’ordre à son subdélégué de « dresser trois potences destinées aux fermiers qui refuseraient de garnir les marchés, comme l’Arrêt du 13 septembre leur en donnait cependant le droit » (3). L’Arrêt du 25 avril établit une prime à l’importation des grains. « Si la dernière récolte en a donné suffisamment pour l’approvisionnement des provinces du royaume, sa médiocrité empêche qu’il n’y ait du superflu ; tous les grains étant néces saires pour subvenir aux besoins, les prix pourraient éprouver encore quelque augmentation, si la concurrence des grains de l’étranger ne vient l’arrêter. Mais la dernière récolte n’ayant point répondu, dans les autres parties de l’Europe, aux espé rances qu’elle avait données, ...dans la plupart des places étrangères les prix sont actuellement plus chers que dans le royaume, et dans celles même où ils ont le moins renchéri, 11 n’y a point une assez grande différence entre leur prix et celui qui a lieu dans les principales villes du royaume pour assurer au commerce des bénéfices suffisants... » Du 15 mai au 1er août 1775, c’est-à-dire pour moins de trois mois, il est donc accordé à l’entrée des grains les gratifications suivantes, rendu dans les ports : 18 sous par quintal pour le froment, et 12 sous pour le seigle. Mais « pour animer ces importations, il est nécessaire de maintenir le commerce dans toute la sûreté et la liberté dont il doit jouir ; et l’exemption du droit de fret est accordée à tous les navires importateurs, nationaux ou étrangers » (4). La liberté de réexpédition aurait mieux (1) Corresp. M ä r a , t. I, p. 339. (2) Hardy, ibid. (3) Ibid . (4) Turgot, Œ ., t. Il, p. 165-188. O . W BU LBRSBB
13
194
LA
PH Y SIO C R A T IE
SOUS
LE
M IN IS T È R E
DE
TURGOT
valu, mais Topinion ne l’eût point admise (1). Déjà, « relative* ment à tous les troubles et au tapage qu’occasionnait en plusieurs endroits la cherté des grains, on ne pouvait s'empê cher de regarder cet Arrêt du conseil comme un remède administré à un agonisant (2). » Six jours après, en effet, éclatait la « Guerre des Farines », dont nous n’avons à parler qu’incidemment. « Le 1er mai, émotions populaires à Pontoise, où plusieurs milliers de personnes, bordant la rivière, arrêtaient les bateaux de blé et pillaient le grain, qu’elles emportaient dans des sacs ; à Saint-Denis, et à Saint-Germain, où on avait éventré les sacs et semé la farine dans les rues ; des émissaires persua daient au menu peuple des villages qu’ils allaient mourir de faim parce qu’on portait tout le grain à Paris (3). » Le 2 mai, violente manifestation à Versailles : « Le roi parut au balcon, parla, mais ne fut point écouté, rentra chez lui désolé, versa des larmes ; et pensant que le mieux était de céder aux cris de la populace, il fit proclamer que le pain serait fixé à 2 sols la livre ; le capitaine des gardes s’empressa de l’annoncer de sa part aux boulangers. C’était désavouer Turgot et toutes ses réformes. « Les vociférations cessèrent ; on se dispersa, tout en annonçant que le lendemain on irait à Paris... Le roi écrivit au ministre une lettre d’excuse et de repentir ; il lui dit... qu'il craignait d’avoir fait une faute en politique et qu’il voulait la réparer. » Le 3 mai, tandis qu’il se produit dans tout Paris une espèce de soulèvement et de révolte (4), Turgot court à Versailles ; il obtint aisément que le roi reviendrait sur sa première déclaration, et qu’il défendrait d’exiger des marchands ou des boulangers du blé ou du pain au-dessous du cours ; une ordonnance de police en ce sens fut affichée [le jour même] (5). Le 4 mai [néanmoins], le Parlement de Paris suppliait le roi de faire baisser le prix du grain ; l’Arrêt était cassé en lit de justice le 5 mai (6). « Dès le 6 mai, le pain diminue aux marchés (7). » En dehors des mesures de police énergiques que l’on connaît, que s’était-il passé ? « D’un côté les fermiers eurent1234567 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Cf. D,, M é m . Turgot, I I · P artie , p. 69. H ardy, 27 av ili 1775, t. I I I , p. 56. H ardy, l« r m ai 1775, p. 57. H ardy, p. 58. Cf. Foncin, p. 197-198. Ibid., p. 202. J.-N . M oreau , Souvenirs, t. II , p. 193*
ATTAQUE
ET
DÉFENSE
DU
SYSTÈM E
195
peur et y portèrent , de l'autre, le contrôleur général, dérogeant à son système, leur fit sous-main donner des ordres. Je le sus pertinemment, écrit J.-N. Moreau, par celui du Moulineau, en bas de Meudon (1). » Linguet ne faisait donc qu’exagérer en déclamateur la vérité, lorsqu’il accusait Turgot de palinodie : « On avait promulgué des lois solennelles pour dispenser le blé de venir aux marchés : il fallait l'y faire traîner par des ordres secrets ; l’étendard philosophique était encore arboré, quand il fallut l’insulter par cette dérogeance douloureuse et employer d'autorité les intendants, les maréchaussées à cette contrainte, devenue vraiment criminelle depuis qu’une loi la proscrivait (2). » Condorcet voyait naturellement les choses sous un autre angle, c’est-à-dire de plus haut. « Peutêtre nos idées là-dessus, dit-il, s’éclaireront-elles davantage avec le temps... Il est plus que vraisemblable que ce sont les dernières convulsions du monopole... L’autorité tutélaire des propriétés ne peut sévir trop fortement contre les auteurs d’un pareil désordre. J ’ai béni comme tout le monde la main qui a signé le pardon de ceux qu’un tournoiement rapide a pu entraîner au niai ; mais les premiers auteurs de tous ces ressorts, s’ils sont connus, ne peuvent espérer de pardon (3). » Le plus fort de la tourmente passé, le ministre pouvait revenir à l’application méthodique de mesures moins grave ment contraires à ses principes généraux. C’est ainsi qu’il étendait le système des gratifications aux importations de blé par les frontières de terre, comme celles d’Alsace, de Lorraine et des Trois-Évêchés (Arrêt du 8 mai 1775) (4). Dans certaines provinces, d’ailleurs, tel que le Languedoc, Turgot avait l’appui des autorités régionales : le Parlement de Toulouse est vite redevenu favorable à l’économie libérale, et pendant la « guerre des farines », l’archevêque avait répondu de ses diocésains : ils ne se laisseront pas séduire par des impressions étrangères ; ils savent par expérience « que la liberté encourage la culture, multiplie les productions, et que plus il croît de blé, moins la disette est à craindre » (5). Bientôt élargissant l’application des principes posés dans l’Arrêt du 22 avril, Turgot décide la suspension générale (sauf réserves pour Paris et Marseille) de tous les droits muni-12345 (1) Ibid. (2) (3) (4) (5)
A n n a le s , t. V I, p. 304-305.
Comm. Blés, p. 82 e t p. 90. Cf. T ., Œ u v re s , t. II, p. 190-191. Cf. V iala, p. 86, cita n t Arch. H érault, C. 2875 (16 mai 1775).
196
LA P H Y S IO C R A T IE
SOUS
LE
M IN IS T È R E
DE
TURGOT
cipaux sur les grains : ΓArrêt du 3 juin 1775 reconnaît en effet que « l’abondance a été rétablie dans la plupart des villes dans lesquelles ces droits ont cessé d’être perçus » (1). Lorsque le duc d’Orléans sollicitera l’autorisation d’ouvrir un marché sur sa terre de Livry, près Bondy, le contrôleur général ne la lui accordera qu’à la condition qu’il n’y sera levé aucune taxe (2). L’Édit (de Reims) du 23 juin porte suppression des offices de marchands privilégiés et porteurs de grains, et abolition du droit de banalité, dans cette cita delle du régime réglementaire, la ville de Rouen : « Tant à l’achat qu’à la vente, le commerce des subsistances y est privé de toute liberté, et concentré dans une société unique, ce qui constitue essentiellement le monopole... ; et le [seul] droit de banalité y augmente le prix d’un neuvième (3). » Est levée du même coup l’interdiction de toute remontée de grains de Rouen vers Paris et l’amont (4). L’agitation cependant se prolonge. « Le 3 juin 1775, le pain étant toujours à 13 livres 1 /2 dans les marchés, on est obligé d’envoyer à Gonesse un détachement de gardes françaises pour y assurer la tranquillité (5). » Le 22 juin, à Corbeil, on arrête, pour le conduire à la Bastille, un parti culier qui avait dit : « La cérémonie du sacre est passée, et le pain ne diminue pas : le Roi veut donc se faire assas siner (6) !» Le 12 juillet circule une lettre anonyme : puisque le riche ne venait pas au secours du pauvre, le pauvre serait forcé d’en demander à main armée ; et il est bruit d’une espèce de conjuration formée pour anéantir les grains sur pied avant la récolte, qui promettait d’être abondante (7). Le 18 juillet, on avait arrêté à Étampes un individu qui ameutait le peuple sur le marché ; aux environs de Meaux on avait brûlé un grenier en jetant du goudron et autres matières inflammables' dans du bois sec, et entrepris de couper le blé pour le voler (8). Tandis que le 19, le lieutenant de police Albert procède à des visites nocturnes dans les fournils pour s’assurer que le pain φ
(1) Œ . T .t t. II. p. 198-200. (2) L ettre de T urgot au x gard. des sceaux, 22 ao û t 1775, F “ 151, citée p ar F o n d a, p. 290. (3) janvier 1776 (Œ. T., t. II p. 248-250).
ZVZ
LA P HYSI OCRATI E SOUS LE MINISTÈRE DE TURGOT
adopteront la même réforme » (1). L ’impôt sur les cuirs retentissait sur tous les consommateurs autant que sur les propriétaires et fermiers « d ’une manière également fâcheuse » (2). La communauté des chandeliers formait une société unique de commerce qui n’avait aucun intérêt à augmenter l’abondance en tirant du suif du dehors. Ainsi il ne se consommait de suif à Paris que celui des animaux qu'on y tue dans les boucheries, ce qui enchérissait cette denrée nécessaire au peuple » (3). Les lettres-patentes du 6 février 1776 enregistrées au lit de justice du 12 mars, abolissaient « ce commerce exclusif ; le prix du suif sera proportionné à celui des bestiaux qui le produisent, et les artisans auxquels l’usage en est le plus nécessaire pourront l’acheter à meilleure composition » (4). Les Déclarations du 25 décembre 1774 et du 8 janvier 1775 avaient supprimé d’abord « les droits qui se percevaient à l’entrée du royaume sur la morue sèche de pêche française ; puis tous droits d’entrée et de halle sur le poisson salé à Paris, particulièrement onéreux aux plus pau vres habitants de cette ville » (5). Enfin ne pouvait-on attendre de la liberté générale de l'industrie — telle que les Physiocrates l'avaient toujours plus ou moins activement réclamée — une réduction des prix de tous les objets manufacturés, donc une diminution du coût de la vie ? Ce serait « un bien inestimable, dont toutes les classes de la société ressentiraient en même temps les salutaires effets : combien le public ne gagnera-t-il pas à faire entrer les compagnons en concurrence avec les maîtres ? » (6). « Sous les institutions arbitraires, les citoyens de toutes les classes sont privés du droit de choisir les ouvriers qu’ils voudraient employer, et des avantages que leur donnerait la concurrence pour le bas prix et la perfection du travail... Les frais immenses que les artisans sont obligés de jteyer pour acquérir la faculté de travailler, les exactions de toutes espèces qu’ils essuient, les saisies multipliées pour de prétendues contraventions, les dépenses et les dissipations de tout genre, les procès interminables qu’occasionnent entre toutes ces communautés leurs prétentions respectives sur l’étendue de12*456 (1) (2) (3} (4) (5) (6)
Journal polit. et lilt., 15 janvier 1775, t. III, p. 75-76. B., Êph.y 1775, n° 4, p. 47. T ., Mémoire au Roi,Janvier 1776 (CE., t. II, p. 250). Œ. T ., t. II, p. 321 et p. 325, note. JD., Mém. Turgot, II· Partie, p. 14. Cf. Œ , i ., t. II, p. 402. Bigot, Essai, p. 109-110 et notes, p. 62.
ATTAQUE
ET D E F E N S E DU 8 Y S T È M E
203
leurs privilèges exclusifs... surchargent l’industrie d’un impôt énorme, onéreux aux sujets... ; enfin les facilités données aux membres des communautés de se liguer entre eux, do forcer les plus pauvres à subir la loi des riches, deviennent un instru ment de monopole, et favorisent des manœuvres dont l’effet est de hausser au-dessus de leur proportion naturelle les denrées les plus nécessaires à la subsistance du peuple (1). » d) L'intérêt du peuple en tant que salarié. — En dehors de l’intérêt général des consommateurs dont les diverses classes jouissent de moyens et d’un niveau d’existence variables, il faut considérer plus spécialement célui des simples salariés, pour qui la régularité de l’approvisionnement et la modération des prix ne sont pas seulement un avantage ou une commodité, mais une question de vie ou de mort, la seule garantie contre la misère et le dépérissement. E t tout de suite nous retrouvons les deux adversaires attitrés de l’École à cette date, Mably et surtout Necker, engagés l’un comme l’autre, dans une chaude controverse. « Je parlerai, s’écrie le premier, de toutes les provinces où les hommes qui gagnent 10 à 12 sous par jour étaient obligés d’acheter le pain plus cher que nous ne le payons actuellement [fin 1775] à Paris, qui est le centre et le gouffre de toutes les richesses du royaume. Je dirai que les malheureux ont été obligés pour vivre de vendre leurs chemises, leurs draps, leurs couvertures et tous les ustensiles de leurs chau mières... De cette misère sont nées trente émeutes qu’on n’a calmées qu’en menaçant les citoyens d’une espèce de guerre où des pendus ont été les trophées de la victoire (2). »— «Avant que les propriétaires se déterminent à augmenter le salaire des manœuvriers et des artisans, leur cupidité aura dévasté les campagnes. E t prenez garde, Messieurs les propriétaires, que vous ne trouviez quelque avantage à faire renchérir les grains que parce que vous avez la dureté et l’injustice de ne pas proportionner les salaires aux prix des denrées que votre avarice a établis (3). » Plus nettement encore Necker transporte le débat sur le terrain des conflits sociaux. « Cette liberté absolue du com merce *des grains n’est que la permission donnée aux proprié-123 (1) Turgot, É dit de février 1776 portant suppression des Jurandes, Œ. T., t. II, p. 302 e1 suiv. (2) Mably, Commerce des grains (Œ . I., X III, p. 260-261). (3) Ibid., p. 255-256 et p. 276. Cf. B. N.-Mss., n° 13796, p. 98.
204
LA PHYSIOGRATIE SOUS LE MINISTÈRE DE TURGOT
taires de déployer toute leur puissance... Si le blé vaut 20 livres, a-t-on dit, les champs de France ne rapporteront qu’un milliard, et s’il vaut 30 livres, ces mêmes terres rendront 1.500 millions... N’est-il pas clair que cette augmentation de fortune pour les propriétaires de blé n ’est oomposée que de la diminution de celle des autres membres de l’État ? C’est l’harmonie générale qui est dérangée, et voilà tout ; car il n’y a pas 500 millions de nouveaux biens descendus du ciel ou sortis de terre... Ces prétendus gains de société ne sont autre chose qu’une conquête momentanée faite par une classe de cette société sur le sort de l’autre (1). » Sans doute « l’homme industrieux parviendra à renchérir le prix de son temps, et les anciens rapports se rétabliront ; mais le passage du bas prix du blé au haut prix et les premiers temps de cherté procurent un avantage réel aux propriétaires ; car tandis qu’ils augmentent Je prix de leurs denrées, ils résistent à hausser celui du travail, ils combattent du moins contre les prétentions des ouvriers ; il suit qu’une disproportion subsiste, ils profitent de toute la souffrance de l’homme de peine... C’est, en dernière analyse, un encouragement sem blable à une capitation immense et rigoureuse, imposée momen tanément sur tous les hommes de travail au bénéfice de tous les hommes à propriété... il s’établit entre ces deux classes de la société une sorte de combat obscur, mais terrible, où l’on ne peut pas compter le nombre des malheureux, où le fort opprime le faible à l’abri des lois, où la propriété accable du poids de ses prérogatives l’homme qui vit du travail de ses mains (2). » « Dès que l’artisan ou l’homme de campagne n ’ont plus de réserve, ils ne peuvent plus disputer, il faut qu’ils travaillent aujourd’hui sous peine de mourir demain ; et dans un combat d’intérêts entre propriétaire et ouvrier, l’un met en jeu sa vie et l’autre un simple retard dans l’accrois sement de son luxe... Le savoir [aussi] s’oppose au travail comme capital ou moyen de luxe... (3). » Beaucoup moins sérieux est l’argument de l’auteur des Man-123 (1) Lég. Comm. Grains (Mélanges, t. II, p. 332-333). (2) Ibid.t p. 241-242, cf. p. 269-272 : sur les salaires réduits au minimum de subsistance et sur l’empire des propriétaires. (3) Ces passages sont cités par Marx dans son H Moire des doctrines économiques, t. I, avec référence au t. IV, des Œuvres de Necker (éd. 1786), p. 63 et 112. L’auteur ajoute : « Est-il bien sûr que cette inégalité de connais sances ne soit pas devenue nécessaire au maintien de toutes les inégalités sociales que l’on a fait naître ? »
ATTA Q U E ET D E F E N S E DU SYSTÈ M E
205
nequins accusant Turgot d’ « ôter ses dernières ressources à Tindigent en resserrant les fantaisies des grands proprié taires » du fait du « sacrifice » présumé de ceux-ci au commerce et à l’industrie (1). E t non moins spécieux le raisonnement du Parlement de Paris, en ses Remontrances du 4 mars 1776, lorsqu’il essaie de tirer la même conséquence de la soi-disant écrasante surcharge que ferait peser sur ses mêmes proprié taires la taxe de remplacement de la corvée (2). Mais ces mêmes magistrats frappent avec plus de vigueur et de perti nence quand ils déclarent que « la classe indigente des consommateurs ne pouvait se soutenir, au milieu de ces élévations rapides du prix des denrées, que dans le cas où elle aurait vu suivre cette progression dans ses salaires. Le temps a démontré combien cette progression était illusoire dans son principe, parce que le besoin vend ses bras à vil prix plutôt que de les laisser oisifs ; et quand cette progression se serait opérée, elle n’aurait été que successive, tandis que l’accroisse ment de la denrée était subit. Et avait-on calculé ce qu’un moment de détresse pouvait porter de découragement et de douleur dans cette classe infortunée qui n’a pour elle que son activité et la protection plus immédiate des lois ? » (3). Quelle va être la riposte de l’École ? Au lit de justice du 12 mars 76, le garde des sceaux parlant r.u nom du roi, exprimant donc non sa propre opinion, mais la thèse du minis tère, déclare avec optimisme « que la liberté de l’industrie proportionnera les salaires des ouvriers au prix des denrées nécessaires à la vie ; le nombre des indigents dimi nuera, etc. » (4). E t Condorcet proclame, non sans légèreté : « ... Pauvres ! si vous avez faim, travaillez pour le riche, il vous associera à sa richesse (5). » Le philosophe toutefois ne dédaigne pas de préciser davantage sa pensée, en revenant d’abord à son« Grand Calcul» sur les heureux effets de l’égalisa tion du prix des grains. « Il est évident, comme 2 et 2 font 4, que la liberté qui augmente le revenu des propriétaires, et par conséquent les salaires du peuple, diminue pour ce même peuple le prix moyen de sa consommation, c’est-à-dire qu’elle diminue les paiements que le peuple a à faire en augmentant12345 (1) (2) (3) (4) (5)
P. 34-36. Cf. Flammermont, t. III, p. 286. Ibid., p. 298-299. Œ. Γ., t. II, note, p. 325. Commerce blés, p. 87.
206
LA PH YSI OC RATI E S O L S LE M I N I S T È R E D E TURGOT
les moyens qu’il a de payer. Donc, la liberté, la liberté seule, peut adoucir le sort du peuple (1). » « Car, ainsi les salariés seront plus forts en eux-mêmes, puisqu’ils s’approcheront davantage du prix moyen ; et de plus, par tous les temps, ils suffiront (2). » « Ce qui importe au peuple, ce n’est pas que le blé soit à un prix plus ou moin haut, c’est que le prix n’en soit pas exposé à de grandes variations... Il n’éprouve plus, dès lors, ces alternatives d’abondance où il manque du travail, et de disette où son travail ne lui suffit pas (3). » « Dans les années où le prix des denrées sera très bas, comme une partie de ceux qui font travailler se trouve avoir un revenu moindre en argent, il y aura [aussi] une moindre masse de salaires exprimés en argent ; et le peuple pouvant travailler à un prix plus bas, il résultera que le prix doit baisser ; mais le peuple se refuse à ce baisseraent dont il craint que l’on ne prolonge la durée. Ainsi, bien que dans une année de bas prix, les salaires se soutiennent au même prix, le nombre en diminue, et le peuple manque d’ouvrage. » Il est encore « intéressé à ce que le prix moyen du blé ne soit pas trop bas : 1° parce que, dans les années où il serait, par quelque accident, obligé de tirer sa subsistance du dehors, il se trouverait hors d’état de l’acheter ; 2° parce qu’il doit désirer un prix assez élevé pour que la culture s’améliore... » (4). Dans les années de disette, en revanche, « le revenu des propriétaires payés en argent, des cultivateurs, des rentiers, exprimé en denrées de nécessité première, étant moindre que les autres années, ils en auront moins à employer en dépenses superflues, et ceux qui sont peu riches remettront à une autre année tout ce qui n ’est pas nécessaire ; ainsi le nombre des salariés étant le même, la masse de leurs ouvrages et celle de leur salaire, évaluée en denrées, sera diminuée ; il y aura une plus grande concurrence entre les ouvriers, et par conséquent le prix [de leur travail] exprimé en denrées sera plus bas » (5). « Les énormes différences, d’une année à l’autre, dans le prix du blé, sont la cause de la misère du peuple, parce que [alors] les salaires n ’augmentent pas à proportion (6). » Le123456 (1) /did. y p. 37. (2) Réflex. Comm. blés (GE., t. X I, p. 141-142). (3) Article Monopole ((E., t. X I, p. 44.) (4) Réflex. Comm. Blés (Œ.t t. X I, p. 143). (5) Réflex. Comm. Blés, t. X I, p. 133. (6) Note à l'article Blé du Dictionnaire philosophique de Voltaire, édition de Kehl.
A T T A Q U E ET D É P E N S E DU SYSTÈ M E
207
Trosne développe en termes analogues cette même thèse (1). « Les nationaux trouvent toujours assez d’occupation lorsque les revenus de la nation ne sont pas déminués ; ils en trouvent toujours davantage lorsque ces mêmes revenus sont augmentés par une sage économie (2). » Dupont félicite Turgot d’avoir posé comme principe fondamental « l’aisance du peuple, par l’augmentation de la richesse des propriétaires et les facilités plus grandes qu’on lui donnerait [ainsi] pour subsister » (3). Mais s’il survient quand même des années de disette ou de cherté où les salariés se voient menacés de ne pas trouver du travail suffisamment rémunéré, ou même point de travail à aucun prix, « la manière utile et sage de soulager les besoins véritables du peuple consiste dans l’orga nisation de ces ateliers de charité » que Turgot alors qu’il n’était encore qu’intendant de Limousin, avait été le premier à proposer au ministère, dès 1766 ; on lui épargnera ainsi la corruption de l’oisiveté et l’avilissement de l’aumône, et on évitera de lui fausser l’esprit par la persuasion que le gouver nement doit le nourrir, soit qu’il travaille ou ne travaille pas, et de fixer le prix des denrées à sa portée, ou le mettre [luimême] à portée de les acquérir (4) ». « L’année prochaine, écrit Dupont, le 4 septembre 1775, la totalité des chemins du royaume formera un immense atelier de charité qui ne laissera presque point de besoins réels à la partie indigente et laborieuse du peuple (5). » Déjà l’Arrêt du 25 avril 1775 avait annoncé que « pour procurer à ses peuples les moyens d’atteindre à la cherté actuelle que la médiocrité de la dernière récolte rend inévi table, S. M. multipliait, dans tous les pays où les besoins se font ressentir, les travaux publics » ; pour les femmes ellesmêmes s’ouvriraient des ateliers de filature et de tricot (6). Le peuple des campagnes n’aurait plus à souffrir de l’oppression économique des villes : « Les habitants des unes et des autres ne seront plus que des frères, ayant un droit égal aux bontés (1 ) Discours au Bailliage d ’Orléans, 10 janvier 1775, Ordre social, p. 452. (2) £>., Mèm. Turgoty IIe Partie, p. 206. (3) Ibid., p. 3. (4) Ibid.y p. 80. Cf. dans le même sens, Condorcet, Réfl. Comm. Blés (Œ., t. XI, p. 133). Cf. B.y Éclaircissements y p. 286, M. Albert, aujourd'hui lieutenant général de police de Paris, proposa les ateliers de charité sous le ministère de M. d ’Invau (1766) ; ils viennent d’être multipliés sur les ordres de M. Turgot. (5) D. au Margrave de Bade. Cf. Knies, 1.1, p. 82. (6) Œ. T.y t, II, p. 185-188.
208
LA P H Y S I O C R A T I E S O U S
LE M I N I S T È R E D E TURGOT
d’un père commun (1). » Paris, pour cela, ne perdra ] son rang : « La ville qui tua les prophètes devint le th< de la désolation ; mais celle qui méconnaît et injuri« Économistes sera sauvée par leurs principes régénérât Petit è petit, elle changera de substance ! Elle cessera d le séjour des vampires, et doublera de force et de splen comme étant la résidence des Hautes-Cours et des Ofïi supérieurs qui desservent le gouvernement paternel d nation florissante ; la patrie des sciences utiles et des prospères, et de toutes les ressources qu’invente, perpéti multiplie l'industrie libre et soudoyée par la dépense c menses revenus toujours assurés et toujours croissants ( Au sein même du peuple citadin régnera une fratei nouvelle. « Plus de cette tyrannie des maîtres qui tue Γ* lation, rend inutiles, expose & la vexation, une quantit sujets qui auraient pu servir l’É tat et qui auraient m que leurs peines leur eussent été profitables (3). » Plus d’ex tation des apprentis et des compagnons (4) : l’Édit février 1776 leur apportera la justice (δ). Contrairemei ce que pensait Mably, que la liberté des travaux permettr; < quelques hommes plus industrieux et plus riches que autres de profiter de leurs avantages pour mettre en 1 mains tout le commerce > (6), Condorcet assure que, < seulement elle empêchera la portion la plus pauvre et la faible de la société d'éprouver l’oppression et de gémir ( la dépendance des commerçants riches et des fabric; privilégiés, mais qu’elle favorisera une distribution égale des fortunes (7). » Baudeau ne se prive pas d’aceuser Necker de démage « Pourquoi faites-vous dire au plus grand nombre de eiioyt nous ne possédons rien ? Leurs habits, leurs meubles, 1< effets, leur argent, leurs contrats, ne sont-ils pas des possess que les lois leur garantissent ? Ne sont-ils pas les maître! les employer à leur gré ? S’ils voulaient et s’ils savaient propriétaires ou cultivateurs, qui est-ce qui les en empêcl S’ils n’ont eu ni assez de bonheur, ni assez de conduite p123 (1) Condorcet, Lettre* Comm. grain*, p. 28. (2) M ., Supplém ent, p. 312. (3) TiÜBut, R éft. philo*., n ote, p. 242.
(4j CL Bigot, notes. (5} CL Turgot, Œ ., t. II, p. 302. (6; Comm. grain* (Œuvre* M aùtu. L XIII. d. 288 289).
A T TA Q U E ET D E F E N S E DU SYSTÈM E
209
amasser un capital, est-cc la faute des lois ? est-ce la faute du gouvernement ? est-ce la faute des propriétaires fonciers et des cultivateurs ? » C’est un peu déjà le célèbre : Enrichissezvous; le conseil était-il plus facile à suivre alors qu’à l’époque de Guizot ? Mais l’abbé de reprendre l’avantage lorsqu’il démasque ce qu’il peut y avoir d’hypocrisie dans le plaidoyer des manufacturiers en faveur soi-disant de leur personnel. « Dites-nous donc d’abord pour qui vous travaillez ! Ce n’est pas pour les simples ouvriers employés à ce commerce Votre politique [quand vous voulez le maintien des denrées à bas prix] a pour but de les multiplier en les réduisant au plus strict nécessaire, parce qu’il en résulte deux avantages pour le commerce extérieur : savoir son agrandissement et la sauvegarde contre la concurrence étrangère, et le bon marché de la main-d'œuvre, ce grand ressort de votre économie colbertiste (1) ! » Chose curieuse, lorsqu’il s’agit d’entreprises réellement productives aux yeux des Physiocrates comme la grande pêche — dont la structure sociale est analogue en somme à la grande culture — l’abbé prend vivement la défense à la fois des armateurs, assimilés à de grands cultivateurs, et des matelots, comparables à des ouvriers agricoles. « Ce ne sont pas les propriétaires des bateaux de pêche qui s’enrichissent aux dépens des pêcheurs ; les armateurs assurent tous qu’ils sont presque toujours en perte ; et la preuve qu’ils disent vrai, c’est que le nombre de ces barques diminue tous les ans. » Et cependant « les matelots pêcheurs ne gagnent que leur subsistance et leur entretien indispensable ; leur sort est, comme celui de tous les ouvriers, beaucoup plus digne de pitié que d’envie » (2). La responsabilité de cette médiocre fortune patronale et de cette pauvreté ouvrière, Baudeau la fait retomber sur le fisc, dont les taxes énormes empêchaient une large consommation du poisson. Avouons cependant que les Physiocrates, en général, se résignent facilement à cette espèce de loi d'airain des salaires ; qu’ils s’en accommodent même volontiers. Bœsnier est bien leur interprète quand il explique que le juste salaire est préci sément fixé par la concurrence. « C’est par la variété infinie des travaux auxquels elle s’étend que la subsistance du peuple devient ordinairement si modique, et ne représente que l’absolu (1) B., Éclaircissements, p. 85-87. (2) B., Éph., 1775, n° 4, p. 184-185. G. W E I L E R S S E
14
210
LA PHYSIOCRAT!E %OV% LE WltflÉTÊJlE DE TCRCOT
nécessaire dam les grande* sociétés f l » Cette concurrence universelle est en somme naturelle et salutaire. · Donnez à un ouvrier le double de ce qui lui est nécessaire pour sa subsis tance dans son état, et bientôt il ne travaillera plus. Quelques gens plus actifs travailleront toujours pour amasser de plus en plus : mais ce n’est pas le train ordinaire de cette espèce d’hommes qu'on appelle mumœuvrt* ci ouvrier* ; et. si Ton contraint le.peuple à travailler d un boot de sa vie à l'autre, ce n'est qu'autant qu'on ne loi accorde que très peu par delà sa subsistance journalière. Le commerce etranger établit le taux convenable pour le travail par la facilité qu'il donne d’échanger les denrées du pays, que les ouvriers seraient dans le cas de consommer, contre d'autres denrées qui ne peuvent être d'usage que pour les riches... : voilà ce qui force le peuple à travailler... Ce n'est pas que. dans des vues purement morales, il ne fût au m bien que les grands vins de Bordeaux fussent consommés en partie par les paysans et les ouvriers de cette province que d’être consommés entièrement, soit en nature, soit en sucre et en café, par les seuls propriétaires des terres ou leurs représentants... Mais c'est qu au fond il serait peut-être également imposable qu'un peuple entretenu dans une si grande aisance pût être laborieux : et que des culti vateurs et des propriétaires cuHivassent pour ne retirer aucune jouissance de leurs productions. C’est parce qu'on ne donne qu’une certaine quantité de denrées pour le travail des manufactures communes, qu'il en reste assez aux riches pour payer les travaux des manufactures de luxe : c'est ainsi que le bas prix du travail ordinaire du peuple multiplie le travail, en laissant le moyen de salarier plus de travaux (2). > Les résultats de cette ample discussion sont sans doute aussi précieux pour Γintelligence de la doctrine sociale des Physiocrates que compromettants pour le succès de leur programme. Mais il y a phis : en examinant de plus près, et objectivement, leur soi-disant principe de la proportionnalité spontanée entre le coût de la vie et le taux des salaires, un philosophe qui n ’est cependant point un de leurs adversaires décidés, le renversa complètement. Si le blé est à bas prix déclare Condillac, le cultivateur est forcé de restreindre sa culture ; « car. avec le faible bénéfice qu’il trouve sur les blés qu’il vend, il pourra d’autant moins s’engager dans de12 (1) Gm t . p. 85. (2) iè ié ^ p . 170-172.
A T T A Q U E ET D É F E N S E DU SYSTÈ M E
211
grands frais de culture, que le journalier qui, par le bas prix du pain, gagne en un jour de quoi subsister deux, ne voudra pas travailler tous les jours, ou exigera de plus forts salaires » (1). Mais si, après cela, ne fût-ce que par la diminu tion de la culture, survient la cherté, « les cultivateurs qui se ressentent des pertes qu’ils ont faites ne sont pas assez riches pour faire travailler tous ceux qui se présentent... Les journa liers demandent à l’envi de l’ouvrage, ils en demandent tous les jours, et ils s’oiîrent au rabais » (2). C’est presque la formule des Remontrances du 4 mars 1775 : « Le besoin vend ses bras à vil prix (3). » E t Turgot lui-même reconnaît que la solidarité d’intérêt célébrée par l’École entre propriétaire et journalier est loin de constituer une association entre égaux : car, s’il maintient que le prix des denrées ne saurait augmenter d’une manière constante sans que le salaire des journaliers augmente..., le propriétaire commence par être enrichi, et l’homme de journée n ’a jamais que ce qui lui est nécessaire pour subister. « L'aisance du propriétaire assure aux journaliers non pas l’aisance, mais le nécessaire » (4). Aussi s’est-il proposé, parfois, de remédier à cette fondamentale inégalité : ., 24 juin 1780. Cf. Schelle, Œ. Γ., t. V, p. 628. (2) M. à Longo, 12 nov. 1776, Mes. A U , XVI, p. 52. Cf. 21 juin 1785, XVII, p. 206 : « Le diable d’homme I il y a deux heures que je travaille pour donner un habit décent à cette phrase expressive et marotique... Qu’il demeure burlesque, puisqu’il le veut être 1 » (3) M. à L.y 12 novembre 1776, Mss. Aix, p. 53.
*240
LA PH Y & IO C R A TIE SO U S L E M IN IS T È R E D E If ECKER
taieurs troublés et déroutés — ce ne serait que désordre et perdition pour tout le reste. Nous marchons è grands pas vers oette époque... Voilà l’Amérique septentrionale éman cipée, mais nos colonies à sucre le sont par le même traité. Voyez l’oppression anglaise se retirer depuis les côtes de l ’Asie, et tous ces grands plans universels chez les petits et grands du commerce, exclus au Levant, au Couchant, au Midi et au Nord, descendre des tètes, fuir des cabinets et des papiers publics, et faire place à de meilleurs systèmes agricoles... Le paradis terrestre et politique sera quand les gens de sens droit tiendront le haut bout, et que les ivres seront tenus d’obéir ou de s’aller coucher ; et ce paradis-là, l ’instruction le fera. Dites à tous sycophantes, théologiens, politiques, philosophistes, fiscaux, trafiquants, municipaux, légistes, et même médicaux : Vous ne nous tenez plus, quant à la généralité du moins ; nous avons Γimprimerie, qui d'abord brouille tout, mais replace loul ensuite (1) ! » Court de Gébelin, qui publiait en 1781 le tome huitième de son Monde Prim itif, en profitait pour faire à la morale physiocratique une large publicité ! Tl vivait alors dans l'intimité du marquis (2), et ne se lassait pas de proclamer les .mérites de cette « sublime philosophie », seule capable de « sauver les nations, de faire de l’Europe une assemblée de frères, et de l ’univers un tout lié par les mêmes droits, soutenu par les mêmes devoirs, heureux par les mêmes jouissances, ayant aussi le même langage, celui de l’ordre... base essentielle de toute législation » (3). Buiré donnait une étude sur les Lois naturelles de Fagriculture (1781), où il présentait une nouvelle réédition du Tableau économique strictement composé suivant les principes de la Phgsiocratie et de la Philosophie rurale (4) ; et le comte d’Albon, c l’Alcibiade chéri du Socrate de nos jours », comme rappelait plaisamment Grimm, publiait en 1779, ses Daman historiques, politiques d critiques sur quelques gouoernemenh de ΓEurope, où il proposait sérieusement à l’Ajagleterre. afin d’éteindre sa dette publique, de vendre toutes ces inu tilités que constituaient ses colonies (5). Mais les œuvres capitales émanaient de l’école d’Orléans.1234 (1) (2) (3) (4) 45)
M . à Longo, 28 aoftt 1779, M es. A U , p . 161. M onde p rim itif, t 8 , p . ix . C ourt de GébeUn, p . l x - u u i . Cf. n o ie, p . 102. CL G rim m , C orrap., ju in 1779, L X II, p. 256-257.
l ’é c o l e
et
le
parti
241
D’abord les livres de Le Trosne, qui allait se révéler de force à soutenir la discussion avec un Condillac. Dès 1777, le traité de L'Ordre social, dont les premiers discours seulement (1) avaient été lus à l’Académie de Caen en 1770 et 1771, et qui paraissaient maintenant augmentés d’une importante disser tation sur l'Intérêt social. Puis, en 1779, un ouvrage encore plus considérable, L'Administration provinciale et la Réforme de l'impôt, rédigé vers 1775, dont le Discours préliminaire avait été publié en 1777 à Orléans, et dont une édition au moins allait être grossie d’une Dissertation sur la Féoda lité (1780). A l’égard de cette collaboration, peut-être trop ambitieuse à son gré, Mirabeau se montre aigrement réservé, a II s’agit d’un énorme volume de 800 pages au moins in-4°. Vous y trouverez bien des détails, mais ceux de ce genre sont toujours fautifs plus ou moins ; l’auteur fixe mal l’impôt et ne donne aucune mesure réelle ; d’où suit que, voulant bannir l’arbi traire, il y retombe par l’autre côté (2). » M. L. T... vient de « donner, ou piller, ou délayer beaucoup... et il bronche à chaque pas (3) ». a ... Comme on ne laisse rien imprimer, il y a mis beaucoup de frais, de peine et d’intrigue ; tout le monde n’a pas cette patience-là (4). » D’après Bachaumont, « l’ouvrage fut un moment distribué gratis, quoiqu’il eût dû coûter une douzaine de livres. Necker d’abord le soutenait ; mais il l’abandonna bientôt pour se ménager le clergé, que l’auteur voulait imposer comme les autres corps de l’État ; on le vendit bientôt très cher et clandestinement » (5). Par ordre du garde des sceaux en effet, « la vente en fut patriotiquement arrêtée à Paris ; et les soins prohibitifs du ministre réussirent si bien que, malgré que l’ouvrage eût été couronné par l’Aca démie de Toulouse, il y en eut peu d’exemplaires vendus en France » (6). L’auteur mourut presque aussitôt après (26 mai 1780) accablé de chagrin. — L’autre représentant de 1’ « école orléanaise », Saint-Peravy était au dire du marquis, « meilleur économiste et de meilleure foi ; celui-là a fait un (1) Les cinq derniers avaient été composés entre 1771 et 1775, et dans le même temps les cinq premiers avaient reçu maintes retouches. (2) M. à Longo, 3 novembre 1779, Mss. Aix, XVI, p. 164. (3) M. à Longo, 11 février 1780, ibid., p. 175. (4) Ibid., 11 février 1780. (5) Cf. Belin, Mouv. Phil., p. 355 (Mém. secrets, XIV, 13 now, 19 déc. 1779). (6) Brissot de Warville, Observations d'un Républicain, p. 114. O . W E I L B R SSS
16
2 ‘i S
LA P H Y S I O C R A T ! « S ö ü i
LE M i m S T f e f c E D E NECKER
Plan, appuyé de dépouillements de culture, qui serait fort bon pour donner au moins des aperçus... Mais il n’a pas 1t môme entregent que l’autre pour imprimer » (1). Malgré l’interdit jeté sur les Mardis de Mirabeau, les Économistes « plus que jamais font corps, peut écrire Bachau· mont en octobre 1776 ; ... ils ont imaginé des réunions et des formules de réception pour les initiés.. G’est aujourd'hui M. Turgot qui préside ; il a loué ïHotel de Brou, où une très belle galerie Sert à réunir tous les Frères, à prononcer des discours, et & l’admission des candidats » (2). Remarquons-te toutefois, ce n’est plus un pur Physiocrate qui dirige tes séances ; et il s’en tient d’autres, en concurrence avec cefles-là, dont l’organisateur en est un Certes, mais très indépendant et fort irrégulier, l’inépuisable abbé Baudeau. Toujours le même, capable de « prendre à tout, incapable de se fixer a rien, ce ne sont qne les soubresauts de la chose économique qui l’y ont acharné si longtemps ; unique pour tout ce qui peut se faire dans la règle des 24 heures ; et au-delà rien » (3). Λ la « Société d'Émulation qu’il a formée, moyennant 2 fouit A'tir par an, se fait inscrire qui veut... La caisse a été garnie avec promptitude, sous les auspices du beau sexe, enrôlé lui-même, qui faisait les quêtes et les recrues j>. C’est es décembre 1776, qu’a eu lieu l’inauguration, où fut rendu « le premier hommage public a ce tendre amour des arts utiles »(4). L’agriculture n ’est pas l’objet exclusif de ce groupement nouveau, elle n’y occupe même pas, aemb}e*t«-ü, la place d’honneur (6). « On y recherche te9 moyens de remplacer lMfcdigo naturel ; on y propose des prix pour la meilleure machine à fabriquer des aiguilles ; et si, à cèlé de ces vulgari sations d ’ordre technique, on aborde un problème économique, on se préoccupe de relever les manufactures, de ies soutenir contre la concurrence anglaise et allemande, tout autant que de ranimer la production agricole (6). » Nous ne savons ce que sont devenues les « assemblées » de Turgot ; mais celles de Baudeau se sont maintenues en12345 (1) M. à Longo, 3 ftövembw 1770, Alte. Aftc, XVI, p. 164. (2) Atim . setrtts, ÔS octobre 1776, t. IX , p. 275-274. (3) M. à Longo, 3 novembre 1779, Mes. A ix, XVI, p. 164. (4) Linguet, Annales, t. IÎI, p. 250-251 (1777). (5) Le titre précis est d’ailleurs : « Société libre d ’Émulation pour l’entouragecneitt êes inventions qui tendent à perfectionner la pratique des arts et métiers, à l'imitation de celle de Londres. » (G) Linguet, op. ait., p. 256-259.
l ’é c o l e
et
le
parti
2 43
conservant le même caractère d’instruction scientifique géné rais à l’usage des gens du monde (1). « La salle de concert de VHôtel de Soubise était le sanctuaire choisi, écrit mécham ment Linguet, pour les vêpres de cette confrérie..* La partie supérieure était réservée pour le clergé, c’est-à-dire poui\leB vénérables associés. Le bas était abandonné au vulgaire. L’espace entre deux... était consacré aux femmes qui hono raient l’institut de leur protection.*. Au milieu de ce cercle de Sibylles s’élevait l’autel, chargé de toutes les reliques destinées, à satisfaire et à échauiler la dévotion du public. On apercevait, par exemple, une soi-disant serrure, une espèce d'alambic..., un mouton à piloter, une rame, un /ust/, etc. Quant à M. l’abbé, il était partout, et sa figure disait : C’est moi qui suis le saint de la fête (2) ! » S’il faut en croire le pamphlétaire, en 1778, la Société était en pleine croissanoe ; elle allait avoir quelques filiales en province, la première è Reims ; elle avait recruté, surtout parmi les hautes classes de la société (3), « beaucoup d’esprits vraiment éclairés » ; elle jouissait même de la faveur du gouvernement : n’était-elle pas autorisée « à solliciter ouvertement la charité publique », et ne disait-on pas qu’elle allait demander < à être reconnue par lettres-patentes ? » (4). Mais, en dépit de la personnalité de son remuant secrétaire, qu’avait-elle de commun avec la Physiocratie ? Elle devait d’ailleurs se dissoudre en 1781. Parmi le groupe même des fidèles, que subsistait-il de l’unité doctrinale d’autrefois ? Dupont, sans doute, est resté Économiste, au témoignage même du comte de Mirabeau ; mais il est aussi « philosophe, éclectique, c’est-à-dire qu’il prend et rejette indifféremment toutes les opinions qui lui paraissent vraies ou fausse » (5). N’avait-il pas fini par adopter12345 (1) En 1777, la Société comprend 20 grande seigneurs, 19 gens de robe 4 abbés, 4 femmès de la noblesse, 1 littérateur, pour 6 négociants, 3 ban quiers, 6 savants (dont Condorcet et Lavoisier). Cf. Ballot, p. 403. (2) « C’était à coup eûr la plus curieuse de ses machines ; rengorgé, pincé, adonisé, tendant la main -è l’on, donnant un coup d'oeil à l’autre, souriant gracieusement aux femmes, s’inclinant avec une dignité qui ne dérangeait ni les marrons de sa frisure, ni les plis de son manteau, ni sa croix pectorale ; c’était une image sensible du m ouvem ent perpétuel. · Linguet, Annales, t. IV, 1778, p. 239-237. (3) « Loin de chercher à humilier les grands, ils o n t tou jours soigneuse ment cultivé leur faveur ; c’est surtout sons la pourpre qu’üs ta ch a n t de faire des prosélytes. » Linguet, Annales , t. I II , 1777, p . 242. (4) Ibid., IV, 1778, p. 241-247. (5) Lettre du comte de Mirabeau écrite du donjDn de Vincennes en 1779. Citée par Schelle, Dupont, p. 207-208.
244
LA PH Y S ÏO CRA TIE SOUS LE M I N I S T È R E D E NECK ER
presque dans toutes les questions le point de vue de Turgot, qui n’était pas toujours, il s’en faut, celui de Quesnay ? Baudeau avait retrouvé dans VAdministration provinciale « les excellentes idées de la Philosophie rurale, de la Théorie de VImpôt, et des auteurs qui de son temps enrichissaient les Êphémérides ; mais très bizarrement amalgamées avec la doctrine hétérodoxe et antimonarchique dont les prôneurs de M. Tu (Turgot) veulent faire honneur à sa mémoire » (1). L’instable abbé, dira-t-on, était médiocrement qualifié pour s’ériger en gardien sévère de l’orthodoxie ; et peut-être Dupont approuvait-il dans le grand ouvrage de Le Trosne précisément ce que l’autre y réprouvait ? Peut-être l’École, réduite à un petit cénacle, gardait-elle, tout en évoluant, quelque cohésion. Mais nous ne voyons pas que Dupont lui-même ait salué sans réticence l’œuvre si consciencieuse et si approfondie de son confrère ; c’est « un assez gros livre, écrit-il..., où, parmi un grand nombre de choses très estimables, j ’en trouverais quelques-unes qui me paraissent moins bien vues » (2). Parmi les écrivains de l’époque, combien les Économistes comptaient-ils encore de ces auxiliaires qui leur avaient été si précieux ? Roucher, dans le premier chant de ses Mois (1779) ne se contente pas de célébrer au nom des laboureurs : Ministre de qui Rome eût adoré l’image, Turgot, libérateur des blés et des vins (3) ; il accompagne ses vues d’un commentaire où il reproduit fidèlement tout le formulaire physiocratique (4). Grimm découvre « dans un manuscrit de M. le docteur Franklin tous les principes auxquels se réduit le système économiste », et dégage de multiples rapprochements avec certaines thèses contemporaines de Le Trosne (5). L’auteur américain avait d’ailleurs reçu le12345 (1) B., Réflexions, III· Partie (1787), p. 17-18. (2) D. au Margrave de Bade, 10 janvier 1780. Cf. Knies, 1.1, p. 201. (3) De cruelles entraves Enchaînaient dans leur course et Bacchus et Cérès : Quelle main osera les venger ? Tu parais, El soudain je les vois, pour enrichir ton Prince, Librement circuler de province en province ; Le commerce renaît, prend un vol plus hardi, Et Iss moissons du Nord nourrissent le Midi... Les Mois, Chant I, p. 23. (4) Ibid., n. 30, p. 61. (5) Grimm, janvier 1780, Corresp., t. X I 1, p. 3 5 e.
l ’é c o l e
et
le
parti
245
nouveau « Tableau économique » de Dupont, et il « le regardait comme une excellente chose, en ce qu’il contenait d’une manière méthodique et claire tous les principes de la nouvelle secte qu’on appelle ici les Économistes » (1). Mais le célèbre abbé Rozier, l’auteur du Cours complel d’Agriculture, ne fait, au dire de Mirabeau que « compléter tout ce qui a été écrit depuis Varron et Columelle ; sa spéculation n ’est que de pur commerce et entreprise ; cet homme, très remuant, est le plus grand escamoteur d’idées et d’exécution qu’ai produit ce siècle, et c’est beaucoup dire » (2). Plus intéressant aux yeux de l’École était le livre de Butel-Dumont ; l’auteur avait figuré parmi les précurseurs de la veille (1755) (3) ; cédant au retour de vogue de l’antiquité classique, il louait YAdminis tration publique et privée des terres chez les Romains (1779), du moins aux premiers temps âe leur histoire. Entre Encyclopédistes et Économistes proprement dits la chûte de Turgot avait naturellement détendu, sinon rompu, le lien le plus fort qui pût encore les unir. « Depuis la disgrâce, assure non sans vraisemblance Linguet, les deux sectes se sont un peu refroidies ; elles ont pris le parti de se spécialiser chacune pour leur compte. La première est retournée à la littérature ; ... l’autre, en pleurant l’occasion manquée, s’est rejetée du moins sur les arts utiles : elle y a porté un enthou siasme devenu suspect et ridicule dans la politique (4). » Nous voyons bien d’Alembert ériger « un monument acadé mique à la gloire du Docteur Quesnay » et déclarer qu’il a bien mérité l’espèce « d’apothéose » que lui ont accordée ses disciples, « par ses connaissances, par ses lumières, par son humanité, par son désintéressement ; enfin par ses travaux et ses vertus » (5). Mais Grimm ne manque pas une occasion de jeter encore un peu de ridicule sur « la vénérable confrérie ». Le colonel de Saint-Leu, un des collaborateurs des Éphémérides, ayant été « trouvé sur le bord d’un fossé des nouveaux boulevards, la tête fracassée d’un coup de pistolet, on ima ginera sans doute, écrit-il, que c’est l’amour de la liberté indé finie, la décadence sensible du crédit de la secte, le désespoir de ne pouvoir ramener le genre humain aux grands principes de l’ordre... qui auront déterminé ce sage à un parti si violent.12345 (1) (2) (3) (4) (5)
Lettre de Franklin à Vaughan, 0 novembre 1779 (trad. Laboulaye). Ai. à Longo, 22 mars 1780, Mss. A ix, XVI, p. 178. Cf. Mouv. Phys., t. I, p. 28. Annales, 1777, t. III, p. 250. Cf. J. A ., janvier 1782, p. 65-66 (lettre de M. de la Blaneherie).
246
LÀ P H Y S IO C R A T !B SOUS LE M I N I S T E R E DE NECKER
Eh bien ! ce n’cst rien de tout cela ; c’est une passion malheu reuse pour une jeune et jolie femme, etc. » (1). Le téméraire comte d’Albon ayant suggéré que l’Angleterre, une fois débarrassée de ses colonies, pourrait transformer ses navires de guerre en vaisseaux marchands, le même impitoyable ironiste lui souffle un projet bien plus séduisant encore ; ce serait qu’elle se défît de tout genre de flotte « pour acquérir, ce qui serait bien plus profitable, des semences de la meilleure espèce, des charrues, et, sur toute chose, les auteurs les plus célèbres de la doctrine par excellence » (2). Necker, enfin, a rallié à lui toute une troupe de gens de lettrée, où figurent à la fois Morellet, qui d’ailleurs n’écrit plus, et l’abbé Raynal, qui « fait le service de timbalier » (3) ; sans parier de tel ancien physiocrate converti k d’autres prin cipes de commerce, comme Abeille, qui de 1776, à 1778 e’en prend ouvertement à Dupont (4). Avec Turgot, qui va disparaître en 1781 sans avoir cessé jusqu’à la fin de protester qu’il n’avait « jamais été ni encyclopédiste ni économiste » (5), Condorcet reste à peu près le seul écrivain notable à maintenir la liaison entre a philosophie et économisme » (6). Voltaire, sur ses derniers jours, s’était bien gardé de sortir de sa pru dente neutralité, et de se ranger, comme le jeune marquis, parmi ceux qui, pour combattre Necker, « dénigrent JeanBaptiste » (7). L'Observateur Anglais de Mairobert reconnaissait l’activité persistante déployée par « la multitude des propaganistes de la Société : point de province, point de ville, de village, qui ne se renomme de quelque correspondance avec les chefs de la capitale. Ces sages modestes répandaient ainsi leurs lumières de toutes parte, prétendant gouverner les hommes de leur cabinet par leur influence sur l’opinion, reine du monde ». Π ne ménageait pas « les différents contrôleurs généraux qui [de Bertin à Terray] tantôt semblaient adopter les principes (1) Grimm, Corresp., mai 1780, t. X II, p. 393-394. (2) Ibid,, juin 1779, t X II, p. 256-257. (3) Lattre du marquis de Caraccioli k d'Alembert. Recueil complet dee ouvrages publiés pour et contre M. Necker, 1782, t. I ll, p. 58. (4) Cf. Schelle, Duponty note, p. 204. (5) T. à £>., 24 juin 1780, Œ. 7\, t. V, p. 628. (6) A t'arrivée de Neoker il avait voulu se démettre de ses fonctions d'inspecteur général des monnaies ; mais il avait finalement conservé sa place. Cf. L. Cahen, Condorcet et la Révolution, p. 9. (7) Cf. Lettres de Voltaire à Condorcet, 22 novembre et 22 décem bre 1776, Œ. T.y Condorcet, t. 1, p. 136 et 140-141.
l
’é
c o l e
e t
l e
p a r t i
217
du parti lorsqu’ils favorisaient leur cupidité particulière, et les décriaient après, afin de faire retomber sur lui l’odieux de leurs opérations ». Mais il ridiculise à son tour l’apothéose du Docteur ; « après un splendide dîner donné aux Frères, Mirabeau avait convoqué chez lui les affiliés, les aspirants, les amateurs, au nombre de 200 environ... ; on connaissait déjà le phœbus, l’obscurité, le néologisme du Successeur ; mais il s’est surpassé... » Suivait une condamnation en règle des hommes et de U doctrine : « Comme en médecine il faut être nécessairement charlatan pour plaire aux malades et gagner leur confiance, ces médecins politiques, pour fixer l’attention du ministère et l’admiration du public, ont cru devoir se servir d’un langage extraordinaire... D’axiomes clairs, irré sistibles dans la spéculation, ils ont tiré des corollaires qui peuvent être très fautifs dans la pratique (1). » Dans toute la littérature de l’époque, d’ailleurs, le point de vue soeial plus ou moins révolutionnaire, tend à dominer les considérations proprement économiques, notamment agricoles, et surtout agronomiques (2).12 (1) t. U 1777, p. 278, 282, 283, 288, 289. (2) Cf. Wolters, p. 169.
C h a p it r e II
LA RÉAFFIRMATTON DES PRINCIPES LE PROGRAMME AGRICOLE Il peut sembler surprenant, mais il est en réalité facilement explicable, que les Physiocrates, rejetés une fois de plus loin du succès après avoir paru l’atteindre, en reviennent à la confirmation, exaltée ou méthodique, de leurs principes pri mordiaux et exclusifs. Chez Mirabeau, cela va de soi, continuaient d’abonder les considérations agro-théistes : « Dieu seul est donateur et rémunérateur ; tout autre n’est et ne saurait être que distri buteur... Or, il est un genre de travail que Dieu récompense par l’organe de la nature, dont il double l’efTet et la mise en pur don, et peut même les tripler et les décupler selon que nous serons plus près des conditions de l’ordre et plus fidèles à ses lois... : c’est l’art par lequel l’homme... se rend en quelque sorte le substitut du Créateur, c’est Yagriculture (1). » Mais le plus positif théoricien du système à cette époque, Le Trosne, en termes moins grandiloquents, professe le même déisme agricole ; « ce n ’est pas l’homme qui par son travail donne à la terre sa fécondité ; elle la tient de la puissance du Créateur et de sa bénédiction originaire » (2). Grimm, signale un reflet de cette conception philosophico-religieuse dans un manuscrit récent de Franklin : l’agriculture est « un miracle continuel que la main de Dieu opère en faveur de l’homme comme une récomp< 1 sa vie innocente et de son industrie vertueuse Cette persistance du déisme agraire se double d’une recru descence de moralisme. En 1778, Clicquot-Blervache envoyé123 (1) M ., Devoirs, p. 56-57, cf. p. 88 : « Fertilité incommensurable de la terre. » (2) L. 7\, Intfrêt social, II, p. 887-888. (3) Grimm, Corrcsp., janvier 1780, t. X III, p. 356-358.
LE PROGR AM M E AGRIC OLE
249
à l’Académie d’Amiens un Discours sur les avantages et sur les inconvénients du commerce extérieur. Il insiste sur les seconds et à la mauvaise hygiène qui règne dans la nouvelle grande industrie, à l’immoralité du régime des corporations, aux excès du luxe corrupteur, qu’il dénonce en vrai disciple de Rousseau, il oppose « le travail de la terre qui fortifie et perfec tionne l’espèce humaine, alors que les manufactures l’abâ tardissent » ; et il conclut, après avoir rappelé la devise de « l’immortel Sully », qu’ « il convient au bonheur et à la constitution propres de la France d’encourager l’agriculture et les arts utiles et nécessaires de ne pas inspirer à la noblesse du royaume l’amour des richesses et du commerce, mais celui de l’honneur et de la gloire ; d’animer le trafic intérieur et d’économie ; de ne pas trop l’étendre au dehors, et surtout de ne pas multiplier les établissements extérieurs, les plantations et les colonies ; de s’attacher à ramener, s’il est possible, les mœurs au point où M. Colbert les avait trouvées ; de ne pas accorder tan t de prix à des trésors stériles et passagers qui ne sont que les signes des véritables biens » (1 ). Ramenant la question sur le terrain des classes écono miques, Baudeau persiste à marquer « entre les divers travaux des hommes un ordre naturel de primogéniture suivant lequel les propriétaires fonciers et les entrepreneurs de culture forment, avec le monarque lui-même, les classes anté rieures )>(2). De même, suivant Le Trosne, la classe foncière et agricole est l’unique « classe productive, parce qu’elle fournit tout ce qui se dépense dans la société, sans être payée ni soudoyée par personne. Elle donne tout, et ne reçoit rien [précisément] parce qu’elle puise directement dans le sein fécond de la nature ». Notre auteur admet bien, avec Condillac, que « les productions ne sont pas la seule matière des ventes et des achats ; que tous les états de la société sont vendeurs et n’achètent qu’autant qu’ils ont vendu ; [mais il ne faut pas pour cela croire que toutes les valeurs sont du même genre, et confondre ceux qui payent avec ceux qui sont payés... ; d’où suit l’unité de la source des richesses, e te a r conséquent de l’intérêt social » (3). Le travail de l’homme, poursuit notre théoricien, « bien que stérile lorsqu’il n ’est pas appliqué à fa terre, peut être123 (1) Inédit. Cité par J. de Vroil, p. 271-272 et 275-276. (2) B., Princip. écon. Louis X l l , p. 13. (3) Int . Soc., p. 909 et 925-6.
8^0
LA P H Y S IO C R A T IS SOUS LE M I N I S T E R E D E N E C K E R
{sans aucun doute] très utile et très nécessaire » (1). < Même oa pourrait objecter que l’industrie n’est pas stérile, puisqu’elle reproduit ses frais par équivalent. »... Mais, au lieu que dans la culture, « c’est la nature qui fait ce remplacement, dans l’industrie c'est l’acheteur qui le fourmi, et il ne peut le faire qu’avec des richesses qu’a fait naître le premier travail » (2). Le Trosne trouve naturel < qu’un ouvrier ou fabricant regarde comme productif un travail qui lui fournit sa subsistance » ; mais il s’étonne « que des gens soldée et salariés par d’autres aient pu réussir à persuader sérieusement ceux qui les payent que la dépense qu’ils font en ce genre augmente leurs richesses » (3). · S’il est des artistes qui se font payer au-delà des frais indispensables, c’est qu’à raison de leur talent et des études qu'ils ont faites, ils ont droit à une plus forte consom mation que les ouvriers ordinaires, et ils exigent d’autant plus qu’ils ont moins de concurrente. Mais s’ils semblent obtenir une sorte de produit net, ils ne le produisent pas, il» U gafnenl ; et cette plus-valeur, qui est pour eux un bénéfice, est une dépense de plus pour les acheteurs (4). » En générai, si l’on peut dire que « l’industrie ne restitue [même] pas ses frais, à plus forte raison ne donne-t-elle pas de produit net ■ (b). Franklin cité par Grimm, soutient la même thèse : < Lee nécessités de la vie qui ne sont pas la nourriture, «t toutes les autres commodités, ont une valeur égale à celle des subsistances que nous consumons dans le tempe employé à nous les procurer... Les ouvragée des manufactures sont seulement une autre forme qu’on fait prendre à autant de denrées et de subsistances qu’il en faut pour égaler leur valeur. Gala est vrai parce que le manufacturier ne reçoit, dans le fait, de celui qui l’emploie que la simple subsis tance (6). » Un argument tout à fait particulier à l’Éoole est que même les bénéfices exceptionnels, ou plus apparents que réels, de l’industrie ne constituent pas une matière imposable, t Cent mille hommes de plue occupés à des travaux de main-d'œuvre, et cent millions de richesses employées à des entreprises de ce genre, n’ajoutent rien à la puissance de l’É tat, parce que ni •
d i / * * .,* . m .
(2) Ibid., p. 941. a . p. 943. (3) Ibid., p. 937-938. (4) Ibid., p. 946.
(5) Ibid., p. 939. (6) Grimm, loe. al., n · 2 e t 6.
LE PR OG PA MME AGR IC OLE
2&1
le capital, ni les ouvrages qui en résultent, ne sont contri buables (1). » — « Pourquoi en est-il ainsi ? Les Économistes ne se mettent pas en frais de raisons nouvelles pour justifier directement leur grand principe de l’immunité nécessaire de toutes les richesses industrielles. Il leur apparaît comme une conséquence inévitable de la stérilité de l’industrie ; et d’autre part ils en viennent à le considérer comme si ferme ment établi en soi, qu’ils l’invoquent au besoin pour prouver, à titre de postulat, cette stérilité elle-même. Après cela, il ne reste plus, pour triompher, qu’à recourir à une métaphysique appropriée : comment l’industrie pourrait-elle être productive quand l’homme, réduit à lui-même, ne « saurait être créateur 1 , quand il n’apporte que des besoins (2) ». En ce qui concerne la stérilité du commerce, quelques argu ments inattendus et curieux, d’un tour presque humoristique, sont apportés par Franklin. « Lorsque le travail et la dépense nécessaires pour se procurer les deux denrées proposées en échange seront connus des deux parties, les marchés se feront généralement avec égalité et justice. Lorsqu’ils ne seront connus que d’une partie seulement, les marchés se feront souvent avec inégalité, l’instruction profitant de l’ignorance. Ainsi celui qui transporte au loin 1.000 boisseaux de froment pour les vendre n’en retire vraisemblablement pas un aussi grand profit que si, en faisant subsister avec ce produit des ouvriers de manufactures, il l’avait préalablement converti en marchandises manufacturées ; parce qu’il y a plusieurs manières de faciliter et de rendre le travail plus prompt qui ne sont pas généralement connues. Les gens étrangers aux manu factures, quoiqu’ils connaissent assez la dépense de la culture du froment, sont absolument ignorants de ces méthodes d’abréger le travail ; et étant plus propres par conséquent à en supposer plus qu’il n’y en a effectivement, on leur impose plus facilement sur la valeur de ces marchandises. L’avantage d’avoir des manufactures dans un pays ne vient donc pas, comme on le suppose communément, de ce qu’elles augmen tent la valeur des matières informes qu’elles travaillent... Mais que, sous la forme des marchandises qu’elles fabriquent, les productions sont transportées plus facilement dans les marchés éloignés, et que par ce moyen nos commerçants peuvent tromper plus facilement les étrangers. » Si bien qu’au12 (1) L. T., ibid., p. 1004. (2) Ibid., p. 942.
252
LA P H Y S I O C R A T I E S O L S
LE M I N I S T E R E
DE NECKER
bout du compte, en dehors de l’agriculture, « il n’y a pour une nation que deux chemins vers la richesse : le premier est par la guerre, comme le fit le peuple romain ; le deuxième, par le commerce, qui généralement est tromperie » (1). Autrement dit, lorsqu’il n’est pas « stérile », le commerce ne saurait être que malhonnête. Le phénomène de la rente foncière urbaine, les Physiocrates continuent de l’ignorer. « Une maison, au dire de Condor cet, doit être considérée, relativement à l’impôt, non comme une propriété, ayant un produit annuel, mais comme un capital portant intérêt. Si les terrains des villes doivent être assujettis à l’impôt, il faut les assimiler aux biens-fonds des campagnes employés d’une manière improductive (2). » I. — La grande et riche agriculture Il semblerait que vers 1778 un peu de bien-être s’était répandu dans l’ensemble des campagnes françaises ; progrès d’ailleurs tout relatif. « Si nous fixons notre attention sur les maisons, écrit à cette date Moheau, nous reconnaîtrons partout l’empreinte de la misère ; cependant, quoiqu’il existe peu de vestiges des habitations anciennes des pauvres, on peut observer qu’il y en a un moindre nombre composées de torchis, que les nouvelles sont moins resserrées et mieux aérées... Le paysan français est mal vêtu, et les lambeaux qui couvrent sa nudité le protègent faiblement contre la rigueur des saisons ; cependant il paraît que son état par rapport au vêtement est moins déplorable qu’il ne l’était autrefois ;... un bien plus grand nombre portent des vêtements de laine... » ; l’alimentation est aussi moins déficiente : pain meilleur et plus grande consommation de vin (3). Surtout « il est constant que la France n’a jamais été mieux cultivée qu’elle l’est k l’époque actuelle : consultez dans tous les pays les chartes, les anciens titres, les terriers des seigneurs, vous verrez que des terres qui rapportent des grains étaient autrefois des bois, des marais ou des prés ; non seulement un grand nombre a été défriché, ou desséché, mais les terres cultivées anciennement le sont aujourd’hui beaucoup mieux,123 (1) Cf. Grimm., toe. dt. (2) Condorcet, A u . Provinciales, II· Partie (Oc., t. V III, p. 332). L 'auteur n'adm et même pas ici la productivité réduite de terrain bâti en ta n t que susceptible d'être cultivé. (3) Moheau, Population française, t. I, p. 261-264.
LE PROGRAMM E AGRIC OLE
203
et les vieillards des campagnes sont forcés d’en convenir... [Il est vrai] que la culture qui exige le plus de bras est celle dont la progression est le plus marquée ; dans la plupart des provinces où croît la vigne on compte que depuis 50 ans ce produit est presque doublé (1) ». Chose qui intéresse plus particulièrement les Physiocrates, même dans une province peu favorisée telle que le Maine, « on constate (en 1777) que les fermages ont augmenté des 2 /3. Le blé se vend cher ; la culture présente des chances assez avantageuses pour que beaucoup de personnes cherchent des fermes sans pouvoir en trouver. On attribue en partie ces heureux effets aux édits qui permettaient la libre circulation des grains dans l’intérieur du royaume. Le prix des bestiaux a doublé : et les exploitations sont garnies d’un mobilier vif plus abondant » (2). Dans l’ensemble du royaume, les décla rations faites depuis 1766 jusqu’à 1780 annonçaient au moins l’intention de mettre en valeur environ 950.000 arpents (3). Mais Le Trosne se refuse à admettre qu’ « un désordre d'administration invétéré », comportant des impôts, indirects et des prohibitions de commerce, ait cessé de produire ses efTets nocifs : « les accroissement successifs des impositions pendant le cours des baux en dérangent les combinaisons ; ils attaquent sourdement les avances de la culture, et la ruinent par une progression infaillible. Sans avoir même dans le moment cette suite imprévue, il suffit qu’ils l’aient eue dès Torigine, pour avoir occasionné des dégradations qui, peu à peu, ont diminué le nombre des riches fermiers, et leur ont substitué des métayers plus ou moins pauvres ; lesquels ne pouvant faire les avances convenables, convertissent en avances une partie des héritages, en les faisant servir de pâture vague aux bestiaux de labour que la charrue ne peut plus nourrir ; dégradent les bois, négligent les vignes, etc. Qui remontera la culture ainsi affaiblie ? Les propriétaires sont forcés de faire une partie des avances, et en prennent droit pour réduire les métayers à la condition de journaliers. Il n’existe presque plus de produit net, et ce qui paraît en tenir lieu n ’est que l’intérêt de ces avances ; les dépenses foncières sont négligées, celles d’amélioration encore plus ;123 (1) Ibid., p. 266-267. (2) F.-Y. Besnard, Souvenirs d'un nonagénaire, t. I, p. 300, cité par Baudrillurt, Populations agricoles, t. II, p. 11. Cf. Inv. Arch. Sarthe, euppl. E., cité par Babeau, Vie rurale, p. 122. (3) .Necker, Adm. Fin, t. Ill, p. 233, chap. 20.
254
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS LE M I N I S T E R E D E N E CKE R
et toutes les terres qui ne peuvent être cultivées qu’à la faveur du bon prix tombent en friche (1). » « La petite culture qui subsiste emploie ordinairement des bœufs, qui font beaucoup moine de travail que les chevaux ; ainsi une charrue ne cultive que 20 ou 30 arpents, et chaque exploitation n’est composée que de 1 à 2 charrues, qui coûtent de 600 à 1.000 livres à établir... E t cette dégradation s’étend sur 30 millions d’arpents ou &peu près les 4 /5 des terres en culture (2). » «Peuvent être considérées comme provinces démunies d ’avances primitives : l’Anjou, le Bourbonnais, le Limousin, le Poitou, l’Angoumois, le Périgord, le Perche, la Marche, le Nivernais, le Berri et d’autres » (3) ; en Bretagne, il n’est pas rare de trouver, sur une exploitation de 20 hectares, 6 seulement en cultures (4). En Picardie même parcourez le Santerre, ou dans l’Artois certains cantons, « il n’y a que de petits laboureurs, et vous verrez combien la culture est négligée ; vous y rencontrerez peu de bestiaux ; les pauvres y manquent de tout, et la vie est loin d’être aussi aisée que du côté de Douai... » (5). Dans Je Languedoc, « on s’aveugle au point de semer en blé des fonds que l’on sait par expérience ne porter le plus communément que 3 (pour 1) et au-dessous... La disproportion entre la grande étendue des terrains mis en valeur, le nombre des bestiaux et les moyens de fournir les engrais que ces terres exigent, ne peut que faire languir l’agriculture... Le odon, au lieu de sacrifier à ces objets essentiels, bestiaux et prairies, une partie de ses terres, ne songe qu’à cultiver beau coup sans réfléchir qu’il serait plus avantageux de cultiver bien » (fi), « Pour mettre toute notre petite culture en grandes et riches exploitations, il nous faudrait bien, au dire de Butré, 9 à 10 milliards (7) ! » La grande culture ne s’étend guère que sur 8 millions d’arpents, surtout autour de la capitale et dans les provinces du Nord ; « et 3 milliards de fonds y sont employés en dépenses productives. Les trois espèces d’avances réunies sont de 375 livres par arpent (8) ; ce qui fait qu’il faut plus d’un mil(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Intérêt S o cia l , II, p. 901. Butré, L o is n ctu relles , p. 121-124. L. T., Adm . prou., I, 15, p. 67. D’Avenel, Liv. II, chap. V, t. I, p. 295. Arch. P.-de-Calais, Agric. n° 9. Cité par A. de Calonne, p. 62. Cf. Dutü, p. 265, citant nota minent BaUainviUiers.
(7) Butré, /oc. cit.
(8) Av. Foncières, 1871 ; primitive® 143 ; annuelles 45. Produit total 89,5. Produit net, 26,25 (soit 58 % des av. annuelles).
LE PROGRAMM E AGRIC OLE
255
Hard par trois millions d’arpents. Il en faudrait bien le triple si on mettait en parallèle la florissante culture de quelque» célèbres agronomes anglais (1) ». Les fermiers ici sont « des maîtres qui dirigent et conduisent toutes leurs opérations comme un riche négociant et un grand entrepreneur de fabri ques. Ce fonds constant de richesses mobilières, employées avec intelligence dans ces grandes entreprises par cette classe précieuse d’hommes versés dans toutes les connaissances de l’économie rurale, assure aux propriétaires des revenue constants » (2). « M. l’abbé de Condillac renferme l’entrepreneur de culture dans la classe des salariés ; mais un hommme qui prend à forfait la fécondité de la terre, qui vient avec un atelier d’avances considérables pour la faire valoir, qui stipule de la portion du produit qu’il donnera au propriétaire, n'est certainement pas un salarié (3). » « Le bénéfice que donnent les avances annuelles est tou jours en raison de la richesse des entreprises, et marque avec précision le véritable état de la culture ; mais pour avoir de fortes avances annuelles, il faut de grosses avances primitives, et on ne peut employer de grosses avances primitives 9ans de grandes avances foncières, qui sont de grands corps de fermes vastes et solidement construite. La richesse de ces avances et le produit net qu’elles procurent déterminent l’ordre national des sociétés politiques ; elles donnent 58 % de produit net » (4), alors que le Taèledu Économique primitif de Quesnay avait théoriquement prévu 100 %. Les avances primitives sont considérées comme devant être rémunérées sur le taux de 10 % d’intérêt au moins, comprenant : 1° l’intérêt ordinaire du pays pour les place ments sans risques et dont on peut jouir sans soins ; 2° les cas fortuits (épidémies, etc.) ; 3° la perte, l’usure. Mais ces 10 % ne seraient pas suffisants, « si les grande entrepreneurs d une aussi riche culture ne retiraient encore une rétribution d’au moins 600 livres par charrue, juste attribution dûe à leurs peines et à leurs travaux..., mais aussi nécessaire pour subve nir aux grands fléaux, et pour élever leur famille suivant la dignité d’un état de cette importance. Même il serait très avantageux qu’ils puissent augmenter leurs entreprises,1234 (1) (2) (3) (4)
Butré, op. cit., p. 50-51. Ibid., p. 7-8. L. T., Int. Soc., II, p. 932. feutré» op. cité., p. 33-34.
256
LA P H Y S IO CRA TIB SOUS LE M I N I S T E R E D E N ECKER
puisque c’est par la seule extension de leurs emplois que les grands États agricoles... peuvent parvenir au plus haut degré de puissance. Il leur faut de l’aisance et même de l’opulence » (1). Quant aux avances foncières, « comme elles sont annexées aux fonds, et que ce sont des travaux solides... elles demandent moins d’entretien annuel ; c’est pourquoi, on se contente d’attribuer δ % de leur capital aux propriétaires qui en ont fait les dépenses, ou qui les ont payées en achetant des fonds avec leur établissement » (2). Pour éviter la confusion des différentes avances, il est avantageux que les trois fonctions de propriétaire, d’entrepreneur de culture et de manouvrier soient séparées, « ce qui est la loi chez les nations opulentes »(3). Et Le Trosne de conclure par cet allègre et triomphant programme qui déborde celui de Butré. « Il faut que les bruyères disparaissent ; il faut que les bestiaux se multiplient ; que les vignes s’étendent sur tant de terrains qui ne sont pas propres au labour ; que les avances productives doublées, quadruples, forcent de toute part la terre à produire ; il faut que la France devienne comme un jardin ; qu’on puisse comparer sa culture à celle de la Suisse et de la Hollande, qui certes, ne sont pas des territoires favorisés par la nature, mais seulement par la liberté (4). » Une place est ici évidem ment réservée aux petits propriétaires-cultivateurs : à ceux-là (’Économiste se contentait de souhaiter qu’on évitât un mor cellement excessif des exploitations, en favorisant les réunions de parcelles : il regrette que des lois financières plus ou moins récentes (1645, 1674, 1690) aient aboli les réductions des droits de mutation que les coutumes avaient consenties en faveur des échanges amiables, ce qui les a peu s’en faut inter dits (5). C’est à peine si, en Bourgogne et en Bresse, la Décla ration du 2 décembre 1777 apportait une légère atténuation des droits — valable seulement jusqu’au 31 décembre 1780 — pour les échanges de pièces de terre de moins de. 10 arpents (6). Pour les grosses fermes, comme d ’ailleurs pour les métairies, Butré célèbre la législation française, qui tend à prévenir l’émiettement des exploitations. « Éclairée et pleine de grandes123456 Bulré, op. c i/., p . 3 4 -3 8 . Ibid., p . 4 4 . Ibid., p . 4 7 . Adm. Proo., X , 5 , p . 5 8 5 . Op. cil., I I I , 12, p . 2 4 2 . (6) leambert, nouv. série, t. I ll, p. 153. Cité par Walters, p. 279.
(1 ) (2) (3) (4) (5)
LE PROGR AM M E AGR IC OLE
257
vues, elle a pourvu à la conservation de ces grands établisse ments : ils ne sont jamais démembrés. S’il y a plusieurs enfants d’un même père qui aient un droit égal à la succession, ils en partagent les revenus ; ou l’un s’arrange pour ces fonds avec les autres, sans que l’exploitation soit divisée... Si les successeurs ne s’accordent pas... la licitation de l’héritage est alors ordonnée par le juge du lieu, sur la requête de l’un quelconque des cohéritiers, et sur le simple exposé que c’eat une exploitation montée dont le partage ne pourrait être fait sans détérioration... Tel est l’ordre général de la culture en France, excepté quelques petits cantons, surtout autour des grandes villes, où il y a des terres qui se cultivent à bras (1). » Pour aider à l’épanouissement de l’agriculture en célébrant les merveilles ou les charmes de la campagne, plus n’était besoin, à cette date, de faire appel au concours des gens de lettres et des artistes. Mais Dupont, qui se piquait de critique d’art, tient à payer de sa personne et se met en frais pour sa correspondante la margravine de Bade : « Voyons si Vernet, Casanova, Le Prince, Loutherbourg peuvent lutter contre le peintre auguste qui dore nos coteaux, qui varie de mille verdures différentes nos prés, nos trèfles, nos luzernes, nos bois épais, nos abondants potagers... Voyons si les femmes et les enfants des deux La Grenée ont la fraîcheur de santé, l’œil vif, le ressort dans les nerfs, la vie dans les chairs, des polissons de nos hameaux folâtrant dans l’herbe ou des filles de nos fermiers dansant sous l’ormée... Voyons si les vieillards et les mères de Greuse, de Wille, d’Aubry, ont l’air aussi respectable que les patriarches de nos cantons (2). » «Au commencement de 1781, Louis XVI, sur la proposition de Bertin, avait fait mettre à la dispostion de Parmentier 54 arpents dans la plaine des Sablons à Neuilly. Vers le 24 août, les fanes précoces annonçaient leur maturité ; c’était la veille de la saint Louis : Parmentier en cueille un énorme bouquet, arrache les tubercules mûrs, et porte le tout à Versailles... Le Roi place à sa boutonnière quelques fleurs, la Reine en fait mettre à sa coiffure, et des ordres sont donnés pour que les pommes de terre soient servies le même jour sur la table royale (3). » Le comte d’Albon pouvait bien nous offrir une fois de plus ( 1 ) B u tr é , op. cii.t p . 1 2 1 -1 2 3 . Cf. o p . I I . (2) L e ttr e d e 1 7 7 9 é d it é e p a r K . O b ser, P a r is, 1 9 0 9 . (3) M a u g u ln , p . 3 7 1 * 3 7 2 . ü . W E U L R R S IE
17
258
LA P H YSI OCR ATI E SOUS LE M I N I S T E R E DE NECKER
l’exemple de PAngleterre où « les propriétaires, sans excepter les plus grands seigneurs, se font une gloire de présider aux travaux des champs » (1). Depuis quelque temps déjà le goût de la campagne « avait gagné les habitants de Paris », au point de déranger les statistiques démographiques (2) ; et les « fêtes céréales » se multiplient, comme celle célèbre de Chevannes, en Bourgogne, à 8 lieues de Dijon, en Pété de 1781 : « Distribution de prix aux meilleurs laboureurs, en présence du gouverneur, de Monsieur l’Intendant et Madame l’Inten dante, aussi de l’évêque, et de plusieurs dames ; les lauréats, couronnés de chêne, avaient banqueté à la table officielle, où l’on n’avait pas été sans s’amuser de leurs étonnements et de leurs naïves surprises (3). » Et le poète des Mois, nouveau saint Lambert, de souhaiter ...Que les Rois eux-mêmes, échappés à l’erreur, Couronnent tous leurs noms du nom de laboureur I (4) Un vallon dont l’hiver a mûri les guèrets Ouvre un théâtre auguste à la foule accourue Des citoyens voués aux soins de la charrue. Eh I quel si grand spectacle attire leurs regards ? Le triomphe annuel du plus noble des arts : Un Prince laboureur qui, descendu du Trône, Doit devant la charrue abaisser la couronne. Jour rayonnant de gloire, où le sage Empereur Au rang du mandarin place le laboureur Ne verront-ils jamais, les cruels politiques. Que leur pouvoir n’est rien sans les travaux rustiques, Et que Cérès est tout... « M’accusera-t-on de vouloir tout sacrifier à l’agriculture ? se demande Roucher. J ’avoue qu’on lui a trop longtemps préféré toutes les autres professions (5). » Fallait-il rappeler des exemples antiques et mémorables? « Les Romains ne laissaient pas d’honorer infiniment le laboureur... Lorsque la richesse des grands propriétaires les12345 (1) (2) (3) (4) (5)
Disc, pol.y t. I , p . 1 5 3 . Cf. M oh eau , p . 2 7 1 . Cf. J . A .f fé v r ie r 1 7 8 3 . R o u ch er , Les Mois , C h a n t V I I , t . I I ., p . 1 3 -1 4 . Ibid., C h a n t I, t. I, p . 2 0 -2 2 , e t n . 2 2 . p . 5 4 -5 5 .
LE PROGRAMM E AG RIC OLE
259
eut dispensés du travail des mains, les laboureurs tenaient encore, après les nobles, le premier rqng parmi les plébéiens... Considérant l’agriculture comme la nourrice commune, on respectait tous les animaux qu’on y employait ; un homme, ayant tué un de ses bœufs pour satisfaire la gourmandise de son mignon, fut condamné par le peuple à l’exil, comme s’il eût tué son laboureur... Les Censeurs punissaient non-seule ment celui qui laissait son champ en friche, mais aussi celui qui ne le soignait pas, celui qui négligeait scs arbres et sa vigne... (1). »« A grands frais, on a [ches nous] embelli les dehors d’un grand nombre de villes, on les a décorées de vastes et solides promenades ; ne voilà-t-il pas bien le Français ? Il n’a pas de chemise, et il se donne des manchettes. Visons à l’utile avant de songer à l’agréable... » (2). Mais il s’agissait d’instruire les cultivateurs : « L’usage des propriétaires étant de résider beaucoup sur leurs terres, l’agriculture romaine n’était pas abandonnée, comme parmi nous, à des gens sans éducation, sans loisir, et qui n’ont d’autre moyen de s’instruire qu’à la longue par les lentes leçons de l’expérience. Les propriétaires romains regardaient l’art de faire valoir leurs terres comme un des plus dignes sujets de leurs méditations... Ils y appliquaient toutes les lumières que leur situation leur permettait d’acquérir... Une aveugle routine ne conduisait pas les économies... Dès qu’ils surent écrire, un des premiers livres qui parurent à Rome fut la Maison rustique de Caton l’Ancien (3). Après la prise de Carthage... le Sénat se réserva les volumes de Magon sur l’agriculture, et les fit traduire... Et un siècle plus tard, Virgile n’eût pas entrepris les Géorgiques si de son temps les détails de la campagne n ’avaient pas encore été connus des classes les plus relevées... (4). » « En Artois, .un mémoire de 1778 sur l’éducation la plus convenable au peuple de la campagne réclame un Traité d'agriculture populaire; et le duc de Béthune-Charost rêve d’organiser un vaste système d’enseigne ment agricole, avec exploitations modèles, écoles rurales, musées ruraux, bibliothèques... (5). » « Si les Anglais, observe d’Albon, veulent que tous les gens de métier fassent un12345 (1) (2) (3) (4) (5)
B u te l- D u m o n t, Recherches, p . 114 e t 1 1 8 -1 1 9 . M a lv a u x , p . 3 8 5 -3 8 6 . B u t e l-D ., p . 1 6 5 -1 6 7 . B u t e l-D ., ibid ., p . 1 2 0 e t 1 22. Cf. A d e C a lo n n e , p . 2 6 8 -2 6 9 .
260
LA P H Y S I O C R À T I E SOUS LE M I N I S T È R E D E NECKER
apprentissage, ils en exigent à plus forte raison des gens de la campagne qui se destinent à être laboureurs (1). » Les Sociétés d’agriculture anglaises étaient restées bien vivantes ; « elles excitèrent l’émulation, et avaient souvent le plaisir de couronner d’illustres concurrents ; le lord Bedford obtenait une prime pour avoir semé du gland, etc. » (2). En France, il n’en était créé qu’une nouvelle en Roussillon, par Arrêt du conseil du 19 mai 1779 (3). Celle de Rouen, grâce à Dambourney, et celle de Châlons, signalée par Le Trosne, étaient presque les seules à conserver une certaine activité ; celle de Caen et le Bureau de Brive ne se réunissaient plus ; la plupart étaient oubliées (4). Des trois premières Assemblées provin ciales, deux au moins, celles de Berry et de Haute-Guienne (Montauban) étudient les moyens effectifs d’améliorer l'agri culture (5). Mais l’École d’Anel, protégée par Vertin, est abandonnée par son successeur ; et Necker supprimait défi nitivement celle de la Rochette ; tout au plus Bertin avait-il réussi à doter l’École vétérinaire d ’Alfort d’une ménagerie d’animaux domestiques de races étrangères, par exemple béliers et brebis d’Espagne (6). « Du fait de la durée plus ou moins grande des ouvrages de main-d’œuvre, une nation possède un fonds considérable de richesses indépendant de sa production annuelle, qui forme un capital accumulé de longue main ; originairement payé par les productions, il s’entretient et augmente sans cesse. Dans les siècles où les mœurs se corrompent, où l’on demande tout à la jouissance et au luxe de décoration, ce fond s’accroît tellement qu’il forme une partie beaucoup trop notable des fortunes, au préjudice des dépenses foncières (7). » Ce sont les propriétaires terriens, au premier chef, qui doivent y remédier. Si une partie du produit net revient à l’État et au clergé, « la majeure portion leur appartient de droit ; il faut qu’ils en emploient une part à réparer les bâtiments, les clôtures et pourvoir à d’autres dégradations que l’injure du temps occasionne toujours ; dépenses essentielles pour rendre (1) (2 ) (3) (4) Cf. L e (5) (6 ) (7)
D ’A lb o n , op. cil., p . 1 5 5 .
Ibid. H . 1511*. Cf. L a b ic h e , Soc. agric., p . 3 6 . H . 1507, p iè c e 1 3 2 ; H . 1 5 0 5 , p . 2 6 4 ; H . 1 5 0 3 . C f. L a fa rg e, p. 185. T ro sn e, Adm. prou., p . 5 4 2 . Cf. K a r e ie v , p . 3 4 6 . Cf. M au gu in , p . 3 3 1 -3 3 5 e t 2 9 1 e t W o lte r s , p . 2 8 0 . Intérèl soc., t. I I . 9 2 8 -9 2 9 .
LE PROGR AM M E AGRIC OLE
‘261
les avances annuelles les plus fructueuses possibles ; et cet intérêt devrait être plus avantageux que dans toute entre prise de la société, afin d’engager à en faire cet emploi consti tutif du corps politique » (1). Or, paradoxe en somme assez explicable, « ce sont les propriétaires les plus riches dont les terres sont le plus mal cultivées » (2). Pourtant il ne manque pas dans le royaume de grands seigneurs ou de grands bourgeois, à la fois agricoles et agro nomes (3). Comme sa belle-sœur et voisine, Mme de Pons, le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, dans sa ferme-école, augmente ses luzernières et fait des semis de trèfle rouge ; il importe d’Angleterre le turneps ; d’Angleterre et de Suisse il fait venir les races de bestiaux les plus fécondes (4). « Dans le Toulousain, MM. d’Escouloubre à Vieillevigne, de Saint-Félix à Mauremont, Prest à Lapeyrouse, et Villèle à Mourville introduisent la même économie, M. de Milhau de Saint-Paul amène de Flandre pour son domaine de la Boue Blanque, près de Castres, des charrues à roues. Le sieur Fastié, flamand, conducteur des mines de charbon de Carmaux, près de la Verrerie, défriche avec des charrues flamandes, fertilise avec de la chaux ; en peu d’années, le revenu est supérieur au prix d’achat (5). » Pour ne pas décourager les grandes entreprises foncières, présentes ou à venir, Le Trosne voudrait subordonner la prérogative du droit d’aînesse aux clairvoyantes préférences paternelles (6). Quant à la main-d’œuvre, il faut utiliser à plein toute celle qui est disponible. Dans l’ancienne Rome, « Caton, qui n’aimait point à perdre son temps, et à qui le grand nombre de jours chômables déplaisait parce qu’en effet il nuit extrême ment à l’agriculture, avait eu soin d’indiquer les ouvrages que l’on pouvait faire ces jours-lè. Columelle et Virgile n’ont pas manqué d’en user de même. Palladius dit nettement que la nécessité n’admet point de fêtes » (7). Dans les États modernes, maintenant qu’ils entretiennent en tout temps (1) Lois naturelles, p. 40. (2) Moheau, op. ci/., t. Il, p. 65. (3) « Ce mot a été introduit depuis quelques années pour signifier qui enseigne l'agriculture ou qui traite de ses règles, ou même simplement qui les a bien étudiées et qui en possède la science. » Bu tel-Dumont, n. 14, cité par Wolters, p. 167. (4) Ferdinand Dreyfus, p. 32-33. (5) Dutil, p. 269-270. (6) Adm. prov.t IX, 20, p. 572. (7) Butel-D., p. 87-89.
262
LA PH YS! OCR ATI E SOUS LE M I N I S T È R E
DE NE CKER
“un corps de troupes réglées pour les former à dévaster métho diquement la terre, pourquoi n’entretiendrait-on pas aussi sur pied une troupe de colons pour la fertiliser ?... Elle se recruterait de tous les hommes en état de travailler qui man queraient d’ouvrage... Prête à marcher au premier appel, cette troupe agraire se transporterait en corps d’armée partout où rappellerait le travail ; on l’appliquerait en particulier aux défrichements et aux dessèchements (1). Les Physiocrates avaient beaucoup discuté sur l’oppor tunité de favoriser le développement de l’industrie campa gnarde. Necker se prononce pour l’affirmative : l’Arrêt du 2-4 novembre 1777 supprime les vingtièmes d’industrie, non seulement dans les bourgs, mais dans les villages et campagnes ; il est « très important d’y introduire cette industrie naissante, qui se trouvait souvent rebutée par le pouvoir ignorant d’un simple répartiteur » (2). Or, à peine plus d’un an après, Clicquot-Blervache présente au directeur général des Finances des Observations importantes où il se félicite des avantages que cette manufacture paysanne à domicile procure à l’agriculture dans les environs de Reims : « Les femmes et les enfants filent les chaînes de laine, le père de famille tisse l’étoffe, et par ce moyen il rassemble dans son ménage le double bénéfice de la culture et de la fabrication. Celle-ci s’est établie dans la partie de la Champagne où le sol est le plus stérile et le plus ingrat... ; elle a donné les moyens de vaincre la nature, et les terres y sont de la plus grande valeur : quel bénéfice pour l’É tat si cet exemple était suivi dans d’autres provinces (3) ! » Les ateliers de charité, trop souvent « placés auprès de nos cités, dirigés en faveur de nos cités, enlèvent des bras à la charrue ». Mais, « même dans les campagnes, les maisons publiques de travail ne devraient être fondées qu’avec pru dence et sagacité... Les hommes se portent toujours vers les professions les plus commodes ou les plus lucratives : celui qui peut gagner sa vie par une occupation sédentaire peu fatigante ira-t-il labourer péniblement la terre à l’ardeur d’un soleil brûlant ? Il serait pernicieux pour l’État que l’art des fabrications un peu adroites et compliquées pénétrât chez les laboureurs : n’introduisez chez eux que les métiers ( 1) Romans de Coppier, cité par Malvaux, p. 377-379 et 386-387. (2) Comple rendu, p. 64. (3) Cf. de Vroil, p. 151-152.
LE PROGR AM M E A G R IC O LE
263
les plus rudes ou les plus analogues aux besoins rustiques. Disposez [aussi] la partie économique des manufactures de charité, tant à la ville qu’à la campagne, de telle sorte que le travailleur gagne un peu moins en fabriquant qu’en labou rant... D’ailleurs on ne les propose que comme un complément de travail : à ce titre vous serez toujours maître de ne les ouvrir que dans les temps morts ou languissants ; vous pourrez les fermer dès que les travaux de la campagne seront ouverts ; ou du moins en interdire l’entrée pendant les labours, les moissons, les vendanges, à tous les bras nerveux, et n’y admettre que les enfants, les vieillards, les infirmes, les gens faibles et exténués. Jamais on n’y sera reçu que par billet... On pense, par tous ces tempéraments, s’être mis à l’abri du reproche intenté aux gens à système, qui, trop entichés de leurs idées, leur sacrifient tout... Sully fut trop agronome ; Colbert trop manufacturier : quel homme on eût formé de ces deux grands hommes (1) » ! IL — Continuité, individualité, liberté de la culture et levée dee servitudes terriennes Si la continuité de l’exploitation exige des baux à long terme, c’est bien le moins qu’on évite les résiliations brusquées. Or, « tout nouveau commandeur de l’Ordre de Malte a droit d’expulser au 1er de mai un fermier quoiqu’entré à la Tous saint, et de s’emparer des grains en terre, en lui remboursant ses labours et ses semences... Comment peut-on tolérer un pareil droit ? s’écrie Le Trosne. Il est d’autant plus criant que le fermier l’ignore absolument quand il prend la terre ; et le cas arrivant, il se trouve ruiné, forcé de se démonter, ou de se rédimer par un pot-de-vin. Veut-il soutenir la contes tation, il est traîné par un committimus du fond du royaume au Grand Conseil... Jusqu’à présent les Bénéficiers ordinaires n’avaient eu le droit d’expulser les fermiers que pour le premier terme, et non en surterme et en prenant les grains en terre, ce qui est un vol manifeste ; mais notre manière de juger est tellement arbitraire que je ne répondrais pas que leur préten tion ne pût être autorisée en justice (2) ». Heureusement la coutume se montrait souvent beaucoup plus respectueuse des intérêts de la culture ; en Alsace par exemple, les fermiers1 (1) Homans de Cuppier, cf. Malvaux, p. 855-356. ('Z) L. T., Adm. prou., XI, 5, p. 607-6U8.
264
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS LE M I N I S T È R E DE NECKER
des ordres religieux se succédaient de père en fils, en ne payant qu’un loyer très modéré : ils regardaient la terre qu’ils cultivaient comme leur patrimoine (1). Pour plus de sûreté, il devrait en être de tous ces fermiers d ’Église comme des fermiers d’État ; l’adjudication du nouveau bail devrait avoir lieu un ou deux ans avant l’échéance de l’ancien. « Il est de l’essence de la propriété foncière d’appartenir k un seul » (2) ; pourtant, « à côté de tan t de propriétés livrées à la mauvaise humeur de maîtres qui sont indignés qu’il pleuve sur leur terre quand les bergers que leur montrent les coulisses sont décorés de beaux rubans, on trouvera que les biens des communautés de mainmorte sont infiniment mieux tenus. A chaque mutation de titulaire, on répare au moins les avances foncières ostensibles : c’est beaucoup par comparaison avec les patrimoines qui, à chaque succession, passent à de la jeunesse entraînée dans la fange de la dépra vation... Quand les terres appartiennent à des corps qui ont des constitutions, celles-ci les préservent à jamais de minorités ; jamais de dépense transplantée ; toujours durée... (3) ». Que signifie, sous la plume de Mirabeau, cet éloge nuancé, mais quand même inattendu, d ’une certaine propriété collec tive ? C’est le même auteur cependant, qui, dans le même ouvrage, plus fidèle à son principe général, fulmine contre « les communes en bois, en pâturages, etc., appartenant k des paroisses entières pour en jouir chacun pour soi ; voyez s’il est désert pareil à l’état de ces concessions abusives ; et vous conviendrez que toute amélioration tient à l’esprit de propriété et toute détérioration à l’esprit de communauté ». Il est vrai que l’exemple de propriété individuelle opposé ici à cette dévastation commune est celui des « propriétés morcelées et chéries de leurs maîtres, de mœurs aussi modestes que laborieuses... » (4). < Mais quelles que puissent être les qualités ou les défauts des divers genres de propriétaires, tant individuels que collectifs, il ne faut pas confondre la propriété avec la jouissance, avec l’exploitation. C’est celle-ci qui importe le plus ; et l’abus général et profond, dans le cas des communes villageoises, consiste dans la communauté usagère ; celle-ci disparaîtrait, en même temps d’ailleurs que123 (1) (2) (3) (4;
Cf. Hoffmann, VAlsace au X V I I J 9 siècle, t. I, p. 187 et suiv. M. Devoirs, p. 142. Ibid., p. 143-144. Ibid., p. 145.
LE PROG RAMAI E AGRIC OLE
265
la communauté foncière, si l’on procédait à ces partages dont l’École avait en somme généralement approuvé le prin cipe. Comment, déclare encore Le Trosne, imaginer une culture exécutée en commun entre un grand nombre de familles ? Trois ou quatre associés dans une entreprise ont souvent bien de la peine à s’entendre ; comment pourrait s’exécuter une culture par une grande société ? Le partage des fruits ne ferait-il pas naître des disputes plus fréquentes encore que ne peut en jamais produire la possession de fonds dont le partage, une fois fait, fixe les droits de chacun (1). » « Des combinaisons établies sur des dénombrements aussi exacts qu’authentiques prouvent invinciblement que les paroisses ayant communes sont, proportionnément à l’éten due, celles où l’on compte le moins d’habitants, le moins de bestiaux, celles qui rendent le moins au fisc. Dans les landes, quelques moutons épars trouvent difficilement à brouter des pâturages qui les échauffent sans les rassasier... Dans les marais, plus endommagée par le pied que par la dent des bestiaux, l’herbe ne saurait pousser ; les bêtes à cornes et les chevaux élevés dans ces pitoyables pâtis sont toujours de la plus chétive espèce ; l’eau croupie encroûte les plantes d’une sorte de rouille... et ne peut fournir une boisson saine ; presque toujours le bétail a le pied mouillé, ce qui est contraire à sa santé et la moiteur du sol ne lui permet pas de se coucher ; rares sont les arbres pour s’abriter en cas d’orage ou des coups de soleil... Changez [donc] ces terrains arides ou sub mergés en prairies artificielles, en champs de blé, en jardins. Les seules communes seraient, après leur défrichement, suffisantes pour faire subsister tous nos mendiants (2). » Pour sortir de cette funeste indivision en tout cas, les Physiocrates n’avaient, jamais envisagé d’autre modalité de partage qu’entre propriétaires exclusivement, au prorata des propriétés ou des impositions. En Haute-Guyenne, comme en beaucoup d’autres provinces, des distributions avaient déjà eu lieu par têtes ; l’Assemblée provinciale au 1er octo bre 1780 propose une solution intermédiaire. Bien que « le pauvre, n ’ayant ni gros bestiaux, ni troupeaux [de moutons], ne fasse aucun usage de ses droits sur des biens plus stériles encore pour lui que pour la société », il ne faut pas l’en dépos séder au profit exclusif des riches, a ce système paraît au12 (1) L. T.t Ordre social, Discours II, note p. 36. (2) G. Malvaux, p. 169-173.
266
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS LE M I N I S T E R E D E NECKEH
premier coup d’œil opposé aux principes d’une administration bienfaisante, et la Justice même le réprouv e à bien des égards ». « La taille il est vrai, à laquelle sont assujettis ces terrains, est répartie au marc la livre ; et les grands propriétaires — qui en ont usurpé des portions considérables — peuvent avoir droit à des portions proportionnées à leur contribution... Mais, s’ils ont payé une plus grande part à l’allivrement, ils ont aussi retiré plus d’avantages. Ils ne peuvent pas réclamer comme une extension de droits l’excès de leur contribution. » « Le Bureau a donc adopté un système conciliant les intérêts du pauvre et du riche : il s’agit de partager une moitié par portions égales entre tous les habitants, et l’autre suivant la proportion de l’allivrement... Dans les pays du Causse les troupeaux ne peuvent exister, en ces terrains secs, que par le moyen des pâturages communs, ou du moins par des parties considérables de ces pâturages... Si les communaux qu’on y a réservés venaient à être défrichés, comme ils ne manqueraient pas de l’être s’ils étaient divisés en petites portions, ou qu’il n’en restât aux grands propriétaires que des portions insuffisantes, la culture de leurs domaines deviendrait impossible et une grande partie de la province serait abandon née à la stérilité la plus absolue... [Au contraire] les grandes portions qui resteront attachées aux propriétés considérables produiront beaucoup plus quelles ne produisent dans l’ordre actuel, du moment qu’elles seront devenues des propriétés limitées et indépendantes; les améliorations qu’y feront les nou veaux maîtres feront plus que compenser la diminution de leur étendue (1). » C’étaient bien, en somme, avec plus de largeur et de souplesse, les tendances physiocratiques qui l’emportaient. Une fois les lots, grands ou petits, délimités, quel en serait le régime ? Sans aucun doute, dans lçs intentions du Rapport et suivant le vœu des Physiocrates, celui de la propriété perpé tuelle. C’était celui qui avait prévalu dans les généralités d’Auch et de Pau après l’Arrêt du 26 octobre 1777, complétant ceux de 1771 et de 1773 (2). En Artois, les lettres-patente du 25 février 1779 consacrent la propriété absolue, héréditaire même par les femmes, jusqu’à extinction au moins de la descendance directe, des nouveaux portionnaires (3). — Quant123 (1) Rapport du Bureau de Bien Public, P. V., t. Il, p. 248-253. Cf. d’Avenel, Liv. II, chap. 5, t. I, p. 279. Cf. Clicquot-Blervache, t. II, p. 77-79. (2) Cf. Graffin, Les Biens communs en France (1899), p. G8-70. (3) Ibid., et cf. Baudrillart, Pop. agric., t. II, p. 265.
LE P R O G R A M M E A G R IC O LE
267
aux pâturages et forêts de montagne, par Arrêts des 8 avril 1776 et 13 décembre 1781, ils sont déclarés, contrairement à la coutume, domaine privé du Roi, ce qui donnait à celui-ci le droit d’en disposer, d’une manière ou d’une autre, en faveur des particuliers (1). Des privilèges nobiliaires de chasse, Le Trosne réclame au moins la restriction sévère : « A tout gentilhomme un Tribunal assignerait l’étendue du terrain sur lequel il aurait droit de chasse exclusive, avec pouvoir de faire garder ; mais sans droit d’empêcher les clôtures, ni de les violer... E t de cette prérogative, un gentilhomme qui aurait plusieurs terres n’en jouirait que dans celle qu’il habiterait (2). » Restriction également du glanage. Un arrêt du Parlement de Paris du 7 juin 1779 « fait défendre à ceux à qu’il est permis de glaner de se servir, dans les prairies et dans les terres ense mencées en luzerne, trèfles, etc., de râteaux ayant des dents de fer, ni d’aucuns autres instruments semblables » (3). « Défense à toutes personnes en état de travailler et de gagner leur vie de glaner pendant le temps de la moisson, et à quiconque entretemps avant le soleil levé et après le soleil couché. En revanche, défense aux cultivateurs d’arracher ou de faucher le chaume avant le 1er octobre, date passée laquelle les 2/3 appartiendront, selon l’usage, aux pauvres de chaque paroisse (4). » Plus importante encore était la question de la vaine pâture. En Boulonnais, par exemple, « aux termes de la coutume (art. 131 et 132) il était défendu aux possesseurs de la terre de faire clore plus de 1 /4 de leurs fiefs ; plus d’une mesure, ou 5 quarterons, en roture ; seuls les anciens enclos, consacrés par le temps, n’étaient pas comptés dans ces limites avares. Or, tout le reste, terres ouvertes, herbagères, cultivées ou non, était soumis à la jouissance commune ; bien entendu après la récolte par la faux ou le dépaissage des bestiaux, période dite de temps clos, qui commençait au 15 mars pour finir au jour de saint Pierre, entrant aoust. Le maître du champ, sauf dans les parties closes si restreintes, n'en disposait donc que durant 4 mois et demi. Un édit de septembre 1777, enregistré le 19 décembre, autorisa la clôture pour tout le1234 (1) Cf. Kovalevski, t. I, p. 136-137. (2) L. 7\, Adm . Prou. Diss. Feod., p. 636. (3) E. D. A., IV, n° 1. (4) Arrêt du P t de Parie du 10 juin 1780, pour le balliage de Montdidier ; dispositions analogues arrêtées pour le bailliage d'Amiens, 4 juillet 1781.
268
LA P H Y S IO C R À T IE SOUS LE M I N I S T E R E
D E N EC K ER
pays, qui ne tarda pas à changer de face dans certains can tons » (1). Des mesures analogues avaient été prises en Flandre en 1776, et dans la sénéchaussée de Saumur en 1777. Un Édit général de 1781 défendit en tout cas d ’envoyer les bestiaux dans les prés avant la première coupe (2). Un arrêt du Parle ment de Toulouse du 25 juin 1779 avait interdit de faire entrer en aucun temps les troupeaux dans les vignes (3). Un arrêt du Parlement de Paris du 28 décembre 1780 faisait, d’autre part « défense de mener paître en aucun temps les moutons et brebis dans les prairies, à moins que celles-ci n’appartiennent aux propriétaires desdits moutons et brebis et soient closes de murs ou de haies » (4). — La suppression de la vaine pâture entraînait le plus souvent, mais non pas tou jours, celle du parcours ; dans les pays de montagnes ce droit réciproque doit, de par la nature des lieux et la forme même de l’élevage, être partiellement rétabli ; il était impossible, sans soulever une multitude de contestations, d’y mettre effectivement les pâturages en défens (5). Diverses réglementations ne faisaient guère que maintenir certaines coutumes anciennes d’un caractère plus ou moins étroitement local : tel cet arrêt du Parlement de Paris du 23 novembre 1779 portant homologation d’une sentence rendue à la prévotée royale d’Essoyes [dans l’Aube] le 30 août précédent « qui enjoint à tous les habitants de labourer, cultiver et ensemencer leurs terres par soles et saisons ordi naires, savoir 1 /3 en blé, 1 /3 en orge ou avoine, et l’autre en jachère » (6) ; les agronomes de la Physiocratie ne pouvaient approuver le. caractère obligatoire attribué à une rotation particulière. Mais la liberté de culture était bien plus grave ment menacée par les progrès de l’absolutisme administratif. « Le gouvernement'n’a pas de droit ni d’intérêt, proclame Le Trosne, de dire à tel canton du royaume : Vous cultiverez du blé, et à cet autre : Vous cultiverez de la vigne (7). * « Les Romains avaient des lois qui interdisaient de convertir (1) H. de Rosny, Hre du Boulonnais, t. IV, p. 270-271, et E. D. A., IV, n° 1. (2) Cf. Coquelin, Dictionnaire, art. Vaine pâture. (3) Cf. Dutil, il, p. 227. (4) Isambert, t. X X VI, p. 407. Cf. Marc Bloch, Indiv. agraire {Annales Hre Econ. et Soc., 1930, p. 363-364). (5) Cf. Arch. Nat.j II, 1485, passim. (6) E. D. A., IV, n® 1. (7) Intérêt social, II, p. 1014.
L E P R O G R A M M E A G R IC O L E
269
en prés des terres labourables, comme si le législateur pouvait mieux savoir que les particuliers ce qui convient à leurs intérêts, et comme si la force publique avait une autre base véritablement solide que les fortunes privées. Varron nous apprend que ces lois avaient tellement gêné les agriculteurs qu’elles avaient cessé d’être observées (1). » L’agriculture du royaume ne réclame aucune protection spéciale, comme un impôt sur les productions étrangères ; elle ne souhaite pas « d’autre encouragement que la liberté du commerce. Si vos cultivateurs ne peuvent à ce prix, c’est-à-dire au cours général, soutenir cette culture ; si l’étranger, malgré les frais de trans port, est encore en état de donner à meilleur compte, c’est une preuve évidente que notre climat y est moins propre qu’un autre. En ce cas vous ferez mieux d’occuper votre terrain à d’autres cultures ; donc laisser toute liberté pour l’emploi des terres » (2). Même liberté pure et simple pour la sylviculture, « On avait [naguère] des bois de construction beaucoup plus qu’aujourd’hui, et les forêts étaient mieux plantées, avant qu’elles fussent gouvernées par des tribunaux institués pour a policer » cette espèce de propriété ; avant qu’il fût ordonné, p. ex. de laisser sur un arpent de taillis 16 baliveaux, et avec le temps 32, puis 64 ; lesquels, tourmentés par les vents ne feront jamais de beaux bois,etétouiTent le taillis... (3).»«Mieux vaudrait réserver un canton à la fûtaie ; mais cet arrangement doit être laissé à la disposition des propriétaires. « Même parmi les mains-morles, il en est qui gouvernent leurs possessions aussi bien que des chefs de familles, ce sont les communautés religieuses ; comme elles ne meurent pas, elles portent leurs vues d’administration au-delà du besoin présent (4). » Seules les terres bénéficialcs de toute nature demandaient une surveillance spéciale : « les bénéficiers ne connaissent pas les dépenses de marner, de défricher, de dessécher. Il faut, sans leur faire tort, admettre les offres des enchérisseurs de faire telle ou telle amélioration, en leur donnant un bail de 3 ou 6 ans de plus... Le souverain n’a pas d’inspection sur la régie des biens des particuliers parce qu’ils sont pleinement1234 (1) Butel-D., p. 84 et p. 95. (2) Intérêt social, p. 1007. (3) L. T.y Ord. social, Disc. 3, note, p. 75. (4) L. T.y Adm. Prov ., V II, 18, p. 430 et IX, I 9 f p . 5 0 9 , Cf. Ordre social, Discours 10, note, p. 443. L. T. félicite le Grand-Duc de Toscane * d’avoir permis aux possesseurs des bois d’en disposer en pleine propriété ».
270
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS LE M I N I S T È R E D E NECKER
propriétaires ; mais les bénéficiers ne sont qiTusufruitiers, ils cherchent à jouir et négligent les charges. L’État a intérêt qu’ils jouissent en bons pères de famille et que leurs biens soient réparés... (1). » « L’aliénation par engagement des domaines royaux offre l’inconvénient de ne pas assurer une propriété pleine, durable » (2) : que ne renonce-t-on à ce système bâtard, pour suivre l’exemple du Grand-Duc de Toscane ? Linguet ne condamne pas moins vigoureusement les pratiques inévitables de ces faux-propriétaires : « Ils ont négligé l’entretien de ces biens précaires ; plus ils les auraient améliorés, plus la tenta tion de les leur enlever aurait été vive » ; « aussi les plus beaux bâtiments dans leurs mains sont devenus des masures ; les terres fertiles, des landes ; les futaies, des taillis rabougris. Quant aux régisseurs royaux, ils en ont tiré le plus grand parti personnel qu’ils ont pu ; mais tout ce qui aurait exigé des avances pour en prévenir le dépérissement a été abandonné ; qu’on en juge par les châteaux et parcs de Vincennes, de Chambord, etc. » (3). — « Il est bien dur, lit-on de même dans un rapport à l’Assemblée du Berri, que les principes doma niaux n’aient pas pu prévenir les dégradations importantes et qu’ils ne servènt qu’à fournir prétextes pour inquiéter une foule de possesseurs paisibles (4). » Necker se saisit de la question. Il se prononce contre toute régie d’État : « La dépossession pure et simple des engagistes, rigoureuse pour eux, ne saurait encore s’effectuer en confiant aux agents de l’Administration une exploitation qui dans les mains de particuliers animés de l’esprit de propriété sera toujours plus favorable à la richesse de l’É tat (5). » Un Arrêt du 14 janvier 1781 autorisa « les Administrateurs des Domaines à recevoir des engagistes de nouvelles offres de renies ou suppléments de renies d'engagement, moyennant lesquelles ils seraient confirmés dans leur possession pendant la durée du règne » (6). « Sous aucun prétexte ceux qui acquiesceront à la redevance déterminée (et qui sera calculée d’après le revenu réel de la terre), ne seront inquiétés d ’aucune manière dans123456 (1) (2) (3) (4) (5) (6) P. V
L, T ., Adm. Prov., X I, 5, p. 608. Ibid,, IX, 19, p. 563. Annales, 1780, t. 8, p. 79-80. Cité par Girardot, p. 236. Necker, Compte-rendu, p. 47. Mém. de Calonne. à ΓAssemblée des Notables, 29 mare 1787, p. 241.
LE P R O G R A M M E A GR IC OLE
271
leur jouissance... (1). » Hélas! les soumissions reçues furent insignifiantes. Quant aux « domaines encore dans les mains du Roi » à l’exception d’un très petit nombre de forêts, et de l’ensemble des droits seigneuriaux y attachés, le ministre aurait souhaité « pour le bien de l’État, qu’on cédât le tout à bail emphytéotique à charge de redevances en grains » (2). Le Trosne allait plus loin : point de régie intéressée même par l’Administration provinciale ; point d’affermage, même à long bail ; il serait « infiniment plus à propos que le Roi aliénât ses domaines à perpétuité .en ne gardant que ses châteaux, et même en aliénant ceux qu’il a dans différentes villes et qui sont absolument inutiles » (3). « Si les Romains avaient connu l’influence du bon état des terres sur la prospérité nationale, ils n’auraient pas eu de domaine public (4). » Le problème des droits féodaux se posait d’une manière de plus en plus urgente, à mesure que « les seigneurs, pressés par le besoin, surtout leurs officiers qui ont droit à une part du revenu, et leurs fermiers, cherchent à faire rendre à leurs domaines tout ce qu’ils peuvent » ; d’autant que la valeur et le revenu des terres marquaient une hausse continue ; les maîtres du sol pouvaient aussi, en quelque mesure, s’effrayer des attaques plus vives dirigées contre la grande propriété foncière (5). L ’École s’y intéresse de plus en plus activement. « Moins préjudiciable que la servitude personnelle [à peine abolie] (6), la servitude foncière est restée ; c’est une entrave aussi à la propriété, qui ne peut être trop pleine et trop entière (7). Elle est cruellement onéreuse pour ceux qui sont placés au dernier terme. Ils en sentent toute la pesanteur sans pouvoir s’en indemniser sur personne, et ce dernier terme est principalement composé de petits propriétaires et de cultiva teurs qui possèdent des subdivisions d’héritages. » Elle est cependant difficile à supprimer d’un trait, par renonciation du Roi, à cause des situations particulières, les uns se trouvant gagner plus qu’ils ne perdent et les autres se trouvant ainsi (1) C. Rendu, p. 48. (2) Ibid., p. 49-50. (3) Adm. Prou., IX, 19, p. 563 et 568. (4) Butel-D., p. 105-106. (5) Cf. Sagnac, Législation, p. 65 et Λ. Espinas, Philosophie sociale, p. 120. (6) V. infra, V. (7) Cf. Disc. Feod., p. 633 et 35 : « On a senti que la propriété, dont Γessence est d ’être absolue, entière, exclusive, répugnait à l ’état d’indivis. »
272
la
ph y sio c r a t ie
sous
le
m in is t è r e
de
necker
lésés ; ce serait une opération de détail à effectuer par l'Assem blée provinciale, et presque « une recherche de pure curio sité » (1). a II serait pourtant bien souhaitable que les terres fussent libres comme les hommes et comme les productions ; qu’on ne connût plus ces distinctions bizarres et factices de fief et de censive ; et que cette institution, dont il ne reste que la partie purement fiscale, fût totalement abolie, ne fût-ce que pour le grand nombre de procès qu’elle suscite, et les dépenses que coûte la rénovation des terriers,... mais n’est-ce pas une de ces réformes plutôt à désirer qu’à espérer (2) ? » Malgré tout, c’est un principe, que « tout propriétaire a droit de forcer à l’aliénation, si le partage ne peut se faire sans inconvénient... Le droit de directe n ’établit-il pas une espèce de copropriété ?... Pourquoi n ’admettrait-on pas aussi, à perpétuité, et à un taux favorable, comme le denier 30, le rachat des rentes foncières établies sur les terres, dont la libé ration est aussi importante que celle des maisons des villes ? » Notre physiocrate semble s’en prendre spécialement au champart et au franc-fief. « La manière la plus juste d’éteindre le premier serait d’autoriser les débiteurs à céder au seigneur en pleine propriété une portion de terre correspondante à la part qu’il a le droit de prendre sur les fruits, et dont le fermage peut lui procurer un revenu égal. Le champart, se levant sur le produit total, emporte une partie considérable du produit net... (3). » En Haute-Guyenne, « le baron de la Guêpie, et quelques autres seigneurs, se sont déterminés à inféoder à leurs vassaux, les redevances qu’ils possédaient à ce titre, moyen nant une rente fixe et équivalente en grains ; les terres ont été mieux cultivées, le revenu des seigneurs a été plus assuré, et le colon plus heureux... Les terres soumises à ce droit sont condamnées à la stérilité par la nature même de l’institution... Dans quelques-unes sur 12 gerbes le seigneur en retire 3, le décimateur 1, les impositions en absorbent deux au moins. Il faut distraire deux pour la semence, et 3 pour les frais de culture. Il en reste donc 1 pour le propriétaire, dont les travaux ne peuvent augmenter le revenu qu’en augmentant celui du seigneur et du décimateur dans une proportion décourangeante (4) ».1234 (1) (2) (3) (4) P. V.,
L. T., Disc, féodalité, p. 617, p. 625 et p. 645. L. T., Adm. Prou., IX, 20, p. 569-570, of. X I, 7, p. 611. Ibid., p. 633-635 et Supp., p. 19. Assemblée de Hte-Guyenne. Rapport au Bureau du Bien Public, t. II, p. 56-57.
LE PROGRAMM E AGRIC OLE
273
Le droit de franc-fief « n’est pas davantage établi sur le revenu : il attaque le fonds même de la propriété. [Le proprié taire] sera encore plus à plaindre si sa terre est affermée à moitié : il se verra taxé arbitrairement par une évaluation forcée. Que sera-ce s’il laboure lui-même son héritage ? Que deviendra sa culture dont vous enlevez les avances ? Cette hypothèse s’applique à 10.000 petits propriétaires et cultiva teurs, qui possèdent 10, 15, 20 arpents en fief. Ah ! qu’ils se hâtent plutôt de vendre à la 19e année, à quelque prix que ce soit : cette propriété leur est funeste (1) ! » III. — Pour rim m unité de la culture : Timpôt territorial unique La corvée des chemins, abolie par Turgot, avait bien pu être provisoirement et presque subrepticement rétablie par Clugny. Sa suppression, ou tout au moins sa transformation, restait à l’ordre du jour. L ’instruction du 6 septembre 1776 « laissait désormais aux communautés assujetties l’option de faire par elles-mêmes les tâches qui leur sont destinées, ou de s’en libérer par une contribution en argent après adjudication des travaux. Ce règlement semblait devoir terminer toute contestation ; mais comme il ordonne par l’article VI que la masse totale de la tâche soit assignée aux paroisses en propor tion de leurs forces, c’est-à-dire du nombre des corvéables ; tandis que par l’article X III il veut que la répartition entre chaque individu soit faite à raison de ses facultés et de son taux de taille ; ces dispositions paraissent difficiles à concilier ; et ce règlement, en apparence si sage et si équitable, n’a pas eu d’exécution uniforme, ni tout le succès qu’on s’en promet tait » (2). « Nous venons de voir, écrit Linguet, avec une apparence d’objectivité acerbe, un ministre plus occupé à favoriser des projets qu’à les choisir, marquer despotiquement aux peuples sa bonne volonté à cet égard, et nécessiter par une réforme ruineuse le rétablissement d’un abus qui fait gémir tous les honnêtes gens. Le moment viendra sans doute où l’on découvrira un secret qui n’ait pas les inconvénients des corvées, ni ceux d’un impôt plus arbitraire encore (3). » (1) L. Γ., Adm. Prov., I ll, II, p. 217-218. (2) Grivel, art. Corvée (Encyclopédie méthodique (1784), section Eco nomie politique, p. 713). (3) Annales, t. II, 1777, p. 73. G. W E LL E R SSH
18
274
LA P H Y S IO C R A T IE ttOUS L E M I N I S T È R E D E NECKER
Le Trosne, a vrai dire, se montre sur ce sujet beaucoup moins hardi que le ministre son ami et que ses confrères Physiocrates. e Vous voulez ouvrir des routes ; vous en sentez toute l’utilité et la commodité : payez-les, si vous en avez le moyen. Si vous ne l’avez pas, faites les payer en détail à ceux qui s’en servent. Mais n ’en rejetez pas la dépense sur le peuple des campagnes qui en est écrasé ; sur les laboureurs que vous ne pouvez y contraindre qu’en les détournant de leur atelier ; sur les journaliers, qui n’ont nul besoin de vos routes, qui doivent même désirer qu’il n’y en ait pas, puisque n’ayant rien à vendre, il est de leur intérêt que les denrées n’augmen tent pas. » Ce dernier point de l’argumentation serait même franchement hétérodoxe ; mais notre auteur se satisferait de la concession des travaux de grande voirie à des compagnies qui s’assureraient leur légitime bénéfice au moyen de péages fixés (1). Si l’on tenait à les exécuter aux Irais de l’Étal, une fois la réforme financière accomplie, il suffirait d’ajouter « 1 sou par livre au nouvel impôt direct ; et Ton pourrait y employer les troupee (2} ». En revanche, vers la même date, le 23 septembre 1779. l’Assemblée de Haute-Guyenne avait nettement pris son parti : « De tous les moyens de faire les chemins, la corvée était le plus long et le plus coûteux ; c’était la charge la pins inégale, la phis pesante et la plus injuste, parce que le poids en tombait plus directement sur le pauvre, à qui les chemins sont le moins utiles. Elle était devenue si odieuse au peuple que l’Administration ferait évanouir sa joie si elle se déter minait à la rétablir. » En fait, la province, faisant plus que suivre l’avis du gouvernement, le devançant plutôt, avait, par l’accord spontané de toutes ses paroisses, organisé le rachat universel moyennant une addition à la taille (3). L’Assemblée du Bern, dès 1778, avait condamné les corvées en principe, parce qu’elles avaient été « jusqu’à pré sent réparties par tètes sans égard aux facultés respectives des contribuables » (4). L ’année suivante, son Bureau des Travaux Publics se prononce à son tour pour une taxe de remplacement à laquelle seraient assujettis tous les habitants des campagnes, aussi bien les journaliers, par exemple, que les1234 (1) L . T.t Adm. Prou., Supp., p. 22.
(2) L. T., Adm. Pro*., V I, 6. (3) Rapport sur lee Grands chemins, P . V.9 t. I, p. 59-60. (4) Délibération du 27 novembre 1778, P. V., p. 110*
LE
PROGRAM M E
A G RICO L E
275
propriétaires. « Les routes, en effet, apportent une vivification générale qui se partage avec une sorte d’égalité entre toutes les classes de citoyens ; leur effet constant est de donner aux denrées une valeur plus égale, mais de telle sorte que le mène principe, agissant par les contraires, favorise dans le temps d’abondance les propriétaires en leur donnant le moyen de se débarrasser de leur superflu ; et vient dans les temps de disette au secours des journaliers, à qui l’importation procure à meilleur marché le nécessaire (1). » Cet ingénieux raisonne ment se fondait sur des considérants physiocratiques pour aboutir à une conclusion contraire ; mais la Commission intermédiaire entend préciser la question préalable du rachat ; elle offre aux paroisses l’option suggérée par Clugny : « Un tiers seulement d’abord reste fidèle au principe du remplace ment ; mais beaucoup d’autres ensuite en viennent à renoncer, elles aussi, au travail en nature (2). » L’Assemblée cependant demeurait hésitante ; l’argent était rare dans cette province ; elle reculait, comme avait fait la Bretagne, devant l’obligation universelle du débours en espèces. Le 22 octobre 1780, l’intendant Dufour de Villeneuve, agissant sans doute sur instructions du Ministre, déclare « que le maintien des corvées, qui obligeait si souvent de recourir à l’autorité, serait bien difficile à concilier avec l’esprit d’une Administration provinciale qui doit singulièrement s’occuper du plus grand avantage des peuples » (3). Cinq jours après, l’Assemblée plénière se décidait enfin, mais « en trem blant », pour le rachat obligatoire. Quant à l’assiette de la taxe de remplacement, désavouant le vœu d’un de ses Bureaux, elle s’était ralliée au projet plus ou moins physiocratique d’un accessoire au Vingtième. L’intendant estime que pareille mesure « ne répondait point aux vues de justice de S. M., parce que précisément les fraie de confection et d’entretien retomberaient alors en entier sur les propriétaires seuls, tandis que toutes les autres classes de ses sujets partageraient avec eux les avantages qui en résulteraient ». Donc, sans parler d’un supplément à la capi tation des villes, l’Administration propose, pour les ruraux, une addition, non au Vingtième, mais à la taille : « Celle-ci affecte les propriétés et les personnes, de même que les che-123 (1) Cf. Girardot, p. 168-169. (2) Cf. Girardot, p. 200-202. Ordonnance du 29 septembre 1779. (3) P. V., p. 146.
276
LA
PH Y SIO C R A TIE
SOUS
LE
M IN IS T È R E
DE
NECKER
mine donnent plus de valeur aux biens et à l’industrie; elle est supportée directement par les ecclésiastiques, les nobles et les exempts, qui la paient sous le nom de leurs fermiers, et qui contribuent actuellement aux chemins. > Il suffira de faire appel à la générosité des exempts exploitant eux-mêmes et qui bénéficient du privilège des 4 charrues Finalement l’Assemblée se range à cette opinion qui avait ’ été dès l’origine celle de son Bureau des Travaux publics : la charge de ceux-ci dereet se partager « au moins mi-partie entre la propriété et l’industrie puisque toutes deux profitent de l’avantage des communications » ; et comme ce Bureau, elle tient à y faire participer les simples journaliers pour cette raison nouvelle, assez originale, que « le patrimoine de ces derniers augmentera du moment où les travaux seront sala riés : leur main-d’œuvre deviendra plus chère ; ils se verront plus recherchés et mieux payés ; c’est donc pour eux que la suppression de la corvée offre les plus grands avantages. Faudrait-il qu’un journalier, à qui elle coûtait autrefois au moins 6 livres, et même 12 et 18 s’il avait un ou deux enfants au-dessus de 16 ans, ne concourût plus pour rien, ou presque rien, à la confection des chemins qui seront désormais pour lui un moyen de subsistance » ? Seuls seront exemptés les taillables imposés à moins de 10 sols, et tous les enfants non inscrits au rôle, de manière à ménager les familles nombreuses ■rue l’ancienne corvée réduisait à une misère affreuse (2). » Autant de considérations diverses, qui sans être toutes conformes à la doctrine de l’École, n ’en tendraient pas moins à la réalisation d’un point im portant de son programme. La décision de l’Assemblée sera sanctionnée par l’Arrêt du Conseil du 13 avril 1781 (3). Necker avait, en cette affaire, adopté et suivi une ligne de conduite à la fois prudente et nette. Il avait d’abord multi plié les instructions aux intendants pour que la charge des corvéables fût plus également répartie, et défendu qu’on les contraignit de se transporter ό plus de 8.000 toises de distance ; il avait quelque temps maintenu aux paroisses de larges facultés d’option ; mais son but était fixé. « En der nière analyse, pourra-t-il écrire dans son Compte rendu, ce n ’est qu’un débat entre les pauvres et les riches... Un homme123 (1) Assemblée du B éni, 22 octobre 1780, P . V., p. 147-148. (2) Ibid., 31 octobre 1780, p. 199-202. (3) a .
ibid.,
p. 191-193.
LE
PROGRAMME
A G R IC O L E
277
sans facultés, un journalier, dont on exige par an 7 ou 8 jours de corvée, n’aurait à payer que 12 à 15 sous pour sa part à l’imposition des chemins, ai elle était établie au marc la livre de la taille... Nul doute donc que la corvée ne soit évidemment contraire aux intérêts de cette classe de vos sujets vers laquelle j(Ia main bienfaisante de V. M. doit sans cesse s’étendre, afin * de tempérer, autant qu’il est possible, le joug impérieux de la propriété et de la richesse... La liberté, l’option, qui semble au premier coup d’œil si raisonnable, n ’est pas à l’abri d’inconvénients, du moment que ceux qui doivent délibérer ont un intérêt si distinct (1). » Ce n’était pas, certes, le point de vue dominant des Économistes, ni même le ton de Turgot ; mais tout de même — et l’un des adversaires habituels de l’École en partageait le mérite — les campagnes allaient être délivrées d’un de leurs plus cruels fléaux. La milice en était un autre, mais qui avait déjà beaucoup perdu de son caractère dévastateur, le principe des engage ments volontaires, sans être encore généralement appliqué, étant acquis. Le Trosne demande qu’on perfectionne la nou velle méthode en exemptant de capitation les parents des engagés, en plaçant les centres d’exercices des miliciens autant que possible à proximité de leur lieux d’origine, sous le com mandement d’anciens officiers réformés ; et que pour achever de réhabiliter une institution jusqu’alors exécrée, on organise des revues populaires (2). « Turgot, pourra déclarer à l’Assem blée de l’Ile-de-France, en 1787, le vicomte de Noailles, s’il imagine une milice, c’est pour la composer de volontaires ; Condorcet et Dupont de Nemours ses disciples, Necker son émule, rejettent comme lui l’enrôlement forcé (3). » L’orateur aurait pu citer à l’honneur toute l’École des Physiocrates. Combien d’autres vexations encore continuent de subir les gens de la campagne : « La chasse n ’est pas libre chez eux comme chez les anciens Romains, où chacun pouvait tuer le gibier, si bien qu’il y en avait peu et faisait peu de dégât (4). » Pas moins de 300.000 mendiants valides, en dehors des hôpi taux, sont disséminés sur la surface de la France... « Ils incen dient les grains des fermiers qui refusent de les héberger ; ils empoisonnent les bestiaux de ceux qui ne leur donnent1234 (1) C. Ä., p. 69-71. Cf. Lavergne, A ss. Prov., p. 50. (2) L. T ., Adm. Prov., IX , 15. (3) Cf. Gébelin, p. 251-252. (4) Butel-D., p. 82.
278
LA PHYSIOCRAT!B SOUS LE MINISTÈRE DE NECKER
pas k leur gré. Ils dérobent tout ce qui se trouve &leur bien séance ; ils débutent par des vols de basse-cour, et finissent en bandits de grands chemine ; combien de voyageurs assommée par leurs bâtons ferrés ; combien de laboureurs & qui ils ont brûlé la plante des pieds pour découvrir l’endroit de leurs trésors... Les émeutes et les soulèvements qui ont eu lieu dans la plupart des provinces en 1775 à l’occasion des trans ports des grains furent excités par des gueux et des mendiants, sons prétexte de vouloir acheter du blé, tandis qu’entre miUe il n’y en avait pas un seul qui eût moyen d’en payer une seule mesure... (1). » Le Trosne ne relâche rien des rigueurs qu'il avait toujours réclamées contre les vagabonds (2). Il insiste également pour que la justice devienne plus accessible aux campagnards, « grâce à la création dans chaque ai^ondissement d’un Comité permanent de Conciliation formé^des princi paux propriétaires, du syndic et d’un certain nombre de vocaux nommés par l’Assemblée » (3). Γ1 faudrait aussi remédier à « la multiplicité des lois civiles qui, non seulement entraîne des frais et des longueurs, mais suscite des contesta tions et gêne l’exercice des droits légitimes » (4). Le Trosne souhaitait une législation aussi encourageante pour les dessèchements. Mais les exemptions accordées, « quoique très bonnes, n ’eussent pas fait défricher un arpent si k bon prix des grains depuis 15 ans n ’y eut engagé : car, pourquoi aurait-on donné 50 à 60 livres pour cette opération, quand on trouvait à acheter une superficie égale en pleine valeur pour 30 ou 40 ?... Dès que la culture sera protégée, dès que ses avances seront en sûreté, et qu’on pourra habiter les campagnes sans redouter l’arbitraire, on portera des capitaux sur les terres abandonnées et l’on y créera des pro priétés foncières... Inutile de proroger l’exemption d’impôts... rintérêt particulier y suffira bien désormais, à la condition toutefois de maintenir l’exemption de la dime... (5) ». H faut surtout réformer les méthodes habituelles et les modalités générales de la fiscalité rurale. S’agit-il des terres affermées, auxquelles l’École porte un intérêt si vif, les aug mentations d’impôt brusques, survenant au cours des baux, avaient un effet destructeur et spoliatif, « prolongé parti-12345 (1) (2) (3) (4) (5)
Malvaux, p. 80 et p. 15 et 18. Adm. Prou.» IX , 14. Ibid., III, 13 et X I, 3, p. 603. Ordre social, Discours IV, notes, p. 171. L . T., Adm. Prou., V III, 5, p. 457-458.
L E P R O G R A M M E AGR IC OLE
27»
culièrement pour les fermiers médiocres et faibles, qui compo sent le plue grand nombre » (1). Quelle idée aussi avait eue le fisc de changer le calendrier des échéances : de janvier à janvier, au lieu d’octobre à octobre ? « Si M. Necker avait des biens fonds, s’il n’était point par système l’ennemi des propriétés territoriales... il aurait su qu’il n’y a point de propriétaire dont les baux ne commencent et ne finissent immédiatement après les récoltes, parce qu’elles sont l’époque naturelle des paiements auxquels elles fournissent... » ; le premier quartier exigible de l’impôt royal se plaçait bien mieux en octobre-décembre qu’en janvier-mars... (2). « D’autre part, la récolte de la première année de tout nouveau bail appartient au fermier sortant, l’entrant, n ’a que la récolte de la deuxième année ; et, dans les usages de la grande culture, on ne bat le grain qu’à mesure qu’on emploie la paille pour les bestiaux ; cette deuxième récolte n’est vendue que dans la troisième année ; il convient donc que ce soit le fermier sortant qui paie fermage et impôts deux ans encore ; tel est l’ordre régulier que prescrit la loi physique de la reproduction (3), » Quant aux petits propriétaires-cultivateurs, « à la fois directeurs et agents de leur exploitation, c’est le tableau d’une société incomplète, où, les avances sociales n ’étant pas suffisantes, les reprises de la culture faiblement entretenue, ne donnent ni revenus ni population réellement disponibles... La souveraineté a donc besoin de ménager extrêmement les revenus de sa copropriété ; car ils deviennent nécessaires à la subsistance et à l’entretien des exploitants, seule claese d’hommes existant sur le territoire... qui ont encore souvent besoin de la bienfaisance souveraine, le moindre excédent les réduisant à la misère... » (4). Très éclairée est déjà la légis lation française qui, « ayant senti que les seuls revenus doivent contribuer à l’impôt, a ordonné que toutes les créances hypo théquées sur les fonds fussent chargées des subventions mises sur ces fonds suivant leur qualité, en raison des intérêts qu’on en retire ; et nulle convention particulière dans l’acte d’hypothèque ne peut affranchir le prêteur de cette redevance publique : elle serait déclarée illusoire par tous les tribu naux » (5).12345 (1) L. T., Effets de l'impôt indirect (1770), p. 80 e t Adm . Proc., p. 15. (2) Suite des Ob** d'un Citoyen, p. 109 {Recueil compta, 1782, t. I). (3) Butré, Lois naturelles, p. 23-26. (4) Ibid., p. 128. (5) Ibid., p. 123.
280
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS LE M I N I S T E R E D E NECKER
Nouveau réquisitoire contre la dime ecclésiastique. « C’est par lui-même un impôt... double de ce qu’il parait être », frappant d’une dégradation progressive particulièrement la médiocre et la petite culture ; d’autant plus onéreux qu’il s’applique è des récoltes naturellement plus inégales, comme celles de la vigne. Elle est « insoutenable par le préjudice qu’elle cause en enlevant les empaillements..., point de pailles, point d’engrais ». Sa perception elle-même est très coûteuse, parce qu’au moment de la récolte on manque de travailleurs (1). Comme Linguet, en 1779, reprenait encore le projet de Vauban, un correspondant du Mercure lui avait reproché, après avoir tant critiqué les Économistes, de passer à l’Économisme. Baudeau écrit spécialement au Journal de Paris pour dissiper une aussi grave confusion : « Jamais les Économistes n’ont admis la Dime royale (2). » L’abbé de Véri, au nom du Bureau des Impositions de l’Assemblée du Bern, après avoir reconnu ce vice fondamental d’un impôt qui c ne tenant pas compte de l’inégalité des frais de culture, surcharge un terrain plus que l’autre », observe seulement qu’en fait, « les contrats des colons partiaires étant en général uniformes dans les cantons et paroisses... la réalité ne doit pas répondre à une aussi grande apparence d'inégalité » (3). CondUlac avait critiqué les impositions indirectes parce que, « si les salariés sont forcés de prendre sur leurs salaires une partie de l’impôt faute de pouvoir le rejeter sur l’acheteur, ils seront réduits à retrancher sur leur consommation, et la perte qui en résultera sur la valeur retombera sur les proprié taires ». Le Troene lui réplique que c l’impôt direct n’évite pas cette répercussion, puisque, en demandant aux propriétaires une portion quelconque de leur revenu, ils la retrancheront, sinon toujours sur leur consommation personnelle, du moins sur la dépense qu’ils auraient pu faire en salaires. Quel que soit l’impôt, les salariés du gouvernement remplacent cette consommation qui ne se fait pas par les salariés du proprié taire. — C’est par des moyens plus approfondis, qu’il faut attaquer l’impôt indirect » (4). Le dernier théoricien de l’École analyse longuement les fameuses Remontrances de la Cour des Aides de 1775, qui condamnent la « monstrueuse régie » de1234 (1) L. T., Adm. Prov., IX, 16, p. 547-560. (2) Voir Annates , t. VI I I (Mercure, 25 décem bre 1779) et Baudeau, Journal de Paris, 1780, n° 4, p. 17. (3) 20 novembre 1778, P . V .% p. 96. (4) L. T., Int. Soc., note, p. 946.
LE PROGRAMM E AGRIC OLE
281
la Ferme et en réclament « la réforme » : mais précisément, suivant notre auteur, elle est « irréformable » (1). Cette fisca lité de la gabelle, des aides et du tabac, dépasse, selon Butré, tout ce qu’on a pu imaginer ailleurs (2). « Illégale et désor donnée..., sans proportion et sans mesure, elle a encore un autre vice capital, c’est d’employer le pouvoir du prince pour soutenir la division et la désunion sociales... Une armée fiscale de plus de 200.000 hommes, répandue sur tous les chemins de l’Europe, est la preuve manifeste d’un état aussi désastreux et de la révolution infaillible qui menace ce grand continent. Les efforts de l’Amérique pour parvenir à l’indépendance que l'ordre ineffable lui assure, préparent à cet événement (3). » Une immunité entière « est le plus sûr moyen de procurer à l’agriculture des succès infaillibles ; sans ce premier pas indispensable, tout autre plan n’est que chimère bâtie sur le vide du néant » (4). Dans la Rome impériale les vexations des publicains ajoutaient tellement aux charges de la gabelle et autres droits de traite que, pour délivrer le peuple de ce fléau, Néron, dans le commencement heureux de son règne, voulait supprimer tous les droits d’entrée (5). Quand donc « la propriété des richesses d’exploitation sera-t-elle aussi respectée que la propriété des terres ? Quand n’y aura-t-il plus de ces charges indirectes qui retombent en double sur le revenu ? » (6). Seuls, à la vérité, Bayonne et le pays de Labourd ont été — au cours des années que nous considérons — « rendus aussi libres que précédemment le pays de Gex » (7). Cependant, par Arrêt du Conseil du 9 jan vier 1780, « la perception des droits d’aide était distraite de la Ferme générale, et devenait l’objet d’une Régie, â laquelle était également confié le recouvrement de divers droits jus qu’alors affermés (cuirs, fers, huiles, amidon, etc.). A la Ferme était de même retirée la perception des droits de contrôle, insinuation et centième denier ; une administration distincte, constituée en régie intéressée, en était chargée, en même tempe que du recouvrement du produit des bois, domaines ruraux et droits seigneuriaux appartenant à la Couronne... (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
L. 7 \, A d m . Prov.y III, 18, p. 265-276. Butré, L o is naturelles, p. 124. Ibid.y p. 133-134. Ibid.y p. 130. Cf. B utel-D ., p. 110. L . T.y In t. Soc.y p. 970. Cf. D.y D iet. Peuchety D isc. prélim.y p. x v .
282
LA P H Y S I O C R A T I E SOUS L E M I N I S T È R E D E N E C K E R
Pour l’ensemble du royaume, il n'y eut plus que 40 fermiersgénéraux au lieu de 60, dont le9 émoluments étaient réduits, et qui devaient reverser à l'É ta t la moitié de leurs béné fices... » (1). « Ne parlons plus de Ferme, plaisantait un adver saire anonyme du ministre, puisque ce mot, qui rappelle la Propriété foncière, fait tan t de peine à M. N... (ecker). Parlons d’Exploitation ou de Régie (2). » La réforme, si loin qu’elle fût de réaliser l’idéal de l'École, n’en était pas moins d’une réelle importance. « Parmi les impôts directs alors existante, lequel pouvait à la rigueur fournir aux Physiocrates une préfiguration approxi mative de leur impôt territorial ? Ç’avait été d'abord le vingtième des biens-fonds ; et depuis 1710 [date de son premier établissement] le dixième [ce fut sa première forme], ôté en 1717, remis en 1733 à l’occasion de la guerre, supprimé à la paix, remis en 1740 et prorogé toujours de terme à autre, a toujours été regardé comme un moyen extraordinaire, occasionné par les circonstances ; tandis qu’il est le seul impôt auquel il faudrait se proposer de réunir tous les autres, maintient encore Le Trosne... Nous n’avons d’impôt direct [au sens physiocratique] que celui-là ; et il ne donne que 40 millions (3) ! » « C’est le plus juste et même le seul juste de tous ceux que la finance a jamais exigés » abonde dans le même sens Linguet : « C’est le premier que la raison conseille, le plus facile, le moins dispendieux à percevoir et le plus doux à supporter (4). » « Sans doute, il souffre de l’arbitraire de sa première fixa tion » (5), rapporte à l’Assemblée du Bern l’abbé de Verri ; mais une « vérification générale » est en cours depuis 1771 ; « S. M. a senti qu’elle ne pourrait l’interrompre sans porter atteinte aux lois de la justice distributive... ; ee serait substi tuer à un impôt proportionnel une subvention fixe et qui n’aurait aucun rapport uniforme avec le produit des biens ; c’est d’ailleurs la classe la plus pauvre de ses sujets qui paye dans la proportion la phis exacte, en sorte que l’immutabilité12345 (1) Gomel, Turgot ei Necker, p. 331. (2) Seconde suite des Obs. d*an Citoyen, p. 59. (3) L. Γ., Adm. Prou., II, 3, p. 101 et I, 6, p. 28. (4) Annales, t. II, 1777, p. 512. (5) Rapport, 20 nov. 1778, P. V .9 p. 81. Cf. Assemblée Hte Guyenne, 26 sept. 1779, P. V., t. I, p. 79-81 : « La culture de certaine loads y suffit à peine... d’où l’appauvrissement excessif et Vengourdissement d’une classe entière et nombreuse de contribuables. »
LB P R OGR AM M E AGR IC OLE
283
de toutes les cotes actuelles serait une faveur acc' rdée princi palement aux propriétaires qui en ont le moitfs besoin. » Dans la suite, les vérifications ne pourront être renouvelées que 20 ans après... ; dorénavant « aucun propriétaire, même ayant le moins de facultés pour se défendre, ne pourra être imposé au-delà de sa cote précédente sur un simple examen particulier de ses biens, sinon uniquement à l’époque d'une vérification générale publique du produit des fonds de sa paroisse » ; enfin toute vérification se fera avec l’assistance de 3 propriétaires notables choisis par l’ensemble à cet effet (1) ; telles étaient précisément les dispositions de l’Arrêt du Conseil du 4 novembre 1777. Ainsi cet impôt est « infiniment moins onéreux au peuple que la taille et la capitation des campagnes ; il porte sur un objet visible à l’œil dont le produit est connu de tout le monde ; le'Contribuable n’a à se défendre $ue contre les erreurs, l’impatience ou la dureté du contrôleur ; il est rare que celui-ci puisse avoir des sentiments particuliers de vengeance, de haine ou d ’intérêt ; si son âme est suscep tible de douceur ou d’indulgence, ce sentiment tourne au profit du contribuable, tandis que ches le collecteur toute faveur au-delà de la juste proportion est au détriment d ’un tiers... et enfin, la cote une fois fixée, le propriétaire n’a point à craindre cette variabilité annuellle qui fait le poison de la taille... » (2). La perfection serait de dresser scientifiquement un véri table Cadastre, tel que celui exécuté dans les États du roi de Sardaigne, depuis 1731 et 1738 ; ou celui définitivement révisé par le Grand-Duc dé Toscane (3) ; un tel inventaire aurait en outre l’avantage de diminuer les frais de rénovation des terriers, qui pèsent si lourdement sur les campagnes (4) ; cepen dant prétendre faire un cadastre général pour toute une province seulement est peut-être un remède plus fâcheux que le mal même ; « mieux vaudra s’en tenir aux révisions partielles et aux rectifications de détail » (5). Que sont pourtant ces inconvénients auprès des vices de la taille personnelle ? « Qu’est-ce qui a forcé les propriétaires de quitter les campagnes ? Qu est-ce qui leur a interdit tout rapport avec la culture, si ce n’est la taille, dont on a eu la (1) Cf. Isambert, t. XXV, p. 146. Cf. Compto-rtnda, p. 63.
(2) Assemblée Berri, fee. ciI., p. 82. (3) L . T., Adm . Prou., V III, 17.
(4) Ibid., X I, 7, p. 611. (6) Aisemb. Hie Oitycnne, loc. cil.
284
LA P H ' S IO CRAT IE SOUS L E M I N I S T È R E D E NECKER
maladresse, de faire un impôt désagréable et humiliant, et en outre écrasant par son arbitraire ( 1) ? » « Les facultés de la plupart des taillables n’ont rien de net aux yeux du public... L’opinion que les collecteurs peuvent avoir de la richesse des contribuables est la seule règle de leur répartition... De telles obscurités ouvrent un champ libre aux passions humaines... Un taillable exact dans ses paiements craint de voir, l’année suivante, son exactitude punie par une augmentation... Personne ne peut nier qu’un désordre politique naît de la crainte de montrer sa richesse ; cette crainte étouffe en partie le goût du travail et les efforts de l’industrie... (2). » Necker est bien loin d’en disconvenir. « Il existe encore, proclame-t-il solennellement, une taille appelée personnelle et qui dépend, non de la propriété territoriale, mais des autres facultés des contribuables... Il serait à désirer que l’on pût renoncer à cette imposition ou parvenir à la dénaturer : car il faut regarder comme contraires à l’ordre toutes les impositions dont la mesure et les proportions sont arbitraires (3). » « Cet impôt, prononce la Déclaration du 13 février 1780, le plus à charge de tous aux habitants des campagnes, s'est élevé dans une proportion supérieure à tous les autres... car c’est le seul qu’on peut augmenter obscurément, ou du moins sam aucune formalité gênante, et par un simple Arrêt du Conseil rendu souvent à l’insu même du souverain... Je crois donc que c’est un rempart perpétuel établi pour la protection des campagnes, et un bienfait éminent de V. M. envers elles, que d’avoir assujetti l’augmentation des accessoires de la taille (4) aux mêmes formalités que tous les autres impôts (5). » La même fixation vaut pour la capitation des campagnes. Vivement critiquée par les Assemblées de Haute-Guyenne et de la généralité d'Auch, elle fut en quelque mesure trans formée en un impôt réel, moins inique, par un arrêt du Conseil du 30 décembre 1780 (6). Un certain esprit de dénigrement systématique perce dans le commentaire que donne de ces dernières réformes un défenseur de l’agriculture : « On promet quelque adoucissement à l’arbitraire, mais ce qu’on123456 (1) (2) (3) (4) ration (5) (6)
L. T., Adm. Prov., t. I, 15, p. 68. Rapp. de Vabbi de Véri, loc. cil., p. 71-74. Cf. Malvaux, p. 374. Compte rendu, p. 67. Le principal avait été fixé, en principe, par Laverdy, par la Décla du 7 février 1768. Ibid., p. 64-65. Cf. Stourn., 1.1, p. 243-244, et Marion, Impôt ë. le Revenu, p. 82.
LE PRO G R A M M E AGR IC OLE
285
exécutera plus sûrement, c’est d’éterniser ces impositions accablantes ; encore n ’ave^-vous voulu les rendre stables qu’au moment où elles sont devenues excessives (1). » Mais pour en revenir à la taille personnelle, la profonde et heureuse transformation était celle réalisée en 1776 dans la généralité de Paris, par l’intendant Bertier de Sauvigny. Bien que le collecteur conservât la liberté de l’augmenter ou la diminuer dans la répartition individuelle annuelle, « le produit de l’industrie des cultivateurs étant combiné sur l’étendue de leurs domaines, sur la valeur des terres cultivées et sur le montant des fermes à prix d’argent, il en est résulté que la valeur des terrains a servi de base à la taxe des taillables qui en recueillent les produits... Ainsi la taille réelle, sous le nom de taille d’exploitation, a pris la place de la taille personnelle pour les 2/3, et peut-être les 3/4... Il est inutile d’observer qu’elle retombe sur les seuls propriétaires, exempts ou non... » (2). Ce qui lui conférait un double caractère d’uniquité tout au moins relative et d ’universalité indirecte, qui pouvait aux yeux des physiocrates évolués, la rendre aussi acceptable en somme que le vingtième même corrigé ; d’autant plus que la découverte d’un grand nombre de terres dissimulées ou oubliées a permis un abaissement graduel du taux jusqu’à concurrence de 1 /4 (3). Necker approuve « cet essai, qui peut être susceptible de perfection, mais dont les principes parais sent raisonnables... La répartition entre les contribuables une fois établie, les proportions de paroisse à paroisse deviendraient plus faciles à régler, puisqu’on acquerrait de nouvelles notions à cet égard, en composant l’impôt qu’on paye dans ces diffé rents lieux pour un arpent d’un produit semblable » (4). — Ce n’était certes pas l’impôt de quotité depuis si longtemps et si vivement réclamé par les Physiocrates ; cette taille trans formée s’en écartait même beaucoup plus que le vingtième en son principe ; c’est néanmoins la solution pratique qui emporte finalement la préférence de Le Trosne, pourvu que la révision soit scrupuleuse et que les fermiers y aient participé. Preuve de plus de rélargissement continu, sinon de la désin tégration, de la doctrine fiscale de l’École.1234
(1) (2) (3) (4)
Lettre à Monsieur Necker, p. 45 (Recueil complet, t. I). Assemblée Berri, 3 novembre 1780, P. V.y p. 232. Cf. Marion, p. 74. Compte rendu, p. 66-67.
Ch apit re I I I
LE PROGRAMME COMMERCIAL I. — Le Bon Prix des productions agricoles Pour assurer le débouché le plus avantageux des denrées agricoles, d’abord diminuer la population des grandes villes : « Sans doute, elles ont vivifié leurs environs ; mais ç’a été au détriment de l’intérieur des campagnes, qui ont perdu à l’éloignement des propriétaires et au déplacement de leur dépense ; tous les frais nécessaires pour les approvisionner au loin ont été payés au détriment du revenu (1). » Ainsi l’entend l’orthodoxie physiocratique à laquelle Le Trosne, malgré les influences nouvelles qui s’exercent sur lui, reste en principe attaché. « Ces frais ne se reproduisent pas comme ceux de la culture, et leur m ontant est l’objet d’une sous traction non d’une addition, dans le calcul total des richesses... Dira-t-on qu’ils font vivre une infinité d’hommes et procurent, une consommation utile ? La difficulté est-elle donc de trouver les moyens de dépenser, et doit-on jamais craindre qu’une épargne sur des frais nuise à la consommation (2) ? » Tant mieux donc si la réforme de l’impôt la fait « refluer dans les provinces et y porter la vie » (3). « Ce n’est pas dans la capitale qu’il faut accumuler les consommateurs » : l’établissement de l’Hôtel des Invalides à Paris fut une faute ; d’autant que ses pensionnaires, à l’exception des mutilés, auraient pu, dans les petites villes, tenir des emplois de gendarmes ou d’huissiers (4). Tout ce que le théoricien admettra, à la manière de Turgot, c’est que « si la considération des frais de transport entre dans la fixation du prix en première main pour le réduire,1234 (1) (2) (3) (4)
L. 7\, Intérêt sociat, t. II, p. 933. Ib id ., p. 960. A d m . Prov., IV, 14, p. 313. L. T.y A d m . Prou., IX, 13, p. 538.
LB PROGRAM Μ E COMMERC IAL
‘4 8 7
elle n’y entre cependant pas tout entière et se partage ordi nairement entre le vendeur en diminution du prix et le consom mateur en renchérissement » (1). Concession déjà assez grave ; mais voici qui trahit un embarras plus grand, et le souffle d’un esprit nouveau : « On pourrait observer, déclare notre auteur non sans nous surprendre, que l’intérêt social est de diviser les richesses plutôt que de les réunir et de les accumuler ; que la dépense de 100.000 francs en profits de finances faite par un seul homme n’est pas si utile à l’É tat que le serait celle de 1.000 familles qui auraient chacune 100 livres de plus à dépenser, et dont la dépense, toute en subsistance ou en habillements grossiers, serait retournée à la terre par un bien plus court chemin. Mais la même chose n’arrive-t-elle point par la dépense d’un grand propriétaire ? — Oui, alors tout est dans l’ordre... (2) ! »Ce grand propriétaire, sans douteT vit en gentilhomme campagnard ? « Il faut qu’il y ait dans un É tat des citoyens opulents, le bien public le demande, admet le curé de Mongues, en Soissonnais ; mais dès que l’opulence particulière nuit à l’aisance universelle... ce renversement est un mal dangereux... la circulation interrompue n’est pas facile à rétablir ; dans les provinces où elle est éteinte, on pourrait fonder de nouveaux ateliers, y faire hiverner les troupes... La Cour pourrait très bien résider durant quatre mois de l’année à Fontaine bleau ou à Compiègne ; il ne serait accordé aucune grâce dans cette saison — d’août à novembre ; les seigneurs seraient obligés de la passer sur leurs terres. Les vacances des tribu naux pourraient commencer plus tôt et finir plus tard. On ne parle pas de la résidence des bénéficiers... ; les canons en ont assez parlé ; mais le Droit canonique n’aurait-il pas un peu besoin d’être protégé par le Droit civil ? Paris et les autres grandes villes sont les tombeaux des campagnes (3). » « L’usage infiniment trop répandu de la soie a causé à la France une perte incalculable, dont son commerce extérieur de luxe ne compense pas la millième partie. Le nombre des troupeaux [de moutons] s’est réduit à la moindre consom mation... ; les terres cultivées aux troupeaux qui les engrais sent ; la quantité des chevaux et des bœufs aux terres en valeur... L’agrément d’être vêtu et meublé d’une manière123 (1) Ini. soc., p. 957. (2) Adm. Prov.f I, 14, p. 61. Cf. M . Ph., t. II, p. 28. (3) Cf. Malvaux, p. 376 et p. 419.
288
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS L E M I N I S T E R E
D E N E CK E R
plus agréable, et le profit de nos brillantes manufactures, nous tiennent lieu de ces avantages ? Quel calcul ! Et combien Sully n’avait-il pas raison de voir dans ce luxe le dépérisse ment de la culture (1) ? » L’industrie de luxe est la moins utile, parce qu’elle tire ses matières premières du dehors et qu’elle ne procure de débit que par la consommation des ouvriers (2). Les matières premières constitueraient presque le tiers de nos importations (70 millions) (3). Les articles manufacturés, par contre, formaient presque la moitié de nos exportations. Or, « en supposant même la liberté entière du commerce, on peut soutenir qu’il y a plus de profit pour une nation à exporter 60 millions de productions [agricoles] que pour la même somme d’ouvrages de maind ’œuvre... » Que sera-ce, si « pour multiplier le travail en cette partie, on cherche à se procurer la préférence en faisant tomber, par des prohibitions, le prix intérieur des denrées de première nécessité ! On pourra, à la vérité, réussir à donner plus d’étendue à ce commerce... ; mais c’est en ruinant la nation » (4). D’autant que si cette industrie d’exportation réalise des bénéfices, « cet avantage lui est propre, la nation n’a rien à y prétendre ; elle perd au contraire en ce qu elle est forcée de payer ces mêmes ouvrages au-dessus du prix indispensable ; car elle ne les aura pas à meilleur marché que l’étranger » (5). Jamais l’orthodoxie physiocratique n’avait été plus limpide ; le moins que l’École puisse souhaiter c’est que « sans se refuser ce débouché... on ne le provoque point par des faveurs particulières » (6). Quant au trafic colonial, « la politique moderne qui interdit èt des colonies la culture des déniées néeevaires et la fabrication des ouvrages de main-d’œuvre, pour les faire approvisionner par la métropole ; qui leur défend même la fabrication de leurs propres productions pour se la réserver ; qui les oblige de n’exporter que par les voituriers nationaux, d’envoyer toutes leurs denrées à la métropole, sauf à en réex porter l’excédent — multiplie encore extrêmement le com merce extérieur par des moyens très favorables aux marchands et aux voituriers régnicoles, mais très onéreux aux colonies,123456 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
L. T., Irü. Soc., II, 966. Ibid., p. 953-954. Cf. Necker, Adm. F in, t. II, chap. 3, p. 130-138. Ibid., p. 967. Ibid., p. 951-952. Ibid., p. 953.
LE PROGR AM M E COM MERCIA L
289
et même à la métropole, aux dépens de laquelle ils renchéris sent les productions qu’elle en reçoit » (1). Plus qu’à celle des grains, sur laquelle le débat pouvait paraître épuisé, Le Trosne s’intéresse à la question des vins. Il célèbre l’Édit d’avril 1776 qui accordait à ceux-ci également la liberté intérieure : il n’enseignera pas « d’autre doctrine que celle consacrée » par la législation libérale de Turgot (2) ; mais il voudrait que dans ce cas aussi la circulation fût aussi franche que libre. « Les grands vignobles se sont peut-être accrus ; mais presque toutes les vignes dispersées dans les campagnes ont disparu... et ce sont ces cultures isolées, mais très multipliées, qui dormaient une quantité... La France pourrait cultiver le double de vignes sans diminuer ses récoltes en grains. Combien de terres maigres, de coteaux et de sables, qui ne sont nullement propres au labour, et qui seraient très fertiles en vins (3) ! Il n’est pas de culture plus favorable à la population et à la multiplication des bestiaux ; il n’en est point qui donne autant de richesses sur la même étendue de terrain » ; car bien que « le propriétaire soit ordinairement l’entrepreneur de culture, la vigne n’étant pas de nature à s’affermer... les dépenses de sa culture sont très considé rables » (4). Ce n’est cependant point sous le poids des charges communes qu’elle plie. Sans doute, outre la dîme qui représente 1 /20 du produit total, soit environ 1 /8 du produit net, la portion du souverain en perception directe consiste d’abord dans ce 10e, qui est assez ordinairement sur le pied de 2 livres par arpent ; puis dans la taille d’exploitation, payée par Γ [ouvrier] vigneron, mais sans contredit aux dépens du pro priétaire qui le salarie, soit environ 4 livres : bien qu’elle soit déjà ainsi la plus profitable pour le roi, cette culture serait en même temps la moins grevée parce que la plus productive... elle n’est devenue onéreuse au propriétaire que par le désordre d ’un autre impôt qui détruit le débit et la valeur de la production » : les Aides (5). L’avilissement qui en résulte est estimé à 50 livres par arpent, en première main, soit 150 livres de produit total, au lieu de 300 ; et cet impôt influe même sur les productions qui ne le paient pas, c’est-à-dire sur les vins des provinces (1) (2) (3) (4) (5)
Jbid., p. 968. Cî. Adm. Prou., III, 9, p. 208, note. Adm. Prou., III, 17, p. 177. Ibid., p. 170-172. Ibid., p. 172-173, cf. I, 5, p. 26.
•G. W E U L E H S S E
19
290
LA P H Y S I O C R A T I E SOUS LE M I N I S T È R E D E NECKER
moins chargées, en raison du manque de débit général. Pour l’ensemble du royaume, la perte est de 80 millions (240 au lieu de 320), si Ton compte les eaux-de-vie ; comme les aides, qui coûtent à la nation 60 millions, n’en rapportent net au roi que 30, la perte totale (avilissement et frais de perception) peut être évaluée à 110 millions (80 + 30) (1) pour le moine. La seule compensation accordée aux viticulteurs est la liberté de distillation des marcs de vendange, rétablie en même temps que celle des cidres (2). Pour les grains, le roi avait ordonné la suppression des droits de circulation ; cependant ils subsistent et la liquidation ne s’en fait point ; quand il serait tout simple d’en charger les Conseils provinciaux (3). Necker maintient la plupart des droits de marché ; et bien qu’il ne fût point partisan en principe des approvisionnements d’É tat, il recourait à maints commissionnaires officiels. « Les lois de Turgot ne sont point révoquées par actes publics, to u t au plus quelques arrêts; mais tout l’esprit de l’administration est changé, et par des mesures de détail on détruit tout l’effet de la réforme (4). La politique d’expédients restrictifs du ministre est soutenue par certaines susceptibilités populaires : ne voyait-on pas, dans la généralité de Toulouse, en 1781, dénoncer à l’Admi nistration les riches propriétaires et les gens aisés qui plaçaient leur argent en grains (5) ? En serait-on encore longtemps à regretter l’Administration des anciens Romains, chez qui les particuliers pouvaient garder leurs denrées et attendre l’occasion de les vendre à bon prix, même au double de leur valeur ordinaire ; où on était libre de vendre sur pied, ou rien n ’interdisait le commerce de province à province (6) ? » Ne pouvait-on au moins détruire tous les. obstacles au commerce général ? « Des péages on ne doit conserver, suivant Le Trosne, que ceux établis en faveur des constructeurs de canaux et qui sont le fruit de leurs avances ; l’É tat ne pourrait les en priver qu’en leur remboursant leurs dépenses. Il faut supprimer sans indemnité ceux qui sont usurpés, et regarder comme tels ceux qui ne sont fondés en titres bien authenti ques ; aussi ceux qui n ’ont été établie qu’à charge d’un service123456 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Ibid., p. 175-176. Cf. D., Diet. Peuchet, Disc, prélim., p. x v . Cf. supra, 1774-1776. L. T., Adm. Prou., IX , 7, p. 524, p. 104. Afanassiev, p. 423 et p. 53. Cf. p. 469. Cf. Viala, p. 38. Butel-D., p. 83-84 et 110 et p. 104.
L B P R O G R A M M E C OM M E RC IA L
291
qui n'est plus fait ; même les péages bien fondés doivent être liquidés, déduction faite des frais de perception, avec un intérêt de 4 % (1). » L'opinion se prononce sur cette question avec assez de fermeté pour qu’un Arrêt du 15 août 1779, formule le principe d’une suppression prochaine « sur les grandes routes et sur les rivières navigables » (2). Touchés par l'appel de Necker, on voit certains seigneurs abandonner d’eux-mêmes généreusement les péages qu'ils possédaient sur leurs domaines. Suivent l'exemple déjà donné par MM. de Laverdy et de Barentin, M. de Thomassin, président du Par lement de Provence, en son marquisat de Saint-Paul, et la comtesse de Ligny dans son comté de Courtenay (3). Pour les octrois Le Trosne a dressé tout un plan de suppres sion, et, ce qui n’était pas inutile, mais tout de même asses nouveau, de remplacement. « Convenons qu'il est parfaitement indifférent à un vigneron, à un nourrisseur de bestiaux, à tous les propriétaires fonciers qui n’habitent pas les villes, que la Ville... ait une belle place ou un magnifique Hôtel municipal, et qu'il n ’est pas juste de grever la culture d’une dépense qui lui est si étrangère... » : cette divergence d’intérêts soulignée entre cités et campagnes est bien, si l’on veut, d’inspiration physiocratique ; mais la réforme fiscale qui va en découler rompt avec la pure doctrine. « Sans doute, avoue l’auteur, c’est toujours la culture qui paiera cette dépense ; mais il est bien différent qu'elle soit payée par le revenu, ou par un impôt sur les productions qui les avilit, et qui nuit au revenu... Lorsque le revenu est une fois dans la main du propriétaire, il peut en faire tel usage qu’il lui plaît, et il n’est que louable si, au lieu de le dépenser pour sa satisfaction personnelle, il veut bien contribuer à la décoration de la ville qu’il habite... » — Mais s’il n ’y habite pas ? — Il faut donc supprimer les octrois ; comment ? D’abord décharger les villes de leurs dettes et des dépenses qu'elles font à l’acquit du gouvernement ; puis voir ce qui leur reste de revenue en d’autres objets ; enfin y suppléer par une somme à prendre sur les ving tièmes (4). Que diire des douanes intérieures ? « Il faut croire que le projet d’isoler les provinces d’un même empire, de gêner et de1234 (1) (2) (3) (4)
Adm. Prou., IX, 6, p. 524. Isambert, IV, p. 147-149. Cf. Stpum, t. I, p. 477. Adm . Prou., IX, 9, p. 528.
292
LA P H Y S I O C R A T ! E SOUS L E M I N I S T È R E D E NE CKE R
grever les communications entre elles, ne soit pas aussi singulier qu’il le parait, puisque nous le voyons réalisé sous nos yeux ; de sorte que le royaume se trouve partagé en deux parts, réputées étrangères l’une à l’autre, et traitées comme telles (1). » Des 16 millions de recettes, les 3/4 passent en frais et faux frais, sans parler de la perte générale sur la valeur des productions. Un projet d’abolition avait été établi par Daniel Trudaine, dès 1763; mais « par la fatalité des circonstances, il avait été condamné à rester dans l’oubli jusqu’en 1780 » (2). Quoi de plus simple, semblait-il, que de transporter toutes les douanes aux frontières ? Ainsi concluait alors l’abbé de Véry, à l’Assemblée du Berri (3). Necker reconnaissait qu’ « un plan aussi simple que grand, en effet, serait de rendre la circulation intérieure absolument libre; mais les drqits qui se paient de province à province devaient être considérés comme des droits de consommation ; par conséquent, en les supprimant, il faudrait se garder de vouloir en retrouver l’exact équivalent par une augmentation de droits à l’entrée ou la sortie du royaume ; car ce serait risquer de nuire essentiellement au commerce avec l’étranger » (4). Le Trosne distingue soigneusement ce qu’il appelle le commerce de spéculation, d’un lieu à un autre, et surtout « d’un temps à un autre, entrepris dans l’attente d’une varia tion dans les prix. Le marchand court le risque que cette situation n’arrive pas... il gagnera ou il perdra, sans aucun égard à cette considération, et sera forcé de se conformer au cours. Il ést donc vrai de dire, en un sens, que les bénéfices de ce commerce ne se font aux dépens de personne. En effet le marchand a acheté au prix courant et il a soutenu la valeur dans un temps ou dans un lieu où les productions étaient à moindre prix ; il sert ensuite les consommateurs en remettant en circulation ces mêmes productions dans un temps ou dans un lieu où elles sont plus chères ; il a donc rendu un double service... E t ce service est d’autant plus précieux qu’il s’agit du commerce de propriété, qui assure par la concurrence la plus entière la valeur en première main des productions du sol et réalise « le produit net qui est tout pour une nation (δ) ». Onéreux par contre est le commerce de transport : il faut le12345 (1) (2) (3) (4) (5)
L. T., Int. Soc., p. 982, note. Cf. Stoum, t. I, p. 479-481. Cf. Girardot, p. 226-227. Compte rendu, p. 90. L. T I n U r ê i social, p. 958-959 et p. 963.
LE
PROGRAM M E
C O M M E R C IA L
293
restreindre en facilitant matériellement les communications. Notre auteur recommande, par exemple, la canalisation du Cher et du Loir, sans impôt sur la navigation ; le souverain ee trouvera amplement dédommagé par Γaccroissement de la culture et du produit ; si toutefois il n’était pas en état de faire l’avance des travaux, il faudrait fixer des droits tempo raires qui promettraient à la compagnie concessionnaire de l’entreprise et de l’exploitation un remboursement rapide de ses actions. On pouvait en tout cas se féliciter de ce que la Loire, fermée depuis des siècles entre Ancenis et Ingrande, ait été rouverte au commerce des vins (1). Quant à la poste, t c’est un service public qui, dans l’état de prospérité, ne doit plus être matière à impôt, le prix des lettres étant réduit aux frais nécessaires » (2). Ce n’était pas l’avis de Necker qui, par l’Arrêt du 23 novembre 1777, restituait à la Ferme des Postes le service des Messageries, tout en confirmant la liberté de tout le gros roulage, rural ou urbain (3). Reste l’exportation des productions du sol. Selon Mirabeau, qui l’envisage effective, elle est, conformément au postulat originel de l’École, avantageuse entre toutes parce que « la nature fait [ici] la moitié des frais... ; la société agricole peut, si elle est sage, parvenir au point vraiment désirable, qui est de n’acheter que des services et ne vendre que des denrées » (4). On ne réclame d’ailleurs pour cette exportation naturellement privilégiée que franchise et liberté ; « tout impôt sur la sortie des productions retombe en perte sur la nation qui vend ; et elle la supporte au centuple... parce qu’elle rejaillit sur toute la masse des productions du même genre, qui est égale ment à portée de sortir, et dont le prix se règle sur celui du débouché, quoiqu’elle se consomme dans l’intérieur » (5) — sauf les cas très rares où la nation peut faire la loi à l’étranger (6). La prétention des propriétaires ne mériterait d’être répri mée que dans le cas où ils demanderaient qu’on provoquât la valeur par des moyens factices, ou qu’en donnant la liberté de la sortie, on mit la moindre borne à la liberté de l’entrée (7)... Cette bonne valeur, si importante à la prospérité d’une nation, (1) D id. Peuchet, toc. cit. (2) L. T ., Adm. Prou., Supp ., p. 15. (3) Cf. Cavaillèe, p. 159. (4) Af., Devoirs, p. 110 et 113, en marge. (5) Intérêt social, p. 991. (6) L . T ., Adm. Prov., III, 9, p. 209. (7) Int. social, p. 956-957.
294
LA
PH Y SIO C R A T !B
SOUS
LE
M IN IS T È R E
DE
NECKER
« n’est donc pas une valeur excessive, arbitraire et indéfinie ; c’est uniquement celle qui résulte de l’exercice légitime des droits de propriété ». Il ne faut pas oublier, d’autre part, que « le Commerce extérieur est plutôt un inconvénient néces saire qu’un avantage réel, lorsque le grand éloignement exige de grands frais » (1) : au moins qu’on ne les aggrave pas par un droit de fret sur les vaisseaux étrangers venant charger dans no9 porte (2). Le privilège dont jouit la métropole de ravitailler ses colonies exclusivement avec les productions de son crû peut bien la dédommager en quelque mesure de la privation générale d’exporter dont elle souffre ; mais « dès que la France se sera accordé à elle-même l’avantage inesti mable de la liberté et de l’immunité du commerce extérieur, elle pourra donner sans aucun désavantage pour elle-même la liberté des achats à ses colonies » (3). Celles-ci, suivant la doctrine constante des Physiocrates, doivent être considérées comme les provinces d’outre-mer d ’un Empire agricole, et l’intérêt véritable de la métropole est de voir augmenter leur produit net (4). Avec ou sans exportation effective, si la liberté d’expor tation n ’établissait pas une communication véritable perma nente entre les marchés du dedans et ceux du dehors, qu’aurait-il servi de développer la circulation intérieure ? c Dans les cantons pauvres par leur éloignement des débou chés, l’argent est rare et cher : la culture ira moins vite ; et l’on y verra encore longtemps rester en friche des terres bien meilleures que celles cultivées dans une autre province avec succès ; peu à peu les débouchés qu’on ouvrira en changeront absolument l’état et l’aspect. Mais la multiplication de ces débouchés [intérieur] ne peut que diminuer les valeurs dans les provinces qui jouissent aujourd’hui de cet avantage, si les prix n’étaient constamment soutenus par la liberté du com merce extérieur ; condition essentielle qui doit faire sentir combien il serait important, après avoir supprimé tous les droits de sortie, de négocier avec les étrangers la suppression réciproque de tous les droits d ’entrée (5). » Ainsi est offerte à la France la formule d’un libre-échange, sinon agrarien, du moins —- spécialement et par préférence — agricole à l’exportation.12345 (1) (2) (3) (4) (5)
I b id ., p. 968-969. A d m . P rov.y II I, 9, p. 212. Ird . soc., p. 1017-1018.
Cf.
Ibid., p. 1011-1013. L . T ., A d m . P ro u ., S u p p lé m e n t , p. 9.
LE
PROGRAM M E
C O M M E R C IA L
295
L'Encyclopédie Méthodique renouvelle contre l'adminis tration de Colbert des attaques violentes toutes inspirées de la doctrine économiste. « Ses règlements sur le commerce, dont l’agriculture ne fut point la base, sont des règlements de destruction... Pendant tout son ministère le prix des grains ne cessa de diminuer jusqu'à ce que, ne suffisant plus pour rembourser les frais de leur culture, on finit par en éprouver la disette... Il fit tout ce qu’il put pour réparer ce mal ; mais il ne fit pas ce qu’il devait ; il persista dans ses principes ; des diminutions sur les tailles, des encouragements accordés à la population et à l’agriculture, ne réparèrent rien. Qu'au raient fait les propriétaires des denrées qu'ils auraient recueillies ? Elles étaient sans débouchés, conséquemment sans valeur. Engager les produçteurs à les cultiver, c’était les engager à devenir plus pauvres de toute la dépense de la culture (1). » Quelle est exactement en cette occurrence la ligne de conduite dé Necker ? Hésitante et fluctuante, semble-t-il. En 1776-1777, à l'exception des généralités de Poitiers, Caen, Rouen, Picardie, Flandres, Hainaut et Champagne — c’est-à-dire plus ou moins voisines de la capitale — la sortie des grains continue d’être permise par toutes les autres provinces-frontières, où elle a été sollicitée par les propriétaires, laboureurs et fermiers... Dans le ressort des Parlements de Toulouse, d'Àix et du Conseil Supérieur du Roussillon, par le jeu automatique du taux prohibitif de 12 livres, 10 sols, la liberté a été rétablie après une simple suspension, dans le ressort du Parlement de Bordeaux, le même taux a décidé d’une suspension d’office à long terme (2). Mais le 27 sep tembre 1777, brusquement un Arrêt général d’interdiction. Il paraîtrait que Necker, croyant la récolte plus mauvaise qu’elle n’était, a manqué de sang-froid : « Il y a eu des moments très difficiles, écrira-t-il, en 1781, et d ’assez grandes inquié tudes dans le midi du royaume [surtout dans le Sud-Ouest] ; et sans la sollicitude et les secours de Votre Majesté, je ne sais si de grands maux eussent été prévenus » (3) ; des renseigne ments inexacts interprétés avec pessimisme auraient exagéré les menaces de disette dans ces régions. Il se produisit des123 (1) Boullanger, article C h arges P u b liq u e s (section F in a n c e s )t 1.1, p. 268. (2) Mémoire remis à M. Aubé et M. de Leeeort, pour M. Necker, en juillet 1777. A. N., F11 265. Cf. Afanaesiev, p. 426-427. (3) C o m p te re n d u , p. 98.
296
LA
PH Y SIO C R A T IE
SOUS
LE
M IN IST È R E
DE
NECKER
réclamations violentes en Bretagne, où l’interdiction fut parti culièrement rigoureuse et causa de grandes pertes aux négo ciants. Et dans le Sud-Ouest même, après que des approvi sionnements disproportionnés eurent provoqué l’alarme au point de faire se cacher un blé assez rare, mais tout de même suffisant, quand chacun eut repris son calme, dès le printemps de 1778, on constata qu’il y avait du trop, au grand dam du Trésor (1). A la même époque, « trente des principaux fermiers de l’Artois déclaraient que s’il ne pouvaient évacuer leurs blés à l’étranger, ils ne pourraient ni exister, ni satisfaire leurs propriétaires » (2). En 1779-1780 « les récoltes ont été bonnes, et l’exportation a été permise successivement dans presque toutes les pro vinces » (3). Dès novembre 1779, l’Assemblée diocésaine de Toulouse protestait contre le taux prohibitif et déplorait la vilité des grains causée par la suspension de sortie dans une année où les récoltes étaient excellentes. Necker ne rouvrit franchement l’exportation qu’en avril 1780 sur les instances du Parlement et de la Chambre de commerce (4). « Mais l’interruption de la navigation [du fait de la guerre] et le peu de besoins des pays voisins occasionnèrent une grande stagna tion dans le commerce avec l’étranger (5). » Il est certes des nations qui, par un avantage particulier à leur climat, possèdent des productions privilégiées qui leur procurent des moyens d’échange sans préjudicier à leur propre consommation, et qui fournissent uii fonds inépuisable au commerce extérieur. Ainsi pour la France, les vins, les eaux-devie, et les sels, la quantité de ces denrées n’est cependant pas telle que les étrangers ne puissent s’en passer, et que nous puissions accumuler sur elles sans inconvénient gênes et impôts. Non seulement ces impôts préjudicient à leur valeur et à leur abondance, mais ils mettent des bornes étroites à leur sortie. A la veille de la guerre d’Amérique, l’exportation des vins, eaux-de-vie, liqueurs, dépassait celle de tous les autres produits agricoles réunis, y compris les cuirs et les bois, et en y joignant même la pêche et les sels : 35 à 40 millions contre 22. L’École pouvait se féliciter de voir supprimer les droits sur12345 ( 1) Ci. Afanassiev, p. 437 et p. 469. (2) Cf. Arch. Dép. Pas-de-Calais, États d’Artois, 309, cité par A. de Calonne, p. 23. ( 3 ) C o m p le r e n d u , loc. c it.
(4) Cf. Viala, p. 93-96. ( 5 ) C o m p te
r e n d u f lo c . c il.
LE
PROGRAM M E
C O M M E R C IA L
297
les eaux-de-vie, non seulement sur leur circulation, mais sur leur sortie (1) ; par contre l’Assemblée de Haute-Guyenne devait sans cesse dénoncer les manœuvres de la ville de Bor deaux pour tourner l’Arrêt de Turgot d’avril 1776. « Sous peine d’amende et de confiscation, les Bordelais exigeaient que la fûtaille de vin de Cahors ne contienne que 28 verges, tandis que leur barrique en contient 32... Si la jauge est petite, les droits sont également forts ; tant pis pour celui qui achète [ou quÎ vend] des tonneaux de petite jauge » ; et combien d’autres abus sur les droits de commission, les taxes d’en trepôt et le fret ; en vain l’Assemblée « remonte au grand principe de la liberté, le seul propre à donner de l’âme et de la vigueur au commerce » ; ses plaintes n’étaient guère entendues (2). Somme toute de l’aveu de Le Trosne, « on ne peut douter que la liberté du commerce des grains rendue à la nation, quoique interrompue et jamais entière n’ait contribué à rendre ses forces à la culture, et n’ait augmenté le revenu territorial (3). Mais cette augmentation ne vaut que dans la partie du labour et principalement dans les provinces proches des débouchés ; elle est nulle dans la partie de la vigne... et elle est en partie relative à l’état du numéraire (4). Enfin il ne fallait pas que ce rétablissement du prix naturel ne fît autre chose que fournir une plus grande marge aux ravages de l’impôt indirect... » (5). « Aujourd’hui qu’une terre qui se vendait 30 et 40 livres en 1760 se vend 150 et jusqu’à 200, et qu’on a beaucoup de peine à en trouver, on est excité à .défricher, et à arracher les haies chargées de vieux arbres qui dévorent les terres voisines. Cette révolution dans la valeur foncière s’est faite en 15 ans. » Le succès de la réforme fiscale en pourra seul confirmer le bienfait (6).1234*6
(1) Cf. Diet. Peuchet, toc. cil. (2) P.-Κ., t. I, p. 39-41. (3) Dans le Languedoc, Γhectolitre de blé est évalué à 15 fr. 39 de 1761 à 1770 et à 17 fr. 05 de 1771 à 1780. Cf. Théron de Montaugé, L'A gri culture et les classes rurales dans le Pays Toulousain, depuis le milieu du X V I I P siècle, 1869, p. 56.
(4) « Quarante-cinq millions de numéraire pendant la dernière paix ont été portés aux hôtels des monnaies du royaume. » Necker, Adm. Pin., Il, 3, p. 141. (o) Adm. P r o v I, 9, p. 46-47. (6) Adm. Prov., VIII, 5, p. 457.
298
LA
PH Y SIO C R A T IE
SOUS
LE
M IN IS T E R E
DE
NECKER
II. — Le bon m arché des produite de l'industrie L’immunité de l’industrie avait toujours été le vœu, logique et paradoxal, des Physiocrates, ils purent donc applau dir à l’Arrêt du 4 novembre 1777 supprimant les vingtièmes « d’industrie » dans les bourgs, villages et campagnes : « Cette imposition, portant sur les fruits inconnus et présumés du travail et de l’intelligence, ne pouvait jamais être répartie avec une sorte d’équité qu’à l’aide d ’une inquisition tellement illimitée qu’une estimation même arbitraire devenait préfé rable. S. M. a résolu de commencer la suppression par les campagnes, tant pour y attirer davantage l’industrie que parce qu’on ne peut pas y régler cette imposition comme dans les villes. » — « Il n ’en œ t pas résulté une grande privation pour les revenus de V. M., déclarait deux ans plus tard le Compte rendu (1), et cependant vos provinces ont senti le prix de ce bienfait (2). » Les fluctuations de la taille industrielle présentaient de tels inconvénients que l’Assemblée de Berri, réclamait au moins l’application d’une méthode analogue à celle introduite dans la généralité de Paris, qui donnait des bases fixes — en attendant une suppression totale (3). Necker lui-même posait des jalons pour la réforme de la capitation urbaine (4). — En Haute-Guyenne, par crainte de surcharger « les propriétaires de fonds, qui forment la partie la plus précieuse de L’État... un règlement de 1666 avait accordé aux communautés la liberté de distraire une portion de la somme qui leur était demandée [pour la taille réelle] et de la répartir sur tous les habitants, par un rôle particulier, relativement à leurs cabaux [capitaux] facultés et industrie » ; mais un très petit nombre avaient fait usage de cette permission, qui ne faisait qu’accroître l’arbitraire de la perception (5). Beaucoup plus redoutables s’avéraient les impôts pesant spécialement sur certaines industries, et c’est à ceux-là que s’attaque Le Trosne. La régie des cuirs constituait une charge (1) En Béni par exemple, « le vingtième réuni de l'industrie et des offices et droits n'était que la 64e partie du vingtième total, le reste portant sur les biens fonds. » A. P. Berri, P . V .9 p. 83. (2) C om pte ren d u , p. 64. (3) I b id ., 3 novembre 1780, P. F., p. 234. (4) C . rendu , p. 69. (5) Assemblée Guyenne, 15 septembre 1779 ; discours de l’intendant Terray, P . V ., t. I, p. 225-226 (C o m p o id s ca b a U ste).
LC
PROGRAM M E
C O M M ER C IA L
299
si terrible que les fabricants offraient, pour y échapper, de verser l’équivalent de son rendement fiscal net. Non moins onéreux le nouvel impôt sur les papeteries. E t plus préjudi ciable encore, la marque des fers : « Les forges sont des fabri ques de première nécessité, puisqu’elles fournissent la matière première de tous les arts, de toutes les manufactures, et de l’agriculture, cet art primordial et nourricier de tous les autres (1). » De même l’Ordonnance de la marine [marchande] devrait être révisée en vue de supprimer tout impôt sur « les ■services des voituriers [navigateurs] régnicoles, ainsi que les gênes et les obligations qui les renchérissent » (2). Ce n’est pas tout : « L ’abaissement du taux de l’intérêt de l’argent, effet nécessaire de la réforme fiscale, de la cessation des emprunts publics, des remboursements effectifs et de l’accroissement de la richesse nationale, produira le grand avantage de faciliter toutes lee entreprises et de les multiplier. Les capitalistes et les négociants, accoutumés aujourd’hui à un haut intérêt de leurs fonds, négligent les entreprises où iis ne pourraient pas le tirer, et regardent comme une mauvaise affaire celle qui ûe produirait que 5 à 6 %. E t en effet les affaires commerciales, étant accompagnées de risques, doivent rendre plus que le taux ordinaire de l’argent. Mais alors ils seront forcés par la concurrence, par la liberté entière du commerce et par l’abaissement du taux, de se contenter d’un moindre bénéfice et de se rejeter sur des entreprises moins lucratives. En même temps que le commerce deviendra plus étendu, les fortunes des entrepreneurs et des négociants deviendront moins rapides et moins considérables, la société sera servie à moindres frais dans tous les genres, et l’on cherchera à s’indemniser de la modicité du gain par l’économie. C’est ce qui arrive en Hollande, où l’argent est si commun, et où l’on aime mieux se contenter de 1 ou 1 1 /2 % que de le laisser oisif (3). » En France, cette révolution économicosociale, qui sera bien une révolution physiocratique, retentira sur le développement de la capitale : « La ville de Paris sera moins riche et moins peuplée qu’elle n’est aujourd’hui, parce que la suppression de la Finance et la diminution des affaires produiront un très grand vide ; [mais] ce sera [précisément] un des avantages de la réforme : les gens d’affaires, les marchands,123 (1) (2) (3)
ltû ir U so c ia l , p. 1002. I b id ., p. 993. A d m . P ro o .f S a p p .t p.
22*23.
300
LA
PH Y SIO C R A TIE
SOUS
LE
M IN IST È R E
DE
NECKËR
le9 ouvriers y perdront sans contredit ; les propriétaires, les bourgeois, les rentiers [fonciers] y gagneront infiniment (1). » La parfaite immunité de l’industrie et du commerce implique évidemment que l’une et l’autre sont entièrement soumis au régime de la libre concurrence ; car ei « l’intérêt des nations est l’intérêt du commerce, il est très distinct de l’intérêt de ses agents » (2). A l’intérieur du royaume d’abord, « il entre nécessairement dans le plan d’une réforme générale de rendre la liberté à l’industrie par la suppression des jurandes. Cette opération est dictée par l’intérêt de la société, parce que ce régime fiscal et réglementaire forme une surcharge beaucoup plus considérable qu'on ne pense par le renchérisse ment des marchandises et de la main-d’œuvre » (3). Les monopoles spécialement autorisés tombent sous le coup de la même condamnation. Le Trosne dut approuver les lettrespatentes du 3 mai 1779, d’ailleurs préparées par Dupont, portant suppression de tous privilèges royaux de ce genre à l’avenir, et ne maintenant ceux qui existaient déjà qu’à titre provisoire (4). Il dut applaudir également à l’Arrêt du δ mai de la même année accordant, avec quelque naïveté dans les termes, « la liberté aux fabricants et manufacturiers, soit d’adopter dans la confection de leurs étoffes telles dimensions ou combinaisons qu’ils jugeraient à propos, soit de se confor mer aux règlements » (5). Bien entendu, l’Édit du 19 août 1776, « portant nouvelle création de Six corps de marchands et de 44 Communautés d ’Arts et Métiers, faisant renaître de ses cendres encore chaudes la majeure partie du régime corporatif, n ’avait pu que contris ter l’École. Il n ’en était pas moins sérieusement atteint; c’est ainsi que défense était faite à ces jurandes ressuscitées « d’étendre leurs privilèges, comme cela s’était produit « autrefois, au-delà des limites des villes et des faubourgs ». Un des résultats de cette restriction devait être, en suscitant des nouvelles concurrences foraines aux divers monopoles citadins, de réduire les onéreuses prétentions de ces derniers et l’excessive cherté de leurs fabrications. « Les villages suburbains eurent désormais leurs boulangers, bouchers, cordonniers, forgerons, boutiquiers quelconques, qui assurè-12345 (1) I b id ., IV, 14, p. 313. (2) In térêt so cia l , p. 970 et p. 1022. (3) A d m . P ro v ., IX, 6, p. 518. (4) Cf. Germain Martin, G rande in d u strie sou s L o u is X V , p. 227. (5) Cf. Qément, H re du sy stèm e p rotecteu r en F ran ce , p. 430.
LE
PROGRAM M E
C O M M E R C IA L
301
rent aux ruraux de la banlieue, outre l’économie d’argent, une non moins précieuse économie de temps et de dérange ment, puisqu’ils n ’étaient plus obligés d’interrompre leurs travaux pour se rendre à la ville s’y approvisionner (1). » Les Physiocrates, dans leur défaite passagère, marquaient tout de même quelques points. — C’en était un autre que l’application à l’industrie de la réduction des jours chômés : « Les travaux de l’artiste ne sont pas comme ceux du labou reur arrêtés par les mauvais temps ; on travaille dans les ateliers l’hiver comme l’été, les 16 jours de fête Supprimés seront donc un pur bénéfice pour nos manufactures. L’on s’est toujours plaint que la main-d’œuvre était trop chère en France ; n’est ce pas là un bon moyen d’en faire baisser le prix ? Multipliez d’un côté les profits des ouvriers, de l’autre diminuez pour eux les occasions de dépenses ; bientôt vous aurez leur temps à meilleur compte. Alors nous verrons refleu rir l’agriculture et le commerce, nos manufactures pourront soutenir la concurrence avec celles des Anglais et des Hollan dais, à qui la suppression des fêtes est devenue avantageuse (2). » A l’extérieur, dans le domaine du commerce international, les monopoles nationaux n ’étaient pas moins nuisibles qu’à l’intérieur les privilèges corporatifs. Ainsi « il est de l’intérêt de la nation qui vend de n’accorder aucune préférence aux voituriers régnicoles » (3). « Le régime prohibitif britannique ne sert qu’à enrichir les négociants anglais, qui font la loi aussi bien aux vendeurs et aux consommateurs anglais qu’aux vendeurs et aux consom mateurs américains (4). Mais la question essentielle est celle de la protection générale accordée aux manufactures natio nales. — Veut-on assurer l’exportation de leurs produits ? Surtout si la matière première est étrangère, ce ne saurait être là, en raison même de la stérilité foncière de l’industrie, aucune source véritable de richesses. — Cependant vous craignez qu’au moyen de la liberté non réciproque l’étranger ne fasse tomber votre industrie par ses importations ? ». Voyons donc quelles pourraient être les causes de cette chûte : « La première viendrait du bon marché de la main-d’œuvre étrangère, résultant de la grande épargne des ouvriers sur1234 (1) Cf. Àrdascheff, p. 359-360. (2) R o m a n s de C o p p ier. Cf. Malvaux, p. 403. (3) In térêt so cia l , p. 993. (4) Cf. de Fréville, C ritiqu e des R é fle tto n s im p a rtia les {A n née L ittéra ire , 1781, t. V, p. 273-295 et p. 306-307).
302
LA
PH Y SIO C R A T IE
SOUS
LE
M IN IS T È R E
DE
NECKER
leur consommation, épargne à laquelle les nôtres refuseraient de se réduire. Tant mieux 1 Ce serait la meilleure preuve de l’aisance nationale... et pourquoi ne profiterions-nous pas du bon marché qu’on nous offre ?... Ce que la nation épargne rait en ce genre, elle le dépenserait en d’autres, au profit de ses citoyens... En vain dira-t-on que si la nation' y trouve un avantage, il faut aussi considérer l’intérêt des agente nationaux, que cette concurrence priverait de travail. Si cette considération doit l’emporter, il faut rejeter toutes les inventions qui tendent à diminuer le travail des hommes ; ou bien, en suivant la parité, ne les admettre qu’en les grevant d’impôts particuliers qui rétabliraient la concurrence entre les deux manières d’exécuter le travail (1) ! » « Autrement, qui pourrait donc procurer aux étrangers cette préférence ? Vos ouvriers et fabricants ne sont-ils pas plus è portée de servir la nation ?... Si malgré cet avantage [et d’autres] vos ouvriers ne pouvaient encore, en certains genres, soutenir la concurrence dans l’état de liberté, ce serait une preuve que dans ce genre la nation a intérêt d’être servie plutôt par les étrangers... Peut-être l’industrie nationale trouvera-t-elle moyen de vaincre ces obstacles ; c’est son affaire ; et la concurrence est le vrai moyen de la forcer à se perfectionner. Au reste, si elle néglige cette partie, elle s’éten dra davantage dans une autre, qui pourra mériter aussi la pratique des étrangers. Mais dans quel genre d’industrie cette singularité peut-elle. se trouver ? Ce n’est certainement pas dans aucun des ouvrages destinés à la consommation du peuple, qui forme sans doute la partie la plus importante par son étendue... Ce ne peut donc être que dans quelques ouvrages de luxe et de pure fantaisie... (2). » Ainsi s’achève avec une impitoyable logique l’effort d’un théoricien resté fidèle à l’idéal physiocratique, pour réduire, subordonner et finalement « stériliser », au double point de vue économique et social, le trafic et l’industrie du royaume (3). Or, la part des manufac tures dans l’exportation française atteignait, nous le savons, à peu près la moitié : 150 millions de livres !1 23 (1) Intérêt social, p. 1000-1001. (2) Ibid. (3) L'importation de ces mêmes articles, introduits la plupart en contrebande, ne représentait que 40 millions. Cf. Neclcer, A dm . Fin., t. II, p. 130-138.
C h a p it r e IV
POLITIQUE ET PHILOSOPHIE DES PHYSIOCRATES I. — L'Individualism e social Jamais peut-être Physiocrate n'a proclamé avec plus de force et plus de chaleur la priorité de l'individu par rapport à la société que Turgot dans sa Lettre au Docteur Price sur les Constitutions Américaines : « Comment se fait-il que vous soyez à peu près le premier, parmi vos gens de lettres, qui ayez donné des notions justes de la liberté, et qui ayez fait sentir la fausseté de cette notion, rabattue par presque tous le£ écrivains républicains, que la liberté consiste à n’être soumis qu’aux lois, comme si un homme opprimé par une loi injuste était libre ! Cela ne serait pas même vrai quand on supposerait que toutes les lois sont l’ouvrage de la nation assemblée ; car enfin l’individu a aussi ses droits, que la nation ne peut lui ôter que par la violence et par un usage illégitime de la force générale... (1). » Mais pour les Physiocrates, c’est le principe de propriété individuelle qui est le premier entre tous, et fondamental par excellence. Mirabeau marque même quelque différence entre les garanties sociales accordées à l’un et à l’autre des deux genres de propriétés : immobilière d’une part ; mobilière — voire personnelle — de l’autre. « La justice est grave, la police prompte ; la justice examine, la police est sommaire ; la justice s’exécute par les lois, la police par des ordres. [Or] la propriété foncière et la portion immobile de la propriété mobilière sont préservées par la justice — sauf les très petites causes n ’en pouvant supporter les frais ou la perte de temps ; encore les affaires de détail, si elles sont foncières, ont-elles des juridictions légales. La police protège et secourt la pro-1 (1) 22 mars 1778, Œ. Γ., t. II, p. 806.
304
LA P H Y S I O C R À T I E S O U S
LE M I N I S T E R E D E NECKER
priété personnelle, la venge même à la réserve des grands délits (1). » « Les Romains donnaient à cette inviolabilité de la propriété [foncière], que les Decemvirs, se conformant aux anciens Règlements, déclaraient sacrilège envers Cérès ceux qui nuitamment et à mauvaise intention gâtaient ou coupaient les moissons, et décernèrent contre le coupable le supplice de la croix... Sous les premiers Césars mêm%, dans ces temps de troubles continuels encourageant les usurpations clandestines ou violentes, on en revint à des châtiments plus graves contre ceux qui enlevaient ou déplaçaient les pierres des bornages. D’abord on augmenta l’amende ; ensuite on prononça des peinee afflictives ; les esclaves furent condamnés aux mines ; les hommes libres, mais de petit état, aux ouvrages publics ; et les gens d’une condition plus élevée à la déportation dans une île et à la perte du tiers de leurs biens. Ceux qui empié taient sur la terre de leurs voisins étaient, en outre, chargés des plus affreuses malédictions et menacés de tous les mal heurs (2). » « La liberté des échanges est la première conséquence du droit de propriété (3)... Il n ’est aucun cas où le souverain puisse par une loi permanente y porter atteinte : car c’est un droit d’hommes, non de citoyens (4). » — De même « la liberté de la presse, résulte évidemment du droit de parler ; elle est une propriété acquise par les avances du temps et du travail ; que penser de cette politique intolérante qui contrarie et étouffe le génie, ôte aux savants le droit d’écrire en toute matière ? » (5). La liberté personnelle elle-même dérive en quelque sorte du droit de propriété. L ’Édit du 10 août 1779, portant suppres sion du droit de mainmorte et de la servitude personnelle dans les domaines du roi ne s’exprime guère autrement que les Économistes : « Un grand nombre de nos sujets, servilement encore attachés à la glèbe, sont regardés comme en faisant partie, et confondus pour ainsi dire avec elle ; privés de la liberté de leurs personnes et des prérogatives de la propriété, ils sont mis eux-mêmes au nombre des posesssions* féodales. » L ’École ne pouvait être que satisfaite d’un législateur, dont12345 (1) Ai., Devoirs, p. 226 et p. 230. (2) Butel-D., p. 69, 72-73, 76-77. (3) L. Γ., Iniérâ social, p. 955. (4) L . T., Ordre social, Discours X , note, p. 401. (5) D em in, p. 576. Cité par Legros, Analyse et Examen du système dei Philosophes Économistes par un solitaire (1787), p. 116.
P O L I T I Q U E ET P H I L O S O P H I E DES P H Y S IO C R A T E S
305
le progrès des mœurs, notamment en ce qui concernait le droit de poursuite, avait d’avance la décision libérale ; « des dispositions pareilles ne sont propres qu’à rendre In d u s trie languissante et à priver la société des effets de cette énergie dans le travail que le sentiment de la propriété le plus libre est seul capable d’inspirer ». Le roi invitait les seigneurs à suivre son exemple, et renonçait à tout droit d’abrègement au profit du Trésor (1). La liberté du travail, réalisée un moment par la suppression des maîtrises et jurandes, était considérée, elle ausi, comme découlant « des lois immuables de la liberté personnelle et de la propriété, qui assurent à chacun l’exercice de son talent et de ses facultés » (2). Le Trosne estime même que la coutume et la nature avaient d’avance fixé les règles de la transmission héréditaire : « On héritait et l’on partageait également dans le degré le plus prochain, et chacun payait sa part des dettes ; lorsque la loi positive est venue déranger l’ordre naturel des successions, établir des prérogatives entre les enfants du même père, exclure des parents plus proches pour appeler des parents plus éloignés, ordonner arbitraire ment la contribution aux dettes (3). » Un mouvement se dessinait en fait contre le droit d'aînesse (4). Seulement le droit de propriété pouvait se retourner contre les réformes mêmes inspirées par le désir de faciliter la pleine mise en valeur du territoire. Boncerf ayant proposé dans un de ses Mémoires de mettre une taxe sur les terres incultes, d’Ailly, premier commis des finances sous Turgot, déclare que « ces idées ne sont point nouvelles ; mais les lumières qui se répandent de plus en plus sur Y utilité de main tenir la propriété, et sur les vrais encouragements de la culture, font évidemment apercevoir combien un tel Édit aurait d’inconvénients. Un impôt sur un fond qui ne produit rien est contraire aux premières notions de l’ordre naturel ; comment en percevoir le montant ? Les exemptions accordées aux défri chements valent mieux que tous ces exercices abusifs de l’autorité tutélaire. On ne peut trop se mettre en garde contre l’idée que le salut du peuple peut être attaché à la violation de la liberté personnelle ou réelle des individus » (δ). Même12345 (1) Cf. Isambert, t. 26, p. 139. (2) L. 7\, Ass. P r o v IX, 5, p. 518. (3) Ordre social, Discours 3, note, p. 73. (4) Cf. Arrêt d’août 1775, relatif à Pernes-en-Artois, Doniol, Hre des classes rurales en France (1857), p. 427. (5) 7 septembre 1780, A. N. H. 1514. G. \V EU LE USSR
20
306
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS LE M I N I S T È R E D E NECKER
pour favoriser les défrichements, « il ne fallait dépouiller per sonne de sa propriété sur les terres incultes » : Le Trosne loue le Parlement d’avoir précisé, par un additif à la Déclara tion du 13 août 1766, « qu'il ne pourrait être rien entrepris que du gré, consentement ou concession des propriétaires ou des seigneurs à l'égard des terres abandonnées » (1). De même, « le plus grand obstacle, suivant notre auteur, à l’abolition de la féodalité, c’est qu’elle tient à la propriété, et qu’elle forme un patrimoine. A ce titre elle est respectable, je ne verrais d’autre moyen de la détruire que d’autoriser les censitaires et les vassaux à racheter la libération de leurs héri tages à un taux qui serait déterminé sans que le suzerain puisse s’y opposer ; et comme la féodalité aboutit de toute part au Roi comme à un centre unique, il faudrait que le Roi donnât l’exemple, en rompant la chaîne et en admettant les rachats » : entreprise longue et difficile (2) ! La mainmorte et le servage sur les domaines seigneuriaux sont maintenus même par l’Édit libérateur de 1779, vu la nécessité d’un rachat et la pénurie du Trésor. Autrement, Le Trosne le reconnaît, si « la propriété est un titre sacré, ce n ’est point la violer que de la supprimer en la payant dans toute sa valeur lorsqu’elle se trouve nuire au service public ». C’est le cas des moulins qui gênent la circulation sur les cours d’eau ; à ce titre tout au moins, sinon pour la pêche, ils forment une sorte de propriété commune ; les besoins de la navigation autorisent leur expro priation pour cause d’utilité publique moyennant indem nité (3). « Lorsqu’un héritage est nécessaire pour construire un chemin ou un édifice public, on ne croit pas blesser la propriété en obligeant le possesseur à en recevoir le prix; d’après ce principe, on ne doute nullement du droit qu’a le Roi de supprimer les droits de hallage, minage, marché, ainsi que tous les péages (4). » — Quant aux dîmes ecclésiastiques, « le plus grand bien qu’on puisse faire à la nation est de l’en affranchir. Fausse propriété, simple revenu affecté à une dépense publique, c’est à elle à la payer ; si elle trouve trop d’inconvénients à la payer de la manière actuelle, peut-on lui contester le droit de le faire d’une manière qui lui convienne, par exemple au moyen d’un traitement, qui compléterait le1234 (1) (2) (3) (4)
Adm. Prou., V III, 5, p. 456. Ibid., IX , 20, p. 570. Ordre social. Discours 4, p. 158, note. Adm. Prov., Dissertation sur la féodalité, p. 633.
P O L I T I Q U E ET P H I L O S O P H I E DES PHYSIOCRA TES
307
revenu des terres ou immeubles attachés à la cure, lui-même exempté de tout impôt 9 » (1). En revanche, ce qu’on peut appeler l’absolutisme proprié taire ne connaît pas de frontières. « N’est-il pas indifférent que les agents de la communication soient citoyens ou étran gers, qu’ils parlent telle ou telle langue, qu’ils soient soumis personnellement à telle ou telle domination ? Qu’importe è un propriétaire berrichon que ses laines soient manufacturées en Berri, en Languedoc, ou en Piémont ? Qu’importe à un propriétaire de Bourgogne que son vin soit bu dans la Flandre autrichienne ou dans la Flandre française, et qu’il soit voituré par un étranger ou par un régnicole ? Tout ce qui l’intéresse, c’est de ne rien perdre du prix possible de sa denrée par le défaut de concurrence ; et par la même raison, tout ce qui intéresse un consommateur est d’être servi à la meilleure condition possible (2). » C’est le libre échange parfait, réciréciproque, si possible : « Le plus grand avantage que le Roi pût tirer de la guerre actuelle pour la nation serait de forcer l’Angleterre à ouvrir avec nous un commerce absolument libre, à lever toutes ses barrières et ses impôts d’entrée, tant en Europe que dans les Colonies, en lui offrant d’en user de même (3). » Mais « indépendamment de la conduite des autres nations, il est utile à chacun en particulier d’établir la liberté du commerce chez elle » (4). « Si cependant l’étranger refuse d’admettre vos productions (eh bien !) il vous fait tort ; mais cela ne vous servira de rien de chercher une vengeance par d’inutiles représailles (5). » « E t s’il est bien constant que jamais les nations n’établiront entre elles la liberté commerciale par un concert unanime », faut-il donc laisser le commerce éter nellement asservi ? Au moins, qu’entre nations voisines, comme la France et l’Angleterre, il se forme des liens de réci procité à deux (6). L’abbé de Véry, à l’Assemblée du Berri, exprime « le vœu de voir tomber complètement les barrières des douanes et proclame le principe de laisser tout passer » (7). Entre États, « l’intérêt de chacun était d’être servi aux meilleures (1) (2) (3) (4) (5) (6)
A d m . Proy., IX, 17, p. 556. L. 7\, Intérêt social, p. 977. Cf. p. 983-984. A d m . Proy., I, 6, p. 34, note. Intérêt social, p. 986. Ibid.y p. 1006. Ibid., p. 984. (7) Ct. Girardot, p. 226-227.
308
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS L E M I N I S T È R E
D E NECKER
conditions possibles, cet intérêt ne change, pas si, au lieu d'un É tat indépendant, nous supposons une colonie. Toute violation des droits naturels nuirait et à la colonie et à la métropole... » (1). La colonie, [tout comme la métropole] « doit être souveraine dans le choix des cultures (2) ; l’intérêt général de la nation n ’embrasse-t-il pas tous les intérêts particuliers des provinces soumises à la même domination ? » Quesnay lui-même ne l’avait-il pas de longue date démontré contre Montesquieu ? (3) Les colonies doivent pouvoir prendre leurs travailleurs [ce pouvait être alors des esclaves Noirs] où il leur plaît (4). En résumé elles doivent, comme de simples provinces qu’elles sont, contribuer « d’une portion du produit net de leur culture aux dépenses publiques » de la métropole — ou plutôt de l’Union commune (5). L’internationalisme, le cosmopolitisme, inhérents à la propriété privée individuelle, débordent largement du terrain économique, non seulement sur le domaine juridique pur, mais sur la politique. L’École avait toujours condamné le droit d'aubaine ; Le Trosne insiste pour la suppression de cet abus ; « en général, ne vous est-il pas avantageux que les étrangers viennent chez vous, qu’ils vous apportent leurs richesses, leur industrie, leur consommation, qu’ils augmentent le nombre de vos sujets ? Si la faculté de tester est du droit civil — ce qui forme une grande question — le droit de laisser ses biens à ses héritiers légitimes est de droit naturel. N’allez pas établir contre l’étranger le principe très faux que, capable de tous les actes du droit des gens, il est incapable de trans mettre sa succession même à ses enfant, quia liber vivit, sed servus moritur » (6). Élargissant encore en philosophe ce grand débat, Turgot n’hésite pas à déclarer que t les prétendus intérêts de posséder plus ou moins de territoires s’évanouissent par le principe que le territoire n’appartient point aux nations, mais aux individus propriétaires des terres. La question est de savoir si tel canton, tel village, doit appartenir à telle province, à tel État, ne doit point être décidée par le prétendu intérêt de cette province ou de cet É tat, mais par celui qu’ont les habitants de se rassembler pour leurs affaires dans le lieu où (1) L. T ., In t. soc., p. 1012. (2) I b id ., p. 1014.
(3) Œ . Q. (Réponse à Va u teu r de VEspril d es Lois, éd. Oncken, p. 566). (4) L. T., op. cit., p. 1021. (5) I b id ., p. 51. Cf. Labrouquère, passim. (6) A d m . P ro o ., II I, 11, p. 219-220.
P O L I T IQ U E ET P H I L O S O P H I E DE S P H YSIOCHAT ES
309
il leur est le plus commode d’aller » (1). E t c’est une raison de plus de honnir toute guerre de conquête : qu’elle soit décidée par le nombre, ou plutôt par la richesse, elle est ruineuse même pour le vainqueur. L ’équilibre européen n’est qu’une instable garantie de la paix, « les contreforces sont mauvaises aussi entre les nations ; il faut créer entre elles le sentiment d’une communauté d’intérêts et d’une élroite solidarité » ; tout le Discours IX de L’Ordre social est consacré à cette haute doctrine, fort répandue d’ailleurs à l’époque, mais que renou velaient les thèses physiocratiques. Des 3 termes de la devise sacramentelle : Propriété — Liberté — Sûreté, les 2 premiers tendaient donc à se fondre et le 3e à disparaître. Mais un 4e terme, en raison de la tendance générale des esprits, plus discrètement formulé que jamais, subsistait néanmoins, nullement désavoué : Inégalité. « La justice, prononce sèchement Le Trosne, n’a pas pour objet de rendre les fortunes égales, mais d’assurer à chacun ce qui lui appartient (2). » Le bailli de Mirabeau ayant reproché aux Economistes d’avoir en Provence, en Languedoc, dans le Dauphiné « et tous les pays où la commune fait communauté, excité une rébellion générale de la canaille, qui argumente toute d’après l’égalité naturelle, si bien que Messieurs les avocats procureurs et gratte-papier répètent leurs arguments en les accommodant à leur genre », le marquis s’indigne contre son frère : « Donnerais-tu aussi dans le cri du vulgaire ? Nous n’avons pas en un seul endroit prêché l’égalité, nous avons au contraire démontré l’essence naturelle de distinctions et la nécessité sociale des prérogatives ; qu’il ne faut pas confondre avec les privilèges, contre lesquels [d’ailleurs] nous n’avons rien dit nominatimy si ce n’est au sujet des exemptions d’impôts. Ce sont les Philosophistes qui ont voulu tout confondre, et qui y tendent de droit et de fait, et par doctrine et par cabale. Au reste ils ont été sur cela la mouche du coche, et n’ont pas changé grand’chose à la face des choses humaines, qui tendent et tendront toujours à l’usurpation. Nous avons prêché l’humanité ; mais elle est dans la justice... (3). »123
(1) Lettre au Docteur Price (Œ . 7\, t. II, p. 808). (2) Ordre sociat, p. 36. (3) Lettre du Bailli du 8 mars 1779. Réponse du marquis, 26 mars, citées par Loménie, t. II, p. 412-413.
310
LA P H Y S I O C R A T ! E SOUS LE M I N I S T È R E D E NECKER
Π . — L’Ordre politique « O n a accusé lee Économistes d’être devenus politiques à contretemps et d’avoir abandonné la charrue pour régler les Empires... Mais réplique Mirabeau, tout s’est trouvé nécessaire pour assurer les avances ; les Empires n’ont été que des concours de charrues, l’ordre naturel nécessaire à connaître pour semer à temps et récolter à profit s’est trouvé la règle indispensable et le canevas en grand de l’ordre social, d’homme à homme, de province à province, de royaume à royauee... (1). »Là-dessus repose la véritable base du régime monarchique : « Il faut un souverain, parce que nous avons découvert (nous parlons d’une nature agricole) que la souveraineté avait son patri moine, fondé par des avances, acquises au même titre, et entraî nant les mêmes charges que la propriété foncière. Souvenezvous que la propriété est un droit et un titre sacré accordé par Dieu et la nature au travail et à la confiance de fixer ses avances en tel lieu ; et qu’il est de l’essence de la propriété d’appartenir à un seul (2). » « Les avances foncières étaient le titre, naturel et non conventionnel, de la propriété foncière ; les avances souveraines d’action, de protection, de manu tention, de défense, etc., en ont fait le complément, la sauve garde et l’efficacité ; elles sont copartageantes aux fruits qui en résultent, parce qu’elles le furent au travail et aux dépenses (3). » « Partout où le patrimoine de la souveraineté n’est point pleinement établi, il n’y a point de souverai neté (4) » : telle est la dernière forme peut-être, sous l’Ancien Régime, de la théorie de la monarchie absolue — forme à laquelle d’ailleurs Le Trosne est très loin de se rallier expressé ment (5). Le rayon d’action de cet absolutisme est, en tout cas, par sa définition même limité. Le roi de Suède Gustave III ayant12345 (1) Note de M . (?) à un Projet d ’établissement d’une Société d’agriculture pratique, 25 avril 1777, A. N.-K. 906, n° 26. (2) Λ#., Devoirs, p. 142 (3) Ib id ., p. 97. (4) Butré, Lois naturelles, p. 131. (5) « Une branche bien intéressante du système des Économistes est l’institution d'une souveraineté unique et héréditaire. Ce qu’il y a de sin gulier, c’est qu’ils sont accusée par les uns de vouloir convertir en despo tisme la moharchie, et par les autres de vouloir détruire la monarchie en com battant le despotisme. La contradiction manifeste de ces deux impu tations vous annonce que ni ceux-là ni ceux-ci ne les ont entendues. > (Éph., 1775, n° 3, p. 46-47 : Un magistral.)
P O L I T I Q U E ET P H I L O S O P H I E DE S P H Y S IO C R A TE S
311
écrit à Mirabeau qu’ « un roi qui se croit véritablement le père de ses peuples lui semblait ce que la politique peut pro duire de plus admirable », le marquis n'en convient pas : « L’objet de la politique est la durée, et une constitution ne peut porter sur le sentiment, guide trompeur et rarement paisible, mais sur des bases solides. Le souverain, propriétaire comme un autre, a ses droits comme un autre et ses devoirs comme un autre ; et quand il se contente de faire son devoir, sans se mêler de la chose d’autrui, bonne ou mauvaise, tout est bien pour tous. Je crois même dangereux d’accoutumer un grand peuple à attendre tout du gouvernement, il n’est que trop porté à lui tout attribuer (1). » La monarchie patrimo niale des Physiocrates n’est pas du tout le gouvernement « paternel » des despotes éclairés : « Ses devoirs se résument en un seul : pourvoir à ce que chacun fasse librement et facilement ses affaires... Dans le vrai, les hommes n ’ont point besoin d’être gouvernés. D’eux-mêmes ils sauront faires leurs affaires, et c’est tout ce qu’ils ont à faire (2). » Familial ou autoritaire, ce paternalisme a depuis longtemps cessé de trouver grâce aux yeux du marquis : « Une jeune imagination bien éduquée veut devenir le père de ses sujets [serait-ce une allusion à Louis XVI ?]... Je lui démontre qu’il n’est point cela, qu’il ne le saurait être, et que cette prétention édifiante n’est qu’une illusion dangereuse et passagère. » Plus grave encore l’équi voque de ce régime lorsqu’il se double de patriarcalisme : « Ce principe établi à la Chine par droit des premiers fonda teurs... L ’axe du respect filial devenu l’artère principale de la constitution sociale [par ailleurs] la meilleure de toutes : voilà ce qui a causé et causera tant de révolutions de trône, de changements de dynastie, parce le fils est en droit de demander du pain à son père, et le père en devoir d’y veiller ; parce qu’un jeune homme, un enfant, ne peuvent être réputés père, parce qu’un père si magnifique et des enfants si gueux supposent exhérédation, etc. (3)... » De cette thèse qui réduit le rôle du souverain à sa plus simple expression, Le Trosne ne fait entendre qu’un écho affaibli, rééditant le « peu gouverner », du marquis d’Argenson et le fameux il mundo va da se des premiers temps de l’École (4)e1234 (1) M.y Lettre à Butré, 6 décembre 1778. Cf. Reuse, p. 49-50. (2) M ., Devoirs, p. 160. (3) M. à Longo, 20 octobre 1780, Mss. À ix , XVI, p. 194. Cf. Af. ΡΛ., II, 49. (4) L. 7\, Intérêt social, p. 926-927. Cf. Ai. Ph., U. d. 40.
312
LA P H Y S I O C R A T I E SOUS LE M I N I S T È R E D E N ECKER
— En dehors de la défense nationale, la première fonction de l’autorité est de veiller aux travaux publics ; la seconde d’assurer la justice et la police ; mais « la justice et son dépar tement n’est que le soin de faire vider les débats et les questions qui dégénéreraient en querelle, qui empêcheraient les contendants d’aller à leurs affaires ; et particulièrement la société, qui doit, en tout et partout, être de bon accord », tandis que « la police entretient l’ordre et la paix dans les communi cations » (1). Le souverain ne saurait être juge : car alors « il serait tout, et les autres hommes rien » ; or, entre tout et rien, plus de rapports, plus de société ; plus de souverain... Le premier n’est juge que des juges mêmes, comme de ses pré posés » (2). Restent l’Instruction et la Finance. Celle-ci peut bien être considérée théoriquement par Mirabeau comme un détail non pas de gouvernement, mais seulement d’administration (3), Le Trosne s’y intéresse de plus près. Il faut en effet se défendre des notions confuses et s’interdire les pratiques fallacieuses. « Quelle est la nation en Europe chez laquelle l’impôt soit établi sur le seul fond qui lui est destiné par l’ordre physique ? Quelle est celle où l’on ne soit pas parti de ce principe que tous les citoyens, participant aux avantages de l’association, doivent en sup porter les charges et que la police, de concert avec l’intérêt social, exige ce partage ?... Principe faux, et qui n’a pour lui qu’un vain éclat de convenance et une apparence trompeuse d’équité. Il n’est pas conforme à la justice, puisqu’il se trouve contraire à l’intérêt de la reproduction, qui est celui de toute la société ; et le seul avantage qu’il paraît présenter est illu soire et trompeur, puisqu’il est faux qu’une répartition géné rale rend le fardeau moins pesant pour les propriétaires » (4). En revanche « l’impôt territorial exclut toutes ces distinctions et tous ces privilèges, aussi injustes que décourageants pour ceux qui n’en jouissent point ; loin que ce soit là un obstacle, c’est un avantage de plus, qui n’en fait que mieux marquer la nécessité » (5). Donc, « dès que l’on suppose l’ordre établi12345 (1) M ., Devoirs, p. 61-62. Cf. L. T., loc. cil. (2) Devoirs, p. 204-205. (3) Af., Devoirs, p. 161-162. (4) L. T., Ordre social, Disc. 2, p. 21-22, Disc. 4, p. 164-167. Cf. Boullanger : « Personae n'est plus convaincu que moi de la nécessité de soulager les propriétaires et les cultivateurs ; mais c'est une chimère de croire les soulager par des taxes et des augmentations sur d'autres objets. » (Encycl. M äh. Seä. Finances, t. I, p. 264.) (5) Cf. ibid., p. 277.
P O L I T I Q U E ET P H I L O S O P H I E
DES PH Y S IO C R A TE S
313
chez une nation, une de ses premières lois constitutives [dérivant des lois naturelles fondamentales, mais supérieures aux simples lois civiles et criminelles] sera la proscription de tout impôt indirect sous quelque forme qu’il soit déguisé» et l’établissement de l’impôt unique fixe et proportionnel, croissant et décroissant avec le revenu des propriétaires » (1). Même, « dans le cas d’un vrai besoin » — plutôt que de recourir à l’expédient ruineux des emprunts — ce sont les propriétaires fonciers encore qui doivent « contribuer par une subvention passagère » (2). Cependant « la souveraineté doit porter ses vues sur la formation sociale des établissements ruraux, elle doit regarder la nation comme une société qui commence à se former, et s’occuper de créer les classes sociales dont l’ensemble et l’har monie composent seuls un ordre social complet et une souve raineté immuable... On voit donc que... si le revenu public est le 5e du produit net dans une grande culture dirigée par de riches chefs, on ne doit point le percevoir à la même quotité dans Une culture médiocre, n’ayant ni directeurs ni agents principaux ; car il est évident que moins la culture est riche, plus elle a besoin d’avances pour soutenir son exploi tation et en améliorer les entreprises... » (3). Par contre Pimpôt devra-t-il croître indéfiniment, suivant la proportion fixée, avec le revenu territorial lui-même ? « Il est des gens qui le pensent (4) ! certains mêmes vont plus loin et voudraient établir comme une loi constante que le propriétaire n’a droit de prétendre que l’intérêt des avances foncières et le rembour sement des dépenses d’entretien, et que le surplus appartienne à l’État... Mais le seul titre sur lequel, est fondé le droit du souverain, est la nécessité de pourvoir &la défense publique... Il n’est pas de même nature que celui du propriétaire, de tirer tout l’émolument possible de son héritage... Si l’impôt établi d’abord dans la mesure qu’exige l’entretien de la chose publi que suivait l’accroissement du revenu, il excéderait bientôt la somme nécessaire aux besoins de la société ; donc, dès que ces besoins sont remplis, l’amélioration du revenu, qui est le fruit des dépenses et des soins du propriétaire, doit tourner tout 1234 (1) (2) (3) (4) Cf. M.
Ordre social, Disc. 6, p. 260 et p. 278-279, note. L. T., Int. social, t. II, p. 976. Butré, Lois naturelles, p. 128-130. C'avait été, en 1759, la thèse de Queenay contre celle de Mirabeau. Ph.y t. I, p. 467.
314
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS LE M I N I S T È R E D E NECK ER
entière à son profit... Seul le revenu personnel du Roi devra suivre ladite amélioration (1). » Mais le grand œuvre est l’Instruction. La liberté de la presse n’en est qu’une des conditions : « Chacun doit être libre d’imprimer... Dieu et la nature le veulent ; seulement, comme le droit d’imprimer dérive du droit d’écrire, et celui-ci du droit de parler, on ne doit imprimer que comme l’on parle, c’est-à-dire à visage découvert... (2). » E t surtout, il faut que l’opinion publique soit éclairée : c’est à quoi doit tendre un € enseignement général », envisagé comme « la contre-force la plus puissante, la barrière la plus forte aussi bien contre les volontés arbitraires du souverain que contre les prétentions mal fondées des sujets... Ce ne seraient plus des tribunaux, un Sénat, ou une Diète qui disputeraient et composeraient avec le souverain : ce serait la nation entière qui réclamerait la justice clairement reconnue, et qu’appuierait la résistance des tribunaux et corps intermédiaires » (3). Cela implique une instruction puissante et organisée. « Je ramène tout à l’Instruction, qui seule fera légion en faveur de la raison des choses, qui ta n t et ta n t est méconnue, et qui cependant est seule la légitime souveraine. » En dépit d’une certaine religiosité (4), elle sera comme nous dirions, laïque : « Tant que nous laisserons subsister une souveraineté méta physique avec quelques passages de l’Écriture, des serments, des décrets : brides à veaux que tout cela ! Elles furent et seront utiles et nécessaires tan t qu’il y aura plus de la moitié des bêtes à cornes dans le troupeau humain ; et que tout ce qui s’en dispense et préserve par privilège de cléricalisme et autres, ne songe qu’à en augmenter le nombre et l’étendue pour mieux lier et garrotter le vulgaire cornard. Le fait, ou le mal pour mieux dire, est que cette influence céleste, portant pleine puissance, réside ensuite sur une ou plusieurs têtes humaines, s’attribue le droit de pendre, de bannir, etc. et surtout de prendre l’argent, au nom et sous le prétexte du bien public (5). » Repoussant tout droit divin et tout < cléricalisme », Mirabeau ne manque pas de spécifier que 1· souverain idéal, représentant la raison, et chef d’un peuple instruit dans le culte de la raison, doit s’appliquer, ne fût-ce que par prudence,12345 (1) (2) (3) (4) (5)
7\, A d m . Proo., X, 5, p. 587, et X, β, p. 590. Ibid., p. 197-198. L. T Ordre social, Discours 6, p. 258-259. Cf. ci-dessus, 2e cahier, p. 1. M . à Longo, 24 octobre 1780, Mss. A i x , XVI, p. 193-194.
L.
P O L IT IQ U E
ET
PH IL O SO PH IE
DES
PH Y SIO C R A TE S
315
à respecter hautement la religion établie. « Laissez parler ceux qui disent que le grand-duc Léopold de Toscane donne dans la dévotion minutieuse. Le prince qui a la bonté de dire que son premier missionnaire fut VAmi des Hommes, et qui, en recevant les Devoirs, déclara qu’il le porterait à la campagne — car ce livre-là n ’était pas pour être lu en courant — peut bien avoir deviné par lui-même que quiconque veut, à bon escient, secouer le joug des prêtres, doit arborer celui de la religion (1). » Comment un monarque aussi sérieux que l’empereur Joseph II pourrait-il négliger aussi élémentaire précaution ? « Il est si aisé à une grande âme d’être religieuse, et si nécessaire à qui veut s’en faire accroire de séparer la religion de la cohorte des prêtres, qu’il n’appartient qu’à un éventé, dès qu’on est sur le grand théâtre du monde, de leur prêter le flanc faute de ce soin (2). » Et l’auteur des Devoirs d’y insister, lorsqu’il trace le tableau des fausses constitutions. « Depuis, mon cocher... en passant par mon cuisinier... jusqu’à mon curé, mon coad juteur... mon capitaine ou mon couronné enfin, je ne vois que des êtres dont le vœu naturel et l’ambition continue aboutit à vouloir recueillir sans avoir semé. C’est ce vœu qui fait la tyrannie, et il ne tient qu’à la fortune de faire éclore un petit tyran recélé dans le ventre de chacun de nous, et qui deviendra grand à sa propice. Un des plus sûrs moyens d’arriver à ce point, c’est de se faire monarque à l’antique, revêtu du pouvoir de tout prendre et de tout donner, sous le prétexte et au nom deo ignoto, du dieu inconnu de la terre. L’habile fut celui qui sut intéresser le corps ecclésiastique, et surtout en faire un, lui donner de l’ensemble, et composer avec ce corps maître et usurpateur d’un des plus gros et productifs domaines de l’opinion — composer, dis-je, et en faire son feudataire, à telles ou telles conditions, spongieuses quant au fond, radieuses quant à la forme, au moyen desquelles celui-ci s’écrie : Venez et vous prosternez ; celui-ci est Voint du Seigneur !... (3). » « Ensuite composer avec les lettrés de la plèbe, et leur dire : rassemblez-vous en juges, et soyez les dépositaires des lois et des usages, et je vous notifierai mes volontés, et vous soumettrai les têtes des grands pavots de mon jardin ; et 123 (1) M. à Longo, 7 décembre 1781, Mss. A ix, XVI, p. 231. (2) M. à Longo, 26 décembre 1781, ibid.%p. 235. (3) M. à Longo, 24 octobre 1780, Mm. A ix , XVI, p. 194.
316
LA P H Y S IO C R A T IE SOUS LE M I N I S T E R E D E N ECKER
les petits vous craindront parce que vous serez noirs, et les grands parce que vous serez comme une ruche, et ni plus ni moins vous ferez pendre et tout sera bien, et vous me ferez souverain de droit, autant que cela ajoute au fait, qui est une apparence. Je. vous décris ici les vrais arcs-boutants de la constitution la plus réelle qui soit en Europe. » « Mais de tout cela, qu’en résulte-t-il ? Que la société est en l’air, sur de frêles appuis, et fort exposée aux orages. Pour un bon prince, souvent bridé par les usages et entraîné malgré lui par la routine, on a dix maîtres atrabilaires ou faibles, ce qui souvent revient au même, sans compter les fols ; et le cahotement civil excite les pauvres sujets et use les ressorts et l’équipage, jusqu’à ce qu’enfin la voiture se brise, vole en éclats ou tombe en lambeaux... î » La vraie constitution, la voici : 13, p. 345.
324
LA P H Y S I OCR ATI E SOUS LF. M I N I S T È R E D E NECKFH
tête, lorsqu'il aura créé ainsi une propriété de 300 livres de revenu ; et le fermier qui Taura fait à ses frais, acquerra aussi, personnellement, une tête. Quant aux propriétaires-cultiva teurs, celui qui fera valoir dans la culture des grains (les autres n'ont pas besoin de cet encouragement) un héritage de 600 livres aura double voix en vertu des deux qualités qu il réunit. En revanche, dans les cantons où il se trouve des fermiers et des métayers, peut-être serait-il à propos d’admettre une distinction entre eux, et même entre les propriétaires des héritages de ces deux manières, en ne donnant qu'un demidroit aux métayers et à leurs propriétaires... Il est à désirer, en effet, que le nombre des métayers diminue pour augmenter celui des fermiers ; et cela arrivera en raison de l’aisance des campagnards. — Les dîmes inféodées, champarts, droits seigneuriaux, ne payant pas l'impôt lorsque ce sont des exempts qui les perçoivent, ne donneront pas voix ; mais ou déchargera d'autant ceux qui les paient. Enfin les fermiers généraux n'auront de voix que pour les parties de terres qu’ils cultiveront eux-mêmes : les voix appartenant pour le reste aux fermiers particuliers. Ces gens font d'ordinaire la ruine des campagnes : ils se font payer durement, ils expulsent les bons fermiers pour tirer davantage, ils rendent les terres épui sées. Les pots-de-vin qu’ils tirent enlèvent des avances à la culture et tendent à frauder l'impôt. S'ils sont chargés des répa rations, ils les négligent, et ne font aucune amélioration. Ils ne peuvent à aucuns égards être regardés comme cultivateurs, mais comme receveurs à leurs risques et profits (1) ». Ainsi ce seront bien « les deux classes productives, qui composeront principalement la nation dans un État agricole ; quel est, en effet, le véritable intérêt national, si ce n’est le leur ? Les nations doivent se regarder respectivement comme vendant et comme achetant. En ta n t qu'elles vendent, c’est l'intérêt des deux premières classes qu’il faut consulter, parce qu'il renferme celui de la troisième. En tan t qu'elles achètent, il n'y a plus de distinction à faire entre les trois classes qui partagent la société ; l’intérêt commun est d'être servi dans l’état d'immunité et de concurrence... » (2). La nation physiocratique sera constituée essentiellement par une aristocratie et une grande bourgeoisie rurale : « Qui la dirigera ? Plus tard, ce pourra être la somme du revenu qui décidera des places,12 (1) Ibid., p. 346-347. Cf. p. 417 et V II, 13. (2) Ordre social, Discours 10, p. 405-407.
P O L I T IQ U E E'T P H I L O S O P H I E DE S P H Y S IO C R A T E S
325
car on aura désormais un grand choix entre les entreprises, et l’on pourra aisément trouver des mérites ; « lors du premier établissement, ce choix sera plus difficile : on pourra ne pas faire la même attention au revenu, quoiqu’il soit indispensable de choisir pour des places gratuites des gens qui aient un bien honnête pour s’y soutenir » (1). Ce régime censitaire agraire atteindra alors son point de perfection : la participation aux Assemblées sera « un service public ; bien qu’absolument gratuit, on s’empressera de le remplir avec zèle lorsqu’on aura soin d’y attacher la considération pour récompense » (2). « Le devoir imminent de chacun de ces notables est de s’inspi rer de l’ordre naturel pour être en état de voter selon ses lois si la société le consulte ou si le souverain l’emploie, et d’agir dans tous les cas dans sa propre sphère qui est une portion de l’État, conformément à ces mêmes lois (3). » Lorsqu’il se réu nira en Conseil National extraordinaire, ses membres seront entourés de grands honneurs, mais ne toucheront qu’une simple indemnité de déplacement (4). Autrement un notable ne doit pas se faire coutisan : « Les grands propriétaires qui voudront avoir part à l’administration seront obligés de quitter le séjour de Paris : ... lorsque presque toute autre voie d’acquérir de l’autorité sera fermée, on cherchera bien à entrer dans celle-là (5). » Les grandes charges proprement dites seront mises au concours et seront seules rémunérées (6). Bien entendu dans l’Ordre Nouveau, 1’ « Ordre Propriétaire », ni le clergé ni là noblesse n’entreront à raison de la qualité, mais uniquement au titre de la propriété ; et rien n’obligera de prendre dans ces deux « ordres » anciens une proportion déterminée de membres ; les Assemblées provinciales ne devront pas ressembler aux États Provinciaux (7). Par l’Arrêt du 12 juillet 1778, Necker donne une satisfac tion partielle et toute relative au vœu de plus en plus nette ment formulé des Physiocrates. « Il est formé dans la province de Berri une Assemblée composée du Sieur Archevêque de Bourges et de 11 membres de l’ordre du clergé, de 12 gentils hommes propriétaires, et de 24 membres du Tiers-État, (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Adm . Prov., V, 4, p. 329. /Md., V, l, p. 316. M., Devoirs, p. 173-175. Cf. Adm. Prov., V, 12, p. 342. Ibid., p. 341. Ordre social, Discours 7, note, p. 292. Adm. Prov., V, 4. p. 330.
326
LA P H Y S I O C R A T I E SOUS L E M I N I S T È R E D E NBCKER
dont 12 députés des villes et 12 propriétaires habitants des campagnes... Une assemblée préliminaire de 16 propriétaires, convoquée en vertu des ordres de S. M., en indiquera 32 autres (1). » Sans doute la pratique combinée de la nomi nation royale et de la cooptation venait contrecarrer ici le principe de l'élection ; sans doute aussi les villes y possédaient une représentation égale à celle des campagnes ; mais aupara vant, dans les États généraux ou Provinciaux, la seconde était à peu près inexistante ; sans doute la distinction des 3 Ordres était maintenue, mais la qualité de propriétaire était stricte ment exigée d’au moins la moitié des membres. Pour la dési gnation des députés de la noblesse en effet, « nul ne sera éligible s’il n’est propriétaire dans la généralité d’un fief titré ou don nant droit à justice, et produisant 3.000 à 4.000 livres de rente... Le gentilhomme sans seigneurie qualifiée doit convenir qu’il a moins d ’intérêts que d’autres dans les objets confiés à l'administration provinciale » (2). Les ecclésiastiques resteront dispensés de cette condition d ’ordre terrien (3). Par contre, les représentants des villes devaient très souvent, en fait, posséder des biens fonciers, sinon ruraux, puisque l’abbé de Véri pouvait déclarer dans son rapport sur les impositions (20 novembre 1778) : « Vous êtes tous propriétaires, Messieurs, puisque c'est le titre qui vous attire ici (4). » — D’autre part le tiers-état rural serait bien effectivement représenté, puisque chacun des 24 collèges électoraux institués dans les 24 arron dissements de la province comprenait & côté du maire et des échevins du chef-lieu, 6 représentants des campagnes, députés par les paroisses réunies de 4 en 4, ou de 5 en 5 (en la personne de leurs syndics respectifs). « Vous apercevez sans doute qu’en suivant cette marche, plus les villes ont d’intérêts dans les élections, plus elles y ont d’influence : la ville de Bourges, ayant 1 maire et 4 échevins aura 5 voix contre les 6 dont jouiront les ruraux, tandis que la ville de Sancoins, beaucoup moins considérable, ne balancera que par 2 échevins les 6 dépu tés des collectes ou paroisses. L ’équilibre se trouvera ainsi assuré de lui-même, et les villes auront d ’autant moins à s’en plaindre que les députés des paroisses, devant être des citoyens1234 (1) Isambert, t. 25, p. 354' e t 356. (2) Rapport de l'abbé de Séguiron au nom du Bureau du Réglement, 17 novembre 1778. P . V., p. 17-19. Cf. Karelev, Question paysanne, p. 113 et p. 342, et Lavergne, Assemblées provinciales, p. 19. (3) Ibid,, p. 21. (4) Ibid., p. 77.
P O L I T IQ U E ET P H I L O S O P H I E DE S PHYSIOCRA TES
327
honnêtement nés, seront bien plus souvent pris dans leur sein que dans nos campagnes malheureusement trop abandon nées (1). N’empêche que « le ministre constituait, par le fait, un Ordre des campagnes qui n’avait été jusque-là représenté à peu près nulle part » (2). Turgot avait sommairement condamné la création de son rival : « Cela ressemble, avait-il aussitôt écrit à son ami Dupont, à mes idées sur les munici palités comme un moulin à vent ressemble à la lune (3). » L’École, tout en regrettant que le titre de propriétaire terrien ne fut pas plus formellement et plus universellement exigé, et surtout que les terres ne fussent pas représentées en propor tion exacte de leur importance, avait plus d’une raison d’accueillir avec quelque faveur ce premier résultat. La seconde Assemblée créée par Arrêt du 11 juiHet 1779 dans la généralité de Montauban allait se rapprocher un peu plus des projets vraiment physiocratiques. L’assemblée préli minaire comprenait, cette fois encore, 16 propriétaires, désignés par le gouvernement, dont la moitié appartenait au Tiers, contre 5 à la noblesse et 3 seulement au clergé. L’Assemblée définitive et complète, grossie de 36 membres choisis par la précédente, comptait 10 membres du clergé, 16 gentilshommes propriétaires, et 26 membres du Tiers tant députés des villes que propriétaires habitants des campagnes. Aucune condition n’était fixée pour le choix des ecclésiastiques ; mais les gentils hommes propriétaires devaient « payer, pour leur justice ou fief, au moins 100 livres d’impositions royales, et les proprié taires représentant les villes y posséder une propriété ou y payer au moins 100 livres de capitation ; les propriétaires représentant les campagnes posséder un bien rural payant au moins 200 livres et y résider habituellement » (4). Mirabeau était encore bien loin de se déclarer satisfait : « Nos modernes assemblées provinciales, ou municipales (je ne sais comment on les appellera), ne vaudront rien encore ; car rien n’est mûr ; on tient à toutes les bêtises, et le clergé et la noblesse et les privilèges ; il faudrait qu’elles fussent rurales et rien de plus ; assemblées de propriétaires élues par les cantons ; ils n’en1234 (1) Ibid., p. 13-15 et p. 42. (2) Lavergne, op. cil., p. 23 et p. 37-38. La nouvelle constitution de la Suède formait une exception que les Physiocrates avaient saluée avec sympathie. (3) Lettres du 28 juillet 1778. Citée par Gomel, p. 417. (4) Projet de règlement général Assemblée Haute-Guyenne, Préambule, art. 9 et 10, P . Verb., t. I, p. 115-118.
328
LA P H Y S I O C R A T I E SOUS LE M I N I S T È R E
DE NECKER
veulent pas. Mais toujours, avouait-il, cela mettra-t-il quelque frein et quelque ordre à la billebaude de l’arbitraire et épargnera au peuple les frais et les extorsions de la levée, qui équivalent au fonds de l’impôt (1). » Continuent d’être exclues du corps de la nation physiocratique, et par conséquent privées de toute représentation qualifiée, les diverses classes industrielles. La plupart des ouvriers « sont des pensionnaires que l’étranger entretient chez nous, et qu’il peut laisser manquer au premier moment, auquel cas ils forment une population onéreuse » (2). La classe des artisans, « par la nature de son travail et l’emploi de ses capitaux, ne tient point au territoire qu’elle habite, et n’a pour patrimoine que les salaires, qui pour la très grande partie lui sont payés par la nation même » (3). Les propriétaires manufacturiers « sont dans ta nation, mais non pas proprement de la nation... ; ils peuvent transporter ailleurs leur industrie et leurs capitaux ; et ils ne sont pas véritablement contri buables... Ils savent en toutes circonstances soustraire leurs richesses à l’impôt et ne font jamais que. prêter leur argent » (4). On doit seulement, tap t qu’il subsistera un impôt personnel, leur « donner droit dé députer deux d’entre eux à l’Assemblée provinciale pour assister à la répar tition » (5). « Les agents du commerce extérieur, quels qu’ils soient, forment une classe particulière répandue au milieu des nations qui, par la nature même de sa profession et l’emploi de ses richesses, est cosmopolite... Leur fortune n’a ni patrie, ni domi cile, elle est dispersée de toute part, elle circule partout... Comment donc la soumettre à l’impôt, et sur quelle base la faire contribuer ?... Dira-t-on que les agents régnicoles peu vent intéresser une nation en ta n t qu’ils prêteront dans l’occasion ? Mais l'étranger en aurait fait autant, et d’ailleurs une nation bien gouvernée ne doit jamais employer cette ressource... Quant à la consommation personnelle de l’agent régnicole, cet avantage, nul d’abord en lui-même par son peu d’importance, le devient absolument dans l’état de pleine liberté du commerce, parce que la nation qui en jouit n’a pas à s’inquiéter par qui se consomment ses productions ; elle est12345 (1) (2) (3) (4) (5)
Lettre à Longo, 3 novembre 1779. Citée par Loménie, t. II, p. 129. JL. Γ., Intérêt social, p. 953. Ibid., p. 952. Ordre social, Discours 10, p. 405. Adm. Prov., V, 4 ; p. 347.
P O L IT IQ U E
ET
P H IL O SO PH IE
DES
PHY SIO CRA TES
329
assurée, non seulement du débit, mais du bon prix (1). »Toutaii plus quelques marchands vraiment nationaux, ou régionaux, « auxquels leur état ou leur propriété ne donne point de voix dans les Assemblées, pourront-ils par leurs générosités y obte nir quelques-unes des voix accordées aux actions de bien faisance » (2). « Des cités ayant usurpé la domination de leur banlieue, faisant des lois de ville, des guerres et des traités de villes, et surtout des écrits que leur agrément et leur politesse ont conservés jusqu’à nous, civilisèrent de petites sociétés passa gères, dont les annales nous ont persuadés que les villes pou vaient gouverner les campagnes et les maintenir en un corps qu’on appelle VÉlat. C’est une erreur fatale. L’esprit de ville et de cité a finalement détruit toutes les sociétés par l’oisiveté, la corruption qui en est la suite, la paresse et la rapine qui en sont l’aliment... Vous verrez pourquoi et comment les villes, et surtout les grandes villes, presque toutes de facture et de prédilection humaines, sont en général la ruine des campagnes... alors que dans leur état naturel elles ne devraient être qu’avances foncières de leur banlieue... (3). » Or, dans l’ensemble du royaume, elles en sont venues à constituer le tiers ou le quart de la population totale (4) ; et « tout Paris se déchaînera contre la réforme fiscale... parce que là sont concen trés tous les gens intéressés à la perpétuité du désordre, et qui tiennent de lui leur fortune et leur existence » (5). Mais « la capitale cessera d’attirer toutes les affaires et toutes les richesses » (6)·; déjà, dans le Grand-Duché de Toscane, « les communautés agricoles ont été soustraites à l’inspection et à l’administration des villes, qui les tenaient dans l'asser vissement » (7). Voilà donc définitivement constituée la société agricole selon le vœu des Physiocrates : mais, plus franchement qu’ils n’avaient jamais fait, il^adm ettent l’existence, ils proclament presque la nécessité de Sociétés d’un autre type, qui seront par rapport à la leur ce que sont à la classe propriétaire les (1) (2) (3) (4) 2.500 (5) EJ (6) (7)
Intérêt social, p. 973-975. Adm. Prov., V, 4 ; p. 349. Cf. M ., Devoirs, p. 51 et 79. M ., Devoirs, p. 51 et 79. Cf. Moheau, I, p. 99. Il s’agit des agglomérations supérieures à habitants. Adm. Prov., I, 16, p. 77. Ibid., V, 11, p. 341. Ordre social, Discours 10, p. 443.
330
LA P H Y S I O C R A T I E
SOUS
LE
M IN IST È R E
D E N ECKER
autres classes sociales, t Autour d’elle se formeront des sociétés commerçantes ou trafiquantes ; des sociétés-pâtres, qui tirent des montagnes des bestiaux, des laitages préparés, des hommes même, qui viennent offrir leurs services les uns noblement et loyalement, d’autres pauvrement et parcimonieusement ; des sociétés agioteuses, qui font la banque et les spéculations d’argent et de profit, etc. (1). Telle « la République de M. Necker, dont il aurait pu être l’excellent ministre des finances. Les individus n’y forment qu’une famille dont une Banque peut établir la fortune. N’ayant point de domaines, elle n'a point de propriétés ; combien son administration doit différer de celle d’un royaume immense qui a plus de millions d’habi tants que Genève n’en a de milliers, et dont les propriétés sont la base et la richesse essentielle ! » (2). a S’il s’élève à la fois plusieurs sociétés agricoles, ces nations seront, chacune dans sa sphère, comme autant de soleils qui donneront le jour et la vie aux planètes environnantes, aux petites sociétés serviles qui se formeront à côté de leur abondance », comme autant de satellites (3). Non pas, encore une fois, que l’É tat agricole s’adonne exclusivement à l’agriculture. « Il entretient dans son propre sein toute l’industrie nécessaire : les fabricants, les artisans, et tout l’attirail des travaux de main-d’œuvre toujours rappro chés naturellement des moyens de vendre des services ; elle les entretiendra, non seulement sans s’épuiser, mais en forti fiant son agriculture de toute la consommation de ses servi teurs par l’effet du retour constant et prochain de ses dépenses à leur source » (4) ; l’économie physiocratique comporte une grande part d’autarcie nationale. Quant au commerce exté rieur, il sera limité de préférence aux pays voisins et d’un genre particulier : il consistera « à nourrir en surplus et leurs marchands et leurs fabricants et leurs voituriers, et leurs pâtres, et l’active cupidité de leurs banquiers. L’État agri cole n’achètera que des services et ne vendra que des denrées. Voilà mon mot » (5).12345 (1) Λ#., Devoir*, p. 116. (2) Sar ΓAdm inistration de M . N . par un Gitogen français, p. 33. Cf. Recueil comptai, édition 1782, t. 1. (3) Devoir», p. 120. (4) Devoirs, p. 120. (5) Ibid., p. 117. Cf. Le Trosne, Intérêt social, p. 967 et Bandeau, Introd. Ph. Écon., p. 738-739 et M . lui-même, ci-deesus, mes p. 12.
PO L ITIQ U E
ET PH IL O SO PH IE
DES
PH Y SIO CRA TES
331
III. — Philosophie des Physiocrates La philosophie morale des Physiocrates conserve une très légère teinte de religiosité : Mirabeau ne manque presque jamais d’associer la volonté de Dieu à celle de la Nature (1). « La nature, c’est-à-dire Dieu, car la nature est un mot vide de sens », écrit quelque part Le Trosne (2) ; mais consultons les épigraphes des divers chapitres de son Ordre Social; ces citations empruntées à Cicéron ne parlent que de la nature : Naturä constitutum jus. — Lex est naturae vis, justo rum et injustorum distinctio, ad illam antiquissimam et rerum omnium principem expressa naturam. » Leur politique semble rait aussi subir quelque peu l’influence du moralisme ambiant : « Un des devoirs des propriétaires étant de concourir à l’Admi nistration, ce travail doit être gratuit de leur part, et les mem bres des tribunaux dans les provinces n’en doivent tirer aucun émolument direct ni indirect. Ils ne doivent avoir d’autre récompense que la considération et l’honneur de servir la Patrie (3). » « Tout service public doit et peut se faire gratuite ment, lorsqu’on voudra conduire les hommes par les mobiles qu’on trouve en eux (4). » Mais le « physicisme » et l’utilitarisme constituent toujours le fond de leur morale. « Lorsque celle-ci n’est pas dérivée de l’ordre physique qui donne l'existence et la vie aux humains, et qui assure leurs droits et devoirs réciproques et communs, ce ne sont plus que des notions vagues de justice et de vertu que chacun interprète arbitrairement suivant son intérêt particulier exclusif ; ce qui forme la désunion sociale et la dépravation des mœurs publiques (5). » « Les philosophes ont donc pris une manière d’enseigner qui ne pouvait être suivie d’aucun succès. Il ne s’agit pas de faire des hommes une secte de contemplatifs, ni de les diriger par le sentiment abstrait de la difformité du vice, par le discernement de l’honnête ; mais de faire des citoyens utiles à eux-mêmes et à la société, de les laisser s’occuper de leur intérêt, et de leur apprendre comment ils doivent le faire sans blesser celui d’autrui... Le sentiment que nous avons de la justice a donc12345 (1) (2) (3) (4) (5)
M., Devoirs, Disc, p r é l i m p. 121. L. T ., Ordre social, p. 97, note. L. T., Adm. Prov., IV, 12, p. 342. Ordre social, Discours 5, note, p. 235. Butré, Lois naturelles, p. 41-42.
33~
LA P H Y S I O C R A T I E S O U S
LE M I N I S T E R E
DE N E C K E R
besoin d ’être guidé et dirigé par une théorie plus à la portée du commun des hommes, à laquelle leur intérêt sensible se trouve attaché, et qui, une fois généralement établie par l’instruction, ne lui permette plus de s’égarer dans la fausse route de l’opi nion (1). » Recte Socrates execrari eum solebat qui primus utilitatem a natura sejunxisset. « On a dit : Qui trouve le moyen de rendre les hommes plus honnêtes aura vraisembla blement celui de les rendre moins malheureux. On pourra renverser cette sentence et dire que le moyen de les rendre plus honnêtes, ce serait de les rendre plus heureux. » a Indé pendamment de toute société, le devoir naturel de l’homme est de vivre et d’être heureux.... Notre morale doit être toute économique (2). » Sans que soit effacée pourtant la marque originelle d’un lointain cartésianisme : Lex anlem est ratio summa, insita in natura. Le souverain ne doit faire que des « lois générales », à la manière des « volontés générales » du Dieu de Malebranche (3). E t l’Instruction a quelque chose d’un minisètre tout puissant et sacré : « Quel meurtre de la refuser à l’homme ! Quel sceau mis de la main de l’Éternel à l’obliga tion de l’instruire : seul moyen de le rendre instructeur luimême par l’exemple, seule manière de le gouverner (4) ! » Considérant la philosophie de l’histoire, Court de Gébelin confirme l’accord de ses recherches érudites avec les concep tions physiocratiques. « On verra dans le Monde primitif que les Empires commencèrent à décliner lorsqu’ils fondirent les campagnes dans les villes, et les villes dans une capitale vaste et immense, gouffre des richesses de l’É tat et tombeau des générations... Ici nous avons eu l’avantage d’être aidés par une philosophie pleine de sens et de raison, que nous avons rencontrée heureusement sur notre chemin, tandis que nous cherchions les causes de ces phénomènes en apparence si bizarres que nous présentait l’Antiquité historique... Nous trouvâmes sur nos pas des chercheurs de vérité, des hérauts de l’Ordre, qui faisaient pour les Sociétés, pour les Empires, ce que nous faisions pour les langues, ce que nous cherchions pour les peuples, qui remontaient aux causes de la prospérité et de la décadence des nations (5). » S’inspirant de l’intendant Poivre, Butré continue de représenter la société chinoise12345 (1) (2) (3) (4) (5)
L. 7\, Ordre social, Discours 3, p. 81-83. Mirabeau, Devoirs, p. 12, 40 et 49. Ordre social, Discours 5, p. 233. M., Devoirs, Disc, préliminaire, p. 27. Monde primitif, t. V III, 1781. Vue générale, p.
lx-lxil
PO L ITIQ U E
et
p h il o s o p h ie
DES
PIIV SIO CH A TRS
333
comme un inaltérable modèle. « La propriété foncière y est pleinement établie ; chacun peut posséder des terres, les acheter, les vendre, sans autres droits que les libres conven tions faites entre les contractants. Celui qui vend reçoit tout le prix de sa terre, l’acheteur ne paie que ce qu’il donne au vendeur. Nuis droits féodaux, domaniaux, fiscaux, pêche, chasse, etc. ; les propriétaires y jouissent entièrement de toute seigneurie ; aucune distinction à cet égard. La jouis sance y est également indépendante : liberté de cultiver, de planter, d’arracher, de récolter et de vendre en tout temps sans autre devoir que les lois physiques de l’ordre reproductif annuel (1). » E t cet Empire de la Propriété et de l’Agriculture est aussi l’Empire de la Paix : Rois, brisez, étouffez les foudres de la guerre, Et, protecteurs d’un art bienfaiteur de la terre, Imitez de Cathay les sages potentats : Voici venir les jours où leurs vastes États Résonnent de leur nom béni dans les campagnes (2). En apologiste rigoureux. Mirabeau révise la liste des véri tables précurseurs de l’École. «Sully, avec sa tête rurale, avait naturellement les bons principes, mais il n’entendait rien aux conséquences, et quand son maître, plein de génie, le pressait pour savoir pourquoi il repoussait le luxe, il, tombe dans des moralités qui font trépigner, et le firent renvoyer se battre en bataille rangée avec les mijaurées de Paris... Vauban, le digne homme, faute d’avoir idée du produit net, confond tout, et en vient à vouloir imposer les grandes perruques... Fénelon n’est que moralité vivante ; s’agit-il de saine politique, tout est démence en l’air... Boisguilbert vient après, l’homme le plus maltraité, le moins connu, et cependant le plus digne de l’être... ; il a tout dit, tout conclu avec une logique supérieure et unique, surtout le terrain étant tout neuf... il marche à pas de géant, il avance, il arrive... le produit net seul lui manque, et c’est le rémora absolu ; la plus forte tête n’est plus que le bonnet de Midas. L’abbé de Saint-Pierre, bafoué de son temps pour sa simplicité trop grande, mais on en pille bien des idées (3). » Quant à Gournay, « il avait relancé la liberté du commerce ; mais on le croyait purement marchand » (4) ;1234 (1) (2) (3) (4)
Lois naturelles, p. 135-136 et p. 143 et 157. Boucher, Les Mow, Chant I, t. I, p. 20. Ai. à Longo, 22 mars 1780, Mss. Aix , XVI, p. 178. M. au Bailli, 19 décembre 1786, ibid., X VIII, p. 101.
334
LA
PH Y SIO C R ATI E
SOUS
LE
M IN IS T È R E
DE
N ECKER
et au marquis d’Argenson, on fait simplement l’honneur d’entrer, avec Turgot et Malesherbes, dans un « triumvirat de ces hommes qui ont le cœur adroit et l’esprit gauche » (1). Parmi les hommes à illustrer il faudrait ensuite reprendre Bodin, Grotius, PufTendorf, Hobbes, etc., pour en faire la critique honoriqfiue; et puis leurs rebouteux, les Melon, les Dutot, les Forbonnais, etc., et fermer la marche par le Contrai social (2). Le marquis retient seulement Montesquieu, envers qui il se montre plutôt sévère : « Partant sans base réelle, allant toujours, il était tombé dans le pyrrhonnisme politique ; on le voit clairement, et ses partialités et ses solu tions Anales font pitié (3). « L'Esprit des Lois n’est ni le livre d’un sage, ni un ouvrage méprisable... un homme d’esprit n’est point un sage, quoiqu’il faille avoir beaucoup fait usage de son esprit pour être éclairé. J ’ai repris ses Considérations ; j ’ai lu cela et relu... 6 pages par jour, ne lieant jamais que du temps où l’on me peigne ; et j ’ai trouvé que c’était là un tout autre ouvrage... Il y a de la prise, de la suite, de la justesse, et même de l’étendue ; il m ’engage à jouter avec cet homme ; vous pensez bien que j ’e n’ai pas la prétention de me croire plus d’esprit, mais je suis plus habile en ce genre : 1° parce que je pars d’après des principes qui éclairent et résument tout; 2° il avait des prétentions à la célébrité, peut-être à être employé, il aimait le monde, les louanges, il avait l’esprit gascon enfin ; je n’ai cherché, moi, que la vérité et futile, c’est mon attrait, c’est mon instinct (4). » « Ses immenses lectures, loin de l’enrichir, l’ont gêné, en le resserrant dans le cercle des législations humaines, la plupart fortuites, d’autres forcées par les circonstances, le plus grand nombre enAn issues de plâtrages suspects et mutilés... Il crut y voir et voulait y trou ver le principe et le lien constitutif des sociétés, et employa le travail le plus opiniâtre et le plus ingénieux à donner de l’ordre et des grâces au plus vaste recueil d’érudition. Sou succès fut général, et le sera. Il éveille les esprits, comme l’aurore éveille les oiseaux, sans les appeler ni les conduire (δ). » Les Physiocrates de la dernière période s’attachent davantage que leurs prédécesseurs immédiats à l’application effective des réformes qu’ils préconisaient pour la France.12345 (1) (2) (3) (4) (5)
Ibid,, 24 avril 1787; ibid., X V III, p. 149. M . à Longo, 8 juillet 1780, Mss. A ix , XV I, p. 191. Ibid., 20 mai 1780. Ai. à Longo, 14 mars 1782, loc. cit., p. 250. M. à Longo, 27 février 1785, Mss. A ix, X V II, p. 177.
P O L I T I C O F, F T
P H IL O S O P H I F
DES
P H Y 8IO C R A T E S
33Γ)
Mirabeau ferait presque grief à Le Trosne de ce souci : « Je crois qu’en ces sortes de matières les écrivains doivent dire tout ce qui est à penser, mais non pas tout ce qui est à faire. » Il conseille de se relâcher d’un excès de dogmatisme, et recommanderait même volontiers un assez large relativisme : « Le papier souffre tout... Mais il est impossible de réduire, dans le fait, à nos principes stricts calcul des avances, prélève ment exact d’icelles, estimation exacte du produit net, etc. Il en est de cela comme de la technique de l’agriculture, variant selon les lieux, les sols, les climate, les années, et la sauvegarde souveraine ne peut aller de cette maniêre-là. Regardez la Théorie de VImpôt et mon Supplément ; dans le pre mier morceau, je paye sur le concours des peuples, dans le deuxième j ’explique que ce sont les propriétaires seulement ; mais je me garde bien de donner des méthodes fixes (1). » « La doctrine est assez écrite et assez répandue. Comptez que le tout demeurera, mais le véritable apôtre, c’est le Grand-Duc [de Toscane], en ce qu’il répond à l’argument banal : cela est bon en théorie, mais la pratique est autre chose. En réalité Le Trosne avait fort soigneusement établi ses calculs relatifs au royaume, et il ne négligeait pas non plus les exemples étrangers contemporains. Parmi les petites puissances européennes, à côté de la Hollande et de la Suède, la Suisse [est-ce l’influence de Jean-Jacques ?] l’intéresse : il célèbre cette culture intensive si riche qui sur les rives vaudoises du lac de Genève triomphe des obstacles de la nature (2). Envers le grand voisin et rival, le Royaume-Uni, l’attitude de l’École est devenue pertinemment plus critique : « La situation de la France est infiniment supérieure. Son territoire est plus que double, sa population trois fois plus grande (24 millions contre 8). La culture est assez généralement bonne dans l’Angleterre proprement dite ; elle est bien moindre en Écosse et en Irlande ; et la France a des provinces aussi riches que les anglaises les plus riches. L’impôt y est aussi mal assis qu’en France, aussi multiplié sous toutes ses formes, aussi destructeur des revenus, aussi contraire à l’exercice de la liberté et de la propriété. La dette nationale y est plus consi dérable... et elle ne peut jamais espérer de la liquider... parce12 (1) A Longo, 3 novembre 1779, Mm. A ixt XVI, p. 164 et à Longo, 11 janvier 1780, Mm. A ix, p. 175. (2) Cf. Butré, Lois naturelles, p. 135-136 et p. 143 et p. 157. « Si la Toscane marche à grande pas vers la liberté chinoise, l’heureuse nation helvétique en approche beaucoup. »
336
IA
PH Y SIO C R A TIE
SOUS
LE
M IN IS T È R E
DE
NECKEft
que sa constitution ne lui permettra pas dans son impôt i réforme qui seule peut mettre une nation en état de libérer (1). » Mais avec cela, Le Trosne. digne adversaire de Condill restait fidèle à la méthode cartésienne : l’évidence qui constil selon lui le fondement de la science économique et qui d servir à « éclairer » l’opinion publique, c’est « un discerneiw clair et distinct des sentiments que nous avons, de toutes perceptions qui en dépendent, et de tous les rapports de perceptions » (2) ; plus profondément que ne l’avait fait au< Économiste, il analyse la notion primordiale de la valeur choses, spécialement des productions agricoles. Élevant la question à un haut degré d’abstraction sei tifique, il définit la valeur « le rapport d’échange qui se troi entre telle chose et telle autre, entre telle mesure d’une prod tion et telle mesure des autres. Le prix est l’expression d·: valeur : il n'est pas distinct dans l’échange, chaque chose réciproquement le prix de la marchandise ; dans la vente prix est en argent ». La valeur « usuelle — la valeur d’usi comme diront les économistes postérieurs — n’est pour ai parler qu’une condition nécessaire, mais non sulfisante, de richesse » ; « la qualité de richesse suppose non seuleim une propriété utile, mais encore la possibilité d'échan^ puisque la valeur n’est autre chose que le rapport d’échange >| « C’est donc la concurrence des consommateurs et des prod teure qui décide souverainement de la valeur. Les circonstan locales cèdent à cette cause générale et sont presque efTac par elle, à moins qu’elles ne soient très étendues... Le pou\ de la concurrence n’empêche pas la vérité du principe qu< valeur dépend de la rareté ou de l’abondance ; mais cet é est relatif, et c’est la concurrence qui la détermine. Chaci de ces causes a donc son effet propre, et agit suivant l’é donné des choses ; et comme cet état est dans une varia' continuelle, la valeur n’est jamais fixée, et ne peut l’êt Voulez-vous la fixer autant qu’il est possible, établissez plus grande liberté du commerce, et ouvrez-lui de toutes pa des communications (4). » « Ce sont (donc) les productions elles-même9 qui sont1234 (1) (2) (3) (4)
L. 7\, Ordre social, Discoure 5, p. 191. Cf. Adm. Prov.} IV, 3, p.S Ordre social, Discours 8, p. 306. L. Γ., Intérêt social, p. 889. Ibid., p. 895. Cf. p. 899 et p. 962.
P O L IT IQ U E
ET
PH IL O SO PH IE
DES
PH Y SIO C R A TE S
337
principe de la valeur ; elles entrent toutes dans la balance des échanges et se font contrepoids les unes avec les autres... Mais si la valeur n’est pas proprement une qualité absolue, elle est encore moins une qualité absolument arbitraire, et qui n’a d’existence que par le jugement personnel des contractants, et par la considération du nécessaire ou du surabondant par rapport à eux (1). » « C’est que toutes les productions d’un même genre ne forment proprement qu’une masse dont le prix se détermine en général et sans égard aux circonstances parti culières... Plus les échanges sont libres et faciles, plus la faci lité des communications est grande, plus on voit le prix s’éga liser au loin (2). » Cette formule du « prix général » annonce déjà les théories d’Adam Smith, de Ricardo, de J. Mille et de Karl Marx suivant laquelle la marchandise doit être « considé rée comme exemplaire du prix moyen de son espèce » (3). Il s’ensuit que l’échange est de sa nature un contrat d’éga lité qui se fait valeur pour valeur égale... tout en étant un moyen de remplir ses besoins et varier ses jouissances... La préférence que chacun donne à la chose qu’il reçoit est bien le motif qui porte à contracter, mais ne touche point à la valeur... D’ailleurs, si chacune des parties reçoit plus qu’elle ne donne, il s’ensuit qu elles traitent avec égalité et qu’il n’y a ni perte ni gain... En effet, dès que la préférence est réciproque, tout est égal dans l’intention comme dans le fait : « chacun est content puisqu’il a ce qu’il avait désiré, et chacun fait un marché égal puisqu’il a acquis moyennement une valeur égale... L ’échange devient désavantageux pour l’une des parties lorsque quelque cause étrangère vient diminuer ou exagérer les prix : alors l’égalité est blessée, mais la lésion pro cède de cette cause et non de l’échange » (4). « L’estime que nous faisons de la chose peut nous décider à acheter ou à ne pas acheter, mais la chose n’en a pas moins sa valeur, parce que nous ne sommes pas les seuls acheteurs et que, si elle ne nous convient pas, elle peut convenir à un autre... Son prix est fixé d’avance par la concurrence qui adopte et exprime le jugement général. La variation fréquente des causes de la valeur pourra demain changer ce résultat ; mais il est tel1234 (1) Ibid., p. 911. Cf. p. 965. (2) Ibid., p. 893-894. (3) Cf. G. W e u l e r s s e , Positions des Mémoires présentés à VÊcole Norm. Sup. pour le Diplôme d*Études, 1897, p. 76. (4) L. T., ibid., p. 904. O . W E U L F .R S S E
22
338
LA
P H Y S lO C R A flE
ÔOÜS
LE
M IN IS T È R E
DE
N EC K Eft
aujourd'hui et forme la loi des prix ou le cours (1). »« Cette vérité est encore plus sensible dans le commerce de spéculation sur la différence des prix d ’un lieu à un autre. Le marchand est assujetti comme tout autre à la loi des prix qui précèdent toujours les achats et les ventes et qui les gouvernent... Tout son art consiste à s’informer des prix qui existent en divers endroits, à les comparer, et à savoir profiter de la diffé rence ; différence à laquelle il n’a contribué en rien et que son opération tend à effacer. En effet s’il en résulte une accrue de valeur dans le lieu de l’achat, il en résultera un abaissement dans le lieu de la revente. La somme des prix reste donc la même ; Tun ne monte, que l’autre ne baisse... Si les causes des prix ont varié dans l’intervalle, le marchand peut se trouver en perte au lieu de gagner (2). » Cette thèse de l’équi valence normale des échanges dans une « société formée # se retrouvera chez la plupart des premiers Économistes classiques et sera reprise par Marx.
C h a p it r e
V
ATTAQUE ET DÉFENSE DU SYSTÈME I. — Le véritable intérêt des propriétaires Les propriétaires terriens et leurs avocats, tout en soute nant, et pour cause, les principes généraux de l’École, pouvaient d’autant plus vivement réclamer contre sa doctrine fiscale, que celle-ci semblait plus près de recevoir une large applica tion. Les seigneurs protestaient contre l’abolition éventuelle des droits féodaux ; mais Le Trosne soutenait que « dans la féodalité » au moyen de la réciprocité des droits et des devoirs, il n’y avait de réel que les frais. Le seul et véritable produit de cette propriété fictive passe aux agents de cette perception, aux commissaires à terrier, aux notaires, aux huissiers, au fermier de l’impôt qui lève des droits sur tous les actes. Pour les [degrés] intermédiaires notamment, le produit net est à peu près nul, il ne présente qu’une compensation de recette et de dépense ; le plus souvent même le résultat de la soustrac tion se réduit à un montant de frais » (1). Le vif du débat portait alors sur le grand projet d’impôt territorial. « En réduisant l’impôt u n iq u e à une légère portion du gain du propriétaire, les Économistes ont autorisé les gouvernements à regarder leurs promesses comme des chimères et leurs raison nements comme des extravagances. Ils ont cependant, avouait Linguet, fait impression sur beaucoup d’observateurs désinté ressés qui adoptent leurs opinions à cet égard, sans partager leur fanatisme sur le reste (2). » « Plusieurs auteurs, déclarait de son côté l’abbé de Véri, prétendent que, quelques expé dients qu’on prenne pour asseoir l’impôt sur les capitalistes en argent ou sur les consommateurs, il retombe infailliblement sur les propriétaires de fonds. En admettant cette hypothèse,12 (1) L. 7\, Adm. Prov., Dissertation Féodalité, p. 640. (2) Annales, t. V III, p. 86, 1780.
340
LA P H Y S I O C R A T I E S OUS LE M I N I 9 T È R E DE NECKER
sur laquelle nous n’entendons pas prononcer, nous n’en persua derons pas le commun des contribuables ; et si. par une cons^ quence de cette opinion, on plaçait tous les impôts sur les fonds on entendrait s'élever une voix générale, qu’on exempte ceu> qui sont le plus en état de le supporter. Ainsi vous devez au> propriétaires la satisfaction de leur faire croire que les capi talistes non-propriétaires supportent leur part (1). » Quelles ne sont pas déjà les difficultés de l’assiette di Vingtième, même dans le cas le plus favorable des terre: affermées ? « Un propriétaire produit des baux fictifs ou répu tés tels par le contrôleur : voilà une dispute ouverte. Un bai à prix d’argent contient souvent des réserves en denrées, er services de voitures et autres objets pareils : nouvelle occasioi de dispute sur l'évaluation. Ces biens-fonds ont des réparation* indispensables à supporter, que la justice exige de prélevei sur le revenu avant d’en exiger le 20e ; mais la quotité varû dans chaque objet : troisième occasion de dispute... Le principi d’incertitude et de décision arbitraire est encore plus marqué sur l’évaluation de plusieurs genres de mobilier, comme bee tiaux et autres, par l’usage que les contrôleurs ont illégalemenl introduit dans quelques cantons de les taxer aux 20e8 ( 2 ) . ) Que dire des propriétés non affermées à prix d’argent ! «Tous les répartiteurs avaient reconnu la difficulté d’en évaluer h prix annuel... Beaucoup pensèrent que la valeur respective des terres devait être fixée d’après le cours commun de ces biens, et non suivant le parti différent que chaque cultivateur savait en tirer (3). » Mode d’estimation que les Physiocrates n ’admettaient pas. Recourra-t-on au cadastre, qu’ils n’acceptaient guère davantage ? « Il serait fort à désirer qu’il en existât un, général et exact, consentait le rapporteur de l’Assemblée de Berri ; mais nous n’osons vous proposer une telle entreprise. [Mieux vaudra] commencer par établir la proportion respective entre les contribuables de chaque paroisse séparément. Lorsque cette proportion de justice distributive sera décidée dans l’intérieur de chaque collecte par l’épreuve de quelques années, vous pourrez prendre facilement connaissance par arrondisse ment de la proportion qu’il y aurait entre la valeur de9 fonds123 (1) Rapport au Bureau des Impositions de Berri, 20 novembre 1778, P . V.t p. 102-103. (2) Ibid., p. 79-80.
(3) Cf. Glrardot, p. 223.
ATTAQUE
ET
DÉFENSE
DU
SYSTÈM E
341
et la quotité de l'impôt dans chaque paroisse, etc. » Méthode que l'Assemblée adopta pour le 20e des biens-fonds le 27 novembre 1778, mais dont la lenteur et la complication répugnaient à l’École (1). Quant au remplacement qu’elle demandait, des aides par l’extension de l’impôt territorial aux vignobles, c’était frapper chaque propriétaire de deux causes de ruine ; perçue chaque année, cette taxe le ruinerait dans les années de stérilité ; répartie sur chaque arpent, elle était injuste, puisqu’elle prélevait la même somme sur des revenus bien différents. Le remède pouvait être pire que le mai, malgré l’offre spontanée de bien des propriétaires de se racheter effectivement de tous ces droits... » L’Assemblée se borna à proposer la mise en régie de ceux-ci : « c’eût été une dureté préjudiciable à l’agriculture d’approfondir les produits obtenus par les cultivateurs les plus industrieux, et d’infliger une peine au travail et au talent » (2). Spéculant sur cet embarras, Linguet s’obstinait à réclamer le retour à un impôt aussi archaïque que la dîme. Il prétend qu’elle n’est pas inégale, qu’elle n’écrase pas les terres pauvres au profit des terres riches. Comment cela ? C’est qu’il n’y a plus aujourd’hui de possession qui n’ait été acquise à prix d’argent, ou du moins qui ne représente une somme quelconque... Une ferme de 100 arpents en Normandie rendra 1.000 écus [bruts] et n’en coûtera pas 500 d’exploitation ; cela est vrai ; mais aussi elle tient lieu au proprétaire d’un capital de 100.000 francs et plus ; un domaine de 600 arpents en Cham pagne rend à peine la même somme en revenu [brut] et en absorbera une double, triple, quadruple, si l’on veut, en frais d’exploitation, je l’avoue ; mais aussi, pour en devenir le maître, on n’a pas déboursé 60.000 francs, peut-être pas 40.000 ; il n’est donc pas injuste de frapper autant les deux proprié taires » ; et quel avantage essentiel qu’une perception en nature, peu coûteuse, et sans arbitraire » ) ! (3) Pourquoi d’ailleurs, poursuit le même critique ingénieux et fertile, écraser le propriétaire en s’abstenant systématique ment de toute taxe sur le revenu propre du fermier ? Qu’est-ce donc, en effet, « je vous prie, que cette seconde mise, ce que vous appelez nouvelle avance... ? Vous l’aviez dans votre coffre, ou vous ne l’aviez pas. Si vous en étiez propriétaire, c’est donc123 (1) P. r ., p. 98-99 et 109. (2) Girardot, p. 240-241 et p. 223. (3) Annales, t. V III, 1780, p. 37.
342
LA PH Y S l O C R A T I E SOUS L E M I N I S T È R E D E NECKER
un fonds de plus ; c’est donc une richesse effective que vous avez employé là, au lieu de la placer ailleurs ; elle doit donc, comme la première, un sacrifice au bien public. Si vous n en jouissez que par emprunt, pourquoi aurait-elle dans von mains un privilège qu’elle n’aurait pas dans celle de prêteur? Pourquoi l’intérêt que vous en tirez serait-il exempt de toute contribution ? » (1). Ici encore l’auteur voulait imposer le produit total, et continuait de prendre le contrepied de tout le système des Économistes ; il en arrive à taxer, non seulement les terrains des villes, mais les revenus de l’industrie et du commerce, suggérant précisément ainsi, après l’impôt sur les bénéfices agricoles, une sorte de patente. Quelle va être la réponse de l’Ecole ? Le Trosne reconnaît que cette opposition des propriétaires à l’impôt territorial unique est la plus sérieuse, avec celle des financiers et des fonctionnaires de finance ; il faut la désarmer. D’abord l’Administration provinciale, qui est la base même d’exécution de la réforme fiscale, ne serait établie que dans les pays d'Élection, où elle aurait le mérite de présenter pour la nation un intérêt nouveau (2). Mais voici une concession bien plus forte, à combler d’aise l’opportunisme tardif ou occasionnel de Mirabeau vieillissant. « Dans l’application de la théorie à la pratique, il faut avoir égard aux circonstances; attendre pour faire un bien particulier, qu’on puisse le faire sans inconvénient ; ne guérir un mal qu’après avoir remédié à la cause, et faire en sorte de procurer l’indemnité d’un change ment avant de l’opérer. Par exemple, quoiqu’il soit démontré dans la théorie que l’impôt ne doit.être établi que sur le produit net des terres, si j ’avais à tracer un nouveau plan d’assiette et de perception, je me garderais bien de proposer d’établir sur-le-champ tout l’impôt sur les propriétaires, avant de leur avoir fait trouver, dans l’accroissement de leur revenu et dans la diminution de leur dépense, les moyens de le payer sans surcharge et même avec un grand avantage. Ce ne serait que successivement et par degrés que je le ramènerais sur sa base. — Je tâcherais de faire voir que cette grande révolution, d’où dépend la prospérité publique et l’aisance de toutes les classes de citoyens, peut s’opérer en peu d’années sans convul-12 (1) Ibid., p. 91. Une déclaration du 9 juin 1779 étendait du moineau Barrois la défense de toute reconduction tacite des baux, prononcée dès 1764 pour les généralités de Soissons, Amiens et Chftlons, (2) Cf. Adm. prou., il, 4, p. 104-107.
A T TAQUE ET D É F E N S E DU S Y S TÈ M E
343
sion et sans secousse (1). » Quel esprit nouveau de modération et de prudence, et quelle diplomatie sociale, à laquelle les Physiocrates ne nous avaient guère habitués ! Pour achever d’apaiser les adversaires, le champion de la réforme ne se borne pas à rappeler qu’on peut remédier à l’abus des contre-lettres faussant l’évaluation des baux agri coles en déclarant celles-ci sans valeur devant la justice en cas de contestation (2). A l’égard des immeubles urbains il maintient, certes, le dogme théorique de leur immunité naturelle : « Le fermier d’un héritage tire du fond même qu’il a pris à bail la somme qu’il s’est engagé de payer au proprié taire, ce n ’est pas de suo qu’il paye, il ne fait que donner une partie convenue des fruits. Tandis que le locataire ne tire pas de la maison le prix du loyer ; cette dépense ne peut être payée que par la terre, le locataire ne la fait qu’autant qu’il a participé à la reproduction ; soit immédiatement comme propriétaire, soit médiatement comme salarié, gagiste ou rentier... D’où il suit que ce revenu, qui est une véritable dépense pour celui qui la paye, ne peut être imposé que par un double emploi. » Mais, dans la pratique, il admet que « c’est là le dernier des impôts