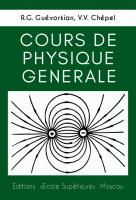Cours III 9782130431435, 2130431437, 9782130463658, 2130463657, 9782130489566, 2130489567
362 57 7MB
French Pages 0 [328] Year 1990
Polecaj historie
Table of contents :
I. Leçons de psychologie et de métaphysique / éd. par Henri Hude avec la collab. de Jean-Louis Dumas. --
2. Leçons d'esthétique à Clermont-Ferrand Leçons de morale, psychologie et métaphysique au lycée Henri-IV. --
3. Leçons d'histoire de la philosophie moderne Théories de l'âme. --
4. Cours de Bergson sur la philosophie grecque.
Citation preview
BERGSON COURS III
Leçons d’histoire de la philosophie moderne Théories de l’âme
h '0àU
1344948 ÉPIMÉTHÉE
puf
■
Ce troisième volume des Cours d’Henri Bergson renferme son enseignement oral sur l’histoire de la philosophie mo derne et contemporaine. Outre quelques leçons datant de l’époque de renseignement à Clermont (1884-1886), et qui ont surtout valeur de témoignage historique, l’essentiel du volume est constitué par trois grands cours dispensés aux « khâgneux » du lycée Henri-IV, en 1893-1895 : — un cours sur l’histoire de la philosophie moderne de Bacon à Leibniz; — un cours sur la Critique de la raison pure; — un cours sur l’histoire des théories de l’âme. Ce dernier cours, fleuron de ce troisième volume, se révèle particulièrement éclairant, parce qu’il est contemporain de la préparation de Matière et mémoire (1896). Il jette sur la genèse et la signification de ce maître livre une clarté sans
égale. Le quatrième volume des Cours rassemblera les principaux enseignements de Bergson en histoire de la philosophie ancienne.
H. H.
/
m
220 FF
22410392/ 3 / 95
1(11111)
LEÇONS D’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE THÉORIES DE L’AME
ÉPIMÉTHÉE ESSAIS PHILOSOPHIQUES
Collection fondée par Jean Hyppolite et dirigée par Jean-Luc Marion
HENRI BERGSON
COURS in LEÇONS D’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE THÉORIES DE L’AME
ÉDITION PAR HENRI HUDE AVEC LA COLLABORATION DE JEAN-LOUIS DUMAS
OUVRAGE PUBLIÉ AVEC LE CONCOURS DU CENTRE NATIONAL DU UVRE
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
ni
2
ISBN 2 13 046365 7 ISSN 0768-0708 Dépôt légal — 1" édition : 1995, mars © Presaes Univeiaitaires de France, 1995 108, boulevard Saint-Germain, 75006 Paria
INTRODUCTION
Les deux premiers volumes de Cours de Bergson ont livré l’essentiel de son enseignement sur les diverses matières philosophiques : psychologie et méta physique, morale et politique. Les deux volumes suivants renfermeront l’essen tiel de son enseignement en histoire de la philosophie. Le quatrième volume sera consacré à la philosophie antique. Quant à ce troisième volume, il traite principalement d’histoire de la philosophie moderne et contemporaine. Les diverses leçons de ce volume III appartiennent à deux périodes de la carrière de Bergson : l’enseignement de classe terminale, comme nous dirions aujourd’hui, au lycée Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand et l’enseignement de khâgne au lycée Henri-IV à Paris. Ils nous permettent de reconstituer la marche de la réflexion de Bergson entre 1885 et 1895. Rappelons que 1 * Essai sur les don nées immédiates de la conscience date de 1889 et Matière et mémoire de 1896. Les leçons de ce volume III se répartissent en quatre ensembles : 1 — Nous donnons d’abord un choix de « Quelques leçons complémen taires de philosophie et d’histoire de la philosophie ». Il s’agit de quatre cours d’histoire de la philosophie, respectivement sur Spinoza, Leibniz, Kant et la philosophie plus contemporaine dans les divers pays européens, ainsi que de deux leçons assez significatives (qui sont peut-être des corrigés de disserta tion), sur Analyse et Synthèse, Espace et Temps. Cet enseignement, professé au lycée Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand, fait partie de l’ensemble dont nous avons déjà donné la plus grande partie dans le volume I des Cours de Bergson. Pour tout ce qui concerne l’histoire et la critique de ces textes, nous nous permettons d’abord de renvoyer à ce que nous avons écrit dans l’intro duction au premier volume des Cours'. Toutefois, il convient de signaler que 1. Bergson, Cours, vol. I : Leçons de psychologie et de métaphysique, édition par Henri Hude et Jean-Louis Dumas, avant-propos par Henri Gouhier, Paris, puf, 1990, p. 16-19.
6
BERGSON - COURS/III
ces leçons complémentaires forment une addition à un ensemble déjà complet par ailleurs et qu’elles sont, elles, et non pas les autres, précédées d’une men tion dactylographiée : Probablement de Bergson. Leur authenticité n’est cependant pas douteuse, tant elles sont pour le fond, la forme et les références en continuité avec le reste. Mais il est probable que la prudence de Désaymart dans l’attribution de ces leçons à Bergson est due au fait qu’il les tenait de quelque source moins directe. Il a pu être renforcé dans sa pru dence par une appréciation lucide sur la qualité quelquefois médiocre de ces leçons. Nous les donnons pourtant, au moins comme un document irrempla çable sur les idées, ou même parfois sur les préjugés de Bergson à cette époque de sa vie : c’est que, de Bergson, tout est intéressant, mais à divers titres ; soit comme document, et c’est plutôt le cas de ce premier ensemble de leçons ; soit comme élément doté d’une forte signification philosophique, comme c’est sur tout le cas pour le troisième ensemble de leçons ici présenté. Pour ce qui est du premier, il s’agit, à notre avis, de leçons plus anciennes, datant sans doute de la première moitié de la présence de Bergson à Clermont, et antérieures de plu sieurs années à l’achèvement de la thèse. La date de 1885-1886 serait peut-être la meilleure. Ce premier ensemble porte conventionnellement ici le nom de Leçons d’histoire de la philosophie à Clermont. 2 — Le deuxième ensemble comprend des « Leçons d’histoire de la philo sophie moderne et contemporaine ». Il comprend l’exposition de Bacon, Des cartes, Spinoza, Malebranche, Locke, Leibniz, Hobbes, Philosophie du xixc siècle (positivisme, birano-cousinisme, psychologie allemande). Bergson y traite ses sujets avec une attention et une considération variables : très attentif et respectueux quand il parle de Descartes et des cartésiens, nettement plus distant quand il parle de Locke, expéditif avec Hobbes et les contempo rains du xixe siècle, sommaire et agressif quand il s’agit d’Auguste Comte. 3 - Le troisième, plus restreint dans son objet, est une explication de la Critique de la raison pure. Aux yeux de Bergson, il y a d’une part un dévelop pement cohérent de la philosophie antique, d’autre part un développement cohérent de la philosophie moderne. Après quoi vient la crise kantienne. C’est alors que la philosophie française relève le gant et rétablit le crédit de la métaphysique, en particulier depuis Biran, mais aussi grâce à la réorganisa tion éclectique, dont Bergson, somme toute, ne dit pas tant de mal que cela. Seule la première Critique fait ici l’objet de l’étude de Bergson. La seconde est étudiée dans les Leçons de morale2. La troisième aussi est connue de Bergson, voir Leçons d’esthétique, op. cit., p. 35-47. Sur les postkantiens, rien, sauf quel ques notations éparses. 2. Bergson, Cours, Paris, vol. II, édition par Henri Hude et Jean-Louis Dumas, Paris, puf, 1992, p. 103-111.
INTRODUCTION
7
Ces deux cours n’ont pas de titre spécial, mais de simples intitulés (His toire de la philosophie, Critique de la raison pure). Nous les nommons ici par convention respectivement : Leçons d'histoire de la philosophie moderne au lycée Henri-IV et Leçons sur la « Critique de la raison pure ». 4 — Ce volume III se clôt avec un quatrième cours aussi profond qu’éclai rant : les leçons sur « Les théories de l’âme ». Ce cours a été professé aux mêmes élèves que les deux précédents, mais constitue en quelque sorte un complément rajouté par le professeur au programme de ses classes. Il porte en première page la date de 1894. Les leçons correspondant aux trois derniers ensembles ont été en effet professées aux élèves de khâgne du lycée Henri-IV autour de 1894. Elles sont extraites des notes de Vacher, conservées à la Bibliothèque de l’Ecole normale supérieure3. Sur leur histoire et leur critique, nous avons déjà dit l’essentiel dans l’Introduction du volume II des Cours auquel nous renvoyons donc le lecteur de ce volume III4. Ce volume III a donc un centre de gravité qui se situe, chronologique ment, en l’année 1894, et, thématiquement, dans l’histoire de la philosophie moderne et contemporaine. Cet ensemble de textes permet au lecteur de se faire une idée précise de l’en seignement de Bergson sur l’histoire de la philosophie moderne et contempo raine. Il lui permet aussi de suivre l’évolution de cet enseignement, en qualité et en doctrine, au long des années qui vont des années précédant YEssai sur les don nées immédiates de la conscience aux années qui précèdent directement la publica tion de Matière et mémoire. On peut mesurer l’enrichissement qualitatif de cette pensée au long de ces années. Matière et mémoire (publié en 1896) fut écrit sans doute pour l’essentiel en 1895. Le cours sur l’histoire des théories de l’âme, en 1894, revêt donc une particulière importance dans l’archéologie de Matière et mémoire. Ce cours sur « Les théories de l’âme » forme un tout cohérent avec les « Trois leçons sur l’espace », le temps et la matière, publié à la fin du second volume. Ce sont là deux textes d’une puissante signification philosophique. Il nous semble impossible de prétendre étudier à fond Matière et mémoire sans en tenir le plus grand compte. Ces cours sur l’âme et sur la matière permettent, à notre avis, de satisfaire pleinement un esprit qui s’interroge sur les rapports existant entre les Œuvres de Bergson et ses Cours. Nous avons donc en face de nous à la fois des documents, des leçons et des textes philosophiques profonds. Les leçons sont toujours vivantes. Par leur sobriété, leur clarté et leur profondeur, elles sont un modèle pour tout professeur, une mine pour les étudiants, et une délectation pour tout esprit 3. Ces notes ont été mises aimablement à notre disposition par son conservateur, M. Petitmangin, que nous remercions ici chaleureusement. 4. H. Bergson, Cours, vol. II, Paris, puf, 1992, p. 7-8.
8
BERGSON - COURS /III
cultivé. En les annotant, nous avons eu le souci de ne sacrifier aucune de ces trois catégories de lecteurs potentiels : 1 / En tant que ce sont des leçons, ordonnées par définition au bien des étudiants, il était dans l’esprit d’une telle publication d’ajouter des indications permettant aux étudiants de mieux tirer parti de cette lecture, même si tel ou tel rappel était superflu au penseur chevronné ou à l’érudit. 2 / En tant que ce sont des documents, il convenait d’éclairer les allusions et les références de Bergson. 3 / En tant que ce sont des productions philosophiques, destinées à être étudiées et interprétées philosophiquement, il a paru convenable d’indiquer certains lieux parallèles dans les Œuvres, et de suggérer, quelquefois, des élé ments historiques ou philosophiques de nature à permettre une interprétation aussi précise que possible de la pensée de Bergson. Ce que faisant, nous avons toujours essayé de garder le milieu entre le trop et le trop peu et, tout en donnant à l’érudition ce qui lui revient, de ne pas sacrifier ce qui pense à ce qui pèse. Henri Hude
I QUELQUES LEÇONS COMPLÉMENTAIRES
DE PHILOSOPHIE ET D’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE A CLERMONT-FERRAND 1884-1885
6 Leçons
.
SPINOZA
[276] Spinoza est né en 1632 à Amsterdam. Il appartenait à une famille juive. Il apprit le latin de bonne heure, et dès qu’il connut la philosophie, il se sentit la vocation philosophique1. Persécuté par les siens, il se réfugia à La Haye ; et là, pauvre, malade, il vécut pour la philosophie seule, refusant l’héritage d’un de ses amis et une chaire de philosophie2 à Heidelberg. Il gagnait sa vie à tailler des verres de lunettes. Il mourut en 1677. Les ouvrages qu’il publia de son vivant sont peu nombreux, le Tractatus theologico politicus et YEthique, le principal de ses ouvrages, où sa doctrine est exposée sous forme géométrique : définitions, théorèmes, corollaires. Pour comprendre la philosophie de Spinoza quelques remarques prélimi naires sont nécessaires sur la méthode géométrique et la nature exacte des objets que la géométrie étudie. Considérons une propriété de la circonférence, par exemple. Il y a plusieurs manières de connaître cette propriété. Il y en a 4 pour Spi noza3 : d’abord, pour en avoir entendu parler4 : c’est la simple croyance. On peut en avoir fait l’expérience sur des figures, c’est une connaissance empirique. On peut l’avoir démontrée, c’est-à-dire l’avoir rattachée à d’autres propriétés de la circonférence ou des autres figures. Mais la dernière manière de connaître est seule parfaite, c’est de se transporter par la pensée au sein de la définition même de la cir conférence et d’y apercevoir par simple intuition la propriété de la cir conférence, le théorème qui en découle et qui n’en est que l’expression
12
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
nouvelle. Car sans doute la définition étant posée on peut en tirer un nombre infini de théorèmes, mais puisque tous s’en déduisent, tous y étaient contenus, et on pourrait tous les y apercevoir, de sorte que cette définition qui est une, simple, indivisible contient en elle une multitude indéfinie de théorèmes, de telle sorte que si on possédait tous ces théorèmes, ce qui est impossible, si on pouvait les embrasser dans une intuition unique, on n’apercevrait pas autre chose que cette définition elle-même une et indivisible5. Ainsi les définitions géométri ques ont ceci de remarquable qu’elles sont unes et infiniment multi ples tout à la fois, unes en tant que pouvant être connues par un effort simple de l’esprit ; infiniment multiples en ce sens [277] qu’infiniment multiples sont les théorèmes qui s’en déduisent et en épuisent le contenu pour ainsi dire. Et la connaissance mathématique, la connais sance parfaite, serait celle qui serait possible à un mathématicien très exercé, parfait, qui se transporterait d’un seul bond à la définition et y apercevrait toutes les conséquences infiniment multiples qui s’en déduisent. Ceci posé, demandons-nous quel rapport ces théorèmes divers de la circonférence soutiennent avec la définition. Quand on parle d’une propriété du cercle, on pourrait dire qu’elle a pour cause une autre propriété du cercle, mais le mot cause est-il pris ici au sens habituel ? Quand nous parlons de causes ordinaires nous faisons allusion à cer taines puissances d’où sortiront certains effets. Ces effets, nous ne les apercevons pas au sein de la cause, nous n’aurions pas pu les prévoir, quelque chose se trouve dans l’effet qui n’était pas dans la cause. Ce n’est pas tout : nous concevions l’effet comme succédant à la cause, la cause étant donnée d’abord, l’effet s’en est suivi. Mais ce n’est pas le sens du mot cause en mathématiques. Dire qu’une propriété du cercle a pour cause une autre propriété, c’est simplement dire que la pre mière était une nouvelle expression de celle-ci ou plutôt que ces deux propriétés sont l’une et l’autre des expressions diverses d’une seule chose, la définition de la circonférence. La causalité se rapproche ici de l’identité6. Ici l’effet n’est plus postérieur à sa cause, car sans doute pour nous autres, esprits imparfaits obligés de considérer les choses en détail, les théorèmes de la circonférence se succèdent, ils prennent
SPINOZA
13
place dans la durée. Mais une intelligence parfaite, comme nous le disions tout à l’heure, les apercevrait tous à la fois au sein de la défini tion même d’où ils sortent. Une fois cette définition posée tous les théorèmes possibles sont posés aussi, en d’autres termes pour employer l’expression de Spinoza, ils sont coéternels à la définition7. Enfin, nous distinguons d’habitude le possible du réel. De ce qu’une chose est possible, de ce qu’elle n’est pas contradictoire avec autre chose, il ne s’ensuit pas qu’elle existe réellement. Il en est autre ment en mathématiques, dès qu’une figure géométrique est possible, dès qu’elle n’implique pas contradiction, elle est réelle, elle existe ou du moins l’objet défini existe, et prend place dans le monde des objets mathématiques. Posez la définition des parallèles, montrez que deux droites de ce genre sont possibles, elles existent mathématiquement, sont réelles. Toutes les conséquences possibles de la définition des parallèles existent, alors même que notre intelligence ne les apercevrait pas toutes. Ainsi le monde mathématique a ceci de remarquable que le possible et le réel ne font qu’un, entre la possibilité et l’existence il n’y a pas de différence8. Ces préliminaires posés, il nous sera plus facile de comprendre le spinozisme, car le système de Spinoza n’est pas autre chose que l’ap plication de ces vues à la connaissance de la totalité des choses. Il est parti de ce double postulat : le nombre des choses est infini ; elles sont en connexion universelle9. Voilà le postulat du système. Ceci posé, nous attarderons-nous à la connaissance d’une chose particulière ? Ce serait puéril, car pour la connaître parfaitement il faudrait se rendre compte des rapports qu’elle entretient avec toutes les autres choses en nombre infini. Ces rapports sont aussi en nombre infini et l’énuméra tion n’en serait jamais terminée. Mais il y a une autre manière de la connaître parfaitement, adéquatement comme dit Spinoza, c’est de se transporter par la pensée au sein du principe un, indivisible, d’où cette conséquence particulière se déduit comme un théorème se déduit d’une définition ; et, au sein de ce principe, le philosophe contemple non pas seulement cette chose particulière mais l’infinité des choses dont le principe n’est que le substitut ou l’équivalent. Ce principe, Spinoza l’appelle substance et il définit ainsi la substance. J’appelle
14
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
substance ce qui existe par soi et n’a pas besoin [278] d’autre chose pour exister10. Cette définition de la substance étant posée on va pro céder à la manière mathématique pour prouver qu’elle est réelle, en démontrant qu’elle est possible. Spinoza se transporte à l’idée d’infini de Dieu et établit que Dieu ne peut exister qu’à la condition de se confondre avec la substance. Car étant infini11, il n’y a rien en dehors de lui et s’il existe il se confond avec la substance ; si la substance existe elle est infinie. Reste à démontrer qu’elle existe. Comment n’existerait-elle pas, puisqu’il n’y a rien en dehors d’elle qui l’empêche d’exister12 ? Spinoza applique le raisonnement du mathématicien que nous signalions tout à l’heure. Il suffit de démontrer la possibilité d’un objet mathématique pour qu’il soit réel. Or l’être infini ne laissant rien en dehors de lui par hypothèse est l’être possible par excellence, et de cette possibilité évidente dans ce cas unique il conclut à la réalité13. Non seulement la substance est infinie, mais elle est une14. Comment Spinoza le démontre-t-il ? Pour comprendre cette démonstration, il faudrait comprendre ce que Spinoza entend par attribut de Dieu. Nous éclaircirons ce point plus loin. Admettons pour le moment qu’il n’y a qu’une substance et qu’elle est infinie. Rappelons-nous le rapport exact qui existe pour le mathématicien entre la définition et les conséquences. Nous disions qu’une fois la défi nition de la circonférence posée, toutes les conséquences possibles de cette définition existaient comme posées du même coup. Or tel est préci sément le rapport que Spinoza va établir entre Dieu et les choses particu lières. Posez la définition et la substance et aussitôt vous posez l’exis tence de toutes les choses particulières qui découlent de son essence ; en d’autres termes les choses ne sont que des expressions infiniment variées15 de Dieu. Peut-on dire en ce sens que les choses aient été créées ? Non. Car étant donné l’énoncé de la substance divine, il était impossible que toutes les conséquences possibles de cette essence n’existassent pas aussitôt. Peut-on dire que cette dérivation des choses par rapport à Dieu ait lieu dans le temps ? Que Dieu, l’être infini, un, indivisible ait existé d’abord ? puis des choses particulières ? Non sans doute. Car de même que tout à l’heure les théorèmes relatifs à la circonférence ne prenaient place dans le temps et ne se succédaient les uns aux autres que pour un
SPINOZA
15
esprit imparfait, ainsi les choses particulières ne forment une série, ne prennent place dans le temps que pour une intelligence imparfaite. Pour un esprit fini qui les considère en elles-mêmes, elles sont coéternelles à Dieu. Enfin, il était impossible qu’une chose existât autrement qu’elle n’est16, ni dans un autre, ni avec d’autres rapports, vis-à-vis de toutes les autres, car de même que la définition de la circonférence étant posée, toutes les conséquences possibles de cette définition existent par cela seul qu’elles sont possibles, ainsi posés la substance et tout ce qui peut découler de son essence, tout ce qui est possible existe par cela seul que c’était possible. Il n’y a donc place dans le monde ni pour la contingence, ni pour le libre arbitre, ni pour la finalité17. Pas de contingence d’abord, car si une chose pouvait être autre ou autrement qu’elle n’est, s’il était possible qu’elle fût autre qu’elle n’est, toutes les possibilités ne seraient pas réalisées, une conséquence possible de la définition n’en sortirait pas, ce qui serait absurde. Pas de libre arbitre, ni de finalité, car dans les deux cas, on suppose la possibilité d’un choix, on suppose deux hypo thèses également possibles, on admet en d’autres termes la contingence de possibles non réalisables. Cette idée d’une nécessité universelle mathématique en vertu de laquelle les choses découlent de l’essence divine, et sont réalisées par cela seul qu’elles étaient possibles : Voilà l’idée fondamentale du spinozisme18. S’il en est ainsi, il est clair qu’une double étude s’impose aux philosophes. On pourra d’abord considérer en lui-même ce principe un et infini d’où les choses sortent nécessaire ment, on pourra considérer Dieu en lui-même dans les attributs19 dont chacun l’exprime tout entier. On obtiendra alors ce que Spinoza [279] appelle la nature naturante ou bien on peut considérer l’infini, multipli cité des choses finies ou des modes des attributs divins, c’est alors à la nature naturée qu’on aura affaire20. Abordons tour à tour ces deux études. Nature naturante. — Dieu possède une infinité d’attributs cha cun infini, sinon il ne réaliserait pas l’idée qu’on se fait de l’être infini. Mais de ces attributs infinis, nous n’en connaissons que DEUX21 : la pensée et l’étendue. Qu’est-ce à dire ? Dieu est-il étendu ? Est-il divi sible ? Point du tout22, car l’étendue attribut divin n’est pas cette éten-
16
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
due que nous connaissons par les sens et l’imagination. Pour com prendre cette idée spinoziste, une comparaison géométrique est néces saire. Imaginez toujours cette loi simple au moyen de laquelle on conçoit qu’une circonférence soit engendrée, la loi d’un mouvement. Elle est une : on l’aperçoit par une simple intuition de l’esprit. Imagi nez maintenant un nombre indéfini de circonférences tracées sur du papier ou sur un tableau. Le nombre en est infini, chacune d’elles est infiniment divisible, et cependant elles sont toutes contenues dans cette loi simple, indivisible en vertu de laquelle on engendre la circon férence. Cette loi simple sera comparable à l’étendue attribut divin, et l’étendue que nous connaissons, étendue illusoire, infiniment divisible, correspond à cette multitude indéfinie de circonférences réelles et divi sibles à l’infini qui ne sont que l’équivalent multiple de cette loi une et indivisible23. De même la pensée est un attribut divin, mais il ne fau drait pas se représenter cette pensée, telle24 que nous nous représen tons la nôtre. Il y a autant de différence entre les deux, dit Spinoza qu’entre le chien animal aboyant et le chien constellation. Dieu est-il personnel25 ? Est-ce une personne ? Pas davantage, car on ne se perçoit comme une personne qu’à la condition de se distinguer des autres choses. La personnalité est une limitation pour ainsi dire et Dieu est infini. Dieu est-il libre ? Si par liberté on entend le libre arbitre, il serait insensé d’admettre un seul instant unç pareille chose26 car ce que Dieu fait suit nécessairement de son essence comme l’égalité des trois angles d’un triangle à deux droits suit nécessairement de la définition du triangle. Mais Dieu est libre d’une liberté infinie, en ce sens que son développement résulte de son essence toute seule et qu’aucun élé ment étranger n’intervient27. Il est libre en ce sens qu’il existe absolu ment par lui-même et qu’absolument aussi toutes les conséquences possibles de sa définition existent dès qu’elles sont possibles28. Pour comprendre cette conception spinoziste de la liberté telle qu’elle est en Dieu, une comparaison géométrique nous est encore nécessaire. Cha cun sait que la théorie des parallèles, par exemple, sort de la définition des parallèles et qu’à un certain moment une proposition intervient qu’on ne saurait démontrer qui ne sort pas de l’essence des parallèles, c’est le postulatum d’Euclide. Voilà une vérité qui fait partie de la
SPINOZA
17
théorie mais qui y est étrangère. Dieu est libre, en ce sens que son développement est ce que serait le développement de la théorie des parallèles s’il n’y avait pas le postulatum d’Euclide, si toutes les théo ries des parallèles suivaient nécessairement de la définition toute seule, en d’autres termes, liberté est synonyme de nécessité interne. NATURE NATURÉE. — Considérons maintenant la nature naturée. Spinoza donne ce nom à l’ensemble de modes qui découlent nécessai rement des attributs voisins, le moment est venu de se rendre exacte ment compte du sens de ces trois mots : substance, attribut, mode. Tout va dépendre de là. J’appelle attribut, dit Spinoza, ce qui exprime l’essence de la substance29. Quel peut être le sens de cette définition ? Là encore elle ne peut être comprise qu’à la lumière des mathémati ques. Rappelons-nous l’invention cartésienne d’une géométrie analy tique. Si je pense à l’idée du cercle, idée très [280] abstraite, idée d’une loi, je puis l’exprimer de deux manières au moins. Elle peut s’exprimer par une figure, mais aussi par une formule et dans la figure et dans la formule cette idée existe tout entière. L’une et l’autre en expriment le sens, mais nous pouvons concevoir une infinité d’autres expressions possibles, car notre algèbre n’est pas la seule concevable30 et même en algèbre on peut représenter d’une foule de manières la circonférence. Aussi dès qu’on engendre par la pensée l’idée de circonférence, aussi tôt existe une foule d’expressions possibles de cette idée. Nous n’en connaissons que deux : la géométrie et l’algèbre. Il en existe une infi nité d’autres qui n’ont pas été découvertes. De même, posez la sub stance divine et aussitôt toutes les expressions possibles de cette sub stance existent. Or ces expressions sont les attributs divins, et dans chacun de ces attributs divins Dieu existe tout entier. Qu’est-ce qu’un mode31 ? Imaginez qu’ayant posé la définition du cercle, ayant tracé la figure géométrique appelée circonférence, et, d’autre part, établi la formule qui y correspond, imaginez tous les théorèmes relatifs à la circonférence représentée d’une part par une série de figures, d’autre part par une série de formules, toutes ces figures se comprendront à la lumière de la première qui exprimait l’es sence du cercle. Toutes ces formules se comprendront à la lumière de
18
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
la première, car toutes peuvent s’en déduire. Bien plus, si vous consi dérez d’une part une figure de la série, d’autre part la formule corres pondante de l’autre série, l’une sera l’expression de l’autre, la figure exprime la formule géométrique, la formule exprime la figure algé brique. Les figures et formules se correspondent et cependant il n’y aura aucune influence réciproque de l’une sur l’autre32. Elles se corres pondent seulement en tant qu’exprimant respectivement ce qu’il y avait de réel dans les figures et formules primitives qui étaient l’une et l’autre des expressions de l’idée de circonférence. Or les modes de l’étendue, d’après Spinoza, ne sont pas autre chose que les choses finies qui découlent ainsi de l’essence des attributs divins33. Nous ne connaissons que deux attributs divins, la pensée et l’étendue, mais la pensée se traduit par une infinité de modes, l’étendue aussi34 et ainsi se forment deux séries parallèles. Et à chaque mode de la pensée corres pond un mode de l’étendue et réciproquement. Et le mode de la pen sée exprime en pensée le mode correspondant de l’étendue, et cepen dant aucune influence n’est possible entre les modes de la pensée et de l’étendue et vice versa. L’ordre et la connexion des pensées sont les mêmes que l’ordre et la connexion des choses, ce qui signifie que les modes de la pensée et de l’étendue forment deux séries parallèles dont chaque terme peut être considéré comme la traduction du terme cor respondant d’autres séries par la raison toute simple que l’un et l’autre sont l’expression d’une seule même et éternelle beauté35. Il s’agit d’étudier en nous-mêmes les modes de la pensée et de l’étendue ; les modes de la pensée sont des idées, les modes de l’éten due sont des corps36. En vertu de ce qui précède, chaque idée sera la représentation du corps correspondant et chaque corps sera la traduc tion en étendue d’idées correspondantes. Si on convient d’appeler âme l’idée totale37 d’un corps total, total aussi, on pourra définir une âme, l’idée de son corps. Ainsi l’âme humaine est l’idée du corps auquel elle est attachée. S’il en est ainsi, plus le corps sera complexe38, plus il entretiendra de rapports avec toutes les autres choses, plus l’âme sera compliquée aussi, car à tout mode de l’étendue correspond un mode de la pensée. Et aux corps les plus complexes correspondent les âmes les plus élevées dans la série. Il y a donc une hiérarchie, dans la com-
SPINOZA
19
plication d’une part des corps de plus en plus compliqués39, depuis le minéral jusqu’au corps humain, d’autre part des âmes simples idées de plus en plus complexes, à mesure qu’on s’avance dans la série depuis l’âme du minéral (car Spinoza lui en suppose [281] une40), jusqu’à l’âme humaine. Arrêtons-nous sur l’âme humaine. Cette âme est l’idée de son corps41, et ce corps entretient une multiplicité infinie de rapports avec les autres et à chacun de ces rapports une idée correspond, de là la nécessité pour l’âme humaine d’un très grand nombre d’idées que Spi noza appelle idées inadéquates42. En effet, tant que nous serons dans la sphère du particulier, tant que nous considérons les choses dans leurs rapports avec d’autres choses, nous avons affaire à une énumération qui ne sera jamais terminée, et l’idée que nous avons de la chose par ticulière, en tant qu’elle soutient des rapports avec d’autres choses par ticulières, sera toujours inadéquate, incomplète. Pour être complète, il faudrait qu’elle fut replacée au sein de la déduction par laquelle les choses sortent de l’essence divine. Il faudrait qu’on la conçût sub specie aeternitatis13 sous l’aspect de l’éternité, car c’est alors seulement que l’idée devient éternelle en tant que coéternelle44 avec l’essence pure et simple. Or de ce que notre âme contient des idées inadéquates, il suit que nous sommes sujets à des passions dont les unes sont bonnes et les autres mauvaises45. Qu’est-ce que la Passion ? Ce n’est pas autre chose que l’idée ina déquate46. En effet, notre corps maintenant des rapports infinis avec tous les corps et toutes les choses, il existe certains états du corps, qui accroissent le nombre de ces rapports avec les autres choses, et par suite sa puissance, comme Spinoza l’appelle. Et il est d’autres états du corps qui diminuent le nombre des rapports, qui diminuent sa puis sance47. Or les idées qui expriment le premier état du corps sont les idées qui expriment un accroissement de force, les autres une diminu tion. Si l’on convient d’appeler bon, ce qui accroît la puissance d’agir du corps, et mauvais ce qui la diminue, on dira que les premiers états constituent les passions bonnes et les autres les passions mauvaises. Les passions bonnes sont celles qui nous augmentent et se ramè nent à la joie ; les mauvaises sont celles qui nous diminuent et se ramè-
20
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
nent à la tristesse. Et Spinoza partant de ces prémisses construit une théorie admirable des passions. Théorie supérieure à celle donnée par les plus grands psychologues. Il montre comment toutes les passions ne sont que joie ou tristesse48, prenant des objets différents accompa gnés d’idées différentes ; et cette réduction49 qu’il a faite de la sensibi lité à l’intelligence lui a permis de pénétrer avec une profondeur inconnue, jusqu’à l’essence et à la nature intime de ces états de l’âme. Conclusion. — Certains états de l’âme peuvent être appelés bons, d’autres mauvais. De là une morale qui ne se propose pas de donner des conseils mais des impératifs, car on ne donne des conseils qu’à un être libre et il serait absurde d’admettre que l’homme eût le choix50, qu’un mode de l’étendue et de la pensée puisse être autre qu’il n’est. Cette morale se propose donc uniquement de déterminer la nature exacte des états qui accroissent ou diminuent la puissance de l’homme. Elle détermine les conditions d’équilibre de l’âme, comme la méca nique détermine les conditions d’équilibre d’un corps51 et, de même que la mécanique, ne change rien à la conduite de l’homme, en déter minant les conditions de l’accroissement de puissance pour l’homme, de bonté morale. Cette morale constate ce qu’il y a52 ; elle ne l’ordonne pas ; elle paraît identifier le bien avec l’accroissement de force. Spi noza va maintenant s’élever plus haut53 et de cette morale qu’on pour rait appeler relative qui détermine les conditions d’équilibre de l’âme, en se fondant sur l’étude des passions, il va s’élever à la morale de la liberté. En effet pourquoi les passions qui accroissent la force de l’homme, celles qui se ramènent à la joie sont-elles des passions bonnes ? Si on analyse le concept d’accroissement [282] de force ou de puissance il se ramène à celui-ci : ce qui augmente notre force c’est ce qui se54 rapproche de l’idée adéquate, de la connaissance des choses et de nous-mêmes en tant que coéternels à l’essence divine55. En effet, puisqu’une idée est d’autant plus parfaite qu’elle exprime un plus grand nombre de rapports, puisque l’idée adéquate est celle qui contient l’expression d’une infinité de rapports quoique une et indivi sible, une idée n’approche de la perfection, de la puissance extrême, qu’à la condition de se rapprocher de l’idée adéquate ; d’où nous
*
SPINOZA
21
concluons que la puissance la plus grande est celle d’un être qui se représente adéquatement les parties de la réalité, celles qui se rappor tent à son corps56. Dès lors quel sera l’état de l’âme qui, grâce à la spé culation philosophique, se connaîtra elle-même adéquatement, se pla cera par la pensée au sein de la déduction par laquelle les choses sortent de l’essence divine, qui se placera en Dieu57 et surtout connaî tra la nécessité mathématique en vertu de laquelle elle sort de l’essence divine? C’est là la liberté absolue pour l’homme : être libre, c’est connaître la nécessité universelle et surtout s’y replacer par la pensée, c’est, nous ne dirons pas par un effort, car nous ne pouvons pas atteindre cet état, c’est reprendre place au sein de l’essence considérée comme contenant dans son unité, dans son indivisibilité, l’infinité des modes particuliers. Supposez un instant les théorèmes relatifs à la cir conférence brouillés, mêlés au hasard, si l’un d’eux pouvait se replacer exactement dans la série des déductions par lesquelles tous sortent de la définition posée, s’il connaissait sa place exacte et la nécessité en vertu de laquelle il devait sortir de la définition, il serait libre en ce qu’il ne subirait pas d’autre influence que celle de la nécessité mathé matique et intense en vertu de laquelle les choses sortent de l’essence divine. Nous sommes libres58 en tant que participant de cette nécessité, non seulement c’est pour l’homme la liberté parfaite, c’est aussi la suprême béatitude car être heureux, c’est aimer Dieu59, c’est-à-dire se replacer en lui et nous nous y replaçons par la pensée qui fait partie de son essence. Enfin, et pour conclure, c’est en cela que consiste l’éternité60. En effet ce qui fait l’éternité de notre âme, c’est qu’elle coïncide avec l’idée adéquate que Dieu peut en avoir. Toutes les âmes ne sont pas éternelles, mais celles-là seulement qui se trouvent avoir conçu nette ment, parfaitement la place qu’elles occupent au sein de Dieu, celles qui sont libres en un mot. Enfin, ici encore nous nous servirons d’une comparaison géomé trique, supposez à côté de la définition éternelle de la circonférence, de la loi éternelle aussi, en vertu de laquelle elle s’engendre, supposez un nombre indéfini de circonférences réelles, je les ai tracées par un mouve-
22
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
ment de la main, un mouvement de la main aussi les effacera, elles sont éphémères, supposez que l’une d’elles ait pu concevoir l’essence éter nelle, en vertu de laquelle elle existe, supposez qu’elle puisse se replacer au sein de cette essence, elle ne pourra être effacée, elle s’est confondue avec l’essence éternelle dont elle était l’expression passagère. L’éternité pour l’âme consiste dans la liberté et sa liberté consiste dans la connaissance absolue qu’elle prend de la nécessité universelle.
L’ESPACE ET LE TEMPS
[283] Jusqu’à ce siècle, les philosophes ont considéré comme soli daires la question de l’espace et celle du temps. En effet, l’expérience prend une double forme : elle est externe ou interne. Or l’espace est à la perception extérieure ce que le temps est à la perception interîle. Dans l’espace, nous localisons les corps et dans le temps les phéno mènes, c’est-à-dire en dernière analyse les faits psychologiques. Il y a donc au moins analogie entre ces deux concepts, mais il y a bien des manières d’en comprendre la nature. 1° On peut considérer le temps et l’espace comme doués d’une exis tence objective et d’une réalité indépendante de nous. C’est ainsi que Clarke, disciple de Newton, entretient avec Leibniz une correspondance restée célèbre61 et dans laquelle il s’efforce de prouver que le temps et l’espace sont des attributs de Dieu, que ce sont par conséquent des réali tés objectives. Descartes n’a point approfondi pour elle-même la ques tion du temps, mais pour ce qui est de l’espace, il paraît très disposé à en faire une chose en soi. Ne dit-il pas en effet que l’étendue est l’essence même des corps ? Enfin, on pourrait rattacher à cette catégorie de penseurs les philosophes dits éclectiques dont le chef est Victor Cousin. Ceux-ci font du temps et de l’espace des idées rationnelles et si l’on réflé chit que la raison est pour eux la faculté de connaître l’absolu, c’est-àdire ce qui existe en soi62, on verra que pour eux comme pour Descartes l’espace est une chose, une réalité objective. Cette conception de l’espace et du temps soulève des difficultés insurmontables. Il faudrait d’abord montrer que nous sommes capa-
L’ESPACE ET LE TEMPS
23
blés de concevoir l’espace et le temps par eux-mêmes. Or l’espace vide et le temps sans phénomènes qui se succèdent sont inconcevables. Nous avons beau subdiviser indéfiniment la matière qui emplit l’es pace, toujours nous attribuons à cet espace des parties, nous y laissons donc quelque chose. Nous avons beau chercher à nous figurer une durée sans phénomènes qui la remplissent, nous rétablissons ces phé nomènes dès que notre idée devient claire. Si donc nous ne concevons pas d’espace sans matière, ni de temps sans phénomènes qui se succè dent, on peut nier que ce soient là des réalités au même titre et au même sens que la matière par exemple ou l’esprit ; ils n’ont point d’existence séparée. Quant à faire des idées d’espace et de temps des idées ration nelles63, cela reviendrait à affirmer que nous sommes incapables de penser sans faire appel à ces deux notions, or ne mettons-nous pas Dieu en dehors du temps64 et de l’espace ? 2° On peut maintenant soutenir avec Leibniz que le temps et l’es pace ne sont point des choses mais des rapports. Ce philosophe65 a défini l’espace un rapport de coexistence et le temps un rapport de succession. Ce ne sont donc point des réalités, mais la monade pen sante et imparfaite ne peut se représenter les phénomènes sans établir entre eux des rapports nécessaires de succession ou de coexistence. Le temps et l’espace sont donc pour lui des idées confuses, c’est-à-dire des idées qui s’évanouissent si, pour parler le langage de Spinoza66, nous connaissons adéquatement les choses. Cette théorie ne diffère pas beaucoup de celle de Kant malgré les apparences. En effet, Kant défi nit le temps et l’espace des formes pures de la sensibilité, entendant par là que notre faculté de percevoir les phénomènes ne saurait fonc tionner sans les grouper dans le temps et l’espace, mais que le temps et l’espace sont en nous et non dans les choses en soi. Kant a eu le mérite de donner des raisons solides à l’appui de cette opinion. [284] Si l’espace n’était pas une forme a priori1 comment donne rait-il naissance à des propositions nécessaires telles que les proposi tions géométriques ? Tout jugement nécessaire est une proposition a priori d’après Kant et puisque les théorèmes géométriques se rappor tant à des propriétés de l’espace sont nécessaires, c’est que nous nous
24
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
représentons l’espace a priori indépendamment de toute expérience. C’est qu’il se réduit à une certaine forme de notre faculté de percevoir, de même pour le temps. Un philosophe de notre temps, M. Cournot68, a critiqué avec quelque profondeur cette théorie de Kant. Si le temps et l’espace ne sont qu’en nous, dit-il, comment se fait-il que nous observions entre les phénomènes des rapports de situation et de durée que nous ne sommes aucunement capables de changer ? Est-ce nous qui faisons la régularité des phénomènes astronomiques ? Quand nous prédisons l’apparition d’une comète dans une année d’ici par exemple, sommes-nous libres de faire qu’elle ne paraisse pas au jour et à l’heure fixés par la loi de son mouvement ? C’est donc qu’il y a dans les choses un principe de détermination en ce qui concerne le temps et l’espace, ce n’est point nous qui réglons arbitrairement la succession des phéno mènes. En revanche la théorie de Leibniz69, moins radicale que celle de Kant puisqu’elle met dans les choses, sinon le temps et l’espace euxmêmes, au moins un certain ordre qui explique la production de ces idées confuses en nous, paraît au contraire à M. Cournot répondre aux exigences de la science actuelle. Au contraire si l’on considère le temps et l’espace comme des rapports de succession et de coexistence et des rapports seulement, on arrive à démontrer a priori des théorèmes que la mécanique déclare indémontrables. La loi d’inertie, par exemple, et celle de l’indépendance des mouvements. Considérons le second de ces deux théorèmes. Etant donné un point A mobile, soumis à l’action d’une force E, le principe de l’indé pendance des mouvements vient de ce qu’une nouvelle force F, s’ajoutant à la première, agit sur le point A comme s’il était immobile. Voilà un axiome en mécanique, mais la conception leibnizienne de l’espace va nous permettre de le démontrer. En effet, représentonsnous par M, N, P, Q, etc., tous les points de l’univers déclaré immo biles, rien ne nous empêche de les supposer en mouvement, sous l’inF
F
M
«s*
E
A
■m Q
25
LEIBNIZ
fluence des forces égales à F et dirigées dans le même sens. Le mouve ment de A ne sera pas changé pour cela, mais qu’arrivera-t-il mainte nant ? C’est que l’univers tout entier se déplaçant avec le point A, celui-ci n’aura pas bougé et ce n’est point là une métaphore, car l’es pace étant relatif, les rapports dans l’espace le sont aussi, et le point A est immobile par cela seul qu’il ne change pas de situation vis-à-vis de M N P Q, mais alors le point A étant immobile la force P' agira sur lui comme si elle était seule. CQFD. 3° Nous arrivons aux solutions proposées de notre temps. Com mençons par dire qu’on a dissocié les deux problèmes du temps et de l’espace et que toutes les discussions se sont concentrées sur le second. On s’accorde à reconnaître aujourd’hui que le temps est une forme du sens intime ou de la conscience, quoiqu’elle ne soit pas sans rap port avec quelque chose d’objectif. Il y a en effet dans les phénomènes un je-ne-sais-quoi qui fait que l’un vient avant l’autre et qu’un ordre de succession70 bien déterminé s’établit entre eux pour notre conscience, mais pour ce qui concerne l’espace l’ancien débat a repris sous une forme nouvelle. Deux écoles se sont formées en Allemagne, l’école nativiste dont le chef est le physiologiste Jean Müller et l’école empirique qui compte des physiologistes et psychologues tels que Lotze et Helmholtz71. D’après les nativistes l’espace est comme inné à notre organe visuel. D’après les empiristes, ce serait une représenta tion que nous formons petit à petit72.
LEIBNIZ
[215] Leibniz naquit à Leipzig en 1646 ; il passa à juste titre pour un enfant prodige. Déjà à l’âge de 14 ans, il pensait à l’alphabet des concepts qui préoccupa toute sa vie. En 1661, il quitta le collège pour l’université ; c’est là surtout qu’il s’initia à la doctrine d’Aristote. Il se livra après avec passion à l’étude de Bacon, de Kepler, de Galilée et de Descartes. Son maître Thomasius73 exerça sur lui une grande influence. En 1667 l’électeur de Mayence lui offrit un emploi à sa cour. C’est ainsi que Leibniz se trouva mêlé aux affaires politiques
26
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
de l’empire. Il se signala par un projet d’expédition en Egypte74 qu’il voulait faire adopter au roi Louis XIV. En 1676, le duc de Brunswick lui fit offrir le titre de bibliothécaire du Hanovre, poste qu’il conserva jusqu’à sa mort en 1716. Ses principaux ouvrages sont : 1° Nouveaux essais sur l'entendement humain, en 1704, Réponse aux essais de Locke. 2° Essais de Théodicée, 1710. 3° Ta monadologie, 1714. 4° Principe de la nature et de la grâce, 1714. 5° Les Lettres à Clarke, 1715-1716. Nous ne citons que les principaux ouvrages de philosophie mais Leibniz est aussi un moraliste, un logi cien, un politicien et la liste de ses ouvrages est considérable. Système de Leibniz. — Et premièrement, la méthode de Leibniz doit à Descartes beaucoup plus qu’il ne le prétend, c’est par le carté sianisme qu’il fut conduit au dynamisme, il l’avoue lui-même75. Mais il se distingue des cartésiens par la méthode éclectique qu’il pratiqua toute sa vie, tandis que ce qui caractérise la méthode cartésienne c’est de vouloir tout reconstruire sans même user des matériaux déjà accumulés. Descartes procède comme les mathématiciens, c’est de lui seul qu’il tire la science. Au contraire Leibniz est d’avis qu’il faut tenir compte de ce qui a été fait avant lui. Il est du reste très éru dit76. Aristote lui plaisait beaucoup, il emprunta fort au Moyen Age, et il a puisé à pleines mains dans saint Thomas77. Enfin malgré le peu de cas qu’il prétend faire du cartésianisme, il lui doit beaucoup et le reconnaît du reste parfois. Locke même, et Spinoza qui l’a combattu, se sont inspirés de ses idées. Ainsi pour définir la méthode de Leibniz il faudrait dire que, sur un point donné, il cherche tout ce qui a été dit par ses prédécesseurs et qu’il s’efforce de concilier les diverses opinions non en les juxtaposant, mais en s’élevant à une idée nouvelle, à la lumière de laquelle ces opinions se rapprocheront et viendront coïncider ensemble. Si donc on définit la méthode de Leibniz un éclectisme, il ne faudra plus confondre cet éclectisme avec celui de Victor Cousin qui prend de côté et d’autres les opinions des divers philosophes et les juxtapose. La méthode de Leibniz est une méthode de conciliation opérée par la découverte d’un point de vue nouveau78.
LEIBNIZ
27
Principes fondamentaux de la monade. — Leibniz dit qu’il avait d’abord adopté la méthode de Descartes comme étant la plus séduisante. Le mécanisme est en effet chose simple et notre esprit qui vise à la simplicité voudrait que le mécanisme fût l’explication défini tive des choses. Il crut donc avec Descartes que la matière n’était que de l’étendue et que la physique pourrait s’édifier sur ses bases. Mais des conditions physiques et mathématiques ne tardèrent pas à lui prouver que le cartésianisme « n’était que l’antichambre de la vérité »79 ; il correspond simplement à l’apparence. Ces considérations sont de diverses natures, la principale est la suivante : si le corps maté riel n’était que de l’étendue comment opposerait-il de la résistance80 à celui qui essaie de le faire mouvoir ? Comment se fait-il [216] surtout qu’un corps en en choquant un autre81 perde une partie de son mou vement ? Le corps est donc quelque chose autre que l’étendue inerte, c’est quelque chose d’actif, c’est une force82 et on arrive au même résultat en partant d’une autre considération. Descartes identifie le corps avec l’étendue, mais toute étendue est divisible, et les parties de cette étendue sont elles-mêmes encore étendues, par suite divisibles, et il faudra bien qu’en dernière analyse on puise à un élément indivisible, c’est-à-dire inétendu. De sorte que l’étendue ne s’explique que par Yinétendue ; elle n’est donc pas l’élément primitif, elle n’est qu’une apparence. C’est ainsi que Leibniz fut amené à chercher l’essence irré ductible des choses dans ce qu’il appelle la monade. Qu’est-ce qu’une monade ? Nous allons en énumérer les propriétés principales. 1° La monade est une substance simple indivisible, et par consé quent inétendue. C’est, comme dit Leibniz, « un atome métaphy sique »83 qui diffère de l’atome matériel en ce qu’il n’a pas d’étendue. Cela tient à ce que l’étendue n’est qu’une apparence. Sans doute nous percevons des objets étendus, mais notre perception de l’étendue n’est qu’ « une perception confuse ». Expliquons-nous. Une monade est inétendue, et une multiplicité de monades est aussi inétendue, mais cette multiplicité de monades pourra à cause de la confusion qu’elle revêt pour nous quand nous la percevons paraître étendue. C’est ainsi que si on mélange des grains de diverses couleurs nos sens ne voient qu’un ensemble grisâtre et pourtant aucun des grains n’étant gris,
28
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
cette couleur n’est que l’aspect confus de l’ensemble. Il en est de même des couleurs de l’arc-en-ciel, car si nous nous transportions au lieu où nous croyons les apercevoir nous ne verrions rien84. Il y a donc des perceptions qui tiennent à la confusion avec laquelle nos sens et notre intelligence perçoivent et la perception de l’étendue est une de celles-là. Leibniz a en effet défini l’étendue « l’ordre de coexistence des monades »85. Il entend par là que là où des monades coexistent, leur agrégat prend pour nous la forme confuse de l’étendue. On s’explique qu’un corps matériel soit formé d’éléments immatériels et que l’étendue se résolve en monades inétendues. 2° Les monades ne peuvent commencer d’être qu’en vertu d’une création et elles ne peuvent cesser d’être qu’en vertu d’une annihila tion86 Et en effet ce qui est absolument simple ne saurait se composer d’autres éléments, ni se décomposer. Pour une substance simple et immatérielle, il n’y a pas de milieu entre être et n’être pas. 3° Les monades ne sauraient agir les unes sur les autres. En effet une chose ne peut agir sur une autre qu’à la condition de la changer et elle ne peut la changer qu’en en déplaçant les parties. Mais la monade n’a pas de parties, elle échappe donc à toute influence. Si rien ne peut agir sur elle réciproquement, elle ne peut agir sur rien ; elle ne connaît pas ce qui est hors d’elle : « Elle est sans porte ni fenêtre sur le dehors. »87 4° La monade étant une substance immatérielle, nous ne pouvons nous la représenter qu’en la comparant à notre âme. En effet, c’est une petite âme, moins perfectionnée que la nôtre, non douée de réflexion, mais qui possède, à un moindre degré, un certain nombre de qualités de l’âme humaine qui n’est qu’une monade plus parfaite. Et si l’on convient d’appeler perception tout état de l’âme qui est une perception plus ou moins confuse, plus ou moins distincte, on dira que la qualité essentielle d’une monade, quelle qu’elle soit, est la perception. Mais les perceptions ne sont pas également distinctes. En effet il y a un nombre infini de degrés entre la perception ou aperception qui est [217] accom pagnée d’une conscience claire et la perception pure89 qui se confond presque avec ce que nous appelons l’inconscient. Quand nous nous trouvons sur le bord de la mer nous percevons distinctement le bruit qu’elle fait, mais nous ne croyons pas percevoir les bruits de chaque
LEIBNIZ
29
gouttelette bien que nous les percevions, car sans cela comment pour rions-nous percevoir le bruit total ? Chacune de ces petites goutte lettes est donc ici une perception confuse ; ce n’est cependant pas l’in conscient, c’est le degré le plus bas de la conscience. Il n’y a donc pas de monade qui ne perçoive, mais la perception peut être distincte ou confuse. Ce qui caractérise notre âme, notre monade à nous c’est qu’elle tend continuellement à changer, à agir, c’est-à-dire passer des perceptions confuses aux perceptions distinctes. Tel est l’état de toute monade. Dans chaque monade il y a une foule de perceptions confuses, mais la monade par une force interne tend à accroître le nombre de ses perceptions distinctes, c’est-à-dire de faire passer des perceptions de l’état confus à l’état distinct, cette tendance Leibniz l’appelle Yappétition™. 5° Quelles sont les choses dont la monade a la perception ? Rappe lons-nous que les monades ne s’influencent pas. Cependant nous constatons que certaines monades, nos âmes, connaissent distincte ment une partie de l’univers. Il en est ainsi de toutes les autres monades, car, entre les diverses monades, il y a des différences de per ception et non de nature. Comment dès lors une monade peut-elle percevoir un univers confusément ou distinctement sans sortir d’ellemême ? Ce ne peut être qu’à la condition que cet univers soit tout entier représenté en elle. Seulement cette représentation de l’univers qui est dans toute monade n’est jamais entièrement distincte. Chez cer taines monades cette perception est tout à fait confuse, chez d’autres une partie de cette représentation est confuse, l’autre distincte, et plus sont nombreuses les perceptions distinctes, plus sont élevées les monades dans la série91. En d’autres termes, il y a une infinité de monades92 et chacune d’elles porte en elle la représentation de toutes les autres, représenta tion dont certaines parties sont éclairées et d’autres dans l’ombre, à moins que tout ne soit confus et chaque monade est comme « un miroir de l'univers » ou « un univers en raccourci »93. Donc, lorsqu’une monade perçoit, elle ne sort pas d’elle-même, elle ne fait que jeter de la lumière sur une partie confuse de cet univers qui est représenté en elle, elle ne perçoit qu’elle-même.
30
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
6° Il n’y a donc pas deux monades qui se ressemblent94 ; ceci résulte, comme nous le verrons, du principe fondamental de Leibniz, du principe de raison suffisante. Si Dieu avait créé deux monades identiques, elles n’en formeraient qu’une, puisqu’il n’y aurait rien pour les distinguer95. Donc toutes les monades diffèrent. Mais par où ? puisqu’elles sont toutes la représentation d’un même univers. Mais c’est que les différentes parties de cet univers qui sont repré sentées distinctement ne sont pas les mêmes pour chaque monade. Il n’y a pas deux monades où soient représentées clairement ou confu sément les mêmes parties. C’est ce que Leibniz exprime en disant « que chaque monade est un point de vue sur l'univers »96. Représentonsnous un même paysage que l’on peut voir de différents sommets. Plaçons-nous sur ces sommets successivement. De chacun d’eux, nous verrons tout le paysage, mais à chacun d’eux aussi correspon dent des parties claires ou obscures qui ne seront pas les mêmes pour le sommet voisin. Pour avoir une perception distincte du tout il faut se placer tour à tour sur chaque sommet. Ainsi si l’on complétait l’une par l’autre les perceptions de toutes les monades, on aurait la perception distincte de l’univers. Les monades ne sont pas identiques mais complémentaires97. 7° Cependant dans l’univers que nous croyons observer il semble [218] qu’il y ait une action et réaction des choses l’une sur l’autre, comment cela est-il possible, si la monade ne perçoit qu’elle-même ? Considérons une monade en particulier, quand elle perçoit distincte ment, elle est entièrement maîtresse de ce qu’elle perçoit ; elle se rend active, et quand elle ne perçoit que confusément, c’est que quelque chose l’arrête, car elle voudrait en vertu de l’appétition que cette per ception fût distincte. Mais sa puissance est limitée, de sorte que toute perception confuse engendre dans l’âme un état de passivité98. La monade est passive quand elle perçoit confusément. Or nous verrons que Dieu a établi entre les monades une harmonie qui fait que dès qu’une perception devient distincte dans une monade, aussitôt cette perception devient confuse dans une autre, de sorte que l’une agit et que l’autre est passive. Et il y a en apparence simulacre d’une influence alors qu’en réalité il y a simplement harmonie préétablie99.
31
LEIBNIZ
Veut-on comprendre cette explication au moyen d’une comparaison ? Supposons des acteurs jouant une scène. Chacun d’eux connaît dis tinctement son rôle, les répliques, qu’il doit donner, mais il ne connaît que confusément et d’une manière vague celui de son interlocuteur. Lorsque l’un d’eux récite son rôle, il agit, il est acteur ayant une per ception distincte, mais il devient passif, n’est plus qu’auditeur quand arrive la partie de la scène qu’il ne connaît que vaguement. C’est alors l’autre qui agit. Dans la scène un spectateur naïf qui ne se saurait pas au théâtre s’imaginerait que chacune des répliques de l’acteur est amenée par ce que l’autre aurait dit ; il pense qu’il y a influence du premier sur le second et réciproquement, alors qu’aucun des acteurs n’influence l’autre, car chacun avait appris séparément son rôle et se borne à inter caler la réplique où il faut. Il y a harmonie préétablie. Eh bien ! Chaque monade est active, agit, joue son rôle quand elle perçoit dis tinctement et est passive quand elle ne perçoit que confusément, et nous qui assistons au spectacle d’une perception devenant distincte de confuse et réciproquement, nous croyons voir une influence réci proque alors qu’en réalité il n’y a qu’harmonie préétablie.
LEIBNIZ (suite)
Leibniz ayant désigné la monade et énuméré ses propriétés essen 100 tielles établit dans la monadologie une hiérarchie entre les monades diverses. Au plus bas degré, nous trouvons les monades nues, celles qui s’agrègent pour former ce qui nous donne l’illusion d’un corps brut ou organisé ; ces monades ont des perceptions qui sont presque toutes confuses. Mais parce que leurs perceptions sont confuses, elles aspirent à la clarté et à la distinction, ce qui revient à dire qu’elles ont comme une exigence de l’étendue101, car elles réclament l’agrégation d’au tres monades qui les complètent. Or cette exigence de l’étendue, Leib niz l’appelle résistance102 ou antitypie. Envisagée en tant que douée de perceptions confuses, cette monade peut s’appeler matière première ou nue. Et l’ensemble des monades qui s’exigent les unes les autres s’ap-
32
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
pellera matière seconde ou matière vêtue. Parfois l’agrégat de monades en comprend une centrale ou dominante103 à laquelle les autres paraissent se subordonner et qui semble être la cause ou la raison104 de l’identité des formes dans l’agrégat, on dit alors qu’il y a organisme et non plus simple masse. Les monades nues n’ont que des perceptions insensi bles, leur activité se réduit à une infinité de perceptions petites qui ne s’unissent jamais de manière à former des perceptions plus relevées. Au-dessus des monades nues, il faut placer les âmes105 ou [219] formes substantielles des êtres vivants, des simples vivants (Leibniz). Les âmes sont des monades douées de sensibilité c’est-à-dire que leurs perceptions ont quelque chose de relevé et de distinct106. De là vient qu’elles sont capables d’attention, de mémoire, et même d’asso ciation des idées ; ce sont les âmes des bêtes. L’animal retient ce qu’il a perçu et sans pouvoir raisonner, il imite le raisonnement grâce à la faculté de retenir des « consécutions empiriques »107. Un chien battu pour avoir mangé du gibier s’abstient de recommencer parce qu’il s’attend au même phénomène. Leibniz ajoute que nous sommes empi riques dans les trois quarts de nos actions108. Dans l’animal l’appétition devient déjà passion. Nous trouvons donc dans la monade âme les qualités inférieures de la monade esprit. Les esprits sont des monades supérieures109, ce sont des âmes raisonnables. Entre les perceptions de ces monades et de celles des âmes il y a différence. Ici en effet la per ception devient distincte au point d’engendrer ce qu’on appelle la réflexion ou la raison110. Là est le trait caractéristique de la monade esprit, elle conçoit les principes rationnels et puisque nous arrivons à l’âme humaine, exposons la psychologie de Leibniz. Il faut distinguer la théorie de la connaissance ou de l’intelligence et la théorie de la liberté ou de la volonté. Théorie de la connaissance. — Ce qui distingue la monade esprit de la monade âme, c’est qu’elle perçoit les principes d’identité ou de contradiction et de raison suffisante. Le principe d’identité d’après Leibniz est le principe de la possibilité, le principe de la raison suffisante est le principe de l’être ou des existences111. En effet dire d’une chose qu’elle n’est pas absurde, c’est dire qu’elle est possible,
LEIBNIZ
33
mais ce n’est pas affirmer qu’elle existe réellement. Pour qu’elle existe il faut que Dieu ait eu une raison de choisir ce possible parmi d’autres, il faut donc faire intervenir le principe de raison suffisante ou de per fection112. Car pourquoi un possible serait-il préféré à d’autres s’il n’était pas meilleur ? Donc principe des essences et principes des exis tences, voilà les deux connaissances fondamentales de la raison, voilà ce qui caractérise l’esprit. Ces deux principes en engendrent d’autres, en particulier le principe des indiscernables, et le principe de continuité. Le premier consiste à affirmer qu’il n’y a pas dans l’univers deux êtres identiques, car alors Dieu n’aurait eu aucune raison suffisante pour ne pas mettre l’un à la place de l’autre et réciproquement. De même le principe de raison suffisante exige qu’entre deux êtres donnés il y ait une infinité d’êtres intermédiaires, car il n’y a pas de rai son pour qu’un degré de la perfection soit réalisé plutôt que tous les autres. Comment l’esprit connaît-il de pareils principes ? Deux théories sont en présence. Celle de l’innéité de Descartes et celle de la table rase de Locke. Leibniz pour concilier ces deux opi nions se place tour à tour à deux points de vue : au point de vue du sens commun et au point de vue de la monadologie. 1° Faisons abstraction de la théorie des monades, admettons la théorie ordinaire sur l’âme et le corps113. Ne pourrait-on pas trouver entre le concept d’innéité et celui de table rase un intermédiaire, ne pourrait-on pas dire que les principes rationnels sont innés et acquis ? Innés en ce sens que nous avons dans l’esprit tout ce qu’il faut pour les former, acquis en ce sens que l’expérience seule nous les révélera. Cet intermédiaire entre l’innéité et l’absence totale, Leibniz l’appelle la vir tualité, les principes préexistent dans l’esprit mais virtuellement comme Hercule dans un bloc de marbre. « Rien n’existe dans l’intelli gence qui ne vienne de l’expérience sauf, dit-il, l’intelligence même. » [220] 2° Mais la doctrine des monades va nous fournir une explica tion qui sans différer de la première pour le fonds sera plus claire pour la forme. La monade ne peut pas sortir d’elle-même, donc toutes ses connaissances sont innées ; elle porte en elle la représentation fidèle de l’univers tout entier, mais si toutes les perceptions de l’âme préexistent en elle, elles préexistent confuses et sont pour l’âme comme si elles
34
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
n’étaient pas. Il faut pour qu’elle en prenne connaissance qu’elle dirige un jet de lumière sur les différents points de ce tableau confus ; c’est cette opération qu’on appelle percevoir extérieurement, connaître par expérience. Donc toutes nos connaissances nous viennent de l’expérience puisqu’elles passent de la confusion à la distinction, et toutes sont innées, car la monade ne saurait sortir d’elle-même. Théorie de la liberté. — Ici encore nous nous trouvons en pré sence de deux doctrines contradictoires : 1° Théorie de liberté d’indifférence115 que Leibniz ne paraît pas loin d’attribuer à Descartes. 2° Le fatalisme à la turque (fatum mahumetanumU(>). C’est le spino zisme qui en est l’expression la plus radicale117. D’après les premiers philosophes, l’esprit pourrait choisir entre deux actions contraires, la contingence de nos actions serait absolue. D’après Spinoza, il est impossible qu’une action soit autre chose qu’elle n’a été, pas de contingence, nécessité absolue. Ces deux théories doivent se faire des concessions mutuelles, on peut les concilier à la lumière d’une idée supérieure, celle de nécessité sans doute, mais de nécessité morale118. Remarquons que d’abord on ne peut admettre le destin à la turque parce que toujours nous nous sen tons capables de choisir, mais d’autre part on ne saurait admettre davantage la liberté d’indifférence, car nous n’agissons jamais sans motif et c’est un motif plus fort qui détermine notre choix. Il faut dire que lorsque nous agissons nous choisissons entre plusieurs motifs et nous optons nécessairement pour le meilleur119, il y a nécessité sans doute mais non géométrique comme celle de Spinoza ; c’est une nécessité morale, nous inclinons parce que nous le voulons vers le meilleur. Sans doute nous ne pouvons pas vouloir le contraire, c’est une bonne nécessité que celle-là, et analysant la liberté humaine, Leib niz y trouve les trois éléments de la liberté humaine parfaite : l’intelli gence, la spontanéité, la contingence120. On a dit non sans raison que cette doctrine était un véritable déterminisme ; c’est le premier exem plaire du déterminisme psychologique, tellement atténué que les parti sans de la liberté pourraient à la rigueur l’admettre.
LEIBNIZ
35
Elevons-nous au-dessus des esprits imparfaits, et arrivons à la monade parfaite, à l’esprit pur qui est Dieu121. Puisque tous les degrés de la perfection sont réalisés il faut qu’entre l’homme et Dieu il y ait des intermédiaires, ce sont les génies dont nous ne pouvons pas dire grand-chose122. La première question est celle de l’existence de Dieu ? L’existence de Dieu est une conséquence nécessaire de la doctrine des monades. En effet : 1° Puisque tous les degrés de perfection sont réalisés par la monade correspondante, il faut qu’une certaine monade représente la perfection absolue123. 2° Puisque les monades sont incapables d’agir les unes sur les autres et que tout est coordonné dans l’univers, il faut que quelqu’un ait préétabli une harmonie parfaite entre les monades. Dieu est néces saire sinon l’harmonie serait inexplicable124. 3° Nous savons que pour qu’un être soit possible, il suffit qu’il n’implique pas contradiction, et que de plus pour qu’il existe il faut qu’il ait une raison suffisante d’exister. Cette raison suffisante est [221] d’ailleurs une perfection ; d’abord l’être parfait est possible, car pour qu’il fût impossible125 il faudrait que quelque chose existât en dehors de lui l’empêchant d’exister, mais par hypothèse il n’y a que des degrés de perfection dans l’univers, donc rien ne peut empêcher la perfection d’exister. Dieu est alors possible. Reste à savoir s’il a une raison d’être. Mais puisqu’un être a d’autant plus de raison d’exister qu’il est plus parfait, l’être qui est la perfection même existe par cela seul qu’il est possible, donc si Dieu est possible, il est. Nous pouvons comprendre maintenant la critique célèbre de Leibniz contre la preuve ontologique de Descartes et de saint Anselme. Leibniz reproche à Descartes de s’être borné à dire que l’être parfait existe par cela seul qu’il est parfait. Il faudrait démontrer que Dieu est possible. S’il est possible, il faut qu’il existe par cela seul qu’on pense à lui, puisque la perfection est la raison d’être de toute existence. Si Dieu était impossible, l’argument n’aurait plus de valeur, il faudrait démontrer que Dieu est possible, c’est ce que Leibniz croit avoir ajouté à la preuve cartésienne126. Quels sont les
36
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
attributs127 de ce Dieu ? Nous trouvons ici la théorie cartésienne de la liberté d’indifférence, Dieu créant les vérités morales128, etc., et d’autre part la doctrine spinoziste, toute contingence étant exclue du développement et des manifestations de l’être divin129. Il est absurde et même impie, dit Leibniz, de prêter à Dieu une liberté d’indiffé rence. Ceci reviendrait à dire que si Dieu l’avait voulu l’assassinat serait chose morale130, mais le destin appliqué aux actes de la Provi dence est tout aussi insoutenable. Nous disons que Dieu obéit à une nécessité morale, il choisit entre deux contraires, mais ne peut choi sir que le meilleur. Tout autre choix serait contraire à son essence131. C’est une nécessité, mais une heureuse nécessité, elle ne contraint pas la volonté divine mais l’incline. Nous pouvons dès lors redescendre dans le monde créé et nous rendre compte des rapports entre Dieu et les autres monades132. Les monades ont été créées par Dieu et Leibniz appelle cette création fulguration™. Il est inutile de soutenir avec Descartes la création continuelle134, Dieu a voulu une fois pour toutes le bien de l’univers, et l’harmonie préétablie est dirigée dans ce sens. Ici se place la théorie de l’opti misme135. Leibniz après avoir réfuté les arguments contre la Provi dence, se plaçant au point de vue du sens commun, se place au point de vue de la monadologie. Tout ce qui n’est pas absurde est possible, mais pour que l’existence se joigne à la possibilité il faut que le pos sible soit compossible avec les autres possibles. Or quand nous voulons un bien à la place d’un mal, nous ne réfléchissons pas que pour que cette modification s’opérât il faudrait avoir choisi un système différent de compossibles et ce système eût été pire que le nôtre. Dieu ne pou vait pas choisir parmi tous les mondes possibles un autre monde pos sible, que le meilleur. Morale de Leibniz. — Leibniz n’a jamais traité qu’incidemment des questions de morale. Néanmoins on peut reconstituer sa doctrine morale, elle n est pas sans rapports avec sa métaphysique. D abord, le bien n’est pas, comme le soutenait Descartes, une créa tion de Dieu, c est déshonorer la divinité que de la considérer comme supérieure aux lois de la morale.
LEIBNIZ
37
Avant que Dieu eût décidé de créer l'homme, les vertus étaient bonnes. Qu’est-ce que la bonté ? Leibniz, comme Locke, identifie le bon et l’agréable. On divise le bien, dit-il, en honnête, agréable et utile136, mais dans le fond il [222] faut bien qu’il soit agréable sinon on ne le rechercherait pas, il semble donc que Leibniz va aboutir à une morale égoïste, mais ce n’est là qu’une apparence, car le plaisir n’est que la mesure du bien, et tout agrément se ramène aux sentiments qu’on a d’un accroissement de perfection. De même qu’en musique on éprouve du plaisir à entendre des accords sans s’apercevoir distinctement que le charme de ces accords tient à ce que des rapports géométriques existent entre les nombres de vibrations des diverses notes137, ainsi on s’attache au plaisir pour le plaisir et on ne voit pas nettement que dans tout plaisir il y a un accroissement de perfection ou de valeur pour la personne. Si l’objet du plaisir est la perfection, on ne peut pas dire que l’in clination au plaisir soit une inclination purement égoïste, elle n’est pas sans analogie avec le penchant artistique. De plus il y aura des degrés dans le plaisir selon qu’il correspond à une perception plus distincte. La joie est supérieure au plaisir pur et simple, parce qu’elle considère la possession d’un bien comme assurée et anticipe sur l’avenir. Enfin le bonheur vaut encore mieux que la joie puisque c’est une joie conti nue. Or, l’amour du bonheur consiste dans un désir de joies toujours de plus en plus parfaites, et ainsi il y a une échelle de plaisirs, et plus le plaisir est intense, plus il se rapproche de la perfection, de sorte que le souverain Bien est en même temps l’extrême béatitude138. Comme d’ailleurs le plaisir d’autrui est une partie de notre plaisir, tous les esprits sont unis par un lien invisible et forment la cité de Dieu, la monarchie universelle. L’homme de bien aime tous les hommes et cette charité devenue habitude constitue la justice, de sorte que pour Leibniz, la félicité est le fondement de la justice. Mais Dieu est la plus parfaite et la plus heureuse des natures, donc c’est lui surtout que nous aimons, puisque nous aimons le bonheur et que Dieu est le bonheur parfait139. Etre heureux, c’est donc aimer Dieu et le connaître ; Leibniz aboutit ainsi à la même conception du bon-
38
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
heur que celle de Platon, d’Aristote, de saint Thomas et de Spinoza. Le bonheur et la moralité consistent l’un et l’autre dans la science absolue ou ce qui revient au même dans la connaissance de Dieu. Chez Leibniz, cette théorie se rattache à celle de la monade. La monade en effet est d’autant plus parfaite qu’elle a des perceptions plus distinctes, et plus ces perceptions sont distinctes plus elles se rapprochent de Dieu qui perçoit la totalité des choses, d’où résulte que se rapprocher de Dieu, le connaître, l’aimer, pratiquer le bien et cultiver la science, tout cela ne fait qu’une seule et même chose140. Il faut également rattacher à la monodologie la doctrine morale et théologique de la Grâce. Leibniz partant de l’harmonie préétablie déclare que si le méchant est esclave de ses passions, c’est que sa nature lui a servi ; il n’est pas né méchant, mais il est né avec des dispositions qui le condamnaient à le devenir. Dieu a donc ses élus et c’est à ceux-ci, surtout, que la morale s’adresse, car elle leur permet de développer les bonnes dispo sitions qui se trouvent en eux.
KANT
[223] Kant est né à Koenigsberg en 1724. Il est mort en 1804, n’étant jamais sorti de sa ville natale. Ses principaux ouvrages sont : Critique de la raison pure. Critique de la raison pratique. Critique du jugement (ouvrage d’esthétique). fondement de la métaphysique des mœurs. Prolégomènes à toute métaphysique future, etc. Kant se propose de chercher les limites de la connaissance humaine. Longtemps, dit-il, on a discuté pour savoir ce qui limitait la terre, on a trouvé que la terre sphérique n’avait pas de limite proprement dite. Ainsi les métaphysiciens discutent sur les idées et se battent contre elles alors que ce ne sont que des ombres. Avant donc d’aborder la métaphy-
KANT
39
sique, il faut se demander si elle est possible, si notre esprit est capable de connaître les choses comme elles sont141. Ce problème, Kant le résout dans le sens idéaliste, il est d’avis que sans doute des matériaux sont don nés à notre connaissance mais que c’est notre esprit qui les coordonne, qui en forme de prétendus objets. Kant a comparé lui-même sa réforme en philosophie à celle de Copernic en astronomie142. Copernic a montré que c’était la terre qui tournait et non pas le soleil, en dépit des appa rences ; ainsi nous croyons que c’est dans les objets que se rencontrent l’unité, la régularité, et c’est nous qui les y mettons. L’esthétique transcendantale. — La première partie de la Cri tique de la raison pure intitulée « Esthétique transcendantale » (le mot esthétique signifie ici science de la sensibilité) a pour objet de prouver que ni le temps ni l’espace ne sont dans les choses. Ce sont des formes pures de notre sensibilité. En d’autres termes, notre faculté de sentir est ainsi faite que nous ne pouvons éprouver les sensations sans nous les représenter juxtaposées ou successives, sans les placer dans le temps ou l’espace ; de là vient que l’extériorité des corps si on la prend au sens que lui attribue le vulgaire est une illusion. Nous croyons à des objets extérieurs parce que nous les localisons dans l’espace mais l’espace n’est qu’en nous, c’est une forme de la sensibilité. Analyse DES concepts. — Dans cette seconde partie du même ouvrage, Kant entreprend de montrer qu’après avoir groupé les sensa tions pour en faire des objets en les localisant, nous groupons les objets, nous établissons entre eux des rapports qui s’expriment par des jugements sans que ces jugements correspondent à une réalité objec tive143. L’entendement pour relier les phénomènes ou objets établit entre eux des relations invariables dont les principales sont celles de causalité ou d’action réciproque. En appliquant ces relations nous fai sons de l’univers une immense chaîne, dont les anneaux sont enchaî nés les uns dans les autres par une inflexible nécessité. Nous obtenons ainsi un monde physique et parfaitement ordonné où tout se tient, où tout s’enchaîne et peut se calculer. Mais il faut bien se dire que cet . ordre n’est pas dans les choses, que c’est nous qui l’y mettons parce
40
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
que nous ne pouvons pas penser autrement que par le moyen des caté gories de notre entendement, véritables tiroirs où nous cachons les choses, moules qui façonnent à leur image les objets ou phénomènes qui y ont passé. Ainsi jusqu’ici nous ne voyons pas que l’esprit puisse atteindre le noumène, la chose en soi, telle qu’elle existe dans l’ab solu144 ; certains matériaux [224] nous sont donnés qu’on appelle sen sations, et l’esprit appliquant sa forme à cette matière en fait des objets en les localisant dans le temps et l’espace, puis rattachant ces objets entre eux au moyen des catégories de l’entendement. Dans la « Dialectique transcendantale », Kant aborde145 franche ment le problème : d’où vient que nous croyons connaître des choses en soi, l'âme, le monde, Dieu : voilà les trois choses en soi, les principes absolus que notre raison croit atteindre et sur lesquels roule toute la métaphysique. Pouvons-nous les atteindre, les connaître ? L'âme. — Notre conscience groupe les faits psychologiques et nous les présente comme formant un tout, mais n’est-il pas vraisem blable que notre conscience impose sa forme146 à ce qu’elle perçoit ; de ce que nous percevons notre moi comme UN, il ne suit nullement que le moi le soit147. Quand nous nous considérons comme des substances, c’est que nous croyons bien à tort peut-être à son unité, laquelle pour rait bien être une unité purement phénoménale. Le monde. — Si maintenant on prétend attribuer au monde une existence objective comme on fait pour l’âme, on se heurte à des contradictions ou comme dit Kant à des antinomies. On peut démontrer avec une égale rigueur que : 1 / Le monde est limité et illimité dans le temps et l’espace ; 2 / Il est divisible en parties simples et divisible à l’infini ; 3/11 laisse une place à la liberté morale et cependant le déterminisme des phénomènes est absolu ; 4/11 existe un être nécessaire et tous les êtres sont contingents. Si sur ces divers points on peut soutenir le pour et le contre, c’est qu’on discute sur des choses qui objectivement ne peuvent pas être reconnues par la raison.
KANT
41
Dieu. — Enfin il est facile de voir que notre croyance théorique à l'existence de Dieu dérive de la même illusion que notre croyance à un monde sensible objectif. Kant examine les trois preuves typiques selon lui de l’existence de Dieu, il les ramène d’ailleurs à la preuve ontologique et s’efforce de démontrer qu’ici comme ailleurs nous érigeons en vérité objective une exigence de notre pensée. La conclusion de la Critique de la raison pure est que la chose en soi nous échappe ; nous ne connaissons que des phénomènes que nous lions en vertu des exigences de notre esprit. Nous pouvons avoir pleine confiance dans l’expérience148 qui ne nous offre que des phénomènes. Dès que nous prétendons avec le métaphy sicien entrer dans le domaine de l’absolu149 nous nous heurtons à des contradictions, nous ne savons plus à quoi nous avons affaire, nous ressemblons à la colombe légère qui fatiguée de la résistance de l’air s’imaginerait qu’elle volerait mieux dans le vide150. « Critique de la raison pratique ». — La morale. — Mais ce que Kant essaie de renverser, il va le reconstruire, tout ce qu’il retire à la métaphysique, il le donne à la morale. Par l’intelligence pure, par les sens, par l’entendement et la raison, nous n’atteignons que les appa rences. Mais si nous nous transportons des idées ou de la raison pure à l’action ou à la raison pratique, nous trouvons que nous touchons à la réalité, nous avons comme une vue sur la chose en soi. En effet parmi les jugements que notre intelligence connaît et formule, il y en a un et un seul qui prend pour nous la forme d’un impératif catégorique151, c’est le devoir, la loi morale ; ce jugement n’est pas comme les autres, il n’ex plique pas comme les autres jugements un rapport d’identité ou de cau salité ou d’action réciproque entre le sujet et l’attribut. [225] Donc, il ne peut pas avoir pour origine comme les autres juge ments l’imposition d’une catégorie de notre entendement aux choses, on peut dire alors, c’est ce qui reste en dernier lieu, qu’il est comme une vue sur l’absolu, une vérité qui n’est pas comme les autres l’œuvre de notre entendement, mais qui s’impose à nous toute faite152. L’existence de cet impératif catégorique donne à la personne humaine une valeur absolue car toutes les autres fins que l’activité humaine se propose ne sont que
42
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
provisoires, des moyens relatifs à d’autres fins, mais seul l’accomplisse ment du devoir est une fin en rw153, une fin absolue, car seul le devoir pré sente la forme d’un impératif inconditionné ou catégorique. Il n’y a donc qu’une seule chose bonne, la bonne volonté, la volonté libre et rai sonnable est à elle-même sa propre fin, elle ne peut vouloir que sa liberté, elle est autonome pour employer l’expression célèbre de Kant. Toute doctrine qui fait de la loi morale un impératif hypothétique et qui fait dépendre la liberté d’une autre fin que la liberté elle-même est une doctrine d'hétéronomie et non plus d’autonomie. Partant de cette idée de la moralité Kant en déduit trois formules de la loi morale : 1 / Traite toujours la volonté libre et raisonnable en toi-même et chez autrui comme une fin et non comme un moyen. 2 / Agis comme si tu étais législateur en même temps que sujet dans la république des volontés libres et raisonnables, c’est-à-dire considère-toi dans la république des âmes comme étant à la fois souve rain et sujet, selon que tu penses à tes droits ou à tes pouvoirs. 3 / Agis toujours de manière que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. Mais, comme nous le disions, Kant va reconstruire sur l’impératif catégorique comme base une espèce de métaphysique154. Nous avons montré comment l’existence de Dieu et l’immortalité de l’âme étaient d’après lui des postulats de la raison pratique, c’est-à-dire des vérités qu’on doit admettre sans démonstration dès qu’on croit à une loi morale absolue. Reste la liberté compromise par la critique de la raison pure. Mais comment nier la liberté humaine ? Si le devoir n’est pas une chimère, il faut admettre qu’au-dessus de nous, du moi-phénomène qui n’est pas libre puisque chacune de ses actions est déterminée par tout ce qui précède, il y a un moi, il y a un moi-noumène155 que nous ne perce vons pas par la conscience, qui agit cependant et dont les actes ne sont perçus par nous qu’en tant qu’ils viennent prendre place dans la série des phénomènes. Il ne nous reste plus qu’un mot à dire sur la Critique dujugement.
L’ANALYSE ET LA SYNTHÈSE
43
h.*art. — La beauté tient le milieu entre la vérité dont s’occupe la science et la bonté qui est l’objet de la morale. La beauté, selon Kant, n’est qu’une représentation symbolique de la liberté156, au moyen des formes de la vie. C’est cette théorie légèrement modifiée que nous avons exposée dans le cours. Le beau se présente sous une forme finie et déterminée, le sublime157 est caractérisé par l’infini, le sentiment du sublime touche à la tristesse par certains côtés. L’immense supériorité de l’objet contemplé cause à notre âme une espèce d’angoisse, mais cette idée de notre petitesse matérielle qui nous frappe alors fait d’autant plus res sortir notre grandeur morale.
L’ANALYSE ET LA SYNTHÈSE
[292] On appelle analyse, le procédé par lequel on décompose un tout en ses parties. On distingue quelquefois l’analyse réelle de l’ana lyse idéale : la première aboutit à des éléments capables d’exister par eux-mêmes. Ainsi l’analyse de l’eau donne de l’oxygène et de l’hydro gène qui existent au même titre qu’elle. L’analyse idéale résout un tout en parties incapables de s’en détacher réellement, mais qu’un effort d’abstraction isole cependant. Ainsi l’analyse de la responsabilité met tra en lumière un certain nombre de conditions qui ne pourront pas cependant s’isoler les unes des autres. On appelle synthèse l’opération inverse. Elle consiste à reconsti tuer un tout avec ses éléments. Cette reconstitution est quelquefois purement idéale comme il arrive en psychologie par exemple. Com binez deux sentiments entre eux, vous obtenez un état mixte que vous pouvez vous représenter mais que vous serez incapable de pro duire expérimentalement. La synthèse est réelle au contraire quand elle aboutit à une chose existant pour soi au même titre que les élé ments composants158. Règles de l’analyse et de la synthèse159. — Ces opérations doi vent être : 1 / exactes ; 2 / complètes. Exactes en ce sens qu’aucun élé-
44
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
ment étranger ne doit être introduit. Complètes parce qu’il faut tenir compte de tous les éléments. Rôle DE L’analyse ET de la SYNTHÈSE. — L’utilité de l’analyse est de nous faire savoir de quoi les choses sont faites. Or, c’est là un des buts de la science, car, si les éléments d’un tout ne suffisent pas à l’ex pliquer, ils doivent néanmoins occuper une place dans l’explication. Ils constituent ce qu’Aristote appelait la cause matérielle. Quand on envisage l’analyse à ce point de vue, l’utilité de la synthèse160 est de lui servir de vérification. En effet, il n’y a guère qu’un moyen de s’assurer qu’on possède bien les éléments d’un tout, qu’on n’en néglige aucun, et qu’aucun terme étranger ne s’est introduit, c’est de reconstituer le tout avec les mêmes éléments. Ainsi la synthèse sert de vérification à l’analyse, etc. Mais ce n’est pas tout. Car si la connaissance des éléments ou de la matière importe à la science, c’est surtout parce qu’elle contribue à sim plifier la connaissance que nous avons des choses. On pourrait croire que l’analyse résolvant un tout en des éléments multiples ne fait qu’en compliquer l’étude, c’est ainsi que la chimie substitue à l’eau une combi naison d’oxygène et d’hydrogène, c’est-à-dire deux choses au lieu d’une. Cette résolution serait antiscientifique, en effet, si elle ne devait pas aboutir à une simplification. En effet le nombre des corps d’aspects dif férents est indéfini ; la chimie découvre chaque jour des substances nou velles, mais l’analyse nous conduit à un très petit nombre de corps sim ples qui entrent dans des proportions diverses au sein de ces substances, qui se combinent à l’infini entre eux, et engendrent la multiplicité tou jours croissante des espèces chimiques, malgré leur nombre restreint. L’analyse aboutit donc ici à une simplification161 puisqu’elle substitue quelques corps en nombre déterminé à une multitude indéfinie de sub stances, c’est ainsi que l’analyse résout un mot en ses lettres, ce qui paraît une complication d’abord, puisque le mot est un son simple et que les lettres sont multiples. Cependant, comme le nombre des éléments communs à tous les mots est très restreint, puisqu’il aboutit à 24 lettres seule ment, l’analyse ramène à un très petit nombre de termes une accumula tion indéfinie d’objets composés.
L’ANALYSE ET LA SYNTHÈSE
45
[293] Bref, le rôle de l’analyse quand elle porte sur des choses réelles est d’en simplifier énormément l’étude en nous faisant décou vrir sous des formes très diverses en apparence et dont la multitude n’a pas de bornes quelques éléments toujours les mêmes qui se combi nent dans des proportions différentes. Quoique décomposant, elle ramène le multiple à l’unité. Si le rôle de l’analyse et de la synthèse est aisé à définir quand les opérations portent sur des objets matériels susceptibles d’être décom posés et recomposés, il n’en est pas de même quand il s’agit de concepts ou de réalités non tangibles. Nous allons passer en revue les diverses sciences et indiquer brièvement en quoi l’analyse et la synthèse consistent dans chacune d’elles. La marche analytique consiste ici à partir 1° Les mathématiques. de la question posée que l’on considère un instant comme résolue et à tirer des conséquences de l’hypothèse qu’on a ainsi faite jusqu’à ce qu’on arrive à une proposition démontrée ou à certains rapports bien déterminés entre des éléments connus (voir la méthode mathé matique). Nous n’expliquerons plus ici en détail l’artifice de cette méthode, il s’agit simplement de faire comprendre en quoi c’est une analyse162. Elle consiste à décomposer pour ainsi dire l’énoncé de la question, de manière à résoudre cette question complexe en questions déjà réso lues, ou en théorèmes déjà démontrés. Il y a ici une analyse véritable, la déduction consiste à faire sortir de l’énoncé certaines conséquences qui y étaient contenues et qui sont justement de nature à le démontrer si c’est un théorème, ou à le résoudre si c’est un problème. La marche synthétique consiste à se reporter au contraire à une proposition déjà connue d’où puisse se déduire celle qui est à démon trer, à supposer qu’il s’agisse d’un théorème. Pourquoi dit-on ici qu’il y a synthèse ? Parce qu’on reconstitue le tout dont le théorème à démontrer n’était qu’une partie, parce qu’on se transporte à une pro position qui contenait parmi ses conséquences celle qui est à démon trer. Résoudre une question par synthèse c’est la replacer au sein du tout dont elle n’était qu’un élément.
46
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
2° Les sciences physiques. — C’est ici que le rôle de l’analyse et de la synthèse est le plus clair, puisqu’on a affaire à des touts réels et à des éléments réels aussi. Pourtant il ne faudrait pas se faire illusion sur les rapports de ces deux opérations comme il arrive quand on a négligé les hautes études philosophiques. C’est un axiome163, semble-t-il, que la proposition sui vante : il n’y a pas autre chose dans un tout que ses parties. C’est pour quoi on affirme que l’eau n’est que la somme d’un certain volume d’hydrogène et d’un volume d’oxygène moitié moindre. Pourtant si l’eau n’était que O + H, comment ce corps présenterait-il des pro priétés que ne possèdent ni l’oxygène ni l’hydrogène ? Comment offri rait-il à nos sens un aspect tout différent ? C’est que dans la combinaison entre autre chose encore que les éléments composants, un je-ne-saisquoi164, disent les philosophes, qui fait que les éléments s’agencent entre eux d’une certaine manière, c’est ce que M. Hirn165 appellera la force. En effet, pour exprimer métaphysiquement ce qui se produit quand on combine de l’oxygène et de l’hydrogène, il ne faudrait pas écrire HO = H + O166, mais eau = O + H + énergie. En effet, il a fallu dépenser de la force électrique ou de la chaleur pour coordonner entre eux les atomes des deux corps, et cette force subsiste dans la combinai son bien qu’elle ne soit pas un élément palpable. La preuve en est que, pour décomposer l’eau, il faudrait faire intervenir une force afin [294] de vaincre la résistance de celle qui retient les molécules. Or, c’est pour n’avoir pas fait cette remarque si simple que bien des savants se sont trompés sur le rôle et la portée de l’analyse. Il est faux que celle-ci nous renseigne sur tout ce qui entre dans le com posé ; elle néglige nécessairement le lien qui unissait les éléments entre eux, ce qui expliquait l’ordre des éléments et la place que chacun d’eux occupait au sein du tout. Le but de la synthèse n’est donc pas seule ment de vérifier l’analyse, comme un examen superficiel pourrait nous le faire croire tout d’abord, mais encore de nous renseigner sur la coordination des éléments entre eux et le rapport que chacun d’eux soutient avec tous les autres. 3° Sciences naturelles. — C’est ici surtout que cette remarque aura son importance. L anatomie résout les organes en tissus, les tissus en
L’ANALYSE ET LA SYNTHÈSE
47
filament et cellules, les cellules en protoplasma, le protoplasma en corps simples. Mais l’impossibilité où nous sommes de pratiquer une synthèse prouve assez que nous avons négligé chemin faisant un terme important, le plus important peut-être, c’est-à-dire l’organisme. Telle est l’erreur fondamentale du matérialisme. Il ne comprend pas qu’il y a dans le tout autre chose que ses éléments, à savoir ce qui retient les éléments entre eux dans un certain ordre plutôt que dans un autre. C’est ce terme que Claude Bernard appelle l’idée directrice167. Toute fois l’analyse a ceci de bon qu’elle nous montre les conditions essen tielles de la production du phénomène, ce sans quoi le phénomène n’aurait pas lieu, elle aboutit à des conditions nécessaires en d’autres termes, mais non pas suffisantes. 4° Sciences psychologiques. — L’analyse résout l’âme en facultés ; elle distingue des faits intellectuels, sensibles et volontaires ; elle n’a d’ail leurs d’autre utilité ici que la commodité de l’étude, puisque ces phé nomènes se pénètrent toujours dans la réalité. Ce qui fait de l’analyse un procédé peu rigoureux, en psychologie, c’est précisément l’impos sibilité où l’on a été jusqu’ici de séparer les éléments l’un de l’autre, de les isoler effectivement ; l’analysé est restée tout idéale. Toutefois les procédés d’expérimentation dont nous disposons aujourd’hui chan gent sans doute cet état de choses168, car remarquons en passant tout procédé d’expérimentation ou d’induction est un procédé d’analyse consistant à isoler certaines conditions pour déterminer si le phéno mène se produira encore. 5° La métaphysique. — Si toute science consiste par une analyse préalable de l’objet pour aboutir ensuite à une synthèse, c’est par la synthèse au contraire que la métaphysique commence. Son but est en effet de reconstituer l’ensemble des choses et profitant sans doute des analyses partielles que les sciences spéciales ont pu faire. Les systèmes philosophiques sont des constructions en effet et c’est pourquoi on donne le nom d’esprit synthétique à celui qui va les169 chercher dans l’ensemble, qui aspire aux principes généraux, aux esprits philosophes en un mot. L’esprit analytique aura au contraire une tendance à ne voir que les détails. Remarquons, pour conclure, que Descartes a défini ces deux opé-
48
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
rations dans la deuxième partie du Discours de la méthode, la première règle définit l’analyse et la troisième la synthèse, mais c’est surtout de l’analyse et de la synthèse mathématiques qu’il a voulu parler.
PHILOSOPHIE ÉCOSSAISE ET ANGLAISE170
[226] Ecole écossaise. — Le fondateur de cette école est David Hume (1711-1776). C’est le premier philosophe qui ait attaché de l’im portance à l’association des idées. Il distingue : 1 / les associations par ressemblances ; 2 / les associations par contiguïté ; 3 / les associations par succession nécessaire ou causalité. En effet, le point capital de la doctrine de Hume est la réduction de l’idée de cause à celle de succession nécessaire. Il a ainsi formulé contre l’idée métaphysique de cause les mêmes critiques que l’Irlandais Berkeley a dirigées contre l’idée de substance ; ce sont donc deux idéa listes. D’après Hume la nécessité apparente du principe de causalité tient uniquement à la forte habitude que nous avons contractée d’asso cier deux phénomènes consécutifs. Adam Smith (1723-1790) est un des fondateurs de l’économie poli tique. Nous connaissons sa doctrine morale fondée sur le sentiment171. Avec Thomas Reid172 (1710-1796) l’école écossaise est entrée dans une voie nouvelle, et quand nous parlons des Ecossais, c’est à cette partie de l’école écossaise que nous faisons allusion. Thomas Reid est d’avis qu’il faut laisser de côté la métaphysique et s’en rapporter au sens commun. La vraie méthode consiste à noter et à observer les faits psychologiques sans se soucier des ques tions métaphysiques de cause, de substance, etc. Sur ce dernier point le sens commun nous renseigne suffisamment. En d’autres termes, Reid, s’inspirant de Bacon, réduit la psychologie à une étude empi rique des phénomènes. Rappelons sa théorie des qualités primaires et secondaires, celle des perceptions naturelles et acquises ; rappelons cette multiplicité de
PHILOSOPHIES ANGLAISE ET FRANÇAISE
49
facultés qu’il trouve dans l’âme humaine inventant pour chaque fait nouveau une faculté nouvelle. Dugald Stewart s’est inspiré des mêmes principes, mais Hamilton, le dernier des grands philosophes écossais, s’est élevé à des vues plus systématiques, remontant à Kant et à Hume, il s’efforça de démontrer le principe qui peut justifier la psychologie purement empirique ; il essaya d’établir que l’absolu est inconnaissable. La thèse restée célèbre est celle de la relativité de la connaissance. L’objet connu par nous serait d’après lui toujours relatif à nous. PHILOSOPHIE ANGLAISE
La philosophie anglaise, toujours empirique au fond, a suivi une évolution continue depuis Bacon jusqu’à Spencer en passant par Hobbes, Locke, Berkeley, Bentham, etc. Les plus grands noms sont dans ce siècle : Stuart Mill, Bain173. PHILOSOPHIE FRANÇAISE
La philosophie française de ce siècle a d’abord été une réaction contre le sensualisme de Condillac, réaction opérée sous l’influence des idées de Kant par Maine de Biran (1770-1824). Condillac avait nié la réalité substantielle du moi, Maine de Biran la rétablit. D’après lui le moi se révèle surtout dans Veffort. L’effort serait la manifestation évidente d’une force ou substance. Nous pénétrerions grâce à lui dans le monde métaphysique. Royer Collard, plutôt orateur174 que philosophe, fut frappé d’une inspiration subite le jour où il lut les philosophes écossais175 ; il essaya [227] d’introduire en France la philosophie du sens commun. Jouffroy enseigna des doctrines analogues avec un accent plus personnel. A son disciple Victor Cousin176 revient l’honneur d’avoir fondé l’éclectisme. Ce philosophe après avoir suivi les panthéistes allemands eut l’idée de recueillir dans les divers systèmes les vérités les plus ac ceptables, celles qui froissent le moins le sens commun et il en com posa une philosophie dite éclectique, philosophie oratoire, fertile en contradictions177, mais qui a le mérite d’avoir conduit les esprits aux
50
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
études historiques. L’étude de l’histoire de la philosophie chez nous date de cette époque178. Les principales thèses de l’éclectisme sont : 1 / la croyance à l’objectivité des corps fondée sur le sens commun ; 2 / la croyance au moi substance, perçu par la conscience ; 3 / la croyance à des principes nécessaires et à des idées absolues four nies par une intuition rationnelle ; 4 / la distinction de plusieurs espèces de certitudes : physique, morale, mathématique, etc. ; 5 / enfin la distinction de quatre grands systèmes qui d’après Cousin se succèdent. Il faut rattacher à cette école MM. Saisset, Frank, Jules Simon et beaucoup d’autres. En face de cette école s’en dresse une autre dont l’influence fut encore plus considérable, nous voulons parler du positivisme dont le chef est le mathématicien Auguste Comte. Nous connaissons sa théo rie des trois époques. Aujourd’hui dans la période positive ou déve loppement de l’humanité, nous devons nous abstenir selon lui de toute métaphysique, nous en tenir aux faits. Ajoutons qu’aucun philo sophe ne fit autant de métaphysique qu’Auguste Comte. Dans un grand ouvrage, Cours de philosophie positive, Comte a passé en revue toutes les sciences humaines depuis les mathématiques jusqu’à ce qu’il appelle la sociologie et cette encyclopédie est dominée tout entière par une idée métaphysique à savoir que le supérieur s’explique par l’infé rieur, les faits psychologiques par des faits physiologiques, les faits physiologiques par des faits physiques et chimiques, les faits physiques et chimiques par des mouvements mécaniques. Ainsi, en dernière ana lyse c’est aux mathématiques que toute science se réduirait. Il est dès lors évident que Comte en dépit de son dédain pour la métaphysique se rattache à la grande tradition cartésienne. Il ne faudrait pas confondre le positivisme de Comte qui s’inspire de Descartes avec celui des Anglais, Stuart Mill par exemple qui s’inspire de Bacon. Les Economistes Proudhon, Saint-Simon, Fourier se rattachent au positi visme par certains points, mais le socialisme179 diffère du positivisme
PHILOSOPHIE ALLEMANDE
51
en ce qu’il n’a pas suivi une évolution constante, il s’est arrêté chez nous au milieu de ce siècle, et c’est à l’étranger qu’il faut chercher les continuations. PHILOSOPHIE ALLEMANDE
La philosophie allemande au commencement de ce siècle ne fit que développer les idées de Kant dans un sens idéaliste d’abord puis pan théiste. Fichte aboutit à un moi seul doué de réalité, et qui crée de toutes pièces un non-moi, c’est-à-dire un monde objectif. Schelling180 développe des idées analogues mais dans un sens plus réaliste. Dans son système de l’idéalisme transcendantal, il considère le moi et le non-moi non plus comme dérivant l’un de l’autre, mais comme déri vant l’un et l’autre d’un même principe, l’absolu. La science, l’art et enfm la religion sont les trois étapes par lesquelles nous arrivons à la connaissance de cet absolu. Hegel poussant ses idées à l’extrême abou tit au panthéisme. D’après lui l’absolu n’est pas, il devient, tout est en [228] voie d’évolution, une seule chose est le devenir, synthèse de l’être et du non-être, c’est la contradiction d’après Hegel qui est le fond même des choses, le devenir n’est-il pas l’état d’une chose qui est et qui n’est pas tout à la fois181. Après Hegel la philosophie allemande se divise en deux branches bien distinctes. Les métaphysiciens et les hommes de sciences, les premiers ou s’en tiennent à Hegel ou remontent à Kant. Parmi ces derniers le plus illustre est Schopenhauer lequel s’élève avec violence contre Hegel quoiqu’il lui emprunte beaucoup, considère la volonté comme principe universel et aboutit au pessimisme. Son disciple Hartmann continue son œuvre182. Mais d’un autre côté l’hégélianisme comme on pouvait s’y attendre a engendré le matérialisme lequel est personnifié dans Buch ner et Moleschott183. De ce matérialisme est sortie l’école contempo raine de la psychologie physiologique dont le chef est Darwin, et Spencer est le chef de l’évolutionniste avec Darwin. I / L‘associationnisme{84. — Cette doctrine consiste à considérer la sensation comme le fait psychologique ultime auquel l’analyse ramène
52
PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
tous les autres et l’association comme l’unique rapport que l’esprit puisse établir entre les faits psychologiques. Dès lors : 1 / la perception des corps se réduira à une association de sensations présentes ou possibles ; 2 / le moi ne sera que la totalité de nos associations associées ; 3 / les principes rationnels ne seront que des associations d’idées ren dues inséparables par la multiplicité des expériences qui nous ont montré les idées associées ; 4 / les raisonnements (inductions, déductions) se ramènent eux aussi à des associations ou juxtapositions d’idées ; 5 / la loi morale enfin s’explique par l’association depuis longtemps établie et fortifiée par l’éducation entre l’idée de bonheur indivi duel et celle de bonheur général. II / L'évolutionnisme. — Darwin et Spencer sont arrivés l’un par des considérations d’histoire naturelle, l’autre par des considérations méta physiques185 à la doctrine de l’évolution. C’est chez Spencer que cette doctrine atteint le plus de généralité. D’après Spencer une grande loi régit l’univers tout entier, le monde matériel et le monde moral c’est le passage de l’homogène à l’hétérogène186. C’est ainsi que le monde où nous habitons a commencé par être une nébuleuse dont toutes les parties étaient uniformes. Des différenciations ont fait sortir un soleil et des planètes, et sur chaque planète ou sur notre terre des êtres de plus en plus complexes et par là même de plus en plus différents ont apparu ou pour mieux dire sont sortis les uns des autres. La sélection naturelle et la concurrence vitale expliquent d’après Spencer comme d’après Darwin187 la complexité croissante des êtres organisés. A l’ori gine nous trouvons peut-être une simple cellule née elle-même du hasard, des combinaisons chimiques que la nature opère. Si l’on passe de la nature à l’homme on expliquera sa croyance à des corps réels par l’évolution de l’intelligence qui a trouvé commode et avantageux dans la grande lutte pour la vie de grouper des sensations et d’en faire des objets établis. La croyance à un moi aura la même origine. L’apparente nécessité des principes rationnels vient uniquement de ce que nous avons perdu de vue leur origine purement expérimentale ; l’héré-
PHILOSOPHIE ALLEMANDE
53
dité et révolution rendront également compte du caractère obligatoire de la loi morale ; ainsi les problèmes qui paraissent insolubles, quand on considère les choses toutes faites et dans leur état actuel s’éclaircis sent aussitôt selon ces philosophes si l’on remonte à l’origine, [229] à l’époque où tout était confondu et si l’on explique les changements par des transitions insensibles. Ces psychologues rejettent le témoignage de la conscience, substi tuent la physiologie à la psychologie et déclarent que toute philoso phie doit s’en tenir là. A cette école s’en rattachent d’autres qui s’ins pirent du même principe, les psychophysiciens avec Fechner188 à leur tête. Ces écoles n’ont pas encore abouti à des résultats très intéres sants, citons seulement une discussion célèbre sur l’origine de la notion d’espace entre l’école nativistique inspirée par Jean Müller qui soutient que la notion de l’espace est innée à l’œil et d’autre part l’école empiristique qui soutient que cette perception est acquise et qui a pour elle Lotze et Helmoltz189.
II LEÇONS
D’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE AU LYCÉE HENRI-IV 1893-1894
8 Leçons
BACON [293-69] François Bacon190 est né à Londres en 1561 et fit ses études à Cambridge ; il se destinait à la jurisprudence. Elu à la Chambre des communes en 1593, il ne s’y fit pas remarquer. Quelques années plus tard, il plut au roi Jacques Ier qui le nomma garde du Sceau, chancelier et pair d’Angleterre : il prit alors le nom de lord Verulamus (1617). De nombreux abus se commirent sous son minis tère, et en 1621 le Parlement l’en déclara responsable. Il fut déclaré coupable, condamné à une forte amende et à la prison perpétuelle. Le roi lui fit remise de sa peine. Il mourut en 1626. Note191. — Un historien anglais contemporain a dit de Bacon que c’est le Socrate britannique. En effet, malgré des différences profondes, il y a entre les deux esprits une grande analogie. Ce qui caractérise l’esprit et aussi l’œuvre de Bacon comme le socratisme, c’est le dédain de la fausse science. La tentative de Bacon, comme celle de Socrate, est une réaction du savoir précis, modeste, limité, contre les prétentions à la science universelle, contre les généralités vagues. Comme Socrate, Bacon restreint le domaine de la science; comme lui, il lui assigne comme premier objet l’utilité pra tique. Mais ici se révèle la différence des deux génies. Pour Socrate, qui est un Grec, l’utilité pratique c’est l’intérêt de l’âme, la moralité, la vertu, et c’est pourquoi il ramène la philosophie à la science morale. Pour Bacon, qui est anglais, l’utilité c’est l’intérêt matériel. Le premier intérêt de l’homme, c’est de se rendre maître de la nature et de faire servir la science à l’industrie. Enfin, l’un et l’autre ont compris que la méthode était l’essentiel de la science : Socrate passait pour avoir inventé la définition et l’induction ; Bacon n’est pas l’inventeur de la méthode expérimentale, mais il est un de ceux qui en ont le mieux pénétré l’esprit et compris l’importance. (Note dans le manuscrit.)
58
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
Il publia en 1605 son Traité de l’avancement des sciences, en anglais, qu’il traduisit plus tard en latin : De dignitate et augmentis scientiarum ; en 1620, le Novum Organum, destiné à remplacer YOrganon ou logique d’Aristote. Ces deux ouvrages furent réunis en un seul qui devait s’appeler înstauratio Magna scientiarum, et qui ne fut jamais achevé. Bacon a été particulièrement frappé par les découvertes scientifi ques de son temps et du siècle précédent. Ce qu’il remarque dans ces découvertes, c’est qu’elles ne sont pas dues toujours à un pur hasard. Dans certaines d’entre elles, et notamment dans la décou verte de l’Amérique, le raisonnement a joué un rôle. Ne pourrait-on déterminer les règles d’une méthode qui conduirait sûrement, et non plus accidentellement, à des inventions et des découvertes utiles ? Cette science que Bacon [294-70] entrevoit pour l’avenir, il en parle déjà en termes magnifiques : elle doit nous rendre maîtres de la nature, car plus on sait, plus on peut : « tantum potest [homo] quantum scit » ; elle n’engendre pas l’athéisme, quoique quelques esprits timorés le prétendent : « laves gustus ad atheismum movere, pleniores autem haustus ad religionem reducere ». Cette science, nous n’y parviendrons qu’en laissant de côté les Anciens, et en nous confiant à nos propres forces. Les Anciens savaient moins de choses que nous : « antiquitas saeculi, juventus mundi ». Nous n’y parvien drons qu’en nous tenant à égale distance des deux excès où la philo sophie est tombée jusqu’ici, d’un côté le pur empirisme, de l’autre le dogmatisme ou intellectualisme. L’empirisme pur est la méthode des alchimistes ; ils recueillent des faits, mais ne savent pas en tirer parti. On peut les comparer à des fourmis192 qui amassent des provisions et les emmagasinent telles qu’elles sont. Quant au dogmatisme ou intel lectualisme — et Bacon désigne par ces mots les philosophes pro prement dits, les disciples d’Aristote, les logiciens, etc. — Bacon les compare à l’araignée193 qui tire d’elle-même une toile subtile mais sans solidité. Il y a un milieu à tenir entre ces deux méthodes, dont l’une consiste à noter simplement les faits que fournit l’observation, à tout tirer du dehors, et l’autre à tout tirer de soi. Le véritable savant sera comme l’abeille194, qui [295-71] va de fleur en fleur cher-
BACON
59
cher ses matériaux, mais qui les transforme et en fait de la cire et du miel. Avant de tracer les règles de cette méthode, Bacon procède pre mièrement à une classification des sciences, et deuxièmement à une énumération des erreurs. Il faut délimiter le domaine de chaque science, pour éviter qu’elles empiètent les unes sur les autres, et pour que le savant sache ce qu’il cherche : rien de plus dangereux que de mêler la théologie à la phy sique. Il faut en outre déterminer les erreurs où nous sommes enclins à tomber afin que nous sachions les éviter. Premièrement, Bacon distingue trois groupes de sciences, corres pondant aux trois principales facultés de l’esprit195 : a) les sciences de mémoire ; b) les sciences d’imagination ; c) les sciences de raison. a) Les sciences de mémoire sont les diverses histoires, histoire politique, histoire ecclésiastique, histoire littéraire et histoire naturelle (histoire des monstres, cas pathologiques). b) Les sciences d’imagination : ce sont les diverses formes de la poésie, qui se ramènent à trois : la poésie narrative (épopée), la poésie dramatique, la poésie parabolique. c) Les sciences de la raison se subdivisent en deux groupes dont l’un comprend principalement la théologie inspirée, et l’autre la philosophie première. La théologie inspirée est l’étude de Dieu [296-71] fondée sur la révélation. La philosophie a un triple objet : Dieu, la nature et l’homme. « Philosophiae triplex propositum, Deus, natura, homo. » L’étude philosophique de Dieu appartient à la théologie naturelle. L’étude de la nature comprend deux parties principales, la métaphysique et la physique. La métaphysique a pour objet les causes finales196 ; la phy sique l’étude des causes efficientes. Quant à la science de l’homme, elle comprend d’une part l’étude du corps humain (médecine), de l’autre l’étude de l’âme (logique et éthique). Il faut remarquer que Bacon ne proscrit pas, comme on l’a dit quelquefois, la métaphysique. « La recherche des causes finales est sté-
60
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
rile, mais cela ne veut pas dire qu’elle soit inutile. » Elle appartient à une science distincte. Il ne faut pas mêler cette recherche aux recher ches physiques proprement dites. Bacon blâme Aristote d’avoir assi gné la détermination des causes finales pour objet à la science. Par là, Aristote a retardé de bien des siècles le progrès de la science. C’est Démocrite197 qui avait compris le véritable objet de la recherche scien tifique. Les Grecs étaient dans la bonne voie avec les premiers pen seurs. Socrate, Platon et surtout Aristote ont retardé le progrès de la science198. Bacon revient plusieurs fois sur cette idée, reprise par Grote, selon laquelle ces trois philosophies ont retardé le progrès de la science pour vingt siècles, en détournant les recherches de la physique vers la métaphysique. [297-72] Deuxièmement, la théorie de l’erreur va préparer l’exposé des principes de la méthode. Bacon appelle « idoles » nos erreurs. Il en distingue quatre espèces : a) Les idoles de la tribu, idola tribus, [sont] les erreurs communes à l’humanité, qui tiennent à la conformation de nos organes ou de notre intelligence. Ainsi, il y a des illusions des sens communes à tous, comme de voir ronde une tour carrée, ou recourbé un bâton à moitié plongé dans l’eau. Il y a des illusions de l’entendement199 qui tiennent à la forme de l’entendement : ainsi, nous tendons à ériger des cas par ticuliers en lois générales ; nous ne voulons pas admettre d’exception ; nous cherchons partout l’unité et la simplicité. De là un grand nombre d’erreurs, surtout dans les sciences. b) Les idoles de la caverne, idola specus : ce sont les erreurs qui tiennent à notre conformation individuelle, physique ou morale. Ainsi, certaines illusions des sens tiennent à un défaut des organes, défaut à nous particulier : les uns ne voient pas de loin ; d’autres ne voient pas de près. De même pour l’entendement : certains ne cher chent et ne comprennent que le détail et les vues générales leur échap pent ; d’autres ne pensent que par idées générales, et sont incapables de comprendre les faits. Certains aiment la nouveauté, d’autres l’anti quité : de là bien des erreurs. c) Les idoles du forum, idola fori : ce sont [298-74] les erreurs du langage. Beaucoup d’erreurs, selon Bacon, doivent être attribuées au
BACON
61
langage. Certains mots, tels que le mot hasard, sont vides de sens ; nous les employons toutefois, croyant penser à des choses ; il nous arrivera d’attribuer un effet au hasard, et de croire que nous l’avons expliqué. d) Les idoles du théâtre, idola theatri. Ces erreurs sont dues aux théories scientifiques, aux systèmes philosophiques. De même en effet que certains héros de théâtre finissent par nous faire l’effet de person nages ayant existé, de même que les héros de la fable finissent par devenir pour nous des êtres vivants, ainsi les théories philosophiques et scientifiques, qui ne sont que des hypothèses200, deviennent pour nous à la longue des vérités que nous mêlons aux faits comme si elles étaient des faits elles-mêmes. Cette classification va des erreurs profondes aux erreurs superfi cielles, et de l’inné à l’acquis. Les erreurs de la tribu sont inévitables ; celles du théâtre sont les plus aisées à éviter. Par certains côtés, cette analyse de nos erreurs fait pressentir la Critique de Kant. Les erreurs de la tribu en effet sont des erreurs qui expriment en quelque sorte la conformation de notre esprit. D’un bout à l’autre de cette analyse d’ailleurs, la même idée domine, l’idée que notre esprit ne reflète pas directement les choses, qü’il y a disproportion entre l’esprit et les choses ; que l’esprit impose aux choses qu’il pense sa propre forme, et [299-75] que par conséquent il les déforme : c’est un spéculum inaequale*201. Kant, comme nous verrons, a une idée analogue. Mais tandis que, pour Kant, l’esprit qui impose aux choses sa forme crée ainsi la vérité, parce que la vérité est relative à l’entendement, au contraire, pour Bacon, cette imposition de la forme de l’esprit aux choses est la source d’erreur par excellence. La méthode de Bacon. — Déterminons maintenant l’objet et les procédés de la méthode baconienne. L’objet de la science, d’après
* De cette idée que l’esprit est spéculum inaequale quod rerum radios immutat à la glorifi cation de l’expérience202, il n’y a qu’un pas. En effet, si l’esprit est un miroir qui dévie les rayons des choses, ce n’est pas en nous que nous trouverons les principes de la connais sance ; il faudra que l’esprit sorte de lui-même, qu’il se fasse écolier à l’école de la nature. L’expérience est le fond de la méthode baconienne. (Note dans le manuscrit.)
62
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
Bacon, est la recherche des formes*, et le sens qu’il donne à ce mot forme est très complexe. Tantôt il paraît identifier la forme avec la définition, ou, comme on dit en logique, avec la différence propre : la science se proposerait de définir, c’est-à-dire de distinguer. Tantôt il désigne sous ce nom l’essence, c’est-à-dire ce sans quoi la chose ne serait pas. Tantôt enfin il appelle forme la loi de génération de la chose. En d’autres termes, Bacon oscille entre la conception antique et l’idée moderne de la science. Pour les Anciens, l’objet de la science était de pénétrer jusqu’à l’essence des choses ; pour les Modernes, la science vise uniquement à rattacher les phénomènes les uns aux autres par des lois générales.
* Le but de la méthode expérimentale, l’objet de la philosophie baconienne, est la détermination de la forme. La forme, pour Bacon, est la loi de l’acte pur, lex actus puri. En y regardant de près, on trouve que Bacon est mécaniste ; malgré son horreur pour la déduction et la pure métaphysique, il se rallie au fond à la doctrine des atomes. Du reste, il ne dissimule pas son admiration pour Démocrite, qui fut, selon lui, le plus grand penseur de l’Antiquité. D’après lui, les propriétés des choses tien nent au groupement de leurs parties élémentaires, et les changements dans les choses, les phénomènes physiques, ne sont que des déplacements des parties : de sorte que la forme d’une chose c’est son essence, et c’est par là même la configuration de ses par ties et leur disposition, xai ôéaiç203. Mais, d’après Bacon, en même temps que les parties de la matière adoptent une certaine disposition, l’objet total se revêt de cer taines qualités qui frappent nos sens. Ces qualités s’expliquent au fond par l’ordre et le groupement des parties élémentaires. Le tort d’Aristote et de la scolastique fut de prendre ces qualités pour des réalités. La qualité est ce qu’Aristote appelait l’acte pur. On peut dire que la forme, entendue au sens de constitution élémentaire, est la condi tion ou la loi qui gouverne l’apparition de la qualité. C’est ce que signifie ce mot de Bacon « la forme est la loi de l’acte pur ». Nous trouvons donc chez Bacon, sous une forme incomplète, le mécanisme des Modernes. Mais, tandis que Descartes a compris que, si l’on réduisait les changements de la matière à des déplacements de parties, à des mouvements, il fallait mettre les qualités apparentes des choses dans l’esprit, dans le sujet, Bacon met dans les objets à la fois les mouvements et les qualités, et considère les qualités comme se superposant, pour ainsi dire, aux choses. Il est donc imparfaitement mécaniste. Il est plus imparfai tement encore criticiste. Le criticisme est cette doctrine qui fait de l’esprit et des formes de l’esprit le centre des choses. Bacon est le premier d’entre les Modernes qui ait signalé l’écart entre la pensée et son objet. Mais il a cru que cet écart pouvait se corriger par des observations bien faites ; il ne croit pas à la relativité essentielle de la connaissance. Il prépare donc le criticisme de la philosophie moderne, mais il est loin d’avoir formulé cette doctrine. (Note dans le manuscrit.)
BACON
63
Bacon se sépare des Anciens, mais il n’est pas encore avec la science moderne. Le but qu’il assigne à la science, à savoir la détermi nation des formes, n’est pas purement scientifique. Malgré lui, il fait encore à la métaphysique sa part. [300-76] Bacon nous dit par ailleurs en propres termes que la science doit se proposer la transmutation des choses204 les unes dans les autres : on doit chercher à faire de l’or, non seulement avec de l’ar gent, mais avec n’importe quels matériaux. Bacon n’est donc pas aussi loin des alchimistes qu’on le suppose souvent : par certains côtés, il appartient encore au Moyen Age. Mais ce qui est remarquable, c’est le moyen imaginé par lui pour atteindre le but des alchimistes. L’idée de Bacon, c’est qu’il faut considérer à part chacune des qualités de l’objet, chaleur, couleur, son, etc. ; déterminer la forme de cette qualité, c’est-à-dire son essence, et son origine. Alors, devenus capables de produire à volonté telles ou telles qualités, nous pourrons à volonté produire telles ou telles choses. Cette idée d’abstraire la qualité de la matière pour les soumettre isolément à l’analyse est une idée éminemment scientifique, que la physique moderne devait adopter. Ainsi, nous trouvons dans la philosophie de Bacon le plus curieux mélange d’idées empruntées au Moyen Age et d’idées modernes. Quels sont les procédés de la méthode baconienne ? Le procédé essentiel est l’induction205. Bacon a le plus profond mépris pour la méthode syllogistique, pour le raisonnement déductif. Les pré misses du syllogisme sont nécessairement des propositions géné rales ; ces propositions, comment les obtiendra-t-on, sinon par induction ? L’induction est donc le [301-77] procédé fécond206 ; il faut partir de l’expérience et généraliser. Cette induction peut prendre deux formes : 1° la généralisation graduelle ; 2° la réjection et l’exclusion. 1° Généralisation graduelle. — Une fois les faits recueillis par l’observateur, il ne faut pas, comme on l’a fait jusqu’ici, s’élever tout de suite aux axiomes les plus généraux. Il faut généraliser graduelle ment, c’est-à-dire formuler une loi d’une généralité restreinte, qui exprimera exactement les faits sans jamais les dépasser. Les lois ainsi
64
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
obtenues pourraient alors être comparées entre elles : on en tirera des lois plus générales. Ainsi, de proche en proche, le savant s’élè vera aux plus grandes généralisations. 2° Induction per exclusiones et rejectiones débitas207 (nécessaires). — Elle consiste à déterminer la cause des phénomènes, en éliminant toutes celles d’entre les conditions qui ne sont pas les véritables causes. Pour pratiquer cette élimination, Bacon veut qu’on dresse trois tables, table de présence, table d’absence et table de degrés. Dans la table de présence, on notera tous les cas où le phénomène se produit ; dans la table d’absence, tous ceux où le phénomène ne se produit pas, malgré des circonstances à peu près identiques à celles où il se produit ; dans la table de degrés, on fera figurer les varia tions quantitatives du phénomène à côté des variations quantitatives de ses conditions. Celle des conditions qui croît et décroît en même temps que le phénomène doit en être la cause. Cette méthode, comme on le voit, diffère du pur [302-78] em pirisme en ce qu’elle substitue à la simple énumération des faits obser vés une coordination et une généralisation scientifiques. Néanmoins, on peut lui reprocher d’êtrfe trop exclusivement expérimentale — si elle n’est plus empiriste208. Bacon se défie de l’esprit209. Il faut, dit-il, attacher du plomb à l’esprit, et non lui donner des ailes ; il proscrit l’hypothèse. Et, comme cela était naturel, il diminue de parti pris le rôle et l’importance des mathématiques. Il les classe parmi les sciences auxiliaires de la physique ; leur objet est de mesurer les objets et les effets que la physique observe. Toutefois, Bacon n’a pas réussi à élimi ner entièrement l’activité et la spontanéité intellectuelles dans la recherche scientifique. Et, quand il en vient à décrire les procédés d’expérimentation, force lui est bien de restituer à l’hypothèse la place à laquelle elle a droit. Il recommande au savant de varier l’expérience (variatio experimenti), de la transporter (translatio) d’un ordre d’objets à un autre, de la renverser (inversio experimenti). Ne sont-ce pas là autant d’inventions ? Conclusion. — On a dit que Bacon était le créateur de la méthode expérimentale. Quelques-uns n’ont pas hésité à le placer au pre-
BACON
65
mier rang parmi les savants. Il ne faut pas aller aussi loin. Bacon n’est pas un savant ; il n’a fait ni découverte, ni même de recherche scientifiques. Il ignore même, ou comprend mal, plusieurs des résultats acquis. Il n’a pas compris les lois de la chute des corps découvertes par [303-79] Galilée, ni le système de Copernic210. Ce n’est pas non plus le créateur de la méthode expérimentale, car cette méthode était connue et pratiquée avant lui, ne serait-ce que par Galilée, qui en tira un merveilleux parti. Bien plus, la théorie de la méthode expérimentale avait été faite avant Bacon par un savant qui fut surtout un grand artiste, Léonard de Vinci211. Même comme théoricien de la méthode expérimentale, Bacon est incomplet et sou vent dans l’erreur. Il n’a pas compris le rôle que le calcul était appelé à jouer dans la découverte scientifique. Il n’a pas fait à l’ima gination sa part, ni déterminé avec précision l’objet de la science, qui est de lier des phénomènes à des phénomènes suivant des rapports de causalité. Où donc est l’originalité de Bacon ? C’est comme philosophe, et mieux encore comme criticiste, si l’on peut appliquer ce nom à un philosophe antérieur à Kant, que Bacon doit être apprécié, bien plus que comme savant et que comme logicien. Bacon a été le premier à marquer avec précision l’écart, la disproportion entre l’esprit et les choses. Il a critiqué ainsi, avant Hume et avant Kant, l’entendement humain. Par là même, il a suggéré une certaine conception de la nature elle-même, qui est tout à fait opposée à la conception carté sienne. Tandis que Descartes, confiant dans l’intelligence humaine, croit à la possibilité d’une science purement déductive, d’une mathé matique universelle, Bacon estime qu’il faut généraliser [304-80] gra duellement, et qu’un moment arrive où les lois découvertes ne sont plus susceptibles d’être réduites à des lois plus générales. La nature ne formerait donc pas un système absolument conforme aux lois de notre logique, ne serait pas réductible à l’unité : force nous serait de nous arrêter quelque part en présence de lois qu’aucun effort de logique n’arrivera à fondre dans une loi plus générale. Si la méthode cartésienne, comme nous le verrons, implique comme postulat la parfaite intelligibilité de la nature, la méthode baconienne procède
66
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
comme si cette intelligibilité était des plus douteuses. Des deux phi losophes, de Bacon ou de Descartes, quel est celui qui est plus près de la vérité ? A cette question, la science de l’avenir et l’expérience pourront seules répondre212.
DESCARTES
[305-81] René Descartes est né en 1596 à La Haye en Touraine. Sa vie213 comprend trois périodes bien distinctes : la période des études, celle des voyages, et celle du séjour en Hollande. 1° (1604-1612). — Descartes étudie au collège de La Flèche chez les Jésuites ; les études qu’il y fait ne paraissent pas avoir satisfait son besoin de science et surtout de certitude. Seules les mathématiques lui donnèrent quelque contentement. 2° (1612-1629). Descartes, « quittant entièrement l’étude des Lettres », se résout « à ne chercher d’autre science que celle qui se pourrait trouver en lui-même ou dans le grand livre du monde ». Mais il trouve à peu près autant de diversité entre les mœurs des hommes qu’entre les opinions des philosophes. Aussi, après plusieurs campa gnes d’abord dans l’armée du prince de Nassau, ensuite dans celle du duc de Bavière ; après une série de grands voyages à travers l’Alle magne, la Suède, le Danemark, la Hollande, Descartes se résout à se fixer dans un pays où il ne soit en butte ni aux persécutions de ses ennemis ni surtout aux importunités de ses amis : il s’établit en Hol lande. Cette période de 1612 à 1629 est celle des recherches mathéma tiques, et métaphysiques. Descartes, parti des mathématiques s’élève graduellement à la métaphysique qui doit lui fournir les moyens d’apNote sur la réjection. — L’induction ne procède pas seulement par généralisation graduelle, mais encore par élimination, par rejectiones débitas. Ce que Bacon reproche aux Anciens, ce n’est pas seulement d’avoir mal observé et généralisé trop vite ; c’est de n’avoir tenu compte que des faits favorables à une hypothèse, sans s’inquiéter des faits qui l’infirment. Une expérience faite suggère l’idée d’une cause; mais cette sug gestion ne suffit pas : il faut chercher s’il n’y a pas des faits qui infirment l’hypothèse. En d’autres termes, la science antique se contente du vraisemblable, du probable; il faut la certitude. (Note dans le manuscrit.)
DESCARTES
67
pliquer la mathématique à toutes les sciences ; c’est dans cette période de sa vie que les règles de la méthode lui furent révélées une certaine nuit, dans plusieurs rêves successifs. A la suite de cette révélation, Descartes fit vœu d’un [306-82] pèlerinage à Notre-Dame-de-Lorette (pas sceptique en religion). 3° (1629-1649). — Descartes réside en Hollande ; c’est la période214 des recherches physiques. Descartes, après s’être élevé des mathémati ques à la métaphysique, descend de la métaphysique aux sciences de la nature. A plusieurs reprises, Descartes fut interrompu dans ses études par des persécutions heureusement peu dangereuses. C’est le recteur de l’Université d’Utrecht, Gilbert Boet, qui en était le principal auteur. Descartes y échappa grâce à la protection de l’ambassadeur de France. Mais, en 1649, menacé de nouvelles persécutions, il se ren dit à l’invitation que lui adressait Christine de Suède. Il mourut à Stockholm en 1650. Ses œuvres principales sont : — Discours de la méthode, publié à Leyde en 1637 ; — Meditationes de prima philosophia (plus tard traduites en français), Paris, 1641 ; — Principia philosophiae (traduits), Amsterdam, 1644 ; — Les passions de l’âme, Amsterdam, 1649. Ouvrages posthumes : — Le monde, ou Traité de la Lumière, 1664 ; — De l’homme, qui faisait suite, (et) détermina la vocation de Malebranche ; — Regulae ad directionem ingenii, 1701 ; — Correspondance sur divers sujets de morale et métaphysique ; — nombreux Opuscula physica et mathematica. [307-83] Objet de la philosophie cartésienne. — L’objet de Descartes ne paraît pas différer sensiblement de celui de Bacon, si l’on s’en tient à la lettre, sans approfondir l’esprit. Il veut nous « rendre maîtres et possesseurs de la nature »2,s. C’est ce que Bacon216 avait dit à peu près dans les mêmes termes. Mais tandis que Bacon nous donne
68
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
une théorie de l’invention, Descartes va nous donner une théorie de la découverte. Tandis que le premier ne voit de la science que les appli cations utiles, pratiques217, Descartes estime que les applications et inventions se trouveront d’elles-mêmes du jour où l’on connaîtra la véritable constitution des choses. S’il veut nous rendre maîtres et pos sesseurs de la nature, c’est d’une possession tout intellectuelle218 qu’il veut parler. L’objet de la science est de reconstruire idéalement l’uni vers, de le créer en quelque sorte à nouveau, de poser des principes tels qu’il suffise d’en déduire mathématiquement les conséquences pour retrouver les faits et toutes les choses qui se présentent à nous dans l’observation de la nature. Or, parmi les sciences qu’on lui a enseignées, les sciences connues de son temps, il en est une et une seule où Descartes trouve réunis les conditions et les caractères de cette science idéale. C’est la science mathématique, à condition toute fois qu’on la dégage de certaines obscurités, et qu’on perfectionne cer taines de ses méthodes. Seules les mathématiques lui plaisent à cause de l’évidence de leurs raisonnements219. Cherchant alors d’où vient cette évidence, et à quoi tiennent la clarté et la certitude supérieure des mathématiques, Descartes s’aperçoit qu’elles tiennent à deux causes. 1° Les principes d’où l’on part sont d’une absolue simplicité220. Ce sont des idées claires et distinctes, des idées construites par notre entendement, et dont nous- [303-84] connaissons entièrement le contenu. 2° Tout le reste des mathématiques se déduit de ces principes de telle sorte qu’à aucun moment de la déduction il ne soit possible de mettre en doute les résultats obtenus. Cette double condition, Des cartes en fait la condition de toute science certaine. Il faut premièrement partir d’idées claires et distinctes, ou, comme dit Descartes, de « natures simples » ; deuxièmement, procéder par déduction. De là l’idée d’une mathématique universelle221, c’est-à-dire d’une science analogue aux mathématiques, et qui s’appliquerait à toutes choses. La méthode de cette science serait la méthode mathématique, ou plutôt la méthode mathématique n’en serait qu’un cas particulier. Il faut trouver la mathématique universelle qui sert d’enveloppe.
DESCARTES
69
Qu’est-ce que cette méthode ? Descartes en expose les règles dans la seconde partie de Discours de la méthode. Dans cette seconde partie, Descartes examine tour à tour les trois méthodes qui semblaient d’abord « devoir contribuer [en] quelque chose à son dessein ». Ces trois méthodes sont la logique, l’analyse des géomètres et l’algèbre. La logique, et Descartes entend par là la méthode syllogistique d’Aristote, « sert plutôt à expliquer à autrui les choses qu’on sait ou à parler sans jugement des choses qu’on ignore ». Descartes est sur ce point de l’avis de Bacon. Tous deux sont d’accord pour déclarer le syl logisme inutile. Quant à l’analyse des géomètres, à l’analyse des Anciens, Descartes entend par là cette méthode usitée encore aujourd’hui dans la géométrie élémentaire, et qui consiste à supposer vraie la proposition à démontrer, puis à en tirer les conséquences, jusqu’à ce qu’on arrive à une proposi tion vraie ou évidente222. [309-85] Descartes reproche à cette méthode d’être « si astreinte à la considération des figures, qu’elle ne peut exercer l’entendement sans fatiguer beaucoup l’imagination ». Reste l’algèbre. La méthode algébrique est la méthode par excel lence pour Descartes, à condition qu’on la perfectionne, et Descartes la perfectionna lui-même par l’invention des exposants. Il généralisa l’emploi de l’algèbre et, pour éviter de fatiguer l’imagination en exer çant l’entendement, pour substituer le travail de l’entendement à celui de l’imagination, il imagina de remplacer l’analyse des Anciens par une analyse toute nouvelle, chaque figure étant représentée par une équation exprimant la propriété commune à tous ses points. Cette invention permettant à Descartes de résoudre « comme en se jouant » des problèmes auxquels les mathématiciens, ses contemporains, ne trouvèrent une solution qu’après de pénibles recherches. Et les merveilleux résultats qu’il obtint le confirmèrent dans l’idée que, par l’ap plication de l’analyse mathématique, c’est-à-dire de l’algèbre, à tout ordre d’objets, on pourrait sans effort, sans qu’il soit besoin de génie, et même d’imagination, aboutir aux plus belles découvertes et surtout réussir à tout expliquer. Autour de l’invention de la géométrie analy tique223 gravite la doctrine de Descartes. C’est ce qu’il faut se rappeler
70
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
toujours quand on le lit et qu’on commente les quatre règles du Dis cours de la méthode. 1° « Le premier [précepte] était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle, c’est-àdire d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et de ne comprendre [210-86] rien de plus en mes jugements que ce qui se pré senterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n’eusse aucune occasion de le mettre en doute. » Il faut voir dans cette règle la condamnation de l’autorité en matière scientifique. Le critérium du vrai n’est pas la parole du maître. C’est l’évidence. Mais ce mot n’a pas pour Descartes un sens banal. Il développe l’adverbe évidemment en deux autres : clairement et distinctement ; et dans ses Principes, il définit les deux termes : « J’ap pelle claire l’idée qui est présente et manifeste à un esprit attentif, et distincte celle qui est tellement précise et différente de toutes les autres qu’elle ne comprend en soi que ce qui paraît manifestement à celui qui la considère. » En d’autres termes, ce qui est évident pour Descartes, c’est l’idée dont l’esprit aperçoit tout le contenu. C’est ainsi que l’idée du cercle est claire et distincte pour le géomètre : l’ayant construite, il sait tout ce qu’il y a mis. En d’autres termes encore, une chose n’est évidente que lorsqu’elle est susceptible de prendre place dans un sys tème dont tous les termes se tiennent géométriquement. Ainsi Des cartes nous dit que l’existence du soleil n’est pas évidente pour celui qui le voit briller. Elle n’est évidente que pour l’astronome qui explique comment le soleil devait nécessairement se former étant donné l’état originel des choses224. Cette première règle implique donc une certaine conception de l’évidence. On y trouve aussi une allusion à la théorie cartésienne du jugement et de l’erreur dont nous parlerons plus loin. Descartes attri bue [311-87] le jugement à la volonté et l’erreur à une précipitation dont la volonté est responsable225. D’où ce précepte : « Eviter soi gneusement la précipitation et la prévention. » 2° « Le second de diviser chacune des difficultés que j’examinerais en autant de parcelles qu’il se pourrait et qu’il serait requis pour les mieux résoudre. » Cette règle définit et recommande l’analyse, mais
DESCARTES
71
l’analyse au sens cartésien du mot226, une analyse idéale et non pas réelle. Ce ne sont pas en effet les objets qu’il faut diviser en parcelles, ce sont les difficultés. Descartes estime en effet qu’il y a un nombre défini d’idées claires et distinctes, par exemple les idées d’étendre, de nombre, de mouvement, d’infini, de figure, de pensée, etc. L’objet de la science doit être de décomposer les phénomènes, les objets et les problèmes, de manière à les ramener à une ou plusieurs de ces notions simples. Alors, raisonnant géométriquement sur ces notions simples, on en déduira les phénomènes ou les objets qu’on se proposait d’expli quer. Exemple : soit à expliquer la lumière. On la résoudra par analyse en figures et mouvements. Il ne restera plus qu’à rechercher quels mouvements et quelles figures se composant ensemble engendrent la lumière227. 3° « La troisième de conduire par ordre mes pensées en commen çant par les objets les plus simples et aussi les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu comme par degrés jusqu’à la connaissance des plus composés, et supposant même de l’ordre entre ceux qui ne se pré cèdent point naturellement les uns les autres. » [312-88] Cette troisième règle définit et recommande la synthèse et l’hypothèse, mais une synthèse et une hypothèse d’un genre tout par ticulier. C’est sur des idées encore et non sur des choses que portera la synthèse. Il s’agit ici d’une synthèse mathématique et non pas chi mique. Descartes veut que l’on parte des objets les plus simples et les plus aisés à connaître, c’est-à-dire de ces idées claires et distinctes qu’il appelle les natures simples. Avec ces idées claires et distinctes, on recomposera par la pensée les objets réels. C’est ainsi qu’on montera jusqu’à la connaissance de la lumière en commençant par l’étendue, la figure et le mouvement228. Descartes veut que nous supposions même de l’ordre entre les objets qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. Il entend par là que lorsque l’esprit n’aperçoit pas le rapport des choses réelles ou observées aux idées simples, il faut faire quelque hypothèse sur ce rapport et voir si elle se vérifie. Le plus sou vent, c’est le calcul qui nous renseignera. 4° « Le dernier de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales que je fusse assuré de ne rien omettre.
72
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
Nous trouvons dans cette règle d’abord un principe de prudence, ensuite un complément de la troisième règle, mais surtout une allusion à ces procédés que Bacon tenait pour essentiels et qui pour Descartes ne sont qu’auxiliaires : l’observation et l’expérimentation. Ces deux mots ne sont pas prononcés dans le Discours de la méthode, et il semble que l’on ait pu dire avec raison que Descartes prétendait [313-89] appli quer à toutes les sciences une méthode de déduction a priori229. Toute fois, en fait nous savons que Descartes observait et expérimentait beaucoup ; et en droit il a déterminé le rôle de l’observation et de l’expérimentation230. D’après lui, l’observation sert plutôt à poser les problèmes qu’à les résoudre. Elle nous apprendra qu’il y a de la lumière et qu’il y a des couleurs. Elle pose ainsi les problèmes de l’optique, mais c’est à l’esprit armé du raisonnement et du calcul qu’il appartient de les résoudre. Les dénombrements entiers et les revues générales, ce sont des dénombrements et des revues de faits donnés dans l’expérience. Descartes assigne encore à l’expérience un autre rôle. Quand nous partons des idées claires et distinctes pour en déduire l’explication des phénomènes naturels, nous aboutissons souvent à plu sieurs solutions que la pure mathématique déclare également valables. Ainsi, une équation de degré n donne n solutions. C’est à l’expérience de décider entre ces solutions également possibles. Car une seule d’entre elles est bonne. En résumé, le rôle de l’expérience est double pour Descartes : 1 / elle pose les problèmes ; 2 / elle opère un choix, une sélection entre les hypothèses et surtout entre les conséquences également possibles auxquelles le calcul conduit. Telle est la méthode cartésienne, si profondément différente de la méthode baconienne. Bacon relègue les mathématiques parmi les sciences auxiliaires, l’hypothèse parmi les procédés auxiliaires, il met en première ligne l’observation et l’expérimentation. Descartes fait de la mathématique la science par excellence ; l’hypothèse et la déduction passent ainsi au premier rang. L’observation et l’expérimentation deviennent des procédés complémentaires. La méthode [314-90] carté-
DESCARTES
73
sienne est celle d’un penseur qui a confiance dans l’entendement humain, qui croit à l’intelligibilité des choses ; c’est-à-dire à l’accord des choses avec la pensée. Sur quel fondement Descartes a-t-il étayé cette croyance ? D’où vient qu’il se croit autorisé à remplacer la diver sité des sciences par l’unité d’une mathématique qui embrasserait tout ? Nous allons examiner les raisons pour lesquelles Descartes éli mine tour à tour de son esprit les connaissances qu’il a reçues, pour les remplacer par une science systématique. Le doute provisoire ou doute méthodique. — Descartes va renoncer tour à tour à toutes les opinions qu’il a reçues « en sa créance ». Il doutera de l’existence des choses extérieures, il doutera de ses raisonnements ; il doutera de toute connaissance, connaissance vul gaire et connaissance scientifique. Quelles sont les raisons de ce doute ? Descartes cherche la certi tude, et tout ce qu’on lui a appris, et tout ce qu’il a appris ne lui paraît jamais que vraisemblable231. Nulle part il ne trouve cette évidence qu’il cherche, la vérité s’imposant par sa seule force. S’agit-il des données des sens ? Nous ne sommes jamais assurés de ne point rêver, de n’être point dupes d’une illusion. Peut-être même le monde extérieur tout entier n’est-il qu’une grande fantasmagorie ? S’agit-il du raisonne ment ? Certes, si nous pouvions apercevoir tout d’un coup le principe posé avec toutes les conséquences qu’on en tire, le doute serait impos sible : car le doute cartésien ne porte pas sur les données de l’intuition (quoique ce point ait été contesté). Mais la déduction exige un certain temps, et, pendant que j’aperçois les conséquences, je puis avoir oublié le principe ou me tromper sur sa nature. En d’autres termes, la mémoire intervient dans le raisonnement, et je ne suis [315-91] jamais sûr de ma mémoire. Il se pourrait qu’un malin génie prît plaisir à me tromper, à fausser mes souvenirs, et je n’en saurais rien. On comprendra l’argumentation cartésienne si l’on se reporte à l’idée que Descartes se fait du temps et de l’activité de Dieu232. D’après Descartes, Dieu crée de nouveau toutes choses à tous les instants de la durée, et Descartes a été conduit à cette théorie de la création conti nuée par l’idée que les moments du temps sont indépendants les uns
74
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
des autres. La durée est discontinue. Il n’y a aucune raison logique pour que le monde matériel et moral soit dans un instant d’ici ce qu’il est en ce moment. Dès lors, nous ne sommes absolument certains d’une vérité de raisonnement que si ce raisonnement est instantané. Dès que le temps intervient, rien ne dit que ce qui était vrai l’instant auparavant n’a pas cessé de l’être. Ainsi, quand notre pensée s’exerce dans l’espace, elle risque de prendre l’illusion pour la réalité et, comme nous dirions aujourd’hui, de confondre le subjectif avec l’objectif. Et quand notre pensée s’exerce dans le temps, elle risque d’être égarée par la mémoire, la mémoire étant comme l’imagination une faculté secondaire, et l’évidence n’étant absolue que lorsque la conséquence est aperçue dans le principe. Le doute de Descartes respecte donc les données de l’intuition ; mais il ne respecte qu’elles et, en ce sens, il est aussi vaste que le doute des sceptiques. Il en diffère cependant profondément et par sa nature et par son but. Le sceptique doute pour douter ; il s’arrête au doute. Descartes doute pour arriver à la [316-92] certitude ; son doute est provisoire, ce n’est qu’un artifice de méthode, un procédé logique. Descartes nous le dit en propres termes : il ne tend qu’à s’assurer et à trouver le roc sous l’argile233. Il cherche ce qui est évident derrière ce qui est simplement probable, et s’il se défait de toutes les opinions qu’il a reçues en sa créance, c’est pour les reconstruire ensuite sur de nouvelles bases. Le « COGITO, ERGO SUM ». — Et en effet234, si je puis douter des choses extérieures, douter même de mes raisonnements, si je vide ma pensée de tout ce qu’elle a reçu jusqu’à ce jour, quelque chose demeure cependant, à savoir la pensée elle-même. Je pense, voilà une vérité indubitable. Ici le doute n’est plus permis, parce que toutes les raisons que j’avais de douter ont disparu. Quand je dis : je pense, je n’affirme pas par là l’existence de quelque objet extérieur à ma pen sée ; ainsi je ne suis plus dans la même incertitude où j’étais en parlant des choses matérielles. Bien plus, l’incertitude qui naissait de l’inter vention de la mémoire et de l’action de la durée est écartée à son tour, car la conscience que j’ai de ma pensée accompagne tous les actes de
DESCARTES
75
ma pensée. C’est donc une idée que je renouvelle à tous les instants de la durée et qui est toujours présente. Mais si je pense, j’existe en tant que pensant. L’existence substantielle de ma pensée n’est pas démon trée encore sans doute ; mais ce qui est mis à l’abri de toute incerti tude, c’est le phénomène de la pensée, le fait de la pensée en tant que ce [317-93] fait se renouvelle à tous les moments de la durée, toujours semblable à lui-même. Le cogito, ergo sum va jouer un double rôle et rendre un double service : 1 / il nous assure au moins de quelque connaissance indiscutable, à savoir celle de notre propre existence en tant que nous sommes des êtres pensants ; 2 / il va nous fournir le type, le critérium de toute vérité possible. Examinant en effet cette vérité, je trouve qu’elle n’est assurée que parce qu’elle est tellement claire et tellement distincte qu’il est impos sible de la mettre en doute. Nous dirons donc que la clarté et la dis tinction, c’est-à-dire l’évidence, sont la marque du vrai. De L’EXISTENCE DE Dieu. — Je dois maintenant prouver l’exis tence substantielle de la pensée, l’existence des choses matérielles et enfin reconstruire sur de nouveaux fondements la science de la nature et celle de la pensée. Pour passer du phénomène de la pensée à l’existence réelle d’une âme pensante, pour prouver la réalité du monde matériel, pour déter miner la vraie nature de l’âme et de la matière, je vais considérer une certaine idée telle qu’elle ne puisse être conçue sans envelopper, sans impliquer [318-94] l’existence réelle, l’existence substantielle de son objet. Cette idée est l’idée de Dieu. C’est dans la 4e partie du Discours de la méthode735 que Descartes prouve l’existence de Dieu. Les preuves sont au nombre de trois. Les deux premières n’ont guère d’autre objet que d’amener la troisième. Première preuve236. — Réfléchissant sur son doute qui est une marque d’imperfection, Descartes s’aperçoit qu’il ne pourrait tenir ce doute comme une imperfection s’il n’avait pas l’idée de la perfection.
76
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
Or toute idée est un certain effet qui suppose une cause, et il faut qu’il y ait dans la cause au moins autant de perfection que dans l’effet. La cause de l’idée de perfection ne peut donc être que l’Etre parfait. Donc Dieu existe. Deuxième preuve237. — J’existe et j’ai l’idée de parfait. Mais quelle est la cause de mon existence ? Cette cause ne peut être moi, car alors je me serais donné à moi-même cette perfection que je conçois et qui me manque. Cette cause est-elle quelque être imparfait ? Pas davan tage, car il faut qu’il y ait dans la cause réelle autant de perfection au moins que dans l’effet. Donc l’auteur de mon être est Dieu. Troisième preuvem. — Nous concevons Dieu comme un être qui possède toutes les perfections. Or, l’existence est une perfection. Donc Dieu existe par cela seul que je pense à lui. Sinon ce ne serait plus à l’Etre parfait que j’aurais pensé. [319-95] Cette preuve, dite preuve ontologique, avait déjà été don née, mais sous une forme beaucoup moins rigoureuse, par saint Anselme de Cantorbery239. Descartes ne la connaissait pas, nous dit-il, il l’a retrouvée. C’est la preuve cartésienne par excellence. Des cartes en effet cherche une idée telle que par cela seul qu’il la conçoit, il puisse affirmer l’existence réelle de son objet. Or l’existence de l’Etre parfait est la seule qui soit dans ce cas. L’idée de Dieu enve loppe l’être. J’ai trouvé enfin l’inébranlable fondement de toute vérité : l’Etre parfait, Dieu. Quels sont, d’après Descartes, les attributs de Dieu240 ? Je dois chercher ce qu’enveloppe l’idée de perfection. Dès lors, j’attribuerai à Dieu, en les portant à une puissance infinie, les qualités que j’observe en moi : 1° la volonté ; 2° l’intelligence. Les philosophes du Moyen Age241 discutaient sur la question de savoir si c’est la volonté qui prime l’intelligence en Dieu, ou si c’est l’intelligence (la sagesse comme on disait) qui prime la volonté. Dans la première hypothèse qui est celle des franciscains, tout ce que Dieu veut est juste et vrai par cela seul qu’il l’a voulu : Dieu est donc créateur de la justice et de la vérité. Au contraire, d’après les dominicains (saint Thomas) l’entende ment de Dieu prime sa volonté, de telle sorte qu’il veut toujours et nécessairement ce que son intelligence lui représente comme le meil-
DESCARTES
77
leur. C’est à la première opinion que Descartes se rallie : Dieu crée arbitrairement le juste et le vrai ; ce sont des décrets arbitraires de Dieu que nous qualifions ainsi. Toutefois, Descartes ajoute qu’il serait contraire à la nature de Dieu de revenir sur ces décrets. Si donc Dieu est libre d’une liberté d’indifférence, il s’astreint lui-même à certaines lois. C’est également d’un décret arbitraire de Dieu qu’est sorti le monde. Bien plus, le monde ne vit et ne continue d’être que parce que Dieu le crée de nouveau à tous les moments de la durée. [320-96] Les ESSENCES et les existences. — Nous pouvons main tenant affirmer et que nous existons nous-mêmes comme substances, et que les choses matérielles existent. En effet, Dieu, qui est l’Etre par fait, ne peut pas vouloir nous tromper, et si nous croyons fermement à l’existence d’un monde distinct de nous, ce monde est un monde réel242. Nous pouvons d’autre part écarter l’hypothèse d’un malin génie. Certes, les moments du temps sont indépendants les uns des autres. Mais Dieu, qui ne peut vouloir nous tromper, crée toujours le monde à l’image de ce qu’il est au moment précédent. Enfm, nous pouvons être assurés de notre propre existence comme êtres pensants, puisque nous y croyons fermement, puisque nous en avons l’idée claire et distincte. Ainsi Dieu nous est garant de la vérité des idées claires et distinctes243. L’évidence de notre propre existence et l’évi dence de l’existence des choses reposent en dernière analyse sur la garantie que Dieu nous en fournit. On a parlé d’un cercle vicieux, on fait allusion au cercle carté sien244. Descartes, a-t-on dit, fonde l’existence de Dieu sur l’évidence, puis il nous donne comme garantie de l’évidence la véracité divine. Il n’y a pas cependant de cercle vicieux ici, mais il y a une distinction très subtile à faire. Ce qui est évident par soi et avant la démonstration de l’existence de Dieu, c’est l’existence des idées claires et distinctes, et même des idées en général, en tant que [321-97] pures idées dans l’es prit. Mais, une fois l’existence de Dieu démontrée, c’est l’existence des objets de ces idées qui devient évidente. Mais non seulement je puis affirmer l’existence de l’âme et du corps, [mais encore] je puis aussi en déterminer l’essence. En effet, ce
78
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
qu’il y a d’essentiel dans les choses doit avoir été représenté clairement et distinctement par Dieu dans mon esprit. Quelle est l’idée claire et distincte que j’ai du corps ? C’est l’idée d’étendue, car seule l’idée d’étendue, avec ses différents modes, le mouvement, la forme, la gran deur, etc., se prête à la déduction et au calcul. Donc l’essence de la matière est l’étendue, la matière est res extenso245. Quelle est d’autre part l’idée claire et distincte que je me forme de l’âme ? C’est de la pensée. Je définirai donc l’âme res cogitans. Dès lors, je puis connaître l’âme et connaître le corps, puisque j’en ai déterminé l’essence. Science de L’âme. — La psychologie cartésienne est une psycholo gie déductive, puisque Descartes part d’une certaine définition de l’âme : res cogitans. Toutefois, l’observation y tient une place plus grande sans doute que n’eût voulu le philosophe. Etudions tour à tour les deux fonctions de la pensée : l’entendement et la volonté. L’entendement est le siège des idées claires et distinctes, des idées se rapportant aux « natures simples ». Descartes répartit nos idées246 en trois catégories : les idées innées, les idées adventices et les idées factices. — Les idées innées247 sont les idées claires et distinctes et [322-98] toute idée, quelle qu’elle soit, qu’elle vienne du dehors ou du dedans, doit se ramener par analyse à une ou plusieurs des idées innées248. — Les idées adventices sont celles qui nous viennent du dehors par les sens. — Les idées factices, celles que l’imagination construit en juxtaposant les don nées des sens (idée du Centaure). Les idées adventices et factices viennent donc des sens, de l’imagi nation et de la mémoire, facultés que Descartes considère comme infé rieures, simples dépendances de l’entendement, et qui n’existent que parce que la pensée est unie à un corps. On peut dire qu’un des prin cipaux objets de la philosophie cartésienne a été de substituer l’activité de l’entendement à celle de l’imagination, des sens et de la mémoire, c’est-à-dire au fond de substituer la déduction et le calcul à l’observa tion décousue et fragmentaire des choses. Mais, pour cela, il fallait prouver que les sens et l’imagination ne font que traduire dans une langue imparfaite et enfantine les mêmes choses que l’entendement nous présente sous leur forme claire et distincte, c’est-à-dire dans leur
DESCARTES
79
essence même. C’est l’Etre parfait qui est destiné, dans la philosophie cartésienne, à nous garantir cette équivalence. En d’autres termes, c’est la métaphysique qui fonde la physique249, c’est la métaphysique qui nous permet d’affirmer a priori que les images présentées sans ordre à nos sens sont réductibles à des idées qui se déduisent mathé matiquement les unes des autres. [323-99] L’entendement ne nous fournit d’ailleurs que des idées — pour juger, il faut que la volonté intervienne250. La théorie carté sienne du jugement et de l’erreur repose tout entière sur cette idée qu’il y a disproportion entre l’entendement et la volonté. Notre entendement est fini ; nous avons reçu de Dieu les idées innées, elles sont la source de toute vérité, il ne nous appartient pas de les modi fier. Notre entendement est donc borné, fini, puisqu’il ne peut pas tout penser. Mais notre volonté peut tout vouloir et c’est même par là que nous sommes infinis et que nous participons à l’infinité divine. Or tout ce que Dieu veut devient nécessairement vrai par cela seul qu’il le veut. Ce qui revient à dire que le jugement de Dieu est infail lible parce que son entendement et sa volonté sont infinis l’un et l’autre. Mais nous pouvons vouloir, êtres finis que nous sommes, autre chose que ce que Dieu a voulu être vrai, autre chose que ce que notre entendement nous représente être clair et distinct. De là l’erreur. L’erreur vient donc de ce que notre volonté infinie, capable de tout vouloir, se décide pour raffirmation de l’existence réelle d’une idée, alors que cette idée n’est pas encore claire et distincte pour l’entendement. Toute erreur vient d’une précipitation du juge ment. Que sera la liberté dans cette théorie ? Descartes est un des rares philosophes qui ait affirmé nettement la liberté humaine251. [324-100] Notre volonté étant infinie, nous pouvons tout choisir, et choisir sans motif, s’il nous plaît. En d’autres termes, nous possé dons la liberté d’indifférence. Toutefois cette liberté, comme dit Des cartes252, n’est que le plus bas degré de la liberté. Il n’est pas digne d’un être raisonnable de choisir autre chose que ce qui est bon et juste. Nous devons donc user de notre liberté d’indifférence, c’est-à-dire de notre libre arbitre, pour choisir le meilleur et c’est dans ce choix que résidera la véritable liberté253. Voilà la différence entre la liberté
80
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
humaine et la liberté divine. En Dieu, il n’y a que la liberté d’indiffé rence, parce que ce que Dieu choisit indifféremment devient le meil leur pour cela seul que Dieu l’a choisi. Mais l’homme est en présence d’un bien, d’une justice, d’une vérité voulus par Dieu, et qu’il reçoit tout faits. La liberté d’indifférence ne peut donc plus être le mode nor mal de son activité. Il ne peut qu’utiliser cette liberté d’indifférence pour conformer son choix à la volonté divine. Science de L’étendue. — La physique cartésienne est déduite plus encore que la psychologie cartésienne. Descartes part de cette défini tion de la matière : res extensa. Cette définition étant posée d’une part, et les attributs de Dieu étant donnés de l’autre, toutes les propriétés de l’Univers s’ensuivent : 1° L’étendue est conçue comme étant sans limites. Donc l’Univers est indéfini254. 2° Puisque la matière est identique à l’étendue, tout ce qui est [325-101] étendue est matière. Il n’y a donc pas d’espace sans matière, il n’y a pas de vide dans l’Univers255 : ce qui paraît vide est rempli d’une matière plus subtile256. 3° Puisqu’il n’y a pas de vide, tout mouvement, considéré dans son ensemble, doit prendre la forme d’un tourbillon257. Soit, en effet, un corps qui se meut de A en B. A
/ A
B
;
\ (A
/
B
Puisqu’il se meut dans le plein, il faut qu’il pousse devant lui une cer taine quantité de matière. Cette matière en meut une autre à son tour. Or, comme il n’y a nulle part d’espace vide où puisse se réfugier en dernier lieu la matière déplacée, il faut bien que ce mouvement de A en B soit l’occasion d’un tourbillon, c’est-à-dire d’un mouvement cir culaire de matière qui fait que les parties séparées se remplacent les unes les autres.
DESCARTES
81
4° Il résulte de la volonté où est Dieu de conserver le monde tel qu’il est (création continuée), que la même quantité de matière et de mouvement se conserve dans le monde258. 5° Puisque la matière n’est que l’étendue, tout changement sur venu dans la matière est un déplacement dans l’espace, c’est-à-dire un mouvement. Les qualités sensibles, la lumière, la chaleur, le son, la pesanteur même doivent donc se réduire en dehors de nous à des mouvements qu’accomplissent les corpuscules constitutifs des corps. Descartes arrive donc déductivement à cette conclusion qui est le principe de la physique contemporaine, à savoir que les propriétés de la matière doivent s’expliquer par des mouvements : mouvements vibratoires ou mouvements de translation. Physiologie cartésienne. — Si toute substance est ou pensée ou étendue, que sera, que doit être le corps vivant ? Ce ne peut être que de l’étendue, puisque ce n’est pas de la pensée. Descartes n’explique donc pas la vie par un principe spécial, distinct de la matière. Il ne voit dans le corps vivant qu’une machine259 plus compliquée que les nôtres, mais de même nature. Il est donc purement mécaniste. Ici encore il est en avance sur son temps. — Claude Bernard260 a dit que s’il y a autre chose dans le corps vivant [326-102] que des faits physiques et chimi ques, s’il y a une idée directrice, un principe de coordination intelli gent, néanmoins le savant, le physiologiste ne doit pas en tenir compte : parce que cela seul est de son domaine qui peut être observé à l’expérimentation. La même raison fait que Descartes refuse toute conscience à l’animal. La pensée est indivisible et n’admet pas de degrés. Elle est tout entière en chacun de ceux qui la possèdent. Si la bête n’est pas douée d’entendement, elle ne possède la pensée à aucun degré, et par suite elle ne peut ni vouloir ni sentir. Donc l’animal est une machine, un automate. Cette thèse à laquelle Descartes était conduit par le développement de son système, il la confirma par divers arguments. 1° L’animal ne parle pas ; or s’il pensait, il inventerait sûrement un langage261.
82
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
2° L’animal n’invente pas ; il nous paraît accomplir des ouvrages merveilleux, mais si nous modifions les conditions où il agit, il conti nue d’agir de la même manière. (Darwin dira tout le côntraire262.) 3° Si les bêtes ont une âme, il faudra leur accorder l’immortalité comme à l’âme humaine, ou bien, de ce que leur âme est mortelle, on conclura que la nôtre l’est aussi. C’est pourquoi Descartes traite d’im piété la croyance à la sensibilité des bêtes. Union de L’âme et du corps. — Descartes a distingué deux substances essentiellement différentes : la pensée et l’étendue. Com ment peuvent-elles communiquer entre elles, n’ayant aucun attribut commun ? A cette question, Descartes n’a pas répondu263. Mais plus préoccupé du réel qu’on ne le pense, il se sent obligé de tenir compte de la communication de ces deux substances, puisqu’en fait l’étendue agit sur la pensée et la pensée sur l’étendue. Descartes imagine donc en outre de264 la pensée et l’étendue non pas une troisième substance, mais un troisième principe d’explication qu’il appelle union de l’âme et du corps. Cette union de l’âme et du corps, nous en trouvons l’expression [327-103] matérielle dans les esprits animaux. Les esprits animaux sont matière, mais matière extrê mement subtile que le sang dégage et qui, circulant à travers les tubes nerveux, impressionnent la glande pinéale où Descartes localise la pensée265. C’est par le jeu des esprits animaux que s’expliquent la per ception des corps, la mémoire, l’imagination, l’habitude et la passion. Les objets extérieurs et les corpuscules qui les composent, toujours en mouvement, agitent les organes de nos sens et par suite les esprits ani maux, qui transmettent ce mouvement à la glande pinéale. Ainsi naît dans l’âme la sensation. Quant à la passion proprement dite, c’est aux esprits animaux qu’il faut l’attribuer. Le mot passion a deux sens chez Descartes : tantôt il désigne tout état de l’âme où n’intervient pas la volonté, et par suite l’idée pure qui n’est pas encore affirmation, qui n’est pas encore juge ment, s’appellera passion ; mais plus souvent Descartes désigne par ce mot266 les troubles ou agitations de l’âme dus aux mouvements déré glés des esprits animaux. Ce sont des états qui ne naissent pas de l’âme
DESCARTES
83
elle-même, mais de son union avec le corps. Il a étudié ces mouve ments dans son Traité des passions. Morale. — C’est dans la 3e partie du Discours de la méthode que Descartes expose les règles d’une morale provisoire. Il l’appelle provi soire ou « morale par provision » puisque obligé à être irrésolu en ses jugements (puisqu’il va créer à nouveau la science), il faut néanmoins qu’il vive le plus heureusement qu’il pourra. Quelle serait la morale définitive de Descartes ? Dans ses Lettres à la princesse Elisabeth, il a tracé l’esquisse d’une morale toute imprégnée de l’esprit stoïcien, morale qui n’est que le développement de sa troisième maxime : Tâcher à se vaincre soi-même plutôt que la fortune. Toutefois, il est permis de supposer que Descartes, mathémati cien et physicien avant tout, a conçu l’idée d’une morale qui cher cherait son fondement dans la physique267. Rappelons-nous en effet que le grand obstacle à la vertu et au [328-104] bonheur est d’après lui la passion, et que la passion a une cause matérielle, à savoir le jeu déréglé des esprits animaux. Si nous devons, provisoirement, agir sur notre âme par un effort de volonté pour la guérir des passions, un jour viendra peut-être où, connaissant exactement les mouve ments des esprits animaux, c’est sur eux que nous pourrons agir. Peut-être Descartes a-t-il pensé à une thérapeutique des passions, à un traitement de la passion analogue à celui que recommandent cer tains médecins de notre temps, et qui rendrait inutile l’effort de volonté qu’exige de nous notre morale268, qui ne serait alors qu’une morale provisoire. Cette morale par provision comprend trois maximes. 1° « La première était d’obéir aux lois et aux coutumes de mon pays, retenant constamment la religion en laquelle Dieu m’a fait la grâce d’être instruit dès mon enfance et me gouvernant en toutes choses suivant les opinions les plus modérées. » Descartes recommande la modération parce que les opinions les plus modérées « sont les plus commodes pour la pratique et que si on se trompe pour les avoir suivies, on est sûr du moins de ne pas s’être
84
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
détourné beaucoup du droit chemin. Chose remarquable, Descartes met au nombre des excès « toutes les promesses par lesquelles on retranche quelque chose de sa liberté ». 2° « La seconde était d’être le plus ferme et le plus résolu dans mes actions que je pourrais et de ne pas suivre moins constamment les opi nions les plus douteuses lorsque je m’y serais déterminé, que si elles eussent été très assurées ; et ceci fut capable de me délivrer de tous les repentirs et les remords qui ont coutume d’agiter la conscience des esprits faibles. » 3° « La troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune, et à changer mes désirs que l’ordre du monde. » Idée stoïcienne entre toutes : l’essence du Stoïcien [329-105] est la tendance à se rendre indépendant des choses extérieures, indépendant de la passion. Descartes loue les Stoïciens de s’être persuadés que « rien n’était en leur pouvoir que leurs pensées ». Enfin, pour conclusion de cette morale, Descartes s’avise de passer en revue les diverses occupations humaines et, « sans que je veuille rien dire de celle des autres », je pensai que je ne pouvais mieux faire que d’employer ma vie à cultiver ma raison269. Cette pensée que Descartes nous donne comme conclusion de sa morale en est en réalité le principe. La morale provisoire de Descartes est la morale d’un penseur qui, ayant assigné pour fin à sa vie la spécula tion et la recherche scientifique, se préoccupe avant tout d’obtenir la paix intérieure et extérieure qui est nécessaire pour bien philosopher. S’il met de côté les vérités de la foi, s’il se promet d’obéir aux lois et aux coutumes, c’est sans doute parce qu’il croit à la religion, à la nécessité d’un gouvernement stable ; mais c’est aussi, autant que nous en puis sions juger par certains traits de sa biographie, pour n’être inquiété en aucune manière par l’autorité constituée. S’il s’impose de ne suivre que les opinions modérées et de persévérer dans toute résolution une fois prise, c’est pour s’épargner les repentirs, les regrets et les remords, qui sont les plus grands obstacles à la tranquillité de l’âme. Et c’est encore pour se mettre à l’abri de l’inquiétude et du désir, qui est une des formes de l’inquiétude, qu’il adopte la maxime stoïcienne : se rendre indépen dant des choses extérieures, ne dépendre que de soi. Il est donc inutile de
DESCARTES
85
montrer en détail les lacunes de cette morale qui n’a nullement la préten tion d’être complète270. Disons simplement qu’il n’y est pas question de charité, que la justice nous y est mal définie, et qu’enfm les devoirs dont il est fait mention ne sont que des devoirs individuels. Descartes nous dit lui-même que c’est pour lui qu’il a posé provisoirement ces règles de conduite. [330-106] Conclusion. — Il y a dans le cartésianisme : premièrement une méthode scientifique, deuxièmement une philosophie, troisième ment une mathématique et une physique. Sur le premier et le troisième point, nous nous sommes expliqués déjà. La mathématique cartésienne est une des plus merveilleuses créa tions de l’esprit. Descartes a transformé la géométrie et même l’algèbre. Quant à l’idée dominante de la physique cartésienne, à savoir que la science de la nature doit viser avant tout à exprimer les phénomènes par des lois de forme mathématique (c’est-à-dire par des équations), on la trouve au fond de toutes les recherches scientifiques depuis Descartes jusqu’à nos jours, c’est l’idée directrice de la physique moderne. Enfin, la méthode cartésienne est bien restée la méthode scientifique. Tout au plus pourrait-on lui reprocher un certain dédain du fait, la trop petite place qu’elle laisse à l’observation et à l’expérimentation, et enfin ce pos tulat que tout est parfaitement intelligible271. Reste la philosophie cartésienne proprement dite. Comme dans toutes les œuvres de génie, on trouve dans cette philosophie, déjà esquissées, déjà préformées, toutes les doctrines philosophiques qui devaient lui succéder. On y trouve une cridque de la connaissance, qui devait conduire, par l’intermédiaire de Berkeley et de Hume, au criti cisme de Kant. On y trouve une explication mécanique de l’Univers dont devaient s’emparer les matérialistes du XVIIIe et du XIXe siècle. Mais ce qu’on y trouve surtout, c’est une tendance, dont Descartes n’a pas eu pleine conscience, à identifier l’existence avec l’essence (preuve ontologique de Dieu), c’est-à-dire l’être avec l’idée, de sorte que, parmi les successeurs de Descartes, ceux-là furent sans doute les plus fidèles à l’esprit de la doctrine qui conclurent à l’idéalisme et au pan théisme272. Nous voulons parler de Malebranche et de Spinoza.
86
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
SPINOZA
[331-107] Spinoza est né à Amsterdam (Hollande) en 1632. Il appartenait à une famille juive et fit d’abord des études purement hébraïques. Mais quand il eut appris le latin et lu Descartes, il sentit se développer en lui la vocation philosophique. La hardiesse avec laquelle il interpréta l’Ecriture le fit excommunier par les rabbins qui, grâce à certaines influences, parvinrent à lui faire quitter Amsterdam. Il se réfugia à La Haye, où il vécut le reste de ses jours, tout entier à la méditation philosophique. Il eut des amis illustres273 et aurait pu avec leur aide arriver à la fortune et aux honneurs ; il refusa tout pour rester indépendant. Pauvre, mais à l’abri du besoin, il gagnait sa vie à tailler des verres de lunettes d’approche. Il mourut à La Haye en 1677. En 1663, il publia un exposé de la philosophie de Descartes sous forme mathématique : Principia philosophiae Renati Cartesii more geometrico demonstrata — en 1670, le Tractatus theologico-politicus. Mais les deux ouvrages les plus importants de Spinoza ne furent publiés qu’après sa mort, car il était aussi peu soucieux de la renommée que de la fortune : ce sont le Traité de la réforme de l'entendement (De intellectus emendatione) et YEthique (Ethica more geometrico demonstrata, 1677). L'Ethique est l’ouvrage capital de Spinoza. Sa philosophie y est expo sée à la manière géométrique. L’Ethique procède par définitions, axiomes, démonstrations, etc. [332-108] Objet de sa philosophie. — L’objet de Spinoza est double. On peut considérer son œuvre en effet du point de vue moral et du point de vue métaphysique. 1° La philosophie de Spinoza est avant tout, dans l’esprit de son auteur, une doctrine morale. Le titre même d'Ethique donné à l’œuvre capitale de ce philosophe est significatif. Non moins significatif est le début du Traité de la réforme de l'entendement. Tandis que Descartes cherche une méthode pour bien penser, tandis que le Discours de la méthode où Descartes nous donne l’essentiel de sa philosophie ne contient qu’une morale provisoire, tandis que l’idée dominante du
SPINOZA
87
livre est que nous devons viser avant tout à discerner le vrai d’avec le faux et à bien juger, au contraire, l’idée indiquée dès le début du De emendatione intellectus, l’idée développée à maintes reprises dans YEthique est que l’essentiel pour l’homme est de bien agir, de discerner les vrais biens d’avec les biens illusoires et de ne s’attacher qu’aux choses éternelles. La philosophie de Spinoza se distingue donc d’abord de celle de Descartes par son caractère pratique. 2° Mais le cartésianisme, en même temps qu’il mettait la morale à l’arrière-plan parce qu’il en réservait l’étude pour une période ulté rieure du développement scientifique, soulevait des difficultés méta physiques considérables que nous nous bornons à énumérer. A / Si la philosophie de Descartes gravite autour de la preuve ontologique de l’existence de Dieu, cette preuve n’est pas concluante dans le cartésia nisme [333-109] parce que Descartes n’identifie pas franchement le réel avec le possible274. De la possibilité de l’existence de Dieu qui est seule réellement démontrée par l’argument ontologique, Descartes passe à sa réalité sans justifier suffisamment ce passage. B / Descartes a distingué si profondément l’étendue de la pensée que ces deux substances n’ont plus rien de commun. Aussi est-il incapable d’expliquer comment elles agissent l’une sur l’autre ; il se borne à constater cette union en affir mant l’union de l’âme et du corps275. C / En attribuant à Dieu une liberté d’indifférence, et en faisant d’autre part du monde matériel un système de causes et d’effets soumis aux lois de la mécanique, Des cartes rend plus obscure encore qu’elle ne l’est pour le sens commun la question de la création. Il a mis dans le monde créé l’absolue et univer selle nécessité, et il se trouve que cette nécessité est l’effet d’un caprice divin. Bien plus, il faut que Dieu intervienne sans cesse dans le monde pour maintenir l’état actuel des choses, pour conserver les mêmes lois. Enfin, si Dieu crée sans cesse le monde avec tout ce qu’il contient, ne crée-t-il pas aussi nos actions ? et comment, dès lors, accorder la liberté de l’homme avec l’action continuelle de Dieu ? Ces trois difficultés graves, Spinoza les élude par une conception nouvelle, une conception originale, premièrement, du rapport entre le réel et le possible ; deuxiè mement, du rapport de cause à effet ; troisièmement, du rapport de l’infini au fini. Cette conception est essentiellement [334-110] mathé-
88
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
matique, et le spinozisme n’est pas intelligible pour celui qui ne se représente pas avec précision la véritable nature des propositions mathématiques, et en particulier de la mathématique cartésienne. Quel ques considérations préliminaires sont donc indispensables. 1° Les objets que le mathématicien étudie sont des objets réels en un sens car la ligne droite, la circonférence, l’ellipse, etc., sont de véri tables êtres pour le mathématicien276. Mais il faut remarquer que la réa lité de ces êtres ne fait qu’un avec leur simple possibilité : par cela seul qu’ils sont possibles, ils existent, au sens mathématique du mot exis ter. Quand le géomètre veut prouver l’existence de deux droites paral lèles, il établit qu’il est possible de concevoir deux droites situées dans le même plan qui ne se rencontrent pas. Et, en effet, deux perpendicu laires élevées sur la même droite satisferaient à cette condition. Deux droites parallèles sont donc possibles. Cela suffit et dès lors les paral lèles existent. Bien plus, cette possibilité ayant toujours existé, étant même indépendante du temps, on peut dire que le parallélisme de deux droites a toujours existé : il est éternel. L’acte par lequel on éta blit la possibilité d’une essence mathématique est donc le même que celui par lequel on constate son existence et même son éternité. 2° Quand la définition d’une figure géométrique [335-111] a été énoncée, on en tire un nombre indéfini de théorèmes qui expriment toutes les propriétés de cette figure. Tous ces théorèmes existaient dans la définition d’où on les tire et ne font qu’exprimer l’infinie mul tiplicité dont cette unité est grosse. Un mathématicien à l’intelligence infinie apercevrait tous ces théorèmes dans la définition dont ils sont l’équivalent. Cette multiplicité indéfinie est équivalente à cette unité. Certes, c’est la définition qui crée les théorèmes. Ils en sont l’effet, puisqu’ils ne seraient pas sans elle. Mais cette création n’est pas un acte arbitraire de la définition. Ils résultent nécessairement de cette définition par cela seul qu’elle est posée. Ils n’en sortent pas à un moment, quoiqu’il faille du temps à notre esprit imparfait pour les déduire. Ils sont éternels comme cette définition, ils lui sont coéter nels, comme dirait Spinoza. 3° Enfin, il faut remarquer qu’un objet mathématique est suscep tible de s’exprimer diversement, et que chacune de ses expressions le
SPINOZA
89
contient tout entier. Soit, par exemple, l’idée d’un cercle. Elle peut s’exprimer géométriquement par une image circulaire, et algébrique ment par une équation du second degré ; elle peut s’exprimer encore de bien des manières, mais nous n’en connaissons que deux. Bien plus, par cela seul que le cercle est possible, toutes ses expressions connues ou inconnues existent au [336-112] même degré et en même temps, de telle sorte que, le cercle étant posé, toutes les expressions du cercle connues ou inconnues sont posées également. En résumé, l’existence est un concept qui a deux sens, dont l’un pourrait s’appeler physique et l’autre mathématique. Le premier de ces deux sens est le plus ordinaire. Si l’on se place au point de vue phy sique, l’existence n’est pas la simple possibilité, car il y a bien des objets conçus comme possibles physiquement et qui n’existent pas réellement. Si l’on se place au premier point de vue encore, le rapport de cause à effet n’est pas un rapport nécessaire, car, la cause étant don née, l’effet n’est pas donné en même temps. Au contraire, si l’on se place au second point de vue, si l’on entend l’existence au sens mathé matique, l’être ne fait qu’un avec le possible, et le rapport de cause à effet n’est que la relation nécessaire de principe à conséquence277, c’est-à-dire au fond l’identité. Nous allons voir que le spinozisme consiste essentiellement à concevoir l’existence au sens purement mathématique, à identifier ainsi la réalité des choses avec leur possibi lité et à traiter le rapport dynamique de cause à effet comme un rap port mathématique de principe à conséquence278. Résumé de l* « Ethique ». — Spinoza définit la Substance « ce qui existe en soi et est conçu par soi »279. Et si nous convenons de don ner au mot existence son sens mathématique (ce qui est le postulat caché de tout le spinozisme), on peut conclure de cette [337-113] défi nition qu’il y a une Substance280. En effet, si une chose n’est pas conçue par elle-même, elle est conçue par quelque autre chose, et force est bien d’arriver à une chose qui ne soit conçue que par soi. Donc la Substance existe. En second lieu, il n’y a qu’une seule Substance, et cette Substance est infinie281. En effet, s’il y avait plusieurs Substances ou si la Subs-
90
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
tance était finie, c’est qu’une Substance serait limitée par d’autres et pour cela il faudrait que ces autres Substances eussent au moins un attribut de commun avec elle. Or deux Substances qui auraient un attribut commun n’en feraient qu’une, parce que l’attribut, comme nous le verrons, est ce qui exprime l’essence de la Substance. Cette Substance une et infinie est Dieu. Dieu étant infini possède une infinité d’attributs quoique nous n’en connaissions que deux : la pensée et l’étendue282. Chaque attribut de Dieu à son tour se manifeste par une infinité de modes. Nous ne connaissons de ces modes que les modes de la pensée et de l’étendue. Si nous envisageons Dieu dans ses attributs tous infinis, nous dirons qu’il est nature naturante : natura naturans. Si nous l’envisageons dans l’infinité de ses modes et plus particulièrement dans les modes que nous connaissons, les modes de la pensée et de l’étendue, nous dirons qu’il est nature naturée283. En d’autres termes, c’est le même être qui, envisagé dans son unité et dans [338-114] son infi nité, est Dieu à proprement parler ; et, envisagé dans sa multiplicité284 et son indéfinité, est le monde des créatures. Dieu n’est donc pas cause extérieure du monde, cause transitive du monde, comme dit Spinoza, il en est cause immanente285. Le monde est coéternel à Dieu et il y a entre les choses créées et le créateur le même rapport qu’entre les théorèmes qui sortent d’une définition et cette définition elle-même. Quelle diffé rence ferons-nous entre les attributs et les modes ? 1° L’attribut286. — L’attribut, d’après Spinoza, est ce qui exprime l’essence de la Substance. Il faut prendre ici le mot exprimer dans son sens mathématique. De même que le cercle s’exprime de lui-même par une figure géométrique, par une équation analytique et, peut-être, de beaucoup d’autres manières, et que le cercle est tout entier dans cha cune de ses expressions, ainsi l’essence infinie de la Substance divine s’exprime en Pensée, en Etendue, et en une infinité d’autres attributs que nous ne pouvons connaître parce que nous ne sommes que des modes de la Pensée et de l’Etendue. Dieu est donc tout entier dans chacun de ses attributs. 2° Le mode287. — Les modes expriment de toutes les manières pos sibles le contenu de chaque attribut. Si nous supposons d’un côté la définition géométrique du cercle, et de l’autre son équation algé-
SPINOZA
91
brique, de la définition on [339-115] tirera des théorèmes et de l’éq uation on tirera des équations. C’est ainsi que, si nous posons la Pensée et l’Etendue288, il en résulte d’une part tous les modes possibles de la Pensée, c’est-à-dire toutes les idées possibles, et de l’autre tous les modes possibles de l’Etendue, c’est-à-dire tous les corps possibles. Ainsi Spinoza assimile l’existence de la Substance à celle d’un objet mathématique, ce qui lui permet de prouver l’existence de Dieu par la démonstration de sa simple possibilité. La substance qu’il obdent ainsi s’exprime d’elle-même en attributs infinis et ces Attributs s’expriment d’eux-mêmes en modes. Nulle part il n’y a de force créatrice ou de choix libre. Tout ce qui est existe nécessairement. Nature naturante. — Dieu qui est nature naturante s’exprime dans des Attributs en nombre infini parmi lesquels nous ne connaissons que la Pensée et l’Etendue. 1° jL'Etendue attribut, c’est-à-dire l’Etendue en Dieu289, n’est pas l’étendue dont nous avons l’idée. L’étendue que nous connaissons est composée d’une multiplicité de parties. L’Etendue divine, ou l’Eten due attribut, est une et indivisible. Mais, dira-t-on, si l’étendue que nous connaissons est un mode de l’Etendue attribut, comment celle-là sera-t-elle divisible, celle-ci indivisible ? Cette difficulté signalée depuis longtemps dans le spinozisme est loin [340-116] d’être insurmontable. Les modes ne sont pas des parties de l’Attribut. Si les corps que nous percevons étaient des parties de l’Etendue divine, il est trop évident que l’Etendue divine serait divisible comme eux. Les modes dévelop pent le contenu de l’Attribut mais ne lui ressemblent pas. C’est ainsi que si l’on suppose tracés tous les cercles possibles, ces cercles déve loppent tout le contenu de l’idée de cercle et néanmoins cette idée en tant qu’idée est indivisible. 2° Dieu est Pensée, mais la Pensée divine ou Pensée attribut ne res semble pas plus à notre pensée, qui est un mode de la Pensée, que le Chien, constellation céleste, ne ressemble au chien, animal aboyant290. Les modes de la Pensée en effet sont finis et la Pensée divine infinie. 3° La liberté. Dieu est-il libre ? Si on prend le mot liberté dans le sens de libre arbitre, c’est-à-dire de libre choix, il serait insensé, dit
92
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
Spinoza, de mettre une pareille liberté en Dieu, car « ce que fait Dieu suit nécessairement de son essence comme les propriétés du triangle suivent nécessairement de l’essence du triangle »291. Mais Dieu est libre au sens spinoziste du mot. Spinoza définit en effet la liberté comme il suit : « Ea res libéra dicitur quae ex sola suae naturae necessitate existit et a se sola ad agendum determinatur. »292 Ainsi la liberté, d’après Spi noza [341-117], est l’état d’un être qui ne subit aucune contrainte exté rieure à lui, ne reçoit pas du dehors les lois de son développement, mais qui se développe en vertu d’une nécessité inhérente à sa nature. La liberté spinoziste est donc ce que nous appellerions la nécessité interne. Se développer nécessairement, mais conformément à sa propre essence, voilà la vraie liberté d’après Spinoza. C’est ainsi qu’une définition géométrique, si elle prenait conscience d’elle-même et de son développement en théorèmes, serait libre en ce sens que ce théorème n’est que l’expression de sa nature et ne dépend d’aucune autre cause. Dieu étant la Substance unique, étant tout l’être, ne peut subir aucune nécessité extérieure à lui. Il se développe donc librement quoique nécessairement. 4° L‘'impersonnalité. Il suit de là que Dieu n’est pas une personne. La personnalité293 est une détermination et par suite une limitation. Dieu est une Pensée infinie ou une Etendue infinie. Il est infini dans tous les sens294. Tel est le Dieu de Spinoza, Substance infinie s’exprimant nécessaire ment en Attributs infinis et en Modes infinis et finis. Il contient éminem ment, comme disait Descartes, et non pas formellement295 la pensée et l’étendue que nous nous représentons, ainsi qu’une infinité d’autres Attributs. Mais ce n’est pas une personne parce que la Substance296 n’est pas une propriété mais une [342-118] négation de toute qualité. Nature naturée191. — La nature naturée n’entretient pas avec la nature naturante les relations d’une chose créée avec son Créateur. Elle lui est coéternelle et suit nécessairement de l’essence de Dieu, dont elle est l’expression multiple et indéfinie. La nature naturée est un ensemble de Modes, Modes de l’Etendue d’une part, de la Pensée de l’autre.
SPINOZA
93
1° Les corps29*. Les Modes de l’Etendue sont les corps. Reprenant sur ce point les idées de Descartes et les développant, Spinoza se représente l’univers matériel299 comme un système indéfini d’éléments étendus soumis à des lois nécessaires. Tout s’explique mécaniquement, les corps vivants comme les autres corps. Bien plus, tous les corps vivent d’une certaine manière, car à tout corps répond une idée qui en est comme l’âme. Mais comme nous le verrons aussi, il ne peut y avoir aucun contact, aucune communication entre les idées et les corps. Aussi rien n’est plus absurde, d’après Spinoza, que de croire à la fina lité300 dans la nature. La finalité, c’est l’idée pénétrant la matière. Or entre les Modes de la Pensée et ceux de l’Etendue toute communica tion est impossible, et inconcevable. Les états des corps et leurs chan gements s’expliquent donc par des causes purement mécaniques301, et un Mode de l’Etendue ne peut trouver son explication et sa raison d’être que dans d’autres Modes de l’Etendue. [343-119] 2° Les idées302. Les Modes de la Pensée sont les idées. De même que l’attribut Etendue s’exprime en une infinité de modes étendus, ainsi l’attribut Pensée se développe en une infinité d’idées. De même que tout mode de l’étendue s’explique par des modes de l’étendue, ainsi toute idée a sa raison dans d’autres idées303. C’est pourquoi les corps ne sauraient pas plus influer sur les idées que les idées sur les corps. D’où vient donc que nous connaissons les corps, et comment s’explique l’action apparente de la pensée sur les choses et des choses sur la pensée ? C’est que la série des Modes de la Pen sée et la série des Modes de l’Etendue sont deux séries parallèles. En effet les Modes de l’attribut Etendue développent et expriment tout le contenu de l’attribut Etendue ; les Modes de la Pensée expriment tout le contenu de l’attribut Pensée ; et comme la Pensée et l’Eten due attributs ne sont à leur tour que deux expressions équivalentes de l’essence de la Substance, il s’ensuit qu’à tout mode de l’étendue doit correspondre un Mode de la Pensée, et réciproquement. Aussi tout corps répond à une idée et toute idée à un corps. L’âme humaine304 n’est pas autre chose que l’idée du corps auquel elle est jointe. Comme le dit fortement Spinoza, « ordo et connexio idearum idem est atque ordo et connexio rerum »305.
94
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
Il suit de là que, dans notre pensée en particulier, il ne peut y avoir d’idées qui ne représentent [344-120] quelque réalité extérieure et, inversement, il ne peut rien se passer dans notre corps306 dont notre conscience ne soit avertie. Et cependant entre le corps et la pensée il n’y a pas de communication possible. Supposons, pour comprendre la conception spinoziste des rapports de l’âme et du corps, l’idée du cercle307 s’exprimant d’un côté par une équation algébrique, et de l’autre par une définition géométrique ; si nous développons cette définition en théorèmes que nous appellerons Al, A2, A3, A4, et si nous développons cette équation en équations que nous appelle rons al, a2, a3, a4, les termes ab et a4, par exemple, représenteront sous forme algébrique les mêmes choses que les termes A3 et A4 représentent sous forme géométrique, pour la raison fort simple que les deux séries développent et expriment dans deux langues différentes la même essence de la circonférence. Pourtant ni une équation ne sau rait influer sur une figure ni une figure sur une équation, parce que la forme et la quantité sont deux attributs différents au sens spinoziste du mot. C’est de la même manière que tout corps a son idée et que toute idée a son état du corps. La correspondance des Modes de la Pensée et de ceux de l’Etendue s’explique donc par une harmonie préétablie308 et par le seul effet du développement nécessaire de l’es sence de la Substance. [345-121] Parmi les Modes de la Pensée, il y en a qui nous intéres sent particulièrement, ce sont ceux qui, réunis, forment l’âme humaine. L’âme n’est pas une substance309, puisque Dieu est la seule substance. Notre âme est une collection310 de modes de la Pensée qui expriment chacun sous forme de pensée un certain état de notre corps. De même que les modes de l’étendue sont soumis à un mécanisme inflexible, ainsi le développement des modes de Pensée est rigoureuse ment nécessaire. Il n’y a pas de contingence, dit Spinoza, pas plus dans les modes de la Pensée que dans ceux de l’Etendue. « Nullum datur contingens in rerum natura. »311 On comprendra donc que Spinoza ait présenté dans les trois der nières parties de l'Ethique une psychologie qui est en même temps une métaphysique, où il est traité des états de l’âme en partant de l’idée de
SPINOZA
95
la Substance et de son développement nécessaire. Spinoza classe les idées en idées adéquates312 et en idées inadéquates. Il y a deux manières principales de connaître une chose : on peut d’abord chercher les rap ports de cette chose finie avec d’autres choses finies313. Mais comme ces dernières dépendent à leur tour d’autres choses finies, et que, d’une manière générale, tous les modes en nombre infini d’un même attribut sont en connexion mutuelle, jamais cette chose ne sera parfai tement connue. L’idée en restera inadéquate. — Il y a un [346-122] autre moyen de connaître, c’est de se replacer par la pensée dans le Principe où cette chose est contenue à la manière d’un mode dans l’at tribut. Alors on aperçoit tout d’un coup et dans une intuition unique314 le rapport de cette chose finie au Principe infini d’où elle émane, et par suite aussi à l’infinité des choses finies qui est l’équiva lent de ce Principe. On obtient ainsi l’idée adéquate et non plus inadé quate de l’objet pensé. Parmi les idées inadéquates, il faut mettre les passions qui expri ment en modes de la Pensée les modifications que le corps reçoit des autres corps315. C’est à l’étude des passions, de l’esclavage où elles nous réduisent, et de l’affranchissement, de l’état de liberté où nous pou vons atteindre, que sont consacrées les trois dernières parties de Y'Ethique. Spinoza, qui traite le libre arbitre d’illusion, de chimère, n’en a pas moins écrit un traité métaphysique qui contient un système de morale. Mais il ne faut pas croire que Spinoza nous donne des conseils ou même des règles de conduite. Tout ce que nous faisons suit néces sairement de ce que nous sommes, et tout conseil est inutile, comme tout regret de ce que nous avons pu faire est puéril316. Le rôle du moraliste est de définir le bien et le mal317, les meilleurs états et ceux que l’on doit considérer comme pires. Il est de déterminer dans quelles conditions se produit l’esclavage, dans quelles conditions l’état [347-123] d’une âme affranchie du joug des passions. Mais le moraliste ne réforme pas plus l’humanité en traitant du bien et du mal, que le géomètre ne modifie la position d’un corps en déterminant les condi tions de son équilibre. Il y a en effet deux états possibles de l’âme. Quand les idées ina déquates, et plus particulièrement les passions, la constituent essen-
96
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
tiellement, elle est esclave. Elle est libre quand elle échappe à la pas sion318, c’est-à-dire lorsqu’elle passe de l’idée inadéquate à l’idée adé quate, lorsqu’elle pense non pas sous forme finie mais sous forme d’éternité, sub specie aeternZ319. Le bien et le mal, d’après Spinoza, doi vent se définir des augmentations et des diminutions d’être, c’est-àdire de force320, et nous existons pleinement quand nous nous repla çons par la pensée en Dieu, quand nous nous rendons compte de l’universelle nécessité. Si donc la liberté consiste pour Dieu dans la nécessité de son développement intérieur, elle consiste pour l’homme dans la conscience qu’il prend de ses rapports avec Dieu, c’est-à-dire de la nécessité à laquelle il obéit. En cela consiste la liberté, en cela consiste aussi la béatitude. La béatitude n’est pas le prix de la vertu, dit Spinoza, elle est la vertu même321, car la vertu est l’état d’une âme qui comprend et sent la parenté qu’elle a avec Dieu, qui se trouve pour ainsi dire replacée en Dieu. Là est aussi l’éternité [348-124], car l’éternité n’est pas quelque chose qui s’ajoute à l’âme, et prolonge en quelque sorte son existence indéfiniment. Nous devenons éternels par cela seul que, pensant les choses sous forme d’éternité, nous coïncidons, pour ainsi dire, avec l’éternel. L’étemel ne vient pas à nous, c’est nous qui entrons dans l’éternité, par cela seul qu’affranchis des passions nous acquérons quelque chose de la liberté divine322.
MALEBRANCHE323
Né en 1638, il entre en 1660 à la congrégation de l’Oratoire. Il avait vingt-six ans quand il lut le Traité de l’homme de Descartes, lec ture qui lui révéla sa vocation philosophique. Son existence se passa tout entière dans une retraite consacrée à l’étude et à la méditation. Il eut à subir des luttes contre Bossuet, le mathématicien Mayran, Arnauld. Il mourut en 1712. Ses principaux ouvrages sont : Ta recherche de la vérité, 1674 ; Médi tations chrétiennes, 1683 ; Traité de morale, 1684 ; Entretiens métaphysiques, 1688.
MALEBRANCHE
97
La doctrine de Malebranche est un pan-[349-125]théisme incom plet et, il faut bien le dire, fort inconséquent. Il interpréta le cartésia nisme dans un sens mystique. Par ses tendances naturelles, il était conduit au panthéisme, mais il a horreur du spinozisme et, sur la pente où il est entraîné, il s’arrête le plus souvent, non sans nuire par là à la logique de sa doctrine. L’idée dominante du système est que Dieu seul agit et que Dieu seul est cause324. Attribuer la causalité de l’homme, c’est une véritable impiété, c’est faire de l’homme un créateur325. De là deux théories essentielles de cette métaphysique, la théorie de la vision en Dieu et celle des causes occasionnelles. 1° La vision en Dieu. — Descartes avait parlé de l’union de l’âme et du corps et expliquait par cette union la connaissance que prend la pensée des choses étendues. Cette explication, avons-nous dit, est des plus obscures, et Malebranche ne la tient pas pour satisfaisante326. Comment supposer d’ailleurs que des corps puissent agir sur la pen sée, alors que cette union doit être rapportée à Dieu ? Connaître direc tement les corps, ce serait subir leur action et un être fini n’agit pas. D’autre part, nous ne connaissons des corps que leurs idées. Si donc ce sont les idées des corps que nous apercevons, et, si d’autre part Dieu seul est cause, nous devons dire que percevoir les corps, c’est en réalité prendre [350-126] connaissance de leurs idées quand Dieu nous les montre. Mais il est contre le principe de la moindre action327 de supposer que Dieu répète les idées des corps autant de fois qu’il y a d’âmes ou d’esprits. L’hypothèse la plus simple est donc que Dieu nous montre en lui les idées des choses ; car les idées des corps sont nécessairement représentées en Dieu qui connaît tout, et le moyen le plus simple pour Dieu de nous communiquer ces idées est de se mon trer à nous sous cet aspect. C’est donc en Dieu que nous voyons les corps. Les idées des corps représentées en Dieu sont tout ce que nous en connaissons. Les corps réels ne sont que des occasions à propos desquelles Dieu nous fait voir les idées des corps. Par ces prémisses métaphysiques et théologiques, Malebranche est donc conduit à une conclusion que ne désavouerait pas la psychologie
98
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
physiologique contemporaine, à savoir que ce que nous connaissons de la matière n’est que le signe de la réalité, comme dit Helmholtz, et non la réalité même, les corps tels qu’ils sont en soi nous fournissant simplement l’occasion d’éprouver certaines sensations et de nous représenter certaines idées. On ne s’étonnera donc pas que Malebranche ait été le premier à étudier empiriquement la perception externe. Mais revenons à sa doctrine métaphysique. [351-127] Ayant mis en Dieu les idées des choses étendues, il recula devant les objections328 qui lui étaient suscitées. De toutes parts on lui reprochait en effet d’avoir mis les choses finies en Dieu d’avoir fait Dieu matériel. Malebranche modifia alors sa doctrine, et, après avoir dit (dans la Recherche de la vérité) que toutes les choses étendues aperçues par nous étaient aperçues en Dieu, il affirma seulement329 qu’en Dieu réside « l’étendue intelligible ». Cette étendue intelligible est le principe de toutes les choses étendues. Elle contient ces choses éminemment, mais non formellement330. C’est nous qui découpons en quelque sorte des objets finis dans cette étendue infinie ; c’est pour nous seulement qu’elle prend son caractère de matérialité. Ainsi, peu à peu, Malebranche s’achemine au spinozisme. Qui ne reconnaîtra en effet dans l’étendue intelligible l’étendue-Attribut de Spinoza ? 2° Les causes occasionnelles. — L’idée dominante de la philosophie de Malebranche est que causalité signifie création, d’où résulte que toute causalité appartient à Dieu. A cette idée, Malebranche est conduit d’abord par une interprétation du christianisme : toute puissance attribuée aux créatures est autant d’enlevé à Dieu ; par suite, il y a impiété à accorder la moindre initiative aux choses créées ; mais il y était conduit aussi par le développement rigoureux et logique de ce principe cartésien qu’il n’y a rien de plus dans les objets que ce qui est contenu dans l’idée claire et distincte que nous en avons. Or quelles sont les choses réelles ? Elles sont, comme l’a dit Descartes, [352-128] ou de l’étendue ou de la pensée. Mais dans l’idée d’étendue, qui est une idée claire et distincte, n’est nullement contenue la concep tion d’une influence quelconque de l’étendue sur l’étendue, du corps
MALEBRANCHE
99
sur le corps. Donc cette influence est quelque chose d’extérieur, d’étranger, qui ne peut pas s’expliquer par la seule essence de la nature. Il en est de même de l’action de l’âme sur le corps, action qui ne se peut conclure, déduire, ni de l’idée de l’étendue ni de celle de la pensée. Force est donc bien d’expliquer par l’intervention divine l’in fluence des corps sur les corps, des corps sur les esprits et des esprits sur les corps. Nous dirons donc que ni les corps n’agissent les uns sur les autres, ni les corps sur les âmes, ni les âmes sur les corps, mais que les états des corps et des esprits ne sont que des occasions offertes à Dieu d’intervenir et d’agir, de modifier les esprits et les corps confor mément à ces états. Reste, il est vrai, l’action de l’âme sur elle-même, les déterminations intérieures et, comme nous dirions aujourd’hui, les pures volitions. Si l’idée d’une action n’est nullement impliquée dans la représentation de l’étendue, ne l’est-elle pas dans celle de la pensée ? Malebranche est ici doublement embarrassé : d’un côté le cartésia nisme fait de l’activité sous forme de volonté un des attributs de la pensée, quelque chose qui est contenu dans l’idée claire et distincte de la pensée — c’est même pourquoi l’affirmation de la liberté est essen tielle dans le cartésianisme — et d’autre part le christianisme exige qu’une certaine latitude soit laissée à l’homme pour agir, sinon il n’y a plus ni bien ni mal moral, de peines et de récompenses légitimes. Aussi Malebranche se sent contraint d’atténuer ici les conséquences de son principe. C’est à Dieu, dit-il, qu’il faut rapporter l’activité essen tielle de l’âme qui en est l’inclination au bien. C’est Dieu qui a ainsi orienté nos âmes mais c’est nous qui pouvons faire dévier331 cette incli nation vers les biens inférieurs, comme il arrive quand nous préférons notre plaisir au bien moral, à la vertu. En cela consiste la puissance de l’homme, et on ne peut pas dire ici que nous retranchions quelque chose de la puissance divine pour l’attribuer aux créatures, puisque cette puissance accordée à l’homme n’est après tout que celle de faire le mal et qu’elle ne saurait appartenir à Dieu. Cela est incontestable. Il n’en est pas moins vrai qu’il y a ici un choix, que l’homme est bien cause du mal qu’il fait, de l’aveu même de Malebranche, et que le prin cipe métaphysique de la doctrine, qui met toute causalité en Dieu, se trouve ici en défaut.
100
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
[353-129] En résumé, il y a entre le mysticisme de Malebranche et le panthéisme de Spinoza une différence. Malebranche comme Spi noza n’admet qu’une seule cause réelle et cette cause est Dieu. Mais, tandis que Spinoza ajoutait qu’il n’y a qu’une seule substance, la subs tance divine, Malebranche maintient la pluralité des substances332, puisqu’il y a, d’après lui, en dehors de Dieu, des êtres créés par Dieu. Il est vrai qu’après avoir affirmé l’existence de ces substances, il leur333 enlève l’essentiel de la substantialité, il les dépouille de l’activité par laquelle ces substances devraient se manifester, pour n’en plus faire que des occasions offertes à Dieu de déployer sa toute-puissance. Et c’est pourquoi cette hypothèse de la pluralité des substances s’éva nouirait elle-même, et la doctrine de Malebranche coïnciderait, malgré les efforts de Malebranche, avec celle de Spinoza, si Malebranche ne cédait à des considérations religieuses.
LOCKE
[353-130] Locke est né à Wrington en 1632. Il étudia d’abord à Oxford pour devenir ecclésiastique. A vingt-sept ans, il lit Descartes. Cette lecture produisit sur lui une impression profonde. Il s’était déjà tourné à cette époque vers les sciences physiques et naturelles ; il réso lut alors de se faire médecin. Il devint ami de lord Shaftesbury dont il partagea d’abord la fortune puis l’exil. En 1683, il dut quitter l’Angle terre ; la Révolution de 1688 lui permit d’y rentrer. Il mourut en 1704, âgé de soixante-douze ans. Ses deux principales œuvres sont : en 1689, Y Essai sur Ventendement humain, œuvre capitale à laquelle Leibniz devait répondre par les Nou veaux Essais ; et, en 1683, Quelques pensées sur l’éducation, ouvrage très important au point de vue pédagogique, premier essai de pédagogie empirique. Objet de la philosophie de Locke. — Locke nous indique luimême l’origine de son Essai sur l’entendement humain. Quelques amis s’étant rassemblés chez lui, on discutait et, en présence de difficultés
LOCKE
101
insurmontables soulevées par cette discussion, Locke pensa3* qu’avant de s’engager dans les recherches philosophiques il fallait mesurer la capacité de l’esprit humain, tracer une ligne de démarcation entre ce qui est à notre portée et ce qui est au-dessus. C’est en cherchant dans cette direction qu’il arriva à formuler ce principe dont Y Essai sur ren tendement n’est qu’une longue démonstration : les seules vérités acces sibles à notre esprit sont celles que fournit l’expérience. L’expérience est à l’origine de toutes nos connaissances. L’objet de la philosophie de Locke est donc tout à fait analogue à celui que Kant devait se proposer plus tard. Kant lui aussi va critiquer la connaissance et faire la part exacte de ce qui est accessible à l’enten dement humain. Mais tandis que Kant sut démêler dans notre connaissance deux éléments irréductibles, la matière et la forme, la matière qui nous est donnée et la forme qui vient de nous, Locke ne poussa pas l’analyse aussi loin [354-131] et, si lui aussi nous interdit de dépasser l’expérience, il ne détermine pas avec la même profondeur le vrai caractère de notre expérience. Méthode de Locke. — Cette méthode comprend deux procédés. D’un côté, Locke va établir positivement que toutes nos connaissances viennent de l’expérience ; de l’autre il cherche à prouver par la critique du cartésianisme qu’il n’y a pas lieu de supposer des idées innées335. Première partie. — Enonçons d’abord avec précision le principe de Locke. Supposons, dit-il, qu’au commencement l’âme est une table rase, vide de tout caractère (tabula rasa**). Elle est sans idées. Com ment vient-elle à recevoir des idées ? Où puise-t-elle les matériaux qui sont les fondements de ses connaissances ? Je réponds en un mot : de l’expérience. Cette expérience, d’après Locke, est double : externe et interne337. La première a lieu par la sensation, la seconde par la réflexion. Sensation et réflexion, voilà les deux sources de l’expéla perception des opérations rience. Locke entend par réflexion accomplies par notre âme sur les idées reçues par les sens, opération qui, lorsque l’âme réfléchit sur elle, fournit à l’entendement une autre espèce d’idées que les objets extérieurs n’auraient pas fournis »338. En
102
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
d’autres termes, Locke entend par réflexion une espèce de sens interne qu’il adjoint aux sens extérieurs pour l’acquisition de la connaissance. Mais l’esprit est passif dans la réflexion comme dans la sensation : dans un cas comme dans l’autre la connaissance s’imprime339 dans l’âme comme le cachet sur la cire ou s’y reflète comme l’image dans le miroir. La réflexion de Locke est donc tout à la fois l’association340 passive des idées entre elles et la conscience que nous prenons de ces associations. Sans la réflexion, dit Locke, il y aurait encore sensation, mais sans la sensation il n’y aurait plus de réflexion. En d’autres termes encore, Locke a bien compris qu’avec la seule sensation on ne peut pas reconstituer toute la connaissance ; il faut en outre ce que Kant appellera plus tard des formes a priori où ces sensations s’organi sent, il faut, comme le comprendra Kant, un effort, une activité de l’esprit pour unir ces matériaux de la connaissance. Mais si Locke comprend l’insuffisance de la sensation, il ne veut pas, ne sait pas, en raison de ses tendances empiristes, accorder à l’esprit cette activité, cette initiative que Kant lui accorde341. [355-132] Il suppose alors que ce travail de combinaison entre les sensations se fait de lui-même, automatiquement. Il ferme les yeux sur ce travail pour ne les rouvrir que lorsque ce travail est fait, et il appelle alors réflexion la conscience que prend l’esprit de cette combinaison effectuée. C’est ainsi qu’û priori il affirme et admet la passivité de l’es prit. Ce n’est pas à dire que YEssai sur l'entendement humain soit un grand cercle vicieux, car en s’efforçant de reconstruire tout l’édifice de la connaissance avec la sensation et la réflexion toutes seules, Locke va donner une démonstration en règle de son principe. Mais le génie de Kant, soumettant à l’analyse cette réflexion que Locke adjoint à la sen sation, y trouvera les formes a priori, les catégories a priori, bref cette activité de l’esprit sur laquelle Locke ferme les yeux et qu’il a pourtant introduite dans son système comme l’ennemi dans la place. Ceci posé, on peut définir la doctrine de Locke une idéologie342, c’est-à-dire un essai de reconstruction de toutes les idées avec des élé ments simples donnés par la sensation ou la réflexion. Les idées simples343, nous dit Locke, peuvent entrer dans l’âme par quatre voies : a) par un seul sens344 ; exemples : la lumière, le
LOCKE
103
bruit, etc. ; b) par plusieurs sens345 indifféremment ; exemple : les idées d’étendue, de forme, de mouvement et de repos; c) par la réflexion346, c’est-à-dire par la considération que fait l’esprit des opéra tions qui s’accomplissent en lui ; exemples : l’idée de volition, l’idée de perception ; d) par l’une quelconque de ces diverses voies, réflexion ou sensation, comme par exemple l’idée d’unité, l’idée de succession, l’idée d’existence, etc.347. Telles sont les idées simples, qui se divisent comme on le voit en quatre espèces. « Ce petit nombre d’idées simples suffit à exercer l’esprit le plus vaste comme les vingt-quatre lettres de l’alphabet forment une infinité de mots. »348 II est impossible de suivre Locke dans le détail de cette reconstruction de la connaissance humaine. On a dit qu’il affirmait le principe de l’empirisme sans le démontrer. Mais Locke en a donné la démonstration qui est la meil leure à ses yeux, la démonstration empirique, en reconstruisant luimême avec les idées simples qui sont, d’après lui, des données de l’ex périence, toutes les conceptions, tous les jugements [356-133] de l’entendement humain. Reste à savoir si les éléments a priori de la connaissance que Locke a écartés et dont il nie l’existence n’intervien nent pas continuellement dans cette reconstruction. Bornons-nous à dire que Locke répartit les idées complexes en trois catégories349 : 1° les idées de modes ; 2° les idées de substances ; 3° les idées de rela tions. Les idées de modes350 sont les idées complexes qui ne renfer ment pas la supposition de subsister par elles-mêmes. Exemples : les idées de triomphe, de gratitude, de meurtre, etc. Les idées de subs tances sont des combinaisons d’idées simples que l’on considère comme subsistant par elles-mêmes. Les idées de relations sont celles que l’on forme par la comparaison des modes. Les idées de substances et celles de relations sont celles que Locke a analysées de la manière la plus intéressante. Dans toute idée de substance il voit une idée confuse351, et il esquisse la théorie que Berkeley devait développer plus tard, à savoir que l’existence d’une substance est toujours probléma tique352. Parmi les idées de relations, Locke étudie particulièrement la relation de cause à effet, où il ne voit qu’un rapport de succession, et la relation morale, c’est-à-dire la convenance ou disconvenance entre les actions volontaires des hommes et une règle à laquelle on les rap-
104
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
porte. « Le plus puissant mobile de l’humanité, dit-il à ce propos, est l’amour de la considération.353 » Notre unique but, ou peu s’en faut, notre unique souci d’après lui est le désir d’une bonne réputation. Là est le fondement de la morale. Deuxième partie. — Réfutation de la théorie cartésienne des idées innées. Locke prétend avoir démontré par le seul fait de la reconstitution empirique de toutes nos idées l’inutilité de l’hypothèse cartésienne. Toutefois il va examiner, pour la critiquer en elle-même, la théorie cartésienne des idées innées. Premièrement, les cartésiens allèguent l’universalité354 de certaines idées pour conclure de là à leur innéité. Mais d’abord cette universalité n’est pas. Prenons en effet le principe le plus universel en apparence : ce qui est est. Beaucoup d’hommes l’ignorent, les enfants et les idiots n’en ont aucune idée. [357-134] Entend-on par universalité la faculté commune à tous les hommes de prendre connaissance de leurs idées ? Elle existe à coup sûr, répond Locke. Mais il en est de même de toutes les vérités qui arrivent à notre connaissance, car on pourra toujours dire que nous avions la faculté de les connaître. D’où l’on pourra conclure que toutes les connaissances sont innées. Veut-on dire que les hommes connaissent ces vérités en faisant usage de leur raison ? Mais comment penser que le raisonnement soit nécessaire pour découvrir des prin cipes qu’on suppose innés ? Entend-on par là que les hommes aperçoi vent ces principes au moment précis où ils commencent à faire usage de leur raison ? Mais alors, répond Locke, l’hypothèse est à la fois fausse et inutile : fausse car des enfants font usage de leur raison sans connaître ces principes ; et inutile en ce qu’on pourrait tout aussi bien admettre avec cette hypothèse que toute connaissance qu’on acquiert quand on raisonne était déjà innée dans l’esprit. Enfin Descartes veutil dire que l’esprit accepte ces principes, y donne son adhésion dès qu’ils lui sont proposés ? C’est possible. Mais on prouverait aussi bien alors que les propositions 1 + 2 = 3, ou le blanc n’est pas rouge sont des vérités innées. Bien plus, ce consentement donné par l’esprit
LOCKE
105
prouve tout le contraire de l’innéité, car il implique qu’on ignore ces principes tant qu’on ne nous en a pas encore parlé. Ensuite, à suppo ser même que cette universalité existât, on ne pourrait pas conclure de l’universalité à l’innéité, car rien ne prouve que l’innéité soit la seule voie par laquelle on peut arriver à l’uniformité de sentiment. Secondement, voici maintenant des faits contraires à l’hypothèse de l’innéité : 1° S’il y avait des idées innées, elles seraient connues avant les choses particulières données dans l’expérience. Or, en fait, la connaissance du particulier précède celle de l’universel ; 2° S’il y avait des idées innées, elles se manifesteraient plus évidemment encore chez les sauvages, les illettrés, les enfants et les imbéciles, car ils ont l’esprit moins altéré par la coutume. Or c’est le contraire ; 3° S’il y avait des idées innées, les éléments qui en font partie seraient innés aussi. Or qui [358-135] soutiendrait que les idées d’identité, de tout et de partie, de substance, sont des idées innées ? 4° Enfin, ces idées innées, si elles existaient, seraient utiles et même indispensables. Or nous voyons que la connaissance se forme presque entièrement sans elles. Conclusion. — Est-il besoin de montrer le vice de cette réfutation ? Locke n’a pas su distinguer entre l’existence actuelle et l’existence vir tuelle. Il n’a pas compris que des idées, des principes de connaissances en général peuvent exister dans l’esprit sans que l’esprit en soit averti explicitement, et que nous pouvons en faire usage sans le savoir, comme nous nous servons pour marcher, dit Leibniz, des muscles et des tendons que nous ne connaissons pas355. Toutes les objections de Locke s’évanouissent dès que l’on fait cette distinction. La connais sance de l’universel précède bien celle du particulier à condition que la première soit tenue pour virtuelle. La connaissance des principes appartient sûrement aux enfants, aux illettrés, aux imbéciles, à condi tion qu’on ne cherche pas dans ces intelligences inférieures ou mal développées la formule des principes, mais seulement l’application. Il y a dans la doctrine de Locke, comme d’ailleurs dans tout l’empirisme, cette idée que tout ce qui est est actuellement réalisé. La puissance, la tendance, l’effort, la virtualité sont des notions qui ne peuvent pas trouver de place dans un système empirique356. La doctrine de Locke
106
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
est donc bien un empirisme conséquent avec lui-même et si, par sa dis tinction entre la sensation et la réflexion, Locke a préparé la critique de Kant, il est très éloigné de Kant, parce que la réflexion dont il parle est une réflexion passive, parce qu’il ne fait aucune part à l’initiative de l’esprit, enfin parce qu’il n’a pas tenu compte de cette vérité fonda mentale, incontestable au moins en psychologie, que l’analyse ne suffit pas, qu’il y a dans le tout autre chose que les parties dissociées par l’analyse, et qu’il faut se préoccuper de la synthèse. Schéma357 : Idées nécessaires Idées quelconques Sensation Organisation (vie, finalité...) Inertie
LEIBNIZ
[359-136] Leibniz est né à Leipzig en 1646. Il était d’origine slave. Enfant, il fît preuve d’une extraordinaire précocité : à treize ans il hésitait entre Aristote et Démocrite, se demandant s’il ne devait pas préférer la doctrine, inspirée d’Aristote, des formes substantielles, au mécanisme. De 1670 à 1676 il voyagea. Nommé en 1676 conservateur de la bibliothèque de Hanovre, il le resta jus qu’à sa mort, en 1716. A l’inverse de Descartes, qui cherchait la solitude et la tranquillité, Leibniz intervint activement dans les discussions politiques et reli gieuses de son temps. Son idée longtemps caressée était de réconcilier et de fondre ensemble les deux Eglises catholique et protestante. Il fut le conseiller des ducs de Hanovre et resta longtemps en relation avec les principaux souverains d’Europe. Esprit d’ailleurs universel, versé dans les questions de droit, d’histoire, de mathématique. C’est surtout comme mathématicien et comme philosophe qu’il est resté célèbre. Il est avec Newton l’inventeur du calcul différentiel.
LEIBNIZ
107
Nulle part il n’a présenté, comme Descartes, Spinoza, Locke, un exposé complet et systématique de sa doctrine ; elle est éparse dans un grand nombre d’ouvrages et d’opuscules : les Nouveaux Essais sur l’en tendement humain (1704), ouvrage composé pour répondre à VEssai de Locke ; Essai de Théodicée (1710) ; la Monadologie (1714) ; la Correspon dance avec Clarke. Méthode de Leibniz. — Leibniz reconnaît tout ce qu’il [360-137] doit à la philosophie de Descartes. Parlant quelque part des écrits de Descartes, il dit : « Ex his lucem hausi. » Mais il ajoute, et il se plaît d’ailleurs à ajouter, que le cartésianisme n’est pas toute la vérité. Ce n’est, dit-il, que 1* « antichambre de la vérité »358. Et en effet il se sépare de Descartes tout à la fois par la méthode, l’objet et le principe de sa philosophie. Par la méthode d’abord : à l’inverse des cartésiens qui tiennent pour nul et non avenu tout ce qui a été fait avant eux, Leibniz estime qu’il y a du bon et du vrai, de l’excellent même dans toute philoso phie. La plupart des philosophes, dit-il, se sont plutôt trompés dans ce qu’ils niaient que dans ce qu’ils affirmaient359. Et, de fait, Leibniz met à contribution Platon, Aristote, saint Thomas, Campanelle, et se préoccupe d’être d’accord avec tous. Il y aurait lieu, dit-il, d’extraire de chaque philosophie le meilleur. On arriverait par ces rapproche ments à faire une philosophie durable et même éternelle, perennis quaedam philosophia. Il y a donc chez Leibniz cette pensée, partout présente dans son œuvre, que la vérité a été aperçue de points de vue différents et avec plus ou moins de clarté par tous les grands penseurs de tous les temps. Et cette pensée, comme nous verrons, cette pensée inspira trice de sa méthode et jusqu’à un certain point de sa métaphysique, dérive en un certain sens de cette métaphysique elle-même. Chaque monade en effet est représentative de l’univers360, et la pensée qui s’approfondit elle-même sincèrement ne peut découvrir que la vérité [361-138] qu’elle aperçoit tantôt distinctement, tantôt confusément, selon le point de vue qu’elle représente sur la totalité des choses. L’éclectisme de Leibniz n’est donc pas cette méthode361 qui consiste à cueillir chez les différents philosophes les idées les plus voisines du
108
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
sens commun pour les coudre ensuite bout à bout. Cette méthode, qui n'est pas à dédaigner pour la solution des problèmes moraux quoi qu’on en ait dit, est inapplicable à la métaphysique. L’éclectisme leibnizien consiste bien plutôt à approfondir les diverses doctrines méta physiques, à les creuser jusqu’au point où on les voit converger et comme coïncider ensemble. C’est ainsi que les diverses monades, si elles pouvaient éclaircir toutes leurs perceptions, deviendraient identi ques362 les unes aux autres. Objet et principe de cette philosophie. — C’est sur l’idée qu’on doit se faire de la substance et plus particulièrement de la matière que Leibniz se sépare d’abord de Descartes. Alors que Descartes avait dit que l’essence de la matière était l’étendue, que le mécanisme était toute vérité et qu’il fallait faire table rase de toutes les facultés, puissances et propriétés, dont la philosophie avait vécu depuis Aristote, Leibniz s’aperçoit que, si ces propriétés et puissances ne devaient pas entrer dans les explications scientifiques proprement dites, elles avaient pour tant leur place en métaphysique, que si le mécanisme exprimait la vérité, ce n’était que la vérité extérieure363, pour ainsi dire, qu’enfm l’étendue à elle seule ne pouvait ni expliquer tout ce que nous savons de la matière, ni fonder la réalité de la substance. [362-139] En effet : 1° Si l’essence de la matière est l’étendue, comment la matière oppose-t-elle une résistance au mouvement364, comment un corps qui en rencontre un autre perd-il quelque chose de ce mouvement ? C’est donc que le corps qu’un autre corps rencontre lui oppose une force qui lui est propre, et que le corps est autre chose qu’étendue. 2° L’étendue est une multiplicité, c’est-à-dire une répétition365, et elle ne peut par conséquent se concevoir que grâce à une substance qui se répète. Or cette substance est nécessairement inétendue, sinon le même raisonnement s’y appliquerait encore. Ainsi la science et la métaphysique sont d’accord sur ce point : l’explication cartésienne est insuffisante. Leibniz reconnaît cependant que tout se passe à la surface des choses comme si Descartes avait raison. Les mouvements s’expliquent par des
LEIBNIZ
109
mouvements, et toute explication de détail doit se faire selon les prin cipes du mécanisme. Mais ce mécanisme auquel nous soumettons les choses dans l’espace n’est, pour ainsi dire, que la représentation symbo lique366 de ce qui se passe réellement dans les choses mêmes. Que sont donc les choses réelles ? Qu’est-ce que la substance ? Les MONADES. — Si nous partons de l’étendue pour retrouver l’élément simple qui est la substance, nous risquons fort de ne pas aboutir, car nous diviserons indéfiniment l’étendue et nous trouverons toujours de l’étendue qui sera encore divisible. Jamais nous ne ren contrerons la substance simple. Ce n’est pas par analyse que nous devons procéder, mais par synthèse. Nous reconstruirons par la pen sée ces substances simples, et nous montrerons comment, se compo sant entre elles, elles [363-140] nous donnent l’idée d’une masse éten due. Quelles sont donc les propriétés de ces substances simples ? 1° La monade est inétendue ; ce n’est pas un point mathématique, car le point mathématique est dans l’étendue ; c’est, dit Leibniz, un point métaphysique, une substance simple367, c’est-à-dire sans parties. Com ment donc ces monades inétendues composeront-elles par leur réunion des corps étendus ? C’est que l’étendue est une perception confuse, c’est la forme que prend pour nous un agrégat de monades dont nous ne connaissons que la masse, c’est-à-dire l’ensemble. Ce que nous appelons espace n’est qu’un ordre de coexistence368. En d’autres termes, par cela seul que nous percevons confusément une multiplicité quelle qu’elle soit, nous la percevons dans l’espace, l’espace étant le symbole pour ainsi dire de cette confusion dans la multiplicité. Ainsi toute réalité vue en elle-même, du dedans et non du dehors, est inétendue. 2° La monade ne saurait commencer que par création et finir que par annihilation369. En effet, une substance composée se forme par combinaison de substances simples et sa fin est une dissolution ; mais la monade est une substance simple, elle ne peut donc que sortir du néant et y rentrer. Tout autre commencement et toute autre fin seraient incompréhensibles pour elle. 3° Les monades ne peuvent en aucune manière agir les unes sur les autres. « Elles n’ont pas de fenêtres par lesquelles quelque chose
110
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
puisse entrer ou sortir. »370 En effet, toute altération d’une substance par une autre substance vient, selon Leibniz, de ce que les parties de la première sont transposées ou déplacées par l’action de là seconde ou, en d’autres termes, [364-141] Leibniz considère toute influence d’une substance sur une autre substance comme un phénomène de la nature du choc. Or des monades sont inétendues et simples. On ne saurait donc en déplacer les parties, puisqu’elles n’en ont pas, ni sup poser entre elles des mouvements ou des chocs, puisqu’elles ne sont pas dans l’espace. Donc toute monade est enfermée en elle-même, incapable de faire impression sur les autres, incapable d’en subir l’ac tion et l’influence. 4° Il suit de là que toutes les monades doivent se distinguer les unes des autres371 et qu’il n’y en a pas deux qui se ressemblent. En effet, si l’espace n’est pas une réalité, les différences de situation dans l’espace ne peuvent pas être des différences réelles. Elles ne peuvent que symboliser d’autres différences, qui ne sont plus alors des diffé rences de position, mais des différences internes de la monade. C’est ce que Leibniz exprime et explique d’une autre manière par le principe des indiscernables. Deux monades identiques n’en feraient qu’une, ditil. Et, en effet, par où se distingueraient-elles ? Ce ne pourrait pas être par leur situation dans l’espace, puisque ces situations différentes doi vent précisément leur différence à l’état interne des monades. 5° Mais si toutes les monades se distinguent les unes des autres, et si cette distinction ne peut porter ni sur la position ni sur la forme, puisque la monade considérée en elle-même est inétendue, les diffé rences entre monades ne peuvent être que des différences internes. Il faut se représenter en effet les monades quelles qu’elles soient par ana logie avec notre esprit, qui est une monade. Les monades, dit Leibniz, sont des « âmes en [365-142] raccourci »372. Or par où des esprits se distinguent-ils les uns des autres, et par où se distinguent aussi les dif férents moments de l’existence d’un esprit ? C’est, dirions-nous aujourd’hui, par les états psychologiques qui répondent à ces diffé rents moments, ou qui remplissent ou déterminent ces différents esprits. C’est ce que Leibniz exprime en disant que les monades diffè rent les unes des autres par leurs perceptions, et que toute différence
LEIBNIZ
111
réelle est une différence interne ou perception. La perception, telle que Leibniz l’entend, est bien un état de conscience, mais un état de conscience qui peut être tellement vague, tellement confus, tellement obscur, qu’il équivaut pratiquement à l’inconscience373. Leibniz réserve le nom d’aperception aux perceptions disdnctes et, comme nous dirions aujourd’hui, pleinement conscientes. Mais, à côté des aperceptions qui sont, dit-il, des perceptions aperçues, il y a des per ceptions non aperçues ou faiblement aperçues. L’erreur des cartésiens a été de ne pas les remarquer, c’est-à-dire de ne pas admettre de degrés dans la pensée et, comme nous dirions aujourd’hui, dans la conscience. Par là, ils ont été conduits à croire que les bêtes n’ont pas d’âme et qu’il n’y a pas d’autres âmes que les esprits raisonnables, comme aussi ils se sont imaginés que l’âme pensait toujours, oubliant ces états de torpeur, d’enveloppement374, où la pensée est latente, obscure, confuse, tout en continuant d’exister. Leibniz, en établissant contre les cartésiens l’existence des peütes [366-143] perceptions375, ou perceptions non aperçues, substitue par là même à la philosophie car tésienne, qui établissait une distinction radicale entre la matière et l’es prit, entre l’étendue et la pensée, une métaphysique beaucoup plus compréhensible où la matière et l’esprit sont considérés comme analo gues en nature. Il n’y a qu’une seule espèce de substance, la monade ; et cette monade est de même nature que notre esprit. Mais il y a une infinité de degrés dans la perception des monades, et ces degrés sont mesurés par la clarté et la distinction de leurs perceptions. C’est ainsi que la monade qui est mon esprit comprend nombre de perceptions distinctes, au lieu que, si nous pouvions voir du dedans une quel conque des monades dont la masse confuse nous apparaît sous la forme d’un corps, nous n’y verrions guère que des perceptions confuses et non aperçues. 6° A côté de la perception qui fait la différence qualitative des monades, Leibniz place l’appétition376, qui est le principe d’activité de la monade. Aucune monade, en effet, ne reste indéfiniment ce qu’elle est, mais chacune d’elles passe par des perceptions successives qui sont les changements de la monade. Ces changements continuels ne peu vent s’expliquer que par une espèce d’effort intérieur et inhérent à la
112
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
monade, et cet effort Leibniz l’appelle appétition. L’appétition est donc ce principe interne de changement qui fait que la monade va de perception en perception [367-144] sans toujours parvenir entièrement à la perception où elle tend377. Du moins elle en obtient toujours quelque chose. 7° Nous arrivons maintenant au point central de la théorie des monades. Ces perceptions par lesquelles la monade passe ne sont pas les perceptions d’une réalité qui lui serait extérieure, car la monade n’a pas de fenêtre sur le dehors. Les perceptions ne sont donc en quelque sorte que des rêves de la monade, et l’appétition qui pousse de percep tion en perception n’est pas autre chose que ce mouvement intérieur de déroulement, si l’on peut ainsi parler, par lequel les perceptions qui préexistaient dans la monade à l’état obscur et confus arrivent succes sivement à la pleine lumière de l’aperception. C’est ce que Leibniz exprime en disant que chaque monade est un miroir de l’univers378 tout entier et qu’elle est représentative de tout l’univers. Dans chaque monade, en effet, tout l’univers passé, présent et avenir existe obscu rément dessiné. Le progrès de l’expérience de la monade consiste à éclaircir les points d’abord obscurs de cette image. Dès lors, nous pouvons exprimer sous une forme plus claire la différence qui sépare les monades les unes des autres. Si chaque monade représente la tota lité des autres monades et si par là elle exprime tout l’univers, elle l’ex prime d’un certain point de vue qui est le sien, et les diverses monades sont [368-145], pour parler comme Leibniz, autant de point de vue sur la totalité des choses. Toutes représentent le même univers, mais les parties de cet univers représentées confusément dans l’une le sont dis tinctement dans une autre379. C’est ainsi qu’en contemplant une même ville380 du haut de différentes collines environnantes on en obtient autant de vues d’ensemble qui toutes représentent la même ville et toutes la représentent différemment. 8° Il suit de là que toutes les monades sont, comme nous dirions aujourd’hui, complémentaires les unes des autres. Aucune d’elles n’exerce une action sur les autres ni n’en reçoit. Mais, comme ce qui est représenté confusément chez l’une est représenté distinctement dans une autre, la première est passive par rapport à cette représentation, et la
LEIBNIZ
113
seconde active, et tout se passe pour les deux monades comme si elles agissaient l’une sur l’autre. Mais d’où vient qu’elles sont complémentaires ? Et si chacune des monades exécute sa partie dans le concert uni versel sans sortir d’elle-même, sans apercevoir directement les autres, d’où vient que tout conspire, que tout est harmonieux, d’où vient enfin que tout se passe entre monades comme si elles agissaient et réagissaient les unes sur les autres ? C’est là un effet de l’harmonie préétablie, car Dieu, en créant les monades, et en faisant de chacune d’elles un miroir de l’univers, a réglé pour chacune d’elles tout de qui s’éclairerait progressi vement [369-146] dans sa représentation du tout, et il a si bien réglé les choses (que tout se passe) comme s’il y avait action réciproque, alors qu’il y a seulement évolution parallèle. HiÉRARCHIE DES MONADES. — Il suit de là que la monade pourrait se définir un point de vue sur l’ensemble des choses et que sa substantialité n’est pas autre chose que l’intime liaison des perceptions qui, réunies, constituent sa représentation de l’univers. Il s’ensuit égale ment que le nombre des monades est infini, bien qu’il n’y en ait pas deux qui se ressemblent, car il faut que tous les degrés de la perfection soient réalisés381 et, par conséquent, qu’il y ait autant de substances qu’on peut concevoir de points de vue sur le tout. Quels sont les prin cipaux degrés de cette hiérarchie ? 1° Les simples monades ou les monades nuer382. — Leibniz appelle ainsi des monades qui n’ont que des perceptions insensibles et dont l’acti vité se réduit à une infinité de perceptions infinitésimales qui ne s’unissent jamais de manière à former des perceptions plus relevées et tant soit peu distinctes. Ce sont ces monades nues qui entrent dans la composition de la matière proprement dite. La théorie de la matière est extrêmement obscure chez Leibniz. Leibniz distingue entre les masses et les organismes. Les organismes sont formés par un groupe de monades subordonnées à une monade dominante. Quant aux masses, il ne s’y trouve pas un ordre fixe entre les monades dont elles sont composées. Toutefois, en y regardant de près, on verrait que les masses elles-mêmes sont organisées dans leurs parties. Ce sont des amas confus d’organismes. Les organismes s’y rencontrent « comme
114
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
les poissons dans un étang »383. Ainsi la vie est partout384, partout aussi la hiérarchie et la subordination. — Mais qu’est-ce que la résistance des corps, leur étendue, leur maté-[370-147]rialité ? Il y a ici chez Leib niz une distinction très obscure entre ce qu’il appelle la matière pre mière, ou matière nue, et la matière seconde ou matière vêtue385. Ce que Leibniz appelle matière nue, c’est ce qu’il y a de passif dans les monades constitutives des masses ou des organismes, c’est ce qu’il y a de confus ou d’indistinct dans leurs perceptions. Comme l’harmonie préétablie exige que ce qui est représenté confusément dans certaines monades le soit distinctement chez d’autres386, une monade tend par la passivité qui est en elle à s’adjoindre d’autres monades qui la complè tent, et c’est ce que Leibniz exprime en disant qu’il y a dans ces monades inférieures « une exigence de l’étendue »387. La matière pre mière n’est donc qu’une abstraction et c’est la matière seconde qui est la réalité. Leibniz donne encore le nom d’ « antitypie » à cette exi gence de l’étendue qui vient de la passivité de la monade. L’antitypie est donc ce qu’il y a d’essentiel dans l’étendue, c’est cette exigence de l’étendue qui vient à la monade de ce qu’elle a besoin d’être en rela tion de coexistence avec d’autres monades. 2° Les âmes. — Leibniz appelle ainsi les monades douées de senti ments ou de sensations, c’est-à-dire des monades chez lesquelles les perceptions ont quelque chose de relié et de distinct parce qu’un très grand nombre de petites impressions y sont comme ramassées, et for ment par leur réunion une impression distincte388. Dans les âmes, nous trouvons l’attention et la mémoire389 ; la monade nue était mens momentanea. On y trouve aussi des associations d’idées, ou, comme dit Leib niz, des consécutions d’images ; cette consécution toute empirique imite le raisonnement. L’homme d’ailleurs est lui-même empirique dans les trois quarts de ses actions. Les âmes appartiennent aux bêtes ; chez l’animal, l’appétition devient passion et, de la multitude innom brable de perceptions confuses qui sont le fond de la vie psychique, résulte une vague inquiétude390 [371-148] « qui travaille l’animal lors qu’il fait des efforts en tous sens pour se mettre à l’aise ». 3° Les espritj391. — Ce sont des âmes raisonnables, ce sont des monades qui n’ont pas seulement la perception pure, ni même, comme
LEIBNIZ
115
les animaux, la sensation, mais encore la pensée, c'est-à-dire la percep tion absolument distincte. L’essence de la pensée, d’après Leibniz, est la raison ou réflexion. Les esprits sont des monades capables d’actes réflexifs. Par la réflexion, nous pouvons nous connaître nous-mêmes, réfléchir sur nous. Par la réflexion, nous nous élevons à Dieu, dont l’idée est enveloppée dans celle du moi. Par la réflexion, nous conce vons les vérités universelle, et nécessaires d’une part, et d’autre part nous devenons capables d’agir librement. Arrêtons-nous sur ces deux points. A / Théorie de la connaissance. D’après Leibniz, il y a deux grands principes392 et deux seulement qui président à la connaissance et sont le fond de notre raison. Premièrement, le principe d’identité ou de contradiction ; deuxièmement le principe de raison suffisante. Ce der nier principe en engendre d’autres qui sont : le principe de continuité, en vertu duquel tout va par degrés dans la nature et rien par sauts. En effet, s’il y avait saut brusque d’un degré à l’autre, par exemple de A à B, il n’y aurait aucune raison suffisante pour que Dieu ait réalisé B de préférence à un degré de perfection plus éloigné de A ou moins éloigné. Et cette objection subsistera tant qu’on n’aura pas réalisé tous les degrés de perfection. Le principe des indiscernables. Il n’y a pas deux êtres semblables, identiques dans l’univers : car si A était iden tique à B il n’y aurait pas de raison suffisante pour que Dieu ait mis A là où A se trouve et non pas là où se trouve B. D’ailleurs, cette doc trine des monades exige l’infinie diversité des monades. Rappelonsnous que les différences de position exigent des différences de qualité. [372-149] La loi d’analogie, en vertu de laquelle nous trouvons partout les traces d’une même intelligence. L’analogie résulte d’ail leurs nécessairement de ce que toutes les monades expriment le même univers. De ces deux grands principes, principe d’identité et principe de raison suffisante, le premier est, d’après Leibniz, la loi des possibles ou des essences393, le second la loi des existences. En d’autres termes, la non-contradiction est seulement signe de possibilité ; mais, pour que ce possible ait été réalisé, il faut que Dieu ait eu une raison suffisante de le choisir ; raison suffisante est d’ailleurs synonyme de perfection .
116
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
Quelle est l’origine de ces principes ? Locke prétend que toute connaissance vient de l’expérience, et Descartes a parlé d’innéité. Leib niz fait la synthèse de ces deux théories et trouve la conciliation dans le concept de virtualité395. Sans doute toute connaissance vient de l’ex périence. Mais l’expérience ne sert qu’à réveiller certaines tendances qui existaient déjà en nous, qui étaient prêtes à l’action. Les principes sont préformés dans l’intelligence avant l’expérience, ils y existent vir tuellement. Telle est la première solution que Leibniz propose du pro blème. Comme toujours, il se place d’abord au point de vue de ses prédécesseurs. Mais, derrière cette solution, il y a une idée plus pro fondément leibnizienne, c’est que la monade étant incapable de sortir d’elle-même aperçoit en elle et non pas en dehors d’elle tout ce qui constitue son expérience. Qu’est-ce que percevoir ? C’est éclairer des parties obscures et confuses de soi-même. Alors, à la question posée entre Descartes et Locke, Leibniz répond qu’en un certain sens tout est inné et qu’en un autre sens tout est acquis par l’expérience. Toute connaissance est [373-150] innée, puisqu’une monade ne saurait sortir d’elle-même. Mais toute connaissance est acquise par l’expérience puisqu’elle commence par être confuse pour devenir distincte et que ce passage de la confusion à la distinction est précisément ce que nous appelons la connaissance par expérience. B / Théorie de la liberté. Les esprits sont libres car on trouve chez eux tous les caractères de la volonté libre, c’est-à-dire : 1° l’intelli gence ; 2° la spontanéité ; 3° la contingence. L’intelligence enveloppe la connaissance, l’intuition distincte de l’objet de la délibération. La spontanéité est la faculté de se déterminer soi-même. Et la contin gence est l’exclusion de la nécessité logique. Or nous sommes intelli gents, nous sommes capables de spontanéité et enfin chacun de nos actes est tel que l’action contraire n’est pas absurde. Comment accor der396 cette théorie de la liberté avec l’hypothèse de l’harmonie prééta blie ? Si Dieu a réglé le développement de toutes les monades, si l’ave nir de chaque monade est préformé dans son présent, s’il n’y a rien dans l’univers qui n’ait été voulu par Dieu, tout n’est-il pas déterminé et fatal ? Pourtant Leibniz proteste vigoureusement contre le fatalisme musulman, le fatum mahumetanum1'*1. Il proteste non moins contre le
LEIBNIZ
117
fatalisme de Spinoza. C’est que dans l’idée de Leibniz, le fatalisme consiste essentiellement à prétendre que tout ce qui arrive devait nécessairement arriver en vertu du principe de non-contradiction, de telle sorte qu’il eût été absurde que ce qui arrive n’arrivât pas. Or, d’après Leibniz, il n’y aurait rien d’absurde à ce qu’un événement ou un acte humain fût autre qu’il n’est, et le [374-151] seul principe d’identité ne suffirait pas à le faire prévoir. Néanmoins, cet événe ment, cette action est398 déterminée à l’avance, il doit avoir lieu, mais il le doit en vertu du seul principe de raison suffisante et par ce que cela vaut mieux pour l’ensemble de l’univers. Ce sont des raisons d’ordre et de perfection, non des raisons logiques qui déterminent cette action. Ce n’est pas une nécessité logique qui plane sur le monde, c’est une « nécessité morale ». Il faut sans doute que toutes choses aient lieu comme Dieu l’a voulu, mais Dieu a voulu ainsi les choses parce qu’il voulait le meilleur. Un autre ordre de choses est possible ; donc cet ordre est contingent, quoique déterminé à l’avance. La doctrine de Leibniz est donc un déterminisme absolu. Mais Leibniz échappe au fatalisme en vertu d’une certaine définition du fatalisme399 qui lui est propre ; et s’il affirme la liberté, c’est après en avoir donné une définition qui fait de la liberté une véritable nécessité. Mais cette nécessité est morale et Leibniz espère ainsi échapper au fatalisme. 4° Au-dessus des esprits, Leibniz place les Génies, qui sans être entièrement dégagés des liens de la matière approchent de plus en plus la perfection des esprits purs. Il faut en effet que toutes les formes de la perfection soient réalisées et nous ne pouvons pas sauter brusque ment des esprits à Dieu. 5° Dieu. — Dieu est la monade suprême, celle qui est pur esprit. L’existence de Dieu se prouve : a) par l’harmonie préétablie*00, qui exige, pour s’expliquer, un être d’une puissance et d’une sagesse infi nies , b) par la contingence401 des change-[375-152]ments qui se font dans le monde : car il faut qu’il y ait un choix entre les possibles et, par conséquent, un être infiniment intelligent et bon pour faire ce choix ; c) par l’essence même de Dieu, car, si l’on peut établir que Dieu est possible, il existe en vertu de la preuve ontologique402. Dieu
118
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
est nécessairement possible, puisqu’il n’y a rien en dehors de l’absolue perfection qui puisse l’empêcher d’exister. Le Dieu de Leibniz diffère essentiellement de celui de Spinoza403, il n’est pas l’unique substance, car Leibniz multiplie infiniment les substances, et par là le spinozisme est détruit. Dieu est la substance suprême qui crée toutes les autres par des fulgurations404 continuelles, mais ces autres substances existent par elles-mêmes. Dieu se représente tous les mondes possibles405 et, en vertu de sa bonté, il choisit le meilleur d’entre eux : son entendement étant infini conçoit l’infinie diversité ; sa volonté réalise nécessaire ment le meilleur d’entre les possibles. Ainsi les choses finies ne sont pas nécessaires, comme le voulait Spinoza, leur existence est contin gente. Et l’explication des choses n’est pas dans le principe logique d’identité, mais dans le principe de raison suffisante, c’est-à-dire dans une raison de perfection. L’optimisme résulte donc de la conception leibnizienne de Dieu. On peut démontrer l’optimisme a priori406. Il eût été contraire au prin cipe de raison suffisante que Dieu ne choisît pas le meilleur des mondes possibles. Dieu est régi par la nécessité morale de ce principe ; cette nécessité morale est précisément la liberté. Leibniz ne se contente pas de cette démonstration a priori. Il examine les différentes formes de mal : le mal physique, le mal moral et le mal métaphysique407. Il atténue les deux premiers [376-153] et les ramène au dernier408 qui est nécessaire, puisque le monde, étant créé, diffère de Dieu. Si Dieu a témoigné de sa bonté dans la création de l’univers et dans l’orientation qu’il a donnée à toutes choses, il y a une partie de la création qu’il préfère, ce sont les âmes raisonnables, celles qui ressem blent le plus à Dieu, « car si les âmes en général sont des miroirs vivants de l’univers des créatures, les esprits sont en outre des images de la Divinité. C’est ce qui fait que les esprits sont capables d’entrer dans une manière de société avec Dieu, et qu’il est à leur égard non seulement ce qu’un inventeur est à sa machine, mais encore ce qu’un roi est à ses sujets et même un père à ses enfants »409. C’est pourquoi l’assemblage de tous les esprits doit composer la Cité de Dieu, et c’est pourquoi aussi il y a « harmonie entre le règne physique de la nature et le règne moral de la grâce »410, c’est-à-dire entre Dieu considéré
HOBBES
119
comme architecte de l’univers et « Dieu considéré comme monarque de la cité divine des esprits ». Leibniz entend par là que, si Dieu a dis posé la série des causes et des effets de manière que tout ce qui se passe soit conforme aux lois de la nature, il a fait ces lois elles-mêmes de telle sorte que les bons soient récompensés naturellement et les méchants punis, soit tout de suite, soit dans une existence ultérieure, car la mort est un état de torpeur qui sera suivi d’un réveil. Cette doctrine implique une certaine conception des rapports entre la causalité et la finalité. D’après Leibniz, la série mécanique des causes et des effets n’est pas autre chose que la série intelligente et morale des moyens et des fins, mais renversée411. Le physicien qui explique chaque état des choses par [377-154] l’état précédent ne voit que méca nisme ; et Dieu a disposé en effet les choses de manière à ce que ce mécanisme soit régulier. Mais ce mécanisme n’est que l’aspect exté rieur des choses. L’explication métaphysique consiste à rendre compte d’un état du monde par les états suivants, c’est-à-dire par l’attraction de la fin, et ainsi, au-dessus des raisons physiques qui sont les raisons superficielles, il y a des raisons profondes qui sont des raisons morales. C’est ainsi que, sans violer les lois de la nature, Dieu récompense et punit412, parce que ces lois ne sont que des moyens institués par Dieu en vue de cette récompense et de cette punition. C’est ainsi que cette conciliation du mécanisme et de la finalité, que nous avons signalée dès le début comme le principal objet de la philosophie leibnizienne, est opérée par une certaine interprétation morale des lois de la nature.
HOBBES
1588-1679. Le De cive paraît en 1642. Le Léviathan**, ou la matière, la forme et l’autorité du gouverne ment. Logica**. En même temps que politique, il est aussi un physicien415 et un logicien416.
120
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
Il est matérialiste, encore qu’il ait déguisé son matérialisme. Pour lui tout se ramène à des corps et mouvements des corps. Cependant, pour lui, la sensation serait une réaction du corps contre l’impres sion venue du dehors, ce qui n’est pas absolument l’idée d’Epicure417. Les idées dérivent des sensations. L’idée générale est un nom qui sert à connoter un certain nombre de sensations qui se ressem blent : c’est le premier nominaliste moderne418. Il définit ensuite les degrés de généralité des idées : les opérations mentales, d’après lui, se ramènent à deux processus : addition (idées de plus en plus com préhensives) et soustraction (idées de plus en plus vides, de plus en plus générales). Cette vue intéressante aurait pu lui inspirer l’applica tion du calcul à la logique. La sensation mise à part, Hobbes se rallie à Epicure. Son originalité est en politique : il part de ce point que la seule tendance naturelle est l’égoïsme419 ; aussi, à l’état naturel, l’homme cherche uniquement la satisfaction de ses instincts naturels, il rencontre les instincts des autres hommes, c’est le plus fort qui l’emporte et le droit se confond avec la force420. Cet état de guerre amène par une réaction naturelle le besoin de la paix, parce que l’homme reconnaît dans la paix son intérêt421. En effet, l’état de nature ne peut satisfaire tous les besoins de l’homme, surtout ses besoins [510] moraux. L’homme cherche alors la vie sociale. Il voit que la société n’est possible que s’il abandonne son droit, c’est-à-dire sa force422. Il abandonne tout au souverain423. Il y a plusieurs formes d’Etat ; Hobbes préfère l’état monarchique424. Dans tous les Etats, tous abandonnent leurs droits au souverain, qui est le droit puis qu’il réunit toute la force. Hobbes n’a pas dit explicitement que tout s’est passé ainsi. C’est plutôt une explication juridique : tout doit se passer comme si la société avait pris naissance à la suite d’un contrat425. Pour Rousseau, l’état de nature est l’état idéal ; pour Hobbes, l’état de nature est le plus misérable. Pour Rousseau, le rôle de l’Etat est de nous éloigner de la nature426 ; pour Hobbes, ce serait plutôt de réagir contre la nature aussi, mais pour nous amener au mieux.
LA PHILOSOPHIE DU XIXe SIÈCLE
121
LA PHILOSOPHIE DU XIXe SIÈCLE
L’Ecole française. Deux mouvements en France au XIXe siècle : l’école de Maine de Biran et de Victor Cousin, école spiri tualiste ; l’école positiviste. Le positivisme. — A. Comte fut le disciple et adopta en général les idées de Saint-Simon. Autre disciple de Saint-Simon, Fourier. SaintSimon426, homme bizarre, grand seigneur qui sut abandonner ses titres sous la Révolution et l’Empire pour les reprendre sous la Restaura tion. Vint à la sociologie sur le tard. Philosophe mystique. La partie qui a influé sur le positivisme, c’est sa sociologie. Saint-Simon, qui a été frappé de l’inégalité parmi les hommes, et a lu et approfondi Rous seau, voudrait que chacun soit récompensé « selon sa capacité et ses œuvres ». Aujourd’hui, la justice ne joue aucun rôle dans la répartition de la richesse. Sans s’être prononcé sur la manière de faire une équi table répartition, ses tendances permettent de voir que c’est l’Etat qui, d’après lui, devrait juger de la capacité et des œuvres de chacun. SaintSimon a eu le premier l’idée d’une étude des sociétés, des lois qui les régissent, d’un art qui compenserait ce qu’il y a de brutal et d’injuste dans la répartition des richesses. C’est ce qu’Auguste Comte lui a pris. Fourier427 a ajouté une [512] psychologie un peu étrange en se fondant sur l’attraction passionnelle : chacun a une passion fondamentale qui le différencie des autres. Il est conforme à la nature de travailler cha cun selon sa passion. Aujourd’hui le travail est désagréable parce qu’on travaille contre ses goûts. Dans la société modèle, ce ne sera plus le hasard qui distribuera le travail, et chacun sera récompensé selon ses capacités et ses œuvres. Fourier déclare ses théories applica bles à de petites sociétés. Il faut donc limiter les sociétés pour pouvoir y appliquer ces vues théoriques : c’est le phalanstère de Fourier, où les instruments de travail sont mis en commun et où chacun obtient selon ce qu’il fait. Les origines du comtisme sont donc les idées de Saint-Simon. L’idée de Comte a été d’instituer une science de la société. A. Comte,
122
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
mathématicien, élève puis professeur à l’école Polytechnique, eut des disciples célèbres en France et à l’étranger. Il trouva dans Mill428 un disciple et un ami ; en France, Littré429. A. Comte emprunte à SaintSimon l’idée de l’importance d’une science des sociétés, puis une idée qu’on regarde chez lui comme adventice, mais qui a toujours été au fond de sa pensée, bien qu’elle ne se [513] développe qu’à la fin de sa vie. C’est l’idée d’une religion nouvelle. Une religion de Dieu est impossible, car la réalité transcendante est inconnaissable ; une reli gion de la nature n’est guère acceptable ; il vaut mieux une religion de l’homme, qui en se divinisant fera de soi le but de ses progrès. 1° Quel est le but de la science ? 2° Quelle a été l’évolution de l’es prit humain ? Cette deuxième question doit être résolue avant la pre mière. C’est la loi des trois états430. Trois méthodes employées par l’esprit humain : méthode théologique, méthode métaphysique, méthode positive. D’où trois états : état théologique, recherche des connaissances absolues, explication de l’univers par des puissances surnaturelles ; état métaphysique, où les agents surnaturels sont rem placés par des forces abstraites, des entités conçues comme capables d’expliquer tous les phénomènes observés ; état positif, où l’esprit humain reconnaît l’impossibilité de notions absolues, et cherche uniquement à découvrir les relations invariables de succession et de similitude des phénomènes. L’explication des faits ne consiste qu’à les réunir. Comte prétend que les diverses sciences gardent des traces de ces trois états ; que dans chaque individu il y a trois périodes : théologien dans son enfance, méta-[514]physicien dans sa jeunesse, physicien dans son âge mûr. Quelle serait la vraie nature, le but de la science ? Connaître les faits et les enchaîner par des lois, voilà toute la science, l’expérience aidée du raisonnement. Elle laissera de côté les causes pour ne rechercher que les lois : la cause est entachée de métaphysique, les lois sont simplement le résumé des faits. La cause génératrice est une entité métaphysique. Pour connaître le but de la science, il faut classer les sciences. La classification des sciences431, qui répond à l’évolution de l’esprit scientifique, repose sur le principe de la généralité décroissante.
LA PHILOSOPHIE DU XIXe SIÈCLE
123
On a commencé par les mathématiques, puis on a continué par Tastronomie432, la physique, la chimie, la biologie, et, dans la période positive, on va passer à la sociologie qui doit être le but de toutes les autres sciences. La psychologie n’est qu’un chapitre de la biolo gie, car la méthode objective en psychologie est seule valable. Cette classification a été très attaquée par Spencer433, un positiviste. Elle suit la genèse434 des sciences et s’appuie sur les mathématiques, où on serait parti du particulier (arithmétique) pour passer par l’algèbre et arriver à l’analyse qui est beaucoup plus générale. [515] D’après Comte, un mathématicien il est vrai, on va plutôt du tout aux par ties (et c’est ce que conteste Spencer). L’astronomie est l’étude de la force physique la plus générale, celle à laquelle se ramèneront peutêtre toutes les autres. (Pour Spencer la marche du particulier au général est plus habituelle à l’esprit : cf. les mathématiques.) La bio logie a envisagé des corps vivants, puis le progrès a montré qu’il fal lait s’occuper de chaque organe, puis de chaque tissu, enfin de chaque cellule, allant toujours à des éléments de moins en moins concrets, de moins en moins viables par eux-mêmes. Mais il y a deux espèces de généralité. Celle qui a frappé un esprit non cultivé, c’est celle de Comte : celle que découvre un esprit scientifique (c’est) celle de Spencer435. Spencer et Comte ont raison, l’un subjective ment, l’autre objectivement. La sociologie est dans l’idée d’A. Comte la science de l’avenir, celle qu’il appelle la physique sociale. La sociologie est le but de la philosophie positive, les autres sciences sont des [516] moyens dont la sociologie est la fin. Cette sociologie devait avoir deux parties : la sta tique sociale et la dynamique sociale. En définissant la loi, un rapport qui résulte de la nature des choses, Montesquieu avait vu un côté de la question, la statique sociale. Comte introduit une comparaison, dont on a abusé depuis, la société comparée à un organisme436. Dans le corps humain, comme dans la société, l’ordre et le progrès437. Comte a subi l’influence de Condorcet, le théoricien de l’idée de progrès. La sociologie prendrait son point d’appui dans l’histoire et la biologie. Comte exclut la psychologie parce qu’elle se sert de la méthode d’observation intérieure ; celle-là lui paraît défectueuse.
124
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
Ce qu’il faut retenir du positivisme, c’est cet essai si fructueux d’une philosophie des sciences, et, d’une science sociologique, Comte a indiqué les grandes lignes de la méthode sociologique. Quant à la religion fondée par A. Comte, ce n’est pas une pièce de rapport : [517] Comte a toujours eu cette idée, empruntée à SaintSimon, que l’intelligence doit être soumise au cœur, et la troisième partie de sa vie (fondation de cette religion) n’est pas une période d’aberration. Elle avait été préparée par les deux autres. L’école de Maine de Biran et de V. Cousin. — Maine de Biran, député sous la Restauration, a philosophé surtout pour lui. Beaucoup de ses ouvrages ont été publiés après sa mort. Le Mémoire sur l’habitude138 est son premier ouvrage, fortement teinté de sensualisme. Parti de Condillac, en s’approfondissant, il s’aperçut que la sensation ne suffi sait pas. Après le sensualisme, la voie s’ouvrait à une philosophie qui s’appuierait sur l’intelligence ou à une philosophie s’appuyant sur la volonté. Cette dernière est la philosophie de Maine de Biran. Sa philo sophie, protestation peut-être contre le relativisme de Kant, surtout contre le sensualisme de Condillac439. Dans la seconde partie de sa vie, au-dessous de tous les phénomènes, il croit trouver le principe de l’être dans l’effort, l’être étant le vouloir440. Il pousse cette idée jusqu’à ses dernières conséquences, séparant l’âme qui fait effort de celle qui sent. La philosophie de Maine de Biran n’est claire que dans cette ana lyse qui fait de l’effort l’essence [518] du moi. Maine de Biran, dans une dernière période de sa vie, aboutit à des conceptions mystiques. Sa philosophie n’a pas eu une grande influence, car l’éclectisme luimême s’est éloigné de plus en plus de Maine de Biran — car il a laissé de côté l’observation intérieure, la préconisant toujours mais la prati quant peu. Victor Cousin. — Parti du panthéisme ou de quelque chose d’ap prochant441, il connut et étudia Kant, et crut plus tard avoir réfuté Kant. Son idée dominante, c’est la valeur dominante de la Raison. Il a cru trouver [là] le point faible de la doctrine kantienne : il y a une Rai son impersonnelle composée de quelques principes, surtout [principes
LA PHILOSOPHIE DU XIXe SIÈCLE
125
de] substance et causalité, nécessaire, absolue, éternelle, existant en soi442. Notre intelligence, en tant qu’elle en participe, sort du relatif et, en les appliquant, crée une science qui a une valeur absolue. Il aurait fallu réfuter Kant par le menu, c’est ce que Cousin n’a pas fait. Partant de cette idée, il a parlé de ses essences supérieures, Beau, Vrai, Bien, platonisme rénové et affaibli. Cousin a essayé une philosophie de l’histoire de la philosophie. On commence par le sensualisme, puis, par opposition [519], voyant l’in suffisance du sensualisme, on passe à l’idéalisme ; de la lutte entre le sensualisme et l’idéalisme naît le scepticisme. L’esprit fatigué passe au mysticisme, c’est-à-dire à la croyance sans raison. Cependant il y a des progrès, car chacun de ces quatre systèmes revient tour à tour, mais complété. Le progrès n’est pas un cercle, il se fait en spirale. Cette classification est insuffisante : le sensualisme est un acc[ident] dans la philosophie. Le scepticisme n’est pas une tendance positive en philosophie, c’est une négation, une impulsion à chercher. Le mysticisme, l’idéalisme sont des tendances philosophiques, mais Cousin n’a pas approfondi la tendance idéaliste. L’éclectisme n’a été professé par Cousin que pendant une dizaine d’années. Cette méthode consistait à faire un choix de ce qui devait rester de chaque système. Mais il s’aperçut qu’on ne bâtit pas un sys tème de philosophie de pièces et de morceaux et il l’a abandonné virtuellement. Il s’est fort inspiré des Ecossais pour [520] la psychologie, excepté dans la théorie de la raison (où il s’inspire) des Anciens443. Proudhon et la morale indépendante. — L’idée d’une morale indépen dante a été développée par Proudhon puis par des disciples (dans la Revue de morale indépendante). La philosophie sociale de Proudhon est assez abstruse ; il procédait par antithèses et thèses comme Hegel444. Pour la morale, il la détache de toute métaphysique, mais, tandis que l’utilitarisme cherche un fondement matériel dans l’intérêt, Proudhon part de la liberté. L’homme naît libre, il doit continuer d’être libre. Cette philosophie se rattache aux théories de Rousseau, ce sont les théories de Rousseau reprises et accommodées à de nouveaux besoins. Il suffît de
126
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
considérer cette liberté innée pour établir droit et devoir. Le droit445 est la liberté que nous apportons en naissant, la liberté nous est donnée la plus grande possible par la nature. Le droit, illimité à l’état de nature, devient limité dans la société. Le droit en tant qu’exprimant la liberté naturelle, voilà le fondement de la morale. Si les hommes ont des droits naturels, le devoir s’ensuit. Si je puis exiger le respect de ma liberté, de mon droit, les autres ont des devoirs envers moi. Le devoir est le corol >446 le devoir est donné ; laire immédiat du droit. Dans 1* < >447 de [521] Proudhon, c’est le droit qui est l’absolu, dans 1’ < donné d’abord. Mais la question est de savoir jusqu’à quel point cette liberté peut résister aux empiétements. Confusion du fait et du droit. De ce que ma liberté existe naturellement, il ne suit nullement que l’on doive res pecter ma liberté. Il faut pour fonder le droit autre chose que le fait de la liberté. L’idée de ceux qui fondèrent la Revue de morale indépendante était aussi de la séparer de la religion. En un sens, on pourrait dire que la morale de Kant est aussi un essai de morale indépendante. La psychologie allemande. Herbart, Lotze, Wundt. — Wundt est un physiologiste, un psychologue et un métaphysicien. La méta physique de Wundt s’inspire très directement de Leibniz et même de Schopenhauer. Déjà chez Lotze448 une théorie de l’âme assez voisine de celle de Leibniz. Wundt est parti de cette idée que tout ce que nous pouvions atteindre de l’être est la tendance, la Volonté. On n’arrive pas à l’essence des choses, mais seulement à un intermédiaire dans la volonté. L’univers est formé de centres dynamiques, les représenta tions ont chacune une volonté, elles s’entre-détruisent, s’unissent. [522] La psychologie, la physique, la physiologie ne peuvent tout expliquer, il faut une métaphysique. L’originalité de sa métaphysique est d’être tout près des faits. Sans repousser l’observation par la conscience, Wundt estime cependant qu’il faut que la psychologie emprunte à la science ses pro cédés de mesure, et par là devienne objective. Il accepte la loi psycho physique de Fechner449 avec quelques modifications peu importantes. Sa théorie de la perception est la partie la plus originale sur ce point.
LA PHILOSOPHIE DU XIXe SIÈCLE
127
Wundt a varié. D’abord il a été d’avis que toute sensation serait la conclusion d’un raisonnement inconscient et, tandis qu’on considère le raisonnement comme le fait le plus élevé de la vie mentale, Wundt en faisait le procédé le plus simple de la vie psychologique. Les sensa tions forment des synthèses qui sont les idées, et ces dernières forment de nouvelles synthèses qui sont les jugements450. Cependant il n’est pas associationniste. Dans l’édition postérieure, il substituera une autre théorie, moins précise : il distingue entre les mouvements nerveux inconscients et l’aperception. [523] La PSYCHOLOGIE anglaise. — Cette psychologie a vécu. L’associationnisme s’est fondu dans l’évolutionnisme et dans la psy chophysiologie. Elle a été appliquée à toutes les questions451 par Mill. Son principe général : l’association est comme la loi d’attraction en physique. Puis, application aux différentes questions452 de la psycholo gie, logique et morale. L’évolutionnisme est devenu une doctrine qui enveloppe tout : [ Caetera desiderantur.]
i
:
r
i
III LEÇONS SUR
LA CRITIQUE DE LA RAISON PURE LYCÉE HENRI-IV 1893-1894
PRÉFACE DE LA « CRITIQUE DE LA RAISON PURE
[196-121] La deuxième édition de la Critique de la raison pure contient une préface importante dans laquelle Kant résume avec beaucoup de force et de concision son œuvre tout entière, en même temps qu’il indique sa méthode et son point de départ. Dès les temps les plus recu lés, dit Kant, les mathématiques ont pris chez les Grecs le caractère d’une science certaine. Il est probable qu’on tâtonna longtemps, et que le changement qui fit des mathématiques ce qu’elles sont restées, une science certaine, fut l’effet d’une révolution intellectuelle opérée par l’heureuse idée d’un seul homme. En effet, celui qui le premier démon tra453 une proposition géométrique (théorème du triangle isocèle) dut être frappé d’une grande lumière, car « il s’aperçut qu’il ne devait pas s’attacher à ce qu’il voyait dans la figure, mais qu’il devait faire voir ce qu’il pensait a priori du concept lui-même ». C’est donc en partant de l’idée du triangle isocèle, et en analysant cette idée454, au lieu de partir de l’objet, c’est-à-dire de l’expérience, que Thalès ou quelque autre fonda la science mathématique. La physique455 mit plus de temps à trouver sa voie. Lorsque Galilée eut fait rouler sur un plan incliné des boules dont il avait lui-même choisi le poids, lorsque Torricelli eut fait supporter à l’air un poids qu’il savait d’avance être égal à celui d’une colonne d’eau à lui connue, alors la lumière se fit dans l’esprit des physiciens. Ils compri rent que la raison ne voit clairement que ce qu’elle produit elle-même, qu’elle doit « prendre l’avance »456, et que loin de se laisser conduire par la nature [197-122] elle doit l’interroger. « La raison doit aborder la
132
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
nature, non comme un écolier qui se laisse tout dire par son maître, mais comme un juge qui fait subir un interrogatoire à des témoins. En résumé, les mathématiques et la physique ont eu une période de tâtonne ments où elles allaient de la chose à l’idée, du conditionné à la condition, de l’objet au sujet. Elles ont trouvé « leur route royale » quand elles se sont orientées dans la direction inverse, allant de l’idée que nous avons à l’expérience, de l’idée à la chose, de la condition au conditionné, enfin du sujet à l’objet. La métaphysique457 n’a pas eu le bonheur de pouvoir se tracer une marche scientifique certaine, et pourtant elle est la plus ancienne des sciences, « celle qui survivrait si toutes les autres venaient à être englouties dans le gouffre de la barbarie ». Il faut refaire sans cesse le chemin de la métaphysique ; cette science paraît n’être qu’ « une arène destinée à des jeux établis pour développer les forces ». La méthode suivie jusqu’ici a certainement été une méthode de tâtonnements, comme celle qui a dû précéder la vraie géométrie et la vraie physique. Demandons-nous donc, dit Kant, si nous ne pourrions pas suivre ici l’exemple de la physique et de la géométrie. Jusqu’ici on a cru, et ç’a été le postulat de toute métaphysique, que notre connaissance devait se régler sur les objets. Essayons si l’on ne réussirait pas mieux en sup posant que les objets doivent se régler sur notre connaissance. Une réforme de ce genre en métaphysique serait comparable à celle de Copernic458, « lequel voyant qu’il ne servait à rien pour expliquer les mouvements des corps célestes de supposer que les astres se meuvent [198-123] autour du spectateur essaya s’il ne vaudrait pas mieux sup poser que c’est le spectateur qui tourne, les astres restant immobiles ». Dès l’abord, cette méthode appliquée à la métaphysique semble devoir supprimer d’évidentes difficultés. En effet, s’il y a des intuitions a priori et des concepts a priori, c’est-à-dire s’il y a quelque chose dans notre esprit antérieurement à l’expérience et indépendamment de l’ex périence, et si d’autre part la connaissance que nous avons des choses cadre avec ces intuitions et avec ces concepts, cet accord ne pourra s’expliquer dans l’ancienne hypothèse métaphysique que par une espèce d’harmonie préétablie entre notre esprit et les choses. Or c’est là une explication paresseuse, ce n’est pas une explication. La difficulté
PRÉFACE DE LA « CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
133
s’évanouit au contraire si l’on suppose que les choses se règlent sur notre esprit, c’est-à-dire que les choses ne peuvent être connues et devenir des objets de connaissance qu’à la condition de se plier à nos intuitions et à nos concepts. En résumé, « nous ne connaissons a priori des objets que ce que nous y avons mis nous-mêmes ». Telle est cette première partie de cette préface, où Kant donne l’idée générale de sa méthode et propose un déplacement du point de vue de la métaphysique. Remarquons de suite que le nerf de l’argu mentation kantienne est une comparaison de la métaphysique avec la science positive459. A l’appui de la méthode qu’il propose, Kant énonce implicitement un raisonnement par analogie, lequel pourrait se formuler ainsi : les sciences, géométrie et physique, prétendent atteindre le réel. Or elles ne se sont constituées comme sciences que du jour où elles sont [199-124] parties de l’esprit pour descendre aux choses, au lieu de remonter des choses à l’esprit ; donc la métaphy sique, qui prétend elle aussi atteindre le réel, doit partir elle aussi non des choses mais de la pensée. Kant admet en même temps que la marche suivie par la métaphysique a toujours consisté à subordonner la pensée aux choses, de telle sorte que la métaphysique aurait été jus qu’à lui gouvernée par ce principe d’Aristote : l’intelligence est mise en mouvement par l’intelligible460. Voici maintenant indiqués tout de suite par Kant les résultats généraux auxquels aboutira cette métaphy sique définitive. « Cette méthode va donner un étrange résultat qui est, suivant toute apparence, très désavantageux à cette science. Ce résultat n’est pas moins que la démonstration que nous ne pouvons jamais dépasser par la connaissance les bornes de l’expérience sensible, ce qui serait cependant l’affaire essentielle de la métaphysique. » Mais le résultat n’est désavantageux qu’en apparence. En effet, cette méta physique nouvelle, en nous montrant comment nous ne pouvons dépasser les bornes de l’expérience, nous fait voir aussi pourquoi nous voulons les dépasser. Nous voulons dépasser l’expérience parce que l’expérience ne nous donne que le « conditionné », et que le condi tionné suppose l’inconditionné461, afin que la série des conditions soit parfaite. Mais, précisément, penser l’inconditionné serait contradic toire ; il n’y a alors qu’une manière de lever cette contradiction, et par
134
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
là précisément, dit Kant, notre hypothèse initiale est vérifiée, c’est de supposer que rinconditionné [200-125] doit être trouvé dans les choses en elles-mêmes, « les choses en soi », mais que ces choses en soi nous échappent complètement, parce que notre connaissance se réglant sur les lois de notre pensée est relative à cette pensée. La méta physique, « une fois introduite par cette critique dans la voie sûre de la science, saisit parfaitement tout le champ de la connaissance de son objet ; par conséquent elle peut accomplir son œuvre et léguer à la postérité un capital qui ne sera jamais augmenté. Mais on nous deman dera quels sont les trésors de science que nous pensons laisser à nos neveux dans une métaphysique ainsi réduite à l’immobilité462. On croira que l’utilité en est purement négative ». Ce serait, d’après Kant, une erreur grave, et en y regardant de près, on verrait que cette cri tique a des conséquences et une utilité positives463. En effet celui qui se place au point de vue de la métaphysique dogmatique, c’est-à-dire courante, admet et applique sans aucune restriction les principes dont l’entendement fait usage dans l’expérience, et justement parce qu’il étend indûment l’usage et l’application de ces principes, il sera amené à tout englober dans le domaine de l’expérience ou, comme dit Kant, de la sensibilité. Par là se trouveront compromises les vérités morales464 dont l’importance est pourtant capitale. En d’autres termes, si l’on ne critique pas les principes de la connaissance, et si la métaphy sique ne consiste pas avant tout dans cette critique, comme les prin cipes de la connaissance, ainsi qu’on va le démontrer, [201-126] sont uniquement destinés à organiser l’expérience et convergent au méca nisme, le mécanisme envahira tout. Au contraire, la Critique de la raison pure, métaphysique nouvelle, en restreignant l’usage de ces principes nous permettra de croire à certaines vérités d’ordre supérieur. Prenons un exemple, la question de la liberté. Kant annonce qu’il va démontrer que l’espace et le temps ne sont que des formes de l’intuition sensible, et par conséquent de simples conditions de l’existence des choses comme phénomène ; qu’ainsi nous ne pouvons connaître aucun objet comme chose en soi, mais simplement en tant que phénomène. D’où résulte que toute connaissance rationnelle, spéculative, se réduit aux seuls objets de l’expérience. Néanmoins, nous pouvons toujours pen-
PRÉFACE DE LA « CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
135
ser465 ces mêmes objets comme existant en soi ; et, même, nous devons les penser ainsi, puisque, sans cela, il s’ensuivrait cette absurdité qu’il y a des phénomènes, c’est-à-dire des apparences, et cependant rien qui apparaisse. Si maintenant on néglige de faire cette distinction des objets de l’expérience d’une part, des choses en soi de l’autre, dis tinction qui résulte immédiatement de la critique de la raison pure, alors le principe de causalité et par conséquent le mécanisme de la nature vaudront nécessairement pour toute chose en général. Je ne pourrai donc plus dire sans tomber dans une contradiction manifeste que ma volonté est libre d’une part, et qu’elle est d’autre part soumise à la nécessité de la nature. Ce [202-127] serait une contradiction, parce qu’en parlant de la volonté de mon âme je n’attribuerais qu’un seul sens, le sens de chose en général, n’ayant pas fait la distinction des phénomènes et des choses en soi. Or cette distinction est l’œuvre même de la critique de la raison pure. Grâce à cette critique, et à cette critique seulement, je puis dire que la même volonté, considérée dans les phénomènes, est nécessairement conforme à la loi physique, et par conséquent non libre, et, d’autre part, considérée comme appartenant à une chose en soi, indépendante de cette loi, et par conséquent comme libre466. Or, sans doute, quand je me place à ce dernier point de vue, au point de vue de la chose en soi, je ne puis pas affirmer, connaître, mais je puis du moins concevoir, c’est-à-dire en ce qui concerne la liberté, affirmer qu’il n’y a pas de contradiction à ce qu’elle existe. Elle devient possible, au lieu qu’elle était impossible, qu’elle impliquait contradiction, dans la première hypothèse. Alors, supposons que la morale exige la liberté comme attribut de notre volonté ; comme la critique de la raison pure a établi que cette liberté était possible, alors nous pouvons l’admettre et, comme dit Kant, « la morale et la physique sont reconnues possibles en même temps w467. Si au contraire il avait été établi que la liberté est inconcevable en ce qu’elle contredit un principe valable sans restriction, alors « la suppo sition de la morale devrait nécessairement céder la place à celle de la physique » ; car nous ne pouvons pas accepter une contradiction. [203-128] On en dirait autant, ajoute Kant, de l’idée de Dieu, de l’idée de l’âme, considérée comme un être simple, de l’idée de l’im-
136
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
mortalité468. Tous ces concepts ne peuvent être admis, bien qu’exigés par l’usage pratique de la raison, si nous n’enlevons d’abord à la rai son spéculative ses prétentions aux aperçus transcendantaux (c’est-àdire sa prétention de dépasser l’expérience). En effet, la raison spécu lative, pour obtenir ces concepts, a besoin de principes qui, par cela même qu’ils se rapportent uniquement à l’expérience possible, trans forment toujours en phénomène les choses supérieures à l’expérience, auxquels ils s’appliquent, « et par là, rendent impossible toute exten sion pratique de la raison pure. Je devais donc abolir la science pour faire place à la foi ». Le dogmatisme de la métaphysique, c’est-à-dire la prétention à avancer dans cette science sans critique de la raison pure, est la vraie source de l’incrédulité morale469. Résumons à son tour cette dernière partie. Kant indique les résul tats généraux de sa critique ; elle nous fera voir que la connaissance est conditionnée par essence, ce qui nous fermera le monde des choses en soi. Mais si ce monde nous est fermé, c’est qu’il existe. Si nous condi tionnons les objets de l’expérience, c’est qu’il y a un inconditionné. Seulement cet inconditionné, nous ne pouvons que le concevoir. Son existence sous une certaine forme est possible. Mais [204-129] s’il y a d’autre part des raisons pratiques ou morales pour que cette réalité soit telle ou telle, nous pourrons l’affirmer ainsi, ou du moins le pos tuler. Au contraire la méthode inverse, le dogmatisme métaphysique, qui, au lieu de conditionner les objets par rapport à la pensée, règle la pensée sur les objets, cette méthode inverse, au lieu d’aboutir à deux ordres d’existence, d’un côté les phénomènes, de l’autre les choses en soi, ne peut aboutir qu’à un seul ordre d’existence. Et dès lors, si quelque principe moral, si quelque principe d’action, comme la liberté, est en contradiction avec une loi toujours vérifiée et en même temps nécessaire, comme la loi de causalité, c’est à la morale à céder. Pour tout résumer, quand dans le dogmatisme métaphysique on abou tit à une contradiction, c’est la morale qui en fait les frais. Ainsi au fond, Kant met au-dessus de toute discussion le principe de contradic tion, et c’est parce qu’en suivant la voie qu’il appelle dogmatique, celle de l’ancienne métaphysique, on aboutit à des contradictions qui ne peuvent être résolues que par le sacrifice des vérités morales
INTRODUCTION À LA « CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
137
comme la liberté, c’est pour cette raison que, ne voulant ni renoncer aux postulats moraux ni accepter des contradictions, Kant tient pour seule possible, seule acceptable, la métaphysique critique, dont le res sort est de départager les existences, d’aboutir à deux ordres d’exis tences, d’un côté les objets de l’expérience, les phénomènes, de l’autre les choses en soi.
L’INTRODUCTION A LA « CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
[205-130] Dans cette Introduction, Kant pose en termes précis ce qu’il appelle le problème de la raison pure. Résumons les considérations par lesquelles il est amené à formuler la question fondamentale : comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ? Toutes nos connaissances, dit Kant, commencent par l’expérience470. En effet, par quoi la faculté de connaître peut-elle être amenée à s’exercer, sinon par les objets qui affectent nos sens ? Mais si toutes nos connaissances commencent avec l’expérience, ce n’est pas de l’expérience que toutes nos connaissances procèdent, car « il se peut que la connaissance même qui nous vient de l’expérience soit un composé de ce que nous recevons dans les sensations et de ce que produit d’elle-même notre faculté de connaître ». C’est donc, dit Kant, une question qui demande à être examinée de près que celle de savoir s’il y a une connaissance indé pendante de l’expérience. Appelons a priori une connaissance de ce genre, si elle existe ; on appellera a posteriori les connaissances qui ont leur source dans l’expérience. Ceci posé, quels sont les caractères d’une connaissance a priori ? Marquons bien ici l’enchaînement des idées : Kant procède hypothétiquement. Son argumentation pourrait se formuler ainsi : s’il y a des connaissances a priori, quels caractères doi vent-elles présenter ? Il y a, d’après Kant, deux caractères qui doivent distinguer sûrement une connaissance pure d’une connaissance empi rique. (Kant appelle pure une connaissance a priori qui ne contient rien d’empirique.) 1° L’expérience nous apprend bien qu’une chose est telle ou telle, mais elle ne nous apprend pas qu’une chose ne puisse être autrement. Donc toute proposition nécessaire471 est une connais-
138
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
sance a priori. 2° Les jugements d’expérience ne sont jamais essentiel lement universels, universels par essence, ils n’ont [206-131] que la généralité qui s’obtient par l’induction, généralité qui signifie seu lement que, jusqu’ici, on n’y a pas trouvé d’exception. Au contraire, un jugement essentiellement universel, c’est-à-dire de telle nature qu’aucune exception ne paraisse possible, ne soit possible, dit Kant, ne peut dériver de l’expérience. Il faut donc distinguer entre l’universa lité empirique472 et l’universalité stricte ou rigoureuse. La première n’existe qu’en fait ; la deuxième existe en droit. Donc la nécessité et l’universalité absolues sont les caractères certains d’une connaissance a priori. Remarquons en passant que Kant considère la nécessité d’une part, et d’autre part l’universalité stricte et rigoureuse, laquelle n’est au fond qu’une autre forme de la nécessité, qu’une espèce de nécessité, comme des caractères irréductibles. Il ne tient aucun compte de l’opi nion des empiristes, opinion qui devait être consolidée par l’évolu tionnisme, opinion en vertu de laquelle ces caractères pourraient être acquis. L’habitude, selon l’opinion des empiristes du siècle dernier473, l’hérédité selon l’opinion des évolutionnistes de ce siècle-ci474 peuvent faire que ces connaissances acquises par l’expérience, en se consoli dant, en s’organisant, arrivent à faire partie intégrante de l’intelli gence, revêtent ce caractère de nécessité et de stricte universalité que Kant tient pour primordiales, pour irréductibles. Ainsi, entre la connaissance que Kant appelle inductive et qui ne présenterait qu’une universalité relative et la connaissance que Kant appelle a priori et dont l’universalité serait rigoureuse, il n’y aurait qu’une différence de degré, à savoir le nombre et, si l’on peut ainsi parler, l’âge des expé riences. Mais, comme nous le verrons dans tout le cours de la Critique, c’est un des postulats de la critique kantienne que de [207-132] ne tenir compte que du donné, que de l’état actuel des choses ; ce n’est pas expliquer, d’après la méthode de Kant, que de raconter l’his toire475. L’explication évolutionniste est une explication historique. L’évolutionnisme nous fait assister à la genèse des concepts dits a priori. Une explication de ce genre ne compterait pas aux yeux de Kant, parce que trop pénétré de l’irréductibilité des deux concepts de
INTRODUCTION À LA « CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
139
nécessité et de contingence, ne tenant compte que des différences de qualité entre ces deux concepts, il ne peut pas admettre qu’on passe par degrés insensibles, par des différences de quantité d’expérience, de l’un à l’autre. Si donc, parmi nos connaissances, il en est de nécessaires et de strictement universelles, on pourra affirmer qu’elles sont a priori. Les caractères de la connaissance a priori étant déterminés, il est très facile de montrer, nous dit Kant, qu’il y a dans la connaissance humaine des jugements nécessaires et strictement universels, c’est-àdire par conséquent des jugements purs a priori. En veut-on un exemple pris dans les sciences, il n’y a qu’à jeter les regards sur les propositions mathématiques. En veut-on un exemple tiré de l’usage commun de l’entendement, on pourra citer ce principe que tout chan gement requiert une cause476. On pourrait même aller plus loin et, sans recourir à des exemples, affirmer a priori l’existence de principes purs a priori, car comment l’expérience elle-même serait-elle possible dans des principes de ce genre ? Où l’expérience prendrait-elle sa certitude, si les règles suivant lesquelles elle procède étaient elles-mêmes empiri ques et par conséquent contingentes ? Il y a donc, il doit y avoir des jugements ou principes purs a priori. Ajoutons qu’il doit y avoir des idées [208-133] pures a priort71. En effet, prenez une idée expérimen tale, l’idée d’un corps, et retranchons de l’idée de corps tout ce qu’il a d’empirique, couleur, dureté, pesanteur ; il restera cependant l’espace qui ne peut être anéanti par la pensée. On peut donc dire que l’espace est donné a priori. Prenons d’autre part une idée quelconque, celle d’un objet, corporel ou incorporel. Si l’on en retranche toutes les qua lités que révèle l’expérience, il reste cependant quelque chose dont on ne saurait faire abstraction par la pensée, qui s’impose nécessairement : ce qui fait que l’on pense cet objet comme une substance. Le concept de substance, étant présenté comme nécessaire et strictement universel, est donc a priori. Ainsi nulle expérience ne paraît possible dès l’abord, s’il n’y a pas de jugements a priori ni de concepts a priori. Ainsi déjà toute science implique des jugements et des représentations a priori, c’est-à-dire des jugements et des représentations antél’objet rieurs et supérieurs à l’expérience. Mais il y a une science dont 1 même, semble-t-il, est supérieur à l’expérience, c’est la metaphy-
140
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
sique478. La métaphysique se joue en dehors de l’expérience, sans qu’elle se soit jamais demandé jusqu’ici si les principes sur lesquels elle s’appuie sont valables en dehors du champ de l’expérience. « On aurait dû agiter depuis longtemps la question de savoir comment l’en tendement peut avoir des connaissance a priori, et par conséquent aussi quelle portée, quelle étendue, quelle légitimité ces connaissances peuvent avoir. Rien n’eût été plus naturel, dit Kant, si l’on entend par naturel ce qui est raisonnable. Mais si l’on entend par naturel ce qui se fait ordinairement, rien n’est plus naturel que le long oubli de cette recherche (...) car une fois franchies les barrières de l’expérience, on est [209-134] bien sûr désormais de n’être pas contredit par elle. »479 De sorte qu’au lieu de critiquer ces connaissances a priori on aime mieux en faire un usage illimité et arbitraire en se lançant dans les régions supérieures à toute expérience sans se laisser arrêter par rien sinon par la contradiction interne, chose qu’il est toujours facile d’évi ter si l’on met un peu d’habileté dans ses fictions. Dans sa passion d’étendre ses connaissances, « la raison croit voir l’infini s’ouvrir devant elle. La colombe légère480, lorsqu’elle fend d’un vol rapide et libre l’air dont elle sent la résistance croit peut-être qu’elle volerait mieux dans le vide. C’est ainsi que Platon, dédaignant le monde sen sible qui tient la raison dans des bornes si étroites, se hasarde par-delà sur les ailes des idées dans l’espace vide de l’entendement pur. Il ne s’aperçoit pas qu’il n’avance point malgré ses efforts, car il manque du point d’appui nécessaire pour se soutenir et d’où il puisse déplacer l’entendement. Telle est la marche ordinaire de la raison humaine qui spécule ; elle élève au plus vite son édifice et ne s’avise que longtemps après de rechercher si le fondement en est solide ». Ainsi l’erreur de toute métaphysique a été d’appliquer sans critique à des objets qui ne sont pas du domaine de l’expérience, Dieu, l’im mortalité de l’âme, etc., des règles de connaissance a priori dont l’usage ordinaire et normal se trouve [210-135] dans l’expérience. Il faut soumettre à la critique toute connaissance a priori pour en déter miner la portée et l’usage légitime. On peut maintenant resserrer encore la question. Toute métaphy sique scientifique, disions-nous, doit rechercher comment une
INTRODUCTION À LA « CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
141
connaissance a priori est possible. Mais il y a deux parts à faire dans la connaissance a priori, et, de ces parts, il en est une qui intéresse plus spécialement, on pourrait dire exclusivement, le philosophe. Kant va distinguer en effet entre le jugement analytique et le jugement synthé tique. Dans tout jugement, dit Kant, le rapport du prédicat au sujet est possible de deux manières. Ou bien ce prédicat B appartient au sujet A comme quelque chose qui lui est contenu, ou bien B est com plètement étranger à A bien que lié à lui par le jugement, par l’affir mation. Le jugement est analytique dans le premier cas, synthétique dans le second. Le jugement pourrait s’appeler explicatif dans le pre mier cas, en ce sens que l’attribut ne fait que développer le sujet, et extensif81 dans le second cas, parce que dans le jugement synthétique l’attribut étend le sujet, ajoute quelque chose qu’on n’aurait pas pu dériver du sujet par décomposition. Ainsi ce jugement : tous les corps sont étendus, est analytique ; au contraire, cet autre jugement : tous les corps sont pesants est synthétique. Or un jugement analytique ne peut pas se fonder sur l’expérience puisque, pour former un jugement analytique, je n’ai pas besoin de sortir de l’idée que j’ai du sujet, ni par conséquent de recourir au témoignage de l’expérience. [211-136] Donc les jugements analytiques sont a priori ; ils s’expli quent, dit Kant, par le principe de contradiction, par la nécessité où je suis de ne pas me contredire moi-même en affirmant du sujet le contraire de ce que le sujet contient. Donc nous pouvons laisser de côté les jugements et connaissances d’ordre analytique, puisqu’ils s’ex pliquent par le principe de contradiction. Restent donc les jugements synthétiques. Comment est possible d’une manière générale un jugement synthétique, c’est-à-dire un juge ment où le prédicat ajoute quelque chose au sujet ? Les jugements d’expérience482 dit Kant, sont tous des jugements synthétiques, de sorte qu’in versement bon nombre de jugements synthétiques sont des jugements d’expérience. Et en effet lorsque l’idée de l’attribut n’est pas contenue dans l’idée du sujet, je ne puis en général affirmer l’attri but du sujet, je dois m’adresser à l’expérience, et c’est l’expérience qui me fait assister, en quelque sorte, à la synthèse. Je ne trouve pas dans mon idée du corps l’attribut pesanteur, mais si je reporte mes regards
142
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
vers l’expérience, j’y rencontre la pesanteur unie au caractère d’éten due qui est inhérent au corps. Et je puis étendre ma connaissance, por ter ce jugement extensif : les corps sont pesants. Mais s’il existait des jugements synthétiques a priori, la synthèse ne pourrait nécessaire ment plus s’expliquer de la même manière. Supposons un instant qu’il y ait des jugements synthétiques a priori. D’un côté, ces jugements ne pourront pas s’expliquer par la seule nécessité de ne pas se contredire, puisque, par hypothèse, le sujet ne contient pas l’attribut, le jugement étant supposé synthétique. [212-137] Et d’un autre côté, ces jugements étant supposés a priori, ce ne serait pas non plus l’expérience qui pour rait rendre compte de la synthèse. « Si je dois sortir du concept A pour connaître un autre concept B comme lui étant uni, sur quoi m’appuierai-je, puisque je ne peux plus m’adresser à l’expérience ? Soit cette proposition : ce qui arrive a une cause. Dans le concept de quelque chose qui arrive n’est nullement impliquée l’idée d’une chose entièrement différente de ce qui arrive, et telle est cependant la cause. Quel est ici l’inconnu x sur lequel s’appuie l’entendement, lorsqu’il croit découvrir hors du concept A un prédicat B qui lui est étranger, et qu’il conçoit néanmoins comme lui appartenant nécessairement ? La véritable question, le problème est donc de savoir comment des juge ments synthétiques a priori sont possibles. » Mais, dira-t-on, ces prin cipes synthétiques a priori existent-ils ? La raison en fait-elle véritable ment usage ? Kant affirme que dans toutes les sciences théoriques de la raison sont contenus des jugements synthétiques a priori. 1° En mathématiques : en effet, d’un côté les propositions mathémati ques étant nécessaires sont a priori, et d’autre part ces propositions sont synthétiques, car on ne peut pas considérer la vérité même la plus simple comme cette proposition d’arithmétique484 7 + 5 = 12 sans recon naître qu’elle est synthétique. En effet, dans l’idée du sujet 7 + 5 on trouvera seulement, par analyse, l’idée de la réunion de ces deux mem bres en un seul, de sorte que pour s’en tenir à un jugement simplement analytique il faudrait dire 7 + 5 = un seul nombre. Mais lorsque je dis 7 4- 5 = 12, je vais beaucoup plus loin, je dis quel est ce nombre, et ceci ne peut [213-138] se faire, comme le montrera Kant dans l’Esthétique transcendantale, que si j’ai recours à une intuition, c’est-à-dire à une syn-
INTRODUCTION À LA « CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
143
thèse d’un genre spécial. Ainsi les jugements arithmétiques en général sont synthétiques a priori. A plus forte raison en est-il ainsi des proposi tions géométriques. Cette proposition : la ligne droite485 est le plus court chemin d’un point à un autre est a priori puis nécessaire ; elle est synthé tique, car le concept de droit qui est celui d’une certaine qualité ne ren ferme rien de relatif à la quantité. De sorte que le concept « plus court » est ajouté au sujet et ne peut se dériver analytiquement de la ligne droite. Donc la plupart des propositions mathématiques sont synthétiques a priori. 2° La physique486, d’après Kant, contient également à titre de prin cipes des jugements synthétiques a priori. Kant en donne deux exem ples. Premièrement, la quantité de matière reste invariable dans tous les changements physiques. Deuxièmement, l’action est toujours égale à la réaction. Ces propositions sont nécessaires et par conséquent a priori, et elles sont aussi synthétiques, parce qu’on ne pourrait pas faire sortir les attributs du sujet matière. Enfin la métaphysique487 n’est pas encore une science, mais c’est du moins une recherche, et l’on peut dire que, quant à son but, la métaphysique ne comporte que des juge ments synthétiques a priori puisqu’elle consiste essentiellement à dépasser l’expérience, et à étendre la connaissance a priori. Exemple : le monde doit avoir un premier principe. Nous voici, dit Kant, en pré sence d’un problème unique qui est le problème [214-139] de la raison pure : comment les jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ? Voilà le problème. Hume est le seul, d’après Kant, qui l’ait soup çonné. Mais il n’a pas tenu compte des mathématiques, et n’a envisagé que la physique, dont le principe, qui est celui de causalité, n’est pas aussi évidemment a priori. Il n’a vu dans ce principe de causaüté qu’une liaison empirique, une donnée de l’expérience devenue habi tude de l’esprit, d’où il a conclu à l’impossibilité de notre esprit de dépasser l’expérience. En d’autres termes, David Hume a esquissé une critique de la raison, en soumettant à un examen approfondi le prin cipe de causalité, qui est la loi de notre expérience, en recherchant l’origine de ce principe. Ayant cru trouver l’origine de ce principe dans l’expérience, c’est à l’expérience qu’il a limité notre connaissance. Ainsi, il a procédé selon la méthode critique ; il s’est trompé parce
144
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
qu’en ramenant la causalité à la succession habituelle, il n’expliquait pas la causalité, il la niait simplement. Les fondements mêmes de la connaissance de la nature étaient ruinés par là, et c’est au scepticisme qu’on aboutissait. Si Hume488 avait saisi la question dans toute sa généralité, s’il en avait vu toute la portée, il ne se serait pas borné à l’examen du principe de causalité, il aurait tenu compte des mathéma tiques, où le caractère a priori des principes est très évident, et alors, au lieu de nier Va priori purement et simplement, il [215-140] aurait cherché comment la connaissance a priori est possible, ce qui l’aurait amené à poser précisément le problème de la raison pure. Telle est cette introduction. Sans entrer dans la critique des idées de Kant, indiquons les problèmes sur lesquels pourraient porter les objections, c’est-à-dire les postulats489. On pourrait dégager les propositions fondamentales suivantes : 1° le caractère de nécessité trouvé à un principe ou à un concept est un caractère irréductible, de telle sorte qu’une connaissance qui porte la marque de la nécessité est une connaissance a priori ; 2° les sciences mathématiques et physiques présentent une certitude absolue, et cette certitude demande à être fondée ; 3° elle est fondée sur certains prin cipes nécessaires et par conséquent a priori. De ces principes, les plus importants sont les principes synthétiques ; il y a des principes synthé tiques absolument nécessaires. Or sur ces trois points la discussion est possible : 1° à la première thèse s’opposera celle des empiristes, et sur tout celle des évolutionnistes ; 2° au second postulat on pourra oppo ser l’idée que les sciences ne donnent jamais que des approximations, que leur certitude n’est pas absolue, qu’elle n’est qu’une très haute probabilité490, la certitude n’étant qu’une limite au sens mathématique du mot, dont toute science peut approcher indéfiniment, qu’elle n’at teint jamais ; 3° enfin, dans les cas où la probabilité est si haute qu’elle équivaut à la certitude, en arithmétique par exemple, on peut soutenir que les propositions sont analytiques et non pas synthétiques. Si en géométrie les propositions ne sont pas purement analytiques, c’est au fond qu’on a recours à l’expérience, expérience très générale, très abstraite, et c’est justement parce que l’expérience ici joue un rôle, que les propositions n’ont plus une nécessité aussi rigoureuse, comme en
ESTHÉTIQUE TRANSCENDANTALE
145
témoignent l’existence de plusieurs géométries qui partent de l’hypo thèse d’espaces différents491. Au fond, Kant écarte, semble-t-il, l’hypo thèse d’un empirisme radical et complet, qui irait jusqu’au bout de son principe, en supposant d’une part que la certitude ne diffère pas par son essence d’une probabilité infinie ; et d’autre part que l’expérience étant infinie, indéfinie, s’étendant sur des générations sans nombre, peut produire l’équivalent d’une transformation de l’intelligence.
L’ESTHÉTIQUE TRANSCENDANTALE
Kant appelle transcendantal un certain ordre de recherches (une certaine espèce de science) ; c’est la science de la possibilité et du fon dement de toute conception ou intuition a priori. Il ne faut donc pas confondre transcendantal et transcendant. L’emploi transcendant d’une connaissance consiste à l’étendre au-delà de toute expérience possible. Or l’objet de la Critique de la raison pure est précisément de montrer l’impossibilité de la connaissance transcendante, et cela par un examen transcendantal des principes de la connaissance, c’est-à-dire par la démonstration du caractère a priori de ces principes et par la recherche des conditions auxquelles cette origine a priori est possible. Ces conditions font précisément que [217-142] l’usage transcendant des principes ou de notre connaissance en général est impossible. La Critique de la raison pure est donc essentiellement transcendantale. Voilà le sens du mot transcendantal. Quant à l’esthétique, c’est la science de la sensibilité. Toute connaissance, d’après Kant, commence par ce qu’il appelle la sensibilité : elle procède de la sensibilité, puis de l’en tendement. La sensibilité est ce qui nous fournit des objets immédia tement, au moyen d’intuitions ; l’intuition (Anschauung) étant une connaissance directe et immédiate. Ainsi, ce que Kant appelle la sensi bilité (Sinnlicbkeit*92), c’est ce que nous appelons la faculté de perce voir, mais dégagée de tout ce qui vient de l’intelligence proprement dite. L’esthétique transcendantale est donc la science de la sensibilité au point de vue transcendantal, c’est-à-dire au point de vue de ce qu’il peut y avoir en elle dya priori.
146
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
A ce point de vue, il faut distinguer tout de suite entre la forme et la matière493. La matière de la sensibilité est ce qui nous est donné de multiple, de divers sans coordination aucune, c’est la sensation brute. La forme est ce par quoi cette matière est coordonnée, se coordonne. La sensibilité n’est pas, d’après Kant, pure réceptivité, pure passivité. Elle doit avoir sa forme, sa forme pure, c’est-à-dire une certaine ten dance originelle, une certaine activité d’un certain genre. A la fin de l’Esthétique transcendantale, Kant oppose nettement sa conception de la sensibilité à celle de Leibniz et de son disciple Wolf. Leibniz et tous les prédécesseurs modernes de Kant n’avaient vu dans la sensibilité qu’un amoindrissement de l’intelligence, une intelligence confuse494, la sensibilité différant de l’entendement par le degré de [218-143] clarté seulement. Une des idées essentielles de l’esthétique transcendantale est de faire de la sensibilité une faculté originale, profondément dis tincte de l’entendement, autonome dans une certaine mesure, en ce qu’elle a sa forme et ses lois propres. Quand l’entendement s’exerce sur des objets, c’est la sensibilité qui les lui livre, et cette sensibilité les a déjà organisés à sa manière, pliés à sa forme. C’est sous cette forme que l’entendement doit les accepter. La forme étant ainsi distinguée de la matière, le but de l’esthétique transcendantale est de déterminer les formes pures a priori de la sensi bilité, c’est-à-dire ce que la sensibilité implique d’éléments purement a priori, c’est-à-dire indépendants de toute expérience. Quelle méthode suivre pour déterminer les formes purement a priori ? Il suffira d’éli miner des objets perçus : 1° tout ce qui vient de l’expérience ; 2° tout ce qui vient de l’entendement. Ces deux séries d’éliminations conver gentes dégageront la forme pure a priori. Soit par exemple un corps ; je commencerai par éliminer de ce corps tout ce qui vient de l’enten dement : divisibilité, force, substance, etc., tout ce que je ne puis en affirmer que par un jugement. J’éliminerai ensuite ce qui est dû à l’ex périence pure, dureté, impénétrabilité, qui sont des sensations. Il res tera alors l’étendue, la figure. Voilà qui sera intuition pure495, intuition d’un côté, mais d’autre part intuition non empirique. Cette méthode étant posée, en voici les ré-[219-144]sultats : il y a deux formes pures a priori de la sensibilité, l’espace et le temps. Kant
ESTHÉTIQUE TRANSCENDANTALE
147
réunit l’espace et le temps, les met tous deux sur le même plan, bien que l’une de ces deux formes soit plus générale que l’autre. La sensi bilité comprend en effet d’un côté le sens externe et de l’autre le sens interne. Par le sens externe, nous nous représentons les objets comme situés dans l’espace. Par le sens interne, nous nous représentons nos états internes comme situés dans le temps. Mais comme les représen tations des choses extérieures ne sont connues de nous qu’en devenant des états internes, le temps se trouve ainsi être soit médiatement, soit immédiatement, la condition de toutes nos représentations. Il y a donc différence de généralité entre ces deux formes, mais non pas différence de nature. C’est pourquoi la critique que Kant institue de ces deux formes est identique à peu près. Et bien que Kant parle séparément du temps et séparément de l’espace, nous réunirons ces deux critiques en une seule exposition. Cet examen de l’espace et du temps comprend deux parties, que Kant appelle l’une exposition métaphysique, l’autre exposition trans cendantale. L’exposition métaphysique n’est pas autre chose que la détermination directe de l’espace et du temps496, détermination directe en ce qu’elle procède par l’analyse de ces formes elles-mêmes. Ce qu’il appelle exposition transcendantale497, c’est la détermination indirecte de ces mêmes caractères, c’est-à-dire une sorte de démons tration par l’absurde, une démonstration qui [220-145] établit que si l’on se place en dehors de la théorie kantienne, il y a des faits inex plicables, tandis que ces faits s’expliquent immédiatement dans l’hypothèse de Kant. I - Kant va établir successivement deux points : a) l’espace et le temps sont donnés a priori ; b) ce sont des intuitions et non pas des concepts : en d’autres termes, il faut les rapporter à la sensibilité et non à l’entendement. a) Le temps et l’espace sont a priori* : 1° l’espace ne peut être dérivé de la sensation extérieure, car « pour que certaines sensations soient rapportées à quelque chose d’extérieur à moi et même pour que je puisse me représenter des termes comme extérieurs les uns aux autres, il faut que la représentation de l’espace soit déjà posée ». De même le temps499 ne peut m’être donné par une expérience de la simul-
148
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
tanéité ou de la succession, car simultanéité et succession ne peuvent s’observer que dans le temps. Il faut donc que le temps soit donné d’abord ; 2° la représentation de l’espace est a priori puisqu’elle est nécessaire500. En effet, on peut très bien imaginer qu’il n’y ait plus aucun objet dans l’espace, mais on ne peut pas penser qu’il n’y ait plus d’espace. De même pour le temps, on peut faire abstraction de tous les phénomènes qui se développent dans le temps, on ne peut faire abstraction du temps ; l’espace et le temps étant des représentations nécessaires sont a priori. b) Il faut montrer maintenant que l’espace et [221-146] le temps sont bien des intuitions et non pas des concepts, c’est-à-dire qu’ils doi vent être rapportés à la sensibilité et non pas à l’entendement. Qu’estce qu’un concept (Begriff) ? C’est une idée générale, et par consé quent, comme dit Kant, un prédicat, un genre. Or l’espace et le temps ne sont pas des prédicats mais des sujets. En effet un concept est contenu sous forme d’attribut dans une multitude indéfinie de repré sentations possibles ; mais le concept lui-même ne contient pas une infinité de représentations, ou, s’il les contient, c’est sous lui, ce n’est pas en lui. Or l’espace et le temps contiennent actuellement une mul titude indéfinie de parties homogènes, et ces parties sont bien en eux501. Dans le concept entre une multiplicité qualitative ; au contraire, l’espace exclut cette diversité qualitative et comprend des termes homogènes. L’espace et le temps ne sont donc pas des rapports, mais des choses. L’entendement donne des rapports, mais l’espace et le temps étant des choses, ces choses doivent être rapportées à la sensibi lité. Comme d’autre part, ils sont a priori, on peut conclure qu’il y a pour la sensibilité des intuitions a priori, des formes pures a priori et que l’espace et le temps sont bien ces deux formes. II - Il y a des faits absolument inexplicables si l’espace et le temps ne sont pas des intuitions a priori. 1° La géométrie502 est une science qui pro cède synthétiquement, et aussi a priori. Elle procède synthétiquement, nous l’avons montré dans l’Introduction, et d’autre part ses proposi tions sont nécessaires, ont une cer-[222-147]titude apodictique, ce qui implique qu’elles sont a priori. Or comment la géométrie serait-elle pos sible, pourrait-elle établir des propositions nécessaires si l’espace dont
ESTHÉTIQUE TRANSCENDANTALE
149
elle étudie les déterminations n’était pas donné a priori ? 2° Il y a des pro positions nécessaires relatives au temps et à l’espace, par exemple celleci : l’espace a trois dimensions, ou cette autre : le temps n’a qu’une dimension ; et ces propositions nécessaires ne se peuvent expliquer que dans l’hypothèse d’un espace et d’un temps donnés a priori, car tout ce qui provient de l’expérience est, d’après Kant, contingent. Conséquences de cette double démonstration^1. — Si l’espace et le temps sont des formes de notre sensibilité, c’est-à-dire des conditions néces saires sous lesquelles nous percevons les choses, si ce sont des cadres où les sensations viennent s’insérer, des formes auxquelles se plient pour s’organiser, pour s’unifier, la diversité, la pluralité de la matière fournie à l’intuition, alors l’espace et le temps sont en nous et non pas dans la réalité considérée en elle-même, non pas dans les choses en soi : « Ce sont des conditions de notre sensibilité et non de la possibi lité des choses. » De là une double conséquence : nous pouvons affir mer de l’espace et du temps qu’ils ont une idéalité transcendantale, et qu’ils ont une réalité empirique. 1° L'idéalité transcendantale de l’espace et du temps est démontrée. En d’autres termes, nous ne pouvons pas faire un usage transcendant de l’espace et du temps, nous ne pouvons pas mettre les choses en soi dans l’espace ni dans le temps. Les choses [223-148] en soi ne sont pas plus étendues dans l’espace qu’elles ne sont successives ou simultanées dans le temps ; en ce sens l’espace et le temps sont de pures représentations qui n’ont qu’une idéalité transcendantale. Kant insiste sur ce point. L’idéalité de l’espace et du temps résulte d’après lui du double examen auquel il vient de se livrer. Mais on peut ajouter que, si on attribuait à l’espace et au temps une réalité absolue, on aboutirait à de véritables absurdités. On admettrait leurs non-êtres étemels et infinis504, qui n’existeraient que pour comprendre en eux ce qui existe réellement. En effet l’espace et le temps ne peuvent pas être des substances ni quelque chose d’inhérent aux substances, attributs de substances. Ce seraient donc de véritables non-êtres, et qui cependant contiendraient tout le reste et subsisteraient alors même que tout le reste serait anéanti. C’est pour avoir considéré l’espace et le temps comme des réalités en soi que
150
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
les idéalistes, aboutissant ainsi à des absurdités manifestes, ont nié pure ment et simplement l’existence des corps ; « et c’est pourquoi on ne peut guère blâmer l’excellent Berkeley d’avoir réduit les corps à de pures apparences ». — Ce n’est pas tout : si le temps et l’espace appartiennent aux choses en soi, nous ne pouvons plus rien affirmer avec une certitude apodictique du temps et de l’espace, car les mathématiques nous fournissent relativement à l’espace des propositions nécessaires. Mais comment pouvons-nous savoir que ces propositions nécessaires s’ap-[224-149]pliquent à des choses en soi, à des choses réelles dans l’organisation desquelles nous ne serions pour rien ? Si l’espace et le temps ne sont qu’en nous et pour nous, et si c’est nous qui objectivons les choses, organisons les objets dans l’espace et dans le temps, alors nos mathématiques construites a priori par nous dans notre espace s’appli quent nécessairement aux objets, les objets étant dans une certaine mesure notre œuvre, puisque c’est nous qui les faisons étendus et succes sifs. Mais si les choses réelles sont indépendamment de mon esprit dans l’espace et dans le temps, rien ne me garantit que les propositions que j’aurai démontrées a priori, en géométrie par exemple, s’appliqueront aux choses. 2° La réalité empirique. — L’espace et le temps ont une réalité empi rique. Kant entend par là que nous pouvons et devons affirmer la réa lité de l’espace et du temps au point de vue de notre expérience, car les objets une fois placés dans l’espace, par exemple, n’ont plus une valeur relative comme le son, la lumière, etc. Ils prennent une valeur objec tive, ils deviennent objets d’expérience pour tous les hommes. En d’autres termes, l’espace et le temps ne sont pas des formes de la connaissance individuelle, mais de la connaissance humaine en géné ral. Grâce à l’espace et au temps, les sensations qui sont par ellesmêmes purement personnelles, purement subjectives, sont projetées au-dehors, objectivées505. [416-150] Ainsi se forment, ainsi se constituent des objets, c’est-àdire des choses qui font partie d’une expérience universelle commune à tous les hommes. Sans l’espace, notre expérience serait subjective et individuelle. Avec l’espace, elle devient objective et universelle, elle n’est plus relative à l’individu. L’espace et le temps ont donc une réa-
ESTHÉTIQUE TRANSCENDANTALE
151
lité empirique, ils sont réels en tant que fondements de toute expé rience, et par conséquent présupposés à toute expérience. Mais si l’es pace et le temps ne sont pas relatifs à l’individu, ils sont relatifs à l’hu manité506. En dehors de la manière humaine de percevoir et de connaître, l’espace et le temps ne sont rien ; et c’est justement parce qu’ils ne sont rien en dehors de la manière humaine de connaître, qu’étant par là même les conditions générales de la connaissance humaine, ils assurent l’universalité et le caractère impersonnel de notre connaissance. C’est donc bien l’idéalité transcendantale de l’espace et du temps qui en fait la réalité empirique. Conclusion. — Nous avons maintenant déterminé une des données requises pour la solution de la question : comment des jugements syn thétiques a priori sont-ils possibles ? En effet nous avons établi que l’espace et le temps sont des intuitions pures a priori, d’où la possibi lité de synthèses a priori dans l’espace et le temps, les synthèses mathé matiques par exemple.
LA CRITIQUE DE L’ESTHÉTIQUE TRANSCENDANTALE
Indiquons les points sur lesquels pourrait porter la discussion, c’est-à-dire les postulats impliqués [417-151] d’un bout à l’autre de l’Esthétique transcendantale. 1° Kant réunit constamment le temps et l’espace ; entre ces deux formes il établit un parallélisme constant. Il y a là une identification, ou du moins un rapprochement dont la légitimité est loin d’être évidente. Ce que Kant dit du temps ne s’appliquerait guère, croyons-nous, qu’au temps traduit sous forme d’espace, et c’est ainsi que nous apercevons d’ordinaire le temps. Mais sa critique ne vaudrait plus pour le temps vu du dedans, tels que la conscience le présente, le temps représenté comme un prolongement des états de conscience les uns dans les autres, le temps envisagé comme qualité et non comme quantité. 2° L’espace et le temps d’après Kant sont donnés a priori, et cela pour diverses raisons qu’on peut ramener à trois principales :
152
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
a) On peut supprimer tout ce qui est dans l’espace et tout ce qui est dans le temps, mais on ne peut pas supprimer l’espace et le temps. — Dans cette première argumentation, il y a impliqué ce postulat que supprimer les objets dans l’espace et le temps est difficile mais non pas impossible, tandis que supprimer l’espace et le temps est impossible absolument. Mais on peut se demander si entre le très difficile et le subjectivement impossible il y a une différence de nature et non pas seulement une différence de degré. Supposons en effet que l’espace et le temps fussent donnés a posteriori, mais dans une expérience constante, alors que mon expérience du son, de la couleur, de la résis tance, etc., est toujours limitée à un nombre défini de cas particuliers ; il en résulterait qu’il me serait sim[418-152]plement difficile de faire abstraction de tout son, de toute couleur, de toute résistance, mais qu’il me serait infiniment difficile de faire abstraction de l’espace et du temps qui ont pour eux un nombre d’expériences pratiquement infini. En d’autres termes l’empirisme peut faire valoir cet argument que la prétendue impossibilité de faire abstraction de l’espace et du temps se réduit à la difficulté infiniment grande de se placer en dehors de ce qui est une condition constante de notre expérience. b) D’après Kant, l’expérience suppose l’espace et le temps comme une condition nécessaire. Donc l’espace et le temps sont antérieurs et indépendants de l’expérience. Ici encore, l’empiriste507 répondra qu’il faut tenir compte de l’histoire. Il en est ainsi pour l’expérience pré sente, édifiée sur un nombre indéfini d’expériences passées. Mais les prétendues formes de temps et d’espace pourraient bien n’être que des habitudes. Elles se seraient imprimées du dehors au-dedans, à mesure que l’esprit enregistrait des successions et des juxtapositions. c) Les vérités géométriques sont données a priori ; donc l’espace est donné a priori. A quoi on peut répondre que Va priori du géomètre n’est pas Va priori du métaphysicien. Il y a ici un postulat qui est l’identifica tion de ces deux a priori. En effet, le géomètre procède a priori en ce qu’il construit la figure lui-même, et n’affirme de cette figure que ce qui résulte immédiatement de sa construction. Mais il ne suit nullement de là que sa construction ne lui ait pas été suggérée par l’expérience. Sa construction n’est qu’une reconstruction [419-153] rationnelle.
LOGIQUE TRANSCENDANTALE
153
3° L’espace et le temps sont des intuitions et non des concepts. Ce dernier point est ce qu’il y a de solide dans l’Esthétique transcendan tale. En effet, ce que Kant a établi, semble-t-il, à l’abri de toute objec tion, c’est que l’espace et le temps sont autre chose que de simples rap ports, comme l’avait voulu Leibnitz508. L’espace et le temps sont des réalités à leur manière, empirique dira Kant, mais peu importe le mot. Le tort de Leibnitz avait été de croire que l’espace était une relation entre les choses inétendues, alors qu’il y a quelque chose dans la forme d’espace de sut generis, quelque chose qui ne se peut définir, et qui fait de l’espace quelque chose de plus qu’un rapport. En ce sens, les conclusions de l’Esthétique transcendantale sont assez voisines de celles du sens commun, qui distingue nettement un espace vide et des objets qui le remplissent.
LA LOGIQUE TRANSCENDANTALE
La distinction entre l’Esthétique transcendantale et la Logique transcendantale a pour fondement la distinction de la sensibilité et de l’entendement. Kant définit l’entendement (Verstancf™), la faculté de produire des représentations mêmes ou la spontanéité de la connais sance. En d’autres termes, au-dessus des formes a priori de la sensibi lité, il y a une puissance active de coordonner et de lier, puissance dont les déterminations particulières, qu’on appellera les Catégories, expriment l’unité d’un genre tout particulier qui est l’unité de la pen sée. Ces puissances, ces expressions de notre spontanéité intellectuelle constituent [420-154] ce que Kant appelle l’entendement. Une intui tion ne peut être que sensible510, au moins chez l’homme. Elle com prend la manière dont nous sommes affectés par les objets. L’entende ment au contraire est la faculté de penser l’objet de l’intuition sensible. Ces deux facultés (sensibilité et entendement) sont d’une égale impor tance, car sans la sensibilité aucun objet ne nous serait donné, et sans l’entendement aucun ne serait pensé. Des pensées sans contenu sont vides, des intuitions sans concepts sont aveugles. Il est donc égale ment nécessaire, et de rendre ces concepts sensibles, et de rendre intel-
154
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
ligibles ces intuitions en les soumettant à des concepts. Bref, l’enten dement ne peut rien percevoir, et les sens ne peuvent rien penser. La connaissance résulte de leur union. Ceci posé, il y a lieu de constituer, à côté de la science des lois de la sensibilité, l’esthétique, la science des lois de l’entendement, c’est-à-dire la logique. Mais que sera plus particulièrement la logique transcendantale511 ? « De même qu’il y a des intuitions pures aussi bien que des intuitions empiriques, ainsi que le prouve l’Esthétique transcendantale, ainsi il pourrait bien y avoir aussi une différence entre la pensée pure et la pen sée empirique des objets. » Il pourrait y avoir des concepts se rapportant a priori aux objets, concepts dont l’origine ne serait pas empirique, et qui ne pourraient pas davantage être rapportés à une intuition pure. « Une science pure512 déterminant l’origine, la circonscription, la valeur objec tive de pareilles connaissances s’appellerait logique transcendantale, puisqu’elle n’aurait affaire qu’aux lois de l’entendement, et qu’elle ne se rapporterait aux objets que d’une manière a priori. Résumons et expli quons cette première partie de l’introduction en empiétant sur ce qui va suivre. » [421-155] La connaissance proprement dite doit être, d’après Kant, rapportée à l’entendement, et consiste essentiellement dans la liaison systématique des termes, hétérogènes entre eux, que fournit la sensibi lité. Penser consiste à unir, et il faut que l’unité soit conçue comme nécessaire, attendu que, d’après Kant, s’il n’y a pas de nécessité, il n’y a pas de science. Penser consiste à unir, et la connaissance scientifique est celle qui établit entre les termes connus des rapports de nécessité. Il suit de là que la science suppose avant tout des synthèses nécessaires. La phy sique, comme les mathématiques, établit des rapports nécessaires. Or comment expliquer des jugements synthétiques a priori en physique ? Etant une synthèse, la pensée exige ici autre chose que les lois de la logique formelle513, car la logique formelle n’est pas synthétique, et d’autre part car il y a nécessité. Cette synthèse est a priori ; donc il y a cer tains cadres donnés a priori, et qui expriment chacun à leur manière la fonction de notre pensée s’appliquant aux objets, fonction qui est d’unir. Penser, c’est ramener la diversité de l’intuition sensible à l’unité de notre conscience. Cette réduction ne peut se faire que par l’applica-
LOGIQUE TRANSCENDANTALE
155
tion aux données de l’intuition sensible de certaines lois qui traduisent l’unité de notre conscience, de notre aperception, et qui résultent de la spontanéité de l’entendement. L’entendement pourrait donc être assi milé à un être organisé qui a une vitalité propre, et qui s’assimile cer taines matières conformément aux lois intérieures et profondes de son organisation. Ces lois, comme nous allons voir, sont les catégories. Il y a maintenant lieu de distinguer, dans la Logique transcendan tale, une Analytique transcendantale et une Dialectique transcendantale. Kant [422-156] entend par analytique transcendantale514 la science des concepts purs a priori, des Catégories, et des principes de l’entende ment ; et il appelle cette science analytique parce qu’elle est une décom position de la faculté même de l’entendement, décomposition dont l’ob jet est d’établir la possibilité de concepts a priori, en ne les recherchant que dans l’entendement seul, c’est-à-dire dans leur « sol natal ». Quant à la Dialectique transcendantale, elle est, comme nous verrons, une cri tique de l’entendement et de la raison au point de vue de leur usage hyperphysique. En d’autres termes, quant on aura déterminé les catégo ries et les principes, c’est-à-dire les lois fondamentales de la pensée, il faudra chercher quelle est la valeur et la portée de ces lois. Peuvent-elles s’appliquer en dehors du champ de l’expérience, servir à constituer une métaphysique ? Ou bien la nature même de ces lois, telle que la déter mine P Analytique transcendantale, n’est-elle pas telle que ces lois per dent toute signification, toute valeur, quand on les applique à autre chose qu’à l’intuition sensible, qu’on en prolonge l’application au-delà de l’espace et du temps ? La Dialectique transcendantale limitera à l’ex périence, c’est-à-dire aux données de l’intuition sensible, l’application possible des catégories et principes tels que les aura déterminés l’Analy tique transcendantale. Et cette limitation s’opérera par une critique de ce Kant appelle l’apparence transcendantale515, c’est-à-dire par une cri tique de la vaine prétention de l’entendement et de la raison à l’exercer en dehors du champ de l’expérience possible. Nous pourrions dire, pour résumer en la simplifiant trop peut-être la pensée de Kant, que l’Analytique transcendantale d’une part, la Dialectique transcendantale de l’autre prouveront la légitimité de la [423-157] physique, d’une part, l’illégitimité de la métaphysique, d’autre part.
156
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
L’ANALYTIQUE TRANSCENDANTALE
Elle comprend deux parties, 1*Analytique des concepts et 1*Analy tique des principes. I - L’analytique des concepts. — L’analytique des concepts va déterminer les concepts purs a priori de l’entendement, en ayant soin de faire que les concepts énumérés soient bien réellement élémentaires et non dérivés, et aussi que la table en soit complète. Il faut, pour une investigation de ce genre, suivre une méthode, trouver un principe, un fil conducteur516. Le tort d’Aristote, par exemple, lorsqu’il recher cha les concepts fondamentaux de l’esprit, fut de recueillir ces concepts fondamentaux comme ils se présentaient à son esprit. Il en rassemble d’abord dix, puis à ces dix en ajoute cinq autres. Sans compter que cette table comprend parmi les catégories des modes de la sensibilité, elle a en outre l’inconvénient de n’être pas méthodique ; on ne sait pas davantage si les concepts qu’on énumère sont réelle ment primitifs, élémentaires, et non pas dérivés d’autres concepts plus simples. Quel sera le fil conducteur ? La réponse de Kant à cette question est de la plus haute impor tance. D’après Kant, nous devons nous adresser à la logique formelle, lui demander sa classification des jugements en la modifiant, en la compliquant surtout, et c’est sur la division ou répartition des juge ments517 telle qu’elle est faite en logique formelle que nous calquerons l’énumération et le classement des catégories. Qu’est-ce que la logique formelle ? C’est la science de l’usage de l’entendement en tant qu’il s’astreint seulement à l’obligation de rester d’accord avec lui-même. [424-158] La logique formelle518 ne s’inquiète pas de la matière de la connaissance, elle ne porte pas par conséquent sur le réel. Son domaine est par conséquent celui du possible. Soit le syllogisme clas sique : tous les hommes sont mortels ; or Socrate est homme ; donc, Socrate est mortel. Il n’est pas question en logique formelle de savoir s’il y a des hommes, ni si ces hommes sont réellement mortels, ni si Socrate a existé. Nous disons simplement ici que s’il y a des hommes,
ANALYTIQUE TRANSCENDANTALE
157
si les hommes forment un genre, et si ce genre a été déclaré mortel, ce qui est possible, mais n’est peut-être pas réel, la conclusion : Socrate est mortel, s’impose. La logique formelle pourrait donc se définir la logique du simple possible. Leibniz519 n’a-t-il pas dit d’ailleurs que le principe de non-contradiction, qui est celui de la logique formelle ne régit que les possibles ? Au contraire, la logique transcendantale, telle que Kant la défmit et l’entend, est une logique du réel520. En d’autres termes, Kant estime, croit que ce que nous appelons la réalité, l’en semble des objets reliés entre eux par des lois et qui constituent la nature, est organisé par notre pensée, de telle sorte qu’il y a avant cette logique qui est enseignée dans les écoles et que règle l’usage des principes formels de notre pensée une logique vivante, appliquée spontanément par l’esprit. Notre expérience en général, telle qu’elle paraît s’offrir d’abord quand nous ouvrons les yeux, est le résultat de ce travail d’élaboration. Or le postulat de la logique transcendantale est que la logique formelle ou logique du possible n’est qu’un reflet de la logique transcendantale ou logique du réel. Quand le logicien énu mère les diverses formes de jugements, il retrouve sous une forme moins vivante, réduite à son squelette, pour ainsi dire, cette [425-159] organisation intérieure de la pensée, qui a servi à relier les objets entre eux et à constituer l’expérience. Si donc nous déterminons d’après les indications de la logique formelle les différentes manières de juger, nous pourrons retrouver, découvrir derrière la classification des juge ments, une énumération systématique des concepts purs ou catégories. D’après Kant, les jugements doivent être considérés par la logique formelle de quatre points de vue différents521 : le point de vue de la quantité, celui de la qualité, celui de la relation et celui de la modalité. 1° Au premier point de vue, celui de la quantité, les jugements sont universels, particuliers, ou singuliers. 2° Au point de vue de la qualité, ils sont affirmatifs, négatifs, ou indéfinis. Kant appelle indéfinis522 des jugements qui, négatifs dans leur forme, sont affirmatifs dans leur matière, c’est-à-dire des jugements où la négation doit raisonnable ment être jointe à l’attribut et non à la copule. Ainsi, quand je dis : l’âme n’est pas mortelle, c’est comme si je plaçais l’âme dans la cir conscription, d’ailleurs indéterminée, des êtres immortels. 3° Au point
158
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
de vue de la relation, les jugements sont catégoriques, hypothétiques ou disjonctifs. 4° Au point de vue de la modalité, les jugements sont problématiques, assertoriques, ou apodictiques. Le jugement problé matique523 est celui qui énonce une simple possibilité. Le jugement assertorique est celui dont l'affirmation ou la négation est considérée comme vraie. Le jugement apodictique est celui dont l’affirmation ou la négation est considérée comme nécessaire. Voici maintenant, d’après Kant, les catégories524 dont on peut extraire la formule en suivant purement et simplement l’ordre de la classification des jugements. 1° Catégories de la quantité : unité, plura lité, totalité ; 2° Catégories [426-160] de la qualité : réalité, négation, limitation ; 3° Catégories de la relation : a) inhérence et substance, b) causalité et dépendance, c) communauté, c’est-à-dire réciprocité entre l’agent et le patient ; 4° Catégories de la modalité : possibilité, existence, nécessité, avec leurs contraires : impossibilité, non-exis tence, contingence. 1° Il faut remarquer d’abord que, dans l’énumération des juge ments, Kant est loin de s’en tenir au point de vue de la logique for melle, car celle-ci ne classe pas les jugements au point de vue de la relation et de la modalité525. De plus, en ce qui concerne la quantité et la qualité, elle ne distingue ni des jugements singuliers, ni des juge ments indéfinis. Donc la table des jugements a été dressée par Kant en vue de la table des catégories. Kant a mis par avance dans la logique formelle ce qu’il se proposait d’en extraire. 2° En ce qui concerne la correspondance des deux tables, il y a des différences sur lesquelles nous n’insisterons pas. Il y a une difficulté considérable à établir le parallélisme entre le jugement disjonctif et la catégorie de la communauté ; de même entre le jugement singulier et la catégorie de la totalité. 3° On a soutenu526, et cette objection n’est pas sans valeur, que les seules catégories véritables sont celles de la relation. En effet, la logique transcendantale a la prétention d’étudier seulement les prin cipes de la connaissance objective et impersonnelle ; elle n’étudie pas les formes subjectives et personnelles de la connaissance. Or les caté gories de la relation sont les seules dont l’usage ne soit pas purement
ANALYTIQUE TRANSCENDANTALE
159
subjectif. En d’autres termes, les jugements [427-161] autres que les jugements fondés par Kant sur les catégories de la relation énoncent non pas des rapports objectifs entre les choses, mais plutôt des rela tions subjectives entre les choses et notre faculté de connaître. Schopenhauer, allant plus loin, a soutenu que la catégorie de la causalité était la seule véritable. En effet, si le rôle de l’entendement est d’éta blir entre les objets de l’expérience une liaison qui les rende intelligi bles, on peut dire que la causalité est nécessaire et suffisante pour éta blir cette liaison. II - L’analytique des principes. — L’analytique des concepts traite des concepts ; l’analyse des principes traite de l’application des concepts aux objets de l’entendement, c’est-à-dire des jugements527 ; car juger, c’est, selon Kant, « subsumer », c’est-à-dire distinguer si une chose est ou n’est pas soumise à une règle donnée. Le jugement est, d’après Kant, « un don naturel particulier qui ne peut pas être acquis, mais qui peut être cultivé »528. L’étude peut donner ou, comme dit Kant, « inoculer » à une intelligence bornée des règles empruntées à un esprit étranger, mais la faculté de s’en servir convenablement est un don de nature. L’expérience, les exemples exercent sans doute le jugement, mais ils peuvent aussi lui porter préjudice, parce qu’ils affai blissent la contention d’esprit nécessaire « pour apercevoir abstraite ment les règles dans leur unité ». Il est intéressant de noter la diffé rence sur ce point entre Kant et Descartes. Ce dernier fait en effet de la faculté de juger ou du bon sens, comme il dit, « la chose du monde la mieux partagée » et également [428-162] répartie entre tous. La rai son de cette différence est profonde : d’après Descartes, la connais sance peut au moins revêtir la forme analytique. Quand on a trouvé le biais par où prendre les choses, il suffit de déduire à l’infini ; et la déduction mathématique est un jeu d’enfant, est à la portée de tout le monde ; il n’y a pas d’erreur possible dès qu’une saine méthode a indi qué le point, et cela parce que l’entendement atteint le réel, l’absolu. Au contraire, pour Kant, la connaissance est synthétique, va de syn thèse en synthèse. Quand la sensibilité nous a montré les phénomènes dans l’espace et dans le temps, il reste à les lier selon des rapports uni-
160
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
versels, objectifs ; il faut donc trouver le concept auquel subsumer des phénomènes, et dans ce choix du concept on peut se tromper. La vérité, d’après Kant, consiste dans un accord de l’intelligence indivi duelle avec l’intelligence universelle ; dans l’accord du rapport que j’établis moi personnellement entre deux termes, avec celui qu’établit l’intelligence humaine en général, l’expérience humaine, la science. Dès lors, la faculté de juger est un don inégalement réparti, selon que l’intelligence de l’individu est plus ou moins bien accordée sur l’intel ligence humaine en général529, selon qu’elle trouve plus ou moins d’instinct le rapport que l’intelligence humaine en général établit. Comment se fait maintenant cette subsomption des intuitions aux concepts purs, c’est-à-dire comment se fait l’application des concepts de l’entendement aux objets fournis par la sensibilité dans le temps [429-163] et dans l’espace ? Pour qu’un concept puisse s’appliquer à un objet de l’intuition, il faut que cet objet soit représenté sous une forme analogue à celle du concept. Mais les concepts purs de l’en tendement sont absolument différents, d’après Kant, des intuitions empiriques. Entre le concept pur de la relation en général et tels objets déterminés fournis par l’intuition dans le temps et dans l’es pace, on ne voit pas d’abord de ressemblance, d’analogie. Il faut donc, d’après Kant, un intermédiaire entre les concepts purs d’un côté, et les intuitions empiriques de l’autre. Cet intermédiaire est ce que Kant appelle le schème transcendantal530. Le schème, intermé diaire entre le concept et l’image, est l’œuvre d’une faculté intermé diaire entre l’entendement et la sensibilité ; cette faculté est l’imagi nation531. Qu’est-ce qu’un schème, et quelle différence y a-t-il entre un schème et une image ? Si je dispose cinq points à la suite l’un de l’autre, j’ai une image du nombre cinq. Au contraire, si je me repré sente un nombre en général qui peut être cinq ou cent, cette repré sentation est celle non point d’une image, mais d’une méthode pour obtenir une image quelconque conforme à un certain concept. Or cette représentation d’un procédé en général destiné à donner à un concept son image s’appelle le schème de ce concept, et nous appel lerons imagination productive532 la faculté de créer cet intermédiaire entre le concept et l’image.
ANALYTIQUE TRANSCENDANTALE
161
Déjà pour les concepts mathématiques des schèmes sont indispen sables. Entre le concept de triangle en général et telle image d’un triangle particulier isocèle ou rectangle, image dont le [430-164] mathématicien ne pourrait rien tirer, il y a le schème de triangle, c’està-dire la méthode de construction, le procédé général pour obtenir un triangle, et c’est sur ce schème que le mathématicien opère. Les concepts de choses sensibles eux-mêmes ont des schèmes ; ainsi le concept de chien suggère à l’imagination une règle, d’après laquelle l’imagination décrit la figure du quadrupède en général, sans être astreinte à telle figure particulière que nous offre l’expérience. Or s’il y a pour les concepts sensibles, comme le concept de chien, des schèmes fournis par l’imagination empirique, il y a pour les concepts purs, les concepts a priori, des schèmes fournis par l’imagination pure, a priori. L’imagination est l’intermédiaire nécessaire pour établir entre les concepts purs a priori et les objets de l’intuition les schèmes trans cendantaux qui rendent l’application des concepts possibles. Mais comment procède cette imagination ? Essayons de définir avec plus de précision le schème transcendantal. Le domaine spécial de l’imagination est, d’après Kant, le temps533. Déjà Kant a montré dans l’Analytique des concepts que l’intervention de l’imagination est nécessaire pour assurer une certaine continuité, cohésion, à l’intuition sensible. En effet, l’espace, par exemple, est pure diversité, et il ne res terait rien d’une ligne qu’on parcourt, si l’imagination ne retenait les parties de cette ligne pour les juxtaposer. D’une manière générale, aucune intuition ne peut arriver à la conscience sans passer par le temps. L’imagination, qui est comme la projection de l’entendement dans le temps, schématise alors dans [431-165] le temps les concepts purs de l’entendement, et par là elle rapproche les concepts des objets pour permettre aux concepts de les étreindre. Par exemple, le concept de la quantité en tant que concept pur est sans application possible aux choses fournies par la sensibilité. Il faut, pour le rendre utilisable, en faire un nombre. Or le nombre534 suppose une succession de moments que l’on compte, dont on fait la somme. C’est la synthèse des actes successifs par lesquels une série est engendrée dans le temps. Par conséquent le nombre est ce qui rend la catégorie de la quantité appli-
162
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
cable aux choses ; il sera donc le schème pur de la quantité. Et puisque le nombre s’obtient par la projection de la catégorie de la quantité dans le temps, et puisque cette projection se fait par une faculté qui, d’un côté, participe de l’entendement en ce qu’elle formule l’exigence de l’entendement, et, de l’autre, participe de la sensibilité en ce qu’elle s’exerce dans le temps, nous devons poser ici une faculté spéciale qui est l’imagination pure en tant que s’exerçant a priori. Nous pourrions donc dire, pour interpréter la pensée de Kant, que l’imagination pure est l’entendement prenant la forme de la mémoire. L’entendement pur fournit des concepts a priori qui expriment son unité, mais qui précisément pour cette raison sont inapplicables, étant sans analogie avec les données de la sensibilité. Il faut que l’entende ment se sensibilise, pour ainsi dire, pour s’appliquer, qu’il [432-166] descende dans la sphère de la sensibilité, que ses concepts purs entrent dans le temps pour y acquérir cette souplesse qui leur permet de se plier aux contours des objets. L’imagination pure est justement cette opération. Qu’est-ce maintenant qu’un principe535 ? Un schème peut être appliqué aux phénomènes fournis par l’intuition de deux manières dif férentes. L’application peut d’abord en être purement personnelle. C’est ce qui arrive lorsque je relie entre eux d’une manière purement subjective les états successifs de ma conscience individuelle, quand je rêve par exemple. Mais au lieu d’être personnelle, individuelle, cette application peut être humaine. Ainsi, quand nous parlons de la nature en général, de l’expérience en général, la liaison établie entre les objets n’est pas une liaison valable pour moi seulement, mais pour tout le monde. Cette seconde application des schèmes, qu’on pourrait appeler impersonnelle, donne donc naissance à des propositions qu’on pourra appeler scientifiques, valables universellement. Or, par cette applica tion impersonnelle des schèmes aux données de l’intuition on consti tue une nature où tout se tient, des objets qui sont pour tous les hommes les mêmes, et entretiennent entre eux les mêmes relations. Bref, les phénomènes donnés dans le temps et dans l’espace, reliés entre eux d’une manière systématique et stable, comme aussi d’une manière impersonnelle, s’objectivent.
ANALYTIQUE TRANSCENDANTALE
163
[433-167] Dès lors, il faut qu’il y ait pour chaque schème de l’ima gination pure un principe correspondant qui permette aux phéno mènes de s’objectiver. Le principe est donc la formule, pourrait-on dire, de l’application légitime du schème. Comment faut-il user du schème, pour que les rapports établis par lui entre les phénomènes ne soient pas des rapports de fantaisie, des rapports valables pour moi subjectivement, mais des rapports valables pour tout le monde, et en ce sens réels ? A cette question, c’est le principe qui répond. Donc le principe détermine l’application légitime du schème. Donc, autant de concepts a priori, autant de schèmes, et d’autre part, autant de schèmes, autant de principes. Nous n’entrerons pas dans le détail de cette énumération ; elle ne serait intéressante que si, dans chaque cas, nous montrions comment on passe du concept pur au schème corres pondant, et du schème au principe. Kant a multiplié le nombre des concepts purs, et par conséquent celui des schèmes et des principes536, cédant en cela à un besoin de symétrie, et parce qu’il a voulu calquer la logique transcendantale sur la logique formelle entendue d’une cer taine manière. A vrai dire, comme l’a montré Schopenhauer, il n’y a qu’un seul concept pur a priori qui, comme l’a reconnu Kant luimême, joue un rôle essentiel dans la connaissance : c’est le principe de causalité. Quel est le schème de la causalité ? « C’est la succession de la diversité en tant que soumise à une règle », c’est-à-dire, la [434-168] succession régulière ; et le principe qui se rapporte à l’application de ce schème est celui-ci : tous les changements se produisent selon la loi de la liaison de la cause et de l’effet537. Résumons ce qui précède. Nous avons résumé l’analytique des concepts et celle des principes, et nous avons défini les termes catégo ries, concepts purs, schèmes, principes. L’idée de Kant pourrait se for muler ainsi : une certaine diversité étant fournie à la sensibilité, et encadrée par celle-ci dans ses formes a priori de temps et d’espace, il faut que ces intuitions de la sensibilité soient pensées, c’est-à-dire sai sies par l’entendement. L’entendement fait alors un pas, pour ainsi dire, vers la sensibilité. En vertu de la spontanéité de sa nature, il a des concepts purs a priori ; mais pour les utiliser, il faut qu’il les rende sen sibles, car il n’a pas d’autre matière que les intuitions sensibles aux-
164
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
quelles il puisse appliquer ces concepts. L’imagination est ce qui est, ce qui opère ce rapprochement ; elle crée le schème, et le schème, à son tour, est utilisé selon un principe qui en détermine l’application légitime. Ainsi se constitue l’expérience, c’est-à-dire un système de rapports stables établis entre les phénomènes, système indépendant de la fantaisie personnelle et, en ce sens, objectif, réel. Plus spécialement, et pour ne tenir compte que du plus important des concepts purs, le concept de causalité, on peut dire que les phénomènes fournis par la sensibilité dans le temps et dans l’espace attendent, pour être pensés, [435-169] que l’entendement les relie entre eux. L’entendement fournit le concept pur a priori de la causalité, mais d’une causalité quelconque, d’une causalité, dirions-nous, intemporelle. Or, par le schème de la succession réglée538, le concept de causalité s’épanouit en principe des causes efficientes, il s’applique ainsi aux choses dans le temps. Nous affirmons a priori que tous les phénomènes s’enchaînent selon la loi de causalité ainsi entendue, que l’ordre de leur succession est déterminé rigoureusement ; nous construisons ainsi un monde objectif539, en ce sens réel, où tout se tient, où tout s’enchaîne selon des rapports néces saires, et qui peut être connu tout entier scientifiquement parce qu’il a été scientifiquement construit. Nous devons maintenant reprendre quelques points sur lesquels nous avons glissé. 1° La méthode suivie par Kant dans l’Analytique des concepts et celle des principes est analogue à celle qu’il a suivie dans l’Esthétique transcendantale. De même que l’expérience sensible n’est possible que par des conditions qui sont données avant elle, à savoir les formes de la sensibilité, ainsi la pensée n’est possible qu’à certaines conditions qui sont données avant l’exercice de la pensée. L’erreur de Locke540 a été de vouloir dériver de l’expérience ce qui est la condition même de l’expérience. Cette méthode de Locke n’a pas seulement l’inconvé nient de ne fonder qu’une expérience toute subjective, puisque des principes obtenus par la généralisation de mon expérience personnelle [436-170] ne se rapporteront qu’à cette expérience ; elle a en outre le tort de ne pas expliquer le caractère de nécessité des principes : à sup poser qu’on établisse ainsi la possession, comme dit Kant, on n’établit
ANALYTIQUE TRANSCENDANTALE
165
pas la propriété, la première étant un fait, la seconde un droit. Admet tons que l’expérience dégage de mieux en mieux ces principes, l’expé rience en établira l’existence de fait, mais non l’existence en droit, l’existence nécessaire. 2° Il faudrait maintenant, d’après l’Analytique des concepts et celle des principes, se demander ce qu’est un concept, ou plus généralement comment nous devons nous représenter d’après Kant cet entendement qui, par des principes développés en schèmes, organise les choses et constitue l’expérience. Nous sommes ici au cœur même de la doctrine de Kant. Pour comprendre le concept kantien de l’entendement, nous ne pouvons mieux faire que de l’opposer d’un côté à l’empirisme, de l’autre à ce que Kant appelle le dogmatisme métaphysique, celui de Descartes par exemple. a) La distinction entre le point de vue de Kant et celui de l’empi risme est évidente. Pour l’empirisme, l’esprit est pure passivité, la pen sée ne fait qu’enregistrer les phénomènes. Cette thèse est rejetée par Kant absolument. Elle ne fonde pas l’expérience objective, la science ; elle ne peut pas expliquer comment certains rapports sont valables objectivement, universellement ; en même temps, et pour la même rai son, elle ne peut [437-171] pas expliquer le caractère apodictique des principes de la connaissance. b) En face de l’empirisme, il y avait eu jusqu’à Kant, le dogma tisme du genre cartésien, la croyance à une pensée douée d’une exis tence substantielle, à un être pensant, à un moi organisé d’une certaine manière et placé en présence de la nature. Dans cette doctrine le monde extérieur, sans doute, n’est connu que relativement, hypothéti quement, mais la pensée se connaît elle-même absolument, puisqu’elle se connaît sans intermédiaire. Les exigences de cette pensée tiennent à sa nature, à son essence, et ainsi, à mesure que nous les connaissons mieux, nous pénétrons mieux l’essence de cette pensée, l’essence de notre moi. Or cette seconde doctrine, Kant la répudie autant que la première541. D’après Kant, nous ne connaissons pas plus notre propre moi tel qu’il est en lui-même, dans l’absolu, que nous n’atteignons les choses extérieures ; et le moi que nous atteignons par la conscience n’a pas plus de réalité absolue que n’en ont les objets de la connaissance
166
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
en général. Les lois que l’esprit impose aux phénomènes ne nous ren seignent aucunement sur la vraie nature de l’esprit tel qu’il est en luimême542. A quoi cela tient-il, et comment le philosophe qui a dégagé mieux que tous les autres la spontanéité de l’esprit, qui a défini mieux que personne les formes et les lois que l’esprit impose de lui-même aux données de l’intuition en est-il venu à dire que nous ne connais sons rien de l’esprit tel qu’il est en [438-172] soi ? Répondre à cette question, ce sera déterminer la vraie nature du concept pur, la vraie nature de l’entendement. La réponse semble être la suivante, et on pourrait résumer en ces quelques mots l’idée, la tentative de toute l’Analytique transcendantale. Nous pourrions atteindre le réel, l’ab solu, si nous nous confondions avec lui ; et ceci arriverait si notre connaissance allait de l’un au multiple. Mais il se trouve qu’en fait elle va toujours du multiple à l’un. Expliquons cette formule : supposons que je puisse atteindre mon être, l’essence en quelque sorte de ma per sonnalité. Supposons que je l’atteigne en soi. Je le saisirais en tant qu’engendrant toutes ses manifestations, en tant qu’engendrant le phénomène ; je serais dans son unité vivante, et de cette unité sorti raient, s’épanouiraient les phénomènes. C’est donc de l’un que j’irais au multiple. Mais bien au contraire, je suis en présence de phénomènes qui me sont donnés d’abord comme multiplicité pure dans le temps, et je suis obligé de lier ces phénomènes, d’en faire un faisceau. Ce sont ces phénomènes multiples qui sont présentés à mon intuition. Sans doute, je leur impose l’unité. Mais l’unité leur vient ainsi du dehors. Cette unité n’est qu’une forme, forme banale, forme qui reste la même, c’est-à-dire incolore, quels que soient les phénomènes multi ples auxquels elle s’applique. Au contraire, l’unité de l’être réel telle [439-173] que Kant se la représente est une unité intérieure, une unité qui ne ressemble en rien à celle d’une forme vide et incolore, une unité qui contient en elle tout ce qu’il y a de couleur et de vie dans la mul tiplicité des phénomènes qui en sortent. Ainsi mon moi, en tant que chose en soi543 est sans doute l’unité qui s’épanouit en diversité ; mais comme c’est cette diversité qui est donnée d’abord à ma conscience, l’unité à laquelle je soumets cette diversité et qui lui vient après coup n’est pas l’unité réelle, l’unité originelle. Que faudrait-il pour saisir
ANALYTIQUE TRANSCENDANTALE
167
cette unité originelle ? Il faudrait qu’elle fût donnée avant la multipli cité sensible qui en émane ; il faudrait donc que mon entendement, au lieu d’être une forme vide, eût une intuition par lui-même. Or il n’y a pas d’intuition intellectuelle. Mon entendement ne trouve comme matériaux que ceux qui lui sont fournis par la sensibilité, car la sensi bilité seule a des intuitions. Donc je n’atteins pas la chose en soi, et les exigences de mon entendement ne me renseignent aucunement sur la vraie nature de mon être tel qu’il est en soi. Veut-on mettre cette idée sous une autre forme encore ? Dans l’absolu, d’après Kant, le tout précède les parties et les explique. Dans notre connaissance, les parties précèdent le tout, et nous [440-174] expliquons le tout par elles. Donc notre connaissance ne peut atteindre la chose en soi. Cela revient à dire que notre connaissance et notre conscience ne peuvent opérer que dans le temps. C’est en dehors du temps qu’on peut dire que le tout précède en soi les parties, que le tout de l’être précède logiquement ses manifestations multiples. C’est donc parce que notre pensée ne peut s’exercer que dans le temps, que nous atteignons toujours le phéno mène, et jamais — pas même au fond de notre conscience — la chose en soi. Voici alors la conclusion : nous devons nous représenter d’un côté le divers de l’intuition, c’est-à-dire une multiplicité de sensations qui dérivent, on ne sait comment, des choses en soi, et qui s’insèrent dans le temps et l’espace, formes pures de la sensibilité. Il y a d’autre part l’unité formelle de l’aperception, l’unité de la pensée impersonnelle544. Cette unité, descendant dans cette diversité pour l’embrasser, étend sur elle le réseau des concepts purs, des schèmes, des principes, qui sont autant de formules de cette unité impersonnelle. Les phénomènes se relient alors entre eux, mais suivant des liens, des rapports qui n’ont rien de commun avec les choses en soi dont ils émanent, et ma person nalité empirique n’est qu’un des objets de cette expérience. [441-175] 3° Il importe maintenant de bien fixer la thèse de la rela tivité de la connaissance, telle qu’elle se dégage de l’Analytique trans cendantale. La philosophie ancienne avait fait de la sensibilité la faculté de percevoir confusément les rapports réels et les choses réelles, ce que Kant appelle les choses en soi. A mesure que les sens
168
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
laissaient la place libre à l’entendement, l’esprit, d’après eux, devenait plus contemplatif, plus passif, recevait plus docilement la pure lumière du réel, se rapprochait enfin de l’absolu. Telle fut la conception de Platon, et même d’Aristote545. Nous ne faisons pas la vérité ; nous la recevons ; l’esprit est le miroir des choses. Au contraire, pour Kant, la sensibilité est une faculté active, autonome, une faculté qui a ses lois, ses dispositions à elle et ses fonctions spéciales. Elle reçoit, par un pro cédé d’ailleurs inconnu et inconnaissable, l’action des choses en soi. Les matériaux ainsi obtenus, elle les insère dans l’espace et le temps qui sont ses formes. Alors survient l’entendement, avec ses concepts purs a priori. Développant ses concepts dans le temps grâce à l’imagi nation, il s’empare des intuitions de la sensibilité, les enchaîne les unes aux autres, établit entre elles des relations stables dont le type est le rapport de causalité dans le temps. Grâce à cette liaison nécessaire, il crée la vérité, car la vérité n’est pas du tout pour Kant le réel en soi, c’est l’organisation systématique des phénomènes par l’entendement en général, l’entendement impersonnel, c’est la nécessité de leur suc cession dans un ordre déterminé. Déjà Leibnitz avait dit quelque chose d’analogue dans le IVe livre des Nouveaux Essais sur Pentendement humain546 : « Le vrai critère en matière des objets des sens est la liaison des phénomènes, c’est-à-dire la connexion [442-176] de ce qui se passe en différents lieux et temps. » La même idée avait été exprimée par Descartes (VIe Méditation). « Si quelqu’un, lorsque je veille, m’appa raissait tout soudain et disparaissait de même (...) ce ne serait pas sans raison que je l’estimerais un spectre ou un fantôme (...), mais lorsque j’aperçois des choses dont je connais distinctement et le lieu d’où elles viennent et celui où elles sont, et le temps auquel elles m’apparaissent, et que sans interruption je puis lier le sentiment que j’en ai avec la suite du reste de ma vie, je suis entièrement assuré que je les aperçois en veillant, et non point dans le sommeil. »M7 En d’autres termes, la réalité des objets, pour Kant, n’est pas autre chose que la nécessité pour eux d’occuper des places déterminées dans l’espace et dans le temps, et cette nécessité résulte de l’imposition aux phénomènes par l’entendement de la loi de causalité. Ainsi, alors que la vérité consistait pour les Anciens dans la réflexion fidèle des choses dans un entende-
ANALYTIQUE TRANSCENDANTALE
169
ment intuitif qui en reçoit la lumière, au contraire pour Kant elle est l’œuvre active de l’entendement, lequel applique ses concepts purs a priori par l’intermédiaire des schèmes aux données de l’intuition sensible, données dont l’origine est la réfraction des choses en soi dans l’espace et dans le temps. La démonstration de cette thèse, et aussi la réfutation de celle des Anciens, est implicitement contenue dans chaque page de l’Analytique transcendantale. Fidèle au plan tracé dans l’Introduction, Kant [443177] se propose d’expliquer comment des jugements synthétiques a priori sont possibles. Il y a d’après lui deux manières, et deux seule ment, de concevoir le rapport de la représentation à son objet. Ou c’est l’objet qui se règle sur la représentation, ou c’est la représenta tion qui se règle sur l’objet. Dans le premier cas, la représentation est empirique, et par conséquent elle ne peut revêtir la forme de la néces sité. Or il n’y a pas d’expérience possible sans les conditions de l’expé rience. Il faut donc que ces conditions soient données a priori. Par conséquent, la seule hypothèse plausible est la seconde, à savoir que les objets se règlent sur la représentation. Par là, la science est fondée solidement. Par là nous sommes assurés de la liaison des phénomènes puisqu’ils ne peuvent pas être pensés sans se soumettre aux lois de notre pensée. Le jugement synthétique a priori, qui exprime l’exigence de notre entendement et formule pour ainsi dire cette exigence dans le temps, s’applique nécessairement aux phénomènes, puisque le phéno mène ne peut se prêter à l’action de l’entendement qu’à la condition de se plier à cette loi. En dehors de cette hypothèse qui fait évanouir toute difficulté, d’après Kant, et de l’hypothèse contraire, l’hypothèse empirique, qui rend l’expérience inintelligible, il n’y a que l’hypothèse faite par Leibniz d’une harmonie préétablie548 entre les choses et la pensée. Mais c’est là une explication paresseuse, d’après Kant, qui fait de l’accord de la pensée avec son objet quelque chose de contingent, qui n’est que par un bienfait de la Providence, alors que dans l’hypo thèse kantienne, l’accord de la pensée et de son objet est nécessaire, puisque la vérité est l’œuvre [444-178] de la pensée. Mais, dira-t-on, qui nous garantit que les matériaux fournis, on ne sait comment d’ailleurs, par la chose en soi, se prêteront aux formes de
170
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
la sensibilité et aux catégories de l’entendement ? Kant se donne les choses en soi d’un côté, de l’autre la pensée. Par une action indéfinis sable de la chose en soi sur la pensée se produisent les intuitions empi riques, éléments premiers de toute connaissance. Qui nous garantit l’obéissance, la docilité de ces intuitions aux lois de l’entendement ? A cette question, la réponse de Kant est fort simple : la connaissance existe, c’est un fait ; donc elle est possible. Et puisque la connaissance est une organisation des données de l’intuition par l’entendement dans l’espace et dans le temps, nous pouvons conclure de la réalité du fait à sa possibilité. Par cette conception de l’expérience et de la science, Kant croit avoir réfuté l’idéalisme sous les deux formes qu’il lui attribue, l’idéa lisme dogmatique de Berkeley, et l’idéalisme problématique de Des cartes549. L’idéalisme de Berkeley est dogmatique en ce qu’il affirme que les corps sont de pures chimères. Or le vice de cet idéalisme consiste en ceci qu’il ne distingue pas l’espace des sensations qui y sont organisées. Comme ses sensations sont subjectives, Berkeley en conclut que toute la réalité des corps est subjective. Mais cet idéalisme est réfuté par l’Esthétique transcendantale, et par la Critique de la raison pure en général. En effet, Kant a distingué de la donnée de l’intuition empirique, qui est subjective en effet, l’ordre des sensations dans l’es pace et le temps, ordre qui [445-179] est indépendant du sujet, puis qu’il est l’œuvre commune de la sensibilité et de l’entendement imper sonnel. L’ensemble des corps situés dans l’espace n’a sans doute pas de réalité en soi, mais il vaut pour l’humanité en général, non pas pour l’individu. Seulement, cet ensemble de corps a donc une réalité objec tive et non subjective comme le disait Berkeley. Kant croit avoir également réfuté l’idéalisme problématique de Des cartes. Descartes tient en effet sa propre existence pour assurée et même croit connaître le tout de son existence consciente ; mais il tient l’exis tence des choses extérieures pour problématique, attendu que la connaissance des choses extérieures est médiate, d’après lui, et celle de la pensée immédiate. Or, d’après Kant, nous connaissons notre propre pensée comme les choses extérieures550. Ces deux connaissances sont du même ordre et atteignent exactement le même genre de réalité : une réa-
ANALYTIQUE TRANSCENDANTALE
171
lité empirique. Il est faux de dire que notre connaissance des choses exté rieures soit médiate, et celle de notre propre pensée immédiate. Le contraire serait plutôt vrai ; et c’est ce que Kant essaye de démontrer dans un curieux passage551 de 1*Analytique des principes. Voici cette démonstration : « Je suis conscient de mon existence comme déterminée dans le temps. Or toute détermination dans le temps présuppose quelque chose de permanent dans la perception. Mais ce permanent ne peut pas être quelque chose en moi, puisque précisément mon existence ne peut être déterminée dans le temps que par le permanent. Donc la perception du permanent n’est possible que par le moyen d’une chose hors de moi (...). Ainsi le [446-180] jeu de l’idéaliste cartésien lui est rendu à son tour, et avec plus de raison. Il prétend que l’existence interne est immédiate, et que l’existence des choses extérieures est seule ment conclue. Mais nous venons de prouver que l’expérience externe est immédiate, et qu’elle seule rend possible l’expérience interne. » Voilà le sens de ce passage : quand je parle de mon être, je fais allusion à quelque chose de permanent. Mais l’essence de ma pensée est de durer. Donc je ne puis la saisir dans sa mobilité qu’à la condition de la rapporter à quelque objet extérieur supposé permanent. En d’autres termes, je ne puis mesurer et me représenter le temps qu’au moyen de l’espace552. La connaissance des choses étendues est donc indispensable à la conscience du moi, et les cartésiens n’ont pas le droit de tenir la connaissance de la pensée par elle-même pour une connaissance plus immédiate que celle des choses extérieures. Ainsi, d’après Kant, notre moi nous est connu comme un objet quelconque. La pensée organisatrice de l’expérience n’est pas le moi concret, c’est une simple forme. Il y a d’un côté le divers de l’intui tion, matériaux de toute connaissance ; et de l’autre côté l’entende ment impersonnel avec ses catégories. Par l’action réciproque, ou plu tôt par la synthèse de ces deux éléments, une nature sensible et une forme impersonnelle, se constituent les objets. Nos personnes553, telles qu’elles se développent dans le temps, nos moi individuels, sont sim plement certains d’entre les objets ; et la réalité de ces objets est du même ordre, du même genre que celle de tous les autres ; [447-181] ce sont des phénomènes systématiquement organisés.
172
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
C'est en effet par la distinction des phénomènes et des noumènes554 que se termine 1*Analytique transcendantale. Le noumène555 n’est pas tout à fait la chose en soi ; c’est la chose en soi telle qu’elle serait donnée à un entendement intuitif ; c’est la chose en soi saisie dans une intuition où se confondraient à la fois l’être et la pensée. La chose en soi ne peut pas être connue du dehors, mais seulement du dedans, intérieurement. Si elle était connue, ce serait dans une intuition intellectuelle, et cette intuition donnerait le noumène. Or notre entendement n’a pas d’intui tion ; seule la sensibilité a des intuitions. Et le rôle de l’entendement est seulement de coordonner, d’unir, en leur imposant ses concepts, les données de la sensibilité. Donc, on peut affirmer comme une consé quence de toute cette critique, que nous n’avons pas une connaissance positive du noumène. En vain l’entendement se flatte d’y aboutir par ses concepts. En vain il allègue que ses concepts dépassent les données de l’intuition sensible. Sans doute le concept pur de l’entendement est plus vaste que l’intuition sensible, il la déborde. Mais s’il est plus grand qu’elle, il ne lui est pas supérieur. Il la déborde, en ce sens qu’il s’ap plique non seulement aux intuitions empiriquement données, mais encore à d’autres intuitions empiriquement possibles. Il la déborde en ce qu’il est d’une application virtuelle indéfinie pouvant servir non seule ment à l’expérience actuelle, mais encore à toute expérience. Mais il ne peut servir qu’à l’expérience, ne peut s’appliquer qu’à des intuitions sen sibles, pour la raison fort simple qu’il n’y a pas d’autre intuition. L’en tendement [448-182] est une fonction, une fonction qui a pour objet d’unir, mais ce n’est qu’une fonction. L’entendement n’a aucune intui tion, l’entendement ne nous présente aucune matière. Dès lors, son rôle est de s’appliquer aux matériaux qui viennent de la sensibilité, et dès qu’il veut sortir de ce rôle, il est dans le vide. « Si nous voulions appli quer les catégories à des objets qui ne peuvent plus être considérés comme des phénomènes, il nous faudrait pour fondement une intuition différente de l’intuition sensible, et alors l’objet serait un noumène dans le sens positif. Mais comme une intuition de cette nature, une intuition intellectuelle, est absolument en dehors de notre faculté de connaître, l’usage des catégories ne peut s’étendre hors des limites des objets de l’expérience. (...) Ce que nous appelons noumènes ne doit donc être
ANALYTIQUE TRANSCENDANTALE
173
entendu que dans le sens négatif. » « Le concept de noumène est simple ment un concept limitatif destiné à circonscrire les prétentions de la sen sibilité, et par conséquent d’un usage purement négatif. »556 En d’autres termes, nous pouvons et devons même poser le noumène, mais nous ne pouvons le poser qu’à titre de barrière pour limiter les prétentions de notre pensée spéculative. Au point où s’arrête la connaissance empi rique, et par conséquent où s’arrête toute connaissance possible, là com mence le noumène, nous n’en pouvons parler que négativement. Resterait à savoir si Kant s’en est bien tenu à cette conception toute négative du noumène. Il y a en effet une question qui se pose constamment au lecteur de la Critique, c’est celle de savoir pourquoi [449-183] Kant affirme l’existence des choses en soi, alors qu’il est si simple de partir des phénomènes et de les ériger en absolu. La raison en est évidemment que ces données sont par essence multiples. Kant les tient pour dérivées de quelque chose, parce qu’elles n’ont pas d’unité par elles-mêmes, et que nous sommes obligés de leur imposer l’unité extérieure et superficielle de la pensée. C’est donc que Kant ne se fait pas une idée simplement négative de la chose en soi. Il se la représente comme une unité557, mais comme une unité différente de celle de notre pensée, unité qui n’est pas simplement formelle, unité qui consiste dans la présence et la préexistence du tout à ses parties, unité comparable à celle de la vie, et dont la nature nous fournit une image558 dans ce qu’on appelle la finalité. Sans cette hypothèse, semble-t-il, il n’y a aucune raison spéculative de croire à une chose en soi, et de ne pas ériger en absolu les données de l’intuition sensible. Mais si cette conception positive du noumène est latente, impliquée dans tout le cours de la Critique, nous avons le droit de nous deman der si la pensée n’est pas capable d’aller plus loin encore, de chercher si nous n’aurions pas, dans des cas privilégiés au moins, l’intuition de cette unité vivante, intérieure et non plus extérieure à la diversité, si nous n’aurions pas des intuitions intellectuelles. Or nous croyons que notre personnalité, quand on la découvre de ce qu’elle a de superficiel et d’acquis, nous est justement donnée dans une intuition de ce genre559 ; et que l’analyse si intéressante faite par Kant de l’idée de per sonne ne [450-184] s’applique pas à l’idée que nous puisons de nous-
174
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
mêmes dans une intuition profonde, où nous saisissons tout d’un coup l’unité et la multiplicité de nos phénomènes, notre durée nous appa raissant comme un tout indivisé. Quoiqu’il en soit, c’est sur ce point qu’une critique du kantisme doit faire porter son effort.
LA DIALECTIQUE TRANSCENDANTALE
Nous abordons la deuxième partie de la Logique transcendantale. L’Esthétique transcendantale a traité de la sensibilité ; l’Analytique transcendantale, de l’entendement ; dans la Dialectique transcendantale, il va être question de la raison. « Toute notre connaissance commence par les sens, d’où elle gagne l’entendement, et s’achève dans la raison, au-delà de laquelle rien de plus élevé ne se trouve en nous pour travailler la matière de l’intuition, et la réduire à la plus haute unité de la pen sée. »560 Mais qu’est-ce que la raison ? La sensibilité a ses formes, l’enten dement a ses concepts purs, ses catégories ; la raison n’a ni formes ni concepts. Son rôle est d’introduire dans la connaissance la plus haute unité possible, et cela en poussant l’entendement à étendre toujours plus loin l’application de ses catégories. Or cette impulsion donnée à l’enten dement se traduit par un double mouvement de l’entendement, l’un en avant, l’autre en arrière. Il y a progression de la condition au condi tionné561 et régression du conditionné à la condition. Or, tant que la série est descendante (de la condition au conditionné), nous [451-185] n’éprouvons pas le besoin de l’arrêter, et nous ne voyons pas de raison pour qu’elle s’arrête. De la condition au conditionné, la descente peut se continuer indéfiniment, l’esprit demeure indifférent sur la question de savoir jusqu’où elle se poursuivra. Au contraire, la série ascendante nous paraît exiger un terme, parce que le conditionné ne s’explique, semble-t-il, et ne peut être conditionné que si la totalité des conditions est donnée. Or la tendance de la raison à pousser l’entendement toujours plus loin se traduit par ce que Kant appelle les idées de la raison pure. L’idée562 n’est à vrai dire qu’un ressort, une impulsion, l’impulsion à remonter toujours plus haut. Elle n’a pas d’objet, elle ne peut pas se rap porter à un objet, elle n’est que la fixation, on pourrait dire le symbole
DIALECTIQUE TRANSCENDANTALE
175
arrêté, d’un mouvement communiqué à l’entendement et qui le porte toujours plus loin ; mais il se produit à propos de ces idées transcendan tales une illusion inévitable. Nous attribuons un objet à ce qui n’est qu’une tendance, une règle d’application. Ce mouvement venu d’en haut, de la raison, et qui dirige l’entendement, le pousse dans le champ des phénomènes, ce mouvement, nous le solidifions563, nous en faisons une chose. Ces idées de la raison que nous faisons correspondre à des choses, et dont le rôle est seulement de servir de régulateur à l’applica tion des catégories, ces idées sont au nombre de trois564, l’idée du moi, l’idée de l’Univers, l’idée de Dieu. [452-186] La première de ces idées exprime l’unité absolue du sujet pensant, c’est l’idée du moi, d’un moi absolu565 ; la deuxième, l’unité absolue de la série des conditions du phénomène, c’est l’idée du monde ; la troisième, l’unité absolue des conditions de tous les objets de la pensée en général, c’est-à-dire du réel et du possible, c’est l’idée de Dieu. Or le sujet pensant est l’objet de la psychologie, le monde est l’objet de la cosmologie ; Dieu est celui de la théologie. La question est donc de savoir s’il y a une psychologie rationnelle possible, une psychologie transcendantale, s’il y a une cosmologie rationnelle ou transcendantale, s’il y a une théologie transcendantale. En d’autres termes, la question est de savoir si nous atteignons réellement un moi, une réalité indépendante du moi, qui serait le monde dans sa totalité, enfin si nous pouvons prouver l’existence de Dieu ; ou bien s’il ne faudrait pas plutôt ne voir dans l’idée du moi, celle du monde, celle de Dieu, telles que nous les atteignons par la raison pure, de pures idées, au sens où nous avons défmi idée de la raison, de telle façon que psy chologie rationnelle, cosmologie rationnelle, théologie transcendan tale seraient également illusoires. Kant va établir ces trois points. Il appelle paralogisme transcendantal566 ou de la raison pure le rai sonnement erroné par lequel on arrive à affirmer l’existence de l’ab solu du moi pensant. Il appelle antinomie de la raison pure l’état où tombe la raison dès qu’elle opère sur le concept du monde considéré comme existant en soi. Enfin, il appelle idéal de la raison pure le rai sonnement dialectique par lequel on prétend conclure à l’existence d’un être de tous les êtres, c’est-à-dire de Dieu.
176
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
[453-187] 1° Le paralogisme de la raison pure. — Il consiste à partir du jugement « Je pense », ïch denke. Ce concept, dit Kant, est le véhicule de tous les concepts en général567, en ce sens qu’il n’y a pas d’acte de la pensée qui ne soit accompagné de la conscience de la pen sée. On part donc du « je pense », et on conclut de là à l’existence d’une prétendue substance, d’un prétendu substrat de la pensée. Quels seraient les attributs de ce moi transcendant, de ce moi substance ? En suivant toujours le fil conducteur des catégories568, on trouve qu’au point de vue de la quantité, l’âme est substance ; au point de vue de la qualité, simple ; au point de vue de la relation, identique ; et au point de vue de la modalité, qu’elle est en relation avec tous les objets pos sibles de l’espace. Du premier attribut, on conclut l’immatérialité de l’âme, du second son incorruptibilité, du troisième sa personnalité, et du quatrième, l’animalité et l’immortalité : l’animalité569, car la subs tance pensante sera considérée comme le principe de la vie de la matière ; et l’immortalité parce qu’elle sera distinguée profondément de tous les objets matériels avec lesquels elle est en rapport. De ces cinq attributs, les trois premiers constituent la spiritualité de l’âme. Maintenant, que faut-il penser de l’argumentation par laquelle on passe de la constatation du phénomène de la pensée, du « je pense », à l’affirmation d’un moi substance, d’une âme spirituelle ? Il y a ici, d’après Kant, une illusion profonde mais inévitable, qui consiste à prendre pour un être réel, pour un sujet métaphysique, ce qui n’est qu’un [454-188] sujet logique570. Interprétons cette idée de Kant. Tout objet, d’après Kant, possède certaines propriétés ; c’est ainsi que cette table est noire, pesante, etc. Par cela seul que je perçois la couleur noire, la pesanteur, comme des qualités des phénomènes, je les mets dans un sujet qui est la table. Et la raison en est que l’esprit humain procède natu rellement, nécessairement, par jugement571, et que pour juger il faut opter entre deux termes, et faire de l’un le sujet de la proposition, et de l’autre l’attribut. L’esprit humain, en vertu de sa constitution même, pose ainsi des sujets logiques de propositions, qui deviennent le point d’intersection d’un nombre indéfini d’attributs ou de qualités. D’ailleurs, parmi les phénomènes, qu’est-ce qui doit être tenu pour attri but, et qu’est-ce qui doit être choisi comme sujet ? Les raisons de ce
DIALECTIQUE TRANSCENDANTALE
177
choix ont été indiquées dans 1*Analytique transcendantale. On y a vu que l’entendement distribue les phénomènes et construit les objets de manière à assurer la plus grande cohérence possible à l’expérience. Il suit donc de la nature même de notre connaissance et de sa forme générale qui est le jugement, que nous constituons des sujets, ou si l’on aime mieux des objets, lesquels, en leur qualité de sujets de propositions, attendent des attributs pour ainsi dire et jouent ainsi le rôle d’une liste toujours ouverte où des attributs viendront s’inscrire. Mais de là à pas ser une substance réelle, existant en soi, un subjectum au sens métaphy sique du mot, il y a très loin ; car ce sujet substrat serait un sujet existant en soi, au lieu que les sujets sur [455-189] lesquels nous opérons ne sont que des sujets logiques. Ils sont sujets en ce sens qu’ils occupent la place de sujets dans la proposition. Or c’est justement un paralogisme de ce genre que nous faisons quand nous parlons d’un moi substance. Nous rapportons tous les états de conscience comme autant d’attributs à un sujet permanent572 qui est le moi. C’est là une opération très naturelle qui consiste à dire qu’on peut prendre la conscience ou la pensée pour sujet dans toutes les proposi tions où l’attribut exprimera un état de conscience particulier, un acte particulier de la pensée, en d’autres termes, que le « je pense » accom pagne tout état de conscience. Ce moi qui sert de sujet à toute proposi tion est permanent si l’on veut, dans ce sens que la même conscience, le même « je pense », accompagne tous les actes de connaissance passés, présents, futurs. Mais prendre cette permanence dans le sens d’existence substantielle, conclure à une âme existant en soi, c’est, encore une fois, confondre ce simple sujet logique avec une substance réelle. Nous pouvons maintenant comprendre cette page de Kant où est formulé en termes précis le paralogisme de la raison pure. D’après Kant, la psychologie rationnelle raisonne comme suit573 : Majeure. — Ce qui ne peut être conçu que comme sujet n’existe que comme sujet, et par conséquent est substance. Mineure. — Or un être pensant considéré simplement comme tel ne peut être pensé que comme sujet. Conclusion. — Donc il n’existe aussi que comme tel, c’est-à-dire comme substance.
178
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
[456-190] « Il est question dans la majeure d’un être tel qu’il peut être donné en intuition. Dans la mineure, il ne s’agit de cet être que par rapport à la pensée et à l’unité de la conscience. Par conséquent, la conclusion est déduite per sophisma figurae dictionis ou par un faux rai sonnement. » Voici l’explication de ce passage. Un sujet qui serait substantiel ne pourrait être saisi que du dedans et par une intuition intellectuelle ; et c’est d’un sujet donné par intuition, d’une vraie subs tance, qu’il est question dans la majeure. Mais, dans la mineure, il n’est question que d’un sujet construit sur l’entendement, d’un sujet auquel l’entendement impose une unité extérieure et artificielle. L’en tendement, qui est le distributeur des sujets et des attributs, peut tou jours faire en sorte que le moi soit sujet de toute proposition qui for mule un acte de connaissance. L’être pensant dont il est question dans ce sens ne peut être que comme sujet, puisqu’il est sujet par définition. Mais ériger ensuite ce sujet, qui est sujet par définition, en substance réelle, c’est jouer sur les mots, puisque c’est prendre le mot sujet dans deux sens différents dans la majeure et dans la mineure. L’illusion de la raison étant ainsi dévoilée, deux questions sont écartées toutes ensemble. La première question est celle qui se pose entre le spiritualisme et le matérialisme. En effet, le moi que nous sai sissons étant par définition un sujet simple574, on n’arrivera jamais à le définir en partant du principe matérialiste, puisque la nature est par définition composée575. Le matérialisme est donc impuissant. Mais le spiritualisme l’est aussi à conclure de mon existence [457-191] empi rique à l’existence d’une âme ou substance pensante. « Donc la psy chologie rationnelle n’existe pas comme doctrine (en ce sens qu’elle ne peut rien nous enseigner) ; mais comme discipline (méthode)576, elle sert à mettre dans le champ de la connaissance des bornes infranchis sables à la raison spéculative, pour l’empêcher, d’une part, de se livrer au matérialisme pur, d’autre part, de se laisser entraîner à un spiritua lisme sans fondement pour nous dans la vie. Ce spiritualisme nous avertit de donner cette incompétence de notre raison pour réponse satisfaisante aux questions curieuses qui portent sur une sphère étran gère à celle de notre vie actuelle. (...) La critique, sévère en ce qu’elle montre l’impossibilité de décider dogmatiquement quelque chose sur
DIALECTIQUE TRANSCENDANTALE
179
un objet de la raison au-delà des bornes de l’expérience, rend néan moins un grand service à la raison en la prémunissant contre toutes les assertions possibles du contraire. » La deuxième question est celle du commerce de l’âme avec le corps. « La difficulté que cette question a toujours présentée consiste dans la dissimilitude supposée entre l’objet du sens interne et les objets des sens externes, ces derniers objets ayant de plus que les pre miers l’espace. Mais si l’on fait attention que ces deux espèces d’objets ne diffèrent pas l’une de l’autre intrinsèquement, mais seulement en tant que l’un semble extérieur à l’autre, et que, par conséquent, ce qui sert de fondement aux phénomènes de la nature comme chose en soi pourrait bien n’être pas si différent, alors, la difficulté s’évanouit, et il n’en reste pas d’autre [458-192] que celle-ci : comment en général un commerce entre substances est-il possible ? Question dont la solution est tout à fait hors du champ de la psychologie, et sans aucun doute hors du champ de toute connaissance humaine. »577 2° Les antinomies de la raison pure. — Nous venons de voir qu’une psychologie rationnelle est impossible. Une cosmologie rationnelle est-elle du moins possible ? Nous avons vu que la psy chologie rationnelle repose tout entière sur un paralogisme. Mais ce paralogisme ne produit l’illusion que « dans un seul sens »578, c’est-àdire que la raison ne fournit pas d’arguments ou de sophisme en faveur de la thèse contraire, de sorte que ce paralogisme est tout entier en faveur du spiritualisme579. Il en est tout autrement quand la raison s’applique à la « synthèse objective des phénomènes », c’est-àdire à l’idée de l’univers. Ici se présente « un phénomène nouveau de la raison humaine, une antithétique naturelle ». En d’autres termes, la raison va se trouver ici en présence de plusieurs systèmes de propositions, chacun de ces systèmes contenant deux propositions contraires incompatibles [l’une] avec l’autre, semble-t-il, mais égale ment vraies, également démontrables. Au lieu d’un simple raisonne ment sophistique, d’où ne se dégageait aucune contradiction appa rente, la raison va tomber dans des contradictions, des antinomies. Or, de même que le paralogisme de la raison pure servait de fonde-
180
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
ment à une psychologie rationnelle, de même, Fantinomie de la rai son pure va nous faire connaître les principes d’une prétendue cos mologie rationnelle, non pour que nous en soyons satisfaits, et pour que nous les [459-193] adoptions, mais pour montrer dans la cosmo logie rationnelle une apparence aussi fausse qu’éblouissante580. Quelle est la cause cachée, la source profonde, d’où jailliront les anti nomies de la raison pure ? La raison, d’après Kant, s’exprime ainsi : « Si le conditionné est donné, il faut que l’inconditionné ou l’absolu soit donné aussi. Or cet absolu peut être conçu, ou comme consistant sim plement dans la série totale de tous les termes conditionnés, et alors la régression est dite infinie, ou bien, au contraire, comme une partie de la série, un premier terme auquel tous les autres termes sont subordonnés, mais qui n’est soumis lui-même à aucune condition. Dans le premier cas, la série est a parte priori [en remontant] sans limite, et néanmoins toute donnée. Dans le deuxième cas, il y a quelque chose de donné dans la série. » S’agit-il, par exemple, d’une étendue déterminée, d’un certain corps ? Cette étendue ne se suffit pas à elle-même puisqu’elle est limitée ; elle a sa condition dans une autre étendue qui l’enveloppe, et celle-ci dans une autre. Voilà ce que dit l’entendement s’appliquant aux données de la sensibilité. Mais la raison, qui règle ou dirige l’usage de l’entende ment, exige que, cette étendue581 étant conditionnée, c’est-à-dire rela tive, l’inconditionné soit donné. Or, cet inconditionné peut consister, soit dans une limite du monde à laquelle nous nous arrêterons, soit au contraire dans l’infinité du monde qu’on supposera donnée tout d’un coup. De même pour le temps. D’autre part, considère-t-on dans cette étendue déterminée, dans ce corps que nous avons choisi, les parties composantes582, au lieu de faire de ce corps, comme [460-194] tout à l’heure, une partie lui-même de l’univers ? Alors, le tout de cet objet matériel étant conditionné par ses parties, nous pourrons, répétant le raisonnement, dire que chaque partie à son tour est conditionnée par ses parties ; et puisque la raison exige que ce qui est conditionné le soit par rapport à quelque chose d’inconditionné, d’absolu, nous pourrons dire que cet absolu consiste dans une partie indivisible à laquelle il faudra s’arrêter, soit au contraire dans l’infinité des parties données tout d’un coup. Passe-t-on à la catégorie de la causalité583 ? Voici un phénomène
DIALECTIQUE TRANSCENDANTALE
181
qui se produit. Il est conditionné par un antécédent, cet antécédent par un autre. L entendement procède ainsi en conditionnant toujours. Mais la raison exige un inconditionné, un absolu ; et, ici encore, on pourra faire consister l’absolu soit dans l’infinité de la série des antécédents qu on supposera alors donnée, soit dans une cause libre qui commence la série, et n’a par conséquent aucun antécédent. Passe-t-on enfin à la modalité584 ? Voici une existence contingente. Elle suppose le nécessaire, puisque c’est par rapport au nécessaire que cette existence est contin gente. Or nous pouvons supposer que la nécessité réside soit dans l’infi nité des termes de la série qui aboutit à cette existence contingente, et que cette infinité est donnée par conséquent ; soit dans un être néces saire qui commence la série. Tel est le principe des quatre antinomies. Il nous reste à les formuler. Première antinomie THÈSE : Le monde a un commencement dans le temps et il est limité dans l’espace. DÉMONSTRATION : Le monde a un commencement dans le temps, car s’il n’a point de com-[461-195]mencement, il s’ensuit qu’à un moment donné une éternité est déjà écoulée, et par conséquent une série infinie d’états successifs est écoulée aussi. Or, l’infinité d’une série consiste précisément en ceci qu’elle ne peut jamais être achevée par une synthèse successive. Par conséquent, une série cosmique pas sée ne peut pas être infinie. Le monde est limité dans l’espace, car si nous supposons que le monde n’a pas de limites, alors, le monde sera un tout infini donné de choses simultanément existantes. Or, nous ne pouvons pas concevoir une grandeur qui ne nous est pas donnée en intuition autrement que par une synthèse de parties, ni la totalité d’une telle grandeur autrement que par la synthèse complète ou l’addiüon répétée des parties. Donc pour concevoir le monde conçu sans limites, il faudrait que la synthèse successive des parties de ce monde infini fût considérée comme complète, c’est-à-dire qu’un temps infini devrait être conçu comme écoulé, ce qui est impossible.
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
182
Antithèse : Le monde n’a ni commencement ni limite ; il est au contraire infini quant au temps et quant à l’espace. Démonstration585 : Le monde n’a pas de commencement. Sup posons en effet qu’il ait un commencement. Puisque le commence ment est une existence précédée d’un temps dans lequel la chose n’est pas, un temps doit donc avoir précédé dans lequel le monde n’est pas, c’est-à-dire un temps vide. Or rien ne peut commencer d’exister dans un temps vide puisque le temps est la condition d’existence. De même, le monde est illimité dans l’espace, car si le monde était limité, il y aurait [462-196] autour de lui l’espace vide ; il n’y aurait donc par conséquent pas seulement un rapport de choses dans l’es pace, mais aussi un rapport des choses à l’espace. Or, l’espace est la source de tout rapport des objets entre eux ; les rapports sont en lui et non pas à lui. Donc le rapport du monde à un espace vide est quelque chose d’incompréhensible. Deuxième antinomie Thèse : Une substance composée dans le monde est composée de parties simples et, partant, il n’existe rien que de simple ou qui ne soit composé de simple. Preuve586 : En effet, si l’on suppose que les substances composées ne le sont pas de parties simples, alors, toute composition disparais sant dans l’esprit, absolument rien ne resterait. Par conséquent, aucune substance ne serait donnée. D’où il suit immédiatement que toutes les choses du monde sont des êtres simples, et que la composi tion n’est que leur état extérieur. Antithèse : Aucune chose composée dans le monde ne l’est de parties simples, et nulle part il n’existe rien de simple. Preuve587 : En effet, supposons qu’une chose composée le soit de parues simples. Comme toute composition de substances n’est possible que dans l’espace, il s’ensuit qu’à chaque partie du composé correspond une certaine partie d’espace que cette partie occupe. Or,
DIALECTIQUE TRANSCENDANTALE
183
l’espace ne se compose pas de parties simples, mais d’espaces. Par conséquent, chaque partie du composé occupant un espace divisible est divisible elle-même. Il n’y a donc pas de partie simple. Troisième antinomie Thèse : La causalité d’après les lois de la nature n’est pas la seule dont nous puissions dériver tous les phénomènes de l’univers ; il est nécessaire encore d’admettre une causalité par liberté. Preuve : En effet, si tout arrive selon les seules lois de la nature, il n’y a jamais qu’un commencement relatif, et jamais un premier commencement. Par conséquent, la série des causes provenant les unes des autres n’est jamais donnée intégralement. Or, cependant, [463-197] c’est une loi de la nature que, sans une cause suffisamment déterminée a priori, rien n’arrive. Par conséquent, la proposition qui énonce que toute causalité n’est possible que d’après les lois physi ques se contredit elle-même, si on pose cette loi sans limite. Donc cette causalité ne peut être admise comme unique588. Antithèse : Il n’y a pas de liberté, mais tout dans le monde arrive selon des lois naturelles. Preuve : Supposez en effet qu’il y ait une liberté, c’est-à-dire une espèce particulière de causalité suivant laquelle les événements du monde pourraient avoir lieu, c’est-à-dire enfin une faculté de com mencer absolument un état. Tout commencement d’action suppose un état de la cause non encore agissante, et un commencement dynami quement premier de l’action589 suppose un état qui n’a aucun rapport de causalité avec le passé de la même cause, c’est-à-dire qui n’en résulte d’aucune manière, de sorte qu’une pareille liberté serait oppo sée à la loi de la causalité. Quatrième antinomie Thèse : Au monde sensible se rapporte quelque chose qui, soit qu’il en fasse partie, soit qu’il en soit la cause, est un être absolument nécessaire.
184
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
Preuve590 : En effet, tout conditionné actuel présuppose une série complète de conditions jusqu’à l’inconditionné absolu qui seul est absolument nécessaire. Par conséquent, si un changement existe, quelque chose d’absolument nécessaire existe aussi. Mais cette chose nécessaire appartient au monde sensible, car étant la cause des change ments, elle occupe un certain moment du temps, et par conséquent ne peut être conçue isolément du monde sensible. Antithèse : Il n’existe nulle part d’être absolument nécessaire, soit dans le monde, soit hors du monde, comme en étant la cause. Preuve591 : Supposez en effet que le monde soit lui-même un être nécessaire, ou qu’il y ait en lui [464-198] un être nécessaire. Alors, il y aurait dans la série de ses changements un commencement qui serait absolument nécessaire, et par conséquent sans cause, ce qui répugne à la loi de causalité. Ou bien la série elle-même serait sans commence ment, et, bien que conditionnée dans toutes ses parties, elle serait cependant inconditionnée dans le tout, ce qui est contradictoire, puisque l’existence d’une multitude ne peut être nécessaire si aucune de ses parties ne l’est. Supposez maintenant que cette cause absolu ment nécessaire [soit] hors du monde. Pour agir, elle serait obligée de commencer d’agir, sa causalité aurait donc lieu dans le temps, et par là même ferait partie de l’ensemble des phénomènes. Cette cause ne serait donc plus hors du monde, ce qui contredit la supposition même. Remarques générales sur les antinomiesm. — 1° Dans ces quatre antino mies, les thèses répondent au point de vue de l’entendement593, les antithèses à celui de la sensibilité. La sensibilité a pour forme l’espace et le temps ; elle nous donne donc un prolongement infini de l’espace et du temps. Au contraire, l’entendement ne comprend que l’unité, le déterminé, l’arrêté. De là vient qu’il exige une limite au temps, à l’es pace, à la divisibilité, un commencement absolu, etc. Il suit de là que chaque démonstration est négative, consiste à prouver l’absurdité de la thèse contraire. A propos de la thèse de la sensibilité, l’entendement fait voir une absurdité intellectuelle, et à propos de la thèse de l’enten dement, la sensibilité dénonce une absurdité sensible.
DIALECTIQUE TRANSCENDANTALE
185
2° Sur ces quatre antinomies, il faut remarquer en second lieu que, les raisons étant d’égale valeur [465-199] pour la thèse et pour l’anti thèse, ceux qui optent pour l’une ou pour l’autre sont obligés de se décider pour des raisons extrinsèques594. Toutes les antithèses ont ceci de commun qu’elles expriment l’idée fondamentale de l’empirisme595. En effet, dire qu’il n’y a ni limites au temps, à l’espace, à la division de la matière, qu’il n’y a ni cause libre ni être [nécessaire], c’est soutenir que toute réalité est faite sur le modèle de ce que nous apercevons dans notre expérience. Par contre, les thèses qui posent un monde fini dans le temps et l’espace, des éléments simples, des causes libres, un être nécessaire, expriment ce que Kant appelle dogmatisme596, la ten dance métaphysique. Or, des deux côtés, du côté de l’empirisme et du côté du dogmatisme, il y a des raisons, extérieures à la démonstration, qu font que l’on se rallie de préférence aux thèses ou aux antithèses. Du côté du dogmatisme, c’est-à-dire des thèses, il y a, premièrement, un intérêt pratique dans lequel tout homme sensé prend parti de bon cœur : que le monde ait un commencement, que le moi pensant soit de nature simple, qu’il soit libre, que l’ensemble des choses dépende d’un être premier, ce sont là autant de pierres angulaires fondamentales de la morale et de la religion. Deuxièmement, il y a pour les thèses l’avantage de la popularité : le sens commun ne trouve pas la moindre difficulté à l’idée d’un commencement absolu de toute synthèse, parce qu’il est plus accoutumé à marcher en descendant du principe à la conséquence, qu’à remonter de la conséquence au principe, et qu’il trouve dans le concept de l’absolument nécessaire un point ferme auquel il peut attacher chacun597 de ses pas ; tandis qu’au contraire, dans l’ascension perpétuelle du conditionné à la condition, il a [466-200] toujours un pied en l’air, il ne peut trouver aucun point ferme. Troisièmement598, il y a enfin un intérêt spéculatif, car si l’on commence ainsi par l’absolu qu’on se donne, on peut embrasser par faitement a priori la chaîne entière des conditions. — Du côté de l’em pirisme (antithèses), il y a cet avantage considérable, très supérieur au point de vue de la spéculation, qu’aucun commencement n’étant posé à la série, l’entendement est sûr de se trouver toujours sur son propre terrain, et par conséquent de pouvoir étendre sans fin ses connais-
186
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
sances. A quelque hauteur qu’il s’élève dans la série des conditions, il est sûr de trouver toujours l’application possible des mêmes lois, qui sont les lois de l’expérience. — En résumé, les antithèses, c’est-à-dire l’empirisme, favorisent la science ; les thèses, c’est-à-dire le dogma tisme métaphysique, favorisent la morale, la religion, et même la spé culation métaphysique. C’est donc l’un ou l’autre de ces intérêts qui détermine l’esprit à prendre parti pour la thèse ou pour l’antithèse. Mais si un homme pouvait s’affranchir de tout intérêt, et estimer les affirmations de la raison selon la seule valeur de leurs principes, celuilà serait en état de doute perpétuel599, à supposer qu’il n’y ait pas de troisième parti à prendre. Aujourd’hui il paraîtrait persuadé de la libre volonté, et le lendemain, considérant l’enchaînement indissoluble des phénomènes de la nature, il prendrait le libre arbitre pour une illusion et penserait que tout est purement naturel. Il est vrai que, s’il venait à agir, le jeu de la raison spéculative pure disparaîtrait d’un coup, et il choisirait ses principes d’après l’intérêt pratique. Nous devons maintenant résoudre600 les antinomies, c’est-à-dire démasquer l’illusion que fait [naître] [467-201] la raison. Celle-ci, quand elle est impartiale, passe tour à tour aux deux affirmations contraires, sans pouvoir s’arrêter à aucune d’elles. — Le principe de cette solution est d’entrer dans l’idéalisme transcendantal601, que nous connaissons déjà, mais dont il formule le principe directeur nettement dans la page suivante (p. 131 du deuxième volume de la traduc tion)602 : « Les objets de l’expérience ne sont jamais en eux-mêmes, mais seulement dans l’expérience ; ils n’existent pas en dehors d’elle. Qu’il puisse y avoir des habitants dans la Lune, quoique aucun homme ne les ait jamais aperçus, c’est ce qui doit être accordé, mais cela signifie seulement que nous pourrons peut-être, dans le progrès possible de l’expérience, les reconnaître un jour, car on doit appeler réel tout ce qui est lié à une perception suivant les lois du progrès empirique. Les phénomènes sont donc réels lorsqu’ils sont liés empi riquement dans la conscience. (...) Rien de réel ne nous est donné que la perception avec la progression empirique de cette perception à d’au tres perceptions possibles, car en eux-mêmes les phénomènes ne sont réels que dans la perception. Appeler un phénomène du nom de chose
DIALECTIQUE TRANSCENDANTALE
187
réelle avant de l’avoir perçu, c’est simplement dire que nous pouvons en rencontrer la perception dans le cours de notre expérience. Qu’il existe en lui-même, sans rapport à notre expérience possible et à nos sens, c’est ce qu’on pourrait dire sans doute, s’il était question d’une chose en soi, mais il s’agit seulement ici d’un phénomène dans l’espace et dans le temps. Or l’espace et le temps ne sont que des déterminadons de notre sensibilité. » A la lumière de ces considérations, nous allons résoudre les quatre antinomies, mais cette solution ne sera pas la même pour les deux premières, les antinomies mathématiques, et pour les deux dernières, les antinomies dynamiques. Pour les deux premières, nous allons voir que thèse et andthèse sont également fausses, et pour les deux dernières peuvent être également vraies. Première antinomie. — Parler du monde603 comme [468-202] fini dans le temps et dans l’espace, ou comme infini dans le temps et dans l’espace, c’est dans les deux cas faire de l’univers une chose, une réalité indépendante de notre esprit. Mais la vérité est que rien n’existe de ce monde sinon nos représentations, lesquelles représentadons étant assujetdes, en vertu de l[eur] origine sensible, aux formes de temps et d’espace, sont dans un progrès indéfini en ce sens que, quelle que soit l’étendue aperçue, il y a toujours une étendue plus grande ; et quelle que soit la durée considérée, il y a toujours une durée antérieure. Ce progrès indéfini de notre perception est tout ce qui nous est donné de l’univers, tout ce qu’il y a de réel dans l’univers en tant que phéno mène. L’univers étant cette progression ou cette régression de notre percepdon, on ne peut pas dire que cette régression ou cette progres sion soit jamais finie, puisque ce serait supposer qu’elle s’arrête et que nous cessons de penser, d’avoir une expérience. Mais on ne peut pas dire davantage qu’elle soit infinie, parce qu’un infini est quelque chose de réalisé, de donné tout d’un coup, et que cette progression ou cette régression est toujours en voie de formaüon, jamais terminée. Citons les termes mêmes de Kant : « Comme le monde n’existe point du tout en soi indépendamment de la série régressive de mes représentations, alors il n’existe ni comme un tout infini en soi, ni comme un tout fini en soi ; il ne consiste que dans la régression empirique de la série des
188
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
phénomènes. (...) Cette série n’est jamais entièrement donnée, et par conséquent, il n’a pas de grandeur, ni finie ni infinie, w604 Qu’y a-t-il donc au fond de cette première antinomie ? Il y a simplement une règle posée par la raison, une impulsion donnée à l’entendement. La raison, qui est la faculté régulatrice de l’usage de l’entendement, exige que l’entendement pousse toujours [469-203] plus loin la recherche des conditions et la régression dans la série des phénomènes. Notre illusion605 consiste à prendre cette règle pour une chose, et à la maté rialiser, pour ainsi dire, dans un univers soit fini soit infini donné tout d’un coup, ce qui permet de se donner tout d’un coup toutes les conditions du phénomène. Deuxième antinomie606. — La solution est analogue. Dire que toute chose est composée de parties simples, ou qu’il n’y a rien de simple dans l’univers, c’est dans les deux cas faire de ces éléments des choses existant par elles-mêmes, choses dont le nombre serait fini dans la pre mière hypothèse, infini dans l’autre. Mais en vertu du principe même de la critique, il n’y a pas plus de parties en soi que d’objets en soi donnés à notre perception. Ce qui nous est donné, ce qui est seul réel, c’est le mouvement, la régression de notre esprit qui décompose et décompose indéfiniment. Or, il n’y a ici ni fmi ni infini. D’un côté en effet ce mouvement peut toujours être poussé plus loin, et par consé quent il n’est jamais quelque chose de terminé ; mais d’autre part, pré cisément parce qu’il se continue indéfiniment, il n’embrasse jamais un infini. Les deux dernières antinomies sont appelées par Kant dynamiques. Kant fait remarquer que dans les deux premières antinomies, soit thèse, soit antithèse, la condition et le conditionné sont toujours de même nature, homogènes ; ils entretiennent en effet des rapports de contenant à contenu. Il est question d’un espace qui enveloppe un espace, d’un temps antérieur à un temps, d’une partie contenue dans un tout. La [470-204] relation est mathématique, c’est celle d’une partie au tout. Au contraire, dans les deux dernières antinomies, la condition est par défini tion différente du conditionné, et par conséquent elle pourrait se trou ver en dehors de la série des phénomènes. L’une est cause, l’autre effet ;
DIALECTIQUE TRANSCENDANTALE
189
l’une est ce qui est provisoirement nécessaire, l’autre ce qui est contin gent. Le rapport est donc comparable au rapport de ce qui engendre à ce qui est engendré. Le rapport est dynamique. Or il résulte de cette diffé rence une distinction à faire pour la solution de ces deux dernières anti nomies. En effet, dans les deux premières antinomies, la condition à laquelle on remonte dans le passé est de même nature que le condi tionné, et fait partie de la série nécessairement, de sorte qu’on a le choix entre la thèse qui dit qu’il faut s’arrêter, et l’antithèse qui dit qu’on ne doit pas s’arrêter, et qu’il faut opter pour l’une des deux affirmations, ou les déclarer toutes deux fausses. Au contraire, dans les deux dernières antinomies, la condition est par hypothèse d’une autre nature que le conditionné, et par conséquent, elle pourrait fort bien se trouver en dehors de la série des phénomènes. Dans ce cas, thèse et antithèse pour raient être également vraies, la thèse faisant allusion à des conditions tout autres que celles dont il est question dans l’antithèse — puisqu’il s’agit dans l’antithèse de phénomènes, et dans la thèse de quelque chose qui n’est pas phénomène. En d’autres termes, l’antithèse concerne les phénomènes dont la série est indéfinie, et où on ne rencontre jamais l’in conditionné. Mais la thèse pourrait concerner des choses en soi, puis qu’il n’est pas spécifié que la condition soit de même nature que le conditionné, comme lorsqu’on [471-205] compare des espaces à des espaces, des temps à des temps. Troisième antinomie. — « On ne peut concevoir607 que deux sortes de causalité, ou suivant la nature, ou par liberté. La première est la liaison d’un phénomène à un phénomène d’après une règle. Au contraire, la liberté est la faculté de commencer par soi-même un état. Or, si les phé nomènes étaient des choses en soi, si l’espace et le temps étaient des formes de l’existence des choses, alors, les conditions et le conditionné feraient toujours partie d’une seule et même série, et c’en serait fait de la liberté. (...) Mais si, au contraire, les phénomènes ne sont que de simples représentations enchaînées entre elles suivant des lois empiriques, alors, ils doivent eux-mêmes avoir des causes qui ne soient pas des phéno mènes. Ces causes seraient par définition même en dehors de la série, bien que leurs effets soient dans la série des conditions empiriques. Dans
190
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
ce cas, il y aurait une cause intelligible, c’est-à-dire nouménale, par rap port à laquelle l’effet serait libre, et cependant cet effet se lierait aux phé nomènes antérieurs suivant la nécessité de la nature. » En d’autres termes enfin, la liberté affirmée dans la thèse est possible, et elle est conciliable avec la nécessité universelle affirmée dans l’antithèse. Si on met la nécessité dans le monde des représentations, et si on place la liberté dans le monde des noumènes, cette liberté concernant l’action et non la représentation, il y aurait donc enfin d’un côté notre caractère empirique, par lequel nos actions comme phénomènes seraient en rap port avec d’autres phénomènes suivant les lois constantes de la nature, et pourraient [472-206] y être rattachées en ce sens qu’elles s’en dérive raient ; et d’autre part, il y aurait un caractère intelligible608, qui est la vraie cause de toutes ces actions comme phénomènes, qui n’est soumis à aucune condition de la sensibilité, qui est par conséquent en dehors du temps ; il y aurait Yhomo noumenon à côté et au-dessus de Yhomo phenomenon. « Ce sujet agissant ne serait soumis à aucune condition de temps, car le temps n’est que la condition des phénomènes. Par suite, il ne serait pas soumis à cette détermination de temps en vertu de laquelle tout ce qui arrive a sa cause dans d’autres phénomènes. »609 Ainsi, la liberté est pos sible et conciliable avec les lois de la nature. Existe-t-il maintenant une causalité libre ? Tout ce que nous pouvons dire, c’est que nous en conce vons la possibilité, et même que, sans elle, on ne comprendrait pas les impératifs que nous nous imposons comme règles dans la pratique. Le verbe devoir610 exprime un genre de nécessité qui ne se rencontre nulle part dans la nature. L’entendement ne trouve dans la nature que ce qui est, a été, ou sera ; il est impossible que quelque chose y doive être autre ment qu’il n’est. Le devoir serait donc dépourvu de sens si l’on ne consi dérait que le cours de la nature. Donc la causalité par liberté n’est pas inconciliable avec les lois de la nature. Quatrième antinomie. — Tout étant conditionné dans l’ensemble des phénomènes, il ne peut y avoir dans cette série aucun terme incondi tionné, et par conséquent, si les phénomènes étaient l’être à propre ment parler, on n’aboutirait jamais au nécessaire. Mais il peut se faire qu’il y ait pour toute la série des phénomènes une condition non
DIALECTIQUE TRANSCENDANTALE
191
empirique, un être absolument nécessaire. Cet être ne ferait pas partie de la série, pas même comme l’anneau le plus élevé. Il serait conçu comme purement intelligible, et échapperait à la loi de contingence qui gouverne tous les phénomènes. Comme on le voit, la solution de [473-207] cette quatrième antinomie est identique à celle de la troi sième611. L’idéalisme transcendantal qui nous conduit à déclarer fausses la thèse et l’antithèse des deux premières antinomies, nous per met d’autre part de considérer thèse et antithèse des deux dernières antinomies comme pouvant être également vraie l’antithèse s’appli quant aux phénomènes, la thèse pouvant être vraie des choses en soi. Mais les quatre antinomies d’autre part démontrent et vérifient l’idéa lisme transcendantal, car elles formulent des contradictions que la dis tinction entre phénomènes et noumènes est seule capable de lever. Ce qui résulte des antinomies de la raison pure, c’est qu’une cos mologie rationnelle est impossible, comme une psychologie ration nelle. Tout au plus pouvons-nous formuler612 des propositions problé matiques, les thèses des deux dernières antinomies. 3° L’idéal de la raison pure. — Nous passons à la troisième par tie de la Dialectique transcendantale, intitulée « De l’idéal de la raison pure ». La question à résoudre est : une théologie transcendantale est-elle possible ? Définissons d’abord l’idéal de la raison pure, c’est-à-dire Dieu. Dans l’ensemble des phénomènes intérieurs, nous voyons le moi ; dans la totalité des phénomènes réels, l’univers ; enfin, dans l’ensemble de toute réalité et de toute possibilité nous voyons Dieu, « la totalité du réel et du possible ». Déjà Leibniz613 mettait en Dieu l’ensemble des existences et des essences, c’est-à-dire le tout de l’être et de la possibilité. Déjà Bossuet614, développant une idée de Descartes, disait : « L’impar fait suppose le parfait, le parfait est le premier en soi et dans nos idées, et l’imparfait en toute chose n’en est qu’une dégradation. » Kant, don nant à cette idée une forme rigoureuse, veut que tout jugement quel qu’il soit, porté par nous, jugement qui consiste à lier un prédicat à un sujet, implique un fond de pensée où serait déposée en couches profondes, pour ainsi dire, la totalité des attributs réels et possibles, de
192
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
telle sorte que juger consiste simplement à choisir, à circonscrire dans cette masse l’attribut désiré. La somme de tous les prédicats, de tous les attributs possibles, est ainsi le terrain, [474-208] l’humus où notre intel ligence puise la matière de ses jugements, de sorte que tout juge ment sur quelque objet que ce soit implique la représentation de tous les attributs réels ou possibles, c’est-à-dire l’idée de Dieu. « Il y a un substratum qui sert de fondement à la détermination universelle ; il contient l’entière provision de matière d’où peuvent être pris tous les prédicats des choses ; ce substratum n’est par conséquent que l’idée d’un tout de la réalité (omnitudo realitatis). (...) Toute diversité des choses n’est donc qu’une manière de limiter le concept de la réalité suprême qui est le substratum commun, de même que toutes figures ne sont que différentes manières de limiter l’espace infini. C’est pourquoi l’objet de l’idéal peut s’appeler l’être primitif (ens originarium), ou être suprême (ens summum), ou enfin l’être de tous les êtres (ens entium). »615 De cette idée du tout de la réalité, nous devons exclure nécessairement les attributs négatifs, c’est-à-dire les imperfections, puisque les attributs négatifs ne sont pas de vrais attributs, mais s’obtiennent par l’exclusion des attributs positifs qui sont les seuls vrais attributs. Par conséquent, cette idée du tout de l’être est en somme l’idée de la perfection, l’idéal de la raison pure, idéal en ce que c’est le prototype de toute réalité pour nous, puisqu’une réalité n’est réelle pour nous qu’en tant que découpée dans cet ensemble. Affirmer l’existence de Dieu, c’est, comme dit Kant, hypostasier cet idéal, en faire une substance. Est-ce légitime ? Avons-nous le droit, si nous restons sur le terrain de la raison pure, de la spéculation, de passer de cette idée de Yomnitudo realitatis à l’affirmation de l’existence de Dieu ? C’est l’examen des preuves de l’existence de Dieu qui peut nous l’apprendre. Il y a, d’après Kant, trois manières, et trois seulement616, de démontrer l’existence de Dieu : « Ou bien on part d’une expérience déterminée et de ses propriétés particulières pour s’élever à une cause suprême située hors du monde, [475-209] ou bien on part d’une expé rience indéterminée, c’est-à-dire quelconque pour aboutir au même point, ou bien enfin on fait abstraction de toute expérience, et on
DIALECTIQUE TRANSCENDANTALE
193
conclut a priori d’un simple concept à l’existence d’une cause suprême. La première preuve est la preuve physico-théologique ; la seconde, la preuve cosmologique ; la troisième, la preuve ontologique. « Il n’y en a pas, il ne peut pas y en avoir davantage. » D’ailleurs, Kant suivra dans l’examen de ces preuves l’ordre inverse, parce que comme nous allons le voir, c’est la preuve ontologique qui fonde la preuve cosmo logique, et ce sont les deux preuves ontologique et cosmologique qui fondent la preuve physico-théologique. Cette démonstration de l’exis tence de Dieu, quelle que soit celle des trois formes qu’elle revêt, ren ferme un sophisme. « Je démontrerai que la raison n’avance pas plus dans l’une de ces voies que dans l’autre, et qu’elle déploie vainement ses ailes pour s’élever, par la seule force de la spéculation, au-dessus du monde sensible. »617 Considérons ces trois preuves tour à tour. La preuve ontologique I — Impossibilité d’une preuve ontologique. part du concept a priori de l’être parfait618, c’est-à-dire du tout de la réalité, et conclut analytiquement à l’existence en soi comme substance de l’être parfait, en se fondant sur ce que l’existence est un attribut qui ne peut, sous peine de contradiction, être refusé au sujet qu’on sup pose être la totalité des attributs possibles. Résumons la critique que Kant fait de cette preuve. L’objection qu’il élève, toujours la même au fond, se présente tour à tour sous plusieurs formes qui la rendent de plus en plus claire. 1° Si dans un jugement identique je fais [476-210] disparaître le prédicat et que je retienne le sujet, il en résulte une contradiction. Mais si je fais disparaître le sujet en même temps que le prédicat, alors, il n’y a pas contradiction, car il n’y a plus rien avec quoi il puisse y avoir contradiction. Il est contradictoire de supposer un triangle si l’on en supprime par la pensée les trois angles. Mais il n’y a pas contradiction à faire disparaître le triangle en même temps que les trois angles. En d’autres termes, on prétend qu’il serait logiquement contradictoire de dire que Dieu n’est pas, mais une absurdité, une contradiction, ne peut naître que de l’attribution ou du refus d’un cer tain prédicat à un certain sujet ; elle ne peut naître de la négation pure et simple du sujet lui-même.
194
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
2° Si vous dites : par cela seul que je pense à Dieu, je pense aussi qu’il existe, vous en avez le droit sans doute, votre proposition est analytique en effet. Mais vous ne pouvez alors que vous répéter vousmême, vous tombez, comme dit Kant, dans une tautologie619, qui consiste à dire que si vous pensez à Dieu, vous pensez à lui. Si au contraire vous dites : « Par cela seul que je pense à Dieu, il existe, alors, vous dépassez votre droit, la proposition n’est plus analytique, elle devient synthétique, mais elle se réduit à une affirmation arbi traire. » Si vous appelez réalité toute position (d’un sujet ou d’un pré dicat), alors, vous avez déjà posé et admis comme réelle la chose avec tous ses prédicats dans le concept du sujet, et vous ne faites que vous répéter dans la prédication. Avouez-vous au contraire, comme doit le faire tout homme raisonnable, que toute proposition existentielle (qui pose l’existence d’un sujet) est synthétique alors comment prétendezvous affirmer que le prédicat existence ne peut être enlevé sans contra diction, puisque ce privilège n’appartient qu’aux propositions analyti ques, dont le caractère analytique consiste en cela même ? [477-211] 3° L’existence n’est pas un véritable attribut620. Que je pense Dieu comme existant ou que je pense Dieu comme simplement possible, c’est la même idée que j’ai dans l’esprit dans les deux cas ; de sorte qu’on n’a pas le droit de dire qu’on diminue l’idée de Dieu en lui refusant l’existence substantielle, l’idée de Dieu étant identiquement la même, soit qu’il existe, soit qu’il n’existe pas. « Cent thalers réels ne contiennent absolument rien de plus (comme attribut) que cent thalers simplement possibles, car, s’il y avait quelque chose de plus, quelque attribut de plus dans le thaler réel que dans le thaler possible, s’il y avait quelque chose de plus dans l’objet que dans le concept qui le représente, le concept n’exprimerait plus tout l’objet et ne serait plus le concept de l’objet. (...) Si donc je pense une chose par ses attributs quels qu’ils soient, et que je dise de plus : “cette chose est”, rien, absolument rien n’est ajouté par ce fait à la chose, car autrement ce ne serait plus précisé ment la même chose qui existerait, puisqu’il y aurait plus dans la chose que je n’aurais pensé dans le concept. » On dira cependant qu’entre le réel et le simplement possible, il y a une différence, et que posséder cent thalers est autre chose que d’en avoir simplement l’idée. Sans doute.
DIALECTIQUE TRANSCENDANTALE
195
Mais cette différence existe entre cent thalers réels et cent thalers pos sibles ; elle n’existe pas entre l’idée de cent thalers réels et l’idée de cent thalers simplement possibles. L’idée est identique dans les deux cas. Ce qui distingue le premier cas du second, c’est seulement que les cent thalers réels621 se rattachent à mon expérience, au lieu que les cent thalers simplement possibles ne sont pas perçus, ne se rattachent pas à mon expérience. De même, Dieu existant se distinguerait de Dieu [478-212] simplement possible en ce que j’en aurais l’intuition. Mais, en fait, je n’ai pas l’intuition de Dieu, car toute intuition est sensible. Je n’ai que le concept de Dieu construit avec la totalité des prédicats possibles. Or, de ce concept, je ne puis passer à l’existence, l’existence étant et ne pouvant être qu’un objet d’intuition. Il n’y a aucune contradiction à poser le concept de Dieu, c’est-à-dire la totalité des attributs possibles, et à lui refuser l’existence, puisque l’existence n’est pas un attribut, et que je ne diminue en rien, par conséquent, le concept de Dieu en lui refusant l’existence, laquelle n’est pas et ne peut pas être représentée dans le concept. « Nous sommes obligés de sortir de notre concept d’un objet pour accorder l’existence à cet objet. » II - Impossibilité d’une preuve cosmologique. — C’est la preuve que Leibniz appelait a contingenta mundi. Elle est ainsi conçue : « Si quelque chose existe, un être absolument nécessaire doit aussi exister. Or il existe quelque chose, quand ce ne serait que moi-même. Donc il existe un être absolument nécessaire, w622 Pour se donner un fonde ment solide, cet argument s’appuie sur l’expérience. Il semble différer ainsi de la preuve ontologique, laquelle met toute sa confiance dans des concepts purement a priori. Mais la vérité est que cette expérience ne sert à la preuve cosmologique que pour faire un seul pas, à savoir pour s’élever à l’existence d’un être nécessaire en général. L’argument empirique ne peut faire connaître les attributs de cet être. Ainsi la rai son l’abandonne et cherche dans de simples concepts quels doivent être les attributs d’un être absolument nécessaire, c’est-à-dire d’un être qui doit contenir toutes les conditions requises pour une nécessité absolue. Or elle ne croit [479-213] trouver ces conditions que dans l’idée de l’être souverainement réel623, parce que le concept de cet être
196
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »
satisfait pleinement au concept de la nécessité absolue dans l’existence, c’est-à-dire que l’on peut conclure de ce concept à cette nécessité, pro position qu’affirmait justement l’argument ontologique. Cet argument revient donc dans l’argument cosmologique, ce qu’on croyait pour tant éviter. » Voici le sens de ce passage. La preuve cosmologique part de ce que quelque chose existe, et conclut de la contingence de cette exis tence à celle d’un être nécessaire. Or, en acceptant même la validité de cette conclusion, laquelle repose sur un emploi, d’après Kant illégi time, du principe de causalité ; en acceptant même la validité de cette conclusion, l’être nécessaire auquel on aboutit n’est pas nécessaire ment l’être parfait. Ce pourrait aussi bien être l’absolu des matéria listes, l’atome, cet être nécessaire et indéterminé. Mais la raison éprouve le besoin de déterminer a priori la nature de cet être néces saire. Elle cherche alors parmi tous les concepts celui qui paraît enve lopper en lui l’existence nécessaire. Or, le concept de l’être parfait est précisément le seul qui réponde à cette condition, puisque, comme nous venons de le voir dans la preuve ontologique, nous sommes por tés naturellement par la logique même de notre esprit à considérer l’être parfait comme enveloppant l’existence nécessaire. De sorte que nous concluons à l’existence de Dieu, mais que le nerf caché de l’argu ment est la preuve ontologique. Cette preuve cosmologique, d’après Kant, nous fait bien com prendre en quoi consiste le mouvement624 par lequel la raison aboutit à poser l’existence comme substance de [480-214] l’être parfait. L’unité systématique de la nature nous paraissant devoir prendre pour fonde ment l’idée d’un être souverainement réel, cette idée est représentée comme un objet réel, et cet objet à son tour, parce qu’il est la condi tion suprême, est représenté comme nécessaire. C’est la même illusion qui nous fait considérer l’espace comme existant par lui-même. « Nous convertissons en un principe constitutif un principe régulateur. »625 III — De l'impossibilité d’une preuve physico-théologique. — Il résulte de ce qui précède que ni le principe de contradiction, ni la loi de causalité ne nous autorisent à poser l’existence de Dieu. Le premier ne vaut que
DIALECTIQUE TRANSCENDANTALE
197
pour les abstractions logiques ; la deuxième n’a de valeur que pour enchaîner des phénomènes, et non pour passer des phénomènes à un créateur situé hors de la série des phénomènes. Reste la finalité. La preuve cosmologique partant de l’expérience de l’existence en général, la preuve physico-théologique part d’une expérience déterminée, de certaines 626 < > constatées de l’existence. Le monde présente un théâtre si étendu de diversité, d’ordre, de finalité et de beauté, que tout langage est impuissant à rendre une telle merveille627. Or, comme rien n’est arrivé de soi-même à l’état où il se trouve, la totalité des choses irait s’abîmer dans le néant, si l’on ne prêtait pour appui à cette contingence infinie quelque chose en dehors d’elle. Nous ne connaissons pas 62B le contenu du monde, nous ne pouvons pas estimer sa grandeur, sa perfection ; mais qu’est-ce qui nous empêche, puisque nous avons besoin de la causalité d’un être extrême et suprême, de la placer quant au degré de perfection au-dessus de tout être possible ? Nous aboutissons ainsi à l’être parfait. Cet argument, d’après Kant, mérite d’être [481-215] rappelé avec respect, et c’est celui pour lequel Kant semble avoir le plus de sympa thie : « C’est le plus ancien, le plus clair, et le plus conforme à la raison humaine. »629 Kant y découvre cependant plusieurs vices. a) On peut contester la valeur du raisonnement par analogie630 qui compare la production de la nature à celle de l’art humain, et qui sup pose que l’art de la nature a pour fondement comme le nôtre une intelligence et une volonté. b) Cet argument aboutit tout au plus à expliquer la forme du monde, et non sa matière. En d’autres termes, on n’aboutit pas à l’idée d’un créateur, mais d’un organisateur du monde, un « architecte du monde »631. c) L’imperfection même de l’univers ne nous permettrait pas de conclure logiquement à un organisateur parfait, la cause étant propor tionnée à son effet632. d) Mais là n’est pas l’objection essentielle. D’après Kant, cette preuve renferme implicitement les deux précédentes. Elle emprunte sa force à l’argument ontologique, dissimulé d’ailleurs dans l’argument cosmologique. En effet, après être parvenu à l’admiration de la gran-
198
« CRITIQUE DE LA RAISON PURE »>
deur, de la sagesse de l’auteur du monde, ne pouvant pas aller plus loin, on abandonne cet argument tout à coup pour passer à la contin gence du monde contingent, que l’on conclut de l’ordre et de la fina lité. Alors, de la contingence du monde, on conclut à un être néces saire ; et de l’idée de l’être nécessaire, on passe à celle de l’être parfait. « La preuve physico-théologique s’arrête dans son entreprise. Dans son embarras, elle saute tout à coup à la preuve cosmologique, laquelle n’est qu’une preuve ontologique déguisée. »633 La conclusion qui se dégage [482-216] de ce résumé de la Dialectique transcendantale, en ce qui concerne la théologie transcendantale d’abord, c’est que, si on ne peut prouver l’existence de l’idéal de la raison pure, on ne peut pas davantage la nier634, puisque nous sommes enfer més dans le monde des phénomènes, et que toute application transcen dante des principes, soit pour affirmer, soit pour nier, est également illé gitime. Plus généralement, la Dialectique transcendantale confirme les deux premières parties de la Critique. Cette question : comment des juge ments synthétiques a priori sont-ils possibles ? a été résolue dans ce sens que c’est notre pensée qui organise les choses, appliquant les concepts purs, par l’intermédiaire des schèmes, aux intuitions sensibles. Ainsi est démontré l’idéalisme transcendantal, ainsi est fondée la certitude en matière scientifique. Mais cette critique, en nous montrant l’impuis sance de la raison à affirmer quelque chose en ce qui concerne l’au-delà, nous montre aussi que la négation, en ce qui concerne cet ordre suprasensible, est également illégitime. Cet ordre suprasensible demeure donc à l’état de possibilité. Ce qui nous incline à y croire, nous y déterminera même, d’après Kant, ce sont les motifs tirés de l’action morale à défaut de raisons purement spéculatives.
IV LEÇONS SUR
LES THÉORIES DE L’ÂME LYCÉE HENRI-IV 1894
7 Leçons
Ve Leçon
LES THÉORIES DE L’AME JUSQU’A ARISTOTE
[1] 1° HOMÈRE. — Comme le fait remarquer Zeller635, c'est le spec tacle de la mort qui a suggéré aux anciens Grecs636 < >, peutêtre à l’homme primitif en général l’idée de la distinction entre le corps d’une part et de l’autre une substance qui serait l’âme. Après la mort en effet le corps semble demeurer pendant quelque temps ce qu’il était. Mais quelque chose a disparu, ce sont les mouvements soit extérieurs soit surtout internes. Il semble donc que quelque chose se soit évanoui, que quelque chose ait disparu, de moins facilement perceptible, de moins tangible que le corps proprement dit. Ce qui aurait disparu, ce qui se serait évanoui, ce serait un principe de mouvement, telle est la t^ux*#) d’Ho mère et des anciens poètes de la Grèce. La ÿux?) est le souffle vital, spiritus en latin, c’est le principe de la respiration 7uve0(xa. A la t|;uyr\ qui est le principe de la vie, Homère rattachait les esprits animaux
![Cours sur la philosophie grecque - Cours IV [Paperback ed.]
2130489567, 9782130489566](https://dokumen.pub/img/200x200/cours-sur-la-philosophie-grecque-cours-iv-paperbacknbsped-2130489567-9782130489566.jpg)
![Leçons de psychologie et de métaphysique, Tome 1 [Paperback ed.]
2130431437, 9782130431435](https://dokumen.pub/img/200x200/leons-de-psychologie-et-de-metaphysique-tome-1-paperbacknbsped-2130431437-9782130431435.jpg)