Leibniz: Dynamique et métaphysique, suivi d'une note sur le principe de la moindre action chez Maupertuis
True PDF
120 48 43MB
French Pages 260 Year 1967
Polecaj historie
Citation preview
LEIBNIZ
7 COLLECTION
ANALYSE ET RAISONS COMITÉ DE DIRECTION
GUEROULT Membre de l'Institut Professeur au Collège de France MARTIAL
PAUL RICŒUR Professeur à la Sorbonne
YvoN BELA VAL Professeur à la Sorbonne VICTOR GOLDSCHMIDT Professeur à la Faculté des Lettres de Clermont-Ferrand
GILLES-GASTON ORANGER
Professeur à la Faculté des Lettres d'Aix-en-Provence
ANALYSE ET RAISONS
MARTIAL GUEROULT
LEIBNIZ DYNAMIQUE ET MÉTAPHYSIQUE suivi d'une
NOTE SUR LE PRINCIPE DE LA MOINDRE ACTION CHEZ MAUPERTUIS
*
Tter1t Unh,ersfty Ulrrar, FHtJH10!'.iOUGH. ONT.
AUBIER - MONTAIGNE 13 Quai de Conti - Paris
() 1967 by Editions Aubier-Montaigne, Paris
AVANT-PROPOS Cette étude qui a entraîné son auteur quelque peu en dehors des travaux qu'il poursuit, et du domaine qui lui est familier, n'aurait pas vu le jour sans l'aimable insistance d'un collègue. Issue de réflexions et de conversations décousues, ordonnées d'abord en vue d'un article dont le cadre devint trop étroit, elle aboutit à un livre qui ne reste malgré tout qu'une introduction. Si certaines questions on été approfondies, d'autres (pour ne citer que celle des rapports avec la physique de New ton) n'ont été que succinctement esquissées. Nous nous en exousons auprès du lecteur. Qu'il nous soit permis en même temps de remercier ici MM. THIRY, correspondant de l'Institut, DANJON et FLAMANT, de la Faculté des Sciences de Strasbourg, pour l'aide qu'ils nous ont cordia lement apportée dans l'éclaircissement de certaines difficultés d'ordre scientifique. M. GUEROULT
A VERTISS.EMENT DE LA SECONDE ÉDITION Cette seconde édition est une reproduction photographique du livre paru en 1934, dans la colJection des Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg (Fascioole 68), sous le titre Dyna miqlN et Métaphysique leibniziennes. On y trouvera, jointe en Appen dice, une note (parue en 1935 dans le Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg) sur Catel·an et Conti. Elle vise à dissiper une confusion entre les deux personnages. En substituant au titre primitif ce titre plus simple: Leibniz, /, Dynamiqile et Métaphysique, nous avons voulu indiquer que cette étude pourrait être suivie d'autres portant sur les principes, la notio primitiva simplex, la substance, l'espace et le temps, etc ... En complément de cet ouvrage, nous renvoyons au livre de M. Pierre Costabel sur Leibniz et la Dynamique (Paris, Hermann, 1960). On y verra que notre analyse a été confirmée par la découverte en 1956 de deux écrits leibniziens datant de 1692-1693. Nous renvoyons égale ment au Tome XXI (1944) de l'édition des Œuvres complètes de . Huyghens par la Société néerlandaise des Sciences, où sont examinées (pp. 505-506) certaines de nos çonclusions.
M.G.
CHAPITRE
I.
LA THÈSE DE LEIBNIZ ET LA CRITIQUE CONTEMPORAINE (1).
Caractère unilatéral des interprétations, surtout des interprétations contemporaines. - Liaison intime de la Dynamique et de la Métaphysique selon Leibniz. - Dis sociation de la Dynamique et de la Métaphysique, d'après Cassirer, Hann�quin, Couturat, Russell. - Nécessité d'une recherche préjudicielle sur les premières conceptions physiqu es.
C'est un dogme universellement reçu que celui d� l'éclectisme de Leibniz et de son tempérament conciliateur ; mais c'est une tendance de ses interprètes - surtout les plus récents - de mettre en valeur plutôt les contradictions et les confusions que les harmonies de sa pensée. C'est sans doute la rançon d'une analyse exacte ; mais cette rançon n'est, bien souvent, inéluctable qu'en raison du parti pris de négliger l'aspect synoptique sous lequel Leibniz aperçoit l'ensemble des problèmes, et de la volonté plus ou moins consciente d'accorder a priori une prépondérance marquée à tel ou tel des thèmes nombreux dont l'enchevêtrement constitue l'univers de ses pensées. C'est ainsi que, pour les uns, sa métaphysique sort exclusivement des conceptions dynamiques - c'est la thèse classique - que pour d'autres elle sort, soit tout entière de la logique (2), soit, àvant tout, des recherches mathématiques, soit tout entière des préoccupations (1) Les références à Leibniz: Die Philosophischen Schriften von Gottfried Wil helm Leibniz, 1 vol. éd. Gerhardt, Berlin 1875 sont indiquées par P. (ex. P, III, p. 45); celles à : ùibnizeru mathematische Schriften, 1 vol. éd. Gerhardt, Halle 1860 sont indi qu ées par M. (ex. M, VI, p. 237). (2) RUSSELL, La Philosophie de Leibniz, trad. franç. Pari! 1908. La Logique de Leibniz, Paris 1902.
COUTURAT,
2
CARACTÈRE UNILATÉRAL DES INTERPRÉTATIONS
religieuses ( 1). Outre que ces interprétations unilatérales risquent fort d'altérer les véritables perspectives de la doctrine, elles sont en dés accord avec ce que nous savons de l'activité de Leibniz depuis sa plus extrême jeunesse. Cette activité se révèle, en effet, comme celle d'un génie essentiellement encyclopédique. Il suffit de consulter la liste des premières œuvres pour se convaincre de la diversité originaire des thèmes (logique, mathématique, physique, juridique, moral, reli gieux, théologique, philosophique, etc.), d'analyser ces œuvres pour les retrouver tous en chacune d'elles, mais à des points de vue diffé rents (2). Aussi ces thèmes se développent-ils ensemble, réagissant les uns sur les autres, dans leurs modifications, de façon simultanée, si bien que de la pensée philosophique de Leibniz� on peut dire ce qu'il affirmait de l'univers, que« tout est lié. tout conspire : 7J p.T:'Joccz r.:b,cc ». Or, il n'est point de problème sur lequel se soit plus exercé l'effort de dissociation critique que celui des rapports de la métaphysique et de la dynamique. Bien des philosophes et des savants ont incliné à séparer chez Leibniz le savant et le philosophe, à isoler dynamique et métaphysique. On ne peut donc trouver, en l'espèce, de meilleure occasion pour tenter l'épreuve d'une méthode qui viserait moins à mettre en évidence les contradictions que les harmonies, et pour montrer, à titre d'exemple, que les conciliations leibniziennes, si elles ne vont point sans difficultés ni obscurités, ni même parfois sans inconséquences, ne reposent point sur de simples méprises ou confusions .
•
•
•
La dynamique est-elle une pièce importante du système? L'un et l'autre ctmtrihuent-ils à s'engendrer réciproquement? A cet égard, Leibniz lui-même semble avoir répondu de façon catégorique. En cc qui concerne l'origine des notions, il proclame que les concepts essentiels de force et de masse sont sortis de considérations métaphysiques. « Quoique cet axiome (l'effet entier est équivalent à sa cause pleine) soit tout à fait métaphysique, il ne laisse pas d'être des plus utiles qu'on puisse l'employer en Physique, et il donne moyen de réduire les forces à un calcul de géométrie» (3). Dans une lettre à Arnauld (1 )
BARUZI.
terre, Paris 1907.
( 2 ) W.
( 3) P.
Leibniz. Paris 1909. - Leibniz et l'organisation religieuse de la
KABITZ,
Die Phiwsophie des jungen Leibniz, Heidelberg, 1908.
III, p. 45.
LIAISON DE LA DYNAMIQUE ET DE LA MÉTAPHYSIQUE
3
(4 juillet 1685), il déclare « réduire toute la mécanique à une seule proposition de métaphysique, et avoir plusieurs propositions consi dérables et géométriformes touchant les cam�es et les effets» (1 ). En ce qui concerne les conséquences métaphysiques, il en indique deux très importantes. La dynamique serait la· source des conceptions nouvelles de la substance et de l'harmonie préétablie. Dans le résumé qu'il fait au Landgrave de Hesse, le 11 février 1686, du § XVIII du Discours de Métaphysique, Leibniz estime que « la distinction de la force et de la quantité de mouvement est importante, entre autre pour juger qu'il faut recourir à des considérations métaphysiques séparées de l'étendue, afin d'expliquer les phénomènes des corps»· (2). Dans le De primae philosophiae emendatione et notione substantiae (1694) il déclare : « La notion de force ou de pouvoir que les Allemands appellent« Kraft», et les Français« la force», à l'explication de laquelle j'ai destiné la science particulière de la dynamique, apporte beaucoup de lumière pour comprendre la notion de substance» ( 3). « Tout cela fait connaître, ajoute-t-il en 1691, dans les Acta eruditorum, qu'il y a dans la nature quelque autre chose que ce qui est purement géo métrique, c'est-à-dire que l'étendue et son changement tout nud. Et à le bien considérer, on s'aperçoit qu'il y faut joindre quelque notion supérieure, ou métaphysique, savoir celles de substance, action et force. Cette considération me paraît importante, non seulement pour connaître la nature de la substance étendue, mais aussi pour ne pas mépriser dans la Physique, les principes supérieurs et immatériels au préjudice de la piété» (4). Quant à l'harmonie préétablie« Je n'y serais jamais tombé, écrit Leibniz à Wolff, si je n'avais pas tout d'abord constitué les lois du mouvement qui renversent le système des causes occasionnelles» (5 ). Dans le § 61 de la Théodicée, Leibniz, après avoir rappelé sa loi de la force vive et sa découverte de la conservation de la même quantité de direction, écrit : « Si cette règle av.J.it été connue de M. Descartes, je crois que cela l'aurait mené tout droit à l'hypothèse de ]'harmonie préétablie où ces mêmes règles m'ont mené» ( 6). (1) P. II, p. 62. - Cf. aussi Théodicée § 346. (2) P. II, p. 13. (3) P. IV, p. 469. (4) ibid. p. 465. (5) M. IV (2) p. 51. (6) P. VI, p. 136. Cf. aussi Monadologie § 80; Lettre à Raymond de Montrnord III, p. 645.
4
DISSOCIATION DE
LA DYNAMIQUE ET DE LA MÉTAPHYSIQUE
En dépit de toutes ces affirmations, la thèse de Leibniz a surtout rencontré des détracteurs. Sans doute a-t-elle été admise autrefois par Lasswitz et Boutroux, et plus récemment par Milhaud et surtout par M. A. Rivaud ( 1 ) . Mais M. Cassirer, Hannequin, Couturat, Russell, la repoussent ( 2 ). Tout d'abord, ils nient l'origine métaphysique de la notion de force. Cette notion a une origine à la fois scientifique et logique. Elle se fonde sur l'expérience, sur des travaux de savants, ceux de Galilée, de Huyghens. Sans doute, elle ne résulte pas non plus d'une simple induction expérimentale ; elle est plutôt une règle a priori p our lier les phénomènes entre eux ; elle précède l'expérience plutôt qu'elle ne s'en inspire, et lorsque l'expérience, comme dans le choc inélastique, révèle une perte de force vive, il faut pour conserver le principe faire appel à une hypothèse complémentaire ( celle des mouvements molé culaires) ( 3 ) . Mais ce caractère a priori témoi gn e plutôt de la nature logique de ce principe. Se fondant sur des considérations tirées de l'égalité entre la cause pleine et l'effet entier, il apparaît comme une sorte de corollaire du principe de raison, lequel lui-même est d'essence surtout logique. Dans les textes précédemment cités, le mot « méta physique » ne peut donc signifier autre chose que « logi qu e et a priori » ( 4 ) ; aussi voyons-nous Leibniz critiquer Descartes pour avoir voulu fonder la vérité de son principe sur une considération proprement métaphy sique, celle de l'immutabilité de Dieu ( 5 ) . ( 1 ) LASSWITZ, Geschichte der Atomistik ( Hambourg 1890). E. BOUTROUX, préface
aux éditions de la Monadologie et des Nouveaux Essaü. G. MILHAUD, Leibniz et les Lo� du mouvement (Nouv. Etudes, 191 1 ), p. 1 97 sq. A.. RIVAUD, Textes inédits de Leibniz publiés par M. Ivan Jagodzinsky, Revue de Métaphysique et de Morale, 1 9 1 4, p. 94-1 20, en part. p. I l 9, ( 2) CASSIRER, Leibniz System in seinen wissenschafdichen Grundlagen (Mar burg 1902), p. SI 7 sq. M. Cassirer ne nie pas le rapport entre les lois du mouvement et certaines thèses métaphysi ques, op. cil. , p. 529, mais il réduit à rien l'influence de la notion de force en physique sur les notions métaphysiqu es de monade et de tmbstance. COUTURAT, Sur la métaphysique de Leibniz ( Revue de Métaphysique 1 902), p. 17 sq. - Le système de Leibniz d'après M. Cassirer (Ibid. année 1 903), p. 89 sq. HANNEQUIN, La première philosophie de Leibniz, dans Etudes d'histoire de la Philo sophie, II, p. 212 sq. - RUSSELL, op . citat. , p. 84 sq. ( 3) Cf. se écrit à Clarke, § 99, P, VI, p. 414. - Cf. COUTURAT, op. citat. 1903, p. 89. (') COUTURAT, op. citat. 1 902, p. 19 sq. (1) Animadversiones in partem generalem II • , pars., art. 36, P, IV, p. 370.
5
DISSOCIATION DE LA DYNAMIQl_jE ET DE LA PllYSJ Qt· E
De plus, envisagée en elle-même, la notion de force n'a rien de métaphysique le mot force nous renvoie à une formule mathématique, mv2, où n'interviennent que des quantités. Il désigne, non quelque entité psychique, mais les forces viVP,S qui concernent uniquement les phénomènes, les forces dérivatives (1 ), et n'appartiennent pas au même monde que les forces primitives, entéléchies ou substances. Enfin, la nouvelle dynamique leibnizienne est tout aussi dépouillée de qualité occulte que le mécanisme cartésien. Elle est même plus déterministe que lui. Elle ne le corrige que pour mieux appliquer son principe, qui consiste à expliquer tous les phénomènes par des chocs ou contacts, sans faire intervenir ce que nous appelons auj ourd'hui , P . VII, p. 260. Tout corps et t donc mouvement, et Leibniz le prouvera d'une autre .façon, quelques années plus tard, en démontrant qu'il ne peut exister d'indivisibles, et qu'un corps immobile impliqu erait des indivisibles : ( Manuscrits de Hanovre, Abt 37, vol. III, fol. 45, recto) ; - cifé par R1vAUD, art. cit. p . I I S, note 5. - Etre en un lieu, c'est par conséquent traverser ce lieu : t E,se in loco est per locum transire •>, Cf. JAGODZINSKY, Leibnitiana . . . , p. 1 6, cité par R1vAUD, Ibid. , p. 1 0 1 . - Sur l'exclusion du repos, Ibid. , p. l l 6.
12
LA THEORIA l\lOTUS CONCRET!
dans le mouvement. « Si corpus motum impingat in quiescens, totum perforabit sine ulla refractione, etsi impi ngens arenacci grani magni tudine, reâpiens mille leucarum crassitie esset» (1 ). La cohésion d'un corps provient du mouvement interne par lequel les parties intégrantes opposent leur conatus et se pressent les unes contre les autres par une action contraire, et de la pénétration commençante qui résulte de cette pression (2). Explication qui offre, comme on ra fait remarquer, bien des difficultés. Comment, en effet, une telle cohésion pourrait-elle durer plus d'un instant, puisque deux conatus égaux, de sens opposé, doivent s'annuler dans leurs effets, et comment la même partie pour rait-elle faire effort dans tous les sens à la fois, de façon à être en cohésion avec toutes les parties qui l'entourent ? (3 ) Quoi qu'il en soit, si cette explication suffit pour rendre compte de l'impénétrabilité qui est une p1·emière forme de résistance au mou vement, elle ne saurait rendre compte de l'inertie naturelle, ou paresse des corps, ou masse, seconde forme de ce tte résistance, en vertu de laquelle comme l'expérience nous l'enseigne, un corps plus grand résiste à une même impulsion, plus qu'un corps plus petit, et en pro portion de sa grandeur ( 4). Il y a donc opposition entre les lois de la physique abstraite et celles de la physique concrète. Il est impossible, semble-t-il, comme on le postulait tout d'abord, de passer du mouvement abstrait au mouvement concret. Le détail des différentes lois du mouvement abstrait le prouverait également. En particulier, les faits de l'acoustique, de l'optique, n'existent que parce que l'expérience dément l'inégalité de l'angle d'incidence et de l'angle de réflexion, sauf dans le cas de l'incidence à 30°, inégalité affirmée par la théorie du mouvement abstrait ( 5 ) . La Theoria motus concreti va essayer de venir à bout de cette opposition. Pour passer des lois abstraites au monde concret, il faut ( 1 ) P. IV, p. 1 88 . HANNEQUIN, Ibid., p. 1 4 2 . Ces vues étaient déj à indiquées dès . 1 669 par Le!bniz, dans l'opuscule qu' il remet à Eric Maurice, et où il réfute les traités d e Wren et de Huyghens parus an térieurement. Cf. M. I, p. 44. - KABITZ, op. cit., p. 1 35 sq. (2 ) P, IV, Theoria, §§ 1 5- 1 6, p. 230. - A HOBBES, 12 juillet 1 670, P. I, p. 84. A ARNAU LD, I, p . 7 2 . - HANN EQUIN, Ibid. , p. 1 00-1 01 . ( 3 ) HANN EQUIN, Ibid., p . 1 0 2 . ( ') P . I V , p . 1 9 1 , § 2 2 . (6 ) P . IV, p . 1 87- 1 90.
LA THEORIA M OTUS CONCRET!
13
supposer une intervention d e la sagesse d e Dieu, qui crée dans l e monde une économie telle que les effets prochains des lois abstraites se trouvent modifiés par leurs effets éloignés, si bien qu'il en résulte des effets réels entièrement différents, qui sont les phénomènes sensibles. Ces effets réels sont liés à l'intervention de certains facteurs : masse, élasticité, pesanttur, mouve ments sympathiques (aimantation) et antipathiques (réactions chimiques) . Ainsi, pour expliquer qu'en fait l'angle d'inci dence est touj ours égal à l'angle de réflexion, il faudra considérer que les corps ne sont plus seulement dé finis par les limites immuables de leur figure géométrique, mais sont capables de reprendre entièrement leur forme, après l'avoir provisoirement laissé altérer, bref qu'ils possèdent l'élasticité. Pour expliquer que le conatus du corps choqué ne se propage pas intégralement au corps choquant, quelle que soit la grandeur de celui-ci, il faudra admettre que chaque corps possède une paresse naturelle proportionnelle à sa quantité de matière, bref une masse ( 1 ) . Mais ces facteurs devront se résoudre en notions intelli gih1es pour la théorie du mouvement abstrait. En conséquence, on observera que si le corps choqué n'est pas un seul co'rps continu pos sédant son conatus propre, mais une file de corps discontinus possédant chacun leur conatus, la soustraction se reproduira avec chaque élément de la file, si bien que la vitesse communiquée en fin de compte au bout de la file, dépendra du nombre des éléments constituants, c'est à-dire de la grandeur du corps. Ainsi il faudra substituer le discontinu au plein pour retrouver les lois de la physique concrète. L'apparition de la masse s'expliquera donc par la division du plein primitif en éléments réellement séparés par des intervalles qui ne sauraient être vides, mais remplis d'une matière plus subtile (2) . Pour dériver des lois du mouvement abstrait celles du monde concret, il faudra alors nous représenter par l'imagination le procédé que Dieu, dans sa sagesse, a pu employer pour différencier progres sivement l'homogène physiquement indifférencié, instituant de la sorte à p artir des lois abstraites, les facteurs déterminants des phéno mènes concrets ( 3) . Cette hypothèse sur les origines aidera notre ima gination à découvrir les causes des phénomènes actuels, car ce qui ( 1 ) P . IV, p. 1 8 3 , 1 87- 1 88 ; 202, 2 1 6 . ( 2 ) Ibid. , p. 1 9 1 ; 234. - HANN.EQUIN, p . 1 04- 1 08 . - Leibniz hésite encore toutefois vers 167 1 à exclure définitivement la possibilité du vide. Cf. A. RIVAUD, art. cit. , p. 1 1 3 . (3) P. IV, p . 1 83, 1 8 8 ; 2 1 9, 2 4 8 , 257 .
14
LA TBEORIA MOTUS CONCRET!
se passe actuellement n'est que la continuation de l'origine ou un perpétuel commencement (1) . Cette hypothèse est celle d e l'éther dont l'existence est attestée par la transmission de la lumière. Lorsque Dieu a voulu organiser l'économie de ce monde visible, il a créé en lui une différenciation primitive qui rendait possible la lumière, et il a fait surgir un corps émetteur : le soleil, un corps récepteur : la terre, un milieu transmetteur : l'éther. Soleil et terre sont animés d'un mouvement de rotation autour de leur axe, mouvement qui conditionne leur cohésion et qui les dif férencie de l'espace homogène. L'éther transmet dans tous les sens, à partir du soleil, les rayons lumineux émis par celui-ci ; les rayons ou particules d'éther frappent la terre avec une vitesse prodigieuse. Ils la pénètrent par les endroits où s� cohésion est minima, c'est-à-dire dans l'intervalle de ses cercles parallèles et la différencient progres sivement, donnant naissance à la terre proprement dite, à l'eau et à l'air, éléments eux-mêmes différenciés en bulles constituées de b ulles plus petites à l'infini. Bien que la terre tourne réellement dans l'éther immobile, tout se passe comme si, la terre étant immobile, l'éther tournait autour d'elle dans une direction contraire à la sienne. Les matières hétérogènes de la terre (eau, air, terre) gênent la circulation de l'éther, qui d'ailleurs pénètre partout. Alors, ou bien l'éther les rejette vers le centre de la terre : c'est la pesanteur ; ou bien, il sépare les parties qui le gênent en les faisant tendre vers une subtilité égale à la sienne : c'est l'élasticité. La circulation de l'éther confère donc à tous les corps la capacité de reprendre leur forme lorsqu'ils ont été comprimés, comme d'ailleurs lorsqu'ils ont été dilatés, car la dila tation de l'un est la compression de l'autre. Ainsi la pesanteur est imposée aux corps très-cohérents, et l'élasticité aux corps moins co hérents. Mais, de même qu'il n'y a pas de corps qui ne soient en quelque mesure pesants, car ils ont des parties physiquement inséparables (par ex. l'air), de même il n'y a pas de corps qui ne soient en quelque sorte élastiques, bien que cette élasticité ne puisse pas touj o urs triompher de la cohésion des éléments. Enfin Leibniz explique de la mêmé façon les phénomènes d'aimantation et les phénomènes chimiques, les pre miers, comme la pesanteur, par la dépression des corps dont la cohésion ( 1 ) , - Cf. HANNE• Q UIN, op. r.it. , p. 1 56- 1 60 ; 1 92 - 1 96 ; 2 1 5 sq. (2) Cf. A. RivAUD, art. cit., p . 1 00- 1 0 1 ; 1 03 ; 1 1 2 ; 1 16- 1 1 7 .
1H
INSUFFISANCE A U POINT D E VUE MÉTAPHYSIQUE
et plus complète, capable de rendre à la science son autonomie, de satisfaire à ce besoin, éprouvé par tout esprit versé à la fois dans la philosophie et les mathématiques, d'une conservation de quelque chose d'absolu (1) . Et il semble bien que cet achèvement de la science, et que ce progrès de son autonomie devrait avoir pour résultat de la détacher de la métaphysique en rendant inutile l'intervention à l'intérieur de la physique des principes d'harmonie. Mais on doit se demander s'il n'y a pas d'autre mode d'unir la science et la métaphysique, qu'une confusion entre les deux, si l'har monie ne peut pas fonder l'univers leibnizien autrement qu'en vertu d'une infirmité de la physique, et surtout si la métaphysique, souffrant elle-même de cette confusion, n'aspirait pas pour sa part à s'en libérer. Dans ce cas, l'effort d� la pensée scientifique, se trouverait naturelle ment conjugué, chez Leibniz, avec un effort« conspirant» de la pensée métaphysique. Or, il est évident que les thèses de l'Ilypothesis physica nova soulevaient autant de difficultés en matière purement philoso phique qu'en matière scientifique. C'est un dogme métaphysique, professé particulièrement par tous les Cartésiens, que tout ce qu'il y a de positif dans la nature ne peut jamais s'annuler ni s'entre-détruire, mais seulement s'unir et s'ajouter pour consti tuer finalement par son ensemble la souveraine .réalité de !'Etre infini. Un véritable accord entre la métaphysique et la science des phénomènes ne peut s'établir que si toutes les oppositions réelles qui nous sont présentées par la réalité sensible, sont finalement réduites à des illusions. C'est une voie inverse que suit ]a première physique leihnizienne : elle multiplie les oppositions réelles ; elle ne peut expliquer le sensible qu'en concevant la résistance de la masse comme l'opposition réelle des éléments également affirmatifs, mais de Eigne contraire. De plus, comme la thèse de l'indestructibilité essentielle des éléments affirmatifs ne pouvait pas être abandonnée (2), ;1 en résultait maintes obscurités dans le détail de la théorie. Le concept de la conservation des conatus, uni à celui de la sommation algéprique de leurs effets, ( 1 ) M. V I , p. 2 1 6 . ( 2) « Conatus scilicet nullos perire, sed omnes in universum esse efficaces, per petuosque etsi aliis conatihus super additis mixtis non sentiantur ». Manuscrits de Hanovre, Aht . 37, vol. IV, f. 45-46 ; - cité par A . RivAUD, art . cit. , 'p . 1 1 7, note 3. - >, Manuscrits de Hanovre, 37 ( Physik), Vol. V, p. 2 2 2 recto, cité par A. RivAUD, art. cit . , p. 1 1 3, note S .
DEUX VOIES POU R S ORTIR DE LA DIFFICULTÉ
19
et à la destruction réciproque d e ceux-ci, conféra it à l'élément positif un double rôle contradictoire et inexplicable . D'un côté on ne pouvait l'opposer, Ùans une opposition réelle capable de le détruire, à un autre positif ; d'un autre côté on devait reconnaître une telle oppo sition lorsqu'on envisage les effets. Mais cette distinction entre l'élément proprement dit et son effet est extrêmement précaire et arti ficielle. C'est par une pure fiction que l'on maintient, même au premier instant, dans tel mobile choqué les deux cona:us opposés d'où sort le mouvement actuel (1). Si ce mobile choqué ·choque à son tour un autre corps im mobile, il ne lui communique pas ces deux conatus compensés, mais un conatus différent qui est l'élément de sa vitesse actuelle. On doit donc reconnaître la destruction réciproque des éléments positifs. La conservation des conatus n'a par conséquent lieu que dans l'esprit, mais alors l'élément du mouvement cesse de lui être purement et simplement homogène : la disparité en.tre la cause (esprit) et l'effet (mouvement des corps) conduit à placer la cause dans une sphère distincte, sans que l'inadéquation soit par là supprimée entre la cause pleine (l'esprit où tout se conserve) et l'effet entier (le mouvement univer sel qui progressivement diminue et s'annihile) . Il faut donc se contenter d'une affirmation compensatrice : on dit que la cause (l'esprit) restaure et maintient dans l'effet la pl�nitude originaire ; et si nou s comprenons que l'esprit (qui rend possible le mouvement en enveloppant le passé et l'avenir de sa traj ectoire) doit évidemment le conserver comme il se conserve lui-même, le comment de cette conservation, c'est-à-dire l'explication physique, nous fait défaut. L'intervention de la métaphysique est donc bien le corrélatif d'un défaut de la physique, mais n'en repose pas moins sur une contra diction fondamentale entre le postulat de la physique et celui de la métaphysique. L'une et l'autre, loin d'en retirer une con firmation réciproque, ne font que souffrir d'un inconvénient commun. Une théorie scientifique qui ne heurterait plus de front le dogme de l'in destructibilité du positif et de l'inexistence des oppositions réelles n'aurait sans doute plus besoin du secours de la métaphysique pour maintenir ce qu'elle est incapable de conserver, mais en retour la méta physique pourrait recevoir d'elle, non plus un démenti, mais un appui d'autant plus solide qu'il serait fourni par une science autonome. Le progrès de l a physique apparaîtra alors non plus comme une satis(1)
Phoranomus,
Archiv I, p. 578-579.
20
RAISONS MÉTAPHYSIQUES D U PARTI ADOPTÉ
faction donnée aux seules exigences de la pensée scienti fique, ma1!- aussi aux besoins non moins légitimes de la pensée philosophi que : « Par là, dira Leibniz plus tard, il sera satisfait en même temps à la rigueur des mathématiques et au souhait des philosophes » (1). Pour rétablir l'unité, deux voies restaient possibles. On pouvait, en reconnaissant définitivement la réalité des oppositions réelles révélées par le monde sensible, faire régner celles-ci partout et les introduire jusque dans la métaphysique. C'est l'essai auquel Kant procédera « d'introduire les quantités négatives en philosophie » (2 ) . Il comportait un bouleversement fondamental de toutes les vues métaphysiques acceptées jusqu'alors. On pouvait, au contraire, se fonder sur la pensée purement rationaliste, et en partant de la métaphysique, refouler hors du sensible, hors de la physique elle-même, l'opposition réelle. C'est cette voie que Leibniz devait suivre dans sa seconde physique, et il est difficile de concevoir que des considérations exclusivement scienti fiques l'y aient poussé. (1) M . V I , p. :! 2 8 . ( 2) KANT, Versuch, den Begriff der ncgativen Gros.i.en in die Weltu;eisheit ein zuführen, Konig sberg 1 76 3 .
CHAPITR E
I II.
LA DYNAMIQUE : LA MÉTHODE A POSTERIORI (PAR LES FORCES VIVES).
Passage aux nouvelles théories de la dynamique. - Le Phorarwmus. - Réfutation simultanée de Descartes et de la Physique abstraite . - Les deux méthodes de démonstration. - La méthode a posteriori et les forces vives. - Le conatus et l'impetus . - Difficultés posées par la notion leibnizienne d'impetus . - Formule mathématique et élément > de la force (vive). - L'idée de l'intervention de la sagesse divine n'est pas dans la pensée de Leibniz une simple survivance de doctrines périmée�.. - Les quatre principes de conservation et leur liaison systématique.
Le voyage à Paris, l'initiation approfondie aux mathématiques supérieures ( 1 ), aux théories de Descartes, de Galilée, la découverte du calcul infinitésimal, les relations avec Huyghens, Arnauld, Malebranche, etc., sont des événements décisifs pour l'évolution de la pensée leib nizienne. Une nouvelle physique s'établit sur les ruines de l'ancienne. Elle renie le princi pe cartésien de la conservation de la même quantité de mouvement. Il est qifficile d'indiquer la date précise de ces inno vations. M ais si l'on se réfère à une lettre à Oldenburg, du 2 7 aoû t 1 676, elles semblent devoir être acquises dès cette époque ( 2 ) . ( 1 ) Sur ce que Leibniz avait appris d e Weigel avant son départ pfJ'Ur Paris, cf. KABITZ, op. cit, p. 9 sq. (2) Il déclare >. M . I. p. 1 86. - En janvier 1 680, il écrit à Filippi : (( La physique de M. Des cartes a un grand défaut, c'est que ses règles du mouvement, ou lois de la nature, qui dojvent servir de fondement, sont pour la plupart fausses. Il y en a démonstration.
22
PASSAGES AUX NOU VELLES THÉORIE S
Toutefois il n'y aura pas de texte capital avant 1686 (1). On a beaucoup discuté sur les facteurs de cette transformation . Leibniz lui-même a invoqué l'expérience : « Ayant tâché d'approfondir Et que son grand principe que la même quantité de mouvement se conserve dans le monde est une erreur. Ce que je dis icy est reconnu des plus habiles gens de France et d'Angleterre », (P. IV p. 286).En revanche le Pacidius Philaleihi de 1 676 ne laisse pas encore transparaître les thèses fondamentales de la physique nouvelle. (1) Les textes principaux sont les suivants. 1 ) Dans les lettres à Malebranche : de 1 674 à 1679, Leibniz combat la thèse cartésienne que l'étendue constitue la seule et totale essence des corps (P. I, p . 32 1 ), mais il n'expose pas lui même ses thèses à ce sujet ; en 1679, l'attaque se fait moins mesurée et plus générale : P. IV, p. 3 50 sq. ; la dernière série de lettres à Malebranche ( 1 692- 171 1), les deux premières lettres sont intéressantes, car elles se rattachent à la polémique qui devait conduire Malebranche encore Cartésien en 1 692 ( d ans le Traité des lois de la communication des mouvements) à adopter les thèses leibniziennes (deuxième édition de 1 698), P. I, p. 343-3 52. - 8) En 1 695, le Specimen Dynamicum, résumé clair de la Dynamica de Potentia non parue ; le Système nouveau de la nature et de la grâce, - 9) En 1698, De lipsa natura sive de vi insita actionibusque Creaturarum, pro Dynamicis suis confirmandis illustrandisque, (P. IV, p. 504), dirigé contre Sturm et les Malebranchistes ; en 1 698- 1 699, Lenres à De Volder, professeur de Physiqu e à Leydes (P. Il, p. 148 sq.) ; après 1704, Lettres de Leibniz et de Wolff. (M . IV, 2, p. 1 - 188). (a) masse étendue = extension + impénétrabilité. (b) force = force passive, ou masse, au sens nouveau. ( 1) Système nouveau ( 1 695) §2. ( 2) FOUCHER de CAREIL, Refutation inédite de Spinoza, p. LXIV. - STEIN, Leibniz und Spinoza p. 5 4 . Leibniz a d'ailleurs moins fait lui-même des expériences qu 'il n'a
24
LE PHORANOMUS
est suggérée par la conscience des difficultés de ses propres conceptions physiques. Dans un texte assez tardif, le Phoranomus (1) Leibniz nous explique que c'est bien là la raison essentielle de son changement. « Lorsque j e ne reconnaissais, écrit-il, que la jurisdictio imaginationis à l'égard des choses matérielles, je pensais qu'on ne pouvait point admettre dans les corps d'inertie naturelle, et que dans le vide ou sur un champ libre, un corps en repos devait recevoir la vitesse de n'importe quel autre corps, si petit qu'il fût. Ne reconnaissant rien d'autre dans la matière que l'extension et l'impé.nétrabilité, en d'autres termes que l'impletio spatii, ne comprenant rien d'autre dans le mouve ment que la mutatio spatii, je voyais qu'entre un corps immobile et un corps en mouvement, la différence à chaque moment consistait en ce que le corps en mouvement possède un certain conatus ou ten dance (pour employer l'expression d'Erhardt Weigel) c'est - à - dire de commencement de parcours (initium pergendi), bien que parfois, par recueilli les expenences d'autrui, en particulier de HUYGHENS, dont il accepte telles quelles toutes les formules. - En ce qui concerne SPINOZA, les paroles de Leibniz prouvent que son argumentation, plus métaphysique, l'emporta chez son interlocuteur sur les démonstrations expérimentales de Huyghens dans son traité du De moiu, dont Spinoza connaissait , dès 1 665, le contenu. Spinoza écrit en effet à Oldenburg, le 20 nov. 1 665 : (( Pour ce que vous m'écrivez encore au sujet des règles du mouve ment posées par Descartes, que j 'aurais donné à entendre qui seraient fausses, c'est, si mes souvenirs ne me trompent pas, l'opinion de M. Huyghens que j 'ai rapportée et je n'ai moi-même, affirmé la fausseté d'aucune de ces règles de Descartes, sauf la sixième, à l'égard de laquelle j 'ai dit que M. Huyghens, lui aussi, comme Descartes, avait commis une erreur 1► (Lettre XXXII, éd. Van Vloten et Land, 1895, Il, p. 3 1 1). Sur la connaissance du contenu du futur traité de Huyghens : De moiu corporum ex percussione . . . cf. Lettre XXXI et X XXIII de Oldenburg , p. 304, 3 1 3 . - Stein (op. citat), p. 7 2 , pense que sur ce point c'est plutôt Leibniz qui a été influencé par Spinoza. Au cours d'un bref passage à _ Amsterdam, en 1 675, Leibniz aurait pris con naissance lors d'une visite chez Tschirnhaus, de la correspondance échangée entre celui-ci et Spinoza ; or à cette époque Spinoza rejetait la doctrine cartésienne de la matière, et semble-t-il aussi celle du mouvement (Ibid., p. 66 et 73) . Les conclusions de Stein semblent assez peu solidement établies. Leibniz en effet rej etait la théorie de la matière étendue dès 1672 (cf. Lettre à Arnaud). D'autre part l'application du principe de l'égalité de la cause pleine avec l'effet entier, conçu comme I I I, § 59. On trouve l'examen d'un cas analogue dans les manuscrits de Huyghens, préparant le Traité De vi centrifuga, année 1 659, Œuvres XVI, p. 306. Toutes ces applications du calcul in finitésimal aux notions de conatus et d'impetus uçoivent l'approbation de Bernoulli ; Cf. Lettre de juin 1 695. ( Commercium, XI, p. 62-63 ; M. I I I [l] p. 1881 -89). Rappelons que le Specimen dynamicum a été publié dan,; les A cta d'avril 1 695.
LE CONATUS ET L'IMPETUS
37
quelque temps, ou par un arc se débandant, ou par toute autre cause, la force est vive et naît d'une in finité d'impressiom . continufes de la force morte (1 ) • En réalité, la détermination exacte du rapport qui relie le con ntus à l'impetus pose un certain nombre de problèmes. On en peut distinguer trois.
1 ° L'impetus est quantité de la motio ou quantité > Lettre au marquis de l'Hosp ital 1: /12 1696. M . II, p. 3 19. (') . Dynamica de Potentia, M . VI, p. 398. (11 ) Essai de Dynamique, M. VI, p. 2 18.
LE CONATUS ET L'IMPETUS
41
Leibniz déclare dans d'autres passages :« Toutefois, bien que l'impetus soit toujours joint à la force vive, les deux diffèrent entre eux» ( 1 ) . D'une part l' impetus par sa formule ,nv s e rapporte à la force morte, il est propriété du conatus, il exprime sa quantité ; d'autre part il est propriété de la force vive, il lui est toujours joint, car il exprim e l'élan qui la caractérise, mais il 11e s'identifie pourt ant p a s avec elle. Il réapparaît donc bien comme intermédiaire entre la force morte et la force vive : résultats de l'intégrale des forces morte.-, , les impetus engendrent à leur tour, par leur sommation, les forces vives. M a i s quelle est l a nature de cet intermédiaire ? Comment u n élément dont la formule mathématique est . mv peut-il représent�r, au point de se substituer à lui, un élément dont ]a formule est mv 2 ? C'est que l'im petus peut être considéré à deux points de vue : A ) en lui-même dans l'instant où il se produit, abstraction faite de la force vive dont il est l'effet. Il est, dans cet instant, la translation d'une certaine masse, le long d'un certain chemin, sa formule e::it bien mv, puisqu'il s'agit, dans cet instant considéré isolément, d'un mouvement uniforme sans accélération, tt l'espace parcouru est exac tement proportionnel à la vitesse. Le cas est comparable à celui de la force morte, puisque celle-ci se réfère à un moment infinitésimal du mouvement, considéré en dehors de toute succession temporelle, indépendamment de tout processus d'accumulation. Il est donc naturel que la même formule mv vaille pour l'un et pour l'autre. B) Mais il y a une différence pourtant, c'est que l'instant considéré dans le cas de la force morte étant en quelque sorte originaire, la quantité de vitesse est de ce fait simplement embryonnée (mrdt), tandis qu'avec l'impetus, l'instant, tout en étant considéré isolément, porte néanmoins en lui le résultat d'une accumulation antérieure de moments ; aussi la vitesse est-elle réelle, un espace est-il effectivement parcouru (mTt ou mv). Ce parcours effectif implique donc la présence d'une force vive ; ce résultat dans l'instant actuel a été possible non seulement par une accumulation de forces mortes (conatus), mais par une som mation concomitante d'impetus, chacun des conatus sommés ayant acquis au moment où ;il intervenait une quantité (ou impetus) corres pondant au nombre de conatus intégrés dans cette quantité. L'impetus a donc comme deux faces différentes : une face externe où il est saisi in abstracto, dans l'instant isolé et où il s'oppose ( 1) Spec.
Dyn., M. VI, p . 238.
42
LE CONATUS ET L'IMPETUS
à la force vive pour se rapprocher de la force morte par sa formule mv ; une face interne où il se réfère à sa cause, où l'instant qu'il repré sente n'est plus envisagé de façon isolée, mais rattaché à sa genèse et comme résultat d'une multitude d'instants antérieurs qu'il enveloppe et qui lui confèrent sa marque propre. Il apparaît alors comme lié étroitement à la force vive et opposé à la force morte, comme pouvant représenter adéquatement la première et lui être substitué, car il naît et meurt en même temps qu'elle. Aussi, ce qui détruit entièrement l'impetus� est-il ce qui consume la force vive et la mesure, à savoir un travail (1, prop. 1 35) ; ce sera la deuxième hypothèse, acceptée sans démonstration par Huyghens dans son De motu. - Il pul,lie encore à Lyon en 1649 une Physica seu Scientia rerum corporearum, et en 1669 des Dialogi physici. Huyghens le cite à plu11ieurs reprises, lui aussi, comme un de ses précurseurs (cf. édition complète de la Société Néerlandaise, XVI, p. 179, 182, 203).
MATHÉMATICIENS ET PHYSICIENS DE L'ÉPOQUE
une importante correspondance, Marcus Marci (1),
57
J. A. Borelli (2 ),
( 1 ) Johannes Marcus MA RCI de Kronland ( 1 595- 1 667) ( M . V I , 239 etc .), médecin, linguiste, astronome, ast rologue, mathématicien, physicien, professeur de mathé matiques à Prague à partir de 1620 ; puis, Recteur de l'Université, médecin personnel de l'Empereur Ferdinand III depuis 1658, cornes palatinus, ordonné Jésuite quelques jours avant sa mort. Il publie : Jdearum operat, icium IJea ( 1 63 S) ; De proportione motus seu regula sphygmica (1639) ; Obstrvationes Exactico- Philosophfrae (1647) ; De pro portione motus figurarum (1648) ; Thaumantios ( 1 648) ; Dissertatio physica curiosa in propositiones mathematicas de natura lridis ( 1 650) ; De longitudine invenienda ( 1 650) ; Labyrinthus, seu via ad circuli quadraturam (1654). Il s'essaye dan s son De proportione motus de 1 639 à formuler les lois du choc en s'inspirant av ant tout de l'expérience, à l'exclmion de toute démonstratior, rationn elle. II tombe ainsi dans une série d'erreurs relevées par Huyghens (op. cit. XVI, manuscrit de 1654, p. 100, et 1, p. 260, 263, 290 ; 307-308). ( 2) J . Alphonse BoRELLI (M. VI, 1 1 9, 240 et c.) ( 1 608 -167 9), professeur de mathématiques à Pise, puis à Naples. Dans son >, Bologne 1 647, i) donne des règles du choc direct des corps durs, critiquées par Huyghens, qui le ci te n éanmoins comme précurseur ( Ibid. , XVI, p. 203). Huyghens le èombat aussi dans son affirmation d'un mouvement absolu opposé au mouvement relatif : , Paris, in -4° (Critiqué par Huyghens, Lettre à Fr. Van Schoot en , 1 /7 , 1654, I, p. 287). Célèbre par son traité post hume, cité par Leibniz (M. VI, p. 194) et par d'Alembert (Encyclopédie, art . Bombe) : > (Amsterdam, 1690). ( 4 ) M. VI, p. 80, 1 94- 197, 204- 2 1 5 etc . Tous ces savants ou philosophes sont bien connus. - Wren et Wallis ont communi qu é leurs lois du choc en 1 668 à la Royal Society, en même temps que Huyghens. Les lois de Wren sont identiques à celles de Huyghens ; celles de Wal lis énoncent la théorie moderne du choc des corps mous (H. XVI , p. 1 78). - Papin et Catclan (ou abbé de Conti) furent contre Huyghens et Leibniz Ifs défenseurs les plus étroits du point de vue des Cartésiens. Quant à Mariotte, il n'est cité par Leibniz qu'en raison de son ouvrage : , ( 2) . Leibniz ne fait que reprendre ce procédé de mesure ( ) , Huyghens. Mariotte admet un mouvement absolu et distingue la > de
la (( vitesse propre >> (éd. 1 673, I, p. 2). Huyghens le cite et le combat sur ce point (XVI, p. 209 et 226). Pour le reste, . A de Volder, P. Il, p. 1 56- 1 5 7. ( 2 ) LEIBNJZ, Speci� n Dynamicum, M. VI, p. 243-244. - A de Volder, P. II, p. 1 57. (3 ) Brevis Demonstratio, M . VI, p . 1 1 8. (') Galileo GALILEI, Dialoghi delle nuove scienze, Giomata terza (Op ere, } ma edizione comp]eta , Firenze 1 855) XIII, p . 1 6.4 sq. - Cf. JouGUET, Lectures de Mé canique, I, p. 98.
�INFLUENCE DE DESCARTES
63
la vitesse des corps qu'elle fait descendre presque en même raison que les temps pendant lesquels ils descendent et que le chemin qu'ils font est presque en raison double du temps? (1 ) Il aurait eu fort peu à faire, semble-t-il, pour découvrir la vraie nature de l'énergie, si guidé par une certaine répulsion pour l'élément dynamique qui est, selon lui, obscur et confus, il n'avait pas été conduit, à l'inverse de Galilée et de Leibniz, à considérer le mouvement uniforme, la statique, com me l'essentiel, et le mouvement accéléré comme l'accidentel, ou le sub sidiaire. Descartes avait même énoncé le premier cette distinction expli cite du travail et de la quantité de mouvement dont LeiLniz croit être l'auteur. Toute la réfutation leibnizienne de l'erreur mémorable consiste à dénoncer une confusion entre le travail et la quantité de mouvement, entre le produit du poids par le chemin et celui du poids par la vitesse. Mais, comme l'ont fait 1·emarquer les critiques (2), Des cartes n'a jamais lui-même commis une telle confusion. Con trairement à Galilée, qui était à cet égard Péripatéticien, il s'était refusé à con sidérer le facteur vitesse, dans la détermination de la force. Il dis tingue en effet la force à une dimension, = P (celle qui soutient le poids) et la force à deux dimensions ( celle qui fo soulève) qui est produit du poids par l'espace parcouru, = P X S, et est à la première comme la superficie est à la ligne : « Que si j'avais voulu joindre la considération de la vitesse avec celle de l'espace, il m'eut été néces saire d'attribuer trois dimensions à la force, au lieu que je lui en ai attribué seulement deux afin de l'exclure ». (3) Cette exclusion lui vaut les critiques des partisans de Galilée, groupés autour de Mer senne. De plus, il marque, infiniment mieux que ne le fera Leibniz, l'im possibilité de déterminer immédiatement la quantité de variation de la force, en fonction de la variation de la vitesse :« Pour ceux qui disent que je devais considérer la vitesse, comme Galilée, plutôt que l'espace, ,
(1) A Mersenne, 1 8 février 1 6 43, A. T. III, p. 6 1 9 . Descartes revenait ainsi sur ce qu'il avait écrit au même Mersenne en 1 629, A. T. 1, p. 7 1 -75. (2) DüHRING, Prinzipien der Mechanik (1 877), p. 98, 226. - LASSWITZ, Ge schichte der A tomistik, II (1 890), p. 1 07. - ADAM, Vie de Descartes, A . T. XII, p. 254 sq. - WAHL, De l'idée d'instant chez Descartes ( 1 920). p. 41 . - MILHAUD, De.,cartes Savant (Paris 1 92 1 ), p . 1 80- 1 8 1 . - DU HEM, Les Origines de la Statique I, p. 343 sq. - CARTERON, La Force mécanique chez Descartes, Revue Phi losophique 1 922. p. 260 et 490. - Mou v, Les Lois du choc des corps selon Malebranche ( 1 927), p. 18 sq. ( 3 ) A. T. II, p. 352 .
64
�INFLUENCE DE DESCARTES
pour rendre raison des machines, je croy, entre nous que ce sont des gens qui n'en parlent que par fantaisie, sans entendre rien en cette matière. Et bien qu'il soit évident qu'il faut plus de force pour lever un corps fort vite que pour le lever fort lentement, c'est toutefois une pure imagination de dire que la force doit être justement double pour doubler la vitesse, et il est fort aisé de prouver le contraire ... » (1 ) En effet, qu'on mette dans une balance en éqw.li.bre le poids minimum capable de la faire trébucher, elle trébuchera fort lentement ; qu'on double ce poids, elle trébuchera bien plus de deux fois aussi vite (2). Ainsi dans l'équilibre d'un levier ou d'une balance dont l'un des bras de longueur 1 supporte un poids moitié moindre que celui supporté par l'autre bras de longueur 2, « ce n'est point la différence de la vi tesse (3) qui fait que ces poids doivent être l'un double de l'autre, mais la différence de l'espace, comme il paraît de ce que pour lever par exemple, le poids F avec la main j usqu'en G, il n'y faut pas em ployer une force qui soit justement double de celle qu'on y aura employé le premier coup, si on le veut lever deux fois plus vite, mais il y en faut employer une qui soit plus ou moins grande que le double selon la diverse proportion que peut avoir cette vitesse avec les causes qui lui résistent». (4) Descartes a donc très bien vu que l'identification de l'espace et de la vitesse dans le mouvement uniforme virtuel des corps en équilibre est, comme le remarque Leibniz, quelque chose d'accidentel et que ce n'est pas dans la vitesse qu'il faut chercher le véritable facteur de la force, la vraie raison de son effet : « La vitesse ne comprend pas la raison pour laquelle la force augmente ou diminue comme fait la quantité d'espace, et il y a plusieurs choses à considérer touchant la vitesse qui ne sont pas aisées à expliquer » (5 ) . « C'est pourquoi Galilée peut bien dire quod ita sit, mais non cur ita sit » ( 6 ) . Arnauld devait se charger d'attirer sur ce point l'attention de Leibniz : « Je ne sçay si vous avez examiné ce que dit M. Descartes dans ses lettres sur son Principe général des Méchaniq ues. Il me semble qu'en voulant montrer pourquoi la même force peut lever par le moyen d'une machine le double ou le quadruple de ce qu'elle leverait sans ( 1 ) A. T.
I I, p. 4.3 3 . (2 ) A. T. 11 I, p . 6 M . (3 ) Virtuelle. ( 4 ) A . T. Il, p. 354. ( 5 ) A. T. I II . p. 6 1 4. - IV. p. 635. ( 6 ) A . T I I , p. 433.
L' INFLU ENCE DE D ESCA RTES
65
machine, il déclare qu'il n'a point d'égard à la vélocité » ( 1 ). En se reportant aux lettres en question, Leibniz convient que Descartes a en effet exclu la considération de la vélocité au profit de celle de la hauteur. Mais il remarque que Descartes, qui a soigneusement distingué espace et vitesse dans la statique où elles se trouvent acci dentellement identiques, et où leur confusion n'aurait par conséquent pas eu d'inconvénient, a abandonné cette distinction en dynamique, c'est-à-dire précisément là où elles ne se confondent plus et où leur identi fication pouvait entraîner des erreurs capitales ( 2 ). En outre, dans cette confusion que Descartes lui-même avait évitée, les Cartésiens ( Papin, Catelan etc.) devaient tomber de la façon la plus explicite. C'est en s'appuyant sur le Traité des Méchaniques que Catelan voudra réfuter la formule mv 2 ( 3 ) . La confusion d'ailleurs était à peu près inéluctable . Descartes avait reconnu lui-même que« dans le levier se rencontre toujours la même proportion de vitesse et d'espace parcouru » ( 4) ; il ne niait pas « la vérité matérielle de ce que les méca niciens ont coutume de dire, à savoir que plus la vitesse de l'extrémité du long bras de levier est grande par rapport à celle de l'autre extré mité, moins e lle a besoin de force pour se mouvoir » ( 5 ). Il semblait (1) P. II, p. 67-68. ( 1 ) t J 'ay trouvé dans les lettres de M. de!i Car tes ce que vous m'aviez indiquf, açavoir qu'il y dit d'avoir tâché exprès de retrancher la considération de la vélocitt' en considérant les raisons des forces mouvantes vulgaires et d'avoir eu seulement égard à la hauteur. S'il s'était souvenu de cela lorsqu'il écriva it ses principes de physique, peut être qu'il aurait évité le!! erreurs où il est tombé à l'égard des lois de la nature. Mais il lui est arrivé d'avoir retranché la considération de la vélocité là où il la pouvait retenir et de l'avoir retenue dans les cas où elle fait naître des erreurs. Car à l'égard des p uissances que j 'appelle mortes (comme lorsqu'un corps fait son premier effort pour descendre sans avoir acquis encore aucune impétuosité par la continuation du mouvement), i tem lorsque deux corps sont comme en balance (car alors les premiers efforts que l'un fait sur l'autre sont toujours morts), il se rencontre que les vélo�ités sont comme les espaces ; mais quand on considère la force absolue des corps qui ont quel que impétuosité (ce qui est nécessaire de faire pour -établir les , lois du mouvement), l'estimation doit être faite par la cause ou l'effet, c'est-à-dire par la hauteur où il peut monter en vert u de cette vi tesse, ou par la hauteur d'où i l devrait descendre pour acquérir cette vitesse. E t s i o n y voulait employer la vélocité, on perdrait ou gagnerait beaucoup de force sans raison. ,. Ibid. , p. 80. Cf. aussi Essay, de Dynamique, 11. VI, p . 2 18, note. - - Dy namica de Potentia, Pars II, Sectio l , prop . 4 1 , M. VI, p . 463 . ( 1) P. III, p . 41 . (') A. T. III, p . 6 1 4. (') A, T, IV, p. 685.
66
L'INFLUENCE D E DESCARTES
n'écarter la notion de vitesse que de façon provisoire et quelque peu artificielle, pour s'éviter d'entreprendre préalablement l'explication de tout le système du monde qui requiert cette notion de vitesse. La force qui se conserve dans les machines simples et qu'exprime le travail ms, n'est-elle pas la force qui se conserve partout, force inerte elle aussi, dont la formule mv se trouve dans ce cas particulier de la statique précisément identique à ms ? La loi du levier ne suffisait-elle pas à établir le principe de conservation d'une même quantité de mouvement ? Tout favorisait donc l'identi fication du travail et de la quantité de mouvement : deux quantités ayant chacune deux dimen sions, l'une et l'autre sans durée, se transférant instantanément l'une aux deux extrémités du levier, l'autre dans le choc ( 1 ). Les deux notions restaient abstraites, ne concernaient que l'inerte et non le vivant. Aussi Leibniz a-t-il raison, à cet égard, de tenir pour négligeable la distinction cartésienne, et de les opposer toutes deux à sa notion de force vive. En effet les raisons profondes qui conduisaient Descartes à exclure la vitesse au profit de l'espace achèvent de dévoiler l'antagonisme irréductible des vues de Descartes et de Leibniz sur la physique, et d'expliquer pourquoi Descartes, malgré une notion correcte ùu travail, mesure de la force, et l'emploi d'une méthode qui sera celle de Leibniz, ne pouvait aboutir à la véritable évaluation des forces dyn amiques.
Ces raisons, il est vrai, ont été diversement interprétées. On a pu dire que Descartes épris d'une s cience universelle désirait un prin cipe fondamental d'explication, et qu'il ne pouvait se le procurer en profitant d'une coïncidence accidentelle entre ms et mv pour sub itituer une formule à l'autre. Sa formule ms semblait seule posséder cette valeur objective qui, en dehors dP,s cas de l'équilibre, pouvait permettre une généralisation (2). Il reste à s'étonner •iue Descartes, loin de généraliser cette formule ait cru devoir adopter une équation de la force dynamique ( = mv) que celle-ci excluait. On a remarqué, en second lieu, que le principe de la clarté entraînait l'évaluation du doublement de la force de préférence par le doublement du chemin parcouru, ce qui est évident, plutôt que par le doublement de la vitesse, ce qui est obscur et douteux ; qu'enfin, l'espace p arcouru, facteur ( 1 ) A. T.
III, p. 209 ; 367. - Cf.
CARTEBON. op. c it .•
p. 260, 490.
(2 ) B OUA SSE, Introduction à l'étude des ihéoriu de la .,l:ff!canique, MILHAUD. Descartes Savant,
p. 1 80.
p. 75. -
L'I NFLUENCE DE D ES CARTES
67
simple, peut être envisagé à part, non la vitesse, fac teur complexe dont la considération séparée suppose comme une mutila tion de la science intégrale (1) . E n réalité, les raisons sont plus profondes, plu� métaphysiques. Le recours à la notion de travail permet à Descartes d'éliminer tout élément non géométrique de la force au pro fit d' une notion géomé triquement représentable. Il l'aide à éliminer les notions de puissance et de virtualité, qui lui semblent occultes, au pro fit du travail réalisé , inerte ; à laisser entièrement de côté la force comme faculté d'un sujet, pouvoir d'engendrer tel effet, pour n'envisager qu,� la force en acte identi fiée à son effet géométriquement exprimable (2) . « Je ne dis pas simplement que la force qui peut lever un poids de 50 livres à la hauteur de 4 pieds en peut lever un de deux cents livres à la hauteur d'un pied� mais je dis qu'elle le peut, si tant est qu'elle lui soit appliquée » (3). « . . . Et lorsqu'on dit qu'il faut employer moins de force à un effet qu'à un autre, ce n'est pas dire qu'il faille avoir moins de puissance, car encore qu'on en aurait davantage, cela ne nuit point, mais seulement qu'il y faut moins d'action » ( 4). Par là, on s'explique que tout en ayant distingué entre la force à deux dimensions (celle qui lève le poids à quelque hauteur) et la force à une dimension (celle qui le soutient) (5 ), Descartes hésite à maintenir entre les deux une différence essentielle, puisqu'il déclare qu'« il faut un peu plus de force pour lever un poids que pour le soutenir » ( 6 ). C'est que cette force à une dimension n'e st qu'une virtualité de travail, donc une puissance occulte. Aussi a�t-on signalé à bon droit (7) que Descartes n'est nullement l'inventeur du principe du travail virtuel, dans le sens, du moins, où on l'entend couramment ( 8 ). Sans doute l'équilibre est-il pour Descartes la diffé rence de deux effets ou travaux opposés ( 9 ) ; la pesanteur relative de chaque corps se doit mesurer par le commencement du mouvement que devrait faire la puissance qui le soutient tant pour le pousser ( 1) (2) (3)
MILHAUD, CARTE RON, A. T.
( 4 ) A. T.
( 11 ) A. T. ( • ) A . T.
Ibid. , p. 1 82-184. op. cit., p. 246 ; 253- 254.
Il, p . 35 1 . Il, p. 432 . Il, p. 352-353. I, p. 438,
(7) CARTERON, op. cit., p. 256-257 . ( 8 ) DuBEM, Or. Stat., I, p. 338 et 350. - Bou.ASSE, op . cit., p. 70. ( 1) Â. T. II, p . 363.
68
L'INFLU ENCE D E DESCARTES
que pour le suivre s'il s'abaissait ( 1 ) ; et ce n'est qu 'au commencement de la d�scente à laquelle il faut prendre garde ( 2 ) ; ainsi l'équilibre est conçu comme mouvement infiniment lent. M ais malgré cette appa rente allusion à }'infiniment petit, il s'agit non d'un travail virtuel, mais d'un travail élémentaire ; non du recours à un processus éner gétique dest.in é à rendre compte de la produ_ction de l'équilibre, mais d'un biais pour rattacher la force à une dimension à la force à deux dimensions, et pour l'exprimer non plus comme un pouvoir, mais sous la forme d'un effet en acte, quoique très petit. La préférence que Descartes affiche dans la statique pour l'espace parcouru plutôt que pour la vitesse sort donc de cette conception du clair et du di stinct, de ce géométrisme que Leibniz veut ruiner, de cette préoccupation de l'actuel à laquelle Leibniz oppose le virtuel et le devenir, l'élément supra-géométrique. Si Descartes exclut la vitesse, c'est qu'elle se réfère au futur et enveloppe ainsi quelque chose d'obscur. Par là, on comprend que la mesure de la force statique par le travail ne l'ait pas conduit à la découverte de la formule des forces dyn amiques. Il n'y serait parvenu, en effet, qu'en recherchant au delà de l'effet, géométriquement représentable, le facteur supra-géo métrique qui en est la cause, c'est-à-dire en renonçant à identifier la force productrice et son résultat en acte, identification qui fonde précisément chez lui sa préférence pour la formule du travail . Seule, la recherche d'un équivalent dynamique du travail aurait pu éliminer cette substitution de la force morte inerte (exprimée dans ce résultat), à l'énergie interne des choses. Mais précisément le préjugé cartésien selon lequel est clair et distinct uniquement ce qui est géométrique, excluait une telle recherche. Aussi le passage à la dynamique est-il marqué par l'extension à ce domaine, non point de la formule ms, de façon à obtenir l' expres sion mv2 de la force vive, mais de la tendance qui pousse D escartes à éliminer de la stati que toute notion de force proprement dite au pro fit d'une notion géométriquement exprimable. Il essaye de retrancher toute force du mouvement et de la matière : « Le mouvement est le transport, non la force qui transporte, le mouvement est dans le mo bile, non dans ce qui meut » (3 ) . La notion de quantité de mouvement (1) A . T . III, p. 245. (3) A. T , 1 1, p. 233. ( ) Princi�!, Il, § 25, 1
A.
T.
VIII, p. 54. -
C ARTERON,
op . cit ., p. 261 -262.
L'INFL V E N C E DE DESCARTES
69
est l a notion d'une force inerte, d'une réalité actuelle et donnée, ab straction faite du processus de sa production interne. Dépouillée de sa relation essentielle avec l'avenir, relation qu'enveloppe son rapport à une puissance de mouvoir, la vitesse, qui était exclue de la statique, peut sans danger réapparaître dans la formule de la dynamique. Dans 1a formule de la statique, elle devait être exclue en raison du poids qui y figure, et qui, déjà en lui-même créateur de la vitesse en vertu de considérations ou et qu'au surplus, il n'y aurait pas d'inconvénients à ce que la mesure des forces fût différente dans l'équi libre et dans le mouvement retardé, puisqu'on ne doit entendre par le mot force que l'effet produit en surmontant-l'obstacle ou en lui résistant, - donne pourtant la préfé re�ce à la formule cartésienne. C'est qu'elle peut s'appliquer aussi, selon lui, aux forces vives, si dans ce dernier cas, on mesure la force « non par la quantité absolue des ohstacles, mais par la somme des résistances de ces mêmes obstacles. Car �Hte somme de résistances est proportionnelle à la quantité de mouvement, puisque de l'aveu général, la quantité de mouvement que le corps perd à chaque instant est proportion nelle au produit de la résistance par la durée infiniment petite de l'instant, et que la somme de ces produits est évidemment la résistance totale. Toute la difficulté se réduit donc à savoir si l'on doit mesurer la force par la quanti.té absolue des obstacles ou par la somme de leurs résistances... Or, il serait plus naturel de mesurer la force de cette dernière manière, car un obstacle n'est tel qu'en tant qu 'il lui résiste et c'est la somme des résistances qu i est l'obstacle vaincu. >> D'ALEMBERT, Discours p réliminaire au Traité de Dynamique, p. XXVI-XXXI, et Encyclopédie, art . Force.
1 16
QUERELLE DES FOBCES VIVES
bref de processus requérant une succession d'instants, il est non moins naturel de se placer au point de vue de l'espace pour mesurer le résultat lui-même. D'abord, ce résultat, c'est-à-dire la force vive, est, considérée en soi, une puissance motrice qui réside non plue dans le temps, m ais dans l'instant, et ce qu'elle �st actuellement ne dépend plus du temps passé actuellement aboli. L'impétuosité par laquelle se caractérise cette force à chaque moment n'est que vitesse, c'est-à-dire un certain dé placement instantané, et celui-ci n'est lui-même que la somme d'effets élémentaires (des forces mortes) qui sont eux-mêmes des déplacements élémentaires. Ainsi la cause s'exprime plutôt par l'intermédiaire du temps, et l'effet par l'intermédiaire de l'espace. Or, quand il s'agit de mesurer la force vive, il faut envisager son effet, conformément au principe de l'égalité entre la cause pleine et l'effet entier, et par conséquent considérer la hauteur à laquelle elle élève le grave où elle réside, c'est-à-dire l'espace . Mais, dira-t-on, cet effet ne pourrait-il pas être aussi bien l'élévation du grave pendant un certain temps ? A coup sûr, si l'espace parcouru dépendait du temps que l'on s'accorde, si la grandeur de l'effet variait avec celle du temps dont on dispose. Mais ici, c'est le contraire qui se produit. La grandeur de l'effet est prédétermin� dans la force (vive) qu'il s'agit de consumer, et cette grandeur prédétermine à son tour celle du temps durant lequel il se déroulera . Se donnerait-on tout le temps possible au delà du temps prescrit qu'on ne parviendrait pas à accroître d'une li gne la grandeur de l'effet ( 1 ) . Sans doute, o n peut contester que l a quantité d'obstacles sur( 1 ) De causa gravitatis, M. VI, p. 203 : � Fuere etiam quibus etc. . . Ce fut une cause d'erreur pour certains, de penser que pour estimer la force, il ne faut pas seulement tenir compte du seul effet qu'elle produit, mais aussi du temps qu'elle met à le pro duire. C'est pourquoi, il ne faudrait pas estimer la force par la seule raison comparée du poids et de la hauteur à laquelle le poids peut monter grâce à la force. Et sans doute, il est exact, qu'il faut tenir compte aussi du temps, dans la producüon de ces effets où la même puissance peut produire un plus grand effet quand p1us de temps lui est imparti, par ex . quand une boule ayant une certaine vitesse, a la force de mouvoir son poids en le déplaçant sur un plan horizontal en un espace donné pendant un temps donné [a] ; mais ici pour les effets et forces en question, il en va autrement, puisque la force se consume en agissant, et si tout ce qui est doué de force (comme l'arc tendu d'un certain degré, ou ayant une certaine vitesse) dépense selon ce seul mode d'opérer, toute son action à élever le poids donné à une certaine hauteur, aucun autre artifice ne fera monter ce poids plus haut, quel que soit le temps qu'on accorde. La considération du temps est donc inutile >>. [a) C'est le cas qui sera envisagé dans la méthode a priori.
QUERELLE DES FORCES VIVES
1 17
montés, par laquelle se consume la force, soit nécessairement traduite par le nombre exprimant la hauteur, car, il y a des cas où celle-ci ne correspond pas au travail. Tel était évidemment le sens de l'objection de Bernoulli, qui prêt à se conv�rtir aux idées de Leibniz, après la lecture du Specimen Dynamicum, hésitait pourtant à mesurer les forces par la hauteur parcourue, celle-ci étant un effet contingent dû à la loi de la gravité sur notre monde, devant varier avec la valeur de cette gravité et s'accroître à l'infini, si tout autre obstacle étant exclu, la- pesanteur tombait à zéro ( 1). Mais l'essentiel de la thèse leihnizienne n'est pas atteint par là. Cette thèse c'est avant tout que la force (vive) doit s'estimer par ce qui la consume, par l'effet violent, c'est-à-dire par le travail ; la hauteur n'est qu'un des effets par lesquels la force se détruit, mais on peut en choisir d'autres (2 ) . Galilée par ex. avait choisi la percussion, l a profondeur à laquelle peut être enfoncé dans tel milieu un pieu recevant le choc d'une force vive (3) . On pourrait aussi la mesurer par le nombre de corps égaux auxquels elle est capable d'imprimer le même degré de vitesse, tout autant que par le nombre d'effets égaux et répétés de certains poids élevés à une certaine hauteur. L'important c'est que le travail envisagé s'exprime en des éléments égaux dont la répétition puisse permettre d'établir un nom bre qui servira de mesure. En réalité, les deux points de vue, temps et espace sont légitimes, mais ils correspondent à deux plans entièrement différents ( 4). Le tort de Leibniz fut de donner à sa formule une valeur exclusive et absolue. Mais surtout il allait par là être conduit à abandonner les voies pru dentes et sûres de la mé thode fondée sur l'expérience. Il ne pouvait pas, en effet, ne pas sentir plus ou moins confusément que le point de vue du temps conservait au moins quelque apparence de légitimité. De ce sentiment devait bientôt surgir pour lui la nécessité, pour réduire ( 1 ) Commercium epistolimm Leibnitii et Bernoullii (Lausanne-Genève, 1 745), 1 , Lettres, XI, p . 63. - M. III ( 1 ) , p. 189 . (2) Réponse d e LEIBNIZ, Commercium, p . 68. - M . III, p . 193. (3) GALILEI, Ibidem, p . 1 57 ; JouGUET, op. cit., p . 93. (') Par là, s'explique la vanité de la controverse : t le concept leibnizien de spontanéité s'exerçant à Poccasion d'un choc élastique, il faut négliger le caractère de loi interne qu'exprime cette spontanéité et surtout la notion de prédétermination totale de tous les moments de chaque mouvement, et de tous les mouvements (1) A. T. V. , 222 .
( 3 ) M. ,IV, (2), p. 43, 1 04. - Thh>dicée, § 6 1 , P. VI, p . 1 36 . M. IV, supp l . , p. 5 1 .
C1 )
DYNAMIQUE ET MÉTAPHYSIQUE
1 79
de l'univers. Cette prédétermination interne exclut radicalement une initiative perpétuelle de Dieu. Or, cette prédétermination, fondement de l'harmonie, est condition même de l'affirmation absolue de cette spontanéité. Aussi Leihni:.-: peut-il affirmer en 1686, Rans qu'il n'y ait là nulle contradiction, que « l'hypothèse de la concomitance est une suite de la notion qu'il a de la substance» (1), non pas dans la mesure où cette notion a une origine simplement logique, mais dans la mesure où elle a une origine mathématique. Or, les notions mathématiques seraient-elles venues féconder la notion de substance, sans l'intervention de la dyn amique ? C'eet peu vraisemblable. Car c'est dans la notion de force que cette information s'opère en fait, et c'est la notion de force qui semble lui conférer sa validité. En effet, la formule essentielle de la nouve1le physique, mv2, est à la fois suggérée par l'expérience et conçue comme l'intégration de s impetus. Par là, le rapport mathématique de la différentielle et de l'intégrale est aperçu comme se réalisant au sein même des choses. Il ne s'agit plus seulement de l'application extrinsèque d'un procédé de calcul en vue de mesurer un donné dont le processus réel de génération peut être tout différent, mais ce rapport apparaît immédiatement comme le mode même de la production de ce donné, de ce changement. Si le physicien, en tant que savant, peut se désintéresser de la signification métaphysique que présente cette conjoncture, et si l'on conçoit que la dynamique puisse ainsi poursuivre son développement, indépendamment du fondement métaphysique que Leibniz lui a donné, pour le Leihnizien qui ne se confine pas simplement au plan scienti fique, mais qui s'élève en même temps au plan philosophique, il devient évi dent que la physi qu e dyn amique n'est possible que parce qu'au fond du phénomène du changement règne une loi intelligible qui le préforme, le prédétermine du dedans, de point en point et dans tous ses détails. Or, cette préformation interne totale, en fonction d'une loi de toute la série, cette détermination de la partie par le tout, c'est la finalité imma nente de l'harmonie préétablie. L'harmonie reçoit donc, de par la phy sique, une validité suffisante parce qu'elle apparaît comme liée à sa possibilité. Ce fondement de possibilité, le savant lui-même a quelque fois intérêt à le connaître, car il peut se transformer pour lui en principe eur1st1que. Et par là s'expli qu ent, chez Leibniz, ces entreprises de recherches et d'explications scientifiques uni quement guidées par le ( 1 ) P. Il, p. 68.
180
DYNAMIQUE ET MÉTAPHYSIQUE
fil d' Ariadne de la finalité, comme le Tentamen anagogicum (1), ou 1� Uni cum opticae catoptricae et dioptricae principium (2 ). Cet usage euristique de la finalité, mise en œuvre des « sentences de la sagesse métaphy sique » ( 3), sera d'ailleurs conservé par Kant dans l'usage des idées régulatrices de la raison, ou des jugements réfléchissants. Mais si la science peut i gn orer l'harmonie qui ) a fonde, celle-ci n'en subsiste pas moins comme condition de sa possibilité. Si en effet, on abandonne le plan du philosophe, le point de vue du tout, pour se tenir au plan strict de la science expérimentale, au point de vue de la partie et des actions partielles, on constatera que les changements nous apparaissent comme se produisant autrement qu'en fonction d'une harmonie interne, en vertu d'un concours de chocs extérieurs qui font dévier les corps de la lign e droite et déterminent du dehors la courbe de leur trajet, courbure qui apparaît contingente et accidentelle. Sans doute le philosophe sait que cette détermination extérieure n'est en réalité que pure apparence et qu'au fond tout obéit sans violence à une prédétermination interne ; mais cette prédétermination ne saurait apparaître à celui qui ne pouvant dépasser le simple plan de l'expérience, ne voit que des actions partielles et non l'action totale où toutes se complètent et s'harmonisent ( 4 ). N'est-il pas paradoxal, cependant que les mêmes notiorns et les mêmes formules servent de fondement à deux conceptions radicale ment opposées : l'une, abstraite, selon laquelle tout s'accomplit par le choc extérieur et suivant la ligne droite, la courbure étant acciden• telle ; l'autre, concrète, où tout s'accomplit paT le dedans et rien par le choc, où le mouvement circulaire est posé comme primitif et la droite tangeante comme accidentelle ? De quel droit le philosophe erige-t-il la seconde en fondement de la première ? Vraisemblablement, parce que la première est déjà réalisation par tielle de la seconde ; parce que le concours de chocs extérieurs qui achève la première et supplée à l'insuffisance apparente de la prédétermina tion interne est comme un succédané et un symbole de la prédétermi-
(1) P, VII, p. 274. (1) Âda eruditorum 1682, Dutens, III, p. 1 45. Cf. Nouveaux Essais, L. IV,
ch. VII, § 1 5 ; - P. IV, p. 3 1 8-319, 448, etc. (1) KANT, Critique du jugement, Introduction, § (') P. IV, p. 543, 558.
5.
DYNAIIIQUE ET MÉTAPHYSIQUE
1 81
nation totale. La dynamique se révèle ainsi comme point , chez celui dont l'indépendance de penser fut à re poiut réelle, au fond, malgré l'aménité parfois trop fuyante des expressions, qu'il ne se tro uvât à sa mort aucun ministre d'un culte quelconque pou r consentir à bénir son cercueil? La liberté que LEIBNIZ a voulu sauver t:st plus proche de celle qui est conçue par le sens commun que celle de SPlNOZA. Mais à la liberté comme conformité à la nature, il a voulu substituer la liberté comme transformation de la nature par un idéa l qui, sans s'opposer encore à celle-ci, la domine néanmoins. Avec lui la morale comme créa!ion tend à se substituer à la morale comme fusion interne avec une force éternellement semblable à soi . Conformément à cttte aspira tion, .il préfère à la béatitude abso]ue, qui >. (Principe� de la nature et de la srâce., § 18). 11 n'y a rien dans ces dessrins qui ne soit entièrement favorable à une capacité individuelle de se décider. Sans doute, les réalisations du système réduisent elles à néant ces 8.!3pira tions, que, techni quement, pouvait 8eulc satisfaire la méthode kanti�nne de la critique d'une rai son pratique : P. II, p. 475 (cité par M. BRVNSCHvICG, i bid. ). Il semble même, à première vue, que par sa technique LEIBNIZ paralyse l'homme à un plus haut point que SPINOZA. La spéci ficité qualitative de chaque essence n'est pas expressément ma:rquée par SPINOZA, et au del à de sa parti cularité individuelle, chacun peut se confondre pleinement avec Dieu. En moi est peut-rtrc déterminé le degré o ù je puis m'élever, en rapport avec ma capacité de connaître, mais ce degré ne dépend que de moi, et est sans relation avec la proportion d'affranchissement accordée aux autres. LEïBNIZ ajoute une pré détermination de ce de 5 ré. en relation avec la proportion impartie aux autres. De plus je reste, selon lui, rivé à la particularité individuelle que marque & l'égard des autres monades ma spéci ficité qualitative indestructi b le. Néanmoins, bien qu'il soit entendu que l'univers lei bni zieu ne puisse se confondre avec l'univers spinoziste, il ne semble pas que ces différnnces puissent opposel' fondamentalement les deux philosophes à propos de la réalité de la liLerté xu'è�uJ_îjV . Outre que LEIBNIZ ildmet une com munion toujours possihle pour ehacun avec la monade centrale, on peut dire qu'il se sépare de SPINOZA moins sur Je fait de la prédétermination même, que sur la fuçon de l'entendre. SPINOZA ne confère pas >, mais à certai nu d'entre elJcs, comprises dans les décrets de Dieu, " la capacité de progrès interne qui les élève à l'adéquation de la connah1sance totale •>. � Comme il serait absurde en effet que le cercle se plaignit parce q ue Dieu ne lui a pas donné les propriétés de la sphère, ou un enfant qui souffre de la pierre, parce que Dieu ne lui a pas donné un corps sain,
DYNAMIQUE ET MÉTAPHYSIQt: E
1 85
comme la clef de voûte commune de la dynamique et de la méta physique qui apparaissent, non plus comme des constructions indé pendantes, mais comme les parties d'un seul et même édifice. Leur étroite compénétration semble donc évidentt'. Mais pour achever de l'établir, il reste toutefois à éliminer une dernière objection capitale, dont l'examen requiert une analyse appro fondie du degré de réalité de la force dérivative. de même un homme sans vigueur en son âme, ne peut St' plaindre parce que Dieu lui a refusé la force morale, ]a connaissance vraie et l'amour de Dieu en lui -même, et lui a donné une nature si faible qu'il ne peut contenir et réi,r;ler ses désirs. Rien de plus en effet, n'appart ient à la nature d'aucune chose que ce qu,i � uit nùessairemerit de sa cause telle quelle est donùée. Que d'ailleurs il n'appar t ien t pa s II la nat ure de tout homme d'avoir une âme forte et qu'il ne soit pas plus en notre pouvoir de posséder la santé du corps que celle de l'âme, nul ne peut le nier, à moins qu'il ne veuille s'inscrire en faux et contre l'expérience et coutre l a raison . . . Tout arriv e selon le décret de Dirn . Mais je ne vois pas que cc soit là une raison pour que tous parviennent à la béatitude : les hommes en effet peuvent être excusables et néanmoins privés de l a béatitude et souffrir des tourments de bien des sortes. Un cheval est excusable d't'.tre cheval et non homme. Qui devient enragé par l a morsure d'un chien doit ê tre excusé à l a vérit:! et cependant on a le droit de l'étrangler. Et qui en fin ne peut gouverner ses dé.,irs, ni les contenir par la crainte des lois, bien qu'i] doive être excusé en raison ùe sa fai blesse, ne peut cependant jouir de la paix de l'âme, de la connaissance et de l'amour de Dieu et périt nécessairement . . . •>, etc . (Lettre à Oldenburg du 7. 2. 1 6 76, Van Vloten (1895), Il, p . 422-423). En définitive on peut d i re que l'homme qui n'e!:it. pas de toute éternité d estiné à acquérir la sagcs5e, ne pourra pas plus devenir sage qu'un cheval ne pourrai t deveni r homme . Pour admettre rhez SPINOZA un . r ntièrement concr de la substance, elle dissoudrait entifr� me1 1 t aggrégat et avec lui l'illusion des processus d'addition cxtéri�u1·� d'impulsion� reçues.
r
De quelle façon alors interpréter Je co1H· • · p t de fori·e dérivative '! Quel degré de réalité lui laisser finalement? Pour u nt> inter prétation exacte, il ne faut pas envisager exclusi vement. au i l �tri uu�nt de l'autre, l'un des deux aspects que nous venons de considérer. Il c8t évident que la force dérivative implique au contrain� leur synthèse. Elle est un concept mixte où dans le phénomène même app araissent étroitement soudés l'une à l'autre et la réalité phénoménale proprement dite et la réalité substantielle ; et par ce caractère s'expliquent à la fois et la double physionomie de la physique leibnizienne, et le rôle de cette physique par rapport à la métaphysique. Il faut remarquer en effet que le travail opéré par l'imagioation à l'égard de la force, ne conduit qu'à une altération très partielle de la réalité de l'accident. Lorsqu'il s'agissait de l'étendue, du temps, du mouvement, l'être forgé par l'im3 gination ne retenait à peu près plus rien du « réel» d'où l'on était parti. C'est ainsi qu'alors que dans le concret toutes les parties sont intrinsèquement discernables '. dans l'es pace et dans le temps imaginaires les parties, quoique numériquement distinctes, sont intrinsèquement indistinguables . Telle couleur, tel arc en-ciel qui sont des réalités phénoménales, c'est-à-dire des songes bien liés, se dissiperaient entièrement par une analyse eomplète, et, d'autre part, ne laissent pas apercevoir immédiatement dans leur simple appa rence l'élément intelligible d'où ih dfrivent : ce sont donc de véritables « phantômes sensitifs », plutôt mème que dt�:, qualités ou des idées ( 1 ). La force dérivative qu'élabore l'i magination ne saurait perdre par l'analyse tous les caractères qu'elle révèle lorsqu'elle est attribuée à l'aggrégat, précisément parce que, dans cet état inférieur, on peut apercevoir immédiatement en elle les caractéristiques essentielles qui la constituent dans l'accident ou la substance élémentaire ; c'est à savoir : la continuité, l'unité de 1� multitude, hmplication du passé (1) Nouveaux Euais, - L. II, 23, § 1 2 ; - L. IV, 6, § 7.
200
L A FORCE D É RIVATIVE CONCEPT MIXTE
et du futur, la tendance au futur et la spontanéité. Sans doute, l'action de la force d'un corps sur un autre corps est conçue comme contact, percussion, le passage du repos au mouvement est conçu comme addition d'impulsions, mais ces caractères dus à l'imagination et opposés à la spontanéité sont unis immédiatement par le physicien à la spontanéité, parce qu'il appréhende immédiatement , dans l'instant donné de la force, qu'elle enveloppe dès maintenant ses effets · futurs, parce qu'il voit aussitôt la nécessité de concevoir l'addition des impulsions comme une intégration dans laquelle chacune de ces impulsions est saisie comme l'un des termes d'une série dont la loi dé termine du dedans et à l'avance la totalité. La formule mu 2 est elle-même résultat de cette intégration . L'expérience la plus courante révèle cette spontanéité de la force. Elle nous enseigne qu'un corps en mouvemen t conserve de lui-même et son mouveme nt et sa direction ; que dans l'exemple du poids suspendu qui tend le câble lui servant de soutien, ou de l'arc tendu ou du ressort bandé, il suffit que l'obstacle soit supprimé pour que la force d'elle même se porte à l'action ( 1 ) . La force dérivative apparaît donc comme l a seule manifestation phénomén�le dans laquelle s'exprime immédiatement la réalité au sens métaphysi que du terme, c'est- à-dire un état de la substance. Elle est quelque chose de mixte dans lequel se mélangent le réel et l'imaginaire. *
*
C'est ce caractère mixte qui constitue le privilège de cette notion, et qui lui permet d'expliquer et de fonder tous les traits de la physiq ue Leibnizienne. Puisqu'il y a au fond identité de nature entre la substance et son état, la force (dérivative), étant état de la substance, en est évidemment l'immédiate révélation pour nous. Elle doit, tout naturellement, en conséquence, être considérée comme le seul moyen que nous ayons de découvrir la nature de la substance qui est au fond du monde physique. La force (dérivative) « passant d'elle-même à l'action, en tant que rien ne l'en empêche . . . je la considère comme le constitutif de la substance, étant le principe de l'action qui en_ est le caractère . ( 1 ) De primae philosophiae emendatione, etc. P. IV, p. 469, etc.
LA DYNAMIQUE SCIENCE MIXTE
2 01
Ainsi j e trouve que la cause efficiente des actions physiques est du ressort de la métaphysique » (1) . La voie est ainsi ouverte à la restauration, sous un aspect nouveau, des « formes substantielles » dont la nature, consistant dans la force, devra être conçue par analogie avec le sentiment et l'appétit et par là identifiée aux âmes ( 2) . En effet, si la physi qu e est capable de nous révéler de quelle nature sont les substances qui sont au fond des phéno mènes du monde matériel, elle ne saurait nous en procurer une connais sance claire et immédiate, puisque son objet, la force qui est en la matière, n'est tout de même qu'une manifestation confuse et obscure de ces substances. Pour achever la physique et pénétrer jusqu'au fond de la nature de la matière, comme de la force qui est en elle, il faut expliquer le confus par le clair, c'est-à-dire délaisser l'observation des forces matérielles pour s'adresser directement aux substances spirituelles qui peuvent être en nous-mêmes objet immédiat de connaissance distincte . Par là on s'explique que la physique dm� ve revêtir finalement ce caractère a priori que nous avons signalé (3 ), pour à la fois prendre son appui dans une psychologie rationnelle et se déduire entièrement de l'harmonie interne des substances : « Si nous y prenons bien garde, les corps ne nous fournissent pas par le moyen des sens, une idée aussi claire et aussi distincte de la puissance active que celle que nous en avons p ar les réflexions que nous faisons sur les opérations de notre esprit » . Toute action est soit penser, soit mouvoir. Or, le corps ne nous fournit nulle idée de la pensée, et s'il nous donne l"idée d'un mouvement, il ne nous en donne aucune de son commencement. Or, « nous trouvons en nous-mêmes, la puissance de commencer ou de ne pas commencer, de continuer ou de terminer plusieurs actions, etc . . . Cette puissance, c'est ce que nous appelons la volonté ». Ainsi, bien qu'il faille touj ours admettre dans les corps de la force ou de la puissance active « cependant, je suis touj ours d'accord . . . que la plus claire idée de la puissance active nous vient de l'esprit. Aussi n'est-elle que dans les choses qui ont de l'analogie avec l'esprit, c'est-à-dire dans les Entéléchies, car la ma tière ne marque proprement que la puissance passive » ( 4 ). Le caractère mixte de la force dérivative conduit donc en quelque sorte à un double jeu de la physique et de la métaphysique. Parce (1) (2) (3 ) (4 )
P. IV, p. 472. Ibid. , p . 479. Cf. plus haut, p. 1 7 1 . Nouveaux Essais, Livre Il, chap. 2 1 , § § 4 e t 5 . P . V , p . 1 56 sq.
202
LA DYNAMIQUE SCIENCE MIXTE
qu'elle est réelle, état de la substance, elle nous révèle la vraie substance, mais parce qu'elle comporte de l'imaginaire, du confus, elle ne peut nous donuer de cette substance une connaissance suffisante. Toutefois comme elle réussit à nous révéler l'essence spirituelle de celle-ci, elle nous indique du même coup où nous pourrons en trouver une intuition claire et distincte. La physique nous renvoie donc à une métaphysi que à partir de laquelle, par une sorte de retournement, tout pourra se déduire de façon claire et distincte . Ainsi réapparaîtront les distinctions platoniciennes entre les causes secondes et les causes premières, les efficientes et les finales, non que ces causes premières et générales puissent assurer par elles-mêmes l'explication des phénomènes sensibles dont peuvent seules rendre compte des causP-s propres et spéciales (1 ), mais elles rendront intelli gible et concevable l'action même de ces causes secondes. Puisque la nature de la force n'est pas celle d'une « faculté morte, incapable de produire une action sans être excitée du dehors», les impulsions externes et les chocs ne devront pas être compris comme d� agents véritables, mais comme la simple suppression des obstacles s'opposant à la dif fusion interne d'un pouvoir. Par là se découvre l'erreur de Couturat (2) qui, constatant le goût de Leibniz pour les explications par le choc et ..;on opposition à l'idée d'une action à distance, en concluait que le dynamisme leihnizien n'était que le mécanisme cartésien renforcé sans l'ombre d'un véritable « dyn amisme >>, et que le concept de monade, force e u centre de forces, devait être « réd uit à néant». Il y a en effet une autre façon dynamique de concevoir la force sans recourir à l'action à distance, c'est de la concevoir comme p uiçsance interne d'exp ansion (3). Or c'est cette conception seule qui 1,elon Leibniz rend compte et de faits d'expérience, comme la tendance du poids à tomber, de la halle à s'échapper de la fronde, etc., et de la possibilité pour le choc de cau6er un effet, et des lois de l'inertie, et des moyens de fonder par le calcul différentiel le vrai rapport des forces mortes et des forces vives.
*
*
( 1 ) M. VI, p. 103, 236 . (!) COUTURAT, Revue de Métaphysique, 1902, are. cit. p. 2 1 . (3) > appliqué aux corps. Il n'en reste pas moins vrai, qu'au point de vue de la connaissance claire et d istincte, c'est-à-dire de l'entélechie, c'est l'idée de bannir la mémoire hors des choses qui semble devoir se faire excuser. (2 ) R USSELL, op. cit. , p. 136 sq. - BRUNSCHVICG, Eiapes de la Philo.,ophie Mathématique ( 1 9 12), p. 235 sq. , 240 sq.
IDÉALISME, RÉALISME ET HARMONIE
2 11
sont bien liés parce qu'ils obéissent à des lois régulières, jamais démen ties. Ces lois régulières ne sont elles-mêmes possibles qu'en fonction de certaines règles de convenance, par exemple celle « qui ordonne que l'effet ne doit pas surpasser sa cause». Ces règles de convenance requièrent à leur tour des conditions objectives : à savoir qu'une mécanique ab straite ne règne pas dans les choses (ce qui exclurait un « système» au profit d'un « chaos»), que les substances ne soient ni simple étendue, ni simple impénétrabilité. qu'elles soient des forces, qu'une force passive soit unie à la force active de façon que la même quantité de force sub siste toujours sans augmentation ni diminution, et que partout soit f respectée l'égalité entre la cause et l'ef et. Ainsi la dynamique comme système des forces apparaît comme un « requisit » du sujet, comme posée par lui à titre de condition de possibilité de la connaissance (1). Mais comme l'existence du monde extérieur a été dès l'abord soustraite au doute, toute cette organisation qui n'a été postulée de la sagesse de Dieu que pour moi (si bien que le principe de convenance est aussi à un certain point de vue le principe de ce qui convient aux nécessités de mon entendement) ( 2) est posée comme réelle en dehors de moi. L'en semble de ces phénomènes bien fondés cesse alors de s'appuyer sur mon moi, pour s'adosser à un ensemble de substances, ou forces primitives dont ces phénomènes constituent à la fois l'accident et l'apparence. Or, l'existence d'êtres en soi, indépendants à la fois et de ma monade percevante et des phénomènes qu'elle perçoit, n'est nullement requise par les besoins du sujet, et dépasse par conséquent la sphère de légitime application du principe de convenance, entendu au sens idéaliste ou kantien. Cet usage transcendant se trouverait au fond de toutes les difficultés rencontrées. Ainsi le sujet requiert pour la liaison des phéno mènes suivant des règles de convenance, des forces vives fugitives, dont le total seul se conserve, ce qui est l'opposé des forces primitives qu'on place à leur fondement, et qui sont conçues comme immuables dans chaque parcelle. Ici on a aimé à voir le lieu du conflit entre le point de vue de l'univers et celui de la substance individuelle. Pourtant, une remarque doit retenir l'attention. Cette contra diction n'a pas arrêté Leibniz, bien que lui-même, néanmoins en ait eu
( 1 ) P. III, p. 636. (2) Idée que KANT reprendra dans l a Critique du Jugement. La convenance a deux sign ifications : 1 o l 'harmonie des monades entre elles ; 2 ° l'accord des choses avec Je8 exigences de notre entendement. Chez Leibniz Je second sens découle du premier.
2 12
IDÉALISME, RÉALISME ET HARMONIE
conscience (1). C'est que la contradiction, pour lui, n'est qu'apparente. Elle ne serait réelle que si l'ensemble des forces vives qui se conserve était, lui aussi, suhstantialisé ; mais cet ensemble n'est qu'un aggrégat et ne saurait jamais être substance qui est loi et virtualité. La per manence des forces vives n'est donc que l'expression de cette loi de coordination supérieure des substances elles-mêmes, qu'est l'ha:rmonie préétablie, et qui pose que dans l'espace llllÎversel, la quantité d'exis tence totale compossible à chaque instant, quantité qui est un maxi mum, est à chaque instant identique. Proposition requise par la science� sans doute, à titre de postulat, et indépendamment de toute métaphy sique ; mais proposition que la métaphysique, de son côté, peut reven diquer au nom du principe de raison .suffisante. Dieu, en choisissant ce monde, a appelé à l'existence la série des possibles réalisant le maxi mum d'essence. Puisque l'univers ainsi choisi est un tout entièrement plein ( non dantur saltus, hiatus, vacuum) on ne pourrait comprendre qu'en tel instant puisse passer à l'existence une moindre quantité totale d'existence, qu'en tel autre, ni par conséquent que la quantité totale de force phénoménale puisse varier d'un moment à l'autre. Au contra°:e, la variation continuelle de chaque force dérivative, à chaque instant, ne s'oppose nullement à l'immutabilité de la substance en ces mêmes instants. Ces variations sont nécessaires, puisque le chan gement perpétuel des existences est la condition de la réalisation selon la loi de compossibilité, - de toutes les essences appelées à l'être. C'est la propriété même des substances et leur dé finition de rester immuables, tandis que la quantité d'existence qu'elles peuvent chacune insérer dans l'ensemble des autres existences s'accroît, diminue ou s'anéantit, suivant le jeu des compossibi]ités ( 2) ( 1 ) > qui fait un maximum ou un minimum (MAUPERTUIS, Œuvra, IV, p . 48 sq.). (3) P. VII, p. 274 (Tentamen A nagogicum).
2 18
LA THÈSE DE MAU PERTl1 JS ET LE POINT DE V U E SCIENTIFIQUE
dans l'énonciation et l'application de son principe, M aupertuis a réussi infiniment mieux que Leibniz« à tirer du vague le principe de la sim plicité des voies » (1 ) . C'est ce qui résulterait de l'examen d'un des cas les plus notoires, à propos duquel fut mis en œuvre le principe de la moindre action : celui de la réfraction. La considération des causes finales est le trait commun qui réunit, contre l'explication cartésienne mécaniste de ce phénomène, les théories de Snellius, de Fermat, de M aupertuis. Fermat' pensait, contre Descartes, que la lumière rencontre plus de résistance dans les milieux denses que dans les milieux rares, mais qu'en conséquence sa vitesse est moindre dans les premiers que dans les derniers. Il déduisait alors la loi de la réfraction du principe du moindre effort de Héron, mais le modifiait en prenant comme minimum non point le plus court chemin, mais le trajet réclamant le moindre temps. De là il réimltait que la lumière allant d'un point à un autre, en passant d'un m ilieu plus rare à un milieu plus dense, devait faire moins de chemin dans ce dernier que dans le premier (2 ). Lf':ihniz ( 3 ) av ait accepté le principe de Fermat ; mais il substituait à la route exigeant le moins de tem ps� 1� chemin le plus facile. Il estimait cette facilité par Je plus ou moin s de résistance que présentent les milieux dans lesquels la lumière se meut, c'est-à-dire au moyen du produit de la rfsistance par le chemin . donc, au moyen du travail. Comme Fermat et contre Descartes, il jugeait J a résistance proportionnelle à la densité du milieu. Comme D�scart.ei,, et contre Fermat, il affirmait que l a vitesse croît avec la densité. mais c'est parce qu'il pensait, contre Descartes, que la vitesse s'accroît avec la résistance. « Une plus grande résistance, en effet, empêche la diffusion des rayons, au lieu que les rayons se dis persent davantage là où la résistance est moindre ; et. . . la diffusion étant empêchée, les rayons resserrés dans leur passage, tels qu'un fleuve qui coule dans un lit plus étroit, en acquièrent une plus grande vitesse » (4 ) . Ainsi le rapport des sinus d'incidence et des sinus de réfrac( 1 ) D ' A LEMB E RT, Encyclopédie. a r t . Co smologie . --· E ULER, Sur le principe de la moi,tdre action. Mémoire de l'Académie d� Berlin , 1 7 5 1 , p. 200. - Cité par BRU NET, op. cit., p. 222. (2 ) FERMAT, Varia opera mathematica. p. 1 56. (3 ) LEIBNIZ, A cta erudiwrum, Leipzig 1682, p . 1 85 : Unicum optir.ae catoptricae et dioptricae principium ( D tiTENS, III, p. ) 46 s q .). - Tentamen anag . , P. VII, p . 270 sq. - A HUYGHE N S , 26. l. 1 680, M. II, p . 36.
(4 ) E U LER, Extrait du Mémoire du T. V I I de l'Académie de Berlin, qi note à
L'accord des Lois de la Nature ,. de MAU PERTUIS, IV, p. 24.
LA THÈSE DE MAUPERTUIS ET LE POINT DE VUE SCIENTIFIQUE
219
tion était e n raison constante et inverse des résistances, mais e n raison constante et directe des vïtesses dans les deux milieux (1). Maupertuis, se fiant au Mémoire de Mayran, sur la Réflexion des corps ( 2 ), assimile entièrement les théories de Leibniz et de Fermat, sur les vitesses dans les différents milieux . Il se donne pour tâche de concilier ces théories, ainsi confondues, avec celle de Newton, qu� Clairaut venait d'opposer aux thèses cartésiennes, dans un mémoire à l'Académie « Sur les explications cartésienne et newtonienne de la r�fraction de la lumière » ( 3 ) . Newton expliquant ] a réfraction par l'attrac tion. estimait que les milieux les plus denses, possédant la plus forte attraction. doivent rapprocher le rayon de la perpendiculaire, ce que rexpérience confirme. Mais la vitesse s'accroissant avec l'attraction, il en résulte que la vitesse s'accroît dans les milieux les plus denses et que le rayon réfracté doit se rapprocher d'autant plus de la perpendi culaire que la vitesse est accrue. Conformément à la thèse newtonienne de i' attraction, Maupertuis admet que la vitesse est plus grande dans le milieu plus dense,« c� qui, dit-il, renverse tout l'édifice de MM. Fermat et Leibniz ». Pour opérer la conciliation� il propose de substituer aux p�·jncipe:s de Fermat et de Leibniz, celui de la moindre action. Un cor puscule de lumière passant d'un milieu rare à un milieu dense, ou réci proquement, va d'un point à un autre de manière que la quantité d'action soit la moindre possible. Par là, se découvre que les sinus sont non seulement en raison constante, mais en raison inverse des vitesses, comme le demandait � ewton, et non pas en raison directe des vitesses, comme le prétendait Fermat ( 4 ) . En réalité, l'ignorance où se trouve encore Maupertuis à l 'égard des véritables opinions de Leibniz, relative ment à la vitesse - ignorance qui ne devait se dissiper que plus tard, (1) >, P. IV, 340 ; cf. aussi IV, 1 83. (2) Mémoires de l'Académie des Sciences, 1 723. (3) Mémoires de l'Académie des Sciences, 1739, p. 350 sq. - Cf. BRUNET, op. cit., p. 269-272. (4 ) MAUPERTUIS, Accord des différentes lois de la nature, etc., IV, p. 1 5 sq.
220
LA THÈSF. D E MAU PERT U I S ET L E POINT D E V U E SCIENTIFI QUE
grâce à Euler - l'empêchait de se rendre compte qu'ils aboutissaient l'un et l'autre aux mêmes conclusions. Mais cette similitude n'empêche point une divergence profon. P. I, p. 33 1 .
22 8
LA TH'f:SE DE MAUPERTUIS ET LE POINT DE VUE MÉTAPHYSIQUE
il dispose pour elles en quantité limitée seulement (espace, temps) : « Et ici le temps, le lieu, et pour ainsi dire la réceptivité ou capacité du monde sont pour lui ce qu'est pour l 'architecte Je terrain dont il dispose, et qu'il doit dépenser au mieux pour faire sa construction de la façon la plus convenable qui soit, - les variétés de formes répon • dant à la commodité de l'édi fice et à l'éJégance des pièces. A insi dans certains jeux, lorsqu'il s'agit d'occuper, selon ·certaines lois fixes, toutes les cases d'un tableau, on se trouvera finalement exclu de certaines qui sont plus difficiles, et l'on devra en laisser libres un plus grand nombre qu'on ne l'aurait voulu ou qu'on ne l'aurait pu, faute d'avoir usé d'un arti fice adéquat. Il existe, en effet, une méthode sûre qui permet d'occuper très facilement le maximum de cases » (1). On voit par là que les traits principaux du système physique et métaphysique de Leibniz excluent le principe de la moindre action tel que le conçoit Maupertuis. Réciproquement, ce principe ne peut se poser chez M aupertuis qu'en effaçant un à un chacun de ces traits. C'est indépendamment de tout recours au concept de force vive que Maupertuis dé finit l'action. Elle est pour lui le concept premier , au delà duquel il n'y a pas lieu de remonter, et n'eût été une trad ition déj à établie, il eût dénommé force Je concept représenté p ar la formule msv (2) . S'il accuse le caractère mathématique et purement nominaliste de sa notion, c'est sans doute pour éviter toute confusion scolastique ( 3 ) , mais c'est aussi pour l u i laisser toute s o n indépendance à l'égard d u
( 1 ) P . V I I , p . 303-304. I l faut remarquer que l& masse ou inertie naturelle doit être comptée aussi parmi les conditions de réceptivité du monde. Cf. Théodicée, P. VII, p. 1 19- 1 20. - Cf. plus haut, chap. VI, p . 1 67- 1 68. (2) Essai de Cosmologie, Œu1:res, I, p. XXXIV. ( 1) Après avoir caractérisé la comme une objectivation d'un sentiment interne, MAUPERTUIS écrit : >. Leibniz à Clarke, p. 352. (3) Tout en posant le principe de conservation de la force vive. - Lettres à LEIBNIZ du 29 mai 1 694, et du 24 août 1 694. M. II, p. 177 et 192. (4) > ( 2 ) . Ses efforts demeurèrent vains. La mort de Leibniz, en novembre 1 7 1 6, les interrompit bientôt. Dans la suite, Newton parut savoir peu gré à Conti de son zèle impartial. Comme il avait, à l'insu de Newton , traduit et publié en France en 1 72 5 , avec des observations, une partie de ses Etudes chronolo g iq ues que la Princesse de Galles avait com muniquées, Newton manifes ta une violente indignation . Mais la défense modérée et déférente de Conti devait finalement concilier à re dernier le monde savant d'Angleterre et de France ( 3 ) . Entre �es deux abbés corre�pondants d e Leibniz, dont les initiales D . C . sont les mêmes, s'occupan t l'un e t l'autre de mécanique, d e calcul diffé ren tiel, l'un sectateur d'une physique impliquant selon Huyghens et Leibnizl le mouvemen t perpé tuel, l'autre dont les discussions ou celles de ses am:rs, a très bien jugé, quoiqu'il l.ui aurait été fort aisié d'y parvenir, s'il s'en fut ... vis-6. Comme il aurait été fort aisé à A poUoni.us de parvenir à ! 'Analyse de Des Cartes sur les courbes, s'ïl s'en étoit avisé, etc. » . Post-scriptwn à la lettre du 6/ 1 2 1 7 1 5 de Leibniz à Conti. Gerh. Der Brie/ wechsel, I, pp. 263-2 6 4 . ( 1 ) Ibid, p. 267 . ( 2 ) Conti à Leibniz, mars 1 7 1 6 . ( 3 ) Cons-ult,er également sur cette controverse The h istory of fluxions, by Joseph Raphson, Lon.dan, l j 1 5 el le Recueil de diverses p ièces sur la philosophie, fa religion naturelle . l'l.istoire, la mcthématique, etc . , publié par des Maî.s-ea,ux, Amsterdam 1 720. Un compte-rendu en laLin de cet ouHage paraît dans les A cta Eruditorum de Leipzig, en 1 7 2 1 et met en relief le rôle de l'abbé de Conti " ahbatmn quendam ltalum de Conti, nobilem venetum de q uo admiratione clign a sibi praes,umpta esse aL Hermanno fatetur Leibnilius, etc . » . Au cours d 'une lettro publ iée dans l� Philosc phical Transactions, vol . XXXIII, 389 , 1 7 2 5 ( publié en 1 726), pp. 3 1 5 sqq et relative à la traduction et à la publication en France de son Index chrono'logique, Newton cite le comp!,c-rendu df>s A c ta et se pla int de Conti qui tant qu' il fut en Anglet.erra se p rétendait son ami, tout en aidant Leibniz à engager de nouvelles di!putes contre lui, etc . Le rôle de mécfü.teur n'avait pas réus,si à Conti et Newton comme on le mit lui en gardait tout autre chose que d� la reconna�ance.
APPENDICE 1
241
touchant les expériences de l'optique newtonienne, sont mises par Newton sur !e même plan que les controverses relatives au momement perpétuel ( 1 ) , l a confusion était facile. En fait elle a été commise d'abord par Gerhardt, dans son édition des· OEuvres Mathématiq ues de Leibniz, V , p. 2 34. Gerhardt, sans autre forme de !)rocès, remplace partout dans le titre et le texte du De Linea isochrona, les initiales D. C. par de Conti. Or nous savons, que dans ce texte paru en 1 689, dans les Acta, Leibniz sous ces initiales désigne de Ca telan. - On la retrouve ensuite chez M. Brunschvicg, clans son livre si justement réputé sur Le.,; Etapes de la Philosophie Mathématiq ue ( 1 i-e édition, 1 9 1 2 , p. 2 1 8, note :;:, et édi tions suivantes) : la controverse a,·ec Leibniz de 1687, dans les Nouvelles de la République des Lettres est dite se dérouler entre M. G. G. Leibniz et M. l'abbé de Conti. Elle reparaît enfin che1. M. P. Mouy dans son solide ouvrage sur Le développement de la Physiq ue cartésienne 1 6!J6-1 7 1 2 ( r 934) , p. 2 3 2 ; et chez nous-même dans Dyna mique et Métaphysique Leibniziennes ( 1·93 4), pp. 2 2 , 95. On pouvait penser à un seul et même personnage portant deux noms différents selon l'occasion, comme le cas se présente fréquemmen t aux -xvu• et xvm e siècles. Mais à défaut de renseignements biographiques précis, cette conjecture doit être écartée, car Leibniz dédaigne Catelan, jugé d'ailleurs par tous, - pour reprendre ici une expression de Huysmans qu i paraît lui convenir entièrement, - comme une « belliqueuse mazette » , tandis qu'il estime Conti . De plus, dans l a même lettre ( à Remond , 1 1 février 1 7 1 5) , il parle des discussions qu'il eut « il y a bien des années avec un M. l'abbé Catelan » , tout en priant son correspondant de marquer à M. l'abbé Conti at à M. l 'abbé Fraguier, combien il est obligé de leurs bontés, e t parlan t des merveilles que MM. Hermann et Bourguet lui on t dites de M. l'abbé Cocti (2). Enfin Conti est né en 1 677 à Padoue r t Catelan, dont nous ignorons la date d e naissance, discute dès t68 1 avec Huyghens 1 (3) La cause est donc entendue. La confusion ne se serait peut-être pas produite sans l'initiative malheureuse de Gerhardt ; elJe ne se serait pai! prolongée, si nous possédions ijUr Catelan les détails biographiques qui nous font à l'heure actuelle complètement défaut. Espérons que les auteurs dn nouveau Dictionnaire de biographie française réussiront à combler cette petite lacune. M. GuEROULT. ( 1 ) Cf. Philosophical TratUJactions 1 725, publié en 1 726, p. 3 16 : Newton termine sa tirade sur Conti par ces mots : « But, I hope that these thin,gs, and the perpetual motion, will be the lf&St efforts of this kind. » M . J. A. Vollgraff, l 'un des éditeurs de l 'Mition des Œuvrcs co�plètes de Huyghens, à qui nous devons d'avoir eu l'attention attirée sur la nécP.esité de vérifier l'idootirlé de Catelan et de Conti, en citant oe texte remarque que par ces mots l'identification des deux personnag� semble devenir probable ; mais il s'agit, ajoute-t-il, de la démontrer. Nous remercions M. Voll gr aff de nous avo,ir permis ain..11 i de mettre fin à une confu&ion. (a) Gerh . Phil., III, p. 637 . (3) Sur l'activité générale de Conti, Antonio-SchineUa, cf. Maugain, Etude sur l'ivoluti-On int.ellectuelle de l'lt.alie de 1 6 57 à 1 750, index, p. 387.
APP ENDICE II
SUR TROIS ABBÉS CARTÉSIENS . . . etc . . . (Sui te à la note de Janvier 1 g3,t; (< Sur Deux A bbés Cartésiens q u'on peul co nfondre » ).
M . D. Housla11 , inspecteur général d,•. philosophie, nous en voie à propos de la note que nous avons publiée an Bll lletin de jamier, des renseigne ments pleins dïutérèt. Nous l 'en rl'me rcions cordialement et publions ci-dessous un la rge ex trai t
![Leibniz - dynamique et métaphysique (; suivi d'une note sur le principe de la moindre action chez Maupertius) [*, 2 ed.]
2700733258](https://dokumen.pub/img/200x200/leibniz-dynamique-et-metaphysique-suivi-dune-note-sur-le-principe-de-la-moindre-action-chez-maupertius-2nbsped-2700733258.jpg)


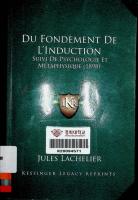





![Leçons sur la volonté de savoir suivi de Le savoir de l'Œdipe [Hautes Etudes ed.]
978020860246](https://dokumen.pub/img/200x200/leons-sur-la-volonte-de-savoir-suivi-de-le-savoir-de-ldipe-hautes-etudesnbsped-978020860246.jpg)
