Le tribut foncier urbain [1 ed.] 9782348062858
Ce livre s'efforce de contribuer à démasquer un certain nombre de fausses cibles : la lutte contre la propriété fon
258 115 40MB
French Pages 290 [300] Year 1974
Polecaj historie
Table of contents :
Avertissement
Introduction
I. Analyse du cadre bâti
II. La production capitaliste du logement
III. Le tribut foncier urbain
IV. Lutte des classes et politique foncière
Postface
Annexes
Citation preview
ALAIN
LIPIETZ
Le tribut foncier ‘urbain documents et recherches d d’économie et socialisme 6
documents et recherches
ge
d'économie et socialisme» 6
COLLECTION PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE CHARLES BETTELH AVEC LA COLLABORATION DE JACQUES CHARRIERE
173
“
«4
rie
alain lipietz
le tribut foncier urbain circulation du capital et propriété foncière dans la production du cadre bâti
FRANÇOIS
MASPERO
1, place Paul-Painlevé, V PARIS
1974
© Librairie François Maspero, 1974
a CRAN
mr ner ete
Avertissement Le texte qu'on va lire eut pour première version une étude effectuée au printemps 1971 dans un cadre universitaire. Cette étude n'a été remaniée que sur des points de détail, sauf en ce qui concerne son « cœur », la troisième partie, qui restait alors trop marquée par « l'ordre de la recherche ». Élle est ici reprise « dans l'ordre de l'exposition », conformément à un article paru dans la revue La Vie urbaine sous la signature d'A. Juillet. Ce livre garde donc un tour universitaire, voire théoriciste, et n'est pas directement utilisable par les femmes et les hommes engagés dans les « pratiques urbaines ». Je ne pense pas cependant qu'il soit totalement inutile, ni par rapport à la pratique, ni pour le développement propre de la théorie. Certes, dans le rapport théorie/pratique, la pratique a toujours le rôle déterminant, Mais précisément elle détermine la théorie comme moment nécessaire. La théorie est une étape indispensable si on ne veut pas se tromper de cible. Précisément, ce livre peut contribuer à démasquer un certain nombre de fausses cibles, à en finir avec un certain nombre de mythes, à liquider certaines attitudes. Quelques exemples, développés de façon parfois provocante : — Il n'est pas vrai que la lutte contre la propriété foncière soit une lutte anticapitaliste, que la municipalisation ou l'étatisation des sols soit une revendication spécifiquement socialiste. Au contraire, cela peut être également le mot d'ordre de certaines fractions du capitalisme moderne, dirigeants de grandes entreprises privées ou publiques, technocrates aussi bien « autogestionnaires » que « jacobins ». Il n'est Le
soit guidée
vrai que la politique des hommes au pou-
par le service
des
intérêts
d'une
bande
de
forbans avec lesquels ils auraient partie liée : requins, grands monopoles ou promoteurs véreux. En particulier, il faut en | finir avec le mythe d'un Chalandon-Ubu qui n'aurait vu dans
sa charge ministérielle qu'un « fromage à partager avec ses
E
—
voir
8
le tribut foncier urbain
petits copains ». Ce mythe accrédité tant par Le Canard Enchaîné, que par les grands partis réformistes ct par des groupes soi-disant où mème réellement révolutionnaires, doit être relégué
au magasin
des
accessoires
de ce que Marx
appelait
« le socialisme des imbéciles ». Faute de procéder à une analyse scientifique, on en reste à l'invective contre « la France du Fric», et on se trouve désarçonné, contraint de crier « menteur », quand un adversaire se range sur votre position et la défend avec conséquence! Et on s'aperçoit qu'on a travaillé pour le Roi de Prusse. Mais dans la pratique de la théorie elle-même, deux erreurs
sont
théoricisme. Le
à éviter,
dogmatisme
teurs » et
intimement
reprend
les rabâche
hors
les
de
liées
: le dogmatisme
«textes
propos.
Or
sacrés
des
les textes
et le
fondasacrés
peuvent être totalement inadaptés pour le cas où on les É plique (quand ils n'étaient pas déjà faux sous la plume de leurs auteurs, Ça arrive !). Et on récitera ainsi que « le prix du sol est la capitalisation de la rente», sans remarquer qu'on ne « récolte» pas un immeuble par an sur le même terrain. Nous verrons que pour construire la théorie du tribut foncier urbain, il nous faudra d'abord remettre en cause point par point l'analyse par Marx de la rente agricole (rente absolue, rente différentielle 1 de fertilité, de situation, rente différentielle 2). Le théoricisme
conçoit
la « pratique
théorique » comme
autonome, trouvant en elle-même ses critères de validation,
sans rapport avec la pratique de la production ou de la lutte des classes. Inutile de citer Mao Tsé-toung. Je puis honnétement certifier que je n'aurais pu mener à bien cette recherche théorique si je n'avais pas été moi-même impliqué dans ces pratiques sociales, en observateur curieux du côté du manche, en « citadin » engagé du côté de la cognée,
Enfin, la problématique théorique elle-même n'est jamais
neutre politiquement. Après un an et demi de discussions autour de mon premier texte, et surtout, après la lecture du texte de Pierre-Philippe Rey sur L'erticulation des modes de production, j'ai mieux compris l'importance d'un livre comme
celui
d'Engels
sur
La
question
du
logement,
j'avais d'abord trouvé bien faibles les développements
riques,
postface
el il m'a
paru
urgent,
en
avril
fixant le statut thévrique
et leurs implications politiques.
dont
théo-
1973, de rédiger une
des concepts employés
avertissement
9
Que tous ceux qui m'ont aidé, par leurs remarques, leurs estions et leurs critiques, reçoivent ici mes remerciements. e remercie en particulier les camarades de l'Ecole des Beaux-Arts, dont les interrogations sur la question foncière me poussèrent à entreprendre l'étude systématique du problème, ainsi que Christian Goux qui, m'accordant sa confiance, me permit de la mener à bien. Je remercie également Charles Bettelheim qui, lors de la rédaction de cette édition, voulut bien m'en signaler les passages ambigus ou méritant lus amples développements. Enfin je remercie Geneviève Lipietz ct Catherine Genesti sans qui la publication de la première version (donc sa diffusion et sa discussion) aurait été impossible.
Mai 1973.
Introduction « Notre Socifté — peut-être en cela, suis-
je marxiste — est subjuguée par Îes forces de production, dominée par la nécessité du vrojit et par les lois du marché.»
Albin CHALANDON'.
S'il est un point d'achoppement classique des théories économiques, conune d'ailleurs des discours idéologiques et des interventions politiques qui s'appuient sur elles, c'est bien la question du prix des sols urbains. Nous verrons que la raison en est très simple : le « prix du sol » n'est pas un pur
fait économique,
l'existence
et le niveau
de
ce prix ne
cadrent pas avec les discours justificatifs habituels de l’économie capitaliste, et les doctrines usuelles au gouvernement des sociétés bourgeoises sont impuissantes face à un phénomène qui apparaît bel et bien « étranger ». L'échec le plus frappant est celui de la théorie économique dominante, celle que l'on appelle, avec un certain flou, ct pas toujours judicieusement, « néo-classique » où « marginaliste ». K. Marx gratifiait généreusement ses premières
ébauches (Bastiat, Carey) du nom
flatteur d’« économie
et Ricardo, ces authentiques
dont
vulgaire ». Pourquoi vulgaire ? Vulgaire, parce qu'elle s'en tient à l'expérience immédiate du phénomène, sans viser à expliquer le phénomène apparent par l'essence cachée, à e briser l'os pour trouver la substantifique moelle». Vulgaire, parce qu'elle constitue une régression par rapport à Smith
savants
pourtant
Marx
critiquait les théories. Et non pas vulgaire parce qu'elle s'en tiendrait au langage du commun : au contraire, jamais discours n’a poussé aussi loin le culte de la formalisation ma thématique pour la formalisation. 1. Discours du ministre de
l'Equipement et du Logement au XI* jour
mondial de l'Urbanisme,Rime D novembre
1970
Equi,
nt, Lo-
gement, Transport, n° 55). Délgué qus Ln oulte come à DÉCEUS de ».
| !
|
12
le tribut foncier urbain
De quoi s'agit-il ? D'une explication de la cohérence su
posée de « l’économie » par sa représentation comme jeu deux types d'agents : les producteurs et les consommateurs.
Les producteurs «ont» un comportement : ils maximisent leurs profits. Les consommateurs en «ont» un autre : ils maximisent leur « satisfaction ». Ces deux comportements sont
formalisables,
pour
chaque
agent,
sous
forme
de deux
deux
groupes
types d'équation : les équations de production et les équations de satisfaction. (On peut trouver d'ailleurs des formalisations plus modernes en termes d’ensembles convexes et de relations
de
préordre.)
En
combinant
les
d'équation, on peut produire deux théorèmes
:
— il existe un système des prix attachés aux différents biens tel que, si chaque agent poursuit ses propres buts en ne
connaissant
du
reste du
monde
que ce système
il y a comptabilité de tous les comportements, tout ce qui est produit est consommé;
de prix,
équilibre
— cette situation est un «optimum» par rapport au « critère de Pareto» : celui où «Ça va mieux» quand ça va mieux pour au moins un agent, et pas plus mal pour les
autres.
Cette théorie est apparemment impartiale : elle concède autant d'importance à l'offre qu'à la demande! Elle s'oppose ainsi aux théories classiques et marxistes a accordent
un rôle déterminant à la production, à l'offre.
effet, tout
le monde peut s'accorder sur les « fonctions de production », qui relèvent de la technologie. Tout le contenu spécifique de la théorie néoclassique porte donc sur l'affirmation, comme fondement de l'économie, des «fonctions de satisfacton »,
c'est-à-dire sur la psychologie
individuelle des consomma-
teurs considérée comme donnée irréductible. L'économie apparaît donc comme une branche de la psychologie, tout comme
la chimie
moléculaire
une branche
de la mécanique
uantique, qui lui assigne son fondement (l'équation de hroëdinger). On touche justement ce point du doigt quand on s'atta-
Los au problème du prix du sol urbain. Ici, nulle production.
1 existe un stock, que les consommateurs doivent se répartir sur le marché. Toutes les théories néo-classiques du prix
du sof se réduisent donc, quant à leur contenu, à la formu2. Telles
qu'elles
sant
notamment
l'IAU.R-P. (Étude de P. MERLIN : « citée sous ce titre.)
dans
les Cahiers
de
d'urbanisation ». Elle sera
:
D po25 néo-classique.
toute la démarche néo-classique vient trébucher. D'abord, aucun psychologue scientifique (si toutefois existe une psychologie scientifique) n'osera reconnaître comme adéquates les différentes formulations de la «fonction de satisfaction » qui servent de point de départ à Wingo, Alonso ou Mayer. Il est même douteux qu'ils acceptent l'idéc d’une fonction de satisfaction. Qu'à cela ne tienne : tout le débat étant porté au niveau des développements mathématiques, les économistes n'ont plus de temps à perdre à discuter des hyopthèses. Pour reprendre notre comparaison, ils développent une théorie chimique fantomatique, totalement autonomisée rapport à l'indice de vérité des hypothèses physiques. C'est pourquoi il est bien difficile de discuter avec un Lui ferez-vous observer que ses hypothèses
de
base n'ont que peu de rapport avec la réalité, que dans les faits ça ne se passe pas du tout comme ça? Il vous répond aussitôt que ce n'est rien, qu'il n'y a qu'à modifier les fonctions de satisfaction, y intégrer quelques variables de plus —
encombrement,
lui est
appliquée.
utilités externes,
etc. —,
que
ce qui
principe
qu'est
ues
lation des « fonctions de satisfaction ». Sur ce cas extrême,
2eme
13
re
introduction
par
l'énoncé
de
ce
porteurs
du
Plan, aient rapidement
préféré
se lourner
vers
LT
C'est
fondée la mécanique moderne, en rupture avec l'énoncé aristotélicien, proclamé faux : F = m v, la vitesse d'un corps est proportionnelle à la force qui lui est appliquée. Que penserait-on d'un théoricien qui nous dirait « v, +, qu'importe! Ça ne fait que compliquer les développements mathématiques ! »? C'est pourtant bien l'attitude néoclassique, qui, après avoir formalisé sommairement le comportement apparecemment autonome de agents, s'en tient au formalisme des développements pour critère de vérité. Dès lors, que leur importe qu'il n'y ait pas de « marché des sols » ? Que la morphologie des villes ne reflète pas les résultats de leur modèle ? Qu'il n'y ait pas d'équilibre, mais une crise permanente? Qu'il n'y ait pas optimalité, mais anarchie ? doctrine du « laissez faire », la propriété garante de la liberté et du bien-être, restent les dogmes logiquement induits de leurs conclusions. Tout juste concéderat-on que quelques taxations judicieusement appliquées pourraient corriger la « non-convexité » et les « externalités » de leurs modèles. Dans ces conditions, on comprend que les «responsables» de la pe foncière de l'Etat, ministres ou rap-
x
. importe, c'est le développement mathématique. Et pourtant, toute l'habileté des formulations eulériennes ou lagrangiennes de la mécanique rationnelle ne change rien à son contenu fondamental, au principe énoncé par Newton : F = m #, l'accélération d'un corps est proportionnelle à la force qui
14
ie tribut foncier urbain
une approche plus empirique ou « sociologique» du problème, quitte à donner au passage un coup de chapeau à la théorie économique officielle, même si elle ne rend aucun compte des faits exposés dans le reste de leurs rapports’. t que vous disent les classiques (Ricardo) et les marxistes ? Ils ont produit une théorie pénétrante du prix des sols
agraires, théorie dont la validité est encore unanimement
re-
ment
les
connue. Encore fallaitil que Marx parachève la théorie de la rente de Ricardo, pour que soit expliquée l’existence d'un «prix du sol» dans le cadre d'une théorie qui fonde la valeur des choses sur le travail nécessaire à sa production. Et encore, nous le verrons, Marx ne poussa-t-il pas assez loin la critique de la théorie de Ricardo pour bien dégager le caractère non-strictement économique, ou mieux, non purecapitaliste,
implications.
de la rente
agricole, et en
tirer toutes
5
Malheureusement, et mis à part le petit livre polémique et politique de Engels, La question du logement, nous
ne disposons pas d'une théorie équivalente pour le cas du
sol urbain. Le but de cette étude, c’est de la produire. Comme bien d'autres, j'ai d'abord che: la solution de facilité, la transpositon terme à terme du Livre III du Capital : remplacer « froment » par « logement ». Et comme
bien
d'autres,
mentaux
:
j'ai échoué,
butant
sur deux
obstacles
fonda-
— pour passer de la campagne à la ville, il faut trouver l'équivalent du capital du fermier dans le cas du logement :
donc
procéder
à une
analyse
concrète
des conditions
de
la production du cadre bâti urbain. Et elles ont bien changé depuis Marx et Engels!
— pour passer de la campagne à la ville, il faut trouver
l'équivalent des conditions faites à la donc procéder à l'analyse concrète de
production du blé : la valeur d'usage du
cadre bâti urbain, de sa place dans la reproduction sociale. Et elle est bien différente de celle du blé! 3. J'aurai à citer fréquemment: — Les rapports des grou] de prospoctives Re Hliau Plan publiés nur éitions Anmand Col dunsils série = Lans et Prospectives ». Je désignerai les tomes 1 et II par Les villes ct Le logement; _— Le rapport de la Commission des problèmes que je citerai comme Rapport Bordier;
fonciers du V* plan
— Le Rapport de la Commission des Villes du VI< plan, désigné ici comme Rapport Piron.
|
El
introduction
15
Il faut donc tout reprendre à zéro. Reléguant en annexe les résultats (sur l'agriculture) de la méthode générale de , il s'agit maintenant de ne plus garder en tête que la méthode, et de nous attaquer successivement d'abord aux deux problèmes : pourquoi faire, des villes ? Comment les produit-on? Et c'est seulement dans une troisième partie que nous toucherons au cœur du problème, à ce que j'appelle le « tribut foncier urbain ». Ce « tribut » est lc résultat de violentes contradictions sociales : nous examincrons pour finir comment celles-ci se sont déplacées dans l'histoire de la formation sociale française Est-il besoin de préciser que les deux premières parties n'ont rien à voir avec les deux premières parties d'un manuel d'économie néo-classique? Il ne s’agit pas de voir
d'abord « la théorie du consommateur », puis « la théorie du
> avant de passer à la « théorie de l'équilibre ». s'agit de voir quelle place la reproduction sociale, ellemême déterminée par les lois générales de la production capitaliste, assigne aux produits d'une branche particulière de la division sociale du travail, puis d'examiner les conditions spécifiques de la production dans cette branche, avant
de procéder à l'analyse des incidences, sur la reproduction . - cette production, de l'existence de la propriété fonCette étude a donc pour ambition d'explorer une petite zone du domaine du matérialisme historique, siège de contradictions (d'ailleurs secondaires) entre fractions du bloc dominant. C'est donc le matérialisme historique, exclusivement en tant que science des formations sociales, en tant que « physique sociale », qui sera son cadre théorique, dans tion que lui ont donné ceux qu'ailleurs nous avons désignés comme la Nouvelle Ecole Française‘. ous serons alors amenés à comprendre la constitution des villes, la croissance urbaine ct l'évolution du prix fonciers non pas comme des « faits économiques », mais comme des produits de l'ensemble des rapports sociaux, en somme, principalement, comme des «faits politiques », et à substituer à la notion pseudo-économique de «prix du sol» le concept de « tribut foncier urbain »,
4, .N s'agit notamment de L. ALTHUSSER ct E. Bazisar dans Lire le Capital, de C. BeTTELHEIM dans Calcul économique et formes de proé et de N. POULANTZAS dans Pouvoir roue ei classes sociales. études seront évoquées par le nom de
auteur.
I
Analyse
du cadre bâti
Introduction Dans la production de leurs moyens d'existence, aussi bien que dans la distribution de ces moyens en vue de la jouissance, les hommes entrent dans des rapports détermi-
nés. Ces rapports sont structurés à dillérents niveaux, aussi
mange (structure des rapports entre les producbien teurs directs, les moyens de travail et les non-producteurs),
reproduction de la politiques (structures de régulation de la 3-1 (articulation des discours formation sociale), ae
sociales). justifiant des pratiques Une structuration typique des rapports économiques (rapports de production), rendue possible par une structuration donnée des rapports de l’homme à la nature (forces productives), nécessite
en vue
de son maintien,
un
type déterminé
d'Etat ct inspire une idéologie elle aussi typique. L'ensemble constitue
un
« mode
RREE paré formation sociale.
En
fait, une
« possible »,
de production », structure
(comme on dit chimiquement purc) de
sociale,
formation
de
par
sa
généalogie
cuncrète, est toujours complexe, combinaison originale de survivances archaïques et d'éléments de mode nouveaux en voie de structuration, mais avec un mode de production dominant, perturbant la typicité des modes dominés, imposant à la formation sociale son caractère (ce qui exclut tout « glissement progressif » d'un mode à l'autre). La formation sociale française est dominée depuis plus de deux siècles par le mode de production capitaliste
(M.P.C.) qui a succédé au mode de
(M.P.F.)
production féodal
à travers une phase de transition (l'époque de l'absolutisme) qui s'est conclue par la Révolution française.
Le
M.P.C.
producteurs
est
fondé
directs
moyens de production listes, au double sens
(les
sur
une
séparation
prolétaires
c:
ouvriers)
lète
des
d'avec les
qui sont entre les mains des capitade la propriété (affectation des ge
réelle (mise en œuvre, direction, duits) et de l'appropriation du procès de production). Au cours du procès de production, ces
rapports
se reproduisent
c'est-à-dire
que
leurs
agents
sont amenés à garder la même place dans la structure, et
introduction
19
une même pratique sociale : d'où une nette autonomie de J'économique et du politique’. Il est donc possible de bâtir une théorie économique relativement autonome du capitalisme : c'est ce qu'à fait Marx dans « Le capital ». J'ai renvoyé en Annexe 1 les principaux résultats de cette théorie, avec la terminologie que j'adopte ici. C'est au niveau politique que vient se refléter et se traiter le maintien de l'unité de la formation sociale dans le cadre des intérêts à terme des classes dominantes (c'est là que s'inscrivent les luttes et l'équilibre entre capitalistes et prolétaires, mais aussi entre classes dominantes des différents modes). Notamment c'est par le biais du A (de Ja force et du droit) qu'est assurée, dans le m de production féodal, l'appropriation du surtravail du producteur direct par le féodal ou par ce qui en reste dans le mode de production capitaliste, le propriétaire foncier. En revanche, dans le mode de production capitaliste, le niveau politique dispose d'une autonomie relative par rapport aux autres instances. C'est-à-dire que les « mesures » proprement politiques peuvent aller à l'encontre de tels intérêts imunédiats de certains capitalistes, pour sauvegarder les intérêts à long terme du capitalisme. Ces « mesures» peuvent d'ailleurs consister en une intervention dans l'économique
(nationalisations,
etc.)
ou
dans
l'idéologique
(uni-
versité, etc.Ÿ. Concrètement, la Nouvelle Ecole Française (Althusser, Poulantzas) a beaucoup insisté sur les appareils, institutions, servant de centre du pouvoir politique ainsi compris, donnant par là même un sens très large aux mots « appareils d'Etat» (l'Etat,
mais
aussi
l'Eglise,
la Grande
Presse,
etc.).
Mais clle n'épuisc pas pour autant la portéc du « politique ». Car il existe d'autres « canaux» par où est assurée la cohésion d'une formation sociale, exprimant plus immédiatement l'imbrication des structures des différents modes et des cifférentes instances, et contribuant directement à la régulation de la pratique des agents. Et le réseau de ces canaux est finalement, parce qu'invisible, implicite, le garant le plus solide de la reproduction sociale : il est en quelque sorte la reproduction en acte. 1. Voir Balibar et Poulantzas. "2 HOUR interventions de l'Etat relève de l'étude des forma-
tions
è
, ct non
du
M.P.C. et de ses stades. En particulier, la
théorisation hâtive d'un « Capitalisme Monopoliste d'Etat» succédant
au capitalisme manopoliste ne vise que
NPC an
de
: care
certain stade
capitalistes.
1e
la pratique de certains
Nos
‘internationalisation
Etats
rapports de pro-
20
le tribut foncier urbain
. C'est le cadre de vie, ensemble de structures, d'institutions el de pratiques qui reflètent la totalité de la formation et modèlent en permanence la pratique des agents. Dans la formation sociale à dominante capitaliste, le cadre de vie dominant est la Société Urbaine.
. À la suite d'Henri Lefebvre, je dirai que l'urbain est po-
litique en ce sens qu'il joue le même
politique
(sous
une
forme
moins
rôle que le proprement
immédiate),
tant
vis-à-vis
des structures que des pratiques sociales’. C'est-à-dire que l'espace urbain n’est pas un lieu neutre où se déploie une pure technicité rationnelle. Cette conception qui prévalait à l'époque des premiers plans quinquennaux tend à être dépassée explicitement par les « responsables ». Comme le remarque Lefebvre! l'espace est tique et le VI‘ Plan en tient compte” : « Si le phénomène de lab nisation est une donnée, l'organisation et la physionomie des villes sont, par contre, des constructions. Même si les agents
qui font la ville sont multiples, ce sont les hommes qui font
la ville [...] Les modalités de construction des villes ne sont plus à ce titre des données, mais des résultats des volontés explicites ou implicites d'individus ou de groupes. » « Corrélativement à cette réflexion, il faut lier intimement les phénomènes techniques, économiques, sociaux, et les décisions du pouvoir politique. En effet, dès lors que le développement des villes dépend de multiples agents, il est inévitable que naissent des tensions ou des conflits. S'agissant d'idéaux vu d'intérêts parfois concordants mais souvent posés, mettant en jeu de grandes collectivités, il est clair que les problèmes posés par la nature, le champ des prérogatives et les moyens des pouvoirs politiques deviennent cruciaux. »
3. 11 re faut
voir là qu'une notion
pratique non encore élaborée,
un problème désigné à l'analyse, Le «cadre de vie» (2t notamment l'urbain), estce une instance « régionale» à part entière (comme la politique), ou un champ de pratiques et de structures combinant les
diverses instances ? Il n'est pas sûr d'ailleurs que l'appareil analytique rigide d'un Poulantzas (en notamment sa très contestable distinction
entre un Champ de structures et un champ de pratiques) soit très adapté au traitement du problème. 4, « Réflexions sur la Politique de l'Espace », in Espaces et sociétés,
NUE
5. Les Villes. On remarquera le tour histariciste, « sur-politisé », Il est vrai que ce rapport invite à une politique volontariste en urbanisme.
De
7
+ CRE ARE S
MD
MST
ee +
F
Pourquoi la ville ? Ville-Temple, Ville-Forteresse, Ville-Palais, d'époque en époque les traits dominants (les formes principales) de l'évolution d'une ville (le « stock » est laissé en héritage) sunt déterminés par les impératifs du mode de production dominant. Le « nerf » du mode de production capitaliste, c'est la concentration et la coopération complexe en vue de la production pour la production de plus-value. La contradiction fondamentale du mode de production capitaliste, c'est la contradiction entre le caractère de plus en plus socialisé du travail productif et le caractère privé de l'appropriation du produit. Cette contradiction se traduit pour le Capital en deux problèmes économiques majeurs : la difficulté croissante de réaliser la plus-value, la baisse tendancicilc du taux &
&
i
La société urbaine du xx‘ siècle se présente comme un reflet de la structure du mode de production capitaliste et de ses impératifs, une réponse (une parade stratégique) instable à son jeu de contradictions. Ce reflet, cette réponse, se présente sous la forme d'une D structurée, qui est la « valeur d'usage » de la
e.
1. La VILLE DANS LA STRUCTURE DU M.P.C. : DIVISION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE L'ESPACE
Agglomération en vue dc produire : c'est le caractère prindes villes du xrx° siècle (ct dans tous les pays traversant une phase d'accumulation du capital). Cette phase de la ville (pôle d'attraction des foules campagnardes prolétarisées chassées par la destructur de la société ation rurale) va de
22
le tribut foncier urbain
pair avec la phase de « soumission formelle »* du travail en capital. Elle se caractérise par :
— L'apparition de «lieux» spécifiques de la production
manufacturière, déterminée par les impératifs de l'économie
spatiale (proximité des matières premières, des moyens de
communication).
Une fois le processus amorcé,
tion du travail appelle la
la socialisa-
poursuite de cette concentration géo-
graphique : la ville est le terrain d'élection des «effets externes ». De même, à l'écart des bruits du port et de Ja forge, se constituent des licux de commandement des affaires, économiques
et financières (la « City »);
— un rassemblement de vastes foules prolétaires, à loger tant bien que mal, et qui ne sont 1 qu'en vue de reconstituer leur force de travail de Façon à pouvoir continuer à produire. Leur logement est un « coût social d'exploitation », contrairement à celui de la bourgeoisie et des classes dominantes, qui est un moyen de jouissance qui compte
comme
« revenu ».
Deux conséquences : — La division technico-économique du travail qui règne
au niveau des forces productives et des rapports de [sc duction se redouble en division technico-économique de l'espace (D.T.E.) : ici le port, là la fabrique, là les bureaux, là le logement ; — la division sociale du travail, qui règne au niveau des rapports sociaux de production, se redouble en division sociale de l'espace (D.S.E.) : ici logent les patrons, là les ingénieurs, là les ouvriers’, 6. La distinction entre « soumission formelle» et + soumission réelle» du travail au capital se trouve chez Mazx dans le 6° Chapitre du Capital. Elle recouvre, à un autre niveau d'ennse, la périodisation
(manufacture, fabrique, automation) du Livre 1. Le capital commence
par soumettre
«les modes de travail tels qu'ils étaient avant que n'ait
surgi le rapport capitaliste », les concentrant sculement
tinction à propos du bâtiment.
duas un même
Toutes les considérations d'ordre gé-
néral de Marx sur le M.P.C. sont tirées de ce Chapitre inédit du «Capital, édition 10-18. T1 concentre tous les fils qui se trouvent dispersés
dans Le capital et les
« doctrines sur
la plus-value »,
ER a NC es Me a pe os la Loire, de la Région Parisienne) depuis 100 ou 190 ans est éloquent
!
pourquoi la ville ?
23
Cette double structuration se combine en une division économique et sociale de l'espace, effet sur la société urbaine de la totalité des instances de la formation sociale. Cette D.E.S.E. a un rôle central pour nous : elle est le « terreau » de la rente urbaine. a. Villes et campagnes La D.E-S.E. au sein de la ville repose sur une première division radicale : villes el campagnes. Celle coupure structurelle (deux mondes
à part’) est globalement
déterminé
his-
toriquement, tant par le niveau des forces productives (la capacité de nourrir les citadins) que par les rapports de production (le besoin des classes dominantes
que les produc-
teurs soient ici ou là). Quant à ses limites précises, géographiques, elles sont à tout moment fixées, à la fois matériellement
(voirie) et administrativement
b. La
division
(périmètres
technico-économique
de
urhains).
l'espace
La division technico-économique de l'espace est doublement déterminée techniquement et économiquement par la
38 gé
tate en effet que l'implantation de l'habitat a été commandée de l'usine, autour de
it on,
et
puis,
au
petit
le s'est élevéz d'abord la maison
bonheur
la
chance,
ou
plutôt
au
petit
ce
la mauvaise chance, les logements des ouvriers » (Discours de
Reims).
8. Dans
la version
de
1971, je parlais
de
| cialke de l'espace». Cela avait l'inconvénient
« division
technique
ct so-
de laisser supposer qu'il
existe des «impératifs techniques », neutres par aux rapports économiques et sociaux. Illusion qui se rattache à la conception quan-
titativiste du + niveau ces forces productives ». L'évolution de la
Chine
a bien mis ces points en lumière. Voir par exemple « Processus révolutionnaire et organisation de l'espace en Chine. Vers la fin des séparations entre villes et campagnes» de Micheline Lucciont, in Espaces et sociétés, n° 5. 9. « Deux mondesà part» est une expression inexacle. D'abord
parce ue ces deux mondes re sont pas auto-suflisants, ils s'insèrent un processus de reproduction commun, où la ville tient le rôle DPrPMrE Ensuite parce qu'il existe des aires dominées par le capi-
1
où la coupure est moins franche
: le Nord, la Hollande,
etc.
Éqt
€
l'ensemble des conditions de production
leur statut économique, de production et à la
Les routes, ports, etc. sont alors du capital fixe,
fonctionnement
du
capital
constant
circulant,
et
le
du capital variable, servant à la reconstitution de la force
Ce point de vue est pour le moment notionnel, une Lies
C'est
cependant dans cette voie qu'il faut creuser pour construire sur des bases solides une théorie générale des investisements publics. Mais RE métaphorique des concepts du capital ne doit pas nous faire oublier que, même s'ils entrent dans la reproduction capitaliste, un nombre de ces éléments sont produits sans viser directement
profit et distribués de façon non-marchande.
Comme
dans son chapitre des Grundrisse sur les transports, produit sur son Revenu, non sur son Capital.
le note Marx
la
Société
les
Eu fait, on retrouve ici un problème plus général : celui de Ja
consommation productive au sein du procès de reproduction immédiat (privé), problème que Marx effleure très souvent dans « Le Capital »
Sans jamais le traiter à fond (voir par exemple P.P. Rey, Sur l'erticulation des modes de production,
Ron
social
société marchande,
F. Maspero, p. 106-111). Pour
; ne avoir parfaitement saisi ce résente
comme
production
ke
privée »,
le traiter
cs ES
l'essence
NE RS
La ville comme agglomération pour produire, se présente en quelque sorte comme un # coût d'exploitation » social, comme une immense agglomération de capital constant particulièrement fixe” et de capital variable immensément exigeant (surtout à l'époque actuclle, on le verra au chapitre I).
à
a. Le financement publique de la ville
28
le tribut foncier urbain
À ce titre, la croissance urbaine précipite la baisse tendantielle du taux de profit global. En revanche, pour chaque capitaliste particulier, s'il peut considérer la ville comme un « don » gratuit, sa présence dans la ville est source d'économies en investissements particuliers, et comme on le verra,
en temps de circulation du capital.
Ce problème classique (divergence entre l'intérêt de chaque capitaliste privé et du Capital général) requiert l'intervention de l'Etat, qui prend à sa charge une grande partie des coûts. Cette prise en charge peut sc faire de plusieurs façons, par exemple par la budgétisation de certains équipe-
ments
soustraits
à la circulation
marchande
(services
« gra-
tuits ») et par la nationalisarion où, sous contrôle de l'Etat, des sociétés fournissent des services vendus au prix de re-
vient, c'est-à-dire sans récupérer
leur part de profit, voire de
façon déficitaire”. D'après le rapport de la commission des Villes du VI: Plan”, la structure des investissements du développement urbain est la suivante : —
40 %
pour
—
34 %
pour l'aménagement
—
26 %
pour les services urbains.
l'Etat
les transports, dont 40 %
à la charge de
foncier, à 90 %
publiques
(surtout à la charge des collectivités locales)
Sur ces investissements, 82 % sont « productifs », 18 % des acquisitions de terrain. é Prenons le cas des transports. C'est par leur niveau de développement qu'est assuré par exemple l’homogénéité du marché du travail parfois retenue comme critère de l'unité d'une agglomération. Que ce sait par le biais des régies de transports en commun, équilibrées ou déficitaires (c'est-à-dire une intervention du type «nationalisation»), ou par la construction de coûteuses infrastructures routières laissées tuitement aux usagers (donc aux entreprises qui les emauchent), l'Etat intervient sur le coût de la force de tra16. Voir l'artice d'Alain JUILLET dans La Vie urbaine, 1971, n° 3 : « La
place
des
transports
dans
la ciculation
du capital.»
Il va de soi que
les fonds de l'Etat, sauf infletion, ne sont qu'une part de la éné
plus-value
Son bien: prévus suu:le maire cave til ÉOQIE donc Een ert volontariste, opérant conjonciureliément au profit de telle couche sociale.
. Ce rapport désigné la suitc comme VI* Plan, tout sim: ge ml vie ne at plement. Il de 7 Pi document
D Des ES nom.
A
pourquoi la ville ?
29
vail. Dans le cas des aménagements pour l'automobile, c'est de plus au profit des entreprises de cette branche qu'il agit". Enfin, ce type d'investissement est créateur de « rente différentielle », mais comme nous le verrons, en l'état actuel, ce n'est pas le but toujours
recherché...
De même, la constitution du secteur du logement social (HL.M.) répond à la nécessité politique d'élever le niveau qualitatif du logement sans diminuer le taux de plus-value. De même les premiers investissements de mise en valeur contribuent à élever la « rente différentielle ». Tout cela sera examiné à son heure. Il faut
souligner,
dans
la ligne
de la note
(14), le carac-
tère conjoncturel de cette politique urbaine. Financièrement elle est fondée sur des transferts. Quand se présente une plus
haute urgence (la politique d'industrialisation du VI* Plan), on voit se reserrer les crédits au logement, et le Schéma di-
recteur de la Région parisienne se voit « contracté » en rentabilisation des infrastructures déjà existantes.
b. La « ville spectaculaire marchande »
« La richesse des nations où règne le mode de production
capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. » Ainsi commence Le capital. Aujourd'hui (et déjà à l'époque de R. Luxemburg) le problème de la réali-
sation de ces marchandises est devenu principal. De même que le capital, après avoir soumis formellement le travail, a
bouleversé réellement le procès de travail, de même après avoir investi formellement le procès de circulation des marchandises,
qe
il l’a entièrement
remodelé
et il n'a
pu
le faire
imposant sa domination sur l'ensemble de la vie quo-
Ne se contentant plus comme jadis de trouver aux colo-
nies des débouchés pour ses produits, il a «colonisé la vie
quotidienne »*. Produire pour produire, vivre pour consommer. La marchandise envahit tout le cadre de vie, réifiant Ja vie même en lui imposant sa logique. La vic quotidienne est réduite en succession de rôles (Producteur — Cher auditeur
—— consommateur) qui s'inscrivent directeiment dans le cycle 18. Cette intervention
relève du
phe suivant. Elle est
ticu-
lièrement flagrante aux U.S.A. et M. Merlin dans son étude Mer dèles d'urbanisation » relève ironiquement le parti pris de l'étude de la
Rand Corporation pour les transports individuels (l'étude était financée par Ford). Ainsi s'explique le refus de fait d'accorder la priorité aux transports en conuuuu, irratiounel d'un simple point de vue technotique.
19. Voir Henri Lerrevre, La vie quotidienne dans lc monde moderne.
30
le tribut foncier urbain
de rotation du capital. « Le capital, à son cumulation, est devenu pt ao »* La
= ms
é suprême d'ac. spectacle
c'est la ville. .… La ville est un théâtre qui modèle la vision du monde des citadins, les informe de leur rôle à tenir dans l’ordre capitaliste. L'urbanisme apparaît alors comme une idéologie, comme l'ont bien montré les situationnistes. Le spectacle de la
ville est le « ciment
société urbaine.
idéologique », au sens de
Gramsci, de la
« La ville prend une forme objective totalement étrangère aux individus, l'espace urbain est accaparé, totalement mobilisé par le système de production tout entier [..], la diminution d'espace public ne trouve plus de limite que dans quelques fonctions économiques indispensables [..] : l'espace public est un espace commercial", » La ville est d'abord une vitrine, avec ses grands magasins, ses devantures luxueuses qui confèrent une rente différentielle particulière au front des avenues (cf. ILI° partie). Mais
le spectacle est surtout
dans la rue et les
quartiers
: la vie
urbaine est une vie en représentation. C'est bien connu en ce qui concerne les U.S.A., mais il suffit de jeter un coup d'œil sur la publicité de Parly II et autres opérations (par exemple du quartier Italie). Cette vie en représentation vient à son tour surdéterminer la division sociale de l'espace : « Etre bien vu de son quartier.» Henri Coing dans Rénovation urbaine et changement social a montré l'extrême sensibilité du phénomène, qui rend très nettes les incompatibilités de voisinage jusqu'à une échelle très fine (manœuvres/ouvriers professionnels). à On montrera dans le chapitre III comment cette société dite « de consommation dirigée » (Lefebvre) se cristallisera en un type bien caractérisé de logement. À
Enfin, fautil le préciser, ce spectacle est un ballet bien
réglé, au fond le meilleur garant de l'ordre. Pas de faille, plus de bistrots; les Halles, ce scandaleux et terrifiant «espace libre » seront rasées. On peut tranquillement reconstituer des «zoncs rouges » désamorcées : les cités-dortoirs sans lieu
collectif”.
20. Guy DrBoRb, La société du spectacle. La mème intuition est thévriséæ par le «filon ouvriériste» italien dans lc concept de «500
21. Collectif
par des
logement,
22. Au moment
œux des
pecsilnt
brochure
rédigé
entre
autres
où fut écrite l'étude (1971), les incidents comme
Blagies Où de La Courneuve
proscrivant
ronéotypée,
res de l'U.P6 de l'Ecole des Beaux-Arts.
n'avaient pas encore eu C'effets
Le grandscuumble sutelee Le première réponse auk enseml son! aux surgies dans ces cités? Il faudrait en voir
Re
pourquoi la ville? 3. VILLE
ET FORMATION
31
SOCIALE
547
La ville n’est pas le pur produit d'un mode de production, ne serait-ce que parce que la Formation Sociale elle-même n'est jamais un mode pur : c'est une structure complexe de M.P., mais tous les modes de production dominés sont modifiés par le M.P. dominant. ‘ Or, la ville est non seulement produit du présent, mais aussi héritage du passé, et comme tel contribue à la survie des modes de p: tion passés. Economiquement, dans la ville se perpétue la vieille propriété foncière (aussi bien de la ville que de la campagne environnante), qui imprime sa marque aux conditions de reproduction élargie de la cité. Politiquement, la généalogie du capitalisme se lit dans l'aménagement général, opposant la France centralisée et l'Allemagne plus équilibrée. Idéologiquement, le poids du passé fait aux Français cette mentalité rurale « pré-industrielle », son inadaptation Proudhonnienne à la grande ville. Terrain et enjeu de la contradiction principale qui oppose la classe ouvrière à la bourgeoisie, la ville est aussi terrain et enjeu de la contradiction secondaire qui oppose entre eux les capitalistes aux propriétaires fonciers et les fractions de la bourgeoisie entre elles”. L'histoire de la ville et celle de la lutte des classes, de la marche triomphale du capital financier
: « Si par exemple
on examine
les effets de la réno-
vation urbaine, on constate que s'y opère la déportation des classes populaires hors des quartiers centraux, mais aussi que s'y accélère le dépérissement des activités populaires collectives, la liquidation de tous les particularismes, traditions locales, semi-communautés » (Collectif Logement). Dans cette étude nous nous intéresserons principalement à la contradiction entre les « producteurs actuels du cadre de vie » et les « héritiers » : entre capitalistes et propriétaires fonciers. Ces propriétaires fonciers (P.F.) n’ont rien à voir, ni généalogiquement ni institutionnellement avec le mode de production : ce sont des bourgeois ou des petits bourgeois (voire des ouvriers) soumis au régime commun de la propriété. Cependant l'analyse de leur place par rapport aux 23. Pour Alain Rist, c'est même à ce niveau concret se règlent les contradictions entre fractions de la bourgeoisie, ns exactement
ê
au niveau des «armatures sociales », sous-formations sociales locales. ce niveau que sont sollicités, contrôlés ou rejetés le développe-
ment des ro
équi)
ts collectifs, le dével t industriel Il local ou ous d'établissements de firmes natio-
32
le tribut foncier urbain
procès de production, la place de la propriété foncière dans l'idéologie française, montrera leur « étrangeté » par rapport au M.P.C. les caractérisera comme «héritiers en ee sorte » du M.P.F.; ce sont des intrus dans le monde moderne, qui vont bloquer les conditions capitalistes normales de la reproduction du cadre de vie.
CONCLUSION
: URBANISATION
ET
LUTTE
DES
CLASSES
Cette analyse sommaire de la ville comme « cadre de vie » dominant du M.P.C. ne prétend nullement à l'exhaustivité ou à la rigueur scientifique. Elle n'avait qu'un but, polémique : en finir avec le schématisme économiste, les illusions fonctionnalistes, et les fondements psychologistes des modèles marginalistes de la croissance urbaine, appeler une analyse de l'allocation des sols urbains en terme de lutte des classes. Lutte politique, d'ailleurs, principalement, mais une forme de politique qui ne s'inscrit pas sur la scène politique traditionnelle, mais dans la vie quotidienne os mäitrise de ce cadre de vie est à la fois l'enjeu et l'arme des protagonistes de la lutte. Cause et effet : c'est un procès de reproduction. La contradiction principale y oppose en France « les possédants » (ceux des usines et ceux des maisons) et les « masses populaires » (ouvriers, employés, intellectuels, petits travailleurs indépendants): et, de juillet 1789 à mai 1968, en passant par la Commune, elle reproduit dans chaque camp les mêmes hantises et les mêmes espérances : « maintenir l'ordre dans la rue », « séparer le bon grain de l'ivraie » d’un côté, « le pouvoir est dans la rue », « la Commune
de
l’autre.
La
politique
boulevards-champs-de-tir
urbaine
a bicn
de Ilausmann
évolué
refleurira»
depuis
et croit même
les
avoir
résolu le problème par une rigoureuse division sociale de l'espace, chassant l'ivraie du cœur des villes vers les cités sans rue. Cette politique visait à briser l’être-de-classe ouvrier, au
niveau du cadre en décomposant
de vie, en renforçant l'effet d'isolement et la vie en fonctions (boulot-dodo). En su
primant « l'agora » ct la rue, elle croyait briser la scène développement d'un contre-pouvoir*. Elle n'a fait que rendre lisible à livre ouvert les rapports de classe : l'habitat, les transports en commun (forme écrasante de récupération du temps libre) deviennent directement l'objet d'une contesta24. « Paris, qui n'est Paris qu'arrachant
ses pavés.»
pourquoi la ville ?
33
tion politique. À tel point qu'une contre-tendance se dessine (uvn dénuée, on le verra, de déterminations économiques), « contre la ségrégation sociale » (entre Français. Les immigrés resteront à part). Mais les conditions de la production même de cette villelutte-des-classes sont le siège de nouvelles contradictions, cette fois entre les possédants : capitalistes et propriétaires fonciers, entre les dépositaires d'un droit acquis et les agents de l'urbanisation capitaliste, En fait, ces agents ne « produisent» pas le «cadre de vie», mais son support matériel, le « cadre bâti » : les bâtiments, les routes, les réseaux divers, etc. Le cadre de vie, nous avons vu que c'est bien plus, même si sa base matérielle est le cadre bâti”. Il fallait pourtant partir du cadre de vie, car il est l'expression de l'ensemble de la formation sociale, UT. donc ses objectifs et ses limites au secteur particulier de la production du cadre bâti.
25. Sur cadre de vie et cadre bâti voir l'étude
dans Critique socialiste n° 4.
Gusta:
Ps 3
2
La production du cadre bâti Analyser la production du cadre bâti, c'est analyser ce
qu'il faut produire, où, comment, et qui produit.
1. QUE
FAUT-IL PRODUIRE?
La réponse à cette question est contenue dans le premier
chapitre. Il faut des locaux industriels, tertiaires, des locaux
d'habitation, des bâtiments de services publics, des équipements infrastructurels. En ce qui concerne la surface, l'estimation du rapport
Bordier était la suivante pour les besoins du Ve Plan (en millicrs d'hectares). A LA CHARGE ce L'Erar
Usaæs
ET LES
COLLECTIVITÉS
Emprise
des
équipements
de
surface | 135
dont voirie secondaire et parcs de stationnement
Espaces
libres
Emprise des bâtiments publics Emprise
des
32
bâtiments
d'habitation
Emprise des activités industrielles et tertiaires
148
|A
L4
CHARGE
DES
CONSTRUCTEURS
la production du cadre bâti
35
Apparemment, le logement ne concerne que le septième de la surface d'expansion urbaine, En ce qui concerne les coûts, le VI< Plan, cette fois, donne les chiffres évoqués dans le premier chapitre, et la Comptabilité Nationale montre que le bâtiment représente, dans la « formation brute de capital fixe » des différents agents, 47 milliards de francs pour les entreprises, 36 pour les ménages, 22 pour les administrations, au total 136 milliards (année 1969). Le logement absorbe à lui seul 27 % de l'épargne brute, 55 % du produit national brut. 2. Où FAUT-IL. PRODUIRE ? Il s'agit d'examiner maintenant les chiffres dans l'optique de notre problème. Revenons d’abord à un examen global de la consommation-surface, 1/7 pour le logement avons-nous dit. Mais en fait, ce qui
compte, c'est l'assiette des opérations immobilières des cités, des grands ensembles. Il faut donc rajouter les « voiries se-
condaires et espaces
libres à la charge des constructeurs »,
soit au total 27.000 ha Le logement a donc une consomma-
tion d'espace sensiblement égale à la consommation + publique » et formidablement prépondérante par rapport aux usa-
ges industriels ct commerciaux. Mais
ce
qu'il nous
faut
revoir,
c'est
: où,
dans
le tissu
urbain, faut-il produire tel ou tel type de construction, quelle est la place de tel ou tel usage dans en
revue.
la D.E.S.E. Passons-les
a. Les infrastructures
Elles sant bien sûr nécessaires partout, ainsi que tous
les équipements publics. Si leur influence est considérable dans la détermination des usages du sol, elles n'ont pas de rôle direct dans la fixation du prix du sol sur le marché. Car : ou bien les infrastructures sont produites avant l’urbanisation, et le terrain est payé au prix du terrain agricole, ou
bien celles interviennent après, et le terrain consommé
est
payé à un prix fixé par l'usage alors dominant. Cette loi économique (confirmée par les lois d'expropriation), nous verrons son explication ultéricurement, Disons ici simplement que cela tient à ce que l'usage du sol en vue d'équipement public est un usage subordonné à tous les autres usages tout en leur étant nécessairement adjoint.
36
le tribut foncier urbain
b. L'usage des sols en vue du logement Il est fortement différencié par la D.S.E. On peut Jui associer une hiérarchie calquée sur la hiérarchie sociale qui est
en
gros
la hiérarchie
des
revenus
(du
moins
dans
la ville
capitaliste. Nous négligeons le cas des «cœurs aristocratiques» des vieilles cités). Nous examinerons plus tard la signification
concrète
(et le mécanisme)
de cette hiérarchie,
mais rien n'empêche de la définir déjà formellement. On se doute cependant déjà que les plus riches se servent les pre-
miers.
c. L'usage du sol en vue de l'industrie Ecartons de suite le cas des petites entreprises dont l'étu-
de Les villes montre
qu'elles
sont dispersées de façon assez
homogène dans toute l'agglomération, Liée souvent au logement du patron, leur implantation est marginale et pas forcément rationnelle. Les grandes entreprises, on l’a vu, sont dans la périphérie du « noyau central » ou en lointaine banlieue. Cette stratification a une explication évidente : la straification histo-
rique.
En gros, l'entreprise doit s'implanter : ©
à proximité d'une grande voie de communication ;
© à proximité
d'unc agglomératon
de main-d'œuvre;
© là où le sol est le moins cher (et ce n'est pas spécialement « dans » l’agglomération !). Elle s'établit donc à la périphérie des villes telles qu'elles existent. Une fois qu'elle est implantée, la population ouvrière continue à s'amasser ct l'entreprise est insérée dans les banlieues. On a ainsi des générations successives : CitroënJavel, Boulogne-Billancourt, puis... Flins. Mais on peut affirmer que la fabrique, surtout au stade
actuel de développement du système des transports et plus
généralement des forces productives, ne recherche pas une implantation déterminée au sein de la ville. Elle hérite d'em-
placements
devenus
centraux,
si elle hésite à déménager
mais
n’en
a guère
besoin, et
à cause des immobilisetions en
capital fixe, elle est prête à les céder Paris XIII).
(Snecma,
Panhard
à
|
la production du cadre bâti d. Les usages tertiaires, bureaux
37
et commerces
On distingue classiquement deux types de commerces
:
© Pour les « achats banaux », quotidiens. Ils sont intégrés aux quartiers de logement. @ Pour les « achats extra-ordinaires ». Leur implantation est soigneusement étudiée par une étude de marché qui les conduit en général, et si l'état du système de transports le permet, dans les quartiers centraux. Dans ces quartiers, qui ont d'ailleurs une fonction de «bourse» (comparaison et fixation des prix), l'« effet vitrine » joue à plaisir pour solliciter la clientèle (Champs-Elysées).
Ou alors (cas des « shopping centers »), ils rechercheront des nœuds routiers privilégiés. © Quant aux bureaux, aux sièges sociaux, qui recherchent les « effets externes de gestion » (facilité de communication, prestige social}, ils ont tendance à s'agglomérer, et, si cette tendance joue spontanément, cela ne peut être que dans les quartiers relativement centraux. Un décentrement peut étre obtenu par une politique volontariste (La Défense) : ce que
cherchent ces usagers du sol, c'est à être groupés et assez bien reliés au reste du monde ; le lieu exact leur importe plutôt moins que pour les grands magasins.
Ces deux derniers types d'usagers (le «tertiaire supérieur ») sont donc assez exigeants dans leur emplacement; ils sont prêts à en payer le prix car ils peuvent le répercuter dans leurs marges commerciales et leurs frais généraux. Conclusion
déterminée
: Il existe une hiérarchie des usages
du sol
par la valeur d'usage de la centralité (ou tout au-
tre particularité de site) et la capacité de l'usager à payer, soit, par ordre décroissant : © les usages tertiaires supérieurs © les usages d'habitation, hiérarchisés par des couches sociales qui délimitent la D.S.E.
le
revenu
© les usages industriels, prêts à liquider leurs biens fonciers centraux et qui s'implantent à la périphérie © … et enfin l'usage agricole.
38
Le tribut foncier urbain
3. QUI PRODUIT LE CADRE BATI ? Cette question est lourde d'une considérable ambiguïté et source de multiples confusions. Il faut donc souligner vigoureusement cette lapalissade : le cadre bâti est le produit de l'activité des entreprises de bâtiment et de travaux publics (B.T.P.}", qu'elles soient artisanales ou industrielles, de
même que le automobiles sont produites par les firmes automobiles et l'armement d'une nation par les manufactures d'armes. J'ajoute que toutes les entreprises de B.T.P. sont
en France des entreprises privées. Au moins formellement, le cadre bâti est donc en France entièrement produit dans
des conditions capitalistes. Mais il existe une différence importante avec les autres produits du M.P.C. : le capital-argent, destiné à se métamorphoser au cours du procès de production en la marchandise que constituc un élément du cadre bâti, maison ou route, n'est pas initialement entre les mains de l'entrepreneur capitaliste, n’est pas sa propriété. Ce capilal est entre les mains de « maîtres d'ouvrage ». On étudiera dans la seconde partie les raisons de cet état de choses et les distorsions qu'il inflige au cycle de rotation du capital, et le statut théorique de ces « maîtres d'ouvrage ». Donnons simplement quelques raisons : il n'y a pas, sur le marché des produits, toutes les conditions nécessaires à la production (c'est le problème foncier) — le produit du B.T.P. n'est pas commodément réalisable, c'est-à-dire que le cycle de circulation du capital est trop long.
Pour le moment, la question + qui produit ? » débouche sur la question « qui finance ?», autrement dit « quel est le propriétaire réel (et non juridique) du capital qui va eflecti-
vement
circuler
productivement
dans
l'entreprise
du
B.T.P. ? » Qui est lc « maître d'ouvrage », le propriétaire de
ce que nous appellerons < capital promotionnel » ? Trois réponses possibles
:
— l'Etat ou une collectivité publique (ou semi-publique);
— le capital privé fonctionnant comme tel”; 26. On serait même
vrai
physiquement
et
tenté de dire : les ouvriers du bâtiment. C'est + moralement », mais
ce
me
serait
pas
juste
économiquement. Dans les conditions de M.P.C., le procès de production Le ie ri cire SR rh en M M tome capi: cette unit ‘entreprise. 3
Zi. « En soi— par définition — cette somme Dos
n'est capital
QE
la production du cadre bâti — le patrimoine comme revenu). En
individuel
ce qui concerne
bâtiments
pe
(argent
39
thésaurisé,
les infrastructures primaires
le maître
d'ouvrage
est
l'Etat
(ou
utilisé et les
assi-
milés), les fonds sont budgétaires. Cela, pour des raisons évoquées au chapitre I et qui tiennent aux modalités économi-
ques du rôle politique de l'Etat”.
En ce qui concerne les bâtiments et superstructures en vue du commerce et de l'industrie, c'est le capital (juridiquement privé ou nationalisé) qui est maître d'ouvrage. L'Etat paie parfois le terrain (constitution du réseau ferré français) mais, comme nous le verrons, l'argent qui paie un terrain n'est pas un capital productif réel. Nous ne reviendrons plus sur ces deux points (les infrastructures et les bâtiments à usage d'entreprise), si ce n'est lorsque nous aurons besoin de tel ou tel élément. Ce qui justifie cet abandon, c'est que le problème foncier, dans la ons du cadre bâti, est dominé, quantitativement et hiérarchiquement”, le problème foncier dans la praduction du logement. C'est à travers ce problème principal que nous aborderons l'objet de notre étude, en réintroduisant les autres éléments quand il lc faudra. Avant d'aborder
une
telle étude, il nous
faut cependant
répondre à la question : Qu'est-ce que le bien « logement » ?
somme d':
6 chapitre
+ et assure cette fonction d'augmenter le capital. » MARx,
du Capital,
d
2. Voir aussi Les fransporis dans la rotation du capital. En fait, les modalités économiques de l'intervention de l'Etat dépendent de
multiples déterminations, principalement le stade de développement
des contradictions du M.PC. atteint dans la formation sociale nationale, ainsi que des particularités de cette formation qui dépendent de
sa
logie.
. Cette domination a été établie précédemment, sauf en ce qmi concerne les usages tertiaires supérieurs, que nous gardons donc à l'esprit comme « prioritaires» per rapport au logement. Mais cela ne
pas grand-chose en surface, et il n’est pas sûr qu'ils « doininent » les logements de très grand luxe. Une étude précise du VITI-
ct du XVI" arrondissements snoutrerait peut-être que la guerre du lo-
gement et des bureaux nc se livre pas uniquement par le biais écono-
3 Qu'est-ce que le bien “ logement *’ ? 1. PRODUIT ET BESOIN On peut analyser un bien de deux façons : comme besoin à satisfaire, comme produit à écouler. La démarche qui part
des besoins
est inadéquate,
dangereuse,
voire mystifiante,
dans une formation sociale où e lc M.P.C. Il n’y a pas, il n'y a jamais eu de « courbe de satisfaction » continuement différenciable dans la 1ête des gens, ni même de quasi-vrdre leur permettant d'arbitrer entre les machines à laver et la télévision en couleur”, Il est vrai que dans
les modes
de production
antérieurs,
il y avait effectivement un rapport « naturel » entre quelques besoins simples — se nourrir, se loger — er les procès de travail assurant leur satisfaction, de façon rituelle ou corporative (c'est-à-dire dans le cadre de normes strictes et intangibles, quantitatives et qualitatives). «La loi qui prévaut alors, c'est le maintien de la production dans les limites que la consommation trace à l'avance. »* Tout autre est le cas du M.P.C. où le but de la production est l'accroissement du capital. Cet accroissement est certes soumis à la condition de réalisabilité : on ne peut produire ayant valeur d'échange que ce qui a unc valeur d'usage. Mais
c'est le capital qui impose ce qui lui plaît sur le marché, choisissant déjà dans l'ensemble des fantaisies possibles, ce 30. Plus cxactement, la psychologic des choix n'est pas un fondement
irréductible
de
l'économie.
Fonctions
TE
de satisfaction
et relations de
prendre leur place dans une « axio-
propre dénomination, la sophistication d'un «empirisme vulgaire » qui [E ».
te
épistémologiquement.
La préfèrence
31. K. Marx, 6 chapitre du Capital.
est aussi
un
« pro-
qu'est-ce que le bien « logement » ? qu'il
est
rentable
de
satisfaire,
et imposant
moyens le goût de ce qu'il produit”.
4 par
tous
les
Le travail concret n'est que le support, le prétexte du travail abstrait créateur de plus-value, « Constamment, le pro-
cès de production immédiat est dès lors union indissoluble
entre procès de travail et procès de valorisation, tout comme le produit est unité de valeur d'échange et de valeur d'usage, autrement dit marchandise”. » Nous devons avoir en tête ces considérations particulièrement en ce qui concerne le cadre de vie. Et pourtant nous allons revenir un temps à la problématique du besoin. C'est que la «production de la marchandisc-logement » présente une série de particularités, n'est souvent pas accomplie comme telle (je veux dire, comme production d'une marchandise). @ Nous avons déjà vu que le logement
duit
simple,
que
le procès
de
valorisation
n'est pas un prone
coïncide
pas
avec le procès de travail : il y a séparation du capital pro-
motionnel
et de l’entreprise
productive.
Mème
du
point
de
vue du procès de travail, le Ingement comme emplacement
n'est pas un produit (problème foncier).
© Cela se rattache à une difficulté majeure : le logement
comme marchandise, nc trouve généralement pas une deman-
de solvable (d'où la persistance de modes artisanaux dans le bâtiment — Voir plus haut la citation de Marx). Bien sûr on pourrait se contenter — et on l'a fait — de produire
moins de logements ou de moins bons. Alors ?
© C'est que fondamentalement le logement se présente comme un besoin relativement autonome, à cause :
— de sa place tactique dans l'Economique du mode; — de son rôle stratégique dans la Formation sociale, rôle
économique, politique, idéologique.
32. Les analyses sur la «persuasion clandestine », la «société de consommation» ct tout ce que j'ai désigné dans la première partie comme « société spectaculaire marchande » sont à présent suffisamment connues L'orientation pharmaceutique de la médecine occidentale est
un amis saisissant. La n ce qui concerne le logement, on Massiah dans l'article déjà cité sur la soin,
«La
production
ne
fournit
pas
t se reporterà
PRE l'analyse
dialectique entre produit et be-
seulement
des
matériaux
aux
besoins, elle fournit aussi un besoin aux matériaux, » (K. MARX, /nfro-
duction à la critique de l'Economie Politique.) 33. K. Marx, 6 chapitre du Capital.
42
le tribut foncier urbain
2. LE LOGEMENT : UN BESOIN SOCIAL « L'âme vivante », le « sang » du capital, c'est la force de travail des producteurs directs, des prolétaires. Cctte force de travail ne se reproduit que lorsque
vailleurs
donne
le capital paie aux tra-
la valeur de leur force de travail, c'est-à-dire leur
les moyens
de paiement
pour acquérir sur le marché
les moyens de subsistance qui doivent s'y présenter comme marchandises. Un de ces moyens de subsistance, c'est le logement. a. Le logement-tanière Le logement occupe donc une place importante dans le cycle de rotation du capital, tant privé que social : c'est une composante décisive de la fameuse «consommation sociale moyenne» qui fixe la valeur de la force de travail aussi bien dans la théorie marxiste que dans la Comptabilité nationale (indexation
du
S.M.I.G.).
Ce caractère décisif tient précisément à son poids (environ 11 % en moyenne) renforcé par son indivisibilité (alors qu'on peut restreindre ses dépenses d'habillement). De plus, dans la période de crise du logement permanente qui caractérise une France qui n'en finit pas de faire sa révolution industrielle (nous verrons pourquoi) on choisit ce qu'on consomme mais On « trouve » un logement. « Dans le M.P.C,. la nécessité de payer un logement (dans le salaire) s'impose par le rôle que celui-ci remplit face à la production : être le lieu où se récupère et se reproduit quotidiennement la force de travail. [..] Au xrx° siècle ceci s’est
traduit
par
une
tendance
à réduire
le logement
aux
seules grd nécessaires à la reproduction de la force de travail. Le logement ouvrier moyen n'est alors qu'une tanière à force de travail." » C'est ce qu’exprime ironiquement la célèbre affiche des Beaux-Arts : «La bourgeoisie ne loge pas les travailleurs, elle les stocke. » En fait, au x1x’ siècle, elle ne les stockait même pas, elle laissait aux rentiers immobiliers le soin de les caser. Cette situation s'est modifiée avec l'évolution du rôle général du logement dans la Formation Sociale. Mais une fraction considérable de la classe ouvrière en France (notam34. Collectif logement. Le chapitre de cette brochure sur le logement la corsommation
sociale moyenne
devrait être cité intégralement,
inspire {out ce paragraphe et
qu'est-ce que le bien «logement» ?
43
ment les immigrés), non concernée par l'analyse qui va suivre, subit toujours les mêmes conditions de logement. A ce stade du ue
(la tanière), la « production
ma-
térielle », c'est extrêmement peu : quelques planches, une mansarde. La production de taudis dégage très peu de plusvalue et comme production capitaliste ne peut qu'être très marginale. En revanche, ce qui est indispensable, c'est l'em-
placement. C'est là que pour la première fois nous rencontrons ce personnage : le propriétaire foncier, ici sous les
traits du propriétaire immobilier urbain. Comme
tout
propriétaire
foncier,
il tire
son
revenu
de
moyenne
au
son titre juridico-politique à contrôler l'usage d'un bout de terrain. Dans ce cas, il perçoit une rente immobilière pour un droit sur l'usage de quelques mètres carrés de plancher à peine viabilisés. Cette pratique économique n'a rien à voir avec la production de re dans le M.P.C. Nous montrerons plus loin (2 partie) qu'elle s'’analyse comme une structure spécifique (« configuration 2 ») de la production des logements à laquelle correspond le concept spécifique de «rente foncière à la Engels» (3 partie), et nous verrons dans la 4 partie la résolution des contradictions principales et secondaires qu'elle suscite“, Insistons déjà sur le fait qu'à ce stade, le capital ne prend pas à son compte la production de logement, car il n'y a rien à produire de solvable à cette époque. L'intérèt du capital est d'accroître le taux d'exploitation, dans d'autres secteurs industriels, donc de diminuer au maximum les salaires. De fait, mises à part quelques explosions de colère spontanées, la jeune classe ouvrière se «contente » de ses tanières. C'est l'époque de l’« accumulation initiale » de Dickens et de Zola. b. Le logement dans la consommation stade actuel du M.P.C.
sociale
Le logement doit maintenant être examiné à la lumière de son rôle dans le cadre de vie et de celui-ci dans Ja formation sociale, notamment par rapport à la réalisation de la plus-value, c'est-à-dire au problème de la reproduction Se Il faut d'abord rappeler quelques points sur le © Le capital, dans son cycle de reproduction, s'il produit des marchandises, se reproduit aussi lui-même, donc reproduit les rapports sociaux. À la fin de chaque cycle, le capi35. Voir également J'Annexe II.
44
le tribut foncier urbain
taliste se retrouve possesseur et propriétaire du capital (accru) et l'ouvrier dépossédé de tout, n'ayant que sa capacité de travail à vendre pour assurer sa survie.
© La duction tour en dre unc
reproduction du capital est explicitement une reproélargie : la plus-value argent est transforméc à son capital. A l'élargissement du capital doit corresponélargissement du marché.
© Les consommateurs tendant à devenir dans leur grande majorité des prolétaires, on se trouve devant une contradiction manifeste : plus on restreint le salaire des travailleurs, plus grand est le taux de profit théorique, mais moins on peut écouler de marchandises. Le calcul (par exemple de Keynes) et l'expérience (par exemple l'expansion qui a suivi Mai
1968)
confirment le raisonnement de Marx et de Rosa Luxemburg. Les capitalistes les plus clairvoyants, tel Henry Ford I, préconisent donc une politique de « hauts salaires ». Mais Ces « hauts salaires » ne doivent pas compromettre la reproduction des rapports
sociaux
(crédit).
La
: ils doivent être effectivement
Le plus sûr cst qu'ils soient consommés consommation
doit
étre
consommés.
avant d'être perçus
strictement
dirigée,
L'élargissement du marché intérieur peul donc être assuré :
— par une élévation du niveau des dépenses somptuaires des classes possédantes (logements de luxe); — par la constitution d'une «couche moyenne», solidement intégrée politiquement et idéologiquement, payée à ne rien
faire de particulièrement
pas son salaire : ceux que « chômeurs bien payés » ;
utile mais
Baran
qui n'épargnera
et Sweezy
— par l'élévation progressive et contrôlée consommation des classes laboricuses.
appellent
les
du niveau de
Ce dernier point est renéu possible par la différenciation au sein du prolétariat que permet l'impérialisme, aux «jindigènes » et « iminigrés » surexploités correspondant l'« aristocratie ouvrière » des nations capitalistes du « centre ». « L'extension de la sphère de circulation des produits existants, l'apparition des produits nouveaux, la création de marchés et de besoins Le ces produits sont une nécessité permanente du M.P.C. Cette nécessité se double avec l'impérialisme de la possibilité dans les pays dominants d'une modification vers le haut du minimum social de stricte subsistance. Ce minimum représente pour les classes populaires un volume croissant de biens et de services. On assiste à la ba-
qu'est-ce que le bien
« logement » ?
45
nalisation de produits autrefois rares ou inexistants et à Ja création de biens nouveaux*.» La valeur de la force de travail «v» n'est plus seulement un paramètre du procès de production déterminant le taux de profit. C'est aussi un ne du cycle de circulation déterminant le volume du profit. Plus particulièrement, le logement, qui était déjà un paramètre tactique du capital variable, se voit stratégiquement investi de la fonction de pôle structurant de la consommation dirigée dans le cadre de la colonisation de la vie quotidicnne. À cela bicn sûr se combine un rôle politique : le logement
doit
être
assez
complexe
pour
mobiliser
les
« temps-
libres» (télévision, appareillage électro-ménager) el permettre une suppression progressive des < espaces libres ». « En tant pe et cadre matériel, le logement ne peut plus être isolé d'autres marchandises dont il est le sue
et auquel il est lié (meubles,
appareils, autos).
Il se c
un
sous-système de consommation qui utilise une forte part du salaire et dont le logement est le pivot structurant, (il est le pôle) où vient se régler, se définir et se limiter l'usage que font les producteurs de l'espace, du temps en système capitaliste. » Encore une fois, tel est l'aboutissement d'une évolution qui, en France, n’est pas achevée, Néanmoins, du point de vue de l'urbanisation, il existe un type-modèle universel du logement moyen. Quelles sont ses caractéristiques ?
© Il est plus cher bien sûr que la « tanière ». Cela exige une évolution des mentalités (maintes fois appelée par les « responsables »). « Petit à petit, on fait passer l'idée qu'il faut payer cher pour être bien logé, que puisque l'on paie cher c'est qu'on est bien logé. Double effet de valorisation du logement et de surveillance des activités à travers une récuSeine impérative et régulière des salaires. » © Ce type de logement est «une valeur d'usage nouvelle ei requiert un t moyen d'équipement fort et bien défini ». phénomène (la nécessité ressentie de s'équiper convenalement quand on accède à un logement « moderne ») a bien été analysé par Henri Coing à propos de la rénovation de l'Ilot National (Paris XI). © «Du
point de vue de ses caractéristiques
techniques
(lumière, chaleur, acoustique, volume), il est cependant calculé au plus juste de façon à permettre une bonne 36. Collectif logement
ainsi
que
les citations
suivantes.
récupé-
46
le tribut foncier urbain
ration de la force de travail et à ne pas fort « taux de déviance » : révoltes, bandes risation des habitants. » Ces impératifs sont pris en compte et font l'objet de mesures
entraîner un trop de jeunes, solidatrès officiellement précises :
. «C'est un fait qu'une réduction excessive de l'espace ha-
bitable, du confort physiologique ou des équipements accroît la probabilité de voir apparaître chez les habitants des trou-
bles neurologiques
graves, de la délinquance, des maladies
physiques ou de la fatigue, ce qui a pour conséquence l'au mentation des coûts sociaux. Inversement, des logements de meilleure qualité pourront contribuer à une plus rapide intégration sociale de chaque individu ou à l'accélération de ses capacités productives”. » En conclusion, il existe un « logement social moyen » bien défini répondant à des fonctions précises qui dépassent la simple fonction d'abri. Or, la définition de ce besoin a largement précédé comme norme universelle son apparition massive
sur le marché, parce que les conditions capitalistes de pro_
le per à insolvable. s’agit là d'un problème le biais du taux d'intérêt, se cement. C'est donc l'Etat qui c'était indispensable, l'Etat élément
comme
constant
rentrant
dans
il avait assumé
. ) de distribution (loyer) qui, par double en problème de finanl'a pris à sa charge. Parce que a assumé la production d'un
la reproduction
la production
(infrastructures).
Ainsi
s'est
du
capital
variable,
d'éléments du capital constitué
un
secteur
social du logement dont le caractère transitoire a été maintes fois proclamé, notamment par M. Albin Chalandon qui veut hâter sa reprise en charge par le capital privé. 3. LA MARCHANDISE-LOGEMENT L'analyse qui précède, qui définit le logement social moyen comme besoin autonome, est valable pour la classe ouvrière et les petits « cols blancs ». [1 reste un vaste espace de « cottches moyennes » et de classes dominantes qui, elles, vont consommer du logement comme revenu social. C'est là que le
logement sc présente proprement comme marchandise, unité
de valeur d'usage et de valeur d'échange, pris en charge par le capital promotionnel comme productif de plus-value. Dans ce cas, il faut observer : 37. N. Portas, Cahier du Centre scientifique ei technique du
ment,
1967.
béti-
qu'est-ce que le bien = logement » ?
47
a) que l'analyse initiale de la dialectique du besoin et du produit est pleinement valable. Le logement est alors un moyen de réaliser de la plus-value. Selon la solvabilité de la clientèle à laquelle il s'adresse, on produira des murs nus « prêt-à-finir » («ls ont bon goût mes parents... ») comme à Grigny II, ou des logements à cuisine automatique intégrée, où «il ne manque plus que la brosse à dent » (publicité de « Super-Italie ») ; b) que, du fait de son rôle d'intégration dans l'unité de la Formation Sociale, il y a une grande unité du type de lugement. Compte tenu des analyses déjà développées, il doit y avoir continuité entre le logement des classes moyennes (qui assurent la « consommation-pilote ») et celui de la classe ouvrière bourgeoisement inté: et cela jusque dans les parages du «logement-tanière ». Les Programmes à loyers réduits dont M. Chalandon vante pudiquement la « rusticité » n'en sont pas moins bâtis sur le même modèle culturel qu'un Immeuble à Loyer Normal. Résultat : du point de vue de la seule construction, il n’y a pas grande diflérence de prix de revient d'un bout à l'autre de l'échelle ! Selon une enquête du mensuel L'Expansion*,
« le coût de construction d'un immeu-
ble de luxe, avenue Paul-Doumer, avec entrée en marbre et salle de bain en céramique de couleur, n'est que 10 % plus cher au m° qu'un H.LM. de Pantin »! C'est sans doute exagéré, mais la différence relative est en tout cas hors de proportion avec celle des prix totaux des appartements, et avec celle des revenus (dont l'échelle en France s'étale de 1 à 10, de décile inférieur à décile supérieur). ec) Ft pourtant cette unité est profondément hiérarchisée. Avec le logement est vendu un rôle social plus ou moins élevé, mais coulé sur le même modèle. Dès lors cette hiérarchie se trouve principalement exprimée, non dans la valeur matériclle de la construction, mais dans la place au sein de Ja division sociale de l'espace. d) Enfin, et le problème de résolu. Entre le e r, pour
sauf pour une petite marge (10 %) de nantis, la solvabilité n'est toujours pas entièrement secteur social et le secteur libre, il faut donc les couches moyennes, un secteur intermé-
diaire, celui des primes et prêts. Ce secteur, pris en charge
teur.
£ 8
e
®
É
k 8
Er
$ Eë ëà
le capital privé, voit son taux de profit bonifié par des terventions de l'Etat.
êe
U
de Jean-Paul Roulleau, dési-
48
: Les
le tribut foncier urbain limites
de ce secicur
sont, comme
il se doit, floues
et mobiles. La politique de l'Etat est de se dégager, de substituer à l'intervention budgétaire des aménagements de la réglementation du crédit. De même, il tente de rejeter vers ce
secteur la frange la plus aisée du secteur « social ». M. Cha-
landon
aux
s'indignait de ce que 80 %
H.L.M.
Cependant
qui ne sont
des ménages
aient droit
« donc » pas des logements
s'il est exact que
«80
% des ménages
sociaux.
de 4 per-
sonnes louant un 4 pièces en province» ont « droit» aux HL.M, ces 80 % ont pourtant un revenu strictement inférieur
à 25.000 F1 Pour atteindre le « taux d'effort » de 15 % dans un logement semblable en secteur libre, il faut avoir un revenu de 55.000 F, ce qui ne concerne que 4 % des ménages”.
4. QUELQUES CONCLUSIONS Si l'on met
à part le secteur
des immeubles
anciens, ré-
gis par la loi de 1948, où les loyers sont bas et où les locataires ont droit au maintien dans les lieux, qui échappe donc dans une certaine mesure au marché (il revient au galop par
le biais du « pas de porte »} ainsi que les taudis, bidonvilles, etc., qui relèvent en gros de l'analyse du « logis-tanière », nous avons douc trois secteurs : social, aidé, libre. En tant que produit des entreprises du bâtiment,
le lo-
gement apparaît assez homogène dans sa forme et dans sa valeur, du plus rustique au plus luxueux (exception faite du petit secteur tout à fait supérieur) un peu comme la gamme des voitures Renault R. 4, 6, 8, 10, 12 et 16. (La comparaison n'est pas entièrement fortuite.) Mais comme produit du capital promotionnel, public ou privé, il est doublement différencié :
— Par la classe ou la couche sociale à laquelle il s'adresse, caractérisé par sa solvabilité qui varie de 1 à 10. —
Par le mode
de financement (crédits H.L.M. primes et
prêts du Crédit Foncier, capitaux privés”). Ces deux différenciations se recoupent à peu près exacte-
39. Tous ces chiffres sont tirés d'ure étude de la direction de Ja Construction, de février 1970, Analyse de la cohérence entre le dispo-
sitij de l'aide publique et la distribution des revenus des ménages. « d'effort » est bien sûr la part du revenu consacrée au
Le LE.
40. Le financement patrimonial {sur le revenu), marginal, est pour l'instant écarté. Il obéit à une logique largement extre-économique (cas
du propriétaire
d'une
parcelle
qui y fait construire
sa maison),
qu'est-ce que le bien « logement » ?
49
ment, puisque précisément le but de l'intervention de l'Etat dans le financement de la construction est de faciliter la solvabilité, dans le cadre de son rôle économique (faciliter la réalisation des marchandises, fournir un gîte à la force de travail) et politique (désamorcer la contestation sur le terrain du cadre de vie). On a donc (en très gros) trois sous-marchés du logement relativement autonomes mais hiérarchisés, en ce sens que chaque marché est subordonné à la priorité au marché suieur. Or, nous avons déjà établi une hiérarchie de la D.S.E. iquement ce doit être la même. Mais ces deux hiérarchies, nous les avons établies en partant de deux optiques différentes : la première, en étudiant
l'effet de la structure de la formation sociale sur la division
de l'espace; la seconde, en partant de la solvabilité pour la marchandise-logement qui débouche sur des sous-marchés de logements différenciés par leur financement. Qu'est-ce qui fait que les immeubles appartenant à tel sous-marché soient aussi des immeubles localisés dans tels quartiers ? La cohérence peut être obtenue directement par la pratique sociale (ségrégation volontaire), et c'est réel dans le cas du secteur des Progranunes à loyer réduit et Programmes sociaux de relogement : « Pour ces populations, il n'est rs possible
de les intégrer dans un habitat normal,
car, ou
ien elles quitteraient les logements qui leurs seraient offerts, ou bien feraient partir cet environnement au profit d'éléments semblables à elles » (Albin Chalandon). Mais nous verrons qu'il existe une médiation plus directement économique : le mécanisme de la rente foncière qui stabilise et reproduit la coïncidence entre la hiérarchie sociale de logements et la Division Sociale de l'Espace. Notons enfin immédiatement que : — la production proprement dite du logement est assurée par des entreprises capitalistes privées — les terrains sont la propriété d'individus; ce droit de riété (jouissance et vente) est régi formellement par es mêmes lois que la propriété des marchandises — l'Etat n'intervient dans le financement du logement que dans les strictes formes du droit privé (sauf le cas d'expropriation, qui sera étudié plus loin)en observant les méCependant, dans le cas
de la loi Loucheur, et compte tenu du rôle
de importance, End
participe
idéologique de la
propriété, il peut avoir, à tel ou tel moment, une gran-
l'instant qu'il est toujours dominé.
à Ia dynamique de
urbanisation
50
le tribut foncier urbain
mes règles que les autres. 11 agit comme un
capitaliste qui
fait volontairement de mauvaises affaires au stade de la réalisation. Mais, comme capitaliste promotionnel, il observe les mêmes règles du jeu, ajustant le prix de revient à la clien-
tèle visée, donc ajustant l'immeuble produit à la division so-
siale de l'espace“.
Autrement dit, la présence massive du financement public
n'introduit pas de perturbation théorique de fond au schéma général d'une production capitaliste du logement, mais simplement un aménagement au stade de la réalisation, aménagement d'autant moins perturbateur qu'il intervient dans les sous-marchés dominés. Par rapport au problème foncier, nous pouvons considérer
Lo
le problème se réduit maintenant à l'étude de la pro-
uction capitaliste du logement. Ce sera l'objet de la seconde partie.
Remarque
de décembre
1973
L'évolution de la politique de l'Etat évoquée p. 48 s'est considérablement accélérée de 1971 à 1973 : concentration de l'aide sur le seul secteur des H.L.M. locatives, diminution du secteur aidé, gonflèement du secteur libre par aménagement du crédit-acquéreur (aidé par l'inflation !.
En 1972, l'origine des crédits nouveaux accordés au loge-
ment (en milliards de francs) se répartit comme pour les prêteurs publics ou parapublics, 5 pour Foncier, 39,6 pour les banques
suit : 13 le Crédit
(40 %), 3 pour le reste.
Pour les huit premiers mois de 1973, le nombre des mil-
liers de logements mis en chantier est de 113 pour le secteur social, 100 pour le secteur aidé, 129 pour le secteur libre. Par rapport à 1972, cela représente + 27 % pour les H.L.M. locatives,
+
17 % pour le secteur libre, et un effondrement
secteur aidé.
du
Conclusion L'étude qui précède est longue, volontairement disproportionnée avec l'objet qui la motive : l'étude du problème foncier dans la rotation du capital. Ce dosage est, dans une certaine mesure, une réaction contre la problématique néoclassique qui définit en une page les hypothèses de comportement d'agents irréductibles («arbitrage entre prix du temps et 7 ») puis développe avec délectation des pages de calculs différentiels, quitte à consacrer une dernière partie à reconnaître des distorsions de la réalité par rapport à son modèle. Les sciences humaines ne relèvent Hs du même protocole (réduction à l'objet formel
—
déve ue
mathéma-
tique) que la mécanique rationnelle; elles requièrent une autre forme de causalité, la causalité dialectique, qui non seulement construit le tout en structurant les parties, mais encore prend en compte l'effet de la totalité sur chaque élément de la structure. D'où l'extrême difficulté à fixer un « ordre de l'exposition ». Le socle épistémologique du matérialisme historique n'est pas le même que celui des sciences physiques. Cela tient à ce que son objet (les pratiques humaines) n'entretient pas avec les « lois scientifiques » les mémes
rapports Lg
ceux des sciences physiques.
J'ai cherché à établir les déterminations concrèles de la production du cadre bâti et crois avoir montré qu'elles ne sont pas le simple choix de « l’homo oéconomicus », qu'elle ne sont même pas l'effet unilatéral de la seule instance économique. Essayons de nous résumer. villes sont le produit de la lutte des classes au sein
de leur formation sociale, l'urbanisation répond à des im
ratifs fixés par celle-ci. Principalement, l'effet de l'ensemble de la structure et des pratiques est la reproduction d'une division économique et sociale et de l'espace. Par rapport à
l'instance économique (et notamment au « prix du sol»), la division économique ct sociale de l'espace apparaîtra tantôt comme une donnée, tantôt comme un produit. La D.E.S.E. s'exprime par une hiérarchie à peu près totalement ordonnée des usages du sol, soit, en décroissant : ter-
52
le tribut foncier urbain
tiaire supérieur — logement des classes dominantes — | ment des classes moyennes — logement des classes domi — industrie. L'usage « public» du sol est un complément nécessaire et également subordonné à chacun de ces usages. La D.S.E. est le principal facteur de différenciation objectif de la marchandise-logement qui, en tant que produit des entreprises du bâtiment, n'est guère différenciée. Cette différenciation doit recouper une différenciation des sousmarchés des logements, différenciation par la forme du capiromotionnel (public, aidé, libre) qui répond elle-même à l'in ale solvabilité des classes et couches sociales à loger.
Le production capitaliste du logement
Introduction Nous avons établi dans la première partie le caractère
principalement capitaliste de la production du logement. La production proprement dite (entreprises B.T.P.) est purement capitaliste privée. Une grande partie du capital promotionnel est certes collectée par l'Etat, et fonctionne pour des buts différents de la maximisation du profit. Mais, même dans ce cas, les « règles du jeu » capitalistes sont respectées avec le handicap
imposé
: caractère
privé de
l'initiative (sauf dans
les secteurs les plus aidés, qui, étant dominés par tous les autres, ne peuvent perturber l'ensemble), minimisation des coûts, libre concurrence, y compris (sauf nuances) sur le
marché
foncier. On est donc fondé à s'attaquer d’abord à
l'étude théorique de la production capitaliste «pure» du logement. I1 nous faut donc maintenant faire une étude théorique du procès de production du logement, c'est-à-dire du cycle des formes que prend diachroniquement le capital promotionnel : ce sera l'objet du chapitre I. Puis nous ferons l'analyse de l'ensemble du système de la promotion immobilière, c'est-à-dire de l'articulation synchronique des divers agents, avec la multiplicité des financements face au marché des logements d'une part, des terrains de l'autre. Cette étude s'inspire largement de celle menée par Christian Topalov dans le cadre du Centre de Sociologie Urbaine, Les promoteurs immobiliers. Je ne reprendrai pas les résultats qui sont l'objectif de son étude (explication du comportement observé de différents types de promoteurs), et m'attacherai surtout aux inexactitudes et aux insuffisances des parties de son ouvrage qui traitent de notre objet, inexactitudes qui tiennent précisément au décentrement de son étude
par rapport à notre problème, mais qui donnent parfois du flou à son analyse. . 1 Cette étude est un
Pi
domaine précis
une k tomber
daus
n
excellent
exemple
de l'efficacité du matéria-
la version de l'Ecole Française, appliqué à un ion
sociale française.
étude préalable menée par interview, elle a su ne l'anecdote et l'empirisme. Elle est guaingtenant
aux Editions Mouton,
introduction
55
Notamment, nous nous pencherons davantage sur la duction capitaliste du logement, dont nous avons vu qu'elle se « dédouble », le capital dominant dans la relation de « possession » (ou « d’appropriation réelle ») n'étant pas le capital dominant dans la relation de « propriété » réelle. Il faut rendre compte de cette séparation et analyser son effet sur l'ensemble du procès de rotation du capital. Elle est au centre du problème de l'« industrialisation du bâtiment », tel qu'il est traité par le Rapport Barets', ou dans le discours des responsables de la Direction de la Construction au Ministère de l'Equipement, ou des entreprises du bâtiment’. Son analyse est facilitée par les récents travaux de l'Ecule Française (Bellelheirm).
Cette deuxième partie, qui mériterait une étude particulière, ne sera cependant traitée qu'autant qu'elle permet de cerner la situation et les intérêts des différents acteurs, notamment vis-à-vis du problème foncier, et de comprendre ainsi la bataille qui se livre actuellement à coups de discours volontaristes et de projets de loi avortés. Elle reste cependant d'un accès difficile, car la complexité des formes développées (par exemple, le « loyer ») rend délicate la mise à jour des procès fondamentaux de mise en valeur. Le lecteur pressé d'en venir à la « rente foncière urbaine » pourra se contenter d'un survol ct de la lecture des { conclusions.
Ë
2. « L'industrialisation du bâtiment et l'organisation des professions concourant à l'acte de construire.» Rapport présenté à M. le Premier istre par M. Jcan Barets. Polycopié. 3. Je fais allusion respectivement à M. Lion, directeur de la Construction, et à M. Ribes, directeur de la GT.BA., qui ont exposer leurs tions au cours des Journées d'Etudes 190 de l'École nationale .des Ponts et Chaussées, « La Crise du Logement ». Toutes les
citations
tirées d'interventions
à ces
journées
(dont
le compte
intégral a été publié par l'Union des es de V'E.N.P.C.) sont par le nom de leur auteur suivi éu sigle E.N.P.C.
rendu
Æ
Le procès de circulation du capital
dans la production du logement A. LES CONDITIONS DU LOGEMENT
DE LA PRODUCTION CAPITALISTE
1. LA PROBLÉMATIQUE DE C. TopaLov Pour C. Topalov', le préalable général à l'organisation actuelle de la production du logement (P.C.L.) est l'organisation de la production capitaliste du bâtiment (P.C.B.), laquelle se caractérise par ces deux conditions : — le logement est une marchandise; — le salariat domine l'artisanat dans le bâtiment. Ces conditions deux problèmes :
une
fois remplies,
la PCL.
se heurte
à
— la période de rotation du capital dans la P.C.L. est très longue tant dans le procès de production que dans le procès de circulation
— le capital industriel ne maîtrise tion de sa reproduction élargie: le
pas la principale condiupport.
Dans la Il: crois être 1‘en4.pense Topalor emtuelen dvtopoée au tentée Je ne tiens pas strictement à la lettre de son étude.
Le procès de circulation du capital
57
Il y a séparation du capital industriel et de la re
foncière. Ces deux problèmes viennent perturber la P.C.L. qui sans quoi serait identique à la P.C.B., ct ne ferait inter-
venir que 2 agents :
Entrer BTP.
-
Usager du logement
(La —
:
Art
He
3
A"—
M
désigne un transfert de propriété par achat-vente.)
La solution aux 2 problèmes nécessite la prise en compte et l'intervention de 2 nouveaux agents : un capital commer-
cial qui s’intercale entre l’u: r et l'entreprise, assurant le préfinancement (à court termc), et le postfinancement (à long
terme) ; et le propriétaire foncier. De la combinatoire formelle de ces quatre agents, Topalov retient 3 configurations historiquement réalisées. La première partie de mon étude rend compte de leurs déter-
minations historiques.
1. Usager = Propriétaire foncier = Préfinanceur Ccla correspond
à une production patrimoniale du loge-
ment. Un noble ou un bourgeois fait construire à ses frais sur son terrain sa maison. Silualion générale avant la domination du M.P.C. 2. Usager # Propriétaire foncier =
Préfinanceur.
C'est l’âge du «rentier immobilier », des immeubles de rapport, caractéristiques de la formation sociale i au xrx° siècle. Le capital industriel appelle un exode massif des ruraux prolétarisés vers les villes. Ces ruraux vont se
« caser » sur un parcellaire urbain et périurbain qui est de-
venu, sous la Révolution de 1789, la propriété de toute la bourgeoisie, petite, moyenne ou grande. Îls se « satisfont» de ces «tanières », que la bourgcoisie en question est en général à même de leur construire, car cela représente très
peu de capital.
58
le tribut foncier urbain
3. Usager = Propriétaire foncier £ Préfinanceur. Cette « autonomisation du capital commercial par rapport à la propriété foncière » a de multiples causes historiques que nous étudierons dans la IV: partie. Elle est liée au déclin général de la petite et moyenne bourgeoisie urbaine comme allié ou partie prenante
du
« bloc au pouvoir », à des mesures
conjoncturelles comme le blocage des loyers, et surtout à la promotion du nouveau « logement social muyen », décrit dans la 1* partie, assumée d'abord par l'Etat, et qui représente enfin quelque chose de «consistant» pour le capitalisme. Autrefois,
pour
être
propriétaire
immobilier,
il fallait
sur-
tout disposer d’un titre juridique. Il faut maintenant surtout un gros Capital, et ce n’est plus à la portée des « petits et moyens bourgeois-propriétaires fonciers ». Ce capital autonomisé, c'est le capital promotionnel dont nous avons parlé dans la 1" partie. €. Topalov, qui l'appelle « capital commercial », réserve le terme de promoteur à l'agent effectuant la fonction d’eassurer la gestion du capital commercial dans sa phase de transformation en marchandise logement ». Pour nous, « Promoteur » désignera tantôt le gérant, tantôt le propriétaire éu capital promotionnel. Cette distinction est cependant pertinente, car cet agent tend à devenir un prestataire professionnel de services rendus à d'autres capitalistes qui investissent dans l'immobilier. Nous allons y revenir.
2. NATURE RÉELLE DU PROCÈS DE PRODUCTION
DU LOGEMENT
a. Critique de la problématique de Topalov : Cette présentation d'allure structuraliste a l'avantage de bien faire apparaître les problèmes; elle est suffisante pour présenter le système de la promotion immobilière et nous l'adoptons alors. Mais elle est insuffisamment dialectique. Notamment, l'exposé des «2 conditions préalables» et des «2 problèmes» doit être approfondi, aussi bien dans Jeur contenu interne que dans leurs corrélations. Deux points sautent aux yeux : les conditions préalables (c'est-à-dire l'organisation capitaliste de la production du bâtiment) ne sont pas vraiment réalisées, et d'autre part, la lace de l’entreprise productrice (invariablement exclue des
configurations)
par
rapport
au
préfinanceur
n'est
pas
le procès de circulation du capital
59
En fait, il faut partir des deux problèmes effectivement
posés pour voir les conditions concrètes de la production
logement, y compris en tant que production du bâtiment.
du
b. Le problème foncier Qu'est-ce qu'un terrain à bâtir? C’est une parcelle de sol juridiquement limitée sur laquelle il est « possible » de bâtir, c'est-à-dire que la formation sociale dans son ensemble lui a conféré cette destination potentielle dans la D.E.S.E. Non
É seulement le sol lui-même n'est pas un produit du travail humain,
mais
la transformation
du sol en
« terrain à bâtir »
n'est pas le fruit d'un travail privé. C'est un rapport social, aboutissement de pratiques multiples (état général et disposition géographique du patrimoine immobilier, démographie, É viabilisation, contraintes juridico-administratives). Il n'y a pas d'entreprise qui « produise » du terrain à bâtir, même si la nr ou l'accessibilité peuvent être le résultat d'un travail.
| Une des conditions principales de la reproduction de chak cun des capitaux investis dans la construction, et de la reproduction du capital total investi dans cette branche, échappe donc à la sphère de circulation du capital. Les schémas idéaux de Marx, qui fixent la dynamique possible de la reproduction élargie, où les entreprises ont pour débouché à leurs produits les conditions de production des autres entreprises, sont donc ici en échec. L'entreprise B.T.P. doit « attendre » le terrain
constructible,
et aucunc
entreprise
ne
peut
le lui fournir. Cependant, puisque la « constructibilité » d'un terrain est un rapport
social aux multiples
déterminations,
l'Etat, agent
de l'unité d'une formation, doit pouvoir assurer la « création » de terrains constructibles, et nous verrons dans la TV° partie comment il s'y emploie. Reste alors un problème tout aussi grave : le terrain constructible est la propriété d'un « propriétaire foncier» (P.F.). Cette « propriété » consiste en ceci : le P.F. peut accepter ou refuser que, moyennant finance, on fasse quelque chose sur « son » terrain. Généalogiquement, la propriété privée du sol est l'ancêtre de toute propriété privée. Elle a pu être au début l'expression juridique d'un rapport de propriété réel de la terre, en tant que moyen de produclion agri-
cole. Mais peu à peu, au cours de l'évolution du mode de pro-
5. Au sens de Marx, c'estàdire effectué indépendamment de tout
autre et ne trouvant la sanction de son utilité sociale qu'a posteriori.
le tribut foncier urbain
ductiun féodal, et surtout lors de son articulation au M.P.C. il n'est plus resté qu'un droit juridique, politiquement assuré, idéologiquement justifié. Elle est de nature strictement non-économique du point de vue du mode de production capitaliste, elle n'est même pas inscrite dans Ja structure
du M.P.C.
Cependant, elle a des conséquences considérables dans la
P.C.L., structurellement (on va le voir tout de suite) et quantitativement (III< partie), ce qui lui confère une forme écono-
mique, voire la forme d'un capital. Dans la formation sociale française, pour des raisons historiques, elle se trouve distribuée à une multitude de propriétaires dont la plupart n'envisagent nullement la forme éconurnique de cette propriété, Ils ne sont donc pas en « vendeurs », et nous verrons dans la III° partis comment, quand ils vendent leur droit à un capitaliste, se détermine la mesure économique du droit de bâtir. Pour l'instant, et en nous restreignant à la « configuration 3 de Topalov », il nous suffit de savoir que pour bâtir, il faut non seulement engager un capital productif, mais aussi dépenser de l'argent pour acquérir la possibilité de bâtir, argent qui fonctionnera comme capital quant à son but (recherche d'un profit) mais absolument Fr quant à sa nature et à son procès (travail accumulé et fertilisé par un travail vivant), ni quant à sa place dans la rotation du capital social (nous verrons que c'est une « désaccumulation du capital »). Cette « forme de capital », je me permellrai parfois de l'appeler « capital foncier ». c. Le cycle de rotation du capital investi dans la P.C.L. Ce cycle se décompose en deux parties, que Topalov considère toutes deux comme exceptionnellement longues : 6. Voir
res
l'annexe
iers
IL
Marx
» comme
cependant
considère
les
classe constitutive es M.PC.
«grands
pro-
«pur». Lé-
terres soit privée, ou soit celle d'une classe Le En fait, il s’agit là d'un
Éssaant2
Valeur
cire à sas
fait le suivant :
: 3
128
le tribut foncier urbain
Nous dirons donc que la rente, et plus éralement Le tribut à la Marx a sa source dans l'effet de la propriété foncière sur le procès de production capitaliste requérant l'usage du sol, Cet effet consiste en une surallocation de travail social à ce procès, obtenue au niveau du procès de travail, avec production d'une plus-value excédant le taux de profit moyen, l'excès étant réalloué à la propriété foncière. Et le logement, dans tout cela ? Estil l'occasion d'apparition d'un tel effet ? Nous avons vu que oui, ct par quelle démarche. Dans le chapitre I de la Il‘ partie, en nous appuyant sur le Rapport Barets, nous avons montré les responsabilités du problème foncier dans le blocage de l’indus-
trialisation du bâtiment, dans le maintien de la production
au stade de la soumission formelle. Il reste à en vérifier les ettets sur le rapport valeur/prix de production dans le bätiment, en procédant à l'analyse des composantes de son le CT interne (c'est-à-dire hors péréquation : voir
nnexe
2. LE
1).
TAUX
DE
PROFIT
INTERNE
DANS
LA PRODUCTION
CAPITALISTE
DU LOGEMENT
Rappelons la formule du taux de profit interne d'un sec-
teur
de la
: pr’
—
US
pl'/t (q
+
1), et examinons
les conséquences
foncière sur chacun de ses éléments.
a. Les facteurs relevant de la composition du capital.
c
Il s’agit de q = — (la composition organique du capital) et de t (le temps
SE
moyen
de la part du capital
dresser
un
tableau
de rotation
du capital indicateur
fixe dans le capital total). Sans vouloir
comptable,
citons
quelques
l'étude de l'INSEE. sur l'activité du bâtiment”.
chiffres
de
La part des « consommations » (capital constant circulant}
dans le chiffre d'affaires est en moyenne de 35,5 %, celle de DT
nation
l'existence de
pont pop
tt
du blé» voit entrer dans sa détermi-
bite qu cette cons due A Da ii depuisï Late D mène cuis dits i Leborgne et Jean Laffont mènent actuellement (1973) au CEPREMAP des recherches sur ce sujet.
les sources du tribut foncier l'investissement
(amortissement
et
accumulation)
129 est
de
6,5 %. Ces chiffres montrent la très faible part du capital fixe. Le rapport du Commissariat Général au Plan « Le loge-
ment », précise que la part du capital fixe est de l'ordre de 3 %, pour atteindre 7 % dans le secteur le plus industrialisé. Cette part croît avec l'entreprise, mais en 1966 il n'y avait que 250 entreprises B.T.P. de plus de 500 salariés, sur un total de 23 600, saus compter les 241 000 « entreprises arlisanales ». Quant à la composition organique du capital, elle est la lus faible de toutes les branches industrielles. D'après Le logement, le rapport « charges salariales/chiffre d’affaires »
est environ de 40 % ! Le secteur suivant (construction électrique) : 26,5 %, la métallurgie : 23 %, la chimie : 9,8 %. Faible
taille
des
entreprises,
faible
composition
organi-
que du capital, faible part du capital fixe : on reconnaît les ‘ caractéristiques artisanales de la construction telles que l'annonçait l'analyse de la II° partie. La valeur dégagée dans la production du logement est donc bien plus forte que le prix de production, et cela, nous l'avons vu, pour des raisons siructurellement liées au problème foncier. Cependant, si le caractère artisanal du bâliment permet de prélever, sur la plus-value produite, le tribut foncier en plus du profit moyen, cela ne signifie pas qu'il y ait > re de causalité directe entre la nécessité de payer le T.F. et la non-industrialisation du bâtiment. Ce sont deux sous-produits
« jumeaux » de la propriété
foncière.
b. Le taux d'exploitation de la main-d'œuvre Ici, comme dans l’agriculture, la liaison est directe. En principe, pl/v — pl' ne varie pas dans une formation sociale, elle est fixée par le rapport des forces globales entre le Capital et le Prolétariat dans leur lutte économique. Or le bâtiment se caractérise par un prélèvement anormal de la plus-value absolue (allongement de la journée de travai) et
relative (très bas salaires). D'après Le logement le salaire
moyen annuel de l'ouvrier B.T.P. est à l'époque de 7 100 F (12000 pour la presse, 8700 pour la métallurgie), « battu » seulement pas les cuirs et peaux et le bois. Quant à la semaine de travail (1967 : 48,9 heures) elle est inégalée! Ce phénomène (surexploitation relative des ouvriers du bâtiment) est aussi un «frère jumeau » de la non-industrialisation (pas de main-d'œuvre qualifiée), cette fois clairement perçue comme conséquence du problème foncier (cf. les dé-
clarations de M. Ribes). Allons plus loin : ce salaire permet à l'ouvrier de reconstituer sa force de travail à court terme,
130
le tribut foncier urbain
mais pas le travailleur lui-même : il s'agit souvent d'une main-d'œuvre immigrée, dont les «coûts de jeunesse et de vieillesse » sont épargnés à la sphère française de péréquation du taux de profit. Allons encore plus loin : la production capitaliste du logement ne reproduit pas int lement la force de travail
de ses ouvriers, elle la consomme. DR
les statistiques de
l'Office professionnel de prévention BTP. chaque année, 1 ouvrier sur 4 est accidenté, chaque jour, 3 morts sur les chantiers. Les ouvriers du bâtiment, gb représentent 20 % de la classe ouvrière, subissent 30 % “accidents, et 40 % des accidents mortels, Ainsi se traduit pour la main-d'œuvre « l'externalité » de la propriété foncière. Là où il y a tribut foncier, il n'y a pas de reproduction complète du capital, il n'y a pas reproduction complète du travailleur. Derrière la de ses tours”, prototype du xxr° siècle, le quartier de la Défense * n'est qu'un effroyable chantier qui évoque plutôt le mode de production des Pharaons. Que ces ouvriers soient aussi
importés de l'Empire est sans doute encore un
jumeau ».
3.
PLUS-VALUE
DU
Tout
prouve
ceci
BATIMENT
une
ET TRIBUT
chose
« phénomène
FONCIER
: il est
possible de payer
un tribut foncier sur la plus-value produite dans le bâtiment.
Au stade actuel de la P.C.L., où les producteurs du logement,
et singulièrement les entreprises de bâtiment deviennent des exploitants puissants et réguliers du sol péri-urbain, le tribut foncier affronte directement leurs profits d'entreprise, sans se noyer dans le profit monopole des anciens rentiers immobiliers. Le 25 mai 1971, la Fédération parisienne du bä-
timent publiait dans France-Soir une page de publicité Es commençait ainsi : « Le ministre de l'Equipement et du
gement, faute de pouvoir agir sur les prix des terrains, consi-
dérable en Région parisienne, et sur les divers frais afférants à
l'achat du logement, construction. »
comprime
au maximum
le prix de la
les sources du tribut foncier
131
Nous pouvons donc nous attendre à la manifestation de plus en plus directe du tribut foncier comme simple excédent de la valeur sur le prix de production, de la plus-value sur le profit moyen. Le «a + ©» de Mayer tend à mesurer directement le tribut foncier comme constante indépendante du prix agricole, fixé en fait par le taux de profit interne de l’activité B.T.P. Cette évolution n'est pas achevée, mais on peut déjà en relever la trace. a. Proposition
d'explication de la « loi de Dutailly »
Nous avons parlé de cette loi, contestable dans sa validité, critiquable dans son épistémologie. Cependant, Dutailly
insiste :
el e semble valable (du moins, à 90 % sur son échan-
tillon) quel que soit le lieu de la D.S.E., la densité et le type de la construction. On peut sans doute admettre qu'elle est valable dans la construction sur parcelles récemment urbanisées
sans
particularité
exceptionnelle
de
site, et dans
les
zones elles-mêmes relativement « vicrges ». Elle exprime alors que le tribut foncier que les promoteurs acceptent de verser est égal à 12,5 % du capital investi (ou du prix de production : J.-CI. Dutailly ne précise pas ce qu'il entend par « prix de revient »). Hors le cas des quartiers résidentiels éficiant déjà d'un prix monopole, le tribut foncier est limité par ce que la plus-value produite dans le bâtiment offre en plus du profit moyen : et il semblerait que ce soit 12,5 %, rapporté au capital (ce qui reste à vérifier Économétriquement), et non à l'hectare. Là où il n'y a pas de contrainte de C.OS., on pourra donc, en
réglant
le niveau
de
l'investissement
(en
choisissant
le
type des logements, leur taille, et la densité), ajuster par l'intermédiaire du T.D. 2 le taux de tribut exigé à l'hectare par le T.D. 1 au taux de tribut rapporté au capital. T.D. 1 et T.D. 2 sont toujours fixés par des lois autonomes, développés par le chapitre suivant. Mais l'obligation faite de plus en plus à la production immobilière de respecter la loi de la valeur (effacement du monopole) vient introduire une contrainte supplémentaire entre T.D. 1 et T.D. 2, contrainte qui ne peut être levée que par le passage aux prix monopoles, ce qui arrive
rarement sur les terrains récemment urbanisés. Où
nous
remettrons
en
cause
la
cassification
TD1/TD2.
Jusqu'ici, avec Marx, nous parlons de T. Diflérentiel 1 quand la
différence est liée au terrain et de T.D.2 quand elle est liée au niveau du capital investi.
132
le tribut foncier urbain
Pour reprendre les 2 formules de Dutailly : —
formule empirique
—
formule
1
: P = : K Pc KPv
=
: P théorique
—
>
1+p
K Pc
C*,
—
la loi de la valeur est respectée si : 9
—Pe=
8
Pv
——————
1+p
Le premier membre est àper
groupe
les paramètres
du T.
C
—
—
K
rès constant, le second re-
PPv
et C) et du TD.
Affirmcer la validité de cette formule
me
semble Re
turé. En tout cas, elle ne sera jamais valable k A
urbaine, D'après L'Expansion (article de J.-P.
2 (K).
Roulleau),
répartition du coût de logement est, et se répartira ainsi, s moyenne générale:
1970
1990
Construction
45 %
24 %
Frais annexes
30 %
6 %
Tribut foncier
25 %
70 %
b. l'echniques de production et secteurs de la P.C.L. Si le T.F., comme le profit la plus- value produite dans le lation entre le taux de profit position organ ve du capital,
concerné (social
promotionnel, est prélevé sur bâtiment, il doit y avoir corréinterne, déterminé par la comet le secteur de la construction
ou libre). Par exemple, le secteur social doit
33. 11 y a une ambiguïté sur K. Dans la seconde formule, J-CI. Du-
monstration, pliqueue sasa démensnation ra ue
constants. Dans la formule aussi D nn
à
rendements Eu llypouue de rendements
s:
ue i s'agit de K réel” En fait, nous rARRUR Jar À DON CE ES
jouter qu'i np le prix vente revient E en banlieue, on vendra plus cher Re M Ne appartement (puisque c'est pour Que les classes moyennes VON En banlieue). TD et TD2 apparaissent dans co cas exclusis lun de ’autre. :
les sources du tribut foncier
133
produire un taux de profit promotionnel nul, un taux de profit industriel normal, un tribut foncier faible, Or le secleur social est précisément le plus « rationalisé» (loutelois la part du capital fixe n'y excède pas 7 %). La liaison avec le problème foncier est évidente par l'intermédiaire des marchés, etc (cf. le Rapport Barets)". On aperçoit ainsi que, plus fondamentalement que par l'addition d'un « prix du terrain » au «prix de la construction », la propriété foncière grève le prix du logement en empêchant
la réduction de la valeur du bâtiment, c'est-à-dire en
bloquant l'accroissement de la productivité, l'abaissement du temps de travail socialement nécessaire, bref le développement de la plus-value relative. On observera cependant que, d'après Le logement, le « coût
de
la construction » sur un
chantier
« industrialisé »
n'est que de 5 % inférieur à celui d'un chantier traditionnel bien organisé, C'est que (outre la nomrindustrialisation réelle des chantiers les plus rationalisés) ce chiffre porte en fait sur le prix de production du bâtiment (prix de revient + profit moyen de l'entreprise B.1.P.) et non sur la valeur (prix de revient + plus-value). En fait, à prix de production égal, la technique classique consomme bien plus de travail vivant, et dégage la plus-value nécessaire au paiement du tribut fon-
cier. Ceci nous amène à une remarque importante : l'industria-
lisation du bâtiment, qui alignerait le taux de profit interne sur le taux de profit moyen, rendrait impossible le paiement
du
T.F,
sur
la plus-value
produite,
Il faudrait
donc
que
le
de
Nous
venons
34. Un
ingénieur
de la
AUTRES
d'étudier chez
Francis
deux
nde-Borne, vantant l'
TRIBUTS
sources
du
FONCIERS
tribut
, constructeur
des
foncier H.LM.
té de la mise en œuvre
abrication lourde et la qualité des appartements : « Ici on a
fait ce qu'on a voulu ; le terrain ne coûtait rien. »
dust
D. SUR OUELOUES URBAINS
eq
à
prix du logement reste un prix monopole, « pompant» de la valeur dans la sphère de péréqualion française, ce qui est contradictoire avec la ralisation du logement comme marchandise ordinaire, qui seule peut assumer la domination réelle du capital dans le bâtiment.
134
le tribut foncier urbain
qui surgit dans la production capitaliste du logement. Quand on passe à d'autres usages du sol urbain, on a affaire à d'autres types de sources, d'autres articulations de la propriété foncière sur d'autres procès de production ou de circulation du capital.
1. LE CAS DU TERTIAIRE SUPÉRIEUR 11 s'agit des usages qui dominent hiérarchiquement l'usage du sol en vue du logement : les grands magasins, boutiques de luxe, bureaux, etc. Il est donc important de les étudier, Ici, un capital promotionnel ne s’intercale pas entre le revenu d'un usager et l'entreprise B.T.P. On peut supposer ue le «client» de l'entreprise B.T.P. est l'entreprise ter: tiairc, maître d'ouvrage de ses locaux, qui, du point de vue du capital finançant la construction, est son propre promoteur, mais qui n'engage pas Ce Capilal comme promotionnel, mais comme fraction de son capital constant, plus précisément de son capital fixe”. A la différence de l'acheteur, ou du locataire d'un logement, son rapport à la propri foncière est celui d'un capital à un droit.
Comme le remarque Lojkine, l'analogie avec le cas du fermier n'est cependant pas complète, car le capital enga dans le tertiaire ne l'est pas en général dans un procès de
production. Cependant, cet
e du sol entre bel et bien
dans un procès de valorisation au poste
d'un capital, intervenant soit
« frais de gestion », soit au poste
« frais de commer-
cialisation », procès permanent à la différence du procès de 35. Les formes pratiques
"
U
L es revendre SÈ le
s'agit È rvduction), non ces
du
@ Une
au secieur
logement.
peuvent être bien entendu
G.FF. à M
différentes :
t produire les mime des machines-outils) :
II (biens de consommation)
société immobilière
pour
comme
le commerce et l'industrie (SI.
C.0.M.I.) peut acheter les locaux et les louer à l'entreprise tertiaire.
Mais là encore c'est une technique commerciale interne au secteur I, semblable au «leasing» d’appareillage productif.
Ces deux ASS drum Dourde et Tiens DS
DENTS
PROPRES
S à
On voit que le schéma est assez différent de celui de la P.C.L., mais il relève de la même théorie générale du tribut foncier et, comme nous l'avons remarqué dans la 1 partie, le lieu de la D.E.S.E. où se déroulent ces activités ne leur est
nullement indifférent. Ces usages du sol suscitent donc un tribut différentiel. Comme nous n'y reviendrons pas, voyonsle directement, a. Les commerces
Le taux de profit du capital commercial est essentiellement conditionné par la vitesse de rotation du capital-marchandise : donc par la « surface de vente » et par la situation de cette surface. Situation en un double sens : à l'échelle de la ville, recherche de la centralité, à l'échelle du pâté de maison, recherche de la façade des grandes avenues (effet de vitrine). La différenciation de l'espace est plus « fine » que pour le logement. C'est ce que relève Paul Vieille à Téhéran : il constate deux courbes de prix avec la distance au centre, selon qu'on étudie le « front des avenues » (de l'alignement jusqu'à quelques mètres
en retrait) ou
le centre
des flots
hnérétnlitrnteet
est alors une rente (S.I.C.O.M.L.), généralement capitalisée en prix du sol.
tete
production du logement. La forme adéquate du tribut foncier
D Eh
135
2 plants
les sources du tribut foncier
:
À rix du so!
:
d
tributs différents suscités par deux usa1, l'un dominant l'autre selon la micro-
saint
sulriltmsntniise,
Font CENT mms
136
le tribut foncier urbain
b. Les bureaux La différenciation de l'espace pour les bureaux est principalement liée à la concentration, soit par diminution des frais de gestion, soit par augmentation chiffre d'aflaires. Le prix à payer en tribut foncier est proportionné à l'importance du pôle d'affaire, à son « prestige », régional, national ou international. La localisation de ce pôle cest relativement moins importante.
2. L'USAGE PUBLIC ET L'INDUSTRIE (Il s'agit bien sûr de la production nouvelle, c'est-à-dire de l'aménagement et de l'équipement industriel des cités, de la question : que doivent payer l'industrie et l’administration
à la propriété
foncière pour de nouveaux
développe-
ments ?) Disons tout de suite qu'il ne serait pas sérieux de traiter ici de cette question. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit plus de l'intervention marginale du droit de propriété sur le cycle, considéré connu de la reproduction capitaliste. Il s'agit ni plus ni moins que de la reproduction capitaliste elle-mêsne, élurgie, dans son déploiement spatial, et dans ses implica- \ tions politico-économiques. Or, d'une part l'intervention du res dans l'économie capitaliste (investissements pulics, planification, etc.) n'a jamais été très correctement traitée g passe sur les raccourcis du « capitalisme monopoliste d'Etat»), et surtout la prise en compte de la caté36.En
général
il s'agit d'un
quartier central.
Cet
cite donc dans le centre-ville un tribut foncier qui peut
et qe
déterminé par l'importance de la ville.
tons-en
volcanique 1
Maure
pour
porter
Un
le prix au centre
nouveau
se fixe par
à la théorie
du sol sus-
très élevé, de
«l'île
intégration à partir de la
dépendrait donc : du prix du terrain de la de ju pente den à prices pour Le CENTS TR
tants. On constate en ellet une relation (par la puissance 3/2) entre la population d'une ville et le prix du terrain au centre. Or, comme me le faisait remarquer le Pr. Darin-Drabkin pour critiquer l'interprétarion de ce fait par le modèle de l'ile volcanique, le + sommet»
européen du tribut foncier se trouve à Zurich, dans le quartier affaires | Serait-ce à cause de la AE
œnire
On mea R
C0 LiEnee
4 re
fertilité du sol agraire autour
sa population pour l'occupation du
it faire la même remarque Te Nes où Paie dun Et
concerne le + somLa Emglsour es trims
dl
goric d'espace économique n'a jamais été assumée par les marxistes” ni d’ailleurs par les économistes en général. Quelques indications seulement. Aujourd'hui l'industrie ne recherche pas un site particulier, mais une insertion dans l'espace économique, ce qui nécessite éralement une intervention publique (création de zones d'activité industrielle, d'infrastructure de transport) qui peut être génératrice de « tribut différentiel interne d'intensité » (voir chapitre IT). Mais en général l'activité industrielle ne suscite pas un tribut supérieur aux autres s (y compris agricole), et se contente de payer le tribut fixé par l'usage antérieurement qui ne représente pas de capital à l'hectare).
cal
présent
grand-chose
pour
elle,
L'usage public du sol ne suscite pas de T.F. autonome. Comme le note le rapport de la Commission des villes du VI* en ce n'est pas un «achat du droit à construire », mais ien un «achat du mètre carré ». L'usage public du sol nc vise pas au profit, mais au bon fonctionnement de l'usage lo-
dominant,
(route) qui
ou
futur.
L'investissement
public
a
dominant (ce vue l'intensité
no
137
ge
les sources du tribut foncier
« crée » un T.D., par le nouvel usage qu'il permet
des environs, risque ainsi de devoir payer le tribut foncier qui lui aura permis de créer*. Mais ce n'est pas lui qui le détermine.
37. Comme
la « politiqueeee
devient
un des nœuds
stra-
niveau présent, qui peut d'ail rs être déjà très lourd. Faut-il s'il en est ainsi, c'est bien r ces raisons politi , OÙ à ues (dans la région juri }, liées à la concepM hanterde troncs spa gurias font remarquer les « technocrates », il n’en serait pas de même si les juges d'expropriation
fixaient l'indemnisation au niveau actuel du tribut foncier.
Ét pourquoi
pas à un prix égal au S.M.IG. capitalisé? La propriété privée donnetelle ou non le droit au maximum de profit que l'on peut en tirer ?
Remarque de 1973. Quand j'ai rédigé œtte note en 1971, je croyais n'avoir écrit qu'une Érsne Or, eu décernbre 1972, Le les élèves de l'E.N.A., M. Esstandon est allé jusqu'à évoquer une « indem-
qe régressive, selon les revenus, en londe, 1° décembre 1972). Voilà qui
au
rang
de t
matière d’expropriation »! (Le re le DES de la CFDT.
proposition réactionnaire! Et qui confirme itique du montant du prix du sol.
le
caractère
n 1973, le vent ayant tourné au détriment du capitalisme moder-
niste, le ministre Guichard ava
à l'automne un
projet
de loi fon-
cière qui renforce au contraire Le « droit à la spéculation foncière».
à
solution sait alors
de s'acquitter du tribut foncier au
à 20
qui
gg
le que, pour l'administration, la seule
le secret des opérations,
he png
Je livre l'état de ma réflexion à l'annexe III (mai 1973).
dite.
Gili).
éd
tégiques du capitalisme, les es commencent à se dessiner (par exempl le : la notion de « production d'espace territorial », de Fahri et
138
le tribut foncier urbain
CONCLUSION Avec le développement du capitalisme, le tribut foncier, comme le mode de production capitaliste, passe par diffé-
rents stades. Mais, loin de présenter, comme à l’époque du mode de production féodal, les formes successives rap-
ports sociaux
de production
invariants, cette évolution n'est
que le reflet, réfracté par un rapport de force déclinant, de la progression
du Capital.
De quasi-impôt arbitraire prélevé par le rentier immobilier sur l'ensemble de la société (« tribut à la Engels ») il tend à devenir (« tribut à la Marx ») une fraction prélevée sur
la masse
énorme
de
la plus-value
produite
dans
l’industrie
de la construction. La France occupera un stade « mixte» tant que durera la crise du logement. Mais de toute façon
subsistera
une
« rente
à la Engels » dans
les échelons
supé-
rieurs de la division sociale de l'espace. Mais dans tous les cas la propriété foncière, directement ou indirectement, se révèle antagonique au développement
du capitalisme : sous forme de rente immobilière, en élevant le prix de la force de travail, en freinant la mobilité de la
main-d'œuvre; sous la construction,
en
forme
freinant
de tribut sur la plus-value dans l'investissement
par
le capital
industriel de ce secteur de l'activité économique. La vicille propriété foncière, prototype idéologique de la propriété du capital, se révèle l'ennemi à abattre du Capitalisme. Nous avons vu la position des théoriciens de l'Immobilière Construction de Paris. Face au blocage de l'industrialisation, la position des grandes entreprises qui produisent les éléments de la préfabrication ouverte est encore plus radicale : « La recherche des terrains et leur aménagement
primaire
dépassent
largement
position
d'un producteur
la
mission
du
constructeur,
tant au point de vue financier qu’au point de vue réglementaire, et il est aussi anormal de demander à ce constructeur de fournir son terrain qu'à un constructeur automobile de fournir sa route, La solution nous paraît être une formule se rapprochant du « prêt-à-construire » actuel où le terrain aménagé serait fourni par l'Administration et mis à la dis-
qui serait chargé
de l'ensemble
conception-réalisation dans le cadre d’un marché de type clé-
en main”.»
, Réponse au Rapport Barets de M. Pagezv, directeur du départe-
de l'habitat du
Holding Saint-Gobain: Pont-à-Mousson. La thèse
est jugée excellente par M, Barets.
s'
3
La différenciation spatiale
du tribut foncier
Au point où nous en sommes, si nous avons bien montré comment tel usage spécifique du sol suscite un tribut foncier,
et si nous
avons
montré
quelles
en
sont
les
sources,
|
su rapports se nouent entre le capital et la propriété néière, il nous reste à rendre compte de la modulation de ce
Quelques remarques préliminaires : nous ne rendrons compte ici que du tribut foncier suscité par la production capitaliste du logement. Ensuite, pour sacrifier à l'usage, nous conservons le ter-
me de «tribut différentiel», pour désigner l'inégalité des
séinn
tribut dans l'espace.
quand
par exemple
le promoteur
« dupe»
quant aux potentialités de son terrain.
A. LA TRANSPOSITION CRITIQUE Le problème pas
DU
des sources
TEXTE
étant
DE
le propriétaire
MARX
laborieusement
ET
SA
réglé, le
blème de la modulation sera-t-il une promenade, suivant
à pas le texte de Marx ? Hélas, la tentation d'une trans-
Sim
celui-ci n'est pas effectivement versé au Propriétaire foncier,
bér-meut héberge à 2 Rom
lieu par un autre usage. Enfin, et pour simplifier, nous parlerons de «tribut» pour désigner le surprofit, même quand
Hasta
la mise en valeur du capital. Rappelons simplement que pour nous ce tribut ne «s'ajoute» pas miraculeusement à un hypothétique «tribut absolu » déterminé en un autre
ES
tributs suscités par la diversité des formes et conditions de
140
le tribut foncier urbain
position « naïve », qu'avec bien des marxistes j'ai partagée, et que représente par exemple l'article d'Alquier, ne nous donne pas de résultats très satisfaisants.
1. MARX
ET LA TENTATIVE D'ALQUIER
Marx distingue unc « rente différentielle 1 » (due aux différences de fertilité des terrains et de situation par rapport aux moyens de transport el au marché), et une « rente diff rentielle 2 » duc au capital investi. Ce dernier type de rente fait l'objet, dans les brouillons du Capital d'une exposition assez confuse. En fait, ce terme vise chez Marx deux phénomènes bien distincts : — une remarque triviale : même si le rendement du capital (donc le surprofit rapporté au capital) reste constant, la rente rapportée à l'hectare est fonction de la quantité inves-
tie à l'hectare : ce qu'on peut appeler rente « extensive » ;
différentielle 2
— une remarque plus subtile, qui annonce toute l'économie marginaliste : rapporté à la mise de capital supplémentaire dans le cadre d'une économie donnée qui détermine le prix du marché, le taux de surprolit est fonction du niveau de capital déjà engagé” : avec l'entrée en jeu des engrais et de machines, le rendement est croissant puis décroissant. Nous désignerons ce phénomène par rente différentielle 2 « intensive » : celle qui traduit la différence des surprofits Marginaux.
Alquier aborde le problème selon une démarche dont nous avons vu qu'elle était viciée à la base : elle part de la circulation simple de la marchandise logement (le rapport : acheteur/propriétaire immobilier) au lieu de partir de la
production de cette marchandise (le rapport : capital promotionnel/propriétaire foncier). Immédiatement, il devient impossible de parler de « Ren-
40. Cela n'est évidemment pas propre à l'agriculture. Pour Marx
le rendement est croissant à moyen l'investissement à EE technique i
Er Dbhache
es condit étant os
eurs » ou
terme
(c'est-à-dire ctà
hsrente Et on, » on
significatifs de réserves
n'écrira
jamais
culatives en France ! 58. C£. Mass
la monographie
occultes. des
Naturelle-
réserves
et la dislectique du produit et du besoin.
spé-
les variations du tribut foncier
c. Profit promotionnel, revente
plus-value foncière,
165
et politique de
Les objectifs des promoteurs sont doubles — réaliser
taux moyen
le
«profit
d'entreprise
:
promotionnelle » au
et réinvestir ailleurs ;
— réaliser en plus une fraction du surprofit de plus-value foncière.
sous forme
Dans les deux cas, l'intérêt du promoteur est de cons.
truire et de revendre
vite le logement,
fraction
de propriété
du sol comprise, N'oublions pas que, si fondamentalement le
T.F. est prélevé sur le profit promotionnel, l'achat du terrain apparaît pour le promoteur comme un capital avancé. L'intérêt des promoteurs est donc le développement de l'acpm re à la propriété, qui accroît la vitesse de rotation du
capital.
L'intérêt général du capitalisme est cohérent avec ce projet : l'accroissement du taux de profit par accélération de la rotation du capital est dans la ligne de la « société de consommation dirigée », Le problème de la réalisation du capital-
marchandise est ainsi transformé en un problème de crédit
pour le consommateur. La tendance générale de la propriété foncière urbaine est donc le morcellement, c'està-dire l’aggravation du problème.
La pratique des Promoteurs transforme de grandes propriétés (sur Dane on produit) en milliers de « millièmes de co-
propriété
» (sur lesquelles
remarque
Alquier,
on ne
produit
il faut distinguer
du
cas
plus
rien).
Mais,
de la périphérie
(où cette analyse est juste) le cas du centre ville. Il est en effet exact que
© Au
centre, le rapport
Tribut à la Engels Capital investi
est plus
important qu'à la périphérie et son augmentation plus rapide : en effet, toutes les causes de hausse du tribut foncier (différentiel et absolu) convergent au centre, dans les im-
meubles de grand luxe et les quartiers de tertiaire supérieur ;
© A la périphérie, ce rapport est moins important que le Or
. Rs
plus-value d'innovation et d'urbanisation
TK: agricole
11 en résulte que le capital s'investit plutôt à long terme
166
le tribut foncier urbain
dans le centre des villes (propriétaires immobiliers, Sociétés
civiles de placement
immobilier,
SICOMI)
et plutôt
terme à la périphérie (promotion immobilière).
à court
CONCLUSION La hausse générale, et pratiquement inéluctable dans la conjoncture à moyen terme actuelle, du prix du sol, rend possible et tentante l'appropriation d'une part du tribut foncier, sous forme de plus-v: foncière, par un capital com-
mercial. Les capitalistes ayant en vue, non pas l'intérêt général de leur classe, ni le souci du développement du mode de production capitaliste, mais leur profit privé, ce phénomène vient tempérer, pour une certaine fraction de la bourgcoisie, y compris financière, l’antagonisme dénoncé dans les ne précédents entre la propriété foncière et le capi-
talisme.
Conclusion Cette analyse a montré l'efficacité de la méthode marxiste dans l'étude du problème foncier urbain. La théorie du tribut foncier, qu'il soit urbain ou agricole, doit partir du point de vue de la production ; mais la nature particulière du bien « logement » oblige ici à une analyse très complexe, qui souligne le rôle du fonctionnement du système de la promotion immobilière en tant que système, comme relais entre la structure et la conjoncture de la formation sociale d'une part, le montant du tribut foncier de l'autre. Nous avons ainsi pu ordonner toutes les causes qui déterminent la distribution de ce tribut, causes dont la plus fon-
damentale est la division économique et sociale de l’espace. En effet, le Tribut différentiel n'est pas dû à l'existence de la propriété foncière (et ne disparaîtrait donc pas avec la
collectivisation du sol), mais à la structuration très différenciée du cadre de vie capitaliste, à commencer par la sépa-
ration initiale entre la ville et la campagne. « C'est le cœur de la question, dit Engels, elle ne pourra être résolue que si
la société était assez profondément
transformée
pour s'at-
taquer à cette opposition”.» Si le capital ne déportait pas garçons et filles de Bretagne et d'Occitanie pour les accu-
muler aux abords des grandes concentrations industrielles
et tertiaires, il n'y aurait pas de question du logement, ni de problème foncier urbain ! s le capitalisme existe et ne peut fonctionner autre
ment. Dès lors, il se heurte à la propriété foncière qui capte
le tribut différentiel, et exige un tribut absolu sur tout ce qui
se fait sur le sol. Ce tribut
se la propriété
foncière
au capitalisme
de
deux façons : à travers le « tribut à la Engels », elle accroît pe l'ensemble du patronat le prix de la force de travail; travers le «tribut à la Marx», cllc bloque le développe59. Effectivement, développement de la production de richesses et
accumulation urbaine ne sont pas éternellement liés, comme le montre
l'expérience chinoise
(cf. Micheline
naire et aménagement de
Luccront
l’espace en Chine
« Processus
révolution-
: vers la fin des sépara-
tions entre villes et campagnes », Espaces et Sociétés n° 5),
168
le tribut foncier urbain
ment capitaliste dans l'industrie du bâtiment. Ces deux rapports cocxistent en permanence, mais l'aspect dominant s'est déplacé depuis la Libération vers le second, parallèlement au
déclin général des rentiers, à la montée en France du capi-
talisme monopoliste. Mais dans la France capitaliste du vI° Plan, qui prétend accélérer l'industrialisation générale donc la croissance urbaine, la solution du problème foncier, sous ses deux aspects,
se fait de plus en plus pressante. A l'issue de cette étude du problème foncier, il ne faut cependant pas oublier les autres problèmes posés à la production capitaliste du logement. D'abord l'extrême arriération
des
institutions
et
professions
(hypothèques,
notariat,
architectes, etc.), sans cesse dénoncée dans les réponses au rapport Barets. Il s’agit d'ailleurs là d'un héritage des « États » d'Ancien Régime, prérogatives, corporations, comme la propriété foncière elle-même. Ensuite le second problème ué dans la Le : l'insolvabilité des acquéreurs. « Faites-nous un crédit-acquéreur convenable et il n'y aura plus de problème de la construction", » Enfin, le quatrième chapitre a montré que dans la contradiction qui l'oppose à la propriété foncière, le capital ne peut compter
sur une attitude
commune
de toute la bourgeoisie,
dont une fraction joue la carte de la s lation foncière. L'histoire de la lutte complexe et voilée des intérêts mis en jeu par la question foncière, tel sera l'objet de la quatrième partie.
60. M. Rorssecier, délégué général de la Fédération nationale des
constructeurs promoteurs, n'est intervenu que sur ce thème aux jour. nées de l'E.N.P.C. C'est effecti t la pri dans le
point de vue privé du promoteur. J:
Verrière-Maurepas,
et de justesse de vuc dans sa voit que «le t est
avec
le «buïlder » de La-
bien plus
d'ampleur
à l'enquête de L'Expansion. IL par deux grands problèmes et deux
» : l'entassement urbain et l'organisation du crédit acqué-
reur, et ne consacre
lui oppose une
“
au second, Quant au premier,
» : Construire de petites villes
Complément à la IIIe partie
La rente foncière pétrolière
deux ans les initiatives de l'O.P.E.P., et depuis trois
mois la «guerre du pétrole», ont remis la question de la rente foncière au premier plan de la réflexion économique.
Nous venons de nous livrer à une lourde étude sur le cas
des tributs fonciers agricoles et urbains, réflexion prolongé: dans la postface. A l'heure où les économistes et les publicistes se replongent anxieusement dans Ricardo, nous pouvons nous offrir le plaisir de réinvestir sur le champ pétrolier notre accumulation théorique dans la veine marxiste, Les marxistes des pays exportateurs ne s'en sont d'ailleurs pas privé (voir par exemple l'article de Douglas Bravo, « L'impérialisme pétrolier », in Les Temps
Modernes,
bre 1973).
novem-
1. LE « PRIX DU PÉTROLE » EST LA FORME QUE PREND SUR LE MARCHÉ MONDIAL L'AFFRONTEMENT
DU CAPITAL
IMPÉRIALISTE
LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE D'ÉTAT DES PAYS EXPORTATEURS
ET DE
L'étude de D. Bravo montre que jusqu'à une date récente les grandes compagnies pétrolières avaient réussi à arracher, aux U.S.A. d'abord, dans les pays du «tiers monde » ensuite,
‘un statut de « copropriétaires fonciers ». La structure oligo-
poliste du traitement et de la distribution pétrolière d’une part, la domination politique impérialiste d'autre part, leur
avait en effet permis d'imposer un régime de concession à
très long terme, leur laissant la faculté quantité extraite, d'autre part le prix rente foncière proprement dite s'éleva sant de 1/8 de la production jusqu'à la
de fixer d'une part la d'embarquement. La progressivement, pasrègle du « fifty-fifty »,
mais en se stabilisant sous la forme d'un « impôt sur le bénéfice des entreprises extractives », forme qui constituait la reconnaissance
juridique par les Etats de l'abandon aux compa-
gnies de la propriété économique du sous-sol, Un autre signe
du statut de co-propriété est le fait que, une fois le pétrole
embarqué produit
et les royalties
était ensuite
réalisé
compagnies qui empochaient
payées (sur une
sur
le marché
base
locale),
mondial
par
le
les
ainsi la rente différentielle ré-
170
le tribut foncier urbain
sultant de l'inégalité des frais de transport ct autres qualités
des gisements. La lutte des nations opprimées pour leur libération, qui se développa
tout au long de
ne
se traduisit peu
à peu au niveau de leurs Etats (quelle qu'en soit la nature politique, c'est-à-dire même chez les Etats réactionnaires
au dedans et liés à l'impérialisme au dehors) par une volonté
d'indépendance, et notamment quant à leurs pouvoirs de propriétaires fonciers. Cette volonté s'exprima très tôt (Mexique, expérience Mossadegh en Iran en 1952), mais c'est aujourd’hui, avec le développement des contradictions interimpérialistes
entre
4 pôles (U.S.A.,, Europe,
Japon,
et social-
impérialisme soviétique), que cette volonté peut se matérialiser sans trop encourir les risques de la « politique de la
canonière »!,
Dès lors, les décisions de l'OP.EP. puis la «guerre du pétrole » peuvent être interprétées comme une réappro-
priation brutale, par certains pays dominés, des droits inté-
graux («user et abuser ») des propriétaires fonciers. En ce qui concerne les Etats arabes, ces droits sont allés jusqu'au
contrôle du volume de la production; mais tous, y compris le Vénézuela, ont recouvré le pouvoir de fixer selon leur propre
8
calcul
économique
le niveau
de
la rente,
et de
limiter
ue es baux (problème de la « réversibilité » évoqué par . Bravo). Au niveau du prix du pétrole, deux conséquences spectaculaires :
— une hausse générale du prix du pétrole sur le marché mondial (par rapport à 1971, multiplication par 5 ou 6) : c'est le bond en avant de la rente absolue. Nous verrons plus loin comment il se fait que la rente puisse varier si vite, sans
modification du système productif mondial;
— unc différenciation du prix à l’embarquement dont bé-
néficient maintenant les Etats pétroliers. C'est la récupération des rentes différentielles par les P.F. Par exemple, suite à la réunion de Téhéran du 23 décembre
1973, qui fixe le prix
affiché du pétrole du Golf Arabique («le plus mauvais ter1. Tout
dépend
dans
des rapports de force diplomatiques,
militaires et financiers et les crulles expériences de Saint Domingué ou du Chili montrent qu'ils ne sont pas encore favorables aux
pays dorninés. 11 est vrai que le Chili allait bien loin que la lutte pour l'indépe une. 2. Le prix affiché est un héritage de la formeimpôt de la rente : le taux d'imposition reste fixe, mais les Ftats pétroliers fixent eux-
mêmes maintenant ce « prix fiscal» abstrait. En multipliant ce prix par le taux, on obtient la rente par baril commercialisé par les compagnies.
|
la rente foncière pétrolière
171
rain ») à 11 $ le baril, le réalignement donne 14,69 $ au Nine et 16 $ en Bolivie. On reconnaît la renle différentielle 1 situation; il existe d'ailleurs une rente de « fertilité », rée par des primes spéciales selon la teneur en souffre, la composition des hydrocarbures, etc.
2. LA RENTE FONCIÈRE PÉTROLIÈRE A SA SOURCE EXCLUSIVE DANS DES RAPPORTS SOCIAUX ANAIOGUES A CEUX DE LA « RENTE A LA ENGELS » C'est une « rente-monopole », déterminée par le « besoin et la capacité de payer » des consommateurs finaux. Elle n'a rien à voir avec la différence valeur-prix de production : dans l'industrie pétrolière celle-ci serait d'ailleurs négative. Elle est donc une part de la plus-value produite « ailleurs », c'est-à-dire dans le système économique mondial et principalement « au centre ». Elle est prélevée dans la circulation générale, soit quand les industriels paient le fuel à leur usage, soit quand ils versent à leurs salariés des salaires pour se chauffer, se déplacer, etc. Elle entre dans le prix des marchandises dérivées du pétrole à la manière d'un impôt indirect. d'Iran a déclaré, à l'issue de
1973, que les Etats importateurs
fiscalité’,
trompés,
la conférence
du
23
et le Chah décembre
n'avaient qu'à réduire
leur
Avant même que la guerre du pétrole ait rendu la chose évidente, D. Bravo avait correctement rejeté l'explication marxienne de la rente absolue et repris la théorie de Engels : « À ce point de notre analyse, il est de la plus haute importance de se poser la même question que Marx : d'où
vient la plus-value constituée par la rente foncière ? [...] Etant donnée la haute composition organique du capital pétrolier,
depuis longtemps et encore aujourd'hui, nous sommes obligés de qu'elle n'est pas exclusivement constituée par la plus-value créée par les ouvriers du pétrole, mais qu'elle est
constituée, fondamentalement, par la plus-value créée par de vastes secteurs du peuple travailleur à l'extérieur de l'indus-
trie pétrolière. »
I1 se donne même la pcine de chiffrer la part de plusvalue captée, en 1971 : le produit par tête des ouvriers et cm3. Avant les récentes décisions de Téhéran, dans les 1,35 F payés
en France l'Etat
un litre de supercarburant, il y avait 9 centimes pour et ® pour le fisc français!
ES
Les Etats pétroliers ne s'y sont pas
172
le tribut foncier urbain
ployés
vénézueliens
serait
de 94 500
$ (!), ce qui
manifeste-
ment ne peut représenter la valeur de leur force de travail! De cette identification du prix du pétrole comme « rente à la Engels », prélevé sur la circulation mondiale de la plusvalue, nous pouvons déduire toute une série de points im-
portants.
3. LA RENTE PÉTROLIÈRE
N’OPPOSE PAS LES ÉTATS EXPORTATEURS
AUX COMPAGNIES DU CARTEL PÉTROLIER
Contrairement à la «rente à la Marx », la rente-monopole n'opposc pas les intérêts du propriétaire foncier et ceux du « fermier», du capitaliste qui investit sur son terrain et commercialise le produit. Au contraire, elle les rend solidaires, puisque la hausse du prix-monopole du produit (blé, logement ou pétrole) entretient à la fois la hausse des profits et la hausse des rentes. La guerre du pétrole l'a bien montré : d'une part les Compagnies ont largement « aidé» les arabes à aver la pénurie par une rétention spéculative de stoks; d'autre part elles ont répercuté en pourcentage
la hausse du brut sur leurs marges. Il ne faut chercher là
nul
rent
«complot à
la
des monopoles» : c'est un
nature
même
de
l'ambiguïté que nous avons rente immobilière.
4. EN
la
phénomène
rentemonopale,
signalée entre rente
REVANCHE, ELLE S'OPPFOSE A L'INTÉRÊT GÉNÉRAL
us
inhé-
à
ière
et
DU CAPITA-
LISME DANS SON ENSEMBLE : C'EST UNE PONCTION SUR L'ACCUMULATION MONDIALE
Comme toute rente de monopole (rente « d'escroquerie généralisée» disait Engels), elle opère en prélevant sa part
sur une plus-value déjà produite, et produite dans l'ensemble impérialiste, par les travailleurs du
:
8
du système
tier, soit en haussant le prix de la «consommation sociale moyenne» des pays de la « société de consommation», soit
en renchérissant le prix des produits du secteur de production des biens de production. Sur la plus-value produite au sein du Mode de production capitaDate, sin prébre une port, qe où PS TS
des profits, donc elle
inue le taux de
Cette question fondamentale présente
t moyen.
aspects :
173
— la rente pétrolière n'est pas un rapport d'exploitation‘. Elle intervient après : c'est un rapport de distribution du MP.C. (voir postface). Si le pétrole peut être aujourd'hui vendu si cher, c'est que la masse de plus-value créée par le capitalisme mondial permet de la payer. À ce propos il faut relever les sermons amusants de ceux qui depuis des décennies n'ont
rien dit contre
le
« pillage
du
tiers-monde », rien
contre « l'échange inégal », rien contre le « développement (par l'impérialisme) du sous-développement », et qui maintenant
s'appitoient
sur
les
pauvres
pays sous dévelop
qui
vont faire les frais de l'égoïisme arabc! Si les «lumpenbourgeoisies » du tiers monde ne peuvent payer le pétrole au méme prix que les bourgeoisies impérialisies des métropoles, ce n'est pas la faute des Etats arabes, mais celui du développement inégal. Quant aux masses misérables des trois continents, qui ont
tout perdu
avec
la colonisation,
le baril
ne $ n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de leur déréon’;
— c'est la dépendance à l'égard de l'industrie pétrolière du système productif mondial, et du mode de consommation
dominant
dans les métropoles, tels qu'ils ont été structurés à
l'époque où les Compagnies baissaient systématiquement leurs prix (quand elles étaient copropriétaires fonciers) afin de barrer la route par « dumping » aux autres sources d'énergie’, qui permet aujourd'hui aux Etats pétroliers de prélever une rente monopole. Le pouvoir de ces rentiers est donc
4, Ce n'empêche pas les classestenants des Ftats (hourgéoisles dE d'Etat, bourgeoisies compradores, féodaux)
par
pétroliers d'exploiter
fellahs ct Jeurs ouvriers.
. 5. Et puisqu'on en est à la méthode moralisatrice en économie, que dire de ceux qui reprochent aux Arabes de faire payer le pue alors qu'ils ne sont pour rien dans l'existence de ce pétrole dans leur sous-
dans sa mwa l'Estco ve par prpdh Soérétion or bourgeoisement esRTE est pour ue chose dans ER du monde t inégal où elle s'est Bonsée ie
pour quel co ? Estce
était
que la Oourgeoine
ue chose dans le fait
était une île tem
ï
que l'Angleterre
* avée du fer et du charbon? If ny a que les se vanter d’avoir colonisé
une terre
splendide,
naturels. en anéantissant les autochtones! es : où l'on s'en lient au monde tel que
et on “
6. Ce
la
remodelé,avec la loi de la valeur et l'objectif du | rrobt
fait de Ténone explicative, Ou on fait de l'éco nee Yes pas mal dé chais à fouelter avant de jeter la
PS
nent
dde Caen.
meme
Den
défini nn chapitre
mic
À D
uelle le ne
ses déstlonpées (et mème
ait sé =" siege cmd ares ere sien térhbldlht mm
la rente foncière pétrolière
174 5.
le tribut foncier urbain RENTE
FONCIÈRE
ET CRISE
MONDIALE
DU CAPITALISME
La hausse brutale de la rente pétrolière, dont on prévoit
déjà qu'elle sera suivie de hausse sur les rentes de toutes les
matières premières venues du tiers monde, réactive l'actualité de la fameuse « formule trinitaire» : Salaire-profit-rente foncière. Les classiques (Ricardo, Malthus) prévoyaient une stagnation du capitalisme par baisse du taux de profit due à la hausse de la rente foncière. Va-t-on vers un tel me de crise, déjà évoquée par le fameux rapport du M.LT.? Marx ne croyait pas à la « crise à la Ricardo », parce qu'il it e la tendance générale du M.P.C. à la hausse de la prouctivité des facteurs
permettrait
toujours,
à moyen
terme,
de repousser les zones de «rendements décroissants », Il est vrai que dans vingt ans, le monde capitaliste pourra se passer du pétrole. Is d'ici là ? D'ici là, le capital doit se résoudre à voir une fraction de son Le captée par les propriétaires fonciers. Comment va-t-il réagir? D'abord, dès qu'il y a lutte au niveau de la distribution d'une valeur déjà produite, ce repartage prend la forme dynamique de l'inflation (cf. « Le tribut foncier est-il inflationniste ? »). C'est probablement ce qui va se pas-
ser : les produits industriels seront
revendus
encore plus
chers (et comme l'inflation mondiale a commencé bien avant la hausse du pétrole, les Etats pétroliers ont très classiquement cherché à légitimer ainsi leur politique). Mais ici intervient la troisième partie prenante de la distribution : les travailleurs. Or, dans les métropoles, les surprofits impérialistes avaient permis au capital d'accorder
aux travailleurs un niveau relalivement élevé de mation sociale moyenne ». Cette politique (dont lance était précisément l'automobile) avait deux ces
:
intégrer
politiquement
une
«aristocratie
«consomle fer de “
ouvrière »
dans les métropoles, et2e le volume de la demande ainsi créée, résoudre le problème de la réalisation de la valeur. Si donc le capital, face à la hausse de la rente foncière, cherche a maintenir son taux de profit en attaquant par la hausse des prix le niveau de vie des travailleurs (c'est-à-dire en
accroissant
le taux
Kautsky »)
que
de plus-value
pl/v), il risque
fort de se
heurter à une crise de surproduction relative. Autrement dit, il n'échapperait à une «crise à la Ricardo» (ou «à la par
une
crise
D'ores et déjà, indépendamment
«à
la
Rosa La
de l'embargo
pétrolier
© 7. Que l'on retrouve d'ailleurs dans certains secteurs des pays éominés : c'est, selon Douglas Bravo, le cas des
du pétrole vénézueliens,
trois
derniers
mois
de
1973, la hausse
175
des
prix
du
pétrole
provoque une baisse de l'activité des industries automobiles, aéronautiques, etc. Il reste que, ce qu'il ne vendra plus à ses ouvriers, le capital pourra encore le vendre aux «propriétaires fonciers ». À l'époque du grand débat sur la «loi des débouchés»
ques
ciers,
qu'a
brillamment
avec
leurs
résumé
Rosa
Say-Ricardo-Sismondi-Malthus), dépenses
Luxemburg
les
improductives
(polémi-
propriétaires de
nié
la rente foncière pétrolière
fon-
luxe,
avaient
pas, car cette Gemande
se com-
À court terme, certainement
posera de biens de luxe, de matériel militaire, et de biens d'équipement pour les industries de « substitution d'importation », et non de biens de consommation de masse pour O.P., techniciens et cadres moyens occidentaux. A moyen terme, il s'agit d'un problème de prospective passionnant, à une dernière question.
Dm
6. À QUOI SERVIRONT LES REVENUS DES ÉTATS PÉTROLIERS ? L'histoire montre que toutes les régions exportatrices de matières premières qui ont connu un «boom» n'ont pas su en profiter, et la régression a suivi les années de prospérité : splendeur fanée de Bahia et des comptoirs. Samir Amin montre que c'est un effet du comportement économique des classes dominantes locales (bourgeoisies compradores, propriétaires
fonciers).
Dans
la
mesure
où
leur
revenu
n'est pas lié à leur initiative, ils n'ont aucune raison d'’accumuler du capital productif.
Mais cette fois, il s'agit d'une rente d'Etat. « L'autonomic du politique » permettra-t-elle aux Etats pétroliers de dépas-
ser
la myopie
l'OPE.P. tique
de
l'initiative
privée? Les
gouvernements
de
s'y déclarent résolus. Si la bourgeoisie bureaucra-
d'Etat
est
assez
forte
(Iran,
qu'elle se ménage grâce à une
Algérie),
il est
possible
« révolution par en haut », à
la Bismarck, une transition vers un capitalisme non pas « pégne
8. C'est ainsi que Samir Amin (dans Le développement étégal) désile fonctionnement du capitalisme au centre (métropoles), où,
grâce
à une
modération
relative
du
taux
d'exploitation,
une base de consommation suffisamment lar mulation élargie. On voit que cette « sociéti
est assurée
me permettre l'accuconsommation» est
liée à la réalisation de surprofits dans les rapports centre-périphérie.
mt
qui nous amène
nn a
précisément pour « fonction » de permettre la réalisation des surplus, Les Etats pétroliers pourront-ils offrir au capitelisme des métropoles la « demande autonome » qu’il ne trouvera plus dans le modèle de « l'accumulation aulocentrée »° ?
176
le tribut foncier urbain
riphérique », mais semi-autonome, c'est-à-dire inséré dans le marché mondial suus la domination techuologique étrangère’, mais
avec
une
certaine
marge
Taronee au
niveau
d'un
sous-continent. Ajoutons qu'il y a une seconde ni gps pour « faire du capitalisme », il faut du capital-argent… mais aussi du prolétariat. C'est tout le problème de la Lybie et des
Etats du Golf!
Il y a donc fort à parier que, hormis les dépenses re ductives (par exemple militaires), l'argent du pétrole ira pour une grande part rejoindre la masse des capitaux spéculatifs, de la « hot-money » qui dérègle eee le système monétaire international. Dans l'odyssée du capital et de son
accumulation,
la rente
”
foncière
est bien
un
nau-
31 décembre 1973.
9. Sur cette autonomie relative des bourgceoisies opérant segment de la rouvelle division internationale du travail, ne lobalement
ES ER
des rapports
dominée par le capital financier et l'i LE les récents travaux de Palloix, Le concept de Poulantzas
NE
De M
“'éonigeae
lus
talistes et l'Etatnation », in les
Temps Modernes,
IF Lutte des classes ef
politique foncière
Introduction Je pense avoir montré que la question foncière est intimement liée à la politique de l'espace, à la politique des
salaires, à la politique industriclle et financière, À ces multiples titres, la propriété foncière l'intérieur de la formation
est suurce
sociale française.
de conflits, à
Il n'est pas question d'approfondir ici les problèmes généraux que nous venons d' uer, pas même le problème plus central de la politique de l'espace. Nous nous proposons simplement d'examiner l'évolution historique et l'état actuel du rapport des forces en présence, sur le point précis de la propriété foncière urbaine : comment les forces sociales brimées, favorisées ou mystifiées par ce droit politique ont infléchi leur attitude à son égard. Nous serons bien sûr obligés de tenir compte de la structure et de la conjonc-
ture d'ensemble de la formation sociale. En revanche nous ne
nous préoccuperons
pas du problème,
pourtant
lié, de la
propriété des sols à usage agricole. Comme nous l'avons vu, l'existence de la propriété foncière pèse sur l'ensemble des couches populaires et moyennes par l'intermédiaire de la question du logement, mais ces couches éprouvent pour le droit de propriété un attachement idéologique. Quant au capitalisme, elle le gêne doublement. Par le tribut prélevé sur le salaire de l'ensemble des ouvriers et des employés, elle hausse improductivement le coût de la main-d'œuvre pour le patronat; par l'obstacle qu'elle présente au déroulement normal du procès de production, elle ferme la porte à l'industrialisation du bâtiment. Elle introduit donc des contradictions d'intérêts au sein des couches « nes », contradictions au reste secondaires, et Scandées par l'évolution du rapport de forces dans l'antagonisme principal entre capital et prolétariat. C'est cependant de ces contradictions que nous allons traiter.
Or, dans la conjoncture actuelle d'accélération de l'accumulation capitaliste industrielle, en France, ces contradic-
tions tendent à devenir antagoniques : antagonisme entre la
Vieille France à la mentalité < rurale », avec son capitalisme
de rentiers, et le projet d'une « nouvelle société », qui se veut « post-industrielle ». L'ennui, c'est qu'entre le «rural»
introduction
179
et le « post-industriel », il faut encore traverser, et vite, l'âge industriel...
Nous étudierons plus sérieusement les raisons de cette représentation idéologique, mais il faut constater que la Commission de l'Habitation du vi Plan a pleinement conscience du problème, elle qui, après avoir souligné que des objectifs industriels ambitieux étaient incompatibles avec le malthusianisme en matière de logement, conclue : « C'est sans doute dans le domaine de la politique du logement que se manifeste avec le plus de clarté et d'intensité les facteurs de blocage qui s'opposent à la transformation de notre société : une structure sociale figée, qui trouve son image et
se renforce dans l'absence de fluidité du parc immobilier, une faveur excessive faite aux droits et situations acquis, un goût immodéré pour les plus-values improductives [...]".» C'est à partir de telles constatations qu'il faut aborder le problème foncier, celui du prix et de la disposition des sols, sous son vrai jour : non pas simplement économique, mais politique, et politique dans un double sens :
© La propriété foncière est un des « droits acquis », droit
juridique
ne
reposant
tion, uniquement tique politique ;
sur
aucun
cunforté
par
rapport
une
social
législation
de
produc-
et une
pra-
© Son existence met en cause le maintien de l'unité de la formation sociale sous la domination du mode de production
capitaliste.
Le
problème
est
d'autant
plus
grave
pour
le capitalisme que, dans le cas de ia France, il oppose entre elles des fractions de la bourgeoisie, chacune n'étant guidée ee par la recherche de ses intérêts propres à court terme.
Nicos Poulantzas a montré l'importance, face à cette situation, du rôle décisif de l’action autonome de l’Ftar. Nous verrons, à propos de l'Impôt Foncier, les difficultés de cette
« prouve à chaque instant que la défense de ses intérêts publics, de ses propres intérêts de classe, ne fait que l'importuner,
comme
gênant
ses affaires
privées,
ses
intérêts
par-
ticuliers les plus bornés [...} ». Il ne s'agit donc pas, dans ce qui va suivre, de « déduire +
met dh-daemiesds
action face à une bourgeoisie qui, comme le soulignait Marx,
1. L'article de Jean-Pol Roulleau aboutit à la même conclusion. 2. Tous les concepts relatifs à la théorie du pouvoir politique (hégéde classe, classes-appuis, alliances
dans
le sens
de
défini par son
essai (Pouvoir Politique et Classes Sociales). Plutôt que d'exposer rine
3. Le 18 Brumaire de Louis
PAR
€.
00
fraction
utilisés exclusivement
me
monie, bloc au pouvoir,
classe, etc.) sont
180
introduction
de la IT: partie des propositions opératoires pour « abaisser le prix des éd a mais d'apprécier, à la lumière de la théorie, la pertinence des différents moyens historiquement mis en avant, ct d'expliquer par la conjoncture générale leurs succès ct leurs échecs.
æ
La propriété foncière et l'histoire de la formation sociale française L'état actuel de la question du logement et du problème foncier n’est pas le fruit du hasard, ni de l'ignorance, de la malignité ou de l'imprévoyance des gouvernements. C'est le résultat très précis d'un stade du développement du M.P.C.
dans le cadre d'une formation sociale historiquement déter-
minée, Nous commencerons donc par examiner « comment on en est arrivé là», cette brève analyse historique systématisant simplement les indications déjà évoquées au long des trois premières parties‘,
1. LA « VICTOIRE A LA PYRRHUS » DU MODE DE PRODUCTION CAPITALISTE a. La révolution bourgeoise en France
Nous avons
évoqué
la structure du M.P. féodal, et les
métamorphoses qui aboutirent, à son stade ultime, au rapport Seigneur-métayer avec rente en espèces. À l'aube des temps modernes, la féodalité française est très fortement cen-
4. En fait ce tableau a souvent été brossé, tant dans ses grandes lignes (histoire de la domination capitaliste) qu'en cæ qui concerne Ja question du logement. Ce itre s'appuie notamment, sans les citer,
gaoise).
, celle
du Colletif logereent (Oriene Motoque des parparfieularités oriquedes (
Capialisme français), et sur le livre de Houdevile.
182
le tribut foncier urbain
tralisée politiquement par les Capétiens; elle tire de riches revenus d'une agriculture largement prépondérante dans la production nationale. La bourgeoisie se développe en marge du M.P.F. (xv'
sans autonomie politique ni idéologique.
La crise générale du mode de production féodal en Europe siècle),
se
stabilise
en
France
par
une
longue
période
d'état d'équilibre, l'Absolutisme, sous hégémonie féodale en apparence (le Roi), de plus en plus bourgeoise en fait (de Colbert à Necker). La bourgeoisie, qui singe la noblesse (vente des offices), ne peut assurer seule son hégémonie sur l'ensemble de la société, Pour renverser l'ancien régime, elle doit passer alliance avec l'ensemble du Tiers Etat, y compris le petit peuple des campagnes et des villes : et c’est la Grande Révolution qui, au sommet de la vague, ou! ssera très largement ce qu'en attendait un Sièyes ! En quelques années
cependant la situation se normalise. La Grande
rgeoisie
est au pouvoir, mais à quel prix ! L'hégémonie de la bourgeoisie sur le peuple-nation est fondée sur le mot d'ordre ambigu de « PROPRIETE », inscrit dans la Déclaration des Droits de l'Homme comme l'un des buts du contrat social. Sur cette mystification SC l'identité abstraite des citoyens qui, puisqu'ils ont le it de posséder un jardin ont bien le droit d'avoir une usine.
Certes, l'Article 17 précise
que, de ce droit
«inviolable et
sacré, nul ne peut être spolié, si ce n'est lorsque la nécessité publique l'oblige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Quand ce droit sacré deviendra vraiment trop encombrant, les spécialistes qui prépareront le V° Plan devront aller trouver chez St Thomas d'Aquin et Bossuet des arguments pour s'en débarrasser. Mais le droit de propriété n'était plus une question de jurisprudence ,mais bien la clé de voûte de la structure idéologique française. Or le vrai mot-d'ordre du capitalisme n'est pas « propriété » mais « liberté d'entreprise », ce qui est quelquefois le contraire. Chose plus grave, la propriété foncière est dispersée aux quatre vents, les immenses fiefs dépecés en millions de parcelles. Est un siècle la penee. dont ÉTRRREE
cependant
nécessaire au règne
bourgeoisie,
entretien
.
une idéologie pusillanime, fondée sur le culte des valeurs anciennes et sûres, la thésaurisation de l'épargne, le refus du « progrès», des « mutations», du départ vers les villes. C'est à cette dispersion de la population française, pri nière de sa propriété parcellaire, que Marx attribue Je retard général de la France sur l'Angleterre. Il cite le baron Dupin « L'industrie française est liée au système de la tenure du sol.
5. Etude de P. Lamour et R. Busso, citée par le Rapport Bordier.
propriété foncière et formation sociale française Etant le fonds, la
183
pays de la propriété morcelée et des petits bicnsFrance est aussi le pays du morcellement de l'indus-
trie et des petits ateliers’. »
Il faut bien saisir qu'une telle « déviation » est caractéristique du type français de révolution bourgeoise. Elle fut re à la bourgeoisie anglaise. Celle». Elle
ne signifie pas
non
plus l'ignorance
du reste du
Elle signifie que le travail y est effectué « pour soi », et non la société», c’est-à-dire conformément à des orientations
conscientes définies à l'échelle sociale par la communauté ann groupe dominant. Dés lors, l'insertion du travail indépendant le travail social prend la forme d'un calcul privé relatif à des informa. teurs sociaux abstraits qui peuvent être aussi bien le système des prix
que le système des normes imposées admnistrativement. Le but du travail privé n'est pas le « service du peuple », mais la cenquéte d'une part de la richesse sociale.
postface
229
sa dépense de «travail en général» produit une « valeur », une marchandise-qui-en-vaut-bien-une-autre. « Le caractère de valeur de ces objets est déjà pris en considération dans leur production même. À partir de ce
moment,
les
travaux
privés
des
producteurs
acquièrent
en
fait un double caractère social. D'un côté ils doivent être travail utile, satisfaire des besoins sociaux et s'affirmer ainsi comme parties intégrantes du travail général, d'un système de division sociale du travail qui se forme spontanément; de l'autre côté ils ne satisfont les besoins divers des producteurs
eux-mêmes,
que
parce que
chaque
espèce
de
travail
privé utile est échangeable avec toutes les autres espèces de travail privé utile, c'est-à-dire est réputé leur égal. L'égalité de travaux qui diffèrent t0!0 cælo les uns des autres ne peut consister que dans une abstraction de leur inégalité réelle, ue dans la réduction à leur caractère commun de dépense force humaine, de travail humain en général, et c'est l'échange seul qui opère cette réduction en mettant en présence les uns les autres sur un pied d'égalité les produits des travaux
les plus
divers.
[...}” »
Ensuite, le producteur direct est « séparé » de ses moyens de production. C'est-à-dire qu'il n'en dispose pas avant d'être entré en rapport avec le non-travailleur. Ici on entre en terrain connu, on sait analyser les différentes étapes de cette séparation, sous les rapports de propriété ct session. Encore faut-il rappeler (pour intégrer les exemples cités de Lénine et de B. Lambert)
que celte séparation
peut se limiter
à celle d'avec les objets du travail : au tout début de la suumission formelle du travail au capital, le travailleur reste en on; possesseur et même propriétaire juridique de ses outils. Nous avons donc deux conditions relatives à la pro-
duction : production privée (travail social = somme de travaux indépendants) séparation du travailleur et des moyens de production. Dès lors, que se passe-t-il ? Le travailleur passe
avec le capitaliste, que Marx
appelle
très justement «l'homme aux écus », le contrat suivant : il travaillera pour lui (de son travail concret), et en échange 24. Le capital, Ecitions Garnier-Flammarion, F: 70.
Cet
pense
schématique
lement
de
sa
du contenu
«+ lecture ».!
essentiel
L'oubli
de
du chapitre
cette
lecture,
4
I ne dis-
où
sa
ré-
duction à l'idée «le travail abstrait produit de la valeur d'échange» a conduit l’école d'Althusser à de graves crreurs, notamment dans la théorie de la reproduction. Cette lacune sera, je l'espère, rapidement
comblée, Le premier chapitre du livre de Ch. BerreLHEIM (Calcul écono-
mique...) est un début de réhabilitation.
230
le tribut foncier urbain
recevra la reconnaissance du caractère social de ce travail : des écus lui permettant d'acheter le produit d’autres travaux
privés. Et il restera à la charge du capitaliste de réaliser (en
vendant le produit) le caractère social du travail. . Ainsi, le capitaliste devient pour le producteur l'intermédiaire entre la société et lui. L'échange de la capacité de travail contre les écus se fait « à sa valeur » : la force de travail contre l'équivalent général des biens de subsistance néces. saires à la reconstituer. Seulement, c’est le capitaliste qui fixe jusqu'à quel niveau cette capacité sera utilisée : et c'est au-delà du travail nécessaire à la reconstituer. Il y a donc un nouvel «échange» (si on peut dire) qui se supe: (force de travail contre argent) : c'est l'échange au pee de la reconnaissance a priori par le capitaliste du caractère privé du producteur, contre la capacité social du travail réservée au capitaliste de fixer la quantité du travail qui sera
fournie dans la journée. Ce second « échange » est sans doute
« moralement » une scandaleuse escroquerie (même s'il permet au capitaliste de dire que le profit récompense son risque, et même d'imposer dans le vocabulaire l'idée que c'est lui qui «offre du travail » à l'autre !). Mais nous ne faisons pas ici de morale. Nous analysons un rapport de production®. Or, que nous apprend cette analyse ? © Le caractère « orienté vers l'échange » de la production
immédiate est la base, la condition nécessaire du reste, mais n'est pas la condition suffisante de l'exploitation capitaliste;
@ Avec la seconde condition, la séparation du travailleur
d’avec les moyens de production (au moins l'objet du travail) a lieu l'exploitation (l'extorsion du
lus-value). Nous
ar bn
de
la coopération
complexe, et à terme l'éviction
de toute production marchande ple concurrence ; © La
surtravail sous forme de
savons par ailleurs qu'elle permet le déve-
combinaison
de ces
non capitaliste par la sim-
conditions
de la production
(celle des choses, des valeurs d'usage), c'est cela les rapports
de production
capitalistes,
dont
on peut
raffiner l'analyse,
comme le fait Balibar, en décortiquant les rapports au sein de chaque unité de production privée. Ces rapports de production sont ceux de l'exploitation : c'est là qu'est extorqué le surtravail, en ce sens que le capitaliste en dispose à l'issue EEE
Lénine des formes
«primitives» de ce rapport
tation par des Particuliers duproduit du travial social orvanisé Par
Féconomie marchande, voilà ce qui constitue l'essence du capitalisme »,
P.
.
ue
postface du
procès de
réaliser
production
sous
sa forme
231
immédiat.
générale
Mais
(il n'a que
il lui reste faire
d'un
à le sur-
produit-lait ou locomotives !) pour pouvoir ensuite acheter sur le marché les objets de son désir ou de son ambition. De
. plus,
à la fin
du
contrat,
le
travailleur
est de
nouveau
un
« homme libre ». Ces rapports de production ne dominent donc pas la reproduction, mais ils déterminent le lieu où elle sera assurée : le moment de la circulation, des échanges ;
© Le rôle de la circulation est dominant dans la reproduction : le capitaliste apparaissant comme le « maître de la socialisation », ses écus comme la clé qui donne accès à tous les produits de la division du travail, c'est en lui vendant
sa
force det ravail que le métallurgiste a accès aux produits de l'agriculture dont il a besoin pour vivre, et la reconstituer,
c'est en lui vendant son lait que le paysan reçoit en échange de sa force de travail une rémunération qui n'atteint pas même le S.M.I.G. Et c'est en portant les produits sur le 26. Sur le moment
de cette exploitation (le procès de production
immédiat) comme sur le fait que ce moment détermine le rapport de distribution, et même sur le fait qu'il peut y avoir exploitation (dans la production) sans que l'exploiteur en tire aucun « profit » (dans la circulation),
« En
Marx
supposant
est
parfaitement
qu'existent
les
clair
m
:
s de production nécessaires
c'est-à-dire une accumulation de capital suffisante, la création de plusvalue ne rencontre d'autre limite que la population ouvrière si le taux
de la plus-value, donc le d'exploitation du travail, est donné, et nulle autre limite que le d'exploitation du travail si c'est la population ouvrière qui est supposée dennéc. Et le procès de p = tion capitaliste consiste essentiellement à produire de la plis-value se manifeste par le surproduit ou fraction aliquote des marchan-
produites qui matérialise le travail non
« L'acquisition de cette plus-value constitue
ES
El
ue
de production
iat qui, nous l'avons dit, n'a pas d'autres tes que les Jimitations précitées. Dès que la quantité de surtravail qu'on peut tirer de l'ouvrier est matérialisée en marchandises, la plus-value est produite. Mais avec cette production de la plus-value, c'est seulement le
premier
acte du procès de production capitaliste, du procès de prot qui s'est achevé. Le capital a absorbé une quantité déterminée de travail non payé. À mesure que se développe le procès se traduit
par la baisse du
taux
de profit, la masse
ce plus-value
te s'enfle démesurément, Alors s'ouvre le deuxième acte du
Ta
séile RE
masse totale des marchandises, le produit total, aussi bien qui remplace le capital constant et le capital variable que
résente de la plus-value, doivent être vendues.
à
prix de production, l'ouvrier certes est exne réalise pas son exploitation en tant que peut DE le capitaliste à une réalisa de la plus-v. extorquée ou à l'absence de aller de pair avec la perte d'une partie ou de
Les conditions de l'exploitation immédiate et
SÈ
rieurs aux le re 3 exploitation seulement partielle sation et méme
RES Rseet
Si cette
lieu ou n'est que partielle, ou si elle a lieu seulement
ne sont
identiques.» (Le Capital,
P. 256-251. C'est moi qui souligne.)
Ed.
So-
232
le tribut foncier urbain
marché que le capitaliste se retrouve à nouveau « homme aux
écus »? ;
© Enfin, ce moment de la circulation est celui où sc résout la contradiction social/privé. Elle sé résout réellement,
en ce sens que la contradiction est réelle : la reconnaissance
du travail privé comme social (réalisation de la valeur) à chaque acte de production privée un nouveau ne dont on ne pourra dire qu'il aura été résolu qu'après l'échange du produit contre sa forme équivalent général : l'argent. ‘ette contradiction est originaire : elle est inscrite dans Jes rapports de production (la division sociale du travail en productions autonomes), et aggravée par leur fonctionnement comme rapports d'exploitations (« Plus la force productive sc développe, plus elle entre en conflit avec la base étroite sur laquelle sont fondés les rapports de consommation" »). Autrement dit, et pour entamer le débat avec les tenants d'une idéologie qui tend à se répandre : — la reproduction capitaliste n'est pas un mécanisme bien huilé, mais la solution instable d'une contradiction eriginaire et permanente, quoi qu'en dise Balibar dans Lire « Le
Capital #7?
— dans cette reproduction, la circulation marchande, avec le passage nécessaire par la forme-argent, n'est pas la simple «illusion » de celui qui s'en tient au procès de production isolé. Elle est la forme même de socialisation du
travail, parce que les procès de production sont effectivement isolés (« privés »), Aussi Marx a parfaitement raison
d'avoir placé le chapitre I du Capital (la résolution de la contradiction privé/social dans l'économie marchande par la transformation du travail concret en travail abstrait qui réalise l'unité de la contradiction) là où il est, avant de cer les mots de « capital » et de * salariat ». Suivre le conseil d'Althusser (« Ne lire le chapitre 1 que lorsqu'on a compris
du
A. Ce a double-moulinet » prend une forme compliquée dans le cas «capitalisme non-salarial» (lait), car la paie du lait superpose
t les deux circuits. Il est alors d'autant plus contraignant ue le paysan s’est plus endetté pour acheter des moyens de travail ns ï
à traire.…). C'est pourquoi B. Lambert comme « étarisés » les
28. sb Le Capi itai, Editions
les
ne considérait dans endettés
Etopen VI,in p. 256258. Ce
postface
233
le reste »), c'est donc risquer un contre-sens complet sur Je reste”. b. P.P. Rey et la circulation Ne pas comprendre la racine du rôle dominant de Ja circulation dans le M.P.C., c'est s'exposer, à partir du constat de ce rôle dominant, à le prenére pour le rôle déterminant, Or, que fait PP, Rey? Suivant explicitement le conseil d'Althusser (p. 115), il tombe dans le « fétichisme de la re-
production »,
La circulation y est conçue comme une simple phase régulière de la production”, la vente des marchandises comme un échange entre capitalistes gérant des centres de transfor-
mation de la nature différents, ct finalement l'échange marchand comme une pure illusion, entre autres l'échange de
la force de travail contre le salaire”, Comment
en vient-il là ? En s'en tenant à la reproduction,
en oubliant la production. Or, s'en tenir à la reproduction, c'est appréhender le produit en tant qu'il est devenu social, et oublier qu'il est le fruit d'une production qui, elle, est privée, C'est donc supposer le problème résolu. C'est donc oublier la raison même qui donne à la circulation le rôle dominant dans la reproduction du rapport d'exploitation capitaliste : l'ouvrier a besoin des écus du capitaliste pour que son travail soit reconnu social. 29. I1 ne s'agit nullement de contester l'importance de la réhabili-
tation de la reproduction par Althusser et Balibar. Il semble pourtant
qu'il
faille maintenant
«tordre
le bâtone
dans
l’autre
sens.
Déjà
le
texte de Balibar uboutissuit à uue véritable idéologie de l'éternisation
d'une luction «sans contradiction originaire x, une « hypastase» de la reproduction, je dirais un «fétichisme de la non-marchan. dise ». Nous avons critiqué ce fétichisme (< Sur les concepts prospectifs du matérialisme histo » Liperz et RounirauLT), et signalé qu'il a sa source théorique dans L l'oubli » du chapitre I. (Bien sûr, il est surdéterminé par d'autres instances que le « théorique »!)
30. Ce qui revient à identificr la division du travail dans la société
et la division
nm:
du
travail
dans fe foriaue.
(Livre I. chapitre 14,
chose
31. Rey en arrive à Rene que RE pour la classe capitaliste dans son
pêche
de reprocher
ansiddrer que
D
me
capital Ra
« bon »
les
refuse
à Rosa Luxemburg, deux pages plus
marchancises
rat
contre
C'est le refus de la 2 loi
p, 141$) n°n'a Là compris la le
ex-
loin, de
les marchandises!
Rosa Luxemburg du
». D'une fai
géné-
"L'Accumulation du
ses générales — et non sectorielles — de la de ne saisit par la contradiction originaire de la
a
Es parce
Marx
est tout à fait superflu (p. 146). Ce ne l'em-
précisément, ne le fond de la CREA Ve
ce cote
que
ier Flammarion).
Æ
fl
e
note
1, p. 97,
£
234
le tribut foncier urbain
Dès
lors, une
série de glissements
de l'idée (juste) que
successifs amène
la circulation a un rôle dominant
Rey
dans
la reproduction du rapport d’exploilation, à l'idée (fausse) qu'elle a le rôle déterminant, qu'elle est le lieu de l’exploitation.
M
« Une
juste
fois
(«les
mise
en
fils
invisibles »)
évidence
cette
devient
unité
du
d'abord
(p.
procès
de
et du procès de circulation, la différence entre pro ‘entretien des machines et l'entretien de la machine ouvriè-
re s'estompe., La vente de la force de travail, au prix même non que coûte son entretien, apparaît comme un pas entre l'ouvrier et le capitaliste mais entre les capitalistes qui fournissent des biens de consommation à l'ouvrier et celui qui achète sa force de travail. Dans cet échange, l’ouvrier ne joue pas un véritable rôle d’intermédiaire, mais, par sa consommation, il permet simplement à la nature de faire un de ces multiples « dons gratuits» qu'elle fait constamrtant ment au capitaliste, ce don gratuit étant le plus i de tous, celui grâce auquel se reproduit la machine à fabriquer de Ja valeur. t telle qu'elle est (au sein du mode « La circulation à de production capitaliste), c'est-à-dire échange de marchandises entre les capitalistes eux-mêmes et eux seuls. » En réalité, le « don gratuit » de la nature, c'est la capacité de surtravail, qui existe dans toutes les sociétés, y compris le communisme, et ne fait pas pour autant de l’homme une « machine à fabriquer de la valeur ». Certes les capitalistes échangent entre eux les éléments de la reproduction simple. Mais $ la faveur du passage par «l'intermédiaire »,
l'échange de la force de travail contre l'équivalent général
des bicns de subsistance, ils imposent au producteur Je surtravail, la mise en valeur à leur profit du « don gratuit » que lui a fait la nature, que l'un ait lieu « à la faveur» de
l’autre ne faisant cependant pas de «la vente de la force de travail le rapport de production déterminant » (p. 110).
Deuxième étape : après la substitution implicite de Ja production à la reproduction (en fait, à la circulation), la négation de son rôle déterminant, et même de son contenu : « Il suffit donc qu'une classe possède collectivement l'ensemble des produits circulant comme marchandises et que
l’autre classe n’en obtienne
ce qu'il lui faut de produits
pour être elle-même vendable, La propriété des de production (qu'elle prenne la forme la propriété privée ou une forme plus collective) exprime cet état de fait et en garantit la permanence. » (P. 110.)
postface Remarquons
235
:
— qu'avec une telle approche on ne distingue plus le sol urbain de la terre agricole, et que le tribut foncier urbain peut devenir un rapport de production; — qu'il n'y a plus de différence spécifique entre ce qui se passe entre ouvriers et patrons et entre locataires et proprié-
taires; —
que
d'une
façon
générale, l'inversion
de
la détermina-
tion production/circulation prend ici une forme caricaturale, puisque, contrairement à la critique marxiste de l’économie « vulgaire », non seulement il n'y a plus de distinction entre moyens de production et marchandises en général, mais encore la propriété des moyens de production n'apparaît que comme « l'expression » et la « garantie » de la propriété en général! Le fétichisme « raffiné» de la non marchandise rejoint le fétichisme vulgaire de la marchandise. Dès lors, P.-P. Rey peut très simplement passer à la troisième étape : situer l'exploitation dans la circulation (p. 113) : « Dans le procès de production capitaliste, dés lors qu'on ne considère plus un acte de production isolé mais la production sociale, le procès de circulation apparaît comme simple phase; mais c'est au cours de cette simple phase que se réalise l’extorsion de la plus-value, c'est-à-dire le rapport de production déterminant du mode de production. » ne nous reste plus 1e développer : tous ceux qui, dans la circulation, ôtent à «la machine à produire de la valeur », une part des
« bons » à racheter la richesse sociale,
lui extorquent de la plus-value, l'exploitent. Il nous reste à leur souhaiter, pour qu'ils aient effectivement quelque chose à extorquer, qu'ils ne se présentent pas tous sous la figure de l'usurier® ou du propriétaire immobilier, mais au moins quelques-uns comme entrepreneurs! Car pour nous, et je re pour Marx, seuls les rapports dans lesquels entrent es homunes dans la production sociale de leurs moyens d'existence, rapports dans lesquels certains imposent aux autres
de
produire
quais, hommes
« plus»
d'armes,
et
pour
sycophantes,
eux
(ou pour
leurs
la-
auxiliaires, représen-
tants, gérants et autres alliés), seuls ces rapports-là sont le lieu de l'exploitation, la base qui détermine tous les autres rapports sociaux, y compris ceux de la distribution du sur32. Je veux parler du crédit à la consommation du prolétaire. L'usure sur les moyens de production de l'artisan peut étre un rapport
production (en général de transition]. C'est pourquoi la Bible interdit de gager le prêt sur la charrue, « car ce serait mettre la vie même
en gage ». Il s'agissait de pro! une société « gentilice » en vole de sédentarisation contre une stratification sociale trop rapide.
236
le tribut foncier urbain
travail entre les non-travailleurs, et les pouvoirs d'oppression
qui ne correspondent pas à une exploitation, c. Un
exemple
: la relation
cadeisjainés
Pour justifier sa thèse étrange (la circulation est le lieu de l'exploitation), Rey entame une controverse avec Emmanuel Terray pour qui «la production est caractérisée par l'exploitation,
Craig
la circulation
est
l'étude
des
par l'échange ». Le
sociétés
lignagères
lieu de cette
et segmnen-
aires”. De quoi s'agit-il? Dans certaines sociétés lignagères et segmentaires d'Afrique, comme les Gouro qu'a étudiés CI.
Meillassoux, les tribus (lignages) sont divisées en « segments » regroupés en villages. Suivant les activités productrices, la coopération et la distribution sont organisées à l'échelle du village (chasse) ou « d'équipes de travail » au sein des ments
(agriculture).
Le
produit
du
travail,
dans
de
le cas
l'agriculture, est centralisé, par exemple dans des greniers, cet redistribué pour la consommation communautaire. Il n'y a pas propriété privée des moyens de production, notamment de la terre.
Comment sont réparties les forces de travail ? Au sein de
chaque
des
segment,
c'est l'aîné
femmes en mariage
du
segment
qui, en distribuant
à ses cadets, constitue les grou
de travail. Où va-t-il chercher des femmes ? En les « ache-
tant» dans d’autres segments, c'est-à-dire en les échangeant avec d’autres aînés contre une « dot» un «bien de prestige», Ces «biens de prestige s sont des produits du travail des
cadets,
que
ceux-ci
livrent
à
l'aîné
(« prestation»).
Il
s'agit de pagnes spéciaux, de couvertures ornées, de défenses d'éléphants, etc.; en tout cas Mcillassoux, Terray et Rey* sont d'accord sur le fait que ces « biens » ne sont ni des moyens de production, ni des biens de consoumuation, du moins tant que la société lignagère ne s'articule pas avec d'autres sociétés. Pour Terray, dans le cycle « prestation — échanges (entre aînés) — redistribution », l'aîné assume un « pouvoir de fonction » ; pour Rey il s'agit d'une exploitation.
Je ne suis nullement qualifié pour trancher si, dans les
sociétés lignagères, l'aîné exploite ou non le cadet. Je conteste simplement l'argumentation de Rey dans le texte « L'arti33. PP. Rey, p. 114-116, RTE
Le marxisme devant les sociétés
primitives, éd. Maspero, p. 1 , 41 le précise don thèse Culonialisme transition au capitalisme (
név-culunialisme,
et
postface
AS
237
culation des modes de production », comme dans le premier
chapitre de sa thèse (« Problématique »). Il se peut que le corps de sa thèse démontre qu'il y a exploitation. Mais, je dis que, sur la base des arguments utilisés ici par Rey, on est amené à parler « d'exploitation », « d'oppositons de classes » à propos de n'importe quoi, on est ramené aux balbutiements du « socialisme utopique » et, en ce qui concerne le rt « propriétaires-locataires », à Proudhon. ‘argument de Rey est le suivant (p. 115) : « Je pense au contraire qu'il n'y à aucun échange entre l'aîné et le cadet, mais simple prestation du cadet à l'aîné :
ce dernier n'a en effet aucun droit de soi sur la femme qu'il
donne en échange, pas plus que le cadet à qui il la fournit et cet échange est donc purement illusoire, pur camouflage d'une prestation sans redistribution. « De même il n'y a pas en vérité d'échange entre ouvrier ct capitaliste mais seulement échange entre le capitaliste qui fournit des biens de consommation à l'ouvrier et celui qui utilise
la force
de
travail
de
cet
ouvrier,
lu consommation
de l'ouvrier lui-même étant un simple incident de ce procès
de
circulation
qui
n'ajoute
aucune
valeur
aux
produits
consommés. « De même dans le mode de production lignager il n'y a pas d'échange entre aînés et cadets, il y a seulement échange
entre les aînés. » Autrement dit : — La fonction
est une
pure
les femmes. —
de distribution de l'aîné sur les femmes
idéologie,
car il n'a aucun
« droit de soi»
sur
A la faveur de cette représentation idéologique, il ex-
ploite le cadet en exigeant de lui des prestations; ou, plus
exactement, comme Rey le précise dans sa thèse, c'est l'en semble des aînés d'un lignage qui extorquent des prestations de l'ensemble des cadets. Le premier point pose déjà un problème. Qu'est-ce qu'un « droit du soi » ? Existerait-il un « droit naturel » rousseauiste
au
nom
duquel
se
pourrait
mener
la
critique
des
so-
ciétés historiquement réalisées ? Et quel serait-il ? Rey sem-
ble répondre (Problématique, p. 49) que les aînés ni les cadets n’ont pas de droit sur les femmes « puisqu'ils ne les ont pas produites», ce qui impliquerait que les aînés du segment d'origine qui les ont engendrées et nourries, aient eux, des « droits de soi» (effectivement, «réciprocité entre aînés » dans l'échange
En réalité, la méthode
p. 43, il parle RS rmofat)
analytique de Marx {comme
de
il le
238
le tribut foncier urbain
précise dans les « Notes sur Wagner») ne l'homme, mais de la société Mount
«
de nie: ». Il
n'existe pas plus de «droit de soi» ni sur les femmes, ni sur la terre, ni sur les biens produits, dans le communisme primitif, que dans les sociétés de classes, ou dans le com-
munisme futur. Il y a des rapports de production qui déterminent lous les autres rapports entre les hommes. Que certaines structures soient plus conformes aux « aspirations hupour elles la Révolution, maines » et vaillent la peine de faire c'est un autre problème, qui sort de la problématique althuslaquelle Rey entend se placer. sérienne dans Revenons donc à «la méthode nn fe 2 ». I] reste maindes rapports matrimotenant que, pour Rey, la structure niaux est organisée de façon à camaufler l'exploitation des cadets par les aînés. Ce dernier rapport serait le rapport déterminant, et les échanges matrimoniaux le rapport déterminé, d’ailleurs comme « représentation-camouflage », exacteselon la «Problématique», les rapports ment comme, d'hostilité entre scgments sont une « mystification » qui mas- . que
la
solidarité
des
aînés
entre
eux".
Nous
arrivons
ainsi au second point : la « prestation » du cadet à l'aîné estelle un rapport d'exploitation, et ce rapport est-il celui qui détermine la forme des rapports matrimoniaux? Je pense devoir répondre non sur ces deux points.
D'abord, en quoi consisterait «J'exploitation »? En la production, directe ou indirecte, par les cadets, des biens de prestige qu'ils confient aux aînés. Peut-on dire qu'il s'agisse de l’extorsion d’un surproduit par une classe de non-travail-
leurs qui vit de ce surproduit ? Même pas. Que les aînés tra-
vaillent autant, moins que les cadets, ou pas du tout, n'est pas la question : ces aînés sont d'ailleurs des vieillards, et ce n'est pas parce qu'une société ne pratique pas l'euthanasie des vieux (« le cocotier »} que l'on peut dire que les vieux y exploitent les jeunes! Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne s'agit pas là de «la production sociale des moyens d'existence ». En tout état de cause, les « biens >» en question n'ont qu'une utilité : servir « d’équivalent particulier » dans l'échange des femmes. Ici il faut signaler, dans le texte « Problématique », la coexistence d'attaques incessantes contre «l'économie vul« richesse» » des mots le plus « vulgair gaire », et de l'usage e 35. Cette «unité réelle des aînés face à l’atomisation des cadets » est certes le fondement de la domination des aînés (de leur pouvoir d'oppression), mais cela ne suffit pes
caractère
« sartrien » ct « économiste
parler d'exploitation. Le » de cette page (le « pra
tico-inerte » face à la «concurrence imparfaitc ») est d'ailleurs nant après la philippique de l'avant-propos à la thèse! (p. 57).
postface
et « biens ». Pour Br
239
les biens de prestiges constituent la
« richesse », leur production le « surtravail » (p. 44), leur thé-
Saurisation une « accumulation » (p. 66), et leur destruction la résolution d'une crise de suraccumulation (p. 66 et 67). Aussi l'aîné ayant davantage de filles est « favorisé », car il devient plus « riche »*., Tout ccla ne paraît guère sérieux : passe
encore
sur
la non-distinction
entre
biens
de consom-
mation et biens de production, mais Rey pousse un peu loin le «fétichisme de la monnaie » : il est vraiment temps de lire la première section du Capital". Que sont donc ces biens de prestige? Des « équivalents particuliers » pour les femmes. Et pourquoi en a-t-on besoin? Nous arrivons à la question du «rapport déterminant ».
Pour Terray, ce sont toujours les rapports de production qui sont déterminants. Parmi ces rapports, celui de distribution de la force de travail vivante est le facteur dominant dans les sociétés primitives où les moyens de travail sont encore très rudimentaires. Or, qu'estce qui caractérise le mode es production des sociétés lignagères ct scgmentaires — La centralisation des produits du travail des équipes au sein des segments (c'est-à-dire que le travail des équipes est directement social au niveau du segment); —
L'indépendance des segments.
La facteur dominant étant, dans la production, la force de travail, le facteur dominant est, dans la reproduction, la
distribution des femmes. Celles-ci sont en effet à la fois une force de travail, et les reproductrices biologiques des forces
de travail. Pour reprendre l'expression de Marx dans la Critique du programme de Gotha, elles sont à la fois « pères et mères » de la plus grande partie des richesses. Ou bien la distribution des femmes est déterminée automatiquement par des règles de parenté. Ou bien, corne il
n'existe pas d'Office central matrimonial, il y a circulation 36. Donc
s'il les marie toutes et s'il garde les dots, il meurt de faim
au sommet de la « richesse+ selon Rev. 31. Cette confusion cevient caricaturale dans le cas de la chasse à
l'éléphant (p. 51). Les expéditions de chasse sont montées à l'échelle
du
village
par
des
cadets
intrépides.
Les
chasseurs
se
partagent
la
chair de l'éléphant, et donnent les défenses à l'ainé. Que Rey appelle ces défenses
« richesse », je veux bien, mais quant à voir dans
l'acquisition
des défenses un surtravail par rapport au + travail nécessaire» à tuer l'éléphant pour le manger!!!
240
le tribut foncier urbain
décentralisée, donc échange, donc moyen de circulation permettant la régulation des échanges multilatéraux, La dot existe donc dans les sociétés lignagères et segmen- | taires exactement pour les mêmes raisons que l'argent existe dans les sociétés marchandes : elle y résout la contradiction

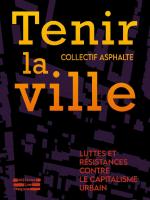



![La valeur du sol urbain et la propriété foncière: Le marché des terrains à Paris [Reprint 2017 ed.]
9783111647371, 9783111264165](https://dokumen.pub/img/200x200/la-valeur-du-sol-urbain-et-la-propriete-fonciere-le-marche-des-terrains-a-paris-reprint-2017nbsped-9783111647371-9783111264165.jpg)
![Constantinople Byzantine. Developpement Urbain et Repertoire Topographique (2nd ed.) [2 ed.]](https://dokumen.pub/img/200x200/constantinople-byzantine-developpement-urbain-et-repertoire-topographique-2nd-ed-2nbsped.jpg)



![Le tribut foncier urbain [1 ed.]
9782348062858](https://dokumen.pub/img/200x200/le-tribut-foncier-urbain-1nbsped-9782348062858.jpg)