La réception de Duns Scot / Die Rezeption des Duns Scotus / Scotism through the Centuries: Proceedings of "The Quadruple Congress" on John Duns Scotus. Part 4 3402102161, 9783402102169
On 8 November 1308, the great Franciscan scholastic thinker, John Duns Scotus, died and was buried in the friars' c
143 119
English, Französisch, German Pages 344 [345] Year 2013
Polecaj historie
Table of contents :
Title
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einführung
Verzeichnis der Siglen
Luca Parisoli: L'innovation scotiste dans l’analyse de la loi: philosophie pratique et normativité
Isabel Iribarren: Le cas du sacrifice d’Isaac: volonté divine et loi naturelle chez Duns Scot et Durand de Saint-Pourçain
Christian Trottmann: Scotistes et arguments inspirés de Scot dans de la controverse de la vision béatifique autour de Jean XXII
Rolf Schönberger: Duns Scotus und Johannes Buridan. Die Standards der Rationalität und ihre Relation
Stephen F. Brown: Peter of Candia and His Use of John Duns Scotus
Volker Leppin: Duns Scot chez les réformateurs (Luther, Zwingli, Calvin)
Francesco Marrone: L’univocité de l’étant et l’origine de la distinction entre realitas subiectiva et realitas obiectiva
Edouard Mehrl: La création des vérités éternelles: Descartes s’est-il forgé un adversaire scotiste ?
Jean-Luc Solère: Scotus Geometres. The longevity of Duns Scotus’s geometric arguments against indivisibilism
Hubertus Busche: Haecceitas und Possibilienlehre - Zur Bedeutung von Johannes Duns Scotus für die Leibnizsche Metaphysik
Yves-Jean Harder: Ontologie et métaphysique chez Kant
Antonie Vos: Scotus in the nineteenth and twentieth centuries
Matthias Vollet: Duns Scot et la métaphysique du possible chez Bergson
Martina Roesner: Duns Scot et la phénoménologie
Andreas J. Beck: Die Scotusforschung in den Niederlanden des 20. Jahrhunderts
Francois Loiret: Absolutisme théologique et contingence: la réception de la pensée scotienne de la volonté chez Blumenberg et Arendt
Cyrille Michon: Une discussion du «scotisme»
Oliver Boulnois: Métaphysique analytique et métaphysique scotiste
Claude Coulot / Franck Storne: En Mémoire de Paul Sabatier
Table ronde du colloque de Strasbourg
Personenregister
Citation preview
Part 4, dealing with the reception of Scotus’s works, contains contributions by
Andreas J. Beck Stephen F. Brown Olivier Boulnois Hubertus Busche Claude Coulot Mechthild Dreyer Yves-Jean Harder Isabel Iribarren Volker Leppin François Loiret Francesco Marrone
Édouard Mehl Cyrille Michon Luca Parisoli Martina Roesner Rolf Schönberger Jean-Luc Solère Franck Storne Christian Trottmann Matthias Vollet Antonie Vos
ISBN 978-3-402-10216-9
Subsidia 6
archa verbi Dreyer/Mehl/Vollet (eds) • La réception de Duns Scot
On 8 November 1308, the great Franciscan scholastic thinker, John Duns Scotus, died and was buried in the friars' convent in Cologne. Building upon the intellectual heritage of his Franciscan predecessors in Paris, Alexander of Hales and Bonaventure of Bagnoregio, Scotus extended this peculiarly Franciscan approach to the philosophical and theological traditions of western Christianity in new and bold directions with unique emphases and implications. These ramifications became the foundation for an important alternate current of philosophical thought known through history as Scotism. On the occasion of the 700th anniversary of the death of John Duns Scotus, international scholars from around the world gathered together to celebrate in a comprehensive manner the life, work and intellectual legacy of the Subtle Doctor. This gathering took on the form of a Quadruple Congress, comprising four conferences, treating four different themes, associated with the intellectual journey and legacy of Scotus, namely Oxford, Cologne-Bonn, Strasbourg and the Franciscan Institute at St. Bonaventure University, New York. The corresponding four volumes represent the current state of international Scotus scholarship and will remain an invaluable tool for years to come.
archa verbi Subsidia 6
La réception de Duns Scot Die Rezeption des Duns Scotus Scotism through the Centuries Proceedings of “The Quadruple Congress” on John Duns Scotus
Part 4 Edited by Mechthild Dreyer Édouard Mehl and Matthias Vollet
Archa Verbi Subsidia, Vol. 6
Archa Verbi
Yearbook for the Study of Medieval Theology Subsidia 6
Mechthild Dreyer / Édouard Mehl / Matthias Vollet (Hrsg.)
La réception de Duns Scot/ Die Rezeption des Duns Scotus/ Scotism through the Centuries Proceedings of »The Quadruple Congress« on John Duns Scotus Part 4
Franciscan Institute Publications
Archa Verbi Annuarium Societatis Internationalis pro Studiis Theologiae Medii Aevi promovendis Annuaire de la Société Internationale pour l‘Étude de la Théologie Médiévale Annuario della Società Internazionale per lo Studio della Teologia Medievale Anuario de la Sociedad Internacional para los Estudios de la Teología Medieval Jahrbuch der Internationalen Gesellschaft für Theologische Mediävistik Yearbook of the International Society for the Study of Medieval Theology
Subsidia iussu Societatis edenda curaverunt Rainer Berndt S.J. Hanns Peter Neuheuser Hideki Nakamura curator Riccardo Quinto Jan Klok Britta Müller-Schauenburg directorium Societatis Volker Leppin praeses Societatis
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detailliert bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. Library of Congress Control Number: 2011963327 Cover illustration: Johannes Duns Scotus, Ordinatio, Bologna, Biblioteca Universitaria, Ms. 2237, f.1r (15th century) © 2013 Aschendorff Verlag GmbH & Co. KG, Münster / Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure, NY Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Vergütungsansprüche des § 54 Abs. 2 UrhG werden durch die Verwertungsgesellschaft Wort wahrgenommen. Gesamtherstellung: Druckzentrum Aschendorff, Münster, 2013 Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier ∞ ISSN 1865-2964 Aschendorff Verlag Münster ISBN 978-3-402-10216-9 Franciscan Institute Publications ISBN 978-1-57659-314-1
5
Inhaltsverzeichnis Vorwort – Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mechthild Dreyer – Édouard Mehl – Matthias Vollet Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Werke des Johannes Duns Scotus und Siglenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . 13 Luca Parisoli L’innovation scotiste dans l’analyse de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Isabel Iribarren Le cas du sacrifice d’Isaac: volonté divine et loi naturelle chez Duns Scot et Durand de Saint-Pourçain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Christian Trottmann Scotistes et arguments inspirés de Scot dans la controverse de la vision béatifique autour de Jean XXII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Rolf Schönberger Duns Scotus und Johannes Buridan. Die Standards der Rationalität und ihre Relation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Stephen F. Brown Peter of Candia and His Use of John Duns Scotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Volker Leppin Duns Scot chez les réformateurs (Luther, Zwingli, Calvin) . . . . . . . . . . . . . . 93 Francesco Marrone L’univocité de l’étant et l’origine de la distinction entre realitas subiectiva et realitas obiectiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Édouard Mehl La création des vérités éternelles: Descartes s’est-il forgé un adversaire scotiste? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Jean-Luc Solère Scotus Geometres The longevity of Duns Scotus’s geometric arguments against indivisibilism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6
Inhalt
5
Hubertus Busche Haecceitas und Possibilienlehre – Zur Bedeutung von Johannes Duns Scotus für die Leibnizsche Metaphysik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Yves-Jean Harder Ontologie et métaphysique chez Kant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Antonie Vos Scotus in the nineteenth and twentieth centuries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Matthias Vollet Duns Scot et la métaphysique du possible chez Bergson . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Martina Roesner Duns Scot et la phénoménologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Andreas J. Beck Die Scotusforschung in den Niederlanden des 20. Jahrhunderts . . . . . . . . 233 François Loiret Absolutisme théologique et contingence: la réception de la pensée scotienne de la volonté chez Blumenberg et Arendt . . . . . . . . 251 Cyrille Michon Une discussion du «scotisme» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Olivier Boulnois Métaphysique analytique et métaphysique scotiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Claude Coulot et Franck Storne En Memoire de Paul Sabatier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Table ronde du colloque de Strasbourg La postérité de Duns Scot» – Samedi 21 mars 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Partie I – Synthèse générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Partie II – Travaux et tendances à venir. Projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Vorwort – Remerciements Die Herausgeber des vorliegenden Bandes und Organisatoren der internationalen Tagung La postérité de Duns Scot, die vom 18. bis zum 21. März 2009 an der Université de Strasbourg stattgefunden hat, haben all denen zu danken, ohne deren Unterstützung beides nicht zustande gekommen wäre. Unser Dank gilt der Université de Strasbourg, der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, dem Conseil Général du Bas-Rhin, der Deutsch-Französischen Hochschule, der Deutsch-Französischen Kulturstiftung sowie dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz. Die Heraus geber danken vor allem Herrn Tobias Heil für seinen unermüdlichen Einsatz bei der Redaktion dieses Bandes. Les éditeurs de ce volume et organisateurs du colloque international La postérité de Duns Scot (Strasbourg, 18-21 mars 2009 : http://www.unistra.fr/scotus/), dont sont issues la plupart des communications réunies ici, souhaitent exprimer leurs remerciements à tous ceux sans l’aide desquels ni ce colloque ni ce ce volume n’auraient pu se faire : la Johannes Gutenberg-Universität Mainz, l’Université de Strasbourg, le Conseil Général du Bas-Rhin, l’Université Franco-Allemande, la Fondation Culturelle Franco-Allemande, et le Ministère de l’Éducation, de la Science, de la Jeunesse et de la Culture du Rheinland-Pfalz. Mechthild Dreyer
Édouard Mehl
Matthias Vollet März 2011
Einführung Archa Verbi. Subsidia 6
9
9–13
Einführung Mechthild Dreyer – Édouard Mehl – Matthias Vollet
Der vorliegende Band versammelt Aufsätze, die sich mit der Rezeption der Philosophie und Theologie des Johannes Duns Scotus (1266/11 – 1308) befassen. Aufgespannt wird ein Bogen, der bei seinen Zeitgenossen und seinen unmittelbaren Schülern im 14. Jahrhundert beginnt und bei der aktuellen analytischen Philosophie endet. Der größte Teil der Beiträge geht auf eine internationale Tagung zurück, die unter dem Titel La posterité de Duns Scot vom 18. bis zum 21. März 2009 an der Universität Straßburg stattgefunden hat. Ziel der Tagung war es, anhand ausgewählter Beispiele aufzuzeigen, wie sich Theologen und Philosophen über die Jahrhunderte hinweg mit dem Denken des Scotus auseinandergesetzt haben, um so skizzenhaft die Wirkungsgeschichte seines Denkens aufzuzeigen.1 Wenngleich Johannes Duns Scotus und Thomas von Aquin als die beiden bedeutendsten und einflussreichsten Theologen und Philosophen des lateinischen Mittelalters gelten, mit je eigenen Ansätzen in der Theologie, der Ethik und der Metaphysik, so ist die Rezeption der Werke des Thomas dennoch deutlich besser erforscht als die des Scotus. Ja, das Thema der Rezeption scheint in der Scotus-Forschung bis heute eher randständig zu sein. Das hat sicher damit zu tun, dass die Lehre des Thomas deutlich stärker als die Lehre des Scotus im eigenen Orden gewirkt hat. So hatte der Dominikanerorden die Lehre seines prominentesten Mitglieds schon sehr früh zur Ordensdoktrin erhoben. Ein Übriges tat die Neuscholastik im 19. und 20. Jahrhundert. In diesem Zusammenhang muss auch auf das Engagement von Papst Leo XIII. hingewiesen werden, der mit seiner Enzyklika Aeterni Patris von 1879 die Erneuerung einer christlichen Philosophie im Geiste des Thomismus forderte und die Neuausgabe der Werke des Thomas beförderte. Die Scotus-Rezeption verläuft im Vergleich zur Thomas-Rezeption eher sporadisch und weniger streng, trifft dafür aber in der Neuzeit und in der Moderne auf Resonanz auch dort, wo das Interesse am Mittelalter kaum oder gar nicht vorhanden ist. Der erste Aufsatz des vorliegenden Bandes bietet einen Beleg für die Rezeptionsgeschichte, an deren Ende Scotus selbst steht. Luca Parisoli befasst sich mit dem für die scotische praktische Philosophie so zentralen Normativitätsgedanken und deckt dessen Vorgeschichte im Werk des 1
Vgl. dann jüngst: Quaestio 8. La posterità di Giovanni Duns Scoto, ed. P. Porro und J. Schmutz, Bari 2008.
10
Einführung
Anselm von Canterbury (1033 – 1109) und in der Summa fratris Alexandri auf. Sodann rekonstruiert Isabel Iribarren anhand der Sentenzenkommentierung des Dominikaners Durandus von Saint-Pourçain (um 1275 – 1334) ein frühes Beispiel der Diskussion scotischer Thesen. Ausgehend von der Frage nach der Deutung des biblischen Isaak-Opfers entwickelt Durandus seine Position zur Frage nach dem Verhältnis von göttlichem Willen und Naturgesetz in kritischer Auseinandersetzung mit Thomas von Aquin und Duns Scotus. Am Beispiel der Kontroverse um die Deutung der visio beatifica im 14. Jahrhundert zeigt Christian Trottmann auf, welche Bedeutung scotischen oder von Scotus inspirierten Argumenten in der zeitgenössischen Theologie zukommen. Im Werk des Johannes Buridanus (um 1304/5 – 1358) gibt es zwar keinen Hinweis darauf, dass ihm das Denken des Scotus bekannt ist. Dass dennoch die Positionen beider bemerkenswerte Konvergenzen aufweisen, ist die These des Beitrages von Rolf Schönberger. Anhand der Kommentierung der Sentenzen des Petrus von Candia (um 1340 – 1410) zeigt Stephen F. Brown auf, wie unter franziskanischen Vorzeichen die Auseinandersetzung mit Scotus und den frühen Scotisten erfolgt. Breitere Bedeutung gewinnt das Denken des Scotus im 16. Jahrhundert, als der Franziskanerorden in seinen Statuten das Studium der scotischen Lehre vorschreibt. Die von Lucas Wadding 1639 in Lyon herausgegebene zwölfbändige Werkausgabe befördert die Rezeption, ist aber zugleich schon selbst Teil des zunehmenden Interesses an diesem Denker. Mit dem Werk des Scotus druckt Wadding auch Kommentare und Scholien von scotistischen Gelehrten ab. Hierzu zählen insbesondere die Arbeiten von Hugo Cavellus und Mauritius de Portu. Ihre Auslegungen sollen dazu beitragen, die nicht immer einfachen Texte des Scotus besser zu verstehen. Zentren der Scotus-Rezeption zu Beginn der Neuzeit finden sich in der so genannten spanischen Spätscholastik und in der deutschen Schulphilosophie. Ein wichtiges Zeichen für die Wirksamkeit des Scotus sind neben der Werkedition von Wadding die zahlreichen Versuche im 17. und 18. Jahrhundert, auf der Grundlage seiner Schriften ganze philosophische Kompendien zusammenzustellen. Dass selbst im Kontext dieser intensiven Scotus-Rezeption Thomas von Aquin jedoch nicht aus den Augen verloren wird, ja auch hier Maßgeblichkeit zu besitzen scheint, zeigt die Gesamtdarstellung der Lehren des Scotus durch Hieronymus von Montefortino. Er orientiert sich bei ihrer Präsentation nämlich am Aufbau der Summa theologiae des Thomas von Aquin. Volker Leppin fragt in seinem Aufsatz nach der Bedeutung, die das Denken des Scotus für die Reformation gehabt hat. Auch wenn die Reformatoren sich wiederholt deutlich von der Theologie des Mittelalters abgegrenzt haben, so sind sie doch aufgrund ihrer Ausbildung unmittelbar oder mittelbar mit ihr verbunden. Wie Leppin anhand ausgewählter Beispiele aufzeigt, gilt dies im Blick auf Scotus sowohl für Martin Luther (1483 – 1546), erst recht aber für Huldrych Zwingli (1484 – 1531). Die scotisch-scotistischen Wurzeln des Begriffs der realitas obiectiva, den Descartes (1596 – 1650) in den Meditationes für seinen Nachweis der Existenz Gottes in Anspruch nimmt, re-
Einführung
11
konstruiert der Beitrag von Francesco Marrone. Er entdeckt die Wurzeln des Begriffspaares realitas obiectiva/realitas subiectiva bei dem Scotisten Johannes Canonicus /Johannes Marbres (Mitte 14. Jh.). Dieser wiederum bezieht sich auf eine Auseinandersetzung, die Duns Scotus mit Heinrich von Gent um die univocatio entis geführt hat. Mit Descartes und Scotus, genauer gesagt: mit Descartes und dem Scotismus befasst sich auch Édouard Mehl: Weist Descartes in seiner Kontroverse mit Mersenne um die Lehre von den ewigen Wahrheiten nur eine scotistische Doktrin zurück, oder ist der Streit zwischen beiden eher als Konflikt inkompatibler scotistischer Standpunkte zu deuten? Die Relevanz scotischer Argumente für prominente wissenschaftliche Debatten des 17. Jahrhunderts zeigt Jean-Luc Solère auf. Die Frage, ob Raum und Materie unendlich teilbar sind oder nicht, hatte schon Aristoteles beschäftigt. Über ihn hinausgehend entwickelt Scotus unter Bezug auf die Tradition weitere (mathematische) Argumente für die unendliche Teilbarkeit, die dann im 17. Jahrhundert wieder aufgenommen werden. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) ist für seine kritische Distanz zur Scholastik bekannt. Hubertus Busche weist in seinem Beitrag nach, dass er sich dennoch intensiv mit zwei Themen der scotischen Philosophie befasst hat: mit dem Individuationsprinzip der Haecceitas einerseits und der Lehre von den Possibilien andererseits. Die jüngere und jüngste Scotus-Forschung ist immer wieder der Frage nachgegangen, ob und wie sich Bezüge zwischen der scotischen Metaphysik und der Transzendentalphilsophie Kants (1724 – 1804) herstellen lassen. Yves-Jean Harder greift unter dem Titel Ontologie et métaphysique chez Kant diese Diskussion auf und führt sie weiter. Dass Werkausgaben die Auseinandersetzung mit einem Autor befördern, ist eine allgemeine Erfahrung. Dies hat die von Wadding herausgegebene und dann im 19. Jahrhundert von Ludovicus Vivès nachgedruckte erste unkritische Ausgabe der Werke des Scotus getan. Diese Funktion hat auch die 1950 mit dem ersten Band einsetzende kritische Edition der Werke des Scotus, die Editio Vaticana, übernommen. Die Renaissance der Scotus-Forschung ab den 1960-1970er Jahren ist zu einem hohen Teil auf dieses Editionsunternehmen zurückzuführen. Auch die unter der Leitung von Girard J. Etzkorn in den Jahren 1997-2006 erstellte kritische Ausgabe der philosophischen Schriften des Scotus hat die Scotus-Forschung befördert. Beide Werkausgaben haben es zudem erst im Detail ermöglicht, authentische von nichtauthentischen Werken des Scotus zu unterscheiden, und beide haben auch geholfen, die Anfänge der Rezeption des Scotus zu erhellen. Sieben Beiträge des vorliegenden Bandes befassen sich mit Positionen des 19. und 20. Jahrhunderts, in denen das Denken des Scotus Aufnahme gefunden hat. Zum Teil wurden diese Positionen noch auf der Grundlage der unkritischen Wadding-Vivès-Edition entwickelt, zum Teil nehmen sie Bezug auf die kritischen Editionen. Antonie Vos charakterisiert in seinem Beitrag die Wiederentdeckung der mittelalterlichen Theologie und Philosophie sowie die Geburt und Entwicklung der disziplinären Befassung mit der Geschichte der Philosophie des Mittelalters vom 19. bis hinein in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Vor diesem
12
Einführung
Hintergrund arbeitet er die Perspektiven heraus, unter denen das Werk des Scotus in den Blick genommen wird. Zentrale Überlegungen der Metaphysik Henri Bergsons (1859 – 1941) kreisen um Themen, die bereits bei Scotus eine zentrale Rolle spielen: Freiheit, Kontingenz, Möglichkeit und (zeitliche) Dauer. Matthias Vollet zeigt in seinem Aufsatz auf, dass und wie Bergson sich unterschwellig mit Scotus auseinandersetzt. Auch die frühe Phänomenologie erweist sich vom Denken des Scotus geprägt. Wie komplex und kompliziert diese Prägung im Einzelnen ist, rekonstruiert Martina Roesner im Blick auf Franz Brentano (1838 – 1917), Edmund Husserl (1859 – 1938) und den frühen Martin Heidegger (1889 – 1976). Die (belgisch-)niederländische Scotus-Forschung im 20. Jahrhundert ist Thema der Ausführungen von Andreas J. Beck. Auf diesen Überblicksbeitrag folgen zwei Aufsätze, die sich mit der Rezeption spezieller Theoriestücke des scotischen Denkens im 20. Jahrhundert befassen: François Loiret behandelt den Willensbegriff bei Hans Blumenberg (1920 – 1996) und Hannah Arendt (1906 – 1975) und fragt nach Bezügen zu Scotus. Die von Anthony Kenny (geb. 1931) und nach ihm von John Martin Fischer als ‚Scotismus‘ bezeichnete Argumentationsstrategie zum Nachweis der Vereinbarkeit von göttlichem Vorwissen und menschlicher Willensfreiheit ist Gegenstand des Beitrages von Cyrille Michon. Er befasst sich mit ihrer Anwendung auf das Thema der menschlichen Freiheit. Entspricht die Metaphysik, so wie sie von Scotus entworfen wurde, noch den heutigen Anforderungen der Philosophie? Olivier Boulnois geht dieser Frage nach, indem er sich darauf konzentriert zu klären, welche möglichen Verbindungen es im Bereich der Metaphysik zwischen der Position des Scotus und der analytischen Philosophie gibt. Im vorletzten Beitrag des Bandes erinnert Claude Coulot an den französischen Theologen und Historiker Paul Sabatier (1858 – 1928), der an der protestantisch-theologischen Fakultät der Universität Straßburg gelehrt hat und der sich in seinen Arbeiten dem Werk von Franz von Assisi und der franziskanischen Bewegung widmet. Der Beitrag knüpft an die Ausstellung Ens infinitum. A l’école de Saint François d’Assise an, die aus Anlass der Tagung in der Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (BNU) Buchbestände der Elsässer Franziskaner und Dokumente zu Paul Sabatier und seinem Werk präsentierte. Der Band schließt mit der Dokumentation der Table Ronde, die unter der Leitung von Mary Beth Ingham am letzten Tagungstag stattgefunden hat und bei der die Resultate und Perspektiven der Tagung diskutiert worden sind.
Einführung
13
Verzeichnis der Siglen Siglen der Editionen ed. Wad. Opera omnia Ioannis Duns scoti. Ed. L.Wadding. Lyon 1639 [Reprint Hildesheim 1968-1969]. ed. Viv. Ioannis Duns Scoti Opera omnia. Ed. L.Vives. Paris 1891-1895. ed. Vat. Ioannis Duns Scoti Opera Omnia. Studio et cura Commisionis Scotisticae ad fidem codicum edita. Civitas Vaticana. 1950 sqq. OPh. B. Ioannis Duns Scoti Opera Philosophica. Ed. G. J. Etzkorn et al. St. Bonaventure, N.Y. 1997-2006. Siglen der Werke Coll. Lect. Met. Op. Ox. Ord. Quodl. – Rep. Tract.
Collationes Oxonienses et Parisienses Lectura Quaestiones super libros Metapysicorum Aristotelis Opus Oxoniense Ordinatio Quaestiones Quodlibetales Reportata parisiensia Reportatio Tractatus de primo principio
Gliederungssiglen a. articulum c. capitulum concl. conclusio d. distinctio l. liber n. numerus p. pars prol. Prologus q. quaestio q. un. quaestio unica
14
15 Archa Verbi. Subsidia 6
15–29
L’innovation scotiste dans l’analyse de la loi : philosophie pratique et normativité Luca Parisoli
I Originalité et héritage de l’innovation scotiste Jean Duns Scot a produit une contribution fondamentale dans le contexte de l’école franciscaine : je propose de parler à cet égard d’un normativisme scotien, puisant ses racines dans la pensée de saint Anselme d’Aoste, en filiation directe des analyses issues de la Summa fratris Alexandri1. Je ne veux pas revenir – dans cette rapide reprise de quelques points de la normativité scotienne – sur les définitions conceptuelles que j’ai adoptés dans ma démarche analytique de l’histoire des idées : ceux qui ne partagent pas ma méthodologie peuvent se référer à ce que j’ai affirmé ailleurs. À la suite de John Langshaw Austin et de sa loi des puces décroissantes2, je préfère me borner à exposer la force explicative de ma proposition, et laisser aux lecteurs le soin d’en évaluer la persuasion. Le volontarisme ontologique ne concerne que la source nomothétique, celle-ci étant l’acte de volonté de la personne habilitée par la légitimité ; le mot ‘volontarisme’ ne renvoie point à un soi-disant volontarisme cartésien – en postulant qu’il y en ait un – au contraire, l’idée que la norme est un objet réel (à savoir, selon la terminologie scolastique, un objet indépendant de l’intellect), donc la thèse que les propositions déontiques sont vraies ou fausses, est de toute évidence une thèse pré-moderne, évoquant saint Anselme bien plus que Descartes, Locke ou Kant. Le volontarisme ontologique ne peut se passer de la recta ratio, une notion qu’Italo Sciuto a placée au cœur de la pensée scolastique, et que lui-même a identifiée comme compatible avec le volontarisme qui n’est pas issu d’une parodie intellectuelle. L’école hollandaise d’Antonie Vos a donné corps à cette notion de volontarisme dans l’historiographie du XXe siècle; et l’efficacité de la notion de norme ne se borne pas à la théorie analytique de Tarello, elle produit des outils comme l’anomie élaborée par Durkheim qui peuvent être utilisés pour faire la différence entre les familles de la pensée
1 2
Parisoli, La Summa fratris Alexandri. En livrant ces pages aux éditeurs, je songe à mon petit filleul Timothée et à ses parents, Fabienne et Anthony, gage de notre amitié in Christo. La critique d’un philosophe à la construction positive d’un autre est comme une puce rongeant ce qui vient d’être proposé, et la riposte à cette critique est à son tour une puce de la première puce, jusqu’à l’infiniment petit.
16
Luca Parisoli
franciscaine, celle anomiste à la manière d’Olivi et celle normativiste à la manière de Duns Scot3. Il y a un panorama de thèses analytiques pouvant être considérées comme l’arrière-fond de l’agenda normativiste de l’école franciscaine, et notamment de Duns Scot ; comme l’a bien dit Olivier Boulnois la présence d’une historiographie analytique pouvant se réclamer d’un scotisme analytique n’est à l’état actuel de la recherche qu’un souhait : apparemment, les scotistes analytiques ne sont point au rendez-vous du XXIe siècle4. Il s’agit de la rencontre de thèmes classiques (par exemple, la nature déchue après le péché originel, ou la valeur de l’obéissance, ou la toute-puissance divine) avec la spécificité de l’approche franciscaine, notamment marquée par la question de la définition de la même identité franciscaine. Grâce au penchant scotiste en faveur de théories subtilement radicales, il s’en dégage une ontologie volontariste de la norme, affirmant une théorie de la loi et une philosophie déontique ouvertement alternatives à celles intellectualistes et thomasiennes (ou pour le dire à l’instar de MacIntyre, à toute théorie éthique ayant son pivot dans la notion de vertu, tandis que Scot utilise le mot ‘vertu’, mais il ne dispose pas d’une éthique de la vertu selon la grille conceptuelle d’ Alasdair MacIntyre)5. La théorie de la normativité est une théorie générale des normes, mais quand Hans Kelsen a intitulé de la sorte son dernier ouvrage il ne parle que de la norme juridique, tandis que chez Scot la théorie est valable pour toute sorte de norme. L’héritage de la pensée de Jean Duns Scot est double: d’une part, elle va marquer la tradition franciscaine, dans la dialectique des divergences dans l’unité ; d’autre part, elle va marquer la pensée juridique de l’Occident latin. Il s’agit là de souligner comment, à l’instar d’Harold Berman, la révolution culturelle promue par Grégoire VII produit le droit canon en opposition au droit romain médiéval, et ensuite comment la contribution franciscaine offre la conception subjective du droit et le normativisme hétéronome (la source axiologique n’est pas chez l’homme). Il n’y a pas de thèse partagée par tout le monde en ce domaine, et ma thèse est qu’avant la mise en chantier de l’agenda franciscain il n’y avait ni de conception pure de la normativité (Abélard ne peut que concevoir la norme comme identique à la vérité évangélique), ni de 3 4
5
Parisoli, La Règle, la Pauvreté, le Destin industriel. Cf. l’affirmation de Gabriele De Anna, review in The Medieval Review - TMR, 07.07.11 (2007), http://hdl.handle.net/2027/spo.baj9928.0707.011: “‘Analytical Thomism’ has now become a common label to refer to attempts to introduce Aquinas’s views in contemporary debates. Parisoli could be named an ‘Analytical Scotist’, and his book has much to teach to ‘Analytical Medievalists’ of all brands. It shows how close the tie between logic and metaphysics is, and how misleading and reductive it could be to rephrase the views of a Medieval metaphysician with the machinery of contemporary logic. This is a warning which should sound like a challenge to Analytical Thomists: the challenge to show that and how Thomistic logic can be safe from the attacks taken to contemporary “classical logic” by Scotus and his contemporary followers, Parisoli in primis”. Dans le langage scolastique, pour Scot les vertus ne sont pas connectées.
L’innovation scotiste dans l’analyse de la loi
17
conception subjective du droit6, confiant à la culture latine occidentale – sans le dire – l’héritage théorique de l’analyse talmudique de la norme7. En dépit du fait que les philosophes fidèles à un volontarisme ontologique déontique radical sont peu nombreux – François de Meyronnes apparaît comme le normativiste le plus éclatant –, l’innovation scotiste va influencer le patrimoine d’une tradition philosophique de l’Occident latin8. II La volonté de Dieu et de l’homme : le législateur La transcendance absolue de Dieu est une donnée essentielle de la pensée scotiste. Elle est la pierre angulaire de la tradition juive qui s’oppose à la conception païenne du monde, donnant forme à la tradition judéo-chrétienne. Il s’agit d’un Dieu transcendant, qui conserve le monde dans son être, où l’homme jouit d’une volonté libre qui reproduit le modèle formel de la volonté divine, pouvant être défini par le modèle philosophique du volontariste platonisant Salomon ibn Gabirol. La loi, avant d’être manifestée par le Texte dogmatique9 des Évangiles, de l’Ancien Testament, du Nouveau Testament, est tirée d’un acte de volonté : le Texte lui-même, privé de cet acte de volonté du nomothète, n’a aucune valeur normative. Mais la loi ne peut se réduire au Texte dogmatique: il y a des normes en dehors du Texte, et il y a d’autres Textes dogmatiques (l’idolâtrie n’étant pas une superstition, mais une liaison avec le démoniaque). En ce sens, entre Abélard et Duns Scot il y a un fossé séparant un christianisme pré-moderne où la loi n’est que la manifestation de la vérité et un christianisme implémentant une notion moderne de loi (il n’y a que la loi divine à être manifestation de la vérité)10. En ce qui concerne la théorie du droit, il convient de souligner comment Scot lui-même nous donne l’indication explicite du passage du modèle du pouvoir divin au modèle du pouvoir humain11. Scot invite à faire la différence entre le pouvoir absolu et le pouvoir ordonné, dans tout étant qui agit par un intellect et par une volonté (agente per intellectum et voluntatem), et qui peut agir de manière conforme à la loi juste, sans pourtant agir nécessairement en conformité avec cette loi12. Il s’agit du cas de Dieu comme de celui de l’homme, et même de l’ange, car saint Anselme dans le De casu diaboli nous explique que la nature essentielle du péché de Lucifer est d’avoir voulu une chose (par ail6 7 8 9
10 11 12
Parisoli, Volontarismo e diritto soggettivo; notamment, la Prefazione d’Andrea Padovani à cet ouvrage. Parisoli, « La nascita della riflessione ». Parisoli, La philosophie normative de Jean Duns Scot. Il s’agit de Texte, et non pas de texte, car j’assume la signification lacanienne qui est sous-jacente à l’anthropologie dogmatique de Pierre Legendre: le Texte est une affaire d’identité, et l’identité humaine est un dossier normatif. Parisoli, « Deux approches à la normativité juridique ». Parisoli, La philosophie normative de Jean Duns Scot. La référence constante est à Ord. I d. 44 q. un., mais aussi à Lect. I d. 44 q. un. et en complément aux Reportata parisiensia I d. 43 q. 2 et d. 44 q. 2.
18
Luca Parisoli
leurs, une bonne chose — être semblable à Dieu) dans un instant où Dieu ne voulait pas que Lucifer veuille cette chose. Donc, l’action en conformité avec la loi juste se dit du pouvoir ordonné : le cas d’espèce est l’objet d’une subsomption par la norme ordonnée (ce pouvoir est principium exsequendi aliqua conformiter legi rectae). Au contraire, l’action se plaçant au-delà de la loi ou ‘carrément’ contre la loi se dit du pouvoir absolu. Ici Scot utilise la terminologie de l’interprétation de la loi et du langage jurisprudentiel13. Le pouvoir ordonné et le pouvoir absolu peuvent ainsi être considérés le premier comme le pouvoir d’une interprétation stricte de la loi, sans recours à des sources normatives extérieures, le second comme le pouvoir d’une interprétation sans borne de la loi existante, par recours à des sources extérieures au système actuel. En outre, on peut considérer le pouvoir ordonné comme celui d’un législateur qui ne peut pas changer les lois qu’il a déjà approuvées, comme dans le cas des normes constitutionnelles immuables. Au contraire, le pouvoir absolu est celui d’un législateur qui ne connaît pas de normes immuables dans son système juridique, de sorte qu’il peut modifier chaque loi en vigueur. Le pouvoir de facto et le pouvoir de iure sont déjà conceptualisés dans la Summa fratris Alexandri dans le contexte des modalités de la toutepuissance divine, et ils peuvent être considérés comme un couple de l’analyse de la normativité dans l’école franciscaine. Pour Dieu, agir de facto équivaut à agir de iure, car sa décision crée une norme chez l’homme ; en revanche, pour l’homme agir de facto revient systématiquement à violer une norme. Tandis que le commentateur des Décrétales de Grégoire IX dans la Glossa Ordinaria produit une taxographie de la valeur sémantique du mot “potentia”, allant de l’agent moral à la génération animale et évoquant ainsi l’influence de Scot Erigène sur les glosateurs très bien analysée par Andrea Padovani, dès la Summa fratris Alexandri, le couple de iure et de facto reçoit une lecture théorique visant non pas à expliquer un usage technique, mais à analyser la source de la légitimité du pouvoir humain dans ses proximités et dans ses différences vis-àvis du pouvoir divin. La légitimité du pouvoir absolu est fonction de la compétence du sujet qui agit : si le sujet n’est pas le maître de l’ordre en vigueur, mais au contraire qu’il est borné par lui, il peut agir licitement uniquement par son pouvoir ordonné (par l’ordre qui a été établi par un autre sujet ou qui lui échappe définitivement). Scot nous dit que tous ceux qui sont assujettis à la loi divine ne peuvent pas agir par leur pouvoir absolu, car le système normatif de Dieu s’impose aux créatures14. Mais il y a des sujets, comme le prince face à ses assujettis, qui peuvent agir par un pouvoir absolu : dans le contexte du système juridique hu-
13 14
La terminologie scotienne est présente chez Bernard de Pavie, Summa Decretalium, l. 1, tit. 2, § 1-3, § 4. Ioannes Duns Scotus, Ord. I d. 44 q. un. n. 4: “omnes qui subsunt legi divinae, si non agunt secundum illam, inordinate agunt”.
L’innovation scotiste dans l’analyse de la loi
19
main15, la loi est droite (c’est à dire juste et contraignante16) uniquement parce qu’elle est droit positif ; le droit naturel n’intervient qu’après la promulgation, par l’action des interprètes autorisés. Dès lors, en changeant le droit positif, le juste et le non-juste changent : ce n’est pas le légalisme éthique aujourd’hui dominant, car la source hétéronome divine est nécessaire au discours scotien17. En dépit du concept contemporain de constitution et des futurs efforts de Guillaume d’Ockham pour développer une théorie des bornes constitutionnelles du pouvoir absolu du Pape, Scot ne développe pas une véritable théorie de la Constitution. En effet, une fois assurée l’obéissance à la loi divine, le législateur humain est souverain absolu dans son système juridique : il est un quasi-Dieu dans son système. En ce sens, nous retrouvons le modèle de la plenitudo potestatis, le pouvoir sans bornes, du Pape : chaque prince est un petit pape dans les limites géopolitiques du système juridique qui lui est propre, et le bien commun est fonction de sa légitimité, et non pas d’une recherche spéculative. Mais si la théorie politique peut se pencher sur les limitations du pouvoir suprême dans un système juridique spécifique, il va sans dire que Dieu n’est pas limité par un système de justice, car sa volonté est la règle de la justice, comme Scot le démontre parfaitement dans la distinction 3818. La justice de la loi humaine est la conformité au droit positif, ou au droit existant. La justice de la loi divine est qualifiée de “juste” au seul motif de la promulgation de la loi par l’acte de volonté divine, qui dispose de l’existence même de l’ordre dans lequel elle veut produire ses normes19. Ainsi, Scot se montre bien conscient de la différence entre la sphère normative de la législation (les énoncés normatifs produits par un acte souverain de volonté) et la sphère normative de la jurisprudence (les normes produites par le juge à partir des énoncés normatifs). L’action ordonnée renvoie toujours à un ordre normatif supérieur par rapport auquel elle est l’action normative conforme. De potentia ordinata, Dieu doit agir conformément aux règles qu’il a déjà promulguées, comme le juge agit selon la loi en vigueur approuvée par le législateur, et dans ce contexte Dieu ne peut pas sauver celui qui est mort comme pécheur, même s’il peut toujours l’empêcher de pécher. De potentia absoluta, Dieu établit les règles qu’il veut, comme le législateur humain écrit et réécrit une loi et son contraire20, et dans ce contexte Dieu peut aussi sauver celui qui est mort comme pécheur par un jugement individuel, contre la règle actuelle, et par Lui établie, selon laquelle tout pécheur doit être damné. La primauté de la volonté du législateur sur son intellect (le fait de vouloir un acte normatif prime la rédaction de 15 16 17 18 19 20
Par la définition scotienne, ce système est assujetti à la loi divine, mais il est notamment un autre système normatif. Parisoli, « La justice au Moyen Age ». Ioannes Duns Scotus, loc. cit. 5. Ioannes Duns Scotus, Ord. I d. 38 q. un. 5-6; 9; et pour l’intellect divin, 10. Ioannes Duns Scotus, Ord. I d. 44 q. un. 8. Ioannes Duns Scotus, Lect. I d. 44 q. un. n. 3.
20
Luca Parisoli
l’acte normatif) est dominante dans la Lectura21. En effet, la promulgation n’est qu’un acte de la volonté, étant donné que l’intellect se borne à présenter des alternatives à la volonté. Le législateur peut agir de potentia absoluta à la condition nécessaire que la loi dépende de sa volonté — car dans le cas contraire il ne peut agir que de potentia ordinata22. L’état d’exception, selon l’expression de Carl Schmitt, est le socle ultime de la production normative, tandis que le cours ordinaire et ordonné de la loi n’est qu’une situation dérivée de la source primaire de la normativité. Scot n’affirme jamais que Dieu peut agir en dehors de toute normativité — saint Anselme dans le De veritate propose un cercle ontologique entre vérité et norme —, il n’affirme jamais qu’il peut violer son propre commandement. Il nous rappelle, entre autres choses, que l’action de Dieu a une spécificité qui n’est pas présente dans les actions du législateur humain. L’action de Dieu manifeste la norme, car l’acte de volonté de Dieu est une norme. Par contre, l’action du législateur doit toujours être conforme à quelque norme antérieure, même quand il s’agit de changer une loi, car au moins la procédure doit être respectée (de même qu’en changeant une norme de la procédure). De plus, la volonté divine est plus parfaite que la volonté humaine en relation à la liberté. La liberté de l’homme est celle de plusieurs actes de volonté qui portent sur des états de choses différents et même contraires, et cette liberté est indiquée aussi comme libre arbitre. La liberté de Dieu est un acte de volonté qui concerne un état de choses et son contraire, et le libre arbitre ne peut pas être une qualité de Dieu23. Dieu regarde la totalité des mondes possibles, l’homme ne peut que regarder le monde actuel ; mais le législateur des totalitarismes du XXe siècle, n’étant pas limité par Dieu, s’empare de l’état d’exception. Hobbes l’avait autorisé depuis bien des siècles. Il convient de souligner que Scot revient sur la nécessité d’assurer la possibilité humaine d’accomplir la finalité surnaturelle (le salut) du système normatif divin, en tant que proposition différente de celle qui envisage la possibilité d’accomplir une norme. Il s’agit d’un principe (et non pas d’une norme — il n’est pas issu de ces-énoncés-là du système, il se dégage du système tout entier) dont le contenu sémantique est lié à la bonté essentielle de Dieu. Il impose l’existence d’un remède permettant d’obtenir le salut éternel ; il s’agit de l’idée que tout système normatif demande des moyens aptes à permettre de poursuivre les buts généraux du système24. L’acceptation passe toujours par l’institutio, un acte de constitution normative qui peut être motivé par de bonnes raisons, mais qui reste essentiellement un acte de volonté, d’une vo21 22 23
24
Ioannes Duns Scotus, loc. cit. n. 4. Ioannes Duns Scotus, loc. cit. n. 3. Ioannes Duns Scotus, Lect. I d. 39 q. 1-5 n. 53 (le texte est reproduit avec traduction anglaise et commentaires dans John Duns Scotus, Contingency and Freedom. Lect. I d. 39. Dordrecht : Kluwer, 1994). Il convient de considérer chez Scot l’argument de l’universalité individuelle du remède et la remarque que l’efficacité abstraite de la norme est liée à la possibilité de la reconnaître comme l’issue de la volonté du législateur.
L’innovation scotiste dans l’analyse de la loi
21
lonté suprême dans un ordre donné. L’homme, en tant qu’il est vivant dans des communautés, doit transmettre des messages manifestes par ses pratiques sociales (remedium, vel signum certum et efficax). Il ne s’agit pas d’une nécessité de la personne humaine, mais d’une nécessité de l’état anthropologique où l’homme se voit plongé après la Chute. La loi doit se donner les moyens d’agir sur la sensibilité de ses destinataires: elle doit être perçue comme un élément façonnant l’action humaine. III Les significations du “droit naturel” Dans la théorie scotienne le moyen le plus sûr d’encadrer la signification de la “nature” dans l’expression “droit naturel” est de s’interroger sur la nature du Décalogue, la manifestation suprême du vouloir normatif divin auprès des hommes. Encore ne faut-il jamais oublier que les normes divines n’ont pas toujours la même signification, car elles sont destinées à quelqu’un, et en fonction du destinataire leur signification ne peut pas être toujours la même. Ainsi, en considérant les normes en fonction de leur Auteur, nous envisageons le problème de la dérogation biblique au Décalogue en tant que changement de la norme et non pas comme interprétation du cas d’espèce: à partir des notions analysées jusqu’ici, il doit apparaître que le maître de la normativité ne peut nullement être borné par son activité nomothétique, donc la dérogation est ouverte au Législateur Suprême. En considérant les normes en fonction de l’état qui précède le péché originel, il faudra se poser la question de la nature du péché d’Adam ; en considérant les normes en fonction des viatores, nous posons le problème crucial de la politique du droit du législateur, d’une part régi par les normes divines, d’autre part formellement investi d’un pouvoir absolu qui semble reproduire (répéter) celui de Dieu. En analysant la gravité du péché d’ Adam, Scot analyse aussi la nature déontique du Décalogue25. Tout d’abord, l’excès d’amour pour soi-même est beaucoup moins grave que la haine envers Dieu ou envers autrui. Cette thèse exclut toute équivalence d’une action normalement positive et actuellement déréglée par excès avec une action qui est en soi négative, car contraire à une norme essentielle. Il ne s’agit pas là d’une question marginale, parce que cette position exclut l’idée que la violation même de la norme est la source de la gravité du péché. Au contraire, la gravité du péché est déterminée par le contenu sémantique de la norme violée : la soi-disant “divine command theory” scotienne est moins formelle que ce que certains tenants d’ Aristote ne l’ont voulu faire croire. Il faut rappeler que selon Scot le péché véniel est un désordre de l’action, mais non pas un détournement de la finalité bonne, car ce serait alors un péché mortel26. Le péché mortel frappe le contenu d’une norme divine (praeceptum), le péché véniel n’a pas cette caractéristique. Ensuite, un péché 25 26
Ioannes Duns Scotus, Ord. II d. 21 q. 2 n. 3; Lect. II d. 21-22 q. 1-2 n. 15; Reportata parisiensia II d. 22, q. un., n. 3. Ioannes Duns Scotus, Lect. II d. 21-22 q. 1-2 n. 15, après n. 24-28.
22
Luca Parisoli
peut être dit très grave seulement quand il est la violation d’une norme qui interdit une attitude et une action qui sont les contraires de l’attitude et de l’action à leur tour commandées par Dieu ou par la nature. Tuer un homme est un péché très grave non seulement parce que Dieu l’a interdit dans son Décalogue, mais notamment parce qu’il y a un devoir naturel de conserver la vie de son prochain ; haïr son père et sa mère est un péché très grave non seulement parce que Dieu a commandé d’honorer ses parents, mais aussi parce qu’il y a un devoir naturel d’honorer ses parents. Le législateur humain fixe son échelle des délits, et il pourra être jugé immoral, mais son œuvre normative n’est que contraignante. Le péché d’Adam, à savoir toucher aux fruits de l’arbre interdit, était un désordre de l’amour pour sa femme, comme le péché des anges est un excès d’amour de soi. C’est pourquoi ce péché ne fut pas très grave (en ce qui concerne la “deformitas intrinseca”). Au contraire, le péché de sa femme fut plus grave, car elle voulait imiter Dieu. Mais d’un autre point de vue, le péché d’Adam fut très grave, notamment par ses conséquences, et dans cette perspective le péché de la femme fut moins grave, car si Adam avait résisté au péché, sans elle il n’y aurait pas eu de descendance pécheresse. Sous un certain angle, le péché d’Adam fut plus grave que celui de la femme car il n’avait aucune inclination au mal et précisément il était censé être plus fort que la femme, et que tous les viatores, marqués par la “pronitatem ad malum”. Finalement, les péchés les plus graves ne sont pas simplement la violation d’une norme divine quelconque, mais ils sont des violations des normes (négatives ou positives) qui sont associées à d’autres normes (positives ou négatives) qui considèrent comme une valeur positive et pourtant obligatoire le comportement contraire. D’où la possibilité pour le législateur chrétien de fixer la sanction à son gré. Dans les Reportata, la formulation des mêmes thèses est moins subtile. C’est pourquoi ce passage est souvent avancé pour accuser Scot d’une contradiction entre son volontarisme théologique et la croyance dans le naturel des commandements du Décalogue ici exprimée27. Or, il n’y a aucune contradiction dans la thèse de Scot, au moins dans le cadre de la dérogation au Décalogue. Dans les Reportata l’auteur souligne seulement le fait qu’il existe un naturel de l’action contraire à celle interdite par les commandements, en utilisant la notion de “malum in se”28 opposée à la notion de “malum quia prohibitum”. Or, cette terminologie classique n’empêche pas de concevoir la manifestation de la volonté de Dieu par le Décalogue comme co-essentielle à la loi naturelle qui 27 28
Ioannes Duns Scotus, Reportata parisiensia II d. 22, q. un. n. 3. Dans la Lect. II d. 21-22 q. 1-2 n. 29, Scot emploie l’expression “bonum decalogi est bonum formaliter ex se”. La gravité du premier péché découle du fait que “tamen plura bona adimebat demeritorie (nobis demerendo) ; et ideo maximum peccatum fuit quantum ad sequelam”. L’interdiction de se nourrir de ligno vitae ne crée un bien par son accomplissement qu’à la condition que praeceptum erat: par contre, un commandement positif (une obligation, et non pas une interdiction), comme “Diliges Dominum Deum tuum etc. et alia praecepta decalogi” possède une bonté qui confère la qualification intrinsèque de gravité au péché qui nous prive formaliter de cette bonté.
L’innovation scotiste dans l’analyse de la loi
23
est la règle de la gravité des péchés contre le Décalogue. Il n’y a aucune raison de supposer que la loi naturelle précède la volonté de Dieu, la loi naturelle est un critère afin de déterminer la gravité du péché, étant donné qu’il y a une différence importante entre une action dont la description est la violation d’un contenu sémantique – que naturellement nous pouvons connaître comme bon – et une autre action dont la description est la violation d’un autre contenu – qui est naturellement indifférent ou sans une connotation évidente de valeur. La volonté de Dieu ne change pas continuellement les limites du bon et du mauvais dans la vie des hommes, mais les limites du péché sont bien fixées par elle seule, comme le montre bien le fait que Dieu peut sauver le “pécheur” et condamner le “saint”, non en raison d’une nature divine arbitraire et opaque, mais parce que la qualification de “pécheur” ou de “saint” tient d’un côté de l’ordre du reproche in via, et est alors fondée par la faute qui caractérise l’action, mais de l’autre de l’ordre de la récompense in patria et elle est finalement attribuée seulement par Dieu lui-même. Comme Scot le dit dans son examen de la toute-puissance divine, de potentia ordinata Dieu ne peut pas sauver Judas déjà condamné (“Iudam iam damnatus”), mais de potentia absoluta il peut très bien le faire, car cela n’est pas contradictoire29. Il affirme notamment que l’ordre concerne seulement la loi générale, qui seule renvoie à la potentia ordinata, tandis que l’ordre particulier est toujours un jugement ad hoc, et non pas une loi (“quasi de isto agibili et operabili particulari tantum”). Le pouvoir absolu de Dieu peut changer non seulement un jugement ad hoc (dans un sens banal), mais il peut aussi changer la même loi générale dans un sens plus important. Scot procède toujours par une comparaison entre l’action de Dieu et celle du législateur humain, en instaurant une véritable fondation théologique de la normativité : interdire l’homicide signifie charger les individus de l’obligation de ne pas tuer, mais on peut supposer que l’individu frappé par la sanction ne soit pas le tueur, mais quelqu’un d’autre selon la volonté du Prince30. La question est très importante pour la théorie normative de Scot, car l’enjeu est la portée de la séparation du droit et de la morale, avec une liaison sans confusion. Mais pour comprendre comment le droit, tout en étant très nettement distingué de la morale, ne retrouve toutefois son fondement et sa légitimité que dans la morale, et plus précisément dans cette théorie métaphysique de la morale qui est le droit naturel et de ses objets réels, les normes naturelles, il faut comprendre la sémantique du verbe “mériter” dans la philosophie de Scot. Le Doctor subtilis affirme qu’un acte est méritoire quand il est “Deo specialiter acceptus”31 ; ainsi Dieu juge qu’il convient de bien récompenser cette action visant un bien particulier — au contraire, si le bien auquel l’action était ordonnée était à son tour général, le jugement de mérite deviendrait un juge29 30 31
Ioannes Duns Scotus, Ord. I d. 44 11 textus interpolatus. Ioannes Duns Scotus, Ord. II d. 7, q. un. 17; Lect. II d. 7 q. un. n. 28. Ioannes Duns Scotus, Quodl. q. 17 n. 3 et n. 4.
24
Luca Parisoli
ment moral stricto sensu de louange. Donc la qualification de “méritoire” ajoute à l’action 1) une relation à la volonté qui a été acceptée, et 2) une relation au bien particulier vers lequel s’est dirigée la volonté acceptée. En fait, seule une volonté libre, dans le sens du libre arbitre, peut produire un acte méritoire. Ainsi Scot envisage une séparation plus explicite entre le domaine de la sanction morale et le domaine du jugement moral concernant ce qui est bon et ce qui est mauvais32. En expliquant la nécessité d’une confession complète de tous ses péchés au ministre, Scot illustre sa notion de droit naturel en se confrontant aux juristes professionnels. En effet, s’il y a une obligation de se confesser, elle doit relever soit du droit naturel, soit du droit positif. Il faut alors souligner la notion de droit naturel33: une norme de droit naturel doit être vraie ex terminis, ainsi on l’appelle principe; ou bien cette norme doit être dégagée d’un principe vrai ex terminis, et donc il n’y a pas d’autre possibilité, au sens strict, de droit naturel. Or, selon l’usage, on appelle aussi norme de droit naturel une norme pratique qui se conforme aux normes naturelles stricto sensu, c’est-à-dire aux normes qui sont évidentes per se ou bien sont des dérivations logiques à partir de normes évidentes per se. Ainsi Scot accuse-t-il Gratien de ne pas donner une bonne définition du droit naturel, car le moine du Decretum fait une confusion entre le droit positif divin et le droit naturel, en confondant la force obligatoire avec la source normative. Scot ne suit pas les prudentes gloses des canonistes sur les passages de Gratien. Il dit brutalement que Gratien s’est trompé. Toute norme des Écritures qui est décrite comme étant en vigueur, ne découle pourtant pas d’un système logique de vérités évidentes per se, car elle est bien sûr une norme positive. Parmi les normes positives certaines ont pour auteur un sujet exceptionnel, telles celles de la législation liturgique judaïque ou chrétienne, que Dieu lui-même a imposée. Elles peuvent ainsi être qualifiées comme faisant partie du “droit divin positif”34. On note alors une grande différence: une norme de droit naturel ne peut pas changer, à l’inverse de toute autre norme qui est soumise au changement. Ainsi, il a été toujours obligatoire d’adorer Dieu, et pourtant dans des systèmes positifs différents, dans l’espace et le temps, on a pu l’adorer de façon différente, voire contradictoire, et tout à fait légitime. La nécessité de la confession étant établie par le droit divin positif, son statut de procédure secrète découle du droit naturel: la raison naturelle nous impose la règle qu’un péché occulte doit être jugé par un procès occulte; ainsi dans les
32 33
34
Ioannes Duns Scotus, loc. cit. n. 14; un autre texte à voir est Lect. I d. 17 pars prima q. un. § 89. Ioannes Duns Scotus, Ord. IV d. 17 q. un. n. 18-19, ed. Vat. XIII, 162-163, eodem loc., n. 3, Scot parle de “principia practica” comme de la souche logique du droit naturel. Ensuite, n. 4, il y a un ensemble de principes moraux qui sont conformes aux précédents, et pourtant ne s’ensuivent pas nécessairement, en dépit de leur nature bonne et rationnelle et obligatoire. Ioannes Duns Scotus, Ord. IV d. 17 q. un. n. 20-21, ed. Vat. XIII, 163.
L’innovation scotiste dans l’analyse de la loi
25
Reportata35, Scot spécifie que le juge des choses cachées est uniquement Dieu, ou bien l’un de ses représentants. Les limites de la force normative du droit positif sont bien montrées par Scot, quand il affirme que l’institution par le Christ du pouvoir de lier et de délier confié à l’Église ne comporte aucune obligation naturelle pour un sujet de s’assujettir à son pouvoir36, si bien qu’il y a d’excellentes raisons en général de se soumettre au pouvoir de l’Église. IV La source de la normativité : “aimer Dieu” L’amour pour Dieu est le fondement ultime de toute la sphère pratique humaine. Cet amour-là (foncièrement gratuit) pour Scot ne doit jamais être confondu avec le désir et plus généralement avec la nature. L’amour nongratuit est fatalement désordonné et donc mauvais par violation de la norme divine. On retrouve ici une valeur emblématique au sens lacanien du mot, signification reprise par Pierre Legendre dans son entreprise de l’anthropologie dogmatique : la logique formelle et le volontarisme ontologique nous amènent à la possibilité de sauver Judas et de damner Pierre, mais l’amour gratuit nous fait dire que Dieu pourra sauver Judas et ne pas damner Pierre. La spécificité anthropologique du christianisme — caractère de sa Révélation — est dans le scandale du pardon chrétien aux yeux du monde, impliquant que l’amour appartient et n’appartient pas au système philosophique. La norme ayant pour objet l’amour pour Dieu est une norme immédiatement évidente, qui impose son autorité morale par la référence au bien absolu, et qui, notamment, reçoit sa normativité naturelle grâce au fait qu’elle est un commandement37. La première règle des actes humains est alors la charité, qui ne comporte ni une croyance spécifique, ni le désir d’un bien pour la personne, mais l’inclinaison par la volonté vers le sentiment de justice38. La haine pour le prochain serait encore possible avec l’amour pour Dieu, même si de potentia ordinata, voire selon la constitution de notre monde moral, le premier détruit le second car ils sont incompatibles39. La norme positive qui nous impose d’aimer Dieu ne doit pas être comprise comme une obligation continuelle d’aimer, ou bien comme une obligation continuelle de ne pas haïr, mais elle est plutôt une obligation d’accomplir parfois l’acte positif d’aimer. En effet, la norme fixe le bien suprême à atteindre, et pour y parvenir ne pré35 36 37
38 39
Ioannes Duns Scotus, loc. cit. n. 7. Ioannes Duns Scotus, Reportata parisiensia IV d. 17 q. un. n. 11. Cf. le commentaire de Duns Scotus on Divine Love. Aldershot : Ashgate, 2003, œuvre de l’école hollandaise à l’instar d’Antoon Vos. Ioannes Duns Scotus, Ord. III d. 27 q. un. 14; Lect. III d. 27 q. un. n. 12. Ioannes Duns Scotus, Ord. ibid n. 16-17. Ioannes Duns Scotus, Ord. III d. 28 q. un. 16, en concluant au 20. Ensuite, 25 et 27, pour souligner encore la centralité de l’amour de Dieu comme moteur de toutes nos actions morales. Cf. aussi la Lect. III d. 28 q. 2 n. 30-33, avec au n. 34 une référence à l’ermite comme capable de l’amour social en dépit de toute relation avec le prochain.
26
Luca Parisoli
voit pas les moyens nécessaires40. Comme pour la norme “il faut aimer Dieu”, aucun moyen n’est en soi nécessaire. Scot explique l’amour pour le prochain, même s’il est notre ennemi, selon le même schéma formel41. Selon Scot, l’amour pour Dieu peut être accompli par les seuls moyens de la nature humaine: l’approche mystique de Scot, bien présente au centre des analyses logiques qui sont les outils de sa théologie et de sa philosophie, ne semble jamais être une doctrine du sacrifice ou du renoncement ou encore de l’expiation. Il s’agit d’aimer Dieu, non pas d’aimer les autres personnes humaines : le seul moyen d’aimer Dieu ouvert à notre expérience est d’apprendre à nous aimer nous-mêmes42, car Dieu nous aime certainement, mais en premier lieu il s’aime lui-même. L’amour de Dieu pour lui-même est une nécessité métaphysique: pour la Nature Première s’aimer soi-même est identique à elle-même. Mais il ne s’agit pas d’une nécessité pouvant limiter la liberté : c’est la même nécessité de dire que la pomme est un fruit étant donné que la pomme est un fruit. Penser autrement, c’est du gnosticisme, car il faudrait supposer la réalité du mal. Et la pensée contemporaine, comme le montre Voegelin dans sa démarche d’histoire de la pensée, et les études académiques plongent dans le gnosticisme. À un moment clef de sa déduction métaphysique, l’amour et la volonté font leur entrée : ainsi Scot parle-t-il de l’ordre, de la finalité et des causes dans les trois premiers chapitres du De primo principio, mais quand il arrive au Dieu de la Révélation, il fait jouer les notions immédiates d’amour et de volonté. Amour, volonté et liberté sont pour Scot trois notions étroitement liées qui ne concernent pas seulement la psychologie humaine : elles sont des notions au coeur de son système métaphysique, mais l’amour n’est pas exprimable par la seule analyse philosophique, par la seule logique et ontologie formelle (liberté et volonté sont en revanche des objets de l’ontologie formelle scotiste)43. En deuxième lieu, la possibilité pour l’homme d’aimer Dieu dans cette vie n’est jamais la possibilité de réaliser dans cette vie la vision béatifique. Nous préférons souligner au niveau de la théorie normative que la possibilité actuelle de l’amour pour Dieu est le fondement de la possibilité de l’existence de la norme pour les hommes. Sans cette possibilité actuelle, le droit positif ne serait pas autre chose que le royaume de l’arbitraire et de la violence. 40 41
42
43
Ioannes Duns Scotus, Ord. III d. 27 q. un. n. 62: Lect. n. 55-57. Ioannes Duns Scotus, Ord. III d. 30 q. un. n. 35: tout d’abord une définition, “proximus dicit relationem aequiparantiae sicut amicus vel frater; igitur si faciens misericordiam est proximus” ; ensuite, 36, sur la réduction de la normativité à la non-haine pour le prochain; enfin, 38-39, une analyse de la mauvaise interprétation judaïque complétée par une analyse de logique formelle. Pour la Lect. n. 28-33. Ioannes Duns Scotus, Ord. III d. 26 q. un. n. 119 ; Lect. n. 80. Au tout début de cette question on peut trouver l’importante distinction entre “velle ordinate” et “nolle ordinate” – Ord. 10 ; Lect. n. 11. A Lect. n. 65, Scot explique la constante différence entre affectio iustitiae et affectio commodi. Parisoli, « The anthropology of freedom » 347-365.
L’innovation scotiste dans l’analyse de la loi
27
L’existence de normes humaines se justifie par l’actualité de l’amour divin qui devient la règle pour le législateur. Les systèmes juridiques sont souvent la réponse à l’éloignement de l’homme de Dieu, et leur fonction pratique n’est pas nécessairement de favoriser le mouvement inverse de rapprochement. Le fondement ontologique de la norme est dans la possibilité de l’amour pour Dieu ; et cet amour-là ne tolère aucune analyse philosophique d’aucune sorte, car il s’agit du concept et de la réalité posant les fondements normatifs du systèmemonde. Autrement dit on peut affirmer que le système-monde est un système complet grâce à une fondation externe et interne en même temps44. V La qualité de la loi est dans la qualité du législateur La loi doit toujours être associée à des outils permettant l’accomplissement de son but ; à défaut, l’obligation politique exprimant la légitimité du système normatif ne pourra être qu’un rêve tournant au cauchemar, comme dans les cauchemars totalitaires du XXe siècle. Elle doit se donner les moyens de l’atteindre, mais il ne s’agit pas là d’une considération touchant la définition réelle de la loi, il s’agit en revanche d’une proposition essentielle de la politique du droit. Dieu voulant le salut pour les hommes, il doit associer sa volonté à la possibilité offerte aux hommes d’atteindre ce but du salut éternel : c’est vrai après la Révélation, c’est vrai à toute époque de l’histoire humaine. La ratio legis divine exprime le but à atteindre, pas nécessairement l’ensemble exclusif des moyens pour l’atteindre : le remplacement actuel de la circoncision par le baptême n’exclut nullement que la circoncision pouvait contribuer à la route du salut. Le législateur idéal, notamment Dieu, ne peut — tout en restant idéal — produire un système de lois sans donner les outils permettant l’accomplissement du but de ces lois, où le but envisagé n’est pas la finalité spécifique de chaque norme, mais la finalité globale de l’ensemble global de normes, à savoir le salut pour une société à légitimité chrétienne (il ne rime à rien de parler de souveraineté chrétienne) ou tout autre bien commun d’une société déterminée. Les canonistes, pour Scot, ne sont pas assez analytiques dans leur démarche : en essayant d’être trop subtils, ils vont tomber dans le même défaut d’analyticité45. En réalité, nous pouvons déjà discerner le choix de Scot pour l’un des deux partis canonistes annoncés par Harold J. Berman dans son classique Law and Revolution46. Berman souligne l’existence d’une dialectique essentielle pour l’émergence de la nouvelle conception du droit, la dialectique entre théologiens et juristes produisant ce que nous appelons aujourd’hui la conception moderne du droit, par opposition à la conception romaine du droit. Il s’agit d’une dialectique entre théologiens-juristes d’une part (Scot, mais aussi les auteurs de la Summa fratris Alexandri, Pierre de la Palud, Guido 44 45 46
Parisoli, La contraddizione vera. Le contexte est celui da la d. 1 de l’Ordinatio, IV, analysant l’efficacité du baptême. Cambridge Mass. 1983, trad. fr. Loi et révolution, Paris 2002.
28
Luca Parisoli
Terreni, John Baconthorp, et bien d’autres), et juristes-théologiens d’autre part (notamment Henry de Suse, à savoir le cardinal Hostiensis, et Sinibaldo Fieschi, à savoir le Pape Innocent IV). Mais il y a aussi des théologiens-théologiens, touchant de façon tout-à-fait superficielle le discours juridique, et des juristes-juristes, préférant puiser dans les sources du droit romain, le corpus du Digeste, du Code et des Institutions de Justinien, et notamment dans l’univers sémantique de ces sources. Parmi ces juristes-juristes, à mon avis, on peut ranger le célèbre Huguccio, évêque de Ferrara, et Bernard de Parme, auteur de la Glose Ordinaire aux Decretales de Grégoire IX, et de nombreux représentants de l’école de Bologne, en les classant à partir de la célèbre querelle systématique entre Bulgarus et Martinus, le premier partisan de l’Empire, le second partisan de la Papauté. Scot n’aime pas du tout ces juristes-juristes, d’où sa polémique violente contre Bernard de Parme : au fond, il ne peut pas tolérer qu’on puisse aborder des questions touchant aux sacrements par des références à la religion païenne, comme le fait dans sa glose Bernard de Parme, en renvoyant à un passage de Celse concernant la dimension du sacré dans la cérémonie sacrificielle. Il ne s’agit pas du fait que Scot refuse la source juridique du Corpus iuris civilis, mais il refuse catégoriquement l’univers sémantique de ces sources en tant qu’elles évoquent une sémantique religieuse complètement révolue. Le droit romain médiéval pour lui n’est pas contraignant en soi. Il peut l’être à condition d’être promulgué par un prince chrétien : de même, suivre la loi juive n’est pas judaizare, à la condition qu’un prince chrétien ait promulgué une norme spécifique de cette loi, enlevant à cette norme son caractère juif (donc ‘judaïsant’). Le discours théologique n’est pas auxiliaire du discours juridique, et inversement : les deux forment ensemble un discours produisant la normativité chrétienne47.
47
Parisoli, « La contribution de Duns ».
L’innovation scotiste dans l’analyse de la loi
29
Bibliographie Littérature primaire Ioannes Duns Scotus, Lect. Ioannes Duns Scotus, Ord. Ioannes Duns Scotus, Quodl. Ioannes Duns Scotus, Reportata parisiensia John Duns Scotus, Contingency and Freedom. Lectura I d. 39, ed A. Vos et al., Dordrecht : Kluwer, 1994. Bernard de Pavie, Summa Decretalium, ed. E. A. T. Laspeyres, Regensburg : 1860.
Littérature secondaire De Anna, Gabriele, review of Parisoli, Luca, La Contraddizione Vera in The Medieval Review TMR, 07.07.11 (2007), http://hdl.handle.net/2027/spo.baj9928.0707.011. Berman, Harold J. Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge Mass. : Harvard UP, 1983; trad. fr. Loi et révolution, Paris 2002. Padovani, Andrea, « Prefazione. » In : Parisoli, Luca, Volontarismo e diritto soggettivo, Roma : Istituto Storico dei Cappuccini, 1999. Parisoli, Luca, « The anthropology of freedom and the nature of human person. » Personalist Forum 15 (2003) : 347-365. Parisoli, Luca, « La nascita della riflessione normativa francescana nel XIII secolo e l’influenza della tradizione ebraica : una ipotesi. » In A recepção do pensamento Greco-Romano Árabe e Judaico pelo Ocidente Medieval, ed. Luis A. De Boni, Roberto Hofmeister Pich, 515-526. Porto Alegre : EDIPUCRS, 2004. Parisoli, Luca, Volontarismo e diritto soggettivo, Roma: Istituto Storico dei Cappuccini, 1999. Parisoli, Luca, La philosophie normative de Jean Duns Scot, Roma 2001. Parisoli, Luca, « La justice au Moyen Age. » In La justice, ed. Guy Samama, 95-111. Paris : Ellipses, 2001. Parisoli, Luca, « Deux approches à la normativité juridique dans les parcours de l’Occident chrétien. Pierre Abélard et Duns Scot. » In Pierre Abélard, ed. Jean Jolivet and Henri Habrias, 515-526. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2003. Parisoli, Luca, « La contribation de Duns Scot à la sciene juridique et la science de la législation: ses analyses à propos du baptême. » Collectanea franciscana 73 (2003) : 589-616. Parisoli, Luca, La contraddizione vera. Roma : Istituto Storico dei Cappuccini, 2005. Parisoli, Luca, La Summa fratris Alexandri e la nascita della filosofia politica francescana. Palermo: OSM, 2008. Parisoli, Luca, La Règle, la Pauvreté, le Destin industriel. Aux sources théologiques du capitalisme. In Pauvreté et capitalisme. Comment les pauvres franciscains ont justifié le capitalisme et le capitalisme a préféré la modernité, études réunies par Luca Parisoli. Palermo : OSM, 2008. Veldhuis, Henri et al. (eds.), Duns Scotus on Divine Love. Texts and Commentary on Goodness and Freedom, God and Humans. Aldershot : Ashgate, 2003.
30
31 Archa Verbi. Subsidia 6
31–42
Le cas du sacrifice d’Isaac : volonté divine et loi naturelle chez Duns Scot et Durand de Saint-Pourçain Isabel Iribarren Les Écritures nous transmettent divers passages où Dieu paraît encourager une action qui contredit son intention, dont l’ordre établi est l’expression. Trois épisodes bibliques ont été retenus par les théologiens médiévaux, devenus par la suite des locus classicus pour l’étude de la question du rapport entre la volonté divine et la loi naturelle : le cas du sacrifice d’Isaac (Gn 22, 1-12), le vol des Égyptiens perpétré par les Israélites (Exode 3, 22) et les relations d’Osée avec une prostituée (Osée 1, 2). Le cas du sacrifice d’Isaac en particulier a gagné une valeur emblématique par l’attention que lui ont porté non seulement les théologiens scolastiques, mais aussi la réflexion philosophique des siècles postérieurs, notamment celle de Kierkegaard. On connaît l’épisode biblique : Dieu ordonne à Abraham de sacrifier son fils unique Isaac sur le mont Moria ; alors qu’il était sur le point d’exécuter le commandement divin, un envoyé de Dieu arrête Abraham dans son geste, et celui-ci sacrifie à sa place un bélier. Le récit montre une apparente contradiction entre le commandement divin et le précepte du Décalogue par lequel le meurtre des innocents est interdit comme quelque chose d’injuste. Or, les préceptes du Décalogue, inscrits dans la loi naturelle, manifestent l’intention de Dieu. L’enjeu est donc double : d’une part, l’immutabilité de la loi naturelle doit être sauvegardée en tant qu’expression de la volonté divine, elle-même immuable ; d’autre part, la liberté de la volonté divine doit être préservée en tant qu’enracinée dans la toute-puissance de Dieu. Le problème n’est pas seulement d’ordre moral ; plus profondément, il relève de la question théologique du rapport entre la toute-puissance divine et l’ordre établi par Dieu. Dieu peut-il dispenser de la loi naturelle sans se contredire1? Je propose de faire une étude comparative des solutions présentées à cette question par Jean Duns Scot et le Dominicain Durand de Saint-Pourçain (†1334). Puisque leur démarche se présente dans un premier temps comme une réaction à la position de Thomas d’Aquin, il sera d’abord question (1) d’un bref examen de la solution proposée par celui-ci. (2) Deuxièmement, je ferai une analyse de la position de Scot et (3) ensuite de celle de Durand, pour 1
Pour d’autres études sur la même question, voir Mandrella, Isaak-Opfer ; du même auteur, voir également « Vernunftrecht versus göttliches Gebot », 170-182 ; Wald, « Die Bestimmung der ratio legis », 662-681 ; Hedwig, « Isaak-Opfer », 645-661 ; McInerny, « The Teleological Suspension », 295-310. Je tiens à remercier Jacob Schmutz et Prof. L. Honnefelder pour m’avoir signalé l’ouvrage d’I. Mandrella.
32
Isabel Iribarren
(4) enfin, aboutir au bilan des trois positions et à quelques remarques générales concernant le climat doctrinal au tournant du XIVe siècle. Comme j’espère pouvoir le montrer, la démarche de Durand présente une grande affinité avec celle de Duns Scot. Que Durand se soit inspiré du volontarisme scotiste ne devrait pas nous étoner. Ce Dominicain, connu surtout par son écart du thomisme, n’hésite pas à associer sa pensée à la ligne adoptée par l’école franciscaine, que ce soit dans sa doctrine trinitaire2, sa théorie sacramentelle, ou sa christologie3. 1. La position de Thomas d’Aquin Thomas traite de la question du statut de la loi naturelle et de son rapport à la volonté divine dans le cadre de la raison pratique. Tout agent agit en vue d’une fin qui, chez l’homme, est le bien conforme à la raison propre à sa nature. La loi naturelle comprend toute inclination naturelle de l’homme dans la mesure où celle-ci est gouvernée par la raison. Les décrets de la loi naturelle ont donc une racine commune, la raison, qui manifeste à son tour la loi éternelle. Les préceptes du Décalogue expriment l’intention de Dieu, le législateur. Ceux de la première table, relatifs à Dieu, concernent l’inclination rationnelle envers Dieu, bien commun et final ; ceux de la seconde table (dont « Tu ne tueras point ») énoncent l’ordre juste qui doit régner entre les hommes, nul tort n’étant fait à personne et chacun recevant son dû4. L’intention du législateur vise donc principalement le bien commun et secondairement l’ordre de justice qui le garantit. Selon Thomas, dans la mesure où les préceptes du Décalogue reflètent l’intention de Dieu, ils ne sont pas susceptibles de dispense5. En effet, si Dieu supprimait l’ordre de justice qui garantit le bien commun, il se renierait lui-même en tant qu’il est lui-même la justice6. L’immutabilité de la loi naturelle est donc basée sur l’intention immuable de Dieu : celui-ci ne peut pas dispenser de la loi naturelle sans entraîner un changement en lui-même. Comment donc interpréter le cas d’Isaac, dans lequel l’action que le législateur commande semble contredire son intention et la loi naturelle ? Selon Thomas, celle-ci peut subir des changements de deux manières : d’abord, par l’addition d’autres lois provenant de la loi positive ; ou bien par mode de « suppression » (per modum substractionis), en soustrayant une prescription de la loi naturelle en raison des circonstances particulières qui empêchent d’observer le précepte7. C’est ainsi que le bien impliqué dans les préceptes de la seconde table peut être soustrait sans pour autant affecter l’ordre à la fin ultime. 2 3 4 5 6 7
Voir Iribarren, Durandus of St Pourçain. Voir Iribarren, « La Christologie de Durand de Saint-Pourçain », 241-256. Thomas d’Aquin, ST, Ia IIae q. 100 a. 1. Pour la position de Thomas sur le sacrifice d’Isaac, voir aussi Mandrella, Isaak-Opfer, 107-130. Thomas d’Aquin, ST, Ia IIae q. 100 a. 8. Thomas d’Aquin, ST, Ia IIae q. 100 a. 8 ad 2. Thomas d’Aquin, ST, Ia IIae q. 94 a. 5 : « Alio modo intelligitur mutatio legis naturalis per modum subtractionis, ut scilicet aliquid desinat esse de lege naturali, quod prius
Le cas du sacrifice d’Isaac
33
Le traitement que Thomas donne au problème analogue des exceptions dans la loi positive apporte un éclairage sur la question de dispense dans la loi naturelle8. Selon Thomas, si l’observation de la loi est préjudiciable au bien commun, celle-ci ne doit plus être observée. Or, il peut arriver qu’une loi établie en vue du bien public, en règle générale, devienne, en certains cas, nuisible. Car le législateur, ne pouvant envisager tous les cas particuliers, rédige la loi en fonction de ce qui se présente le plus souvent, portant son intention sur l’utilité commune. C’est pourquoi, s’il surgit un cas où l’observation de telle loi soit préjudiciable au salut commun, celle-ci ne doit plus être observée. Thomas donne l’exemple d’une ville assiégée où l’on promulgue la loi, en principe bénéfique, que les portes doivent demeurer closes ; mais s’il arrive que les ennemis poursuivent des citoyens dont dépend la survie de la cité, il serait très préjudiciable pour cette ville de ne pas leur ouvrir ses portes. Dans ce cas là, il faudrait aller contre la lettre de la loi, afin de sauvegarder l’intérêt général que le législateur avait en vue. Thomas recourt au concept d’epikie pour expliquer cette idée. D’origine aristotélicienne9, l’epikie, qu’on peut traduire en français par « équité bienveillante », consiste en une correction du sens strict de la loi selon l’esprit du législateur en vue d’un bien majeur. Dans la loi romaine, cette notion renvoyait à une certaine « bienveillance » dans l’interprétation de la loi, là où une adhésion stricte à la lettre porterait préjudice au bien commun. Cependant, il n’appartient pas à n’importe qui d’interpréter ce qui est utile ou pas au bien commun. Cela est la prérogative du prince, qui détient l’autorité pour dispenser de la loi. Dans la mesure où le principe d’epikie implique une certaine insuffisance dans le plan du législateur, Thomas n’y recourt pas dans les questions relatives à la loi naturelle. En effet, celle-ci, expression de la volonté divine, n’admet pas de correction. Cependant, abstraction faite du contexte de droit civil dont elle est originaire, la notion d’epikie permet, dans un sens analogue, de mettre en relief le problème théologique de la relation entre la puissance divine et l’ordre établi. Il ya donc lieu de se demander si la démarche de nos auteurs permet une applicabilité de la notion d’epikie où l’on verrait Dieu, le législateur, « réinterpréter » sa propre loi en vue d’un bien majeur, en l’occurrence la consolidation de la foi d’Abraham. En ce qui suit, je propose d’utiliser cette notion comme grille de lecture, et de reformuler la question dans les termes suivants : le cas d’Isaac constitue-t-il une réinterprétation bienveillante de la loi naturelle qui proscrit le meurtre en vue d’un bien majeur conforme à l’intention divine ? Nos théologiens privilégient-ils l’immutabilité de la loi ou l’esprit de la lettre ?
8 9
fuit secundum legem naturalem. Et sic quantum ad prima principia legis naturae, lex naturae est omnino immutabilis […] Potest tamen immutari in aliquo particulari, et in paucioribus, propter aliquas speciales causas impedientes observantiam talium praeceptorum. » Thomas d’Aquin, ST, Ia IIae q. 96. a. 6 ; aussi IIa IIae q. 120 a. 1. Aristote, Ethique à Nicomaque, V, 10, 3.
34
Isabel Iribarren
Dans sa réponse, Thomas cherchera à montrer que le cas d’Isaac ne constitue pas une dispense du précepte général de la loi naturelle. Pour le faire, il présente l’enjeu autrement : la question n’est pas de savoir « comment le meurtre d’un homme innocent peut être juste » mais de savoir « comment ce qui devrait généralement constituer un meurtre ne l’est pas dans un cas particulier ». Selon Thomas, le sacrifice d’Isaac ne constitue pas strictement une dispense de la loi naturelle, mais un cas d’intervention divine qui transforme la nature même de l’acte en question. De même que le vol que les Israélites ont perpétré auprès des Égyptiens ne constitue pas un vol dans la mesure où Dieu, maître de toutes choses, en aurait rétabli la propriété aux Israélites, de la même manière, Abraham ne consent pas à un homicide, car Dieu, qui est le maître de la vie et de la mort, l’a ordonné. Cette mort devient par conséquent juste, car la mort de tous les hommes relève en fin de compte de la volonté divine10. Ce n’est pas que le meurtre d’Isaac ne soit pas injuste ; plutôt, il ne constitue pas un meurtre11. Il ne s’agit pas non plus d’une « soustraction » à la loi naturelle dans le cas particulier d’Isaac. Tel que Thomas reformule l’enjeu, la question d’une exception ne se pose même pas. Le concept d’epikie n’est pas applicable non plus, car il ne s’agit pas ici d’une correction de la loi naturelle, mais d’un cas qui sort du cadre des lois prescrites par le Décalogue. Dans cette mesure, l’immutabilité de la loi naturelle est préservée. 2. La position de Duns Scot La solution de Duns Scot passe par une critique de la position thomasienne, en particulier sa notion de substractio, qui prétend préserver le principe de justice de la loi naturelle en soustrayant le cas particulier de la loi générale. Aux yeux de Scot, l’idée de substractio présuppose qu’il y aurait des préceptes qui sont justes par soi indépendamment de la volonté divine12. Scot change le pivot de l’argumentation d’une défense de l’immutabilité de la loi naturelle à une défense de la liberté de la volonté divine. Il admet que l’argument thomasien peut être vrai des préceptes de la première table, par lesquels les hommes sont ordonnés à Dieu. Ceux-ci appartiennent strictement à la loi naturelle et 10 11 12
Thomas d’Aquin, ST, Ia IIae q. 100 a. 8 ad 3. Aussi Ia IIae q. 94 a. 4 ad 2 ; q. 64 a. 6 ad 1 ; IIa IIae q. 104 ad 2. Voir McInerny, « The Teleological Suspension », 295-310. Duns Scot, Ord. III d. 37 q. un. n. 4 : « si praecepta Decalogi, vel propositiones practicae, quod possent formari ab eis, haberent talem necessitatem, puta, quod haec esset necessaria : proximus non est occidendus, furtum non est faciendum, ita quod circulscripto omni velle apud intellectum apprehendentem, tales complexiones essent sic notae, intellectus divinus apprehendens talia necessario apprehenderet ea tanquam ex se vera, et tunc volunta divina necessario concordaret istis apprehendis, vel ipsa non esset recta, et ita esset ponere in Deo rationem scientia practicae, quod negatum est in primo. Esset etiam ponere quod voluntas ejus simpliciter necessario determinatur circa aliqua volibilia alia a se, cujus oppositum est dictum in primo, ubi tactum est quod voluntas divina in nihil aliud a se tendit, nisi contingenter. »
Le cas du sacrifice d’Isaac
35
ne tolèrent pas de dispense, car ils ont Dieu comme objet immédiat. En effet, il est impossible de ne pas aimer Dieu de manière licite. En revanche, les commandements de la seconde table, par lesquels l’homme est ordonné à son prochain, relèvent de l’ordre contingent et n’obligent pas la volonté divine. Ces préceptes appartiennent à la loi naturelle seulement dans un sens large, dans la mesure où ils manifestent une conformité aux premiers principes13. Ils restent donc susceptibles de dispense. Dans cette optique, le cas d’Isaac pourrait-il s’interpréter comme une modification de la loi par le législateur en vue d’un bien majeur ? L’epikie serait-elle applicable aux actions divines telles que Scot les entend ? Selon Scot, que l’on puisse libérer quelqu’un de l’obligation due aux préceptes de la seconde table relève de la seule volonté divine. Similairement à Thomas, il maintient que l’appropriation par les Israélites des biens des Égyptiens ne consiste pas en une dispense du précepte qui interdit le vol : Dieu, qui est maître suprême, a le pouvoir de transférer la propriété des biens aux Israélites, de sorte qu’ils auraient pris à juste titre ce qui leur appartenait. L’action des Israélites reste licite en vertu de l’autorité d’un juge supérieur14. De même, le cas d’Isaac ne traduit pas une dispense de la loi, mais l’autorité divine : il ne s’agit pas d’un meurtre mais d’une mort voulue par Dieu. Mais, contrairement à Thomas, Scot ne prétend pas sauvegarder par là l’immutabilité d’un ordre qui imposerait en fin de compte une certaine nécessité à la volonté divine. Scot veut plutôt souligner le fait que les préceptes de la seconde table appartiennent à un ordre juste et contingent du fait même qu’il a été établi par la libre volonté divine. Bien que s’engageant à respecter l’ordre pré-établi par lui-même, Dieu aurait pu, en vertu de sa puissance absolue, agir autrement. En effet, l’ordre établi n’épuise pas la puissance divine15. La liberté de l’action divine réside donc dans le fait que sa volonté est capable d’autodéterminer ses propres lois, de sorte que son action n’est pas déterminée par les diktats d’un modèle préordonné, qui de toutes façons n’a pas de force normative en dehors de la volonté divine. À la base de l’argument de Scot se trouve sa conception « volontariste » du rapport entre intellect et volonté, plus sécifiquement la théorie des instants de nature. Celle-ci lui permet d’établir que Dieu cause de manière contingente sans pour autant compro13 14
15
Duns Scot, Ord. III d. 37 q. un. nn. 6-8 et 11-12. Pour le traitement que Scot fait du cas d’Isaac, voir aussi Mandrella, Isaak-Opfer, 132-150. Duns Scot, Ord. III d. 37 q. un. n. 15 : « de filiis Israel spoliantibus Egyptios, potest dici quod ibi non dispensavit contra praeceptum de furto, quia ipsi non acceperunt simpliciter alienum ; tum quia Deus erat superior Dominus, et potuit transferre dominium illarum rerum in eos, etiam invitis inferioribus dominis. Et hoc modo non peccavit Christus licentians in porcos intrare daemones, qui statim praecipitati sunt in mare ; non enim injuste privavit illos porcis suis. Tum etiam quia filii Israel serviendo Egyptiis meruerant tanta recipere, licet Egyptii nollent ea reddere ; et tunc per superiorem judicem potuerunt compelli, de cujus licentia filii Israel potuerunt juste et licite accipere. » Duns Scot, Ord. I d. 44 q. un. n. 1. Pour la dialectique des puissances divines, voir Courtenay, « The Critique on Natural Causality », 77-94.
36
Isabel Iribarren
mettre la certitude de la science divine. Il s’agit de séparer, par une distinction logique et non pas temporelle, le moment de la volonté et le moment de la réalisation de l’effet choisi : l’intellect divin présente toutes les possibilités d’action à la volonté divine avant que la volonté ne choisisse une des possibilités. Chaque possibilité est connue par l’intellect divin comme étant logiquement possible, alors que la volonté, dans une action intemporelle, actualise une des possibilités16. On retrouve ici une thèse typiquement scotiste, selon laquelle la possibilité logique est coextensive avec la puissance absolue de Dieu. Dans cette optique, la loi naturelle qui interdit le meurtre peut coexister avec la production effective d’un précepte contraire, à savoir le commandement qu’Abraham sacrifie son fils unique. Ce dernier oblige tout de même, en vertu du fait que Dieu l’a commandé. Donc, plutôt qu’une dispense des préceptes de la loi naturelle, le cas d’Isaac illustre la contingence de l’ordre établi. Le contraste avec Thomas est patent. Pour le Dominicain, pour qui la volonté est nécessairement mue par l’intellect, la perfection de la volonté réside dans son adaptation à la fin préfixée par l’intellect. La valeur morale d’un précepte est ainsi déterminée par sa conformité à l’ordre établi. Dans cette optique, il n’y a qu’un ordre d’action, celui manifesté par le décret actuel, en l’occurrence « Tu ne tueras point ». Il n’y a pas d’autre volonté possible que celle exprimée par l’ordre établi, et où l’on pourrait situer le pouvoir de ne pas agir selon le décret en question. Pour Scot, au contraire, la volonté est autodéterminée et sa perfection réside en elle-même, dans sa capacité d’agir autrement qu’elle ne l’a choisi. Dans une telle optique, la valeur morale d’un précepte dépend de l’autodétermination de la volonté divine17. Pour revenir à notre concept de base, l’epikie semblerait donc davantage compatible avec une vision volontariste de la loi morale. En effet, dans la mesure où celle-ci relève du vouloir du législateur plutôt que de la sauvegarde d’un ordre établi, la question d’une possible réinterprétation de la loi en vue d’un bien majeur gagne toute sa force. Conforme au sens profond du concept d’epikie, Scot choisit de privilégier l’esprit de la loi (c’est-à-dire l’intention divine) à l’encontre d’un modèle qui risque un certain rigorisme légal et moral.
16 17
Duns Scot, Lect. I d. 39 qq. 1-5. Voir aussi Met. IX q. 15 ; Ord. I d. 44 q. un. nn. 2 et 3. Voir Sylwanowicz, Contingent causality, 54-97.
Le cas du sacrifice d’Isaac
37
3. La position de Durand de Saint-Pourçain De prime abord, Durand s’inscrit dans le droit fil du volontarisme scotiste : le principe d’action divine est la volonté ; Dieu n’est pas déterminé par les diktats de l’intellect ni par la nécessité de la nature. Il peut ne pas vouloir ce qu’il veut effectivement, car sa volonté se porte de façon contingente à l’égard d’êtres autres que lui-même18. Quant à la question qui nous occupe, à savoir l’écart apparent entre l’ordre établi et la volonté divine, la réponse de Durand passe, comme celle de Scot, par une critique de la position thomasienne. En particulier, Durand met en question l’idée selon laquelle les principes de la raison pratique, bien qu’indispensables dans leur contenu général, peuvent subir une dispense dans leur application à des cas particuliers19. Aux yeux de Durand, l’argument de Thomas prétendrait que les préceptes du Décalogue sont définis principalement par l’obligation de respecter l’ordre juste, abstraction faite de leur application à des cas particuliers. Si l’on accepte cet argument, poursuit Durand, les préceptes du Décalogue seraient réduits à deux : un positif, selon lequel l’homme doit suivre un ordre juste et droit à l’égard de Dieu et de son prochain, et un négatif, selon lequel l’homme ne doit pas agir de façon injuste envers Dieu et son prochain. Mais cela est contraire aux Écritures, où le Décalogue, comme le nom l’indique, comporte dix préceptes avec un contenu bien déterminé20. Selon Durand, un précepte peut subir une dispense lorsque, tout en préservant son contenu principal et ses conditions propres, il est séparable de la notion (ratio) d’obligation s’il s’agit d’un précepte affirmatif, ou du caractère illicite s’il s’agit d’un précepte négatif. La dispense, admissible dans les préceptes de la seconde table, consiste donc en la séparabilité de la raison de justice vis-à-vis de ce qui est prescrit ou interdit21. Corrélativement, un précepte est indispensable si son contenu inclut intrinsèquement et inséparablement la notion de ce qui est dû (debitum). Les principes de la loi naturelle qui concernent la première table du Décalogue ne peuvent pas subir de dispense, car la raison de justice y est comprise formellement (formaliter) ; c’est-à-dire que le contraire ne peut être considéré comme licite sous aucune condition. Le raisonnement que Durand développe pour étayer sa position établit un parallèle entre l’ordre de la nature et l’ordre moral : de même que dans l’ordre de la nature la dépendance des créatures à l’égard de leur cause première est inséparable des créatures, alors que la dépendance d’une créature vis-àvis d’une autre en est séparable (du moins par le pouvoir divin) ; de même dans l’ordre moral le lien d’obligation d’une créature envers Dieu est inséparable de la créature, alors que l’ordre de justice l’obligation d’une créature 18
19 20 21
Durand, C Sent., I d. 43 q. 4, nn. 5-7. Pour les mêmes raisons, Durand rejette tout pouvoir de causalité aux idées divines, comme principes d’action extrinsèque qui imposeraient un certain déterminisme à l’action de la volonté. Voir C Sent., I d. 45 q. 2 nn. 6-7. Durand, C Sent., I d. 47 q. 4, nn. 11-12. Pour Thomas, voir ST, Ia IIae q. 94 a. 4. Durand, C Sent., I d. 47 q. 4, nn. 13-15. Durand, C Sent., I d. 47 q. 4, nn. 7-10 ; 16-17.
38
Isabel Iribarren
envers une autre en est séparable (du moins par le pouvoir divin). Comme Scot, Durand dira qu’aucune autorité ne peut ordonner qu’on n’honore pas Dieu, alors qu’il est parfaitement concevable de ne pas honorer son père ; car l’obligation du fils envers le père est séparable du fils par l’autorité divine, de la même manière que Dieu peut abolir l’ordre de causalité naturelle entre les créatures22. En ce qui concerne le sacrifice d’Isaac, Durand soutient qu’il ne constitue pas une dispense à proprement parler. On l’a vu, une dispense exige que le contenu et les conditions de l’acte prescrit soient préservés, tout en écartant la raison d’obligation ou son caractère illicite, selon le cas. Mais l’acte d’Abraham cesse, par intervention divine, de constituer un meurtre. Faisant écho aux solutions déjà avancées par Thomas et Scot, Durand soutient que dans la mesure où Dieu, qui est le maître de la vie et de la mort, l’ordonne, le sacrifice qu’Abraham aurait perpétré aurait eu la valeur d’une mort aussi naturelle que celle qui surviendra à tous les hommes23. Ce n’est pas que Dieu rende le meurttre licite alors qu’il était auparavant illicite. Dans les mots de Durand, « si on interdit à quelqu’un de boire du vin, et qu’ensuite on change le vin en eau, la personne peut dès lors boire le contenu sans que l’interdit ne subisse aucune 22
23
Durand, C Sent., I d. 47 q. 4, n. 21 : « Verum tamen ratio debiti differenter annexa est materie preceptorum que ordinant nos ad Deum et materie illius precepti quod ordinat hominem ad proximum, quia primis preceptis annexa est ratio debiti inseparabiliter, alii autem precepto non. Cuius ratio est quia sicut est in esse naturali rerum dependentia quam res habent ad causam primam inseparabilis est a rebus, dependentia autem quam res habent ad se invicem separabilis est ab eis, saltem virtute divina (potest enim Deus facere accidens sine subiecto, quod tamen secundum naturam dependent ad subiectum et effectum cause secunde sine causa secunda) ; ergo similiter est in moralibus quod ordo debitus creature rationalis ad Deum est inseparabilis a creatura, sed ordo debitus crea-ture ad creaturam separabilis ab ea, saltem autoritate divina. Et ideo nulla autoritate potest debite fieri quod non credatur in Deum vel quod Deus non honoretur, quia opposita horum includunt inseparabiliter rationem debiti, sed bene potest fieri quod pater non honoretur aliquo modo, quia debitum filii ad patrem separari potest autoritate divina, non humana, sicut solus Deus potest tollere naturales rerum dependentias. » Durand, C Sent., I d. 47 q. 4, n. 23 ad 1 : « [...] occisio innocentis non sic est mala quin ratio mali sit ab ea separabilis autoritate Dei, qui est plenus Dominus vite et mortis, et ideo potuit a Deo precipi. De concubitu autem fornicario et ablatione rei aliene dicendum est quod nunquam fuerunt precepta a Domino cum includant intrinsece et inseparabiliter rationem indebiti ; sed Deus potest mutare naturas et conditiones rerum ; potuit ergo facere quod mulier, que non erat Osee, per perpetuum vinculum matrimonii esset eius ad temporaneum usum, et sic accessit ad suam nec est fornicatus, quia fornicari est accedere ad non suam ; similiter potuit Deus facere quod res que erant Egiptiorum fierent Hebreorum vel ex mero dono Dei, qui est Dominus omnium, vel in recompensationem laboris et servitii quod impenderant Hebrei Egiptiis et sic Hebrei non abstulerunt rem alienam, sed suam, et ideo non sunt furati. Nullo ergo modo facta est dispensatio in illis preceptis Non mechaberis et non furtum facies, quia non est factum quod a mechia et furto manentibus in natura sua sit ablata ratio illiciti, quod pertinet ad dispensationem, sed solum mutata est natura vel conditio rei, ut iam in ea non habeant locum mechia et furtum, nec est ibi aliqua dispensatio. »
Le cas du sacrifice d’Isaac
39
dispense »24. Par cette allusion au miracle de Jésus à Cana Durand veut signaler qu’il s’agit ici d’une intervention de la volonté divine. En effet, la nature même de l’acte est transformée de sorte que ce qui était naturellement inséparable devient séparable. Durand articule sa solution dans les termes d’une distinction entre la volonté antécédente et la volonté conséquente de Dieu. Cette distinction joue chez le Dominicain un rôle analogue à celui que la théorie des instants de nature joue chez Scot : elle cherche à insérer le débat sur la contingence de l’ordre créé dans le cadre de la liberté divine. Introduite par Jean Damascène25, la distinction entre volonté antécédente et volonté conséquente était normalement adoptée pour répondre à des difficultés soulevées par la distinction classique entre le pouvoir absolu et le pouvoir ordonné de Dieu. Ces difficultés portaient sur les actes temporels d’un Dieu éternel, en particulier la nécessité d’accommoder des miracles et des changements dans les lois divines, ou la possibilité du mal dans le monde26. Comme Thomas et Scot, Durand situera ces problèmes dans le cadre de l’ordre établi par Dieu selon son plan général de création dont le but ultime est de ramener les hommes à lui. Il n’est donc pas question ici de sa puissance absolue, car la puissance considérée dans son sens absolu n’a rien à voir avec l’action, et aucun théologien chrétien n’aurait sérieusement entretenu l’idée d’un Dieu qui changerait son avis et qui agirait d’une façon qu’il n’a pas préordonnée. Selon la définition traditionnelle, que Durand suit27, la volonté antécédente désigne la volonté divine de façon absolue (simpliciter). Elle fait référence à son plan général ordonné vers le bien ultime, mais qui n’est pas toujours nécessairement accompli. La volonté conséquente désigne la volonté divine considérée dans les circonstances, permettant ainsi des interventions hic et nunc. Il s’agit de l’exécution actuelle de l’ordre divin qui doit être réalisé nécessairement28. Ainsi, Dieu veut toujours ce qui est bon, mais ce qui est bon 24
25 26
27 28
Durand, C Sent., I d. 47 q. 4, n. 23 ad 1 : « si enim alicui esset prohibitum bibere vinum et vinum ipsi oblatum mutaretur in aquam, certe posset bibere illud vinum conversum in aquam absque dispensatione : semper enim dispensatio fit quando manente materia precepti in sua natura et conditione amovetur ab ea ratio obligationis vel illiciti. » Jean Damascène, De fide orthodoxa, II c. 29 (PG 94, col. 968-969). Thomas fait référence à cette doctrine en ST, Ia q. 19 a. 6 ad 1. Il l’explique en termes de la distinction anselmienne entre nécessité antécédente et nécessité conséquente, une distinction qu’on retrouve chez Boèce en termes de nécessité du conséquent et nécessité de la conséquence. Pour Anselme, voir Cur Deus Homo, II ch. 17. Durand, C Sent., I d. 47 q. 3, n. 3 ; aussi I d. 47 q. 3, n. 14. Durand, C Sent., I d. 47 q. 1, n. 4 : « Voluntas [divina] beneplaciti distinguitur in antecedentem, quae est solum quaedam velleitas ; et consequentem, quae est voluntas simpliciter. » Aussi I d. 47 q. 3, n. 4 : « voluntas antecedens respicit ordinem creaturae rationalis in finem. Voluntas autem consequens respicit executionem ordinis » ; n. 14 : « Distinctio voluntatis divinae per antecedentem et consequentem non est ex parte ipsius voluntatis, sed potius ex parte volitorum. Dicitur enim aliquid volitum voluntate consequente quando est volitum in se, ita quod super illud fertur voluntas divina. Sed dicitur volitum voluntate antecedente quando non est volitum in se, ita quod super ipsum feratur
40
Isabel Iribarren
considéré absolument n’est pas toujours bon en toutes circonstances. Lorsque Dieu considère les hommes en tant qu’hommes, ce qui est bon pour eux est qu’ils soient sauvés. C’est ainsi qu’un Dieu absolument bon désire sauver tous les hommes. Mais puisque quelques-uns refusent la grâce et persistent dans le péché, ce que Dieu veut effectivement est de ne pas les sauver d’entre les hommes. En termes techniques, cela veut dire que de façon antécédente (du point de vue du plan qu’il a ordonné pour sa création), Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ; mais il veut de façon conséquente (dans des circonstances concrètes, une fois l’arbitre des hommes pris en compte) que quelques-uns ne soient pas sauvés. Cela permet d’établir une compatibilité entre le dessein universel de Dieu et des changements qui y peuvent survenir. En effet, on peut admettre que la volonté antécédente de Dieu soit contredite dans l’éventualité d’une chose contraire au plan divin. Les hommes peuvent pécher, ce qui représente un écart par rapport au désir initial de Dieu. Dans des termes tout à fait scotistes, Durand dira qu’en tant que puissance d’opposés, la volonté antécédente peut coexister avec un événement contraire29. En revanche, rien ne peut contredire la volonté conséquente, car ce que Dieu veut effectivement doit se réaliser nécessairement30. Revenons à notre cas : le sacrifice d’Isaac a été voulu par Dieu non pas par sa volonté conséquente, mais par sa volonté antécédente. Le commandement que Dieu adresse à Abraham ne signifie pas sa volonté conséquente de voir Abraham tuer son fils. Sa volonté conséquente veut plutôt épargner Isaac et mettre à l’épreuve la foi d’Abraham31. Dieu prescrit qu’Abraham sacrifie son fils, non pas parce qu’il veut sa mort, mais conformément au plan divin qui ordonne les hommes vers le but ultime qui est leur union à lui. La distinction entre volonté antécédente et volonté conséquente de Dieu permet donc de donner toute son intelligibilité à la notion d’epikie. Le sacrifice d’Isaac représente un cas où l’interprétation de la loi se veut au-delà d’une application stricte de la lettre et est laissée à la discrétion du législateur en vue d’un bien majeur. Quitte à voir dans l’obéissance d’Abraham une violation de la loi natu-
29
30 31
voluntas, sed super suum antecedens ad quod natum est consequi, licet non ex necessitate. » Sur ce sujet, voir Courtenay, « The Dialectic of Divine Omnipotence », 243-69. Durand, C Sent., I d. 47 q. 1 n. 5 : « Si ergo loquamur de voluntate antecedente, sic multa sunt praeter eam et contra eam. Cuius ratio est, quod potentia ad unum oppositorum stat cum actu alterius […] Sed voluntas antecedens est de eventu rerum solum in universali et in potentia, sicut Deus dicitur velle omnes homines salvos fieri, quatenus dedit omnibus naturam ordinabilem in beatitudinem, et omnibus quantum in ipso est praebet auxilia communia quibus possunt ad beatitudinem dirigi et eam mereri. Ergo, talis voluntas potest stare cum actuali eventu opposito, utpote quod iste non salvetur. » Durand, C Sent., I d. 47 q. 1, n. 6. Durand, C Sent., I d. 47 q. 3, nn. 15 et 16 : « immolatio Isaac fuit volita voluntate antecedente, non consequente ». Voir aussi C Sent., I d. 47 q. 3, n. 14 : « distinguendum est de precepto, quia aut proponitur ut preceptum […] aut proponitur ut documentum solum, et hoc precipitur ab eo cui fit preceptum et tunc precipiens non vult aliquo modo rem que precipitur, nec in se, nec in suo antecedente, quia non proponit ut preceptum antecedens ad executionem, sed ut documentum ad aliorum instructionem. »
Le cas du sacrifice d’Isaac
41
relle, il s’agit ici de la mise en action d’une fin supérieure, l’union d’Abraham à Dieu par la foi. 4. Conclusion Nos trois théologiens font tous appel à l’autorité supérieure de Dieu pour expliquer l’écart entre la loi naturelle et la volonté divine. Pour Thomas, il s’agit d’une intervention praeter naturam, en vue de sauvegarder l’immutabilité de la loi naturelle comme expression de la volonté divine. Son argument présuppose donc une conformité assez stricte entre la volonté divine et l’ordre établi, conformité qui convient à une divinité qui agit selon les diktats de son intellect. La notion thomasienne de dispense comme « suppression » d’un cas particulier de la loi générale reflète cette préoccupation de préserver la fiabilité du contenu essentiel de la loi naturelle. Dans cette optique, une réinterpétation « bienveillante » de la loi n’a pas de place. La notion d’epikie se voit vidée de son contenu, dans la mesure où le bien commun s’exprime dans la lettre. Par là je ne veux pas suggérer que Thomas souscrit à un rigorisme normatif qui mettrait en cause la puissance divine. La réflexion de Thomas découle plutôt du principe que la contingence s’inscrit dans le plan providentiel de Dieu, et non pas tant dans sa volonté, en fin de compte insondable. C’est donc la loi naturelle, en tant qu’expression manifeste de la volonté divine, qui est susceptible d’offrir au théologien un aperçu du propos divin. Dans cette optique, et dans la mesure où l’epikie renvoie à une prérogative du législateur, Thomas ne voit pas l’intérêt de chercher à décoder l’intention derrière la lettre. Il se limite donc à ce que la création effective peut nous transmettre sur la volonté divine32. Quant à Scot et Durand, leur critique de la position thomasienne, en particulier sa notion de substractio, reflète pour sa part les priorités doctrinales des théologiens issus du milieu universitaire d’après 1277. Leur pensée est tributaire de l’esprit de la condamnation, dans la mesure où celle-ci entendait rétablir l’idée d’un Dieu éminemment libre et tout-puissant, et avec ceci la contingence de l’ordre créé. Le cas d’Isaac représente la liberté divine d’intervenir directement dans la loi naturelle sans pour autant supprimer l’ordre de justice et le lien de dépendance de la part des créatures. Nos théologiens privilégient l’esprit de la loi là où son application stricte risquerait un positivisme légal qui irait au détriment d’un bien supérieur. L’ordre moral ne réside donc pas tant dans la conformité aux lois immuables, que dans la libre volonté d’union avec Dieu par un lien d’obéissance. Personification même de la libre alliance du croyant avec Dieu, Abraham exemplifierait de façon emblématique les priorités doctrinales du Moyen Âge tardif. 32
La remarque de Hester Gelber est clarifiante à cet égard : « Aquinas’s assertion that much that happens within God’s providential order happens through necessary causes and that not even contingent causes escape God’s providence, established a world where everything is ultimately determined […] Since contingent events are part of God’s providential design, the important focus for a theologian is on what actually is the case, which is what offers information about God’s purposes » : It Could Have Been Otherwise, 120–123.
42
Isabel Iribarren
Bibliographie Littérature primaire Aristote, Éthique à Nicomaque. Durand de Saint-Pourçain, In Petri Lombardi Sententias Theologicas Commentarium libri IIII, 2 vols. Venise, 1579, repr. Ridgewood, NJ : The Gregg Press, 1964. Ioannes Duns Scotus, Ord. Ioannes Duns Scotus, Lect. Ioannes Duns Scotus, Met. Jean Damascène, De fide orthodoxa, The Versions of Burgundio and Cerbanus, ed. Eligius M. Buytaert, Franciscan Institute Publications : Text Series, 8. St Bonaventure, NY : Franciscan Institute ; Louvain : E. Nauwelaerts ; Padeborn : F. Schöningh, 1955. Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, ed. Petrus Caramello, 3 vols. Turin et Rome : Marietti, 1952-6.
Littérature secondaire Courtenay, William J., « The Critique on Natural Causality in the Mutakallimun and Nominalism. » The Harvard Theological Review 66 (1973) : 77-94. Courtenay, William J., « The Dialectic of Divine Omnipotence in the High and Late Middle Ages. » In Divine Omniscience and Omnipotence in Medieval Philosophy, ed. T. Rudavsky. Dordrecht, 1984 : 243-269. Gelber, Hester, It Could Have Been Otherwise. Contingency and Necessity in Dominican Theology at Oxford, 1300 – 1350. Leiden et Boston : Brill, 2004. Hedwig, Klaus, « Das Isaak-Opfer. Über den Status des Naturgesetzes bei Thomas von Aquin, Duns Scotus und Ockham ». In: Mensch und Natur im Mittelalter, ed. A. Zimmermann and A. Speer, 645-661. Miscellanea Mediaevalia. Berlin : De Gruyter 1992. Iribarren, Isabel, Durandus of St Pourçain. A Dominican Theologian in the Shadow of Aquinas. Oxford Theological Monographs. Oxford : Oxford University Press, 2005. Iribarren, Isabel, « La Christologie de Durand de Saint-Pourçain dans le contexte du thomisme émergeant au XIVe siècle. » In Revue des sciences philosophiques et théologiques, 92 (2008) : 241-256. Mandrella, Isabelle, Das Isaak-Opfer. Historische-systematische Untersuchung zu Rationalität und Wandelbarkeit des Naturrechts in der mittelalterlichen Lehre vom natürlichen Gesetz, Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, 62. Münster : Aschendorff, 2002. Mandrella, Isabelle, « Vernunftrecht versus göttliches Gebot : Das Isaak-Opfer als naturgesetzlicher Konfliktfall. » In De Usu rationis : Vernunft und Offenbarung im Mittelalter. Symposium des philosophischen Seminars der Leibniz Universität Hannover vom 21. bis 23. Februar 2006, 170-182, Würzburg : Königshausen & Neumann 2007. McInerny, Ralph, « The Teleological Suspension of the ethical. » The Thomist 20 (1957) : 295310. Sylwanowicz, Michael, Contingent causality and the foundations of Duns Scotus’s Metaphysics. Leiden – New York – Cologne : E. J. Brill, 1996. Wald, Berthold, « Die Bestimmung der ratio legis bei Thomas von Aquin und Duns Scotus. Zur Frage der Inkompatibilität oder Kontinuität mittelalterlicher Naturrechtstheorien. » In Mensch und Natur im Mittelalter, ed. A. Zimmermann and A. Speer, 662-681. Miscellanea Mediaevalia, 21. 2. Berlin, 1992.
43 Archa Verbi. Subsidia 6
43–55
Scotistes et arguments inspirés de Scot dans la controverse de la vision béatifique autour de Jean XXII Christian Trottmann
Les recours explicites à Duns Scot sont peu nombreux dans les textes de la controverse de la vision béatifique. Nous avions signalé naguère celui plutôt formel de Guiral Ot dans son Quodlibet, nous n’y reviendrons ici que très rapidement, ne pouvant dans l’espace imparti rendre compte de l’ensemble de la communication proposée au Colloque de Strasbourg. Mais nous avions aussi indiqué la présence d’une ligne de défense oxfordienne de l’opinion de Jean XXII sur la vision différée soutenue par le chancelier John Lutterell, qui n’est pas considéré comme d’obédience scotiste, mais surtout par Gautier de Chatton et Guillaume d’Alnwick. Nous nous arrêterons donc principalement sur ces deux protagonistes franciscains de la controverse qui viennent d’être évoqués et leurs contributions propres. Pour Guiral Ot, le docteur subtil sert plutôt de prétexte, en défense d’une position qui n’est d’ailleurs pas celle de Jean XXII sur la vision béatifique. Nous en viendrons ensuite au plus explicitement scotiste : Guillaume d’Alnwick, mais qui intervient dans la controverse comme l’ouvrier de la dernière heure, car en fait, celui dont la contribution met le plus efficacement à son service une théologie de la vision béatifique d’inspiration scotiste semble bien être Gautier de Chatton. 1. La référence la plus explicite à Duns Scot, dans le Quodlibet de Guiral Ot A. Rappel sur la controverse de la vision béatifique1 Le second pape d’Avignon avait dans plusieurs sermons de la fin de l’année 1331 et du début de l’année 1332 avancé l’hypothèse que les âmes saintes devaient se contenter de voir l’humanité du Christ jusqu’au jugement dernier où, réunies à leur corps ressuscité, elles pourraient enfin contempler sa divinité. Dans un souci pastoral qui l’honore, le pontife déclarait à la suite de saint Bernard que le corps mystique ne saurait entrer dans la joie définitive avant d’être au complet, ni le prélat sans que son peuple le soit également. Cela remettait en cause l’intercession pour les fidèles défunts et ne manqua pas de choquer les fidèles de son temps. Toutefois, il ne voulait nullement imposer sa thèse de la vision différée jusqu’au jugement dernier, mais entendait solliciter la réflexion des théologiens de son temps sur cette difficile question. La 1
Cf. Trottmann, La vision.
44
Christian Trottmann
plupart se mirent au travail sans tarder, en particulier Jacques Fournier et le maître du Sacré Palais, Armand de Belvézer qui dut y consacrer son cours dès la rentrée de 1332. La cour d’Avignon apparaît alors comme l’épicentre de la discussion théologique sur la vision béatifique, mais des traités ou lettres arrivent des quatre coins de l’Europe. À Naples par exemple, le roi Robert d’Anjou en personne rédige un traité sur la question et, le dominicain Jean de Naples dispute une question sur le sujet. Au même moment, c’est encore à Avignon que le patriarche d’Alexandrie, Jean d’Aragon adresse sa lettre très critique au pape. Parmi les réactions les plus rapides à l’opinion du pape, il faut évidemment compter celle de ses principaux opposants, franciscains schismatiques, réunis à Munich autour de l’empereur. À la fin de l’année, la résistance dominicaine à la thèse de la vision différée commence aussi à s’organiser. Pour la sainte Lucie, un Dominicain critique en chaire à Avignon l’opinion de Jean XXII sur la vision béatifique, provoquant les répliques d’un franciscain le 21 décembre et celle du cardinal de Ceccano pour la saint Étienne, à quelques jours du sermon de Thomas Waleys qui devait « mettre le feu aux poudres », le 3 janvier suivant et bien avant le traité de Durand de Saint-Pourçain qui arrivera en Avignon au printemps. À l’université de Paris, un maître dominicain dispute en décembre 1332 un Quodlibet où il attaque vigoureusement l’opinion du pape. L’événement est relaté, par deux bacheliers qui lui sont au contraire favorables. L’un est carme, l’autre Arnaud de Clermont, franciscain. Fin 1333, Guiral Ot, général des franciscains y soutint à son tour une question de Quodlibet et se vit convoquer devant les théologiens parisiens qui examinèrent deux questions s’y rapportant. Entre-temps, la controverse s’était envenimée, en Avignon du moins. Thomas Waleys ne s’était pas contenté de critiquer en chaire l’opinion du pape, il avait accusé ses partisans de rechercher auprès de lui des récompenses temporelles. Emprisonné et confié à l’inquisition aux mains des Franciscains, son procès retardé en septembre de l’année suivante l’associait à l’évêque de Meaux : son confrère Durand de Saint-Pourçain. Nous comprenons qu’après le scandale provoqué par Thomas Waleys, le pape et ses partisans aient eu à cœur de reprendre le débat en main, du moins à Avignon. Le Cardinal Annibal de Ceccano lance un défi au prieur des dominicains, dont la réponse pourrait bien être le traité édité par M. Dykmans à la suite de celui de Ceccano2. C’est de cette même période que datent les sermons favorables au pape prononcés par les scotistes Chatton et Alnwick, mais aussi par le Carme Jean Rubey de Clarano et par Alvaro Pelayo. Vers Pâques, Ceccano dirige en curie une question disputée avec pour répondants Pierre Roger, futur Clément VI et le futur général des carmes, Pierre Desmaisons. C’est dans ce contexte, que Guiral Ot, qui venait de siéger au procès de Thomas Waleys et Durand de Saint-Pourçain lorsque sa mission en Écosse le 2
Dykmans, Pour et Contre.
Scotistes et arguments inspirés de Scot
45
conduisit à Paris est inquiété par les théologiens dominicains majoritaires à Paris et au contraire persécutés en Avignon par leurs homologues franciscains. L’occasion est belle de faire parler et d’« épingler » le général des Frères mineurs, très lié au pape dans le contexte qui l’a vu succéder à un prédécesseur passé dans le camp des schismatiques munichois. B. Guiral Ot : une pensée scotiste au service de l’opinion du pape sur la vision différée ? Pour gagner de l’espace, nous ne donnerons ici que les résultats concernant cet auteur. Son Quodlibet essentiellement consacré à la vision béatifique est comme enveloppé dans une gangue dont l’esprit scotiste est manifeste, mais représente moins de 3 folios sur 53. Une première lecture de cette question sur la finalité spéculative ou pratique de la théologie pourrait ainsi laisser croire que c’est une pensée d’inspiration et de forme scotiste qui est mise au service de l’opinion de Jean XXII. Or nous avons montré, que loin de défendre la position précise du pontife, il s’en démarque habilement. Si la vision des âmes séparées, fin intermédiaire de la théologie, ne saurait être identique à la vision ultime du jugement dernier, ceux qui avec Jean XXII dénient toute vision de l’essence divine aux âmes séparées des saints, n’ont pas raison pour autant. Guiral Ot peut ainsi, dans sa sixième et dernière conclusion, se démarquer par rapport au parti négateur. Pourtant on notera la disproportion entre cette dernière conclusion qui couvre à peine plus d’un folio et semble un peu improvisée, et la précédente qui s’étale sur plus de 13 folios, n’hésitant pas le moment venu, à réemployer des arguments provenant du procès de Durand de Saint-Pourçain. Comprenons que si Guiral Ot agit en allié objectif des partisans de la vision différée, il ne partage pas pleinement leur opinion théologique et préfère constater que dans l’état actuel de la science et du débat théologique, il est impossible de conclure dans un sens ou dans l’autre. Qu’en est-il maintenant de son rapport à la conception scotiste de théologie ? Sur cette question prétexte, il nous semble que la réponse de Guiral Ot intervenant au tout dernier folio est, elle, parfaitement scotiste3. La conclusion est bien conforme à la tradition franciscaine en général voyant en la théologie une science pratique, et scotiste en particulier, ne cherchant aucun compromis introduisant une dimension spéculative de la théologie. À l’objection à la fois contre la thèse du pape et en faveur d’une théologie spéculative, tirée
3
« Ad questionem igitur principalem secundum premissa respondeo quod doctrina theologica est simpliciter pratica. Hec autem probo quia “ omnis doctrina utilis ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in iustitia, ut perfectus sit homo Dei ad omne opus bonum instructus ”, est simpliciter pratica, ut patet ex premissis in secunda difficultate. Sed omnis doctrina seu “ omnis scriptura divinitus inspirata ”, que quidem est doctrina theologica, est huiusmodi, ut habetur secunda ad Thi. 3 capitulo, , quare ipsa simpliciter pratica. », Ot, La vision, 264-265.
46
Christian Trottmann
principalement de Jn. 20, 31 et surtout 17, 3, la réponse invoquant au contraire comme sa fin dernière la charité est encore d’esprit scotiste4. Si ce Quodlibet porte en apparence sur le statut spéculatif ou pratique de la théologie, pensé en des termes conformes à la tradition scotiste et y apportant une réponse non moins conforme, il abrite six conclusions constituant les 95 % du texte consacrées à la question brulante de la vision béatifique et selon une position qui n’est pas exactement celle du pape. Nous avons donc une pensée qui n’est conforme à celle de Scot que dans la construction formelle de la question et les conclusions et qui n’est pas non plus vraiment au service de la thèse de Jean XXII sur la vision différée. Mais si le Général des franciscains n’a pas une réputation de scotiste, il n’en va pas de même du second des protagonistes de la controverse que nous avons retenus parmi les plus engagés de son ordre en faveur de la thèse pontificale : Guillaume d’Alnwick. 2. Guillaume d’Alnwick, l’ouvrier de la dernière heure Guillaume d’Alnwick est sans doute le plus officiellement scotiste des trois protagonistes sur qui nous concentrons notre propos. Il prononça le 7 mars 1333 un sermon favorable à la thèse de la vision différée. Voir en ce ralliement une simple habileté politique serait oublier que l’évêque de Giovinazzo appartenait à la cour de Naples où M. Dykmans5 se demande même si cette prise de position n’allait pas rendre impossible son retour auprès d’un souverain dont il avait apporté au pape la dernière version d’un traité hostile à la vision différée. Il est vrai que le problème ne se posa pas du fait de la mort du franciscain survenue en Avignon avant la fin du même mois de mars 1333. Le prompt ralliement de ce scotiste de la première heure à l’opinion de Jean XXII et le fait qu’on lui confie une prédication dans la chaire dominicaine deux mois après le sermon incendiaire de Thomas Walleys n’en demeure pas moins surprenant. Rappelons qu’Alnwick avait à plusieurs reprises sévèrement critiqué les thèses du même pape sur la pauvreté, au point d’être convoqué en Avignon. Il avait trouvé refuge auprès du roi de Naples, dont l’épouse, la reine Sancia était notoirement favorable aux spirituels. Il est vrai que lorsque le frère de la reine, Philippe de Majorque avait violemment pris à parti le pape dans plusieurs lettres, Alnwick avait été parmi les premiers à lui en faire reproche, réfutant même par écrit ses thèses excessives sur la pauvreté. Si le pape avait obtenu que la cour de Naples revienne à des positions plus modérées concernant les spirituels franciscains, elle ne s’alignait pas pour autant sur sa nouvelle opinion 4
5
« Per hoc ergo patet responsio ad argumentum in oppositum, quia noticia fidei et credulitas catholica, propter quam ea que scripta sunt, est notitia non speculativa ab omni opere humano morali et bono abstracta, sed notitia appetitiva et operativa. Fides enim “ per karitatem operatur ” ad Gal. 5 capitulo, . Illa etiam vita que est cognitio Dei beatissima ad quam ordinatur fides, non est speculativa adiectione nostri appetitus abstracta, sed est pratica et appetitiva a materia et honorativa Dei, ad quam ipse nos perducat qui vivit et regnat in secula seculorum amen. » Id., ibid. Alnwick, « Le dernier sermon», 265.
Scotistes et arguments inspirés de Scot
47
concernant la vision béatifique. Tant s’en faut puisque la délégation mandée de Naples apportait le traité de Robert d’Anjou très critique à son sujet. Marquant ainsi que la crise liée au sort des spirituels était résorbée, l’évêque de Giovinazzo rejoignit naturellement un camp franciscain rallié au pape. Notons d’abord que sa position sur la question est clairement conforme à celle du pontife. C’est seulement au jugement dernier que les saints recevront la récompense essentielle qui est la vie éternelle consistant en la vision faciale de Dieu6. Il s’appuie pour cela sur des autorités essentielles : Jn. 17, 3 : « la vie éternelle c’est qu’ils te connaissent […] » et surtout Mt. 25, 46 : c’est seulement après le jugement dernier que « les justes iront à la vie éternelle ». Mais surtout, le premier scotiste insiste sur la possibilité pour les âmes séparées des saints de bénéficier d’une vision éminement bienheureuse et claire atteignant la divinité infinie par la médiation de l’espèce la plus parfaite : la vision de Dieu aperçue dans l’âme du Christ7. Une telle solution, avancée en faveur de la thèse de Jean XXII nous semble dériver de la conception proprement scotiste de la vision béatifique. Elle maintient en effet la présence d’une espèce dans la vision des bienheureux. Certes, une telle espèce ne saurait pour Scot constituer un “ medium cognitum ”, qui viendrait s’interposer entre l’intelligence humaine et l’objet connu qui n’est autre que l’essence de Dieu8. Mais une vision immédiate laisse place, précise-t-il dans son quodlibet, à une espèce conçue comme “ ratio cognoscendi ”, entendons comme une forme disposant à l’acte bienheureux. Or il est intéressant de constater qu’une telle espèce est réintroduite à propos de la vision béatifique dans la Distinction 49 (q. 11) de l’Ordinatio à l’occasion d’un retour, à partir de l’opposition binaire entre intellect et volonté (mettant aux prises dominicains et franciscains durant tout le XIIIe siècle), aux trois puissances augustiniennes9. Sans compromettre 6
7
8
9
« Plena et perfecta visio facialis divine essentie est premium essentiale non accidentale. Sed Christus post disceptationem extremi iudicii dabit Sanctis plenam ac perpetuam visionem divine essentie. Ergo Christus post disceptationem extremi iudicii dabit Sanctis premium essentiale. » ibid., 271. « Anima Christi est principalis pars sue humanitatis. Summa autem perfectio anime Christi est visio divine essentie. Hec autem visio cum sit formaliter finita, videtur ab aliis animis sanctis. Hec etiam visio beata qua anima Christi videt divinam essentiam est propria et distincta similitudo representativa divine essentie, quia, ut scribitur I Jo. III : “ Scimus quoniam cum apparuerit, similes ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est ”. » ibid., 278. « Cognitio distincta vel est mediata vel immediata. Dico immediatam quando objectum non mediante aliquo alio objecto intelligitur per quod vel in quo intelligatur, ita quod hic excluditur medium cognitum, non autem medium quod esset praecise ratio cogscendi vel intelligendi», Ioannes Duns Scotus, Quodl. 14 n. 2 p. 3. Cf. aussi n. 26, ed.Viv. XXVI, 108-110. « Et cum duplex potentia concurrat operatione in beato, scilicet intellectus et voluntas, propter utramque, potest talis forma poni. Si autem ponatur propter haec tria aliquid prius operatione, erunt tres formae supernaturales praecedentes ; una correspondens objecto, scilicet species intelligibilis in memoria ; secunda ex parte intellectus, quae dicitur lumen gloriae ; tertia ex parte voluntatis, quae dicitur charitas », Id., Ord. d. 49 q. 11, ed. Viv. XXI, 418.
48
Christian Trottmann
l’immédiateté de la vision béatifique comme connaissance intuitive de son objet, une espèce sera requise comme forme disposant la mémoire à l’acte bienheureux, de même que le “ lumen gloriae ” y dispose l’intellect et la charité la volonté. Scot peut ainsi éviter ce que peut avoir de passif une théorie de la béatitude provoquée par l’“ illapsus ” divin dans l’essence de l’âme, que l’on pourrait lire chez Henri de Gand, tout en assumant le fait que cette présence de Dieu dans la connaissance intuitive concerne les trois puissances et non les seules intelligence et volonté. Mais si, comme le suggère l’opinion du pape sur la vision différée, une telle actualisation ultime ne peut intervenir qu’après la résurrection finale et le jugement dernier, il faut trouver une espèce, conçue de la même manière active comme “ ratio cognoscendi ” pour le type de connaissance déjà très claire, mais non encore faciale dont peuvent jouir les âmes des saints au ciel en attendant. Or une telle espèce est fournie comme sur un plateau par l’exégèse même des versets d’Ap. 6, 9-11, proposée par le pontife à partir de sa lecture des sermons de Toussaint de saint Bernard. Il s’agit de l’humanité glorifiée du Christ. Le maître oxfordien va mettre sa subtilité noétique au service de cette habile tentative de sauver la thèse du pape. Ce que les thomistes pensent à partir de l’articulation entre grâce créée du “ lumen gloriae ” mettant l’intellect possible à niveau, et grâce incréée par laquelle celui-ci reçoit pour forme intelligible l’essence même de Dieu, Alnwick le conçoit en-deçà de la vision définitive pour les âmes séparées. Pour elles, c’est la vision même de la divinité infinie du Christ par sa propre intelligence créée et donc finie, sommet de son humanité glorifiée, qui sert d’espèce pour une vision qui sans être plénière et immédiate donne aux âmes séparées des saints un accès à la contemplation bienheureuse de Dieu. Certes, on pourrait objecter que ce medium semble plus objectif que subjectif et actif. Alnwick parle de “ similitudo representativa ” à l’égard de l’essence divine10. Doit-on comprendre que les bienheureux passent ainsi, comme les apôtres lors de la transfiguration, de la contemplation encore extérieure de l’humanité glorifiée du Christ dans son resplendissement de gloire, à la découverte de sa divinité, à travers la contemplation qu’il en a lui-même ? Certes, il s’agit encore d’une vision abstractive et l’allusion explicite à Avicenne est du plus grand intérêt ici. L’analogie proposée mérite qu’on s’y arrête : l’espèce intelligible présente dans notre esprit reste une réalité singulière, même si elle a une valeur représentative universelle. De même, la vision bienheureuse de l’âme du Christ est une réalité finie eu égard à son humanité créée, et pourtant, elle constitue aussi une similitude représentative de son essence divine infinie11. 10
11
« Hec etiam visio beata qua anima Christi videt divinam essentiam est propria et distincta similitudo representativa divine essentie, quia, ut scribitur I Io. III : “ Scimus quoniam cum apparuerit, similes ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est. ”» Alnwick, « Le dernier sermon », 278. « Unde, licet visio qua anima Christi videt divinam essentiam sit in se formaliter finita, tamen reputative est infinita, representando obiectum infinitum ; sicut species est intelligibilis in intellectu nostro : licet sit singularis subiective, est tamen universalis representative, ut dicit Avicenna, V Metaphisice sue, quod representat naturam universa-
Scotistes et arguments inspirés de Scot
49
Or Alnwick ne se contente pas de s’approprier l’opinion que l’on retrouve dans le camp des franciscains favorables au pape, il en tire les conséquences en argumentant contre Waleys. Celui-ci avait proposé dès son sermon et surtout dans son traité De instantibus et momentis, une réflexion profonde sur l’antériorité de la résurrection par rapport au jugement dernier12. En fait, selon lui ne se déroulerait dans le temps que le mouvement de collection préalable des cendres opéré par les anges, tandis que la résurrection des corps, étant une entrée dans l’éternité, échappe au temps et ne saurait que coïncider en cette éternité même avec le jugement prononcé par Dieu. Résurrection et jugement coïncidant hors du temps, dans l’éternité, ne sauraient donc être distingués que par nature, non dans une succession. Or Alnwick répond que la résurrection et le jugement final doivent être distincts non seulement par essence mais dans le temps13. L’évêque spirituel aura donc eu tôt fait d’être mis au courant des discussions menées contre le dominicain emprisonné par une inquisition tenue par les frères de son ordre. Il lui répond que la résurrection intervenant avant le jugement, le sujet complet serait dès lors parfaitement béatifié corps et âme et n’aurait plus de rétribution à attendre du jugement divin. Il faut dire que la question du temps avait été longtemps l’objet de sa réflexion évoluant d’ailleurs au cours des trois rédactions de son commentaire des Sentences. D’abord défenseur d’une théorie aristotélicienne et réaliste du temps rapporté à la seule mesure du mouvement, il semblait avoir ensuite fait une place à la théorie d’Henri de Gand d’une dimension à la fois subjective du temps mesuré par l’âme, et objective dans le mouvement mesuré. Mais refusant d’y voir un combiné hybride, “ partim, partim ”, son compromis restait à dominante réaliste avant d’adopter dans la troisième rédaction la conception du “ respectus realis ”. Le temps serait le rapport entre le mouvement mesuré et sa mesure dans l’âme. Or la réponse d’Alnwick à Thomas Waleys procède en fait en deux temps14. A supposer une telle préséance de nature et non dans le temps, de la résurrection sur le jugement, elle suffirait déjà à rendre ce dernier inutile dans la mesure où les sujets reconstitués auraient déjà reçu leur récompense dès la
12 13
14
lem ut natura est ; sic in proposito : visio beata anime Christi, licet in se sit finita, tamen est similitudo representans essentiam Dei infinitam. Anime ergo sancte, per visionem anime Christi, sicut per distinctam similitudinem, vident illum clare non obscure, distincte non confuse. Ergo anime sancte, a corporibus exute, modo vident Deum clare. » Id., ibid. Thomas Waleys, sermon, dans Le procès, 102-103. « Resurrectio precedit iudicium extremum non solum natura sed tempore, ut probabo. Si ergo in resurrectione suppositum Petri erit beatificatum perfecte in corpore et anima, sequitur quod in extremo iudicio nichil premii tribuetur supposito Petri. » Alnwick, « Le dernier sermon », 276. « Instance. - Sed ut solvatur istud argumentum, dicitur quod in eodem instanti temporis erit resurrectio et extremum iudicium, resurrectio tamen precedet iudicium prioritate nature non temporis. Réponse. - Contra istam responsionem arguo dupliciter : 1. Primo ostendo quod argumentum stat in suo robore etiam concesso quod resurrectio precedat iudicium solum prioritate nature. » ibid., 275.
50
Christian Trottmann
résurrection. Plus exactement, leur vision de Dieu résulterait d’un exercice accidentel d’une faculté dont l’animation serait obtenue par essence à la résurrection15. Si Dieu donc décidait en sa puissance absolue de ressusciter Paul sans le faire comparaître ensuite en jugement, celui-ci, déjà béatifié par la résurrection dans son corps comme dans son âme, n’aurait plus à recevoir au jugement ni une récompense essentielle ni une récompense accidentelle. Alnwick ajoute un argument tiré de la Première aux Thessaloniciens16 où Paul, croyant d’ailleurs que le retour du Christ interviendrait avant sa mort, suggère que si les morts doivent d’abord ressusciter, ceux qui seront encore en vie lors de cet avènement pour le jugement dernier, seront quant à eux emportés sur les nuées célestes. Entre la résurrection finale des morts et le jugement dernier il y a donc place pour un mouvement local : celui des corps de ceux qui seront encore en vie au dernier jour. Un tel mouvement, de rapt corps et âme de ces derniers vivants, ne saurait se passer que dans le temps. Ainsi Alnwick, s’il tente une conciliation en concevant la vision des âmes séparées des saints comme médiatisée par une espèce suprême, la vision même de sa divinité par l’humanité du Christ, entend faire droit au sens principal de l’objection de Jean XXII : il faut que la rétribution ultime soit donnée seulement au jugement dernier, non pas déjà lors de la résurrection finale qui doit le précéder dans le temps et moins encore avant. Or si le scotiste put aussi rapidement mettre ses compétences théologiques au service de l’opinion du pape, c’est sans doute parce qu’un autre maître franciscain et ancien régent d’Oxford venait de le faire quelques semaines avant lui.
15
16
« Et arguo sic : effectus consequens aliquam causam per se, precedit naturaliter effectum consequentem eandem causam per accidens, quia omne quod est per accidens reducitur ad per se, ex II libro Phisicorum […] Sed in resurrectione, suppositum Pauli videre Deum sicuti est, consequitur per se Paulum in resurrectione esse animatum, anima vidente Deum sicuti est. Ideo suppositum Pauli in resurrectione Pauli videbit Deum sicuti est. Iudicium autem Pauli consequitur per accidens resurrectionem eius, posset enim Deus facere resurrectionem Pauli sine iudicio conséquente. Ergo Paulus prius per naturam erit beatificatus, in corpore et anima, ante extremum iudicium ; ergo post extremum iudicium non dabitur supposito Pauli nee premium essentiale nec accidentale, quod ipsi negant, quod est contra auctoritatem scripture. » ibid., 275-276. « […] inter resurrectionem et adventum Christi ad iudicium erit motus localis, dicente Apostolo, I ad Thess. IV, quod “ mortui qui in Christo sunt resurgent primi, deinde nos qui vivimus, qui relinquimur, simul rapiemur cum illis in nubibus obviam Christo in aera ”, Christo, inquam venienti ad iudicium, ut ibidem patet. Sed raptus corporalis est motus localis, quia est transitus de loco ad locum per medium plenum. Sed motus localis mensuratur tempore. Ergo erit tempus medium inter resurrectionem et extremum iudicium. » ibid., 276.
Scotistes et arguments inspirés de Scot
51
3. Gautier de Chatton : principal artisan de la ligne oxfordienne de défense de l’opinion de Jean XXII ? C’est en effet le 22 février, dans l’église des franciscains qu’il prononça le sermon sur lequel nous nous arrêterons maintenant. On sait que le chancelier d’Oxford, arrivé en Avignon vers 1331 était connu comme scotiste et farouche opposant d’Ockham. D’ailleurs, Thomas Waleys, incarcéré par l’inquisition franciscaine d’Avignon voyait en lui son principal persécuteur. Le sermon entend montrer que l’opinion du pape n’est pas condamnable, mais objet d’opinion, probable et même vraisemblable. Et c’est en abordant le dernier point qu’il avance une argumentation dont nous verrons là encore ce qu’elle peut devoir à son scotisme. Il oppose vision faciale et vision spéculaire, entendons dans le miroir, selon l’image reprise à I Cor. 13, 1217. Or on s’attendrait à voir coïncider cette distinction avec celle établie par Scot entre vision intuitive et abstractive. De fait, la vision faciale ne saurait être qu’intuitive, mais ce n’est pas là sa seule caractéristique : elle est encore claire, portant sur un objet présent, immédiate. Telle est sa principale caractéristique : atteindre sans intermédiaire et selon sa raison propre la chose connue, au point d’en constituer la vision la plus parfaite et ultime qu’il soit possible d’en avoir. Or, la vision spéculaire peut être selon le maître franciscain, claire ou non, intuitive ou pas, portant ou non sur un objet présent. Mais sa principale caractéristique est de n’être pas immédiate. Comprenons que, quand bien même elle pourrait être claire, intuitive et atteignant un objet présent, elle ne le ferait que par la médiation de quelque espèce. La différence entre vision des bienheureux et vision spéculaire atteinte in via, ne semble pas chez Chatton recouvrir exactement l’opposition scotiste entre connaissance intuitive et abstractive. En vérité, celle-ci repose, conformément à l’enseignement du Docteur Subtil, sur le fait que l’objet connu est où non présent au sujet connaissant. Certes, la vision faciale des bienheureux ne saurait avoir lieu in absentia, le maître ne l’envisage même pas comme certains quodlibets ou sophismata, “ de potentia absoluta ” : Dieu trompeur qui se donnerait à voir comme présent alors qu’il se serait retiré. Pour autant la vision spéculaire ne sera pas nécessairement abstractive, mais pourra porter sur un objet présent ou non, saisi clairement ou non, de manière intuitive ou pas. Toutefois, dans tous les cas elle passera par un intermédiaire. 17
« Igitur secundum quod ego pro nunc intelligo, inter specularem et facialem, est ista quod facialis est visio clara, cadens super obiectum presens, intuitive inmediate. Et talis est de re, perfectissima et ultimata visio que possit esse. Specularis autem est visio que non inmediate cadit super obiectum, et hoc sive claritate sive non, sive intuitive sive non, sive obiectum sit presens sive non, hoc excepto quod intuitio vel claritas vel presentia est alterius rationis et non ita perfecta sicut et facialis. Et hec tamen est propriissima potissima differentia ambarum quod specularis non cadit inmediate super rem, facialis autem de sui ratione cadit inmediate super rem visam. » Chatton, Walter,« Les franciscains », 143.
52
Christian Trottmann
Or le maître qui renvoie donc la vision faciale après le jugement dernier où elle peut être reçue comme récompense ultime, va distinguer entre trois modalités de la vision spéculaire18. Il y a une vision de Dieu par adhésion dans la foi. Elle est certaine, mais non évidente. Nous retrouvons ici les critères remontant à Hugues de Saint-Victor. Mais le maître distingue encore une vision qu’il appelle “ arguitiva ”, qui, elle, est évidente et dont il envisage deux modalités : l’une (dans la science) joint la certitude à l’évidence, l’autre pas (dans l’opinion). Nous retrouvons donc les trois modalités classiques : la foi, certitude sans évidence, l’opinion, évidence sans certitude et la science, certitude avec évidence. Mais le franciscain ajoute encore une modalité de la vision spéculaire : qu’il appelle “ expressiva ” et considère comme également certaine et évidente. Nous comprenons quant à nous qu’elle est rendue possible par la médiation d’une espèce expresse, conformément à une tradition noétique assez répandue dans l’ordre franciscain en particulier. Et il se plaît à prendre un exemple19. Je peux avoir connaissance qu’il y a le feu à la maison par les dires d’un homme sage auxquels je porte crédit : connaissance d’adhésion. Mais je peux encore apercevoir la fumée ou même des flammes qui s’échappent par les ouvertures de la maison. Nous aurons alors une connaissance de type à la fois évidente et certaine, même si le feu en lui-même n’est pas vu, mais seulement ses conséquences. La seconde est plus évidente que la première, mais ces deux connaissances spéculaires restent moins évidentes qu’une connaissance intuitive qui verrait le feu lui-même, présent et sans intermédiaire. Or Chatton envisage une troisième connaissance spéculaire “ expressiva ”. Qui verrait le feu de cette maison dans un miroir le verrait clairement, sans pour autant être en présence de ce feu et en saisir les dimensions et la chaleur. Or il déclare une telle vision non seulement claire, mais encore “ intuitiva et presentialis ”. Si le feu n’était pas présent au miroir, il ne serait pas vu et cette vision le fait voir lui et non un autre objet présent. Pourtant, une telle vision reste médiate, passant par les rayons réfléchis sur le miroir. Il est intéressant de retrouver ici des termes optiques. La vision n’est pas intuitive car ce ne sont pas des rayons en ligne droite qui donnent connaissance directement à l’œil et à l’intelligence de la présence du feu. La vision est bien intuitive en ce sens qu’elle porte sur le feu comme objet, mais elle reste médiate car c’est par le biais d’une “ refulgentia ”, ce qui se traduit par reflet, mais suggère aussi une fulgurance du feu qui resurgit sur le miroir. Si nous transposons maintenant l’analogie. La connaissance de Dieu par adhésion est celle de la foi ici-bas au Christ à travers son Église. La connaissance, à la fois certaine et évidente, est celle des philosophes remontant à Dieu 18
19
« Et tantum habebunt sancti pro premio post iudicium ; specularem autem possunt habere ante, diversimode secundum diversos status. Nunc autem distinguo de speculari quod est triplex : quedam pro nunc, adhesiva, certa licet non evidens ; quedam arguitiva, que evidens quandoque certa, ut in scientia, quandoque non, ut in opinione ; quedam autem expressiva, que certa et evidens. » ibid. Ibid., p. 144.
Scotistes et arguments inspirés de Scot
53
à partir de ses effets20. L’auteur remarque qu’une telle évidence reste abstraite. Mais il envisage une troisième vision qui semble relever de l’opinion et concerne pourtant l’union hypostatique, alors que la dernière, “ expressiva ” donnerait accès à l’être même de Dieu mais par des rayons réfléchis, ainsi que c’est le cas dans un miroir21. Suivent des considérations optiques très intéressantes tirées du De oculo moralis de Pierre de Limoges22, sur la vision par des rayons réfléchis, par des lignes brisées ou directes, renvoyant aux trois états des viatores ici-bas, des âmes séparées au ciel et des bienheureux après le jugement. Mais des trois visions spéculaires, la plus parfaite est celle qui passe par une espèce expresse, et la plus parfaite possible, à savoir la béatitude même de l’âme du Christ23. Voyant la vision qu’il a lui-même de sa propre divinité, les âmes des saints aperçoivent celle-ci comme dans le miroir le plus représentatif qui soit24. Ainsi les âmes voient-elles la divinité, non directement mais par la médiation de la vision béatifique du Christ lui-même25. 4. Conclusion Parmi les trois franciscains dont nous avons examiné le rôle dans la controverse de la vision béatifique, le premier, Guiral Ot est celui qui fait le plus explicitement référence à Scot. Pourtant loin de constituer un soutien scotiste à la thèse de la vision différée, son Quodlibet apparaît comme une manière de renvoyer habilement dos à dos partisans et opposants de la thèse du pape, tandis que la problématique scotiste de départ sur le statut spéculatif ou pratique de la théologie apparaît plutôt comme un prétexte à une dispute consacrée essentiellement à la vision de Dieu. Alnwick au contraire est un scotiste de la première heure et son revirement opéré au soir de sa vie en faveur du pape 20 21
22 23
24 25
Ibid. « Alia autem tertia specularis Dei est et deitatis expressiva, ut cum Deus videtur in aliquo representativo creato et non per lineam rectam super ipsam deitatem cadentem, sed mediante representativo, et hec est magnum gaudium et magna beatitudo, que habere potest a creatura rationali citra ultimatam facialem inmediatam. Et certe magnum, ubi homo non posset videre faciem amici directe, si saltem videret eam in speculo, expresse se obicientem, et loquentem eidem ; sed adhuc desideraret eum videre inmediate et in se. » ibid., 144-145. Ibid., 145. « Potest tamen dici quod sit, beatitudo anime Christi, qui est actus Dei visionis inmediate summus, et ideo clarius representativum est speculum quod sit vel forsan esse possit[…]. » ibid. Ibid., 145-146. L’on pourrait sans doute rapporter cette solution habile à la crise déclenchée par Jean XXII à la noétique scotiste développée par Chatton dès son commentaire des Sentences C’est un travail que nous n’avons ni le temps ni l’espace de réaliser ici, mais pour lequel nous avons relevé quelques pistes : Commentaire des Sentences : Prol., Q. 1, a. 4, Q. 2, 6 et 7, resp. 60-64, 76-144, 321-400 ; I Sent D. 1, Q. 3 ; D. 17, Q. 2-3, resp. t. I, 51-66, t. II, 62-103 ; II Sent. D. 2, Q. 2-4, D. 4, resp. 99-159, 195-233 ; IV Sent., Q. 9-11, 323-356.
54
Christian Trottmann
et de sa thèse apparaît plus surprenant. Il s’explique si l’on considère qu’il a ainsi épousé la cause d’un parti franciscain des défenseurs du pape mettant au service de sa thèse sur la vision différée une noétique qui par le rôle laissé à une espèce dans la vision béatifique nous semble d’esprit scotiste. La solution consiste à regarder cette espèce non comme “ medium cognitum ”, mais comme “ ratio cognoscendi ”, medium subjectif et non objectif de l’acte ultime de vision de Dieu. Dans le cas des âmes séparées, il resterait ainsi, selon Alnwick et Chatton, mais aussi Lutterell et Ceccano, médiatisé par l’espèce la plus parfaite qui soit : la vision de la divinité atteinte par l’humanité glorifiée du Christ. Voyant l’âme du Christ voir sa divinité, les âmes l’apercevraient ainsi comme dans un miroir. Sans doute le docteur subtil aurait-il été bien étonné des conséquences étranges tirées par ses disciples de sa noétique de la vision béatifique.
Scotistes et arguments inspirés de Scot
55
Bibliographie Littérature primaire Alnwick, Guillaume d’, « Sermon du 7 mars 1333», ed. M. Dykmans. In Le dernier sermon de Guillaume d’Alnwick. Archivium Franciscanum Historicum 63 (1970) : 259-279. Chatton, Walter, Commentaire des Sentences, eds. J.C. Wey et al, Toronto 1989-2009. Chatton, Walter, « Sermon du 22 février 1333.» In Les frères mineurs d’Avignon au début de 1333 et le sermon de Gautier de Chatton sur la vision béatifique, ed. M. Dykmans, 105-148. Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age XXXVIII (1971). Ioannes Duns Scotus, Ord., ed. Viv. Ioannes Duns Scotus, Quodl., ed. Viv. Ot, Guiral, La vision de Dieu aux Multiples formes, ed. and trans. Christian Trottmann, Sic et non, Paris : Vrin, 2001.
Littérature secondaire Dykmans, Marc, Les sermons de Jean XXII sur la vision béatifique. Rome : Presses de lUniv. Gregoriennes, 1973. Dykmans, Marc, Pour et Contre Jean XXII en 1333. Deux traités avignonnais sur la vision béatifique. Studi e testi 274. Cité du Vatican : BAV, 1975. Käpelli, Thomas, Le procès contre Thomas Waleys O.P. Rome, 1936. Trottmann Christian, La vision béatifique des disputes scolastiques à sa définition par Benoît XII. Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome, 289, Rome : École francaise de Rome, 1995.
56
57 Archa Verbi. Subsidia 6
57–74
Duns Scotus und Johannes Buridan. Die Standards der Rationalität und ihre Relation Rolf Schönberger
A. Prologus: Vorbemerkung zur Problemstellung Die Originalität der scotischen Philosophie haben schon früh so unterschiedliche Köpfe wie Martin Heidegger und Étienne Gilson hervorgehoben; die besondere Bedeutung Buridans genauer einschätzen zu können, verdanken wir Pierre Duhem und Anneliese Maier – bei allen inzwischen erforderlich gewordenen Korrekturen oder Modifikationen. Aus der besonderen Bedeutung diese beiden Denker, Duns Scotus und Johannes Buridan, möchte man angesichts der zeitlichen und räumlichen Nähe ihres Wirkens auch auf die Bedeutung ihrer Beziehung schließen. Doch ihre Beziehungen sind überraschender Weise nicht bedeutend. Es scheint sich keine Stelle in Buridans (edierten) Werken angeben zu lassen, an der er ausdrücklich den Namen des Johannes Duns Scotus erwähnt1 – im Unterschied etwa zu denen von Robert Grosseteste, Albertus Magnus, Thomas von Aquin, Aegidius Romanus, Pierre dAuvergne, Walter Burley, Geraldus Odo etc. (um die Aufzählung auf die Autoren des 13. und 14. Jahrhunderts zu beschränken). Manche Quelle und mancher Adressat buridanischer Ausführungen ist inzwischen identifiziert – Johannes von Jandun,2 William Ockham,3 Walter Burley,4 Geraldus Odo,5
1 2 3
4 5
Dies habe ich bereits in meinem Buridan-Buch festgestellt: Schönberger, Relation als Vergleich, 347sq. Pinborg, „The Summulae“, 76 n.15. In der Frage eines möglichen sensus agens hat sich Buridan hingegen an Johannes von Jandun angeschlossen. Met. IV q. 8 (18vb); V q. 7 (30va); auf diese Stelle bezieht sich aber auch schon die Questio de dependentiis, diversitatibus et convenientiis: Dekker, „John Buridan´s Treatise “. 116; 144; Sum. log. III-2, 27 (OPh. 1), 554; in jüngerer Zeit wurde auf diese Quelle verwiesen: R. Van der Lecq / H.A.G. Braakhuis, Johannes Buridanus, Questiones elenchorum, Nijmegen 1994, p. XXX-XXXV; ich selbst hatte dies bereits in meinem Buridan-Buch vermerkt: Schönberger, Relation als Vergleich [Fn. 1], p. 357. Tractatus de differentia universalis ad individuum, p. 2 q. 1 c. 1, ed. Szyller, 138. Walsh, „Some Relationships”, 237-275; die Nennungen finden sich gegen Ende des fragmentarisch gebliebenen, gleichwohl ziemlich umfänglichen Ethik-Kommentar: Eth. IX q. 2 (192rb); IX q. 3 (194rb; 194vb).
58
Rolf Schönberger
Nicolaus von Autrecourt,6 Johannes Mirecourt,7 Gregor von Rimini8. Aber mit keiner der zahllosen anonymisierten Bezugnahmen (aliqui dicunt) scheint Duns Scotus gemeint zu sein. Gewiss, die Häufigkeit seiner Erwährung ist zum einen kein hinreichend sicherer Indikator für die wahre Bedeutung eines Autors. Der Name Albertus fällt bei Thomas von Aquin nicht ein einziges Mal.9 Hat Scotus etwa selbst seine Lehrer namentlich erwähnt? Buridans Werk macht es schwer zu ermessen, was genau er denn etwa von William Ockham gelesen hat. In den epochengeschichtlichen Darstellungen wird derlei irgendwie vorausgesetzt oder ignoriert. Zum anderen werden Konzepte und Ideen nicht allein durch direkte Lektüre vermittelt. Die Verbreitung kann auch auf andere Weise geschehen. Wenn man auch feststellen muss, dass Buridan nicht nur die theologischen Werke des Duns Scotus nicht zur Kenntnis genommen hat, sondern selbst dessen Aristoteles-Kommentare ignoriert hat, dann liegt darin wenigstens negativ eine Spezifizierung der Rezeptionslinien. Nun ist ja längst bekannt, dass Buridan, so sehr er später den moderni zugerechnet und natürlich zu Recht als solcher wahrgenommen wurde, doch auch in einer ganzen Reihe von Sachfragen eher „konservative“ Positionen vertritt. In seinem Werk findet sich vereinzelt ein Vokabular, das ansonsten von den Terministen nicht nur nicht geschätzt, sondern geradezu perhorresziert worden ist; am auffälligsten sind die Neologismen, die auch im Scotismus begegnen: perseitas, effectuatio, causatio. Wenn also keine direkte Rezeption zu analysieren, sondern ein Vergleich anzustellen ist, dann kann sich dieser nicht an beliebigen Konzepten oder Theorien orientieren, sondern muss vielmehr die jeweilige Konzeption der Rationalität selbst zum Gegenstand der Untersuchung machen, denn dies ist der philosophisch interpretierte und konzipierte Maßstab der Philosophie. Während in der angelsächsischen Buridan-Forschung meist die ArgumentAnalyse und die Erforschung historischer Fakten und Bezüge im Vordergrund stehen, wird demgegenüber hier ein Ansatz verfolgt, in dem die jeweilige These zu einer durchaus wohl bestimmten Sachfrage in ihrer Aussagekraft für das philosophische Rationalitätskonzept insgesamt in Anspruch genommen wird. Dies scheint dann ganz unumgänglich, wenn es nicht darum geht, einen Begriff, eine These oder ein Argument, sondern eine Philosophie insgesamt zu verstehen und sie zu einer anderen in Beziehung zu setzen.
6 7 8 9
De an. III q. 11; cf. Maier, „Das Problem der Evidenz “. Aber selbst dies ist inzwischen bestritten worden: cf. Thijssen, „John Buridan and Nicholas of Autrecourt“. Maier, „Bewegung ohne Ursache“. Scott, „John Buridan“; Wendland, „Die Wissenschaftslehre“. Super Sent. I d. 8 q. 5 a. 3 enthält in der Editio Parmensis zwar einen Hinweis auf Albert, aber schon die Vivès-Ausgabe (VII, 123b) und die Edition von P. Mandonnet haben dies getilgt: Bd. I, Paris 1929, p. 233.
Duns Scotus und Johannes Buridan
59
Zur Rationalität können wohl folgende fünf Momente zugerechnet werden: I. Das Verhältnis der Vernunft zu Gründen; II. Das Verhältnis der Vernunft zur Totalität von Gründen; III. Das Verhältnis der Vernunft zur höchsten Wirklichkeit; IV. Das Verhältnis der Vernunft zum ersten Begriff; V. Das Verhältnis der Vernunft zu anderen Formen von Verbindlichkeit. Wir haben es hierbei gerade mit Fragen zu tun, denen beide Denker nachgehen und die sie zu einem erheblichen Teil sogar inhaltlich konvergierend beantworten. Daher muss sich aus der Art der Begründung das Verhältnis dieser beiden großen Gestalten gewinnen lassen. B. Comparatio I Das Verhältnis der Vernunft zu Gründen 1. Duns Scotus Es entspricht dem Selbstverständnis der klassischen griechischen Philosophie, dass sich Wissen durch die Fähigkeit ausweist, Gründe angeben zu können. Nun hat bekanntlich Aristoteles die Bedeutung des Wortes „Grund“ als vielfältig angesehen.10 Der Rekurs auf Gründe ist also erst dann ein in der Sache triftiger, wenn man erstens angeben kann, in welchem Sinne von Grund jeweils die Rede ist, und wenn man zweitens geklärt hat, wie diese verschiedenen Formen von Gründen zusammenhängen. Duns Scotus nimmt in seinem späten ›Tractatus‹ die „berühmte“ Spezifikation des Begriffes causa in die „wohlbekannten“ Formen der Ursächlichkeit11 auf und versucht wie andere vor ihm, innerhalb einer Systematik des ordo essentialis deren Vollständigkeit zu zeigen. Dies tut er so, dass die Formen von Ursächlichkeit in einen logischen Zusammenhang gebracht werden. Sie stehen zueinander jeweils in einem Bedingungsverhältnis. Wenn die Wirksamkeit nur so viel besagt wie die Leistung, eine Wirkung hervorzubringen, so muss dies doch zugleich so verstanden werden, dass es beim Auftreten oder Nicht-Auftreten der Wirkung um etwas geht; die qualitative Bestimmtheit der Wirkung ist – insbesondere beim Lebendigen – nicht gleichgültig. Dieses Moment enthält nicht die causa efficiens, es ist aber für das Verständnis der Natur wesentlich. Dies sogar in einem doppelten Sinne: Wenn diese Wirksamkeit vielfach versagen würde, könnte man „Natur“ nicht denken; aber auch wenn sie punktuell versagt, dann kann man doch davon nur sprechen, wenn es hier10 11
Met. V, 2; Phys. II, 3. Tract. I div. 4 n. 7, ed. Kluxen, 8: famose dividitur in quatuor causas satis notas.
60
Rolf Schönberger
für einen Maßstab gibt: eben den Zweck.12 Daher gilt: Das Zielbestimmtsein ist die Bedingung des Bewirktseins.13 Dieses Bewirktsein restringiert aber auch umgekehrt die causa finalis.14 Wirken wiederum heißt etwas verändern oder etwas hervorbringen. Daher setzt das Wirken in diesem Etwas eine Materie voraus.15 Sofern also eine Hervorbringung irgendeine Form von Komplexität einschließt, muss deren interne Verfassung als eine Einheit von einander komplementären Momenten gedacht werden. Was also keine Materie in sich enthält, enthält auch keine Form.16 Dies ist aber auch nicht erforderlich, weil etwas zu sich selbst nicht in einem kausalen Verhältnis stehen kann und etwas Einfaches eben nur es selbst ist. Es ist in diesem einen Gehalt ja bereits gedacht und bedarf keiner Konstituierung. Aber nicht nur die Ursachengattungen als einzelne stehen in einem fortlaufenden Bedingungsverhältnis, es lassen sich auch noch zwei Gruppen bilden – die äußeren Ursachen von Zweck- und Wirkursache und die inneren Ursachen von Form- und Stoffursache –, die nun ihrerseits ebenfalls in einem Bedingungsverhältnis stehen. Daher kann man auf die äußeren Ursachen rekurrieren, ohne notwendig auch zugleich auf die inneren rekurrieren zu müssen. Daher ist die Allgemeinheitsfähigkeit der inneren Ursachen beschränkt, nicht jedoch die der äußeren Ursachen. Duns Scotus hat unter anderem auf dieser Basis bekanntlich einen der wirkungsgeschichtlich bedeutsamsten Schritte zu einer definitiven Trennung von Metaphysik und Physik getan, eine Trennung, die sich offenkundig auch mit Hilfe der Ursachenlehre formulieren lässt.17 2. Johannes Buridan Buridan ist berühmt für seine Kritik an der Teleologie, genauer an der Eigenständigkeit der causa finalis.18 Er kann sie daher nicht als erste Bedingung ansetzen. Bezeichnender Weise lautet die erste Frage für Buridan: Um welche Art von sprachlichem Gebilde handelt es sich beim Wort causa? Es ist ein nomen relativum, d.h. es gilt für das Wort causa all das, was für alle nomina relativa gilt: Diese werden bestimmt durch ihr Fundament und ihr Korrelat. Zunächst aber verweist er auf das reale Vorkommen dieses Begriffes, und dieses ist von einer besonders großen Vielfalt. Es handelt sich nun gleichzeitig um einen terminus significativus. Und daher ist die Frage, ob die Viergliedrigkeit die begrifflichen Verhältnisse zutreffend und angemessen bestimmt. In gewissem Sinne enthalten die vier Gattungen weitere Arten in sich. Es geht Buridan 12 13 14 15 16 17 18
Met. V q. 1 n. 15, OPh. III, 398: Si ergo nullus finis sit intentus, nullum agens ageret frustra. Tract. II concl. 4 n. 11, ed. Kluxen, 12-14. Tract. II concl. 5 n. 12, ed. Kluxen, 14-16. Tract. II concl. 6 n. 13, ed. Kluxen, 16-18. Tract. II concl. 7 n. 14, ed. Kluxen, 18. Zur Entzweiung der Tradition zwischen den neuplatonisierenden Denkern und Duns Scotus cf. Schönberger, Causa causalitatis. A. Maier, „Finalkausalität und Naturgesetz“.
Duns Scotus und Johannes Buridan
61
aber nicht um die Verfolgung und Durchdringung dieser Begriffspyramide des Begriffes causa, sondern um das Verhältnis der vier Gattungen zueinander. Die nächste Frage muss daher sein: Wovon sind die berühmten vier Ursachen denn Gattungen? Was ist mit dem Begriff causa gemeint? Dann lässt sich in einem zweiten Schritt die Frage beantworten, in welcher Weise sich der Begriff in diese Gattungen differenziert. Buridan fasst ohne jede weitere Diskussion den Begriff der Ursache als ein Abhängigkeitsverhältnis: sciendum quod sufficit ad rationem causae, quod res dependeat ab ea aut in esse aut in fieri aut etiam in aliqualiter se habere.19 Buridan unterscheidet also Hinsichten des Abhängigseins, aber nicht verschiedene Auffassungen von Kausalität. Die hier angegebene Bestimmung des Begriffes Ursache ist übrigens, wenn man vom Kontext absieht, inhaltlich der des Duns Scotus sehr nahe. Auch Scotus fasst Kausalität wesentlich als Relation der Abhängigkeit. Soll die Viergliedrigkeit in ihrer Legitimität einsichtig werden, muss gezeigt werden, dass keine der genannten Ursachen von der Art ist, dass sie auf eine andere Ursache reduzibel wäre, dass es aber andererseits auch keine Ursachenart gibt, die noch in den Kreis der Ursachen aufzunehmen wäre. Buridan steht jedoch solchen Vollständigkeitsanalysen prinzipiell skeptisch gegenüber; dies hat er schon bei der klassischen Problemstellung der Zehnzahl der Kategorien grundsätzlich abgewehrt. Es gibt in der Tat zehn Kategorien, aber diese Zehnzahl ist auch nur eine tatsächliche. So auch hier: Mehr als das wechselseitige Verhältnis der angestammten vier Ursachen scheint sich in den Augen Buridans nicht eruieren zu lassen. Gleichwohl liegt eine wesentliche Änderung vor, die ebenso auffällig wie konsequent zu sein scheint. Wenn man nämlich das Ursacheverhältnis als eine Relation der Dependenz fasst, dann ermöglicht dies, die Ursachen nicht nur in ein begriffliches, sondern ihrerseits in ein kausales Verhältnis zu bringen. Er rechtfertigt nacheinander mit kurzen Erläuterungen folgende Sätze: materia est causa formae; forma est causa materiae; agens est causa formae in fieri. Der Finalursache kommt in diesem Zusammenhang eine Sonderstellung zu. Sie bestimmt das Agens zum Agieren. Dass die am Ende sich einstellende Wirkung ebenfalls finis genannt werden kann, hält Buridan – übrigens ebenso wie Duns Scotus20 – für eine uneigentliche Redeweise.21
19
20 21
Met. V q. 1 (26vb); Phys. II q. 8 (36ra): Hoc nomen causa vel causa agens et alia nomina causarum dicuntur valde multipliciter secundum diversas valde intentiones, licet attributas ad unam primam intentionem. Prima enim intentione dicitur aliquis causa alicuius quia ab eo aliud dependet in esse suo, ita quod impossibile esset ipsum esse saltem naturaliter, si non dependeret ab illo. Sic enim lux est causa luminis et materia formae et subiectum accidentis et deus omnium aliorum. Tract. II concl. 5 n. 12, ed. W. Kluxen, 14. Met. V q. 1 (26vb): Sed etiam aliquando effectus productus ab agentis vel producendiis vocatur finis vel causa finalis ipsius agentis et credo quod haec non sit propria locutio, immo est denominatio extrinseca et attributiva sicut si diceremus urina est sana. Unde in attributione ad finem ordinantem ipsum agens vocatur finis vel causa finalis quia vera causa finalis determinavit agens ad producendum illum effectum.
62
Rolf Schönberger
Buridan erläutert die entsprechenden aristotelischen Texte folgendermaßen: Die Materie ist insofern Ursache der Form, als die Form durch die Wirkursache aus der Potentialität der Materie in die Wirklichkeit überführt wird und weil eine Form normalerweise – einen göttlichen Eingriff ausgenommen – ohne Materie nicht Bestand haben kann. Das Angewiesensein auf einen vorgängigen Aggregatzustand und auf eine Realitätsbasis sind zwei Abhängigkeitsaspekte, welche diese kausale Redeweise rechtfertigen. Es gilt nun aber auch das umgekehrte kausale Verhältnis: Die Materie kann ohne diese bestimmte Form sein, so ist sie doch in ihrem Bestimmtsein als informatum von der Form abhängig. Die Kausalität des Agens bezieht sich nun auf beides: Das Agens ist Ursache der Form, sofern es diese hervorbringt (producit) – natürlich nicht schlechthin, sondern im Zusammenhang des Werdens. Das Agens ist aber auch Ursache der Materie; auch dies in einer eigentümlichen Hinsicht: Die Materie, so Buridan, ist auf einen Faktor der Veränderung bzw. Verwandlung angewiesen. Nicht die Begriffe von Kausalität werden somit hergeleitet, vielmehr wird der Vorgang des Werdens mit ihrer Hilfe beschrieben. II Das Verhältnis der Vernunft zur Totalität von Gründen 1. Duns Scotus Es könnte nun sein, dass die wirklich angegebenen Gründe so zu denken sind, dass jeder dieser Gründe einen weiteren voraussetzt. Dies bestreitet Aristoteles und versucht, es sowohl prinzipiell wie auch im Hinblick auf alle einzelnen Gründe zu zeigen. Wenn es unendlich viele Gründe gäbe, dann würde sich der Sinn des Unternehmens, die Welt zu verstehen, selbst aufheben. Gründe werden angegeben, damit etwas verständlich und das Verstehen als Wissen begründet wird.22 Wenn es aber unendlich viele Gründe gäbe, würde gerade nichts verständlich; das Unendliche ist als solches nicht verständlich,23 also auch dasjenige nicht, was nur durch die Angabe einer unendlichen Anzahl von Gründen transparent werden könnte. Dies spielt in den mittelalterlichen Beweisen für die Existenz Gottes eine wesentliche Rolle, denn eine vermittelte Erkenntnis ist ja nur erreichbar, wenn die Vermittlungsschritte von endlicher Anzahl sind. Allem Anschein nach hat kein mittelalterlicher Denker soviel Energie auf diese Fragen gewendet wie Duns Scotus.24 Nach ihm gilt es zweierlei zu berücksichtigen: einmal die Relation der causa zum causatum, und zum anderen die Relation einer causa zu einer anderen. Bei der Konstellation mehrerer Wirkursachen sind nochmals zwei Fälle zu unterscheiden: Eine causa kann in doppelter Weise im Zusammenhang ei22 23 24
Metaph. I, 3; 983 a 25-26; Anal. post. I, 6; 75 a 35. Phys. I, 4; 187 b 7; das Unendliche lässt sich definitionsgemäß nicht durchschreiten: Phys. VIII, 9; 265 a 19-20; Anal. post. I, 22; 82 b 38-39. Honnefelder, Duns Scotus, 96: „Der dort entwickelte Beweis ist nicht nur der detaillierteste und differenzierteste, der von einem mittelalterlichen Autor verfasst worden ist, er verbindet auch zwei verschiedene Ansätze zu einer bis dahin nicht gekannten Einheit.“
Duns Scotus und Johannes Buridan
63
ner anderen oder mehrerer anderer stehen: Entweder eine andere causa ist vorausgesetzt, damit die fragliche causa, also das ens, das als causa fungiert, überhaupt existiert. Dies nennt Duns Scotus ein akzidentelles Verhältnis. Es bildet nur einen allgemeinen Hintergrund, enthält jedoch kein spezifisches Verhältnis. Denn die Bedingung, existieren zu müssen, um wirksam sein zu können, gilt für alle causae. Von entscheidender Bedeutung sind hingegen die causae, deren Konstellation eine wesentliche ist. Hier steht nicht eine Ursache für die Existenz der causa überhaupt im Blick, sondern vielmehr für ihr Wirksamwerden selbst. Die Wirksamkeit eines Instrumentes hängt unmittelbar an demjenigen, der es gebraucht. Duns Scotus fügt aber noch zwei weitere Kriterien hinzu: Wenn nämlich das Wirksamwerden einer causa selbst wiederum an einer causa hängt, dann muss diese zudem zweitens von anderer Art sein – wären nämlich beide gleichartig, würde eine von beiden redundant25 –, und drittens müssen Wirkendes und Bewirktes gleichzeitig sein. Das wohl zentrale Argument für die Behauptung eines Ersten ist, dass die Gesamtheit der in einer wesentlichen Ordnung stehenden Ursachen ihrerseits verursacht ist. Das gravierende Bedenken gegen diesen Schluss lautet: Heißt nun nicht von einer Gesamtheit (universitas) sprechen, ein Erstes bereits voraussetzen? Es handelt sich zunächst nur um eine Totalität, eben um jene, die erforderlich ist, um eine Wesensnatur verständlich zu machen. Was nun diese Gesamtheit verursacht, kann als deren Ursache jedenfalls nicht Teil dieser Gesamtheit sein. Wenn diese Ursache Teil der Gesamtheit und zugleich Ursache der Gesamtheit wäre, wäre sie damit Ursache ihrer selbst – ihre Annahme daher ein Verstoß gegen das Prinzip des Widerspruches.26 Was immer eine Ursache, die in einer solchen Reihung steht, bewirkt, sie bewirkt als solche nicht die Reihe. Da diese aber nicht zufällig ist, sondern für das Wirksamwerden wesentlich, kann sie nicht grundlos sein. 2. Johannes Buridan Das Problem des unendlichen Regresses – die Scholastik redet übrigens immer vom unendlichen progressus27 – wird bei Buridan auf eine ganz unspektakuläre Weise gelöst. Ob es unendliche viele Ursachenstufen (nicht wie bei Kant homogene Bedingungen in einer Reihe!) geben könnte, ist eine Frage, die in dieser Allgemeinheit gar nicht beantwortet werden kann. Es lassen sich nämlich zwei unterschiedliche Weisen des kausalen Verhältnisses denken. Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob die Ursache eine Wirkung typischer 25
26
27
Es geht also nicht um die in anderem Zusammenhang von Scotus genannten Fälle, wo zwei Faktoren eine Wirkung herbeiführen können, zu der nur der jeweils eine Faktor nicht imstande wäre: Lect. II d. 25 q. un. n. 71, ed. Vat. XIX, 253. Ord. I d. 2 p. 1 q. 1-2 n. 53, ed. Vat. II, 157: [...] universitas causatorum essentialiter ordinatorum est ab aliqua causa quae non est aliquid universitatis, quia tunc esset causa sui. Tota enim universitas dependentium dependet, et a nullo illius universitatis; fast wörtlich wiederkehrend in: Tract. III concl. 2 n. 29, ed. Kluxen, 36. Pozzo, „Regressus/progressus“.
64
Rolf Schönberger
Weise hervorbringt – der vielzitierte Baumeister das Haus – oder ob es sich dabei um eine zufällige Beziehung handelt. In dieser zweiten Hinsicht ist eine Unendlichkeit der Ursachen durch nichts ausgeschlossen, in der ersten Hinsicht hingegen durchaus. Auffällig und charakteristisch für Buridan ist hierbei aber doch, dass er das Problem wiederum zuerst im Hinblick auf die sprachlichen Gegebenheiten formuliert: Die perseitas kennzeichnet ein bestimmtes Verhältnis in den propositiones causales (das Prädikat causa wird von einem Subjekt ausgesagt). Daraus ergibt sich nun für Buridan eine spezifische Begründungsform: non sunt infinita subiecta de quibus per se verificatur hoc praedicatum causa domus, causa aeris vel hoc praedicatum causa aquae.28 Wenn das Prädikat „Ursache dieses Hauses“ von unendlich vielen Subjekten ausgesagt würde, läge eben gar keine Auskunft über den Urheber vor. Wenn hier unendlich viele kausale Prädikationen möglich wären, dann wäre eben die Möglichkeit des vollkommenen Wissens aufgehoben. Dies wäre in einem Kontext, in dem die Dinge eben durch eine unabzählbare Menge von Prädikaten bestimmt sind und die Begrenzung nur aus den pragmatischen Erfordernissen erwächst, natürlich kein beeindruckender Einwand. Aber wenn vorausgesetzt ist, dass es Arten von Dingen gibt, dann schon. Das „vollständige“, d.h. alles Wesentliche umfassende Wissen ist hier also in seiner Faktizität vorausgesetzt. Unbestimmte kausale Verhältnisse sind demgegenüber zufällig; was auf diese Weise zustande kommt, ist etwas, wofür nicht „der“ Zufall aufkommt, sondern jeweils irgendein Zufall, nämlich jedes Mal ein anderer Zufall. Was hierbei aber im Hinblick auf Duns Scotus auffällt: Buridan scheint anders als Scotus die causa per se mit den causae essentialiter ordinatae zu identifizieren. Da er dies ohne jede Kritik an der Unplausibilität oder Überflüssigkeit dieser Unterscheidung tut, wird man wohl annehmen müssen, dass er diese Lehre gar nicht kennt. Er spricht auch von subordinatus, was der Sache nach angemessen ist, bei Duns Scotus aber wohl nicht verwendet wird. Zudem macht er keine Unterscheidung im Hinblick darauf, ob eine Ursache für eine andere Ursache von deren Existenz oder von deren Wirksamkeit ist. Wenn die perseitas nicht vom Subjekt-Prädikat-Verhältnis ausgesagt wird, sondern das reale Abhängigkeitsverhältnis zweier Entitäten betrifft, dann ist damit gemeint, dass etwas mit Notwendigkeit für sein Entstehen und Dasein einer Ursache bedarf. Dies kann aber nach Buridan keine unendliche Anzahl von Ursachen sein. Wenn es nun keine erste gäbe, würde damit zugleich der Begriff der mittleren Ursachen aufgehoben. Denn diese wirken definitionsgemäß in virtute prioris. Er beruft sich hier sehr konventionell wieder auf das Argument des Aristoteles, das er auch bei Averroes findet. III Das Verhältnis der Vernunft zur höchsten Wirklichkeit Für die Konzeption der Metaphysik ist es von Bedeutung zu bestimmen, in welcher Weise sie sich zum letzten Grund der Wirklichkeit verhält. Es geht also 28
Met. II q. 5 (12ra).
Duns Scotus und Johannes Buridan
65
nicht nur darum, ob Gott ist, ob seine Existenz beweisbar ist und wie sie beweisbar ist, sondern darum, welche Disziplin einen solchen Beweis führt. Aristoteles hatte ein solches Argument sowohl in der Physik wie in der Metaphysik platziert. Avicenna hat diesen Gedanken für einen der Metaphysik gehalten, was Averroes bekanntlich kritisiert hat.29 Denn Gott als unbewegter Beweger und also nicht zur Natur gehörige Instanz sei der eigentliche Gegenstand der Metaphysik, diese aber könne nicht die Existenz ihres eigenen Gegenstandes beweisen; dies tue nämlich prinzipiell keine wissenschaftliche Disziplin. Duns Scotus erörtert dies an verschiedenen Stellen; in der Ordinatio nimmt sich seine Stellungnahme besonders klar aus. Gott ist zwar das unendliche Seiende, aber eben doch ein Seiendes. Daher gilt von der philosophischen Thematisierung Gottes dasselbe, was auch von allen sonstigen Thematisierungen von bestimmten Seienden gilt: Sie ist eine spezielle. Und von jeder speziellen Thematisierung gilt wiederum, dass sie allgemeine Bestimmungen des Seienden voraussetzt, die ihrerseits philosophisch geklärt werden müssen. Diese Klärung kann nur die Metaphysik erbringen. Daher ist Gott nicht deren erstes Objekt. Das heißt umgekehrt keineswegs, dass der Gottesgedanke aus der Metaphysik ausgeschlossen würde. Vielmehr wird er in der Metaphysik auf die angemessenste und vollkommenste Weise thematisiert: est tamen consideratum in illa scientia nobilissimo modo quo potest considerari in aliqua scientia naturaliter acquisita.30 Averroes mache gegen Aristoteles (!) die Physik gegenüber der Metaphysik zur höheren Disziplin. Das Erfordernis einer Ursache, ihre pure Existenznotwendigkeit, kann durchgängig bei allen Bestimmungen einer Wirkung gezeigt werden. Wenn also der Begründungsanspruch aus der Metaphysik herausdividiert würde, könnte sie solche ontologischen Bestimmungen gar nicht verständlich machen. Zuletzt aber ist es unzulänglich, weil schlichtweg zu limitiert, wenn der Gottesgedanke einzig über die Bewegung gewonnen wird. Man würde darauf verzichten, Gott eine schlechthin allgemeine Ursächlichkeit zuzuschreiben, wenn er nur als Beweger gedacht würde.31 Auch Buridan kommt auf die berühmte Kontroverse zwischen Avicenna und Averroes zu sprechen. Wohl nicht in Orientierung an Duns Scotus, aber eben doch wie dieser votiert Buridan ebenfalls für Avicenna: Credo quod in praedictis Commentator inepte reprehendit Avicennam et quod Avicenna melius locutus est in isto proposito.32 Buridan bestreitet keineswegs, dass Gott der erste Beweger ist. Er bestreitet aber, dass damit der angemessenste Begriff Gottes gefasst ist. Mit 29 30 31
32
Cf. Zimmermann, Ontologie oder Metaphysik, 409-412. Ord. prol. p. 3 q. 1-3 n. 193, ed. Vat. I, 130, 10-11. Ord. prol. p. 3 q. 1-3 n. 194, ed. Vat. I, 131: perfectior enim cognition er immediatior de primo ente est cognoscere ipsum ut primum ens, vel ut necesse esse, quam cognoscere ipsum ut primum movens; Ord. II d. 1 q. 3 n. 115, ed. Vat. VII, 57: efficiens in plus est quam movens; dazu allerdings n. 153 (p. 77); Met. I q. 1 n. 83, OPh III, 43: quattuor causae, in quantum quaelibet in suo genere dat esse – circumscribendo rationem motus et mutationis –, pertinet ad metaphysicum: Materia et forma inquantum sunt partes essentiae. Efficiens in quantum dat esse, circumscribendo motum – licet enim non ageret nisi movendo, tamen ratio dantis esse prior est ratione moventis. Phys. VIII q. 1 (109rb)
66
Rolf Schönberger
dem Begriff der Bewegung ist – das Argument kehrt ja seit Thomas von Aquin immer wieder – keine universelle Form der Hervorbringung gedacht. Bewegen – auch in dem ganz allgemeinen aristotelischen Sinn des In-Gang-Setzens einer Veränderung – ist immer noch eine bestimmte Weise des Verursachens, aber nicht diejenige, deren Allgemeinheit nicht mehr übertroffen werden kann. Aristoteles hatte durchaus Gott keine verändernde Wirkung mit Bezug auf die Intelligenzen zugeschrieben. Das heißt aber für die mittelalterliche Autoren nicht, dass nicht auch diese Intelligenzen in ihrem Sein von Gott abhängig sind. So kann man und muss man sogar den ersten Beweger mit Gott identifizieren, aber die Einsicht in diese Identität ist keine naturphilosophische, sondern eine metaphysische Einsicht.33 IV Das Verhältnis der Vernunft zum ersten Begriff Innerhalb der Metaphysik war Duns Scotus wohl für keine Lehrmeinung so berühmt wie für die von der univocatio entis. Auch Buridan hat diese These vertreten. Während aber Duns Scotus die Möglichkeit vermittelter Erkenntnis einzig durch die Eindeutigkeit der vermittelnden Begriffe sieht und die Reduktionsbewegung bei der Struktur der Begriffe zu einem ersten, nicht mehr weiter analysierbaren und also einfachen und daher eindeutigen Begriff kommt, rekurriert Buridan auf den ontologischen Status der Dinge – sogar auf denjenigen, den man nicht vorweisen, sondern den man nur wie andere Inhalte des Glaubens in Rechnung zu stellen hat.34 Die Texte sprechen mitunter eine Sprache, als gäbe es mit Bezug auf den ontologischen Status von Akzidentien eine doppelte Wahrheit. Der einzige Denker, der in seiner Konzeption des Verhältnisses von Substanz und Akzidens die Fragen der Eucharistie berücksichtigt hat, scheint Buridan zu sein. Für Aristoteles sind akzidentelle Bestimmungen zwar nicht-notwendige Bestimmungen, ihr Auftreten ist aber mit Notwendigkeit an eine Substanz gebunden. Dies kann Buridan nicht mehr so behaupten. Jene Lehre von der Eucharistie besagt, dass hier die Verwandlung der Brotsubstanz nicht gebunden ist an eine entsprechende Verwandlung der Akzidentien. Das ist insofern bemerkenswert, weil in der überaus umfangreichen Debatte um die analogia entis oder univocatio entis, die ja weitgehend von Autoren der theologischen Fakultät beherrscht war, jener Gesichtpunkt so gut wie keine Rolle gespielt hat. Buridan, obwohl Magister der Artes, nimmt diesen auf; seiner Auffassung nach kann die Behauptung einer möglichen Selbständigkeit von Akzidentien, da sie ja wahr ist, nicht folgenlos bleiben für den Status und die begriffliche Struktur des ens. Zwar ist für Buridan unstrittig, dass erstens Aristoteles und mit ihm auch Porphyrios die qualifizierte Mehrdeutigkeit des ens lehrt, und zweitens subsistente Akzidentien unmöglich sind. Aber bereits innerhalb dieser Klarstellungen formuliert Buridan eine Aristoteles-Interpretation, an die er dann anknüpft. 33 34
Cf. Schönberger, „Philosophical Theology“. Cf. de Rijk, „On Buridan‘s View“; Schönberger, Relation als Vergleich, 329 sqq.
Duns Scotus und Johannes Buridan
67
Man muss nun aber fragen, inwieweit eine derartige Berücksichtigung der Eucharistiedogmatik die Rede von Substanz und Akzidens noch als eine sinnvolle gelten lassen kann. Dies ergibt sich aus der zusätzlichen Bedingung, dass ein regulärer und nicht ein mirakulöser Fall gegeben ist. Die Subsistenz wird also zur „natürlichen“ Eigenschaft der Substanz und die Inhaerenz zur „natürlichen“ Eigenschaft des Akzidens. Dies scheint ein ingeniöser Vorschlag zu sein. Denn „Natur“ ist gut aristotelisch als dasjenige definiert, was „meistens“ (ut in pluribus) ist. Mit einem natürlicherweise inhärenten Akzidens werden andere Fälle zum einen nicht ausgeschlossen, zum anderen sind diese schon per definitionem keine natürlichen; ihr Vorkommen ist miraculose. Allerdings kann man dem entgegenhalten, dass dies nur ein Pseudo-Aristotelismus sei. Denn das, was meistens der Fall ist, dass bestimmte Dinge bestimmte Eigenschaften haben, dass bestimmte Ereignisse bestimmte Ursachen und bestimmte Folgen haben, wodurch Aristoteles die Häufigkeit, das „Meistens“, erst verständlich werden lässt, dieses Phänomen des Spezifischseins fasst Aristoteles im Begriff der Natur. V Das Verhältnis der Vernunft zu anderen Formen von Verbindlichkeit 1. Duns Scotus In den einführenden Darstellungen der Philosophie des Duns Scotus spielt der Begriff des Glaubens weithin keine nennenswerte Rolle. Die scotische Reflexion des Glaubens zu berücksichtigen scheint aber unumgänglich zu sein, wenn man die Grenzen der Rationalität in seinem Sinne adäquat zu bestimmen sucht. Schon Étienne Gilson35 hat auf den bemerkenswerten Auftakt der scotischen Ordinatio hingewiesen: Utrum homini pro statu isto sit necessarium aliquam doctrinam supernaturaliter inspirari.36 Von Interesse ist hierbei schon die Fragestellung selbst: Zum einen wird für die Notwendigkeit einer übernatürlichen Lehre offenkundig im Blick auf die Philosophie diskutiert: Wenn eine Belehrung des Menschen durch Gott in einen Rahmen gestellt werden soll, dann ist es derjenige Rahmen, der hierfür eine Notwendigkeit zeigt. Um diese Notwendigkeit geht der Disput, wie Duns Scotus selbst sagt, zwischen den Philosophen und den Theologen. Und um diese Notwendigkeit nun zu zeigen, muss Duns Scotus aber bereits einen bestimmten Begriff von Philosophie voraussetzen. Hierdurch bekommen die historischen Formen der Philosophie eine besondere Bedeutung. Denn an ihnen gilt es ja abzulesen, was Philosophie ist und was sie vermag. Drittens aber kommt Duns Scotus auch selbst dazu, anders als Augustinus oder etwa Thomas von Aquin, die Grenzen der Philosophie nun doch als eine prinzipielle Frage nach den Grenzen der natürlichen Vernunft zu stellen statt als Frage nach den faktischen Möglichkeiten rationaler Bemühungen angesichts Beschränkungen in der Begabung, der sozialen Freisetzung etc.37 Allein mit dem Ausdruck pro statu isto ist ein Gesichtspunkt 35 36 37
Gilson, „Les maîtresses positions“. Ord. prol. p. 1 q. un., ed. Vat. I, 1-58. Thomas von Aquin, Summa contra gentiles I, 4.
68
Rolf Schönberger
ins Spiel gebracht, welcher der antiken Philosophie völlig fremd war und der der neuzeitlichen Philosophie nur deswegen nicht fremd geblieben ist, weil das mittelalterliche Denken ihr diesen vermittelt hat. Das heißt nämlich nichts weniger als dass die Selbstdeutung des Menschen unvermeidlicher Weise Wesensnatur und faktischen Zustand verwechselt. Von diesem Zustand könnte sie nur wissen, wenn sie auch von anderen Zuständen wüsste; dazu kann aber die natürliche Vernunft keinen Zugang gewinnen.38 Schon Augustinus39 und Thomas von Aquin40 haben geltend gemacht, was jetzt auch Duns Scotus geltend macht: Dass nämlich zwar der Inhalt des Glaubens singulär ist, nicht aber die Form. Wir nehmen vieles an, was wir doch nicht überprüft haben. Dies zu tun ist ein Konstitutivum des menschlichen Zusammenlebens und daher nichts, was sich überwinden ließe oder überwunden werden sollte.41 Es handelt sich also um eine Gewissheit, die darin besteht, dass es keinen Anlass zum Zweifel gibt. In gewissem Sinne hat sie sogar zirkuläre Züge: Der Grund dafür, jemandem etwas zu glauben, liegt darin, dass man glaubt, dass er wahrhaftig ist. Abgesehen davon ist jedoch der Inhalt des Geglaubten durchdringbar, es gibt in ihm Folgerungsverhältnisse etc. Manches ist sogar der rationalen Begründung zugänglich. Die Unzulänglichkeit der Philosophie wird also nicht ausschließlich an deren internen Maßstäben gemessen. Es handelt sich nicht um veritable Widerlegungen, sondern unweigerlich um viel weniger: non sunt nisi persuasiones theologicae.42 Dies deshalb, weil diese Kritik der Philosophie auf Prämissen rekurriert, welche die Philosophie gar nicht anerkennen kann, weil sie ihr fremd sind. Die Philosophie erbringt erstens keinen Begriff von Gott als solchem, sie rekurriert auf allgemeine Bestimmungen und schränkt sie durch Kombination ein. Neben diesem Defizit erzeugt sie aber notorisch einen gravierenden Irrtum: Sie schreibt – qua Philosophie, nicht als individuelle Fehlleistung! – dem notwendig Seienden eine ebenso notwendige Wirksamkeit zu,43 so dass 38
39 40 41
42 43
Der neuzeitliche Kontraktualismus spricht zwar unter Verwendung des Begriffes “status” von einem Naturzustand, doch ist dieser ein geltungstheoretischer Konstrukt und kein historischer Zustand, der durch ein datierbares Ereignis beendet worden wäre. Augustinus, De fide rerum quae non videntur, 2, 4 (PL 40), 173sq. Thomas von Aquin, Super Credo [In Symbolum Apostolorum expositio], prol., ed. R.M. Spiazzi, Opuscula theologica, Turin/Rom 1954, nr. 866. Ord. prol. p. 2 q. un. n. 107, ed. Vat. I, 68sq.: [...] aut nulli credes de contingenti quod non vidisti, et ita non credes mundum esse factum ante te, nec locum esse in mundo ubi non fueris, nec istum esse patrem tuum et illam matrem; et ista credulitas destruit omnem vitam politicam. Si igitur vis alicui credere de contingenti quod tibi non est nec fuit evidens, maxime credendum est communitati, sive illis quae tota communitas approbat, et maxime quae communitas famosa et honesta cum maxima diligentis praecepit approbanda; cf. Lect. III d. 23 q. un. n. 15, ed. Vat. XXI, 102: […] et adhaeret omnibus quibus nos credimus, sicut etiam ego fide acquisita ex auditu aliorum (scilicet parentium, quorum veritati credo) credo multa tempora transivisse et mundum non incipisse mecum, et credo Romam esse quam numquam vidi, ex relatu fide dignorum. Ord., prol. p. 1 q. un. n. 12, ed. Vat I, 9, 10. Ord. prol. p. 1 q. un. n. 18, ed. Vat. I, 13; n. 41 (ebd.), 25; d. 8 p. 2 q. un. n. 230, ed Vat. IV,
Duns Scotus und Johannes Buridan
69
sie entweder alle Kontingenz leugnet oder diese auf eine ganz unzulängliche Weise begründet. Wenn nämlich alle Ursachenketten auf Gott zurückgehen, dann kann sich aus deren Interferenz keine Kontingenz ergeben. Bei anderen Theorien ist Avicenna für Scotus übrigens deswegen kein Gegenbeispiel, weil er in seinen Augen die Religion in seine Philosophie, wie Duns Scotus mit den Worten des Averroes sagt, „gemischt“ hat.44 2. Johannes Buridan Es ist schon mehrfach vermerkt worden, dass Buridan entgegen der Regel aus dem 13. Jahrhundert, die lautete: non est consenescendum in artibus, zeitlebens Magister der Künste geblieben ist. Duns Scotus hat gezeigt, dass die Theologie zwar nicht die historisch überlieferte Philosophie in einer bestimmten Gestalt, aber eben doch eine Metaphysik braucht. Sie bietet den Horizont, innerhalb dessen die Offenbarung identifizierbar wird. Umgekehrt wird kein mittelalterlicher Philosoph, auch nicht eine Philosophie eines mittelalterlichen Theologen sagen, dass die Philosophie die Theologie nötig hat. Die Behauptung war ja vielmehr, dass der Mensch ein Wissen jenseits der Philosophie nötig habe. Wie soll sich aber die Philosophie selbst dazu stellen? Die wirkmächtigste Konzeption war wohl die Separation beider. Doch Separierung lässt sich mit unterschiedlichen Intentionen vornehmen: Dies kann eine unpolemische wissenschaftstheoretische Konzeption sein, es kann aber auch aus einer Auffassung hervorgehen, welche die Theologie als solche für nichtig hält. Buridan gehört sicherlich nicht dieser zweiten Strömung an; er stellt ähnlich wie Ockham45 die verschiedenen Instanzen der Verbürgung einfach nebeneinander: Wahrnehmung und Erfahrung, vernünftiges Nachdenken oder die Autorität der Hl. Schrift.46 Die Frage ist allerdings, wie sich diese zueinander verhalten. Mitunter verweist Buridan zwar auf die Theologie, in den allermeisten Fällen aber “nur” auf den Glauben des Christentums – oder in seiner Sprache: auf die Bekundung des eigenen Glaubens (ego credo). Dieser wird unbedingt als wahr anerkannt, aber seine Wahrheit lässt sich philosophisch nicht begründen – sie wäre dadurch keine Wahrheit des Glaubens mehr. Wenn sie aber gleichwohl
44
45
46
282; n. 250sqq. (ebd.), 294sq.; d. 30 q. 1-2 n. 54, ed Vat. VI, 193; n. 57 (ebd.), 195: secundum philosophos; Met. I q. 1 n. 40, OPh III, 30. Ord. prol. p. 1 q. un. n. 33, ed. Vat. I, 19: Miscuit enim secatm suam – quae fuit secta Machometi – philosophicis, et quaedam dixit ut philosophica et ratione probata, alia ut consona sectae suae. Allerdings nimmt Scotus Avicenna auch als Zeugen dafür, dass die Glücksvorstellung im Islam unzureichend ist und nicht von ungefähr durch eine philosophische Konzeption der Vollendung überboten wird: Ord. prol. p. 2 q. un. n. 109, ed. Vat. I, 72. Tractatus de quantitate, q. 3, OTh X, 70: [...] nihil enim quod dicunt est recipiendum nisi quod possunt probare per rationem evidentem, vel per auctoritatem Sacrae Scripturae, vel per determinationem Ecclesiae, vel per Doctores approbatos ab Ecclesia. Qu. De caelo I q. 17, ed. Patar, 318: Non debemus ponere quae non apparent nobis per sensum vel experientiam aut per rationem naturalem aut per auctoritatem Sacrae Scripturae.
70
Rolf Schönberger
anerkannt wird, dann kann aus dieser Anerkennung ja nichts für das faktische Wissen von der Welt folgen. In diesem Fall würde ja umgekehrt die fides nostra die rationale Bemühung um die Erkenntnis der Wirklichkeit überflüssig machen. Wenn es also nicht im Inhaltlichen um die reale Wirklichkeit der Natur gehen kann, dann bleibt nur, wenn es hier irgendetwas zu berücksichtigen gilt, der formale Aspekt übrig, demgemäß es sich um den Status der Natur handeln muss. Und dies scheint auch in der Tat der auffälligste Zug in der Naturphilosophie Buridans zu sein. Dies trennt ihn aber auch grundsätzlich von der aristotelischen Naturbetrachtung, deren Artikulation ja unablässig der Gegenstand der Buridanischen Kommentare sind. Der Begriff der hatte, wie oben bereits festgehalten, die Aufgabe, das Phänomen des Typischen und Spezifischen in den Erscheinungen, in deren Entstehungsphasen und in deren Wirkungen festzuhalten. Das Zufällige kann man nur zur Kenntnis nehmen. Was aber natürlicher Weise geschieht, kann man aus dem Begriff der Sache her verständlich machen. Wenn etwas nicht zu seinem vorgezeichneten Ziel kommt, dann nur deswegen, weil etwas „dazwischenkommt“. Dies kann man vorher nicht wissen. Im Gegensatz dazu hat diejenige Wirkung, die einer Überlegung entspringt, notwendig eine Alternative; dies deswegen, weil das Denken Gegensätze zu fassen vermag, wohingegen reale Dinge keine gegensätzlichen Eigenschaften aufweisen können. Nun ist offenkundig mit dem Schöpfungsbegriff eine Modifikation des Naturbegriffes gegeben, denn jetzt gibt es zu dieser Natur selbst eine Alternative, sogar unendliche viele Alternativen: Es könnte sie auch nicht geben und es könnte eine andere Welt geben. Duns Scotus hat es bekanntlich als ein wesentliches Manko der Philosophie angesehen, dass sie schon in dieser Welt, wie sie faktisch ist, Kontingenz nicht in einem radikalen Sinne47 zu begründen vermag. Dies kann man nach Scotus nur, wenn man den Ursprung der Welt als einen willentlichen ansieht, denn zum Willen gehöre konstitutiv die Erfahrung des Anders-Wollen-Könnens.48 Dass Gott im höchsten Maße frei handelt, dies ist auch nach Buridan eine unersetzliche Orientierung, wenn auch selbstredend eine, die sich philosophisch nicht einholen lässt. Um nochmals an die Alternative der möglichen Antworten auf die Frage, was denn daraus für das menschliche Verstehen der Welt genau folgt, zu erinnern: Da es nicht um Einzeltatsachen zu tun sein kann, bleibt nur, den Status der Natur und des Natürlichen selbst darauf zu beziehen. Und genau dies tut Buridan. Immer wieder stellt er in seinen Kommentaren zu den Werken der aristotelischen Naturphilosophie die Frage, ob sich ungeachtet der Anerkennung der realen Verhältnisse auch andere Möglichkeiten denken ließen: Könnte ein Körper auch unendlich groß sein? Könnte die Welt als Gesamtheit der entstehenden und vergehenden Dinge auch selbst entstehen und vergehen? Wären bei den 47 48
Ord. I d. 2 n. 86, ed. Vat. II, 178: [...] cuius oppositum posset fieri quando illud fit; übernommen in Tract. IV concl. 9 nr. 56, ed. Kluxen, 71). Met. IX q. 15 n. 30, OPh IV, 682 sq.: A posteriori probatur: Experitur enim qui vult se posse non velle, sive nolle.
Duns Scotus und Johannes Buridan
71
Himmelskörpern statt kreisförmiger Bewegungen auch lineare Bewegungen möglich? Dies darf man nicht für irgendwelche beliebige Spekulationen halten und darin einen völlig haltlosen Wildwuchs der philosophischen Phantasie sehen. Sie haben nämlich einen präzisen Sinn und eine ganz einheitliche, immer wiederkehrende Antwort. Buridan kommt durchgängig, soweit ich sehe, zu demselben Resultat: Man kann einsehen, dass die Dinge so sein müssen wie sie sind. Eine andere Möglichkeit ist natürlicher Weise nicht möglich. Wenn man aber das Vermögen Gottes in Rechnung stellt, dann wäre in übernatürlicher Hinsicht doch eine andere Natur möglich. Der Glaube macht hier also nicht etwas sichtbar – wie im Falle der Kontingenz –, sondern bestimmt nur abstrakt den faktischen Status der natürlichen Gegebenheiten.49 Von Belang dabei ist freilich, dass der Begriff der göttlichen Allmacht nicht die Rationalität sprengt, wie dies bei manch anderen Überlegungen der sog. Nominalisten der Fall war. Der Begriff der omnipotentia ist nämlich nicht weniger als die potentia einem Kriterium unterworfen, und nur dadurch bleibt bei der Rede von einer solchen Macht bzw. einem solchen Vermögen die Bedingung der Rationalität in Geltung. Wenn mit Allmacht gemeint wäre, dass Beliebiges möglich ist, dann wäre das Mögliche vom Unmöglichen nicht mehr zu unterscheiden. Das Kriterium für diese über die Natur, aber nicht über die Vernunft hinausgehende Möglichkeit ist das der Widerspruchsfreiheit.
C. Epilogus Hier steht Buridan aber nicht allein. Auch hier kann man wohl nicht von einer Rezeption des Duns Scotus sprechen. Vielleicht aber von einem Zusammenhang noch grundsätzlicher Art als derjenige der literarischen Filiation: Es gibt in der Philosophie Gedanken, die nicht bloß „Einfluss“ gewinnen, Berücksichtigung finden, auf Interesse stoßen u. dgl. m. Es gibt wie in wenigen anderen menschlichen Betätigungen auch Gedanken, die, wie man sagt, „Epoche machen“, die wie eine Kontinentalverschiebung für alle weitere theoretische Bemühung neue Voraussetzungen schaffen. Dies zeigt sich bei Duns Scotus und Johannes Buridan insbesondere an den Modalitätsbegriffen, Kontingenz und Notwendigkeit, die beide ja in einem besonderen Verhältnis zur Rationalität stehen. Die göttliche Allmacht enthält all das, was überhaupt möglich ist und sein kann. Und gerade Duns Scotus hat das Sein überhaupt durch die Freiheit von Widerspruch definiert: ens, hoc est, cui non repugnat esse.50 Die Möglichkeit löst sich vom Spielraum in der Natur im Sinne des Aristoteles, und ganz entgegen seinem Sinne wird die Natur zu einem Reich vollständiger kausaler Bestimmtheit. So nimmt bei Duns Scotus wie bei Buridan das Natürliche ganz den Charakter 49 50
Cf. Schönberger, „Eigenrecht und Relativität“. Ord. IV d. 8 q. 1; n. 23, ed. Vat. XI, 5, 104-105, d. 1 p. 1 q. 1 n. 812, ed. Vat. XI, 63, 4951: [...] sive ‚non-ens accipiatur proprie pro impossibili, quod includit contradictionemrt‘, sive pro pura negatione vel privatione, quia ‚non-ens‘ non habet ‚quid est‘; Quodl. q. 3 n. 2, ed. Vivès XXV, 113a: ens ergo vel res isto primo modo accipitur omnino communissime et extendit se ad quodcumque, quod non includit contradictionem.
72
Rolf Schönberger
des Notwendigen an, die Welt als ganze aber den der Kontingenz – eine nicht wenig bemerkenswerte Konvergenz bei zwei Autoren, die sich nicht kennen.51
51
G. Krieger hat demgegenüber auf terminologische Konvergenzen hingewiesen: Subjekt und Metaphysik,. 32 sq. Eine direkte Lektüre scotischer Texte durch Buridan scheint mir im Vergleich den zu Beginn bei Buridan namentlich genannten Autoren gleichwohl ganz unwahrscheinlich; doch dies schließt eine vermittelte Übernahme (Geraldus Odo?) ja nicht aus. Es schließt umgekehrt aber auch nicht ein, dass alle Konvergenzen allenfalls zufälliger Natur sein könnten.
Duns Scotus und Johannes Buridan
73
Bibliographie Primärliteratur Johannes Buridanus, „The Summulae, Tractatus I, De introductionibus.“ In The Logic of John Buridan, ed. Jan Pinborg. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1976. Dekker, Dirk Jan, „John Buridan´s Treatise De dependentiis, diversitatibus et convenientiis. An Edition.“ Vivarium 42 (2004): 109-149 Johannes Buridanus, Quaestiones Elencorum, edited with an introduction, notes and indices by Ria van der Lecq and H. A. G. Braakhuis. Artistarium Supplementa Vol. 9. Nijmegen: Ingenium Publishers 1994. Johannes Buridanus, „Tractatus de differentia universalis ad individuum, p. 2 q. 1 c. 1”, ed. S. Szyller. Przeglad tomistyczny 3 (1987): 135-178. Ioannes Duns Scotus, Lect. Ioannes Duns Scotus, Met., OPh. Ioannes Duns Scotus, Ord., ed. Vat; ed. Viv. Ioannes Duns Scotus, Quodl., ed. Viv. Ioannes Duns Scotus, Tract. Ockham, William, Met. Ockham, William, Sum. log., OPh I. Thomas von Aquin, Super Credo [In Symbolum Apostolorum exposition], prol., ed. R. M. Spiazzi, Opuscula theologica, Turin, Rom, 1954.
Sekundärliteratur Honnefelder, Ludger, Duns Scotus. München: Beck, 2005. Maier, Anneliese, „Das Problem der Evidenz in der Philosophie des 14. Jahrhunderts.“ In: Ausgehendes Mittelalter. Gesammelte Aufsätze zur Geistesgeschichte des 14. Jahrhunderts, II, 367418. Rom 1967. Maier, Anneliese, „Bewegung ohne Ursache.“ In Zwischen Philosophie und Mechanik, 329-339 Studien zur Naturphilosophie der Spätscholastik V. Rom, 1958. Maier, Anneliese, „Finalkausalität und Naturgesetz.“ In Metaphysische Hintergründe der spätscholastischen Naturphilosophie, 279-335. Studien zur Naturphilosophie der Spätscholastik IV. Rom 1955. Pozzo, Riccardo, „Regressus/progressus.” In: HWPh VIII, 1992, col. 484-487. Schönberger, Rolf, Relation als Vergleich. Die Relationstheorie des Johannes Buridan im Kontext seines Denkens und der Scholastik. Leiden: E. J. Brill, 1994. Schönberger, Rolf, „Causa causalitatis. Zur Funktion der aristotelischen Ursachenlehre in der Scholastik.“ In Miscellanea Mediaevalia XXII (Scientia und ars im Hoch- und Spätmittelalter), ed. Ingrid Craemer-Ruegenberg and Andreas Speer, 421-439. Berlin, New York: de Gruyter, 1994. Schönberger, Rolf, „Philosophical Theology in John Buridan.” In The Metaphysics and Natural Philosophy of John Buridan, ed. J. M. M. H. Thijssen and J. Zupko, 265-281. Medieval and Early Modern Science 2. Leiden: E. J. Brill, 2001. Scott, Theodore K., „John Buridan on the Objects of Demonstrative Science.” Speculum 40 (1965): 654-673. Thijssen, Johannes M. M. H., „John Buridan and Nicholas of Autrecourt on Causality and Induction.” Traditio 43 (1987): 237-255.
74
Rolf Schönberger
Walsh, James J., „Some Relationships between Gerald Odo‘s and John Buridan‘s Commentaries on Aristotle‘s ‚Ethics‘.” In: Franc. Stud. 35 (1975): 237-275. Wendland, Volker, „Die Wissenschaftslehre Gregors von Rimini in der Diskussion.“ In: Gregor von Rimini. Werk und Wirkung bis zur Reformation, ed. H. A. Oberman, 241-300. Berlin, New York 1981. Zimmermann, Albert, Ontologie oder Metaphysik? Die Diskussion über den Gegenstand der Metaphysik im 13. und 14. Jahrhundert, Texte und Untersuchungen. Leiden, Köln: E. J. Brill, 1965. Leuven: 21998.
75 Archa Verbi. Subsidia 6
75–91
Peter of Candia and His Use of John Duns Scotus Stephen F. Brown In his Commentary on the Sentences, delivered at Paris from 1378-1380, the Franciscan Peter of Candia cites with preference many authors belonging to his own religious order.1 The principal Franciscan author for him is John Duns Scotus, though Peter Aureoli and William of Ockham also play major parts. For Peter of Candia, as we will see, Scotus (and his followers) belong to the antiqui doctores or magistri; Peter of Candia and Ockham are the moderni. If Scotus is to some degree his favorite Franciscan, still the Subtle Doctor is not beyond criticism. Nor are Scotus’s followers necessarily spared critique, especially when they seem to be claiming falsely to represent his position. The following selected discussions will give a sample of Candia’s relation to the Scotistic tradition. The Nature of Theology (Prologue) In the prologue to his Commentary on the Sentences, Peter of Candia focuses on the general discussions concerning the nature of theology presented over the preceding century.2 He begins with what he considers the far extremes: views that claim that theology is science in the proper Aristotelian sense of the term ‘science’, where such study is viewed as providing certainty and the evidence justifying that certainty, and the contradictory position that theology only provides a logically organized order to the truths of faith found in Sacred Scripture, not supplying evidence for their truth. Theology, according to this second opinion, is science according to its methodology and structure, not however according to its content. The first option, in Aureoli’s judgment, promises too much and the second opinion offers too little. Peter then moves on to portraits of theology that seem more balanced: the positions of the Franciscan Peter Aureoli and the Augustinian Hermit Gregory of Rimini. Aureoli presents a position that is very broad in its description: he admits that while studying theology one could pursue knowledge of divine things that offers certitude and evidence – it is called metaphysics. He also admits that while studying theology one could also learn a great deal of logic and put it into practice by bringing logical order to Christian beliefs and drawing further 1
2
For an introduction to the life and an outline of his Commentary on the Sentences, cf. Brown, “Peter of Candia’s Commentary on the Sentences”, 439-469. This article also presents a bibliography of studies on Peter of Candia, his life and his works. We have earlier presented an edition of this prologue to the Candia’s Commentary on the Sentences, along with a commentary, in Brown, “Peter of Candia’s Hundred-Year ‘History’”, 156-190.
76
Stephen F. Brown
legitimate conclusions concerning Christian faith from its basic truths or articles of faith. To this extent both extreme positions concerning the nature of theology formulated before his era have a certain legitimacy. However, Peter Aureoli argues that what theologians should accomplish primarily or principally is to follow the urging of St. Augustine, in Book XIV of his De Trinitate,3 to pursue “the kind of knowledge by which our most wholesome faith, which leads to eternal life, is begotten, nourished, defended and strengthened.” Aureoli’s interpretation of Augustine’s advice is to focus principally on the main truths or articles of the faith and to pursue the kind of knowledge that will bring to them not a justification for assenting to these truths but rather the kind of knowledge that will bring understanding or clarity concerning them. The Augustinian Hermit Gregory of Rimini advised Aureoli to go back to the De Trinitate and any other works of Augustine and to find where he proved or used natural knowledge to show that God is three in one. I think, he argues,4 that he could not find any, but he will only find what Augustine proved from the authorities of Scripture. Let him go back and reread what he has read inattentively. Rimini’s own close and attentive reading of Augustine led him to different conclusions regarding the nature of theology and the role of the theologian. Gregory to some degree agrees with Aureoli: both, following Godfrey of Fontaines and John Duns Scotus, argue that theology is not science in the sense that it brings certitude and evidence for the articles of the Christian faith. However, Gregory sees theology as the kind of knowledge that stays in the realm of faith, in the sense that theologians, examining the Scriptures, find truths that are not formally contained as such in Sacred Scripture, but which follow necessarily from what is contained there. It makes explicit what is found there implicitly. A theologian sees that such truths necessarily flow from what is formally revealed in the Scriptures, whether or not they are articles of faith, whether or not they have supporting or confirming arguments gained from other sciences, and whether or not they are determined as revealed truths by the Church or not. Theology, for Gregory, extends the content of the faith; it is a certain acquired faith. It extends faith to its further necessary logical implications.5 Even though Aureoli and Rimini hold to more balanced positions than the extremists, Peter of Candia still does not find them to be balanced enough. He speaks of Aureoli’s approach as declarative theology and of Rimini’s orienta3
4
5
S. Augustinus, De Trinitate, XIV, 1 (PL 42), 1037: “Non utique quidquid sciri ab homine potest in rebus humanis, ubi plurimum supervacuae vanitatis et noxiae curiositatis est, huic scientiae tribuo, sed illud tantummodo quo fides saluberrima, quae ad veram beatitudinem ducit, gignitur, nutritur, defenditur et roboratur.” Gregorius Ariminensis, Lectura super Primum et Secundum Sententiarum, I, q. l, a. 2, ed. Trapp et Marcolino, 19, lin. 11-15: “Sed rogo illum reverendum magistrum: Ubi in praedictis libris praedictas veritates probavit Augustinus ex propositionibus probabilibus aut in aliis qualibuscumque ex mundanis sumptis doctrinis? Puto quod invenire non poterit, sed hoc solum inveniet quod ex auctoritatibus probavit scripturae.” Cf. Grassi, “La questione della teologia”, 610, n. 1.
Peter of Candia and His Use of John Duns Scotus
77
tion as deductive theology, and declares that each tends to be one-sided in his approach. He has taken a sample of many other approaches but passes over any discussion of them, since he is not pleased with the presentation of any of them in many of their ways of presenting their positions. Rather, he clings by preference to those he judges to run a middle path: “I come to the position that seems to me to be more in agreement with the truth, an approach that can be gathered from the words of the Subtle Doctor, in distinction 24 of Book III of the Sentences, and of the Venerable Inceptor, Ockham, both of whom among all who treat this matter take a middle path”6.
Providing his summary of the teachings on the nature of theology according to Scotus and Ockham, Peter of Candia tells us that when a theologian studies in a theology faculty he acquires a habit that is distinct from faith. In other words, in using their intellectual talents when theologians consider propositions contained in the Scriptures and other propositions that are acquired naturally, they do not acquire faith. They already believe, just the same as the ‘simple’ believer. Such an acquired theological habit, distinguishing the theologian from the layman, is a declarative habit, bringing understanding to what is believed because of faith. Such study does not provide the ground for assent. The habit developed in the theology faculty helps the theologian to nourish, strengthen and defend the faith; it does not make him believe. If a student did not develop a habit distinct from faith, then all his hard work in the theology faculty would be a waste of time and effort, since the theologian after all his work does not believe more strongly than the simple believer does. A theologian, examining himself, realizes that he does not believe more firmly that God is three and one after his studies than he did before. Theology, therefore, strengthens the faith not by increasing the believer’s faith but by increasing understanding or at least by decreasing the confusion that may exist in the believer’s mind because of misrepresentations and challenging objections to the faith. Theology according to Candia’s representation of its nature according to Scotus and Ockham so far seems to favor the declarative theology approach of Aureoli and to hold in disfavor the deductive theology of Rimini. Candia does not commit himself, however, to a mission of historical accuracy and judgment. He is mainly interested in presenting his view on the nature of theological study. His representation of Rimini’s position, as that of other scholastic authors, is judiciously expressed: “if I may take his position as a universal statement” (si intelligat conclusionem suam universaliter). All of his first four conclusions, representing himself, Scotus and Ockham, defend declarative theology.7 His fifth, 6
7
Petrus de Candia, In I Sententiarum, prol., cod. Vat. lat. 1081, f. 10va: “[…] Venio ad illud quod mihi videtur magis consonum veritati et prout potest colligi ex dictis Doctoris Subtilis, III Sententiarum, distinctione 24, et Venerabilis Inceptoris Ockham, quaestione septima prologi, inter omnes mediando […].” Ibid., ff; 10va-11va: “[…] Pro cuius declaratione septem pono conclusiones. Prima conclusio: intellectus viatoris per exercitium theologicum adquirit habitum ultra fidem. […]
78
Stephen F. Brown
sixth and seventh conclusions, walking again in the footsteps of Scotus and Ockham, swing the other way. Once more, Candia is judicious in his historical representation: he well remembers that Aureoli says that theology is primarily and principally declarative. He so stresses declarative theology, nonetheless, that he could lead others into thinking that theological study should only be declarative. Candia therefore leans toward Scotus and Ockham who appear to provide a fuller blend of both the declarative and deductive forms of theological study. His fifth conclusion indicates that theology is a faith-increasing habit, at least in the sense that when we pass from a proposition that we did not consider to admit as an explicit truth of the Christian faith to one that we now believe to be implicitly taught in the Scriptures, then we have gained belief that we did not explicitly have before. This, quite likely, is one of the meanings captured in the expression “acquired faith.” At least, this is the way that Rimini and Scotus and Ockham and Candia might give to this expression. Candia’s sixth conclusion, again based on the works of Scotus and Ockham, is that theology is represented adequately only when we admit both a declarative and a deductive theology. The seventh conclusion admitted by Peter of Candia extends the general declaration enunciated by Peter Aureoli that in the theology faculty we may learn many kinds of knowledge. The way this observation is restated by Candia is that besides the habits named above, namely declarative and deductive theology, one can learn to acquire by exercises in the theology faculty where we consider theological truths many non-theological habits that pertain to sciences distinct from the science of theology. The prologue does not reveal Candia’s detailed knowledge of Scotus, but as we step beyond the prologue, we can begin to discover in what way he considers Scotus and Ockham as providing a middle path for theological study, although in quite different ways. 1.The Object of the Human Will The first article of the second question of Book I of the Sentences opens with a discussion of the issue with which Peter Lombard began Book I, his reflection on St. Augustine’s words concerning enjoyment at the beginning of his De doc-
Secunda conclusio: habitus huiusmodi taliter adquisitus sub evidenti notitia minime continetur. […] Tertia conclusio: habitus huiusmodi taliter adquisitus non exsistit habitus adhaesivus. […] Quarta conclusio: habitus huiusmodi taliter adquisitus est theologicus proprie, qui potest declarativus merito nuncupari. […] Quinta conclusio: praeter habitum superius nominatum per theologicum exercitium adquiritur creditivus habitus qui theologicus potest similiter nominari. […] Sexta conclusio: habitus theologicus per creditivum et declarativum habitus dividitur adaequate. […] Septima et ultima conclusio est haec: praeter habitus superius nominatos per exercitium theologicum adquisitos possunt de veritatibus theologiae adquiri plures habitus non theologici ad diversas scientias pertinentes.”
Peter of Candia and His Use of John Duns Scotus
79
trina Christiana8. Peter of Candia poses the question related to this subject in the following way: whether a nature that alone is universally and completely perfect is the object that totally satisfies man’s desire for enjoyment?9 Peter summarizes his position in four conclusions. 1) It is not demonstrable for us by human reason that in the present life the divine essence above all else is the object of enjoyment. 2) It is not demonstrable for us by human reason that in the present life nothing besides God is for us the object of enjoyment. 3) It is not impossible in an evident way that the desire of a created will be satisfied totally in the present life by an object marked by certain limitations. 4) Although it may not be demonstrated in an evident way, still it is arguable in a probable way that only God is to be enjoyed and that generally speaking no created substance can completely satisfy our human appetite.10 Duns Scotus enters this scene explicitly in regard to the second conclusion. The Subtle Doctor here opposes Avicenna, to whom he seems to attribute the position that something below God can bring enjoyment. Avicenna suggests such a conclusion through his interpretation of the words of Proclus that “each thing can attain its fulfillment by returning to its source.” Since Avicenna admits a hierarchy of sources or efficient causes, members of this hierarchy may seem to attain their perfect and complete circle of return when they go back to the immediate, and not necessarily the ultimate, source from which they emanate. In his Ordinatio, Scotus presents three arguments by which he attempts to demonstrate to Avicenna that it is only when the will or enjoying power goes back to its highest source that its appetite attains rest. First of all, since Avicenna argues in his Metaphysics that being in general is the object of the human intellect, he should realize that only that being which is the most perfect being can satisfy this universal hunger. Secondly, and here we have in reality an argument confirming the preceding one, a faculty that is essentially inclined to many objects may be fulfilled perfectly by one object only if it is an object that virtually contains all those other objects. The third and strongest argument, according to Candia, moves to a consideration of Avicenna’s hierarchy of intelligences. Scotus’s rebuttal contends that when an inferior intelligence seeks a 8 9 10
For a more complete presentation of this section on the object of the human will, see Kitanov, “Peter of Candia”, 427-489. Ibid., 452: “Utrum sola natura universaliter et completive perfecta sit obiectum fruitionis.” Ibid., 466-489: “Istis igitur praelibatis descendendo ad decisionem articuli sub forma propria pono quatuor conclusiones, quarum prima sit ista: Non est nobis pro statu viae naturaliter demonstrabile quod nobis divina essentia sit fruendum […]. Secunda conclusio: Non est nobis pro statu viae naturaliter demonstrabile quod a nobis non sit fruendum aliquo citra primum […]. Tertia conclusio, et est articuli decisiva, quod non est evidenter impossibile affectum creatae volitivae in via quietari totaliter in aliquo certis limitibus circumscripto […]. Quarta conclusio et finalis est ista: licet non sit evidenter demonstrabile, tamen probabiliter est deducibile solo Deo fore fruendum, et generaliter, nullam creatam substantiam posse nostram volitativam plenarie satiare.”
80
Stephen F. Brown
superior one, then it sees it as something finite, or it believes it to be something infinite, or it does not see whether this superior intelligence is finite or infinite. If he believes it to be infinite, and it is not, then he does not attain beatitude in union with it, since nothing is more foolish than to hold that an intelligence becomes happy due to a false opinion. If, on the other hand, this intelligence does not see whether it is finite or infinite, then it does not see it perfectly and thus, seeing it imperfectly, such an intellect is not happy. If it sees this object as finite, then it can understand that there is something greater than this finite goal and thus it cannot be happy with what is less.11 Peter of Candia tells us that his present purpose is not to defend Avicenna, so he has little concern for whether or not Scotus represents the Arab philosopher correctly. Neither does Peter want to show that something below God can bring a creature fulfillment. The important point for Peter is that Scotus deals with Avicenna’s position and deals with it philosophically. The fuller context in the Ordinatio treatment of this question shows the character of Scotus’s approach. After responding to Avicenna, the Subtle Doctor reports two other efforts to respond to the same opinion. The first can be found in Bonaventure’s Commentary on the Sentences, where, following St. Augustine, he argues that “insofar as the soul is the image of God, it is capable of being joined with Him and can participate in His being.” A second effort may be found in question 8 of St. Thomas’s Quodlibet X, where Aquinas declares that “the soul is created immediately by God, and therefore it immediately rests and attains peace in Him.”12 The Subtle Doctor stresses that, in both cases, the arguments are based on premises derived from faith. He presents his own arguments as philosophical efforts to refute Avicenna in his own arena countering the arguments this philosopher presents in his Metaphysics and that Avicenna justifies by reliance on one of Proclus’s principles13. That Scotus argues on natural grounds is something appreciated by Peter of Candia, since natural arguments are the only arguments effective in refuting a philosopher. His greater respect in his prologue to the Sentences for Scotus over Aureoli for their ways of doing theology is due to the fact that Scotus more often attempted to deal with philosophical issues philosophically, whereas Aureoli placed his accent on arguments confirming or strengthening faith. Still, even though he applauds Scotus for showing that Avicenna’s position is not a demonstration, he stresses that Scotus’s arguments themselves are also not demonstrations: “Because the reasons that this Doctor presents seem to demonstrate on natural grounds, as he himself says, therefore, I will bring them forth and respond to them so that the truth of the previous conclusion, may be more clearly evident [...]. To these reasons I answer and say that although they are probable enough, espe11 12 13
Ibid., 477-481. Ioannes Duns Scotus, Ord. I d. 1 p. l q. 1 nn. 13-14, ed. Vat. II, 8-9. Ibid., nn. 14-15, ed. Vat. II, 9-10.
Peter of Candia and His Use of John Duns Scotus
81
cially the third one, they are not demonstrative […]. And thus it is clear that in regard to this issue demonstrations have no place at all”.14
Candia simply notes that Scotus’s arguments are not demonstrations. He does not claim that Scotus contends that they are demonstrations, but that for him they seem to be demonstrations. Peter admits that Scotus’s reasons themselves, especially the third one, are probable enough, but argues that they are not demonstrative. His fourth conclusion cited above, clarifies this position. 2. Beatific Enjoyment and Freedom Peter of Candia first introduces the question of freedom in created beings in his Commentary on Book I of the Sentences, q. 2, a. 3, part 3, when he asks: Whether the created will is determined with respect to the act of beatific enjoyment? Here he dialogues with the positions of those whom in this precise context he considers as defenders of three forms of determinism: the determinisms of Thomas Aquinas, Peter Aureoli and John of Ripa. Aquinas, in his response to I-II, q. 10, a. 2 of the Summa theologiae says that: “[...] the will is moved in two ways: in one way in regard to the exercise of its act; in a second way in regard to the specification of its act, which derives from its object. In the first way the will is moved by no object out of necessity, for someone can just not think about any object whatsoever, and consequently it can also not will that object actually. However, in regard to the second kind of motion, the will is moved by some object out of necessity and by other objects not out of necessity [...]. Wherefore, if some object is presented to the will and that object is universally and under every consideration good, the will by necessity tends to it if it chooses anything, since it is not able to choose the opposite”.15
This passage understood in its broader context is interpreted by Peter of Candia as leading to four implications. First, that the will naturally and necessarily seeks its well-being and this well-being is found in what is universally good. Secondly, that in regard to an object to which the nature of the highest good belongs, known nonetheless obliquely, the will does not necessarily have an act 14
15
Kitanov, “Peter of Candia”, 477: “Et quia rationes quas doctor iste facit, videntur naturaliter, ut ipse dicit, demonstare, idcirco illas adducam et solvam ut clarius pateat veritas praemissae conclusionis […].” 479: “Ad istas rationes respondeo et dico quod quamvis sint rationes satis probabiles – maxime tertia – non tamen sunt demonstrativae […].” 481: “Sic igitur apparet quod in hac materia demonstrationes minime habunt locum.” S. Thomas, Summa theologiae, I-II, q. 10, a. 2: “Dicendum quod voluntas movetur dupliciter: uno modo quantum ad exercitium actus; alio modo quantum ad specificationem actus; quae est ex obiecto. Primo ergo modo voluntas a nullo obiecto ex necessitate movetur; potest enim aliquis de quocumque obiecto non cogitare, et per consequens neque actu velle illud. Sed quantum ad secundum motionis modum, voluntas ab aliquo obiecto ex necessitate movetur, ab aliquo autem non […]. Unde, si proponatur aliquod obiectum voluntati quod sit universaliter bonum et secundum omnem considerationem, ex necessitate voluntas in illud tendit si aliquid velit; non enim poterit velle oppositum.”
82
Stephen F. Brown
of love. Thirdly, if the will without charity had a clear vision of God, it would still not necessarily have enjoyment, because without the supernatural gift of charity it could not love God above all things. The fourth point would be that, having the clear vision of God, a will elevated by charity necessarily has an act of love toward Him.16 Almost a half-century later, the Franciscan Peter Aureoli, within the context of beatific enjoyment as presented in his Scriptum super Primum Sententiarum, d. 1, q. 3, sustains the principle that every power in the world is most perfectly quieted by that which most perfectly participates in the character of its object. Now, since the will’s object is the good and it grasps it only through the intellect, then the will is moved toward the good to the degree that the intellect manifests it. In the case where the intellect would show in the clearest way possible the object that has the total perfection of goodness, then this will of necessity would be moved immutably toward this object. Nonetheless, wherever there is less than such an intuitive knowledge of the perfect good, the will could not be necessitated. According to Peter of Candia, this position of Peter Aureoli effectively ends up coinciding with that of Aquinas.17 In the late 1350s, the Franciscan John of Ripa’s form of determinism, portrayed in his Scriptum in I Sententiarum, d. l, a. 3, claims that a created will is free as long as it can hold itself indifferently in regard to limited forms of goodness. When, however, the good is presented to the will as something that is totally good or totally evil, it cannot stand by indifferently. If the object is totally good, the will must choose it; if it is totally evil, it must choose to resist it. Applying this general principle to the case of seeing God in heaven, since God there shows Himself most clearly to the intellect, it is in this way that the will grasps Him. Now, since in heaven the intellect will always represent Him in this way,
16
17
Petrus de Candia, In I Sententiarum, q. 2, a. 3 (cod. Vat. lat. 1081), f. 38r: “Et secundum hoc quasi colliguntur quattuor documenta. Primum: quod voluntas naturaliter et necessario appetit bene esse, et hoc est bonum in universali, quia nullus potest per se appetere miseriam. Secundum est quod respectu obiecti cui competit ratio summi boni aenigmatice cogniti non necessario voluntas habet actum dilectionis. Tertium est quod si voluntas esset sine caritate, stante clara Dei visione, adhuc non necessario haberet voluntas fruitionem, quia sine dono supernaturali non posset Deum super omnia diligere. Quartum vero documentum est quod, stante clara Dei visione, voluntas per caritatem elevata necessario habet actum dilectionis circa Deum.” Petrus de Candia, In I Sententiarum, q. 2, a. 3 (cod. Vat. lat. 1081), f. 38rb: “Imaginatio Domini Petri Aureoli est haec prout potest colligi ex dictis suis in Scripto ordinario, distinctione prima, quaestione 3, quod quaelibet potentia mundi est perfectissime quietabilis in illo quod participat perfectissime rationem sui obiecti. Quia igitur bonum est obiectum voluntatis, et istud non apprehendit talis potentia nisi mediante intellectu, idcirco secundum variam ostensionem intellectus varie voluntas movetur ad tale obiectum. Ubi autem intellectus clarissime ostenderet voluntati tale obiectum in quo per se consistit tota perfectio bonitatis, de necessitate talis voluntas in tali obiecto immutabiliter figeretur. Sed citra eius intuitivam notitiam numquam voluntas potest necessitari. Et sic apparet quod iste modus coincidit cum primo.”
Peter of Candia and His Use of John Duns Scotus
83
the will in relation to God who is so clearly seen will always have the love that is enjoyment.18 According to Peter of Candia’s presentation of them, all three of these authors are united because they agree in their one final conclusion: the created will is such that it can be necessitated by the vision of God.19 Peter of Candia himself believes that it is not necessary that even the vision of God presented to the created will move it necessarily to an act of desiring it; rather the will may hold a neutral position.20 Perhaps because he presents his own conclusions in relation to Peter Aureoli and John of Ripa, who are authors after the time of John Duns Scotus, he does not invoke the name of Scotus in stating and proving the conclusions he himself sustains. However, his third conclusion, stating positively his own position, namely, that in respect to beatitude known fully, no movement coming from the created will necessitates it to choose such beatitude, his arguments are taken from Scotus.21 For Candia, following Scotus, the will is an active potency that is not determined by its object. Will is thus distinguished from nature, which is a potency that as far as itself is concerned cannot fail to act when not impeded from without. Will, for Scotus and Candia, is on its part undetermined: it can act or not act. Candia takes up the question of freedom again in the third article dealing with beatific enjoyment. The preceding discussion involved his reflections on the positions of Aquinas, Aureoli and John of Ripa and the focus was on the will on its part (subiective). In the third article his stress is different as he asks: whether the created will in regard to its freely chosen enjoyment is able to be necessitated objectively (obiective), that is, on the part of the object of beatific enjoyment or the divine substance?22 Here Candia addresses the interpretation 18
19 20
21
22
Petrus de Candia, In I Sententiarum, q. 2, a. 3 (cod. Vat. lat. 1081), f. 38rb: “Imaginatio vero Magistri Ioannis de Ripa consistit in hoc, ut apparet Primo Scripto super Sententias, distinctione 1, quaestione 3, articulo 3, quod voluntas circa quodlibet bonum sibi propositum sub aliqua ratione sive tristabili sive delectabili habet statim actuale velle vel nolle. Et idcirco si aliquid ostenditur voluntati per intellectum, aut ostenditur sibi sub ratione boni praecise, aut sub ratione mali praecise, aut mixti. Si primo modo ostendatur, respectu illius numquam potest habere nolle sed semper habet velle. Si secundo modo, videlicet sub praecisa ratione mali, numquam respectu illius potest habere velle, sed semper nolle, et hoc durante ostensione. Si vero ostenderetur tertio modo, tunc indifferenter potest habere nolle vel velle prout sibi placet. Applicando igitur ad propositum, quia Deus in patria ostendet se clarissime intellectui, et sic voluntas percipiet. Et quia sic semper intellectus repraesentabit, ideo de necessitate semper voluntas respectu Dei clare visi habebit fruitivam dilectionem.” Petrus de Candia, In I Sententiarum, q. 2, a. 3 (cod. Vat. lat. 1081), f. 38rb: “Ex quibus apparet quod isti tres tam solemnes doctores conveniunt in conclusione finali.” Petrus de Candia, In I Sententiarum, q. 2, a. 3 (cod. Vat. lat. 1081), f. 38rb: “Imaginor ergo quod non oportet quod obiectum voluntati ostensum ipsam necessario moveat ad actu volendi vel nolendi, sed stat ipsam neutram permanere […].” Petrus de Candia, In I Sententiarum, q. 2, a. 3 (cod. Vat. lat. 1081), f. 37ra: “Tertia conclusio est haec: respectu beatitudinis universaliter cognitae nulla creatae voluntatis affectio ipsam necessitat subiective.” Petrus de Candia, In I Sententiarum, q. 2, a. 3 (cod. Vat. lat. 1081), f. 36rb: “Consequenter
84
Stephen F. Brown
of Scotus that has been given by a loyal follower of the Subtle Doctor, Landulphus Caracciola. Candia praises him for his reading of Scotus but also argues that Landulphus deviates from the position that his master holds in Question 16 of his Quodlibet and in his response to distinction 10 of Book I of his Sentences,23 He quotes the arguments of Landulphus, found in the third question of first distinction of the latter’s Commentary on Book I of the Sentences and attempts to refute them.24 In this article Candia is pushing to establish the deeper roots of Scotus’s view of freedom. He goes after Peter Aureoli once again, but his main focus is on Landulphus, who, in d. 1, q. 3 of his Scriptum in I Sententiarum, defends an interpretation of Scotus that has this master holding the position that a will cannot remain free when the object that completely fulfills it is present. Among the five arguments in favor of his interpretation of Scotus, Landulphus goes back to the end of the Subtle Doctor’s Quaestiones in libros Metaphysicae, where the distinction is made between a free and a natural potency.25 In his presentation, Landulphus argues that when a potency is so determined in regard to one of two opposites that it cannot go to the other opposite, it is not a rational and free potency but rather a natural one. But when the will, whether uncreated or created, has its fulfilling object before it, it is necessarily happy. For instance, God, contemplating himself, is necessarily happy, and thus beholds and loves the beatific object. A man, encountering the beatific vision of God, is necessarily happy. What has happened to freedom? Scotus, and Can-
23
24 25
tertio videndum est si creata voluntas respectu fruitionis elicitae sit necessitabilis obiective.” Petrus de Candia, In I Sententiarum, q. 2, a. 3 (cod. Vat. lat. 1081), f. 33ra: “Ergo nec valet dicere, sicut dicit Landulphus in Scripto suo I, distinctione prima, quaestione tertia, videlicet, quod necessitas istius determinationis non provenit ratione libertatis formaliter, sed ratione naturae, et ideo ab extrinseco provenit voluntati divinae quod non possit esse indifferens, videlicet, quia est talis natura.” F. 33va: “Et certe mirum videtur de isto doctore, cuius doctrina sententialiter et ex toto sub verbis clarioribus est doctrina Doctoris Subtilis, quomodo a suo magistro deviavit, nam ipse oppositum tenet et nititur declarare, Quodlibet, quaestione 16, et similiter Scripto I super Sententias, distinctione 10, in responsione quaestionis.” Cf. Ioannes Duns Scotus, Quodl., q. 16, ed. F. Alluntis, Cuestiones cuodlibetales; Introduccion, resumenes y version, Biblioteca de autores cristianos 277; Madrid 1968, 581-609; Ioannes Duns Scotus, Ord. I d. 10 nn. 30-32, ed. Vat. IV, 352. Cf. etiam Ioannes Duns Scotus, Met. IX, q. 15, OPh. IV, 675-699. Petrus de Candia, In I Sententiarum, q. 2, a. 3 (cod. Vat. lat. 1081), f. 35v. Petrus de Candia, In I Sententiarum, q. 2, a. 3 (cod. Vat. lat. 1081), f. 35vb: Praeterea, Philosophus, IX Metaphysicae, dicit quod potentiae rationales ideo distinguuntur a naturalibus, quia valent ad opposita. Tunc sic: potentia determinata sic circa unum oppositorum quod non potest in reliquum non est potentia rationalis et libera, sed potius naturalis; sed voluntas, per adversarium, ita determinatur ad unum oppositorum quod nullo modo ad alterum; ergo non est potentia rationalis sed magis naturalis; quod videtur valde absurdum.” Peter of Candia’s response (f. 36ra): “Ad quartum, de auctoritate Philosophi, IX Metaphysicae, dico quod Aristoteles libertatem contradictionis numquam posuit nisi in potentiis organicis, et ideo illa distinguit ab aliis, nec umquam in Deo vel intelligentiis.”
Peter of Candia and His Use of John Duns Scotus
85
dia, seem to be arguing that you can have it both ways. Candia, claiming to give to Scotus a correct interpretation, would say that the Subtle Doctor holds that in God the perfection of his love for his own nature is not only free but necessary. It is free, in the sense that it is a will-act, and will as opposed to nature never tends to anything except in the spontaneous, self-determining, and liberated way that is peculiar to it as will. But it is also in some sense necessary. “Necessary” has many meanings, but here in question 16 of his Quodlibet Scotus uses it in the sense of “a steadfast will” or a “firmness of purpose”. In his case, Scotus is attempting to explain how “freedom of the will and natural necessity can be present in the same lover in regard to the same act of loving.” Freedom and necessity are not determined by the objects in the sense that necessary objects cause necessary assent and contingent objects alone allow for freedom. Perhaps another way of presenting this is that our love for God is not totally determined by God as its object. We can choose to love God because He is our fulfillment. We can also love God for Himself. It is the distinction stressed by St. Anselm (affectio commodi and affectio iustitiae), the first is the affection for what is for our advantage, essentially the drive of nature. The affection for justice on the other hand inclines us to do justice to the objective goodness, the intrinsic value of the object, whether or not it happens to be a good for oneself or not.26 3.The Eucharist and Questions concerning Accidents Two questions dominated discussions of the Eucharist in XIVth century treatments of this sacrament. The first question concerned the separability of accidents from substances; the second question focused on the relationship between quantity and quality. In many treatments of this era, these questions were located in Book IV of the Sentences. It is a different case with Peter of Candia: he deals with both these issues in the second article of the opening question of Book II.27 For Peter they form one of the challenges to God’s omnipotence: “Can the divine omnipotence free an accident from its dependence on a subject?”28 This question leads Peter to present and evaluate three opinions concerning the nature of accidents. The first opinion has its roots in the ancient Greek world and is attached to Parmenides and Melissus, for whom accidents have no reality.29 The second opinion, which Peter attaches to Scotus 26 27
28
29
For a more recent portrait of Scotus’s position regarding created and uncreated freedom, see Wolter, “Duns Scotus on the Will and Morality”. The general outline and Latin texts for this section is dependent on Bakker, La Raison et le Miracle, 422-430, although I have changed his Latin text at places since I have preferred to depend on Peter of Candia’s text as found in cod. Vat. lat. 1081. Petrus de Candia, In II Sententiarum, q. l, a. 2 (f. 167va): “Secundus articulus erit iste: utrum immensa divinitatis omnipotentia possit quodlibet accidens absolvere qualibet dependentia subiective.” Petrus de Candia, In II Sententiarum, q. l, a. 2 (f. 167va): “Pro cuius articuli declaratione primo investigabitur conditio et quidditas totius ambitus accidentis […]. Quantum ad
86
Stephen F. Brown
and the other antiqui, defends the reality of Aristotle’s ten categories. These ‘realists’ distinguish absolute accidents, such as quantities and qualities from relative accidents. The latter are split into two groups: Aristotle’s category of relation, which expresses an intrinsic connection and the other six categories (actio, passio, quando, ubi, situs and habitus), which express extrinsic connections.30 The third opinion concerning the categories is the position of the moderni, among whom he lists Peter Aureoli and William of Ockham. For these authors, only substances and certain qualities are realities. The other eight categories are modes of signifying substances and real qualities. They do not signify distinct things (res) from substances and the species of qualities that are realities.31 In defense of the opinion of Scotus and the ancients Peter presents five conclusions: 1) A successive accident, such as time or movement, can exist in reality, but, to avoid a contradiction, it requires the presence of some permanent existing reality. 2) A continuous quantity is separable from its subject, whereas a discrete quantity, to avoid a contradiction, is not. To justify the first part, we just have to realize that in the Eucharist quantity exists without its subject. 3) A relation is real and independent of the mind; still to be able to exist it needs the presence of an absolute thing. 4) An indivisible quality can exist without any subject whatsoever, whereas a divisible quality demands the presence of a continuous quantity as its proximate subject.32 Every quality that depends
30
31
32
primum sciendum est quod circa conceptum accidentis triplex fuit positio loquentium de accidente. Prima ponebat quod realiter in rerum natura quidquid erat, erat secundum suam realitatem, ita quod accidens realiter loquendo nihil erat. Ista autem positio videtur fuisse Parmenidis et Mellissi ponentium omnia unum esse, non utique numero sive specie specialissima, sed genere generalissimo.” Petrus de Candia, In II Sententiarum, q. l, a. 2 (f. 167vb): “Secunda opinio est huic totaliter contraria et extrema, quae ponit quod cuilibet praedicamento sub ambitu accidentis correspondet ex natura rei res aliqua positiva a re alterius praedicamenti realiter condistincta. Unde ista positio imaginatur conceptum accidentis sui divisione primaria dividi in conceptum absolutum et respectivum. Et ulterius absolutum dividi in quantitatem et qualitatem, quae, secundum eos, sunt accidentia absoluta; sed respectivi dividunt in septem praedicamenta. Unde si respectus sit intrinsecus adveniens, sic dicunt quod est relatio; si vero extrinsecus, sic sunt sex genera respectiva, ut actio, passio, quando, ubi, situs et habitus. Et istius opinionis videtur fuisse Doctor Subtilis et multi antiqui doctores.” Petrus de Candia, In II Sententiarum, q. l, a. 2 (ff. 167vb-168ra): “Tertia vero opinio ponit quod sub ambitu accidentis nihil realiter a qualitate distinctum continetur, sed quodlibet accidens est vera qualitas. Et ex hoc dividunt conceptum entis in substantiam et qualitatem. Et sic apud eos praedicamenta non essent nisi conceptus varii duorum rerum genera diversimode exprimentia intellectui talium rerum multimodas passiones manifestando. Et istius opinionis fuit dominus Petrus Aureoli et frater Guillelmus Ockham et plurimi modernorum doctorum. Et haec videtur modernis probabilior opinio respectivi.” For a current-day presentation of Ockham’s dealings with the categories, see Brown, “A Modern Prologue.” Petrus de Candia, In II Sententiarum, q. l, a. 2 (ff. 168vb-170rb): “Sit igitur ista prima conclusio: licet sit possibile in rerum natura aliquod accidens existere successivum, tamen
Peter of Candia and His Use of John Duns Scotus
87
on its subject only according to its definition and not according to its nature can be conserved by God without its subject. A quality such as knowledge depends upon its subject, i.e. the intellect, for its production. Conservation basically comes down to a consideration of efficient causality. Since God can provide for the conservation of something without employing secondary causes, He can conserve a quality like knowledge without conserving the soul or secondary efficient cause that produced it. The case is different, however, with a divisible quality, since it inheres in a necessary way in a continuous quantity as its immeditate or proximate subject. Here, we see that an accident can be the subject of another accident. In the case of the Eucharist, the qualities of bread subsist without their remote subject – the substance of bread, but they continue to subsist in their proximate subject – continuous quantity. 5) Every absolute accident, by God’s omnipotence, can subsist without inhering in a substance. When we speak of the dependence of an absolute accident on its subject we are dealing with the issue of efficient causality, and God can supply such causality without dependence on secondary causes.33 In the context of God’s omnipotence, these five conclusions flowing from Scotus’ view of the ten categories allow us to summarize the formal response to the question: Can the divine omnipotence free an accident from dependence on its subject? The immense divine omnipotence cannot free every accident from every subjective dependence. This is not due to any defect on the part of the omnipotence of God, but is because of varying natural conditions of accidents. The understanding of the ancient doctors to the degree that I am able to grasp it consists of the following. An accident grasped by the mind is either absolute or relative. If it is an absolute accident, then it is either permanent or successive. If it is successive, it necessarily presupposes some fixed and permanent reality, and thus God cannot make such an successive accident to exist without a sub-
33
contradictionem implicat huiusmodi successivum existere sine praesentia existentiae permanentis […].” (It should be noted here that in regard to this first conclusion Peter of Candia proves it by going to Walter Chatton’s anti-razor. Here is Candia’s argument, f. 168vb: “Ista conclusio quantum ad primam partem sic probatur: quandocumque ad verificationem alicuius propositionis non sufficiunt duae res, oportet ponere tertiam, et si ad verificationem talis non sufficiunt tres res oportet ponere quartam, quia secundum Philosophum, ab eo quod res est vel non est, oratio dicitur vera vel falsa […]. Secunda conclusio est haec: licet quamlibet quantitatem continuam non praesupponentem aliam sit possibile absolvi a qualibet dependentia subiectiva, tamen quantitatem discretam sine subiecto existere nullatenus permittit lex contradictoriae facultatis […].” “Tertia conclusio est haec: licet relatio absque intellectus negotiatione sit entis accidentalis positiva conditio, ipsam tamen sine absoluta subsistentia est impossibile quovis modo […].” “Quarta conclusio est haec: licet quaelibet qualitas indivisibilis possit existere sine quocumque subiecto, nulla tamen qualitas partibilis extensive potest existere sine subiecto proximo et remoto.” Petrus de Candia, In II Sententiarum, q. l, a. 2 (f. 170rb): “Quinta conclusio est haec: universaliter quodlibet ens absolutum potest per Dei omnipotentiam absolvi a qualibet substantiali dependentia subiecta.”
88
Stephen F. Brown
ject, because it implies a contradiction. If it is a permanent absolute accident, then it will either be divisible or indivisible. If it is indivisible, then it depends on its subject only for conservation, and therefore God can make it exist without a subject, and so qualities of the soul and even the very points that are starting and ending points of continuous quantities can exist without a subject. If an accident is a divisible continuous accident, it is either immediately and essentially divisible or accidentally divisible. If it is the first kind, it can exist without a subject, as a quantity can. If it is divisible in the second way, then, although it can exist without a remote subject, that is, without a substantial subject, still it cannot exist without a proximate subject, namely, without quantity. If, however, an accident is relative, it is totally impossible for it to exist without a subject.34 In a parallel way, Peter summarizes the main conclusions of the Moderni, i.e. Aureoli and Ockham. He lists eight conclusions: 1) A successive accident, such as movement and time, can in no way whatsoever exist as a distinct reality. 2) No continuous or discrete quantity can exist as a reality really distinct from a substance or a really existing quality. 3) No concept of qualities which are located in the second and fourth species of qualities signifies a reality distinct from the qualities located in the first and third species of qualities. 4) No relation of a numerical kind (e.g. half or double) signifies a reality distinct from the interrelated terms. 5) No relation expressing a power (e.g. paternity or sonship) expresses a reality distinct from the interrelated terms. 6) No relation expressing a measure (e.g. taller) expresses a reality distinct from the interrelated terms. 34
Petrus de Candia, In II Sententiarum, q. l, a. 2 (f. 170rb) “Et ex his quinque conclusionibus sequitur pars articuli negativa, videlicet, quod immensa deitatis omnipotentia non potest quodlibet accidens absolvere a qualibet dependentia subiectiva. Hoc autem non provenit ex aliquo defectu ex parte Dei omnipotentiae sed propter naturalem conditionem variam accidentis, ut declaratum est. Imaginatio ergo antiquorum doctorum, quantum possum perpendere, in hoc consistit: accidens ab intellectu apprehensum aut est absolutum aut respectivum. Si absolutum, aut permanens aut successivum. Si successivum, necessario praesupponit aliquod fixum et permanens, et ideo Deus non potest facere tale accidens successivum sine subiecto, quia contradictionem implicat. Si vero sit permanens absolutum, aut est divisibile aut indivisibile. Si sit indivisibile, illud dependet a suo subiecto tantum conservative. Et ideo quodlibet tale Deus potest facere sine subiecto, et sic tam qualitates animae quam etiam ipsa puncta quantitates continuas terminantes possunt existere sine subiecto. Si vero tale accidens absolutum sit divisibile, aut est continuum aut discretum. Si discretum, non potest existere sine subiecto, quoniam praesupponit illa quae distinguunt, et ideo numerus a Deo non potest fieri sine rebus numeratis. Si vero sit continuum divisibile, aut est divisibile primo et per se aut per accidens. Si primo modo, sic potest esse sine subiecto, sicut quantitas. Si vero sit secundo modo, licet possit esse sine subiecto remoto, utpote sine substantiali subiecto, non tamen sine proximo, videlicet, sine quantitate. Si autem tale accidens sit respectivum, universaliter ipsum impossibile est existere sine subiecto.”
Peter of Candia and His Use of John Duns Scotus
89
7) Generally speaking, no positive reality can belong to the nature of a relation as it is understood to be under the ambit of an accident. This conclusion is to be understood formally, distinguishing the relation from its foundation and term. 8) It is only qualities which fall under the first and third species of quality that are realities. I mean that every accident that has real existence is in the first or third species of quality.35 According to Candia, the moderni, differing from the antiqui, give an affirmative answer to the question: Can the divine omnipotence free an accident from its dependence on a subject? “From this perspective of the moderni it follows manifestly that every existing thing is formally absolute. The affirmative part of the article thus is true, namely, that the divine omnipotence can free every accident from dependence on a subject.” This, of course, holds for the accidents in the realm of the first and third species of qualities which are in fact realities.36 4. Conclusion Franz Kardinal Ehrle, in his work that introduced Peter of Candia to modern scholars, gave selections from Peter’s texts that mentioned by name John Duns Scotus.37 He did not go into a detailed exposition of the way that Candia used Scotus. In the sample above, we have attempted to present an initial approach to some of the key Scotistic issues that Peter considered. There are many more and as texts become available we will have a broader and more thorough pic35
36
37
Petrus de Candia, In II Sententiarum, q. l, a. 2 (ff. 168ra-169vb): “Prima sit haec: nulla realitatis positiva conditio potest existere quovis modo entitas quae sit accidens successivum […].” “Secunda conclusio: nulla quantitatis continuae vel discretae conditio potest existere accidens a substantia et qualitate realiter separatum […].” “Tertia conclusio est haec: nullus conceptus de secunda vel quarta specie qualitatis significat rem distinctam a substantia vel qualitatibus in prima et tertia specie situatis […].” “Quarta conclusio est haec: nulla relatio modo numeri est a rebis relatis ad invicem realiter condistincta […].” “Quinta conclusio: nulla relatio modo potentiae dicit formaliter ultra fundamentum et terminum aliquid formale positivum […].” “Sexta conclusio: nulla relatio modo mensurae est accidentis positiva conditio a substantia et qualitate realiter condivisa […].” “Septima conclusio: rationi relationis ut intelligitur sub ambitu accidentis repugnat generaliter entis conditio positiva. Et intelligitur conclusio formaliter, praescindendo relationem a fundamento et termino […].“ “Octava conclusio et finalis est haec: realitas sumpta communiter in prima et in tertia specie qualitatis commensurat aequaliter totum ambitum accidentis. Volo dicere quod omne accidens cui potest correspondere esse existere vel est in prima vel in tertia specie qualitatis.” Petrus de Candia, In II Sententiarum, q. l, a. 2 (f. 168va): “Ex ista positione sequitur manifeste quod quaelibet res existens in rerum natura est formaliter absoluta. Et ita consequenter sequitur pars affirmativa articuli, quod deitatis omnipotentia potest quodlibet accidens absolvere a qualibet dependentia subiectiva.” Ehrle, Der Sentenzenkommentar, 56-78.
90
Stephen F. Brown
ture. From the very prologue where he discusses the nature of theology, he indicated that Scotus and Ockham are authors from whom he gains the most. In dealing with Scotus, we discover traces in his text not only of Scotus, but also signs, at times explicit, that he has in mind Scotus and his followers. He criticizes the Scotists John of Ripa and Landulphus Caracciola and he supports Scotistic positions from arguments taken from Walter Chatton. Peter of Candia admires Scotus and follows him, but he at times, as we have seen, also criticizes him. In his prologue, Peter likewise speaks highly of William of Ockham. In dealing with accidents he gives the positions of both Scotus and Ockham and evaluates the positions of each. He favors Scotus more than Ockham, but finds that many respected theologians at his time have sided with the moderni. He leaves it up to his audience to choose, but he is more impressed by the abundance he finds in Scotus than in the thrifty approach of Ockham’s razor.38
38
Ibid., f. 171vb:” Sic igitur apparet imaginatio antiquorum doctorum. Si vultis esse liberales, ista opinio vobis porrigit multitudinem copiosam; si vero avari, praecedens opinio vobis offert pauca et minus scrupulosa. Utraque opinio est multorum venerabilium magistrorum.”
Peter of Candia and His Use of John Duns Scotus
91
Bibliography Primary literature Augustinus, De Trinitate, XIV, 1 (PL 42, 1037). Gregorius Ariminensis, Lectura super Primum et Secundum Sententiarum, I, q. l, a. 2, ed. A. Damasus Trapp et Venicio Marcolino. Berlin: De Gruyter, 1981. Petrus de Candia, In I Sententiarum, prol., cod. Vat. lat. 1081. Petrus de Candia, In II Sententiarum. Ioannes Duns Scotus, Quodlibet, ed. F. Alluntis, Cuestiones cuodlibetales; Introducción, resúmenes y versión, Biblioteca de autores cristianos 277, Madrid 1968. Ioannes Duns Scotus, Ord. I, ed. Vat. Ioannes Duns Scotus, Met. IX, OPh.
Secondary literature Bakker, Paulus Johannes Jacobus Maria, La Raison et le Miracle: les doctrines eucharistiques (c. 1250-c. 1400): contribution à l’étude des rapports entre philosophie et théologie. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor. Nijmegen: Katholieke Universiteit, 1999. Brown, Stephen F., “A Modern Prologue to Ockham’s Natural Philosophy.” In Sprache und Erkenntnis in Mittelalter, ed. Wolfgang Kluxen, 107-129. Miscellanea Mediaevalia 13/1. Berlin: de Gruyter, 1981. Brown, Stephen F., “Peter of Candia’s Hundred-Year ‘History’ of the Theologian’s Role.” In Medieval Philosophy and Theology I (1991), 156-190. Brown, Stephen F., “Peter of Candia’s Commentary on the Sentences of Peter Lombard in Medieval Commentaries on the Sentences of Peter Lombard”, vol. 2, ed. Philipp Rosemann. Leiden: Brill, 2009. Ehrle, Franz Kard., Der Sentenzenkommentar Peters von Candia. Münster : Aschendorff, 1925. Grassi, Onorato, “La questione della teologia come scienza in Gregorio da Rimini.” Rivista di Filosofia Neo-scolastica LXVIII-1 (1976): 610-644. Kitanov, Severin V., “Peter of Candia: On Demonstrating that God is the Sole Object of Beatific Enjoyment.” Franciscan Studies 67 (2009): 427-489. Wolter, Allan B., “Duns Scotus on the Will and Morality.” In: The Philosophical Theology of John Duns Scotus, ed. Marilyn McCord Adams, 181-206. Ithaca: Cornell University Press, 1990.
92
93 Archa Verbi. Subsidia 6
93–101
Duns Scot chez les réformateurs (Luther, Zwingli, Calvin) Volker Leppin La Réformation commença comme réforme des études théologiques. Il s’agissait d’abord pour Martin Luther de libérer la formation des théologiens de l’influence dépassée d’Aristote. Ainsi écrivit-il le 18 mai 1517 à son frère en religion d’Erfurt : « Avec l’aide de Dieu, notre théologie et Saint Augustin font de grands progrès et dominent notre Université. Aristote descend peu à peu de son piédestal et s’approche de son éternel crépuscule. De façon étonnante les cours sur les ‘Sentences’ s’enlisent de sorte que personne ne peut espérer y rien entendre s’il ne veut lire quelque chose de cette théologie, c’est-à-dire de la Bible, de saint Augustin ou d’un autre docteur de l’Église. Adieu et priez pour moi »1.
Six mois environ avant le début symbolique de la Réformation — la protestation de Luther contre l’indulgence du 31 octobre 15172 — il formule son refus contre la structure de base de l’université médiévale, le chemin des artes vers la théologie. Il incrimine pratiquement la totalité de la théologie scolastique et l’accuse d’une évolution en laquelle il voit la ruine de toute théologie. À vrai dire, Luther n’a appris à connaître la philosophie et la théologie scolastiques que de manière très spécifique et déterminée. Il avait terminé sa formation universitaire à l’Université d’Erfurt, où sous l’influence de Gabriel Biel3 de Tübingen, se développait une véritable renaissance d’Ockham4. Après qu’Ockham dans le siècle précédent avait été largement relégué à l’arriére-plan par Buridan et les autres penseurs du XIVe siècle, il redevint soudainement une figure centrale à laquelle on se référait pour comprendre la théologie contemporaine. C’est pourquoi Luther put prétendre, plus tard, qu’il était allé à l’école d’Ockham. C’est à travers ces lunettes ockhamiennes que Luther perçut tout ce qu’il sut jamais de l’enseignement scolastique, même quand il se tourna ensuite vers d’autres auteurs scolastiques. Il a vraisemblablement peu connu Thomas 1
2
3 4
WA. B 1, 99, 8-13 (Nr. 41) : „ Theologia nostra et S. Augustinus prospere procedunt et regnant in nostra universitate Deo operante. Aristoteles descendit paulatim inclinatus ad ruinam prope futuram sempiternam. Mire fastidiuntur lectiones sententiariae, nec est, ut quis sibi auditores sperare possit, nisi theologiam hanc, id est bibliam aut S. Augustinum aliumve ecclesiasticae auctoritatis doctorem velit profiteri. Vale et ora pro me “. Pour les circonstances historiques du „ Thesenanschlag “, Eds. Ott, Treu, Faszination Thesenanschlag ; pour les sources mystiques Leppin, “[...] ’omnem vitam fidelium penitentiam esse voluit’“. Grane, Contra Gabrielem ; Oberman, Spätscholastik und Reformation. Kleineidam, Universitas Studii Erfordensis, 140.
94
Volker Leppin
d’Aquin5. Quant au reste, tout ce que nous pouvons dire est qu’il n’a pas vraiment lu Duns Scot. Dans la Dispute du 4 septembre 1517 contre la théologie scolastique par Franz Günther, on trouve effectivement quelques mentions occasionnelles de Duns Scot, mais toujours en rapport avec Gabriel Biel. Ainsi dit-il à la fin de la thèse 2, contestant que la volonté puisse s’assimiler au syllogisme : “ contra Scotum, Gabrielem ”6. Ceci est caractéristique à un double point de vue : d’une part cela montre clairement que Scot apparaît ici comme le représentant d’une doctrine du libre-arbitre — comme de nouveau dans la thèse 20. D’autre part, cela montre que Duns Scot, sur un point central de la nouvelle théorie de la justification, va directement à l’encontre d’idées qui, selon Luther ; viennent nécessairement de Paul. Duns Scot était le représentant d’un point de vue contre lequel Luther avait dirigé ses attaques dans les années précédentes, attribuant à l’homme la capacité de ramener un pécheur sur le chemin droit, alors que, selon Luther, le salut vient entièrement de la volonté et du secours divins, donc de la grâce. Dans ces années-là, la doctrine de la justification n’était pas encore entièrement formulée. En particulier il y manquait l’idée que l’homme ne peut obtenir son salut que par la foi. Mais l’accent mis sur la thèse augustinienne que seule la grâce est ce dont dépend le salut, était pourtant déjà représentée dans une autre dispute académique en 1516. C’était manifestement la doctrine d’Augustin que Luther voulait défendre dans sa dispute contre la théologie scolastique. Et si Duns Scot fut reconnu sur ce point décisif comme représentant de la doctrine officielle contre Augustin, ceci montre combien centrale était son erreur aux yeux de Luther, et quelle conscience claire celui-ci avait de devoir s’opposer à lui. Mais tout ceci est encore plus remarquable sous un autre aspect. À d’autres endroits de la Dispute la mention conjointe de Duns Scot et de Gabriel Biel montre que Luther percevait Duns Scot dans une continuité traditionnelle que nous référerions aujourd’hui à la Voie moderne (Via moderna). Luther luimême ne l’a pas strictement thématisé, et, dans le cours de la Dispute, s’en est pris à la théologie scolastique en général. Pourtant la remarque à propos de l’École d’Ockham montre bien que la querelle des écoles de la fin du Moyen âge lui était bien connue. En ce sens il rangeait donc Duns Scot dans cette catégorie à laquelle il pensait lui-même appartenir et dont il voulait vraiment se libérer. En outre on peut dire que, dans la conception que Luther se faisait du « Moyen Âge », la formation scolastique était moins décisive que la littérature de piété religieuse de la « mystique »7 (c’est en particulier de l’œuvre de Jean Tauler, à laquelle il s’est intensivement confronté en 1515, alors qu’il travaillait au commentaire de l’Épitre aux Romains, qu’il a reçu une impulsion décisive). En revanche, Duns Scot a eu une influence décisive pour Huldrych Zwingli, le réformateur de Zürich.
5 6 7
Janz, Luther on Thomas Aquinas. WA 1,224. Hamm, Leppin (Ed.), Gottes Nähe unmittelbar erfahren.
Duns Scot chez les réformateurs
95
Heiko Augustinus Oberman8 a voulu expliquer le face à face des deux réformateurs — qui s’étaient définitivement séparés en 1529 dans un entretien religieux à Marburg, par leurs différences doctrinales sur l’eucharistie — par le fait que l’un d’eux (Luther) était imprégné par la Via moderna et que l’autre (Zwingli) l’était par la Via antiqua. Ce qui vient d’être dit sur Luther a déjà montré que cette image agréablement simpliste ne suffit pas, car des influences très diverses s’exerçaient sur lui. Mais on ne peut pas non plus expliquer Zwingli de cette façon unilatérale. Le mérite revient à Daniel Bolliger d’avoir montré dans une grande étude que Zwingli ne pouvait être aussi sommairement décrit comme l’héritier de la Via antiqua, mais que l’influence décisive lui venait d’un scotisme qui s’était lui-même frayé sa propre voie dans l’université médiévale des XIVe-XVe siècles. La référence décisive pour Zwingli est ici Stéphane Brulefer. Étrangement Brulefer était grosso modo le contemporain de Gabriel Biel, de sorte qu’on peut voir l’influence directe de théologiens tardo-scolastiques sur les réformateurs, représentants d’une seule et même génération, dans laquelle il était courant de s’appuyer sur les grands penseurs des années 1300. Le français Brulefer9 était actif à partir de 1361 comme professeur à Paris ; huit ans plus tard comme directeur des études à l’ordre franciscain de Mayence. Comme on le sait d’autres théologiens appartenaient à des ordres importants — Thomas d’Aquin mais naturellement aussi Duns Scot — pareille évolution n’est donc pas complètement inhabituelle. Elle ne signifie pas, en tout cas, un quelconque déclassement académique. L’importance de Brulefer était surtout celle d’un disciple et adaptateur des idées de Duns Scot. Le fait qu’il ait exercé une activité dans un studium generale le fait justement échapper à l’alternative Via moderna / Via antiqua. De même que Duns Scot, qui pouvait être rattaché à l’une ou l’autre tendance, Brulefer lui-même n’était fixé à aucune de ces deux voies. Ce à quoi il était engagé, c’était surtout la doctrine du Doctor subtilis. Daniel Bolliger a précisément montré que c’est grâce à lui que Huldrych Zwingli a lu Duns Scot dans une perspective très particulière. On peut reconstruire cette lecture de nos jours, grâce à des annotations marginales de Zwingli aussi bien à Brulefer qu’à Duns Scot, probablement datées des environs de 1510 et un peu plus tard10. On aurait ainsi une lecture de Duns Scot préexistant à sa rencontre décisive avec Érasme de Rotterdam, en mars 1519. Zwingli — qui dans l’intervalle exerçait à Zürich une activité de prêcheur — avait donc d’emblée apprécié Duns Scot et d’autres scolastiques comme „Gänse“, à côtés des humanistes comme Reuchlin ou Érasme de Rotterdam. Et plus tard, il ne dédaigna pas la scolastique, dont l’influence fut profonde et durable tant pour Zwingli que pour d’autres. Ma thèse est qu’elle est même devenue une vérité centrale pour la pensée de Zwingli et des calvinistes. On pourrait la formuler ainsi : les calvinistes sont 8 9 10
Oberman, “ Via antiqua and Via moderna ”. Pour sa biographie v. Bolliger, Infiniti Contemplatio, 189 n. 166. Bolliger, Infiniti Contemplatio, 497-505.
96
Volker Leppin
jusqu’à un certain point des scotistes modernes. Pour préciser ceci je reviens encore au travail remarquable de Daniel Bolliger sur les lectures scotistes de Zwingli, d’où on peut tirer toutes les preuves nécessaires pour sa « réception ». Bolliger se concentre dans ses exposés sur la différence de l’infini au fini, que Zwingli avait appris à connaître dans les œuvres de Brulefer et Duns Scot, et qui, pour lui, se marque, théologiquement, par la différence infinie entre créateur et créature11. La conceptualité scotiste a donc ainsi exercé son influence et marqué de son empreinte le réformateur zürichois. Cette empreinte se montrait déjà dans les premiers des grands textes réformateurs de Zwingli, les Soixante-sept Conclusions. Elles sont à la base de la dispute, qui, en janvier 1523, ouvrit la brèche de la Réformation à Zürich. Ceci est d’autant plus remarquable que cet écrit est beaucoup plus centré sur la christologie que les textes ultérieurs de Zwingli. De fait, sa profession de foi sur la différence fondamentale entre Créateur et créature a donné à l’ensemble de sa théologie un caractère plus fortement théocentrique que christocentrique. À ce théocentrisme s’ajoute une anthropologie qui fait peu de cas des capacités de l’homme devant Dieu. Ceci est manifeste dans son grand écrit De providentia – revenant sur un sermon tenu à Marburg en 1529, où il fait tant de place à la providence divine qu’il n’en reste plus aucune pour la liberté de la volonté humaine. Combien prégnante est ici l’influence scotiste, c’est ce que montre la comparaison avec Luther, qui a aussi contesté dès le début la liberté de la volonté humaine pour le salut, mais pour lui le motif n’est pas dans la direction souveraine du monde par la providence de Dieu, mais dans la justification par le Christ. Ici Luther était pleinement héritier de la mystique et de sa focalisation sur le salut individuel de l’homme. Plus clairement encore on remarque la différence dans la question de la communion sur laquelle se brisa, en 1529, l’entente entre la réforme de Wittenberg et la réforme suisse. Ce qui avait conduit Oberman à une interprétation géniale sur la différence entre Via moderna et Via antiqua avait d’autres motifs. Pendant que, dans le discours marbourgeois, Luther se fixait sur la phrase “ ceci est mon corps ” et fondait par là la présence réelle du Christ dans la communion, Zwingli, lui, tenait pour absurde l’idée que Dieu puisse entrer dans la matière : si la différence entre créateur et créature est infinie, comme il l’avait appris des scotistes, alors le pain eucharistique ne peut pas contenir Dieu lui-même, car Dieu est toujours plus grand et au-delà de tout ce qui est matériel. Parallèlement à ces conclusions dogmatiques venant de la différence scotiste fondamentale entre créateur et créature il y a aussi une application méthodologique qui rend encore plus clair le caractère réformateur de la théologie zwinglienne. Zwingli faisait une grande différence entre l’Écriture Sainte et la parole humaine : ici aussi la différence avec Luther saute immédiatement aux yeux, dans l’utilisation critique de cette distinction quant à la pratique religieuse. Tous deux, Luther comme Zwingli, critiquèrent la prescription du jeûne. Chez Zwingli cette critique donna l’impulsion aux mesures réfor11
Bolliger, Infiniti Contemplatio, 395-423.
Duns Scot chez les réformateurs
97
matrices. Durant le Carême de 1522 il y eut dans l’imprimerie Froschauer à Zürich un repas de viande pris en commun. Le prêtre Zwingli ne mangea pas lui-même de cette viande défendue, mais il fut présent au repas. Par cet acte il démontrait qu’il l’acceptait. Un peu plus tard il parla en prêche du libre choix des aliments. Sur ce point l’essentiel était pour lui que l’obligation du jeûne vînt de l’autorité humaine et non de l’Écriture. Luther voyait autrement les choses : il ne pensait pas aux dispositions particulières de l’Écriture, mais à leur moyen qui, dans la justification du pécheur, ne pouvait consister qu’en la grâce et la foi seule. Pour lui, si la prescription du jeûne était à rejeter, c’est parce qu’elle faisait dépendre le salut de l’action humaine et non du seul don de Dieu. Tandis que Luther, dans la Réforme, est le théologien de la justification, Zwingli est le théologien de la souveraineté de Dieu, et ceci selon la conviction fondamentale, d’origine scotiste, de la différence infinie entre créateur et créature. Cette différence est le fondement le plus important de l’autorité de l’Écriture, car “ je ne veux pas ma parole mais celle de Dieu, pas la vanité humaine, mais propager l’intention de l’Esprit de Dieu ”12. Le lien étroit entre le principe de l’autorité de l’Écriture et la différence scotiste entre créateur et créature est parfaitement représenté dans le Commentaire de la vraie et fausse religion (1525). Zwingli ne s’y confronte pas à une théorie du divin fondée sur la Révélation, mais à une théorie philosophique, et met l’accent, par là, sur l’incognoscibilité de Dieu, tout à fait dans le sens de la distinction scotiste créateur / créature. C’est d’ailleurs cela qui lui sert à souligner que l’homme est assigné à la révélation divine. Donc, la différence infinie entre créateur et créature conduit directement à l’Écriture. Cette position porte à l’évidence la marque scotiste, mais il est toutefois tout aussi évident qu’elle impose à Zwingli une attitude qui rompt avec la fondation de la théologie propre au Moyen-âge. Avec de telles conceptions, ni la philosophie, ni les Pères de l’Église ou les conciles ne peuvent prétendre à l’autorité, et tous tombent sous le même verdict : ce ne sont que de simples paroles humaines. De façon analogue ceci devint le point de départ pour une vaste critique de nombreuses réglementations de l’Église. Les Soixante-sept conclusions déjà mentionnées, peuvent se lire comme un programme de réforme né de cette seule racine. Le motif de l’absence de fondement scripturaire suffit pour critiquer, en bloc, le Pape, la messe, les possessions matérielles de l’église, le monachisme, le célibat, le purgatoire et la prêtrise. Toutefois l’étroite liaison avec les Saintes Écritures a non seulement pour conséquence que Zwingli conteste dogmes humains, mais qu’il donne aux commandements de l’Ancien, comme aussi à ceux du Nouveau Testament, un poids supérieur à celui que leur donne Luther. Tandis que pour celui-ci la Loi et l’Evangile diffèrent profondément et se rapportent dialectiquement l’un à l’autre, Zwingli, lui, déclare que l’Évangile incite à l’accomplissement de la Loi. Son action est donc plus importante au regard de la Loi chez Zwingli 12
Z II 56,4-6.
98
Volker Leppin
que chez Luther. Ceci est particulièrement manifeste dans son insistance sur l’interdiction des images, en vertu de laquelle il s’oppose à toute présence des représentations imagées dans l’Église beaucoup plus radicalement que ne l’avaient fait la théologie médiévale et Luther lui-même. Dans cette insistance sur la défense des images se joue cependant une autre transformation spirituelle de la pensée scotiste liée à l’orientation réformatrice de Zwingli. De l’Humanisme avec lequel il entretenait depuis quelques années des liens étroits, il a repris la différence platonicienne entre esprit et matière, à l’aide laquelle il a reformulé la différence scotiste créateur/créature. Cette opposition (esprit-matière) joue surtout dans la théologie des images et la doctrine des sacrements, où Zwingli se réfère explicitement à Duns Scot. C’est précisément dans les textes des dernières années de Zwingli, postérieurs à 1527, qu’il revient de manière toujours plus explicite sur Duns Scot, alors que Scot n’était pas explicitement commenté dans les années où le zürichois en avait fait une lecture directe et l’avait annoté. Tout se passe comme s’il avait eu besoin de temps pour que devienne claire, pour lui-même comme pour les autres, la manière dont les pensées scotistes et réformatrices peuvent se rencontrer. Dans ce contexte il interprétait les sacrements – avec un recours typiquement humaniste au sens du terme « sacramentum » comme serment – comme une obligation extérieure ou comme engagement personnel. Ceci vaut déjà pour le baptême et c’est ce qui explique que des groupuscules anabaptistes aient pu se former, justement à Zürich. Mais c’est surtout sa doctrine de l’eucharistie marquée par la différence entre esprit et matière qui a eu un effet durable. En 1523, Zwingli assumait encore naturellement la thèse de la présence réelle du Christ dans les espèces13, même s’il critiquait – comme Luther – la doctrine de la transsubstantiation et du sacrifice. Dans le milieu des années vingt, influencé par les réflexions de l’humaniste hollandais Cornelisz Hendricxz Hoen, il en vint à la conviction que le est dans la formule rituelle (Mc 14, 22) est à comprendre comme significat. Les espèces devaient donc signifier le corps et le sang du Christ, sans qu’il y ait, ontologiquement, aucune présence du corps et du sang dans les espèces. L’importance pour Zwingli de la distinction entre esprit et matière peut se vérifier dans un lieu biblique que Zwingli utilisa notamment pour justifier cette interprétation ; il s’agit de Jn 6, 63 : “ La chair ne sert de rien ”. Ainsi était signifiée non seulement la différence entre l’esprit et la matière, mais aussi le mépris de cette dernière. Ceci ne pouvait toutefois se comprendre comme n’ayant de sens que par rapport aux espèces de la communion, et devait avoir des conséquences christologiques que Zwingli a surtout développées dans sa discussion avec Luther. Du fait de son application rigoureuse de la différence scotiste entre créateur et créature, la relation chalcédonienne entre nature divine et humaine ne pouvait être comprise que comme une figure de rhétorique, non comme une union ontologique réelle : Zwingli en arrivait quasi, par 13
Z VIII 84-89.
Duns Scot chez les réformateurs
99
suite de ce principe scotiste, à une christologie nestorienne ! Le rapport avec la communion se comprend alors : l’omniprésence convient à la seule nature divine, non à la nature humaine, et ne pouvait pas davantage lui être transmise au sens d’une communicatio idiomatum. Ainsi tombe la possibilité d’une omniprésence corporelle du Christ, à laquelle Luther avait toujours fait référence. Seul l’esprit pouvait être partout à la fois, et cela emportait pour conséquence, aux yeux de Zwingli, que la communion est un fait spirituel et et non corporel. Plus Zwingli poussait ses réflexions sur ce sujet, plus se précisait le risque qu’elle se retournent, pour ainsi dire, contre ses propres principes. Si l’on pousse en effet cette logique jusqu’à son terme, même l’écriture, comme parole extérieure de Dieu est quelque chose de matérialisé. Ainsi Zwingli en vint-il à définir une théologie, dans le texte précédemment évoqué, De Providentia, selon laquelle, finalement, la doctrine philosophique de Dieu et la révélation chrétienne proviennent d’une même source, « de la nature et de l’esprit de l’Être suprême divin »14. Mais en argumentant ainsi il devenait difficile d’expliquer pourquoi la parole biblique devait avoir la signification que lui avait attribuée Zwingli depuis sa première phase réformatrice. On en arrive de fait au résultat directement contradictoire que l’opposition de la matière et de l’esprit relativise la différence entre parole divine et parole humaine, si elle ne l’annule pas tout simplement – toutes deux ne constituant plus que deux énonciations distinctes d’un seul et même texte : le contraste infini entre créateur et créature, tel que Duns Scot et le scotisme, en particulier Brulefer, l’avaient enseigné. Du point de vue d’un critique luthérien, ceci faisait de Zwingli un « Schwärmer », parce qu’il n’était plus certain que la parole divine et le salut de l’homme viennent de l’extérieur. Autrement dit : dans cet ordre de pensée, avec le risque de ne plus pouvoir différencier l’Esprit saint de l’esprit humain, la théologie de Zwingli pouvait arriver au résultat fatal de faire une place centrale à l’humain plutôt qu’au divin. Mais ce n’est pas dans ces conséquences possiblement douteuses, que le scotisme de Zwingli fit le plus sentir ses effets : ce fut bien plutôt dans sa théorie des sacrements. La théologie réformée actuelle affirme à bon droit que la théologie de la communion de Calvin est tout autre que celle de Zwingli. Calvin ne défend pas une interprétation symboliste de l’eucharistie, mais il y va pour lui d’un authentique événement spirituel. Toutefois, comme Zwingli, il conteste que le corps et l’esprit divin soient liés aux espèces du pain et du vin. Et ce qui est intéressant est précisément ce qui sert de justification, métaphysique, à ce rapport — ou plutôt à ce non-rapport entre l’infini divin et la matière sensible. C’est, tout simplement, que « finitum non est capax infiniti ». Cette formule est si marquante qu’on parle, à juste titre, dans la théologie évangélique d’un hypercalvinisme, pour évoquer ce principe fondamental selon lequel l’esprit infini de Dieu dépasse tout ce que le fini peut en concevoir. Ce principe imprègne, aujourd’hui encore, l’inteprétation calviniste de l’eucharistie, précisément par constraste avec la doctrine catholique romaine et celle de Luther, toutes 14
Z VI/3 106,13-107,1.
100
Volker Leppin
deux présupposant que la substance même de Dieu entre dans le monde, que le corps peut la recevoir et la contenir. Ce principe, fondamental dans le calvinisme, vient sans aucun doute de Zwingli et, par ce détour, de Duns Scot et du scotisme.
Duns Scot chez les réformateurs
101
Bibliographie Littérature primaire Luther, D. Martin Luthers Werke. Weimar : Böhlau 1883-2009 (WA: Weimarer Ausgabe). Zwingli, Huldreich, Huldreich Zwinglis Sämtliche Werke, ed. E. Egli et al., Zürich: Berichthaus 1905ss. (Corpus Reformatorum 88 ss.).
Littérature secondaire Bolliger, Daniel, Infiniti Contemplatio. Grundzüge der Scotus- und Scotismusrezeption im Werk Huldrych Zwinglis. Mit ausführlicher Edition bisher unpublizierter Annotationes Zwinglis. SHCT 107. Leiden et al. : Brill 2003 Dieter, Theo, Der junge Luther und Aristoteles. Eine historisch-systematische Untersuchung zum Verhältnis von Theologie und Philosophie. Theologische Bibliothek Töpelmann 105. Berlin et al. : De Gruyter 2001. Grane, Leif, Contra Gabrielem. Luthers Auseinandersetzung mit Gabriel Biel in der Disputatio Contra Scholasticam Theologiam 1517. Acta Theologica Danica. Kopenhagen : Gyldental 1962. Hamm, Berndt and Leppin, Volker (Eds.), Gottes Nähe unmittelbar erfahren. Mystik im Mittelalter und bei Martin Luther. Spätmittelalter und Reformation. Neue Reihe 36. Tübingen : Mohr 2007. Janz, Denis R. Luther on Thomas Aquinas. The Engelic Doctor in the Thought of the Reformer. Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 140. Wiesbaden, Stuttgart : Steiner 1989. Kleineidam, Erich, Universitas Studii Erfordensis. Überblick über die Geschichte der Universität Erfurt. Teil 2: Spätscholastik, Humanismus und Reformation 1461-1521. Erfurter Theologische Studien 22. Leipzig : St. Benno-Verlag ²1992. Leppin, Volker, “’omnem vitam fidelium penitentiam esse voluit’. Zur Aufnahme mystischer Traditionen in Luthers erster Ablaßthese.” Archiv für Reformationsgeschichte 93 (2002): 7-25. Oberman, Heiko A., Spätscholastik und Reformation. Bd. 1: Der Herbst der mittelalterlichen Theologie. Zürich : Theologischer Verlag 1965. Oberman, Heiko A., “Via antiqua and Via moderna. Late Medieval Prolegomena to Early Reformation Thought.” In The Impact of the Reformation, ed. Heiko A. Oberman, 3-21.Grand Rapids : Eerdmans 1994. Ott, Joachim and Treu, Marin (Ed.), Faszination Thesenanschlag – Faktum oder Fiktion. Schriften der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt 9. Leipzig : Evangelische Verlags anstalt 2008.
102
103 Archa Verbi. Subsidia 6
103–118
L’univocité de l’étant et l’origine de la distinction entre realitas subiectiva et realitas obiectiva1 Francesco Marrone
Que la distinction entre realitas subiectiva et realitas obiectiva constitue l’un des principaux lieux scolastiques pénétrés dans la pensée moderne est sans doute une évidence, suite aux enquêtes sur l’histoire de la métaphysique et de la noétique menées ces dernières années. Il suffit de considérer l’usage qu’en fait Descartes dans la troisième de ses Meditationes (sous la forme de « « realitas obiectiva ») pour se rendre compte de la manière dont la modernité a trouvé dans cette distinction un dispositif conceptuel extraordinairement efficace2. Cependant, si la reconnaissance de ce qui s’impose aujourd’hui comme une donnée historiographique est, somme toute, assez banale, mettre une telle donnée en perspective n’en est pas moins utile. Ceci revient précisément à interroger l’origine de cette distinction, ainsi que le contexte doctrinal de sa formulation, à tenter d’identifier ceux qui en ont fait usage et ceux qui ont contribué, sans pourtant la formuler explicitement, à sa première apparition. En effet, si Descartes a consigné à la postérité le vocabulaire de la realitas, son mérite, en dépit d’une originalité qui a été peut-être trop valorisée par les commentateurs, n’est pas d’avoir constitué un nouveau vocabulaire conceptuel, mais plutôt d’avoir récupéré – consciemment ou non, il est difficile de le dire avec certitude – un lexique qui s’était formé bien avant 1641, année de parution de ses Meditationes, et dans un contexte qui était tout sauf “ moderne ”. L’invention de la distinction entre realitas subiectiva et realitas obiectiva se produit au sein de la première école scotiste, dans le contexte de la formulation de la doctrine de l’univocité de l’étant, où il s’agissait pour les disciples de Scot de transmettre les thèses du Docteur Subtil en éclaircissant le sens et la portée. Celui qui le premier a formulé cette distinction est à notre connaissance Jean Marbres (Ioannes Canonicus, Jean le Chanoine, John the Canon, Juan Marbres), scotiste actif au XIVe siècle. La formulation qu’il en propose s’inscrit dans le contexte d’une “ répétition ” quasi littérale (mais qui s’avèrera d’une grande importance historique, vu le succès que la distinction connaîtra pendant les siècles suivants) de la réponse de Duns Scot à un argument contre 1
2
Je tiens à remercier C. Esposito, E. Mehl et P. Porro pour leurs remarques et suggestions ; I. Agostini pour avoir discuté des points délicats de cette étude ; E. Cassan et S. Vermot pour avoir rendu un peu plus lisible mon français. L’importance de l’enquête sur la genèse historique de la notion de realitas obiectiva est confirmée par la grande quantité d’études qui lui est consacrée : pour le détail, mais sans prétention d’exhaustivité, cf. la bibliographie de cette étude.
104
Francesco Marrone
l’univocité formulé par Henri de Gand dans la Summa quaestionum ordinariarum. De l’histoire du vocabulaire de la realitas, qui comporte de nombreuses étapes, on se contentera ici d’envisager ce “ moment inaugural ”. Dans un premier temps on mettra l’accent sur l’arrière-plan de la distinction, en faisant référence à la discussion entre Henri et Scot ; dans un deuxième temps, en considérant les textes où la distinction apparaît pour la première fois, on cherchera à mettre en avant le rôle joué par Jean Marbres. L’univocité conceptuelle. Henri de Gand et Duns Scot C’est une donnée désormais acquise par l’histoire du commentaire que la théologie de Duns Scot s’est esquissée dans le contexte d’une discussion avec Henri de Gand. L’importance qu’assume Henri dans les ouvrages théologiques de Scot émerge à tous les égards, mais c’est peut-être à propos de la fondation de la théologie et de la nécessité de résoudre l’alternative équivocité / analogie / univocité qu’elle se manifeste le plus clairement. Afin de mieux comprendre la doctrine de l’univocité théologique chez Scot – laquelle est à l’origine de la distinction entre realitas subiectiva et realitas obiectiva, ainsi qu’on le verra –, c’est donc d’une synthèse de la position d’Henri qu’il faut partir3. Il est bien connu qu’Henri admet la possibilité de penser Dieu et la créature par un seul concept – le concept d’être indéterminé. Néanmoins, afin de sauvegarder la distance infinie qui les sépare et d’éviter de réduire l’être divin à l’être créé (ce qui justement se produirait par l’institution d’un régime univoque), il nie toute convenientia ou communitas réelle entre eux4. À ses yeux, la possibilité de penser Dieu et la créature par un seul concept, loin de se fonder sur une communitas in aliqua re una, ne résulte que d’une espèce de confusion structurelle de l’intellect humain, lequel n’est pas à même, à cause de son imperfection, de distinguer l’indétermination négative de Dieu (indeterminatio per abnegationem) de l’indétermination privative de la créature (indeterminatio per privationem)5.
3
4
5
Sur ce qui suit, voir Gómez Caffarena, Ser participado, ch. 7, en part. 182-193 ; Boulnois, « Analogie et univocité », 352-355 ; Porro, Enrico di Gand, 41-53, en part. 43-44 ; Boulnois, Être et représentation, 271-280 ; Honnefelder, Ens inquantum ens, passim. Mais cf. aussi, parmi les travaux les plus récents, Pickavé, Heinrich von Gent, passim. Pour signifier la communauté réelle (in re) des analogues, Henri se sert des expressions suivantes : « communitas in aliqua re una » (p. ex. Summa, a. 21, q. 2, I, 125vV), « communitas rei » (p. ex. Summa, a. 21, q. 2, I, 124rF), « convenientia in aliquo uno reali » (p. ex. Summa, a. 21, q. 2, I, 124rF), « aliquid commune reale » (p. ex. Summa, a. 21, q. 2, I, 124rF). Cf. Henricus de Gandavo, Summa, a. 21, q. 2, I, 124rvO-125rS. Sur cette « confusion », cf. les études citées à la note 1 ; pour une interprétation alternative, cf. Pickavé, Heinrich von Gent, 167-178.
L’univocité de l’étant
105
D’après Henri, l’univocité de l’ens, tout en étant apparemment possible, n’est donc qu’une illusion : la notion univoque d’être indéterminé n’implique aucune communication réelle entre les termes dont elle est prédiquée, et elle ne postule pas non plus cette communitas rei qui est par contre requise par l’univocité. La possibilité de penser Dieu et la créature par un seul concept, loin de fonder un régime effectivement univoque, ne fait que produire une univocité tout simplement nominale6, derrière laquelle se cache un modèle analogique (le seul possible, selon Henri) fondé à son tour sur la dépendance de la créature à l’égard de Dieu7. Selon Henri, en effet, ce n’est que par la participation, à son tour comprise comme conformitas, qu’il est possible d’affirmer une communauté réelle entre Dieu et la créature8. Mais il ne s’agit, ainsi qu’on l’a déjà remarqué, que d’une communitas analogique, car l’univocité exigerait quant à elle une communitas in aliqua re una qui pourtant n’est pas possible entre Dieu et la créature. Une des raisons qui selon Henri excluent qu’il y ait entre Dieu et la créature une communitas in aliqua re una, c’est la simplicité de l’être divin : l’indétermination de la nature de Dieu – c’est-à-dire le fait qu’elle n’admet aucune forme de composition – lui interdit de partager avec la créature quelque chose de réel. Selon Henri, si l’on affirmait une telle thèse, on finirait par poser en Dieu une pluralité incompatible avec sa nature : « Quoniam quaecumque sunt diversa inter se et in aliquo communi conveniunt necessarium secundum esse in illo communi differunt, ut homo et asinus sub animali. Si ergo esset esse aliquid commune deo et creaturae, sub illo secundum esse differrent. Erit ergo duplex esse Deo : unum in quo cum creatura convenit sive communicat ; aliud in quo a creatura differt. Hoc autem est impossibile, quia tunc non esset in Deo esse omnino simplex nec esset esse purum, cuius contrarium infra patebit. Ergo etc. »9.
La prémisse de l’argument d’Henri tient dans l’affirmation de la nécessité d’une distinction entre les univoques. Pour qu’il soit possible de postuler une communauté entre deux étants, comprise ici comme leur subsomption sous un concept commun, il est nécessaire que ces étants se distinguent secundum rem : la convenientia, en posant la communauté, postule nécessairement la distinction. Afin d’élucider cette implication, Henri se sert d’un exemple. De même qu’il est nécessaire que l’âne et l’homme se distinguent tout en convenant dans le genre (animal), aussi est-il nécessaire, pour que la prédication univoque de l’ens soit possible, que Dieu et la créature se distinguent et se diversifient tout en convenant dans l’ens : la convenientia, de même que les relations de conformité ou de similitude, exige toujours la distinction des termes relatifs.
6 7 8 9
Cf. Henricus de Gandavo, Summa, a. 21, q. 2, I, 124rF. Cf. Henricus de Gandavo, Summa, a. 21, q. 2, I, 124rI. Cf. Henricus de Gandavo, Summa, a. 21, q. 2, I, 125vV. Cf. Henricus de Gandavo, Summa, a. 21, q. 2, I, 124rE.
106
Francesco Marrone
Néanmoins, à la différence du cas de l’attribution du genre « animal » aux espèces « homo » et « asinus », le cas de la prédication univoque de l’étant jouit d’un statut exceptionnel : la simplicité divine exclut de iure la possibilité que Dieu soit distinct par différence de la créature et qu’en même temps il partage avec elle quelque chose de réel. Si Dieu convenait en quelque chose avec la créature et en même temps s’en distinguait, on devrait postuler dans son être une pluralité incompatible avec sa simplicité et affirmer l’existence, en Dieu justement, d’un être double : d’une part, ce qu’il partage avec la créature et qui fonde le concept commun ; d’autre part, ce qui le distingue d’elle et qui justifie leur diversité10. Mais au delà de la négation de la simplicité divine, la position d’un concept commun à Dieu et à la créature aurait au moins trois autres conséquences : la réduction de l’être à un genre (dont Dieu et la créature seraient des espèces) ; l’introduction, en Dieu, d’une forme de composition comprise selon le modèle genre-différence ; l’homologation de l’indétermination per abnegationem (Dieu) à l’indétermination per privationem (créature) – ce qui ne ferait évidemment que produire une réduction de l’être divin à l’être de la créature. Dans la d. 8 de l’Ordinatio, où il s’agit pour lui d’établir la compatibilité entre l’univocité de l’étant et la simplicité divine, Duns Scot pose le problème dans des termes qu’il hérite d’Henri. Et parmi les rationes contre l’univocité il reprend justement l’argument que l’on vient d’envisager (en le reformulant selon son propre lexique) : « [...] primo diversa in nullo conveniunt ; Deus est primo diversus a quacumque creatura, alioquin haberet quo conveniret et quo differret ; et ita non esset simpliciter simplex ; ergo Deus in nullo convenit cum creatura, et ita nec in aliquo conceptu communi »11.
L’argument peut être résumé ainsi : a. Si Dieu et la créature partageaient quelque chose, il faudrait postuler en Dieu un fondement pour la convenientia entre lui et la créature et un fondement pour leur distinction ; et Dieu, par conséquent, ne serait pas absolument simple (simpliciter simplex), mais composé par ce en quoi se fonde sa convenientia avec la créature et ce qui le distingue ou différencie d’elle. b. Mais Dieu est simpliciter simplex. c. Dieu et la créature sont donc primo diversa : il ne conviennent ni ne peuvent convenir en rien. d. Par conséquent, puisqu’ils ne partagent rien sur le plan de l’être, ils ne peuvent non plus convenir dans un concept commun.
10 11
Cf. Henricus de Gandavo, Summa, a. 21, q. 2, I, 126vI. Ioannes Duns Scotus, Ord. I, d. 8, p. 1, q. 3, n. 47, ed. Vat. IV, 172.
L’univocité de l’étant
107
L’impossibilité d’une communitas in aliqua re una se trouve ici à l’origine de l’impossibilité du concept commun univoque d’étant. Selon l’argument proposé par Henri et ici rappelé par Scot, l’impossibilité de l’univocatio entis s’appuie sur le présupposé d’une correspondance entre le plan de la réalité extramentale et le plan conceptuel : selon Henri, pour qu’un concept univoque commun soit possible, il faut que dans les univoques se trouve, partagé, le fondement du concept, c’est-à-dire quelque chose de réellement commun qui soit apte à fonder la vérité du concept commun. Ainsi, afin de pouvoir prédiquer un concept univoque commun d’étant de Dieu et de la créature, il faut premièrement que le concept soit fondé sur quelque chose qui se trouve realiter dans les deux univoques (quelque chose qui corresponde in re au concept commun), et, deuxièmement, que ce fondement soit le même dans les deux (sinon le concept ne serait pas univoque). Mais comme on l’a vu, cela n’est pas imaginable dans le cas de Dieu : si l’on admettait, dans les termes univoques, quelque chose de commun en tant que fondement du concept commun, il faudrait aussi postuler quelque chose qui fonde le concept de ce qui les différencie ou les distingue ; mais alors en Dieu, de même que dans la créature, il y aurait composition et puissance (composition, puisqu’il faudrait un fondement pour le concept qu’il partage avec la créature et un fondement pour le concept qui les différencie ; puissance, puisqu’une telle composition s’articulerait selon le modèle genre-différence)12. D’après Scot, la limite de la thèse d’Henri est en cela qu’elle fait dépendre trop rigidement les distinctions conceptuelles des distinctions in re : c’est l’isomorphisme mentionné plus haut – la conviction qu’à tout concept doit correspondre une res ou realitas – ce qui, aux yeux de Scot, s’avère inadmissible dans la thèse d’Henri13. Pour Duns Scot, en effet, il est bien vrai que la prédication univoque exige que les univoques conviennent en quelque chose de commun (ici l’ens) et que néanmoins ils doivent se distinguer par quelque chose qui les différencie ; mais cela ne contredit nullement la simplicité divine. En effet, il est possible a. que la même res, absolument simple, puisse produire 12
13
L’impossibilité d’appliquer le modèle genre-différence à Dieu est argumentée par Scot à partir de son incompatibilité avec les attributs de l’infinité et de la simplicité : cf., p. ex., Ioannes Duns Scotus, Ord. I d. 8 p. 1 q. 3 n. 106, ed. Vat. IV, 201 ; Lect. I d. 8 p. 1 q. 3 nn. 102 et 118, ed. Vat. XVII, 34 et 41. L’isomorphisme dont il est ici question est plutôt le résultat de la lecture de Scot qu’une thèse explicitement assumée par Henri ou déterminant sa pensée. Quant à lui, Henri semble se placer sur la même ligne que Scot, s’il est vrai que la distinction intentionnelle dont il est peut-être l’inventeur avait pour but de justifier la possibilité d’effectuer des distinctions sans correspondance in re. En réalité, donc, son “ erreur ” n’a pas été celle de soutenir explicitement la thèse de l’isomorphisme entre le plan du concept et le plan de la réalité, mais plutôt celle de ne pas avoir mené jusqu’au bout cette entreprise d’autonomisation du “ conceptuel ” inaugurée par la distinction intentionnelle. Mais aux yeux de Scot c’est justement ce dernier point, c’est-à-dire l’insuffisance de la réfutation henricienne de l’isomorphisme, qui ne permet pas à Henri de sortir de l’isomorphisme, d’où la conséquence de ne pas réussir à penser une communauté de l’ens compatible avec la simplicité divine.
108
Francesco Marrone
plus d’un concept (d’une part, le concept de ce qu’elle partage avec une autre chose ; d’autre part, le concept qui la différencie d’elle), et b. que ces deux concepts non seulement ne signifient pas deux realitates distinctes, mais qu’en plus ils ne se rapportent pas l’un à l’autre selon le modèle genre-différence (= puissance-acte). En passant par la négation de l’isomorphisme, à ses yeux implicite dans la thèse d’Henri, Scot peut ainsi mettre en place un autre mode de concevoir la composition des éléments dans la définition de Dieu et soutenir que la distinction entre le concept de ce qui est commun et le concept de ce qui différencie Dieu de la créature ne présuppose pas qu’il y ait en Dieu une composition réelle (ex realitate et realitate) entre les fondements des deux concepts. D’autre part, néanmoins, pour que les concepts de ce qui est commun et de ce qui est différent ne résultent pas d’une multiplication fictive de l’intellect, il faut qu’ils aient en Dieu un fondement, mais tel qu’il ne comporte aucune composition conçue selon le modèle genre-différence. La réponse de Scot à cette exigence consiste à affirmer la possibilité de concevoir la composition comme la conjonction entre nature et mode intrinsèque, c’est-à-dire comme la composition d’objets formels ne comportant in re aucune distinction entre realitates. En fait, le modèle nature-mode intrinsèque, à la différence du modèle genre-différence, ne comporte aucune composition réelle (ex realitate et realitate) et préserve par conséquent la simplicité de la res dans laquelle les concepts de la nature et du mode intrinsèque sont fondés. Par cette articulation nature-mode intrinsèque, Scot réussit donc à justifier la possibilité de concevoir ce qui est commun à Dieu et la créature indépendamment de ce qui les différencie sans pour autant être contraint d’admettre en Dieu une forme de composition risquant de compromettre sa simplicité14. Cette négation de l’isomorphisme entre le plan de la chose et le plan conceptuel n’est pas sans conséquences quant à la façon dont Scot répond à l’argument d’Henri. En fait, s’il est possible qu’une seule et même res puisse produire des concepts concevables séparément sans que cette séparabilité in conceptu comporte une distinction réelle dans la chose, alors la raison évoquée par Henri contre l’univocité de l’étant n’a plus aucune prise. Affirmer qu’une seule res puisse produire deux concepts et que par conséquent l’entitas puisse être conçue en Dieu séparément de l’infinité, sans pour autant introduire de pluralité dans son être, cela revient précisément à annuler l’incompatibilité entre l’esse primo diversa (impossibilité d’une communitas rei) et la formulation d’un concept commun univoque : « Ad tertium patebit in tertio articulo ‘quia Deus et creatura non sunt primo diversa in conceptibus’ ; sunt tamen primo diversa in realitate, quia in nulla realitate conveniunt »15.
14 15
Cf. Ioannes Duns Scotus, Ord. I d. 8 p. 1 q. 3 nn. 137-150, ed. Vat. IV, 221-227 et Lect. I d. 8 p. 1 q. 3 nn. 123-125, ed. Vat. XVII, 43-45. Ioannes Duns Scotus, Ord. I d. 8 p. 1 q. 3 n. 82, ed. Vat. IV, 190.
L’univocité de l’étant
109
Aux yeux de Scot, donc, Dieu et la créature sont bien primo diversa quant à la chose (in realitate), comme le soutenait Henri, mais cela n’implique point qu’ils ne puissent pas convenir au moins in conceptu. La nouveauté de la thèse de Duns Scot consiste donc dans le fait qu’il a dégagé le plan du concept d’une dépendance trop étroite à l’égard du plan de l’être et qu’il a fondé l’univocité sur le plan conceptuel – ce qui lui a permis d’affirmer dans le même temps, et sans contradiction, l’équivocité (donc l’analogie) sur le plan de l’être (Deus et creatura sunt primo diversa) et l’univocité sur le plan du concept16. Cette dissociation entre le plan du concept et le plan de l’être est formulée encore plus explicitement dans le passage correspondant de la Lectura : « Ad aliud, quando dicitur quod ‘primo diversa in nullo conveniunt’, dico quod sicut sunt primo diversa, sic in nullo conveniunt ; si enim sint primo diversa secundum realitatem, in nulla realitate conveniunt ; si autem secundum conceptus suos sint primo diversa, tunc in nullo uno conceptu conveniunt. Nunc autem creatura et Deus conveniunt in uno conceptu absque unitate in realitate […] ; sunt igitur primo diversa in realitate, sed non in conceptu »17.
Scot part ici d’une définition générale d’esse primo diversa, selon laquelle sont primo diversa ces choses qui ne conviennent en rien. Après avoir énoncé cette définition générale, néanmoins, il se soucie de distinguer les deux significations que la notion d’esse primo diversa peut recouvrir. D’une part, cette notion peut être rapportée au plan de la réalité, et ainsi deux res sont susceptibles d’être primo diversa in realitate ou secundum realitatem ; de l’autre, en revanche, elle peut être rapportée au plan conceptuel, et ainsi les mêmes res sont susceptibles d’être primo diversa in conceptu ou secundum conceptus suos. L’enjeu de cette distinction est clairement celui de justifier la possibilité de prédiquer le concept commun univoque même dans le cas où, comme cela arrive avec Dieu et la créature, la diversité totale des univoques sur le plan de la chose semblerait empêcher toute prédication univoque. Autrement dit, la distinction entre les deux significations de l’esse primo diversa sert, dans l’argument de Scot, à la légitimation de la possibilité de concevoir une forme de communauté sans être contraint de postuler (ainsi que le voulait Henri) que les univoques conviennent in realitate. Cette distinction comporte donc une véritable autonomisation des plans de la réalité et du concept :la diversité totale sur le plan de la realitas (res primo diversa in realitate), n’impliquant pas l’équivocité conceptuelle (res primo diversa in conceptu), ne préjuge pas non plus la possibilité d’un concept commun univoque d’étant. Pour qu’un concept commun univoque d’étant soit possible, la condition à satisfaire n’est pas, en effet, que les termes 16
17
La compatibilité entre l’analogie (in re) e l’univocité (in conceptu) est énoncée, à propos du rapport entre substance et accident, p. ex. dans Ioannes Duns Scotus, Ord. I d. 3 p. 1 q. 3 nn. 163-164, ed. Vat. III, 100-101. Cf. aussi Boulnois, « Analogie et univocité », 359 et 367. Ioannes Duns Scotus, Lect. I d. 8 p. 1 q. 3 n. 84, ed. Vat. XVII, 28. La même thèse apparaît aussi en conclusion : Lect. I d. 8 p. 1 q. 3 n. 129, ed. Vat. XVII, 46-47.
110
Francesco Marrone
de la prédication ne soient pas primo diversa in realitate (comme le voulait Henri), mais plutôt qu’ils ne soient pas primo diversa in conceptu – ce qui revient à affirmer que l’univocité est possible absque unitate reali, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire qu’il y ait une réalité (res ou realitas) dans laquelle les univoques conviennent realiter. À partir de là, pour Scot, la quaestio de univocatione se déplace définitivement du plan de la res au plan du conceptus. La double réalité. Jean Marbres À l’instar de Duns Scot, Jean Marbres se confronte lui aussi à l’objection d’Henri. Dans la formulation qu’il en propose, cependant, l’argument assume une portée plus générale. Si, dans le contexte de la discussion entre Henri et Scot, l’enjeu était d’inclure le cas Dieu-créature, exceptionnel et excentrique, à l’intérieur du modèle “ univociste ”, dans l’argument de Marbres il s’agit plutôt d’expliquer comment et en quel sens l’univocité, aussi bien dans le cas de la prédication transcendentale (Dieu-créature) que dans le cas de la prédication catégoriale (substance-accident), peut s’avérer une univocité réelle. Pour le dire autrement, chez Marbres ce n’est pas seulement le problème métaphysique et théologique de l’inclusion de Dieu dans le concept d’étant qui est en jeu, mais plutôt ou principalement la détermination du rapport entre l’univocité et le réalisme qui la gouverne : si, en effet, comme le soutient Scot, l’univocité s’effectue in conceptu, de quelle manière est-il possible d’affirmer que le concept commun univoque d’étant est réel, sans réduire l’univocatio entis à une forme d’univocité purement et simplement logique ou nominale ? Marbres introduit l’objection d’Henri déjà discutée par Scot de la manière suivante : « Sed contra deus et creatura, substantia et accidens, conveniunt in ratione entis realis, ut tu dicis, et eadem distinguuntur se totis realiter secundum rem ; ergo implicas contradictionem »18.
Marbres part ici d’une justification ostensive de la possibilité d’attribuer l’étant à des singuliers se totis realiter distincta. À ses yeux, s’il est vrai que Dieu et la créature ne partagent rien de réel – et cela, justement, dans la mesure où ils sont se totis distincta –, il est également vrai, par ailleurs, que l’on peut en abstraire un concept d’intention première univoquement prédicable des singuliers dont il est abstrait : « Pro evidentia huius quaestionis pono aliqua propositiones. Prima est ista, quod ab aliquibus se totis realitate subiectiva distinctis potest abstrahi aliquis conceptus primae intentionis. Hoc probatur, nam ab individuis eiusdem speciei potest abstrahi unus conceptus primae 18
Ioannes Canonicus, In libros auditus naturalis Aristotelis, f. 10va.
L’univocité de l’étant
111
intentionis ; sed ipsa sunt se totis distincta realitate subiectiva, quia in nullo tali tertio […] subiective conveniunt »19.
La possibilité d’abstraire un concept commun à partir d’individus se totis realiter distincta témoigne de la possibilité et de la légitimité de l’univocité même en régime d’équivocité dans la réalité extramentale. Mais s’il en est ainsi, c’est-à-dire s’il est possible d’abstraire un concept commun tout en admettant une distinctio se totis realiter entre les singuliers, alors la prédication univoque fait essentiellement abstraction de la distinction réelle, fût-elle radicale (se totis realiter), entre les termes de la prédication. Contrairement à l’objection d’Henri, donc, il n’existe aucune contradiction entre la diversité totale sur le plan de la réalité (distinctio se totis realiter) et la prédication univoque de concepts communs : il est possible d’affirmer en même temps et sans contradiction aussi bien la possibilité d’un concept commun univoque que la distinction se totis realiter entre les termes dont on prédique ce concept. Ce qui, par ailleurs, est prouvé aussi par le fait que la prédication du concept commun abstrait n’empêche pas que les termes auxquels il est attribué ne soient, dans la réalité, se totis distincta : « Secunda propositio est haec. Quod ponere aliquem conceptum primae intentionis esse communem deo et creaturae non est tollere quod deus et creatura se totis realiter distinguantur, saltem realitate subiectiva »20.
Mais si la formulation d’un concept d’intention première univoquement prédicable n’abolit pas la distinctio se totis realiter, l’univocité ne requiert aucune communauté réelle : « Tertia propositio est ista. Quod proprie univocationi conceptus entis non correspondet aliqua res subiectiva et in effectu. Probatur illis qui se totis realiter realitate subiectiva distinguuntur non potest esse aliqua res subiectiva communis. Sed deus et creatura realitate subiectiva distinguuntur, ergo deo et creaturae non potest esse communis aliqua ratio subiectiva una et per consequens proprie univocationi conceptus entis non correspondet aliqua res una in effectu »21.
Puisque les choses qui se distinguent se totis realiter ne conviennent en rien de réel (au sens de la res ou de la realitas subiectiva), et que, néanmoins, il est possible d’en abstraire un concept commun univoquement prédicable, il est tout à fait certain que l’univocité n’exige, ainsi que le prétendait implicitement Henri, aucune convenientia in aliqua re una. 19
20 21
Ioannes Canonicus, In libros auditus naturalis Aristotelis, f. 10va. La source de la thèse proposée ici est encore Duns Scot : cf. Ioannes Duns Scotus, Ord. I d. 3 p. 1 q. 3 n. 163, ed. Vat. III, 100-101. Ioannes Canonicus, In libros auditus naturalis Aristotelis, f. 10va. Ioannes Canonicus, In libros auditus naturalis Aristotelis, f. 10va.
112
Francesco Marrone
Ce qui vient à manquer, dans cette démonstration ostensive de la possibilité de l’univocité, c’est donc le présupposé qui, aux yeux de Scot, régissait l’objection d’Henri, c’est-à-dire la conviction que le conceptus entis doit correspondre à une res ou realitas (isomorphisme) et que l’univocité présuppose une communitas rei. Ainsi l’argument d’Henri est-il neutralisé par la négation de son présupposé implicite : la nécessité d’une correspondance entre le plan conceptuel (conceptus) et le plan réel (res / realitas / realitas subiectiva). La possibilité de l’univocité étant justifiée par le recours à l’abstraction, il faut maintenant s’interroger sur le statut du concept commun abstrait. La possibilité d’abstraire un concept commun univoquement prédicable, même si elle démontre la compatibilité de l’univocité avec la distinctio se totis realiter, n’explique en effet pas la “ réalité ” du concept univoque abstrait. Le problème qui se profile ici est celui du “ fondement ” du concept d’étant : ce concept, en effet, affranchi de toute correspondance avec le plan de la réalité extramentale, risque de se réduire à un ens rationis, une généralisation sans fondement. Par là une nouvelle tension succède à la première : si, dans un premier temps, il s’agissait de montrer la compatibilité entre la prédication d’un concept commun univoque et la distinctio se totis realiter, il s’agit maintenant surtout de résoudre la tension entre la nature logico-conceptuelle de l’univocité, d’une part, et, d’autre part, la nature réelle de l’univocatio (univocatio conceptus entis est vere realis)22 et du conceptus entis (illud quod praedicatur essentialiter et in quid de aliquo ente reali est notio realis)23. L’enquête de Marbres prend donc la direction suivante : comment concevoir que l’univocité s’effectue dans le concept, sans aucune communauté dans la chose, et qu’en même temps elle puisse être dite realis ? Pour résoudre cette tension, Jean Marbres introduit, le premier à notre connaissance, la distinction entre realitas subiectiva et realitas obiectiva : c’est précisément par l’introduction de cette distinction qu’il pourra justifier la nature conceptuelle de l’univocatio et la “ realité ” du conceptus entis. Le présupposé de la duplication de la notion de realitas est qu’un concept, pour être tenu pour “ réel ”, doit représenter un contenu indépendant des opérations de l’intellect : est “ réel ”, en ce sens, tout concept qui n’est pas l’effet de la conceptio. Conformément à ce modèle, qui exigerait une enquête qu’il n’est pas possible de retracer ici24, le conceptus entis, de même que tous les autres concepts, doit lui aussi répondre à cette “ exigence de réalité ” : pour être tenu pour “ réel ”, il doit se rapporter à un niveau de réalité qui, tout en n’étant pas identifiable au “ réel ” tout court (res/realitas), s’avère quand même métaphysiquement solide, non dépendant de l’intellect et donc capable de fournir un fondement à la conceptio.
22 23 24
Ioannes Canonicus, In libros auditus naturalis Aristotelis, f. 10rb. Ioannes Canonicus, In libros auditus naturalis Aristotelis, f. 10va. Qu’il me soit permis de renvoyer à mon travail de thèse : Marrone, Res et realitas, ch. I et II.
L’univocité de l’étant
113
Marbres introduit la distinction entre realitas subiectiva et realitas obiectiva dans les termes suivants : « Est autem advertendum quod cuilibet conceptui reali univoco correspondet duplex realitas. Una in se, alia in suis inferioribus. Prima realitas est obiectiva, secunda est subiectiva sive in effectu. Sed prima abstrahit ab existentia actuali : et ab illis qui actualem existentiam consequuntur. Sed secunda concernit actualem existentiam : et qui ipsam consequuntur »25.
Pour qu’un concept commun soit réel, il n’est donc pas nécessaire qu’il signifie une realitas dans laquelle les termes de la prédication conviennent réellement. À cet effet, il suffit – car il s’agit d’un niveau de réalité proportionnel à la vérité du concept – qu’il se rapporte à une réalité immanente (mais non réductible) à l’intellection elle-même, c’est-à-dire, justement, à une realitas obiectiva. Afin d’élucider sa thèse, et avant d’aborder le cas de l’étant, Marbres a recours à l’exemple du concept d’homme. Au concept d’homme correspond une double réalité : d’une part, la nature rationnelle en tant qu’indéterminée ; d’autre part, la même nature rationnelle en tant que déterminée et instanciée par des individus. Selon Marbres, il est clair qu’il s’agit de la même nature rationnelle, mieux de la nature rationnelle elle-même : si, dans le premier cas, elle est considérée en elle-même et abstraction faite des singuliers, dans le second elle est envisagée dans son état d’individualité, c’est-à-dire en tant qu’instanciée dans les singuliers. À ces deux modes de considération de la nature rationnelle correspondent des modi essendi différents et des formes opposées d’unitas. Selon la première considération (realitas obiectiva), la nature rationnelle comporte, quant au modus essendi, le seul esse obiectivum, c’est-à-dire cet être qui revient à l’objet en tant qu’il est le terme d’une puissance (ici l’intellect), et, quant à l’unitas, une forme d’unité réelle et formelle, intermédiaire entre l’unité numérique et l’unité de raison26. Selon la seconde considération (realitas subiectiva), en revanche, la nature rationnelle comporte, quant au modus essendi, un esse subiectivum, c’est-à-dire cet être qui revient à la nature in suppositis, alors que, quant à l’unitas, elle en est complètement dépourvue, puisque, en tant qu’instanciée, elle est plurificata in diversis suppositis.
25 26
Ioannes Canonicus, In libros auditus naturalis Aristotelis, 10va. Le modèle en fonction duquel Marbres pense l’univocité de l’étant est celui de la natura communis : c’est en ce sens qu’il faut lire l’exemplification du concept d’étant à partir du concept de la nature rationnelle. Il ne faut pourtant pas oublier que, dans le cas de l’étant, l’unité de la notion d’ens n’est pas, comme il arrive dans le cas de la nature rationnelle, une simple unité formelle, encore trop liée à un horizon intracatégorial, mais plutôt une unité transgénérique, que Marbres définit dans la suite du texte unitas transcendens : cf. Ioannes Canonicus, In libros auditus naturalis Aristotelis, f. 10va.
114
Francesco Marrone
Ce modèle, exemplifié par le cas de la nature rationnelle, s’applique aussi à l’étant : « Similiter conceptui entis correspondet realitas dupliciter. Uno modo ipsa entitas non determinata ad hanc vel illam entitatem, nec ad existere vel non existere, nec ad hunc modum essendi vel ad illum. Et secundum hanc realitatem habet propriam unitatem et esse obiectivum praecise et secundum hanc accidit etiam sibi omnis entitas significata et omnis modus essendi determinatus. Alio modo correspondet sibi ipsa entitas ut est determinata et plurificata in diversis suppositis actu existentibus, et secundum hanc non habet esse obiectivum nec aliquam propriam unitatem, immo totalem diversitatem, nisi quis vellet dicere quod habet unitatem analogiae et habitudinis, quae est inter ipsa, in quibus existit »27.
D’une part, l’entitas peut être douée de la realitas qui revient à la natura en tant qu’elle existe in suppositis, c’est-à-dire de la realitas subiectiva. D’autre part, elle peut être douée de realitas obiectiva, c’est-à-dire de cette realitas, indifférente et indéterminée, qui lui revient en tant qu’elle constitue l’objet de la puissance cognitive. Comme on peut le constater, le cas du conceptus entis est analogue à celui, mentionné plus haut, de la nature rationnelle. Néanmoins, dans le passage où il énonce la double realitas qui peut revenir au conceptus entis, Marbres insiste particulièrement sur l’articulation entre les deux acceptions de la realitas et l’unitas. Dans le cas de l’ens, considéré quant à sa realitas subiectiva, il ne mentionne pas, comme dans le cas de la nature rationnelle, une simple pluralitas (laquelle ne pourrait pas d’elle-même exclure toute forme de communauté entre les suppôts). Il parle plutôt de totalis diversitas, et il est clair que la position de cette diversité totale, quant à elle, implique justement l’impossibilité de toute communauté réelle – ce qui pose à nouveaux frais le problème (déjà abordé par Scot dans sa réponse à l’objection d’Henri) de la possibilité de la prédication d’un concept commun univoque d’étant même dans le cas où subsisterait une totale diversité (primo diversa esse) entre les termes de la prédication. À la différence de la prédication de concepts communs à l’intérieur de la species (c’est le cas de la nature rationnelle), la prédication de l’étant présente donc une difficulté accessoire. Les cas de l’univocité catégoriale (substance-accident) et de la prédication transcendantale (Dieu-créature) n’admettent par principe aucune communauté réelle (in aliqua re una) : s’il n’en était pas ainsi, on aboutirait à la réduction de l’étant à un genre, dans le cas des catégories, et à la négation de la simplicité et de l’infinité divines dans le cas Dieu-créature. La conséquence de cette exceptionnalité du cas de la prédication de l’ens est par conséquent que la pluralitas constitue une instance de totalis diversitas. Or c’est justement sur la base de la distinction entre les deux acceptions de la realitas que Marbres peut finalement aborder l’objection d’origine henricienne contre l’univocité en évitant le risque de réduire le conceptus entis à un ens rationis et en assurant en même temps sa “ réalité ” :
27
Ioannes Canonicus, In libros auditus naturalis Aristotelis, f. 10va.
L’univocité de l’étant
115
« Sed contra deus et creatura, substantia et accidens, conveniunt in ratione entis realis, ut tu dicis, et eadem distinguuntur se totis realiter secundum rem ; ergo implicas contradictionem. Respondeo et dico quod praedicta se totis distinguuntur secundum realitatem subiective acceptam, et conveniunt realiter secundum realitatem obiective acceptam, vocando realitatem omnem conceptum primae intentionis ; et sic patet non esse contradictionem in dictis »28.
De même que la realitas, la distinctio se totis connaît deux acceptions, selon qu’elle est rapportée au plan de la réalité extramentale (realitas subiective accepta) ou au plan conceptuel (realitas obiective accepta)29. In re, c’est-à-dire sur le plan de la realitas subiective accepta, l’univocité est impossible à cause de la totalis diversitas des termes de la prédication (il s’agit des cas substance-accident et Dieu-créature), de sorte que la seule possibilité est l’institution extra intellectum d’un régime analogique. In conceptu, c’est-à-dire sur le plan de la realitas obiective accepta, l’univocité est en revanche possible, car l’unité du concept d’étant – lequel constitue une véritable realitas – s’avère suffisante pour justifier la “ réalité ” du concept. C’est sur la base de cette distinction entre les deux acceptions de la realitas – qui répètent au fond le couple scotien realitas / conceptus – que Jean Marbres peut répondre à l’objection d’Henri sans pourtant nier le contenu de l’objection. Selon Marbres, qui montre par là partager l’essentiel de l’argument d’Henri, il est impossible a. que Dieu et la créature conviennent en une realitas, et b. qu’il y ait un concept d’étant qui puisse être attribué univoquement à Dieu et à la créature envisagés en tant que singuliers existants (selon la realitas subiective accepta). Ce qui pourtant oppose Marbres à Henri c’est que d’après lui ces impossibilités n’abolissent pas la possibilité d’une communauté qui permettrait de fonder l’univocité sur le plan du concept, compris à son tour comme une “ réalité ” commune (mais pas subiective commune) dans laquelle peuvent communiquer les termes d’une possible prédication univoque. La thèse de Scot, que Marbres rend ici explicite du point de vue lexical, est donc que le concept, en tant qu’abstrait des individus, comporte une véritable realitas, une réalité qui est apte d’elle-même à fonder une communauté réelle : ainsi, bien qu’ils ne conviennent pas in aliqua re una (in realitate subiectiva), deux individus se totis distincta realiter peuvent quand même convenir dans un concept – ce qui suffit pour que se réalise un régime prédicatif univoque réellement fondé. La “ duplication ” de la notion de realitas est donc le dispositif conceptuel qui rend possible la position d’un régime univoque sans impliquer la négation de la distinctio se totis realiter entre les termes de la prédication. Cette duplication, néanmoins, ne permet pas seulement, ainsi que le faisait déjà le couple scotien realitas / conceptus, de neutraliser l’objection d’Henri ; elle permet aus28 29
Ioannes Canonicus, In libros auditus naturalis Aristotelis, f. 10va. La double acception de la distinctio se totis énoncée ici correspond pour l’essentiel à la double acception de l’esse primo diversa énoncée par Scot dans le passage de la Lectura cité supra.
116
Francesco Marrone
si de remarquer que l’univocité soutenue par Scot et par ses disciples est bien logique, dans le sens où elle s’effectue sur le plan conceptuel et prédicatif, mais qu’elle n’est pas pour autant “ irréelle ”. Car si le concept comporte une véritable réalité (realitas obiectiva), alors l’univocité, qui justement s’effectue au niveau du concept, est en même temps une univocité réelle, puisqu’elle s’avère fondée sur la réalité qui est incluse dans le concept d’étant se prédiquant de manière univoque. La nature logique ou logico-conceptuelle que Scot attribue à l’univocatio dans ses œuvres théologiques ne doit donc pas se comprendre comme une réduction de la totalité de l’étant à une notion de l’intellect, au sens d’un génitif subjectif qui ferait du conceptus entis une simple notion prédicable de multis. Elle est plutôt à concevoir comme la trace ou l’indice, sur le plan prédicatif, d’une convenientia des singuliers dans une véritable realitas (et pas simplement dans un concept) apte à fonder une prédication réelle sans inclure la négation la distinctio se totis des individus extra intellectum. Dans ce nouvel horizon conceptuel, l’étant est donc bien un concept, mais ce concept se constitue en même temps comme une véritable realitas, laquelle s’avère métaphysiquement solide sans pour autant se déterminer comme subjectivement existante (realitas subiectiva). À travers cette nouvelle manière de concevoir le conceptus comme une objectité réelle, pour les scotistes il ne s’agissait pas seulement de produire une nouvelle solution au problème de l’attribution univoque de l’ens, mais aussi de reformuler et redéfinir le réalisme qui la gouverne. Dans le passage de Duns Scot à Jean Marbres, l’enjeu n’était donc plus seulement théologique, mais aussi et surtout métaphysique. Au delà de l’alternative analogie / univocité, de la possibilité d’inclure Dieu sous le conceptus entis et de la relation entre les catégories, c’était un nouveau concept de réalité qui était en train de se définir, selon lequel la propriété d’être “ réel ” ne revient plus seulement aux res (realitates subiectivae), mais aussi aux natures abstraites (realitates obiectivae). Et à côté de cette redéfinition du réalisme et de l’extension qu’elle implique du “ réel ” aux natures in esse obiectivo, on assistait également à la formation d’un nouveau vocabulaire (realitas subiectiva / realitas obiectiva), qui dans les siècles suivants, ainsi qu’il n’est que trop notoire, devait connaître un grand succès.
L’univocité de l’étant
117
Bibliographie Littérature primaire Henricus de Gandavo, Summa quaestionum ordinariarum, Theologi recepto praeconio Solennis Henrici a Gandavo. Parisiis : in aedibus J. Badii Ascensii, 1520 [réimpr. New York : Saint Bonaventure – Leuven : Nauwelaerts – Paderborn : Schöningh, 1953]. Ioannes Canonicus, In Libros auditus Aristotelis subtilissime questiones [...]. Venetiis per Dominum Lucantorium de Gionta florentinum, 1516 [= Quaestiones super VIII Libros Physicorum Aristotelis] Ioannes Duns Scotus, Ord., ed. Vat. Ioannes Duns Scotus, Lect., ed. Vat.
Littérature secondaire Alanen, Lilli, Some Questions Concerning Objective Reality and Possible Being in Descartes and His Predecessors. In Knowledge and the sciences in medieval philosophy. Acta philosophica fennica, ed. Työrinoja et alii, t. 3 : 553-565. Helsinki : Societas Philosophica Fennica,1990. Ashworth, Earline J., « Descartes’ theory of Objective Reality. » The New Scholasticism 49 (1975), 3 : 331-340. Boulnois, Olivier, « Analogie et univocité selon Duns Scot : la double destruction. » Les Études philosophiques, 1989, 3-4 : 347-369. Boulnois, Olivier, Être et représentation. Une généalogie de la métaphysique moderne à l’époque de Duns Scot, XIIIe-XIVe siècle. Épiméthée. Paris : Presses Universitaires de France, 1999. Courtine, Jean-François, « Realität formale\obiective. »In Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 8, 194. Basel, Stuttgart : Schwabe & Co., 1992. Courtine, Jean-François, « La doctrine cartésienne de l’idée et ses sources scolastiques. » In Lire Descartes aujourd’hui, ed. O. Depré et D. Lories, 1-20. Louvain-la-Neuve : Institut Supérieur de Philosophie – Paris : Peeters, 1997. Cronin, Timothy J., Objective Being in Descartes and in Suárez. Analecta Gregoriana, cura Pontificiae Universitatis Gregorianae edita. Vol. 154. Series Facultatis philosophicae. Sectio A (n. 10). Roma : Gregorian University Press, 1966. Dalbiez, Roland, « Les sources scolastiques de la théorie cartésienne de l’être objectif. À propos du ‘Descartes’ de M. Gilson. » Revue d’Histoire de la Philosophie 3 (1929) : 464-472 Doig, James C. « Suárez, Descartes and the Objective Reality of Ideas. » The New Scholasticism 51 (1977), 3 : 350-371. Forlivesi, Marco, « La distinction entre concept formel et concept objectif : Suárez, Pasqualigo, Mastri. » Les Études philosophiques 2002, 1 : 3-30. Gómez Caffarena, José, Ser participado y ser subsistente en la metafísica de Enrique de Gante. Analecta Gregoriana, cura Pontificiae Universitatis Gregorianae edita. Vol. XCIII. Series Facultatis philosophicae. Sectio B (n. 8). Romae : apud aedes Universitatis Gregorianae, 1958. Honnefelder, Ludger, Ens inquantum ens. Der Begriff des Seienden als solchen als Gegenstand der Metaphysik nach der Lehre des Johannes Duns Scotus. Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 16. Münster : Aschendorff, 1979. Kobusch, Theo, Sein und Sprache. Historische Grundlegung einer Ontologie der Sprache. Studien zur Problemgeschichte der antiken und mittelalterlichen Philosophie, 11. Leiden : Brill, 1987.
118
Francesco Marrone
Marrone, Francesco, « Descartes e la tradizione scotista. Gli antecedenti storici della nozione di realitas obiectiva. » Quaestio 8 (2008) : 279-302. Marrone, Francesco, Res e realitas in Descartes. Gli antecedenti scolastici della nozione cartesiana di « realitas obiectiva », thèse de troisième cycle, Université de Lecce - Université de Caen / Basse Normandie, 2005. Normore, Calvin, « Meaning and Objective Being : Descartes and His Sources ». In Essays on Descartes’ Meditations, ed. A. Oksenberg-Rorty, 223-241. Berkeley, Los Angeles, Londres : University of California Press, 1986. Pickavé, Martin, Heinrich von Gent über Metaphysik als erste Wissenschaft. Studien zu einem Metaphysikentwurf aus dem letzten Viertel des 13. Jahrhunderts. Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 91. Leiden, Boston : Brill, 2007. Porro, Pasquale, Enrico di Gand : la via delle proposizioni universali. Vestigia, 2. Bari : Levante, 1990. Renault, Laurence, « La réalité objective dans les Premières objections aux Méditations métaphysiques : Ockham contre Descartes. » Revue de métaphysique et de morale 2000, 1 : 29-38. Wells, Norman J., « Objective Being : Descartes and his Sources. » The Modern Schoolman 45 (1967) : 49-61. Wells, Norman J., « Objective Reality of Ideas in Arnauld, Descartes, and Suárez. » In The Great Arnauld and Some of his Philosophical Correspondents, ed. E. J. Kremer, 138-183. Toronto, Buffalo, Londres : University of Toronto Press, 1994. Wells, Norman J., « Objective Reality of Ideas in Descartes, Caterus, and Suárez. » Journal of the History of Philosophy 28 (1990), 1 : 33-61. Wells, Norman J., « Old Bottles and New Wine : A Rejoinder to J. C. Doig. » The New Scholasticism, 53 (1979) : 515-523.
119 Archa Verbi. Subsidia 6
119–137
La création des vérités éternelles : Descartes s’est-il forgé un adversaire scotiste ? Édouard Mehl
On commence à entrevoir, aujourd’hui, les contours d’une histoire qui voit se rencontrer et se croiser l’aristotélisme scolaire, de la Spätscholastik à la Schulmetaphysik, avec les grands systèmes de la philosophie, de Descartes à Kant. Mais cette rencontre est d’une telle complexité, et liée à des circonstances si précises — la formation scolaire des philosophes, leurs lectures supposées, leurs interlocuteurs, les aspects et enjeux confessionnels du débat philosophique, etc. —, qu’on désespère d’arriver à des vues synthétiques qui ne soient pas des simplifications unilatérales. Il s’agira en tous les cas d’examiner ici comment les racines des systèmes de pensée à l’âge classique plongent, diversement et variablement, dans un sol irrigué par le « scotisme ». Mais ce sol n’est pas un sol stable, continu, ni un continent oublié, ni un stock de connaissances disponibles qu’il suffirait de remettre à la disposition des chercheurs et de la mémoire collective. De surcroît, s’il est aujourd’hui possible et nécessaire d’esquisser une cartographie du scotisme à l’âge classique1, c’est bien parce que celui-ci n’avait, pour ses contemporains, qu’une assez faible visibilité. Il faut se rendre à l’évidence qu’en lui-même et pour lui-même le « scotisme » n’a pas spécialement attiré l’attention d’un Descartes ou d’un Spinoza2. Cependant il n’est pas moins évident que les positions fondamentales d’une philosophie peuvent excéder les connaissances historiques et les intentions de leurs auteurs. On ne doit donc pas exclure la possibilité que la philosophie d’un Descartes ou d’un Spinoza joue avec ou contre le « scotisme », sans qu’ils en aient une connaissance claire, et sans même, peut-être, qu’ils s’y intéressent. C’est avec Duns Scot que se déploie et se structure la controverse médiévale par excellence, celle qui porte sur l’objet et le statut de la métaphysique — puisque la métaphysique est la science qui a le privilège ambigu et embarrassant d’avoir à établir elle-même son sujet (Dieu, la substance, l’être, le concept d’étant …), si tant est qu’elle doive n’en avoir qu’un et un seul3. Cette contro1 2
3
Schmutz, « L’héritage », 51-81. Pour ce qui est de Spinoza, voir les remarques prudentes de Manzini : Spinoza, 179. En suggérant que Spinoza a pu « connaître la doctrine scotiste par de multiples intermédiaires, comme par exemple les manuels des Conimbricenses », l’auteur concède, tacitement, que Spinoza n’a sans doute pas eu la curiosité d’en acquérir une connaissance de première main. Il va de soi que cette remarque ne vaudrait pas pour un Leibniz, dont le rapport à l’histoire de la philosophie est fort différent. Les historiens insistent aujourd’hui volontiers sur l’irréductible pluralité des métaphy-
120
Édouard Mehl
verse n’a cessé de solliciter et de produire des discours antinomiques, comme, exemplairement, les deux définitions concurrentes de la métaphysique aristotélicienne chez Avicenne et Averroès, antinomie sur laquelle la première et la seconde scolastique ont bâti tout leur édifice4. Notre enquête portera ici plus spécialement sur un des aspects de cette controverse, et son enjeu moderne : la discussion entre Duns Scot et Henri de Gand sur le concept de (première) vérité, et corrélativement sur le statut de la connaissance certaine. Cette discussion est au cœur de l’augustinisme franciscain, elle engage des positions fondamentales concernant le rapport de la métaphysique et de la théologie. Disons sommairement que Duns Scot illustre un point de vue selon lequel la vérité naturellement accessible à l’esprit humain n’est plus définie par rapport à Dieu, en tant qu’il est supposé en être la source, le modèle et la cause. L’entendement fini ne voit pas la vérité comme ce qui dépend de Dieu mais comme ce qui se manifeste par soi. La thèse a produit des effets à long terme, qui se font sentir jusqu’au XVIIe siècle. Il semble que la radicalisation des positions scotistes dans la seconde scolastique espagnole, notamment chez Vázquez5, soit en grande partie provoquée par la perte de la distinction entre l’indépendance « formelle » et la dépendance « principiative » des essences et des possibles6 ; possibles qui dépendent de Dieu ut causa effectiva sive productiva, mais justement pas, comme chez Descartes, de Dieu ut efficiens et totalis causa, c’est-à-dire du Dieu créateur dont dépendent aussi bien et en même façon, estime Descartes, les essences que les existences7. Cette évolution, dont on peut suivre la trace jusque chez les deux « grands » scotistes du XVIIe siècle, Mastrius et Poncius8, se serait donc faite au bénéfice de l’indépendance des « possibles » et des « vérités éternelles », libérant ainsi un espace ou continuum d’intelligibilité dans lequel même l’action créatrice, au lieu de le produire, est supposée s’inscrire9. Cette évolution, dans laquelle il semble que le scotisme de la seconde scolastique ait joué un rôle décisif, donnerait lieu à la position
4
5 6
7 8 9
siques médiévales a parte objecti : cf. de Libera, « Genèse et structure des métaphysiques médiévales », 159-181, et plus vigoureusement encore Biard, « La métaphysique au Moyen Âge », 99-117. Pour sa place chez Scot, voir Gilson, « Avicenne », 129-189, puis Boulnois, Être et représentation, ch. VII, 327-404. Pour la persistance et la fortune de l’antinomie avicennoaverroïste, voir Suárez, Disputationes Metaphysicae, XXIX, section I, §§ 2-3. Voir Schmutz, « Un Dieu indifférent », 185-221. Hoffmann, Creatura intellecta, 195-196. T. Hoffmann suggère dans ses conclusions que Scot n’est pas essentialiste, mais que l’essentialisme caractérise en revanche l’école scotiste. Il nous semble que Scot défend en fait clairement une thèse qui est antinomique pour l’intellect créé : les possibles sont à la fois dépendants et indépendants (mais pas sous le même rapport). Descartes à Mersenne, 27 mai 1630, AT I, 152, 2. Sur ces deux auteurs, notamment pour l’indépendance des possibles, voir Sousedik, « Sinn der scotischen Possibilienlehre », 193. Pour un tableau général des aboutissants de la thèse — la « dédivinisation » de la science divine, la constitution d’une science générale portant sur « toutes les formes d’objets, même impensés, irréels ou faux », voir Boulnois et Bardout, Sur la science divine, 55.
La création des vérités éternelles
121
contre laquelle réagit violemment Descartes : dans son premier coup d’éclat métaphysique que constituent les trois Lettres à Mersenne de 1630, où il conteste, en quelque sorte, la confusion du Faktum et du fatum rationis10. Mais aussi bien, ultérieurement, dans l’affirmation que la vérité des idées claires et distinctes n’est assurée que par l’existence divine : « cela que j’ai tantôt pris pour une règle, à savoir que les choses que nous concevons très clairement et très distinctement sont toutes vraies, n’est assuré qu’à cause que Dieu est ou existe […] »11. Ce propos, rendu célèbre par l’objection du « cercle » qu’il a suscité, peut en fait se lire comme une objection à la philosophie de l’École. Traduite dans les termes de la métaphysique scolaire, elle revient en effet à dire que la partie générale de la métaphysique dépend, au moins logiquement, de sa partie spéciale. Reste à savoir toutefois si Descartes avait distingué une quelconque provenance scotiste des thèses qu’il incrimine, et si la doctrine de la création des vérités dites éternelles, constitue, partant, un bréviaire de l’opposition au scotisme — le scotisme plus ou moins latent, plus ou moins assumé et conscient de l’interlocuteur direct de Descartes : Mersenne. Étienne Gilson et l’interprétation volontariste de Duns Scot L’hypothèse que la doctrine de la création des vérités éternelles, concentrée dans trois lettres à Mersenne (avril - mai 1630), réagit contre des thèses et des énoncés caractéristiques dans l’école scotiste, sur l’indépendance des vérités logiques et mathématiques par rapport à la volonté et à la puissance divine, s’est construite au fil des travaux de Gilson sur Duns Scot, et il est patent qu’elle lui a servi de fil conducteur, d’abord pour récuser ce qu’il considère comme la « légende » d’un volontarisme scotien — légende qui ne manquait pas d’arguments solides, et à la lumière de laquelle l’hypothèse d’une réaction critique de Descartes en 1630 perdait toute évidence12 ; puis Gilson avait identifié dans le Prologue de l’Ordinatio le modèle de l’énoncé que Descartes conteste : « Supposé que le triangle soit, et que Dieu ne soit pas, le triangle aurait encore trois 10
11
12
Descartes à Mersenne, « 15 avril 1630, AT I, 145, 10-13 : « C’est en effet parler de Dieu comme d’un Jupiter ou un Saturne, & l’assujettir au Styx et aux Destinées, que de dire que ces vérités sont indépendantes de lui ». Sur l’opposition théorique évidente de Descartes et Scot concernant les modalités logiques, voir Knuuttila, « Foundations of logical modalities », 134-136. Descartes, Discours de la Méthode, IV, AT VI, 38,15-19. Il ne peut donc y avoir de science certaine (certa scientia) tant que cette existence n’est pas connue : Principia Philosophiae, I, 13, AT VIII-2, 10,4-5. Gilson, Jean Duns Scot, 285, critiquant la thèse de Kahl (Die Lehre, 1886), comme il l’avait déjà fait dans La liberté, 136 ; et celle de Pluzanski (Essai, 1888), pour qui « selon Scot, les possibles sont créés en tant que possibles » (Gilson, Jean Duns Scot, 290). Outre ces minores la thèse d’un Scot « volontariste » et même créateur des vérités éternelles, d’ailleurs exprimée en des termes ostensiblement empruntés aux trois Lettres à Mersenne de 1630, est surtout présente chez un des maîtres dont Gilson s’est peu à peu éloigné : Henri Bergson (voir ici même la communication de Matthias Vollet).
122
Édouard Mehl
angles »13, après avoir douté que jamais aucun théologien ait pu soutenir une chose pareille. On peut même citer d’autres textes, encore plus éloquents, dans la distinction 43 de l’Ordinatio I : « Est absolument impossible ce à quoi l’être répugne par soi, et ce qui premièrement de soi est tel que l’être lui répugne, et non par un quelconque rapport Dieu, affirmatif ou négatif ; et même, l’être lui répugnerait, si par impossible Dieu n’existait pas »14. Réponse cinglante de Descartes, dont Scot pourrait donc être une cible éminente : « Il ne faut pas dire que si Deus non esset, nihilominus istae veritates essent verae ; car l’existence de Dieu est la première et la plus éternelle de toutes les vérités qui peuvent être, et la seule d’où procèdent toutes les autres »15. En critiquant donc l’idée que la vérité ou la possibilité ne dépendent pas de Dieu, Descartes atteindrait de plein fouet la proposition qui est à la fois la plus paradoxale, sous la plume d’un théologien, et une des plus caractéristiques, semble-t-il, de l’école scotiste. Aussi Gilson pensait-il qu’il fallait réécrire son opus de jeunesse, La liberté chez Descartes et la théologie (1913), en fonction de ce fait « nouveau » (à l’époque de son Duns Scot, en 1952)16. Cela dit, l’énoncé (si Deus non esset…), tel quel 13 14
15
16
Ord. Prol. p. 2 q. 3 n. 98 : E. Gilson, Jean Duns Scot, 185. Ord. I d. 43 q. un. n. 5 : « Illud ergo est simpliciter impossibile cui per se répugnat esse, et quod ex se primo est tale quod sibi répugnat esse, — et non propter aliquem respectum ad Deum affirmativum vel negativum ; immo repugnaret sibi esse, si per impossibile Deus non esset » (Voir Hoffmann, Creatura intellecta, 198). Sur la généalogie de cette formule, voir Boulnois : « Si Dieu n’existait pas », 50-74. Descartes à Mersenne, « 6 mai 1630 «, AT I, 149, 30 – 152, 4. Derechef, on peut trouver chez Duns Scot l’affirmation que la « première vérité » n’est pas telle naturaliter pour l’intellect créé, du moins n’est-elle pas première selon l’ordre suivi dans la connaissance naturelle (Quodl. q. 14. n. 14 : « unumquodque verorum esse tale propria sibique intrinseca ac proportionata veritate, secundum gradum essendi, et non veritate divina, nisi secundum participationem et effectivam causalitatem ; sicuti in simili dictum fuit de bonitate, q. 6. Art. 4. Nam veritas prima et infinita nullum ordinem naturalem dicit ad intellectum creatum »). Il faut rappeler ici que Descartes définit expressément l’objet de la métaphysique comme « en général [la science] de toutes les premières choses que l’on peut connaître en philosophant » (à Mersenne, AT III, 235,17-18). Sur la priorité de l’idea entis infiniti : AT VII, 45,28 : « [...] ac proinde priorem quodammodo in me esse perceptionem infiniti quam finiti, hoc est Dei, quam mei ipsius ». Sur cet élément historiographique important, voir Marion, Théologie blanche, 62, n. 22. Indépendamment de Gilson, le rapprochement avec Duns Scot avait été fait de manière allusive par Gueroult, Ordre des raisons, I, 24, qui jugeait la position cartésienne de 1630 « très proche de Duns Scot », bien que, avec Bréhier, Gueroult reconnût que le Dieu de Duns Scot est limité par les contradictoires et que sa volonté ne crée pas les possibles ! (voir Cronin, « Eternal Truths », 553-559). Il nous semble toutefois que l’imprécision et le caractère incohérent des propos de Gueroult viennent de ce qu’il est, sur ce point, entièrement dépendant de Gilson lui-même, qui répétait les arguments de Kahl en faveur d’un Duns Scot pré-cartésien (notamment avec ce texte auquel Gilson fit un sort assez injuste, ne serait-ce que parce qu’il offre une occurrence de la formule causa sive ratio qui préfigure celle des Secundae Responsiones (AT VII, 165,2-3) : “ […] voluntas […] est immediat et prima causa, cuius non est aliqua alia causa quaerenda […] et quaerere huius propositionis – licet contingentis immediate – causam, est quaerere causam sive rationem cujus non est ratio quaerenda ”. (Ord. II d. 1 q. 2. n. 9 : Gilson, La liberté, 143).
La création des vérités éternelles
123
et décontextualisé, peut passer pour un paradoxe suicidaire dont on voit mal l’usage qu’on pouvait faire en théologie. Quelle raison pouvait-on avoir, en théologie, de faire l’hypothèse que Dieu n’existe pas? Il faut, pour faire la généalogie de cet énoncé, revenir au texte fondamental d’Aristote, Métaphysique E, 1, qui établit la nomenclature des sciences théorétiques (métaphysique, physique, mathématique). Dans ce texte, dont la dimension aporétique et problématique ne doit pas échapper, tout le raisonnement aristotélicien est hypothétique (1026a10) : s’il existe une substance séparée et immobile, il revient à une science distincte de l’étudier. C’est la philosophie première, science qui est dite ici « théologique », ce qui ne signifie pas nécessairement que la philosophie première soit la théologie, de même que, lorsqu’on dit que la physique est une science mathématique, cela ne signifie pas que la physique est la mathématique. Le dernier paragraphe de E, 1, envisage les deux types de substance (matérielle, immatérielle), et, sans évoquer un seul instant la possibilité que la première n’existe pas — ce que fait précisément Descartes, dès la Meditatio prima —, il envisage que la seconde n’existe pas (1026 a 28) : « S’il n’y avait pas d’autre substance que celles qui sont constituées par nature, la physique serait la science première »17. Cette éventualité n’est pas si simple, et ne signifie pas, unilatéralement et sans plus, que le savoir se ramènerait à deux sciences théorétiques, la physique et la mathématique, puisqu’en effet les substances séparées ne sont pas l’objet premier de la métaphysique, qui étudie d’abord les termes transcendantaux (ens, unum, verum, bonum…) ; mais cette partie générale d’une métaphysique amputée de sa partie spéciale n’aurait peut-être pas suffisamment d’ampleur pour se distinguer de la physique et constituer par elle-même une science autonome. L’ouvrage scolaire de B. Perera, De communibus rerum omnium naturalium principiis et affectionibus (1576), qui défend et illustre, chez les Jésuites, la primauté de la métaphysique sur toutes les autres sciences spéculatives18, mentionne ici l’opinion de « certains scotistes », qui écartent les intelligences de l’objet de la « métaphysique », pour mieux faire apparaître sa nature de science transcendantale des caractères les plus généraux de l’étantité19 : « Si on leur demande la raison pour laquelle [les scotistes] ont passé sous silence la substance incorporelle, et par exemple Dieu ou les intelligences, ils répondent qu’une telle substance n’est pas naturellement ni scientifiquement connaissable pour nous selon sa nature propre et ses propriétés (propriam naturam et proprietates ejus), mais qu’elle l’est seulement d’après les propriétés communes qui sont celles de l’étant et de la substance (proprietates communes entis et substantiae)20. » 17
Aristote, Métaphysique, Tricot, I, 334. En critiquant la scientificité des mathématiques, que, du côté scientifique (essentiellement Clavius), on considère comme un parangon de scientificité. 19 Duns Scot, Met., Prol. 5, OPh., « Igitur necesse est esse aliquam scientiam universalem, quae per se consideret illa transcendentia, et hanc scientiam vocamus metaphysicam, quae dicitur a meta, quod est trans, et physis, scientia (sic !), quasi transcendens scientia quia est de transcendentibus ». Sur la définition de la métaphysique comme science transcendantale, voir Honnefelder, La métaphysique, 36. 20 Nous citons d’après Courtine, Suarez, 450 et 463. Duns Scot s’opposait à la thèse aver18
124
Édouard Mehl
Jamais les « scotistes », évidemment, n’ont voulu nier l’existence de Dieu, puisqu’ils assignent au contraire à la métaphysique la tâche de démontrer l’ens infinitum, alors que la physique ne démontre dans le meilleur des cas qu’un « premier moteur ». On sait comment le XIIIe siècle, à la suite d’Avicenne, a exclu Dieu du sujet de la métaphysique dans l’unique but de mieux pouvoir l’y démontrer21. Il n’était pas évident que le texte d’Aristote pût jouer ce rôle sans difficulté, et le XIIIe siècle aurait donc pu s’en détourner au profit d’un augustinisme (éventuellement avicennisant) très éloigné de l’epistémè aristotélicienne ; mais, curieusement, la recherche d’une démonstration métaphysique de l’existence de Dieu a présidé à la relecture et la réinterprétation du corpus aristotélicien, pour y créer là cette possibilité qu’il ne semblait pas offrir, du moins pas de manière évidente. L’idée de Dieu, premier objet de la métaphysique Cela dit, l’ens infinitum auquel aboutit la scientia entis n’est pas Dieu en personne : il s’agit du plus haut concept naturel de l’intellect, qui ne nous fait pas connaître Dieu sub ratione Deitatis, mais seulement Dieu sous la ratio entis22. Le strict partage entre théologie et métaphysique implique que la connaissance de Dieu par la raison naturelle, et sans « illumination spéciale », est incapable d’envisager Dieu directo aspectu, comme c’est le cas dans la vision des bienheureux, et encore moins capable de saisir Dieu sub ratione deitatis, c’està-dire comme il se connaît lui-même. En termes spinozistes, la connaissance métaphysique est une connaissance du deuxième genre, la connaissance théologique est la connaissance du troisième genre. L’énoncé paradoxal (« si Dieu n’existait pas, il serait vrai que trois et deux font cinq ») est donc un énoncé philosophique, tel que peut en proférer l’intellect viateur, qui rend évident
21
22
roïste selon laquelle la connaissance des substances séparées n’est pas impossible mais seulement « difficile » et malaisée, comme il est difficile aux oiseaux de nuit de voir en plein jour, et ce avec un argument finaliste dans lequel Duns Scot voyait une fallacia consequentis : ce n’est pas parce que ces substances seraient inconnues de nous qu’elles existeraient ociose et frustra : elles peuvent très bien n’être connues que d’elles-mêmes ! Voir Zimmermann, Ontologie, montrant comment ce raisonnement est devenu topique. Voir également Noone, « Albert the Great’s conception of metaphysical knowledge », 686. La déclaration d’Avicenne est la suivante : « Je dis donc qu’il est impossible que Dieu lui-même soit le sujet de cette science, car tout sujet est d’une science est une chose dont on accorde l’être (res quae conceditur esse), et la science elle-même ne recherche que les dispositions de son sujet ; ceci est connu par d’autres lieux. Mais il ne peut être accordé que Dieu soit dans cette science en tant que sujet, car il est plutôt recherché en elle » (Philosophia prima, 4). Il faut noter ici que la ligne thomiste (Cajetan, Suárez) tend à affaiblir la rigueur de l’énoncé interdisant à une science de démontrer son objet, car « Cum autem dicitur scientiam supponere suum obiectum esse, intelligitur per se loquendo, ut notavit Caietanus, I p., q. 2, a. 3 ; per accidens vero non inconvenit scientiam aliquam demonstrare quoad nos obiectum suum » (Suárez, Disputationes Metaphysicae, I, III, 14) Demange, La théorie du savoir, 354-355.
La création des vérités éternelles
125
que les essences exprimées par les propositions mathématiques, et les termes transcendantaux (verum) sont, de son point de vue, indépendants d’une existence qui ne les fait pas connaître, mais qu’ils font connaître, eux. Chez Descartes, la critique et le déni d’indépendance aux vérités dites éternelles, se retourne en un énoncé spectaculaire et original concernant leur création : « les vérités mathématiques, lesquelles vous nommez éternelles, ont été établies de Dieu & en dépendent entièrement, aussi bien que tout le reste des créatures » (AT I, 1457-10), « car il est certain qu’il est aussi bien auteur de l’essence comme de l’existence des créatures » (AT I, 1522-3). Le jugement paraît sans appel, si ce n’est que c’est que Duns Scot lui-même avait déjà énoncé des réserves quant à l’appellation de « vérités éternelles », selon l’habitude des augustiniens : l’éternité s’entend seulement de l’existence, or les vérités éternelles ne concernent pas l’existant, donc ces vérités ne sont éternelles que secundum quid23. En tous les cas, et quelle qu’en soit la cible, la critique cartésienne est indissociable de l’affirmation de l’existence divine et du Deus auctor essentiarum comme première vérité, vérité susceptible d’une démonstration potissima, et d’une certitude éminente24. Chose sans doute surprenante de la part d’un mathématicien qui s’occupe surtout d’optique, de physique, et se moque des « disputes » philosophiques. On imagine sans peine que, au XVIIe siècle, l’énoncé mis en cause peut fort bien servir à des fins auxquelles Duns Scot n’avait jamais songé : dispenser la science mathématique de toute nécessité d’une fondation métaphysique, l’affranchir de son aliénation à la métaphysique, c’est-à-dire à la philosophie de l’École. En tous les cas, la réaction de Descartes, qui juge ces énoncés inconvenants, blasphématoires (AT I, 14926), et donc condamnables, constitue une réaction théologique qui vise l’intrusion, dans le discours théologique, ou prétendu tel, d’un point de vue inconséquent et inconscient du fait qu’il offre une justification inattendue au discours de l’athée. Descartes ne vise d’ailleurs pas au premier chef une doctrine constituée et identifiable, ni Duns Scot, ni Vázquez, ni Duns Scot sous l’apparence de Thomas dans les Disputationes de Suárez, mais d’abord une « manière de parler » : celle du vulgaire qui, lorsqu’il parle de Dieu « l’imagine presque toujours ainsi qu’une chose finie » (14618-19), ou bien celle des athées qui, « parce qu’ils comprennent parfaitement les vérités mathématiques, et non pas celle de l’existence de Dieu […] ne croient pas qu’elles en dépendent ». En 1630, la première marque et le premier caractère du divin, c’est bien l’infini, mais c’est l’infinité d’une « puissance incompréhensible » en laquelle voir, vouloir et faire ne se distinguent pas, pas même par une distinction de raison qu’y introduirait l’entendement humain. 23
24
Ord. I d. 3 p. 1 q. 4 n. 262, ed. Vat. E. Gilson avait signalé ce texte, sans rapprochement explicite avec Descartes (Jean Duns Scot, 568), bien que l’affirmation que « l’existence de Dieu est la plus éternelle des vérités qui peuvent être » soit absolument cohérente avec cette affirmation scotienne. Descartes à Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 144, 13-17 : « au moins pensé-je avoir trouvé comment on peut démontrer les vérités métaphysiques d’une façon qui est plus évidente que les démonstrations de géométrie ».
126
Édouard Mehl
La promotion ultérieure de l’ens infinitum en premier nom métaphysique de Dieu, dans la Troisième Méditation, pourrait donc bien faire songer à une certaine proximité de Descartes avec Scot25, à condition de ne pas oublier que, pour le second, la lumière naturelle n’atteint Dieu que par des raisons générales, et comme entachées par la confusion intrinsèquement liée au concept d’ens, dont celui d’ens infinitum est une espèce. Au contraire, Descartes affirme que l’existence même de Dieu se découvre à la lumière naturelle, mais sans ombre, sans le vague attaché à la notion générale de l’être, et avec la même clarté et distinction qui me fait connaître l’étant en tant que je le suis, l’ens sous la figure précise du ille quod sum. Mettre l’ego sum à la place du concept d’étant (ou, si l’on préfère, l’égologie à la place de l’ontologie), ou bien mettre un nom propre sur le concept anonyme d’ens, ne fait pas une mince différence, et la métaphysique de Descartes ne se borne pas à réciter une ontologie à la première personne. De l’ontologie scolaire à la protologie cartésienne, il n’y a qu’une relation de dissymétrie. D’abord parce que la division scolaire de la métaphysique, en train de s’imposer, en une partie générale (ontologique) et une partie spéciale (théologie, noologie, cosmologie) est ici brouillée et subvertie ; même, suivant l’hypothèse herméneutique de Courtine, dans le prolongement du dispositif proposé par Marion (Sur l’ontologie grise de Descartes), qui consisterait à exporter l’ontologie (ou l’épistémologie générale qui en tient lieu) dans les Regulae, on se trouve toujours confronté, avec Descartes, au constat qu’il n’y a aucune science générale de l’être, que toute question de l’être est pour ainsi dire superflue, comme peut l’être une question qui est toujours devancée par sa réponse. Descartes est le premier philosophe moderne qui, sans renoncer à la constitution d’une « métaphysique » ou « philosophie première », ait explicitement renoncé à donner à cette science l’objet et le thème qui devaient, de Scot à Suárez, occuper et justifier la métaphysique : l’étant, ou le concept (anonyme) d’étant. Avec Descartes, la philosophie commence sans qu’aucun « objet » (subjectum) lui soit encore donné, par la mise en suspens de tout objet, et par le congé donné à ce qui fait l’objet traditionnel de la métaphysique : l’être en général. La question la plus fondamentale, pour Descartes, n’est certainement pas « qu’est-ce qu’il y a ? » mais serait plutôt « qu’est-ce qu’on voit ? ». Par ailleurs, la partie « générale » de la métaphysique cartésienne, loin d’être exportée dans les Regulae et assumée par la mathesis universalis de la Règle IV, s’inscrit parfaitement dans le corps et l’itinéraire des Meditationes, au titre de la recherche et la conquête d’une règle générale de vérité : il n’y a, en règle générale, de res vera et vere existens qu’en tant que nous en avons une idée claire et distincte, à l’instar de cette idée qui me fait connaître cette chose q ue je 25
Voir encore Marion, Sur le prisme métaphysique, 265-262. Des rapprochements suggestifs entre Descartes et Duns Scot (sur la connaissance intuitive, le lexique de la clara et distincta perceptio, et l’innéité de l’idea dei) ont été également faits par Scribano, Angeli e beati, 119-160. Dans le même sens d’un Descartes scotiste, mais sur d’autres aspects (la relativité de l’espace et du temps) : Ariew, « Descartes and the scotists », 55-56.
La création des vérités éternelles
127
suis26. L’ontologie des scolastiques est ici remplacée, précédée et fondée par une théorie générale de l’idée vraie dont le prototype est l’idea mei ipsius, celle-ci étant comme une pièce dont l’autre face est l’idea entis infiniti27. Ensuite parce que, entre Duns Scot et Descartes, la différence l’emporte, eu égard à la certitude de la connaissance métaphysique, qui, ancrée dans l’évidence indéfectible de l’existentia mei ipsius, chez Descartes, ne laisse rien à désirer de plus ni d’autre que ce qu’elle offre : la contemplation du vrai Dieu, et de sa divine majesté, contemplation qui donne en cette vie (in hac vita, AT VII, 5219), le plus grand plaisir qui se puisse concevoir (maxima […] voluptas, 5220), et constitue l’absolution de la finitude, dès lors qu’elle se sait ne dépendre que de cet être infini. Les dernières lignes de la Meditation III, qu’on lit souvent comme un moment d’enthousiasme un peu rhétorique, interviennent de manière précise dans le débat qui oppose Scot et Henri de Gand sur la capacité de l’intellect in via à percevoir la « lumière incréée » en laquelle nous connaissons toutes choses — sans la connaître en elle-même ajoutait Henri28. Dans le débat qui l’oppose à Henri, Scot a affranchi la notion de vérité de la référence aux idées exemplaires, et, partant, à la causalité divine. L’intellect créé ne voit pas la vérité en Dieu, mais en lui-même. À tout le moins perçoit-il une évidence qui se présente par définition comme une propriété intrinsèque des termes et des relations qui les unissent. La contingence de l’intellect créé ne lui interdit nullement d’accéder à la connaissance « certitudinale », qui lui est naturelle : c’est une certitude qu’il peut avoir aussi bien vis-à-vis des premiers principes, que vis-à-vis de ses actes propres. Ici, le travail de Scot s’inscrit pleinement dans la lignée d’un débat, au cœur de l’école franciscaine, sur l’interprétation d’Augustin, et d’un platonisme soupçonné de mener au scepticisme. C’est ce débat que reprend Descartes quasi mot pour mot dans les Meditationes, lorsqu’il est question de la vérité et de la certitude de la connaissance sensible. « Il me semble que je vois ou que j’entends [Videtur mihi quod videam, vel audiam […], là où pourtant, je ne vois ni n’entends. Il n’y a donc pas de certitude à cet égard », dit Henri29. Descartes objecte qu’il s’agit peut-être d’un semblant, mais très vrai et très certain : certe videre videor, audire, calescere. Hoc falsum esse non potest […] (AT VII, 2915-16). Descartes s’entendrait donc avec Scot pour rejeter l’explication henricienne de l’incertitude des sens, qui oublie la certitude du sentir en tant que mode de la cogitatio, ou pour parler comme Scot en tant qu’acte propre dont nous avons une connaissance 26 27
28 29
Sur la déduction de la res cogitans à partir de l’axiome ontologique « ex nihilo nihil fit », voir Principia Philosophiae, I, art. 11. Jusqu’à plus ample informé, l’école scotiste n’a jamais réservé le nom d’idée aux seuls actes de la res cogitans, c’est pourquoi, comme le note Olivo (Descartes et l’essence de la vérité, 289-290), la mise en évidence d’antécédents scotistes à la doctrine de l’esse objectivum (Cf. Courtine, « La doctrine cartésienne de l’idée », 1-18) achoppe sur cette nouveauté essentielle : pour Descartes, l’idée n’est rien d’autre que la res cogitans, et, à proprement parler, Dieu n’a pas d’idées. Ord. I d. 3 p. 1 q. 4. Ibid., n. 254.
128
Édouard Mehl
certaine. Sans s’en rendre compte, Henri traîne Augustin du côté d’Héraclite. Mais jamais Duns Scot n’a mis la certitude des actes propres au rang et à la place de la certitude des premiers principes, ni fait de l’existentia mei ipsius le patron et le parangon de toute certitude. La vérité comme évidence et la critique de l’exemplarisme Le relativisme est le risque encouru, selon Scot, à soutenir que la « vérité » n’est pas une propriété intrinsèque à la chose connue, mais une propriété extrinsèque, à savoir la conformité de cette chose à son exemplaire divin, si bien que la vérité des choses créées ne peut se voir que « dans » la lumière éternelle, sans d’ailleurs qu’on voie cette lumière elle-même, lux increata, ratio cognoscendi incognita30. La définition exemplariste de la vérité pèche de multiples manières, et d’abord, estime Scot, parce qu’elle s’applique à toutes choses à une exception près : Dieu lui-même, dont la vérité ne se définit par sa conformité avec un exemplaire. Autre argument : les vérités accessibles à l’intellect humain ont plus ou moins d’évidence. Ramener la vérité aux exemplaires, et donc dire que Dieu est la seule vérité, c’est s’arroger sur la création le point de vue indifférent de Dieu lui-même et nier le degré variable d’évidence que les choses ont pour l’intellect créé (secundum gradum essendi)31. C’est bien le fond de la critique scotiste d’Henri : il n’y a que Dieu qui connaisse les choses par son essence, et par le rapport qu’elles ont à lui. Connaître le triangle en tant qu’il participe à l’essence divine (ut quaedam participatio dei), et l’exprime à sa manière, est une manière de connaître certes plus relevée que la connaissance rationnelle du même triangle per rationem trianguli. Mais Scot n’est pas Spinoza, et le premier mode mentionné (l’essence singulière du triangle en tant qu’elle exprime la perfection de l’esse divin) n’appartient pas à l’intellect viateur, qui voit l’évidence, sans en connaître la cause divine, sans mesurer la conformité des choses à leurs exemplaires, sans mesurer nos concepts aux idées divines. Certes, Scot ne nie pas l’exemplarisme32 : il nie qu’il soit accessible à l’intellect viateur, et à sa lumière naturelle. Sur ce point, il ne faudrait d’ailleurs pas l’isoler complètement ni en faire le champion d’une révolution aussi radica30
31
32
Sur les différents aspects de l’analogie entre la lumière et la connaissance de l’intelligibilité de l’étant, voir Hedwig, Sphaera lucis, 187, qui attribue très précisément à Scot l’image de l’entendement solaire et indifférent aux objets qu’il éclaire (sicut sol est indeterminatus ad generandum multa) que Descartes attribue à la sapientia humana de la Règle I (AT X, 360,7-12). Coll. I d. 3 q. 4 n. 2 : « Deinde falsum putamus veritatem in rebus esse per conformitatem ad divinum intellectum, seu ad exemplaria in illo existentia ; quia, ut dictum fuit art. 1., haec veritatis ratio non congruit ipso primo principio, Utique verissimo, quippe quod sit veritas per essentiam […] imo haec (sc. veritatis ratio) statuenda videtur in ratione sui manifestativa ». Voir cette formule caractéristique : « Quamvis igitur omnia vera sint talia per participationem Veritatis increatae, attamen non sunt formaliter et intrinsece vera per illam, sed per propriam et proportionatam veritatem, pro ratione scilicet entitatis, ipsis ab illa communicatam et participatam » (Ord. I. d. 1 q. 4 n. 17).
La création des vérités éternelles
129
le qu’elle est singulière. Il est en fait très proche d’un Matthieu d’Aquasparta, qui assigne pour objet à la connaissance humaine des essences indifférentes à l’existence, et qui, sans nier l’exemplarisme, tend à le réserver au domaine de la connaissance théologique et parfaite33. Il faut, pour l’un comme pour l’autre, trouver un certain équilibre entre la position théologienne (il n’y a de vérité qu’en Dieu et par lui) et celle des philosophes (il y a des vérités nécessaires, indépendamment de toute existence, y compris celle de Dieu) ; tous deux s’accordant à reconnaître que la première, mal comprise, conduit au scepticisme : « La position des anciens académiciens [sc. Platon & alii, selon qui toutes choses sont vraies et certaines mais dans le monde intelligible] est rendue invraisemblable par l’expérience. Nous faisons l’expérience que nous ignorons maintes choses, et que nous doutons de maintes choses. Et ils furent trompés par cela même qu’ils posèrent cette lumière éternelle ou ces raisons immuables comme la pure, seule et entière (nudam, totam et solam) raison de la connaissance. Si en effet cette lumière était la pure raison de connaissance, la connaissance dans la voie ne différerait pas de la connaissance dans la patrie ; si elle était toute la raison de connaissance, la connaissance dans un genre propre ne différerait pas de la connaissance dans le Verbe, ni la connaissance philosophique de la connaissance prophétique, ni la recherche de la révélation ».
Matthieu objecte qu’il y a des vérités évidentes en lesquelles l’intellect ne peut se tromper, et qui ne semblent pas requérir l’illumination par des raisons éternelles, comme le montre Augustin : « si fallor, sum. Igitur […] in eo quod me novi esse, non fallor ». Duns Scot et Matthieu ne se distinguent guère, si ce n’est que le premier rabat plus strictement les vérités « éternelles » sur de simples vérités d’entendement, dont l’être objectif est indépendant de la réalité formelle de la chose représentée. À partir de cette position scotienne, qui, rappelons-le, est indissociablement liée à la méditation sur la finitude de la raison humaine, deux voies s’ouvrent à la postérité scotiste : l’une suit la pente de l’univocité, et soumet la science divine, comme celle de toute intelligence, à l’indépendance des essences. L’autre consiste à maintenir la différence entre connaissance humaine de la vérité (par l’évidence intrinsèque de son objet) et connaissance divine (de tout étant, et de toute essence comme participation de la sienne). Ces deux voies tendent à devenir incompatibles, contradictoires, et exclusives 33
Voir la Quaestio disputata secunda de Matthieu d’Aquasparta : Utrum ad cognitionem rei requiratur ipsius rei existentia, qui d’ailleurs mentionne la position augustinienne selon laquelle « veritate prima desistente per impossibile, non maneret veritas in rebus » (« si par impossible la première vérité venait à manquer, il ne demeurerait aucune vérité dans les choses », 119). Matthieu considère que la relation des concepts à l’exemplaire éternel n’est pas nécessaire pour constituer la ratio objecti, du moins une raison suffisante et congruente, mais qu’il s’agit là d’une manière incomplète de voir la vérité et la perfection de cette ratio objecti, qui inclut nécessairement, elle, le rapport à l’exemplaire, donc aux idées divines. La lecture proposée par A. de Libera, La querelle des universaux, 312-321, s’en tient à la position philosophique que Matthieu juge « cohérente » mais sans plus.
130
Édouard Mehl
l’une de l’autre. C’est ce qui oblige Descartes à la réaction que l’on sait, mais dont la portée pourra encore être précisée en tenant compte de l’alternative qui lui fait face, et qu’il semble refuser en bloc. C’est chez Mersenne qu’il la rencontre. Mersenne scotiste? Signalons ici trois textes de Mersenne : les deux premiers, antérieurs à 1630, sont tirés des Quaestiones celeberrimae in Genesim (1623) ; le troisième, est un texte de quelque peu ultérieur à l’échange avec Descartes : il s’agit de la réponse que Mersenne donne à la question épistolaire que le médecin hollandais van Beverwyjck pose aux savants et aux théologiens de son temps(« Si le terme de la vie est fatal, ou bien si l’art humain peut en disposer »)34. Cette ques-tion concerne plus spécialement celle, connexe, des futurs contingents, mais permet de vérifier, s’il en était besoin, que Mersenne s’obstine à soutenir que la science ne cause pas les possibles, mais qu’elle en dépend. Il assume cette position curieuse pour un théologien, selon laquelle les futurs dépendent plus de nous que de lui et de sa science, si bien qu’en pratique l’homme doit faire comme si Dieu n’avait aucune prescience, c’est-à-dire en somme comme s’il n’existait pas35. La décomposition de l’acte créateur en différents instants 34 35
Beverovicius, Epistolica Quaestio de vitae termino,1634. Mersenne à Beverovicius, juillet 1633 (Correspondance de Mersenne, III, 454-455) : « Ut ut sit, aio praevisionem Dei nihil influere in nostras actiones, aut in praesidiorum, quae ad medicis ad morbos tollendos adhibentur, effectus, sed illas supponere, neque enim Deus scit illas, nisi quia futurae sunt : tolle enim rerum, ut ita dicam, futuritionem, tolles et Dei praenotionem : quod ut melius capias, suppone quaedam rationis momenta, quae ad ingenii levandam imbecillitatem, in rebus divinis solemus astruere ; itaque primo momento aeternitatis Deus vidit omnia, quaecunque possibilia sunt simul et impossibilia absque ullo ordine ad decreta divina, in quo quidem momento si stitisset, nihil futurum erat, eodemque vel secundo momento, vidit hoc aut illud in vita hominum possibile futurum, si quae fierent hoc vel illo tempore, cumque his & illis temperamentis & aliis circumstantiis, nec dum tamen quidpiam agebat, neque propterea quidquam pendebat a deo, tametsi quaelibet eo modo futura essent, si quando vellet illa extra causas existentiae beneficio petere. Praetera non ita futura videbat, ex eo quod ita futura vellet, cum illa praevisio voluntatem antecedat. Igitur secundo vel tertio instanti decrevit se facturum non omnia quidem illa possibilia sive absoluta, sive conditionata, sed aliqua, puta Johannem cum hoc et illo temperamento, in hac vel illa regione, &c, cui omnia contingent, prout ante dei decretum, futura erant, qui solummodo ponuntur actu, quae jam erant dunamei. Igitur nihil confert ad rem existentem, neque ad illius actiones aut passiones Dei praescientia, quippe quas non infert [...]. Uno verbo, debent homines juxta lumen rationis & religionis suos omnes motus peragere, ac si Deus nil praevidisset, cum illa praevisio nil in ulla re statuat, sed illam supponat. Neque decrevit de vitae longiquitate aut brevitate, nisi per haec aut illa futura remedia, quae medicus subministrat. Quid tua interest, dummodo leges providentiae nobis statutas sequaris? Igitur remedia producunt vitam, quid tum, si Deus praevidit & voluit istam productionem? An minus producitur vita, vel etiam magis, quam si non praescivisset? ». Sur la décomposition en instants de la création, voir Coll. d. 35 q. un. n. 10 (Gilson, Jean Duns Scot, 282).
La création des vérités éternelles
131
idéaux (et partant en différentes instances indépendantes) semble directement inspirée de Duns Scot. Les Quaestiones in Genesim constituent un gigantesque pêle-mêle, où des exposés généraux d’optique, d’astronomie et de musique servent d’argument apologétique en faveur de la causa dei, voire d’éléments démonstratifs pour la constitution d’une des quelque quarante preuves de l’existence divine que Mersenne oppose aux athées36. Le premier texte, sur lequel J.-L. Marion avait attiré l’attention dans la Théologie Blanche, montre assez clairement que Mersenne adopte la position incriminée par Descartes : Dieu est naturellement soumis à la considération des possibles, « parce qu’ils sont nécessaires, éternels, et que, comme disent d’autres auteurs, (ut alii loquuntur) les choses sont possibles de soi, indépendamment de toute cause (ex se, independenter), en vertu de la connexion ou encore de le non contradiction des termes qui concernent la nature d’une chose »37. J.-L. Marion repérait ici la thèse de Suárez et Vázquez, mais il est sans doute possible d’inclure les scotistes parmi les alii, qui soutiennent l’indépendance de la possibilité, du moins la possibilité logique qui n’est pas mesurée par la puissance divine. L’autre texte qu’il faut ici examiner affirme aussi bien l’indépendance de la possibilité : « Toutes les choses, donc, qui n’impliquent pas contradiction sont contenues sous ces possibles. Quant à celles qui impliquent contradiction, elles ne sont pas contenues dans la toute-puissance divine, puisqu’elles ne peuvent avoir la raison de possibles (quia non possunt habere possibilium rationem). Raison pour laquelle il vaut mieux dire qu’elles ne peuvent être faites, plutôt que de dire que Dieu ne peut les faire. »
Poursuivons la lecture de ce paragraphe, qui n’est en fait qu’une citation littérale de la Summa Theologiae thomiste (Ia-Iae, q. 25, a. 3, resp.)38, et le commentaire, qui sous couvert d’une simple précision terminologique à propos du terme « possible », fait une concession de taille, où l’empreinte de la théorie scotiste peut se faire reconnaître : « Il convient de remarquer avec Cajetan qu’ici le terme de non contradictoire ou de possible s’entend seulement comme causable, car, encore que Dieu soit un être qui, non content d’être non-contradictoire, est aussi la vraie cause pour laquelle les autres étants n’impliquent point contradiction (encore que, dans le statut actuel, nous puissions à peine le concevoir, du fait que nous concevons les essences actuelles réales de toute éternité, ou non contradictoires par soi, comme indépendantes de toute cause, tant efficiente qu’exemplaire) pourtant, Dieu n’est pas possible (c’est-à-dire causable), puisqu’il est par soi39. » 36 37 38
39
Armogathe, An Deus sit, 161-170. Carraud : « Mathématique et métaphysique », 145-159. La source thomiste est citée un peu plus haut (col. 332), mais fautivement. Dans l’ex. corrigé par Mersenne (Mazarine), le lieu thomasien est corrigé « Recte D. Tho. Q. 25 primae partis a. 3 […] ». Gilson, citant ce texte dans La liberté cartésienne, 149-150, n’en identifie pas le lieu, bien qu’il signale que cette position reproduit fidèlement « dans l’esprit et dans la lettre, la position de saint Thomas à laquelle Descartes va s’opposer ». Mersenne, Quaestiones in Genesim, col. 332-333 (tr.).
132
Édouard Mehl
Mersenne pointe ici une difficulté et comme une espèce d’antinomie de la possibilité : si possible signifie causable, cela signifie que tout possible est pensé dans sa dépendance à l’égard de sa cause, mais comme la possibilité (logique) est appréhendée comme possibilité par soi, indépendamment de toute cause, l’humaine raison tombe dans une contradiction insurmontable, puisqu’il lui faut penser le même possible comme indépendant en soi, et dépendant au regard de Dieu. Contradiction inévitable et insoluble pro hoc statu, dit à peu près Mersenne, qui n’affirme donc pas, unilatéralement l’indépendance des possibles, mais l’indépendance des possibles pour l’intellect créé qui ne peut voir simultanément, c’est-à-dire comprendre, l’indépendance logique et la dépendance causale. De ce fait, la seule possibilité qui s’offre à lui de résoudre cette contradiction est d’en disjoindre les termes : l’entendement métaphysique ne connaît que l’indépendance logique et la théologie affirme la dépendance causale. Or cette position redéploie les arguments du Docteur subtil, qui, on l’a vu, considérait que la conjonction des prédicats ex se et ex alio n’entraîne pas de contradiction, du fait qu’ils indiquent deux causes de genre différents. C’est donc la diversité du « genre de cause » (ici la cause formelle, là la cause effective) qui permet d’éviter la contradiction (Ord. I d. 2 p. 2 q. 1-4 n. 259). On comprend donc pourquoi Mersenne demande à Descartes « en quel genre de cause » il entend que Dieu a disposé les vérités éternelles, et pourquoi Descartes répond, avec la fausse naïveté dont il est coutumier : ut totalis et efficiens causa. On peut interpréter la doctrine cartésienne de la création des vérités éternelles comme une tentative inédite de produire une autre solution, qui consiste à rapatrier la causalité des « vérités éternelles », devenues des idées (en tant qu’elles sont mentibus nostris ingenitae), dans l’orbe de la métaphysique et de la lumière naturelle : la causalité des vérités éternelles est certes « incompréhensible », mais elle n’en est pas moins évidente pour autant. Dès lors, l’exigence universelle de la cause n’est donc plus un impératif théologique qui s’impose à tout (excepté celui qui l’exerce), mais un réquisit fondamental dont tout étant, et même tout aliquid se trouve justiciable : « même » et d’abord les idées40. Aussi y a-t-il un lien direct entre la causalité « efficiente et totale » à l’égard des vérités éternelles et la théorie cartésienne de la causalité de l’idée dans la Méditation III. Les vérités éternelles (s’il convient d’appeler ainsi les premiers éléments de la raison humaine) ont bien une cause, et c’est leur parfaite intelligibilité qui le prouve : le fait que nous les comprenions parfaitement (leur évidence intrinsèque) n’implique pas leur indépendance ontique et logique, mais c’est au contraire le signe certain de leur finitude et donc d’un certaine déficience : « […]ils [les athées] devraient juger que Dieu est une cause dont la 40
Primae Responsiones, AT VII, 112, 3-8, où l’axiome est dit « per se notum » ; la traduction ajoute « une chose connue de soi, et qui n’a pas besoin de preuve » (AT IX-1, 89) ; voir Carraud, Causa sive ratio, 267. Mais dire que l’exigence de cause est un axiome de la lumière naturelle qui s’applique premièrement aux idées, c’est indiquer clairement le statut catégorial de la causalité, et c’est sans doute par là que Descartes est le plus novateur.
La création des vérités éternelles
133
puissance surpasse les bornes de l’entendement humain, & que la nécessité de ces vérités n’excède point notre connaissance, qu’elles sont quelque chose de moindre, & de sujet à cette puissance incompréhensible » (AT I, 15018-22). C’est peut-être là que, pour la première fois, Descartes aborde la problématique de la réalité objective et de l’esse diminutum41 (« quelque chose de moindre » !), ce qui confirmerait qu’il y a bien, en 1630, une première confrontation critique avec le scotisme, qui pour être critique n’en est pas moins approfondie et féconde, puisqu’elle mène Descartes au seuil de la question centrale dont dépendent les Meditationes : comment une idée fait-elle connaître sa cause ? La réponse n’est pas encore claire, en 1630, ni même l’éventualité que les idées n’aient pas d’autre cause que l’ego lui-même, éventualité qu’il est nécessaire d’envisager pour montrer que seule l’idea dei y résiste absolument. Entre 1630 et les Meditationes, l’idée a tellement étendu son empire, que l’impossibilité de l’inexistence divine s’est entièrement reportée sur l’impossibilité que son idée ne manifeste rien de réel : « […]quamvis forte fingi possit tale ens non existere, non tamen fingi potest ejus ideam nihil reale mihi exhibere[…] »42. Où il se confirme, comme on le suggérait plus haut, que « ens » et « verum » sont maintenant des propriétés de l’idea, et que l’ontologie des Meditationes, ou ce qui en tient lieu, se trouve en fait dans la théorie générale des ideae distribuées en « certains genres » (« prius omnes meas cogitationes in certa genera distribuam […] », AT VII, 3630-371). Cette entreprise met en œuvre un projet dont la conception remonte aux années 1628-1630, c’est-à-dire au moment des Regulae : projet de « dénombrer toutes les pensées des hommes, et[…] les mettre par ordre[…] qui est à mon avis le lus grand secret qu’on puisse avoir pour acquérir la bonne science »43. Or l’ordre veut que l’on commence par l’« âme raisonnable, pour ce que c’est en elle que réside toute notre connaissance »44. Gibieuf “ scotiste ” ? L’historiographie récente a montré la nécessité de réinterroger la place de Duns Scot dans le développement de la philosophie à l’époque moderne. L’essai de cartographie du scotisme de J. Schmutz a montré qu’on ne peut faire abstraction du scotisme (et des controverses scotisme / thomisme) si l’on prétend s’intéresser au rapport qu’entretient la philosophie classique avec la « scolastique ». C’est tellement vrai que la réciproque l’est aussi : on ne peut pas faire abstraction des philosophies classiques pour répondre à la question « qu’est-ce qu’un scotiste ? », encore qu’elles-mêmes ne l’aient peut-être jamais posée ; et encore que, comme le notait Deleuze, Spinoza n’ait vraisemblablement jamais lu Duns Scot, ce qui pourrait aussi être le cas de Descartes en 41
42 43 44
Nous renvoyons ici au travail de F. Marrone qui apporte certainement ici des éléments de continuité entre la théorie cartésienne et celle des scotistes (voir déjà Carraud, Causa sive ratio, 207 sq., n. 3). Med. III, AT VII, 46, 13-15. Descartes à Mersenne, 20 novembre 1629, AT I, 81, 11-15. La Recherche de la Vérité par la lumière naturelle, AT X, 504, 11-13.
134
Édouard Mehl
1630. Cela dit, Descartes aura pu vérifier que certaines théories scotistes exposées dans le De libertate dei et Creaturae de G. Gibieuf (1630), vont exactement dans son sens45. Et, souscrivant à l’hypothèse de Gilson selon laquelle Descartes avait trouvé en Gibieuf un interlocuteur privilégié sur des questions de métaphysique depuis 162646, nous pouvons supposer une information précise sur la pensée du Docteur Subtil, par l’intermédiaire de Gibieuf, sur la question aussi essentielle que la connexion de l’immutabilité et de la liberté dans l’essence divine (De Libertate, 38-39), ou bien sur le rôle de la « prémotion » des causes secondes par la cause première (De libertate, XVIII, 109 sq.)47. Mais le profil que montre Duns Scot chez Gibieuf est aux antipodes de celui qu’aurait l’adversaire de Descartes en 1630. En bref, il serait beaucoup trop simple de penser que Descartes a pris position contre le scotisme en 1630 : mais il y a bien, dans la formulation même des questions échangées entre Descartes et Mersenne, trace d’un conflit entre deux « scotismes » incompatibles : celui de Mersenne, des Jésuites et de la scientia media d’un côté ; celui de Gibieuf de l’autre : et c’est assurément de ce côté que penche Descartes. L’argument théologique sur lequel la physique du Monde appuie le principe d’inertie (conservation du mouvement rectiligne) semble tout droit tiré de l’enseignement de Gibieuf : « il faut dire que Dieu seul est l’auteur de tous les mouvements qui sont au monde, en tant qu’ils sont, & en tant qu’ils sont droits… Ainsi que les théologiens nous apprennent que Dieu est aussi l’auteur de toutes nos actions, en tant qu’elles sont, et qu’elles ont quelque bonté »48.
Gibieuf l’a bien dit : « […] quicquid autem essentiae et bonitatis in illis (sc. omnibus actionibus in quas incidit defectus) reperitur, id totum a prima procedere » (De libertate, I, cap. XXVI, a. 4, p. 184). Ce que Descartes entendra finalement non seulement de toutes les actions, mais aussi de tous les actes de la pensée, c’est-à-dire des idées : « tout ce qui est en nous [tr. : quicquid entis in nobis est] vient de lui [ab eo necessario procedat]. D’où il suit que nos idées ou notions, étant des choses réelles, et qui viennent de Dieu, en tout ce en quoi elles sont claires et distinctes, ne peuvent en cela être que vraies »49. Si curieux que cela puisse donc paraître, cette affirmation de la primauté divine, est historiquement « scotiste » ; mais c’est le scotisme de l’oratorien Gibieuf. 45
46 47 48 49
Gibieuf de libertate Dei et creaturae (1630). Sur la connaissance (encore incomplète, mais réelle) que Descartes a de cet ouvrage dès le début de l’année 1630, voir Robinet, Descartes. La lumière naturelle, 282, selon qui ce rapprochement avec l’Oratoire reflète « la cassure[…] nette avec l’univers des jésuites ». Gilson, La liberté, 203-206. Sur le chapitre XVIII du De libertate dei et creaturae, voir Boulnois, « Le refoulement de la liberté d’indifférence », 199-237. Le Monde, AT XI, 468-471. Discours de la Méthode, IV, AT VI, 38,20-24.
La création des vérités éternelles
135
La métaphysique cartésienne, c’est une chose avérée, et même évidente, ne se situe pas du côté de la scientia entis / scientia transcendans. C’est d’abord une question de structure et de forme. Descartes écrit des Méditations parce qu’il ne présuppose pas l’existence, l’objet et la validité de la science qu’il recherche. La métaphysique cartésienne s’organise moins sur le modèle d’une scientia entis, que d’une « chasse aux étants », donc d’un itinerarium mentis. Il s’agit en premier lieu de savoir comment atteindre ces étants qui ne sont pas donnés, mais que l’esprit possède surabondamment, s’il le veut, les moyens de connaître et d’atteindre. Les étants ne sont pas donnés, surtout pas le premier, situation que Descartes se refuse à décrire dans les termes, théologiquement connotés, de chute, de déchéance ou d’exil, mais dans le registre, plus prosaïque et expressément métaphorique, du voyageur égaré en une forêt. L’homme cartésien, en son statut actuel, n’est pas exactement expatrié et privé de la vision intuitive de l’essence divine, il est simplement désorienté, et n’a qu’à marcher droit pour arriver quelque part. Cette indétermination essentielle de sa destination et de son lieu renvoie, évidemment, à la libre détermination de la volonté. La proximité et la différence entre Descartes et Duns Scot doivent être avant tout pensées, semble-t-il, à ce niveau fondamental et pré-scientifique de ce qu’ils définissent comme le statut de l’homo viator, que Descartes, qui n’est pas théologien, s’interdit de penser à partir d’une autre condition, celle des bienheureux, dont la condition de viator serait la privation. La condition du viator, ce n’est pas la privation, ni l’aveuglement, ni l’exil, ni l’emprisonnement corporel, Mais, de toute évidence, la liberté.
136
Édouard Mehl
Bibliographie Littérature primaire Avicenne, Liber de philosophia prima, sive scientia divina, ed. S. Van Riet. Avicenna latinus, vol. 1. 4. Louvain : Peeters – Leiden : E. J. Brill, 1977. Beverovicius, Jan van, Epistolica Quaestio de vitae termino, fatali an mobili ? Lugduni Batavorum – Dordrecht : H. Essaeus, 1634. Gibieuf, Guillaume, De libertate Dei et creaturae libri duo. Paris ; Cottereau, 1630. Ioannes Duns Scotus, Coll., Gilson Ioannes Duns Scotus, Met., OPh. Ioannes Duns Scotus, Ord., ed. Vat. Matthieu d’Aquasparta : Utrum ad cognitionem rei requiratur ipsius rei existentia, aut non-ens possit esse objectum intellectus. Quarrachi : Collegium s. Bonaventurae, 1957 Mersenne, Marin, Quaestiones celeberrimae in Genesim, Paris, Sébastien Cramoisy, 1623. Mersenne, Marin, Correspondance du P. Marin Mersenne, religieux Minime, ed. Cornelis de Waard, Armand Baulieu, Bernard Rochot. Paris : Presses universitaires de France et C. N. R. S., 21969. Pererius, Benedictus, De communibus omnium rerum naturalium principiis et affectionibus libri quindecim. Roma : 1576 ; Lyon : S. a Porta, 31585. Suárez, Francisco, Disputationes Metaphysicae. Salamanca : Juan & Andrés Renaut, 1597.
Littérature secondaire Ariew, Roger, « Descartes and the scotists ». In id. : Descartes and the Late Scholastics, 39-57. Ithaca, London : Cornell University Press, 1998. Armogathe, Jean-Robert, « An Deus sit. Les preuves de l‘existence de Dieu chez Marin Mersenne », Les Études Philosophiques, 1994, 1-2, 161-170. Bardout, Jean-Christophe and Boulnois, Olivier. Sur la science divine. Paris : PUF, 2002. Biard, Joël, « La métaphysique au Moyen Âge ». InY a-t-il une histoire de la métaphysique?, ed. Yves-Charles Zarka and Bruno Pinchard, 99-117. Paris : PUF, 2005. Boulnois, Olivier, « Si Dieu n’existait pas, faudrait-il l’inventer ? Situation métaphysique de l’éthique scotiste. » Philosophie, 61 (mars 1999), Duns Scot : de la métaphysique à l’éthique, 5074. Boulnois, Olivier, Être et représentation. Une généalogie de la métaphysique à l’époque de Duns Scot (XIIIe-XIVe siècle). Paris : PUF, 1999. Boulnois, Olivier, « Le refoulement de la liberté d’indifférence et les polémiques anti-scotistes de la métaphysique moderne », Les Études philosophiques, 2002/1, 199-237. Carraud, Vincent, « Mathématique et métaphysique », Les Études Philosophiques, 1994, 1-2, 145-159. Carraud, Vincent, Causa sive ratio. La raison de la cause de Suarez à Leibniz. Paris : PUF, 2002. Courtine, Jean-François, « La doctrine cartésienne de l’idée et ses sources scolastiques ». In Lire Descartes aujourd’hui, ed. Olivier Depré et Danielle Lories, 1-120. Louvain, Paris : Vrin, 1997. Courtine, Jean-François, Suárez et le système de la métaphysique. Paris : PUF, 1990. Cronin, Thimoty J. (S. J.), « Eternal Truths in the thought of Descartes and of his adversary », Journal of the history of ideas 21: (Oct. - Déc., n° 4, 1960) : 553-559. Demange, Dominique, Jean Duns Scot. La théorie du savoir. Paris, Vrin, 2007. Gilson, Étienne, Jean Duns Scot. Introduction à ses positions fondamentales. Paris : Vrin, 1952. Gilson, Étienne, La liberté chez Descartes et la théologie. Paris : F. Alcan, 1913 ; Paris : Vrin, 21982.
La création des vérités éternelles
137
Gilson, Étienne, « Avicenne et le point de départ de Duns Scot ». In Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen-Âge (1927). Paris : Vrin Reprise, 1986, 129-189. Gueroult, Martial, Descartes selon l’ordre des raisons (2 vol.). Paris : Aubier, 1953. Hedwig, Klaus, Sphaera lucis. Studien zur Intelligibilität des Seienden im Kontext der mittelalterlichen Lichtspekulation. Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, 18. Münster : Aschendorff, 1980. Hoffmann, Tobias, Creatura intellecta. Die Ideen und Possibilien bei Duns Scotus mit Ausblick auf Franz von Mayronis, Poncius und Mastrius. Münster : Aschendorff, 2002. Honnefelder, Ludger, La métaphysique comme science transcendantale : entre le Moyen Âge et les temps modernes. Traduction par I. Mandrella, revue par O. Boulnois. Paris : PUF, 2002. Kahl, Wilhelm, Die Lehre vom Primat des Willens bei Augustinus, Duns Scotus und Descartes. Strassburg : J. Trübner, 1886. Knuuttila, Simo, « Duns Scot and the foundations of logical modalities ». In John Duns Scotus. Metaphysics and Ethics, ed. Ludger Honnefelder, Rega Wood, Mechthild Dreyer, 128-143. Leiden et al. : Brill, 1996. Libera, Alain de, La querelle des universaux de Platon à la fin du Moyen-Âge. Paris : Le Seuil, 1996. Libera, Alain de, « Genèse et structure des métaphysiques médiévales ». In La métaphysique, son histoire, sa critique, ses enjeux, ed J.-M. Narbonne and L. Langlois, 159-181. Paris, Québec : Vrin, Les Presses de l’Université Laval, 1999. Manzini, Frédéric, Spinoza, une lecture d’Aristote. Paris : PUF, 2009. Marion, Jean-Luc, Sur la théologie blanche de Descartes. Paris : PUF, 1981. Marion, Jean-Luc, Sur le prisme métaphysique de Descartes. Paris : PUF, 1986. Noone, Thimoty B., « Albert the Great’s conception of metaphysical Knowledge. » In Albertus Magnus und die Anfänge der Aristoteles-Rezeption im lateinischen Mittelalter von Richardus Rufus bis zu Franciscus de Mayronis, ed. Ludger Honnefelder, Rega Wood, Mechthild Dreyer, Marc-Aeilko Aris, Subsidiana Albertina 1, Münster : Aschendorff, 2005. Olivo, Gilles, Descartes et l’essence de la vérité. Paris : PUF, 2005. Pluzanski, E., Essai sur la philosophie de Duns Scot, Paris : E. Thorin, 1888. Robinet, André, Descartes. La lumière naturelle. Paris : Vrin, 1999. Schmutz, Jacob, « L’héritage des subtils. Cartographie du scotisme de l’âge classique. » Les Études philosophiques 57 (2002), 51-81. Schmutz, Jacob, « Un Dieu indifférent. La crise de la science divine durant la scolastique moderne. » In Le Contemplateur et les idées. Modèles de la science divine du néoplatonisme au XVIIIe siècle, ed. Olivier Boulnois, Jacob Schmutz and Jean-Luc Solère, 185-221. Paris : Vrin, 2002. Scribano, Emanuela, Angeli e beati. Modelli di conoscenza da Tommaso a Spinoza. Roma, Bari : Gius. Laterza and Figli, 2006. Sousedik, Stanislav, « Der Streit um den wahren Sinn der scotischen Possibilienlehre ». In: John Duns Scotus. Metaphysics and Ethics, ed. Mechthild Dreyer, Ludger Honnefelder and Rega Wood, 191-204. Leiden : Brill, 1996. Zimmermann, Albert, Ontologie oder Metaphysik? Die Diskussion über den Gegenstand der Metaphysik im 13. und 14. Jahrhundert, Texte und Untersuchungen. Leiden, Köln : E. J. Brill, 1965.
138
139 Archa Verbi. Subsidia 6
139–154
Scotus Geometres The longevity of Duns Scotus’s geometric arguments against indivisibilism Jean-Luc Solère
Two types of theses are in competition regarding the nature of extension. Matter, as well as pure space, are either indefinitely divisible, as Aristotle maintains, or they are made up of elementary parts that cannot be divided, whatever the nature of these parts is (as we shall see, several variants are possible). Some of the best arguments raised against indivisibilism are mathematical. Indivisibi lism, as a matter of fact, is absolutely incompatible with Euclidian geometry. Such mathematical objections were proposed by the pseudo-Aristotelian treatise On indivisible lines (969b29-970a19), then by Avicenna.1 John Duns Scotus adopted some of them but he also framed new ones. I intend, first, to explain and underscore the novelty of two arguments he has set forth, then to call attention to the persistence of these arguments in 17th century debates. I Scotus’s demonstrations In the course of a discussion on the angels’ mode of presence in the world, where he maintains that angels are able to move in space with continuity, Scotus has to face the objection that space is composed of indivisibles – which would entail that motion is discontinuous.2 Whom does Scotus mean to refute? Who defended such indivisibilism before him? It is hard to tell. Scotus had only indirect knowledge of Motazillite indivisibilism through Al-GhazzâlÎ, and possibly also through Maimonides, although no explicit reference is made to the latter.3 However, a Latin theory of indivisibles emerged in the 12th century, found, for instance, in Abelard and William of Conches. One should also mention Robert Grosseteste, who based his cosmogony on the model of light propagating from point to point, with the result that space is made up of indivisible points. One may imagine that Grosseteste’s theories were preserved among some Franciscans, but so far 1 2 3
Vd. Avicenna, Le livre de science, 141-146. Cf. Dhanani, Physical Theory, 176. Ioannes Duns Scotus, Ord. II, d. 2, pars 2a, q. 5, nn. 286-289, 279-280. Shortage of room prevents me to give here detailed references. For a survey of the question of indivisibles in the Middle Ages and bibliographies, vd. Murdoch, „Infinity and continuity“, and more recently Grellard and Robert, eds., Atomism. For the wider picture, vd. Pyle, Atomism, and Papst Atomtheorien.
140
Jean-Luc Solère
we know nothing about them (they do not include [pseudo-]Rufus, Bacon, or Olivi). On the other hand, Scotus might just deal with various objections against infinite divisibility, without these objections necessarily constituting a consistent theory. Some discrepancies among the assumptions of the opponent hint at that possibility. If such is the case, we would not have to worry too much about identifying a definite position in effect defended by some author. Let us try, however, to outline the patterns of the arguments for indivisibilism that Scotus takes to task. First, although some of Scotus’s responses are geometrical, the position he repels is not purely mathematical but lays claim to say something about the real composition of things – recall that the initial question is about angels in space. The first set (“via”) of arguments proposed by the opponent may apply to geometrical space, but more obviously bears on physical space. In particular, the second argument analyzes the phenomenon of succession. The claim is that a “successivum”, an element in a succession, cannot be actual without being indivisible.4 Furthermore, the second via of the opponent appeals to the Aristotelian notion of “minimum naturale”.5 This notion applies to physical realities such as the minimal size under which flesh cannot remain flesh or fire cannot remain fire, or to the first stage of a motion.6 Scotus accepts to follow his opponent on that field and answers at great length.7 The least one can say is that there is no clear-cut distinction between the mathematical and the physical levels. Second, although there is talk of minima naturalia, the opponent explicitly considers them, in the secunda via, as devoid of magnitude: each quantity has by definition parts which are smaller than it is; now, by definition also, a minimum has no parts since these parts would be smaller than it is; therefore, a minimum is in no respect a quantity (“omnino non-quantum”).8 The minima that are hypothesized are then point-like, sizeless.9 One may think that a fortiori it is also the case for the indivisibles defined by the prima via. I will call “pointillism” that particular sort of indivisibilism, in order to distinguish it from atomism. Thanks to Aristotle, mediaeval thinkers were well aware that Democritean atoms were supposed to have magnitude and theoretical parts,
4
5 6 7 8 9
Ioannes Duns Scotus, Ord. II d. 2 p. 2a q. 5 n. 289, 280. Granted that this successivum be wholly given in actuality and be divisible, all its parts would be given in actuality and therefore would co-exist, which means that within the succession there would be a type of reality called permanens. As a consequence, a successivum must be indivisible and fleeting (“raptim transeunte”). Paradigmatically, such a successivum is an instant in time. Ibid. nn. 291-294, 280-281. Ibid. nn. 295-300, 282-284. Ibid. nn. 332-353, 298-311; nn. 376-411, 321-338. Ibid. n. 291, 280-281. That such physical minima be dimensionless derives from the fact that they are not indivisible according to matter, but according to the form, as the objector insists (Ibid. nn. 334-338, 300-302). Cf. Cross, Physics, 127-138.
Scotus Geometres
141
which is to say, to be indivisible only physically, but it is not that kind of indivi sibilism which is here supported. Thirdly, the opponent maintains that the indivisibles succeed immediately to each other.10 The notion of succession could be understood in the technical sense that Aristotle gives to it in Physics V.3 (226b34-227a1): two indivisibles are successive when there is no other indivisible between them. This would not preclude that there is between them something of a different nature, such as a gap for instance. However, as we shall see later, Scotus’s geometrical arguments would not work if gaps were interspersed between the points. Scotus, then, cannot have in view here that kind of position. Rather, one must empha size the adverb immediate in the description of the targeted thesis: the points succeed each other without any kind of intermediary between them. Does that mean that they are what Aristotle calls contiguous, namely, that their extremities touch each other, or are “together”, that is, in the same place (227a10-17)? No, for the points here considered by Scotus cannot be in contact. In the parallel text of the Lectura, the opponent says that the indivisibles have no extremities (“indivisibilia non habent ultima”), that is, one cannot distinguish in them a middle and extremities.11 They are therefore indivisible in the strictest sense: not only physically (as Democritean atoms) but also conceptually (as Epicurean “minimal parts” of atoms). Consequently, the points cannot be said to touch each other by their edge or any other kind of part. Theories in which the indivisibles are immediately adjacent to each other without being contiguous in the Aristotelian sense (so as to avoid Aristotle’s objections) have been proposed by Henry of Harclay and Walter Chatton. For the latter, although they are sizeless the points occupy different situs and can be added to each other. However, both Harclay and Chatton wrote after Scotus. Again, we do not know whom Scotus may have in view. Finally, such points could be (and have been historically thought of) as being, within a finite magnitude, either in a finite or in an infinite number. But as we shall see later,12 Scotus’s arguments work only against a finite number of indivisibles, and such must be, therefore, the assumption of his opponent(s) here. I shall concentrate on the geometrical refutations Scotus opposes to the prima via of the adversary, since they are the ones which will be still discussed in the early modern era. One might have recourse to Aristotle’s objections in Physics VI, such as: a point added to a point does not result in anything larger than a point, but, Scotus declares, geometry is here more efficient than physical arguments.13 10
11 12 13
“Si aliquod indivisibile succedit sibi in continuo, habetur propositum, quod indivisibile sit immediatum indivisibili (my italics)“ (ibid. n. 289, 280). In his reply Scotus again specifies this constraint when constructing the hypothesis he is going to prove false by contradiction: “duo puncta sibi immediate signetur” (ibid. n. 320, 292). Ioannes Duns Scotus, Lect. II d. 2 p. 2 a q. 5 n. 262, 179. Vd. infra pp. 145 and 147. Ioannes Duns Scotus, Ord. II d. 2 p. 2a q. 5 n. 320, 292. Scotus’s geometrical arguments
142
Jean-Luc Solère
These geometrical arguments share a common basis on projections and bi-unique mapping. They also all proceed by reductio ad impossibilem. Let us suppose, then, that every magnitude is composed of a finite number of extensionless points not separated by gaps. Scotus’s first objection is quite original. At least, I have not encountered any earlier instance of it.14 Suppose two circles with the same center A.15 Let us pick two adjacent points (B and C) on the outer circumference (for the sake of visibility, they are represented, in the figures below, distant from each other, but there should not be any gap between them). Let us now draw two radii from each point to the center. Do these lines intersect the inner circumference at one and the same point, or at two distinct points? If at two distinct points, then every radius drawn from a point on the outer circle will define a corresponding point on the inner circle. In other words, we will have a one-to-one correspondence between the points of the outer circumference and those of the inner circumference. We will thus be forced to conclude that the two circumferences have the same number of points, that is to say, the same magnitude.16
14
15 16
have already been presented in various studies, but I have not found a detailed and satisfying account of the counter-objection in the second part of the first argument (that is, the case where the two radii intersect in one point of the small circle), nor of the second part of the second argument (which is Scotus’s original input regarding this argument). That is why I am analyzing them again. Avicenna has an anti-indivisibilist argument relying on the properties of the circle (quoted by Dhanani, Physical Theory, 172). But, first, he appeals to only one circle. Second, Avicenna’s objection is not applicable to sizeless points. It addresses later Motazillite atomism, which supposes that the circumference has a certain thickness and that one can distinguish an outer and an inner side of the same circumference. Hence, Avicenna argues: if that was right, the outer perimeter would be longer than the inner one, whereas, since these perimeters would be completely in contact with each other, they should be equal because what is completely in contact must be equal to that with which it is in contact. Regarding Scotus’s possible sources, one might think also to the mill stone objection used by al-Nazzam, Avicenna, Al-GhazzâlÎ and Maimonides (vd. Dhanani, Physical Theory, 177). But that objection is more physical than mathematical since it relies on differences of speed. Ioannes Duns Scotus, Ord. II d. 2 p. 2a q. 5 n. 320, 292. Ibid. n. 321, 292-293.
Scotus Geometres
143
If at one and the same point, let us call that point D.17 Let us now draw DE, the tangent to the inner circle at D.
Euclid has demonstrated (III.17) that the tangent is perpendicular to the radius at D. Consequently (in virtue of Euclid I.13), ADE and EDC are two right angles. By the same token, ADE and EDB are two right angles as well, at least 17
Ibid. Scotus points out that this second hypothesis must be addressed only because his opponent is a relentless one, a protervus (ibid. n. 326, 295). In Euclidian geometry, two non-parallel straight lines cannot have in common more than one point. But the opponent does not feel constrained by Euclidian geometry. His view would be better represented if, in the figure, the inner circle was extremely small, very close to the center, so that the segments AD, DB and DC would appear more as a ‘V’ than a ‘Y’. In other words, the radii would merge insensibly, in less shocking a way. As we shall see later, such is Arriaga’s and Hume’s belief.
144
Jean-Luc Solère
according to the hypothesis (which Scotus is fighting) that AB and AC are two distinct straight lines which nevertheless both contain D and are therefore both perpendicular to DE. (Again for the sake of visibility, EDC and EDB cannot be represented as two right angles, but that is what they are according to the pointillist hypothesis). Then, if we subtract the angle that is common to both sets of angles, namely, ADE, we find that EDB = EDC. However (and this is the thrust of the argument), this would imply that the part is equal to the whole, since EDB must be included in EDC if C is “after” B on the circumference (turning counterclockwise). Yet, Scotus realizes that his opponent could claim that DB and DC do not form an angle.18 As a matter of fact, should they form an angle, the triangle CDB would have a base (opposing D), which means that there would be a line segment between B and C. But this cannot be, since, by hypothesis, B and C are immediately adjacent. Thus there is no angle CDB to be added to EDB. Therefore, angle EDC does not exceed EDB. It is not the case, then, that the part is equal to the whole. Scotus retorts, first, that this reply entails new absurdities from the view point of Euclidian geometry.19 Indeed it amounts to affirming that two distinct straight lines that intersect do not form an angle, contrary to Euclid’s definition of an angle. But pointillists are again willing to endorse such absurdities, which are actually conform with their principles. Their geometry is a nonEuclidian one. Accordingly, in their theory two straight lines may be drawn from two adjacent points to a same point and yet not form an angle. As a consequence, they must be refuted in some other way. It is remarkable that Scotus takes the trouble to follow his opponents on their ground and still manages to find a geometrical refutation. Although they deny that there is an angular difference between EDC and EDB, the pointillists nonetheless have to admit that there is a “difference of a point”, Scotus says, between the angles EDB and EDC. Now, according to the pointillists, a point is an actual part of the extended magnitude (its most basic part). Thus the angle EDC is made up of the angle EDB plus a part. There consequently is a part-to-whole ratio between EDB and EDC.20 What does Scotus mean by “difference of a point”? He himself explains that two hypotheses must be considered.21 An angle is defined as the space between two intersecting lines, but these lines can be considered either as extrinsic limits, or as intrinsic limits of the angle. 18 19 20
21
Ibid. n. 322, 294. Ibid. n. 323, 294. My two figures are inspired by Hugues, “Franciscans and mathematics”, 118, and Pod konski, “Al-Ghazali’s metaphysics”, 623, but their figures are wrong regarding the position of B and C, since in Scotus’s text EDB is smaller than EDC. The figure in Grant, A source book in medieval science, 317, is correct but must be read “clockwise”. Ibid. n. 324, 295.
Scotus Geometres
145
In the first case, let us take on line DB the “first point that lies outside the inner circumference,” which is to say, the point immediately after D (made possible only by the pointillist hypothesis). This point does not belong to angle EDB since the intersecting lines DE and DB are not part of this angle. It belongs, however, to angle EDC since it is included in the space between ED and DC. There is thus something more in EDC than in EDB. In the second case, let us take on line DC the first point after D. This point belongs to angle EDC, since DC is an intrinsic limit of this angle, but does not belong to EDB, since it lies outside of DB. Again, there is something more in EDC than in EDB. Therefore, in no case can the two angles EDB and EDC be equal, which contradicts the conclusion that we must draw based on constructing the tangent DE. Thus the two radii AC and AB cannot intersect the inner circle at point D. Nor can they intersect the inner circle at two distinct points, as we saw earlier. Conclusion of the whole first demonstration: the hypothesis that circumferences are made up of adjacent points is ruled out. The second demonstration, although directly inspired from Roger Bacon, is improved and made more complex by Scotus. Bacon himself probably borrowed his argument from Avicenna, through the presentation given by Al-Ghazzali.22 But Bacon fine tunes the elementary argument of sixteen atoms assembled into a square by proceeding as follows.23 Let us suppose a square with sides composed of ten adjacent points each (depicted with gaps between them only for the sake of illustration). From each point on one of the sides, draw perpendicular lines to each corresponding point on the opposite side. By definition, there cannot be more than ten lines.
Yet these lines intersect the diagonals. Now, since the horizontal lines are immediately adjacent to each other and fill up, so to speak, the whole surface of the square, we are forced to conclude that each diagonal is exactly made up of 22 23
Al-Ghazzâlî, Metaphysics, 12. Vd. Thijssen, “Roger Bacon”, especially 29-30. Bacon, Opus majus, t. I, 151-152.
146
Jean-Luc Solère
the points of intersection with the horizontal lines, numbering no more than ten. It follows that the diagonals and the sides have the same length – which is patently false. Scotus adopts the same principle, but improves the demonstration.24 He introduces a dilemma. Either the horizontal lines intersect the diagonal at each of its points (this is Bacon’s construction, except not limited to ten points), and there will be the same number of points on the diagonal as on the side; or there are points on the diagonal that do not belong to any of the horizontal lines. The opponent might well be tempted to use the second hypothesis as an escape (so that the side is not as long as the diagonal), and Bacon had not addressed this possibility. In that case, Scotus argues, let us take on the diagonal a point (G) which by hypothesis is situated between, and adjacent to, two points (E and F) through which two of the original horizontal lines pass. Let us draw from G a new line, parallel to those two lines.
Either this new line will intersect the opposite side at a point (H) that is situated between the two points A and C. But this cannot be, since A and C were earlier supposed to be immediately adjacent. Or the new line drawn from G intersects the opposite side at A or at C. But then it is not parallel to AE or CF, contrary to hypothesis. Therefore, there cannot be more points on the diagonal than on the side. To close on Scotus, we may conclude that the Doctor Subtilis had a certain competence in geometry. His first argument seems to be new and his second argument is more sophisticated than Bacon’s. As John Murdoch has emphasized, Scotus’s treatment of the question of indivisibles will exert a widespread 24
Ioannes Duns Scotus, Ord. II d. 2 p. 2a q. 5 n. 330, 297.
Scotus Geometres
147
influence in the Middle Ages. The rationes Scoti will become standard arguments and will consecrate the importance of the mathematical approach. However, Scotus’s geometrical demonstrations do not refute two variants of pointillism. First, if the points were separated by more or less extended gaps, then, in the case of the square, we would be able to embrace the second limb of Scotus’s dilemma: we would be able to find a point on the diagonal that has no corresponding point on the side. Put simply, we would be able to draw from G a line that passes through an empty gap between A and C. We could thus have many more points on the diagonal than on the side. The same reasoning would hold for the case of the two concentric circles. Scotus’s arguments do not allow, either, to refute the hypothesis of an infinite number of points. Admittedly, that solution, in turn, raises new questions. Typically, in the Middle Ages one would object: is the actual infinity of points on the outer circle larger than the infinity of points on the inner circle? The idea of infinites of different sizes remained a stumbling block for many medieval thinkers. Nevertheless, Robert Grosseteste endorsed, in his indivisibilist theory, the existence of different infinites.25 Moreover, Scotus knew that position, since he notes that it can be used by those who want to argue for the eternity of the world.26 Now, these two last variants of pointillism will be formulated in the 17th century, when the debate over indivisibles will once again flare up. II The rationes Scoti in the early modern era As a matter of fact, pointillism and atomism enjoyed renewed favor in the 16th17th centuries. The 1630’s were particularly pivotal, marked by the publication of several important books on that topic. In his Labyrinthus sive de compositione continui (1631), Froidmont thunders against those whom he calls Epicureans and denounces the “danger that comes from Spain”, by which he means new Jesuit theories that resurrect Wycliff’s and other heretics’ error. The Louvain professor reminds the reader that the Council of Constance anathematized Wycliff’s indivisibilist doctrine.27 But, as he then stresses, Euclid is the atomists’ fiercest enemy, and that is why he gives a prominent place to Scotus’s (whom he cites by name) argument of the two circles.28 Froidmont, however, had not seen the worst of it, so to speak, since the following year Arriaga defended pointillism. Galileo, in turn, for very different reasons, launched a scientific and infinist indivisibilism, soon to be followed by Gassendi’s rehabilitation of Epicurus.
25 26 27 28
Vd. Murdoch, “Beyond Aristotle”, 21-24. Ioannes Duns Scotus, Ord. II d. 1 q. 3 n. 171, 87; referred to by Cross, Physics, 125. Froidmont, Labyrinthus, cap. IV. Ibid., cap. VII, 29-31.
148
Jean-Luc Solère
The hierarchy of the Jesuit order actually shared Froidmont’s concern. The General Chapters repeatedly prohibited teaching that continua are composed of indivisibles (in 1606, 1613, 1615, 1641, 1650-1).29 The reason for these censorships was most likely (as it was for Froidmont’s) the issue of the transubstantiation. As a matter of fact, one of the propositions banned in 1608 affirms that “Christ multiple times exists in the host, namely, as many times as there are indivisibles in the extended sacramental species, the extension of which is made up of indivisibles.” Nonetheless, not all Jesuits followed their superiors’ admonitions, as the multiple reiteration of the ban shows. The “danger that comes from Spain” loomed again with Rodrigo Arriaga, whose Cursus Philosophicus (1632) granted the pointillist thesis (which he calls “Zenonist”) a success that the Society was powerless to contain.30 Admittedly, Arriaga acknowledges that there are “very grave objections” against the pointillist position.31 The geometric arguments, however, do not strike him as decisive. Arriaga faithfully reports the argument of the two concentric circles, but gives the following reply. First, the natural light of reason makes us know evidently that we cannot draw as many lines from the head of a pin as from the whole circumference of the sky. We must, then, simply deny that the same number of lines may pass through the outer and inner circles. Consequently, whatever the nature of the continuum may be, some radii drawn from the circumference of the outer circle must eventually fuse into one another before reaching the center, and there simply are fewer radii issued from the circumference of the inner circle. Another Jesuit, Oviedo, adopts the same position: he resigns himself to admit the merging of radii. He acknowledges that this flies in the face of Euclid. However, Oviedo explains: “I have consulted expert mathematicians who have admitted that Euclid’s assertion is not proved. It is not so self-evident as to be beyond all doubt. Maybe Euclid listed it as an axiom precisely because he could not establish it demonstratively.”32
Similarly, Arriaga and Oviedo reject on the same grounds the argument of the square. Next, Gassendi, joining the debate about the famous problem put by Poysson,33 criticized invoking pure mathematics in physical questions. In a letter to Mersenne dated 13 December 1635, he writes, alluding to the two arguments coming from Scotus:
29 30 31 32 33
Palmerino, “Two Jesuit responses”, 187. Feingold, “Jesuits: savants”, 27-29. Arriaga, Cursus, Physica, sectio VIII, subsectio 4, 240. Oviedo, Cursus, Controversia XVII (liber VI Physicorum), punctum X, 359, § 5. Vd. Joy, Gassendi, 89 sqq.
Scotus Geometres
149
“You will thus see what weight to give to the subtle objections that are raised against those who think that the continuum is composed of indivisibles — objections such as: the diagonal of the square will be no greater in length than the side, concentric circles will be equal, etc.”34
Gassendi does not try to refute the geometric arguments. He simply attempts to persuade himself that his theory of indivisibles is beyond their reach. Gassendi later reiterates this stance in his Syntagma Philosophicum. He just dismisses the geometric objections (once again, Scotus’s square and concentric circles) that are directed against atomism. Gassendi’s view is that geometry reigns in its own ideal domain, separated from matter and the real world.35 Ironically, the author of Against Aristotelians (1624) thus has recourse to a distinctly Peripatetic argument. It seems to me that Gassendi’s defense is weak. True, as Gassendi insists, his physical atoms are not mathematical points: they have size, extension. Accordingly, if we suppose real, material concentric circles, with circumferences composed of atoms, Scotus’s arguments become irrelevant. If we imagine radii to be drawn, for example, from the center of each material atom of the outer circle, Gassendi claims that there is no difficulty imagining that they traverse one and the same atom in the inner circle through different parts, for example through its center and through its edge. The problem, however, is that Gassendi remains silent about these theoretical “parts” of atoms. His atoms are not conceptually indivisible since it is possible to distinguish in them a center and a periphery. The issue of the possibility of indivisibility is just transferred to these parts and their relative spatial position. It is difficult to see how Gassendi can justify indivisibles of space and time (which he holds) without establishing entities that are indivisible both physically and conceptually. The most scientific rehabilitation of indivisibilism, however, came from Galileo, under the form of a new “pointillism”. As we saw, Scotus’s arguments prove that the existence of a finite number of adjacent indivisibles is incompatible with Euclidian geometry. Nonetheless, they leave open the possibility of an infinite number of separated indivisibles. It is just such a theory that Galileo provides in Two New Sciences (1638). Salviati hypothesizes that the cohesion of solid bodies is tied to the intrinsic presence of empty interstices. As the dialogue unfolds, Sagredo asks what might be the number of these empty interstices. Salviati answers that there is an infinite number of them, just as there is an infinity of particles in the same body. But both these particles and the empty interstices between them must be extensionless. They are like mathema tical points, not like atoms. Or else, their accumulation would result in an infinite extension.36 As Sagredo balks at the idea of an actual infinite, Salviati undertakes to prove that “it is not impossible to find an infinity of empty interstices in an 34 35 36
Mersenne, Correspondance, vol. 5, 533-534. Emphasis is mine. Gassendi, Syntagma (Physica), sectio I, liber III, 264. Galilei, Discorsi, 67 and 72.
150
Jean-Luc Solère
extended continuum”. He appeals to the famous paradox of “Aristotle’s wheel”— which is not Scotus’s concentric circles argument, but derives from the Aristotelian school’s Problemata. The line that is traced by the inner circle, Salviati argues, appears to be continuous, but in reality is composed “of an infinity of points, some full, the others empty.” He then applies the same principle to bodies.37 And yet, how will the infinity of points in a large body be greater than the infinity of points in a small body? Galileo answers that infinities cannot be compared: the relation “greater than” and “less than” and “equal to” simply do not apply.38 Although this reply is far from providing a final answer to the problem of mathematical infinity, Galileo thus managed to remove an important epistemological obstacle. Furthermore, the fruitfulness of indivisibles in mathematics will be illustrated in the 1630’s by one of Galileo’s disciples: Bonaventura Cavalieri. The basic idea of his method is the following: a solid may be decomposed into planes, or a plane into lines, and it makes sense to speak of “all the lines” of a given plane or of “all the planes” of a given solid, even if the lines or the planes are infinite in number. Cavalieri goes on to posit that the ratio of the areas of two figures is equal to the ratio of their sets of respective lines. At first, Cavalieri’s approach encountered fierce resistance. In order for there to be a ratio between the two sets of lines, those sets must be magnitudes, which indeed Cavalieri assumed. Jesuits such as Guldin or Tacquet, as well as Galileo himself, judged Cavalieri’s attempt to determine a ratio between infinite sets to be doomed to failure. Against Cavalieri, Galileo invoked his famous paradox of the bowl, but also Scotus’s concentric circles!39 However, Evangelista Torricelli was inspired by Cavalieri’s method and was soon followed by the majority of mathematicians of the middle of the 17th century. Did indivisibles thus win a decisive victory over Scotus’s arguments? In fact, no, since Torricelli and others modified Cavalieri’s idea on a crucial point. They consider that the so-called “indivisibles” have a size, albeit an extremely small one (as small as is wished, or less than any given quantity). This marks the birth of the infinitesimal calculus. After John Wallis, Leibniz, in his Quadratura Arithmetica (1676), replaces the indivisible lines with rectangles. The long side of each rectangle corresponds to one of Cavalieri’s lines, but the short side is a segment of “indefinitely small” size, which means that, far from being indivisible, it may be decreased without limit. This is why there can be continuity among all of the rectangles. The upshot, then, is a sort of compromise: an actual infinite enters into the composition of the continuum, but the infinitesimals are not indivisible. They are quantities that are homogenous with the quantities of which they are the infinitesimals: they are not like lines
37 38 39
Ibid., 68-69. Ibid., 77-79. Vd. Cavalieri, Geometria, 756-757.
Scotus Geometres
151
as compared to surfaces, or like points as compared to lines, but like infinitely small surfaces as compared to the surfaces of which they are parts. In an earlier work, the De minimo et maximo (Nov. 1672-Jan. 1673), Leibniz had invoked against indivisibilism the argument of the square. His presentation of that objection is so close to Scotus’s that it is tempting to speculate that Leibniz drew it directly from a Scotist text. Exactly as Scotus, Leibniz deploys his proof in two stages.40 First, parallels are constructed from one side of the square, cutting the diagonal, which serves to establish that there should be as many indivisibles on the side as on the diagonal. Next, in case someone wants to object that there may be more points on the diagonal, an intermediary point between two of the earlier points on the diagonal is hypothesized with the same resulting impossibility that Scotus pointed out. Similarly, in his 1665 Lectiones mathematicas, Isaac Barrow, Newton’s teacher and a likely precursor of infinitesimal calculus, rejected indivisibles on the ground that they contradict the basic principles of Euclidian geometry. Notably, he appeals to the argument of the two concentric circles—without naming Scotus, though.41 A few decades later, the same argument is once more taken up (again without crediting Scotus with it) in the third lecture of John Keill’s Introduction to Natural Philosophy.42 Keill, one of Newton’s disciples, taught natural philosophy at Oxford and published his lectures in Latin in 1702. The resulting Introductio ad veram physicam was a success, judging from the fact that the Latin text went through many reprints and was eventually translated into English in 1720 with the title above mentioned, and thenceforth republished many times. Keill’s lectures even were adopted as a textbook both in Cambridge and Oxford. Thus at the start of the 18th century, Scotus’s arguments against indivisibles had not lost currency, compatible as they were with the emergence of infinitesimals. In addition, Scotus’s arguments did not survive among mathematicians alone. Thanks to Pierre Bayle, they were disseminated to a wider philosophical audience. Long before he wrote his opus magnum, the Dictionary, Bayle issued the following warning in the philosophy lectures he gave from 1675 to 1680: “We have reached the most difficult question that there is in physics, namely the question of whether or not continua are composed of parts that are further divisible without limit, or of mathematical points, or of extended corpuscles that are indivisible because of their material solidity. Whatever sect we choose, we are faced with insoluble and incomprehensible difficulties. The extreme weakness of the human mind prevents us from discovering what we must think.”43
In effect, Bayle does not rally to a particular position. He prefers to entertain his skepticism with the mutual refutations heaped on all sides. Both the Ari40 41 42 43
Leibniz, “De minimo et maximo”, 8-11. Barrow, Lectiones, 17. Keill, Introduction, 29-30. Bayle, Institutio, 295-296.
152
Jean-Luc Solère
stotelian doctrine and atomism succumb, each to its own proper difficulties. Against the third thesis, that of the “mathematical points,” Bayle appeals to the square and the concentric circles arguments, to which he adds the pyramid argument coming from Gregory of Rimini. Bayle’s sources, as he himself indicates, are his Jesuit contemporaries: Oviedo and Arriaga, above mentioned, and Hurtado de Mendoza. Bayle recycles the same aporia in the article “Zeno of Elea” of his Historical and Critical Dictionary. There, Bayle alludes only indirectly to Scotus’s arguments, but the success of the Dictionary spread the issue into the 18th century. It is, for instance, probably in Bayle (perhaps also in Keill) that Hume found elements for his own discussion of the problem. His Treatise on Human Nature attacks the possibility of dividing space infinitely and defends indivisibilism. He rejects the geometrical arguments as “scholastic chicanery, undeserving of attention.”44 While he acknowledges the medieval origin of these arguments, he does not even bother to present them, assuming that they are familiar by now. And as all indivisibilists, he casually dismisses them rather than refutes them. A little farther, however, he feels compelled to overthrow the very foundations of Euclidian geometry. Hume’s contention recalls Arriaga’s and Oviedo’s solutions and would indeed dissolve (only at a high price) the paradox of the two concentric circles. How might the mathematician “prove to me, for instance, that two right lines cannot have one common segment? Or that ‘tis impossible to draw more than one right line betwixt any two points?”45 If we suppose, he goes on, two straight lines getting closer by an inch every 20 leagues, “I perceive no absurdity in asserting that upon their contact they become one”, that is to say, eventually share a common segment. It is thus clear that while Scotus’s own arguments are presented and discussed in less and less detail, they remain in the background and frame the discussion as late as the 18th century, which is an outstanding achievement.46
44 45 46
Hume, Treatise, book I, part II, section II, n. 9, 27. Ibid., section IV, n. 30, 38. I would like to express my many thanks to Anne A. Davenport for her help.
Scotus Geometres
153
Bibliography Primary literature Al-Ghazzâlî, Algazel’s Metaphysics. A Mediaeval Translation, ed. J. T. Muckle, Toronto: St. Michael’s College, 1933. Arriaga, Rodrigo de, Cursus philosophicus. Editio quarta. Lyon: Claude Prost, 1653. Avicenna, Le livre de science, trans., M. Achena and H. Massé, Paris: Les Belles Lettres, 1955. Bacon, Roger, Opus majus, ed. R.B. Burke, Philadelphia, London: University of Pennsylvania Press, Oxford University Press, 1928. Barrow, Isaac, Lectiones habitæ in scholis publicis Academiæ Cantabrigiensis anno Domini MDCLXV, v. 1, London: G. Wells, 1684. Bayle, Pierre, Institutio brevis et accurata totius philosophiae, in Œuvres diverses de Mr. Pierre Bayle, t. IV. La Haye, Rotterdam: T. Johnson et al., 1731. Cavalieri, Bonaventura, Geometria degli Indivisibili, trans., introd. and notes by L. Lombardo Radice, Torino: Utet, 1966. Froidmont, Libert, Labyrinthus sive de compositione continui liber unus, Anwerp: Plantin-Moretus, 1631. Galilei, Galileo, Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno a due nuove scienze. Le opere di Galileo Galilei. Nuova ristampa della edizione nazionale (1890-1909), vol. 8. Firenze: G. Barbèra, 1968. Gassendi, Pierre, Syntagma philosophicum, pars II (Physica). P. Gassendi, Opera omnia. Lyon : Laurent Anisson et Jean-Baptiste Devenet, 1658. (6 vol.) Hume, David, A treatise of human nature, ed. D. F. and M. J. Norton, Oxford, New York: Oxford University Press, 2001. Ioannes Duns Scotus, Lect., ed. Vat. Ioannes Duns Scotus, Ord., ed. Vat. Keill, John, An introduction to natural philosophy or, philosophical lectures read in the University of Oxford, Anno Domini 1700, 4th ed., London: M. Senex, W. Innys, T. Longman and T. Shewell, 1745. Leibniz, Gottfried Wilhelm, “De minimo et maximo.” in The labyrinth of the continuum: writings on the continuum problem, 1672-1686, New Haven: Yale University Press, 2001. Mersenne, Marin, Correspondance du P. Marin Mersenne, religieux minime, ed. P. Tannery and C. De Waard, Paris: G. Beauchesne, 1932. Oviedo, Francisco de, Cursus philosophicus, ad unum corpus redactus. Secunda editio. Lyon: Philippe Borde, Laurent Arnaud & Claude Rigaud, 1651.
Secondary literature Cross, Richard, The physics of Duns Scotus: the scientific context of a theological vision. Oxford, New York: Clarendon Press, Oxford University Press, 1998. Dhanani, Alnoor, The physical theory of Kalâm: atoms, space, and void in Basrian Mu’tazillî cosmology. Leiden: E. J. Brill, 1993. Feingold, Mordechai, “Jesuits: savants.” In Jesuit science and the republic of letters, ed. M. Feingold, 1-45. Cambridge, MA: MIT Press, 2003. Grant, Edward, A source book in medieval science. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974.
154
Jean-Luc Solère
Grellard, Christophe, and Aurélien Robert, Atomism in late medieval philosophy and theology. Leiden: Brill, 2009. Hugues, Barnabas, “Franciscans and mathematics.” Archivum Franciscanum Historicum 76 (1983): 98-128. Joy, Lynn Sumida, Gassendi the atomist: advocate of history in an age of science. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1987. Murdoch, John E., “Beyond Aristotle: Indivisibles and Infinite Divisibility in the Later Middle Ages.” In Atomism in Late Medieval Philosophy and Theology, ed. C. Grellard and A. Robert, 15-38. Leiden, Boston: Brill, 2009. Murdoch, John E., “Infinity and continuity.” In The Cambridge history of later medieval philosophy, ed. N. Kretzmann, A. Kenny and J. Pinborg, 564-91. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1982. Papst, Bernhard, Atomtheorien des lateinischen Mittelalters. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994. Palmerino, Carla Rita, “Two Jesuit responses to Galileo’s science of motion: Honoré Fabri and Pierre Le Cazre.” In The new science and Jesuit science: seventeenth century perspectives, ed. M. Feingold. Dordrecht, Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003. Podkonski, Robert, “Al-Ghazali’s metaphysics as a source of anti-atomism proofs in John Duns Scotus Sentences Commentary.” In Wissen über Grenzen: arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter, ed. A. Speer and L. Wegener. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2006. Pyle, Andrew, Atomism and its critics: from Democritus to Newton. Bristol: Thoemmes Press, 1997. Thijssen, Johannes M. M. H., “Roger Bacon (1214-1292/1297): a neglected source in the medieval continuum debate.” Archives Internationales d’Histoire des Sciences 34 (1984): 24-34.
155 Archa Verbi. Subsidia 6
155–173
Haecceitas und Possibilienlehre Zur Bedeutung von Johannes Duns Scotus für die Leibnizsche Metaphysik Hubertus Busche
Die Stellung Gottfried Wilhelm Leibnizens zur scholastischen Philosophie überhaupt und seine Beurteilung gewisser Scholastiker im Besonderen sind inzwischen relativ gut erforscht. Was jedoch Leibniz’ konkrete Argumentation hinsichtlich der von ihm teils hoch-, teils geringgeschätzten Scholastiker angeht, so ist hier noch manch größere Differenzierungsarbeit zu leisten. Das gilt erst recht für die Bedeutung, die dem „doctor subtilis“ in und für Leibnizens Metaphysik zukommt. Im Folgenden soll versucht werden, ein möglichst feinkörniges Bild von Leibniz’ gedanklicher Stellung zu Johannes Duns Scotus zu zeichnen. Hierfür sind zwei Schritte nötig. Erstens ist Leibniz’ Beurteilung und Kenntnis der Scholastik überhaupt in Erinnerung zu rufen. Erst vor diesem Hintergrund kann deutlich werden, welche besondere Bedeutung Scotus für Leibniz einnimmt. Im zweiten Teil sind dann jene beiden Problemfelder ausführlich zu analysieren, auf denen Leibniz dem „doctor subtilis“ gedanklich begegnet. Dies sind a) das Individuationsprinzip der „haecceitas“ und b) die Lehre von den Possibilien im göttlichen Verstand. 1. Leibniz’ Beurteilung und Kenntnisstand der scholastischen Philosophie überhaupt Während in der heutigen Scotus- und Leibnizforschung die Beziehung beider Denker eher im Schatten der Aufmerksamkeit liegt, wurden die maßgeb lichen Einsichten hierzu vor längerem erarbeitet. Dies gilt insbesondere für Leibnizens Stellung zur scholastischen Philosophie insgesamt.1 Bahnbrechend sind hier ein kurzer, aber ebenso prägnanter wie zuverlässiger Aufsatz von Robert von Nostitz-Rieneck aus dem Jahre 18942 und eine ausführlichere Darstellung von Fritz Rintelen aus dem Jahre 19033, begleitet von der sorgfältigen Materialsammlung des Josef Jasper von 18984 und gefolgt von der korrigierenden Übersicht durch Karl Eschweiler von 1928.5 Zu diesen älteren Arbeiten hat die neuere Forschung bislang nur wenige Ergänzungen beitragen 1 2 3 4 5
Einen gewissen Auftakt zur Rekonstruktion von Leibniz’ Beurteilung der Scholastik macht Pichler, Die Theologie des Leibniz, Bd. I, 140-145. Nostitz-Rieneck, „Leibniz und die Scholastik“, 54-67. Rintelen, „Leibnizens Beziehungen zur Scholastik“, 157-189 u. 307-334. Jasper, Leibniz und die Scholastik. Eschweiler, „Zu dem Thema: Leibniz und die Scholastik“, 251-325.
156
Hubertus Busche
können. Für Leibniz’ Stellung zur Scholastik ist im Folgenden zunächst seine Bewertung, dann sein Stand der historischen Kenntnis zu skizzieren. Was die Bewertung der Scholastik betrifft, so geriet der frühe Leibniz durch seine beiden großen akademischen Lehrer, Jakob Thomasius in Leipzig und Erhard Weigel in Jena, in eine gewisse negative Voreingenommenheit gegen die Scholastik, die sich aus der protestantischen Polemik seit Luthers „Disputatio contra scholasticam theologiam“ (1517) speiste. Bezeichnend hierfür sind Leibniz’ Briefe von 1668 und 1669, in denen er dem Lutheraner Thoma sius seine Analogie zwischen theologischer und philosophischer Reformation darlegt. Während in der Theologie die Kirchenväter die Heilige Schrift durch beste Auslegungen erläutert, die Mönche aber sie „durch abergläubische Vorstellungen verdunkelt“ hätten, könne es nun, „beim Sonnenaufgang der Geister“, zu einer vorbildlichen „theologia reformata“ kommen. Analog müsse man auch in der Philosophie drei Phasen unterscheiden. „Ähnlich haben die griechischen Kommentatoren den Aristoteles erläutert; die Scholastiker haben ihn mit ihren Albernheiten verdunkelt. Nach Sonnenaufgang“ stehe nun entsprechend eine wahrhafte „philosophia reformata“ an.6 Daher müsse man Cartesianern wie Jean de Raey7 Recht geben, „dass die Dunkelheiten bei Aristoteles vom scholastischen Qualm herrühren“; und keinem sei besser bekannt als Thomasius, „dass die Scholastiker seinen [des Aristoteles] Wortsinn erstaunlich verdunkelt hätten“.8 Auch wenn diese Konstruktion einer scholastischen Verdunklungsphase stark überpointiert und nicht ohne Akkommodation an den Adressaten Thomasius sein dürfte, zeigt sie doch, dass Leibniz der scholastischen Philosophie insgesamt eine kritische Distanz entgegenbringt. Ihre Verfälschung des Aristoteles führt er primär auf ihre Geringschätzung der mathe ma tisch-mechanischen Natur erklärung zurück. „Tatsächlich haben zuerst die 6
7 8
„Scilicet quod Theologis, idem et Philosophis agendum est. Scripturam sacram sancti patres optimis interpretationibus illustrarunt: mox monachi obscurarunt superstitionibus. Orta luce animorum, theologia reformata triplex est: alia haeretica, quae ipsas scripturas reiicit, vt fanaticorum; alia schismatica, quae priscos patres ecclesiae reiicit, vt Socinianorum; alia vera, quae ecclesiae doctores cum scriptura sacra et primitiua ecclesia conciliat, vt Euangelicorum. Similiter Aristotelem interpretes Graeci illustrarunt, scholastici obscurarunt nugis. Orta luce, philosophia reformata triplex est: alia stolida, qualis Paracelsi, Helmontii, aliorumque, Aristotelem prorsus reiicientium; alia audax, quae exigua veterum cura, immo contemtu eorum palam habito, bonas etiam meditationes suas suspectas reddunt, talis Cartesii; alia vera, quibus Aristoteles vir magnus, et in plerisque verus cognoscitur.“ (An Jakob Thomasius, 20./30. April 1669, A II 1, 21, 1728) Die Sigle A steht im Folgenden für: Gottfried Wilhelm Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe, hg. von der Preußischen (nunmehr Deutschen) Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Darmstadt (Berlin) 1923 ff. De Raey, Clavis Philosophiae naturalis. „Satis ostendit Raey in claue philosophiae naturalis, tenebras Aristotelis a scholastico fumo esse [...].” – „Nam Scholasticos eius sensum mire deprauasse cui magis est cognitum, quam Tibi, vir Clarissime [...]” (an Jakob Thomasius, 26. September/6. Oktober 1668, A II 1, 10, 24 u. 16, 1).
Haecceitas und Possibilienlehre
157
Scholastiker so abschätzig von der Mathematik geurteilt, dass sie mit aller Anstrengung darauf hinarbeiteten, die Mathematik aus der Zahl der vollkommenen Wissenschaften auszuschließen“.9 In der Nachlässigkeit, ja Abneigung gegen mathematische Verfahren erblickt Leibniz sogar das kardinale „Laster“ der Scholastik, aus dem sich zum einen ihre Neigung zu „unverständlichen Qualitäten“ in Physik und Metaphysik erkläre10, zum anderen ihr Hang zu einem unpräzisen Sprechen und Denken, das „an die Stelle einer einzigen Definition viele Unterteilungen“ und „an die Stelle eines unbezwingbaren Beweises viele spitzfindige Fechtereien pro und contra“ setze.11 Andererseits erkennt Leibniz aber sehr wohl an, dass man in der Scholastik metaphysische „Lehrsätze von bewundernswürdigem Scharfsinn“ und beweisbarer Wahrheit findet, und macht diese beispielsweise an den summi viri wie Thomas von Aquin, Bonaventura, Durandus von St. Pourcain oder Gregor von Rimini fest.12 In diesen Zusammenhang gehört auch das berühmte Urteil des Discours, „dass unsere Modernen dem Hl. Thomas und anderen großen Männern dieser Zeit nicht genügend Gerechtigkeit widerfahren lassen und dass in den Lehrmeinungen der scholastischen Philosophen und Theologen weit mehr an Zuverlässigem steckt, als man sich vorstellt“.13 Im Blick auf die Größen der Scholastik tadelt Leibniz schon 1670 den Humanisten Marius Nizolius dafür, bei seiner Polemik gegen die Scholastiker keinen Unterschied gemacht zu haben zwischen den Leuchttürmen mittelalterlicher Schulphilosophie und jenen kleinen Erfindern von innumerae frivolae quaestiones, die meistens zu 9
10
11
12
13
„Et vero tam abiecte de Mathematicis scholastici primum senserunt, omni conatu id agentes, vt ex perfectarum scientiarum numero Mathesin excluderent.“ (An Jakob Thomasius, 20./30. April 1669, A II 1, 19, 29-31) Vgl. an Conring, 3. Januar 1678, GP I 188. – Die Sigle GP steht im Folgenden für: Die philosophischen Schriften von Leibniz, hg. v. Carl Immanuel Gerhardt, 7 Bde., Berlin 1875-1890, Reprint Hildesheim 1978. „Ce n’est pas cela, mais nous desapprouvons la methode de ceux qui supposent, comme les Scholastiques d’autrefois, des qualités deraisonnables, c’est à dire, des qualités primitives, qui n’ont aucune raison naturelle, explicable par la nature du sujet à qui cette qualité doit convenir.” (An Bourguet, 5. August 1715, GP III 580) „Sunt qui mathematicum rigorem extra ipsas scientias quas vulgo mathematicas appellamus locum habere non putant. Sed illi ignorant, idem esse mathematice scribere, quod in forma, ut Logici vocant, ratiocinari, et praeterea distinctionum captiunculas, quibus alioquin tempus teritur, una definitione praevenire. Hoc enim unico Scholastici vitio laboravere, quod cum plerumque ordinate satis et ut sic dicam mathematice ratiocinentur, vocabulorum usum relinquere in incerto. Unde pro definitione unica multae distinctiones, pro demonstratione irrefragibili multae in utramque partem argutationes natae, quibus divina eorum dogmata et admirandae non raro contemplationes ab homine mathematice docto non difficulter purgentur.” (De vera methodo Philosophiae et Theologiae, GP VII 324) „Videbam summos Viros, D. Thomam et S. Bonaventuram et Guilelmum Durandum et Gregorium Ariminensem et tot alios eorum temporum scriptores non paucas dedisse primae philosophiae propositiones admirandae subtilitatis, quae severissime demonstrari possent [...]” (De vera methodo Philosophiae et Theologiae, GP VII 323). Leibniz, Discours de métaphysique, Kap. 11, A VI 4, B 1544, 17-19.
158
Hubertus Busche
den jüngeren Scholastikern gehörten.14 Angesichts seiner ambivalenten Ein schätzung, dass die scholastische Philosophie „viel guthes in sich hat, wenns nur ausgeklaubet wäre“15, bedient sich Leibniz öfter des Vergleichs, dass man häufig „Goldadern in diesen unfruchtbaren Felsen“16 oder auch „Gold in der Schlacke“ finde.17 Soweit Leibniz’ Bewertung der Scholastik im Allgemeinen; was nun seine historische Kenntnis der Scholastiker betrifft, so glaubten frühe Interpreten es für „eine bekannte Thatsache“ ausgeben zu können, dass „Leibniz innig vertraut gewesen ist mit der Lehre des Thomas von Aquin und derjenigen der meisten Scholastiker“18, ja dass Leibniz „ein genauer Kenner der Scholastik“ gewesen sei.19 Die anschließende Forschung war daraufhin ins Gegenextrem verfallen und hatte nicht bloß die Vertrautheitsthese als „arge Uebertreibung“ gewertet, da man „einen durchschlagenden Beweis für tief eindringende, viele Autoren umfassende Studien“ bei Leibniz „nicht zu sehen“ vermöge.20 Vielmehr nahm man an, Leibniz habe sogar „niemals den Drang verspürt“, „mit einer Lehre der Scholastik sich kritisch auseinanderzusetzen oder irgend eine in ihrer Tiefe zu begreifen“.21 Aus heutiger Sicht müssen jedoch beide Extreme der Beurteilung als schlecht begründet zurückgewiesen werden. Nicht nur, dass es unfair wäre, an das 17. Jahrhundert unsere heutigen hohen Ansprüche an historisch-philologische Auseinandersetzung mit scholastischen Quellen anzulegen. Vielmehr hat sich auch erwiesen, dass man hinsichtlich der Scholastik Unterschiede machen muss. So hat Eschweiler erstmals überzeugend nachgewiesen, dass sich „das Urteil über das Verhältnis Leibnizens zur Scholastik bedeutend verändert, je nachdem das Verhältnis zur Hochscholastik oder zur Spätscholastik betrachtet wird. Es trifft zu, dass der große Polyhistor die klassischen Werke der mittelalterlichen Denker nur oberflächlich und aus zweiter Hand gekannt hat. [ ….] Es trifft dagegen nicht zu, dass Leibniz auch die im siebzehnten Jahrhundert geläufige Scholastik, die vorzüglich von Suarez und seinen Schülern bestimmt worden ist, nur oberflächlich gekannt habe. V. Nostitz-Rieneck und die ihm unkritisch Nachsprechenden haben keinen einzigen Grund beigebracht, der dazu berechtigte, das von Leibniz häufig ausgesprochene Bekenntnis, er habe in seiner Jugendzeit diese 14 15 16
17
18 19 20 21
Leibniz, Marii Nizolii de veris principiis et vera ratione philosophandi, A VI 2, 424-428. Leibniz, An Gabriel Wagner, 1696, GP VII 523. „En effet, de la maniere que ces choses sont traitées communement par les scholastiques, ce ne sont que disputes, que distinctions, que jeux de paroles; mais il y a des veines d’or dans ces rochers stériles” (an den Landgrafen Ernst von Hessen-Rheinfels, November 1686, GP II 82). „Saepe dixi ad eos qui non nisi recentioris philosophiae sectatores probant, non esse prorsus spernendos Scholasticos saepeque in eorum luto aurum latere ut adeo operae pretium ingens facturus sit, qui selecta inde in usum publicum aliquando congereret“ (an des Bosses, 24. Dezember 1707, GP II 344). „J’ay dit souvent, aurum latere in stercore illo scholastico barbariei“ (an Remond, 26. August 1714, GP III 625). Koppehl, Die Verwandtschaft Leibnizens mit Thomas von Aquino in der Lehre vom Bösen, 9. Trendelenburg, „Das Verhältnis des Allgemeinen zum Besondern“, 237. Nostitz-Rieneck, „Leibniz und die Scholastik“, 66, 62. Rintelen, „Leibnizens Beziehungen zur Scholastik“, 333.
Haecceitas und Possibilienlehre
159
Scholastik eifrig, ja mit einem seinen Lehrern übertrieben vorkommenden Eifer studiert, irgendwie in seiner objektiven Wahrheit anzuzweifeln.“22
Hatte doch Leibniz selbst mehr als nur einmal betont, dass er schon in früher Jugend Zabarella, Rubius, Toledo, Fonseca und andere Spätscholastiker studiert habe23, darunter auch den Suárez angeblich so mühelos, wie andere „die milesischen Märchen oder Romane“ verschlingen.24 Im Vergleich zu diesem eher intensiven Studium spätscholastischer Autoritäten wird man in der Tat einräumen müssen, dass Leibniz sich mit den Klassikern der Vor-, Früh- und Hochscholastik kaum aufgrund eigener Quellenlektüre auseinandergesetzt hat. 2. Duns Scotus im Werk von Leibniz Angesichts dieser zweigeteilten Lage ist es umso bemerkenswerter, dass ausgerechnet der „doctor subtilis“ innerhalb des engen Rahmens von Leibniz’ spärlicher Eigenlektüre hochscholastischer Quellen doch immerhin eine echte Ausnahmestellung einnimmt. Denn Leibniz setzt sich gleich auf zwei Problemfeldern intensiv mit der Lehre des Scotus auseinander: Zum einen widmet er dem scotischen Individuationsprinzip der „haecceitas“ eine ausführliche Untersuchung; zum anderen greift Leibniz die scotische Lehre von den Possibilien als fruchtbare Anregung auf, um sie in seinem Sinne weiterzuentwickeln. A. Leibniz’ Kritik der scoti(sti)schen „haecceitas“ In Leibniz’ Bildungsweg genießt Duns Scotus’ neues Individuationsprinzip der „haecceitas“ die Ehre, der erste große Gegenstand zu sein, mit dem sich junge Universalgelehrte öffentlich auseinandersetzt. Der 16jährige Leibniz legte am 30. Mai 1663 seine mündliche Prüfung zum Baccalaureus ab, indem er sich einer „Disputatio metaphysica de principio individui“ stellte.25 Dass Leibniz dieses Thema selbst wählte, die Schriftgrundlage selbst verfasste26 und die 22 23 24 25
26
Eschweiler, „Zu dem Thema: Leibniz und die Scholastik“, 261. Leibniz, Initia et specimina scientiae generalis, GP VII 126. Leibniz, „Vita Leibnitii a se ipso breviter delineata“, in Werke, ed. Klopp, I1, XXXVI f. Der lateinische Text findet sich in A VI 1, 9-19 (= GP IV 15-26). Eine deutsche Übersetzung findet sich bei Kirchmann, Die kleineren philosophisch wichtigen Schriften von G. W. Leibniz, 1-17; eine englische Übersetzung gibt McCullough, The Early Philosophy of Leibniz on Individuation, 301-323; französische Übersetzungen geben Quillet, “Disputation métaphysique sur le principe d’individuation”, 86-105, und Violette, „Lettres et opuscules de Physique et de Metaphysique”, 28-33. Zur ausführlichen Deutung der Leibnizschen Disputation vgl. Busche, Leibniz’ Weg ins perspektivische Universum, 34-51. Die Lobesworte des Vorsitzenden der Kommission, Jakob Thomasius, gegenüber dem Prodekan sind aufschlussreich. „Der hochgelehrte junge Gottfried Wilhelm Leibniz hat das Thema für gut befunden, um hieran sein Genie und seinen Fleiß zu üben. Mit seinem wahrlich jugendlichen Alter ist er schon jetzt zu diesen sehr schwierigen und weitläufigen Kontroversen befähigt. Und so sind die vorliegenden metaphysischen The-
160
Hubertus Busche
Arbeit publizierte, zeigt, dass ihn die Problematik „schon damals lebhaft inter essierte“27 und dass er dem Prinzip der Individuation eine große Bedeutung beimaß. Die Streitfrage lautet, welches das principium reale „insbesondere bei den erschaffenen selbständigen Einzeldingen“ sei, welches macht, dass selbst eineiige Zwillinge von sich aus gegeneinander unterschieden sind. Scholastisch formuliert geht es um jenes Prinzip, das die „Grundlage für den Formalbegriff des Individuums oder der Vereinzelung“ und somit für seine „numerische Ver schiedenheit im Verstand“ ist.28 Nachdem Leibniz die Lehrmeinungen zum Individuationsprinzip in vier mögliche Positionen unterteilt, die er durch gelehrtes Zitieren den scholastischen Autoritäten zuordnet29, überrascht der Text dadurch, dass die Auseinandersetzung gerade mit der vierten Ansicht, der scoti(sti)schen „haecceitas“, den mit Abstand größten Raum einnimmt, nämlich 10 von insgesamt 26 Paragraphen. Diese Sonderbehandlung des scoti (sti)schen Individuationsprinzips ist im Folgenden durch eine systematische Analyse der leibnizschen Disputation zu erläutern. Die „prima opinio“, die Leibniz selbst verteidigt, erklärt zum Individuationsprinzip die „ganze Seiendheit (tota entitas)“, d.h. nichts anderes als die Einheit des aus Materie und Form zusammengesetzten Einzeldings.30 Die damit verbundene These „omne individuum suâ totâ entitate individuatur“ sei keine exklusive „opinio [...] Terministarum seu Nominalium“, sondern werde „à gravissimis viris“ unterschiedlichster Richtungen verteidigt.31 27 28
29
30
31
sen entstanden, die wir an diesem Lehrstuhl genährt haben“ (A VI 1, 5, 12-15). Kabitz, „Die Bildungsgeschichte des jungen Leibniz“, 178. „[...] qvod rationis individui formalis seu individuationis, seu differentiae numericae in intellectu sit fundamentum, idqve in individuis praecipuè creatis substantialibus“ (Disputatio metaphysica de principio individui, § 2, A VI 1, 11, 7-16). Zu Leibnizens Umgang mit den Zitaten der Autoritäten bemerkt Hochstetter, „LeibnizInterpretation“, 182 f., treffend: „Wer evangelische philosophische Dissertationen aus der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts kennt, weiß, daß [...] diese Arbeiten oft geradezu aus einer Kette von Citaten mittelalterlicher Autoritäten, gleichviel welcher Zeit und welcher Herkunft, ob approbiert oder indiciert, geformt sind, in Vergleich zu denen Leibniz’ eigene Disputatio metaphysica de principio individui als eine eigenständige, vergleichsweise nur dünn ‘kolorierte’ Arbeit erscheinen muß.“ Dass die Zitatkenntnis dabei eher „auf sekundäre Quellen als auf die Originaltexte“ zurückzuführen ist, „auch wenn die Belegstellen nach den Originalen angegeben sind“, gilt allerdings zum größten Teil auch für Leibniz. „Auf üble Weise aber stellt Ramoneda diejenigen, die behaupten, dass das Individuum sich selbst vereinzele, denjenigen gegenüber, die behaupten, dass Materie und Form dies leisteten – als ob sich beide widersprechen würden; sind doch die letzten den erstgenannten eher untergeordnet wie spezielle Ansichten den allgemeinen. Denn was ist die Materie vereint mit der Form anderes als die ganze Seiendheit des Zusammengesetzten? Ich füge hinzu, dass ich hier von der Unterscheidung zwischen Körpern und Engeln absehe und deshalb [!] besser den Begriff ‘ganze Seiendheit’ verwende als ‘Materie’ und ‘Form’.“ (A VI 1, 12, 3-7, § 4) Ebd., § 4, A VI 1, 11, 26-31. Leibniz nennt hier als Mitstreiter außer den Nominalisten Petrus Aureoli, Durandus, Gabriel Biel und Fulgentius Schautheet auch folgende Autoritäten: Thomas Herveus, Gregor von Rimini, Franciscus Murcia, Suárez, Marcus Antonius
Haecceitas und Possibilienlehre
161
Mit der „secunda opinio“, der zufolge die „Negation“ das Prinzip der Individuation sei, weiß Leibniz inhaltlich nichts anzufangen. Auch nennt er keinen Vertreter32, sondern formuliert gegen die erörterte These, die eine Negation im Individuum selbst, also unabhängig von jeder Setzung durch den Verstand (extra intellectum) unterstellt, lediglich drei Absurditätsverdächtigungen von seinem nominalistischen Standpunkt aus.33 Die „tertia sententia“, die als Vereinzelungsprinzip eine „pars Physica“, nämlich die „existentia“ ansetzt,34 identifiziert Leibniz mit seiner eigenen Ansicht, sofern sie so aufgefasst werde, dass existentia und essentia „bloß dem Begriff nach (solùm ratione)“ unterschieden sind; denn auf diese Weise sei eben die existierende Wesenheit als ganze das „principium individuationis“. Nicht verteidigungsfähig sei dagegen die Variante, wonach die reale Existenz eine Bestimmung sein soll, die zwar das Konkrete „von innen her vereinzelt“, selbst aber „von dessen Wesenheit der Sache nach abgetrennt ist (ut existentia realis aliqvis sit modus rem intrinsecè individuans ab ejus essentiâ à parte rei distinctus)“.35 Leibniz sucht vielmehr – gegen jeden Universalienrealismus – zu beweisen, dass sich „Wesenheit und Dasein nicht abtrennen lassen (essentia et existentia non possunt separari)“, sondern „der Sache nach dasselbe (idem à parte rei)“ sind.36
32
33
34 35 36
Zimara, Perera, Daniel Stahl und – „neuerdings auch“ – den „ehrwürdigen Professor“ Abraham Calov. Obwohl er sich auf Suárez’ fünfte metaphysische Disputation De unitate individuali eiusque principio beruft (ebd., 12, 8; 16, 24 f.), geht er dessen Hinweis auf Heinrich von Gent nicht nach, sondern vermutet irgendeinen halbherzigen „dunkleren Nominalisten“, der übersehen habe, dass die Negation als Individuationsprinzip doch gerade unterstellt, „dass das Allgemeine mehr ein Seiendes ist als das Einzelne (universale magis esse Ens qvàm singulare)“. „Wie kann ein positives Seiendes durch etwas Negatives konstituiert werden? Ferner kann eine Verneinung keine individuellen Akzidentien hervorbringen. Und schließlich gilt jede Verneinung einem positiven Etwas, sonst ist sie bloß eine Verneinung dem Wortlaut nach.“ All das laufe auf den Widersinn hinaus, dass das Prinzip des Sokrates die Verneinung Platons und umgekehrt sei, ohne dass auf irgendeiner Seite etwas Positives sei, auf dem das Individuelle fußen könne. Das Prinzip der Negation könne nicht einsichtig machen, was Leibniz selbst für gewiss hält, nämlich dass eine spezielle „Natur sich selbst vereinzeln kann (quòd natura possit individuare seipsam)“. (§ 11 f.; ebd. 14, 3-28). § 3, A VI 1, 11, 24 f. § 13, ebd. 14, 29-35. § 14, ebd. 15, 7 f.; 4 f. Das Beweisargument, das in De principio individui immer wieder vorgetragen wird, lautet, dass alles, was der Sache nach verschieden ist, sich auch voneinander abtrennen lasse („qvaecunqve realiter differunt possunt à se invicem separari“) (§ 14, ebd. 15, 4-10). Die Abtrennbarkeit der Essenz von der Existenz widerlegt Leibniz so: „Alles, was entfernt wird, existiert auch ohne dasjenige weiter, von dem es entfernt wird. Denn ‘Entfernen’ wird wie ein Wirken auf dasjenige bestimmt, von dem etwas entfernt wird. Folglich existiert die Wesenheit auch nach ihrer Abtrennung von der Existenz weiter, was logische Verwirrung stiftet.“ (§ 15, ebd. 15, 11-13) Dass sich auch umgekehrt die Existenz nicht von der Essenz entfernen lässt, beweist Leibniz ebenfalls
162
Hubertus Busche
Es ist schließlich die vierte Lehrmeinung zum Individuationsprinzip, nämlich die von Scotus und seiner Schule vertretene „haecceitas“ oder Diesheit, welcher Leibniz mit der ausführlichsten Kritik begegnet. Leibniz sieht richtig, dass der “doctor subtilis” mit seiner „haecceitas“ einen „metaphysischen Teil“ einführt, der in Richtung Individuum „die Art eingrenzt (pars […] Metaphysica speciem terminans)“.37 Für seine Kritik beruft sich Leibniz nicht direkt auf die Schriften des Johannes Duns Scotus, sondern vor allem auf Johannes von Bassolis.38 Da Leibniz die
37 38
apagogisch: „Eine Wesenheit, die von der Existenz entfernt worden ist, ist entweder ein real Seiendes oder nichts. Wenn sie nichts ist, so war sie entweder nicht unter den erschaffenen Dingen, was ungereimt ist“, denn die Grundfrage betrifft ja nach § 2 das In dividuationsprinzip der erschaffenen Einzeldinge; „oder sie war nicht von der Existenz verschieden, was ich ja behaupte. Ist die Wesenheit aber ein reales Seiendes, so ist sie entweder ein bloß mögliches oder ein wirkliches Seiendes.“ In der Vorstellung der Gegner muss sie ein bloß mögliches sein, „denn es kann nicht wirklich sein außer durch seine Existenz, von der wir doch vorausgesetzt haben, dass sie entfernt worden sei“. Wer aber die Wesenheit als ein bloß mögliches Seiendes versteht, macht dadurch nach Leibniz „alle Wesenheiten“ zur „ersten Materie“, d.h. im Sinne des Aristotelischen Grenzbegriffs zu einem gänzlich formlosen Stoff, der reine Möglichkeit ohne Wirklichkeit ist. Denn „zwei bloß mögliche Dinge“ könnten sich jedenfalls „nicht in Beziehung auf ihr Wirklichsein“ unterscheiden, solange ihre Beziehung bloß „das Seiende der Möglichkeit nach“ betrifft. Das Monstrum einer irgendwie faktischen Möglichkeit, das ein solcher Schlaf der Vernunft nach Leibniz unfreiwillig produziert, könnte allenfalls die Erstmaterie sein, sonst wäre die Beziehung zwischen möglichen Dingen eben „keine reale“. (§ 15, ebd. 15, 14-21). Diese Lehrmeinung zum Individuationsprinzip liefe also darauf hinaus, dass die Wesenheiten letztlich „nicht von der Materie verschieden“ wären, ja dass „allein die Materie den wesentlichen Teil der Dinge“ ausmachte. Weil die amorphe hyle jedoch keine wirkliche „Form“ einschlösse, die Form aber „das Prinzip der spezifischen Unterschiedenheit“ ist, so folgte daraus, dass die Dinge „nicht der Art nach verschieden wären, wie z.B. die Wesenheit der Tiere von der des Menschen“. Wollte man dieser Katastrophe mit dem Hinweis darauf ausweichen, dass die bloß möglichen Dinge immerhin durch ihre unterschiedlichen Wesenheiten im göttlichen Intellekt, d.h. „durch ihre Beziehungen zu den Ideen“ spezifiziert seien, so fehlte erneut die „reale Beziehung“, die für ein Individuationsprinzip erforderlich ist. Denn die Relation zwischen verschiede nen Wesenheiten, sofern diese nur in Gott gedacht werden, ohne durch Schöpfung in die Existenz getreten zu sein, ist nur „ein Akzidens in GOTT“. (§ 15, ebd. 15, 22-26) Mit dieser Widerlegung lässt der früheste Leibniz seine ontologischen Vorentscheidungen erkennen. Eine distinctio realis zwischen Essenz und Existenz weiß er nicht anders zu verstehen als nach Art einer physischen Abtrennung, die realitas einer Wesenheit nicht anders als nach Art der materiellen Existenz in Raum und Zeit. Ein mittlerer Status der Essentien zwischen ihrer ewigen Möglichkeit in der göttlichen Idee und ihrer zeitlich wandelbaren Verwirklichung in der Welt scheint ihm allenfalls konstruierbar über die Fiktion eines gestaltlosen Urstoffes. Hierzu passt das IV. der Korollarien, mit denen Leibniz De principio individui beschließt: „Essentiae rerum non sunt aeternae nisi ut sunt in DEO“ (ebd., 19, 5). § 3, A VI 1, 11, 24 f. Leibniz bezieht sich auf De Bassolis, In quattuor sententiarum libros. Denn Bassolius sei unter Scotus’ Schülern „der mit Abstand älteste“, weshalb man seine Ansicht „getrost durchforschen“ könne. „Er hat Scotus noch selbst gehört, ist jedoch vielleicht noch frü-
Haecceitas und Possibilienlehre
163
scoti(sti)sche Position auch nach Benito Perera39 und Petrus Fonseca40 referiert, glaubt er folgendes als bekannt voraussetzen zu dürfen: „dass Scotus äußerster [Universalien-]Realist war;41 denn er nahm an, dass das Allgemeine eine wahre Realität auch außerhalb des Geistes hat“. Dagegen habe Thomas von Aquin eingeräumt, dass das Allgemeine immerhin „der Form nach vom Verstand gebildet wird. Um sich jedoch nicht der Ansicht zu nähern, die Aristoteles Platon zuschrieb, hat er zur Vorbeugung des Irrtums die Formaldistinktion eingeführt. Diese bestehe zwar vor der Tätigkeit des Verstandes, aber doch bezogen auf ihn. Er glaubte, dass durch sie die Gattung von der [spezifischen] Differenz unterschieden ist und infolgedessen auch die numerische Differenz von der Art. Sofern er nämlich voraussetzte (sei es aus Widerspruchseifer oder deshalb, weil er die Ansicht des Thomas für unerklärlich, die der Nominalisten aber für unglaubwürdig hielt), dass das Allgemeine real ist, hielt er es für zwingend, dass das Einzelne aus dem Allgemeinen und einem gewissen Zusatz entstehen müsse und dass zwischen Gattung und Art dasselbe Verhältnis bestehen müsse wie zwischen Art und Individuum, so dass es in gleicher Weise, wie es dort einen spezifizierenden Unterschied gibt, hier einen individuierenden Unterschied geben müsse“ (A VI 1, 16, 1-10, § 17).42
In dieser Hypostasierung des individuellen Unterschiedes zu einem positiven superadditum steckt nach Leibniz das ganze prôton pseudôs überflüssiger wie ungereimter Entitäten, die er gleichsam mit dem Schermesser Ockhams und der Nominalisten43 in zwei Etappen abrasieren will.44 Zunächst legt er sieben „Scoti fundamenta“ auseinander45, die sich allerdings meist vielmehr als Argumente
39 40 41 42
43
44 45
her als Ockham anzusetzen, weil er dessen grundsätzliche Einwände gegen Scotus an keiner Stelle zurückweist“ (§ 16, ebd. 15, 32-35). Pererio, De communibus omnium rerum naturalium principiis et affectionibus. Petrus de Fonseca, Commentaria in libros metaphysicorum Aristotelis. Eine Korrektur dieses Bildes begann mit Minges, Der angebliche exzessive Realismus des Duns Scotus. „Notum autem est Scotum fuisse Realium extremum, qvia universalia veram extra mentem realitatem habere statuit, cum Thomas formale eorum proficisci ab intellectu vellet. Ne tamen in sententiam vergeret, tributam ab Aristotele Platoni, distinctionem formalem commentus est palliando errori, qvae esset qvidem ante operationem intellectus, diceret tamen respectum ad eum. Hâc credidit genus distingui à differentiâ, et conseqventer differentiam numericam à specie: qvoniam enim universalia realia esse praesupposuerat, vel contradicendi studio, vel qvòd Thomae sententiam inexplicabilem putaret, Nominalium incredibilem, necesse fuit singularia ex universali et aliqvo superaddito oriri; ut autem est proportio inter genus et speciem, ita inter speciem et individuum; qvare uti illîc differentia specifica est, ita hîc individuificam esse concludebat.“ (§ 17, A VI 1, 16, 1-10) Hübener, „Leibniz’ gebrochenes Verhältnis zur Erkenntnismetaphysik der Scholastik“, 70, führt die „novacula Occami et Nominalium“, die sich nicht explizit bei Leibniz findet, bis 1649 auf Libertus Fromondus zurück, dessen Labyrinthus de compositione continui Leibniz allerdings spätestens 1671 studiert hat (vgl. A II 1, 111, 33 f.; 90, 24 f.; 97, 97, 21; A VI 2, 262, 2 f.; 274, 8 f.). Auf die vorausgeschickte Kritik an Scotus’ Identifizierung von „haecceitas“ und „materia totius“ kann hier nur abstrakt hingewiesen werden (vgl. § 18, ebd. 16, 11-20). Sie lauten: I. „Jede Einheit folgt auf eine bestimmte Entität, also auch die numerische.
164
Hubertus Busche
von Scotisten denn von Scotus selbst erweisen, und nennt bloß zu jeder These den Einwand, den er wahrscheinlich in der mündlichen Disputation näher ausgeführt hat. Erst dann erfolgt die Begründung seiner Kritikpunkte durch vier Gegenbeweise, die die haecceitas mit dem „geballtem Geschütz“ hypothetischer Schlüsse abwehren sollen.46 Um die Art zu verdeutlichen, wie Leibniz vom nominalistischen Standpunkt aus die „haecceitas“ kritisiert, sind die vier Gegenbeweise zu erläutern, ohne dass hier die Triftigkeit der Leibnizschen Kritik am historischen Scotus beurteilt werden könnte. I. Erstens will Leibniz zeigen, dass „Art und spezifische Differenz bloß vom Verstand unterschieden werden“, so dass eine haecceitas als eigenständige Entität, als superadditiver „individueller Unterschied“, nicht eingeräumt werden kann.47 Es gibt dann zwar dasjenige Reale, worin sich zwei Individuen unterscheiden, nicht jedoch diesen Unterschied als solchen, d.h. nicht eine bestimmte Diesheit (z.B. die „Socratitas“ oder „Platonitas“) im scoti(sti)schen Sinne einer realen Wesenheit, die in Relation zur Art denselben Status haben soll wie die Art zur Gattung. Dass Gattung und Differenz nur im subjektiven Begriff unterschieden seien, beweist Leibniz mit zwei negativen Argumenten, die er Soncinas entlehnt. Hauptargument hierbei ist die prinzipielle Entfernbarkeit alles realiter Verschiedenen voneinander. 1. „Qvae ante operationem mentis differunt, separabilia sunt.“ Nun lassen sich aber Gattung und spezifische Differenz nicht real abtrennen. Denn Scotus’ gelegentliche Behauptung, Gott könne bewirken, „dass das Allgemeine außerhalb der Einzeldinge und ähnlich die Gattung außerhalb der Art ist (ut universalia sint extra singularia, et similiter genus extra speciem)“, sei ungereimt, weil dann isolierte Gattungen nicht adäquat spezifiziert wären. Vielmehr würden Gespenster eingeräumt wie ein Lebewesen, das weder vernünftig noch unvernünftig ist, oder eine Bewegung, die weder geradlinig noch kurvenförmig ist – fast wie jenes von Hegel bemühte Obst, das weder Kirsche noch Birne noch Traube usw. sein soll.48 2. Dass genus und differentia specifica nicht abgetrennt werden können, zeige auch die Tatsache, dass die höheren Unterschiede von den niedrigeren ausgesagt werden. So
46 47 48
Deren Entität ist aber nicht das, was im Artbegriff eingeschlossen ist. Also ist ihr etwas hinzugefügt, nämlich die differentia individualis.“ – „II. Die Art wird nicht durch die Form, nicht durch die Materie, nicht durch die Akzidentien usw. eingeschränkt. Also bleibt nur die Diesheit übrig.“ – „III. Was verschieden ist, ist per aliqua primò diversa verschieden. Also sind Sokrates und Platon durch einen letzten Unterschied, nämlich die Diesheit, verschieden.“ – „IV. Die Art schränkt die Gattung durch den spezifischen Unterschied ein. Also schränkt das Individuum die Art durch den numerischen Unterschied ein.“ – V. „Die Individuen sind unter einer bestimmten Natur univok. Also schließen sie ein ursprünglich Verschiedenes ein.“ – VI. „Durch einen Unterschied geht das Individuum über die Art hinaus. Also gibt es einen solchen Unterschied.“ – VII. „Die spezifische Natur hat aus sich heraus eine Einheit, die geringer ist als die numerische und eine andere, die real von ihr verschieden ist.“ (§ 20 f., ebd. 16, 30 - 17, 11) § 19, ebd. 16, 28 f. „Si genus et differentia tantùm ratione distinguuntur, non datur differentia individualis“ (§ 22, ebd. 17, 15 f.). Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), Einleitung, § 13.
Haecceitas und Possibilienlehre
165
wird z.B. im Urteil „Haec rationalitas est rationalitas“ der bestimmten Vernünftigkeit des Sokrates die Vernünftigkeit überhaupt prädiziert. Der Artbegriff schließt somit die Merkmale seines Gattungsbegriffs ein. „Differentia specifica includit in se differentiam generis. E.[rgo] à genere non differt“. Folglich seien auch species und haecceitas nicht voneinander abtrennbar.49 Diese Argumentation zeigt deutlich, dass Leibniz sich nicht etwa gegen die in der haecceitas gedachte voll ständige Bestimmtheit des Individuums durch die göttliche Idee wendet. Vielmehr dürfte schon der frühe Leibniz die scoti(sti)sche „haecceitas“ in diesem Punkt sehr hochschätzen, da sie das Individuelle extrem aufwertet. Denn ganz wie in Leibniz’ später entwickelter Theorie des von Gott vorherbestimmten Individualbegriffs (notio completa) ist auch mit der „haecceitas“ das Individuum nicht mehr das Inkommensurable des Begriffs, nicht mehr, wie in der aristotelisch-thomistischen Lehre, eine bloß zufällig abweichende Materialisierung derselben Natur. Das von Leibniz selbst vertretene Individuationsprinzip der „tota entitas“ hat nämlich zugleich die andere Stoßrichtung, ebenso die Einseitigkeit des von Aristoteles her kommenden Vereinzelungsprinzips der „materia signata“ zu kritisieren. Dass Leibniz gerade in der scoti(sti)schen „haecceitas“ die Nobilitierung des Individuellen zum Prinzip durchaus anerkennt und begrüßt, beweisen die nicht wenigen Stellen im späteren Leibnizschen Werk, an denen die „haecceitas“ durchaus mit der göttlichen „notio individualis“ identifiziert wird.50 Was Leibniz an der „haecceitas“ lediglich beanstandet, ist dies, dass ihr von Scotus eine bewusstseinstranszendente Realität innerhalb der geschaffenen Natur zugeschrieben wird.51 Dass Leibniz Gattung und Art „nur im Begriff unterschieden“ wissen will, heißt nicht etwa, dass z.B. die Unterscheidung zwischen Tier und Mensch ohne ein korrespondierendes fundamentum in re, d.h. willkürlich wäre. Er bestreitet lediglich, dass die sachlich begründete Merkmalsdifferenz zwischen Tier und Mensch eigenständige Entitäten verlangt, welche außerhalb der konkreten Exemplare und doch, als Individuationsprinzipien, innerhalb des geschaffenen Seins bestehen sollen. Leibniz’ nomina listi sches Credo, wonach die Universalien im menschlich subjektiven Begriff post rem sind, widerspricht somit keineswegs dem theologischen, wonach die Universalien im göttlichen Intellekt ante rem sind.52
49 50
51
52
§ 22, ebd. 17, 15-27. So etwa „la notion individuelle ou hecceité d’Alexandre“ (Discours de métaphysique, § 8, A VI 4, B, 1540, 20), oder „Individualia seu haecceitates” (De divisione praedicati, A VI 4, A, 927, 3). Sehr plausibel scheint die Vermutung von Hübener, „Leibniz’ gebrochenes Verhältnis zur Erkenntnismetaphysik der Scholastik“, 70, dass Leibniz „eher, um der Schulform Genüge zu tun, seine prinzipiellen Vorbehalte gegen eine von ihm längst als unhaltbar erkannte Position mit Hilfe förmlicher Gegenargumente zu artikulieren versucht hat“. Insofern kann Leibniz fünf Jahre nach seiner Disputation durchaus formulieren: „In Deo sunt infinitae Ideae realiter diversae et tamen Deus est indivisibilis“ (De Transsubstantiatione, A VI 1, 512, 9 f.).
166
Hubertus Busche
II. Während der erste Einwand gegen Scotus die extramentale Realität der individuellen Differenz als solche widerlegen sollte, wendet sich der zweite nun gegen ihre reale Zusammensetzung mit dem Artbegriff, z.B. einer Dunsscotitas mit der humanitas. „Wenn es unabhängig von der Tätigkeit des Geistes keine Universalien gibt, so wird auch eine unabhängig von der Tätigkeit des Geistes bestehende Zusammensetzung aus dem Allgemeinen und dem individuierenden Prinzip nicht eingeräumt. Eine Zusammensetzung ist nämlich nicht real, bei der nicht alle ihre Glieder real sind.“53
Dieser Einwand reicht jedoch zusammen mit dem ersten noch nicht aus, um das Zentrum der scoti(sti)schen Haecceität zu treffen. Denn bisher wurde bloß eine reale Distinktion zwischen den Prädikabilien entkräftet. Scotus hat jedoch gerade jenen erläuterungsbedürftigen Modus einer formalen Distinktion eingeführt, nach dessen Namen die Scotisten auch „Formalistae“ genannt wurden. Daher tritt Leibniz erst mit dem folgenden, dritten Schritt näher in den Umkreis der Stärke seines Gegners ein. III. Die „haecceitas“ als eigenständige individuierende Entität „bricht zusammen“ erst dann, wenn auch die „formale“ Unterschiedenheit der Prädikabilien widerlegt ist. „Si non datur distinctio formalis ruit Haecceitas.“54 Zur Klärung dessen, was „formal“ hier besagen soll, beruft sich Leibniz auf die Interpretationen von Stahl55, der ein halbes Jahr später in Jena sein Lehrer wurde, sowie von Soncinas56 und Petrus Bilinus.57 Hierbei versteht er die Formaldistinktion durchaus richtig als eine distinctio „media inter realem et rationis“ 58 und weist darauf hin, dass Scotus sie nicht nur zwischen den praedicata superiora und inferiora, zwischen genus und differentia, zwischen essentia und existentia ansetzt, sondern auch zwischen den attributa in Divinis, zwischen relationes personales und essentia, zwi53
54 55 56 57 58
„Si non sunt universalia ante mentis operationem, non datur compositio ante mentis operationem ex universali et individuante. Non est enim realis compositio, cujus non omnia membra sunt realia“ (§ 23, A VI 1, 17, 28 f.) Den letzten Satz beweist Leibniz folgendermaßen. „Alles, was vor der Tätigkeit des Geistes realiter von einem anderen so unterschieden ist, dass keines von beiden einen Teil des anderen darstellt (sei es als ganzes oder nur teilweise), kann von dem anderen abgetrennt werden. Denn bei den auf adäquate Weise Unterschiedenen bedarf keines des anderen zu seinem Sein.“ Also können nur solche adäquat zerlegbaren Dinge „durch GOTTES unbedingte Macht getrennt werden, und somit ist bloß der Teil von dem Ganzen, sofern dieses bestehen bleiben soll, schlechthin unabtrennbar.“ (§ 23, ebd. 17, 30-34) § 24, A VI 1, 18, 1. Stahl, Compendium Metaphysicae, Kap. 23. Paolo Barbo [Soncinas], Quaestiones metaphysicales acutissimae, l. 7. q. 35. Petrus [Bilinus] de Posnania, Commentaria ad doctrinam Scoti in primo libro sententiarum cum censuris adversariorum, I. sent. de 34. dubio 64. Auch Assenmacher, Die Geschichte des Individuationsprinzips in der Scholastik, 65 u. Anm. 5, spricht von einem „Mittelding zwischen der realen und der bloß gedachten Distinktion“, wobei er diese mittlere als „eine bloß logische, virtuelle und nicht reale“ charakterisiert.
Haecceitas und Possibilienlehre
167
schen den quidditates rerum untereinander sowie zwischen den Washeiten und Gott selbst, sofern er in seinem Sein erkannt zu werden vermag.59 Nun lässt sich Leibniz zwar durch Johannes von Rada60 darüber belehren, dass die distinctio formalis zwischen zwei „realitates seu formalitates“ bestehe, die im Gegenstand als eins gesetzt sind (in subjecto identificatae), im Hinblick auf den Verstand (in ordine ad intellectum) jedoch als verschieden. Sie sei von der bloßen distinctio rationis dadurch unterschieden, dass nur diese zuvor eine tatsächliche operatio mentis erfordere. Doch diese Erläuterung überzeugt Leibniz nicht davon, dass die Formaldistinktion irgendeine erhellende Kraft hat. Derartige Erläuterungen scheinen ihm vielmehr in der speziellen Anwendung „erstaunlich verworren und schwankend“. Denn wenn die formale Verschiedenheit zwischen haecceitas und species bloß darin liegen soll, das die „haecceitas“ fähig ist, „in deutlicher Weise den Verstand [zur Bildung seiner Differenzierungen] zu veranlassen (distinctè movere intellectum)“, dann könne die „haecceitas“ schlecht als „principium individui“ fungieren, denn das Vereinzelungsprinzip müsse ja „unabhängig vom Verstand (praeciso intellectu)“ Realität haben. Weil für Leibniz ein Drittes zwischen Name und Sache gar nicht erst in Betracht kommt, folgert er mit einem gewissen Kopfschütteln, dass unter den Worten der Scotisten „etwas Größeres verborgen“ liegen müsse, ihre Formaldistinktion jedoch, „was immer es sein möge“, auf eine Absurdität hinauslaufe.61 Denn sie solle einerseits mehr sein als eine bloße Setzung im Geiste, andererseits aber weniger als ein Unterschied auf Seiten des Gegenstandes selbst.62 59 60 61
62
§ 24, A VI 1, 4-7. De Rada, Controversiae theologicae inter S. Thomam et Scotum super IV libros sententiarum. § 24, A VI 1, 18, 7-14. Die Wichtigkeit dieser Stelle betont Hübener, „Leibniz’ gebrochenes Verhältnis zur Erkenntnismetaphysik der Scholastik“. Er erläutert sein treffendes Urteil, wonach Leibniz in De principio individui „eine immanente Kritik der skotistischen Position im Stil der disputativen Methode der zeitgenössischen Schulphilosophie nicht gelingen will“ (67), mit dem Hinweis auf Leibniz’ Gleichgültigkeit gegenüber dem, „was sich [...] hinter den verworrenen Aussagen der Formalisten verbergen mag“ (71). Dass Leibniz sich „in seiner Kritik an der skotistischen distinctio formalis gar nicht erst auf die Unterscheidungsmetaphysik der Formalizantes“ einlässt und „überhaupt nicht die Arena“ der historischen Positionskämpfe „betritt“ (68 f.), hat seinen Grund allerdings darin, dass er nicht recht sehen kann, um welchen Preis und zu welchem höheren Zweck in dieser Arena eigentlich gefochten wird. Nicht geeignet, Leibniz’ Sinnlosigkeitsverdacht gegenüber der Formaldistinktion auszuräumen, mit der die haecceitas als Individuationsprinzip steht und fällt, ist auch die Hilfe des Scotisten Petrus Bilinus, der die „formalitates“ als gegenstandsbezogene Begriffskorrelate (conceptus objectivi) und als nur vom Verstand erkennbare Beziehungen (rationes intelligibiles) interpretiert, d.h. als Dinge zusammen mit ihrer Beziehung zu den subjektiven Begriffen (res cum relatione ad conceptus in mente formales). Vielmehr ergeben sich nach Leibniz dann vier neue Aporien. 1. Weil der eher formale Begriff auf den gegenständlichen zurückgeführt werden müsste, dieser jedoch in jenem fundiert sein soll, ergäbe sich ein begründungstheoretischer Zirkel. 2. Soll die intelligible Bezie hung sich auf den conceptus divinus, d.h. auf die Idee beziehen, so wäre sie wieder keine relatio realis; soll sie sich aber auf das sogenannte verbum mentis creatum, d.h. auf den Be-
168
Hubertus Busche
IV. Hat sich die haecceitas damit für Leibniz als ungereimt erwiesen, selbst wenn sie bloß „formal“ von der Art verschieden sein soll, so zielt sein abschließender Einwand zudem auf eine Erklärungsschwäche dieses Individuationsprinzips. Es sei nämlich „unerklärlich, wie die individuellen Akzidentien aus der Diesheit entspringen sollen (inexplicabile est qvomodo accidentia individualia ab Haecceitate oriantur)“. Wenn man dagegen, wie Leibniz selbst, „Anlagen der Materie zur Form (dispositiones materiae ad formam)“ einräume, sei dies klar einzusehen, während es „keine Anlagen der Art zur Diesheit (nullae speciei ad Haecceitatem)“ gebe.63 Dieser Kritikpunkt scheint insofern nachvollziehbar, als mit dem Individuationsprinzip ja in der Tat ein „Realgrund (principium reale)“ gesucht wird.64 Wenn die „haecceitas“ jedoch gar nicht im Sinne einer „distinctio realis“, sondern bloß im Sinne einer „distinctio formalis“ verstanden wird, ist schwer einzusehen, wie sie real die Vereinzelung des Seienden bewirken kann. Resümiert man Leibniz’ frühe Auseinandersetzung mit dem Individuationsprinzip des Johannes Duns Scotus, so handelt es sich zwar um eine standpunktgebundene und somit externe Kritik am scoti(sti)schen Universalienrealismus; innerhalb dieser Voraussetzungen bleibt sie jedoch recht fair und zeichnet keineswegs ein Zerrbild des Gegners. Vielmehr nimmt sie Scotus gleichsam als einen Gegner auf gleicher Augenhöhe durchweg ernst. Das im Folgenden zu erörternde zweite Feld der Auseinandersetzung, auf dem Leibniz der scotischen Gedankenwelt begegnet, ist sogar frei von solcher Gegnerschaft, sondern vielmehr mit großer Zustimmung und Anerkennung verbunden. Es handelt sich um Scotus’ logische wie theologische Lehre von den Possibilien, also jenen Möglichkeiten, die insbesondere in Gottes schöpferischem Verstand existieren. B. Leibniz’ Weiterentwicklung von Scotus’ Possibilienlehre Allerdings finden wir bei Leibniz keine Evidenzen im Text dafür, dass Leibniz seine Möglichkeitslogik in bewusster, eigenständiger Auseinandersetzung mit den damals verfügbaren Quellen des „doctor subtilis“ entwickelt hat. Wahrscheinlich ist vielmehr, dass Leibniz, der seine eigene Lehre von den Möglichkeiten (Possibilien)65 schon früh entwickelte, die scotische Lehre griff des endlichen Geistes beziehen, so dürften überhaupt keine individuierten Dinge mehr übrigbleiben, sobald in einem Gedankenexperiment jeder endliche Verstand aufgehoben würde. 3. Wenn die intelligible Beziehung eine reale sein soll, so wäre sie ferner auch eine singuläre, so dass sie ihrerseits individuiert wäre und dazu erneut einer eigenen Diesheit bedürfte, was in infinitum ginge. 4. Wenn die intelligible Beziehung den bloß möglichen subjektiven Begriff betreffen, zugleich aber auch formaliter von ihm verschieden sein soll, so lässt sich wiederum ins Unendliche fort nach der Bezogenheit dieser Beziehung fragen, weil jede wiederum eine Beziehung auf den Verstand verlangt. (§ 25, A VI 1, 18, 15-26) 63 § 26, ebd. 18, 27-31. 64 § 2, ebd. 11, 7 f. 65 Zum historischen Überblick vgl. Honnefelder; Arndt, „Possibilien“, 1126-1135, 1135-1139.
Haecceitas und Possibilienlehre
169
über ihre Darstellung bei Suárez kennenlernte.66 Im Zusammenhang seiner Auseinandersetzungen hebt er z.B. auch „Scotus’ höchst ausgezeichnete Lehrmeinung“ hervor, „dass der göttliche Verstand nichts erkennt (aus der Menge der faktischen Dinge), was er nicht auch bestimmt hat; andernfalls wäre er wertlos“.67 Es sind insgesamt drei Neuerungen, die Leibniz bei seiner Lehre von den logischen Möglichkeiten im intellectus divinus zumindest mittelbar von Scotus übernimmt. Erstens setzt Scotus an beim Begriff des „logisch Möglichen (possibile logicum)“, das er definiert als dasjenige, „dessen Teilbegriffe keinen Widerspruch einschließen (cuius termini non includunt contradictionem)“.68 Obwohl Scotus das „possibile logicum” vom „possibile reale“ abgrenzt, wendet er die logische Möglichkeit auch auf die kontingente Realität von Sachverhalten an, indem er sie mit der Begrifflichkeit der „Kompossibilität“ auslegt, die auch Leibniz später übernimmt. „Kompossibel“ sind solche Sachverhalte, deren Verknüpfung keinen Widerspruch einschließt.69 Zweitens aber verabschiedet Scotus die traditionelle, extensionale Auffassung des Kontingenten als dasjenige, was „nicht notwendigermaßen oder nicht immer der Fall ist“. Er versteht das Kontingente nun vielmehr intensional als dasjenige, „dessen Gegenteil wirklich sein könnte zu dem Zeitpunkt, da jenes auftritt“.70 Mit dieser Annahme synchroner kontrafaktischer Alternativen werden mögliche Sachverhalte denkbar, die niemals realisiert werden. Und hierdurch wiederum wird genau jener Gedanke koexistierender „möglicher Welten“ zu denken erlaubt, an der bekanntlich Leibniz seine metaphysische Lehre von der besten aller möglichen Welten festmacht. Drittens schließlich hat Scotus’ neue Auslegung der Kontingenz von synchronen Alternativen her aber auch Auswirkungen auf die Lehre vom Modalanstieg, mit der sich wiederum das Prinzip der Fülle verbindet. Die Lehre vom Modalanstieg besagt, dass alle realen Möglichkeiten dadurch ge66
67
68
69
70
Vgl. Suárez, Über die Individualität und das Individuationsprinzip, 31.12.40 ff.; vgl. Schepers, „Möglichkeit und Kontingenz“, 901-914; Honnefelder, Scientia transcendens, 266 f. Zur Lehre selbst vgl. Knuuttila, „Duns Scotus and the Foundation of Logical Modalities“, 127-143. „Praeclara Scoti sententia, quod intellectus divinus nihil cognoscat (ex rebus facti), quod non determinavit, alioqui vilesceret.” (Scientia media, November 1677, A VI 4, B, 1374, 23-25) Vgl. Ioannes Duns Scotus, Ord. I d. 38 p. 2 et d. 39 q. 1-5 n. 23, ed. Vat VI, Appendix A, 428f. „Possibile logicum est modus compositionis formatae ab intellectu, illius quidem cuius termini non includunt contradictionem, [...] sed possibile reale est, quod accipitur ab aliqua potentia in re sicut a potentia inhaerente alicui vel terminata ad illud sicut ad terminum” (Ord. I d. 2 p. 2 q. 1-4, n. 262; auch Ord. I d. 2 q. 7). Zum Begriff und zum Zusammenhang der Kompossibilität bei Leibniz vgl. Burkhardt, „Möglichkeit, Kontingenz und Kompossibilität“, 273-318; Brown, „Compossibility, Harmony, and Perfection in Leibniz“, 173-203; Evers, Gott und mögliche Welten, 24 ff. „Non voco hic contingens quodcumque non-necessarium vel non-sempiternum, sed cuius oppositum posset fieri quando illud fit” (Ord. I d. 2 p. 1 q. 1-2, n. 86.). Vgl. Mondadori, “Modalities, Representation and Exemplars”, 169-188.
170
Hubertus Busche
kennzeichnet sind, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt auch realisiert werden. Leibniz selbst schränkt allerdings diese Verwirklichung des Möglichen dahingehend ein, dass sie nur bei Gott, dem vollkommenen Wesen, unbedingt notwendig ist. Bei den geschaffenen, endlichen Wesen dagegen kann nicht alles Mögliche in die Existenz treten, da sich die nach Existenz drängenden Dinge gegenseitig an der Realisierung hindern. Folglich tritt aus dem Reich der Möglichkeiten nur dasjenige in die Existenz, was einen höheren Grad an Vollkommenheit hat als anderes.71 Durch Scotus’ Annahme gleichzeitiger kontrafaktischer Alternativen wird der lineare Zeitbegriff, dem zufolge die verwirklichten Möglichkeiten „statistisch“ verteilt auf der Zeitachse liegen, ersetzt durch einen verzweigten Zeitbegriff, dem zufolge gleichsam aus einem Set kompossibler Ereignisse jeweils nur eine einzige Serie realisiert wird.72 Diese bifurkationistische Auffassung des Kompossiblen sollte von entscheidender Bedeutung werden für die leibnizsche, gegen den Nezessitarismus gerichtete Ontologie. Denn ihr zufolge führen die Möglichkeiten im göttlichen Intellekt – unter den oben genannten Bedingungen der nur begrenzten Realisierungsmöglichkeiten endlicher Wesen einerseits und der göttlichen Entscheidung zugunsten der insgesamt bestmöglichen Welt andererseits – nun gleichsam einen „Kampf“ um ihre Realisierung innerhalb des Endlichen.73 Abstrakt betrachtet gilt zwar: „Alle Möglichkeiten drängen mit gleichem Recht zum Existieren je nach ihrem Verhältnis an Realität“.74 Doch aufgrund der gegenseitigen Behinderung oder faktischen Ausschließung haben alle Wesen „außer ihrer reinen Möglichkeit eine Neigung, in Proportion zu ihrer Güte zu existieren“.75 Ohne die skizzierten drei fundamentalen Vorgaben, die der „doctor subtilis“ mit seiner Possi bi li enlehre gemacht hatte, wäre Leibniz’ Logik und Metaphysik der bestmöglichen Welt demnach nicht möglich gewesen. Bilanziert man am Ende die Bedeutung und den Stellenwert, den Johannes Duns Scotus teils mit seinem Individuationsprinzip, teils mit seiner Possibilienlehre in Leibnizens Denken einnimmt, so darf man insgesamt das vorsichtige Fazit ziehen, dass Scotus zumindest von allen Hochscholastikern wahrschein71
72 73
74 75
„[…] sciendum est autem omne possibile extiturum esse si possit, sed quia non omnia possibilia existere possunt, aliis alia impedientibus, existunt ea quae sunt perfectiora. Itaque quod perfectissimum est, id certo constat existere” (Definitiones, Mitte 1685, A VI 4, A, 626, 21-24). Zur Erläuterung vgl. Burkhardt, „Duns Scotus und Leibniz“, 93-102; ders.: „Duns Scotus, Leibniz und Crusius über mögliche Welten”, 40-43. „L’on peut dire qu’aussitost que Dieu a decerné de créer quelque chose, il y a un combat entre tous les possibles, tous pretendans à l’existence” (Essais de Théodicée, § 201, GP VI 236). „[...] omnia possibilia pari jure ad existendum tendunt pro ratione realitatis“ (De rerum originatione radicali, GP VII 304). „Itaque omnia Entia quatenus involvuntur in primo Ente, praeter nudam possibilitatem, habent aliquam ad existendum propensionem, proportione bonitate suae“ (Specimen inventorum de admirandis naturae generalis arcanis, GP VII 310*); vgl. hierzu Ramelow, Gott, Freiheit, Weltenwahl, 348 ff.
Haecceitas und Possibilienlehre
171
lich derjenige ist, mit dem sich Leibniz am intensivsten auseinandergesetzt hat. Auch bleibt festzustellen, dass die Bedeutung Scotus’ für das Leibnizsche Denken sich geradewegs auf den originellen Kern der Leibnizschen Metaphysik bezieht. Im Hinblick auf das Individuationsprinzip der Haecceitas galt ihm Scotus teils als ernster Gegner, teils als radikaler Vordenker der Individualität jedes Seienden. Im Hinblick auf die Possibilienlehre jedoch war Scotus für Leibniz uneingeschränkt der große Anreger.
172
Hubertus Busche
Bibliographie Primärliteratur De Bassolis, Joh., In quattuor sententiarum libros, ed. Fr. Reynault and J. Frellon, Paris, 1516-17. De Rada, Johannes, Controversiae theologicae inter S. Thomam et Scotum super IV libros sententiarum. Köln, 1620. De Raey, Jean, Clavis Philosophiae naturalis seu introductio ad naturae contemplationem AristotelicoCartesiana, Leiden, 1654. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), Gesammelte Werke, Bd. XX, ed. Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Hamburg: Meiner, 1968 ff. Ioannes Duns Scotus, Ord. I, ed. Vat. Leibniz, Gottfried Wilhelm, Sämtliche Schriften und Briefe, ed. Preußische (Deutsche) Aka demie der Wissenschaften zu Berlin, Darmstadt (Berlin), 1923 ff. Leibniz, Gottfried Wilhelm, Die philosophischen Schriften von Leibniz, 7 Bde., ed. C. I. Gerhardt, Berlin, 1875-1890, Reprint Hildesheim, 1978. Leibniz, Gottfried Wilhelm, Die Werke von Leibniz, 11 Bde., ed. O. Klopp. Hannover, 1864-1884. Paolo Barbo [Soncinas], Quaestiones metaphysicales acutissimae. Lyon, 1586. Pererio, Benito, De communibus omnium rerum naturalium principiis et affectionibus. Rom, 1576. Petrus de Fonseca, Commentaria in libros metaphysicorum Aristotelis. Rom, 1577. Petrus [Bilinus] de Posnania, Commentaria ad doctrinam Scoti in primo libro sententiarum cum censuris adversariorum. Mainz, 1612. Stahl, Daniel, Compendium Metaphysicae in XXIV Tabellas redactum. Jena, 1655.
Sekundärliteratur Assenmacher, Johannes, Die Geschichte des Individuationsprinzips in der Scholastik. Leipzig: F. Meiner, 1926. Brown, Gregory, „Compossibility, Harmony, and Perfection in Leibniz.“ Philosophical Review 96, 2 (1987): 173-203. Burkhardt, Hans, „Möglichkeit, Kontingenz und Kompossibilität.“ Annali dell’Istituto di discipline filosofiche dell’Università di Bologna 4, 1982-83 (1985): 273-318. Burkhardt, Hans, „Duns Scotus und Leibniz: Moraltheorie und Modallogik.“ Leibniz. Werk und Wirkung. Vorträge des IV. Internationalen Leibniz-Kongresses. Hannover, 1983, 93-102. Burkhardt, Hans, „Duns Scotus, Leibniz und Crusius über mögliche Welten.”Abstracts of the 7th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Bd. 6. Salzburg, 1983, 40-43. Busche, Hubertus, Leibniz’ Weg ins perspektivische Universum. Eine Harmonie im Zeitalter der Berechnung. Hamburg: Meiner, 1997. Eschweiler, Karl, „Zu dem Thema: Leibniz und die Scholastik.“ In Die Philosophie der spanischen Spätscholastik auf den deutschen Universitäten des siebzehnten Jahrhunderts. Spanische Forschungen der Görres-Gesellschaft I, 251-325. Münster: Aschendorff, 1928. Evers, Dirk, Gott und mögliche Welten. Studien zur Logik theologischer Aussagen über das Mögliche. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006. Hochstetter, Erich, „Leibniz-Interpretation.“ Revue internationale de Philosophie 76/77 (1966): 174-192. Honnefelder, Ludger, Scientia transcendens. Die formale Bestimmung der Seiendheit und Realität in der Metaphysik des Mittelalters und der Neuzeit (Duns Scotus-Wolff-Kant-Peirce). Hamburg: Meiner, 1990.
Haecceitas und Possibilienlehre
173
Honnefelder, Ludger and Hans Werner Arndt, „Possibilien.“ In Historisches Wörterbuch der Philosophie, ed. Joachim Ritter et al., Bd. VII, Sp. 1126-1135, 1135-1139. Basel: Schwabe, 1989. Hübener, Wolfgang, „Leibniz’ gebrochenes Verhältnis zur Erkenntnismetaphysik der Scholastik.“ Studia leibnitiana 17 (1985): 66-76. Jasper, Josef, Leibniz und die Scholastik. Phil. Diss. Leipzig: Münster i. W., 1998. Kabitz, Willy, „Die Bildungsgeschichte des jungen Leibniz.“ Zeitschrift für Geschichte der Erziehung und des Unterrichts 2,3 (1912): 164-184. Kirchmann, Julius Hermann von (ed.), Die kleineren philosophisch wichtigen Schriften von G. W. Leibniz. Leipzig, 1879. Knuuttila, Simo, „Duns Scotus and the Foundation of Logical Modalities.“ In John Duns Scotus. Metaphysics and Ethics, ed. Mechthild Dreyer, Ludger Honnefelder and Rega Wood. Leiden: Brill, 1996, 127-143. Koppehl, Hermann, Die Verwandtschaft Leibnizens mit Thomas von Aquino in der Lehre vom Bösen. Jena: H. Pohle,1892. McCullough, Laurence Bernard, The Early Philosophy of Leibniz on Individuation. A Study of the Disputatio metaphysica de principio individui of 1663. Ann Arbor (Mich.), London, 1978 (Mikrofilm zur Phil. Diss. von 1975, University of Texas, Austin). Minges, Parthenius, Der angebliche exzessive Realismus des Duns Scotus. Münster: Aschendorff, 1908. Mondadori, Fabrizio, „Modalities, Representation and Exemplars: The ‘Region of Ideas’.” In Mathesis rationis. Festschrift für Heinrich Schepers, ed. Albert Heinekamp, et al., 169-188. Münster: Nodus, 1990. Nostitz-Rieneck, Robert von, „Leibniz und die Scholastik.“ Historische Beiträge zur Philosophie, Bd. II: Vermischte Abhandlungen. Berlin: G. Bethge, 1855. Nostitz-Rieneck, Robert von, „Leibniz und die Scholastik.“ Philosophisches Jahrbuch 7 (1894): 54-67. Pichler, Aloys, Die Theologie des Leibniz aus sämtlichen gedruckten und vielen noch ungedruckten Quellen. 2 Bde. München: J. G. Cotta, 1869/70. Quillet, Jeannine, “Disputation métaphysique sur le principe d’individuation de G. W. Leibniz (1663).” Les Études philosophiques (1979): 79-105. Ramelow, Tilman, Gott, Freiheit, Weltenwahl. Der Ursprung des Begriffes der besten aller möglichen Welten in der Metaphysik der Willensfreiheit zwischen Antonio Pérez S. J. (1599- 1649) und G. W. Leibniz (1646-1716). Leiden: Brill, 1997. Rintelen, Fritz, „Leibnizens Beziehungen zur Scholastik.“ Archiv für Geschichte der Philosophie 16 (Neue Folge, Bd. 9, 1903): 157-189 u. 307-334. „Leibnizens Beziehungen zur Scholastik.“ Historische Beiträge zur Philosophie, Bd. II: Vermischte Abhandlungen. Berlin: G. Bethge, 1855. Schepers, Heinrich, „Möglichkeit und Kontingenz. Zur Geschichte der philosophischen Terminologie vor Leibniz.“ Filosofia (Turin) 14 (1963): 901-914. Suárez, Francisco, Über die Individualität und das Individuationsprinzip. 5. metaphysische Disputation/De unitate individuali eiusque principio (lat./dt.), I-II, ed. Rainer Specht, Hamburg: Meiner, 1976. Trendelenburg, Adolf, „Das Verhältnis des Allgemeinen zum Besondern in Leibnizens philosophischer Betrachtung und dessen Naturrecht.“ Historische Beiträge zur Philosophie, Bd. II: Vermischte Abhandlungen. Berlin: G. Bethge, 1855, 233-256. Violette, R. (ed.), “Lettres et opuscules de Physique et de Métaphysique du jeune Leibniz (1663-1671).” Sciences et Techniques en Perspective, vol. 6, Université de Nantes 1984-85, 2833.
174
175 Archa Verbi. Subsidia 6
175–193
Ontologie et métaphysique chez Kant Yves-Jean Harder
Depuis les travaux de grands historiens de la philosophie1, Duns Scot est le nom qui dénote la structure moderne de ce qu’on peut appeler, après Kant, l’onto-théologie. Ce terme, comme le rappelle Olivier Boulnois dans la somme qu’il a consacrée à la constitution de la métaphysique moderne2, est utilisé par Kant pour désigner la tentative, vaine, de « connaître l’existence de Dieu sans l’aide de la moindre expérience »3, tentative qui culmine dans la preuve ontologique, « seule preuve possible »4 puisque les deux autres, la cosmologique et la physico-théologique, se fondent sur elle. Mais il faut aller plus loin : le fondement du théologique dans l’onto-théologique implique la subordination du théologique à l’ontologique, de Dieu à l’être. Car ce n’est pas seulement l’être de Dieu qui est en jeu dans l’onto-théologique, c’est l’être lui-même, l’étant en tant qu’étant. S’il y a chez Kant une ontologie au sens traditionnel, une thèse sur l’être, elle est exposée dans la critique de la preuve ontologique. « L’être n’est pas un prédicat réel » se dit de tout étant, et cette universalité de la thèse justifie seule son application à l’être de Dieu. Précisons : parce que l’existence ne peut se tirer de la réalité, l’étant le plus réel qu’on puisse concevoir – et rien n’interdit en effet de concevoir la réalité, y compris sous sa forme suprême – ne contient pas dans toute sa réalité le moindre soupçon d’existence. On ne peut donc pas prouver, du summum ens, ou de l’ens realissimum, qu’il est. La subordination de la théologie à l’ontologie, c’est-à-dire la thèse selon laquelle connaître Dieu présuppose de connaître au préalable l’étant en tant qu’étant, ou selon laquelle l’objet premier de la métaphysique est la détermination de ce qu’il y a de commun à tous les étants, et non la détermination du premier parmi les étants, définit très exactement le moment scotiste de la métaphysique. Il s’agit, comme le soulignent les auteurs qui ont mis en lumière l’importance historique de Scot, d’un « renversement »5 comparable à 1
2 3 4 5
Honnefelder, Scientia transcendens. Deux textes de L. Honnefelder sont traduits en français : 1) Vernunft und Metaphysik ; traduction française de Jacob Schmutz : Raison et métaphysique. 2) La métaphysique comme science transcendantale, traduction par I. Mandrella. Courtine, Suarez. Boulnois, Être et représentation. Cf. note précédente. Kant, Critique de la raison pure [CRP], trans. Barni et Delamarre, Ak. III, 420. CRP, Ak. III, 419. Boulnois, Être et représentation, 512. Courtine, Suárez, 137 parle de « bouleversement considérable », et ajoute : « Dans l’histoire de la constitution ontothéologique de la métaphysique ,il y a assurément une époque scotiste » (137).
176
Yves-Jean Harder
la révolution copernicienne : avant Scot, ou hors de Scot, dans la définition de la métaphysique héritée d’Aristote, l’étant en tant qu’étant était pensé à partir de l’universalisation de l’être de l’étant premier ; après Scot, ou dans la tradition qui trouve en lui son origine, l’être de Dieu ne peut être pensé qu’à partir de l’universalité du concept d’être, ou de la détermination du commun de l’étant. On passe d’une théo-ontologie, qui est plus simplement nommée par Aristote théologie6, dans laquelle « la science du divin détermine celle de l’étant »7, à une onto-théologie. La primauté de l’ontologie sur la théologie ne signifie nullement la moindre importance, ou le moindre intérêt de la seconde par rapport à la première. Mais l’objet premier de la métaphysique n’est pas nécessairement le plus noble ou le plus élevé dans la dignité des étants ; il est premier parce que la pensée a d’abord affaire à l’universel, c’est-à-dire à ce qui est commun à tous les étants. La primauté se déduit de l’universalité. Tel est le renversement fondamental opéré par Duns Scot : non plus universel parce que premier8, mais premier parce qu’universel. Au terme de ce bouleversement, « universel », et « premier », ont changé de signification. L’universel n’est plus le meilleur de chaque genre, celui qui a du genre les traits éminents, à partir desquels il peut être défini, il est devenu le quelconque, celui qui peut être dit indifféremment du supérieur comme de l’inférieur, de Dieu comme de la créature, du maître comme de l’esclave, du juif comme du grec. Le premier n’est plus le premier dans l’ordre de l’être, être parce que un, il est premier dans l’ordre de la pensée, non pas ce que le pensée rencontre en premier dans le commencement de son procès, mais ce qui rend possible la pensée en général, ce qui détermine les conditions de pensabilité les plus générales d’un objet. Ce changement de sens n’est autre que le passage de l’antiquité à la modernité. On appellera moderne la saisie, aussi bien théorique que pratique, de la totalité des étants à partir du concept de l’étant en général, ou, ce qui revient au même, à partir de la définition des conditions les plus générales de la pensabilité de l’étant9. Comme l’exprime Jean-Luc Marion : « Le primat du concept d’étant implique le primat du concept sur l’étant. »10 Cette primauté du concept universel, ou de la représentation, sur l’être représenté, ou sur l’étant en tant qu’effectif ou existant, caractérise bien la révolution galiléenne, ce « violent changement de sens qui assigne d’abord à la mathématique […] des tâches universelles »11, qui fait de l’idée mathématique, en tant qu’elle peut être pensée, le point à partir duquel s’ouvre un monde infini d’objets, qui n’offrent aucun obstacle à leur investigation par la pensée. Mais « cette mutation essentielle de l’idée et de la tâche de la philosophie universelle, qui s’est accomplie au commencement des Temps Modernes dans la 6 7 8 9 10 11
Métaphysique, E, 1, 1026 a 19. Boulnois, Être et représentation, 462. Métaphysique, E, 1, 1026 a 30. Duns Scot : « Nihil potest adaequari intellectui nostro ex natura potentiae in ratione primi obiecti nisi communissimum » (Ord. I d. 3 p. 1 q. 3 n. 186, ed. Vat. III, 113). Marion, « La science toujours recherchée et toujours manquante ». Husserl, La crise des sciences, trans., Granel, 25.
Ontologie et métaphysique chez Kant
177
transposition de l’idée antique »12 a pour assise une nouvelle articulation de la métaphysique, qui la précède de plus de trois siècles. La rupture avec les Grecs permet l’avènement d’une universalité paulinienne, qui s’accorde au christianisme mieux que la primauté essentielle du divin héritée d’Aristote, dans la mesure où elle promeut une univocité qui fait se rencontrer dans l’être l’homme et Dieu, tout en préservant le mystère du Seigneur : le primat du concept n’implique pas que l’intellect humain puisse s’élever au point de vue divin. Dans la mesure même où il a accès à l’universel de la connaissance, il doit renoncer à connaître l’éminence de Dieu. De plus l’être lui-même, s’il est, en tant qu’objet premier de l’intellect humain, le seul objet possible d’une connaissance à la mesure de l’homme, n’est pas l’ « étant véritablement étant » que les Grecs dénotaient par le terme d’ousia. Il n’est qu’un concept abstractif d’étant, transcendant toutes les catégories de l’étant, non du fait de son éminence, mais du fait de sa communauté dans tous les étants13. Par conséquent la métaphysique, assurée dans son objet et dans sa méthode, affirme la modestie de sa portée, en renonçant à être une scientia propter quid, une metaphysica secundum se scibilis, ou métaphysique en soi metaphysica in se, connaissance qui serait parfaitement adéquate aux choses telles qu’elles sont en elles-mêmes. Si l’on admet, comme les Modernes, que la métaphysique est définie par son objet premier, que celui-ci ne peut être que conçu, que l’intellection atteint un universel qui est une abstraction commune, alors la métaphysique est essentiellement une ontologie, ou plus exactement une science transcendantale de l’être, c’est-à-dire une science qui vise le terme en lequel se rejoignent non seulement tous les étants, mais toutes les catégories de l’étant, qui n’est ni un étant particulier, serait-il suprême, ni un mode exemplaire de l’étantité, seraitil essentiel ou substantiel. Mais quoi ? Ce que l’on ne peut pas ne pas viser quand un objet quelconque se présente à l’esprit, qui, faute d’être une chose, est du moins quelque chose, aliquid, qui n’est que la transcription positive de ce qui ne peut s’énoncer que négativement, pas rien. Pourquoi pas ? Parce qu’on ne peut pas ne pas le penser, dès lors qu’on pense un objet ; c’est la réalité de l’objet en tant qu’il est pensé. C’est le point de départ de la métaphysique moderne : partir de presque rien, au lieu de se fonder sur la contemplation de la présence surabondante de l’Un, ou du moins sur son désir. Pas grand-chose, mais assez pour commencer, assez pour que la pensée se saisisse d’un objet, le minimum pensable, représentable, ce sans quoi il n’y aurait pas de représentation. L’ontologie tire son point de départ de la nécessité propre à la pensée ; en renonçant à trouver l’être dans le monde, elle l’extrait de la pensée, qui est ainsi mise au fondement. L’universalité de l’objet de l’ontologie a pour contrepartie sa quasi-inanité : n’être pas rien, c’est être, mais pas être en plénitude. Par conséquent si la connaissance vise tout étant par la saisie de ce qui transcende tout étant, 12 13
Ibid. Cf. Honnefelder, La métaphysique comme science transcendantale, 35-37.
178
Yves-Jean Harder
elle n’atteint aucun étant véritable, aucun absolu. La connaissance des conditions de possibilité de l’apparition d’un objet en général à la pensée, ou des conditions de la représentation, implique la critique de toute connaissance de l’absolu. Connaître, c’est sans doute accéder à ce qui fonde la possibilité de tous les étants, mais pas à l’étant en totalité. L’universalité n’est possible qu’au prix du renoncement à la totalité : tous, donc pas tout. Celui qui est pris dans l’ensemble de l’universel doit le payer du renoncement à être totalement ce qu’il est. N’entre dans le royaume de l’être que celui qui abandonne une partie, même essentielle, de ce qu’il est. Hegel en a fait la caricature : du fruit, mais ni des cerises, ni des poires, ni des raisins …14. La modernité se contente de peu de chose. En réalité, elle a déplacé le lieu de son contentement. Le fait que l’objet soit défini à partir des conditions de la représentation ne fait pas de celle-ci une norme pour la béatitude. Ce par quoi la vie a une valeur n’est plus, comme chez Platon, le souci de la pensée, ni, comme chez Aristote, une praxis qui culmine dans l’acte pur de la pensée, mais un salut qui vient d’un amour qui excède toute pensée, toute connaissance, toute représentation. La détermination de la pensée en représentation est une dévaluation de la pensée. Le primat théorique de l’intellection dans la saisie de l’étant commun n’implique pas la valeur pratique de la pensée : celle-ci est dévaluée par rapport à la volonté, par une inversion du rapport établi par les Anciens, par Aristote en particulier, entre la vie active et la vie contemplative. L’objet est sans doute conçu, mais il n’est pas lui-même un Intellect ; quant à l’intellect humain, il n’est pas la condition de la béatitude. Ainsi que le résume Olivier Boulnois : « Pour Aristote, l’acte par excellence de la béatitude divine est la pensée de la pensée ; pour Scot, il est la volonté de la volonté : le vouloir de soi qui possède à la fois pour sujet et pour objet l’Amour subsistant15 ». La modernité est, dans son inauguration, une radicalisation du christianisme, qui se traduit par un rejet non pas tant du savoir des Anciens que de la possibilité d’identifier le savoir à une sagesse. D’où ce paradoxe que les plus savants parmi les Modernes, du savoir le plus moderne, comme les mathématiques ou la physique, peuvent être ceux qui accordent le moins de prix à ce savoir. Le renversement scotiste se traduit donc par un double déplacement : dans le domaine de la théorie, le fondement ultime de tout savoir, l’être, se rapporte à la représentation, donc à la fonction intellective, comme à sa condition, parce qu’il est son objet ; d’autre part, le théorique en général, est soumis, d’un point de vue axiologique, au primat du pratique. À partir d’une telle caractérisation, on n’aura pas de mal à reconnaître une figure philosophique bien connue : celle du kantisme. La découverte de la révolution scotiste entraîne une autre révolution, dans l’histoire de la philosophie cette fois : on croyait jusqu’ici que la révolution copernicienne marquait une rupture dans la compréhension de l’objet de la connaissance, qui devait être rapporté aux conditions de la représentation et non aux choses mêmes ; en réalité Kant ne 14 15
Encyclopédie, § 14, remarque. Boulnois, Être et représentation, 215.
Ontologie et métaphysique chez Kant
179
ferait que redécouvrir, sans le savoir ou peut-être en le sachant un peu16, la modernité scotiste. Le véritable « génie refondateur de la métaphysique »17 n’est pas Kant, encore moins Descartes18. Une fois admis ce déplacement du pivot de la modernité, reste à définir ce que ce changement de perspective apprend sur Kant. Il y a en effet deux manières d’envisager l’appartenance de Kant à ce qu’on appellera, avec Olivier Boulnois, la « structure de la métaphysique moderne »19 : l’héritage ou la répétition. Dans le premier cas, la définition de la métaphysique chez Kant, notamment l’articulation de celle-ci à la philosophie transcendantale, par suite le projet critique lui-même, sont, pour l’essentiel, déjà contenus dans les auteurs qui se rattachent à une même tradition par une généalogie dont l’ancêtre commun est Duns Scot. La liste des jalons essentiels peut être plus ou moins longue ; elle comprend au moins : Suárez et Wolff20. Comprendre Kant à la lumière de Scot signifie alors évaluer le rapport du premier à la Schulmetaphysik, en précisant aussi bien les concepts dont il hérite de ses maîtres, que la manière dont il les infléchit, voire les bouleverse. Si, au terme de cette confrontation, il reste une originalité de Kant, elle demeure incluse dans une problématique qui s’impose à lui, et qui concerne la définition même de l’objet de la métaphysique. La révolution copernicienne sera circonscrite dans 16
17 18
19 20
Honnefelder, « Raison et métaphysique », trans., Schmutz, 35 : « Comme en témoigne l’évocation de la “ philosophie transcendantale des Anciens ”, Kant n’ignore pas le lien historique qui le rattache à la longue tradition qui le précède. » Boulnois, Être et représentation, 506. Scot déloge Descartes de la position de « véritable initiateur de la philosophie moderne », comme le nomme Hegel (Histoire de la philosophie, t. VI, trans., Garniron, 1384). Non seulement Descartes n’est pas premier, mais on peut s’interroger sur sa réelle modernité. En effet, ce qui justifierait ce titre, c’est l’absence de toute présupposition, le commencement de la pensée par elle-même, le doute et la certitude d’exister du sujet pensant. Pourtant le moment ontologique, donc moderne, de Descartes, est plutôt à chercher dans la Ve Méditation, lorsqu’il accorde à la représentation, une fois assuré de sa vérité intrinsèque dans l’acte qui la soutient, d’être d’une certaine manière : non tamen dici possunt nihil esse (AT, VII, 64). Mais Descartes ne va pas, contrairement à Malebranche, jusqu’au bout de ce mouvement ontologique, car la suspension de l’existence qui accompagne l’affirmation de l’essence (etiam si extra me fortasse nullibi existant) ne dure que le temps de cette Méditation. Descartes retrouve l’existence des choses matérielles dans la VIe : il est donc en définitive impossible de dissocier l’être de l’existence, et de le réduire à un aliquid. Le commencement par la pensée, qui serait inaugural de la modernité, est tout aussi bien l’affirmation conjointe de l’être et de l’exister, serait-ce à la première personne. Comme l’écrit Vincent Carraud : « Pour Descartes, être n’est pas seulement penser ou être pensé, c’est aussi immédiatement exister, et exister sous la forme du je suis, j’existe aussitôt réécrit : “ sum autem res vera, et vere existens ” (AT VII, 27, 15-16). » (« L’ontologie peut-elle être cartésienne », 27). Op. cit. p. 512 ; cf. aussi le titre du chapitre V : « La nouvelle structure de la métaphysique ». Pour une généalogie plus approfondie, on se reportera aux historiens cités en note 1, et tout particulièrement au chapitre conclusif de Scientia transcendens de Honnefelder : « Metaphysik als scientia transcendens ».
180
Yves-Jean Harder
une révolution plus radicale puisqu’elle concerne la possibilité même de définir la métaphysique à partir d’une philosophie transcendantale. La question est alors de savoir quelle place occupe le kantisme dans cette généalogie : est-il un simple chaînon dont la fonction serait limitée à la transmission, ou joue-til un rôle spécifique, qui donnerait à la chaîne tout entière sa structure ? En parlant d’ « achèvement kantien », Olivier Boulnois21 indique que, si Kant est bien compris dans la structure moderne de la métaphysique, celle-ci trouve avec lui sa dernière expression. Faut-il l’interpréter comme un échec du kantisme à renouveler et à pérenniser le modèle hérité, ou bien y a-t-il, dans le kantisme lui-même, une destruction interne de l’ontologie traditionnelle ? Si la Critique de la raison pure est une « autocritique »22 de la tradition onto-théologique scotiste, elle procède, dans la remise en cause de la tradition, de cette tradition même. Cela ne permet pas de conclure si cette tradition survit à cette critique ou si elle est emportée sous les coups qu’elle s’inflige à elle-même. Pour situer le kantisme, et évaluer la portée de sa critique, on peut envisager un rapprochement plus direct entre Kant et Scot, par une analogie qui dépasse la simple continuité au sein d’une même famille de penseurs. C’est ce que propose Honnefelder, qui par ailleurs abonde en arguments généalogiques, lorsqu’il insiste sur la nature essentiellement critique de la métaphysique : c’est toujours une crise du savoir qui motive une refondation de la métaphysique. « Les deux auteurs, écrit-il23, se considèrent comme faisant face à une crise qui ne touche pas seulement certains aspects de la métaphysique communément acceptée de leur époque, mais bien la possibilité de la métaphysique en elle-même. » La question de la métaphysique est alors posée en des termes différents de l’approche généalogique ; il ne s’agit plus d’établir des ressemblances ou des dissemblances à l’égard d’un modèle supposé commun, mais bien de réinventer ce modèle. La crise de la métaphysique wolffienne, qui initie la réforme kantienne, peut en effet être interprétée, non pas comme l’épuisement du principe ontologique, mais comme un dévoiement de la métaphysique telle que Scot la conçoit. En effet si la systématisation wolffienne de l’ontologie, qui en fait le moment premier et général de la métaphysique, d’où dépendent les autres branches, rabaissées à une spécialité, explicite la subordination onto-théologique qui caractérise en partie le renversement scotiste, en revanche la portée totalisante que la méthode des géomètres donne au système contredit la modestie spéculative qui est le corollaire de la scientia transcendens de Scot. Certes le reproche que Kant adresse à la méthode dogmatique n’est pas tant de vouloir aboutir démonstrativement à des certitudes apodictiques24, mais de confondre l’apodicticité de la connaissance par pur concepts avec celle de la construction de concepts, c’est-à-dire de partir de concepts dont 21 22 23 24
Être et représentation, 493. Être et représentation, 500. Honnefelder, « Raison et métaphysique », 31 ; cf. aussi Honnefelder, Scientia transcendens, 403. La science « doit toujours être dogmatique, c’est-à-dire strictement démonstrative à partir de principes a priori purs » (CRP, Préface, Ak. III, 21)
Ontologie et métaphysique chez Kant
181
la définition est considérée comme évidente alors qu’il serait nécessaire de l’établir par une critique préalable. Mais Kant retrouve par là une position analogue à celle de Scot. Comme l’écrit L. Honnefelder : « Par cette critique, il ne touche cependant pas la possibilité de la métaphysique comme science en général, mais seulement la prétention que Scot avait pour sa part déjà rejetée de manière décisive, à savoir le projet de poursuivre la métaphysique sous la forme d’une demonstratio propter quid. »25 Ce que Wolff appelle Ontologia methodo scientifica pertractata comprend un statut qui est celui de la scientia in se ou encore secundum se scibilis, que Scot accorde à la connaissance mathématique, mais qu’il tient pour incompatible avec la métaphysique26. Si la seule erreur de Wolff est d’avoir négligé de préparer la métaphysique à la scientificité par une critique préalable de la raison, et si, par conséquent, le seul mérite que Kant lui-même s’accorde, tient dans une telle critique, celleci ramène la métaphysique au statut que Scot lui avait déjà assigné : celui de scientia in nobis. La critique kantienne n’est plus alors un prolongement de la Schulmetaphysik par la médiation de laquelle elle se rapporterait indirectement au paradigme scotiste, elle est la répétition de ce paradigme par-delà, et contre, la Schulmetaphysik. Selon qu’on le considère comme héritage ou comme répétition, le scotisme de Kant est équivoque : tantôt il signifie la dépendance conceptuelle à l’égard de la métaphysique scolaire, tantôt son émancipation. L’un n’empêche pas l’autre, il est vrai : on réfute seulement des doctrines familières. Mais l’éclairage porté sur le sens de la philosophie de Kant est différent, et même opposé, selon que l’on place le moment scotiste de Kant dans l’identification avec la tradition, ou dans la rupture. Dans un cas le scotisme concerne la définition de la métaphysique comme onto-théologie – la fondation de toute la métaphysique dans l’ontologie qui finit par l’absorber entièrement ; dans l’autre, il concerne la portée de la métaphysique par rapport à la valeur, le salut chez Scot, le pratique chez Kant. Le premier Scot est celui de la scientia transcendens, dont la structure permet de penser le projet de philosophie transcendantale ; le second Scot est celui de la Théologie comme science pratique, et du primat de la volonté sur l’intellect. C’est de ce second Scot que pourrait se réclamer celui qui a voulu « supprimer le savoir, pour trouver une place à la foi »27. Ce n’est pas le même Scot, mais ce n’est pas non plus le même Kant. Quand bien même on aurait montré la filiation, ou la dépendance structurelle, entre la scientia transcendens et la philosophie transcendantale, on n’a pas pour autant pris en considération le projet kantien pris dans son ensemble, qui ne se borne pas à une élucidation des conditions de la représentation, et donc à la constitution de l’expérience possible, mais qui comprend, au centre de sa visée architectonique, l’articulation du théorique et du pratique.
25 26 27
Honnefelder, « Raison et métaphysique », 37. Cf. Honnefelder, Scientia transcendens, 325. CRP, Préface à la 2e édition, Ak. III, 19.
182
Yves-Jean Harder
Les historiens du scotisme, ne disent rien, ou peu de chose, sur le rapport entre la theologia scotiste et le pratique chez Kant. Pour des raisons évidentes : ce rapport excède la structure de la métaphysique moderne. La théologie est subordonnée à l’ontologie du point de vue théorique, et le pratique, aussi nécessaire soit-il à la considération de la vie bonne, semble exclu du problème de la métaphysique. Cette séparation entre le pratique et le théorique conduit à centrer la lecture de Kant sur l’Analytique transcendantale de la Critique de la raison pure, et à négliger, non seulement l’entreprise architectonique qui se déploie à travers les trois Critiques, mais même, dans la première, les avancées essentielles de la Dialectique transcendantale, réduite à la discussion de la métaphysique scolaire et à la préparation de la philosophie pratique. Or est manqué, par cette vision restreinte, non pas ce qui serait chez Kant extérieur à la définition de la métaphysique, mais le cœur même du projet d’institution de la métaphysique future comme science. L’enquête purement historique, consistant dans la tâche infinie des rapprochements de tous les énoncés du corpus kantien avec les énoncés proches ou similaires décelables dans le corpus indéfiniment extensible des petits intermédiaires appartenant à une lignée scotiste de la métaphysique allemande, entre Scot et Kant, et surtout entre Wolff et Kant, est certes précieuse à la compréhension de la philosophie kantienne, mais seulement dans la mesure où elle met en lumière, par élimination de ce qui chez Kant n’est pas vraiment de Kant, ce qui est en définitive vraiment de lui. C’est ici qu’on rencontre les limites de l’érudition dans l’interprétation d’un philosophe : on ne peut avancer dans l’enquête que si on est guidé par une attention à ce qui est problématique dans la mise à jour d’une structure univoque, se retrouvant, avec des variantes secondaires, dans un champ conceptuel défini comme époque de l’épistémé. Il ne s’agit pas de nier une historicité inhérente à l’élaboration conceptuelle de la philosophie, qui inscrit la pensée pensante dans la pensée purement structurale d’une époque, comme la parole s’inscrit dans la langue ; mais qu’est-ce que la philosophie, sinon la possibilité, pour un sujet singulier, de coïncider avec cette structure sous une forme qui fait apparaître un sens inouï ? Si les noms propres ont une véritable signification philosophique, elle ne se déduit pas des événements de leur existence empirique, de la liste de leurs publications, du corpus de leurs énoncés. Ils désignent, chacun à leur manière, toujours différente, une possibilité, pour la singularité, d’exposer un trait qui lui est propre, et de l’inscrire dans l’universel. Ce n’est donc pas l’appartenance à une tradition dite philosophique ou métaphysique, établie sur des critères extérieurs, historiques, qui atteste le caractère philosophique d’une doctrine ; c’est une décision de philosophe28 qui relève de la pure souveraineté du sujet – ce que Kant énonce ainsi : « législateur de la raison humaine »29, dont le pouvoir consiste à décréter l’exceptionnel, et donc à excéder la tradition. Comme le montre Platon, il n’y a pas de philosophie, il n’y a que des philosophes – et 28 29
Cf. Hegel, Encyclopédie, § 17. CRP, Ak. III, 542.
Ontologie et métaphysique chez Kant
183
en toute rigueur, il ne peut y en avoir qu’un. Kant ne dit pas autre chose, il ajoute seulement qu’ « il ne se rencontre nulle part »30. La singularité en laquelle se rassemblent les exigences de la raison humaine, n’a pas d’occurrence historique. Ce que dit Platon revient, pour le présent, au même : l’occurrence est passée, le philosophe n’est plus. Mais l’absence du maître fait de tout homme le dépositaire potentiel de sa souveraineté : « l’idée de sa législation se trouve partout dans toute raison humaine »31. La philosophie existe, s’inscrit, dans la tension entre un singulier idéal absent et un universel inassignable. On peut en tirer une conséquence pour l’interprétation d’un philosophe : une fois la part faite de ce qui, dans l’accès aux énoncés attribués à un auteur et transmis par une tradition, ne peut être connu que de manière historique, le philosophique comme tel, si tant est qu’il ait un sens et une valeur pour celui qui veut comprendre, est à chercher dans le singulier de chaque œuvre, ce qui ne se confond pas avec la structure épochale. Si on met en application cette règle méthodologique dans l’évaluation du scotisme de Kant, on peut en tirer des conclusions contraires, mais non contradictoires : on peut fort bien admettre que le discours kantien appar-tient à la structure de la métaphysique moderne ou onto(théo)logie, tout en reconnaissant que la singularité philosophique de Kant se tient ailleurs. Pour donner à cette remarque encore trop générale un contenu plus précis, et la recentrer sur le problème de la métaphysique – pour autant que ce problème ne soit pas précisément celui de la singularité du philosophe : si avec Kant on appelle métaphysique « le système de la raison pure (la science), toute la connaissance philosophique (vraie aussi bien qu’apparente) venant de la raison pure dans un enchaînement systématique »32, par conséquent si la métaphysique s’origine fondamentalement dans la législation de la raison humaine, et si on considère de plus que le projet kantien est de donner au système, à la science, à la métaphysique – puisque ces termes sont équivalents – une assise telle qu’elle (la métaphysique) ait un avenir, on peut mettre en question le fait qu’une telle métaphysique se confonde avec l’ontologie, y compris avec ce qui chez Kant tient lieu d’ontologie. L’hypothèse, en elle-même purement historique, du scotisme de Kant, conduit donc à une réflexion sur ce qu’est, pour Kant, la métaphysique, ou plutôt, sur ce qu’est la métaphysique. On est donc conduit de l’histoire à la métaphysique, en suivant un chemin qui est l’inverse de celui des historiens. Ramenée à son expression la plus simple, l’hypothèse scotiste appliquée à Kant contient deux propositions différentes : la première énonce que la métaphysique moderne, en l’occurrence celle de Kant, est essentiellement, sinon totalement, ontologie ; la seconde dit que l’ontologie se déploie en son achivement kantien comme philosophie transcendantale. Ces deux propositions sont relativement indépendantes l’une de l’autre : la philosophie transcen30 31 32
CRP, Architectonique, Ak. III, 543. Ibid. CRP, Architectonique, Ak. III, 544.
184
Yves-Jean Harder
dantale peut répondre aux caractères structuraux de l’onto(théo)logie scotiste sans que pour autant la métaphysique y soit consignée. Inversement on peut émettre des doutes ou des réserves sur cette assimilation de la philosophie transcendantale à l’ontologie sans que cela permette de trancher le premier point ; soit que la métaphysique, ne pouvant se constituer en ontologie, soit en définitive absente du kantisme, alors réduite à une théorie de la connaissance, soit qu’elle se situe ailleurs. Il est remarquable que la discussion, qu’elle parte du point de vue scotiste (L. Honnefelder) ou du point de vue kantien (J. Benoist33), porte pour l’essentiel sur la seconde proposition, parce que le premier point semble aller de soi : la métaphysique kantienne est à la fois une critique de la métaphysique du transcendant, qui se confine dans la metaphysica specialis, et une refondation de la metaphysica generalis ou ontologie34. L’alternative à une interprétation dite néokantienne qui ramène le kantisme à une théorie de la connaissance35 serait donc dans la réhabilitation de l’ontologie – réhabilitation qui passe par un rajeunissement : soit qu’on cherche dans la philosophie transcendantale, et plus particulièrement dans la doctrine de la sensibilité, l’amorce timide d’une ontologie fondamentale (Heidegger) ; soit qu’on trouve chez Kant une voie ouverte vers la relativisation de l’ontologie (Quine), dans un minimalisme qui situe l’être à même le concept, ou encore vers une explication systématique de notre structure conceptuelle (Strawson)36. Ainsi se trouverait confirmée la modernité de Kant et, à travers lui, le prolongement de la structure fondée par Scot à l’âge de la raison calculatrice. L’absence de réelle interrogation sur l’équivalence entre métaphysique et ontologie, et par suite, sur le problème de la métaphysique relève non pas d’une ignorance, mais de ce que Heidegger appelle un oubli, une impossibilité liée à la structure d’occultation de l’époque. Ce n’est pas l’oubli de l’être, mais cela pourrait bien être l’oubli de la philosophie. Le paradoxe est que Kant est à la fois l’auteur dont on peut se réclamer pour oublier, et celui qui a tenté, au contraire, de ne pas oublier, c’est-à-dire de faire une place à la philosophie dans une modernité qui peut fort bien s’en passer. En effet la critique kantienne semble avoir porté à son comble la structure onto-théologique de la métaphysique moderne en éliminant ce qui y subsistait de théologique pour 33 34 35
36
Dans deux textes importants : 1) Benoist, « Sur une prétendue ontologie kantienne » 2) Benoist, « Les limites de l’ontologie et le sujet critique ». Cf. Chauvier, « Kant et la métaphysique générale ». C’est ainsi que J. Benoist résume la position d’Hermann Cohen : « chez Kant, il n’y a pas d’ontologie dans la mesure exacte où celle-ci relève de la métaphysique, et où la pensée kantienne se caractérise par le remplacement de la métaphysique par la théorie de la connaissance. » (Benoist, « Sur une prétendue ontologie kantienne », 138) L’auteur attribue en réalité à Hermann Cohen sa propre conception des rapports entre ontologie et métaphysique. La lecture de Kants Begründung der Ethik devrait conduire à une révision des deux propositions contenues dans cette phrase, qui ne reflètent ni l’une ni l’autre la position d’Hermann Cohen. Cf. Chauvier, « Kant et la métaphysique générale », 52.
Ontologie et métaphysique chez Kant
185
ne conserver que l’ontologie, réduite elle-même à sa plus simple expression : détermination des conditions de possibilité des objets en général, donc « système de tous les principes de la raison pure »37. Or la « radicalisation de la pensée d’une fondation transcendantale »38 chez Kant implique l’élimination de toute application des principes de la raison à un objet suprasensible et la restriction du champ de l’objectivité à celui de l’expérience. L’objet ne peut être défini à partir des conditions générales de la pensée que comme objet devant apparaî tre dans le champ d’une expérience possible. L’objet transcendantal ne peut pas être un objet transcendant. Comme le montre la Déduction transcendantale des catégories, la réalité objective des concepts, qui leur confère une teneur ontologique immanente, se fonde exclusivement sur le fait qu’ils fournissent une structure intellectuelle nécessaire à la constitution de l’expérience. C’est pourquoi lorsque Kant utilise le terme d’ontologie dans les Progrès de la métaphysique, il reprend la définition de la philosophie transcendantale (« un système de tous les concepts et de tous les principes d’entendement »), avec cette précision qui exclut toute confusion avec l’ontologie wolffienne : « mais seulement dans la mesure où ils s’appliquent à des objets qui peuvent être donnés dans les sens, et donc être justifiés par l’expérience »39. Cette restriction donne à l’ontologie kantienne une portée qui la distingue de l’ontologie wolffienne sur deux points essentiels. D’une part la teneur ontologique du concept ne peut être tirée du pur logique : elle vient du transcendantal, qui est ce qui, dans le concept, rend possible une synthèse. D’autre part l’ontologique ne peut être étendu à d’autres objets que ceux qui se sont constitués par une telle synthèse ; des objets qui seraient définis par le fait qu’ils ne peuvent être donnés dans les sens sont donc exclus de l’ontologie. L’ontologique se ramène à l’expérience : « L’ontologie ne pose que des objets auxquels un objet de l’expérience peut être adéquat »40. Encore faut-il préciser : l’ontologie ne s’occupe pas des objets d’expérience eux-mêmes, en tant qu’ils sont effectivement donnés dans les sens, mais seulement des conditions qui rendent leur connaissance possible. Au sens strict l’ontologie n’a pas affaire à des objets, mais seulement à des connaissances. Comme l’écrit J. Benoist : « Le propre du renversement kantien, qui réassume certes la notion d’ontologie, mais du bout des lèvres, et pour la déplacer, serait donc de reconduire le problème de l’être, ou tout au moins de l’étant (la recherche d’une science de “ l’étant en tant qu’étant ”), à celui de la connaissance. » 41 On ne peut donc concevoir aucun passage, ni de la logique à l’ontologie, ni de l’ontologie à la théologie. La pensée se trouve donc dépouillée de toute puissance ontologique en deçà et au-delà du transcendantal, ce qui est une rupture décisive avec le dogmatisme de la métaphysique moderne depuis 37 38 39 40 41
CRP, Ak. III, 44. Honnefelder, Scientia transcendens, 420. Ak. XX, 260. Leçons sur la métaphysique, Metaphysik Dohna, Ak. XXVIII, II/1, 617, cité par Benoist, « Sur une prétendue ontologie kantienne », 155. Benoist, « Sur une prétendue ontologie kantienne », 143.
186
Yves-Jean Harder
Descartes. Qu’on appelle ou non ontologie la philosophie transcendantale kantienne, il demeure qu’il est désormais exclu de fonder sur elle une théologie. C’est donc l’idée même d’une onto-théologie qui se trouve invalidée : Kant n’utilise ce terme que pour indiquer une impossibilité. S’il devait y avoir une théologie fondée sur la raison, celle-ci serait une onto-théologie ; or l’ontologie exclut une telle extension pour des objets qui ne peuvent être donnés dans l’expérience, donc aucune théologie rationnelle n’est possible d’un point de vue théorique. Les conditions qui s’imposent à un objet transcendantal pour qu’il puisse être crédité d’une teneur ontologique impliquent qu’elles ne s’appliquent pas à Dieu, ni, d’une manière plus générale, à une quelconque idée de la raison, puisque celles-ci sont telles qu’aucun objet donné dans les sens ne peut leur être adéquat42. Mais il faut en conclure que la structure de subordination du théologique à l’égard de l’ontologique, qui caractérise la métaphysique scotiste, est devenue caduque : il n’y a plus d’univocité de l’être de l’étant en général à l’être de Dieu ; donc le discours rationnel sur Dieu n’est plus dépendant de l’ontologie. Mais qu’est-ce qui empêche de penser une autre forme de théologie que celle qui est circonscrite par l’onto-théologie ? On raisonne sur la philosophie de Kant comme si elle devait répondre à une définition de la métaphysique empruntée à la tradition scolaire au point précis où Kant se démarque de cette tradition. En effet la vraie question n’est pas de savoir si ce que Kant appelle, avec des réticences, ontologie43 est ou non l’ontologie traditionnelle ; elle est de savoir ce qu’il en est de la métaphysique, une fois admis cette définition restrictive de l’ontologie. Si l’on admet comme encore valide, dans toutes ses implications, la division traditionnelle entre métaphysique générale et métaphysique spéciale, on ne peut que constater que la critique kantienne élimine entièrement, dans la Dialectique transcendantale, la seconde, puisqu’elle exclut toute possibilité d’une science rationnelle qui porterait sur des objets associés aux trois idées transcendantales. Si la métaphysique ne comporte ni psychologie rationnelle, ni cosmologie, ni théologie ; que lui reste-t-il, sinon la métaphysique générale, ou ontologie ? On en conclura donc, avec Stéphane Chauvier, que le projet kantien vise à sauver la métaphysique comme ontologie, et ainsi à préparer la voie à Strawson : « La Critique de la Raison pure marquerait donc moins la fin de la Metaphysica generalis sive Ontologia que son remplacement par ce que Strawson appellera une “ explication systématique de notre structure conceptuelle ”. Le discours sur les propriétés générales de l’étant devrait céder la place à un discours sur les patrons d’objectivation de l’esprit, parce que les propriétés générales de l’étant ne seraient rien d’autre que des patrons d’objectivation de l’esprit. »44
42 43 44
Cf. CRP, Ak. III, 254. « Le nom orgueilleux d’ontologie […] doit faire place au nom plus modeste de simple analytique de l’entendement. » (CRP, III, 207) Chauvier, « Kant et la métaphysique générale », 52.
Ontologie et métaphysique chez Kant
187
Si la métaphysique est composée de deux parties, et que la seconde est éliminée, il ne reste que la première, métaphysique générale ou ontologie : le raisonnement est imparable ; mais il est fondé sur une prémisse fausse, à savoir que la définition de la métaphysique est onto-théologique au sens scotiste, et que, par conséquent, la théologie ne saurait être qu’une partie spéciale, subordonnée dans sa possibilité, son contenu et sa méthode, à l’ontologie. La division de la métaphysique en générale et spéciale présuppose que le sens de ce qui est métaphysique est défini, premièrement et fondamentalement, à partir de l’ontologie, et, donc qu’une discipline ne peut relever de la métaphysique comme science que dans la mesure où elle est dérivable de l’ontologie. Tout le but de la Critique de la raison pure est de réfuter ce présupposé. La question posée dès l’Introduction : « comment la métaphysique est possible à titre de science ? »45, ne trouve aucune réponse dans l’Analytique transcendantale, et ne peut être traitée qu’au terme de la Dialectique transcendantale, dans l’Appendice qui établit la convergence entre la science et la régulation par les idées. La réponse à la double question : « Qu’est-ce que la métaphysique ? » et « Comment est-elle possible comme science ? » est donnée dans l’Architectonique par un enchaînement d’énoncés qui établissent un lien entre la science, le système, l’idée, la métaphysique : 1. Ce qui distingue une science d’une simple connaissance, c’est l’unité systématique ; 2. l’unité systématique est l’organisation sous une idée ; 3. une idée est une fin essentielle de la raison ; 4. le philosophe est celui qui définit les fins essentielles de la raison, ou encore, il est le législateur de la raison humaine ; 5. lorsque la raison s’organise elle-même selon sa propre unité systématique, devient système, elle s’appelle métaphysique. La métaphysique n’est donc pas une partie, générale ou spéciale, d’un système ; elle est le système lui-même, parce qu’elle est la discipline des idées de la raison pure. On peut en déduire que la réduction de la métaphysique à l’ontologie est contradictoire avec l’entreprise kantienne, pour au moins trois raisons. D’abord on impose à la métaphysique une division systématique supposée canonique et traditionnelle, sous prétexte que Kant semble en reprendre les termes. Nul ne peut contester, il est vrai, que Kant utilise cette division46, et la subdivision en psychologie, cosmologie, théologie pour indiquer les différentes parties qui composent la métaphysique47, et qui reproduisent la partition de la métaphysique scolaire. Mais si Kant revient aux noms traditionnels des parties, et à leur disposition dans un tableau dichotomique, cela ne signifie pas que leur articulation ait le même sens. Ce n’est pas la division qui s’impose à la métaphysique, c’est la métaphysique qui fonde la division à partir de son pouvoir systématisant. Par conséquent la partie générale n’est pas fondatrice de la 45 46
47
CRP, Ak. III, 41. La distinction entre Metaphysica generalis et specialis est évidemment familière à Kant, qui l’utilise parfois (cf. notamment Réflexion 4851) pour aboutir à la même dichotomie que dans la Critique de la raison pure ; toutefois elle n’intervient pas comme telle dans celle-ci. CRP, Ak. III, 547. Il faut ajouter la physique rationnelle.
188
Yves-Jean Harder
partie spéciale. C’est en réalité l’inverse, et telle est la seconde raison qui rend absurde la réduction ontologique. En effet le principe directeur, celui qui donne l’unité systématique, vient des parties appelées par commodité spéciales, non de la partie générale. En effet chaque partie spéciale provient d’une idée transcendantale, et ce sont les idées qui jouent un rôle directeur, parce que régulateur. Or, l’ontologie, comme on l’a vu, n’a pas affaire aux idées. S’il n’y avait pas de partie dite spéciale, il n’y aurait donc pas du tout de métaphysique, parce qu’il n’y aurait pas d’unité systématique de la raison. Mais il faut aller plus loin et indiquer la troisième raison de l’absurdité. On affirme que la partie critique, négative, de l’analyse de Kant, concerne la métaphysique spéciale, qui se trouve donc, contrairement à la partie générale, invalidée48. Comment explique-t-on alors que la métaphysique spéciale figure néanmoins dans le plan du système ? Que signifie en particulier la théologie rationnelle, si aucune connaissance rationnelle de Dieu n’est possible selon des principes tirés de la raison pure ? Kant a-t-il oublié dans l’Architectonique les leçons de la Dialectique transcendantale ? On cherche parfois à se tirer de ces difficultés en invoquant la théologie morale. Mais il suffit de remarquer que la théologie rationnelle figure dans la métaphysique de la nature et non dans la métaphysique des mœurs, pour exclure cette réponse. Pour s’assurer que la théologie n’est pas nommée par inadvertance, on peut se reporter au §§ 57-60 des Prolégomènes : la connaissance par analogie est conçue pour fonder une théologie d’un genre nouveau. La connaissance du rapport analogique se substituant à la connaissance des termes du rapport, la théologie consisterait dans la connaissance non pas de l’objet transcendant, mais de la simple relation de transcendance. Or une telle connaissance est indispensable non pas pour déterminer les attributs divins, mais pour poser la limite à partir de laquelle l’expérience peut être pensée dans sa totalité, car une telle limite « se trouve tout à fait en dehors d’elle »49, et « il est absolument nécessaire qu’il se trouve en dehors du monde des sens quelque chose qui est seulement pensé par l’entendement pur »50. Cette nécessité est inscrite dans la « destination propre de la raison »51, telle que l’expriment les idées transcendantales, parce que ce que cherche la raison, ce n’est pas d’épeler l’universalité des objets que l’entendement découvre dans l’expérience, c’est de saisir dans une unité 48
49 50 51
Cf. Chauvier, « Kant et la métaphysique générale », 51 : « Lorsqu’on songe à la fameuse critique kantienne de la Métaphysique, on omet en effet souvent de préciser que la cible de Kant dans la Dialectique transcendantale et dans tous les passages dénonçant l’état chaotique de la Métaphysique, c’est la Metaphysica specialis traditionnelle, autrement dit la théorie rationnelle de l’âme (psychologia rationalis), du monde (cosmologia rationalis) et de Dieu (theologia rationalis). C’est fondamentalement cette triple prétention à connaître rationnellement l’âme, le monde et Dieu que Kant a jugé entièrement vaine et qu’il s’est efforcé de déconstruire dans la Dialectique transcendantale. » Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik § 59, Ak. IV, 360, trans., Guillermit, 141. Ibid. Ak. IV, 361, trans. cit. 141. Ibid. § 56, Ak. IV, 349, trans. cit. 127.
Ontologie et métaphysique chez Kant
189
l’intégralité de cette expérience. D’où il résulte que la théologie, qui pense l’intégralité des déterminations, rassemblée dans une unité, et projetée dans un terme transcendant, est la condition de la systématicité en laquelle la métaphysique trouve son sens au terme de la critique. On peut, si l’on veut, se féliciter du remarquable travail de la pensée accompli par la philosophie depuis et avec Scot, pour éliminer de la métaphysique moderne la transcendance que la scolastique thomiste véhicule encore avec des résidus de néo-platonisme52 ; il faut alors en conclure que Kant n’est pas moderne. L’effort de Kant est au contraire de sauver la transcendance de son enfermement dans l’ontologie. Bien loin que Kant ait voulu réduire la métaphysique à l’ontologie, il a voulu l’en préserver. On peut d’ailleurs s’étonner qu’on ait invoqué le texte déjà partiellement cité plus haut, tiré des Progrès de la métaphysique, comme un argument en faveur de la réduction à l’ontologie53. Kant affirme bien dans ce texte que l’ontologie « ne touche pas au supra-sensible »54 ; mais il en fait si peu un argument en faveur de l’ontologie – comme si son propos était de « remettre en cause la possibilité même d’une métaphysique en tant que doctrine du suprasensible »55 – qu’il ajoute immédiatement : « qui est [il s’agit du supra-sensible] pourtant la fin ultime de la métaphysique. »56 Il est d’autant plus difficile de manquer l’accent portée sur cette « fin ultime » que tout le contexte de la citation y est consacré, et que Kant a écrit quelques lignes plus haut : « Cette fin ultime à laquelle s’ordonne la métaphysique tout entière est aisée à découvrir et peut à cet égard en assurer une définition : “ c’est la science qui permet de passer grâce à la raison de la connaissance du sensible à celle du supra-sensible ”. »57
Le fait que l’ontologie ne touche pas au supra-sensible a deux implications : d’une part l’ontologie n’appartient pas vraiment à la métaphysique parce qu’elle n’en est que la « propédeutique », le « vestibule », l’« entrée »58 ; 52
53
54 55 56 57 58
« C’est à partir de Wolff que l’ontologie s’impose enfin comme “ philosophie première ” et noyau dur de la métaphysique, autour de laquelle s’organisent toutes les disciplines de la métaphysique, lorsqu’elles ne sont pas conformées à son image, dans la mesure où celle-ci décide de la forme générale de leur objet : l’étant. » (J. Benoist, « Sur une prétendue ontologie kantienne », op. cit., p. 145, nous soulignons) « Il faut tout d’abord remarquer que si l’on suit le texte des Progrès à la lettre, le dépassement critique de la métaphysique semblerait bien passer par une réduction de celle-ci au seul texte d’une ontologie, fût-elle elle-même restreinte à sa plus simple expression, c’est-à-dire à une analytique du sensible. En effet le propos de Kant est de remettre en cause la possibilité même d’une métaphysique en tant que doctrine du suprasensible, celui-ci entendu comme indépendant de toute donation sensible. » (ibid. p. 144) Op. cit. Ak, XX, 260. Cf. note 53. Ak, XX, 260. Ibid. Nous citons la traduction de Guillermit, Paris, Vrin, 1973, 10. Il vaut la peine de lire le passage de Kant en entier : « Elle [l’ontologie] ne touche pas au suprasensible, qui est cependant la fin ultime de la métaphysique, et n’appartient donc
190
Yves-Jean Harder
d’autre part la véritable métaphysique ne sera atteinte que lorsqu’on l’aura préservée de toute contamination d’ontologie, autrement lorsqu’on aura mis fin à « l’effort séculaire »59 mené depuis Scot jusqu’à Wolff, pour situer la métaphysique dans l’immanence de la constitution des objets, et lorsqu’on aura rendu ses droits à la transcendance. En effet la critique de la Dialectique transcendantale ne porte pas sur la transcendance comme telle, mais, au contraire, sur l’illusion qui consiste à la traiter en des termes qui ne relèvent en droit que d’objets immanents, c’est-à-dire susceptibles d’être donnés dans le sensible. Ce qui est critiqué, c’est la tentative, propre à l’entreprise de la métaphysique moderne depuis Scot, de penser le théologique dans les termes de l’ontologique, c’est la confusion de la théologie dans l’onto(théo-)logie, qui fait disparaître la transcendance du divin, et par conséquent le principe extérieur à l’expérience à partir duquel une unité est pensable comme donatrice de sens. Cette extériorité au sensible, qui suppose une inadéquation ou incongruence, est consignée dans la définition de l’idée, qui indique à elle seule le projet de la métaphysique : « J’entends par idée un concept nécessaire de la raison, auquel aucun objet congruent ne peut être donné dans les sens. »60 Puisque l’ontologie montre qu’on ne saurait penser un objet en général sans qu’il puisse être donné dans l’expérience61, on en déduira qu’une idée définit un objet tel qu’il excède non seulement l’expérience effective, mais les conditions de possibilité d’une expérience en général, c’est-à-dire la constitution ontologique de l’expérience. Non que cet objet ne puisse être pensé, mais il ne peut l’être à partir des concepts auxquels on accorde une réalité objective du fait de leur fonction constitutive à l’égard de l’expérience. Mais la nécessité qui s’impose dans l’idée malgré l’impossibilité de la schématiser dans une synthèse vient de la raison elle-même, puisqu’elle se définit comme le désir de l’inconditionné. La métaphysique est la discipline qui fait droit à cette nécessité et qui tente de la mettre en œuvre dans un système. Le propre de Kant, sa singularité, ne tient pas dans la radicalisation de l’ontologie, mais au contraire dans la transgression de l’ontologie, son dépassement dans la métaphysique, ainsi restituée dans sa fonction de transcendance : « Le vieux nom de cette science metà tà fusiká fournit déjà une indication sur le genre de connaissance auquel elle tendait en intention. On veut grâce à elle s’élever au-dessus de tous les objets de l’expérience possible (trans physicam) pour connaître, si possible, ce qui ne peut absolument pas être objet d’expérience. Et la définition de la métaphysique […] serait donc : c’est une science qui permet d’aller au-delà de la connaissance du sensible jusqu’à celle du supra-sensible »62.
59 60 61 62
à cette dernière que comme propédeutique, comme entrée ou vestibule de la métaphysique proprement dite, et elle est nommée philosophie transcendantale parce qu’elle renferme les conditions et les premiers éléments de toute notre connaissance a priori. » (Ibid.) J. Benoist, « Sur une prétendue ontologie kantienne », 145. CRP, Ak. III, 254. Cf. CRP, Ak. III, 189. Progrès de la métaphysique, Ak. XX, 316, trad. cit., 79.
Ontologie et métaphysique chez Kant
191
Une telle définition ne trouve pas d’autorité parmi les Modernes, car elle signifie que le problème de la métaphysique n’est plus, pour la première fois peut-être depuis l’avènement scotiste de la métaphysique moderne, celui de l’être de la représentation. L’innovation se réclame du retour à un sens originaire du mot idée63, placé sous l’invocation de Platon. L’idée n’est pas la représentation, elle est l’indication d’un terme extérieur aux objets du monde sensible, auquel il faut se référer comme à leur modèle pour les comprendre. Si « la structure de la métaphysique moderne peut se lire comme le renversement, à partir de Scot, de la structure katholou-protologique de la métaphysique d’Aristote » en une structure « katholou-tinologique »64, on peut affirmer que la refondation kantienne de la métaphysique consiste au contraire à tenter d’infléchir le mouvement de la modernité vers l’universalité du quelconque, c’est-à-dire à reconnaître, à côté de l’explication de l’expérience par ses structures immanentes, la légitimité du désir qui porte la raison à adopter un point de vue qui transgresse les limites définissant cette immanence. Comme on l’a vu, on pourrait rapprocher ce désir de la raison, du primat scotiste de la volonté sur l’intellect. Mais la volonté accordée à l’amour se situe sur un autre plan que celui de la métaphysique, alors que le désir rationnel, faculté supérieure de désirer comprise comme pur désir, est au cœur de la métaphysique. C’est donc, plutôt qu’à un modèle moderne ou médiéval, aux Anciens, à Platon et à Aristote, qu’il faut se référer pour comprendre la métaphysique kantienne. En effet pour les Anciens comme pour Kant, la métaphysique, n’a pour objet ni l’être commun à tous les êtres, ni un étant parmi les étant dont les propriétés seraient en elles-mêmes dignes d’intérêt. La théologie n’intéresse la métaphysique que dans la mesure où elle permet de penser le Premier auquel s’accordent tous les autres. Cette position du Premier transcendant s’accorde à la définition architectonique de la métaphysique. Le préjugé moderne conduit trop souvent à interpréter l’architectonique comme une structuration, et donc à confondre le système et la structure. C’est oublier que l’ἀρχιτέκτων n’est pas celui qui construit, mais celui qui commande65, l’homme royal66. L’architectonique permet donc de penser la solidarité entre la primauté métaphysique de la science des principes, identifiable à la dialectique de la République, et la primauté politique de celui qui commande parce qu’il sait la place qui revient à chacun. La recherche de la primauté à la fois principielle (dans le rapport de l’ensemble des énoncés vrais à un terme qui leur donne sens, l’Idée du Bien, au-delà de l’essence), architectonique (dans le rapport des différentes sciences à la philosophie première), et politique (dans le rapport de l’ensemble du corps politique à une instance royale qui institue la justice comme ordre, comme assignation 63 64 65
66
CRP, Ak. III, 249. Boulnois, Être et représentation, 512. Il est le maître d’œuvre, celui qui commande (ἄρχειν) à ceux qui produisent l’œuvre proprement dite, les ouvriers ; il est, comme le dit Platon (Politique 259 e) ™ργατὤν ἄρχων. Platon, Politique, 260 b.
192
Yves-Jean Harder
à chacun de la place qui lui revient), définit la tâche propre de la philosophie depuis ses origines grecques. La tâche que Kant assigne au système s’inscrit dans la continuité de cette métaphysique d’origine platonicienne. Plus précisément : le système est le nom nouveau du principe d’ordre qui définit la métaphysique elle-même, nom qui vient se substituer à celui que, depuis Aristote, la métaphysique donne au Premier. Libérée de l’hypostase par laquelle le Premier s’identifie à l’être, et par suite, de la définition de l’Idéal de la raison pure en termes ontologiques, la métaphysique est rendue à sa vérité architectonique, déjà exposée par Platon. La métaphysique est le système – ce qui est à entendre de manière absolue : non pas au sens où le système serait la mise en forme, la structure, d’une connaissance portant sur l’ens summum, mais le système est le summum lui-même, la seule « fin suprême », qui réside dans « la parfaite unité systématique de la raison »67. Si Scot est un Moderne, le premier d’entre eux, qui se cache sous les apparences du commentaire des Anciens, Kant est un Ancien qui se confond avec les Modernes : le plus moderne des philosophes parce que sa métaphysique est parfaitement accordée à la science moderne de la nature, mais l’un des premiers à prendre conscience de l’écart inévitable entre la modernité et la philosophie. Si l’ontologie peut être le cri de ralliement des Modernes de tous bords, la métaphysique contient en elle, contre l’oubli, une nostalgie, toujours plus mélancolique, de la Grèce.
67
Ak. III, 543.
Ontologie et métaphysique chez Kant
193
Bibliographie Littérature primaire Aristoteles, Métaphysique. Hegel, Georg W. F., Histoire de la philosophie, t. VI, trans., Garniron, Paris : Vrin, 1985. Ioannes Duns Scotus, Ord. I, ed. Vat. Kant, Immanuel, Critique de la raison pure [CRP], trans., Barni et Delamarre, Paris : Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 1980. Kant, Immanuel, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, trans., Guillermit : Prolégomènes à toute métaphysique future visant à se présenter comme science (1783), Paris : Vrin, 1986. Kant, Immanuel, Die wirklichen Fortschritte, die Metaphysik seit Leibniz und Wolff ’s Zeiten in Deutschland gemacht hat, trans., Guillermit : Les progrès de la métaphysique en Allemagne depuis le temps de Leibniz et de Wolff (1793), Paris : Vrin, ²1973. Platon, Politique.
Littérature secondaire Benoist, Jocelyn, « Sur une prétendue ontologie kantienne : Kant et la néo-scolastique. » In Kant et la pensée moderne : alternatives critiques, éd. Ch. Ramond, 137-163. Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux, 1996. Benoist, Jocelyn, « Les limites de l’ontologie et le sujet critique. » Introduction de : Emmanuel Kant, Réponse à Eberhard, 7-81. Paris : Vrin, collection « Textes & Commentaires », 1999 . Boulnois, Olivier, Être et représentation. Une généalogie de la métaphysique à l’époque de Duns Scot (XIIIe-XIVe siècle). Paris : PUF, 1999. Carraud, Vincent, « L’ontologie peut-elle être cartésienne? L’exemple de l’Ontosophia de Clauberg de 1647 à 1667, de la mens à l’ens. » In Johannes Clauberg (1622-1665) and Cartesian Philosophy in the Seventeenth Century, ed. Theo Verbeek. Dordrecht : Kluwer 1999, 13-38. Chauvier, Stéphane, « Kant et la métaphysique générale. » Philosophie (70) 2001, 51-71. Courtine, Jean-François, Suárez et le système de la métaphysique. Paris: PUF, 1990. Honnefelder, Ludger, Scientia transcendens. Die formale Bestimmung der Seiendheit und Realität in der Metaphysik der Mittelalters und der Neuzeit (Duns Scotus, Suárez, Wolff, Kant, Peirce). Hamburg : Felix Meiner, 1990. Honnefelder, Ludger, « Vernunft und Metaphysik. Die dreistufige Konstitution ihres Gegen standes bei Duns Scotus und Kant. » In Grenzbestimmungen der Vernunft. Philosophische Beiträge zur Rationalitätsdebatte, ed. P. Kolmer und H. Korten, 319-350. Freiburg, München : 1994 ; traduction française de Jacob Schmutz : « Raison et métaphysique, les trois étapes de la constitution de son objet chez Duns Scot et Kant. » Philosophie (70) 2001 : 30-50. Honnefelder, Ludger, La métaphysique comme science transcendantale : entre le Moyen Age et les temps modernes, trans., I. Mandrella, revue par O. Boulnois. Paris : PUF, 2002. Husserl, Edmund, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, trans., Granel, Paris : Gallimard, 1976. Marion, Jean-Luc, « La science toujours recherchée et toujours manquante. » In La métaphysique, son histoire, sa critique, ses enjeux, ed J.-M. Narbonne and L. Langlois, 13-36. Paris, Québec : Vrin, Les Presses de l’Université Laval, 1999.
194
195 Archa Verbi. Subsidia 6
195–208
Scotus in the nineteenth and twentieth centuries Antonie Vos
1. Introduction John Duns (1266 – 1308) was a Sunday’s child, but a Sunday’s child who died an early death. Nevertheless, the influence of his philosophical and theological innovations dominated the debates for five centuries (1300–1800).1 § 2 signals this sunshine. However, what happend in the nineteenth century? The place of Scotus’ legacy in the nineteenth century reveals a lot about the nature of nineteenth-century thought that shows an enormous discontinuity in comparison with the centuries before. The origins of the historiography of medieval philosophy at Paris and its Louvain counter-movement is attention paid to in § 3, and § 4 deals with the first steps of Protestant historical theology where in contrast to its own necessitarianism Scotus is seen as the embodiment of voluntarism and irrationalism. Scotus’ place in German Dogmengeschichte was also rather ambivalent as we can still conclude from Loofs’s Leitfaden (§ 5). § 6 sketches how great dogmaticians in the last century dealt with Scotus and the last section (§ 7) concludes with some final remarks. 2. The sunshine of half a millennium From the beginning, John Duns was appreciated very much. His family name was Duns and he originated from Duns (Berwickshire), in the South of Scotland. At an unusually early age he emigrated to the South, to live and to study at Oxford. The young boy must have impressed his surroundings, but the persons who had discovered him, were not ready to send him to the custodial school at Newcastle, because the Brethren from the North quarrelled with the English Province. So, they took him to the Studium at Oxford.2 If there were not to have been an intervention by the internatinal leadership of the Franciscan Community, John Duns would have become Franciscan professor at Oxford University in 1301 at the earliest possible age of 35. Instead, he left Oxford for Paris, the intellectual capital of Europe, where he acted as magister regens during the years 1306–1307, whereas he already died at Cologne in November 1308. He was world famous in that world. We find a 1 2
See Vos, “Duns Scotus’s Significance for Western Philosophy and Theology”. On John Duns’ years in Scotland and England, see Vos, The Philosophy of Scotus, 13-56.
196
Antonie Vos
text worth to be highlighted in a letter of Gonsalvo of Spain, dating from the autumn of 1304: By this appointment I assign to your love Father John Scotus, beloved in Christ. I am fully acquainted with his praiseworthy life, excellent knowledge and most subtle mind.3 Gonsalvo’s praise was not social convention. It was only of Duns that Gonsalvo spoke in this way, not of the other candidates. He was beloved. He was excellent, and most subtle. Gonsalvo did not just write in his letter: Scotus is subtle, as if he were the only subtle mind, but most subtle. At that time theology abounded in subtle minds.4 Wodeham tells us: ‘Scotus was rationalis’ – he was able to substantiate his point of view by delivering formidable arguments. It was precisely this demonstrative efficiency that was very much appreciated in his own time, and in the centuries to come. His was a rich theological world which delighted in quality and cherished high standards: Duns was loved and admired in that world. The dynamics of his personality could cope with the challenges of this dynamic milieu. Wodeham mediates a unique observation: that human person, who was so lively and could really argue. Wodeham calls him vivax, lively – he was a lively teacher, not a dull one.5 A pleasant climate maintained itself for John Duns Scotus during half a millennium. 3. The dilemma of modern studies in the history of medieval philosophy According to De Wulf and Van Steenberghen, Renaissance and Reformation sounded the death knell for medieval scholasticism and contributed badly to a regrettable leap over the Middle Ages, but it is not as bad as that.6 Reformational thought during the sixteenth, seventeenth and eighteenth centuries has to be included in the whole of the scholastic tradition.7 Scotus’ influence was growing steadily over the centuries, reaching its zenith in the seventeenth 3
4 5
6 7
The text of Gonsalvo’s letter was reprinted by Little, The Grey Friars, 220: “Baccalaureus hujusmodi praesentandus ad presens debeat esse de aliqua provincia aliarum a Provincia Francie dilectum in Christo Patrem Joannem Scotum, de cujus vita laudabili, scientia excellenti, ingenioque subtilissimo, aliisque insignibus conditionibus suis, partim experientia longa, partim fama, quae ubique divulgata est, informatus sum ad plenum, dilectioni vestre assigno, post dictum patrem Egidium, principaliter et ordinarie praesentandum.” See Callebaut, “La maîtrise du Bx. Jean Duns Scot”, 206-39. The source is: Denifle and Chatelain, Chartularium Universitatis Parisiensis II 1, 117. On John Duns’ continental years, see Vos, The Philosophy of Scotus, 57-102. This remarkable and eloquent testimony originates from John Duns’ own studium at Oxford. When Adam of Wodeham discusses a certain theory put forward by John Duns, he adds his personal impression. See Wood and Gál), Adam de Wodeham, distinction 10 §5 (153): “[...] ille homo, sicut vivax et rationalis.” De Wulf, Histoire de la philosophie médiévale I, 9-10, and Van Steenberghen, Introduction, 369. See Vos, “De kern”, 106-25, Vos, “Ab uno disce omnes”, 173-204, and Van Asselt and Dekker, Reformation and Scholasticism.
Scotus in the nineteenth and twentieth centuries
197
century in most of Europe’s universities, in particular in the majority of the Catholic universities and in the Reformed universities on the continent and in Scotland, and, including the Puritan tradition in New England: Harvard and Yale. It is an old adage that the sixteenth and seventeenth centuries were the golden age of Scotism (aetas aurea scotismi).8 What one calls the new – early modern – gap between faith and reason is simply to be reduced to the difference between Scotism reigning in theology and nominalism prevailing in so-called philosophy. Cousin and Hauréau After 1800 scholastic thought went into paradoxical obscurity when it had enjoyed a wonderful career of almost a millennium. The traditional university collapsed, and suffered an institutional disaster which came along with the oblivion of scholastic thought. The historical revolution of Niebuhr and Ranke (after 1825) also led to investigating medieval philosophy according to historical methods and to creating the history of medieval philosophy as an independent subject. However, the first quarter of the nineteenth century simply forgot what scholastic thought consisted in. Scholastic thought is a complex and detailed phenomenon which requires a lot of effort and time to master it. One generation of negligence may mean the end of it. The technicalities of scholasticism were forgotten, because the continuity of training collapsed. Scholasticism was never refuted; it was only forgotten.9 Nevertheless, rescue was near and it came from quite an unexpected corner. The critical history of medieval philosophy was born in the second quarter of the nineteenth century. This unexpected rebirth was the more paradoxical, because the first historians of medieval philosophy did not believe that there was genuine philosophy in the Middle Ages. The Middle Ages were The Age of Faith and in the age of Faith one was unable to think rationally, because one did not know what the age of Reason would reinvent: scientific thought and rational philosophy. The Parisian world of historical scholarship produced the first critical editions, the first monographs and the first historical textbook of the history of medieval philosophy. Apart from his general work in the history of philosophy, Victor Cousin published two text editions of Abelard: Ouvrages inédits d’Abélard (1838) and Petri Abaelardi Opera I-II (1849–1859). In the same spirit, Charles de Rémusat (1797–1875) wrote his Abélard in two volumes (1845) and his Saint Anselme (1853). Ernest Renan’s doctoral thesis Averroès et l’Averroïsme dated from 1852. The Parisian scholarly thinkers, critical of the Catholic Church and the Christian religion, were the fathers of searching for and discovering manuscripts, editing texts critically, investigating historical connections and 8 9
See Sondag, “Jean Duns Scot”, 4. Likewise, one generation of negligence would be disastrous to mathematics by destroying the subject as cared for at the most important research centers.
198
Antonie Vos
initiating comparative philosophy. Paradoxically, they were also driven by admiration for scholasticism. ‘I am an avowed friend of scholasticism’ (Cousin). The master of the Cousin tradition was the keeper of the manuscripts of the Parisian Bibliothèque Nationale (since 1848): Jean-Barthélémy Hauréau († 1898). In 1850 Hauréau published the first history of medieval philosophy: De la philosophie scolastique. There only existed philosophy as a suppressed legacy which could not be digested, because it was alien to the age of faith and its patrimonium fidei. Hauréau is the author of the standard history of medieval philosophy of the second half of the nineteenth century: Histoire de la philosophie scolastique IIII (1872–1880).10 Émile Bréhier (1876–1952) continued the Hauréau tradition of Paris. His La philosophie du moyen âge (1937) presupposes that human reason was constituted by Greek philosophy. The Middle Ages were the period when philosophical teaching was the business of the clergy. It was a period of conflict between reason and faith and attempts to reconcile them, but Christianity and non-Christian ancient culture, faith and rationality are incompatible realities. So, the medieval project which tried to reconcile the irreconcilable, had to fail,11 and Duns’ philosophy embodies this failure. Fides quaerens intellectum is only a wooden piece of iron. The rebound of the ‘historiens croyants’ The second quarter of the nineteenth century saw the birth of the history of medieval philosophy in the hands of the so-called ‘rationalist historians;’ the third quarter saw the subject cared for by ‘historiens croyants’ (Fernand Van Steenberghen). What did the catholic rebound consist in? The Neoscholastic revival reached back to the beginning of the nineteenth century when Vincenzo Buzzetti (1777 – 1824) succeeded in arousing new interest in the philosophy of Thomas Aquinas introducing many talented students into a still seventeenth- and eighteenth-century styled training. His important student Serafino Sordi (1793 – 1865) taught, among many others, Giuseppe Pecci, the brother of the future Pope Leo XIII (1878 – 1903), and Gioacchino Pecci (* 1810), who himself had taught philosophy at the Jesuit German College in Rome. The young Joseph Kleutgen (* 1811), born in Dortmund (Germany), became acquainted with catholic Enlightenment christianity, but he was converted to pre-Enlightenment theology and philsophy, studying in Munster in 1832– 1833. He joined the Jesuits in 1834 and in these early years he was already convinced that reason and revelation can be reconciled, only if one steps back from modern philosophy. Kleutgen’s first work against the Enlightenment was Über die alten und die neuen Schulen (1846) and he continued to publish: Die 10
11
Even more important are his Notices et extraits I-VI (1890-93). Cf. Van Steenberghen, Introduction, 47-8, and Inglis, Spheres of Philosophical Inquiry, 55-7, 93-5, 109-12 and 159-60. Cf. Jolivet, “Les études de philosophie médiévale en France”. Berr, “Avant-propos”, iii: “Il (= Bréhier) suit l’effort pour unifier deux données irréductibles: le christianisme et ce qui subsiste de la civilisation gréco-romaine; il met en vive lumière [...] les conflicts de la raison et de la foi.”
Scotus in the nineteenth and twentieth centuries
199
Theologie der Vorzeit vertheidigt I-III (Münster 1853 – 1860) and Die Philosophie der Vorzeit vertheidigt I-II (Münster 1860 – 1863). Kleutgen was convinced that the revolutionary destruction of the first half of the nineteenth century proved the evil nature of modern philosophy and theology. He claimed that Thomas Aquinas’ theory of knowledge was superior to modern thought. His criterion was that good philosophy logically leads to the moral good. The three medieval philosophical schools were those of realism, nominalism and formalism. Thomas Aquinas’ philosophy is the crown of the project for reconciling reason and revelation, but Ockham destroyed this achievement: Kleutgen implies that since Protestants are members of many churches and not united in one church they have a predilection to agree with Ockham’s view of the importance of multiplicity. There are only particulars in the universe and no forms shared by individuals. In general, Protestants are unable to evaluate correctly the philosophy of Aquinas.12 Kleutgen’s treatment of Duns Scotus is even more enigmatic. Scotus does away with actual individual subjects because of his idea of individuality. Because there are no subjects in Scotus’ philosophy, there is only an endless number of predicates. ‘Formalism’ leads to the conclusion that the entire world is a single subject and this means that Duns Scotus implicitly ends up in pantheism. This early form of decline ideology is rather highly spirited. At the end of the century, De Wulf judged that such an approach was not historical, but its historical character had already been questioned in 1861. Albert Stöckl (1823 – 1895) followed in the footsteps of Kleutgen. Stöckl also adopted Kleutgen’s models of the reconciliation of faith and reason and the threefold picture of realism, nominalism and formalism.13 In fact, Kleutgen and Stöckl did not discover what they thought of medieval philosophy, but they imposed an apriori model on it. So, we may appreciate the criticisms of the young De Wulf (1867 – 1947) that their studies were not histories. Nevertheless, even De Wulf holds: Albert the Great and Thomas Aquinas closely follow Aristotle, the uncontested master of logic, but Duns’ excessive realism and Ockham’s excessive subjectivism destroyed the Aristotelian balance. The scholasticism of the fourteenth and fifteenth centuries is a degenerated scholasticism.14
12
13
14
Inglis, Spheres of Philosophical Inquiry, 97, but the Protestant neoscholastic revival also followed the footsteps of Aquinas. If a Protestant thinker took into account medieval Christian thought, he mainly opted for Aquinas. John Inglis discovered the important role Kleutgen and Stöckl had played in defining the dominating model of neoscholastic philosophy studying the history of scholasticism which was identified with medieval scholasticism. Van Steenberghen fairly mentioned them in his mighty Introduction. Van Steenberghen, Introduction, 287-8. For a striking memoir by his star pupil and successor Van Steenberghen, see Van Steenberghen, “Maurice De Wulf (1867 – 1947)” (1948); Id., Introduction, 287-313. Cf. Wielockx, “De Mercier à De Wulf”, 89-95.
200
Antonie Vos
4. The new history of theology: Scholten The same assessment holds for the early ‘histories’ of Protestant scholasticism: many studies date from 1835 to 1860. Although these theologians were liberal, they wholeheartedly believed in the truth of their own tradition, but according to their own interpretation. J. H. Scholten and his pupils revolutionized Dutch theology within a few years after 1848. They called themselves moderns, modern theologians, and the foundation of their modern theology consisted in the following rules: the rule of demonstrability: (D) Everything is demonstrable and has to be demonstrated / proved, the rule of causality: (C) The relation of an effect to its cause is necessary, and the rule of necessity: (N) All states of affairs and all facts are necessary. Within a decade modern theology achieved the complete dismantlement of a New Testament based theology. All specific biblical and Christian elements disappeared. Hundreds and hundreds of Reformed ministers followed the lead of Scholten and Opzoomer. Moreover, around 1860 there raged a battle about the issue of free will. According to modern theology, free will embodied a gross error. Scholten is the great champion of this theological necessitarianism: The most opponents to my criticisms of free will, – Pareau, Hofstede de Groot, Kist, Douwes, Chantepie de la Saussaye, Opzoomer, including ‘de Katholiek,’ reject, as I do myself, ‘the free will’ in the afore-mentioned sense.15 When Scholten writes that he and his opponents reject free will in a sense still to be specified, which concept of free will is at stake in this conflict? The involved concept of free will understands free will as the faculty/potency, to will something at a certain time (ogenblik) or not to will, to will in this way or otherwise.16 This concept of free will deserves more attention and it was paid attention to around 1860 in the determinism debate of those days. In the second place, this concepts and its allies have still to be investigated in depth. How does it play its role in the works of the afore-mentioned authors? For Scholten, just this concept is the axis of the whole conflict. Scholten also refers to the exchange of thoughts with J. Douwes.17 Here, Scholten does not speak of free will, but of liberum arbitrium.18 He critically rejects the liberum arbitrium, under which I understand the equilibristic freedom, the indifferentia ad velle aut non velle, or the
15 16
17 18
Scholten, De Leer der Hervormde Kerk, xxxv. Scholten, De Leer der Hervormde Kerk, xxxv : “[…] als het vermogen, om in een bepaald ogenblik iets te willen of niet te willen, zóó of anders te willen.” The key expressiond are put in italics. Scholten, De Leer der Hervormde Kerk, xxxv. See Douwes, Het Determinisme van den hoogleraar J.H. Scholten. Scholten, De Leer der Hervormde Kerk, xxxiv.
Scotus in the nineteenth and twentieth centuries
201
potency (of man) to will something at a certain time of life (ogenblik) or not to will, to will in this way or otherwise.19 N. C. Kist observed that only a human faculty is at stake in the theory of will. Kist’s theory of will is clear: The fact that a human person will is the necessary result of the disposition in which he finds himself at the time of his volition or act of willing. Whatever a human person wills or does, what he wills or does at a certain/given time, is the only thing that is possible for him.20 However, Scholten has a necessitarian system that he defends without any scruples. According to Scholten, the conceptual decisions he makes, are based on necessary truths. If a factual act of willing is the only possibility, then the result is necessary,21 and all other alternatives are impossible. Scholten agrees wholeheartedly, but this position perfectly excludes the equilibristic freedom. For this reason, Kist states that the theory of equilibristic freedom is a wrongheaded presentation of the view under discussion.22 Now Scholten sees water burning. This theory excludes all true alternativity. Every act of will is a necessary act of will at when it occurs, and that is precisely the core of Scholten’s ethical determinism. According to Scholten, Kist c. s. lost the critical right to oppose him. He explicitly concludes that only Hoekstra is a consistent critic. All other opponents reject the concept of willing Scholten rejects himself, and they subscribe to the same approach he defends. Not only the theory of synchronic contingency is the black sheep, these early historians of theology are also aware that this tradition is Scotus’, although for them Scotus and Ockham, the Pelagians and the Arminians sleep all under the same blanket. According to nineteenth-century necessitarianism, it is the line of arbitrary voluntarism and fideistic irrationalism. 5. Friedrich Loofs (1858–1928) In addition to the earliest historians of philosophy and theology we have the line Ritschl-Harnack-Loofs. Instead of saying only a little bit about Baur and Ritschl, Harnack and Loofs, Seeberg and I pay special attention to Harnack’s most famous pupil Loofs, because his introduction enjoyed a very remarkable career: the dogma historical guide by Loofs, one of the grand masters of the original Dogmengeschichte: his Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte (11889). According to the young Loofs, Duns Scotus’ thought was eventually a fruit of vulgar catholicism. The Opus Oxoniense is a unique quarry of creative theological and philosophical theories, but all this is only vulgar.23 However, I am in a hur19 20 21 22 23
Scholten, De Leer der Hervormde Kerk, xxxiv. See also Scholten, De vrije wil, 1. Kist, De mensch een redelijk en zedelijk wezen, 40. Scholten cites this theory in note 1 of Scholten, De Leer der Hervormde Kerk, xxxvi. Scholten, De Leer der Hervormde Kerk, xxxvii. Scholten, De Leer der Hervormde Kerk, 14. Loofs, Leitfaden, 31893 (11889, 21890), 305. According to the sixth edition published by Kurt Aland (1959) we are still standing where the great Dogmengeschichtler stood: “Trotz aller Fortschritte der dogmengeschichtlichen Arbeit im einzelnen stehen wir,was die
202
Antonie Vos
ry to add that this faux pas was a sin of his youth. The Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte would enjoy a unique future. In 1906 Loofs published a new edition: the fourth, and his last, edition of the Leitfaden. The guide, the guiding thread (Leitfaden), became a bulky volume of more than thousand pages. In fact, it was a new book quantitatively and qualitatively. By now Scotus’ vulgar Catholicism has disappeared; in general, the invectives largely disappeared from the scene. In the meantime, Loofs had payed studious attention to the new Vivès edition and Seeberg’s monograph (1900). The title of §67 reads: the dogma historical significance of Duns Scotus. Where is this historical significance to be located? Now Duns Scotus participates in the height of Thomas Aquinas, but the subtle doctor is far more critical than the angelic doctor: his continuous criticisms of the Thomistic synthesis prepared the dissolution of scholasticism during the later Middle Ages and his dogma historical significance lies precisely in this critical and negative role.24 Another important issue is that of the putative Pelagianism of medieval theology and the Franciscans in particular. Loofs is aware that the common Protestant claim that medieval theology embodies Pelagianism, or at least Semi-Pelagianism, is a rather enigmatic view. According to Loofs, Abelard was no Pelagian and later medieval theology also held on to the doctrine of gratia infusa. Grace is a gift.25 However, Alexander of Hales and Bonaventure built the foundation of later ‘Neo-Semi-Pelagianism’.26 Loofs confuses the view which takes seriously the pivotal role of the will in all aspects of life with a much later ideology of relative autonomy. If willing is essential in everything a person does, then all aspects of willing in all possible situations have to be discussed. If there is some good willing in whatever human situation, it must be grace dependent.27 Still according to Loofs, the great exception to this rule is Thomas Aquinas who rejected Neo-Semi-Pelagianism because of his deterministically predestinarian thought which already foreshadowed Luther’s stance.28 The move of relegating Scotus exclusively to the Middle Ages meant the end of Scotus, but not the end of the Leitfaden. After the Second World War, and more than forty years after the last edition, the publisher Max Niemeyer Verlag invited Kurt Aland (1915–1994) to resurrect the Leitfaden from the grave and Aland accepted this enormous task. The principles adopted for preparing the new edition were simple: to update the introductory bibliographies
24 25 26 27 28
Gesamtdarstellung angeht, immer noch da, wo schon unsere Väter standen” (op. cit., vi). Before the publication of the Vivès edition, the honest Loofs confessed that he did not have Wadding! The university library did not have Scotus. Loofs, Leitfaden (41906), 591. Faith and reason do not coincide any longer. See Loofs, Leitfaden (41906), 539-44, cf. Leitfaden (61959), 443-7. What is called Neo-Semi-Pelagianism, is a way of thinking which carried on in the middle of the thirteenth century on the basis of the view adhering to the pivotal role of the will. On the so-called ‘Neo-Semi-Pelagianism’ of Alexander of Hales and Bonaventure, see Loofs, Leitfaden (41906), 544-9, cf. Leitfaden (61959), 447-51. See Loofs, Leitfaden (41906), 549-60, cf. Leitfaden (61959), 451-65. Unfortunately, both Loofs’s praise and blame are based on mistaken theories.
Scotus in the nineteenth and twentieth centuries
203
of every section (until 1952), to check the references and the quotations, including the adaptation of the quotations to recent editions, and to improve the spelling and the punctuation. Kähler and Aland did so. Though such a task may seem simple, it requires huge efforts. Nevertheless, Kurt Aland and Ernst Kähler succeeded to publish two volumes: one in 1950 and one in 1953.29 However, Aland was unable to produce a new edition of the fourth main part of the old Leitfaden: Partial purification and transformation of Catholic doctrine on the basis of the religious understanding of the Gospel in Protestantism.30 Because the 1950 and 1953 volumes only contain the three first parts of Loofs’s book, they end with Vaticanum I without presenting Loofs’s decisive views of point with respect to Luther and the Reformation. Only these views explain the denunciation of the Middle Ages, and, in particular, the later Middle Ages. The a priori condemnation of medieval theology is only understandable in terms of Loofs’s theology of the Reformation. It also makes a systematic analysis of Duns Scotus’ theories superfluous. Time determined them, the creative theories of the subtle doctor do not matter any longer. In 1959 Aland combined these two volumes and improved on his reissue.31 The last Aland reissue appeared in 1968: the Leitfaden did not push through hundred years of age, but still became almost eighty! Aland added a helpful bibliographical appendix of thirty pages,32 but this scholarship simply overlooked the historical Scotus. In sum, in spite of this welcome achievement, the upshot is somewhat odd: the point of view is colonially Protestant, but, at the same time, it is hidden, for Trent and Vaticanum I are dealt with, but Luther and Melanchthon, and Zwingli and Calvin are not. 6. Barth and his generation When Barth discusses God’s will in his Göttingen 1924–1925 course: Unterricht in der christlichen Religion II, he also mentions the tradition of the pivotal role of the divine will from Duns Scotus to Seeberg. For Barth, this line is an im29
30 31
32
See Aland (ed.), Loofs. Leitfaden I (1950), containing the two first main parts of Loofs’s fourth edition (up to Augustin), and volume II, containing the third main part. The fourth main part of Loofs’s Leitfaden, dealing with Luther and the Reformation, never appeared. The bibliographies are still fruitful and the references useful. The reissue is utterly respectful; for instance, ‘acceptiert’ becomes ‘akzeptiert,’ and the punctuation is made coherent. Loofs, Leitfaden (41906), 684-949. See Aland (ed.), Loofs. Leitfaden (61959), vii. §67: ‘Die dogmengeschichtliche Bedeutung des Duns Scotus’ (484-94, 41906: 590-601) deals with Scotus. When I made my master stu dies in theology and philosophy during the second half of the 1960s, I had also to study in detail more than 2.000 pages in the history of dogma, including the Aland reissue of 1959 (!), and Oberman, The Harvest of Medieval Theology (1963). Aland (ed.), Loofs. Leitfaden (71968), 574-604. The pages 1-573 are the same. During the 1960s and the 1970s there were fine contacts between Münster and Utrecht thanks to the friendship between Kurt Aland and Wim van Unnik (1910 – 78), both great New Testament scholars.
204
Antonie Vos
possible one, for all God’s attributes are identical with his nature.33 He also mentions famous old terms such as scientia naturalis and scientia libera. The notion of God’s free knowledge (scientia libera) plays a key-role in the whole tradition of Reformed scholasticism, but not in Zwingli and Calvin. For different reasons, it also fails inAquinas and William of Ockham. Of course, Barth rejects fatalism, but he places the pair of scientia naturalis /simplicis intelligentiae opposite to the pair of scientia libera / scientia visionis, as is regularly the case in seventeenth-century Reformed scholasticism. It is clear that ‘scientia naturalis’ and ‘scientia simplicis intelligentiae’ are treated as synonyms, and, likewise, ‘scientia libera’ and ‘scientia visionis’ are treated as synonyms, but what do they mean? It is not easy to fathom Barth’s exposition and this comes as a surprise. Barth explains God’s scientia naturalis (= scientia simplicis intelligentiae) as the knowledge by which God knows the world of the possible.34 Here, two questions arise: What does Barth understand by the possible (das Mögliche), and what does the following qualification: apart from what God wills as actual (‘abgesehen von dem was er als wirklich will’) mean?35 Barth states that God’s natural knowledge creates space for real knowledge of real objects, but free knowledge integrates knowing and willing: God knows willingly as actual what he knows by his free knowledge. Here, knowing and willing are only to be distinguished formally.36 For Barth, they are no different acts, since there is only one divine personal act. Knowing and willing are aspects of the same act. Divine acts are not multi-dimensional. Now, it becomes clear what Barth meant by ‘abgesehen von dem, was er als wirklich will’. There is no difference between God’s basic knowledge and what God wills actually. So, the surprising transition from knowing to willing only points at internal distinctions. With respect to God’s natural knowledge, Barth does not take into account the viewpoint of will. The natural knowledge creates space for real knowledge, since the impossible cannot be known. Just as knowledge and will are aspects of the same act, so are possible and actual aspects of the same reality.
33
34 35
36
Stoevesandt, Hinrich (ed.), Karl Barth. Unterricht II. Die Lehre von Gott / Die Lehre vom Menschen 1924 / 1925, 133 (132-43): “Nach meinem ganzen Verständnis der gött lichen Eigenschaften und des göttlichen Wesens ist mir das unmöglich. Wir meinten ja die Eigenschaften verstehen zu müssen als die auf eine unanschauliche Mitte sich beziehenden Radien eines Kreises.” Barth also mentions Schleiermacher’s identifications: possibility = actuality, willing = acting, and freedom = necessity (op. cit., 119-20). Stoevesandt (ed.), Barth. Unterricht II 129: “scientia naturalis [...] durch die Gott die Welt des Möglichen erkennt.” The Thomist meaning of what is possible refers to what is not the case, but the Scotist meaning of the possible does not stand over and against the actual, but includes the actual, while there are infinitely more consistent states of affairs possible than are actually the case, but what does Barth mean? On Thomas Aquinas’ notion of scientia simplicis intelli gentiae, see Dekker, Rijker dan Midas, 94-5, and Vos, “Ab uno disce omnes”, 182-7. Op. cit., 129: “Der zweite (namely, free knowledge) führte es wieder zurück auf ein Wissen, das vom Wollen nur noch formal zu unterscheiden war.”
Scotus in the nineteenth and twentieth centuries
205
Reformed scholasticism continues the mainstream contingency and freedom tradition of the Middle Ages,37 but exactly the distinction between necessitas absoluta (consequentis)/hypothetica (consequentiae) is missing in Karl Barth. There is even the striking fact, that this distinction is not only missing in his own systematic thought, but also in his detailed descriptions of doctrines to be found in Reformed scholasticism.38 It is so far removed from his own frame of mind that he even overlooks the fact that this distinction is the backbone of the conceptual structures of Reformed scholasticism, and, for that matter, of the whole of Christian medieval and early modern scholasticism. In contrast with all great twenty-century colleagues, conscientious attention is paid by Barth to many ancient distinctions, but the pivotal one is missing. The same is true of the Catholic theology of Karl Rahner and Hans Urs von Balthasar: it is all diametrically opposed to the logic and ontology of Duns Scotus’ thought. Likewise, Brunner and Tillich forget Scotus. 7. Final considerations According to the Renaissance view of the development of Western philosophy there is a breakdown of traditional thought about 1500. This approach leads to paradoxical views: English and French, German and Italian, Spanish and Dutch, Scandinavian, Middle- and East-European philosophy start only after 1500 and modern European philosophy is not much older than American thought. However, this approach begs some questions: Can systematic thought of the sixteenth, seventeenth and eighteenth centuries be understood without taking into account university thought? Can a realistic approach of the history of Western philosophy ignore the continuity of thought from about 12000 to about 1800? The European university shows a remarkable continuity between its birth about 1200 till about 1800. The six first centuries of the Western university (± 1200 – ± 1800), consisting of two sets of three centuries, form one specific whole.39 The traditional view overlooks medieval thought and the philosophical contributions of its Augustinian main line. The separation of the modern languages from Latin and the separation of modern philosophy from medieval philosophy are linked with the separation of philosophy from theology, but what we now call theology, is the key to understanding the dynamics of 37
38
39
See Van Asselt et al., Reformed Thought on Freedom; Vos, “Ab uno disce omnes”, 173-204; Vos, “Scholasticism and Reformation”, 99-19; and Vos and Beck, “Conceptual Patterns Related to Reformed Scholasticism”, 223-33. An explanation of Anselm’s crucial between necessitas praecedens, the Anselmian forerunner of the notion of necessitas consequentis, and necessitas sequens, the Anselmian forerunner of the notion of necessitas consequentiae is also missing in Barth’s fine Anselm book – see Jüngel, Dalferth, Karl Barth. Fides quaerens intellectum, 51-2, where an incorrect explanation of necessitas is found. The development of philosophy and theology until 1800 has to be studied as a whole. Only the nineteenth-century university takes a different route.
206
Antonie Vos
Western and medieval thought in an alternative way. When we block out medieval thought and Duns Scotus’ philosophy, we miss the most original facet of Western thought. There is still much to be done to repair the many mistakes of modern philosophy and theology, not only historically, but also systematically. In the Netherlands, they called themselves moderns, modern theologians, and the foundation of their modern theology consisted in the following rules: the rule of demonstrability: (D) Everything is demonstrable and has to be demonstrated, the rule of causality: (C) The relation of an effect to its cause is necessary, and the rule of necessity: (N) All states of affairs and all facts are necessary. However, we can know better, for we are familiar with Father John from Scotland, who already refuted all these rules.40 Thus, I finish with a personal touch Father John from Scotland,beloved in Christ. I am fully acquainted with his praiseworthy life, excellent knowledge and most subtle mind.
40
On the rule of demonstrability, see Vos, The Philosophy of Scotus, chapters 8 and 9, on the rule of causality, see Vos, op. cit., chapter 10, and on the rule of necessity Vos, op. cit., chapters 7, 14 and 16.
Scotus in the nineteenth and twentieth centuries
207
Bibliography Asselt, Willem Jan van and Eef Dekker (Eds.), Reformation and Scholasticism. An Ecumenical Enterprise. Grand Rapids: Baker Book House, 2001. Asselt, Willem et al (Eds.), Reformed Thought on Freedom. Grand Rapids: Baker Book House, 2009. Barth, Karl, Unterricht in der christlichen Religion II, ed. Hinrich Stoevesandt, Die Lehre von Gott/Die Lehre vom Menschen 1924/1925. Zürich: Evangelischer Verlag 1990. Barth, Karl, Fides quaerens intellectum, eds. Eberhard Jüngel and Ingolf Ulrich Dalferth. Zurich: Evangelischer Verlag, 31981 (Munich 11931). Berr, Henri, “Avant-propos.” In Bréhier, Émile, La philosophie au moyen âge. Paris: 11937 (21949), i-xviii. Bréhier, Émile, La philosophie au moyen âge. Paris: 11937 (21949). Callebaut, André, “La maîtrise du Bx. Jean Duns Scot en 1305.” Archivum Franciscanum Historicum 21 (1928): 206-239. Denifle, Heinrich and Alain Chatelain (Eds.), Chartularium Universitatis Parisiensis II 1. Paris: Delalain, 1891. Dekker, Eef, Rijker dan Midas. Vrijheid, genade en predestinatie in de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609). Zoetermeer: Boekencentrum, 1993. Douwes, Jan, Het Determinisme van den hoogleraar J. H. Scholten, in twee zijner grondbegrippen beschouwd. Groningen: 1859. Gál, Gedeon and Rega Wood (Eds.), Adam de Wodeham, Lectura secunda in librum primum Sententiarum III. St. Bonaventure: St. Bonaventure University Press, 1990. Hauréau, Barthélémy, Notices et extraits de quelques manuscrits latins de la Bibliothèque Nationale I-VI. Paris: Klincksieck, 1890-1893. Imbach, Ruedi and Alfonso Maierù (Eds.), Gli studi de filosofia medievale fra otto e novecento. Rome: Edizioni di Storia e Letteratura, 1991. Inglis, John, Spheres of Philosophical Inquiry and the Historiography of Medieval Philosophy. Leiden: Brill, 1998. Jolivet, Jean, “Les études de philosophie médiévale en France de Victor Cousin à Étienne Gilson.” In Ruedi Imbach and Alfonso Maierù (Eds.), Gli studi de filosofia medievale fra otto e novecento, 1-20. Rome : Edizioni di Storia e Letteratura, 1991. Kist, Nicolas C., De vrije wil of de mensch een redelijk en zedelijk vrijwerkend wezen. Leiden: Brill, 1859. Little, Andrew, The Grey Friars in Oxford. Oxford 1892. Loofs, Friedrich, Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte, Halle 41906 (11889, 21890, 31893). Friedrich Loofs. Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte I, ed. Kurt Aland, 51950, and Friedrich Loofs. Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte, ed. Kurt Aland. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 61959. Oberman, Heiko A., The Harvest of Medieval Theology. Cambridge (Ma.): Harvard University Press, 1963. Scholten, Jan H., De Leer der Hervormde Kerk I. Leiden: Engels, 41864 (11848). Scholten, Jan H., De vrije wil. Leiden: Engels, 1859. Sondag, Gérard, “Jean Duns Scot et la Métaphysique classique.” Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques 83 (1999): 1-5. Steenberghen, Fernand van, Introduction à l’étude de la philosophie médiévale. Receuil de travaux offert à l’auteur par ses collègues, ses étudiants et ses amis. Louvain, Paris, 1974. Steenberghen, Fernand van, “Maurice De Wulf (1867-1947)” (1948), Introduction à l’étude de la philosophie médiévale, 287-313. Louvain, Paris, 1974.
208
Antonie Vos
Vos, Antonie. “De kern van de klassiek gereformeerde theologie.” Kerk en Theologie 47 (1996): 106-125. Vos, Antonie, “Ab uno disce omnes.” Bijdragen 60 (1999): 173-204. Vos, Antonie, “Scholasticism and Reformation.” In Reformation and Scholasticism, eds. Willem Jan van Asselt and Eef Dekker, 99-119. Grand Rapids: Baker Book House, 2001. Vos, Antonie and Andreas J. Beck, “Conceptual Patterns Related to Reformed Scholasticism.” Nederlands Theologisch Tijdschrift 57 (2003): 223-233. Vos, Antonie, The Philosophy of John Duns Scotus. Edinburgh: Edinburgh University Press 2006. Vos, Antonie, “Duns Scotus’s Significance for Western Philosophy and Theology.” In Canterbury Studies in Franciscan History II, eds. Philip Yates and Jens Rohrkasten, 61-83. Canterbury, 2009. Wielockx, Robert, “De Mercier à De Wulf. Débuts de l’École de Louvain.” In Ruedi Imbach and Alfonso Maierù (Eds.), Gli studi de filosofia medievale fra otto e novecento. Rome: Edizioni di Storia e Letteratura, 1991, 75-95. Wulf, Maurice de, Histoire de la philosophie médiévale I. Louvain, 61934.
209 Archa Verbi. Subsidia 6
209–220
Duns Scot et la métaphysique du possible chez Bergson Matthias Vollet
I Questions de méthode Parler de la postérité d’un philosophe fait immédiatement penser aux réactions qu’il a pu susciter, à son influence, ou à l’histoire des controverses que son œuvre a produites. Or il y a aussi des postérités qui relèvent d’une influence sous-jacente, d’une controverse dans laquelle le philosophe en question n’est visible qu’ “ a remotis ”. Tel est plus ou moins le cas pour le rôle de Duns Scot dans la pensée de Bergson. Bergson n’avait qu’une connaissance médiocre de la philosophie médiévale1, et en outre il en a eu une mauvaise opinion ; où il en parle, il ne fait que la mentionner brièvement, et ceci quasi exclusivement dans ses cours. Son verdict (ici un cours de 1886) porte sur la relation étroite entre philosophie et théologie au moyen-âge : « On donne le nom de scolastique à la philosophie du Moyen-Âge. Ce qui distingue cette philosophie, c’est son union plus ou moins étroite avec la théologie. En effet les scolastiques sont à peu près tous des religieux. Ils voient dans la philosophie un moyen de démontrer ou d’interpréter les vérités de la foi. Là est précisément le défaut du Moyen-Âge. Il n’a guère connu la liberté. Philosophia ancilla theologiae, voilà la devise de la scolastique dans sa période d’éclat »2.
Ce n’est que dans les Deux sources de la morale et de la religion que Bergson vient à reconsidérer son opinion sur la philosophie médiévale – mais pas exactement sur celle-ci, sinon sur la mystique chrétienne. Ne faut-il donc pas fermer immédiatement ce chapitre sur la postérité bergsonienne de Duns Scot ? Je dirais que non, car, en dépit des réticences méthodologiques de l’histoire de la philosophie qui doit se baser sur les faits écrits et influences repérables par des témoins et traces inéquivoques, il y a aussi une possibilité de confronter des positions qui ne se sont pas touchées immédiatement, mais qui se croisent par l’intermédiaire de transmetteurs de concepts, ou bien si l’un fait partie d’une tradition philosophique que l’autre critique globalement sans pour autant en connaître tous les penseurs individuellement. Un tel cas de controverse indirecte est celui de Bergson et Duns Scot. 1 2
Pour Bergson historien de la philosophie, cf. Vollet, “Bergson Historien”. Bergson, Leçons clermontoises II, 180-182. Voir aussi une lettre de Bergson à la Comtesse Murat en 1916, in Bergson, Correspondances, 675 : « Je ne connais que très incomplètement la philosophie du Moyen Âge ».
210
Matthias Vollet
D’autre part on peut se demander toujours si des verdicts explicites et implicites ont leur bien-fondé – et essayer de construire une espèce de ‘sacra conversatio’ entre des philosophes qui ne se sont pas connus sur terre. Bien que méthodologiquement contestable, ceci pourrait mettre sous une nouvelle lumière des philosophies déjà assez bien connues. Dans ce qui suit, partant des mentions du Scot chez Bergson, j’expliquerai brièvement la position de Bergson sur les thèmes de la liberté, du néant et du possible, ce qui se présente en bonne partie comme une controverse avec Leibniz (et indirectement Duns Scot), et sur la métaphysique classique en général – décrit par Bergson à l’aide d’une discussion de ces concepts. Il s’agira de vérifier si les verdicts de Bergson valent aussi pour Duns Scot ; il ne s’agira donc pas de suivre en détail les arguments de Scot autour de la liberté, de l’être et du néant, du possible et de la contingence, mais d’en mettre en relief quelques traits fondamentaux à partir de la perspective bergsonienne. On verra un Bergson qui a un concept assez normatif de l’histoire de la philosophie ; et un Scot qui dans les yeux de Bergson devrait faire partie des occasions manquées de la philosophie. La question sera donc : est-ce que Duns Scot se trouve inclus dans la métaphysique telle que la conçoit Bergson ? De quelle manière Duns Scot constitue-t-il une cible de Bergson ? II Mentions de Duns Scot chez Bergson Voyons d’abord les mentions directes de Duns Scot par Bergson ; on y verra les perspectives systématiques sous lesquelles Bergson cite le nom du Scot. C’est à partir de ces thématiques qu’ensuite sera discutée systématiquement la place de Scot dans l’univers bergsonien. Dans les écrits publiés de son vivant, Bergson ne fait qu’une seule fois mention de Duns Scot : Dans L’intuition philosophique, conférence faite au congrès de philosophie à Bologne en 1911 et reprise dans son recueil La pensée et le mouvant en 1934, il entame des réflexions sur comment la pensée d’un philosophe évolue et comment elle peut être comprise ; or on ne la comprendrait, selon Bergson, que très superficiellement si l’on la reconstituait par ses sources ou par ses ressemblances avec des philosophies antérieures (au lieu de chercher sa poussée intérieure, son intuition profonde). Tel serait le cas si l’on voulait expliquer une partie de la pensée de Berkeley par le fait qu’elle se trouverait déjà chez Duns Scot : Bergson, comme exemple d’une méthode qu’il repousse, résume la philosophie de Berkeley en quatre thèses dont la troisième affirme « la réalité des esprits et les caractérise par la volonté : disons que c’est du spiritualisme et du volontarisme ». Or, on trouverait aussi cette thèse chez Duns Scot (et Descartes) 3. Mais avec une telle reconstruction extérieure d’une philosophie, on n’aurait, dit Bergson, qu’une « salade qui ressemblerait suffisamment, de loin, à ce que Berkeley a fait »4. 3 4
Bergson, “L’intuition philosophique”, 125. Bergson, “L’intuition philosophique”, 126.
Duns Scot et la métaphysique du possible chez Bergson
211
Dans L’Intuition philosophique, Bergson dit que chaque philosophie a une intuition profonde que le philosophe essaye d’exprimer tout au long de son travail. Or il paraît que pour Bergson, cette idée (ou ‘intuition’) centrale, c’est que Bergson appelle le volontarisme. Les mentions du Scot dans les notes de cours de Bergson vont dans le même sens. Dans ses cours, selon que leurs notes sont publiées jusqu’ici5, Bergson fait rarement mention du Scot. Dans un cours sur l’histoire de la philosophie, à Clermont-Ferrand en 1886, il le mentionne quand il explique le volontarisme divin chez Descartes6, une deuxième fois opposant le volontarisme divin du Scot à la conception de Leibniz7. La troisième mention se trouve au lieu d’où j’ai cité le verdict général sur la philosophie médiévale ; il se trouve dans la dernière leçon de ce cours (le 2 juillet 1886), après avoir traité la philosophie contemporaine. Tout se passe comme si Bergson avait voulu repousser la philosophie médiévale jusqu’à la fin du cours. Là, on lit : « Mais le grand docteur de l’école, le docteur subtil, doctor subtilis, est l’anglais Duns Scot (1274 – 1308). Selon Duns Scot c’est la volonté de Dieu qui est supérieure à son intelligence, elle ne trouve pas une loi toute faite à laquelle elle doit se conformer, c’est elle qui fait la loi et qui crée la vérité. Dieu est absolument libre, théorie reprise par Descartes »8.
Dans le cours de métaphysique de la même année au lycée à Clermont-Ferrand, Bergson, parlant sur les « attributs moraux » de Dieu et spécialement sur la volonté de Dieu, dit, après avoir opposé Descartes et Leibniz : « Si l’on analyse ces deux doctrines contraires, on verra qu’il s’agit au fond du problème qui se posait au Moyen-Âge entre les thomistes et les scotistes. D’après Duns Scot la volonté de Dieu est supérieure à son intelligence, ce qui signifie que Dieu peut tout vouloir et que ce qu’il a voulu une fois se trouve être par cela même le vrai et le bien. Ainsi les vérités dites éternelles auraient été toutes autres si Dieu l’avait voulu, le bien et le mal aussi. […] Ce problème est d’une obscurité telle qu’aucune intelligence humaine ne peut aspirer à le résoudre. Disons seulement que la liberté ne suppose pas nécessairement une hésitation entre les deux contraires et que, au lieu de se demander si le bien et le vrai sont supérieurs à Dieu ou si Dieu les a crées comme tout le reste, il faudrait peut-être chercher si le vrai et le bien ne feraient pas un avec Dieu lui-même »9.
Notons que c’est le volontarisme divin, et donc le problème de la liberté, qui intéresse positivement Bergson chez Duns Scot, et que c’est en le mettant en relation avec Leibniz et Descartes – en le mettant aux côtés de Descartes contre Leibniz. Bergson donne ce cours au temps de la composition de sa thèse, l’Essai sur les données immédiates de la conscience (publié en1889). Dans ce livre, il présente sa théorie de la durée, et il donne un essai de la portée de son intuition en traitant le problème de la liberté. Bergson retient donc de Duns Scot 5 6 7 8 9
Les cours de Bergson ne se conservent que sous formes des notes d’élèves, d’étudiants ou des dactylographes. Bergson, Leçons clermontoises II, 119. Bergson, Leçons clermontoises II, 152. Bergson, Leçons clermontoises II, 186. Bergson, Leçons clermontoises I, 325sq.
212
Matthias Vollet
(et des autres penseurs cités) ce qui est pour lui d’un intérêt spécial ; on peut donc voir dans ses remarques une pré-étude de sa propre pensée. D’ailleurs Bergson lui-même disait que cette sorte d’étude historique d’un problème ne devrait pas passer dans des livres, mais qu’il trouverait bien sa place dans l’enseignement10. III La liberté bergsonienne Le but de la métaphysique bergsonienne se concentre dans deux mots de la fin de son « Introduction à la métaphysique » : « Expérience intégrale »11. Cette expérience intégrale de la réalité, qui en fait n’est autre chose que ce que Bergson appelle « l’intuition », est la connaissance, la sympathie qui s’insère immédiatement dans une réalité qui pour Bergson est substantiellement temporelle – temporalité qui n’est pas caducité, mais créativité. La métaphysique de l’intuition selon Bergson touche donc l’absolu, la durée. En ceci Bergson veut dépasser tout relativisme ou dogmatisme négatif métaphysique en ce qui concerne l’accessibilité de la réalité temporelle. Pour lui dès les temps de Zénon d’Élée le fondement de la métaphysique traditionnelle se trouve dans la méconnaissance de la durée, de la créativité et temporalité du monde sensible ; soit qu’on niait tout court son existence, soit qu’on la mettait au deuxième rang, soit qu’on la disait inconnaissable. Le premier pas de la philosophie bergsonienne se trouve dans sa thèse, l’Essai sur les données immédiates de la conscience de 1889, où il présente sa conception de la liberté. Celle-ci, pour lui, n’est pas une faculté de l’homme, sinon une qualité que ses actes peuvent avoir : « Bref, nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils l’expriment, quand ils ont avec elle cette indéfinissable ressemblance qu’on trouve parfois entre l’œuvre et l’artiste »12. Au cours d’une délibération, après des hésitations qui empêchent des réactions automatiques, le moi se modifie continuellement, formant « une série dynamique d’états qui se pénètrent, se renforcent les uns les autres, et aboutiront à un acte libre par une évolution naturelle13 ». De tels actes sont rares, la liberté admet des degrés, comme Bergson le dit14 ; la plupart du temps, dans notre vie quotidienne, nous vivons dans un état comme dispersé, spatialisé ; nous nous représentons la vie comme des passages par des stations et la liberté comme des situations de choix entre des alternatives, des possibilités. C’est sur ce fond, renforcé par les habitudes du langage, qu’est traditionnellement posé le problème de la liberté : il se présente comme une lutte entre les déterministes et indéterministes sur la détermination ou l’indétermination du choix 10 11 12 13 14
Bergson, Mélanges, 763 ; Vollet, “Bergson Historien”, 324sq. Bergson, “Introduction à la métaphysique”, 227. Bergson, Essai, 129. Bergson, Essai, 129. Bergson, Essai, 125.
Duns Scot et la métaphysique du possible chez Bergson
213
entre des possibilités déterminées. Or, c’est dans cette position du problème que son insolubilité traditionnelle trouve sa cause ; c’est la pensée au moyen des possibilités qui détourne le regard de la durée réelle. C’est cette position qui se préparait aux temps où Bergson dictait ses leçons à Clermont-Ferrand cités plus haut. La lutte contre la position fausse des problèmes reste une constante dans la philosophie de Bergson. Pour lui – la chose est bien connue – la durée est l’étoffe même de la réalité, sa substance. En 1903, dans l’Introduction à la métaphysique, le pas décisif est fait. Bergson dit : « Cette réalité est mobilité. Il n’existe pas de choses faites, mais seulement des choses qui se font, pas d’états qui se maintiennent, mais seulement des états qui changent. Le repos n’est jamais qu’apparent, ou plutôt relatif. La conscience que nous avons de notre propre personne, dans son continuel écoulement, nous introduit à l’intérieur d’une réalité sur le modèle de laquelle nous devons nous représenter les autres. Toute réalité est donc tendance, si l’on convient d’appeler tendance un changement de direction à l’état naissant »15.
C’est la vie même qui est créatrice. Or, les années qui suivent L’introduction à la métaphysique, Bergson se rapproche de plus en plus à l’idée d’un Dieu créateur, créateur du célèbre élan vital – un Dieu encore loin des dogmes de l’Église. Ce Dieu n’est que la source absolument libre de cette créativité intramondaine : « Si, partout, c’est la même espèce d’action qui s’accomplit, soit qu’elle se défasse soit quelle tente de se refaire, j’exprime simplement cette similitude probable quand je parle d’un centre d’où les mondes jailliraient comme les fusées d’un immense bouquet, – pourvu toutefois que je ne donne pas ce centre pour une chose, mais pour une continuité de jaillissement. Dieu, ainsi défini, n’a rien de tout fait ; il est vie incessante, action, liberté. La création, ainsi conçue, n’est pas un mystère, nous l’expérimentons en nous dès que nous agissons librement »16.
Le problème de la liberté est pour Bergson étroitement lié au problème du possible ; là, on verra Bergson contre Leibniz et avec lui implicitement contre Duns Scot. La remarque citée du cours de Bergson préfigure la position que Bergson prendra au sujet de la liberté dans l’Essai sur les données immédiates de la conscience (1889) ; si l’on substitue le mot « contraire » à celui de « possible », on obtient immédiatement l’argument central autour de la liberté : « la liberté ne suppose pas nécessairement une hésitation entre deux possibles ». Cet argument est le premier pas de son argumentation autour du sujet du possible qu’il développera jusqu’à son dernier article, Le possible et le réel (1930)17. Sa réflexion sur le possible s’inscrit, si l’on regarde le Bergson historien de la philosophie, dans sa dévalorisation de la métaphysique qui le précède ; et elle
15 16 17
Bergson, “L’introduction à la métaphysique”, 211. Bergson, L’évolution créatrice, 249. Pour ce développement à l‘intérieur de la philosophie de Bergson, et pour ce qui suit, cf. Vollet, Wurzel.
214
Matthias Vollet
se dirige spécialement contre Leibniz (bien qu’il y ait des moments où Bergson semble s’en inspirer)18. IV Bergson, le néant, et la possibilité Pour Bergson, la métaphysique traditionnelle est loin de comprendre la réalité comme tendance, de voir la durée comme son fondement. Au quatrième chapitre de L’évolution créatrice, il explique sa position envers l’histoire de la philosophie jusqu’à nos jours. Nous voilà devant le jugement de Bergson qui en peut inclure aussi un sur Duns Scot. Pour Bergson, la tâche de la métaphysique est de suivre les ondulations du réel comme son « expérience intégrale »19. Il s’agit de penser en durée. Cette tâche, qui reste toujours à réaliser, donne le critère pour juger de l’histoire de la philosophie. Dans cette perspective, l’histoire de la philosophie est l’histoire de l’oubli de la durée. C’est une histoire d’une pensée qui, par le succès facile de l’intelligence, laquelle, au fond pratique, opère et pense par des choses, concepts, possibles tout faits, se laisse détourner de la durée et ne contemple que l’extratemporel : pour cette pensée, « la réalité, comme la vérité, serait intégralement donnée dans l’éternité »20 – dans des idées aussi bien que dans des lois. « L’éternel fixité des lois de la nature » chez Lucrèce21 aussi bien que les paradoxes de Zénon22 étaient pour Bergson dès ses débuts philosophiques des pierres d’achoppement, comme aussi la métaphysique moderne de Leibniz et Spinoza, la philosophie de Kant23 ou bien l’insuffisance de Spencer24. Tous subissent au même poids de l’intelligence, et de ce côté25, l’histoire de la philosophie est condamnée en bloc : elle ne représente que l’attitude naturelle de notre intelligence face à la réalité. Mais c’est aussi une histoire des occasions manquées : ainsi Descartes était sur le point de se tourner dans la bonne direction quand il postulait le libre arbitre de l’homme et pour Dieu une volonté absolument libre et une création continuée qui était au point de se convertir en une création continue, 18 19 20 21 22 23
24 25
Cf. Vollet, Wurzel, 247-256 ; Vollet, “Cours de Bergson”, 25-34. Bergson, “L’introduction à la métaphysique”, 227. Bergson, L’évolution créatrice, 353. Bergson, Mélanges, 286 (Extraits de Lucrèce). Pour leur rôle pour Bergson, qu’il n’est pas nécessaire de présenter in extenso, cf. Gouhier, Bergson dans l’histoire, 23-33. Elle est présente dès l’Essai ; cf. la citation de Gilbert Maire, “ Bergson mon maître ”, dans Bardy, Bergson professeur, 47sq : “ Lorsque j’étais étudiant, j’admettais facilement la doctrine du philosophe que je lisais. J’étais cartésien avec Descartes, berkeleyen avec Berkeley, spencérien avec Spencer. Ce fut devant Kant seulement que je m’écriais ‘non’ et ce refus m’apparaît [sic] comme la première démarche originale de ma pensée ”. Cf. p.ex. les dernières pages de L’évolution créatrice ou les premières de l’ »Introduction« de Bergson, La pensée et le mouvant. Bergson souligne qu’il ne parle que d’une certaine perspective ; cf. Bergson, L’évolution créatrice, 331.
Duns Scot et la métaphysique du possible chez Bergson
215
liberté absolue26. Pensons ici à Duns Scot mis aux côtés de Descartes. Nous voilà devant un autre penseur à une occasion manquée. Or, aussi à l’âge moderne, la métaphysique se pliait aux coutumes de l’ancienne, ce qu’on peut voir le plus aisément chez celui dont Bergson est l’adversaire le plus constant, Leibniz. Il commet des fautes que Bergson prend pour fondamentales pour les problèmes faussement posés en quoi consiste la métaphysique classique. D’abord il essaie de penser le plein par le vide, l’être par le néant : la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien » pose, nous explique Bergson au IVe chapitre de L’évolution créatrice, le néant comme précédant l’être, l’être étant forcé de surmonter cette obstacle de quelque manière, et de cette manière cette question témoigne d’un malentendu profond sur la nature de la réalité. « Il faut que ce mystère soit éclairci. Il le faut surtout, si l’on met au fond des choses la durée et le libre choix. Car le dédain de la métaphysique pour toute réalité qui dure vient précisément de ce qu’elle n’arrive à l’être qu’en passant par le « néant », et de ce qu’une existence qui dure ne lui paraît pas assez forte pour vaincre l’inexistence et se poser ellemême. C’est pour cette raison surtout qu’elle incline à doter l’être véritable d’une existence logique, et non pas psychologique ou physique. Car telle est la nature d’une existence purement logique qu’elle semble se suffire à elle-même, et se poser par le seul effet de la force immanente à la vérité »27. « L’existence toute physique n’a pas, par elle-même, de quoi vaincre l’inexistence. Mais l’ “ essence logique ” du cercle, c’est-à-dire la possibilité de le tracer selon une certaine loi, c’est-à-dire enfin sa définition, est chose qui me paraît éternelle ; elle n’a ni lieu ni date, car nulle part, à aucun moment, le tracé d’un cercle n’a commencé d’être possible »28.
Voilà les fondements d’une discussion implicite avec Duns Scot. Le néant, dit Bergson, n’est que le résultat d’une série d’opérations de l’esprit ; il en vaut de même pour le concept apparenté du possible. Tandis que le néant sert comme pierre d’achoppement négatif pour l’être et la réalité, la notion du possible sert, selon Bergson, plutôt pour s’expliquer positivement l’existence de quelque chose – on l’a déjà vu dans la citation qui précède. Pour Bergson, penseur du plein et de l’évolution, la possibilité logique, la pure non-contradiction n’a aucune force, étant pure fiction. Bergson parle encore du possible au sens négatif, le non-impossible, « absence d’empêchement », « condition de réalisation » et en distingue le possible au sens positif, « préexistence sous forme d’idée », « l’idéalement préexistant »29. Mais aussi les autres manières de parler des possibles ne servent que pour expliquer la réalité, mais l’expliquer par et pour l’intelligence, rien de plus. Possibilité, pour Bergson – prenant pour modèle Leibniz –, veut toujours dire essence déterminée. L’intelligence humaine, selon lui, a besoin, pour s’orienter dans cette réalité 26 27 28 29
Bergson, L’évolution créatrice, 344sq. Bergson, L’évolution créatrice, 276. Bergson, L’évolution créatrice, 277. Bergson, „Le possible et le réel”, 112.
216
Matthias Vollet
fuyante, de concevoir des possibles par lesquels s’explique l’avènement de cette réalité, mais aussi son sort futur et aussi sa subdivision en des arrêts possibles. Mais cette pensée en possibles rend impossible de voir la réalité dans sa tendancialité ouverte30. V Jean Duns Scot Dans ce qui précède, bien des points d’intersection entre la pensée de Bergson et celle du Scot ont été décelés à partir de Bergson ; dans ce qui suit, on mettra en relief quelques traits fondamentaux de la pensée du Scot pour les mettre en contraste avec contre Bergson. À première vue, Duns Scot est le prototype d’une métaphysique rejetée par Bergson ; en différenciant une metaphysica secundum se scibilis, qui serait celle de Dieu, de la métaphysique humaine, une metaphysica in nobis qui s’appuie sur des notions abstraites, en proposant une scientia transcendens31, il se trouve dans un mode de pensée rejeté par Bergson. Cette métaphysique traite l’objet le plus loin de la réalité mouvante et le plus vide de détermination, l’ens transcatégorial. Mais d’autre part, par le poids qu’il donne à la liberté, comme prédécesseur de Descartes, il paraît avoir des traits séduisants pour Bergson, comme on a vu. En fait, le thème de la volonté a été celui que Bergson a constamment associé à Scot. Qu’en est-il ? VI L’étant et le néant L’ens étant indéterminé, il faut quand même l’expliquer. Cette explication ne pouvant porter sur des contenus, elle porte sur les modalités de l’étant. La première partie de cette détermination modale de « ens » porte sur l’ens différencié de son opposé, le néant32. Dans la troisième des Quaestiones quodlibetales33, il distingue trois significations (au sens d’ « usus loquendi », c’està-dire des manières de parler courantes ou plutôt des auteurs) d’ens ou res : la première, « communissime », « se extendit ad quodcumque quod non est nihil ». Il détermine donc l’ens, faute de détermination, délimitation positive, négativement à partir de ce qu’il n’est pas – et ce dernier est donc, dans la perspective bergsonienne, pris comme ce qu’il faut surmonter pour être. « Nihil », pour Duns Scot, a deux significations : « verissime » « quod includit contradictionem » : deux contradictoires ne peuvent jamais être réunies pour former un ‘un’ intelligible. L’ens dans cette signification englobe donc aussi les « entia rationis » ou « conceptibiles ». Dans une deuxième signification, nihil veut dire « quod nec est, nec esse potest aliquod ens extra animam ». Res serait donc « quod non includit contradictionem » ou bien, pris à partir de notre perspective sensible et de la 30 31 32 33
Cf. Vollet, Wurzel, 191-246. Honnefelder, Duns Scotus, 72f. Honnefelder, Duns Scotus, 75ff. ; Cervellon, “Duns Scot”. Ioannes Duns Scotus, Quodl. III, ed. Viv. XXV, 114 ; ed. Wad. XII, 66sqq.
Duns Scot et la métaphysique du possible chez Bergson
217
deuxième signification de nihil, « quod habet vel quod habere potest aliquam entitatem non ex consideratione intellectus ». C’est ce deuxième usage de ens qui est pris en considération, selon Scot34, dans la pensée transcatégoriale autour de l’étant. Il y a une troisième signification de res, celle de substance au sens fort, « ens cui per se et primo convenit esse ». On voit que le parler sur l’être est décrit ici comme reposant sur la profération du néant ; le néant est, tout à fait comme le décrit Bergson pour la pensée métaphysique classique, posé comme ce qui est à surmonter : l’étant s’étend à tout ce qui n’est pas néant. On se demande donc implicitement dans cette perspective, comme Leibniz le fera explicitement, pourquoi il y aurait quelque chose plutôt que rien. La première victoire sur le néant est celle de la logique, comme Bergson le décrit dans la citation donné plus haut : c’est le pur p rincipe de non-contradiction qui l’emporte sur le néant. VII intuition, abstraction, science Mais cette référence au néant est d’une certaine manière expliquée en connexion avec une certaine manière de parler du possible (potest habere) ; et c’est exactement la manière dont Bergson décrit aussi les procédés quand il décrit la métaphysique contre laquelle il lutte : qu’elle se baserait sur un usage “ métaphysique ” des notions qui de leur source ne sont que des outils de l’intelligence pour s’orienter dans le monde. Quand Duns Scot opte pour une métaphysique basée sur la connaissance abstractive, c’est justement parce qu’elle a à voir avec des essences possibles qui, étant sans contradiction interne, en ceci sont nécessaires – et peuvent servir de cette manière comme objets et base d’une science au sens aristotélicien, dévalorisant la connaissance dite intuitive qui a pour objet l’individuel dans sa contingence. Or c’est aussi une intuition qui est au fond de la métaphysique bergsonienne – une intuition bien différente parce qu’elle porte directement sur la temporalité, la durée de ses objets, mais semblable en ce que (comme chez Duns Scot aussi) l’intuition porte sur l’individuel concret, actuel et contingent. Mais pour Duns Scot, l’intuition est limitée ; de plus, derrière la réalité des contingents il y a celle de Dieu, qui est l’auteur du choix qui les a mis en existence, comme aussi la source de sa possibilité métaphysique. Chez Bergson, il n’y a pas de réalité derrière la nôtre qui en différerait comme le vrai diffère du raisemblable. L’abstraction pour Bergson est constructive en ce sens qu’elle érige des concepts en essences, pour lui ‘fictives’ ; pour Bergson, l’abstraction est un obstacle pour la connaissance de la réalité (qui s’effectue dans l’intuition de la durée), à que pour Duns Scot, c’est par elle que nous avons accès aux fondements (formels) de la réalité.
34
Honnefelder, Duns Scotus, 76.
218
Matthias Vollet
VIII Les possibles et la liberté Chez Bergson, la source de la réalité toujours changeante et créatrice est un fonds inépuisable de virtualités qui à leur tour se différencient en tendances et en choses, lesquelles jamais ne sont des choses stables, mais toujours des choses en voie de changement. Dieu comme liberté n’a pas de possibles qu’il élirait pour les mettre en existence ; cette conception contre laquelle il lutte, conception leibnizienne, est pour lui une fantaisie de l’intelligence pratique. Pour Duns Scot, la question se pose de manière différente : le Dieu Créateur, qui crée volontairement, crée à partir des possibles qu’il connaît auparavant. Ces possibles avant la création ont leur être-possible, c’est-à-dire leur nonrépugnance formaliter ex se, mais leur esse intelligibile dérive principative per intellectum divinum. C’est Dieu lui-même qui restreint sa potentia absoluta à une potentia ordinata en ce qu’il fait une élection libre d’un complexe de compossibles (“ monde possible ” avant la lettre, comme dit Honnefelder)35. Dieu a librement voulu ceci ou cela, seulement restreint par la non-répugnance (du point de vue bergsonien, la volonté de Dieu n’est donc pas si libre que cela). Les choses ainsi créées sont des contingentia : non qu’ils soient changeables, mais en ce qu’au lieu d’eux il pourrait y avoir autre chose au même moment : contingence synchronique, une nouveauté scotienne. Parce que c’est Dieu qui a élu ceci et non pas cela (et ceci sans restriction ultérieure du choix, pas comme chez Leibniz le meilleur monde des possibles), Scot peut dire que les choses sont bonnes parce que Dieu les a voulues – à quoi Bergson fait allusion dans ce qu’on a cité au commencement. La source de la contingence des étants est la liberté, la contingence opérative de Dieu. La possibilité logique de la non-repugnantia est donc la précondition du possibile metaphysicum et de l’être contingent, mais aussi du nécessaire (c’est-à-dire aussi de Dieu) – aussi Leibniz voulait-il prouver la possibilité de Dieu avant d’en prouver l’existence. La disjonction transcendantale nécessaire-contingent est donc une détermination ultérieure de la non-repugnanatia. C’est la non-répugnance sur laquelle se fonde donc toute la métaphysique abstractive, la scientia transcendens de Duns Scot, et sur c’est la volonté contingente de Dieu que se fonde la contingence des êtres. Mais cette volonté est, du point de vue bergsonien, limitée par la non-répugnance d’un part, mais aussi par l’existence intelligible des possibles d’autre part, entre lesquels Dieu ne peut que choisir. IX Conclusion Bergson, le philosophe de l’évolution créatrice, ne peut être satisfait de la manière dont Duns Scot forge le concept de création. Du point de vue systématique, Duns Scot fait donc partie de la métaphysique classique critiquée par 35
Honnefelder, Duns Scotus, 85.
Duns Scot et la métaphysique du possible chez Bergson
219
Bergson. Pour Bergson, penseur radicalement physique et psychologique et non logique, le possible logique ne joue aucun rôle dans la constitution de la réalité ; l’arrière-fond de la création n’est pas constitué, pour lui, des possibles hors de la réalité mouvante, mais des tendances en son sein ; compossibilité et mondes possibles sont des inventions de l’intelligence humaine qui servent à l’orientation dans la réalité, mais qui n’expliquent pas sa structure ou son devenir. Dans la perspective bergsonienne, Duns Scot ne peut pas penser la créativité parce qu’il est toujours limité par des conceptions logico-métaphysiques telles que le “ possible ”. Bergson se réfère donc d’une part à un Duns Scot volontariste, mais, d’autre part, se sépare d’une pensée qui met Dieu devant un choix des possibles déterminés, produits à leur tour sous le règne de la non-contradiction.
220
Matthias Vollet
Bibliographie Littérature primaire Henri Bergson, Mélanges, Paris : PUF, 1972. Henri Bergson, Correspondances, Paris : PUF, 2002. Henri Bergson, Leçons clermontoises I, ed. Renzo Ragghianti, Paris : LHarmattan, 2003. Henri Bergson, Leçons clermontoises II, ed. Renzo Ragghianti, Paris : LHarmattan, 2006. Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris : PUF, 2007. Henri Bergson, L’évolution créatrice, Paris : PUF, 2007. Henri Bergson, La pensée et le mouvant. Essais et conférences, Paris : PUF, 2009. Henri Bergson, “Introduction à la métaphysique”. In La pensée et le mouvant, 177-227. Paris : PUF, 2009. Henri Bergson, “Le possible et le réel”. In La pensée et le mouvant, 99-116. Paris : PUF, 2009. Henri Bergson, “L’intuition philosophique”. In La pensée et le mouvant, 117-142. Paris : PUF, 2009. Ioannes Duns Scotus, Quodl., ed. Viv., ed.Wad.
Littérature secondaire Bardy, Jean, Bergson professeur. Paris : LHarmattan 1998. Cervellon, Christophe, “Duns Scot”. In Le néant. Contribution à l’histoire du non-être dans la philosophie occidentale, ed. Jérôme Laurent et Claude Romano, 305-320. Paris 2006. Gouhier, Henri, Bergson dans l’histoire de la pensée occidentale. Paris : Vrin, 1989. Honnefelder, Ludger, Johannes Duns Scotus. München : Beck, 2005. Vollet, Matthias, “Bergson historien de la philosophie.” In L’évolution créatrice de Bergson, ed Arnaud François, 321-337. Paris : PUF, 2010. Vollet, Matthias, Die Wurzel unserer Wirklichkeit. Problem und Begriff des Möglichen bei Henri Berg son. Freiburg, München : Alber, 2007. Vollet, Matthias, “Cours de Bergson sur le De rerum originatione radicali de Leibniz.” In Annales bergsoniennes III. Bergson et la science, ed. Frédéric Worms, 25–52. Paris : PUF, 2007.
221 Archa Verbi. Subsidia 6
221–232
Duns Scot et la phénoménologie Martina Roesner
Introduction Présent implicitement sous forme d’allusions et de motifs généraux plutôt que de citations directes, traité explicitement à travers l’exégèse d’une œuvre qui lui fut attribuée à tort, Duns Scot entretient avec la tradition phénoménologique du XXe siècle une relation dont on pourrait d’emblée se demander si elle possède un quelconque « être réel » en dehors du regard intentionnel de celui qui envisage ces deux approches philosophiques du point de vue de l’histoire des idées. La façon peu précise dont Brentano et Husserl emploient comme en passant des concepts et des figures de pensée scotistes sans les nommer comme tels, l’insouciance allègre avec laquelle le jeune Heidegger reformule les notions-clés d’un traité pseudo scotiste dans la terminologie du Husserl des Recherches logiques et des Ideen I en disent, semble-t-il, plus long sur la phénoménologie elle-même qu’elles ne justifient l’idée d’un impact direct et palpable de l’œuvre de Duns Scot sur ce courant de pensée né il y a un peu plus d’un siècle. À y regarder de plus près, cependant, on s’aperçoit qu’à l’intérieur même du courant phénoménologique, cette curieuse présence-absence de la pensée scotiste subit des changements tout à fait significatifs. Après avoir exercé une influence la plupart du temps anonyme sur la pensée de Brentano et de Husserl, elle devient l’objet d’une thématisation explicite mais délibérément « actualisée » chez le jeune Heidegger avant de passer à nouveau à l’arrièreplan pour former la toile de fond omniprésente mais non-thématique de la relecture, par le Heidegger plus tardif, de toute l’histoire de la philosophie occidentale. Ce sont ces trois étapes de présence anonyme, de présence explicite et de présence cachée de Duns Scot dans le courant phénoménologique que nous nous proposons de parcourir ici afin d’en dégager la logique interne et les enjeux philosophiques. 1. La question de l’ « inexistence intentionnelle » et la théorie de l’ « objet en général » chez Brentano et Husserl Le premier point de contact entre Duns Scot et la phénoménologie naissante s’établit assez naturellement, dans le domaine de la théorie de la connaissance, à propos du phénomène de l’intentionnalité des actes psychiques. Dans sa Psychologie du point de vue empirique, Brentano se réclamait en effet « des scola-
222
Martina Roesner
stiques du Moyen Âge »1 pour appuyer sa propre conception de l’« inexistence intentionnelle d’un objet » comme trait distinctif des phénomènes psychiques par opposition aux phénomènes physiques. Par contre, la façon dont Brentano récapitule brièvement, dans une note en bas de page, les étapes principales de l’histoire de ce motif depuis Aristote jusqu’à Thomas d’Aquin montre bien qu’il n’est pas particulièrement attentif aux différences considérables qui séparent, au sein même de la scolastique médiévale, les positions des différents auteurs eu égard à cette problématique2. Peu de questions philosophiques ont en effet suscité des réponses aussi divergentes que celle qui porte sur l’existence ou non et le statut ontologique précis d’éventuelles entités intermédiaires qui viendraient s’interposer entre l’intellect connaissant et la réalité extra-mentale qu’il s’agit de connaître. Chez Brentano, tout se passe en effet comme si tous les philosophes scolastiques avaient, premièrement, postulé la nécessité d’une telle instance intermédiaire, appelée species ou autrement, et deuxièmement, conçu le rapport de l’intellect à cet objet intentionnel sur le mode d’une relation entre deux termes fixes et bien définissables, quel que soit par ailleurs leur statut ontologique et leur rapport de dépendance éventuel. Curieusement, Brentano semble ne pas s’être aperçu de la tension entre sa propre explication de l’« inexistence intentionnelle » et les approches noétiques des auteurs qu’il cite en appui de cette thèse. Ces auteurs – notamment Aristote et Thomas d’Aquin – soutiennent en effet un modèle de connaissance fondé sur l’idée d’assimilation dynamique, c’est-à-dire d’une union entre le connaissant et le connu dans l’acte de connaître, sans faire le détour par une troisième instance plus ou moins hypostasiée qui ne ferait que « représenter » une réalité extérieure par ailleurs inconnaissable3. Brentano en revanche parle, à propos de l’intentionnalité, d’« objets immanents » et les considère comme des entités « contenues » dans l’acte de connaître, sans mettre en relief qu’une telle conception traduit déjà certains choix noétiques et métaphysiques qu’on est tout aussi libre de ne pas partager. La notion même d’inexistence, quoique conçue en un sens intentionnel et non pas physique, renvoie d’elle-même au paradigme de la substance « contenant » des accidents qui jouiraient alors d’un mode d’être dépendant certes, mais tendanciellement hypostasié en vertu de leur « suppôt » ontologique. Si les contenus de connaissance sont alors non seulement « présents à » l’esprit lors de sa mise en contact effective avec la réalité connue, mais aussi « présents en » lui, telle une détermination accidentelle, sur le mode de l’inhérence statique, cela semble suggérer que ce sont ces « objets immanents », et non pas la réalité extra-mentale, qui constituent le terme objectif principal de notre faculté de connaissance. Le risque est alors grand d’interpréter la différence entre l’objet naturel et l’objet intentionnel non pas comme une simple diffé1 2 3
Cf. Brentano, Psychologie, 124. Cf. Brentano, Psychologie, 125 (note). Cf. Aristote, De anima III 4, 429a 13-24, 430a 3-5, ainsi que Thomas Aquinas, In Arist. De anima., lib. III, l. VII, n. 679-680, ed. Pirotta, 165.
Duns Scot et la phénoménologie
223
rence de modalité du même objet, mais comme deux objets distincts, ce qui entraînerait évidemment toutes sortes de difficultés concernant la possibilité même d’une connaissance « vraie » de la réalité extra-mentale. Duns Scot lui-même, il est vrai, n’est pas allé jusqu’à proclamer ce « dédoublement » radical de la réalité. Pour lui, la species n’est pas le représentant plus ou moins adéquat d’une réalité « derrière » les phénomènes, mais au contraire le moyen à travers lequel notre intellect peut accéder à une connaissance réelle des objets eux-mêmes. La nécessité d’une instance intermédiaire intentionnelle découle chez Duns Scot d’une considération théologique, dans la mesure où l’intellect humain pro statu isto, c’est-à-dire pendant la vie terrestre après la chute, n’est plus à même de saisir immédiatement l’essence des choses individuelles telles qu’elles sont4. À partir du moment cependant où ces présupposés théologiques sont oubliés – ce qui va de plus en plus être le cas entre le début de l’époque moderne et le XIXe siècle –, les objets intentionnels risquent de ne plus apparaître dans leur relativité, c’est-à-dire comme la consé quence d’un certain état de choses contingent, mais comme une sphère de la réalité sui generis existant en soi, dont on peut se demander si et dans quelle mesure elle « correspond » au monde « réel ». En concevant le phénomène de l’intentionnalité non pas comme une tension dynamique qui ouvre le sujet connaissant à autre chose que lui-même, mais comme une relation binaire entre un sujet et des objets immanents déjà constitués, Brentano suit donc plutôt la piste du scotisme tardif que celle de Duns Scot lui-même. Si, dans le domaine de la connaissance sensible, cette conception a l’inconvénient de suggérer l’existence d’une sphère ontologique « tierce » qui empêcherait l’accès direct du sujet connaissant au monde réel dans sa matérialité, elle a cependant le mérite, dans le domaine de la connaissance intellectuelle, de souligner la différence entre l’aspect génético-psychologique du processus de connaissance et ses enjeux proprement logico-noétiques. Plus on veut minimiser le risque d’une hypostase indue des contenus intentionnels, plus on est en effet tenté de lier leur statut à l’exercice effectif de nos facultés de connaissance, avec pour conséquence que la validité logique de ces contenus semble ne pas dépasser le niveau d’un jugement assertorique portant sur du « réel ». L’accent que Brentano met sur l’aspect de l’« immanence » des objets intentionnels lui permet en revanche d’analyser les structures de la connaissance indépendamment de considérations de type métaphysique concernant l’existence « réelle » des objets connus. Le domaine du pensable, c’est-à-dire de l’objectivable, n’est pas seulement bien plus large que celui des objets « existants », mais se présente d’emblée sous une autre perspective : celle de la signification qui englobe, entre autres, aussi les objets du monde réel – non pas en tant que réels, mais à titre de sous-ensemble du domaine du « quelque chose en général ». Si la question de l’« existence » est ainsi évincée du côté des objectualités intentionnelles, elle continue cependant de se poser au niveau de la subjectivité connaissante elle-même. Les 4
Cf. Ioannes Duns Scotus, Ord. I d. 3 p. 1 q. 3 n 185-187, ed. Vat. III, 112-113.
224
Martina Roesner
entités que la visée intentionnelle du sujet prend pour objets peuvent être aussi bien réelles que fictives, imaginaires ou contradictoires, mais qu’en est-il du sujet en tant que « support » de ces actes intentionnels comme de leurs objets ? Ne faut-il pas d’emblée distinguer plusieurs niveaux d’intentionnalité, selon qu’on considère la relation entre le sujet et ses objets d’un point de vue empirique ou d’un point de vue universel, voire transcendantal ? Il faut reconnaître que Brentano lui-même a été nettement moins sensible à cette différence entre l’intentionnel au sens empirico-psychologique et l’intentionnel au sens d’une psychologie transcendantale5 que Duns Scot luimême. Husserl, à son tour – dont la connaissance directe de la philosophie médiévale était singulièrement mince, pour ne pas dire nulle –, reprendra cette distinction entre les deux manières de considérer la vie de la conscience et en fera une pièce maîtresse de sa propre approche phénoménologique. Dès les Recherches logiques, en effet, celle-ci s’établit en tant que méthode visant à dégager les structures essentielles invariantes de la conscience et de ses possibles contenus intentionnels, abstraction faite des processus psychiques qui expliquent la genèse « réelle » de ces contenus chez un sujet empirique concret6. S’agissant de l’indépendance des contenus de conscience par rapport à toute « existence » d’un objet correspondant dans le monde réel, Husserl lui aussi évoque, dans les Idées I, le concept scolastique d’ « objet mental », « intentionnel » ou « immanent »7. Cependant, contrairement à Brentano, Husserl n’admet plus de synonymie entre la notion d’« inexistence » ou d’« immanence » d’un côté et la présence intentionnelle d’un contenu ou d’un objet de l’autre, dans la mesure où l’on risquerait ainsi de confondre les trois niveaux de la psychologie empirique, de la psychologie pure ou apriorique et de la phénoménologie transcendantale8. En concevant la présence intentionnelle d’un objet comme une immanence « réale », c’est-à-dire spatio-temporelle, dans un sujet concret, on retomberait dans une considération purement empirique qui ne porterait que sur la structure psycho-physique d’un sujet singulier. Mais même si l’on évitait une telle metabasis eis allo genos en limitant l’analyse à des considérations purement structurelles de la sphère psychique en général, la notion d’« immanence » resterait ambiguë et source de confusion. L’interprétation de la présence intentionnelle au sens d’une immanence « réelle » de l’objet dans la conscience effacerait en effet la différence principi5
6 7 8
« Ein Beispiel für die psychischen Phänomene bietet jede Vorstellung durch Empfindung oder Phantasie ; und ich verstehe hier unter Vorstellung nicht das, was vorgestellt wird, sondern den Akt des Vorstellens. […] ebenso aber auch das Denken eines allgemeinen Begriffes, wenn anders ein solches wirklich vorkommt » (Brentano, Psychologie, 111-112 ; nous soulignons). Contre une telle réduction de l’intentionnalité à la mise en œuvre effective d’une visée psychique singulière, indépendamment du caractère individuel ou universel de son objet, cf. Ioannes Duns Scotus, Ord. I d. 3 p. 1 q. 1 n. 350, 357-359, ed. Vat. III, 210-211, 215-218. Cf. Hua XVIII, 88-158, ainsi que Hua XIX/1, 372-376. Cf. Hua III/1, 207 (§ 90). Cf. Hua IX, 247-254.
Duns Scot et la phénoménologie
225
elle entre la sphère du noétique proprement dit, c’est-à-dire tout ce qui relève de la conscience en tant qu’acte, et ses contenus noématiques qui lui sont donnés sous forme d’une transcendance « immanente »9. Les contenus et les objets de conscience ne sont donc précisément pas « réellement » immanents à la conscience en tant que conscience ; ils se constituent à l’intérieur du flux de la conscience comme des entités dont le sens est radicalement « autre » que celui de toute subjectivité constituante. Pour Husserl, le problème du statut des objets intentionnels ne se pose donc pas exactement dans les mêmes termes ni avec les mêmes implications que pour Duns Scot ou pour Brentano. La raison en est que du point de vue de la phénoménologie transcendantale, le monde dans son ensemble, c’est-à-dire l’horizon ultime de toute objectivité transcendante, doit encore être soumis à l’épochè, c’est-à-dire à la mise entre parenthèses de tout jugement portant sur son existence « réelle ». La question n’est donc pas de savoir si aux contenus intentionnels donnés à notre conscience correspondent ou non des « choses extra-mentales » ou si nous sommes « enfermés » dans la sphère d’une immanence sans portes ni fenêtres donnant sur le monde des objets « réels » – une telle assomption aboutirait effectivement à un dédoublement absurde de la réalité. Toute thèse ou assomption impliquant une quelconque « existence réelle » des objets connus ou du sujet connaissant doit être suspendue au profit d’une approche qui conçoit les différents modes d’être – réel, idéal, fictif, contradictoire, etc. – non pas comme des « sphères » subsistant en soi mais comme synonymes des différents types de constitution possibles qui font surgir n’importe quelle objectualité intentionnelle à l’intérieur de la sphère de la conscience – conscience par rapport à laquelle il n’y a, par principe, plus de « dehors » possible. Selon le modèle husserlien, il n’y a donc pas une seule notion d’intentionnalité, mais deux : l’une considère, sous l’angle d’une réduction purement eidétique, la structure corrélationnelle de l’unité noéticonoématique, l’autre dégage, à travers l’épochè transcendantale, la dépendance radicale de tout horizon d’objectualité vis-à-vis de la conscience constituante dont la structure ultime n’est plus spatiale ni quasi spatiale, comme les notions d’ « immanence » et de « transcendance » semblent encore le suggérer, mais temporelle. C’est ce lien primordial entre la subjectivité et la temporalité qui permet à Husserl de tordre le cou à toute interprétation des phénomènes comme simples « représentants », voire de « simples apparences » (bloßer Schein) renvoyant à un monde transcendant, c’est-à-dire extra-mental. Dans la mesure où tous les phénomènes se constituent, d’un point de vue génétique, de façon successive sous des aspects intentionnels toujours changeants, la notion même de « réalité », conçue au sens de l’existence effective, n’est qu’un concept limite désignant un certain type de phénomènes dont le statut ne pourra jamais être détaché de la temporalisation originaire de la subjectivité en tant que source de toute constitution. Mais la même chose vaut aussi pour des idéalités ou des « essences » : étant donné qu’elles font encore partie de l’horizon 9
Cf. Hua III/1, 207.
226
Martina Roesner
« mondain » au sens large10, l’épochè les fait apparaître dans leur relativité et leur dépendance foncière, non pas de tel ou tel sujet concret, mais de la subjectivité transcendantale comme telle. Si la théorie husserlienne de l’intentionnalité va, de ce point de vue, évidemment plus loin que celle de Duns Scot, le père fondateur de la phénoménologie s’approprie en revanche pleinement une autre notion aux accents ouvertement scotistes, à savoir celle de l’« ontologie formelle » comme théorie apriorique des objets possibles en général. À côté des mathématiques, qui envisagent les formes et les systèmes de signification d’un point de vue purement syntaxique, Husserl développe, dans Logique formelle et logique transcendantale, le concept d’une logique ontologico-formelle qui considère les unités de signification non pas en elles-mêmes, mais comme possibles formes catégoriales portant sur des objectualités ou des substrats au sens large. Dans le cadre d’une telle logique ontologique, le niveau des jugements et des formes pures de signification ne sera plus l’objet primaire de la connaissance, mais seulement le moyen, alors que l’intérêt principal se concentrera sur les objectualités possibles de ces formes catégoriales11. En soulignant que la visée primaire de la logique ne porte par sur ses propres formes catégoriales, mais à travers celle-ci, sur des objets au moins possibles, Husserl se montre donc très proche de la conception de Duns Scot lui-même, à ceci près que chez lui, le domaine d’objet de cette ontologie formelle reste le corrélat aussi général qu’indéterminé de la subjectivité transcendantale, sans donner lieu à des subdivisions du type « être fini / être infini » : seule réalité « absolue », la conscience transcendantale husserlienne exclut en effet d’emblée la possibilité que le concept transcendantal d’« objet en général » puisse renfermer des dichotomies ontologiques plus radicales que celle qui s’ouvre entre le sens d’être de la conscience et toute autre forme de réalité. 2. Théorie de la signification, individualité ultime et univocité de l’être chez Heidegger entre la thèse d’habilitation et Être et temps La thèse d’habilitation de Heidegger sur Duns Scot constitue une œuvre charnière dans la reprise de la pensée scotiste à l’intérieur du courant phénoménologique. D’un côté, la relecture par Heidegger du traité pseudo scotiste De modis significandi s’inscrit encore dans le sillage husserlien de l’analyse de l’intentionnalité, de la théorie de l’« objet en général » et de la grammaire pure ; de l’autre côté, Heidegger y développe d’autres motifs phares de la pensée de Duns Scot, dont Husserl n’avait pas tenu compte mais qui vont s’avérer décisifs pour sa propre approche philosophique jusqu’à Être et temps et au-delà, à savoir les implications métaphysiques du caractère supra-transcendantal de l’être univoque, la mise au centre de la concrétude ultime non ontologique10 11
Cf. Hua XVII, 257-278. Cf. Hua XVII, 149-153.
Duns Scot et la phénoménologie
227
ment dérivable de l’individu et la dimension essentiellement historique de la Révélation chrétienne. Le jeune Heidegger partage avec Husserl une orientation fortement antipsychologiste en matière de logique et de théorie de la connaissance. À ce propos, il ne manque pas de souligner que la psychologie scolastique, contrairement à celle des XIXe et XXe siècles, distingue clairement entre l’aspect « génétique » de la vie psychique et le sens noématique des entités intentionnelles qui se constituent à l’intérieur de cette sphère comme des idéalités supra-empiriques12. Aux yeux de Heidegger, la sphère de la validité logique doit son indépendance vis-à-vis du monde « réel » à l’homogénéité de la sphère intentionnelle, qui découle de l’univocité du concept d’être (ens) comme synonyme du « quelque chose en général »13. Cependant, à la différence de Husserl, Heidegger ne se contente pas d’interpréter ce concept dans sa plus grande neutralité formelle, mais investit cette « objectualité » universelle, subrepticement, d’une dimension qualitative émanant de la visée du sujet connaissant. « Tout ce qui se tient ‘en face’ du Moi sous forme de vécu, est saisi d’une certaine manière »14, note Heidegger, avant d’ajouter que l’« en face » lui-même (donc l’équivalent de l’objectualité noématique husserlienne) est toujours déjà teinté d’une certaine perspective significative, une Bewandtnis, qui arrache l’objet à l’anonymat de la sphère du pur pensable. Déjà à cette époque, Heidegger commence donc à entrevoir l’insuffisance de l’approche husserlienne des Recherches logiques et des Ideen I, qui passe complètement sous silence que la visée théorique et l’idéation n’épuisent pas tout le domaine de l’intentionnalité mais sont déjà en elles-mêmes le résultat d’une certaine auto-interprétation, par le sujet, de son propre mode d’être et de son rapport au monde. Mais cette critique de l’approche husserlienne l’amène à interpréter la pensée de Duns Scot d’une façon pour le moins inhabituelle : suivant l’approche de Heidegger, il n’y aurait plus de distinction entre la visée intentionnelle qui porte sur l’objectualité formelle du concept d’être en général et la visée intentionnelle des actes de connaissance et des actes significatifs proprement dits qui portent sur tel ou tel étant. Cette réinterprétation de la doctrine de l’« objet en général » entraîne également un infléchissement significatif de l’être univoque comme concept précédant encore la distinction fondamentale entre l’être infini de Dieu et l’être fini qui englobe toute la sphère du créé. Heidegger remplace en effet cette indifférence de l’objectualité formelle par une significativité transcendantale de tout objet que le sujet puisse jamais rencontrer dans son contexte mondain. Il est alors évident que Dieu ne pourra plus tomber sous un tel concept d’« objet », cantonné désormais du côté de la finitude du sujet existant. L’ontologie fondamentale que Heidegger est en train de développer se présente ainsi comme une double radicalisation de l’approche scotiste : d’un 12 13 14
Cf. GA 1, 277. Cf. GA 1, 215-217, 283. GA 1, 223 (c’est Heidegger qui souligne).
228
Martina Roesner
côté, l’investissement de tout objet d’une dimension « herméneutique » qui découle de la situation mondaine du sujet ne fait qu’accentuer la nécessité d’un retour philosophique sur cette source de significativité qu’est l’existence d’un individu « à chaque fois » singulier. De l’autre côté, la non-applicabilité du concept d’objet « mondanéisé » à l’être infini divin fait définitivement sortir Dieu du domaine de compétence de la philosophie. Si la religion, en tant qu’expression vécue d’une relation existentielle à Dieu, peut bien faire l’objet d’une analyse philosophique ou phénoménologique, elle le sera uniquement à partir de sa dimension historique et scripturaire. Non content d’opérer une distinction claire et nette – pour ne pas dire radicale – entre le Dieu révélé de la foi et le concept formalisé de Dieu des philosophes, Heidegger élimine du discours philosophique jusqu’à la notion même d’« être infini » pour réinterpréter à la fois l’existence humaine « mondaine » et tout le domaine de la religion sur fond de finitude radicale et indépassable15. C’est ainsi que Heidegger, à propos de la « généralité » tout-englobante de l’être, peut continuer d’employer le terme scotiste de « transcendance » tout en supprimant la branche « théologique » de la première subdivision entre l’être infini et l’être fini, que ce concept est censé « transcender ». Dans Être et temps, cette notion modifiée de « transcendance » sert de charnière entre le projet de la destruction de l’histoire de l’ontologie traditionnelle et l’ontologie fondamentale en tant qu’analyse des structures ultimes de l’existence du Dasein. Dès les premières pages du premier paragraphe de cet ouvrage, Heidegger évoque expressément le motif scolastique de la « généralité ultime » de l’être par rapport à toutes les déterminations catégoriales, et vers la fin du septième paragraphe, il définit expressément l’être comme « le transcendens par excellence »16. Comme il appert d’une note ajoutée en marge de son exemplaire personnel d’Être et temps, Heidegger donne cependant à ce terme latin d’emblée un tout autre sens que celui qu’il avait dans le contexte de la philosophie médiévale. Cette note plus tardive glose le passage en question de la manière suivante : « transcendens évidemment pas – malgré toute assonance métaphysique – de façon scolastique et gréco-platonique koinon, mais transcendance comme l’ekstatique – temporalité [Zeitlichkeit] – temporellité [Temporalität] ; mais ‘horizon’! L’être [ou « estre » : Seyn] ‘forme le toit’ [überdacht] de l’étant [ou « estant » : Seyendes] »17. D’une part, Heidegger entend donc garder la « généralité suprême » de l’être à titre d’« horizon » ultime de toute compréhension des étants, d’autre part, cette universalité n’est plus de nature conceptuelle, mais prend la forme d’une structure existentiale : celle de la trans-cendance (Überstieg) du Dasein vers un monde de phénomènes qui lui apparaissent dans un cadre de compréhension essentiellement temporel et fini18. L’être ainsi conçu ne garde de son universalité transcendantale que la 15 16 17 18
Cf. Camillieri, Phénoménologie de la religion, 42-44, 213, 316-317. « Sein ist das transcendens schlechthin » (SZ, 38). Cf. GA 2, 51 (note a). Cf. GA 9, 166-168.
Duns Scot et la phénoménologie
229
qualité de condition ultime indépassable de toute compréhension. L’apparente illimitation d’un tel concept d’être comme horizon extérieur de la compréhension de tout étant reste cependant inscrite dans l’horizon intérieur de la structure ontologique du Dasein, dont la finitude et la temporalité essentielles forment la toile de fond de toute relation de compréhension, conceptuelle ou non, entre le sujet et la sphère de l’étant. Ainsi, l’univocité de l’être scotiste se trouve réinterprétée, chez Heidegger, comme univocité de la sphère de l’étant capable d’une compréhension implicite ou explicite de l’être : ni Dieu ni aucun animal, mais le Dasein seul est à même de comprendre les étants dans leur être19, même si la forme concrète de cette compréhension se réalise dans le cadre non – universalisable d’une existence « à chaque fois unique ». 3. La conception scotiste de l’univocité de l’être comme clé de lecture de l’histoire de la philosophie occidentale Le début des années 1930 marque à bien des égards une césure dans le développement philosophique de Heidegger, qui se traduit également par un changement perceptible de la façon dont la présence de la philosophie de Duns Scot s’exprime dans sa pensée. Avec la prise de distance à l’égard de la phénoménologie husserlienne, l’approche scotiste de la problématique de l’intentionnalité, de l’objectualité et de la grammaire spéculative perd, aux yeux de Heidegger, quelque peu de son intérêt et cède la place à une mise au centre de la notion de l’univocité de l’être dans la perspective d’une relecture philosophique de toute l’histoire de la philosophie occidentale. Déjà dans la perspective d’Être et temps, il est vrai, la « destruction » de l’ontologie traditionnelle était implicitement placée sous le signe d’une conception de l’être qui était beaucoup plus proche de Duns Scot que les nombreuses références à Platon, Aristote, Thomas d’Aquin et d’autres ne semblaient le suggérer. C’est donc déjà à travers des lunettes « scotiennes » ou « scotianisantes », si j’ose dire, que Heidegger lit les différentes réponses des autres philosophes à la question de l’être, comme si l’idée du caractère « transcendant » et supra-catégorial, non pas de l’être, mais du concept d’être avait été partagée, sous cette forme précise, plus ou moins par tous les philosophes anciens et médiévaux20. À l’époque d’Être et temps, cependant, cette évocation des différentes étapes principales de l’histoire de la philosophie restait encore subordonnée à un traitement systématique de la question du sens de l’être dans le cadre de l’ontologie fondamentale. Dans ce contexte, la « transcendance » de l’être n’était autre que celle qui découlait du caractère « existential » et par là même supra-catégorial du Dasein, caractère qui est aussi à l’origine de son ouverture primordiale et constitutive à un monde d’objets qui lui apparaissent d’abord dans la visée d’une intentionnalité pratique. À partir du moment, cependant, où le Dasein concret cesse d’être le point de départ privilégié des 19 20
Cf. GA 3, 216, 228-229, 246. Cf. SZ, 3-4.
230
Martina Roesner
analyses de Heidegger, la question de la phénoménalité du monde s’estompe au profit de la question portant sur la phénoménalité de l’être dans son histoire, qui est en même temps l’histoire de la philosophie. Les différentes approches philosophiques depuis les Grecs jusqu’à Nietzsche ne sont alors, pour Heidegger, qu’autant de variantes d’un même geste inaugural visant à réduire toute manifestation de l’être à sa qualité d’« objet » pour la pensée21. Ce qui caractérise, pour Heidegger, la compréhension de l’être dans toute l’histoire de la métaphysique résulte en réalité de la projection rétrospective généralisée de l’approche scotiste sur toutes les époques de la philosophie. Pour Heidegger, le concept d’être qui sous-tend l’interrogation philosophique de toute pensée métaphysique souffre, à proprement parler, d’une double insuffisance : d’un côté, il se distingue par son exténuation ontologique extrême (« le concept le plus général et le plus vide », interprété comme « l’étantité de l’étant » : die Seiendheit des Seienden)22, de l’autre, ce « presque rien » du pensable s’arrête précisément devant ce qui est pour Heidegger la source de toute phénoménalité mondaine comme de toute philosophie, à savoir le néant dans son appartenance originaire à l’être, là même où celui-ci se manifeste et s’offre à la pensée23. L’interprétation de l’être comme concept formel de pensabilité d’un côté et la réduction parallèle du néant au non-pensable, c’est-à-dire au logiquement contradictoire de l’autre, aplatissent ainsi les deux dimensions qui ouvrent pour Heidegger aussi bien l’accès du Dasein au monde phénoménal que l’articulation philosophique de cette phénoménalité en tant que telle. Si Heidegger joue ainsi son interprétation de l’histoire de la philosophie dans son intégralité sur la corde scotiste du concept univoque de l‘être, la mise au centre de cette perspective totalisante finit par oblitérer cet autre aspect de la philosophie de Duns Scot que Heidegger avait si soigneusement souligné dans ses travaux jusqu’à Être et temps inclus, à savoir l’individualité « à chaque fois unique » et indérivable du Dasein dans sa contingence essentielle. Ce glissement thématique se manifeste notamment à travers la façon dont Heidegger emploie désormais le terme de « transcendance ». Alors qu’à l’époque d’Être et temps, il était interprété, sur fond scotiste, comme synonyme de l’ouverture ontologique précatégoriale du Dasein à la phénoménalité du monde, il redevient, dans le contexte de la réinterprétation « destructrice » par Heidegger de toute l’histoire de la philosophie occidentale, synonyme du geste « méta-physique » par excellence qui subdivise la réalité en un « en deçà » et un « au-delà ». Il ne s’agit donc précisément plus d’une « transcendance » supra-catégoriale située en amont de toute subdivision entre différents modes d’êtres ou sphères ontologiques, mais de l’identification de la « transcendance » à une sphère bien définie de la réalité, celle du monde « séparé » supra-empirique au sens aristotélicien24. Ainsi, la réduction par la métaphysique occidentale de l’être 21 22 23 24
Cf. EiM, 137-149 et GA 65, 215. Cf. GA 65, 171-175. Cf. EiM, 15-25. Cf. GA 65, 322.
Duns Scot et la phénoménologie
231
à un concept ontologiquement vidé et formalisé au maximum perd, dans l’interprétation heideggérienne, tout lien intrinsèque avec la compréhension de l’être par le Dasein concret et se présente désormais comme le résultat d’une « histoire de l’être » dont le déroulement relève cependant davantage du « destin » que de la contingence historique proprement dite. Les différents représentants de l’histoire de la philosophie depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque contemporaine ne sont plus lus comme des contributions à chaque fois uniques à la question de l’être, mais se trouvent réduits à des instances numériquement distinctes d’un seul et même concept de métaphysique, pris à son tour en un sens univoque. De la dualité des motifs fondamentaux qui distinguent la pensée de Duns Scot, à savoir, d’une part, l’autarcie et l’homogénéité intentionnelle de la sphère de la logique et d’autre part, une approche métaphysique soucieuse de l’unicité de l’individualité concrète – dualité si fructueuse aux yeux du jeune Heidegger –, il ne reste plus, à première vue, que l’univocité statique du concept d’être, pris comme synonyme de la prétention tacite de toute métaphysique à réduire l’être à son objectualité. Dans un cours donné en 1935 / 1936 et intitulé Qu’est-ce qu’une chose? (Die Frage nach dem Ding), Heidegger développe avec force l’idée que les conséquences de ce geste réducteur ont commencé à se manifester à l’aube de l’époque moderne, notamment à partir de Suárez, de Galilée et de Descartes. La mathématisation de tout phénomène dans le domaine des sciences de la nature, tout comme l’approche aplatissante, dans le cadre de la Schulmetaphysik, de l’ontologie comme théorie des concepts qui régissent la choséité des choses en général expriment, chacune à sa manière, l’homogénéisation de la réalité au détriment de la singularité des choses dans leur contingence préthéorique. Et c’est à ce propos que Heidegger emploie une notion qui fait écho à l’existence « à chaque fois mienne » dans Être et temps, à savoir la Jediesheit (l’« être à chaque fois ceci »), ce qui n’est rien d’autre que le décalque allemand de l’haecceitas scotiste25. Il reste cependant une différence de taille : alors que dans Être et temps, cette notion d’unicité ne s’appliquait qu’au Dasein, à l’époque de la critique par Heidegger de l’histoire de la métaphysique occidentale, elle est réservée aux choses que la raison philosophique, guidée par l’idée de l’univocité de l’être et la transcendantalisation de la pensée, a dépouillées de leur caractère propre non-conceptualisable. C’est donc encore au nom d’un concept-clé scotiste que Heidegger entend s’opposer à un développement philosophique qui tire son origine du concept d’être du même Duns Scot, comme si celui-ci incarnait à lui seul toute la « dérive » de la métaphysique occidentale, au même titre que son possible correctif. Véritable abrégé de toute l’histoire de la philosophie, le Docteur subtil disparaît ainsi en tant qu’individu intentionnellement envisagé pour devenir le medium quo invisible de l’interrogation de la métaphysique sur sa propre essence.
25
Cf. FD, 12.
232
Martina Roesner
Bibliographie Littérature primaire Aristote, De l’âme [De anima], ed. A. Jannone, trad., E. Barbotin, Paris : Les Belles Lettres, 1989. Brentano, Franz, Psychologie vom empirischen Standpunkt (1ère ed. 1874). Leipzig : Meiner, 1924. Heidegger, Martin, Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendentalen Grundsätzen (FD). Tübingen : Niemeyer, 1962. Heidegger, Martin, Frühe Schriften (GA 1). Frankfurt am Main : Klostermann, 1978. Heidegger, Martin, Kant und das Problem der Metaphysik (GA 3). Frankfurt am Main : Klostermann, 1991. Heidegger, Martin, Sein und Zeit (SZ). Tübingen : Niemeyer, 171993. Heidegger, Martin, Sein und Zeit (GA 2). Frankfurt am Main : Klostermann, 1977. Heidegger, Martin, Wegmarken (GA 9). Frankfurt am Main : Klostermann, 32004. Heidegger, Martin, Einführung in die Metaphysik (EiM). Tübingen : Niemeyer, 51987. Heidegger, Martin, Beiträge zur Philosophie [Vom Ereignis] (GA 65). Frankfurt am Main : Klostermann, 21994. Husserl, Edmund, Formale und transzendentale Logik. Husserliana XVII. Den Haag : Nijhoff, 1974. Husserl, Edmund, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. Husserliana III/1. Den Haag : Nijhoff, 1976. Husserl, Edmund, Logische Untersuchungen, Bd. 1 : Prolegomena zur reinen Logik. Husserliana XVIII. Den Haag : Nijhoff, 1975. Husserl, Edmund, Logische Untersuchungen, Bd. II/1. Husserliana XIX/1. Den Haag : Nijhoff, 1984. Husserl, Edmund, Phänomenologische Psychologie. Husserliana IX. Dordrecht : Nijhoff, 1968. Ioannes Duns Scotus, Ord., ed. Vat. Thomas Aquinas, In Aristotelis librum De anima commentarium, ed. A. M. Pirotta (Opera omnia 6). Torino : Marietti, 1959.
Littérature secondaire Camillieri, Sylvain, Phénoménologie de la religion et herméneutique théologique dans la pensée du jeune Heidegger. Commentaire analytique des “Fondements philosophiques de la mystique médiévale (1916-1919).” Phaenomenologica 184. Dordrecht : Springer, 2008. Perler, Dominik, Theories de l’intentionnalité au Moyen Âge. Paris : Vrin, 2003.
233 Archa Verbi. Subsidia 6
233–250
Die Scotusforschung in den Niederlanden des 20. Jahrhunderts Andreas J. Beck 1. Einleitung Das Ziel dieses Beitrags ist ein bescheidenes: Aus Anlass des Duns Scotus-Jubiläums, welches auch das Erbe und die vielfältige Nachwirkung des doctor subtilis im Blickfeld hat, soll erstmals ein Überblick über die niederländische Scotusforschung seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts geboten werden. Die hier erwähnten Forschungsbeiträge finden in den letzten Jahren zunehmend Beachtung vor dem internationalen Forum der Scotusforschung.1 Bis Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts jedoch blieb, teilweise bedingt durch die Sprachbarriere, die internationale Ausstrahlung der niederländischen Scotusforschung eher marginal.2 In methodologischer Hinsicht erscheinen mir mindestens drei präliminare Bemerkungen erforderlich. Erstens ist, da wir uns dem 20. Jahrhundert zuwenden, unter den Niederlanden im Folgenden primär das geographische Gebiet des Königreichs der Niederlanden zu verstehen, dessen Grenzen in Europa seit 1830 stabil sind, nachdem sich die südlichen Niederlande endgültig abgetrennt hatten und das Königreich Belgien bildeten. Wir sollten jedoch die südlichen historischen Regionen der Low Countries nicht aus dem Auge verlieren. Das gilt insbesondere für Leuven (Löwen), wo 1425 die mit Abstand älteste Universität der historischen Niederlande gegründet wurde; die älteste holländische Universität in Leiden hingegen ist eine protestantische Gründung und 150 Jahre jünger. Zweitens kommt für diesen Beitrag als Scotusforscher/-in in den Niederlanden in Betracht, wer mindestens für einige Jahre seinen oder ihren primären Wirkungskreis in den Niederlanden – unter Einbeziehung der Stadt Leuven – hat bzw. hatte und einen Beitrag zur Scotusforschung geleistet hat. Freilich ist diese Eingrenzung etwas künstlich und daher rein heuristisch zu verstehen. Noch eine dritte Vorbemerkung. Es ist für den Historiker nicht unproblematisch, einen so nahen Zeitraum, der bis in die Gegenwart hineinreicht, zu beschreiben. Dazu kommt, dass der Verfasser dieses Beitrags seit beinahe zwanzig Jahren hauptsächlich im Gebiet der historischen Niederlande lebt und sich mit Scotus beschäftigt, weshalb er in gewisser Weise beteiligter Beob1 2
Siehe etwa William A. Franks Vorwort zur zweiten Auflage von Frank, Duns Scotus on the Will and Morality, ix-xii. Dies änderte sich erst nach 1994 mit dem Erscheinen von Scotus, Contingency and Freedom. Vgl. für einen Überblick über die wichtigsten Forschungszentren der Gegenwart zu Duns Scotus Beck and Veldhuis, “Inleiding”, 1-19.
234
Andreas J. Beck
achter ist. Es kann daher nicht Ziel dieses Aufsatzes sein, einen rein objektiven historiografischen Beitrag zu leisten. Vielmehr sollen aus der Perspektive eines participating observer einige Einblicke mit informativem Gehalt in den niederländischen Beitrag zur Scotusforschung seit Beginn des 20. Jahrhunderts geboten werden.3 Zunächst soll in Kürze die Situation vor dem zweiten Weltkrieg skizziert (§ 2) und sodann der Beitrag Adelhard Eppings und seiner Mitbrüder des Franziskanerklosters Alvera gewürdigt werden (§ 3). Die neuere Scotusforschung in den Niederlanden verdankt sich wesentlichen Impulsen Lambertus M. de Rijks (§ 4) und wird insbesondere von Antonie Vos (§ 5) und der von ihm gegründeten Research Group John Duns Scotus vorangetrieben (§ 6). Wichtig sind auch die Beiträge der Dutch Society for Medieval Philosophy Medium Aevum (§ 7), die vor dem zusammenfassenden Schlußabschnitt (§ 8) zur Sprache kommen sollen. 2. Vor dem Zweiten Weltkrieg Insbesondere für die Scotusforschung vor dem Zweiten Weltkrieg müssen wir unseren Blick nach Leuven wenden. 1900 erschien dort Maurice De Wulfs (1867 – 1947) große Histoire de la philosophie médiévale, die, in vielen Auflagen erweitert und in mehrere Sprachen übersetzt, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Standardwerk zur Geschichte der mittelalterlichen Philosophie war. De Wulf, der von 1893 – 1939 in Leuven und von 1920 – 1927 in Harvard lehrte, passte die Abschnitte zu Duns Scotus in den Neuauflagen seines Hauptwerks zumeist rasch an den jeweiligen Stand der Forschung an. Scotus blieb für ihn jedoch in erster Linie ein Theologe; dessen Beiträge zur Philosophie unterschätzte De Wulf nach heutiger Sicht.4 Übrigens benannten Fernand van Steenberghen und Gerard Verbeke das von ihnen 1956 gegründete Forschungszentrum für antike und mittelalterliche Philosophie in Leuven nach Maurice de Wulf und dem Aristotelesforscher Augustin Mansion (1882–1966). Seit der Spaltung der Universität 1968 gibt es nun kurioserweise sowohl im flämischen Leuven als auch im wallonischen Louvain-la-Neuve ein „De WulfMansion Zentrum“.5
3
4 5
Der Forschungsschwerpunkt des Autors liegt übrigens nicht bei der jüngeren Geschichte, sondern bei der frühneuzeitlichen protestantischen Scholastik und deren Scotusrezeption; vgl. etwa Beck, Gisbertus Voetius. Leider konnte aus planungstechnischen Gründen ein entsprechender Beitrag nicht mehr ins Tagungsprogramm eingebaut werden. Siehe über De Wulf: Van Steenberghen, “Maurice De Wulf”, 267-313; Wielockx, “De Mercier à De Wulf”, 89-95; Vos, Philosophy, 550-553. Siehe für das “De Wulf–Mansion Centre for Ancient, Medieval and Renaissance Philosophy” in Leuven: http://www.hiw.kuleuven.ac.be/dwmc/index.htm, und für das “Centre De Wulf-Mansion: Recherches en philosophie ancienne et médiévale” in Louvain-La-Neuve: http://www.sofi.ucl.ac.be/dewu/dewu.html.
Die Scotusforschung in den Niederlanden des 20. Jahrhunderts
235
Das Jahr 1923 ist für die Scotusforschung insgesamt wichtig und in besonderer Weise mit Leuven verbunden. Damals erschien Auguste Pelzers (1876–1958) wichtiger Aufsatz „A propos de Jean Duns Scot et des études scotistes“, worin er den Worcester- und Utrecht-codices der Reportatio Parisiensis besondere Aufmerksamkeit widmete. Im selben Jahr verfasste er einen weiteren Aufsatz zum ersten Buch der Reportata Parisiensia, worin er den Wadding-Text stark kritisiert.6 Dieser Beitrag wirkte wie ein Katalysator für die textkritische Forschung. Zwar arbeitete der Belgier Pelzer damals nicht mehr in Leuven, sondern als Bibliothekar im Vatikan, doch blieben die Verbindungslinien nach Leuven intakt, so dass De Wulf sofort Pelzers Erkenntnisse verarbeiten konnte.7 Im selben Jahr, 1923, kam der junge Kroate Karlo Balíc nach Leuven, wo er seine Studien fortsetzte und 1927 mit einer Arbeit über die marianische Theologie der Franziskanerschulen des 13. und 14. Jahrhunderts promoviert wurde.8 Wichtiger ist freilich Balícs bedeutende Untersuchung zu den Sentenzenkommentaren des Scotus, die 1927 anonym erscheinen musste und in Leuven entstanden ist.9 3. Adelhard Epping (1909–1975) und das Franziskanerkloster Alvera Die Universität Leuven war auch das geistige Zentrum, wo 1939 der niederländische Franziskaner Adelhard Epping (1907 – 1987) seine Dissertation zu Scotus̓ Gottesbeweis verteidigt.10 Im Vorwort beklagt er die bisher armselige Literatur zu diesem Thema, diskutiert jedoch auch „schwerwiegende Bedenken“ im Hinblick auf eine gründliche Arbeit hierzu: Die historisch-kritischen Studien der letzten Jahre hätten überzeugend gezeigt, dass die bestehenden Ausgaben der Opera omnia des Scotus ungenügend seien. Epping befand sich jedoch in der glücklichen Lage, schon auf drei der insgesamt vier Kapitel der von Marianus Müller vorbereiteten kritischen Edition zu De Primo Principio, die 1941 erscheinen sollte, zurückgreifen zu können. Außerdem gewährten ihm die Patres Editores in Rom Zugang zu den wichtigsten Scotushandschriften, darunter die codices 178 (Lectura prima Oxoniensis), F. 69 (Lectura prima Parisien6 7
8
9
10
Pelzer, “Le premier livre”, 422-467. Vgl. Vos, Philosophy, 119-120. Pelzer wurde in Aachen von belgischen Eltern geboren und besuchte dort das KaiserKarls-Gymnasium. Siehe zu Pelzers Biographie Van Steenberghe, “Monseigneur Auguste Pelzer”, 13-18. Ein Exemplar seiner unveröffentlichten Dissertation Theologiae marianae scholae franciscanae saeculorum XIII & XIV fontes critice stabiliuntur et doctrina exponitur ist zu finden in der Bibliothek der Université catholique de Louvain in Louvain-la-Neuve (Signatur: UCL BGSH-BMAG - Lv 11158). Bálics Werk Les Commentaires de Jean Duns Scotus sur les quatre livres des Sentences de Pierre Lombard wurde anyonym als Fasc. 1 von den Herausgebern der Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique veröffentlicht, ist jedoch nicht die Veröffentlichung seiner Dissertation (contra Wolter, “Reflections”, 40). Adelhard Epping, Scotus’ Godsbewijs, Leuven 1939, 172 pp. (maschinenschriftliche Dissertation). Adelhard ist Eppings Klostername; seine Eltern nannten ihn Gerardus Johannes.
236
Andreas J. Beck
sis) und 137 (Ordinatio).11 Eppings gründliche und immer noch lesenswerte Arbeit ist in drei Kapitel gegliedert, wobei das erste Kapitel ganz der textkritischen Debatte gewidmet ist. Heute sind diese Darlegungen freilich in weiten Teilen überholt. Eppings Dissertation blieb unveröffentlicht und ist nur in einigen wenigen Bibliotheken einsehbar.12 1943 fasste er jedoch die wichtigsten Ergebnisse zusammen in einem Aufsatz, der in Studia Catholica erschien.13 Drei Jahre später veröffentlichte er einen weiteren Folgebeitrag seiner Dissertation, wobei er diesmal Scotus̓ Rezeption des anselmianischen Gottesbeweises thematisierte.14 Dieser Aufsatz erschien 1946 in einem dem Doctor subtilis gewidmeten Themenheft der Collectanea Franciscana Neerlandica, worin auch Carolus Balíc, Benignus Körver (1913 – 1984) und Aquilinus Emmen (1907 – 1987) jeweils einen Beitrag beisteuerten, alle in niederländischer Sprache.15 Wie Epping waren auch Benignus Körver und Aquilinus Emmen dem Franziskanerkloster in Alverna bei Nijmegen verbunden. Körvers Beitrag zum genannten Themenheft behandelt die Natur der Theologie bei Duns Scotus und beobachtet treffend, dass zur Frage des Verhältnisses von Glauben und Wissen zu den Prologen auch das dritte Buch des Sentenzenkommentars herangezogen werden muss. Auch der Unterschied zwischen scientia subalternata und subalternans wird in diesem noch immer lesenswerten Aufsatz instruktiv behandelt.16 Zwei Jahre zuvor hatte Körver bereits zum Verhältnis von Heiliger Schrift und Theologie bei Scotus publiziert.17 Emmen setzt sich in seinem Beitrag kritisch mit dem Zeugnis des Landulphus Caracciolos zu Scotus̓ angeblichem Pariser Disput zugunsten der unbefleckten Empfängnis Mariens auseinander, welches er als Legende entmythologisiert.18 Emmen lehrte damals Philosophie und, mit vierjähriger Unterbrechung, Theologie in Quaracchi.19 Auch später erschienen von seiner Hand noch einige Beiträge zur Immakulatalehre, wobei hier insbesondere ein Aufsatz von 1965 zu nennen wäre, worin er zeigt, dass diesbezüglich Wilhelm von Ware ein wichtiger Vorläufer des Scotus war.20 Schließlich darf hier ein Hinweis auf Willibrordus Lampen (1888 – 1966) nicht fehlen, der in den dreißiger Jahren als Historiker in Nijmegen lehrte und ebenfalls mit Alverna verbunden war. Bereits 1924 schrieb Lampen einen 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
Epping, Scotus’ Godsbewijs, 1-2, 161. Etwa in den Universitätsbibliotheken in Leuven und Utrecht. Epping, “De Structuur van Scotus̓ godsbewijs”, 86-98. Epping, “Scotus en het anselmiaans Godsbewijs”, 29-60. Es überrascht nicht, dass Balíc zu Scotus‘ Werken im Lichte der Textkritik schrieb. Die vier Aufsätze fehlen in Tobias Hoffmanns Duns Scotus Bibliography, wie überhaupt jedwede Einträge zu Epping und Körver. Körver, “De natuur van de theologie volgens J. Duns Scotus”, 61-91. Körver, “Schrift en theologie”, 21-37. Emmen, “Het getuigenis”, 93-129. Siehe zu Emmen Struyker Boudier, Wijsgerig leven, vol. III, 224. Emmen, “Wilhelm von Ware”, 363-394.
Die Scotusforschung in den Niederlanden des 20. Jahrhunderts
237
Aufsatz zum Heiligen Stuhl und Duns Scotus, den er 1929 zu einer kleinen Monographie in lateinischer Sprache erweiterte.21 Mindestens ebenso wichtig ist sein Aufsatz von 1952 in Studia Catholica zur neuen Scotus-Ausgabe, worin er die bahnbrechende Arbeit der Commissio Scotistica lobt.22 4. Lambertus M. de Rijk (geb. 1924) Die neuere Scotusforschung in den Niederlanden wird markiert durch den bedeutenden Mediävisten Lambertus de Rijk, obwohl er kaum zu Duns Scotus publiziert hat. In kritischer Auseinandersetzung mit seiner Lehrerin Cornelia de Vogel, der überragenden Kennerin der Philosophie der Antike, wendete sich de Rijk der Philosophie des Mittelalters zu, welche er als zunehmende Emanzipationsbewegung weg von einem Nezessitarianismus der Antike würdigte.23 Nach seinen kritischen Editionen zu den Dialectica Abélards und Garlandus Compotistas wurde er 1961 in Nijmegen (Nimwegen) Professor für mittelalterliche Philosophie, was ein Novum in den Niederlanden darstellte. 1962 erwarb er zusätzlich einen Lehrauftrag in Utrecht, den er bis 1984 weiterhin wahrnahm, nachdem er 1969 von Nijmegen nach Leiden übergewechselt war. Inzwischen waren zwei Teile seiner annotierten Textausgabe Logica Modernorum erschienen.24 Über Duns Scotus schrieb de Rijk neben einem grundlegenden Artikel in der Grote Winkler Prins- Enzyklopädie und einem Aufsatz zum esse possibile, der 1989 erschien, vor allem in seinem Handbuch zur mittelalterlichen Philosophie.25 Dort heißt es: „Die vielleicht tiefgreifendste Weise, in der das Mittelalter sich gegen das Denken der Antike abgesetzt hat, tritt am Ende des 13. Jahrhunderts ans Licht. Gegen die Herrschaft des sogenannten griechischen ‚Notwendigkeitsdenkens’ erringt eine fundamentale Denkweise den Durchbruch, die man üblicherweise als das Durchdenken der radikalen Kontingenz des Geschöpflichen charakterisiert.“26
Diese radikale Kontingenz nun bringt de Rijk insbesondere mit Scotus in Verbindung und deutet sie als einen wesentlichen Beitrag zur Philosophiegeschichte. Sie ist für ihn „der wichtigste Faktor, ja, der Katalysator“ der Neuerungen zur Epistemologie im 14. Jahrhundert, wodurch die aristotelische Erkenntnislehre 21 22 23 24 25 26
Lampen, De Heilige Stoel en Johannes Duns Scotus, später als B. Ioannes Duns Scotus et Sancta Sedes. Lampen, “De nieuwe Scotus-uitgave”, 85-94. Vgl. de Rijk, “In Memoriam Cornelia Johanna De Vogel”, 1-2. De Rijk, Petrus Abaelardus; ders., Garlandus Compotista; ders., Logica Modernorum. De Rijk, “Einiges zu den Hintergründen der scotischen Beweistheorie”; ders., “Duns Scotus”; ders., Middeleeuwse wijsbeegeerte (franz. Übers.: La philosophie au moyen âge). De Rijk, Middeleeuwse wijsbegeerte, 93 (La philosophie, 70, wo allerdings “13e eeuw” irrtümlich mit “XIIe siècle” statt mit “XIIIe siècle” übersetzt wird).
238
Andreas J. Beck
und das Evidenzprinzip ausgeräumt werden.27 De Rijk sieht in Scotus‘ Lehre der radikalen Kontingenz alles Geschaffenen eine prinzipielle Abweisung des griechischen Notwendigkeitsdenkens. Dabei ist es, so de Rijk, „die Offenbarung, die, nicht als religiöse Inspiration, sondern auf dem Wege eines bestimmenden theologischen Denkmodells das philosophische Denken beeinflusst. Und zwar folgendermaßen: Alle natürliche Evidenz ist an das tatsächliche, kontingente und daher metaphysisch unsichere Seinsstatut dieser zufälligen Welt gebunden. Deshalb muss das metaphysische Denken, das sich ja auf das Sein als solches richtet, die wesentlichen Strukturen, die nun in dieser Welt gelten, lediglich als de facto wesentlich betrachten.“28
Zugleich wird, wie de Rijk an anderer Stelle ausführt, der antike Parallelismus zwischen Denken und Sein zugunsten einer transzendental-logischen Sichtweise durchbrochen.29 5. Antonie Vos (geb. 1944) De Rijks Schüler Antonie Vos greift dessen Impulse zur Scotusforschung auf und führt sie 1981 in seiner Dissertation wesentlich weiter. Vos studierte in Utrecht Philosophie und Theologie und hielt bereits 1968 mit 24 Jahren Vorlesungen an der theologischen Fakultät. In den 70er Jahren arbeitete er eng mit de Rijk zusammen und studierte zeitweise in Oxford bei Sir Anthony Kenny. 1981 wurde er an der theologischen Fakultät in Utrecht mit einer kritischen Analyse des absoluten Evidentialismus in Philosophie und Theologie unter dem Titel Kennis en Noodzakelijkheid (= Wissen und Notwendigkeit) promoviert. Mit absolutem Evidentialismus ist dabei eine epistemologische Position gemeint, die das Wissen als absolut sicher betrachtet und das Wissensobjekt als notwendig. Also gilt einerseits: (C.WW) Wenn a weiß, dass p, dann weiß a, dass a weiß, dass p und andererseits, (C.WN) Wenn a weiß, dass p, dann ist es notwendig, dass p. Hieraus folgt (C.W,NW) Wenn a weiß, dass p, dann ist es notwendig, dass a weiß, dass p.30 27 28 29
30
De Rijk, Middeleeuwse wijsgebeerte, 275. De Rijk, Middeleeuwse wijsgebeerte, 275-276 (Hervorhebungen im Original). De Rijk, Middeleeuwse wijsgebeerte, 232 und vgl. 186 (La philosophie, 1982: “Alors que Duns Scot pose, du point de vue physique et métaphysique, une analogie entre Dieu et la créature, il maintient, pour le domaine logique, la doctrine de l’univocité totale de l’être. Il a accepté ainsi les limites imposées à la pensée logique. Le parallélisme entre la pensée et l’être n’était plus longtemps chez lui une question d’isomorphie entre deux domaines autonomes, quoiqu’interdépendants. Chez lui le parallélisme commence, de façon modeste, à être conçu dans la direction d’une approche transcendentale-logique.” Vgl. 144). Vos, Kennis en Noodzakelijkheid, XIII, 394.
Die Scotusforschung in den Niederlanden des 20. Jahrhunderts
239
Eine solche Epistemologie ist, wie Vos zeigt, deterministisch und setzt somit voraus, dass alle Ereignisse notwendig sind. Vos beschreibt den absoluten Evidentialismus als erkenntnistheoretisches Gegenstück zum principium plenitudinis, wonach sich alles, was wirklich möglich ist, auch realisiert.31 Im historischen Teil seiner Arbeit stellt Vos nun dar, wie der absolute Evidentialismus bei Parmenides, Plato und Aristoteles, und in der antiken Philosophie insgesamt, dominiert.32 Im Mittelalter vollzieht sich dann bei Anselm, Bonaventura und Thomas von Aquin eine partielle Emanzipation vom absoluten Evidentialismus, die jedoch erst bei Duns Scotus vollständig durchgeführt wird.33 Wilhelm von Ockham folgt hierin zum Teil Scotus, kehrt jedoch zugleich wieder zu einer eher unausgeglichenen Reaktion gegen den absoluten Evidentialismus zurück.34 Zentral für diese Emanzipation vom absoluten Evidentialismus und vom antiken Notwendigkeitsdenken ist Scotus̓ Konzept der radikalen Kontingenz. Anhand von Lectura I 39 analysiert Vos im Einzelnen diesen Kontingenzbegriff und arbeitet heraus, dass es sich hierbei um synchrone Kontingenz handelt – diese Terminologie, die sich heute in der Forschung durchgesetzt hat, wird, soweit ich sehe, erstmals von Vos verwendet und genau definiert.35 Allerdings erscheinen im selben Jahr 1981 zwei wichtige Aufsätze von Simo Knuuttila, worin dieser zeigt, wie Scotus erstmals die sogenannte ‚statistische‘ Interpretation der Modalität überwindet und Zeit und Modalität voneinander entkoppelt.36 Wie Vos zeigt, besagt synchrone Kontingenz die Konsistenz von pt1 & M-pt1.37 Wenn p zum Zeitpunkt 1 wahr ist, besteht zugleich die Möglichkeit, dass p zum Zeitpunkt 1 nicht wahr ist. Oder formuliert mithilfe der Möglichen-Welten-Semantik: für die aktuelle Welt, in der p zum Zeitpunkt 1 wahr ist, gibt es eine alternative mögliche Welt, in der das nicht der Fall ist.38 Vos entgeht dabei nicht, dass es anachronistisch wäre, eine MöglicheWelten-Metaphysik bei Scotus finden zu wollen. Zudem ist der Begriff der synchronen Kontingenz nicht zu verwechseln mit unserem modernen Kontingenzbegriff, da für Scotus contingentia immer Tatsächlichkeit impliziert: Ein
31 32 33 34 35 36 37
38
Vos, Kennis en noodzakelijkheid, 172-209, 394-398. Vgl. zum principium plenitudinis Lovejoy, The Great Chain of Being. Vos, Kennis en noodzakelijkheid, 1-38. Vos, Kennis en noodzakelijkheid, 39-87. Vos, Kennis en noodzakelijkheid, 87-104. Vos, Kennis en noodzakelijkheid, 68-87, bes. 81-87. Vgl. zur synchronen Kontingenz in neuerer Forschung etwa Dumont, “Origin”, 149-167; Söder, Kontingenz und Wissen, 91-100. Knuutilla, “Duns Scotus’ Criticism”, 441-450; Knuuttila, “Time and Modality”, 163-257. Für diese und weitere Formeln gilt: - = Negation; & = Konjunktion; p = propositionale Variable oder Variable eines Sachverhaltes; pt1 = p ist der Fall zum Zeitpunkt 1; M = Möglichkeitsoperator; N = Notwendigkeitsoperator. Vos, Kennis en noodzakelijheid, 83-86.
240
Andreas J. Beck
kontingenter Sachverhalt ist immer ein tatsächlicher Sachverhalt, der jedoch zum gleichen Zeitpunkt auch nicht-sein kann.39 In diesem Zusammenhang findet sich eine geradezu poetische Passage in Vos‘ leider bis heute unübersetzt gebliebenen Dissertation: „Obschon Duns nicht in das verheißene Land einer Metaphysik möglicher Welten kam, stand er doch bei einem Drittel des Lebensalters des Moses auf dem Berg, von wo aus er es sah. Allerdings sollte er keinen Josua haben, der hierin sein Nachfolger werden könnte. Willem von Ockham hätte dies seiner Anlage und Inspiration nach sein können. Mit seinem geradezu unvorstellbar sensiblen und tiefen christlichen Glauben bewirkt er jedoch eine verzweifelte Komplikation in der Entwicklung des Denkens.“40
Wie Vos zeigt, kennt Ockham zwar Scotus‘ Begriff der synchronen Kontingenz, verwirft ihn jedoch im Hinblick auf die schöpfungsgemäße Ordnung (potentia ordinata).41 6. Research Group John Duns Scotus Nach seiner Promotion übernahm Vos eine Vorlesungsreihe de Rijks zu Lectura I 39 und studierte mit einer Gruppe Studenten auch außerhalb der Vorlesungen intensiv diesen Text. So entstand die Research Group John Duns Scotus, die 1992 ihre erste gemeinsame Buchveröffentlichung vorlegte, eine niederländische Übersetzung von Lectura I 39 mit Einleitung und Kommentar, die 1994 in einer überarbeiteten englischen Fassung bei Kluwer Academic Publishers mit dem Titel Contingency and Freedom erschien.42 In der Einleitung wird die scotische Kontingenztheorie anhand hilfreicher schematischer Darstellungen erläutert und dabei sowohl gegen das radikale Notwendigkeitsdenken des Parmenides als auch das der diachronen Kontingenz bei Aristoteles abgesetzt. In den entsprechenden Schemata bedeuten die grauen Felder aktualisierte Sachverhalte und die leeren Felder nicht-aktualisierte Sachverhalte.43 In der Ontologie des Parmenides ist p der einzig mögliche Sachverhalt:
p –p 39 40 41 42
43
Zeitachse
Vos, Kennis en noodzakelijkheid, 81-83. Vgl. auch vier Jahre später Vos, “On the Philosophy”, bes. 211-214. Vos, Kennis en noodzakelijkheid, 273. Vos, Kennis en noodzakelijkheid, 87-104. Der zugrundeliegende Text ist Ioannes Duns Scotus, Lect. I, d. 39, q. 1-5, n. 1-93 (ed. Vat. 17), 481-510. 1998 veröffentlichte dieselbe Forschungsgruppe eine entsprechende Übersetzung mit Kommentar zu Auszügen des Paralleltextes in Ord. I, d. 39 [= Appendix A], q. 1-5, n. 1-35 (ed. Vat. 6), 401-444; siehe Vos et al., “Freiheit und Kontingenz”, 99-136. Siehe zum Folgenden Contingency and Freedom, 23-33.
Die Scotusforschung in den Niederlanden des 20. Jahrhunderts
241
Veränderung und Kontingenz sind nicht real, sondern lediglich Phänomene einer Sinnestäuschung, der ‚doxa‘.44 Aristoteles stellt diesem Modell, vergröbert ausgedrückt, eine alternative Ontologie gegenüber, welche Raum schafft für zeitliche Veränderung:
p –p
Zeitachse
Diese Veränderung in der Zeit ist für Aristoteles äquivalent mit Kontingenz. Hier gilt: Wenn p der Fall ist zum Zeitpunkt t1, dann ist es möglich, dass -p der Fall ist zum Zeitpunkt t2 (diachrone Kontingenz).45 Duns Scotus nun geht einen wesentlichen Schritt weiter und zeigt, dass ein Sachverhalt erst dann wirklich kontingent oder nicht-notwendig ist, wenn für denselben Zeitpunkt, zu dem p der Fall ist, -p möglich ist.46 Als Grafik veranschaulicht (die leeren Felder indizieren synchron alternative Sachverhalte):
p –p
Zeitachse
Damit soll freilich nicht gesagt werden, dass es möglich wäre, dass p und -p zum gleichen Zeitpunkt der Fall sind. Dies wäre ein reiner Widerspruch, den Scotus natürlich abweist.47 Leider wird sein Kontingenzbegriff häufig in dieser Weise missverstanden, etwa von einigen niederländischen Thomasforschern.48 Interessant ist, dass die Entkoppelung von zeitlicher Veränderlichkeit und Kontingenz auch die Entkoppelung von zeitlicher Unveränderlichkeit und Notwendigkeit bedeutet. So kann etwa Gottes Wissen und Wollen zeitlich unverändert und zugleich ‚synchron‘ kontingent sein:
p –p
Zeitachse
Die Einleitung zu Contingency and Freedom will weiterhin aufzuzeigen, wie Scotus mithilfe dieser Theorie der synchronen Kontingenz das Handeln sowohl 44 45 46 47 48
In Formel: pt1 & -M-pt2. In Formel: pt1 & M-pt2. In Formel: pt1 & M-pt1. Es gilt also: -M(pt1 & -pt1). Te Velde, “Enkele kanttekeningen”, 93-99.
242
Andreas J. Beck
des Willens Gottes als auch des menschlichen Willens sozusagen innerhalb einer ontologischen Grundmatrix verortet, welche neben unzählbar vielen kontingenten Sachverhalten auch notwendige Sachverhalte umfasst.49 In verschiedenen gemeinsamen Publikationen, bisher insgesamt 5 Büchern und 3 Zeitschriftenaufsätzen, versucht die genannte Forschergruppe zu zeigen, wie die scotische Kontingenztheorie in mancherlei Hinsicht als hermeneutischer Schlüssel zu einem besseren Verständnis der Theologie und Philosophie des doctor subtilis dienen kann.50 Dazu kommen die individuellen Publikationen der verschiedenen Mitglieder, die auf der Website der Forschergruppe bibliographisch erfasst sind.51 Ich nenne nur einige Beispiele. Erstens versucht der 2003 bei Ashgate erschienene Band Duns Scotus on Divine Love: Texts and Commentaries on Goodness and Freedom, God and Humans unter anderem zu zeigen, wie die Kontingenztheorie eine konsistente Interpretation der scotischen Ethik erlaubt. Einerseits ist Gottes Wille frei und kontingent. Andererseits gilt: „Every possible divine act is ethically good, because all possible decisions of God are situated within the range constituted by his best possible nature“.52 Diese Deutung wendet sich insbesondere gegen Thomas Williams̓ voluntaristische bzw. positivistische Interpretation der Ethik des doctor subtilis.53 Das zweite Beispiel betrifft Antonie Vos‘ Monographie Johannes Duns Scotus, die 1994 in Leiden erschien und bisher leider unübersetzt blieb.54 In einem eindringlichen Kapitel zur Gotteslehre deutet Vos die Unterscheidung von Gottes potentia absoluta und ordinata bei Scotus von dessen Kontingenztheorie her und entkräftet so William Courtenays Argumente, wonach diese
49 50
51 52
53 54
Contingency and Freedom, 23-36. Gemeinsame Bücher: Contingentie en vrijheid (1992); Contingency and Freedom (1994); Teksten over God en werkelijkheid (1995); Duns Scotus on Divine Love (2003); Geloof geeft te denken (2005). Gemeinsame Aufsätze: Vos et al., “Freiheit und Kontingenz“ (zu Ord. I d. 39 [= Appendix A], ed. Vat. VI, 401-444); Vos et al., “Duns in Potency“ (zu Met. IX, q. 1-2 n. 1-69, OPh 4, 509-534); Den Bok et al., “More Than Just an Individual“ (zu Lect. III d. 1 q 1 n. 1-91, ed. Vat. 20, 1-35; eine integrale Übersetzung dieser Distinktion ist auf der Seite http://www.dunsscotus.nl/Nederlands/Bibliografie/Scotus_Lectiii_i_translation.pdf online gestellt). Siehe http://www.dunsscotus.com. Duns Scotus on Divine Love, 61. In diesem Band werden nach einer Einleitung die folgenden Texte wiedergegeben, übersetzt und ausführlich kommentiert: Ioannes Duns Scotus, Lect. prol. p. 3 n. 107-121, ed. Vat. XVI, 39-43; Lect. prol. p. 4 n. 172, ed. Vat. XVI, 57; Ord. III d. 28 q. un. n. 1-26, ed. Wolter; Lect. I d. 17 p. 1 q. un. n. 56-103, ed. Vat. XVII, 200-213; Lect. I d. 40 q. un. n. 1-9, ed. Vat. XVII, 511-513; Lect. I d. 41 q. un. n. 1-27, ed. Vat. XVII, 515-521; Ord. I d. 46 q. un. n. 1-9, ed. Vat. VI, 377-380; Ord. I d. 47 n. 1-10, ed. Vat. VI, 381-385; Lect. I d. 10 q. un. n. 1-31, ed. Vat. XVII, 115-126. Siehe Duns Scotus on Divine Love, 58-64, für die Diskussion mit Williams’ Aufsätzen “The Unmitigated Scotus”, 162-181, und “Reason, Morality, and Voluntarism”, 73-94. Eine stark erweiterte englischsprachige Monographie zur Theologie des Duns Scotus vom selben Autor ist in Vorbereitung.
Die Scotusforschung in den Niederlanden des 20. Jahrhunderts
243
Unterscheidung bei Scotus den Weg zu einem nominalistischen Skeptizismus öffne.55 Drittens wird in dem im Jahre 2005 als achtem Band der Scripta Franciscana erschienenen Aufsatzband Geloof geeft te denken unter anderem von Nico den Bok die scotische Kontingenztheorie historisch und systematisch situiert.56 Schließlich weise ich auf Antonie Vos̓ jüngstes Buch The Philosophy of John Duns Scotus hin, das 2006 bei Edinburgh University Press erschienen ist. Vos arbeitet hier nicht nur detailliert Scotus̓ innovativen Beiträge zur Logik, Ontologie, Epistemologie, Freiheitslehre und Ethik heraus, sondern bietet auch eine umfassende Beschreibung von dessen Leben und Werk. In den letzten fünfzehn Jahren zählte die Forschergruppe außer dem Leiter Vos, zwischen fünf und sieben weitere Mitglieder, die alle in Utrecht betreut von Antonie Vos promoviert wurden. Die meisten dieser Dissertationen stellen ausführliche Bezüge zu Duns Scotus und seinem Erbe her.57 Obwohl diese Forschergruppe offiziell verbunden ist mit dem Franziskanischen Studienzentrum in Utrecht, hat bisher leider noch kein römisch-katholischer Forscher zu ihr gefunden, so dass noch immer alle Mitglieder evangelische Theologen sind.58 7. Dutch Society for Medieval Philosophy Medium Aevum Einige wichtige Forschungsergebnisse zu Duns Scotus wurden in den letzten fünfundzwanzig Jahren von Mitgliedern der von de Rijk gegründeten „Dutch Society for Medieval Philosophy Medium Aevum“ vorgelegt. Ich konzentriere mich hier auf diejenigen Mitglieder, die nicht wie Vos zugleich Mitglieder der “Research Group John Duns Scotus” sind. Hier ist zunächst Henri Krop (geb. 1954) zu nennen, der 1987 in Leiden seine Dissertation zum Theologiebegriff bei Duns Scotus erfolgreich verteidigte. Die Arbeit enthält eine annotierte niederländische Übersetzung des Ordinatio-Prologs und eine ausführliche Einleitung, die besondere Aufmerksamkeit der Frage nach dem Verhältnis zwischen Theologie und Metaphysik widmet.59 1989 promovierte Maarten Hoenen (geb. 1957) in Nijmegen bei Henk Braakhuis mit einer Arbeit zur Marsilius von Inghen und dessen Lehre vom gött55 56 57
58
59
Vos, Johannes Duns Scotus, 217-245, bes. 242-245. Henri Veldhuis führte diesen Punkt weiter mit seinem Aufsatz “Ordained and Absolute Power in Scotus’ Ordinatio I 44”, 222-230. Beck und Veldhuis, Geloof geeft te denken, bes. Kap. 15-16. Vgl. zu den heutigen Mitgliedern Veldhuis, Ein versiegeltes Buch; Dekker, Rijker dan Midas; Den Bok, Communicating the Most High; Beck, Gisbertus Voetius; Bac, Perfect Will Theology, und zu früheren Mitgliedern Bom, De ruimte van het hart; Labooy, Freedom and dispositions. In den Anfangsjahren gehörte auch Aline H. Looman-Graaskamp der Forschungsgruppe an. Zu erwähnen wäre jedoch die gute und langjährige Zusammenarbeit mit katholischen Theologen wie Theo Zweerman (bis zu seinem Tod 2005), Axel Schmidt und Thomas Möllenbeck. Krop, De status van de theologie.
244
Andreas J. Beck
lichen Wissen, die Hoenen mit den wichtigsten theologisch-philosophischen Positionen zwischen ca. 1255 und 1396 vergleicht. In diesem Zusammenhang bespricht er ausführlich Duns Scotus, wobei er sich weitgehend an die von Vos in Kennis en Noodzakelijkheid vorgelegte Deutung anschließt. 1993 erschien diese wichtige Arbeit in überarbeiteter Fassung und englischer Übersetzung bei Brill.60 Schließlich ist Bert Bos (geb. 1947) zu nennen, der als Professor für mittelalterliche Logik und Semantik in Leiden sein Werk in großem Maße als Fortsetzung des Werks seines Lehrers de Rijk versteht. Als früherer Sekretär und heutiger Vorsitzender von Medium Aevum organisierte er eine Vielzahl bedeutender Symposia, wovon das dritte Symposium im Mai 1996 besonders erwähnenswert ist, da es ganz Duns Scotus gewidmet war. In dem 1998 bei Rodopi erschienenen Kongressband stammen fünf der insgesamt vierzehn Beiträge von Mitgliedern der “Research Group John Duns Scotus”.61 Neben diesen Beiträgen sei an erster Stelle explizit den Aufsatz von Jos Decorte zum scotischen relatio-Begriff erwähnt. Daneben wären zu nennen die Aufsätze von Ria van der Lecq zur Frage der Realität möglicher Welten bei Scotus, von Joke Spruyt zu Scotus’ Kritik am Begriff des freien Willens bei Heinrich von Gent, von Bert Bos zur Kategorienlehre bei Albert, Thomas und Scotus, und schließlich von Maarten Hoenen zur Skotistenschule im 13., 14. und frühen 16. Jahrhundert.62 Dazu kommen Beiträge von Jan Aertsen, Paul Mercken, Rudi te Velde und dem Gastreferenten Wolfgang Kluxen.63 An letzter Stelle sei das unlängst von Egbert Bos und Henri Krop redigierte Themenheft zu Duns Scotus der niederländischen Zeitschrift Wijsgerig Perspectief erwähnt. Als Hauptartikel enthält dieses Themenheft einen von Bos verfassten Beitrag zu Leben und Werk des Duns Scotus, einen in Scotus̓ Philosophie einführenden Aufsatz von Krop, einen Beitrag zur Kontingenz von Vos sowie einen Aufsatz von Spruyt zur Nachwirkung der Philosophie des Duns Scotus.64
60 61
62
63
64
Hoenen, Marsilius van Inghen. Bos, ed., Renewal of Philosophy. Siehe Vos, “Duns Scotus and Aristotle”, 49-72; Vos, “Knowledge, Certainty and Contingency”, 75-88; Dekker, “Scotus’s Freedom on the Will Revisited”, 113-121; Dekker, “Does Duns Scotus Need Molina?”, 101-111; Beck, “’Divine Psychology’ and Modalities”, 123-137. Decorte, Creatio and conversatio, 27-48; Van der Lecq, “Duns Scotus on the Reality of Possible Worlds”, 89-99; Spruyt, “Duns Scotus’s Criticism”, 139-154; Bos and Van der Helm, “The Division of Being”, 183-196; Hoenen, “Scotus and the Scotist School”, 196-120. Aertsen, “Being and the One”, 13-26; Mercken, “Necessity and the Moral Order”, 171182; Te Velde, Natura in seipsa recurva es, 155-169; Kluxen, “On Metaphysics and the Concept of Freedom”, 1-12. Bos and Krop (eds.), Johannes Duns Scotus.
Die Scotusforschung in den Niederlanden des 20. Jahrhunderts
245
8. Schluss Überblicken wir die Scotusforschung der Niederlande im 20. Jahrhundert, so fällt für die erste Jahrhunderthälfte die dominante Rolle Leuvens und der dort gepflegten textkritischen Arbeit auf. In der zweiten Jahrhunderthälfte verschiebt sich der Schwerpunkt auf Nijmegen, Utrecht und Leiden, die drei Wirkungsplätze de Rijks, der über seinen Schüler Antonie Vos und die von ihm gegründete Gesellschaft Medium Aevum maßgebliche Impulse nicht nur zur Erforschung der mittelalterlichen Philosophie und Theologie insgesamt, sondern auch zur niederländischen Scotusforschung gegeben hat. Dabei spielt der von de Rijk betonte Begriff der radikalen Kontingenz, welcher von Vos präziser als synchrone Kontingenz analysiert wurde, eine wichtige Rolle. Der Schwerpunkt dieser Scotusforschung liegt seit 1980 bei Vos und der von ihm geleiteten „Research Group John Duns Scotus“. Daneben ist auf die Beiträge der „Dutch Society for Medieval Philosopy Medium Aevum“, die allerdings ebenfalls teilweise von Mitgliedern der „Research Group John Duns Scotus“ getragen werden, hinzuweisen.
246
Andreas J. Beck
Bibliographie Primärliteratur Ioannes Duns Scotus, Lect. I, ed. Vat. XVII. Ioannes Duns Scotus, Ord. I, ed.Vat. VI. Duns Scotus on Divine Love. Texts and Commentary on Goodness and Freedom, God and Humans. Ed. A. Vos, H. Veldhuis, E. Dekker, N.W. den Bok and A.J. Beck. Aldershot: Ashgate, 2003. Duns Scotus on the Will and Morality. Selected and transl. with an introd. by Allan B. Wolter; ed. William A. Frank; without Latin texts, but with new preface. Washington, D.C.: Catholic University of America Press, 1997 (original edition with Latin texts: Washington, D.C.: Catholic University of America Press, 1997). Ioannes Duns Scotus, Contingency and Freedom. Lectura I 39. Introduction, Translation and Commentary by A. Vos Jaczn., H. Veldhuis, A. H. Looman-Graaskamp, E. Dekker, N. W. den Bok. The New Synthese Historical Library 42. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers, 1994 (niederländ. Erstfassung: Ioannes Duns Scotus, Contingentie en vrijheid. Lectura I 39. Ingeleid, vertaald en van commentaar voorzien door Vos Jaczn., H. Veldhuis, A. H. Looman-Graaskamp, E. Dekker, N. W. den Bok. Zoetermeer: Meinema, 1992.) Ioannes Duns Scotus, Teksten over God en werkelijkheid. Vertaald, ingeleid en van commentaar voorzien door A. Vos Jaczn., H. Veldhuis, E. Dekker, N. W. den Bok en A. J. Beck. Sleutelteksten in godsdienst en theologie 17. Zoetermeer: Meinema, 1995.
Sekundärliteratur Aertsen, Jan A., “Being and the One: the Doctrine of the Convertible Transcendentals in Duns Scotus.” In John Duns Scotus (1265-1308). Renewal of Philosophy, ed. E. P. Bos, 13-26. Elementa 72. Amsterdam and Atlanta, GA: Rodopi, 1998. Bac, Martin J., “Perfect Will Theology. Divine Agency in Reformed Scholasticism as against Suárez, Episcopius, Descartes, and Spinoza.” Brill̓s Series in Church History 42. Leiden : Brill, 2010. Balíc, Carolus et al., Doctor Subtilis – Vier studies over Johannes Duns Scotus. Collectanea Franciscana Neerlandica 7 / 1. ’s-Hertogenbosch: Teulings’ Uitgevers-Maatschappij, 1946. Balíc, Carolus, “Duns Scotus’ werken in het licht van de tekstkritiek.” Collectanea Franciscana Neerlandica 7 / 1 (1946): 5-28. Balíc, Carolus, Les Commentaires de Jean Duns Scot sur les quatre livres des Sentences de Pierre Lombard: étude historique et critique. Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique. Fasc. 1. Louvain: Bureaux de la Revue, 1927. Beck, Andreas J., “‘Divine Psychology’ and Modalities. Scotus’s Theory of the Neutral Proposition.” In John Duns Scotus (1265-1308). Renewal of Philosophy, ed. E. P. Bos, 123-137. Elementa 72. Amsterdam and Atlanta, GA: Rodopi, 1998. Beck, Andreas J., und Henri Veldhuis, “Inleiding.” In Geloof geeft te denken: Opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus, ed. Andreas J. Beck and Henri Veldhuis, 1-19. Scripta franciscana 8. Assen: Van Gorcum, 2005. Beck, Andreas J., and Henri Veldhuis (ed.), Geloof geeft te denken: Opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus. Scripta franciscana 8. Assen: Van Gorcum, 2005. Beck, Andreas J., Gisbertus Voetius (1589-1676). Sein Theologieverständnis und seine Gotteslehre. Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 92. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007.
Die Scotusforschung in den Niederlanden des 20. Jahrhunderts
247
Bok, Nico W. den, Communicating the Most High. A Systematic Study of Person and Trinity in the Theology of Richard of St. Victor († 1173). Bibliotheca Victorina 7. Paris et al.: Brepols, 1996. Bok, Nico W. den et al., “More Than Just an Individual. Scotus’s Concept of Person From the Christological Context of Lectura III 1.” Franciscan Studies 66 (2008): 169-96. Bos, Bert, und Henri Krop (ed.), Johannes Duns Scotus. Wijsgerig perspectief 48 (2008) no. 4. Amsterdam: Boom, 2008. Bos, E. P. (ed.), John Duns Scotus (1265/6-1308): Renewal of Philosophy. Acts of the Third Symposium Organized by the Dutch Society for Medieval Philosophy Medium Aevum. Elementa 72. Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 1998. Bos, E.P., and A.C. van der Helm, “The Division of Being over the Categories According to Albert the Great, Thomas Aquinas and John Duns Scotus.” In John Duns Scotus (12651308). Renewal of Philosophy, ed. E. P. Bos, 183-196. Elementa 72. Amsterdam, Atlanta, GA: Rodopi, 1998. De Wulf, Maurice, Historie de la philosophie médiévale. Louvain: Institut supérieur de philosophie, 1900 (61933-1947). Decorte, Jos, “Creatio and conversatio as relatio.” In John Duns Scotus (1265-1308). Renewal of Philosophy, ed. E. P. Bos, 27-48. Elementa 72. Amsterdam and Atlanta, GA: Rodopi, 1998. Dekker, Eef, “Does Duns Scotus Need Molina? On Divine Foreknowledge and Co-causality.” In John Duns Scotus (1265-1308). Renewal of Philosophy, ed. E. P. Bos, 101-111. Elementa 72. Amsterdam, Atlanta, GA: Rodopi, 1998. Dekker, Eef, “Scotus’s Freedom on the Will Revisited.” In John Duns Scotus (1265-1308). Renewal of Philosophy, ed. E. P. Bos, 113-121. Elementa 72. Amsterdam, Atlanta, GA: Rodopi, 1998. Dekker, Eef, Rijker dan Midas. Vrijheid, genade en predestinatie in de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609). Zoetermeer: Boekencentrum, 1993. Dumont, Stephen D., “The Origin of Scotus’s Theory of Synchronic Contingency.” The Modern Schoolman 72 (1995): 149-167. Duns Scotus Bibliography: 1950 to the Present. Compiled by Tobias Hoffmann. Last updated: 8-Dec-08. URL: http://faculty.cua.edu/hoffmann/Scotus-Bibliography.pdf. Emmen, Aquilinus, “Wilhelm von Ware, Duns Scotus’ Vorläufer in der Immakulatalehre.” Antonianum 40 (1965): 363–394. Emmen, Aquilinus, “Het getuigenis van Landulphus Caracciolo over Scotus’ dispuut ten gunste der Onbevlekte Ontvangenis.” Collectanea Franciscana Neerlandica 7 / 1 (1946): 93-129. Epping, Adelhard, Scotus’ Godsbewijs. Leuven 1939 (maschinenschriftliche Dissertation). Epping, Adelhard, “De Structuur van Scotus’ godsbewijs.” Studia Catholica 18 (1943): 86-98. Epping, Adelhard, “Scotus en het anselmiaans Godsbewijs.” Collectanea Franciscana Neerlandica 7 / 1 (1946): 29-60. Hoenen, Maarten J. F. M., “Scotus and the Scotist School. The Tradition of Scotist Thought in the Medieval and Early Modern Period.” In John Duns Scotus (1265-1308). Renewal of Philosophy, ed. E. P. Bos, 196-210. Elementa 72. Amsterdam, Atlanta, GA: Rodopi, 1998. Hoenen, Maarten J. F. M., Marsilius of Inghen. Divine Knowledge in Late Medieval Thought. Studies. Studies in the History of Christian Thought 50. Leiden: Brill, 1993. Kluxen, Wolfgang, “On Metaphysics and the Concept of Freedom in the Philosophy of John Duns Scotus.” In John Duns Scotus (1265-1308). Renewal of Philosophy, ed. E. P. Bos, 1-12. Elementa 72. Amsterdam, Atlanta, GA: Rodopi, 1998. Knuuttila, Simo, “Duns Scotus’ Criticism of the ‘Statistical’ Interpretation of Modality.” In Sprache und Erkenntnis im Mittelalter: Akten des VI. Internationalen Kongresses für mittelalterliche Philosophie der Société internationale pour l‘étude de la philosophie médiévale, 29. Aug. - 3. Sept. 1977 in Bonn, ed. Jan P. Beckmann et al., 441-450. Miscellanea Mediaevalia 13 / 1. Berlin, New York: De Gruyter, 1981. Knuuttila, Simo, “Time and Modality in Scholasticism.” In Reforging the Great Chain of Being: Studies of the History of Modal Theorie, ed. Simo Knuuttila, 163-257. Synthese Historical Library 20. Dordrecht: D. Reidel, 1981.
248
Andreas J. Beck
Körver, Benignus, “De natuur van de theologie volgens J. Duns Scotus.” Collectanea Franciscana Neerland ca 7 / 1 (1946): 61-91. Körver, Benignus, “H. Schrift en theologie in de proloog van Scotus’ Sentenzencommentaar.” Studia catholica 20 (1944): 21-37. Krop, Henri A., De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica, Amsterdam: Rodopi, 1987. Labooy, Guus H., Freedom and dispositions. Two main concepts in theology and biological psychiatry; a systematic analysis. Contributions to philosophical theology 8. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 2002. Lampen, Willibrordus, “De Heilige Stoel en Johannes Duns Scotus.” De Katholiek 165 (1924): 335-350. Lampen, Willibrordus, “De nieuwe Scotus-uitgave.” Studia Catholica 27 (1952): 85-94. Lampen, Willibrordus, B. Ioannes Duns Scotus et Sancta Sedes. Florentiae et al.: Ad Claras Aquas, 1929. Lecq, Ria van der, “Duns Scotus on the Reality of Possible Worlds.” In John Duns Scotus (12651308). Renewal of Philosophy, ed. E. P. Bos, 89-99. Elementa 72. Amsterdam, Atlanta, GA: Rodopi, 1998. Lovejoy, Arthur O., The Great Chain of Being. A Study of the History of an Idea. The William James Lectures Delivered at Harvard University. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936. Mercken, H. Paul F., “Necessity and the Moral Order: Scotus’s Interpretation of the Lex Naturae in the Perspective of Western Philosophical Ethics.” In John Duns Scotus (1265-1308). Renewal of Philosophy, ed. E. P. Bos, 171-182. Elementa 72. Amsterdam, Atlanta, GA: Rodopi, 1998. Pelzer, Auguste, “A propos de Jean Duns Scot et des études scotistes.” Revue néoscolastique de philosophie 25 (1923): 410-420. Reprinted in: Auguste Pelzer, Études d’histoire littéraire sur la scolastique médiévale. Recueil d’articles mis à jour à l’aide des notes de l’auteur par Adrien Pattin, O.M.I. et Émile Van de Vyver. Philosophes médiévaux 8. Louvain: Publications Universitaires, 1964, 411-421. Pelzer, Auguste, “Le premier livre des Reportata Parisiensia de Jean Duns Scot.” Annales de l’Institut Supérieur de Philosophie 5 (1923): 449-491. Reprinted in: Auguste Pelzer, Études d’histoire littéraire sur la scolastique médiévale. Recueil d’articles mis à jour à l’aide des notes de l’auteur par Adrien Pattin, O.M.I. et Émile Van de Vyver. 422-467 Philosophes médiévaux 8. Louvain: Publications Universitaires, 1964. Pelzer, Auguste., Études d’histoire littéraire sur la scolastique médiévale. Recueil d’articles mis à jour à l’aide des notes de l’auteur par Adrien Pattin, O.M.I. et Émile Van de Vyver, O.S.B. Philosophes médiévaux 8. Louvain: Publications Universitaires, 1964. Rijk, Lambertus Marie de, Middeleeuwse wijsbegeerte: Traditie en vernieuwing. Assen: Van Gorcum 1977, 21981 (französ. Übers.: La philosophie au moyen âge, Leiden: Brill, 1985). Rijk, Lambertus Marie de (ed.), Garlandus Compotista: Dialectica. First edition of the manuscripts. With an Introduction on the Life and Works of the Author and on the Contents of the Present Work. Assen: Van Gorcum, 1959. Rijk, Lambertus Marie de (ed.), Petrus Abaelardus. Dialectica. First Complete Edition of the Parisian Manuscript. Wijsgerige Teksten en Studies uitgegeven door de Filosofische Instituten te Utrecht 1. Assen: Van Gorcum, 1956 (21970). Rijk, Lambertus Marie de, Logica Modernorum. A Contribution to the History of Early Terminist Logic. 2 in 3 Bde. Wijsgerige teksten en studies 6.16. Assen: Van Gorcum, 1962–1967. Rijk, Lambertus Marie de, “In Memoriam Cornelia Johanna De Vogel.” Vivarium 25 (1987): 1-2. Rijk, Lambertus Marie de, “Einiges zu den Hintergründen der scotischen Beweistheorie. Die Schlüsselrolle des Seins-Könnens (esse possibile).” In Die Kölner Universität im Mittelalter. Geistige Wurzeln und soziale Wirklichkeit, ed. Albert Zimmermann, 176-191. Miscellanea mediaevalia 20. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1989.
Die Scotusforschung in den Niederlanden des 20. Jahrhunderts
249
Rijk, Lambertus Marie de, “Duns Scotus.” In Grote Winkler Prins. Encyclopedie in twintig delen. 7de geheel nieuwe druk. Hoofdredactie J.F. Staal en A.J. Wiggers. Vol. 6. Amsterdam: Elzevier, 1968. Söder, Joachim Roland, Kontingenz und Wissen. Die Lehre von den Futura contingentia bei Johannes Duns Scotus. Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters NF 49. Münster: Aschendorff, 1999. Spruyt, Joke, “Duns Scotus’s Criticism of Henry of Ghent’s Notion of Free Will.” In John Duns Scotus (1265-1308). Renewal of Philosophy, ed. E.P. Bos, 139-154. Elementa, 72. Amsterdam, Atlanta, GA: Rodopi, 1998, 139-154. Struyker Boudier, Cornelis E. M., Wijsgerig leven in Nederland, België en Luxemburg. Vol. III: In Godsnaam: de augustijnen, carmelieten en minderbroeders. Nijmegen: Katholiek Studiecentrum, 1987. Van Steenberghen, Fernand, “Maurice De Wulf (1867-1947).” In Introduction à l’étude de la philosophie médiévale. Recueil de travaux offert à l’auteur par ses collègues, ses étudiants et ses amis, 287-313. Philosophes médiévaux 18. Louvain: Publications Universitaires, 1974. Van Steenberghen, Fernand, “Monseigneur Auguste Pelzer.” In Auguste Pelzer, Études d’histoire littéraire sur la scolastique médiévale. Recueil d’articles mis à jour à l’aide des notes de l’auteur par Adrien Pattin, O.M.I. et Émile Van de Vyver, 7-12. Philosophes medievaux 8. Louvain: Publications Universitaires, 1964 (siehe auch die Bibliographie Pelzers ebd., 13-18). Velde, Rudi te, “Enkele kanttekeningen bij Scotus’ leer van de contingentie volgens Vos.” Jaarboek 1994 Thomas Instituut Utrecht (1995): 83-99. Velde, Rudi te, “Natura In Seipsa Recurva Est: Duns Scotus and Aquinas on the Relationship between Nature and Will.” In John Duns Scotus (1265-1308). Renewal of Philosophy, ed. E. P. Bos, 155-169. Elementa 72. Amsterdam, Atlanta, GA: Rodopi, 1998. Veldhuis, Henri, “Ordained and Absolute Power in Scotus’ Ordinatio I 44.” Vivarium 38 (2000): 222-230. Veldhuis, Henri, Ein versiegeltes Buch. Der Naturbegriff in der Theologie J.G. Hamann (1730-1788). Übers. Renate Drewes-Siebel. Theologische Bibliothek Töpelmann 65. Berlin et al.: de Gruyter, 1994. Vos, Antonie et al., “Duns in Potency. The Dating of Scotus’ Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis, IX, 1-2 and its Concept of Possibility.” Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale 30 (2005): 41-68. Vos, Antonie et al., “Freiheit und Kontingenz in der Ordinatio I 39 des Johannes Duns Scotus.” Wissenschaft und Weisheit 61 (1998): 99-136. Vos, Antonie, Johannes Duns Scotus. Kerkhistorische Monografieën. Leiden: Groen en Zoon, 1994. Vos, Antonie, Kennis en Noodzakelijkheid. Een kritische analyse van het absolute evidentialisme in wijsbegeerte en theologie. Dissertationes Neerlandicae 5. Kampen: Kok, 1981. Vos, Antonie, “On the Philosophy of the Young Duns Scotus: Some Semantical and Logical Aspects.” In Mediaeval Semantics and Metaphysics: Studies Dedicated to L. M. de Rijk, Ph.D., Professor of Ancient and Mediaeval Philosophy at the University of Leiden on the Occasion of His 60th Birthday, ed. E.P. Bos, 195-220. Artistarium. Supplementa 2. Nijmegen: Ingenium, 1985. Vos, Antonie, “Duns Scotus and Aristotle.” In John Duns Scotus (1265-1308). Renewal of Philosophy, ed. E. P. Bos, 49-74. Elementa 72. Amsterdam and Atlanta, GA: Rodopi, 1998. Vos, Antonie, “Knowledge, Certainty and Contingency.” In John Duns Scotus (1265-1308). Renewal of Philosophy, ed. E. P. Bos, 75-88. Elementa 72. Amsterdam, Atlanta, GA: Rodopi, 1998. Vos, Antonie, The Philosophy of John Duns Scotus. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. Wielockx, Robert, “De Mercier à De Wulf. Débuts de l’École de Louvain.” In Gli studi di filosofia medievale fra otto e novecento. Contributo a un bilancio storiografico: atti del convegno
250
Andreas J. Beck
internazionale, Roma, 21 - 23 settembre 1989, ed. Rudi Imbach and Alfonso Maierù, 7595. Storia e letteratura 179. Rome: Edizioni di Storia e Letteratura, 1991. Williams, Thomas, “Reason, Morality, and Voluntarism in Duns Scotus: A Pseudo-Problem Dissovled.” The Modern Schoolman 74 (1997): 73-94. Williams, Thomas, “The Unmitigated Scotus.” Archiv für Geschichte der Philosophie 80 (1998): 162-81. Wolter, Allan B., “Reflections about Scotus’s Early Works.” In John Duns Scotus. Metaphysics and Ethics, ed. Ludger Honnefelder, Rega Wood and Mechthild Dreyer, 35-57. Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalter 53. Leiden: E. J. Brill, 1996.
251 Archa Verbi. Subsidia 6
251–268
Absolutisme théologique et contingence : la réception de la pensée scotienne de la volonté chez Blumenberg et Arendt François Loiret
En elle-même, l’expression « la postérité de Duns Scot » est ambiguë. Elle peut être lue aussi bien au sens d’une postérité sans Duns Scot que d’une postérité avec Duns Scot. Toutefois, elle suppose que postérité il y a. Or si avec Blumenberg, nous pouvons parler d’une postérité de Duns Scot sans Duns Scot, avec Hannah Arendt, nous pouvons parler d’un Duns Scot sans postérité. Hans Blumenberg et Hannah Arendt nomment les deux grandes réceptions contemporaines de la pensée scotienne de la volonté. Mais alors que Blumenberg, en vertu même de son propos, arrête la pensée de Duns Scot dans la figure d’une époque finissante et le fixe dans la succession des époques, Arendt l’arrache délibérément à un ancrage chronologique et du même coup à la successivité des époques. Pour les deux, la pensée du Docteur subtil est avant tout une pensée de la volonté, mais pour l’un la volonté scotienne se dresse comme absolutisme divin caractéristique à la fois d’une époque qui s’accomplit et d’un tournant historique. Pour l’autre, la volonté scotienne est avant tout irruption de la libre contingence, irruption qui n’est jamais inscrite dans une époque et ininscriptible dans une succession. I Absolutisme théologique scotiste et insécurisation du monde. Le fil conducteur de l’approche de Duns Scot par Hans Blumenberg dans La Légitimité des Temps modernes n’est rien d’autre que l’insécurisation du monde. L’absolutisme théologique conduit à la perte du monde, c’est-à-dire à la destruction d’une présence humaine qui puisse se fier au monde. L’éloignement d’un Dieu désormais absolu, c’est-à-dire délié, rend le monde incertain et prépare l’affirmation de soi de l’homme qui définit les Temps Modernes, car cette affirmation de soi est projet de sécurisation du soi par la sécurisation du monde. C’est donc à partir du motif de l’affirmation de soi comme motif typique des Temps modernes que Blumenberg est conduit à lire la pensée médiévale en général, Duns Scot en particulier. 1. Les traits fondamentaux de l’absolutisme théologique. L’absolutisme théologique, selon Blumenberg caractérise la pensée scolastique dans son ensemble d’Albert le Grand à Ockham1. Il n’en reste pas moins 1
Blumenberg, La Légitimité des Temps Modernes, 191, n. 1 et 2.
252
François Loiret
que pour le traitement de ce problème la figure de Duns Scot demeure pour le philosophe la figure privilégiée. Avec le Doctor subtilis, en effet, l’absolutisme théologique se présente ouvertement comme absolutisme volontariste et cet absolutisme volontariste ouvre la voie à l’affirmation moderne de soi. Toutefois, la métaphysique moderne comme métaphysique de l’affirmation de soi n’est pas une métaphysique de l’absolutisme divin, elle ne peut être une métaphysique de l’affirmation de soi qu’en y renonçant complètement. C’est pourquoi, si l’absolutisme théologique est bien le trait typique de la théologie scotiste, la postérité de Duns Scot ne peut être qu’une postérité sans Duns Scot. Aussi la théologie scotienne de la potentia absoluta Dei ne saurait être le précurseur de la métaphysique moderne2. À partir de La Légitimité des Temps Modernes, on peut déterminer l’absolutisme théologique en général selon quatre axes qui seraient à l’œuvre chez Duns Scot : 1 – la réduction de la Providence divine ; 2 – la déliaison de la Création et de la créature humaine ; 3 – la destruction de tout rapport de motivation entre l’Incarnation et le salut des créatures humaines ; 4 – la circularité de l’amour divin. Il va de soi que ces quatre axes ne concernent pas seulement la théologie de Duns Scot, mais c’est en référence constante à celle-ci que Blumenberg les déploie. La Providence divine est d’emblée réduite, depuis son coup d’envoi augustinien, en ce qu’elle ne vaut que pour les élus. L’élection et la grâce tracent un partage originaire entre les créatures humaines puisque c’est pour les élus et les grâciés que Dieu a voulu la Création. C’est une thèse que soutiendrait avec d’autres docteurs Duns Scot comme en témoignerait la distinction 33 du Commentaire des Sentences où il avance que « Dieu veut le monde sensible dans l’ordre pour le prédestiné »3. Cette réduction de la Providence divine pourrait laisser croire qu’il existe un rapport de motivation entre la Création et le salut, du moins le salut de quelques uns, mais cette illusion disparaît dès que l’on aborde le second axe, à savoir la déliaison de la Création et de la créature humaine. En créant, Dieu n’aurait pas en vue l’homme, il n’aurait en vue que luimême, la seule manifestation de sa présence comme puissance absolue. La création ne serait au fond ni voulue ni faite en vue de l’homme, mais dans sa formation volontariste extrême, qui est sa formulation scotiste, elle serait un fiat absolu, arbitrairement absolu car rien ne doit venir limiter la puissance absolue, nous dit Blumenberg, y compris des motifs qui favoriseraient l’homme 2
3
Contrairement à ce que soutient André de Muralt, pour qui les Temps Modernes trouveraient dans la théologie de Duns Scot toutes leurs armes conceptuelles, voir notamment : Muralt, L’enjeu de la Philosophie médiévale. Ord. III d. 32 q. un. n. 6, ed. Wad. VII,2, 693. Toutefois le texte est plus complexe que ce qu’en veut montrer Blumenberg qui ne tient pas compte d’un « sive […] sive ». Duns Scot écrit en effet : « Sive igitur quia Deus vult mundum sensibilem in ordine ad hominem praedestinatum, sive quia quodammmodo vult immediatius hominem amare se, quam mundum sensibilem esse : homo erit finis mundi sensibilis ». Dans la seconde formulation, il n’est plus question du seul prédestiné, mais de l’homme : c’est l’homme qui est la fin du monde sensible de sorte que Dieu veut d’abord l’homme et ensuite le monde sensible.
Absolutisme théologique et contingence
253
dans le projet de la création. Le monde n’étant pas créé en vue de l’homme, ce dernier s’en trouve donc a priori éjecté : la création lui est étrangère et il ne peut y être qu’un étranger puisque son ordre lui est totalement illisible. Si la Création est un fiat absolu dans lequel l’homme n’est en rien concerné, l’incarnation ne viendrait-elle pas limiter la puissance absolue divine ? La formule du concile de Nicée selon laquelle Dieu a créé le Christ pour l’amour de l’homme apparaît incontournable. Mais avec Duns Scot le rapport de motivation entre Création et Incarnation serait ouvertement brisé en vertu de la théorie de la prédestination absolue du Christ. Cette théorie, avance Blumenberg, n’hésite pas à substituer au « propter nos homines » du concile de Nicée un « propter se ipsum »4. Chez Duns Scot, l’incarnation ne trouverait plus sa motivation dans le salut de l’homme, car ce serait lier la puissance absolue divine et, en la liant, la détruire dans son absoluité. Le théologien écossais produirait ainsi la théorie théologique de l’absolutisme divin la plus conséquente en attribuant à la chute de l’homme le statut de cause simplement occasionnelle de l’incarnation5. La théorie scotiste de la prédestination absolue du Christ permettrait de comprendre l’incarnation comme un processus entièrement compatible avec la puissance absolue divine dans lequel le Dieu trine se rapporte avant tout à lui-même et se glorifie lui-même en glorifiant le Christ. Si l’on admet cette approche de la théologie scotiste, on peut cependant lui objecter qu’elle fait totalement l’impasse sur l’amour comme relation forte de Dieu à l’homme. Or Blumenberg balaye brutalement cette objection en mettant en valeur le quatrième axe de l’absolutisme théologique, la circularité du rapport de Dieu à lui-même : « [...] dans le théocentrisme parfait dans lequel débouchait la scolastique, l’idée aussi centrale qu’édifiante de Duns Scot que le rapport de Dieu au monde et à l’homme doit être compris à partir du motif de l’amour, cette idée à peine exprimée, est dénigrée en la circularité grotesque du schéma aristotélicien, pour lequel ce ne peut être pour ainsi dire que le détour par lequel Dieu s’aime lui-même en élisant au sein de la totalité des hommes ceux auxquels il inspire de l’amour »6 . 4
5
6
« Malgré la formule univoque du symbole de Nicée selon laquelle Dieu est devenu homme pour l’amour de l’homme (« propter nos homines […] homo factus est ») apparaît la théorie singulière de Duns Scot affirmant la prédestination absolue du Christ, qui transforme le « propter nos homines » en un « propter se ipsum ». Blumenberg, La Légitimité des Temps Modernes, 194. Léon Veuthey rapporte que le premier à avoir posé la question : si Adam n’avait pas péché, le Verbe se serait-il incarné ? semble être Rupert. Selon Rupert, dit Veuthey, « le péché n’est pas la raison de l’incarnation, mais seulement raison du fait de sa venue dans une chair passible, c’est-à-dire capable de souffrir et mourir ». Veuthey, Jean Duns Scot. Une position très proche se trouve à la même époque dans le Libellus octo quaestionum d’Honorius d’Autun pour lequel la prédestination du Christ est indépendante du péché. Veuthey remarque toutefois que « cette doctrine, déjà si avancée au début du XIIe siècle, fut combattue ensuite par la généralité des théologiens et par les plus grands, comme saint Bonaventure et saint Thomas » Ibid., 91. Duns Scot donne résolument une forme affirmative à une doctrine qui demeurait hypothétique chez Rupert et Honorius d’Autun. Blumenberg, La Légitimité des Temps Modernes, 195. Léon Veuthey distinguait pour sa part
254
François Loiret
Dans la théologie scotiste, le motif de l’amour ne viendrait pas restaurer la relation privilégiée de Dieu à l’homme mise à mal par tout le développement de la pensée scolastique, car l’homme, et plus précisément les élus, ne jouent qu’un rôle de médiation dans le processus circulaire de l’amour qui partant de Dieu revient à Dieu. Ni l’incarnation, ni la création, ni le salut des élus ne seraient en vue de l’homme, mais en vue de Dieu seul. Dieu est absolu signifierait alors : il s’absout de toute relation essentielle à l’homme. Le résultat de toute cette entreprise qui culmine dans la théologie scotiste, c’est, nous dit Blumenberg, que « le fil directeur de l’idée de Création pour la compréhension de soi de l’homme était rompu »7. En résumé, Dieu a avant tout affaire à lui-même et ne saurait compromettre son absoluité avec la créature humaine qui n’est plus que médiatisée et instrumentalisée au profit de la pure activité divine. Alors que Dieu se retire dans la hauteur de son énigmatique puissance absolue et devient incompréhensible pour l’homme, l’homme devient pour lui-même une énigme et le monde lui devient étranger en ce sens qu’il ne dispose plus d’aucune clé et d’aucun lieu qui l’assurerait de sa place et de son rôle dans le tout de la Création. Comme le monde devient illisible pour l’homme, se produit alors une insécurisation de l’homme et du monde dont le corrélat est une diminution des vérités disponibles. L’exigence de certitude que les Temps modernes produiront est, selon Blumenberg, le contre-coup de l’absolutisme théologique et du rôle que joue la potentia absoluta, particulièrement chez Duns Scot et Ockham. Le nouveau fil conducteur exigé par l’insécurisation doit permettre de produire des certitudes assurant l’homme de sa propre présence et de sa présence dans le monde : ce sera l’affirmation de soi comme tâche des Temps Modernes dont le corrélat est une nouvelle détermination de la scientificité. Mais dans le même mouvement par lequel il produirait l’insécurité absolue pour la créature humaine en produisant la sécurité absolue pour Dieu, l’absolutisme théologique détruirait à la racine l’édifice médiéval. L’accomplissement scotiste de l’absolutisme théologique serait à la fois l’auto-destruction de l’absolutisme théologique qui caractérise la scolastique et l’auto-destruction de la construction médiévale
7
deux types d’amour chez Duns Scot, l’éros et l’agapé, l’amour métaphysique et l’amourdonation. L’amour métaphysique est l’amour que Dieu se porte à lui-même et c’est cet amour de soi divin qui porterait Dieu à la création et à l’incarnation. Commentant Reportata Parisiensa, III d. 7 q. 4, Veuthey écrit : « Voulant obtenir de la création un amour infini, Dieu veut d’abord le Christ en qui tout est ordonné au suprême amour ». L’éros divin présenterait donc bien la circularité aristotélicienne dont parle Blumenberg. Selon Veuthey, la plupart des approches de l’amour chez Duns Scot méconnaissent cette distinction fondamentale entre l’amour divin comme amour de soi et l’amour divin comme charité. Le Docteur subtil, soutient Veuthey, « fait clairement de la charité l’amour désintéressé, l’amour-donation, alors que l’espérance est l’amour intéressé, l’amour-désir. Mais cela n’empêche pas que l’amour qui préside au développement de l’opération divine ad intra et ad extra, selon les écrits de Duns Scot, soit l’amour de soi, l’éros grec. Et les auteurs des synthèses scotistes autour de de l’agapé, de l’amour-donation, faussent la perspective historique », Jean Duns Scot, 179. Ibid., 197.
Absolutisme théologique et contingence
255
depuis son coup d’envoi augustinien, dans la mesure où il correspond à un retour de la gnose. 2. Retour de la gnose et appropriation de la théologie aristotélicienne. En quoi l’absolutisme théologique en général et la théologie scotiste en particulier seraient-ils un retour de la gnose ? En ce que le Dieu souverain qui se retire dans l’abîme énigmatique de sa puissance absolue ne se soucie au fond que de soi et n’est plus du même coup identifiable au Dieu du salut. La différenciation gnostique du Dieu créateur et du Dieu du salut avancée par Marcion revient de manière voilée dans la théologie du Dieu absolu. Mais pourquoi peut-on parler d’un « retour » de la gnose ? Pour Hans Blumenberg, la gnose est le défi initial à partir duquel se construit la pensée médiévale de sorte que le Moyen Âge n’est pas un dépassement mais une transposition de la gnose8. Dès Augustin le dualisme gnostique demeure conservé à la faveur de son déplacement au cœur de l’humanité elle-même par la séparation des élus et des bannis. Cette séparation a un effet en retour sur Dieu lui-même puisque la théorie de la prédestination fait assumer cette séparation par Dieu lui-même de sorte qu’Il devient responsable en dernière instance du poids de la corruption du monde qu’Augustin voulait lui ôter9. À partir de la riposte augustinienne, la gnose hanterait comme son ombre la pensée médiévale et se trouverait réaffirmée de manière implicite avec l’appropriation scolastique de la théologie d’Aristote. La distance entre le Dieu biblique lié à la créature humaine, à son action, son histoire et son salut, et le Dieu de la théologie scolastique semble étrange si l’on ne saisit pas que le Dieu de la scolastique est construit dans et par une reprise de la théologie philosophique grecque, et surtout celle d’Aristote. La pensée scolastique assumerait entièrement l’autarcie divine aristotélicienne sans pouvoir en saisir le motif. L’autarcie divine grecque était motivée, nous apprend Blumenberg, par l’opposition de la philosophie à l’arbitraire des dieux du culte traditionnel. Elle faisait partie, avec l’insensibilité divine, des « mesures de protection » prise par la philosophie contre des dieux erratiques et capables de tout, mesures qui sauvent Dieu de toute compromission avec le monde10. 8
9
10
Ibid., 146 : « Le point essentiel est le fait que le dernier saint Augustin, le théologien du péché originel et de la prédestination, allait être la source et l’autorité la plus importante de la spéculation théologique de la fin du Moyen-Âge. La gnose non dépassée mais seulement transposée revint sous la figure du Dieu caché et de sa souveraineté incompréhensible ». Ibid. : « le dualisme gnostique était éliminé au profit du principe métaphysique universel mais il survivait, au sein de l’humanité et de son histoire, dans la séparation absolue des élus et des bannis. Cette crudité inventée pour la justification de Dieu a son ironie cachée dans le fait que, par le détour de l’idée de la prédestination, est réintroduite la responsabilité du principe absolu pour la corruption cosmique, dont toute l’entreprise visait à l’élimination. Pour ce péché-ci, dans sa répercussion universelle, seul le fondement originel des choses lui-même pouvait être rendu en fin de compte responsable – la massa damnata n’avait plus qu’à en supporter les conséquences ». Ibid., 195 : « En réalité, le Dieu de la haute scolastique était plutôt la conséquence para-
256
François Loiret
L’absolutisme théologique réassume les mesures immunitaires de la philosophie grecque ou plutôt les « réinvestit », mais cette fois contre le Dieu biblique lui-même et contre sa créature humaine. En élevant Dieu et sa puissance absolue au-delà de toute compréhension, en défaisant le lien de Dieu et du Christ à la Création et au salut, il protège assurément la transcendance divine et l’immunise contre le monde et les hommes. Cette immunité divine qui réinvestit l’autarcie divine des Grecs aboutirait néanmoins à une destruction, interne à la théologie, du Dieu biblique. L’apothéose de cette destruction n’est rien d’autre que la conception de l’amour divin comme amour que Dieu se rend à lui-même en instrumentalisant la créature humaine. Avec Duns Scot, soutient Blumenberg, nous n’avons pas tant une réaffirmation de la primauté de l’amour chrétien qu’une aristotélisation de l’amour divin qui devient alors un amour circulaire. 3. Duns Scot contre la Gnose. On peut relever, comme l’a fait Blumenberg, combien la pensée augustinienne reste marquée par la gnose et son combat contre la gnose, mais ce qui vaut pour Augustin, ne vaut pas pour toute la théologie catholique. La théologie de Duns Scot est en ce sens une théologie qui ne correspond en rien à un retour de la gnose. La théorie scotienne de la rédemption, dans sa rupture avec l’augustinisme, est aussi une rupture avec les restes gnostiques de la pensée augustinienne comme l’a souligné avec force Claude Tresmontant : « Le coup de génie du bienheureux Duns Scot ce fut, malgré l’influence dominante, on peut dire écrasante de saint Augustin sur l’Église latine, de voir qu’en réalité le Christ est bien plus, beaucoup plus que rédempteur, et que la Rédemption n’est pas la raison principale, exclusive du Christ. Le Christ est la finalité ultime de la Création »11.
La force de la théologie scotiste de l’absolutisme divin n’est pas de briser le lien de Dieu et de l’homme, mais de détruire ce lien marqué par la faute et la vengeance qui caractérisait la doctrine de la Rédemption depuis Augustin. La critique courtoise, mais ferme, de la compréhension anselmienne de la Rédemption va tout à fait dans ce sens. Duns Scot, introduit une subtile
11
doxale de toutes les « mesures de protection » qui avaient été prises par la philosophie des Grecs contre l’arbitraire des dieux mythiques dans leur fréquentation des hommes – sauf que ce motif de la « protection » était devenu tout à fait méconnaissable pour la scolastique (comme des motifs se perdent pour toute sorte de scolastique) lorsqu’elle crut reconnaître dans le Dieu d’Aristote son propre Dieu et pouvoir le rendre démontrable ». Tresmontant, La Christologie, 25. L’auteur écrit auparavant : « En Occident latin, c’est saint Augustin qui a imposé largement sa vision du monde quelque peu touchée ou léchée, comme disent les médecins, par la gnose manichéenne ». À l’encontre de ce que soutient Blumenberg, Tresmontant affirme plus loin l’infidélité de la grande pensée scolastique à l’augustinisme : « Les grands scolastiques rompaient donc avec la tradition platonicienne dominante depuis saint Augustin chez les latins, et Origène d’Alexandrie chez les Grecs », ibid., 49.
Absolutisme théologique et contingence
257
distinction entre la prédestination du Christ et la passion du Christ. Contre la tradition augustinienne en général, et contre Anselme en particulier, il brise effectivement le lien entre la prédestination du Christ et la Rédemption : la prédestination du Christ est indépendante en elle-même de la faute de l’homme, elle ne trouve pas en elle sa raison12. Aux saints qui affirment que la prédestination du Christ a sa raison dans la chute de l’homme, Duns Scot répond sans équivoque : « Igitur fuit primo praedestinatum – ante omnia merita – ad gloriam, et multo magis ante omnem culpam : igitur ante lapsus hominis »13. Or si la prédestination du Christ n’est pas en raison de la chute de l’homme, la passion du Christ l’est bien, car sans la chute de l’homme, le Christ n’aurait pas souffert la passion, même s’il la souffert librement : « Verumtamen si non fuisset homo lapsus, non fuisset Christu homo natus ad patiendum et sustinendum passiones et ignominias : haec enim sustinuit propter reparationem naturae lapsae »14. Le Christ a souffert la passion en rémission des péchés, mais il n’est pas venu en rémission des péchés. L’idée que la prédestination du Christ aurait pour raison la chute de l’homme suppose que Dieu aurait été atteint dans son honneur et sa dignité par cette chute, elle suppose donc un Dieu non seulement jaloux, mais aussi vengeur. Or, du point de vue de Duns Scot, cet argument d’Anselme ne tient pas, car comment un être fini pourrait-il causer un dommage infini à un être infini ? Dieu ne peut en rien être atteint par la faute de l’homme, le dommage que l’homme cause par sa faute n’est pas un dommage envers Dieu, mais envers l’homme lui-même et la Création. Dans cette mesure, la passion que souffre le Christ pour le salut des hommes n’est pas une réparation du dommage subi par Dieu, elle est un libre acte d’amour. Dieu veut librement que les hommes soient sauvés et le Christ veut librement souffrir la passion pour le salut des hommes15. En présentant sa conception de la prédestination du Christ, le docteur subtil fait d’ailleurs référence à sa conception de la prédestination de l’homme selon laquelle les élus sont prédestinés à la vie indépendamment de toute 12
13 14 15
Sur l’opposition de Duns Scot à la théorie anselmienne de la Rédemption, nous renvoyons à la lumineuse conférence du Père Luc Matthieu : Matthieu, « Était-il nécessaire ? ». Claude Tresmontant avait déjà attiré l’attention sur cette opposition puisqu’il écrit : « La raison d’être du Christ est donc beaucoup plus que de réparer la faute orginelle, puisque c’est en lui, par lui, avec lui qu’est en réalité créé l’Homme véritable que Dieu envisage depuis les origines ou avant les origines de l’univers. Combien nous sommes loin de la perspective augustinienne, reprise et aggravée par Saint Anselme de Cantorbéry, reprise et aggravée encore plus par Martin Luther, Calvin et Jansénius, - perspective selon laquelle la raison d’être du Christ est seulement ou du moins principalement d’obtenir à notre place le pardon de Dieu pour la faute originelle et de réparer les dégâts ». Tresmontant, La Christologie, 46 (nous soulignons). Lect. III d.7 q.1-2 appendix, ed. Vat. XX, 446. Ibid., 447. Comme le rappelle Luc Mathieu, la passion du Christ est tout à fait contingente : le Christ aurait pu rédimer les hommes d’une toute autre manière, mais s’il la fait en donnant sa vie pour les hommes, il faut voir dans ce don, un suprême acte d’amour qui est en même temps un suprême acte de justice.
258
François Loiret
prévision de la condamnation à la peine, c’est-à-dire indépendamment de la chute. Dans la lecture qu’en fait Blumenberg, la conception de cette prédestination des élus chez Duns Scot confirmerait le retour de la gnose dans la pensée scolastique à la faveur de l’acceptation du modèle aristotélicien du divin. Dieu prédestinerait certains hommes, les élus, afin que ceux-ci l’aiment. Autrement dit, Dieu n’aimerait les hommes et la Création que pour être aimé par eux de sorte que les hommes seraient les instruments d’un amour qui partant de Dieu revient à Dieu. Or ce n’est pas du tout l’intention de Duns Scot comme le montre très bien la compréhension qu’il élabore de l’amour de soi divin. Il y affirme que l’amour de soi divin est un amour ordonné et, comme tel, n’est pas un amour jaloux ou envieux : « [...] qui enim amat se ordinate, et per consequens non inordinate zelendo, vel inviendo isto modo, secundo vult habere alios diligentes : et hoc est velle alios habere amorem suum in se, et hoc est praedestinare eos, si velit eis hoc bonum finaliter »16.
Dieu ne s’aime pas d’un amour jaloux de sorte qu’il se réserverait à lui seul la jouissance de l’essence divine. Si, comme le soutient Veuthey, l’amour de soi divin était de l’ordre de l’éros, il serait nécessairement un amour jaloux et envieux qui impliquerait que Dieu seul puisse jouir de l’essence divine. En excluant que l’amour de soi divin soit un amour jaloux, Duns Scot exclut d’avance qu’il soit de l’ordre de l’éros. Dieu en s’aimant jouit de la suprême béatitude et ce qu’il veut, ce n’est pas du tout que d’autres l’aiment. On se demande quel sens aurait pour Dieu un tel amour : rigoureusement parlant, Dieu qui s’aime infiniment et qui jouit donc infiniment de lui-même, n’a absolument pas besoin de l’amour des hommes. Il n’est habité par aucun désir de reconnaissance. Aussi, lorsque Duns Scot déclare que Dieu veut que d’autres l’aiment, il faut comprendre par là que Dieu veut que d’autres que lui jouissent du bonheur dont il jouit, et rien d’autre. Dieu veut donc librement et gratuitement que d’autres que lui aient le même objet d’amour. En ce sens, il veut que d’autres que lui puissent accéder à l’amour infini et à la jouissance infinie. L’essence divine, bien suprême, n’est pas un bien que Dieu se réserve, mais un bien qu’il offre aux hommes, et ce avant toute prévision de la chute et toute rédemption. L’amour est toujours co-amour : aimer, ce n’est pas du tout vouloir être aimé, c’est vouloir que ce qu’on aime soit aimé par d’autres, c’est vouloir que d’autres jouissent de ce dont on jouit et c’est en ce sens qu’il faut comprendre l’affirmation de Duns Scot selon laquelle Dieu veut que d’autres que lui l’aiment. Nous ne sommes pas en présence d’un cercle aristotélicien, mais de la surabondance de l’amour divin et de la libéralité divine. Hannah Arendt va jusqu’à parler de l’amour chez Duns Scot comme d’une acceptation sans conditions. Dieu pour Duns Scot n’a créé les hommes, souligne Hannah Arendt « que parce qu’il voulait leur existence » et il les aime sans les désirer, c’est-à-dire sans les vouloir posséder. En ce sens, tout acte de création divin est 16
Ord. III d. 32 q. un n. 5, ed. Wad. VII, 592.
Absolutisme théologique et contingence
259
un acte d’amour, aussi bien la création du Christ que la création de l’homme. Le cercle téléologique est brisé par l’amour que Dieu porte à la Création et dont nous sommes capables et cet amour selon la formule lapidaire que Hannah Arendt emploie, a le sens de « Je veux que tu sois ». Contrairement à ce que soutient Blumenberg, l’absolutisme théologique de Duns Scot demande à être compris non dans les termes d’une insécurisation de la situation de l’homme dans le monde inextricablement liée à un retour de la gnose, mais dans le contexte d’une théologie de la liberté qui est aussi une théologie de l’amour. Cet absolutisme théologique chez Duns Scot ne peut pas être abordé indépendamment de la contingence qui est, nous indique Hannah Arendt, le prix que l’on paye joyeusement pour la liberté. II La primauté du moi voulant et l’expérience de la contingence Alors que Blumenberg, dans son regard rétrospectif, nous amenait à voir dans la pensée scotienne de la volonté un forme d’accomplissement de la scolastique menée jusqu’à son autodestruction, Hannah Arendt, par son regard prospectif, nous invite plutôt à y voir une pensée sans égale de la volonté, une expérience sans précédent du moi voulant qu’il n’est pas possible d’inscrire commodément dans les chronologies historiques auxquelles nous sommes habitués. 1. L’impossible assignation historique À la fin du chapitre consacré à Duns Scot dans Le Vouloir, Hannah Arendt s’écrie : « J’ai essayé de montrer qu’on ne rencontre pas chez Duns Scot de simples renversements conceptuels, mais de véritables trouvailles qui, toutes, sans aucun doute, pourraient s’expliquer comme condition spéculatives d’une philosophie de la liberté »17.
Duns Scot n’est pas en arrière de nous dans la période heureusement quittée de l’absolutisme théologique, à laquelle seule des penseurs conservateurs seraient encore fidèles, mais en avant de nous puisqu’il nous propose les « conditions spéculatives d’une philosophie de la liberté », étant donné que cette philosophie de la liberté ne s’est pas encore déployée. Quelles sont donc ces fameuses « trouvailles » par lesquelles la pensée scotienne va à contre-courant de la tradition philosophique d’une manière inaperçue ? Hannah Arendt évoque la réfutation du vieux philosophème selon lequel tous les hommes veulent être heureux (elle parle même ici du « vieux cliché »), la conception d’une activité qui trouve en elle-même son repos, l’idée du caractère délectable de l’expérience du vouloir (par différence avec le topos philosophique du caractère délectable de l’expérience du moi pensant), la considération de 17
Arendt, La Vie de l’Esprit, le Vouloir, 170.
260
François Loiret
la nécessité comme d’une erreur due au moi pensant, et surtout l’approche positive de la contingence contre toute la tradition philosophique antérieure et postérieure18. Selon Hannah Arendt, les trouvailles de Duns Scot ne sont pas à trouver du côté de la pensée de l’étant en tant qu’étant, du côté d’une philosophie première, elles sont à trouver du côté de la pensé de la volonté. Les « trouvailles » sont à la fois sans précédent et sans suite, elles n’ont ni prédécesseurs ni successeurs. Aussi après avoir déclaré qu’on ne peut trouver à Duns Scot « une case confortable entre ses prédécesseurs et ses successeurs dans l’histoire des idées »19, Hannah Arendt radicalise son propos en allant jusqu’à dire : « La simple vérité est que s’agissant de l’essence de sa pensée – la contingence, prix qu’on paye joyeusement en échange de la liberté – il n’a ni prédécesseurs ni successeurs »20. Cette contingence n’est pas seulement sans prédécesseurs dans sa conception, elle l’est aussi dans son estimation : la contingence n’est pas en soi le prix que l’on paye pour habiter le cul de basse fosse de l’univers comme chez Aristote. Sans prédécesseurs, elle est sans successeurs, dans la mesure où elle est encore l’objet d’un désaveu dans la pensée moderne au profit de la nécessité. Et cela caractérise même la pensée contemporaine21. Nous nous trouvons donc avec l’approche de la pensée du Docteur subtil par Hannah Arendt dans la singulière situation d’aborder la postérité d’une pensée sans postérité. 2. Le terrain d’une rencontre On ne peut comprendre le statut singulier de Duns Scot dans la démarche de la philosophe sans mettre en place des traits fondamentaux de sa pensée qui montrent à quel point s’établit une intime résonance entre ses thèses et celles de Duns Scot. Ce que Hannah Arendt lit avant tout chez Duns Scot, c’est une considération positive de la contingence, une attention au singulier, une valorisation de la vita activa ou du bios praktikos. S’il y a bien quelque chose de terrifiant pour Hannah Arendt dans la tradition philosophique et scientifique, c’est le privilège de la nécessité qui est en même temps privilège de l’universel, plus précisément du générique, et privilège du théorétique. Ce privilège se traduit d’un côté par le despotisme du 18
19 20 21
Ibid. : « L’idée qu’il puisse exister une activité qui trouve son repos en elle-même est aussi étonnamment originale — sans précédent et sans suite dans l’histoire de la pensée occidentale — que la préférence ontologique que manifeste Duns Scot pour le contingent plutôt que pour le nécessaire, pour le particulier existant plutôt que pour l’universel ». On remarquera que les « trouvailles » évoquées par l’auteur caractérisent son propre cheminement. Qu’est-ce que la Politique ? s’insurge dès le début contre le privilège philosophique du générique qui aboutit à manquer les affaires humaines qui concernent non le genre humain, mais des hommes singuliers, le politique n’ayant pas son lieu dans l’universel, mais dans l’espace entre les singularités humaines. Ibid., 156 Ibid., 157. Ibid., 47 : « Ce qui ne fait aucun doute, c’est que ce préjugé contre le contingent, le particulier et la volonté – et la prédominance concomitante de la nécessité, l’universalité, l’intellect – ont résisté aux attaques jusqu’à une date avancée de l’époque moderne ».
Absolutisme théologique et contingence
261
logique et d’un autre côté par la négation de la liberté. Aux yeux de Hannah Arendt, les philosophes, comme représentants par excellence de l’attitude théorétique, et aussi les hommes de science, ont éprouvé une méfiance vis-àvis de la liberté en laquelle, dit-elle, ils ont rarement reconnu une bénédiction, méfiance qui va de pair avec le peu de dignité reconnu aux affaires humaines. Il en résulte qu’à la différence de la pensée, la volonté rencontre très souvent, y compris dans la philosophie contemporaine, l’objection de sa possible inexistence : la volonté libre est considérée comme une illusion22. Cette négation philosophique de la volonté demeure, malgré tous les sophismes des philosophes qui prétendent concilier liberté et nécessité, une négation de la liberté. En ce sens, la rencontre de Hannah Arendt avec Duns Scot a une dimension décisive dans la mesure où elle lit chez lui la révocation du privilège métaphysique de la nécessité, à savoir de ce que Duns Scot nommait la « nécessité naturelle ». Hannah Arendt a retenu de Duns Scot l’idée d’une nécessité implacable des processus intellectuels, nécessité qui se manifeste dès que le moi pensant envisage les événements du monde et, particulièrement, les affaires humaines23. Pour le moi pensant, ce qui a eu lieu est tel qu’il ne pouvait pas ne pas avoir lieu et même devait avoir lieu. Les événements du monde ne peuvent avoir une dignité métaphysique que s’ils sont aussi enchaînés les uns aux autres que le sont des propositions logiques ou mathématiques. S’emparant de l’actuel, le moi pensant le voit non comme impossible, mais comme nécessaire, d’où la tentation d’envisager les affaires humaines en terme de processus nécessaires au même titre que tout autre processus24. Hannah Arendt ne se contente pas ici d’élucider la pensée de Duns Scot, elle y souscrit complètement. Le moi pensant n’est pas le moi libre, et sa tendance est de nier la liberté dans le monde. La négation de la volonté libre au nom de la nécessité, ou du moins sa dévalorisation, est une négation ou au moins une dévalorisation de la contingence. Avec la volonté libre, soutient Hannah Arendt, c’est la contingence qui 22
23
24
Ibid., 18 : « L’obstacle majeur, chaque fois qu’on discute de la volonté, c’est tout simplement qu’il n’est pas d’autre capacité de l’esprit dont l’existence ait été mise en doute et contredite avec autant de persistance par une galerie aussi impressionnante de philosophes ». Arendt, La Pensée, 78 : « L’intellect, organe du savoir et de la connaissance, est encore de ce monde ; à en croire Duns Scot, il est soumis à l’emprise de la nature, cadit sub natura et traîne derrière lui toutes les nécessités auxquelles est astreint l’être humain avec ses organes sensoriels et son intelligence ». Arendt, Le Vouloir, 162 : « Rien, à la vérité, ne pourrait contredire de façon plus flagrante toutes les traditions philosophiques que cette insistance [de Duns Scot] sur le caractère contingent des processus (il n’est que de penser au nombre de volumes écrits pour expliquer la nécessité qui a conduit aux deux dernières guerres, chaque théorie sélectionnant une cause unique différente – quand, en fait, rien n’est plus plausible que la coïncidence de plusieurs causes auxquelles une dernière est venue s’ajouter, dans la « cause contingente » des deux explosions ». On reconnaîtra ici la théorie scotienne des causes concourantes partielles appliquée au champ de l’histoire.
262
François Loiret
se manifeste par excellence dans la mesure où, dit-elle d’une manière quasi scotienne, « rien ne peut être plus contingent que les actes voulus qui – si l’on admet la libre volonté – peuvent tous se définir comme des actes dont je sais que j’aurais pu ne pas les accomplir. Une volonté qui n’est pas libre est une contradiction dans les termes »25.
Duns Scot effectivement ne disait pas autre chose. Si l’on explicite ce que la philosophe entend par volonté libre, la proximité est encore plus grande. En effet, le seul libre arbitre ne suffit pas du tout à caractériser la liberté de la volonté, soutient Arendt, car le libre arbitre s’en tient à des options déjà présentes comme possibles, de sorte que lui fait défaut ce qui caractérise la volonté dans sa liberté native, à savoir le pouvoir de commencer. La volonté libre est donc avant tout au sens de Hannah Arendt, « le messager possible de la nouveauté »26, à savoir le pouvoir de commencer. Le règne de ce que Arendt nomme « nécessité » et Duns Scot « nécessité naturelle » correspond à l’impossibilité radicale d’un commencement, c’est-à-dire dans les termes de la tradition, à la négation de toute spontanéité libre. Une volonté qui serait causée à causer ne serait pas libre soutenait Duns Scot et, en effet, étant causée, elle serait incapable de commencement. Or dès qu’il y a commencement, il y a impossibilité d’intégrer le nouveau qui apparaît à un processus nécessaire, aussi le nouveau a-t-il le caractère de la contingence. C’est pourquoi Hannah Arendt soutient que le prix à payer pour la volonté libre comme pouvoir de commencer est la contingence et ce prix la plupart des philosophes et des théologiens ne sont pas prêts à le payer27. À partir de là, nous pouvons comprendre le statut singulier de Duns Scot dans la démarche de Hannah Arendt : il est l’un des rares, sinon même le seul, à avoir accepté de payer le prix de la contingence en échange de la liberté de la volonté. A la fin du Vouloir, Hannah Arendt s’écrie : « Parmi tous les philosophes et théologiens à qui nous avons fait appel, Duns Scot seul – nous l’avons vu – était prêt à payer le prix de la contingence en échange du don de liberté — capacité mentale de mettre en route quelque chose de nouveau, dont on sait que cela pourrait ne pas exister »28. 25 26 27
28
Ibid., 27. Ibid., 31. Ibid., 277-278 : « Les penseurs de profession, philosophes et hommes de science, ne sont pas « satisfaits de la liberté » et de son inéluctable « au petit bonheur » : ils se montrent réticents à payer le prix de la contingence, en échange du cadeau douteux que représente la spontanéité, le pouvoir de faire ce qu’on pourrait laisser tranquille ». L’expression « ce qu’on pourrait laisser tranquille » ne témoigne pas d’un activisme chez Hannah Arendt, elle est à comprendre en référence au privilège intellectuel de la quiétude ou de la sérénité, car la volonté libre, à la différence de la pensée, ne laisse pas en repos. Ibid., 224.
Absolutisme théologique et contingence
263
Sans une approche positive de la contingence, il ne peut y avoir de commencement et donc de nouveauté. En ce sens, Hannah Arendt rencontre, dans l’affirmation par Duns Scot du caractère contingent aussi bien de la Création que de l’Incarnation, l’expression de la nouveauté et donc du commencement. Comme lui, elle soutient que le commencement suppose la liberté de la volonté. 3. Duns Scot, penseur de la volonté comme telle Duns Scot est le penseur par excellence du moi voulant. Certes, le moi voulant surgit avant Duns Scot chez Paul et Augustin, mais certainement pas, souligne Hannah Arendt, chez Épictète et les stoïciens. La compréhension de la liberté chez Épictète demeure une compréhension antique de la liberté : Épictète ignore comme les Anciens le « je veux » et ne connaît que le « je peux »29 . Chez lui a lieu seulement une intériorisation du « je peux » au sens où le « je peux » se restreint et dans cette restriction à ce qui ne dépend que de lui manifeste sa liberté. Il n’y a là aucune place pour le dédoublement du vouloir en vouloir et en ne pas vouloir30. Le consentement au monde et à la nécessité mondaine ne saurait équivaloir à un vouloir. L’expérience du moi voulant c’est donc cette expérience dans laquelle la volonté ne s’affronte au fond à rien d’autre qu’elle-même et se sait capable aussi bien de poser un acte de nolition qu’un acte de volition. Se sait non seulement capable de dire non au désir mais tout aussi bien à la raison, ce dont le désir et la raison sont euxmêmes incapables. Toutefois, la pensée médiévale ne s’est pas toujours tenue à la hauteur de l’expérience du moi voulant inaugurée par Augustin comme en témoignent par exemple, pour Hannah Arendt, les textes de Thomas d’Aquin, dont elle sait bien par ailleurs qu’il n’était pas l’interlocuteur privilégié du Docteur subtil. La compréhension de la volonté chez Thomas d’Aquin comme chez bien d’autres auteurs médiévaux et modernes demeure une compréhension appétitive : la volonté est au fond assimilée au désir. Entendre la volonté en termes de désir implique d’une part que la volonté humaine est une volonté manquante comme l’éros platonicien et que la béatitude ne peut consister dans le vouloir-désir, puisque dès que le désir est comblé, il cesse, et ne peut donc connaître la perpétuité31. Cette compréhension appétitive de la volonté 29
30
31
Arendt, Responsabilité et Jugement : « Il n’y a pas chez Épictète de passage du désir à la volonté, ou du « je peux » au « je veux », mais seulement un glissement dans les objets du désir. Afin de rester libre, même si je suis esclave, je dois exercer mes appétits à ne désirer que ce que je peux obtenir, ce qui ne dépend que de moi-même et est ainsi effectivement en mon pouvoir. » C’est pourquoi on ne peut soutenir comme le fait Olivier Boulnois que « le concept de volonté naît véritablement chez les Stoïciens » (« Entretiens avec Olivier Boulnois »). L’erreur de perspective vient de la réappropriation de motifs stoïciens dans la pensée médiévale et surtout moderne de la liberté. Le Vouloir, 144 : « La volonté comprise essentiellement comme désir cesse quand l’objet désiré entre en sa possession, et l’idée que « la volonté est comblée quand elle est en possession de ce qu’elle veut » est tout simplement fausse – c’est précisément à ce mo-
264
François Loiret
l’enchaîne, comme le désir, à la nécessité. Bien que posée comme libre, bien que lieu de la liberté, la volonté ne peut pas plus que le désir établir des fins, elle veut nécessairement la fin ultime comme elle veut nécessairement le bonheur. Sa liberté se restreint au choix des moyens. Or, avance Hannah Arendt, « C’est précisément en voulant les moyens que la volonté n’est pas libre » car les moyens sont impliqués par les fins32. Une volonté qui ne serait libre que par rapport aux moyens et non par rapport aux fins ne peut donc être une volonté libre parce qu’elle se porte irrésistiblement vers la fin comme elle se porte irrésistiblement vers le bonheur. C’est précisément ce que soutenait Duns Scot en rejetant toute idée d’une volition nécessaire. En présentant la conception appétitive de la volonté qui est celle de Thomas d’Aquin et de bien d’autres auteurs médiévaux, Hannah Arendt indiquait déjà ce que pouvait être une pensée de la volonté comme telle. Cette pensée se déploie avec Duns Scot qui, conséquent avec la considération de la volonté comme volonté, dans son irréductibilité au désir, va jusqu’à renoncer au lieu commun philosophique et théologique selon lequel tous les hommes veulent nécessairement être heureux. Toute idée d’un vouloir nécessaire montre qu’on ne s’est pas encore établi sur le véritable plan de la volonté et de la liberté, et conduit non seulement à traiter la volonté comme désir, mais aussi à nier la liberté. Hannah Arendt souligne à ce propos que l’opposition déterminante chez Duns Scot est celle de la nature et de la liberté, la nature se caractérisant par la présence de processus nécessaires, de déterminations de toutes sortes, que ce soient des déterminations vitales, des déterminations désirantes ou des déterminations intellectuelles. La volonté comme volonté se distingue donc de l’intellect et du désir en ce qu’elle est le lieu de la liberté, de l’autodétermination. Or l’autodétermination est indissociable de la contingence pensée en terme d’altérité dans la mesure où la contingence a sa source dans une volonté autodéterminée : est contingent ce qui est tel que son opposé peut se produire au moment où il se produit parce qu’il est librement voulu. Cette contingence est pour Hannah Arendt le trait essentiel de la liberté de la volonté. Dès le début du Vouloir, elle déclare : « La pierre de touche de l’acte libre est toujours qu’on sait très bien qu’on aurait pu ne pas faire ce qu’on fait »33. L’acte libre est l’acte contingent, à savoir l’acte qui a la marque de l’altérité et non celle de l’identité dans la mesure où il peut être autre que ce qu’il est. C’est dans la pensée de Duns Scot que Hannah Arendt trouve la confirmation de cette idée car il est le seul penseur « [...] pour qui le mot ‘contingent’ ne présente pas de connotation péjorative »34. Chez Duns Scot l’acte libre est d’abord celui de la création divine dans laquelle se montre la puissance absolue divine comme puissance réelle : Dieu aurait pu créer un monde différent et si l’existence de Dieu est nécessaire, celle du monde ne l’est pas puisque la volonté divine n’est
32 33 34
ment-là qu’elle arrête de vouloir ». Arendt, Responsabilité et Jugement, 310, texte en note extrait des Basic Moral Propositions. Arendt, Le Vouloir, 41. Ibid., 158.
Absolutisme théologique et contingence
265
en rien nécessitée à créer tel ou tel monde. Il y a donc une contingence du vouloir divin ad extra, et cette contingence du vouloir est aussi caractéristique du vouloir humain dans la mesure où l’homme est à l’image de Dieu et il l’est en tant que volonté libre. « La créature de Dieu », souligne Hannah Arendt en parlant de l’être humain, « se singularise par le pouvoir mental d’affirmer ou de nier librement, affranchie du désir ou du raisonnement »35. La contingence chez Duns Scot caractérise donc bien pour Hannah Arendt la volonté en elle-même, donc autant la volonté humaine que la volonté divine. La totalité des affaires humaines est contingente et elle l’est dans la mesure où elle a pour source la libre volonté humaine. Chez la créature humaine, le pouvoir mental d’affirmer, de nier ou même de suspendre le vouloir est aussi un pouvoir de révocation. L’expérience du moi voulant est une expérience de la contingence de toute volition puisque dans l’instant de nature où le moi voulant pose une volition, il conserve le pouvoir de la révoquer et en ce sens se maintient dans ce que Hannah Arendt nomme la brèche de la volonté, inconnue d’Épictète : le deux-en-un de la volonté. Ce pouvoir de révocation fait entièrement défaut à l’intellect dont l’assentiment n’est jamais contingent et libre, mais nécessaire et déterminé. C’est pourquoi la primauté accordée au moi pensant sur le moi voulant correspond en fait à une négation de l’homme dans son humanité. L’homme de la tradition philosophique, celui des philosophes anciens, et aussi celui des philosophes modernes, n’est pas un homme, à savoir une créature à l’image de Dieu, capable de transcender la nature par sa volonté, il est une bête, et tout au plus une « bête intellectuelle » selon l’expression de Pierre Olieu, assumée et développée par Duns Scot. Chez lui le désir de savoir comme le désir du bonheur est pulsionnel, et l’appétit de savoir comme tel ne pourrait en rien différencier l’homme des bêtes, ni le situer comme être à l’image de Dieu. 4. La surabondance de la volonté Une brute intellectuelle pourrait se porter de manière pulsionnelle vers la fin ultime, mais l’homme comme volonté se détermine à vouloir la fin ultime et il ne s’y détermine que dans la mesure même où il peut aussi se déterminer à s’abstenir de la vouloir. Seule une volonté peut librement louer Dieu et librement l’aimer remarque Hannah Arendt en référence à Duns Scot. Quelles pourraient être d’ailleurs la beauté et la dignité d’un amour nécessaire de la fin ultime ? Un amour nécessaire n’est pas amour mais concupiscence, c’està-dire désir. L’amour est libre acceptation inconditionnelle, aussi bien chez la créature humaine que chez Dieu. Il se différencie foncièrement du désir, à savoir de l’éros grec, de sorte que toute compréhension appétitive de la volonté demeure étrangère à l’amour. L’amour comme activité suprême de la volonté est radicalement étranger à tout manque et à toute prise de possession. Il se distingue cependant de la volition dans la mesure où il n’est pas un acte purement mental, mais bien une activité. Activité, action suprême, l’amour 35
Ibid., 159.
266
François Loiret
comme libre acceptation, est libre affirmation et libre relation : dans l’amour la volonté se dégage de sa solitude et se lie librement à ce qu’elle aime, souligne Hannah Arendt dans les Basic Moral Propositions36. C’est même par l’amour que la créature humaine dépasse sa propre finitude en s’infinitisant. La volonté libre, en effet, est ce qui rend l’homme capable de transcender sa finitude comme de transcender la nature37. Pour saisir la dimension de cette transformation de la volonté en amour, par laquelle la volonté libre se rachète de son auto-division, il faut se tourner vers le débat de la philosophe avec Nietzsche. Abordant la question de la volonté de puissance chez Nietzsche, Hannah Arendt soutient que la puissance n’est pas ce que veut la volonté, elle est bien plutôt à comprendre comme ce qu’elle peut. La puissance signifie la surabondance de la volonté, et cette surabondance, souligne-t-elle en faisant référence à Jésus et François d’Assise, est à comprendre comme générosité, autrement dit manifestation de l’amour : « Et c’est bien sûr aussi cette surabondance de force, cette générosité extravagante ou cette ‘volonté surabondante’ qui pousse les hommes à vouloir et à faire le bien. Ce qui est des plus évidents chez quelques hommes que nous connaissons qui ont consacré toute leur vie à ‘faire le bien’, comme Jésus de Nazareth ou saint François d’Assise, ce n’est pas certainement pas l’humilité, mais bien plutôt une force surabondante »38.
La compréhension de la puissance, comme l’indique nettement la double référence à Jésus et à François d’Assise, dépasse le strict cadre d’une approche de la philosophie de Nietzsche et apporte un éclairage sur ce que dit la philosophe de l’amour chez Duns Scot. L’amour manifeste la puissance de la volonté libre comme générosité toujours en excès qui caractérise aussi bien la volonté créée que la volonté incréée. Cette compréhension de la puissance comme surabondance de la volonté permet d’apprécier tout autrement que Blumenberg ne l’a fait la question de la puissance absolue chez Duns Scot. Certes, Hannah Arendt ne s’intéresse pas à la puissance absolue, toutefois il est tout à fait pertinent de comprendre la puissance absolue divine et humaine chez Duns Scot comme l’expression non pas d’un pouvoir qui se soumet quelque chose et qui serait inquiétant parce qu’il serait sans limites et demeurerait rebelle au principe de raison, mais comme l’expression d’une puissance débordante d’amour. Dire que Dieu ne peut pas tout réellement, ce ne serait pas limiter le pouvoir réel de Dieu, ce 36
37
38
« Je peux dire oui ou non à ce qui est. Chez Augustin : Amo : volo ut sis. Mon affirmation de quoi ou de qui me relie à ce qui est d’une certaine manière, tout comme mon désir m’en aliène. En ce sens le monde est dilectores mundi. Ou encore, l’amour du monde constitue le monde pour moi et me fait entrer en lui », cité dans Arendt, Responsabilité et Jugement, 310, n. 41. Arendt, Le Vouloir, 150 : « Qu’y a-t-il dans l’esprit humain qui le rende capable de transcender ses propres faiblesses, sa finitude absolue? Et la réponse chez Duns Scot, à la différence de chez saint Thomas, est la volonté ». Arendt, Responsabilité et Jugement, 160.
Absolutisme théologique et contingence
267
serait en fait limiter son amour et sa générosité comme l’attestent les exemples pris par Duns Scot. Si la puissance absolue de Dieu n’était pas réelle, Dieu serait mesquin et avare en amour. Là où Blumenberg, conformément à toute une tradition interprétative, voit l’inquiétante étrangeté d’une liberté abyssale qui nous demeure incompréhensible, nous pouvons voir à partir de Hannah Arendt, l’excès d’une générosité qui dépasse les limites de notre intellect fini, mais à laquelle nous sommes appelés en tant que nous sommes des volontés libres, car nous aussi, en tant que volonté libre, nous sommes capables d’un amour qui dépasse notre finitude. Absolutisme théologique et contingence ne sont pas au fond deux perspectives différentes sur la volonté chez Duns Scot. Il n’y a pas à les opposer si l’on saisit que la contingence se rattache à la puissance absolue d’une manière radicale et si l’on saisit que la puissance absolue ne correspond pas à l’affirmation d’un pouvoir, comme le croit Blumenberg, mais à l’intensité d’une puissance. La lecture de Blumenberg nous montre le risque encouru par toute approche rétrospective. Ce risque n’est pas tant celui d’une perspective unilatérale que celui d’une assignation historique trop rigide. D’un autre côté, le risque des lectures actualisantes est de projeter chez les penseurs des préoccupations qui n’étaient pas les leurs et de les « moderniser » outrancièrement. La lecture généreuse de Hannah Arendt échappe à ces deux risques. Sa seule limite est d’être redevable dans une certaine mesure de l’interprétation heideggerienne de la volonté. Soulignant la non – postérité de Duns Scot comme penseur de l’expérience du moi voulant et donc de la volonté, Hannah Arendt nous fait saisir les limites de toute approche historicisante, ce qui, bien sûr, ne peut se faire qu’en prenant en considération l’histoire de la pensée. Il arrive que les chemins qu’ouvrent des penseurs demeurent des chemins à l’écart de l’histoire dans la mesure où nul après eux ne les a emprunté. Ces chemins n’étaient pas des impasses, mais étaient trop singuliers. En ouvrant son propre cheminement dans la tradition, il arrive qu’un penseur rencontre un autre penseur : la rencontre de Hannah Arendt et de Duns Scot est de ce type.
268
François Loiret
Bibliographie Littérature primaire Duns Scot, Lect., ed. Vat. Duns Scot, Ord., ed. Wad. Arendt, Hannah, La Vie de l’Esprit, La Pensée, trans., Lucienne Lotringer, Paris : PUF, 1981, 2 1987. Arendt, Hannah, La Vie de l’Esprit, le Vouloir, trans., Lucienne Lotringer, Paris : PUF, 1983. Arendt, Hannah, Responsabilité et Jugement, trans., Jean-Luc Fidel, Paris : Payot, 2005. Blumenberg, Hans, La Légitimité des Temps Modernes, trans., Marc Sagnol, Jean-Louis Schlegel and Denis Trierweiler ; avec la collab. de Marianne Dautrey, Paris : Gallimard, 1999.
Littérature secondaire Boulnois, Olivier, « Entretiens avec Olivier Boulnois ». Entretien réalisé par Christophe Cervellon et Dominique Demange. Le Philosophoire 18, 2002, 11-27. Muralt, André de, L’enjeu de la philosophie médiévale. Leiden, New-York, Köln : E. J. Brill, 1993. Tresmontant, Claude, La Christologie du Bienheureux Jean Duns Scot, l’Immaculée Conception et l’Avenir de l’Église. Note complémentaire à propos du péché originel. Paris : François-Xavier de Guibert,1996. Matthieu, Luc, « Était-il nécessaire que le Christ mourût sur la croix? » In Duns Scot à Paris. Turnhout : Brepols, 2004. Veuthey, Léon, Jean Duns Scot. Paris : Éditions franciscaines, 1967.
269 Archa Verbi. Subsidia 6
269–281
Une discussion du « scotisme » Cyrille Michon L’étiquette de « scotisme » a été utilisée par John Martin Fischer1, pour désigner une stratégie de réponse à certains arguments, dits « incompatibilistes », qui prétendent établir l’incompatibilité du libre arbitre et du déterminisme, que celui-ci ait une base causale, dans les lois de la nature, ou théologique, dans l’omniscience divine. Fischer avait isolé cette stratégie à partir de l’usage qu’Anthony Kenny a fait, en plusieurs endroits, de sa lecture d’un texte de Duns Scot dans la Distinction 39 de l’Ordinatio2. Fischer ne parle pas de Scot, et Kenny n’y fait qu’une brève référence, même s’il a proposé une analyse un peu plus élaborée, mais encore sommaire, dans un article plus récent3. Ce qui suit n’aura donc pas de prétention historique, ni de prétention à discuter le « scotisme » dans un sens où il devrait s’agir de l’ensemble ou d’une partie significative de la pensée de Duns Scot. Je voudrais seulement discuter le scotisme au sens de Fischer. Mais je crois que cette discussion peut avoir un intérêt pour la compréhension de la pensée de Duns Scot sur ce point particulier. Je vais présenter l’argument incompatibiliste et la réponse « scotiste » proposée par Kenny. Puis je chercherai à voir si cette stratégie correspond bien à ce que dit Scot. Enfin je discuterai la stratégie scotiste et tirerai de cette discussion une leçon pour la compréhension de la doctrine scotiste sur la contingence du présent, doctrine qui invoque comme on sait la notion de « puissance non manifeste » que met en jeu la liberté humaine. 1. Deux principes de transfert, et deux applications des principes Les discussions sur la compatibilité de la prescience divine et de la liberté humaine ont mis en évidence, au moins au XIIIe siècle, un argument visant à établir leur incompatibilité. En général reçu comme une objection, à laquelle il convient de répondre, cet argument repose sur un principe de transfert de nécessité : quand l’antécédent d’une conséquence est nécessaire, le conséquent l’est aussi. On fait alors valoir que la prescience divine d’une action humaine est nécessaire, parce qu’elle constitue un fait passé (« Dieu a cru hier que je prendrai du café demain » est nécessaire : nul ne peut faire qu’il n’ait pas eu cette croyance, cela est nécessaire, irrévocable). C’est la nécessité accidentelle du passé, pour reprendre la terminologie de Guillaume de Sherwood, mais 1 2 3
Fischer, « Scotism » ; Metaphysics, ch. 2. Voir Kenny, Will, Freedom and Power, 155-157 ; Kenny, The God of the Philosophers, 55-58 ; Kenny, « Duns Scotus on Free Will ».
270
Cyrille Michon
dont l’idée se trouve bien entendu chez Aristote. Thomas d’Aquin envisage ainsi l’objection que la nécessité de la prescience se transmet par le principe évoqué, ce qui permet de conclure à la nécessité de l’action qui faisait l’objet de prescience (nécessairement, je prendrai du café demain). Et il remarque que le caractère éternel de la science divine ne supprime pas l’objection ainsi formulée, car l’éternité est tout aussi nécessaire que le passé. Pour récuser l’argument, il faut refuser une prémisse (que le passé n’est pas nécessaire, ou que la croyance passée de Dieu n’appartient pas vraiment au passé) ou récuser la règle d’inférence que constitue le principe de transfert4. La structure de cet argument a été utilisée par de nombreux philosophes pour établir cette fois l’incompatibilité du déterminisme causal et de la liberté humaine. Si le déterminisme est vrai, la conjonction des lois de la nature et d’un état passé du monde implique tout état du monde ultérieur, notamment celui qui contient telle action humaine. L’antécédent de la conséquence est nécessaire : le passé est fixe, irrévocable, et nul ne peut enfreindre une loi de la nature. En vertu du même principe de transfert de la nécessité, l’état ultérieur du monde contenant telle action humaine est également nécessaire. Une version apparemment symétrique de la précédente peut-être construite en utilisant un principe de transfert de pouvoir. Nelson Pike en a donné une version qui a alimenté les débats sur le dilemme de la prescience et de la liberté depuis plus de 40 ans5. Nous supposons que Dieu existe, qu’il est éternellement et essentiellement omniscient, et nous supposons que Jean réalise une certaine action A à Tn, postérieur à T1 (tondre sa pelouse). Il suit de l’omniscience essentielle et de l’éternité de Dieu que Dieu croyait à T1 (ou croit éternellement) que Jean ferait A à Tn6. Si l’on prétend que Jean peut à T2 ne pas faire A à Tn, il s’ensuit que Jean peut agir de telle sorte que Dieu n’a pas eu la croyance qu’il a eue7. Mais cette conclusion s’oppose au principe de la fixité du passé. Pike conclut donc à l’incompatibilité du pouvoir des opposés et de la prescience divine (par réduction à l’absurde, et non directement comme dans l’argument précédent). L’argument repose cette fois sur un principe de transfert du pouvoir, moyennant l’équivalence des descriptions d’une action ou ici d’une omission. PT* peut s’énoncer ainsi : (1) X peut faire une action A (2) Dans certaines circonstances (hypothèse), faire A est équivalent à faire en sorte que B 4 5 6
7
L’argument est très clairement formulé par Thomas STh I, q. 14, a. 13 arg. 2. Pike, « Divine Omniscience and Voluntary Action ». Pour la raison évoquée par Thomas d’Aquin, il semble que la distinction entre une éternité atemporelle et une existence en tout temps (éternité temporelle) ne fasse pas de différence notable, même si les formulations devraient être adaptées. Par souci de simplicité, je continuerai en utilisant des expressions qui situent Dieu dans le temps. Pike envisage en fait la disjonction de trois possibilités, soit, outre celle évoquée dans le texte, la possibilité que Jean agisse de telle sorte que Dieu n’ait pas existé, ou de telle sorte que Dieu se trompe. Mais les conditions de l’hypothèse les excluent, et je ne m’attarde pas.
Une discussion du «scotisme»
271
(3) Donc, X peut agir de telle sorte que B Soit, dans l’exemple de Pike (i) Jean peut ne pas faire A à Tn (ii) Faire A à Tn = agir de telle sorte ou que Dieu n’a pas eu la croyance qu’il a eue (iii) Jean peut agir de telle sorte que Dieu n’a pas eu la croyance qu’il a eue [par PT*] Comme avec PT, le principe PT* peut également servir à formuler un argument incompatibiliste fondé sur le déterminisme causal. Selon l’hypothèse du déterminisme causal, si X fait A à T2, cet état du monde S(T2) est nécessité par la conjonction d’un état antérieur S(T1) et des lois de la nature (L). L’argument incompatibiliste utilisant PT* a la forme suivante : (i) X peut ne pas faire A à T2 (ii) Faire A à T2 = agir de telle sorte ou que (a) S(T1) a été autre que ce qu’il a été ou que (b) les lois de la nature aient été violées (iii) X peut faire en sorte ou que (a) ou que (b) Et l’incompatibiliste fera valoir que cette conclusion est impossible car (a) s’oppose à la fixité du passé et (b) à la fixité des lois, de sorte que là encore le pouvoir exprimé par la première prémisse paraît incompatible avec l’hypothèse du déterminisme causal8. L’idée de Kenny est que Scot refuse le principe de transfert de forme PT*. Et Fischer propose d’appeler « scotisme » un refus de l’argument incompatibiliste reposant sur ce refus du principe PT*, soit la double affirmation que PT* est faux, et que la fausseté de PT* permet de récuser l’argument incompatibiliste. Pour récuser un principe, il suffit de produire un contre-exemple. Kenny prétend trouver un contre exemple à PT* dans un texte de Duns Scot, dont il rend compte en ces termes : nous faisons l’hypothèse que je suis en train de porter une pierre A, que je suis capable de porter une pierre B, mais pas de porter à la fois A et B. Pourtant par application de PT* (i) Je peux porter cette pierre B (ii) Dans cette circonstance, porter B serait porter A et B (iii) Donc, je peux porter A et B Ce qui est exclu par hypothèse. Le principe PT* est donc mis en échec, ce n’est pas un principe universel, on ne peut donc pas s’appuyer dessus pour construire un argument valide. 2. Est-ce un argument de Scot ? Le rapprochement de cette analyse et du texte de Scot donne un résultat surprenant. Kenny donne la référence à Ordinatio I, d. 39, q. 1-5, p. 424 de l’édition vaticane. On y trouve en effet le texte suivant : 8
Il s’agit de ce que l’on appelle communément l’argument de la conséquence, intialement formulé par Carl Ginet, puis David Wiggins, mais dont la version la plus discutée est celle de Peter van Inwagen, An Essay on Free Will.
272
Cyrille Michon
« Ita etiam non sequitur ‘possum tota die portare istum lapidem (sit portabile aliquid, adaequatum virtuti meae), et possum tota die portare illum lapidem, ergo possum simul portare ambos’ ; non sequitur, quia hic utrumque ad quod est potentia divisim, excludit reliquum.9 »
Dans ce texte Scot énonce simplement la non agglomérativité de la possibilité : si ‘P’ est possible et ‘Q’ est possible, il ne s’ensuit pas que la conjonction ‘P & Q’ soit possible (la conjonction des possibilités n’entraîne pas la possibilité de la conjonction, ou compossibilité). Le principe vaut clairement pour le pouvoir d’un agent : de ce que S peut faire X et de ce qu’il peut faire Y, il ne s’ensuit pas qu’il peut faire X et Y. La puissance ou le pouvoir vis-à-vis de chacune des deux actions ou situations vaut divisim : car une action exclut l’autre (sinon ce pouvoir vaudrait coniunctim). Ce n’est donc apparemment pas une contestation du principe de transfert PT*, qui transmettrait le pouvoir attaché à une description d’action à une autre description tenue pour équivalente dans certaines circonstances. En tout cas l’exemple que Kenny attribue à Scot ne traduit absolument pas le texte auquel il fait référence. Mais la reconstruction qu’il propose au moyen d’un principe de transfert (PT*) et la critique qu’il en fait peuvent-elles être rapprochées de l’argumentation générale de Scot ? Ce n’est pas du tout évident. Premièrement, l’exemple des pierres est donné par Scot au sein d’une réponse à une objection faite à son principe « voluntas volens a potest non velle a ». Cette proposition exprime la puissance non manifeste à l’égard de quelque chose au moment même où cette puissance ne s’exerce pas, ce que l’on désigne souvent comme la thèse scotiste de la contingence du présent, ou de la possibilité synchronique. Scot se fait l’objection suivante : Supposons que X peut vouloir a à T et ne veut pas a à T, il suit de ce qu’il ne le veut pas qu’il peut ne pas vouloir (ab esse ad posse valet consequentia). Et alors, par agglomérativité, il suivrait qu’il peut à la fois vouloir et ne pas vouloir a à T. « si potest velle a pro hoc instanti, et non vult a pro hoc instanti, igitur potest non velle a pro hoc instanti’, quia ad illam de inesse sequitur illa de possibili ; et tunc videtur sequi quod possit velle a et non velle a, simul pro eodem instanti. »10
C’est-à-dire qu’il procède ainsi : (i) X peut faire A (vouloir a) à T (ii) X ne fait pas A (ne veut pas a) à T (iii) Donc X peut ne pas faire A (ne pas vouloir a) à T (de (ii) avec ab esse ad posse) (iv) Donc, X peut faire et ne pas faire A (vouloir et ne pas vouloir a) à T [par (i), (iii) et agglomérativité] Et il n’a pas de mal à la récuser, puisque le principe d’agglomérativité est clairement faux, comme le montre l’exemple des deux pierres. 9 10
Ord. I d. 39 q. 1-5, ed. Vat VI, 425, 5-8. Ord. I d. 39 q. 1-5, ed. Vat VI, 424, 2-5.
Une discussion du «scotisme»
273
Kenny, quant à lui, semble comprendre l’argument de manière différente, en utilisant le principe de transfert (PT*), il substitue aux prémisses (ii) et (iii) du précédent argument, la prémisse de l’équivalence des descriptions dans certaines circonstances, soit : (i) X peut faire A (vouloir a) à T (ii) Dans ces circonstances (où X ne veut pas a à T), faire A à T serait équivalent à faire A et ne pas faire A à T (iii) Donc, X peut faire A et ne pas faire A à T [par PT*] Il pourrait sembler que cet argument est meilleur que le précédent (et constitue donc une objection plus solide), car il déduit la même conclusion par une règle d’inférence qui n’est pas fausse de manière évidente comme l’est le principe d’agglomérativité. Oui, mais il diffère aussi en attribuant à l’opposant l’idée d’une équivalence des descriptions (ii), que Scot n’attribue pas à son opposant. On pourra répondre que cette équivalence paraît difficile à refuser. Kenny s’inspirerait donc de Scot, pour former un argument plus puissant (qu’on ne pourrait récuser sur la seule base du refus de l’argument envisagé par Scot). Deuxièmement, Scot envisage un argument pour l’incompatibilité de la prescience et de la liberté qui fait penser à un principe de transfert. Sur le modèle de (i) Dieu croit que je suis assis (ii) Je ne suis pas assis (iii) Dieu se trompe qui est clairement un argument valide (et si la conclusion est fausse on en conclut que l’une des deux prémisses est fausse), il envisage une objection à la compatibilité de la prescience et de la liberté (i) Dieu a cru que je serai assis demain (ii) Il est possible que je ne sois pas (Je peux ne pas être) assis demain (iii) Il est possible (je peux agir de telle sorte) que Dieu se trompe Dans sa réponse, Scot récuse l’argument non en refusant une prémisse, mais en contestant la validité de l’inférence : « [...] Licet ad duas de inesse sequatur conclusio de inesse […], tamen ex una de inesse et altera de possibili nec syllogistice nec necessario sequitur conclusio de possibili. 11 »
Le principe est général : on ne peut conclure à partir d’une proposition d’inhérence (de inesse) et d’une proposition modale de possibilité à une autre modale de possibilité. Mais Scot ne se contente pas d’invoquer ce principe, il rend compte de la différence des deux syllogismes. Il est entendu que ‘se tromper’ (falli) signifie : ‘penser que la chose est autrement qu’elle n’est au moment même où on le pense’ (‘falli’ est rem opinari aliter esse quam sit, pro tunc pro quando creditur esse). Dès lors 11
Ord. I d. 39 q. 1-5, ed. Vat. VI, 433, 11-12.
274
Cyrille Michon
a) Quant à l’inférence sans proposition modale : « Istud autem includitur in illis duabus praemissis de inesse, quarum altera significat istum credere hoc et reliqua negat hoc esse, et hoc pro eodem instanti, - et ideo sequitur conclusio de falli.12 »
Les deux propositions posées en prémisses portent bien sur le même instans et disent que pour cet instans Dieu croit que je suis assis alors que je suis debout. Il s’ensuit donc que Dieu se trompe. b) Quant à l’inférence contenant les propositions modales : « Non sic autem ex alia parte, quia illa de inesse affirmat unum oppositum pro illo instanti, illa de possibili affirmat potentia ad alterum oppositum, non pro eodem instanti coniunctim sed disiunctim, et ideo non sequitur quod pro aliquo instanti possit esse coniunctio oppositi in re ad illud quod creditur ; et ideo non sequitur possibilitas deceptionis, quae includit istam coniunctionem.13 »
La proposition d’inhérence attribue à Dieu la croyance que je serai assis à tel instant, demain. La proposition modale affirme que j’ai le pouvoir d’être debout, mais que j’ai ce pouvoir disiunctim et non coniunctim avec le fait de la croyance divine que je serai assis. Il faut entendre par là que l’objet de cette puissance (être debout) qui est opposé (alterum oppositum) à l’objet de la croyance divine, peut être avéré à un autre instant (disiunctim), et non en même temps, au même instant (pro eodem instanti coniunctim), que le fait. De sorte que l’attribution de ce pouvoir n’entraîne pas que Dieu se trompe14. Si l’on essaie de reconstruire l’argument de Scot sur le modèle du « scotisme » de Kenny, il faudrait comprendre que l’objection a cette forme : (i) Je peux ne pas être assis demain (hypothèse) (ii) Dans ces circonstances, ne pas être assis demain = faire en sorte que Dieu se trompe (iii) Il est possible (je peux agir de telle sorte) que Dieu se trompe [par PT*, (i) et (ii)] 12 13 14
Ord. I. d. 39 q. 1-5, ed. Vat. VI, 433, 16-18. Ord. I. d. 39 q. 1-5, ed. Vat. VI, 433, 18--434,3. Ce qui autorise, sans doute, une interprétation en termes de mondes possibles : dire que la proposition modale (« je peux être debout demain ») est vraie disiunctim revient à dire que la proposition indicative correspondante (« je serai debout demain ») est vraie dans un monde possible, mais distinct du monde actuel (où je serai assis). La conjonction des deux ne dit donc pas que les deux propositions indicatives sont vraies dans ou pour le même monde possible, ce qu’il faudrait pour qu’il y ait erreur divine. Kenny veut que ‘instans’ renvoie à un monde possible, mais il ne me semble pas que la continuité du texte autorise cette interprétation. Le terme instans est une reprise de l’indication temporelle explicite dans l’argument qu’il discute : cras. Cela dit, le point marqué par Scot peut recevoir cette formulation en termes de mondes possibles alternatifs, pour un même moment temporel.
Une discussion du «scotisme»
275
Et, la conclusion serait refusée sur la base d’un refus de la règle d’inférence PT*, pour lequel on aurait fourni un contre exemple avec le cas des deux pierres. Autant dire que tout repose sur la valeur de cet exemple, tel qu’il est compris par Kenny, tandis que la réfutation de l’objection par Scot ne reposait pas sur le refus d’une règle d’inférence comme PT*. Il est bien possible qu’il y ait une certaine parenté entre les deux arguments et entre les deux réfutations. Mais tant que l’on ne montre pas que la solution de Scot implique celle de Kenny, celle-ci ne vaut que ce que valent ses contre-exemples à PT*15. C’est ce qu’il nous faut évaluer. 3. Discussion (1) : Les contre-exemples à PT* Comme le dit Fischer, un contre exemple à PT* doit (i) présenter une situation claire où un agent a le pouvoir de faire ou d’éviter une action, (ii) présenter une équivalence claire entre la description de cette action ou omission avec une autre description de la même action ou omission, (iii) manifester clairement que l’agent n’a pas le pouvoir de réaliser l’action (omission) présentée sous cette seconde description. L’exemple tiré de Scot faisait l’hypothèse d’une situation où (i) je suis capable de porter une pierre B, où (ii) je suis en train de porter une pierre A et où (iii) je ne peux pas porter à la fois A et B. Mais Fischer fait valoir que, si l’exemple est sans doute satisfaisant quant aux conditions (ii) et (iii), le pouvoir exprimé en (i) ne peut être que celui d’une capacité générale de porter B, car cette capacité se trouve entravée dans les circonstances particulières où je porte A. De sorte que, dans les conditions de l’exemple, je n’ai pas la capacité particulière ou spécifiée (qui tient compte des conditions particulières de la situation où je me trouve) de porter B (de même, si je suis enchaîné je n’ai pas la capacité particulière de me déplacer dans la pièce, bien que j’ai cette capacité générale). Les circonstances ou conditions qui permettent que la capacité s’exerce peuvent être rassemblées sous le nom d’opportunité : l’absence d’une de ces conditions constitue un obstacle ou un empêchement et retire l’opportunité. Maintenant, le verbe ‘pouvoir’ peut exprimer la capacité, l’opportunité, ou la somme des deux (c’est le all-in sense, le sens inclusif de ‘pouvoir’). C’est cette capacité d’agir dans ces circonstances qui importe pour le libre arbitre et pour la position incompatibiliste. Et le contre-exemple n’a pas 15
Il me semble que Kenny peut bien expliquer l’échec (présumé) de PT* en recourant à la distinction de Scot entre attribution divisim et attribution coniunctim. La distinction est utilisée par Kenny pour dire que, bien que la description d’une certaine action (être debout) soit dans certaines circonstances équivalente à une erreur divine, il ne suit pas, du fait qu’un agent a le pouvoir de réaliser cette action (divisim), qu’il ait le pouvoir d’agir de telle sorte que Dieu se trompe (coniunctim). Autrement dit, ce pouvoir ne peut pas être actualisé dans ces circonstances (ou coniunctim), mais seulement dans d’autres (divisim). Mais cela explique l’échec de l’inférence, sans précisément montrer que PT* est invalide : il semble plutôt que cela pointe en direction d’une équivocité de l’expression de la modalité.
276
Cyrille Michon
montré que le pouvoir en ce sens inclusif ne se transmettait pas, puisque la première prémisse n’a pas présenté un cas de pouvoir inclusif. Mais la discussion ne s’arrête pas là, car Kenny a proposé deux autres contre-exemples à PT* (II) la situation envisagée est celle où je vais garder le gâteau. L’application de PT* devrait donner : (i) Je peux manger ce gâteau (ii) Dans cette circonstance, manger ce gâteau serait donc aussi le conserver (iii) Donc je peux manger et conserver ce gâteau Mais il est clair que je ne peux pas manger et garder mon gâteau (eat my cake and have it), de sorte que PT* est falsifié. Mais, comme le dit Fischer, cette fois, si les conditions (i) et (iii) sont clairement satisfaites, c’est (ii) qui pose un problème. La situation évoquée est celle où je mange un gâteau que j’avais le pouvoir de ne pas manger, et il est clair (pour des raisons qui tiennent non à la situation mais à la logique ou au moins à nos concepts) que je ne peux pas à la fois le manger et le garder. Kenny pense qu’une même action peut être décrite par « manger le gâteau » et (puisqu’il y a équivalence des descriptions) par « manger et garder le gâteau ». Mais comme la seconde description est logiquement contradictoire ou conceptuellement impossible (impensable), on ne décrit par là aucune action. Il faudrait montrer, pour avoir un contre-exemple à PT*, qu’un agent a le pouvoir de réaliser une action, ainsi décrite, et n’a pas le pouvoir de réaliser cette même action, décrite autrement. Mais cette seconde description n’en est pas une, elle ne décrit rien, elle ne peut rien décrire. (III) Enfin, dans le dernier scénario, la situation envisagée est celle où j’atteins le centre de la cible, bien qu’il soit clair que c’est par chance car mon habileté ne permet pas de dire que j’en suis capable. Pourtant l’application de PT* semble donner : (i) Je peux atteindre la cible (ii) Dans cette circonstance, j’atteins la cible en atteignant le centre de la cible (iii) Donc, je peux atteindre le centre de la cible Ce dont, par hypothèse, je ne suis pas capable. Les conditions (i) et (ii) sont réalisées cette fois. Selon Fischer, le problème est désormais (iii). Le « scotiste » prétend que je ne peux pas atteindre le centre, mais cela doit s’entendre au sens où je n’en ai pas la capacité. Car je peux sans doute l’atteindre, mais par chance. Or « Je peux, par chance » peut aller de pair avec « je n’ai pas la capacité » (qui suppose une habileté permettant de réitérer l’exploit plus souvent que par chance). Les circonstances ne confèrent pas une capacité, même s’il y a un pouvoir nouveau (elles ne peuvent que limiter une capacité générale, supprimer telle capacité spécifiée). La chance qui me permet d’atteindre le centre la cible ne m’a pas donné la capacité de le faire. Elle a seulement rendu possible ce résultat.
Une discussion du «scotisme»
277
Fischer fait valoir que, pour d’autres, le principe ab esse ad posse est toujours valable, ce qui revient sans doute à diminuer la différence entre opportunité et capacité. Mais il reconnaît que le scotiste qui doit se ranger dans le premier camp a une position défendable, et est donc prêt à admettre que le principe PT* est ébranlé. Même s’il n’admet pas les contre-exemples de Kenny, il admet que le dernier d’entre eux rend le principe PT* contestable16. Je crois que l’on peut répondre autrement, en limitant l’application du principe et en admettant qu’il ne vaut pas pour le transfert de la capacité si l’équivalence introduit des circonstances (si j’ai la capacité de faire A et que A est équivalent à B en toutes circonstances, j’ai sans doute la capacité de faire B, mais si B n’est équivalent à A que dans certaines circonstances, alors je n’ai pas forcément la capacité de faire B)17. Dès lors, puisque le pouvoir que m’attribue la prémisse (i) est le pouvoir au sens inclusif, qui inclut la capacité, il ne se transmet pas non plus. Mais alors, n’est-ce pas accepter qu’il n’y a pas de transfert du pouvoir ? Non, car le pouvoir que donne l’opportunité est bien transmis de (i) à (iii), ce pourquoi, en un certain sens de « pouvoir » (celui de l’opportunité), le syllogisme semble bien valide. Si j’ai l’opportunité de faire une action A, laquelle, dans certaines circonstances, est équivalente à B (qui la spécifie), j’ai donc l’opportunité de faire B. La question est alors de savoir si cette réduction de PT* à la transmission de l’opportunité permet de maintenir l’argument incompatibiliste que combattait Kenny. Il me semble que la réponse est oui. Car on pourrait formuler l’argument ainsi : (i) J’ai l’opportunité de me lever (à T) (ii) Dans ces circonstances, me lever serait faire en sorte que Dieu se trompe (ou n’ait pas eu une certaine croyance) (iii) J’ai l’opportunité de faire en sorte que Dieu se trompe Si c’est vraiment une opportunité, et même si je n’ai pas la capacité, cela suppose que la chose est possible. La liberté semble bien exclure la prescience J’en conclus donc que le principe de transmission du pouvoir est valide quand il est restreint à la transmission de l’opportunité, et que cela suffit à construire un argument incompatibiliste résistant aux contre-exemples scotistes. 4. Discussion (2) la conception scotiste du pouvoir de la liberté Je voudrais profiter de cette défense du principe de transfert restreint à l’opportunité pour discuter la doctrine de Scot qui est en fait en cause ici, celle du pouvoir de faire une chose alors même qu’on ne la fait pas, exprimée par le « volens a potest non velle a ». Cette compatibilité est la même que celle exprimée 16 17
Fischer propose alors une version dite « conditionnelle » de l’argument incompatibiliste, qui reste valable quand bien même PT* serait abandonné. On pourrait dire que la transmission de la capacité (au sens d’aptitude, d’habileté) n’est pas assurée par une implication matérielle (qui peut être liée aux circonstances) mais seulement par une implication stricte (qui vaut en toute circonstance).
278
Cyrille Michon
par « je serai assis demain et (mais) peux être debout demain ». Dans les deux cas il s’agit de la conjonction de la réalité (actualité) d’un fait à un moment donné, en l’occurrence une action ou une volition, et de la possibilité du fait opposé (de l’absence d’action ou de volition) au même moment. La tradition antérieure à Scot suit le texte du Perihermeneias, et estime que le présent partage avec le passé la nécessité accidentelle : ils sont fixes, irrévocables. Il y a sans doute d’autres mondes possibles, logiquement possibles, avec un passé ou un présent différents. Mais ces mondes ne sont pas accessibles à un agent quel qu’il soit (même Dieu ne peut changer le passé), ce pour quoi on dit qu’il ne peut pas (il n’est pas en son pouvoir de) faire quelque chose qui aurait pour conséquence un fait passé ou présent différent des faits passés ou présents avérés. Seul le futur est ouvert : ne sont accessibles à un agent que les mondes qui partagent l’histoire de cet agent jusqu’au moment présent inclus. Mais la thèse de Scot est que, alors que je suis assis à T, je peux à ce même moment T (au sens où cela m’est accessible, est en mon pouvoir, dépend de moi) être debout à T18. C’est-à-dire : alors que dans le monde actuel, à T, je suis assis, il y a un monde possible où, au même moment, à T, je suis debout, et ce monde est accessible depuis le monde actuel à ce même moment, à T. Mais ce pouvoir, comme le dit Scot, n’est pas manifeste, il est donc occulte, et n’est certainement pas rendu acceptable par la seule considération de la non agglomérativité du possible. Que veut dire « je suis assis à T et peux (à T) être debout à T » ? Reprenons la distinction de la capacité et de l’opportunité, faite par Kenny, qui reproche à Scot de ne pas l’avoir faite, d’autant qu’elle lui aurait évité la doctrine d’un pouvoir occulte. Elle permet d’introduire des distinctions nécessaires sur l’attachement d’une indication temporelle à l’expression du pouvoir (« peut … à T »). Rien ne s’oppose à ce qu’un agent qui réalise une action A ait, au moment même où il la réalise, à T, la capacité de ne pas faire A. Mais l’indication temporelle se rapporte à la possession de la capacité, non à l’objet de cette capacité. Une capacité est générale, porte sur un type d’actions, pas sur une action individuelle, à un moment précis. Je suis capable de recevoir et lire un courrier électronique parce que j’ai ce qu’il faut pour cela. Je peux être devenu capable à T de lire un courrier électronique parce que ma connexion a été rétablie à T. Mais cette capacité n’est pas une capacité de lire un courrier à T. En revanche, si vous m’envoyez un courrier, vous me donnez l’opportunité de lire un courrier, et cette opportunité qui se présente à un moment donné porte également sur ce moment donné. J’ai l’opportunité, avec cet envoi, de lire un courrier à T19. Si l’expression du pouvoir (« je peux ») n’exprime que la capacité, « je suis assis à T et peux être debout à T » veut seulement dire que, étant assis 18 19
Voir King, « Duns Scotus on Possibilities », notamment section 3. Kenny remarque que c’est pour l’opportunité qu’on mettrait le verbe pouvoir au futur : « je peux parler chinois ce soir » signifie que j’en ai la capacité, « je pourrai parler chinois ce soir » signifie que j’en aurai l’opportunité.
Une discussion du «scotisme»
279
à T, j’ai la capacité, au même instant T, d’être debout. Cela ne pose pas de problème. Si « je peux » signifie « j’ai l’opportunité », il faut distinguer entre « j’ai l’opportunité à T d’être debout » (OtD) et « j’ai l’opportunité d’être debout à T » (ODt). La première proposition paraît clairement compatible avec le fait que je sois assis à T. La seconde ne poserait pas de problème si elle voulait dire que j’ai, avant T, l’opportunité d’être debout à T (Ot-nDt). En revanche, elle en pose un si elle veut dire que à T, alors même que je suis assis, j’ai l’opportunité d’être debout à T (OtDt). Comment peut-on avoir à un moment donné l’opportunité de faire une chose à ce même moment alors qu’on ne la fait pas (At&OtDt) ? Il n’est peut-être pas usuel de dire que l’on a l’opportunité de faire une chose alors même qu’on la fait. Mais ce n’est pas aberrant : je suis en train de faire une conférence parce que j’en ai l’opportunité (j’ai eu cette opportunité, elle m’a été donnée il y a déjà quelque temps, mais on ne peut pas dire que je l’ai perdue au moment même où j’en profite). En revanche, si j’ai eu aussi, il y a quelque temps, l’opportunité d’aller à Marseille maintenant (aujourd’hui), je n’ai plus maintenant (aujourd’hui) cette opportunité, elle est perdue. 5. Que veut dire Scot ? Il me semble qu’il veut dire plus que « j’ai la capacité générale à T – alors que je suis assis – d’être debout », car le verbe « pouvoir » est censé exprimer le pouvoir de la liberté, et ce pouvoir de me lever n’est pas seulement la capacité générale de me lever, mais celle de le faire hic et nunc, soit une capacité particulière qui suppose l’absence d’obstacle à la capacité générale et donc l’opportunité de l’exercer. Mais je ne vois pas comment on peut soutenir que j’ai à un moment donné l’opportunité de faire quelque chose à ce même moment alors que je ne la fais pas à ce moment. Reste alors l’hypothèse que, sans être limité à la seule capacité, le pouvoir dont parle Scot (le pouvoir de la liberté) n’inclut pas forcément l’opportunité, et se trouve compatible avec l’impossibilité de faire (pas d’opportunité) ce qu’en un autre sens on a pourtant le pouvoir de faire. Scot dirait ainsi que je suis libre de faire une chose, parce que je peux la faire, en un certain sens (plus riche que la simple capacité générale), alors que, en un certain sens (celui de l’opportunité ultime, à T, maintenant), je ne peux pas la faire, parce que l’opportunité a disparu. L’argument du contre-exemple au principe de transfert est alors acceptable, puisque l’opportunité (seul pouvoir transféré) n’est plus prise en compte. Mais le prix à payer pour la stratégie de Scot est alors une conception « compatibiliste » de la liberté, puisque celle-ci est alors compatible avec la nécessité (une forme de nécessité). Un argument parallèle peut être établi pour le déterminisme causal, qui conduit à la conception compatibiliste au sens classique de compatibilité avec le déterminisme.
280
Cyrille Michon
Conclusion Ma conclusion est donc triple : 1. La stratégie « scotiste » de Kenny ne correspond pas aux arguments effectifs de Scot. 2. Cette stratégie (refus du principe de transfert PT*) échoue à établir la compatibilité de la liberté et du déterminisme, si l’on considère que le pouvoir qui est censé être transféré est le pouvoir de l’opportunité et non celui de la capacité générale. 3. Paradoxalement, la doctrine scotienne de la puissance non manifeste, qui semblait élargir le pouvoir de la liberté à une plus grande extension du possible (le possible simultané et non seulement successif), conduit en fait à une conception plus faible de la liberté, une conception compatible avec la nécessité. C’est d’ailleurs bien ainsi que l’avait compris Kenny, qui n’attribue pas le compatibilisme à Scot (ce serait trop contraire à ses déclarations explicites), mais qui voyait dans le refus du principe de transfert un moyen de défendre une conception compatibiliste du libre arbitre20.
20
Je remercie Jean-Baptiste Guillon de remarques très judicieuses qui m’ont notamment amené à corriger la 2e section de cet article.
Une discussion du «scotisme»
281
Bibliographie Fischer, John Martin, « Scotism », Mind 94 (1985) : 231-253. Fischer, John Martin, The Metaphysics of Free Will, Oxford : Blackwell, 1994. Kenny, Anthony, Will, Freedom and Power. Oxford : Blackwell, 1975. Kenny, Anthony, The God of the Philosophers. Oxford : Clarendon Press, 1979. Kenny, Anthony, « Duns Scotus on Free Will. » In Aristotle in Britain During the Middle Ages, ed. John Marenbon. Louvain-la-Neuve : Brepols, 1996. King, Peter, « Duns Scotus on Possibilities, Powers, and the Possible » In Potentialität und Possibilität : Modalaussagen in der Geschichte der Metaphysik, eds. Thomas Buchheim et al, 175-199. Stuttgart-Bad Canstatt : Fromann-Holzboog, 2001. Pike, Nelson, « Divine Omniscience and Voluntary Action. » Philosophical Review 74 (1965) : 27-46. Van Inwagen, Peter, An Essay on Free Will. Oxford : Oxford University Press, 1983.
282
283 Archa Verbi. Subsidia 6
283–312
Métaphysique analytique et métaphysique scotiste1 Olivier Boulnois
Si nous nous interrogeons sur la postérité de Duns Scot, nous devons nous demander si la pensée qu’il a développée au début du XIVe siècle est totalement caduque, ou si, tout en étant évidemment insérée dans son époque, elle contient des énoncés rigoureux, dont la validité s’étend au-delà de l’instant de leur profération. Ma réflexion portera uniquement sur la question de la métaphysique et sur sa pérennité. À quelles conditions une métaphysique est-elle possible ? La métaphysique dont Duns Scot a jeté les bases est-elle encore valide au vu des exigences de la philosophie contemporaine ? Cela nous oblige à poser autrement le problème de notre rapport à la tradition. Celle-ci doit-elle être prise autrement que dans l’optique hegelienne d’un progrés cumulatif de l’Esprit dans l’histoire, ou bien, dans l’optique inverse, heideggerienne, de l’oubli de l’être ? S’il était vrai que la philosophie continentale reste dominée par l’histoire de la philosophie et par l’historiographie heideggerienne, il ne nous resterait plus que la confrontation avec la philosophie analytique pour répondre à cette question. Notre question deviendrait alors : dans le champ de la métaphysique, quelles sont les relations possibles entre la pensée de Duns Scot et la philosophie analytique? Avant d’aller plus loin, il faut s’entendre sur la définition de la philosophie analytique. Je propose une définition provisoire : la philosophie analytique est une méthode d’investigation qui s’attache aux conditions de la pensée par le biais de l’analyse du langage. Selon cette démarche, l’analyse philosophique a pour but la clarification logique des pensées, plutôt que la démonstration de vérités ou de savoirs nouveaux. Son étude passe le plus souvent par l’analyse de la forme logique des propositions philosophiques, et par le rejet des systèmes qui prétendent aller du concept du tout aux parties (par exemple la pensée de Hegel ou celle de Heidegger). Pour B. Russell, par exemple, l’« empirisme analytique » se caractérise par plusieurs traits : il incorpore des analyses logiques poussées ; il entend ainsi arriver à la rigueur d’une science ; enfin, il traite les problèmes un par un, au lieu d’inventer un système global2. Plus récemment, 1 2
Une première version de cet article a été publiée sous le titre Boulnois, « La philosophie ». Voir Russell, A History of Western Philosophy, 834 : « Modern analytical empiricism [...] differs from that of Locke, Berkeley, and Hume by its incorporation of mathematics and its development of a powerful logical technique. It is thus able, in regard to certain problems, to achieve definite answers, which have the quality of science rather than of philosophy. It has the advantage, as compared with the philosophies of the system-buil-
284
Olivier Boulnois
Strawson considère que la philosophie analytique est l’équivalent, pour notre pratique et notre pensée habituelle, de ce qu’est la grammaire pour le praticien d’une langue : elle expose la structure et les règles que nous utilisons implicitement dans notre pratique quotidienne3. De ce fait, elle a une dimension thérapeutique évidente : elle permet de nous débarrasser des concepts vides et des raisonnements erronés4. La question des rapports entre Scot et la philosophie analytique prend diverses formes : 1. Existe-t-il un scotisme analytique (réel) ? 2. La pensée de Duns Scot a-t-elle elle-même une dimension analytique ? 3. Un scotisme analytique est-il possible ? C’est-à-dire : une métaphysique analytique peut-elle se fonder sur les analyses de Duns Scot ? I Existe-t-il un scotisme analytique? Le concept de « scotisme analytique » se construit en vis-à-vis du concept de « thomisme analytique ». Le thomisme analytique se propose de présenter et de mettre à jour la pensée de saint Thomas dans le langage de la philosophie analytique, éventuellement en débrouillant les embarras et en éclairant les obscurités du thomisme classique. L’expression a été frappée par John Haldane dans une conférence donnée à l’université de Notre Dame en 1992 : elle visait à faire dialoguer les réflexions de Thomas et celles de ses disciples avec la philosophie de langue anglaise5. Dans un volume de 2006, Haldane expose le sens des deux termes en présence : « le thomism désigne des manières de penser qui sont dans l’esprit de Thomas d’Aquin, ou qui développent ce qu’il a à dire », et « analytique » indique la poursuite de réponses « à une série de questions par l’examen a priori de structures intelligibles »6. C’est une lapalissade de rappeler que le thomisme analytique est une sous-espèce du thomisme, mais les
3
4 5
6
ders, of being able to tackle its problems one at a time, instead of having to invent at one stroke a block theory of the whole universe. Its methods, in this respect, resemble those of science. I have no doubt that, in so far as philosophical knowledge is possible, it is by such methods that it must be sought ; I have also no doubt that, by these methods, many ancient problems are completely soluble. » Strawson, « La Philosophie analytique : deux analogies », 14 : « de même que le grammairien […] travaille à produire une explication systématique de la structure des règles que nous observons sans peine en parlant grammaticalement, de même le philosophe travaille à produire une explication systématique de la structure conceptuelle dont notre pratique quotidienne nous montre doués d’une maîtrise tacite et inconsciente ». Voir Wittgenstein, Investigations philosophiques, § 255, trans., Klossowski, 214 : « En philosophie, une question se traite comme une maladie ». Haldane, Faithful reason, Essays catholic and philosophical, xii : « Analytical Thomism involves the bringing into mutual relationship of the styles and preoccupations of recent English-speaking philosophy and the ideas and concerns shared by St Thomas and his followers ». Haldane, Analytical Thomism : Traditions in Dialogue, 190-191, n.3.
Métaphysique analytique et métaphysique scotiste
285
lapalissades sont parfois éclairantes. Le thomisme analytique appartient au mouvement doctrinal de la renaissance de la pensée thomiste, dans la ligne de Gilson et de Maritain. Les œuvres d’Elizabeth Anscombe, de Peter Geach et d’Anthony Kenny constituent une seconde phase de ce dialogue avec la pensée contemporaine. Certes, l’expression de thomisme analytique est postérieure à leurs œuvres, et trop étroite pour les décrire, P. Geach rejetant par exemple l’intemporalité divine, mais il est exact que chez eux le thomisme et la pensée analytique entrent en dialogue. Lorsque John Haldane emploie pour la première fois l’expression « analytical Thomism » en 1997, comme titre d’un volume de la revue The Monist7, c’est dans la mesure où la pensée thomiste lui apparaît comme l’expression philosophique adéquate de la foi chrétienne. Comprenons par là qu’il cherche à l’exprimer dans la langue de son temps. Nous voyons bien ce qu’un tel aggiornamento apporte à la continuité doctrinale de l’école thomiste, mais le lecteur non-thomiste, qui ne reconnaît pas de valeur spécifique à une telle pensée, peut se demander ce qu’elle apporte à la philosophie analytique. Pourtant, « développer ce que Thomas avait à dire »n’est pas toujours compatible avec la fidélité à ce que saint Thomas a vraiment dit : on retrouve ici le conflit entre le néo-thomisme et le paléothomisme d’un Gilson fidèle à la méthode historico-critique. Et le thomisme analytique ne se prive pas de développer ses analyses dans des directions souvent très critiques envers Thomas. Car si le thomisme est la continuité doctrinale d’une école, les engagements de fidélité dogmatique du thomiste sont-ils compatibles avec ceux du philosophe analytique? Sinon, que va-t-il devoir abandonner? La notion d’esprit, comme le font certains lecteurs de Wittgenstein ? Le concept d’éternité, comme Kenny ?8 En réalité, nous pourrions même dire que la partie la plus stimulante et la plus suggestive du thomisme analytique est celle où il critique, déplace, remanie, réinterprète les positions les plus classiques de saint Thomas – bref, les passages où il n’est pas thomiste […] Ainsi, sous le nom de « thomisme analytique » n’est-on pas en train de vénérer un oxymore ?9 Or il faut observer que, dans le cas du scotisme, la situation est pire encore : à la différence de l’école thomiste, l’école scotiste ne peut pas faire fond sur 7
8
9
En guise d‘introduction au volume, J. J. Haldane retrace l‘histoire de la formation et de la réception d‘une pensée métaphysique, théologique, éthique et politique qui réconcilie l’héritage du platonisme augustinien avec la redécouverte de l‘aristotélisme par ses sources arabes. Reconnu comme l’aristotélisme chrétien par excellence, le thomisme est aussi confronté au rationalisme post-chrétien. Aujourd‘hui le thomisme analytique propose une réflexion métaphysique sur les concepts fondamentaux : forme, matière, existence, individu, énoncé mental, bien et mal. Le volume contient notamment un article de Hilary Putnam (« Thoughts Addressed to an Analytical Thomist ») et d’E. Stump (« Aquinas’s Account of Freedom »). Voir Shanley, « Analytical Thomism » ; l’article étudie précisément les articles de The Monist d’octobre 1997 ; l’auteur demande si l’on peut être à la fois thomiste et philosophe analytique. Cross, « Review of Analytical Thomism : Traditions in Dialogue », 1.
286
Olivier Boulnois
la même continuité traditionnelle jointe à une autorité doctrinale supérieure dans la tradition catholique. D’un autre côté, il semble clair aujourd’hui que l’existence d’un thomisme analytique indique, de l’intérieur même de la demarche analytique, la nécessité d’un dialogue avec l’histoire de la philosophie. Toute analytique qu’elle soit, la philosophie est une discipline argumentative, engagée dans un dialogue avec autrui, et inscrite dans une histoire. L’analyse seule ne nous donne rien à penser. Sans histoire, le formalisme logique est aveugle et tourne à vide : c’est l’histoire qui a constitué les concepts que la philosophie analytique entend critiquer ou combiner. Dans ce cas, redécouvrir une pensée qui sort du répertoire habituel (anglo-saxon, moderne) de la philosophie analytique, c’est pour cette philosophie l’occasion de sortir du solipsisme. Il n’est pas étonnant que Thomas permette de renouveler le débat philosophique, puisqu’il constitue l’inconscient des discours modernes qu’analyse habituellement la philosophie analytique. Mais on peut en dire autant de toute la philosophie médiévale dans son ensemble. Et notamment de Duns Scot, son pendant dans bien des disputes de la scolastique moderne. La seconde difficulté provient du fait qu’il existe déjà un thomisme analytique, tandis qu’un scotisme analytique est éventuellement possible, mais qu’il reste pour le moment virtuel. – Cependant cette minceur est purement factuelle. Elle ne change rien à l’essence et aux possibilités de la pensée. Si le scotisme analytique est possible, il suffirait que se lèvent quelques analyticiens décidant de repenser l’œuvre de Scot à la manière analytique pour que celui-ci devienne réel. Il existe d’ailleurs un modèle pour cela, la reconstruction, savoureuse et pleine d’humour, proposée par A. B. Wolter, d’un dialogue entre un analyticien d’Oxford et Jean Duns Scot revenu sur terre. Duns Scot y met l’accent sur sa théorie sémantique, qui insiste sur la référence envers le singulier, sur sa définition de l’abstraction, présentée comme proche de celle de Russell, et sur sa manière de concevoir l’infini (dont Cantor se réclamera)10. Cependant, il n’est pas certain que les motifs poussant à la construction d’un thomisme analytique soient pertinents pour le scotisme. L’exigence de prolonger l’autorité du scotisme n’a pas la même vigueur que la poursuite du thomisme par d’autres moyens. Si quelqu’un construit un jour, peut-être aujourd’hui, un scotisme analytique, ce sera moins en raison de l’autorité de son origine que de la rigueur de sa construction rationnelle. C’est pourquoi il me semble indispensable d’étudier d’abord la dimension analytique de la pensée scotiste, avant de revenir à une confrontation entre analytique métaphysique et métaphysique analytique.
10
Wolter, « An Oxford Dialogue on Language and Metaphysics », 323-348 ; Wolter, « A Reportatio », 179-191.
Métaphysique analytique et métaphysique scotiste
287
II La dimension analytique de la métaphysique : Aristote, Duns Scot, Kant Depuis Aristote, l’analytique est la condition de possibilité de toute science. Les Premiers et les Seconds analytiques d’Aristote exposent précisément la condition de possibilité de la science comme telle. Une science repose sur la résolution (analysis) de ses propositions complexes en éléments simples, qui doivent être connus par leur évidence interne, ou par une expérience certaine. La connaissance des termes est donc l’élément ultime auquel nous puissions remonter11. L’intelligence des termes simples est le principe de la science. Mais ceci débouche sur la considération inverse : les principes premiers et immédiats de la science sont des propositions dont la vérité apparaît avec évidence dès qu’on en connaît les termes. Comme le dit saint Thomas : « Les principes immédiats ne sont pas connus par un moyen [terme] extérieur, mais par la connaissance de leurs propres termes: une fois que l’on sait ce qu’est un tout et ce qu’est une partie, on sait que chaque tout est plus grand que sa partie, parce que, dans de telles propositions […] le prédicat appartient à la raison du sujet (praedicatum est de ratione subiecti) »12.
Nous connaissons les principes de la démonstration à partir de la seule connaissance de leurs termes, en apercevant que le prédicat est inclus dans le sujet. Cela deviendra un adage aristotélicien, recueilli dans les Auctoritates Aristotelis : « Nous connaissons les principes en tant que nous connaissons leurs termes »13. Pour utiliser un vocabulaire kantien, une proposition dont le prédicat est inclus dans le sujet (per se nota primo modo) est une proposition analytique. Pour la scolastique médiévale (aussi bien thomiste que scotiste) les premiers principes de la science sont donc des propositions analytiques14. Qu’est-ce que l’analytique ? Pour un auteur mediéval, « Analytique » est d’abord le titre d’un ouvrage d’Aristote, celui où il donne sa théorie de la proposition et sa théorie de la démonstration. C’est la doctrine par laquelle on ramène les conséquences aux principes en les y résolvant (analuein).
11
12
13 14
Aristote, Seconds Analytiques I, 3, 72 b 23-25 : « [...]nous disons qu’il y a aussi un certain commencement de la science, par lequel nous connaissons les termes (horoi) ». Cf. Translatio Iacobi (Minio-Paluello / Dod, 10, 19-21) : « [...] sed et principium scientie esse quoddam dicimus in quantum terminos cognoscimus ». Thomas, Expositio libri Posteriorum I, 7, ed. Leonina, 31 : « Ipsa principa inmediata non per aliquod medium extrinsecum cognoscuntur, set per cognitionem propriorum terminorum : scito enim quid est totum et quid pars, cognoscitur quod omne totum est maius sua parte, quia in talibus propositionibus […] predicatum est de ratione subiecti ». Auctoritates Aristotelis, ed. Hamesse, 313, n. 32 : « Principia cognoscimus inquantum terminos cognoscimus ». Voir Thomas, Summa Theologiae I-II, 94, 2 ; In XII Metaphysicorum librorum IV, 6 (§ 607, Spiazzi, 168) : le premier principe ne peut pas être démontré, mais seulement retrouvé par analyse.
288
Olivier Boulnois
La science procède à partir des conséquences, elle les ramène à leurs causes : l’analytique ramène les conséquences à leurs principes, d’où son nom : « Et puisqu’on ne peut obtenir un jugement certain sur les effets qu’en les résolvant dans leurs premiers principes, cette partie est appelée analytique, c’est-à-dire résolutoire. Or la certitude du jugement, qu’on obtient par l’analyse, provient, soit de la seule forme du syllogisme, et c’est à cela qu’est ordonné le livre des Premiers analytiques, qui traite du syllogisme pris absolument ; soit à la fois de cette forme et d’une matière, parce que l’on admet des propositions par elles-mêmes (per se) et nécessaires, et c’est à cela qu’est ordonné le livre des Seconds analytiques, qui traite du syllogisme démonstratif »15.
L’analytique est une méthode de résolution qui résout les conséquences logiques dans les premiers principes. Mais elle peut le faire de deux manières, soit en s’appuyant sur la seule forme du syllogisme, soit en s’appuyant également sur l’évidence de sa matière. Les Premiers analytiques portent sur la dimension formelle de la certitude. Mais si on ajoute à la forme une matière, c’est-à-dire une fondation sur certaines propositons nécessaires et par soi, nous avons affaire aux syllogismes démonstratifs, étudiés dans les Seconds analytiques. L’analytique remonte plus loin que la seule logique : au lieu d’être simplement formelle, elle atteint les principes propres de chaque espèce de démonstration. Aristote entend montrer ici qu’il y a un terme (status) dans les propositions affirmatives, aussi bien vers le haut que vers le bas. Et est divisée en deux parties : dans la première partie, il montre son propos de manière logique, c’est-à-dire par les raisons communes à tout syllogisme, qui sont reçues selon des prédicats pris au sens commun (communiter) ; dans la seconde, il montre la même chose de manière analytique, c’est-à-dire par des raisons propres à la démonstration, qui sont reçues selon des prédicats « par soi » (lesquels sont propres à la démonstration), à cet endroit : « il est analytiquement évident etc […] »16. On peut démontrer quelque chose soit logiquement, c’est-à-dire par les propriétés communes de tout syllogisme, soit par des propriétés analytiques, c’est-à-dire propres à chaque science : par la démonstration qu’on établit à l’aide de prédicats inclus dans le sujet. — Le rap15
16
Thomas, Expositio Posteriorum Analyticorum I, lect. 1 n. 6. : « Et quia iudicium certum de effectibus haberi non potest nisi resolvendo in prima principia, ideo pars haec analytica vocatur, idest resolutoria. Certitudo autem iudicii, quae per resolutionem habetur, est, vel ex ipsa forma syllogismi tantum, et ad hoc ordinatur liber Priorum analyticorum, qui est de syllogismo simpliciter ; vel etiam cum hoc ex materia, quia sumuntur propositiones per se et necessariae, et ad hoc ordinatur liber Posteriorum analyticorum, qui est de syllogismo demonstrativo. » Thomas, Expositio Posteriorum Analyticorum I, lect. 33 n. 1. « [...]hic intendit ostendere quod sit status in affirmativis in sursum et deorsum. Et dividitur in duas partes : in prima parte, ostendit propositum logice, idest per rationes communes omni syllogismo, quae accipiuntur secundum praedicata communiter sumpta ; in secunda, ostendit idem analytice, idest per rationes proprias demonstrationi, quae accipiuntur secundum praedicata per se, quae sunt demonstrationi propria ; ibi : analytice autem manifestum etc. »
Métaphysique analytique et métaphysique scotiste
289
prochement avec Kant est tentant, mais il doit être mené avec prudence : il y a plusieurs formes d’inclusion, qui ne sont pas toutes analytiques au sens kantien. Seul l’inclusion per se primo modo (où le prédicat est inclus dans les sujet) correspond au sens kantien. L’analytica au sens de Thomas n’est pas l’analytique au sens de Kant. La distinction entre logique et analytique se précise ; la logique comprend deux branches : l’analytique, qui résout la science aux principes connus par soi ; la dialectique, qui considère les prédicats qui ne sont pas inclus par soi17. L’analytique correspond bien aux prédicats inclus par soi dans un sujet, et donc aux propositions évidentes par soi. Mais pas aux propositions analytiques au sens kantien, qui ne recouvrent que les propositions connues par soi du premier mode (où le prédicat est inclus dans le sujet). A la fin du XIIIe siècle, analytique signifie : « démontré à partir des principes propres de la science correspondante ». S’inspirant manifestement de Thomas, Henri de Gand ajoute : « De même que, pour l’intelligence complexe, il faut parvenir à une analyse (reductio) en un principe premier complexe, entièrement connu par soi pour l’intellect (sans quoi il faudrait remonter à l’infini), de même, dans le concept de l’intelligence du simple […] il faut ramener tous ces concepts à un concept simple, premier et le plus connu, dans lequel tous les autres doivent s’analyser, et qui est inclus dans tous les autres. Et celui-ci est le concept d’étant en tant qu’il est étant, selon Avicenne, dans la Métaphysique I »18.
Ainsi, le premier principe dans l’ordre des réalités simples est un concept auquel on peut ramener tous les autres. Il est simple (incomplexum), premier (primum), et le plus connu (notissimum). De plus, il est inclus dans tous les autres, comme un aspect dans le tout plus compréhensif. Comme le dit fort justement J. Paulus, « ce qui n’est chez Aristote que doctrine de la science et du savoir, se trouve partiellement intégré par Henri à une doctrine de la conception intellectuelle »19. M. Pickavé, dans son livre sur la métaphysique d’Henri de Gand, consacre un chapitre tout à fait remarquable à 17
18
19
Thomas, Expositio Posteriorum Analyticorum, I lect. 35 n. 2 : « [...] brevius et citius poterit manifestari analytice quam manifestatum sit logice. Ubi considerandum est quod analytica, idest demonstrativa scientia, quae resolvendo ad principia per se nota iudicativa dicitur, est pars logicae, quae etiam dialecticam sub se continet. Ad logicam autem communiter pertinet considerare praedicationem universaliter, secundum quod continet sub se praedicationem quae est per se, et quae non est per se ». Henri de Gand, Summa 34, 3, ed. Macken, 190 : « Sicut in intellectu complexo oportet fieri reductionem in aliquod primum principium complexum omnino intellectui per se notum — aliter enim procederetur in infinitum —, sic in conceptu intellectus incomplexi […] oportet omnes huiusmodi conceptus reducere ad aliquem conceptum incomplexum primum et notissimum, in quem omnes alii habent reduci, et qui includitur in omnibus aliis. Et est iste ‘conceptus entis inquantum ens est’, secundum Avicennam in I° Metaphysicae ». Paulus, Henri de Gand, Essai sur les tendances de sa métaphysique, 4.
290
Olivier Boulnois
cette question20. À côté de la recherche d’un premier principe des propositions complexes, on pourra rechercher un premier principe dans les intelligibles simples. Tout le débat métaphysique sur l’être se situe ainsi sur le plan du concept : l’étant est accessible en un concept ; le terme premier de la connaissance est un concept. Le problème de la métaphysique n’est plus le problème de l’être, mais le problème du concept d’être. Celui-ci constitue le premier concept, appréhendé par lui-même, et qui constitue le principe dans lequel s’analysent tous les autres concepts, et à partir duquel ils sont produits par composition. Mais le tournant, devenu manifeste chez Henri de Gand, naissait structurellement chez Avicenne. Alors qu’Aristote remontait aux termes simples de la proposition, Avicenne, Thomas et Henri de Gand remontent aux termes simples de l’analyse des concepts. L’ordre des propositions complexes repose sur l’ordre des concepts simples qu’elles composent et divisent. De même qu’on peut remonter à un principe premier dans l’ordre des propositions complexes, on peut remonter à un terme premier dans l’ordre de la conception de l’intelligence du simple21. L’opération est une reductio (analysis). Au lieu de descendre vers l’aval (et vers des conclusions), on remonte vers l’amont, vers les conditions de possibilité de la connaissance simple et de la science propositionnelle. On peut donc remonter à des éléments, ou des intelligibles simples, sousjacents à la fois aux propositions complexes et à tous les concepts simples. Ainsi, la métaphysique, science de l’étant en tant qu’étant, parce qu’elle est analytique, et parce qu’elle devient la science du concept, constitue la science fondamentale, et la science des sciences. Dès Henri de Gand et Duns Scot, tout le problème de la validité de la science porte donc sur le rapport entre le caractère analytique des premiers principes et le caractère synthétique des connaissances acquises à partir de l’expérience. Henri de Gand dénombre trois sources de la connaissance : « Il faut remarquer qu’à l’égard des principes comme à l’égard des conclusions, il y a divers modes de connaissance. Et à l’égard des principes, il y en a trois : en effet, d’une première manière, nous connaissons des principes en tant que nous en connaissons les termes ; […] mais encore, nous connaissons le principe d’une seconde manière, par la voie du sens, de la mémoire et de l’expérience ; enfin, nous connaissons les principes d’une troisième manière, quand la raison mène à une impossibilité »22.
20 21 22
Pickavé, Heinrich von Gent über Metaphysik. Aristote, Premiers Analytiques I, 1, 71 a 1-2 : « Tout enseignement et tout apprentissage provient d’une connaissance préalable ». Henri de Gand, Quodlibet IX, q.4, ed. Macken, 75-80 : « Sed est advertendum quod tam circa principia quam circa conclusiones varii sunt modi cognoscendi. Et est circa principia triplex : principia enim cognoscimus uno modo inquantum terminos cognoscimus […] ; principium etiam cognoscimus alio modo via sensus, memoriae et experientiae ; principia etiam cognoscimus tertio modo ratione ducente ad impossibile ».
Métaphysique analytique et métaphysique scotiste
291
Les trois sources de la connaissance sont donc : le caractère analytique de certaines propositions, l’induction à partir de l’expérience, et la réfutation dialectique (par l’absurde). Duns Scot s’est interrogé sur cette triple origine de la connaissance, dont la complexité se reflète profondément dans le problème du premier objet de notre intellect. Pour qu’une proposition soit analytique, il n’est pas nécessaire que nous en ayons une connaissance distincte, ni que nous puissions concevoir la quiddité des termes qu’elle enveloppe23. De même, l’étant n’est pas (pour nous) le premier objet de l’intellect dans l’ordre de la génération de notre connaissance, car celle-ci commence avec l’expérience ; mais il l’est (en soi), dans l’ordre des concepts distincts et quidditatifs. Dans le cas d’une proposition immédiate, la vérité ne provient pas d’une relation à la chose extérieure, ni de la simple relation entre ses termes antérieurement à toute proposition composée, mais de la relation entre la connaissance des termes simples et la connaissance de la proposition complexe. La connaissance du premier principe est alors saisie en un seul acte simple, c’est donc une sorte d’acte intuitif, non-discursif, par lequel l’intellect aperçoit que tel prédicat convient à tel sujet. La proposition ne fait que formuler une convenance ou conformité qui se trouve déjà dans la chose, elle ne la crée pas. La connaissance des termes simples produit d’elle-même l’évidence de la proposition qui les unit24. La vérité de la proposition est directement incluse dans les termes qui la composent. Dans le cas des propositions « par soi du premier mode » (analytiques, où le prédicat est inclus dans le sujet), la relation fondatrice sera la nature, ou quiddité, signifiée par les termes de la proposition25. Il s’agit en 23
24
25
Ioannes Duns Scotus, Rep. I-A d. 3 q.2 n. 72, ed. Wolter, 204 : « Unde talis conceptus evidenter ostendit unionem sui et habitudinem ad entitatem, quando scilicet termini concipiuntur secundum quid et confuse, ut in ‘toto’ et in ‘parte’, unde statim notum est per se quod ‘omne totum maius est sua parte’. » Sur ces questions, voir Demange, Jean Duns Scot. La théorie du savoir ,183-195. Ioannes Duns Scotus, Met. VI q. 3 n. 64, OPh IV, 78 : « Haec via ponit veritatem complexi cognosci non per collationem complexionis ad rem extra, nec ad habitudinem realem extremorum priorem naturaliter compositione (quae enim habitudo esset illa nisi identitas pro affirmativa — quae est relatio rationis —, vel diversitas pro negativa — quae forte non est relatio realis ?) ; sed tantum ponit collationem complexionis ad notitiam extremorum simplicem, vel ad extrema, ut in notitia simplici. Statim ex notitia tali patet, si complexio sibi conformetur in primis principiis, quia ratio termini ostendit praedicatum convenire subiecto, et sic non est discursus in cognoscendo primum principium, quia ista notitia simplex includitur in collativa. Non enim componuntur nisi quae in se cognoscuntur, et ita in ipsa complexione tali includitur, ut prius naturaliter ipsa, unde ipsa complexio sive compositio necessario videatur conformis ; quia tunc visa sunt ambo extrema conformitatis, cum tunc intelligantur simplicia, et tunc fiat compositio. Nec requiritur hic collatio compositionis ad simplicia quasi alius actus, sed intellectus componens terminos illos et notitia habitualis terminorum sunt causa necessaria et immediata et integra ad causandum notitiam conformitatis compositionis ad terminos. » Ioannes Duns Scotus, Ord. II d. 3 p. 1 q. 1 n. 32, ed. Vat. VII, 403 : « Secundum prioritatem naturalem est ‘quod quid est’ per se obiectum intellectus […] et propositiones ‘verae primo modo’ sunt verae ratione quiditatis sic acceptae, quia nihil dicitur ‘per se
292
Olivier Boulnois
effet, pour Duns Scot, de dégager une « vérité objective », une théorie de l’objet et de l’ens en tant que visé par l’intellect, sans renvoyer pour autant à la vérité comme adéquation entre la chose extérieure et l’intellect. Mais pour Duns Scot, la connaissance n’est pas seulement fournie par la forme analytique des premiers principes. Les deux autres sources de la connaissance, l’expérience et la réfutation dialectique, doivent s’y articuler. Selon le début de la Métaphysique d’Aristote, l’art (ici au sens de savoir-faire, ou de savoir tout court) est engendré par l’expérience26. À titre d’objection, Duns Scot propose naturellement la théorie augustinienne de l’illumination : « il ne faut pas attendre la vérité authentique des sens »27. Mais il propose aussi, ce qui est plus radical, une réflexion sur l’induction évoquée par Aristote : il appartient à l’expérience de savoir qu’un événément survient dans plusieurs cas ; mais savoir qu’il intervient dans tous les cas, c’est le propre de la science ; or à partir d’une pluralité, on ne peut pas conclure qu’il en va ainsi pour tous les cas28. L’induction n’est pas l’accumulation d’expériences, mais le passage à une règle universelle, qui ne peut pas provenir de l’expérience. Pour employer une formulation kantienne, la connaissance commence avec l’expérience, mais elle n’en dérive pas. La solution consiste à poser qu’en droit, la connaissance est déductive à partir de principes, mais en fait, il arrive que l’intellect ait besoin d’une aide extérieure pour renforcer sa capacité d’atteindre la demonstration. Bref, en soi, la science est a priori, même si, pour nous, il nous arrive d’y remonter a posteriori29. Il est impossible de s’interroger sur le sens de l’analytique chez Scot et dans sa postérité sans évoquer l’interrogation kantienne sur l’analytique. Car chez Kant également, l’articulation entre l’a priori et l’a posteriori, entre l’analytique et l’expérience, mais aussi entre l’analytique et la dialectique, est au coeur du problème de la métaphysique.
26 27
28
29
primo modo’ de quiditate nisi quod includitur in ea essentialiter. » Cf. Ioannes Duns Scotus, Rep. II d. 12 q. 6 n. 11, ed. Wad. XI, 328b. Aristote, Metaphysica I c. 1 (AL XXV2 7 ; A c. 1, 981a 5) : “ Experientia quidem enim artem fecit ”. Augustin, 83 Quaestiones, q. 9 : « [...] ex sensibilibus non est exspectanda sincera veritas » (BA 10, 60) ; l’argument joue un rôle essentiel chez Henri de Gand (Summa 1, 2, f° 5 E, ed. Wilson, 43), cf. Porro, Sinceritas veritatis. Ioannes Duns Scotus, Met. I q. 4 n. 1, OPh III, 95 : « Secundum Philosophum in littera : habere quod in multis singularibus, experimenti est ; habere quod in omnibus, artis ; sed ex multis non possunt concludi omnia, sed est consequens ; ergo etc. » ; cf. Aristote, Metaphysica A, 1, 981 a 6-14 (I c. 1 ; AL XXV2 7-8). Ioannes Duns Scotus, Met. I q. 4 n. 11, OPh III, 98 : « Ita in quibusdam, naturale lumen intellectus est ita potens quod ex se sufficit quod applicet principia ad conclusiones, et tunc dicitur scientia acquiri per inventionem. Quandoque non potest, et tunc iuvatur ex quibusdam signis sensibilibus propositis sibi a docente, per quae docens exprimit applicationem quam apud se habuit. Et addiscens concipit, et in virtute luminis proprii conclusioni consentit, quam deductam esse videt ex principiis sibi prius notis. »
Métaphysique analytique et métaphysique scotiste
293
La métaphysique est une science transcendantale, dit Scot30. Or selon Kant, cette definition est inadéquate : la métaphysique des anciens était « improprement transcendantale », parce qu’elle faisait des critères de pensée ” des « propriétés des choses en elles-mêmes »31. Autrement dit, le concept scotiste de transcendental avait le tort d’être réaliste. On sait quelle est la clé de la critique kantienne : l’erreur de la métaphysique antérieure consiste à s’en tenir à un usage purement logique de l’analytique (c’est-à-dire des concepts purs de l’entendement), en prenant ces critères logiques pour les propriétés des choses en elles-mêmes. Elle use de la logique comme d’un organon, comme d’un outil pour la science des objets de l’expérience, alors qu’elle est simplement un canon, une norme préalable32. Or, pour Kant, les lois de la logique s’appliquent immédiatement aux représentations et seulement médiatement – par les representations – aux objets représentés. Le rapport de convertibilité entre logique et ontologie n’est qu’un rapport indirect. L’erreur, finalement, est d’user des concepts métaphysiques (et d’abord des transcendantaux) comme de prédicats réels. Contrairement à cette lecture réaliste, il faut comprendre le transcendantal, non comme une condition de possibilité de la chose même, mais comme une condition de possibilité de l’expérience et de la science des objets. L’on comprend alors qu’un concept pur de l’entendement n’est pas un prédicat réel, mais une règle pour la synthèse dans l’expérience. C’est alors qu’on peut user de l’analytique d’une manière vraiment transcendantale. Le lien entre l’analytique et la métaphysique est donc extrêmement fort. La connaissance a priori du concept pris dans sa pure forme logique, indépendamment des conditions de l’expérience, est métaphysique ; c’est ainsi que se construisent nos trois idées transcendantales de l’âme, du monde et de Dieu. L’analytique construit donc la métaphysique. Mais l’analytique transcendantale fonde également la validité future de la métaphysique comme science. Car la critique ne consiste pas à nier toute validité à la métaphysique, mais à établir les conditions de possibilité d’une métaphysique future33. Et il est possible de donner un sens critique à la dimension analytique de la métaphysique. La philosophie transcendantale de Kant est critique parce qu’elle repose sur une analytique : elle précède et fonde la métaphysique ; la critique de la raison révèle autant les fondements que les limites de la métaphysique ; elle en est donc la propédeutique. Au sein de la Critique de la raison pure, cette fonction critique est particulièrement assumée par l’analytique de l’entendement : « Le 30 31 32 33
Ioannes Duns Scotus, Met. Prol. n. 18, OPh III, 9. Kant, Critique de la Raison pure, B 113-114 (I, 839-840). Kant, Critique de la Raison pure, A 60-61 / B 85 (I, 819). Kant, Prolégomènes à toute métaphysique, Préface : « je pouvais avancer d’un pas assuré, quoique toujours lent, de façon à déterminer enfin toute l’étendue de la raison pure, dans ses limites comme dans son contenu, complètement et conformément à des principes universels, car c’est ce don’t la métaphysique a besoin pour construire son système selon un plan sûr. » (AK IV, 261 ; trad. fr. J. Rivelaygue. Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1985, II, 24).
294
Olivier Boulnois
nom orgueilleux d’ontologie, qui prétend donner des choses en général des connaissances synthétiques a priori, dans une doctrine systématique […] doit faire place au nom modeste d’une simple analytique de l’entendement pur »34. Ainsi, la metaphysica generalis de Duns Scot, l’ancienne ontologie qui s’occupait des propriétés de l’ens commune, devient une analytique des concepts de l’entendement pur35. La dimension critique de la métaphysique repose donc sur une lecture transcendantale de l’analytique. Même si le transcendantal kantien ne s’y réduit pas, c’est avec Kant que l’analytique prend une dimension critique qu’elle conservera dans la philosophie analytique, dans un dialogue inconscient avec la structuration scotiste de la métaphysique. Mais la principale différence avec Scot reste le refus du réalisme direct de notre connaissance. III Duns Scot et l’origine de la philosophie analytique : C. S. Peirce Il semble impossible d’examiner les positions de la philosophie analytique sans évoquer Peirce, bien qu’il se situe en-deçà de la philosophie analytique du XXe siècle. Car même s’il n’a pas défini lui-même ainsi sa philosophie, c’est bien un père fondateur de la philosophie analytique. D’une part, il définit la tâche de la philosophie comme une tâche d’analyse36. Surtout, il soutient quatre principes méthodologiques anticartésiens souvent repris par la philosophie analytique : 1. Nous ne saurions commencer par le doute complet : « Ce scepticisme initial [de Descartes] ne sera donc que duperie sur soi : ce ne sera pas un doute réel »37. Car la démarche qui prétend surmonter le doute total n’aboutit qu’à rétablir la totalité des préjugés antérieurs. Bien au contraire, il ne faut douter que de ce dont on trouve des raisons de douter au cours de la recherche38. 2. Ce qui peut faire avancer la philosophie n’est pas une certitude individuelle, mais le travail collectif d’une communauté, examinant avec discipline et rigueur les théories. 3. Les raisonnements en philosophie ne doivent pas être des chaînes d’arguments, qui n’auraient pas plus de force que n’en possède le maillon 34 35 36
37 38
Kant, Critique de la Raison pure, B 303, trans., Pléiade, I, 977, je souligne. Sur ce point crucial, voir l’article de Hinske, « Ontologie oder Analytik des Verstan des ? », 303-309. Peirce, Pragmatisme et pragmaticisme, trans., 282 : « [...] il faut une tournure d’esprit extrêmement différente pour le travail analytique de la philosophie et pour le travail observationnel de la science spéciale ». – La meilleure étude des relations entre Peirce et Scot se trouve chez Honnefelder, Scientia transcendens, 383-402 ; voir aussi Maddalena, « Un estremista dello scotismo : Charles Sanders Pierce », 569-583. Peirce, Pragmatisme et pragmaticisme, 37. Cela restera la position de Wittgenstein dans De la Certitude et dans les Investigations philosophiques.
Métaphysique analytique et métaphysique scotiste
295
le plus faible, mais des faisceaux de raisonnements convergents, fins mais suffisamment nombreux et tressés serrés. 4. Il existe une donnée ultime, inanalysable : « Toute philosophie non-idéaliste suppose un terme ultime absolument inexplicable et inanalysable ; en un mot, quelque chose qui résulterait de la médiation, mais qui ne serait pas lui-même susceptible de médiation. Or, que quelque chose soit ainsi inexplicable, on ne peut le savoir qu’en raisonnant à partir de signes »39. Enfin, Peirce estime avoir démontré quatre autres points, qui restent fondamentaux pour la philosophie analytique : « 1. Nous n’avons aucun pouvoir d’Introspection. Au contraire, toute notre connaissance du monde interne est dérivée par raisonnement hypothétique de notre connaissance des faits externes. 2. Nous n’avons aucun pouvoir d’Intuition. Au contraire, toute connaissance (cognition) est déterminée logiquement par des connaissances (cognitions) antérieures. 3. Nous n’avons aucun pouvoir de penser sans signes. 4. Nous n’avons aucune conception de l’absolument inconnaissable »40. De surcroît, Peirce montre que la quadruple erreur de Descartes correspond à une quadruple rupture avec la scolastique. Il est donc clair que sa critique de Descartes aboutit à une manière de renouer avec la scolastique en général. Tout d’abord, Peirce estime que la science moderne exige une réflexion philosophique, celle-ci étant d’abord de nature métaphysique. Un simple survol des index permet de s’apercevoir que les auteurs les plus cités par Peirce sont, dans l’ordre, Aristote, Kant et Duns Scot. Dans son œuvre, la référence à Duns Scot est omniprésente et toujours positive. Peirce caractérise l’originalité de la scolastique à partir de l’oeuvre de Scot, une réflexion approfondie sur les choses mêmes, et non un inutile système : « Son œuvre n’est pas programmée pour incarner ses idées, mais la vérité universelle. […] Car il n’y a aucun travail mécanique, aucune répétition sans pensée à propos de la même chose. Chaque partie est travaillée pour elle-même comme un problème séparé, n’importe le degré d’analogie qu’elle institue envers une autre partie »41.
Peirce voit dans l’œuvre de Scot un modèle de la sienne, et admire en lui « l’un des plus grands métaphysiciens de tous les temps »42. Il se décrit lui-même comme un « réaliste scotiste », et explique son attachement à Scot par le fait que celui-ci soutient à la fois l’existence d’une métaphysique et le réalisme des universaux : 39 40 41
42
Peirce, Pragmatisme et pragmaticisme, 38-39. Peirce, Pragmatisme et pragmaticisme, 39. Peirce, CP 8. 11. Selon la tradition, je cite l’édition des Collected Papers, Cambridge : CP, puis un chiffre arabe qui renvoie au tome, un point, et le numéro de paragraphe ; l’édition des Writings (W), Bloomington, sera suivie d’un chiffre romain pour renvoyer au tome, d’une virgule, et du numéro de page. Peirce, CP 4. 28.
296
Olivier Boulnois
« En s’appelant lui-même scotiste, l’auteur ne veut pas dire qu’il revient aux vues générales d’il y a 600 ans ; il veut simplement dire que la question (point) de la métaphysique, sur laquelle Scot a principalement insisté, et qui, depuis, a été perdue de vue (has passed out of mind), est une question très importante, inséparablement liée à la question la plus importante sur laquelle insister aujourd’hui »43.
La question fondamentale est donc pour Peirce le problème des universaux, et il en trouve la solution chez Scot, à l’articulation entre logique et métaphysique, dans une théorie originale et radicale, une forme de réalisme, à ses yeux la plus aboutie. Pour Peirce, c’est d’abord la science moderne elle-même qui exige le réalisme des universaux : les sciences formulent les lois qui relient des événements singuliers44. Et la question du corrélat objectif de ces lois universelles se pose : les « lois et les types généraux » sont-ils « des fictions de l’entendement, ou sont-ils réels ? »45. Peirce observe que les sciences modernes présupposent l’objectivité et la réalité de ce qu’elles connaissent. Toute science implique que le réel soit connaissable, et réciproquement, que les corrélats de ces connaissances soient quelque chose de réel. Par exemple, la prévision des phénomènes suppose que les lois universelles aient un répondant dans la nature46. Par conséquent, la science moderne exige le réalisme : « les réalistes soutenant que la réalité appartient à ce qui est présent en nous dans une connaissance vraie de quelque sorte que ce soit, les nominalistes soutenant que les causes absolues externes de la perception sont les seules réalités »47.
Certes, la science ne peut prouver la réalité de l’universel, elle se borne à le présupposer : la méthode scientifique exige qu’il y ait « […] des choses réelles, dont les propriétés sont entièrement indépendantes de nos opinions »48. Ainsi, le réalisme, c’est-à-dire l’existence réelle d’un corrélat objectif aux lois de la nature, est la condition de possibilité de la science49. Peirce retrouve ici des arguments caractéristiques de Duns Scot. Pour le Docteur subtil, si la science n’était fondée que dans notre intellect et non dans la chose, quand nous connaissons un concept, nous ne connaîtrions rien de réel, « […] et notre opinion ne serait pas changée du vrai au faux en raison d’un changement dans l’existence de la chose »50. Autrement dit, si toute 43 44 45 46 47 48 49 50
Peirce, CP 4. 50. Peirce, CP 4. 530. Peirce, CP 1. 16. Peirce, CP 5. 101 ; 5. 94. Peirce, W II, 490. Peirce, CP 5. 384 (W III, 254). Peirce, CP 1. 20 ; 4. 1. Ioannes Duns Scotus, Met. VII q.18 n.58, OPh III, 354 : « esse in intellectu primo modo vel secundo non est nisi habere relationem rationis ad intellectum. Illud autem, quod est in re, bene habet istam relationem ; ergo illud quod est universale, est in re. [n. 59] Confirmatur : aliter in sciendo aliqua de universalibus, nihil sciremus de rebus sed tantum de conceptibus nostris, nec mutaretur opinio nostra a vero in falsum propter
Métaphysique analytique et métaphysique scotiste
297
notre connaissance n’était qu’une fiction, forgée par notre intellect, notre connaissance ne pourrait jamais être falsifiée. Le nominalisme peut expliquer les sciences comme représentations des choses, mais seul le réalisme peut permettre de comprendre leur falsifiabilité. Comme le dit Peirce, « […] l’ignorance et l’erreur ne peuvent être connus que comme corrélatifs de la connaissance réelle et de la vérité, qui ont à leur tour la nature de connaissances. Au-delà de chaque connaissance et en contradiction avec elle, il y a une réalité inconnue, mais connaissable ; mais au-delà de toutes les connaissances possibles et en contradiction avec elles il n’y a que ce qui se contredit soi-même. En bref, la connaissabilité (au sens le plus vaste), et l’être (being) ne sont pas seulement la même chose métaphysiquement, mais ce sont des “ termes synonymes ” »51.
Tout être est connaissable, tout le connaissable est être. Et tout le reste est littérature. Peirce distingue soigneusement l’existence individuelle, inconnaissable sinon par une expérience ineffable, et les concepts universels par lesquels nous la visons, mais auxquels correspond toujours une réalité dans l’objet : « Le réel, alors, est ce en quoi, tôt ou tard, l’information et le raisonnement résulteront finalement, et ce qui est pour cette raison indépendant de vos caprices (vagaries) et des miens. […] Par conséquent, ce qui est pensé dans ces connaissances (cognitions) est le réel, tel qu’il est réellement. […] Mais, puisque aucune de nos connaissances n’est absolument déterminée, il en découle que les universaux (generals) doivent avoir une existence réelle. Maintenant, ce réalisme scolastique est habituellement démoli comme une croyance en des fictions métaphysiques. Mais en fait, un réaliste est simplement quelqu’un qui ne connaît pas plus de réalité que celle qui est représentée dans une représentation vraie. Puisque, pour cette raison, le mot “ homme ” est vrai de quelque chose, ce que signifie “ homme ” est réel »52.
Le réalisme n’ajoute pas une fiction au réel, comme on l’en accuse parfois : il reconnaît simplement que toute connaissance vraie implique un réel connu. Autrement dit, la science présuppose une métaphysique réaliste, entendue comme « science de la réalité »53. La grande « theory of reality »54 élaborée par Peirce s’inspire ainsi de l’interprétation scotiste de la métaphysique. Selon Peirce, le sens métaphysique du terme de realitas serait même né avec Duns Scot55. La réalité n’est ni du domaine de la chose extérieure (ce que Peirce appelle le « Premier », First) ni de celle de la pensée (Second) mais du domaine de la médiation entre les deux (Tiers). La réalité désigne : « un mode spécial d’être, dont la caractéristique est que les choses qui sont réelles sont tout ce qu’elles 51 52 53 54 55
mutationem in exsistentia rei. » Peirce, CP 5. 257 (W II, 208) : “ Cognizability […] and being are not merely metaphysically the same, but are synonymous terms ”. Peirce, CP 5. 312 (W II, 239). Peirce, CP 5. 121 et 129. Peirce, CP 5. 331 (W II, 251 sq.) ; Peirce, CP 8.13 (W II, 469 sq.). Peirce, CP 4. 28 ; 5. 430 ; 6. 495 ; 8. 319.
298
Olivier Boulnois
sont réellement, indépendamment de toute assertion sur elles »56. Alors que l’existence suppose une « réaction avec l’environnement », et implique un « caractère dynamique », la réalité est « un certain mode de l’indépendance envers la pensée », mais possède un « caractère cognitif (cognitionary) », parce qu’elle en est aussi le corrélat57. Le domaine de la réalité ne se réduit pas à celui de l’existence. Le réel est un moyen terme entre l’existant et la représentation : l’existant est « ipso facto réel », tandis que « l’objet de la représentation » ne l’est pas ipso facto58. « L’existence, ainsi, est un mode spécial de la réalité, qui, quelles que soient les autres caractéristiques qu’il possède, a celle d’être absolument déterminé. La réalité, en retour, est un mode spécial de l’être, dont la caractéristique est que les choses qui sont réelles, sont ce qu’elles sont réellement, indépendamment de toute assertion à leur sujet »59.
La réalité englobe donc la correspondance entre la pensée et le réel : « Des choses réelles sont de nature cognitive et donc significative, si bien que le réel est ce qui signifie quelque chose de réel »60. La réalité n’est pas seulement l’existence dans un objet extérieur, mais aussi tout ce qui fonde la vérité, y compris ce qui n’existe pas mais qui possède une essence « réale » (chosique, realis, celle d’une res) et pensable : le pensable et le réel sont corrélatifs. Cette position est une reprise exacte de la définition de la métaphysique comme scientia realis par Duns Scot. L’erreur du nominalisme et de la philosophie moderne est de comprendre l’existant comme le seul mode de la réalité61, et de s’en tenir à la dichotomie entre fictions et choses singulières existantes. On la retrouve, chez Kant, dans l’idée que la chose en soi est irreprésentable, ce qui rend sa réalité inconnaissable62. Certes, le nominalisme a raison de dire que l’objet immédiat sur lequel porte un terme universel est quelque chose de pensé. Mais cela ne veut pas dire que cet objet pensé est une fiction. Il faudrait plutôt dire que la chose en soi, ce à quoi se rapporte chaque terme universel, est toujours quelque chose d’inconnu, mais de connaissable 63. La négation du fait n’est pas la négation de la possibilité. Le nominalisme commet l’erreur double et symétrique de faire dépendre la validité de la connaissance d’une fiction, c’est-à-dire de la seule représentation64, et de penser la réalité comme « quelque chose d’indépendant de la relation représentative »65. Les nominalistes (jusqu’à Kant) ne voient pas 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Peirce, CP 6. 349. Peirce, CP 5. 503. Peirce, CP 5. 96. Peirce, CP 6. 349. Peirce, CP 5. 320 (W. II, 244) : « Real things are of a cognitive and therefore significative nature, so that the real is that which signifies something real » . Peirce, CP 1. 21, 422 ; 2. 115. Peirce, CP 5. 312 (W II, 239 s.). Peirce, CP 5. 257 (W II, 208). Peirce, CP 8. 16 (W II, 471). Peirce, CP 5. 312 (W II, 239 s.).
Métaphysique analytique et métaphysique scotiste
299
que le medium peut être transparent à la réalité et construisent ainsi un abîme entre nos représentations libres et lumineuses, d’une part, et une réalité obscure et inconnaissable, de l’autre. Ils en concluent à tort, en raison de la différence incontestable de l’être représenté et de l’être réel, que l’objet d’une représentation ne peut jamais être réel66. Sur ce point, Peirce se réfère toujours à l’interprétation d’Avicenne par Scot67, c’est-à-dire à l’indifférence et à l’isolement de l’essence (equinitas est equinitas tantum) : l’essence du cheval n’est ni son universalité logique, ni son existence individuelle, ni l’être dans l’intellect, ni l’être dans le monde, mais ce qui fonde l’un et l’autre68. Il reprend également la voie scotiste pour caractériser l’étant (being) comme objet de la theory of reality. La connaissance de tout étant particulier présuppose celle de l’étant en tant que tel. Or l’étant n’est pas une structure déterminée (comme le genre et l’espèce) qui serait commune à tous les objets connaissables, « […] car il n’y a rien de tel à observer »69. On ne peut atteindre la signification de ce terme que par une analyse de nos concepts et de leurs modes de prédication, « […] par l’intermédiaire de ce que nous pensons à l’aide de signes »70. L’étant n’a pas de contenu propre, particulier, il ne peut pas être défini par des concepts supérieurs, et ne peut être déterminé que par la négation71. L. Honnefelder a raison d’insister sur ce point : Peirce arrive alors au même résultat que Scot, qui distingue l’étant au sens le plus général (generalissime) (le représentable), englobant l’ens reale et l’ens rationis, et l’étant au sens simplement général, c’est-à-dire « […] celui à qui l’être ne répugne pas » (le possible). Pour Peirce, on manifeste l’être en éliminant son contraire, le néant, sous la forme du contradictoire, de l’impensable et de l’inconnaissable. Si le néant est le contradictoire en soi, l’être est le pensable72. Mais l’étant est ambigü, il désigne tantôt « tout ce qui peut être nommé » (le représentable), tantôt « l’étantité des choses réelles, qui est indépendante de ce que nous en pensons », c’est-à-dire la reality, distinguée de la fiction (figment). Ce qui est l’exacte reprise du tableau des sens de l’être dans le Quodlibet III de Scot73. L’ensemble de la réflexion métaphysique de Peirce culmine dans l’insistance sur le dépassement du possible logique par le possible réel, distinction qui remonte à Scot : le possible logique indique simplement une non-contradiction logique, perçue par l’intellect, le possible réel indique une aptitude à être, fondée sur une puissance d’être74. Le réel, connaissance possible de l’objet, sera atteint par 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Peirce, CP 5. 96. Peirce, CP 8. 18 (W II, 472 s.) ; 5. 312 (W II, 239 s.). Cf. Duns Scot, Ord. I, d.2, notamment p. 2 q. 1–4 nn. 382–408, 390, ed. Vat. II, 349–350. Peirce, CP 5. 294 (W II, 231). Peirce, CP 5. 294 (W II, 231). Peirce, CP 1. 548 (W II, 49 s.) ; 5. 294 (W II, 231). Peirce, CP 5. 257 (W. II, 208) ; 5. 294 (W. II, 231) Peirce, W. II, 103-104 ; voir Boulnois, Etre et Représentation, 444-452. Cf. Johannes Duns Scotus, Ord. I d. 2 q. 1–4 n. 262, ed. Vat. II, 282 : « Possibile logicum est modus compositionis formatae ab intellectu, cuius termini non includunt contra-
300
Olivier Boulnois
la pensée après une recherche progressive, par essais et erreurs, qui aboutira à une « opinion définitive ». Il ne doit pas être confondu avec la simple possibilité logique : la réalité du réel n’est pas la « simple possibilité » (bare possibility) du possible logique. Le pragmatisme conclut que la réalité de l’universel se manifeste par sa connaissabilité dans une « conclusion ultime ». Ce qui est exigé par le pragmatisme n’est pas simplement l’affirmation qu’« il y a des possibilités logiques », mais qu’il il y a une possibilité « objective », une « possibilité réelle »75. Seule la possibilité réelle, la fondation objective de toute connaissance fonde le « réalisme scolastique » exigé par la démarche pragmatiste. Avec le concept de possibilité réelle, Peirce se fonde radicalement sur la compréhension de l’être qui est au cœur de la métaphysique scotiste. Pour Scot, cette possibilité est réelle parce qu’elle est non seulement non-contradictoire en soi, mais engendrée dans le principe (principiative) par un intellect. Selon Peirce, « […]la troisième catégorie, — la catégorie de la pensée, de la représentation, de la relation triadique, de la médiation, du véritable Tiers, le Tiers comme tel — est un ingrédient essentiel de la réalité, et pourtant elle ne constitue pas la réalité par elle-même »76.
Il tente ainsi de fonder une définition du possible réel, où la connaissabilité est une partie intégrante de la réalité, d’une manière analogue à ce que Scot exprime avec la liaison entre « possible logique » (« formaliter ex se ») et « possible réel » (« principiative per intellectum »). Ainsi, dans toutes les étapes de la démarche métaphysique, et malgré la différence de méthode qu’implique le pragmatisme, Peirce suit de près la voie de Duns Scot. IV La philosophie analytique et Duns Scot Contrairement à Peirce, pour qui la démarche métaphysique est indispensable à la réflexion philosophique, une bonne part de la philosophie analytique, depuis Carnap et le cercle de Vienne, croit devoir éliminer la métaphysique au nom d’une critique exigée par la logique et la science moderne. Ce »positivisme logique« reste problématique : toute l’œuvre de Wittgenstein montre l’impossibilité de réussir l’entreprise de réduction de la signification à la vérification et de la connaissance à la science. En revanche, tout un autre pan de la philosophie analytique estime que la philosophie comporte nécessairement une réflexion métaphysique fondamentale. Comme je l’ai déjà dit, malgré des rapprochements stimulants, tels ceux effectués par G. Krieger77, il n’existe pas de philosophie analytique qui soit
75 76 77
dictionem, et ita possibilis est haec propositio « Deum esse », « Deum posse produci », « Deum esse Deum » ; sed possibile reale est quod accipitur ab aliqua potentia in re sicut a potentia inhaerente alicui vel terminata ad illud sicut ad terminum ». Peirce, CP 5. 453 s. Peirce, CP 5. 436. Krieger, « Die Begründung der Metaphysik in der Existenz ».
Métaphysique analytique et métaphysique scotiste
301
explicitement d’inspiration scotiste. Puisqu’il n’existe pas de « système » analytique, il ne peut exister de philosophie analytique (complète) d’inspiration scotiste. Simplement, il existe des thèses de Scot, sur la structure de l’être, le possible, la liberté, le temps, ou Dieu, qui peuvent être reprises par certains analyticiens, plus ou moins consciemment d’ailleurs. Pour rapprocher Duns Scot et la philosophie analytique sur le plan de la métaphysique, il faut se situer au niveau plus fondamental des structures de pensée. Parmi les philosophes analytiques qui renouent, par-delà la rupture moderne, avec la tradition scolastique, il me semble possible de distinguer trois familles d’analyticiens, ceux qui se réclament du nominalisme, ceux qui se réclament du thomisme (nous l’avons vu), et ceux qui poursuivent les options fondamentales de Duns Scot (sans se réclamer explicitement de lui). Plutôt que de rapprocher, de manière plus ou moins forcée, telle ou telle philosophie avec le scotisme, il me semble plus juste d’examiner les critères généraux qui impliquent une reprise des acquis de Scot par la philosophie analytique. Comme pour la pensée de Peirce, trois critères me semblent décisifs : le réalisme des universaux (ce qui exclut ipso facto toute la famille d’esprit se réclamant du nominalisme) ; l’analycité de l’être (ce qui exclut le thomisme, avec sa doctrine de l’acte d’être) ; le statut du possible-réel. On ne pourra parler véritablement de voie scotiste dans la philosophie analytique que si une pensée remplit ces trois critères : admettre le réalisme des universaux ; suivre la voie de la résolution des concepts sans épouser la doctrine de l’analogie de l’être ; admettre la réalité modale du possible. 1. Le réalisme des universaux L’enjeu de la philosophie analytique dépend largement de sa relation à Kant. Pour Kant, le propre de la science, et donc de la métaphysique comme science, réside dans l’existence de propositions synthétiques et a priori. Telle est la question que la philosophie doit affronter après Kant : la métaphysique est-elle une discipline analytique ou synthétique ? L’ensemble de nos connaissances est-il obtenu par des équivalences analytiques ? Or la philosophie analytique, comme son nom l’indique, tourne le dos à la voie synthétique (des conditions de possibilité de l’expérience). De surcroît, c’est une philosophie analytique du langage. Ainsi, pour Frege et Bolzano, la distinction entre « sens et dénotation » ou « signification et référence » (Sinn et Bedeutung) est fondamentale. Une expression peut se référer au même objet par deux significations différentes. La différence réside dans « le mode de donation » (Art des Gegebenseins) de l’objet : l’étoile du matin et l’étoile du soir renvoient l’une et l’autre au même référent, Vénus. L’expression recouvre alors une identité ontologique et une différence sémantique. Or l’objectif de la philosophie, selon Frege, est de fournir une grammaire pure et idéale (une idéographie) permettant de résoudre l’ensemble des problèmes philosophiques par des équivalences analytiques entre les propositions. Ici, deux voies s’ouvrent. Faut-il interpréter les propositions en extension ou en compréhension ? Soit on considère que la proposition s’épuise dans l’extension de sa référence, soit on s’interroge sur la structure signifiante
302
Olivier Boulnois
des propositions, sur les alternatives possibles. Soit on se borne, comme N. Goodman, à arpenter la structure de l’apparence78, soit on recherche, grâce à la structure signifiante du langage, les structures formelles du réel. Pour Goodman, deux descriptions sont équivalentes si elles ont la même extension, mais on ne s’occupe pas de savoir s’il aurait pu en être autrement. Par exemple, »les habitants de Wilmington qui ont les cheveux roux en 1947 pèsent entre 175 et 180 livres« : d’une manière purement nominaliste, on se borne à constater le fait d’une coïncidence, mais on ne s’interroge pas sur les corrélations réelles, causales, entre le régime alimentaire et la couleur des cheveux, par exemple, ni sur les possibilités alternatives (combien de personnes aux cheveux noirs ont le même poids ? etc.). Ainsi, le domaine de référence remplace les modes de signifier. Goodman refuse ainsi l’existence de propriétés, de classes et de catégories réelles. Il serait peut-être possible de regrouper les doctrines extensionnalistes comme celle de Carnap et de Quine dans la même interprétation. Mais il est possible d’analyser autrement la différence des modes de signifier, en compréhension. Comme l’a fait remarquer Husserl, 1+1 et 2 ne sont pas seulement des expressions de même référent, mais des expressions de sens différents79. L’autre voie est donc celle qui s’interroge, à partir des possibilités du langage, sur les structures possibles du monde. Cela suppose qu’il y ait une réalité des modes de signifier, qui corresponde à des modes d’être réels. Suivre la voie analytique, si l’on entend par là procéder par analyse conceptuelle, c’est suivre une métaphysique réaliste (sans le savoir ou en le sachant), et indirectement épouser une position scotiste sur la structure de la métaphysique. Dans cette ligne, C. Tiercelin a récemment proposé d’adopter, comme Peirce, la voie de l’analyse conceptuelle, en testant l’ensemble des cas possibles pour un problème donné. Reposant sur des expériences dont elle explore les contradictions et les points communs, elle les teste dans une perspective faillibiliste, à la manière des sciences et du pragmatisme peircien. Mais sa réflexion comporte aussi une partie a priori qu’elle élabore en recourant à la méthode des cas possibles, permettant ainsi de fonder l’expérience sur une nécessité conceptuelle, de nature métaphysique80. La question de la réalité des objets rejaillit sur celle de leurs propriétés. Certaines tentatives s’efforcent de penser les propriétés des objets comme des faisceaux de »tropes« , et non comme des entités qui appartiendraient à la catégorie fondamentale de l’être. Pour ces penseurs, comme dans la tradition nominaliste, il n’existe pas d’autre propriété que l’existence, tandis que tous les universaux se ramènent à des « tropes ». — D’autres comprennent l’objectité et les universaux comme des catégories ontologiques fondamentales, et soulignent l’irréductibilité des universaux à toute propriété distincte d’eux. David Armstrong définit un monde comme un ensemble d’états de choses, qu’ils soient singuliers (particulars) ou universels, et dont la combinatoire pro78 79 80
Goodman, The Structure of appearance. Husserl, Philosophie der Arithmetik : Mit ergänzenden Texten (1890-1901), ed. Eley, 104-105. Tiercelin, « La métaphysique et l’analyse conceptuelle ».
Métaphysique analytique et métaphysique scotiste
303
duit des modalités conceptuelles. Comme Aristote et contre Platon, il n’admet pas que les universaux existent en soi, mais seulement des universaux instanciés dans le singulier. Les catégories sont donc fondées sur les objets et sur les universaux, mais D. Armstrong croit pouvoir éliminer les tropes de sa table des catégories81. Le concept de « truthmaker » (« vérifacteur ») est introduit pour expliquer en quoi une proposition n’est pas simplement un entrecroisement de possibilités, mais renvoie à un état de chose, un concept dont J. Schmutz a montré l’enracinement dans la métaphysique post-scotiste82. C’est celui-ci qui la « rend vraie » (facit vera, diraient les médiévaux). C’est évidemment une manière de fonder le réalisme. Le vérifacteur d’une proposition est tel qu’il appartient à l’essence d’une proposition d’être vraie si l’état de fait correspondant existe83. P. Simons a donné la définition suivante du vérifacteur : TM Pour tout p : p Il existe x, x rend p vrai (x makes it true that p)84. La proposition : « Garfunkel chante » est le porteur de vérité du vrai si et seulement si le prédicat « chante » est rempli (satisfied) par l’individu « Garfunkel ». C’est une manière de fonder la vérité comme adéquation sur une condition objective. C’est ce que l’on peut appeler le théorème Simon and Garfunkel. La question du vérifacteur pose cependant de nombreux problèmes : par exemple, comment fonder la vérité d’une proposition négative, par exemple « there is no cat on this mat » ? Existe-t-il un état de chose négatif ? En quoi un état de chose négatif peut-il fonder quoi que ce soit ? Les réflexions de Jonathan Lowe vont dans le même sens, mais intègrent une théorie des tropes. Lowe considère qu’il est possible de donner une fondation ontologique pour les sciences particulières85. Il signale d’abord que la catégorie la plus vaste est celle de l’étant, et que les réalités sont échelonnées en universelles et particulières. D’autre part, sur la doctrine des universaux, il suit de très près la position d’Avicenne. Certes, l’universel ne subsiste pas réellement : « il ne peut pas y avoir d’universaux non-instanciés, et les singuliers (particulars) jouissent d’une sorte de priorité ontologique sur les universaux, précisément comme le croyait Aristote »86. Les universaux dependent des réalités singulières pour exister. Néanmoins, ils ont leur consistance propre, qui ne dépend pas, par exemple, de la réalisation instanciée en tel lieu et en tel instant de cet universel. Ils n’existent pas davantage dans un monde idéal : « L’universel n’a pas à exister « ailleurs », simplement parce qu’il n’a pas de lieu dans l’espace : il a simplement à exister »87. 81 82 83 84 85 86 87
Armstrong, A World of States of Affairs. Schmutz, « Les innovations conceptuelles de la métaphysique » ; cf. Smith., « Sachver halt » ; de Libera, La Référence vide. Armstrong, Truth and Truthmakers. Simons, « Logical atomism and ontological refinement ». Lowe, The Four-Category Ontology. Voir aussi Lowe, « La métaphysique comme science de l’essence ». Lowe, The Four-Category Ontology, 25. Lowe, The Four-Category Ontology, 25.
304
Olivier Boulnois
Le réalisme des universaux pose autant de problèmes qu’il en résout. Mais fondé sur la consistance de l’essence, ou sur une para-existence de l’universel, il se rapproche de la position scotiste, dans sa lignée typiquement avicennienne. 2. Universalité de l’objet et univocité de l’être Dire que la philosophie est la science première parce qu’elle est présupposée par toutes les autres sciences, c’est déjà choisir une option scotiste. Cela revient à prendre sa primauté au sens d’une priorité dans l’ordre de conception, comme Avicenne. La présupposition s’enracine dans la doctrine porphyrienne de la division : diviser un genre, c’est le spécifier en lui adjoignant des différences. Ce qui est le plus général est aussi antérieur dans l’ordre de la division. Il est donc premier. La philosophie première traite ainsi réalités les plus générales et premières. La métaphysique constitue une science transcendantale, parce que son objet transcende tous les genres déterminés. C’est ainsi que la science première, celle de l’étant en général, se distingue de la philosophie seconde, celle de l’étant mobile, ou la physique. L’ontologie est la science la plus générale, parce qu’elle porte sur l’étant en tant qu’étant, elle est présupposée par les autres sciences, qui sont des sciences particulières88. La métaphysique est alors une science de l’objet en général, une métaphysique générale, par opposition à la métaphysique spéciale, qui porte sur Dieu, le monde ou l’âme (Kant). C’est même une théorie de l’objet en général, et non une théorie des objets spécifiques. Comme le remarque F. Nef, on peut alors parler d’ »ontologie« 89. – On peut objecter à cela que la métaphysique est un projet historique daté, donc dépassé, qui comprend aussi une psychologie et une cosmologie. — Mais on peut encore répondre à l’objection qu’il serait possible construire une psychologie et une cosmologie analytiques qui seraient incluses dans la métaphysique. La métaphysique reste architectonique : ce n’est pas un moment philosophique dépassable, pas une doctrine (comme le sont le matérialisme, le spiritualisme) mais une discipline nécessaire pour toute démarche analytique fondamentale. 88
89
La phénomenologie de Husserl est indiscutablement une métaphysique, contrairement à ce que laisse entendre une certaine réception francophone, voir Méditations cartésiennes § 64, (Husserliana 1), 182 : « la phénoménologie […] n’exclut que la métaphysique naïve, opérant avec les absurdes choses en soi, mais non la métaphysique en général ». Dans les œuvres de jeunesse, il est vrai, Husserl emploie « métaphysique » dans le sens d’une représentation qui se substitue à l’accès phénoménologique aux choses mêmes. Il admet, à partir des années 1920, un sens positif de « métaphysique » : à côté des lois d’essence, dégagées par la phénoménologie transcendantale, l’analyse phénoménologique rencontre des données comme l’incarnation et l’altérité (je ne peux être que dans un seul corps, et je ne peux pas m’identifier à autrui) ; c’est à cela que Husserl fait ici allusion. La métaphysique au sens de Scot, l’articulation ultime des structures du réel, Husserl l’appelle plutôt « ontologie formelle ». En somme, Husserl considère que l’ancienne metaphysica generalis doit intégrer la phénoménologie sous le titre d’ontologie formelle, et qu’il peut effectivement y avoir une métaphysique phénoménologique, mais qui relève des faits ultimes sur lesquels débouche l’expérience humaine. Cf. Nef, Qu’est-ce que la métaphysique ?, 49-73.
Métaphysique analytique et métaphysique scotiste
305
Seconde objection : une telle métaphysique nous emmènerait forcément là où certains analyticiens ne veulent pas aller, au-delà de la physique. — Mais il est possible de répondre à la seconde objection : l’analyse métaphysique ne remonte pas nécessairement au-delà du physique. Car la proposition « il n’existe que des objets physiques » est une proposition métaphysique, hors de portée de la physique. C’est par un raisonnement analogue qu’Aristote affirme que, même si Dieu n’existait pas, la métaphysique aurait encore sa raison d’être : elle porterait sur la nature, tout simplement90. Malgré l’immense diversité des positions, suivre la voie de la métaphysique comme analytique du concept d’étant, revient à reprendre indirectement l’une des thèses les plus fondamentales de Scot : le caractère transcendantal de la métaphysique. 3. La réalité du possible La pensée de Duns Scot peut sans l’ombre d’un doute être définie comme une sorte de réalisme modal91. En effet, Duns Scot est l’inventeur du concept de possible réel (entendu comme objet de la toute-puissance divine). Surtout, il fonde la possibilité sur une non-contradiction formelle des parties d’un concept92, ce qui revient à dire qu’il y a un fondement réel, intrinsèque, de la possibilité93, antérieur à la pensée divine qui le rend objectif, pensable, avant de le rendre réel en le créant. De surcroît, dans son analyse métaphysique de la pensée divine, après l’instant de la reconnaissance d’un possible comme non-contradictoire, il envisage la combinaison de plusieurs ensembles de compossibles, entre lesquels la volonté divine pourra choisir. Ainsi, il est 90
91 92
93
Aristote, Métaphysique E, 1, 1026 a 28 : « Si donc il n’y a pas de substance autre que celles constituées par nature, la physique sera science première ». Cet argument est à la source de la spéculation scotiste sur l’hypothèse de l’inexistence de Dieu. Voir Boulnois, « Si Dieu n’existait pas », 50-74. Nef, Qu’est-ce que la métaphysique ? , 27 : « nous comprenons mieux l’importance de certaines analyses scotistes à la lumière de la métaphysique modale contemporaine ». Johannes Duns Scotus, Ord. I d. 43 q. un., n. 5, trans. Boulnois, 274 : « […] rien n’est absolument impossible que parce qu’il lui répugne absolument d’être ; or ce à quoi l’être répugne, il lui répugne par soi (ex se) d’emblée, et non à cause d’une relation affirmative ou négative qu’il entretiendrait d’emblée envers quelque chose d’autre. En effet, toute répugnance [contradiction] est une répugnance [contradiction] des extrêmes d’après leur raison formelle et leur inhérence essentielle par soi, abstraction faite de toute autre relation — positive ou négative — de l’un et l’autre extrême envers quoi que ce soit d’autre. Ainsi, le blanc et le noir, par soi, d’après leurs raisons formelles, sont contraires et ont une répugnance formelle, abstraction faite (par impossible), de toute relation envers quoi que ce soit d’autre. Est donc absolument impossible ce à quoi il répugne par soi d’être, et qui est de lui-même d’emblée tel que l’être lui répugne. » Johannes Duns Scotus, Ord. I d. 36 q. un. n. 60, ed. Vat. VI, 296 : « Et pourquoi cela [exister] n’est-il pas contradictoire avec l’homme alors que c’est contradictoire avec la chimère ? – Parce que celui-ci est ceci, et celui-là cela, et cela quel que soit l’intellect qui le conçoit, car — comme on l’a dit— tout ce qui est par soi formellement contradictoire avec une chose lui contredit, et tout ce qui n’est pas formellement contradictoire ne lui contredit pas ». Il est possible “ formaliter ex se ” (Id. I d. 36 q. un. n. 48). Cf. Boulnois, « Jean Duns Scot ».
306
Olivier Boulnois
l’inventeur du concept d’ensemble de compossibles, ce que Leibniz appellera un « monde possible ». Même s’il n’utilise pas l’expression, Duns Scot indique clairement que, dans un instant logique originaire, avant de créer, Dieu envisage dans son intelligence, non seulement des possibilités alternatives pour chaque essence, mais les diverses compositions de ces possibilités en plusieurs ensembles, soumis à la condition qu’ils soient compatibles entre eux (» compossibles «), avant de choisir par sa volonté lequel il créera. Cette analyse est soutenue par une conception radicale de la contingence : « Je n’appelle pas contingent tout ce qui est non-nécessaire ou non-éternel, mais ce dont l’opposé peut arriver quand il arrive »94. C’est ce que S. Knuuttila appelait une contingence synchronique : « Cette possibilité logique n’est pas en tant que la volonté a des actes successifs, mais dans le même instant : car dans le même insatant où la volonté a un acte de vouloir, dans le même instant et pour le même instant, elle peut avoir un acte de vouloir opposé »95. Or cette analyse est largement reprise par le théoricien du réalisme modal, David Lewis. Lewis critique radicalement l’hypothèse des vérifacteurs. Par exemple, dans le cas d’un énoncé négatif, on ne voit pas comment un état de chose non-existant pourrait fonder l’énoncé. C’est simplement l’instanciation, la réalisation de l’universel dans une instance, qui explique la vérité de la proposition. « Elle est vraie simplement parce que la chose instancie la propriété »96. La contrepartie est importante, elle consiste à accepter que les possibles restent possibles même là où ils n’instancient aucune propriété. 94 95
96
Johannes Duns Scotus, Ord. I d. 2 n. 86, ed. Vat. II, 178. Johannes Duns Scotus, Lect. I dist. 39 V. 50, ed. Vat. XVII, 495. Malgré les analyses remarquables de Schmutz, « Qui a inventé les mondes possibles ? », et tout en concédant qu’indiscutablement le terme ne se trouve pas chez Scot, je ne vois pas de raison de refuser à Duns Scot la paternité du concept de » monde possible «. L’argument de la p. 16, qui revient sur les exemples fournis par Scot, ne me semble pas suffisant : Scot » parle de compossibilité de prédicats pour définir un ‘possible’ individuel « ; »Nous sommes ici dans l’analyse de situations individuelles, et non de mondes possibles« . Car Scot parle régulièrement de “ compossibilia ” à propos de plusieurs essences. Par exemple Ord. I d. 43, qu. un. n. 16, ed. Vat. VI, 359 : « Est ergo ibi iste processus, quod sicut Deus suo intellectu producit possibile in esse possibili, ita producit duo entia formaliter (utrumque in esse possibili), et illa ‘producta’ se ipsis formaliter sunt incompossibilia, ut non possint simul esse unum, neque aliquid tertium ex eis ; hanc autem incompossibilitatem, quam habent, formaliter ex se habent, et principiative ab eo — aliquo modo — qui ea produxit ». Il s’agit bien de la compatibilité et de l’incompatibilité entre plusieurs essences, et si l’on n’oublie pas que l’instant de nature où sont produites les essences est logiquemen antérieur à celui où elles sont créées dans l’existence, il semble clair que le Dieu de Scot doit d’abord comparer l’ensemble des essences pour vérifier si elles sont compatibles entre elles avant de les créer. Il envisage donc la possibilité des essences créables et leur compossibilité avant de les créer. Même si le terme de “ monde possible ” n’est pas chez Scot, en est-il si loin ? Lewis, Papers in Metaphysics and Epistemology, 204 : « Même si nous assurons que les manières d’être sont des entités — des universaux ou des propriétés en quelque autre sens —, la prédication ne sera toujours pas vraie en vertu de la pure existence des choses et de la propriété. Elle est vraie simplement parce que la chose instancie la propriété ».
Métaphysique analytique et métaphysique scotiste
307
Pour David Lewis, il existe une pluralité de mondes possibles (et même une infinité), qui ont tous le même degré de possibilité, et qui ont leur consistance indépendamment les uns des autres ; c’est de ces autres mondes que nous parlons lorsque nous parlons d’une réalité possible mais non réelle. Pour chaque manière distincte dont le monde aurait pu être, il y a un monde possible distinct. « Il y a d’innombrables autres mondes. […] Nous, et ce qui nous entoure, même éloignés dans le temps et l’espace, constituons notre monde. [… Les mondes] sont isolés : il n’y a ni relation spatio-temporelle entre des choses qui appartiennent à des mondes différents, ni une chose survenant dans un monde qui cause la survenue de quelque chose dans un autre monde »97.
Cette doctrine renvoie à une sémantique des propositions : chaque proposition est soit vraie soit fausse dans chacun des mondes possibles. Par conséquent, le statut modal d’une proposition se traduit en faisant référence aux mondes où elle est vraie et aux mondes où elle est fausse : une proposition qui est vraie dans tous les mondes possibles est une proposition nécessaire ; une proposition qui est vraie dans au moins un monde est une proposition contingente ; une proposition impossible est fausse dans tous les mondes possibles. Notre monde n’ajoute l’existence que du point de vue de l’observateur : tout ce qui peut être relié à l’observateur dans l’unité de l’espace et du temps constitue notre monde, et tout ce qui ne s’y trouve pas constitue un autre monde possible. L’effectivité de ce monde est donc indexicale, elle tient simplement à sa relation à l’observateur (de même que « ici » et « maintenant » sont des termes indexicaux, qui se réfèrent toujours au locuteur). Le monde effectif (actual) n’est en acte que pour nous qui l’habitons. Comme dit Lewis : « Un monde quelconque contient toutes les choses seulement actuelles »98. Les autres mondes sont appelés « contrefactuels » (ineffectifs), ils n’en sont pas moins réels99. Le réalisme modal de Lewis accorde le même degré de réalité à tout ce qui « consiste », et met sur un pied d’égalité tous les mondes possibles. On a donc pu caractériser la pensée de D. Lewis comme un leibnizianisme sans Dieu100. Quelle place occupe cette thèse dans l’histoire de la métaphysique ? Selon F. Nef, « d’Aristote à Lewis, le progrès d’émancipation (sic) du possible est continu : bridé auparavant par le principe de plénitude, il accédait au statut d’alternative synchronique chez Duns Scot, puis au statut plein et entier de monde chez Leibniz — mais avec un système centré sur le monde actuel — et enfin Lewis vint, qui accorda l’actualité relative à tous les mondes »101. 97 98 99 100
101
Lewis, On the Plurality of Worlds, 2. Lewis, Philosophical Papers, I, 26. Lewis, Counterfactuals, 84. Cf. Loux, The Possible and the Actual. Plus exactement, pour D. Lewis, Dieu existe sans doute dans au moins un monde possible : son concept n’est pas contradictoire. Mais il n’existe pas dans le nôtre : son concept n’est donc pas celui d’être nécessaire. Nef, Qu’est-ce que la métaphysique ?, 675.
308
Olivier Boulnois
Mais en réalité, c’est le scotisme qui est plus radical que la pensée de Leibniz, et la pensée de Lewis se branche directement sur la radicalité scotiste. Sachant que, pour Duns Scot, même si Dieu n’existait pas, le possible serait identique102, on comprend que la doctrine de la possibilité intrinsèque est pour lui indépendante de l’existence de Dieu. La thèse est encore plus radicale chez Vázquez : de Duns Scot à Vázquez et Izquierdo, la science divine ne cesse de changer de structure, on passe à un monde qui détient en soi sa vérité propre, devient la règle intangible du savoir divin, et finalement se dispense de Dieu103. Le scotisme accomplit d’avance un dépassement de la pensée leibnizienne qui avait déjà été aperçu — et rejeté — par Leibniz lui-même104. Tandis que Leibniz affirme encore : « Si Dieu n’existait pas, rien ne serait possible »105, la scolastique scotiste n’a pas ces réticences. Ainsi, l’absence, dans la théorie de Lewis, d’un Dieu nécessaire, ne l’empêche pas de s’inscrire dans la lignée de Duns Scot. Il faut également souligner que, par-delà D. Lewis, d’autres formulations du réalisme modal ont été proposées. Certaines rejettent l’exigence stricte de parallélisme entre les mondes possibles, et une théorie de la modalité où les différentes versions du possible ont une indépendance stricte. Mais l’idée forte demeure : le réalisme modal se traduit par une sémantique des mondes possibles106. Si D. Lewis va plus loin que Scot, c’est plutôt en affirmant que les autres mondes possibles existent (sans être pour autant « effectifs », i. e. réels en acte : actual). Il ignore la neutralité avicennienne de l’essence (c’est-à-dire du possible) : pour Avicenne (et Duns Scot), le possible n’a pas besoin d’exister pour être possible. — Robert Adams, Alvin Plantinga notamment, ont rejeté la pensée de D. Lewis comme extravagante, et suggéré à la place l’interprétation des mondes possibles comme des ensembles cohérents de propositions décrivant le monde, mais à la manière dont il pourrait être autrement, et non à la manière dont il existerait un autre monde ; non seulement notre monde est le seul actuel, mais les mondes possibles n’en sont que des possibilités alternatives. Comme le dit R. Adams, « Nous ne pensons pas que la différence qui existe entre Henry Kissinger et le Magicien d’Oz à l’égard de l’actualité tienne 102 103 104
105
106
Cf. Boulnois, « Si Dieu n’existait pas ». Voir Bardout, Boulnois (eds.), Sur la science divine. Leibniz, Essais de théodicée II, § 184 : « il n’est pas à propos d’aller tout à fait au-delà de Dieu, et de dire avec quelques scotistes que les vérités éternelles subsisteraient, quand il n’y aurait point d’entendement, pas même celui de Dieu. Car c’est, à mon avis, l’entendement divin qui fait la réalité des vérités éternelles ». Leibniz, La cause de Dieu (1710), § 8 (Gerhardt 6), 440 : « Ipsa rerum possibilitas, cum actu non existunt, realitatem habet fundatam in divina existentia ; nisi enim Deus existeret, nihil possibile foret et possibilia ab aeterno sunt in ideis Divini Intellectus ». « La possibilité même des choses, quand elles n’existent pas en acte, a le fondement de sa réalité dans l’existence divine ; car, si Dieu n’existait pas, rien ne serait possible, et les possibles sont de toute éternité dans les idées de l’entendement divin » (Opuscules philosophiques choisis, 240, c’est moi qui souligne). Voir Nef, « La métaphysique du réalisme modal ».
Métaphysique analytique et métaphysique scotiste
309
seulement à la relation qu’ils entretiennent avec nous »107. Bref, les possibles forment précisément des ensembles de compossibles, mais non des mondes qui existent. Il est donc clair que d’autres versions, plus modérées, du réalisme modal, sont parfaitement compatibles avec la pensée de Scot. Elles en sont même plus proches. Nous l’avons constaté, il n’existe pas de scotisme analytique. Néanmoins, il faut souligner qu’une reprise consciente de la pensée de Scot est indéniablement présente à l’origine de la philosophie analytique, chez Peirce. Surtout, il est possible d’envisager trois formes de scotisme possible, c’est-à-dire trois sortes de présence du scotisme dans la philosophie analytique : 1°) l’admission d’une existence réelle des universaux ; 2°) le caractère analytique de la métaphysique du concept d’étant ; 3°) le réalisme modal du possible. Tout le problème réside finalement dans la méthode herméneutique de l’interprète : soit on se borne à une approche historiciste de la métaphysique, qui a connu une naissance, une vie et une mort, et dans ce cas, la métaphysique de Duns Scot s’achève au milieu du XIVe siècle, remplacée la métaphysique nominaliste ; soit on adopté une approche doctrinale, insistant sur l’idée que les propositions ont une valeur de vérité dépassant l’instant et le lieu de leur production, irréductible à tout système. Dans le premier cas, la renaissance contemporaine de la spéculation métaphysique est incompréhensible, et la reprise des problématiques scotistes est une simple coïncidence. Dans le second cas, la répétition des mêmes énoncés métaphysiques correspond à la structure de la question de l’être, toujours travaillée et jamais résolue, à l’incessante obstination du désir de savoir, qui bute toujours sur la diversité finie des réponses possibles.
107
Adams, « Les théories de l’actualité », trans., Drapeau-Contim, 233 ; voir Plantinga, « Deux concepts de la modalité ».
310
Olivier Boulnois
Bibliographie Littérature primaire Aristote, Analytica prioria et posteriora, ed. W. D. Ross, Oxford, Clarendon, 1964 ; Translatio Iacobi, ed. L. Minio-Paluello, B. G. Dod. Bruges, Paris : Desclée de Brouwer, 1968. Aristote, Metaphysica, ed. W. Jaeger. Oxford : Clarendon, 1957. Auctoritates Aristotelis, ed. J. Hamesse : Les Auctoritates Aristotelis, Un florilège médiéval, Étude historique et édition critique, Louvain, Paris : Publications universitaires – Béatrice-Nauwelaerts, 1974. Augustin, De diversis quaestionibus 83, ed. Bénédictine (Œuvres de saint Augustin 10, Mélanges Doctrinaux), Paris : Desclée de Brouwer, 1952. Henri de Gand, Summa (Quaestiones ordinariae), art. XXXI-XXXIV, ed. R. Macken (Opera Omnia XXVII), Louvain : University Press, 1991. Henri de Gand, Quodlibet IX, ed. R. Macken (Opera Omnia XIII), Louvain : University Press, 1983. Husserl, Edmund, Philosophie der Arithmetik : Mit Ergänzenden Texten (1890-1901), ed. L. Eley (Husserliana 12), La Haye : Nijhoff, 1970. Husserl, Edmund, Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, ed. S. Strasser (Husserliana 1). La Haye : Nijhoff, ²1991. Ioannes Duns Scotus, Ordinatio I, d. 43., ed. Vat. VI, 1963, trad. O. Boulnois, La Puissance et son Ombre. De Pierre Lombard à Luther, Paris : Aubier, 1994. Ioannes Duns Scotus, Rep. I-A, ed. A. Wolter and O. Bychkov, St Bonaventure, New York, 2004. Ioannes Duns Scotus, Lect. I dist. 39, ed. Vat. XVII. Ioannes Duns Scotus, Met. I-IX, ed. Viv. VII. Ioannes Duns Scotus, Rep. II, ed. Wad. XI. Ioannes Duns Scotus, Ord. II, ed. Vat. VII. Kant, Immanuel, Critique de la Raison pure, trans. F. Marty and A. Delamarre: Emmanuel Kant, Œuvres Philosophiques, tome 1. Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1980. Kant, Immanuel, Prolégomènes à toute métaphysique future, trans. J. Rivelaygue : Emmanuel Kant, Œuvres Philosophiques, tome 2. Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1985. Leibniz, Die Philosophischen Schriften, ed. C. I. Gerhardt, Berlin, 1875-1890. Hildesheim, New York : Georg Olms (repr.), 1978 (7 vol.). Leibniz, La cause de Dieu (1710), trans. P. Schrecker : Leibniz, Opuscules philosophiques choisis, Textes et traduction P. Schrecker. Paris : Vrin, 2001. Peirce, Charles S., Pragmatisme et pragmaticisme, Œuvres I, ed. C. Tiercelin and P. Thibaud, Paris : Le Cerf, 2002. Peirce, Charles S., Collected Papers of Charles Sanders Peirce, ed. e C. Hartshorn, P. Weiss et al. Cambridge : Cambridge University Press, 1931-1958 (8 vol.). Peirce, Charles S., Writings of Charles S. Peirce. A chronological edition. ed. M. Fisch et al. Bloomington : Indiana University Press, 1982-1993 (6 vol.). Thomas, Expositio libri Posteriorum, ed. Leonina (Opera omnia I-II), Roma, Paris : Commissio Leonina, J. Vrin, 1989. Thomas, Summa Theologiae I-II, (Biblioteca de Auctores Cristianos), Madrid, 1962. Thomas, In XII Metaphysicorum librorum Expositio, ed. M. R. Cathala. Turin : Marietti, 1964. Thomas, In Aristotelis libros Peri hermeneias et Posteriorum analyticorum expositio, ed. R. M. Spiazzi. Turin : Marietti, 1955. Wittgenstein, Ludwig, De la Certitude, trad. J. Fauve, Paris : Gallimard, 1969.
Métaphysique analytique et métaphysique scotiste
311
Wittgenstein, Ludwig, Investigations philosophiques, trans. P. Klossowski : Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, suivi de Investigations philosophiques, Paris : Gallimard, 1961.
Littérature secondaire Adams, R. M., « Les théories de l’actualité. » Noûs 8 (1974 ) : 211-253, trad. F. DrapeauContim, in E. Garcia and F. Nef, Métaphysique contemporaine, Propriétés mondes possibles et personnes, Paris : Vrin, 2007, 227-253. Armstrong, D., A World of States of Affairs. Cambridge : Cambridge University Press, 1997. Armstrong, D., Truth and Truthmakers. Cambridge Studies in Philosophy. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. Bardout, Jean-Christophe and Olivier Boulnois (eds.), Sur la science divine. Paris : PUF, 2002. Boulnois, Olivier, Être et Représentation. Une généalogie de la métaphysique moderne à l’époque de Duns Scot (XIV° siècle). Paris : PUF (Epiméthée), 1999. Boulnois, Olivier, « Si Dieu n’existait pas, faudrait-il l’inventer ? Situation métaphysique de l’éthique scotiste. » Philosophie, 61 (mars 1999), Duns Scot: de la métaphysique à l’éthique, 50-74. Boulnois, Olivier, « Jean Duns Scot. » In Sur la Science divine, ed. Jean-Christophe Bardout et Olivier Boulnois, 245-272. Paris : PUF, 2002. Boulnois, Olivier, « La philosophie analytique et la métaphysique selon Duns Scot. » Quaestio 8, La posterità di Giovanni Duns Scoto, ed. P. Porro, J. Schmutz, 585-610. Bari, 2008. Cross, Richard « Review of Analytical Thomism: Traditions in Dialogue. » Ars Disputandi 7 (2007 ) : 1 (www.Arsdisputandi.org). Goodman, Nelson, The Structure of appearance. Dordrecht, Boston : Reidel, ³1977. Haldane, John. J., Faithful reason, Essays catholic and philosophical. London, New York : Routledge, 2004. Haldane, John. J., Analytical Thomism: Traditions in Dialogue, ed. Craig Paterson, M. S. Pugh, Aldershot : Ashgate, 2006. Hinske, Norbert, « Ontologie oder Analytik des Verstandes ? Kants langer Abschied von der Ontologie. » In Quaestio 9, Origini e sviluppi dell’ontologia, secoli XVI-XXI, ed. Constantino Esposito, Bari, 2009, 303-309. Honnefelder, Ludger, Scientia transcendens, Die formale Bestimmung der Seiendheit und Realität in der Metaphysik des Mittelalters und der Neuzeit. Hamburg : Meiner, 1990. Krieger, Gerhard, « Die Begründung der Metaphysik in der Existenz – Zu einer Parallele zwischen sprachanalytischer Ontologie und spätmittelalterlichem Scotismus. » Franziskanische Studien 72/1 (1990) : 70-86. Lewis, David, Counterfactuals. Cambridge, Mass. : Harvard UP, 1973. Lewis, David, Philosophical Papers. Oxford : Oxford UP, 1983, 21986. Lewis, David, On the Plurality of Worlds. Oxford : Blackwell, 21986. Lewis, David, Papers in Metaphysics and Epistemology. Cambridge : Cambridge UP, 1999. de Libera, Alain, La Référence vide. Théories de la proposition. Paris : PUF (Chaire Étienne Gilson), 2002. Loux, Michael J,. The Possible and the Actual. Readings in the Metaphysics of Modality. Ithaca, New York : Cornell University Press, 1979. Maddalena, Giovanni, « Un estremista dello scotismo : Charles Sanders Pierce. » Quaestio 8 (2008), 569-583. Lowe, Ernest J., The Four-Category Ontology, A Metaphysical foundation for Natural Science. Oxford : Oxford University Press, 2006. Lowe, Ernest J., « La métaphysique comme science de l’essence. » In Métaphysique contemporaine, Propriétés, mondes possibles et personnes, ed. Emanuelle Garcia and Frédéric Nef, 85-120. Paris : Vrin, 2007.
312
Olivier Boulnois
Nef, Fréderic, « La métaphysique du réalisme modal: Régression ou enjeu veritable ? » Revue internationale de philosophie, 51/200 (1997) : 231-250. Nef, Fréderic, Qu’est-ce que la métaphysique ? Paris : Gallimard, 2004. Nef, Fréderic, Les propriétés des choses, Expérience et logique. Paris : Vrin, 2006. Paulus, Jean, Henri de Gand, Essai sur les tendances de sa métaphysique. Paris, 1938. Pickavé, Martin, Heinrich von Gent über Metaphysik als erste Wissenschaft, Studien zu einem Metaphysikentwurf aus dem letzten Viertel des 13. Jahrhunderts. Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 91. Leiden, Boston : Brill, 2007. Plantinga, Alvin, « Deux concepts de la modalité : le réalisme modal et le réductionnisme modal. » In Philosophical Perspectives I, Metaphysics, 1987, 189-231, trad. Frédéric Nef dans Emanuelle Garcia et Frédéric Nef, op. cit., 269-307. Porro, Pasquale, « Sinceritas veritatis, Sulle trace di un sintagme agostiniano. », Augustinus 39 (1994), 413-430. Russel, Bertrand, A History of Western Philosophy. New York : Simon & Schuster, 1945. Schmutz, Jacob, « Qui a inventé les mondes possibles ? » Cahiers de Philosophie de l’université de Caen 42 (2005), Les mondes possibles, 9-35. Schmutz, Jacob, « Les innovations conceptuelles de la métaphysique espagnole post-suarézienne : les status rerum selon Antonio Pérez et Sebastián Izquierdo. » Quaestio, Annuario di Storia della Metafisica 9 (2009) : 61-99. Shanley, Brian J., « Analytical Thomism. » The Thomist, 63/1 (1999) : 125-137. Simons, Peter, « Logical atomism and ontological refinement: a defense. » In Language, Truth and Ontology, ed. Kevin Mulligan, 157-179. Dordrecht: Kluwer 1992. Smith, Barry, « Sachverhalt » In Historisches Wörterbuch der Philosophie VIII, 1102-1113. Basel : Schwabe, 1992. Strawson, Peter F., « La Philosophie analytique: deux analogies. » In Analyse et Métaphysique, Peter F. Strawson. Paris : Vrin, 1985. Tiercelin, Claudine, « La métaphysique et l’analyse conceptuelle. » Revue de Métaphysique et de Morale (2002/4) : 558-584. Wittgenstein, Ludwig, Investigations philosophiques, trans., P. Klossowski, Paris : Gallimard, 1961. Wolter, Allan B., « An Oxford Dialogue on Language and Metaphysics. » The Review of Metaphysics, 31 (June 1978) : 615-648 and 32 (December 1978) : 323-348. Wolter, Allan B., « A Reportatio of Duns Scotus’ Merton College Dialogue on Language and Metaphysics. » In Sprache und Erkenntnis im Mittelalter, ed. A. Zimmermann, 179-191. Miscellanea Medievalia 31/1. Berlin : De Gruyter, 1981.
313 Archa Verbi. Subsidia 6
313–321
En Mémoire de Paul Sabatier1 Claude Coulot et Franck Storne
Depuis 2002, la province franciscaine franco-belge des « Trois Compagnons » a déposé à la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (BNU), un « Fonds franciscain » à des fins de conservation et de communication aux chercheurs. Celui-ci n’est pas seulement un fonds patrimonial. C’est aussi un fonds que les franciscains continuent à développer par des achats en partenariat avec la BNU afin d’offrir aux chercheurs les résultats des recherches récentes sur le franciscanisme. Ce fonds est complété par les archives du pasteur et professeur Paul Sabatier, un spécialiste bien connu de l’historiographie franciscaine au tournant des XIXe et XXe siècles. Celles-ci ont été données à la Bibliothèque par son petit-fils, Étienne Juston et par Maurice Causse, un ami de la famille qui a continué les recherches commencées par Paul Sabatier. L’organisation à Strasbourg d’un colloque sur la postérité de Duns Scot a fourni l’occasion d’une exposition Ens Infinitum. À l’école de saint François d’Assise pour faire connaître davantage le Fonds franciscain et les archives de Paul Sabatier, désormais conservées à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Dans le but de replacer Duns Scot dans la tradition franciscaine des XIIIe et XIVe siècles, l’exposition, inaugurée le 18 mars 2009, s’ouvrait par une évocation de la figure de François d’Assise. Puis elle montrait comment se sont développées la théologie et la philosophie franciscaines à travers les figures de saint Bonaventure, Pierre de Jean Olivi, Roger Bacon, Duns Scot et Guillaume d’Ockham. Elle s’est poursuivie avec Antoine de Padoue, aussi grand théologien que prédicateur, et elle a évoqué l’installation des franciscains en Alsace. Elle se terminait par une présentation de Paul Sabatier, historien du franciscanisme. C’est sa figure que nous évoquerons dans les lignes qui suivent. Après avoir retracé les principales étapes de sa vie, nous présenterons ses recherches sur la vie de saint François et sur le Speculum perfectionis. 1. Les grandes étapes de la vie de Paul Sabatier Paul Sabatier naquit le 3 août 1858 à Saint-Michel-de-Chabrillanoux où son père, Michel Sabatier (1812 – 1877), était pasteur. Après une enfance heureuse, Paul Sabatier fit des études secondaires à Besançon, puis à Lille, et en 1878, 1
Cette contribution s’appuie sur deux autres : Juston, «Paul Sabatier ». Causse, Storne, «Paul Sabatier, historien et pasteur ».
314
Claude Coulot — Franck Storne
il partagea deux années de sa vie entre la pharmacie de son frère aîné, à Nîmes, et la faculté de médecine de Montpellier. En 1880, l’exemple du ministère de son père qui venait de mourir lui fit rejoindre la faculté protestante de théologie de Paris où il étudia jusqu’en 1885. Là il eut, entre autres, deux professeurs qui eurent sur lui une grande influence : son homonyme, Auguste Sabatier, et Ernest Renan, professeur au Collège de France, auprès de qui il perfectionna sa connaissance de l’hébreu. En 1884, Paul Sabatier soutint une thèse sur la Didachè dont le manuscrit avait été découvert en 1873 par Philotheos Bryennios, métropolite de Nicomédie, dans la bibliothèque du couvent du Saint-Sépulcre à Constantinople. Dans sa thèse où il commença par un état de la question sur les travaux de ses prédécesseurs, Paul Sabatier insista particulièrement sur les affinités judaïques de la Didachè. S’écartant des solutions généralement adoptées, il data la Didachè des années 50–60 de notre ère et en fit un témoignage capital sur l’histoire de l’Église primitive, alors que la majorité des critiques lui conférait une date de rédaction postérieure (IIe siècle). Si la datation qu’il proposait fut mise en cause par les critiques, tous lui reconnurent de grandes qualités, en particulier Ernest Renan qui, ne partageant pas son point de vue, lui écrivit : « votre travail témoigne d’une rare aptitude pour les recherches de critique et d’histoire ecclésiastique. » De telles études le préparèrent, avant même qu’il put le discerner pleinement, aux austères recherches sur le mouvement franciscain du xiiie siècle et sur l’évolution de l’Église catholique au début du xxe. « Au terme de ses études, Paul Sabatier fut nommé vicaire de la paroisse française de SaintNicolas à Strasbourg. Il resta peu de temps en Alsace (de 1885 à 1888), assez cependant pour épouser Léna Wust d’une famille protestante de la ville, famille libérale et d’une certaine aisance. Mais le pouvoir allemand – à cette époque, l’Alsace était annexée à l’empire allemand – expulsa ce couple qui ne voulait pas intégrer la nationalité germanique2 ».
Et c’est ainsi que Sabatier et sa femme arrivèrent au presbytère de SaintCierge-la-Serre en Ardèche, dans une paroisse pauvre et escarpée où sa santé se trouva vite compromise par la rudesse du climat. Les cérémonies d’enterrement s’effectuaient en ce temps-là en plein vent près des maisons d’habitation et se poursuivaient dans les cimetières familiaux en rase campagne. Des problèmes de voix et de gorge le conduisirent alors à renoncer au pastorat actif. Dès lors, grâce à une indépendance matérielle appréciable, il put progresser dans son intérêt et ses recherches sur saint François. La recherche de documents ou la consultation d’archives le conduisirent alors à de nombreuses reprises en Italie et à Assise. Ses travaux aboutirent en 1893 à la publication d’une Vie de saint François d’Assise3. En 1898, le conseil municipal d’Assise lui conféra la citoyenneté d’honneur, car il consacrait son « grand talent à 2 3
Juston, « Paul Sabatier », 198. Sabatier, Vie de saint François d’Assise.
En Memoire de Paul Sabatier
315
d’heureuses études infatigables pour illustrer la plus grande gloire de la cité4 ». Par ailleurs, de nombreuses conférences en France et en Angleterre en firent un globe-trotter européen avant l’heure. En 1902, il joua un rôle prépondérant dans la création de la Società Internazionale di studi francescani à Assise dont le but était multiple : fonder une bibliothèque sur le franciscanisme, assurer une entr’aide scientifique internationale aux franciscanisants, établir un « codex diplomaticus Assisiensis » et un catalogue descriptif de tous les manuscrits franciscains. Le projet rencontra d’abord une sympathie presque générale, mais il suscita aussi une grande méfiance de la part des milieux catholiques ; elle se transforma en opposition. Ainsi interdit-on à de grands historiens catholiques du franciscanisme d’en devenir membres. Parallèlement à ses travaux franciscains et précisément à la faveur de ses multiples déplacements, Sabatier fut très attentif au catholicisme et à la société de son temps. Il suivit de près la séparation de l’Église et de l’État en France. Après le vote du projet de loi de Séparation des Églises et de l’État, il publia en 1905 À propos de la Séparation des Églises et de l’État5. L’ouvrage n’était pas en prise immédiate avec l’actualité politique : « il y est surtout question de l’évolution religieuse de l’Église catholique et guère de l’ensemble des cultes reconnus par le système concordataire6. » Son propos n’était pas non plus de parler de l’accueil de la loi en France. Il y explique que la séparation est bien plus que la suppression des cultes. Elle est la concrétisation d’une rupture entre deux mentalités, celle d’une partie de l’Église catholique, et celle de la démocratie dont l’objectif est d’amener le citoyen à penser par lui-même. Paul Sabatier y fait aussi la description d’une autre partie de l’Église, celle des modernistes, capables de dialoguer avec les libres penseurs et qui sont les précurseurs d’une nouvelle Église catholique. Quelques années plus tard, en 1909, il publiera sur le même sujet trois conférences dans un livre Les modernistes, notes d’histoire religieuses7. De nouveau, il y décrit « le mouvement moderniste : les obstacles mis à son développement par le Saint Siège, le renouveau qu’il représente pour l’Église catholique, son apport à la vie spirituelle, à l’analyse des sources scripturaires, aux notions religieuses8 ».
Dans cet ouvrage, Paul Sabatier fait encore un état de la situation des modernistes en Europe et il donne leur réaction à l’encyclique « Pascendi » qui condamne leurs théories. Dans un ouvrage intitulé L’orientation religieuse de la France actuelle9, il dépassera ce problème interne au catholicisme pour déboucher sur un panorama où protestants et libres penseurs ont leur place.
4 5 6 7 8 9
Causse, Storne, « Paul Sabatier, historien et pasteur », 227. Sabatier, A propos de la Séparation des Eglises et de l’Etat. Causse, Storne, « Paul Sabatier, historien et pasteur », 241. Sabatier, Les modernistes, notes d’histoire religieuses. Causse, Storne, « Paul Sabatier, historien et pasteur », 247. Sabatier, L’orientation religieuse de la France actuelle.
316
Claude Coulot — Franck Storne
Par ailleurs, durant cette période, Paul Sabatier fut toujours très attentif aux questions de l’enseignement et il eut une action sociale. Il le manifesta dans son pays natal en instituant des prix dits du « 14 juillet » pour les lauréats des écoles primaires de Saint-Michel-de-Chabrillanoux et de Saint-Maurice-enChalencon. À Assise, dans un autre contexte, mais à une époque où la misère de beaucoup était évidente, il traduisit une préoccupation similaire en créant l’œuvre des cantines scolaires à laquelle il put intéresser nombre de ses amis et des admirateurs dans le but de procurer aux garçons de l’école élémentaire de la cité une soupe nourrissante et du pain. « La guerre de 1914-1918 le ramena à la Maisonnette à St-Maurice où il reprit le ministère pastoral pour remplacer ses collègues mobilisés […] Il multipliait démarches et interventions pour secourir les personnes que les malheurs des temps plaçaient dans de tragiques situations, notamment beaucoup d’Alsaciens réfugiés à Privas. En 1918 retour à Strasbourg où, remontant dans la chaire du temple de Saint-Nicolas, il prêcha sur le texte « La victoire qui a vaincu le monde c’est notre foi » (1 Jn 5,4). À la faculté protestante, la dernière étape de sa vie fut consacrée à l’enseignement de l’histoire ecclésiastique où saint François et le catholicisme avaient une juste et large place. Et là aussi l’Ardèche et Saint-Michel qu’il retrouvait pendant les vacances à la Maisonnette étaient encore bien présents dans son esprit. Son logis à Strasbourg était une halte appréciée des appelés au service militaire affectés en Alsace, des fonctionnaires de « l’intérieur » nommés dans les départements recouvrés, trait d’union entre deux provinces éloignées, aussi différentes que l’Alsace et le Vivarais.En 1928, le cancer qui rongeait Paul Sabatier depuis plusieurs années le terrassait et le ramenait au pays natal dans le cimetière de Combier10. »
2. Les recherches de Paul Sabatier Durant l’été 1888, Paul Sabatier visita Assise, puis alors qu’il était pasteur à Saint-Cierge-la-Serre, il commença la rédaction de sa Vie de saint François d’Assise. Comme il le raconte lui-même, il y avait été encouragé par Ernest Renan : « Avant mon départ pour Strasbourg comme pasteur, Renan m’appela dans la salle des professeurs et me dit à part : « J’avais au cœur trois œuvres à accomplir : la vie de Jésus-Christ, l’histoire des origines chrétiennes et la vie de saint François d’Assise. Je ne réussirai à faire que la première. Toi, tu dois faire la vie de saint François » Je me récusai, mais l’appel ne fut pas oublié11. »
La rédaction s’échelonna du 16 octobre 1890 au 10 février 1893. Une présentation de la progression de celle-ci, presque dans l’ordre final des chapitres, offre un aperçu du contenu du livre : « Luttes et triomphe (16 octobre 1890), Première année d’apostolat (18 et 21 octobre 1890), S. François et Innocent III (22-23 octobre 1890), Rivo Torto (24 octobre 1890), Premières tentatives sur les Infidèles (28 octobre 1890), Introduction (23 mars 1891), À la Portioncule (26 nov. 1892), La famille franciscaine primitive (29-30 novembre 1892), Sainte Claire (5-8 décembre 10 11
Juston, « Paul Sabatier », 198. Cité par Causse, Etudes Théologiques et Religieuses, 386.
En Memoire de Paul Sabatier
317
1892), L’homme intérieur et le thaumaturge (14 décembre 1892), Un protecteur (27 au 30 décembre 1892), François et Dominique. Mission de François en Orient (31 décembre 1892 - 5 janvier 1893), La crise de l’Ordre (6-8 janvier 1893), La Règle de 1221 (9-14 janvier 1893), Les Frères Mineurs et la science (14-19 janvier 1893), Le cantique du soleil (26-27 janvier 1893), La dernière année (24 janvier- 3 février 1893), Le testament et la mort (4-7 février 1893), Stigmates (24-25 janvier 1893), L’Indulgence de la Portioncule (9-10 février 1893), avec une exception pour le début de rédaction de la Conclusion (16 janvier 1890)12. »
L’ouvrage parut le 25 novembre 1893. Le succès fut immense, il connaîtra 46 éditions. Tolstoï proposa à Sabatier d’en faire lui-même la traduction en russe. Une traduction anglaise par L. S. Houghton parut en 189413. Une autre en allemand par Margarete Lisco fut publiée en 189514. Le livre reçut un accueil enthousiaste auprès d’écrivains comme Alphonse Daudet, François Coppée ou Frédéric Mistral. Certes dans le livre, la figure historique de l’homme que Paul Sabatier présentait de François ne différait pas tellement de ce qu’elle était chez Karl Hase en 185615. Un canevas chronologique sûr avait déjà été fourni par le P. MarieLéon Patrem16, O. F. M., et le drame de la vocation franciscaine primitive, contrainte de se plier aux normes ecclésiastiques, avait été analysé de main de maître par K. Müller17. Toutefois, la nouveauté de Paul Sabatier résidait dans son art d’insérer la vie de saint François dans le cadre de l’Ombrie, dans la pénétration psychologique dont il faisait preuve et dans son analyse de la crise de l’ordre. Enfin et contrairement à Renan, Paul Sabatier affirmait l’authenticité des stigmates. Le livre suscita des critiques parfois sévères. Du côté catholique, le Fr. Pie de Langogne écrit : « l’indulgence ne serait pas de mise à l’égard de M. Sabatier. Son livre sur saint François n’est pas seulement erroné, hérétique : il est déloyal. Ce mot paraîtra bien dur ; il n’est que juste. Comment ne pas qualifier sévèrement un volume qui, a capite ad calcem, n’est qu’un parti pris de falsification hagiographique, falsification habilement étudiée, et frauduleusement présentée au public comme une œuvre d’érudition et de sincérité ? »18.
Du côté protestant, Émile Doumergue écrit : « [...] Voilà le Christ de Bethléem mis sur la même ligne que le Christ d’Assise. Ce n’est qu’une négation. Il n’y a plus de Christ. Je n’accuse pas ; je ne discute pas ; je constate […] je ne connais pas de phénomène anarchique comparable à ce livre écrit par un pasteur et béni par un pape19. »
12 13 14 15 16 17 18 19
Causse, Storne, « Paul Sabatier, historien et Pasteur », 223. Hougthon, Life of St. Francis of Assisi. Lisco, Leben des heiligen Franz von Assisi. Hase, Franz von Assisi. Patrem, Tableau synoptique. Müller, Die Anfänge des Minoritenordens. De Langogne, Annales franciscaines, 843. Doumergue, Le Christianisme au XIXe siècle.
318
Claude Coulot — Franck Storne
Auguste Sabatier fut plus nuancé : « M. Sabatier est catholique et franciscain exactement comme M. Renan était chrétien en dépouillant le Christ de son auréole surnaturelle. Il s’efforce à tout instant de rendre au « Poverello » en hommages mystiques et en couplets littéraires ce que sa critique historique lui enlève. [...] Ce que j’aurais désiré seulement, c’est dans son attitude générale un peu plus de simplicité et d’austérité, un peu moins de complaisance dans l’abus de certains tours de phrase, complaisance qui peut donner lieu à des méprises, bref, un peu moins de renanisme, je veux dire de cette habitude qu’avait Renan de flatter le plus ceux-là même dont il détruisait le système ou la foi »20.
Dès la parution de l’ouvrage, Paul Sabatier en envoya un exemplaire au Pape Léon XIII. Le cardinal secrétaire d’État, Mariano Rampolla, lui fit parvenir un accusé de réception qui se terminait par une bénédiction papale. Toutefois, les comptes rendus défavorables de la Vie de saint François d’Assise parus en 1894 dans les Annales franciscaines comme dans la Revue franciscaine ne pount que laisser supposer une réaction négative de la hiérarchie catholique. Le 8 juin 1894, la Congrégation de l’Index condamne l’ouvrage de Paul Sabatier. « Ce qui fut principalement reproché à Sabatier, c’est d’avoir fait de François l’homme d’un sacerdoce nouveau, spirituel, s’en tenant à sa conscience individuelle et déclarant recevoir sa mission directement du Christ, en dehors de l’Église ; c’est de faire de la sainteté de François l’antithèse de la prêtrise et de lui supposer une moindre obéissance au pape et à l’Église ; c’est enfin d’affirmer que la création de François a dégénéré en institution ecclésiastique. Cette vision s’inscrit en faux contre celle traditionnelle de l’hagiographie d’un François singulier, mais filialement attaché à l’Église officielle et à son sacerdoce clérical21 ».
La hiérarchie romaine s’opposa ainsi à cette biographie, qu’elle estimait déformée et qu’elle comparait à la Vie de Jésus de Renan tout autant condamnée, à cette laïcisation du saint Patriarche qu’elle craignait de voir apparaître comme un apôtre du libre examen, indépendant du clergé et côtoyant l’hérésie, et devenu un précurseur de la réforme22. La mise à l’index ne ralentit pas son succès, mais elle a certainement freiné le développement des études franciscaines. Tout au long de sa vie Paul Sabatier continua de travailler sa Vie de saint François d’Assise ; ses annotations servirent à une édition posthume en 1931. Après la parution de la Vie de saint François d’Assise, Paul Sabatier entreprit des recherches qui aboutirent à une première édition23, puis à une seconde édition du Speculum Perfectionis24. En 1894, Paul Sabatier démontra que la Légende des Trois Compagnons était incomplète et il partit à la recherche de la partie qu’il croyait manquante. Retranchant au Speculum Vitae de 1509 tous les éléments dont l’origine était 20 21 22 23 24
Sabatier, Journal de Genève. Causse, Storne, « Paul Sabatier historien et pasteur », 227. Causse, Storne, « Paul Sabatier historien et pasteur », 227. Sabatier, Speculum Perfectionis.
Sabatier, Le speculum perfectionis ou mémoire.
En Memoire de Paul Sabatier
319
identifiable, il se retrouva devant un résidu de 118 chapitres. Ce résidu représentait donc, selon toute vraisemblance, ce qu’il cherchait. Sabatier découvre alors dans le manuscrit 1743 de la bibliothèque Mazarine à Paris, rassemblés sous le titre Speculum Perfectionis, 116 des 118 chapitres sélectionnés dans le Speculum Vitae. Ce fut la confirmation de son intuition. Paul Sabatier relata luimême sa démarche critique : « La certitude qu’une partie des sources primitives avait disparu, m’avait amené à en rechercher des lambeaux dans le Speculum Vitae de 1509. En éliminant successivement de ce recueil : 1° les Fioretti, 2° des fragments de Bonaventure, 3° quelques fragments monastiques édifiants, 4° les Chroniques de l’Ordre, 5° une partie des œuvres de saint François, 6° quelques groupes de documents sur le pardon d’Assise, on trouve un résidu d’une homogénéité remarquable, où le style et l’inspiration restent les mêmes à travers toutes les pages et où rien ne décèle le travail postérieur de la légende. Ce document, tel que je l’avais reconstitué, comprenait 118 chapitres que j’employai comme une des sources de la vie de saint François. Sur ces 118 chapitres, 116 se retrouvent dans le Speculum Perfectionis qui en renferme au total 124. « [...] La reconstitution des 118 chapitres n’avait absolument rien d’arbitraire. J’étais tenté, à la vérité, d’y voir la partie supprimée des 3 Socii [la Légende des Trois Compagnons], mais plusieurs considérations m’empêchèrent de formuler cette thèse comme absolue et définitive. Je n’y trouvai en effet pas le même plan que dans les 3 Socii, et si les analogies de style, et surtout de pensée, y étaient souvent très apparentes, il fallait pourtant reconnaître que la phrase sacramentelle Nos qui cum eo fuimus ne se trouve guère que dans la lettre d’envoi des 3 Socii. Enfin la vocation de fr. Egide se trouve racontée dans les deux documents, non pas d’une façon contradictoire, mais d’une façon assez différente pour qu’on ne puisse pas voir dans les deux récits les répétitions d’un seul et même écrivain qui, à quelques pages de distance, revient sans y penser à un fait qu’il a déjà mentionné. On devine combien j’étais perplexe, aussi pris-je le seul parti scientifiquement possible : 1° utiliser un document que la critique externe aussi bien que la critique interne mettaient au premier rang ; 2° attendre de nouvelles lumières pour se prononcer sur son origine. Ces nouvelles lumières, le Ms. 1743 me les a fournies en fixant la composition à 1227, et la légende elle-même prouve bien qu’elle est l’œuvre de celui qui s’en déclare très clairement l’auteur, frère Léon d’Assise »25.
Paul Sabatier fit précéder l’édition critique du Speculum Perfectionis de deux parties. La seconde consistait en une description de manuscrits. La première évoquait la vie de frère Léon et l’histoire des premiers temps de l’Ordre : Paul Sabatier y soutint la thèse selon laquelle le portrait que Thomas de Celano et saint Bonaventure avaient tracé de saint François était inexact parce qu’il avait été sciemment déformé au nom de l’autorité et sous l’influence de préoccupations, peut-être respectables, mais étrangères au souci de la vérité ; le vrai portrait de saint François, c’est à frère Léon qu’il fallait le demander, frère Léon, l’auteur du Speculum Perfectionis. Sabatier insista sur ce qu’il considérait comme une preuve frappante de l’ancienneté du Speculum Perfectionis : le rôle qui est joué dans cette légende par la première règle ou règle de 1221, en opposition à la règle approuvée par Honorius III le 29 novembre 1223 et remise aux frères au chapitre général de 122426. 25 26
Sabatier, Speculum Perfectionis, XXII-XXIV. Causse, Storne, « Paul Sabatier, historien et pasteur », 229.
320
Claude Coulot — Franck Storne
L’édition du Speculum Perfectionis fut unanimement saluée, mais la critique ultérieure contesta la date de 1227 pour la composition, l’attribution à frère Léon, et l’interprétation de l’idéal franciscain. Paul Sabatier estima nécessaire de donner une nouvelle édition critique du Speculum Perfectionis, et dès 1911, il entreprit des travaux pour établir un « textus receptus » en se basant sur 45 manuscrits au lieu de 16 précédemment. La guerre qui l’amena à reprendre un service pastoral, le décès en 1926 de sa nièce Marguerite Stotz qui était sa secrétaire et sa propre maladie en retardèrent la publication. À sa mort le 4 mars 1928, la recherche était presque terminée. Mme Sabatier remit ses notes au professeur A. G. Little qui fit paraître l’édition du texte latin en 1928 et l’étude critique en 1931. Dans l’étude critique qui occupe le second volume, Paul Sabatier y réaffirmait les conclusions auxquelles il était arrivé en 1898 : « [...] parmi tous les services que le Speculum Perfectionis a rendus à la critique historique franciscaine, un des plus importants, c’est de renseigner sans cesse le lecteur sur l’élaboration de la règle, élaboration pénible comme les douleurs de l’enfantement, et où l’on voit saint François luttant tantôt avec une partie de ses fils spirituels, sans arriver à les convaincre, tantôt avec des princes de l’Église »27.
À côté des travaux qui ont permis à Paul Sabatier de rédiger la vie de saint François d’Assise et qui ont abouti aux éditions du Speculum Perfectionis, il en entreprit d’autres28, en particulier une traduction française du Speculum Perfectionis qui est restée inédite et la préparation d’un manuscrit en vue d’une édition critique de la Légende des Trois Compagnons. Il avait aussi élaboré une méthode de travail afin de comparer les documents à sa disposition. Ainsi tant par ses études sur les sources franciscaines que par sa méthode de travail, il apporta une contribution importante aux recherches sur les sources franciscaines au tournant des XIXe et XXe siècles.
27 28
Sabatier, Le speculum perfectionis ou mémoire, t. I, XIV. Cf. la bibliographie dans Coulot, Storne, Ens infinitum, 227-228.
En Memoire de Paul Sabatier
321
Bibliographie Primärliteratur Sabatier, Auguste, Journal de Genève, 14 janvier 1894. Sabatier, Paul, Vie de saint François d’Assise. Paris : Librairie Fischbacher, 1893. Sabatier, Paul, Speculum Perfectionis seu S. Francisci Assisiensis legenda antiquissima auctore frate Leone, nunc primum edidit Paul Sabatier, Paris : Fischbacher, 1898. Sabatier, Paul, A propos de la Séparation des Eglises et de l’Etat. Paris : Librairie Fischbacher, 1905. Sabatier, Paul, Les modernistes, notes d’histoire religieuses. Avec le texte intégral de l’encyclique « Pascendi », du syllabus « Lamentabili » et de la supplique d’un groupe de catholiques français au pape Pie X. Paris: Fischbacher, 1909. Sabatier, Paul, L’orientation religieuse de la France actuelle. Paris : A. Colin, 1911. Sabatier, Paul, Le speculum perfectionis ou mémoire de frère Léon : sur la seconde partie de la vie de saint François d’Assise, Manchester : The University Press, 1928, 1931.
Sekundärliteratur Causse, Maurice, Études Théologiques et Religieuses 3 (1991). Causse, Maurice and Storne, Franck, « Paul Sabatier, historien et pasteur. » In Coulot, Claude and Storne, Franck (eds.), Ens Infinitum. A l’école de saint François d’Assise, 221-252. Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, 2009 De Langogne, Pie, Annales franciscaines, 18 (1892-1894). Hase, Karl, Franz von Assisi, Leipzig, 1856 ; trad. française par Charles Berthoud, Paris, 1864. Houghton, L. S. Life of St. Francis of Assisi, Londres : Hodder & Stoughton ; New York : Scribner, 1894. Juston, Etienne, « Paul Sabatier. » In Ens Infinitum. À l’école de saint François d’Assise, Coulot, Claude and Storne, Franck (eds.), 197-199. Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 2009. Lisco Margarete, Leben des heiligen Franz von Assisi, Berlin : Reimer, 1895. Müller, K. Die Anfänge des Minoritenordens und der Bussbrüderschaften, Fribourg i.B., 1885. Patrem, Marie-Léon, Tableau synoptique de l’histoire de tout l’ordre séraphique de 1208 à 1278, Paris, 1879.
322
323 Archa Verbi. Subsidia 6
323–333
Table ronde du colloque de Strasbourg « La postérité de Duns Scot » Samedi 21 mars 20091
Présidence : Mary Beth Ingham Participants : Andreas J. Beck, Stephen Brown, Mechthild Dreyer, Francesco Marrone, Édouard Mehl, Cyrille Michon, Timothy Noone, Martin Pickavé, Martina Roesner, Jacob Schmutz, Jean-Luc Solère, Matthias Vollet, Antonie Vos.
Partie I – Synthèse générale Ingham — Avant toute chose, je voudrais remercier tous les organisateurs du colloque, Édouard Mehl, Matthias Vollet et Mechthild Dreyer pour l’excellente organisation et leur accueil à Strasbourg, ainsi que les institutions qui l’ont rendu possible, à savoir les universités de Strasbourg et de Mayence, la Fondation culturelle franco-allemande, l’Université franco-allemande et le Conseil général du Bas-Rhin. Dans un premier temps, je voudrais identifier quatre points généraux qui nous permettraient de faire la synthèse de nos travaux. Notre colloque a soulevé les points suivants : (1) la réception de Duns Scot, selon divers genres de réception : des concepts ou des thèses individuelles, l’enseignement, mais aussi la vision plus globale de ce que serait un « système » scotiste ; (2) l’histoire de la réception en tant qu’histoire de modifications et de transformations successives. Cela a posé la question de l’existence d’une orthodoxie doctrinale scotiste ; (3) la question de ce qui ferait l’identité d’un « scotiste », au cours des siècles, question qui fut posée par T. Noone à propos de Guillaume d’Alnwick ; (4) enfin, cela nous a permis d’apprécier l’influence des éditions critiques qui ont vu le jour au cours des dernières décennies. Les Opera philosophica ont vu le jour. De l’édition Vaticane il reste encore à les volumes correspondant au livre IV des Sentences (vision béatifique, questions théologiques). La Commission scotiste en annonce la publication imminente en 4 volumes à partir de 2008 (IV, dist. 1-7). 1
Transcrit et traduit par Jacob Schmutz.
324
Table-ronde du colloque de Strasbourg
C’est à partir de ces quatre points que nous pourrions commencer la discussion. Dreyer — Je constate que du XIVe siècle à nos jours, il y a un mouvement intéressant qui consiste à vouloir rendre Scot « plus clair ». Dans un premier temps, il s’agissait surtout de la réception de doctrines ou d’opinions individuelles. À partir de l’époque moderne, on assiste au contraire à la réception d’une doctrine « scotiste » plus générale. C’est toute la théologie de Duns Scot qui est reçue, et qui forme ainsi une école scotiste. Ensuite, dans un troisième temps, on constate que l’importance de Duns Scot s’affaiblit, au point de devenir une « ombre ». Mais aujourd’hui, Duns Scot semble avoir encore quelque chose à nous dire. Comme l’a montré Antonie Vos, les questions existentielles de la théologie protestante permettent de remettre Duns Scot à l’honneur. C’est ce qui explique le regain d’intérêt aujourd’hui, au-delà de l’intérêt général manifesté par la médiévistique. Mais tout cela repose à nouveau la question de l’identité du scotisme. À mon avis, il s’agit d’une étiquette sous laquelle on peut mettre beaucoup de choses. Certains concepts (univocité, haecceitas, distinction formelle, relation créateur-créature, etc.) peuvent être associés à Scot et lus dans des contextes très différents. Des personnes différentes aux opinions différentes peuvent ainsi se recommander de Scot, comme l’a démontré É. Mehl dans son exposé à partir de l’exemple du scotisme chez Gibieuf. Noone — Je veux pour ma part soulever un point un peu différent. Comme éditeur de Duns Scot, je suis depuis longtemps frappé par le fait que ses textes restent toujours extrêmement difficiles à comprendre. Le P. Gédeon Gál avait coutume de dire : « Duns Scotus needed an editor in the fourteenth century and nothing we do now will fix that ». Duns Scot est un écrivain horrible ; brillant, mais horrible. Et malgré cela, peu après sa mort, on voit se former des écoles, à Cologne, Paris, Padoue, Oxford, Cambridge, etc. On ne peut qu’être frappé par le fait que dans la plupart des cas, on l’a compris et apprécié. Comment expliquer qu’un écrivain aussi mauvais ait été aussi compréhensible ? Ma réponse à cette question soulève l’importance de son enseignement oral : il semble que l’enseignement de Duns Scot ait été de très grande qualité. Par un tableau historique, on peut assez facilement retracer la ligne de l’enseignement oral, de personne à personne. C’est ce qui explique la formation primitive de l’école scotiste, à savoir par l’enseignement oral. Michon — J’aimerais poser une question. On a beaucoup parlé de l’influence de Duns Scot en théologie. Qu’en est-il de la fin du XIXe siècle ? C’est l’époque où a été promu le dogme de l’Immaculée Conception au Vatican, et qui est une doctrine franciscaine et scotiste. Est-ce que cela n’a pas donné une impulsion nouvelle à l’étude de sa théologie ?
«La postérité de Duns Scot» — Samedi 21 mars 2009
325
Dreyer — Je dirais que non. En ces années, Thomas d’Aquin restait la grande autorité. Jusque dans les années 1930-40, on avait coutume de comparer systématiquement Scot et Thomas d’Aquin, comme l’avait déjà fait en son temps Girolamo de Montefortino, en composant une « somme scotiste » sur le modèle de celle de Thomas d’Aquin. Vos — Il faut ajouter que Duns Scot n’était pas seulement mesuré à l’aune du thomisme, mais qu’il a même été systématiquement interprété dans le langage aristotélico-thomiste. Le langage est crucial. Les interprètes du début du XXe siècle n’avaient pas le langage adéquat pour lire et comprendre Duns Scot. Quand j’ai commencé moi-même à lire Duns Scot dans les années 1960, la plupart de mes professeurs expliquaient qu’au Moyen Age on pensait de telle ou telle sorte, mais en fait, leur vision correspondait à celle de la Summa de Thomas. On se condamne alors à ne pas comprendre Duns Scot. Mais une fois que l’on maîtrise son langage, on se rend compte que c’est l’homme le plus clair qui ait jamais existé. Noone — Une personne qui n’a pas été mentionnée, mais dont le rôle a été crucial aux Etats-Unis, était Étienne Gilson, suite à son enseignement à Toronto. Bien que thomiste, il a été un si bon historien qu’il a toujours attiré l’attention sur l’importance de Duns Scot. Et même s’il participait à ce que j’appelle le grand récit néo-scolastique (the neo-scholastic narrative), il avait pris au sérieux les accomplissements du Moyen Âge tardif. Dreyer — Je souhaiterais poser une question à Antonie Vos. Quand vous avez mentionné la réception de Scot aux Pays-Bas et dans la théologie protestante, il y avait toujours la figure de Carlo Bálic. Existe-t-il plus généralement une connexion entre la tradition protestante et le franciscanisme ? Vos — Il s’agit essentiellement d’une connexion moderne. Aux Pays-Bas, beaucoup de professeurs à l’université catholique dUtrecht étaient franciscains. Mais il y a aussi une piste qui remonte à la Renaissance. Certains des pères de la Réforme, comme Zanchi (Zanchius) ou Vermigli, étaient des jeunes Italiens qui ont fui vers les Pays-Bas. Mais ils restaient influencés par la scolastique italienne de leur temps, dans laquelle ils avaient été formés. Et même si c’était un langage thomiste, les idées étaient scotistes. Cela a permis de comprendre l’œuvre de Calvin, chez lequel on trouve à la fois une doctrine de la volonté et une doctrine nécessitariste. Plus tard, ses successeurs ont vu qu’on ne pouvait combiner sans autre forme de procès le modèle volontariste (will-model) et le modèle nécessitariste (necessity-model), et Duns Scot permettait d’expliquer cela. La réception protestante des jésuites a aussi beaucoup contribué à ouvrir les yeux aux réformés. En dépit de leur haine des contre-réformés, ils ont appris beaucoup de choses, en premier lieu comment faire de la théologie scolastique.
326
Table-ronde du colloque de Strasbourg
Ingham — Cela me permet de revenir sur un autre point, que m’inspire l’exposé de M. Loiret sur Hannah Arendt. Comme Arendt, les étudiants de Duns Scot ont de toute évidence été excités par certaines de ses doctrines particulières. Mais cela donne au fond une tradition de transmission étrange : soit on le place dans un cadre néo-scolastique qui n’est en fait pas le sien, soit on se contente d’étudier certaines thèses individuelles. Pour ma part, quand j’ai commencé à étudier Duns Scot, j’ai commencé par être frappée par certaines de ces idées (insights), et je les ai trouvées remarquables, mais je n’arrivais pas à les faire tenir ensemble ou bien à les combiner. Ce n’est qu’après des années et des années d’enseignement que je suis parvenue petit à petit à mettre les pièces du puzzle ensemble. C’est en particulier en m’intéressant à la question de la beauté qu’une image et un sens globaux commençaient à apparaître. Enfin, je me suis intéressée à son identité franciscaine. C’est au bout de ces étapes que ses textes finirent par prendre sens. Nous avons vu hier qu’il y avait au fond deux modes de réception. Premièrement, il y a le mode académique, ou « intellectuel », comme en témoigne l’intérêt que nous avons aujourd’hui pour les doctrines de Duns Scot sur les modalités, la liberté, la volonté humaine, etc. Deuxièmement, il y a une réception plus existentielle, celle de ceux qui voient la valeur personnelle ou existentielle de la vision (the existential payoff) de Scot. Cette valeur transforme la manière dont certains lisent Duns Scot. La tradition qui a permis aux textes de traverser 700 années d’histoire a créé l’ombre de Duns Scot, au détriment de la vision qui est derrière le texte, et qui est difficile à percevoir. Vos — Il y a une grande cohérence à la fois dans cette vie chrétienne et dans cette pensée. C’est aussi seulement en finissant mon livre que je me suis rendu compte de cette cohérence. Michon — J’ai une autre question. Il a été question des « lunettes thomistes » avec lesquelles on lisait Duns Scot. Ma question est : est-ce qu’il n’y a pas eu aussi un phénomène inverse A savoir des lunettes scotistes pour lire Thomas d’Aquin ? Il me semble qu’il y a une manière de faire scotiste à partir du XVe siècle (Sylvestre de Ferrare). Il y a un héritage, une influence Thomas-Scot dans les deux sens. Schmutz — Effectivement, une telle influence dans l’autre sens a été récemment beaucoup étudiée, notamment par les travaux d’I. Iribarren ou d’A. Robiglio sur des figures dominicaines comme Hervé de Nédellec (Hervaeus Natalis) et Durand de Saint-Pourçain. Ils ont bien montré à quel point ces auteurs se servent d’un univers conceptuel qui remonte à Duns Scot. Je ne sais pas si l’on peut parler ici vraiment d’influence scotiste, mais en tout cas d’un langage scolastique qui s’est profondément modifié dans la dernière décennie du XIIIe siècle, qui abandonne le langage arabo-latin et aristotélicien qui est encore celui d’un Albert ou d’un Thomas d’Aquin. En théorie de la connaissance, cela a souvent été démontré, comme même les auteurs « thomistes »
«La postérité de Duns Scot» — Samedi 21 mars 2009
327
finissent par se servir des expressions comme esse obiectivum-subiectivum, repraesentatio, etc. au détriment de la doctrine classique des species par exemple, et Francesco Marrone l’a rappelé dans sa conférence sur realitas obiectiva. Je ne sais pas s’il faut imputer tout cela à Scot, ou bien à un contexte plus général, puisque le même langage se trouve déjà chez Richard de Mediavilla, Jacques d’Ascoli, etc. En revanche, il y a un autre aspect plus fort que le simple langage : c’est la nature des questions posées. Sur ce point, il me semble clair que Duns Scot a été une sorte de provocation pour la philosophie comme pour la théologie de toute la fin du Moyen Age. Ce sont des questions posées par Duns Scot auxquelles il faut désormais répondre, en parlant souvent le même langage que lui, mais parfois à partir de paradigmes doctrinaux différents (aristotéliciens, thomistes, humanistes, etc.). Quand on lit les commentaires de Cajetan à la Somme, qui connaissait bien les scotistes de Padoue, on le voit très clairement : c’est systématiquement à des objections scotistes qu’il doit répondre, tout comme auparavant, Capreolus répondait à Duns Scot et surtout à Pierre Auriol. L’« agenda » intellectuel était désormais imposé par cette tradition franciscaine. Michon — Pour résumer, on pourrait alors distinguer entre une influence positive et une influence négative. La positive serait l’influence sur ceux qui se revendiquent de lui, et la négative serait l’influence sur tous ceux qui répondent à des questions scotistes sans l’être eux-mêmes. Noone — Vous avez raison de souligner l’importance de l’influence des transformations terminologiques à la fin du XIIIe siècle, et on doit encore mentionner Henri de Gand et Godefroid de Fontaines, qui eux-mêmes ont déjà forgé les mots et posé les questions qui allaient être celles de Duns Scot. Et on le voit aussi dans les disciples thomistes qui répondent à Henri, Godefroid ou Gilles de Rome. Cette terminologie s’est répandue partout. Vos – On assiste encore à cette gigantomachie opposant deux langages dans les études scotistes. Le cas exemplaire de Maurice De Wulf l’illustre bien : dans les deux premières éditions de son Histoire de la philosophie médiévale, il parlait encore un langage thomiste, et présentait Duns Scot avec les préjugés habituels du thomisme. Dans la troisième édition, il a adapté et modifié son point de vue, c’est ce qui fait tout son intérêt. C’est très largement la lecture de l’œuvre du franciscain allemand Parthenius Minges qui lui a permis de corriger sa vision. Marrone — Sur la base de ma propre expérience, à savoir la recherche sur les origines du concept de realitas obiectiva, je ne peux que constater que c’est bien le langage scotiste qui s’est imposé sur la longue durée, même s’il n’y a pas de domination de la manière scotiste de l’expliquer au niveau du contenu. Le vocabulaire s’est transformé et va clairement dans le sens d’une « scotisation ».
328
Table-ronde du colloque de Strasbourg
Brown — Je voudrais pour ma part dire quelque chose sur la manière dont nous faisons nos recherches et regardons vers l’avenir. J’ai commencé ma carrière par une thèse de philosophie sous la direction de Fernand Van Steenberghen. Pendant trente ans, j’ai enseigné la philosophie dans LÉtat de New York et le Tennessee. Le mieux que j’aie trouvé pour quitter ce derniere poste était un poste de théologie à Boston College, alors que je n’ai aucun diplôme en théologie – à l’exception d’un diplôme honoraire, délivré par une université… luthérienne ! Mais cela me permet de dire quelque chose sur la manière dont je suis passé à la théologie, et cela m’a appris beaucoup de choses sur la pratique moderne de la philosophie. Je voudrais citer le fameux texte de Pierre le Chantre (Petrus Cantor), qui affirme qu’il y a trois offices pour un maître : lectio, praedicatio, disputatio. La plupart d’entre nous, aujourd’hui, ne faisons que disputer, alors que la tâche complète d’un maître est de faire les trois. Au début du XIIIe siècle, dans les nouvelles universités, on constate que les maîtres s’adonnaient surtout à la praedicatio. On étudiait l’Écriture Sainte pour changer sa vie et devenir un meilleur chrétien, et pour l’enseigner aux autres. On apprenait ensuite aussi à lire correctement le texte, et l’art de la lectio remonte à ce qu’écrivait Augustin dans son traité sur l’éducation chrétienne ou encore au fameux Didascalicon d’Hugues de Saint-Victor. Quand on ouvre les Sentences de Bonaventure, on voit qu’il s’agit à la fois de quaestiones et de dubia : au niveau du texte, on trouve l’intégralité du texte du Lombard, et des dubia relatifs à ce texte. Mais au début des Sentences, Bonaventure rappelle qu’il y a deux exercices fondamentaux, la praedicatio et la quaestio. La quaestio demande alors, sous une forme très aristotélicienne, quelles sont les quatre causes du livre de Pierre Lombard, et Bonaventure donne la liste suivante : un scribe, qui l’écrit ; une personne qui le commente ; une autre personne qui compile les autorités classiques, principalement les sentences des Pères (le compilator) ; et enfin l’auctor, qui est Pierre Lombard lui-même. Mais avant de poser la quaestio, Bonaventure rappelle aussi l’exercice de la praedicatio, et là aussi il identifie quatre causes : Dieu est la cause efficiente ; ensuite il y a les livres individuels ; ensuite les pères qui expliquent les livres, et enfin le Lombard. Sur ce point, on voit donc que le Lombard est un auteur très dépendant, mais neanmois un vrai auteur. Quand on passe maintenant à Duns Scot, on constate qu’il n’y a presque plus de lectio, mais seulement des quaestiones. Il n’y a également plus de praedicatio. Cela a disparu des Sentences depuis l’époque de Richard Rufus, qui avait attaqué Richard Fishacre en l’accusant de faire des sermons en classe. Il en va de même à notre époque : nous ne faisons plus de praedicatio. Quand nous expliquons la simplicité divine selon Duns Scot, nous n’avons pas la prétention de rendre simples les âmes de nos auditeurs. La pratique de la théologie se partage alors en théologie déclarative et théologie déductive. La théologie déclarative est celle qui a été codifiée au livre XIV du De Trinitate d’Augustin : il ne faut pas chercher toute forme de connaissance, mais seulement celle qui conduit à la vie éternelle. C’est à cette fin là qu’il faut être précis dans les mots que nous employons, pour ne pas confondre les hommes. La
«La postérité de Duns Scot» — Samedi 21 mars 2009
329
précision et la clarté du vocabulaire sont les importante dans les disputationes pour cette raison. Au départ, la théologie déclarative s’adressait aux hérétiques ; puis au milieu du XIIIe siècle, elle est dirigée contre Aristote, et contre Averroès, les « philosophes ». Il fallait dès lors savoir faire une lectio sur eux, afin de savoir comment les interpréter. Aussi, quand je lis les commentaires logiques de Duns Scot, je ne dois pas oublier qu’il fait de la théologie déclarative en lisant Aristote. Le deuxième type de théologie est alors la théologie déductive, qu’on trouve incarnée dans les Sentences de Duns Scot. C’est ici que la structure de la scientia se déploie totalement, et qu’il pratique une théologie solide (hardnosed theology) : il pense, argumente, donne des définitions suivant une voie qu’il s’est lui-même fixée. L’étude des manuscrits nous renseigne admirablement sur ces différences d’approche. Dans de nombreux manuscrits anciens sur les Sentences, on trouve des sermons à leur commencement, ce qui indique bien leur finalité. Mais à partir d’un certain moment, on ne les trouve plus. Cela veut dire que les copistes s’intéressaient surtout à la disputatio. J’aimerais bien savoir quel type de chrétien était Guillaume d’Ockham, comment il priait, etc. Mais malheureusement sa tradition manuscrite ne nous l’enseigne pas. Cette dualité s’est retrouvée tardivement, comme l’a montré J. Schmutz, en parlant des deux traditions franciscaines présentes à Paris au XVIIe siècle, celle de l’Ave Maria et celle du Grand Couvent. Scot et Ockham sont avant tout des disputatores, et ils ne vivaient pas de la manière dont nous vivons. Il faut se garder de projeter nos images sur les « carrières » sur cette époque. Quand on pense au Maître Général d’un ordre, on imagine quelqu’un de très occupé, qui n’aurait pas le temps de se consacrer aux études. C’est ce que j’ai cru aussi, jusqu’à me rendre compte, par exemple, que Gérard de Bologne citait en 1308 la première rédaction de Durand, ce qui indique qu’il a rédigé son commentaire alors qu’il était déjà Maître Général. Aujourd’hui, si nous parlons le langage des philosophes de notre époque, il faut toujours savoir lire Duns Scot sans vouloir lui faire dire ce que Heidegger voulait dire. Pour ma part, j’ai consacré une grande partie de ma carrière à émanciper Guillaume d’Ockham de Hobbes, car ce ne sont pas les mêmes « nominalismes ».
330
Table-ronde du colloque de Strasbourg
Partie II – Travaux et tendances à venir. Projets Ingham — A la fin du premier colloque de ce « Quadruple Scotus Congress », qui s’est tenu à Saint Bonaventure (N.Y.), nous avons eu une discussion où participaient, sans que cela ait une intention spéciale, à la fois des philosophes et des théologiens, ainsi que de nombreux frères. La discussion a été très riche, parce qu’interdisciplinaire. Il me semble que si nous cherchons aujourd’hui à traduire la vision de Duns Scot dans un nouveau langage, cela ne pourra se faire que dans le cadre de projets de plus interdisciplinaires. Noone — Aux Etats-Unis, j’ai pour ma part encore eu le bénéfice d’une éducation double, à la fois philosophique et culturelle, mais la situation est moins propice aujourd’hui. Je suis également convaincu qu’il est impossible de comprendre la philosophie et la théologie médiévales sans un background culturel et historique solide. A cet égard, la situation me paraît aujourd’hui difficile : les jeunes chercheurs qui veulent faire du travail sérieux en philosophie médiévale se mettent en danger pour trouver du travail. Je ne peux pas, la conscience tranquille, pousser un jeune à travailler avec moi sur l’édition critique de Duns Scot, car le temps qu’il doit consacrer à acquérir toute une série de compétences risque en fait d’être négatif pour sa carrière. Les grandes éditions critiques sont un peu comme le Manhattan Project durant la Seconde Guerre Mondiale : il faut réunir beaucoup de personnes avec des compétences à la fois pointues et bizarres (il faut être bon en latin, philosophie, paléographie, théorie de l’argumentation, etc.). Je crois que du point de vue culturel, nous vivons une époque très tendue. Brown — Il nous est impossible de parler de Hobbes et d'Heidegger comme s’il s’agissait d’un même individu. Si nous voulons arriver à une compréhension adéquate de Duns Scot, nous devons nous consacrer à une étude détaillée, en petit groupe. Il est dur de faire cela dans le cadre de grands événements comme durant les rencontres de l’APA (American Philosophical Association), car nous serions alors obligés de « vendre Scot » et le faire parler justement comme Hobbes ou Heidegger, plutôt que de le présenter simplement pour ce qu’il a à dire. D’une manière générale, je suis très critique à l’égard de tous les réductionnismes, comme il est par exemple aujourd’hui pratiqué dans le domaine de la théologie comparée, qui se résume souvent à affirmer simplement que « nous avons des cierges, vous aussi avez des cierges », sans vraiment comprendre les différences. Il est très dur de faire de la théologie comparée avec l’hindouisme si dans votre université personne ne maîtrise le sanscrit. On en resterait à un niveau très creux. La même chose vaut pour les penseurs médiévaux : on ne peut simplement les réduire à une sorte de plus petit dénominateur commun, qui faciliterait alors le dialogue.
«La postérité de Duns Scot» — Samedi 21 mars 2009
331
Schmutz — Pour ma part, je pense que le futur des études scotistes dépendra du futur de cette « auto-compréhension » (Selbstverständnis) de la philosophie qu’a justement invoquée Mechthild Dreyer. Notre manière de lire Scot dépendra de l’évolution générale des pratiques en histoire de la philosophie. Je pense qu’aujourd’hui se dégagent deux grandes tendances. Premièrement il y a la poursuite, très allemande en quelque sorte, des grands récits (grand narratives), de la pensée par « époques » (Weltzeitalter), dont tant Heidegger que Foucault ont été des exemples influents. C’est à partir d’un tel paradigme qu’on a alors interprété Duns Scot comme une pensée « époquale », qu’on a pu parler de « tournants scotistes », comme on pu le faire tant J.-Fr. Courtine, O. Boulnois ou L. Honnefelder. La question – et la limite de cette approche – est alors de savoir si nous sommes toujours dans l’horizon de ce tournant, dans cette époque, où si nous sommes « post-scotistes », au même titre que d’autres se qualifient de « post-modernes », et dans ce cas, on peut se demander ce que Duns Scot a encore à nous dire, où s’il ne fait pas partie d’un « monument » qu’on continue d’admirer comme on admire un palais d’une époque révolue. Une deuxième option est incarnée par ce que j’appellerais une approche plus empiriste : suivre non pas des paradigmes globaux, des « visions », des systèmes, mais au contraire des thèses individuelles à travers l’histoire. Ceux qui parmi les philosophes analytiques pratiquent l’histoire de la philosophie (comme l’a fait C. Michon) suivent cette option, en individualisant une thèse de Scot par exemple et en étudiant sa pertinence ou alors sa reprise dans d’autres contextes. C’est ce que j’ai fait observer à partir de l’exemple de la scolastique française d’ancien régime, pré-cartésienne : elle n’est pas « scotiste », ni « thomiste », mais elle est faite d’une multitude de thèses individuelles qui ne forment pas toujours un système. Cette approche a également des limites : car il n’est pas du tout sûr qu’une thèse ou un argument (comme le fameux argument du transfert de nécessité dont a parlé C. Michon) puisse s’individualiser et s’émanciper totalement du cadre général de pensée qui l’a vu naître. Il faut alors analyser les différentes significations d’un même argument dans des cadres différents. Pour les recherches futures, je pense en tout cas qu’il faut suivre la voie plus empiriste, et réfléchir sur les différentes manières de lire un philosophe. Les médiévistes ont à ce titre beaucoup à nous apprendre : par leur pratique des manuscrits, comme on l’a vu dans l’exposé de T. Noone, ils peuvent vraiment suivre à la trace la manière dont une thèse est reprise ou comprise par un lecteur-commentateur. Les historiens de la philosophie moderne sont quant à eux assez démunis, encore aujourd’hui, alors que nombre d’historiens récents ont beaucoup réfléchi à ces questions de lecture (je pense aux travaux de Roger Chartier sur l’Europe des « lecteurs »). Il faudrait aujourd’hui faire une étude des manières de lire les classiques médiévaux (Thomas, Scot), en fonction des contextes : dans les couvents, les écoles (ce qu’on commence à assez bien connaître), mais aussi en dehors – je pense à titre d’exemple à la tradition protestante (et la Reformationsgeschichte récente a fait des travaux remarquables en ce sens, comme par exemple les travaux d’A. J. Beck, W. J. van Asselt, etc.)
332
Table-ronde du colloque de Strasbourg
ou à la grande tradition aristotélicienne anglaise d’Oxford et de Cambridge, arrière-plan de tant de pensées spéculatives fortes (Hobbes, Locke, Hooker, etc.), et dont on connait encore mal les pratiques de lecture, alors qu’ils disposaient peut-être des plus belles bibliothèques européennes. Pickavé — J’aimerais ajouter une note plus optimiste, car je suis moins négatif que Stephen Brown et Tim Noone. Il faut se rendre compte que notre discipline suscite beaucoup d'interêt. En philosophie moderne, des millers de thèses sur de grands auteurs comme Descartes et Spinoza, sont soutenues chaque anné, et bon nombre d'entre elles explorent des sources médiévales. Il en va de même de l' histoire littéraire : par exemple, les travaux sur des auteurs comme Chauceur tentant de lier l'œuvre à son contexte philosophique se multiplient. L’APA serait sûrement heureuse d’accueillir plus des commissions sur la philosophie médiévale, mais c’est à nous de les proposer. Et je suis aussi moins pessimiste quant au marché du travail : les milliers de titulaires d’un doctorat en éthique ont statistiquement plus de difficulté à trouver un poste d'enseignement, car ils sont beaucoup plus nombreux. Dautre part, il y a chez nous une plus grande exigence linguistique, mais cest une chose positive, et en cela nous ne différons pas de la philosophie antique par exemple. Enfin, je pense qu’il est aussi temps de cesser d’écrire des manuels ou des introductions à la philosophie médiévale qui reproduisent les récits traditionnels. La recherche a beaucoup progressé, et l’appréciation de certaines périodes a changé, néanmois, les manuels tendent à reproduire toujours les mêmes schémas. Nos travaux et nos conférences devraient porter davantage sur des arguments philosophiques : Scot argumentait avec ses collègues sur des questions bien spécifiques, et c’est sur de telles questions qu’on pourrait aujourd’hui réunir les spécialistes. Et sur ce point, je pense quil serait bénéfique d'utiliser les concepts de la philosophie analytique pour examiner les acteurs médié vaux, comme l'illustrent por exemple les travaux remarquables de Claude Panaccio. Beck — Je voudrais ajouter un mot sur les manuels. Il y a cent ans, on écrivait des manuels commençant avec Platon, Aristote et Plotin, puis avec un grand saut jusque Descartes. Désormais, la philosophie médiévale a acquis droit de cité. Mais des parties importantes sont toujours manquantes, comme la philosophie académique des XVIe-XVIIIe siècles. Sven Knebel a par exemple montré à quel point certains des jésuites étaient des auteurs très influents en leur époque. Plus que de nouveaux commentaires sur les Meditationes de Descartes, nous avons besoin de plus de travaux sur ces traditions, sur laquelle notre connaissance reste encore trop fragmentaire. Schönberger — Qu’est-ce que nous apporte l’histoire de la réception (Rezeptionsgeschichte) ? Si l’histoire du monde n’est pas le tribunal du monde, alors l’histoire de la réception doit être indépendante de ce qu’un auteur a pu penser. Si l’histoire de la réception est accidentelle, alors on doit se contenter de la décrire. Elle n’acquiert une valeur déclarative que lorsqu’elle énonce vrai-
«La postérité de Duns Scot» — Samedi 21 mars 2009
333
ment quelque chose. C’est ainsi que l’on peut montrer que Buridan est dans le champ d’influence (im Windschatten) de Duns Scot. La manière dont un auteur comme Duns Scot est reçu doit alors être comparée avec d’autres réceptions. Mais le problème continue alors à se présenter comme l’histoire d’événements contingents, lié à la structure de certains ordres religieux, la permanence de certains manuels, etc. En revanche, si l’on ne considère pas la réception de façon simplement extérieure, alors il est question de l’importance de la doctrine de Duns Scot dans un autre sens : on ne parle alors pas d’influence, mais de poids intellectuel. C’est la force des arguments, la prise en considération de nouveaux points de vue, etc. qui constitue une physionomie intellectuelle. Il est donc impossible de faire l’impasse sur le recours purement philosophique à une œuvre comme Duns Scot. La question est de savoir ce que l’on veut comprendre ou savoir. Il ne faut jamais oublier que notre histoire est très largement accidentelle. Quand j’ai ouvert pour la première fois l’édition Vivès, je ne savais même pas distinguer entre le texte de Scot et celui de ses commentateurs. Ce n’est qu’une fois que notre attention n’est plus accidentelle qu’elle devient philosophique, et lorsqu’on voit dans quelle mesure et sous quel aspect un auteur est sollicité. L’histoire de la réception doit nous éduquer à cette attention intellectuelle (Aufmerksamkeit). Qu’est-ce que Duns Scot appelle « cause » ? Existe-t-il un ordo essentialis ? Avant de prendre la mesure de la force d’un argument, nous devons comprendre l’auteur, et pour cela nous avons besoin d’une multitude de points de vue, à laquelle l’histoire de la réception peut bien entendu contribuer. Ingham — Merci de cette discussion riche et variée. Nos recherches et nos échanges sur la postérité de Duns Scot ouvrent d’autres chemins d’investigation pour nos collègues et pour nous-mêmes. En terminant ce colloque, je vous redonne rendez-vous dans cinquante-sept ans pour le 800ème anniversaire de la naissance de Jean Duns Scot en 2066.
Personenregister Abraham 31, 33, 38, 40, 41 Achena, Muhammad 153 Adam 21, 22, 253 Adams, Robert 308, 309, 311 Adamus Goddamus (A. of Wodeham) 196, 207 Aegidius Romanus (Gilles de Rome) 57, 327 Aertsen, Jan A. 244, 246 Agostini, Igor 103 Al-Ghazzali (Algazel) 139, 142, 144, 145, 153, 154 Al-Nazzam 142 Aland, Kurt 201, 202, 203, 207 Alanen, Lilli 117 Albertus Magnus 57, 58, 124, 137, 199, 244, 247, 251, 326 Alexander (Magnus) 165 Alexander Halensis (A. of Hales) 202 Alluntis, Felix 84, 91 Alvarus Pelagius 44 Anscombe, Elizabeth 285 Anselmus Cantuarensis (Anselm von Canterbury, Anselme de Cantorbéry, Anselme d’ Aoste) 9, 15, 17, 20, 39, 85, 197, 205, 239, 257 Antonius Patavinus (A. de Padova, A. von Padua) 313 Arendt, Hannah 12, 251, 258 – 268, 326. Armandus de Bellovisu (A. de Belvézer) 44 Arminius, Jacobus 297 Annibal de Ceccano, card. 44, 54 Ariew, Roger 126, 136 Aris, Marc-Aeilko 137 Aristoteles 11, 21, 33, 42, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 86, 93, 101, 113, 115, 120, 123, 124, 137, 139, 140, 141, 147, 149, 150, 151, 152, 156, 163, 165, 172, 176, 177, 178, 191, 192, 193, 199, 222, 229, 232, 239, 241, 249, 255, 270, 281,
287, 288, 289, 290, 292, 295, 303, 305, 307, 308, 310, 311, 329, 332 Arminius, Jacobus (Jakob Hermanszoon) 247 Armogathe, Jean Robert 131, 136 Armstrong, David 302, 303, 311 Arnaud de Clermont 44 Arnauld, Antoine 118 Arndt, Hans-Werner 168, 173 Ashworth, Earline J. 117 Assenmacher, Johannes 166, 172 Augustinus 67, 68, 76, 78, 80, 91, 93, 94, 127, 128, 129, 137, 203, 255, 256, 257, 263, 266, 292, 310, 328 Austin, John Langshaw 15 Averroes 64, 65, 69, 120, 197, 329 Avicenna 48, 65, 69, 79, 80, 120, 124, 136, 137, 139, 142, 145, 153, 289, 290, 299, 303, 304 Bac, J. Martin 243 Baco, Roger 140, 145, 146, 153, 154, 313 Bakker, Paulus J. J. M. 85, 91 Balíc, Karlo / Carolus 235, 236, 246, 325 Barbotin, Edmond 232 Bardout, Jean-Christophe 120, 138, 308, 311 Bardy, Jean 214, 220 Barni, Jules 175, 193 Barrow, Isaac 151, 153 Barth, Karl 203, 204, 205, 207 Bartholomaeus Mastrius de Meldula (Mastri) 117, 120, 137 Baulieu, Armand 136 Baur, Ferdinand 201 Bayle, Pierre 151,152, 153 Beck, Andreas J. 12, 205, 208, 233, 234, 243, 244, 246, 323, 332 Beckmann, Jan P. 247 Benedictus papa XII 55
336
Register
Benoist, Jocelyn 184, 185, 189, 190, 193 Bergson, Henri 11, 12, 121, 209–220 Berkeley, George 210, 214, 283 Berman, Harold J. 16, 27, 29 Bernardus Claraevallensis (Bernard de Clairvaux) 43, 48 Bernardus de Parma 28 Bernardus de Pavia (Bernard de Pavie) 18, 29 Berr, Henri 198, 207 Berthoud, Charles 321 Biard, Joël 120 Biel, Gabriel 93, 94, 95, 101, 160 Blumenberg, Hans 12, 251–256, 28, 259, 266, 267, 268 Boethius 39 Bolliger, Daniel 95, 96, 101 Bolzano, Bernard 301 Bom, Klaas 243 Bonaventura 80, 157, 202, 239, 313, 319, 328 Bos,Egbert 244, 246–249 Bos, Bert 244, 247 Boudier, Struyker 236 Boulnois, Olivier 12, 16, 104, 109, 117, 120, 122, 134, 136, 137, 175, 176, 178, 179, 180, 191, 193, 263, 268, 283, 305, 308, 310, 311, 331 Bourguet, Louis 157 Braakhuis, Henk A.G. 57, 73, 243 Bréhier, Émile 122, 198, 207 Brentano, Franz 12, 221–225, 232 Brown, Gregory 172 Brown, Stephen F. 10, 75, 86, 91, 169, 323, 328, 330, 332 Brulefer, Stéphane 95, 96, 99 Brunner, Emil 205 Bryennios, Philotheos 314 Buchheim, Thomas 281 Burgundius Pisanus (Burgundio da Pisa) 42 Burke, Robert Belle 153 Burkhardt, Hans 169, 170, 172 Busche, Hubertus 11, 155, 159, 172 Buytaert, Eligius M. 42 Buzzetti, Vincenzo 198 Bychkov, Oleg 310
Cajetan, Thomas (Tommaso de Vio, Gaeta nus) 124, 131, 327 Callebaut, André 196, 207 Calov, Abraham 161 Calvinus, Iohannes (Jean Cauvin) 93, 95, 99, 203, 204, 257, 325 Camillieri, Sylvain 228, 232 Cantor, Georg 286 Caramello, Petrus 42 Carnap, Rudolf 300, 302 Carraud, Vincent 131, 132, 133, 136, 179, 193 Cathala, M-Raymundus 310 Cavalieri, Bonaventura 150, 153 Cavellus, Hugo (Aodh Mac Cathmhaoil, Hugh MacCaghwell) 10 Cassan, Élodie 103 Caterus, Johannes 118 Causse, Maurice 313, 315–319, 321 Celsius (Celse) 28 Cerbanus 42 Cervellon, Christophe 216, 220, 268 Chantepie de la Saussaye, Pierre Daniël 200 Chartier, Roger 331 Chatelain, Alain 196, 207 Chauceur (Chaucer, Geoffrey) 332 Chauvier, Stéphane 184, 186, 188, 193 Clauberg, Johannes 193 Clavius, Christophorus 123 Cohen, Herrmann 184 Conring, Hermann 157 Copernicus, Nicolaus 176, 179 Coppée, François 317 Coulot, Claude 12, 313, 320, 321 Courtenay, William J. 35, 40, 42, 242 Courtine, Jean-François 117, 123, 126, 127, 136, 175, 193, 331 Cousin, Victor 197, 198, 207 Craemer-Ruegenberg, Ingrid 73 Cronin, Timothy 117, 122, 136 Cross, Richard 147, 153, 285, 311 Crusius, Christian August 170 Dalbiez, Roland 117 Dalferth, Ingolf Ulrich 205, 207 Daudet, Alphonse 317
Register
Dautrey, Marianne 268 Davenport, Anne A. 152 De Anna, Gabriele 16, 29 De Arriaga, Rodrigo 143, 148, 152, 153 De Boni, Luis A. 29 De Lagogne, Pie 317, 321 De Libera, Alain 120, 129, 137, 303, 311 De Muralt, André 252, 268 De Oviedo, Francisco 148, 152, 153 De Raey, Jan 156 De Rémusat, Charles 197 De Rijk, Lambertus Marie 60, 234, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 248, 249 De Vogel, Cornelia Johanna 237, 248 De Waard, Cornelis 136, 153 De Wulf, Maurice 196, 199, 207, 208, 234, 235, 247, 249, 250, 327 Decorte, Jos 244, 247 Dekker, Eef 196, 204, 207, 208, 243, 244, 246, 247 Dekker, Dirk Jan 57, 73 Delamarre, Alexandre J.-L. 175, 193, 310 Deleuze, Gilles 133 Demange, Dominic 124, 136, 268, 291 Demokritos 141, 154 Den Bok, Nico W. 242, 243, 246, 247 Denifle, Heinrich 196, 207 Depré, Olivier 117, 136 Des Bosses, Bartholomaeus 158 Descartes, René 10, 11, 15, 103, 117, 118, 119–137, 154, 172, 179, 186, 210, 211, 214, 215, 231, 294, 295, 332 Dhanani, Alnoor 139, 142 Diether, Theo 101 Dod, Bernard G. 287, 310 Doig, James C. 117, 118 Doumerge, Émile 317 Douwes, Jan 200, 207 Drapeau-Contim, Filipe (Drapeau-VieiraContim) 309, 311 Drewes-Siebel, Renate 249 Dreyer, Mechthild 137, 173, 250, 323, 324, 325, 331 Duhem, Pierre 57 Dumont, Stephen D. 239, 247
337
Durandus de Sancto Portiano (Durand de Saint-Pourçain) 9, 10, 31, 32, 37–42, 44, 45, 157, 160, 326, 329 Durkheim, Émile 15 Dykmans, Marc 44, 45, 55 Eberhard, Johann August 193 Egli, Emil 101 Ehrle, Franz card. 89, 91 Eley, Lothar 302, 310 Emmen, Aquilinus 236, 247 Epiktetos 263, 265 Epikuros 141, 147 Epping, Adelhard 234, 235, 236, 247 Erasmus de Rotterdam 95 Ernst Landgraf von Hessen-Rheinfels 158 Eschweiler, Karl 155, 158, 159, 172 Esposito, Constantino 103, 311 Etzkorn, Girard J. 11, Euklides 139, 143, 144, 148, 149, 151, 152 Evers, Dirk 169, 172 Fabri, Honoré 154 Fauve, Jacques 311 Feingold, Mordechai 148, 153, 154 Fidel, Jean-Luc 268 Fieschi, Sinibaldo = Innocentius papa IV 28 Fisch, Max Harold 310 Fischer, John Martin 12, 269, 275, 276, 277, 281 Fonseca, Petrus 159, 163, 172 Foucault, Michel 331 Fournier, Jacques 44 Forlivesi, Marco 117 Franciscus de Assisi (François d’ Assise) 12, 266, 313, 314, 316, 317, 320, 321 Franciscus de Maironis (François de Meyronnes) 17, 137 François, Arnaud 220 Frank, William A. 233, 246 Frege, FriedrichLudwig Gottlob 301 Froidmont, Libert 147, 148, 153 Fromondus, Libertus 163 Frellon, Jehan 172
338
Register
Froschauer, Christoph 97 Gál, Gedeon 196, 207, 324 Galilei, Galileo 149, 150, 153, 154, 231 Garcia, Emanuelle 311, 312 Garfunkel, Art 303 Garlandus Compotista 237, 248 Garniron, Pierre 179, 193 Gassendi, Pierre 148, 149, 153, 154 Geach, Peter 285 Gelber, Hester 41, 42 Gerardus de Bologna 329 Gerardus Odonis (Guiral Ot) 43, 44, 45, 55, 57, 72, 74 Gerhardt, Carl Immanuel 157, 172, 308, 310 Gibieuf, Guillaume 133, 134, 136, 324 Gilson, Étienne 57, 67, 117, 120, 121, 122, 125, 130, 134, 136, 207, 285, 325 Ginet, Carl 271 Girolamo de Montefortino 325 Godefridus de Fontibus (Gottfried v. Fontaines) 76, 327 Gómez Caffarena, José 104, 117 Gonsalvus Hispanus (Gonsalvo of Spain) 196 Goodman, Nelson 302, 311 Gouhier, Henri 214, 220 Grane, Leif 93, 101 Granel, Gérard 176, 193 Grant, Edward 144, 153 Grassi, Onotaro 76, 91 Gratianus 24 Gregorius papa VII 16 Gregorius papa IX 18, 28 Gregorius Ariminensis (Grégoire de Rimini) 58, 74, 75, 76, 77, 91, 152, 157, 160 Grellard, Christophe 139, 154 Grosseteste, Robertus 57, 139, 147 Gualterus Burlaeus (Walter Burleigh, W. Burley) 57 Gualterus Chatton (Walter Chaton) 43, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 87, 90, 141 Gueroult, Martial 122, 137 Guillon, Jean-Baptiste 280 Günther, Franz 94
Guillelmus Alaunovicanus (Guillaume d’ Aln wick, Wilhelm v. A., ep. de Giovinazzo) 43, 44, 46, 47 48, 49, 50, 53, 54, 55, 323 Guillelmus de Conchis (Guillaume de Conches, Wilhelm v. C.) 139 Guillelmus Ockham (Guillaume d’Occam, Wilhelm v. O.) 19, 51, 57, 58, 69, 73, 75, 77, 78, 86, 88, 90, 93, 94, 118, 163, 199, 201, 204, 239, 240, 251, 254, 313, 329 Guillelmus de Shyreswood (Sherwood) 269 Guillelmus de Waria (Wilhelm von Ware) 236 Guillermit, Louis: 188, 189, 193 Guldin, Paulus 150 Habrias, Henri 29 Haldane, John : 284, 285, 311 Hamm, Berndt 94, 101 Hamann, Johann Georg 249 Hamesse, Jacqueline 287, 310 Harder, Yves-Jean 11, 175 Hartshorn, Charles 310 Hase, Karl 317, 321 Hauréau, Jean-Barthélémy 196, 198, 207 Hedwig, Klaus 31, 128, 137 Hegel, Georg Friedrich Wilhelm 164, 172, 178, 179, 182, 193, 283 Heidegger, Martin 12, 57, 184, 221, 222, 226–232, 283, 329, 330 Heinekamp, Albert 173 Helmontius, 156 Henricus de Gandavo (Heinrich von Gent, Henri de Gand) 10, 48, 49, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 120, 127, 128, 161, 244, 249, 289, 290, 292, 310, 312, 327 Henricus de Harclay 141 Henricus de Segusia (Henry de Suse, card. Hostiensis) 28 Herakleitos 128 Hervaeus Natalis (Hervé de Nédellec) 326 Herveus, Thomas 160 Hieronymus de Montefortino 10 Hinske, Norbert 294, 311 Hobbes, Thomas 20, 329, 330, 332 Hochstetter, Erich 160, 172
Register
Hoekstra, Sytze 201 Hoen, Cornelisz Hendricxz 98 Hoenen, Maarten 243, 244, 247 Hoffmann, Tobias 120, 122, 137, 236, 247 Hofmeister Pich, Roberto 29 Hofstede de Groot, Petrus 200 Honnefelder, Ludger 31, 62, 73,104, 117, 123, 137, 168, 169, 172, 173, 175, 177, 179, 180, 181, 184, 185, 193, 216, 217, 218, 220, 250, 299, 311, 331 Honorius papa III 319 Honorius Augustodunensis (H. von / d’ Autun) 253 Hooker, Richard 332 Hosea propheta (Osée) 31 Houghton, Louise Seymour 317, 321 Hübener, Wolfgang 163, 165, 167, 173 Hugo de Sancto Victore 52, 328 Hugues, Barnabas 144, 154 Hugutio (Huguccio, Ugguccione da Pisa, ep. de Ferrara) 28 Hume, David 143, 152, 153, 283 Hurtado de Mendoza 152 Husserl, Edmund 12, 176, 193, 221, 224– 227, 229, 232, 302, 304, 310 Iacobus de Aesculo (I. d’ Ascoli) 327 Iacobus de Venetiis 287, 310 Iesus Christus 25, 39, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 96, 98, 253, 256, 257, 259, 266, 268, 316, 317, 318 Imbach, Ruesi 207, 208, 250 Ingham, Mary Beth 12, 323, 326, 330, 333 Inglis, John 198, 199, 207 Ioannes Papa XXII 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 55 Ioannes de Aragon (Jean d’Aragon) 44 Ioannes Baconthorp 28 Ioannes Buridanus (Jean Buridan) 10, 57,58,60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 93, 333 Ioannes Canonicus (Jean Marbres) 10, 103, 104, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 Ioannes Capreolus 327 Ioannes Damascenus 39, 42
339
Ioannis de Bassolis 162, 172 Ioannes de Ianduno (I. de Gandavo) 57 Ioannes de Rada 167, 172 Ioannes de Mirecourt 58 Ioannes de Neapoli (Jean de Naples) 44 Ioannes de Ripa 81, 82, 83, 90 Ioannes Lutterell 43, 54 Ioannes Poncius 120, 137 Ioannes Rubey de Clarano 44 Ioannes Scotus Eriugena 18 Ioannes Tauler 94 Iribarren, Isabel 9, 31, 32, 42, 326 Isaac 31–42 Iudas (Iskarioth) 23, 25 Iustinianus 28 Izquierdo, Sebastián 308, 312 Jaeger, Werner 310 Jannone, Antonio 232 Jansenius (Cornelius Jansen) 257 Janz, Denis R. 94, 101 Jasper, Josef 155, 173 Joy, Lynn Sumida 148, 154 Jolivet, Jean 29 Jüngel, Eberhard 205, 207 Jupiter 121 Juston, Étienne 313, 314, 316, 321 Kabitz, Willy 160, 173 Käpelli, Thomas 55 Kähler, Ernst 203 Kahl, Wilhelm 121, 122, 137 Kant, Immanuel 11, 15, 119, 172, 175, 178–193, 214, 232, 287, 289, 292–295, 298, 301, 304, 310 Keill, John 151, 152, 153 Kelsen, Hans 16 Kenny, Anthony 12, 154, 238, 269, 271– 278, 280, 281, 285 Kierkegaard, Sören 31 King, Peter 278, 281 Kirchmann, Justus Herrmann von 159, 173 Kist, Nicolas 200, 201, 207 Kissinger, Henry 308 Kitanov, Severin 79, 81, 91
340
Register
Kleineidam, Erich 93, 101 Kleutgen, Joseph 198, 199 Klopp, Onno 159, 172 Klossowski, Pierre 284, 311, 312 Kluxen, Wolfgang 59–61, 63, 70, 91, 244, 247 Knuuttila, Simo 121, 137, 169, 173, 239, 247, 306 Kobusch, Theo 117 Körver, Benignus 236, 248 Kolmer, Petra 193 Koppehl, Herrmann 158, 173 Korten, Harald 193 Kremer, Elmar J. 118 Kretzmann, Norman 154 Krieger, Gerhard 72, 300, 311 Krop, Henri A. 243, 244, 247, 248 Kuebel, Sven 332 Labooy, Guus H. 243, 248 Lacan, Jacques 25 Lampen, Willibrordus 236, 237, 248 Landulphus Caracciola 84, 90, 236 Langlois, Luc 137, 193 Laspeyres, Ernst Adolf Theodor 29 Laurent, Jérôme 220 Le Cazre, Pierre 154 Legendre, Pierre17, 25 Leibniz, Gottfried Wilhelm 11, 150, 151, 153, 155–173, 210, 211, 213, 214, 215, 217, 218, 306, 307, 308, 310 Leo papa XIII 9, 198, 318 Leo de Assisi 319, 320, 321 Leppin, Volker 10, 93, 94, 101 Lewis, David 396, 307, 308, 311 Lisco, Margarete 317, 321 Little, Andrew George 196, 207, 320 Locke,John 15, 283, 332 Loiret, François 12, 251, 326 Lombardo Radice, Lucio 153 Loofs, Friedrich 195, 201, 202, 203, 207 Loomann-Graaskamp, Aline H. 243, 246 Lories, Danielle 117, 136 Lotringer, Lucienne 268 Loux, Michael J. 307, 311 Lovejoy, Artur O. 239, 248
Lowe, Ernest Jonathan 303, 312 Lucifer 17, 18 Lucretius (Titus Lucretius Carus) 211 Luther, Martin 10, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 156, 202, 203, 257, 310 MacIntyre, Alasdair 16 Macken, Raymond 289, 310 Maddalena, Giovanni 294, 312 Maier, Anneliese 57, 58, 60, 73 Maierú, Alfonso 207, 208, 250 Maire, Gilbert 214 Maître du Sacré Palais 44 Malebranche, Nicolas 179 Mandonnet, P. 58 Mandrella, Isabelle 31, 32, 35, 42, 137, 175, 193 Mansion, Augustin 234 Manzini, Frédéric 119, 137 Markion (Marcion) 255 Marcolino, Venicio 91 Marenbon, John 281 Marion, Jean-Luc 122, 126, 131, 176, 193 Maritain, Jacques 285 Marrone, Francesco 10, 103, 112, 118, 133, 323, 327 Marsilius de Inghen 243, 247 Marty, François 310 Massé, Henri 153 Matthias de Aquasparta 129, 136 Matthieu, Luc 257, 268 Mauritius de Portu (Mauritius Hibernicus, Muiris Ó Fithcheallaigh, Maurice O’Fihely) 10 McCord Adams, Marilyn 91 McCullough, Laurence Bernhard 159, 173 McInerny, Ralph 31, 34, 42 Mehl, Édouard 11, 103, 119 Melanchthon, Philipp 203 Melissos 85, 86 Mercier, Désiré-Félicien-François-Joseph, card. 199, 208, 234, 250 Mercken, H. Paul E. 244, 248 Mersenne, Marin 120, 121, 122, 125, 130, 131, 132,133, 134, 136, 148, 149, 153
Register
Michon, Cyrille 12, 269, 323, 324, 326, 327, 331 Midas, rex 204, 207, 243, 247 Minges, Parthenius 163, 173, 327 Minio-Paluello, Lorenzo 287, 310 Mistral, Frédéric 317 Möllenbeck, Thomas 243 Molina, Luis de 247 Mondadori, Fabrizio 169, 173 Moses Maimonides 139, 142 Muckle, Joseph Thomas 153 Müller, Marianus 235 Mulligan, Kevin 312 Murat, Thérèse Joachim, comtesse 209 Murcia de la Llana, Franciscus 160 Murdoch, John E. 139, 146, 147, 154 Mu’tazilli, Basrian 139, 142, 153 Narbonne, Jean-Marc 137, 193 Nef, Frédéric 304, 305, 307, 308, 311 Newton, Isaac 151, 154 Nicolaus de Altricuria (N. de Autrecourt) 58, 73 Niebuhr, Barthold Georg 197 Nietzsche, Friedrich 230, 266 Nizolius, Marius 157, 158 Noone, Timothy 124, 137, 323, 324, 325, 327, 330, 331, 332 Normore, Calvin 118 Norton, David Fate 153 Norton, Mary J. 153 Oberman, Heiko Augustinus 74, 93, 95, 96, 101, 203, 207 Olivo, Gilles 127, 137 Oksenberg-Rorty, Amelie 118 Opzoomer, Cornelis Willem 200 Origenes (O. Adamantius ; O. de Alexandria) 256 Ott, Joachim 93, 101 Padovani, Andrea 18, 29 Palmerino, Carla Rita 148, 154 Papst, Bernhard 139, 154 Paracelsus, Theophrastus 156
341
Pareau, Jean Henri 200 Parisoli, Luca 9, 16, 17, 19, 26, 27, 28, 29 Parmenides 85, 86, 239 Pasqualigo, Pietro 117 Paterson, Craig 311 Patrem, Marie-Léon 317, 321 Pattin, Adrien 248, 249 Paulus apostolus 50, 263 Paulus, Jean 289, 312 Paulus Barbus (Paolo Barbo; Soncinas) 166, 172 Pecci, Gioacchino (Leo papa XIII) 198 Pecci, Giuseppe card. 198 Peirce, Charles Sanders 172, 193, 294– 302, 309, 310, 312 Pelzer, Auguste 235, 248, 249 Pererius, Benedictus (Perera, Benito; Pereira; Pererio) 123, 136, 161, 163, 172. Pérez, Antonio 173, 312 Perler, Dominik 232 Petrus apostolus 25 Petrus Abaelardus (Pierre Abélard) 16, 17, 29, 140, 197, 202, 237, 248 Petrus Aureoli 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 160, 327 Petrus Cantor (Pierre le Chantre) 328 Petrus de Alvernia (Pierre d’Auvergne) 57 Petrus (Bilinus) de Posnania 166, 167, 172 Petrus de Candia (Peter of Candia, Pierre de Candie) 10, 75, 76, 77, 78, 79–91 Petrus Ioannis Olivi (Pierre Olieu) 16, 140, 265, 313 Petrus Lombardus 42, 78, 91, 310, 328 Petrus de Palude 27 Petrus Roger (Clemens papa VI) 44 Philippus de Maiorca (Philippe de Majorque) 46 Pichler, Alois 155, 173 Pickavé, Martin 104, 118, 289, 290, 312, 323, 332 Pierre de Limoges 53 Pierre Desmaisons 44 Pike, Nelson 270, 281 Pinborg, Jan 57, 73, 154 Pinchard, Bruno 136
342
Register
Pirotta Angelo M. 222, 232 Pius papa X 321 Plantinga, Alvin 38, 309. 312 Platon 98, 127, 129, 137, 161, 163, 164, 178, 182, 183, 191, 192, 193, 229, 239, 303, 332 Plotinos 332 Pluzanski, Émile C.A. 121, 137 Podkonski, Robert 144, 154 120 Porphyrios 66, 304 Porro, Pasquale 9, 103, 104, 118, 292, 311, 312 Poysson, Jean-Baptiste 148 Pozzo, Rirardo 63, 73 Pseudo-Rufus 140 Pugh, M. S. 311 Putnam, Hilary 285 Pyle, Adrew 139, 154 Quillet, Jeannine 159, 173 Quine, Willard Van Orman 184, 302 Ragghianti, Renzo 220 Rahner, Karl 205 Ramelow, Tilman 170, 173 Ramond, Charles 193 Ramoneda, Christian de 160 Rampolla, Mariano 318 Remond, Nicolas 158 Renan, Ernest 197, 314, 316, 317, 318 Renault, Laurence 118 Reuchlin, Iaonnes 95 Reynault, FranÇois 172 Richardus de Mediavilla 327 Richardus de Sancto Victore 246 Richardus Fishacre 328 Richardus Rufus 137, 328 Rijk, Lambertus M. de 60 Rintelen, Fritz 155, 158, 173 Ritschl, Albrecht 201 Ritter, Joachim 173 Rivelaygue, Jacques 293, 310 Robert d’Anjou 44, 46 Robert, Aurélien 139, 154 Robiglio, Andrea 326 Robinet, André 134, 137 Rochot, Bernard 136
Roesner, Martina 12, 221, 323 Rohrkasten, Jens 208 Romano, Claude 220 Rosemann, Philipp 91 Ross, William David 310 Rubius, Antonius 159 Rudavsky, Tamar 42 Rupertus Tuitensis (Rupert von Deutz) 253 Russel, Bertrand 283, 286, 312 Sabatier, Auguste 314 Sabatier, Michel 313 Sabatier, Paul 12, 313–321 Sagnol, Marc 268 Sagredo, Giovan Francesco (in dialogo Galilei) 149 Salomon Ibn Gabirol (Avicebron) 17 Salviati, Filippo (in dialogo Galilei) 149, 150 Sancia (reg. neapolitana) 46 Samama, Guy 29 Saturnius 121 Schautheet, Fulgentius 160 Schepers, Heinrich 169, 173 Schlegel, Jean-Louis 268 Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst 204 Schmidt, Axel 243 Schmitt, Carl 20 Schmutz, Jacob 9, 119, 120, 133, 137, 175, 179, 193, 303, 306, 311, 312, 323, 326, 327, 329, 331, 332 Schönberger, Rolf 10, 57, 60, 66, 71, 73, 332, 333 Scholten, Jan H. (Johannes Henricus) 200, 201, 207 Schrecker, Paul 310 Sciuto, Italo 15 Scott, Theodore K. 58, 73 Scribano, Emanuela 126, 137 Seeberg, Reinhold 201, 202, 203 Shanley, Brian 285, 312 Simon, Paul 303 Simons, Peter 303, 312 Smith, Barry 303, 312 Söder, Joachim Roland 239, 247
Register
Sokrates 161, 164, 165 Solère, Jean-Luc 11, 137, 139, 323 Sondag, Gérard 197, 207 Sordi, Serafino 198 Sousedik, Stanislav 120 Specht, Rainer 173 Speer, Andreas 42,. 73, 154 Spencer, Herbert 214 Spiazzi, Raimondo M. 68, 73, 287, 311 Spinoza, Bendictus 119, 124, 128, 133, 137, 214, 332 Spruyt, Joke 244, 249 Staal, J. F. 249 Stahl, Daniel 16z1, 166, 172 Stöckl, Albert 199 Stoevesandt, Hinrich 204 Storne, Franck 313, 315, 317–321 Stotz, Marguerite 320 Strawson, Peter F. 184, 186, 284, 312 Struyker Boudier, Cornelis E. M. 249 Stump, Eleonore 285 Styx 121 Suárez, Franciscus 117, 118, 120, 123, 124, 126, 131, 136, 158, 159, 160, 161, 169, 173, 175, 179, 193, 231 Strasser, Stephan 310 Silvestri, Francesco (Sylvestre de Ferrare) 326 Sylwanowicz, Michael 36, 42 Szyller, Slawomir 73 Tacquet, Andreas 150 Tannery, Paul 153 Tarello, 15 Te Vedde, Rudi 241, 244, 249 Terreni, Guido 27, 28 Thibaud, Pierre 310 Thijssen, Johannes M. M. K. 58, 73, 145, 154 Thomas de Aquino (Thomas d’Aquin) 9, 10, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 57, 58, 67, 68, 73, 80, 81, 82, 83, 93, 94, 95, 101, 125, 131, 157, 158, 163, 165, 167, 172, 198, 199, 202, 204, 222, 229, 232, 239, 244, 247, 249, 253, 263, 264,
343
266, 270, 284–289, 310, 311, 325, 326, 331 Thomas de Celano 319 Thomas Wallensis (Waleys) 44, 46, 49, 51 Thomasius, Jacobus 156, 157, 159 Tiercelin, Claudine 302, 310, 312 Tillich, Paul 205 Toledo, Francisco 159 Tolstoj, Lev 317 Torricelli, Evangelista 150 Trapp, A. Damasus 91 Trendelenburg, Adolf 158, 173 Tresmontant, Claude 256, 257, 268 Treu, Marin 93, 101 Trierweiler, Denis 268 Trottmann, Christian 10, 43, 55 Työrinoja, Reijo 117 Van Asselt, Willem Jan 196, 203, 205, 208, 332 Van Bewerwijck, Jan (Beverovicius) 130, 136 Van de Vyver, Émile 248, 249 Van der Helm, A. C. 244, 247 Van der Lecq, Ria 57, 73, 244, 248 Van Inwagen, Peter 271, 281 Van Riet, Simone 136 Van Steenberghen,Fernand 196, 198, 199, 207, 234, 235, 249, 328 Van Unnik, Wim 203 Vázquez, Gabriel 120, 125, 131, 308 Veldhuis, Henri 29, 233, 243, 246, 249 Venus 301 Verbeek, Theo 193 Verbeke, Gerard 234 Vermigli, Peter Martyr (Pietro Mariano Vermigli) 325 Vermot, S. 103 Veuthey, Léon 253, 254, 258, 268 Violette, René 159, 173 Vivès, Ludovicus (Louis Vivès) 11, 202, 333 Voegelin, Eric 26 Voetius, Gisbertus 234, 243, 246 Vollet, Matthias 12, 121, 209, 212, 213, 214, 216, 220, 323 Von Balthasar, Hans Urs 205
344
Register
Von Harnack, Adolf 201 Von Müller, Karl Ferdinand F. 317, 321 von Nostitz-Rieneck, Robert 155, 158, 173 Von Ranke, Leopold 197 Vos, Antonie 11, 15, 25, 29, 195, 196, 201, 204, 205, 206, 208, 234, 238, 239, 240, 242–246, 249, 322, 324–327 Wadding, Lucas 10, 11, 202 Wagner, Gabriel 158 Wald, Berthold 31, 42 Wallis, John, 150 Walsh, James J. 57, 74 Wegener, Lydia 154 Weigel, Erhard 156 Weiss, Paul 310 Wells, Norman J. 118 Wendland, Volker 74 Wey, J.C. 55 Wielockx, Robert 199, 208, 234, 250 Wiggers, A. J. 249 Wiggins, David 271 Williams, Thomas 242, 250 Wilson, Gordon 292 Wittgenstein, Ludwig 284, 285, 294, 300, 311, 312
Wolff, Christian 172, 179–182, 185, 189, 190, 193 Wolter, Allan B. 91, 246, 250, 286, 291, 310, 312 Wood, Rega 137, 173, 196, 207, 250 Worms, Frédéric 220 Wust, Léna 314 Wycliff, John 147 Yates, Philipp 208 Zabarella, Giacomo 159 Zanchius (Girolamo Zanchi) 325 Zarka, Yves-Charles 136 Zeno de Elea 148, 152, 212, 214 Zimara, Marcus Antonius 160, 161 Zimmermann, Albert 42, 65, 74, 124, 137, 248, 312 Zu Dohna-Wundlacken, Heinrich Ludwig Adolph, Graf 185 Zupko, Jack 73 Zweermann, Theo 243 Zwingli, Huldrych 10, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 203, 204

![Duns Scotus. Vol. II. The philosophical Doctrines of Duns Scotus [2]](https://dokumen.pub/img/200x200/duns-scotus-vol-ii-the-philosophical-doctrines-of-duns-scotus-2.jpg)


![John Duns Scotus: 1265-1965 [Reprint ed.]
0813231086, 9780813231082](https://dokumen.pub/img/200x200/john-duns-scotus-1265-1965-reprintnbsped-0813231086-9780813231082.jpg)
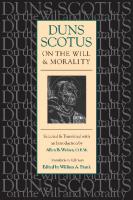

![Understanding John Duns Scotus : Of realty the rarest-veined unraveller [1 ed.]
9781576594148](https://dokumen.pub/img/200x200/understanding-john-duns-scotus-of-realty-the-rarest-veined-unraveller-1nbsped-9781576594148.jpg)


