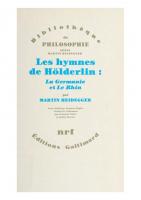Ernest de Bavière (1554-1612) et son temps French: L'automne flamboyant de la Renaissance entre Meuse et Rhin 9782503543451, 2503543456
Prince-évêque de Liège de 1581 à 1612, Ernest de Bavière est aussi archevêque de Cologne, évêque de Munster, Hildesheim
351 74 21MB
French Pages 340
Polecaj historie
Citation preview
ERNEST DE BAVIÈRE (1554-1612) ET SON TEMPS L’AUTOMNE FLAMBOYANT DE LA RENAISSANCE ENTRE MEUSE ET RHIN
DE DIVERSIS ARTIBUS COLLECTION DE TRAVAUX
COLLECTION OF STUDIES
DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE
FROM THE INTERNATIONAL ACADEMY
D’HISTOIRE DES SCIENCES
OF THE HISTORY OF SCIENCE
DIRECTION EDITORS
EMMANUEL
POULLE (†)
ROBERT
HALLEUX
TOME 88 (N.S. 51)
F
ERNEST DE BAVIÈRE (1554-1612) ET SON TEMPS L’AUTOMNE FLAMBOYANT DE LA RENAISSANCE ENTRE MEUSE ET RHIN
Études réunies par GENEVIÈVE XHAYET et ROBERT HALLEUX
F
Publié avec le soutien de la Région Wallonne.
© 2011 Brepols Publishers n.v., Turnhout, Belgium All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the publisher
D/2011/0095/222 ISBN 978-2-503-54345-1 (hardback) ISBN 978-2-503-54346-8 (paperback) Printed in the E.U. on acid-free paper
LIMINAIRES
PRÉFACE Jean-Pierre Hupkens, Échevin de la Culture de la Ville de Liège
Marguerite Yourcenar a dit de Liège qu’elle était « une étape sur la route de l’esprit »1. La petite principauté épiscopale, terre d’Empire aux marches de la romanité, fut, pendant un millénaire, un espace d’échanges entre la France, l’Allemagne et les Pays Bas. La Sambre et la Meuse qui l’irriguent n’ont pas seulement acheminé des marchandises et des invasions, mais des hommes, des livres et des idées, dont les Liégeois ont fait leur miel. À Liège, arts, sciences, lettres et culture sont à la fois ancrés dans le terroir et ouverts sur l’Europe. Pour comprendre et valoriser cette polarité féconde, Liège mène, depuis des décennies, une ambitieuse politique d’expositions internationales. En 1966, Lambert Lombard et son temps marque le quatrième centenaire de la mort du peintre mais explore aussi le règne d’Erard de la Marck et les premiers temps de la Renaissance liégeoise. Deux ans plus tard, en 1968, l’abbaye de Saint-Laurent, désormais millénaire, est à son tour célébrée. Cette même année, la commémoration du sac de Liège de 1468 est l’occasion d’organiser Liège et Bourgogne qui ravive le souvenir du XVe siècle liégeois et de la résistance à la domination bourguignonne. Il y eut ensuite Le siècle de Louis XIV au pays de Liège, en 1975, et Le Siècle des Lumières dans la Principauté de Liège en 1980, dans le cadre des célébrations du millénaire de la principauté. L’une et l’autre soulignaient les liens de la principauté mosane avec la France. La relecture du passé liégeois reprit en 2001 par une interrogation sur le XIXe siècle et le concept de Modernité. Avec le XXIe siècle, les anniversaires redeviennent aussi prétextes à commémorations : Lambert Lombard, à nouveau, en 2005, Jean Delcour, en 2007, en attendant André Ernest Modeste Grétry, en 2013, et les mille ans de l’abbaye de SaintJacques, en 2015-2016. Mais entre la mort de Lambert Lombard (1566) et le début du Grand Siècle s’étendait une période peu connue et cependant cruciale où le pays de Liège passe de la Renaissance au maniérisme, puis au baroque tandis qu’il entre dans la Révolution Scientifique et le capitalisme moderne. Cette période coïncide avec le règne d’Ernest de Bavière (1554-1612), prince évêque de Liège de 1581 à 1612. Oublié, voire décrié à Liège, ce personnage paradoxal tient néanmoins un rôle non négligeable dans l’histoire politique et culturelle de l’Europe. Ainsi naquit l’idée d’une exposition qui s’intitula d’abord, à la manière de Huizinga « l’automne de la Renaissance ». Pour écarter toute mélancolie, on lui accola l’épithète « flamboyant » qui évoque à la fois les splendeurs du maniérisme, le rougeoiement des hauts fourneaux, l’œuvre au rouge des alchimistes, mais aussi, hélas, le bûcher des sorcières. Pour que cette grande entreprise réussisse, il fallait que se rencontrent, comme au temps d’Ernest de Bavière, un lieu, des savants, des artistes et des politiques. Le lieu, c’est le palais Curtius, pièce maîtresse de l’exposition. Il fut construit sous le règne d’Ernest, par un richissime marchand d’armes, et il est probable que le prince le visita. Entièrement restauré, il est aujourd’hui le cœur du Grand Curtius, un nouvel ensemble muséal d’art et d’histoire d’envergure européenne. Les savants, c’est l’équipe universitaire dirigée par le Professeur Robert Halleux, membre de l’Institut de France, membre de l’Académie royale de Belgique, et Madame Geneviève Xhayet, directrice du Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques de l’Université de Liège. Ils ont conçu l’exposition dans le détail et ont voulu qu’elle s’accompagne d’un recueil d’études où les aspects les plus divers sont abordés, de la politique à la sculpture, en passant par la vie religieuse, la cour savante, la pratique de la science et de la médecine, l’essor industriel, la gravure, la peinture et la musique. Les artistes, c’est l’équipe des Musées de Liège, dirigée par Jean-Marc Gay, Directeur général des musées. Conservateurs, gestionnaires, graphistes, techniciens ont donné le meilleur d’eux mêmes pour que 1. Marguerite Yourcenar, Souvenirs pieux, Paris, Gallimard, 1974, p. 66.
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
la présentation matérielle réponde aux plus hautes exigences des contenus scientifiques et de la muséologie moderne. La volonté politique, enfin. Dans une vieille région industrielle, les autorités politiques liégeoises savent qu’il n’est richesse que d’hommes et que, si toutes les industries sont délocalisables, le patrimoine, lui, ne l’est pas. Elles ont fait le pari de la culture et veulent faire de leur ville ce qu’elle était du temps d’Ernest, une métropole culturelle. Ainsi, l’exposition et le livre qui l’accompagne ne sont pas seulement un microcosme de l’Europe, mais un condensé de savoirs et de volontés. De nombreux partenaires publics et privés ont soutenu l’entreprise et les prêteurs ont répondu avec générosité à nos demandes. L’Académie internationale d’Histoire des Sciences a bien voulu nous accorder son haut patronage et accueillir le recueil d’études dans sa prestigieuse Collection de Travaux. Je les en remercie.
8
INTRODUCTION : OMBRES ET LUMIÈRES D’UN RÈGNE Geneviève Xhayet et Robert Halleux
Loin derrière les figures emblématiques de Notger, le fondateur de la principauté, d’Erard de la Marck, l’initiateur de la Renaissance, ou de Velbruck, l’évêque des Lumières, Ernest de Bavière est, dans la galerie des princes évêques de Liège, un personnage relativement méconnu. On le dit cultivé, féru de sciences et de techniques. On lui sait gré d’avoir fondé, à Liège, un hôpital éponyme. Dans un registre plus léger, on retient aussi la boutade d’Henri IV à son propos : « Mon cousin de Liège me ressemble jusqu’à la ceinture »1. On se souvient enfin qu’il est le premier des princes de la Maison de Bavière qui régnèrent sur la principauté durant la période moderne et que cette mainmise, souvent peu appréciée des Liégeois, dura un siècle et demi. Au-delà des clichés, l’historiographie liégeoise a cependant tenté de cerner le personnage et son époque. Au XIXe siècle, le jeune État belge qui se construit un passé, recherche et inventorie les archives de ses anciennes principautés constitutives. Dans le cadre de la Commission pour la publication des Anciennes Lois et Ordonnances de la Belgique, l’archiviste liégeois Mathieu Polain publie, en 1871, un Recueil des règlements édictés dans la principauté de 1581 à 1620, qui couvre par conséquent tout le règne d’Ernest de Bavière et le début de celui de Ferdinand, son neveu et successeur. La publication des répertoires d’archives ecclésiastiques (les conclusions capitulaires du Chapitre cathédral de Liège2, les archives de la Nonciature) et étatiques (dépêches du Conseil privé du prince évêque3, les archives des métiers, etc.,) complètent le matériel diplomatique disponible. Dans la foulée de ces publications, Eugène Polain, le petit-fils de Mathieu, se lance dans un considérable travail d’écriture. Sa Vie à Liège sous Ernest de Bavière, une synthèse plus de 900 pages publiée dans l’entre deux guerres, est un travail remarquable4. Polain s’appuie sur une documentation très riche. Outre les archives, il utilise les diverses chroniques manuscrites qui subsistent et surtout les nombreux ouvrages publiés à Liège sous le règne du prince bavarois. L’œuvre se distingue par sa variété. Polain tente une histoire globale de la période. À côté de questions classiques d’histoire politique, religieuse ou institutionnelle qui y trouvent place, il enquête aussi sur l’économie, la culture, ou encore les divers aspects de la vie quotidienne de ce temps. Si certaines interprétations peuvent apparaître aujourd’hui obsolètes et doivent être revues, ce livre demeure néanmoins un point de départ utile pour toute étude portant sur le règne d’Ernest de Bavière. Un livre de Paul Harsin constitue l’autre jalon majeur de l’historiographie liégeoise relative à cette période. Dans les années 1950, l’historien économiste entreprend la rédaction d’Études critiques sur l’histoire de la principauté de Liège 1477-1795. Monumental, le projet restera inachevé. Sous le titre Politique extérieure et défense nationale au XVIe siècle, le tome III aborde la politique étrangère de la principauté, de la mort d’Erard de La Marck jusqu’en 16105. Le travail repose sur une documentation impressionnante et retrace, avec un souci méticuleux du détail, toutes les facettes de la politique étrangère liégeoise de ces temps troublés. Paru en 1959, cet ouvrage reste une synthèse fondamentale. Paul Harsin réservait les développements 1. Ernest avait reçu les ordres majeurs à Cologne, le 19 juin 1577 (Hansgeorg Molitor, Das Erzbistum Köln im Zeitalter der Glaubenskämpfe, 1515-1688, Köln , 2008, p. 228), mais il eut dans son château d’Arnsberg une liaison durable avec l’intendante de ses domaines, Gertrude von Plettenberg, qui lui donna un fils et une fille (Magdalena Fadberg, « Jungfer Gertrud und ihre Familie ». Jahrbuch Hochsauerlander Kreis, 1990, p. 120-126). À Liège, il s’affichait avec Jeanne de Royer, qui lui donna une fille, Maximilienne, qu’il légitima et qui épousa en 1618 François Bernardin, fils de son conseiller Charles de Billehé (Pierre Hanquet, « Les Perez et leur groupe familial », Recueil de l’Office généalogique et héraldique de Belgique, 7 (1958), p. 61. 2. S. Bormans, « Répertoire chronologique des conclusions capitulaires du chapitre cathédral de Saint-Lambert à Liège, 14261652 » dans Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique, Louvain, 1870-1876. 3. E. Poncelet, Inventaire des dépêches du conseil privé t. 1, Épiscopat d’Ernest de Bavière (1581-1612), Liège, 1945. 4. E. Polain, La vie à Liège sous Ernest de Bavière parut d’abord par segments dans les Bulletin(s) de l’Institut archéologique liégeois, entre 1929 et 1938, avant de faire l’objet d’une publication intégrale, à Tongres, en 1938. 5. P. Harsin, Études critiques sur l’Histoire de la Principauté de Liège, 1477-1795, t. 3 Politique extérieure et défense nationale au XVIe siècle (1538-1610), Liège, 1959.
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
relatifs à la politique intérieure du temps d’Ernest de Bavière à un tome quatrième6, qui ne vit malheureusement jamais le jour. Hormis ces deux synthèses générales, d’autres études contemporaines ou postérieures ont éclairé diverses facettes de l’histoire de la principauté au tournant des XVIe et XVIIe siècles. Il serait vain de vouloir toutes les citer ici. En parcourant les pages qui suivent, les lecteurs découvriront ces travaux et les noms de leurs auteurs, que ce soit dans le texte ou au détour d’une note. Basé tant sur les derniers états de la recherche et que sur les travaux des différents auteurs, le présent ouvrage dresse un état des lieux sur Ernest de Bavière, il ne prétend pas épuiser le sujet. Il s’articule en trois parties. La première traite de politique et de religion. Prince évêque de Liège, archevêque électeur de Cologne, évêque de Freising, Münster, Hildesheim, Ernest est un prince de stature européenne. Il le doit à ses origines familiales prestigieuses, à son éducation chez les Jésuites, à ses capacités et à ses ambitions. En cela, il se distingue de ses prédécesseurs, souvent issus de la petite noblesse locale. Entre ses différents États, il voyage sans cesse, mais un décompte minutieux de ses présences et de ses absences révèle que Liège est un de ses séjours de prédilection. Il mène son action politique dans un contexte international âpre, marqué par une reconfiguration politique et religieuse de l’Europe après les guerres de religion, comme par les premières affirmations des structures étatiques modernes. À l’avènement d’Ernest, la principauté est, sur le plan extérieur, un État neutre. Sur le plan intérieur, c’est un pays meurtri par les guerres du siècle précédent et qui se reconstruit sur ses anciennes bases institutionnelles. D’un point de vue religieux, c’est un pays catholique. Comme évêque de Liège, Ernest de Bavière implante la réforme tridentine dans le diocèse et consolide ainsi l’ancrage catholique de la principauté. Malgré une certaine complaisance en faveur des États catholiques, il préserve, comme prince, la neutralité liégeoise. Sur le plan intérieur, ses efforts pour rompre avec la tradition institutionnelle se heurtent à la résistance des Liégeois. La modernisation étatique, et son corollaire la tendance à l’absolutisme, seront davantage le fait de ses successeurs. La deuxième partie étudie l’homme de savoir. Depuis Erard de la Marck, l’humanisme fleurit au pays de Liège7 et les amateurs d’antiques y sont nombreux. La coupe ornée de monnaies romaines, fabriquée pour la famille Oranus, en est un éloquent exemple. Certes, les humanistes n’ont pas manqué dans l’entourage d’Ernest de Bavière, comme son secrétaire, le Pictor doctus, Dominique Lampson8, ses vicaires généraux Liévin Torrentius9 et Jean Chapeaville10, mais ils ont été requis par les hautes tâches de l’Église et de l’État. Juste Lipse11 ne fera qu’un séjour de six mois à Liège et à Spa. En réalité, les intérêts du prince sont ailleurs. Prince praticien, il s’investit dans la double aventure de la Révolution scientifique et du capitalisme moderne. Solidement adossé à la Compagnie de Jésus, il importe à Liège la contre-réforme mathématique, en même temps qu’il protège les Paracelsiens, stimule la modernité médicale et pratique l’alchimie. Son règne coïncide avec l’essor industriel du pays de Liège, dans l’exploitation de la houille, la sidérurgie, la chimie industrielle. La troisième partie traite de l’architecture, de la peinture, de la sculpture et de la musique sous Ernest de Bavière. Une « génération perdue » pour la peinture, une période peu florissante dans l’architecture, une « indigence de témoins » en sculpture, comme l’affirment les auteurs des études consacrées à ces disciplines
6. Ibidem, notice bibliographie, p. 1. 7. L’étude de Jean Puraye, La Renaissance des études au pays de Liège, Liège, 1949, reste bien utile. 8. Jean Puraye, Dominique Lampson. Humaniste. 1532-1599, Desclée de Brouwer, 1950. Plus récemment : Mathilde Bert, Pline l’Ancien et Dominique Lampson, dans « Actes du colloque Pline l’Ancien à la Renaissance », sous presse dans Archives internationales d’Histoire des sciences, 166-167 (2011). 9. Marie Juliette Marinus, Laevinus Torrentius als tweede bisschop van Antwerpen (1587-1595), Bruxelles, 1989 (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en schone Kunsten van België, 51 n° 131) 10. Jean Chapeaville (1551-1617) et ses amis. Contribution à l’historiographie liégeoise. Édition critique du texte latin, traduction française et notes philologiques de René Hoven, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2004. 11. Sur le séjour de Juste Lipse à Liège, on se reportera à l’article ancien d’Albin Body, « Juste Lipse aux eaux de Spa », Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 15 (1879). 10
INTRODUCTION : OMBRES ET LUMIÈRES D’UN RÈGNE
artistiques dans les pages qui suivent. Le temps d’Ernest de Bavière s’inscrirait-il en creux dans le domaine artistique ou bien, parce qu’il échappe aux catégories, souffre-t-il seulement d’être méconnu ? Les tendances en art s’accommodent mal des césures brutales que sont les débuts et fins de règnes, aussi les historiens d’art ont-ils élargi leur fourchette chronologique, tant en amont qu’en aval, par rapport au principat d’Ernest de Bavière. Ce faisant, leur travail a mis au jour une production artistique abondante et de qualité, mais dans sa majeure partie, ignorée.
Coupe Oranus. Liège, Grand Curtius. © Cliché Yvette Lhoest.
Au tournant du XVIIe siècle, les arts plastiques traversent une période de transition. Plus vraiment renaissant, le style s’achemine vers le baroque. Les œuvres produites dans le pays d’entre Meuse et Rhin n’échappent pas à cette hésitation. Elles se ressentent en outre d’influences extérieures diverses, italienne ou flamande notamment, qui rendent malaisé l’effort de caractérisation. Hormis en architecture, où une manière particulière de construire a été reconnue et identifiée sous l’appellation de Renaissance mosane, les arts liégeois ne donnent pas lieu à un style particulier. En outre, peu de noms vraiment marquants d’artistes se détachent. En revanche, les études publiées ici révèlent l’émergence de familles d’entrepreneurs artistes, organisés en ateliers, et dont on peut parfois suivre le parcours au long de plusieurs générations. À l’exception de quelques familiers de la cour, Dominique Lampson par exemple-, tout ce mouvement artistique semble relativement indépendant du prince. Pour trouver trace d’une impulsion princière aux arts, il faut surtout se tourner vers la musique. À l’instar des chapelles bavaroise ou italienne qu’il avait connues dans sa jeunesse, Ernest de Bavière a en effet appelé des musiciens auprès de lui.
11
PREMIÈRE PARTIE
L’HOMME D’ÉTAT ET L’HOMME D’ÉGLISE
ERNEST DE BAVIÈRE ET LA PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE LE GRAND PRINCE D’UN PETIT ÉTAT Geneviève Xhayet
Un petit État neutre Lorsqu’Ernest de Bavière découvre la principauté épiscopale de Liège, en 1581, celle-ci se présente comme un petit état aux contours très morcelés, étiré le long du sillon de la Sambre et de la Meuse moyenne. D’un point de vue juridique, elle fait partie du Saint Empire germanique, et plus particulièrement elle dépend du « Cercle de Westphalie », une de ses divisions fiscales et militaires. La tutelle impériale est toutefois assez légère et, hormis sur certains points, l’État liégeois est pour ainsi dire indépendant. La principauté se compose de cinq entités : le pays de Liège proprement dit, la châtellenie de Franchimont, récemment érigée en marquisat à l’Est, l’ancien comté de Looz et le comté de Hornes au Nord, et le duché de Bouillon au Sud-Est. Hormis les deux derniers, liégeois de fraîche date, ces territoires font partie de la principauté depuis le Moyen Âge. D’un point de vue politique et institutionnel, ils constituent un enchevêtrement de fiefs et d’alleux dépendant de divers seigneurs et de « villes », agglomérations urbaines plus ou moins grandes, et pourvues d’une certaine autonomie de gestion. À La fin du XVIe siècle, la principauté compte ainsi vingt-deux « bonnes villes ». Liège, Thuin, Dinant, Huy, Maastricht, Tongres, Visé, Saint-Trond, figurent parmi les principales. Les frontières de l’évêché ont, quant à elles, été redessinées en 1559. Ses limites s’ajustent désormais plus exactement à celles de la principauté.
Fig. 1 : C. Braun et F. Hohenberg, Leodium ; 1574, gravure sur cuivre extraite du Theatrum urbium et civitatum. © Liège, Cabinet des Estampes.
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
La neutralité apparaît comme le principe fondamental de sa politique internationale. Ce statut remonte à la fin du XVe siècle, aux lendemains du retour à l’indépendance après l’épreuve de la domination bourguignonne. Son adoption a alors été décidée par les États du pays de Liège, noblesse, Église et villes, avec l’approbation de l’évêque. La France et les Pays Bas bourguignons l’ont reconnue en 1492. En 1518 pourtant, une altération des relations de l’évêque Erard de la Marck avec le roi François Ier a conduit le prélat à modifier ce statut, en concluant avec l’empereur Maximilien d’Autriche une alliance défensive. Le traité signé à Saint-Trond au mois d’avril de cette année sera souvent rappelé par la suite par l’Espagne. Le pacte établit, entre autres clauses, de se prémunir mutuellement contre les agressions et de tolérer, en cas de guerre, le passage de troupes sans dommages sur le territoire. Les soldats ne pourront toutefois ni loger dans le pays, ni y prendre leurs quartiers d’hiver. Les habitants ne seront astreints à aucune contribution. Le pacte lie le prince à l’empereur mais Erard de La Marck s’est engagé à le faire ratifier par les Liégeois. Ce régime qui établit une neutralité perméable est en réalité une source de péril. À l’exception de milices urbaines et de quelques compagnies armées, l’État liégeois ne dispose pas à proprement parler d’armée pour faire respecter sa neutralité. Dans les périodes de troubles, sa situation de couloir séparant les Pays-Bas, les Provinces-Unies et la France en fait alors un possible champ clos pour les exactions de soudards en manque de solde ou en rupture de ban. La principauté de Liège dans l’Europe politique et religieuse vers 1580 À la fin du XVIe siècle la neutralité liégeoise constitue une originalité qui contraste avec un paysage d’Europe occidentale largement marqué par les guerres de religion et des forces politiques réparties selon les appartenances religieuses. Les choix religieux opérés par plusieurs pays se répercutent directement sur les positions qui seront celles de la principauté liégeoise, durant le règne d’Ernest de Bavière. Il y a d’abord les pays limitrophes. La principauté de Liège sépare les Pays Bas du Sud en deux zones selon une ligne sud-ouest/ nord-est : comtés de Hainaut et de Namur, duché de Brabant d’une part ; duchés de Limbourg et de Luxembourg de l’autre. Les Pays Bas résultent de l’unification territoriale effectuée aux XIVe et XVe siècles par les Ducs de Bourgogne de diverses principautés médiévales (Hainaut, Brabant, Flandres, mais aussi Hollande, Zélande, etc.). À la mort du duc Charles le Téméraire, le mariage de Marie de Bourgogne, héritière de Bourgogne, avec Maximilien d’Autriche, de la Maison de Habsbourg, transfère cet ensemble de dix-sept provinces dans les possessions territoriales de cette famille. En 1555, à son abdication, Charles Quint partage l’ensemble de ses territoires entre son frère Ferdinand et son fils Philippe II. Les territoires orientaux avec le titre impérial reviennent à Ferdinand. De même que les possessions espagnoles, les Dix-sept provinces échoient à Philippe II. Fig. 2 : Portrait d’Alexandre Farnèse. Dès ses débuts, la Réforme avait connu un très vif succès Dans Alexandre Farnèse et les Origines dans cette région, suscitant une réaction féroce de la part des de la Belgique moderne (1545-1592) autorités espagnoles, farouchement attachées à la foi catholipar Léon Van Der Essen, Bruxelles, 1943. que. La répression conduite par le duc d’Albe aboutit à partir de 1568 à la scission des Pays-Bas et à la création des Provinces Unies (1579, Union d’Utrecht). Les provinces du Nord, bientôt appelées Provinces Unies sont majoritairement protestantes. Elles font sécession, sous la conduite de Guillaume d’Orange qui, avec le titre de stathouder, en devient chef d’État. Guillaume d’Orange est assassiné en 1584. Son fils Maurice de Nassau 16
ERNEST DE BAVIÈRE, LE GRAND PRINCE D’UN PETIT ÉTAT
lui succède. Porteur de ce même titre, il gouverne jusqu’à sa mort en 1625. Les provinces du sud, en revanche, sont restées sous obédience catholique. Des gouverneurs agissant pour le compte de Madrid et installés à Bruxelles les dirigent. Sous le règne d’Ernest de Bavière, les principaux sont Alexandre Farnèse, gouverneur des Pays Bas de 1578 à sa mort en 1592 et le gendre de Philippe II, Albert d’Autriche. Entre 1595 et 1598, Albert exerce seul le pouvoir. À partir de 1598 et jusqu’en 1621, il gouverne de concert avec son épouse Isabelle, la fille de Philippe II. Autre État dont les positions politiques et religieuses se répercutent sur les destinées de l’État liégeois, la France des derniers Valois est catholique. Au moment où Ernest accède à l’évêché de Liège, Henri III règne depuis sept ans. Il affronte deux problèmes majeurs qui, liés entre eux, minent la politique de son royaume : l’existence de partis religieux antagonistes d’une part, sa propre succession de l’autre. Une partie de la noblesse passée à la Réforme a en effet pour chef un prince de la maison de Bourbon, Henri de Navarre, futur Henri IV. Du côté catholique, existe de même une Ligue extrémiste, que le roi essaie de contrôler en s’en proclamant le chef, mais qui obéit surtout à la famille de Guise. La dévolution de la couronne, avec les conflits entre les héritiers d’Henri II et de Catherine de Médicis, constitue un second problème. Lorsqu’Henri III monte sur le trône, en 1574, son frère cadet François duc d’Anjou devient son héritier. En conflit ouvert avec son frère aîné, ce dernier s’est allié aux Réformés. Ses menées concernent le pays de Liège. À partir de 1577, il soutient un projet huguenot d’intervention aux Pays Bas, en lutte contre le pouvoir espagnol et entretient des contacts avec Guillaume de Nassau. En 1584, à la mort de François d’Anjou, Henri de Navarre devient l’héritier présomptif de la couronne de France. Il précipite alors le pays dans le chaos de la « guerre des trois Henri » (de Valois, de Navarre et de Guise). En 1588, Henri III fait assassiner Henri de Guise, avant d’être lui-même tué l’année suivante. De 1589 à 1598, Henri IV, rallié au catholicisme, conquiert progressivement son royaume. D’un point de vue international, il maintient son appui aux Provinces Unies. Sur la frange orientale de la principauté, le Saint Empire germanique est un dernier partenaire. À l’époque d’Ernest, les empereurs sont des Habsbourg. Rodolphe II, qui règne de 1576 à 1612, est un petit neveu de Charles Quint. En matière religieuse, l’empire est catholique. Depuis 1555 et la proclamation de la Paix d’Augsbourg, chaque principauté applique toutefois le principe cuius regio, eius religio, qui fait de la religion de chaque prince, la religion officielle de sa principauté. Le duché de Bavière est depuis le Moyen Âge aux mains de la Maison de Wittelsbach, qui l’a solidement ancré dans la foi catholique. Ernest de Bavière appartient à cette famille. Un prince d’Empire, comme prince évêque de Liège. Né le 17 décembre 1554, Ernest est un fils cadet du duc de Bavière Albert V (1528-1579) et d’Anne d’Autriche (1528-1590), une fille de l’empereur Ferdinand Ier et nièce de Charles Quint. En 1579, Guillaume Fig. 3 : Portrait gravé de l’empereur Rodolphe II. V, frère aîné d’Ernest, succède à son père. À partir de Liège, Université, Collections artistiques. 1597, Guillaume associe son fils, Maximilien Ier, au © Collections artistiques. pouvoir. Celui-ci règne jusqu’en 1651 sur le duché de Bavière. Wittelsbach par son père et Habsbourg par sa mère, Ernest de Bavière provient de familles parmi les plus puissantes d’Europe. En 1581, quand il est élu prince évêque de Liège, à l’âge de 26 ans, il est déjà évêque de Freising depuis 15 ans, et d’Hildesheim depuis 8 ans. Il lui reste à obtenir l’archevêché de Cologne (1583) et l’évêché de Münster (1585). Son cas montre un exemple classique de cumul d’évêchés, permis 17
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 4 : H. Wörl, Portrait en pied d’Ernest de Bavière. © Château de Brühl. 18
ERNEST DE BAVIÈRE, LE GRAND PRINCE D’UN PETIT ÉTAT
par la papauté aux prélats dont l’orthodoxie et la fidélité à Rome sont assurées. Les deux parties y trouvent leur compte. La possibilité pour une Maison régnante d’accroître sa puissance par la mainmise sur de nouveaux territoires, tout en établissant avantageusement ses cadets, est la contrepartie d’une garantie de fidélité à l’Église romaine. À cet égard, Eugène Polain cite le témoignage du vicaire général liégeois Jean Chapeaville à propos d’Ernest : « un prince que les souverains pontifes employèrent fréquemment pour aplanir les difficultés religieuses de l’Allemagne et des Pays-Bas ; (…) L’Église de Liège le pleura, elle qui, sous ses ailes et malgré les guerres civiles sévissant tout autour de son territoire, malgré les convulsions de l’hérésie demeura intacte et inviolée ». Le contexte de l’élection liégeoise L’élection d’Ernest par le chapitre cathédral de Liège, le 30 janvier 1581, résulte de la conjonction de deux jeux d’intrigues. Le premier découle de la politique familiale des Wittelsbach qui pallient la relative modicité de leur patrimoine par l’obtention de prébendes ecclésiastiques dans des régions stratégiques, permettant la constitution d’ensembles territoriaux cohérents. L’élection liégeoise d’Ernest couronne les efforts d’Albert de Bavière et de son beau-frère le duc de Clèves-Juliers (tous deux ont épousé des filles de l’empereur Ferdinand). Dès les années 1570, ces princes interviennent pour favoriser la candidature d’Ernest, qui brigue les sièges de Liège et de Cologne. En 1577, Ernest subit un revers dans cette dernière ville. Le siège archiépiscopal lui échappe. Le Chapitre colonais lui préfère alors Gebhard Truchsess de Waldburg (15471601), issu d’une famille de nobles catholiques du lac de Constance, ancien élève des Jésuites d’Ingolstadt, et titulaire de prébendes à Augsbourg et à Cologne. Cet Fig. 5 : Blason et devise d’Ernest de Bavière. échec oblige Ernest, qui en 1576 tentait aussi sa chance Dans Historia admirandarum curationum (...), à Salzbourg, à se rabattre sur l’évêché de Liège. En Liège, Hovius, 1601. © Liège, Université, Bavière, le jeune prince avait eu pour précepteur Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres. l’humaniste liégeois Andreas Fabricius. Détenteur d’une prébende à Saint-Lambert, Fabricius la résilie en 1578 en faveur de son ancien élève. De son côté, Ernest intrigue auprès de l’évêque Gérard de Groesbeeck, afin de se faire choisir comme coadjuteur avec droit de succession. Celui-ci ne consent finalement qu’en décembre 1580, sur son lit de mort. La voie est ouverte à une élection épiscopale. Survenant sur fond d’affrontements internationaux politiques et religieux, le scrutin de janvier 1581 est aussi le fruit d’âpres tractations diplomatiques. Les Provinces Unies protestantes et François d’Anjou, leur allié français, se prononcent en faveur de Mathias d’Autriche, un frère de l’empereur Rodolphe II, hostile à l’Espagne. Ernest est, quant à lui, le prétendant du camp catholique. Dès décembre 1576, Philippe II et Alexandre Farnèse, son représentant à Bruxelles, soutiennent sa candidature à Cologne, ensuite à Liège. En janvier 1581, le Grand Conseil de Malines réaffirme encore son appui à l’élection sur le siège épiscopal d’un prince « vertueux, pacifique, catholique »1. Le 30 janvier, le vote des chanoines en faveur d’Ernest est unanime. Le 3 février, l’élection à l’abbatiat de Stavelot Malmédy parachève l’accession du prince bavarois à la tête de la principauté épiscopale de Liège.
1. Cité dans P. Harsin, Politique extérieure et défense nationale, op. cit., p. 311-312. 19
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
La joyeuse entrée : une célébration politique Ernest de Bavière prend officiellement possession de sa capitale le 18 juin suivant. Depuis le Moyen Âge, à Liège comme ailleurs, il est de coutume que des cortèges solennels saluent les avènements de souverains ou leur joyeuse entrée dans une ville. Ces cérémonies, souvent relatées avec forces détails par les témoins, sont désormais bien connues des historiens qui en ont analysé les ressorts et souligné la signification2. Ils ont ainsi mis en évidence les multiples missions assignées tant aux cortèges souvent fastueux, qu’aux réjouissances populaires qui les accompagnent (notamment des distributions de vivres ou de boissons). Ces événements festifs sont l’occasion pour le prince de se présenter aux yeux de son peuple et de montrer sa munificence, ils permettent aussi la démonstration de force de telle ou telle faction, famille ou institution qui forment le cortège, ou prennent part à la cérémonie. Sur la base de chroniques et de témoignages, Eugène Polain a minutieusement retracé la joyeuse entrée d’Ernest à Liège et décrit les diverses délégations qui défilent, les éléments de décor établis le long du parcours, les interventions de participants. La fête chatoyante dut impressionner par sa somptuosité. Le cortège était ainsi rehaussé par la présence de pages, d’hommes d’armes ou encore de musiciens ; des centaines de personnes qui défilent à pied ou à cheval, en grand apparat ou arborant les couleurs de leurs maîtres respectifs. Sur le parcours, des monuments éphémères avaient été dressés, telles les habituelles fontaines de vin. En Féronstrée, une machinerie installée dans l’église de Saint-Georges, aujourd’hui disparue, permet la descente du haut d’un arc de triomphe d’un perron et d’une jeune fille, allégorie de Liège. Elle récite un compliment à Ernest et lui offre un plat en argent rempli de joyaux. Sur la place du Marché enfin, des tréteaux supportant des tableaux allégoriques représentent les piliers de l’État liégeois : l’Église, la noblesse et les villes. Sur un quatrième tableau, la belle devise d’Ernest audiatur altera pars, « que la partie adverse soit écoutée », symbolise le pouvoir épiscopal. Parmi les gens qui paradent le 18 juin 1581, apparaissent nombre d’acteurs étrangers de l’élection du jeune prélat. Dans le climat politique ambiant, leur présence à ses côtés est chargée de sens. La suite du duc de Juliers, Clèves et Berg, celle du duc de Bavière représentent la parentèle du prince, et les artisans de son élection. Les Pays Bas et le pouvoir espagnol sont présents par sa noblesse (les suites du prince de Chimay, de Charles de Ligne prince d’Arenberg et de Charles de Croy, duc d’Aarschot), et surtout par les envoyés de Marguerite de Parme et d’Alexandre Farnèse. Fig. 6 : Jeune fille de Liège. Les différentes composantes du pouvoir liégeois sont aussi de Gravure sur bois extraite de la fête. En tête, s’avancent les officiers du prince : gouverJean-Baptiste de Glen, Des Habits, mœurs, neurs, châtelains et baillis, représentants du prince dans ses cérémonies, façons de faire anciennes et places fortes, dans ses villes etc. Ces hommes sont suivis de modernes du monde, Liège, 1601. la noblesse féodale de la principauté. Plus loin, on distingue © Liège, Université, Bibliothèque de la Faculté des membres du Conseil privé, c’est-à-dire le groupe des de Philosophie et Lettres.
2. On se reportera en particulier à B. Guenée et Fr.Lehoux, Les entrées solennelles royales françaises de 1328 à 1515, Paris, CNRS, 1968. N.Coulet, « Les entrées solennelles en Provence au XIVe siècle. Aperçus nouveaux sur les entrées royales françaises au bas Moyen Âge », Ethnologie française, nouvelle série t. 7 n°1, 1977, p. 63-82. 20
ERNEST DE BAVIÈRE, LE GRAND PRINCE D’UN PETIT ÉTAT
conseillers personnels du prince. Parmi eux, se reconnaissent quelques figures éminentes, notamment Liévin Torrentius le vicaire général de l’évêché, Dominique Lampson, l’un des secrétaires du prélat. L’échevinage liégeois, cour judiciaire dépendante de l’évêque, est enfin représenté par la personne de son grand mayeur, Henri de Berlaymont. Depuis le XIVe siècle, les bonnes villes du pays – et surtout Liège, la première d’entre elles – se sont progressivement imposées, tant auprès de l’évêque que du chapitre cathédral, comme des instances politiques majeures. Les magistrats de la cité mosane apparaissent également dans le cortège. On y reconnaît les vingtdeux commissaires qui, depuis le XVe siècle, interviennent dans l’élection annuelle des bourgmestres de même que les « XXXII de la Cité », vraisemblablement les trente-deux délégués des métiers qui procèdent au vote. Les deux bourgmestres de l’année 1580-1581, issus des puissantes familles d’Ans et Goswin, jouent quant à eux un rôle central dans la cérémonie. Les deux bourgmestres qui se sont portés à la rencontre d’Ernest, l’escortent depuis Visé. À l’entrée de Liège, ils l’accueillent officiellement et reçoivent son serment de respecter la Paix de Fexhe ainsi que les « statuts et franchises » de la cité. Chevauchant ensuite de part et d’autre du prince, ils parviennent, par le faubourg Saint-Léonard et Féronstrée, sur le Marché et jusqu’au pied de la cathédrale de Saint-Lambert. C’est alors au tour de l’Église de Liège, incarnée par le chapitre cathédral d’entrer en scène, pour l’investiture religieuse. L’évêque est convié à l’intérieur de l’édifice religieux par les principaux dignitaires du chapitre : le prévôt Wynand de Wyngaerde et le doyen. Les autres chanoines et des échevins assistent également à la cérémonie. Cette dernière partie de la Joyeuse entrée scelle le rapport hiérarchique entre l’évêque, dépositaire de l’autorité publique sur l’État liégeois, et le Chapitre qui lui en confie les rênes. La marge de manœuvre princière Le pouvoir dévolu à l’évêque n’est pas sans limites. La coutume, qui régit le droit privé ou certains aspects de la justice, s’impose au souverain. Les « paix et franchises », ces pactes remontant pour l’essentiel au Moyen Âge qui règlent les rapports entre l’Église, la noblesse et les « bonnes villes », sont d’autres barrières aux velléités d’absolutisme princier. Au sein même de l’Église liégeoise, le poids du chapitre cathédral est enfin un frein puissant aux ambitions politiques du prince. Depuis l’avènement d’Erard de La Marck en 1505, tout nouvel évêque doit s’engager à respecter les « capitulations » rédigées par le Chapitre de SaintLambert et qui déterminent les conditions de l’exercice de son pouvoir. Celles établies en 1581 pour Ernest sont une affirmation de la prééminence du Chapitre par rapport à l’évêque. Les chanoines s’arrogent une nette mainmise sur la fonction épiscopale. Chercheraient-ils aussi à se prémunir contre les éventuels traits d’indépendance d’un rejeton d’une puissante Maison étrangère ? Ernest de Bavière ne pourra donc résilier son siège sans leur assentiment. Son vicaire général, qui le représente in spiritualibus, et son chancelier, responsable pour les affaires temporelles, seront tous deux choisis parmi les membres du corps canonial. Les officiers du prince prêteront serment entre les mains des chanoines de Saint-Lambert. Les gouverneurs des places fortes liégeoises proviendront enfin de la noblesse du pays. Les chanoines de Saint-Lambert président en outre les travaux des deux instances chargées d’assister l’évêque dans l’exercice du pouvoir : le Conseil privé et la chambre des comptes. Cette dernière administre la mense épiscopale, c’est-à-dire la part des biens de l’Église de Liège dont les revenus sont affectés à la personne de l’évêque, à savoir aux frais de son administration, à la rémunération de son personnel, ou encore à son propre entretien. La chambre traite d’affaires judiciaires, financières ou intervient encore en matière législative, chaque fois que la mense épiscopale est concernée. Apparue avec cette appellation au début du e XVI siècle, la chambre des comptes se structure sous le règne d’Ernest de Bavière. Elle se compose de membres du Chapitre et de laïcs, versés en matières juridiques. Hiérarchiquement, elle dépend du Conseil privé. Depuis le XIIIe siècle en effet, le prince dispose pour l’aider de collaborateurs personnels. Ces hommes préfigurent le Conseil privé, que l’on rencontre à l’époque moderne. Longtemps fondée sur la coutume, cette instance reçoit des règles précises de fonctionnement à partir du règne d’Ernest de Bavière, et plus encore sous son neveu Ferdinand. Aux côtés de l’évêque, le conseil privé est, par excellence, l’organe de gouvernement. Ses compétences s’étendent à toute la principauté. Elles concernent toutes les affaires publiques ou privées relevant du pouvoir princier. Les conseillers se prononcent en matière de maintien de la foi catholi21
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
que, statuent sur la justice, veillent à la conservation de la juridiction et de l’autorité du souverain liégeois. Ils traitent aussi de politique étrangère. De concert avec le Chapitre cathédral, le Conseil privé remplace Ernest de Bavière aux affaires de l’État, lorsque celui-ci est absent de la principauté. Outre des proches de l’évêque, choisis librement par lui parmi les ressortissants de la principauté, on y trouve des membres de l’échevinage liégeois, dont le grand Mayeur. Des chanoines de Saint-Lambert y siègent obligatoirement. Le Conseil privé apparaît comme l’instrument privilégié du gouvernement d’Ernest. Il en infléchit la physionomie en y introduisant ses familiers. Au fil de son règne, y paraissent notamment son historiographe, le poète et jurisconsulte Jean Polit, et surtout Charles de Billehé (1540-1606), qui soutient activement sa politique internationale. Originaire d’une famille connue à Cambrai à la fin du Moyen âge, Billehé provient, par ses parents, de la grande bourgeoisie bruxelloise. Ces liens avec les Pays Bas lui seront sans doute utiles comme ambassadeur d’Ernest, résident permanent auprès d’Alexandre Farnèse pour les affaires liégeoises, dans les années 1590. Avant cela, il avait participé aux opérations militaires de la guerre de Cologne. En 1584, c’est lui qui assura le commandement de Bonn, après la chute de la ville aux mains des forces bavaroises. Trois ans plus tard, en 1587, Charles de Billehé est à Cologne, aux prises avec les Réformés qui se sont emparés de la cité archiépiscopale. Les liens de Charles de Billehé avec Ernest de Bavière étaient étroits. Le mariage de son fils François Bernardin, avec Maximilienne, fille légitimée d’Ernest et de sa compagne liégeoise Jeanne de Royen contribua encore à les renforcer. Moderniser l’État et augmenter ses ressources Dans les limites fixées par les diverses composantes du régime liégeois, l’action publique d’Ernest de Bavière a pris diverses orientations. Sa politique religieuse, ses initiatives en matière industrielle ou en faveur des démunis qui en constituent pourtant des pans essentiels n’apparaîtront pas ici. À partir des travaux existants, ce chapitre introductif s’interrogera surtout sur l’évolution de l’État liégeois au temps d’Ernest et sur l’action de ce dernier à sa direction ; le tout se développant sur un arrière-plan âpre de tensions internationales et de guerres. Sur le plan intérieur, Ernest s’efforce de moderniser son appareil d’État, afin d’en augmenter l’efficacité. Si la formalisation des deux Conseils qui secondent son action, le conseil privé et la chambre des comptes, reflète aussi le souci du Chapitre d’empiéter sur les domaines dévolus à l’évêque, elle représente aussi un premier indice de ce mouvement. Dès son accession à l’épiscopat, Ernest se préoccupe d’augmenter le rendement de la mense épiscopale, insuffisante et mal gérée. Dès 1581, il ordonne la tenue régulière des séances de la chambre des comptes. Quatre fois aussi durant son règne, en 1598, 1601, 1605 et enfin en 1611, il promulgue des règlements généraux relatifs à son fonctionnement. La principauté souffre d’un mal fréquent des États de l’Europe moderne : l’insuffisance de leurs ressources financières entraîne d’importants efforts pour augmenter les rentrées fiscales. Pour affronter les frais inhérents à la protection du pays, classiquement, Ernest de Bavière tente d’accroître ses ressources en levant des taxes et des impôts (en l’occurrence des tailles, des aides, des impôts sur les biens fonds et les immeubles). Ces subsides ne sont pas récurrents. Après négociation et dans le respect des franchises, l’Église, la noblesse, les villes du Pays consentent – ou non – à les octroyer au prince. En 1603, puis en 1611, un impôt sur les cheminées frappe par exemple les Liégeois, au prorata des feux qu’ils utilisent, pour se chauffer ou pour travailler. Des taxes sur le commerce des denrées alimentaires, en particulier sur les boissons (vin ou bière) existent de même. Le soixantième est quant à lui perçu durant tout le règne. Cette taxe d’1,66 % de la valeur des marchandises est perçue aux frontières, sur les denrées importées et sur les exportations du hors du pays de Liège. Payé tantôt par les autochtones, tantôt par les étrangers, le soixantième est, moins que d’autres contributions, l’objet de contestations. Qu’il s’agisse d’apurer d’anciennes dettes, de faire face à d’importantes dépenses imprévues, ou simplement de « subvenir aux necessités publicques »3, le prince évêque de Liège recourt en outre à l’emprunt. En 1595 par exemple, la reprise de Huy par les Liégeois, et le maintien ultérieur de troupes dans la place forte 3. Cité dans S. Zanussi, La politique intérieure liégeoise sous Ernest de Bavière, p. 60. 22
ERNEST DE BAVIÈRE, LE GRAND PRINCE D’UN PETIT ÉTAT
épiscopale s’avèrent de coûteuses opérations militaires, requérant un soutien financier du pays. Ernest lance, à cette occasion, un emprunt de 100 000 florins, remboursable sous forme de rentes. De mai à septembre de cette année, 7000 florins sont récoltés auprès de particuliers. Mais certains versent des sommes beaucoup plus fortes. Plus que des nobles ou des membres du clergé, les personnes qui acquièrent ces rentes sont pour la plupart des bourgeois enrichis dans les affaires industrielles ou des représentants de professions libérales. Parmi elles, on citera par exemple Antoine Rosmarin, riche marchand liégeois et parent probable de Matheo Romero, ce musicien actif à la cour d’Espagne à l’époque d’Ernest. Le receveur puis trésorier général de la chambre des Comptes, Antoine Cornely, figure aussi parmi les prêteurs. Le plus célèbre de ces créanciers est néanmoins l’industriel Jean Curtius à qui, en 1596, l’État liégeois rembourse la coquette somme de 27 400 florins. Plusieurs initiatives d’Ernest de Bavière découlent de ses droits seigneuriaux. C’est notamment le cas de ses prérogatives en matière monétaire, tout comme de ses efforts dans le domaine judiciaire. On observera qu’Ernest de Bavière rend la justice tant séculière qu’ecclésiastique, comme seigneur dans le premier cas, comme évêque dans le second. Sa politique monétaire vise à régler le cours des monnaies et ainsi qu’à endiguer la raréfaction des pièces de bon aloi. Ces problèmes sont récurrents. Durant ses trois décennies de règne, ils donnent lieu à des mesures pour fixer la valeur des pièces, lutter contre la circulation de pièces illégales ou de monnaies étrangères, ordonner enfin la frappe de nouvelles pièces. En 1509, le florin du Brabant est, en outre, adopté comme seule monnaie de compte légale dans la principauté.
Fig. 7 : Monnaies frappées sous le règne d’Ernest de Bavière. © Liège, Grand Curtius.
La réforme de la justice est pour Ernest une autre entreprise de longue haleine, réclamant plusieurs années d’efforts mais dont les résultats n’atteindront pas la hauteur des espoirs suscités. Comme la plupart des institutions de ce temps, l’appareil judiciaire du pays de Liège est un héritage médiéval. C’est un écheveau complexe de juridictions multiples et hiérarchisées, découlant tant de la diversité des statuts conférés aux terres et aux personnes que de la nature des litiges examinés. Outre le Tribunal des XXII, institution tout à fait particulière habilitée à juger les officiers épiscopaux en cas d’abus commis dans l’exercice de leurs fonctions, quelques juridictions dominent cette mosaïque de cours et tribunaux. Présidée par le grand Mayeur, la souveraine justice des échevins de Liège intervient en matière civile et pénale dans toutes les zones du pays régies par la coutume de Liège. Elle agit également comme chambre d’enregistrement pour nombre d’actes 23
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
de droit privé (testaments, contrats de mariage, désignation de tuteurs pour des orphelins). Elle régit aussi les poids et mesures ou l’aloi des monnaies. Elle statue sur l’accès à la bourgeoisie. L’Officialité est le tribunal ecclésiastique. Il est généralement compétent pour juger les affaires relevant du droit canon ou toute personne pouvant s’affirmer membre du clergé. Dans le pays de Liège, son pouvoir est néanmoins plus large. Saisi le premier d’une affaire, il la traite, quitte à appliquer au prévenu le droit séculier, si celui-ci est un laïc. Les justiciables préférant souvent comparaître devant l’Officialité, réputée plus indulgente, plutôt que devant une juridiction laïque, l’échevinage par exemple, nombre de conflits de compétence surgissent entre les instances judiciaires. En 1582 et en 1592, Ernest s’efforce de restreindre l’accès à l’Officialité. Sa réforme s’appuie sur les prescrits du Concile de Trente qui alourdissent les conditions à remplir pour bénéficier du statut clérical. Elle se heurte pourtant à la résistance de l’Église de Liège, jalouse de ses prérogatives.
Fig. 8 : Ordonnance de 1592, relative à la réforme de la justice. © Liège, Université, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres.
Ces diverses politiques s’avèrent difficiles à mettre en œuvre pour des raisons variées. La politique monétaire est tributaire de la situation de carrefour du pays de Liège entre des pays en guerre. Elle dépend aussi des difficultés économiques comme l’approvisionnement en grains, lié à de mauvaises récoltes récurrentes qui entraînent hausse du prix des denrées et spéculation. La conjoncture est défavorable. En ce qui concerne la justice, le problème est autre. Les tentatives de réformes judiciaires se heurtent à des résistances de la part des Liégeois. La résistance émane ici de groupes sociaux attachés à leurs statuts et assez puissants pour se dresser contre l’évêque. 24
ERNEST DE BAVIÈRE, LE GRAND PRINCE D’UN PETIT ÉTAT
Manier les Liégeois À l’avènement d’Ernest de Bavière, le cardinal de Granvelle avait fait part de ses craintes à Marguerite de Parme : « Dieu veuille que le nouveaul evesque de Liege attrempe ses humeurs (…). Il aura besoing de s’accomoder a ceulx de Liege qui, s’ils ne sont bien menez, sont dangereux pour ceulx qui les manient »4. Des incidents de la vie politique liégeoise sous le règne d’Ernest montrent qu’en effet le prince fut souvent amené à composer avec les autres forces en présence, de jouer sur les antagonismes que les différents groupes sociaux développaient entre eux, faute de pouvoir s’imposer à eux. Les relations d’Ernest avec les trente-deux métiers et les bourgmestres de Liège sont un éclairant exemple de ce rapport de forces tendu et des conflits qu’il engendre. Depuis le XIVe siècle, les magistrats communaux détiennent un pouvoir réel dans la cité mosane. Souvent solidaires des bourgmestres à l’époque médiévale, par le biais du clientélisme ou d’autres liens de proximité, les métiers les affrontent désormais. Et pour se renforcer, ils en appellent à l’évêque. Les sources ont conservé quelques traces de tels incidents. C’est ainsi par exemple, qu’au tournant des années 1600, ils dénoncent auprès d’Ernest les menées des bourgmestres qui ont indûment apposé leurs armoiries sur la porte de Sainte-Marguerite, à peine reconstruite. L’affaire la plus importante aboutit à la réforme du mode d’élection des bourgmestres, en 1603. Au long du XIVe siècle, un mode d’élection annuelle relativement libéral des deux bourgmestres liégeois, par les Métiers, s’était peu à peu mis en place5. À son aboutissement, en 1384, le système prévoit l’élection par chaque corporation de deux « jurés » qui siégent en son nom au conseil communal et font aussi office de grands électeurs, lors du scrutin magistral. Ces modalités furent révisées en 1424, par l’adoption du « régiment de Heinsberg ». Trente-deux liégeois (un par métier) désignés par une commission inamovible de six représentants de l’évêque et de seize délégués des quartiers (vinâves) éliraient désormais les bourgmestres. La liste des personnalités élues sous Ernest montre un net accaparement de la charge par quelques lignages. Le répertoire des bourgmestres médiévaux ne montrait pas autre chose, mais des relations de clientélisme ou de solidarité tempéraient alors les différences socio-économiques. Le Régiment de Heinsberg qui confère au pouvoir épiscopal un important droit de regard sur le scrutin semble aussi avoir crispé les relations au sein de la commune. À sa tête, les bourgmestres s’imposent comme une oligarchie, contre laquelle les métiers n’hésitent pas à se dresser. La levée de taxes est souvent à l’origine des conflits. En 1596, les bourgmestres qui ont doublé les taxes sur la bière et le vin et frappé d’une accise les marchandises entrant ou sortant de la cité mécontentent les métiers. Les artisans se révoltent, provoquent des émeutes et portent plainte auprès d’Ernest. Un durcissement de l’élection des commissaires, délégués des vinâves est une première réponse aux griefs des métiers. À l’automne 1602, une nouvelle contestation survient au sujet des impôts. Ernest se pose en arbitre. En cas de dissensions avec les magistrats communaux, plutôt que de se révolter, les métiers sont priés de s’en remettre au Conseil privé. Dans le même temps, une refonte des modalités de l’élection magistrale est mise en chantier. Elle aboutit le 14 avril suivant. Dans sa nouvelle version, le mode de scrutin est complexe mais vise à l’équité. Il combine un double tirage au sort d’électeurs (un premier tirage de trois noms de membres/métier est suivi d’un second, désignant cette fois un électeur par métier), préalable au vote proprement dit. L’instauration d’un délai de quatre ans entre deux élections successives doit casser les velléités d’accaparement personnel du pouvoir. Pour favoriser la meilleure représentativité possible de la population, l’inscription au sein d’une des corporations (donc aussi sur les listes d’électeurs potentiels) devient obligatoire. En compensation de la réforme, les métiers promettent, pour l’avenir, de se prononcer rapidement sur les demandes de contributions financières formulées par Ernest. Contemporaine de la création de l’hôpital de Bavière, dont il sera question plus loin, la réforme de l’élection magistrale s’inscrirait-elle dans un ensemble de mesures prises par Ernest pour remédier à un problème social ? La procédure de 1603 fut abandonnée dès le règne de Ferdinand. Tout comme la maison de
4. Lettre du cardinal de Granvelle à Marguerite de Parme, citée dans E. Polain, La vie à Liège sous Ernest de Bavière, t. 1, Tongres, 1938, p. 70. 5. Sur l’élection magistrale, on se reportera notamment à G. Xhayet, « Le rôle politique des métiers liégeois à la fin du Moyen Age », Les métiers au Moyen Age. Aspects économiques et sociaux. Actes du colloque international de Louvain-la-Neuve, Louvain-laNeuve, 1994, p. 361-378 (Univ. catholique de Louvain, Publications de l’Institut d’Etudes médiévales, vol. 15). 25
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
soins, elle contribua sans doute à façonner dans l’imaginaire liégeois la bonne image qui demeura celle de l’évêque Ernest. Neutres dans une Europe en guerre Ces événements intérieurs avaient pour toile de fond une situation internationale périlleuse pour la principauté. Les enjeux externes au pays de Liège qui avaient pesé sur l’élection épiscopale d’Ernest de Bavière marquent ensuite la plus grande partie de son règne. De 1581 à la fin de la guerre franco-espagnole en 1598, le pays de Liège est tiraillé entre les Pays Bas espagnols en guerre contre les Provinces-Unies protestantes. Engagée dans le camp catholique, la Bavière s’aligne sur la position espagnole. Les Provinces-Unies s’appuient sur le parti protestant français, puis à partir de 1589, sur la France d’Henri IV. Durant ces années, les Liégeois conservent leur option de neutralité. Laissés en dehors du conflit, ils supportent néanmoins le passage des troupes sur leur territoire et leur stationnement en hiver. Tour à tour, les armées en guerre déferlent sur les campagnes liégeoises et terrorisent les habitants. L’Entre Sambre et Meuse tout comme le comté de Looz sont les plus touchés par ces exactions. Ainsi, en janvier 1585, des mercenaires allemands à la solde de l’Espagne se répandent en Hesbaye et menacent Waremme de pillage. Sur ordre du Chapitre et du Conseil privé, les milices liégeoises, aidées par les paysans en armes, ripostent par une expédition nocturne. Surpris dans leur sommeil, les mercenaires sont mis en fuite et quelques-uns tués. Des armes, des munitions et des drapeaux sont saisis et ramenés à Liège. En 1589, l’avènement d’Henri IV déséquilibre l’échiquier international et le crispe. Respectée jusqu’alors, la neutralité liégeoise est mise à mal dans la décennie suivante. Philippe II, qui soutient la Ligue, et d’autre part les Provinces Unies, sollicitent en vain le soutien liégeois. Ils s’en prennent ensuite ouvertement à la principauté, soupçonnée dans les deux camps de favoriser l’adversaire. En 1590, des troupes hollandaises pillent Tirlemont, Stockhem et Maaseyck. Deux ans plus tard, Maurice de Nassau tente un coup de main contre Maastricht. Les agressions peuvent aussi provenir d’Espagne. Durant l’automne 1593, une ambassade liégeoise à Bruxelles réclame la fin des incursions espagnoles dans la principauté. Au mois de février 1595, survient un incident plus sérieux, retenu par l’Histoire sous le nom de « surprise de Huy », qui fragilise le principe de neutralité. Henri IV a déclaré la guerre à Philippe II. Les Hollandais qui cherchent à rejoindre leur allié français en passant par la vallée mosane, entrent à Huy le 7 février 1595. Ernest de Bavière reprend la ville et, pour y parvenir, fait appel aux Espagnols. La réaction d’Ernest, conjuguée à sa demande d’intervention espagnole, déclenche la colère d’Henri IV. Liège est menacée de représailles. Les Hollandais se retirent le 20 mars suivant. D’autres escarmouches, telle l’attaque de Spa qui effraya Juste Lipse en juillet de la même année, éclatent encore occasionnellement et détériorent les relations de la principauté avec les Provinces Unies. La « surprise de Huy » a suscité dans cette ville des sympathies sévèrement réprimées par le pouvoir liégeois. Plus tard dans l’année, Ernest de Bavière justifie sa réaction auprès d’Henri IV, avec qui les relations s’apaisent. D’un point de vue international, Liège apparaît de facto proche de l’Espagne. Ernest bénéficie des revenus de l’évêché de Valence, qui lui ont été octroyés par Philippe II. Lors de la surprise de Huy, un accord passé avec Bruxelles oblige le prochain gouverneur de la place forte hutoise à prêter serment tant au prince de Liège qu’au représentant espagnol dans les Pays Bas. Henri IV perçoit cette connivence. En 1597, il note que ses « ennemis ont toujours obtenu plus de faveur et d’assistance des villes de Liège et de Cologne » que lui6. L’année suivante le traité de Vervins scelle le retour à la paix entre les deux royaumes. Ernest a souhaité en vain intervenir dans les pourparlers. La principauté et son évêque apparaissent dans les dispositions de paix comme alliés du souverain espagnol. La fin du règne d’Ernest reste caractérisée par la rivalité entre États catholiques et protestants et ses conséquences concrètes sur le sol liégeois. La première décennie du XVIIe siècle est ainsi marquée par l’empreinte de la France. Quoique converti au catholicisme, Henri IV favorise toujours les Provinces Unies,
6. Cité dans Harsin, op. cit., p. 391n13. 26
ERNEST DE BAVIÈRE, LE GRAND PRINCE D’UN PETIT ÉTAT
face à l’Espagne. Dans le cadre de ce soutien, il amorce une « politique rhénane » qui vise à intégrer Liège et Cologne dans la sphère d’influence de Paris. Sur le terrain, la rivalité hispano-néerlandaise se traduit à nouveau par la circulation de troupes étrangères dans la principauté, que les autorités liégeoises ne contrôlent qu’avec difficulté.
Fig. 9 : Jean Polit, Prognosie de l’estat de Liege et responce à un escrit sedicieux espars par l’Isle de Liège lors de la surprinse du chasteau de Huy, Liège, Chr. Ouwerx, 1598. Frontispice et dédicace. © Liège, Université, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres.
Dans ce contexte, la guerre de succession du duché catholique de Clèves-Juliers, qui éclate en 1609, apparaît comme une dernière source de menaces. Faute d’héritier direct, le duché de Clèves-Juliers est revendiqué à la fois par des princes protestants et catholiques. Dans l’Empire, deux ligues antagonistes soutiennent les prétendants à la succession. Comme électeur de Cologne, Ernest appartient à la ligue catholique. En juillet 1609, une Union évangélique qui s’est constituée en soutien aux candidats protestants reçoit l’appui du souverain français. En mai 1610, Ernest refuse à Henri IV le passage des troupes en chemin vers L’Empire sur le sol liégeois. Dans la principauté, on frôle alors le pire. Mais l’annonce de l’assassinat du souverain français qui survient peu après décrispe la situation. Empruntant un autre itinéraire, l’armée française s’empare de la ville de Juliers le 18 août. Son retour, par la principauté, s’opère ensuite pacifiquement. Les ambiguïtés d’une politique Pour Ernest de Bavière, la politique liégeoise n’est toutefois qu’un pan de l’action publique à mener. Si la principauté est un État assez faible sur la scène européenne, lui même apparaît par contraste comme un prince ambitieux. Il provient de la grande noblesse allemande et son élection à Liège résulte d’une stratégie familiale de domination territoriale. Il s’investit également dans ce jeu. Dès 1595, il choisit son neveu Ferdinand, né en 1577, comme coadjuteur. Il consolide ainsi l’assise des Wittelsbach à la tête de leurs possessions ecclésiastiques familiales et, par le népotisme, amorce à Cologne comme à Liège un siècle et demi de 27
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
dévolution dynastique des charges épiscopales. Les circonstances de son élection à l’archevêché de Cologne constituent par ailleurs un témoignage éloquent de sa stratégie. Évincé lors du scrutin de 1577, Ernest obtient une nouvelle occasion six ans plus tard. En effet, confirmé en 1580, Gebhard Truchsess déclare en avril 1582 vouloir se marier, résilier son siège archiépiscopal et opter pour la religion réformée. En décembre suivant, il revient partiellement sur sa décision et, au nom de la liberté de culte, refuse de quitter son archevêché. Le pape le dépose. Le 23 mai 1583, le chapitre colonais procède à un nouveau vote, favorable cette fois à Ernest. Cette élection lui fait gravir un échelon dans la hiérarchie ecclésiastique. Elle l’introduit aussi dans le cercle prestigieux des Princes Électeurs d’Empire. Dans le contexte politique et religieux de la fin du XVIe siècle, le puissant archevêché de Cologne est un enjeu stratégique et le risque de le voir basculer dans le camp des Réformés s’avère d’une toute grande importance. Truchsess résiste à la décision prise en mai. S’il ne dispose pas de forces comparables à celles de l’évêque de Liège, soutenu par la coalition des troupes de son frère Guillaume V de Bavière et d’Alexandre Farnèse, il dispose de l’appui de princes protestants de la région : Guillaume de Nassau et les ProvincesUnies, mais aussi les comtes palatins Jean Casimir (15431592) et Jean Ier de Deux-Ponts (1550-1604). Des villes le soutiennent également, telle Bonn qui tombe aux mains d’Ernest en 1584. La guerre de Cologne dure six ans, et se termine à l’avantage du camp catholique. En 1589, Gebhard Truchsess s’établit à Strasbourg avec son épouse. Il y meurt en 1601. La participation de la principauté à la guerre semble avoir été limitée, comme le précise le chapitre « en raison de la neutralité ». Les chanoines de Saint-Lambert ont consenti à prêter à Ernest deux canons et permis un appel discret à des mercenaires liégeois, pourvu qu’ils ne parcourent « en aucune manière la cité ni le pays de Liège »7. Bien dans la Fig. 10 : Portrait de Gebhard Truchsess en 1581. ligne de leur attitude en politique intérieure le soutien des Dans H. Molitor, Geschichte des Erzbistums Köln, pl. IV hors texte [p. 256]. chanoines à l’évêque ne fut pas inconditionnel. *** Entravé sur le plan interne par les lourdeurs du régime politique et institutionnel de la principauté, et par un climat international très défavorable, le bilan politique liégeois d’Ernest de Bavière se dessine en demiteinte. La faiblesse de la principauté à l’échelle internationale, conjuguée à son option originale de neutralité, a réduit la marge de manœuvre du prince. En 1598 par exemple, Ernest de Bavière échoue à se faire admettre comme intervenant lors des négociations de la Paix de Vervins. Sur le plan intérieur, son action politique et institutionnelle marquée par des tentatives de réformes se heurte à des résistances. Certaines sont structurelles (tel le poids de l’Église de Liège), d’autres résultent de positions de principe des Liégeois, attachés à leurs « franchises et libertés ». À cette époque, l’appareil politique et institutionnel liégeois est un héritage médiéval, complexe, fait d’un ensemble d’instances (le pouvoir communal liégeois, le chapitre cathédral, la noblesse et les villes – le Sens du Pays) qui s’équilibrent mais tendent aussi à se brider mutuellement. Seul passera le renforcement, voulu par lui, du poids des métiers face aux bourgmestres. Comment expliquer cette option de soutien ? Manœuvre pragmatique pour amoindrir à son profit la trop forte influence des bourgmestres ou souci d’équité ? Répondre à cette question revient à s’interroger sur le substrat intellectuel de la politique du prélat. La philosophie politique définie par ses Maî7. Ibid., p. 330, note 41. 28
ERNEST DE BAVIÈRE, LE GRAND PRINCE D’UN PETIT ÉTAT
tres, les Jésuites, pourrait-elle fournir une clé d’interprétation pertinente ? Le profil qu’ils tracent du prince catholique et de ses qualités de loyauté, de justice, et de recherche du bien des sujets inciterait en tout cas à le faire penser8. Sur ce point toutefois la recherche reste à mener. Quoi qu’il en soit, le volet politique de l’action d’Ernest paraît difficilement soutenir la comparaison avec d’autres aspects de ses activités intellectuelles, où il eut davantage les coudées franches, et où son règne apparaît nettement plus brillant.
ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE La politique d’Ernest de Bavière a fait l’objet de différents travaux historiques. Ils ont servi de base à la présente synthèse. M. Sébastien Zanussi nous a aimablement communiqué son mémoire inédit. Qu’il en soit ici chaleureusement remercié. Borman (C. de), Les échevins de la souveraine justice de Liège, Liège, 1899. Demoulin (B.), Kupper (J.-L.), Histoire de la principauté de Liège, Toulouse, 2002. Dubois (A.), Le chapitre cathédral de Saint-Lambert à Liège au XVIIe siècle, Liège, 1949. Hansotte (G.), Les institutions politiques et judiciaires de la principauté de Liège aux temps modernes, Bruxelles, 1987. Harsin (P.), Politique extérieure et défense nationale (1538-1610), Études critiques sur l’histoire de la principauté de Liège (1477-1795), t.3, Liège, 1959. Harsin (P.), « Henri IV et la principauté de Liège », Académie royale de Belgique, 5e série, t. 34, 1953, p. 554-623. Lejeune (J.), Introduction au catalogue de l’exposition Le siècle de Louis XIV au pays de Liège (1580-1723), Liège, 1975, p. IX-XCVI. Lejeune (J.), La formation du capitalisme moderne dans la principauté de Liège au XVIe siècle, Liège, 1939. Molitor (H.), Geschichte des Erzbistums Köln, Dritter Band : Das Erzbistum Köln im Zeitalter der Glaubenskämpfe (1515-1688), Köln, 2008. Moreau (G.), « L’élection du prince-évêque de Liège Ernest de Bavière », Bulletin de la Société royale le Vieux Liège, t. 86 (1950), p. 433-441. Pirenne (H.), Histoire de Belgique des origines à nos jours, t. 2, De la mort de Charles le Téméraire à la Paix de Münster, Bruxelles, La Renaissance du Livre, s.d [1948-1951]. Polain (E.), La vie à Liège sous Ernest de Bavière, évêque et prince de Liège (1581-1612), 2 vol., Tongres, 1938. Polain (M.-L.), Recueil des Ordonnances de la principauté de Liège 2e série 1507-1684, vol. 2 contenant les ordonnances du 6 mars 1581 au 24 novembre 1620, Recueil des anciennes ordonnances de la Belgique, Bruxelles, 1871. Zanussi (S.), La politique intérieure liégeoise sous Ernest de Bavière (1581-1612), mémoire dactylographié, université de Liège, 2003-2004.
8. Nous pensons notamment à P. de Ribadeneyra, Traité de la Religion que doit suivre le prince chrestien et des vertus qu’il doit avoir pour bien gouverner et conserver son Estat : Contre la doctrine de Machiavel et des Politiques de nostre temps, composé en espagnol par le R.P. Piere de Ribadeneyra de la Compagnie de Jesus : Et traduit par le P. Antoine de Balinghem de la même Compagnie, Douai, 1610. 29
ERNEST DE BAVIÈRE ET LE CATHOLICISME TRIDENTIN1 Annick Delfosse
Au début du XVIe siècle, la chrétienté, jadis unie, s’est déchirée. Des conflits ouverts ont alterné avec des tentatives de conciliation, jusqu’à ce qu’en 1545 s’ouvre à Trente, petite ville de culture italienne située dans l’Empire, un concile chargé de réunir catholiques et protestants2. Presque vingt ans plus tard, après de nombreuses péripéties, ce concile s’est conclu bien différemment de ce que ses initiateurs avaient initialement espéré : la conciliation n’a pu avoir lieu et la chrétienté s’est définitivement disloquée. L’Église romaine a en effet redéfini une position doctrinale forte par laquelle elle a rejeté en bloc les propositions protestantes concernant le salut, le péché originel, les sacrements… Par la même occasion, elle s’est fixé un strict programme de réformes internes, démontrant ainsi un souhait de renouveau, particulièrement pour ce qui concerne le clergé. Le cœur des réformes tridentines, en effet, est constitué par le souci d’assurer le salut des âmes : il fallait donc, du même coup, redéfinir nettement la fonction du prêtre3. Aussi a-t-il été décidé à Trente qu’il était désormais nécessaire d’offrir aux fidèles un accompagnement de qualité, assuré par des clercs formés, fermes dans leur conduite morale et prêts à remplir pleinement leurs fonctions pastorales pour la cura animarum. Ces clercs, pour mener à bien leur tâche, devaient aussi être soumis au pouvoir presque illimité de leur évêque, principal responsable du soin des âmes et, pour cette raison, contraint à être toujours présent dans son diocèse. Cumuler les bénéfices Ernest de Bavière a neuf ans quand se clôt le concile. Il est alors l’élève des jésuites, principaux fers de lance de la réforme catholique appelés en Bavière par son grand-père et son père, les ducs Guillaume IV et Albert V. En 1566, alors qu’il a à peine douze ans, il est placé par ce dernier à la tête de l’évêché de Freising4. Son prédécesseur, Moritz von Sandizell, est pressé de lui céder la place5. Le diocèse, dont dépend la ville de Munich où sont installés les Wittelsbach, est en effet dominé par la dynastie bavaroise qui entend non seulement y empêcher la propagation du protestantisme mais également y exercer son autorité : Ernest est un pion placé par son père. En 1573, Ernest est appelé au Nord de l’Empire, dans le diocèse de Hildesheim où ne reste qu’une faible minorité de catholiques, largement dominés par un luthéranisme en pleine expansion. Il est le premier des Wittelsbach à prendre pied dans ce diocèse sur lequel règneront les Bavière jusqu’à la fin du XVIIIe siècle6. Ce deuxième évêché à peine acquis, il est pressenti au siège de l’archevêché de Cologne qu’il manque de peu en 1577, les chanoines de la cathédrale lui préférant, à une courte majorité, Gebhard Truchsess de Waldbourg. En 1581, le chapitre de la Cathédrale Saint-Lambert l’élit comme évêque 1. Sur l’histoire de l’Église de Liège à l’époque d’Ernest de Bavière, on consultera l’ancien mais néanmoins toujours utile J. Daris, Histoire du diocèse et de la principauté de Liège pendant le XVIe siècle, Liège, 1884 ainsi que J.-P. Massaut, M.-E. Henneau et E. Hélin (dir.), Liège, histoire d’une Église, vol. 3 (Du XVIe au XVIIIe siècle), Strasbourg, Éditions du Signe, 1995 et J.-P. Delville, Le grand séminaire de Liège : 1592-1992, Liège, 1992. 2. Pour une excellente synthèse sur le concile, son esprit et ses conséquences, voir M. Venard, « L’Église catholique », dans J.-M. Mayeur, Ch. Pietri, A. Vauchez et M. Venard (dir.), L’histoire du christianisme des origines à nos jours, vol. 8 (Le temps des confessions, 1530-1620), Paris, Desclée, 1997, p. 223-280. Voir également R. Bireley, « Redefining Catholicism : Trent and Beyond », R. Po-Chia Hsia (dir.), The Cambridge History of Christianity, vol. 6 (Reform and expansion : 1500-1660), Cambridge, 2007, p. 145-161. 3. L.-E. Halkin, « La formation du clergé catholique après le concile de Trente », Miscellanea Historiae Ecclesiasticae, t. III (colloque de Cambridge 1968), Louvain, 1970, p.114. 4. Sur le parcours ecclésiastique d’Ernest de Bavière, voir Fr. Bosbach, « Ernst von Bayern », Lexikon für Theologie und Kirche [= LTK], t. III, 1995, col. 818-819 ; Paul Harsin, « Ernest de Bavière », Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques [= DHGE], t. VII, 1934, col. 3-5. 5. G. Schwaiger (dir.), Das Bistum Freising in der Neuzeit, Munich, 1989, p. 313. 6. H.-G. Aschoff, « Hildesheim », LTK, t. V, 1996, col. 108-110.
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
de Liège. Deux ans plus tard, Gebhard Truchsess se convertit au protestantisme et Ernest est élu à sa place comme archevêque, devenant alors l’un des plus importants personnages de l’Empire, la dignité d’archevêque de Cologne étant associée à celle d’électeur impérial. En 1585, enfin, Ernest prend la tête du diocèse de Munster, qui relevait déjà de sa juridiction en tant qu’archevêque de Cologne. En près de vingt ans, Ernest de Bavière a réussi à cumuler quatre évêchés et un archevêché. S’il maîtrise alors des postes-clés du catholicisme dans l’espace moso-rhénan, il ressemble peu, en revanche, au modèle de l’évêque tel que l’a défini le concile de Trente et tel que l’incarne alors son contemporain Charles Borromée, l’archevêque de Milan. Selon le concile, en effet, l’évêque tridentin a autant de devoirs qu’il n’a de pouvoirs : il doit résider dans son diocèse qu’il est invité à visiter régulièrement, il est contraint d’assumer ses responsabilités religieuses et de faire figure de bon pasteur, il est soumis à l’obligation de rendre compte à Rome de son apostolat et de celui de son clergé… Ernest de Bavière répond à grand’ peine à ces critères. Plus prince qu’il n’est évêque, il s’absente la plupart du temps de ses diocèses qu’il confie à des évêques suffragants ou à des vicaires généraux. Ainsi, dans le diocèse de Liège, c’est d’abord à l’humaniste et poète Laevinus Torrentius qu’il délègue ses responsabilités épiscopales, comme Gérard de Groesbeek l’a fait avant lui. Lorsqu’en 1587, l’éditeur raffiné de Suétone part à Anvers pour y prendre enfin ses fonctions d’évêque, il est remplacé par Thierry de Lynden auquel succédera en 1598 le théologien et historien Jean Chapeaville. Ce sont ces hommes qui ont véritablement la charge du diocèse, menant pour l’évêque des missions délicates et gérant des affaires de première importance, tout en devant composer avec le puissant Chapitre noble de la Cathédrale Saint-Lambert. Ils développent une excellente connaissance du terrain liégeois et conseillent, voire semoncent, un prince-évêque trop lointain, trop distrait par d’autres priorités, trop souvent mal renseigné et trop peu enclin à introduire dans le diocèse la réforme conçue à Trente. Le sage Torrentius, en particulier, lui adressera plusieurs remontrances indignées7. En 1601, l’élection comme coadjuteur de son neveu, Ferdinand de Bavière, soulage les détracteurs du prince : on attend de Ferdinand, profondément influencé par les jésuites dont il a suivi les cours à l’université d’Ingolstadt, qu’il exerce une « grande influence sur l’état malheureux de l’évêché »8 et succède avec bonheur à un oncle aussi libertin qu’il est lui-même ascète. Car avant d’incarner l’esprit tridentin, Ernest est d’abord un Wittelsbach : il est l’un des principaux acteurs de la politique familiale visant une position dominante dans l’Empire. Toutefois, la configuration toute politique qu’il donne à sa carrière ecclésiastique n’en fait pas pour autant, comme on a pu le dire, un évêque « décevant » et « mauvais administrateur »9 qui mépriserait superbement la réforme catholique en amassant les charges et en affichant une vie pour le moins désordonnée10. La puissante dynastie de Bavière, en effet, en assurant avec les Habsbourg un monopole sur les sièges épiscopaux, entend participer activement au renforcement du catholicisme allemand. En 1583, le pape a signé un concordat avec le frère d’Ernest, le duc Guillaume V, donnant à ce dernier le droit de taxer le clergé, de procéder à des nominations épiscopales et de participer aux visites diocésaines, autant d’avantages offerts aux Wittelsbach pour qu’en échange, ils contribuent consolider un catholicisme allemand fortement secoué11. De la même manière, si Ernest cumule les bénéfices, c’est avec l’accord du Saint-Siège qui voit en lui un sauveur de la confession catholique dans l’Ouest de l’Empire12.
7. L. Torrentius, Correspondance, t. I (Période liégeoise, 1583-1587), éd. critique par M. Delcourt et J. Hoyoux, Paris, Les Belles Lettres, 1950, passim (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, fasc. CXIX). 8. Aldovrandini à Garzadoro, Rome, 24 mars 1601 (H. Dessart, L.-E. Halkin et J. Hoyoux, Inventaire analytique de documents relatifs à l’histoire du diocèse de Liège sous le régime des nonces de Cologne (1584-1606), Bruxelles-Rome, IHBR, 1957, doc. 359). 9. Voyez le portrait qui est fait de lui à l’art. « Cologne » du DHGE, t. XIII, 1956, col. 295 : « Ernest de Bavière déçut malheureusement tous les gens de bien : sa mauvaise administration, tant politique que religieuse, comme aussi sa conduite privée, menèrent, pour la troisième fois en ce siècle, son archevêché à la ruine. Pour éviter le pire, la Curie romaine lui donna comme coadjuteur son noble et habile neveu, Ferdinand ». 10. H. Dessart, L.-E. Halkin et J. Hoyoux, Inventaire analytique…, op. cit., p. 10-11. 11. Kl. UNTERBURGER, Das Bayerische Konkordat von 1583. Die Neuorientierung der päpstlichen Deutschlandpolitik nach dem Konzil von Trient und deren Konsequenzen für das Verhältnis von weltlicher und geistlicher Gewalt, Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer, 2006 (=Münchner Kirchenhistorische Studien, 11). 12. Ainsi, lorsqu’Ernest sera la cible de critiques sévères relatives notamment aux désordres de sa vie privée et à sa tiédeur face aux réformes, Paul V prendra fermement sa défense (H. Dessart, L.-E. Halkin et J. Hoyoux, Inventaire analytique…, op. cit., doc. 498). 32
ERNEST DE BAVIÈRE ET LE CATHOLICISME TRIDENTIN
Ainsi, à Liège, Ernest de Bavière renforcera dès son élection la législation antiprotestante. Certes, son diocèse liégeois est moins touché par la réforme que ses évêchés du Nord : les princes-évêques qui l’ont précédé ont en effet très tôt mené une politique de répression ferme du protestantisme, déterminés à maintenir solidement dans le diocèse le catholicisme romain aux moyens d’édits sévères, voire en recourant aux bûchers. Néanmoins, le protestantisme n’est pas totalement absent du diocèse : des foyers calvinistes et anabaptistes se sont maintenus en divers endroits comme à Hasselt, Stockem, Brée, Tongres, Maaseik, SaintTrond ou le pays de Franchimont. Aussi Ernest fera-til publier plusieurs édits visant à la consolidation de la foi catholique (fig. 1). Parmi ceux-ci, l’on retiendra particulièrement l’édit de mars 1589 qui contraint tous les habitants de la principauté à professer la religion catholique et les autres à s’expatrier, n’autorise que les catholiques dans l’administration publique, n’accorde le doit de bourgeoisie qu’aux catholiques et impose une surveillance étroite des imprimeurs et des libraires invités à n’imprimer ni vendre aucun ouvrage contraire à la foi catholique13. Ces mesures amorcent le déclin progressif de la présence calviniste en divers lieux du diocèse mais n’empêchera pas le maintien d’Églises protestantes dans les terres de frontière. Introduire les décrets tridentins à Liège
Fig. 1 : Lettres patentes pour la conservation et le maintien de la foi catholique, Liège, 1599. © Liège, Université, Bibliothèque de Philosophie et Lettres.
Si le concile s’achève en 1563, il faudra des décennies – et à Liège bien plus longtemps encore – pour que les réformes qui y ont été décidées remodèlent effectivement le catholicisme moderne et lui donnent sa dimension dite « tridentine ». Certes, par la bulle Benedictus Deus, Pie IV ratifie les décrets du concile immédiatement après la clôture de la dernière session. Dans les mois qui suivent, il publie un décret des livres prohibés, fonde la sacrée congrégation du Concile chargée de veiller au respect des décisions conciliaires, impose au clergé catholique une Profession de foi tridentine et ordonne la rédaction d’un « catéchisme du Concile de Trente » qui sera publié en 1566. Pour autant, la réforme peine à prendre pied. Si Philippe II en Espagne et Sigismond II en Pologne adhèrent immédiatement aux décisions prises à Trente et introduisent la législation tridentine dans leurs royaumes respectifs, la plupart des autres pays d’Europe entrent dans la réforme à reculons. À Liège, notamment, le clergé qui, de longue date, bénéficie de nombreuses exemptions grince des dents. Les Liégeois ont peu participé aux réunions du concile. Les évêques, pourtant, n’ont pas été insensibles à l’impérieuse nécessité de réformer leur diocèse. Robert de Berghes a ainsi mis tout en œuvre pour accueillir à Liège les jésuites et leur permettre d’ouvrir une école14. Il a également projeté l’érection d’un « collège public » où auraient été formés les prêtres des communautés rurales. En vain. Il a en effet face à lui un clergé extrêmement récalcitrant qui redoute les réformes parce qu’elles menacent ses privilèges autant 13. M.-G. de Louvrex, Dissertationes canonicae, Liège, 1729, p. 98. 14. L. Halkin, « Les origines du collège des Jésuites et du séminaire de Liège », Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois, vol. 51 (1926), p. 83-191. 33
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
que sa routine. Pour cette raison, Gérard de Groesbeeck, élu en 1564, a tardé à proposer au clergé liégeois l’introduction des décrets tridentins dans le diocèse. Quand il l’a invité à y réfléchir en 1567, il a rencontré l’opposition de ce clergé exempt. Une seule concession lui a été accordée : la législation tridentine relative au mariage a été introduite dans le diocèse à la fin de l’année. Aucun autre décret, toutefois, n’a été accepté. Certes, les décrets du Concile seront à plusieurs reprises publiés à Liège, chez Morberius, à partir de 156915 (fig. 2). Cela ne signifie pas pour autant que le clergé leur fasse bon accueil. C’est donc dans un diocèse où il semble bien difficile d’introduire les réformes qu’arrive Ernest en 1581. Le pape Grégoire XIII Buoncompagni (1572-1585) est depuis neuf ans à la tête de l’Église romaine. Voilà longtemps qu’il attend que Liège adopte les décrets tridentins et se plie à la réforme. En 1582, Grégoire XIII ordonne au nouvel évêque de faire publier – et observer ! – les décrets du concile16. Hélas, Ernest est aussi impuissant que ses prédécesseurs à introduire les mesures prises à Trente. Aussi Grégoire XIII, dont le pontificat est caractérisé par la multiplication de nonciatures à travers l’Europe catholique pour convaincre les clergés locaux d’appliquer les décrets, finit-il par recourir au même procédé afin d’imposer la réforme à Liège. Une nonciature permanente est ainsi créée en 1584 à Cologne, capitale d’un des plus importants électorats de l’Empire et dernier rempart catholique du Nord avant que ne se déploient les territoires où le luthéranisme comme le calvinisme se sont largement répandus : Giovanni Francesco Bonomi (1536-1587), évêque de Vercelli, en est le premier représentant17. Le nonce devient ainsi un des agents de la politique réformatrice pontificale et tridentine dans l’Empire, venant renforcer le rang formé par le nonce près de l’empereur et celui installé à Gratz. Il est chargé, au nom de Grégoire XIII, d’y lutter contre l’hérésie et d’y implanter solidement une réforme dont il a une intime expérience. Bonomi est en effet un proche de Charles Borromée : non seulement l’a-t-il accompagné dans ses visites Fig. 2 : Sacrosancti et oecumenici concilii Tridentini canones et decreta, Liège, Hovius, 1587. pastorales en Suisse et a-t-il participé activement à la © Liège, Université, préparation du concile provincial de Milan de 1569 Bibliothèque de Philosophie et Lettres. – une des étapes de la tridentinisation spectaculaire et intensive de l’archevêché de Milan –, mais il a mené ensuite sous sa direction dans son propre évêché du Piémont, Vercelli, une activité réformatrice de grande ampleur multipliant les visites pastorales, convoquant chaque année un synode diocésain, imposant l’usage romain en liturgie et appelant dans son diocèse de brillants agents de la réforme comme les Barnabites ou les Jésuites. Ce protégé de Borromée, en raison du profil intensément tridentin qu’il partage avec ce dernier, est rapidement remarqué par Rome qui l’envoie comme nonce apostolique d’abord en Suisse (1579-1581) puis à Vienne, à la cour impériale (1581-1584). 15. Les Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini canones et decreta sont publiés à Liège en 1569, 1570, 1577, 1587 et 1612. 16. J. Hartzeim, Concilia Germaniae, t. VIII, Cologne, 1769, p. 504. 17. S. Ehses et AL. Meister (éd.), Die Kölner Nuntiatur, t. I (Bonomi in Köln, Santonio in der Schweiz. Die Straßburger Wirren), Munich-Paderborn-Vienne, Schöningh, 1969, p. XIV-LXIII (= Nuntiatur berichte aus Deutschland) ; G. Rill, « Bonomi (Buonhomo, Bonhomi, Bonhomini, Bonhomius), Giovanni Francesco », Dizionario biografico degli Italiani, t. XII, 1970, p. 309- 314. 34
ERNEST DE BAVIÈRE ET LE CATHOLICISME TRIDENTIN
En 1582, il est mandaté à Cologne pour régler les problèmes que pose l’apostasie de l’archevêque Gebhard Truchsess. En 1577, Truchsess avait été préféré de quelques voix à Ernest et était monté sur le siège archiépiscopal et électoral mais, épris d’une chanoinesse protestante de Gerresheim – la comtesse Agnes von Mansfeld-Eisleben – qu’il voulait épouser, il avait fini par se tourner vers le calvinisme tout en entendant bien rester à la tête de l’Électorat de Cologne qu’il voulait convertir en principauté civile. Or, il avait été décidé à Augsbourg en 1555, par la clause reservatum ecclesiasticum, que tout prince-évêque qui embrasserait la réforme devrait quitter son poste. Aussi Bonomi est-il chargé par Grégoire XIII de se rendre à Cologne pour démettre l’apostat et lui trouver un remplaçant. Bonomi soutient alors Ernest qui est élu par le chapitre le 2 juin 1583, provoquant la réaction armée de Truchsess et l’ouverture de la Guerre de Cologne (1583-1588). Quand, un an plus tard, le pape décide d’installer une nonciature permanente à Cologne, c’est naturellement ce réformateur catholique actif et bon connaisseur du terrain rhénan qu’est Bonomi qu’il désigne. De Cologne, Bonomi se rend à Liège au printemps 1585. Il y convoque pour le mois d’octobre suivant un synode diocésain destiné à introduire les fameux décrets dans l’évêché18. Depuis la fin du concile, les églises locales avaient relancé en nombre ces synodes. Destinés à mettre en œuvre concrètement au sein des diocèses la discipline et la doctrine tridentine, ils étaient l’occasion de développer des trésors d’ingéniosité adaptatrice… ou d’opposer une résistance vigoureuse au renouveau de l’Église. À Liège, le synode convoqué par Gérard de Groesbeeck en 1571 s’est ainsi soldé par un cuisant échec. Mais Bonomi tient à l’introduction des décrets et réitère l’expérience. Il entame par la même occasion une première visite du diocèse, exhortant le clergé de la cité de Liège et des alentours à plus de discipline. À son départ pour Cologne, il confie au vicaire général, Laevinus Torrentius, et aux doyens du diocèse le soin de poursuivre la surveillance du clergé et de punir sévèrement tous ceux qui se rendraient coupables de concubinage et d’ivrognerie ou qui refuseraient de porter l’habit ecclésiastique19. Il invite également le clergé à définir ce qui porterait préjudice à ses privilèges dans les décisions conciliaires. Des revendications en 19 points lui sont soumises à la veille de l’ouverture du synode. Pour ne pas raidir le clergé, Bonomi accepte de différer l’application des décrets du concile sur neuf de ces points jusqu’à ce que le pontife rende sa décision. Le synode est ouvert le 3 octobre 1585. Les deux premiers jours sont consacrés à la lecture partielle des décisions conciliaires ainsi que de plusieurs bulles et brefs pontificaux. Le clergé présent est alors invité à prononcer la profession de foi tridentine telle que l’a définie Pie IV quelque vingt ans plus tôt dans la bulle Injunctum nobis. Le troisième, et dernier, jour est l’occasion de lire, en abrégé, les statuts synodaux20. Différents point sont alors abordés : on y parle, entre autres, de l’hérésie, de la superstition, du blasphème, des reliques de saints, des sacrées images, du clergé, de ses fonctions, de sa moralité… Torrentius est chargé de la publication de ces statuts : Ernest de Bavière rechigne, la publication traîne, Laevinius est finalement envoyé comme évêque à Anvers et quitte le diocèse. Bonomi meurt peu de temps après. Les statuts ne sont jamais publiés. Par la suite, Rome essayera, par l’intermédiaire de ses nonces à Cologne ou de ses légats dans l’Empire, de forcer la réunion d’un nouveau synode à Liège afin de pallier la « distraction » d’Ernest de Bavière et de publier enfin les décrets du concile21. En vain. La résistance aux décrets tridentins est ferme : le clergé liégeois ne veut pas de cette réforme qu’il perçoit comme une menace pour le prestige de l’Église de Liège, malmenant ses traditions et menaçant ses privilèges. Ce n’est que très lentement que le changement s’opérera et il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que la réforme transforme véritablement le diocèse.
18. F. Willockx, Introduction des décrets du concile de Trente dans les Pays-Bas et dans la principauté de Liège, Louvain, 1929, p. 238-248. 19. G. F. Bonomi, Mandement intimé aux doyens liégeois, Stavelot, 25 juillet 1585 (S. Ehses et AL. Meister (éd.), Die Kölner Nuntiatur…, op. cit., doc. 80). 20. A. van Hove, « Les statuts synodaux liégeois de 1585. Un document inédit de la nonciature de Bonomi à Cologne », Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de Belgique, 33 (1907), p. 5-51 et 163-212. 21. Minuccio Minucci à Frangipani, Rome, 26 juin 1593 (H. Dessart, L.-E. Halkin et J. Hoyoux, Inventaire analytique..., op. cit., doc. 105). Voir également les instructions données au cardinal Madruzzo, légat à la diète de Ratisbonne (Idem, doc. 132). 35
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Former le clergé L’introduction des décrets tridentins à Liège a donc échoué. Toutefois, l’esprit de la réforme n’en marque pas moins le diocèse. Depuis longtemps, en effet, s’est imposée la conviction de l’absolue nécessité de donner une excellente formation à ceux qui sont chargés du soin des âmes. L’idée est ancienne : les prédécesseurs d’Ernest de Bavière avaient rêvé en vain à l’érection d’un lieu de formation des prêtres liégeois22. Anticipant le canon Cum adolescentium aetas adopté lors de la XXIIIe session du concile (1563), Robert de Berghes a eu l’idée en 1560 de confier à la jeune Compagnie de Jésus un collège-séminaire. Le clergé liégeois, peu disposé à renoncer à ses prébendes pour financer la nouvelle institution, en a empêché la concrétisation. L’institution d’un séminaire, en effet, coûte cher : il faut des bâtiments pour accueillir les élèves, des revenus pour payer les professeurs, de l’argent pour nourrir et loger les boursiers… Les solutions proposées se font au détriment du clergé qui n’entend pas renoncer à ses privilèges financiers. Quelques années plus tard, alors que, de l’Italie à la Pologne, des séminaires voient le jour à travers toute l’Europe catholique23, Gérard de Groesbeek reprend le projet en main, toujours en collaboration avec les jésuites. Il doit toutefois à son tour s’incliner devant un clergé réfractaire tandis que dans les Pays-Bas voisins, on trouve au contraire les moyens d’ériger des séminaires. Un premier est ouvert à Ypres en 1565, un second à Gand en 1569. À Liège, Torrentius puis Bonomi tentent bien de relancer l’entreprise mais ce n’est qu’à partir de l’année 1588, avec l’arrivée à Liège du nonce Frangipani pressé par le pape Sixte Quint, que le projet se concrétise peu à peu. En février 1589, Ernest de Bavière accorde enfin les lettres d’institution du séminaire. Il faut toutefois encore trouver les moyens de financer cette nouvelle érection. Les palabres continuent donc pendant trois ans. Entretemps, en cette même année 1589, le prince-évêque fonde à Saint-Trond un petit séminaire destiné à préparer à la formation dispensée au grand séminaire de Liège24. Ce petit séminaire, sont étaient enseignées les « humanités », connaît un fulgurant succès parmi la jeunesse thioise qui fréquente l’établissement pour y recevoir un enseignement de qualité sans pour autant rêver à une carrière ecclésiastique. En attendant, le grand séminaire liégeois auquel le petit trudonnaire était censé prépaFig. 3 : Jean Valdor l’Aîné, rer ne voit pas le jour, toujours en raison des difficultés Portrait de Jean Chapeaville, 1617. qu’engendre son financement. Ernest finit par proposer © Liège, Cabinet des Estampes. d’installer le séminaire dans les bâtiments de l’hôpital de Saint-Mathieu-à-la-Chaîne, voisin de la cathédrale Saint-Lambert, qu’il incorpore à la nouvelle institution25. Le clergé, soulagé de n’avoir pas à financer le séminaire, se montre favorable. En 1592, celui-ci est enfin inauguré : les séminaristes, pour la plupart inter-
22. L. Halkin, « Les origines du collège des Jésuites et du séminaire de Liège… », op. cit., p. 83-191. 23. L. E. Halkin, « La formation du clergé catholique après le concile de Trente », op. cit., p.118 et suiv. 24. A. Grandsard, « Histoire du grand séminaire de Liège jusqu’au milieu du XVIIe siècle », Bulletin de la Société d’Art et d’Histoire du Diocèse de Liège, 39 (1955), p. 101-103. 25. Y. Charlier, « La fondation et les premières années du Grand Séminaire », Jean-Pierre Delville (dir.), Le grand séminaire de Liège (1592-1992), Liège, 1992, p. 26-28. 36
ERNEST DE BAVIÈRE ET LE CATHOLICISME TRIDENTIN
nes, y reçoivent les enseignements de plusieurs professeurs parmi lesquels ceux du futur vicaire-général, Jean Chapeaville (fig. 3)26. Celui-ci, nommé inquisiteur épiscopal en 1582 et chanoine pénitencier du chapitre cathédral quatre ans plus tard, dispense au séminaire des cours de théologie morale et dogmatique. Sur base de son cours de dogmatique, il publiera en 1600 une « élucidation scolastique » du catéchisme romain27 que la papauté tente d’imposer depuis la clôture du concile28. Le vicaire-général proposera rapidement une version abrégée dudit catéchisme29 (fig. 4). On remarquera toutefois que la théologie n’est pas le seul objet d’enseignement au séminaire : les séminaristes, en effet, sont également formés au chant, à la liturgie, à la prédication et à l’accompagnement spirituel. C’est donc bel et bien une formation pratique, et non strictement académique, qu’ils reçoivent entre ces murs. Dans les années qui suivent, Ernest de Bavière fonde un nouveau séminaire dans le prieuré Saint-Elisabeth du comté de Hornes : il s’agit de créer, en frontière de catholicité, une pépinière de prêtres solidement formés et capables dès lors d’empêcher la propagation du protestantisme depuis les ProvincesUnies voisines30. Malgré les réprimandes de Rome, le séminaire est démantelé en 1600 par la volonté du général des chanoines réguliers de Saint-Augustin dont dépend le prieuré. Ernest en recrée aussitôt un nouveau à Maaseik qu’il confie aux jésuites. Cette tentative est cependant vite avortée : le séminaire est fermé en 1602 pour des raisons financières. Ce double échec dévoile toute la difficulté que pose l’implantation des séminaires tridentins : mal financés ou financés au détriment de chapitres ou d’ordres religieux, ils Fig. 4 : Jean Chapeaville, soulèvent les résistances et finissent par échouer31. Catechisimi romani elucidatio scholastica, Liège, 1600. En 1605, enfin, Ernest parachève la structure de © Liège, Université, Bibliothèque de Philosophie et Lettres. formation du clergé liégeois. Il fait ériger à Louvain un collège destiné à accueillir les séminaristes liégeois qui souhaiteraient parfaire leur formation théologique à l’Université de Louvain32 (fig. 5). Une série de biens immobiliers ont été achetés quelques années auparavant non loin de la collégiale Saint-Pierre pour accueillir en résidence les meilleurs élèves du grand séminaire. Logés dans ce collège, ces séminaristes peuvent suivre aisément le cursus académique louvaniste et obtenir le grade de docteur en théologie. 26. G. Simenon, « Chapeaville et les études théologiques », Revue ecclésiastique de Liège, 26 (1934-1935), p. 213-228. 27. J. Chapeaville, Catechismi romani elucidatio scholastica, Liège, 1600. 28. Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii V jussu editus, Rome, 1566. 29. J. Chapeaville, Summa Catechismi Romani, in gratia ordinandorum catechistarum et parochium dioecesis Leodiensis edita, Liège, 1605. 30. H. Dessart, L.-E. Halkin et J. Hoyoux, Inventaire analytique…, op. cit., doc. 336 ; Y. Charlier, « La fondation et les premières années du Grand Séminaire », op. cit., p. 34. 31. Voir L.-E. Halkin, « La formation du clergé catholique après le concile de Trente », Miscellanea Historiae Ecclesiasticae, III (colloque de Cambridge 1968), Louvain, 1970, p. 109-125. 32. N. Thiemann, Le collège liégeois de Louvain (1605-1797), Mémoire de licence inédit, Liège, 1994. 37
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 5 : Calice (1607) offert par Jean Chapeaville au Collège liégeois de Louvain. © Liège, Grand Séminaire.
S’adjoindre des vigoureux soutiens : les jésuites Ernest, on l’a dit, fut l’élève des jésuites. La jeune Compagnie de Jésus, fondée par Ignace de Loyola et approuvée par Paul III en 1540, avait très tôt été réclamée en Bavière par son grand-père et son père pour réorganiser l’université d’Ingolstadt et ramener dans le duché un catholicisme conquérant. Un collège avait été fondé à Munich en 1559. À son tour, Ernest recourra au soutien de la Compagnie dans ses propres diocèses. Il la fera venir à Hildesheim en 1587 où les jésuites fonderont rapidement le Gymnasium MarianoJosephinum. En 1588, trois ans après son élection au siège épiscopal, c’est à Munster que les jésuites s’installent, prenant du même coup la direction du Collegium Paulinum, collège épiscopal pluriséculaire. À Liège, Ernest cède à la Compagnie, en 1581, les bâtiments du gymnase des Hiéronymites sur « l’isle à l’Hochet », en bord de Meuse, pour qu’elle en fasse son propre collège. Les classes sont ouvertes à la jeunesse liégeoise dès l’année suivante. Les mérites de l’ouverture ce collège liégeois ne reviennent toutefois pas à Ernest lui-même. Voilà longtemps que les autorités liégeoises espéraient voir s’implanter dans la cité épiscopale les jésuites, présents dans les Pays-Bas voisins depuis 1542. En 1563, un collège avait été fondé dans la principauté, à Dinant, mais le projet de fondation liégeois, étroitement lié à celui du séminaire, avait lui rencontré les difficultés que nous venons d’évoquer33. Renonçant à son projet de séminaire, Gérard de Groesbeek avait finalement
33. L. Halkin, « Les origines du collège des Jésuites et du séminaire de Liège », BIAL, 51 (1926), p. 83-191. 38
ERNEST DE BAVIÈRE ET LE CATHOLICISME TRIDENTIN
élaboré en 1566 le plan pour le moins original – et en tout cas inédit – de rassembler Hiéronymites et Jésuites au sein du même collège, les premiers s’occupant des petites classes et les seconds des trois classes supérieures. Jérôme Nadal, alors nommé visiteur de plusieurs provinces jésuites, et notamment de celle de la Germanie inférieure dont aurait relevé Liège, s’oppose au projet qui en reste là. Le général, toutefois, autorise l’établissement dans la cité d’une mission temporaire, chargée de s’atteler à l’érection du collège tant attendu et de prendre en charge les traditionnels ministères de l’ordre tels que la confession, la direction spirituelle, la prédication, le catéchisme, le service des malades et des prisonniers… Ce n’est que quatorze ans plus tard que Gérard de Groesbeek reprend le projet abandonné, revenant à son idée d’exploiter le gymnase Saint-Jérôme désormais tombé en décadence. Une convention est négociée par Laevinus Torrentius : les frères de Saint-Jérôme renoncent, moyennant quelques avantages, à leurs bâtiments qu’ils cèdent aux jésuites. Le chapitre Saint-Lambert approuve la cession en 1580. Gérard de Groesbeek meurt entretemps et c’est Ernest, ce Wittelsbach élevé chez les jésuites, qui a le privilège d’exécuter ce que son prédécesseur avait conçu. En 1585, 500 élèves fréquentent déjà l’établissement. Ils seront le double quinze ans plus tard34. Ils y suivent un cursus destiné à répondre à l’idéal pédagogique des studia humanitatis que défend la Compagnie en enseignant la grammaire, la syntaxe, la poésie, la rhétorique ainsi que le grec35. La confessionnalisation solide des jeunes Liégeois occupe évidemment tout autant les professeurs du collège. Alfred Poncelet rappelle qu’en 1595, alors que Huy venait d’être prise par les Hollandais, les jeunes élèves montent sur scène pour offrir au prince-évêque une pièce de théâtre au cours de laquelle « ils exhortèrent les États de la principauté à se serrer autour du prince pour la défense de la foi »36. Dix ans plus tôt, le manuel que François Coster avait publié en 1576 pour ses congréganistes de Cologne avait été réédité à Liège, à l’intention de la jeune sodalité mariale liégeoise37. Celle-ci, fondée dès l’ouverture du collège, devait à l’instar des autres congrégations mariales créées dans les collèges de l’ordre rassembler quelques étudiants triés sur le volet afin de les inciter à prier ensemble la Vierge et à diffuser parmi leurs jeunes camarades un comportement catholique exemplaire. Pour répondre au même objectif de renforcement du catholicisme, le « Petit catéchisme des catholiques » (1566) du jésuite Pierre Canisius (1521-1597) est réédité à Liège en 1591 puis en 159238. Cet abrégé rendait plus accessible son « grand catéchisme », la Summa doctrinae christianae (1555), déjà republié à Liège chez Morberius en 157339. Une traduction française était parue à Liège en 158840. Le catéchisme du jésuite Zacharie Rotz paraît sur ordre d’Ernest lui-même en 1598, en néerlandais et en français. Trois ans plus tard, c’est la version française, traduite de l’italien, du catéchisme de Bellarmin qui est publiée à Liège. La production jésuites, qu’il s’agisse de livres de controverse ou de traités de spiritualité, est en effet en vogue à Liège : des textes de Louis Richeome, Luca Pinelli, François Arias ou Gaspar Loarte sont très tôt réédités dans la cité. Outre l’enseignement adressé aux jeunes élèves des collèges, les jésuites développent à Liège des cours de théologie morale, d’Écriture sainte et de controverses, accueillant vraisemblablement au collège des futurs prêtres dès 1585 et palliant ainsi l’absence de séminaire épiscopal41. Ces enseignements cessent lors de l’érection du séminaire. Ernest pense alors à confier la nouvelle institution aux jésuites mais ce n’est qu’en 1598 qu’ils sont associés au corps professoral du séminaire42. À cette date, le jésuite anglais Edmond 34. P. Guérin, Les jésuites du collège wallon de Liège durant l’Ancien Régime, t. I, Liège, Société des Bibliophiles liégeois, 1999, p. 51. 35. Le manuel de langue grecque Institutionum linguae graecae de Jacob Gretser est plusieurs fois publié à Liège à partir de 1596. 36. A. Poncelet, Histoire de la Cie de Jésus dans les anciens Pays-Bas, t. II, Bruxelles, 1927, p. 92. 37. Fr. Coster, Piarum et christianarmu institutionum libri tres in usum sodalitatis B. Mariae Virginis primum conscripti, nunc vero minium christianorum pietati ac devotioni destinati, Liège, H. Hovius, 1585. Sa Bulla super forma juramenti professionis fidei, également destinée aux membres des congrégations mariales, avait aussi été republiée chez Morberius en 1579. – Sur la production éditoriale jésuite à Liège, voir M. Hermans, « Le livre liégeois. Stratégies éditoriales au début du XVIIe siècle », C. Bousquet-Bressolier (dir.), François de Dainville, pionnier de l’histoire, de la cartographie et de l’éducation, Paris, École Nationale des Chartes, 2004, p. 137 et suiv. Voir également M.-É. Henneau, « Les livres religieux », P. Bruyère et A. Marchandisse (dir.), Florilège du livre en Principauté de Liège, Liège, Société des Bibliophiles liégeois, p. 259-263. 38. Institutiones christianae pietatis seu parvus catechismus catholicorum, Liège, s.n., 1591 ; Idem, Liège, Chr. Ouwerx, 1592. 39. X. De Theux de Montjardin, Bibliographie liégeoise, Bruges, 1885, col. 11. 40. Idem, col. 19. 41. P. Guérin, Les jésuites du collège wallon…, op. cit., t. I, p. 45. 42. Y. Charlier, « La fondation et les premières années du Grand Séminaire », op. cit., p. 30. 39
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Lemikenor est nommé régent du séminaire tandis que les cours de théologie sont confiés aux jésuites wallons qui les dispensent dans leur propre collège43. Parmi les professeurs, l’on rencontre notamment le Aisnois Antoine Le Gaudier (1572-1622), élève de Corneille a Lapide et Léonard Lessius à Louvain, futur recteur du collège liégeois et auteur de plusieurs traités de théologie ascétique44. En 1599, faisant le constat du manque de formation philosophique pourtant nécessaire au cursus théologique, les pères ouvrent en outre, au grand dam de l’université de Louvain, un cours de dialectique. La Compagnie maintient ces enseignements théologique et philosophique jusqu’à l’érection du collège liégeois à Louvain en 1605. À cette date, la formation dispensée à Liège devient essentiellement pastorale et pratique, le cursus théologique étant suivi par les meilleurs des séminaristes à l’université brabançonne. L’enseignement philosophico-théologique offert par les jésuites devient inutile. On notera que les Capucins, appartenant à une autre grande famille militante de la Réforme catholique, moins connue que la Compagnie mais néanmoins aussi énergique, s’installent dans le diocèse à la même époque. Autorisée en 1574 par Grégoire XIII à quitter l’Italie où elle avait été longtemps cantonnée, cette branche de l’ordre franciscain s’est très rapidement exportée à travers l’Europe : Ernest de Bavière l’accueille dans la cité épiscopale de Liège, en 1598. Les Capucins – après un bref séjour au collège des jésuites wallons ! – déménagent dans leur propre couvent en 1600. Ils s’établirent ensuite à Maastricht et Dinant avant de prendre pied, sous les successeurs d’Ernest, à Saint-Trond, Hasselt, Thuin, Maaseik et Stavelot. Réformer la liturgie Le concile de Trente a confié au pontife et à ses successeurs le soin de trouver des solutions pour unifier les pratiques et ramener une liturgie de plus en plus chronophage à la pristina patrum norma, à la première norme des Pères de l’Église… Un Bréviaire romain est paru à Rome en 1568. Le Missel romain a été publié deux ans plus tard. Ces livres liturgiques « tridentins » sont rapidement publiés à Liège chez Henri Hovius, bien que le diocèse – qui peut se prévaloir d’une liturgie antique – ne soit pas contraint d’adopter ces nouvelles normes. De nombreux prêtres liégeois, néanmoins, semblent préférer le missel romain aux usages liégeois45. De son côté, Ernest, en dehors du diocèse de Liège, a lui-même manifesté un intérêt pour l’ouverture de la liturgie locale aux normes romaines. Ainsi, il a fait imprimer chez Adam Berg à Munich, pour le diocèse de Freising, un Missale Frisingense accompagné de la mention ex missale romano46, participant au processus d’uniformisation de la liturgie catholique. À Liège, il ne soutient aucune réforme du missel ou du bréviaire liégeois mais propose en revanche de remplacer l’ancien rituel (Louvain, 1553) par un nouveau, désormais appelé Parochiale (1592). Ce livre de référence, publié l’année de l’érection du grand séminaire, est destiné aux prêtres liégeois : il contient tous les éléments nécessaires, les paroles comme les gestes, à l’exécution des cérémonies catholiques, et en premier lieu, à l’exécution des sacrements. Il est un précieux outil entre les mains du nouveau clergé liégeois en charge des âmes, invité à répondre aux exigences tridentines. Ernest, enfin, réforme le calendrier liturgique en 1608, à la demande des doyens ruraux. Une lourde obligation festive pesait alors sur les épaules des Liégeois qui devaient respecter un nombre très important de fêtes obligatoires : contraints à la prière et au chômage forcé lors de ces jours de fête, ils voyaient leurs moyens de subsistance menacés. Ernest les autorise alors à ouvrir leurs magasins, à exploiter leurs champs
43. P. Guérin, « Professeurs au séminaire épiscopal de Liège de 1598 à 1604 », Cercle Historique Fléron, septembre 1996, p. 67-72. 44. H. de Gensac, « Antoine Le Gaudier », dans Ch. E. O’Neill et J. M. Dominguez (dir.), Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, Rome, Institutum Historicum S. I. et Madrid, Universidad Pontifica Comillas, 2001. 45. É. Corswarem, De la ville à l’église. Musique et musiciens à Liège sous Ernest et Ferdinand de Bavière (1581-1650), thèse de doctorat inédite, Liège, 2008, p. 246. 46. K.G. Fellerer, Beiträge zur Musikgeschichte Freisings von den Aeltesten Christlichen Zeiten bis zur Aufloesung des Hofes 1803, Freising, 1906, p. 73. Nous remercions Émilie Corswarem pour cette précieuse indication. 40
ERNEST DE BAVIÈRE ET LE CATHOLICISME TRIDENTIN
ou à s’adonner à toute autre forme de travail en transformant onze jours de fêtes dites de « précepte » en autant de jours de fêtes de dévotion47. On l’a dit, Ernest est prince avant d’être évêque. Très éloigné de la définition épiscopale élaborée à Trente, il incarne avant tout l’idéal Wittelsbach, mettant ses privilèges d’évêque au service de la politique de conquête que mène la dynastie de Bavière. Il n’en joue pas moins un rôle actif dans la consolidation d’un catholicisme allemand pour le moins précaire. Certes, le cumul de charges le rend incapable d’assurer ses fonctions de bon pasteur et il est fréquent que Rome, ou ses représentants à Cologne, doivent le rappeler à l’ordre. Il reste néanmoins activement soutenu par le Saint-Siège qui est convaincu qu’Ernest est un réel garant du renouveau catholique dans ces terres de frontières. À Liège, s’il refuse de se heurter de front à un clergé particulièrement réfractaire aux réformes tridentines et ne parvient dès lors pas à imposer les décrets tridentins, il réussit en effet à ériger le séminaire que ses prédécesseurs avaient échoué à mettre en place et inaugure le Collège liégeois à Louvain. Grâce à lui également, les prêtres, mieux formés, disposent dorénavant d’un manuel de référence pour administrer exactement les sacrements. Sous son épiscopat, enfin, la Compagnie de Jésus s’installe confortablement dans la cité : après avoir pris possession du collège des Hiéronymites pour y dispenser les « humanités », elle accueille entre ses murs les enseignements théologiques du séminaire. Il est vrai que ces efforts ne permettent guère à la réforme tridentine de s’implanter solidement : les absences d’Ernest laissent l’autorité entre les mains du chapitre cathédral exempt qui résiste âprement aux nouvelles formes disciplinaires et ecclésiologiques imaginées à Trente. Néanmoins, l’obstination des vicaires-généraux à qui Ernest confie la direction spirituelle du diocèse ainsi que ces premières mesures ouvrent la voie d’une lente, mais certaine, tridentinisation liégeoise…
47. Ernest de Bavière, 8 juin 1608 (Jean CHAPEAVILLE, Gesta pontificum Tungrensium, Trajectensium, Leodiensium, t. III, Liège, 1616, p. 659-660). 41
DEUXIÈME PARTIE
LE PRINCE PRATICIEN
UNE COUR SAVANTE Robert Halleux
L’historiographie est unanime à présenter Ernest de Bavière comme versé dans les sciences et entouré de savants1. Le prince et son entourage s’inscrivent ainsi dans un courant qui parcourt le XVIe et le XVIIe siècles, la création de cours savantes2, qui a concentré l’attention des érudits au cours des dernières décennies. Sous l’influence de Norbert Elias3, des travaux féconds ont été consacrés aux Médicis4, à Philippe II5, à Rodolphe II6, à Moritz de Hesse-Kassel7, à Christine de Suède8, aux Gonzague9, aux Hohenlohe10. Comme lieu d’interaction des pouvoirs et des savoirs, la cour joue un rôle-clé dans le changement de vision du monde que l’on est convenu d’appeler la Révolution Scientifique. Entre le De revolutionibus de Copernic (1543) et les Principia de Newton (1687), l’héliocentrisme détrône le géocentrisme et le paradigme mécaniste remplace le modèle aristotélicien de la matière, du mouvement, du cosmos et du vivant. Or, il est bien connu qu’à toutes les mutations de la science ont correspondu des changements dans les structures chargées de la développer et de la transmettre. Si l’université médiévale a été créée pour rencontrer le défi de l’aristotélisme gréco-arabe, la cour est, dès la Renaissance, un des lieux du savoir, avec les cercles savants, les ordres religieux, l’armée, les librairies et les bibliothèques. Encore faut-il distinguer les temps et les modes. Depuis le temps où Archimède fréquentait la cour de Hiéron à Syracuse, les souverains se sont entourés de spécialistes : des médecins chargés de leur corps, des astrologues pour leur destin, des mesureurs pour les calculs, les poids, les mesures et les arpentages, des architectes et des mechanici que l’on appellera plus tard des ingeniatores, constructeurs d’ingenia, engins de paix et de guerre. Viendront ensuite s’y ajouter des alchimistes, riches de promesses et pauvres de résultats. Parfois l’investissement personnel du prince crée une véritable cour savante comme celle de Frederic II de Hohenstaufen à Palerme, microcosme de la science de son temps11. Mais c’est dans les cours italiennes et allemandes du XVIe siècle que ce modèle se développe. L’idéal ficinien du prince prêtre, initié aux secrets du cosmos, à la prisca philosophia et protecteur de son peuple, se
1. J’ai consacré à cette question des premiers aperçus dans « Les curiosités scientifiques d’Ernest de Bavière, prince-évêque de Liège (1581-1612) », dans Actes du 45e Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique, Comines, 1980, t. IV, 1983, p. 253-260 ; « La cour savante d’Ernest de Bavière » (avec la collaboration d’A.-C. Bernès), dans Archives Internationales d’Histoire des Sciences, 45 (1995), p. 3-29 ; « Nouveaux matériaux sur la cour savante d’Ernest de Bavière », dans Actes du cinquième Congrès de l’Association des Cercles Francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique, II, Namur, 2000, p. 394-404. 2. A.-C. BERNÈS, « Cours savantes », dans M. BLAY, R. HALLEUX, La science classique. Dictionnaire critique, Paris, Flammarion, 1998, p. 44-49 ; R. HALLEUX, « De la curiosité princière à la naissance d’une politique scientifique », dans B. SAULE, C. ARMINJON (éds), Sciences et curiosités à la cour de Versailles, Château de Versailles, RMN, 2010, p. 255-299. 3. N. ELIAS, Die hofische Gesellschaft, Berlin, 1969, tr. fr. La société de cour, Paris, 1974. Voir par exemple M. GOSMAN, A. MACDONALD, A. VANDERJAGT (eds), Princes and princely culture, 1450-1650, Leiden, Brill, 2003, 2 vols. 4. A. PERIFANO, L’alchimie à la cour de Cosme Ier de Médicis. Savoirs, culture et politique, Paris, 1997 ; F. CAMEROTA, M. MINIATI, I Medici e le scienze. Strumenti e macchine nelle collezioni granducali, Firenze, 2008. 5. D. GOUDMAN, Power and Penury : Government, Technology, and Science in Philipp II’s Spain, Cambridge, 1988. 6. R.J.W. EVANS, Rudolf II and his World. A Study in Intellectual History 1576-1612, Oxford, 1973. 7. B.T. MORAN, The Alchemical World of the German Court. Occult philosophy and Chemical Medicine in the Circle of Moritz of Hessen (1572-1632), Stuttgart, 1991 (Sudhoffs Archiv, Beiheft 29) ; H. BORGGREFE, T. FUSENIG, A. SCHUNICHT-RAWE, Moritz der Gelehrte. Ein Renaissancefürst in Europa, Kassel, Minerva, 1998. 8. S. AKERMAN, Queen Christina of Sweden and her Circle : the Transformation of a Seventeenth-Century Philosophical Libertine, Leiden, 1991. 9. K. TARGOSZ, La cour savante de Louise-Marie de Gonzague et ses liens scientifiques avec la France, Ossolineum, 1982. 10. J. WEYER, Grag Wolfgang II von Hohenhole und die Alchemie, Alchemistiche Studien in Schloss Weikersheim 1587-1610, Sigmaringen, 1992. 11. Voir l’ouvrage collectif Federico II e le scienze, Palermo, Sillerio editore, 1994.
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
combine avec l’idée moderne du prince opérateur culturel et investisseur industriel à l’époque où naît le capitalisme moderne. Il y a une dualité chez ces princes de l’âge maniériste et baroque qui ambitionnent à la fois de maîtriser la réalité par des pouvoirs magiques, et de rendre la science utile pour résoudre les problèmes concrets. Bruce Moran distingue trois aspects de cette activité : le prince collectionneur, le prince savant, le prince praticien12. Le prince collectionneur affirme sa magnificence et sa connaissance du monde par ses cabinets, le Trésor (Schatzkammer), la collection d’œuvres d’art (Kunstkammer) et le cabinet de curiosité (Wunderkammer)13. Le cabinet des merveilles privilégie l’objet rare, surprenant, hors norme. Sa grammaire du réel est délibérément anomaliste. Il décrit un monde où les choses sont des signes d’un ordre caché, perceptibles aux seuls initiés. La qualité maîtresse d’un tel prince est la curiositas. La recherche récente a montré comment la curiositas, que saint Augustin tenait pour une vraie concupiscentia oculorum14, devient à la Renaissance une valeur positive15. Le prince savant pratique la liberalitas et exerce le patronage16, une relation complexe fondée sur la symbolique du don et de la dédicace. Les dédicaces emploient le langage de l’obligation et le don d’un livre, d’un instrument, crée un lien social. Le prince, de son côté, ne distribue pas seulement des pensions, des positions, des titres. Aux hétérodoxes, il assure la protection contre l’Église et l’université. Mais surtout, son appui donne de la crédibilité aux hommes et à leurs réalisations. L’expertum médiéval n’est pas mort, et un remède gagnera en efficacité s’il est employé à la cour. Il arrive que le prince sollicite de ses savants une réponse à l’une ou l’autre question d’administration, mais l’essentiel est de contribuer à l’éclat de son règne. Le prince praticien (prince practitioner) s’investit personnellement dans la pratique scientifique17, monte ses propres projets et met la science au service de ses desseins politiques. Cosme Ier de Médicis crée l’Académie de dessin, réorganise l’université de Pise et son jardin botanique, codifie la pharmacopée et pratique l’alchimie dans sa Fonderia. Guillaume IV de Hesse-Kassel (1532-1592) crée un véritable institut de recherche en astronomie et en horlogerie. Tous ont la passion des machines, des instruments scientifiques, surtout de nivellement, ainsi que des cartes comme instrument politique. Quant à l’alchimie, ses implications économiques ne sont pas négligeables puisque, même si elle échoue, elle produit quantité de substances utiles et la réputation de posséder la Pierre ouvre des lignes de crédit chez les banquiers. On voit s’amorcer ici une politique pour la science et par la science qui investit dans la science non plus seulement pour le prestige, mais pour la mettre au service des grands desseins de l’État et de la prospérité publique. C’est la définition même de ce que l’on appelle aujourd’hui une politique scientifique.
12. B.T. MORAN, « Patronage and Institutions : Courts, Universities and Academies in Germany. An Overview 1550-1750 », dans B.T. MORAN (ed.), Patronage and Institutions, Science, Technology and Medicine at the European Court 1500-1750, Boydell Press, 1991, p. 169-183. 13. B.J. BALSIGER, The Kunst- und Wunderkammer : a catalogue raisonné of collections in Germany, France and England, 15561750, thèse, Pittsburgh, 1970 ; P. FLINDEN, Possessing Nature, Museums, Collecting and Scientific Culture in Early Modern Italy, Berkeley, Los Angeles, Londres, 1994. 14. SAINT AUGUSTIN, Confessions, X, 36. 15. R.J.W. EVANS, A. MARR, Curiosity and Wonder from the Renaissance to the Enlightenment, Ashgate, 2006. 16. Voir ici le livre controversé de M. BAGIOLI, Galileo, Courtier : The Practice of Science in the Culture of Absolutism, Chicago, 1993. 17. B.T. MORAN, « German prince-practitioners. Aspects of the Development of Courtly Science, Technology and Procedures in the Renaissance », dans Technology and Culture, 22 (1981), p. 253-254. 46
ERNEST DE BAVIÈRE ET LA CONTRE-RÉFORME MATHÉMATIQUE Robert Halleux
1. Dans le sillage de Christophe Clavius Il était de tradition, chez les Wittelsbach, de donner aux fils une formation soignée. Le 28 avril 1563, Ernest, âgé de neuf ans, avait été inscrit à l’Université d’Ingolstadt avec ses deux frères aînés Wilhelm et Ferdinand. Les instructions écrites que leur père le duc Albrecht leur avait remises le 21 avril prescrivaient notamment de rechercher un maître spécialisé en cosmographie, géographie, physique et arithmétique. Destiné aux carrières de l’Église, Ernest avait reçu en outre un solide enseignement théologique avec deux professeurs particuliers, Jodocus Castner et André Fabricius. Le 23 mars 1574, Ernest partait à Rome1. Il y fréquenta le Collège Romain, dont la Compagnie de Jésus avait fait un bastion de ce qu’Antonella Romano appelle la ContreRéforme mathématique2. À côté des langues anciennes (latin, grec, hébreu), les Jésuites développaient, dans des collèges choisis, un enseignement mathématique poussé pour intégrer les acquis de la « nouvelle science » à un aristotélisme éclectique mis au service de la foi, mais aussi pour attirer les élites qui se destinaient aux grandes carrières de l’armée ou de la gestion publique. Quoique postérieure, la ratio studiorum de 1586 synthétisait un courant qui s’était consolidé pendant quatre décennies. « Les mathématiques apprennent aux poètes le lever et Portrait de Christophe Clavius. le coucher des astres ; aux historiens la situation et les Dans I. Bullart, Académie des Sciences et des Arts, Bruxelles, 1695. distances des divers lieux ; aux philosophes des exem© Liège, Université, ples de démonstrations solides ; aux politiques des Bibliothèque de Philosophie et Lettres. méthodes vraiment admirables pour conduire les affaires dans le privé et à la guerre ; aux physiciens, les modes et les diversités des mouvements célestes, de la lumière, des couleurs, des corps diaphanes, des sons ; aux métaphysiciens le nombre des sphères et des intelligences ; aux théologiens les principales parties de la création divine, aux juristes et aux canonistes le comput, sans parler des services rendus par le travail des mathématiciens à l’État, à la médecine, à la navigation et à l’agriculture. Il faut donc faire effort pour que les mathématiques fleurissent dans nos collèges aussi bien que les autres disciplines »3. On enseignait donc à la fois la mathematica pura (mathématique-astronomie), mais aussi la mathematica mixta, c’est-à-dire
1. F. SCHMIDT, Geschichte der Erziehung der Bayerischen Wittelsbacher von den frühesten Zeiten bis 1750, Urkunden nebst geschichtlichem Überblick und Register, Berlin, 1892 (Monumenta Germaniae Paedagogica, XIV), p. XL-XLV et 12-27. 2. A. ROMANO, La Contre-Réforme mathématique. Constitution et diffusion d’une culture mathématique jésuite à la Renaissance, Ecole française de Rome, 1999 (Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome, 306). 3. A. ROMANO, op. cit., p. 117.
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
l’ensemble des savoirs mathématisés et mathématisables, y compris des disciplines techniques comme l’hydraulique, la construction des machines, la balistique et la fortification. Fondé en 1551, le Collegio Romano pouvait s’enorgueillir de posséder un des premiers mathématiciens du temps, Christophe Clavius4. Né en 1538 à Bamberg, Clavius avait rejoint la Compagnie à Rome en 1555 à l’âge de dix-sept ans. C’est Ignace lui-même qui l’avait envoyé au Collège de Coimbra où il avait suivi entre 1556 et 1559 les cours de l’aristotélicien Fonseca. Revenu à Rome en 1561, il enseignait les mathématiques depuis 1565 et il avait entamé, depuis 1570, une œuvre scientifique abondante, manuels, commentaires de mathématiciens classiques (Euclide, Sacrobosco) et ouvrages de polémique5. Les matricules du Collège Romain ne recensent que les élèves appartenant à la Compagnie, mais la correspondance de Clavius conservée aux archives de l’Université Pontificale Grégorienne contient des références nombreuses à Ernest6. Le professeur Ugo Baldini, qui en achève l’édition, a eu l’extrême amabilité de m’en communiquer les pièces pertinentes7. Dans une lettre du 1er avril 1611 au P. Christophe Grienberger, adjoint de Clavius, Ernest le priait de saluer « son vénéré précepteur »8. Le 11 avril 1595, dans une lettre écrite en italien, il remerciait Clavius pour l’enseignement qu’il lui avait donné, particulièrement sur Euclide9. De fait, c’est dans les années 1574 que Clavius écrit son grand commentaire à la géométrie d’Euclide. Il est certain que les deux hommes se sont appréciés au point qu’Ernest voulut faire venir son maître à Liège pour y enseigner. Une lettre du supérieur général à Jean Hayus, datée du 16 décembre 1595 signale que des raisons de santé l’empêchent d’envoyer Clavius à Liège comme le prince le souhaitait10. Le 13 janvier 1597, Ernest écrit à Henri de Rantzau, conseiller de Rodolphe II, que Clavius passe pour le père des mathématiques, qu’il est vénéré chez les Espagnols, les Français, les Italiens et le plupart des Allemands11. De son côté, Clavius restait attaché à son élève, et en 1603 un de ses familiers s’informait pour son compte sur les recherches mathématiques du prince12. De fait, leur attitude est la même. Comme l’a montré Eberhard Knobloch, Clavius vise à la clarté, à la simplicité, à l’application pratique. Il n’hésite pas à prendre du recul par rapport aux découvertes nouvelles13. Pratique lui aussi, Ernest, prince manufacturier, s’intéresse d’abord aux applications. Cette formation aura une double conséquence : d’une part les préoccupations mathématiques du prince feront écho à celles de son maître, qu’il ne manquera pas de consulter ; d’autre part, les mathématiciens de son entourage seront, soit recrutés dans le réseau de Clavius, soit intégrés à ce réseau. En 1592, un poète de cour, Jean Polit, évoque un entretien où Ernest disputa de la « très célèbre et très recherchée quadrature du cercle »14. C’était un problème d’actualité. La même année, Joseph Juste Scaliger
4. Sur Clavius, voir A. ROMANO, op. cit., p. 85-180 ; S. ROMMEVAUX, Clavius. Une clé pour Euclide au XVIe siècle, Paris, Vrin, 2005. 5. E. KNOBLOCH, « Sur la vie et l’œuvre de Ch. Clavius », dans Revue d’histoire des sciences, 41 (1988), p. 331-356 ; « L’œuvre de Clavius et ses sources scientifiques », dans L. GIARD (éd.), Les Jésuites à la Renaissance. Système éducatif et production du savoir, Paris, 1995, p. 262-283. 6. E.T. PHILLIPS, « The Correspondence of Father Christoph Clavius s.j. preserved in the Archives ot the Pontifical-Gregorian University », dans Archivum Historicum Societatis Jesu, 8 (1939), p. 193-222. 7. Christoph Clavius, Corrispondenza. Edizione critica a cura di U. BALDINI e P.D. NAPOLITANI, 7 vols in 14 fasc., Pisa, Università di Pisa, Dipartimento di Matematica, 1992 (diffusion restreinte). 8. Voir U. BALDINI, « Galileo nelle lettere dell’Elettore di Colonia e di Ricardo de Burgo a Christoph Grienberger », dans Nuncius, II (1987), p. 1-14, voir p. 12-13. 9. Ernest à Clavius, 11 avril 1595, dans BALDINI-NAPOLITANI, 1, 2, n° 112, p. 115. 10. A. PONCELET, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas, Bruxelles, 1927, t. II, p. 119, n. 2. 11. Ernest, lettre à H. Rantzau, Arnsberg, 13-1-1597, ed. E. NYSTROEM, Epistolae et acta ad vitam Tychonis Brahe pertinentia (Tycho Brahe Opera Omnia, ed. J.L.E. DREYER, t. 14), Kopenhagen, 1928, p. 309-311, ici 310. 12. Editée dans HALLEUX-BERNES, « La cour savante d’Ernest de Bavière », dans Archives Internationales d'Histoire des Sciences, vol. 45 (1995), p. 3-29. Elle peut être datée de 1603 par référence à la publication imminente de l’ouvrage de Clavius sur le calendrier. 13. E. KNOBLOCH, op. cit., p. 337. 14. Sonnets et Epigrammes de Jean Poli J.C. Liégeois, Parmi deux discours latins, l’un de la précellence du roiaume de France, avec une déploration de son misérable estat du aujourd’hui, l’autre sur l’excellence de la cité de Liège. Ensemble une exhortation aux Princes chrestiens pour la guerre contre les Infidèles. A Liège, chez Christian Ouwerx, 1592, petit in 4° de 25 ff. n. ch. 48
ERNEST DE BAVIÈRE ET LA CONTRE RÉFORME MATHÉMATIQUE
avait prétendu le résoudre dans sa Nova cyclometria15 et s’était attiré des répliques, non seulement de Viète et d’Adrianus Romanus, mais aussi de Clavius16. En 1595, Ernest consulte son maître sur la détermination des longitudes. Il avoue rechercher une règle « sûre et facile pour calculer la longitude des régions, villes et cités, pour servir à la géographie »17. La détermination des longitudes, surtout en mer, était cruciale pour le commerce, dans la concurrence que se livraient les flottes anglaise, française, hollandaise, espagnole et portugaise. En 1598, un des premiers actes du gouvernement de Philippe III d’Espagne sera d’organiser un concours international18. En 1609, dans la dédicace à Ernest de son Canon triangulorum sphaericorum, l’illustre Adrianus Romanus, professeur à Louvain, puis à Würzburg19, souligne que les mathématiciens les plus illustres voient en lui un des leurs et il ajoute : « Passerai-je sous silence cette invention divine par laquelle Votre Altesse a établi, entre les poids et les mesures de tous genres, une harmonieuse liaison au point que sous une seule dénomination civile, ou, pour parler en arithméticien, dans une seule progression géométrique, tous les poids, toutes les longueurs, toutes les surfaces, tous les volumes trouvent leur mesure. Certes, tant que les arts libéraux seront en honneur, tant qu’ils seront utiles, tant que le monde luimême subsistera, cette découverte excitera l’admiration des hommes »20. C’est ce grand projet que mit Ernest en rapport avec Kepler. En novembre 1605, Kepler était, une fois de plus, pressé d’argent. Un de ses amis, Herwart von Hohenburg, s’efforça de le recommander au prince par l’intermédiaire du grand veneur de la cour de Bavière21. Mais en décembre, l’électeur est à Prague et Kepler est allé d’initiative lui offrir un exemplaire des Paralipomènes à Vitellion, traité d’optique paru en 160422. Kepler raconte : « L’Électeur avait sous la main un livre Portrait de Johannes Kepler. sur une question mathématique avec les réponses de © Liège, Université, Schöner23, de Zeelst24, de Stevin25, à quoi il demandait Bibliothèque de Philosophie et Lettres. d’ajouter la mienne. Je le fis, en m’excusant beaucoup
15. E.W. HOBSON, Squaring the Circle, a History of the Problem, Cambridge, 1913 ; reprint Chelsea, 1953. 16. E. KNOBLOCH, op. cit., p. 334 et 337. 17. Ernest à Clavius, 11 avril 1595, dans BALDINI-NAPOLITANI, I, 2, n° 112, p. 115-116. 18. Sur ce problème, voir W.J. ANDREWS (ed.), The Quest for longitude, Cambridge (Mass.), 1996. 19. Sur Adrianus Romanus, voir H. BOSMANS, art. « Romain (Adrien) », dans Biographie nationale de Belgique, t. 19, Bruxelles, 1907, col. 848-889 ; P. BOCKSTAELE, art. « Roomen, Adriaan van », dans Nationaal Biographisch Woordenboek, t. II, Bruxelles, 1966, col. 751-756 ; P. BOCKSTAELE, « Adrianus Romanus and the Trigonometric Tables of Georg Joachim Rheticus », dans Amphora, Festschrift für Hans Wussing zu seinem 65. Geburtstag, Bâle, Boston, Berlin, 1993, p. 55-66. 20. Adrianus Romanus, Canon triangulorum sphaericorum, Mayence, 1609 21. Lettre de Herwart von Hohenburg à Kepler, Munich, 21 novembre 1605, dans Johannes KEPLER, Gesammelte Werke (cité ciaprès K.G.W.), t. XV, Munich, 1951, n° 360, p. 281-282. 22. Voir l’édition de C. CHEVALLEY, Johan Kepler, Les fondements de l’optique moderne. Paralipomènes à Vitellion (1604), Paris, 1980. 23. Johannes Schöner (1477-1547) est connu comme astronome, astrologue et cartographe. Il ne s’agit donc pas ici d’une consultation directe, mais de notes prises dans un des ouvrages de Schöner. 24. Sur Zeelst, voir plus bas note 48. 25. Le texte de Stevin semble perdu, et le nom d’Ernest n’apparaît pas dans l’édition hollandaise de ses œuvres complètes. 49
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
L’algèbre de Christophe Clavius, traduit par Gilles Guillion, Liège 1612. © Liège, Université, Bibliothèque de Philosophie et Lettres.
L’arithmétique avec les gettons et la croye de Gilles Guillion, Liège 1604. © Liège, Université, Bibliothèque de Philosophie et Lettres.
de la liberté que je prenais. Mais lui, d’autant plus charmé de ma réponse, me combla d’une générosité encore plus abondante et me reçut deux fois »26. Ernest lui offrit son portrait en or et une coupe d’or de trois marcs27. Le rapport de Kepler, encore inédit, se trouve conservé aujourd’hui dans les archives de Pulkovo28. Parallèlement, l’entourage scientifique d’Ernest s’intègre ou se recrute dans le réseau Clavius. En 1608, Clavius publiait son Algèbre. Quatre ans plus tard, sa traduction française paraissait à Liège29. Elle était
26. Kepler à Herwart von Hohenburg, 13 janvier 1606, dans K.G.W., t. XV, n° 368, p. 295-300, voir p. 299. 27. Même lettre, ibid., p. 298 : Cum iam defunctus esse omni labore viderer (de Salario extorquendo nihil dicam) ecce Coloniensem Electorem, qui me per octiduum amplius exercuit in questione Mathematica, donataque aurea sui imagine cum poculo trium Marcarum necessitatem mihi imposuit identidem officiis causa comparendi. 28. Manuscrits Kepler à Pulkovo, t. V, f. 189-204. 29. L’Algèbre de Christophe Clavius, de la Société de Iesus Mathematicien. Sommairement recueillie et traduite du latin par Gille Guillion Prestre Liegeois du Collège de S Martin. Enrichie d’un Auant propos, traictant de tout ce qui est requis és nombres, pour la cognoissance de l’art. Outre plus d’une amplification de l’Algèbre à toutes les reigles sur lesquelles l’Arithmeticque se fonde, demonstrant par là quelle est sa preeminence. Le tout, avec tel ordre, et esclaircissement des liens les plus abscurs, que l’amateur de la science n’aura occasion de se mescontenter, Liège, Leonard Streel, 1612. 50
ERNEST DE BAVIÈRE ET LA CONTRE RÉFORME MATHÉMATIQUE
l’œuvre de Gille Guillion, curé de sainte Marguerite30, qui relate dans sa préface la genèse de l’œuvre31. Après avoir enseigné l’arithmétique aux enfants et produit un manuel élémentaire32, Guillion découvrit l’œuvre du maître romain et se convainquit que l’algèbre « est le seul refuge pour résouldre les plus difficiles et les plus obscures propositions qui se trouvent cachées sous la couverture des nombres ». Il entreprit donc de la traduire du latin « ayant recours à l’auteur en difficultés occurrentes ». De fait, on trouve dans les pièces liminaires une lettre de Guillion à Clavius33 et une réponse de ce dernier34, qui souligne le zèle de Guillion et consent bien volontiers « à ce qu’il la traduise dans sa langue pour qu’elle puisse être utile à ceux qui ignorent le latin ». 2. La construction des instruments scientifiques L’Algèbre liégeoise se termine par diverses pièces de vers dont l’une, de Guillion lui-même, à Lambert d’Ameri (Damery), mathématicien et graveur liégeois. Te quoque crede operis d’Ameri Lamberte manebit Insolitos propter gloria magna typos Belgica te solum qui cossica signa pararet Repperit aut faciles ad mea scripta cubos Ipsa quoque inuentrix artis Germania tanta Dicitur ad numeros obstupuisse tuos Plus minus ad signum cum Radicale reponis Ostendis magna quantus in arte fias Vivasque novosque emitte Globos, lunaeque recessus Accessus Solis perdoceasque nouos Toi aussi, crois-le, Lambert d’Ameri, une grande gloire t’attendra à cause de tes caractères inhabituels.
30. Sur Gille Guillion, voir C. LE PAIGE, « Notes pour servir à l’histoire des mathématiques dans l’ancien pays de Liège », dans BIAL, 21 (1890), p. 493 ; VALERE ANDRE, Bibliotheca Belgica, p. 26, attribue à Gille Guillion les ouvrages suivants, en français, demeurés inédits : Théorie et pratique de la fondation et de la fortification des villes ; Epitome d’Arithmétique ; Optique ; Astronomie en français, avec les cycles solaires et lunaires. 31. Dédicace à Arnold de Bocholtz, datée du 2 octobre 1612 : « Aiant avec les preceptes de la Philosophie, un petit gousté de la douceur de l’art, en ay prins telle accointance que depuis ce temps là (apres les estudes requis à ma profession) me suis efforcé d’y trouver contentement. L’effet s’en est suivy, en ce que nostre Autheur apres avoir soustenu des grans et continus trauaux en la Mathematique, a mis en lumiere en sa grande vieillesse son Algebre comme le comble de tous ses labeurs. L’occasion s’estant offerte ay fueillete l’œuvre en toute diligence, ayant recours à l’Autheur en difficultés occurentes et le voile de l’ignorance osté, l’expérience m’a monstré que l’Algebre est le seul refuge pour resouldre les plus difficiles et obscures propositions qui se trouvent cachés sous la couverture des nombres, là où l’arithmetique ne peut aucunement monstre comme très bien dit l’Autheur. Cecy m’a esguillonné, Monseigneur, de traduire ceste œuvre, avec adveu de l’Autheur. Daté de vostre maison és fauxbourgs de S Laurent lez Liege ce 2 d’octobre 1612 ». 32. Gille GUILLION, Institution de l’arithmétique avec les gettons et la croye, Liège, Streel, 1604. 33. Cette lettre n’est pas éditée par Baldini-Napolitani. La voici in extenso. f.n.c. (5) v. Requeste du Translateur, desirant l’adveu de l’Autheur. Admodum Rdo ac eximio Dno ac Patre Christophoro Clavio Bambergensi e Societate Iesu Mathematicarum scientiarum peritissimo. Perbelle quidem, Clarissime Domine tanquam saepius expertus in Proemio tuae nuper editae Algebrae Arithmetices Studiosum depinges : quot enim bone Deus, inextricabiles in numeris reperiuntur nodi, quorum in solutione frustra quis laborat ? atque ut verbis utar tuis, ad has ac illas animum refert studiosus regulas, expertus singulas, recognoscit singulas, torquet sese ac conficit, ad extremum inanes labores suos sentit, infelix studiumque damnat. Haec, inter reliquas non parvas, causa fuit vel praecipua cur Romam venirem. Acceperam V. R. emissurum Algebram in lucem, et ilico, contemptis omnibus viarum difficultatibus, accinxi me itineri, ut huius pretiosi thesauri particeps fierem. Opus vidi, perlegi frequentius, in dubiis tamquam sitibundus, ad fontem cucurri demum ex ignorantiae latebris exiliens, percepi frustra Arithmeticum angi, cui hoc adeo praeclarum, familiare non esset studium. Nunc autem cum plurimos norim huius avidos, linguae Latinae tamen insolentes, proposui si per R. V. licuerit, Algebrae vestem dare gallicam : sed in hoc, ne mihi labor inanis fiet iudicium requiro vestrum. Tu statue, rescribe ac vale. Ab amicissimo tuo. Egidio Guillion Leodio. Romae, nono calend. Maii, anni 1610. 34. Cette lettre n’est pas éditée par Baldini-Napolitani. La voici in extenso. R. P. Clavii responsio. Magnifice D. Egidi, cognovi hic in urbe indefessam tuam diligentiam in perlegendo meae Algebrae opusculo. Placet itaque, ut illud in nativam tuam linguam transferas, ut iis etiam qui Latinam linguam ignorant possit prodesse. Christophorus Clavius Bambergensis e Societate IESV. Dans la dédicace qui suit, Guillion annonce un livre sur L’usage de la reigle et du compas, avec démonstrations géométriques. 51
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
C’est toi seul que la Belgique a trouvé pour préparer les signes cossiques ou des cubes appropriés à mes écrits. La Germanie elle-même, si grande, et inventrice de l’art a été, dit-on, stupéfaite devant tes nombres. Tu replaces le plus le moins au signe avec le radical ; et tu montres combien tu es grand dans le grand art. Vis et produis de nouveaux globes, et enseigne de nouveaux reculs de la lune et les avances du soleil. De ce poème, il ressort que Lambert Damery était le seul en Belgique à savoir graver les caractères cossiques, c’est-à-dire algébriques (de l’italien cosa qui désigne l’inconnue, le x d’une équation) et qu’il construisait aussi des globes et des images du ciel, cartes ou astrolabes. Damery n’appartient pas à la famille qui donnera les peintres Walter (†1678) et Jacques (†1678)35. On sait que les constructeurs d’instruments scientifiques se recrutaient souvent chez les graveurs. Le manuscrit français 2058 de la Bibliothèque Nationale contient la description par Damery d’un de ses instruments, le carré géométrique36. Un astrolabe non signé, datable des environs de 1610, et conservé au Musée de la Vie Wallonne37, lui est attribué par Henri Michel. D’autre part, Damery grava l’astrolabe équinoxial du jésuite Odon Van Maelcote, dont un exemplaire (ou un exemplaire apparenté), daté de 1614, est conservé à l’Observatoire Royal de Belgique38. Odon Van Maelcote (1572-1615) est un personnage considérable, correspondant de Kepler et de Galilée39. La correspondance de Clavius permet de l’intégrer au milieu d’Ernest. Après son noviciat à Tournai et sa théologie à Louvain, il enseigna le grec à Liège en 1596-97, la poésie à Anvers en 1598. De 1599 à 1604, il se trouvait à Liège où il enseignait les cas de conscience au séminaire40. Le 19 octobre 1600 et le 18 janvier 1601, il soumet à Clavius deux projets d’astrolabes, c’est-à-dire probablement des dessins commentés41. Le 16 février, le maître romain lui adresse ses critiques détaillées42. C’est peut-être pour cela que Maelcote ne fera publier son ouvrage qu’en 1607 à Bruxelles par les soins de Léonard Damery, le fils de Lambert43. Dans sa préface, Léonard mentionne que son père en a gravé un exemplaire, mais on ne sait s’il s’agit à ce moment d’un instrument matériel ou d’une plaque d’impression44. Dans cette même lettre, Clavius insistait pour que Van Maelcote le rejoignît à Rome45 (de fait, il y vint fin 1601 pour enseigner l’hébreu et suppléer Grienberger, parti au Portugal, et il fit à partir de 1603, en alter-
35. Voir ci-dessous la notice de Pierre-Yves Kairis. 36. Paris, Bibliothèque Nationale, ms français 2058 (Mazarin). Livre contenant les parties et usages du quarré géométrique par Lambert Damery, liégeois, XVIIe siècle. 37. Liège, Musée de la Ville Wallonne, coll. Max Elskamp, n° 35 ; voir H. MICHEL, Les cadrans solaires de Max Elskamp, Liège, Musée de la Vie Wallonne, 1966, p. 65. 38. Bruxelles, Observatoire Royal de Belgique, Astrolabe signé Lambertus Damerius faciebat 1614. Voir H. MICHEL, Un astrolabe de Lambert Damery, Ciel et Terre, LV, 3 (1939), p. 86-93 ; V. RASQUIN, La mesure du temps dans les collections belges. Les instruments non mécaniques, Catalogue d’exposition à la Société Générale de Banque, Bruxelles, 1984, p. 45, n° 15 ; H. VAN BOXMEER, Instruments anciens de l’Observatoire Royal de Belgique, Bruxelles, 1996, p. 12-13. Le rapprochement avec le modèle de Van Maelcote est de M. Rasquin. 39. Sur Van Maelcote, voir C. LE PAIGE, art « Maelcote (Odon van) », dans Biographie Nationale, t. 13 (1894-95), col. 43-45 ; SOMMERVOGEL, V (1894), col. 281-282 ; XII (1960), col. 855 ; P.GUERIN, « Professeurs au séminaire épiscopal de Liège de 1598 à 1604 », dans Bulletin trimestriel du Cercle historique de Fléron, septembre 1996, p. 69-70 d’après des documents inédits (registre du noviciat de Tournai, catalogues et lettre mortuaire). 40. P. GUÉRIN, loc. cit. 41. Les lettres, aujourd’hui perdues, sont citées en référence dans la lettre de Clavius. 42. Clavius à Van Maelcote à Liège, 16 février 1601 dans BALDINI-NAPOLITANI, IV, p. 124-125, n° 170. 43. Astrolabium Aequinoctiale, Odonis Maelcotti Bruxellensis e soc. Jesu, Per modum compendii a Leonardo Damerio Leodiensi in lucem editum, Bruxelles, Velpius, 1607 in 8° de 8 ff. n. ch. 1 pl. (Paris, B.N., V20732). 44. Odon VON MAELCOTE, Astrolabium aequinoctiale, 1607, préface « Je t’apporte cet astrolabe de toi gravé sur cuivre avec précision par mon père Lambert Damery, etc. ». S’agit-il d’une planche gravée ou d’un astrolabe matériel ? 45. Lettre citée n. 63. Si tui superiores cum P. N. Generali agerent ut in urbem vocaveris (lire vocaverit) donec vivo, res mihi esset gratissima. Nam ut video habes ingenium ad studia mathematica aptissimum. Cura ergo diligenter ut aliquando possis venire. 52
ERNEST DE BAVIÈRE ET LA CONTRE RÉFORME MATHÉMATIQUE
nance avec Grienberger, le cours public de mathématique46). Enfin, Clavius y priait Van Maelcote de saluer Ernest, si possible, ainsi que l’astronome Gerard Stempel de Gouda. Celui-ci appartenait de longue date à l’entourage d’Ernest. Dès 1596, pourvu d’un canonicat de Cologne, il envoyait à Clavius son premier ouvrage : une table gnomonique adaptée au carré de Jean Curtius de Senfteneau47. En 1601, au palais de Liège, il préparait avec le graveur Adriaan Zeelst un superbe ouvrage qui parut chez Ouwerx en 1602 Utriusque astrolabii tam particularis quam universalis fabrica et usus48Dans cet ouvrage, ils s’efforcent de perfectionner l’astrolabe « particulier » de Johann Stoefler (1512) et l’instrument « universel » mis au point par Gemma Frisius et décrit par son fils Cornelius Gemma dans le De astrolabio catholico de 1556. La différence des deux instruments réside dans le fait que l’astrolabe ordinaire nécessitait un tracé spécial pour chaque latitude tandis que Gemma Frisius, grâce à une projection stéréographique particulière, avait élaboré un instrument convenant à toutes les latitudes. Stempel les simplifie tous deux et montre qu’on peut résoudre tous les problèmes astronomiques de Stoefler et de Gemma Frisius en ne se servant que d’un seul tympan. Les observations sont toutes datées de Liège 1599. Le livre est illustré d’admirables gravures de Zeelst, notamment d’un modèle réduit d’astrolabe en papier découpé. La bibliothèque de l’Université de Liège possède une copie reliée aux armes de Maximilien, archiduc d’Autriche, cousin d’Ernest, qui pourrait être un exemplaire de présentation49.
Adrian Zeelts, face d’un astrolabe, vers 1600 (Cologne, Kölnisches Stadtmuseum). © Koenraad Van Cleempoel.
46. Sur l’activité de Van Maelcote au Collège Romain, voir U. Baldini, « La nova del 1604 e i matematici e filosofi del Collegio Romano », dans Annali dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza, 6 (1981), 2, p. 63-97. 47. L’exemplaire offert à Clavius, aujourd’hui conservé à la Bibliothèque Nationale de Rome (7-8-E-32, 1), est décrit par BALDININAPOLITANI, IV, 2, p. 70. 48. G. STEMPEL, A. ZEELST, Utriusque astrolabiit tam particularis quam universalis fabrica et usus, sine ullius Retis aut Dorsi adminiculo, Liège, Chr. Ouwerx, 1602. 49. Notice par C. OPSOMER, dans La reliure, parure du livre, Liège, 1991, n° 22 , p. 30. 53
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Quelques années plus tard, un autre membre du réseau de Clavius, le constructeur d’instruments et mathématicien Jean Eutel Zugmesser (ou Zukmesser), rejoindra le cercle d’Ernest. Ami et correspondant de Van Maelcote et de Grienberger, il correspondit avec Clavius en 1604 alors qu’il était au service de Georg Fugger50. Zugmesser et impliqué dans les controverses sur les origines du compas de proportion. Il nous est en effet surtout connu par l’opuscule que Galilée publia en 1607 contre Capra51 pour réclamer la priorité dans l’invention du compas de proportion. Galilée, à l’en croire, aurait inventé l’instrument dès 1594, l’aurait fait fabriquer en 1599 et en aurait distribué certaines copies. En 1603, Zugmesser, à Padoue, aurait montré un compas de proportion, partiellement semblable à celui de Galilée, dont il se prétendait inventeur. Selon Galilée, Zugmesser confronté avec lui aurait été incapable d’expliquer les similitudes, et ses papiers auraient montré qu’il connaissait Galilée. Capra aurait quant à lui trouvé ses informations chez Zugmesser. Rien d’étonnant, dès lors, que l’on retrouve Zugmesser parmi les ennemis de Galilée. Toujours est-il que ce genre d’instruments fut étudié dans l’entourage du prince, puisque le savant gantois Liévin Hulsius lui dédie en 1605 la traduction latine de son ouvrage sur les instruments mathématiques et sur le compas de réduction de Jost Bürgi52. De fait, Ernest collectionne les instruments scientifiques et en stimule la construction. À Liège, la vieille tradition mosane de gravure du métal53 disposait d’un matériau noble, le laiton ou cuivre jaune, un alliage de cuivre et de zinc produit par cémentation du cuivre avec la calamine (carbonate de zinc), abondante dans les vallées de la Vesdre et de la Meuse. Au palais d’abord, puis en son château d’Outre-Meuse, il possède le cabinet de physique et de mathématique de Gérard Drunaeus54, chanoine prémontré de Tongerlo mort en 1601, qui avait laissé en manuscrit des tables de sinus, d’ascensions droites et obliques, des tables de parallaxes, de levers et de couchers, des traités du quadrant et de l’astrolabe. Adrianus Romanus dit avoir vu en 1604, au palais de Liège, la sphère et l’astrolabe de Gemma Frisius55, c’est-à-dire, sans doute, deux produits choisis du célèbre atelier d’Arsenius56. En 1615, le voyageur Philippe de Hurges admirait encore la bibliothèque d’Ernest et ses instruments de mathématiques57. En 1619, un autre voyageur, Pierre Bergeron, remarqua dans une galerie « deux globes de prodigieuse grosseur, faicts à la main, puis des sphères et quantité de cartes géographiques qui estoient à ce prélat »58. 3. Ernest, Galilée et la lunette La collection d’instruments va de pair avec un intérêt bien attesté pour l’astronomie d’observation. En 1597, au moment où l’illustre Tycho Brahé, quittant son observatoire d’Uraniborg, était l’hôte du comte de Rantzau, Ernest usa de son crédit, qui était grand, auprès de Rodolphe II, pour le faire inviter à la cour de Prague. Dans une lettre à Rantzau, le prince-évêque spécifie que si l’empereur n’est pas assez généreux
50. Johann Zukmesser à Christoph Clavius, 17 mai 1604 dans BALDINI-NAPOLITANI, V, 1, p. 100-101, n° 219 (il lui écrit praeceptori suo) ; Georg Fugger à Christoph Clavius, 8 juin 1605, Ibid., p. 158-159, n° 253 ; Iohann Reinhard Ziegler à Christoph Clavius, Ibid., VI, 1, p. 45-46, n° 262. 51. GALILEE, Difesa contro alle calunnie e imposture di Baldessar Capra, Venise, 1607 ; réimpr. dans les Opere di Galileo Galilei, t. II, p. 513-601. Analyse incomplète du débat dans G. MONCHAMP, Galilée et la Belgique, p. 17-23. 52. Liévin HULSIUS, Tractatus primus instrumentorum mechanicorum ocularis demonstratio novi Instrumenti, Planimetrum dicti, Frankfurt, 1605. 53. S. COLLON-GEVAERT, Histoire des arts du métal en Belgique, Bruxelles, 1951 (Académie Royale de Belgique, Classe des Beaux-Arts, mémoires, collection in-8°, 2e série, t. VIII). 54. Sur Drunaeus, voir FOPPENS, Bibliotheca Belgica, I, p. 349 ; VANDER MEERSCH, art. « Drunaeus », dans Biographie Nationale, VI, p. 181 ; A. QUETELET, Histoire des sciences mahématiques et physiques chez les Belges, Bruxelles, 1864, p. 128. 55. Adrianus Romanus, op. cit., voir n. 37. 56. K. VAN CLEEMPOEL, A Catalogue Raisonné of Scientific Instruments from the Louvain School 1530 to 1600, Turnhout, Brepols, 2002 (De diversis artibus, 28). 57. H. MICHELANT, Voyage de Philippe de Hurges à Liège et à Maestricht en 1615, Liège, 1872, p. 102. 58. H. MICHELANT, Voyage de Pierre Bergeron ès Ardennes et Pays-Bas en 1619, Liège, 1875, p. 131. 54
ERNEST DE BAVIÈRE ET LA CONTRE RÉFORME MATHÉMATIQUE
envers l’astronome danois, lui-même y pourvoira avec le plus grand empressement59. Songea-t-il à faire venir Tycho à Liège ? On ne peut le dire. Dans les années 1609, les techniques astronomiques furent bouleversées par l’invention de la lunette. Les origines de cet instrument sont obscures. C’est probablement dans le milieu des artisans hollandais que naquit l’idée d’ajuster une lentille convexe et une lentille concave aux deux bouts d’un tube en carton. L’outil se répandit dans le milieu des ingénieurs militaires et des artilleurs60, mais c’est Galilée, qui, le premier sans doute, le tourna vers le ciel. Au début de l’année 1610, Galilée publiait son Sidereus nuncius, le « messager astral ». Il y décrivait sa découverte des quatre satellites de Jupiter ou planètes médicéennes grâce à la lunette61. La lunette fournissait aux coperniciens un argument de poids, Galilée écrivait : « En outre, nous tenons un argument excellent et lumineux pour ôter tout scrupule à ceux qui, tout en acceptant tranquillement la révolution des Planètes autour du Soleil dans le système copernicien, sont tellement perturbés par le tour que fait la seule Lune autour de la Terre – tandis que ces Planètes accomplissent toutes deux une révolution annuelle autour du Portrait de Galilée. Dans Galileo Galilei, Systema Cosmicum, 1635. Soleil – qu’ils jugent que cette organisation du monde © Liège, Université, doit être rejetée comme une impossibilité. Maintenant, Bibliothèque de Philosophie et Lettres. en effet, nous n’avons plus une seule Planète tournant autour d’une autre pendant que toutes deux parcourent un grand orbe autour du Soleil, mais notre perception nous offre quatre Étoiles errantes, tournant autour de Jupiter, comme la Lune le fait autour de la Terre, tandis que toutes poursuivent ensemble avec Jupiter, en l’espace de douze ans, un grand orbe autour du Soleil »62. À Prague, Kepler prépare, sans avoir les mêmes moyens d’observation que Galilée, un examen critique du Nuncius sidereus. C’est la Dissertatio cum nuncio sidereo qui paraîtra en mai63. Entre temps, Prague est le théâtre d’une véritable agitation anti-galiléenne, récemment analysée par Isabelle Pantin64. Zugmesser est un des détracteurs les plus actifs. Le 19 mars 1610, Galilée écrit à Belisario Vinta qu’Ernest de Bavière lui a demandé une lunette et qu’il pense lui envoyer une des rares bonnes qu’il possède65. Nous ne savons pas quand la lunette arriva, pas davantage si elle fut précédée, accompagnée ou suivie du Sidereus nuncius. Toujours est-il qu’au printemps, Ernest est à Prague avec Zugmesser et que le 28 avril 1610, Martin Hasdale annonçait à Galilée, de Prague, qu’il venait de rencontrer Zugmesser66. Celui-ci lui a appris qu’Ernest a reçu de Galilée deux copies du 59. Ernest, lettre à H. Rantzau, Arnsberg, 13-1-1597 ed. E. NYSTROEM, Epistolae et acta ad vitam Tychonis Brahe pertinentia (Tycho Brahe Opera omnia, ed. J.L.E. DREYER, t. 14), Kopenhagen, 1928, p. 309-311, ici 310. 60. A. VAN HELDEN, The invention of the Telescope, Philadelphia, American Philosophical Society, 1977 (Transactions of the American Philosophical Society, 67, 4). 61. GALILEE, Sidereus nuncius, Venise, 1610, rééd. dans les Opere di Galileo Galilei, ed. naz., t. III ; voir la belle traduction commentée du regretté Fernand Hallyn, Le message des étoiles, Paris, 1992. 62. GALILEE, Le messager des étoiles, éd. citée, p. 164. 63. J. KEPLER, Dissertatio cum nuncio sidereo, Prague, 1610, éditée dans les K.G.W., t. IV, p. 283-311 ; éditée, traduite et commentée par I. PANTIN, Kepler, Discussion avec le messager céleste. Rapport sur l’observation des satellites de Jupiter, Paris, 1993. 64. J. KEPLER, Discussion avec le messager céleste, éd. citée, p. XXVIII-LXXVIII. 65. Opere di Galileo Galilei, ed. naz., t. X, n° 277, p. 297-302, voir p. 298 et 301. 66. Ibid., t. X, n° 303, p. 344-346. 55
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Sidereus nuncius et qu’il a demandé à Zugmesser de consulter un expert de Bologne, l’astronome Magini. Zugmesser lui-même suspend son jugement tant qu’il n’a pas essayé l’instrument, mais a montré à Hasdale la réponse de Magini au prince : Galilée s’est trompé parce que l’observation a la lunette est trompeuse. Magini, observant le Soleil, avec une lunette et des verres colorés, a vu trois soleils. Le 31 mai67 et le 7 juin, Hasdale ajoute des précisions68. Zugmesser ne veut pas se déclarer contre Galilée, mais il a fini par avouer qu’il avait été gravement offensé par le livre contre Capra. Hasdale offre ses bons services pour le réconcilier avec Galilée, car Zugmesser médite d’écrire contre lui et d’être son ennemi mortel. Le 5 juillet 1610, Hasdale informe Galilée que Zugmesser exhibait à Prague trois lettres signées de Magini et de vingt-quatre astronomes de Bologne qui affirment n’avoir rien vu à la lunette69. Lorsque Zugmesser part avec son patron pour Vienne, il laisse la cour de Prague tout à fait montée contre Galilée (juillet 1610) et Kepler ne sait comment résister à cette opposition70. En août, Ernest revient à Prague avec la lunette. Au témoignage de Kepler lui-même71 : « Au moins d’août, le révérendissime et sérénissime archevêque de Cologne, électeur et duc de Bavière, Ernest, revenant de Vienne en Autriche, me prêta un instrument qu’il disait avoir reçu de Galilée lui-même, cependant il le mettait loin après d’autres qu’il avait avec lui sous le rapport de la commodité qu’il pouvait en tirer pour voir, se plaignant que les étoiles fussent représentées carrées ». Cet instrument permit à Kepler d’observer les satellites de Jupiter à partir du 30 août. « Après avoir réalisé ces observations et suffisamment confirmé la fiabilité des rapports de Galilée, je restituai l’instrument, car on pensait que l’Électeur devait partir »72. La Narratio de observatis a se quatuor Iouis satellibus erronibus est datée du 11 septembre 161073. Au même moment, Kepler écrivait sa Dioptrique où il étudie l’action des lentilles simples et composées. Il remet le Galileo Galilei. manuscrit à l’électeur en septembre 1610 pour qu’il le Sidereus Nuncius, Venise, 1610. publie74. La dédicace de l’ouvrage à Ernest de Bavière est © Liège, Université, datée du 1er janvier 161175. Kepler y reconnaît non seuleBibliothèque de Philosophie et Lettres. ment l’intérêt de l’Électeur pour les lunettes, mais même
67. Ibid., t. X, n° 324, p. 365-367. 68. Ibid., t. X, n° 328, p. 370. 69. Ibid., t. X, n° 351, p. 390-391. 70. Martin Hasdale à Galilée, Prague, 12 juillet 1610, Ibid., t. X, n° 360, p. 401-402. 71. J. KEPLER, Narratio de observatis a se quatuor Iouis satellitibus erronibus, Francfort, 1610, dans les K.G.W., t. IV, p. 315-325, voir p. 318-319 ; édité, traduit et commenté par I. PANTIN, op. cit., p. 34-41, voir p. 37. 72. Id., Op.cit., dans les K.G.W., t. IV, p. 322 ; dans l’édition d’I. PANTIN, p. 41. 73. Ibidem. 74. Voir la lettre de Kepler à son correspondant inconnu, de Dresde, 18 décembre 1610, dans les K.G.W., t. XVI, n° 600, p. 345353, voir p. 350 ; Kepler à Galilée, décembre 1610, dans les Opere di Galileo Galilei, ed. naz., t. X, n° 449, p. 506-508 ; Kepler à Galilée, 9 janvier 1611, Ibid., t. XI, n° 455, p. 15-17, voir p. 16-17. 75. J. KEPLER, Dioptrice, Augsbourg, 1611, dans les K.G.W., t. IV, p. 329-414, voir p. 333. 56
ERNEST DE BAVIÈRE ET LA CONTRE RÉFORME MATHÉMATIQUE
son activité très concrète dans ce domaine. « Je me suis attelé à cette tâche à un moment où mon esprit, engourdi dans un froid lamentable, a été réchauffé par le soleil magnificent de la présence de Votre Altesse Révérendissime et Sérénissime et où la bienveillance de ses entretiens et ses fréquentes exhortations m’ont tiré du sommeil comme un nouveau Mercure. Les machines à main, aussi agréables qu’ingénieuses, de votre mathématicien et chambellan le noble M.J. Zugmesser et les très artificieux polissages de verres où je voyais votre Altesse prendre plaisir m’ont en quelque sorte provoqué à l’émulation dans ce travail »76. Dans la suite, les efforts d’Ernest semblent se concentrer bien moins sur l’enjeu cosmologique que sur les perfectionnements des instruments d’observation. Le 24 mars 1611, Ernest écrit à son maître Clavius77 en lui envoyant un traité, peut-être la Dioptrique de Kepler. La lunette qu’il a reçue de Galilée ne lui permet pas de rencontrer les exigences de perfection décrites dans cet ouvrage. Il la juge inférieure à celle que Clavius a reçue de Venise (c’est-à-dire une lunette d’Antonio Santini). C’est pourquoi Ernest s’adresse à Clavius, afin de s’en procurer une semblable. Le 1er avril 1611, Ernest interroge Christophe Grienberger, l’adjoint de Clavius, sur les moyens mathématiques de perfectionner les lentilles78. « Nous avons appris de divers côtés comment les observations par le mathématicien Galilée de nouvelles planètes ont été aussi trouvées vraies par beaucoup d’autres. Comme nous avons un furieux désir d’avoir une connaissance certaine de cela, vous nous feriez un grand plaisir si vous acceptiez de nous communiquer dans les prochains jours vos observations et votre jugement. Et quoique nous ayons obtenu de Galilée lui-même un tube ou instrument d’observation, cependant celui-là n’est pas de la perfection que nous supposons que possèdent les autres en ceci qu’il ne montre pas seulement certaines étoiles à trois ou quatre côtés lorsqu’il tourne et est employé, mais pour les figures terrestres que l’on veut regarder à distance, il ne suffit pas et les montre dans une proportion déformée. C’est pourquoi il vous est gentiment demandé si vous pourriez contribuer à un instrument plus parfait ou nous faire savoir le mode de composition et comment les verres se comportent en concavité et convexité selon le diamètre. Car nous pensons nous y exercer nous-même. Tous les frais supplémentaires vous seront payés avec reconnaissance, et nous voulons reconnaître et élargir toutes les grâces possibles pour vous-même et toute la Société ». Or, ces questions, directement liées à l’affaire Galilée, agitaient le Collège Romain. Dans son commentaire à la Sphère de Sacrobosco, Clavius avait mentionné « le nouveau tube amené de Belgique qui permet de voir beaucoup plus d’étoiles qu’à l’œil nu »79. Le 17 décembre 1610, il avait écrit à Galilée qu’il avait pu, de la sorte, vérifier l’exactitude de ses observations80. D’autre part, Ernest se procure au prix fort de cent écus une autre lunette de Galilée par l’intermédiaire du frère de l’astronome, Michelangelo Galilei, musicien à la cour de Bavière81. De ces échanges épistolaires, il ne s’ensuit pas qu’Ernest ait partagé les idées héliocentriques de Galilée. Comme les autres princes praticiens82, il a préféré la recherche de la précision instrumentale à la spéculation cosmologique. L’intérêt pour le polissage des lentilles, la construction d’un nouveau modèle de polissoir et le travail même d’Ernest à l’atelier révèlent un goût prononcé pour les machines. Aux dires d’Adrianus Romanus83 « Les diverses machines utiles pour la guerre et pour la paix, d’une invention admirable, d’une exécution parfaite, prouvent votre habileté et sont telles, que ceux qui prennent le titre glorieux d’ingénieurs sont remplis d’admiration en les voyant et avouent ingénument que ce qu’ils regardaient comme leurs inventions les plus sublimes pâlissent au prix des vôtres ». L’ambiguïté du concept de machine, au tournant des deux siècles, et la fascination qu’il exerce, se reflètent dans le contenu des ouvrages pittoresquement intitulés Théâtres de machines. On y trouve des engins de guerre ou des automates hérités de la tradition antique et 76. J. KEPLER, op. cit., éd. Cit., p. 332. 77. Opere di Galileo Galilei, ed. naz., t. XI, n° 500, p. 73. 78. Lettre publiée par U. BALDINI, art. cité. 79. CLAVIUS, La Sphaeram Ioannis de Sacrobosco commentarium, dans Opera Mathematica, III, Mayence, 1611-12, p. 75. 80. Clavius à Galilée, 17 décembre 1610, Opere di Galileo Galilei, ed. naz., t. X, n° 437. 81. Lettre de Michelangelo Galilei à Galilée dans les Opere di Galileo Galilei ed. naz., t. XI, n° 522, p. 95-97, voir p. 97. 82. B.T. MORAN, « Princes, Machines and the Valuation of Precision in the XVIth Century », dans Sudhoffs Archiv, 61 (1977), p. 209-228. 83. A. ROMANUS, Canon triangulorum., préface. 57
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
médiévale, mais aussi des machines minières et métallurgiques – treuils, pompes, bocards, laminoirs – requis par l’industrie capitaliste à ses débuts84. D’engins de guerre, il est question dans les Poliorcétiques que Juste Lipse dédie au prince en 159685. Ces dialogues sur l’art militaire des anciens sont censés se dérouler dans une propriété d’Ernest en Outre-Meuse et mettent en scène des érudits liégeois, Jean Furius, Jacques Carondelet, Pierre Oranus86 et Charles de Billehé. La matière est antique, mais le goût est moderne.
Machines de siège. Dans Juste LIPSE, Poliorceticôn siue de Machinis, tormentis, telis. Libri quinque, Anvers, 1596. © Liège, Université, Bibliothèque de Philosophie et Lettres. 84. R. HALLEUX, article « Machine », dans M. BLAY, R. HALLEUX, La science classique, XVIe-XVIIIe. Dictionnaire critique, Paris, Flammarion, 1998, p. 581-589. 85. J. LIPSE, Poliorceticôn siue de Machinis, tormentis, telis. Libri quinque, Anvers, 1596. 86. Pierre Oranus est connu comme antiquaire et collectionneur. Le Musée Curtius à Liège conserve la « coupe Oranus » incrustée de monnaies d’or antiques. 58
ERNEST, DISCIPLE DE PARACELSE ET ALCHIMISTE Robert Halleux
1. Dans le sillage de Paracelse À l’extrémité du palais, Philippe de Hurges put encore observer, en 1615, la tour où Ernest « practiquaient les secrets de son alchimie ou art chimique, à laquelle il fut de sa vie follement aheurté, comme aux femmes qui sont les deux vices dont il fut noté estant du reste bon prince »1. Il est certes choquant, pour un historien d’aujourd’hui, de voir des attitudes « modernes » coexister chez un bon esprit du XVIIe siècle avec des pratiques « archaïques » comme l’alchimie. Pareille dichotomie n’existe pas à l’époque. Car qu’est-ce en définitive que l’alchimie ? Les alchimistes eux-mêmes en donnent quatre définitions : c’est d’abord l’art (chimérique) de transmuter les métaux vils, plomb, cuivre, étain, en métaux nobles, argent et or. C’est ensuite une théorie de la matière, de sa composition et de ses mélanges, qui fonde et justifie ces pratiques. C’est aussi l’application au corps humain de la « médecine » qui guérit les métaux de leurs imperfections et la recherche des remèdes efficaces, voire de l’élixir de longue vie. Enfin, tardivement, c’est une voie spirituelle qui transpose le processus transmutatoire à l’âme de l’opérateur2. Née dans l’Égypte hellénistique, puissamment dévePortrait gravé de Paracelse. XVIIe s. loppée par les Arabes, réintroduite en Europe au XIIe siè© Paris, Musée d’Histoire de la Médecine. cle, l’alchimie échoue à s’imposer comme savoir universitaire et s’étiole à la fin du moyen âge. C’est Paracelse qui lui donne une nouvelle vigueur3. Au fil d’une vie errante, le médecin suisse Philippus Aureolus Theophrastus Bombast de Hohenheim, dit Paracelse (1493-1541) ne cessa de cribler de ses sarcasmes la médecine universitaire pour prôner une médecine nouvelle, fondée sur la double lumière de l’Ecriture Sainte et de la Nature. Les deux lumières n’en forment en réalité qu’une seule, et c’est Dieu et la Nature qui l’allument dans l’homme accueillant. Le véritable médecin comprendra la maladie et le remède en interrogeant ceux qui côtoient la nature et la laissent parler, rebouteux, vagabonds, sorciers, mineurs, paysans et alchimistes. Comme l’alchimiste, le médecin séparera le pur de l’impur, rendra parfait ce qui est imparfait. Ainsi, les remèdes chimiques produits au laboratoire remplaceront les remèdes galéniques hérités de la tradition grécoarabe4.
1. Ph. DE HURGES, Loc. cit. 2. R. HALLEUX, Les textes alchimiques, Turnhout, Brepols, 1979 (Typologie des sources du moyen âge occidental, 32). 3. Voir la belle thèse de Didier KAHN, Alchimie et paracelsisme en France (1567-1625), Genève, Droz, 2007 (Cahiers d’Humanisme et Renaissance, 80). 4. R. HALLEUX, art. « Paracelse », dans M. BLAY, R. HALLEUX, La science classique. Dictionnaire critique, Paris, 1998, p. 366373.
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Lorsqu’il est élu au siège épiscopal de Liège le 30 janvier 1581, le prince a vingt-sept ans. Il est, depuis dix ans au moins, acquis à l’alchimie et au paracelsisme. Plusieurs membres de sa famille s’en sont occupés. Il est cousin de Rodolphe II, que le cercle alchimique de Prague tenait pour une réincarnation d’Hermès Trismégiste. Un de ses oncles n’a-t-il pas accueilli à Salzbourg Paracelse lui-même, au terme de sa dernière errance ?5 Mais selon les annalistes qui ont retracé son adolescence bavaroise6, c’est en 1571, peu après son retour de Cologne (où il était chanoine depuis 1565), qu’il s’occupe d’alchimie, au désespoir de ses précepteurs et de sa mère. Peut-être est-il, dès cette époque, en contact avec les cercles paracelsiens groupés autour de l’imprimeur Birckmann7. La découverte en 1964 à Cologne des restes d’un laboratoire témoigne d’une pratique de l’alchimie dans la métropole rhénane à cette époque8. L’année suivante, le recteur des jésuites de Munich obtient qu’il brûle ses livres et détruise son matériel9. Le 23 mars 1574, il quitte Munich pour Rome, où il séjourne chez Otto de Truchses, cardinal d’Augsbourg10. Non seulement son hôte est bien connu comme protecteur de divers alchimistes italiens, mais le médecin d’Ernest, Johannes Albert von Wimpfen dit Wimpeneus, est un paracelsien de la première génération qui avait publié en 1569 un essai de conciliation entre paracelsiens et hippocratiques11. En privilégiant la nature et ses pouvoirs cachés (ce que l’on appelait la magie naturelle), la doctrine de Paracelse est profondément subversive car elle réduit le surnaturel au naturel et met en cause la notion de miracle. Aussi, les conseillers d’Ernest ne cesseront-ils de le mettre en garde. En 1599, le jésuite Martin Del Rio lui dédie ses célèbres Disquisitiones magicae, un véritable vade mecum du chasseur de sorcières12. Mais il autorise le prince à pratiquer l’alchimie en raison de son haut pouvoir de discernement13. Thomas Feyens, professeur à Louvain, lui dédie en 1607 son De viribus imaginationis, où il conteste les idées de Paracelse et de Pomponazzi sur le pouvoir que l’imagination aurait sur la matière14. Autre louvaniste, Lambert Schenkel (Schenkelius) va lui adresser un Art de la mémoire de facture très classique, fondé sur la Rhétorique à Herennius, mais dirigé contre les ouvrages d’inspiration lullienne15. Son propre médecin, Henri de Heer, l’appelle « le coryphée des chimistes de notre siècle »16. En 1591, au moment où le prince se propose d’inviter Juste Lipse à Liège, son propre secrétaire, Dominique Lampson, écrit à l’humaniste flamand17 « Je ne sais si je dois souhaiter de vous voir à la cour […] j’aime le prince et voudrais le servir. Malheureusement ses mœurs dissolues, son goût de l’alchimie et les courtisans dont il écoute les flatteries gâtent chez lui les bonnes dispositions ».
5. W. STEINITZ, « Salzburg zur Zeit des Paracelsus », dans Paracelsus, Werk und Wirkung Festgabe für Kurt Goldammer, Wien, 1975, p. 304. 6. M. LOSSEN, Der Kolnische Krieg, I, Gotha, 1882, p. 118. 7. Sur ce groupe, voir L. NORPOTH, « Kölner Paracelsismus in der 2 Hälfte des 16. Jahrhunderts », dans Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins, 27, 1953, p. 133-138 ; Id., « Paracelsismus und Antiparacelsismus in Köln in der 2 Hälfte des XVI Jahrhunderts », dans Festschrift Wilhem Katner, Düsseldorf, 1968, p. 91-102. 8. H. STEUER, « Ausrüstung einer chemischen Werkstatt des 16 Jahrhunderts », dans Kölnisches Stadtmuseum Auswahlkatalog, Köln, 1984, p. 275-276. 9. M. LOSSEN, op. cit., p. 122. 10. M. LOSSEN, op. cit., p. 122, 336 sq. 11. A.G. DEBUS, The Chemical Philosophy, New York, 1977, p. 135-139. On trouve des informations pittoresques sur les frasques (aussi amoureuses) d’Ernest à Rome dans K. SCHELLHASS, « Italienische Schlendertage Herzog Ernsts von Bayern. Vornehmlich auf Grund der Korrespondenz Camillo Camilapi’s mit Rom (1575) », dans Quellen und Forschungen herausgegeben vom Koenigl Preussische Historischen Institut in Rom, X (1907), p. 325-364. 12. M. DEL RIO, Disquisitiones magicae, Louvain, 1599. 13. M. DEL RIO, op. cit., p. 57-82. 14. Th. FIENUS, De viribus imaginationis tractatus, Louvain, 1607. 15. L. SCHENKELIUS, De memoria, Liège, 1595 ; Id., Gazophylacium artis memoriae, Strasbourg, 1610. Selon EVANS, Rudolph II and his World, p. 229, Schenkel aurait été disciple de Bruno et aurait fréquenté les cercles praguois. 16. H. DE SEER, Spadacrene, Liège, 1614, f. B 4 r. 17. Lampson, lettre à Juste Lipse, 12 juin 1591, dans P. BURMANNUS, Sylloges epistolarum a viris illustribus, I, Leyde, 1727, p. 139. Sur Lampson, voir J. PURAYE, Dominique Lampson, Humaniste, 1532-1599, Bruges, 1950. 60
ERNEST, DISCIPLE DE PARACELSE ET ALCHIMISTE
2. Protecteur des adeptes et des médecins persécutés Un des plus célèbres disciples de Paracelse, Joseph Duchesne (Quercetanus) donnait aux médecins paracelsiens la liste des cours où ils pouvaient trouver accueil et emploi18 : l’Empereur Rodolphe II, le roi de Pologne, Ernest électeur de Cologne, le duc de Saxe, le landgrave de Hesse, le margrave de Brandebourg, les ducs de Braunschweig et Bavière et tous les princes d’Anhalt. De fait, Ernest se fera, toute sa vie, le zélateur et le mécène des paracelsiens. En 1585, il rencontre à Bonn le médecin Jean Huser de Brisgau19, et le projet se forme de réunir en une édition tous les écrits dispersés de Paracelse. La même année, grâce à ses relations de famille, il emprunte les cent quatre volumes manuscrits, patiemment réunis dans les années 1560 par le comte palatin Otto-Heinrich et son secrétaire Hans Kilian, qui se trouvaient au château de Neuburg sur le Danube, en possession du comte palatin Philipp-Ludwig20. Certains manuscrits lui furent apportés personnellement par Kilian à son évêché de Freising. Ils constituent la base de la grande édition de Paracelse, financée par le prince, qui sort des presses de Waldkirch à Bâle en 1589159021, dont on peut suivre l’élaboration à travers la correspondance de Huser, récemment publiée par Joachim Telle22. Jean Polit lui-même saluera le dernier volume, les Chirurgische Büchern d’une gracieuse élégie super Theophrasti Paracelsi restitutionem23. Ernest avait gardé les cent quatre manuscrits de Paracelse, que Philippe-Ludwig ne cessait de réclamer. Le 12 septembre 1607, Ernest écrit d’Arnsberg que les manuscrits se trouvent à Liège et qu’il va les expédier. Du 11 septembre au 20 octobre, l’envoyé du comte palatin attendit les manuscrits à Francfort, en vain. Ils sont peut-être touPortrait gravé de Léonhard Thurneysser. jours à Liège. © Paris, Musée d’Histoire de la Médecine. Rien d’étonnant donc que les adeptes errants trouvent refuge à Cologne et à Liège. C’est sous la protection d’Ernest que Leonhard Thurneysser, un des plus brillants épigones de Paracelse, vient analyser les sources du Geer près de Waremme et y découvre du borax24, et publie en 1587 sa Magna alchymia chez Johannes 18. H. TREVOR-ROPER, « The Court Physician and Paracelsianism », dans V. NUTTON (ed.), Medicine at the Courts of Europe, 1500-1837, London, New York, Routledge, 1990, p. 89. 19. C’est Huser lui-même qui le raconte : Erster Theil der Bücher und Schriften des Edlen, Hochgelehrten und Bewehrten Philosophi und Medici Philippi Theophrasti Bombast von Hohenheim, Paracelsi genannt, Bâle, Waldkirch, 1589, f. A3 r- Bl v. 20. K. SUDHOFF, Versuch einer Kritik der Echtheit der Paracelsischen Schriften, I, Bibliografia Paracelsica, Berlin, 1894, p. 368406 ; II, Paracelsus-Handschriften, Berlin, 1899, p. 2-8. Voir aussi L. NORPOTH, op. cit., p. 138-140 ; J. TELLE, « Kilian, Ottheinrich und Paracelsus », Heidelberger Jahrbücher, 18 (1974), p. 37-49. 21. Dix volumes im 4°. 22. J. TELLE, « Johann Huser in seinen Briefen. Zum Schlesischen Paracelsismus in 16 Jahrhundert », dans Parerga Paracelsica, Paracelsus in Vergangenheit und Gegenwart, Stuttgart, 1991 (Heidelberger Studien zur Naturkunde der Frühen Neuzeit, 3), p. 159-248. 23. Chirurgische Bücher und Schriften/des Edelen Hochgelehrten und Bewehrten Philosophi und Medici Philippi Theophrasti Bombast von Hohenheim Paracelsi genandt… durch Johannem HUSERUM, Strasbourg, Zetzner, 1605, f. n. c. 2. Les derniers vers sont significatifs : Quin age et Ernesto placeas vir magne, sagaci / Illius ingenio livida turba ruet / Ille favet doctis, doctissimus ipse, Camaenis / Et charites dextra liberiore fovet. 24. Ph. GHERINX, Description des fontaines acides de Spa et de la fontaine de fer de Tungre, Liège, Morberius, 1583.
61
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Gymnicus et, traqué, vient mourir à Cologne en 159625. Paracelsiens et alchimistes dédient leurs œuvres au prince, ainsi en 1594 Hans Christoff Rheinhart son commentaire au pseudo-Basile Valentin26, Helisäus Röslin (1597) ses traités médicaux27 et Johann Grasse (après 1560-1618) ou Grasshoff son « petit paysan »28. Enfin, Ernest lui-même correspond avec le plus important des paracelsiens français, Joseph Quercetanus29. La correspondance de Liévin Vander Beken, dit Torrentius, ancien archidiacre de Liège, devenu évêque d’Anvers, est riche d’informations sur les étranges hôtes de la cour. Le 5 janvier 1589, il écrit à Roland de Lannoy, chanoine de Saint-Paul à Liège30 « Méfiez-vous des associations d’Anglais, surtout de celui qui transporte avec lui, croit-on, la fontaine de Tantale, qui se montre à tout le monde mais ne permet à personne d’en profiter. Si vous étiez alchimiste, il s’imposerait spontanément à vous, espérant le centuple ». Il n’y a qu’un seul moyen d’interpréter cette allusion, c’est d’y voir l’illustre John Dee et son acolyte Edward Kelley, se rendant à la cour de Liège avant d’aller, à Prague, fasciner Rodolphe II31. C’est d’un personnage de moindre stature qu’il s’agit dans une lettre du même Torrentius adressée d’Anvers le 25 janvier 1590 au secrétaire du prince-évêque, Dominique Lampson32 : « Le fameux Bragadin, ce métis de Vénitien et de Chypriote, à présent qu’il a donné à Venise une preuve de son art, où pourrait-il se rendre plus commodément que chez vous ? ». Et le 15 février, en réponse à une lettre aujourd’hui perdue33 « J’ai bien ri aussi de ce que l’on vous a écrit à propos de cet imposteur vénitien ou chypriote. Nos marchands ici racontent une tout autre histoire, et d’ailleurs, il est suffisamment connu à Anvers, d’où il a émigré ailleurs. On verra, comme il a été autrefois capucin, ses affaires retourneront à la corde »34. Cette lettre apporte des éléments neufs sur le fameux alchimiste-imposteur Marco Mamugnà, dit Bragadino35, né à Chypre entre 1545 et 1550, installé à Venise, puis à Florence où il fit bien des dupes, puis à Rome où il devint capucin. En 1579, il s’enfuit du couvent et entame une période de vagabondage dont on connaît peu d’étapes : Genève, l’Angleterre, la Flandre, et particulièrement Bruges, puis la France. Rentré en Italie à la fin de 1588, il connaît à l’automne 1589 une éphémère période de gloire à Venise, mais dès décembre il est soupçonné, s’enfuit à Padoue qu’il quitte le 6 août 1590 pour la Bavière à l’invitation du duc Guillaume V chez qui il paiera son imposture de la vie le 26 avril 1591. De la lettre de Torentius, deux choses peuvent se tirer : au début de 1590, Bragadin faisait des démarches pour se faire inviter à Liège (on sait qu’il en avait fait d’autres pour la France). S’il était bien connu à
25. K. SUDHOFF, « Ein Beitrag zur Bibliographie der Paracelsisten im 16. Jahrhundert », dans Centralblatt für Bibliothekswesen, 10 (1893), p. 320-326 ; P. MORYS, Medizin und Pharmazie in der Kosmologie Leonhard Thurneisser zum Thurn 1531-1596, Husum, 1982 (Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, 43). Il fut enterré près de la tombe de Saint Albert le Grand. 26. H.C.H. RHEINART, Das Valete : über den Tractat der Arcanorum Basilii Valentini Zusammen gesetzten hauptschluss Puncten des Lichts der Natur, Halle, 1608, fol. BIIIIv. 27. P. DIESNER, « Leben und Streben des elsässischen Arztes Helisaeus Röslin (1544-1616) », dans Elsass-Lothringisches Jahrbuch, 14 (1935), p. 115-141. 28. Sur l’auteur du petit paysan, Johann Grasse ou Chortalasseus, voir le témoigage de Johann Harprecht, « le fils de Sendivogius » professeur à Tubingen, cité par O. BORRICHUS, « Conspectus scriptorum chemicorum celebriorum » 55, dans MANGET, Biblioteca chemica curiosa, I, Genève, 1702, p. 49. Cette lettre fut écrite trois ans après l’Aperta arca arcani artificiosissimi (Borrichus, op. cit.). D’après la lettre, l’auteur ne semble pas avoir dépassé la préparation de la matière première. 29. Ernest lettre à Joseph Duchesne, Hamburg, Staats und universitätsbibl. Sup. ep. 4.30 ff. 79 v-81 v. 30. M. DELCOURT, J. HOYOUX, Laevinus Torrentius. Correspondance, t. III, Liège-Paris, 1954, p. 427, lettre 555 : Cave itaque Anglorum consortia, ejus praesertim qui Tantali fontem secum ferre creditur, omnibus sese ostentans sed non omnibus sese fruendum praebens. Si chymicus esses, ultro se tibi obtruderet, sperans centuplum. 31. P.J. FRENCH, John Dee. The World of an Elisabethan Magus, London, 1972. 32. M. DELCOURT, J. HOYOUX, op. cit., p. 22, lettre 683 Bragadinus ille hybrida ex Veneto et Cypride natus, ubi Venetiis artis experimentum dederit, quo, quaeso, commodius quam ad vos se conferat ? Accedet aurum ex Iberia quod Francimonte olim a Loncino praefecto non repertum. Is qui nunc est aliunde secum conferet. Infelix ego qui haec tempora Leodii non exspectaverim. La deuxième phrase fait allusion à des tentatives infructueuses de trouver de l’or dans le marquisat de Franchimont par le gouverneur, Robert de Lynden, dont il y a des mentions dans la lettre 164, t. I, p. 324-325 (du 2 novembre 1585). 33. M. DELCOURT, J. HOYOUX, op. cit., t. III, p. 48, lettre 702 Risi quoque ea quae de Veneto aut Cyprio illo impostore ad vos scripta sunt. Nostri hic mercatores longe aliter narrant et alioqui satis Antverpiae notus est, unde alio commigravit. Videat, cum olim Capucinus fuerat denuo illi ad restem res redeat. Hic finis Priami regnorum. 34. Application humoristique au cas du cordelier, d’un vers de TERENCE, Phormion, 686 ad restem mihi res redit « il ne me reste plus qu’à me prendre ». 35. I. STRIEDINGER, Der Goldmacher Marco Bragadino. Archivkundliche Studie zur Kulturgeschichte des 16 Jahrhunderts, Munchen, 1928 (Archivalische Zeitschrift herausgegeben vom Bayerischen Haupstaatsarchiv, Beiheft II), p. 20-28. 62
ERNEST, DISCIPLE DE PARACELSE ET ALCHIMISTE
Anvers, où les marchands, fort heureusement pour eux, ne s’en étaient pas laissé conter, c’est qu’il y avait autrefois séjourné entre 1579 et 1588. Autre familier des cercles de Liège et de Cologne, Théobald de Hoghelande (1560-1608)36. Noble Hollandais né près de Middelburg, il avait étudié à Louvain et à Paris. Il parcourt toute l’Europe, particulièrement l’Est, la Dacie, la Hongrie d’où il écrit à Charles de l’Escluse et envoie à Juste Lipse des copies d’inscriptions romaines. Il visite les mines d’Idria, parcourt la Lorraine, l’Alsace, la Lombardie, la Carinthie, la Bavière, la Saxe. Il revient à Cologne en 1589, repart pour l’Autriche, la Hongrie, la Transsylvanie chez les Bathory. Il passe les années 1590-1592 en Silésie et en Bohême, visite Leyden, revient à Cologne d’où il correspond avec la princesse de Chimay et dédie à Ernest son De alchemiae difficultatibus37. Après avoir disparu quelques temps, peut-être sous le pseudonyme d’Ewald Vogel, il se retrouve en 1604 dans le cercle de Cologne, où il publie ses Historiae aliquot transmutationis metallicae38. Il y rapporte la transmutation réalisée à Cologne en 1603 par l’Écossais Alexandre Seton39, le véritable Cosmopolite, qui avait auparavant réalisé des transmutations en série à Rotterdam, à Amsterdam, à Francfort, à Strasbourg, à Bâle. Les opérations eurent lieu devant son hôte Anton Bordemann, le chirurgien Meister George, les orfèvres Hans de Kempen et Johan Lohndorf. Il est difficile de croire que le prince n’en ait pas été avisé. Plus surprenante enfin est la présence dans le cercle paracelsien de Liège du peintre Othon Van Veen, Otho Venius, le maître de Rubens. On sait que Othon Van Veen avait été, dans sa jeunesse, page à la cour d’Ernest de Bavière, dont il fit le portrait40. Mais lorsqu’en 1627 et 1630, l’official de Malines consulte sur Van Helmont accusé d’hérésie les théologiens de Louvain, ils profitent de l’occasion pour englober dans l’accusation Otho Venius41 : « Nous estimons que tous deux, Venius et Van Helmont, instruits dans l’école de Paracelse, c’est-à-dire du diable, ont été installés par leur maître dans la même chaire de pestilence, et, chacun dans son art, l’un en peignant ou en dessinant, l’autre en philosophant par le feu, répandent dans le monde entier ces ténèbres plus que Cimmériennes dont l’esprit de chacun des deux est profondément recouvert, et agité selon la volonté du démon ». Et Schenckelius, rédigeant la formule de rétractation du médecin, recommande de brûler les deux ouvrages42. Mais il s’agit ici dans le chef d’Otto Vaenius d’une publication précise d’un livre illustré, rédigé dans un esprit paracelsien. Il s’agit d’une œuvre publiée à son insu, en 1621, les Conclusiones physicae et theologi-
36. Sur Théobald, F.M. JAEGER, Historische Studien. Bijdragen tot de kennis van de geschiedenis der natuurwetenschappen in de Nederlanden gedurende de 16de en 17de eeuw, Groningen-Den Haag, 1919. Il n’est pas sûr qu’Edwald Vogel soit Théobald de Hoghelande. 37. Th. DE HOGHELANDE, De alchemiae difficultatibus, Cologne, 1594, épître dédicatoire Quapropter Illustrissime et Reverendissime antistes, cum Celsitudo tua naturali animi propensione (quod fere familiae illustrissimae Bavariae ducum proprium est, hanc scientiam semper excoluerit, amaverit, et summo studio investigandam curaverit, quinimo alios etiam juvare, aliorumque studia promovere conata sit, prout testantur T. Paracelsi opera sumptibus Celsit. Tuae edita, et collegia et gymnasia in ditionis suae urbibus in pauperum gratiam constituta, fundata et reditibus annuis dotata primum Deum O.M. precor, ut votis Cels. Tuae annuere dignetur et eam tribuere fortunam quae ad Dei gloriam et subjectorum sibi populorum consolationem. 38. Th. DE HOGHELANDE, Historiae aliquot transmutationis metallicae, Cologne, 1604. 39. Sur Alexandre Seton, voir A. KIRCHER, « De lapide philosophico », dans MANGET, I, p. 98. 40. L. VAN PUYVELDE, art. « Venius », dans Biographie Nationale, 26, 1936-1938, col. 578-583. 41. Censure des théologiens de Louvain 24 octobre 1630 (BROECKX, « Notice sur le manuscrit Causa J.B. Helmontii », Annales de l’Académie d’Archéologie de Belgique, 1852, p. 303) Itaque non dubitamus duos hos in Paracelsi hoc est diaboli scola institutos discipulos Venium et Helmontium idcirco ab hoc suo magistro in eadem pestilentiae cathedra constitutos esse, ut quo singuli valent artificio unus pingendo seu delineando, alter pyrotechnic philosophando, has plusquam cimmerias tenebras, quibus utriusque intellectus altissime obsessus est et pro nutu daemonis circumagitur toti mundo effundant. La Faculté censura Venius et Van Helmont en 1627 sur rapport de Capronius et Merchier, elle entendit de nouveau le 14 février 1630 des extraits de leurs ouvrages rédigés par Schenckelius et Jansenius. Le 24 octobre 1630, la Faculté répondait. Le 9 mars 1631, elle admettait les animadversiones de Schenckelius et Jansenius. Voir J. ORCIBAL, « Un grand universitaire malgré lui : C. Jansenius d’Ypres », dans Facultas S. Theologiae Lovaniensis 14321797. Contributions à son histoire, Louvain, 1977, p. 351-380, spéc. 363-364 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 45). 42. Formule de rétractation de Schenckelius, p. 307. Et sane indignum esset vel hunc, vel Vaenii librum uno eodemque daemonis spiritu, ad Paganismum, contra Dei ac Christi fidem, resuscitandum typis evulgatum, privata tantum poena multari, quam contraria fama illius fautores mox suspectam ambiguamve reddent, inde etiam suis artibus elevabunt, ac in impietatis extenuandae argumentum trahent. Utroque libro exusto, videtur auctor e Belgio proscribendus ob periculum, quod non obstante etiam publica retractatione, Belgis incumbit. 63
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
cae, récemment retrouvée à Wolfenbüttel, où une cosmologie platonicienne et paracelsienne vient à l’appui de considérations théologiques43 et qui exerça sur Rubens une influence non négligeable44. 3. Ernest à son fourneau L’activité d’Ernest ne se limita pas au patronage et au mécénat. Il travailla lui-même au laboratoire, à la fois pour la préparation de remèdes et l’alchimie transmutatoire. Dans une lettre du 13 décembre 1588 à son ami Lampson, Liévin Torrentius45 raille gentiment la médecine paracelsienne qui se pratique à Liège. On conserve une recette sur la préparation du sel de tartre, qui se réclame d’Ernest46. Le 5 juin 1595, à l’issue d’un grand dîner, la famille de l’échevin Pierre Oranus fut intoxiquée par du pépin d’Espagne acheté au marché. Ernest se rendit en personne auprès des malades avec un contrepoison, ce qui n’empêcha pas trois morts47. On verra plus loin son rôle dans l’analyse des eaux minérales. L’alchimie transmutatoire fut certainement le domaine de prédilection d’Ernest, dans ses lectures, d’abord. Lampson orne d’un poème grec l’exemplaire princier de la Chrysopée d’Augurelli48. Nicolas Majus, préfet des mines de Joachimsthal et conseiller de Rodolphe, lui fait copier un superbe manuscrit de Lamspring, conservé à Salzbourg49. Un autre manuscrit conservé à Londres présente une collection de traités alchimiques en latin et en allemand, copiée entre 1609 et 1613 par Gessler de Zabern, chanoine de Strasbourg. Il contient (ff. 160-208) les rapports d’expériences réalisées sur la « pierre philosophale végétale » par le prince électeur Ernest de 1581 à 158550. Quelques témoignages, à ce jour inconnus, permettent d’entrer dans la familiarité du cercle alchimique de Liège. En 1588, un certain Jérôme de Liège écrit à Barbara Fugger pour lui proposer d’acquérir des ouvrages alchimiques et des secrets pratiques51. En 1592, Gaston Duclo, lieutenant particulier du Nivernais, dédie un livre d’alchimie à Ernest. Il avoue ne pas connaître le prince, mais le sculpteur Thomas Tollet (1537-1650), qui édifiait à la cathédrale de Nevers le monument de Louis de Gonzague en 1590, lui avait rapporté qu’il avait vu trois fois, au palais de Liège, en présence du prince-évêque, la projection sur le mercure par des inconnus de passage52. Huser évoque les efforts du prince pour extraire le soufre solaire et leur discussion sur la méthode trompeuse de Bragadino53. 43. Conclusiones physicae et theologicae, notis et figuris dispositae ac demonstratae de primariis fidei capitibus, atque in primis de Praedestinatione, quomodo effectus illius operetur e libero arbitrio (Authore Othone Vaenio), Orsellis, 1621, 43 p. Voir à ce sujet Ch. RUELENS, Pierre-Paul Rubens. Documents et lettres publiés et annotés, Bruxelles, 1877, p. 115-120. 44. T. MEGANCK, « Rubens on the Human Figure Theory, Practice and Metaphysics », dans Rubens. A Genius at Work, Bruxelles, 2008, p. 52-64. 45. M. DELCOURT, J. HOYOUX, La correspondance de L. Torrentius, II, Période anversoise (1587-1589), Liège-Paris, 1953, p. 403-404, n° 537. 46. Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cpg 782, fol. 110. 47. Sur cet épisode, C. DE BORMAN, Les échevins de la souveraine justice de Liège, t. II, Liège, 1899, p. 142. 48. Lettre de Lampson à Torrentius, éd. citée, voir note 148. 49. Ms. Salzburg Universitätsbibl. M I 92. Sur Nicolas Maius, P. BOREL, Bibliotheca chemica, Heidelberg, 1653, réimpr. Hildesheim, 1969, p. 145 ; R. EVANS, Rudolph II, p. 210 et 216. 50. Londres, Wellcome Historical Medical Library, ms. 310, ff. 160-208 (d’une autre main), F. CRELL, Operationes chemicospagyricae… Sampt allerley Handgriffen, Notelen undt Cautelen… super opus Lapidis Philosophici vegetabilis… by churfursten Ernesto Laborirt Anno 81, 82, 83, 84, 85 etc. Voir S.A.J. MOORAT, Catalogue of Western Manuscripts on Medicine and Science in the Wellcome Historical Medical Library, 1, Mss written before 1650 A.D., Londres, p. 197. De meme ANSELME BOECE DE BOODT, Gemmarum et lapidum historia, Hanau, 1609, p. 122 donne une recette de Ioannes Macinius, conseiller de l’électeur de Cologne et artis spagiricae peritissimus. 51. Jérôme de Liège (aussi von Barnichhusen) lettre à Barbara Frugger, Augsburg, 19 août 1588, München, SB, CGM 4233, f. 1 r4 r. 52. G. DUCLO, De recta et vera ratione progignendi lapidis philosophici seu salis argentifici dilucida et compendiosa explicatio, Nevers, 1592, lettre dédicatoire. Le récit est reproduit dans F. SECRET, « Notes sur quelques alchimistes de la Renaissance », dans Bibliothèque d’Humanisme et de Renaissance, 33 (1971), p. 639-640. Sur Thomas Tollet, J. MORET, « Henri de Borset et Thomas Thollet, sculpteurs liégeois du XVIe siècle. Leurs travaux dans la cathédrale de Nevers », dans BIAL, 48 (1923), p. 85-134 atteste p. 108 que Thomas Tollet était employé par Ernest, notamment pour l’aménagement de la maison Porquin, son palais-laboratoire dont il fit ensuite un hôpital. 53. HUSER, Lettre à Franz Kretschmeir, n° 13 (19 mars 1596) et 14 (21 juillet 1596), édition Telle, p. 193-197. 64
ERNEST, DISCIPLE DE PARACELSE ET ALCHIMISTE
Plus curieux encore est le manuscrit latin 14013 de la Bibliothèque Nationale à Paris54. Il a appartenu à un certain Jean-Baptiste de Hardencourt55, médecin du prince, seigneur d’Angleur à partir de 1586, ami de John Dee et qui est connu comme propriétaire d’autres manuscrits du même genre56. Il s’agit d’une lettre adressée de Liège le 8 décembre au prince absent qui demande des comptes et soupçonne l’auteur d’imposture. Dans une lettre, Ernest lui annonçait qu’avec sa practica il n’arrivait pas à faire pénétrer la teinture. L’auteur s’en justifie à grand renfort d’autorités puisées dans la bibliothèque de Liège. Il copie même pour le prince des opuscules dont une version inédite de Flamel et un petit traité italien. Il y mentionne ses collègues, tous des inconnus, Klotz, Van Guel, les recherches parallèles menées chez le frère du prince (Guillaume V), une opération réalisée par Herdencourt le 22 octobre, une lettre de Rodolphe II qui annonce une transmutation imminente. L’auteur du manuscrit signe des initiales N.G., se dit familier dévoué (additissimus famulus) du prince, et semble très informé des réalités italiennes. Dans le Who’s who alchimique du temps, nous sommes tenté d’y reconnaître le médecin lorrain Nicolas Guibert, qui servit comme alchimiste plusieurs princes italiens, et ensuite Otto de Truchses à Augsbourg, l’hôte d’Ernest. En fait, on ne connait rien de sa vie de 1580 à 1603, date à laquelle, désabusé, il se réfugie à Vaucouleurs et publie des pamphlets contre l’alchimie57.
Reconstitution d’un laboratoire alchimique avec alambic. Heidelberg, Musée d’Histoire de la pharmacie. © Cliché CHST.
54. Paris, B.N. lat. 14013, ancien Saint-Germain latin 1150 (cote sur le f. de garde), auparavant Saint-Germain Coislin 1179 (page de garde et notice dans B. de MONTFAUCON, Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum nova, II, Paris, 1739, p. 1115, n° 1179. De opere magni lapidis epist. Scripta Leodii 1592. Comme toute la collection Coislin, il provient de la bibliothèque du chancelier Pierre Séguier (1588-1672). Sur la couverture, on lit sur les plats « d’Hardencourt 1598 » et au verso « 1598 Lescar ». Décrit par J. CORBETT, Catalogue des manuscrits alchimiques latins, I, Bruxelles, 1939, p. 207-208. 55. Fol. 4v et 37 r, marge. 56. Paris, B.N. lat. 14012 ; Oxford, Bodleian Library, Arch. Selden B 18 (3364) ; Kassel, Murhardsche und Landesbibliothek, 2° ms. Chem I. Ces deux derniers manuscrits, qui contiennent des traités grecs d’alchimie, furent achetés en 1567 par John Dee à Hardencourt. 57. La principale source est son autobiographie, N. GUIBERT, De interitu Alchymiae metallorum transmutatoriae tractatus aliquot. Accidit ejusdem Authoris in Sophistam Libavium, Tulle, 1614, premier traité, p. 16-22. Ces données sont reprises par Dom A. CALMET, Bibliothèque Lorraine, Nancy, 1751, p. 453-456 et celles de Dom Calmet par D.I. DUVEEN, A. WILLEMART, « Some 17th Century Chemists and Alchemists of Lorraine », Chymia, 2 (1949), p. 111. 65
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Le dernier témoignage est la correspondance de Franz Kretschmeir, surintendant des mines de Bohême sous Rodolphe II, conservée à Bamberg58. Le 23 décembre 1594, une lettre de Hans Kaper annonce qu’Ernest est arrivé à Prague avec Huser59. Le même jour, Nicolas Reusberger écrit « L’Électeur est arrivé et s’est enfermé trois heures avec l’Empereur et le Seigneur anglais (c’est-à-dire Edward Kelley, l’acolyte de John Dee). Monsieur Kelley dit que Son Altesse Électorale possède une vraie pierre. Il s’est tenu tranquille. J’aimerais bien savoir sur quoi il travaille (c’est-à-dire la matière première), si c’est par voie courte ou voie humide »60. Les cercles praguois étaient en fièvre. Le 19 janvier 1595, le paracelsien Oswald Croll, qui se trouvait à l’Abbaye de Bebenhusen, demande à Kretschmeir si un certain Messinus accompagne Ernest et s’il a parlé à Kelley61. Le 8 février, ses questions se font plus pressantes. Qu’a fait l’Électeur ? Où est Messinus ? A-t-il vu Kelley ? L’Électeur et son équipe sont-ils encore à l’œuvre au blanc, ou déjà au rouge ? Ce Messinus est inconnu. C’est peut-être le Liégeois Pierre Massin, à qui le bibliographe Pierre Borel attribue un traité de la pierre philosophale, en latin et en français, que nous n’avons pu retrouver62. Ernest mourut dans la contrition à son château d’Arnsberg le 17 février 1612, peu de temps après Rodolphe63. Il refusa de recevoir la Sainte Communion dans un lit où il avait reçu tant de dames et se jeta à terre. La tradition liégeoise selon laquelle il refusa dans son ultime maladie tout remède chimique reflète plutôt la réaction de galénistes comme de Heer, dont Van Helmont fera les frais. Le cercle paracelsien et alchimique de Liège survécut à Ernest. On en a pour preuve un prospectus publicitaire pour un médicament intitulé « Huyle celeste ayant grande vertu, et des merveilles operations sur le corps humain tant interieurement qu’exterieurement. Lesquelles vertus sont ici comprinses et declarées. À Liège, par Christian Ouwerx le jeune, demeurant proche S. Denys, à la Patience, l’an 1620 » (Bruxelles, KBR LP 10005 A). Le texte est anonyme, mais le colophon (fol. 4 v, col B) mérite d’être cité in extenso : « Les susdites huyles celeste, congelee, liquide, avec autres de toute sorte d’herbes, drogues et gommes, comme huyle de canelle, fenoil, anis, girofles, huyle de Mastic, benioin, ladalun, de diamant, rubis, safirs, perles, esmeraudes cailloux, chaux viue et d’autres pierres, huyles d’or d’argent et plombs avec leurs douceurs et tainctures et autres metaux avec la douceur de Mercure : composees premierement par feu noble homme Jean de Hardencourt Gentilhomme François Seigneur d’Angleur Bethine. En son temps Docteur célébré en Medecine tant de Messieurs les Eschevins de Liege que du public ; se retrouveront et distribueront par Monsieur, M. Jean d’Or, chanoine de D. Denis en Liege lequel a servy ledit Seigneur Hardencourt son beau frère audit Art de Medecine, distillation et composition desdites huyles l’espace de vingt ans et plus mesme icelui dict art exercé, et practiqué avec lui iusques a sa mort advenue l’an 1598 et du despuis, et presentement encore l’erxerceant, et practiquant avec autant, ou plus de vertus, science, et experience comme sondit temps, à son honneur et contentement des grands et petits. Tesmoings les attestations, et lettres scellees luy despartes et donnes lors par Messeigneurs le comte d’Esneux les Barons de Swartzenburgs Mirbich, Corswarem, l’Angely etc. Messieurs de Naufchasteau, Falois, le capitaine de Bouillon, André d’Ans alors Bourguemestre de la noble Cité de Liege et autres personnages infinis du populace et puis dudict Liege ». Il s’agit d’un remède d’inspiration paracelsienne avec un large spectre d’application. Ainsi, dans l’ordre classique a capite ad calcem, de la tête aux pieds, l’huile est souveraine contre les maux de tête, la surdité, les catarrhes ou défluxions qui viennent du cerveau, les maux de dents, les faiblesses de l’estomac, les maladies des seins, la douleur de côté, la goutte froide et la sciatique, les maux de pieds des marcheurs, les brûlures y compris
58. C.G. VON MURR, Litterarische Nachrichten zu der Geschichte des sogenannten Goldmachens, Leipzig, 1805, p. 37-45 (anciennement archives de Passenburg). 59. C.G. VON MURR, op. cit., p. 43, n° 5. 60. C.G. VON MURR, op. cit., p. 43-45, n° 6. Sur Kelley, EVANS, p. 218 sq. Ce témoignage est important car on estimait jusqu’ici que Kelley était en disgrâce depuis 1591. 61. C.G. VON MURR, op. cit., p. 41-42, n° 2 et 3. 62. P. BOREL, Bibliotheca chemica, p. 147, Pierre Massin Liégeois de la pierre philosophale. Traduit du latin en français. Petrus Massin Leodicensis de Lapide phil. MS. La première des notices est reprise par N. LENGLET DU FRESNOY, Histoire de la philosophie hermétique, III, Paris, 1742, p. 232, n° 482. Toutefois, TELLE, op. cit., p. 208 a trouvé un alchimiste nommé Peter Ludwig Messinus dans la région d’Orztal près de Freising. Les deux personnages n’en font peut-être qu’un. 63. B. FISEN, Sancta Legia, II, Liège, 1696, p. 408 ; DE VAULX, Mémoires, V (Ms. ULg 1019), p. 341-343. 66
ERNEST, DISCIPLE DE PARACELSE ET ALCHIMISTE
de poudre à canon, les contusions et les fractures, les coups d’épée, les maladies de la peau, les cicatrices, les hémorragies, les piqûres des bêtes venimeuses. Des cas cliniques, tous liégeois, sont donnés à l’appui. Il en résulte que Jean-Baptiste de Hardencourt tint laboratoire de 1578 à sa mort en 1598 avec son beaufrère Jean d’Or (Oranus) qui poursuivit son travail. La tradition alchimique à Liège se maintiendra bien tard dans le XVIIe siècle64.
64. R. HALLEUX, « Un alchimiste liégeois au XVIIe siècle », dans Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois, 87 (1975), p. 21-30. 67
VERS UNE MODERNITÉ MÉDICALE Geneviève Xhayet
Lorsqu’Ernest arrive dans sa nouvelle principauté, le paysage médical et hospitalier qu’il y découvre est en profonde mutation. Tandis que des institutions d’origine médiévale renaissent ou se réforment, de nouvelles apparaissent. Le mouvement s’est amorcé dès le règne d’Erard de la Marck. Il se confirme sous Ernest de Bavière qui l’encourage. L’essor du thermalisme spadois et la fondation d’un hôpital à Liège en seront des témoignages durables. La structuration du monde de la santé La confrérie des saints Côme et Damien est fondée à Liège en novembre 1525 pour les chirurgiens et barbiers de la cité mosane – accessoirement aussi pour les médecins –. Comme la formulation de ses statuts le laisse penser, elle ressuscite en fait une institution plus ancienne, emportée par la débâcle liégeoise de 1468 et dont, faute d’archives, nous ne savons plus rien1. Apparues au Moyen Âge, les confréries sont surtout des institutions à vocation religieuse rassemblant les membres d’une communauté professionnelle donnée, sous l’égide d’un saint patron. La nouvelle sodalité n’échappe pas à la règle. À côté de l’établissement de cotisations à acquitter pour rejoindre le groupe, l’acte fixe les modalités d’élection d’un bureau, de même que les actes de dévotion auxquels les confrères sont astreints. Les questions d’ordre professionnel n’y tiennent qu’une place mineure. Elles concernent l’admission de nouveaux venus à Liège et désireux de s’y installer comme barbier ou chirurgien. Les compétences des candidats seront examinées par des confrères « connaisseurs [dans ce domaine], commis à cette tâche, et assermentés ». Elles portent aussi sur les procédures à suivre vis-à-vis de blessés en danger de mort (le chirurgien doit accéder au désir de son patient ou de ses proches de disposer d’un avis autre que le sien). Ce texte ne concerne pas les apothicaires. Avant tout considérés comme des négociants en produits coûteux ou exotiques, les apothicaires appartiennent à la corporation des Merciers, l’un des trente-deux métiers liégeois. En 1534, lorsque les Merciers promulguent leurs nouveaux statuts, quelques dispositions portent sur la profession d’apothicaire. L’acte mentionne la thériaque2 (tiracle) parmi touttes apoticadries vendues par les membres de ce métier3. En janvier 1592, la Confrérie des médecins fait approuver par l’échevinage de nouveaux statuts. Réforme catholique oblige, des conditions d’orthodoxie religieuse y sont formulées sans ambiguïté. Le nouveau texte insiste aussi davantage sur l’attitude à adopter vis-à-vis des praticiens étrangers4. Analysé par Carl Havelange, le texte lui semble refléter un raidissement de la profession à l’égard des étrangers, vaguant, et suspects de charlatanisme : « ces étrangers … courant d’un pays à l’autre, qui prétendent être médecins, physiciens [médecins diplômés par une université] chirurgiens ou opérateurs dans ces arts, et exerçant sans raison, en abusant souvent le simple peuple ». Ces nouveaux statuts traduisent aussi un rapprochement de la chirurgie et des métiers médicaux ainsi que, de la part des uns et des autres, un souci de tendre vers la science. Il sera ainsi interdit aux chirurgiens de pratiquer des opérations graves (ouverture du crâne, amputation de membres, ‘autres accidents dangereux’) sans l’aval d’un « connaisseur et docteur habilité à ce faire 1. Édition : F. Tihon, « Les statuts de l’association des médecins, chirurgiens, barbiers de la ville de Liège et de la banlieue, ou compagnie de saint Cosme et de saint Damien », Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 39 (1909), p. 551-557. 2. La thériaque est un remède d’origine antique, à base de chair de vipère. Ce remède apparait souvent dans la pharmacopée médiévale et moderne. Cf par exemple le De theriaca ad Pisonem de Galien (Opera omnia, éd. et trad. latine C.G. Kühn, 20 vol., Leipzig, 1821-1833), t. 14, p. 210-294. 3. Ordonnance approuvant les chartes et privilèges du métier des merciers (9 oct. 1534), dans M.L. Polain, Recueil des ordonnances de la Principauté de Liège, 2e série (1507-1684), vol. 1, Bruxelles, 1871, p. 98-103. 4. Règlement pour la confrérie dite de saint Cosme et saint Damien, dans M. L. Polain, Recueil…, 2e série (1507-1684) vol. 2, p. 122-126.
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
et connaissant la physiologie ». Comme Carl Havelange le souligne, la subordination des premiers aux seconds se double, en contrepartie, d’une légitimation implicite par les médecins des actes posés par les chirurgiens. Ces statuts amorcent de même l’intégration des apothicaires, et dans la confrérie des saints Côme et Damien, et dans le corps médical liégeois au sens large. L’autorisation « de hayener, et de vendre de la thériaque, des potions ou des drogues » à Liège et sa banlieue dépend en effet « de l’accord des deux maîtres et d’un apothicaire de la confrérie ». Quoiqu’influencée par les nouveaux courants issus du paracelsisme, en faveur à la cour d’Ernest, la médecine, comme la pharmacopée de ce temps, se fonde encore principalement sur les principes énoncés dans l’Antiquité par Hippocrate (Ve siècle avant notre ère) et surtout Galien (IIe siècle de notre ère). Cette médecine postule l’existence dans chaque individu de quatre « humeurs » : le sang, le phlegme, la bile jaune, la bile noire appelée aussi mélancolie. Les humeurs sont pourvues de qualités (chaud, froid, sec, ou humide), groupées deux par deux. Le sang est ainsi chaud et humide, la bile jaune est chaude et sèche, la bile noire froide et sèche, le phlegme est froid et humide. Les humeurs déterminent le tempérament – ou complexion – de chaque personne (sanguin, flegmatique, bilieux ou mélancolique). Ces humeurs résultent de la transformation, par le biais de cuissons successives, de la nourriture ingérée, au sein de différents organes du corps. Ainsi le sang a son siège dans le cœur, la bile dans le foie, le phlegme dans le cerveau et la mélancolie dans la rate. Si les humeurs produites sont en équilibre (ni trop épaisses, ni trop abondantes, ni trop chaudes, etc.), l’individu est en bonne santé. Leur déséquilibre entraîne la maladie. Comme les hommes, les plantes, les animaux ou les minéraux, sont pourvus de qualités. Par des médications appropriées (c’est-à-dire dotées des qualités inverses de celles qui ont provoqué le déséquilibre des humeurs), il appartient au médecin de rétablir l’équilibre humoral ; par exemple, lorsqu’une humeur trop épaisse obstrue les conduits de l’organisme et provoque chez le patient une « oppilation », source de maladie. Le choix des médications dépend du mal à combattre et de diverses autres données propres au patient lui-même : son sexe, son âge – parfois aussi son statut socio-économique –, sa stature et sa complexion. À l’époque qui nous intéresse, les médicaments sont encore pour la plupart préparés en combinant des simples – surtout des plantes –. Les minéraux des fontaines « ferreuses » ou « acides » commencent également à être utilisés. Le recours à ces nouvelles substances favorisera le succès des cures thermales. Dans la seconde moitié du XVIe siècle et au tournant du siècle suivant, quelques médecins se détachent dans le paysage liégeois. À l’exception du premier d’entre eux, ces hommes appartiennent à un même milieu géographique, probablement aussi social – celui de la notabilité urbaine –. Ils ont noué entre eux d’étroits liens familiaux. Gilbert Fusch dit Lymborgh (ca 1505-1567) est un médecin et homme d’église d’origine allemande. Installé à Liège à partir de 1529, et doté d’une prébende à la collégiale de Saint-Paul, il est l’auteur de différents traités médicaux dans la veine scolastique, notamment une Conciliation d’Avicenne avec Hippocrate et Galien. On lui doit aussi un régime de santé pour les vieillards, publié à Cologne en 1545. Philippe Gherinx (ca 1549-ca 1585) est quant à lui originaire du nord de la principauté. Il provient d’une famille de notables, connue depuis la fin du Moyen Âge pour ses activités médicales et comme échevins à Saint-Trond. Philippe Gherinx, qui s’est formé à l’université de Louvain, arrive dans la capitale liégeoise en 1579 où il s’établit. À sa mort en 1585, sa veuve, Ida van der Hagen, originaire de Maastricht se remarie avec Thomas de Rye. Celui-ci, qui provient du duché de Brabant et a pris ses grades à Louvain, se fixe à son tour à Liège. Il y réside jusqu’à sa mort en 1610. En 1605, sa fille a épousé Henri de Heer (ca 1570-ca 1636), le dernier des médecins envisagé dans ces pages. Henri de Heer (ou Heers, selon les sources), qui déclare être un cousin de Philippe Gherinx, a une plus grande envergure que ses prédécesseurs. Il est né en 1570 à Tongres, mais son nom inciterait plutôt à le rattacher à la localité de Heer, désormais incorporée dans la ville de Maastricht. Henri de Heer a voyagé en France, en Angleterre, en Allemagne et en Italie. Il a aussi étudié dans ce dernier pays, entre autres à Padoue. À partir de 1605, et jusqu’à sa mort en 1636, il réside à Liège. Henri de Heer est l’auteur d’un traité en latin sur les eaux de Spa paru en 1614 (la Spadacrene) sur lequel nous reviendrons et d’Observationes medicae5, publiées en 1630. Dans ces œuvres, Henri de Heer évoque en clinicien érudit son expérience, à Liège, 5. Édition utilisée : Henri de Heer Observationes medicae oppido rarae in Spa et Leodii animadversae, cum medicamentis aliquot selectis, et ut volunt secretis, Leyde, 1685. 70
VERS UNE MODERNITÉ MÉDICALE
comme médecin de ville et comme médecin attaché à l’hôpital de Bavière, et à Spa, durant les étés, comme médecin de curistes de haut rang6. Ses travaux apportent de précieux témoignages sur la pratique quotidienne d’un médecin au début du XVIIe siècle, sur ses patients, leurs maladies et les remèdes prescrits pour les combattre.
Fig. 1 : Portrait gravé de Gilbert Fusch dit Lymborgh, Liège, Université, Collections artistiques. © Collections artistiques de l’Université de Liège.
Un paysage hospitalier liégeois remodelé Période de structuration corporative pour les artisans de la santé, le XVIe siècle est aussi le moment d’une refonte considérable du paysage hospitalier liégeois. Dans la cité médiévale de Liège existait, dès les XIIee XIII siècles, une quinzaine d’institutions religieuses, d’importance variable, vouées à l’accueil et aux soins des malades. À la Renaissance, peu d’entre elles subsistent avec leur mission initiale. L’hôpital saint Abraham, qui accueille des étrangers de passage à Liège et leur prodigue des soins est, par exemple, dans ce cas. 6. H. de Heer, Spadacrene. Hoc est fons spadanus ; eius singularia, bibendi modus, medicamina bibentibus necessaria. Henrico ab Heer Tunger[o] Ph[ilosophiae] et medic[o] doct[ore] Ex fide recensui, Leodii, apud A. de Corswaremia, 1614, petit in-8°, 51ff non numérotés. L’édition principalement utilisée dans cet article est la deuxième : Spadacrene, hoc est fons spadanus accuratius descriptus eum bibendi modus medicamina bibentibus necessaria, Leodii, apud A. de Corswaremia, 1622, 67ff non numérotés, [f5v°, f38v°]. 71
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
La léproserie de Cornillon constitue un autre exemple. Fondée à la fin du XIIe siècle, cette institution héberge des lépreux (appelés méseaux), reconnus tels après un examen effectué par une commission d’experts et bénéficiant d’une rente allouée par les autorités communales. Cette dernière est source de convoitise et d’abus. En 1529, une réforme de la léproserie impose aux méseaux un examen médical annuel. S’ils sont reconnus « sans macule ou tache de ladre » par les médecins, les lépreux perdent leur prébende et doivent quitter l’hospice. En 1651, un acte des bourgmestres de Liège constate la fin de la « vraie lèpre » et ouvre l’hospice de Cornillon à des patients souffrant d’autres affections de la peau. Dans le sillage de mouvements religieux et de pénitence venus des Pays-Bas et d’Allemagne à la fin du Moyen Âge, de nouvelles congrégations s’installent en Brabant et dans le pays de Liège aux XVe et XVIe siècles. Souvent appelées sur place par les autorités civiles, elles prennent en charge les habitants les plus démunis. Elles les soignent à domicile ou dans un cadre hospitalier. C’est notamment le cas des frères Cellites, encore appelés Alexiens7. Présents par intermittence à Liège à partir de la seconde moitié du XVe siècle, ces religieux s’y fixent en 1519. Avant de se spécialiser dans l’accueil des aliénés, ils assurent un secours à domicile pour les malades, ensevelissent les morts, en particulier les victimes d’épidémies, dont les pestiférés. En 1519, en contrepartie de leurs soins aux défunts, les autorités communales liégeoises leur confient une résidence. Les Cellites occupent d’abord une maison de la rue Saint-Séverin avant de s’installer, rue de la Volière en Pierreuse, dans la maison dite La Licorne, site initial de l’hôpital psychiatrique, où ces religieux se maintiendront jusqu’au XXe siècle.
Fig. 2 : Hôpital des Cellites. Pots de pharmacie (fin XVIe siècle) trouvés dans les fouilles. © SPW, Liège, service des fouilles.
L’hôpital de Bavière « On m’assura que le jeune Gilles d’Ouffet qui, l’an dernier était serviteur d’un tailleur nommé Barthélemy Wolters, évacuait des vers de partout, car il en vomissait une infinité et les rendait aussi par l’anus. Il 7. Ces religieux sont appelés Cellites en raison de la cella (cabane) dans laquelle ils logent à leurs débuts ou Alexiens d’après le nom de leur Patron, saint Alexis. 72
VERS UNE MODERNITÉ MÉDICALE
en urinait aussi, ce que l’on voit rarement. Un jour que je lui tenais moi-même l’urinal qui était tout neuf et parce que je craignais qu’il ne le dérobe, pour contenter ma curiosité et m’assurer de ce cas si étrange, je l’ai vu uriner une fois seize vers tout vifs et qui remuaient, semblables aux vers qui viennent dans les fromages. Or, parce qu’il était pauvre, je le mis à la Maison de Bavière, c’est un hôpital institué par notre prince sérénissime, nommé la Maison de Miséricorde en laquelle j’ai servi comme médecin ordinaire il y a huit ans. Le garçon a été guéri par l’usage de ces eaux [=les eaux de Spa] et d’autres médicaments ». Ce rare témoignage des circonstances d’une hospitalisation au début du XVIIe siècle provient de la Spadacrene d’Henri de Heer8 . Dans le domaine médical et de la bienfaisance, l’institution emblématique du règne d’Ernest de Bavière est certainement cet hôpital liégeois, établi dans la « Maison Porquin », un des palais du prince situé sur l’actuelle place de l’Yser en Outremeuse, et bientôt désigné couramment par son nom.
Fig. 3 : Alfred Ista, La Maison Porquin, dessin à la plume, 1904. © Liège, Cabinet des Estampes.
L’hôpital est une expression de la charité privée. À son origine se trouve une confrérie fondée en mars 1602 par de riches bourgeois de Liège, et placée sous le patronage d’Ernest de Bavière9. La dénomination dont ils se sont dotés, « Confrérie de Miséricorde », est exceptionnelle dans les Pays-Bas, tant au Moyen Âge qu’à la Renaissance. On lui trouverait en revanche de multiples équivalents dans le monde méditerranéen, où existent dès l’époque médiévale, des compagnies pieuses de ce nom, poursuivant des buts comparables. Si l’on se réfère aux relations d’Ernest avec l’Italie, une telle source d’influence semble une hypothèse plausible. Dans le préambule de l’acte, le prélat assigne pour principale tâche à la fondation de soulager « la misère de nos sujets, reconnaître les plus pauvres maisons des citoyens, visiter souvent les maladreries, hôtels-Dieu ou hôpitaux, consoler et soulager les prisonniers », bref, « exercer les offices de 8. H. de Heer, Spadacrene. Hoc est fons spadanus ; eius singularia, bibendi modus, medicamina bibentibus necessaria. Henrico ab Heer Tunger[o] Ph[ilosophiae] et medic[o] doct[ore] Ex fide recensui, Leodii, apud A. de Corswaremia, 1614, petit in-8°, 51ff non numérotés. Traduction française : ID., Les fontaines de Spa, decrites premierement en latin soubs le titre de Spadacrene, maintenant traduict en françois avec des additions, Liège, chez A. de Corswarem, 1616, non folioté. 9. Acte publié par N. Gazet, Le grand palais de la Miséricorde, partie 1, Douai, 1606, p. 14-21. Reproduit par J. Noël, L’origine et le développement de la Maison de Miséricorde dite Hôpital de Bavière à Liège au XVIIe siècle (…), t. 2, p. 65-68. 73
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 4 : Nicolas R.P.F. Gazet, Le grand palais de la Miséricorde, t. 1, Douai, 1606, page de titre. Contient aux pages 14 à 21 l’acte d’institution de la Confrérie de la Miséricorde, publié le 15 mars 1602 par Ernest de Bavière. © Liège, Université, Bibliothèque de Philosophie et Lettres. 74
VERS UNE MODERNITÉ MÉDICALE
Règles de la Maison de la Miséricorde approuvées par Ernest de Bavière. © Liège, Archives de l’État, Hôpital de Bavière, n° 730. 75
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
piété et de charité envers toutes les personnes oppressées par quelque calamité ». Plus loin, l’acte précise la nature de l’aide : reconnaître les plus honnêtes ménages des pauvres et dans la mesure du possible les assister. Pour les malades dans les hôpitaux : leur faire obtenir le nécessaire « tant pour leur salut que pour leur santé de l’âme et du corps » ; apporter un soulagement aux prisonniers. Ces mesures paraissent très rapidement insuffisantes et la nécessité de prévoir un nouveau lieu d’hospitalisation pour les malades s’impose bientôt ; une institution dans laquelle les citadins les plus pauvres, « accablés par une maladie grave seront reçus et seront honnêtement et salutairement nourris et soignés ». Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, cet hôpital reste sous la responsabilité de la Confrérie de la Miséricorde qui contrôle ses activités et gère ses fonds. La majeure partie de ses ressources provient de dons et de legs de bienfaiteurs et des revenus qui en découlent. Mais d’anciens patients témoignent aussi de leur gratitude pour les soins reçus. Au milieu du XVIIe siècle, l’un d’eux justifie sa donation « en raison des bons plaisirs, services et amitié qu’il a reçus des sœurs de la dite maison et espère encore au futur recevoir ». Au XVIIIe siècle, l’hôpital disposera de 40000 florins de revenus annuels, qui lui permettront de soigner une centaine de patients. Le fonctionnement de l’hôpital est, dès ses origines, bien connu grâce aux statuts établis, à une date indéterminée de l’année 1603 lors de sa fondation, et publiés chez l’imprimeur Arnold de Corswarem, cette même année10. La Maison de Miséricorde est un hôpital moderne, médicalisé, caractérisé par un souci d’hygiène et de confort pour le malade. Comme le montre encore l’exemple relaté par Henri de Heer, des médecins sont attachés au service de l’hôpital. C’est de leur initiative, qu’après une auscultation des patients à leur domicile, dépend l’hospitalisation. À leur arrivée, les malades « seront dépouillés de leurs vêtements, ils recevront de la Maison de Miséricorde une chemise, un bonnet, et du linge ». Ils seront couchés seuls (et non à plusieurs comme c’était souvent le cas dans les hôpitaux médiévaux) dans des draps blancs et nouveaux (=propres). Ces draps seront changés autant de fois que ce sera nécessaire. Les lits seront réchauffés avant leur entrée. Une visite quotidienne des médecins aux malades est prévue. Au fil du temps, cette situation se dégrade. À la fin du XVIIIe siècle, les médecins se voient reprocher d’être à la fois trop peu nombreux, et trop peu assidus, au chevet des hospitalisés. La gestion journalière de l’institution est confiée à une congrégation féminine. Dans un premier temps, les religieuses sont des tertiaires de saint François, venues de l’hôpital Sainte-Madeleine d’Ath. À partir de 1626, la communauté est commuée en Régulières de saint Augustin, avec des vœux définitifs. Fondation civile, la Maison de miséricorde revêt cependant la forme d’un établissement religieux, avec une structure et une hiérarchie conventuelles. Assistée d’une boursière chargée de la gestion financière et d’une maîtresse des novices, une mère supérieure, la mater, dirige la communauté. Les sœurs se conforment aux règles de la vie conventuelle, tant en matière d’assistance aux offices, que d’habit, de vie claustrale, de respect du silence, des jeûnes, etc.). L’âge minimal pour entrer dans la communauté est fixé à 18 ans. Après un an de noviciat, les jeunes religieuses peuvent prononcer leurs voeux. Ceux-ci correspondent aux engagements traditionnels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, sinon que les sœurs promettent aussi « de servir Dieu et les malades, selon les Constitutions de cet Institut de Miséricorde ». Les statuts montrent, en effet, une adaptation des contraintes habituellement en vigueur pour les religieuses, aux exigences spécifiques du métier de garde-malade et d’infirmière. Les statuts de 1603 révèlent en effet que les candidates doivent avoir « les forces corporelles entières et suffisantes pour s’activer tant de jour que de nuit [aux besoins suscités] par la maladie des pauvres ». L’organisation même du couvent est subordonnée aux nécessités des soins hospitaliers. C’est ainsi que le nombre maximum de religieuses admissible dans la Maison de Miséricorde dépend des besoins de l’établissement en personnel. Le chapitre III de l’acte de fondation précise que : « Nous ne voulons toutefois pas que la Maison compte une grande multitude de religieuses. Leur nombre sera proportionné au nombre de malades que la Maison pourra panser et nourrir à savoir, pas plus de dix ou douze soeurs pour servir trente ou quarante malades. Cette limitation se justifie par le souhait des Confrères de s’en tenir à leur intention initiale et d’éviter « qu’au lieu d’une maison pour les malades, on se trouve en présence d’un monastère de religieuses contre notre première et principale intention ». 10. Règles de la compagnie de Miséricorde et règles pour les malades de la Maison de Miséricorde publiées à Liège, chez A. de Corswarem, 1603. Textes reproduits dans J. Noël, op. cit., p. 71-91. 76
VERS UNE MODERNITÉ MÉDICALE
Les obligations régulières, principalement le respect du jeûne, se subordonnent de même aux nécessités du service hospitalier. Le sixième chapitre du règlement prescrit aux sœurs de respecter les jeûnes ordonnés par l’Église mais précise qu’elles ne pourront en entreprendre de supplémentaires sans l’autorisation expresse de l’aumônier (le pater) et de la mère supérieure. L’objectif est d’éviter que ces jeûnes n’affaiblissent les religieuses et les rendent inaptes au service des malades. Au contraire, la mater recommandera aux religieuses dont le tour sera venu de servir les malades de se nourrir le matin avant de se rendre auprès d’eux, même durant les jours de jeûne. Cette nourriture sera prise « à titre de médecine ». Comme le statut de 1603 le précise encore, « gouverner les malades » incombe aux sœurs. Ceci s’entend d’un point de vue matériel, médical et spirituel. En pratique, les religieuses sont responsables de la propreté de la chambre et du lit des malades. Elles veillent à la qualité de la nourriture et de la boisson qui leur est offerte, afin de hâter leur rétablissement. Elles assurent le maintien de l’ordre dans les chambrées : « afin d’ôter aux malades les occasions de se quereller ou de « caquetter comme il advient souvent ». Sur le plan médical, elles apparaissent Fig. 5 : J’estois malade... comme une courroie de transmission entre les hospiNicolas R.P.F. Gazet, Le grand palais de la Miséricorde, talisés, dépossédés de toute responsabilité quant à op. cit., Planche gravée hors texte. leur état de santé, et les médecins. « De lit en lit », © Liège, Université, Bibliothèque elles leur rendent compte de l’évolution des patients de Philosophie et Lettres. entre deux visites successives. L’application scrupuleuse des prescriptions leur incombe. Il leur est défendu d’y « rien changer, selon leur fantaisie, tant dans la quantité ou la qualité des aliments ou des boissons, que dans les durées de traitements prescrits ». Ce sont elles qui préparent les médications, puisque la pharmacie, tout comme l’entretien du jardin, sont également de leur ressort. Leur mission est enfin spirituelle. Elles « consoleront le malade par de pieuses exhortations à la patience et aux autres vertus chrétiennes ». Ce rôle acquiert tout son poids quand l’état d’un malade s’aggrave et que la mort approche. Il leur appartient alors de prévenir l’aumônier. Les statuts éclairent enfin la personnalité des patients, les conditions régissant leur accès à l’institution de soins, et le personnel médical et de soins affecté à leur chevet. La gravité de l’état est ainsi prise en compte : « tous malades incurables et contagieux en seront absolument forclos ». L’accès dépend aussi du statut social et civil du malade (être citadin de Liège ou résider dans cette ville, être un adulte, homme ou femme, catholique, « vrayement pauvres ». La conjugaison des critères de pauvreté et de résidence fera, qu’à l’instar de Gilles d’Ouffet, nombre des patients hospitalisés seront des serviteurs et des servantes de la bourgeoisie liégeoise. Pas plus que les mendiants, on n’y reçoit ni les enfants ni les « vieilles gens qui ne sont malades que de vieillesse ». Plus tard dans le siècle, des institutions spécifiques accueilleront ces catégories d’indigents. Un orphelinat pour filles et garçons apparaît en 1620, et un hospice pour vieillards, est fondé en 1690. Ces établissements ne suffiront toutefois pas à éponger la misère endémique régnant alors dans la cité mosane. Les dernières conditions traduisent un effort de moralisation de la société, par le biais d’une stigmatisation de certaines maladies : « nous excluons aussi ceux-là qui ont et traînent des maladies incurables et des maladies contagieuses infâmes », en l’occurrence, les malades atteints de vérole ou victimes de la peste. Sont également exclus « ceux qui ont acquis leur mal par la suite de leur débauche ou de leur faute propre ». Cette dernière clause qui vise expressément les blessés lors de bagarres, ou lors d’émeutes, évoque peut être 77
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
aussi la violence à caractère politique. Une fois qu’ils sont admis, les patients adopteront un comportement exemplaire, fait de soumission. Les patients s’engageront à prendre : « les nourritures et les médications qui leurs seront prescrites par les médecins et les chirurgiens. Ils les prendront à l’heure et selon la quantité qui leur auront été ordonnées, sans protestation ni contradiction ». D’ailleurs, « si un malade est rebelle et refuse de se plier à l’ordre donné dans le règlement, les sœurs en avertiront discrètement les maîtres [de la confrérie] ou les confrères visiteurs. Ceuxci porteront remède à la situation et ils admonesteront avec charité et prudence les fauteurs de troubles. Si ceux-ci ne se laissent pas admonester, les visiteurs feront part de leur refus aux maîtres, afin de les faire renvoyer. Ils agiront ainsi, afin que les Religieuses n’aient à se quereller avec personne ». Les informations relatives à la vie même de l’hôpital s’avèrent très fragmentaires pour les XVIIe et XVIIIe siècles. Des témoignages de gratitude de la part d’anciens patients sont autant d’indications sur la qualité des soins reçus. Pour le XVIIIe siècle, Juliette Noël a trouvé cet éloge des religieuses dans les archives de l’hôpital : « elles ont soin des malades et s’acquittent de ces fonctions avec propreté et zèle ». Fig. 6 : Une religieuse de l’hôpital de Bavière. L’histoire des Augustines de Bavière Photographie, avant 1895. © Liège, Musée de la Vie wallonne. confine parfois à l’hagiographie. Le tournant des XVIIe et XVIIIe siècles est ainsi dominé par la personnalité de la Mère Marie Agnès d’Esne, réputée avoir obtenu par la prière, la multiplication du froment stocké dans les greniers de l’hôpital pendant une période de disette. L’institution hospitalière fondée par Ernest de Bavière était appelée à se pérenniser. Elle survécut à la principauté. La Révolution française préserva les institutions vouées à l’éducation et aux soins de santé. Sous le régime français, l’hôpital devint le « Grand hôpital » et passa sous l’autorité d’une Commission des hospices, ancêtre de l’actuel Centre public d’Action sociale, dépendant des autorités communales. Cette Commission demeura en vigueur sous le régime hollandais, et jusqu’à la Belgique indépendante. Lorsqu’au début du XIXe siècle, une université fut créée à Liège, l’hôpital de Bavière fut en outre choisi comme école d’application de la Faculté de médecine ; une mission qui lui resta dévolue jusqu’à la création de l’hôpital de la Citadelle et du Centre Hospitalier Universitaire, en 1980. Au XIXe siècle, l’ancienne Maison de Miséricorde connut ainsi un statut hybride, source potentielle de tensions entre sa vocation charitable initiale et les exigences d’une médecine universitaire toujours plus marquée par la science ; entre les autorités universitaires masculines, souvent libérales et inspirées par la francmaçonnerie, et les religieuses augustines, investies de son fonctionnement quotidien. Mais au – delà de son rôle fondamental social et sanitaire, comme des querelles idéologiques dont il fut parfois le théâtre, l’hôpital fondé au début du XVIIe siècle s’était profondément gravé dans la mentalité liégeoise, au point qu’aler à Bavîre était devenu, à Liège, synonyme d’hospitalisation. 78
VERS UNE MODERNITÉ MÉDICALE
Fig. 7 : Cuillère incurvée en étain (XVIe siècle), découverte dans les latrines de l’ancien couvent des frères Cellites dit « La Licorne » à Liège. Peut être utilisée pour alimenter les malades. Dessin A. Mélon. © SPW.
L’intérêt pour les eaux thermales et l’essor du thermalisme spadois La redécouverte des eaux thermales Connues de Pline l’Ancien, mais délaissées au Moyen Age, les sources du pays de Liège sont redécouvertes au milieu du XVIe siècle. En 1559, Gilbert Fusch dit Lymborgh, un médecin d’origine allemande, installé à la cour de Liège, avait publié à Anvers un De acidis fontibus sylvae Arduennae praesertim eo qui in Spa visitur libellus, traduit en français, sous le titre Des fontaines acides de la forest d’Ardenne et principalement de celle qui se trouve à Spa11. L’auteur s’y présentait comme le découvreur des eaux de Spa et l’initiateur de leur mise en exploitation. Au XVIe siècle, les deux fontaines acides (c’est-à-dire au goût aigre, à cause de leur teneur en minéraux) connues dans la station ardennaise sont le Pouhon et la Sauvenière. « Suffisante pour étancher la soif de tous ceux qui se trouvent à Spa, même pendant les jours de canicule », le Pouhon jaillit au cœur du village. La Sauvenière sourd dans un site agreste, à une petite heure de marche à l’est de Spa. En 1614, Henri de Heer décrit également deux autres sources mises en exploitation depuis peu : la source de Géronster et le Tonnelet. Parce que leur site est inhospitalier ou que leurs eaux agissent trop violemment sur l’organisme, ces autres fontaines sont cependant moins appréciées que les deux premières. La seconde moitié du XVIe siècle se caractérise d’ailleurs par la recherche de nouvelles sources thermales dans le pays de Liège. Gilbert Fusch annexe à son Traité sur les fontaines acides la liste d’une quarantaine d’autres sources situées à Spa ou dans la région, notamment à Francorchamps, Sart-lez-Spa, Malmedy (fontaine pétrifiante), Stavelot, ou encore à Stoumont. Ce répertoire est dressé à partir d’informations glanées auprès des villageois, ou d’une prospection menée personnellement sur le terrain. Certaines, précise encore Fusch, servent pour la boisson, d’autres sont utilisées pour le bain. D’autres encore, telle la source de
11. G. Fusch dit Lymborh, Gilberti Philareti [sic], De acidis fontibus sylvae Arduennae praesertim eo qui in Spa visitur libellus, Antwerpiae, apud J. Bellerum, MDLIX, in-4°, traduction française : Des fontaines acides de la forest d’Ardenne et principalement de celle qui se trouve à Spa. Par M. Gilbert Lymborh, medecin. En Anvers, chez Iehan Bellere, au Faucon, MDLIX, 16 feuillets non numérotés. – Traduction espagnole : Tratado breve de las fuentes azedas que nascen al rededor de la selva de Arduena y principalmente de la d’el lugar Llamado vulguramente Espa que es la fuente que suelen dezir de Lieja. Por el doctor Gilberto Lymborgh medico. Impresso en Anvers en casa de Juan Bellero, MDLIX, 14 feuillets non numérotés. Traduction italienne : G. Fusch dit Lymborh, Trattato breve delle fonti acetose che nascono in torno alla selva di Ardenna et principalmente di quella del luogo uolgarmente chiamato Spa ; la quale è la fonte che si suol dir di Liége, composto primo in latino per il dottore Gilberto Limbor medico (…), In Milano, per Paolo Gottardo Pontio, l’anno MDXCII, 26 p. 79
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Géronster « se perd pour n’être pas fréquentée ». Une de ces sources a un usage médical. On l’utilise en effet pour des soins dermatologiques. Un mot aussi de la querelle érudite relative à la « fontaine de Pline ». Dans le climat d’humanisme fervent de la Renaissance, l’intérêt pour les fontaines thermales liégeoises trouve certainement une part de son origine chez Pline l’Ancien. Le livre XXXI de l’Historia naturalis mentionne une fontem insignem plurimis bullis stellantem, ferruginei saporis dans la Tungri civitas Galliae12. Pour Fusch, Pline évoque Spa, incorporée dans la cité des Tongres. Issu d’une famille intéressée à la gestion publique de Tongres, et Tongrois lui-même, Philippe Ghérinx riposte en 1578. Sa Description de la fontaine ferrugineuse de Saint-Gille, près de Tongre, paraît chez l’imprimeur liégeois Morberius, avec une dédicace au magistrat et à l’échevinage tongrois. Arguments philologiques, historiques, chimiques et médicaux à l’appui, Gherinx soutient que la fontaine ferreuse de Saint-Gilles, qui jaillit au pied des anciens remparts de Tongres correspond bien à la source décrite par le naturaliste latin13. C’est le début d’une rivalité durable entre les deux localités.
Fig. 8 : La Fontaine du Pouhon en 1603. Détail de la gravure de Jean Valdor Vera et exacta descriptio Spa Arduenne. Ms Henri Van den Berch, L’estat de la saincte et noble cité, pays etc., © Liège, Bibliothèque Ulysse Capitaine.
Le 24 août 1700, le magistrat de la ville de Tongres fait solennellement procéder à l’analyse de la source et acte dans le procès-verbal établi à cette occasion que celle-ci « convient entièrement avec la fontaine décrite par Pline au livre XXXI de son Histoire naturelle ». Au début du XIXe siècle encore, Hilarion Noël de Villenfagne signait une Histoire de Spa où on examine entr’autres choses si Pline a voulu désigner une des Fontaines de ce lieu célèbre dans ce passage Tungri civitas Galliae fontem habet insignem etc. ou bien si ce Naturaliste a voulu parler de la Fontaine de Tongres14. L’auteur se prononce en faveur de Spa. Henri de Heer était pourtant déjà resté indifférent au débat : « Pline, avait-il écrit, met aussi une fontaine ferree qu’il dist estre lez Tongre, lieu de ma naissance. Maintenant on doute si ceste fontaine est celle qui est entre 12. Pline l’Ancien, Histoire naturelle, livre XXXI, texte établi, traduit et commenté par G. Serbat, Paris, Belles Lettres, 1972, p. 31. 13. Ph. Gherinx, Description de la fontaine ferrugineuse de Saint-Gille, près de Tongre, par Monsieur Philippe Gherincx, médecin, à Liège, chez G. Morberius, 1578. 14. Hilarion Noël de Villenfagne d’Ingihoul, Histoire de Spa où on examine entr’autres choses si Pline a voulu désigner une des Fontaines de ce lieu célèbre dans ce passage Tungri civitas Galliae fontem habet insignem etc. ou bien si ce Naturaliste a voulu parler de la Fontaine de Tongres avec des notes qui servent de développement au texte et donnent des renseignements sur toutes les sources minérales du pays de Liège, 2 vol., Liège, 1803. 80
VERS UNE MODERNITÉ MÉDICALE
les masures lez la ville ou s’il la faut chercher dans le Pouhon de Spa (…). Les idiots au siècle où nous sommes se soucient peu de quelle fontaine ils boivent, pourvu qu’elle soit acide »15. Les aménagements dont les fontaines sont l’objet constituent un dernier indice de l’intérêt qu’elles suscitent. Au contraire des fontaines jaillissant en forêt et laissées à peu de choses près dans leur état naturel, la fontaine du Pouhon est, selon la description d’Henri de Heer, « environnée d’un beau marbre, qui peut contenir plus de quatre tonnes »16. L’iconographie confirme ces dires. Lors de leur séjour à Spa, en 1612-1613, Remigio Cantagallina (1582/83-1656) et Jan Breughel de Velours (1568-1625) ont en effet illustré les sources. Sur la place de Spa, Brueghel montre le pouhon, protégé de la pluie par un petit édifice : un entablement gazonné, supporté par quatre colonnes. Pour Tongres, on rêva, à la cour d’Ernest, d’une construction plus grandiose. Dominique Lampson décrivit un monument de marbre surmonté de trois statues : celle du prélat, entourée des effigies de Pline l’Ancien et de Philippe Ghérinx, les thuriféraires de la fontaine. L’oeuvre ne vit cependant jamais le jour.
Fig. 9 : Le Pouhon en 1612. Gravure de Guillaume II van Nievlant, d’après un dessin de Jan Brueghel Ier dit de Velours. © Bruxelles, Bibliothèque royale.
L’essor des eaux de Spa Passé chez les Anglo-saxons dans le langage courant pour désigner un établissement de bains, le thermalisme spadois élargit très rapidement son ancrage à l’Europe tout entière. « Ce lieu est un des plus célèbres et fameux de l’Europe pour l’abord de toutes nations, à cause des eaux médicinales qui y sont estimées les meilleures, plus salubres et plus universellement guérissantes, qu’en tout autre endroit du monde »17. Cette observation du géographe Pierre Bergeron, en 1619, à l’issue de sa visite aux eaux de Spa cerne bien toute l’ampleur de ce phénomène médical et social. 15. H. de Heer, Spadacrene (2e édition, Liège, 1622), f5 v° : Nec mihi hanc litem, aliis occupato, componere promptum est. Texte français dans H. de Heer, Les fontaines de Spa (…), Liège, J. Mottet, 1654, p. 4. (Cette remarque ne figure pas dans l’édition française de 1616). « Idiot » a ici le sens étymologique de « non spécialiste ». 16. H. de Heer, Spadacrene (2e édition, Liège, 1622), f20v°. 17. Voyage de Pierre Bergeron es Ardennes, Liege et Pays Bas, éd. H. Michelant, Liège, Société des bibliophiles liégeois, 1875, p. 161. 81
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Dès son démarrage, il est vrai, ce dernier a été a été servi par une abondante littérature médicale, qui a joué un rôle efficace de caisse de résonance. Parmi les textes qui paraissent, beaucoup sont l’oeuvre de praticiens étrangers, mais aussi de quelques Liégeois. Outre le traité sur les fontaines acides de Gilbert Fusch, on retiendra la Description des fontaines acides de Spa et de la fontaine de fer de Tungre de Philippe Ghérinx18. Publiée à Liège en 1583, la Description est traduite en latin neuf ans plus tard par Thomas de Rye († 1610) qui l’accompagne d’Observationes personnelles sur les eaux de Spa, sous le titre de Fontium acidorum pagi Spa et ferrati Tungrensis accurrata descriptio Autore Philippe Gaeringo medico19. Au début du XVIIe siècle enfin paraît la Spadacrene d’Henri de Heer, avec un titre partiellement forgé sur le grec, krênê, c’est-à-dire source ou fontaine. Publiée en 1614, elle est traduite en français en 1616 (Les fontaines de Spa). Avec des ajouts et des remaniements, les deux versions seront plusieurs fois rééditées au XVIIe siècle et jusqu’au milieu du siècle suivant. Au travers de ces textes, se construit un discours sur les eaux de Spa, leur nature et leurs vertus thérapeutiques, qui façonnent la réputation des sources. Les traités des eaux de Spa s’adressent aux médecins qu’ils informent sur la composition des eaux et les maladies qu’elles peuvent soigner. Ce sont aussi des manuels d’utilisation des eaux minérales, destinés aux curistes. Fig. 10 : Thomas de Rye, Fontium acidorum pagi Spa et ferati Tungrensis accurrata descriptio... Liège, ex officina H Hovii, 1592. Page de titre. © Liège, Université, Bibliothèque de Philosophie et Lettres.
La composition des eaux et leurs usages
Par une analyse sensorielle (par le goût, la couleur, l’odeur), progressivement affinée grâce à la distillation, les médecins liégeois établissent la composition des eaux en minéraux. Fusch met en évidence la présence de fer et de soufre dans les fontaines. Initié à l’alchimie par un confrère français, Philippe Besançon qui séjourne à Spa, Gherinx, y détecte également du vitriol (sulfate de fer et de cuivre). Besançon avait cru aussi y déceler de l’or, mais Ghérinx réfute cette affirmation. Au siècle suivant, Henri de Heer confirme ces résultats et les précise. Selon lui, la Sauvenière contient « de la terre rouge d’où on tire le fer, de l’ocre, du cuivre, du soufre, du salpêtre et du vitriol. Le Pouhon est riche en fer, cuivre, plomb, vitriol, soufre, alun, salpêtre et céruse (blanc de plomb). Il analyse aussi la fontaine de Géronster, surtout riche en fer et celle du Tonnelet, caractérisée par sa forte teneur en salpêtre. Pas plus que ses prédécesseurs, Henri de Heer ne peut toutefois déterminer en quelles proportions les métaux se répartissent dans les eaux20. 18. Ph. Gherinx, Description des fontaines acides de Spa et de la fontaine de fer de Tungre par Monsieur Philippe Gherinx, médecin, à Liège, chez G. Morberius, 1583. 19. Th. de Rye, Fontium acidorum pagi Spa et ferrati Tungrensis accurrata descriptio. Autore Philippe Gaeringo medico, e gallica latina facta a Thoma Ryetio, Principis Electoris Coloniensis, Leodiensis etc., Leodii, ex officina H. Hovii, 1592. 20. H. de Heer, Spadacrene, (2e édition, Liège, 1622 [f 30] : sufficiat ergo scire his aquis ferri, sulphuris, chalcanti, aliorum fossilium vim inesse qualitatum tamen primarum proportione manere incerta. 82
VERS UNE MODERNITÉ MÉDICALE
Ces différents métaux ont des qualités « froides et humides mais potentiellement chaudes et sèches », qui permettent de soigner les maladies. La variété des métaux « froids et chauds, ouvrants ou astringents (…) rendent les eaux « bonnes et salutaires pour des maladies contradictoires les unes par rapport aux autres »21. Dans une perspective galénique, les médecins louent surtout les sources pour leurs vertus purgatives, et leur faculté d’ouvrir les conduits de l’organisme. Le huitième chapitre du traité de Gilbert Fusch concerne « la vertu purgative de ceste fontaine et de la faculté d’icelle pour provoquer l’urine et la sueur ». Il observe « ceste fontaine beüe exerce diversement ses operations en diverses gens, en faisant vomir les uns, provoquant l’urine et lachant le ventre aux autres »22. De ces facultés émétiques, laxatives et diurétiques, découlent certains emplois thérapeutiques de l’eau de Spa : principalement, la purgation de la mélancolie ou du phlegme, l’expulsion des calculs des reins et de la vessie, l’expulsion des vers. Sa capacité de dessiccation fait de l’eau de Spa un remède à la stérilité, en asséchant la matrice23. Elle est aussi censée assécher « le cerveau trop humide » produisant trop de phlegme. On traitera ainsi les écoulements nasaux des rhumes, mais aussi la paralysie, qui pense-t-on résulte aussi de la trop grande humidité du cerveau. Ces eaux sont aussi utilisées contre les fièvres, la goutte, les maladies vénériennes ou les maladies de peau. Hormis Henri de Heer qui emploie aussi l’eau pour des applications, des bains, voire des injections (pour des curetages de la vessie ou de l’utérus notamment), l’eau de Spa est généralement donnée à boire. Le discours théorique s’accompagne souvent de la relation de cas cliniques, exceptionnels ou spectaculaires censés le corroborer. Philippe Gherinx relate ainsi le cas « d’une dame très honorable », qui fut sa patiente, et à qui il avait recommandé la cure à Spa. « Chose admirable à dire, la dame était âgée de 46 ans quand j’ai pu la rencontrer. À cause de la suppression durable de ses règles, elle était tombée dans l’hydropisie ascite et avait déjà, huit ans auparavant, été soignée par des médecins très expérimentés, pour ce mal. Malgré les remèdes les meilleurs, rien ne lui avait été profitable. Sur mon conseil, elle se rendit aux eaux de Spa. Après quelques semaines de traitement, ses règles reviennent et enfin, de l’eau en abondance et un ver d’une longueur d’un demi coude, avec quatre pattes, une queue oblongue, ressemblant à un lézard, de couleur jaune hors de l’eau et rougeâtre dans l’eau. Enfin, huit ou neuf animaux analogues par la forme et la couleur mais plus petits sont sortis. Elle expulsa enfin du sable, des excréments issus de la suppression durable de ses règles. En même temps son ventre s’est dégonflé et aussitôt elle a commencé à mieux se porter »24. Curatives, les eaux de Spa se prennent aussi à titre préventif. Henri de Heer évoque les personnes saines qui viennent aux eaux, pour « se maintenir saines et se préserver des maladies »25. Les jeunes mariés et les amants par exemple, se rendent par plaisir aux fontaines thermales, sans que leur état requière un traitement préalable plus sévère qu’une légère purgation26. Quant aux Spadois, qui utilisent l’eau acide comme breuvage habituel, leur santé, comme leur longévité sont exceptionnelles : « Les habitants du village de Spa, affirme Philippe Ghérinx, mènent dans une santé presque continuelle leur vie jusqu’à l’extrême vieillesse. Certains d’entre eux dépassent les 100 ans. Je me souviens, qu’en ma présence une petite vieille a été ensevelie, elle avait atteint les 120 ans. Cependant, jusqu’à sa mort sa santé avait été optimale, n’usant de rien d’autre pour sa boisson que de l’eau du pouhon »27 . Prendre les eaux et se promener Destinés aux médecins, les traités relatifs aux eaux de Spa sont aussi des manuels pour curistes. « Ceux qui désirent recouvrer la santé perdue, par la boisson d’eau acide ou qui souhaitent conserver la santé iront
21. H. de Heer, Spadacrene, [f 30] Constat sane omnes hos fontes actu frigidos esse ac humidos, ceterum potentia calidos et siccos. Ph. Gherinx, Descriptio fontis spadanis, p. 20 : dicimus igitur aquas hasce medicatas communiter refrigerare ab initio potionis, tandem calefacere, universim autem dessicare omnes, ibidem, p. 22 (morbos curent inter se contrarios). 22. G. Fusch, op. cit., f 9v°. 23. H. de Heer, Spadacrene, [f38v°]. 24. Ph. Gherinx, Descriptio fontis spadani, p. 25-26. 25. H. de Heer, Spadacrene, f 32 ; sed et illos a predictis morbis praeservare, immunesque reddere. 26. H. de Heer, Spadacrene, f 41v° ; qui aquas bibituri sunt uel sani voluptatis ergo, ut solent recens nuptiae cum maritis, vel proci cum amasiis. 27. Ph. Gherinx, Descriptio fontis spadani, p. 37-38. 83
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
de grand matin à la Sauvenière, vers 5h ou plus tôt ou plus tard selon le temps et commenceront à boire, ils iront à pied ou, s’ils sont faibles de tout le corps, se feront transporter à cheval, ou en chariot, ou en litière. Les paralytiques et ceux qui sont alités boiront l’eau de la fontaine récemment apportée par leurs serviteurs. Les plus riches et ceux qui ne peuvent supporter l’air et ceux qui ne supportent pas les secousses du cheval ou des véhicules souffriront d’être portés en chaise. À la source où il sera venu, si quelqu’un se sent fatigué (car le chemin est rude et difficile), il se reposera un peu. Ensuite, il commencera à boire, en se promenant entre chaque prise »28.
Fig. 11 : Curistes cheminant en litière. Détail de la gravure de Jean Valdor, Vera et exacta descriptio Spa vici Arduenne. Ms Henri Van den Berch, L’estat de la saincte et noble cité, pays etc. © Liège, Bibliothèque Ulysse Capitaine.
Les quantités ingurgitées sont importantes, mais variables d’un individu à l’autre. Les médecins recommandent de commencer à boire en augmentant journellement la dose, jusqu’à atteindre un niveau de satiété, et sans alourdir l’estomac. Le matin, on boit l’eau à jeun. Des graines d’anis, de coriandre29 ou d’autres épices30, entre chaque verre, aident à digérer l’eau. Après l’ingestion de chaque verre, il convient de se promener afin d’activer le travail de l’eau dans le corps. La promenade « réchauffe les viscères qui, ainsi se renforcent, et sucent l’eau plus abondamment »31. Pour ceux qui le peuvent, des médecins suggèrent de retourner aux sources durant l’après-midi, pour une deuxième ration, de moitié moins importante que la première. Le rythme de la boisson est quotidien, seulement interrompu par les jours de pluie, car la pluie
28. Ibidem, p. 30-31. 29. Ibidem, p. 31. 30. H. de Heer, Spadacrene, f49 (ces graines peuvent être mélangées à du sucre). 31. Ibidem, f49 : nam ambulatio calefacit viscera, quae adeo aquam avidius attrahunt magisque roborantur. 84
VERS UNE MODERNITÉ MÉDICALE
détrempe les eaux acides et les déminéralise. La cure s’étend sur plusieurs semaines « pour que la qualité et vertu minerale s’imprime au corps » et, si c’est nécessaire pour obtenir une guérison parfaite, plusieurs années d’affilée32. Les modalités de la boisson, telles que Philippe Gherinx les décrit, se retrouvent à peu de choses près, dans les différents traités, en ce qui concerne les quantités et le rythme des prises, la saison pour prendre les eaux, voire les rituels qui s’associent bientôt à la cure. Dès le tournant du XVIIe siècle, elles donnent sa tonalité au thermalisme spadois.
Fig. 12 : Remigio Cantagallina, La source de la Sauvenière à Spa. Dessin à la plume et lavis sur croquis au fusain, 4 août 1612. © Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
Au début du XVIIe siècle, Henri de Heer et Pierre Bergeron évoquent la canne décorée, dont les curistes se munissent pour cheminer vers les sources33. Dans un autre registre, on citera les femmes qui se tiennent à la Sauvenière pour distribuer les verres et les rincer. Leur familiarité avec les sources est telle que, dit-on, elles peuvent prédire les orages, au bruissement particulier de l’eau34. Enfin, l’appellation même de bobelin
32. La formule provient du chapitre relatif aux eaux de Spa de Nicolas Abraham sieur de la Framboisière, Le gouvernement nécessaire à chacun pour vivre longuement en santé avec le gouvernement requis en l’usage des eaux minérales tant pour la préservation que pour la guérison des maladies rebelles. Seconde édition reveuë, corrigée et augmentée par l’autheur, Paris, chez Michel Sonnius, 1601, p. 430-431. 33. H de Heer, Spadacrene, [f57v°] : in prato ambulationi aut choraeis vacant, vel scipionibus quibus ad fontem ituri nituntur, ad palum se exercent. Pierre Bergeron, op. cit., p. 165 (le simple baston peint et enjolivé pour la monstre et contenance ou pour le soustien ou la commodité), p. 165. 34. H. de Heer, Spadacrene, f 57v°. Bibl. communale de Spa, Fonds Albin Body, farde 200, J. Junius, Aquarum Spadanarum Griphi sive Aenigmata eorundem explicatio proficiscentibus ad Aquas spadanas non minus utilis quam iucunda, Lovanii, 1614, p. 9 (copie manuscrite d’Albin Body). 85
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
donnée par les Spadois aux curistes, jugée étrange par Gilbert Fuchs qui la cite déjà, participe de ce folklore35. Dans son dictionnaire de dialecte liégeois, le philologue Jean Haust rapproche bobelin du wallon boublin, qui signifie sot, niais, stupide36. Le régime pour les curistes La prise quotidienne des eaux s’assortit du respect de règles de vie, censées renforcer les effets de la cure. Les règles concernent principalement l’alimentation et plus généralement l’hygiène de vie. Esquissé dans ses grandes lignes par Gilbert Fusch, le régime pour les curistes est ensuite développé par Philippe Ghérinx et par Henri de Heer. Il constitue de même un aspect important de traités dus à des médecins étrangers, Philippe Besançon37 et Nicolas Abraham de La Framboisière, par exemple. Pour tous les auteurs, deux repas quotidiens suffisent aux curistes, le premier vers 11h (dîner), le second vers 18h ou 19h (souper). Ces repas ne peuvent être pris que trois heures environ après l’ingestion de l’eau, et après que celle-ci, ayant accompli son office de purgation, ait été complètement éliminée de l’organisme. Le menu doit être nourrissant et « de viande facile à digérer », rôtie ou bouillie. Au chapitre des nourritures carnées, les médecins permettent les volailles, le mouton, le veau, mais proscrivent des tables les viandes « de suc gros et visqueux, de dure digestion et de mauvais nourrissements qui pourroient boucher les conduits »38, tels le bœuf, le porc ou le gibier. Une interdiction analogue frappe les laitages. Le poisson s’impose durant des jours maigres. Les variétés citées sont des poissons de rivière, et notamment précise Henri de Heer, des truites qui abondent à Spa39. À l’inverse des Liégeois qui n’en parlent pas, les médecins français évoquent les aliments d’origine végétale. Philippe Besançon déconseille aux curistes les « herbes fortes et âcres comme oignon, poireaux ou autres choses de mauvais jus »40. La Framboisière recommande pour sa part de consommer du pain blanc, bien cuit et bien levé. Pour le dessert, les curistes choisiront des écorces de citrons ou d’oranges confites, des graines d’anis confites, de coriandre, de fenouil sucré, des raisins ou d’autres fruits secs, telles les amandes ou les pistaches. En saison, Henri de Heer suggère aussi les pommes et les poires rôties à la cannelle ou bouillies dans du vin. Nicolas de la Framboisière ajoute les biscuits et le massepain à la carte des desserts. Du vin blanc ou clairet accompagne le repas. La sélection des crus découlant de la situation géographique de Spa, les vins cités sont ceux disponibles sur place, en l’occurrence des vins blancs du Rhin ou de la Moselle. Nicolas de la Framboisière et Henri de Heer désapprouvent l’habitude de couper le vin d’eau de sources, en particulier d’eau du pouhon qui pourtant « le fait trouver meilleur et plus piquant »41. C’est qu’il ne faut pas « mesler le medicament avec le nourrissement »42. Henri de Heer juge en outre contradictoire « d’affirmer d’une part qu’il faut dîner quand on a rendu toutes ses eaux et au dîner, en boire de la nouvelle, d’autre part que toute chose diurétique ou relevant des urines doit se prendre longtemps après le repas »43. En conclusion de quoi, il conseille de boire le vin pur, ou coupé d’eau de puits, bouillie, et aromatisée à la cannelle44.
35. G. Fusch, Des fontaines acides, non folioté, fin du ch. 3 « Ils appellent les étrangers qui boivent cette eau d’un vocable assez étrange à savoir Boulhin et boublins ». 36. J. Haust, Le dialecte wallon de Liège. 2e partie : Dictionnaire liégeois, Liège, 1933, p. 98. 37. Ph. Besançon, Petit Traicte des merveilleux effects de deux admirables fontaines en la forest d’Ardenne et le moyen d’en user à plusieurs maladies. Pris du latin de Maistre Philippes Besançon, docteur en medecine et mis en françois par Martin le Febvre chirurgien à Illiers en Beauce, Paris, 1577. 38. N. de la Framboisière, op. cit., p. 434. 39. H. de Heer, Spadacrene, f 54v°. 40. Ph. Besançon, Petit Traicte des merveilleux effects, p. 12. 41. N de la Framboisière, op. cit, p. 434. 42. Ibidem, p. 434-435. 43. H. de Heer, Spadacrene, f 55-v°. 44. Ibidem, f55v°-56. 86
VERS UNE MODERNITÉ MÉDICALE
Fig. 13 : Remigio Cantagallina, La source de la Géronstère à Spa. Dessin à la plume sur croquis au fusain, traces de sanguine, 9 août 1612. © Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
Tout bien considéré, la cuisine proposée aux curistes ne manque ni de variété, ni de saveur. Les menus requièrent souvent l’emploi de produits luxueux, réduisant le public susceptible de les consommer à une élite socio-économique. Des conseils relatifs au mode de vie dans la ville d’eaux, en dehors du temps consacré à la cure, qui complètent le régime des curistes confirment cette impression d’aisance matérielle. En référence aux recommandations hippocratiques, avant de prendre les repas, l’exercice physique est préconisé, mais sans se fatiguer ou se faire suer. On dansera ou on pratiquera une sorte d’escrime avec la canne qui sert pour se rendre aux sources. Enfin, on se promènera « doucement après souper le longs des ruisseaux et fontaines qui sont fréquentes en ce territoire là »45. Après le repas, les curistes sont aussi invités à se divertir à des jeux de société, notamment aux jeux de cartes, et bientôt, selon Pierre Bergeron à des spectacles46. Parce que le sommeil empêche l’expulsion des superfluités du corps, après le repas de midi, les curistes éviteront la sieste47. Seul auteur à tenir ces propos, La Framboisière recommande aussi d’éviter les exercices intellectuels et, aux femmes, les travaux de couture qui étourdissent la tête48. Il invite en outre les curistes à se coucher tôt, hommes et femmes à part. La cure spadoise implique enfin d’adopter un état d’esprit particulier, fait de sérénité et de joie de vivre, au milieu d’un paysage agréable49. Philippe Besançon parle de boire les eaux d’un « cœur allègre »50. Et selon Pierre Bergeron, « Le régime mesme, porte que chascun se tienne le plus gay et joieux qu’il pourra, bannissant tout soin, soucy et melancholie »51. Henri de Heer, enfin, observe qu’au plus fort de l’été, « les 45. Ph. Besançon, op. cit., p. 12. H. de Heer, Spadacrene, f 57 parle de « se promener doucement » leviter ambulandum. 46. P. Bergeron, op. cit., p. 164-165. 47. Cf par exemple H. de Heer, Spadacrene, f 56v°-57. 48. N. de La Framboisière, op. cit., p. 435-436. 49. P. Bergeron, op. cit., p. 161 évoque « les petites plaines et prairies assez délectables » qui servent de « pourmenoir à ceux qui prennent cet exercice par medecine et après la boisson de leurs eaux ». 50. Ph. Besançon, op. cit., p. 13. 51. P. Bergeron, op. cit., p. 165. 87
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
notables liégeois» « viennent à Spa en grande troupe, ils se préservent de la chaleur et de la soif en prenant les eaux, et des ennuis et fâcheries avec des propos joyeux et pleins de la gaieté naturelle à ce pays »52. Dès les premières décennies s’amorce ainsi, pour les patients spadois, les conditions d’une villégiature oisive, insouciante et aristocratique. Les « amusements des eaux de Spa » tels qu’ils seront décrits au XVIIIe siècle sont en germe. Profils de Bobelins Les auteurs de traités relatifs aux eaux de Spa et, après eux les historiens du thermalisme spadois, se sont plu à établir une prestigieuse galerie de portraits de curistes, de personnages importants, hommes et femmes, venus des Pays Bas, de France, d’Angleterre, d’Italie ou encore d’Espagne, à Spa afin d’y prendre les eaux. Parmi les plus célèbres, Marguerite de Valois y vint en 1577, Alexandre Farnèse, gouverneur des Pays Bas s’y rendit à trois reprises en 1589, 1591 et 1592. En 1583, le roi de France Henri III se fit livrer à Mézières, des bouteilles d’eau puisées aux sources spadoises, pour soulager ses accès de gravelle. Dans sa relation de voyage aux Pays Bas, Pierre Bergeron évoque de son côté une foule bigarrée de curistes de toute origine géographique et sociale : « outre nos François et ceux de tous les Païs Bas, des Italiens, Espagnols Allemands, Anglois, Danois de tout âge, sexe, profession, religion comme catholiques et protestants de toutes sortes, (…) plusieurs princes, seigneurs et dames et de toute autre condition de personnes, jusqu’à des mendiants aussi curieux de la santé que de la quête de leur vie »53. Un traitement à Spa supposait un séjour sur place long et donc onéreux, inaccessible à une majorité de malades. Les médecins recommandent, en préalable à la cure proprement dite, une préparation du corps, en l’occurrence, une purgation. Dans la Spadacrene, Henri de Heer tient aussi compte du public moins fortuné en lui proposant des médications peu coûteuses54. Et reconnaissant les difficultés matérielles qu’implique un long séjour à Spa, il propose d’assortir la cure de médicaments qui en hâteront les effets55. Il est vrai que le médecin liégeois se soucie de toucher un public le plus large possible. À la fin de son traité, il définit aussi les modalités de la cure pour les femmes enceintes et pour les enfants. À ceux qui doutent de l’utilité des cures pour les plus jeunes, il rappelle que sa propre fille a pris les eaux, avec profit, dès avant l’âge de trois ans. Il estime seulement nécessaire d’adapter les rations quotidiennes à leur taille et à leur capacité corporelle. Il les recommande aussi aux femmes enceintes, moyennant toutefois quelques précautions. Tous les curistes, cependant, n’allaient pas à Spa. Les conditions de l’exportation de l’eau du Pouhon, sont connues dès la fin du XVIe siècle. Mise en bouteilles, l’eau fait rapidement l’objet d’un commerce international. Henri de Heer évoque son transport jusqu’en Angleterre, en Hollande, en France, en Germanie et vers l’Italie56. Avant lui, un médecin d’Ernest de Bavière, Jean-Baptiste d’Hardencourt avait commercialisé une « poudre de Spa », dotée des mêmes propriétés médicinales que l’eau, et exportable sans dommage jusqu’en Vénétie57. Beaucoup de patients enfin suivaient leur cure à Liège. Henri de Heer évoque des Liégeois faisant, à la belle saison, provision de bouteilles du pouhon pour l’hiver58. C’est notamment le cas de l’humaniste brabançon Juste Lipse, lorsqu’il ne peut se rendre à Spa. Enfin, les eaux étaient, semble-t-il, prescrites aux hospitalisés de Bavière. C’est en tout cas ce que laisse penser le cas de Gilles d’Ouffet, relaté ci-dessus.
52. H. de Heer, Spadacrene, f48. Dans ses conseils finaux, Henri de Heer recommande encore aux curistes de quitter leur maison curis domi relictis, ibidem, f 66. 53. P. Bergeron, op. cit., p. 161-162. 54. H. de Heer, Spadacrene, passim ch. 10, f 40-44. 55. H. de Heer, Spadacrene, f44-v° : cum non omnes his aquis eaque dicam quantitate, pauci etiam iis quas praescribam hebdomadibus vel mensibus bibere possint. 56. Henri de Heer, Spadacrene, ff n ch 20 : et tamen infinitae in dies lagenae ex eo implentur, in vicina eburonum loca, Britanniam, Hollandiam, Galliam, Germaniam, Italiam ipsam mittendae. 57. J.-B. d’Hardencourt, Si dimanda informatione delle proprietà et particolarità che seguitano arcana l’acqua di Spaa ? f 5. Ms de la Biblioteca Apostolica vaticana, (fonds Urbino), Tirage sur papier, conservé à la bibliothèque communale de Spa, fonds Albin Body, farde 223. 58. H. de Heer, Spadacrene, f 23v°-24. 88
VERS UNE MODERNITÉ MÉDICALE
Fig. 14 : Bouteille à eau de Spa. Début XVIIe siècle. Spa, Musée de la Ville d’eaux. © Cliché CHST-ULg.
La part du prince Tout comme les codifications relatives aux professions médicales entérinées par l’échevinage liégeois, la fondation de la Compagnie et de la Maison de Miséricorde sont des faits du prince, placés sous son égide. Les chartes de fondation et les statuts sont dressés au nom d’Ernest de Bavière. Le prince offre, de surcroît, un de ses palais pour y installer le nouvel établissement de soins. Des liens avec le pouvoir liégeois existent de même pour les eaux de Spa. Les quatre médecins, auteurs de traités sur le thermalisme se succèdent comme médecins des princes-évêques. Gilbert Fusch dit Lymborgh sert ainsi Georges d’Autriche (1544-1557), Robert de Berghes (1557-1564) et Gérard de Groesbeek (1564-1580). Dans le sillage de ce prélat, apparaît ensuite le deuxième auteur Philippe Gherinx, que l’on trouvera également attaché à Gérard de Groesbeek, ensuite à Ernest de Bavière. Ghérinx sera à la fois son médecin et son conseiller personnel. À sa mort, en 1585, sa veuve, Ida van der Hagen, s’est remariée avec Thomas de Rye, devenu à son tour médecin d’Ernest qu’il soigne jusqu’à sa mort en 1610. En 1605, la fille de Thomas de Rye a épousé Henri de Heer. Celui-ci sera le médecin attitré de Ferdinand de Bavière, des fonctions qu’il conserve jusqu’à son décès, vers 1636. C’est donc au sein de l’entourage princier que se sont effectuées les analyses des eaux minérales et que s’est construite la réputation du thermalisme spadois. À différents égards, les traités sur les eaux de Spa s’apparentent à une littérature de propagande. C’est donc aussi dans le milieu curial que, dès 1560 environ, s’est organisée la promotion des eaux minérales locales. Il s’agissait tout à la fois de convaincre le public d’aller à Spa pour y prendre les eaux, de défendre la réputation de la station ardennaise contre la concurrence étrangère, d’imposer enfin le thermalisme comme un nouveau moyen thérapeutique. Ceci ressort de la « réponse aux frivoles qui critiquent les eaux », conclusive de la Descriptio fontis spadani de Philippe Ghérinx59. Celui-ci vise les tenants de la médecine galénique traditionnelle. Ghérinx y réfute les arguments des partisans du régime hippocratique : « les discours des stupides buveurs de vin et non buveurs d’eau, qui s’efforcent d’obscurcir la réputation des nobles sources », qui prétendent qu’à Spa, la guérison s’opère, non grâce aux fontaines mais par « la nourriture recherchée
59. Ph. Gherinx, Descriptio fontis spadani, p. 35-38. 89
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
associée à l’exercice ». Le médecin liégeois soutient d’autre part le recours à des médicaments d’origine minérale, contre les personnes qui prétendent les eaux de Spa dangereuses, à cause de leur teneur en vitriol. D’un point de vue philosophique et scientifique, Spa et la Maison de Miséricorde pourraient avoir le paracelsisme comme dénominateur commun. Expression de la bienfaisance privée et héritier de l’hospitalité religieuse médiévale, l’hôpital de Bavière est aussi le reflet de la philosophie médicale de Paracelse qui n’admet l’exercice de la médecine qu’à titre gratuit60. L’intérêt pour le thermalisme ressortit également à la doctrine de Paracelse. En établissant un lien étroit entre semence des métaux et apparition d’eaux minérales, les Paracelsiens lient iatrochimie et thermalisme. Et si Ernest n’a pas lui-même analysé les eaux de Spa, du moins a-t-il procédé à l’analyse des sources de Bad Ems en Rhénanie61.
Fig. 15 : Jean Valdor, Vera et exacta descriptio Spa Arduenne (1603). Ms Henri Van den Berch, L’estat de la saincte et noble cité, pays etc., f72. © Liège, Bibliothèque Ulysse Capitaine.
Si la fondation de la Maison de Miséricorde découle du paracelsisme, elle s’explique certainement aussi par le contexte de la Contre Réforme qui favorise le développement de sodalités religieuses sous le contrôle des autorités, et qui, par sa volonté d’encadrement social et doctrinal des démunis, participe à la mission des autorités catholiques de reconquête des esprits. Sous cet angle, comme à d’autres points de vue, les deux pôles de l’action d’Ernest dans le domaine sanitaire doivent être dissociés.
60. R. Halleux, A.C. Bernès, « La cour savante d’Ernest de Bavière », p. 23. 61. Ibidem, p. 23. 90
VERS UNE MODERNITÉ MÉDICALE
Le démarrage du thermalisme spadois ne se comprend peut être pas bien sans son arrière-plan socio-économique, voire politique. Comme Gilbert Fusch le rappelle à Robert de Berghes, dédicataire de son traité, le vicus de Spa dépend du marquisat de Franchimont62, une terre dans la mouvance directe du pouvoir épiscopal liégeois. Au XVIe siècle, le village ardennais connaît un essor important, grâce à l’exploitation minière et métallurgique qui s’y déploie, et à laquelle Ernest de Bavière s’intéresse de près. Les cures aux eaux sont le prétexte à de longs séjours dans la région spadoise, favorables pour l’économie du lieu. Hormis quelques hôtes triés sur le volet que l’évêque honore d’un logement dans son château de Franchimont (tel Alexandre Farnèse), les curistes logent tantôt dans des hôtelleries (diversoria), tantôt, semble-t-il chez l’habitant. Aux dires de Pierre Bergeron, Spa est, en 1619, un « bourg de quatre à cinq cents maisons, toutes assez bien basties et commodes pour tous les survenans estrangers qui y viennent de tous costez de l’Europe y boire des eaux médicinales du lieu »63. Dans une Europe aux prises avec les conflits religieux, la principauté de Liège, est désormais un territoire relativement paisible et prospère. Les fontaines de Spa pourront apparaitre comme un havre de paix pour des personnalités de tout rang et de tous horizons qui s’y rencontrent. En termes de renom international pour le pays de Liège, Spa a aussi un rôle non négligeable à jouer. *** Avec leurs diverses implications, le thermalisme spadois et la Maison de Miséricorde illustrent des aspects contrastés d’une même volonté princière de modernité médicale. Mais, chacun à sa manière, ces deux pôles de l’action sanitaire de l’évêque bavarois reflètent aussi les ombres et les lumières de son règne. Les efforts pour endiguer la misère physique et matérielle du plus grand nombre contrastent avec la quête d’un bien être corporel et d’une villégiature insouciante, réservée à une minorité de privilégiés.
ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE Médecine et cours : R. HALLEUX, « Nouveaux matériaux sur la cour savante d’Ernest de Bavière », Cinquième Congrès de l’Association des Cercles francophones d’Histoire et d’archéologie de Belgique. Herbeumont août 1996, Actes, t. 2, Namur, 2000, p. 394-404. R. HALLEUX, A.C. BERNÈS, « La cour savante d’Ernest de Bavière », Archives internationales d’Histoire des Sciences, t. 45, 1995, p. 3-29. NUTTON V., Medicine at the courts of Europe 1500-1837, London, 1990. E. POLAIN, La vie à Liège sous Ernest de Bavière, 2 vol., Tongres, 1938. J. VONS, ST. VELUT (dir.), Pouvoir médical et fait du prince au début des temps modernes, Paris, 2011 (sous presse). Médecine et pharmacie à Liège : J.-FR. ANGENOT, La pharmacie et l’art de guérir au pays de Liège, Liège, 1983. U. CAPITAINE, « Études biographiques sur les médecins liégeois depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1850 », Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 3, 1857, p. 71-103, 226-267, 427-496. M. FLORKIN, J. KELEKOM, Le monde médical liégeois avant la Révolution, 2 vol., Liège, Société des Bibliophiles liégeois, 1996. 62. G. Fusch, op. cit., dédicace non foliotée. 63. Pierre Bergeron, p. 160. Certains curistes de haut rang, tel Alexandre Farnèse gouverneur de Pays Bas du sud, sont accueillis dans le château du prince évêque à Franchimont. 91
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
HAVELANGE C., Les figures de la guérison (XVIIIe-XIXe siècles), Une histoire sociale et culturelle des professions médicales au pays de Liège, Paris, 1990. J. STIENNON, « Une dynastie de médecins du pays de Liège aux XVe et XVIe siècles : les Gherinx », Revue médicale de Liège, t. 11-n°10 (1956), p. 295-306. G. XHAYET, « Henri de Heer, médecin de ville et médecin de cour dans la principauté de Liège au début du e XVII siècle », p. 107-122 dans Pouvoir médical et fait du prince au début des temps modernes, J. VONS, ST. VELUT (dir.), Paris, 2011 (sous presse). Hôpitaux liégeois et Hôpital de Bavière : BAUWENS C. (dir.) La licorne. Secrets et découvertes (Études et documents. Archéologie), Namur, à paraître. De Bavière à la Citadelle, Catalogue de l’exposition organisée par le Centre public d’Aide sociale, Liège, 1980. J. DARIS, « Les Alexiens à Liège », Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 11, 1872, p. 273-282. M. DE MEULEMEESTER, Les Augustines de l’hôpital de Bavière à Liège, Louvain, 1934. P. DE SPIEGELER, Les hôpitaux et l’assistance à Liège (Xe-XVe siècles), Paris, 1987. M. FLORKIN, « Les origines de l’Hôpital de Bavière », dans MARCEL FLORKIN ET LÉON-E. HALKIN, Chronique de l’université de Liège, Liège, 1967, p. 9-22. R. HANKART, « L’ancien hôpital Saint Abraham à Liège. Des origines à la fin de l’Ancien Régime », Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 96, 1984, p. 69-173. R. HANKART, « L’hospice de Cornillon à Liège », La Vie wallonne, 40, 1966, p. 5-49. La Licorne apprivoisée. De la cellule d’isolement à l’appartement familial. Catalogue d’exposition, Charleroi, 2009, 73 p. J. NOËL, L’origine et le développement de la Maison de Miséricorde dite Hôpital de Bavière à Liège au XVIIe siècle. Contribution à l’histoire de la bienfaisance dans la principauté de Liège, 2 volumes dactylographiés, Université de Liège, 1948. G. XHAYET, « Couvents et maisons religieuses comme établissements de soins à Liège et dans son diocèse au moment de la Renaissance », dans J. VONS (dir.), Pratique et pensée médicales à la Renaissance, Paris, 2009, p. 77-90. Thermalisme et Eaux de Spa : P. BERTHOLET, « Histoire quantitative et organisation du commerce des eaux de Spa aux XVIIe et XVIIIe siècles », Histoire et Archéologie spadoises, n° spécial de juin 1980, pp. 72-86. A. BODY, Bibliographie spadoise et des eaux minérales du pays de Liège, Bruxelles, 1875. ID., « Juste Lipse aux eaux de Spa (1591-1595) », Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 14 (1878), p. 277-292. ID., La vie des Bobelins autrefois, sl, sd. D. BOISSEUIL, M. NICOUD, Séjourner au bain : le thermalisme entre médecine et société (XIVe-XVIe siècles), Lyon, 2010. Histoire d’eaux. Stations thermales et balnéaires en Belgique XVIe-XXe siècles, Bruxelles-Spa, 1987-1988. J. BOUCHER, « Voyages et cures thermales dans la haute société française à la fin du XVIe et au début du e e XVII siècle », in Villes d’eaux. Histoire du thermalisme. Actes du 117 congrès national des sociétés savantes. Clermont-Ferrand, 1992. Paris, 1994, p. 41-53. L. M. CRISMER, La fabuleuse histoire des eaux de Spa, Spa, 1983. G. RATH, « Die Mineralquelleanalyse im 17. Jahrhundert », Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, t. 41, 1957, p. 1-9. 92
VERS UNE MODERNITÉ MÉDICALE
J. TOUSSAINT, Bibliographie spadoise, t. 1 (1541-1784). Essai de mise à jour et de correction de la Bibliographie spadoise d’Albin Body, mémoire inédit Liège, 1970. H. N. DE VILLENFAGNE D’INGIHOUL, Histoire de Spa où on examine entr’autres choses si Pline a voulu désigner une des Fontaines de ce lieu célèbre dans ce passage Tungri civitas Galliae fontem habet insignem etc. ou bien si ce Naturaliste a voulu parler de la Fontaine de Tongres avec des notes qui servent de développement au texte et donnent des renseignements sur toutes les sources minérales du pays de Liège, 2 vol., Liège, 1803. G. Xhayet, « Les premiers traités liégeois relatifs aux eaux de Spa (1559-1616) », à paraître dans la revue Seizième Siècle. Eaux de Tongres : FR. DRIESEN, Recherches historiques sur Tongres et ses environs, avec les plans topographiques de Tongres, Tongres, 1851.
93
L’OPÉRATEUR INDUSTRIEL Robert Halleux
Comme la plupart des princes praticiens du XVIe siècle, Ernest de Bavière est intervenu personnellement dans le développement industriel de ses États. Jean Lejeune a montré que son règne coïncidait avec le développement du capitalisme moderne, particulièrement dans le secteur minier et métallurgique1. Alchimiste et paracelsien, Ernest ne pouvait rester indifférent aux richesses minières de la Principauté. À Liège et aux environs, la houille affleurait et on l’exploitait depuis le XIIe siècle au moins2. En bordure du massif ardennais et dans l’Entre Sambre et Meuse, on trouvait des couches et des amas de minerai de fer presque toujours exploitables à faible profondeur3. La grande forêt d’Ardenne fournissait le charbon de bois nécessaire aux fourneaux. La région de Verviers-Limbourg et de Theux-Franchimont (synclinorium de Verviers) et la vallée de la Meuse (synclinorium de Namur et synclinorium de Dinant) contenaient des gisements significatifs de blende (sulfure de zinc) souvent altérée en calamine (carbonate de zinc), de pyrite (sulfate de fer) et de galène (sulfure de plomb) contenant parfois de l’argent4. Ces gisements sont souvent oxydés près de la surface où on trouve des produits d’altération, aluns, sulfates de fer et de cuivre. Dans tous ces domaines, l’époque d’Ernest voit des avancées significatives, auxquelles l’action personnelle du prince n’est pas étrangère. 1. La houillerie En 1609, Remacle Mohy5 écrit « Les charbons que l’on tire des fosses ou houillières de Liège se peuvent bien mettre au rang des merveilles qui se retrouvent aux entrailles de la terre... Le feu desdits charbons est beaucoup plus chaud que celuy des bois et je l’estime aussi beaucoup plus sain, ores que ceste grande chaleur est d’une fort grande opération et qu’elle peut per ce moyen servir de beaucoup à ceulx qui sont chargés d’humeurs froides et catarrheuses ». En 1615, Philippe de Hurges décrit Liège comme une ville minière, avec les collines percées de galeries et de bures6. Toutefois, tant dans les houillères que dans les mines métalliques, les techniques d’extraction durent très tôt surmonter des difficultés importantes liées à la présence de nappes aquifères7. C’était une maxime chez les maîtres de fosses que plus on fait d’ouvrages et plus on acquiert d’eaux. La méthode la plus ancienne pour démerger les travaux miniers inondés fut de creuser des galeries sinueuses, en pente douce, menées depuis le pied de la colline jusqu’aux travaux noyés. Ces galeries d’écoulement, qui s’appelaient des araines, assuraient en même temps l’approvisionnement en eau de Liège. « Point de fosse sans araine » répétaient depuis le XIVe siècle les coutumes de houillerie liégeoise8. Ce procédé s’avéra inefficace dès que les puits descendirent plus bas que le fond des vallées. 1. J. LEJEUNE, La formation du capitalisme moderne dans la Principauté de Liège au XVIe siècle, Liège, 1939. 2. C. GAIER, Huit siècles de houillerie liégeoise. Histoire des hommes et du charbon à Liège, Alleur, Editions du Perron, 1988. 3. A. DELMER, La question du minerai de fer en Belgique, Bruxelles, 1913. 4. L. DEJONGHE, F. LADEUZE, D. JANS, Atlas des gisements plombo-zincifères du synclinorium de Verviers (Est de la Belgique), Bruxelles, 1993. 5. R. MOHY, Le cabinet historial, Liège, 1610. 6. H. MICHELANT, Voyage de Philippe de Hurges à Liège et à Maastricht en 1615, Liège, 1872, p. 100. 7. Sur ce problème en général, voir GILLE B., « Les problèmes de la technique minière au Moyen Age », Revue d’Histoire des Mines et de la Métallurgie, I, 2 (1969), p. 278-297. 8. Voir par exemple les « coutumes de houillerie » du manuscrit 6300 de la Bibliothèque de l’Université de Liège : Description des ouvrages de houillerie par M. Delaruelle, échevin de Liège, 1695, f. 3 v, 5 ; ms 6301 (anonyme, date 1696), f. 32 v. Sur les araines, voir PIRMEZ E., Des araines et du cens d’araine, 1880 ; GOBERT Th., Eaux et fontaines publiques à Liège depuis la naissance de la ville jusqu’à nos jours, Liège, 1910 ; DE JAER L., « De l’épuisement dans les mines de houille au pays de Liège avant le XIXe siècle », dans La Vie Wallonne, VIII (1927), p. 95-109.
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Ce problème était commun à tous les districts miniers d’Europe. C’est pourquoi les machines d’exhaure se multiplièrent dès la fin du XVe siècle dans les manuscrits d’ingénieurs, les traités d’exploitation des mines et les Théâtres de machines9. Le métallurgiste Georg Agricola, dans son De re metallica de 1556, décrit et représente celles qui étaient en usage dans les mines de Saxe à son époque : chaînes à godets, pompes à chapelet, pompes aspirantes et foulantes à chaîne ou à tige, mues par l’homme, par les animaux, par le vent ou par des roues à eau10.
Machine d’extraction à chevaux, Détail d’une gravure de Wenzel Hollar (1607-1677), illustrant un plan de la cité de Liège, Amsterdam, 1649. © Liège, Université, Collections artistiques.
À Liège, les petits puits de mine (bures) étaient équipés d’un treuil à bras, par lequel les femmes hissaient une simple tinne (bassin). Dans des bures plus importantes, un hernaz ou manège à chevaux actionnait, soit un treuil, soit une chaîne sans fin pourvue de godets, soit encore par une manivelle, des pompes à chaîne ou à tige11. Plusieurs inventeurs décrochèrent un octroi ou privilège pour une machine et passèrent même des
9. Sur cette littérature, voir HALLEUX R., art. « Ingénieurs », dans M. BLAY, R. HALLEUX, La science classique. XVIe-XVIIIe siècle. Dictionnaire critique, Paris, Flammarion, 1998, p. 51-60 ; art. « Savoirs techniques », Ibidem, p. 801-811. 10. GEORG AGRICOLA, De re metallica, Basel, Froben, 1556, réimpr. Bruxelles, Culture et civilisation, 1967. 11. Les machines, petites et grandes, en usage dans le pays de Liège sont décrites en détail dans le recueil de MORAND, Art d’exploitation du charbon de terre, nouvelle édition, II, 2 (Description des arts et métiers t. XVII), Neuchatel, 1780, p. 280-320. Quoique postérieur d’un siècle, il vise à l’exhaustivité et décrit même les machines les plus frustes. 96
L’OPÉRATEUR INDUSTRIEL
contrats d’installation, mais le document est en général très laconique pour se faire une idée de la structure et du fonctionnement12, encore que parfois on puisse deviner l’usage de roues hydrauliques. En 1531. Antoine Gentil, marchand lombard, passa contrat avec les maîtres de la Petite Goffe13 ; en 1551, Servais Bamps de Maastricht équipa d’une machine d’exhaure la mine de plomb dite de la Blanche Plombière14 ; en 1561, Henri Tenne de Metz demanda un octroi du Conseil Privé15 ; en 1561, Christophe Hagenbücher sollicita du Conseil Privé un privilège pour une machine mue par une roue de moulin16 ; en 1579. Jean Vliesleger (Olisleger) du pays de Julers obtint lui aussi un privilège17. Le 21 décembre 1581, Ernest de Bavière décréta le célèbre « Edit de Conquête », promulgué le 10 juillet 1582, qui donna une grande impulsion aux machines d’exhaure, puisqu’il accordait les mines noyées à qui les démergerait18. On vit affluer de toute l’Europe des inventeurs avec leurs machines. Tel Georges Jean, comte de Velden, arrivant d’Allemagne, qui obtient le 2 septembre 1585, du conseil de la cité de Liège les autorisations nécessaires pour l’installation de machines d’exhaure empruntant la force motrice au courant de la Meuse. L’année suivant, il installa ses appareils en Leuze, c’est-à-dire en aval de l’église Sainte-Foy19. En 1601, le prince céda les revenus de la mense épiscopale sur la Blanche Plombière, une mine de plomb (près de Prayon), à David Kock, alias Remacle qui a inventé « certains instruments et mollins tirant pompes en grand nombre, chose novelle et inusité en nostre pays de Liège, à effet de tirer les eauwes hors des fosses et ouvraiges de la montaigne de la Plumterie de Prailhon »20. On entrevoit une machine mue par l’énergie hydraulique (mollin) actionnant par des chaînes ou des tiges (tirant) des pompes situées au fond de la mine. C’est l’origine de la grande tradition hydraulique de Liège, dont la machine de Marly, au siècle suivant, sera la plus belle illustration. 2. La sidérurgie Depuis le XIXe siècle, de nombreux érudits se sont attachés à la sidérurgie pré-industrielle. On citera en particulier René Evrard21, Jean Yernaux22, Georges Hansotte23, Marcel Bourguignon24, Alphonse Gillard25. Mais leur perspective est essentiellement économique et sociale. Cela tient à la nature des documents qu’ils ont eu à leur disposition. Ce sont des documents administratifs, juridiques et comptables, qui n’entrent pas
12. BORMANS St., Tables des registres aux octrois, rendages et engagères (Chambre des finances des princes de Liège), Liège, 1865 ; FAIRON E., Tables des octrois, manuscrit conservé aux Archives de l’État à Liège (en abrégé AEL). 13. A.E.L, Echevins de Liège, Obligations, reg. 20 fol. 3. 14. A.E.L, Echevins de Liège, Obligations, reg. 28 fol. 104. 15. A.E.L, Conseil Privé, Dépêches, reg. 4 fol. 75. 16. A.E.L, Conseil Privé, Dépêches, reg. 4 fol. 89. 17. A.E.L, Conseil Privé, Dépêches, reg. 10 fol. 178-179. 18. Mathias de LOUVREX, Recueil des édits, reglemens, privileges, concordats et traitez du Pais de Liege et Comté de Looz, II, Liège, 1730, p. 241-243. 19. Th. GOBERT, Eaux, p. 74-79. 20. A.E.L., Chambre des Comptes, Rendages, reg. 74, fol. 344. Texte dans Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois, 21, p. 134. 21. E. EVRARD, Les Artistes et les usines à fer. Œuvres d’art inspirées par les usines à fer, Liège, Solédi, 1955 ; E. EVRARD, A. DESCY, Histoire de l’usine des Vennes, suivi de Considérations sur les fontes anciennes, 1548-1948, Liège, Solédi, 1948 ; R. EVRARD, Forges anciennes, Liège, Solédi, 1956. 22. J. YERNAUX, La métallurgie liégeoise et son expansion au XVIIe siècle, Liège, 1939. 23. G. HANSOTTE, La métallurgie dans les bassins de l’Amblève et de l’Ourthe stavelotaine et limbourgeoise, 1393-1846, Malmedy, Famille et Terroir, 1968 ; « L’industrie sidérurgique dans la valle de l’Ourthe liégeoise aux Temps Modernes », dans La Vie Wallonne, 29 (1955), p. 116-123 ; « L’industrie métallurgique dans la vallée de la Vesdre aux Temps Modernes », dans Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois, 75 (1962), p. 165-220 ; « Les fourneaux à fer dans la vallée de la Meuse liégeoise aux XVIe et XVIIe siècles », dans Bulletin de la Société Royale le Vieux Liège, 192 (1976), p. 228-231 ; G. HANSOTTE, « La métallurgie wallonne au e e XVI siècle et dans la première moitié du XVII siècle. Essai de synthèse », dans Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois, 84 (1972), p. 21-42. 24. M. BOURGUIGNON, « L’ère du fer en Luxembourg (XVe-XIXe siècles). Études relatives à l’ancienne sidérurgie et à d’autres industries au Luxembourg », éd. P. HANNICK, C. MULLER, Annales de l’Institut Archéologique du Luxembourg, t. 124-125, 19931994. 25. A. GILLARD, L’industrie du fer dans les localités du comté de Namur de 1345 à 1600, Bruxelles, 1971. 97
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
dans le détail technique et qui emploient une terminologie très imprécise. Le flou des dénominations a de grandes conséquences sur la chronologie : nous ne pouvons dater avec précision l’apparition du marteau hydraulique, ni celle du haut-fourneau, ni celle de la fenderie, ni l’introduction du laminoir. D’autre part, les analyses d’objets ferreux et de scories et la fouille d’usines anciennes ne sont pas assez développées dans nos régions pour apporter des matériaux fiables. On peut distinguer quatre étapes : la production au procédé direct, la mécanisation du martelage vers 1200, l’apparition du haut-fourneau vers 1320 et de l’affinage de la fonte peu après, la fenderie et la platinerie au XVIe siècle. Du début de l’âge de fer jusqu’à la fin du XIIIe siècle, le fer était produit au procédé direct. Le minerai de fer, généralement un oxyde, était réduit par le charbon de bois dans un bas-fourneau, simple trou dans la terre, et donnait une loupe spongieuse qu’il fallait marteler. Au XIIe siècle s’introduit le marteau ou martinet hydraulique, lourde masse de fer emmanchée dans une poutre (le manche) que soulève un arbre à cames placé soit à la tête soit à la queue. L’arbre à cames est mis en mouvement par une roue hydraulique26. À la fin du XIIIe siècle, le fourneau augmente sa capacité, est bâti en hauteur et passe du bas-fourneau au hautfourneau. On ne peut plus le souffler à la main. C’est un arbre à cames, mû par l’énergie hydraulique, qui actionne deux soufflets à plateaux. Quand l’un se vide, l’autre se remplit. À l’intérieur, la température s’élève, le fer absorbe plus de carbone, devient de la fonte et coule27. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, il y avait trente hauts-fourneaux dans le Namurois, contre vingtquatre dans le pays de Liège. Les hauts-fourneaux du XVIe et du XVIIe siècle sont mentionnés dans divers types de documents : octrois de coups d’eau, contrats, testaments, inventaires qui donnent peu de détails techniques28. Ils sont très bien représentés par les artistes. On citera en particulier d’Henri Blès (1490-1550) le Paysage avec forge et minière (Musée national de Prague), de Lucas Gassel les Travaux de la Mine(daté 1534) (Bruxelles, Musée des Beaux-Arts), de Jean Brueghel le Vieux, dit Brueghel de Velours, le Haut-fourneau (Galerie Doria Pamphili à Rome, vers 1602), quelques paysages de Joachim Patinir et de Lucas Van Valkenborch29, et surtout le carnet de dessins du diplomate italien Remigio Cantagallina (1583-1636), qui visita nos régions en 1612-1613 et représente les installations industrielles avec une grande précision technique30. En revanche, il y a une seule fouille, celle du haut-fourneau de Marsolle construit en 153731, et très peu de descriptions techniques, puisque les grands traités de métallurgie du XVIe siècle sont centrés sur les non ferreux et que Agricola, par exemple, décrit le four à masse que l’on employait encore en Saxe. Le haut-fourneau qui se généralise à partir de 1500 est un massif de maçonnerie ayant la forme d’un tronc de pyramide quadrangulaire de 5 à 10 mètres de haut. Il est souvent adossé à un talus naturel ou artificiel et flanqué d’un bief d’amenée. C’est le cas du haut-fourneau de Marsolle construit par le seigneur de Mirwart vers 1537 à la confluence de deux petits ruisseaux qui faisaient tourner les roues, à une centaine de mètres de la forêt. Les murs de schiste gris de plus d’un mètre d’épaisseur sont conservés jusqu’à deux mètres de hauteur. À l’intérieur, un puits vertical s’ouvre au sommet par le gueulard, qui sert à alimenter en minerai et en charbon et à évacuer les gaz. L’intérieur du haut-fourneau est recouvert de matières réfractaires (dont il n’y a pas de traces à Marsolle). À Marsolle, le puits est vertical. Nous ne savons pas quand le haut-fourneau prit la forme classique de deux troncs de pyramide ou de cône accolés par la base distinguant deux 26. B. GILLE, « Le moulin à fer et le haut-fourneau », dans Métaux et civilisations, 1 (1946), p. 89-94 ; C. VERNA, P. BENOIT, « La sidérurgie de Clairvaux au Moyen Age (XIIe-XVe s.) », dans Actes du colloque Histoire de Clairvaux, Bar sur Aube, juin 1990, Bar sur Aube, 1991, p. 85-111. 27. A. JOCKENHÖVEL, Ch. WILLMS, « Archaeological investigations to the Beginning of Blast Furnace Technology in Central Europe. A preliminary report », dans Material Culture in Medieval Europe. Papers of the « Mediaeval Europe Brugge 1997 », Conference, vol . 7, éd. G. DE BOE, F. VERHAEGHE, Zellik, 1997, p. 17-19. 28. H.W. HERMANN, P. WYNANTS (ed.), Wandlungen der Eisenindustrie vom 16. Jahrhundert bis 1960. Mutations de la sidérurgie du XVIe siècle à 1960, Namur, FUNDP, 1997 (Colloques Meuse-Moselle, 1). 29. D. ARRIBET-DEROIN, Hauts-fourneaux et forges dans les paysages peints du XVIIe siècle (sous presse) ; Les sites mosans de Lucas I et Martin I Van Valckenborch. Essai d’identification, Liège, Société royale des Beaux-Arts, 1954. 30. FIERENS-GEVAERT, « Voyage inédit d’un artiste florentin du XVIIe siècle au beau pays de Flandre et de Wallonie », dans Le Flambeau, 6 (1923), p. 1-36. 31. J.P. WEBER, « Fouille du haut-fourneau de Marsolle (comm. de Saint-Hubert) », dans Archaeologia Belgica, III (1987), p. 271276. 98
L’OPÉRATEUR INDUSTRIEL
parties : l’ouvrage, où se fait la réduction, et en dessous le creuset, où s’accumulent la fonte et la scorie liquide (le laitier). Par des orifices communicant vers l’extérieur, les tuyères insufflent dans l’ouvrage le vent de deux soufflets qu’actionne un arbre à cames mû par une roue hydraulique. Une pierre verticale, appelée dame, retenait le métal fondu dans le creuset. À la base du fourneau, un petit orifice bouché à l’argile pendant l’opération permettait d’évacuer la scorie et la fonte. Par le gueulard, on versait des paniers de minerai de fer et de charbon de bois et le fondeur surveillait la marche du fourneau. Quand la réduction était achevée, la fonte coulait dans une rigole ménagée dans la salle du plancher de coulée et se solidifiait en gueuses (de l’allemand giessen « couler »)32.
Haut-fourneau (XVIIe siècle). © Liège, Maison de la Métallurgie et de l’Industrie.
La localisation des hauts-fourneaux ne changera pas jusqu’au XVIIIe siècle. Ils ne s’établissent pas sur de grosses rivières, comme la Meuse, la Chiers, la Lesse, l’Ourthe, la Roer, sauf à proximité de la source, à 32. G. HANSOTTE, « Comment fonctionnait un fourneau liégeois au XVIIe siècle », dans Annales du XLe Congrès de la Fédération archéologique et historique de Belgique, p. 159-166. 99
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
cause de l’abondance de leur débit, des dangers d’inondation, de la navigation, de la pêche et du flottage du bois. Les métallurgistes ont choisi des rivières plus petites, comme le Ton, la Marge, la Rulles, la Vierre, la Lomme, la Houille, l’Amblève, la Vesdre et leurs affluents, même très petits. Si le courant était trop puissant, on en détournait une partie. S’il était trop faible, on construisait un réservoir de retenue ou étang. Il est capital pour un fourneau d’avoir un coup d’eau. Dans les actes d’inspection (visitations), on retient les quatre aménagements : la clawire (la chaussée d’eau), les vennes (vannes), la chute, les biefs. À partir de la venne de retenue, un bief d’amenée (la venne ouvrière) amenait l’eau à la chute qui mettait la roue en mouvement. Au-delà de la roue, une venne de décharge (bief de fuite) ramenait l’eau à la rivière. Le long d’une rivière se groupaient ainsi les fourneaux, les affineries et les divers ateliers de transformation. Ces groupements donnèrent naissance à de véritables bassins industriels : le bassin de Namur (entre Sambre et Meuse), le bassin de Huy (le Hoyoux), le bassin de Liège (Ourthe inférieure, Vesdre, Hoëgne), le bassin de Durbuy (Ourthe supérieure, Amblève, Aisne), le bassin de Habay (Lesse, Semois, Chiers), les bassins de Sarre, de Juliers, de Lorraine, de Sedan, de Chimay. Ils entraînèrent aussi une véritable pénurie de bois, que l’on tenta de compenser par un recours au charbon de terre, en le débarrassant des matières volatiles qui altèrent le fer. Le 18 juin 1625, le Conseil Privé de Liège accordera à Ottavio da Strada, gentilhomme de Bohême, un brevet pour fondre le minerai au combustible minéral33. Le personnage est connu. C’est le petit-fils de l’ingénieur et artiste Jacopo da Strada (15151588), familier de Rodolphe II et frère de sa maîtresse34. Nous ne savons rien de son procédé. Ces recherches n’aboutirent qu’au XVIIIe siècle avec la fabrication du coke. La fonte produite au haut-fourneau pouvait être refondue à la fonderie de deuxième fusion. Ce n’était pas la même fonte. Les hautsfourneaux pouvaient changer d’allure à la fin de chaque campagne et produire, au lieu de la fonte blanche d’affinage, de la fonte grise de moulage. Le coulage de la fonte dans des moules est une véritable révolution. La fonte est véritablement le bronze des pauvres. Malgré les travaux précurseurs de René Evrard35, il est très difficile de dater les fontes anciennes. Beaucoup de pièces conservées dans les musées sont très probablement des faux récents, par exemple la taque de cheminée du Musée Gaumais datée de 1589 et représentant une scène de sorcellerie. Quoi qu’il en soit, on procédait soit en bas-relief, soit en haut-relief. Les bas-reliefs se faisaient dans un moule en sable gris tassé par un modèle sculpté en bois, méthode illustrée dans le monde arabe au XIe siècle. Les plus fréquents de ces produits sont les taques ou contrecœurs de cheminées, ornées d’armoiries, de sujets religieux, mythologiques, historiques ou littéraires. La fonte pouvait aussi être coulée en haut-relief dans des moules en réfractaire parfois de plusieurs pièces faits sur des modèles en bois. On produisait ainsi des canons (concurrents des canons en bronze) et des boulets, mais aussi des chenets, des pots et marmites (possons), des statuettes ou des éléTaque de foyer avec l’aigle bicéphale. ments d’architecture. L’imagerie et le style des fontes domestiques e Début XVII siècle. ont été bien étudiés par les folkloristes. Elles sont communes à © Liège, Maison de la Métallurgie toute la Grande Région (collection de la Maison de la Métallurgie et de l’Industrie. à Liège, du Fourneau Saint-Michel à Saint-Hubert, du musée
33. Le texte de l’octroi est publié par J. FRANQUOY, Mémoire sur l’histoire des progrès de la fabrication du fer dans le pays de Liège, Liège, 1860, p. 357-358 ; voir S. BORMANS, Table des octroies et des rendages, p. 57 et 59. 34. Jacopo da Strada (1515-1588) avait laissé un manuscrit sur la mécanique qui fut édité par son petit-fils en 1617 sous le titre de Künstliche Abriss allerhand Wasser- Wind- Ross und Handtmühlen. 35. Voir supra note 21. 100
L’OPÉRATEUR INDUSTRIEL
d’Arlon, du Musée Gaumais à Virton, de la collection Metz à Luxembourg, de la collection Lobiez à Longwy, du Musée Lorrain à Nancy). Mais le plus souvent la fonte était convertie en fer par affinage. C’est ce qu’on appelle le procédé indirect. La fonte est du fer qui a absorbé trop de carbone, ce qui la rend trop cassante pour faire des outils. Dès la fin du XIVe siècle, on mit au point plusieurs méthodes pour lui enlever l’excès de carbone. La méthode liégeoise consistait à brûler la gueuse dans un foyer plus petit, dit foyer d’affinerie, dans le vent oxydant des soufflets. On obtenait des masseaux de fer qui étaient façonnés en barres au gros maka ou martinet, aplaties à la platinerie ou au laminoir ou à la fenderie36.
Foyer d’affinerie, XVIIe siècle. © Liège, Maison de la Métallurgie et de l’Industrie.
36. R. LEBOUTTE, La grosse forge wallonne (du
XVIe
au
XVIIIe
siècle), Liège, 1979. 101
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
À la platinerie, le petit maka convertissait les masses de fer parallélépipèdiques en tôles ou en barres d’épaisseur variable. Les platineries se répandent à la fin du XVe siècle. Entre 1499 et 1566, 10 platineries s’étendent dans la vallée de la Hoëgne. Il y en aura 17 en 1630 et 10 en 1625 dans la vallée de la Vesdre.
Martinet hydraulique ou Maka, XVIIIe siècle. © Liège, Maison de la Métallurgie et de l’Industrie.
Au laminoir, la barre de fer est aplatie en tôle d’épaisseur variable entre deux cylindres. À la fenderie, les tôles ou les barres sont découpées en vergettes par une ou plusieurs scies circulaires. Le premier laminoir est figuré dans les carnets de Léonard de Vinci (vers 1500). Il sert à aplanir des métaux moins nerveux que le fer, comme les baguettes de plomb utilisées dans le vitrail. Il est figuré en 1615 dans le théâtre de machines de Salomon de Caus37. Dans nos régions, les spatats mentionnés dans l’inventaire d’une usine liégeoise en 1587 sont peut-être des cylindres de laminoir puisque le verbe wallon spater signifie « écraser »38. En 1646, le voyageur anglais Sir James Hope observe dans une fenderie « deux cylindres pour étirer le fer à la largeur et à l’épaisseur déterminée »39. Le laminoir classique, constitué de deux cylindres lisses en fonte grise coulée, puis polie au tour, apparaît au XVIIIe siècle en Angleterre et se répand dans nos régions à la fin de ce siècle.
37. Salomon de CAUS, Les raisons des forces mouvantes. Avec diverses machines tant utiles que plaisantes, Francfort, Ian Norton, 1615. 38. AEL, Echevins de Liège, Paroffres, reg. 54, f. 186. 39. « The Diary of sir James Hope, 24th January-1st October 1646 », éd. P. MARSHALL, Miscellany of the Scottish History Society, 9 (1958), p. 129-197 ; analyse par E. HELIN et N. MÉLON, « Le voyage métallurgique de sir James Hope », dans La Vie Wallonne, 44 (1970, p. 269-296). 102
L’OPÉRATEUR INDUSTRIEL
À la fenderie, le fer préalablement aplati, est découpé en tiges par des rouleaux tranchants qui peuvent prendre plusieurs formes : scies circulaires en parallèle ou cylindres cannelés, éventuellement associés à des rouleaux lisses. Les tiges de fer ou vergettes produites à la fenderie sont utilisées pour fabriquer des clous. La première fenderie est mentionnée en 1532 par Eoban Hesse qui décrit une machine à découper le fer plat40. En 1561, Christophe Hagenbucher demande et obtient du Conseil privé de Liège octroi pour l’exploitation des machines d’exhaure et d’une machine hydraulique pour « préparer toute sorte de gros fer, à l’aplanir et à le diviser en petits morceaux »41. La première description se trouve dans le Premier livre des instrumens mathématiques méchaniques (Nancy, 1584) de l’ingénieur Jean Errard de Bar-le-Duc sous le titre de « Nouvelle fabrication pour fendre aysément le fer et laquelle jusque a présent n’a point été praticquée. Cette invention vient aussi dudit Desrué qui premier en a faict la démonstration et l’expérience. Nova findendi ferri fabrica hactenus incomperta »42. La figure qui suit représente deux cylindres engrenés à trois cannelures qui entaillent une barre de fer. Ils ne sont pas refroidis par l’eau. L’inventeur est inconnu, mais il est clair que le mécanisme a été mis au point par les sidérurgistes de ce que l’on appelle aujourd’hui la Grande Région, Lorraine, Luxembourg, Wallonie.
La première représentation d’une fenderie chez Jean Errard, 1584. © CHST.
Trois ans plus tard (1587), les échevins de Liège expertisent, dans une usine appartenant à Laurent Budbach, « des rouleaux fendants, croissants, spatats et plusieurs instruments gastés et corrompus ». Si les rou-
40. E. HESSE, Arbs Nurembergica, Nuremberg, 1532. 41. A.E.L., Conseil privé, Dépêches, reg. IV, f. 89 als oech om te slaen grote quantiteyt van allerley clye ende berenden (= bereiden) allen sorten van groossen ysere ende tzelve te planeren ende recken in cleyner former, d’où il ne s’ensuit pas que ce soit une fenderie. 42. J. ERRARD, Le premier livre des instrumens mathématiques méchaniques, Nancy, 1984, reproduction en fac-similé avec une introduction de A. France-Lanord, Paris, 1979, pl. 20. 103
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
leaux fendants sont les scies circulaires, on ne sait pas ce que sont les rouleaux croissants43. En 1592, le même Laurent Budbach fait son testament et lègue à son fils Henri « ses usines, forges, forneas, plattineries et fenderies se trouvant à Vaux-sous-Chèvremont, Ninane et Prayon »44. En 1587, Daniel Remacle, dit Koch de Limbourg, construit à Polleur une des premières fenderies du pays45. Le 21 novembre 1595, Daniel Kock vend à Guillaume Macorps le fourneau dit des Polets à Fragnée « un coup d’eaue et vantal joindant à un petit isleu sur lequel est érigé un fornea et usine pour fendre le fer ». Ce Daniel Kock dirigeait les fenderies de Henne, Hoster et Vaux-sous-Chèvremont. En 1595, Gilles Grisar achète aux héritiers de Laurent Budbach leur usine de Sauheid et installe une fenderie. C’est sous le règne d’Ernest que la fenderie se répand dans le pays de Liège et au-delà de ses frontières. 3. La chimie industrielle En 1582-1583, Ernest donne commission à Gilles de la Rôlette d’Or pour prospecter les gisements de fer, cuivre, plomb, soufre, couperose (sulfate de cuivre), kisses (pyrites), alun et calamine46. Il prend des parts dans les sociétés minières, notamment pour le plomb, soufre, cuivre et couperose de Prayon47. Selon Chapeaville48 et De Vaulx49, il découvre lui-même en 1587, en Ardenne, des gisements de soufre, alun et vitriol. Selon la chronique de Henri Vanden Berch50 « Nostre evesque Ernest, qui estoit doué de rares secrets de nature en traversant un jour l’Ardenne trouva fortuitement quelques vennes de métal, lesquels ayant expérimenté il donna à cognoistre aux ouvriers de nostre pays, où paravant n’en avoyant heu alcunne cognoissance et entre aultres estoit de soulphre, de l’alun, de la couperose ou vitriol, ce qui n’apporte pas moins de proffit à ceulx de nostre pays qui le tirent hors de la terre que de commodité aux provinces voisines ». Le soufre peut se trouver à l’état naturel. C’est le soufre natif, le sulfur vivum des Anciens. À partir du e XVI siècle, on le tire de la pyrite de fer, qui est un sulfure. On l’utilise pour la poudre à canon et pour la fabrication des acides minéraux. Le vitriol ou la couperose (cupri rosa) est le sulfate de fer et de cuivre. On l’appelle chalkanthos (fleur de cuivre) en grec, vitriolum (petit verre) en latin médiéval à cause de l’aspect vitreux de ses petits cristaux verts ou bleus. Il sert à tanner et à noircir les cuirs (d’où son nom d’atramentum sutorium, noir de cordonnier, en se combinant avec le tanin des cuirs). Il sert aussi à fabriquer de l’encre (en réagissant avec la noix de galle)51. Dans l’Antiquité, le vitriol se fabriquait en laissant décanter au soleil les eaux vitrioliques qui percolaient à la base des gisements pyriteux, notamment à Chypre. À la fin du moyen âge, le vitriol romain était produit par lessivage de terres vitrioliques, Michel Mercati, conservateur des collections minéralogiques du Vatican, décrit le procédé de la façon suivante52 : « On extrait une certaine terre (la melanteria des anciens) que l’on met sous un hangar, on l’émiette en poudre avec des râteaux et des houes ; on construit de grands bacs en brique maçonnés à la chaux ; on les remplit d’eau et on y jette le matériau que l’on brasse, on laisse déposer le sédiment, on extrait l’eau par une ouverture latérale du bac et on le cuit dans des chaudières de plomb posées sur la grille d’un fourneau ; on fait bouillir l’eau ; parfois on y jette un peu de fer ; quand il est à
43. A.E.L., Echevins de Liège, Paroffres, reg. 54, f. 186. 44. A.E.L., Echevins de Liège, CT, Greffe Bernimolin, 1587-1595, f. 253. 45. J. YERNAUX, M. MATHY, « Une famille de pionniers industriels wallons au XVIe siècle : les Kock de Limbourg », dans Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Classe des sciences morales et politiques, 5e série, 46 (1960), p. 66-121. 46. E. POLAIN, « La vie à Liège sous Ernest de Bavière. Etudes archéologiques », dans BIAL, 61 (1937), p. 50-53. 47. E. POLAIN, op. cit., p. 55. 48. J. CHAPEAVILLE, Qui gesta pontificum leodiensium scripserunt auctores praecipui, III, Liège, 1616, p. 542. 49. DE VAULX, Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique du Diocèse de Liège (Ms. ULg 1019), p. 343 date la découverte de 1587. 50. Manuscrit. ULg 465, f. 243v, année 1587. 51. D. GOLTZ, Zur Geschichte der Mineralnamen von den Anfänge bis Paracelsus, Wiesbaden, Steiner, 1972. 52. M. MERCATI, Metallotheca, éd. J.M. LANCISII, Rome, 1717 (l’ouvrage est posthume ; Mercati est mort en 1593). 104
L’OPÉRATEUR INDUSTRIEL
moitié et à l’épaisseur du miel on rajoute de l’eau quatre ou cinq fois, l’eau est transvasée dans des bacs de châtaignier où le vitriol se fige en quinze jours. On le met en pains et on le vend dans toute l’Europe ». À partir du XVIe siècle, tant le soufre que le vitriol furent produits à partir de pyrites dans un four à pots muni de creusets ou retortes qui sont en réalité des cornues53. Le fourneau était un bloc de maçonnerie au centre duquel existe un foyer autour duquel étaient disposés des pots de terre réfractaire ou creusets « en manufacture de terre ». Les pyrites appelées kisses (de l’allemand kies) étaient placées dans des creusets que l’on chauffait modérément. Le soufre était libéré par la chaleur et se volatilisait à l’abri de l’air, sans avoir l’occasion de s’oxyder ; des tuyaux de terre réfractaire l’amenaient dans des baquets pleins d’eau où il précipitait. C’était du soufre gris, contenant des sablons, qu’il fallait affiner par une nouvelle distillation. Les pyrites retirées après distillation contenaient encore du soufre et brûlaient au contact de l’air, donnant des sulfates. On les jetait dans des cuves en bois et on les aspergeait d’eau bouillante. L’eau dissolvait les sulfates produits, on décantait les cuves par le bas et le vitriol à l’état liquide était mis à évaporer, pour former les cristaux de couperose verte (sulfate de fer), bleue (sulfate de cuivre), blanche (plomb ou zinc). C’est à Sasserotte près de Theux, dans le pays de Franchimont, que l’on trouve la première attestation de cette technique. Depuis le XVe siècle, on exploitait à Sasserotte le fer et le plomb. Le 7 juin 1577, devant le notaire Lapide, Antoine Vaes, Jean Geury, Guillaume Stevarts fondèrent une compagnie pour tirer le soufre des marcassites et kisses de Sasserotte, au moyen d’un four à vingt-et-un pots installé à Prayon54. On se proposait de faire un soufre « meilleur que celui de Hambourg », c’est-à-dire du Rammelsberg dans le Harz, exporté par Hambourg. La soufrerie est figurée dans le carnet de dessins du diplomate italien Remigio Cantagallina (vers 1610). On y voit une roue hydraulique actionnant par un mécanisme de tringlerie les pompes d’exhaure placées à l’intérieur du bâtiment.
La soufrière de Sasserotte à Franchimont. Dessin de Remigio Cantagallina, 1612-1613. © Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts, cabinet des dessins.
Le mine fut exploitée par intermittences et bien développée jusqu’au niveau moins quarante mètres (niveau des eaux) ; au début du XIXe siècle, ses bures couvraient une superficie de deux mille mètres carrés. 53. A. ANDRÉ-FELIX, Les origines de l’industrie chimique dans les Pays-Bas autrichiens, Bruxelles, 1971. 54. E. POLAIN, « La fabrication du soufre et de la couperose au Pays de Liège au XVIe siècle », dans Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois, 39 (1909), p. 1-8. 105
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
D’autres privilèges furent accordés pour l’exploitation des pyrites à Prayon (27 août 1573, renouvelé le 19 mars 1584), à Warfusée (31 octobre 1603, nouveaux contrats en 1603, 1604, 1605, 1616). L’industrie de l’alun est tout aussi importante. On appelle aujourd’hui alun les sulfates doubles d’aluminium et de potassium, ou d’aluminium et d’ammonium, ou le mélange des deux. Autrefois, le mot avait une extension plus vaste encore, puisque le latin alumen et le grec stypteria désignaient toute sorte de matières dotées de propriétés astringentes, notamment les sulfates de fer. Depuis l’Antiquité, l’alun est employé pour la tannerie, le mordançage des tissus et la pharmacopée ; depuis le XIVe siècle, il entre dans la composition des acides minéraux produits par distillation. Les couches de schiste alunifères (ampélite alumineux) s’étendent le long de la Meuse, avec une épaisseur de huit à douze mètres avec une importante inclinaison par rapport au lit de la Meuse55. Elles sont plus riches et plus rentables sur la rive gauche (Engis, Ampsin, Flône, Chokier, Flémalle) que sur la rive droite (de Ramioul au Val Saint-Lambert). Diverses concessions furent accordées à Flémalle Haute (1586), Warfusée (1586), aux Awirs (1605), à Horion-Hozémont (1606). Une galerie d’exploitation, mentionnée en 1603, a été fouillée à Raysse près de Ramioul56. On y pratiquait l’abattage au feu. Jusqu’au XVIIIe siècle, l’extraction se faisait par galeries que l’on éboulait successivement en enlevant les étançons (foudroyage). Cette méthode a provoqué de nombreux affaissements de terrains encore visibles aujourd’hui. Les alunières de Chokier ont été décrites en 1627 par le voyageur français Dubuisson Aubenay et en 1646 par le voyageur britannique sir James Hope57. Le minerai extrait était calciné en petits tas sur un lit de fagots, puis jeté dans des bacs de lavage dont l’eau était acheminée par des chenaux de bois dans de grandes chaudières de plomb où on ajoutait de l’urine (chargée en ammoniaque, elle provoquait la formation d’alun d’ammonium). On pratiquait plusieurs cuissons successives pour raffiner et cristalliser l’alun que l’on laissait reposer dans des tonneaux. Pour protéger l’industrie locale, Ernest prit des édits le 7 novembre 1597 et le 24 décembre 1598 interdisant le commerce de l’alun, du soufre et de la couperose. En 1621, l’alun était invendable ce qui provoqua la constitution d’un syndicat pour maintenir le prix, autorisé par le Conseil de la Cité de Liège le 15 septembre 1621. 4. L’expansion de la métallurgie liégeoise À la faveur de son statut de neutralité, la Principauté de Liège exportait des produits métallurgiques, notamment des armes. L’existence de riches gisements métallifères dans les pays clients incita les industriels liégeois à y établir des usines et à y transférer les technologies liégeoises. C’est le cas de Jean Curtius en Espagne. Jean Curtius avait fait fortune dans le commerce des armes et de la poudre à canon. Le 30 juillet 1613, Hurtino de Ugarte, pagador général des Pays-Bas, avait adressé une supplique au roi d’Espagne proposant d’introduire en Espagne avec Jean Curtius des machines sidérurgiques liégeoises, une fenderie, une tréfilerie, un martelage, une fonderie. La description de la fenderie est détaillée « ung engin de tirer, amenuyser et coupper le fer en barres, grandes ou petites, pour avec une grande célérité pouvoir faire cloveure (clouterie) de toutes sortes. En quoy je m’asseure que deux hommes feront plus en vinte quatre heures que cent a la forme qu’ils travaillent esdits royaulmes. Et avecque le mesme engin on peut aussy tirer, amenuyser et de la grosseur qu’on vouldra, tout or, argent et cuyvre pour battre et forger monnaye de toute espece et pris. L’autre engin est de tirer le filet de fer et cuyvre qui ne se fait point par delà ». Ayant obtenu promesse d’octroi, Ugarte et Curtius passèrent contrat le 23 juin 161658. 55. I. DELATTE, « Notes relatives aux alunières du pays de Liège », dans Bulletin et chronique de la Société Royale de Vieux-Liège, t. IV, 1951-1953, p. 11-14. 56. J.P. DISCRY, R. GENTES, J.M. HUBART, D. MATTART, « L’alunière de Ruysse (Ramioul, Flémalle, prov. Liège). Découverte et exploration d’une galerie d’extraction », dans Bulletin des chercheurs de Wallonie, 31 (1991), p. 79-89. 57. Cf. supra note 39. 58. A.E.L., Notaire M. Veris, reg. 3888, f. 233 ; D. VAN DE CASTEELE, « Jean Curtius, associé de Hurtino de Ugarte, pagador général des Pays-Bas, pour l’introduction des machines liégeoises en Espagne », 1616, Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois, 18 (1885), p. 415-428 ; A. LAMARCHE, « Lierganes Jean Curtius en Espagne », dans Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois, 105 (1993), p. 171-234. 106
L’OPÉRATEUR INDUSTRIEL
La famille liégeoise de Besche est établie en Suède depuis 1595, date à laquelle Guillaume de Besche prit à ferme les mines de cuivre et les fourneaux de Nyköping. Il transférait en Suède une autre technologie wallonne : la fabrication du laiton par cémentation et importait sa calamine de Liège par la Hollande. Dans la suite, il étendit ses activités à la sidérurgie. Les de Geer, négociants et maîtres de forge, sont des partenaires commerciaux des de Besche. En 1596, Louis I de Geer s’établit à Dordrecht dans l’estuaire de la Meuse, principal entrepôt des produits liégeois d’exportation. En 1615, son fis Louis II (né en 1587) s’établit à Amsterdam, se lance dans le commerce des armes et de munitions et fournit l’armée suédoise. En 1626, à l’appel de Gustave II Adolphe, il s’établit en Suède et y crée, sur le minerai, divers établissement sidérurgiques où il applique la « méthode wallonne » et emploie des techniciens (mineurs, fondeurs, charpentiers de machines et charrettes, armuriers) recrutés dans le pays de Liège, Franchimont, Durbuy et Couvin59.
Portrait de Jean Curtius gravé par Wiericx. © Liège, Grand Curtius.
Portrait de Louis de Geer. © Liège, Maison de la Métallurgie et de l’Industrie.
59. Bibliographie très complète dans R. HALLEUX, P. BRICTEUX, P. TOMSIN, G. XHAYET, La Wallonie de Louis de Geer et la Wallonie d’aujourd’hui, Catalogue d’exposition, Stockholm, Tekniska Museet, 1999, p. 55. 107
TROISIÈME PARTIE
LE PROTECTEUR DES ARTS
L’ARCHITECTURE AU TEMPS D’ERNEST DE BAVIÈRE (1570-1620) Mathieu Piavaux
Introduction Cadre et limites Dans le diocèse de Liège, l’épiscopat d’Ernest de Bavière ne correspond pas à une période très florissante de l’histoire de l’architecture. Les conflits politiques et religieux qui touchent les Pays-Bas à la fin du XVIe siècle pourraient expliquer en partie cette faible activité constructive, tout comme le rôle mineur joué par l’évêque dans la promotion de nouveaux chantiers. Les constructions remarquables sont donc peu nombreuses entre 1580 et 1612 et relèvent pratiquement toujours de l’architecture civile. L’analyse des principaux monuments de cette période suppose d’emblée l’élargissement du champ de la recherche. Le respect strict des frontières du diocèse ou de celles de la Principauté de Liège et les dates limites de l’épiscopat d’Ernest de Bavière mènent en effet à une vision tronquée de l’histoire de l’architecture à la charnière des XVIe et XVIIe siècles. Qu’ils soient bâtis en terre liégeoise ou dans le Comté de Namur, dépendant des Pays-Bas espagnols, les principaux édifices de cette période reflètent l’emploi des mêmes traditions constructives. Plutôt que de faire coïncider les frontières du corpus des édifices étudiés avec celles d’une entité ecclésiastique ou politique bien définie, il apparaît donc plus prudent de d’envisager l’architecture à l’échelle de la région de la Meuse moyenne, en considérant que les ressources matérielles régionales mais aussi le réseau économique tissé le long du fleuve contribuent à l’élaboration des nouvelles formules. Les formes et techniques mises à l’honneur durant cette période ne peuvent par ailleurs se comprendre que dans une perspective diachronique un peu plus large, outrepassant de deux décennies environ les dates limites de l’épiscopat d’Ernest de Bavière. Dès le début des années 1570, en effet, les principaux chantiers de la région semblent reléguer au second plan les références de la haute Renaissance pour privilégier de nouvelles formes, d’une grande sobriété, et qui imprègneront ensuite la plupart des chantiers civils pendant la majeure partie du XVIIe siècle. Un demi-siècle plus tard, dès 1620, le clergé régulier fait bâtir dans les principales villes de la région de nouvelles églises dont le langage architectural s’intègre dans la mouvance de l’architecture baroque des Pays-Bas du sud1. Entre 1570 et 1620 se développe donc une manière de bâtir « en dur »2 des résidences ou des bâtiments civils publics qui, sans être véritablement spécifique à la région envisagée, trouve néanmoins dans la vallée de la Meuse un champ d’expression privilégié. L’absence de chantiers religieux d’envergure constitue l’une des particularités de cette période. Que l’activité constructive du clergé séculier et des ordres monastiques d’origine médiévale soit très discrète n’a rien d’étonnant. Ici comme dans d’autres régions, il n’est pas question de rebâtir les églises existantes, parfois achevées depuis peu, mais seulement de leur apporter des transformations ponctuelles. Les modifications apportées à quelques églises situées à Liège, Namur ou Tongres donnent une bonne idée du type de 1. L’église des Carmes déchaux de Liège ouvre la série des chantiers religieux des années 1620-1630 avec une première pierre posée en 1619 (Église Notre-Dame de l’Immaculée Conception, dans Le Patrimoine monumental de la Belgique. Wallonie, vol. 3 : Province de Liège. Ville de Liège, Liège, 1974, p. 150-154). L’église des Jésuites de Namur, initialement dédiée à saint Ignace, est mise en chantier en 1621 (GENICOT, L. Fr. et COOMANS, Th., Les bâtiments des Jésuites à Namur aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans Les Jésuites à Namur. 1610-1773. Mélanges d'histoire et d'art publiés à l'occasion des anniversaires ignatiens, Namur, 1991, p. 104-105). Les Carmes font également édifier l’église Saint-Joseph à Namur dès 1627 (PHILIPPOT, P., COEKELBERGHS, D., LOZE, P., VAUTIER, D., L’architecture religieuse et la sculpture baroques dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège. 1600-1770, Sprimont, 2003, p. 75-76). 2. L’architecture en pan-de-bois n’est pas envisagée ici. Sur cette production architecturale relativement spécifique, nous renvoyons à l’excellente synthèse publiée récemment : HOUBRECHTS, D., Le logis en pan-de-bois dans les villes du bassin de la Meuse moyenne (1450-1650), Liège, 2008 (Dossier de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, 12), spécialement les p. 215-228 pour la fin du XVIe et le XVIIe siècle.
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
chantiers privilégiés à l’époque3. Les grandes églises bâties par le clergé régulier sont également rares en région mosane avant 1620 ; la région accuse donc un certain retard par rapport aux grandes villes des PaysBas espagnols comme Bruxelles, Gand et Anvers. Les nouveaux ordres ne sont cependant pas inactifs dans les villes mosanes, comme en attestent les collèges jésuites fondés à Maastricht, Liège, Namur ou Dinant. Deux églises sont même édifiées dans les premières décennies du XVIIe siècle, à Liège et à Maastricht, mais leur architecture demeure mal connue4. Des constructions jésuites antérieures à 1620, il subsiste donc surtout des bâtiments conventuels qui empruntent leurs caractéristiques majeures au bâti civil urbain de l’époque. Les Capucins, très actifs dans la plupart des villes des Pays-Bas du sud dès la fin du XVIe siècle, s’installent également dans les principales villes mosanes. Ils fondent ainsi des couvents à Liège, à Dinant, ainsi qu’à Maastricht5. Seuls les deux derniers conservent des bâtiments de cette époque, et notamment l’église, qui illustre bien les principes de sobriété et de fonctionnalité privilégiés par cette branche des Frères mineurs. L’architecture des couvents capucins établis dans la provincia Wallonia ne sera pas envisagée ici en tant que telle car les limites géographiques et chronologiques de notre propos ne permettent pas d’appréhender ces traditions architecturales avec cohérence. L’architecture rurale, enfin, sera peu abordée, dans la mesure où ses principaux témoins sont souvent mal datés et qu’ils relèvent de milieux de productions spécifiques, de conditions du terroir qui déterminent la physionomie de ces bâtiments ruraux6. Le corpus Le patrimoine civil des principales villes mosanes semble avoir payé un lourd tribut aux différentes guerres qui touchent la région dès la fin du XVIIe siècle. Les bombardements de Huy et de Dinant par les troupes de Louis XIV, par exemple, ravagent des quartiers entiers7. Les deux conflits mondiaux du XXe siècle génèrent également des destructions considérables dans certaines villes mosanes, comme Visé et Dinant par exemple, particulièrement touchées par les bombardements de 14-188. L’inventaire dressé dans les pages suivantes correspond donc à un état des lieux de l’architecture conservée, éventuellement enrichi par les témoignages écrits ou iconographiques de monuments disparus. L’architecture urbaine Les deux hôtels de ville bâtis dans la région témoignent bien des péripéties traversées par cette architecture. L’hôtel de ville construit par Conrad II de Nuremberg et Bastien Sion à Namur dès 1572 environ est ainsi détruit en 1826 et ne peut être que superficiellement appréhendé sur base des représentations anciennes de sa façade principale9. À Visé, la démolition de l’hôtel de ville construit vers 1612-1614 résulte des bom3. A Liège, la paroissiale Saint-Servais voit son flanc sud reconstruit en appareil mixte vers 1584 (Egl. Paroissiale Saint-Servais, dans Le Patrimoine…, vol. 3, p. 116-120) ; à Namur, la tour de l’église Saint-Jean-Baptiste est rehaussée d’un étage (Église St-JeanBaptiste, dans Le Patrimoine monumental de la Belgique. Wallonie, vol. 5/2 : Namur (N-Y), Liège, 1975, p. 574) ; celle de l’église Saint-Jean-Baptiste de Tongres est reconstruite à la même époque (1615) (Parochiekerk St.-Jan-de-Doper, dans Bouwen door de Eeuwen heen. Een inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, vol. 14/1 : Arrondissement Tongeren. Kanton Riemst-Tongeren, Brussel, 1990, p. 208-210). 4. L’église des Jésuites de Maastricht élevée par Huysens entre 1606 et 1614 est conservée de manière très fragmentaire ; celle bâtie par les Jésuites Anglais avant 1617 (année de la consécration) a complètement disparu, cf. CLOSON, M.-A., De l’ancien collège des Jésuites anglais au « site des anglais » de la DGATLP du Ministère de la Région wallonne à Liège, dans Les échos du patrimoine, n° 48, 2000, p. 3. 5. TEUNS, St., Les Capucins. 1585-2000, cat. expo., Bruxelles, Archives Générales du Royaume, 8/05-29/06/2002, p. 11-12. 6. Quelques constructions rurales datées sont citées dans PUTERS, A., 1950, p. 23. 7. Sur les dégâts occasionnés à Huy, cf. RORIVE, J.-P., L'enfer d'une ville au siècle de Louis XIV, Liège, 1991, p. 97. 8. GHEQUIERE, A., L’architecture civile ancienne au pays de la Meuse wallonne, Namur, 1922, p. 142 ; VAN DE CASTYNE, O., L’architecture privée dans les centres urbains aux XVIe et XVIIe siècles, Bruxelles, 1934, p. 288 (Mémoires de l’Académie royale de Belgique. Classe des Beaux-Arts, 2e série, 7). À Dinant, la maison « en dur » la plus ancienne recensée par Puters date de 1631, cf. PUTERS, A., Architecture privée au pays de Liège, Liège, 1940, p. 57 ; CHARLIER, S., CARPEAUX, C. et MERLAND, M., Paul Jaspar architecte (1859-1945), cat. expo., Liège, Grand Curtius, 2009, Bruxelles, 2009, p. 134-135. 9. Dessin anonyme de l’hôtel de ville avant sa démolition en 1826, conservé au Musée archéologique de Namur, publié dans VAN TUSSENBROEK, G., The Architectural Network of the Van Neurenberg Family in the Low Countries (1480-1640), Turnhout, 2006, p. 117 (Architectura Moderna, Architectural Exchanges in Europe, 16th-17th Centuries, 4). C’est probablement sur ce document que se base Kegeljan un siècle plus tard pour reconstituer le bâtiment disparu dans une ambiance urbaine de l’Ancien Régime, cf. Franz KEGELJAN, Place Saint-Remy et l'hôtel de ville de Namur, 1914, aquarelle, Namur, Musée des Arts anciens du Namurois, vue publiée dans COURTOY, F., L'architecture civile dans le Namurois aux XVIIe et XVIIIe siècles, Bruxelles, 1936, p. 11 et photographiée par l’IRPA (num. nég. : B72610). 112
L’ARCHITECTURE AU TEMPS D’ERNEST DE BAVIÈRE (1570-1620)
bardements de 191410. Les travaux de reconstruction menés par Paul Jaspar dans les années 1923-1925 ont donné au bâtiment son allure actuelle. Lors de cette entreprise, la maison voisine, rebâtie en style « néo mosan », est annexée au corps de bâtiment principal, lequel, avec ses trois niveaux d’élévation et son porche en portique s’ouvrant dans la façade principale, constitue une reconstitution assez fidèle de l’hôtel de ville qui se dressait dans la petite cité mosane à la fin du XIXe siècle11. La nouvelle halle des bouchers à Namur (fig. 1) s’inscrit dans la tendance des reconstructions « en dur » des halles en pan-de-bois de la fin du Moyen âge12. Le chantier, qui se déroule entre 1588 et 1590, est confié à Conrad II de Nuremberg, maître-maçon du Comté de Namur et Bastien Sion, son aller ego pour les ouvrages charpentés13.
Fig. 1 : Namur, halle des bouchers. Façade sur Sambre (sud).
De l’architecture hospitalière du début du XVIIe siècle, il ne reste malheureusement que de très maigres indices. La fondation d’un hôpital en Outremeuse au début du XVIIe siècle semble composer avec un édifice en pierres préexistant, la maison Porquin, acquise par Ernest de Bavière lui-même en 1584 et léguée à la
10. Le millésime 1612 était gravé au dessus de la porte d’entrée, celui de 1614 sur une pierre sous la corniche, cf. LENSEN, J.-P., Visé et son Hôtel de ville, Visé, 1994, p. 11. 11. Ibidem, p. 15 ; CLAASSENS, Ch., Le patrimoine de Visé, Namur, 2009 (Carnet du Patrimoine, 60) ; CHARLIER, S., CARPEAUX, C. et MERLAND, M., 2009, p. 136-137. 12. BODART, E., Les halles de Namur (XIIIe-XVIe siècles) : lieux de commerce entre initiative comtale et volonté urbaine, dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 84, 2010, p. 101. La halle aux viandes de Liège, construite vers 1544-1546 et la nouvelle boucherie de Mons (détruite en 1852) illustrent également cette tendance. 13. COURTOY, F., 1936, p. 10-11 ; VAN TUSSENBROEK, G., 2006, p. 115-116 ; MARCHAL, J., Namur. L’ancienne Halle à la chair, aujourd’hui Musée archéologique, dans JORIS, Fr., ARCHAMBEAU, N. et PAQUET, P. (coord.), Le patrimoine majeur de Wallonie, Namur, 1993, p. 467-469. 113
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
« Compagnie de Misericorde » en 160214. Les vues anciennes montrent que des ailes en brique et pierre de taille sont ajoutées au noyau primitif, probablement dans le courant du XVIIe siècle. Enfin, la chapelle édifiée en 1606 a également disparu15. Parmi les grands chantiers urbains de l’époque figurent plusieurs hôtels particuliers et un refuge monastique. La « grande maison du marché » à Bouvignes, dite aussi « Maison Espagnole » est probablement construite par Gobert Maistrecocq, maître de forge et échevin, entre 1570 et 1584, et subirait peut-être quelques décennies plus tard l’ajout des trois pignons qui couronnent sa façade ouest (fig. 2) et l’extrémité occidentale de sa façade sud16.
Fig. 2 : Bouvignes, Maison Espagnole. Façade occidentale. 14. Cette vaste demeure est construite entièrement en pierres de taille autour du milieu du XVIe s. par l'Italien Bernardin Porquin, vers 1570 selon Puters, et rasée en 1904, cf. PUTERS, A., 1940, p. 43 (desssin) et 45 (notice) ; JOIRIS, A., Hôpital et environnement, dans De Bavière à la Citadelle, cat. expo., Liège, hôpital de la Citadelle, 7/11-7/12/1980, p. 115-121, 130. Voir aussi les photographies réalisées par Jaspar publiées dans CHARLIER, S., CARPEAUX, C. et MERLAND, M., 2009, p. 264-265. 15. La chapelle actuelle a été construite en 1894 par Laurent Demany, peut-être à l’imitation de la chapelle du début du XVIIe siècle, cf. Chap. de l’Hôpital de Bavière, dans Le Patrimoine monumental …, vol. 3, p. 87. 16. Ces dates résultent du croisement de l’analyse stylistique et des textes du XVIe siècle, cf. LANOTTE, A. et BLANPAIN, M., Bouvignes sur Meuse, visages présents et à venir d'une cité médiévale , dans Bulletin de la Commission royale des Monuments et Sites, t. 7, 1978, p. 58-62. Cf. aussi SAINT-AMAND, P., La Maison Espagnole (1472-2005), dans Les Echos de Crèvecoeur, n° 20, 2005, p. 31-49. Une datation dendrochronologique récente de la charpente situe l’abattage des bois entre 1568 et 1578 ; elle conforte donc la datation traditionnellement proposée mais n’envisage pas les transformations de la toiture et l’ajout des trois pignons, cf. EECKHOUT, J. et HOUBRECHTS, D., Analyse dendrochronologique de la Maison Espagnole de Bouvignes (Dinant), ULg, rapport inédit, cité dans SAINT-AMAND, P., 2005, p. 31. 114
L’ARCHITECTURE AU TEMPS D’ERNEST DE BAVIÈRE (1570-1620)
À Huy, l’ancien refuge de l’abbaye du Val-Saint-Lambert, aujourd’hui appelé Maison Batta, est commencé sous l’abbé Renier de Raizier (1559-1577) et achevé sous son successeur, Guillaume le Pannetier, qui décède en 1589. De cette période date l’imposant corps de logis à deux niveaux situé dans la zone sud-ouest du complexe, l’aile en retour d’équerre sur la façade côté Meuse (fig. 3), elle-même flanquée d’une sorte de tour de plan carré, coiffée de pignons chantournés à volutes, et contre laquelle s’adosse une tourelle d’escalier un peu plus élevée. Une longue aile percée de part en part par un passage couvert est ajoutée vers 1643 (millésime sur la clef d’un arc) dans le prolongement du corps de logis primitif17.
Fig. 3 : Huy, ancien refuge de l’abbaye du Val-Saint-Lambert, dit Maison Batta. Corps de logis du dernier tiers du XVIe siècle, façade sur Meuse (sud-est).
L’hôtel de la Cloche est édifié à Huy en deux temps : un premier bâtiment, qui correspond à la moitié sud du bâtiment actuel, daterait peut-être du dernier tiers du XVIe siècle ; un deuxième volume, de largeur équivalente, lui est ensuite ajouté vers 1606 (millésime en briques sur la façade)18. Le nouvel hôtel particulier que le richissime marchand liégeois Jean Curtius fait bâtir à Liège entre 1597 et 1605 constitue assurément le chantier majeur de l’époque. Le Palais Curtius se déployait sur une vaste parcelle et comptait plusieurs corps de bâtiments, répartis autour de cours intérieures bordées par des portiques. Du complexe du début du XVIIe siècle subsiste, pour l’essentiel, la Maison Curtius (fig. 4), soit cette construction très monumentale bordant l’actuel quai de Maastricht, coiffée d’une tour à quatre registres émergeant de l’ample toiture, et une aile rectangulaire longeant la rue Féronstrée, appelée par la suite « hôtel Libert », dont l’architecture du XVIIe siècle se devine aujourd’hui dans les volumes, les quelques cordons en
17. DUBOIS, R., Les rues de Huy. Contribution à leur histoire, Huy, 1910, p. 45-48 ; MARCHAL, M., Maison Batta, dans Le Patrimoine monumental…, vol. 15, p. 66-71. 18. DUBOIS, R., 1910, p. 54-58 ; REGINSTER, N., Hôtel de la Cloche, dans Le Patrimoine monumental…, vol. 15, p. 73-74. 115
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
calcaire de Meuse, les ancres à volutes et l’imposant portail appliqué sur la façade à rue19. L’hôtel de Loets de Trixhe, situé rue Hors-Château, date également du début du XVIIe siècle et sa façade à rue, millésimée 1606, préserve les grands traits de l’architecture d’origine20.
Fig. 4 : Liège, Maison Curtius. © Marc Verpoorten.
Plusieurs maisons conservent sur leur façade des millésimes qui permettent de les ajouter à ce corpus. Il s’agit par exemple, à Namur, du numéro 169 de la rue des brasseurs (1621)21, ou encore de ces quelques maisons situées Bostraat ou Bleumersstraat à Maaseik22. À Tongres, plusieurs maisons de modeste facture sont bâties dans le béguinage Sainte-Catherine dans les années 161023.
19. Sur le Palais Curtius, cf. notamment : DANDOY, A., Les origines du Palais Curtius, Liège, 1958 ; IDEM, Le palais Curtius : le témoignage de Philippe de Hurges, Liège, 1959 ; JANS, R. et PHILIPPE, J., Le Palais Curtius, dans Chronique Archéologique du Pays de Liège, t. 60, 1969, p. 3-116 ; HOFFSUMMER, P., La charpente de la maison Curtius et son analyse dendrochronologique, dans Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois, t. 98, 1986, p. 291-303 ; HINQUE, L., Une habitation bourgeoise de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle à Liège : la maison Curtius, ULg, mémoire de licence inédit, 2001 ; CHEVALIER, A., MORA-DIEU, G. et LAURENT, G., L’hôtel dit « maison Curtius », quai de Maestricht n° 13, dans DEVESELEER, J. (coord.), Le patrimoine exceptionnel de Wallonie, Namur, 2004, p. 349-353. 20. Hôtel Loets de Trixhe, dans Le Patrimoine monumental..., vol. 3, p. 155. 21. COURTOY, 1936, p. 25 ; Le Patrimoine monumental…, vol. 5/2, p. 509. 22. La maison numéro 38 de la Bosstraat est millésimée 1590 ; la Bleumerstraat conserve plusieurs maisons édifiées dans le courant du XVIIe siècle dont la plus ancienne, portant le numéro 47, daterait de 1620 environ, cf. GLAUDEMANS, R., Die Entwicklung des Bürgerhauses in Maaseik, dans GOER, M., DE VRIES, D. J., FURRER, B. e.a., Naturstein als Baumaterial, Jahrbuch für Hausforschung, t. 52, Marburg, 2007, p. 313-316. 23. Notamment les maisons portant les numéros 15, 17, 19, 20 et 21, cf. Bouwen door de Eeuwen heen…, vol. 14/1, p. 136-137. 116
L’ARCHITECTURE AU TEMPS D’ERNEST DE BAVIÈRE (1570-1620)
Les bâtiments que les Jésuites font élever à Namur, Dinant, Liège et Maastricht dans les années 1610 clôturent la liste des grands chantiers urbains connus du début du XVIIe siècle. À Namur, le collège et la maison des Jésuites sont élevés entre 1611 et 161924. Les différentes ailes, réparties autour de deux vastes cours rectangulaires, sont remarquablement conservées (fig. 5). Du collège fondé par les Jésuites anglais à Liège en 1616 subsistent aujourd’hui deux ailes perpendiculaires, partiellement transformées au XVIIIe siècle et dont l’aspect actuel résulte par ailleurs des importantes restaurations des XIXe et XXe siècles25. De la maison fondée par les Jésuites à Maastricht à la même période, enfin, il resterait au moins une tourelle d’escalier, adossée à un corps de bâtiment plus tardif, en plus d’une partie de l’église édifiée par Huyssens entre 1606 et 1614, tandis que le collège dinantais du début du XVIIe siècle a aujourd’hui disparu26.
Fig. 5 : Namur, collège des Jésuites. Aile occidentale du collège.
Les résidences aristocratiques ou bourgeoises hors des villes Dans les campagnes de la région, plusieurs châteaux sont également bâtis ou transformés à la même époque par les seigneurs locaux ou de riches bourgeois. Reconstruit dans le dernier tiers du XVIe siècle, le château de Freyr est ensuite transformé à plusieurs reprises. Son aile orientale, millésimée 1571, donne une idée assez juste de l’architecture d’origine. Le château de Bonne Espérance daterait de la fin du XVIe siècle27. Il présente un imposant volume parallélépipédique de huit travées coiffé en son centre d’une tour dans-œuvre et doté, sur sa face sud, d’une galerie (fig. 6). Dans les environs, le château de Tihange, aujourd’hui appelé château Poswick, est reconstruit sur les ruines du château médiéval dès 1576, et modifié à plusieurs reprises 24. GENICOT, L. Fr. et COOMANS, Th., 1991, p. 140-141. 25. CLOSON, M.-A., De l’ancien collège des Jésuites anglais au « site des anglais » de la DGATLP du Ministère de la Région wallonne à Liège, dans Les échos du patrimoine, t. 48, 2000, p. 1-4 ; GOBERT, Th., Liège à travers les âges. Les rues de Liège, e 3 éd., t. 3, Bruxelles, 1976, p. 99-107. 26. Connu notamment par un plan de J. Du Blocq de 1613, conservé au Cabinet des Estampes Paris et publié dans GENICOT, L. Fr. et COOMANS, Th., 1991, p. 139. 27. Le millésime de 1588 apparaît sur plusieurs cartouches, accompagné des armes du bâtisseur probable de ce château, A. Audacé, cf. Château de Bonne-Espérance, dans Le Patrimoine monumental…, vol. 15, p. 303-304. 117
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
au XVIIe et au XVIIIe siècle28. La tour-porche dans œuvre du château de Wégimont est édifiée vers 1614 (fig. 7), au sein d’un complexe architectural qui subira des transformations aux XVIIe et XVIIIe siècles, avant d’être incendié en 196429. Toujours en région liégeoise, le château d’Oupeye est reconstruit par Jean Curtius au début du XVIIe siècle. Il en subsiste aujourd’hui une grosse tour de plan carré privée de sa toiture ancienne, et qui réutilise des fragments de murs d’une tour médiévale30. La cense de Solières, maison forte de la région hutoise, serait également élevée dans les deux premières décennies du XVIIe siècle ; elle conserve l’essentiel de son gros-œuvre primitif, à l’exception de la tourelle d’escalier hors-œuvre, reconstituée au début du XXe siècle31. Enfin, le château de Fernelmont se voit adjoindre une galerie toscane en 162132 (fig. 8) et le château-ferme de Courrière, construit autour de 1620 également, est doté d’une galerie similaire, millésimée 1622.
Fig. 6 : Tihange, château de Bonne-Espérance, façade sur jardin. Les baies à croisées datent des travaux de restauration du XIXe siècle ; elles remplacent les oculi primitifs.
En région mosane, l’architecture civile élevée entre 1570 et 1620 environ s’illustre donc par une vingtaine de chantiers bien datés : deux hôtels de ville, dont l’état primitif a disparu, une halle, un refuge monastique, quelques hôtels particuliers, dont le célèbre Palais Curtius, des maisons plus modestes, dont les exemples datés et conservés ne constituent assurément qu’une petite proportion de ce qui fut construit à l’époque, quatre établissements jésuites et une petite dizaine de châteaux d’ampleur variable et dont l’architecture de la période étudiée est souvent altérée par de nombreuses campagnes de transformations. Bien qu’elles appartiennent à des types différents, qui sous-tendent des problématiques spécifiques, toutes ces constructions présentent des élévations traitées selon les mêmes principes. Les traditions techniques et les modèles formels employés pour bâtir les façades de ces édifices varient peu en effet et permettent de
28. LAMOTTE-REGINSTER, N. de, Château de Tihange, dans Ibidem, p. 311-314. 29. Tour millésimée 1614, cf. JOWAY-MARCHAL, M., Château de Wégimont, dans Le Patrimoine monumental de la Belgique. Wallonie, vol. 8/2, Province de Liège. Arrondissement de Liège (L-V), Liège, 1980, p. 605-608. 30. OTREPPE DE BOUVETTE, H. de, Château d’Oupeye, dans Le Patrimoine monumental …, vol. 8/1, p. 551-552. 31. CLOSON-REMY, M.-A., Cense de Solières, dans Le Patrimoine monumental …, vol. 15, p. 278-280. 32. COURTOY, F., La galerie du château de Fernelmont, dans Namurcum, t. 13, 1936, p. 36-39 ; JAVAUX, J.-L., Le château-ferme de Fernelmont, dans DEVESELEER, J. (coord.), Le patrimoine exceptionnel de Wallonie, Namur, 2004, p. 517-519. 118
L’ARCHITECTURE AU TEMPS D’ERNEST DE BAVIÈRE (1570-1620)
définir, dans les grandes lignes, un style régional relativement typique de la fin du XVIe et des deux premiers tiers du XVIIe siècle environ. D’abord qualifié de « mosan », ce style est ensuite associé par la majorité des auteurs au concept de « Renaissance mosane » ; il est aujourd’hui considéré comme un « style traditionnel mosan ». L’évolution de cette terminologie illustre les différentes perceptions de cette production architecturale, en fonction de grilles de lecture étroitement conditionnées par l’évolution de l’histoire de l’architecture en Belgique. L’analyse de l’architecture s’accompagnera donc de considérations historiographiques, afin d’évaluer la pertinence des théories développées dans la littérature du XXe siècle à l’aune d’une lecture renouvelée de ce patrimoine.
Fig. 7 : Wégimont, château. Tour porche. 119
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 8 : Fernelmont, château. Galerie surmontée d’un étage contre l’aile orientale.
Caractéristiques matérielles et formelles Ordonnance générale Les nombreux écrits consacrés à l’architecture de la fin du XVIe et du XVIIe siècle s’accordent le plus souvent sur les grandes caractéristiques des façades de ces constructions mosanes33. Alors que les parements extérieurs sont majoritairement en pierres dans la première moitié du XVIe siècle, l’appareil mixte s’impose dès le dernier tiers du XVIe siècle. Si la proportion de pierres de taille est encore importante dans la Maison Espagnole de Bouvignes, voire dans l’hôtel de la Cloche à Huy, elle ne compose plus ensuite que certains éléments spécifiques : le soubassement, les chaînes d’angle, les encadrements ainsi que les croisées des baies et les cordons horizontaux qui rythment l’élévation.
33. La caractérisation de cette architecture s’étoffe au fil du XXe siècle. Nous proposons ici les principaux jalons bibliographiques de cette évolution, tout en soulignant l’apport majeur des travaux de Puters dans l’analyse de cette architecture : GHEQUIERE, A., 1922, p. 149-160 ; VAN DE CASTYNE, O., 1934, spécialement les p. 74, 282-285, 288 ; COURTOY, F., 1936, p. 10-18, 24-25 ; BONIVER, F., Les styles des constructions liégeoises, Liège, 1938, p. 63-66 ; PUTERS, A., 1940, p. 50-55 ; PUTERS, A., L’architecture privée dans la région verviétoise, 2e partie : La renaissance mosane, Verviers, 1950, p. 17, 21 ; DANDOY, A., La Renaissance liégeoise. Contribution à l’étude de l’évolution historique de l’habitation liégeoise, Liège, 1957, p. 15 ; VAN ACKERE, J., Belgique baroque & classique (1600-1789) : architecture, art monumental, Bruxelles, 1972, p. 49-53, 61-62 (Histoire de l’architecture en Belgique, 4) ; BASTIN, N., L’architecture civile à Namur (XVIe-XXe s.), Paris-Gembloux, 1977, p. 18-20 (Wallonie, art et histoire, 40) ; CHEVALIER, A., L’architecture civile et religieuse au Pays de Liège aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans LEJEUNE, R. et STIENNON, J. (dir.), La Wallonie, le pays et les hommes : lettres-arts-culture, t. 2 : Du XVIe siècle au lendemain de la Première Guerre mondiale, Liège, 1978, p. 196 ; GENICOT, L. Fr. (dir.), Architecture rurale de Wallonie. Pays de Herve, Liège, 1987, p. 100 ; LEHAEN, J.-L., Recherches sur le style dit « renaissance mosane », ULg, mémoire de licence inédit, 1988 ; HINQUE, L., Une habitation bourgeoise de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle à Liège : la maison Curtius, ULg, mémoire de licence inédit, 2001, p. 264-265. 120
L’ARCHITECTURE AU TEMPS D’ERNEST DE BAVIÈRE (1570-1620)
Les principaux étages sont éclairés par des baies à croisée, subdivisées en quatre jours de dimensions sensiblement identiques et dotées de piédroits harpés34. Dans les constructions très monumentales, comme la Maison Curtius, meneaux et croisillons se multiplient selon des formules variables donnant des baies à six, huit voire douze jours. Dès le dernier tiers du XVIe siècle, les relations spatiales entre les baies d’un même registre sont organisées selon deux principes différents. Soit les bâtisseurs réduisent au maximum la surface murale entre les baies, et confèrent dès lors aux registres des baies, exclusivement composé de pierres de taille, l’apparence d’une claire voie – selon un principe popularisé dans l’architecture de la fin du gothique35 – soit ils disposent entre chacune des baies une bande murale plus large, composée majoritairement de briques. Dans ce dernier cas de figure, qui tend à se généraliser sur les chantiers dès le début du XVIIe siècle36, croisées, linteaux et appuis sont reliés entre eux par des cordons horizontaux en pierre de taille qui s’accordent avec les hauteurs d’assises des chaînes d’angle. Quand un attique s’étend sous la corniche, les petites baies qui y sont disposées sont reliées dans la plupart des cas par de semblables cordons, qui prolongent les appuis et les linteaux. Le plus souvent privés de mouluration, ces cordons marquent également les limites entre les différents niveaux de l’élévation et se retrouvent sous la corniche, où ils servent d’assise de réglage pour la disposition des corbeaux sculptés ou, plus sobrement, pour l’assise de couronnement du mur37. Les portes, enfin, sont le plus souvent en plein cintre et de petites dimensions. Décor Le décor mural, très sobre, se réduit souvent à peu de choses. Dans la majeure partie des exemples, en effet, tous les éléments qui structurent l’élévation sont de la plus grande sobriété. La modénature qui anime les fenêtres et cordons de la fin du XVe et du début du XVIe siècle disparaît progressivement dans le dernier quart du XVIe siècle38. À Bouvignes, le profil des encadrements de baies, de leurs meneaux et allèges, présente encore une doucine associée à une scotie. À Huy, la Maison Batta, bien restaurée, conserve également des vestiges d’une modénature en doucine qui animait les croisées comme les linteaux et piédroits des baies du premier étage. Dans les monuments postérieurs, les éléments des baies ne reçoivent plus de modénature et les arêtes des blocs sont traitées en angle droit, selon une formule appliquée également pour les cordons horizontaux rythmant l’élévation. Parfois, un cordon placé sous l’attique est animé par un jeu de retraits successifs de minces bandes horizontales, qui semble imiter les trois fasces des architraves ioniques et corinthiennes39. Des cordons-larmiers peuvent également être employés comme au Moyen âge pour limiter le ruissellement des eaux de pluie sur les parements extérieurs. Sur les façades de la Maison Curtius, enfin, les murs sous-appuis sont mis en évidence par des cordons dotés de larges bandeaux en saillie. Outre ces quelques exceptions, les baies et cordons horizontaux sont désormais dénués de modénature et les faces de parement de leurs blocs sont placées au même nu que les maçonneries de briques.
34. L’emploi du même module pour les jours supérieurs et inférieurs des baies est moins fréquent dans d’autres régions, et notamment dans le Brabant ou en France, où les jours inférieurs des croisées ont souvent une plus grande hauteur, cf. PUTERS, A., 1950, p. 19. Cette différence de hauteur est également appliquée aux baies à croisée de la halle des bouchers de Namur. À la maison Curtius, les baies à trois niveaux de jours superposés présentent pour chacun des niveaux des hauteurs légèrement différentes : registre inférieur de 4 pieds de haut, registre médian de 3,5 pieds, registre supérieur de 3 pieds, cf. HINQUE, L., 2001, p. 171. 35. Notamment à l’hôtel de ville de Namur, à la Maison Espagnole de Bouvignes et à l’hôtel de la Cloche à Huy. Sur l’influence de l’architecture gothique sur cette formule, cf. NUYTTEN, D., Architectural and technical Examples : between Antique Modernity and Gothic Tradition, dans LOMBAERDE, P. (éd.), Hans Vredeman de Vries and the Artes Mechanicae revisited, Turnhout, 2005, p. 69-70 (Architectura Moderna, Architectural Exchanges in Europe, 16th-17th Centuries, 3). 36. Principe appliqué à la Halle des bouchers à Namur, à la Maison Curtius, aux collèges des Jésuites de Liège et de Namur ainsi que dans tous les châteaux recensés. 37. Parfois aussi appelés cordons en « tranches de lard », cf. FRECKMANN, Kl., Specklagenformationen - nur in den Niederlanden ? Zur zeitlichen und regionalen Verbreitung von Specklagen, dans GOER, M., DE VRIES, D. J., FURRER, B. e.a., 2007, p. 193-206. 38. PUTERS, A., 1950, p. 16 ; DANDOY, A., 1957, p. 128 ; HINQUE, L., 2001, p. 165-166. 39. Notamment à la Halle aux viandes de Namur et à la Maison Espagnole de Bouvignes. 121
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Les frontons, colonnes, pilastres et embellissements divers qui agrémentaient les fenêtres lors de la période précédente40 ont cédé la place à des encadrements en pierres de taille régis par la ligne droite et dépourvus de toute ornementation. Parfois, des petits reliefs sculptés en tuffeau s’alignent sur les murs sous appuis des registres supérieurs ou prennent place au sommet du mur, entre les corbeaux de la corniche41 : ils peuvent être ornés de figures zoomorphes ou anthropomorphes42 ou consister en des médaillons moulurés plus sobres43. Les ancres en volutes contribuent également à atténuer la sévérité de ces élévations, comme les corbeaux en bois supportant les corniches, et souvent ornés d’un motif de gland et, sur les faces latérales, de petits motifs circulaires caractéristiques dont découle l’appellation de « corniche à cymbales ». À la différence des constructions brabançonnes, les édifices mosans de l’époque sont souvent dépourvus de pignons et de lucarnes en façades. Encore cette caractéristique souvent rappelée dans la bibliographie, parfois à renfort d’arguments peu convaincants44, doit-elle être nuancée. La façade côté Meuse du refuge du Val-Saint-Lambert est en effet dotée de belles lucarnes en briques et, partiellement du moins, en tuffeau, dont la partie supérieure est ornée de petits ailerons, de deux petites colonnes ioniques et est couronnée d’un fronton courbe. À Namur, l’hôtel de ville détruit au début du XIXe siècle était agrémenté d’un pignon massif à deux registres, flanqué de deux lucarnes conçues dans le même style. Cet exemple de pignon ouvragé n’est pas isolé dans la région. La tour du refuge du Val-Saint-Lambert est ainsi couronnée de deux pignons chantournés (fig. 9) qui, bien que probablement touchés par des restaurations mal documentées45, conservent encore des éléments importants de leur élévation primitive, qui témoigne de ce style orné, également appliqué sur les lucarnes du corps de logis et sur la frise d’inspiration dorique qui court sous les corniches. À Maaseik, le pignon chantourné qui somme une maison de la Bosstraat, millésimé 1590, présente des formes en briques et tuffeau d’un autre type46. Les cordons horizontaux se combinent ici avec des petits éléments verticaux et des motifs courbes, selon une composition symétrique animée en son centre par deux petites baies superposées. L’effet constitue une allusion aux modèles fournis par Hans Vredeman de Vries dans les gravures qu’il publie dans le dernier tiers du XVIIe siècle47. Le pignon que Guillaume I de Nuremberg construit vers 1605 (millésime) sur la halle aux draps de Nimègue se réfère à l’évidence à un modèle très proche. Si Nimègue sort du cadre géographique de nos recherches, sa halle aux draps n’en est pas moins bâtie par un membre de la famille des De Nuremberg, ces marchands de pierres et entrepreneurs mosans dont la place très en vue sur le marché de la construction aux Pays-Bas se fonde en partie sur l’exploitation des carrières du Namurois48. Le modèle choisi est par ailleurs très proche de celui reproduit, en plusieurs exemplaires, au sommet de la Maison Espagnole de Bouvignes. La combinaison de trois pignons identiques en briques et calcaire de Meuse sur une même construction est peu commune si l’on considère que ces éléments sont tous trois du côté occidental de l’édifice et qu’ils semblent avoir considérablement compliqué l’enchevêtrement des différents pans de toiture. Un tel dispositif s’explique probablement par la volonté de mettre en évidence cette 40. Voir par exemple l’hôtel de Soer de Solières, bâti à Liège probablement avant 1566, et malheureusement profondément altéré par un incendie, puis par une restauration très discutable, ou encore l’hôtel de Liévin Torrentius, construit dans la même ville vers 1561, cf. PUTERS, A., Lambert Lombard et l’architecture de son temps à Liège, dans Bulletin de la Commission Royale des Monuments et Sites, t. 14, 1963, p. 43-45 (hôtel Torrentius) et 45-47 (hôtel de Soer). 41. PUTERS, A., 1950, p. 17, 21. 42. L’exemple le plus célèbre reste bien sûr la Maison Curtius avec ses trois rangs de reliefs où des mascarons alternent avec des scènes très variées. Le motif du mascaron est également appliqué sur la façade de l’hôtel de la Cloche à Huy et sur celle de la maison n. 47 de la Bleumerstraat à Maaseik, cf. GLAUDEMANS, R., 2007, p. 307-308. 43. Notamment à l’hôtel de ville de Visé, sur plusieurs maisons du béguinage de Tongres et sur plusieurs maisons de Maaseik. 44. O. van de Castyne reprend par exemple la théorie de Jaspar, selon laquelle l’absence de pignons à rue dans la région mosane résulterait à la fois d’un climat très pluvieux et de la dureté de la pierre de Meuse, cf. VAN DE CASTYNE, O., 1934, p. 98-99. 45. Informations aimablement transmises oralement par Francis Tourneur, chargé par le Ministère de la région wallonne d’une étude préalable de ces éléments. Nous l’en remercions vivement. 46. GLAUDEMANS, R., 2007, p. 314. 47. Voir notamment : Hans VREDEMAN DE VRIES, Le peuple de Ninive, avant 1577/1578, publiée dans UPPENKAMP, B., The influence of Hans Vredeman de Vries on the cityscape constructed like a picture, dans LOMBARDE, P. (éd.), 2005, p. 118-119. 48. VAN TUSSENBROEK, G., 2006, p. 121. 122
L’ARCHITECTURE AU TEMPS D’ERNEST DE BAVIÈRE (1570-1620)
vaste construction bourgeoise en lui conférant un couronnement qui devait probablement se voir de loin. Excepté le pignon couronnant le mur ouest de l’aile sud, ces éléments ne se centrent pas symétriquement sur la composition de l’élévation. Ces décalages seraient le signe d’une campagne de travaux ultérieure, visant à ajouter des pignons au bâti primitif sans toujours pouvoir respecter les lignes maîtresses de la composition des façades d’origine. Des comparaisons stylistiques permettraient par ailleurs de dater ces ajouts des années 1630-164049. Ces deux arguments paraissent néanmoins peu convaincants. La présence d’une demi-travée sur chacun des deux murs coiffés par ces pignons empêche en effet les pignons de se centrer sur une élévation privée d’axe vertical de symétrie. Les exemples de Nimègue et de Maaseik prouvent par ailleurs que des modèles de pignons de ce type circulent dans la vallée mosane entre 1590 et 1605. Cette fourchette chronologique peut donc être également proposée pour l’ajout des pignons de la Maison Espagnole de Bouvignes50.
Fig. 9 : Huy, ancien refuge de l’abbaye du Val-Saint-Lambert, dit Maison Batta. Partie supérieure de la tour.
La sobriété souvent rappelée des façades mosanes résulte également de l’absence fréquente des ordres de la Renaissance51. À l’hôtel de ville de Namur et au refuge du Val-Saint-Lambert à Huy, les ordres semblent
49. LANOTTE, A. et BLANPAIN, M., 1978, p. 61-62. 50. S’ils sont l’œuvre de Gobert de Maistrecocq, ces pignons doivent alors être datés d’avant 1601, puisque l’échevin de Bouvignes est déssaisi de son bien au cours de cette année. Ces transformations peuvent également être attribuées à Nicolas Marotte, qui hérite de la « grande maison du marché » en 1608, cf. SAINT-AMAND, P., 2005, p. 36-37. L’analyse dendrochronologique n’a pas permis d’explorer les transformations apportées à la toiture lors de l’ajout de ces pignons. 51. PUTERS, A., 1950, p. 15. 123
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
se cantonner aux lucarnes et pignons. Le palais Curtius conserve quant à lui trois portails doriques animés de bossages rustiques (fig. 10), peut-être inspirés d’un modèle de Hans Vredeman de Vries52. Dans cet édifice d’une ampleur pourtant exceptionnelle, c’est là l’unique exception concédée à la grande sobriété des façades. Une maison de la Bosstraat de Maaseik, datée par ses ancres de 1620, est animée en façade par des colonnes en haut relief sculptée dans du tuffeau et reposant sur des consoles en calcaire de Meuse supportant par ailleurs le surplomb de la partie supérieure de la façade53. L’effet produit rappelle les façades brabançonnes54 et témoigne par conséquent, pour cette ville, d’une plus grande diversité de modèles que celui de la façade sobre et dépourvue de relief dont sont dotés les édifices conservés à Liège, Huy, Namur et Bouvignes.
Fig. 10 : Liège, hôtel de Loets de Trixhe (ancienne aile du Palais Curtius). Façade sur rue. Détail : portail.
Enfin, les portiques sur colonnes toscanes ne sont pas rares dans les premières décennies du XVIIe siècle. Comme au siècle précédent, ils s’ouvrent le plus souvent sur des cours intérieures et sont surmontés le plus
52. Voir notamment cet exemple de portail dorique doté de bossages rustiques publié dans Hans VREDEMAN DE VRIES, Architectura, Anvers : chez Gérard Smits, 1577, f° 8. 53. GLAUDEMANS, R., 2007, p. 309. 54. VAN DE CASTYNE, O., 1934, p. 293-295. 124
L’ARCHITECTURE AU TEMPS D’ERNEST DE BAVIÈRE (1570-1620)
souvent de un voire de deux étages. Au collège des Jésuites de Namur, la colonne cède la place à d’élégants piliers, selon une formule exceptionnelle pour la région55. Matériaux Le calcaire de Meuse, issu des carrières de la région namuroise, constitue le matériau par excellence de cette architecture. Son extraction et sa commercialisation reposent sur un marché organisé par quelques puissantes familles de marchands de pierre, comme les De Nuremberg ou encore les Lambillon56. À Visé, mais également au refuge du Val-Saint-Lambert à Huy et sur les maisons de Maaseik, il est néanmoins combiné avec des pierres plus tendres, dont le tuffeau de Maastricht, qui règnent dans les registres supérieurs et contribuent assurément, à Huy comme à Maaseik, à la variété de l’ornementation des façades. Le tuffeau est abondamment employé au Moyen âge dans la région mosane. Il alimente encore quelques chantiers fameux du XVIe siècle à Liège, comme celui de l’hôtel de Soer de Solières ou encore celui de l’hôtel Torrentius, où il est destiné aux ornements sculptés, mais aussi aux cordons moulurés marquant les niveaux principaux de l’élévation. À Liège, dans la façade de la chapelle Saint-Roch comme sur le mur sud de l’église Saint-Servais, le recours aux calcaires tendres vise à élever des maçonneries mixtes rythmées par de nombreux cordons en pierre de taille ; le calcaire lorrain est probablement encore employé à l’époque aux côtés du tuffeau, ainsi, peut-être que d’autres « pierres blanches » de provenances diverses57. Cette variante de l’appareil mixte est popularisée sur les façades de nombreux bâtiments construits aux XVIe et XVIIe siècles dans les actuelles régions du Limbourg belge et du Limbourg hollandais, en milieu rural comme en milieu urbain, dans une zone où se concentrent les gisements de tuffeau les plus importants58. Un style traditionnel Plusieurs traits importants de cette architecture perpétuent l’héritage des constructions élevées dans les Pays-Bas du sud entre la fin du XVe siècle et le milieu du XVIe siècle environ. Ce poids de la tradition s’exprime particulièrement dans les cordons horizontaux qui soulignent les différents registres de l’élévation, de même que dans les baies à croisées systématiquement appliquées aux principaux étages59. Ce conservatisme n’a cependant rien de typiquement mosan. Ces mêmes éléments jouent en effet un rôle important dans la physionomie de nombreuses bâtisses brabançonnes ou hennuyères de la seconde moitié du e e XVI siècle et du début du XVII siècle. Des variantes locales apparaissent ça et là, en fonction de l’ampleur du chantier et, probablement, des modèles favorisés dans l’une ou l’autre région des Pays-Bas du sud. Ce qui tend souvent à distinguer le bâti mosan de constructions civiles élevées en style traditionnel au e XVII siècle à Bruxelles, Malines, Louvain ou Tournai, c’est probablement la très grande sobriété conférée aux façades, cette absence de relief résultant du traitement très sobre des cordons, croisées et encadrements de baies. Les contraintes techniques du calcaire de Meuse sont souvent invoquées pour expliquer cette disparation de l’ornementation sculptée extérieure. La pierre par excellence de l’architecture de la région mosane serait
55. GENICOT, L. Fr. et COOMANS, Th., 1991, p. 146-147. 56. VAN TUSSENBROEK, G., 2006, p. 67, 105 ; IDEM, Der Namurer Blausteinhandel am Beispiel der Familie Van Neurenberg (1480-1640), dans GOER, M., DE VRIES, D. J., FURRER, B. e.a., 2007, p. 35-56. 57. Le mur sud de l’église Saint-Servais de Liège, par exemple, datée de 1587, se compose de pierres d’un jaune orangé qui s’apparentent davantage aux calcaires du Bajocien, très présents en région liégeoise à la fin du Moyen âge, qu’au tuffeau de Maastricht. Sur ces matériaux, cf. DE JONGHE, S., GEHOT, H., GENICOT, L. Fr., e.a., Pierres à bâtir traditionnelles de la Wallonie. Manuel de terrain, Namur, 1996, p. 138-139 (tuffeau) et p. 240-241 (calcaires du Bajocien). 58. HUPPERHEITZ, W., MEIERINK, B. O. et ROMMES, R., Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, 2005, voir notamment la maison forte d’Oien (p. 178-179), la ferme-château de SibberHusske (p. 389-390), le château dit « de Bongard » (p. 449-451) ; voir aussi les commentaires de Freckmann sur cette technique de construction dans FRECKMANN, Kl., 2007, p. 194. 59. Ce caractère traditionnel est souvent rappelé dans la bibliographie sur le sujet, cf. notamment VAN DE CASTYNE, O., 1934, p. 74 ; PUTERS, A., 1940, p. 50 ; IDEM, 1950, p. 17 ; DANDOY, A., 1957, p. 15 ; RADERMECKER, L., 1974, p. 8-10 ; CHEVALIER, A., 1978, p. 196. 125
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
ainsi trop dure pour permettre la sculpture d’ornements60. L’argument semble bien fragile quand on considère les portails du Palais Curtius ou encore les pignons de la Maison Espagnole à Bouvignes, voire, dans un autre contexte, un peu plus tardif, la façade de l’église des Jésuites de Namur. La maîtrise des tailleurs de pierre mosans pour donner aux blocs de calcaire de Meuse des formes en accord avec les modèles de leur époque n’est donc pas à démontrer. Que la dureté remarquable du matériau ait influé sur le coût du chantier est en revanche évident, mais cette explication ne suffit cependant pas à expliquer que Jean Curtius, pourtant richissime, fasse lui aussi bâtir un palais dont les ornements extérieurs sont rares et, hormis pour les trois portails doriques, exclusivement sculptés dans du tuffeau. Le style qui s’élabore sur les chantiers mosans de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle résulte donc à la fois d’une simplification de traditions formelles et techniques du début du XVIe siècle et du faible succès des modèles maniéristes diffusés dans les traités du XVIe siècle. Ce style traditionnel, sobre et fonctionnel, contamine rapidement la majeure partie des chantiers de l’époque, en transcendant souvent les types et les genres. Les façades d’une maison bourgeoise se construisent désormais selon les mêmes principes que ceux appliqués pour un vaste hôtel particulier ou un château de plaisance, la différenciation sociale se marquant, outre dans le plan, dans l’échelle du bâtiment, dans l’emploi de galeries s’ouvrant souvent sur des cours intérieures et, éventuellement, dans l’ornementation de parties spécifiques de l’élévation extérieure, comme les portails. Plus étonnant encore, le caractère sobre et fonctionnel de cette architecture permet d’observer de nombreuses similitudes entre une vaste demeure bourgeoise ou aristocratique et une halle, voire une ferme de la même époque. Si des constructions rurales présentent parfois les mêmes caractéristiques que les bâtiments civils urbains – plusieurs exemples plus tardifs existent notamment dans le Pays de Herve, le Condroz ou la Hesbaye61 – elles s’en distinguent néanmoins par l’absence totale d’ornements et, parfois, par le remplacement des briques par des grès locaux. Il n’est pas rare non plus que les cordons en calcaire de Meuse fassent défaut dans le bâti rural en briques. Une Renaissance mosane ? Harmonie des proportions et esthétique de la sobriété Les caractéristiques des constructions mosanes de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle n’empêchent nullement les auteurs de vanter les qualités intrinsèques de ce style. De nombreux écrits s’attachent à rehausser le statut de cette architecture traditionnelle en invoquant des recherches qu’il serait possible de situer dans le sillage de l’architecture de la Renaissance italienne. Dès le milieu du XIXe siècle, le terme Renaissance est employé pour désigner le style de la Maison Curtius, dont l’architecture imiterait les grands palais florentins du XVe siècle. Le décalage chronologique pour le moins important entre les modèles présumés et la copie est alors atténué par une datation du milieu du XVIe siècle proposée pour l’édifice liégeois62. L’influence de la Renaissance est ensuite régulièrement évoquée pour expliquer les traits majeurs des constructions civiles édifiées en région mosane dès la fin du XVIe siècle à tel point que cette architecture est régulièrement associée au concept, au reste mal défini, de « Renaissance mosane »63. Elle s’exprimerait à la fois dans un rapport de proportions particulièrement harmonieux ainsi que dans une recherche esthétique basée à la fois sur les matériaux employés et sur les lignes de composition des façades. Vers le milieu du XXe siècle, Puters plaide également pour l’influence du palais italien sur la Maison Curtius. Le volume et l’élévation de ce vaste bâtiment seraient ainsi inspirés d’un type de palais urbains dont le
60. GHEQUIERE, A., 1922, p. 149 ; VAN DE CASTYNE, O., 1934, p. 286. 61. Quelques exemples du deuxième ou du troisième tiers du XVIIe siècle sont publiés dans GENICOT, L. Fr. (dir.), 1987, p. 100, 103 (Pays de Herve), dans IDEM, Architecture rurale de Wallonie. Condroz, Liège-Bruxelles, 1989, p. 143, 149 et dans IDEM, Architecture rurale de Wallonie. Hesbaye liégeoise ; Liège-Bruxelles, 1986, p. 96. Voir aussi l’exemple publié dans FRECKMANN, Kl., 2007, p. 198-199. 62. CRALLE, H. A., Revue des Monuments de la ville de Liège, Liège, 1856, p. 84. 63. L’expression semble apparaître sous la plume de Coenen, cf. COENEN, J., Les monuments de Liège. Guide archéologique, Liège, 1923, p. 26 ; elle est ensuite reprise dans BONIVER, 1938, p. 63-64, ainsi que dans les différentes publications de Puters (cf. notamment PUTERS, A., 1940, p. 44 ; IDEM, 1950, p. 23, 66). Elle est encore employée dans VAN ACKERE, J., 1972, p. 61, avant d’être remise en question dans RADERMECKER, L., 1974, p. 16, puis dans CHEVALIER, A., 1978, p 196, et finalement d’être abandonnée au profit de la dénomination « style mosan » ou « style traditionnel mosan ». 126
L’ARCHITECTURE AU TEMPS D’ERNEST DE BAVIÈRE (1570-1620)
Palais Farnèse, à Rome, constituerait l’exemple le plus emblématique64. L’absence d’ordres sur les registres de l’élévation liégeoise, conséquence de cette filiation stylistique, serait dès lors compensée par la disposition régulière et systématique de cordons en calcaire de Meuse disposés sur les façades selon de savants rapports de proportion et conférant à cette architecture un accent classique65. Les rapports de proportions et les schémas de composition qui auraient guidé l’exécution des façades mosanes sont analysés de bonne heure par Jaspar. Les bâtisseurs privilégieraient ainsi des rapports de proportions assez variés et composeraient plans et élévations au moyen de formes géométriques élémentaires associées en des combinaisons diverses. D’après les monuments étudiés, et notamment l’hôtel de ville de Visé, dont Jaspar supervise la reconstruction, le triangle rectangle du théorème de Pythagore (côtés de 3, 4 et 5 unités) jouerait par ailleurs un rôle central sur les chantiers mosans, notamment dans sa position oblique intégrée au carré, que les auteurs nomment souvent le « triangle égyptien » 66. Puters s’intéresse également aux rapports de proportions des façades mosanes, dont il encourage l’étude, convaincu de « l’eurythmie » de ces constructions67. Un mémoire de fin d’études s’est récemment attelé à l’étude de ces problématiques, sans déceler cependant des modèles géométriques ou des tracés régulateurs d’une grande complexité68. De nouvelles recherches devraient permettre de renouveler ce débat. Dans l’état actuel des connaissances, « l’eurythmie » vantée par Puters est une notion fragile qu’il apparaît difficile de démontrer. Si les compositions sont équilibrées par des rapports de proportion relativement harmonieux et que la régularité des hauteurs des différents bandeaux de pierre de taille contribue à l’homogénéité de ces façades, rien ne permet à ce stade d’en déduire de savants calculs de proportions ou encore l’existence de tracés régulateurs d’une réelle complexité. Les maîtres d’œuvre semblent plutôt appliquer des principes de composition simples, dont les finalités devaient être tout autant, sinon davantage, d’ordre technique que d’ordre esthétique69. Les irrégularités ne sont pas rares, par ailleurs, même pour des édifices majeurs et réputés emblématiques de le « Renaissance mosane », comme la halle des bouchers de Namur ou la Maison Curtius. Souvent, le rythme des travées est en effet perturbé par l’une ou l’autre travée plus large ou plus étroite disposée en bout de mur. Le principe de la demi-travée, fréquemment employé, le plus souvent de manière asymétrique, et le décentrement des portails – une pratique très courante – perturbent par ailleurs l’effet de symétrie global. Dans bien des cas, le pragmatisme prime donc sur la quête d’harmonie des proportions et sur la recherche de compositions symétriques. Les propos récurrents sur le rythme des façades mosanes, voire sur celui de constructions des régions limitrophes, sont issus de réflexions plus globales sur les recherches esthétiques dont témoigneraient les façades mosanes. Selon la plupart des auteurs, la superposition de bandeaux de pierre de taille à intervalle régulier et l’alignement de certain de ces éléments sur les linteaux et appuis de baies résulteraient ainsi pour l’essentiel de motivations esthétiques. Parfois, les commentaires se muent même en éloges dithyrambiques de la sobriété des façades mosanes, comme si la grande simplicité de ces élévations répondait à une esthétique minimaliste, fondée sur la ligne et la beauté du matériau70. L’alternance entre les maçonneries de briques et les assises de pierres de taille constituerait l’un des effets recherchés pour embellir les façades des constructions civiles des XVIe et XVIIe siècles71. La polychromie résultant de la combinaison de plusieurs matériaux aurait 64. PUTERS, 1940, p. 44. 65. PUTERS, 1950, p. 19-20. 66. JASPAR, P., Pour la reconstruction de Visé, dans L’Emulation, t. 41, 1921 ; Les conclusions de Jaspar sont reprises dans VAN DE CASTYNE, O., 1934, p. 69-70. 67. PUTERS, A., 1950, p. 19-20. 68. COLIGNON, C., Problématiques des constructions de type mosan en Terre de Sambre et philosophie d’intervention, FPMons, mémoire de licence inédit, 2003, p. 31-32. 69. Cf. l’analyse du système de proportions pour deux registres de la Maison Curtius, dans HINQUE, L., 2001, p. 171, qui met en évidence, entre les cordons et les jours des baies, des rapports de 1/6 environ (0,5 pieds pour 3 pieds de saint Hubert), et entre la largeur des jours et les meneaux des rapports de ¼ (0,5 pieds pour 2 pieds de saint Hubert). 70. DANDOY, A., 1957, p. 15 : « triomphe de la ligne droite et de la nue beauté de la matière » 71. VAN DE CASTYNE, O., 1934, p. 45, 74 ; DANDOY, A., 1957, p. 15 et IDEM, 1958, p. 11 ; RADERMECKER, L., 1974, p. 12 ; HINQUE, L., 2001, p. 166. 127
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
ainsi une vocation ornementale, que Oda van de Castyne dénomme « système coloriste »72. Cet effet esthétique serait d’autant plus recherché quand des pierres de natures diverses se mêlent aux briques, comme dans la région de Visé, où le tuffeau côtoie le calcaire de Meuse73. Sur les chantiers brabançons du début du XVIe siècle, où ces bandeaux se multiplient en un rythme très serré, l’influence des façades toscanes combinant des assises de marbres de couleurs différentes a même été récemment évoquée74. Ces considérations récurrentes se fondent sur la promotion remarquable de la brique sur les chantiers de la région. Le nouveau matériau doit probablement son succès à son coût moins élevé que la pierre de taille, comme le suggère Hans Vredeman de Vries75, mais aussi à la qualité des appareils ainsi montés à moindres frais. L’exemple de ce propriétaire lillois qui, ayant bâti une maison en pan-de-bois en dépit des recommandations communales en faveur de reconstructions « en dur », se voit contraint de « faire rougir les potteaux et litteaux de sa devanture et les rayer en formes de briques » en dit long sur les qualités esthétiques effectivement associées à ce nouveau matériau76. Dans le paysage urbain namurois du début du XVIIe siècle, la Halle des bouchers et le collège des Jésuites devaient assurément passer pour des constructions de prestige vis-à-vis des nombreuses constructions en pan-de-bois qui dominaient encore le centre de la cité, et ce malgré le caractère encore traditionnel de leur architecture77. Les commentaires élogieux que suscite par ailleurs le Palais Curtius dès le début du XVIIe siècle tiennent probablement aussi, en partie du moins, à l’aspect de ses façades et donc à l’emploi conjugué de briques et de pierres de taille78. Dépourvues d’ordres et des nombreux ornements traditionnellement employés dès la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle dans les régions limitrophes, les façades mosanes seraient conçues selon une esthétique tirant ses effets de rapports de proportions plus ou moins harmonieux et des compositions conjuguant briques et cordons en pierres de taille. Si de nombreux auteurs attirent judicieusement l’attention sur le rôle croissant joué par l’appareil mixte dans l’esthétique des façades, selon une évolution du goût qui se marque dans différentes régions d’Europe à la même époque79, leurs propos peu nuancés trahissent souvent la prédominance de l’approche stylistique sur l’analyse technique de l’architecture, comme ils témoignent parfois du chauvinisme croissant dans l’histoire de l’architecture belge dans le second tiers du XXe siècle. Il n’est pas rare, en effet, que les analyses du patrimoine national ou régional, au-delà de la caractérisation stylistique, parfois technique aussi, des monuments étudiés, vise à définir une architecture civile magnifiée, emblématique du génie des bâtisseurs de nos régions. En conclusion de son étude sur la « Renaissance liégeoise », Dandoy laisse éclater cette lecture profondément régionaliste de l’architecture : « À bien la considérer, on retrouve dans la renaissance mosane l’ordonnance et la sérénité d’un équilibre qui témoignait de la survivance de nos affinités romanes et latines. Émanation de notre terroir, héritière de nos traditions médiévales élargies par la renaissance italienne, qui lui avait inculqué sa discipline classique, elle fut, au sens le plus strict, notre style national »80. La mise en évidence de styles régionaux se fonde de manière récurrente sur la persistance de traits médiévaux dans l’architecture brabançonne ou mosane des XVIe et XVIIe siècle – les deux principaux groupes régionaux 72. VAN DE CASTYNE, O., 1934, p. 197-198. 73. Ibidem, p. 289-290. 74. FRECKMANN, Kl., 2007, p. 194. 75. Hans Vredeman de Vries envisage trois manières de bâtir, depuis la construction la plus coûteuse, entièrement en pierres, jusqu’à le plus économique, entièrement bâtie en briques, en passant par l’appareil mixte, cf. Hans VREDEMAN DE VRIES, Architectura, f° 7, cité et analysé dans NUYTTEN, D., 2005, p. 74. 76. Texte d’archive daté de 1624, cité dans VAN DE CASTYNE, O., 1934, p. 51 et dans HOUBRECHTS, D., 2008, p. 228. 77. Le contraste probable entre les nouveaux bâtiments des Jésuites et le bâti urbain environnant est évoqué dans GENICOT, L. Fr. et COOMANS, Th., 1991, p. 156 ; Frappée des armes de Philippe II lui-même, la halle des bouchers est considérée par plusieurs auteurs comme une construction de prestige, que l’usage de la brique est destiné à rehausser, cf. BODART, E., 2010, p. 101 ; MARCHAL, J.., 1993, p. 467. 78. « La maison de Curtius, quoyque ce ne soit que l’édifice d’un homme privé et particulier, mérite d’estre nombrée entre les belles de l’Europe » écrit Philippe de Hurges 1615, cf. PHILIPPE, J., 1969, p. 7 ; DANDOY, A., 1958, p. 258. 79. Les appareils mixtes promus en France sous Henri IV puis Louis XIII sont parfois évoqués à titre de comparaison, cf. VAN DE CASTYNE, O., 1934, p. 309-310 ; RADERMECKER, L., 1974, p. 16. 80. DANDOY, A., 1957, p. 15. 128
L’ARCHITECTURE AU TEMPS D’ERNEST DE BAVIÈRE (1570-1620)
définis – afin de servir la théorie d’une évolution relativement autonome, influencée certes, par des apports essentiellement français et, dans une moindre mesure, italiens, mais néanmoins capable d’intégrer ces courants étrangers dans un langage architectural régional relativement spécifique81. La mise en valeur de traditions architecturales régionales explique en partie le succès accordé à l’idée d’une influence prépondérante des maisons en pan-de-bois sur les constructions « en dur » de la région mosane. L’influence de la construction en pan-de-bois ? Pour de nombreux auteurs, les appareils mixtes en brique et pierre de taille des XVIe et XVIIe siècles résulteraient d’une imitation, au moins partielle, des structures en pan-de-bois. Également appliquée à l’architecture française de la même époque82, la théorie trouve dans l’étude des constructions de la région mosane un terreau particulièrement fertile83. Les bandeaux limitant les différents niveaux d’élévation correspondraient aux sablières et la combinaison de baies à croisée rectangulaires et de bandeaux prolongeant les appuis et linteaux constituerait une autre allusion explicite aux maisons en pan-de-bois qui dominaient alors le paysage urbain des villes mosanes. Quant aux briques disposées entre ces bandeaux, elles correspondraient aux hourdis remplissant la structure en bois. Cette théorie trouve en Radermecker l’un de ses plus fervents partisans. Au terme d’une démonstration sinueuse, cet auteur proclame ainsi : « Les architectes de la principauté appartiennent à la corporation des charpentiers ; l’emploi du bois leur est familier et ils utilisent pour la pierre le même système que pour le bois » puis, un peu plus loin, « Nous conclurons de toutes ces considérations que le style mosan a été créé par les architectes-menuisiers des habitations en charpentes, qui se sont convertis en architectes-constructeurs en brique et pierre pour rendre les habitations incombustibles. L’art mosan est né du terroir. Aucun génial architecte ne l’a inventé » 84. L’appareil mixte des grandes constructions mosanes s’expliquerait dès lors par une pétrification des façades en bois et torchis, dans une composition structurelle profondément influencée par le pan-de-bois, en réponse aux risques d’incendie qui menacent les cités dominées par les bâtiments construits, au moins partiellement, en bois. Si, sur le plan de la composition des façades, l’influence de la construction en pan-de-bois sur la construction « en dur » du début du XVIIe siècle n’est certainement pas à exclure, elle apparaît cependant largement surévaluée. Tout d’abord, parce que les façades en appareil mixte sont dépourvues d’éléments verticaux en pierre de taille – si l’on excepte bien sûr les croisées et les piédroits des baies – alors que les poteaux et potelets des édifices en pan-de-bois constituent des éléments structurels essentiels qui n’auraient aucune raison de disparaître dans une transposition de cette manière de construire dans l’appareil mixte. Ensuite parce que les premières réglementations communales destinées à lutter contre les incendies et, par conséquent, à promouvoir les constructions « en dur », semblent peu fréquentes avant le milieu du XVIIe siècle85. La filiation du pan-de-bois vers l’appareil mixte semble en revanche autrement plus convaincante pour les façades érigées dès la fin du XVIIe siècle, où les piédroits, désormais composés de blocs monolithiques en délit, sont prolongés dans les murs sous-appui par d’autres blocs posés verticalement86. La structure assurée autrefois par des poutres en bois semble bel et bien transposée ici dans une architecture en briques et pierres de taille. Auparavant, dans l’architecture traditionnelle de type mosan qui fleurit à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, les éléments en pierre de taille qui
81. VAN DE CASTYNE, O. 1934, p. 307-310 – RADERMECKER, L., 1974, p. 16, 18, 21. 82. HAUTECOEUR, L., Histoire de l’architecture classique en France, t. I/2 : La formation de l’idéal classique. L’architecture sous Henri IV et Louis XIII, Paris, 1943, p. 631. 83. VAN DE CASTYNE, O., 1934, p. 42, 72, 284-285 ; BONIVER, F., 1938, p. 63 ; RADERMECKER, L., 1974, p. 12, 13, 17, 19, 20. 84. RADERMECKER, 1974, p. 19. 85. A Liège, par exemple, le premier règlement connu n’est promulgué qu’en 1657 et encore n’a-t-il pas l’effet escompté puisqu’il doit être réaffirmé en 1666 et en 1691, cf. HOUBRECHTS, D., 2008, p. 229. 86. Les liens entre ce type de structure et le pan-de-bois sont soulignés de manière très précoce dans GHEQUIERE, L., 1922, p. 154-155, puis à nouveau dans PUTERS, 1950, p. 18. 129
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
rythment les élévations se justifient difficilement par l’ambition d’imiter le pan de bois ; l’analyse technique de cette architecture permet de démontrer qu’ils assument en fait des fonctions spécifiques aux appareils mixtes et qu’ils s’inscrivent dans une autre filiation. Origines et significations techniques des appareils mixtes Depuis l’Antiquité, les appareils mixtes se composent le plus souvent de maçonneries irrégulières, faites de moellons plus ou moins bien équarris et d’assises de réglage87. Ces dernières sont en briques dans l’architecture antique et du haut Moyen âge, puis en pierres de taille dans les derniers siècles du Moyen âge. Le transept de la collégiale Saint-Germain de Tirlemont, par exemple, est élevé au XIVe siècle selon ce principe, avec des assises en pierres de Gobertange disposées à intervalle régulier sur toute la hauteur de l’élévation, entre des bandes maçonnées de moellons en grès local88. Ces cordons en pierres permettent du reste de raidir la maçonnerie, surtout si les blocs qui les composent sont posés en parpaing. Ce rôle structurel explique assurément le succès du procédé dans la construction mixte en pierres et briques des siècles suivants, davantage qu’une éventuelle fonction d’assise de réglage. Si ce dernier principe n’est probablement pas ignoré par les maîtres d’œuvres des XVIe et XVIIe siècles, il ne semble cependant pas conditionner la qualité des maçonneries. La régularité des dimensions des briques suffit en effet pour garantir l’horizontalité des lignes de joint. Dans le milieu de production mosan des XVIe et XVIIe siècles, il n’est d’ailleurs pas rare de voir des constructions privées de ces cordons et où la pierre de taille se limite dès lors aux soubassements, aux organes des baies et aux chaînes d’angle. L’économie représentée pas l’absence de ces éléments devait être d’autant plus conséquente quand le chantier était éloigné de la vallée de la Meuse ou de l’un de ses affluents navigables89. Les avantages structurels offerts par les cordons en pierres de taille sont décrits dès la fin du XVe siècle par Alberti dans son célèbre De re Aedificatoria. Le chapitre 8 du livre III envisage ainsi deux fonctions essentielles pour ces éléments. Lorsque le mur comporte une maçonnerie de remplissage entre les deux parements, des « rangées de pierre » doivent être insérées tous les cinq pieds, « afin que la maçonnerie soit étroitement serrée et ceinturée comme par des tendons et des ligaments »90. Outre ce type de « rangées », que l’auteur dénomme également « chaînes », il en existe d’autres « que l’on fait courir sur toute la longueur du mur pour soumettre les angles à leur prise et maintenir en place la construction ». Puis Alberti ajoute que ces « chaînes » sont plus rares et se limitent généralement au nombre de deux ou trois par murs91. En revanche, les grands traités du XVIe siècle écrits par Serlio, Palladio ou Philibert de l’Orme, peu loquaces sur les techniques de construction modernes du mur, ne soufflent mot des principes techniques qui régissent les appareils mixtes. Seul Hans Vredeman de Vries réserve quelques commentaires aux manières de combiner briques et pierres. Les consignes, très pragmatiques, ne s’attardent pas sur les raisons techniques de l’emploi de pierres de taille dans telle ou telle partie de l’édifice, mais affectent néanmoins pierres bleues et pierres blanches – deux types de matériaux qui se distinguent notamment l’un de l’autre par leur dureté – à des parties spécifiques du bâti92. Les livres d’architecture des XVIIe et XVIIIe n’abordent pas davantage le comportement structurel des maçonneries en appareil mixte. Carront, par exemple, qui publie un « Art de
87. ADAM, J.-P., La construction romaine. Matériaux et techniques, 4e éd., Paris, 2005, p. 151-156 (Grands manuels Picard) ; FRECKMANN, Kl., 2007, p. 201-202. 88. DOPERE, Fr., De evolutie van de middeleeuwse bouwwerf van de Sint-Germanuskerk te Tienen (Brab.), dans Archaeologia Mediaevalis, t. 16.1, 1993, p. 52-53. 89. L’absence de cordons est ainsi fréquente dans les campagnes, non seulement dans l’architecture rurale, mais également sur les façades de plusieurs châteaux. Il en est ainsi au château d’Oupeye, de même qu’au château de Bonne-Espérance, ou encore à la cense de Solières. 90. Leon Battista ALBERTI, L’art d’édifier, trad. du latin, présenté et annoté par P. CAYE et Fr. CHOAY, Paris, 2004, p. 157 (Sources du savoir). 91. Ibidem, p. 158. L’auteur sous-entend probablement ici que ces « chaînes » sont disposées entre les différents registres de l’élévation. 92. Voir l’analyse de ces informations dans NUYTTEN, D., 2005, p. 74-76. 130
L’ARCHITECTURE AU TEMPS D’ERNEST DE BAVIÈRE (1570-1620)
bâtir » à Liège vers le milieu du XVIIIe siècle et qui connaît nécessairement bien les façades mosanes en pierres et briques ne fait aucune allusion à ce type de maçonneries93. Il reste que les maçons et maîtres d’œuvre font un usage abondant de l’appareil mixte en région mosane, mais également dans le Duché de Brabant, où ce procédé connaît un grand succès dès la fin du XVe siècle. Dans cette vaste région des anciens Pays-Bas, la tradition constructive la plus ancienne, mise à l’honneur notamment sur les chantiers de Rombouts II Keldermans, qui consiste à multiplier les cordons horizontaux de part et d’autre de minces bandes murales en briques, va perdurer pendant tout le XVIe siècle94. Si ce rythme soutenu de cordons de pierres blanches sur fond de briques a de probables vertus esthétiques, destinées à rehausser la valeur des bâtiments sur lesquels il est appliqué, la formule est néanmoins régulièrement employée du XVIe au XIXe siècle dans d’autres régions, comme le Limbourg hollandais, pour bâtir des constructions rurales où les motivations esthétiques apparaissent secondaires95. Le système possède donc d’évidentes vertus techniques également, qui justifient sa pérennité : composés probablement de blocs posés en parpaing, ces cordons servent à raidir les murs et à leur conférer ainsi une résistance proche de celle des maçonneries en pierres de taille, mais à moindres frais. En Brabant, la maçonnerie mixte est également conçue dans le courant du XVIe siècle selon une formule où la pierre de taille est employée avec une plus grande parcimonie : les cordons marquent désormais la séparation entre les différents étages du bâtiment et sont placés dans le prolongement des éléments horizontaux des baies. C’est sous cette forme que l’appareil mixte va se diffuser en région mosane dès la fin du XVIe siècle. Un récent mémoire de fin d’études en Sciences appliquées a soumis les appareils mixtes de type mosan à une analyse structurelle approfondie. Les résultats montrent que les cordons sont placés aux endroits qui subissent les contraintes les plus importantes. Ils permettent de soulager à la fois les linteaux et appuis des baies, mais aussi la maçonnerie du mur elle-même en des points où elle est soumise à des efforts de traction plus importants. Les simulations effectuées démontrent en outre que l’efficacité de ce système est encore renforcée si les pierres de taille sont disposées dans toute l’épaisseur du mur96. L’évolution de l’appareil mixte au XVIe siècle illustre donc une connaissance empirique assez élaborée du fonctionnement structurel des maçonneries en appareil mixte et permet par ailleurs de substantielles économies de moyens en réservant la brique aux zones les moins sollicitées par les déformations potentielles du mur. Organisation du chantier et contexte économique L’étude de l’organisation du travail sur les grands chantiers civils de la région mosane, depuis la conception du projet jusqu’aux modalités de la construction, souffre du manque de textes connus. À ce stade, les archives liégeoises restent muettes sur les personnalités impliquées dans la construction du Palais Curtius ; les chantiers hutois ne sont pas davantage documentés et on ignore également tout des architectes, maîtres d’œuvre et artisans impliqués sur les chantiers de la Maison Espagnole de Bouvignes ou de l’hôtel de ville de Visé. Les quelques textes livrant des informations sur les intervenants impliqués et sur l’organisation du chantier concernent les édifices construits à Namur ou dans sa région proche97. Les actes relatifs au chantier de la halle des bouchers et de l’hôtel de ville, à celui de la colonnade du château de Fernelmont ou encore
93. CARRONT, F., L’Art de bien bâtir dédié à messieurs les bourgemaîtres et conseil de la Noble Cité de Liège, Liège, 1749. 94. La formule est appliquée aux résidences aristocratiques dans les campagnes (château de Horst) comme dans les villes (Bergen op Zoom, Markiezenhof) de même qu’aux constructions civiles publiques (Anvers, halle des bouchers, 1501-1504 ; Léau, ancienne halle), cf. DE JONGE, K., GELEYNS, P. et HÖRSCH, M., Gotiek in het hertogdom Brabant, Leuven, 2009, p. 92-96, 133-134. 95. FRECKMANN, Kl., 2007, p. 197-198, 200-201, cite plusieurs exemples de constructions rurales en briques et tuffeau, ainsi que des exemples d’architecture rurale en Champagne, où la brique alterne avec des assises de craie locale. 96. COLIGNON, C., 2003, p. 63-66. 97. Des contrats relatifs à la construction de la halle des bouchers et du Mont-de-Piété sont édités dans VAN DE CASTEELE, D., Archives d'anciens monuments namurois, dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 16, 1883, p. 153-170 ; sur les chantiers de l’hôtel de ville et de la halle des bouchers, cf. aussi COURTOY, F., 1912, p. 508-510. Les comptes liés à l’édification de la halle namuroise sont par ailleurs étudiés dans BODART, E., 2010, p. 100-102. Enfin, Courtoy édite un acte relatif au chantier de la colonnade du château de Fernelmont, cf. COURTOY, F.0 La galerie du château de Fernelmont, dans Namurcum, t. 13, 1936, p. 37. 131
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
au deux chantiers un peu plus tardifs du Mont-de-Piété (1627) et du Palais du Gouverneur (1631) donnent ainsi une idée du profil professionnel requis pour mener l’édification de grandes constructions civiles de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Dans cette documentation, les architectes dignes de ce nom brillent par leur absence. Le seul monument qui échappe à ce silence des textes est le Mont-de-Piété, élevé dans les années 1620 par le célèbre Cobergher, alors « Superintendant général des Monts de Piété »98. L’étude du collège des Jésuites a par ailleurs permis d’attribuer le projet de ce complexe architectural au frère Jean du Blocq, architecte attitré de la Compagnie depuis 160999. Pour les autres monuments, il est seulement question de maîtres-maçons, voire de maîtres tailleurs de pierres. Conrad II De Nuremberg, maître-maçon du Comte de Namur, est cité comme le maître d’œuvre de la halle des bouchers et de l’ancien hôtel de ville100. Il appartient à une famille de marchands de pierres active dans la région mosane dès la fin du XVe siècle et dont les différents membres combinent le plus souvent le commerce des calcaires mosans avec une activité constructive101. Johan Lambillon, qui collabore à l’édification de la halle namuroise, appartient à une autre famille impliquée dans le commerce des pierres comme dans la construction102. Quelques décennies plus tard, le maître-maçon du Palais des Gouverneurs, Roussel, présente le même profil, celui d’un entrepreneur polyvalent, impliqué dans la fourniture des matériaux comme dans leur mise en œuvre103. Le rôle précis de ces maîtres-maçons dans la conception des projets dont ils supervisent la réalisation reste difficile à évaluer. L’organisation du travail se complexifie en effet dans les Pays-Bas à cette époque, avec une répartition des tâches plus précise entre les architectes – concepteurs et les maître-maçon ou entrepreneurs exécutants104. En région mosane, l’influence potentielle d’un architecte pèse cependant peu sur les principes adoptés pour l’élévation. Au collège des Jésuites comme au Mont-de-Piété, par exemple, les formules adoptées ne diffèrent guère de celles privilégiées sur les autres chantiers de la région. On y retrouve le traditionnel appareil mixte, sobre et fonctionnel, avec les cordons en pierres non moulurés et alignés sur les éléments horizontaux des baies à croisées. Tout au plus la personnalité de l’architecte s’exprime-t-elle probablement dans le choix d’élégants piliers pour soutenir les arcades du portique (collège des Jésuites) ou dans le dessin de l’un ou l’autre portail (Mont-de-Piété). Les ornements plus personnalisés paraissent simplement juxtaposés aux formes architecturales traditionnelles. Pour expliquer le poids de la tradition, Courtoy invoque la participation d’artisans locaux qui auraient imposé leur manière de faire au projet105. Il est évident que les artisans ne peuvent imposer des formes et modèles à l’architecte en charge du chantier. Les textes sont très clairs sur ce point. Pour le Mont-de-Piété, les maîtres tailleurs de pierre Toussaint Tecquemenne et Servais Ghislain doivent tailler les blocs des fenêtres et autres éléments en pierres de l’édifice selon les modèles fournis106. Pour la colonnade du château de Fernelmont, les deux maîtres-tailleurs de pierre de Live, Jean de Lathour et Jean Ghys, s’engagent à mettre en forme les pierres selon un modèle conçu par un « maistre architect » dont le nom n’est pas dévoilé107. Le succès du style dit traditionnel sur l’ensemble des chantiers civils mosans tiendrait plutôt selon nous à l’organisation du commerce de la pierre. Dès la dernière décennie du XVIe siècle, les blocs fournis sur les chantiers mosans apparaissent peu diversifiés, avec une nette prédominance de blocs parallélépipédiques du
98. VAN DE CASTEELE, D., 1883, p. 155-166. 99. GENICOT, L. Fr. et COOMANS, Th., 1991, p. 140. 100. COURTOY, F., Les De Nurenberg, architectes des XVIe et XVIIe siècles, dans Wallonia, t. 20, 1912, p. 508-510 ; VAN TUSSENBROEK, G., 2007, p. 115. 101. Ibidem. 102. VAN TUSSENBROEK, G., 2006, p. 67. 103. COURTOY, F., 1936, p. 22-23. 104. VAN TUSSENBROEK, G., 2006, p. 97-99. 105. COURTOY, F., 1936, p. 19. 106. AEN, Fonds des notaires, notaire Delevaulx, 1620-1629, n° 682, acte du 16 avril 1627, éd. VAN DE CASTEELE, D., 1883, p. 155-156. 107. COURTOY, F., La galerie…, p. 37. 132
L’ARCHITECTURE AU TEMPS D’ERNEST DE BAVIÈRE (1570-1620)
même type, qui composent à la fois les cordons horizontaux et les linteaux, appuis et croisées des baies. L’une des caractéristiques majeures de la production étudiée, c’est finalement la standardisation de ses éléments constitutifs. La multiplication d’éléments identiques, sobres et fonctionnels, amène naturellement à s’interroger sur l’organisation éventuelle de « productions en série », d’une rentabilisation du commerce par la simplification du travail d’extraction et de mise en forme des blocs. Quant on sait que la plupart des maîtres maçons de l’époque sont membres de riches familles de marchands de pierre, il n’est pas interdit d’imaginer que des stratégies de valorisation des ressources lithiques de la vallée mosane, privilégiant une architecture « modulaire » adaptée aux riches demeures comme aux constructions plus modestes, aient activement contribué au succès de cette manière de bâtir en « style traditionnel ». La question mérite assurément d’être creusée, en croisant le dépouillement des archives conservées, l’histoire économique et une archéologie du bâti accordant un intérêt accru à l’analyse métrique et, dans la mesure du possible, au travail d’extraction. Le développement de « l’industrie » de la brique dans la région mosane devrait être intégré aux nouvelles recherches sur le marché des matériaux de construction à la charnière des XVIe et XVIIe siècles. Les modalités de production et d’utilisation de la brique sur les chantiers de la région mosane restent en effet peu étudiées, tant d’un point de vue technique que sous l’angle économique108. Il est néanmoins très probable que le développement de ce matériau – assez tardif en région mosane en regard des régions limitrophes – réponde au besoin de matériaux moins onéreux que la pierre de taille tout en permettant une régularité et une qualité de maçonnerie supérieure au moellonnage et de conférer à moindres frais un certain prestige à cette architecture « en dur » par rapport au bâti contemporain en pan-de-bois. Conclusions L’architecture civile qui se développe en région mosane à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle consacre le succès de formules traditionnelles, employées dès la fin du Moyen âge, et qui composent les grandes lignes des élévations. L’ornement sculpté occupe une place modeste dans cette architecture d’une grande sobriété. Les modèles qui circulent dans les traités maniéristes, et notamment dans ceux de Hans Vredeman de Vries, inspirent parfois un pignon ou un portail, sans pour autant affecter la composition générale des façades. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer l’émergence de cette manière de bâtir. Les formes privilégiées tiendraient tout d’abord au matériau, peu propice à l’ornementation sculptée, mais relèveraient également d’une esthétique classique privilégiant les lignes de composition des façades, que l’alternance de la brique et de la pierre de taille, rythmée par de savants rapports de proportions, tendrait à souligner. De cette lecture élogieuse, mâtinée parfois de forts accents régionalistes, découle l’expression de « Renaissance mosane », mainte fois répétée pendant les deux premiers tiers du XXe siècle. Pour expliquer la physionomie des façades de la région mosane de la fin du XVIe et du XVIIe siècle, l’influence du pan-debois sur l’appareil mixte en briques et pierres de taille est également invoquée, en écho à une théorie appliquée aux constructions françaises de la même époque. Cette filiation présumée semble d’autant mieux accueillie dans l’histoire de l’architecture en Belgique qu’elle permet de défendre l’idée d’une évolution autonome du bâti mosan, d’un art de construire « en dur » profondément marqué par les pans-de-bois qui dominent probablement encore le paysage urbain mosan pendant la majeure partie du XVIIe siècle. Si les façades en « style traditionnel mosan » présentent effectivement certaines ressemblances avec celles construites en bois et torchis, elles constituent également l’aboutissement de recherches spécifiques aux constructions en maçonnerie, déjà menées dans la Basse Antiquité et au Moyen Âge pour concevoir des appareils mixtes combinant des cordons soigneusement assisés, en briques ou pierres de taille, avec des matériaux plus frustes. Les expériences brabançonnes menées dès le XVe siècle permettent ensuite de promouvoir l’appareil mixte en brique et pierre de taille dans les anciens Pays-Bas du sud, et contribuent probablement à définir les grands principes des formules adoptées par les bâtisseurs mosans dès la fin du XVIe 108. Voir l’état de la question de l’usage de la brique sur les chantiers namurois, sur base des textes d’archives, dans BODART, E., 2010, p. 103 ; les analyses les plus approfondies sur la construction en briques s’appliquent au patrimoine rural de la région : GENICOT, L. Fr. (dir.), 1987, p. 96, 102-103 ; IDEM, 1986, p. 87, 95, 100. 133
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
siècle. S’il témoigne probablement d’une évolution des goûts, le succès de ces formules en région mosane pendant près d’un siècle résulte aussi de contraintes techniques et structurelles que les bâtisseurs semblent parfaitement maîtriser. La fortune de ce style, enfin, s’explique peut-être aussi par des modalités de conception et de réalisation des ouvrages et, de manière concomitante, par l’organisation du réseau économique des matériaux de construction.
134
ENTRE LAMBERT LOMBARD ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE LES PEINTRES À LIÈGE AUTOUR DU RÈGNE D’ERNEST DE BAVIÈRE (1570-1620) Pierre-Yves Kairis
Introduction Sur les mille pages qu’il a dévolues à l’ensemble de la vie liégeoise sous le règne d’Ernest de Bavière1, Eugène Polain n’en consacre qu’une à la peinture2. Et de citer à peine trois noms : Jean Ramey, son élève (présumé) Otto Vaenius et Pierre Furnius. Puis il conclut : « Il n’y a pas de doute qu’il ait existé encore, à cette époque, d’autres peintres : on connaît les noms de certains d’entre eux, comme il existe des œuvres de mérite dont les auteurs ne sont pas connus, mais comment pouvoir attribuer l’une ou l’autre de celles-ci à tel ou tel nom ? » Polain résume de la sorte parfaitement la problématique qui se pose à nous. Dans l’histoire de la peinture au pays de Liège, l’époque d’Ernest de Bavière s’inscrit dans un de ces multiples temps creux qui jalonnent périodiquement l’histoire de l’art. Elle se situe entre le temps de Lambert Lombard (1505/1506-1566) et le puissant renouveau de la peinture liégeoise des années 1620. C’est la période de ce que René Jans appelait « la génération perdue », tant l’activité picturale de cette époque a sombré dans l’oubli3. Une académie chez Lambert Lombard ? En dépit de l’image de rénovateur qu’il a laissée dans l’histoire de l’art comme pionnier du romanisme, Lambert Lombard demeure quant à sa production picturale un phénomène mystérieux. À ce jour, il n’est pas un seul tableau qu’on puisse lui attribuer en toute certitude. C’est sur la foi de faisceaux de présomptions plus ou moins fondés qu’ont été tentées diverses restitutions. L’ensemble des toiles du cycle des Femmes héroïques de l’Antiquité offre nombre d’accointances formelles avec les nombreux dessins connus du peintre. Ces huit tableaux, aujourd’hui répartis entre l’église Saint-Amand de Stokrooie (Hasselt) et le Musée dit Grand Curtius à Liège (fig. 1), constituent aujourd’hui les attributions les plus fondées au maître4. Ils ornaient à l’origine l’église de la riche abbaye cistercienne de Herkenrode. Ils illustrent bien les ambitions humanistes de leur auteur, qui se hisse au rang de pictor doctus et associe Antiquité chrétienne et Antiquité païenne. Si l’image de Lombard en tant que peintre reste un peu confuse aujourd’hui, que dire de ses successeurs ? On peut affirmer sans risque que le brouillard s’épaissit… Ils durent pourtant être nombreux ceux qui suivirent l’enseignement du maître. Il est en effet communément admis que Lombard a créé une « académie » en sa ville natale5. C’est Louis Abry (1643-1720) qui a le premier utilisé le terme pour qualifier la petite école ouverte à Liège par Lombard à son retour d’Italie6. Il a déduit le terme de la Vita rédigée par Lampson 1. Eugène Polain, La vie à Liège sous Ernest de Bavière (1581-1612), dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 54, 1930, p. 27-91 ; t. 55, 1931, p. 104-183 ; t. 57, 1933, p. 135-236 ; t. 60, 1936, p. 5-135 ; t. 61, 1937, p. 5-251 ; t. 62, 1938, p. 5-359. 2. Ibidem, t. 57, 1933, p. 222-223. 3. René Jans, Les peintres liégeois Bertin Hoyoul, Michel Ponceau et Jean de Fraipont, dans Bulletin de la Société royale Le VieuxLiège, t. 11, n° 234, 1986, p. 191. 4. Pour l’état de la question, voir les multiples contributions sur ces tableaux dans Godelieve Denhaene (dir.), Catalogue de l’exposition Lambert Lombard peintre de la Renaissance. Liège, 1505/06-1566 (Liège), Bruxelles, 2006. 5. Je reprends ici les conclusions publiées dans mon article Les peintres liégeois dans le sillage de Lambert Lombard du volume cité à la note précédente, p. 310-312. 6. Louis Abry, Les hommes illustres de la nation liégeoise, éd. Henri Helbig et Stanislas Bormans, Liège, 1867, p. p. 161 : « (…) il en tenoit même chez lui plusieurs [graveurs], qu’il enseignoit avec d’autres disciples pour le dessin, et qui composoient une espèce d’académie ».
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 1 : Lambert Lombard et atelier, Coriolan recevant sa femme et sa mère, toile, Liège, Grand Curtius. © IRPA-KIK, Bruxelles.
– le premier écrit d’histoire de l’art dans les Pays-Bas7. Abry a bien compris le caractère innovant de l’enseignement du maître. Godelieve Denhaene a montré tout ce que cette « académie », pour modeste qu’elle ait été, devait à celle que le sculpteur Baccio Bandinelli avait tenue à Rome8. À partir du XVe siècle, nombre d’artistes italiens tentèrent d’échapper au joug des corporations, refusant que la peinture et la sculpture demeurassent ravalées au rang d’arts mécaniques. Une nouvelle position de l’artiste dans la société devait prendre corps peu à peu. Dans ce contexte devait se forger un nouveau mode de formation. Le premier centre d’enseignement artistique à porter le nom d’« académie » est attesté par une estampe de 1531 gravée par Agostino Veneziano et montrant l’atelier que Bandinelli tenait au Vatican9. Jusqu’alors, comme le note Pevsner, les académies étaient des lieux de réunion informels où des érudits italiens débattaient de philosophie. Soucieux de hisser les Beaux-Arts au rang des lettres selon un paragone fréquemment évoqué à la Renaissance, l’orgueilleux Bandinelli dénomma immodestement « académie » l’atelier dans lequel il recevait en soirée des confrères et disciples pour dessiner ou copier en société autant que pour débattre des préceptes et de la pratique de leur art. 7. Jean Hubaux et Jean Puraye, Dominique Lampson Lamberti Lombardi... Vita. Traduction et notes, dans Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, t. 18, 1949, p. 75. 8. Godelieve Denhaene, L’album d’Arenberg. Le langage artistique et les intérêts humanistes de Lambert Lombard, thèse de doctorat en histoire de l’art, t. 1, Université libre de Bruxelles, 1983, p. 225-227.- Idem, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme à Liège, Anvers, 1990, p. 217-219. 9. Nikolaus Pevsner, Academies of Art. Past and Present, Cambridge, 1940 ; éd. française, Paris, 1999, p. 57-58. 136
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
À l’évidence, Lombard eut connaissance de ce mode de formation novateur lors de son séjour à Rome en 1537-1538. De sa biographie publiée par Lampson, il ressort d’ailleurs que Baccio Bandinelli était considéré par Lombard comme un des grands artistes italiens contemporains. Bandinelli était passionné de lettres et il reconnaissait la supériorité de la plume sur le ciseau ou le pinceau. C’est donc aux fins de hausser la sculpture au rang des arts libéraux qu’il désigna son atelier sous le vocable d’« académie ». Une telle attitude ne pouvait que fasciner le Liégeois, porteur du même intérêt pour les belles-lettres. Lombard a donc tenté de transposer l’expérience de l’atelier du Vatican dans sa ville natale. L’« académie » de Liège, même si elle ne porta jamais ce titre, dut bénéficier d’une aura certaine10. C’est ainsi qu’elle reçut bientôt quelques-uns des futurs grands maîtres de la peinture des Pays-Bas, tels Hubert Goltzius, Frans Floris et Willem Key. Ce n’était pas pour un apprentissage traditionnel du métier de peintre que ceux-ci se sont rendus auprès de Lombard, mais pour bénéficier des connaissances que celui-ci avait acquises de l’art antique et de la Renaissance italienne11. Lombard cherchait à rompre avec les pratiques d’atelier traditionnelles et leurs visées trop commerciales à son gré. Les centaines de dessins de son fonds d’atelier attestent la vaste culture visuelle du maître et son érudition autant que le souci qu’il avait de partager celles-ci avec ses disciples. Lampson confirme les préoccupations pédagogiques du maître, rappelant par exemple que celui-ci a même pris à sa charge une partie des frais de séjour à Rome de deux de ses élèves particulièrement prometteurs12. Cette école/académie demeure difficile à appréhender dans tous ses contours. Si Lampson évoque de manière sibylline le grand nombre d’élèves accueillis en son sein, il ne cite aucun peintre local : seuls apparaissent les noms de Frans Floris, Willem Key et Hubert Goltzius13. La renommée et l’originalité de sa jeune école se sont donc rapidement répandues au-delà même des confins de la principauté de Liège. G. Denhaene m’a signalé avoir repéré une trentaine de mains d’élèves fidèles parmi trois cents dessins anonymes de l’album d’Arenberg, recueil de dessins ayant fait partie du matériel didactique de Lombard. Les disciples de Lombard On le voit, la prolifique « académie » de Liège demeure en fait bien mystérieuse14. Nous sommes du reste face à un curieux schéma. Les disciples étrangers de Lombard dont les noms sont connus semblent avoir fréquenté l’académie dans ses premières années : vers 1539-1541 pour Floris et Key et vers 1544-1546 pour Goltzius. En revanche, les seuls disciples liégeois dûment attestés par Abry (Furnius, Ramey et Lampson) auxquels il faut ajouter le nom du Namurois Jean de Robionoy, n’ont pu la fréquenter qu’à la fin de la carrière du maître, dans les années 1560. Il faut attendre les écrits tardifs de Louis Abry pour voir surgir dans l’historiographie de nouveaux noms de peintres qui auraient suivi la leçon du maître. Cet important biographe des anciens artistes liégeois, peintre lui-même, cite Pierre de Four ou Dufour, Jean de Ramey et Dominique Lampson, ainsi que huit obscurs petits maîtres de Liège dont l’œuvre n’est pas connu : Pierre Pesser, Jean Lambert, Henri Esseneux, Laurent Pietkin le Vieux, Léonard Ornis, Jacques de Libermé, les frères François et Gilles Hardy15. Que vaut cette liste ? Sa crédibilité laisse à désirer. À la suite de René Jans, on notera que Pierre Pesser, par exemple, avait vingt ans de plus que Lombard16 ; il est peu imaginable d’y voir un élève de ce dernier. 10. Pour qualifier l’atelier de Lombard, Lampson utilise le terme de schola, mettant par là en évidence un enseignement d’ordre intellectuel, comme l’a bien relevé Carl Van de Velde, Quelques considérations sur Frans Floris et Willem Key, les élèves anversois de Lambert Lombard, dans Jean-Patrick Duchesne, Dominique Allart et Pierre-Yves Kairis (éd.), Mélanges Pierre Colman, dans Art&fact. Revue des historiens d'art, des archéologues, des musicologues et des orientalistes de l'Université de Liège, t. 15, 1996, p. 102 et 103. 11. Ibidem, p. 102. 12. Hubaux et Puraye, op. cit., p. 77. 13. Ibidem, p. 75. 14. Pour une première tentative de démêler l’écheveau, voir Martine Marchal, L’Académie de Lambert Lombard, mémoire de licence en histoire de l’art, Université de Liège, 1976. 15. Abry, op. cit., p. 168-169, 172, 176-177. 16. René Jans, Une dynastie de peintres liégeois méconnus : les Pesser et Pasque Balen, dans Bulletin de la Société royale Le VieuxLiège, t. 9, n° 200, 1978, p. 232. 137
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Henri Desneux, gendre (et sans doute élève) du peintre Gilles Hardy, fit relief (soit l’enregistrement des fils ou gendres de maîtres dans la corporation) du métier des orfèvres de Liège en 1578 ou 1579 seulement, soit douze ou treize ans après le décès de Lombard17. Cette inscription au sein de la corporation dont dépendaient les peintres paraît bien tardive pour un élève du maître dont on sait par ailleurs qu’il fut un peintre actif. À l’évidence, Abry a inconsidérément enregistré au nombre des élèves de Lombard des peintres contemporains dont il ne connaissait guère que le nom. Au milieu du siècle dernier, Jean Yernaux a inconsidérément ajouté une kyrielle de noms18. À ses dires, tout peintre actif à Liège dans les deux derniers tiers du XVIe siècle aurait fréquenté « l’académie » ; en cela, il suit la logique peu convaincante d’Abry. Malheureusement, cette théorie a été souvent répétée depuis lors. Elle ne repose sur aucun fondement sérieux, même s’il est problable que quelques-uns des peintres cités par Yernaux aient effectivement fréquenté la maison de Lombard. Toutefois, il serait inopportun d’enfermer toute la peinture liégeoise de ce temps dans la seule perspective de cette « académie ». Car le paradoxe du brouillard qui entoure la peinture en nos régions à cette époque, c’est que les peintres furent relativement nombreux à Liège. Particulièrement entre 1570 et 1620, le répertoire qui suit en témoigne. Les archives regorgent de noms, sans qu’il soit malheureusement possible d’évaluer la qualité de la production de la grande majorité d’entre eux. Du reste, les documents relevés sont le plus souvent sans rapport avec leur activité artisanale ou artistique. Mais ce répertoire, pour provisoire qu’il soit, témoigne à tout le moins de la vitalité de l’activité picturale à la charnière des XVIe et XVIIe siècles. Il propose en même temps un compendium des rares œuvres connues des peintres listés. De Lombard aux maîtres anversois : changement de paradigme pour les peintres liégeois
Fig. 2 : Suiveur de Lambert Lombard, Ecce Homo, panneau, Liège, Grand Curtius. © IRPA-KIK, Bruxelles.
17. Jacques Breuer, Les orfèvres du pays de Liège. Une liste des membres du métier, dans Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois, t. 13, 1935, p. 84. 18. Jean Yernaux, Lambert Lombard, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 72, 1957-1958, p. 295-318. 138
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Ce qui ressort avant tout de celles-ci, c’est l’empreinte formelle somme toute assez ténue de Lombard. Même parmi les tableaux anonymes repérés, très peu dénoncent l’influence stylistique de Lambert Lombard. Un panneau peu connu, à double face, conservé dans les réserves du Grand Curtius à Liège (53 x 85 cm) en offre une rare illustration, même si elle se révèle assez médiocre sur le plan formel (fig. 2 et 3). Il montre d’un côté un Ecce Homo à la mise en page originale avec des jeux de lignes dans le pavement qui montrent des recherches de perspective héritées de Lombard. On y retrouve aussi les lourdes draperies dérivées du maître. Le revers, de meilleur aloi, présente une curieuse scène d’allégorie religieuse avec une double effigie du Christ Roi dans un décor architectural imposant qui à son tour rappelle les recherches lombardiennes. Cette double représentation du Christ avec une couronne et un sceptre offre sans doute un écho à la scène de l’autre face, avec le Christ de douleur qui a reçu peu auparavant la couronne d’épines et le sceptre.
Fig. 3 : Suiveur de Lambert Lombard, Allégorie christique, revers du panneau précédent. © IRPA-KIK, Bruxelles.
Ce tableau est exceptionnel dans le panorama des peintures du sillage de Lombard. Les rares tableaux identifiés d’élèves présumés de Lambert Lombard, tels que Furnius et Ramey, n’offrent qu’un écho stylistique relativement lointain à son art, qui semble être passé rapidement de mode. C’est plutôt dans la gravure que l’esprit humaniste du maître semble avoir été prolongé. Les tableaux liégeois du dernier tiers du XVIe siècle nous ramènent bien davantage à la peinture anversoise contemporaine des Frans Floris, Maarten de Vos, Frans Pourbus et autres Michel Coxcie. Les disciples de Lombard n’ont pas hésité à s’affranchir de la manière du maître pour se tourner vers le grand centre artistique qu’était Anvers et qui commençait à rayonner de tous ses feux dans toute l’Europe septentrionale. Deux des pièces liégeoises majeures de cette époque en témoignent particulièrement. Elles sont d’autant plus intéressantes qu’elles semblent pouvoir être attribuées à Pierre Furnius, sans doute un des derniers élèves de Lombard ; elles sont évoquées sous son nom dans le répertoire qui suit. La Déploration du Christ mort (fig. 4) de l’église paroissiale de Horion-Hozémont et l’Assomption de la Vierge (fig. 5) tout juste restaurée de l’église Saint-Nicolas à Liège confirment que le sillage de Lambert Lombard, dans lequel on a rangé toute la production picturale liégeoise de ce temps, doit se comprendre davantage comme le sillage de Frans Floris (1519/20-1570). Floris est le plus grand peintre anversois adepte du romanisme, en quelque 139
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
sorte la transposition nordique de l’art en vogue en Italie ; son style a profondément marqué toute la sphère artistique des Pays-Bas dans la seconde moitié du XVIe siècle. Furnius a largement assimilé, par-delà l’enseignement de son maître Lambert Lombard, les concepts italianisants développés par Floris. À telle enseigne qu’on peut se demander s’il ne fut pas l’un de ces cent vingt peintres qui, au dire de son contemporain Van Mander, vinrent se perfectionner dans le grand atelier que Floris avait ouvert à Anvers19. Comme l’a bien démontré Bénédicte Grignard, les gravures de l’artiste liégeois le rattachent également à la production anversoise de la seconde moitié du XVIe siècle, et plus particulièrement au style de Floris20.
Fig. 4 : Pierre Furnius, Déploration du Christ mort, panneau, Horion-Hozémont, église Saint-Sauveur. © IRPA-KIK, Bruxelles.
19. Carel Van Mander, Le livre des peintres, éd. Henri Hymans, t. 1, Paris, 1884, p. 347. 20. Bénédicte Grignard, L'estampe à Liège au XVIe siècle, mémoire de licence en histoire de l'art et archéologie, t. 1, Université de Liège, 1982, p. 119-122. 140
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Fig. 5 : Pierre Furnius, Assomption de la Vierge, avant traitement, panneau, Liège, église Saint-Nicolas. © IRPA-KIK, Bruxelles. 141
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
On notera l’écart qui sépare l’art de Furnius de celui de son maître Lombard, dont il a été longtemps considéré comme un simple imitateur. Dans l’Assomption, il n’y a guère que certaines couleurs un peu acides qui pourraient rappeler le précédent lombardien du cycle des Femmes héroïques de l’Antiquité. Encore cette gamme est-elle assez commune à de nombreux peintres du XVIe siècle, il serait donc abusif de conclure à une influence évidente. Et pour constater l’avancée que représentent tant la gravure que le tableau de Furnius sur le thème de la Déploration du Christ mort par rapport à Lombard et à ses épigones, il suffit de les comparer aux productions plus strictement lombardiennes, comme la planche de la Déploration réalisée par Cornelis Bos en 1545 d’après un dessin de Lombard lui-même. Les volumes trahissent encore une influence lointaine des peintres primitifs, influence qui ne se décèle plus dans les Déplorations peinte et gravée de Furnius. Si celui-ci s’y montre un adepte convaincu de l’art alors à la mode à Anvers, on n’en doit pas pour autant oublier que ses deux grands modèles, Frans Floris et Willem Key, travaillèrent, comme on l’a vu, tous deux à Liège. Ainsi, par-delà Floris et Key, Furnius renoue-t-il indirectement, mais de manière plus moderne, avec l’enseignement humaniste de son maître liégeois. Furnius représente finalement le dernier avatar de l’humanisme « lombardien », qu’il conduit à l’orée du XVIIe siècle. On ne peut en dire autant des autres peintres actifs à Liège à la charnière des XVIe et XVIIe siècles et auquel le répertoire qui suit fait écho. Hors de Liège : le foyer dinantais Ce répertoire ne porte que sur les peintres mentionnés dans la ville de Liège. Mais il ne faudrait pour autant pas oublier que d’autres bonnes villes de la principauté ont compté en leur sein quelques peintres. Ce n’est pas le lieu de s’y attarder ici, mais on soulignera quand même que, hors Liège, la petite ville de Dinant émerge du lot : c’est elle qui, eu égard à sa taille, a bénéficié du plus large rayonnement. Il semble qu’on puisse dresser le même constat dans le domaine de la sculpture également21. Pour la période qui nous intéresse, on relève au moins les noms des peintres Jean et Denis Goblet, Lambert Gorins et ses élèves André Ravelot et Nicolas Richard, Gérard de Marche I, Jaspar et Michel Wanneson. Il semble que Joachim Patinier participe en fait d’un mouvement plus vaste qu’on l’avait imaginé et qui se poursuivra jusqu’à Antoine Wiertz ; il reste à expliquer. Une curieuse rencontre à Spa À la fin de la période de référence de cet article, le bourg de Spa commence également à jouer un rôle important. À partir du XVIIe siècle, les peintres vont s’y multiplier – on pense surtout aux membres des familles Le Loup et Xhrouet – pour travailler au service des nombreux curistes-touristes. Dans les mois qui suivent le décès d’Ernest de Bavière et l’élection de son neveu et successeur, Spa est même le théâtre d’une curieuse rencontre. Attardons-nous quelque peu sur la présence de ses protagonistes au pays de Liège. Grâce à quelques dessins signés, on peut circonscrire la présence du grand paysagiste anversois Jean Brueghel l’Ancien (1568-1625) à Spa en août 1612. Ce séjour est connu à travers quelques dessins22. Une Vue de Spa conservée à la Fondation Custodia à Paris porte la mention en bas à gauche « Spa Bruegel fec. a di 22 Agusto 1612 ». Il s’agit d’une vue de la place du marché avec à droite le perron, au centre les halles, marché couvert qui abrite à l’étage l’hôtel de ville, et au second plan le Wayai, la rivière du lieu ; sur le fond se détache l’église Saint-Remacle. Ce lavis est une vue topographique originale dans l’œuvre de l’artiste, car celui-ci n’a guère cédé à ce genre.
21. C’est ce qui ressort des nouvelles propositions avancées par Michel Lefftz, Ligier Richier et la sculpture mosane de Dinant à Liège, dans Noëlle Cazin et Marie-Agnès Sourier (dir.), Ligier Richier. Un sculpteur lorrain de la Renaissance, Nancy, 2008, p. 233243. Voir aussi sa contribution dans le présent volume. 22. Sur le séjour de Brueghel de Velours à Spa, voir le catalogue de l’exposition Dessins flamands du dix-septième siècle. Collection Frits Lugt. Institut néerlandais. Paris (Londres, Paris, Berne, Bruxelles), Gand, 1972, n° 14 et surtout Louis Pironnet, Spa et Brueghel de Velours, Bruxelles, s.d. [ca 1988]. 142
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Un autre dessin montre des buveurs d’eau autour d’une fontaine (Leyde, Cabinet des Estampes de l’Université) ; il porte l’inscription « Savonir tot spa. 1612 ». On y reconnaît effectivement la fontaine de la Sauvenière, l’une des plus courues par ces curistes qui fréquentaient déjà nombreux dès cette époque la cité thermale. Quant à La fontaine du Pouhon (Bruxelles, Bibliothèque royale), dessin également à la plume et au lavis, elle est intéressante dans la mesure où elle est reprise en encadré dans une grande gravure représentant Spa. Comme l’indique l’inscription, cette estampe fut gravée par Willem Van Nieulandt sur le dessin de Jean Brueghel. Le dessin de la Bibliothèque royale reprend exactement la forme de l’encadré de la gravure : c’est bien le dessin dont s’est servi le graveur. Brueghel s’est, à n’en pas douter, rendu à Spa en août 1612 pour répondre à cette commande d’une vue topographique de ce village déjà renommé ; cela explique du reste le caractère très précis et achevé du dessin de l’encadré de droite. Ni le dessin de la vue générale de Spa depuis le nord-est ni celui de l’encadré de gauche n’ont été repérés. Cette commande émanait peut-être de Théodore Galle, l’éditeur de la gravure23. D’autres dessins de Brueghel réalisés à Spa sont connus : Vue de la rue du Marché à Spa (Cambridge, Fitzwilliam Museum), Vue d’une ruelle à Spa (Cleveland Museum of Art), Vue de l’église Saint-Remacle et du chemin de la Sauvenière (vente Sotheby’s, Londres, 1er décembre 1964, n° 2). De la même période doit dater le dessin à la plume et lavis de bistre (17,5 x 29,5 cm ; fig. 6)24 dont l’artiste s’est servi pour représenter le haut fourneau de Hola à Spa dans un panneau conservé à la Galerie Doria Pamphili à Rome. La composition du tableau (22 x 33,5 cm) est très fidèle au dessin et tout à fait caractéristique du style coloré des paysages réalistes au point de fuite déplacé latéralement que l’on retrouve fréquemment dans les œuvres de la seconde partie de la carrière de Brueghel de Velours. Le site reproduit peut être identifié avec certitude par la comparaison avec un dessin de Cantagallina (fig. 7) ; on y voit le même haut fourneau mais vu du point de vue opposé.
Fig. 6 : Jean Brueghel l’Ancien ?, Le fourneau de Hola à Spa, dessin, localisation actuelle inconnue. © IRPA-KIK, Bruxelles. 23. Selon le catalogue de l’exposition L’art ancien au pays de Liège tenue à Liège en 1881 (2e section, n° 97), cette gravure daterait de 1603, ce qui est impossible ; elle doit nécessairement être postérieure au séjour de Brueghel à Spa en 1612. 24. Collection G. Bellingham-Smith, vendue à Londres les 5 et 6 juillet 1927. Klaus Ertz (Jan Brueghel der Ältere [1568-1625]. Die Gemälde miet kritischem Oeuvrekatalog, Cologne, 1979, p. 572) considère quant à lui ce dessin plutôt comme une copie d’après le petit tableau de Rome. 143
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Coïncidence, le peintre, dessinateur, graveur, architecte et décorateur florentin Remigio Cantagallina (1582/1583-1656) a en effet séjourné à Spa au même moment, dans le cadre d’un voyage effectué dans les Pays-Bas méridionaux et la principauté de Liège entre le début de l’année 1612 et la fin de l’année 1613. Ce séjour est bien connu grâce aux cent cinq vues de nos régions acquises à Florence en 1886 par les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Quelques-unes portent le monogramme « R.C. ». Henri FierensGevaert, le premier, identifia ce monogrammiste à Remigio Cantagallina25. La plupart des dessins – des paysages – sont précisément datés et annotés de l’indication du lieu représenté.
Fig. 7 : Remigio Cantagallina, Le fourneau de Hola à Spa, dessin, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. © IRPA-KIK, Bruxelles.
On ignore la raison de ce séjour dans les Pays-Bas qui apparaît comme un contrepoint au traditionnel voyage des peintres nordiques en Italie. Edmond de Bruyn, cité par Fierens-Gevaert26, suppose que l’artiste florentin fut appelé au service du duc Alexandre de Bournonville, comte de Henin-Liétard et seigneur de Tamise. Le duc avait sans doute fait la connaissance de Cantagallina lors de son séjour à la cour des Médicis au début du siècle. Les vues de Tamise sont particulièrement nombreuses dans l’album de dessins du Musée de Bruxelles, qui compte également des vues de Hénin en Artois ainsi que diverses représentations des propriétés bruxelloises du duc de Bournonville. Selon Roland de Lathuy, Bournonville se serait attaché le Florentin pour qu’il commémore certains événements précis ; ainsi de ce feu d’artifice au château de Tamise dont un dessin de Cantagallina a conservé le souvenir27. Grâce aux annotations sur les dessins, on peut établir que Cantagallina est resté à Spa du 1er au 26 août 1612. Il exécute dans cette bourgade et ses environs pas moins de dix-huit dessins. Le 27 août, il est à Fraipont, où il peint la vallée de la Vesdre, puis à Chaudfontaine, où il dessine le château de la Rochette – le dessin est annoté « Roschet » et non « Roscret », comme on l’a lu généralement. Le 28 août, il doit être à Liège. Il donne deux dessins de la cité mosane : une vue panoramique et une vue de la Meuse en Gravioule. Le 29, il dessine deux vues du château d’Argenteau (peut-être depuis le bateau qui l’emmenait de Liège à Maestricht). De la même journée date une représentation de ce qui paraît être Visé ; cette vue est donnée 25. Henri Fierens-Gevaert, Voyage inédit d’un artiste florentin du XVIIe siècle au beau pays de Flandre et de Wallonie, dans Le Flambeau, t. 6, vol. 1, 1923, p. 203. 26. Ibidem, p. 202. 27. Catalogue de l’exposition Le peintre et l’arpenteur. Images de Bruxelles et de l’ancien duché de Brabant, Bruxelles, 2000, p. 212. 144
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
depuis les bords de la Meuse. Le lendemain, Cantagallina est à Maestricht ; il y dessine la collégiale SaintServais. Le 1er septembre, on le retrouve à Saint-Trond, où il exécute un dessin de l’église Notre-Dame. Dans les jours qui suivent, l’artiste retourne dans les Pays-Bas espagnols. Cantagallina offre de Spa des vues pittoresques. Il s’attache aux diverses sources qui ont fait la fortune de la cité thermale et il n’hésite pas à mettre en scène les bobelins venus prendre les eaux, comme dans cette Vue de la source de la Sauvenière (27,5 x 41 cm ; fig. 8). Il s’intéresse à la métallurgie locale et dresse aussi des vues panoramiques de la bourgade. Il va se démarquer de l’art maniérisant auquel ressortissent les paysages imaginaires caractéristiques de l’art toscan du début du Seicento. À son retour en Italie, sans doute en 1614, Cantagallina importe dans son pays un art topographique marqué par le tempérament nordique de précision réaliste. Nombre de ses dessins se ressentent des dispositions de l’artiste pour l’eau-forte. On peut se demander si certains ouvrages particulièrement achevés et aux traits de plumes très précis, telle la vue de la source de la Géronstère (18,5 x 31 cm), n’étaient pas destinés à une traduction en gravures. D’autres en revanche, tels ceux rehaussés de lavis, insistent sur l’aspect pictural des panoramas représentés. Dans sa Vue du village de Spa (19,5 x 31,5 cm), au clair-obscur marqué, l’artiste traduit au moyen de larges aplats de sépia une atmosphère lourde et orageuse. De manière générale, il se révèle un topographe minutieux, même s’il lui arrive de recomposer ses vues en atelier, en se fondant sur des feuilles d’études prises de plusieurs points de vue28. Afin d’insister sur les prises sur le vif de ses croquis, l’artiste n’a pas hésité à se mettre luimême en scène dans plusieurs d’entre eux, comme dans la Source de la Géronstère ou la Source de la Sauvenière. La présence de quadrillage sur quelques dessins de l’album de Bruxelles permet de supposer que certains d’entre eux devaient être transposés en peinture.
Fig. 8 : Remigio Cantagallina, Vue de la source de la Sauvenière à Spa, dessin, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. © IRPA-KIK, Bruxelles. 28. Ibidem, p. 216. 145
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Nous voyons donc que Cantagallina se trouvait à Spa exactement au même moment que Brueghel. Cela apparaît d’autant moins comme un hasard qu’un troisième larron était peut-être à Spa en ce mois d’août 1612. Pierre-Paul Rubens (1577-1640) se serait en effet rendu à Spa au même moment pour peindre un portrait (aujourd’hui perdu) de Thomas Howard, comte d’Arundel, alors en cure dans la petite cité thermale29. Le séjour spadois d’Arundel en août 1612 est bien attesté30. Mais qu’en est-il du portrait peint par Rubens à cette occasion ? Howarth appuie son hypothèse sur une note publiée par John Rowlands31. Apparemment, cette information remonte à Robert Delevoy, qui écrit dans sa biographie de Rubens32 : « 1612. Séjour à Spa où il fait le portrait (disparu) de Thomas Howard, comte d’Arundel ». Je n’ai pu recouper ce renseignement, les portraits du comte d’Arundel dûment attestés étant largement postérieurs. On considérera donc le passage de Rubens à Spa avec beaucoup de circonspection. Mais la coïncidence est quand même troublante. On sait que Brueghel et Rubens sont alors très proches ; ils font d’ailleurs tous deux partie de l’entourage des archiducs qui règnent alors sur les Pays-Bas. Tous deux sont également intimement liés au peintre Hendrik Van Balen. Or, celui-ci servira de guide à Arundel à Anvers dans les semaines qui précéderont son arrivée à Spa. David Howarth a émis l’hypothèse que Van Balen aurait présenté Rubens à Arundel lors de ce séjour à Anvers33. En outre, Brueghel, Rubens et Van Balen seront tous trois envoyés conjointement en mission officielle dans les Provinces-Unies vers 161334. Ce trio ne se serait-il pas retrouvé à Spa en août 1612 avec Arundel dans un cadre diplomatique également ? La présence à Spa à ce moment du Florentin Cantagallina est peut-être à envisager partiellement dans la même perspective. Sachant que la régente de France est alors une Médicis, le duché de Toscane dispose à cette époque d’une sphère d’influence peu commune. On se plaît donc à imaginer une importante mais discrète négociation toscano-néerlando-britannique sur le terrain neutre de notre petite principauté épiscopale. Le cadre européen est à ce moment en mouvement. Un nouvel empereur, Mathias Ier, a été élu deux mois auparavant. Et la France vient de se rapprocher de l’Espagne suite à l’annonce du mariage du jeune roi et de l’infante. Sans même parler de la récente élection du nouveau prince-évêque de Liège et archevêque de Cologne, Ferdinand de Bavière, qui n’a pas encore pris ses fonctions. Voilà bien de quoi nourrir les réflexions des chancelleries sur l’évolution possible des différentes alliances. Concernant le séjour de Rubens au pays de Liège en 1612, il convient de rappeler ici que Louis Abry situe précisément en 1612 l’envoi du jeune peintre liégeois Gérard Douffet dans l’atelier de Rubens à Anvers35. Si l’anecdote est douteuse, il n’en reste pas moins que la coïncidence de date avec le séjour présumé du grand maître anversois au pays de Liège est troublante36. Rubens ne sera plus mentionné en région liégeoise avant 1632, année au cours de laquelle il effectuera plusieurs missions diplomatiques en principauté37. Ernest de Bavière et les peintres liégeois Pour en terminer avec cette introduction, envisageons maintenant les rapports entre Ernest de Bavière et les peintres du pays de Liège. Il n’y eut jamais vraiment d’activité de peintre de cour à Liège au XVIe siècle,
29. David Howarth, Lord Arundel and his Circle, New Haven et Londres, 1985, p. 34. 30. Musée de la Ville d’Eaux à Spa, Livre d’or de Spa, ms. d’Arnold de Thier, p. 18.- Mary Frederica Sophia Hervey, The Life, Correspondence and Collections of Thomas Howard, Earl of Arundel, Cambridge, 1921, p. 64-66. 31. Catalogue de l’exposition Rubens Drawings and Sketches, Londres, 1977, p. 16. 32. Robert L. Delevoy, Rubens, Genève, 1972, p. 13. Une partie des archives du célèbre critique d’art sont conservées aux Archives de l’art contemporain à Bruxelles. Je n’y ai pas trouvé la documentation qu’il a utilisée pour son livre sur Rubens. 33. Howarth, op. cit., p. 33. 34. Klaus Ertz, Jean Brueghel l'Aîné, dans Catalogue de l’exposition Bruegel. Une dynastie de peintres, Bruxelles, 1980, p. 166167. 35. Abry, op. cit., p. 182. 36. Si un séjour de Gérard Douffet à Anvers vers 1612-1614 est vraisemblable, la probabilité que le jeune peintre ait été l’élève du grand maître anversois reste très faible. Cf. Pierre-Yves Kairis, Le peintre Gérard Douffet (1594-1660), fondateur de l’école liégeoise du XVIIe siècle, mémoire de licence en histoire de l’art, Université de Liège, 1982, p. 36-39. 37. Louis-Prosper Gachard, Histoire politique et diplomatique de Pierre-Paul Rubens, Bruxelles, 1877, p. 242-243. 146
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Lambert Lombard avait d’ailleurs fortement souffert du désintérêt des princes-évêques successifs, comme il l’a confié à Lampson38. Sous le règne d’Ernest, la vie de cour resta fort limitée au palais de Liège puisque le prince résidait le plus souvent à Bonn ou à Arnsberg. Il paraît néanmoins avoir porté davantage d’attention à la peinture que la plupart de ses prédécesseurs39. Deux mois à peine après son intronisation, il accordait une commission de « peintre de Son Altesse » à Thomas Puteanus, bourgeois de Saint-Trond. Au vu des seuls tableaux conservés de ce dernier, ce n’est sans doute pas pour ses qualités de peintre mais plutôt pour celles de miniaturiste que Puteanus a été retenu. L’année suivante, il enlumina du reste un livre pour son « patron ». D’autres peintres ont travaillé pour celui-ci. C’est le cas d’Henri d’Esneux, qui réalisa un portrait d’Ernest à destination d’un prince étranger. Denis Pesser a quant à lui été rémunéré à plusieurs reprises par la Chambre des comptes pour des travaux au profit du prince et du palais. Mais le peintre le plus proche du prince est resté Dominique Lampson, prolongé dans ses fonctions de secrétaire. Rien ne dit toutefois qu’il ait exercé son art pour son nouveau maître. En revanche, il ne fait guère de doute que c’est lui qui a attiré l’attention d’Ernest sur les qualités de son ancien élève Otto Vaenius, lorsque celui-ci est revenu séjourner à Liège à son retour de Rome, vers 1583. Le prince a donné une forme de sinécure au jeune peintre en le recrutant comme valet de chambre40. De cette époque doit dater un portrait du Wittelsbach réalisé par Vaenius et mentionné dans un des ouvrages du poète Jean Polit. Les contacts entre le prince et le peintre se sont poursuivis bien au-delà du départ du peintre pour les Pays-Bas. En 1590, Vaenius lui a dédié la gravure d’une Dernière Cène et en 1595, à une époque où le jeune Rubens fréquentait son atelier, il a peint un autre portrait d’Ernest. Entre-temps, en 1593, le prince-évêque lui avait conféré une prébende à la collégiale Saint-Jean à Liège. Voilà certainement le signe le plus concret du haut intérêt porté par Ernest de Bavière à celui qui était alors devenu un des grands maîtres des Pays-Bas et qui ne revint plus à Liège que de manière épisodique. Ce soutien nous permet de déduire en creux qu’Ernest devait estimer, à juste titre, qu’il n’y avait plus de très grandes personnalités dans le cercle des peintres du pays de Liège. Et les liens tissés de la sorte ont peutêtre été déterminants pour les relations entre artistes mosans et artistes brabançons, dans le prolongement des contacts que Lombard et ses disciples ou successeurs (Lambert Suavius, Pierre Furnius, Lambert Bottin…) avaient antérieurement établis avec Anvers.
RÉPERTOIRE41 Alexandre (mentionné en 1573) Jean Yernaux a découvert dans les comptes de la collégiale Saint-Denis, sous l’année 1673, un paiement de 34 florins dédié à « Magistro Alexandro, pictori, qui reparavit altare majus »42. Ce paiement porte
38. Hubaux et Puraye, op. cit., p. 73 et 75. 39. Encore cette impression n’est-elle peut-être due qu’au hasard des documents découverts. Pour les exemples cités ci-après, on trouvera les références utiles dans les notices biographiques du répertoire. 40. À son entrée en fonction, Ernest disposait de quatorze pages ; ceux-ci étaient placés sous la direction du chapelain (Eugène Polain, Ernest de Bavière évêque et prince de Liège 1581-1612, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 53, 1929, p. 160). 41. Ce répertoire recense les peintres (dans toutes les acceptions du terme) qui sont mentionnés dans la cité de Liège à un moment donné entre 1570 et 1620. Il propose avant tout un bilan des connaissances disponibles sur des maîtres souvent peu connus, mais il ne prétend nullement à l’exhaustivité. Pour les peintres liégeois reconnus dont la carrière à largement débordé au-delà de 1620, les notices se concentrent sur la période ici considérée et non sur l’ensemble de leur carrière. 42. Jean Yernaux (1885-1974), manuscrit dactylographié sur les peintres anciens du pays mosan, déposé à la bibliothèque de la Société libre d'Émulation à Liège, f° 5 (ci-après cité Manuscrit Yernaux). La partie consacrée aux peintres liégeois a été partiellement publiée (lettres À à H) sous le titre de Dictionnaire des peintres liégeois. Du moyen âge à la fin du XVIIIe siècle dans Bulletin de la Société libre d’Émulation (du t. 2, 1986-1987, au t. 6, 1991-1992). 147
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
manifestement sur une restauration des panneaux peints par Lambert Lombard et ses disciples ornant le grand retable brabançon qui faisait à l’époque figure de maître-autel. Pascal Balen (ca 1580 ?-1658) René Jans a retracé avec beaucoup de précision la vie de ce peintre souvent erronément prénommé Pierre43. Selon Abry, « Pacque Balen » est le fils de l’apothicaire Martin Balen et d’Anne de Bassenge44. Il serait né vers 1570, selon le baron de Villenfagne45, ou vers 1580, selon le comte de Becdelièvre46 ; cette seconde date paraît plus vraisemblable. Au dire d’Abry, il aurait été l’élève de Jean Ramey et il aurait épousé en 1599 Marie, l’une des filles issues du troisième mariage du peintre Lambert Lombard47. Ce qui est erroné, comme l’avait déjà relevé Yernaux48. Le Lambert Lombard qui fut le beau-père de Balen était un cousin homonyme du peintre ; il était boucher de son état et avait épousé Marie Pesser, la fille du peintre Jean Pesser et la sœur de ce Denis Pesser qui a signé la peintre murale de la Résurrection du Christ encore conservée à l’église Saint-Jacques. Balen relève en 1608 le « bon métier » des orfèvres en tant que gendre de ce Lombard49. Comme le remarque René Jans, il faut situer son mariage avec Marie Lombard plutôt vers cette époque. Ce mariage a probablement lieu au retour du voyage en Italie « et ailleurs » auquel fait allusion Louis Abry50 – cet « ailleurs » devient les Pays-Bas sous la plume quelque peu inventive de Villenfagne. Le couple aura au moins six enfants, nés dans la paroisse Sainte-Véronique entre 1610 et 1627. Marie décédera dans cette même paroisse le 22 février 164051. Le 3 mars 1610, Marie Pesser cède à son gendre tous ses biens, notamment la propriété familiale du Jonckeu (où avaient vécu plusieurs peintres de la famille Pesser), en échange de sa subsistance sa vie durant. En 1614, le prince-évêque Ferdinand de Bavière nomme son « cher et aimé » maître Pasque Balen échevin de la Cour de justice d’Avroy. En 1615, il est élu administrateur de l’hôpital Saint-Jacques en tant que voyageur, ce qui paraît attester son voyage à Rome. À ce titre, il apparaît à l’une ou l’autre reprise dans les comptes de l’hôpital ; son blason sera relevé par Simon-Joseph Abry sur le lambris d’une pièce de l’hôpital52. Balen sera par ailleurs échevin puis mayeur de la Cour de justice de Fragnée. Il exerce encore cette fonction, lorsqu’il s’éteint, entre le 4 mai et le 13 juin 1658, comme l’a noté Jans. On connaît peu de choses de ses activités artistiques. Quelques travaux artisanaux ont été repérés dans les années 1630, qui dépassent la fourchette chronologique ici retenue. Pour Abry, il n’exécuta que de « menus ouvrages », à l’exception d’une Trinité encore visible de son temps à l’église Saint-Christophe à Liège53. Hamal dit qu’elle se trouvait autrefois dans le chœur ; elle n’était en tout cas plus en place à la fin du XVIIIe siècle54. Pourtant, Del Vaux de Fouron la signale encore au maître-autel au milieu du XIXe
43. Jans, Une dynastie…, op. cit., p. 236-239. 44. Abry, op. cit., p. 177. 45. Hilarion-Noël de Villenfagne, Recherches sur l’histoire de la ci-devant principauté de Liège, t. 2, Liège, 1817, p. 355. 46. Antoine-Gabriel de Becdelièvre, Biographie liégeoise, t. 2, Liège, 1837, p. 139. 47. Abry, op. cit., p. 166. 48. Yernaux, Lambert Lombard, op. cit., t. 72, 1957-1958, p. 304. 49. Breuer, op. cit., p. 138. 50. Abry, op. cit., p. 178. 51. Archives de l’État à Liège (ci-après AEL), Registres paroissiaux de Liège, 308, à la date. 52. AEL, Fonds Abry, 28, p. 257. Dans le même registre (p. 237), Simon-Joseph Abry a relevé des armoiries peintes dans l’église Sainte-Véronique (sans précision). On retrouve là également celles de Pascal Balen. Celui-ci a donc exercé des fonctions au sein de la communauté paroissiale, peut-être comme fabricien. 53. Abry, op. cit., p. 178. 54. Henri Hamal, Notice sur les objets d’art, avec le nom des auteurs, qui se trouvaient dans les églises de la ville de Liège en 1786, éd. René Lesuisse, Tableaux et sculptures des églises, chapelles, couvents et hôpitaux de la ville de Liège avant la Révolution. Mémento inédit d'un contemporain, dans Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois, t. 19, 1956, p. 246. 148
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
siècle55 ; son témoignage est-il crédible ? Renier56 et Gobert57 la confondent avec un Saint Joseph portant en ses bras l’Enfant Jésus encore en place en leur temps mais disparu depuis lors. Il serait tentant, mais ce n’est qu’une hypothèse, d’identifier cette Trinité avec un intéressant tableau liégeois anonyme de la première moitié du XVIIe siècle conservé en l’église Saint-Pholien. Ce tableau (290 x 155 cm) semble remonter aux années 1620-1630 ; il a été récemment restauré à l’Institut supérieur des Beaux-Arts SaintLuc à Liège. Iconographiquement très riche, il montre la Vierge et les saints intercédant auprès de la Trinité en faveur d’un mourant (fig. 9) ; dans l’église, il porte le titre de La mort du juste. À ma connaissance, il s’agit du seul tableau liégeois conservé qui pourrait correspondre à la Trinité de Saint-Christophe. En dépit d’une certaine sévérité plastique, la composition en trois registres s’avère complexe mais agréable, le développement des drapés est savant, les visages, quoique stéréotypés, sont d’une facture harmonieuse. L’œuvre est d’un maître qui devait bénéficier en son temps d’une bonne reconnaissance. R. Jans souligne d’ailleurs que Balen dut conquérir quelques titres de gloire, sans quoi il serait difficile d’expliquer les honneurs dont il fut comblé. Philippe de Beco (mentionné entre 1600 et 1625) e
Fig. 9 : Anonyme liégeois du XVII siècle (Pascal Balen ?), En 1600-1601, Philippe (de) Beco (alias Becko La mort du juste, toile, avant restauration, Liège, église ou Becco), fils du peintre François de Beco, relèSaint-Pholien. © IRPA-KIK, Bruxelles. 58 ve le métier des orfèvres à Liège . En 1612, il 59 est cité comme habitant au faubourg d’Avroy . Le 4 juillet 1616 est baptisée à Saint-Adalbert à Liège sa fille Oudon ; celle-ci est issue de son mariage avec Oudon Bragard60. Le 7 novembre 1616, il obtient de la céarie du prince l’autorisation d’abattre un mur se trouvant devant sa maison de la chaussée Saint-Gilles, dans le même quartier d’Avroy61. En 16241625, il relève le métier des fèvres en tant qu’époux d’Oudon Hustin, fille de maître62. 55. Henri Del Vaux de Fouron, Dictionnaire géographique de la province de Liège, 2e éd., t. 2, Liège, 1842, p. 229. 56. Jean-Simon Renier, Inventaire des objets d'art renfermés dans les monuments civils et religieux de la ville de Liège, Liège, 1893, p. 35. 57. Théodore Gobert, Liège à travers les âges. Les rues de Liège, t. 4, Liège, 1976, p. 200 (réédition du texte original de 19241929). 58. Breuer, op. cit., p. 121. 59. Manuscrit Yernaux, f° 12. 60. AEL, Registres paroissiaux de Liège, 75, à la date. 61. AEL, Échevinage d’Avroy, 22, p. 224 (Dictionnaire informatisé des artistes liégeois, cité ci-après DIAL ; communication de Mme É. Gaspar). Pour la consultation du DIAL en ligne, voir http://promethee.philo.ulg.ac.be/dial/. Les fiches de base (dont certaines n’ont pas été encodées) ont été récemment déposées à la salle des manuscrits de la Bibliothèque générale de l’Université de Liège. 62. Bibliothèque Ulysse Capitaine de la ville de Liège, Ms. 327, année 1624-1625 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar).- Manuscrit Yernaux, f° 12. 149
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
François Bidelot (ca 1585-après 1640) Selon Raoul Van der Made, repris par René puis André Furnémont, la Présentation au Temple sur bois (192 x 225 cm), datée 1620 et conservée au Musée communal de Huy (fig. 10), serait issu du pinceau d’un peintre hutois du nom de Frans Badehoz63.
Fig. 10 : François Bidelot, Présentation au Temple, panneau, Huy, Musée communal. © IRPA-KIK, Bruxelles.
Celui-ci aurait obtenu du receveur du Grand Hôpital une somme de 20 florins et des setiers de vin pour l’équivalent de 2 florins 8 patards. La vérification opérée dans les archives a permis d’affiner cette attribution et de rendre le tableau au peintre liégeois François Bidelot64. Le 6 septembre 1620, c’est bien le
63. Raoul Van der Made, Le Grand Hôpital de Huy. Organisation et fonctionnement (1263-1795), dans Anciens pays et assemblées d’états, t. 20, 1960, p. 33.- René Furnémont, Huy-sur-Meuse, Gembloux, 1973, p. 63.- André Furnémont, Le Musée communal, dans André Furnémont et Albert Lemeunier, Le Musée communal et le Trésor de la collégiale de Huy, Bruxelles, 1992, p. 36. 64. Pierre-Yves Kairis, La Présentation au Temple (1620), une œuvre du peintre liégeois François Bidelot au Musée de Huy, dans Annales du Cercle hutois des sciences et Beaux-Arts, t. 56, 2002-2003, p. 129-136. 150
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
peintre Frans Bideloz qui reçoit de la Commission des Onze Hommes 20 florins pour le tableau reprenant les effigies des membres de ladite Commission65. Dans les comptes du Grand Hôpital de Huy apparaît encore, sous l’année 1620-1621, un paiement de 4 florins 8 patards « Aux gouverneurs du mestier des merciers pour la lisence données à mre france biddelots peintre de besongner et faire le tableau estant en las salle des Srs Onze Hommes »66. Le tableau est un hommage aux gestionnaires de la bienfaisance à Huy. Présidée par les deux bourgmestres en fonction, la Commission des Onze Hommes comprenait un représentant de chacune des onze corporations hutoises. Les deux bourgmestres en fonction en 1620, Jacques de Préalle et Jean de Hoyoul, sont évoqués par leurs armoiries de part et d’autre de la partie supérieure du tableau. Les Onze Hommes sont quant à eux représentés en buste, avec leurs armoiries et celles de leur corporation, sur les côtés de la scène principale – l’un d’entre eux se trouve en dessous à gauche, la symétrie n’ayant pu être conservée en raison du nombre impair des membres de la Commission. En bas figurent, selon Jopken, les responsables « administratifs » du Grand Hôpital67. Le montant versé au peintre paraît tellement dérisoire qu’on est en droit de supposer que les quatorze personnes représentées (outre celles dont le blason est reproduit) ont aussi contribué individuellement à l’achat de la peinture. Selon le même Jopken, le tableau évoquerait la grande distribution d’argent en faveur des estropiés qui eut lieu à Huy le 2 février 1620, jour de la fête de la Purification de la Vierge. L’hypothèse est d’autant plus plausible que la composition présente une iconographie originale de ce thème. Sur un fond d’architecture sombre évoquant le Temple de Jérusalem, on distingue deux vieillards à droite distribuant l’aumône aux miséreux qui entourent les acteurs principaux. Délibérément enlaidis par le peintre, tous ces personnages secondaires sont traités de manière plus sommaire. Les quatre figures principales (la Vierge, l’Enfant, saint Joseph et Siméon), de très belle facture, se concentrent au cœur du tableau et apparaissent comme étrangères au reste de la scène. Quant aux portraits entourant la scène, s’ils sont bien dans l’esprit du temps, ils trahissent une facture laborieuse. Le peintre ne leur a, chose étrange, pas accordé la même attention qu’à la Sainte Famille. On aurait pu penser qu’il accorderait davantage d’intérêt à ses clients. Les deux vieillards en haut à droite de la composition relèvent clairement de la tradition maniériste issue de Frans Floris et ses suiveurs anversois ; c’est un trait caractéristique de nombreuses peintures liégeoises de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Outre les quatre personnages centraux, une dernière figure émerge par sa forte présence. Il s’agit de la femme à gauche portant une cage avec les deux colombes offertes par la Vierge à l’occasion de la cérémonie. Ces cinq figures sont en fait tirées d’une Présentation au Temple gravée par Francesco Villamena en 1597 (fig. 11) ; cette gravure copie une peinture de Véronèse peinte en 1558-1560 pour l’église San Sebastiano à Venise68. Malgré le caractère quelque peu compact de la composition, celle-ci est d’une belle ampleur. Le sujet est traité avec beaucoup d’originalité. Il se réfère au texte de Luc (2, 22-38), le seul évangéliste qui ait évoqué la présentation de Jésus au Temple. Conformément à la loi de Moïse, la mère de tout nouveau-né devait, quarante jours après la naissance, se rendre au Temple de Jérusalem pour se purifier et consacrer son fils au Seigneur. Selon la coutume, les parents étaient tenus d’offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou deux jeunes colombes. Dans le tableau hutois, la jeune femme à l’extrême gauche porte le panier avec les colombes, contrairement à la tradition iconographique qui laisse généralement ce soin à saint Joseph. Portant l’Enfant Jésus, la Vierge est agenouillée devant une estrade qui supporte la tribune du haut de laquelle deux patriciens – évocation probable des deux bourgmestres en fonction – distribuent les
65. Archives de l’État à Huy, Grand Hôpital, 431, f° 55. 66. Archives de l’État à Huy, Grand Hôpital, 463, Comptes de 1620-1621, p. 67. 67. E. Jopken, Note sur trois tableaux provenant du Grand Hôpital de Huy, dans Annales du Cercle hutois des sciences et BeauxArts, t. 15, 1906, p. 200-201. 68. La figure féminine de gauche ayant été reprise par Annibal Carrache dans son Aumône de saint Roch conservée à la Gemäldegalerie de Dresde, j’ai longtemps cru que Bidelot s’était inspiré, pour ce personnage, de la gravure que Guido Reni a donnée en 1610 de la composition peinte par Carrache (cf. Kairis, op. cit., p. 131-132). La récente découverte de la gravure de Villamena a contredit cette interprétation. 151
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
aumônes aux infirmes. Ces deux personnages ne peuvent se confondre avec Siméon et son serviteur, comme cela fut parfois prétendu69. Cette confusion atteste bien la complexité iconographique de cette composition. La tribune, qui fait quasiment figure d’autel, est mise en évidence par la large draperie vermillon qui la recouvre. À la gauche de la Sainte Famille se prosterne un grand prêtre. Ce dernier se confond avec le vieux Siméon mentionné par saint Luc et que la tradition a, sans fondement évangélique, souvent assimilé à un prêtre. L’action se déroule au moment où Siméon va recevoir l’enfant dans les bras et entonner son cantique Nunc Dimittis, prédisant que le nouveau-né serait le salut, la lumière des nations et la gloire d’Israël. Derrière la Vierge, saint Joseph est représenté en vieillard, selon une tradition ancienne qui se perdra peu à peu au cours du XVIIe siècle70. De la main gauche, il tient un cierge, référence à la lumière évoquée par Siméon et qui vaudra à la fête de la Purification de la Vierge le vocable de Chandeleur ; dans la liturgie chrétienne, cette fête est en effet marquée par le rite de la bénédiction des cierges.
Fig. 11 : Francesco Villamena d’après Véronèse, Présentation au Temple, estampe, Londres, British Museum. © Cliché du musée.
L’examen du groupe principal du tableau atteste les qualités du peintre. Si les draperies se caractérisent pour l’essentiel par d’épais plis bourrelés sans guère de finesse, on ne manquera pas d’apprécier la délicatesse des chairs nacrées de la Vierge, d’habiles effets d’ombre et de lumière, l’harmonieuse diversité des coloris, la justesse du dessin et la maîtrise des raccourcis. Le peintre a même recouru au procédé, cher aux peintres de la Renaissance italienne, de libération d’un acteur du cadre du tableau. La figure féminine à gauche, dont le pied semble tendu vers l’extérieur du cadre de la composition, semble vouloir rejoindre l’espace réservé au spectateur. Elle fait de la sorte office de figure repoussoir introduisant le regard du spectateur dans le tableau.
69. Catalogue de l’exposition Mille ans d’aide sociale (Huy et Liège), Liège, 1985, p. 64. 70. Émile Mâle, L’art religieux du XVIIe siècle, Paris, 1984, p. 282. 152
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Notons enfin un élément hétérodoxe : il s’agit de la crosse épiscopale (ou abbatiale) qui paraît comme plantée sans raison au second plan au centre du tableau. Sans doute considérée comme un attribut du grand prêtre agenouillé, elle figure sous le phylactère qui reprend les paroles du Nunc Dimittis et la date de 1620. Ce phylactère somme le blason de Jean de Groesbeeck, gouverneur de la ville de Huy de l’époque. L’originalité de l’iconographie autant que la grande qualité plastique de certaines parties de ce tableau n’ont guère retenu l’attention jusqu’à présent. Cette œuvre constitue pourtant un jalon essentiel pour l’histoire de la peinture du XVIIe siècle au pays de Liège. Son auteur n’est pas tout à fait inconnu. Selon Jean Yernaux, France Bidelot (alias Bidelo, Biddelots, Bideloz ou Buijdelo) serait né à Liège vers 158571. Yernaux ne cite cependant pas la source de cette information. Bidelot relève le métier des orfèvres entre 1606 et 160872. Un « Fransoys Buijdelo, van Luyck » est cité comme apprenti dans les archives de la gilde de Saint-Luc à La Haye en 160973. Il s’identifie à n’en pas douter avec notre peintre. Peut-être faudrait-il postposer de quelques années la date de naissance envisagée par Yernaux : il est rare, mais nullement impossible, de trouver un apprenti âgé de vingt-quatre ans. Quant à cette formation au cœur de la Hollande, elle transparaît dans le panneau du Musée de Huy. On y devine la marque des artistes du maniérisme tardif hollandais (tels Hendrick Goltzius, Cornelis Van Haarlem ou Abraham Bloemaert) dans les modelés fermes des acteurs du groupe central, dans les jeux d’ombre sur les visages et surtout dans le traitement quelque peu trivial d’un sujet religieux. Pour le reste, le tableau semble assez conforme à cette tradition maniériste flamande qui marqua tant la peinture liégeoise à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles. Le 18 novembre 1619, Bidelot à Liège signe une convention matrimoniale dans la perspective de son prochain mariage avec Agnès Deschamps74. De ce document, il ressort qu’il est le fils d’un autre François Bidelot et de Marine Delpierre75 et qu’il est le frère de Jean Bidelot, chanoine de la Petite Table à SaintLambert. Ce qui atteste le niveau social relativement élevé de sa famille. François Bidelot père est qualifié de « mesager » dans son acte de relief du métier des orfèvres en 159376. Après son mariage, il s’en est vraisemblablement allé vivre dans la maison du Pont d’Avroy que son beau-père venait de céder à Agnès. Le 24 décembre 1619, il relève le métier des merciers, comme fils de maître – son père avait lui-même relevé le métier en 160377. En 1620, il relève celui des vieux-warriers, comme l’a noté Yernaux. Le 15 septembre 1624, il est encore mentionné à Huy ; il reçoit ce jour-là plusieurs paiements pour un retable d’autel exécuté pour l’abbaye du Val-Notre-Dame78. Divers documents donnent donc à penser que les attaches du peintre avec Huy ont été importantes. Il est encore mentionné à différentes reprises dans les archives dans les années 1620 et 1630. L’attribution de la Présentation au Temple à un peintre liégeois très peu connu est d’importance pour l’étude de la peinture du XVIIe siècle au pays de Liège. L’école liégeoise ne se développera qu’à partir du retour d’Italie, en 1623 ou 1624, de Gérard Douffet. Le tableau de Huy est un des rares témoins bien identifiés de la production liégeoise du premier quart du XVIIe siècle. Il constitue surtout un des trop rares cas où le lien a pu être établi entre une œuvre isolée et un nom de peintre uniquement connu par des mentions d’archives.
71. Manuscrit Yernaux, f° 14. 72. Breuer, op. cit., p. 131. 73. Fr. D. O. Obreen, Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis, t. 4, Rotterdam, 1881-1882, p. 5. 74. AEL, Échevins de Liège. Convenances et testaments, 54, f° 217-219.- Breuer, op. cit., p. 131. 75. Celle-ci est la fille d’un Jean Delpierre ou delle Piere qui s’identifie au peintre verrier qui releva le métier des orfèvres vers 1585 (Ibidem, p. 97). 76. Ibidem, p. 106. 77. AEL, Métiers, 338, p. 63.- Édouard Poncelet, Documents inédits sur quelques artistes liégeois. Deuxième partie, dans Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois, t. 5, 1892-1895, p. 110. 78. Archives de l’État à Huy, Abbaye du Val-Notre-Dame, 164 bis, p. 13. 153
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Herman Blomaert (mentionné entre 1585/89 et 1622) Originaire de Maestricht, Herman Blomaert (alias Blomars, Blommaert, Bloemaert, Bloemaerts ou Bloemarts), fils du juriste Cornelis Blomaert, acquiert le métier des orfèvres à Liège entre 1585 et 158979. En 1609, Maître Herman, peintre de Liège, paie une redevance à la gilde de Saint-Luc à Dordrecht pour avoir peint durant un certain temps dans cette ville80. Le 11 décembre 1611, « Mr Hermen van Luyck » devient maître de ladite corporation81. Le 18 octobre 1613, Herman Bloemaert est reçu à la gilde des peintres de La Haye82. Il est encore mentionné à La Haye en 162283. Il se confond probablement avec le peintre Herman Blomers dont le nom est repris un siècle plus tard en 1725-1726 dans les messes anniversaires de la veuve de Johan Reversteine en l’église Saint-Thomas à Liège84. Henri de Bois (mentionné en 1615) Après avoir œuvré à la restauration de tableaux anciens dans les collégiales liégeoises et dans les demeures canoniales, ce peintre demande le 3 octobre 1615 à être employé à cet effet à la cathédrale SaintLambert ; ce qui lui sera accordé85. Jean Bologne (ca 1580 ?-1654) Voici une figure majeure qui n’était jusqu’il y a peu connue que par la notice d’Abry86. Ces quelques renseignements se sont généralement vus confirmés et surtout complétés par les recherches dans les archives qui constituent le socle de l’étude biographique publiée par René Jans87. L’essentiel des informations qui suivent sont tirées de cette étude. Jean (de) Bologne (alias Boulogne, Bollon, Boulongne, Bolongne ou Bouloigne) est issu d’une famille de notables. Contrairement à ce qu’affirme Abry, c’est son grand-père, Olivier, et non son père qui était secrétaire du Conseil ordinaire. Olivier était aussi notaire et se serait également occupé d’histoire et d’architecture. Le père de Jean, Ogier, était peintre et marchand. Il fit le voyage de Rome, releva le métier des orfèvres vers 1555 et épousa Anne, fille de l’apothicaire Jean du Château. Il fut reçu parmi les confrères de l’hôpital Saint-Jacques, au titre de voyageur, à partir de 1574 et il donna pour son entrée 45 florins pour la restauration de la peinture de l’autel de la chapelle88. Il décéda en 1598. Selon René Jans, Jean Bologne dut naître vers 1580. Celui-ci fut en effet émancipé en 1602 – il n’avait donc pas atteint l’âge de vingt-cinq ans à ce moment. Et son frère cadet est né en 1586 ou 1587. 79. Breuer, op. cit., p. 96. 80. Jan Briels, Peintres flamands au berceau du Siècle d’Or hollandais 1585-1630, Anvers, 1997, p. 300. 81. Obreen, op. cit., t. 1, 1877, p. 195. 82. Ibidem, t. 4, 1881-1882, p. 2. 83. Edwin Buijsen (dir.), Haagse schilders in de Gouden Eeuw. Het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag. 1600-1700, Zwolle, 1998, p. 288. 84. AEL, Cures. Saint-Thomas à Liège, 2, non paginé (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). L’église Saint-Jacques à Louvain conserve un Saint Jacques le Majeur entouré de membres de gildes louvanistes signé « BLOVMAERTS » au centre et daté 1642 en bas à gauche. Le tableau, très flamand de style, est mentionné dans le répertoire de l’IRPA sous le nom du peintre Hermans Bloemaerts (Jaak Jansen, Fotorepertorium van het meubilair van de belgische bedehuizen. Provincie Brabant. Kanton Leuven I en II, Bruxelles, 1980, p. 65). Il serait tentant de l’attribuer à notre peintre, qui aurait peut-être achevé sa carrière à Louvain. Toutefois, selon Marina Jordens (De schilderkunst van de Contrareformatie in de Leuvense parochiekerken. 1585-1700. Het voorbeeld van de Sint-Jakobskerk, dans De Brabantse Folklore, t. 245, 1985, p. 28-29), ce nom correspondrait plutôt à celui du donneur d’ordre ; ce dernier se confondrait alors avec Lambrecht Bloumaerts, membre de la gilde de Saint-Jacques à Louvain. 85. Manuscrit Yernaux, f° 20. 86. Abry, op. cit., p. 173-175. 87. René Jans, Jean Bologne ou Boulogne, peintre philanthrope, dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, t. 12, n° 249, 1990, p. 45-52. 88. AEL, Bienfaisance. Hôpital Saint-Jacques, 250, non paginé. 154
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Jean releva le métier des orfèvres en 159389. Selon Abry, il fut l’apprenti de Pierre Furnius, ce qui est chronologiquement possible. Il se rendit ensuite en Italie. Selon Jans, Bologne aurait effectué le traditionnel voyage transalpin entre 1593 et 1599 et serait rentré suite à la mort de son père. Si le peintre est né au début des années 1580, cette période paraît fort précoce, même si elle n’est pas à exclure ; on sait par exemple que Nicolas La Fabrique est arrivé à Rome à l’âge de quinze ans. Mais on peut plus vraisemblablement présumer que Bologne s’est rendu en Italie aux alentours de 1600, vers l’âge de vingt ans. Comme René Jans a trouvé la trace du peintre à Liège en 1599, 1602 et 1605, on peut supposer que le séjour en Italie fut relativement court. Selon le même Jans, Bologne est resté célibataire et vécut à partir de 1626 au moins dans une spacieuse propriété du faubourg Saint-Laurent, dans la paroisse Sainte-Gertrude. Son jardin jouxtait celui des sépulcrines qui occupaient l’hôpital Sainte-Agathe. Selon Abry, ces religieuses bénéficièrent des largesses du peintre. C’est grâce à cette générosité qu’elles furent à même d’édifier leur nouvelle église. L’artiste testa une première fois le 9 mai 1647. Il laissait ses biens mobiliers et ses rentes à son frère, à ses neveux et à ses nièces, mais il laissait aux sépulcrines sa maison ainsi que la maison voisine, qu’il possédait également. Ses deux exécuteurs testamentaires, les chanoines tréfonciers Jean de Chockier et Adrien-Conrad de Bourgogne, venaient chacun de recevoir une peinture : le Martyre des onze mille vierges pour le premier et la Résurrection du Christ pour le second. Il s’agissait vraisemblablement de tableaux de la main de Bologne lui-même. Celui-ci rédigea un second testament le 23 décembre 1654, quelques jours avant sa mort. Ces nouvelles dispositions étaient plus vagues. Le peintre demandait essentiellement à ses héritiers de veiller à l’érection d’une fondation pieuse. Cette imprécision fut à l’origine du long procès qui opposa les sépulcrines aux parents du peintre, Abry l’avait déjà signalé. Les religieuses eurent finalement gain de cause et purent réédifier leur couvent en 1662-1663. Et Jans de conclure : « Malgré tout ce qui avait été consacré aux Sépulcrines, la multitude des legs, les sommes distribuées aux ‘pauvres et honnêtes ménages’, le reliquat des biens de Jean Bologne put alimenter une fondation, à ce point considérable qu’elle eut sa comptabilité propre et sa répartition particulière aux indigents : c’est ‘l’aumône de Jean Bologne’, dont on avait perdu le souvenir qu’elle portait le nom du peintre ! » On le voit, le surnom de « peintre philanthrope » qui lui octroie Jans est justifié. Le peintre bénéficiait d’une fortune considérable. Selon Abry, il acquit sa fortune grâce à ses nombreux tableaux rapidement exécutés. Toutefois, en dépit de l’assertion de cet auteur, la fortune du peintre paraît avoir été davantage tributaire des biens familiaux dont il avait hérité. Les indications sur les travaux de Jean Bologne sont rares. Abry en cite quelques-uns. À ses dires, l’un des premiers tableaux peints au retour d’Italie fut une Piscine probatique. Il fut posé au-dessus de la sépulture des parents du peintre en l’église des dominicains. Abry le commente en ces termes : « cette pièce est pleine d’activité et d’un grand goût ; son coloris brun est négligé par le peu de couleurs qu’il employait sur ses tableaux, qu’il embauchoit90 assez curieusement, mais qu’il n’achevoit qu’à manière de rehausse quand il retouchoit ». Le tableau dut disparaître assez tôt : il ne figure pas dans le relevé établi par Hamal des œuvres d’art conservées dans les monuments publics de Liège avant la Révolution. Abry cite ensuite les tableaux exécutés pour l’abbaye du Val-Saint-Lambert. Ces tableaux, aux sujets inconnus, furent commandés par l’abbé Gilles de Pas en 1605. Abry les dit « mieux peints et conservés » que la Piscine probatique. Les comptes de l’abbaye mentionnent la participation de Bologne à la décoration du jubé avec son confrère Piron Morea au tout début du XVIIe siècle91 ; peut-être les tableaux évoqués par Abry ornaient-ils ce jubé. Les seules autres productions mentionnées par Abry sont le plafond peint et le retable d’autel réalisés pour le compte de Jean de Chapeaville et placés en l’église Sainte-Gertrude à Liège, église paroissiale du peintre. Ces réalisations ne sont pas citées par le chanoine Hamal dans son répertoire des monuments liégeois ; elles avaient peut-être déjà disparu à la fin du XVIIIe siècle.
89. Breuer, op. cit., p. 106. 90. C’est bien ce terme qui figure dans le manuscrit original d’Abry conservé au château de Warfusée (Ms. 13, f° 108 v°) ; Abry a sans doute voulu dire « esbauchoit ». 91. AEL, Abbayes et Couvents. Val-Saint-Lambert, 386, 8 v°-15 v°. 155
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
En 1616, le peintre se vit commander le retable du maître-autel de l’église abbatiale du Val-Dieu92. Il a sans doute livré le tableau avec retard car il ne fut payé que le 20 septembre 1625 ; il reçut à cette date la somme de 975 florins. Renier suppose que le tableau a disparu dans l’incendie de l’église en 1683. Il sera remplacé par une Annonciation de Renier Panhay de Rendeux aujourd’hui conservée à l’église de Kadier-en-Keer, près de Maestricht. Bologne bénéficie décidément de relations privilégiées avec les communautés cisterciennes. Trois ans après le Val-Dieu, l’abbaye du Val-Saint-Lambert fait appel à ses services pour le retable du maître-autel de leur église. Le 12 mars 1619, il signe un contrat avec l’abbé Paul Fisen à ce sujet93. Le prix du tableau, déjà commencé à la date du contrat, est fixé à 1700 florins, somme exorbitante. La peinture devra être achevée pour la Noël de la même année. Le tableau et « les pièces de peinture des huis » (les volets) seront réalisés « selon qu’entre eulx plus amplement at esté conceu et arresté ». En 1627, une autre communauté cistercienne, celle de l’abbaye de la Paix-Dieu à Jehay, fait appel aux talents du peintre. Les religieuses commandent à cette date une Apparition du Christ à la Madeleine (un Noli me tangere) au peintre Bolonique94. Ce nom renvoie à n’en pas douter à Jean Bologne. On peut par ailleurs se demander si les moniales de la Paix-Dieu n’ont pas fait appel au même artiste huit ans plus tard pour réaliser un grand panneau (180 x 127 cm) représentant la généalogie des cisterciennes depuis Humbeline, la sœur de saint Bernard ; mais ce n’est qu’une conjecture. Ce tableau provenant de la Paix-Dieu se trouve aujourd’hui au prieuré de Marienlof à Kerniel (Borgloon). Sous le Christ représenté les bras ouverts dans une nuée apparaissent trente-trois personnages féminins de la mouvance cistercienne des XIIe et XIIIe siècles : trois de chaque côté de Humbeline et vingt-cinq dans les médaillons qui font figure de fruits sur l’arbre peint au centre du tableau95. En 1629, un peintre « Jan Bollon » reçoit 463 florins et 12 sous pour une peinture et son cadre destinés à la gilde des arquebusiers de Malines96. L’information provient d’un registre de ladite gilde. Traditionnellement, cette mention est mise en rapport avec un tableau conservé au Musée Hof van Busleyden de Malines. Cette grande toile (297 x 400 cm) datée 1630 montre les septante-et-un membres du Serment de l’Arquebuse réunis autour d’un crucifix. Il y a peu de chances qu’elle revienne au maître liégeois, contrairement à ce qu’on répète depuis Helbig. En effet, parmi les maîtres de la gilde de Saint-Luc de cette ville apparaît un peintre Jan de Bolion ; celui-ci a pris en apprentissage un Machiel de Bolion, sans doute son fils ou son neveu, à partir du 23 juillet 163097. Il y a tout lieu de penser que le tableau revient à ce peintre plutôt qu’au presque homonyme liégeois. Ogier Bologne († 1598) Père du précédent, Ogier Bologne, peintre et marchand, fit relief du métier des orfèvres entre 1553 et 155598. Il était alors marié à Anne du Château. Il releva le métier des merciers en 1571. Deux ans plus tard, il reçut en héritage une maison sur le Pont d’Île qui avait appartenu à son père ; celui-ci, Olivier Bologne, fut notaire, historien et peut-être également architecte. En 1574, il fut reçu comme voyageur parmi les confrères qui géraient l’hôpital Saint-Jacques, signe qu’il avait dû effectuer le pèlerinage de Rome. À l’occasion de son admission, il restaura la peinture qui ornait l’autel de la chapelle de l’hôpital99. Le 24 juillet 1574, il céda une partie de son jardin de la maison du Pont d’Île au greffier François 92. Jean-Simon Renier, Historique de l’abbaye du Val-Dieu, Verviers, 1865, p. 184. 93. Yernaux, Lambert Lombard, op. cit., p. 312. 94. Marie-Élisabeth Montulet-Henneau, Contribution à l’histoire des abbayes cisterciennes de la principauté de Liège : la PaixDieu (XVIe-XVIIIe s.), dans Annales du Cercle hutois des sciences et Beaux-Arts, t. 35, 1981, p. 186. 95. Catalogue de l’exposition Filles de Cîteaux au pays mosan (Huy), s.l., 1990, n° 25. Le tableau en question est reproduit en couverture de cet ouvrage. 96. Jules Helbig, La peinture au pays de Liège et sur les bords de la Meuse, Liège, 1903, p. 202. 97. Hyacinthe Coninckx, Le livre des apprentis de la corporation des peintres et des sculpteurs à Malines, Malines, 1903, p. 48. 98. Breuer, op. cit., p. 50. Sauf mention contraire, les informations qui suivent sont tirées de Jans, Jean Bologne…, op. cit., p. 46-47. 99. On ne sait rien de cet autel, qui fut remplacé vers 1630 par un nouveau avec pour retable l’Apparition du Christ à saint Jacques, tableau de Gérard Douffet aujourd’hui conservé au château de Schleissheim, près de Munich. 156
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Streel100. En 1585, il a fourni à la collégiale Saint-Denis deux corporaux et une peinture, probablement de sa main101. En 1587, il est cité avec un de ses neveux, qui lui cède une rente102. Il a fourni du linge d’autel à la même collégiale en 1591. Il testa le 22 mai 1598 et mourut quelques jours plus tard. Lambert Bottin (mentionné entre 1553/1555 et 1572) Fils d’un peintre homonyme (son père ?) qui fut très actif à Liège dans la première moitié du XVIe siècle, Lambert Bottin II est apparemment souvent confondu avec lui. Il releva le métier des orfèvres entre 1553 et 1555, comme Ogier Bologne103. En 1559, il est cité comme gouverneur du métier des orfèvres en compagnie de l’orfèvre Jacques Pestia104. Il est cité pour des rentes en 1563, 1570 et 1572105. Comme sa trace se perd ensuite à Liège, on peut se demander s’il ne se confond pas avec le graveur Lambert Bottin qui épousa Volcxken Diercx, la veuve du fameux éditeur anversois Jérôme Cock (décédé en 1570). Ce Lambert Bottin est mentionné à Anvers à la fin des années 1570 ; il est décédé avant le 17 octobre 1581106. Quoi qu’il en soit, le nom du second époux de Volcxken Diercx induit vraisemblablement une origine liégeoise. Ce personnage pourrait avoir été un lien utile entre les artistes liégeois et la métropole scaldienne. Jean de Bussonville (mentionné en 1606-1608) Ce peintre releva le métier des orfèvres à Liège au cours de la période 1606-1608107. Jean de Clercque (mentionné entre 1585-1589 et 1590-1591) Ce fils du peintre et marchand Henry de Clercque est cité à deux reprises dans les registres d’entrée au métier des orfèvres ; une fois entre 1585 et 1589 (date non précisée) et une fois en 1590-1591108. Il serait tentant de voir en ce peintre marchand le grand peintre bruxellois Hendrick de Clerck, mais ce n’est chronologiquement pas possible, ce dernier étant né vers 1570. Olivier Colson (1595 ?- après 1614) En 1614, Olivier, fils du notaire Jean Colson (ou Colchon), devient l’apprenti du maître peintre Michel Ponceau pour deux ans109. Le contrat prévoit que le maître pourra aussi utiliser l’apprenti dans l’art de la broderie. Il y a fort à parier que ce peintre se confond avec Olivier, fils de Jean Colson et d’une Marguerite, qui a été baptisé à Notre-Dame-aux-Fonts à Liège le 30 mai 1595110.
100. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 366, f° 127 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 101. Manuscrit Yernaux, f° 20. 102. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 418, f° 35 v° (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 103. Breuer, op. cit., p. 50. 104. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 244, f° 212 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 105. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 276, f° 251 ; 331, f° 368 v° ; 346, f° 328 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 106. Joris Van Grieken, In de vier winden / Aux quatre vents (1548-1600). De Antwerpse prentenuitgeverij op wereldschaal. Een stand van zaken, dans Godelieve Denhaene (éd.), Actes du colloque La gravure de la Renaissance dans les Pays-Bas méridionaux, dans Archives et bibliothèques de Belgique, numéro spécial 89, 2010, p. 99. 107. Breuer, op. cit., p. 132. 108. Ibidem, p. 97 et 102. 109. AEL, Notaire G. Milemans à Liège, 17 avril 1614.- Manuscrit Yernaux, f° 144.- Jans, Les peintres liégeois Bertin Hoyoul…, op. cit., p. 194. 110. AEL, Registres paroissiaux de Liège, 2, f° 118 v°. 157
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Willem Coxcie (ca 1545-ca 1597) « Guillaume Cocksien » a pu acquérir le métier des orfèvres en 1572 pour la somme de 16 écus111. Dans l’enregistrement de l’acquêt, il est dit natif de Bruxelles et se trouve cité comme fils de maître Michel, jadis peintre du roi Philippe, en l’occurrence le fameux peintre malinois Michel Coxcie. Il faisait sans doute partie de la cohorte des protestants chassés de la ville d’Aix-la-Chapelle, où ils avaient trouvé un refuge provisoire pour échapper à la répression du duc d’Albe112. Willem Coxcie ne dut guère rester à Liège, puisqu’il s’est marié à Malines en 1574 et qu’il est parti la même année en Italie. Il y fut du reste condamné à dix ans de galères pour ses sympathies hérétiques ; c’est grâce aux relations de son père qu’il fut tiré d’affaire113. Lambert Damery (ca 1545-1622) Né vers 1545, ce peintre, graveur et géomètre fut actif à Liège à la charnière des XVIe et XVIIe siècles. Il est le premier membre de ce qui fut, au dire de René Jans, la plus importante dynastie de peintres liégeois (dynastie au nombre de laquelle il faut compter les Lairesse)114. Cette dynastie, il faut le répéter, n’a aucune parenté avec la famille des peintres Jacques, Laurent et Walthère Damery. Lambert Damery (alias Damri ou Damerier) est ignoré par Abry ; on doit donc beaucoup à René Jans, auquel est repris l’essentiel des informations biographiques qui suivent. Damery fut émancipé par son père en septembre 1568, il n’avait donc pas vingt-cinq ans à cette date. Il releva le métier des brasseurs en 1572, celui des orfèvres en 1573115 et celui des entretailleurs de draps en 1578. Il épousa en 1573 Marie Kettenis et acquit une maison dans la rue du Pot d’Or, au coin de l’actuelle rue du Mouton blanc. La même année, il fut admis parmi les confrères de l’hôpital Saint-Jacques ; il entra au titre de bourgeois et non de voyageur, ce qui laisse penser qu’il n’est pas allé à Rome. Il est qualifié de peintre à différentes reprises dans les documents. En 1602, il acheta une maison à l’enseigne des Trois Pucelles, derrière l’église des dominicains ; cette maison portera plus tard l’enseigne du Lion d’or et appartiendra aux peintres Jean Taulier et Renier de Lairesse. Il orna notamment de gravures divers ouvrages de mathématiques et d’astronomie. Il a lui-même écrit un traité de géométrie ; le manuscrit se trouve à la Bibliothèque nationale de France. Le Musée de la Vie wallonne à Liège conserve un astrolabe qu’il a réalisé en 1600. Il s’identifie sans doute avec le Damery qui a peint une Nativité sur bois en 1608 pour la deuxième chapelle de droite en la collégiale Saint-Paul à Liège116. Ce tableau fut commandé par le chanoine Albert de Limbourg ; il a disparu à la fin du XVIIIe siècle. Lambert est mort le 12 août 1622 dans la paroisse SaintAdalbert. Il est le père du graveur de monnaies Léonard Damery, du peintre Simon Damery I et le beaupère du peintre d’origine bruxelloise Jean Taulier. On peut d’ailleurs se demander si, à son arrivée à Liège, ce dernier n’a pas été le collaborateur de Lambert Damery. Simon Damery (avant 1592-1630 ?) Simon Damery a fait l’objet de diverses confusions dans le chef de Louis Abry117. Ce dernier lui a consacré une notice substantielle qui atteste la réputation acquise par ce peintre de son vivant, alors qu’il avait 111. Breuer, op. cit., p. 73. 112. Cf. infra la notice consacrée à Hans Vredeman de Vries. 113. Carine Dechaux et Joke Vandermeersch, s.v. Coxcie, dans Dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours, t. 1, Bruxelles, 1994, p. 218. 114. René Jans, D’autres peintres Damery (et apparentés, Taulier et les Lairesse) qui ont compté, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 101, 1989, p. 49. Pour la biographie de Lambert Damery, voir p. 53-55. 115. Breuer, op. cit., p. 75. 116. Hamal, op. cit., p. 224. 117. Abry, op. cit., p. 205-207. 158
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
accompli toute sa carrière en Italie. Saumery s’est contenté quasi exclusivement de paraphraser cette notice en l’enjolivant118. René Jans, une fois encore, a fourni quelques précisions importantes tirées des archives liégeoises119. Simon est le fils du peintre Lambert Damery, déjà évoqué (et non d’un autre Simon comme l’affirme Abry). Il est le père d’un Simon, peintre également, avec lequel il a parfois été confondu. Abry ne fixe pas l’année de sa naissance. De l’avis de Jans, celle-ci est nécessairement antérieure à 1592, année de naissance d’un frère cadet de Simon. Selon Abry, Simon a pour premier maître son futur beau-frère Jean Taulier, peintre d’origine bruxelloise installé à Liège. On peut cependant supposer, à la suite de Jans, que Lambert, son père, ne dut pas être étranger à la première formation du jeune garçon. Très jeune, trop au dire d’Abry, Simon prend le chemin de Rome. L’étude des grands maîtres l’amène à changer sa manière et à les imiter. Écrivant à l’époque romantique, Adolphe Siret enrobe une réalité trop prosaïque à son gré : Damery, après avoir été l’élève de Jean Taulier, se serait enfui de la maison paternelle pour visiter l’Italie120. La date du séjour ultramontain n’est pas connue, mais il y a tout lieu de penser que Simon arrive à Rome avant 1610. La date de 1616 proposée par Helbig est sans réel fondement121. Damery trouve une ville en pleine agitation artistique. Aux derniers ferments du maniérisme se confrontent à cette époque deux grands courants qui vont révolutionner la peinture du Seicento : le ténébrisme hérité du Caravage et l’éclectisme issu de l’école bolonaise. Nul doute que Simon Damery tire profit de ce climat d’effervescence culturelle. Abry ne semble pas dire autre chose, avec le langage fleuri qui est le sien : « (...) il sut profiter de tant de belles choses qu’il voyoit tous les jours et qui l’excitoient à changer de manière, sur le modèle de ces savants maîtres qu’il méditoit avec grande application ». Le seul souvenir précis de son séjour romain est fourni par un document se rapportant à l’emprisonnement du peintre. Celui-ci est consécutif à un différend qui, le 18 avril 1616, l’oppose à un confrère nommé Enrico Quando122. Damery vit alors dans une résidence appelée le palais Caballuti – cette résidence n’a pu être identifiée. Non content de pratiquer la peinture, il en exerce également le négoce. Il a commandé à Enrico Quando – peintre non identifié par ailleurs – deux tableaux : une Arrestation du Christ et un Repas d’Emmaüs. Quando porta plainte contre Damery parce que celui-ci refusait de lui payer la somme convenue pour les deux tableaux. Le Liégeois s’est justifié en expliquant que le second tableau était demeuré inachevé. Damery accusa les peintres Enrico Quando et Lucca Neuli, alias Lucas Van Nevele, de l’avoir fait incarcérer injustement par un faux témoignage. Damery doit prendre le chemin du retour peu après cette date. Il s’arrête à Milan, où il entend travailler quelque temps. Il collabore avec un peintre dont Abry ne cite pas le nom mais qu’il qualifie de « maître de réputation ». Le peintre liégeois épouse la fille de ce maître, en 1620 au plus tard, et s’installe définitivement dans la capitale lombarde. Grâce à des documents d’archives liégeois, René Jans a identifié le maître milanais concerné. Il s’agit de Vincenzo Lavezzone, totalement inconnu par ailleurs. Simon Damery et Magdalena Lavezzone auront quatre enfants. L’aîné, Simon, était dit âgé de vingt ans en 1640. Damery mourut de la peste à Milan. En 1640, affirme Abry. Mais c’est en 1630 que la ville de Milan fut victime d’une grande épidémie de peste : plus de 140.000 personnes périrent en cette circonstance. Jans ayant démontré que Simon Damery était déjà décédé en 1633, il y a tout lieu de croire qu’il est décédé en Lombardie en 1630. Simon avait maintenu le contact avec sa terre natale. Au dire d’Abry, il y avait même envoyé bon nombre de ses tableaux. De retour de Rome en 1625, le Liégeois Guillaume de Fayn acquit ainsi à Milan divers tableaux de Damery pour décorer sa maison de Fayenbois à Jupille. Le peintre avait aussi réalisé divers portraits, des « portraits à charnières », dit Abry ; celui-ci fait sans doute allusion à des diptyques ou à
118. [Pierre-Lambert de Saumery], Les délices du païs de Liège, t. 5, 2e partie, Liège, 1744, p. 328-330. 119. René Jans, D’autres peintres Damery…, op. cit., p. 56-58. 120. Adolphe Siret, Dictionnaire historique des peintres de toutes les écoles depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, Bruxelles, 1848, p. 20. 121. Helbig, op. cit., p. 322. 122. Antonio Bertolotti, Artisti belgi e olandesi a Roma nei secoli XVI e XVII, Florence, 1880, p. 90. 159
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
des volets de triptyques. Damery avait aussi exécuté deux grands tableaux pour la chapelle des Flamands de la cathédrale Saint-Lambert : une Vierge à l’Enfant (?) – Abry évoque de son côté une Vierge avec des enfants – et un Christ tenant sa croix. Le même auteur précise que ces tableaux avaient disparu et s’étaient retrouvés chez des particuliers. C’est peu vraisemblable, car Hamal cite nommément deux tableaux de Simon Damery conservés en la chapelle des Flamands à la fin du XVIIIe siècle123 : l’Annonciation de la Vierge et Notre Seigneur apparaissant à la Madeleine – ce dernier pourrait correspondre au second tableau signalé par Abry. Selon le baron de Villenfagne, Liège ne conservait que deux tableaux du peintre en 1779124 ; il s’agit sans nul doute de ces deux tableaux de Saint-Lambert. Cela indique en tout cas combien Simon Damery sombra rapidement dans l’oubli à Liège.
Fig. 12 : Simon Damery I ?, Apollon et Daphné, dessin, Liège, Cabinet des Estampes. © IRPA-KIK, Bruxelles.
Ses seules œuvres encore connues sont les sept dessins conservés au Cabinet des Estampes de Liège qui lui sont attribués sur la base d’une annotation de Hamal à la fin du XVIIIe siècle125. Mais que vaut l’attribution ? Nous sommes bien en peine de le dire. Ces croquis au crayon sont traités de manière assez confuse. Les lignes s’entrecroisent de manière anarchique, traduisant une annotation rapide. Le plus grand de ces dessins, Apollon et Daphné (18 x 25 cm ; fig. 12), illustre bien ce manque de maîtrise. L’annotation disegno originale qui figure au bas de ces dessins et renvoie à l’Italie – ne serait-ce pas la principale raison de l’attribution à Simon Damery ? – semble tardive.
123. Hamal, op. cit., p. 219. 124. Hilarion-Noël de Villenfagne, Discours préliminaire, dans Œuvres choisies du baron de Walef, Liège, s.d. [1779], p. 20. 125. Didier Bodart (La ‘Bacchanale de putti’ par Walthère Damery à la Pinacothèque nationale de Sienne, dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, t. 9, n° 201, 1978, p. 264) a fait justice de l’attribution à Simon Damery d’un tableau conservé à la Pinacothèque de Sienne signé et daté « Damery 1649 » ; il s’agit d’une œuvre caractéristique de Walthère Damery. 160
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Que vaut par ailleurs l’attribution à Simon Damery (le père ou le fils ?) de deux Vanités sur toile (42 x 32 cm) présentées à la vente des tableaux de J. de Senezcourt (Bruxelles, 27-28 décembre 1866, n° 163) ? On ne peut répondre à cette question. Le 20 décembre 1999 est passée en vente à l’hôtel des ventes Gioffredo à Nice (n° 141) une Annonciation sur cuivre (42,5 x 30,5 cm) dont le vendeur avait toujours considéré qu’elle était de la main de Walthère Damery. Cette déduction se fondait selon toute apparence sur une trace de signature figurant au revers du cuivre. Ce beau tableau tardo-maniériste conjugue les influences flamande et italienne, un peu à la manière de Calvaert126. On peut se demander – mais c’est pure conjecture – s’il ne pourrait s’agir d’une œuvre du peintre lombardo-liégeois. Henri Desneux († 1618) Selon Abry, Henri Desneux (alias d’Esneux ou d’Esseneux) serait à compter au nombre des disciples de Lambert Lombard127. Il faut sans doute entendre le terme « disciple » au sens large. Au titre de mari de Catherine, fille du peintre Gilles Hardy, Henri relève le métier des orfèvres en 1579128. Il a vraisemblablement été auparavant l’apprenti ou l’ouvrier de Gilles Hardy. Curieusement, il est encore repris sous l’année 1583, comme fils d’un autre Henri, dans la liste des membres entrés cette année-là dans le même métier129. Peut-être y eut-il à Liège deux peintres homonymes tout à fait contemporains. Au vu du faible écart entre les deux dates, on aura cependant peine à voir dans ce second Henri le fils du premier, comme le propose Jean Yernaux130. Henri Desneux reçoit, via sa femme, 6 florins le 20 février 1598 pour un portrait du prince-évêque Ernest de Bavière destiné à un prince étranger131. En 1612, il comparaît devant les échevins de Liège pour un transport de rente opéré en sa faveur par André Jaspar132. Il vivra dans l’ancienne demeure de son beaupère dans l’actuelle Féronstrée, non loin de la porte Saint-Léonard, en la paroisse Saint-Thomas133. Il est mort là le 14 février 1618134. Il est le père du peintre Jean Desneux, qui suit. Jean Desneux (mentionné entre 1606 et 1631) Fils du précédent, il relève le métier des orfèvres à Liège en 1606 au titre de fils du peintre Henri Desneux135. De 1623 à 1631 au moins, il figure à plusieurs reprises dans les comptes de la cathédrale Saint-Lambert pour de menus travaux dont la teneur n’est pas précisée136. Il se confond peut-être avec le Jean Desneux époux d’une Catherine qui vivait dans la paroisse Saint-Georges et qui eut trois enfants entre 1613 et 1621137. André le Dosket (mentionné en 1602) Fils de Constant le Dosket, Andrien relève le métier des orfèvres à Liège en 1602138. 126. La composition est en fait tirée d’une gravure de Jan Sadeler I d’après une composition de Pieter de Witte, dit Candido. 127. Abry, op. cit., p. 168. 128. Breuer, op. cit., p. 84. 129. Ibidem, p. 92. 130. Yernaux, Lambert Lombard, op. cit., p. 309-310. 131. Alexandre Pinchart, Archives des arts, sciences et lettres, t. 2, Gand, 1863, p. 321. 132. Manuscrit Yernaux, f° 55. 133. René Jans, Un important peintre liégeois du XVIIe siècle, dont aucune œuvre n’est connue : Alexandre de Horion, dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, t. 10, n° 225, 1984, p. 480. 134. AEL, Registres paroissiaux de Liège, 287, n° 362. 135. Breuer, op. cit., p. 130 et 132. 136. Archives de l’Évêché de Liège, Cathédrale, B.II.16, 24 novembre 1623, 1624 ; B.II.17, 16 octobre 1627 et 11 octobre 1631 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 137. AEL, Registres paroissiaux de Liège, 161, 12 mars 1613, 21 octobre 1617, 4 novembre 1621. 138. Breuer, op. cit., p. 123. 161
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Gérard Douffet (1594-1661) La notice exceptionnellement longue que consacre Louis Abry139 à ce peintre confirme le rôle-pivot joué par cet artiste, déjà célébré de son vivant par le peintre et poète namurois Florent du Rieu140 : « N’oubliez pas Doufet, esprits ingenieux, Ses desseins sont hardis, ses traits sont precieux (…) ». Si l’on en croit Abry, Gérard Douffet est né le 6 août 1594 des œuvres du prélocuteur homonyme et de Marie le Spineux. Les registres de baptême de la paroisse Saint-Adalbert de cette époque ayant disparu, on doit bien se fier au témoignage d’Abry ; mais celui-ci est d’autant plus crédible que la précision de la date induit que le biographe a consulté les registres paroissiaux. Dès l’âge de douze ans, Douffet relève le métier des orfèvres, ce qui indique une vocation précoce141. Il reçoit d’abord une première formation chez un voisin de la maison familiale, Jean Taulier, un peintre bruxellois installé à Liège ; celui-ci joua un rôle non négligeable dans sa cité d’adoption, notamment comme « fondateur » de la dynastie des Lairesse (cf. infra). Le jeune Douffet est par la suite accueilli à Dinant chez un maître inconnu prénommé Perpète. Toujours selon Abry, il aurait fréquenté l’atelier de Rubens de 1612 à 1614. C’est peu vraisemblable, même s’il est possible que Douffet se soit rendu à Anvers à cette époque. À son retour d’Anvers, il peint une Judith (tableau disparu) d’après Rubens, sans doute d’après la Grande Judith gravée par Corneille Galle l’Ancien. Il peint aussi à cette époque un Supplice de Prométhée (tableau qui se trouvait chez un baron de Villenfagne à Bruxelles vers 1910 et qui a disparu depuis lors). Toujours selon Abry, Douffet part pour Rome au cours de cette même année 1614. Il aurait travaillé là notamment pour « le peintre du cardinal de Médicis » et se serait lié d’amitié avec les grands peintres caravagesques Valentin de Boulogne et Bartolomeo Mandredi. Dès son séjour romain, il se serait spécialisé dans l’art du portrait. Les archives romaines le documentent avec certitude en 1620 et 1622. Selon les Stati d’anime, il partage ces années-là le logement de son compatriote Tilman Woot de Trixhe, futur peintre jésuite, de Valentin de Boulogne ainsi que d’un sculpteur lorrain du nom de David Lariche. Par ailleurs, Douffet se confond très probablement avec le Gerardo pitor qui est répertorié en 1619 avec le Toulousain Nicolas Tournier. D’autres mentions dans les archives romaines de peintres Gerardo, entre 1615 et 1623, pourraient se rapporter à lui. Il a par ailleurs peut-être fait partie de la Schildersbent, confrérie festive qui regroupait nombre de peintres flamands et hollandais. Il fut en tout cas très proche des peintres caravagesques du courant de la Manfrediana methodus. C’est pourquoi il a parfois été identifié, à tort, avec le Maître du Jugement de Salomon, un peintre manfrédien au tempérament plus classicisant que la plupart de ses congénères142. Malgré de multiples tentatives d’attributions depuis une soixantaine d’années, on ne connaît à ce jour aucun tableau de sa période italienne. Après un séjour à Malte et à Naples, il repart pour Liège via Venise avec ses confrères et concitoyens Tilman Woot de Trixhe et Michel Houbar. Rentré à Liège en 1623 ou 1624, il réalise bientôt, pour un bénédictin de l’abbaye de Saint-Laurent, dom Charles Hardy, une Invention de la sainte croix (Neuburg, Staatsgalerie). Ce morceau capital (309 x 367 cm) fait figure de tableau-manifeste de la nouvelle école liégeoise (fig. 13). Douffet s’affirme sur la place de Liège en rompant avec le maniérisme des suiveurs de Lambert Lombard et en imposant un style caravagesque tempéré, plus proche de Vouet que de Manfredi. Ses effets de lumière et le naturalisme restent 139. Abry, op. cit., p. 181-204. Sur Douffet, voir essentiellement : Helbig, op. cit., p. 219-242 ; Gustave Jorissenne, Les œuvres de Douffet, dans Chronique archéologique du pays de Liège, t. 5, 1910, p. 96-101 ; Pierre-Yves Kairis, Le peintre Gérard Douffet (15941660), fondateur de l’école liégeoise du XVIIe siècle, mémoire de licence en histoire de l’art et archéologie, Université de Liège, 1982 ; Idem, Le peintre Gérard Douffet, fondateur de l’école liégeoise du XVIIe siècle, dans Bulletin de la Classe de Beaux-Arts. Académie royale de Belgique, 5e série, t. 70, 1988, p. 40-54 ; Idem, s.v. Douffet Gérard, dans Allgemeines Künstler-Lexikon, t. 29, Munich et Leipzig, 2001, p. 195-197. 140. [Florent du Rieu], Les tableaux parlans (sic) du peintre namurois, Namur, 1658, p. 16. 141. Breuer, op. cit., p. 137 et 153. 142. Ce peintre anonyme a été depuis peu identifié, de manière audacieuse, au jeune Ribera dans sa production romaine des années 1610 (Gianni Papi, Jusepe de Ribera a Rome e il Maestro del Giudizio di Salomone, dans Paragone, t. 44, 2002, p. 21-43 ; Nicola Spinosa, Ribera, Naples, 2003, p. 26-47). 162
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
modérés par rapport au Caravage et à ses principaux disciples ; de larges zones claires se détachent du fond et mettent les figures en évidence. Celles-ci sont rendues dans leur rusticité plébéienne, les modèles sont traduits sans noblesse aucune. Les personnages de grandeur nature, la palette dominée par les bruns et l’espace sans véritable profondeur sont des traits qui ressortissent également au caravagisme. Au contraire de ses modèles italiens, Douffet n’a cependant pas conféré de concision à sa composition ; la surabondance d’acteurs secondaires rend la scène un peu confuse. C’est un défaut fréquent chez le peintre que cette absence d’unité et cette impression de remplissage. Les gestes théâtraux et les attitudes figées dénoncent un art un peu froid, très pondéré, bien éloigné de la vitalité des grands morceaux de bravoure des peintres anversois contemporains. L’absence de dynamisme se retrouve en quelque sorte dans la psychologie des personnages : les visages sont graves et impassibles, guère expressifs. Le groupe des jeunes femmes en bas à droite constitue peut-être le plus beau morceau jamais peint par Douffet, en particulier par le raffinement des draperies, typiques de l’artiste : plis aigus, serrés, abondants, souvent cassés et enchevêtrés, creusés d’ombre. Les effets lumineux, le type de drapés, la surabondance de personnages ainsi qu’une certaine rusticité chez ceux-ci, tous ces traits de cette révolutionnaire Invention de la sainte croix marqueront durablement les peintres liégeois des générations postérieures.
Fig. 13 : Gérard Douffet, Invention de la sainte croix, toile, Neuburg, Staatsgalerie. © Cliché Direktion der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Munich.
Les premiers portraits de sa période liégeoise, tels ceux de ce couple conservés au Musée de l’Art wallon à Liège (101 x 78 cm et 99 x 75 cm), présentent une synthèse originale, et remarquable, du vérisme caravagesque et des mises en page comme du sens du réalisme des peintres flamands (fig. 14 et 15). La carrière de Douffet est maintenant lancée. Elle déborde du cadre du présent répertoire. 163
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 14 : Gérard Douffet, Portrait d’homme, toile, Liège, Musée de l’Art wallon. © IRPA-KIK, Bruxelles. 164
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Fig. 15 : Gérard Douffet, Portrait de femme, pendant du précédent, toile, Liège, Musée de l’Art wallon. © IRPA-KIK, Bruxelles. 165
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Antoine Durbuto (après 1580-1634) Le nom d’Antoine Durbuto (Durbuito, Durbut, Durbuthoz) est passé à la postérité par la grâce de Louis Abry et pour un seul motif : il fut le premier maître de Walthère Damery143. Encore Abry le qualifie-t-il de « peintre assez médiocre, propre cependant et curieux dans ses couleurs, duquel on a assez de preuve de sa capacité ». Et Abry de citer le tableau du maître-autel de l’église des cisterciennes de Robermont et les tableaux des deux petits autels à l’entrée du chœur de l’église de la chartreuse de Liège. Ces tableaux ont certainement disparu dans le courant du XVIIIe siècle. Hamal ne les cite en effet pas dans son répertoire des monuments de Liège. Il ne mentionne du reste aucun autre tableau de Durbuto. Pourtant, Abry affirmait au début du XVIIIe siècle qu’il s’en voyait beaucoup à Liège. Selon le même auteur, le retable de l’autel majeur de Robermont était une pièce « remplie de travail et de couleurs conservées dans leur fraîcheur ». Cela n’a pas empêché les religieuses, quelques années à peine après ce témoignage, de remplacer ce tableau par une Assomption de la Vierge de Fisen (datée 1721) qui se trouve aujourd’hui à la cathédrale de Limoges. Malgré son bon état de conservation, le tableau de Durbuto apparaissait démodé. Ce manque de modernité explique la disparition, au cours du XVIIIe siècle, de ses tableaux présentés dans les églises de Liège. L’infatigable René Jans a retracé le parcours de Durbuto d’après les archives144. Ce peintre est issu du mariage d’Antoine Durbuto et Agnès Germeau. Après son veuvage, Agnès acquiert ou relève le métier des orfèvres en 1598145. Elle désire sans doute faciliter l’accès de son fils au métier ; à cette date, il doit déjà être engagé sur la voie de la peinture. Antoine et son frère Grégoire sont émancipés par leur mère en 1604, preuve qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de vingt-cinq ans. Le 23 février 1606, le peintre est le parrain d’un fils de son frère Grégoire, drapier de son état. Vers 1611, il épouse Marguerite Gérard, fille d’un marchand. Il aura de celle-ci deux filles, nées en 1612 et 1613. Le 26 février 1613, il acquiert d’un oncle de son épouse une maison en Neuvice (paroisse Saint-André), à l’enseigne de l’Homme sauvage. Bientôt veuf, il ne tarde pas à se remarier. Sa seconde épouse, Françoise Maitre, est la fille d’un brasseur. Elle lui donnera quatre enfants, nés entre 1616 et 1623. Le peintre et son épouse testeront le 15 novembre 1624, quelques jours avant le décès de celle-ci. Le couple ne vivait pas dans la gêne. On en jugera par la clause du testament qui prévoit que les enfants issus du couple disposeront de 400 florins à leur majorité. Dans les semaines ou les mois qui ont précédé son nouveau veuvage, Durbuto avait relevé le métier des charpentiers. Divers actes d’archives le mentionnent encore dans les années 1620 et 1630. À la fin de sa vie, il se trouvera dans une situation matérielle difficile. Selon René Jans, ces difficultés ne sont peut-être pas étrangères à sa fin prématurée, dans le courant de l’année 1634. Un inventaire après décès a été établi, le 9 décembre 1634, probablement à la requête de ses créanciers. Ce recensement, largement publié par Jans, comprend de nombreux tableaux. Comme toujours avec ce type de document, il est bien difficile de dire lesquels étaient de la main du peintre défunt. Seuls les tableaux inachevés laissent à penser qu’ils étaient de Durbuto. On trouve parmi ces tableaux inachevés tant des peintures religieuses (Saint Jean) ou allégoriques (Sept arts libéraux) que des portraits et des paysages. Cela montre combien les petits maîtres de second plan travaillaient tous les genres, loin de toute spécialisation. Les noms des modèles de plusieurs portraits sont précisés : feu le docteur Castro, le roi de Suède (Gustave-Adolphe, mort en 1632), feu le suffragant (Étienne Stregnart, mort en 1628), feu l’échevin Halynx et sa femme (Jean de Haling, mort en 1633, et son épouse Béatrice Lupus), Jaminet et sa femme, Raymondi. On le voit, plusieurs portraits représentaient des personnages décédés depuis peu, comme si le peintre avait perdu la commande suite à ce décès. Les tableaux les mieux prisés dans cet
143. Abry, op. cit., p. 226-227. 144. René Jans, Le peintre Antoine Durbuto, maître de Walthère Damery, dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, t. 10, n° 213, 1981, p. 33-37. 145. Breuer, op. cit., p. 316. 166
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
inventaire sont une Adoration des Mages, estimée à 20 florins, et trois « prospects » (vues), dont un de Saint-Lambert, évalués chacun à 18 florins. Cet inventaire comprend également les accessoires nécessaires au travail du peintre. À commencer par des gravures, qui constituaient un matériel précieux dans lequel l’artiste puisait des modèles. On trouve enfin une tête en bronze, des boîtes, des pots, des bacs, sept à huit palettes, des pinceaux, un chevalet et, plus mystérieux, trois « pierres à crayon », du « papier à armoirier », des « feuilles de dessin aux armoiries », une « boîte d’épitaphes » (sans doute pour les obits), des « minutes de couleurs » et un « corps de figures en couleur ». À propos du portrait de l’échevin de Haling mentionné dans cet inventaire, signalons qu’un château situé sur la commune d’Anhée conserve un portrait en miniature censé représenter ce personnage. Cette miniature est d’une sécheresse qui rappelle les œuvres que j’attribue à Alexandre de Horion. Ce qui devrait être à la mesure du modeste Durbuto. Serions-nous en présence d’un de ses tableaux ?
Fig. 16 : Antoine Durbuto ?, Adoration des Mages, toile, Fosses-la-Ville, église Saint-Feuillen. © IRPA-KIK, Bruxelles.
Hormis les mentions de l’inventaire après décès et les trois tableaux évoqués par Abry, on ne connaît rien de la production de Durbuto. Suite à la publication de l’article de René Jans, feu José Quitin a signalé à l’auteur la mention d’une Adoration des Mages réalisée en 1624 par Durbuto pour la collégiale SaintFeuillen à Fosses-la-Ville146. Or, une Adoration des Mages archaïsante est encore conservée dans cette église (fig. 16). Elle pourrait correspondre au tableau de 1624. Cela reste cependant du domaine de
146. René Jans, Les frères Henri et Matthieu Trippet, peintres liégeois du Liège, t. 11, n° 232-233, 1986, p. 147.
XVII
e
siècle, dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-
167
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
l’hypothèse car cette Adoration des Mages (110 x 143 cm) semble avoir pour pendant une Adoration des bergers (± 117 x 147 cm) conservée dans la même église ; et ce second tableau n’a pas été mentionné par J. Quitin. La composition de l’Adoration des Mages ne manque pas d’originalité, avec une vaste ouverture de paysage à l’arrière-plan. La scène principale occupe la moitié droite de la composition. La Vierge paraît assise sur un trône et, tandis que son corps est vu de trois quarts, son visage offre un profil très pur. À le comparer avec le visage des anges ou de Joseph, tous derrière la Vierge, on constate que le peintre a cherché davantage de noblesse pour le rendu du visage de la mère de Dieu. À n’en pas douter, cette scène est reprise à une gravure (italienne ?) du XVIe siècle qui reste à découvrir. Quant à la partie gauche de la composition, elle est entièrement occupée par un cavalier et sa monture vus de dos. Au contraire de la partie gauche, celle-ci est probablement d’invention. Les multiples erreurs de dessin et de perspective montrent les limites de l’auteur de cette peinture. De tels défauts se retrouvent également dans le pendant. Si le tableau correspond effectivement à l’Adoration des Mages de Durbuto repérée par M. Quitin, il serait l’exact contemporain de l’excellente Invention de la sainte croix de Gérard Douffet, œuvre qui annonçait en 1624 une ère du renouveau pour la peinture au pays de Liège. Le caractère ô combien naïf du tableau de Durbuto ressort davantage encore de cette comparaison. Jean Fevet (mentionné en 1590) Ce peintre a relevé le métier des orfèvres en 1590147. Renier Flémal I (ca 1552-1611) René Jans a remarquablement démêlé l’écheveau de la famille du célèbre Bertholet Flémal148. Grandpère de Bertholet, Renier I était le fils du notaire Jean de Flémal(le) et de Gillette Lamarche. Il naquit vers 1552. Orphelin très jeune, il fut confié à sa grand-mère maternelle. Il devint bientôt peintre sur verre, releva le métier des orfèvres vers 1581-1583149, puis celui des merciers en 1586. De son épouse Hubertine Boelen, il eut cinq enfants entre 1585 et 1597 ; ils sont tous nés dans une paroisse de Liège différente. Renier Flémal I acheva son existence dans la maison du Cerf volant qu’il possédait sur le Pont d’Île, dans la paroisse Saint-Adalbert. Il est décédé là le 16 juillet 1611. Hamal attribue à « Renier Flémale père » le vitrail de la Sainte Famille qui surmontait l’autel de la chapelle du Crucifix des Miracles à Saint-Lambert ainsi que la grande verrière ornée de grisailles qui se trouvait à côté150. Reste à voir si ce « Renier Flémale père » correspond bien à Renier I et non à son fils Renier II (qui suit). Jans fait par ailleurs mention d’une information inédite découverte par Jacques Breuer : un tableau de l’Adoration des Mages daté 1590 et exécuté par un Flémal aurait été donné à l’abbaye du Val-Benoit par Raes d’Ans et son épouse Barbe de Horion. Ce qui permet de déduire que Renier I, le seul Flémal à qui peut revenir ce tableau, ne fut pas exclusivement peintre sur verre. Renier Flémal II (1585-1640/1641) Le père du grand Bertholet fut, comme Renier Flémal I, peintre verrier151. Il est baptisé à Liège, plus précisément à Notre-Dame-aux-Fonts, le 16 décembre 1585152. Il relève le métier des orfèvres en 16091610153. Le 19 octobre 1609, il épouse à Saint-Adalbert Agnès Soiron, fille d’un boulanger de la paroisse
147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 168
Breuer, op. cit., p. 102. René Jans, Bertholet Flémalle et sa famille, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 101, 1989, p. 73-80. Breuer, op. cit., p. 89. Hamal, op. cit., p. 216. Jans, Bertholet Flémalle…, op. cit., p. 77-79. AEL, Registres paroissiaux de Liège, 1, f° 39.- Jans, Bertholet Flémalle…, op. cit., p. 76. Breuer, op. cit., p. 142.
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Saint-Jean-Baptiste154. Peu après son mariage, Renier II achète une maison à l’entrée de Hors-Château, dans la paroisse Saint-André. Là naîtront les trois premiers de ses six enfants : Renier en 1610, Sophie en 1612, Bertholet en 1614. Le 12 juin 1613, Renier reconnaît avoir reçu comme apprenti verrier pendant un an Jean de Bodeur, de Malmedy155. En 1615, il vend la maison de Hors-Château et s’installe dans la maison paternelle du Cerf volant, au Pont d’Île. C’est là que naît Guillaume en 1617. L’année suivante, il se défait à nouveau de cette maison et retourne en Hors-Château, cette fois dans la paroisse Saint-JeanBaptiste. Là naîtront ses derniers enfants : Agnès en 1621 et Henri en 1624. Les quatre fils du couple Flémal-Soiron exerceront tous une activité artistique. Louis Abry l’explique ainsi156 : « le père [Renier II], naturellement incliné pour les belles sciences, n’oublia rien pour les instruire ; il leur fit enseigner la musique chez soi et à dessiner ; il savoit l’importance de ces deux arts, et pour les y accoutumer, il les tint courts et renfermés dans une chambre tout le temps qui leur étoit désigné pour leurs leçons ». Renier II connaît bientôt d’importants déboires financiers et de multiples procès. Il meurt à la fin de l’année 1640 ou au début de l’année 1641. On sait peu de choses de son activité professionnelle. En 1614, Renier II, « maistre fort expert en Liége » demande 74 livres et 5 sous pour réaliser, aux frais de la Ville de Namur, douze verrières portant les armoiries des échevins locaux157. Ces verrières sont destinées à la « maistresse chambre » de l’auberge tenue par Laurent Le Beau. Le 23 avril 1627, il reçoit 5 florins et 2 patards d’Henri de Salme, futur chanoine de Saint-Paul à Liège, pour une verrière destinée à la maison d’un certain Picquart158. Comme son père, il paraît avoir exercé l’art de la peinture sur un mode mineur. Hamal lui attribue une Nativité sur bois, de 1622 ; elle ornait l’autel de la troisième chapelle du bas-côté sud de la cathédrale Saint-Lambert159. Gilles de Fraipont († 1623) Le peintre bourgeois de Liège « Giele » (de) Fraipont est mentionné dans le testament que son frère Mathieu rédigea, le 11 septembre 1610, au moment de son entrée chez les dominicains de Boneffe160. Gilles et Mathieu sont les frères de Jean de Fraipont (cf. infra), mentionné aussi dans ce testament mais sans titre de peintre. Le 1er octobre 1623, Gilles de Fraipont et son épouse Marguerite de Gomzé effectuent un prêt à un certain Gyon, d’Andoumont161. Les deux époux testent ensemble le 8 novembre 1623162. Gilles meurt quelques jours plus tard. Il se confond peut-être avec le Gilles, fils de Toussaint Fraipont et de son épouse Marie, qui a été baptisé à Notre-Dame-aux-Fonts le 6 avril 1586163. Jean de Fraipont (mentionné en 1610 et 1615) De même que son frère le peintre Gilles de Fraipont, Jean est mentionné dans le testament que son frère jumeau Mathieu a rédigé, le 11 septembre 1610, au moment de son entrée à l’abbaye de Boneffe. Mais
154. AEL, Registres paroissiaux de Liège, 74, p. 175.- Jans, Bertholet Flémalle…, op. cit., p. 77. 155. Joseph Brassinne, Documents relatifs à des artistes mosans, dans Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois, t. 10, 1912, p. 187. 156. Abry, op. cit., p. 210. 157. Ferdinand Courtoy, Quelques métiers d’art à Namur du XVe au XVIIIe siècle, dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 38, 1927, p. 301. 158. Maurice Yans, Les chanoines de Salme, bienfaiteurs de la collégiale Saint-Paul au XVIIe siècle, dans Chronique archéologique du pays de Liège, t. 57, 1966, p. 58. 159. Hamal, op. cit., p. 208. 160. AEL, Échevins de Liège. Convenances et testaments, 52, f° 272 v°-274 v°. 161. AEL, Cour de Jupille, 84, f° 14 v°-15 v° (comm. Père P. Guérin). 162. AEL, Échevins de Liège. Convenances et testaments, 91, f° 150 v° (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 163. AEL, Registres paroissiaux de Liège, 1, f° 51. 169
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
il n’est pas sûr qu’il fût déjà peintre à cette époque. Le 11 avril 1615, Jean (de) Fraipont, fils des défunts Mathieu et Barbe Herkenroede, rédige son testament avant son départ pour l’Italie, où il compte aller « apprendre lart et stil de pindre touttes sorte dessigns »164. Il laisse l’essentiel de ses biens à l’abbaye de Boneffe ; le testament est d’ailleurs rédigé dans cette abbaye. Mathieu de Fraipont (mentionné vers 1619) Par erreur, Jacques Breuer a fait de Mathieu de Fraipont un peintre et bourgeois de Liège qui testa en 1612165. Dans ce testament, rédigé le 11 septembre 1610 mais enregistré par le peintre Gilles de Fraipont le 23 novembre 1612, l’état de ce Mathieu de Fraipont est spécifié : il est en réalité dominicain. Il est le frère de Gilles et de Jean I, qui ont été évoqués précédemment166. L’abbé Thys mentionne cependant un peintre Mathieu de Fraipont actif à Liège vers 1619, mais il ne fournit aucune précision à son sujet167. Cet artiste s’identifierait-il au Mathi de Fraipont, époux de Philippette Godefroid, qui releva le métier des orfèvres en 1589 ou bien au Mathi de Fraipont, fils d’un procureur homonyme, qui releva le même métier en 1609-1610168 ? Il est possible que ce dernier se confonde avec le Mathieu de Fraipont qui, répondant alors à une nouvelle vocation, entra chez les dominicains de Boneffe en 1610 précisément. Mais ce n’est pas sûr, car les frères Gilles, Jean et Mathieu de Fraipont avaient un cousin prénommé Mathieu. Jean Furnius (1599-1631/1632) Jules Helbig est le premier à faire allusion à ce peintre, fils du fameux Pierre Furnius169. Il a en effet publié un acte passé le 17 février 1625 chez le notaire Etten à Liège. Au terme de ce document, le marchand lillois Michel Muwette déclare avoir reçu de « Jean Jalhea dit de Forre, maistre peintre bourgeois de Liege », des « estampes de cuyvre et peinturres sur toilles avec plusieurs printes en papier » au coût de 500 florins, pour partie versés. Pour ce prix, Jean Furnius doit encore livrer à Muwette deux tableaux, une Crucifixion et une Notre-Dame. Il a remis ces deux tableaux à son cousin Lambert Matthys, maître brodeur ; celui-ci doit en faire des copies. Dès que les copies seront achevées, Jean Furnius remettra les deux peintures à Muwette. On est tenté de penser, à la suite de Jean Puraye, que les « estampes de cuyvre » cédées au marchand de Lille sont les plaques gravées que Pierre Furnius avait léguées à son fils170. Le marchand comptait probablement commercialiser des retirages. René Jans a fourni diverses précisions sur le peintre171. Jean Furnius – il signait de ce nom – est né en 1599. Il est le fils naturel de Pierre Furnius et de sa servante, Jeanne Thiry. Il est mentionné dans le testament que son père rédige le 2 avril 1605 et par lequel il lui laisse, outre 150 florins de rente, le solde du paiement à recevoir de l’abbé de Saint-Jacques pour un retable ainsi que les cuivres de ses gravures et les peintures conservées dans la maison172. Jean héritera de son père cinq ans plus tard. En 1609-1610, il relève le métier des orfèvres en tant que fils de maître173.
164. AEL, Abbayes et couvents. Dominicains de Liège, 103, à la date (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 165. Breuer, op. cit., p. 100. 166. AEL, Échevins de Liège. Convenances et testaments, 52, f° 272 v°-274 v°. 167. Bibliothèque générale de l’Université de Liège, Ms. 1224 (seconde version d’un Dictionnaire historique des artistes liégeois de l’abbé Édouard Thys, vers 1875), f° 113. 168. Breuer, op. cit., p. 100 et 141. 169. Helbig, op. cit., p. 189-190. 170. Jean Puraye, Pierre Furnius graveur liégeois du XVIe siècle, dans Miscellanea J. Gessler, t. 2, s.l., 1948, p. 1024. 171. René Jans, Précisions sur le peintre-graveur Pierre Furnius et sa famille, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 99, 1987, p. 162-167. 172. Puraye, op. cit., p. 1023. 173. Breuer, op. cit., p. 143. 170
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Selon Jans, il s’adonne à la peinture dès l’âge de quatorze ans. En 1615, il décide d’aller se perfectionner « dans les pays étrangers où l’art fleurit particulièrement ». Il n’a que seize ans, mais souhaite « apprendre ainsi à être un artiste » en se mettant au service de différents maîtres. Sa mère obtient pour lui l’aliénation d’une rente qui doit sans doute lui donner les moyens de survivre pendant ce temps. On ne sait où Jean Furnius s’est rendu, mais il est de retour au plus tard en 1621. Cette année-là, il institue comme héritier son cousin le brodeur Lambert Matthys. Fin 1623, il s’installe dans la maison qu’il vient d’acquérir au Thier Saint-Martin (ou Thier de la Fontaine), dans la paroisse Saint-Remacle-en-Mont. Il épouse à cette époque Catherine Brandesire, qui tenait une petite manufacture de boutons. Il en aura deux enfants. Le 26 novembre 1626, Jean relève le métier des merciers pour lui et pour son père... décédé depuis seize ans174. Selon Jans, ce genre de relief posthume n’était pas rare pour justifier l’admission dans un métier. En avril 1631, Jean rachète la maison paternelle de la rue Meersen, à l’enseigne de Bouillon, en la paroisse Sainte-Aldegonde. Il retourne y vivre mais y décède bientôt, entre avril 1631 et mars 1632. Lambert Furnius (ca 1557-après 1622) René Jans a redonné vie à ce peintre jusqu’alors inconnu175. Fils du brasseur et peintre verrier homonyme et de Péronne le Berlier, frère cadet du célèbre disciple de Lombard, Lambert Furnius est déclaré avoir dix-huit ans le 16 septembre 1575. À cette date, orphelin de père, il reçoit pour tuteurs et mambours son oncle Gilles le Berlier et son beau-frère Denis de Hasque. En 1589, il relève le métier des orfèvres176. De l’avis de Jans, Lambert prend sans doute ses premières leçons de peinture auprès de son frère Pierre, d’une dizaine d’années son aîné. En 1596, les deux frères deviennent les tuteurs des enfants de leur sœur Isabeau, veuve de Nicolas Matthys. En 1599, Lambert reçoit une donation de sa mère. En 1605, son frère Pierre, par son testament, lui laisse la moitié de ses vêtements et le désigne comme tuteur de son fils alors mineur et comme exécuteur testamentaire. Lambert s’occupera effectivement de son neveu Jean, de nombreux documents d’archives l’attestent. Il sera peut-être son premier maître dans l’art de la peinture. En 1614, il remet à la mère de son neveu et ancienne concubine de Pierre les « ustensiles convenables à un peintre » ; ce matériel provient très certainement de la succession de son frère. Il doit servir à Jean, au moment où celui-ci entame son apprentissage. En 1615, « Maître Lambert Furnius dit Jalhea, peintre » demeure dans la paroisse Saint-Nicolas-au-Trez. Le 10 décembre 1622, il figure encore, comme témoin, dans un acte concernant les enfants de sa sœur Barbe. On ne connaît rien de son activité professionnelle. Pierre Furnius (ca 1545-1610) Jusqu’à l’article de Jean Puraye de 1948177, Furnius n’était connu que par ses gravures – plus de quatrevingts sont répertoriées – et par la notice substantielle que lui a consacrée Louis Abry178. Ce dernier fournit peu d’informations biographiques. Il s’attache pour l’essentiel à la description de cinq tableaux de Furnius, sans même évoquer son activité de graveur. Il nous apprend que Pierre de Four, dit de Jalhea, fut mis assez jeune auprès de Lambert Lombard, ce qui est chronologiquement plausible. Si l’anecdote est authentique, il faut croire que le jeune Furnius fut l’un des derniers élèves du maître, mort en 1566. Après la mort de Lombard, Furnius aurait bénéficié de nombreuses commandes du fait qu’il était bien introduit à Liège. Sa réputation aurait même surpassé celle de Lombard, ce qui n’a pas manqué de choquer Abry ; cela a visiblement engagé cet auteur à se montrer peu indulgent à l’endroit des tableaux de Furnius. Sur
174. Poncelet, op. cit., p. 110. 175. Jans, Précisions…, op. cit., p. 158-165. La présente notice reprend pour l’essentiel l’article que j’ai consacré au peintre : PierreYves Kairis, Un peintre issu de l’académie de Lambert Lombard : Pierre Furnius (ca 1545-1610), dans Bulletin de l’Institut royal du Patrimoine artistique, t. 29, 2001-2002, p. 133-153. 176. Breuer, op. cit., p. 99. 177. Puraye, op. cit., p. 1016-1025. 178. Abry, op. cit., p. 169-172. 171
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
le plan biographique, l’article de Jean Puraye n’apporte guère de neuf. À la suite de Breuer179, il note que Furnius a relevé le métier des orfèvres entre 1562 et 1564. Il commente par ailleurs le testament du peintre, découvert par le même Breuer. Le principal intérêt de ce testament est de citer un retable, de sujet inconnu, exécuté pour l’abbé de Saint-Jacques et non encore entièrement payé à la date du testament, le 2 avril 1605. René Jans a quelque peu complété la biographie de Pierre de Jalhea dit du Four180. Les aïeux du peintre étaient originaires de Jalhay et son arrière-grand-père, Pirotte de Jalhea, exerçait la profession de boulanger ; ce détail explique le surnom. Le père de Pierre, Lambert du Four, était brasseur et peintre sur verre. Ce dernier avait épousé en 1543 Péronne le Berlier. De cette union sont issus au moins huit enfants. Pierre fut l’un des premiers. Son année de naissance doit se situer entre 1543, année du mariage de ses parents, et 1550 ; cette dernière date est induite par un acte du 16 septembre 1575 par lequel Péronne le Berlier émancipait ses enfants encore mineurs (donc de moins de vingt-cinq ans) et Pierre n’était pas du nombre. Bénédicte Grignard l’a montré, les plus anciennes gravures connues de Furnius datent de 1565181. Il devait avoir largement plus que quinze ans. On peut situer sa naissance approximativement vers 1545. Lombard étant décédé en 1566, du Four dut appartenir à la génération de ses derniers élèves. Comme le suppose Jean Puraye au regard du caractère érudit des gravures, l’artiste dut recevoir une solide éducation littéraire et historique. Selon une tradition courante dans les milieux humanistes, il latinisa bientôt son nom. On ne connaît à peu près rien de son existence, sinon qu’il acquit une certaine aisance. En témoignent d’une part la spacieuse maison à l’enseigne de Bouillon (achetée en 1593 rue Meersen à Liège) et d’autre part son testament de 1605. Ce testament révèle que l’artiste était resté célibataire et qu’il légua une bonne partie de ses biens à sa servante, Jeanne Thiry. Il en avait eu un fils, Jean ; comme on l’a vu, celuici devint peintre également. Selon Abry, Furnius eut Jean Bologne en apprentissage. Péronne le Berlier étant apparentée à l’arrièregrand-mère d’Alexandre de Horion, René Jans se demande si Furnius n’aurait pas également été le maître de celui-ci182. Cela ne paraît pas convaincant. Furnius aurait également pu avoir pour apprenti son propre frère cadet Lambert ainsi que son neveu Pierre Mathys. La date de décès de Furnius est inconnue. Selon Jans, il était déjà mort à la date du 4 mai 1610. Or, selon Abry, la Déposition de croix de Saint-Étienne portait la date de 1610. Il doit donc être décédé au début de cette année-là, sans doute encore en pleine activité. René Jans l’a montré : la mort misérable du peintre à l’hôpital Saint-Jacques, relayée par Abry, relève de la légende. Ce genre de topos de la littérature artistique a été rapporté au sujet de Lambert Lombard également183. On ne sait pratiquement rien de l’activité picturale de Pierre Furnius. Il fut pourtant considéré comme un des meilleurs peintres de son temps. Dans une lettre, publiée par Puraye184, au peintre et écrivain Dominique Lampson, l’évêque d’Anvers Liévin Torrentius va jusqu’à affirmer : « (…) nous n’avons aucun meilleur peintre que lui, de l’avis même d’Ortelius, qui a vu mon portrait peint par lui ». Cette opinion du grand humaniste et amateur d’art anversois Abraham Ortelius est particulièrement flatteuse. D’autres commentateurs sont moins enthousiastes, tel le chanoine Henri Hamal. Ce dernier affirmait que « les ouvrages de ce peintre sont fort inférieurs à ceux de Lombard »185. Les quatre-vingts gravures identifiées autant que diverses mentions dans les archives de l’imprimerie Plantin permettent d’en convenir : l’artiste fut prolixe en tant que graveur. Il ne dut guère l’être moins
179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 172
Breuer, op. cit., p. 61. Jans, Précisions…, op. cit., p. 153-167. Grignard, op. cit., p. 120. Jans, Un important peintre liégeois…, op. cit., p. 480. Voir Denhaene, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme…, op. cit., p. 24-25. Puraye, op. cit., p. 1021. Helbig, op. cit., p. 190.
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
comme peintre. Abry affirme que Furnius exécuta un très grand nombre de tableaux, mais que la plupart d’entre eux avaient déjà « péri » à l’aube du XVIIIe siècle en raison d’une technique peu solide. Outre le portrait de Torrentius, on ne connaît de lui, par des auteurs anciens, que cinq tableaux. Tous ornaient des églises de Liège. Soit ils avaient déjà disparu avant la Révolution, soit ils se trouvaient en fort mauvais état au XVIIIe siècle. Ils sont signalés par Abry et par Hamal186 : un triptyque du Christ au jardin des Oliviers (1578) à la cathédrale de Liège (Hamal le dit ‘fort gâté’), un triptyque de la Résurrection (1580) placé dans le chœur du même sanctuaire en guise d’épitaphe pour le tombeau du prince-évêque Gérard de Groesbeeck (triptyque démembré vers 1755187), un triptyque de Saint Michel (ca 1575) à la collégiale Saint-Barthélemy (déjà en mauvais état à l’époque d’Abry), un triptyque de sujet inconnu qui ornait le maître-autel de l’église abbatiale Saint-Jacques (disparu dans le courant du XVIIIe siècle)188, enfin une Déposition de croix (1610) au maître-autel de l’église paroissiale Saint-Étienne189. À ces mentions, il faut ajouter celle fournie par les archives de l’abbatiale de Saint-Hubert. Elles attestent que le peintre Pierre Jalhay a peint le retable de l’autel majeur ; il a reçu pour ce travail plus de 800 florins entre 1594 et 1603190. Ce tableau a disparu de longue date et on en ignore même le sujet. Bref, on dispose de bien peu d’informations pour estimer l’art d’un peintre qui fut important à l’échelle régionale. Par référence à l’une de ses gravures, on peut cependant lui restituer un grand panneau (212,5 x 176,5 cm) naguère identifié en l’église Saint-Sauveur à Horion-Hozémont (fig. 4)191. L’iconographie de ce panneau se réfère au modèle de Déploration imposé au début du XVIe siècle par le Corrège. Au contraire de la Pietà médiévale, le Christ n’est plus porté par la Vierge mais, couché sur son linceul, son torse repose contre sa mère. Celle-ci rejette la tête en arrière et pose la main sur la poitrine en geste d’affliction, le regard perdu dans le vide, tandis que saint Jean la soutient. Aux côtés de ce groupe central s’articulent d’une part les « Trois Marie » éplorées et d’autre part six disciples contemplant presque distraitement la scène. Dans le fond du tableau se distinguent à gauche les roches où a été taillé le sépulcre et à droite la colline du Golgotha, avec les trois croix se détachant sur le ciel. Au centre, dans la vallée, se devine la ville de Jérusalem. Cette disposition est en tous points identique à celle d’une estampe signée de Furnius192. Cette remarquable gravure, manifestement une des plus belles pages issues du burin de son auteur, détaille davantage la composition que le tableau. Surtout, elle affine les détails dans la manière caractéristique de Furnius tout en jouant sur les effets de clair-obscur. Les draperies en particulier (mais aussi les rochers et les arbres les surmontant) y sont plus fouillées, plus ciselées, même si le tableau restitue des effets similaires de lourdeur dans les drapés noueux, compliqués comme par plaisir, de certains acteurs du second plan. La gravure porte la signature de Furnius avec la mention Inve(n)tor : le graveur est bien le concepteur de la composition. Il est d’autant plus tentant d’attribuer le tableau au même artiste que la gravure est inversée. Les changements de composition découverts au cours de la récente restauration accréditent l’idée d’une composition originale et non d’une copie.
186. Hamal, op. cit., p. 208, 212, 230 et 231. 187. Curieusement, Michel Ponceau réalisera en 1625 un nouveau tableau-épitaphe en mémoire de Gérard de Groesbeeck. 188. Ce triptyque se confond peut-être avec le retable peint pour l’abbé de Saint-Jacques mentionné dans le testament du peintre. Jean Yernaux le dit, à tort, conservé dans la chapelle des ursulines à Saint-Trond (Manuscrit Yernaux, f° 62). 189. René Jans (Une autre œuvre probable de Denis Pesser : la ‘Mise en croix’, peinture murale récemment découverte en l’église Saint-Jacques, à Liège, dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, t. 9, n° 204, 1979, p. 336) se demande si Furnius ne pourrait être l’auteur de la Mise en croix découverte en 1966 sur la paroi d’une chapelle rayonnante de l’église Saint-Jacques. Ce n’est que pure conjecture fondée sur une coïncidence d’époque. 190. Richard Jusseret, Mémoires de papier, mémoire de pierres : histoire en chantier, dans L'ancienne église abbatiale de SaintHubert, Namur, 1999, p. 64-65. 191. René Jans, Un tableau ancien identifié, dans La Meuse-La Lanterne, 21 décembre 1993.- Catalogue de l’exposition S.O.S. oude schilderijen. Redding en behoud van 20 werken op paneel / S.O.S. peintures anciennes. Sauvegarde de 20 œuvres sur panneau, Bruxelles, 1996, p. 104-113.- Pierre-Yves Kairis et Isabelle Happart, La « Déploration du Christ mort » attribuée à Pierre Furnius. L’œuvre et sa restauration, Horion-Hozémont, 1997.- Kairis, Un peintre issu…, op. cit., p. 141-151. 192. Reproduite dans Jacques Hendrick, La peinture au pays de Liège. XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Liège, 1987, p. 95. 173
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Un élément technique pourrait se révéler utile pour confirmer l’attribution. Aujourd’hui, nous n’avons gardé le souvenir des peintures de Furnius qu’à travers le témoignage d’Abry. À ses dires, la plupart de ces peintures avaient fortement souffert des outrages du temps en raison, notamment, de « couleurs appliquées extrêmement maigres ». Or, la restauration du panneau de Hozémont a permis de relever la minceur extrême de la couche picturale. Il n’est pas sûr que l’agressivité de « restaurations » antérieures suffise à expliquer ce fait. Ceci pourrait légitimer les propos d’Abry. Cette découverte a été d’importance pour la compréhension d’une des périodes les plus obscures de la peinture liégeoise : celle qui fait la charnière entre les XVIe et XVIIe siècles et que l’on dénomme souvent, de manière un peu réductrice, l’école de Lambert Lombard. On pourrait dès lors affirmer que, dans le contexte liégeois de l’époque, Furnius fut un peintre au talent des plus honorables. Si les types physiques vigoureux du panneau de Hozémont rappellent l’œuvre de Floris, sans que l’on y retrouve la souplesse de son modelé, le tableau démarque surtout une œuvre majeure d’un autre grand maître anversois qui fut un élève de Lambert Lombard. La composition s’inspire en effet d’un tableau de même sujet que Willem Key (ca 1515-1568) a signé et daté de 1553 (137 x 103 cm). Ce tableau, dont la localisation actuelle est inconnue, était conservé jusqu’en 1928 dans la collection Six à Amsterdam et il a fait l’objet de diverses copies. Furnius a transposé à sa manière le groupe du Christ et des saintes femmes du premier plan. Son Christ mort dénote la même envergure michelangelesque que celui de Key. Il est naturellement tentant d’identifier le tableau de Hozémont à la Déposition de croix mentionnée par Abry au maître-autel de l’église Saint-Étienne à Liège. Dans le langage affecté et peu intelligible qui est le sien, cet auteur commente le tableau en ces termes : « La Déposition de la Croix, du grand autel de S. Etienne à Liége, est pourtant plus éclairé que les autres et a plus du goût de Lombard ; tout stéril que le fonds est, les figures y sont peintes en portrait et le nom de l’auteur de l’an 1610 ». Si l’on comprend bien, le tableau « plus éclairé » était, en ce début du XVIIIe siècle, dans un meilleur état de conservation que les autres peintures connues de Furnius. Tous les auteurs ont par ailleurs déduit du texte d’Abry que le tableau était signé et daté de 1610. Mais le nom et la date pouvaient aussi bien se trouver sur un cartouche placé à proximité de l’œuvre. De sorte que l’on ne peut rien déduire de l’absence de la moindre trace d’inscription relevée au cours de la restauration du panneau de Hozémont en 1996. Si la date de 1610 est exacte, le tableau de Saint-Étienne dut certainement être le dernier exécuté par le peintre. On l’a vu, celui-ci est en effet déclaré décédé dans un document d’archives du 4 mai 1610. Quant aux figures « peintes en portrait », elles peuvent tout à fait s’accorder avec celles qui apparaissent sur le tableau qui nous retient ici. L’histoire du retable de Saint-Étienne ne peut être retracée avec certitude au-delà du XVIIe siècle. Selon Abry, il fut enchâssé en 1624 dans un nouveau maître-autel ; cette date est confirmée par un contrat du 8 janvier 1624 au terme duquel le menuisier Lambert Collin s’engage à réaliser cette nouvelle « table d’autel » ; celle-ci peinte et dorée un an plus tard par Jean Gruyninx193. Berthe Lhoist-Colman a aussi établi que cet autel a été démonté en juin 1695 et qu’il fut remplacé quelques semaines plus tard par un nouvel autel dessiné par … Louis Abry en personne. Au tableau de Furnius succède alors une œuvre plus moderne, un Martyre de saint Étienne peint par Englebert Fisen, le peintre liégeois alors en vogue ; celuici l’inscrit cette année-là dans son livre de comptes194. Chose incroyable, quoique Louis Abry ait rédigé bien après 1695 son manuscrit sur les anciennes gloires du pays de Liège, il mentionne toujours à SaintÉtienne l’ancien autel majeur. Or, à cette époque était en place un meuble dont il avait lui-même fourni le dessin… Qu’est devenu le tableau de Saint-Étienne après 1695 ? C’est d’autant moins aisé à établir que le chanoine Hamal195 et différents auteurs à sa suite, interprétant erronément le texte d’Abry, ont situé à tort le tableau sur l’autel de la chapelle Saint-Étienne en la collégiale Saint-Barthélemy. Néanmoins, Hamal signale 193. Berthe Lhoist-Colman, Louis Abry et la rénovation de l’église Saint-Étienne à Liège (1690-1705), dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, t. 10, n° 214, 1981, p. 64. 194. Jules Helbig, Les papiers de famille d’Englebert Fisen, dans Bulletin de la Société d’art et d’histoire du diocèse de Liège, t. 1, 1881, p. 35. 195. Hamal, op. cit., p. 230. 174
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
encore une Mise au tombeau de l’école de Lambert Lombard au fond de l’église Saint-Étienne à la fin du XVIIIe siècle 196. Il précise : « c’est un présent fait à l’église du temps du curé Melcion par une personne de la paroisse ». Comme Gilles-Joseph Melcion fut pasteur de Saint-Étienne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, force est de conclure que le tableau évoqué par Hamal n’a aucun rapport avec celui qui nous occupe. À moins qu’il ait été recueilli en 1695 par quelque paroissien dont un descendant le restitua à son lieu d’origine près d’un siècle plus tard. Ceci est naturellement très hypothétique. Le mobilier qui restait à Saint-Étienne fut dispersé à l’époque révolutionnaire. Aucune œuvre de cette église ne fut jugée digne d’être conservée197. Aucun autel ni aucun tableau n’est cependant indiqué dans l’inventaire du mobilier de l’église dressé le 28 frimaire an 6 (18 décembre 1797)198. Enfin, on se souviendra que le tableau de Hozémont reflète fidèlement l’art anversois de la seconde moitié du XVIe siècle. À première vue, son style est peu compatible avec la date de 1610. Mais on ne peut oublier que Liège est à cette époque un centre secondaire, marqué par les archaïsmes. Rien ne permet donc de certifier que la Déploration de Hozémont s’identifie au retable jadis à SaintÉtienne. Quant aux archives de la fabrique de l’église, elles sont apparemment muettes sur l’origine du panneau. La plus ancienne mention de celui-ci figure dans l’inventaire rédigé par Jean-Simon Renier à la fin du XIXe siècle199. Le tableau se trouvait déjà à son emplacement actuel, sur le mur de fond du collatéral gauche. Un indice, certes très mince, pourrait autoriser le rapprochement du tableau de Saint-Étienne avec la gravure reproduisant le tableau qui nous occupe. Selon Jean Puraye, la gravure de la Déploration n’a été éditée qu’au XVIIe siècle, par le graveur et marchand d’estampes anversois Frans van den Wyngaerde (16141679)200. Ne serait-ce pas là l’indication d’une œuvre tardive de Furnius ? Le rapprochement avec le tableau serait d’autant plus tentant que celui-ci daterait de 1610, année du décès de l’artiste. Dans le bref article déjà cité du quotidien La Meuse où il fait écho à ma découverte du tableau de Hozémont, René Jans propose de rapprocher celui-ci du panneau central du triptyque de l’ancien maître-autel de Saint-Jacques cité par Abry ; ce dernier n’en précise toutefois pas le sujet. Sachant que l’abbé de SaintJacques était l’un des deux décimateurs et collateurs de l’église de Hozémont, René Jans se demande si l’abbaye liégeoise n’aurait pas fait don de son ancien retable à l’une des paroisses de son ressort : « il n’est pas rare, écrit-il, qu’une œuvre d’art, devenue démodée, d’une importante église liégeoise, ait été cédée à un sanctuaire de campagne qui en dépendait ». Était-ce là vraiment affaire courante ? Il semble que cela reste à démontrer. On ne sait pas grand-chose du retable de Saint-Jacques. Abry prétend qu’il était loin de valoir les productions de Lambert Lombard. Il n’était plus en place avant même la Révolution. L’œuvre datait sans doute des premières années du XVIIe siècle, car elle n’était pas encore payée en 1605, lorsque l’artiste a rédigé son testament. En tout cas, rien ne permet d’établir que le tableau de Hozémont ait un jour servi de panneau central à un triptyque. Le cadre étant moderne, il n’y a pas lieu d’y chercher la trace des charnières devant supporter les volets. Un autre panneau établit le lien entre la Déploration peinte et les estampes de l’artiste201. Il s’agit d’une grande Assomption de la Vierge (313 x 201,5 cm) conservée au fond de l’église Saint-Nicolas à Liège (fig. 5). Selon Jean-Simon Renier, ce panneau était à l’origine à double face ; il aurait servi de double retable à l’église202. Vers 1875, le peintre Bonnefoi a scié le panneau et séparé les deux peintures, toujours conservées dans l’église203. La seconde peinture est un très intéressant Sacre d’un évêque manifestement d’une main tout à fait différente (peut-être celle d’Alexandre de Horion ?). Elle semble beaucoup 196. Ibidem, p. 255. 197. AEL, Fonds français. Préfecture, 459, portefeuille 2. 198. AEL, Fonds français. Préfecture, 511, portefeuille 11. 199. Paul Bertholet, Inventaire d'églises de l’arrondissement de Liège réalisé vers 1890 par Jean-Simon Renier, dans Leodium, t. 87, 2002, p. 24. 200. Puraye, op. cit., p. 1020. 201. Kairis, Un peintre issu…, op. cit., p. 151-152. 202. Renier, Inventaire…, op. cit., p. 222. 203. L’information est confirmée par le Bulletin administratif de la ville de Liège, 1875, p. 610-611 (aimable communication de Mme Nadine Reginster). 175
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
plus tardive que l’Assomption. Elle ne peut être antérieure à 1620. De cette année-là date le fameux Coup de lance de Rubens, tableau dont le peintre s’est en partie inspiré pour le retable représenté sur l’autel au fond de sa composition. Quant au décor architectural, il est emprunté à une gravure d’Egbert Van Panderen reprenant une Circoncision peinte en 1615 par le caravagiste d’origine brugeoise Louis Finson (Poitiers, ancienne chapelle des jésuites). On ne connaît pas l’origine de ce panneau originellement à double face. Il ne figure pas dans le répertoire du mobilier des églises établi par Hamal au début du XIXe siècle. Il n’est pas impossible qu’il ait été acquis par la fabrique de l’église Saint-Nicolas en raison de l’iconographie de l’un des côtés, censé montrer le sacre de saint Nicolas. Mais la représentation offre peu de repères iconographiques. Il pourrait aussi bien s’agir de l’ordination épiscopale de saint Martin, saint Hubert, saint Éloi204, etc. La composition, au demeurant assez traditionnelle, est marquée par l’horror vacui. Au registre inférieur, les apôtres et les saintes femmes témoignent de leur émoi autant que de leur affliction dans des gestes et des attitudes très diversifiés. Au registre supérieur, la Vierge, fort élancée, est baignée par un délicat halo de lumière. Elle paraît finalement peu mise en évidence, tant est perceptible la présence des anges qui l’enserrent dans une sorte de gigue céleste. Dans ce tableau, on décèle d’abord la gamme générale des tons aigres de la Déploration, spécialement les rouges, les verts et les jaunes ; ceux-ci apparaissent comme autant de points focaux visuels dans une ambiance générale ocre que la restauration menée par l’IRPA en 2011 a quelque peu atténuée. On y retrouve en outre le même type d’expressions et de gestes appuyés ainsi qu’une maîtrise anatomique parfois défaillante – on le remarque particulièrement dans les cous et les doigts massifs des personnages. Enfin, on retrouve dans la cohorte céleste encerclant la Vierge le découpage hésitant des draperies autant que les chevelures hérissées en grosses mèches, traits fréquents dans les estampes de Furnius. Plusieurs figures se retrouvent par ailleurs identiques dans les deux tableaux. Ainsi de l’apôtre à la chevelure dégarnie qui se trouve à l’extrême gauche de la Déploration et dans le coin inférieur gauche de l’Assomption. Enfin, certains traits de détails se retrouvent similaires, tels les mains aux longs doigts effilés et les pieds aux orteils allongés et dont les deux premiers se trouvent très écartés. Il s’agit d’une sorte de tic de peintre qui trahit manifestement une même main. La Déploration de Hozémont et l’Assomption de Liège apparaissent comme des points d’ancrage déterminants pour porter une nouvelle appréciation sur la peinture du pays de Liège à la fin du XVIe siècle. André Gisson (mentionné entre 1611 et 1619) On ne sait rien sur ce peintre sinon qu’il est mentionné à Liège 1611205. La référence donnée par Jean Yernaux, qui le nomme André Gissen, est trop imprécise pour être vérifiée. À n’en pas douter, il se confond avec le peintre Adrien Gisson recensé en 1619 dans la paroisse Saint-Remy206. Il correspond certainement à André Gisson, époux de Barbe Hallebaie, qui a fait baptiser sa fille Marie à Saint-Adalbert le 25 janvier 1613207. Les parents étaient en effet paroissiens de Saint-Remy. Jean de Glen (mentionné entre 1597 et 1631) Un peintre et graveur liégeois de ce nom est mentionné dans un procès à Rome en 1627208. Jean de Glen (ou de Glans) est décrit comme uomo vecchio che fa il pittore e intagliatore. Il habite via Ferratina, dans la maison de la Torretta, avec un autre Liégeois, l’interprète Tilman Pierre. Je n’ai pas trouvé la trace des deux hommes dans les Stati d’anime, certes fort lacunaires, de la paroisse San Lorenzo in Lucina à cette époque. Il est fort probable que le premier se confond avec le graveur liégeois Jean de Glen. 204. La représentation de nombreuses pièces d’orfèvrerie dans ce Sacre d’un évêque doit peut-être nous renvoyer vers ce saint patron des orfèvres. 205. Manuscrit Yernaux, f° 81. 206. Extrait des procès-verbaux concernant les communications faites durant les séances mensuelles. 1896, dans Bulletin de la Société d’art et d’histoire du diocèse de Liège, t. 10, 1896, p. 380. 207. AEL, Registres paroissiaux de Liège, 75, f° 44. 208. Bertolotti, op. cit., p. 229. 176
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Ce dernier est connu pour avoir orné de gravures (assez maladroites au demeurant) des ouvrages de son frère Jean-Baptiste, docteur en théologie de la Faculté de Paris et prieur des augustins de Liège († 1617)209. Les deux frères, l’un auteur du texte et l’autre des illustrations, ont été souvent confondus. C’est le cas dans la notice substantielle du baron de Villenfagne consacrée à Jean210. Comme d’autres auteurs, Villenfagne a erronément conclu d’une indication sur l’un des livres illustrés par Jean de Glen que celuici fut également imprimeur. Jean de Glen a orné de ses gravures, généralement médiocres, les ouvrages suivants de son frère211 : Du debvoir des filles, traicté brief et fort utile... (Liège, 1597, 40 planches ; comme l’a noté le chevalier de Theux de Montjardin, les « patrons d’ouvrages pour toutes sortes de lingeries », modèles de broderies et de dentelles, plagient pour la plupart des planches d’un ouvrage de Cesare Vecellio édité à Venise en 1591), Vitæ Romanorum Pontificum a Petro usque ad Clementem VIII… (Liège, 1597 ; 239 portraits gravés), Histoire pontificale… (Liège, 1600 ; traduction du livre de 1597 ; 236 portraits gravés), Les habits, mœurs, cérémonies, façons de faire anciennes et modernes du monde… (Liège, 1601 ; 104 gravures, dont certaines sont ici encore copiées de l’ouvrage de Vecellio). Ajoutons un portrait gravé du pape Célestin IV pour un ouvrage anonyme paru à Louvain en 1610212 : Concordata nationis Germanicæ cum sancta sede apostolica… Il réalisa enfin un grand nombre de gravures sur bois pour une traduction française, publiée à Liège en 1631, d’un ouvrage de Pietro-Martire Felini da Cremona213 : Tractato nuovo delle cose maravigliose dell’alma cita di Roma… Nul doute que ce soit pour préparer les illustrations de cet ouvrage que de Glen s’est rendu à Rome, où on a repéré sa trace en 1627. Comme il n’apparaît pas que Jean de Glen ait eu la moindre activité de peintre, on peut se demander s’il ne s’agit pas d’une mention erronée dans les minutes du procès romain de 1627. Au début du XVIIe siècle, il habitait à Liège en la maison de l’Écu d’or en Gérardrie214. Libert Grégoire (mentionné entre 1570 et 1603) Le 12 décembre 1570, le doreur Libert Grégoire comparaît devant les échevins de Liège avec Andrieu de Hollogne, qui restitue à Grégoire une rente sur la maison que celui-ci possède sur le Pont d’Île215. Le peintre ne réapparaît ensuite que dans son testament du 14 janvier 1603216. Il est alors malade. Il partage ses biens entre sa seconde épouse, Marie Bassenge, et ses enfants, notamment son fils Grégoire, issu d’un premier mariage. Ce dernier ne pourra hériter qu’à la condition qu’il retourne à la foi catholique. Le testament est produit devant les échevins le 20 juin 1606 ; Libert Grégoire est sans doute décédé peu de temps auparavant. Dans ce testament, la maison qu’il possède sur le Pont d’Île est dite à l’enseigne du Doreur. Léonard Gromet (mentionné entre 1614 et 1643) Ce peintre, qui apparaît sous le nom de Gromet, Grommet, Groumet, Groimet ou Grommer, n’est connu pour l’essentiel qu’au travers de quelques documents administratifs repérés par Mme Étiennette Gaspar. Il s’identifie peut-être à l’un des deux Lynar Grumet ou Gromet qui relèvent ou acquièrent le métier des orfèvres à Liège en 1597 et en 1600-1601217. Le 24 novembre 1614, il comparaît devant les échevins de Liège, avec son père et homonyme, contre le peintre Laurent Pietkin ; les deux hommes sont en conflit à 209. À son sujet, voir Abry, op. cit., p. 75 et De Theux de Montjardin, Bibliographie liégeoise, 2e éd., Bruges, 1885, col. 28, 30, 35, 40, 48, 174, 1329 et 1330. 210. Hilarion-Noël de Villenfagne, Mélanges de littérature et d’histoire, Liège, 1788, p. 117-120. 211. De Theux de Montjardin, op. cit., col. 28, 30 35 et 40. 212. Ibidem, col. 52. 213. Ibidem, col. 101-102. 214. Gobert, op. cit., p. 343. 215. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 330, f° 171 v° (DIAL ; comm. Mme E. Gaspar). 216. AEL, Échevins de Liège. Convenances et testaments, 64, f° 224 v°-225.- Breuer, op. cit., p. 172. 217. Ibidem, p. 114 et 121. 177
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
propos d’une rente sur des biens situés à Glain218. En 1619, il résidait avec son épouse dans la paroisse Saint-Remacle. Il apparaît régulièrement dans les archives jusqu’à son décès en 1643, notamment pour des travaux de restauration de tableaux à la cathédrale. Georges Gruyninx (mentionné entre 1572 et 1617) « George Gruyninx, de Liège et flamand » est brièvement cité par Abry, mais ce dernier ne dit pas nommément que Gruyninx (alias Gruninx, Greuninx, Groninx, Groeninx, Groeninck, Greuninck, Gruninck, etc.) était peintre219. Il lui dédie cependant quelques lignes entre la notice consacrée à Michel Ponceau et celle sur Gérard Douffet. De ce Gruyninx, Abry dit seulement qu’il acquit le métier des orfèvres à Liège en 1572220, qu’il avait épousé Jenne Wérard et qu’il demeurait avec elle dans la paroisse Saint-Servais, « où il y avoit de son travail ». Cela signifie que l’un ou l’autre tableau de Gruyninx se trouvait à l’église Saint-Servais. Hamal n’en dit cependant rien. Vers 1580, Georges Gruyninx, bourgeois de Liège, cède sa maison de la rue Saint-Jean l’Évangéliste, en la paroisse Saint-Adalbert, à Libert Ryckman221. Le 8 octobre 1585, Georges Gruninck, maintenant dans la paroisse Saint-Servais, fait baptiser son fils Gilles à Notre-Dame-aux-Fonts222. Le parrain est un chanoine de Saint-Lambert de la famille de Mérode, soit Arnold, Henri ou Jean de Mérode, tous trois tréfonciers à cette époque ; visiblement, le peintre a de brillantes relations. Le 1er septembre 1588, son fils Jean est baptisé dans la même église223. Le père est repris cette fois sous le prénom de Gioris et la mère sous celui de Jenekijne. Le parrain est un certain Johan Pieter. Toutes ces indications confirment l’origine flamande du peintre. La marraine, dame Barbe de Horion, renvoie à nouveau vers la noblesse locale. En 1602, le peintre prend en location une maison claustrale de Saint-Jean, mettant en garantie la maison qu’il possède rue des Écoliers224. Bien que ce ne soit pas sûr, il se confond sans doute avec le Georges Gruninck qui est décédé en la paroisse Saint-Adalbert le 28 mars 1623225. On connaît peu de chose de son activité artistique. En 1595, il a pour apprenti peintre Lambert Lambion226. En 1617, il reçoit 86 florins de l’église d’Ans pour avoir doré le maître-autel227. Plusieurs fils de Georges Gruyninx relèveront à leur tour le métier des orfèvres : Guillaume en 1585, Gilles et Jean en 1606228 ; seul Jean sera mentionné ultérieurement comme peintre. En l’année 1606, un Charles Groninx natif de Bruxelles acquiert de son côté le métier des orfèvres229. Yernaux en fait un fils de Georges, ce qui est loin d’être assuré230. Jean Gruyninx (1588-1636) Comme on l’a vu à la notice précédente, ce fils du peintre Georges Gruyninx est né en 1588 et il a relevé le métier des orfèvres en 1606 en même temps que son frère Gilles. En 1619, il dore la table de l’autel du chœur des dames de l’abbaye de la Paix-Dieu à Amay231.
218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 178
AEL, Échevins de Liège. Obligations, 69, f° 147-148 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). Abry, op. cit., p. 181. Ce qui est confirmé par Breuer (op. cit., 1935, p. 96). AEL, Abbayes et couvents. Sépulcrines de Visé, 174, f° 32 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). AEL, Registres paroissiaux de Liège, 1, f° 31 v°. Ibidem, f° 148. AEL, Collégiale Saint-Jean l’Évangéliste à Liège, 135, à la date (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). AEL, Registres paroissiaux de Liège, 76, à la date. Breuer, op. cit., p. 112. Poncelet, op. cit., p. 109. Breuer, op. cit., p. 96 et 131. Ibidem, p. 130. Manuscrit Yernaux, f° 83. Montulet-Henneau, op. cit., p. 183.
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Le peintre et son épouse Agnès Boens sont paroissiens de Saint-Adalbert. Dans leur église paroissiale, leur fille Anne est baptisée le 28 juin 1621232. Le 8 décembre 1624, « Jean Greunincx maistre peintre bourgoix de Liége » passe un contrat avec Gertrude Masset, veuve de Guillaume de Louvrex, pour dorer et peindre le nouveau maître-autel de l’église Saint-Étienne à Liège ainsi que les statues de Gilles Fiacre qui l’ornent233. La réalisation doit être conforme au modèle que le peintre a produit. Le travail doit être terminé dans les quinze jours suivant Noël et le peintre recevra à l’issue des travaux la somme de 125 florins. Entre 1625 et 1636 au moins, son nom apparaît à de multiples reprises dans la compterie de la cathédrale pour de menus travaux mais aussi pour quelques tableaux ; il n’en reste rien aujourd’hui234. Il décède de la peste dans la paroisse Saint-Adalbert le 20 juin 1636 et est inhumé dans l’église Saint-Remacle-en-Mont235. Sa veuve, reprise sous le patronyme d’Agnès Bouwens, recevra encore divers paiements de la cathédrale bien après la mort du peintre236. Apparemment, elle bénéficie d’une pension de la part du chapitre. On peut se demander si mari n’a pas été appointé par la cathédrale en même temps qu’Alexandre de Horion. Jehan delle Halle (mentionné entre 1562 et 1570) En 1561, Johan delle Halle relève le métier des orfèvres en tant que fils d’un brodeur homonyme237. Selon Breuer, il relève le métier des merciers l’année suivante. Cité dans certains actes comme peintre et brodeur, Jehan delle Halle est mentionné pour diverses affaires de rentes entre 1562 et 1570 ; il vit à cette époque en Vinâve d’Île238. Wathieu de Hallebaye (mentionné entre 1602 et 1625) Wathieu est le fils de Piron (de) Hallebaye (Halebay ou Hallembaye) et de Marie de Limbourg. Veuve, cette dernière a épousé en secondes noces, entre 1593 et 1601, le peintre Jean Ramey239. « Wathy de Hallebaye, peintre » acquiert le métier des orfèvres à Liège en 1602240. Le 3 janvier 1603, sa sœur Marie et lui reçoivent en donation une rente de 52 florins de Jean Ramey et de leur mère241. Le 11 septembre 1609, Wathieu cède à Gilles Gilot dit Dorey un jardin proche du sien, en la Longue Rue, non loin de l’église Saint-Remy242. Enfin, il relève le métier des merciers le 23 juillet 1625243. Laurent (?) Hansken (mentionné entre 1583 et 1603) En 1583, « Hansken de schilder » réalise en collaboration avec le sculpteur Gaspar Van Vrede, aux frais de la municipalité, des blasons et autres peintures destinées la confrérie des arbalétriers de Hasselt244. En
232. AEL, Registres paroissiaux de Liège, 76, à la date. 233. Abry, op. cit., p. 172.- Poncelet, op. cit., p. 127.- Berthe Lhoist-Colman, op. cit., p. 64.- Jans, Précisions…, op. cit., p. 155. 234. Archives de l’Évêché de Liège, Cathédrale, B.VII.33, 15 janvier 1625 et 15 février 1626 ; B.II.19, 30 novembre 1631, 18 août 1632 et 1er septembre 1632 ; B.II.20, 25 novembre 1634 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar) ; B.VII.34, 22 février 1636 et f° 122 (comm. M. J. Quitin). 235. AEL, Registres paroissiaux de Liège, 78, f° 179 v°. 236. Archives de l’Évêché de Liège, Cathédrale, B.II.25, B.II.26 et B.III.1 à 4 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar, sans indication des dates précises). Agnès Bouwens décédera à Saint-Adalbert le 20 septembre 1672 (AEL, Registres paroissiaux de Liège, 81, f° 458). 237. Breuer, op. cit., p. 58. 238. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 272, f° 260 v° ; 322, f° 204 ; 331, f° 66 ; 333, f° 61 ; 334, f° 3 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 239. Jean Yernaux, s.v. Ramey Jean, dans Biographie nationale, t. 30, 1958-1959, col. 736. 240. Breuer, op. cit., p. 121. 241. Yernaux, s.v. Ramey Jean, op. cit., col. 736. 242. AEL, Fondation Stéphany, 95, à la date (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). Il vivait donc à proximité de l’ancienne maison de son beau-père, depuis lors passée à Élias, fils du sculpteur Martin Fiacre (cf. Brassinne, op. cit., p. 182-183 et Yernaux, s.v. Ramey Jean, op. cit., col. 735 et 736). 243. Poncelet, op. cit., p. 110. 244. Jo Rombouts, Schilders, dans Kunst en kunstambacht in Hasselt tijdens het Ancien Régime, dans Catalogue de l’exposition Oog in oog. Hasseltse familieportretten en -objecten uit de 17de en 18de eeuw, Hasselt, 2003, p. 52 et 56. 179
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
1602, le peintre Hansken reçoit de la fabrique de la cathédrale de Liège 33 florins 15 sous pour avoir peint les colonnes du parvis245. L’année suivante, il reçoit encore de la cathédrale 12 florins pour divers travaux de peinture. En 1604, la même fabrique effectue plusieurs paiements à maître Laurent, peintre ; il s’agit certainement du même artiste. Son patronyme est probablement une corruption du nom « Haske », qui signifie « de Hasselt ». À noter qu’un Laurent de Haske, décédé avant 1612, est cité comme co-propriétaire d’une affinerie hutoise, le marteau de Pispot, dans le dernier tiers du XVIe siècle246 ; serait-ce notre peintre ? Il est sans doute apparenté au peintre Jean-Louis de Haske, gendre de Lambert Lombard, cité ci-dessous. Charles Hardy (mentionné entre 1544 et 1578) Ce peintre appartient à une famille qui, si l’on en croit Jean Yernaux, a livré au moins sept peintres à la ville de Liège au cours du XVIe siècle247. Charles est le fils du peintre François Hardy (mentionné entre 1525 et 1565) et de Catherine Morea. Il est cité pour la première fois en 1544, lorsqu’il relève le métier des orfèvres en tant que fils de maître248. En 1566, il reçoit du receveur des États de Liège un paiement de 4 dalers pour avoir peint et doré des blasons ornant divers instruments de musique249. Il est cité à diverses reprises, entre 1569 et 1575, pour des affaires de rentes250. En 1569, il est dit époux de Gillette le Banselier. Yernaux a repéré sa trace pour la dernière fois en 1578, lorsqu’il intervient dans un rendage devant l’official pour la tutelle des enfants de feu Jean Hardy, sans doute son frère. Gilles Hardy (mentionné entre 1561 et 1572) Frère de Charles, Gilles Hardy n’est pas aisé à situer car il semble avoir eu plusieurs homonymes, en particulier un oncle (cité avec son père par Abry parmi les disciples de Lombard251). Est-ce bien notre homme qui fut, par exemple, gouverneur du métier des orfèvres en 1562, qui travailla pour la collégiale Saint-Denis en 1551 ou encore pour la chapelle de l’hôpital des Pauvres-en-Île en 1564252 ? Sans parler des divers peintres repris sous le vocable énigmatique de « Gilles le Pondeur ». En tout cas, il est mentionné pour des ventes de terrains ou des cessions de rentes entre 1561 et 1572. En 1565, il habite rue Pécluse253. En 1572, lorsqu’il achète un morceau de terrain derrière sa maison, il vit près de la porte Saint-Léonard. Le 9 avril 1565, en compagnie de son père François et leur collègue Jacques Libermé, Gilles Hardy s’engage envers les bourgmestres de la cité pour la fourniture de divers décors éphémères en vue de la Joyeuse Entrée du prince-évêque Gérard de Groesbeeck prévue pour le 20 mai suivant254. Cela concerne des arcs de triomphe à placer devant l’église Saint-Georges ainsi que la décoration de l’hôtel de ville, le tout devant être réalisé selon les instructions d’un certain « maistre Jacques Bollogne ».
245. Édouard Poncelet, Les architectes de la cathédrale Saint-Lambert de Liège, dans Chronique archéologique du pays de Liège, t. 25, 1934, p. 36. 246. Georges Hansotte, Contribution à l’histoire de la métallurgie dans le bassin du Hoyoux aux Temps modernes, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 80, 1967, p. 69-70. 247. Jean Yernaux, s.v. Hardy, dans Biographie nationale, t. 31, 1962, col. 430-437. 248. Breuer, op. cit., p. 49. 249. Yernaux, s.v. Hardy, op. cit., col. 431. 250. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 323, f° 266 ; 327, f° 170 ; 349, f° 198 ; 373, f° 257 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 251. Abry, op. cit., p. 151 et 168. 252. Manuscrit Yernaux, f° 88.- Yernaux, s.v. Hardy, op. cit., col. 433-434. 253. Poncelet, Documents inédits…, op. cit., p. 118. 254. Manuscrit Yernaux, f° 87. 180
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Jean-Louis de Haske ou Jean Louys de Haske (mentionné entre 1561 et 1570) C’est en tant que gendre de Lambert Lombard que ce peintre est connu255. Abry le mentionne déjà256 : « L’une de ses filles [de Lombard] avait épousé dès l’an 1561, Louis de Hasque, peintre aussi ». C’est par sa femme « fille maistre Lambert Lombart, peintre » que Jean Louys de Haske relève le métier des orfèvres en 1561 (en fait Louys est peut-être le patronyme, « de Haske » indiquant simplement son origine hasseltoise). C’est sans doute cette date de 1561 qui inféra la date du mariage à Louis Abry ; Jean-Louis de Haske et Anne Lombard étaient peut-être mariés depuis plusieurs années au moment de l’entrée du peintre dans la corporation qui accueillait les peintres à Liège. Le 4 août 1570, il signe un acte avec sa belle-mère, Anne de Chauveheid, son beau-frère Georges Lombard et deux autres parents pour attester que de son vivant Lambert Lombard avait promis la carrière de Ninane à son gendre, le sculpteur Thomas Tollet257. Quelques mois plus tard, le 4 décembre, il comparaît avec sa belle-mère et un autre des ses beaux-frères, Jérôme, pour défendre les droits de l’ensemble des enfants de feu Lambert Lombard concernant des rentes impayées touchant des biens situés près de la vigne del Chieff d’or à Sclessin258. On perd sa trace par la suite. Il était peut-être apparenté à Willem Lowichs, peintre mentionné à Hasselt entre 1540 et 1564 au moins – il y fut même bourgmestre259 – ou au peintre Jean Louys, dit Rockus (cf. infra). Jean Herman dit Pité (mentionné entre 1606/1608 et 1634) Entre 1606 et 1608, Jean (Herman dit) Pité a relevé le métier des orfèvres de Liège en même temps que son père, retondeur homonyme260. Le 14 mars 1623, le retondeur Henri Pité, probablement son parent, lui cède tous ses meubles et toutes ses rentes contre 100 florins261. Le 6 juin 1634, il donne procuration au chanoine de Saint-Pierre Gilles Counotte pour toucher sa part des revenus de l’areine de Richonfontaine262. Il se confond peut-être avec le peintre Jean Pietri. Celui-ci n’est connu que par la mention de la restauration d’un tableau de la cathédrale en 1634263. Le Musée des Beaux-Arts de Nantes conserve depuis 1814 une nature morte de chasse à la Snyders (119 x 139 cm) signée « (J ?) Hermann ft ». La première lettre du nom est une majuscule bouclée : il peut s’agir d’un H orné autant que d’un J et d’un H entrelacés264. Par ailleurs, le Rijksbureau voor kunsthistorische Documentatie à La Haye a répertorié, sous le nom de Jan Hermans, une nature morte de fleurs et de fruits avec un singe et un chien datée 1653. Sans doute avons-nous affaire à un seul et même peintre. Ce dernier s’identifierait-il au Liégeois ? L’écart des dates permet d’en douter. Mais il faut noter qu’aucun autre Herman dont le prénom commence par la lettre J n’a été répertorié à ce jour. L’attribution des deux natures mortes au Liégeois ne laisserait toutefois pas d’étonner, car ces tableaux attestent un maître de qualité qui aurait sûrement laissé des traces dans l’historiographie. Le tableau documenté au RKD est du reste attribué par Marie-Louise Hairs à Hendrick Hermans, peintre qui fut reçu à la gilde de Saint-Luc à Anvers en 1650265.
255. Breuer, op. cit., p. 58. 256. Abry, op. cit., p. 166. 257. Yernaux, Lambert Lombard, op. cit., p. 334. 258. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 333, f° 225 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 259. Sur celui-ci, voir Rombouts, op. cit., p. 56. 260. Breuer, op. cit., p. 134. 261. AEL, Notaire A. Etten, 1623, f° 262-262 v°.- Jean Yernaux, s.v. Walschartz, dans Biographie nationale, t. 31, 1962, col. 726. 262. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 498, f° 307 v° (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar).- Manuscrit Yernaux, f° 142. 263. Archives de l’Évêché de Liège, Cathédrale, B.II.19, 18 février 1634 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 264. Selon une indication que m’a aimablement communiquée Mme Claire Gerin-Pierre, conservateur au Musée de Nantes. 265. Marie-Louise Hairs, s.v. Hermans Hendrick, dans Dictionnaire des peintres belges..., op. cit., p. 523. 181
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Alexandre de Horion (ca 1590 ?-1659) À la lecture du présent répertoire, le lecteur prend aisément conscience du décalage existant entre le nombre élevé d’artistes connus par les textes (archives ou auteurs anciens) et le nombre réduit de peintres dont une œuvre au moins conservée a été identifiée. Or, plusieurs de ces peintres qui ne sont plus connus que par les textes furent des artistes importants. C’est le cas d’Alexandre de Horion, mentionné dans la plupart des études sur la peinture liégeoise ancienne, mais dont personne n’a pu jusqu’à présent énoncer une seule œuvre préservée. La plupart des ouvrages relatifs à la peinture liégeoise ancienne reprennent ce portraitiste à leur sommaire. Tous se contentent pratiquement de répéter les rares informations fournies par Louis Abry266. Seul Helbig a pu compléter les informations d’Abry par quelques mentions d’archives confirmant que Horion, peintre officiel de la Cité, était un artiste bien établi à Liège. En fait, Horion serait demeuré au nombre de ces artistes oubliés n’ayant survécu que par le témoignage d’Abry, si son nom n’avait resurgi dans des travaux récents. Dans mon étude sur Gérard Douffet, j’ai à plusieurs reprises évoqué le nom de Horion pour certains portraits jusqu’alors mis au compte de Douffet, spécialement les portraits de Sébastien La Ruelle conservés au Musée de l’Art wallon267. Dans le même temps, René Jans s’attelait à une étude biographique approfondie268. Il arrivait aux mêmes conclusions que moi, mais par des voies différentes, quant à une possible attribution à Horion de l’un ou l’autre des portraits de La Ruelle. Poursuivant la recherche, je crois avoir réuni un faisceau d’indices suffisants pour attribuer à Horion avec vraisemblance l’un de ces tableaux269. Au départ de ces attributions, il apparaît aujourd’hui possible de proposer un embryon de catalogue, certes encore fort hypothétique, mais ces tableaux sortant du cadre chronologique de cette étude, ce problème ne sera pas abordé ici. Cet embryon de catalogue atteste en tout cas que Horion, comme Abry le laissait déjà entendre, fut un peintre non négligeable dans le contexte liégeois. La biographie dressée par René Jans le confirme. Alexandre de Horion, fils du prélocuteur Jean de Horion et de Jeanne Gommersbacht, nièce du doyen de la collégiale Saint-Barthélemy, serait né vers 1590. Jules Helbig est le premier à proposer cette date270 ; il la tient vraisemblablement d’un manuscrit perdu du chanoine Hamal. Alexandre eut au moins trois frères et quatre sœurs. On ne sait rien de sa jeunesse ni de sa première formation. Selon Jean Yernaux, il aurait été l’élève de Laurent Pietkin I, disciple présumé de Lambert Lombard271. Yernaux n’avance aucune preuve. Il se fonde vraisemblablement sur le fait que, par son mariage en 1625 ou 1626, Horion devint le beau-frère de Pierre Pietkin I ; ce Pierre Pietkin était le fils dudit Laurent. Reprenant ce type d’argument assez léger, Jans signale que la mère du peintre et graveur Pierre Dufour, dit Furnius, était apparentée avec l’arrière-grand-mère d’Alexandre. Il pose la question de savoir si Horion n’aurait pas plutôt travaillé auprès d’Henri Desneux, qui demeurait dans le voisinage de la maison des Horion. Tous ces arguments paraissent de peu de poids, reconnaissons-le. Toutefois, les liens avec Pierre Pietkin sont bien documentés. On peut se demander si ce n’est pas lui qui accueillit le jeune Horion dans son atelier. En effet, les deux hommes étaient en relation bien avant qu’ils ne devinssent beaux-frères. Ainsi Alexandre fut-il, le 18 décembre 1619, témoin du testament de Pierre Pietkin et de son épouse Gillette (alias Jeanne) de Meers272. Il sera plus tard également témoin du testament que Marie Thorette, veuve du peintre Laurent Pietkin et mère dudit Pierre Pietkin, établira le 10 juillet 1632273. Ne serait-ce pas par le biais de cet éventuel apprentissage (ou compagnonnage) que 266. Abry, op. cit., p. 204-205. 267. Kairis, Le peintre Gérard Douffet…, mémoire de licence, op. cit., p. 99, 181, 195-196 et 197. 268. Jans, Un important peintre liégeois…, op. cit., p. 477-485. 269. Pierre-Yves Kairis, Autour de Walthère Damery, dans Catalogue de l’exposition Walthère Damery 1614-1678 (Alden Biesen), Louvain et Paris, 1987, p. 28. 270. Jules Helbig, Histoire de la peinture au pays de Liège, Liège, 1873, p. 248. 271. Yernaux, Lambert Lombard, op. cit., p. 314-315. 272. AEL, Échevins de Liège. Convenances et testaments, 54bis, f° 98-99 v° (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 273. Manuscrit Yernaux, f° 138. 182
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Horion aurait fait la connaissance de sa future épouse, sœur de la femme de Pierre Pietkin ? C’était affaire fréquente en ce temps, on le sait. Horion est allé parfaire sa formation à l’étranger. C’est en effet au titre de voyageur qu’il sera admis, le 13 février 1636, au sein du conseil de gestion de l’hôpital Saint-Jacques en remplacement de feu le peintre Jean Taulier. Cette admission d’un artiste comme voyageur permet de déduire un séjour à Rome. René Jans laisse entendre que Horion revenu d’Italie en janvier 1617 au plus tard : à cette date, il est en effet signalé à Liège. En fait, c’est bien plus tard qu’il s’est rendu à Rome. J’ai en effet retrouvé sa trace dans les Stati d’anime (répertoire annuel des paroissiens appelés à communier le jour de Pâques) de la paroisse San Lorenzo in Lucina en 1621, 1622, 1624 et 1625274. Il habite via Ferratina, au sein du fameux quartier, sis à l’entrée de Rome, qui abritait la majorité des artistes étrangers. Or, Horion était encore à Liège en décembre 1619. Son départ pour l’Italie se situe donc entre cette date et le début de l’année 1621 – le trajet vers pour Rome durait généralement de six à huit semaines275. Peut-être a-t-il croisé sur place ses compatriotes Walschartz et Douffet, qui devaient tous deux se trouver à Rome en cette année 1620. Quoi qu’il en soit, Horion n’habitait pas encore via Ferratina à ce moment-là. Il est resté à Rome jusqu’au printemps 1626. Sa présence à Liège est attestée dès le mois de juillet de cette année-là. Si la carrière de Horion sort du cadre de cette étude, signalons quand même que les Stati d’anime de 1624 le renseignent au domicile du grand peintre français Simon Vouet, en compagnie d’une kyrielle de grands peintres au premier rang desquels il faut citer Nicolas Poussin, dont c’est la première mention à Rome276. Et l’année suivante, on retrouve Horion sur un chantier prestigieux : les décors éphémères réalisés sous la direction du Bernin à la basilique Saint-Pierre à l’occasion de la canonisation par Urbain VIII de sainte Élisabeth du Portugal277. Chantier prestigieux, mais intervention modeste : le peintre liégeois est cantonné dans les peintures décoratives, notamment des blasons, du baldaquin érigé pour cette occasion. Comme le note Loredana Lorizzo, il y a fort à parier que c’est Vouet, lui-même bien en cour, qui a introduit le Liégeois dans le cercle des Barberini. Sa carrière liégeoise ne sera pas à la hauteur de ces prémices. Il est clair que Horion fut d’un talent modeste aux côtés de ses confrères Douffet et Walschartz, ce qui dut limiter ses ambitions. Johan Houmar (mentionné en 1606-1608) Ce doreur a acquis le métier des orfèvres à Liège en 1606-1608278. Bertin Hoyoul (ca 1570-1655/1657) René Jans a également retracé l’existence de ce peintre peu connu279. Abry ne voit en lui que le maître de Michel Ponceau280 : « (...) Bertin Hoyoul, peintre assez passable, duquel on voit encore quelques pièces par ci par là, mais que l’on quitte parmi nos églises, comme de divers autres dont les mémoires nous sont échapés ». Hoyoul appartenait à ces peintres mineurs dont les ouvrages apparaissaient complètement 274. Archivio storico del Vicariato di Roma, Stati d’anime. San Lorenzo in Lucina, 1621, f° 15 v° ; 1622, f° 14 v° ; 1624, f° 19 ; 1625, f° 16. 275. Voir par exemple Jean Ceyssens, De Visé à Rome en 1709, dans Leodium, t. 3, 1904, p. 101-108 ; Jacques Thuillier, « Il se rendit en Italie... » Notes sur le voyage à Rome des artistes français au XVIIe siècle, dans « Il se rendit en Italie… » Études offertes à André Chastel, s.l., 1987, p. 328. 276. Cette mention importante, et souvent commentée depuis lors, pour la compréhension du milieu des peintres français – et liégeois – à Rome a été publiée pour la première fois par Jacques Bousquet, Documents sur le séjour de Vouet à Rome, dans Mélanges d’archéologie et d'histoire de l’École française de Rome, t. 64, 1952, p. 293-294. 277. Loredana Lorizzo, Bernini’s ‘apparato effimero’ for the Canonisation of St Elisabeth of Portugal, dans Burlington Magazine, t. 145, 2003, p. 358 et 360. 278. Breuer, op. cit., p. 131. 279. Jans, Les peintres liégeois Bertin Hoyoul…, op. cit., p. 189-192. 280. Abry, op. cit., p. 180. 183
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
démodés au XVIIIe siècle. Hamal ne cite aucun de ses tableaux dans les églises de Liège. Selon un manuscrit inédit de Villenfagne (cité par Jans mais déjà connu de Becdelièvre), il aurait surtout été spécialisé dans les portraits. Selon la même source, Bertin Hoyoul (ou Hoyoux, Hoillou, Hollou, Houllou, de Hoyoul) serait né à Jupille. René Jans le croit toutefois né à Liège. Le peintre appartenait à une famille patricienne originaire du Condroz. Il est le fils de Jean de Hoyoul dit de Herve, procureur à la Cour de l’Officialité et commissaire de la Cité, et de Jeanne Berto, nièce du peintre Lambert Hardy. René Jans situe sa naissance vers 1570 ; il tient compte du fait que ses parents se sont mariés vers 1560, qu’il était leur troisième enfant et qu’il avait déjà recruté un apprenti en 1594. De l’avis du même René Jans, les quatre enfants du procureur Hoyoul demeurèrent célibataires et vécurent ensemble dans la maison paternelle de la rue des Carmes-en-Île (l’actuelle rue Saint-Paul), dans la paroisse Saint-Martin-en-Île. Jean-Guillaume Carlier occupera cette maison ultérieurement. Lors de l’impôt de 1650 sur les vitres, Bertin Hoyoul verse la somme relativement importante de 9 florins 3 patards, pour soixante et une vitres281. Tout jeune encore, en 1581-1583, Hoyoul relève le métier des orfèvres282. Michel Ponceau se trouve en apprentissage auprès de lui lorsqu’il intègre à son tour le métier des orfèvres, en 1595283. Ce qui confirme l’assertion d’Abry, pour qui Michel Ponceau commence son apprentissage auprès de Hoyoul en 1594. Le 6 mars et le 24 mai 1612, Hoyoul reçoit de la Chambre des comptes respectivement 40 et 70 florins pour des blasons peints à l’occasion des funérailles du prince-évêque Ernest de Bavière284. Le 23 avril 1624, il reçoit 5 florins 16 sous de la compterie de la fabrique de la cathédrale Saint-Lambert pro nova delineatione civitatis Leodiensis iuxta ordinationem285. Comme on le voit, on dispose de peu d’éléments sur son existence. On sait seulement qu’il a vécu à l’aise. René Jans a noté que, à travers les archives, on le trouvait à diverses reprises intervenant contre des débiteurs récalcitrants ou monnayant des cens et rentes, même auprès de son ancien élève Ponceau en 1648. À la fin de novembre 1655, il est encore en vie, tandis qu’à la date du 19 juin 1657 il est dit décédé286. Nicolas de Jeneffe (mentionné en 1599 et 1626) Le peintre Nicolas de Jeneffe, alias de Pont, acquiert le métier des orfèvres à Liège en 1599287. Le 15 mars 1626, il relève le métier des merciers en tant qu’époux de Barbe de Bernimolin288. Cette dernière, veuve de Nicolas de Jeneffe, décédera dans la paroisse Saint-Thomas le 1er janvier 1663289. Antoine Lambert (mentionné entre 1562 et 1575) Plusieurs peintres de ce nom émergeant des documents du temps, on restera prudent sur les identifications. Car il n’est pas sûr qu’il s’agisse du même individu qui acquit une maison de l’Îlot des Fèvres avec
281. Description du rapport des vitres et bonniers, tant de la Cité que villages circonvoisins, Liège, 1651, [p. 257]. 282. Breuer, op. cit., p. 91. 283. Ibidem, p. 113. 284. Théodore Gobert, Données historiques, artistiques et économiques d’il y a trois siècles, dans Leodium, t. 18, 1925, p. 16. 285. Archives de l’Évêché de Liège, Cathédrale, B.VII.33, à la date (comm. M. J. Quitin). 286. Sur la foi d’un acte notarié qu’il datait erronément de 1669, Jean Yernaux (Manuscrit Yernaux, f° 96) concluait à l’existence de deux peintres du nom de Bertin Hoyoul à Liège. L’acte en question, portant sur le transport d’une rente par Bertin Hoyoul et sa sœur Jeanne, date en réalité du 20 mars 1649 (AEL, Échevins d’Alleur, 18, f° 34-34 v°). 287. Breuer, op. cit., p. 118. 288. Poncelet, Documents inédits…, op. cit., p. 110. 289. AEL, Registres paroissiaux de Liège, 288, n° 1053. 184
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
ses beaux-frères en 1562290, qui releva le métier des merciers le 11 juin 1563291, qui sous le vocable d’« Anthonio pictori » reçut 16 florins en paiement d’un travail mené pour le compte du chapitre de la collégiale Saint-Denis en 1564292, qui avec son fils Jean a mis en location une maison de la Neuverue derrière Saint-Pierre en 1566293, qui fut gouverneur du métier des orfèvres en 1567-1568294, qui testa le 29 mai 1563295 puis le 6 mai 1568 avec son épouse Marie de Longpois296, qui reçut 1 florin la même année pour un petit crucifix peint pour la collégiale Saint-Pierre, qui fut encore gratifié de 26 florins de la part de la même institution en 1574 pour la pictura candelabrorum de la chapelle d’Ans297 et qui avec son gendre réapparaît dans les archives en 1575 pour la location de la maison de Neuverue298. Il devait être parent avec les différents peintres du nom de Jean Lambert299, dont l’un est cité par Abry comme un peintre de réputation qui fut l’élève de Lambert Lombard300. Lambert Lambion (mentionné en 1595) En 1595, celui-ci était apprenti peintre chez Georges Groeninx ; c’est pourquoi son père releva le métier des orfèvres cette année-là301. Ce relief devait permettre à son fils d’entrer plus aisément, et surtout à moindre coup, dans cette corporation. Dominique Lampson (1532-1599) Ce peintre, historien d’art, diplomate et poète est un personnage-clé de l’humanisme au pays de Liège. Par la diversité de ses activités intellectuelles et artistiques, par son rôle politique en tant que secrétaire de plusieurs princes-évêques de Liège et à ce titre membre du Conseil privé (gouvernement), par ses multiples contacts avec les lettrés de son temps (Reginald Pole, Giulio Clovio, Ludovico Guicciardini, Giorgio Vasari, Liévin Torrentius, Charles Langius, Abraham Ortelius, Juste Lipse…), il fait figure de pivot de la vie intellectuelle liégeoise dans la seconde moitié du XVIe siècle. On peut y voir une sorte de Pic de la Mirandole local, comme le laisse entendre Lambert Lombard dans sa lettre à Vasari du 26 avril 1565302 : « Quelle est la chose qui lui est inconnue ? » Dominique est né à Bruges en 1532 des œuvres de Jacques Lampson et Catherine Corde303. En 1549, il est immatriculé au Collège du Lys, de la Faculté des Arts de l’Université de Louvain. En 1554, il fait la connaissance du cardinal Reginald Pole, qui le prend à son service. Lampson le suit en Angleterre et demeure au service du nouvel archevêque de Canterbury jusqu’à sa mort en 1558. Sur recommandation d’un membre du Conseil privé à Bruxelles, le prince-évêque de Liège Robert de Berghes l’engage ensuite comme secrétaire privé. Lampson se verra confirmer dans cet office par les trois successeurs de ce prince,
290. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 276, f° 20 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 291. Poncelet, Documents inédits…, op. cit., p. 109. 292. Breuer, op. cit., p. 39. 293. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 300, f° 48 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 294. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 315, f° 279 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar).- Manuscrit Yernaux, f° 113. 295. Poncelet, Documents inédits…, op. cit., p. 109. 296. AEL, Échevins de Liège. Convenances et testaments, 49, f° 146 (DIAL ; comm. M. J.-E. Lefever).- Breuer, op. cit., p. 118. 297. Manuscrit Yernaux, f° 7 et 113. 298. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 372, f° 161 v° (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 299. Breuer, op. cit., p. 39. 300. Abry, op. cit., p. 151 et 168. Abry qualifie les œuvres de ce Jean Lambert de « très achevées et fort tendres » et il affirme que celui-ci « a peint joliment et bien fini ». 301. Breuer, op. cit., p. 112. 302. Citée dans Denhaene, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme…, op. cit., p. 318. 303. Les données sur Lampson sont pour l’essentiel tirées de l’ouvrage de référence sur l’artiste : Jean Puraye, Dominique Lampson humaniste 1532-1599, s.l., 1950. Voir aussi Idem, s.v. Lampson Dominique, dans Biographie nationale, t. 39, 1976, col. 590-597. 185
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
ce qui en dit long sur la qualité de son travail. En dehors de ses nombreux voyages, il résidera durant tout le reste de son existence au palais de Liège. Il obtiendra des prébendes rémunératrices aux collégiales Saint-Pierre puis Saint-Denis (dont son propre frère deviendra doyen). Les canonicats n’étant alors pas réservés aux seuls ecclésiastiques, Lampson se marie à Hasselt en 1569 avec Isabeau Schelen, fille d’un riche brasseur local. Elle lui donnera deux enfants. Il mourra le 17 juillet 1599. Son souvenir sera longtemps perpétué par deux monuments funéraires érigés dans la collégiale Saint-Denis. Dans le domaine artistique, c’est avant tout comme critique et historien d’art que Lampson est reconnu. Il est en droit de disputer à Van Mander le titre de fondateur de l’histoire de l’art des Pays-Bas. Il a d’abord publié une monographie, pionnière dans le genre, sur Lambert Lombard à Bruges en 1565 chez Hubert Goltzius. Ensuite un recueil d’effigies gravées et commentées des peintres des Pays-Bas Anvers en 1572 chez la veuve Cock304. Ces deux volumes ont fait date : ce sont les premiers ouvrages d’histoire de l’art des Pays-Bas305. Leur auteur fut la principale source de Vasari en ce qui concerne l’art nordique. Le grand historien d’art italien publia les informations communiquées par Lampson dans sa seconde édition des Vitae, parue en 1568. La vaste correspondance de Lampson traduit aussi ses choix esthétiques, orientés par son admiration pour l’art antique et ses réminiscences italiennes contemporaines. Mais il n’en avait guère qu’une vision indirecte, en particulier grâce à sa collection personnelle de gravures, puisqu’il n’eut jamais l’occasion de se rendre en Italie ; il fut dès lors le premier grand promoteur de la gravure de reproduction, sorte de pis-aller pour les esthètes qui n’avaient pu visiter l’Italie306. Son goût pour l’art italien ne l’empêcha pas de relever les mérites des grands maîtres flamands du XVe siècle. Et il ne fut pas moins attentif à ses contemporains. Sans même s’attarder sur son ami Lambert Lombard, il fut très proche, dès son séjour en Angleterre, d’Anthonis Moor, dit Antonio Moro, qui exécuta son portrait et le lui offrit. Apparemment, ses aptitudes artistiques se manifestèrent essentiellement dans le dessin. Dans sa lettre à Vasari de 1565, Lambert Lombard s’émerveille de la qualité de son jugement en matière d’art et de son trait doux et nuancé lorsqu’il travaille à la pointe d’argent. Mais rares sont les témoins de son activité qui ont subsisté. Puraye lui attribue le dessin des gravures documentaires, de peu d’intérêt artistique, qui illustrent le Poliorceticon que Juste Lipse publia chez Plantin en 1596 avec une dédicace à Ernest de Bavière. Cette attribution se fonde sur une remarque de Juste Lipse dans son propre ouvrage par laquelle il invite Lampson à illustrer ses descriptions des machines de guerre. Une aquarelle sur parchemin montrant le portrait en buste du roi de France Henri III porterait la signature de Lampson à son revers, selon un catalogue de vente307. La signature serait accompagnée de la mention « Anvers 1572 ». Cette mention est en tout cas incorrecte puisque l’ovale qui enserre le portrait évoque les qualités de roi de France et de Pologne. Or, Henri III est monté sur le trône de Pologne en 1573 et a hérité du royaume de France en 1574. Voilà qui laisse un sérieux doute sur l’authenticité de cette « signature »308. Il s’agit probablement d’un projet de gravure. Une gravure attribuée à un Wierix en est d’ailleurs très proche, sans que l’on puisse affirmer qu’elle dérive directement de cette aquarelle309. 304. On se plaît à penser que Lampson ait assuré le contact entre la veuve de Jérôme Cock et son futur mari, qui se confond vraisemblablement avec le peintre liégeois Lambert Bottin (cf. la notice consacrée à ce peintre). 305. Les études sur le rôle de Lampson comme critique et historien d’art sont nombreuses. Pour les études les plus récentes, voir Gianni Carlo Sciolla et Caterina Volpi, Introduzione, dans Da van Eyck a Brueghel. Scritti sulle arti di Domenico Lampsonio, Turin, 2001, p. 7-28 ; Nicolas Galley, De l’original à l’excentrique : l’émergence de l’individualité artistique au nord des Alpes, thèse de doctorat de la Faculté des Lettres, Université de Fribourg, 2005, p. 99-152 (http://ethesis.unifr.ch/theses/downloads.php?file=GalleyN.pdf ; consulté en juillet 2011) ; Sarah Meiers, Portraits in Print : Hieronymus Cock, Dominicus Lampsonius and Pictorum aliquot celebrium Germaniae inferioris effigies, dans Zeitschrift für Kunstgeschichte, t. 69, 2006, p. 1-16. 306. Au début du XVIIIe siècle, Gérard de Lairesse érigera ce succédané en doctrine : dans ses Principes du dessin (publiés pour la première fois, en néerlandais, en 1701), il recommande de privilégier l’achat de gravures et de livres plutôt que les voyages. Comme le remarque Alain Roy (Gérard de Lairesse [1640-1711], Paris, 1992, p. 86), il faut sans doute voir là une auto-justification de Lairesse de n’avoir pu effectuer le voyage d’Italie. 307. Vente Rameau, Versailles, 28 juin 1974, n° 5. Cette feuille (22 x 18 cm) n’est plus localisée ; elle n’est connue que par la reproduction figurant dans le catalogue de vente. 308. Sur le bandeau sous le buste du roi apparaît lisiblement une mention tout aussi erronée : « Obyt Anno 1575 2 august ft ». Or, Henri III est bien mort un 2 août, mais de l’année 1589. Cette inscription n’est pas nécessairement de l’auteur de la composition. 309. Cf. Marie Mauquoy-Henderickx, Les estampes des Wierix conservées au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque royale Albert Ier, t. 3, vol. 1, Bruxelles, 1982, n° 1829. 186
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Dans sa lettre à Vasari, Lombard confirme indirectement que Lampson a peu peint310 : « (…) s’il le pratiquait [l’art de la peinture], il ne serait guère inférieur aux artistes les plus fameux d’aujourd’hui (…) ». Ce témoignage permet de penser que Lampson ne pratiquait pas la peinture à cette époque (1565). Il avait pourtant été initié à cette discipline par le paysagiste Lucas Gassel, suiveur d’Henri Blès, ainsi qu’il le laisse entendre dans le poème qui accompagne le portrait de ce peintre dans les Effigies311. Cette initiation ne doit pas nécessairement être interprétée comme un apprentissage en bonne et due forme. Dans une lettre à Vasari du 30 octobre 1564, Lampson confesse lui-même ses limites dans la pratique de la peinture. Il reconnaît sa compétence pour peindre à l’huile des nus et des habits de toutes sortes, mais ajoute qu’il ne s’est jamais senti le courage de se hasarder plus loin, dans des paysages par exemple. Et de préciser312 : « Quoi qu’il en soit je me suis contenté dans ce domaine de faire des portraits, et cela d’autant plus que les nombreuses occupations que mon office entraîne nécessairement ne me permettent pas davantage ». Sa faible production se déduit aussi de son inscription tardive au métier des orfèvres de Liège. C’est le 14 novembre 1575 que « Dominick Lampson, secrétaire du Prince, parmy 16 écus, acquiert »313. Cet acquêt tardif, qui permet à l’impétrant de pratiquer officiellement la peinture dans la ville de Liège et de répondre aux commandes publiques314, est sans aucun doute à mettre en relation avec son seul tableau conservé : la Crucifixion (375 x 270 cm) exécutée pour l’autel majeur de la collégiale Saint-Quentin de Hasselt (fig. 17)315. Ce tableau fut livré au mois de juillet 1576. Le prince-évêque Gérard de Groesbeeck, qui résidait dans son château voisin de Curange, vint en personne l’admirer dans l’église le 27 juillet. Le tableau coûta 100 florins à l’administration communale de Hasselt, comme il appert d’une requête des marguilliers de l’église en date du 28 juin 1578. Ce tableau, toujours conservé dans cette église, est typique de l’élan maniériste de ce temps, mais c’est l’œuvre d’un petit maître. Il semble rempli de formules avec, par exemple, cette diagonale expressive du groupe qui soutient la Vierge défaillant – les prescriptions post-tridentines sur le Stabat Mater n’ont pas encore cours à Liège à ce moment – ou les deux soldats coupés à mi-jambe au premier plan à droite et qui apparaissent comme des figures-repoussoirs introduisant le spectateur dans le tableau. Autre trait caractéristique de ce temps : ce tableau apparaît comme une sorte de patchwork d’emprunts extérieurs. Comme l’a bien montré Jean Puraye, la figure du Christ est tirée d’une Crucifixion de Giulio Clovio (elle-même inspirée d’un modèle de Michel-Ange) gravée en 1568 par Cornelis Cort (dont Lampson semble avoir été le protecteur). Quant aux deux larrons, ils dérivent d’une Crucifixion de Michel Coxcie gravée par Pierre Furnius (autre proche de Lampson). On ne s’étonnera pas de tous ces emprunts, dans la mesure où Lombard avait mis au point une méthode d’enseignement du dessin qui faisait une large place à l’utilisation de sa collection personnelle d’estampes316. Dans les modèles dessinés qu’il proposait à ses élèves, il avait réinterprété les gravures des grands maîtres de la Renaissance plus qu’il ne les avait copiées. Godelieve Denhaene a noté à quel point il s’était à cet égard émancipé des pratiques des peintres de la première génération du XVIe siècle par une « assimilation plus profonde des formes transmises par les gravures »317. Ses disciples n’ont pas fait preuve de la même habileté. Ils semblent être souvent revenus à une intégration assez sommaire de motifs tirés de gravures.
310. Cité dans Denhaene, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme…, op. cit., p. 318. 311. Dominique Lampson, Les effigies des peintres célèbres des Pays-Bas, éd. Jean Puraye, s.l., 1956, p. 64-65. Van Mander (op. cit., t. 2, 1885, p. 272) confirme que Lampson avait pratiqué la peinture dans sa jeunesse, sans doute bien avant son arrivée à Liège. 312. Cité par Puraye, Dominique Lampson…, op. cit., p. 84. 313. Breuer, op. cit., p. 79. 314. Abry (op. cit., p. 176) écrit qu’il « se fit inscrire de (sic) la société des peintres et orphèvres, qui n’est qu’un même corps, l’an 1575, pour jouir de la bourgeoisie et hanter avec les savants des dites professions ». 315. Sur ce tableau, voir le fascicule de la Fondation Roi Baudouin édité à l’occasion de sa restauration de 1992 : Philippe Farcy et Leon Smets, Calvarie (1576). Dominicus Lampsonius, Bruxelles, 1992. 316. Denhaene, L’album d’Arenberg…, op. cit., p. 142-152. 317. Ibidem, p. 152. 187
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 17 : Dominique Lampson, Crucifixion, toile, Hasselt, cathédrale Saint-Quentin. © IRPA-KIK, Bruxelles. 188
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
À l’image de son ami Lambert Lombard, Lampson fut sans doute davantage un théoricien qu’un praticien. À cet égard, il semble avoir prolongé les conceptions de Lombard, dont il avait suivi l’enseignement théorique. On peut se demander s’il ne fut pas en quelque sorte l’héritier désigné par Lombard pour la perpétuation de son enseignement – il faut peut-être comprendre en ce sens le monument que Lombard érige à son disciple dans sa lettre à Vasari. C’est sans doute dans ce contexte que Lampson s’est vu confié en 1573 l’éducation d’un jeune peintre de quinze ans émigré à Liège avec ses parents : Otto Van Veen, dit Vaenius (cf. infra). Jacques Libermé I (mentionné entre 1536 [?] et 1576) Ce personnage est laconiquement cité par Abry au nombre des peintres ayant bénéficié de quelque réputation à Liège jusqu’aux années 1560318. Il est cité dans les archives du métier des orfèvres en 1536, mais c’est plutôt comme gouverneur du métier, fonction qu’il exerce alors avec le peintre verrier Jean Scheers319. Ce Jacques Libermé s’identifie-t-il bien à celui dont il va maintenant être question ? Ce n’est pas tout à fait sûr. Le 27 novembre 1549, Jacques Libermé acquiert de sa belle-sœur une maison dans la paroisse SaintHubert320 ; il y réside encore en 1573321. Il est encore mentionné pour des problèmes de rentes en 1564 et 1576322. Comme on l’a vu dans la notice consacrée à Gilles Hardy, Jacques Libermé collabore en 1565 avec Gilles et son père à la décoration des rues en vue de la Joyeuse Entrée du prince-évêque Gérard de Groesbeeck323. Il s’identifie peut-être au Jacques le Pondeur qui restaura quelques tableaux de l’église de Jupille en 1543324. À mon sens, il correspond sans aucun doute à ce Jacques le Pondeur époux de Marcken Petri dont le fils Gisbert fut baptisé à Notre-Dame-aux-Fonts le 9 juin 1576 ; les parents résidaient bien dans la paroisse Saint-Hubert325. Le parrain était rien moins que le peintre Otto Vaenius. On doit sans doute en inférer que ce dernier a été formé chez Libermé dans le cadre d’un atelier traditionnel, tandis qu’il suivait une formation plus théorique auprès de Lampson. La tradition aura par la suite confondu les noms de Libermé et de Ramey (voir la notice sur Otto Vaenius). Jacques Libermé II († 1574) Fils de Jacques I, il a relevé le métier des orfèvres en 1571 ou 1572 au plus tard326. Il est décédé en 1574327. Vu la date tardive de son relief du métier, il est probable qu’il n’ait jamais exercé lui-même la peinture et qu’il ne soit entré dans la corporation que pour faciliter l’entrée de son fils Jean, qui a fait le relief peu après. Jacques Libermé III (ca 1565-après 1590) Fils de Philippe et petit-fils de Jacques I, il a relevé le métier des orfèvres en 1590 ou 1591328. Il est cité aux côtés de son père pour une affaire de rentes en 1590 et il est dit âgé d’environ vingt-cinq ans329. 318. Abry, op. cit., p. 151. 319. Breuer, op. cit., p. 42. 320. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 182, à la date (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 321. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 352, f° 352 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 322. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 284, f° 66 ; 376, f° 206 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 323. Manuscrit Yernaux, f° 87 et 119. 324. Ibidem, f° 119. 325. AEL, Registres paroissiaux de Liège, 54, à la date.- Anciens peintres liégeois, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 18, 1885, p. 498. 326. Breuer, op. cit., p. 73. 327. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 424, f° 63 v° (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 328. Breuer, op. cit., p. 102. 329. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 424, f° 63 v° (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 189
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Jean Libermé (mentionné en 1572) Fils de Jacques II, il a relevé le métier des orfèvres en tant que fils de maître en 1572330. Philippe Libermé († 1597/1598) Fils de Jacques I, il a relevé le métier des orfèvres comme fils de maître entre 1562 et 1564331. Yernaux a retrouvé la mention d’autres reliefs : celui du métier des entretailleurs en 1563, en tant mari de Lucie Roland, fille de maître ; celui des merciers en 1564 ; celui des chandelons en 1579332. Il est cité pour des affaires de rentes et de terrains entre 1577 et 1590333. Il testa avec son épouse le 5 septembre 1597 ; ils habitaient en Vinâve d’Île334. Il est décédé entre septembre 1597 et février 1598. Les comptes de la collégiale Saint-Denis mentionnent plusieurs paiements à son endroit : pour le dessin (?) du buffet d’orgue en 1586, pour des travaux dans le bâtiment en 1591, pour le jubé en 1592, pour la chaire en 1594335. Il restaura le tabernacle de l’autel de la chapelle Saint-Materne à la cathédrale en 1589336. Jacques Loheau (mentionné en 1602 et 1603) Ce peintre n’est connu que par quelques mentions dans les archives du métier des orfèvres337. Fils du boulanger Jean Loheau, il est cité comme apprenti chez Jean Ramey en 1602. Il verse au métier 2 écus d’or à cet effet. Il acquiert le métier seulement le 19 octobre 1603 contre 8 écus d’or supplémentaires. Jean Louys (mentionné en 1605-1606) Le peintre Jean Louys (ou Loui), dit Rockus, releva le métier des orfèvres en 1605-1606 en tant qu’époux de Catherine Stevenotte, petite-fille d’un sellier338. Peut-être est-il apparenté à Jean-Louis (ou Jean Louys) de Haske, gendre de Lambert Lombard déjà cité. Hans Lucas (mentionné en 1601) Ce peintre manifestement étranger et son épouse, Annekynne, eurent un enfant à Liège en 1601. Celui-ci fut baptisé le 9 mai et il eut pour parrain et marraine Renier de Franchimont et Péronne Caré339. Il s’agit peut-être d’un peintre itinérant qui n’est pas demeuré longtemps à Liège. Se confondrait-il avec l’architecte Hans Lucas (1569-1649), qui travailla à partir de 1603 pour le duc Charles II de MünsterbergOels340 ?
330. Breuer, op. cit., p. 102. 331. Ibidem, p. 60. 332. Manuscrit Yernaux f° 119. 333. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 378, f° 43 ; 424, f° 63 v°.- AEL, Abbayes et couvents. Célestines de Liège, 38 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 334. Breuer, op. cit., p. 60. 335. Ibidem. Le document cité par Breuer pour l’orgue évoque la peinture par Philippe Libermé des exemplari organorum, mention peu claire. Celle-ci pourrait se rapporter à des volets peints, comme le suppose Richard Forgeur (L’église Saint-Denis à Liège, 2e éd., Liège, 1971, p. 16). Ces volets évoquaient des scènes de la vie de saint Denis ; ils ont disparu au cours du XIXe siècle. 336. Manuscrit Yernaux f° 119. 337. Breuer, op. cit., p. 122, 124 et 147-148. 338. Ibidem, p. 129 et 153. 339. Anciens peintres liégeois, op. cit., p. 498. 340. Ulrich Thieme et Felix Becker (dir.), Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, t. 23, Leipzig, 1929, p. 432. 190
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Robert Malpais (mentionné en 1606) Ce peintre a acquis ou relevé le métier des orfèvres à Liège en 1606341. Gilles Marischal (mentionné en 1618) La Bibliothèque de l’Université de Leyde possède une grande vue topographique de Liège qui s’avère un unicum342. Cette estampe (40 x 205 cm) en quatre feuillets a été gravée par Johan Veenen (inconnu par ailleurs) et a été publiée par l’éditeur strasbourgeois Gérard Alzenbach. Elle porte la mention « Ægidius’ MARI’SCHAL pictore Leodii dilineavit (sic). A° 1618 ». Cette vue montre Liège depuis Saint-Laurent jusqu’à Herstal. Elle a été dessinée depuis les hauteurs de Saint-Maur, dans l’actuel quartier de Cointe. Qui est ce Gilles Marischal qui se dit peintre liégeois ? Deux options s’offrent à nous. Soit, comme le propose Obreen, il se confond avec l’Anversois Ægidius Mareschal qui étudia les Lettres à l’Université de Leyde entre 1580 et 1583343. Soit ce peintre se confond – ce qui me semble plus vraisemblable – avec « Gille Marichal, dit de Tier », repris dans les archives du métier des orfèvres de Liège mais sans qu’il soit fait mention de sa qualité de peintre344. Il est d’abord inscrit comme apprenti en 1599, puis il acquiert le métier le 26 septembre 1604. Il paie à cette occasion 34 florins, la somme qu’il avait payée en 1599 lui ayant été décomptée. Gérard Martin Ce peintre à acquis une maison sur la chaussée des Prés en 1574345. Pierre Mathys (1577-ca 1613) On connaît peu de choses sur ce fils de Nicolas Mathys et d’Isabeau de Forre, alias de Jalhea, sœur du peintre Pierre Furnius. On sait qu’à la mort de son père, en 1596, il reçut pour tuteurs ses oncles Pierre et Lambert Furnius346. En 1600-1601, il relève le métier des orfèvres347. Le 23 janvier 1613, Pierre Mathys (ou Mathis), bourgeois et peintre de la Cité de Liège, dicte son testament. Parmi les légataires figure le sculpteur Pierre de Mettecoven, avec lequel il a sans doute collaboré à maintes reprises. Malade, le peintre est alité dans sa maison du Pont de Torrent (alias rue Meersen), dans la paroisse Sainte-Aldegonde348. Comme l’indique René Jans, la maison de Mathys se trouvait dans la même rue que celle de son oncle Pierre Furnius, mais à l’extrémité opposée. Piron Morea (mentionné entre 1562/1564 et 1609) Ce peintre fit relief du métier des orfèvres en 1562-1564349. Breuer a noté que le pondeur Piron Morea été mentionné en 1589 comme propriétaire d’une maison dans la paroisse Saint-Séverin. Dans la première
341. Breuer, op. cit., p. 133. 342. Sur cette gravure, voir Nicolas Henrotte, Ancien plan ou vue de la ville de Liège, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 13, 1877, p. 85-88 ; La grande vue de Liège, par Gilles Marischal, 1618, dans Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois, t. 3, 1886-1887, p. 103-108 ; Catalogue de l’exposition Liège et la principauté dans la gravure ancienne (XVIe-XIXe siècle), Liège, 1980, p. 8 et n° 14. 343. Obreen, op. cit., t. 5, 1882-1883, p. 270-271. 344. Breuer, op. cit., p. 118, 124 et 149. 345. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 364, f° 122 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 346. Poncelet, Documents inédits..., op. cit., p. 110. Jans, Précisions…, op. cit., p. 161. 347. Breuer, op. cit., p. 120. 348. AEL, Bienfaisance. Hôpital de Bavière, 2645.- AEL, Échevins de Liège. Convenances et testaments, 54, f° 186 v°-189.- Jans, Précisions…, op. cit., p. 161. 349. Breuer, op. cit., p. 62. 191
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
décennie du XVIIe siècle, il participe à la décoration du jubé de l’église abbatiale du Val-Saint-Lambert avec son confrère Jean Bologne350. Jean Moske I (mentionné entre 1580 et 1622 ?) Jean, fils du peintre Jacques Moske (ou Mosque ou Moss ou Mostre), relève le métier des orfèvres à Liège en 1580351. Le 4 octobre 1597, il comparaît devant l’official comme tuteur des enfants de Laurent d’Aineffe et Damide Moske, sa sœur ; il opère le rendage d’une maison du quartier d’Avroy352. En juin 1602, il acquiert une maison à Huy, sur le Marché aux Bestes, derrière le couvent des frères mineurs353. Un document du 14 mars 1605 indique que la maison qu’il occupe à Huy est à l’enseigne de Pourceau354. Il avait épousé Anne, fille du procureur Pierre Gaene355. En 1608, son fils Jean relève à son tour le métier des orfèvres de Liège356. En 1622, il est reçu et admis au sein du métier des maçons et charpentiers de Huy357 ; s’agit-il de Jean Moske I ou de son fils et homonyme ? Le fait que le premier possédait une maison à Huy incite à penser qu’il s’agit bien de lui. Jean Moske I est le père des peintres Jean II et Nicolas Moske, qui suivent. Jean Moske II (mentionné en 1608) Ce fils de Jean Moske I relève le métier des orfèvres en 1608, apparemment en même temps que son frère Nicolas, peintre également358. Nicolas Moske (mentionné en 1608) Sous l’année 1608 figure dans le registre des reliefs du métier des orfèvres de Liège la mention – ambiguë – suivante : « Maître Jean, fils Jean Mostre, pintre, et Nicolas, son frer, ossy peintre »359. Il semble bien que les deux fils de Jean Moske I aient relevé le métier des orfèvres le même jour. Dans un acte assez abscons de 1662, un Nicolas Moske dont la qualité n’est pas précisée obtient de la Cité gain de cause contre le métier des orfèvres360. S’agit-il du même personnage ? Il serait téméraire de l’affirmer. Nicolas de Nivelle (mentionné en 1595) Ce peintre dit natif de Bruxelles a intégré le métier des orfèvres en 1595361. Nicolas d’Oupeye (mentionné entre 1605 et 1619) Ce peintre, fils de Martin d’Oupeye, acquiert ou relève le métier des orfèvres à Liège en 1605362. Il relève par ailleurs le métier des vieux-wariers le 3 mars 1619363. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 192
AEL, Abbayes et Couvents. Val-Saint-Lambert, 386, 8 v°-15 v°. Ibidem, p. 86. Manuscrit Yernaux, f° 126. Ibidem. Edmond Tellier, Les enseignes, dans Au cœur de Huy, Huy, 1987, p. 103. Manuscrit Yernaux, f° 126. Breuer, op. cit., p. 139. Archives de l’État à Huy, Ville de Huy, 349, f° 145. Breuer, op. cit., p. 139. Ibidem. AEL, Métiers, 359. Breuer, op. cit., p. 108. Breuer, op. cit., p. 127 et 128. Manuscrit Yernaux, f° 130.
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Gilles delle Perier (mentionné entre 1570 et 1592) Gilles delle Perier (ou Perye) est cité à quelques reprises, entre 1570 et 1575, pour des rentes364. Il relève le métier des merciers en 1571365. Il est cité en tant que fils de Lambert et de Catherine Gilteau dans un rendage proclamatoire devant l’official le 12 avril 1572366. Selon son testament du 25 janvier 1592, il laissait à son parent Johan Rentkin le soin de distribuer toutes les peintures qui lui restaient. Il habitait alors derrière Saint-Paul, près de l’église Saint-Remy et de l’abbatiale Saint-Jacques367. De son œuvre, on ne connaît qu’une Vue de Spa gravée en deux parties en 1559 d’après sa composition. Le volet gauche de la gravure a été publié dans un traité des eaux de Spa du médecin Gilbert Lymborch. Cette jolie vue topographique, la plus ancienne représentant Spa, est signée Ægidium Pierriers pictorem368. Sans aucun doute notre Gilles delle Perier. Denis Pesser († 1608 ?) Fils du peintre Jean Pesser (cf. infra), petit-fils du peintre et peintre verrier Pierre Pesser († 1558), neveu du peintre François Pesser († ca 1578), Denis est l’ultime rejeton d’une de ces dynasties de peintres artisans qui ont marqué le XVIe siècle liégeois. C’est une fois de plus à René Jans qu’il revient d’avoir corrigé maintes données biographiques sur les peintres de cette famille – sauf mention contraire, les données ici reprises se réfèrent à son étude369. Alexandre Pinchart avait déjà publié trois documents relatifs à l’activité professionnelle de Denis Pesser370. Le 7 juillet 1589, celui-ci reçoit de la Chambre des comptes 5 florins pour avoir enluminé le livre du duc de Brunswick avec les armoiries du prince-évêque Ernest de Bavière. Le 24 juillet suivant, le même est payé 36 livres pour une peinture intégrant les armoiries du prince-évêque ; cette peinture est destinée à l’église liégeoise des frères mineurs. Celle-ci étant prévue pour orner un autel, je ne crois pas, au contraire de René Jans, qu’il puisse s’agir d’une peinture murale comme celle que Pesser réalisera à Saint-Jacques une dizaine d’années plus tard. Le 31 décembre 1591, il reçoit 51 florins et 16 sous pour quelques travaux artisanaux au palais princier à l’occasion de la visite du duc de Lorraine. Il peint, dore et argente des litières et des brancards, mais il exécute apparemment aussi des tableaux, sans doute des pièces de circonstance. En 1598, Pesser signe et date une peinture murale située dans l’actuelle chapelle Notre-Dame de SaintRemy en l’église Saint-Jacques à Liège : la Résurrection du Christ (fig. 18). L’inscription en latin qui se trouve sous la peinture nous apprend qu’elle a été commandée par Martin Fanchon, abbé du monastère de Saint-Jacques. C’est une des rares peintures murales de cette époque qui ait été conservée en région liégeoise. Elle a été peinte à l’huile sur un enduit préalablement posé sur la muraille. L’iconographie est tout à fait traditionnelle. Autour du tombeau se dispersent les soldats effrayés tandis que le Christ s’élève dans les cieux en tenant la traditionnelle bannière à la croix. Si le talent du peintre apparaît certes honorable dans le contexte local, nous n’avons néanmoins pas affaire à un maître de premier plan. Les défauts dans les proportions et dans la perspective sont évidents. Ils témoignent d’un artiste qui, comme beaucoup à cette époque, se contente d’incorporer à leurs compositions des motifs empruntés à des sources diverses. On devine ici un peintre bien en peine pour sublimer l’effet de patchwork, caractéristique de tous les petits maîtres de ce temps.
364. 365. 366. 367. 368. 369. 370.
AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 331, f° 145 v° ; 341, f° 200 ; 373, f° 134 et 288 v° (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). Manuscrit Yernaux, f° 130. Poncelet, Documents inédits…, op. cit., p. 109. Manuscrit Yernaux, f° 130. Reproduite notamment dans Georges-Emile Jacob, Rues et promenades de Spa, 2e éd., Bruxelles, 1983, p. 8-9. Jans, Une dynastie…, op. cit., p. 232-236. Pinchart, op. cit., p. 319-320. 193
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 18 : Denis Pesser, Résurrection du Christ, peinture murale, Liège, église Saint-Jacques. © IRPA-KIK, Bruxelles. 194
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Cette impression se confirme lorsque l’on constate que la figure du soldat au premier plan à gauche qui masque son visage sous l’effet de la frayeur est reprise à une gravure de Cherubino Alberti de 1572 d’après la Conversion de saint Paul de Taddeo Zuccaro conservée à l’église San Marcello à Rome ; feu Jacques Folville, qui a restauré la peinture en 1958, avait déjà noté de son côté l’emprunt à Zuccaro. Pour lui, cette peinture murale aurait été réalisée par deux artistes différents : le Christ triomphant, de caractère tintoresque (sic), lui apparaissait d’une technique bien supérieure371. À mon sens, cette différence s’explique par le fait que le peintre a utilisé une autre gravure, encore à identifier, pour le Christ ; il aura fait preuve de plus d’application pour la réalisation de ce qui s’avère évidemment la figure principale. Les autres personnages, sans grande consistance, sont sans doute de l’invention du peintre et attestent bien les limites de ce disciple attardé de Lambert Lombard. En 1966 a été découverte dans une chapelle rayonnante de la même église une seconde peinture murale avec une Mise en croix. Il s’agit d’une peinture contemporaine de la Résurrection et qui est également peinte à l’huile sur enduit. Pour René Jans, elle serait de la même main que la Résurrection372. C’est possible mais c’est loin d’être assuré ; cette Mise en croix semble à première vue attester un artiste plus compétent. Si son auteur maîtrise davantage les effets de perspective, le rendu des types physiques et la répartition des masses dans l’espace, c’est toutefois dû à la source gravée qu’il a utilisée. Isabelle Lecocq a montré que l’auteur de la Mise en croix avait quasi entièrement copié une gravure d’après Van Heemskerck373. Les personnages ont largement perdu de leur vigueur et certains défauts de la composition du peintre hollandais ont été accentués ; voyez la déformation du plan de la croix. Le peintre liégeois a ajouté en bas à droite de la composition un évêque agenouillé sur un prie-Dieu, juste derrière la tête du Christ. Les armoiries figurant sur le prie-Dieu et répétées entre deux putti au sommet de la composition permettent d’y reconnaître Baldéric II, le prince-évêque qui succéda à Notger et qui fonda l’abbaye de SaintJacques en 1015. René Jans s’est demandé si cette figure, qui semble renvoyer à un portrait, n’emprunte pas les traits de l’abbé de l’époque, Martin Fanchon. Pour cet auteur, le style particulièrement soigné du portrait et du personnage tout entier contraste avec le caractère fruste des autres personnages. Il se demande dès lors si ce portrait n’aurait pas été ajouté à la composition après coup et par une main plus experte. Jans en veut pour preuve que la hampe de la hallebarde du soldat à droite se fiche malhabilement dans la tête de l’évêque, « faute de composition qui n’aurait pas été commise dans le cas où l’évêque aurait pris place dans l’ensemble primitif ». L’identification de l’estampe ayant servi de modèle réduit cette hypothèse à néant. On remarque en effet que le peintre a surélevé le soldat à la hallebarde justement pour pouvoir intégrer la figure du prélat agenouillé. Que ce soit pour la Résurrection du Christ ou pour la Mise en croix, rien ne paraît donc indiquer l’intervention de deux artistes différents dans chaque composition. Les deux peintures sont-elles pour autant de la même main ? La Mise en croix offre plus de fraîcheur dans les coloris et plus de dégagement dans la composition, qui offre davantage de respiration. Certes les types figurés se ressemblent, mais ils sont caractéristiques des petits maîtres tardo-maniéristes qui témoignent des derniers feux de l’école de Lambert Lombard. Rien n’interdit de penser que Denis Pesser soit également l’auteur de cette seconde peinture murale, même si cette attribution demeure très incertaine. En revanche, on peut penser que c’est une même main qui a exécuté la Mise en croix et un ensemble de peintures murales découvert en 2002 dans une pièce de l’abbaye de Saint-Jacques qui donnait jadis sur le cloître et qui relevait sans doute du quartier des malades374. Les rares parties dégagées (fig. 19) indiquent qu’il s’agissait d’un cycle de peintures inspirées de gravures de 1559, également d’après Van Heemskerck, sur le thème de la Parabole des Noces royales.
371. Arthur Moreau, Chronique de la paroisse Saint-Jacques à Liège 1900-1960, Liège, 1966, p. 180. 372. René Jans, Une autre œuvre probable de Denis Pesser…, op. cit., p. 335-336. 373. Isabelle Lecocq, Contribution à l’étude de l’art liégeois de la seconde moitié du XVIe siècle, dans Art&fact. Revue des historiens d’art, des archéologues, des musicologues et des orientalistes de l’Université de Liège, t. 17, 1998, p. 170. 374. Sur ces peintures, voir Geneviève Coura, Caroline Bolle et Jean-Marc Léotard, Les vestiges des bâtiments claustraux de l’abbaye de Saint-Jacques à Liège, dans Cahiers de l’urbanisme, t. 44, 2003, p. 62-64. 195
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 19 : Denis Pesser ?, Parabole des Noces royales, détail, peinture murale, Liège, Centre wallon d’Archéologie du Bâti. © IRPA-KIK, Bruxelles. 196
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Par ces trois ensembles, l’ancienne abbaye de Saint-Jacques se trouve de la sorte érigée en haut lieu de la peinture murale au pays de Liège. L’édifice devait du reste en comporter d’autres. Louis Abry évoque laconiquement les peintures du grand réfectoire ; il les disait réalisées par des disciples de Lombard sur le dessin du maître375. La dernière mention connue de Denis Pesser remonte au 23 mai 1608, date à laquelle il signe un acte à la place de son père. Lorsque ce dernier teste, le 24 juin suivant, sa fille Marie (belle-mère du peintre Pascal Balen) devint seule héritière, ce qui permet de supposer que Denis Pesser était déjà décédé, sans héritier, à cette date. Denis Pesser a eu pour élève André Wesmael I (cf. infra). Une copie du registre des reliefs du métier des orfèvres l’atteste : Wesmael était apprenti chez Denis Pesser lorsqu’il releva le métier en 1602376. François Pesser († ca 1578) François Pesser, fils du peintre Pierre Pesser († 1558) et cousin de Pierre Furnius, apparaît à deux reprises dans les comptes de l’église Saint-Martin-en-Île en 1541 pour de menus travaux artisanaux d’enluminure, de polychromie et de dorure377. Cette même année, il épouse Marie, fille de l’orfèvre Piron Massar alias de Haulstoul378. En 1546, il vend la maison dans laquelle il résidait, sur le Pont d’Île379. Il apparaît dans de nombreux actes entre 1545 et 1570 pour des affaires de rente ou d’héritage380. En 1563, il est dit veuf. Le couple a eu au moins quatre fils (Pierre, François, Jean et Mathieu) et une fille (Ailid), mentionnés dans certains de ces actes. En 1566, il est cité avec sa nouvelle épouse, Oudon Colchon, veuve de Jean de Scorgne ; selon René Jans, celle-ci lui a donné à son tour deux enfants. Elle lui apporta le vaste domaine de la Scorgne sur les hauteurs de Fragnée, au pied de l’actuel quartier de Cointe. D’après Jans, ce domaine causa bien du souci à François, en butte à de nombreux créanciers et devant soutenir plusieurs procès. Il avait perdu ce terrain lorsqu’il est décédé, vers 1578. Jean Pesser († 1608/1609) Cet autre fils de Pierre Pesser fut peintre, à l’instar de son père et son frère François. Il était par ailleurs cousin du peintre Pierre Furnius. On connaît peu de choses de lui381. On sait qu’il était le mari d’Anne Van der Rivieren. En 1556, il vend sa maison de Vinâve d’Île et il acquiert une propriété au Jonckeu, dans la paroisse Sainte-Véronique. Il habite là sa vie durant. Comme l’a noté Robert Hankart, il est pour cette raison fréquemment cité dans les registres de la Cour de justice d’Avroy382 : « Il se présente dans les actes comme un homme modeste, faisant peu parler de lui et soucieux de ses rentes ». En 1567, il comparaît devant les Échevins avec son frère François et le fils de celui-ci, qui lui cède une rente383. Vers 1578, sans doute à la mort de son frère François, il rachète aux créanciers de celui-ci le domaine de Scorgne. Ce n’est qu’en 1583 qu’il relève le métier des orfèvres, comme si sa vocation était apparue tardivement. Trois ans plus tard, il restaure une image de la Vierge en la collégiale Saint-Denis. On ne connaît rien d’autre de ses activités. En 1590, il teste avec son épouse devant le curé de Sainte-Véronique. Veuf, il
375. Louis Abry, Revue de Liège en 1700, éd. Stanislas Bormans, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 8, 1866, p. 285. 376. Breuer, op. cit., p. 122. 377. Yernaux, Lambert Lombard, op. cit., p. 303-304.- Manuscrit Yernaux, f° 137.- Jans, Une dynastie…, op. cit., p. 235. 378. Jans, Une dynastie…, op. cit., p. 234. 379. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 165, f° 343 v° ; 166, f° 276 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 380. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 174, f° 170 ; 248, f° 82 v° ; 266, f° 70 ; 276, f° 235 ; 285, f° 60 ; 304, f° 215 v° ; 305, f° 116 v° ; 306, f° 143 ; 319, f° 97 ; 324, f° 336 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 381. Et on les connaît bien sûr par René Jans, Une dynastie…, op. cit., p. 235. 382. Robert Hankart, Les artistes en Avroy et leur famille (XVIe siècle), dans La Vie wallonne, t. 38, 1964, p. 101. 383. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 306, f° 143 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 197
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
rédige un nouveau testament le 24 juin 1608 et décède dans les mois qui suivent. Il eut deux enfants : Denis, peintre à son tour (cité ci-dessus), et Marie, qui épousera le boucher Lambert Lombard et deviendra la belle-mère du peintre Pascal Balen. Laurent Pietkin I (mentionné entre 1569 et 1614 ?) Laurent Pietkin le Vieux est cité par Abry au nombre des élèves de Lambert Lombard384. Pour Yernaux, il est le fils d’un Pierre Pietkin et d’Agys Goyet385. Selon le même auteur, il épouse, à une date inconnue, Marie, fille du procureur Louis Thorette. La plus ancienne mention datée se rapportant à lui concerne son acquisition, le 4 novembre 1569, de la maison à l’enseigne de l’Étoile en la paroisse Saint-Hubert386. Il relève le métier des chandelons à Liège en 1573387. Le 14 mai de la même année, il relève celui des merciers388. En 1583, il relève enfin celui des entretailleurs389. Il est mentionné comme « citain » de Liège en 1587 et 1588390. En 1589, il réside dans la paroisse Saint-Séverin391. Au baptême de son fils, le 2 août 1590, il réside dans la paroisse Notre-Dame-aux-Fonts392. Par contrat du 23 août suivant, il s’engage à décorer l’intérieur de la collégiale Sainte-Croix et à polychromer diverses statues393. En 1591, il est en procès avec Perpète le Scrinier pour le paiement de peintures394. En 1592, il réclame à Renier de Xhenceval 60 florins pour prix d’un tableau d’autel livré à Notre-Dame-aux-Fonts395. En 1604, la fabrique de la cathédrale de Liège effectue divers versements à maître Laurent, peintre396. Dans la notice consacrée au peintre Hansken, j’ai montré qu’il s’agissait peut-être de ce Hansken ; mais il pourrait aussi s’agir de Laurent Pietkin. Selon Yernaux toujours, Pietkin aurait été le maître d’Alexandre de Horion, mais l’auteur n’étaye pas cette affirmation397. On peut supposer que celle-ci se fonde sur le fait que les épouses de Horion et de Pierre Pietkin I, fils de Laurent, étaient deux sœurs. Plusieurs actes mentionnant un peintre Laurent Pietkin dans les années 1610 pourraient se rapporter à lui (à moins qu’il s’agisse de Laurent II). Un peintre Laurent Pietkin est cité dans un acte liégeois du 26 mai 1611 dont ni la nature ni la source ne sont précisées398. Le 24 novembre 1614, le peintre Léonard Gromet comparaît devant les échevins de Liège, avec son père et homonyme, contre le peintre Laurent Pietkin ; les deux hommes sont en conflit à propos d’une rente sur des biens situés à Glain399. La veuve de Laurent Pietkin, Marie Thorette, disposait manifestement de quelques biens. On le devine à la lecture d’un registre de ses cens et rentes entamé en 1616 et conservé aux Archives de l’État à Liège400. Elle teste une première fois le 19 juillet 1621401. Elle a alors trois enfants encore en vie : Pierre, 384. Abry, Les hommes illustres…, op. cit., p. 168. 385. Manuscrit Yernaux, f° 138. 386. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 325, à la date (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 387. Yernaux, Lambert Lombard, op. cit., p. 314. 388. AEL, Métiers, 337, p. 147. 389. Manuscrit Yernaux, f° 138. 390. Breuer, op. cit., p. 93. 391. Manuscrit Yernaux, f° 138. 392. AEL, Registres paroissiaux de Liège, 1, f° 250 v°. 393. AEL, Collégiale Sainte-Croix à Liège, 58, à la date.-.- Manuscrit Yernaux, f° 140-141. 394. Yernaux, Lambert Lombard, op. cit., p. 314. 395. Ibidem. 396. Poncelet, Les architectes…, op. cit., p. 36. 397. Yernaux, Lambert Lombard, op. cit., p. 314-315. 398. Anciens peintres liégeois, op. cit., p. 498. 399. AEL, Échevins de Liège. Obligations, 69, f° 147-148 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 400. AEL, Famille Pietkin, un seul dossier.- Berthe Lhoist-Colman, Jean Pietkin (1597-1679...), orfèvre liégeois, auteur d’une Vierge à l’Enfant pour la collégiale de Fosses-la-Ville, dans Leodium, t. 85, 2000, p. 40. Ce registre s’achève sur les comptes de 1672. Ils étaient alors tenus par le chanoine et musicien Lambert Pietkin. 401. AEL, Notaire Gh. Milemans à Liège, à la date.- Lhoist-Colman, Jean Pietkin…, op. cit., p. 43. 198
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Laurent et Catherine, qui vit à Maestricht. Elle teste une seconde fois le 10 juillet 1632402. Alexandre de Horion est témoin de ce second testament. Laurent Pietkin I est le premier d’une longue dynastie de peintres et d’orfèvres. Il est le père des peintres Laurent II, Pierre et peut-être Lambert. Laurent Pietkin II (1590-après 1621) Le 2 août 1590 est baptisé à Notre-Dame-aux-Fonts « Lorent fils maître Lorent le pondeur et maroÿe conj. »403. Il s’agit sans conteste du fils de Laurent Pietkin I et de Marie Thorette. Laurent II fait relief, en 1611, du métier des orfèvres404. Il fait relief du métier des merciers à Liège le 8 juillet 1612405. Le 20 juillet 1617, il passe un contrat avec une certaine Pirette, demeurant en Pierreuse, à laquelle il donne en location le rez-de-chaussée de sa maison en Gérardrie, dans la paroisse Notre-Dame-aux-Fonts406. Selon un premier testament rédigé en 1621, sa grand-mère, Marie Thorette, le désigne comme héritier universel407. Ce testament nous l’apprend, il est alors l’époux d’une personne prénommée Marie et il a une fille qui porte le même prénom. C’est sans doute cette fille qui est ainsi enregistrée dans les décès de la paroisse Saint-Servais en date du 25 novembre 1622 : « l’enfant laurent Pietkin Pintre »408. En 1625, l’orfèvre Pierre Simon paie à la cathédrale une rente sur une maison qui a auparavant appartenu à ce Laurent Pietkin, pour autant que l’identification proposée par Jean Yernaux409 soit bien fondée et que la mention ne se rapporte pas à Laurent I. Pierre Pietkin († 1626) Fils de Laurent Pietkin I, Pierre relève le métier des orfèvres, comme fils de maître, en 1584410. Il relève celui des merciers en 1596411. Il épouse à une date inconnue Gillette (alias Jeanne) de Meers, fille du maître tanneur Lambert de Meers ; celle-ci est issue d’une famille patricienne qui a donné deux bourgmestres à la ville412. Le couple a plusieurs enfants, dont Jean (1597-après 1664), qui sera orfèvre, et Lambert (1612-1696), qui sera chanoine de Saint-Materne à la cathédrale et musicien réputé. Ils ont également deux filles, Marie et Andrienne, qui seront religieuses clarisses413. Il est probable que le peintre Pierre Pietkin II soit aussi un de leurs enfants414.
402. Manuscrit Yernaux, f° 138. 403. AEL, Registres paroissiaux de Liège, 1, f° 250 v°. 404. Breuer, op. cit., p. 145. 405. AEL, Métiers, 337, p. 147. C’est par erreur que Yernaux (Manuscrit Yernaux, f° 141) a dévolu une notice spécifique à ce Laurent. Il le dit en effet fils d’un Jean Pietkin. Vérification opérée, il s’agit bien de Laurent, fils de Laurent et non de Jean. Et l’année de ce relief est bien 1612 et non 1611. 406. AEL, Notaire J. Prion à Liège, 1611-1656, f° 21 v° (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 407. AEL, Notaire Gh. Milemans à Liège, à la date.- Lhoist-Colman, Jean Pietkin…, op. cit., p. 43. 408. AEL, Registres paroissiaux de Liège, 262, à la date. 409. Manuscrit Yernaux, f° 138. 410. Breuer, op. cit., p. 93. 411. Poncelet, Documents inédits…, op. cit., p. 109. 412. Jans, Un important peintre liégeois…, op. cit., p. 480. 413. Ibidem, p. 483. 414. À la lecture du testament rédigé le 18 décembre 1619 par Pierre Pietkin et son épouse, on devine que le couple a plusieurs fils et filles (Cf. AEL, Échevins de Liège. Convenances et testaments, 54bis, f° 98 [DIAL ; comm. Mme É. Gaspar]). Toutefois, ceux-ci ne sont pas nommément cités puisque les biens des parents doivent être partagés en parts égales entre tous les enfants. Ce qui ne permet pas d’apprécier l’étendue exacte de ces biens. Au premier rang de ceux-ci, on peut citer la maison de l’Étoile d’or dont il va être question. Le peintre paraît avoir été assez aisé, à l’image de son père. Le 26 octobre 1606, sa belle-mère lui cède des rentes sur une maison de Tanneurue (AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 454, f° 288-288 v° [DIAL ; comm. Mme É. Gaspar]). En tête de cet acte, il est erronément prénommé Paul. 199
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Le couple Pietkin-de Meers vivra dans la maison de l’Étoile d’or, derrière le palais, dans la paroisse Saint-André. Alexandre de Horion occupera cette maison à partir de 1641. Elle aura entre-temps été occupée par le peintre Canisius. On peut donc croire qu’elle convenait bien pour le travail de la peinture. Cette maison est vaste. Lors de l’imposition en 1650 des vitres, les peintres paient généralement entre 3 et 8 florins de taxe. Horion verse quant à lui près de 14 florins pour nonante-trois vitres415. On connaît peu de choses de l’activité artistique de Pietkin. On sait qu’il fut le peintre assermenté de la Cité de Liège416. Son nom figure par ailleurs dans deux actes, du 26 juillet 1615 et du 6 juin 1617, comme pictor et cancellarius 417. Cette dernière mention renverrait-elle à une activité de calligraphe ? Le 9 février 1616, il est payé 39 florins pour six tableaux sur bois et seize sur fer blanc destinés au palais princier ; il s’agissait de blasons418. Le 17 décembre 1620, il reçoit encore 60 florins pour des ouvrages dont la nature n’est pas précisée419. Je suis enclin à croire que Pierre Pietkin (et non son père Laurent, comme le prétend Yernaux) fut le maître d’Alexandre de Horion, beaucoup plus jeune que lui. Avant même le départ de Horion pour l’Italie, les deux hommes étaient en relation. Le 18 décembre 1619, Horion est le témoin du testament rédigé par Pietkin et son épouse420. Peu après son retour d’Italie au printemps de 1626, Horion épousera Élisabeth de Meers, la sœur de Gillette. Horion ne reste pas longtemps le beau-frère de Pietkin, puisque celui-ci décède en septembre 1626. Horion lui succédera comme peintre de la Cité le 15 septembre 1626421. Toussaint Pirotte (mentionné entre 1570 et 1576) En 1570, le peintre brodeur Toussaint Pirotte, qui réside en Potiérue dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste, possède deux maisons dans cette rue ; il cède l’une d’entre elles au serrurier Jehan Counotte le Jeune422. L’année suivante, il vend sa propre maison423. Il est encore cité à plusieurs reprises pour des rentes de 1572 à 1576424. Pierre de Plat († 1659) Le peintre Pierre de Pla(t) (alias Leplat) acquiert le métier des orfèvres à Liège en 1602425. C’est la plus ancienne mention de ce bourgeois de Liège maintes fois cité dans les archives locales. Le 1er août 1606, il reçoit un paiement pour avoir polychromé et doré les statues du Christ, de la Vierge et de saint Jacques dans la chapelle de l’hôpital Saint-Jacques426. Il se marie vers cette époque avec Ailid, fille du postainier Jean Charles ou Charlis427. Le 17 janvier 1613, il est payé 60 florins pour la dorure des pieds du lit du prince-évêque au palais428. Le peintre dispose manifestement de nombreux biens. En attestent de multiples documents d’archives relatifs à la gestion de ses rentes, de son patrimoine immobilier et aux multi-
415. Description du rapport des vitres…, op. cit., [p. 27]. 416. Helbig, Histoire de la peinture…, op. cit., p. 248. 417. Anciens peintres liégeois, op. cit., p. 498. 418. AEL, Chambre des comptes, 65, f° 150 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar).- Gobert, Données historiques…, op. cit., p. 20. 419. AEL, Chambre des comptes, 65, f° 242 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 420. AEL, Échevins de Liège. Convenances et testaments, 54bis, f° 98 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 421. Helbig, Histoire de la peinture…, op. cit., p. 248. 422. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 326, f° 67 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 423. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 336, f° 148 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 424. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 346, f° 240 ; 351, f° 184 ; 376, f° 280 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 425. Breuer, op. cit., p. 121. 426. Manuscrit Yernaux, f° 119. 427. Il était en tout cas déjà marié avec elle à la date du 26 août 1609 (AEL, Bienfaisance. Hôpital Saint-Jacques, 258, f° 168). 428. AEL, Chambre des comptes, 65, f° 62 v° (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar).- Gobert, Données historiques…, op. cit., p. 18. 200
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
ples procès y afférents ; l’homme était très soucieux de ses affaires429. Parmi les nombreuses rentes dont il dispose figure un cens de 4 florins sur la maison occupée par le sculpteur Guillaume Cocquelé sur Avroy. Il est par la suite souvent mentionné dans les archives de l’hôpital Saint-Jacques, dont il a par exemple doré le nouvel autel en 1633430. À la fin de sa vie, il y sera même logé, après avoir fait don de tous ses biens à l’hôpital. Il est décédé au début de l’année 1659 et a été inhumé aux côtés de son épouse en l’église Saint-Christophe431. Paul Pochet (mentionné en 1616) Par un acte du 31 décembre 1616, on apprend que ce peintre habite sur le Vieux Marché, entre le palais et la cathédrale432. Sa demeure jouxte la boutique de l’orfèvre Jacques Libert. Michel Ponceau (1583/1584-1649) Abry consacre une brève notice à Michel Ponceau (alias de Ponceau, Ponciani, Pontianus, Ponsea, Poncea, Ponseau, Ponchea, Poncheau, etc.) ; celle-ci nous apprend peu de choses433. Au dire de l’auteur, Ponceau entre en apprentissage chez Bertin Hoyoul en 1594. Effectivement, l’acte de relief du métier des orfèvres de l’année suivante confirme que Ponceau est alors l’apprenti de Hoyoul434. Abry cite ensuite quelques tableaux, aujourd’hui disparus. Le plus notable à son gré était une Sainte Famille « fort considérée pour sa dévotion » pour l’autel de Sainte-Anne en l’église Saint-Martin-en-Île. Il ajoute deux tableaux à l’église des carmes chaussés, proche du domicile du peintre : un Massacre des carmes et une Concession des indulgences par le pape en faveur du scapulaire. Il présume que reviennent à Ponceau également les différents tableaux de la chapelle Notre-Dame du Carmel en la même église ; ils ont pour thème les Miracles de la sainte Vierge en faveur du scapulaire. Abry ne donne pas d’appréciation sur la qualité de toutes ces peintures. Celles-ci avaient sans doute déjà disparu à la fin du XVIIIe siècle, car Hamal ne les évoque pas. Abry conclut sa notice en précisant que Ponceau demeura célibataire (ce qui est faux), qu’il habitait une belle maison au milieu de l’actuelle rue des Clarisses (en fait, non loin de chez son maître Hoyoul), que cette maison était ornée de fenêtres de bois (des volets) représentant des têtes d’empereurs « pour se faire connoître en qualité de peintre », enfin qu’il a beaucoup travaillé et que son testament témoigne de son aisance financière. Dans le manuscrit original d’Abry figure la mention obiit 1650435 ; celle-ci a, curieusement, été omise dans l’édition de son texte en 1867. Dans son étude du peintre, René Jans apporte une fois encore d’utiles précisions ; sauf mention contraire, c’est à cette étude que se rapportent les faits biographiques rapportés ci-après436. Michel Ponceau est né en 1583 ou 1584, les archives l’attestent. Il est le plus jeune des quatre enfants de Jean, notaire à la Cour de l’Officialité, et de Hellewy Caroly (et non d’Oudon de la Vignette, comme le prétend Abry). On sait que sa mère (décédée avant 1589) était une cousine germaine de Bertin Hoyoul, que Jean Ponceau (décédé en 1589) avait été un collègue du père du même Bertin Hoyoul et que ledit Jean Ponceau avait acheté
429. On dispose notamment du livre de comptes dans lequel le peintre a enregistré, de 1607 à 1656, les versements qu’il a reçus (AEL, Bienfaisance. Hôpital Saint-Jacques, 307). À noter que ce registre s’ouvre sur trois gravures collées au revers de la couverture : une Crucifixion de Jean Valdor I datée 1611 (encadrée par deux bandeaux de petites vignettes allégoriques signées du même graveur et à ma connaissance inédites), un Saint Pierre de Jérôme Wierix et un Saint Jacques le Majeur d’Adriaen Collaert. Ces estampes appartenaient sans doute au matériel de travail du peintre. 430. AEL, Bienfaisance. Hôpital Saint-Jacques, 294, comptes de 1633, f° 10 v°. 431. AEL, Bienfaisance. Hôpital Saint-Jacques, 258, f° 96. 432. AEL, Chambre des comptes, 275 I, à la date (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 433. Abry, Les hommes illustres…, op. cit., p. 180-181. 434. Breuer, op. cit., p. 113. 435. Archives du château de Warfusée, Ms. 13, f° 111 v°. 436. Jans, Les peintres liégeois Bertin Hoyoul…, op. cit., p. 192-195. 201
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
en 1585 sa maison de la rue Saint-Jean au marchand Jean Berto, oncle de Hoyoul ; on ne s’étonnera dès lors pas de constater que Bertin ait été choisi pour initier le jeune Michel à l’art de la peinture. Leurs parents étant très tôt décédés, les enfants de Jean Ponceau et Hellewy Caroly sont recueillis par leur famille maternelle, qui vit dans l’actuelle rue des Dominicains. Selon Jans, Michel Ponceau est encore présent à Liège en 1602. Il doit s’expatrier en Italie peu de temps après. À la suite du baron de Villenfagne437, tous les auteurs ont inféré que Ponceau est demeuré très longtemps en Italie, où on l’appelait Ponciani. Siret précise même438 : « Presque tous ses ouvrages sont restés en Italie ». En réalité, je crois que cette information provient d’une extrapolation de Villenfagne. La notice que celui-ci consacre à Ponceau démarque entièrement – comme quasiment tout son ouvrage de 1817 – le texte alors inédit de Louis Abry. On l’a vu, Abry n’évoque aucun séjour en Italie. Villenfagne déduit ce voyage du surnom de Ponciani qu’Abry donne au peintre. Toujours est-il que Ponceau est de retour à Liège en 1614 au plus tard. S’il s’est rendu dans la Péninsule (où on n’a à ce jour trouvé nulle trace de son passage), c’est nécessairement à un moment situé entre les années 1602 et 1614. Quoi qu’il en soit, ce séjour ne peut être remis en cause puisque le peintre entre, le 23 décembre 1621, au titre de « voyageur » dans la confrérie qui gère l’hôpital Saint-Jacques ; on l’a déjà dit, cette mention renvoie presque toujours à un séjour à Rome. Au sein de l’hôpital, Ponceau exerce manifestement des responsabilités, car il apparaît à diverses reprises dans ses archives, notamment en tant que témoin du contrat de commande passé en 1633 avec Gérard Douffet pour l’Apparition du Christ à saint Jacques, un des chefs-d’œuvre du peintre439. Il sera également nommé maître de cet hôpital440. En 1614, Ponceau est à Liège. Le 17 avril de cette année-là, Olivier, fils du notaire Jean Colson (ou Colchon), devient pour deux ans l’apprenti du maître peintre et bourgeois de Liège Michel Ponceau441. Le contrat prévoit que le maître pourra aussi utiliser l’apprenti dans l’art de la broderie ; René Jans en conclut que le peintre Michel Ponceau réalisait aussi des tapisseries. Ponceau dut avoir d’autres élèves. Jans suppose qu’il fut le maître d’Henri Trippet à l’entour de 1620. Dans un acte notarié passé au domicile de Ponceau le 9 mars 1620, le jeune Trippet (né vers 1600) figure en tant que témoin442. On connaît d’autres exemples d’élève apparaissant en tant que témoin d’un acte passé chez leur maître ; ce fut le cas pour le jeune Fisen, mentionné au domicile de Bertholet Flémal en 1674. René Jans avance le nom d’un troisième élève : Jean de Fraipont (né en 1612), fils de la sœur de Michel Ponceau. L’hypothèse est d’autant plus plausible que ledit Jean de Fraipont apparaît entre 1638 et 1640 associé au nom de Michel Ponceau dans des actes notariés ; Ponceau lui léguera même ses biens, dont tout son matériel de peintre ; « ses patrons et ustensiles servant à la poincture », dit le testament443. Fraipont semble avoir été un ouvrier de Ponceau plutôt qu’un apprenti. En 1617, on trouve le peintre à Huy. Michel Ponceau, peintre « citain » de Liège est admis comme maître au métier des maçons et charpentiers de Huy sur la base d’une Décollation de sainte Barbe réalisée pour les frères mineurs444. En 1619, Ponceau est définitivement établi dans la Longue Rue (rue des Clarisses), dans la paroisse SaintRemy, ce qui s’avère conforme au témoignage d’Abry. Il y détient même deux immeubles contigus. L’un jouxte le couvent des sœurs grises, avec lesquelles il se trouvera en conflit pour un problème de mitoyen-
437. Villenfagne, Recherches…, op. cit., p. 347. 438. Siret, Dictionnaire historique…, op. cit., p. 18. 439. AEL, Bienfaisance. Hôpital Saint-Jacques, 301. C’est le seul contrat de commande à ma connaissance connu pour un tableau liégeois du XVIIe siècle encore conservé. 440. Guy Poswick, Armorial d’Abry, Liège, 1956, p. 431. 441. AEL, Notaire Gh. Milemans à Liège, 17 avril 1614.- Manuscrit Yernaux, f° 144. 442. Jans, Les frères Henri et Matthieu Trippet…, op. cit., p. 147. 443. AEL, Bienfaisance. Hôpital Saint-Jacques, 353, non classé.- Jans, Les peintres liégeois Bertin Hoyoul…, op. cit., p. 195. 444. Archives de l’État à Huy, Ville de Huy, 349, p. 131 ; 350, sous l’année 1617.- Archives de l’État à Huy, Papiers Discry, 226, farde Sculpteurs-Graveurs-Peintres. 202
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
neté. La maison où il réside est peut-être celle qu’avait occupée quelques années auparavant son confrère Jean Ramey, lui aussi voisin des sœurs grises dans la Longue Rue (cf. infra). Ponceau a un statut social reconnu. Il est mambour de sa paroisse et membre de la confrérie de SaintRoch établie dans son église paroissiale. Il est visiblement très actif dans sa paroisse445. C’est sans doute pour affermir ce rôle social que, en février 1622, il relève le métier des charpentiers. Son nom apparaît ensuite à diverses reprises dans les archives liégeoises, en particulier dans les actes de son beau-frère le notaire Gh. Milemans. Contrairement à ce qu’a prétendu Abry (qui confond probablement ici Ponceau avec son maître Hoyoul), Ponceau n’est pas resté célibataire. Il a épousé, peut-être en 1627, Anne Eggens, fille d’un procureur. Il testera le 27 mars 1645 ; un des témoins de cet acte est l’orfèvre Jacques Goesin, futur beau-frère du peintre Gérard Goswin. Le peintre meurt entre le 5 novembre et le 9 décembre 1649. Au registre des œuvres, on connaît peu de choses. Abry, on l’a vu, mentionne quelques tableaux. Villenfagne y ajoute des peintures destinées au couvent des sœurs grises446. À mon avis, cette proposition est inférée de l’emplacement de la maison du peintre, voisin de ce couvent ; je pense que ce n’est donc qu’une supposition de Villenfagne. Les archives fournissent quelques mentions d’œuvres complémentaires. Le 26 mai 1625, Ponceau apparaît dans les comptes de la fabrique de Saint-Lambert pour avoir peint le tableau-épitaphe du cardinal de Groesbeeck447 ; le triptyque peint une cinquantaine d’années plus tôt par Pierre Furnius aurait-il été remplacé ? Ponceau sera rappelé vingt ans plus tard pour restaurer son tableau-épitaphe448. Les autres mentions sont trop tardives pour être reprises ici. Dans les notices qui ont jusqu’à ce jour été consacrées à Michel Ponceau, aucun auteur n’a évoqué les deux gravures qui offrent les seuls souvenirs de l’art d’un peintre qui, selon Abry, fut particulièrement productif. La première (14,5 x 10 cm) est de Jean Valdor I ; elle servit de frontispice à une Vie du cardinal Bellarmin écrite par Giacomo Fuligatti et publiée à Liège en 1626 (fig. 20)449. Elle montre deux figures allégoriques devant une ville imaginaire. On découvre un soldat vêtu à l’antique qui d’une main porte l’index aux lèvres et de l’autre tient enchaîné un prisonnier aux cheveux longs et qui, assis sur le sol, paraît arracher les pages d’un livre. De part et d’autre émergent deux pins entre les branches desquels se déroule une draperie portant le titre de l’ouvrage. Trois signatures apparaissent en bas de la gravure : Antonio Abbondanti en tant qu’Inventor, Michel Ponceau en tant que peintre et Jean Valdor en tant que graveur. À ma connaissance, ce type d’association est unique dans l’histoire de la gravure liégeoise. Antonio Abbondanti a probablement fourni l’iconographie, mise en page par Ponceau puis traduite par le burin de Valdor. L’abbé Abbondanti (ca 1590-1653) est bien connu à Liège. Ce poète italien est arrivé à Liège en septembre 1625 comme secrétaire du nonce Pier Luigi Carafa450. Il y mourra en 1653 en chanoine de la collégiale Saint-Paul ; sa pierre tombale est d’ailleurs encore conservée dans le cloître de Saint-Paul. La date de la gravure montre que le secrétaire du nonce s’est rapidement intégré à la vie artistique liégeoise : il était à Liège depuis quelques mois à peine quand sortit de presse cette apologie du jésuite Robert Bellarmin. Il est vrai, Abbondanti est sans doute entré en contact avec Ponceau et Valdor par l’intermédiaire du traducteur en latin de l’ouvrage de Fuligatto, le Père Petra Sancta. Le jésuite liégeois Petra Sancta fut le confesseur et l’ami du nonce Carafa, auquel il consacra quatre ouvrages entre 1627 et 1634. Petra Sancta collabora en outre au fameux recueil de poèmes qu’Abbondanti publia en 1630 : La Giuditta. Lorsqu’on se souvient que le cardinal Bellarmin fut l’un des grands controversistes catholiques, le sujet de 445. Son épouse et lui deviendront notamment membres de la confrérie de Sainte-Anne dès l'érection de celle-ci à Saint-Remy en 1647 (AEL, Cures. Saint-Remy à Liège, 31, passim). 446. Villenfagne, Recherches…, op. cit., p. 348. 447. Archives de l’Évêché de Liège, Cathédrale, B.VII.33, à la date (comm. M. J. Quitin). 448. Archives de l’Évêché de Liège, Cathédrale, B.II.22, 21 octobre 1645 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 449. F. W. H. Hollstein (e.a.), Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts ca 1450-1700, t. 32, Amsterdam, 1988, p. 108. 450. Sur Abbondanti, voir en particulier : Léopold Dupont, Les loisirs littéraires et la vie mondaine du secrétaire Abbondanti à Liège vers 1630, dans La Vie wallonne, t. 50, 1976, p. 22-40 ; Albert Maquet, Un poète romagnol chez les Éburons : Antonio Abbondanti (Imola, 1590 ? - Liège, 1653), dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, t. 13, n° 265, 1994, p. 61-81, avec une bibliographie fouillée sur le personnage. 203
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 20 : Jean Valdor I d’après Michel Ponceau, frontispice à l’édition liégeoise de la Vita Roberti Bellarmini de Giacomo Fuligatti, estampe, Bruxelles, Bibliothèque royale. © Bibliothèque royale de Belgique. 204
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
la gravure ne peut s’interpréter que d’une manière : l’Église catholique – qui tient une pomme de pin, symbole d’éternité – a enchaîné l’Hérésie et lui ordonne de se taire. La mention pinxit laisse perplexe ; on a peine à croire qu’elle renvoie à une peinture. L’image n’a en effet de sens que dans le contexte de l’ouvrage de Fuligatto. Je présume que le pinxit vaut ici delineavit. La seconde gravure (17 x 13 cm) en rapport avec Ponceau est de Michel Natalis. Peu connue, elle ne figure pas dans le catalogue des estampes de Natalis dressé par Renier en 1871. Elle n’a été mise au jour qu’en 1977451. Elle est datée 1645 et a pour sujet la vénération de la statue miraculeuse de Notre-Dame de Consolation, qui se trouvait à cette époque en l’église Saint-Remy à Liège. La gravure porte la mention : « Mel Ponceau Delineavit MN [accolés] Fec. ». Elle porte également les blasons du princeévêque Ferdinand de Bavière et du pape Innocent X. La statue, peu conforme à l’originale aujourd’hui conservée en l’église Saint-Jacques, est présentée sur un autel figuré dans une absidiole. Edmond Pochet y voit – ce n’est guère probant – l’abside de l’église Saint-Remy, toujours en cours de reconstruction à cette date. Derrière la sculpture figure une croix. Au registre supérieur, de part et d’autre de cette croix, volètent deux angelots portant les verges qui tourmentèrent le Christ durant sa Passion. Au mur de l’absidiole pendent les ex-voto les plus divers émanant de malades ayant recouvré la santé. Au pied de l’autel s’agenouillent deux enfants soutenus par des béquilles et venus implorer la Vierge consolatrice des affligés. De chaque côté se découvrent deux groupes d’individus en prosternation. À gauche apparaissent six hommes aux pieds de saint Lambert et à droite six femmes devant saint Remy. Le chanoine Pochet a tenté d’identifier les portraits des figures agenouillées, mais son argumentation n’est nullement convaincante. En revanche, le même auteur a bien perçu les circonstances de la commande de la gravure. En 1645 aurait eu lieu, à l’intercession de Notre-Dame de Consolation, la guérison miraculeuse de deux enfants ; attestés par des experts, ces événements eurent lieu le 23 février et le 25 mai 1645. Elles ont fait l’objet d’un livre publié par le zélé curé de Saint-Remy de l’époque, Jean-Henri Manigart : « Miracles ou faveurs grandes qui se sont faictes par l’intercession de la très glorieuse Vierge Marie honnorée en son image soubs le tiltre de Nostre Dame de Consolation en l’église paroissiale de sainct Remy en la Cité de Liège ». Aucun exemplaire de cet ouvrage n’a été repéré452 ; son contenu n’est connu que par une copie manuscrite conservée, au dire de Pochet, à la Bibliothèque du Séminaire de Liège453. L’estampe de Natalis dut servir de frontispice à l’ouvrage de Manigart. Les deux enfants au premier plan évoquent les miraculés auxquels Manigart a consacré son opuscule. Ponceau étant mambour de Saint-Remy, il était naturel que Manigart s’adressât à lui pour dessiner la composition. Au travers de ces deux gravures, il est bien difficile d’apprécier les qualités exactes de Michel Ponceau. Mais il est certain que nous avons affaire à un artiste qui devait surclasser la moyenne de ses concurrents. La mise en page des deux gravures est cohérente, le développement des drapés est souple, les proportions semblent respectées, mais les traits des visages semblent relativement stéréotypés, ce qui dénonce un maître secondaire. Thomas Puteanus (1532-1608) Ce peintre et miniaturiste trudonaire jusque-là ignoré a été mis au jour par Pierre Vanaise454. Thomas Vanden Put(te), alias Puteanus, est baptisé à Saint-Trond le 11 décembre 1532. Il est le douzième et dernier enfant de Wauthier Vanden Put, commissaire de la Ville de Saint-Trond, et d’Elisabeth Van Joeck. Il épouse vers 1555 Marie Vanden Spiegel, dite A Speculo. Il en aura neuf enfants. Le 9 avril 1570, Thomas Puteanus est élu conseiller communal et garde-clé des archives de Saint-Trond. Le 15 août 1581, il 451. Edmond Pochet, Une gravure rare de Notre-Dame de Saint-Remy à Liège, dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, t. 9, n° 196, 1977, p. 123-127. Charles-Nicolas Simonon (1774-1847) la cite toutefois dans ses notes (Collection privée à Chaudfontaine, Observations sur des erreurs et omissions touchant des artistes liégeois, p. 8). 452. Il n’est par exemple pas répertorié par le chevalier de Theux de Montjardin dans sa Bibliographie liégeoise. 453. Je ne l’y ai pas trouvée... 454. Pierre Vanaise, Le monogrammiste de l’évangéliaire dit de Quercentius (1564-1565) ou Thomas Vanden Put(te), dit Puteanus, enlumineur et peintre de Saint-Trond (1532-1609), dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, t. 7, n° 153, 1966, p. 58-59. 205
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
obtient une commission de peintre de la part du prince-évêque Ernest de Bavière ; il est qualifié de bourgeois de Saint-Trond455. En 1582, il est payé 150 florins pour avoir enluminé certain livre pour ledit prince. Il appartient à la corporation des maréchaux, la première des treize gildes locales. Le 27 décembre 1585, il est élu délégué des maréchaux à la gilde des drapiers. Le 20 juin 1596, il reçoit encore du prince 150 florins, mais la teneur de travail réalisé n’est pas expliquée. Bourgeois de Saint-Trond, il possède une maison sise sur la chaussée de Tongres. Il meurt le 23 avril 1608 (et non en 1609, comme l’indique le titre de l’article de Vanaise par suite d’une erreur typographique). Visiblement, l’artiste est bien introduit à Liège. Plusieurs membres de sa famille y occupent, il est vrai, des fonctions importantes. Son oncle Georges Van Joeck est conseiller du prince-évêque et son frère Jérôme, jurisconsulte éminent, est échevin. Ce qui doit favoriser la carrière de l’artiste. Vanaise l’a remarquablement démontré, Puteanus se confond avec le monogrammiste TVP (et non TMP) qui enlumina notamment l’évangéliaire de la collégiale Saint-Jean calligraphié par Robert Quercentius (aujourd’hui en dépôt au Grand Curtius). Le monogramme de Puteanus figure dans la miniature de l’Adoration des bergers (fig. 21). Ce manuscrit fut calligraphié en 1564, à l’occasion de l’admission de Quercentius au sein dudit chapitre. Selon l’épître dédicatoire, Quercentius a offert le manuscrit dans le cadre d’une redevance ; il s’agit sans doute de l’offrande due par les chanoines au titre de première résidence et qui correspond à la tradition dite du « drap d’or ». Ce sont les chanoines eux-mêmes qui l’ont fait orner de six grandes miniatures en l’année 1565. Je ne partage guère l’enthousiasme généralement suscité par ces miniatures, considérées comme des chefs-d’œuvre de la Renaissance liégeoise. En dépit de leur chatoiement, elles ne sont pas d’une qualité aussi exceptionnelle que la littérature d’amon nos-ôtes, souvent grandiloquente, l’a répété456. Les personnages sont engoncés dans des attitudes compassées et ils sont souvent malhabilement articulés dans l’espace. La référence à Lambert Lombard se devine dans l’esprit très classicisant des compositions – encore que le vocabulaire idéalisé de Lombard soit repris ici sur un mode mineur, comme l’a bien perçu Godelieve Denhaene457. On retrouve aussi le rapport avec Lombard dans certains détails formels (par exemple les draperies de certains apôtres de la Dernière Cène). Et si les fonds de plusieurs miniatures rappellent les œuvres de Patinier et Blès, ils ne sont en tout cas nullement caractéristiques de la peinture dite « mosane ». Quant aux marges ornées de motifs animaliers, végétaux ou ornementaux stylisés, on peut y voir une version abâtardie du style ganto-brugeois. On connaît deux autres manuscrits calligraphiés par Quercentius également rehaussés d’enluminures : un Liber precum de 1556-1557 conservé à la Bibliothèque royale de La Haye et un Liber missarum pontificalium (entre 1557 et 1560) provenant de la cathédrale Saint-Lambert et conservé au Landesmuseum de Münster. Seules les miniatures du second peuvent être données à Puteanus. Annette Baumeister a étudié les sources auxquelles le miniaturiste a puisé458. Même si nombre de rapprochements sont un peu sollicités, l’érudite montre que Puteanus a pris son bien dans de nombreuses gravures, selon la mode du temps. Dans l’évangéliaire de Saint-Jean, le paysage « déchiqueté » du Saint Jean à Patmos est partiellement emprunté à une gravure de Jérôme Cock qui se situe dans la filiation des paysagistes flamands « à la Blès ». Dans le missel de Münster, la majorité des personnages de la Circoncision sont repris à une estampe de Dürer, plusieurs des soldats épouvantés dans la Résurrection du Christ sont tirés d’une des nombreuses gravures éditées d’après la Conversion de saint Paul de la chapelle Pauline au Vatican, la Dernière Cène est une copie rétrécie de la planche de Giorgio Ghisi d’après Lambert Lombard, enfin le registre terrestre de l’Assomption de la Vierge est une citation d’une autre gravure de Dürer. Comme la plupart des petits maîtres de son temps, Puteanus est un artiste fort impersonnel. 455. Léon Lahaye, Analyse des actes contenus dans le Registre du Scel des Grâces sous Ernest de Bavière 1580-1602, Liège, 1938, p. 37. 456. Pour la bibliographie sur cet évangéliaire, voir Sophie Denoël, L’influence de la Renaissance et de Lambert Lombard sur les manuscrits enluminés dans la principauté de Liège, dans Denhaene (dir.), Catalogue de l’exposition Lambert Lombard …, op. cit., p. 323. 457. Denhaene, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme…, op. cit., p. 233-234. 458. Annette Baumeister, Ein illuminiertes Missale des 16. Jahrhunderts im Landesmuseum zu Münster, dans Zeitschrift für Kunstgeschichte, t. 42, 1979, p. 92-116. Voir aussi Denoël, op. cit., p. 323-324. 206
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Fig. 21 : Thomas Puteanus, Adoration des bergers, miniature de l’évangéliaire de Quercentius, Liège, Grand Curtius. © Yvette Lhoest.
Sophie Denoël a mis en évidence ses liens avec l’art anversois. Les encadrements architecturaux de deux enluminures du missel de Münster sont, selon elle, repris à une série gravée de Hans Vredeman de Vries qui a été éditée par Jérôme Cock en 1560. Or, le manuscrit de Münster aurait été achevé un peu avant cette année-là, ce qui tend à démontrer que Puteanus a eu connaissance des dessins préparatoires. L’intercession de Lambert Lombard, familier de l’officine Cock, n’est peut-être pas à exclure459. 459. Ibidem, p. 324. 207
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Deux tableaux de Puteanus seulement sont connus. Pierre Vanaise les a retrouvés au Musée de l’Art wallon sous le nom de Lambert Suavius460. Ils proviennent de la collection de Soer de Solières. Il y a donc de fortes chances qu’ils aient appartenu au chanoine Hamal. Ils représentent Abraham et les trois anges (32 x 51,5 cm ; fig. 22) et Éliézer obtenant de Bathuel la main de Rebecca (32,5 x 52,5 cm). Ils sont peints sur des panneaux de réemploi provenant de vantaux d’une armoire. Vanaise les date des environs de 1575. Dans le premier, l’artiste a inscrit un blason avec ses armoiries et celles de son épouse au fronton de courbe qui orne l’entrée de la maison d’Abraham. Il a repris ce blason avec les noms Van den Put et A Speculo au revers du panneau. Comme le suppose Vanaise, ces tableautins sont peut-être des peintures de circonstance faisant allusion à l’un ou l’autre événement survenu dans la famille du peintre. Les deux compositions sont analogues : scène figurée au premier plan à droite devant un bâtiment classicisant et, au fond à gauche, large ouverture vers paysage accidenté à la mode des suiveurs de Blès. Tout cela est traité sans prétention. Vanaise a déjà souligné le traitement un peu gauche des personnages, considérant que l’auteur était sans doute plus expert dans l’enluminure que dans la peinture de chevalet.
Fig. 22 : Thomas Puteanus, Abraham et les trois anges, panneau, Liège, Musée de l’Art wallon. © IRPA-KIK, Bruxelles.
En décembre 2010, un panneau peint (66 x 52 cm) montrant des scènes de la Passion était présenté sur le marché de l’art lyonnais avec une attribution – erronée – à Lambert Lombard (fig. 23). Les types physiques des personnages, les avant-bras trop allongés, la distribution très centripète des acteurs dans l’espace, le chatoiement des coloris qui fait songer à un peintre enlumineur, le fond de paysage bleuté à la Blès, tout cela m’incite à poser, prudemment, la question d’une éventuelle attribution à Puteanus.
460. Vanaise, op. cit., p. 59-62. 208
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Fig. 23 : Thomas Puteanus ?, Scènes de la Passion, panneau, localisation actuelle inconnue. © Cliché Galerie Gilbert Molle, Lyon. 209
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Comme Furnius et Ramey, Puteanus fut de ces quelques peintres qui perpétuèrent jusqu’au début du XVIIe siècle les conceptions des romanisants. En dépit de la « révolution » amorcée par Gérard Douffet, cellesci ont durablement marqué tout un pan de la peinture liégeoise de la première moitié du XVIIe siècle. Gérard Ramey († 1638) Ce fils du peintre Jean Ramey est mentionné pour la première fois le 9 août 1604. Avec ses deux sœurs, il vend à Élias, fils du sculpteur Martin Fiacre, la maison paternelle sise dans la Longue Rue, dans la paroisse Saint-Remy461. Gérard est cité comme peintre dans l’acte de vente. Sur la base d’une hypothèse erronée, Joseph Brassinne a proposé d’attribuer à ce Gérard le Saint Paul et saint Barnabé à Lystres du Grand Curtius traditionnellement donné à Jean Ramey (cf. infra)462. Le fils de Jean Ramey s’identifie certainement au peintre Jean (?) Ramée recensé dans la paroisse Saint-Remy en 1619463. Selon Yernaux, Gérard Ramey est décédé en 1638464. Jean Ramey (1541-1603/1604) Comme Furnius et Puteanus, Jean Ramey (alias Geradon, Ramet, Ramé, Ramée, Rameye, de Ramey, del Rameye, etc.) appartient à la dernière génération des peintres de Liège qui ont pu connaître personnellement Lambert Lombard. S’il est réputé avoir été l’élève dudit Lombard, c’est sur la foi d’une assertion de Louis Abry : ce dernier le cite au nombre des principaux disciples du maître qui ne se sont pas rendus en Italie465. Abry consacre par ailleurs quelques lignes substantielles à celui qu’il nomme Jean del Rameye466. De celles-ci, il ressort que le peintre a, plus que tout autre, retenu la manière de Lombard, que nombre de ses tableaux ont passé pour des œuvres du maître en personne bien que ni son dessin ni ses compositions ne soient aussi louables, que son œuvre majeure était une Dernière Cène peinte en 1576 pour une chapelle de la collégiale Saint-Pierre à la requête des héritiers du doyen Jean Hubar, qu’au nombre de ses derniers ouvrages il faut compter les « douze médailles en rond des Apôtres » placées en 1602 aux colonnes de la collégiale Saint-Paul. Abry ajoute aussi quelques précisions biographiques. Jean Ramey était le fils d’un autre Jean et de Catherine de Sart. Il avait épousé Marie de Limbourg. Il devint gouverneur du métier des orfèvres en 1585. Il fut appelé à Paris pour décorer quelques hôtels467. Il mourut tout au début du XVIIe siècle. Jean Ramey fut longtemps perçu sur la foi de ces seules informations. La découverte de divers documents a permis de compléter ces maigres renseignements468.
461. Brassinne, op. cit., p. 182-183. 462. Ibidem, p. 186-187. 463. Extrait des procès-verbaux …, op. cit., p. 380. 464. Yernaux, s.v. Ramey Jean, op. cit., col. 736. 465. Abry, Les hommes illustres…, op. cit., p. 168 et 177. 466. Ibidem, p. 172-173. 467. De manière assez confuse, Abry ajoute que c’est Rubens qui a succédé à Ramey « dans cet emploi » et que le peintre anversois s’est rendu à Paris pour décorer les galeries du palais du Luxembourg. Sollicitant quelque peu les propos d’Abry, la plupart des auteurs, à la suite de Villenfagne (Variétés sur deux peintres liégeois, élèves de Lambert Lombard, dans Journal politique du Département de l’Ourthe, 16 avril 1812), ont conclu que Ramey avait travaillé au palais du Luxembourg même. La construction de celui-ci ne débuta qu'en 1615. Faut-il comprendre que Ramey a travaillé dans un de ces hôtels particuliers dans le voisinage desquels Marie de Médicis a fait édifier son palais ? Il s’agirait alors des hôtels de François de Luxembourg, de Montherbu, de Champrenard... (cf. Marie-Noëlle Baudouin-Matuszeck, Topographie du Faubourg Saint-Germain-des-Prés, dans Marie de Médicis et le palais du Luxembourg, Paris, 1991, p. 177-184). 468. Jean Yernaux (s.v. Ramey Jean, op. cit., col. 735-741) a publié une notice biographique très fournie sur Ramey. Sauf indication contraire, c’est à cette étude que renvoient les informations biographiques qui suivent. 210
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Jean est né en 1541, et non vers 1530 comme le suppose Helbig469. Il est le troisième fils de Gérard Geradon dit de Ramet et de Jeanne de Visé. En 1556, ses parents quittent Ramet et s’installent à Liège. Jean épouse là en premières noces Catherine de Neve, alias de Sart. Ce mariage a induit Abry en erreur : il confond la première épouse du peintre avec sa mère. Le couple Ramey-de Neve aura trois enfants : Gérard (qui deviendra peintre), Gertrude et Marguerite470. En 1576, Ramey est juré du métier des orfèvres471. Il en devient gouverneur, avec l’orfèvre Jacquemin Massart, en 1585472. L’assertion d’Abry à ce propos est donc justifiée. Il épouse en secondes noces, entre 1593 et 1601, Marie de Limbourg, déjà citée par Abry. Veuve de Piron Hallebaye, Marie est la mère du peintre Wathieu Hallebaye (cf. supra). Ce dernier, qui relève le métier des orfèvres comme peintre en 1602, n’aurait-il pas été un apprenti ou un collaborateur de Ramey ? De ce second mariage, Jean Ramey a deux filles : Catherine et Jeanne, cette dernière étant née vers 1601473. Jean Ramey habite dans une maison acquise par son père en 1561, dans la Longue Rue, à côté du couvent des sœurs grises. Ses enfants la vendront en 1604 à Élias, fils du sculpteur Martin Fiacre. C’est peut-être dans cette maison que résidera le peintre Michel Ponceau quelques années plus tard (cf. supra). Le 3 janvier 1603, Jean Ramey et sa seconde épouse font don d’une rente aux deux enfants issus du premier mariage de cette dernière. Jean décède entre ce jour et le 9 août 1604, date de la vente de sa maison à Élias Fiacre. Des propos alambiqués de Louis Abry, Hilarion-Noël de Villenfagne a, le premier, déduit qu’il était mort « sur les frontières de la France »474. Cette indication non fondée a été répétée par la majorité des auteurs. Les archives renseignent par ailleurs quelque peu sur son activité artistique. La plus ancienne mention à cet égard remonte à 1565. Cette année-là, « ung peintre excellent nommez maistre Jehan del Ramée » copie une Crucifixion peinte en 1290 – et non en 1330 comme le répètent la plupart des auteurs – et conservée à l’église de Chênée. Le fait ressort d’une note du 1er octobre 1574 rédigée par Jean de Brialmont, seigneur de Fraiture et grand bailli du Condroz475. Il est évidemment intéressant de relever que, à vingt-quatre ans à peine, Ramey est qualifié de « peintre excellent ». Dans cette Crucifixion aujourd’hui perdue figuraient aux côté du Christ, non seulement la Vierge et saint Jean, mais aussi les donateurs, Wery Gailhart de Brialmont à gauche et son épouse Jeanne de Fraipont à droite. Wery et Jeanne étaient présentés avec leurs enfants : le mari était accompagné des quatre fils et l’épouse des quatre filles. Les dix personnages étaient représentés agenouillés, en prière. Le fond du tableau était rouge (‘de geulle’) avec des roses d’or « à la fascon d’une tapisserie ». Cette copie était destinée à remplacer l’original, sans doute mal en point, à l’église de Chênée. Jean de Brialmont décida de conserver chez lui – il résidait à Huy – le tableau original offert par son ancêtre. La seconde mention de l’activité artistique de Ramey remonterait à 1568. Cette date figure sur un dessin à la sanguine signé conservé dans l’album d’Arenberg au Cabinet des Estampes de Liège et rendu à Ramey par Godelieve Denhaene476. Il s’agit d’un projet de gravure (17,5 x 25 cm) qui a pour thème Juda et Thamar (fig. 24). Ce beau dessin est d’un fini et d’une délicatesse de trait qui augure d’un jeune artiste au talent fort honorable. La présence de plusieurs dessins de Ramey dans un recueil issu de l’atelier de Lombard accrédite naturellement la collaboration des deux peintres avancée par Abry477.
469. Helbig, Histoire de la peinture…, op. cit., p. 142. 470. Brassinne, op. cit., p. 182-187. Yernaux (Lambert Lombard, op. cit., p. 306) ajoute au nombre de ces enfants un Jean, qui serait également devenu peintre. Il doit s'agir d’une confusion. Yernaux a reconnu implicitement cette erreur puisque, dans sa notice sur Ramey parue dans la Biographie nationale en 1958-1959, il ne cite plus ce fils parmi les enfants de Jean Ramey. 471. Breuer, op. cit., p. 80. 472. Ibidem, p. 94. 473. Helbig, La peinture…, op. cit., p. 182. 474. Villenfagne, Variétés sur deux peintres liégeois…, op. cit. 475. Stanislas Bormans, Jean Ramée, peintre liégeois, dans Messager des sciences historiques, 1879, p. 285-289. 476. Denhaene, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme…, op. cit., p. 227. 211
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 24 : Jean Ramey, Juda et Tamar, dessin, Liège, Cabinet des Estampes. © IRPA-KIK, Bruxelles.
En 1570, le trésorier (compteur) de la fabrique de Saint-Martin-en-Ile paie à Ramey 4 florins 10 aidants « pour avoir pondu le baston delle vieux croix et doré d’or les quatre pommes ». Toujours selon la note de Jean de Brialmont du 1er octobre 1574, Ramey a, au mois d’août précédent, « tirez et contrefaictz au viff et fort bien adressez après le naturel » le portrait des parents de ce seigneur, à savoir Ottard de Brialmont et Aldegonde de Berlaymont478. Ramey a exécuté en même temps les portraits dudit Jean de Brialmont et de son épouse, Louise Vander Meeren479. Selon les comptes de l’abbaye du Val-Saint-Lambert, Jean Ramey reçoit le 23 mai 1577 puis le 1er avril 1578 des paiements pour des patrons de vitraux, notamment pour une Nativité réservée à la grande verrière de l’église abbatiale. En 1583, il décore la grande salle de la maison nouvellement construite du marchand de vin Jean de Woestenraedt ; le contrat est conservé480. Contre 75 florins – et non 125 comme le transcrit Polain – et une partie de l’huile nécessaire, Ramey s’engage à peindre, de poinctur bone et lealle, toute la grande salle de la maison de Woestenraedt à l’enseigne du Puits. Ce décor comprend notamment deux dessus-
477. Deux dessins d’étude de l’album d’Arenberg portent la signature de Ramey : le Noli me tangere (15,2 x 10,3 cm) et la Rencontre d’Anne et Joachim à la porte dorée (19,8 x 8,8 cm). Ce dernier s’apparie à un autre croquis de la même main : l’Annonce à Joachim (17,8 x 9,8 cm). Jules Helbig (La peinture…, op. cit., p. 186) fut le premier à attirer l’attention sur ces deux dessins (et à en donner l’identification exacte, souvent oubliée depuis lors). En dehors de Lombard lui-même, Ramey est le seul artiste représenté avec certitude parmi les sept cents dessins des albums dits d’Arenberg et de Clerembault, qui constituaient le matériel didactique de l’atelier de Lambert Lombard. 478. Bormans, op. cit., p. 290 et 293. 479. Ibidem, p. 293. 480. AEL, Notaire J.-A. Lapide à Liège, 1568-1585, f° 73 v°.- Helbig, La peinture…, op. cit., p. 185.- Eugène Polain, Analectes liégeois, dans Chronique archéologique du pays de Liège, t. 5, 1910, p. 14. 212
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
de-cheminée sur toile. L’artiste doit aussi peindre les solives et les portes. Le contrat est daté du 23 mai et le travail doit être achevé pour la Saint-Gilles, soit le 1er septembre. Si le travail n’est pas achevé dans les délais, le prix sera diminué de 12 florins et 5 patards. Trois jours avant le terme, les contractants signent un avenant : le salaire est augmenté de 15 florins, à condition que toutes les peintures soient exécutées exclusivement à l’huile481. René Jans a montré que cette maison se situait en Gérardrie ; elle était voisine de la maison familiale du peintre François Walschartz482. En 1584, Ramey ajoute les portraits d’un certain Hercule de Portes et de sa femme sur les volets d’un triptyque de l’Adoration des Mages ; le panneau central ne paraît pas être de la même main. Trois ans plus tard, ce tableau se trouve encore au domicile du peintre. Il est alors mis aux enchères, apparemment avec tout le fonds d’atelier de l’artiste, au moment où celui-ci s’apprête à quitter Liège. Cette vente doit avoir du retentissement, « attendu que lenthier mestier de painctres avoit esté convoqué et en bonne partie aussy esté présent avecque plusieurs aultres bourgeois et gens y aians volu venir ». Le triptyque est acquis par Aert Zutman. Hercule de Portes soumet l’affaire au tribunal des échevins et exige la restitution du tableau. Le tribunal lui donne raison, mais lui impose de rembourser à Zutman le prix payé pour l’acquisition du tableau483. L’affaire est pour le moins embrouillée et paraît attester une longue absence de Ramey à la fin des années 1580. C’est peut-être l’époque du séjour à Paris. Toujours est-il que l’on n’en trouve plus de trace avant la fin des années 1590. Si l’on en croit Hamal, Ramey exécute à nouveau, en 1597 cette fois, des cartons de vitraux484. Ceux-ci sont destinés à la collégiale Saint-Paul. Selon le chanoine Thimister, on en voyait des restes dans la partie supérieure des fenêtres méridionales485. Le peintre est, à l’évidence, fort actif pour cette église. Jules Helbig évoque une Conversion de saint Paul peinte en 1599, mais il ne cite pas sa source486. Et, selon Abry, on l’a vu, Ramey peint en 1602 des médaillons avec les têtes des apôtres. On va voir que Saint-Paul conserve aujourd’hui encore un triptyque de Ramey. Or, selon Yernaux, le père de Jean Ramey serait devenu, après son veuvage, chanoine de Saint-Paul. Ne peut-on trouver là l’explication des multiples travaux que l’artiste a réalisés pour cette collégiale ? On ne connaît que deux élèves de Ramey. En 1602, il a pour apprenti Jacques, fils du boulanger Jean Loheau487. Dans sa notice sur le peintre Pascal Balen, Abry fait de celui-ci l’apprenti de Ramey488. Si l’anecdote est exacte, Balen a dû fréquenter l’atelier de Ramey dans les années 1590. Le chanoine Hamal fait aussi de l’Anversois Otto Vaenius, futur maître de Rubens, un disciple de Ramey489. Or, on sait par Van Mander que Vaenius fut mis par son père, émigré à Liège, au service de Dominique Lampson à Liège en 1573490. Hamal a très certainement confondu Lampson et Ramey. Différents auteurs citent sous le nom de Ramey quelques tableaux, outre ceux déjà cités, aujourd’hui disparus. Hamal mentionne, à la cathédrale Saint-Lambert, un Christ mort sur les genoux de sa mère (dans la sacristie des bénéficiers) et une Crucifixion (dans la chapelle du cloître)491. Cet auteur juge ce dernier tableau « gâté ». Fait étonnant, Jules Helbig cite un Christ au jardin des Oliviers dans la quatrième cha-
481. La même pièce avait été ornée quelques mois auparavant de vitraux réalisés par le verrier Jacques de Marche (Eugène Polain, Analectes liégeois, dans Chronique archéologique du pays de Liège, t. 4, 1909, p. 77-78). 482. René Jans, La vie mouvementée du peintre liégeois François Walschartz (1597/98-1678/79), dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, t. 10, n° 220, 1983, p. 291. 483. AEL, Échevins de Liège. Grand greffe. Paroffres, 72, f° 128. L'acte, du 9 avril 1587, relatant toute cette affaire est reproduit in extenso dans le manuscrit de Yernaux (Manuscrit Yernaux, f° 150). 484. Hamal, op. cit., p. 224. 485. O.-J. Thimister, Histoire de l'église collégiale de Saint-Paul actuellement cathédrale de Liège, 2e éd., Liège, 1890, p. 532. 486. Helbig, Histoire de la peinture…, op. cit., p. 142. On a peine à croire qu’il s’agisse ici du chanoine Hamal, la source privilégiée de Helbig. En effet, celui-ci ne mentionne pas ce tableau dans son répertoire des œuvres d’art conservées à Liège à la fin du XVIIIe siècle. 487. Breuer, op. cit., p. 147-148. 488. Abry, Les hommes illustres…, op. cit., p. 177. 489. Helbig, La peinture…, op. cit., p. 184. 490. Van Mander, op. cit., t. 2, 1885, p. 271-272. 491. Hamal, op. cit., p. 217 et 219. 213
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
pelle méridionale de la cathédrale492. Or, ce tableau n’est pas cité par Hamal, la source habituelle de Helbig. Ce dernier a-t-il confondu ? Le même Hamal possédait par ailleurs dans sa collection deux tableaux sous le nom de Ramey : un portrait d’une dame de Surlet peint sur bois et daté 1582 (80 x 62 cm) et un autoportrait sur toile dont les dimensions données dans le catalogue de vente (12 x 55 cm) sont manifestement erronées493. On peut aussi s’étonner de voir Helbig s’étendre longuement en 1873 sur la description d’une Résurrection de Lazare (113 x 130 cm) dont il ne reparle pas dans son édition de 1903, comme s’il était revenu sur l’attribution494. Il la dit pourtant signée et datée : « IO. RAMEY. PINGEB. 1602 ». Charles-Nicolas Simonon cite déjà cette Résurrection de Lazare au début du XIXe siècle : le tableau se trouvait au palais de Liège et il a été vendu par l’Administration des Domaines en octobre 1828495. En 1873, le panneau appartenait à Mme de Favereau de Grand Han496. Le silence de Helbig dans sa seconde édition s’explique sans doute par la médiocrité de la pièce autant que par son mauvais état. Il en dénonçait effectivement le dessin lourd, les têtes vulgaires, l’absence complète de sentiment et d’expression. Cette analyse n’est malheureusement pas incompatible avec les quelques tableaux conservés du maître. Au vu de la date tardive, Helbig y voit un effet de la sénilité qui affectait celui-ci. Dans le même ouvrage de 1873, Helbig cite deux portraits traditionnellement attribués à Ramey, à raison selon lui497. Ce sont les portraits, de grandeur naturelle, du bourgmestre de Liège Jacques Herlet et de son épouse, Gertrude Hock. L’un des deux tableaux portait la date de 1585. Ils appartenaient alors à Auguste Hock. Une fois encore, Helbig ne les reprend pas non plus dans son édition de 1903. Peut-être l’attribution ne lui agréait-elle plus. En revanche, il cite là une Adoration des bergers qu’il n’avait pas évoquée en 1873498. Ce grand panneau (250 x 145 cm) appartenait à la collection Desoer de Solières. Sans fondement, Jean Yernaux en fait une réplique de celui de l’église de Glain dont il va être question499. Je n’ai repéré qu’un seul tableau repris sous le nom de Ramey dans une vente ancienne, sans que l’on puisse évidemment apprécier la validité de l’attribution. Il s’agit d’une station du chemin de croix sur bois (73 x 55 cm)500 ; le nom de Ramey est des plus douteux, la dévotion au chemin de croix étant postérieure à ce peintre. Rares sont les tableaux conservés de Ramey. On peut d’abord citer la Judith récemment entrée dans la collection Albert Vandervelden à Liège (fig. 25). Ce petit panneau (47 x 38 cm) est signé et daté sur une pierre en bas à droite : « IO. Ramey pingebat / Leod. 1585 ». Sur une pierre en bas à gauche figure une inscription reprenant le premier verset du psaume 115 : NON NOBIS / DOMINE, NON NOBIS, SED / NOMINI TUO DA GLORIAM501. Judith est représentée nue à l’entrée de la tente au sein de laquelle elle a commis son forfait libératoire. Elle exhibe fièrement son trophée, la tête du général assyrien Holopherne, tout en s’appuyant sur le glaive ensanglanté, instrument de l’irréparable. On ne manquera pas de noter l’opposition entre la dureté de l’action et la frivolité de l’apparence. L’héroïne biblique nous est présentée telle une actrice entrant en scène au lever de rideau. Le caractère érotisant est rare dans le traitement de ce thème ; il semble renvoyer aux œuvres du maniériste anversois Jan Massys. Mais ce type de nu allongé est bien dans l’esprit des peintres nordiques et germaniques de l’époque ; on le retrouve dans de nombreuses compositions de Hendrick Goltzius, Antonius Eisenhoit, Bartholomeus Spranger, de l’école de Fontainebleau… 492. Helbig, Histoire de la peinture…, op. cit., p. 143. 493. Vente Henri Hamal, chez Duvivier, Liège, 17 mars 1824, n° 42 et 52. 494. Helbig, Histoire de la peinture…, op. cit., p. 144-145. 495. Collection privée à Chaudfontaine, Observations sur des erreurs et omissions touchant des artistes liégeois de Charles-Nicolas Simonon (1774-1847), p. 9. 496. Les descendants de la famille de Favereau avec lesquels j’ai pris contact ont vainement recherché la trace de ce tableau. 497. Helbig, Histoire de la peinture…, op. cit., p. 145. 498. Helbig, La peinture…, op. cit., p. 188. 499. Yernaux, s.v. Ramey Jean, op. cit., col. 740. 500. Vente Mélotte de Lavaux, Liège, 26 avril 1937, n° 931. 501. Cette phrase étant par ailleurs la devise des templiers, je ne doute pas qu’elle fera l’objet de divers commentaires ésotériques… 214
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Fig. 25 : Jean Ramey, Judith, panneau, Liège, collection Albert Vandervelden.
215
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Ensuite vient la Conversion de saint Paul (fig. 26) qui orne l’autel latéral sud de l’église Saint-Martin de Villers-le-Peuplier (Hannut). Cette toile (217 x 128 cm), paradoxalement peu connue, est signée « JO. RAMEY PINGEBAT 1598 »502. Il est bien entendu tentant de l’identifier à celle de 1599 signalée par Helbig à la collégiale Saint-Paul. Elle est entièrement repeinte et n’offre qu’un vague souvenir du dessin d’origine. On y relève cependant le goût de la confusion, les plans courts et sans profondeur ainsi que les attitudes exacerbées des peintures typiques du maniérisme flamand de cette époque. Mais tout cela est ici traité en mode mineur. La figure de saint Paul, dont la jambe droite est bizarrement coupée, est certainement tirée de quelque gravure contemporaine. En 1998, un nettoyage a permis de retrouver la signature de Ramey, avec la date de 1599, sur le triptyque de la Déploration du Christ mort de la cathédrale Saint-Paul à Liège (fig. 27). Ce triptyque semble se confondre avec le « tableau peint sur bois avec deux portes représentant La Descente De La Croix » qui est mentionné dans un inventaire de cette église daté du 16 mars 1798503. Ce triptyque fut longtemps attribué à Lambert Lombard, puis a porté diverses attributions : Jean Ramey, Hubert GoltzFig. 26 : Jean Ramey, Conversion de saint Paul, ius, anonyme anversois de la seconde Villers-le-Peuplier, église Saint-Martin. moitié du XVIe siècle. Jean-Simon Renier © IRPA-KIK, Bruxelles. a, le premier, avancé le nom de Ramey504. L’attribution fut approuvée par Godelieve Denhaene avant même la réapparition de la signature505. Le panneau central (100 x 126 cm) montre le Christ soutenu par les saintes femmes, tandis que saint Jean, au visage un peu enjoué, réconforte la Vierge. Celle-ci détourne la tête du spectacle macabre de son fils mort. Au fond du panneau apparaît l’inhumation du corps du Christ dans le sépulcre. Les volets intérieurs (112,5 x 61 cm) montrent à gauche le Portement de la croix et à droite, la Résurrection. Au revers figurent, d’un côté, Saint Michel terrassant le dragon et, de l’autre, Saint Jean l’Évangéliste. Les deux saints sont représentés en grisailles dans une niche feinte. Ils constituent peut-être la meilleure partie du tableau. La représentation de ces 502. Dans le répertoire des églises réalisé par l’IRPA, la signature a été erronément interprétée comme celle d’un Joseph Ramey et la date a été indûment lue 1758 au lieu de 1598 (Jean-Jacques Bolly, Répertoire photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique. Province de Liège. Canton de Hannut, Bruxelles, 1977, p. 45). Cette confusion de date en dit long sur l’état du tableau... 503. Catalogue de l’exposition Les peintures de la cathédrale de Liège. Histoire et restauration, dans Feuillets de la cathédrale de Liège, t. 2-6, 1992, n° 4. 504. Renier, Inventaire…, op. cit., p. 265. 505. Denhaene, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme…, op. cit., p. 231. 216
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
deux saints est sans doute à mettre en rapport avec le prénom du donateur (inconnu) et/ou avec l’autel de Saint-Paul auquel était destiné le tableau. Précisément, un Jean Natalis était le recteur de l’autel des Saints-Michel-et-Léonard à la collégiale Saint-Paul à la date de réalisation du tableau506. Serait-il le donateur ? Rien ne permet évidemment de l’affirmer. D’autant qu’il existait par ailleurs un autel dédié aux saints Michel, Jean l’Évangéliste et Élisabeth ; on peut se demander si le triptyque n’ornait pas cet autel.
Fig. 27 : Jean Ramey, Triptyque de la Déploration du Christ mort, panneau, Liège, Trésor de la cathédrale Saint-Paul. © IRPA-KIK, Bruxelles.
Comme souvent chez les petits maîtres de second plan de ce temps, cette peinture est un véritable assemblage de motifs tirés de gravures. Maria Otto a montré que le Portement de croix était pour l’essentiel tiré d’une gravure de Jan Sadeler d’après Maarten de Vos507. Plus récemment, Isabelle Lecocq a noté que le Saint Jean l’Évangéliste du revers était tiré d’une gravure de Jérôme Wierix d’après le même de Vos508. La Vierge et le saint Jean de la Déploration ainsi que la scène de la Mise au tombeau au fond à droite dérivent aussi d’une gravure d’après Maarten de Vos, celle gravée par Jan Sadeler vers 1578-1579509. D’autres sources gravées sont encore à repérer510. Quoi qu’il en soit, les personnages semblent dérivés de Frans Floris autant que de Maarten de Vos. Tous ces personnages apparaissent ici fort massifs. Il est vrai que les draperies empesées, vraisemblablement héritées de Lombard, renforcent cette impression. La comparaison du motif de saint Jean avec la gravure de Sadeler est éclairante. Tout en les copiant assez fidèlement, Ramey a réinterprété les drapés, en ciselant des plis cassés plutôt qu’arrondis. Les personnages sont sans grand caractère, tout comme le paysage au second plan. La scène centrale, en particulier, manque de souffle : on n’y trouve en rien le pathos de la Déploration du Christ mort de Furnius à HorionHozémont.
506. Christian Dury, L’obituaire des chapelains de la collégiale de Saint-Paul à Liège (XIIIe-XVIIIe siècles), dans Bulletin de la Société d’art et d’histoire du diocèse de Liège, t. 63, 1998, p. 67. 507. Catalogue de l’exposition Les peintures de la cathédrale de Liège…, op. cit., n° 4. 508. Lecocq, op. cit., p. 170. 509. Cf. Hollstein, op. cit., t. 46, 1995, n° 874. La Vierge et le saint Jean de la Déploration se retrouvent identiques dans un tableau de même sujet erronément attribué à Lambert Lombard par son propriétaire (collection privée bruxelloise). 510. C’est par exemple une même gravure qui a servi de modèle au Christ ressuscité de Ramey et à celui d’un vitrail Renaissance qui fut détruit dans l’incendie de l’église Saint-Servais à Liège en 1981. Il y a fort à parier que Ramey ait été l’auteur des cartons des six verrières de cet édifice, très marquées par le style de Lambert Lombard. Elles sont évoquées par Isabelle Lecocq dans un autre article de ce volume. 217
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 28 : Jean Ramey, Saint Paul et saint Barnabé à Lystres, toile, Liège, Grand Curtius. © IRPA-KIK, Bruxelles.
Un troisième tableau signé et daté (?) est à mentionner ici. Il s’agit du Saint Paul et saint Barnabé à Lystres (161 x 211 cm) du Grand Curtius (fig. 28). Helbig est le premier à mentionner cette toile qui provient du château du comte de Méan à Andenne511. Elle fut donnée par le collectionneur Édouard BrahyProst à l’Institut archéologique liégeois en 1909. Selon Helbig, elle portait la signature : « IO. G. D. RAMEY PINGEBAT, 1600 ». Cette signature n’est plus visible. Joseph Philippe suppose qu’elle a disparu au cours d’un nettoyage du tableau dans la première moitié du XXe siècle512. Ce qui permet de s’inquiéter de son authenticité. Il est peu aisé d’apprécier les qualités de cette grande toile en raison de son état lamentable. Son style paraît en tout cas compatible avec les autres peintures connues de Ramey, mais il s’agit d’une œuvre secondaire. Malgré un souci d’étagement de la composition et en dépit d’une recherche sur la perspective linéaire, les deux plans successifs en frise trahissent le malaise du peintre à ordonnancer tous les personnages. Le tableau montre en fait, de manière clairement séparée, deux épisodes connexes de la prédication de Paul et Barnabé à Lystres tels qu’ils sont narrés par les Actes des
511. Helbig, La peinture…, op. cit., p. 187-188. 512. Joseph Philippe, Ville de Liège. Musées Curtius et d’Ansembourg. Catalogue des peintures de l’école liégeoise (XVe-XIXe siècle), Liège, 1955, p. 13. 218
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
apôtres (14, 8-18). Aussi le titre habituellement donné au tableau, Saint Paul guérissant le perclus de Lystres, apparaît-il trop réducteur. Au premier plan, saint Paul guérit un paralytique. Au second plan, derrière le portique d’un temple, figure l’épisode qui suit immédiatement. Émerveillés par le miracle, les habitants de Lystres considèrent Paul et Barnabé comme des incarnations de Mercure et Jupiter. En leur honneur, le prêtre du temple de Jupiter s’avance avec des taureaux qu’il veut sacrifier en leur honneur. Nous voyons le moment où Paul et Barnabé s’insurgent contre cette forme de vénération, le premier déchirant ses vêtements, conformément au texte biblique. Le plus étonnant dans cette composition est l’élément naturaliste que constitue le petit chien placé pratiquement au centre de la toile. Joseph Brassinne a proposé d’interpréter la signature comme celle de « Joannes Gerardus de Ramey » et de voir dans cette toile une œuvre du fils de Jean Ramey cité ci-avant513. À la suite de Simone de Geradon514, j’interpréterais plus volontiers cette signature comme celle de Jean Geradon de Ramey. On l’a vu, le plus ancien tableau conservé de Ramey porte la date de 1585. Il est d’un raffinement sans égal dans sa production, mais il n’est peut-être pas représentatif. Les trois seuls autres tableaux assurés de Jean Ramey – encore doit-on être prudent pour le dernier évoqué – que nous ayons conservés sont datés respectivement de 1598, 1599 et 1600 (?). Ce sont des œuvres très tardives, cela suffit peut-être à expliquer leur manque de caractère. On serait curieux de découvrir une œuvre plus précoce de ce « peintre excellent nommez maistre Jehan del Ramée », ainsi qualifié par Jean de Brialmont dès 1574. À voir le dessin de Juda et Thamar de 1568 et à juger de la date de 1576 avancée par Abry pour le chef-d’œuvre du peintre (la Cène de la collégiale Saint-Pierre515), il faut situer sa pleine maturité dans ces années-là. À cette époque remonte très certainement la dernière peinture signée de Ramey qui soit connue, à tout le moins grâce à un souvenir photographique.
Fig. 29 : Jean Ramey, Adoration des bergers, panneau, jadis Glain, église Notre-Dame des Lumières. © IRPA-KIK, Bruxelles. 513. Brassinne, op. cit., p. 186-187. 514. Simone de Geradon, Origines et branches collatérales de la famille de Geradon, s.l., 1974, p. 79. 515. Ce tableau avait sans doute déjà disparu à la fin du XVIIIe siècle ; en effet, Hamal ne le cite pas. 219
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Il s’agit de l’Adoration des bergers (fig. 29) qui fut détruite dans l’incendie qui ravagea l’église NotreDame-des-Lumières à Glain (Liège) en 1976. Ce panneau (129 x 179 cm) n’est plus connu que par les clichés de l’IRPA. Le premier auteur y faire allusion est Jules Helbig. Il précise que le tableau est signé516. Cette information ne figure plus dans la seconde édition, en 1903, de sa volumineuse étude sur les peintres liégeois. Elle est de la sorte tombée dans l’oubli. Et tous les auteurs postérieurs ne parlent plus que d’un tableau attribué à Ramey. Or, la signature « RAMEY » est visible, sur la photographie, dans le coin inférieur droit du tableau. Comme le pressentait déjà Helbig, ce tableau-ci relève manifestement de la meilleure période du peintre. L’artiste est parvenu à intégrer habilement des figures de grandeur naturelle dans un espace compact et sans respiration aucune tout en mettant en évidence, par la disposition même des figures, l’Enfant Jésus au centre de la composition. Helbig commente ainsi le tableau : « (…) la peinture est d’une couleur transparente et forte dans les ombres, vraie et très-heureuse dans les lumières. L’artiste a rendu avec beaucoup de talent la variété des carnations, et le profil de la Vierge est non-seulement modelé et coloré avec une habileté remarquable, mais il y a même un peu d’expression, qualité qui fait trop défaut dans les autres têtes de ce tableau. Les draperies sont intenses dans le ton et très-harmonieuses ». En dépit de son caractère un peu trivial, le visage de la Vierge paraît en effet le meilleur morceau de toutes les peintures connues de Ramey. Les visages de saint Joseph et des bergers semblent également particulièrement expressifs au regard des autres tableaux conservés. Comme dans ceux-ci, les personnages apparaissent comme gonflés par les draperies. Un Christ en croix entre saint Roch et saint Sébastien conservé à l’église Notre-Dame et Saint-Remacle à Spa est attribué à Jean Ramey depuis Albin Body517. Ainsi qu’il ressort d’une inscription figurée sous les pieds des deux saints antipesteux, il s’agit un ex-voto offert en 1598 par Pierre Le Clerc, un noble parisien alors en villégiature à Spa. Celui-ci l’a donné en remerciement de la guérison de son épouse, qui avait contracté la peste dans la cité thermale. Cette toile (± 120 x 85 cm) est caractéristique des œuvres mineures de l’époque. Malgré quelques vagues ressemblances, les liens avec les tableaux attestés de Ramey ne semblent pas assez affirmés pour maintenir le tableau dans le (maigre) catalogue du peintre. À titre d’hypothèse de travail encore, on peut attribuer à Ramey une Mort de Saphira sur bois du Musée des Beaux-Arts de Verviers (74 x 158 cm). Il s’agit d’un tableau de confrérie qui intègre dix-huit portraits au premier plan à gauche (auxquel il faut ajouter un autoportrait du peintre en bas à droite), alors que l’épisode biblique est relaté dans la moitié droite de la composition. Il s’agit du seul portrait de groupe que l’on puisse à ce jour assigner à un peintre liégeois du XVIe siècle. Ramey semble avoir exercé une influence non négligeable sur ses confrères. En témoignent divers tableaux qui peuvent être attribués à un même atelier à situer dans la lignée de l’art de Ramey, dont il simplifie les traits. Il s’agit d’abord de trois panneaux ou ensembles provenant de l’abbaye du Val-Notre-Dame à Antheit, tous trois aux armoiries de l’abbesse Catherine de Henry (1577 au plus tard-1614)518. La pièce principale est le triptyque de la Pentecôte de l’église de Moha (Wanze), récemment restauré par l’ENSAV La Cambre (178,5 x 132,5 cm pour le panneau central ; fig. 30). Il se complète de la Crucifixion de 1588 (105,5 x 116,5 cm) et du Massacre des Innocents de 1589 (106,5 x 123 cm ; fig. 31) provenant de l’église Saint-Martin à Héron519. Ces trois pièces sont aujourd’hui en dépôt au Grand Curtius. Elles sont assurément de la même main, celle d’un maître anonyme dont le nom de convention le plus approprié serait celui de Maître du Val Notre-Dame520. Dans le triptyque, on trouve une structure très classicisante qui dénonce
516. Helbig, Histoire de la peinture…, op. cit., p. 143-144. 517. Albin Body, Spa. Histoire et bibliographie, t. 2, Liège, 1892, p. 155. 518. Pierre-Yves Kairis, Les peintres liégeois dans le sillage de Lambert Lombard, dans Denhaene (dir.), Catalogue de l’exposition Lambert Lombard…, op. cit., p. 307. 519. Sur les deux tableaux de Héron, voir le catalogue de l’exposition Filles de Cîteaux…, op. cit., n° 185 et 186. 520. Il faudrait peut-être ajouter à cet embryon de catalogue le tableau-épitaphe de la Mort du seigneur Olivier de Saint-Fontaine, qui jusqu’à sa récente disparition ornait la chapelle Notre-Dame à Pailhe (cliché IRPA M64604). J’y joindrais volontiers également les volets d’un triptyque démantelé conservés au Musée de l’Art wallon (clichés IRPA KM16500 et KM16501). D’un côté on y relève deux cisterciennes (du Val-Notre-Dame ?) en prière prénommées Catherine et Adrienne et accompagnées chacune de leur saint patron. Au revers, on y voit la Vierge agenouillée sur une nuée et intercédant auprès de la Trinité. Dans tous ces tableaux se retrouvent les formules simplificatrices des modèles anversois dont Ramey s’était apparemment fait le principal traducteur au pays de Liège en cette fin du XVIe siècle. 220
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
bien le sillage de Lombard, même si les types physiques semblent une fois encore renvoyer à la peinture anversoise. Il est vrai que l’auteur a manifestement puisé ses motifs dans diverses gravures ; ainsi le Martyre de saint Sébastien, qui figure au revers d’un des volets, est-il copié d’une gravure d’après Maarten de Vos. Quant à la figure au premier plan à droite de la Pentecôte, elle semble tirée d’une vignette de la Dernière Cène éditée par Jérôme Wierix chez Christophe Plantin en 1572521.
Fig. 30 : Maître du Val-Notre-Dame, Triptyque de la Pentecôte, panneau, Liège, Grand Curtius. © Liège, Grand Curtius.
Comme Pierre Furnius, Denis Pesser et Thomas Puteanus, Jean Ramey est une personnalité intéressante pour comprendre la production picturale à Liège à la charnière des XVIe et XVIIe siècles. Ce qui ressort tant de sa biographie que des œuvres conservées, c’est le lien finalement relativement ténu avec l’art de Lambert Lombard. Sur le plan formel certes, mais surtout sur le plan intellectuel. Sur le plan formel, les tableaux de Ramey – comme des tableaux liégeois contemporains du reste – se ressentent davantage de la peinture flamande de la seconde moitié du XVIe siècle. Sur le plan intellectuel, on ne retrouve guère les préoccupations humanistes qui caractérisaient le foyer principautaire à l’époque désormais révolue de Lambert Lombard et dont Godelieve Denhaene a finement rendu compte522. En ce sens, les œuvres de Ramey paraissent témoigner d’un affaiblissement intellectuel de la société liégeoise en général dans les dernières années du siècle.
521. Cf. Marie Mauquoy-Henderickx, op. cit., n° 2145. 522. Denhaene, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme…, op. cit., p. 167-248.- Idem, Lambert Lombard humaniste, dans Denhaene (dir.), Catalogue de l’exposition Lambert Lombard…, op. cit., p. 79-97. 221
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 31 : Maître du Val-Notre-Dame, Massacre des Innocents, panneau, Liège, Grand Curtius. © IRPA-KIK, Bruxelles.
Riske († avant le 1er février 1623) Riske (alias Risque), maître peintre de la Cité de Liège, n’ayant pas payé au métier des orfèvres « certains droits », la corporation en a réclamé le paiement à sa veuve. Celle-ci a prétendu s’y soustraire en introduisant un recours auprès de l’official contre la juridiction des maîtres et jurés du métier. À l’intervention dudit métier, les bourgmestres de Liège ont requis de la veuve, le 1er septembre 1623, le retrait de sa plainte dans les six jours. Comme la veuve Riske n’a donné aucune suite à cette requête, les bourgmestres décidèrent six jours plus tard de convoquer les parties le dimanche suivant pour envisager une transaction à l’amiable523. On ignore l’issue du conflit. Il est intéressant dans la mesure où il semble traduire un premier vent de rébellion à Liège de la part des artistes contre le système moyenâgeux des corporations. François de Robionoy († 1602) François (de) Robionoy (Robionoi, Robionoye, Robionoix ou Robionois), peintre originaire de Namur, s’installe à Liège vers 1590 ; il acquiert cette année-là le métier des orfèvres524. Le 19 août 1591, il est 523. AEL, Cité de Liège, 7, p. 553-556.- Poncelet, Documents inédits…, op. cit., p. 133. 524. Breuer, op. cit., p. 102. 222
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
reçu bourgeois de Liège525. Le 16 janvier 1592, il signe un contrat de mariage avec Anne, fille du bourgeois de Liège Guillaume Beeckman526. Toujours selon Yernaux, il teste avec son épouse en sa maison proche des sœurs de Hasque, le 16 octobre 1596. Si l’on en croit Jacques Breuer, il rédige un nouveau testament avec celle-ci en 1601. Selon A. Oger, « François de Robionoy, en son temps peintre en estime » est décédé en 1602527. Au 18 avril 1603, date de l’enregistrement de leur convention matrimoniale, les deux conjoints étaient effectivement décédés. Cette convention précise que François était le fils de Jean Robionoix, jadis bourgeois de Namur, et d’une Marguerite (en réalité Marguerite Maloteau, comme il appert de différents documents d’archives namurois). Selon Yernaux, ce Jean se confondrait avec le peintre namurois Jean de Robionoy, disciple de Lambert Lombard dont le Musée des Beaux-Arts de Verviers conserve trois panneaux remontant à l’année 1560. Le même Yernaux restitue curieusement ces tableaux à François, considérant l’attribution à Jean comme erronée. L’un des panneaux porte pourtant lisiblement la signature « I-ROBIONOI FECIT A° 1560 ». En réalité, François est le frère de Jean de Robionoy († 1578/1581), qui dirigea ce qui semble avoir été le principal atelier de peintre du Namurois dans le troisième quart du siècle528. Cette fratrie ressort d’un acte namurois au terme duquel, le 9 mai 1578, François a fait un relief au nom de son frère Jean « le poinctre », qui lui avait remis une procuration529. Jacques Rosselle (mentionné en 1613 et 1614) En juin 1614, ce peintre reçoit un paiement de la fabrique de la collégiale Saint-Denis à Liège pour des travaux de nettoyage effectués au maître-autel, conformément à une convention passée avec le chapitre le 21 juin 1613530. Salmier (mentionné au début du XVIIe siècle) Selon feu René Jans (comm. or.), Renier Salmier (mort en 1624 ou 1625), organiste et chanoine de la collégiale Saint-Barthélemy, avait un frère peintre qui fut actif au début du siècle531. Gilles de Stordeur (mentionné entre 1600 ? et 1613) Le peintre Gilles Destordeur relève le métier des merciers le 24 août 1609 comme mari de Christine d’Hérordre, fille de Louis d’Hérordre532. Ce peintre doit se confondre avec Gilhon, fils du brasseur Henry de Stordeur, qui avait acquis le métier des orfèvres en 1600533. Le 9 mai 1613, il est cité avec son épouse Christiane comme légataire universel dans le testament de sa tante Jeanne Gilson534. Le couple habitait à cette époque en la paroisse Saint-Martin-en-Île. Jean Taulier († 1636) Abry fournit une notice relativement substantielle sur ce peintre, surtout connu pour avoir été le premier maître de Gérard Douffet535. On peut résumer de la sorte les différentes informations qu’il fournit. Tau525. Manuscrit Yernaux, f° 160. 526. AEL, Échevins de Liège. Convenances et testaments, 64, f° 62 v°-63 v°.- Manuscrit Yernaux, f° 160. 527. A. Oger, François de Robionoy, sculpteur namurois, dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 24, 1900, p. 236. 528. Pour un premier catalogue de ses tableaux, voir Kairis, Les peintres liégeois dans le sillage…, op. cit., p. 310. 529. Archives de l’État à Namur, Fonds Courtoy, 1177. 530. AEL, Collégiale Saint-Denis à Liège, 600, juin 1614.- Manuscrit Yernaux, f° 163. 531. Sur ce chanoine, voir René Jans et Richard Forgeur, Renier Salmier, organiste de Saint-Denis et de Saint-Barthélemy à Liège, dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, t. 9, n° 201, 1978, p. 276-278. Le peintre n’est pas cité. 532. Poncelet, Documents inédits…, op. cit., p. 109. 533. Breuer, op. cit., p. 11. 534. AEL, Échevins de Liège. Convenances et testaments, 52, f° 306-308 v°.- Manuscrit Yernaux, f° 171. 535. Abry, Les hommes illustres…, op. cit., p. 179-180. 223
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
lier était originaire de Bruxelles. Il vint s’installer à Liège vers 1600, afin d’y travailler pour une clientèle privée. Il convola avec Catherine, la fille du peintre Simon Damery. Il était protestant, mais on ne s’en rendit compte qu’après sa mort. Ce qui lui permit de travailler pour divers établissements religieux du pays de Liège. Il œuvra notamment au réfectoire des abbayes bénédictines de Saint-Laurent et de SaintJacques. Il réalisa aussi des dorures avec des motifs très personnels (‘toutes sortes de mauresques et filigranes’) pour les autels majeurs des églises de ces deux abbayes ; cette vogue apparaissait largement démodée cinquante ans plus tard. Il travailla aussi à la décoration du maître-autel de la collégiale SaintMartin, une des ses plus importantes réalisations. Notons-le au passage, son disciple Renier de Lairesse s’est aussi spécialisé dans la peinture de mobilier religieux ; l’impact de Taulier dut être déterminant à cet égard. Saint-Martin abritait aussi des épitaphes de ce peintre. Taulier « travailloit franc et de grande manière, approchant de Martin de Vos et autres flamands ». Il pratiquait par ailleurs la xylographie et la taille douce. Il signa notamment une Sainte Famille « Joes Taulier sculp. et excudit, Leodii, a° 1635 »536. Il réalisa aussi une gravure sur bois illustrant la chapelle ardente érigée dans la cathédrale Saint-Lambert lors du passage de la dépouille mortelle de Marie de Médicis. L’artiste s’intéressait par ailleurs à la « chimie » ; il faut sans doute comprendre là l’alchimie. Le princeévêque de l’époque, Ernest de Bavière, était, c’est un fait bien connu évoqué dans un autre chapitre du présent volume, féru d’alchimie. Taulier ne se serait-il pas établi à Liège en raison du climat favorable dont y bénéficiait alors cette pratique ? Abry achève sa notice en citant une œuvre énigmatique – peinture ou gravure ? – en sa possession : « une tête de fou, laquelle, étant contournée, rend la figure d’un autre dans un ovale ». Le même auteur cite par ailleurs comme élèves de Taulier son voisin Gérard Douffet, son beau-frère Simon Damery I et son futur gendre Renier de Lairesse537. Toutes ces indications peuvent être complétées ou corrigées par des précisions exhumées pour l’essentiel des archives538. Jean Taulier (alias Thaulier, Tauler ou Taulir) serait le fils de Hubert Taulier, de Fontaine-l’Évêque, et de Gertrude de Montfort. L’origine bruxelloise de l’artiste est donc très relative. Il épouse non pas la fille du peintre Simon Damery I mais la sœur de ce dernier, fille du peintre Lambert Damery. On peut d’ailleurs se demander si, à son arrivée à Liège, Taulier ne travailla pas comme ouvrier au sein de l’atelier de Lambert Damery. La fille de ce dernier se prénomme non pas Catherine mais bien Marguerite. Elle avait auparavant épousé, en 1602, le procureur Jean Marchand. Celui-ci fut assassiné par un cousin de sa femme le 4 février 1604. Mère d’une petite fille, Marguerite se remarie bientôt avec Jean Taulier, sans doute en 1605 ou en 1606. Le couple aura (au moins) quatre enfants, nés entre 1607 et 1622. Comme on l’a vu, l’aînée, Catherine, sera l’épouse du peintre Renier de Lairesse. Taulier relève le métier des orfèvres en 1605539. Le 22 août 1606, il acquiert une maison dans l’actuelle rue Saint-Remy. Mais après quelques années, il décide de s’installer dans la maison de son beau-père, à l’enseigne du Lion d’or, en face du couvent des dominicains ; ce sera la maison familiale de la « tribu » Lairesse. On ne sait en quelle année il est entré dans la confrérie qui gère l’hôpital Saint-Jacques mais il est repris comme « maître » de celle-ci en 1614. Le 14 septembre 1622, il relève le métier des vieuxwariers. À noter que, dans un acte du 24 décembre 1624 au terme duquel Jean Damery cède à son beaufrère Jean Taulier tous ses droits sur la maison du Lion d’or, l’un des témoins porte le nom de Gérard Douffet. Il y a fort à parier qu’il s’agit-là du peintre. Rentré d’Italie depuis peu, celui-ci a rapidement renoué avec son ancien maître et toujours voisin. À la fin de sa vie, Jean Taulier se préoccupe beaucoup du règlement de la succession, longtemps vacante, de ses beaux-parents. Il décède dans sa maison derrière les dominicains, en la paroisse Saint-Adalbert, un peu plus de trois ans après son épouse, soit le 19 février
536. Aucun exemplaire de cette gravure n’a jamais été repéré. Elle n’est citée dans Hollstein (op. cit., t. 29, 1984, p. 174) que d’après la mention d'Abry. 537. Abry, Les hommes illustres…, op. cit., p. 181, 205 et 239. 538. Sauf mention contraire, ces informations sont tirées de l’article de René Jans (D’autres peintres Damery…, op. cit., p. 55-61) sur l’une des deux familles de peintres Damery et les familles apparentées. 539. René Jans ne fournit malheureusement pas la source de cette information. Ce relief ne figure en tout cas pas dans les listes publiées par Jacques Breuer en 1935. 224
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
1636. Il est enterré en l’église Saint-Martin-en-Île540. Fait exceptionnel, il s’était vu remplacé au sein du conseil de gestion de l’hôpital Saint-Jacques par Alexandre de Horion dès le 13 février 1636541. De l’avis d’Abry, Taulier était protestant : tous auraient ignoré sa confession de son vivant et on ne l’aurait découverte qu’à travers ses enfants. Cela paraît peu vraisemblable : le seul des fils de Taulier qui lui survécut fut chanoine bénéficier de la cathédrale Saint-Lambert… Les archives apportent peu de précisions sur l’activité professionnelle de Taulier. En 1611, il polychrome et dore le nouvel orgue de la collégiale Sainte-Croix pour plus de 2719 florins542. Dans ce prix est manifestement inclus un travail autour des volets, mais on ignore si Taulier y a peint des scènes figurées. Des comptes de la collégiale, il ressort que l’artiste devait avoir un atelier important car plusieurs de ses compagnons collaborèrent à son travail autour de l’orgue. Deux ans plus tard, il peint un crucifix placé sous cet orgue543 ; on ne sait si le travail se rapporte à un tableau peint ou à une sculpture polychromée. À la même époque, l’artiste œuvre pour la collégiale Saint-Denis. En 1612, il en reçoit un paiement de 112 florins, mais on ignore pour quel travail544. Selon de Theux de Montjardin, le chanoine de Saint-Lambert Arnold Hoen de Hoensbrouck fit imiter (sic) par Taulier un réseau de filigranes d’argent qui servit à décorer les gradins de la chapelle Sainte-Croix à Saint-Lambert545. L’artiste y aurait ajouté des petits médaillons ciselés et l’ouvrage fut placé sur le devant de l’autel de cette chapelle. L’anecdote laisse un peu perplexe. Hoen de Hoensbrouck ne fut reçu à Saint-Lambert que le 14 février 1636, alors que Taulier était décédé cinq jours plus tard. D’autre part, la participation de ce chanoine à la décoration de la chapelle Sainte-Croix date des années 1650. Abry se trompe quant à l’attribution d’une œuvre à Taulier. L’erreur a été relevée par René Jans à la suite de la découverte de la date de décès de l’artiste. Selon Abry, Taulier aurait réalisé une xylographie de la Pompe funèbre de Marie de Médicis lors du passage du convoi funèbre à Liège en février 1643. À cette date, Taulier était décédé depuis sept ans. Il n’est pas inutile d’insister sur un point : c’est le seul cas où une donnée archivistique contredit une attribution proposée par Abry, généralement fiable en cette matière. Aucune trace de la production artistique de Taulier n’a survécu. Aucune gravure n’a été repérée à ce jour. On ne peut deviner l’œuvre qu’en creux. La référence d’Abry à Maarten de Vos « et autres flamands » est intéressante. Elle montre que Taulier est à situer dans le sillage des derniers maniéristes actifs à Liège, tels Ramey ou Furnius. René Jans (comm. or.) se demandait si une Sainte Famille avec sainte Anne et un ange conservée à l’église Sainte-Croix à Liège ne pourrait pas se révéler de la main de Taulier. Il n’en parle cependant pas dans son article de 1989 et il ne m’a malheureusement pas fait part des fondements de cette hypothèse intéressante. La disposition originale de cette peinture sur panneau (120 x 105 cm) n’est plus connue que par une ancienne photographie546 ; elle a en effet été mutilée lors d’un vol. Très chatoyant, d’une gestuelle affectée typiquement maniériste, elle est à situer dans le sillage du peintre bruxellois Hendrik de Clerck (ca 1570-1629), peintre à la cour des archiducs Albert et Isabelle et lui-même élève de Maarten de Vos. Mais je présume qu’il s’agit plutôt d’une copie d’atelier d’après un original de Hendrik de Clerck ; plusieurs autres copies du même modèle sont connues (par exemple au château de Ramelot et à l’abbaye du Parc à Heverlee), mais je n’en ai pas trouvé de gravure. La composition ne doit en tout cas rien à Taulier, mais elle se situe bien dans le contexte bruxellois, d’où est issu ce peintre ; ce n’est peut-être pas un hasard.
540. AEL, Registres paroissiaux de Liège, 78, f° 177 v°. 541. AEL, Bienfaisance. Hôpital Saint-Jacques, 248, à la date. À moins d’une erreur d'annotation dans le document, cette date surprend un peu : Horion est accueilli dans la confrérie quelques jours avant le décès de son prédécesseur. La tradition voulait pourtant que l’on pourvût au remplacement d’un administrateur dans les jours ou les semaines qui suivaient son décès. 542. Helbig, La peinture…, op. cit., 221-222.- Richard Forgeur, Notice historique sur l’orgue de la collégiale Sainte-Croix (1609), dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 87, 1975, p. 173-175. 543. Helbig, La peinture…, op. cit., p. 222. 544. Manuscrit Yernaux, f° 173. Le document original n’a pas été retrouvé aux Archives de l’État à Liège. 545. J. de Theux de Montjardin, Le chapitre de Saint-Lambert à Liège, t. 3, Bruxelles, 1871, p. 274. 546. Cliché IRPA B153489. 225
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Otto Vaenius (1556-1629) C’est Van Mander qui nous apprend que le futur maître de Rubens a reçu une formation à Liège547. Cet auteur précise que Dominique Lampson, savant et poète, conféra au jeune homme une éducation soignée, quoique lui-même ne maniait plus à cette époque le pinceau. C’est bien une éducation théorique dans le prolongement de celle que dispensait Lombard dans son « académie » que Vaenius reçut auprès de Lampson. Issu d’une famille aristocratique, le jeune Otto van Veen, dit Vaenius ou Venius, suivit une première formation dans sa ville natale de Leyde, plus précisément dans l’atelier du peintre Isaac Claesz. van Swaenenburg548. Il disposait dans le même temps de quelques heures par jour pour une formation littéraire, souligne Van Mander. Rudi Ekkart situe cet apprentissage à Leyde entre la fin des années 1560 et octobre 1572549. Ce mois-là, l’ancien bourgmestre Cornelis van Veen, catholique et partisan de l’Espagne, trouve prudent de quitter la ville face aux assauts des Gueux. Il se réfugie quelque temps avec sa famille, dont son fils Otto, à Anvers puis à Aix-la-Chapelle. En février 1573, cette famille vient s’établir à Liège. On notera la concomitance de cette arrivée avec l’afflux à Liège d’artistes protestants des Pays-Bas en provenance d’Aix-la-Chapelle (voir ci-dessous la notice sur Hans Vredeman de Vries). Il semble donc que l’exaspération de la population aixoise à l’endroit des immigrés des Pays-Bas ne concernait pas uniquement les hérétiques. C’est donc à Lampson que Cornelis van Veen confie l’éducation de son fils. À l’évidence, c’est une formation de pictor doctus que vise Cornelis van Veen. Le jeune Otto restera à Liège même après le retour de sa famille à Leyde. Comme on va le voir, il n’a quitté la cité des princes-évêques que dans le courant de 1576, pour se rendre en Italie. Il a donc assisté à l’élaboration du seul tableau connu de Lampson, la fameuse Crucifixion de Hasselt qui fut mise en place en juillet 1576 (cf. supra). Peut-être même le jeune disciple a-t-il participé à son exécution. On peut présumer que la commande du tableau et la présence de cet élève auprès de Lampson ne sont pas indépendantes l’une de l’autre. Lampson n’aurait-il pas accepté un collaborateur dans la perspective de la réalisation de cette commande importante ? À moins que ce soit au contraire la présence de Vaenius à ses côtés qui incitât Lampson à accepter un travail manuel de cette ampleur. Ekkart attribue un tableau à la période liégeoise de Vaenius : une vue du village de Vliet, près de Leyde, pendant la distribution de hareng et de pain qui eut lieu le 3 octobre 1574550. Ce panneau (40 x 59,5 cm) monogrammé « OVVf » est conservé au Rijksmuseum d’Amsterdam. Il s’agit d’une médiocre vue qui aurait, selon Ekkart, été réalisée par Vaenius à la fin de l’année 1574 ou au début de 1575, donc durant son séjour principautaire. Ekkart présume que Van Swanenburg, témoin oculaire de l’événement, a envoyé une esquisse à son ancien élève. Parallèlement à l’enseignement de Lampson, le jeune Hollandais aurait suivi à Liège une formation plus traditionnelle auprès de Jean Ramey ; c’est en tout cas ce qui se répète dans toute la littérature qui est consacrée à Vaenius. Le premier auteur à évoquer cette anecdote est le chanoine Henri Hamal à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles551. Le fait que Hamal évoque la formation chez Ramey sans faire allusion à Lampson me donne à penser qu’il a confondu les deux hommes, deux des rares peintres liégeois du XVIe siècle dont le nom avait traversé les siècles. Comme je l’ai évoqué dans la notice consacrée à Jacques Libermé, il y a de fortes chances que Vaenius ait suivi un apprentissage traditionnel chez celuici plutôt que chez Ramey. Libermé paraît en effet s’identifier à ce Jacques le Pondeur époux de Marcken Petri dont le fils Gisbert fut porté sur les fonts de Notre-Dame-aux-Fonts le 9 juin 1576 par « Ottone 547. Van Mander, op. cit., t. 2, 1885, p. 271-272. 548. La littérature sur Vaenius est abondante, même s’il n’a pas encore bénéficié de la monographie qu’il mérite. Pour des synthèses récentes sur ce peintre, voir Leen Huet, s.v. Vaenius Otto, dans Dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours, t. 2, Bruxelles, 1994, p. 971-973 ; Hans Vlieghe, Flemish Art and Architecture 1585-1700, Yale, 1998, p. 18-19 et 117. 549. Rudolf E.O. Ekkart, Isaac Claesz. van Swanenburg 1537-1614 Leids schilder en burgemeester, Zwolle, 1998, p. 125. 550. Ibidem, p. 125-126. 551. Helbig, La peinture…, op. cit., p. 184. 226
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Venio »552. Ce pourrait être là un indice de la collaboration entre les deux hommes. Cette mention d’archives, négligée jusqu’à ce jour, est précieuse : elle fournit en effet un terminus post quem pour le voyage ultramontain. À son retour d’Italie, Vaenius passe quelque temps à la cour de l’empereur Rodolphe II, sans doute à Prague, où celui-ci vient de s’installer. Il séjourne ensuite à la cour du duc Guillaume V de Bavière à Munich, avant de revenir à Liège au service d’un autre Wittelsbach, le prince-évêque Ernest de Bavière, frère du précédent. Nul doute que c’est Lampson qui a recommandé son ancien protégé au nouveau prince-évêque. Ernest lui offre une place parmi ses pages553. Ce titre de valet de chambre doit en réalité faire figure de sinécure. Il semble qu’à cette époque Vaenius doive plutôt être considéré comme un peintre de cour itinérant. Il ne reste que quelques mois à Liège, autour de 1583-1584, avant de reprendre la route. On le retrouve à Prague, à Leyde, à Bruxelles enfin ; dans la capitale des Pays-Bas, il se mettra, à partir de 1585, au service du gouverneur Alexandre Farnèse. C’est sans doute de ce second séjour liégeois que date son portrait d’Ernest de Bavière (perdu) évoqué par Jean Polit dans ses Panegyrici ad christiani orbis principes parus à Cologne en 1587554. Le peintre de Leyde conservera au-delà des liens avec Liège. L’évêque d’Anvers Liévin Torrentius donne à plusieurs reprises de ses nouvelles à son ami Dominique Lampson555. En 1590, Vaenius exécute le dessin d’une planche de la Dernière Cène qui sera gravée par Jérôme Wierix avec une dédicace à Ernest de Bavière556. Le 13 mars 1593, ce dernier lui attribue une prébende à la collégiale Saint-Jean557 ; l’attribution de cette nouvelle sinécure est un signe manifeste de reconnaissance. Vaenius réalisera en 1595 un autre portrait d’Ernest ; celui-ci n’est connu que par sa mention dans un poème de Lampson intitulé In effigiem Ernesti, ab Octavio pictam558. Et on sait que Vaenius conservait précieusement des poèmes manuscrits de son maître Lampson559. Il a en outre peint l’effigie de celui-ci dans sonn propre Album Amicorum aujourd’hui conservé à la Bibliothèque royale de Belgique. D’une lettre de Torrentius à Lampson, en date du 29 janvier 1592, il ressort que Vaenius doit se rendre incessamment à Liège. L’évêque laisse entendre que l’artiste pourrait y peindre la Dernière Cène que, sur sa recommandation, la confrérie du Saint-Sacrement de la cathédrale d’Anvers vient de lui commander560. Cette toile (350 x 247 cm) est toujours conservée dans la cathédrale (fig. 32)561. Elle est typique du mouvement novateur issu de la Contre-Réforme. L’auteur en a évacué les éléments strictement anecdotiques qui caractérisaient la plupart des œuvres antérieures sur le sujet. La mise en page avec les apôtres attablés dans la pénombre et resserrés autour d’une table ronde crée une intensité nouvelle dans ce type de scène, intensité renforcée par l’estompement des contours avec un curieux effet de sfumato dans lequel on devine une réminiscence de l’Italie. Seul élément anecdotique : la puissante figure de Judas qui se détourne sciemment de la solennité de l’institution de l’Eucharistie. Au vrai, il n’est pas sûr que ce grand retable, un des chefs-d’œuvre de son auteur, ait été peint à Liège. On n’en trouve au demeurant aucun écho dans la peinture locale, alors qu’il marquera au contraire les artistes anversois : par sa Dernière Cène aujourd’hui conservée à la Pinacothèque de Brera à Milan, Rubens en a évoqué le souvenir. 552. AEL, Registres paroissiaux de Liège, 54, à la date.- Anciens peintres liégeois, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 18, 1885, p. 498. La vérification opérée dans le registre original ne laisse aucun doute sur le nom du parrain. 553. Polain, Ernest de Bavière…, op. cit., p. 90. 554. Ibidem, p. 91. 555. Laevinus Torrentius, Correspondance, éd. Marie Delcourt et Jean Hoyoux, t. 3, Période anversoise 1590-1595, Paris, 1954, p. 146 et 205-206 (lettres des 14 décembre 1590 et 30 juin 1591). 556. Justus Müller-Hofstede, Zum Werke des Otto van Veen 1590-1600, dans Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, t. 6, 1957, p. 151-152. 557. Lahaye, op. cit., p. 104. 558. Polain, Ernest de Bavière…, op. cit., p. 91. 559. Puraye, Dominique Lampson…, op. cit., p. 39. 560. Torrentius, op. cit., p. 313. 561. Sur ce tableau, voir en dernier lieu la notice que lui a consacrée Prisca Valkeneers dans Ria Fabri et Nico Van Hout (dir.), Catalogue de l’exposition De Quinten Metsijs à Peter Paul Rubens. Chefs-d’œuvre du Musée royal réunis dans la cathédrale, Anvers, 2009, p. 135-138. 227
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 32 : Otto Vaenius, Dernière Cène, toile, Anvers, cathédrale Notre-Dame. © IRPA-KIK, Bruxelles. 228
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Si l’art de Vaenius se fond dans le mouvement de fin du maniérisme et d’apologie de la Réforme catholique, l’artiste n’en a pas moins développé un raffinement intellectuel propre à cette capacité de pictor doctus qu’il a pu développer grâce à l’enseignement de Dominique Lampson lors de son premier séjour dans ce haut lieu de l’humanisme que constituait alors le contexte liégeois. Sur le plan formel, Jacques Foucart résume ainsi l’apport du milieu liégeois562 : « D’une parfaite correction qui n’est pas sans comporter quelque froideur, l’art de Venius représente le plus haut niveau d’un certain académisme anversois qui prolonge Floris en évitant les exagérations maniéristes des Néerlandais de Haarlem. Il résulte de l’heureuse rencontre entre un vieux courant nordique archaïque et conservatif dérivé de Lambert Lombard par l’intermédiaire de Lampsonius et le maniérisme apaisé et classicisant du milieu romain de l’époque de la Contre-Réforme (Cigoli, les Zuccaro, Girolamo Muziano) ». Nicolas Van der Sandre (mentionné en 1584) Ce peintre de Louvain a intégré le métier des orfèvres en 1584563. Jérôme Van Kessel (1578-après 1636) Ce sobre portraitiste d’origine anversoise voyagea à de multiples reprises564. En 1606, il est mentionné à Francfort. De là, il part travailler à Augsbourg. Vers 1609, il est installé à Innsbrück. En 1610, il est à nouveau à Augsbourg, d’où il se rend en Italie. Il est à Rome en 1613, puis à Cologne en 1615. Il rentre à Anvers vers 1616. Il y travaille jusqu’en 1636. Sa trace se perd par la suite. Les historiens de la peinture flamande l’ignorent, ce véritable peintre itinérant séjourna à Liège en 1604. Le 1er février de cette année-là, Jeronimus Kessel a acquis le métier des orfèvres pour la somme de 16 écus565. On ne connaît rien de ce séjour, qui dut être fort bref. L’artiste était sans doute sur le chemin de l’Allemagne. Jacob Gérard Soen Van Scaeyck (mentionné en 1573) Ce peintre, sans doute étranger, acquit le métier des orfèvres en 1573566. Melchior Verlaye (mentionné en 1610) Le 10 janvier 1610, ce peintre céda au maçon Simon Huwar sa maison de la « rue des grises sœurs » à Liège (l’actuelle rue des Clarisses), dans la paroisse Saint-Nicolas-au-Trez567. Thiry Vertruyden (mentionné en 1573) Ce peintre fit relief du métier des orfèvres en 1573568.
562. Catalogue de l’exposition Le siècle de Rubens dans les collections publiques françaises, Paris, 1977, p. 241. 563. Breuer, op. cit., p. 93. 564. Cf. Willy Laureyssens, s.v. Van Kessel Hieronymus, dans Dictionnaire des peintres belges…, op. cit., t. 2, p. 1086. 565. Breuer, op. cit., p. 124 et 148. 566. Ibidem, p. 74. À son sujet, voir aussi la notice réservée à Hans Vredeman de Vries. 567. AEL, Échevins de Liège. Œuvres, 458, f° 278 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar).- Manuscrit Yernaux, f° 190. 568. Breuer, op. cit., p. 74. À son sujet, voir aussi la notice consacrée à Hans Vredeman de Vries. 229
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Hans Vredeman de Vries (1526-1609) Originaire de Frise, ainsi que l’indique son nom, il travailla dans l’atelier de Pierre Coeck d’Alost à Malines avant de s’installer à Anvers. Il y a fait la brillante carrière que l’on sait en tant que peintre d’architecture. Il dut quitter la métropole en 1570 pour des raisons religieuses et il se réfugia à Aix-la-Chapelle pendant deux ans, en espérant toutefois pouvoir retourner au plus tôt sur les bords de l’Escaut. À l’automne 1572, il adressa à la gilde des peintres d’Anvers une demande d’autorisation de rentrer au pays. En date du 21 novembre, le doyen de la gilde, Maarten de Vos, donna une suite favorable à cette demande. C’est sur le chemin du retour que le peintre s’arrêta quelque temps à Liège ; une année et demi, selon Van Mander569. Il rentra à Anvers au printemps de l’année 1575570. Cette étape liégeoise est confirmée par les archives du métier des orfèvres : « Hans Fredeman van Frisland » acquit en effet, dans le courant de l’année 1573, ledit métier571. On peut s’étonner de cette étape liégeoise pour un peintre qui cherchait à rentrer au plus tôt à Anvers. Malgré l’accueil positif que lui proposait la gilde, les temps n’étaient sans doute pas mûrs à la fin de 1572 pour rentrer au pays. Or, cette année-là, les nombreux protestants des Pays-Bas qui s’étaient réfugiés à Aix par suite des persécutions du duc d’Albe subirent d’intenses pressions de la part du conseil communal afin qu’ils quittent la ville ; certains furent même expulsés manu militari572. Pressé de quitter Aix mais attentiste face à la situation aux Pays-Bas, Vredeman de Vries préféra séjourner un temps à Liège. D’autant que la principauté a joui en cette année 1573 d’une embellie : la paix a succédé aux troubles semés les années précédentes pas les incursions des troupes orangistes573. Il ne fut manifestement pas le seul artiste protestant à s’établir à Liège à cette époque. D’autres peintres aux noms à consonance étrangère cités dans le présent répertoire, tels Guillaume Cocksien (Willem Coxcie), Jacob Gérard Soen Van Scaeyck et Thiry Vertruyden, se sont fait enregistrer eux aussi en 1572 ou 1573 dans la corporation liégeoise qui comprenait les peintres. On peut se demander s’il ne s’agit pas de protestants des Pays-Bas ayant dû à leur tour quitter prestement Aix-la-Chapelle. Il semble du reste qu’ils se soient inscrits au métier des orfèvres dans le même contexte. Jacques Breuer a en effet relevé une écriture différente dans le registre de la corporation pour toute une série d’étrangers. Outre les noms déjà cités, on relève « Antoine Witte, natif d’Anvers », « Antoine de Buisson, orphèvre, (…) natif de Bruxelles », « Jean de la Grainge, natif de Mons en Haynaut, brosdeur »…574 Le paiement de l’acquêt à l’un des « bons métiers » de Liège fut peut-être une des conditions à leur accueil par la Cité. François Walschartz (1597/1598-1678) À l’image de Gérard Douffet ou d’Alexandre de Horion, ce peintre majeur du XVIIe siècle liégeois n’est cité ici que pour le début de sa carrière et le renouveau dont, avec les deux précités, il sera porteur au pays de Liège. La notice que Louis Abry consacre à l’artiste alors décédé est relativement brève575. Elle n’inspire guère la confiance lorsqu’on constate que l’auteur se trompe même dans le prénom de l’artiste, qu’il baptise Jean. Cette confusion perdurera longtemps dans la littérature consacrée au peintre. Elle se compliquera
569. Van Mander, op. cit., t. 2, 1885, p. 103. 570. Sur ces péripéties, voir Heiner Borggrefe, Hans Vredeman de Vries 1526-1609, dans Catalogue de l’exposition Tussen stadspaleizen en luchtkastelen. Hans Vredeman de Vries en de Renaissance (Anvers), Gand et Amsterdam, 2002, p. 18-19. 571. Breuer, op. cit., p. 75. 572. Joseph Daris, Histoire du diocèse et de la principauté de Liège pendant le XVIe siècle, Bruxelles, 1884, p. 428-429. 573. Ibidem, p. 334. 574. Breuer, op. cit., p. 73-75. Ne sont repris dans le présent répertoire que les noms des personnages nommément cités comme peintres. 575. Abry, Les hommes illustres…, op. cit., p. 207-209. 230
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
même. Ainsi, en 1873, Renier proposera de distinguer deux peintres différents, un Jean et un Lambert Walschartz576. C’est essentiellement au travers des archives que les contours de l’existence de François Walschartz pourront être esquissés. Confrontées au récit d’Abry, ces archives ont fait l’objet d’une magistrale synthèse de l’incontournable René Jans577. En 1573, le marchand anversois François Walschartz, le grand-père du peintre, acquiert à Liège le métier des merciers et est admis comme bourgeois578. Il s’installe sur le Pont d’Île ; il y achète une maison en 1578. C’est ainsi que la famille Walschartz est arrivée à Liège. Le fils et homonyme dudit marchand acquiert le métier des orfèvres à Liège en 1590-1591579. Ce qui confirme l’assertion d’Abry, selon qui le père du peintre Walschartz était orfèvre. Il se marie en juin 1596 avec Marie, fille du marchand Guillaume de Bois dit La Barbe. C’est sans doute en 1597 ou 1598 que naît François, l’aîné des enfants des époux Walschartz-de Bois. Cette date est inférée d’un acte du 25 septembre 1624, qui dit que François est alors âgé de « 26 ans et plus ». C’est sans fondement que Thys le fait naître à Tongres580. Selon Abry, François Walschartz « s’adonna premièrement à graver près de son père et à dessiner ». Né dans un milieu artistique, François doit effectivement bénéficier rapidement d’une initiation aux beauxarts et sa vocation ne risque pas d’être contrariée. Toujours selon Abry, il est envoyé à Anvers pour y faire son apprentissage de peintre. Bientôt, il travaille dans la manière de Rubens et après « une assez belle étude qu’il fit d’après ledit Rubens, il revint à Liège, vers l’an 1618 ». René Jans a montré que François Walschartz ne fut pas à proprement parler envoyé à Anvers pour y devenir peintre, mais que, très jeune encore, il dut y suivre ses parents. Criblé de dettes, son père a en effet préféré s’expatrier dès 1603. Il ne reparaît à Liège qu’en 1617 – la coïncidence avec la date proposée par Abry pour le retour de son fils est troublante. Il y a tout lieu de croire que les Walschartz se sont établis durant quelques années à Anvers, où ils avaient de la famille. L’orfèvre Walschartz ne profitera guère de son séjour à Liège puisqu’il mourra entre le 8 octobre 1618 et le 9 janvier 1619581. Ne serait-ce pas en cette circonstance que le peintre serait revenu d’Anvers ? On demeurera circonspect sur la chronologie ; il est peut-être déjà à Rome à ce moment. Abry n’est nullement fiable en matière de dates, on le sait. Lorsqu’il écrit « vers l’an 1618 », il témoigne de ses propres hésitations. On redoublera donc de prudence. La première mention sûre du peintre revenu à Liège date du 4 janvier 1620. Ce jour-là, sa mère, « Marie de Bois dite Labarbe veuve de feu Lambert Walcart » le fait émanciper et lui alloue pour sa subsistance la somme symbolique de 1 florin582. L’acte précise, fait important, que « France Walcart » est présent. Le peintre apparaît encore dans les archives liégeoises en 1621, 1622 et 1624. Se pose dès lors le problème de la chronologie de son séjour en Italie. Le voyage à Rome s’avéra déterminant pour la suite de sa carrière. Il s’est inscrit là dans le sillage du peintre caravagesque Carlo Saraceni, dont il conservera la manière pendant toute son existence. Or, Saraceni a quitté Rome en 1619 pour retourner dans sa ville natale, Venise, et il y est décédé en 1620. L’influence de Saraceni sur Walschartz est tellement prégnante qu’on peine à croire que les deux hommes ne sont pas connus. On peut se demander si le Liégeois ne s’est pas rendu à Rome vers 1618-1619. Si le
576. Jean-Simon Renier, Catalogue des dessins d'artistes liégeois d’avant le XIXe siècle possédés par l’Académie des Beaux-Arts à Liège et Catalogue des dessins possédés par la Bibliothèque de l’Université de Liège, Verviers, 1873, p. 95-96. 577. Jans, La vie mouvementée…, op. cit., p. 281-294. 578. Juliette Rouhart-Chabot et Étienne Hélin, Admissions à la Bourgeoisie de la Cité de Liège. 1273-1794, Liège, 1962, p. 31. 579. Breuer, op. cit., p. 104. 580. Charles-Marie-Théophile Thys, Essai de biographie tongroise, Tongres, 1891, p. 318. 581. AEL, Échevins de Liège. Greffe Crahay. Paroffres, 34, paroffre du 8 octobre 1618.- Jans, La vie mouvementée…, op. cit., p. 287. 582. AEL, Échevins de Liège. Oeuvres, 765, f° 96 v°.- Jans, La vie mouvementée…, op. cit., p. 287. La confusion de prénom pour le père du peintre explique peut-être celle qui se reportera sur le peintre lui-même, que certains auteurs prénomment Lambert. 231
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
voyage a eu lieu au début des années 1620, il n’a pu qu’être court puisque le peintre est à cette époque cité à diverses reprises dans les archives liégeoises. En tout cas, dès les années 1620, il est au faîte de sa carrière : c’est l’époque des meilleurs tableaux, telles l’Adoration des bergers du maître-autel de l’église de pèlerinage de Foy Notre-Dame (vers 1627) ou la Sainte Famille dans l’atelier de saint Joseph de la chapelle Saint-François de Malmedy (194 x 110 cm), sans doute de peu postérieure. Cette dernière peinture (fig. 33) illustre à merveille le sentiment d’intériorité dont le peintre avait le secret. On lit dans le regard de la Vierge qu’elle est consciente des souffrances à venir. C’est une œuvre qui montre, dans une grande sérénité, une forme de piété populaire, de réalisme rustique, qui caractérise le peintre. À ce jour, une petite trentaine de tableaux de ce maître d’exception, la plupart inédits, ont été recensés583. Willem de Waremme (mentionné en 1573) Il paie une rente en 1573 avec son épouse, Jehanne Lynon584. André Wesmael (mentionné entre 1602 et 1634) André Wesmael (ou Wesmalle, Wismal, Wetzemael ou Wetzmael) relève le métier des orfèvres en 1602585. À cette époque, il est l’apprenti de Denis Pesser, l’auteur de la peinture murale de la Résurrection du Christ encore conservée à l’église Saint-Jacques à Liège (cf. supra). Il est le fils de Raskin Wesmael, de la paroisse Sainte-Véronique586. Curieusement, il relève à nouveau le métier des orfèvres en 1608, en tant que mari de Jeanne, fille de Jean de Peron587 ; cette année 1608 correspond probablement à celle où il devient maître. En 1616, il relève le métier des merciers588. En mars 1624, son beau-frère le passementier Jacques Morea, lui cède, contre 50 florins de rente, une maison située en Roture, dans la paroisse Saint-Nicolas-Outre-Meuse589. Il s’établira en Chéravoie et il est encore vivant en 1634590. Il est le père du peintre André Wesmael II. Sa veuve réside encore dans la maison de Chéravoie en octobre 1664591. Par sa femme, il est apparenté à son confrère et proche voisin André Marckon dit Romanique (1602-ca 1682), époux d’une Lucie de Peron. Sa veuve et son fils apparaissent d’ailleurs à plusieurs reprises dans des actes notariés relatifs audit Marckon, grand ami de ce Bertholet Flémal qui dominera le panorama de la peinture liégeoise au milieu du siècle592.
583. Pour une première approche de l’art de Walschartz, voir Hendrick, La peinture au pays de Liège…, op. cit., p. 117-123 ; Kairis, Autour de Walthère Damery, op. cit., p. 33-38 ; Idem, Le peintre François Walschartz et l’Adoration des bergers du maître-autel, dans Actes du colloque « Foy Notre-Dame : art, politique et religion » (Dinant, 26 mai 2009), dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 83, 2009, p. 119-129. 584. AEL, Collégiale Saint-Barthélemy à Liège, 1, f° 12 v° (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 585. Breuer, op. cit., p. 122. 586. Jans, Une dynastie…, op. cit., p. 236. 587. Breuer, op. cit., p. 137. 588. Manuscrit Yernaux, f° 199. 589. AEL, Notaire H. Oupie à Liège, 1623-1624, f° 148 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 590. Jans, Une dynastie…, op. cit., p. 236. 591. AEL, Notaire J. Léonard à Liège, 1662-1664, acte 229 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 592. Ibidem, actes 93, 95, 96, 97 et 229 (DIAL ; comm. Mme É. Gaspar). 232
ENTRE LAMBERT LOMBART ET GÉRARD DOUFFET : LA GÉNÉRATION PERDUE
Fig. 33 : François Walschartz, Sainte Famille dans l’atelier de saint Joseph, toile, Malmedy, Trésor de l’église Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Quirin. © IRPA-KIK, Bruxelles. 233
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE, DEPUIS LA MORT DE LAMBERT LOMBARD JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE Michel Lefftz
Introduction Dire que l’historiographie de la sculpture dans nos régions entre la mort de Lambert Lombard jusqu’aux prémices du Baroque est pauvre serait un euphémisme. Il n’y a pas que l’indigence de témoins sculptés qui permet d’expliquer cette situation, il y a davantage les perspectives de recherche selon lesquelles on a envisagé l’interprétation des œuvres. Ainsi, il y a quelques décennies encore, l’analyse devait nécessairement être au service d’un discours général, lequel servait à son tour à proposer une vision cohérente de l’époque considérée. Fort heureusement pour la conservation du patrimoine et pour la connaissance scientifique, la manière d’écrire l’histoire de l’art a considérablement évolué depuis un demi-siècle et un certain nombre d’historiens de l’art ont à nouveau recours de manière privilégiée à la méthode inductive. Aussi, plutôt que de s’efforcer d’insérer à tout prix les œuvres dans une trame dont le maillage est prédéterminé par des éléments extérieurs, ils bâtissent leurs analyses sur la critique interne des œuvres et tentent de mettre en place des groupements dont la cohérence repose principalement sur des critères techniques et morphologiques. Ce juste retour méthodologique aux sources est nécessaire à chaque fois que la trame de l’Histoire de l’art est trop lâche et qu’elle ne peut accueillir les données livrées par le terrain. C’est précisément le cas pour le patrimoine artistique du dernier tiers du XVIe siècle et du premier quart du XVIIe siècle. Les œuvres de qualité de cette époque n’entrent effectivement plus dans la catégorie Haute Renaissance et il est encore trop tôt pour parler de Baroque. La revalorisation du Maniérisme, que l’on observe depuis la fin du XXe siècle et qui fut notamment consacrée en France, en 1997, par la parution de « La Renaissance maniériste » dans la collection L’univers des Formes, aurait pu résoudre ce hiatus de l’Histoire de l’art1. On avait espéré que le resserrage du cadre conventionnel des catégories stylistiques allait résoudre le problème de la période qui nous intéresse ici, mais tel ne fut pas le cas, car la majorité des œuvres concernées par cette nouvelle étiquette ne se situent pas au-delà du troisième quart du XVIe siècle. D’autres appellations ont été suggérées, mais comme l’avait déjà démontré Antonio Pinelli, la notion d’art de la Contre-Réforme, sans doute l’une des étiquettes les plus employées, était bien trop protéiforme pour pouvoir définir la production artistique de cette époque2. La mise en perspective sur le Maniérisme proposée par Pinelli a grandement clarifié les limites géographiques et chronologiques de ce style et surtout, pour le sujet qui nous intéresse particulièrement ici, il a proposé une lecture convaincante de la place des théoriciens de l’art dans ce débat. Rappelons-en brièvement les circonstances. Après les conclusions du Concile de Trente, le lent déclin de la Manière était devenu inéluctable, car l’Église misait sur une utilisation des images à destination du peuple. Or la sophistication de la Manière la destinait à une élite intellectuelle, elle se réfugia donc dans quelques cours, dont celle de Rodolphe II à Prague offrit le panorama le plus complet et probablement le plus tardif. Comme la Manière avait eu en Vasari son porte-parole, la condamnation de la Manière eut aussi son théoricien, à Venise, en la personne de Lodovico Dolce3. Cette opposition précoce du Maniérisme devait aboutir à l’affrontement entre la Manière de Michel-Ange, objet théorique des Vite de Vasari, et le classicisme convenant de Raphaël4. Chez Dolce, cette revalorisation de Raphaël se fit naturellement aux dépens de Michel-Ange, mais surtout elle s’accompagna de la promotion de Titien comme champion incontesté de la peinture, notamment par son naturalisme de la couleur. Quelques décennies plus tard, le classicisme naturaliste des Carrache devait 1. 2. 3. 4.
Daniel ARASSE et Andreas TÖNNESMANN, La Renaissance « maniériste », Paris, 1997. A. PINELLI, La Belle Manière. Anticlassicisme et maniérisme dans l’art du XVIe siècle, Paris, 1996, p. 273-274. A. PINELLI, La Belle Manière. Anticlassicisme et maniérisme dans l’art du XVIe siècle, Paris, 1996, p. 282-287. On trouve notamment au cœur de cette opposition le problème des pudenda des figures nues de la chapelle Sixtine.
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
s’opposer au réalisme du Caravage ; mais entre ces deux moments clefs on trouve une sorte de no mans land de l’Histoire de l’art. Or, les artistes effectuant le voyage d’Italie dans le dernier tiers du XVIe siècle y allaient aussi pour étudier d’autres œuvres que celles des génies de la Haute Renaissance et du Maniérisme. Il faut insister sur ce point, car si les œuvres de cette époque ont été presque systématiquement délaissées, voire considérées comme le reflet d’une décadence artistique, c’est précisément parce qu’on les a systématiquement comparées à des modèles plus anciens, relevant pour la plupart de la Haute Renaissance. Il n’est sans doute pas inutile d’illustrer brièvement ce dernier point historiographique pour le contexte qui nous occupe ici. On aura tout d’abord recours à la grande synthèse de Jules Helbig sur la sculpture mosane5 : « La période qui commence avec le règne de Corneille de Berghes, successeur d’Érard de la Marck, est une époque de décadence pour les arts. Il ne pouvait en être autrement du jour où le goût des classes élevées et l’esprit des artistes se laissèrent diriger par des influences étrangères au génie naturel des populations auxquelles ils appartenaient. L’art ne saurait avoir de valeur réelle que comme l’expression du génie et de la vie d’une race, du caractère d’une nation ». Grand défenseur du renouveau du style gothique en Belgique, notamment par conviction nationaliste, Jules Helbig exprime ici clairement son rejet pour l’art ultramontain des Temps Modernes. Faisant sienne l’opinion d’Eugène Müntz, Helbig considérait que le recours à l’Antiquité comme modèle avait tué les « aspirations nationales » et condamné l’art à la stérilité, ce qui devait entraîner « sa longue et douloureuse agonie »6. Se rendant en Italie pour y étudier les maîtres, nos artistes n’y auraient plus trouvé que « des imitateurs déjà bien déchus, qui pouvaient les aider, à la vérité, à ‘tuer les aspirations nationales’ sommeillant encore dans leur cœur, mais qui, incapable de les remplacer par un art vivace, devaient leur inoculer l’anémie par laquelle commençait alors la longue et douloureuse de l’art italien, agonie à laquelle allait succomber naturellement aussi l’art des nations qui venait lui demander des recettes et des modèles »7. Moins intolérant, Simon Brigode concluait quelques décennies plus tard son étude sur la sculpture du XVIe siècle en évitant d’aborder directement le problème du dernier tiers du siècle : « Notre XVIe siècle se résume ainsi en une variété de tendances : des artistes gothiques, d’autres qui timidement associent à leurs œuvres traditionnelles quelques détails nouveaux, d’autres enfin, qui adoptent le langage de la Renaissance, mais qui ne font que traduire avec un vocabulaire italien une pensée toute gothique encore. Et puis, émergeant de cette masse un ou deux artistes au tempérament exceptionnel et qui sont réellement des gens de la Renaissance ou du moins qui s’en rapprochent très fort par leur pensée »8. Ces artistes qui émergent ne sont aux yeux de Brigode ni Mone ni Floris qui n’adoptent la Renaissance que dans « ce qu’elle a de superficiel, son vocabulaire ». Seul Dubroeucq trouve grâce aux yeux de cet auteur, car il « est vraiment un homme de la Renaissance par la résonance profonde de ses œuvres, par son individualité nettement accusée ». Le rejet dont la production du dernier tiers du XVIe siècle fut l’objet dans ces deux travaux de synthèse s’est largement maintenu jusqu’à aujourd’hui. Il est sans doute encore trop tôt pour réhabiliter l’art qui se situe entre le Maniérisme et le Baroque, mais il est certainement temps de commencer à ordonner les matériaux qui permettront d’y parvenir. C’est donc vers les artistes et les œuvres que se tournera notre contribution. Si beaucoup d’œuvres sculptées en pierre et en marbre sont perdues, il en subsiste néanmoins un grand nombre appartenant pour la plupart à des ensembles de mobilier liturgique, malheureusement presque tous démantelés. La production en bois n’a guère connu de meilleur sort9. En regard de ces œuvres, les archives ont livré quelques noms d’artistes, mais les liens entre auteurs et réalisations sont encore ténus, voire conjecturaux. N’empêche, l’occasion qui nous est donnée ici permettra d’aller au-delà de l’état de la question puisque nous allons proposer les premiers jalons solides et des pistes de recherche balisées.
5. Jules Helbig, La sculpture et les arts plastiques au pays de Liège et sur les bords de la Meuse [2e éd.], Bruges, 1890, p. 157-161. 6. Eugène Müntz, Raphaël et son temps, Paris, 1886, p. 4 (cité par Helbig). 7. Jules Helbig, La sculpture et les arts plastiques au pays de Liège et sur les bords de la Meuse [2e éd.], Bruges, 1890, p. 158. 8. Simon B RIGODE, La sculpture au XVIe siècle, in P. FIERENS (dir.), L’art en Belgique du Moyen Âge à nos jours, Bruxelles, s.d., p. 206-208. 9. Joseph de Borchgrave d’Altena avait tenté de mettre un peu d’ordre dans la production en albâtre, Notes et documents pour servir à l’histoire de l’art et de l’iconographie en Belgique, 1ère série. Sculptures conservées au Pays Mosan, Verviers, 1926, p. 188-204. 236
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
LES ARTISTES Henri Borset L’ample étude réalisée en 1923 par l’abbé Moret sur Henri Borset et Thomas Tollet, constitue encore aujourd’hui l’assise des connaissances sur ces deux artistes ; nous n’en reprendrons ici que l’ossature en nous servant notamment des compléments et corrections apportés en 1956 par Jean Yernaux10. En 1551, le sculpteur liégeois François Borset s’engageait à réaliser un retable d’autel dédié à sainte Anne et à la Vierge pour l’église Sainte-Catherine à Liège11. La partie architectonique devait être de marbre et de jaspe, les statues, de pierre blanche. Trois ans plus tard, un contrat du 11 juillet 1544 fait intervenir François Borset pour divers travaux en marbre à réaliser à la chapelle du Saint-Sacrement de l’église de l’hôpital Saint-Mathieu à la Chaîne. En 1551, le sculpteur prit en location une carrière située sous le bois nommé Basdrée, sous Ninane, jouxtant entre autres les héritiers de Jehan Tollet et le 6 avril 1556, il obtenait la location de la carrière de marbre noir à Theux, près de l’église, laquelle carrière passera plus tard à Thomas Tollet12. Le fils aîné de François, Henri, épousa Catherine de Xhéneumont. Tous deux firent leur testament dans leur maison de la rue Saint-Remy à Liège, le 14 octobre 1584, alors qu’Henri était malade. Ce dernier eut comme témoin de ses dernières volontés le sculpteur Elias Fiacre, fils d’un autre membre du métier, Martin Fiacre. Pas plus que pour son père, on ne connaît d’œuvres conservées de Henri Borset. Le contrat qu’il passa en 1580 avec le duc de Nevers pour le maître-autel de l’église de Nevers prouve cependant qu’il fut un sculpteur reconnu13. Thomas Tollet (1537-1621) Né en 1537, le jeune Thomas Tollet épousera en 1565 Philippette Lombard, la fille du célèbre peintre Lambert Lombard14. Celle-ci avait reçu en dot une rente de six cents florins d’or du Rhin, une somme de cent dallers en deniers comptants et la promesse d’une carrière de jaspe située à Ninane, près de la Vesdre. Deux ans après son mariage, Thomas acquiert une maison de la rue d’Avroy et l’une des tours de la porte d’Avroy à Liège. Plusieurs moments de la longue vie de Thomas Tollet peuvent être suivis dans les archives15. On l’y voit notamment faire des transactions immobilières et foncières. Il est manifestement actif dans le commerce de la pierre. Ainsi, en 1570, il échange avec l’« entretailleur de pierres », Jean van Heynsberg, une carrière de pierres sur la Vesdre, près de Chaudfontaine. Plus tard, il reprendra la carrière de marbre noir à Theux qu’avait précédemment exploitée Henri Borset. La dalle funéraire de l’artiste, d’aspect fort modeste pour un homme riche, est conservée à l’église Saint-Christophe. En voici l’inscription : ICY GIST HONORABLE HOM[M]E M[AIT]RE THOMAS THOLLET BOVRGEOIY DE LIÈGE QVI 16 TRESPA[SSA]T L’AN 1621 LE 19 DÉCEMBRE PRIE[S ] DIV POVR SON AME . 10. Justin MORET , Henri de Borset et Thomas Tollet, sculpteurs liégeois du XVIe siècle. Leurs travaux dans la cathédrale de Nevers, in Bulletin de l’Institut Archéologique liégeois, 48, 1923, p. 85-134 ; Jean YERNAUX, Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 137-141. 11. E. PONCELET, Documents inédits sur quelques artistes liégeois. Deuxième partie, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 5, 1895, p. 125. 12. Pierre DEN DOOVEN, Histoire de la marbrière antique de Theux et des tombeaux de la famille de la Marck dans l’Eifel, in Bulletin de la Société verviétoise d’Archéologie et d’Histoire, 53, 1966, p. 115-162. 13. Transcrit dans ses parties principales par Moret : Henri de Borset et Thomas Tollet, sculpteurs liégeois du XVIe siècle. Leurs travaux dans la cathédrale de Nevers, in Bulletin de l’Institut Archéologique liégeois, 48, 1923, p. 89-93. 14. Marguerite DEVIGNE, Tollet (Thomas), in Biographie nationale, Bruxelles, 1930-1932, 25, col. 406-413. Si cette notice comporte une date de décès erronée, on y trouvera de nombreuses données sur la famille et les biens du sculpteur. Jean YERNAUX, Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 141-146. 15. Outre la bibliographie déjà mentionnée, on recourra aussi avec grand intérêt à la base de données du Dictionnaire informatisé des artistes liégeois (DIAL : http://promethee.philo.ulg.ac.be/dial/). 16. Pierre COLMAN, La dalle funéraire du sculpteur Thomas Tollet (1537-1621), in Bulletin de l’Institut royal du patrimoine artistique, 1959, p. 158-162. Le professeur Colman a proposé une interprétation séduisante de l’indigence de la dalle funéraire de Thomas Tollet et surtout de l’absence de ses armoiries. 237
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
La première œuvre que l’on puisse mettre à l’actif de Thomas Tollet date de 1566, année de la mort de Lambert Lombard ; il s’agit d’un autel qu’il exécute pour la collégiale de Tongres17. Cet autel ainsi qu’une grande partie du mobilier de l’église fut détruit lors de l’incendie du 28-29 août 1677, mais il en subsiste néanmoins probablement des fragments qui ont été remontés dans le retable d’autel de la chapelle du chapitre18. Dans cet ensemble disparate, où l’on reconnaît le style de l’atelier Thonon dans deux bas-reliefs en albâtre, on voit encore sur la prédelle cinq basreliefs en albâtre d’une qualité exceptionnelle qui n’ont jusqu’ici pas attiré l’œil des connaisseurs. Ils représentent des personnages de l’Ancien Testament dont le roi David, Moïse et des prophètes (fig. 1 à 5)19. Malgré l’usure, les proportions très maniéristes des corps ainsi que les subtils effets de schiacciato du relief concordent parfaitement avec les années 1560 et avec le milieu de production influencé par Lambert Lombard. Nous proposons donc, à titre d’hypothèse de travail, d’en donner la paternité à Thomas Tollet. Une représentation en bas-relief de la Charité du Musée Curtius à Liège offre certaines similitudes dans le traitement du drapé avec la magnifique figure du prophète qui tourne le dos et brandit son rotulus. La qualité des figures de Tongres est telle qu’on songe immanquablement à les rapprocher de l’art de Primatice. Jean Yernaux avait découvert que le 16 décembre 1569, Thomas Tollet et son frère Pierre, signèrent un Fig. 4 : Thomas Tollet (?), contrat avec Jean Le Rond représentant l’abbaye Le roi David, ca 1566, albâtre. de Lobbes, mais malheureusement la teneur de Tongres, église Notre-Dame cet acte est inconnue20. Les travaux concernés © Michel Lefftz. durent néanmoins être importants, car ils n’étaient pas encore terminés en 1577. Plus tard, le gendre de Lambert Lombard se retrouva également employé par Louis de Gonzague. Henri Borset et Thomas Tollet travaillèrent donc côte à côte à Nevers après 1580. Le contrat de Tollet fut passé le 29 août 1580 par le notaire Le Ducquet, dans la maison du Val-Saint-Lambert à Liège ; l’abbé Moret en a retranscrit de larges extraits21. Le monument funéraire de marbre et de jaspe devait être confectionné
17. Edmond THYS, Le chapitre de Notre-Dame à Tongres, in Annales de l’Académie d’archéologie de Belgique, Bruxelles, 1887, 43, p. 421. 18. Jean PAQUAY, Monographie illustrée de la collégiale Notre-Dame à Tongres, Tongres, 1911, p. 49, 64. 19. Sur la prédelle encore, deux bas-reliefs en plâtre (?) montrant des figures d’Adam et Eve ainsi que des ornements de style maniériste attestent d’une facture différente. Dans les niches se trouvaient deux statues en marbre blanc ou en albâtre qu’il aurait été très intéressant d’étudier mais qui restent introuvables. On les voit encore sur un cliché de l’IRPA, de 1914 : B20447. 20. Jean YERNAUX, Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 144. 21. Justin MORET , Henri de Borset et Thomas Tollet, sculpteurs liégeois du XVIe siècle. Leurs travaux dans la cathédrale de Nevers, in Bulletin de l’Institut Archéologique liégeois, 48, 1923, p. 93-97. 238
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
à Liège puis transporté à Nevers dans des caisses de bois. Les archives mentionnent cependant des séjours prolongés de l’artiste à Nevers tandis que sa femme demeurait à Liège22. Le monument funéraire de Louis de Gonzague et de son épouse Henriette de Clèves, tout comme celui de Jean de Bourgogne comte de Nevers et duc de Brabant, et encore celui de François de Clèves et de Marguerite de Bourbon, également de Tomas Tollet, furent tous détruits à la Révolution, mais on en conserve fort heureusement le souvenir grâce à des croquis réalisés par Gaignières (fig. 6 à 8). Ces importantes commandes furent achevées en 1591, peu après le décès de Marguerite de Bourbon23. Alors qu’il exécutait le monument funéraire de Louis de Gonzague, Thomas Tollet était rappelé à l’ordre par le Conseil privé à propos d’une autre commande non encore livrée : une pyramide en pierre commandée par le représentant de la reine de Navarre et qu’il s’était engagé à ériger à Spa. La dernière commande connue de Thomas Tollet se rapporte à la construction d’un jubé pour l’église abbatiale des Cisterciens du Val-Saint-Lambert. Avec d’autres, il y travaillera sans doute dès la signature du contrat en février 1600, jusqu’en août 1603, date de la consécration des deux autels inclus dans le vaste meuble liturgique24. Tout est détruit.
Fig. 6 : Thomas Tollet (dessin d’après). Mausolée de Louis de Gonzague et Henriette de Clèves. © BNF, Ms français 8226, f° 356 r°.
La renommée de Thomas Tollet subsista jusqu’au milieu du XVIIe siècle, car le sculpteur Gilles Fiacre devait déclarer devant le notaire Théo Pauwea qu’il l’avait fort bien connu et que « c’était le meilleure maître sculpteur qu’il y eût dans Liège et par tout le pays. C’était un homme de bien et d’honneur ; jamais 22. J. GESSLER, À propos de Thomas Tollet, sculpteur liégeois, in Chronique archéologique du Pays de Liège, 24, 1933, p. 79-81 ; Jacques BREUER, Les orfèvres du Pays de Liège. Une liste des membres du métier, in Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois, 13, 1935, p. 66. 23. Justin MORET , Henri de Borset et Thomas Tollet, sculpteurs liégeois du XVIe siècle. Leurs travaux dans la cathédrale de Nevers, in Bulletin de l’Institut Archéologique liégeois, 48, 1923, p. 120. 24. Des comptes s’y rapportant sont conservés aux archives de l’État à Liège, cf. Marylène LAFFINEUR-C RÉPIN, Pour magnifier le service divin et perpétuer la mémoire des hommes. Entre renaissance et baroque, quelques exemples prestigieux de sculptures en marbre, à Liège et à Nevers, in Pouvoir(s) de marbres (Dossier de la commission royale des monuments, sites et fouilles, 11), Liège, 2004, note 20. 239
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
il n’avait entendu dire qu’il y eut en lui ou en ses prédécesseurs aucune tache d’illégitimation. On avait beaucoup d’estime pour lui. Il avait été élu et choisi pendant sa vie, juré du cordeau, comme aussi l’un des confrères de l’hôpital Saint-Jacques… »25. Les Fiacre Jean Yernaux a posé les bases prosopographiques des sculpteurs Martin et Elias Fiacre à l’occasion de son étude sur l’atelier des Palardin26. Fils de Fiacre le Queux, Martin Fiacre devint apprenti dans l’atelier de sculpture des Italiens Palardin vers le milieu du XVIe siècle. Après avoir pris une certaine importance auprès de ses maîtres, notamment en les représentant officiellement pour des transactions, il finit par épouser Marie Palardin en 1552. Les noces furent célébrées à Saint-Adalbert à Liège. Suite à divers abus de Nicolas Palardin II envers sa mère veuve, un accord est trouvé en 1579 devant les échevins de Liège pour que Martin Fiacre puisse assurer la gestion des biens de son beau-père décédé, notamment de la maison du Laveux. Peu après, il s’installe dans cette demeure avec son épouse et bientôt leur fils Elias y naîtra. Si l’on en juge d’après les prêts hypothécaires qu’il consentit, la fortune de Martin Fiacre s’accroit considérablement par la suite. Deux ans après avoir rédigé son testament, il décède en 1601. De l’union d’Elias Fiacre et de Catherine Dossin, naquirent deux fils : Martin et Gilles. Devenu veuf peu de temps après, le sculpteur se remaria avec Anne Botton et en eut trois filles, Agnès, Anne et Marie. Une nouvelle fois veuf, Elias épousa cette fois en troisièmes noces Marie Stavesoul qui lui donna deux fils, Elias et Martin27. Grâce aux archives de l’hôpital Saint-Jacques, nous savons qu’Elias Fiacre entreprit le voyage de Rome en 1602. Il était déjà de retour à Liège en 1606 où il vécut jusqu’en 1636. Un troisième membre de la lignée des Fiacre devait prolonger la tradition de la sculpture : Gilles. Il épousa Marguerite de la Préalle et habitèrent dans la paroisse Saint-Nicolas-au-Trez. Gilles Fiacre décéda en 1664, sans laisser d’enfant mâle et donc sans espoir de prolonger la tradition. Il a probablement travaillé jusqu’à la fin de sa vie, car en 1662 il fournissait encore deux statues d’anges pour l’église Saint-Remy de Liège28. Les Tabaguet-de Wespin Nous n’allons pas reprendre ici la vaste synthèse de Marguerite Devigne sur cette importante famille de maîtres de carrière, marchands et sculpteurs, qui remonte aux années 192029, ni retranscrire toutes les données s’y rapportant dans l’étude de Ferdinand Courtoy sur les arts « industriels » à Dinant au début du XVIIe siècle30, mais plutôt prendre cet exemple pour insister sur la nécessité de mener une étude de fond sur le milieu de la pierre dans la Meuse, de Dinant à Liège, dans lequel la famille des Dinantais Tabaguet joua un rôle considérable à l’époque d’Ernest de Bavière. Les marchands de marbre et maîtres
25. Justin MORET, Henri de Borset et Thomas Tollet, sculpteurs liégeois du XVIe siècle. Leurs travaux dans la cathédrale de Nevers, in Bulletin de l’Institut Archéologique liégeois, 48, 1923, p. 126. 26. Jean YERNAUX, L’atelier italo-liégeois des Palardins et des Fiacres, sculpteurs, aux XVIe et XVIIe siècles, in Annuaire de la Commission communale de l’histoire de l’Ancien Pays de Liège, 5, 1936, p. 268-292. Voir aussi : Joseph DESTRÉE, Le monument de Réginard évêque de Liège, in Annales de la Société Royale d’Archéologie de Bruxelles, 28, 1919, p. 307-334 ; Joseph DESTRÉE, À propos du monument de Réginard évêque de Liège, exécuté en 1604 par Martin Fiacre, in Annales de la Société Royale d’Archéologie de Bruxelles, 30, 1921, p. 65-67 ; Marthe CRICK-KUNTZIGER, Le monument de l’évêque Réginard, in Bulletin des Musées royaux d’art et d’histoire, 1932, p. 135-145. 27. Comme le suppose judicieusement Jean Yernaux, le premier fils prénommé Martin était sans doute mort en bas âge d’où la reprise du même prénom. 28. Archives de l’État à Liège, Cures Liège, Saint-Remy, reçu du 5 juillet 1662, de Gilles Fiacre sculpteur, déjà cité par Jean YERNAUX, Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 160. 29. Marguerite DEVIGNE , Les frères Jean, Guillaume et Nicolas de Wespin, dits Tabaguet et Tabaghetti, sculpteurs dinantais, in Annales de la Société Royale d’Archéologie de Bruxelles, 29, 1920, p. 97-135 et 31, 1923, p. 5-22. 30. Ferdinand COURTOY, Les arts industriels à Dinant au début du dix-septième siècle, in Annales de la Société archéologique de Namur, 34, 1920, p. 217-235. 240
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
de carrière de cette famille étaient manifestement au cœur d’un réseau d’échanges de la pierre dont les ramifications restent à préciser, mais qui dépassent certainement le bassin mosan, de la Lorraine aux Pays-Bas. Dans les années 1560, on trouve par exemple Guillaume I († ca 1577-1579) comme fournisseur de marbre de l’architecte du Louvre de François Ier, Pierre Lescot, duquel il touchera près de trois mille livres31. Guillaume II († 1643) poursuivra l’entreprise familiale et saura s’associer avec des partenaires importants, par exemple les Thonon. Plusieurs des Tabaguet partirent en Italie, deux d’entre eux y restèrent et y firent souche. Ainsi, une déclaration judiciaire nous apprend que maltraités et chassés par leur père Guillaume I, Jean et Nicolas partirent de Dinant, le premier s’en alla en 1587 et le second le rejoindra en 1597, après avoir passé deux ans d’apprentissage à Anvers, auprès du sculpteur Van Blocke32. Sans doute est-ce le premier que l’on retrouve à Aix-en Provence, dans les années 1590, associé au sculpteur de Douai Élie de Lille, pour la réalisation du cénotaphe d’Hubert de Vins destiné à la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence33. Il n’en subsiste que des fragments, dont un captif enchaîné au pied d’un trophée d’armes. L’activité de Jean Tabaguet († 1615) dans les pré-Alpes italiennes s’étend sur une vingtaine d’années au moins34. Avec son frère Nicolas, ils participèrent à l’installation du « système » des Sacri Monti, ensemble constitué de chapelles contenant des reconstitutions en grandeur nature des scènes bibliques, principalement des scènes de la Passion, formant une véritable barrière catholique contre la pression protestante toute proche35. La présence de Jean Tabaguet est attestée à Varallo dès 1585, ce qui confirme qu’il fit des allers et retours avant de quitter définitivement Dinant. Au Sacro Monte de Varallo, il réalise notamment les sculptures d’Adam et Eve dans la scène du Péché originel au Paradis (1595-1599) (fig. 9), puis celles de la Tentation du Christ au désert (1599) et contribue avec d’autres sculpteurs au vaste ensemble du Massacre des Innocents. On l’y retrouve encore pour les nombreuses sculptures de la Montée au Calvaire, avec le très beau groupe de la rencontre entre Véronique et le Christ (1599-1602) (fig. 10). Le style de Jean Tabaguet dans ces œuvres porte la marque d’influences italiennes, notamment celle Andrea Sansovino. À Crea, il contribue à la réalisation des figures de la XXIe chapelle consacrée au Couronnement de la Vierge (avant 1604). Quant à Nicolas Tabaguet, son nom est cité à Varallo dès 1599 pour la Montée au Calvaire et à Crea pour diverses chapelles, dont le Mariage de la Vierge et les Noces de Cana36. Comme son frère, sous la direction duquel il semble avoir toujours travaillé, il épousera une Italienne, en 1604. Guillaume II, resté à Dinant, continua l’entreprise familiale et en élargit les activités. Par exemple, il fit commerce de meules de moulin venues de Bretagne, échangea du marbre noir ou jaspé contre de l’albâtre et entreprit la construction de mobilier liturgique pour lequel il s’associait à d’autres artisans37. L’un de ses plus importants chantiers fut celui du jubé de l’église abbatiale de Saint-Omer où il travailla avec le sculpteur valenciennois Adam Lottman (1619)38. C’est dans le contrat qui lie les deux hommes à l’abbé Guillaume Loemel qu’est mentionné un autre chantier de Guillaume II Tabaguet, le retable d’autel du noviciat des Jésuites de Tournai.
31. J.-J. GUIFFREY, Les comptes des bâtiments du Roi (1528-1571) suivis de documents inédits sur les châteaux royaux et les beaux-arts au XVIe siècle, Paris, 1877-1880, 2, p. 44 et 139. 32. Ferdinand COURTOY, Les arts industriels à Dinant au début du dix-septième siècle, in Annales de la Société archéologique de Namur, 34, 1920, p. 220-221. L’auteur y publie de larges extraits de plusieurs pièces d’archives essentielles pour la prosopographie de ces artistes, mais bien d’autres restent à découvrir. Aucun Tabaguet ni Wespin n’apparaissent dans les archives des Liggeren éditées par Ph. Rombouts et Th. Van Lerius. 33. J. BOYER, Peintres et sculpteurs flamands à Aix-en-Provence aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, in Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, 26, 1957, p. 66. 34. Silvano COLOMBO, Giovanni Wespin detto il Tabacchetti, in Luigi ZANZI et Paolo Z ANZI, Atlante dei Sacri Monti prealpini, Milan, 2002, p. 124. 35. Voir e.a. Luigi ZANZI, Il « sistema » dei Sacri Monti prealpini, in Luigi ZANZI et Paolo ZANZI, Atlante dei Sacri Monti prealpini, Milan, 2002, p. 17-71. 36. Francesco NEGRI, Santuario di Crea. Arte storia nel Monferrato, Villanova Monferrato, 1902, p. 80-84. 37. Parmi les réalisations encore peu connues de Guillaume II, notons la fontaine ducale de Charleville réalisée en 1616 à la demande du duc Charles de Gonzague. Cf. Alain SARTELET, Charleville au temps des Gonzague, s.l., 1997. 38. Henri DE LAPLANE, Jubé de l’église abbatiale de Saint-Bertin. Devis passé en 1619 par Guillaume Loemel, 72e abbé, in Bulletin des antiquaires de la Morinie, 3, 1861-1866, p. 330. 241
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 10 : Jean Tabaguet, la Montée au Calvaire (1599-1602), Sacro Monte de Varallo (Italie).
La dynastie des Tabaguet, maîtres de carrière et marchands, se perpétua au moins jusqu’à la fin du XVIIe siècle puisque Philippe-Georges Tabaguet sera l’entrepreneur du maître-autel en marbre de la collégiale de Dinant à partir de 168539. C’est Arnold Hontoire qui réalisera les projets des trois figures du couronnement et Cornelis Vander Veken qui en achèvera les sculptures. Les Thonon C’est à Ferdinand Courtoy que revient le mérite d’avoir dressé la biographie la plus complète de deux sculpteurs dinantais homonymes : Jean Thonon 40. On ne connaît ni la date de naissance, ni celle du décès du premier d’entre eux. Qui est le Jean Tonon qui devient bourgeois d’Anvers le 20 octobre 157041 ? Comment expliquer les raisons de ce séjour anversois d’un sculpteur dinantais ? On songe évidemment à une éventuelle période d’apprentissage du sculpteur, mais lequel, du père ou du fils42 ? Sachant qu’un Jean Thonon aura un fils homonyme en 1610, ne serait-il pas raisonnable d’envisager qu’il y eut trois générations de sculpteurs homonymes plutôt que deux comme on l’a fait jusqu’ici ? Nous proposons donc de voir dans le bourgeois d’Anvers Jean I. Le premier Jean Thonon envisagé par Courtoy serait le second 39. Ce maître-autel a été transporté à l’église paroissiale de Maaseik en 1867. Cf. notre thèse : La sculpture baroque liégeoise, Louvain-la-Neuve, 1998, . II-6.1. Arnold Hontoire, p. 93-95. 40. Ferdinand COURTOY, Les arts industriels à Dinant au début du dix-septième siècle, in Annales de la Société archéologique de Namur, 34, 1920, p. 239-241 ; Ferdinand Courtoy, Thonon (Jean), in Biographie nationale, 25, 1930-1932, col. 119-120 ; Ferdinand COURTOY, Thonon (Jean), in Biographie nationale, 25, 1930-1932, col. 120-121 ; Jean YERNAUX, Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 151-155 ; Pierre COLMAN, Jean Thonon, in La sculpture au siècle de Rubens dans les Pays-Bas méridionaux et la principauté de Liège, Bruxelles, 1977, p. 186-187. 41. E. BUCHIN, Les Poortersboeken anversois au service de l’histoire liégeoise, in Annuaire de la Commission communale de l’Histoire de l’Ancien Pays de Liége, 3, (1932-1934), 1937, p. 162. 42. S’agit-il d’un séjour de formation ? Le sculpteur y aurait-il travaillé ? C’est en 1570 que débute le chantier du jubé de la cathédrale de Tournai. L’analyse des sculptures montre à l’évidence que plusieurs mains ont dû travailler dans l’atelier du célèbre Corneille Floris, mais une analyse fouillée des œuvres de cet atelier n’a toujours pas été proposée. 242
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
(Jean II) et le troisième, né à Dinant le 11 juillet 1610 qui s’installera dans la paroisse Sainte-Véronique de Liège où il décèdera le 18 octobre 1673, sera prénommé ici Jean III43. On donna comme parrain à Jean III Thonon Guillaume Tabaguet, ce qui atteste des liens étroits entre les deux familles dinantaises. Jules Helbig confondait les deux artistes homonymes (II et III), ce qui entraîna diverses erreurs d’appréciations44. Au cours de ses recherches aux archives de l’État à Namur, Ferdinand Courtoy avait exhumé une pièce capitale qui n’a pourtant pas encore été appréciée jusqu’ici à sa véritable valeur. Il s’agit d’une convention établie le 23 mai 1615 entre Jean Thonon II et un marchand de Delft, Jacques Matheus45. Le sculpteur s’y engageait à tailler 12 figures de deux pieds et demi et à les poser à Bois-le-Duc tandis, que Matheus devait fournir l’albâtre qu’il livrera à Bois-le-Duc. Les dimensions et le nombre d’« Ymages et figures » n’y semblent pas encore tout à fait fixés, car le contrat prévoit une possibilité de changement, mais en tous cas la commande ira à Thonon. Ferdinand Courtoy qui ne disposait pas de la documentation dont nous bénéficions aujourd’hui n’avait pas fait le lien entre le contrat qu’il avait exhumé des archives et les sculptures du jubé d’Hertogenbosch. Or, la date du contrat et l’analyse stylistique des statues de l’ancien jubé de Bois-le-Duc, actuellement au Victoria & Albert Museum de Londres, nous permettent maintenant de les attribuer à Thonon46. On le verra avec l’analyse des œuvres, ce chantier prestigieux et abondant en sculptures servira de référence à d’autres productions de l’atelier Thonon. Le jour du contrat passé avec Thonon, le même Matheus passait un autre contrat avec Guillaume Tabaguet marchand et entrepreneur de Dinant, et par ailleurs, parrain de Jean Thonon III47. La transaction est très importante puisqu’elle engage à long terme les deux hommes sur la fourniture réciproque de matériaux pierreux48. Le Dinantais fournira de la pierre jaspée, c’est-à-dire du marbre rouge de SaintRemy et d’Agimont. Le prix de vente sera le même que celui fixé pour Pierre Cosme de Neurenberg et Thierry Bidart. En retour, le Delftois fournira à Tabaguet de l’albâtre. Ces deux autres marchands de pierre qui apparaissent en référence dans le contrat ne sont pas des inconnus, surtout le premier qui appartient à l’importante famille des marchands de pierre et entrepreneurs en construction, les Neurenberg, très actifs sur les marchés des régions du Bas-Rhin et de la Meuse49. Le second appartient également à une famille de négociants en pierres, moins connue et dont l’histoire reste à écrire50. Dans la même perspective de recherches, il y aurait lieu également de s’intéresser à un certain Philibert Thornon qui s’associe en 1599 avec Guillaume Tabaguet afin de financer l’exploitation de deux carrières de marbre, la sienne et celle des Croisiers51.
43. Si l’on en reste à la proposition de Courtoy de considérer seulement deux sculpteurs homonymes, cela signifierait que le bourgeois d’Anvers aurait eu environ 60 ans avant d’avoir son fils Jean. Ce n’est évidemment pas impossible, mais la durée des activités de ce sculpteur, certainement au-delà des années 1630, rendent néanmoins très improbable cette conception de la situation. C’est pourquoi nous optons pour l’hypothèse de trois générations de sculpteurs homonymes. 44. Jules HELBIG, La sculpture et les arts plastiques au pays de Liège et sur les bords de la Meuse [2e éd.], Bruges, 1890, p. 160161. Edmond Marchal commet la même erreur puisqu’il reprend ses informations à Helbig : La sculpture et les chefs-d’œuvre de l’orfèvrerie belges, Bruxelles, 1895, p. 397-399. 45. Le contrat est retranscrit intégralement dans Ferdinand COURTOY, Les arts industriels à Dinant au début du dix-septième siècle, in Annales de la Société archéologique de Namur, 34, 1920, p. 240. 46. Courtoy avait bien fait le lien entre la date du contrat et le jubé de Bois-le-Duc, mais il ne disposait pas des critères stylistiques pour pouvoir lui attribuer les sculptures. 47. Ce contrat a été publié par Ferdinand Courtoy, Les arts industriels à Dinant au début du dix-septième siècle, in Annales de la Société archéologique de Namur, 34, 1920, p. 226-227. Le marchand hollandais signe Jacop Mattyis van Wang ; il s’agit de Jacques Matthijsz. Ce Tabaguet appartient à la famille des Tabaguet-Wespin dont sont issus au moins deux sculpteurs. 48. Puisqu’il est maintenant établi que Thonon se chargea de la réalisation de la majorité des sculptures du jubé, cela pourrait changer les perspectives de fourniture des marbres pour la construction du meuble liturgique. Ne serait-ce pas Jacques Mattijsz (Jacob Mathijssen van Wenen) plutôt que Coenraad IV Van Neurenberg qui aurait livré la matière première à Hertogenbosch ? Grâce à l’accord de fourniture auprès de Tabaguet, Mathijssen aurait en effet été en mesure de pourvoir le chantier. 49. Pierre Cosme intervenant ici est Coenraad IV van Neurenberg. Sur le réseau commercial mis en place par cette famille, on consultera avec profit : Gabri VAN TUSSENBROEK, The architectural network of the Van Neurenberg Family in the Low Countries (1480-1640), Turnhout, 2006. 50. Ferdinand Courtoy avait déjà glané quelques textes d’archives qui pourraient utilement servir à une recherche plus ample sur le commerce de la pierre à Dinant. Thierry Bidart et Coenraad IV van Neurenberg sont probablement apparentés car le père de ce dernier avait épousé Marie le Bidart. 51. Archives de l’État à Namur, Notaire Delahaye, 3 octobre 1599, f° 19 v°, retranscrit dans Archives de l’État à Namur, Fonds Ferdinand Courtoy, 1161, Gorin (L.) et Tabaguet (G. de Wespin (métiers d'art dinantais, 16e-17e. Liasse de documents sur Tabaguet (notes publiées dans mes Metiers d'art de Dinant). 243
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Une seconde pièce d’archives donne à mieux connaître la production de Jean Thonon I ; il s’agit du contrat passé le 16 avril 1629 entre les chanoinesses de Nivelles et le sculpteur. Ce dernier s’engageait à y ériger une « table d’autel pour le grand autel madame Sainte-Gertrude » pour la somme de 800 florins et 50 florins de vin52. Ce retable du maître-autel fut modifié à plusieurs reprises, avant d’être démonté et en partie détruit, mais il en subsiste des fragments significatifs. En 1635, Jean Thonon maître sculpteur à Dinant s’engage à réaliser six chapiteaux ioniques et diverses autres sculptures pour le nouveau jubé érigé dans l’église abbatiale de Floreffe, sur les plans du sculpteur Valenciennois Pierre Schleiff53. Il devait s’agir d’une commande importante dont il semble que presque tout ait été anéanti. En 1641, Jean Thonon II bourgeois de Dinant et maître sculpteur de la même ville s’engageait à construire un nouveau jubé pour l’abbaye de Florennes. Le contrat est conservé, mais le jubé détruit54. Plusieurs mentions d’archives attestent de l’activité des Thonon à Liège sans qu’il soit toujours possible de distinguer si l’on nomme le père ou le fils. Ce qui est probable, c’est que Jean Thonon III ira se fixer à Liège dans les années 1630, peut-être déjà en 1637, car comme l’ont suggéré plusieurs auteurs, le 23 juillet de cette année un Jean Thonon fit relief du métier des orfèvres55. En tous cas, le 16 décembre 1643, un Jean Thonon, qualifié de tailleur d’image et bourgeois de Liège, prend en location une maison enseignée du Grand Cerf, en Potiérue, auprès des frères Bailly. L’inventaire du mobilier dressé à l’occasion de la rédaction du bail permet d’exclure la possibilité d’un atelier56. Tel n’est pas le cas près de trente ans plus tard, le 21 septembre 1671, alors que Jean Thonon III s’installe dans l’Islea des Fèvres, dans une maison qu’il avait prise en location auprès d’André Henrion. Il y séjourna jusqu’à son décès, survenu deux ans plus tard, le 18 octobre 167357. Le sculpteur avait épousé Agnès Rampenne58. Le déménagement de Jean Thonon III, de Dinant à Liège, pose diverses questions : Père et fils ont-ils continué à travailler ensemble ou y a-t-il eu séparation des activités ? L’ensemble de l’atelier aurait-il déménagé à Liège ? Dans l’état actuel des connaissances, et comme il est à peu près certain que les deux et probablement les trois sculpteurs ont œuvré ensemble sur plusieurs chantiers, il est préférable d’utiliser l’appellation atelier Thonon pour en désigner les auteurs.
52. Le contrat original n’avait pas été retrouvé par Marie-Louise Fichefet à l’occasion de son mémoire à l’UCL : Aspects et décoration de la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles au XVIIIe siècle, Louvain, 1959, p. 59-61 ; les extraits utilisés ici ont été publiés par Jules TARLIER et Alphonse WAUTERS, La Belgique ancienne et moderne : géographie et histoire des communes belges. Province de Brabant. Arrondissement de Nivelles, Bruxelles, 1859 [éd. anastatique de 1963], p. 123. Les 800 florins avaient été légués par l’abbesse M. De Haynin à cette intention. 53. Archives de l’État à Namur, Commune, ancien régime, 584. Cahier : archives communales de Dinant I. Travail fait à Dinant par Jules Borgnet (?) vers 1872, f° 22 r° : Divers fragments de dossier retrouvés par Mr Remacle : « 17 mars 1635, contrat entre Pierre Schleiff maître tailleur d’images à Valencienne et Mr Jean Thonon maître sculpteur à Dinant au sujet de l’enrichissement de pierre blanche de Verdun pour servir au doxal qui se doit poser en l’église de l’abbaye de Floreffe sur le modèle mis en main de Thonon par Schleiff, Thonon doit faire six chapiteaux ioniques, le remplissement de l’archure (?) de la porte du milieu, les coins des deux histoires du costé de la cuirasse avec figures entaillée en pierre de Verdun qui seront le couronnement d’ung escritteau qui serat dans ung nys au dessus de la porte - pour 225 patagons ». 54. L’acte passé chez le notaire de Frahan à Dinant avait été signalé à Ferdinand Courtoy par J. Bovesse (Fonds Ferdinand Courtoy, 1145, Sculpteurs M-W). 55. Jacques BREUER, Les orfèvres au pays de Liège, n° 1386 ; Jean YERNAUX, Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 152. 56. L’inventaire est retranscrit dans Jean YERNAUX, Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 152. 57. Jean YERNAUX, Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 153. 58. Jean YERNAUX dans sa Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 153, écrit Jeanne Rampenne ; N. Rouche mentionne à la place une Agnès Rampenne (Huy, Registres Paroissiaux, 14, f° 112 v°, cité dans Mécénat du prévôt E. d’Oultremont, portes peu connues de la collégiale de Huy et autres monuments, in Chronique archéologique du Pays de Liège, 55, 1964, p. 88). C’est bien Agnès Rampenne qui apparaît dans les archives à deux reprises au moins : Archives de l’État à Liège, Liège, Notaire Lesuysse P., « 29 janvier 1670, Jean Thonon sculpteur, mari moderne de Agnès Rompenne rachètent au moyen de 36 fl. bb les cens et rentes de l’usufruit et de propriété des parents de Agnès Rompenne au profit et faveur de Jacques de Hasgine… » ; Archives de l’État à Liège, Liège, Notaire Lesuysse P., 20 janvier 1670, « Jean Thonon sculpteur et son épouse Agnès Rompenne renoncent aux cens et rentes héritées de Jean Stevenin premier mari de Agnès Rampenne », p. 327. Laurence Druez, archiviste à Liège, a bien voulu effectuer la vérification pour nous dans les archives paroissiales de Huy : le mariage de Jean Thonon et d’Agnès Rampenne a été célébré en la paroisse Saint-Denis de Huy, le 21 janvier 1659. Qu’elle en soit ici remerciée. 244
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Hamal attribue à Thonon divers travaux perdus à la cathédrale de Liège. Il y a tout d’abord « les sculptures en bois du jubé avec les anges qui jouent divers instruments » que le chanoine dit avoir vues réalisées en 1640, sans doute sur base d’une date qui devait figurer à proximité de l’ensemble59. Il y a aussi, les figures de la Vierge et des quatre évangélistes à la chaire de vérité, que le chanoine date du XVIe siècle60. D’autres travaux perdus des Thonon sont encore connus par les archives. Ainsi, le 18 janvier 1658, Jean Thonon s’engageait devant notaire à réaliser en marbre un projet dessiné, présenté par Émile d’Oultremont, baron de Ham et chanoine de la cathédrale de Liège. Ce travail, qui devait rapporter six cents florins au sculpteur, comprenait des colonnes de marbre, mais sa forme précise et sa destination restent énigmatiques61. Un autre contrat rédigé durant l’année 1640 nous fait connaître un Hendrick Thonon, tailleur de pierres, probablement un second fils de Jean Thonon II62. Celui-ci s’engageait à fournir les pierres taillées d’un portail armorié pour l’église des frères Mineurs de Liège63. La façade a été complètement reconstruite, en 1865-1867, presque à l’identique nous dit Gobert64. La restauration n’a cependant pas renouvelé les cartouches et les armoiries sommant la porte principale indiqués dans le contrat. Les travaux devaient être achevés pour le jour de la saint Michel de l’année suivante. Le chronogramme que l’on peut voir actuellement au-dessus de la porte principale livre la date de 164565. Le contrat est signé en présence du peintre Gérard Douffet et du sculpteur et architecte Léonard de Froidmont, peut-être l’auteur du projet66. Le style de cette façade, pour autant qu’on puisse en juger d’après la restitution du XIXe siècle, n’a encore rien de baroque, il prolonge une certaine forme de maniérisme très atténué. Du couple Hendrick Thonon et Marguerite Dorlot naîtra au moins un fils, Alexandre, qui deviendra charpentier en 167967. La lignée semble se poursuivre dans cette filière professionnelle, mais un Lambert Thonon qualifié d’« entretailleur de pierres » a encore été retrouvé par Yernaux dans les archives du métier des merciers duquel il relève le 17 avril 163368. Enfin, un sculpteur prénommé Joseph exercera ses médiocres talents à l’église de Leffe, en 168269. Les de Froidmont Un sculpteur et architecte Léonard de Froidmont fut actif au Pays de Liège au début du XVIIe siècle. Jean Yernaux a pu reconstituer une partie de son activité qui semble avoir été importante70. Le 19 novembre
59. Henri Hamal, Notice sur les objets d’art, avec le nom des auteurs, qui se trouvaient dans les églises de la ville de liège en 1786, in René Lesuisse, Tableaux et sculptures des églises, chapelles, couvents et hôpitaux de la ville de Liège avant la Révolution. Mémento inédit d’un contemporain, Liège, 1956, p. 29. 60. Idem, p. 39. 61. Le contrat a été publié dans : Jean YERNAUX, Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 179-180. N. Rouche propose d’y voir un portail pour la collégiale de Huy dont E. d’Oultremont était prévôt (Mécénat du prévôt E. d’Oultremont, portes peu connues de la collégiale de Huy et autres monuments, in Chronique archéologique du Pays de Liège, 55, 1964, p. 88. 62. Avis déjà émis par Yernaux, Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 154. 63. Le contrat a été publié dans : Jean YERNAUX, Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 173-174. 64. Théodore Gobert, Liège à travers les âges. Les rues de Liège, 8, Bruxelles, 1977, p. 245 : À un certain nombre de détails près, la façade est conçue sur un plan identique à celle du XVIIe siècle, en style renaissance. 65. ChrIsto LIberatorI aVgVstæ CœLorVM RegInæ PatrIarChe FranCIsCo et AntonIo PataVIno PII EbVrones VoVebant. 66. C’est en tous cas l’avis de Yernaux, Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 154. 67. Jean YERNAUX, Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 154. 68. Jean YERNAUX, Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 154. 69. Deux bustes reliquaires et un groupe du martyre de saint Erasme en bois lui sont en effet attribués dans la base de données de l’Institut royal du patrimoine artistique. 70. Jean YERNAUX, Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 155-161, 172-173, 175-179. 245
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
1612, Léonard de Froidmont passait une convention avec les moines de Stavelot pour la réalisation de stalles et de deux statues représentant saint Remacle et la Vierge. Cet important chantier suivit celui du jubé dont un résumé du contrat (1607) nous indique qu’il fut érigé en marbre et jaspe pour la somme de 4000 florins. Les noms des maîtres de l’ouvrage ne sont pas cités, mais Yernaux pense qu’il pourrait s’agir de Léonard de Froidmont et d’Amel Huppe associés dans la convention relative aux stalles et aux statues du chœur. C’est sans doute conclure un peu vite, car il n’est pas attesté que ces artistes travaillaient la pierre. Léonard de Froidmont eut au moins trois enfants dont un fils homonyme, également sculpteur. En 1633, celui-ci prend une maison en location rue Lulay des Fèvres. Est-ce bien lui, comme le croit Yernaux, qui exécuta le retable d’autel de la chapelle Notre-Dame à Villers-l’Évêque, en 163271 ? Léonard de Froidmont et Nicolas Savary, qualifiés de « scriniers », passèrent contrat en 1635 avec le curé et les mambours de l’église Saint-Martin-en-Ile pour un ensemble mobilier, probablement un retable, que devait peindre Henri Trippet. Un autre membre de la famille, également sculpteur, apparaît dans les archives en 1639 : Gilles de Froidmont. Un coin du voile sur les activités d’architecte de Léonard de Froidmont a été soulevé par Yernaux grâce à quelques pièces d’archives, mais à part la reconstruction et l’aménagement de l’église Saint-Remy à Liège (1656), l’objet des autres travaux reste confus. Les Huppe Amel (alias Aurèle) Huppe a déjà été mentionné plus haut comme travaillant avec Léonard de Froidmont à l’abbatiale de Stavelot. Il était le fils d’un certain Mélotte Huppe qualifié de maître alors que son fils relève le métier des merciers, le 25 juillet 162372. Amel Huppe devait épouser Marie de Vigne dont il eut deux filles baptisées à Notre-Dame-aux-Fonts, en 1623 et 1624. Son confrère et parent Gilles Huppe habitait dans la paroisse Saint-Adalbert en 1610 avec sa femme Isabeau de Rocour. En 1617-1618, il œuvre avec son frère Nicolas, peintre, à Dordrecht73. Aurèle Huppe fut employé par la cathédrale de Liège de 1632 à 1644 ; il est notamment payé pour des sculptures du nouveau jubé de l’ancien chœur (1642), pour des travaux aux stalles du chœur (1644) et à l’autel majeur de la chapelle et de la sacristie (1644)74. Les Le Pieme Parmi les Le Pieme identifiés par Jean Yernaux, le premier qui nous intéresse ici fut le gendre du sculpteur et maître de carrières Henri Borset I75. On peut suivre Yernaux lorsqu’il déduit que ce Martin Le Pieme fut sculpteur. Son petit fils, homonyme et sculpteur, devait épouser, au début du XVIIe siècle, Marie de Bliche, fille de Guillaume. Martin Le Pieme a réalisé le monument funéraire de Balthasar de Pallant et de son épouse, Marguerite de Millendonck, actuellement à Reuland (1624). Les de Bonne-Espérance Bien que cité par Abry avec Thonon et Del Cour76, c’est à Jean Yernaux que revient le mérite d’avoir exhumé Gérard de Bonne-Espérance de l’oubli en publiant quelques pièces d’archives impliquant ce sculpteur77. Les papiers Moret contiennent également quelques notes utiles sur cette famille de sculp71. Cf. Yernaux, op. cit., p. 157 et E. Fréson, Le peintre Jean de Fraipont, in Leodium, 1934, p. 59. 72. Jean YERNAUX, Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 161-162. 73. Marguerite DEVIGNE, La sculpture wallonne, in Les Arts en Wallonie. Cahier du Nord, p. 221-252. 74. Archives de l’Évêché de Liège, Cathédrale Saint-Lambert, Dépenses de la Fabrique, B II 19 à B II 22 (communication de madame E. Gaspar). 75. Jean YERNAUX, Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 147-151. 76. Louis ABRY, Les hommes illustres de la nation liégeoise [éd. par H. Helbig et S. Bormans], Liège, 1867, p. 300. 77. Jean YERNAUX, Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 176-177. 246
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
teurs78. En 1639, Gérard de Bonne-Espérance, appuyé par le témoignage d’autres sculpteurs, atteste les coutumes suivies dans la réalisation des retables d’autels, ce qui prouve à l’évidence ses compétences en ce domaine. En 1650, il livre à l’église Saint-Remy de Liège deux statues des saints Pierre et Paul et des pierres sculptées à placer au chœur79. Arguant du patronyme, Yernaux a suggéré une origine hennuyère du grand-père du sculpteur, Godefroid, qualifié de « scrinier », ce qui signifie qu’il travaillait le bois. Le père de notre sculpteur s’appelait également Godefroid, il était sculpteur comme l’atteste un reçu autographe à propos de travaux réalisés pour le baron Érasme de Surlet en 167580. Gérard de BonneEspérance épousa vers 1630 une Marie Roumenair dont l’origine n’est pas établie. Trois filles naquirent du couple, entre 1631 et 1639. Moret avait montré que l’une des filles de Gérard, Marguerite, avait épousé le sculpteur Arnould Lespinne, natif de Paris et qui releva le métier le 20 mars 1674. Plusieurs pièces d’archives encore retrouvées par Yernaux concernent les activités politiques de Gérard. Celui-ci s’était en effet fortement impliqué dans les luttes entre Grignoux et Chiroux, lors de l’élection des bourgmestres François de Liverloz et Charles de Méan, en 1646. Ces documents ne livrent qu’incidemment des informations sur les activités professionnelles du sculpteur. On apprend ainsi qu’il a travaillé à diverses reprises pour l’abbaye de Beaurepart dans les années 1640-1650, et à partir de 1648, pour le prieuré de SaintLéonard et pour l’église des Onze Mille Vierges à Liège. Un certain Jean de Bonne-Espérance, peut-être frère de Gérard, est qualifié « d’entretailleur de bois » dans un acte de location d’une maison, à Liège, en 1640. Il avait relevé le métier des sculpteurs le 24 janvier 162681.
Fig. 11 : Mise au Tombeau du Christ, 1ère m. XVIIe s. Pierre polychromée et marbres. Saint-Hubert, église abbatiale. © Michel Lefftz.
78. Archives de l’évêché de Liège, Fonds Moret (boîte D I). 79. Jean YERNAUX, Contribution à l’histoire de la sculpture mosane, in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 160, 162. 80. Archives de l’État à Liège, Château de Lexhy, 179, Comptes et quittances, quittance de Godefroid Bonne Espérance sculpteur demeurant à Herstal, le 18 mars 1675. 81. Archives de l’évêché de Liège, Fonds Moret (boîte D I). 247
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Aucune sculpture de cette famille d’artistes n’a pu être identifiée à ce jour alors qu’il existe de nombreuses sculptures de cette époque qui ne sont pas encore attribuées. Ainsi, pour les années d’activité des Bonne-Espérance, on mentionnera tout particulièrement deux groupes sculptés en ronde-bosse de la Mise au Tombeau82. L’un se trouve à l’église abbatiale de Saint-Hubert (fig. 11), il a certainement été réalisé sous l’abbatiat de Nicolas de Fanson (1611-1652) ; l’autre provient des Sépulcrines de Huy et est à présent à la collégiale de la même ville, il est daté par une inscription dédicatoire de 1640 (fig. 12)83. Si conjecturalement il serait envisageable de proposer d’attribuer ces deux beaux ensembles à l’atelier des Bonne-Espérance, aucun argument solide ne permet jusqu’ici d’étayer une telle hypothèse.
LES ŒUVRES Pas plus que pour les notices sur les artistes, nous n’avons l’ambition de traiter de l’ensemble des œuvres appartenant à la période concernée, nous nous efforcerons seulement de mettre en place des jalons qui serviront utilement à des recherches futures. La production d’artistes contemporains de Lambert Lombard ne sera pas envisagée, mais plutôt celle des générations suivantes. Ainsi, malgré de nouvelles découvertes, l’abondant catalogue des œuvres du maître du retable de Saint-Pierre-lez-Libramont et des stalles de Nivelles sera écarté84. Henri Borset Jusqu’ici, il semble que l’on n’ait pas encore pu identifier le moindre vestige du maître-autel qu’Henri Borset réalisa pour la cathédrale de Nevers. Fort heureusement, une photographie ancienne, un dessin et un relevé de 1868, gardent la mémoire de cette importante réalisation (fig. 13)85. Des similitudes dans la composition architecturale avec le cénotaphe d’Hadelin de Royer à la collégiale de Huy sont à noter, mais la date donnée par l’inscription dédicatoire ne permet pas de le lui attribuer. Thomas Tollet
Fig. 13 : Relevé de l’ancien maître-autel de la cathédrale de Nevers par A. Bouveault, 1868 (d’après Jacques PALET, Cathédrale de Nevers à travers le passé(...), Nevers, 1932).
A priori, le sculpteur Thomas Tollet, gendre de Lambert Lombard, aurait pu constituer un intéressant fil conducteur dans la période qui nous intéresse ici puisque sa carrière s’y inscrit parfaitement. Tout espoir reste pourtant jusqu’ici déçu,
82. Nous avions déjà proposé ce rapprochement des deux groupes et une attribution commune dans : Styles, in L’ancienne église abbatiale de Saint-Hubert (collection Études et documents, Monuments et sites, nº 7), Namur, 2001, p. 118-119. 83. Sur le monument d’Hadelin de Royer à Huy, cf. Henri DEMARET , La collégiale Notre-Dame à Huy, notes et documents, troisième partie (ameublement artistique, trésor et archives), Huy, 1924, p. 47-48 ; On trouvera la bibliographie récente dans : Hadrien KOCKEROLS, Monuments funéraires en pays mosan. Arrondissement de Huy, Malonne, 1999, p. 202. 84. Une première approche de cette abondante production avait fait l’objet d’une communication à Mons en 2008 : Un atelier de sculpture maniériste original et inédit : aspects d’une Renaissance mosane de la seconde moitié du XVIe siècle. Conférence au colloque La sculpture de la Renaissance des anciens Pays-Bas à l’époque de Jacques Du Broeucq (ca 1505-1584) (Mons, 7-9 mars 2008). On en trouvera une évocation partielle dans notre contribution : Ligier Richier et la sculpture mosane de Dinant à Liège, in N. CAZIN & M.-A. SONRIER (dir.), Ligier Richier. Un sculpteur lorrain de la Renaissance, Actes du colloque de Saint-Mihiel (4-7 octobre 2007), Nancy, 2008, p. 233-243. 248
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
car la quasi-totalité de ses œuvres est perdue ou détruite. Outre l’attribution hypothétique de cinq bas-reliefs en albâtre de la collégiale Notre-Dame à Tongres (fig. 1 à 5), seuls deux fragments de monuments funéraires constituent le maigre catalogue des œuvres attribuées avec quelques certitudes à ce sculpteur. On proposera d’y ajouter, sur base du style et avec la prudence qui convient, trois belles statues en albâtre de la collégiale de Huy (fig. 1618).
Fig. 14 : Thomas Tollet. Tête du monument funéraire de Louis duc de Gonzague, ca 1580-1591. Marbre. © Michel Lefftz.
Des importantes commandes du duc de Nevers, seuFig. 16 : Thomas Tollet (?). les subsistent la tête très usée de Louis duc de GonLe Bon Pasteur, fin XVIe s. ? zague et la plaque dédicatoire de son monument Albâtre. Huy, collégiale Notre-Dame. funéraire, érigé dans la cathédrale de Nevers jusqu’à © Michel Lefftz. la Révolution (fig. 14)86. Le second fragment conservé de l’œuvre certifiée de Thomas Tollet est l’effigie en bas-relief d’Antoine de Carondelet (ca 1583-1587 ?). Ce dernier est représenté agenouillé dans une niche ornée (fig. 15)87. Les fragments supposés de ce monument ont été réassemblés et insérés dans un mur de la collégiale Sainte-Waudru à Mons. Mais la niche semble fort petite pour y inscrire la figure du défunt et son saint protecteur. On n’y distingue pas non plus la trace de fixation du crucifix qui 85. Ces documents sont reproduits dans Jacques PALET, Cathédrale de Nevers à travers le passé, second fascicule, le chœur, première partie, Nevers, 1932. Je tiens particulièrement à remercier Pierre-Yves Kairis de m’avoir signalé cette étude. La photographie de 1867-1871 se trouve en planche II, les relevés et dessins en planche VIII. 86. Ces fragments ont été recueillis par le musée de la ville de Nevers. Je tiens à remercier très chaleureusement la Conservatrice des musées de Nevers, madame Françoise Reginster pour avoir effectué des recherches à ce sujet en 2007, et aussi pour l’envoi de photographies de travail de ces deux fragments. 87. Ce monument avait déjà été attribué par l’abbé Moret : Henri de Borset et Thomas Tollet, sculpteurs liégeois du XVIe siècle. Leurs travaux dans la cathédrale de Nevers, in Bulletin de l’Institut Archéologique liégeois, 48, 1923, p. 128-133. 249
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
devait se trouver devant les yeux d’Antoine de Carondelet. Quant à l’inscription, elle est illisible. Malheureusement, comme ces vestiges très sales sont placés fort haut, ils ne permettent pas de se faire une idée définitive sur la cohérence de l’ensemble88. Par ailleurs, le style de la figure du défunt et plus encore celui de son saint patron ne sont pas sans rappeler celui des trois grandes statues en albâtre de la collégiale de Huy, sans doute les seuls vestiges d’un vaste ensemble mobilier. Le Bon Pasteur, sainte Catherine et saint Domitien (?) présentent une belle facture caractérisée par une solide stature résultant en grande partie du traitement des draperies parcourues de puissants plis en pince à becs dont les extrémités tombent au sol et s’enroulent sous des effets de torsion puissants et expressifs. Cette similitude nous invite à proposer, sous réserve, l’attribution de ces œuvres à Thomas Tollet (fig. 16, 17, 18). Les Fiacre À ce jour, une seule œuvre est attribuable avec certitude à Martin Fiacre (†1601), il s’agit du monument dit de Réginard (1604), conservé aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire89 (fig. 19). Ainsi que nous l’avons déjà mentionné ailleurs90, cette dalle sculptée tout comme celle de l’abbé Jean de Coronmeuse (†1526)91 furent emportées à la Révolution pour les envoyer à Paris92. Elles échouèrent alors à Charleville où elles devaient rester durant une bonne partie du XIXe siècle. La dalle de Jean de Coronmeuse finit par arriver au Louvre vers 1884, tandis que le monument dit de Réginard parvint aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire en 1913. Jean-Simon Renier puis Destrée et Brassinne mirent en relation cette seconde dalle avec un dessin du héraut d’armes Henri Van den Berch sur lequel on voit la bordure avec l’épitaphe, dont est actuellement privé le monument93 (fig. 20). C’est donc grâce à ce dessin que Renier a pu rétablir l’inscription et déduire qu’il s’agit du monument érigé en l’honneur du fondateur de l’abbaye, Réginard. Voici la transcription de la dédicace : D. REGINARDO DVCIS BAVARIAE FILIO EPISCOPO LEODIENSI HVIVS BASILICAE// CONSTRVCTORI. QVI MORTEM OBIIT OCTO// GENARIVS ANNO 1036 NONIS DECEMBRIS. POSVIT A° 1604 NONIS AVGVSTI MARTINVS FIACRI’ SCVLPSIT// R.D. OGERVS DE LONCHIN ABBAS 35.// Il faut ajouter que la dalle de Bruxelles est signée près du pied gauche de l’évêque : MARTINUS FIACRIUS SCULPSIT. D’après les sources anciennes, l’œuvre aurait donc comporté, alors qu’elle était encore en place, deux fois le nom du sculpteur. Destrée a mis les différences importantes qui apparaissent entre le dessin et le monument funéraire sur le compte de la mémoire défaillante du héraut d’armes, qui aurait réalisé le dessin sans avoir l’œuvre sous les yeux, ou encore sur la complexité des ornements qui « rebuterait même l’archéologue le plus patient » s’il avait voulu les reproduire. Pour Brassinne, il suffit que l’allure générale, et surtout que les armoiries de Bavière sommées d’une mitre et brochant sur l’épée et la crosse s’y retrouvent pour excuser les imprécisions et même les « fantaisies ». Le dessin, souvent reproduit, qu’Henri Van den Berch réalisa du monument
88. Les deux figures de Victoires insérées dans les écoinçons de la niche semblent relever du style des Thonon. Une analyse minutieuse de ce monument et des sources s’impose. 89. Inv. n° 4459 (1913). J. DESTREE, Le monument de Réginard, évêque de Liège. Étude sur des monuments funéraires de la Renaissance, Annales de la Société royale d’Archéologie de Bruxelles, t. 28, 1914-1919, p. 307-334. 90. Ce paragraphe consacré à Martin Fiacre a déjà été exposé à Liège en 2006 dans le contexte plus large de l’atelier PallardinFiacre, lors du colloque consacré à l’art et à la culture autour Lambert Lombard. Dans l’attente de la publication des actes, il semble opportun de reprendre ici les données se rapportant spécifiquement à Martin Fiacre. 91. Ce n’est pas ici le lieu pour développer l’argumentation nécessaire, mais il est cependant utile d’ouvrir une piste de travail de plus en appuyant une attribution de cette dalle funéraire à Daniel Mauch ou à l’un de ses compatriotes actifs à Liège. Des comparaisons éloquentes pourront facilement être établies entre les putti de cette dalle et ceux de la Vierge de Berselius ou d’autres encore qui appartiennent à des vestiges de mobilier en pierre (MARAM, Musée du Grand Curtius). 92. J. BRASSINNE, Le tombeau dérobé. Histoire d’une substitution, in Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois, 16, 1942, p. 5-17. On trouvera la bibliographie récente dans : H. KOCKEROLS, Monuments funéraires en pays mosan. Arrondissement de Liège, Malonne, 2004, p. 264. 93. D’après Destrée, qui ne cite pas de sources, celle-ci était gravée sur une bordure en marbre noir de Dinant. 250
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 19 : Martin Fiacre. Monument dit de Réginard (1604). Pierre calcaire carbonifère. Bruxelles, Musées Royaux d’Art et d’Histoire. © Musées Royaux d’Art et d’Histoire de Belgique. 251
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
funéraire d’Érard de la Marck pour la cathédrale de Liège, pourrait être cité pour juger du sens de la précision de l’auteur. Peut-on dès lors se contenter de justifier l’écart important qui existe entre le dessin et la dalle en pierre de cette manière ? Ce qu’il importe d’évaluer ici, ce ne sont évidemment pas tant les omissions ou les simplifications qui sont monnaie courante dans ce genre de recueil, mais plutôt les transformations dans la composition. Ainsi, comment justifier la substitution des termes masculins avec des gaines droites par des caryatides avec des gaines en torsades ? Celles-ci ne sont pas plus faciles à dessiner que ceux-là ! La question se pose dans les mêmes termes pour les ornements en médaillons de la chape qui sont remplacés par des rinceaux. On pourrait prendre d’autres exemples94. Finalement, outre l’effigie d’un abbé et une arcade, restent les armoiries de Bavière, associées aux emblèmes de l’abbatiat, comme seul élément réellement décisif pour déclarer pertinente la relation entre la dalle et le dessin. N’y auraitil pas une autre possibilité ? Pourquoi ne pas envisager que le dessin reproduisait une autre dalle que celle de Bruxelles ? Il y aurait naturellement lieu de vérifier si les armes de Bavière peuvent se rapporter à un autre abbé. Dans le cas d’une réponse affirmative, cela n’enlèverait rien à l’hypothèse de Destrée reposant sur les dires de Van den Berch, selon laquelle la dalle du dessin était celle de Van der Stappen (†1558) qui aurait été réutilisée par l’abbé de Saint-Laurent, Oger de Lonchin, pour la placer dans le chœur de l’église en mémoire de Réginard, après avoir remplacé l’inscription. Plus, on pourrait alors aussi accorder foi à Van den Berch lorsqu’il déclare que la modification du tombeau de Van der Stappen avait fait disparaître la signature de l’artiste. Raison pour laquelle elle aurait été rajoutée à la nouvelle épitaphe. Martin Fiacre aurait exécuté le monument funéraire de Van der Stappen après 1558, signé l’œuvre sur la bordure, avec l’inscription de l’épitaphe originale. Peu importe dès lors que Fiacre fut décédé depuis trois ans au moment du remploi de la dalle de Van der Stappen puisqu’il s’agissait seulement de remplacer l’épitaphe du défunt par celle dictée par Oger, et d’y ajouter le nom du sculpteur de la dalle. Il n’y aurait dès lors pas eu de double mention du nom de Fiacre sur la même dalle, mais deux dalles distinctes comportant chacune une signature. Voici donc l’ébauche d’une nouvelle piste à suivre. Au début du XVIIe siècle, l’atelier Palardin-Fiacre poursuit ses activités dans le domaine de la sculpture avec un nouveau membre, Elias Fiacre, le fils de Martin. Yernaux a retrouvé plusieurs mentions relatives à des travaux exécutés par ce sculpteur95. Cependant, une seule œuvre a été proposée à ce jour, il s’agit du mémorial de Nicolas Périlleux, abbé de Flône et curé d’Antheit et de Gilles Raymundi, payé 40 florins en 1611 et que Suzanne Collon-Gevaert propose d’identifier avec la très belle dalle des abbés Nicolas de Périlheux (1606-1608) et Thomas Vinamont (1608-1625) à l’abbaye de Flône96. Il existe dans nos régions une importante série de monuments funéraires de fort belle qualité qui mériteraient d’être réexaminés en détail afin de les caractériser et d’en faire émerger des caractéristiques communes propices à la constitution de groupes, voire à des attributions97. Outre les prototypes de composition, il s’agira d’étudier le traitement des figures et de l’ornement. À ce propos, n’est-il pas remarquable de constater l’identité de la conception ornementale du monument dit de Réginard et celle du mausolée de Jean de Bourgogne, connu par un dessin (fig. 8) ? Il nous semble qu’il y a là un goût pour la surcharge et l’étrange qui se distingue fortement de ce que l’on trouve chez Cornelis Floris et qui pourrait peut-être caractériser le milieu liégeois de la seconde moitié du XVIe siècle98. Ce style s’exprime magistralement dans le mémo-
94. Dans le dessin, les putti placés au-dessus de l’arcade, se retournent vers le centre, comme dans la dalle d’Ernest de Miche (†1641) à Saint-Paul, tandis que dans celle de Bruxelles, ils s’affrontent et sont accompagnés de génies tenant des torches renversées. 95. Jean YERNAUX, L’atelier italo-liégeois des Palardin et des Fiacre, sculpteurs aux XVIe et sion communale de l’Histoire de l’Ancien Pays de Liège, I, 4, 1935-1936, p. 284-287.
XVII
e
siècles, Annuaire de la Commis-
96. Sur cette œuvre, on consultera aussi Suzanne COLLON-GEVAERT, Les pierres tombales de l’abbaye de Flône, Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 67, 1949-1950, p. 208-213. 97. Hadrien Kockerols a déjà franchi un pas dans cette direction en procédant à l’inventaire systématique des œuvres, avec sa série des Monuments funéraires en pays mosan. 98. À ce propos, n’est-il pas significatif que Marthe CRICK-KUNTZIGER (Le monument de l’évêque Réginard, in Bulletin des Musées royaux d’art et d’histoire, 1932, p. 141) ait précisément choisi un dessin de monument funéraire atypique de Floris pour le comparer avec le monument de l’évêque Réginard ? Ce projet de monument funéraire est illustré dans : Antoinette HUYSMANS et alii, Cornelis Floris, 1514-1575, beeldhouwer, architect, ontwerper, Bruxelles, 1996, p. 159, fig. 188. 252
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
rial de Jean Stouten (1557) à la cathédrale de Liège, et également dans le monument d’Hubert Mielemans, à l’église Sainte-Croix (après 1558)99. Le musée Grand Curtius à Liège possède une Pietà en terre cuite signée au revers G. F. Ces initiales ont été identifiées à Gilles Fiacre. Une autre inscription, en relief et sur la face, identifie l’image : « N. Dame de Consolation à S. Remy en Ile » et la date 164[9]100. Martin Le Pieme Une seule œuvre signée et datée Martinus Le Pieme Leodius faciebat A° 1624 pourra servir d’assise à la constitution d’un catalogue pour cet artiste. Il s’agit du mausolée en marbre noir de Balthasar de Pallant et de son épouse Marguerite de Millendonck actuellement installé dans l’église Saint-Étienne de Reuland. Les défunts époux sont couchés sur un sarcophage parallélipipédique garni sur ses flancs d’une série de blasons et d’une inscription dédicatoire. Le style des figures est soigné, et témoigne d’une recherche d’animation dans les volumes. Quant aux ornements, ils sont traités en méplat, de manière très régulière et appliquée. Le traitement des physionomies, du système pileux, des drapés et des ornements est à rapprocher du mausolée de Conrard de Gavre († 1602), à l’église Saint-Martin de Liège, comme Fig. 8 : Thomas Tollet (dessin d’après). du monument funéraire d’Érard de Rivière († 1582) Mausolée de Jean de Bourgogne. et de son épouse Jeanne de Mérode († 1587), à © BNF, Ms français 8226, f° 359 r°. l’église Saint-Martin de Heers, mais aussi de la dalle funéraire de Pierre Stévart († 1624), à l’église Sainte-Walburge de Liège, et enfin du monument votif de Jacques Auxbrebis et Andrienne du Pontdermy († 1578), à l’église Saint-Médard de Samart. Les dalles funéraires d’Ernest de Miche († 1641) à la cathédrale Saint-Paul de Liège et celle de Gilles Blocquerie († 1647) à l’église Saint-Denis de Liège pourraient dériver de ces œuvres, mais le choix du style des éléments architectoniques et de celui des ornements témoigne déjà d’une sensibilité baroque. Pour mieux circonscrire la personnalité artistique de Martin le Pieme, il s’agira d’affiner les critères de comparaison de ces œuvres et d’élargir le catalogue de sa production. Les Thonon Le jubé de l’église Saint-Jacques à Liège (ca 1602) Une exceptionnelle description ancienne de l’ancien jubé de Saint-Jacques publiée dans le récit de voyage de Philippe de Hurges en 1615, à Liège et à Maastricht permet de se faire une idée de ce jubé alors qu’il 99. Le monument dit de Réginard semble très influencé par ces deux monuments funéraires liégeois. La comparaison des putti tenant les flambeaux renversés du monument dit de Réginard et de celui d’Hubert Mielemans est particulièrement éloquente du style de Fiacre, moins virtuose que celui de l’auteur des deux monuments précités. 100. N° inventaire : D 34/48. La statue médiévale originale, très vénérée et reproduite ici en terre cuite pour la dévotion, se trouve à l’église Saint-Jacques. 253
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
était encore à son emplacement original101 : « Le doxal de Saint-Jacques est composé de porphyre, de jaspe, d’alebastre et de marbre noir, bouchant toute la largeur du chœur, eslevé à la hauteur de vingt et cinq pieds ; l’on y monte par plusieurs degrez de marbre noir ; au milieu est la grande et principale porte du chœur, et à chasque costé un autel où paraissent relevées en bosse les plus belles images que l’on puisse veoir, toutes d’alebastre et à la grandeur naturelle, agencées d’or, d’argent et de peintures, autant que l’œuvre le requiert. Sur les corniches du portail de ces autels sont des statues entières selon la grandeur humaine, les mieux exprimées et cizelées que l’on puisse s’imaginer, dont les unes représentent Nostre Sauveur ressuscitant, les autres la Transfiguration du Messie au mont de Thabor, les autres l’Assumption de la glorieuse Vierge-Mère. Et pour le faire bref, ce doxal excède en art, en beauté et en richesse tout autre que j’eusse veu jusques lors, sans excepter celuy de St-Wauldrud à Monts, que l’on estime entre les plus beaux et les plus coustageux de l’Europe ». Saumery attribuait la réalisation de ce jubé à l’abbé Martin Fanchon102. Il se basait sans doute sur une inscription figurant sur le monument et relevée en 1705 par Mathieu Brouerius103 : « De là, je vins au chœur où je trouvais une belle façade enrichie d’une très belle sculpture de marbre blanc et noir avec 10 colonnes de marbre de Corinthe. Sur les deux côtés de la porte, vous voyés deux autels magnifiques, au-dessus de la porte se lit cette inscription : DNE DILEXI DECOREM DOM. TVÆ et plus bas : D :O :M : ECCLESIÆQVE DECORI ET ORNAMENTO REVERENDVS DNS MARTINVS FANCHON LEODIENSIS HVIVS MONASTERII ABBAS XLII OPVS HOC FIERI ERIQVE CVRAVIT ANNO DNI 1602. Vous avés deux marches à monter pour venir au chœur ; sur la première, vous y trouvés cette inscription qu’une main vous montre du bout du doigt : DeMptVs et eX febrVIs VIX ChorVs Extat aqVIs. Ces inscriptions ont esté gravées en mémoire d’un débordement d’eau qui est venu dans l’Église à cette hauteur dans l’an 1658 comme le désignent les lettres numérales de l’inscription. Dans l’année 1643, il y a eu aussi un débordement qui vint jusqu’à la dernière marche du chœur, comme le marque l’inscription qui est aussi gravée, qu’une main nous montre ; voici l’inscription telle qu’elle se lit : VIX ChorVs est IanI præsens eXeMptVs ab VnDa ». En 1751, le jubé aurait été démonté, divisé en deux parties dont les fragments auraient servi à confectionner deux grands autels aux bas-côtés de l’église, à l’extrémité orientale des nefs. En 1884, ces vestiges réassemblés du jubé furent déplacés une fois encore et replacés au fond de l’église, contre la paroi occidentale des basses nefs (fig. 21)104. Jules Helbig regrettait de ne pouvoir attribuer cet ensemble105. C’est uniquement sur base de la réputation de Thomas Tollet que Moret le lui attribua ce jubé106. Quant à Jean Mogin, il notait, au milieu du XXe siècle : « Le style légèrement ampoulé des bas-reliefs, à l’expressivité outrée, traduit aussi les prémisses de la crise baroque. Statues et bas-reliefs sont l’œuvre d’un artiste honnête, technicien laborieux, mais nullement d’un grand maître que l’enthousiaste voyageur du XVIIe siècle [Philippe de Hurges] avait dit. Nous entrons dans la seconde partie de la Renaissance, le pathos s’insinue là où avaient régné une gravité vraie, une fantaisie de bon aloi. Le style du XVIIe siècle qui s’annonce garde la richesse du siècle précédent, mais s’affuble du masque d’une sévérité de commande »107. Comme on le voit, le style antiquisant qui s’exprime ici n’est pas compris par l’auteur qui ne trouve où le classer. L’œil expert de Joseph de Borchgrave d’Altena avait pourtant détecté les qualités de l’artiste : « … les scènes du jubé de Saint-Jacques ont une fougue et une ampleur qui sont la griffe d’un artiste de grand
101. H. MICHELANT , Voyage de Philippe de Hurges à Liège et à Maestrect en 1615, Société des Bibliophiles liégeois, Liège, 1872. Le manuscrit original de Philippe de Hurges, est conservé à Paris, à la Bibliothèque Nationale de France, Écrits du for privé, sous la cote 9025. Cité ici d’après la retranscription de Jules HELBIG , La sculpture et les arts plastiques au pays de Liège et sur les bords de la Meuse, Bruges, 1890, p. 158-159. 102. Lambert DE S AUMERY, Les délices du Païs de Liége, ou Description géographique, topographique et chorographique des monumens sacrés et profanes de cet Évêché-principauté et de ses limites, Liège, Liège, 1738, I, p. … 103. Cf. la retranscription complète de ce récit de Brouerius dans : Léon HALKIN, Une description inédite de la ville de Liège en 1705, Liège, 1948. Le passage qui nous intéresse ici se trouve p. 39-41. 104. Jules HELBIG, La sculpture et les arts plastiques au pays de Liège et sur les bords de la Meuse [2e éd.], Bruges, 1890, p. 159. 105. Jules HELBIG, La sculpture et les arts plastiques au pays de Liège et sur les bords de la Meuse [2e éd.], Bruges, 1890, p. 159. 106. J. MORET, Henri de Borset et Thomas Tollet, sculpteurs liégeois du XVIe siècle, leurs travaux dans la cathédrale de Nevers, in Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 48, 1923, p. 127. 107. Jean MOGIN, Les jubés de la Renaissance, Bruxelles, 1946, p. 30. 254
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
talent »108. Dans sa grande synthèse sur les jubés dans les anciens Pays-Bas, Jan Steppe reprenait l’attribution à Tollet109. Le traitement de l’anatomie et des draperies des figures permet de fixer ici les caractéristiques propres à l’atelier de Thonon au début du XVIIe siècle. Celles-ci serviront de référence pour l’attribution de toute une série d’œuvres. Il faut particulièrement remarquer les proportions encore très maniéristes de certaines figures, le traitement vigoureux et saccadé des draperies où dominent les recherches de forts contrastes et de mouvements vifs. Le style de l’atelier ira progressivement vers des postures plus calmes, des figures plus robustes et des draperies plus souples. Cette évolution générale est peut-être due à l’influence de Jean II Thonon, mais il faut bien garder à l’esprit que ces grands ensembles étaient réalisés par un atelier et que diverses personnalités s’y exprimaient simultanément. Nous en reparlerons à propos des grandes figures du jubé d’Hertogenbosch, au Victoria & Albert Museum de Londres. Plusieurs figures conservées de ce jubé, notamment les figures allégoriques qui sont couchées sur les frontons témoignent d’une forte influence de l’antique dans les visages et les coiffures. Pour comprendre cette tendance, il faut en chercher les modèles Fig. 21 : Atelier Thonon. potentiels et rappeler que dès les années 1570, Vestige du jubé de Saint-Jacques, ca 1602. l’évolution de la sculpture s’accompagne, à Rome Marbre noir et albâtre. Liège, église Saint-Jacques. et à Florence, d’un phénomène commun avec © Michel Lefftz. l’architecture : celui du retour à l’antique comme modèle pour un renouveau du classicisme110. Ce recours va de pair avec un changement progressif dans les proportions des figures qui deviennent plus solides. C’est donc davantage vers ce type de sources, plutôt que du Maniérisme, qu’il faut se tourner pour comprendre la sculpture mosane de la fin du XVIe siècle et du premier tiers du siècle suivant. Figures de Moïse et d’Aaron à l’église Saint-Jacques Le style et le thème iconographique de ces deux statues en albâtre d’une hauteur d’un mètre permettent d’envisager avec quelque assurance une provenance de l’ancien jubé de l’église Saint-Jacques à Liège.
108. Joseph DE BORCHGRAVE D’ALTENA , Notes et documents pour servir à l’histoire de l’art et de l’iconographie en Belgique, 1ère série. Sculptures conservées au Pays Mosan, Verviers, 1926, p. 201. 109. Jan STEPPE, Het koordoksaal in de Nederlanden, Bruxelles, 1952, p. 339-340. Marguerite Devigne avait estimé qu’il s’agissait là d’une pure hypothèse sans fondement, car elle croyait Tollet mort en 1601 : Tollet, in Biographie nationale, 25, 1930-1932, col. 411. Ignace Vandevivere s’est montré plus circonspect : Ignace VANDEVIVERE et Catheline PERIER-D’IETEREN , Belgique renaissante. Architecture, art monumental, Bruxelles, 1973, p. 88. 110. En sculpture, voir entre autre le Monument pour Michel-Ange à l’église de Santa Croce de Florence, d’après un projet de Vasari (marbre, 1570) ou à Rome, le monument funéraire de Sixte V, exécuté d’après les plans de Domenico Fontana, à Santa Maria Maggiore, entre 1584 et 1590, ou enfin la statue de sainte Catherine d’Alexandrie de la chapelle Theodoli à Santa Maria del Popolo, par Giulio Mazzoni (marbre, 1569-1570).
255
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Adoration des Mages du MARAM Deux fragments d’un bas-relief en albâtre conservés dans les collections du MARAM (Grand Curtius) représentent une Adoration des Mages. Les proportions du panneau et le style adopté pourraient également indiquer comme provenance l’ancien jubé de l’église Saint-Jacques à Liège. Fragment de mobilier liturgique à Momalle Deux bas-reliefs en albâtre représentant l’Annonciation et la Visitation sont conservés à l’église NotreDame de Momalle111. Le style saccadé des draperies et le traitement un peu raide des figures sont à mettre en relation avec les bas-reliefs des vestiges du jubé de l’église Saint-Jacques à Liège. Statue de sainte Barbe à l’église paroissiale de Bas-Oha Une statue en bois de l’église Saint-Lambert de Bas-Oha présente les caractéristiques stylistiques de l’atelier Thonon. On rapprochera notamment le traitement du drapé et des physionomies des figures du grand bas-relief en albâtre de Tongres. Le jubé de Bois-le-Duc au Victoria & Albert Museum, ca 1615 Cette œuvre prestigieuse a fait l’objet de plusieurs études importantes et pourtant de nombreuses questions demeurent en suspens (fig. 22-26)112. Celles qui concernent l’attribution des sculptures nous semblent maintenant partiellement résolues grâce à l’exploitation du contrat du 23 mai 1615, établi entre Jean Thonon II et un marchand de Delft, Jacques Matheus pour la fourniture de sculptures113. La similitude stylistique avec plusieurs sculptures de l’ancien jubé de Saint-Jacques à Liège est totalement convaincante ! Dans l’attente d’une étude détaillée qui ne pourrait trouver place ici, nous proposons d’ores et déjà d’attribuer à l’atelier Thonon les statues de la Vierge à l’Enfant, saints Pierre et Paul, et les figures porteuses des armoiries ducales. Quant aux bas-reliefs, leur style n’est pas totalement homogène, mais il semble qu’on puisse néanmoins les attribuer à l’atelier Thonon. Les grandes figures des saints Pierre et Paul et de la Vierge serviront de références à d’autres attributions. Leur style général se caractérise par une recherche de tensions et de ruptures dans les drapés et dans les anatomies. Les longs plis raidis se tordent et se brisent lorsqu’ils sont saillants, alors qu’ailleurs ils adhèrent au corps pour en souligner les formes. L’angulosité des brisures des plis est fortement soulignée, tout comme celle des articulations des doigts où celle des tendons des membres. Le traitement du système pileux se caractérise par des jeux de gradations des boucles de cheveux ou de la barbe, ou encore par le décentrement des barbes lorsque celle-ci est formée de mèches torsadées (Paul). La Vierge à l’Enfant du jubé d’Hertogenbosch incarne un archétype à succès puisqu’on le retrouve utilisé en bois ou en pierre à l’église de l’Immaculée Conception de Châtelet (fragments du retable de l’autel Notre-Dame), à la chapelle Notre-Dame de SaintFontaine (Pailhe, épitaphe de Nicolas de Saint-Fontaine), au Musée Curtius de Liège (fig. 27-29) (SN 2001/25) et à la cathédrale de Liège (fig. 38) (retable de l’autel de Pierre Oranus).
111. Ces bas-reliefs mesurent 56 x 70 cm. Clichés IRPA : M99664 et M99665. 112. Citons ici les études les plus importantes : Jan STEPPE, Het koordoksaal in de Nederlanden, Bruxelles, 1952, p. 279-285 ; Charles AVERY, The Rood-Loft from Hertogenbosch, Londres, 1969 ; C. P EETERS, De Sint Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch, ’S-Gravenhage, 1985, p. 337-338 ; Mariët WESTERMANN, A monument for Roma Belgica. Functions of the « Oxaal » at ’s-Hertogenbosch, in Reindert FALKENBURG, Dulcia MEIJERS, Herman ROODENBURG, Victor SCHMIDT , Frits SCHOLTEN , Beelden in de late middeleeuwen en Renaissance (Nederlands kunsthistorisch jaarboek, 1994, 45), Zwolle, 1994, p. 383-446. 113. Cf. Notre argumentation ci-avant, à la notice biographique consacrée aux Thonon. Jacques Matheus (alias Jacques Matthijsz) signe Jacop Mattyis van Wang. 256
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 22 : Atelier Thonon. Jubé d’Hertogenbosch, ca 1615. Marbre noir et albâtre. Londres, Victoria & Albert Museum. © Londres, Victoria & Albert Museum.
Sans vouloir entrer ici dans le détail des analyses stylistiques, il est néanmoins important de noter la diversité stylistique des sculptures qui se côtoient dans cet ensemble. Il n’est pas question de remettre en cause l’attribution à l’atelier Thonon de la grande majorité des sculptures, mais plutôt d’y reconnaître une diversité de mains actives simultanément. Cette différence de style s’exprimant d’une part dans les statues, mais aussi entre les statues et les bas-reliefs, nous serions enclins à penser qu’il pourrait y avoir eu une certaine spécialisation des tâches. Ainsi, si le style des figures des saints Pierre et Paul s’inscrit parfaitement dans la continuité de celles du jubé de Saint-Jacques à Liège, celui de la Vierge à l’Enfant relève d’un style différent : les draperies y sont plus souples, adoptant même une grammaire différente, les têtes sont plus rondes, les visages plus ramassés, les membres et les mains sont plus charnus. C’est peut-être à ce maître qu’il faudrait donner les reliefs se rapportant à la vie de saint Martin, conservés à l’église du même nom à Liège. Fragments de deux retables d’autel à l’église Saint-Martin de Liège Quatre panneaux sculptés, en albâtre, insérés dans une paroi de la crypte de l’église Saint-Martin à Liège proviennent très certainement de deux retables d’autel, car on y identifie les éléments de deux cycles distincts (fig. 30-33). Il y a d’une part trois épisodes de la vie de saint Martin (le Baptême de saint
Fig. 27 : Atelier Thonon. Vierge à l’Enfant, bois. Liège, Musée Grand Curtius. © Michel Lefftz. 257
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Martin, la Messe miraculeuse de saint Martin, saint Martin partageant son manteau) et d’autre part, deux scènes de la vie de la Vierge (l’Assomption et le Couronnement de la Vierge). Il semble que l’on puisse y reconnaître au moins deux mains actives dans l’atelier Thonon.
Fig. 30 : Atelier Thonon. Saint Martin partageant son manteau. Albâtre. Liège, église Saint- Martin. © Michel Lefftz.
Fig. 32 : Atelier Thonon. L’Assomption de la Vierge. Albâtre. Liège, église Saint-Martin. © Michel Lefftz.
Fragments de mobilier liturgique à Tongres Suite à l’incendie du 28-29 août 1677, des fragments du mobilier sinistré de l’église Notre-Dame de Tongres ont été remontés dans le retable d’autel de la chapelle du chapitre114. Sous le portique, le grand basrelief en albâtre illustrant la Naissance de la Vierge relève clairement du style de l’atelier Thonon et ornait probablement un autel dédié à la Vierge, peut-être avec la Pietà en ronde-bosse qui se trouve actuellement au Trésor de la collégiale (fig. 34)115. Un petit bas-relief de la prédelle de ce retable d’autel composite montre un ange portant le livre des Ecritures ; il relève du même style (fig. 35). Enfin, un troisième basrelief en albâtre (?), très abîmé, représente saint Michel terrassant le démon ; il devrait également pouvoir être rattaché à l’atelier Thonon116. Les bas-reliefs ornementaux de ce retable ne sont pas sans rappeler ceux de l’ancien jubé de l’église Saint-Jacques à Liège.
114. Jean PAQUAY, Monographie illustrée de la collégiale Notre-Dame à Tongres, Tongres, 1911, p. 49, 64. 115. Hauteur 64 cm. Jean PAQUAY, Monographie illustrée de la collégiale Notre-Dame à Tongres, Tongres, 1911, p. 160. L’hypothèse d’un retable d’autel est celle à laquelle on songe en premier, mais il ne faudrait cependant pas totalement exclure celle d’un jubé. 116. Hauteur 62 cm, cf. cliché IRPA B149212. 258
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Retable de l’autel de Pierre Oranus117 à la cathédrale Saint-Paul (ca 1618) L’ensemble du retable d’autel offert par Pierre Oranus à la collégiale Saint-Paul, aujourd’hui cathédrale, s’inscrit parfaitement dans la typologie des œuvres produites par l’atelier Thonon (fig. 36-40). Les statues de la Vierge, des saints Pierre et Paul qui le somment constituent des variantes de leurs homologues au jubé d’Hertogenbosch, conservé au Victoria & Albert Museum. Le retable du maître-autel de la chapelle du noviciat des Jésuites de Tournai, ca 1618 Eugène Soil s’est intéressé à plusieurs reprises au noviciat des Jésuites de Tournai118. Il avait aussi établi le lien entre le retable du maître-autel exécuté en 1618 (fig. 41-44) pour cette chapelle et le maître de carrière dinantais Guillaume Tabaguet, car ce retable était en effet cité dans un contrat passé en 1619 avec l’abbé de Saint-Bertin à Saint-Omer, Guillaume de Loemel119. Tabaguet y apparait comme l’entrepreneur et le fournisseur des matériaux du meuble liturgique : « Toutes les dites pierres en matière bonne et cele marFig. 34 : Atelier Thonon. chandises, bien polie et lustrée en jaspre Pietà. Albâtre. Tongres, Trésors de l’église Notre-Dame. aussy blanc que celuy des deux termes © Michel Lefftz. livrés par maître Tabaguet pour la table d’autel de l’église du noviciat de la compagnie de Jésus à Tournay »120. Le travail de sculpture incombait à Adam Lottman (1585-1663)121 tandis qu’il revenait à Tabaguet de fournir toutes les pièces d’architecture. Soil déduisit des termes de ce contrat que Tabaguet était également l’auteur de l’ensemble du maître-autel et du retable. Mais à Tournai comme à Saint-Bertin, il faut envisager une collaboration entre l’entrepreneur dinantais et un sculpteur. Cette fois, le style des reliefs et des ornements 117. On trouvera la bibliographie récente dans : Hadrien KOCKEROLS, Monuments funéraires en pays mosan. Arrondissement de Liège, Malonne, 2004, p. 321. 118. Cf. e.a. Eugène SOIL Les maisons de la compagnie de Jésus à Tournai, Bruges, 1889, p. 108-117, Inventaire des objets d’art et d’antiquité existant dans les édifices publics des communes de l’arrondissement judiciaire de Tournai, Charleroi, 1924, p. 186. 119. Le contrat très détaillé est édité dans : H. DE LAPLANE, Jubé de l’église abbatiale de Saint-Bertin. Devis passé en 1619 par Guillaume Loemel, 72e abbé, in Bulletin historique de la Société académique des antiquaires de la Morinie, 13, 1864, p. 330-337. 120. Ferdinand COURTOY, Les arts industriels à Dinant au début du dix-septième siècle, in Annales de la Société archéologique de Namur, 34, 1920, p. 233. 121. Félicien MACHELART, Peintres et sculpteurs de la confrérie Saint-Luc de Valenciennes au XVIIe et XVIIIe siècles, Valenciennes, 1987, p. 107-108. Ce sculpteur d’origine colonaise fut témoin au mariage du sculpteur Pierre Schleiff en 1628. C’est le même Schleiff qui se retrouvera sur le chantier du jubé de Floreffe vers 1635. 259
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
qui subsistent offre des similitudes flagrantes avec celles réalisées par l’atelier Thonon. En 1927, Eugène Soil de Moriamé avait envoyé deux photos de ce retable à Ferdinand Courtoy, à la demande de ce dernier122. On y distingue les deux grands bas-reliefs d’albâtre de la prédelle et les quatre statues du couronnement. Dans sa lettre d’accompagnement, Soil confirme que la croix manque au Calvaire, celui-ci manque encore sur les photographies de 1941. Depuis, un Christ a été réinstallé (fig. 42). Pour autant que l’on puisse en juger à distance et sur photos, ces grandes statues paraissent être en albâtre et leur style paraît être également celui des Thonon. C’est très probablement aussi cet atelier qui aura entrepris la réalisation des sculptures du portail de la chapelle (fig. 45)123.
Fig. 44 : Atelier Thonon. Le lavement des pieds. Retable de l’autel du noviciat des Jésuites à Tournai (ca 1618). Marbre noir et albâtre. Tournai, Athénée. © Michel Lefftz.
Le Christ Salvator Mundi de la cathédrale de Tournai (ca 1620 ?) Dans son Histoire de Tournai, Jean Cousin mentionne un collège apostolique aux piliers de la nef : « Il y a a chasque pilier un image taillée d’albastre ou de pierre blanche albastrée, de la grandeur humaine ; au pilier soubs la chapelle S. Michel est l’image albastrée de nostre sauveur, aux douze d’auprès les images des douze Apostres, aux quatre plus loing les images des quatre Docteurs de l’église, & aux deux plus avant, deux images d’albastre, celle qui est au costé gauche en entrant en l’église, est l’image de l’Ange Gabriel, saluant la Vierge Marie, & luy annonçant l’Incarnation : aux costés droict vis à vis est l’image 122. Archives de l’État à Namur, Fonds Ferdinand Courtoy. 123. Cet ensemble qui mériterait une étude approfondie et surtout un traitement de conservation urgent, comprend deux statues d’anges encadrant le blason des Jésuites et une Vierge à l’Enfant en très mauvais état de conservation. 260
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
de la glorieuse Vierge annoncée Mère de Dieu »124. Il semble donc que ce Christ colossal soit la seule statue subsistante d’un collège apostolique placé dans la nef au début du XVIIe siècle (fig. 46-47)125. Le style de l’œuvre peut notamment être rapproché de la statuette de saint Pierre à Nivelles. Bas-reliefs avec anges à l’église de Souxhon (ca 1622 ?) Deux petits bas-reliefs en albâtre ont été insérés, avec d’autres fragments provenant d’un retable d’autel de l’église Saint-Jean l’évangéliste à Liège, dans un retable d’autel composite, à l’église Saint-Nicolas de Souxhon (Mons-lez-Liège)126. Ces deux anges encadrent une belle inscription dédicatoire en marbre noir, richement ornée et datée 1622. Le style des anges peut être comparé avec celui de l’ange de Tongres, luiaussi rescapé d’un mobilier ancien. Le retable du maître-autel de la collégiale de Nivelles, ca 1629 Ce retable a été démantelé, mais il en subsiste d’importants fragments, épars dans la collégiale (fig. 48-58). D’après le contrat signé le 31 mai 1629, « la table avait 8,5 pieds de large sur 7 de haut ; au sommet règne une corniche de marbre noir, avec architrave et frise d’albâtre ; plus bas se trouvent quatre colonnes de jaspe, avec base et chapiteaux à la corinthienne, l’emplacement pour mettre une peinture, deux niches occupées par une statue d’albâtre, de 2,5 pieds de haut, surmontée d’une aiguille de jaspe, et six chérubins d’albâtre, le tout reposant sur un piedestal de marbre, avec quatre aiguilles de jaspe. Au milieu il y avait un reposoir du saint Sacrement, avec quatre colonnes de jaspe à la corinthienne, vases et chapiteaux d’albâtre, timbre du dôme en marbre avec le pélican et trois festons d’albâtre »127. Le contrat stipulait encore que le modèle devait être achevé dans les huit jours et le monument dans les six mois. Tarlier et Wauters voyaient dans une estampe illustrant la Vie de sainte Gertrude par J. G. van Ryckel le maître-autel construit par Thonon (fig. 59)128. Il s’agit d’une méprise, car cette estampe, ainsi qu’une autre où l’on reconnait un paralytique implorant la statue de sainte Gertrude, reprennent la composition inversée de deux des huit bas-reliefs en albâtre racontant la vie de sainte Gertrude (fig. 51). Or le style de ces derniers les apparente à
Fig. 48 : Atelier Thonon. Sainte Gertrude (ca 1629). Albâtre. Nivelles, collégiale. © Michel Lefftz.
124. Jean COUSIN, Histoire de Tournai ou le troisième livre des chroniques, annales, ou démonstrations du christianisme de l’évêché de Tournay, Douai, 1620, p. 165. 125. Le chanoine Warichez date l’œuvre de 1624 en se référant à Jean Cousin, pourtant l’ouvrage de ce dernier a été publié en 1620 ! J. W ARICHEZ, La cathédrale de Tournai et son chapitre, Wetteren, 1934, p. 248-248. 126. Marylène LAFFINEUR-CREPIN , Mobilier religieux, in Millénaire de la collégiale Saint-Jean de Liège, Liège, 1982, p. 196. 127. D’après la retranscription de Jules TARLIER et Alphonse WAUTERS, La Belgique ancienne et moderne : géographie et histoire des communes belges. Province de Brabant. Arrondissement de Nivelles, Bruxelles, 1859 [éd. anastatique de 1963], p. 123. 128. Jules TARLIER et Alphonse WAUTERS, La Belgique ancienne et moderne : géographie et histoire des communes belges. Province de Brabant. Arrondissement de Nivelles, Bruxelles, 1859 [éd. anastatique de 1963], p. 123. Au moins deux éditions de la Vie de sainte Gertrude présentent cette gravure : Joseph Geldolphus van Ryckel, Vitae S. Gertrudis abbatissae Nivellensis, Brabantiae tutelaris, historicæ narrationes tres, Louvain, Cornelii Coenestenii, 1632 ; Joseph Geldolphus van Ryckel, Historia S. Gertrudis Principis Virgini primae Nivellensis Abbatiae notis et figuris æneis subinde illustrata, Bruxelles, G. Schovaert, 1637. 261
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
celui de l’atelier Thonon. Ces reliefs ont donc de toute évidence été réalisés pour le retable du maîtreautel entrepris en 1629 par Thonon129. L’absence de mention de ces bas-reliefs dans les extraits du contrat retranscrits par Tarlier et Wauters n’infirme aucunement cette hypothèse comme le croyaient Helbig et Courtoy qui, par ailleurs, n’y reconnaissaient pas le style de Thonon. Dans cette série de reliefs, on voit la châsse à trois reprises ; celle-ci est à chaque fois placée sur un édicule de style différent afin d’évoquer la longue histoire de la sainte et de ses miracles. Tarlier et Wauters auront été induits en erreur par le style antiquisant des membres du retable tel qu’on les voit sur le relief du miracle de l’incendie (fig. 50). Outre ces huit petits bas-reliefs, il y a encore un grand bas-relief en albâtre présentant l’Adoration des bergers. Cette œuvre ornait le retable de l’autel Notre-Dame du Pilier jusqu’à sa destruction lors du bombardement durant la Seconde Guerre mondiale130. Le traitement de l’espace, comme celui des physionomies et des drapés y sont très caractéristiques de la production des Thonon. Enfin, les deux statuettes de sainte Gertrude et de saint Pierre provenant du maître-autel constituent une base solide pour les attributions à l’atelier des Thonon. Il existe d’ailleurs une autre version de saint Pierre, en bois cette fois, à l’église paroissiale de Saint-Gérard131. Le jubé de l’église abbatiale de Floreffe, ca 1635 Saumery décrit ce jubé : « Le magnifique jubé qui sépare le chœur de la nef, est une très riche pièce d’architecture. Il est embelli de six colonnes & d’autant de pilastres de marbre noir jaspé d’ordre composite, dont les bases, les chapiteaux & les autres ornements sont de marbre blanc. La porte du chœur à plein ceintre, dont les jambages sont de marbre noir, est placée au milieu, entre deux colonnes & deux pilastres de porphire d’ordre ionique, entre lesquelles sont deux niches de marbre noir, qui en accompagnent trois autres uniformes, qui, placées au-dessus de la porte, remplissent un fronton cintré & cantonné des figures de la Vierge et de Saint Jean, entre lesquelles est placé un beau crucifix. La niche du milieu, qui est, en quelque façon, au pié de la croix, est remplie des figures du diable & de la mort vaincus par Jésus-Christ en croix, & les quatre autres logent les figures des quatre évangélistes. On y voit deux superbes autels de marbre placés aux deux côtés entre les colonnes & les pilastres, & fermés par des balustrades de marbre noir, mêlé de très bon goût avec du marbre jaspé »132. En 1635, Jean Thonon maître sculpteur à Dinant s’engage à réaliser six chapiteaux ioniques et diverses autres sculptures pour le nouveau jubé érigé dans l’église abbatiale de Floreffe sur les plans du sculpteur valenciennois Pierre Schleiff133. Il devait s’agir d’une commande importante dont il semble que presque tout ait été anéanti134. Épitaphe de François Oranus (†1636) à la cathédrale de Liège Ce retable pariétal est orné d’un grand bas-relief sous le portique montrant le donateur agenouillé et en prière face à saint François, lui-même prosterné devant le Christ et la Vierge (fig. 60-61)135. On reconnaît 129. Le thème déployé ici de la vie et des miracles de la sainte devait être placé à proximité immédiate de la châsse. 130. On ne connait pas l’histoire de cet autel et de son retable qui ont peut-être été recomposés à partir des fragments du retable du maître-autel. 131. Cette statue n’apparaît pas dans la base de données de l’Institut royal du patrimoine artistique, elle m’a très aimablement été signalée par le conservateur du Musée diocésain de Namur, Jacques Jeanmart. Qu’il trouve ici mes remerciements les plus amicaux. 132. Lambert DE S AUMERY, Les délices du Païs de Liége, ou Description géographique, topographique et chorographique des monumens sacrés et profanes de cet Évêché-principauté et de ses limites, Liège, 1740, II, p. 310-314. 133. Archives de l’État à Namur, Commune, ancinen régime, 584. Cahier : archives communales de Dinant I. Travail fait à Dinant par Jules Borgnet (?) vers 1872, f° 22 r° : Divers fragments de dossier retrouvés par Mr Remacle. « 17 mars 1635, contrat entre Pierre Schleiff maître tailleur d’images à Valencienne et Mr Jean Thonon maître sculpteur à Dinant au sujet de l’enrichissement de pierre blanche de Verdun pour servir au doxal qui se doit poser en l’église de l’abbaye de Floreffe sur le modèle mis en main de Thonon par Schleiff, Thonon doit faire six châpiteaux ioniques, le remplissement de l’archure (?) de la porte du milieu, les coins des deux histoires du costé de la cuirasse avec figures entaillée en pierre de Verdun qui seront le couronnement d’ung escritteau qui serat dans ung nys au dessus de la porte - pour 225 patagons ». 134. Il faudrait examiner de plus près les quelques fragments de mobilier qui sont conservés au petit musée de l’abbatiale avec l’espoir d’y retrouver l’un ou l’autre vestige de ce jubé. Je songe notamment à deux consoles, l’une en bois et l’autre en pierre blanche, chacune ornée d’un chérubin. 135. On trouvera la bibliographie récente dans : Hadrien KOCKEROLS, Monuments funéraires en pays mosan. Arrondissement de Liège, Malonne, 2004, p. 350. 262
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
dans la scène de l’arrière-plan, saint François renonçant à l’héritage paternel. Les trois statuettes sommant l’ensemble représentent le Christ, sainte Catherine et sainte Barbe ; elles ont fait l’objet de restaurations. Celles du Christ et de sainte Catherine semblent être d’un style conforme au relief alors que la tête de sainte Barbe devrait être examinée de près pour s’assurer de son authenticité.
Fig. 61 : Atelier Thonon. Épitaphe de François Oranus (†1636). Marbre noir et albâtre. Liège, cathédrale. © Michel Lefftz.
Le jubé de l’église abbatiale de Florennes, ca 1641 Ce jubé, pour lequel Jean Thonon avait signé le contrat en 1641, est mentionné par Saumery dans ses « Délices du Païs de Liège : La nef est séparée du chœur par un jubé de marbre noir orné de figures & de reliefs d’albâtre, & accompagné de deux autels assortis de plusieurs colonnes torses de marbre noir avec leurs bases, châpiteaux & autres ornements de sculpture. Deux reliefs de marbre d’Italie parfaitement bien travaillés, leur tiennent lieu de tableaux »136. Le contrat est peu explicite sur la forme que devait prendre le jubé, car, comme à l’accoutumée, il était accompagné d’un dessin (modelle) malheureusement perdu. D’une hauteur de 17 pieds, et de la largeur de l’entrecolonnement, il devait être construit en « piere, tant de jaspes, marbres y albattes avec tous ornemens »137. Malheureusement, le programme iconographique n’est pas précisé ; on peut cependant raisonnablement supposer que comme pour les autres jubés de cette époque, il devait y avoir des statues et des reliefs. Peut-être que ce sont ces derniers qui avaient été réutilisés dans un édifice voisin de l’abbaye puisque les fragments de quatre grands basreliefs de marbre blanc se trouvaient encore dans la chapelle funéraire du château de Rosée il y a seulement une dizaine d’années. Dom Cyrille Lambot les y avait vus et décrits brièvement : « quatre grands panneaux de marbre blanc sculptés présentent des scènes d’histoire religieuse. Ce ne sont plus que des fragments ; quoique assez considérables, ils ne permettent pas d’identifier les scènes, à l’exception d’une 136. Lambert DE S AUMERY, Les délices du Païs de Liége, ou Description géographique, topographique et chorographique des monumens sacrés et profanes de cet Évêché-principauté et de ses limites, Liège, 1744, IV, p. 379. 137. Archives de l’État à Liège, notaire de Frahan (Dinant), acte du 17 juin 1641 : Contrat passé entre le sculpteur Thonon et l’abbaye de Florennes pour la construction d’un jubé. 263
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
seule, le Christ aux outrages »138. Depuis, ils ont été volés, mais on en a heureusement gardé une photographie139. Il reste à l’église Saint-Remi de Rosée quelques beaux éléments architectoniques qui proviennent très probablement du jubé de Florennes. Il s’agit des seize colonnettes en albâtre qui soutiennent la tablette du banc de communion140. Il y a peu, nous avons pu démontrer la cohérence d’un groupe de figures qui auraient formé un grand Calvaire en bois probablement destiné à l’ancienne abbaye de Florennes141. La statue de saint Jean de l’église Saint-Aubin, que la tradition orale dit provenir de l’ancienne abbaye de Florennes (fig. 62), a pu être rapprochée d’un Christ et de deux larrons, encore présents à l’église Saint-Gengulphe de Florennes jusque dans l’immédiate après-guerre142. La statue de saint Jean offre les caractéristiques de la production de l’atelier Thonon, on la comparera notamment aux figures de l’ancien jubé de l’église Saint-Jacques à Liège et à celles du jubé d’Hertogenbosch. Nous avons proposé d’y associer également une figure de la Vierge de Douleur de la cathédrale de Namur à cause des similitudes morphologiques et de ses dimensions semblables à celles du saint Jean (fig. 63). L’ancienne attribution de cette statue, qui fut un moment transformée en Notre-Dame des Sept Douleurs, à Coquelet avait été proposée par Ferdinand Courtoy, elle ne peut être retenue143. Épitaphe de Nicolas de Saint-Fontaine († 1642) et Charlotte de Haultpenne Cette belle épitaphe conservée à la chapelle Notre-Dame de Saint Fontaine est occupée en son centre par l’inscription dédicatoire avec autour les quartiers des défunts144. Au sommet du couronnement, la Vierge à l’Enfant du type de celle d’Hertogenbosch, les défunts étant agenouillés de part et d’autre. Fragments d’un retable d’autel à Vianden (ca 1618 ?) Fig. 62 : Atelier Thonon. Saint Jean de Calvaire. Bois. Église de Saint-Aubin. © Michel Lefftz.
La prédelle du retable de l’autel du Saint-Sacrement à Vianden comporte deux bas-reliefs en albâtre représentant l’Annonciation et l’Adoration des Bergers. Une reproduction photographique de ce der-
138. Dom Cyrille Lambot et consignées dans Edifices et curiosités de l’abbaye de Florennes, paru dans la revue Florinas en 1965 et réédité dans Millénaire de l’abbaye Saint-Jean-Baptiste et Saint-Maur, in Florinas, 1-2, 2011, p. 24. 139. Communication écrite du propriétaire des lieux, Mr Antoine Mincé du Fontbaré de Fumal, 16 avril 2011. La découverte de photos ou de dessins permettrait peut-être d’en reconstituer le programme. 140. Ces colonnettes de 71 cm de hauteur avaient aussi été remarquées par Dom Cyrille Lambot et consignées dans Edifices et curiosités de l’abbaye de Florennes, paru dans la revue Florinas en 1965 et réédité dans Millénaire de l’abbaye Saint-Jean-Baptiste et Saint-Maur, in Florinas, 1-2, 2011, p. 24. 141. Notre communication Le calvaire reconstitué de l’abbaye de Florennes ? a été présentée le 9 avril 2011 à la journée d’étude Une abbaye d’Entre-Sambre-et-Meuse à la croisée des chemins, à l’abbaye de Maredsous. 142. La date des trois clichés de l’Institut royal du patrimoine artistique indique qu’ils furent pris en 1944. 143. Ferdinand Courtoy, Les Duchesne tailleurs de pierres et marbriers namurois, in ASAN, 43, 1938, p. 289 : « Jean Duchesne entreprit à la même époque la façon du gracieux autel de Notre-Dame des Sept Douleurs, qui orne le collatéral gauche de la cathédrale Saint-Aubain. Une enquête du Conseil provincial nous apprend qu’il ne put faire les ‘statues, troignes (figures) et autres semblables ouvrages dépendant du métier des menuisiers’ : il dut employer, à cette fin, Guillaume Coquelet, maître tailleur d’images ». En note 16, F. Courtoy conclut : « Cette indication nous permet ainsi d’attribuer la statue de bois de la Vierge de cet autel à Guillaume Coquelet, qui sculpta les SS Pierre et Paul du chœur de l’église Saint-Loup, comme nous l’avons dit dans les Annales de la Société archéologique de Namur, XLII, p. 12 ». 144. On trouvera la bibliographie récente dans : Hadrien KOCKEROLS, Monuments funéraires en pays mosan. Arrondissement de Huy, Malonne, 1999, p. 205. 264
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
nier nous permet de l’attribuer à l’atelier Thonon145. Il s’agit, en quelque sorte, d’une version réduite et simplifiée de l’Adoration des Bergers de Nivelles. Fragments de bas-reliefs illustrant la vie du Christ au Musée Curtius Lors d’une visite dans les réserves du Musée Curtius, en 2008, nous avions réassemblé les deux fragments d’un bas-relief en albâtre représentant la Flagellation du Christ (fig. 64-65)146. La figure du bourreau est à rapprocher de celle du serviteur de dos, à l’arrière-plan de l’épitaphe de François Oranus à la cathédrale de Liège. Plusieurs autres fragments semblent provenir du même ensemble ; on y reconnaît une Arrestation du Christ ( ?) (fig. 70) (I.0.2017), un Portement de croix (fig. 66), un Christ de la Résurrection (fig. 67). Il faut peut-être aussi y ajouter le fragment d’un Jugement Dernier (fig. 68), celui d’un Couronnement de la Vierge (fig. 69) (I 836) et d’une Pentecôte (?) (fig. 71). Enfin, on peut ajouter à cet ensemble un bas-relief de la Circoncision qui pourrait provenir de l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste à Liège.
Fig. 68 : Atelier Thonon. Fragment d’un relief du Jugement Dernier. Albâtre. Liège, Musée Grand Curtius. © Michel Lefftz.
Médaillon de la Résurrection du Christ provenant de Flône Ce beau relief en médaillon se trouvait encore en 1970 à l’église Saint-Mathieu de Flône. Depuis, il est passé dans la collection du château de Jehay. La face bombée de la plaque d’albâtre accentue l’effet illusionniste de la profondeur obtenue par la saillie progressive des formes à partir du fond du médaillon. On
145. Jospeh WALENTINY, La sculpture au Luxembourg à l’époque de la Renaissance, Luxembourg, 1986, p. 192-193, fig. 41. 146. Le plus grand des deux fragments mesure 49 x 34 cm ; tous deux sont sans numéro d’inventaire. 265
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
peut aisément rattacher cette œuvre à l’atelier Thonon en observant les longs plis parallèles du manteau du Christ dont l’angulosité des brisures est volontairement accentuée pour créer des effets de contraste. Épitaphes liégeoises à Saint-Paul et à Saint-Martin Quatre épitaphes liégeoises présentant des caractéristiques semblables sont rassemblées ici. Il s’agit de celle de Baudouin Goff (†1570) (fig. 72-73), et de celle de Pierre Vogels († 1576) (fig. 74-75) à la cathédrale Saint-Paul ; de Gilles Voroux (1576) (fig. 76-77), et de Jean Wibroux (†1590) (fig. 78-79), à l’église Saint-Martin147. Les dates de décès des défunts, fort précoces par rapport à l’activité de Jean II Thonon, pourraient parfaitement correspondre à celle de Jean I, bourgeois d’Anvers en 1570. Le traitement morphologique des figures des défunts agenouillés relève d’un même type et d’un style très semblable. Le drapé mouvementé de la figure du Christ trouve sa correspondance dans celui de la Vierge de l’épitaphe de Jean Wibroux. L’iconographie plus riche de ce dernier relief se prête naturellement davantage à des comparaisons stylistiques. Il était aisé de la faire avec les bas-reliefs de la vie de saint Martin, déjà mentionnés dans la crypte de l’église Saint-Martin, et attribués à l’atelier Thonon. On comparera notamment les figures d’anges, mais aussi celle de l’enfant de chœur agenouillé derrière saint Martin dans la scène de l’offrande devant l’autel.
Fig. 73 : Atelier Thonon. Épitaphe de Baudouin Goff (†1570). Marbre noir. Liège, cathédrale. © Michel Lefftz.
Deux statues de chanoines en prière, aux Musée du Louvre et au Musées royaux d’art et d’histoire de Belgique
Les figures de défunts des monuments funéraires analysés ci-avant et conservés dans les églises liégeoises de SaintPaul et de Saint-Martin, ainsi que celle de l’enfant de chœur soutenant la chape de saint Martin dans la scène de la Messe miraculeuse peuvent servir de base à l’attribution des deux belles statues très semblables de chanoines en prière conservées, l’une au Musée du Louvre (fig. 80-81)148 et l’autre aux Musées royaux d’art et d’histoire de Belgique149. Comme huit autres statues en albâtre, celle du Louvre pourrait provenir de la cathédrale de Cambrai, détruite sous la Révolution. Rien n’empêche donc à priori de la rattacher à l’atelier des Thonon, mais peut-être faudraitil s’interroger alors sur l’attribution des deux autres statues de figures assises, qui semblent appartenir à un même groupe : il s’agit d’une statue de Dieu le Père et d’une autre de Saint-Jean l’évangéliste, également conservées au Louvre150.
147. On trouvera la bibliographie récente dans : Hadrien KOCKEROLS, Monuments funéraires en pays mosan. Arrondissement de Liège, Malonne, 2004, p. 278, 286, 288, 290. 148. Inv. N° RF 1440, albâtre, h. 77,8 cm, début du XVIe siècle. Jean-René GABORIT (dir.), Sculpture française II – Renaissance et Temps Modernes. Vol. 2 Goujon- Warin et anonymes, Paris, 1998, p. 679. Attribué au Nord de la France ou aux Pays-Bas méridionaux. 149. Inv. n° 6660, albâtre. 150. Inv. N° RF 1441, h. 110 cm et RF 1442, h. 92 cm, toutes deux en albâtre, début du XVIe siècle. Jean-René GABORIT (dir.), Sculpture française II – Renaissance et Temps Modernes. Vol. 2 Goujon- Warin et anonymes, Paris, 1998, p. 679. Attribué au Nord de la France ou aux Pays-Bas méridionaux. 266
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Une Vierge et un saint Jean de Calvaire au Musée Curtius Ces deux statuettes en albâtre parfois attribuées à Thomas Tollet et supposées provenir de la chapelle des Flamands à l’ancienne cathédrale Saint-Lambert à Liège nous paraissent plutôt devoir être données à l’atelier Tollet sur base de critères stylistiques (fig. 82-83)151. Pour s’en convaincre, on les comparera utilement aux figures des reliefs de la crypte de Saint-Martin.
Fig. 82 : Atelier Thonon. Vierge de Calvaire. Albâtre. Liège, Musée Grand Curtius. © Michel Lefftz.
Fig. 83 : Atelier Thonon. Saint Jean de Calvaire. Albâtre. Liège, Musée Grand Curtius. © Michel Lefftz.
Fragments d’un retable d’autel à l’église de l’Immaculée Conception de Châtelet L’actuelle église Notre-Dame de l’Immaculée Conception de Châtelet conserve des fragments mobiliers en marbre et albâtre provenant de l’ancienne église paroissiale. Ainsi, une niche abritant une statue de la
151. Hauteur de la Vierge : 64,5 cm ; hauteur du saint Jean : 64 cm. Toutes deux avaient les pupilles incrustées d’une matière différente. 267
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Vierge à l’Enfant de la même composition que celle d’Hertogenbosch et deux figures féminines couchées, sans doute des allégories religieuses, ont été intégrées au-dessus d’un autel latéral. Le maître-autel de la fin du XIXe siècle intègre également des fragments architectoniques de l’ancien mobilier du début du XVIIe siècle, ainsi que des chérubins et deux statues représentant sainte Anne Trinitaire et saint Joseph avec l’Enfant Jésus. Conclusions Voici mise en place l’ossature du sujet que nous nous étions proposé de traiter. On constate d’emblée que si le matériel s’est révélé riche et abondant, il demande néanmoins un traitement plus fouillé pour donner lieu aux interprétations. Cependant certaines grandes lignes apparaissent déjà, nous présenterons ici les plus importantes d’entre elles. Tout d’abord, on constate la mise en place progressive de la suprématie liégeoise comme centre majeur de production. La migration des artistes vers Liège l’atteste, la dualité entre Dinant, Namur et Liège disparaît donc au profit de cette dernière dans le courant du XVIIe siècle. Ainsi, à Dinant : Robert Henrard (16171676) déclarait être parti pour Liège afin d’assurer sa formation, mais après un voyage d’Italie il retournera dans la Cité ardente pour y faire carrière. Jean Thonon III ira s’installer lui aussi à Liège pour y exercer ses activités. Namur subit le même sort puisque les sculpteurs Lambert Duhontoir (1603-1661) et Guillaume Coquelé († 1686), tous deux originaires de Namur iront s’installer à Liège pour pratiquer leur art. Le premier des deux y est actif dès le milieu du siècle et il sera admis au service de la cathédrale en 1654152. Le second acquiert sa maîtrise à Namur en 1652-1653, mais quelques années plus tard il est forcé de quitter la ville faute d’emploi. Au décès de Lambert Duhontoir qu’il retrouvera à Liège, il épousera sa veuve et poursuivra ses affaires153. Un second constat que l’on peut formuler ici porte sur la méthode de travail. On l’aura compris, il serait vain de tenter d’étudier la sculpture en pierre sans envisager l’ensemble du milieu de la production et de la commercialisation de la pierre en région mosane. Inutile donc de songer à une approche prosopographique étroite des sculpteurs, mais au contraire il s’avère nécessaire de traiter des relations reliant les divers protagonistes de ce milieu, en prenant en compte ceux qui interviennent depuis l’extraction jusqu’à la commercialisation des matériaux pierreux. À partir des divers exemples traités ici, on comprend déjà que si ces réseaux étaient structurés à géométrie variable afin de répondre aux besoins des commanditaires, il apparaît déjà aussi que des relations privilégiées et souvent durables s’étaient établies. De nombreux protagonistes restent encore à identifier dans cette histoire de la sculpture ; les noms de certains d’entre eux ont déjà été exhumés, mais ils restent isolés, car les œuvres à leur donner font défaut. D’autres comme les Bidart, marchands de pierre et sculpteurs namurois connus comme maître d’œuvre pour la réalisation du portail des Jésuites de Saint-Omer154 et pour le jubé de l’abbaye Saint-Jean à Valenciennes, devraient enfin révéler toute leur importance155. Une chose est certaine, c’est que la conclusion de Simon Brigode, formulée il y a plus d’un demi-siècle, a vécu : « En tant que période de transformations profondes, notre XVIe siècle est bien digne d’intérêt ; mais peut-être l’est-il surtout par ses humanistes et certains de ses peintres. Il faut reconnaître qu’il est moins captivant si l’on n’étudie que ses architectes et ses sculpteurs. Tout compte fait, notre XVIe siècle ne fut pas un siècle de splendeur artistique »156. L’auteur avait bien évidemment les modèles de la Renaissance florentine
152. Michel LEFFTZ, La sculpture baroque liégeoise, Louvain-la-Neuve, 1998, II-14, Répertoire des sculpteurs, p. 29-30. 153. Michel LEFFTZ, La sculpture baroque liégeoise, Louvain-la-Neuve, 1998, II-14, Répertoire des sculpteurs, p. 9-10. 154. A. O., Thiéry Bidart, sculpteur namurois, auteur du portail de l’église des Jésuites wallons à Saint-Omer, in Annales de la Société archéologique de Namur, 20, 1893, p. 504-505. 155. A.-M. Et P. PIÉTRESSON DE SAINT-AUBIN , (5 janvier 1615), marché entre l’abbé de Saint-Jean à Valenciennes et Thierry Bidart, sculpteur, pour la construction d’un jubé dans l’église abbatiale, in Revue du Nord, 23, 1937. 156. Simon BRIGODE, La sculpture au XVIe siècle, in P. F IRENS (dir.), L’art en Belgique du Moyen Âge à nos jours, Bruxelles, s.d., p. 208. 268
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
du Quattrocento à l’esprit lorsqu’il analysait les œuvres. Nous l’avons vu, les sculpteurs mosans ont eu recours à des modèles de leur temps et notamment aux œuvres d’Andrea Sansovino. Enfin, pour conclure, on proposera encore ici une hypothèse de travail pour des recherches futures : les grands marchands de pierre comme les Tabaguet n’auraient-ils pas proposé une sorte de catalogue de mobilier liturgique et funéraire à leurs clients moyennement fortunés ? Dans quelle mesure, la transformation des pierres mises en œuvre dans la réalisation de ce mobilier, à proximité des sites d’exploitation, a-t-elle entraîné une certaine forme de production standardisée ? On pourra vérifier ces pistes de recherche en dressant le catalogue complet de la production et en caractérisant minutieusement ces œuvres dont le style semble se distinguer plus qu’on ne l’avait pensé jusqu’ici de celui du célèbre Cornelis Floris.
269
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 1-2 : Thomas Tollet (?). Prophètes, ca 1566 (?), albâtre, Tongres, église Notre-Dame. © Michel Lefftz.
Fig. 3-5 : Thomas Tollet (?). Prophètes, ca 1566 (?), albâtre, Tongres, église Notre-Dame. © Michel Lefftz. 270
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 7 : Thomas Tollet (dessin d’après). Mausolée de François de Clèves et Marguerite de Bourbon. © BNF, Ms français 8226, f° 358 r°. 271
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 9 : Jean Tabaguet, le Péché originel (1585-1589), Sacro Monte de Varallo (Italie).
272
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 12 : Cénotaphe d’Hadelin de Royer avec Mise au Tombeau du Christ, ca 1640. Pierre polychromée et marbres. Huy, église Notre-Dame. © Michel Lefftz. 273
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 15a : Thomas Tollet. Monument funéraire d’Antoine de Carondelet (ca 1583-1587 ?). Marbre noir et albâtre. Mons, collégiale Sainte-Waudru. © Michel Lefftz. 274
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 15b : Thomas Tollet. Monument funéraire d’Antoine de Carondelet (ca 1583-1587 ?). Marbre noir et albâtre. Mons, collégiale Sainte-Waudru. © Michel Lefftz. 275
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 17 : Thomas Tollet (?). Sainte Catherine, fin XVIe s. ? Albâtre. Huy collégiale Notre-Dame. © Michel Lefftz. 276
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 18 : Thomas Tollet ( ?). Saint Domitien ( ?), fin XVIe s. ? Albâtre. Huy, collégiale Notre-Dame. © Michel Lefftz. 277
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 20 : Dessin de H. VAN DEN BERCH d’après le manuscrit de l’Estat et la saincte et noble cité de Liège. 278
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 23-24 : Atelier Thonon. Jubé d’Hertogenbosch, ca 1615. Marbre noir et albâtre. Londres, Victoria & Albert Museum. © Londres, Victoria & Albert Museum.
279
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 25 : Atelier Thonon. Jubé d’Hertogenbosch, ca 1615. Marbre noir et albâtre. Londres, Victoria & Albert Museum. © Londres, Victoria & Albert Museum.
Fig. 26 : Atelier Thonon. Jubé d’Hertogenbosch, ca 1615. Marbre noir et albâtre. Londres, Victoria & Albert Museum. © Londres, Victoria & Albert Museum. 280
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 28 : Atelier Thonon. Vierge à l’Enfant, bois. Liège, Musée Grand Curtius. © Michel Lefftz.
Fig. 29 : Atelier Thonon. Vierge à l’Enfant, bois. Liège, Musée Grand Curtius. © Michel Lefftz. 281
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 31 : Atelier Thonon. Messe miraculeuse de saint Martin. Albâtre. Liège, église Saint-Martin. © Michel Lefftz.
Fig. 33 : Atelier Thonon. Le couronnement de la Vierge. Albâtre. Liège, église Saint-Martin. © Michel Lefftz. 282
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 35 : Atelier Thonon. Ange. Albâtre. Tongres, église Notre-Dame. © Michel Lefftz. 283
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 36 : Atelier Thonon. Retable de l’autel de Pierre Oranus (ensemble et détails, ca 1618). Marbre noir et albâtre. Liège, cathédrale Saint-Paul. © Michel Lefftz. 284
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 37 : Atelier Thonon. Retable de l’autel de Pierre Oranus (ensemble et détails, ca 1618). Marbre noir et albâtre. Liège, cathédrale Saint-Paul. © Michel Lefftz.
Fig. 38 : Atelier Thonon. Retable de l’autel de Pierre Oranus (ensemble et détails, ca 1618). Marbre noir et albâtre. Liège, cathédrale Saint-Paul. © Michel Lefftz. 285
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 39 : Atelier Thonon. Retable de l’autel de Pierre Oranus (ensemble et détails, ca 1618). Marbre noir et albâtre. Liège, cathédrale Saint-Paul. © Michel Lefftz.
Fig. 40 : Atelier Thonon. Retable de l’autel de Pierre Oranus (ensemble et détails, ca 1618). Marbre noir et albâtre. Liège, cathédrale Saint-Paul. © Michel Lefftz. 286
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 41 : Atelier Thonon. Retable de l’autel du noviciat des Jésuites à Tournai (ca 1618). Marbre noir et albâtre. Tournai, Athénée. © Michel Lefftz. 287
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 42: Atelier Thonon. Retable de l’autel du noviciat des Jésuites à Tournai (ca 1618). Marbre noir et albâtre. Tournai, Athénée. © Michel Lefftz.
Fig. 43 : Atelier Thonon. La dernière Cène. Retable de l’autel du noviciat des Jésuites à Tournai (ca 1618). Marbre noir et albâtre. Tournai, Athénée. © Michel Lefftz. 288
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 45 : Atelier Thonon ( ?). Portail du noviciat des Jésuites à Tournai (détail, restauré ?). Pierre. Tournai, Athénée. © Michel Lefftz. 289
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 46-47 : Atelier Thonon. Salvator Mundi (ca 1620 ?). Albâtre. Tournai, cathédrale. © Michel Lefftz.
Fig. 49 : Atelier Thonon. Saint Pierre (détail, ca 1629). Albâtre. Nivelles, collégiale. © Michel Lefftz. 290
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 50 : Atelier Thonon. Scènes de la vie de sainte Gertrude (ca 1629). Albâtre. Nivelles, collégiale. © Michel Lefftz.
Fig. 51 : Atelier Thonon. Scènes de la vie de sainte Gertrude (ca 1629). Albâtre. Nivelles, collégiale. © Michel Lefftz. 291
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 52 : Atelier Thonon. Scènes de la vie de sainte Gertrude (ca 1629). Albâtre. Nivelles, collégiale. © Michel Lefftz.
Fig. 53 : Atelier Thonon. Scènes de la vie de sainte Gertrude (ca 1629). Albâtre. Nivelles, collégiale. © Michel Lefftz. 292
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 54 : Atelier Thonon. Scènes de la vie de sainte Gertrude (ca 1629). Albâtre. Nivelles, collégiale. © Michel Lefftz.
Fig. 55 : Atelier Thonon. Scènes de la vie de sainte Gertrude (ca 1629). Albâtre. Nivelles, collégiale. © Michel Lefftz. 293
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 56 : Atelier Thonon. Scènes de la vie de sainte Gertrude (ca 1629). Albâtre. Nivelles, collégiale. © Michel Lefftz.
Fig. 57 : Atelier Thonon. Scènes de la vie de sainte Gertrude (ca 1629). Albâtre. Nivelles, collégiale. © Michel Lefftz. 294
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 58 : Atelier Thonon. Adoration des Bergers (ca 1629). Albâtre. Nivelles, collégiale. © Michel Lefftz.
295
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 59 : Gravure tirée de la Vie de sainte Gertrude par J. G. van Ryckel. © Michel Lefftz. 296
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 60 : Atelier Thonon. Épitaphe de François Oranus (†1636). Marbre noir et albâtre. Liège, cathédrale. © Michel Lefftz. 297
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 63 : Atelier Thonon. Vierge de Douleur. Bois. Cathédrale de Namur. © Michel Lefftz. 298
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 64 : Atelier Thonon. Fragments d’un relief de la Flagellation du Christ. Albâtre. Liège, Musée Grand Curtius. © Michel Lefftz.
Fig. 65 : Atelier Thonon. Fragments d’un relief de la Flagellation du Christ. Albâtre. Liège, Musée Grand Curtius. © Michel Lefftz. 299
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 66 : Atelier Thonon. Fragment d’un relief du Portement de croix. Albâtre. Liège, Musée Grand Curtius. © Michel Lefftz.
Fig. 67 : Atelier Thonon. Fragment d’un relief de la Résurrection du Christ (?). Albâtre. Liège, Musée Grand Curtius. © Michel Lefftz. 300
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 69 : Atelier Thonon. Couronnement de la Vierge. Albâtre. Liège, Musée Grand Curtius. © Michel Lefftz.
Fig. 70 : Atelier Thonon. Fragment d’un relief de l’Arrestation du Christ (?). Albâtre. Liège, Musée Grand Curtius. © Michel Lefftz. 301
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 71 : Atelier Thonon. Fragment d’un relief de la Pentecôte (?). Albâtre. Liège, Musée Grand Curtius. © Michel Lefftz.
Fig. 72 : Atelier Thonon. Épitaphe de Baudouin Goff (†1570). Marbre noir. Liège, cathédrale. © Michel Lefftz. 302
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 74-75 : Atelier Thonon. Épitaphe de Pierre Vogels († 1576). Marbre noir et jaspé. Liège, cathédrale. © Michel Lefftz.
303
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 76-77 : Atelier Thonon. Épitaphe de Gilles Voroux (1576). Albâtre, marbre noir et jaspé. Liège, église Saint-Martin. © Michel Lefftz.
304
LA SCULPTURE DANS L’ANCIEN DIOCÈSE DE LIÈGE JUSQU’AUX PRÉMICES DU BAROQUE
Fig. 78-79 : Atelier Thonon. Épitaphe de Jean Wibroux (†1590). Albâtre, marbre noir et jaspé. Liège, église Saint-Martin. © Michel Lefftz.
305
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 80-81 : Atelier Thonon. Chanoine en prière. Albâtre. Paris, Musée du Louvre. © Michel Lefftz.
306
LA GRAVURE Jean-Patrick Duchesne
En théorie, la naissance et le développement d’une école de gravure, en Europe occidentale comme au Japon, repose sur des facteurs cumulatifs : une connexion avec les foyers où se décide ou est relayé « le goût du jour », un milieu propice à la formation d’une élite de praticiens, soit, hic et nunc, une importante activité en matière d’orfèvrerie, l’action d’éditeurs et de relais marchands, ainsi qu’une clientèle prospère et à prétention cultivée. Si la principauté de Liège, gagnée à la Renaissance sous l’impulsion d’un prince d’exception, Erard de la Marck, et de son principal protégé, le peintre et architecte Lambert Lombard (1505-1566) est en mesure d’exploiter les deux premiers atouts, tout en imposant une inspiration italianisante durable, puisqu’elle s’étend à toute la période sous rubrique, elle peinera longtemps à conquérir les deux autres. L’éclosion de talents demeurera assurée du milieu du XVIe siècle à la fin du XVIIIe mais avec pour corollaire constant l’évasion des meilleurs vers des cieux commercialement plus cléments, en Allemagne puis en France. Le règne d’Ernest de Bavière débute environ quatorze ans après le décès du premier praticien d’envergure, Lambert Zutman, alias Suavius (vers 1510-vers 1567). Quatre graveurs au burin sont actifs ou naissent à Liège sous son règne. Leur doyen, dont les fils et successeurs, Jean-Théodore (1563-1623) et Jean-Israël (1565-1609) ne verront jamais sa ville natale, Théodore de Bry (vers 1527-1598) ne s’adonne à l’estampe qu’après avoir rejoint Strasbourg, vers 1560. Après un détour par Londres en 1587-1588, il opte définitivement pour Francfort, où l’a précédé Suavius et où il s’est marié dès 1570. Le cadet, Michel Natalis (16101668), que nous mettrons de côté par la suite, puisqu’il n’a vu le jour que deux ans avant le décès du prince, ne sera liégeois que par intermittence, son parcours étant jalonné de déplacements professionnels à Rome, à Anvers, à Paris, où il aurait dû terminer sa carrière, et à la cour de l’empereur Léopold Ier. En dépit du privilège de faire « à l’exclusion de tous, toutes sortes d’images pieuses en notre cité et pays de Liège » que lui a accordé Ferdinand de Bavière, Jean Valdor l’aîné (vers 1580-après 1632), formé à Anvers, ne résistera pas à l’appel du pied de Charles IV, duc de Lorraine. Il se signale dès lors de 1627-1628 à 1632 à Nancy, qu’il quitte sans plus laisser de trace. Seul Pierre Furnius (1540/50-1610/18 ou vers 1626) demeurera fidèle à la cité ardente, hormis un possible séjour de perfectionnement à Anvers, dans l’atelier de Frans Floris, comme lui ancien élève de l’Académie ouverte par Lombard. Notons que l’attribution des départs vers des villes protestantes aux opinions religieuses des artistes a été depuis longtemps remise en cause au profit de motivations économiques. Revenons à Théodore de Bry pour pointer que son autoportrait (ou le portrait que son fils Jean-Théodore lui aurait dédicacé) revendique encore son origine liégeoise. Comme cette référence à la mère patrie demeurera constant chez les Liégeois expatriés jusqu’à la fin du XVIIIe siècle et que cette image a été incorporée à la plus ancienne affiche commerciale illustrée connue, il y a lieu d’hésiter entre l’expression d’une nostalgie ou la mise en avant d’un label de qualité. Comme avant lui Suavius et à sa suite Furnius, il est issu d’une famille d’orfèvres et instruit comme tel. Devenu graveur, il accède à Francfort au rang de libraire et d’éditeur. Associé à ses fils Jean-Théodore et Jean-Israël, il publie de nombreux ouvrages illustrés : recueils de modèles pour orfèvres, emblèmes, alphabets ornés, fleurs, portraits d’hommes illustres, sans oublier les justement célèbres Grands et Petits voyages (1590-1634), qui relatent des expéditions contemporaines en Amérique et aux Indes, sur base des comptes rendus et des dessins réunis par les explorateurs. Les de Bry ont en outre gravé d’après Dürer, Beham, Giulio Romano, le Titien, Jérôme Wierix et Jodocus van Winghe. C’est surtout en tant que graveur de reproduction qu’exerça Pierre du Four ou Furnius, qui fut aussi peintre et sculpteur. Sa réalisation la plus importante est la série des Vices et des vertus, d’après Jan van der Straet, dit Stradanus. À la suite de Suavius, il collabora avec l’éditeur anversois Jérôme Cock. Bien qu’il ait été distingué par Ferdinand de Bavière, Jean Valdor l’Aîné fut certainement un artiste en relation avec Ernest, comme en témoigne la suite des Œuvres de miséricorde, réalisée en 1604, dans la fou-
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
lée du don accordé par le souverain de son palais d’Outre-Meuse à la Compagnie de la Miséricorde, en vue d’ériger l’hôpital, qui perpétua la mémoire de son nom. Valdor I a aussi laissé des vignettes hagiographiques et de nombreux portraits, tels ceux de Jean-Baptiste de Glen, d’Oger de Loncin et de Nicolas de Rebbe. Il est surtout le père de Jean Valdor le jeune, qui, aux côtés de Jean Varin, implanta à Paris, dès le début du règne de Louis XIV, un efficace lobby de spécialistes de la gravure de monnaies, de médailles et d’estampes, où brilleront Michel Natalis, les Duvivier, les Demarteau et les Redouté.
BIBLIOGRAPHIE Eugène BENEZIT, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, 10 vol., Paris, Librairie Gründ, 1976. Véronique BÜCKEN, Théodore de Bry et Joos Van Winghe à Francfort. Un exemple de collaboration entre peintre et éditeur à la fin du XVIe siècle, dans Art&fact, n° 15, Mélanges Pierre Colman, 1996, p. 108111. Suzanne COLLON-GEVAERT, Le graveur liégeois Théodore de Bry (1528-1598), raconte la conquête du Pérou, in Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, t. VII, n° 153, 1966, p. 29-53. Pierre COLMAN, Rétrospective Théodore, Jean-Théodore et Jean-Israël de Bry, dans Première biennale internationale de gravure de Liège, catalogue d’exposition, Liège, 1969, p. 71-87. Alexia CREUSEN, De l’estampe à la sérigraphie. L’image imprimée en Wallonie des origines à nos jours, Bruxelles, Crédit Communal et La Renaissance du Livre, 2000, p. 207-242. Lydia DE PAUW-DE VEEN, Jérôme Cock. Éditeur d’estampes et graveur. 1507-1570, Bruxelles, Bibliothèque royale Albert Ier, 1970. Jean-Patrick DUCHESNE, L’affiche en Belgique. Art et pouvoir, Bruxelles, Éditions Labor, 1989. Jean-Patrick DUCHESNE, Les arts et les lettres à l’Époque moderne. La musique et les arts plastiques, dans DEMOULIN, Bruno et KUPPER, Jean-Louis (dir.), Histoire de la Wallonie, Toulouse, Privat, 2004, p. 222-232. Jean-Patrick DUCHESNE (dir.), Le patrimoine artistique de l’Université de Liège, Liège, Éditions du Perron, 1993 M. DUCHET (dir.), L’Amérique de Théodore de Bry. Une collection de voyages protestante du XVIe siècle. Quatre études d’iconographie, Paris, éditions du CNRS, 1987. F.-W.-H. HOLLSTEIN, Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, 1450-1700, 48 vol., Amsterdam, 1949-1997. Jean HOUSEN, Jean-Théodore de Bry, dans Livres d’images - Images du livre. L’illustration du livre de 1501 à 1831 dans les Collections de l’Université de Liège, Bruxelles, Crédit Communal de Belgique, 1998, p. 12. René JANS, Précisions sur le peintre-graveur Pierre Furnius et sa famille, in Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 99, 1987, p. 153-167. Marguerite M. JANSSEN-DELVAUX, La Renaissance à Liège. XVIe siècle, Gembloux, 1971, collection Wallonie, Art et histoire. Laurence JOTTARD, Les graveurs, dans Jacques STIENNON, Jean-Patrick DUCHESNE, Yves, RANDAXHE, De Roger de le Pasture à Paul Delvaux. Cinq siècles de peinture en Wallonie, Bruxelles, Lefebvre & Gillet, 1988, p. 125-134. M. LANOYE, A propos des Album Amicorum des de Bry, dans Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois, vol. XVI, 1942, p. 65-75. Louis LEBEER, Jean Valdor, dans Biographie nationale, Bruxelles, tome XXVI, 1936-1938, colonnes 64-79. 308
LA GRAVURE
Isabelle MALAISE-ENGAMMARE, Théodore de Bry et Bartholomé de Las Casas. Images de la dissidence religieuse, dans Art&fact, n° 15, Mélanges Pierre Colman, 1996, p. 112-115. Alfred MICHA, Les graveurs liégeois, Liège, Bénard, 1908. Jean PURAYE, Pierre Furnius, graveur liégeois du XVIe siècle, in Miscellanea J. Gessler, t. II, 1948, p. 1016-1025. J.-S. RENIER, Les Valdor, graveurs liégeois, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 1865. K. G. SAUR, Allgemeines Künstler-Lexikon, Munich et Leipzig, depuis 1992. Le siècle de Bruegel. La peinture en Belgique au XVIe siècle, catalogue d’exposition, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1963, p. 216. Ulrich THIEME et Felix BECKER, Allgemeines Lexikon der bildenden Kùnstler von der Antike bis zur Gegenwart, t. V, Leipzig, 1911, p. 162-163, t. X, Leipzig, 1914, p. 91, t. XXXV, Leipzig, 1942, p. 77-78. Trésors d’art de la Collection Wittert (XVe-XIXe siècle) Université de Liège, catalogue d’exposition, Liège, salle Saint-Georges, 1983.
309
ERNEST DE BAVIÈRE : UN MÉCÈNE ATTENTIF À L’ART DU VITRAIL (1581-1612) Isabelle Lecocq
La ville de Liège a été durant l’Ancien Régime un grand centre de production de vitraux, favorisé par le mécénat des princes-évêques. Les hasards de la conservation font que les splendides ensembles conservés dans les édifices liégeois majeurs, la cathédrale Saint-Paul, la basilique Saint-Martin et l’église Saint-Jacques, datent des années 1530 et sont contemporains du règne d’Érard de La Marck (1505-1538), qui a d’ailleurs offert plusieurs verrières de ces ensembles. Les seuls vitraux monumentaux de l’Ancien Régime postérieurs au milieu du XVIe siècle actuellement en place à Liège ornent l’abside du chœur de la cathédrale Saint-Paul et datent des années 1557-15591. La présente contribution2 est organisée en deux parties. La première envisage les commandes du princeévêque et de son administration, ainsi que celles de diverses personnalités de Liège et de la principauté. La seconde examine six œuvres créées dans les années 1580 pour l’église Saint-Servais, située derrière l’actuelle gare de Liège Palais, et dont l’une avait été offerte par Ernest de Bavière. Cet ensemble, malheureusement détruit par un incendie, était un patrimoine artistique majeur. Vitraux réalisés pour le compte d’Ernest de Bavière Des princes-évêques qui ont succédé à Érard de La Marck durant le XVIe siècle3, Ernest de Bavière (15811612) est certainement celui dont le mécénat dans le domaine du vitrail est le mieux connu. La comptabilité des princes-évêques conserve le souvenir d’une vingtaine de vitraux (petites verrières, verrières, fenêtres) armoriés ou aux armes du Prince, offerts entre 1587 et 1596 à des particuliers, des communautés religieuses, des églises, des abbayes, des couvents de Liège et des environs4. Ces comptes précisent parfois l’iconographie et les noms des verriers (vitrifex) chargés de l’exécution : Tilman Pisset, Thiry de Leumont, Jean de Bastogne, Antoine et Hubert Wypart, Guillaume Smelz et François Lowichs. Antoine Wypart semble accaparer les commandes de vitraux historiés passées par Ernest de Bavière. Il appartient à une famille de verriers qui s’est établie à Liège, vraisemblablement sous le règne d’Érard de La Marck. En 1586-1587, Antoine Wypart est chargé de la confection de trois vitraux destinés à l’église SaintServais de Liège5, à l’abbaye de Robermont6 et à l’église de l’abbaye du Val-Benoît7, payés respectivement 120, 70 et 150 florins de Brabant. En 1596, il reçoit du prince-évêque Ernest de Bavière la somme de 230 florins pour une grande verrière destinée à l’église des Jésuites8. Le prélat prend à sa charge également les 1. Voir LECOCQ I., Les vitraux de la seconde moitié du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe siècle conservés en Belgique. Provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège et de Namur (Corpus Vitrearum Belgique, VI), Bruxelles, 2011, p. 475-578. 2. Cet article a bénéficié des lectures et des commentaires judicieux d’Yvette Vanden Bemden et d’Yves Dubois. Je les en remercie chaleureusement. 3. Outre Ernest de Bavière, Corneille de Berghes (1538-1544), Georges d’Autriche (1544-1557), Robert de Berghes (1557-1564) et Gérard de Grœsbeck (1564-1580). 4. Les comptes des dépenses des évêques de Liège sont conservés aux Archives de l’État à Liège. La collection embrasse la seconde moitié du XVIe siècle ; A. Pinchart a publié dans ses Archives des arts, sciences et lettres les comptes rapportant les paiements des vitraux offerts par Ernest de Bavière depuis 1587 jusque 1596 (PINCHART A., Archives des arts, sciences et lettres. Documents inédits, vol. 2, Gand, 1863, p. 9). 5. PINCHART A., op. cit., p. 9. Paiement le 19 février 1587 (terminus ante quem). Voir également J. Yernaux qui cite le compte en question mais qui, pour le paiement, donne la date du 14 février 1587 (voir YERNAUX J., « L’art du vitrail au Pays mosan », dans Bulletin de la Société des Bibliophiles liégeois, t. 18, 1951, p. 146 [n. 1]) : Item XIV februari, anno 1587, solvi Anthonio Wypart, pro una vitrea fenestra Principis nomine constitua in abbatia de Robertimonte, de mandato œconomi, LXX fl. bb. Item eidem, eodem die, pro una vitrea fenestra Principis nomine constitua in ecclesia S. Servatii Leodii, juxta cedulam castellani, centum XX fl. bb. 6. PINCHART A., op. cit., p. 9 et HELBIG Jean, De glasschilderkunst in België. Repertorium en documenten, vol. 1, Anvers, 1943, R. 1386. Paiement en février 1587 (terminus ante quem). 7. BREUER J., « Les orfèvres du Pays de Liège. Une liste des membres du métier », dans Bulletin de la Société des Bibliophiles liégeois, t. 12, 1935, no 207 ; PINCHART A., op. cit., p. 9 ; HELBIG Jean, op. cit., R. 1389. Paiement en janvier 1588 (terminus ante quem). 8. PINCHART A., op. cit., p. 11 ; HELBIG Jean, op. cit., R. 1367.
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
frais de l’armature en fer de la fenêtre. En 1597, Wypart réalise pour la somme de 60 florins une verrière pour l’église de Reckeim. L’importance des sommes déboursées par l’administration du prince-évêque permet d’assurer qu’il s’agissait dans tous ces cas de vitraux historiés. Pour la même période, le coût des autres verrières mentionnées dans les comptes varie entre 4 et 8 florins. En 1590, la nouvelle cour échevinale de Liège reçoit quatre fenêtres armoriées payées 6 florins à la femme du verrier Tilman Pisset. Deux autres verrières sont placées en 1595 dans la chambre échevinale vers la galerie du palais par le vitrifex Thiry de Leumont pour la somme de 16 florins. Les deux verrières exécutées dans l’intervalle par Jean de Bastogne pour le séminaire fondé par le prince-évêque ont coûté 6 florins. Le prince-évêque a pourvu également à la décoration de maintes demeures particulières, pour la plupart d’ecclésiastiques liégeois : Pierre Curtius (1588, Antoine Wypart), Jacques de Herve (1588, François Lowichs), le doyen de Saint-Servais (1588, Antoine Wypart), Dominique Lampson (1591, Guillaume Smelz), Antoine Romarin (1593, Tilman Pisset), le suffragant (1593, Hubert Wypart) et l’écolâtre (1593, Tilman Pisset)9. Ces donations ont certainement été soutenues par l’usage selon lequel des demeures, nouvellement acquises ou édifiées, étaient garnies de verrières par des amis du nouveau propriétaire : le souvenir des amis demeurait ainsi dans l’habitation. Les vitraux de la maison d’un dénommé Conrardy avaient été donnés de la sorte par des dignitaires ecclésiastiques et le prédécesseur d’Ernest de Bavière, Gérard de Grœsbeck ; cette générosité était rappelée par l’inscription partout répétée Amicus amico posuit10. Cette pratique était bien ancrée dans les milieux humanistes qui vouaient, à l’instar d’auteurs antiques comme Cicéron et Sénèque, un culte à l’amitié qui se manifestait par des cadeaux divers, des dédicaces d’ouvrages, et surtout par les albums d’amis (album amicorum)11. Vitraux réalisés à Liège et dans la principauté pendant le principat d’Ernest de Bavière La présence de vitraux contemporains du principat d’Ernest de Bavière est attestée dans de nombreux autres édifices que ceux précédemment cités, demeures, couvents, maisons religieuses et églises. On ignore souvent les auteurs de ces vitraux et distinguer les compositions plus importantes de petits panneaux ou de vitreries à médaillon n’est guère aisé. Les exemples suivants sont choisis parmi d’autres. Peu avant 1583, le couvent des Récollets reçut un vitrail donné par une certaine Maria de Gré et représentant la Résurrection12. Un dénommé « Tamison » avait fait placer en 1589, dans l’abbaye du Val-desÉcoliers, un vitrail à ses armes et avec sa devise, En tout temps et saison13. Un vitrail localisé dans le monastère de Robermont14 et daté de 1601 commémorait le « syndic » de ce monastère. L’église du couvent des Augustins, près d’Avroy, conservait une composition avec les armoiries des métiers, offerte par ceux-ci en 160615. L’ancien bourgmestre de Liège Hubert Loen, seigneur de Montgauthier et Laloux16, fit don vers 1611 d’un vitrail armorié au couvent des Sœurs de Hasque. Après l’incendie de 1557 qui détruisit presque toute l’église, de nouveaux vitraux furent placés dans l’abbaye du Val-Saint-Lambert17, près de Seraing, à 9. PINCHART A., op. cit., p. 9-12. 10. FRANCOTTE G., « Les vitraux », dans Conférences de la Société d’Art et d’Histoire du Diocèse de Liège, Liège, 1888, p. 118. 11. BURKE P., La Renaissance européenne, Paris, 2000, p. 244-245. Érasme et Peter Gillis par exemple offrirent à leur amis commun Thomas More leur portrait jumelé. Les albums d’amis rassemblaient des lettres, des autographes, des armoiries, des devises, etc. Dans les années 1550, cette coutume est largement répandue. On imprime même des albums vierges sous des titres comme Trésors d’amis (Thesaurus Amicorum). 12. HELBIG Jean, op. cit., R. 1385. 13. HELBIG Jean, De glasschilderkunst in België. Repertorium en documenten, vol. 2, Anvers, 1951, R. 2473. 14. À l’abbaye de Robermont, les hérauts d’armes Lefort ont relevé la présence d’un premier vitrail daté de 1601, aux armes de Christian de Bollan, sindic de ce vénérable monastère (voir NAVEAU L., Analyse du recueil d’épitaphes de Jean Gilles et de Jacques Henri Le Fort, Liège, 1899, p. 165 [no 1211], HELBIG Jean, op. cit. [1943], R. 290), et d’un second, daté de 1620, et donné par Guillaume de Manshoven, docteur en théologie, chanoine de Sainte-Cécile à Cologne, avec les armoiries Manshoven et Hinnisdael (voir NAVEAU L., op. cit., p. 64 [no 439] ; HELBIG Jean, op. cit. [1943], R. 1387). 15. PONCELET E., « Les bons métiers de la Cité de Liège », dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 28, 1899, p. 59. 16. HELBIG Jean, op. cit. (1951), R. 2474. 17. DE JAER L., « Peintres verriers liégeois aux XIVe et XVe siècles », dans Chronique archéologique du Pays de Liège, 1932, p. 8390 ; HELBIG Jean, op. cit. (1943), R. 1745. 312
ERNEST DE BAVIÈRE : UN MÉCÈNE ATTENTIF À L’ART DU VITRAIL (1581-1612)
une dizaine de kilomètres de Liège. Parmi les maîtres verriers qui intervinrent pour leur placement, les comptes citent Hubert de Wert qui réalisa entre 1576 et 1597 La Naissance du Christ18, d’après des cartons du peintre Jean Ramey. L’abbaye reçut encore de 1606 à 1615 une douzaine de vitraux commémoratifs19. Lorsque Ernest de Bavière prend la tête du diocèse de Liège, le chœur de la cathédrale Saint-Lambert venait d’être rénové20 et de recevoir un nouvel ensemble vitraux offerts par des chanoines du chapitre de Saint-Lambert21. Les quartiers de ces donateurs, disposés autour des armoiries du prince-évêque Gérard de Grœsbeck, sont repris sur un dessin de la cathédrale Saint-Lambert conservé aux Archives de l’État à Liège (fig. 1).
Fig. 1 : La cathédrale Saint-Lambert entourée des armoiries du prince-évêque Gérard de Groesbeck et de celles de chanoines liégeois. Liège, Archives de l’État. © I. Lecocq.
18. DEJAER L., op. cit., p. 83-90 ; HELBIG Jean, op. cit. (1943), R. 1746. 19. NAVEAU L., op. cit., p. 161 (nos 1189-1199) ; HELBIG Jean, op. cit. (1943), R. 1751-1762. Des inscriptions rappelaient Gilles Gillon dict Blavier de Flémale la Haute, tenant de Vaulx Sainct Lambert ; Jean Goeswin, receveur et syndic de la cathédrale de Liège et de l’église d’Aix, et sa femme Jennekenne de Laen (1607) ; Philippe de Saint-Esprit, seigneur de Fraineux, jadis bourgmestre de Liège, et son épouse Catherine d’Heur (1607) ; Otto Ernest de Brialmont, seigneur de Fraiture, Atrin, haut voué de Xhos et gentilhomme de la chambre du prince-évêque de Liège, et Catherine van der Gracht, dame de Melsenne, Aasche, etc., sa compagne (1607) ; Gilles de Pas, abbé du Val-Saint-Lambert (1608) ; Gérard Charles, conseiller ordinaire, et Marie Tabolet sa femme (1609) ; Nicolas Beckman, chanoine de Notre-Dame de Maastricht et son oncle de Pas, chanoine de la même église, enterré dans l’église du Val-SaintLambert (1609) ; Guillaume Beckman, son épouse Idelette et George Beckman, religieux du Val-Saint-Lambert (1609) ; Gilles de Glen, tréfoncier, official de Liège, prévôt de Sainte-Croix et de Notre-Dame de Maastricht (1613) ; Jean de Méan, licencié en droit et conseiller ordinaire, et Pétronille Counotte sa compagne (1615). 20. FORGEUR R., « Sources et travaux concernant la cathédrale. Étude critique », dans Otte M. (sous la dir. de), Les fouilles de la place Saint-Lambert à Liège, 1. La zone orientale (Études et recherches archéologiques de l’Université de Liège, 18), 1984, p. 55-56. Par décision actée le 27 août 1546, le chapitre ordonne de continuer les deux fenêtres du grand chœur à l’instar de celle qui est commencée. Cette campagne de travaux a nécessité le renouvellement d’au moins la vitrerie des parties hautes du chœur. 21. Voir LECOCQ I., Les vitraux des anciens Pays-Bas. L’apport du fonds Goethals de la Bibliothèque royale de Belgique (Catalogue d’exposition, avec une introduction de Chr. Vanden Bergen Pantens, Bruxelles [Bibliothèque royale de Belgique]), Bruxelles, 2002, p. 65-67. 313
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
De nombreuses églises ont manifestement reçu des vitraux sous le principat d’Ernest de Bavière : les collégiales Sainte-Croix, Saint-Martin-en-Mont et Saint-Paul, et les églises Saint-Séverin, Saint-Thomas, SaintVincent et Saint-Hubert. En 1581, un ouragan détruit le vitrail des Sibylles22 de la collégiale Sainte-Croix, vraisemblablement remplacé peu après23. Le transept de la collégiale Saint-Martin-en-Mont a été vitré pendant la seconde moitié du XVIe siècle. Déposés suite à la grêle qui s’est abattue sur Liège le 3 juillet 1946, les quatre vitraux conservés de cette partie de l’édifice attendent toujours que l’on statue sur leur sort. Un d’entre eux avait été offert en 1584 au plus tard par Conrard de Gavre24 († 1604). Celui-ci avait offert également à l’église Saint-Servais un vitrail daté de 1586 (cf. infra) et un autre, daté de 1601, à un édifice indéterminé, et connu uniquement par un dessin de Jean-Gilles († 1718) ou Jacques-Henri Lefort25 († 1751). Vers 1608, la collégiale Saint-Paul avait reçu du prélat Albert de Lymborch un vitrail représentant saint Caprais assistant au martyre de sainte Foy26. Les églises Saint-Séverin, Saint-Thomas27, Saint-Vincent28 et Saint-Hubert ont reçu des vitraux datés de 1586 à 1609 mais, excepté pour cette dernière, on ignore s’il s’agissait de compositions historiées. L’iconographie d’un vitrail offert en 1582 à l’église Saint-Hubert, aujourd’hui détruite, est décrite par les hérauts d’armes Lefort29. La Résurrection était encadrée latéralement par les donateurs agenouillés. Dans le bas du vitrail, une inscription rappelait les titres de ceux-ci : « Jehan de Withem, marquis de Berghes, comte de Walhain, baron de Bautershem, seigneur de Bresselr, Braine l’Alleud, Sebourcq, Boesmeghr, etc., grand receveur de Brabant, chef et capitaine d’une compagnie d’hommes d’armes au service du roi catholique, et Margarite de Mérode, sa compagne, marquise, comtesse et dame des dits lieux, 1582 ». Jehan de Witthem était portraituré en seigneur avec une cotte à ses armes. L. Abry qui révèle l’existence d’un vitrail offert en 1586 à l’église SaintSéverin précise, à propos du donateur, « Godefroid Hulst alias Taxis, de Bilsen, célèbre grammaticien, fils de Léonard Hulst, commissaire de Brée, et d’Emile Van Engelen, s’est produit par ses propres mérites et l’introduction savante qu’il a enseignée à la jeunesse de la Campine, par lesquels il est parvenu à la cour d’Ernest de Bavière, duquel il fut très bien reçu et favorisé de quelques charges, surtout d’un échevinage de Liége, le 7 juin 1583, en place de Mathieu Wyshoff. Il est mort en 1594 et repose dans la paroisse S. Séverin »30. L’existence de vitraux de la période considérée est encore attestée dans diverses villes et localités de la principauté qui n’en comportent actuellement plus aucun : Huy (v. 1580), Vottem (1585)31, Stavelot (1601 et 1609). Au couvent des Frères mineurs de Huy, des vitraux avaient été offerts par des membres de la famille du bourgmestre Jehan de Brion, notamment Érard de Brion († 1583) et son épouse Anne de Chasteleer († 1603)32. À l’abbaye de Stavelot, deux vitraux datés de 1601 et de 160933 commémoraient deux bourgmestres et conseillers stavelotains, respectivement Philippe et Guillaume de Rave, ainsi que l’épouse de celui-ci, Jehenne de Boix, dite de Soheit. 22. FRANCOTTE G., op. cit., p. 114 ; HELBIG Jules, La peinture au Pays de Liège et sur les bords de la Meuse, 2e éd., Liège, 1903, p. 212 ; HELBIG Jean, op. cit. (1943), R. 1334, p. 155. 23. Voir LECOCQ I., op. cit., p. 639-651. 24. NAVEAU L., op. cit., p. 42 (no 242) et HELBIG Jean, op. cit. (1943), R. 1284. 25. LIÈGE, Archives de l’État. Fonds Lefort, Atlas Lefort I : Jean-Gilles ou Jacques-Henri Lefort, relevé d’un vitrail offert par Conrard de Gavre en 1601, probablement à une église liégeoise (XVIIIe siècle). 26. HELBIG, op. cit. (1943), R. 1262. 27. À l’église Saint-Thomas, un vitrail daté de 1609 portait les armoiries de Jean de Lynt de Baillonville et d’Anne d’Orjo, son épouse (voir NAVEAU L., op. cit., p. 334 [no 1975] et HELBIG Jean, op. cit. [1943], R. 1353). 28. L’église Saint-Vincent conservait deux vitraux datés de 1596, l’un avec une inscription rappelant Mathey de Geer, marchand bourgeois de Liège, et sa femme Jehenne Robert, avec les armoiries de ces conjoints et également celles des époux de Butback (?) – Hodeige, l’autre rappelant Guilhame Macours, marchand bourgeois, et Catharina Halloyx, sa femme (voir NAVEAU L., op. cit., p. 79 [nos 585 et 586] et HELBIG Jean, op. cit. [1943], R. 1354 et 1355). 29. NAVEAU L., op. cit., p. 329 (no 1951) ; HELBIG Jean, op. cit. (1943), R. 1324. 30. ABRY L., Les hommes illustres de la nation liégeoise [v. 1715], Bormans S. et Helbig H. (éd.), Liège, 1867, p. 57-58. 31. Jean-Gilles et Jacques-Henri Lefort rapportent la présence de quatre vitres portant chacune la date de 1585 et respectivement ces quatre armoiries : GOYE, DANS, [BLAVIER], GRODEMBO (NAVEAU L., op. cit., p. 170 [no 1239], HELBIG Jean, op. cit. [1943], R. 1879). 32. FURNEMONT A., « Acquisition par la ville de Huy de deux aquarelles, copies de vitraux de l’ancienne église des Frères mineurs », dans Annales du Cercle hutois des Sciences et des Beaux-Arts, t. 43, 1989, p. 7-18. 33. NAVEAU L., op. cit., p. 356 (nos 2063 et 2064) ; HELBIG Jean, op. cit. (1943), R. 1819 et 1820. 314
ERNEST DE BAVIÈRE : UN MÉCÈNE ATTENTIF À L’ART DU VITRAIL (1581-1612)
Les vitraux réalisés à la demande ou sous le règne d’Ernest de Bavière étaient donc nombreux. On ne peut que déplorer leur disparition. Jusqu’en 1981, l’église Saint-Servais en conservait un ensemble des années 1596-1587, parmi lequel le vitrail offert par Ernest de Bavière (cf. supra). Cet ensemble a disparu lors de l’incendie du 21 août qui n’a épargné du bâtiment que les murs extérieurs et le clocher (fig. 2).
b
a Fig. 2 : Incendie de l’église Saint-Servais, le 21 août 1981 (a), et intérieur de l’église dévastée (b). © Fabrique d’église Saint-Servais [a] et © IRPA-KIK, Bruxelles [cliché 1981] [b].
Les vitraux de l’église Saint-Servais à Liège Les vitraux de Saint-Servais étaient parmi les témoins les plus représentatifs de l’art du vitrail dans les anciens PaysBas du Sud et la principauté de Liège pendant la seconde moitié du XVIe siècle. Des documents nous en donnent heureusement une idée très précise avant leur destruction en 1981 : des textes d’archives et le relevé dessiné d’un des vitraux, les cartons de restaurations établis au XIXe siècle par Jean-Baptiste Capronnier et des photographies, notamment des vues des panneaux, réalisées à l’occasion de la dépose des vitraux pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces documents sont conservés à Liège, aux Archives de l’État et à la cure de l’église, et à Bruxelles, aux Musées royaux d’Art et d’Histoire et à l’Institut royal du Patrimoine artistique. Sous le curé Jean Curtius (1564-1615), frère de l’industriel du même nom34, la nef de l’église Saint-Servais, fortement endommagée en 1584 par l’écroulement du sommet de la Fig. 3 : Plan de l’église Saint-Servais et emplacement tour, est en grande partie reconstruite. Les travaux sont des vitraux anciens disparus. financés par les subventions de la fabrique, les cotisations des paroissiens et l’intervention de la cité. Une pierre armoriée aux armes des bourgmestres de l’an 1584, André d’Ans et François de Meers, insérée dans la façade méridionale, témoignait de la générosité des magistrats communaux35. La nef a été ornée, peu après son réaménagement, des six vitraux conservés jusqu’à l’incendie de 1981. 34. DELHAES A., L’église Saint-Servais à Liège (Feuillets archéologiques de la Société royale Le Vieux-Liège, 12), Liège, 1966, p. 5. 35. Ces armoiries ont été remplacées en 1848 par celles de l’évêque Richaire et le millésime 933, date hypothétique de l’érection de la première église, de style roman. 315
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
a
b Fig. 4a et 4 b : a. Les six vitraux disparus de la nef de l’église Saint-Servais (de haut en bas et de gauche à droite : NVI, NVII, NVIII, SVI, SVII, SVIII) ; b. critique d’authenticité des six vitraux avant leur disparition (de haut en bas et de gauche à droite : NVI, NVII, NVIII, SVI, SVII, SVIII) – les parties renouvelées par Jean-Baptiste Capronnier sont indiquées par des aplats gris-foncé et les panneaux de verre incolore mis en plombs par des aplats gris clair. © IRPA-KIK, Bruxelles [clichés 1956] [a]. 316
ERNEST DE BAVIÈRE : UN MÉCÈNE ATTENTIF À L’ART DU VITRAIL (1581-1612)
Pour autant que leur disposition observée depuis le XIXe siècle jusque 1981 reproduise l’originale, ces vitraux représentaient au sud, la Nativité (SVI), l’Adoration des mages (SVII) et la Présentation au temple (SVIII) et, au nord, l’Assomption (NVIII), la Résurrection (NVI) et l’Ascension (NVII) (fig. 3 et 4a). Les trois vitraux du côté sud formaient un cycle cohérent consacré à l’Enfance du Christ ; les trois vitraux du côté nord constituaient un cycle consacré à la Glorification du Christ et de la Vierge. Les vitraux se présentaient différemment suivant qu’ils se trouvaient au nord ou au sud. Au nord, ils comportaient quatre lancettes de quatre panneaux, et dans le tympan, outre les couronnements trilobés des lancettes, six grandes formes. Au sud, ils comportaient par contre cinq lancettes de cinq panneaux et dans le tympan, outre les couronnements trilobés des lancettes et une dizaine de petits panneaux, six grandes formes. Des libéralités d’Ernest de Bavière et d’autres donateurs… Le don d’un vitrail à Saint-Servais par Ernest de Bavière est révélé par la comptabilité du prince-évêque (cf. supra). Le 14 février 1587, une somme de 120 florins est versée à Antoine Wypart pour l’exécution de ladite verrière. Cette dernière est sans aucun doute possible un des six vitraux destinés à orner l’une des baies de la nef nouvellement rebâtie par le curé Curtius : le montant de 120 florins est l’un des plus élevés qui figurent dans la comptabilité des princes-évêques pour le financement de l’exécution d’un vitrail (cf. supra). Le compte de 1587 se rapporte-t-il à un vitrail du côté nord ou du côté sud ? En regard du rang d’Ernest de Bavière, on a souvent opté pour la seconde solution36, les vitraux de cette partie de l’édifice étant plus grands et apparaissant mieux composés. Le paiement de 120 florins, somme élevée pour un vitrail, est le plus vraisemblablement bien intervenu pour un des trois grands vitraux du côté sud. Quand elle n’est pas clairement précisée, l’identité des donateurs des cinq autres vitraux peut être déduite des archives des hérauts d’armes Jean-Gilles et Jacques-Henri Lefort. Un relevé dessiné par Jean-Gilles ou Jacques-Henri Lefort concerne un vitrail daté de 1586 qui n’est pas identifié mais qui peut être mis d’emblée en rapport avec La Présentation au temple (SVIII) (fig. 6). Son auteur interFig. 5 : J.-G. ou J.-H. Lefort, relevé des armoiries prète librement la scène religieuse, en notant néanmoins de vitraux de l’église Saint-Servais à Liège. Liège, Archives de l’État, Fonds Lefort (Recueils des éléments très spécifiques, comme la frise supérieure d’épitaphes des églises de Liège). © I. Lecocq. et la tenture dans le coin supérieur gauche. En revanche, les armoiries et les inscriptions sont soigneusement relevées et dévoilent l’identité du donateur, Conrard de Gavre, prévôt de la cathédrale Saint-Lambert, des collégiales de Tongres et de Saint-Martin, sire de Hamale et de Peer, seigneur d’Elsloo, Diepenbeek et du pays de Rhode Sainte-Agathe. Auparavant, Conrard de Gavre avait offert au moins un vitrail à la collégiale SaintMartin, où il a été inhumé. Les hérauts d’armes Lefort ont également effectué le relevé d’armoiries qui se trouvaient sur des vitraux de Saint-Servais, mais pas sur ceux offerts par Ernest de Bavière et Conrard de Gavre (fig. 5). Ces relevés
36. HELBIG Jean, op. cit. (1943). 317
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 6 : J.-G. ou J.-H. Lefort, relevé du vitrail de Conrard de Gavre à l’église Saint-Servais. Liège, Archives de l’État, Fonds Lefort (Atlas I). © I. Lecocq. 318
ERNEST DE BAVIÈRE : UN MÉCÈNE ATTENTIF À L’ART DU VITRAIL (1581-1612)
sont cités d’après la transcription qu’en donne L. Naveau37, numéros 445 à 459 de son Analyse du recueil d’épitaphes… : 445) vitrail avec inscription rappelant Henry de Berlaymont, seigneur de la chapelle, Odeur, Modave, grand mayeur de Liége et Catherine de Hosden, sa femme. 1586. Armoiries ; huit quartiers [Berlaymont, Oultremont, Seraing, Haultepenne ; Hosden, Haynin, Aix, La Marck dit de Rochefort] ; 446) armoiries et inscriptions rappelant Louis de Berlaymont, tréfoncier, 1586, Gabriel de Chasteleer, seigneur de Waudimpré et Élisabeth de Berlaymont, sa femme, 1586, [Jean] de Berlaymont, seigneur de la Chapelle et [Philippine de Recourt dite] de Licques, sa femme, 1586 [...] ; 448) vitrail portant les armoiries et les huit quartiers de ... Hoen de Hoensbroeck, tréfoncier, 1586 [Hoen de Hoensbroeck, Lichtenborch, Corswarem, Waroux ; Dave, Enghien, Wideux, Jauche] ; 449) vitrail portant les armoiries et les huit quartiers de Wynand de Wyngaerde, grand prévôt de Liège ; 450) vitrail portant les huit quartiers de Henry de Ruyschenberg, grand commandeur des Vieux Joncs [Ruysschenberg, Reinshem, Greyn, Oppem ; Nesselraedt, Holtorp, Spiesz, Blenss] [...] ; 459) vitrail portant deux blasons aux armes de Glymes et de Berlaymont (Jacques de Glymes, baron de Florennes et Jeanne de Berlaymont, sa femme). Les relevés des frères Lefort ne précisent pas la localisation des vitraux. On peut néanmoins supposer que les compositions avec huit quartiers prenaient place dans la nef, les fenêtres du chœur étant trop étroites pour avoir pu les recevoir. Il est ainsi permis de conclure que quatre vitraux de la nef rappelaient les donateurs par huit quartiers : Henry de Berlaymont38 († 1585, seigneur de la Chapelle et grand mayeur de Liège) et Catherine de Hosden († 1596) ; un tréfoncier de la famille Hoen de Hoensbroeck ; Winand de Wyngaerde († 1593, prévôt de Saint-Lambert) ; Henry de Ruyschenberg. Deux de ces vitraux portaient la date « 1586 ». Quatre autres verrières auraient été placées au même moment dans le chœur et offertes par Louis de Berlaymont, Gabriel de Chasteleer et sa femme Élisabeth de Berlaymont, Jean de Berlaymont et son épouse Philippine de Recourt dite de Licques, Jacques de Glymes et Jeanne de Berlaymont. … en 1586-1587 Les trois vitraux du côté nord (Résurrection, Ascension du Christ, Assomption de la Vierge) ont été considérés comme les plus récents39 (XVIIe siècle), et les autres (Nativité, Adoration des mages, Présentation au temple) les plus anciens40 (v. 1585), placés immédiatement après la reconstruction de la nef endommagée par l’écroulement de la tour en 1583. Cette dissociation chronologique n’a pas lieu d’être. Les modèles des vitraux sont issus du même fonds et strictement contemporains ; les procédures de mise en œuvre sont en outre analogues (cf. infra). Dans le contexte architectural de l’édifice, l’exécution de l’ensemble des vitraux peut être située au plus tôt en 1584. Plusieurs éléments invitent d’ailleurs à avancer la date de 1586-1587 : l’extrait de la comptabilité des princes-évêques de Liège, daté du 14 février 1587, le dessin du vitrail de Conrard de Gavre et les relevés de Jean-Gilles et Jacques-Henri Lefort qui renseignent à trois reprises le millésime « 1586 ». Cette proposition de datation est confirmée par les divers rapprochements effectués avec des estampes (1571-1585). Réparations, restaurations et… destruction Avant leur destruction, en 1981, les vitraux de la nef de Saint-Servais avaient été endommagés et restaurés à de multiples reprises. Ils auraient été particulièrement endommagés sous l’occupation française et pen37. NAVEAU L., op. cit., p. 65. 38. L. Abry mentionne le vitrail d’Henri de Berlaymont à Saint-Servais à la suite de divers repères biographiques : « M. Henri de Berlaimont, chevalier, seigneur de la Chapelle, Odeur, Modave, gentilhomme du pays, de grand mérite, fut constitué commandant et capitaine de la ville et château de Dinant l’an 1554, que l’armée de France vint assiéger dans les formes. Il fit connoître par ses belles défenses ce qu’il savoit faire, et quoiqu’il dût succomber à la force par une capitulation, il ne laissa pas d’être conduit prisonier en France, contre la bonne foi, et obligé de payer sa rançon après deux ans de prison, qu’il revint. Il fut fort honoré et récompensé de la charge de grand mayeur l’an 1556, et constitué du conseil ordinaire de S. A. et de ses conseillers privés. Il mourut l’an 1585, et gît à Taviers où la noble et héroïne dame son épouse, dame Catherine de Hosden, l’a rejoint l’an 1596 ; desquels conjoints se voit à S. Servais une belle verrière ornée de leurs huit quartiers » (cité dans ABRY L., op. cit., p. 325). 39. RENIER J.S., Concours de la Société Libre d’Émulation de Liège. Inventaire des objets d’art renfermés dans les monuments civils et religieux de la ville de Liège, Liège, 1893, p. 90 ; HELBIG Jean, op. cit. (1943), R. 1294, R. 1295, R. 1296 ; PHILIPPE J., Liège, terre millénaire des arts, Liège, 1971, p. 96. 40. RENIER J.S., op. cit., p. 90 ; HELBIG Jean, op. cit. (1943), R. 1297, R. 1298 et R. 1299. 319
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
dant la période d’annexion de la principauté de Liège à la France (1792-1814). Les armoiries qui les ornaient auraient été détruites à ce moment. Le 8 septembre 1849, la Gazette de Liège rapporte l’étendue des dommages : « ces vitraux se trouvaient tellement dégradés qu’il était devenu presqu’impossible de se faire une idée exacte de leur état primitif. Pour quelques uns d’entre eux, c’est à peine si l’on pouvait reconnaître le sujet que l’artiste avait voulu traiter »41. H. Vrancken précise « beaucoup de verres peints étaient cassés et perdus, c’est pourquoi dans la suite, on a remplacé les armoiries par des verres ordinaires, et les morceaux peints ont été intercalés dans l’intérieur des tableaux »42. Les interventions ponctuelles ne suffisaient alors plus. Une restauration globale des vitraux fut confiée à l’atelier Capronnier de Bruxelles en 1849. Pour financer l’intervention, dont le coût total s’élevait à 4 604 francs, la fabrique fit appel aux souscriptions des paroissiens. Le curé Wafflard et sa sœur, Rosalie Wafflard, donnèrent l’exemple en engageant la somme de 700 francs. Le travail fut terminé le 5 février 1850, après le replacement des trois vitraux du côté nord. Le restaurateur Capronnier établit sur du carton des dessins des vitraux à taille réelle. Conformément à son habitude, le maître verrier y a numéroté les pièces qu’il remplaçait et marqué de croix celles qu’il conservait. Les paroissiens ayant apporté la contribution la plus large étaient commémorés par une inscription ou la figuration de leurs armes au bas d’un des six vitraux43. Les interventions les plus conséquentes, après celles de Capronnier, furent celles de l’atelier Osterrath de Tilff en 1910 et 1912. De nouveaux dégâts avaient été occasionnés lors des émeutes qui accompagnèrent les élections législatives de juin 191244. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les vitraux de Saint-Servais furent déposés de juillet à septembre 1942, comme les autres verrières anciennes des églises de Liège (Saint-Martin, Saint-Jacques, Saint-Paul, Saint-Antoine)45. Pendant la dépose des vitraux, le service photographique du Musée du Cinquantenaire réalisa des vues de tous les panneaux des vitraux. Les vitraux anciens de la nef furent replacés en 1946, après restauration et remise en état des meneaux. Les six vitraux anciens furent complètement détruits par l’incendie du 21 août 1981. Seul le fenestrage en pierre demeurait en place sans grand dommage apparent ; une entreprise privée fut chargée par la fabrique d’église et la ville de Liège de « jeter au sol » les quelques débris qui subsistaient. Les cartons établis par Capronnier préalablement à la restauration de 1849-1850 sont heureusement conservés aux Musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles46 (fig. 7) et l’Institut royal du Patrimoine artistique conserve les vues de détail des panneaux réalisées par le service photographique du Musée du Cinquantenaire. Ces documents permettent d’apprécier le bon état de conservation des vitraux avant leur destruction (fig. 4b). Les encadrements architecturaux de ceux-ci furent refaits par Capronnier, mais très vraisemblablement d’après des éléments existants.
41. LIÈGE, Archives de l’État, Inventaire des archives des cures, Liège, Église Saint-Servais, no 35 : VRANCKEN H., Histoire abrégée de l’église Saint-Servais à Liège ainsi que la fabrique de la dite église, extraits du livre des délibérations et de l’histoire de la paroisse par feu le curé Wafflard, 1905, p. 49-51 (années 1849-1850, restauration des anciens vitraux de l’église). 42. Ibidem. 43. Les personnes qui ont contribué au financement de la restauration en 1849-1850, appartiennent aux anciennes grandes familles liégeoises : Stembert, Fisenne, Mottart, etc. GOBERT Th., Liège à travers les âges. Les rues de Liège, 2e éd., 12 vol., Bruxelles, 19761978, cite à maintes reprises plusieurs de leurs membres, toutes époques confondues. 44. GOBERT Th., op. cit. (vol. 10, 1977), p. 385 ; LIÈGE, Archives de l’État. Inventaire des archives des cures, Liège, Église SaintServais, Journaux des recettes et dépenses (1902-1915) : [le 13 septembre 1912] remboursement de la Ville de Liège : reçu pour réparation des vitraux de l’église brisés par les émeutes le 3 juin [225 francs] ; Ibidem, Livre des délibérations du bureau des marguilliers de octobre 1909 à juin 1937 : [Séance du 11 juin 1912] [...] « Le bureau ayant écrit à l’administration communale pour lui faire part des dégâts qui ont été fait aux verrières de l’église pendant les émeutes des 2 et 3 juin 1912, le secrétaire donne la lecture d’une lettre de l’administration qui dit que l’affaire sera examinée par les services compétents et prie la fabrique de faire les propositions qu’elle juge le mieux répondre à la situation. Le Bureau décide de faire faire un devis par M. Osterrath de Tilff lequel sera soumis au conseil échevinal ». 45. LIÈGE, Musée du Grand Curtius, Fonds Osterrath. Dépose des vitraux anciens des églises de Liège (1941-1942) : Joseph Osterrath et André Biolley à Bourgault, architecte, à propos de la dépense que nécessiterait l’enlèvement des vitraux anciens des églises de Liège. 46. BRUXELLES, Musées royaux d’Art et d’Histoire, fonds Capronnier. Boîtiers 21 (vitrail de la Nativité [SVI], lancettes b, c, d, e), 22 (vitrail de l’Adoration des mages [SVII], lancettes b, c, d, e), 23 (vitrail de la Présentation de Jésus au Temple [SVIII], lancettes b, c, d, e), 24 (vitrail de la Résurrection du Christ [NVI], lancettes b, c, d), 25 (vitrail de l’Ascension [NVII], lancettes b, c, d), 26 (vitrail de l’Assomption [NVIII], lancettes b, c). 320
ERNEST DE BAVIÈRE : UN MÉCÈNE ATTENTIF À L’ART DU VITRAIL (1581-1612)
Fig. 7 : J.-B. Capronnier, détail du carton pour la restauration du vitrail de la Résurrection du Christ de l’église Saint-Servais à Liège (NVI). Bruxelles, Musées royaux d’Art et d’Histoire, boîtier 24. © I. Lecocq.
Composition des vitraux avant l’incendie de 1981 Les vitraux étaient composés de manière analogue : les scènes religieuses étaient toutes disposées sous un encadrement architectural. À l’origine, ces représentations étaient associées aux armes des donateurs qui en avaient financé l’exécution mais rien ne permet de préciser la situation de celles-ci dans les fenêtres. Les armoiries auraient pu être disposées dans les deux lumières latérales, séparées de la scène religieuse par le cadre architectural. Cette disposition est en effet fréquemment adoptée, pour les monuments funéraires muraux par exemple. Cependant, dans le relevé des frères Lefort du vitrail de la Présentation au temple, elles sont regroupées dans la partie inférieure et cette mise en page a peut-être prévalu. Aucun donateur, couple ou donateur isolé, ne figurait sur les vitraux, faute d’espace. Des œuvres en phase avec l’art de leur époque Les qualités stylistiques des vitraux ont été appréciées différemment selon qu’ils se trouvaient au sud, ou au nord47. Les vitraux de la façade méridionale (La Nativité, L’Adoration des mages, La Présentation au 47. RENIER J.S., Concours de la Société Libre d’Émulation de Liège. Inventaire des objets d’art renfermés dans les monuments civils et religieux de la ville de Liège, Liège, 1893, p. 85 et 90, tient ce raisonnement : « Dans les petites nefs, les verrières sont anciennes ; [...] la première en descendant du chœur, du côté de l’épître, représente la nativité, figures presque grandeur nature, composition bien établie, les ombres des carnations sont très pâles. [...] Suivent : l’Adoration des mages, figures demi-nature, d’un bon dessin, et coloris vigoureux. [...] La Circoncision, de coloris, de dessin et composition agréables [...]. Dans la nef du côté de l’évangile, les vitraux sont anciens aussi, mais moins vieux que leurs pendants [...] Ces pages artistiques des petites nefs sont attribuées à Lombard, ce qui doit s’entendre faites d’après ses cartons, mais pour certitude le dessin des fenêtres de la façade est de son école. Lombard mourut en 1566 ; la tour croula en 1583 et la reconstruction, telle que nous la voyons, s’ensuivit, comme il a été dit. Quant aux verrières de la nef nord elles sont d’une autre main, nous les croyons du XVIIe siècle, et ayant pu remplacer d’autres détruites par l’écroulement précité ». 321
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
temple) étaient unanimement jugés de qualité supérieure pour le coloris particulièrement agréable, le dessin de qualité et la composition des mieux établies48. Ils ont été mis en rapport avec l’art de Lambert Lombard (1505-1566). Les trois vitraux du côté nord (La Résurrection, L’Ascension, L’Assomption) étaient plus sévèrement jugés. L’ensemble est même considéré comme assez lourd par le chanoine Hamal49. Lors de l’exposition consacrée en 1966 à Lambert Lombard, les trois vitraux du côté sud seulement furent présentés dans le catalogue. Il est vrai que les vitraux sud manifestaient des caractéristiques générales de l’art de Lambert Lombard : une mise en page élaborée avec de nombreux personnages (La Présentation au temple), la mise en valeur des éléments architecturaux et une grande attention accordée au traitement de la figure humaine (La Nativité). Ces qualités faisaient, semble-t-il, défaut dans les trois vitraux du côté nord. Ces derniers mettaient en scène un nombre restreint de personnages, uniquement ceux dont la présence était imposée par le thème iconographique correspondant. Pour La Résurrection par exemple, le Christ et deux soldats seulement apparaissaient, l’un n’étant figuré que partiellement. Les personnages des vitraux du côté nord paraissaient souvent plus frustes que ceux du côté sud. Ils étaient simplement vêtus de robes drapées dépourvues d’ornementation. Les coiffures n’avaient ni la recherche ni l’élégance des personnages féminins de La Nativité ou de La Présentation au temple. Les fonds étaient particulièrement sobres : des nuages, du ciel bleu, quelques éléments de verdure, un caillou. La dissociation stylistique des vitraux ne résiste pourtant pas à l’analyse et les références particulières à l’art de Lambert Lombard ne sont pas évidentes. Le vitrail de la Nativité (fig. 8a) rappelle l’art de Frans Floris qui a été élève du maître liégeois († 1570). Une composition analogue a été adoptée par Frans Floris peu avant 1568 dans une Adoration des Bergers (fig. 8b) et plusieurs éléments rapprochent les deux scènes : la souplesse des drapés, la fluidité des plis des vêtements, très serrés, la variété des poses des personnages. D’autres rapprochements avec Frans Floris peuvent être proposés pour les visages présentés de profils ou de trois quarts et élégamment inclinés. Les deux personnages, derrière Marie, une femme et un homme d’un certain âge, rappellent les portraits d’Élisabeth et de Joseph gravés par Cornelis Cort (vers 1560-1565) d’après un tableau peint par Frans Floris vers 1556-1558 et aujourd’hui disparu, La sainte Famille avec Élisabeth et le jeune Jean-Baptiste50. Des modèles ont pu être identifiés pour les vitraux nord et sud : des estampes de Martin van Heemskerck (1498-1574) et de Gérard van Groeningen. Ce dernier artiste, méconnu, fut actif à Anvers pendant la seconde moitié du XVIe siècle, plus particulièrement entre 1561 et v. 1575/7651. Les estampes d’après Gérard van Groeningen identifiées comme modèle proviennent de la Christi Iesu vita admirabiliuq[ue] actionum speculum commentée par Bénito Arias Montanus et éditée à Anvers pour la première fois en 157352. Les illustrations de cette vie du Christ forment la plus grande suite gravée par Jan Wierix et l’atelier de Philippe Galle d’après des dessins de Gérard van Groeningen. Au moins cinq personnages ont ainsi été conçus sur un modèle de cet artiste. Dans le vitrail de la Résurrection (NVI), le soldat couché au premier plan (fig. 9a) a pour modèle celui qui, dans l’estampe de Gérard van Groeningen correspondante, assiste à la Trahison du Christ, prostré au sol (fig. 9b)53 ; dans le vitrail de l’Ascension (NVII), la femme agenouillée à l’avant-plan (fig. 9c) est une cita48. RENIER J.S., op. cit., p. 85. 49. LESUISSE R., « Tableaux et sculptures des églises, chapelles, couvents et hôpitaux de la ville de Liège avant la Révolution. Mémento inédit d’un contemporain », dans Bulletin de la Société des Bibliophiles liégeois, t. 19, 1956, p. 254. Rappelons que LESUISSE R. édite et commente la notice du chanoine Henri Hamal, Notice sur les objets d’art, avec le nom des auteurs, qui se trouvoient dans les églises de la ville de Liège en 1786. 50. Voir VAN DE VELDE C., Frans Floris (1519/20-1570). Leven en werken (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, 37e année, no 30), Bruxelles, 1975, vol. 1, p. 249 et vol. 2, cat. 173. 51. MIELKE H., « Antwerpener Graphik in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Der Thesaurus veteris et novi. Testamenti des Gerard de Jode (1585) und seine Künstler », dans Zeitschrift für Kunstgeschichte, vol. 38, fasc. 1, Berlin, 1975, p. 29-83 ; MIELKE U., « Gerard Groenning, ein Antwerpener Künstler um 1570. I. Verzeichnis seiner Zeichnungen und Stichwerke aus dem Wissenschaftlichen Nachlass von Hans Mielke », dans Jahrbuch der Berliner Museen, no 37 (1995), p. 143-157, no 38 (1996), p. 121-1501995 ; SCHUCKMAN Chr. et LUIJTEN G., Gerard van Groeningen (The New Hollstein Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, 14501700), vol. 1, Rotterdam et Amsterdam, 1997, p. 7-27. 52. SCHUCKMAN Chr. et LUIJTEN G., op. cit. (vol. 2, 1997), p. 88-119, cat. 314-364. 53. Ibidem, p. 96 (fig. 317). 322
ERNEST DE BAVIÈRE : UN MÉCÈNE ATTENTIF À L’ART DU VITRAIL (1581-1612)
tion fidèle de l’estampe de l’Ascension de Gérard van Groeningen (fig. 9d)54, même si le mouvement du drapé de son vêtement a été enrichi d’un complément à l’avant ; dans le vitrail de l’Assomption (NVIII), le personnage de gauche (fig. 9e) a pour modèle un apôtre dans une Descente du Saint-Esprit de Gérard van Groeningen (fig. 9f)55 ; dans le vitrail de l’Adoration des mages (SVII), Balthazar trouve sa source dans l’estampe de l’Adoration des mages de Gérard van Groeningen, mais ici l’adaptation du modèle est plus importante.
b
a Fig. 8a et 8b : a. Scène de l’Adoration des bergers (SVI), Liège, église Saint-Servais ; b. Frans Floris, tableau de l’Adoration des bergers (panneau peint peu avant 1568). Anvers, Musée royaux des Beaux-Arts. © IRPA-KIK, Bruxelles.
Dans le vitrail de la Présentation au temple (SVIII) (fig. 10), la tête d’un des personnages situés à l’extrême droite a manifestement pour modèle celle du porteur de cierge dans l’estampe de la Circoncision de Gérard van Groeningen. Le groupe formé par le grand prêtre, sa servante, Marie, Joseph et l’Enfant Jésus a par contre pour modèle une estampe de Martin van Heemskerck (fig. 11)56. Le modèle est consciencieusement reporté et les positions de la servante, du grand prêtre, de Marie, de Joseph et de l’Enfant sont fidèlement conservées. Marie tient aussi le cierge. Seul l’Enfant est inversé ; il bénit maintenant de la main gauche. L’ornementation plus que l’habillement change. Les postes en bas de la robe du grand prêtre sont
54. Ibid., p. 107 (fig. 339). 55. Ibid., p. 119 (fig. 362). 56. Voir VELDMAN I.M. et LUIJTEN G., Maarten van Heemskerck, 2, New Testament, Allegories, Mythology, History and Miscellaneous subjetcs (The New Hollstein Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, 1450-1700), Rotterdam et Amsterdam, 1994, p. 83 (fig. 377). Le dessin préparatoire à la gravure de la Circoncision est conservé à Rotterdam, Museum Boymans-Van Beuningen, Prentenkabinet, inv. N.130. Il est daté de 1564 et appartient à la suite préparatoire à la série des gravures des Sept Blessures du Christ (7 planches, 1565 [2 estampes datées], gravée par Herman Jansz. Muller). Une autre gravure de cette suite représentant le Crucifiement du Christ a servi de modèle pour une peinture murale à l’église Saint-Jacques à Liège (voir LECOCQ I., « Contribution à l’étude de l’art liégeois de la seconde moitié du XVIe siècle », dans Art&fact, no 17, 1998, p. 170-172). 323
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
a
b
c
d
e
f
Fig. 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f : a. Soldat du vitrail de la Résurrection (NVI) [cliché 1956] ; b. d’après Gérard van Groeningen, Trahison du Christ (v. 1573) ; c. personnage de la partie inférieure du vitrail de l’Ascension (NVII) [cliché 1956] ; d. d’après Gérard van Groeningen, Ascension du Christ (v. 1573) ; e. personnage agenouillé du côté gauche, dans le vitrail de l’Assomption (NVIII) [cliché 1918] ; f. d’après Gérard van Groeningen, Descente du Saint-Esprit (v. 1573). a, c, e : © IRPA-KIK, Bruxelles ; b, d, f : SCHUCKMAN Chr. et LUIJTEN G., op. cit., fig. 317, 339 et 362. 324
ERNEST DE BAVIÈRE : UN MÉCÈNE ATTENTIF À L’ART DU VITRAIL (1581-1612)
Fig. 10 : Scène historiée du vitrail de la Présentation au temple (NVIII) de l’église Saint-Servais. © IRPA-KIK, Bruxelles [cliché 1956]. 325
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
reproduites mais elles sont inversées par rapport à l’estampe, une broche avec des perles est ajoutée. Le motif du damas présent sur l’estampe uniquement dans la partie supérieure est reproduit et appliqué jusque dans le bas du vêtement. Les perlés du vêtement de la Vierge disparaissent. Le visage de la servante est indiqué comme ancien sur les cartons de Capronnier or il ne rappelle que très vaguement la physionomie caractéristique de Martin van Heemskerck (haut front et cheveux longs qui ondulent sur l’avant). Il en va de même pour les visages de Siméon et de Joseph. Le visage de Marie, bien que restauré, est le plus proche de l’estampe avec le nez en boule typique des physionomies de Martin van Heemskerck.
Fig. 11 : D’après Martin van Heemskerck, La Circoncision (1565). VELDMAN I.M. et LUIJTEN G., op. cit., fig. 377.
Les traités de Hans Vredeman de Vries (1526-1609) ont aussi très vraisemblablement été utilisés pour les vitraux de l’Adoration des mages (SVII) et de la Présentation au temple (SVIII). L’architecture qui sert de fond à l’Adoration des mages se distingue par la rigueur de son articulation. Les éléments en retour qui la relient au cadre ornemental extérieur accentuent la perspective. Hans Vredeman de Vries illustre ce procédé à maintes reprises dans une série de vingt vues de portails en ruine présentés selon une perspective centrale57. Ces planches ont été éditées pour la première fois à Anvers, chez Jérôme Cock, en 1560-1566. Par 57. FUHRING P. et LUIJTEN G., Vredeman de Vries (Hollstein’s Dutch & Flemish Engravings and Woodcuts 1450-1700), vol. 47, Rotterdam et Amsterdam, 1997, p. 69. 326
ERNEST DE BAVIÈRE : UN MÉCÈNE ATTENTIF À L’ART DU VITRAIL (1581-1612)
ailleurs, les obélisques qui prolongent les deux pilastres de l’arcade limitant la Nativité sont des ornements particulièrement affectionnés par Hans Vredeman de Vries58. L’obélisque est considéré comme typique du répertoire personnel de l’artiste qui le fait reposer sur des sphères. La Présentation au temple était située à l’intérieur d’un édifice qui occupait une grande partie de la scène historiée et qui conférait à la représentation une grande unité et un caractère monumental certain. Le motif de la tenture et la frise ornementale (5b, 5c, 5d) assuraient la liaison avec le cadre architectural externe. Dans les anciens Pays-Bas, c’est encore le Frison qui a largement contribué avec ses vues d’optique à la diffusion de modèles pour la représentation des vues d’édifices en perspective59. Les encadrements extérieurs ont été renouvelés par Capronnier au milieu du XIXe siècle mais certainement à partir d’éléments anciens. Ils rappellent Hans Vredeman de Vries pour certains décors spécifiques comme les gaines de ferronneries dans le tiers inférieur des colonnes. D’autre part, dans le vitrail de la Nativité, le décor du panneau du piédestal gauche est manifestement emprunté à une suite ornementale de Gérard van Groeningen, les Deorvm Dearvmqve Capita ex uetustis numismatibus... Ex museo Abrahami Ortelio, éditée à Anvers en 157360. Une commande complexe L’exécution du vitrail d’Ernest de Bavière a été confiée au vitrifex Antoine Wypart. Rien ne s’oppose à ce que celui-ci ait également été chargé de l’exécution d’autres vitraux de Saint-Servais. La vitrerie de la nef étant un travail considérable, Wypart a pu faire appel à des collaborateurs. L’un des nombreux maîtres verriers liégeois actifs à ce moment pourrait être retenu : Jacques de Marche, actif depuis 156061. Un incident révèle que celui-ci était peut-être impliqué dans les travaux pour l’église Saint-Servais. En 1598, Olivier de Saive, receveur de Saint-Servais, saisit les biens de Jacques de Marche pour une raison indéterminée. J. Breuer met ce fait en rapport avec la fourniture des vitraux de la nef de Saint-Servais62. Rien n’est pourtant moins sûr. Cet incident témoigne tout au plus de relations entre l’église ou la paroisse de Saint-Servais et le verrier. Le verrier Antoine Wypart peut donc être considéré comme l’un des réalisateurs des vitraux de la nef. L’intervention d’autres verriers, dont Jacques de Marche, n’est pas à exclure. La réalisation des vitraux a été précédée d’un travail de composition et d’établissement des cartons. Wypart a pu se faire aider par un peintre qui aurait pu intervenir sur l’ensemble de la vitrerie puisque les modèles qui ont été identifiés pour les vitraux du côté nord et du côté sud sont issus du même fonds, parmi lequel une Vie du Christ de Benito Montanus, et que les procédures de mise en œuvre sont semblables. Un inconnue demeure : quelles ont pu être les exigences des commanditaires pour les vitraux dont ils prenaient en charge la réalisation ? En l’absence de données d’archives, devant la variété des cas de figure, la question reste ouverte. Tout au plus peut-on remarquer que la nef ayant été vitrée selon un programme iconographique, les donneurs d’ordre n’ont sans doute guère eu l’occasion d’intervenir sur cet aspect. Leur implication a pu être limitée au versement de la somme nécessaire à l’exécution de « leur » vitrail et à la fourniture des informations sur les armoiries et les inscriptions à y faire figurer. Dans d’autres lieux, à la même époque, des commanditaires de vitraux ont eu des exigences plus contraignantes. Dans son testament daté du 27 juillet 1607, Winand de Wyngaerde prévoit d’avoir sa sépulture dans la cathédrale Saint-Lambert, en la chapelle où son oncle « le prévost Wyngaerde » est enseveli ; il prend des dispositions pour l’épitaphe et la confection d’un nouveau vitrail avec les portraits de son oncle et de luimême. Ce testament est exceptionnel pour la qualité et la précision des informations fournies : « Ordonnant 58. VAN DE WINCKEL M., « Hans Vredeman de Vries », dans Les Traités d’architecture de la Renaissance, Paris, 1988, p. 456. 59. Voir les premiers recueils de gravure d’après Hans Vredeman De Vries publiés chez Jérôme Cock à Anvers en 1560-1562 : les Scenographiae, sive perspectivae (1560), les vues ovales d’architectures en perspective pour la marqueterie (vers 1560-1562) et les petites vues d’architectures en perspective (1562). Voir FUHRING P. et LUIJTEN G., op. cit., p. 52-108, pl. 30-100. 60. SCHUCKMAN Chr. et LUIJTEN G., op. cit. (vol. 1), pl. 62-69, cat. 27. 61. Jacques de Marche fait relief à la corporation en 1560. BREUER J., op. cit., no 335. 62. Ibidem, p. 57. 327
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
que pour mon épitaphe l’image de Nostre Damme que j’ay en ma maison en la sale d’embas soit colloquée sur l’autel de ladite chapelle , en la place d’iceluy que j’ay fait ériger pour l’épitaphe dudit feu mon oncle, lequel sera mis à l’opposite dudit autel et qu’icelle image de Nostre Dame soit ornée de piliers et de colonnes en marbre, avec deux huysses sur lesquels seront pourtraicts mondit feu oncle et moy, comme aussy je veult estre fait en laqite chapelle une neuve voirier avec l’image de Nostre Dame et personnages la suppliante par ces paroles : ORA PRO POPULO. – INTERVENI PRO CLERO. – INTERCEDE PRO DEVOTO FEMINEO SEXU63, à l’imitation de celle qu’est pourtraicte au tapisse de feu Monsieur le cardinal de la Marche que l’on pend ordinairement au côté droit dans le coer de l’église de Liège, sur laquelle voirier mon dit oncle et moy serommes pourtraicts avec les armoiries de Wyngarde seulement sans les quartiers »64. *** La qualité de l’ensemble réalisé pour Saint-Servais, hélas disparu, laisse présumer d’autres réalisations de qualité sous le règne d’Ernest de Bavière. Un autre ensemble important dont quatre vitraux subsistent dans des caisses a été réalisé peu auparavant pour le transept de la collégiale Saint-Martin. Tout devrait être mis en œuvre pour que ces précieux témoins ne sombrent pas dans un oubli fatal et soient rendus à la lumière sans tarder.
63. « Prie pour le peuple, intervient pour le clergé, intercède pour le sexe pieux » (paroles d’une prière à la sainte Vierge extraites du sermon 18 De Sanctis de saint Augustin [O beata Virgo, etc.]). Cette prière est encore présente à de nombreuses reprises dans des recueils du XIXe siècle (voir par exemple PRINZIVALLI L., Recueil de prières et d’œuvres pies auxquelles les souverains pontifes ont attaché des indulgences (traduit de l’italien par l’abbé Louis Pallard), 13e éd., Paris, 1856, p. 263). 64. PONCELET E., « Œuvres d’art mentionnées dans les testaments des chanoines de Saint-Lambert », dans Bulletin de la Société d’Art et d’Histoire du Diocèse de Liège, t. 26, Liège, 1935, p. 11. 328
ERNEST DE BAVIÈRE ET LA MUSIQUE Émilie Corswarem
Père du futur prince-évêque de Liège, le duc Albert V de Bavière (1528-1579) fait de la chapelle musicale de Munich l’un des plus illustres centres de la fin de la Renaissance. À la tête d’un effectif composé de nombreux musiciens « néerlandais », Roland de Lassus (1532-1594) signe jusqu’à sa mort les riches heures de la chapelle bavaroise1. Services religieux, visites d’état et festivités diverses se parent d’une musique pour le moins remarquable et laissent, sans conteste, leur empreinte sur le jeune Ernest. En 1575, celui-ci est le dédicataire, au même titre que ses frères Guillaume et Ferdinand, d’un livre de motets à trois voix de Lassus2. Un an plus tard, il reçoit le Der dritte Theil schöner, neuer, teutscher Lieder3 et pour son couronnement à la tête de l’archevêché de Cologne, le motet triomphal Huc ades, o Erneste4. Sans pour autant avoir les moyens de recréer à Liège ou dans ses autres circonscriptions un mécénat comparable à celui de son père, Ernest de Bavière s’attache à développer une musique de cour. La chapelle de Freising - l’empreinte de Munich Freising est la première circonscription qui échoit à Ernest. Les quelques éléments connus relatifs à la vie musicale de l’évêché offrent des clés d’analyse quant au mécénat musical mis en œuvre par le prince dans les autres territoires dont il a la charge et à Liège en particulier. Ce n’est sans doute pas par hasard si Ernest de Bavière place à la direction de sa chapelle un élève de Roland de Lassus, le Liégeois Antoine Goswin (ca. 1545-ca. 1600)5. La majorité des chanteurs de cette chapelle, quoique modeste, est en outre issue de celle de Munich6. Il semble que Lassus ait dirigé à plusieurs reprises des exécutions musicales à Freising, comme l’indiquent des dons de vins, parfois concédés en grande quantité au musicien à partir de l’automne 1589 et jusqu’à l’année de son décès. Il pouvait probablement y entendre quelques-unes de ses propres œuvres, listées en nombre dans les inventaires conservés7. L’effectif que dirige Goswin compte au moins huit membres permanents et augmente à sa mort : des instrumentistes intègrent alors peu à peu la chapelle et les chanteurs se font plus nombreux8. Les successeurs
1. L’intégration d’un nombre important de chanteurs « néerlandais » à la chapelle munichoise n’est pas étrangère à la dissolution de la chapelle de Charles Quint en 1555 ; voir James HAAR, « Lassus, Orlande de », The New Grove Dictionary of Music and Musicians [en ligne] (http://www.oxfordmusiconline.com). 2. Liber mottetarum, trium vocum, quae cum vivae voci, tum omnis generis instrumentis musicis commodissimé applicari possunt, Munich, Adam Berg, 1575. 3. Der dritte Theil schöner, neuer, teutscher Lieder, mit fünff stimmen, sampt einem zu end gesetzen frantzösischen frölichen Liedlein, welche nit allein lieblich zusingen, sonder auch auff allerley Instrumenten zugebrauchen, Munich, Adam Berg, 1576. 4. Ce motet est publié dans Cantica sacra, recens numeris et modulis musicis ornata, nec ullibi antea typis evulgata, sex et octo vocibus, Munich, Adam Berg, 1585. 5. Dans la dédicace adressée à Ernest, Goswin décrit Roland de Lassus comme son lieber praeceptor. Voir Newe teutsche Lieder […] welche gantz lieblich zu singen, auch auff allerley Instrumenten zu gebrauchen 3v., Nuremberg, s.n., 1581. 6. Pour le détail des musiciens actifs à Freising, voir Karl Gustav FELLERER, Beiträge zur Musikgeschichte Freisings von den Aeltesten Christlichen Zeiten bis zur Aufloesung des Hofes 1803, Freising, Verlag des Freisinger Tagblattes, 1906, p. 68-70. 7. Idem p. 67. Si les sources manquent pour étayer la nature des contacts entre Ernest et le compositeur, une série d’indices révèlent l’intégration du Lassus dans la ville et ses liens privilégiés avec certains personnages. En 1585, Lassus dédicace à Alexandre II Fugger, le prévôt de la cathédrale un livre de 32 motets : Sacrae cantiones : antehac nunquam nec visae, nec typis uspiam excusae, quatuor vocum, Munich, Adam Berg, 1585. Outre Fugger, Lassus est aussi en liens avec Kaspar Fras, l’abbé du cloître bénédictin de Weihenstephan, à qui il dédie son quatrième volume de Patrocinium musices. Pour une transcription et une traduction de la dédicace en anglais, voir Nicolas Dean Johnson, The Influence of the Jesuits on the Passion Music of Orlando di Lasso, Master of Arts, University of Maryland, 2006, p. 30 (http://drum.lib.umd.edu/bitstream/1903/3703/1/umi-umd-3517.pdf) [en ligne], 2006. L’épître dédicatoire atteste d’une relative proximité entre les deux hommes et des gratifications dont Lassus pu se prévaloir de la part du père abbé. 8. Karl Gustav FELLERER, Beiträge zur Musikgeschichte Freisings, p. 70.
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
d’Ernest ne s’intéressent sans doute pas davantage que lui à l’art musical mais force est de constater qu’ils résident plus souvent à Freising. Le dynamisme d’une vie de cour suppose que celle-ci s’installe en un lieu donné, symbole du pouvoir d’où rayonne la magnificence du prince. Le souverain peut dès lors déployer un mécénat garant de stabilité pour les artistes qui peuvent prétendre à s’installer de manière durable dans son entourage. Or, la vie d’Ernest marque plutôt par ses va-et-vient entre les différentes circonscriptions à la tête desquelles il se trouve. Le prince cumule peu à peu les dignités ecclésiastiques dans l’Empire. En 1573, il est pourvu de l’évêché d’Hildesheim. Deux ans plus tard, il est le candidat de Philippe II (1527-1598) à Cologne puis à Liège en tant que coadjuteur de Gérard de Groesbeeck (1517-1580). En 1581, Ernest de Bavière devient prince-évêque de Liège et administrateur de la principauté de Stavelot-Malmédy. L’archevêché et l’électorat de Cologne lui reviennent en 1583 et l’évêché de Münster, en 15859.
Fig. 1 : Dédicace d’un recueil de madrigaux à Ernest de Bavière par Bernardino Mosto. Madrigali di Bernardino Mosto, organista del serenissimo duca Ernesto di Baviera (…), Anvers, 1588. © Münich, Bayerische Staatsbibliothek, Musikabteilung.
La carrière des musiciens actifs à cette époque révèle que le cumul de circonscriptions de leur potentiel patron, donnée a priori défavorable, ne rime pourtant pas avec absence d’opportunité10. Les dédicaces de recueils de musique destinées au souverain11, de même que les extraits de correspondance conservés sont 9. Max BRAUBACH, « Ernst, Herzog von Bayern, Erzbischof und Kurfürst von Köln », Neue Deutsche Biographie, IV, Berlin, Duncker & Humblot, 1959, p. 614 et Bruno DEMOULIN et Jean-Louis KUPPER, Histoire de la principauté de Liège, Toulouse, Privat, 2002, p. 151. 10. Voir Émilie Corswarem, De la ville à l’église. Musique et musiciens à Liège sous Ernest et Ferdinand de Bavière (1581-1650), Thèse de doctorat en Histoire, art et archéologie (Musicologie), Université de Liège, 2008. Sur l’activité des musiciens liégeois dans l’Empire ; voir Bénédicte EVEN-LASSMAN, Les musiciens liégeois au service des Habsbourg d’Autriche au XVIe siècle, Tutzing, Hans Schneider, 2006 ; José QUITIN, « Les Le Radde, musiciens liégeois du XVIIe siècle en service à la cour de Bonn », Studien zur Musikgeschichte des Rheinlande, Cologne, Arno Volk, 1962 (Beiträge zur Rheinischen Musikgeschichte, 52), p. 190-197 et, du même auteur, « Beziehungen Lütticher Musiker zu den deutschen Landen von 15. bis 18. Jahrhundert », Hans Jochem MÜNSTERMANN (éd.), Beiträge zur Musikgeschichte der Stadt Aachen II, Cologne, Arno Volk, 1979 (Beiträge zur Rheinischen Musikgeschichte, 125), p. 29-40. 11. Ernest est le dédicataire d’un seul traité théorique : Andreas PAPIUS, De consonantiis seu pro diatessaron libri duo, Anvers, Christophe Plantin, 1581. Ce traité de la défense de la quarte constitue une sorte de réponse négative aux idées exposées par Giuseppe Zarlino (1517-1590) dans Le istitutioni harmoniche (Francesco Senese, Venise, 1558). Au sujet de Papius (1552-1581) et de son traité, voir Heinrich HÜSCHEN, « Andreas Papius, ein Musiktheoriker aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts », Kirchenmusikalisches Jahrbuch, XXXVII, 1953, p. 47-53 et Jacques VAN DEUN, De muziektheoreticus Andreas Papius (ca. 1550-1581) en zijn traktaat « De Consonantiis », 2 vol., Thèse de doctorat, Katholieke Universiteit Leuven, 1975. 330
ERNEST DE BAVIÈRE ET LA MUSIQUE
autant d’éléments laissant entrevoir la vitalité des pratiques musicales autour du prince12. En suivant les musiciens dans leurs pérégrinations et en examinant les déplacements d’Ernest de Bavière, quelques traces de son usage privé de la musique peuvent être saisies sur le vifs. Antoine Goswin, l’exemple d’une carrière itinérante Ernest connut sans doute Antoine Goswin à la cour de Munich, où il fut enfant de chœur avant d’être engagé comme altiste13. Après un bref passage à la cour de Guillaume de Bavière à Landshut en 1569, un retour dans la région liégeoise entre 1571 et 157414 et un séjour à Vienne, c’est à Munich que le musicien réapparaît15. Il y occupe en 1577 le poste d’organiste de la Peterskirche16. Au début de l’année 1580, Goswin emménage à Freising. Une lettre de Roland de Lassus adressée à Guillaume de Bavière en février 1580 fait part de l’engagement du musicien liégeois à servir le prince durant sa vie entière17. Ce sera effectivement le cas. Ernest lui confie la direction de sa chapelle à Freising et ne l’oublie pas lors de ses déplacements à Bonn, à Hildesheim etc.18 Goswin l’accompagne aussi régulièrement à Liège en 1588 et 1589, comme le confirment les archives liégoises, le qualifiant de maître de chapelle du prince-évêque19. Peut-être partage-t-il alors le poste avec René del Mel (ca. 1554-ca. 1598), doté d’émoluments pendant quelques mois20. Sur la page de titre du recueil de canzonette napolitane que Joanin Favereo (fl. 1590-1610) dédie en 1592 à Ernest, apparaît sa fonction de maestro di capella del serenissimo Ellettor di Cologna21. Deux ans plus tard, c’est cependant déjà Goswin qui dirige les musiciens d’Ernest à la Diète de Ratisbonne22. Revenu dans son pays natal, il termine sa carrière au service du prince-évêque de Liège, à nouveau pourvu du titre de maître de chapelle23. La carrière de Goswin s’organise entre Liège et les autres évêchés du prince ; le compositeur se voit confier la direction de la musique tant à Freising que dans sa cité d’origine. Sa carrière est de la sorte intimement liée aux allées et venues de son mécène, à ses séjours dans l’une ou l’autre ville où il l’accompagne. C’est par ce biais qu’envisager une carrière auprès du prince relève de l’ordre du possible, du viable.
12. Voir Émilie CORSWAREM, Katelijne SCHILTZ et Philippe VENDRIX, « Der Lütticher Fürstbischof Ernst von Bayern als MusikMäzen (1580-1612) », Actes du colloque Das Erzbistum Köln in der Musikgeschichte des 15. und 16. Jahrhunderts (Köln, 2005), dir. Klaus Pietschmann, Kassel, Merseburg, 2008 (Beiträge zur Rheinischen Musikgeschichte, 172), p. 311-329. 13. Voir Bruno Edouard HIRZEL, Anton Gosswin, ca. 1540-1594 : sein Leben und seine Werke : ein Beitrage zur Geschichte der Hofkapellen in Mu?nchen und Freising, Munich, Hans Sachs, 1909, p. 11 et 48. 14. Idem, p. 18-21. 15. Il demeure cependant en relation avec la cour impériale et reçoit en 1574 et 1576 des gratifications pour des œuvres dédiées à l’empereur Maximilien ; voir Walter PASS, Musik und Musiker am Hof Maximilians II, Tutzing, Hans Schneider, 1980, p. 283. 16. Bruno Edouard HIRZEL, Anton Gosswin, ca. 1540-1594, p. 23-24. 17. Un extrait de cette lettre est publié dans idem, p. 27. 18. Idem, p. 33, 38. 19. Voir par exemple Liège Archives de l’État, Chambre de Compte, Comptes généraux (ci-après : AEL, ChC, CG), reg. 197 (15871588), f. 160, le 26 avril 1588. 20. Voir par exemple AEL, ChC, CG, reg. 197 (1587-1588), f. 164. 21. Il primo libro di canzonette, napolitane a tre voci, Cologne, Gerhard Grevenbruch, 1593. La dédicace est l’unique source sur l’activité de Favero auprès d’Ernest. Elle est signée à Cologne en novembre 1592. Le texte dédicatoire ne permet pas d’en savoir plus. 22. Sous sa direction figurent, entre autres, Matteo Foresto (voir infra) et le musicien liégeois Mathieu Jamar ; voir Gerhard PIETZSCH, « Zur Musikkapelle Kaiser Rudolfs II », Zeitschrift für Musikwissenschaft, III, 1934, p. 173. La même année, il réapparaît dans les comptes de Munich, remplaçant un certain « Michaelis », décédé. Voir Bruno Edouard HIRZEL, Anton Gosswin, ca. 1540-1594, p. 41-42. 23. Un ultime paiement daté de novembre ou de décembre 1600 remet en cause la date habituellement considérée comme celle de son décès, à savoir la deuxième partie de l’année 1597 ou le début de l’année suivante ; voir AEL, ChC, CG, reg. 211 (1599-1600), f. 227. Selon Lavern Wagner et José Quitin, Goswin serait décédé entre le 2 juin 1597 et le 28 octobre 1598 ; voir Lavern J. WAGNER, « Goswin, Antonius », The New Grove Dictionary of Music and Musicians (2e éd.), Stanley SADIE et John TYRELL (dir.), Londres, Macmillan, 2001, vol. X, p. 191 et José QUITIN, « À propose de Antoine Goswin », Revue belge de Musicologie, VI, 1952, p. 285. Bruno Hirzel avance l’hypothèse que Goswin décède entre le 20 novembre 1594 et la fin de l’année, sans pour autant pouvoir le vérifier puisque les livres de décès de Freising n’existent qu’à partir de 1687, voir Bruno Edouard HIRZEL, Anton Gosswin, ca. 1540-1594, p. 42. 331
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Les frères Mosto ou la tentation de la musique italienne L’attention d’Ernest de Bavière envers les musiciens anciennement actifs à la cour de son père est également perceptible dans son attitude à l’égard de Bernardino Mosto. Victime des restrictions budgétaires faisant suite à la mort d’Albert V, Mosto quitte vers 1580 la cour de Munich24. Il réapparaît lui aussi au service d’Ernest. Sur la page de titre et dans la dédicace du recueil de madrigaux qu’il fait paraître en 1588, le musicien se présente comme son organiste25. Peut-être Mosto se maintient-il un temps dans l’entourage du prince. Un motet de sa composition figure en effet dans l’anthologie de musique pour luth d’Adrien Denss (ca. 1545-1596/1598) imprimée à Cologne en 159426. Ceci invite à penser que l’organiste-compositeur est connu du musicien flamand ou que Denss a pu entendre la pièce de Bernardino à Cologne, où il réside peu avant la publication de son recueil27. Or, l’année de la parution de l’anthologie, un certain « Bernhardin Mosto » figure déjà à la Diète de Ratisbonne, non pas dans la suite du prince-évêque de Liège mais dans celle de Rodolphe II (1552-1612)28. Il semble donc que ce soit à la cour impériale de Prague que Mosto poursuive sa carrière29.
Fig. 2 : Madrigali di Bernardino Mosto, organista del serenissimo duca Ernesto di Baviera (…), Anvers, 1588. Page de titre. © Münich, Bayerische Staatsbibliothek, Musikabteilung. 24. Bien que la fonction qu’occupe Bernardino à la cour doive être précisée, une chose est sûre : il y perçoit un salaire, ainsi que l’indiquent les comptes de 1578 ; voir Wolfgang BOETTICHER, Orlando di Lasso und seine Zeit, 1532-1594. I : Monographie, KasselBâle, Bärenreiter, 1958, p. 500. Voir aussi Elena ZOTTOVICEANU, « Giovanni Battista Mosto, un compositeur italien à Alba-Iulia, au e XVI siècle », Revue roumaine d’histoire de l’art - Série théâtre, musique, cinéma, XIII, 1976, p. 96. Au sujet de la restructuration de la chapelle de Munich, voir Annie CŒURDEVEY, Roland de Lassus, Paris, Fayard, 2003, p. 269-270 et 279-284. 25. Madrigali di Bernardino Mosto organista del serenissimo duca ernesto di baviera, elettore di colonia. Novamente Composti & dati in luce, 5 v., Anvers, Pierre Phalèse et Jean Bellère, 1588. Sur ce recueil, voir Florence MINON, Bernardino Mosto, le madrigali a cinque voci, Anvers, Pierre Phalèse et Jean Bellère, 1588, Mémoire de maîtrise en Musicologie, Université de Liège, 2010. 26. Florilegium omnis fere generis cantionum suavissimarum ad testidunisi tabulaturam accomodatarum […] redacta per Adrianum Denss, Cologne, Gerhard Grevenbruch, 1594. Au sujet de ce recueil, voir Harold Bruce LOBAUGH, « Adrian Denss’s Florilegium (1594) », Journal of the Luth Society of America, III, 1970, p. 13-21 et Dieter KLÖCKNER, Das Florilegium des Adrian Denss (Köln, 1594). Ein Beitrag zur Geschichte der Lautenmusik am Ende des 16. Jahrhundert, Colone, Arno Volk, 1970 (Beiträge zur Rheinischen Musikgeschichte, 15). 27. Adrien Denss séjourne peut-être brièvement à Anvers puis rejoint Cologne avant la publication de son anthologie en 1594. Peu de données relatives à sa carrière sont connues mais Denss était indubitablement impliqué dans la vie musicale d’Arnold von Manderscheidt-Blanckenheim, official de Cologne à qui le Florilegium est dédié ; voir Harold Bruce LOBAUGH, « Denss, Adrian », The New Grove Dictionary of Music and Musicians [en ligne] (http://www.oxfordmusiconline.com). 28. Gerhard PIETZSCH, « Zur Musikkapelle Kaiser Rudolfs II », p. 172. 29. En 1607, il reçoit un salaire annuel de 17 florins comme « Trometter und Musicus » ; voir idem, p. 175. Voir aussi la notice sur Giovanni Battista et Bernardino Mosto dans Walter PASS, Musik und Musiker am Hof Maximilians II, p. 291. 332
ERNEST DE BAVIÈRE ET LA MUSIQUE
Son frère, le compositeur mieux connu Giovanni Battista Mosto (avant 1550-1596), semble lui aussi avoir furtivement tenté de se faire une place auprès d’Ernest de Bavière. Quittant la cour de Sigismond Bàthory (1575-1613) lorsque les invasions turques obligent le prince et ses musiciens à se réfugier à Cracovie en 1594, Giovanni Battista continue sa route en compagnie du musicien Matteo Foresto jusqu’à Cologne30. Dans une lettre adressée au duc de Mantoue, Foresto relate qu’Ernest aurait emmené les deux hommes avec lui à Bonn, à Liège et à Bruxelles31. Mais le premier mars 1595, Giovanni Battista est reparti à Venise. La même année, il réintègre le poste de maître de chapelle à la cathédrale de Padoue, qu’il occupait déjà de 1580 à 158932. Les quelques gestes manifestés par Ernest pour conserver à son service ces personnalités de qualité demeurent à l’état de prémices... René del Mel, de l’importance du geste dédicatoire C’est encore en relation avec Munich ou de manière plus générale avec la Maison de Bavière qu’il est possible de situer un troisième compositeur actif sous le règne d’Ernest de Bavière : René del Mel. Celui-ci reçoit sa formation à la cathédrale Saint-Rombaut de Malines33. Il se serait rendu ensuite à la florissante cour de Lisbonne34, puis en Italie où il accomplit une bonne part de sa carrière. Jusqu’en 1587, son activité se déroule principalement dans la région de Rome et à Venise. Outre quelques rares mentions dans les archives, le contenu des textes dédicatoires de ses nombreux recueils de musique constituent la source quasi unique étayant sa biographie35. En 1587, René del Mel dédie un livre de madrigaux à six voix à Ernest36. Un an plus tard, dans le titre du recueil de Sacrae Cantiones qu’il dédicace à Renée de Lorraine, l’épouse de Guillaume de Bavière, le compositeur fait apparaître sa fonction de musici excellentissimi, sereniss[imi] utriusque Bavariae Ducis Ernesti 37. Les archives liégeoises confirment qu’il est alors le maître de chapelle du prince-évêque. Du mois d’août 1588 au mois de en mars 1589, il se maintient à cette fonction38.
30. Elena ZOTTOVICEANU, « Giovanni Battista Mosto, un compositeur italien à Alba-Iulia, au XVIe siècle », p. 102-103. 31. Pietro CANAL, Della musica in Mantova. Notizie tratte principalmente dall’Archivio Gonzagua, Genève, Minkoff, 1978, p. 87 (repr. 1881). 32. Elena ZOTTOVICEANU, « Giovanni Battista Mosto, un compositeur italien à Alba-Iulia, au XVIe siècle », p. 103. 33. Sur la maîtrise de Saint-Rombaut, voir Georges VAN DOORSLAER, « Notes sur les jubés et les maîtrises des églises des SaintsPierre-et-Paul, de Saint-Jean, de Notre-Dame au-delà de la Dyle et de Saint-Rombaut », Bulletin du Cercle archéologique littéraire et artistique de Malines, XVI, 1906, p. 145-181 ; Emile STEENACKERS, « L’école des choraux de l’église métropolitaine de Saint-Rombaut à Malines », Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines, XXXI, 1926, p. 53-94 ; Georges VAN DOORSLAER, Notes sur la musique et les musiciens à Malines, Malines, Dierickx-Beke, 1934 ou encore Joseph KREPS, « Cinq siècles de maîtrise : Saint-Rombaut à Malines », Musica Sacra, XLI, 1960, p. 141-64. 34. Giuseppe BAINI, Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina, II, Hildesheim, Olms, 1966 (Reprod. Rome, 1828), p. 126-127. 35. Au sujet de l’intérêt des dédicaces de René del Mel, voir Emilie CORSWAREM, « Les dédicaces latines des recueils de motets de René del Mel », Cui dono lepidum novum libellum ? Dedicating Latin Works and Motets in the Sixteenth Century Theory and Practice, Actes du colloque (Rome, Academia Belgica, 18-20 août 2005), Ignace BOSSUYT, Nele GABRIELS, Dirk SACRÉ et Demmy VERBEKE (dir.), Leuven, Leuven University press, p. 269-291. Les dédicaces des recueils de René del Mel sont éditées pour la première fois par Georges VAN DOORSLAER dans « René del Mel, compositeur du XVIe siècle », Annales de l’Académie royale d’archéologie de Belgique, LXIX, 1921, p. 275-288. Plus récemment, les dédicaces latines de ses recueils de motets ont fait l’objet d’une édition rigoureuse par Demmy VERBEKE : Ad musicae patrono : Latijnse dedicaties en inleidende teksten in motettenbundels van componisten uit de Nederlanden (ca. 1550-ca. 1600), Thèse de doctorat, Katholieke Universiteit, Leuven, 2005. Voir Katholieke Universiteit Leuven [en ligne] (https://repository.libis.kuleuven.be/dspace/handle/1979/160), janvier 2005. 36. Madrigali a sei voci, Anvers, Pierre Phalèse et Jean Bellère, 1588. Au sujet de ce livre de madrigaux, voir Clothilde Larose, Rinaldo del Mel : Madrigali a sei voci (Anvers, Phalèse et Bellère, 1588), introduction et transcription, Mémoire de maîtrise en musicologie, Université de Liège, 2008. 37. Sacrae cantiones […] V. VI. VII. VIII. ac XII. vocum, cum litania de B. Maria Virgine V. vocum, Anvers, Pierre Phalèse et Jean Bellère, 1588. Ce livre a fait l’objet d’une édition en notation moderne ; voir Johan AKKERMANS, Die bundel Sacrae Cantiones…V.VI.VII.VIII ac XII vocum van Renatus del Melle, Antwerpen, 1588, 2 vol., Mémoire de licence, Katholieke Universiteit Leuven, 1984. 38. Voir AEL, ChC, CG, reg. 197 (1587-1588), f. 164 et reg. 198 (1588-1589), p. 226. Comme mentionné plus haut, sans doute a-t-il partagé le poste avec Antoine Goswin qui reçoit sporadiquement des émoluments à la même période. 333
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
Fig. 3 : René del Mel, Sacrae cantiones, Anvers, 1589. Page de titre. © Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique.
Durant les années suivantes, une succession de recueils de del Mel offerts aux membres de la famille du prince attire l’attention39. Les efforts du musicien ne se concentrent pas sur Ernest. Après la dédicace adressée à Renée de Lorraine en 1588, signalons un livre de madrigaux à six voix, dédié à Minutio Minucci (1551-1609)40. L’année suivante, Maximilien de Bavière (1573-1651) reçoit son troisième livre de madrigaux41. La sœur de Renée, Dorothée de Lorraine (1545-1621), déjà bénéficiaire d’un livre de madrigaletti en 1590, se voit offrir en 1596 un recueil de madrigaux spirituels42. René del Mel ne demeure pas au service d’Ernest. Faut-il comprendre son départ comme la manifestation de la volonté du compositeur à se mettre en recherche d’une plus grande stabilité ou comme celle de l’absence d’initiative du prince à tisser pour del Mel des liens entre Liège et ses autres cours, qui, à l’instar de Goswin, lui auraient peut-être ouvert des perspectives plus séduisantes ? En 1595, del Mel est au service du cardinal Gabriele Paleotti43. Il a peut-être d’autres ambitions. La succession d’un nombre significatif de dédicaces aux membres de la famille Lorraine-Bavière pourrait suggérer que del Mel considère le poste qu’il occupe à Liège comme un marche-pied vers de meilleurs auspices. Les dates des dédicaces correspondent à l’extrême fin de la carrière de Lassus à la cour de Munich et à la vacance, à sa mort, du poste de maître de chapelle. Johannes de Fossa (ca. 1540-1603) n’est pas encore nommé premier Kapellmeister et Lassus a
39. En 1581, René del Mel avait déjà dédicacé son premier livre de motets à Christine de Danemark, la mère de Renée de Lorraine : Liber primus […] mottettorum quae partim quaternis, partim quinis, partim senis, ac unum septenis, altero vero octonis vocibus concinuntur, Venise, Angelo Gardano, 1581. Deux ans plus tard, Guillaume de Bavière reçoit un livre de madrigaux : Madrigali a quattro, cinque et sei voci, Venise, Angelo Gardano, 1583. 40. Il secondo libro de madrigali a sei voci, Venise, Vincenti, 1593. Nommé Secrétaire d’État des affaires allemandes par Innocent IX en 1591, Minucci exerce antérieurement déjà la fonction d’agent de la Bavière en tant que conseiller du duc Guillaume V ; voir Meinhard POHL, « Minucci », Neue Deutsche Biographie, XVII, Berlin, Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschafter (éd.), 1994, p. 547-549. Voir aussi Bettina SCHERBAUM, Bayern und der Papst : Politik und Kirche im Spiegel der Nuntiaturberichte 1550 bis 1600, St. Ottilien, E.O.S. Verlag Erzabtei, 2002 (Forschungen zur Landes und Regionalgeschichte, IX), p. 110121. 41. Il terzo libro delli madrigaletti a tre voci, Venise, Angelo Gardano, 1594. 42. Il primo libro delli Madrigaletti a tre voci / nuovamente rimessi insieme, Milan, Francesco et héritiers de Simon Tini, 1590 et Madrigaletti spirituali libro quarto a tre voci, Venise, Angelo Gardano, 1596. 43. Vers 1595, Gabriele Paleotti nomme René del Mel maître de chapelle de la cathédrale de Magliano et professeur de musique au séminaire récemment créé ; voir la dédicace du Liber quintus motectorum, Venise, Angelo Gardano, 1595. 334
ERNEST DE BAVIÈRE ET LA MUSIQUE
délégué une partie de ses attributions à son fils Ferdinand (ca. 1560-1609) depuis 1584. Del Mel a peut-être entrevu la concrétisation d’une fin de carrière brillante.
Fig. 4 : Tirsi io mi part’à Dio (canto). Madrigal de René del Mel. René del Mel, Il quinto libro de madrigali a cinque voci, Venise, 1594. © Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique.
Jean de Castro (ca. 1540/45-ca. 1600), un musicien sans poste à Cologne Si del Mel déploie d’évidents efforts pour marquer une déférence particulière à la Maison de LorraineBavère, Castro vise plutôt le milieu colonais. Son objectif est clair : briguer un emploi officiel dans la ville où il s’installe en 1591, après après avoir occupé pendant trois années le poste de Kapellmeister à la cour de Düsseldorf. Présent au mariage du duc de Juliers, Clèves et Berg (1562-1609) et de la comtesse Jakobe de Bade (1558-1597) en 1585, Jean de Castro a pu y rencontrer Ernest de Bavière44. Trois ans plus tard, soit la même année que del Mel et Mosto, le musicien dédie ses Novae sacrae cantiones au prince-évêque de Liège45. Comme l’a montré Katelijne Schiltz, cette édition est la première d’une série dédiée aux hauts personnages de Cologne46. Une bonne partie des Cantiones sacrae [...] quinque vocibus compositae, paru en 1591, est clairement destinée à l’élite colonaise : du conseil de la ville au maire de l’époque Johannes Hardenraidt, sans oublier des hauts dignitaires parmi lesquels Ernest est sans doute évoqué sous les traits du princeps cla44. Pour l’occasion, il compose un épithalame, Vien, doux hymnénée, qui figure en première pièce de son Livre de chansons à cinq parties (Anvers, Pierre Phalèse & Jean Bellère, 1586). Sur les festivités du mariage, voir Gerhard PIETZSCH, « Die Jülich’sche Hochzeit 1585 », Herbert DRUX, Klaus Wolfgang NIEMÖLLER et Walter THOENE (dir.), Studien zur Musikgeschichte des Rheinland II : Karl Gustav Fellerer zum 60. Geburtstag überreicht von den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft für rheinische Musikgeschichte, LII, 1962, p. 181 et Else RÜMMLER, Die Fürstlich Jülichsche Hochzeit zu Düsseldorf 1585. Das Fest und seine Vorgeschichte, Düsseldorf, Hans Marcus, 1983. 335
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
rissimus au quinzième motet, Humanae speculum47. Deux ans plus tard, Castro fait une ultime tentative et dédicace son recueil de Cantiones partie aliquote sacrae trium vocum à Ernest de Bavière, en vain48. La même année, il consacre ses Bicinia seu duarum vocum cantiones aliquot sacrae à Theodor von Wedich, chanoine de Saint-Géréon de Cologne49. Tant Castro que del Mel se signalent régulièrement à l’attention du prince. Il semble pourtant que jamais, le premier n’ait occupé de position officielle auprès d’Ernest. Cela ne l’empêche pas de faire preuve d’une pugnacité sans pareille puisqu’en 1596, il dédie sa collection de Trium vocum partie aliquote cantiones à Ferdinand de Bavière50. Le dernier recueil connu du compositeur, les Missae a tres, trium vocum, est destiné à Charles de Billehé († 1606), un conseiller liégeois d’Ernest51. Castro jouit d’une renommée appréciable en dehors de l’archevêché. Ses œuvres connaissent une diffusion internationale et trente ans après sa mort, elles sont encore imprimées. Seules les œuvres de Roland de Lassus sont vendues en nombre plus important que celles du compositeur liégeois52. Il est difficile de comprendre l’attitude du prince face à un musicien de telle envergure. À Cologne, même s’il se fait un nom, Castro semble avoir toujours travaillé de manière indépendante, sans bénéficier de poste officiel auprès d’un de ses dédicataires53. À la lumière des quatre carrières exposées ici, l’attitude d’Ernest envers ses musiciens paraît pour le moins ambiguë. Tant dans le procédé mis en œuvre par le prince pour constituer sa chapelle que dans le cheminement des compositeurs, un centre s’impose : la chapelle ducale de Munich. C’est de là que proviennent une série de musiciens, passés de la cour d’Albert V à celle de son fils et c’est en outre peut-être encore Munich qui est visé par del Mel à la fin de sa carrière. Goswin et Mosto ne sont d’ailleurs pas les uniques musiciens d’Albert V repris par Ernest à son service : dans la liste du personnel relevé dans les archives de Freising par Bruno Hirzel, figurent également les bassistes Bärtlme Damitz et Gallus Rueff ainsi que le ténor Peter Gattmair. Damitz, comme Goswin, reçoit des émoluments pour avoir accompagné ou rejoint Ernest à Bonn. La bienveillance d’Ernest pour les musiciens anciennement actifs à la chapelle bavaroise témoigne aussi d’une certaine passivité, même s’il faut bien croire le prince amateur de musique. Bernardino Mosto fait allusion dans sa dédicace au plaisir éprouvé par Ernest lors d’une exécution de ses madrigaux ; del Mel lui dédie d’autres pièces du même type et Goswin s’engage à le servir sa vie durant. Et pourtant, ni del Mel ni Giovanni Battista Mosto ne resteront actifs auprès d’Ernest de Bavière. La tentative du second est avortée avant même qu’il ait pu profiter d’une position officielle. Que faut-il en déduire ? La carrière de Goswin recèle quelques clés d’interprétation. Elle fait la lumière sur les liens qu’Ernest tisse entre ses possessions, en particulier entre Freising, Liège et Bonn. Il en va peut-être de même pour la carrière de Bernardino Mosto, entre Liège et Cologne cette fois. Goswin assume la fonction de maître de chapelle dans chacune des circonscriptions. Il suit visiblement le prince, incarnant un des rares membres de l’effectif permanent de la 45. Ces musiciens auraient-ils entrevu une période d’accalmie coïncidant avec la fin de la guerre de reconquête menée par Ernest, soutenu par les armées espagnoles dans son électorat de Cologne contre les armées de Truchsess ? Voir Émilie CORSWAREM, Katelijne SCHILTZ et Philippe VENDRIX, « Der Lütticher Fürstbischof Ernst von Bayern als Musik-Mäzen (1580-1612) ». Au sujet des six années de guerre faisant suite à la nomination d’Ernest de Bavière comme archevêque de Cologne, voir notamment voir Paul HARSIN, Etudes critiques sur l’histoire de la principauté de Liège 1477-1795, III, p. 329-337 ; Henry BOGDAN, Histoire de l’Allemagne de la Germanie à nos jours, Paris, Perrin, 1999, p. 188 et H. De Schepper, « De ‘Reconquista mistukt’. De katholieke gewesten, 1579-88 », Algemene Geschiedenis der Nederlanden, VI, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1979, p. 276. 46. Novae [...] cum quincque sacrae cantiones, sexe, et octo vocibus, Douai, Jean Bogard, 1588. 47. Cantiones sacrae [...] quinque vocibus compositae, Frankfort, Wechel, 1591. 48. Cantiones partie aliquote sacrae trium vocum, Cologne, Gerhard Grevenbruch, 1593. 49. Bicinia seu duarum vocum cantiones aliquot sacrae, continentes hymnos, prosas et laudes ab ecclesia decantari solitas, Cologne, Gerhard Grevenbruch, 1593. 50. Trium vocum partie aliquote cantiones, Cologne, Gerhard Grevenbruch, 1596. En 1598, ce recueil est réédité avec la même dédicace. 51. Missae à tres, trium vocum, Gerhard Grevenbruch, Cologne, 1599. 52. Ignace BOSUYT, Katrien DERDE et Saskia WILLAERT, « Castro, Jean de », The New Grove Dictionary of Music and Musicians [en ligne] (http://www.oxfordmusiconline.com). 53. Sans doute ne prétendait-il pas à une carrière à Liège. Ses efforts se concentrent surtout sur des personnalités colonaises, à l’exception de Charles de Billehé. 336
ERNEST DE BAVIÈRE ET LA MUSIQUE
chapelle. Une série de Liégeois sont en outre de temps à autres rémunérés pour aller rejoindre le prince à Bonn, en Westphalie ou à Arnsberg : un luthiste, des joueurs de trompettes et même des enfants de chœur « empruntés » à l’une ou l’autre église de la ville54. Le prince est donc assuré de pouvoir bénéficier d’une musique de cour, fût-elle minimaliste, là où il se trouve. Le passage de del Mel à Liège est peut-être le signe d’une époque plus favorable : nous avons vu que sa carrière chevauche pendant une courte période celle de Goswin. Sans doute, les deux musiciens se partagentils la fonction de directeur de musique entre Liège et les autres évêchés du prince. Mais l’activité du compositeur malinois auprès d’Ernest de Bavière n’est que de courte durée. Del Mel ne peut se prévaloir des avantages dont est pourvu Goswin, bien installé à son poste de maître de chapelle. Ernest n’a certes pas bénéficié d’un contexte politique favorable à l’épanouissement de relations fortes entre ses diocèses. Ses continuels déplacements entre l’électorat de Cologne, Liège et ses autres dignités s’opèrent dans l’urgence conséquente aux troubles qui sévissent dans l’Empire. Quelle place pour développer un mécénat véritable ? Une musique de cour, certes à petite échelle, sut trouver sa place malgré tout.
54. Voir par exemple, AEL, ChC, CG, reg. 195 (1580-1598), f. 7 ; reg. 197 (1587-1588), f. 174 ; reg. 204 (1593-1594), f. 204 ; reg. 208 (1596-1597), f. 132, le 3 février 1597, f. 132v, le 16 juin 1597, le 13 juillet 1597, f. 152, le 30 avril 1597, f. 178, le 19 août 1597 ; reg. 209 (1597-1598), f. 150v, le 30 décembre 1597, f. 154v, le 22 septembre 1597, f. 177, le 18 novembre 1597 ; reg. 210 (1598-1599), f. 4v, le 2 décembre 1598, f. 133, le 13 novembre 1598, f. 135, le 11 juin 1598, f. 150v, le 29 août 1598 et f. 156, le 18 avril 1599, f. 154, le 3 septembre 1598, f. 183, le 29 mai 1599. 337
TABLE DES MATIÈRES LIMINAIRES Préface ................................................................................................................................................................7 Jean-Pierre Hupkens, Échevin de la Culture de la ville de Liège Introduction : Ombres et lumières d’un règne ..................................................................................................9 Geneviève Xhayet et Robert Halleux PREMIÈRE PARTIE
L’HOMME D’ÉTAT ET L’HOMME D’ÉGLISE Ernest de Bavière et la Principauté de Liège..................................................................................................15 Geneviève Xhayet Ernest de Bavière et le Catholicisme Tridentin ..............................................................................................31 Annick Delfosse DEUXIÈME PARTIE
LE PRINCE PRATICIEN Une cour savante..............................................................................................................................................45 Robert Halleux Ernest de Bavière et la Contre-Réforme mathématique .................................................................................47 Robert Halleux Ernest, disciple de Paracelse et alchimiste......................................................................................................59 Robert Halleux Vers une modernité médicale ..........................................................................................................................69 Geneviève Xhayet L’opérateur industriel .......................................................................................................................................95 Robert Halleux TROISÈME PARTIE PARTIE
LE PROTECTEUR DES ARTS L’architecture du temps d’Ernest de Bavière (1570-1620)........................................................................... 111 Mathieu Piavaux Entre Lambert Lombard et Gérard Douffet : la génération perdue. Les peintres à Liège autour du règne d’Ernest de Bavière (1570-1620) .....................................................135 Pierre-Yves Kairis La sculpture dans l’ancien diocèse de Liège, depuis la mort de Lambert Lombard jusqu’aux prémices du Baroque ........................................................235 Michel Lefftz
ERNEST DE BAVIÈRE ET SON TEMPS
La gravure ......................................................................................................................................................307 Jean-Patrick Duchesne Ernest de Bavière : un mécène attentif à l’art du vitrail (1581-1612) ......................................................... 311 Isabelle Lecocq Ernest de Bavière et la musique ....................................................................................................................329 Émilie Corswarem
340