Ens mobile : conceptions phénoménologiques du mouvement 9789042936614, 9782758403036, 9789042937499, 9042936614
Cet ouvrage est le tout premier a proposer un tour d'horizon historique et systematique des multiples conceptions p
192 110 6MB
French Pages 267 [277]
Polecaj historie
Table of contents :
ENS MOBILE
SENS DU MOUVEMENT ET KINESTHÈSE
HUSSERL ET LE GÉOSTATlSME
LE MOUVEMENT COMME A FR/OR/ MATÉRIEL
HEIDEGGER
LE RÔLE OPÉRATOIRE DU
PLASTICITÉ, INTENTIONNALITÉ
MOUVEMENT ET CONSTITUTION DU SENS
CE QUI AURAIT PU ÊTRE FAIT
ESQUISSE D'UNE PHÉNOMÉNOLOGIE DES
LE POIDS VIVANT
TABLE DES MATIÈRES
Citation preview
BIB LIO THÈQUE
PHI LOSOPHIQUE
------
DE
LOUV A I N
102 ------
ENS MOBILE CONCEPTIONS PHÉNOMÉNOLOGIQUES DU MOUVEMENT
Édité par SYLVAIN CAMILLERI
et
JEA N-SÉBASTIEN HA RDY
LOUVAIN-LA-NEUVE
PEET ERS 2018
(Éd.)
ENS MOBILE
BIB LIO THÈQUE
PHI LOSOPHIQUE
-------
DE
LOUV A I N
102 -------
ENS MOBILE CONCEPTIONS PHÉNOMÉNOLOGIQUES DU MOUVEMENT
Édité par SYLVAIN CAMILLERI
et
JEA N-SÉBASTIEN HA RDY
ÉDITIONS DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE PHILOSOPHIE LOUVAIN-LA-NEUVE PEETERS LOUVAIN - PARIS - BRISTOL, CT 2018
(Éd.)
A catalogue
record for this book is available from the Library of Congress.
© 2018, Peeters, Bondgenotenlaan 153, B-3000 Leuven Ali rights reserved, inc1uding the right to translate or to reproduce this book or parts thereof in any form. ISBN 978-90-429-3661 -4 (Peeters Leuven) ISBN 978-2-7584-0303-6 (Peeters France) eISBN 978-90429-3749-9 D/2018/0602/l 07
ENS MOBILE. CONCEPTIONS PHÉNOMÉNOLOGIQUES DU MOUVEMENT Sylvain CAMILLERI et Jean-Sébastien HARDY
Ens mobile est subjectum naturalis philosophiae1• Ce qui frappe ici, c'est la préséance du mouvement par rapport à tous les autres modes de changement. Toute activité de changement est médiatisée par l'activité du mouvement et, de façon originairement pratique, par l'activité du mouvement du corps vivantl.
TraditiOllllellement, le mouvement est avant tout l'affaire de la phi losophie de la nature3. On pourra bien trouver, chez Platon, Aristote, les scolastiques ou encore Hegel, des conceptions « métaphysiques » du mouvement - qu'on pense à l'âme du monde, auprôton kinoun akinêton, à l'aspect créateur du Dieu chrétien, à la dialectique de l'Esprit -, mais celles-ci semblent néanmoins construites par analogie avec des concep tions « physiques » du mouvement qui semblent dès lors détenir une valeur paradigmatique. Il en est ainsi depuis les présocratiques, physio logues s'il en est. Le ta panta rei d'Héraclite, digéré par Protagoras, deviendra le to pan kinesis en du Théétète (156), et si Aristote, dans le chap. 3 du huitième livre de la Physique, en discute le bien-fondé au nom de la véracité du repos, il ne conteste pas que le mouvement est, pour ainsi dire, une catégorie éminemment empirique - ce qui en un sens vaut des mouvements de l'âme également. Il est à peine besoin de rappeler que le Stagirite conçoit généralement le mouvement comme la réalisation du possible, le passage de la puissance à l'acte, l'archi-cause du devenir (cf. Phys. 201b4 ; De gen. et corr., 336aI7). Mais la kinesis dit en même temps et plus particulièrement le changement de lieu d'un corps, que 1 Thomas d'Aquin, De natura generis (opscule 41), cap. XIV. 2 E. Husserl, Autour des Méditations cartésiennes, trad. de N. Depraz, Grenoble, Millon, 1998, p. 301. 3 La traversée de l'histoire de la philosophie qui fait la première partie de cette introduction s'appuie en partie sur l'article « Bewegung " de Rudolf Eisler dans son W6rterbuch der philosophischen Begriffe.
2
SYLVAIN CAMIILERI ET JEAN-SÉBASTIEN HARDY
celui-ci se trouve dans le monde sublunaire ou dans le monde supralunaire. Dans l'ensemble, les penseurs médiévaux - d'Avicelllle à Suàrez en pas sant par Albert le Grand et Thomas d'Aquin - se fondent tous sur la compréhension aristotélicienne du mouvement, qu'ils déclinent bien SÛT selon les préoccupations qui leur sont propres. Il nous faut d'ailleurs noter que le titre même de notre ouvrage, « ens mobile », est emprunté au Docteur Angélique, chez qui le mouvement est une propriété de la matière si fondamentale qu'elle relègue la matière elle-même au second plan. S'il sera montré plus d'une fois que notre emprunt relève surtout du clin d'œil et que l'ens mobile sur lequel nous portons notre attention est à la fois plus englobant et plus principiel que celui de Thomas - ce qui va en quelque sorte, et de notre point de vue, justifier un traitement phénoménologique -, nous pouvons relever, une fois n'est pas coutume, lUle certaine continuité en la matière entre le Moyen Âge et la première Modernité. Certes, pour la nouvelle physique, contrairement à l'ancielllle, le mouvement est lUl état de la matière plutôt qu'un processus de devenir, ce qui le rend éminemment relatif. Conséquemment, la cause du mouve ment d'un corps n'est pas tant dans ce corps qu'à l'extérieur de lui, dans lUl autre corps déjà mouvant, qui lui a transmis tout ou une partie du mouvement qui l'anime. Ce motus n'en reste pas moins, pour Descartes, Spinoza ou encore Leibniz (avec parfois des différences de taille il est vrai entre leurs physiques respectives), cette actio au travers de laquelle des parties de l'étendue s'éloignent ou se rapprochent alternativement les lUles des autres ; par où la définition du mouvement comme migration d'une chose d'un lieu vers un autre est globalement conservée (Princ. Phil. l, 24 ; Eth. II, prop. XIII ; Nouv. Ess., II, 2 1 ), ce qui sera le cas au moins jusqu'au génial systématicien Christian Wolff qui, au § 642 de son Ontologia, reprend la définition de son maître et protecteur Leibniz (Spec. Dyn. 1, 4) : « Continua loci mutatio dicitur Motus ». Kant va bien sûr capitaliser sur les cOllllaissances de la physique moderne, tout en leur conférant plus de précision conceptuelle. Il y va ainsi de sa propre définition, en écrivant que le mouvement d'une chose est le « changement de la relation extérieure de cette même chose à un espace donné » qu'il nous est donné de constater (Met. An!, chap. 4). Il en est ainsi parce que le mouvement est un concept empirique et non lUl concept a priori : il ne présuppose pas seulement l'espace et le temps, mais également la perception de quelque chose qui se meut (ibid.). L'enseignement à retenir est aussi et surtout que « le mouvement, comme tout ce qui se représente par les sens, n'est fourni qu'en tant que phéno mène » (ibid.). C'est peut-être d'une telle idée que repart Hegel dans sa
ENS MOBILE.
CONCEPTIONS PHÉNO:MÉNOLOGIQUES DU MOUVEMENT
3
Nalurphilosophie. Et il lui fait subir la torsion qu'il impose à toutes les idées qu'il reprend de la pensée kantielllle, puisqu'en l'occurrence ce phénomène qu'est le mouvement y est décrit comme « la disparition et la recréation de l'espace dans le temps et du temps dans l'espace » (Enz., II, § 261) ; en sorte que si Hegel s'accorde avec Kant pour dire que le mouvement suppose l'espace et le temps, il soutient en même temps que « c'est par lui seulement qu'ils arrivent à la réalité »4. Sans aller jusqu'à dire que Hegel inverse le sens de l'évolution philosophique de la notion de mouvement, il faut reconnaître qu'il retrouve en un sens Platon en ce que le mouvement se voit élevé au rang de « principe de la véritable We/tseele ; il n'est point un simple prédicat, mais le sujet même comme tel, le substratum de tout ce qui se passe »5. Il n'est dès lors pas étonnant que le mouvement soit au fondement de la dialectique qui tra vaille tout étant. Cette note particulière dans l'histoire du concept est d'autant plus remarquable qu'elle ouvre mutatis mutandis la voie à d'autres retrouvailles, avec Aristote cette fois, chez Trendelenburg, un penseur du milieu du xrxe siècle presque oublié, partisan d'un idéalisme non-absolu, qui anticipe - encore très indirectement - les conceptions phénoménologiques du mouvement auxquelles nous nous attarderons plus loin6 Trendelenburg revient à un concept beaucoup plus général de mouvement, compris comme « ce qu'il se produit de plus universel dans l'être et dans la pensée », « ce qui fait naître la fonne des choses », ou encore « ce qui non seulement dépend de l'expérience mais encore la rend possible » (Log. Uni. l, 243). Malgré leurs différences, on voit sans peine ce qui rapproche Hegel et Trendelenburg sur la question qui nous occupe, mais tout autant ce qui fait de cette paire contrariée une paren thèse, un événement marginal dans la Begrifftgeschichle du mouvement. Car, pendant qu'ils opéraient, la philosophie de la nature n'a jamais vu son primat dans l'interprétation du phénomène du mouvement bousculé. Ce primat s'est au contraire renforcé du développement fulgurant (post hégélien) des sciences empiriques, auquel les philosophes « de métier » pour ainsi dire, assistent impuissants. D'ailleurs, Trendelenburg lui-même s'est rapidement résolu à concéder l'autonomie des sciences empiriques, s'efforçant de repositionner la philosophie en la pensant comme une théo rie ou une logique des sciences spéciales, en quête d'une compréhension
4 Cf J. Willm, Histoire de la philosophie allemande, vol. 4, Paris, Ladrange, 1849, p. 239. 5 Ibid. 6 Rappelons pour l'anecdote que Brentano étudia un temps auprès de Trendelenburg.
4
SYLVAIN CAMIILERI ET JEAN-SÉBASTIEN HARDY
de ses méthodes, plutôt qu'en voulant lui conserver le rôle de fondation de la science en général, objectif inaccessible une fois prouvé de manière indubitable que la pensée échoue bien des fois à justifier la connaissance ou en tout cas n'a plus le monopole en cette affaire. C'est ainsi que la psychologie en général et la psychologie expéri mentale en particulier, à travers lesquelles la philosophie, à la fin du xrxe siècle, se prolonge ou renaît suite à l'effondrement de l'idéalisme allemand, héritent nécessairement de l'étude du mouvement au prisme de la Naturphilosophie et, plus encore, s'en montrent tout imprégnées. Ne négligeons pas cependant que le fort naturalisme de l'époque est atténué par un « retour à Kant » (Zurück zu Kant) duquel une majorité de phy siologues et psychologues sont parties prenantes, à des degrés divers bien entendu. Cela importe car, relativement au sujet qui nous occupe, il appa raît qu'on cherche désonnais autant à expliquer le mouvement d'un corps que ce qu'il se produit dans l'esprit de celui qui perçoit le mouvement d'un corps. En forçant légèrement le trait, il est possible de parler d'une pre mière évolution significative vers une réelle subjectivation de et dans l'ana lyse philosophique du mouvement7 Nous illustrerons cette évolution par le travail d'un important théori cien de la Gestalt, Max Wertheimer, auquel se référera plus tard Merleau Ponty dans la Phénoménologie de la perception, se montrant tout à la fois enthousiaste vis-à-vis de la thèse selon laquelle la perception et l'action ressortissent à des « fonnes » complexes, et critique vis-à-vis du réalisme qui conduit les « gestaltistes » à justifier lesdites fonnes par des théories neuro-physiologiques. En 1912, Wertheimer signe dans la Zeitschrift for Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane un article qui fera date dans les recherches sur la perception visuelle : « Experimentelle Studien über das Sehen von der Bewegung »8 Le titre parle de lui-même : l'intérêt de Wertheimer va à la « vision du mouvement », à ce qu'il appelle ailleurs 7 Une première évolution suscitée par une relecture de Kant, qui en est l'ancêtre lointain, même s'il faut reconnaître que le penseur de Këmigsberg n'a pas lui-même lancé lUle révolution (copernicienne) en la matière. Mais il n'est pas interdit de penser que Hegel et Trendelenburg ont eux aussi joué un rôle indirect dans cette évolution, à la fois négativement et positivement (ce que d'aucuns pourraient voir comme la marque de la ruse de la Raison . . . ). 8 M. Wertheimer, « Experimentelle Studien über das Sehen von der Bewegung '>'>, Zeitschrift for Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, 61, 1, 1912, p. 161-265. Panni les fondateurs de la revue, on retrouve Hermann Ebbinghaus, psychologue encore bien connu des philosophes. Notons également que d'autres figures importantes de la philosophie de l'époque, parlois comptées au rang de précurseurs de la phénoménologie, contribuaient à l'édition de la section « Psychologie ,>,> de la revue : Theodore Lipps, Alexius Meinong ou encore Carl Stumpf.
ENS MOBILE.
CONCEPTIONS PHÉNO:MÉNOLOGIQUES DU MOUVEMENT
5
dans l'article le « mouvement perçu » (wahrgenommene Bewegung)9 Il y a lUle manière proprement théorique de fonnuler cet intérêt. Celle-ci revient à se poser la question de savoir si la vision du mouvement ressortit à lUl « type d'union entre l'intuition du temps et celle de l'espace qui se laisserait dériver et déduire sans reste », ou à une « intuition sensible immédiate et idiosyncrasique, qui reposerait sur lUl mode particulier de sensation ou sur un processus psychique de plus haut niveau »10. Toute fois, la question concernée ne pourra trouver de réponse que par et dans l'expérience ou, pour être plus précis, l'expérimentation ; lUl traitement philosophique seul ne débouchera nulle part sinon sur lUl cerclé carré. Nous n'entrerons pas ici dans le détail de la comparaison entre mouve ment apparent et mouvement stroboscopique ainsi que dans les subtilités du « phénomène-phi ». Il nous suffira de montrer que la formulation expé rimentale de la question du mouvement perçu exige encore et toujours lUle attitude fortement - et à notre sens démesurément - naturaliste. En effet, la Gestalt qui constitue pour Wertheimer la clé de ce qu'il nomme 1'« illusion du mouvement » (Bewegungstauschung) provient de mécanismes cérébraux, plus exactement corticaux, en sorte que les causes ultimes du mouvement apparent doivent être dites physiologiques ll . On peut certes considérer qu'une telle explication se libère de la physique classique comme de la psychologie philosophique qui lui correspond en ce que le mouvement perçu n'est plus reconduit à une sensation conçue comme le lieu d'lUle « correspondance directe entre l'énergie du stimulus et le fait de conscience »12, mais à lUle configuration, lUl ensemble de fonnes qui gouverne la perception et répondent à des lois organiques au sens biologique. Mais peut-on pour autant considérer que la psychologie de la fonne, dont les analyses expérimentales sont concluantes à plus d'un titre, a totalement épuisé l'explication du mouvement ? Pas si l'on postule que l'attitude naturaliste qui commande les recherches de Wert heimer et de ses contemporains sur le mouvement n'est pas indenme de présupposés en souffrance de reconnaissance et de clarification. C'est ici que la phénoménologie entre en jeu : avec sa méthode, rigoureuse dans l'exigence d'une suspension de toute préconception inquestionnée, qui pennettra d'ébranler les fondations même de l'analyse gestaltiste du mouvement ; mais également avec son questionnement 9 Ibid , p. 217. w IbUi., p. 163-164. Il Ibid , p. 248. 12 J.-L. Lœas, L'attention visuelle : de la conscience aux neurosciences, Liège, Mardaga, 1992, p. 1 1 1 .
6
SYLVAIN CAMIILERI ET JEAN-SÉBASTIEN HARDY
propre, qui inaugurera une seconde évolution significative - et, ajoute rions-nous, plus détenninante encore - vers ce que nous avons appelé plus haut une réelle subjectivation de et dans l'analyse philosophique du mouvement. Ce qui s'observe, c'est en réalité un passage, une transition de l 'observation du mouvement perçu à l 'exploration du mouvement vécu. Wertheimer entamait son étude de 1 9 1 2 par la fonnule suivante : « Man sieht eine Bewegung : ein Gegenstand bewegte sich von einer Lage in eine andere »13. La phénoménologie s'en distingue en ce qu'on pourrait énoncer son point de départ comme suit : « Ich er/ebe eine Bewe gung : ich bewege mich »14, dans lequel la mise au présent est cruciale. Malgré des connexions évidentes, à la fois historiques et systématiques, entre psychologie de la fonne et phénoménologie, il y a un monde - c'est le cas de le dire - entre leurs approches respectives du mouvement. Et non pas seulement parce que la phénoménologie privilégie la perspective de la première personne. L'ampleur de cet écart se mesure aisément dans un texte décrivant avec force perspicacité la problématique qui structure l'approche phénoménologique du mouvement ; un texte daté de 1935, intitulé tout simplement « Le mouvement vécu », signé d'Envin Straus15. Dans ce texte, Straus, COllllU pour être un représentant majeur de la psy chologie phénoménologique, commence par expliquer : « L'adjectif "vécu" différencie le mouvement ainsi caractérisé et l'oppose à ce qu'on se représente d'habitude lorsqu'on parle de mouvement tout simplement, sans détennination plus précise. Le mouvement en général est pour nous le mouvement dont nous avons appris les lois dans la physique classique. La notion de mouvement de la physique classique provient en droite ligne de la philosophie de Descartes »16 Voilà qui suffit pour démarquer l'entreprise de Straus de la philoso phie moderne de la nature. Mais ce n'est pas tout, car Straus est d'avis que la conception cartésielllle du mouvement infonne encore, plus ou moins secrètement et directement, toute la psychologie qui est née dans son sillage, jusqu'à la psychologie expérimentale ; notamment car « Des cartes enseigne précisément que la psychologie du mouvement dépend
1 3 « On voit lUl mouvement : un objet se meut d'lUl lieu à lUl autre " . M. Wertheimer, « Experimentelle Studien über das Sehen von der Bewegung '>'>, art. cit., p. 162. 14 « Je fais l'expérience d'un mouvement : je me meus '>'>. I 5 E. Straus, « Le mouvement vécu '>'>, Recherches philosophiques, 5, 1935-1936, p. 112-138. Ce texte est à l'origine une conférence prononcée en Sorbonne, en français. Il reflète les tmvaux en cours de l'auteur à l'époque (cf « Les fonnes du spatial '>'>, Du sens des sens, etc.). " IbUi., p. 112-1l3.
ENS MOBILE.
CONCEPTIONS PHÉNO:MÉNOLOGIQUES DU MOUVEMENT
7
absolument de la physiologie »17. Il n 'y aurait donc aucune place, dans le schéma cartésien régnant, pour le mouvement vécu, lequel se distin guerait foncièrement du « mouvement mécanique » par ce qu'on pourrait appeler son assise ontologico-facticielle18 Pour la psychologie phénomé nologique telle que Straus la conçoit, « le véritable problème n'est pas la contemplation qui fait cOllllaÎtre l'espace » dans lequel je me meus, mais « le fait d'être dans l'espace ». Traduction : « C'est seulement en tant qu'être existant dans le monde que je puis sentir et me mouvoir »19. Tel pourrait être le dénominateur commun de toutes les conceptions phéno ménologiques du mouvement. Et Straus l'illustre d'un exemple d'une extrême simplicité : « Lorsque je pars d'ici pour aller là, il me faut un certain nombre de pas. Le chemin est un, et mon mouvement est un, et moi je suis un dans mon attitude vis-à-vis du monde »20. Comment rendre compte de cette unité dans la diversité même des vécus du mouvement et des sens qu'ils peuvent générer : telle est la tâche que se fixe la phé noménologie du mouvement. Et c'est dans les leçons de l'été 1907 sur La chose et l 'espace de Husserl que, pour la première fois, la thématisation philosophique du mou vement passe des choses au corps propre, accomplissant la subjectivation promise et à la fois empêchée par la psychologie du mouvement. Plus radicalement encore, il ne s'agira pas alors pour Husserl de prendre en compte le mouvement du corps physique du sujet, mais bien plutôt de décrire le mouvement en tant que pouvoir s'exprimant dans les couches inférieures de la sensibilité, avant la perception constituée du monde phé noménal. Ainsi, la mobilité ne constituera pas pour la phénoménologie husserlienne une simple faculté que possèderaient certains étants en plus de leur corporéité : elle vient au contraire définir en propre le mode de déploiement de la chair, en tant que condition de l'ensemble des projets perceptifs et pratiques, voire affectifs, du sujet. Comme l'affinne Husserl, Un organe, c'est ce au sein de quoi (wabei) je suis en tant qu'ego de l'affection et des actions, et ce d'une façon tout à fait unique et tout à fait immédiate, en ce sens que j'y (warin) domine kinesthésiquement de façon totalement immédiate (ganz unmittelbar).21
1 7 Ibid., p. p. 116 (voir également p. 114 et p. 119). 18 Ibid., p. 1 1 7 et p. 119. Pour autant, Straus ne voit pas la psychologie expérimentale et la psychologie phénoménologique comme absolument incompatibles : « Les deux ordres de recherches ne se contrecarrent pas, ils se complètent " (art. cit., p. 122 sq.). " IbUi., p. 119. 20 Ibid., p. 129. 21 E. Husserl, La crise des sciences européennes, Paris, Gallimard, 1976, p. 121.
8
SYLVAIN CAMIILERI ET JEAN-SÉBASTIEN HARDY
Reconduit à sa signification originaire, chaque organe mobile de la chair désigne ainsi pour Husserl une sphère dans laquelle l'ego se trouve affecté et agissant, et ce sans médiation ni délai. La sensibilité étant alors conçue comme « le fonctionnement de la chair sous l'action du Je )} (das ich-tiitige Fungieren des Leibes)22, on voit toute l'importance que l'ana lyse du mouvement vécu recevra chez Husserl. Bien que les concepts et thèses essentielles de la phénoménologie de la perception paraissaient acquis depuis les années 1890, Husserl s 'attarde à l'été 1907, quelques semaines seulement après voir explicité le geste de la réduction dans les leçons sur L 'idée de la phénoménologie, à décrire la corrélation originelle et structurante entre mouvement et perception, corrélation qui préside (à) l'apparaître des choses et d'autrui. Loin d'être la sensation du mouvement du corps physique, la kines thèse désigne en effet la corrélation réglée et constituante entre le se mouvoir (sich Bewegen), volontaire ou non, et les sensations visuelles et tactiles : si j 'accomplis un mouvement détenniné, alors se produit une modification tout aussi détenninée de mes impressions. Ce pouvoir de « motivation » ou de conditiOllllement de l'apparition pennet progressi vement la fonnation, au sein de la sensibilité immanente, de schèmes sensibles exposant des choses perceptibles : Les choses matérielles, en tant qu'elles sont sensibles et telles qu'elles se présentent à moi dans l'intuition, dépendent de ma complexion, c'est-à-dire de mon corps. En ceci tout d'abord que c'est le corps propre qui est le moyen de toute perception, qu'il est nécessairement en cause dans toute perception. L' œil est, dans la vision, dirigé sur ce qui est vu, en parcourt les angles, les surfaces, etc. La main glisse sur les objets en les touchant. En bougeant, je tends l'oreille afin d'entendre. La possibilité de l'expé rience implique la spontanéité des déroulements des actes de sensation. [Dans la perception], le corps propre est en cause en tant que librement mû, et ainsi, à partir de ce fondement originaire, toute chose du monde environ nant de l'ego a son rapport au corps propre.23
La perception se révèle ainsi tout sauf réceptive, et même dans le cas-limite de la perception acoustique, le corps est et doit être en un certain mouvement d'ajustement, de positionnement, d'orientation, etc. Dans un projet conscient de refonte de l'esthétique transcendantale kan tienne, Husserl conçoit le pouvoir motivant de la mobilité chamelle 22 Ibid. 23 E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologiquepures. Livre second: Recherchesphénoménologiquespour la constitution, trad. de D. Souche-Dagues, Paris, PUF, 1996, p. 92.
ENS MOBILE.
CONCEPTIONS PHÉNO:MÉNOLOGIQUES DU MOUVEMENT
9
comme ne représentant rien moins que la condition de possibilité de l'expérience des choses et de l'espace, et ce à divers niveaux de la consti tution : sensation, perception, praxis, signification, etc. Si l'œuvre ultérieure ne reviendra jamais sur les acquis de la théorie des kinesthèses suivant laquelle la perception est essentiellement ciné tique, elle viendra néanmoins d'une part l'étayer génétiquement et d'autre part l'étendre thématiquement. Dans un premier temps, dans de très nombreux textes des 19201930, la phénoménologie génétique viendra mettre en lumière la genèse passive de ce pouvoir actifjusqu'à son soubassement instinctuel primitif Pour cette raison, la définition que donne John Drummond du système kinesthésique apparaît tout à fait juste d'un point de vue statique, mais insuffisante d'un point de vue génétique : « The system afthe perc pients i free capabilities of self-movement is the kinaesthetic system ,,24 Le sys tème des kinesthèses est certes celui d'un je peux à chaque instant « libre », mais cette liberté, en tant qu'elle repose sur une disponibilité constituée, engage pour Husserl la question de sa genèse, qui s'avère à l'origine instinctuelle puis mimétique. Remarquant que « la biologie [est] chez l'homme, pour des raisons d'essence, guidée par son humanité »25, Husserl laisse finalement penser que l'humanisation de l'expérience implique le partage de certains mouvements communs, originaires, mais sédimentés par une certaine « nonnalisation » (Nannalisierung)26 . Dans un second temps, à partir des années 1920, Husserl emploiera le concept de kinesthèse dans des contextes fort divers et souvent à pre mière vue éloignés, en montrant notamment comment la mobilité subjec tive est impliquée dans la perception d'autrui, dans l'appréhension de la causalité des choses, dans l'appropriation pré-juridique des objets, dans le rapport au sol de la Terre, etc. Après tout, puisque « L'homme meut ce qu'il meut par le fait qu'il se meut lui-même. »27, l'étude des kinesthèses se situe à un point charnière où se rencontrent plusieurs des dimensions du monde de la vie. Ces analyses variées, menées à toutes les couches de la constitution du monde, confinnent ce faisant l'importance de la découverte réalisée en 1907. Au fil de tous ces paragraphes plus ou moins développés et liés entre eux, il n'en va finalement pas tant d'une quelconque « intentionnalité du mouvement » comme le voulait 24 J. J. Drummond, « On Seeing a Material Thing in Space: The Role ofKinaesthesis in Visual Perception '>'>, Philosophical Papers, 40, 1979, p. 23. 25 E. Husserl, La crise des sciences européennes, op. cit., p. 534. 26 Cf E. Husserl, Autour des Méditations cartésiennes, op. cit., p. 174. 27 Ibid., p. 30û. .
10
SYLVAIN CAMIILERI ET JEAN-SÉBASTIEN HARDY
Merleau-Ponty, mais bien de façon générale du mouvement de l 'inten tionnalité sous toutes ses fonnes. Le mouvement est alors bel et bien la condition de la vie intentionnelle de l'ego, non tant au sens logique, temporel ou causal, mais bien au sens où la mobilité est le milieu à partir duquel tout rapport au monde se déploie concrètement. Certaines difficultés considérables entourant la phénoménalité et le statut architectonique de ce mouvement originaire et constituant subsistent néanmoins chez Husserl, avant d'être reprises par ses successeurs. Comment la mobilité de la chair apparaît-elle en tant que telle, si elle précède tout apparaître du monde et si elle n'affecte pas l'ego au même sens et de la même façon que les autres sensations ? Husserl consi dère bien les kinesthèses comme une « hylè » spécifique, mais radicalement distincte qualitativement et fonctionnellement des sensations visuelles et tactiles, mais aussi olfactives et acoustiques, qui « exposent » (darstellen) quelque chose au moyen de différences qualitatives et intensives de cou leurs, textures, timbres, etc. À l'inverse, une kinesthèse oculaire droite gauche ne figure ni n'annonce rien à elle seule et elle ne possède pas une sensation propre (cutanée, musculaire, articulatoire, etc.) : elle est en ce sens radicalement immanente. Il semble alors que le mouvement revêt chez Husserl un mode de donation propre, irréductible à celui des choses, mais aussi de la chair sensorielle. Il y aurait alors à confinner cette remarque de Rudolf Bernet selon laquelle « les kinesthèses sont des don nées originellement ultimes »28. Cette première difficulté quant à la phénoménalité propre du mou vement se trouve redoublée dès lors que l'on tient compte du fait que, pour fondamental que le mouvement soit d'un point de vue d'une théo rie de la « constitution du monde primordial » (intitulé regroupant les manuscrits du groupe D auquel appartiennent la grande majorité des textes sur les kinesthèses), il paraît malgré tout dérivé par rapport à la temporalité immanente de la subjectivité absolue que décrit les leçons de 1905, mais aussi par rapport à l'affectivité pulsionnelle. De ce point de vue d'ailleurs, comme Husserl le reconnaît lui-même, le se-mouvoir est génétiquement d'abord un être-mû (Bewegtwerden) : par le « por tage » des parents en ce qui concerne la locomotion, mais aussi par les réflexes en ce qui concerne les mouvements propres, et ce sans même considérer les forces pulsionnelles travaillées par la culture qui 28 R. Bernet, « La motivation kinesthésique de la constitution de la chose et de l'espace '>'>, trad. de N. Depraz, Alter. Revue de phénoménologie, 4, 1996, p. 471.
ENS MOBILE.
CONCEPTIONS PHÉNO:MÉNOLOGIQUES DU MOUVEMENT
Il
pourraient représenter toute une « éducation sensible » en majeure par tie inconsciente29. Nonobstant ces points aveugles de la conception husserlienne du mouvement, les kinesthèses y conservent un privilège descriptif insigne puisqu'elles se situent pour ainsi dire à la croisée des phénomènes, à la naissance du monde, d'autant plus qu'elles sont la toute première fonne d'activité appartenant à l'ego30 : les sensations dernières, c 'est-à-dire celles en deçà desquelles l'analyse constitutive ne peut plus régresser, sont celles du mouvement. Si Heidegger ne s'est jamais prononcé directement sur la description du mouvement menée par Husserl, il est facile d'imaginer qu'il aurait souligné et synthétisé d'un trait les deux écueils mentionnés précédem ment : l'appel à retourner à une activité plus profonde du sujet dans sa sensibilité immanente manque le caractère plus originaire de la significa tivité par rapport à la sensibilité, fût-elle celle de quelconques « projets moteurs » délibérément voulus par l'ego. Le tort de Husserl ne serait pas tant de n'avoir pas su expurger tout résidu de sensualisme et de psycho logie physiologique de son concept de mouvement que de continuer à entretenir une position subrepticement théorétique suivant laquelle c'est d'une immanence sensible pré-mondaine et anté-significative que l'on doit attendre la genèse du monde. Une telle analyse du mouvement vécu, constituant la première ekstase hors de l'encapsulement de la chair sur elle-même, est incompatible avec la thèse de la primauté de l'être-au monde et ainsi nulle et non avenue. Plus encore, au sein des structures de renvois, le mouvement vécu n'est à la rigueur tout au mieux qu'un moment de la systématique des renvois, la chair partageant du reste avec l'outil la possibilité d'une défectuosité (le mouvement empêché, inadapté, épuisé, etc.). La mobilité ne dit encore à elle seule rien du mode d'être du Dasein. Plus exactement, la Bewegtheit est un caractère du monde, ou du rapport du sujet au monde (en particulier celui du travail), et non pas de l'ego incarné. En consé quence, bien que l'on n'ait sans doute pas encore « médité sérieusement
29 « Plus convaincante [que la phénoménologie génétique de Husserl] serait peut être lUle analyse tenant compte des forces. Mais quand la phénoménologie ne s'est-elle jamais donné les moyens de décrire et de penser les forces ? " (D. Franck, Dramatique des phénomènes, Paris, PUF, 2001, p. 73-74). 3 0 « D'après son sens, la réceptivité est bien une expression qui comprend l'lUle couche des plus profondes de l'activité (eine niederste Stule der Aktivitiit) '>'> (E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phiinomenologie und phiinomenologischen Philosophie. Band II, Dordrecht, Springer, 1976, p. 312. Nous traduisons).
12
SYLVAIN CAMIILERI ET JEAN-SÉBASTIEN HARDY
sur ce qu'est l'être-chair (das Leiben) » qui s'avère ainsi « encore et d'abord un mot obscur »31, toute phénoménologie de la chair et de ses pouvoirs propres apparaît tout au mieux dérivée par rapport à l'analytique des existentiaux du Dasein lui-même. Peut-être les quelques réflexions heideggérielllles tardives sur le geste pennettraient-elles alors d'explorer Ulle philosophie du mouvement qui ne doive plus rien à l'esthétique kan tielllle ou à un quelconque sensualisme. Faisant droit semble-t-il à une véritable ontologie du mouvement, Heidegger affinne par exemple laco niquement que « Faire-signe ( Winken) et gestes (Gebarde) appartiennent et ont place dans un tout autre espace de déploiement [que celui de la métaphysique1 » 32 Quoi qu'il en soit, toutes les phénoménologies du mouvement qui succéderont à celle de Husserl chercheront justement à déplacer le lieu de phénoménalisation et d'effectuation du mouvement, comme si la pos térité avait assmné cette critique générale mais implicite de la phénomé nologie de la perception et du mouvement, celle-ci étant reconduite à ses conditions mondaines (Merleau-Ponty), ontologiques (Patocka), affec tives (Henry) ou même neurologiques de déploiement. C'est chez Merleau-Ponty que la description du mouvement vient pour la première fois constituer une thématique propre de l'analyse phénoménologique, non subordonnée à un fil conducteur comme c'était encore le cas chez Husserl où l'enjeu initial est d'élucider la matérialité de la chose et la tridimensionnalité de l'espace. Au chapitre III de la première partie de La phénoménologie de la perception ainsi qu'au chapitre II de sa deuxième partie, Merleau-Ponty entend en effet décrire distinctement un cogito moteur, en montrant comment, des habitudes les plus concrètes à celles abstraites, les actes de l'ego impliquent tou jours une activité du corps propre, effectif ou seulement virtuel. S'ins pirant du deuxième tome des Idées directrices de Husserl portant sur la constitution et puisant tout autant qu'à Grünbamn et Goldstein, Mer leau-Ponty lutte contre toute tentative de préconcevoir les potentialités du sujet comme étant désincarnées et sans monde. La chair est chez lui « l'enveloppe vivante de nos actions »33, position en proie de devenir un lieu commun de la phénoménologie. En en étendant le sens,
3 1 M. Heidegger, Nietzsche l, GA 611, Franfurt a. M., Klostennann, 1997, p. 565 et 439.
32 ·M. Heidegger, Unterwegs zur Sprache, GA 12, Frankfiut a. M., Klostennann, 1985, p. 1 1 1 . Nous traduisons. 33 M. Merleau-Ponty, La structure du comportement, Paris, PUF, 1967, p. 203.
ENS MOBILE.
CONCEPTIONS PHÉNO:MÉNOLOGIQUES DU MOUVEMENT
13
Merleau-Ponty fait du mouvement l'expression la plus générale de tout Je peux : [C]es éclaircissements nous pennettent enfin de comprendre sans équi voque la motricité comme intentionnalité originale. La conscience est ori ginairement non pas un « je pense », mais un « je peux ». [ . . . ] Dans le geste de la main qui se lève vers un objet est enfennée une référence à l'objet non pas comme objet représenté, mais comme cette chose très déter minée vers laquelle nous nous projetons, auprès de laquelle nous sommes par anticipation, que nous hantons34.
Même le comprendre ( Verstehen), c'est-à-dire l'accord progressif entre une intention et un donné, impliquerait ainsi un mouvement éprouvé, s'ajustant d'instant en instant sur le sens à effectuer, vérifier, instancier, etc.35 Or, que la potentialité soit d'abord motricité et qu'on puisse sur cette base parler d'une « intentiOllllalité motrice », cela demeure éminemment problématique au sein d'un régime de pensée husserlien, duquel juste ment Merleau-Ponty s'émancipe. Certes, « Wahmehmen et sich bewegen émergent l'un de l'autre »36, mais, règle générale, chez Husserl la mobi lité de la chair survient à travers une conscience sensible pré-intention nelle : la kinesthèse n'est pas une action au sens strict. Faire de la motricité la donnée fondamentale d'une phénoménologie de la praxis dans, sur et avec le monde et autrui implique par conséquent une trans fonnation profonde du sens du concept de mouvement : de déploiement immanent de l'ego, le mouvement recouvre chez Merleau-Ponty pos tures, allures, gestes, expressions, attitudes, etc. Qu'on y voie ou non un court-circuit indu3?, Merleau-Ponty conduit ultimement dans Le visible et l 'invisibile le thème du mouvement vers une cosmologie phénoménolo gique, dans laquelle physis et corps propre s'entre-appartiennent, aux « détroits »38 de certains gestes fondamentaux. Par la plurivocité relative qu'il prête au concept de mouvement, les analyses de Merleau-Ponty auront ouvert la voie à des usages riches et variés, notamment en philosophie de la danse, du sport, de l'art et de l'architecture. L'article aujourd'hui célèbre d'Iris Marion-Young,
34 M. Merleau-Ponty, Laphénoménologie de laperception, Paris, Gallimard, 1945, p. 160-161. ; s IbUi., p. 169. 3 6 M. Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, Paris, Gallimard, 1964, p. 303. 37 Cf D. Pradelle, L 'archéologie du monde, Dordrecht, Springer, 200û, p. 254-255. 3 8 M. Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, op. cit., p. 173.
14
SYLVAIN CAMIILERI ET JEAN-SÉBASTIEN HARDY
« Throwing Like a Girl »39, qui cherche à retracer la différence sexuelle à l'œuvre dans la réflexivité de la chair à partir du simple mouvement de lancer un ballon, constitue à cet effet une attestation d'un tel développe ment original et potentiellement critique rendu possible par la phénomé nologie merleau-pontielllle du pouvoir de se mouvoir. Là où la conception merleau-pontienne du mouvement est encore redevable aux textes husserliens ainsi qu'à leurs propres sources histo riques dans la psychophysique et la neurologie naissante, celle que déve loppe Patocka s 'inscrit d'emblée pour sa part dans une tradition tant heideggérielllle qu'aristotélicienne ; elle se situe pour ainsi dire entre « phénoménologie et métaphysique du mouvement » pour reprendre le titre du texte qui ouvre ses Papiers phénoménologiques. Ce positiOllllement inédit implique essentiellement deux thèses cor rélatives. D'abord, le mouvement représente une compréhension en acte, le pouvoir de se mouvoir étant celui d'explorer et de faire exister le système de renvois du monde40. Aussi infime soit-il, tout mouvement est en effet « mouvement-avec »41, inclusion du soi dans un horizon de sens. Non seulement « le mouvement subjectif ressortit[-il ainsi] à la donation de sens », mais, plus encore, « toute effectuation de sens est corpo relle »42. Ensuite - ce qui vient marquer la distance entre les conceptions merleau-pontienne et patockienne du mouvement -, il s'agit, en s'inspi rant d'une physique aristotélicienne « dédogmatisée »43, de se défaire résolument de tout subjectivisme résiduel dans le corrélationnisme phé noménologique. Pour ce faire, le mouvement doit être compris comme passage du non-être à l'être, dans une réactivation d'une conception pré moderne de la physis. Le mouvement est toujours un « rendre-présent »44, recouvrant ainsi une fonction temporelle que le temps à lui seul ne peut remplir. En ce sens, c'est bien davantage à une certaine « ontologisation » du mouvement que l'on assiste chez Patocka, celle-ci s 'exprimant le plus clairement dans la théorie des trois mouvements que sont l'enracinement (entre autres dans la famille), le dessaisissement (notamment par le tra vail) et la percée (par un engagement authentique), qui n'ont plus à voir
39 1. M. Young, « Throwing Like a Girl: A Phenomenology of Feminine Booy Comportment. Motility and Spatiality '>'>, Human Studies, 3, 1980, p. 137-156. 40 Cf J. Patocka, Papiers phénoménologiques, Grenoble, Millon, 1995, p. 17. 4 1 Ibid., p. 20. 42 Ibid., p. 25 et 23. 43 Ibid., p. 31, n. 1 . 44 Ibid., p . 45.
ENS MOBILE.
CONCEPTIONS PHÉNO:MÉNOLOGIQUES DU MOUVEMENT
15
avec le mouvement compris de façon directement chamelle ou sensible. Patocka se libère définitivement des assises cartésiano-kantielllles de la conception husserlienne de la subjectivité, dont la sensibilité était conçue comme la matrice primordiale d'une genèse transcendantale de l'expé rience. Refusant la possibilité même d'une telle « endogénèse » du monde, la phénoménologie asubjective de Patocka situe la genèse même du sujet dans un triple « mouvement de l'existence » qui implique tant autrui que l'histoire. Tour à tour pensé comme accueil, travail, soin de soi, etc., le concept de mouvement se voit alors recevoir des significa tions entièrement nouvelles non seulement en phénoménologie, mais aussi en philosophie. Panni les tendances les plus récentes issues du commentaire ou de l'étude de ce corpus gravitant autour des figures de Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty et Patocka, on notera à la fin des années 1990 une volonté expresse de naturaliser certaines des dOIlllées et découvertes phénoméno logiques ayant trait à la mobilité vécue, non sans écho à la préhistoire de la phénoménologie du mouvement dans la philosophie et surtout la psy chologie du 1ge siècle. Aussi constatons-nous, et ce dès le premier mani feste de la naturalisation de la phénoménologie45, un effort d'assigner certaines structures de l'expérience motrice constitutives de notre rapport au monde - l'orientation, l'équilibre, l'attention, etc. - à un substrat neu rologique ou à des processus cognitifs sous-jacents. En redonnant ses droits plutôt qu'en suspendant le psychologisme qui guette toute phéno ménologie du mouvement, cette « renaturalisation » de la phénoménologie renoue paradoxalement avec le lexique et l'attitude même avec lesquels Husserl souhaitait explicitement rompre en introduisant le concept phéno ménologique de « kinesthèse »46. S'agirait-il alors de valider à renfort de traductions, observations et expérimentations les résultats de la phénomé nologie, ou à l'inverse de faire valoir l'ancrage phénoménologique des concepts qui sont pris comme allant de soi dans des sciences qui objec tivent, bon gré mal gré, la subjectivité vivante qu'elle étudie ? L'enjeu est-il de compiler ou croiser des lumières diverses sur une même réalité (auquel cas il faudrait montrer qu'existe un tel concept univoque, tout logos confondu, de mouvement) ou, de fonder l'un discours sur l'autre ? Les auteurs semblent diverger sur cette question, pourtant fondamentale.
45 J. Petitot et al. (eds.), Naturalizing Phenomenology. Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science, Stanford, Stanford University Press, 1999. 46 E. Husserl, Chose et espace. Leçons de 1907, trad. de J.-F. Lavigne, Paris, PUF, 1989, p. 196-197.
16
SYLVAIN CAMIILERI ET JEAN-SÉBASTIEN HARDY
La phénoménologie n'aura peut-être pas tant donné lieu à diffé rentes phénoménologies du mouvement qu'elle aura déployé différentes sources conceptuelles du mouvement, appartenant à des ancrages séman tiques et philosophiques distincts : physique, psychologie, éthologie, etc. n n'est pas certain en effet que l'on puisse reconduire la compréhension du mouvement comme effort chez Henry, la conception des mouvements de l'existence chez Patocka, etc. à une seule souche théorique, ni même à lUle seule dimension de l'expérience même. La multiplicité des phéno ménologies du mouvement est le témoignage du fait que le mouvement demeure l'un des philosophèmes les plus archaïques et récurrents de la pensée occidentale, un schème fondamental et essentiel par lequel on rend compte à la fois de la non-pennanence des choses, de la liberté de l'homme et des possibilités d'une transfonnation du monde. Cet ouvrage entend ainsi contribuer à la richesse des analyses qui émergent de cette plurivocité même du mouvement, concept qui appartient à la grammaire même de la pensée occidentale.
SENS DU MOUVEMENT ET KINESTHÈ SE. É LA D COUVERTE DU « CONCEPT PHÉNOMÉNOLOGIQUE DE MOUVEMENT » DANS CHOSE ET ESPACE DE HUSSERL Jean-Sébastien HARDY
Dans mes convictions fondamentales [ . . . ], je me suis considérablement éloigné des hommes et des ouvrages auxquels je suis le plus redevable de ma fonnation scien tifique, tandis que je me suis notablement rapproché d'une série de philosophes dont je n'avais pas été en mesure d'apprécier antérieurement les œuvres à leur valeur.1
Le concept de « kinesthèse », une percée de la phénoménologie husserlienne ? Ce texte a pour objectif de cerner le moment d'introduction du concept phénoménologique de mouvement chez Husserl en le rapportant aux sources dont il émerge et se libère à la fois. Ce rapport aux origines psychophysiques de la notion de mouvement revêt une grande impor tance afin de comprendre toute la portée que Husserl confère au mouve ment dans son œuvre, de la phénoménologie de la perception à celle de l'espace, de l'intersubjectivité et même de la communauté, comme diverses études l'ont montré depuis une vingtaine d'années environ2, mais aussi en vue de mesurer l'originalité de l'usage husserlien du mou vement par rapport à ceux merleau-pontyen, patockien, henryen, etc. Il ne s'agit pas par là de dire que ceux-ci émaneraient du concept restreint 1 E. Husserl, « Préface de la première édition " (1900), Recherches logiques. Tome premier: Prolégomènes à la logique pure, trad. de H. Elie, A. L. Kelkel et R. Schérer, Paris, PUF, 1959, p. IX. 2 Pour ne citer que les plus connus : N. Depraz, Transcendance et incarnation. Le statut de l 'intersubjectivité comme altérité à soi chez Husserl, Paris, Vrin, 1995 ; A. J. Steinbock, Home and Beyond: Generative Phenomenology after Husserl, Evanston, Northwestem University Press, 1995 ; E. Housset, Personne et sujet selon Husserl, Paris, Puf, 1997 ; D. Pradelle, L 'archéologie du monde : constitution de l'espace, idéalisme et intuitionnisme chez Husserl, Dordrecht, Kluwer, 2000, et P. Ducros, Husserl et le géosta tisme. Perspectives phénoménologiques et éthiques, Paris, Cerf, 2011.
18
JEAN-SÉBASTIEN HARDY
de « kinesthèse » - et bien au contraire, comme nous y reviendrons en conclusion -, mais seulement de souligner que Husserl est bien le pre mier à fonnuler une conception rigoureusement phénoménologique du mouvement vécu tout en lui conférant une fonction transcendantale, c'est-à-dire proprement constitutive, dans la mesure où il se trouve impli qué dans une série d'actes du sujet (perception, rapport à autrui, mais aussi, à en croire certains textes, ressouvenir imagination3). À l'été 1907, au cours de ses leçons sur la chose et l'espace, Husserl découvre en effet l'implication ou la « mise en scène » (Inszenierung)4 essentielle de la mobilité dans la perception du monde : une chose n'est perçue au sens strict que pour autant que l'ego exerce sa potentialité motrice. Comme ['affirmeront plus tard les Idées II : la chair est le moyen de toute perception, elle est l'organe de la perception, elle est nécessairement en cause (dabei) dans toute perception. L'œil est, dans le voir, dirigé sur ce qui est vu et parcourt les angles, les surfaces, etc. La main glisse en touchant les objets. Me mouvant, j'approche l'oreille afin d'entendre. [ . . . ] La possibilité de l 'expérience implique la spontanéité des déroulements des actes de sensation (Empfindungsakte), actes qui se pré sentent accompagnés par des séries de sensations kinesthésiques et motivés par elles dans leur dépendance.5
La perception d'une chose du monde externe ne survient qu'à partir d'une mise en mouvement de la chair de l'ego, qui tourne autour d'elle, s'avance vers elle, l'explore du regard, etc., et ce de façon à en susciter, confinuer, préciser, etc. la corporéité (en tant qu'elle est res extensa et materialis). Pour désigner ce pouvoir de se mouvoir qui appartient en 3 Husserl soulève cette idée notamment dans ses conversations avec Cairns D. Cairns, Conversations avec Husserl et Fink, Grenoble, Millon, 1997, p. 85. La phéno ménologie de l'expérience esthétique (théâtrale en particulier) pourrait également exem plifier ou étayer cette idée d'un mouvement de l'imagination : « Je suis là, debout devant la peinture [ . . . ] Il s'agit précisément d'un pur Je de l'imagination, doté d'une corporéité charnelle indéterminée [ . . . ] Aussi ne puis-je pas non plus poser la question de savoir quelle chair possède le spectateur de l'image " (E. Husserl, De l'intersubjectivité II, trad. de N. Depraz, Paris, PUF, 2001, p. 43). 4 Husserl parle à diverses reprises d'une « mise en scène de la chair ,>,> (lnszenierung des Leibes) ; voir Autour des Méditations cartésiennes, trad. de N. Depraz et P. Vande velde, Grenoble, Millon, 1998, p. 220 et 227 et Analysen zur passiven Synthesis. Aus Vorlesungs- undForschungsmanuskripten, 1918-1926 [Hua XI], éd. par Margot Fleischer, Hague, Nijhoff, 1966, p. 13. Waldenfels relève et examine cette expression relativement inusitée ; voir Das leibliche Selbst: Vorlesungen zur Phiinomenologie des Leibes, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 2000, p. 208-209. 5 E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phéno ménologique pures. Livre second : Recherches phénoménologiques pour la constitution, op. cit., p. 92 (abrev. ldeen II).
SENS DU MOUVEMENT ET KlNESTHÈSE
19
propre à l'ego6 et qui assure la constitution primordiale du monde perçu, Husserl emploiera alors, à titre de néologisme, le tenne de « kinesthèse » (Kinasthese)1. Or, ne faut-il pas se surprendre que Husserl élabore cette première conception phénoménologique du mouvement au lendemain même du « tournant transcendantal » allllOncé seulement quelques semaines aupa ravant par l'explicitation de la méthode de la réduction dans le cadre de ses leçons sur L 'idée de la phénoménologie ? N'y a-t-il là que coïnci dence, ou l'analyse de la fonction du mouvement dans la constitution des choses et de l'espace ne pennet-elle pas précisément à Husserl de concevoir une activité du Je qui ne se cantonne pas aux actes judicatifs et évaluatifs, mais qui traverse même la sensibilité immanente et intransitive ? Au vu de ce contexte d'origine, notre hypothèse est que l'introduc tion d'une conception phénoménologique du mouvement dans l'œuvre de Husserl constitue proprement une « percée », et ce à double titre. Elle est lUle percée d'abord pour l'histoire de la pensée phénoménologique puisque l'apparaître du monde sera désonnais lui-même pensé à partir d'une certaine mobilité originaire (Husserl emploie le tenue d' Urbeweg lichkeit8), certes subordonnée à l'ego, mais en tant que celui-ci est incarné -, et également une percée pour l'évolution interne de la pensée 6 Il ressort toutefois d'un certain nombre de textes que cette propriété ou mienneté de la kinesthèse est problématique. Aussi Husserl affinne-t-il par exemple que « [les sen sations de la chair] n'appartiennent pas au domaine de l'égoïque (ichliche) proprement dit. " (Ideen II, op. cit., p. 295-296). Un manuscript de 1932, intitulé « Schwierigkeiten der Kiniisthese '>'> questionne le sens propre de l'égoïté des kinesthèses : « La kinesthèse n'est-elle pas là aussi égoïque (ichlich) ? Mais que veut dire cette égoïté (Ichlichkeit) ? '>'> (11s D 10 IV, p. 11-12). Retenons que la chair n 'est mienne que là oùje peux m y sentir agissant. 7 Husserl choisit le terme de « kinesthèses '>'> en 1907 pour éviter toute confusion avec l'expression, courante en psychologie, de Bewegungsempfindungen. Or, le terme n'est pas non plus un néologisme dans l'histoire de la pensée scientifique puisque en 1880 l'anglais H. C. Bastian le proposait dans The Brain as an Organ ofMind : « We may much more reasonably and conveniently, in the face of all the disagreements conceming the "muscular sense", speak of a Sense ofMovement* as a separate endowment of a complex kind, whereby we are made acquainted with the position and movements of our limbs [ . . . ] *Or, in one word, Kinaesthesis (from KtvÉo, to move, and aiG811Gtç, sensation). To speak of a "Kinaesthetic Center" will certainly be found more convenient than to speak of a "Sense of Movement Center" '>'> (H. C. Bastian, The Brain as an Organ ofMind, London, Kegan Paul, Treneh & Co., 1882 [1880], p. 543). 8 Notamment E. Husserl, Zur Phiinomenologie der Intersubjektivitiit. Texte aus dem Nachlafl. Erster Teil. 1905-20 [Hua XIII], éd. par 1. Kern, Den Haag, Nihoff, 1973, p. 70, et E. Husserl, Zur Phiinomenologie der Intersubjektivitiit. Texte aus dem Nachlafl. Zweiter Teil. 1921-28 [Hua XIV], éd. par 1. Kem, Den Haag, Nijhoff, 1973, p. 541.
20
JEAN-SÉBASTIEN HARDY
de Husserl - puisque le concept phénoménologique de mouvement vien dra justement faire droit et « donner chair » au tournant transcendantal, du moins pour ce qui est de la théorie de la constitution du monde pri mordial qui joue une fonction insigne pour toutes les couches subsé quentes de la mondanéité (monde intersubjectif, monde des œuvres, etc.). Or, afin d'étayer cette hypothèse quant à l'histoire interne de la phénoménologie en général et de la phénoménologie husserlielllle en par ticulier, il importe en un premier temps de détenniner de quelle façon Husserl hérite de notions tirées de la psychophysique anglaise et alle mande du XIXe siècle, pour en radicaliser toutefois les concepts fonda mentaux ainsi que les problèmes porteurs. Il nous faudra montrer ensuite comment le concept de kinesthèse viendra modifier en 1907 le sens de la phénoménologie de la perception présente en filigrane dans l'œuvre anté rieure et l'exposer à un ensemble de problèmes nouveaux.
Repères pour une préhistoire du concept phénoménologique de mouvement La phénoménologie du mouvement que Husserl élabore une pre mière fois en 1907 émerge d'un contexte qui la détennine d'une façon claire mais indistincte, à savoir les travaux sur le « sens du mouvement » (sense ofmovement, Bewegungssinn) qui avaient cours et circulaient en Allemagne au xixe siècle, tant dans la psychologie physiologique que dans la psychologie descriptive, ou encore dans 1'« analyse des sensa tions » d'un Mach. Les travaux de Johann Friedrich Herbart, de Wilhehn Wundt et de Carl Stnmpf, disciple de Brentano, mais aussi ceux de Wil liam James, avec lesquels Husserl était entré en contact et qui abordaient tous la question du mouvement, constituaient des références tout à fait communes à l'époque de sa fonnation académique. Dans les notes qui suivent sa traduction de Chose et espace, Jean-François Lavigne nous met toutefois en garde, car, selon lui, « Il serait vain de chercher dans ce contexte extra-phénoménologique l'''origine'' du concept husserlien [de kinesthèse]. » 9 En ce sens, nous aimerions confinner la thèse de Jean-François Lavigne, mais en prenant soin de mettre en lumière en quoi Husserl échappe justement aux théories du mouvement qui lui étaient familières, et ce non pas en les amendant, mais en en changeant l'indice de sens, en les soumettant à l'épreuve de la réduction. 9 E. Husserl, Chose et espace, op. cit., p. 462.
SENS DU MOUVEMENT ET KlNESTHÈSE
21
La préhistoire du concept de kinesthèse a donc pour scène les débats internes à la psychologie physiologique du xix' siècle portant sur la nature de la sensation de mouvement (Bewegungsempfindung). Cette idée d'une sensation ou, plus proprement, d'un sens du mouvement, était un lointain écho aux premières découvertes neurologiques faites par l' Écos sais Charles Bell. C'est en effet au tout début du même xixe siècle que l'idée d'une sensation spécifique de mouvement voit le jour dans le cadre d'abord restreint de la psychologie physiologique. En 1 8 1 1 , J. G. Stein buch publiait ses Beitrage zur Physiologie der Sinne, dans lesquels il évoquait l'existence de « Muskelideen » ; la même année, l' Écossais Charles Bell distribuait à son cercle d'amis An Idea of a New Ana/orny of the Brain, qui jette les bases neurologiques pennettant de penser, en amont comme en aval (c'est-à-dire du système nerveux central à celui périphérique), un « sens du mouvement » irréductible aux autres sens. La notion se propage alors comme une traînée de poudre, suscitant des contributions d'Alexander Bain, Herbert Spencer, RudolfH. Lotze, Her mann von Helmholtz, Wilhelm Wundt, etc. ID Ce qu'ont en commun ces recherches11 est d'aborder la signification du mouvement corporel par le biais d'une analyse de la sensation à cet égard le titre de l'ouvrage d'Ernst Mach (Beitrage zur Analyse der Ernpfindung) est exemplaire12 : elles se dOllllent pour tâche d'identifier la nature du contenu (conscient ou inconscient, volontaire ou involontaire, etc.) et le substrat anatomique -
10 Quelques travaux déterminants dans l'histoire de la notion de Bewegungsempfin dung : A. Bain, The Senses and the Intellect (1855) ; W. Wundt, Die Lehre von der Mus kelbewegung (1858) et Grundzüge der physiologischen Psychologie (1874), t. l, chap. 9 et t. II, chap. I l ; C. Stumpf, Über den psychologischen Ursprung der Raumvorstellung (1873), § 3 ; H. von Helmholtz, Die Tatsachen in der Wahrnehmung (1878) ; E. Mach, Grundlinien der Lehre von den Bewegungsempfindungen (1875) et Beitriige zur Ana lyse der Empfindung (1886) et W. James, Principles ofPsychology (1890). Il L 'esquisse d'une psychologie (1895) de Freud, qui fait aussi usage de l'idée d'un sens du mouvement, aura la particularité d'en approcher le concept à partir d'une analyse de l'affectivité : l'objet atteint, source de plaisir ou de déplaisir, laisse une trace ou image motrice (Bewegungsbild) de son accès dans la conscience, de telle sorte que tout mouve ment effectif ultérieur est susceptible de réactiver la représentation affective de cet objet et par là d'éveiller le désir. Cf S. Freud, « Entwurf einer Psychologie '>'>, in Gesammelte Werke, Nachtragsband, Texte aus den Jahren 1885 bis 1938, Frankfurt a. M., Fischer, 1987, p. 411, 468 et 476-477 : « nous ne pouvons désormais nous représenter l'agir (Han deln) autrement que comme le plein investissement (Vollbesetzung) de ces images de mouvement ,>,> (p. 476). 12 Wilhelm Wundt utilise également l'expression (Grundzüge der physiologischen Psychologie, t. l, p. 420). Husserl connaissait bien l'ouvrage de Mach pour en avoir tiré des « exercices philosophiques ,>,> (philosophische Übungen) dans un séminaire de 1 9 1 1 . Cf K . Schuhmann, Husserl-Chronik. Denk-und Lebensweg Edmund Husserls, Dordrecht, Nijhoff, 1981, p. 157.
22
JEAN-SÉBASTIEN HARDY
(cutané, musculaire, articulaire, nerveux, etc.) spécifiques de la sensation de mouvement panni les diverses autres sensations qu'on trouve chez l'homme. Ce débat quant aux contours du sens du mouvement n'aurait sans doute COllllU qU'lUle postérité éphémère et limitée, n'eût été le fait que les dOllllées du problème furent importées au centre d'un autre débat, plus philosophique que scientifique cette fois, quant à l'origine de la représen tation de l'espace (Ursprung der Raumvorstellung, titre de l'ouvrage important de Stumpf). L'usage philosophique de ce « sixième sens » que serait le mouvement prenait en effet pour point de départ l'idée que les sens dits réceptifs - la vue, le toucher, l'ouïe, etc. - ne sauraient à eux seuls à produire certaines des détenninations essentielles du dOllllé spatial (en particulier l'étendue, la distance et la symétrie). Il s 'agissait alors, chez plusieurs psychologues allemands, de mobiliser les ressources que fournissaient les études psychophysiques sur le mouvement dans une cri tique et une refonnulation de l'esthétique transcendantale kantienne. À titre d'exemple, Hennann von Helmholtz avançait en 1 878, dans son discours pour l'anniversaire de l'Université de Berlin, qu'il est nécessaire de traduire et de fonder neuro-physiologiquement la doctrine de l'es pace13, l'intuition du monde extérieur étant liée selon lui à une « impul sion volitive motrice » (motorischer Willensimpulse), impulsion au mouvement (Impulz zur Bewegung). Cette critique de l'esthétique transcendantale kantienne - qui à sa façon n'est pas demeurée sans écho dans la phénoménologie husser lienne14 - se donnait comme stratégie spécifique d'élaborer une révision génétique de la fonne de l'espace qui, selon ces différents auteurs, aurait été à tort comprise par Kant comme étant innée, ou à tout le moins antérieure à l'expérience (position souvent qualifiée de « nativiste »). Les fonnes de la sensibilité peuvent bien être des « conditions transcen dantales » - à tout le moins en ce qu'elles sont en jeu dans toute expé rience de l'extériorité -, elles sont néanmoins acquises ou, au sens strict, 1 3 Cf « Die Tatsachen in der Wahmehmung '>'>, in H. von Helmholtz, Vortrage und Reden, t. 2, 1896, p. 225. 14 « Nous pouvons désigner le complexe extrêmement vaste des recherches concer nant le monde primordial (qui forme à lui seul toute une discipline) par le terme d'« esthé tique transcendantale '>'>, pris en un sens très élargi ; nous reprenons ici l'expression kan tienne ,>,> (E. Husserl, Méditations cartésiennes et Les conférences de Paris, § 61, trad. de M. de Launay, Paris, PUF, 1994, p. 197). Or, « Dans de telles considérations, on se meut dans une abstraction thématique, dans la mesure où l'élément kinesthésique participe par tout de façon essentielle, mais ne figure pas d'abord dans le thème de l'analyse ,>,> (De la synthèse passive, op. cit., p. 346-347).
SENS DU MOUVEMENT ET KlNESTHÈSE
23
impures15• Chacun à leur façon, les détracteurs explicites ou implicites de Kant cherchent alors à penser l'espace en tant que « product of our experience », à savoir en tant que résultat d'une « genèse » associative ou causale, et ce, en reconduisant celle-ci à ce sixième sens nouvelle ment admis. Cette posture anti-kantienne et empiriste - voire « expéri mentaliste » dans le cas de Mach - amenait par exemple Wundt à affirmer de façon paradigmatique en 1 886 que « la première base fon damentale des intuitions de temps et d'espace est donnée dans l'action immédiate de la volonté sur les organes de mouvement. »16 Cette posture est si commune que même un mathématicien comme Poincaré viendra à émettre l'hypothèse d'un fondement non logique mais moteur de l'espace formel : Quand on dit que nous « localisons » tel objet en tel point de l'espace, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie simplement que nous nous représentons les mouvements qu'il faut faire pour atteindre cet objet ; et
qu'on ne dise pas quepour se représenter ces mouvements, il faut lesprojeter eux-mêmes dans l 'espace et que la notion d'espace doit, par conséquent, préexister. 17
En somme, l'intuition du mouvement est antérieure à celle de l'es pace, précisément parce que c'est au mouvement que revient la charge de détenniner les détenninations essentielles de ce dernier : largeur et longueur, étendue, homogénéité, etc. Que cette attitude générale envers l'esthétique transcendantale kantielllle ait bel et bien conquis le Zeitgeist à l'époque où Husserl tennine sa fonnation à Halle, cela transparaît enfin de la remarque de Mach en 1 886 selon laquelle « Il y a longtemps qu'on ne dispute plus le fait que la sensation d'espace dépende étroitement des processus moteurs. Les opinions divergent seulement sur la manière dont il faut concevoir cette connexion. »18 Cette dernière précision ne saurait être plus exacte, et toute l'originalité de la position de Husserl tiendra à reconcevoir le sens qu'il faut donner à la corrélation même entre mouve ment et choses perçues.
1 5 Il Y aurait alors à reconstruire, en dehors de la phénoménologie, lUl « empirisme transcendantal " dans la philosophie du mouvement, dont on pourrait trouver des traces par exemple chez Gilles Deleuze, chez les penseurs de 1'« anthropotecbnie '>'> ou encore, dans un tout autre registre, chez Didier Anzieu. 16 W. WlUldt, Grundzüge der physiologischen Psychologie, t. II, 1874, p. 4. 1 7 H. Poincaré, La valeur de la science, Paris, Flammarion, 1905, p. 82. Nous sou lignons. 18 E. Mach, L'analyse des sensations : le rapport du physique au psychique, tr. de F. Eggers et J.-M. Monnoyer, Nûnes, Jacqueline Chambon, 1996, p. 115. Nous soulignons.
24
JEAN-SÉBASTIEN HARDY
Que Husserl ait lu ou non cet ouvrage dont il détenait (toutefois) un exemplaire, c'est certainement la théorie d'Alexander Bain - et la critique qu'en a faite Stnmpf - qui aura été la plus déterminante pour la formation du concept de kinesthèse dans la pensée de Husserl. Alexander Bain, dans The Senses and the Intellect (1 855), ouvrage considérable et ambitieux consacré presque exclusivement aux problèmes posés par l'invention récente à l'époque, souvent indistinctement scientiste et philosophique, de la notion de « sens du mouvement », développera sur quelques pages denses une théorie cinétique de la genèse de la représentation de l'espace19. Il est à noter que, dans l'élaboration d'un tel projet, Bain a néan moins un prédécesseur ou un « éclaireur » en Allemagne en la personne de Johann Friedrich Herbart. En 1825, dans le deuxième tome de sa Psychologie ais Wissenschaji, Herbart avait cherché en effet à fonder la représentation de l'espace sur la possibilité de renverser (rückkehren) Ulle série quelconque de sensations. À lui seul, le cours de nos sensations et de nos perceptions ne déploie le donné que suivant une linéarité tempo relle : les données sensibles et les choses qui apparaissent ne sont l'une en dehors de l'autre (AufJereinandersein) que du point de vue de leur successivité dans un flux irréversible de conscience sensible. Toutefois, Herbart fait remarquer que si en marchant dans une allée nous reculons subitement, les perceptions périphériques qui jusque-là s'évanouissaient - dans la phase de rétention pour ainsi dire - se réani ment alors les unes à la suite des autres de façon ordonnée et qu'ainsi chaque moment perceptif se voit assigné une place fixe par rapport aux autres. Dans leur réactualisation et le recouvrement de la série inversée des sensations antérieures, les dOllllées sensibles reçoivent une fonne d'identité à travers et malgré l'écoulement temporel de la perception. Un être-l'un-au-dehors-de-l'autre proprement spatial surviendrait donc à l'origine selon Herbart lorsque « l'on meut vers l'avant et vers l'arrière (vorwarts und rückwarts) l' œil qui contemple ou le doigt qui touche )}2o. La représentation de l'espace renvoie ainsi chez Herbart aux lois ou léga lités de la reproduction (Reproduktionsgesetzen) des sensations ou per ceptions tout juste passées, reproduction qui ne se réalise que grâce à la
1 9 Cf A. Bain, The Senses and the Intellect, op. cit., §§ 23-24. Husserl possédait en 1880 un exemplaire de Geist und K6rper, traduction allemande de l'ouvrage d'Alexander Bain (K. Schubmann, Husserl-Chronik, op. cil., p. 8). 20 J. F. Herbart, Psychologie als WlSsenscheift. Neu gegründet aufEifahrung, Meta physik und Mathematik. Zweiter, analytischer Teil, in Siimt/iche Werke, t. 6, Leipzig, Scientia Verlag, 1989 [1825], § l l l, p. 90.
SENS DU MOUVEMENT ET KlNESTHÈSE
25
possibilité qu'a le mouvement du corps de renverser et répéter à tout moment une série quelconque de celles-ci. L' Écossais Alexander Bain cherchera plus explicitement encore à faire de la motricité volontaire l'instance à laquelle revient le privilège de fonner la représentation de l'espace, et même celle du temps. Pour ce faire, Bain décompose en 1 855 au § 23 de The Senses and the Intel lect la « sensibilité élémentaire » que constitue à ses yeux le sens du mouvement : celui-ci comporte d'une part un sentiment de la force active du mouvement et d'autre part un sentiment de la résistance, qu'il nomme « continuance »21. Cette dynamique entre sentiment de se mou voir et sentiment d'une résistance interne au mouvement ('>, regret tant du même coup de n'avoir pu en lire et en comprendre davantage (K. Schuhmann,
SENS DU MOUVEMENT ET KlNESTHÈSE
29
Husserl souligne bien le caractère deskriptiv-psychologisch de ces considérations et il est difficile à cette seule lumière de savoir jusqu'où il s'approprie l'une des idées essentielles de James. Il y a certes là quelques observations que Husserl réactivera dans Chose et espace : les « circonstances » motrices de la perception apparaissent comme relevant du domaine du subjectif pur (les sensations de mouvement ne pro viennent d'aucune façon de la chose et ne nous disent en elles-mêmes rien de la chose) et elles tombent hors du champ de l'attention (pour être purement égologiques, elles sont néanmoins pour ainsi dire non conscientes, voire involontaires). Toutefois, Husserl affinne de façon vague - et c'est précisément ce que viendra corriger sa théorie des kinesthèses - que 1'« accompagnement irréel » que fonnent les circons tances perceptives subjectives (sensation de mouvement) fusionne « d'une certaine façon » avec les contenus perceptifs objectifs (couleur, étendue, etc.). Dans le même texte de 1 893, Husserl revient néanmoins sur ce point précis, pour ajouter une distinction significative : Il en va donc d'elles [des fringes] comme de sensations fugitives de pas sage, qui sont des phénomènes complexes, consistant dans le mouvement du contenu, c'est-à-dire dans le phénomène du mouvement qui rend autre le contenu et qui intervient dans la transfommtion de A en A' et de B en B' ; en outre, dans le phénomène de mouvement qui fait devenir autres les cir constances objectives (sensation de mouvement, sensation de conver gence, sensation d'accommodation, etc.) ; enfin, dans le mouvement qui fait devenir autre le remarquer lui-même. Cesfringes apportent une contri bution essentielle à la conscience d'identité ; mais elles n'appartiennent pas au « contenu », elles n'appartiennent pas à la chose.28
Husserl distingue cette fois expressément trois types de « circons tances » impliquées dans la perception externe : celles du changement du contenu de l'apparition, celles qui provoquent le changement des circons tances objectives de la perception et enfin celles liées au changement de l'attention (bemerken et aufmerken). Le se-mouvoir phénoménologique (sich-bewegen) se rangerait alors, si tant qu'il ait déjà sa place ici, dans la deuxième catégorie : le mouvement est ce qui fait varier la position de mon corps par rapport à l'espace objectif des choses du monde et donc ma perspective sur celles-ci. Ce faisant, le sens du mouvement est ici Husserl-Chronik, op. cit., p. 32). En 1894, sous le conseil de Stumpf, Husserl relit James, dont la Psychology est connnentée par Husserl (E. Husserl, Pers6nliche Aufzeichnungen, in Philosophy and Phenomenological Research, 16, 3, 1956, p. 295, n. 1). 28 E. Husserl, Sur les objets intentionnels, op. cit., p. 231-232.
30
JEAN-SÉBASTIEN HARDY
entièrement reconduit aux sensations des mouvements du corps, com prises comme processus d'accommodation, ou d'« ajustement », sur la chose perçue. C'est ce que confinue distinctement le texte du complément : Les circonstances consistent, abstraction faite du changement portant sur le fait de remarquer (bemerken) et de faire attention (aufinerken), en des gra dations de sensations musculaires (Muskelgeflihle) qui, se déroulant en [affile de séries, peuvent s'inverser [ . . ] À toute situation possible d'un point insigne dans le champ de vision, correspond, quand la tête est placée d'une manière fixe, une sensation musculaire détenninée [ . . ] Quand les circonstances sont semblables, nous voyons dans l'objet toujours la même chose. [ . . ] Les circonstances n'appartiennent pas au contenu ; car elles ne sont qu'un moyen de le désigner (pointieren) et de tendre vers lui (inten dieren), éventuellement de l'atteindre (erreichen). Aussitôt que le contenu est là effectivement, c'est vers lui uniquement qu'est tourné l'intérêt. Les sensations musculaires (Muskelempfindungen) se passent entièrement en dehors de celui-ci.29 .
.
.
Le sens du mouvement est rabattu à cette époque sur la sensation musculaire. Et si Husserl lui reconnaît une fonction relative dans la per ception des choses, le cadre d'analyse est davantage celui d'une psycho logie descriptive de l'attention que celui d'une phénoménologie de la perception. Le pouvoir moteur du Je signifie simplement alors la possi bilité factuelle de conduire et de maintenir la chose au centre du champ perceptif, en compensant le mouvement physique de l'objet par celui du corps propre, ce que Husserl nommera plus tard, tout comme l'optométrie actuelle, « accommodation » (Akkommodation)30. S'il y a des points de similitude entre certaines des thèses émises par Husserl à l'intérieur de ces textes du début des années 1 890 et celles développées à partir de 1907, il semble à première vue impossible d'y rattacher toute la teneur de sens du concept phénoménologique de kinesthèse, et à plus forte raison ses usages plus tardifs. Il s'agit main tenant de voir directement en quoi la réduction des kinesthèses à une simple faculté sensitive est inconciliable avec la portée phénoménolo gique et les ambitions rigoureusement transcendantales de la théorie des kinesthèses.
29 Ibid., p. 271-272. Voir aussi ibid., app. VII. 30 Par exemple E. Husserl, Chose et espace, op. cit., p. 114.
SENS DU MOUVEMENT ET KlNESTHÈSE
31
Uintroduction du concept phénoménologique de mouvement dans Chose et espace
Bien que dans les années 1 890 Husserl relaie, sur le mode d'un discours plus ou moins indirect, le débat sur l'origine de la représentation de l'espace, c'est plutôt dans un tout autre contexte, à savoir celui d'une phénoménologie de la manifestation de la chose (Sich-Beurkunden), qu'il découvre la fonction constitutive du mouvement subjectif31 . Ce point est d'une importance considérable : ce n'est pas au sein d'une réflexion sur la perception à proprement parler que Husserl en vient à devoir considé rer la mobilité subjective, mais bien au sein d'une réflexion sur la dona tion de la chose, et ce même s'il abandOllllera dans une certaine mesure ce projet général d'une « phénoménologie de la choséité » (Phiinomeno logie der Dinglichkeit). Rappelons que l'expression même de « phéno ménologie de la choséité » est directement issue des leçons de l'été 190732, que Husserl nommait succinctement les « Dingvorlesungen »33 . Au § 40, paragraphe charnière dans l'élaboration du problème et l'intro duction de sa solution, Husserl rappelle en effet l'enjeu et le programme qui sont ceux du cours, et qui se traduisent concrètement dans des « ana lyses de la perception dans le cadre de la réduction phénoménologique » : il s'agit de comprendre l'être-donué de la chose (Ding-Gegebensein), qui a lieu de façon privilégiée certes, mais non exclusivement, au sein de l'intentionnalité perceptive. Or, c'est justement en mettant en lumière son articulation à l'être-donné de la chair que la chose fait sens et devient l'objet d'uue description possible. Husserl aperçoit alors que la perception des choses du monde (Welt dingen) est essentiellement cinétique, c'est-à-dire que, pour qu'il y ait perception d'une chose au sens propre, il doit y avoir un mouvement, qui vienne ou bien de la chose ou bien de l'ego : Ce fait important possède une valeur générale. Dans notre cas, il signifie qu'un corps spatial [immobile] ne se légitime comme tel que dans une série perceptive cinétique, qui fait accéder continûment ses diverses faces à l'apparition. Le corps doit se tourner et se déplacer, ou bien je dois me ; , IbUi., § 2. 32 Ibid., p. 156. De façon similaire, Husserl qualifie en 1908 ses recherches de « tentative d'une phénoménologie de la choséité " (Versuch einer Phiinomenologie der Dinglichkeit) (Persëmliche Aufzeichnungen, op. cit., p. 302) et en 1909 de Dinganalyse (E Husserl, Hua Mat. VII: Einführung in die Phiinomenologie der Erkenntnis. Vorlesung 1909, Dordrecht, Kluwer, 2005, p. 13 7). 33 Cf s. Rapic, « Einleitung '>'>, in E. Husserl, Ding und Raum, Hamburg, Meiner, 1991, p. XI.
32
JEAN-SÉBASTIEN HARDY mouvoir, mettre en mouvement mes yeux, mon corps, pour en faire le tour et en même temps m 'approcher et m 'éloigner ; ou finalement, l'un et l'autre doivent avoir lieu. C'est ainsi que la situation s'exprime du point de vue de la chose qui apparaît. 34
Comme Husserl le souligne déjà, il en va ici d'une nécessité d'es sence générale, et non simplement d'un fait empirique - si bien qu'il ne faudrait pas simplement dire avec Husserl dans les Idées directrices que, si Dieu perçoit, il perçoit par esquisses, mais aussi que, si Dieu perçoit, il doit avoir une « chair » quelconque mobile. La phénoménologie trans cendantale naissante ne constate pas tant la relation du mouvement à l'apparaître qu'elle le pense comme une nécessité pour la constitution. Parvenu à la moitié des leçons, Husserl réalise toutefois que les premiers résultats sont encore insuffisants. Une distinction phénoménologique nette règne entre 1'« être-mû » (Bewegtwerden) de la chose et le « se mouvoir » (Sich-Bewegen) de l'ego, et surtout, en conséquence de la réduction, il s'agit de reconduire la manifestation originaire des choses à l'expérience subjective elle-même. Il amende alors sa thèse pour affinner, au § 46, que toute perception commande, non simplement un mouvement (de la chose ou duje), mais un mouvement de la part du Je : J'ai ici en vue naturellement les sensations de mouvement (Bewegungsemp findungen). Elles jouent dans l'appréhension de toute chose externe un rôle essentiel, mais ne sont pas appréhendées de manière à pennettre la repré sentation d'une matière en propre, ni non plus de façon impropre ; elles n'appartiennent pas à la « projection » (Projektion) de la chose. [ . . . ] Et pourtant, sans leur concours il n 'y a pas là de corps, pas de chose.35
Et, plus loin : Les sensations kinesthésiques jouent un rôle essentiel dans la constitution de la chose [ . . . ] [puisque] les processus (Verliiufe) simplement visuels ne suffisent pas à l'appréhension [ . . . ] La constitution de la place et de la spa tialité objectives est essentiellement médiatisée par le mouvement du corps ou, en tennes phénoménologiques, par les sensations kinesthésiques.36
La découverte de la non-équivalence phénoménologique et fonction nelle entre le mouvement des choses perçues et le mouvement du sujet percevant pennet à Husserl de voir que c'est par le conditionnement de l'appréhension visuelle et tactile des esquisses de la chose à travers un mouvement de l'ego que la chose apparaît autrement que comme un simple schème ou Wle pure image. En d'autres mots, le « corps » de la 34 E. Husserl, Chose el espace, op. cil., p. 191. Nous soulignons. 35 Ibid., p. 196. Nous soulignons. ; 6 IbUi., p. 212-213.
SENS DU MOUVEMENT ET KlNESTHÈSE
33
chose intramondaine est construit par l'entremise de la libre effectuation de la potentialité kinesthésique.
Caractérisation sommaire des kinesthèses par rapport aux sensations de mouvement Quels sont alors les traits qui caractérisent la kinesthèse en son acception phénoménologique et qui la distinguent de la notion antérieure de sensation de mouvement ? La kinesthèse comporte au moins quatre caractéristiques essentielles, dont la dernière est particulièrement signi fiante pour marquer le saut qu'opère Husserl par rapport aux théories psychophysiques du mouvement. 1) D'abord, les kinesthèses correspondent aux possibilités de mouve ment du corps vécu en tant qu'elles se déploient sur un ou plusieurs axes, qui ont chacun leurs extrémités et leur centre, se rapportant lui-même ultimement au centre de la chair qui vaut comme ici absolu (Nullpunkt). Ainsi, 1'« œil », centré sur l'horizon3?, peut se diriger à droite ou à gauche et en haut ou en bas ; dans une portée relative, la « main » peut s'étendre de l'avant à l'arrière et sur tous les côtés, etc. Ainsi entendu, le mouvement n'est pas celui du corps objectif, orga nique ou anatomique - bien qu'il y a ait en quelque sorte une anato mie transcendantale, une division, une articulation et une limitation du pouvoir de se mouvoir. Le système kinesthésique désigne unique ment les possibilités de variations au sein d'un système de coordon nées parfaitement immanent. Pour cette raison, les kinesthèses peuvent être dites idéales, c'est-à-dire qu'elles valent partout de la même façon G 'ai partout une droite et une gauche, un haut et un bas, etc.) et l'homogénéité de l'espace perceptif renvoie justement à cette « onmivalence » de mes possibles incarnés. 37 Demeure la question de savoir si cette normalité (Nonnalitiit) d'une position privilégiée du corps et du regard en particulier est un fait empirique, lUl fait transcendan tal ou le résultat d'une genèse (auquel cas, suivant quels principes). Husserl est tout à fait conscient de ce problème, auquel il n'offre pourtant aUClUle réponse définitive. Entre plu sieurs autres passages, notons celui-ci : « Cela n'est pas clair : Ce n'est pas la détente qui est ici en question, mais une situation normale à cela est liée l'orientation et, pour la kinesthèse totale, la position à partir de laquelle sont déterminées les directions fondamen tales '>'>, puis « Alors la position couchée, vu qu'elle est la plus confortable, devrait être la position zéro. Il/aut donc de nouveau prendre en considération que le zéro nonnal consti tue un problème. '>'> (E. Husserl, La telTe ne se meut pas, tr. de D. Franck, D. Pradelle et J.-F. Lavigne, Paris, Minuit, 1989, p. 42, n. 2 et p. 43, n. 3, nous soulignons). -
34
JEAN-SÉBASTIEN HARDY
2) Ensuite, les kinesthèses ne sont pas proprement une sensation de mouvement. La sensitivité des muscles, de la peau, des articulations, etc. n'est pas essentielle à la kinesthèse et bien que Husserl la qualifie aussi de « flux hylétique », la kinesthèse n'est généralement pas sen tie et n'a pas à l'être. Elle est le déploiement de la volonté dans la chair qui se manifeste indirectement dans le changement des sensa tions visuelles, tactiles, auditives, etc., et non dans une sensation propre. C'est d'ailleurs une des mésinterprétations que Husserl cherche à neutraliser lorsqu'il introduit le tenue nouveau de « kines thèse » : d'un point de vue phénoménologique, il n'importe aucune ment qu'il renvoie ou non à une sensation propre, que celle-ci soit sensation cutanée, musculaire, etc. ou encore qu'elle ait son siège dans le système nerveux centra138. 3) Cela dit, les kinesthèses fonnent un flux originairement et nécessaire ment cOllllecté à celui des sensations tactiles, visuelles et auditives : tout changement kinesthésique provoque un changement sensitif dans ces champs (variations d'intensité, de couleur, d'étendue, etc.). À chaque position de mon œil qui bouge vers la gauche ou qui se focalise sur un détail correspond une sensation détenninée et, s'il y a lieu, l'es quisse du corps d'une chose. La sensibilité primitive est ainsi scindée en au moins deux flux hylétiques : l'un kinesthésique, l'autre sensitif 4) Ce point est d'une importance particulière, et conduit au quatrième et dernier critère de la kinesthèse, à savoir qu'elle donne lieu à une rela tion dite de « motivation » intrasensible. Les kinesthèses contraignent l'apparaître sensible, suivant la fonne d'un « si . . . , alors . . . » pré-mon dain : « si je me meus ainsi, alors se produit ce type de variation du côté de la sensation ». La kinesthèse a ainsi pour charge de détecter et explorer des légalités phénoménales dans la sensibilité, rendant ainsi possible la perception de choses grâce à l'animation intention nelle ultérieure ou simultanée. Et c'est précisément par la découverte de cette force contraignante du pouvoir de se mouvoir que Husserl parvient à refonnuler sa théorie de la perception, et en particulier à dépasser les fonnulations initiales de la théorie des esquisses. 3 8 « Cependant je dois remarquer tout de suite, d'un point de vue terminologique, que le terme de "sensation de mouvement" est pour nous inutilisable, car on ne doit pas entendre que nous sentons le mouvement de la chose, ni même que le mouvement de la chose s'y expose. On sait que le terme se rapporte à celui qui se meut (den sich Bewegen den), et qu'il doit être pris en un sens psychologique. Nous ferons usage, en excluant la signification psychologique, du terme de sensation kinesthésique (kiniisthetische Empfin dung), qui, d'origine étrangère, est moins susceptible d'occasionner l'erreur " (E. Husserl, Chose et espace, op. cit., p. 196-197).
SENS DU MOUVEMENT ET KlNESTHÈSE
35
Pour mieux comprendre cette idée, rappelons que, à la question de savoir sur quel fondement s 'opère la synthèse de l 'apparition actuelle avec l 'inactuelle, disons d'une face perçue à une autre, les Recherches logiques concevaient que cette liaison se réalisait par contiguïté (Konti gui/dt) et/ou similitude (Ahnlichkei/) des profils39. Or, la contiguïté des esquisses ou des aspects n'est qu'une condition formelle de la synthèse perceptive, et la similitude des faces entre elles (qui assurerait leur fusion, Verschmelzung) n'est pas un phénomène nécessaire à l'appréhen sion du perçu et surtout ne rend pas compte de la manière par laquelle la synthèse des profils de la chose est actualisée et vérifiée. Dans le cadre des Recherches logiques, l'identité et l'effectivité de la chose perçue restent ainsi présupposées ou non problématisées. Postérieurs, mais précédant de peu Chose et espace, les manuscrits rédigés à Seefeld en 1905 ne semblent guère offrir une réponse plus précise au même problème : De quoi ai-je une évidence dans la perception phénoménologique, et auprès de quoi ai-je un savoir indirect et transcendant en ce qui concerne la même perception ? Je vois une bouteille de bière, qui est brune, je m'en tiens au brun dans son étalement (Ausbreitung), « tel qu'il est véritablement donné », j'exclus tout ce qui dans le phénomène est simplement visé et non donné. Une bouteille de bière se trouve là et elle est telle ou telle. Je diffé rencie les apparitions de la bouteille de bière [ . . . ] Je trouve la connexion (Zusammenhang) de ces apparitions, je trouve la conscience de l'identité qui les traverse.40
Ce que manque la « réduction immanentiste » de 190541, c'est que la chose perçue n 'est pas que la suite temporelle de ses apparitions concordantes ; et il s'agit précisément d'analyser cette connexion, et non simplement d'en faire le constat. C'est toute la distinction entre psycho logie descriptive et phénoménologie transcendantale de la perception qui est alors enjeu. Jean-François Lavigne aperçoit d'ailleurs dans la théorie des kinesthèses un apport inédit à celle de l'intentionnalité perceptive : Ces analyses de la perception élaborent enfin la nouvelle [onne que prendra désonnais la théorie de la constitution progressive de l'objectité, par « couches » intentionnelles : la mise en évidence de la corrélation de moti-
39 Cf E. Husserl, Recherche logique III, § 8 et Recherche logique VI, §§ 14 b, 15 et 26. 40 E. Husserl, Zur Phiinomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-191 7) [Hua X], éd. par R. Boehm, Den Haag, Nijhoff, 1966, tx.t. 35 : Seefelder Manuskripte über Indivi duation (1905), p. 103. 4 1 Cf J.-F. Lavigne, Husserl et la naisscmce de la phénoménologie (1900-1913), Paris, PUF, 2005, p. 547.
36
JEAN-SÉBASTIEN HARDY vation entre la variation kinesthésique des conditions d'apparition et la variation coordonnée des « esquisses » d'objet introduisent dans la consti tution de l'identité objective une troisième composante, qui vient s'ajouter au couple de la corrélation intentionnelle apparitions/face identique.42
Le mouvement de l'ego est donc justement la condition de fait de l'intentiOllllalité perceptive, car c'est le mouvement de l'ego qui vient lier de façon réglée les faces de la chose. La kinesthèse est pour ainsi dire le mouvement intérieur de ['intentionnalité : elle fait varier les données de la chose pour en découvrir la régularité immanente. Presque à la manière d'une heuristique sensible, la motivation kinesthésique n'est alors rien moins que l'exploration du rapport intérieur entre les données imma nentes (hylétiques) de la chose en voie d'apparaître comme telle et mes possibilités de me mouvoir. Il y a là lUle percée maj eure de la phénoménologie husserlielllle, puisque Husserl aperçoit lUle première fois la corrélation nécessaire et structurée entre mouvement et phénoménalisation, mais aussi l'implica tion de l'activité dans les sphères les plus intérieures de la sensibilité, qui n'est alors plus aUClUlement pensée comme réceptivité.
Conclnsion. La mnltiplicité irrédnctible des paradigmes phénomé nologiqnes du mouvement Or, cette façon de donner lUle fonction au mouvement dans l'archi tectonique de la phénoménologie a-t-elle connu comme on pourrait s'y attendre lUle postérité au sein même de la phénoménologie ? En guise de conclusion, nous souhaiterions émettre quelques brèves réflexions quant aux divers paradigmes du mouvement en phénoménologie, qui corres pondraient peut-être à autant de lignées historiques irréductibles43. 42 Ibid., p. 639. 43 Dans Le toucher, Jean-Luc Nancy (Paris, Galilée, 2000, p. 109-1 10), Derrida présente l'hypothèse philologique d'lUl « héritage " ou « sillage ,>,> typiquement français dans la phénoménologie de la chair, dont les traces nous conduiraient à Bergson, Ravais son et Maine de Biran. James Dodd, dans Idealism and Corporeity: an Essay on the Problem of the Body in Husserls Phenomenology (Dordrecht, Kluwer, 1997, p. 60), insiste dans le même sens sur l'irréductibilité de la conception husserlienne de l'incarnation : « To focus on sensation alone is to focus on a very narrow slice of the experience of the body; it shows us how removed Husserl's analyses of perception are from the French tradition, stretching from Maine de Biran to Merleau-Ponty, which seeks to articulate a sense of the body as OWll, the corps propre, as an underlying unity of any perceptual experiences. For Husserl, the real unity of the body is achieved only in the progressive idealization of perception as such, of the constitution of "higher" objectivities '>'>.
SENS DU MOUVEMENT ET KlNESTHÈSE
37
Nous pourrions identifier ainsi un régime biranien, qm aurait ses sources chez les idéologues français, en particulier dans l'analyse des sensations de Condillac et Destutt de Tracy, traçant pour ainsi dire une genèse historique parallèle au lignage anglais et allemand duquel émerge Husserl. Michel Henry serait alors l'un des derniers représentants de cet héritage qui comprend le mouvement comme effort, c'est-à-dire comme un mode d'affection de soi par soi dans la lutte contre la résistance du monde, de la volonté ou de la chair à elle-même. Bien qu'il soit possible d'établir des correspondances entre les questions et les concepts direc teurs des idéologues français et des physiologues allemands, Husserl apparaît à première vue complètement étranger à ce paradigme du mou vement comme effort�-4. Dans quel sillage la conception du mouvement de Husserl s'inscri rait-elle donc ? Ce qui apparaît crucial chez Husserl est que le mouve ment n'est plus compris à partir de sa donation sensitive, mais qu'il est plutôt conçu comme une articulation. L'articulation est le point où s'en gage et se concentre le pouvoir de l'ego en sa chair, en tant qu'elle est susceptible de se rapporter à elle-même en même temps qu'à l'espace et aux choses externes. Dans Le système de l 'éthique, Fichte expose cette idée de façon on ne peut plus nette : Il doit être du pouvoir de ma volonté d'unir à moi des choses naturelles ou de les mettre en relation avec moi. Or, cette union ou cette relation se rap portent à des parties de mon corps organisé et ce corps qui est le mien est l'instrument immédiat de ma volonté. Il faut donc que ces parties soient sous la domination de ma volonté et, puisqu'il s'agit ici de relation dans l'espace, que, comme parties, c'est-à-dire en rapport avec le tout de mon corps, elles soient mobiles et que mon corps lui-même soit mobile en rap port avec le tout de la nature. Ilfaut, puisque ce mouvement doit dépendre d'un concept librement esquissé et indéfiniment modifiable, qu 'il y ait une
44 Nous pourrions en outre distinguer un régime aristotélicien, sinon deux régimes aristotéliciens : l'un puisant à la physique aristotélicienne pour laquelle la question du mouvement implique celle du temps ; l'autre à la « psychologie " aristotélicienne, pour laquelle la kinesis doit être rapportée à l' aisthesis et surtout à l' orexis, au désir, à une fonction « appétitive ,>,> pour reprendre la traduction de Richard Bodéüs. Les conceptions du mouvement de Patoèka et de Renaud Barbaras relèveraient sans doute, au moins en partie, de cette filiation lointaine. Enfin, il est signifiant que Husserl ne va jamais jusqu'à penser le mouvement connne geste, idée que l'on pourrait trouver et reconstruire dans l'anthropologie, mais aussi en un sens plus fondamental chez Heidegger (cf M. Heidegger, Unterwegs zur Sprache (1950-1959), GA 12, op. cit., p. 19 et Zollikoner Seminare, Pro tokolle - Gersprache - Briefe Herausgegeben von Medard Boss, GA 89, éd. par M. Boss, Franfurt a. M., Klostennann,1987, p. 117-1 18).
38
JEAN-SÉBASTIEN HARDY mobilité diversifiée. On nomme une telle disposition du corps articulation. Sije dois être libre, ilfaut que mon corps soit articulé.45
En comprenant le mouvement - sans lequel il fi 'y aurait manifesta tion ni de la chose ni donation de ma chaiIA6 - dans un paradigme « arti culaire » plutôt que musculaire, Husserl conférera une fonction toute privilégiée au mouvement, puisque son efficace se répercutera ensuite à tous les niveaux de la constitution du monde. C'est pourquoi la kinesthèse n'a pas seulement un rôle dans la perception, mais aussi dans la consti tution de l'intersubjectivité, de l'expérience esthétique, de l'expérience juridique (la formation de la propriété par exemple), etc. C'est donc admettre qu'il y a, plus profondément, corrélation entre les structures immanentes de la chair et celles du monde à constituer et qu'ainsi, la chair elle-même est, ou pourrait avoir été, le produit d'une genèse47. À cet égard, il faut ajouter enfin que pour toutes ces raisons, chez Husserl, le mouvement ne vient pas « empiriciser » et encore moins naturaliser la phénoménologie, mais au contraire, consacrer et signer la signification transcendantale même du projet phénoménologique dans ce que l'on peut considérer comme sa rigueur même ou sa démesure constitutive.
45 J. G. Fichte, Le système de l 'éthique d'après les principes de la doctrine de la science, trad. de P. Naulin, Paris, PUF, 1986, p. 123. Nous soulignons. 46 « La chair est d'une façon tout à fait unique toujours présente dans le champ de la perception avec une immédiateté entière, dans lUl sens d'être tout à fait lUlique, préci sément ce sens d'être qui est désigné par le mot d'organe (pris ici dans son acception originaire (Urbedeutung)). Un organe, c'est ce dans quoi (wobei) je suis en tant qu'ego de l'affection et des actions d'une façon tout à fait unique et tout à fait immédiate, en ce sens que j'y (worin) domine kinesthésiquement très-immédiatement (ganz unmittelbar) " (E. Husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, tr. de G. Granel, Paris, Gallimard, 1976, p. 121). 47 Husserl affirme ainsi que « L'organe est quelque chose de constitué (etwas Konstituiertes), de familier dans l'expérience ,>,> (De l'intersubjectivité l, op. cit., p. 85). L'un des principaux torts de l'empirisme humien est justement aux yeux de Husserl de n'avoir pas su interroger de façon immanente la constitution génétique du corps comme système non-naturel de sense organs. Voir notamment E. Husserl, L 'idée de la phénomé nologie. Cinq leçons, trad. de A. L6wit, Paris, PUF, 1970, p. 41-42.
HUSSERL ET LE GÉOSTATlSME
Paul DUCROS
Le géostatisme est un concept que l'on peut forger à partir de la lecture d'un texte de Husserl, écrit en 1934, qui accompagne et prolonge les réflexions de la Krisis : « Renversement de la doctrine copernicienne dans l'interprétation de la vision habituelle du monde. L'arche-originaire Terre ne se meut pas. Recherches fondamentales sur l'origine phénomé nologique de la spatialité de la nature »1 . On lui donnera comme titre : « L'arche-Terre ne se meut pas >J. On pourra également le nommer, en suivant la classification des Archives Husserl, le Manuscrit D1 7. Insistons d'emblée sur un point : la notion de géostatisme fi ' est pas instituée par Husserl, mais elle nous a paru parfaitement exprimer l'idée forte qu'il soutient dans ce texte : la Terre originaire qui ne se meut pas est absolument immobile'l. Il y a un sens originaire de la Terre, que nous éprouvons à chacun de nos pas, qui est d'être l'appui immobile pour notre propre motricité. Ce sens originaire, nous le vivons de façon per manente et nous en avons même une certaine compréhension. Nous demeurons cependant inattentifs à lui car d'autres représentations, issues notamment de la rationalité scientifique, nous empêchent de le considérer. La démarche phénoménologique s'efforce de retrouver ce sens. Ce sont ces dimensions, que nous avons pu abondamment considé 3 rer , que nous allons rappeler, en nous efforçant de lever les risques d'équivoque et d'incompréhension que la phénoménologie en général et la pensée de Husserl en particulier peuvent éveiller. À partir de là nous
1 E. Husserl, La Terre ne se meut pas, op. cit., tr. de D. Franck et al., Paris, Minuit, 1989, p. 1 1-29. 2 Nous avons forgé ce concept dans Husserl et le géostatisme. Perspectives phéno ménologiques et éthiques, Paris, Cerf, 201 1 . L'ensemble de notre livre développe le concept de géostatisme et ses implications. Nous y avons mené des analyses phénoméno logiques avec le souci de la plus grande rigueur possible. Tout au long du présent texte, nous renverrons à l'ouvrage et à sa pagination. 3 Husserl et le géostatisme, op. cit.
40
PAUL DUCROS
tenterons d'évoquer les conséquences possibles, notamment sur un plan éthique, de ce sens de la Terre originaire.
Les nécessaires réductions Le sol de la Terre est un appui immobile que chaque sujet marchant éprouve. Cependant, seule la phénoménologie, par sa démarche propre et originale, peut le mettre en lumière. Il faut en effet être en régime épo chal pour que cette dimension puisse être saisie. L'épochè est l'attitude initiale du phénoménologue par laquelle il échappe à l'attitude naturelle, c'est-à-dire à une adhésion immédiate aux choses dOllllées. Nous vivons selon lUle attitude dans laquelle l'objectivité du monde s'impose d'une façon irréfléchié. Le phénoménologue - porté par lUle démarche philosophique très ancielllle (puisqu'elle remonte aux sceptiques grecs), et pressentant que l'adhésion au donné des choses est une fonne d'aliénation de la pensée proche de la paresse - se retient de continuer d'adhérer à ce donné et à son immédiateté. L'épochè ne consiste pas à nier la réalité du monde, il ne s'agit pas de faire tomber le monde dans un non-être, mais de ne pas croire en la positivité de ce qui est. Le présupposé (parfaitement assumé) de l'épochè phénoménologique est que le dOllllé objectif positif, puisqu'il est un donné, est donné par des actes de la subjectivité. L'objet n'est pas un donné brut, mais le sens d'une visée, de telle sorte que la visée et son sens relèvent du vécu dont ils sont les deux faces. Telles sont les significations, au fond assez simples, de la noèse et du noème qui sont bien les deux dimensions d'un vécus. Ici la réduction épochale s'est faite réduction transcendantale par reconduction du donné à une dimension subjective, institutrice de sens, c'est-à-dire constituante. La réduction transcendantale s'est originée de la réduction épochale qui met en place une déréalisation. Cette dernière rappelons-le - n'est pas un anéantissement puisque les choses données ne sont pas niées. Elle a néanmoins placé le donné comme apparaissant selon le mode du quasi, c'est-à-dire comme possédant une certaine irréa lité6. L'épochè est liée à la déréalisation de l'imagination qui institue un 4 E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phéno ménologiques pures. Livre premier : Introduction générale à la phénoménologie, tr. de J.-F. Lavigne, Paris, Gallimard, 2018, p. 87-91 (cité plus loin Ideen 1). 5 E. Husserl, Ideen l, op. cit., p. 267-377. 6 E. Husserl, Phantasia, conscience d'image, souvenir, tr. de R. Kassis et J.-F. Pes tureau, Grenoble, Millon, 2002, p. 83-91.
HUSSERL ET LE GÉOSTATIS:ME
41
sens comme quasi réel, autrement dit comme contenant une dimension irréelle. Il y a lUle part d'imaginaire dans la réduction qui interprète le dOllllé comme plongé dans le flottement de ce qui se tiendrait entre la réalité et l'irréalité. La réduction détache la pensée de la positivité de la réalité et libère une part d'imagination. Ainsi le phénoménologue, lorsqu'il a reconduit ce qui est à la vie subjective, lorsqu'il a montré que l'objectivité est constituée par la subjectivité et que c'est un vécu qui est source de sens, peut faire varier celui-ci en passant d'lUl vécu à un autre par association? Si, ainsi que l'établit la phénoménologie, la perception est le vécu qui donne la chose en présence, le phénoménologue fait varier ce vécu de proche en proche, jusqu'à parvenir à un vécu qui serait une limite de la perception au-delà duquel on verserait dans une expérience de l'irréalité ou d'objets qui, tout en ayant une réalité, relè veraient d'une sphère de sens au-delà du mondain, par exemple les obj ets mathématiques8. Rappelons enfin que, à partir des années vingt, Husserl a ajouté à cette méthode de réduction, qu'il a alors appelée statique, lUle réduction de type génétique par laquelle on pense que chaque vécu est porté par un autre selon lUle succession temporelle qui se prolonge à chaque instane. Aussi y a-t-il des vécus archaïques qui en portent d'autres au sens où ils les motivent. Ces derniers sont issus d'eux, qui ne cessent de les animer. Ainsi pour Husserl, et surtout pour le dernier Husserl, notamment celui qui écrit « La Terre originaire », toute représentation scientifique provient d'expériences primitives qui l'habitent mais dont elle ne veut rien savoir et qu'elle tend à refouler.
Uarchaïsme du se mouvoir Husserl s'est constamment penché sur le vécu de perception. S'il est lUl des axes des analyses des Recherches logiques, il est repris dans les Ideen et jusque dans la Krisis. La perception est d'un certain point de vue lUl vécu paradigmatique qui peut servir de modèle d'évaluation eidétique pour les autres. L'analyse eidétique est une variation qui part toujours de la perception. C'est au fond la perception que l'eidétique des vécus fait 7 E. Husserl, Ideen l, op. cit., p. 203-219. 8 E. Husserl, Philosophie de l 'arithmétique. Recherches psychologiques et logiques, tr. de J. English, Paris, PUF, 1972. 9 E. Husserl, « Méthooe phénoménologique statique et génétique '>'>, tr. de N. Depraz, in De la synthèse passive, Grenoble, Millon, 1998, p. 323-3 3 1 .
42
PAUL DUCROS
vaner. C'est ainsi par rapport à la perception que l'on comprend la vie de l'imaginationlO, puisque cette dernière se représente des irréalités qui n'ont de sens que par rapport à la réalité du présent perçu. C'est aussi en comparaison à la perception que toute visée d'objets idéaux a sens. En effet, l'objet perçu présent estompera sa présence selon une progression temporelle, alors qu'un objet idéal tel qu'un objet mathématique n'est pas intemporel, mais onmi-temporel, de telle sorte que c'est tout de même par rapport à ce qui est constitué dans la perception qu'on peut com prendre son sensll. L'analyse phénoménologique part du sens du perçu comme objectivité, c'est-à-dire comme présence, pour la reconduire aux vécus qui constituent cette présence. Une chose perçue se dOlllle en elle-même comme présence. La présence est son sens qui apparaît à une subjectivité. Le phénomène au sens husserlien n'est d'ailleurs pas tant l'apparaître de la chose que le lien nécessaire et premier entre l'apparition de la chose et la subjectivité pour laquelle il y a apparition12 Le phénomène est au fond le vécu comme lien sujet-objet, selon l'articulation noético-noématique. Toute fois il ne s'agit là que de la dimension la plus superficielle du vécu. Celui-ci, lorsqu'on est en régime de réduction à la fois statique et géné tique, doit être compris comme composé de strates. Plusieurs niveaux de vécus en composent un, de telle sorte que ces couches s'articulent les unes aux autres en se répondant et en se motivant mutuellement. La phénoménologie husserlielllle recherche les couches les plus pri mitives, les vécus les plus archaïques qui, universellement, pourraient porter les autres. Le vécu sous sa fonne la plus consacrée, comme arti culation noético-noématique, possède en fait une dimension bien trop cognitive. Sa structure en visée le rapproche beaucoup trop de fonnes logiques. Et il faut bien comprendre que la phénoménologie husserlienne, dans son long développement, s 'est de plus en plus intéressée à des vécus beaucoup plus aveugles, beaucoup moins articulés, et qui, par cette dimension même, portent les autres. Ainsi, les vécus de perception proprement dits, qui visent un objet en présence, sont, réellement, portés par des kinesthèses, c'est-à-dire de pures sensations de mouvement, qui ne visent rien en elles-mêmes. Ainsi que le répète Husserl tout au long de Chose et espace, les kinesthèses 10 E. Husserl, Phantasia, conscience d'image, souvenir, op. cit., p. 61. E. Husserl, Expérience et jugement. Recherches en vue d'une généalogie de la logique, tr. de D. Souche, Paris, PUF, 1970, p. 312-316. 12 Sur ce point nous nous permettons de renvoyer à notre étude : « L'équivoque du phénomène '>'>, Philopsis, éditions numériques, janvier 2015. II
HUSSERL ET LE GÉOSTATIS:ME
43
sont des vécus inexposants, c'est-à-dire qui n'ont aucun objet13. Toutefois leur dimension inexposante est la motivation même de tout vécu perceptif qui, lui, expose, c'est-à-dire donne, un objet en chair et en os. Il faut ici entendre qu'un pur se mouvoir, une puissance à être en mouvement de mon corps propre, intérieurement éprouvée, est la condition de tout per cevoir. Je ne perçois qu'en étant motivé par ma capacité à me mouvoir. Le vécu de perception est bien un vécu complexe, composé d'autres vécus qui ne sont pas nécessairement intentionnels 14. Tout objet que je perçois a pour sens d'être un tout. Or il ne se dOlllle à chaque fois, dans le réel de ma vie éprouvée, que latéralement. Je ne perçois effectivement qu'un côté de l'objet ; cependant il n'en reste pas moins vrai que l'objet comme tout se donne à moi. Il n'y a d'appa rition que d'une face de l'objet, mais, d'une certaine façon, l'objet dans son ensemble m'apparaît15. Cela signifie que lorsque je perçois effective ment un côté, j'anticipe les autres, et je ne peux anticiper les autres que parce que, analogiquement, je les vise en souvenir, parce que plus fon cièrement encore je retiens les apparitions des autres faces précédentes. La perception proprement dite est cette articulation, à chaque fois chan geante quant à son contenu mais identique sur un plan fonnel, entre une apparition en propre et des visées impropres16. Or cette structure a une condition, car elle est motivée par un vécu foncier qui la porte : l'auto-motricité de mon corps propre1? Si je retiens des faces cachées de l'objet, c'est bien parce que je les ai précédemment perçues et cette perception avait pour condition le face à face de mon corps avec cet objet. Cela signifie que, entre-temps, je me suis déplacé et que, dans l'instant présent, je retiens les différentes phases de mon mou vement. Si j'anticipe des apparitions à venir, c'est parce que je sais que mon corps, par son aptitude à se mouvoir, pourra aller vers ces faces cachées. J'éprouve mon pouvoir à être en mouvement par mes kines thèses et c'est cette auto-motricité qui fonde la perception. Bref, je ne perçois les objets, leur environnement et même le monde, que parce que Je me meus. 1 3 E. Husserl, Chose et espace. Leçons de 1907, tr. de J.-F. Lavigne, Paris, PUF, 1989, p. 189-243. 14 Pour une caractérisation plus précise du se mouvoir de la subjectivité concrète incarnée, nous renvoyons à nos analyses dans Husserl et le géostatisme, op. cit., p. 25-29. Plus généralement, nous renvoyons à l'ensemble du premier chapitre, p. 25-72. 15 E. Husserl, Méditations cartésiennes, § 17, tr. de M. de Lallllay, Paris, PUF, 1994, p. 84-86. 16 E. Husserl, Chose et espace, op. cit., § 23, p. 104-106. n IbUi., p. 240-243.
44
PAUL DUCROS
Le sol de la Terre Le mouvement, mon mouvement en tant qu'auto-motricité, est lié à mes pieds. Ces derniers impliquent des kinesthèses spécifiques ; ils contiennent des sensations propres d'automouvement. Toutefois - et tel est l'enjeu du fameux texte de 1934 « L'arche-originaire-Terre ne se meut pas » - mes pieds offrent aussi des sensations haptiques exposantes spé cifiques18. Je sens une dimension propre par mes pieds quand je me meus. Plus précisément, cette sensation expose une dimension qui a pour sens irréductible d'être sous mes pieds. À chacun de mes pas, le sol se donne comme un irréductible et nécessaire dessous. Quand je marche, c'est le sol de la Terre qui apparaît comme l'indéfectible soutien de mes pieds19. Il s'ensuit que la vie de la perception est perpétuellement accom pagnée de l'apparition de la Terre2o. En effet la perception est nécessai rement soutenue par la motricité ; celle-ci dOlllle le sol qui est la Terre. La perception est un ensemble de vécus, porté par le vécu du se mouvoir qui est lui-même accompagné et par là même motivé par le vécu donnant la Terre. Si les choses, leur environnement, le monde se dOllllent comme horizontalité, la Terre, elle, est un dessous. Si les choses et le monde apparaissent plutôt à la vue appuyée d'un toucher manuel, le sol de la Terre n'a sens que pour le toucher pédestre. Il est bien un sol qui est un fonds irréductible pour toute subjectivité vivante. Une généalogie de vécus se dessine : la perception ; le se mouvoir ; le toucher pédestre de la Terre. La perception dOlllle les choses ; l'auto motricité n'expose rien, mais révèle la puissance subjective à se mou voir ; les sensations pédestres dOllllent la Terre comme sol irréductible. Ces différents vécus et leurs exposés s 'enchevêtrent et se motivent. On est toutefois en droit d'affinner que celui donnant la Terre est le plus archaïque et que c'est en étant lié aux sensations de se mouvoir qu'il porte la perception. Le sol de la Terre, la Terre comme sol, a un sens spécifique : l'im mobilité. Le Terre est immobile en tant qu'elle est le sol qui est un appui pour mes pas ; ce sont bien ces derniers qui révèlent la Terre comme immobilité. Pour que je me déplace, le sol doit être immobile. Mon mou vement révèle cette dimension en tant que sa condition.
18 Nous analysons longuement cette expérience dans Husserl et le géostatisme, op. cit., p. 50-72. 1 9 E. Husserl, La TelTe ne se meutpas, op. cit., p. 18. 20 Ibid., p. 11-12.
HUSSERL ET LE GÉOSTATIS:ME
45
Ce sens de la Terre, donné par un vécu spécifique, est une nécessité et une universalité. La terre ne peut avoir que ce sens, partagé par toute subjectivité. La Terre possède un sens intersubjectif21. Chaque sujet éprouve l'immobilité du sol sous ses pas en tant que condition de sa mobilité et condition de l'apparition des choses et du monde au-delà d'elles. Je sais parce que je sens - selon un savoir sensible lié à une vie affective - l'immobilité de la Terre sous mes pas. Il s'agit là d'une dimension nécessaire à ma vie propre et individuée. Dans le monde, d'autres êtres m'apparaissent dans lesquels je reconnais une vie analogue à la mienne. Je ne peux donc que pressentir une apparition de la Terre pour eux comme pour moi. Et si la Terre se dOlllle à moi comme immo bile, elle aura nécessairement ce même sens pour eux. Il n'y a ici aucune déduction, simplement un partage de vécus et l'apparition d'un vécu qui est la rencontre d'autres vécus. Le sol de la Terre est immobile. Cette immobilité est donnée par la marche de nos pas. Le mouvement de mon corps est le vécu ayant pour contenu, pour noème pourrait-on dire, le sol immobile. L'auto motricité de mon corps est la dimension archi-subjective du vécu ayant comme contenu le sol immobile, mais de telle sorte que ce sol est la face objectale de ce vécu. Il faut ici insister sur le fait (l'archi-fait) selon lequel l'immobilité n'est pas le repos. Ce dernier est le sens de la choséité et de l'objectivité. Tout objet se donne comme étant en mouvement ou en repos, selon une relativité de ces états. La Terre, elle, est immobile et ne peut modifier cet état ; et c'est bien pourquoi l'im mobilité est un absolu. On pourra dire que cette immobilité est relative au mouvement de mon corps. Or une telle perspective serait une péti tion de principe phénoménologique. Elle serait en effet le retour à une perspective naturaliste qui ferait de mon mouvement un état mondain lié à un corps terrestre et dont les états possibles (le mouvement et le repos) seraient relatifs. Le mouvement de mon corps est un vécu, une dimension que seule mon intériorité peut saisir lorsqu'elle n'est pas naïvement ouverte au chosique mondain. Lorsque je suis attentif à l'in tériorité de ma corporéité propre, je saisis que, même si je me tiens immobile et si mon immobilité est l'état de ma subjectivité (en quoi d'ailleurs elle ne serait qu'une modalité de mon mouvement incarné), la Terre apparaîtra comme immobile sous mes pieds. Mon repos est une modalité de ma motricité pour laquelle le sol est absolument immobile. L'immobilité de la Terre est un état absolu pour moi que seule peut 21 Ibid., p. 21-23.
46
PAUL DUCROS
révéler une analyse phénoménologique attentive à mes vécus les plus intimes et les plus archaïques. Ces derniers relèvent de l'aptitude à se mouvoir. Celle-ci appartient à une vie animale. Déjà pour Aristote, mais Husserl le prolonge ici, l'auto-motricité est le sens même de la vie animale, présente en l'homme22. En tant qu'il se meut, l'homme possède une dimension subjective qui le rattache à l'animal. C'est une intersubjectivité animale qui advient lorsque je me meus. Je recOllllais cette dimension comme partagée avec l'animal. Dès lors ce qu'elle donne, son sens (l'immobilité de la Terre), m'apparaît comme je sais et je sens qu'il apparaît à l'animal. La Terre a donc bien un sens intersubjectif qui lie subjectivités humaines et ani males. Et il ne s'agit pas d'y voir une analogie avec le seul mammifère terrestre, car Husserl peut, dans le Manuscrit D 1 1, indiquer que l'oiseau qui, après avoir volé, se repose sur sa branche est, lui aussi, lié au sol de la Terre immobile23. Toute subjectivité vivante est, sur le plan de sa vie corporelle, archaïquement liée à l'immobilité de la Terre.
La non corporéité de la Terre Reprenons le sens de ce vécu animal bien spécifique que, en tant que subjectivité humaine, je peux néanmoins comprendre : la branche sur laquelle se pose l'oiseau vaut selon Husserl comme sol. Il nous conduit à penser que la Terre n'est pas un corps singulier. Elle n'est pas même un corps au sens strict ou usuel, puisque n'importe quel corps peut valoir comme sol et peut résonner comme Terre immobile. Dans le Manuscrit D1 1, Husserl évoque aussi l'exemple de spationautes loin de la Terre, mais pour qui leur vaisseau vaudrait comme sol et donc comme Terre24. On pourrait alors dire qu'ils ont en mémoire la Terre qu'ils ont pu fouler et que les matériaux dont leur vaisseau est fait proviellllent de la Terre. Or Husserl imagine, dans un effort de variation, que ces spationautes n'ont jamais COllllU la Terre et que les matériaux du vaisseau n'auraient alors rien de terrestre. Il n'en resterait pas moins évident que leur vais seau est pour eux un sol qui vaut comme appui. Leur vaisseau est la Terre, même dans l'absence de la planète terre25. Ceci nous conduit à
22 23 24 25
Aristote, De l 'âme, 433bI2-433b29. E. Husserl, La TelTe ne se meutpas, op. cit., p. 19-20. Ibid., p. 21-23. Ibid., p. 23.
HUSSERL ET LE GÉOSTATIS:ME
47
affinner que la Terre au sens husserlien n'est en rien un corps. Elle est l'appui pour l'auto-motricité d'une subjectivité incarnée. La Terre n'est pas un corps mais le sol de toutes mes expériences. Il s 'ensuit que la Terre ne doit en rien être confondue avec la pla nète terre, pas même celle à laquelle nous aurions affaire dans notre vie26. Cette terre vaut pour la Terre comme sol, mais si je peux substituer à la terre d'autres corps c'est bien que la Terre ne se confond pas avec elle. Bref, la Terre au sens husserlien n'est pas la surface terrestre. Elle est plutôt ce qui serait irréductiblement en dessous d'elle. La Terre est bien, ainsi que le rappelle Patocka, un repère pour mon orientation, car tout corps mondain se réfère à elle, ce qui la pose comme absolu27. Cependant, un repère possède une dimension spatiale, il est dans l'espace car il est un corps. Il est, surtout s'il vaut comme Terre, proto-corps, mais il possède à ce titre une dimension corporelle et spatiale. Or la Terre, au sens rigoureusement husserlien que sa postérité n'a pas vrai ment repris, est plutôt le fonds de toute spatialité qui, à ce titre, n'est pas spatiale. La spatialité se dOlllle selon une horizontalité ; la Terre, elle, est en profondeur. Elle est le dessous, le profond même. Il s'agit là de déter minations spatiales, mais qui connotent un sens qui se dérobe à l'appa rition même de la spatialité. Celle-ci est chose dont les faces peuvent se dOllller, et elle est le rapport entre ces faces. Tout cela suppose une apparition visuelle en présence ou, au moins, en possibilité de présence. La Terre quant à elle est un irréductible dessous qui se dérobe à la pos sibilité même de se donner en présence. Toute chose spatiale n'est pas présente mais peut l'être. La Terre, en tant qu'irréductible dessous de ce qui est présent, ne passera jamais à la présence. La Terre n'est jamais présente. À ce titre, elle n'est pas spatiale. Elle est le fonds de toute
26 Précisons le sens de la différence que nous marquons orthographiquement entre TelTe et telTe. C'est là une distinction ontico-ontologique fondamentale que nous avons précisément et longuement analysée dans notre livre (Husserl et le géostatisme, op. cit., p. 37-44 ; p. 76-95). La telTe est la planète terre. À ce titre elle est un corps et une telle détermination ne change pas même lorsque nous considérons la terre comme le lieu que nous habitons. La TelTe, elle, est le sol que nous foulons sous nos pieds. Il s'agit d'une autre expérience et, donc, d'un autre sens. La Terre comme sol est originaire ; la terre comme corps et comme lieu est dérivée. La subjectivité humaine incarnée passe de la Terre à la terre, du sol au corps. Le passage d'une détermination à l'autre est essentiel, mais il a pour origine le sol de la Terre immobile sous les pas de mes pieds. 27 J. Patocka, « Le monde naturel et la phénoménologie " et « Méditation sur Le monde naturel comme problème philosophique '>'>, tr. de E. Abrams, in Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, Dordrecht, Kluwer, 1988, p. 30-31 et p. 1 1 1 .
48
PAUL DUCROS
spatialité et pour toute spatialité, mais se dérobe à une détennination de cet ordre. La spatialité est la détennination première de la choséité, de l'objec tivité et des corps. Toute chose est un corps spatial et c'est bien cela qui la donne comme objective. La Terre est le fonds de la spatialité chosique qui ne se dOlllle pas comme corps présent. C'est bien pour cela que la Terre ne peut être définie comme un corps. Cette pensée peut paraître déroutante. Mais ce n'est là qu'un effet de la radicalité du questiOllllement husserlien. Si la Terre était un corps, même privilégié, on ne comprendrait pas en quoi elle serait l'absolu de l'expérience. En effet un corps n'est toujours que relatif à un autre. Surtout, les états du corps (repos ou mouvement) sont relatifs. La relati vité des corps et de leurs états est le sens même de la spatialité. Husserl pose le sol de la Terre comme étant absolument immobile. Il ne peut donc qu'être a-spatial et imposer la Terre comme radicalement non corporelle. Si la Terre n'est pas corps, elle n'est pas objectivité présente. Dès lors elle ne peut ontologiquement être détenninée selon le registre de l' effectivité. Elle est en fait, ainsi que le dit là aussi Patocka, une dimension de puissance28. La Terre est même pure puissance depuis laquelle, ainsi que le dit le philosophe tchèque, toute force provient et même, pourrions-nous ajouter, toute objectité. Il faut alors considérer la puissance en un sens plus proche de celui d'Aristote, dont Heidegger a rappelé la profondeur tout au long de son œuvre : la Terre est un pur pouvoir être depuis lequel l'être en effectivité des corps objectifs ou des forces physiques vient à paraître mais qui, lui, se dérobe à toute appa rition29. L'apparition est ici manifestation de présence, elle est l'effec tivité. Elle est la présence dans laquelle le pur pouvoir être n'a plus de sens. La puissance, par contre, possède un sens ontologique bien parti culier entre l'être (effectif) et le non-être. Elle est ce qui tend à être mais bien pour n'être pas (encore). La Terre en tant que fonds est cette dimension où la pure puissance se trouve préservée dans son sens onto logique fondamental. La Terre est puissance pure. Elle est le fonds depuis lequel tout se donne en présence effective, mais qui ne peut et
28 J. Patocka, « Le monde naturel et la phénoménologie '>'>, in op. cit., p. 3 1 . 29 Aristote, Métaphysique B5 à B9 (1047b30-105 1b34) ; Heidegger, « L'origine de l'œuvre d'art '>'>, tr. ft. W. Brokmeier, in Chemins qui ne mènent nullepart, Paris, Gallimard, 1962, p. 13-92, et plus particulièrement p. 49-54.
HUSSERL ET LE GÉOSTATIS:ME
49
ne doit pas lui-même être effectif ; il doit bien plutôt être préservé conune pUIssance. Il n'est donc pas approprié d'affinner, ainsi que certains, même panni les plus éminents, peuvent le penser, que la Terre serait substan tielle et constituerait un premier substrat30. Détenniner la Terre de la sorte revient à la penser conune effectivité, conune étant la première effectivité depuis laquelle toute autre effectivité proviendrait et c'est bien pour cela qu'on en vient à la penser conune le repère premier, avec une détenni nation spatiale, qui est celle d'un corps réellement effectif dans le monde. Or la Terre n'est pas le premier des corps. Elle n'est pas même un corps, elle est le sol en dessous de tout corps et depuis lequel tout corps se donue. Chaque corps effectif apparaît depuis un fonds de puissance qui demeure puissance et ne passe pas à l'effectivité. La puissance n'est pas effectivité, mais condition de toute effecti vité. On peut ainsi la caractériser conune ce qui n'est pas encore effec tif, mais pour le devenir en ce qu'il va le devenir. On peut ainsi considérer la puissance conune un fonds qui ne devient pas effectif. Si l'effectivité provient d'une puissance, il y a toujours une part de cette dernière qui reste puissance et qui ne se fait pas effective. À chaque passage à l'effectivité, un fonds de puissance reste puissance non effec tuable. Tel est le sens de la Terre : elle est le pur pouvoir-être pour toute effectivité qui, en tant qu'elle est bien un pur pouvoir-être, ne se rend jamais effective. C'est de Heidegger que Husserl est ici le plus proche. En effet conune pour son successeur hétérodoxe, la Terre est un pur pouvoir être pour Husserl. Au-delà de leurs intentions les deux auteurs se rejoignent, quoiqu'ils continuent de diverger, surtout sur un plan méthodique, car si Husserl maintient l'exigence descriptive de vécus archaïques, Heidegger s'en remet à des analyses d'objets culturels déjà symboliquement déter minés31. Quoiqu'il en soit de ces divergences entre les deux penseurs majeurs de la phénoménologie, celles-ci conduisent à penser la Terre conune un sol de pure puissance pour toute expérience humaine, sol qui ne peut se donner que selon une foncière inunobilité. 3 0 J. Patoèka, « Le monde naturel et la phénoménologie '>'>, in op. cit., p. 30. Le substrat se tient bien dessous. On peut le considérer comme invisible à notre regard charnel. Cependant le substrat est ce qu'il y a de plus effectif. Et s'il n'est pas présent pour l' œil de notre corps, le regard intellectuel de l'esprit, lui, peut pleinement saisir l'effectivité de sa présence. 3 1 Pour l'analyse de cette différence, voir notre Husserl et le géostatisme, op. cit., p. 356-392.
50
PAUL DUCROS
Renversement du copernicianisme et du modèle de la science galiléo cartésienne Affinner que la Terre est immobile, c'est affinner qu'elle n'est pas un corps et c'est alors remettre en question les fondements de la science moderne. Cette dernière a pour impulsion la révolution copernicienne qui institue le mouvement de la terre pour en faire un corps spatial comme les autres qui, ontologiquement, n'a pas plus de valeur qu'une simple pierre en ce que, comme cette dernière, elle est en repos ou, plus précisé ment, aussi bien au repos qu'en mouvement selon le référentiel consi déré. La relativité du repos et du mouvement, physiquement instituée par Galilée, a pour racine et pour impulsion, selon ce dernier lui-même, la représentation copernicienne de l'wlivers32. Le Manuscrit Dl 7 veut, dans son titre même, renverser le copernicianisme. La pensée de Husserl, notamment dans ce texte, est l'incarnation la plus pure de la révolution anti-copemicienne33 qui ne peut s 'instituer qu'en remettant en question le modèle de la mobilité de la terre. Retourner le copernicianisme, renverser la science moderne dont Copernic est le symbole et l'initiateur, ne consiste pas à donner une nou velle représentation scientifique de l'univers. Scientifiquement, la repré sentation galiléelllle, et donc la structure copernicienne de l'univers, demeure absolwnent valide. L'ambition de Husserl, et de la phénoméno logie, ne consiste pas à fournir un nouveau modèle objectif : sur le plan de l'objectivité, la science moderne est en fait indépassable. Retourner le copernicianisme, c'est, plus fondamentalement, mon trer qu'il y a une dimension plus originaire que le modèle proposé par la science, parce que cette dimension ne relève d'aucun modèle scientifique. Retourner le copernicianisme c'est montrer que cette dimension est la condition même de toute représentation objective. Retourner le coperni cianisme c'est enfin montrer que la force du modèle objectiviste scienti fique est telle qu'elle masque et même refoule cette dimension plus originaire. La Krisis appelle cette dernière le monde de la vie. Il s'agit d'un domaine d'expérience, essentiellement lié au sentü-34. Le monde de la vie 32 Galilée, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, tr. de R. Fréreux et F. De Gandt, Paris, Seuil, 1992, p. 243-246. 33 Selon l'expression employée par Dominique Pradelle dans Par-delà la révolution copernicienne. Sujet transcendental etfacultés chez Kant et Husserl, Paris, PUF, 2012. 34 E. Husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcen dantale, tr. de G. Granel, Paris, Gallimard, 1976, p. 1 1 7-216.
HUSSERL ET LE GÉOSTATIS:ME
51
est la totalité de ce qui est, telle que cette totalité apparaît à la subjecti vité. Il est le monde à l 'état naissant, il est l'apparition de l'apparaissant pour une subjectivité primitive. La subjectivité archaïquement incarnée dans le corps propre vivant se mouvant n'a de relation aux choses que selon des apparitions partielles. Si, au-delà des choses, l'horizon se dOlllle, il apparaît comme non intégralement dOllllé. Bref, la vie percep tive, qui est le vécu primordial du monde de la vie, constitue un monde foncièrement inachevé. Le monde de la vie est l'expérience la plus pri mitivement subjective du monde. La science moderne et sa rationalité instituent une objectivité et une positivité intégrales. Par la quantification qu'elle effectue des choses du monde, elle en fournit la représentation objective la plus convaincante. Il ne s'agit en rien, pour Husserl, de nier la légitimité ou la validité de cette position. Il s'agit plus simplement de montrer que l'attitude radicalement objectivante de la science se soutient de l'expérience archi-subjective du monde de la vie. Ainsi l'humanité quantifiante ne peut se représenter les objets qu'après qu'ils soient apparus selon des vécus que seule l'analyse phénoménologique peut mettre en lumière. La phénoménologie husserlienne n'est en rien une négation de la rationalité. D'une part, elle ne nie pas le bien-fondé de la rationalité scientifique et, d'autre part, c'est par une voie intégralement rationnelle qu'elle met en œuvre l'eidétique des vécus. La phénoménologie est radi calement ratiollllelle et montre un déficit de rationalité dans la science objectivante par son oubli des expériences subjectives qui sont portant la condition de toute apparition d'objets. C'est la science qui est insuffisam ment rationnelle lorsqu'elle ne tient pas compte de cette couche pourtant primordiale. La science moderne ne se contente pas d'oublier le monde de la vie ; elle ne veut rien savoir de lui. Or, j'ai toujours affaire aux apparitions subjectives de choses, c'est bien cette expérience qui rend possible la détennination objective et elle ne cesse de jouer durant la mise en place de ces détenninations35. Cependant, précisément, la science galiléelllle ne veut rien en savoir, renvoyant le sol de l'expérience au rang d'illusion36. La phénoménologie est là pour rappeler ce sol indépassable d'expérience. C'est précisément ce rappel, par les voies de la rationalité ;5 IbUi., p. 137-140. 3 6 Galilée, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, op. cit., p. 226-247. Ajoutons que Galilée ridiculise toute position qui ne reconnaîtrait pas la nécessité du mouvement du corps terrestre. Cette moquerie galiléenne inhibe, jusqu'à nos jours, toute évaluation critique que l'on voudrait exercer sur les fondements épistémologiques et philosophiques de la science moderne.
52
PAUL DUCROS
phénoménologique intégrale, que l' obj ectivité quantifiante de la science moderne ne peut accepter. Aucune analyse n'est plus révélatrice de la prise au sérieux du monde de la vie que la réflexion sur le géostatisme mise en place dans le Manuscrit Dl7. L'épreuve du sol immobile au-dessous de mes pas en mouvement relève bien de ces expériences primordiales que la subjecti vité incarnée vit à chaque instant. Il s'agit bien d'une expérience absolu ment subjective et d'une indépassable évidence. Chaque fois que je me meus, je sens le sol de la Terre selon une irréductible immobilité. Il s'agit bien là d'un absolu, mais qui n'a rien d'objectif car il n'a sens que pour la subjectivité. De plus, c'est à partir de cette expérience que tout se dOlllle, y compris l'univers. Je ne peux l'expliquer causalement et objec tivement que depuis cette expérience première. Il n'y a d'héliocentrisme, d'apparition des corps célestes en mouvement, qu'en partant de mon expérience de la Terre immobile sous mes pas. Or, la science moderne se refuse à reconnaître cette expérience. Elle la renvoie au rang d'illusion, précisément parce qu'elle est une expé rience subjective de la sensibilité. La pensée galiléelllle affinnera que l'immobilité de la Terre n'est qu'une représentation illusoire que l'on peut corriger précisément lorsqu'on fera intervenir le modèle de la rela tivité du mouvement et du repos des corps. Sur le plan de l'objectivité, le repos de la terre n'est bien qu'une illusion qui provient de la relativité des états des COrpS3? Or ce n'est pas sur ce plan que l'analyse phénomé nologique se situe. Il s'agit de prendre au sérieux le sens de l'expérience dans sa subjectivité même, précisément parce qu'elle est le foyer primor dial de toute apparition. La Terre (et non la terre) est nécessairement et absolument immobile (et non simplement au repos) lorsqu'on la consi dère sur le plan du monde de la vie. Il y a ici un absolu pour la subjec tivité. C'est une telle position, spécifique à la phénoménologie, que la science moderne ne peut entendre. Lorsqu'il s'agit de tout reconduire à l'objectivité, le sol de l'expérience subjective ne peut ni ne doit être considéré. Il s'agit bien pourtant du sol de l'expérience duquel tout appa raît et qui est la condition de toute représentation, y compris la plus objectivante, y compris celle imposée par le positivisme de la science. L'analyse phénoménologique révèle que le fond originaire est le vécu donnant la Terre immobile et non le donné objectif d'un corps spa tial en mouvement selon une représentation scientifique objectivante. L'originaire est ici le vécu d'une expérience. Et c'est de lui que toute H
IbUi., p. 484-5 13.
HUSSERL ET LE GÉOSTATIS:ME
53
objectivité provient. Ainsi la terre peut être instituée comme corps, mais bien à partir de l'expérience du sol de la Terre immobile. Il y a là une évidence subjective que seule la rationalité phénoménologique peut faire apparaître et qui échappe à la rationalité positiviste scientifique. Cette dernière - et c'est d'ailleurs l'intention ultime de Husserl - devrait s'en remettre à la pensée phénoménologique qui montre les conditions de possibilité de sa propre effectuation. Toutefois elle refuse obstiné ment toute fonne d'échange, renvoyant le sol archi-subjectif au rang d'illusion.
Géostatisme et géocentrisme Il convient ainsi d'éviter un contresens qu'une lecture inattentive et paresseuse du texte de Husserl ainsi que de nos analyses pourrait suggé rer. En effet, et contrairement à des apparences immédiates, le géosta tisme n'est pas le géocentrisme. Husserl ne pense pas que la Terre telle qu'il l'entend devrait être au centre de l'univers. Il veut seulement consi dérer que l'expérience archi-subjective éprouve un sol immobile. Le géostatisme n'est pas même (et surtout pas) la volonté de réintroduire une représentation géocentrique dans une civilisation qui l'a dépassée. Bref, renverser 1 'héliocentrisme38 ce n'est absolument pas retrouver le géocentrisme. Ce dernier est en effet une représentation astronomique au même titre que l'héliocentrisme. Le géocentrisme est une représentation objec tive et objectivante du monde. La terre y est un astre, et donc un corps. Elle est, certes, dotée d'un statut particulier (puisqu'elle est perpétuelle ment en repos), mais est bien un corps. Le géocentrisme étant une repré sentation astronomique qui conduit nécessairement à une représentation de la terre comme un corps. Il s 'ensuit que le géocentrisme ne peut que se transfonner en héliocentrisme, car ce dernier est la représentation la plus satisfaisante du point de vue de l'objectivité scientifique. L'astrono mie se fondant sur la notion de corps, le géocentrisme, en tant que repré sentation astronomique, est voué à être dépassé dans et par l'hélio centrisme. Renverser le copernicianisme n'est pas annuler l'héliocentrisme, mais aller vers une dimension qui n'est pas astronomique, et c'est bien pourquoi, répétons-le, le géostatisme n'est pas le géocentrisme. Avec ce 3 8 E. Husserl, La TelTe ne se meut pas, op. cit., p. 9.
54
PAUL DUCROS
dernier, la terre n'est pas en mouvement parce qu'elle est en repos. Cet état ne se conçoit que relativement aux mouvements de tous les autres corps célestes. La terre, au repos plutôt qu'immobile, est au fond le réfé rentiel pour le mouvement des autres corps. Les Anciens n'avaient pas d'autre moyen pour calculer les mouvements des corps et se représenter l'Wlivers que de prendre la terre comme référentiel. Il s'ensuit qu'on est dans un nécessaire progrès scientifique lorsqu'on pense une relativité du repos et des mouvements pour tous les corps, y compris la terre. L'objec tivité des lois de la mécanique est plus rigoureusement instituée lorsque d'autres corps que la terre sur laquelle se trouve l'observateur astrono mique peuvent servir de référentiel. L'institution héliocentrique se révèle une authentique évolution positive pour l'astronomie et la science. Le géocentrisme astronomique ne pouvait que devenir héliocentrisme. Renverser l'héliocentrisme c'est donc aussi bien dépasser le géocen trisme en tant qu'ils sont tous les deux des représentations astronomiques. C'est en effet retrouver une dimension archi-subjective qui fonde toute représentation scientifique objectivante. Le géostatisme a pour vocation de donner à penser l'expérience subjective et intersubjective qui fonde toute objectivité scientifique, y compris astronomique, qu'elle soit hélio centrique ou géocentrique. Le géocentrisme, parce qu'il pense une terre au repos, est, certes, plus proche du géostatisme. On peut considérer qu'il garde une certaine proximité avec l'expérience archi-subjective de la Terre immobile et qu'il est une représentation astronomique qui n'a pas totalement refoulé le sens originaire de la Terre. Ce n'est toutefois pas sur ce plan que réside la portée essentielle du géostatisme et d'ailleurs Husserl n'évoque pas dans son texte la pertinence de quelque représentation antique de l'univers39. Le géostatisme n'est décidément pas le géocentrisme ni la nostalgie de celui-ci. Husserl n'est d'ailleurs pas un auteur cultivant le souvenir bien heureux d'époques culturelles révolues. Le fondateur de la phénoméno logie veut penser le sens d'expériences subjectives originaires qui fondent toutes sortes de représentations. Le géocentrisme est une représentation astronomique, il est aussi investi de significations symboliques quant à la place de l'homme et au sens de 1 'univers40. Ces significations sont variables : ainsi si on a pu
39 L'ambition de Husserl n'est en rien de retrouver Aristote ou Ptolémée. Interpréter le texte de Husserl de cette façon c'est commettre le plus grossier des contre-sens. 40 On peut dire la même chose de l'héliocentrisme. Il offre d'autres caractérisations symboliques, mais ne fait qu'en fournir.
HUSSERL ET LE GÉOSTATIS:ME
55
penser que le géocentrisme était aussi un anthropocentrisme attribuant une place éminente et avantageuse à l'homme41, on peut aussi affinner en étant d'ailleurs plus proche des représentations antiques - que la cen tralité de la terre dans le cosmos est aussi sa place au fond de ce dernier, c'est-à-dire le lieu de la plus grande imperfection42. Si les astres se meuvent selon l'éternité de la régularité et de la perfection de la circula rité, la terre est le fond de l'univers soumis à la corruption du temps43. L'enjeu de la phénoménologie husserlienne est tout autre. Il ne s'agit pas de spéculer sur quelque dimension symbolique que ce soit. La phénoménologie husserlielllle n'est pas le souci de considérer un sens ou des sens déjà faits et de réfléchir à leurs significations et leurs portées symboliques. Elle est l'effort pour suivre le sens à l'état naissant, se faisant. Le symbolique est un sens déjà constitué, dont on prolonge l'état constitué, mais dont on n'interroge pas (à moins d'être rigoureusement phénoménologue) la constitution elle-même. Le sens se faisant naît tou jours pour et dans une subjectivité originaire, absolument archaïque. Le sens se faisant advient dans des vécus sensibles aussi simples que celui de la marche. Cette dernière n'est pas considérée quant aux significations qu'elle posséderait, par exemple d'être le symbole de la liberté de l'homme. La marche est ici envisagée au niveau des sensations tactiles qu'elle met en jeu, notamment celles de mes pieds. Pour eux, un sol rigoureusement immobile apparaît. Ce n'est qu'à partir de cette expé rience que toute signification symbolique peut être donnée. Mais les réflexions sur ces significations oublient le sens originaire se faisant. Pen sant au sens de la marche pour la dignité de l'homme, réfléchissant à la portée de la place de l'homme au sein de l'univers (qu'il soit sur une terre au repos ou en mouvement), on oublie que tout cela a pour naissance mon simple mouvement pédestre pour lequel le sol immobile de la Terre se dOlllle à mes sensations.
4 1 On a alors pu considérer que la découverte de l'héliocentrisme s'accompagne d'une représentation humiliante de l'homme par laquelle il pouvait accéder à une compréhension de sa finitude. C'est ce que Freud affinen , notamment dans Introduction à la psychanalyse, tr. de S. Jankelevitch, Paris, Payot, 1982, p. 266-267. 42 R. Brague, La sagesse du monde. Histoire de l 'expérience humaine de l 'univers, Paris, Fayard, 1999, p. 275-292. 43 On pense alors que l'homme, puisqu'il habite dans le fond de l'univers, est l.Ul être imparfait vivant à chaque fois sa limite. On est alors en droit de dire que c'est l'homme de l'héliocentrisme qui, en tant qu'astronome et physicien, accède à une place cosmo théorique privilégiée et conquiert ainsi un pouvoir que la civilisation antique (qu'elle fut polythéiste ou monothéiste) lui refusait.
56
PAUL DUCROS
La phénoménologie est l'analyse du sens naissant se faisant. Rien ne l'atteste mieux que la pensée husserlielllle du géostatisme. C'est à ce niveau, seul, que cette pensée doit être évaluée. Toute autre considération ne serait qu'un contresens.
La portée éthique du géostatisme Une expérience archaïquement sensible porte toutes les construc tions langagières ou symboliques. L'épreuve de la Terre sous mes pas est la condition de toute représentation astronomique de l'univers et de toute interprétation de cette organisation du monde. Il faut donc relier toutes les représentations ordonnées à ce fonds archaïque, et montrer comment il les origine. Or les représentations objectives s'y montrent étrangères. Elles se déploient en oubliant ce fonds, comme si cet oubli était la condi tion de leur déploiement. On peut ainsi considérer qu'il y a un devoir du phénoménologue : mettre à jour le lien des vécus verbaux et symboliques avec cette source archaïque. Le phénoménologue doit mener les descriptions des vécus afin de montrer leur spécificité mais aussi leur dimension fondatrice des autres vécus. Il y a bien une éthique du phénoménologue en ce qu'un devoir qui lui est propre résonne dans sa conscience : être phénoméno logue précisément, en mettant en œuvre les analyses de vécu, en repre nant sans cesse ces analyses elles-mêmes. La phénoménologie est une exigence éthique qui s'incarne dans le processus même de sa démarche : préciser sans cesse l'essence d'un vécu ; montrer toujours mieux en quoi certains vécus en portent d'autres44. Mais l'exigence phénoménologique est aussi une éthique pour l'hu manité. Les philosophes en tant que phénoménologues doivent se faire « fonctiOllllaires de 1 'humanité »45. À cette fin ils doivent montrer aux hommes quels sont les vécus qui les portent. Ils doivent aussi mettre en lumière qu'elles sont les détenninations spirituelles qui les font exister à tel ou tel moment de leur histoire. Ainsi Husserl a toujours voulu montrer (mais l'urgence de cette exigence s'est particulièrement manifestée à par tir des années trente) que les Temps modernes sont portés par l'esprit des 44 Rudolf Bernet met exemplairement en lumière la dimension éthique de la démarche théorétique phénoménologique dans « Finitude et téléologie de la perception '>'>, in La vie du sujet, Paris, PUF, 1994, p. 121 à 138. 45 E. Husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcen dantale, op. cit., p. 23.
HUSSERL ET LE GÉOSTATIS:ME
57
sciences de la nature, fondé par Descartes et Galilée à partir de Copernic. il est alors du devoir du phénoménologue de montrer les limites de telles représentations et de leurs applications. Ainsi le phénoménologue doit prouver que la représentation de la science moderne oublie le sens de la Terre immobile. Révéler le caractère inévacuable de cette expérience, c'est montrer la limite spirituelle de la science moderne. La phénoméno logie, en tant qu'effort de pensée, apparaît alors bien comme une éthique pour laquelle rien n'est plus éthique que l'effort de penser le sol immo bile de la Terre. Husserl ne confère pas à cette réflexion précise un sens éthique, mais il nous paraît nécessaire de le faire. Ainsi, lorsque nous parlons de géostatisme, nous ne considérons pas seulement l'analyse strictement théorique mettant en hunière le vécu spécifique d'épreuve de la Terre immobile lorsque je marche. Le géostatisme signifie aussi la dimension éthique de cette analyse, tout d'abord en ce qu'il s'agit de répondre à un devoir de pensée lorsqu'on analyse avec autant de rigueur un tel vécu, mais aussi en ce que cette analyse est un devoir vis-à-vis de l'humanité46. Le philosophe doit en effet lui montrer ce qui la fonde mais qu'elle a, dans ses représentations spirituelles, refoulé. Le géostatisme est l'analyse eidétique du vécu de la Terre immobile sous mes pas, mais comporte aussi - ainsi que nous l'avons rappelé plus haut - la caractérisation ontologique de la Terre ainsi révélée et, enfin, les implications éthiques d'une telle analyse. S'il y a, pour le phénoménologue, une éthique de la Terre immobile, elle résOlllle pour l'humanité au point de pouvoir devenir un ensemble de nonnes en vue de l'agir de l'homme contemporain. Le géostatisme - au delà de la lettre du texte de Husserl mais dans le prolongement de son esprit - peut fournir des principes d'action pour les hommes dans leur rapport au monde et aux autres. Cette dimension est exemplairement à l'œuvre dans la réflexion sur la Terre immobile. Un vécu perceptif spécifique, plus archaïque que la perception de la chose proprement dite, donne la Terre comme sol absolument immobile sous mes pieds. La Terre, le sol de la Terre comme dessous, est un invisible et même une dimension de non présence résolue.
46 Nous avons interrogé la dimension éthique de la théorie du géostatisme dans la deuxième partie de notre livre, à partir du quatrième chapitre et jusqu'à la fin (Husserl et le géostatisme, op. cit., p. 143-436).
58
PAUL DUCROS
C'est là un sens ontologique qui se révèle à même la perception. On peut - ainsi que nous l'avons affinné plus haut - ajouter qu'un tel sens est au bout du compte celui de la pure puissance en tant que pur pouvoir être qui ne s'actualise jamais. La Terre est puissance pure qui ne passe pas à l'effectivité. Un tel sens ontologique est alors immédiatement por teur d'un sens axiologique : l'inappropriabilité. Celle-ci s'ajoute au sens ontologique mais comme une conséquence nécessaire. Si la Terre est une pure puissance qui ne passe pas à l'effectivité elle doit échapper à toute tentative de prise, de reconduction à la présence pour une subjectivité qui tenterait de s'approprier le monde dans son intégralité. Un devoir éthique s'impose à l'homme dans son rapport à la Terre : respecter son inappro priabilité. Cette dernière est un sens axiologique qui provient de son sens ontologique de pure puissance. Ce sens ontologique, quant à lui, se révèle dans le vécu de perception. Une généalogie se dessine donc : on part du vécu de perception animé par le se mouvoir qui donne les choses liées au monde et à la Terre ; celle-ci possède un sens ontologique qui est à même l'expérience de perception ; cette signification ontologique détient une portée axio logique ; cette dernière imposera des devoirs à l'humanité pensante et agissante. Bref, la perception révèle un sol immobile non donné et inap propriable que je devrai respecter et préserver. Nous avons dégagé ailleurs plusieurs impératifs fondés par le sens de la Terre, qui devraient commander l'homme dans son rapport au monde. Nous insisterons sur l'un d'entre eux, auquel les autres peuvent d'ailleurs être ramenés47. Ce devoir éthique consiste à respecter l'inappropriabilité de la Terre. Un tel devoir s'impose à l'homme moderne qui n'a de cesse de dominer l'espace qui l'entoure. Les dimensions éthiques du géostatisme husserlien peuvent alors donner des principes pratiques pour l'humanité contempo raine. Celle-ci, notamment lorsqu'elle est fondée par la science et ses applications teclmiques, est portée par une force et un appétit de pouvoir qui, ainsi que pourrait le dire Heidegger, arraisonnent le monde. Une telle tendance doit être limitée ; les principes de la Terre immobile hus serlielllle peuvent y aider. Si l 'homme moderne, scientifique et technique, peut ainsi dominer le monde, c' est parce qu'il pense que tout ce qui l' entoure - et 47 Nous avons développé les différents contenus de l'éthique dans les chapitres VI à XI de notre ouvrage Husserl et le géostatisme, op. cit., p. 207-436. Nous nous efforçons, ici, de nous en tenir à l'essentiel.
HUSSERL ET LE GÉOSTATIS:ME
59
notamment les choses avec leur dimension spatiale - peut (et même doit) être pensé selon le registre ontologique de l'effectivité. L'homme domine ce qui se donne comme présent ; la présence des choses est la condition de leur domination par la pensée et la praxis humaines. DOllllées en pré sence, les choses sont entièrement appropriables par l'homme. Et si je veux dominer ce qui n'est pas encore effectivement présent ce ne sera qu'en le ramenant à la présence. La pensée de la Terre immobile est, rappelons-le, la pensée d'une dimension qui se dérobe à la présence. Elle est un latent qui le demeure, un possible qui ne s'actualise pas. En tant que puissance pure elle est bien inappropriable. Elle ne peut alors que s 'imposer comme une nonne pour limiter les tendances à l'appro priation intégrale du monde par l'homme. Le sens de la Terre est bien à la fois ontologique et axiologique et, à ce titre, impose un devoir de limitation. Bref, la Terre me commande de me retenir de tout reconduire à l'effectivité. On est alors en droit de dire que la pensée husserlienne de la Terre immobile pourrait aider à fonder certaines nonnes de ce que l'on appelle l'écologie. Ce courant de pensée est d'ailleurs intimement lié au mouve ment des Amis de la Terre. La pensée husserlienne pourrait ainsi servir de point d'appui aux Amis de la Terre. Aussi certains rêvent-ils de tisser des liens entre la pensée husserlienne et les développements que l'on peut rencontrer par exemple chez Aldo Leopold48. Un souci de la Terre traver serait ces deux pensées. Or, ce n'est là qu'un rapprochement homonymique porteur de pos sibles contresens. En effet les analyses d'Aldo Leopold - pour belles et suggestives qu'elles soient et porteuses d'une authentique vérité concernent seulement l'environnement que nous partageons avec tous les vivants. La Terre du penseur américain n'est en fait que la planète terre, en tant que lieu d'habitation pour tous les hommes avec tous les animaux. Elle est, elle n'est que (serions-nous tentés d'ajouter), l'espace environ nant pour nous tous. C'est là une dimension essentielle mais qui ne recoupe que partiellement la pensée du géostatisme husserlien. En effet la Terre immobile husserlienne est, certes, cet espace de surface horizon tale que nous vivons intersubjectivement avec les autres. Toutefois elle est aussi, elle est surtout, le fonds de cet espace terrestre qui ne se donne jamais. La terre, pour une écologie simplement écologique, est un espace qui a pour sens de se donner en présence, et donc de pouvoir être dominé. 48 Cf Aldo Leopold, Almanach du comté des sables, tr. de A. Gibson, Paris, Garnier-Flammarion, 2000.
60
PAUL DUCROS
La Terre au sens husserlien est une dimension bien plus profonde à tous les sens du tenue. Elle est ce qui du monde ne se donnera jamais ; elle est cette pure puissance qui habite toute effectivité même si elle ne deviendra jamais effective. Elle impose alors d'être préservée avec son sens de pure puissance. Il ne s'agit pas simplement de sauver notre envi ronnement mais bien de se retenir de tenter de tout arraisOllller. Et c'est cette seconde limitation à notre agir qui pourra fonder la première. Je ne pourrai me retenir de dominer l'espace que lorsque j 'aurai compris la nécessité de préserver un fonds de pure puissance. À ce titre la pensée husserlienne nous paraît capable de fonder radi calement les fonnes de représentation et d'action de l'homme contempo rain. Celui-ci domine la Terre et en éprouve un sentiment ambigu, fait à la fois de fierté mais aussi d'angoisse, composé d'une croyance en un accomplissement de soi auquel se mêle une impression d'erreur et même de faute. La phénoménologie montre les raisons de ces affects complexes et contradictoires. Elle peut alors aussi montrer comment les relativiser. Si l'homme contemporain s 'inquiète de son trop grand pouvoir sur le monde, la pensée du géostatisme indique comment limiter l'usage de cette force et de ses abus. Il nous paraît alors évident que la phénoméno logie husserlielllle possède une actualité brûlante. Or cette dimension est très peu reCOlllu l e et la pensée contemporaine a tendance à s'en remettre à d'autres sources théoriques, y compris pour les problèmes que nous venons de mentionner. En plus de sa technicité, la marginalité dont est victime la pensée husserlienne - et d'ailleurs de plus en plus la phénoménologie elle même - nous paraît tenir à d'autres raisons, plus essentielles. Husserl est le penseur qui a probablement mené le plus radicalement possible la critique la plus fondamentale des fondations théoriques de la modernité. Tout en étant résolument moderne, ainsi qu'il l'affinne dans « L'arche originaire Terre ne se meut pas »49, Husserl a évalué les fondements théoriques de la modernité tels qu'ils proviennent de la science galiléo cartésielllle. Il ne s'est jamais agi pour lui de déconsidérer cette science mais d'établir qu'elle a une origine et - surtout - qu'il y a des dimensions de sens qui lui échappent et dont elle ne veut rien savoir. En bref, Husserl a voulu montrer que l'objectivité de la science ne peut être considérée comme la seule source de vérité.
49 E. Husserl, La TelTe ne se meut pas, op. ci!., p. 12.
LE MOUVEMENT COMME A FR/OR/ MATÉRIEL FONDAMENTAL DE LA PHÉNOMÉNOLOGIE' Claude Vishnu SPAAK
1. Introduction L'objet de ce travail est de rendre compte du mouvement phénomé nologiquement. Il s'agit donc de montrer que là où un phénomène se présente, apparaît, un mouvement est sous-jacent de sa venue à la pré sence, et que cette loi phénoménologique est à la fois universelle et nécessaire. Il s'agit, dans la langue de Husserl, qui emprunte lui-même à la langue de Kant, d'un a priori matériel. Reprise husserlielllle de la langue de Kant, mais moyennant pourtant une défonnation ou une torsion de cette langue, si tant est que pour Kant l'a priori ne peut être que for mel. Le plan suivi sera donc le suivant : d'abord on fera retour à Husserl afin de rendre compte de sa conception de la phénoménologie comme science des a priori matériels. Dans un second temps on mettra en évi dence un certain nombre de problèmes qui découlent de la fonnulation husserlienne du proj et de la phénoménologie comme science universelle, centrée sur la découverte de ces a priori matériels. Notamment, on se concentrera sur le problème de savoir comment la phénoménologie peut s'assurer de mettre en évidence des structures d'essence de la phénomé nalité qui ne soient pas en réalité de simples structures du mode d'accès à la phénoménalité par la conscience seulement humaine. En bref, on se demandera comment il est possible de déceler des lois d'essence absolues de la phénoménalité de façon apodictique, et qui ne soient pas en réalité des structures anthropologiques du mode d'accès par l'homme à l'appa raître. Il semble que Husserl n'a jamais réussi à proposer un critère pennettant de faire la part des choses entre les structures nécessaires et universelles qui régissent l'apparaître en tant que tel, et celles qui ne sont que contingentes ou en tout cas relatives au mode d'accès de la subjectivité finie de l'homme à l'apparaître. Dans un dernier temps, on se Une partie de ce travail a parne dans Matiere et mouvement. Essai de cosmologie phénomenologique, Paris, Hemnann, 2017. *
62
CLAUDE VISHNU SPAAK
rapprochera de Heidegger, et surtout de Patocka, pour montrer que la prise en compte des a priori matériels absolus de la phénoménologie n'est possible qu'à condition de considérer la différence phénoménolo gique entre les phénomènes apparaissants et le champ phénoménal, lequel champ phénoménal - contrairement à ce que suggère trop souvent Hus serl - ne peut en aucun cas être la conscience. Une fois que l'on aura rendu compte de cette différence essentielle, il sera possible de proposer que le mouvement constitue un a priori matériel fondamental de la phé noménologie, parce qu'il est justement le garant de cette différence phé noménologique : le mouvement est l' œuvre dynamique par laquelle surgissent les phénomènes à la présence à partir du champ phénoménal à leur horizon. Dans un tout dernier temps de cette analyse, on soutiendra que Husserl n'avait pas les moyens de rendre compte du mouvement de cette manière.
II. Qu'est-ce qu'un
a
priori matériel ?
Dans le paragraphe Il de la 3' Recherche logique, Husserl établit une différence entre d'une part les catégories fonnelles de la pensée qui pennettent de mettre en évidence les lois, ou plutôt les axiomes, qui régissent l'ontologie de l'objet en général (c'est-à-dire encore les struc tures de la pensée qui s'appliquent à tout objet possible), et d'autre part les catégories matérielles qui portent non plus simplement sur les struc tures de la seule pensée objective en général, mais sur des objets suscep tibles d'être effectivement donnés dans une expérience concrète : Des concepts comme quelque chose, ou une chose quelconque, objet, qualité,
relation, connexion, pluralité, nombre, ordre, nombre ordinal, tout, partie, grandeur, etc., ont un caractère fondamentalement différent de celui de concepts comme maison, arbre, couleur, son, espace, sensation, sentiment, etc., qui, eux, expriment quelque chose de concret. Tandis que ceux-là se groupent autour de l'idée vide du quelque chose ou de l'objet en général, et sont reliés à lui par les axiomes ontologiques fonnels, ceux-ci s'or donnent autour des différents genres concrets les plus généraux (catégories matérielles) dans lesquelles sont enracinées des ontologies matérielles1•
1 E. Husserl, Recherches logiques, vol. 2, Recherches pour la phénoménologie et la théorie de la connaissance (2 volumes ; Première partie : Recherches 1 et II ; Deuxième partie : Recherches III, IV et V), trad. de H. Elie, A. L. Kelkel et R. Schérer, Paris, PUF, respectivement 2011 et 2010 (cité RL, suivi du lllunéro de la Recherche), RL III, p. 35-36.
LE MOUVEMENT COMME A PRIORI MATÉRIEL
63
Ce texte s'appuie sur une distinction d'origine kantielllle entre l'es prit et l'expérience : d'une part l'esprit dans lequel se constituent les structures de l'objectivité en général - les catégories logiques -, catégories qui ne produisent toutefois encore aucune cOllllaissance si tant est qu'elles sont purement fonnelles et n'ont donc aucun contenu ; et d'autre part l'expérience effective et sensible à laquelle se réfèrent les structures objectives de la pensée pour y trouver un contenu matériel susceptible d'étoffer la connaissance de façon synthétique, par la découverte de lois qui régissent les différentes ontologies régionales ou ontologies maté rielles, lois qui sont induites sur la base des faits rencontrés et des simi litudes entre eux. Chez Kant, à la différence de la logique catégoriale fonnelle qui est le lieu de production des énoncés analytiques nécessaires et universels, mais purement fonnels et en fin de compte tautologiques, la science empirique au contraire, ayant pour objet les phénomènes acces sibles à des observations sensibles, est le lieu de production des énoncés synthétiques matériels, pennettant d'étoffer les connaissances humaines sur une base pourtant plus ou moins contingente selon le degré d'expo sition des sciences considérées aux phénomènes, base contingente puisque les sciences, même la physique, sont toutes tributaires jusqu'à un certain point des faits de l'expérience qui sont ce qu'ils sont mais que rien n'interdit d'avoir été autrement. Lorsque Husserl dit, dans le texte cité, que des concepts comme « maison », « arbre », « couleur », « son », « espace », « sensation » et « sentiment » désignent quelque chose de concret, on peut penser qu'il estime avec Kant que la concrétude que gagnent ces concepts se fait moyennant notre renoncement à leur deman der d'offrir des connaissances universelles et nécessaires. Pourtant, de façon très spectaculaire et fameuse, Husserl continue son analyse au para graphe 1 1 dans une voie radicalement anti-kantienne, en mettant au jour la notion de connaissances synthétiques a priori des objets matériels, ou a priori matériels : Cette division cardinale entre la sphère ontologique « fonnelle » et la sphère d'essence « concrète » ou matérielle nous livre la véritable diffé rence entre disciplines ou, respectivement, lois et nécessités analytiques a priori et celles qui sont synthétiques a priori2.
Les ontologies régionales, ou bien ontologies matérielles, comportent selon Husserl des lois et nécessités (ou bien encore des essences, des eidè) qui sont synthétiques a priori (donc apodictiquement nécessaires et 2 RL III, op. ci!., 36.
64
CLAUDE VISHNU SPAAK
universelles) et non pas synthétiques a posteriori (dérivées de l'expé rience sur une base inductive), comme on aurait pu s 'y attendre dans la perspective kantieIllle. Quels types d'ontologies matérielles, susceptibles de délivrer des cOIlllaissances synthétiques a priori (ou a priori matériel) Husserl a-t-il donc en vue ? Tout objet matériel, objet de la physique, ou vivant, objet de la biologie, ou capable d'une activité symbolique, objet de l'antbropo logie, etc. doit pouvoir être d'abord donné, c'est-à-dire apparaître en chair et en os dans une perception ; ou bien en tout cas, puisque les objets scientifiques sont déjà le plus souvent des constructions idéales, ils doivent tout de même pouvoir être rapportés à des phénomènes perceptifs dont ils constituent justement des idéalisations par des processus théoriques d'abs traction. Autant dire que les ontologies déployant des a priori matériels sont pour Husserl des ontologies phénoménologiques, c'est-à-dire des domaines d'objet qui apparaissent à la conscience, et les a priori maté riels ne sont pas autre chose que les structures essentielles qui régissent le mode d'apparaître de ces domaines d'objets. Or, si l'on s'en tient à la perception des objets donnés dans une expérience sensible, un certain nombre de lois nécessaires et universelles, ou a priori matériels, se montrent effectivement selon Husserl. Ainsi, le fait pour toute couleur de devoir nécessairement être donnée sur un support spatialement étendu (une couleur non étendue étant impossible) ; ou bien pour le son d'avoir nécessairement une intensité, une hauteur et un timbre. Il ne s'agit pas là de vérités obtenues simplement sur une base empirique, c'est-à-dire inductive, sur la simple considération d'un nombre fini de cas. Certes, pour Husserl il est certain que pour mettre en évidence des vérités maté rielles de ce type, il faut en passer par la méthode de la variation eidétique, consistant à faire varier imaginativement les cas considérés, en modifiant pour chaque expérience un paramètre dans la représentation des objets, de sorte à faire apparaître des invariants. Cependant cette méthode eidétique ne débouche aucunement sur des lois générales ayant statut de simples constantes ou de régularités empiriques, mais bien justement sur des lois d'essence ou structures eidétiques absolument nécessaires : ainsi, non seu lement la conscience ne peut pas se représenter une couleur qui ne soit pas étendue, mais je ne peux même pas imaginer quel sens il pourrait y avoir à ce qu'une couleur ne soit pas étendue, une telle idée étant propre ment inconcevable. Pour autant, les a priori matériels n'en sont pas moins matériels, et non pas fonnels, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vérités d'essences déductibles analytiquement de la seule fonne de notre pensée, et plus précisément ici de la seule fonne sémantique des concepts que
LE MOUVEMENT COMME A PRIORI MATÉRIEL
65
nous construisons dans le langage. Que la couleur doive être étendue n'est en aucun cas dérivable analytiquement d'une simple définition conven tionnelle du concept de couleur. En effet, la liaison entre couleur et éten due est synthétique, elle doit être d'abord découverte à même les choses apparaissantes à la conscience sur le pôle transcendant. Contrairement au positivisme logique d'un Schlick3, les vérités d'essence qui régissent les ontologies matérielles doivent être révélées au sein d'un contenu d'expé rience factuel inaugural, au sein duquel par exemple une couleur pour la première fois étant dOIlllée, il est donné du même coup par intuition une liaison synthétique nécessaire et universellement valide entre elle et le support spatial auquel elle doit être associée. Comme le note ainsi Claude Romano dans Au cœur de la raison : la phénoménologie, l'a priori maté riel est « ( . . . ) un a priori fondé dans la nature même des contenus d'expé rience susceptibles de l'exemplifier, par exemple dans la nature même des choses spatiales, des sons ou des couleurs »4. Et Romano de conclure : « [les a priori matériels sont des] structures nécessaires de la phénomé nalité en tant que telle »5. Contrairement à Kant, la phénoménologie de l'expérience doit mettre au jour des essences de la phénoménalité qui ne soient pas seulement fonnelles, c'est-à-dire qui ne soient pas simplement déductibles de la forme subjective de cette expérience (chez Kant l'espace et le temps), mais concernent sa matière sensible également, ce que Kant aurait été conduit à refuser. Cependant, la conception phénoménologique des a priori matériels ne peut pas en rester là, il faut qu'elle radicalise la position kantienne sur un autre aspect capital également : dans la mesure où Husserl conteste à Kant le bien-fondé de sa distinction entre phénomène et chose en soi, entre l'étant tel qu'il apparaît à la conscience humaine et l'étant tel qu'il est en lui-même, alors il faut dire que les a priori matériels ne sont en aucun cas chez Husserl de simples lois relatives au mode d'apparaître des choses à la seule conscience humaine, en vertu des caractéristiques anthropologiques qui nous sont échues (ces caractéristiques fussent-elles en même temps transcendantales, comme chez Kant). Husserl s'oppose résolument à la pente kantienne vers l'anthropologisme ou même le psy chologisme transcendantal. Il faut ainsi dans une veine husserlienne 3 Cf M. Schlick, « Gibt es ein materiales a priori? '>'>, in Wissenscheiftlicher Jahres bericht der Philosophischen Gesellschaft an der Universitiit zu Wlen, 3 1 , 1930 ; repris in Gesammelte Aufsiitze, 1926-1936, Berlin, Müller, 2006. 4 C. Romano, Au cœur de la raison : la phénoménologie, Paris, Gallimard, 2010, p. 53. 5 Ib;d, p. 249.
66
CLAUDE VISHNU SPAAK
envisager ces lois de la phénoménalité comme étant tout aussi bien des structures des choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, puisqu'être et apparaître à la conscience sont rigoureusement identiques, dès lors que la conscience elle-même n'est rien de contingent et de relatif à la consti tution finie des facultés humaines, mais l'ouverture absolue à l'apparaître (une fois ressaisie pleinement grâce à la réduction phénoménologique), selon l'essentielle corrélation entre d'une part la conscience pure inten tiollllelle et d'autre part les étants apparaissants sur le versant transcen dant. De ce point de vue, on peut même dire que les a priori matériels de la phénoménologie, c'est-à-dire l'ensemble des structures d'essence de la phénoménalité, sont fondés sur l'a priori de tous les a priori maté riels, à savoir cette vérité d'essence selon laquelle il existe une corréla tion entre tout apparaître et ses modes subjectifs de donnée (il suffit de renvoyer ici au célèbre paragraphe 48 de la Krisis, intitulé : « Tout étant, quel qu'en soit le sens et quelle qu'en soit la région, est l'index d'un système subjectif de corrélation »)6 Il convient d'insister sur cette conséquence pour le moins surpre nante, afin d'en montrer ensuite le caractère problématique, ce qui justi fiera la transition vers une discussion sur le statut du mouvement en phénoménologie : les a priori matériels sont tout autant et indifférem ment des structures nécessaires et universelles des choses en elles-mêmes que de leur apparaître à la conscience, étant dOllllé qu'être et apparaître à la conscience sont pour Husserl une seule et même chose. Comme le pose Husserl dans le paragraphe 6 de la 3' Recherche logique, dans une perspective très classiquement éléatique, l'être est au fonnat et à la mesure de la pensée, puisque « ce que nous ne pouvons penser ne peut pas exister, et ce qui ne peut pas exister, nous ne pouvons pas le penser » 7. Mais si l'on reprend dès lors notre exemple de tout à l'heure sur les couleurs, cela signifie que la synthèse de la couleur et de l'étendue n'est pas simplement une loi subjective de la représentation dans la conscience des objets colorés (le fait que tout objet coloré doit être perçu comme étant spatial) ; en vertu de la corrélation entre la conscience et l'appa raître, cette synthèse vaut eo ipso pour les choses en elles-mêmes, ce qui signifie qu'il y a objectivement des choses colorées, indépendamment du fait que tel ou tel sujet conscient effectif, humain ou non humain, s'y rapporte ou non. Que la couleur soit étendue n'est pas seulement une 6 Cf E. Husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie trans cendantale, trad. de G. Granel, Paris, Gallimard, 1976, p. 188-189 (cité plus loin Krisis). 7 RL III, op. cil., § 6, p. 2 1 .
LE MOUVEMENT COMME A PRIORI MATÉRIEL
67
caractéristique de la représentation des choses colorées par le regard humain (regard qui implique l'effet sur le psychisme de la structure bio logique-évolutive du corps avec ses caractères psycho-physiologiques propres, ce que la philosophie classique nomme les qualités secondes). Les choses colorées sont étendues en elles-mêmes puisque la couleur fait partie de leur mode de donation. Et comme être et apparaître sont iden tiques, alors les a priori matériels sont accessibles de la même manière quel que soit le destinataire subjectif considéré, qu'il soit humain, extra terrestre, ange ou Dieu. En effet, pour ces quatre types d'entités (hommes, extra-terrestres, anges, Dieu[x]), ce n'est pas en vertu de leur constitution de fait (leur constitution ontique pourrait-on dire) qu'ils ont accès aux structures de l'apparaître, ou a priori matériels. S'ils y ont accès, c'est plutôt parce qu'ils sont tous capables d'assumer le point de vue de la conscience absolue sur l'apparaître, et c'est ce point de vue absolu qui délivre ces structures de la phénoménalité. D'où chez Husserl l'importance extrême de la réduction phénoménologique, comme voie méthodique vers la mise au jour de la région originaire de la conscience pure, distincte de la conscience intramondaine du sujet psychologique et anthropologique incarné que je suis aussi, mais seulement en tant qu'homme doté d'Wle complexion psycho-physiologique.
III. Les a priori matériels, structures absolues ou structures anthro pologiques ? Mais n'est-ce pas Wle thèse pour le moins curieuse ? Comment pouvons-nous être sûrs que la couleur soit vraiment Wl mode d'apparaître des choses en elles-mêmes, et non pas simplement des choses en tant que l'accès à elles est biaisé, limité par l'appareil défonnant de la complexion physiologique de la corporéité humaine ? Il n'est évidemment pas absurde de penser que d'autres ouvertures intentionnelles sur le monde verraient ce qui nous apparaît en couleur (à nous autres hommes), de façon diffé rente. Et pourquoi Wl Dieu n'aurait-il pas accès à ces choses, qui à nous paraissent colorées, mais selon leurs qualités premières intrinsèques, les percevant directement selon leurs longueurs d'onde spécifiques, celles-là même que nous ne pouvons (nous autres hommes) nous représenter qu'idéalement grâce aux constructions théoriques de la science physique, mêlant des fonnalisations mathématiques ? On sait que Husserl était farouchement opposé à ce genre de prise de position philosophique. Par Wle opération de substruction (Substruktion), qui s 'accomplit d'abord
68
CLAUDE VISHNU SPAAK
dans la physique de Galilée, Husserl considère au paragraphe 9h de la Krisis que « le monde mathématique des idéalités ( . . ) est pris pour le seul monde réel, celui qui nous est donné vraiment comme perceptible, le monde de l'expérience réelle ou possible : bref, notre monde-de-vie quotidien »8. Mais ce que Husserl reproche vraiment à ces substructions scientifiques (qui en viellllent à remplacer les qualités secondes effecti vement perçues par des qualités premières des corps non perceptibles et caractérisées par une mathématisation de l'espace et de la matière), c'est en toute rigueur le préjugé objectiviste que charrie la science moderne, qui implique la dissolution de la région conscience (et de son ouverture spirituelle au monde environnant [Umwelt], telle qu'elle s'effectue origi nairement dans la Lebenswelt). L'objectivisme s 'inscrit d'après Husserl dans une démarche scienti fique issue de la modernité, guidée par les deux fameuses idées gali léenne et cartésielllle, selon lesquelles d'une part la nature est écrite en langage mathématique, d'autre part la science de la nature (la physique) doit tendre vers la constitution d'une mathesis universalis, c'est-à-dire une connaissance intégrale des lois, fonnalisables comme des relations mathématiques, qui régissent le monde objectif compris de plus en plus comme une totalité onmi-englobante, englobant y compris les objets spirituels, et donc finalement le psychisme dont le fonctionnement peut s 'expliquer en dernière instance selon les mêmes lois qui régissent l'ensemble de la nature matérielle, assimilable à un continuum physico chimique. Il faut reconnaître face à cela le grand mérite de Husserl d'avoir tout mis en œuvre philosophiquement pour sauvegarder le plan de la conscience, et garantir contre l'objectivisme naturaliste l'irréductibilité du spirituel. Toutefois, ce souci légitime ne le condanmait aucunement, comme il semble l'avoir cru, à poser un primat à la fois génétique et structural des qualités sensibles des objets sur les qualités premières. Il y a là en tout cas, tout au moins, un parti pris fort discutable. À bien y regarder, il en est de même après tout de la fameuse thèse husserlienne de la perception par esquisses : qui nous dit que Dieu ne peut changer quoi que ce soit au fait que la perception d'une chose maté rielle dans l'espace ait toujours lieu par esquisses ? Rappelons le passage célèbre des Ideen 1 : .
C'est de cette façon qu'une imperfection indéfinie tient à l'essence insuppres sible de la corrélation entre chose et perception de chose. ( . . ) Par principe, il subsiste toujours un horizon d'indétennination susceptible d'être déter.
8 E. Husserl, Krisis, op. ci!., p. 57.
LE MOUVEMENT COMME A PRIORI MATÉRIEL
69
miné, aussi loin que nous avancions dans le cours de l'expérience, et aussi importantes que soient déjà les séries continues de perceptions actuelles auxquelles nous avons soumis la même chose. Nul Dieu ne peut y changer quoi que ce soit ; pas plus qu'il ne peut empêcher que 1 + 2 ne fasse 3, ou que toute autre vérité d'essence ne subsiste9.
À moins de comprendre cette impossibilité comme une simple impossibilité grammaticale ( (ibid., p. 392).
HEIDEGGER : PROBLÈME DE LA FACTICITÉ, PROBLÈME DE LA KINlITIL
91
certain brouillage délibéré de la distinction des plans physique et anthro pologique : le concept de K1VllŒlS, analysé par Aristote notamment dans la Physique, devient ainsi, dans le cours de l'été 1 924, GrundbegrifJe der aristotelischen Philosophie, le fil conducteur de l'explicitation de l'être de l'homme et de l'existence humaines, ce qui illustre et confinne par ailleurs son statut de concept clef de l'hennéneutique de la vie facticielle, que nous examinerons un peu plus loin. Le mouvement se transfonne par là en ce qu'il n'était aucunement (ou du moins pas de prime abord) pour Aristote : un concept somme toute anthropologique. Mais entre le plan de la physique et celui de l'existence humaine, il existe bien lUle média tion d'un point de vue aristotélicien : il s'agit de la théorie du vivant ou théorie de l'âme, telle que l'élabore le De anima. En même temps, Hei degger est loin d'ignorer la dimension cosmologique du mouvement, ou le fait que celui-ci est aussi « un mode de l'existence du monde » 6 : il est en effet bien manifeste que la mobilité ne caractérise pas uniquement l'existence humaine, mais embrasse la totalité du monde sublunaire. C'est cette portée extrêmement vaste du mouvement qui conduit ultime ment à y voir lUle détennination ontologique, ou un mode d'être insigne, et elle invite au bout du compte, par un coup théorique qui revient à renverser les schémas aristotéliciens, à penser lUle mobilité de l'être en tant que tel. Le fait de concevoir le mouvement, en étant plus radical qu'Aris tote, comme « un mode de l'être (eine Weise des Seins) »7 en tant que tel, pennet en effet d'avancer en direction de ce que Heidegger appellera, en 1926, d'une fonnule saisissante, la « pandynamique de l'être en général (Pandynamik des Seins überhaupt) »8 Cette expression qui donne à pen ser une mobilité de l'être lui-même, malgré l'imprécision inévitable qu'implique le fait de nommer la kinesis par la dynamis qui n'en est qU'lUl moment, indique déjà la décision philosophique de ne plus recon naître d'exception au caractère dynamique (ou, plutôt, cinétique ou kiné tique) de l'être ou de l'existence. Le mouvement est ainsi radicalement plus et autre chose qu'un état transitoire et accidentel que cOlllmît l'étant, 5 M. Heidegger, Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie, GA 18, éd. par Mark Michalski, Franfurt a. M., Klostermann, 2002 (désormais noté GA 18), p. 273. 6 « [ . . ] eine Weise des Daseins der Welt " (GA 18, p. 303). 7 GA 18, p. 304. Cf GA 18, p. 372 : « Qu'est-ce que le mouvement ? Ce n'est pas lUl étant, mais un mode de l 'être (ein Wie von Sein) '>'>, ou encore : « le mouvement est lUl mode de l 'être (ein Wie des Seins) '>'>. 8 Martin Heidegger, Die Grundbegriffe der antiken Philosophie, GA 22, éd. par Franz-Karl Elust, Frankfurt a. M., Klostermann, 1993, )2004 (désormais noté GA 22), p. 170. .
92
CLAUDIA SERBAN
à côté du repos : il est la détennination ontologique fondamentale de tout ce qui est, et en ce sens l'être lui-même est mouvemene. Loin de se réduire donc à un concept cosmologique, biologique ou anthropologique, le mouvement est en définitive, et dans sa portée ultime, un opérateur ontologique, et c'est ce caractère de détennination ontolo gique fondamentale qui justifie par la suite sa haute pertinence pour défi nir l'être du monde ou l'être de l'homme. La pandynamique de l'être signifie précisément que l'être lui-même est mobilité. Mais pour pouvoir tirer une telle conséquence radicale, pour soutenir une telle universalité et originarité du mouvement, il s'impose d'entreprendre une déconstruc tion de l'ontologie aristotéliciennelO, afin de réussir à penser le mouve ment indépendamment de la téléologie (et de la théologie) de l'acte pur et immobile. La théologie aristotélicienne, telle qu'elle est exposée au livre A de la Métaphysique, découle en effet de la nécessité de poser un premier moteur immobile comme cause ultime du mouvement, et pense donc le divin, l'étant suprême, comme un acte pur dépourvu de la déter mination de la mobilité. (Rappelons d'ailleurs que la pensée ou l'intel lection, qui représente pour Aristote la vie du dieu, est caractérisée, dans le De anima comme dans la Métaphysique, comme ayant une nature proche de l'arrêt ou du repos, donc contraire à la mobilité.) De cette manière, chez Aristote, l'être par excellence est soustrait à toute caracté risation cinétique : une pandynamique (ou pancinétique) de l'être ne sau rait donc trouver sa place à l'intérieur de la physique ou de la métaphysique aristotélicielllles. Certes, la démarche d'Aristote, en Métaphysique A 7, a la spécificité de partir de la mobilité comme donnée première et d'at teindre le divin à partir du mouvement. Mais cela n'empêche que la cause première du mouvement qui est ainsi découverte, le premier moteur, se caractérise de façon constitutive par son immobilité. Qui plus est, le manque de mouvement va ici de pair avec le manque de toute puissance, de toute négativité et donc aussi de toute matière : le premier moteur immobile est acte pur et fonne pure, alors que le mouvement renvoie précisément à l'entrelacement de l'acte et de la puissance. La réhabilitation du caractère originaire et irréductible de la mobilité de l'être s'accompagne en revanche d'une restitution de la dignité onto logique de la puissance en tant qu'irréductible. C'est là un aspect qui
9 GA 18, p. 372 ; GA 22, p. 170, 171, 173. 10 On consultera, à ce sujet, l'étude de Servanne Jollivet, « Das Phanomen der Bewegtheit im Licht der Destruktion der aristotelischen Physik '>'>, Heidegger-Jahrbuch, 3, 2007, p. 130-155.
HEIDEGGER : PROBLÈME DE LA FACTICITÉ, PROBLÈME DE LA KINlITIL
93
intéresse au plus haut degré Heidegger dans son entreprise de destruction de l'ontologie aristotélicienne : « le mouvement [ . . . ] n'anéantit pas la puissance (Moglichkeit), mais au contraire la maintient, lui ménage une place - comme puissance à l 'œuvre (tatige Moglichkeit) » 1 1 L'analyse du mouvement invite en effet à recOllllaÎtre un type d'effectivité ou d'ac tualité propre à la puissance elle-même, indépendamment de l'acte. Et la manière dont Heidegger refonnule et se réapproprie à la même époque la définition aristotélicienne du mouvement (dont la fonne scolaire est : « acte de la puissance en tant que telle » 12) montre elle aussi que le mou vement attire son attention avant tout comme mode de présence de la puissance : « le mouvement est la présence du pouvoir-exister en tant que tel (Bewegung ist die Gegenwart des Daseinkonnens ais solches) »1 3 ; ou encore : la « KiVllcnç est présence d'un pouvant-être (KiVllŒ1Ç ist Gegenwart eines Seinkonnenden) » 14 . Dans cette perspective, la portée ontologique du mouvement découle en premier lieu du fait qu'il donne à voir l'intrication de l'acte et de la puissance qui le constituent. Mais ainsi, la primauté de la kinesis pour l'analyse est à tout moment susceptible d'être renversée, car si le mouvement ne livre pas, chez Aristote, l'une des significations directrices de l'être, l'acte et la puissance le font : ils fournissent en effet, avec l'être par essence ou par accident, l'être comme vérité et fausseté et l'être selon les catégories, l'un des axes de la poly sémie de l'être, ou l'une des significations directrices de l'étant. De cette manière, même chez Aristote, le mouvement semble s'effacer dans une certaine mesure devant ses principes ontologiques que sont l'acte et la puissance, et l'interprétation de Heidegger ne va finalement qu'exacerber cette tendance. Il note en effet dans son cours de 1924 que « l'enquête aristotélicienne sur le mouvement a une signification fondamentale pour l 'ontologie : la détennination fondamentale de l'étant comme EVÉpyElU, [EVTEÀÉXEla] et DVVal.llS » 1 5 C'est pourquoi il n'est pas étonnant de voir que, dans le cours mar bourgeois de l'été 1926, Die GrundbegrifJe der antiken Philosophie, le problème du mouvement sera abordé en suivant le fil de son origine ontologique, et cela en fonction de ses deux principes que sont la DUVUJ.UÇ et l'EVÉpyElu. Au § 62 de ce cours, c'est la signification ontologique du mouvement qui intéresse Heidegger, et avec elle le sens que reçoivent Il 12 l3 14 15
GA 18, p. 378. Aristote, Physique, III, 1 . GA 18, p . 3 1 3 . GA 1 8 , p. 328. GA 18, p. 328.
94
CLAUDIA SERBAN
dans cette perspective l'acte et la puissance. L'EVÉpyElU, en tant qu'effec tivité de ce qui est en œuvre, indique le régime de la présence subsistante ou du Vorhandensein : elle reste donc réglée sur le mode de présence de l'étant intramondain. C'est ce qui fait que l'importante thèse d'une anté riorité de l'acte sur la puissance, posée par Aristote en Métaphysique 0, 9, révèle en dernière instance l'exemplarité qui revient, dans l'ontologie grecque, au monde et à l'étant mondain16. Pour l'ontologie fondamentale qu'élabore Être et temps, en revanche, « plus haut que l'effectivité se tient la possibilité ,,17 (pour reprendre l'affirmation célèbre du § 7), dans la mesure où le mode d'être de l'étant que nous sommes, le Dasein, diffère de part en part de la présence subsistante. Chez Aristote, en revanche, la puissance, en tant que concept onto logique, trouve son champ d'application et d'illustration premier dans la physique (qui est, comme on le sait, infusée de schémas et modèles arti sanaux ou techniques). Le mouvement physique donne en effet à voir la puissance en tant que telle (il en est, nous pourrions dire, la ratio cognos cendi) : c'est ce que suggère Heidegger en traduisant la célèbre définition aristotélicielllle du mouvement en Physique, III, 1 : « Le mouvement est la présence du pouvoir-exister en tant que tel »18. Le mouvement montre donc la puissance à l'œuvre (ce qui revient à dire, inversement, qu'elle en est la ratio essendi). D'où sa portée ontologique capitale, pour autant que c'est dans son horizon seulement que se dégagent ces significations fondamentales de l'être que sont l'acte et la puissance. En même temps, dans le mouvement, l'acte et la puissance n'apparaissent pas à l'état séparé, mais toujours en synergie : c'est ce qui fait que la dynamis dont il est ici question n'est pas possibilité vide ou fonnelle mais, précisément, « possibilité opérante (tatige Moglichkeit) ,,19 Si dans le mouvement se manifeste l'être comme présence20, cette présence n' est donc pas à confondre simplement avec l'actuel, car elle est tout autant celle de la puissance : c'est donc une présence qui contient, en creux, le négatif de l'acte. 1 6 Cette thèse se retrouve jusque dans le cours de 1927 consacré aux Problèmes fondamentaux de laphénoménologie. Voir par exemple M. Heidegger, Die Grundprobleme der Phiinomenologie, GA 24, éd. par Friedrich-Wilhelm von Hemnann, Frankfurt a. M., Klostermann, 1975, 21989, 31997 (désormais noté GA 24), p. 162, où l'ontologie grecque est décrite comme étant « orientée en premier lieu sur le cosmos " . 1 7 Sein und Zei!, op. cit., p. 38. 1 8 GA 18, p. 3 1 3 . 1 9 GA 1 8 , p . 378. 20 Cf GA 18, p. 395 : « L'analyse du mouvement lui-même n'est rien d'autre que la découverte de l'être comme être-présent '>J.
HEIDEGGER : PROBLÈME DE LA FACTICITÉ, PROBLÈME DE LA KINlITIL
95
Cependant, la position de l'antériorité de l'acte sur la puissance allllule ou du moins affaiblit la primauté du mouvement pour l'analyse, pour autant que le premier moteur, thématisé au livre A de la Métaphy sique, se caractérise par son immobilité. Par cet achèvement cosmolo gique de la physique, l'ontologie aristotélicienne se dévoile lUle fois de plus « ontologie du monde »21 : c'est en effet dans le monde supralunaire qu'elle trouve la stabilité, l'immuabilité que les phénomènes commlUlS de la vie (les phénomènes du monde sublunaire) ne laissent pas aperce voir, et c'est aussi sur ces mouvements parfaits et immuables qui tendent à imiter la perfection de l'immobilité qu'elle essaie de régler l'existence humaine. De cette manière, la hiérarchie ontologique entre acte et puis sance, allant jusqu'à lUle assimilation entre pensée et acte, met au jour les implications (ontologiques et anthropologiques) les plus profondes de la conception grecque de l'être : C'est seulement lorsque l'on comprend que le sens du concept grec d'être est celui de présence (Anwesenheit) que cette thèse en apparence para doxale, selon laquelle l'effectivité (Wirklichkeit) peut-être nommée anté rieure (jrüher) à la possibilité (Moglichkeit), devient claire22.
Dans cette optique, la visée propre à la destruction phénoménolo gique d'Aristote est susceptible à son tour de devenir plus claire : poser, comme il est fait dans Sein und Zeit, que « plus haut que l'effectivité se tient la possibilité » (l'orientation anti-aristotélicielllle de cette affinnation ne faisant ici auclUl doute) revient à déconstruire le concept grec d'être comme présence. La prise en considération radicale du temps, qui pour Aristote ne détenait qu'une place subordonnée à l'intérieur de l'étude du mouvement, sera à cet égard d'une portée fondamentale.
II. La mobilité de la vie Cependant, dans les premiers cours fribourgeois de Heidegger que l'on regroupe communément sous la rubrique de l'hennéneutique de la vie facticielle (1919-1923), ce primat du possible et du temps n'a pas encore éclipsé la fécondité descriptive du concept de mouvement. Dans ces cours où la vie, en tant que facticielle, n'est pas radicalement distin guée de l'existence, la mobilité fournit en effet le fil directeur principal 21 C'est là, comme on le sait, l'interprétation que donne Heidegger de toute l'onto logie grecque. Cf GA 22, p. 3 1 3 . 22 GA 22, p. 3 3 1 .
96
CLAUDIA SERBAN
pour la description de la facticité. Pour le montrer, il s'impose, pour ainsi dire, de remonter le courant d'Être et temps en allant encore plus loin que l'enseignement marbourgeois portant sur Aristote, jusqu'au premier cours que Heidegger consacre à l'auteur de la Physique à l'hiver 1921-1922. Dans les analyses proposées par ce cours, le mouvement fonctionne comme l'indication fonnelle de certains caractères fondamentaux de la vie facticielle, dont en premier lieu son inquiétude (Unruhe) : « La mobi lité de la vie facticielle se laisse expliciter au préalable comme inquié tude. Le comment (das Wie) de cette inquiétude en tant que phénomène plénier désigne la facticité »23. Nous avons ici un précieux indice de ce qui explique le caractère directeur de cette équivalence dont il s'agit pour nous de restituer le sens et les implications : « problème de la facticité, problème de la K1Vllcnç »24. En effet, ce qui est contenu en genne dans cette indication, c'est la perspective radicalement nouvelle qu'offre la conceptualité aristotélicienne de penser les structures de la vie facticielle comme des mouvements ou des mobilités25, et non pas comme des carac tères figés. Avant que le projet inchoatif d'Wle ontologie ne s'accomplisse comme pandynamique de l'être, Heidegger a donc d'abord forgé et déve loppé le projet d'une analytique de la vie dont l'objet est la dynamique de la facticité. L'intérêt d'Wle telle approche « cinétique » de la facticité vient aussi de sa forte compatibilité avec les prescriptions méthodiques de l'indication fonnelle, énoncées par Heidegger dans son cours de 19201921, Introduction à la phénoménologie de la religion26 : en tant qu'ou til méthodique d'analyse et d'exposition, l'indication fonnelle est requise là où les détenninations objectives échouent ou s'avèrent inadéquates, et ce précisément parce que les manifestations de la vie facticielle ne sont rien de fixe ou d'arrêté - ce sont au contraire des phénomènes 23 GA 61, p. 93. Comme le note Sophie-Jan Arrien, « l'association de la facticité comme sens d'être de la vie à l'idée du mouvement, de la mobilité en tant que telle, est ce qui manifeste le plus clairement l'irruption d'Aristote dans la pensée de la vie du jeune Heidegger " (L 'inquiétude de la pensée. L 'hennéneutique de la pensée du jeune Heideg ger, Paris, PUF, 2014, p. 337). 24 GA 61, p. 117. 25 Cf GA 61, p. 114 : « Grundstrukturen des Lebens als Bewegungen, Beweglich keiten '>'>. 26 Martin Heidegger, Phiinomenologie des religi6sen Lebens, GA 60, éd. par Mat thias JlUlg, Thomas Regehly et Claudius Strube, Frankfurt a. M., Klostermann, 1995, :2201 1 (désormais noté GA 60), §§ 12-13. Voir à ce sujet les contributions de L . Villevieille : « Heidegger, de l'indication formelle à l'existence '>'>, Bulletin d'Analyse Phénoméno logique, 9, 2013, n° 5, URL : http://popups.ulg.ac.bel1782-20411index.php?id=615, et S.-J. Arrien, L 'inquiétude de la pensée, op. cit., p. 203-213.
HEIDEGGER : PROBLÈME DE LA FACTICITÉ, PROBLÈME DE LA KINlITIL
97
fluides et intrinsèquement mobiles. C'est pourquoi, même si Heidegger ne parle pas expressément, lorsqu'il introduit le mouvement, d'un dispo sitif d'indication fonnelle de la facticité, nous pouvons deviner que c'est bien de cela qu'il s'agit lorsqu'il affinne qu'« en tant que détenninité principielle de l'objet dont il est question (la vie facticielle) s'ajoute la mobilité » 27. La facticité - ce « caractère d'être », « sens d'être » (voire « être » tout COurt28) de la vie - doit donc être saisie à partir de sa mobilité intrin sèque. Panni les directions multiples et divergentes que peut prendre cette mobilité, Heidegger accorde lUle place particulière au mouvement qui éloigne de l'accomplissement propre de l'existence (ce qui était déjà le rôle de la tentatio augustinienne, qu'analyse le cours de 1921) et qu'il saisit sous le vocable de la ruinance (Ruinanz)29 Celle-ci comporte non seule ment la COllllotation de la chute (ruina), mais se laisse en outre expliciter, de façon tout aussi « cinétique », comme fuite : Flucht var sich selbsëo, fuite devant soi-même qui exprime la tendance de la vie facticielle à cher cher la légèreté et à s'esquiver devant la lourdeur et la difficulté de l'exis tence. Si la ruinance se laisse fonnaliser comme fuite, cela manifeste toute la complexité de sa structure et de la mobilité qu'elle exprime : elle est certes tendance à la légèreté, mais co-originaire par rapport à elle est la possibilité de prendre en charge le poids de l'existence, ce fardeau que je suis pour moi-même, pour reprendre l'image d'Augustin. L'on voit donc ici tout l'intérêt qui existe à lire les phénomènes de la vie facticielle à travers la grille aristotélicienne de la kinesis : cette grille aide en effet à comprendre que la ruinance (proto-figure de la Verfallenheit que mettra en avant Être et temps) est lUl mouvement avec lequel est co-donnée la pos sibilité du mouvement contraire. C'est pourquoi, comme l'écrit Heidegger en 1921-1922, « selon une définition formellement indicative, la ruinance se laisse détenniner comme suit : la mobilité de la vie facticielle, que celle ci "accomplit", c'est-à-dire, "est", en soi-même en tant que soi-même à partir de soi-même et somme toute contre soi-même »31.
27 GA 61, p. 116. 28 GA 61, p. 114 : « Seinscharakter '>'>, « Seinssinn '>'> ou « Sein des Lebens '>'>. 29 Celle-ci nomme, en effet, « le caractère de chute propre à la vie facticielle (GA 61, p. 121). 3 0 GA 61, p. 123. 3 1 GA 61, p. 1 3 1 .
'>'>
98
CLAUDIA SERBAN
La ruinance suppose donc sa contre-possibilité, et cela précisément sous la fonne d'Wl contre-mouvement32 possible. Pour le jeune Heidegger comme pour l'Aristote du livre X de l'Éthique à Nicomaque, cette Gegenmoglichkeit qui fait pendant à la ruinance n'est autre que celle de la philosophie, autrement dit, de la pleine compréhension de soi de la vie facticielle. L'activité philosophique, comprise comme pratique du ques tiOllller et de l'interprétation, exprime une « mobilité contre-minante »33 (voire une lutte contre la ruinance34) pour autant qu'elle assume la pro blématicité de l'existence au lieu de l'éluder. L'interprétation - cette opé ration hennéneutique que Heidegger reconduit à son acception fondamentale d'une explicitation de soi de la vie - revient en effet à une manière de se frayer un « chemin dans la mobilité ( Weg in der Bewegtheit) », et ce à l'aide de concepts fonnellement indicatifs dont le caractère « prohibi tif»35 tient à distance les détenninations objectivantes susceptibles d'alté rer la dynamique propre aux phénomènes étudiés. L'interprétation et l'indication fonnelle sont donc, à l'intérieur de l'hennéneutique de la facticité, les outils d'une méthodologie elle-même dynamique ou ciné tique, à l'image de la vie facticielle qui est son objet. C'est pourquoi, sur le versant méthodique, la mobilité qui caractérise la facticité est aussi à comprendre comme mobilité de la détennination36 ou comme espace de jeu entre l'indétenniné et la détennination37. À l'hiver 1921 -1922, la conceptualité aristotélicienne de la kinesis se trouve ainsi mobilisée pour penser et décrire les phénomènes de la vie facticielle que les cours de Phénoménologie de la vie religieuse de l'an née universitaire précédente avaient mis au compte de l'expérience (proto-)chrétielllle. La mobilité fonctionne pleinement, à ce niveau d'ana lyse, comme lUle indication fonnelle de l'inquiétude de la vie facticielle. Mais la lecture phénoménologique d'Aristote sous le signe de la Bewegtheit pennet en même temps d'accéder à lUle caractérisation de la vie comme « ce qui porte en soi des possibilités en un sens spécifique »,
32 Dans son article « L'inquiétude de la vie facticielle. Le tournant aristotélicien de Heidegger (1921-1922) '>'>, Christian Sommer indique ainsi que « l'une des sources du concept heideggérien de Gegenbewe�ung est la notion de mouvement contraire (enantia kinèsis) dans Phys., V, 5 et 6 '>'> (Les Etudes philosophiques, 1, 2006, p. 1-28, p. 16). ;; GA 61 , p. 160, 178. H C f GA 61 , p. 153. 3 5 GA 61 , p. 141. ; 6 Cf GA 61 , p. 175. H C f GA 18, p. 318 et 320.
HEIDEGGER : PROBLÈME DE LA FACTICITÉ, PROBLÈME DE LA KINlITIL
99
voire qui « est ses possibilités, est elle-même comme possibilité »38 : en cela, elle manifeste déjà le glissement inévitable de la kinesis à la dyna mis (du mouvement à la possibilité) qui se trouvera entériné pendant les cours marbourgeois qui recouvrent la période d'élaboration de Sein und Zeit. Quant à l'effectivité de la vie (correspondant ici à l'energeia aristo télicienne), elle ne nomme finalement que « l'unité de l'extension dans la possibilité et comme possibilité »39, et elle n'est en définitive qu'acte du possible (ou de la puissance) en tant que tel, selon la façon qu'a Hei degger d'accentuer la définition aristotélicienne du mouvement. La solidarité qui relie la problématique ontologique de l'acte et de la puissance et la considération proto-phénoménologique de la vie se trouve donc placée par Heidegger, lorsqu'il lit Aristote et lorsqu'il pro pose ses propres esquisses d'une ontologie qui soit à la fois hennéneu tique de la facticité, tout d'abord sous le signe du mouvemen-r-°. Le mouvement n'apparaît pas seulement comme la clef du problème de la facticité, mais aussi comme la clef du problème de la possibilité et de l'effectivité. Et pourtant, la fécondité de cette clef ne sera pas mise à profit indéfiniment par Heidegger car, comme nous l'avons rappelé au début de notre propos, la mobilité ne sera finalement pas présente de façon manifeste dans le dispositif des existentiaux. De la vie facticielle comme mouvement à l'existence comme possibilité : tel est l'infléchis sement qui sous-tend le passage d'une hennéneutique de la facticité à une analytique du Dasein. Même si, dans une perspective aristotélicienne, 38 GA 61, p. 84. Voir aussi Martin Heidegger, Einführung in diephiinomenologische Forschung, GA 17, éd. par Friedrich-Wilhelm von Hemnann, Frankfurt a. M., Kloster manu, 1994, )2006 (désormais noté GA 17), p. 21 et 30. 3 9 GA 61, p. 84. 40 Comme le note Christian Sommer : « C'est du phénomène de la vie qu'Aristote tire les catégories fondamentales du mouvement que sont dunamis et energeia " (Heideg ger, Aristote, Luther. Les sources aristotéliciennes et néo-testamentaires d 'Être et Temps, Paris, PUF, 2005, p. 74). Une analyse très fine de cette intrication est proposée par Rémi Brague dans son ouvrage Aristote et la question du monde. Essai sur le contexte cosmo logique et anthropologique de j 'ontologie (Paris, Cerf, 2009) : voir le § 13, intitulé « La vie en acte '>'> et, sllliout, le § 39, « La définition de l'âme et ses difficultés '>'>, où l'auteur écrit : « Ce qui est courant, voire rebattu, c'est la structure puissance/acte, et la possibilité de l'appliquer à différents niveaux, de telle façon que ce qui, d'un point de vue, est acte, soit puissance à un autre point de vue - de même ce qui est forme en un sens peut être matière en un autre. Mais ce que le Traité de l'âme introduit de nouveau, c'est l'idée d'lUl passage à l'acte qui ne se fait pas à partir d'lUle puissance, mais d'un acte premier à lUl acte second. Cette théorie, sans doute construite ad hoc, exprime l'impossibilité, pour la vie, de se situer en dehors de l'acte. Ainsi, c'est la fidélité même au phénomène de la vie, c'est l'exigence de le considérer et de l'introduire sans l'esquiver dans la définition de l'âme qui produit, à l'intérieur de celle-ci, l'éclatement des schémas habituels de l'aristo télisme '>'>.
100
CLAUDIA SERBAN
« l'utilisation du concept de DuvaJ.uç dans un sens ontologique trouve son origine dans l'analyse du mouvement »41, cette origine « cinétique » de la thématisation du possible ne sera plus prise en compte lorsque, au § 3 1 de Sein und Zeit, Heidegger soutiendra que « la possibilité conune existential est la détenninité ontologique et positive ultime et la plus originaire »42 du Dasein.
III. Mouvement, repos, contre-mouvement Le caractère décisif de la lecture d'Aristote et de la promotion de la mobilité en concept clef de l'hennéneutique de la facticité se confinue en 1922 à travers deux documents importants : d'une part, le cours fri bourgeois de l'été 1922, qui poursuit l'interprétation phénoménologique d'Aristote au fil conducteur de ses traités d'ontologie et de logique, et d'autre part, le fameux Natorp-Bericht. Si l'on y trouve une poursuite résolue de l'ontologisation de la problématique de la vie facticielle, il s'y fait aussi jour une visée déconstructive plus marquée à l'égard de l'onto logie et de la physique aristotéliciennes. Les deux cibles les plus impor tantes de cette déconstruction sont la doctrine de la sophia, de la sagesse, comme vertu théorétique, et la théologie du premier moteur immobile. Il est d'abord à remarquer que Heidegger s'approprie le concept de sophia en le traduisant par « comprendre authentique (eigentliches Ver stehen) »43, pour faire de la theoria, de l'activité qui trouve sa perfection dans cette vertu particulière qu'est la sagesse, un mouvement insigne de la vie44 : il affinne en effet que dans le comprendre s'épanouit « la mobi lité propre (eigentliche Bewegtheit) de la vie ,,45 Pour Aristote, à travers la sophia, c'est pourtant une aspiration au repos (AuJenthalt) qui s 'exprime, la même qui transparaît dans la doctrine du premier moteur immobile, défini d'ailleurs lui-même comme « pensée de la pensée »46. Ce qui suscite le désaccord de Heidegger à cet égard, ce n'est pas tant cette référence au repos que son absolutisation trop 4 1 GA 22, p. 317. 42 Sein und Zeit, op. cit., p. 143-144. 43 Martin Heidegger, Phiinomenologische Interpretationen ausgewiihlter Abhandlun gen des Aristoteles zu Ontologie und Logik, GA 62, éd. par Günther Neumann, Frankfurt a. Main, Klostermann, 2005 (désormais noté GA 62), p. 30, 87, etc. 44 GA 62, p. 87. Toute la problématique grecque des vertus est d'ailleurs ressaisie par Heidegger dans l'horizon des modalités (mobilités) de la vie. Cf GA 62, p. 71. 45 GA 62, p. 97. 46 Aristote, Métaphysique, A, 9.
HEIDEGGER : PROBLÈME DE LA FACTICITÉ, PROBLÈME DE LA KINlITIL
101
rapide, dépourvue de toute vraie justification phénoménologique. En évo quant, environ Wle année plus tard, Pascal et plus précisément une des Pensées où il est question du mouvement et du repos ( (L'inquiétude de la pensée, op. cit., p. 340). " Cf GA 62, p. 100. 50 C'est à la discussion de cette importante question qu'est consacré l'ouvrage déjà cité de Rémi Brague, Aristote et la question du monde. On se reportera également à Ch. Sommer, Heidegger, Aristote, Luther : « Le recours à un premier moteur immobile pour penser la mutabilité de la vie humaine est l'indice d'un désir de présence constante, d'un désir d'être toujours, bref d'un certain appétit d'éternité ,>,> (op. cit., p. 114-115). 5 1 Aristote, De anima, l, 3, 407a32-33.
102
CLAUDIA SERBAN
ou d'un refuge dans l'éternité : elle passera ainsi par une assomption radicale de l' historicité en tant qu'inséparable de la facticité. L'historicité ne peut en effet être détachée de la mobilité intrinsèque de la vie, ce qui veut dire aussi que l'ontologisation de l'hennéneutique de la facticité débouchera nécessairement sur une ontologie de l'historique52.
IV. Mouvement, historicité, temporalité
Ce parti-pris en faveur de l'historicité et de l'assomption de sa propre situation historique est radicalement opposé à la position aristoté licienne dans la mesure où l'auteur de la Physique illustre au contraire la recherche de l'expérience rassurante d'une présence sans faille et sans fin. Seule une telle présence fournira, en effet, l'antidote de la peur devant le néant attribuée à certains physiciens en Métaphysique 0, 853, au moment même où Aristote établit l'antériorité de l'acte sur la puissance. Or, une telle expérience est introuvable dans le monde sublunaire : elle est tout aussi absente du monde historique que du monde de la nature et doit être cherchée ailleurs, dans le mouvement des astres qui seul offre un spectacle consolateur d'éternité. Selon la glose que donne Heidegger de ce passage important du livre e dans son cours de 1924 : Ce qui renfenne la possibilité de ne pas avoir été une fois renfenne aussi la possibilité de périr à un moment donné. Le présent d'un tel étant n'est pas imaginé, mais vu sur le mouvement du ciel, vu en effet, non pas sim plement dans la pure contemplation, mais éprouvé dans la peur qu'à la fin même cet existant éternel (Immer-Daseiende) ne reste plus en place, mais disparaisse de la présence (aus dem Da verschwindet)54.
Aristote tente en effet de prouver l'inconsistance de toute peur devant la perspective d'une fin du monde en montrant que l'éternité du mouvement céleste met l'univers à l'abri de l'annihilation et le préserve ce faisant de l'intrusion corrosive de la puissance55. Au niveau de la vie humaine, une mise à l'abri parfaitement analogue est offerte, nous avons 52 D'où l'équivalence « Faktizitiit (das Historische) " (GA 62, p. 113). Cf GA 62, p. 170 et plus généralement tout le § 21, qui contient un excursus dédié au rapport entre ontologie et histoire. 53 Aristote, Métaphysique, 0, 8, 1050b. " GA 18, 296-297. 55 Cf R. Brague, Aristote et la question du monde, op. cit., p. 428 : « L'univers est envisagé comme ce dont l'existence et la perpétuité supposent lUle activité pleine, et sans mélange de possibilité, ce qui s'appellera plus tard acte pur '>J.
HEIDEGGER : PROBLÈME DE LA FACTICITÉ, PROBLÈME DE LA KINlITIL
103
déjà pu le suggérer, par la contemplation (theoria) qui, selon la célèbre affinnation d'Éthique à Nicomaque X, 7, pennet à l'homme de « s'im mortaliser dans la mesure du possible »56 . La « plus haute possibilité d'être (hOchste Seinsmoglichkeit) ,,57 qu'est la theoria est donc à son tour l'expression d'un désir de demeurer, de s'attarder dans la présence (et donc dans le présent), de tenir à distance la négativité de la puissance, la possibilité du non-être, bref, la mort. La philosophie d'Aristote serait elle alors, dans la perspective de ses choix ultimes, « fuite devant le Dasein »58 , c'est-à-dire fuite devant la finitude de l'existence mortelle ? Cette question qui ne peut manquer de surgir ici fait apparaître un enjeu existentiel (voire éthique) massif de la thèse aristotélicienne de l'éternité du monde, qui présente l'univers comme un « vivant parfait éternel »59 . La contemplation du ciel pennet aux mortels d'oublier leur mortalité en leur offrant l'image pérenne d'une présence stable et inaltérable, et l'intellect, partie impérissable de l'être humain, est lui-même semblable à un principe céleste. La dynamis et sa négativité constitutive sont en revanche chez elles dans le monde, sublwlaire, de la vie et de la praxis hwnaine, dont elles fournissent même l'élément propre. Si la contemplation du ciel fournit l'image d'Wl acte pur de toute-puissance sous la fonne du mouvement parfait et éternel des astres, le monde sublunaire donne donc à voir, quant à lui, la puissance à l'œuvre, et cela à même les mouvements spécifiques qui s'y déploient. La destruction phénoménologique d'Aristote consiste ainsi à reparcourir en sens inverse le chemin qui va de la physique à la théologiéO, en récusant d'un même geste la thèse aristotélicienne de l'antériorité de l'acte sur la puissance, la théologie de l'acte pur et le primat de la contemplation comme manière de s'immortaliser. C'est cette destitution à visée multiple qui s'exprime dans ce que Heidegger appel lera, en 1926, la « pandynamique de l'être en général »61 , et le premier
56 Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 7, 1177b. 57 GA 18, p. 246. 58 Christian Sommer situe en ce point précis le noyau de la « destruction " de l' on tologie aristotélicienne : « le primat accordé à la vie théorétique est fondé sur la crainte d'une disparition pure et simple de l'être-là ,>,> (Heidegger, Aristote, Luther, op. cit., p. 1 1 5). Ou encore : « Désirer "s'immortaliser", c'estfuir la mutabilité de l'être comme puissance de la mort '>'> (ibid., p. 286). 59 Aristote, Métaphysique, A, 7. 60 « Le parcours de la Physique, écrit Rémi Brague, est ainsi autant lUle avancée vers le mouvement de l'univers qu'une démarche à reculons, qui fuit le plus loin possible de la vie humaine comme telle ,>,> (Aristote et la question du monde, op. cil., p. 413) . 6 1 GA 22, p. 170.
104
CLAUDIA SERBAN
biais pour y arriver est représenté, comme nous l'avons déjà indiqué, par l'exploration de la dynamique de la facticité. Or, déjà à ce niveau d'analyse, le problème de la kinesis commence à se muer en problème de l'histoire et en définitive en problème du temps. Pour avancer dans la direction d'une pandynamique (ou « panci nétique ») de l'être en général, il faut en effet mettre hors circuit toute référence à un supposé plan d'éternité, toute présupposition d'un étant suprême soustrait au mouvement, à la négativité, à la puissance et au temps. Il faut dès lors partir, non pas du mouvement mais du temps lui même, et plus précisément (pour ne pas risquer de réitérer par d'autres biais la reconduction aristotélicienne du temps au mouvement), partir de l'histoire, de l'historique en tant que caractère irréductible de la facticité. C'est à cet endroit précis que s'amorce une reconduction des traits les plus importants de la facticité à la temporalité, comme ce sera le cas pour la mobilité (Bewegtheit)62 elle-même. Le passage de la vie facticielle à l'existence (qui est certes aussi un approfondissement, puisque l'existence est donnée à même la facticité à titre de possibilité insigne) est rigoureu sement symétrique par rapport à cet infléchissement de la mobilité en direction du temps. Nous avons vu que Heidegger se livre dans les allllées vingt à la « destruction » de la métaphysique aristotélicienne de l'acte pur, sous le signe d'une « pandynamique de l'être ». Mais avant de renvoyer à une conception ontologique de l'être comme mobilité ou à la mise à l'hon neur de la DUVUJ.UÇ sous les espèces du possible existential dans Sein und Zeit, cette expression fait d'abord signe vers la radicale récupération de la K1Vllcnç dans l'hennéneutique de la vie facticielle, sous la fonne de ce que l'on pourrait symétriquement appeler une pandynamique de la facti cité. L'infléchissement opéré par l'analytique existentiale peut alors être ressaisi sous le signe d'une double reconduction de la Klvi1mç, d'une part au possible ou à la DUVUJ.llÇ, et d'autre part au temps, et donc comme un renversement de l'ordre de fondation établi par Aristote entre le mouve62 Reconduction symétriquement inverse par rapport à celle opérée par Aristote dans la Physique : ce n'est pas le temps qui est à définir en fonction du mouvement, mais c'est le mouvement qui est « un mode de la temporalité " (GA 63, p. 65). Comme le remarque àjuste titre Christian Sonnner : « Pour Heidegger, le temps n'est pas le nombre du mou vement selon l'antérieur et le postérieur, mais il est l'être du mouvement lui-même comme Bewegtheit de l'être-là humain '>'> (Heidegger, Aristote, Luther, op. cit., p. 299). Un renver sement de cette subordination du temps à l'égard du mouvement a été opéré par Patoèka. Voir à ce sujet l'ouvrage de D. Duicu : Phénoménologie du mouvement. Patocka et l 'héri tage de la physique aristotélicienne, Paris, Hermann, 2014.
HEIDEGGER : PROBLÈME DE LA FACTICITÉ, PROBLÈME DE LA KINlITIL
105
ment et ses composantes. Or, si le mouvement n'est présent dans Être et temps qu'à titre d'« énigme »63, et si la dynamique de la facticité s'es tompe, dans l'analytique du Dasein, derrière la projection de possibilités que désigne l'existence et dont le sens intime est la temporalisation, il faut noter que le projet d'lUle « pandynamique de l'être » sera implicite ment récupéré au début des années trente, lorsque Heidegger consacre un cours entier aux trois premiers chapitres du livre e de la Métaphysique. Le cours de 1931 pose, comme son titre l'indique, la question de l'effec tivité de la force, Wirklichkeit der Kraft, et son enjeu sera à son tour une radicalisation d'Aristote, sous la fonne d'un prolongement et d'un déve loppement de sa critique de l'éléatisme des Mégariques, consistant à identifier la puissance au non-être et l'effectivité à la seule signification recevable de l' être. Et cependant, comme cette brève description de l'objet de ce cours l'indique, au début des années trente, Heidegger ne fait qu'entériner ce qu'Être et temps suggérait déjà, contre Aristote, à savoir que plus haut que la KivTJ"lS se tient la DVVal.llS qui en est le prin cipe. C'est ce que les Beitrage zur Philosophie diront à leur façon en affinnant que « dans l'être seul réside, comme sa fissure la plus profonde, le possible, de sorte que c'est sous la figure du possible que l'être doit d'abord être pensé dans la pensée de l'autre commencement »64.
63 Sein und Zeit, op. cit., p. 375 et 389. 64 Martin Heidegger, Beitrage zur Philosophie (Vom Ereignis), GA 65, éd. par Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Frankfurt a. M., Klostennann, 1989, )1994, 32003, p. 475.
LE RÔ LE OPÉRATOIRE DU CONCEPT DE MOUVEMENT DANS LA PHÉNOMÉNOLOGIE DE JAN PATOCKA
Dragos DUICU
Dans ce qui suit nous nous proposons de présenter la conception que Patocka se fait du mouvementl, ainsi que le rôle qu'il assigne à ce concept tant dans sa tentative de penser l'ajointement de la vie subjective au monde que dans l'élaboration de sa phénoménologie asubjective. Nous progresserons donc d'une présentation de son interprétation de la définition aristotélicienne du mouvement à un passage en revue synthé tique de la manière dont Patocka thématise le mouvement comme moyen tenue dans l'ajointement du sujet et du monde, pour examiner enfin le sens du projet asubjectif et la manière dont celui-ci est requis, à son tour, par une pensée du mouvement. Mais qu'est-ce que le mouvement ? Comment trouver une définition du mouvement qui conviendrait à toutes les variantes et espèces qui peuvent y être distinguées, qui donc serait susceptible de rassembler pour notre pensée toute la diversité du monde : déplacement, mais aussi per sistance ; altération d'une chose et processus qu'elle subit, mais aussi génération et dépérissement ? À propos de la définition du mouvement par Aristote (l'acte de la puissance en tant que puissance) la modernité a pu demander, par exemple dans la Logique de Port-Royal, « à qui servit elle jamais pour expliquer aucune des propriétés du mouvement ? »2 Néanmoins, à partir de la fin des années cinquante et jusqu'à l'élabora tion de ses positions phénoménologiques et ontologiques les plus propres, Patocka se penche constamment sur cette définition et s'y réfère comme à un guide infaillible.
1 Cet article reprend, à la fois en les synthétisant et en les développant sur certains points, quelques uns des résultats les plus importants de l'enquête que nous avons menée dans Phénoménologie du mouvement. Patocka et l'héritage de la physique aristotélicienne, Paris, Hermann, 2014. 2 Antoine Arnauld, Pierre Nicole, Logique de Port-Royal, II, XVI, Lille, Giard, 1964, p. 219.
108
DRAGOS DurCU
Le geste le plus propre d'Aristote est présenté par Patocka comme une tentative - digne d'être reprise - de penser « l'être de l'étant fini comme faisant partie d'un mouvement global d'accroissement d'être3 >J. Dans le même esprit, dans une lettre à Robert Campbell datant du 20 mars 1964 citée par Erika Abrams dans 1'« Avertissement » précédant sa tra duction du volume Aristote, ses devanciers, ses successeurs, Patocka décrit ses efforts de présentation et la conception même d'Aristote dans les tenues suivants : L'idée qui sous-tend mes considérations historiques est la suivante. Le deve nir, le mouvement qui est à l'origine de toutes nos expériences, est lui-même impossible sans lUl devenir plus profond et plus élémentaire qui est, non pas mouvement dans l'expérience et dans le monde, mais devenir, mouvement du monde en tant que tel : devenir ontologique. [ . . . ] J'ai essayé de montrer que, chez Aristote lui-même, le mouvement possède encore et toujours cette fonction plus profonde de source de l'être (de la vérité) des choses à côté et au travers de sa fonction d'événement intracosmique, empiriqué.
La définition aristotélicienne du mouvement L'analyse la plus complète que Patocka donne de la définition aris totélicienne du mouvement se trouve dans un passage difficile des notes de travail de 1969 : « Phénoménologie et ontologie du mouvement », passage qui qualifie ladite définition de négative. Patocka commence par rappeler que la pensée de Platon peut être envisagée comme une tentative d'opérer la réduction (au sens fort) du mouvementS à l'être immobile, au principe. Et le texte se poursuit dans un style laconique : « Aristote 1 ) effectue la réduction 2) comprend que la réduction est impossible. » Pour Aristote aussi le mouvement doit être pensé, donc détenniné, mais ne peut pas être réduit aux principes, car ni le schéma tripartite privation-matière-fonne, ni les autres archai, comme le trajet, le temps, la cause ou le telos ne suffisent à le penser. Comme le précise Patocka au même endroit : Le mouvement est bien plutôt quelque chose qui se déroule essentiellement
entre ces damées détennmantes, en dehors d'elles. Les données détenninantes,
3 Jan Patocka, Aristote, ses devanciers, ses successeurs, trad. de E. Abrams, Paris, Vrin, 2011, p. 253. 4 Lettre à Robert Campbell du 20 mars 1964 citée par Erika Abrams dans 1'« Aver tissement " de sa traduction d'Aristote, ses devanciers, ses successeurs, op. cit., p. 12. 5 Cf Jan Patocka, Papiers phénoménologiques, tr. de E. Abrams, Grenoble, Millon, 1990, p. 40 : « Réduction platonicienne du mouvement - réellement réduction ! '>J.
LE RÔLE OPÉRATOIRE DU CONCEPT DE MOUVEMENT
109
les archai, sont certes indispensables, mais elles sont un simple cadre qui, s'il pennet de maîtriser le mouvement, ne suffit jamais pour en saisir
l'essencé.
L'exemple que prend Patocka dans le livre qu'il consacre à Aristote au début des années 1960 est celui d'un arbre, plus précisément d'un églantier. Ainsi, l'arbre est d'abord la graine qui gennine, qui pousse et croît jusqu'à sa fonne adulte (et celle-ci nous montre la graine comme étant sa privation) ; en temps venu, les bourgeons apparaissent, suivis par les feuilles et les fleurs, qui elles aussi changent de couleur et de fonne ; et les fleurs deviennent elles aussi des fruits qui changent à leur tour de qualités en mûrissant et en déposant leurs graines, et ainsi de suite jusqu'au dépérissement final de l'arbre, parallèle à la gennination d'un nouveau. Cette description de la marche de la physis s'inscrit bien dans le cadre du schéma tripartite, matière-fonne-privation, car l'on peut bien mettre en évidence, à chaque étape, une fonne spécifique qui infonne une matière et annule une privation. Mais quand peut-on dire que la fonne finale, pleine, l'eidos complet de l'arbre, le te/os (final, et non pas inter médiaire) de son être a été atteint ? Quand est-ce que l'arbre est complè tement dans son te/os, où est son entéléchie proprement dite ? À quel point peut-on dire qu'il « est pleinement? » ? Ce n'est ni quand il fleurit (car il n'a pas encore des fruits), ni inversement, etc., bref : « il ne pourra jamais être en acte tout entier en même temps8 ». Et Patocka de conclure : « Il lui manquera toujours quelque chose pour être pleinement actualisé. Pour cette raison, il opère son actualisation en passant d'une détennina tion à l'autre, par le mouvement typique du déploiement de sa vie propre »9 . Il sera donc toujours acte inachevé ; l'arbre est, à proprement parler, mouvement. C'est le mouvement qui définit le mieux ce qu'est un étant, car c'est lui qui dépose toutes les détenninations d'un étant. Le meilleur exemple serait ici organique : les muscles d'un corps vivant sont bien déposés par l'effort, par le mouvement, et non seulement par la fonne génétiquement configurée de l'espèce. Cette fonne spécifique est elle-même le résultat d'innombrables sédimentations de gestes qui ont été accomplis dans la clairière du monde, et non pas dans le secret d'une transmission génétique indifférente à ce qui se passe dans le monde envi ronnant de l'organisme qui la porte. Ainsi, l'héritage génomique d'un 6 J. Patocka , Papiers phénoménologiques, op. cit., p. 40. 7 J. Patocka, Aristote, ses devanciers, ses successeurs, op. cit., p. 152. 8 Ibid., p. 153. 9 J. Patocka, Aristote, op. cit., p. 153.
110
DRAGOS DurCU
individu quelconque est la sédimentation des gestes de tous les chaînons (seulement en apparence manquants) de son histoire philogénétique. Le paysage actuel du monde, à son tour, est le résultat de tous les mouve ments physiques qui l'ont dessiné tel quel : un arbre sur une colline est le dépôt d'écorce et de bois des efforts de sa petite partie vivante qui cherchait la lumière, tout comme d'innombrables plantes et animaux avant lui ont sédimenté, en laissant les traces de leurs propres vies et ce qui reste d'eux, le sol nourrissant qui fournit à l'arbre sa chair. De même, la colline elle-même est issue de la plaine comme tenue final des mou vements géologiques qui l'ont déposée, et à leur tour les conditions de possibilité de ces mouvements géologiques (c'est-à-dire des mouvements des grandes masses géologiques) ne sont devenues effectives qu'en étant déposées par des mouvements encore plus grands qu'elles, par des mou vements d'échelle astronomique. Toute détennination qu'on peut trouver dans le monde des étants peut ainsi être reconduite au mouvement qui la sédimente. La détennination positive du mouvement est pourtant impossible, car le mouvement ne peut pas être pensé à l'aide des principes immobiles tels (que) la forme, la matière et la privation, qui s'appliquent à la chose arrêtée en son mouvement. Compris comme immobile, même s'il ne l'est paslO, l'être mobile ne se montre pas dans son être. Mais on ne peut pas faire autrement que de procéder à une telle compréhension, car le logos est essentiellement un arrêt du mouvement. Voici donc la situation où se trouve Aristote avant de dOllller la définition du mouvement, telle que la résume Patocka : « Penser le mouvement au moyen de l'immobile est nécessaire - est impossible ». D'où aussi la solution : « Je ne peux penser qu'au moyen de ce qui ne suffit pas - par la négation de mes tentatives de penser positivement, mais à la fois par la négation des thèses négatives [ . . J. Je dois nier et la position, et la négationll. » Les principes priva tion-matière-fonne sont des descriptions immobiles de l'étant immobile (ou mieux encore, du mobile comme s'il était immobile). Mais tout aussi insuffisante est la négativité de la dynamis, qui nie la positivité des principes. Nous devons donc nier (avec la dynamis) la positivité des prin cipes, c'est-à-dire nier l'acte (car c'est l'être en acte - arrêt du mouve ment, coïncidence, même si passagère, du présent et du parfait - qui nous .
10 Voir le passage de Physique, II, 2, 193b23-194aI2, où Aristote dit des mathé maticiens (et l'on pourrait sans doute inclure Platon dans cette catégorie) qu'ils considèrent l'être physique comme immobile, même s'ils savent très bien qu'il ne l'est pas. Cf P. Aubenque, Le problème de l 'être chez Aristote, Paris, PUF, 1962, 2 1991, p. 421. Il J. Patocka, Papiers phénoménologiques, op. cit., p. 40.
LE RÔLE OPÉRATOIRE DU CONCEPT DE MOUVEMENT
III
montre la chose comme eidos infonnant une matière et niant une sterê sis). Mais nous devons aussi nier (avec l'acte, avec la présence des choses, même si mobiles) la dynamis, la négativité qui fait que ce monde n'est jamais figé. Le mouvement nie l'acte en brisant les contours figés de la présence, en prolongeant la présence au-delà de sa figure actuelle, en fissurant par exemple l'apparence monolithique et immobile de tel ou tel paysage (uue colline verdoyante sur laquelle nous apercevons un arbre solitaire, figé à sa place), le peuplant d'illllOmbrables mutations, le transportant tout sim plement vers d'autres configurations. Mais le mouvement physique nie aussi la puissance, le règne pur du possible en tant que tel, en choisissant parmi la multiplicité indéfinie des configurations possibles d'uu paysage comme celui-là uniquement certaines configurations, et non pas les autres. Pour dire ce que la physis nous montre, l'acte comme pleine posi tivité ne suffit donc pas ; mais tout aussi insuffisante est la négativité profonde et pleine de la dynamis. Autrement dit, uue double négation est requise pour penser le monde tel qu'il se donne, comme monde de mou vement : il n'est pas acte pur, présence figée, mais il n'est pas non plus une somme indétenninée de potentialités. Le monde n'est ni uniquement actuel, ni purement possible, et pour dire ce qu'il est, il est nécessaire de définir un concept (celui de mouvement, justement) qui signifie précisé ment cette double négation : ni présence sans évanescence et reconfigu ration, ni potentialité sans incarnation configurée. Nous pouvons aussi conclure, dans un deuxième moment, que c'est la physis, le mouvement global du monde (le mouvement d'individuation, le mouvement de tous les mouvements), qui nous montre tant la dynamis (l'insuffisance de la positivité) que l'acte (l'insuffisance de la négativité). C'est le mouvement qui, dialectiquement, dépose devant nos yeux et pour notre pensée la dynamis comme négativité nécessaire et l'acte comme positivité nécessaire. Le mouvement qu'est un églantier - pour reprendre l'exemple de Patocka - manifeste (à la fois ontologiquement et pour l'analyse) l'évanescence et l'insuffisance de toute fonne (de tel eidos figé de l'églantier à tel moment précis). C'est toujours le mouvement qu'est l'églantier qui montre l'insuffisance de cette insuffisance, l'insuffisance de la dynamis pour saisir son être, car, bien qu'évanescent dans son mou vement, il est néanmoins là, présent dans son energeia. Autrement dit, l'essence de l'églantier ne réside pas dans son champ infini des possi bilités, dans les innombrables variations biologiques ou physiques qu'il pourra subir, et qui sont susceptibles d'être subsumées sous le concept d'églantier en général. C'est le mouvement qu'est l'églantier qui manifeste
112
DRAGOS DurCU
donc tant la nécessité de son évanescence (sa dynamis) que la nécessité de sa présence (son acte). Ainsi donc, l'acte et la puissance sont déposés par la localisation du mouvement, car l'acte est le là, l'ancrage du mou vement, son actualité. De même, tout ce que le mouvement n'engage pas ici même est inactualité, potentialité du mouvement. L'acte et le possible sont donc, de ce point de vue qui cherche à surprendre l' originarité même du mouvement, les dérivés de celui-ci, montrés en tant que tels seulement à travers lui. Néanmoins, la domination des dérivés logiques du mouvement sur une pensée proprement dite de celui-ci est très ancienne et quasi-généra lisée. Elle est manifeste, par exemple, dans la manière dont encore main tenant, pour parler du mouvement, nous usons plutôt de noms qui se rapportent à des concepts dérivés de celui-ci. Nous disons ainsi « dyna miser », « dynamique », croyant parler du mouvement, sans nous rendre compte que nous désignons seulement une de ses extases, la dynamis, la puissance (le possible, sans doute le plus « logique » des sédiments du mouvement). Mais nous parlons également d'« activité » ou d'« actuali sation », et nous échangeons alors la perspective de la puissance pour celle de l'acte, qui n'est cependant à son tour qu'un sédiment du mouve ment que nous essayons de nommer. (Et encore, en brouillant complète ment les distinctions, nous disons « avoir l'énergie » pour nommer la possibilité d'effectuer un effort). Ces choix qui ne font que cacher une oscillation conceptuelle se retrouvent aussi chez les phénoménologues. Heidegger lui-même, qui dénonce l'oubli de la Physique aristotélicienne, succombe très tôt à une surenchère du possible. Le rationalisme de Hus serl, dans sa période transcendantale, peut être lu de manière similaire : le rabattement des choses sur leurs significations, l'absorption du noème dans la noèse (logos, possible) requiert en retour quelque chose de l'ordre de l'acte pur : l'actualité immanente et transparente de l'ego constituant. Merleau-Ponty aussi s'efforce d'obtenir, dans Le visible et l 'invisible, l'unité du moi et du monde à l'aide d'un concept de l'ordre du possible12, mais la chair (car c'est d'elle qu'il s' agit) reste malgré tout double, comme la puissance active et la puissance passive qui ne renvoient pas encore au mouvement qui les sédimente. Autant dire que l'oubli du sens originaire du mouvement attendait encore une pensée comme celle de
12 M. Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, éd. par C. Lefort, Paris, Gallimard, 1964, p. 304 : « La chair du monde n'est pas se sentir comme ma chair - Elle est sensible et non sentant - Je l'appelle néanmoins chair [ . . . ] pour dire qu'elle est prégnance de possibles, Weltm6glichkeit " .
LE RÔLE OPÉRATOIRE DU CONCEPT DE MOUVEMENT
113
Patocka (du moins dans ses percées les plus radicales) pour pouvoir com mencer à espérer une réparation. Nous avons tenté de restituer le sens de la reprise par Patocka de la définition du mouvement comme acte de la puissance en tant que telle. Ce que cette définition montre, c'est l'originarité du mouvement qui, comme c'est toujours le cas avec ce qui est fondamental, ne peut être thématisé que de manière indirecte, à travers des tenues qui sont ses déri vés13. C'est cette originarité profonde et fondamentale du mouvement que Patocka compte le plus souvent récupérer quand il critique et dépasse ses deux maîtres fribourgeois - nous voulons bien sûr parler de Husserl et de Heidegger. Or la définition aristotélicienne sert non seulement à montrer que rien n'est plus originaire que le devenir, la manifestation, le mouve ment d'individuation des étants, mais aussi à indiquer le sens de ce mou vement. C'est l'acte, même incomplet, comme maximum de présence possible, qui marque à chaque fois l'ancrage et la tendance du mouve ment : ce que le mouvement « veut », son orientation, c'est bien le plus de détennination possible. Retenons ce résultat, nous y reviendrons.
Le moyen terme de l'ajointement Le concept primaire de mouvement, dégagé à partir de la définition aristotélicielllle, est mobilisé par Patocka à chaque moment important de l'élaboration de sa propre pensée. Dans le texte qui est sans doute la plus importante synthèse de ses propres positions philosophiques (la postface tchèque, 33 ans après la publication, au Monde naturel comme problème philosophique), Patocka précise quel est « en définitive le sens » de l'in terprétation de l'existence comme mouvement. En effet, il appelle sou vent de son vrai nom de mouvement la « réalisation de possibilités » qui définit l'essence du Dasein, et renvoie ainsi l'existence, à l'aide de la définition aristotélicielllle, à son vrai sens de mouvement. La signification de ce renvoi serait la suivante : « le mouvement serait ici le moyen tenue entre les deux manières fondamentales dont l'être découvre l'étant ». Ces manières dont l' être découvre l'étant sont ici, en premier lieu, 1 3 J. Patoèka, Papiers phénoménologiques, op. cit., p. 156 : « L'apparaître connne sortie du fondement obscur ; qu'il y a ici un mouvement de l'apparaître, un proto mouvement, c'est ce qu'atteste per analogiam l'étude de l'apparition secondaire [ . . . ]. De même, il doit y avoir quelque chose connne un mouvement par lequel le cœur du monde constitue son contenu contingent et dont l'espace-temps-qualité en totalité est l.Ul sédiment '» .
114
DRAGOS DurCU
l'individuation primaire des étants par le proto-mouvement de la physis, et deuxièmement, l'entrée de ces étants dans la clarté apportée par le Dasein, leur entrée dans l'apparaître-à-moi, leur entrée en phénoménalité. On retrouve ici la référence au mouvement ontogénétique, physique, que nous évoquions en commençant à propos d'Aristote, qui précède, dans l'ordre ontologique, la clarté qu'apporte l'entrée dans la phénoménalité. Pour citer Patocka : Les choses seraient alors ce qu'elles sont, non à partir de l'ouverture secon dairement humaine, mais déjà à partir de l'ouverture primordiale, physique, de l'étant par l'être14.[ . . . ] Notre propre individuation appartiendrait elle aussi à cet univers de l'individuation primordiale englobant tout ce qui se dévoile initialement dans sa simple advenue, dans son déploiement, sa nais sance et sa disparition [ . . . ]15.
Patocka appelle aussi cette individuation primaire délimitation, et la clarté qu'apporte l'apparaître-à-moi, dévoilement. Examinons à présent pourquoi le mouvement est précisément le moyen tenne qui relie ces deux modalités. Patocka se trouve amené en 1973, dans le séminaire Platon et l' Eu rope, à dire plus d'Wle fois que le problème de la manifestation est plus profond et plus originaire que le problème de l'être!6 (voire que la ques tion de l'ontologie est, telle que Heidegger la pose, prématurée!7). La raison de cette critique est à trouver peut-être dans Wle équivocité qui affecte le sens de l'être lui-même. Ainsi, la fin de son cours de 1968-1969 sur la corporéité propose de distinguer Wl double sens de l'être, qui serait d'abord « le tout préalable de l'espace-temps », fonne présupposée et condition de possibilité de toutes les singularités (qui relève donc comme telle de ce que Patocka appelle la manifestation primaire) et irréductible aux choses étantes18. Ensuite, et seulement dans Wl deuxième sens, l'être serait « le tout préalable de la compréhension qui rend possible l' être-à découvert tant de l'Wlivers en totalité que des singularités ». L'être est donc non seulement la condition de possibilité de l'individuation des choses, mais aussi ce qui rend possible « la rencontre et le dévoilement
14 J. Patocka, Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, Dordrecht, Kluwer, 1988, p. 100. I 5 Ibid., p. 100 1 6 On se reportera par exemple J. Patocka, Platon et l'Europe, tr. de E. Abrams, Lagrasse, Verdier, 1983, p. 143 et p. 177. l 7 Ibid., p. 187. 1 8 J. Patocka, Papiers phénoménologiques, op. cit., p. 116.
LE RÔLE OPÉRATOIRE DU CONCEPT DE MOUVEMENT
115
des choses19 », en d'autres tennes, la phénoménalisation. Et cette dernière ne peut être obtenue, pour Patocka, qu'à condition de dépasser le cadre prématuré où se pose la question de l'être chez Heidegger et de concevoir l'être comme manifestation ou physis (au premier sens, de mouvement d'individuation, de mouvement ontogénétique, de délimitation) et comme mouvement de l'existence (au deuxième sens, d'entrée dans la clarté apportée par le Dasein, d'apparaftre-à-moi, de dévoilement). Le mouve ment est ainsi le moyen tenne recherché pour hannoniser et comprendre l'unité de ces deux sens du monde - individuation physique première et phénoménalité, monde de la vie. C'est à partir de sa reprise d'Aristote et de son concept de mouve ment que Patocka pense, dès 1 964, l'articulation entre phénoménalité et individuation physique. Dans un essai qui accompagne la publication de son Aristote, il commence par constater, en prolongeant une intuition aristotélicielllle, que c'est le mouvement qui occasionne la rencontre en acte de toutes les détenninations présentes d'une chose. Et il poursuit : « Comme ce sont les détenninations du substrat que nous élucidons en employant le mot : "est", "il y a", il s'ensuit que c'est le mouvement qui dOlllle aux choses d'être ce qu'elles sont - le mouvement est un facteur ontologique fondamentapo. » C'est donc « le mouvement qui fait que les choses sont », mais ce faisant il leur donne aussi leur unité, un sens com préhensible pour nous. Et le mouvement ontogénétique concilie (tout en les produisant) la détermination des choses (ce que Patocka appellera par la suite leur individuation primaire) et leur teneur de sens pour notre compréhension, et cela parce que le mouvement vise ce qui est « éternel lement présent », la « présence la plus stable », le « maximum de pré sence21 ». La conséquence est directe : « Il s'avère ainsi que le mouvement est essentiellement lié, non seulement à la détennination du substrat, à sa
1 9 Ibid., p. 116. 20 J. Patoèka, Le monde naturel et le mouvement de l 'existence humaine, op. cit., p. 129 : « La conception aristotélicienne du mouvement : signification philosophique et recherches historiques " . 21 Ibid., p. 1 3 1 . Patoèka présente cette conclusion d'Aristote, qui se trouve à la base de sa téléologie (projet qui reste pour Patoèka valide en un certain sens, à condition de le purifier de « l'empirie grossière ,» et des moyens ontologiques parfois « naïfs ,» d'Aristote) (Aristote, op. cit., p. 253) comme étant obtenue « en prolongeant au-delà de ses limites effectives la tendance dont il [le mouvement analysé, sous le regard, phénoménalisé, n. n.] ne peut réellement atteindre le terme ,» (Le monde naturel et le mouvement de l 'existence humaine, op. cit., p. 131). Il s'agit d'un passage phénoménologique à la limite, d'une sorte de déduction transcendantale de l'ontologie à partir de la phénoménologie.
116
DRAGOS DurCU
délimitation et à son individuation, mais encore à son dévoilement »22. Autant dire que la définition commune de l'individuation primaire et de la phénoménalité est le mouvement comme « accroissement de la pré sence >J. Et finalement, Patocka nous fournira, dans un passage remarquable, tous les tenues (et leurs relations réciproques, qui paraissent parfois anti nomiques) à l'aide desquels il développera par la suite le problème de l'articulation du sujet au monde, de la phénoménalité à l'individuation primaire dans le cadre de sa phénoménologie : La délimitation et le dévoilement peuvent être subsumés sous le concept global de manifestation. Le mouvement est le fondement de toute manifes tation. Or la manifestation [ . . . ] n'est pas quelque chose dont l'essence demeurerait en retrait. Au contraire, l'être tout entier entre dans le phéno mène car « être » ne signifie rien d'autre que détenniner un substrat ; la détennination du substrat est mouvement, et le mouvement réside précisé ment [ . . . ] dans la manifestation. Le mouvement est ainsi ce qui fonde l'identité de l'être et de l'apparaître. L'être est être manifeste23.
Ainsi, le mouvement de manifestation subsume et contient tant l'individuation physique (délimitation) que l'entrée dans la phénoména lité (dévoilement). L'identité de l'être et de l'apparaître désigne ce que Patocka appellera par la suite la « co-détermination » du monde par la phénoménalité, car l'ajointement du phénoménal au proto-mouvement d'individuation peut être pensé comme requis, co-déterminé par leur nature commune de mouvement qui vise le maximum de présence. On peut en effet penser cet ajointement au-delà de la perspective husserlielllle de la constitution, et sans pour autant prendre uniquement en considération, comme le second Heidegger, la domination de la phénoménalité par l'être et son retrait. Le retrait de l'être n'est qu'une modalité de l'apparaître (ou, comme le dit Patocka ici, l'être et l'apparaître sont synonymes), dès lors que l'on conçoit les deux comme manifestation, comme mouvement qui cherche la présence maximale. Le sens de l'analyse que Patocka fait de la définition aristotéli cienne du mouvement comme acte de la puissance en tant que telle était de montrer que ce qui est donné n'est ni la présence (l'acte), ni l'éva nescence (la puissance), ni même l' évanescence de la présence (le temps pris dans sa fuite irréparable), mais bien la présence de l'évanes cence. L'acte signifie en effet ici le maximum d'être, à savoir ce vers
22 J. Patocka, Le monde naturel et le mouvement de l 'existence humaine, op. cit., p. 132. 23 Ibid., p. 132.
LE RÔLE OPÉRATOIRE DU CONCEPT DE MOUVEMENT
117
quoi s'achemine la manifestation dans ses deux modes de délimitation et de dévoilement. Cela justifie l'emploi du même concept, celui de mouvement, pour définir les deux. Le mouvement comme cheminement vers le maximum d'être ou de présence ne peut être un moyen tenne entre les deux pôles de la corrélation, la physis et l'existence, qu'à condition que l'existence ne soit pas la seule responsable de l'accrois sement de détennination. Il est vrai qu'une nouvelle lumière est jetée sur une chose quelconque quand elle entre, en tant que phénomène, dans l'apparaître-à-quelqu'un. Elle sort, pour ainsi dire, de son gise ment anonyme, et ses qualités n'interagissent plus uniquement de manière aveugle avec les autres choses qui se trouvent en contact avec elle. Son « agissement » n'est plus uniquement mécanique, a tergo, mais quand elle entre dans le champ phénoménal, son individuation devient aussi signification, et ses qualités matérielles auparavant ano nymes deviennent couleur, dureté, lourdeur, etc. La chose se trouve transfonnée, par exemple, en outil, en objet de contemplation esthé tique, en obstacle, ou tout simplement en un petit moment indifférent de l'horizon d'un champ perceptif. Mais malgré ce dédoublement de l'individuation en apparaître comme phénomène, l'existence ne peut jamais opérer à elle seule cet enrichissement de détenninations qu'elle incarne pour autant. La synthèse perceptive suit touj ours une synthèse déjà opérée dans le monde, dans l'individuation de la chose : ainsi, par exemple, malgré tous mes efforts, je ne peux pas faire varier les cou leurs d'une chose donnée dans une perception actuelle ; et même si on peut imaginer la même chose avec une couleur différente, l'on perd alors, dans l' ais ob, toute la réalité de cette chose-ci. L'imagination ne nous pennet d'ailleurs pas d'inventer une nouvelle couleur, non issue de la perception, tout comme elle ne pennet pas de concevoir une pesanteur ou une dureté d'un autre type que celles qu'on connaît par notre commerce sensible avec les choses individuées. Toutes les varia tions que l'ego peut apporter au champ phénoménal (même celles intro duites par l'imagination) sont bien circonscrites dans les limites de ce que Husserl appelait une ontologie matérielle. La subjectivité, l'exis tence n'est en rien responsable de ces limites qu'elle ne peut pas trans gresser ou faire varier, et force nous est donc de constater que la richesse des détenninations qu'elle accueille et dévoile en tant que phénomènes lui est apportée et est déjà synthétisée par l'individuation primaire de la physis. Voyons à présent pourquoi Patocka refuse d'attribuer un rôle constituant exclusif à l'ego dans ce qu'il appelle le projet d'une phéno ménologie asubjective.
DRAGOS DurCU
118 Le projet asubjectif
En effet, la prise en compte radicale du mouvement régit aussi le projet de phénoménologie asubjective du philosophe tchèque, car le sujet réel (non pas le sujet pronominal vide, mais son remplissement ontique) peut être lui aussi envisagé comme un sédiment qui doit tomber sous le coup d'une épochè généralisée. C'est là le sens - commandé donc par la même pensée du mouvement qui dépose ses dérivés - du projet patockien d'une phénoménologie asubjective. C'est en s'interrogeant sur le comment de l'apparaître que Patocka est conduit à affirmer que l'apparition (le phénomène) ne peut pas être expliquée à partir d'un sujet qui, avant tout, est lui-même quelque chose d'apparaissant. S'il apparaît à son tour, c'est qu'il est soumis lui-même à la légalité de l'apparaître, au lieu d'en être le principe. À partir de ces considérations, il devient possible de fonnuler une distinction tranchée entre deux types de phénoménologie, comme le fait Patocka dans un fragment de 1972 : Quelle est la différence entre la phénoménologie subjective et la phénomé nologie asubjective ? Le plan d'explication de la phénoménologie subjective se situe dans le sujet. L'apparaître (de l'étant) est reconduit au subjectif (le moi, le vécu, la représentation, la pensée) comme ultime base d'éclaircis sement. Dans la phénoménologie asubjective, le sujet dans son apparaître est un « résultat » au même titre que tout le reste. Il doit y avoir des règles a priori tant de ma propre entrée dans l'apparition, que de l'apparaître de ce que je ne suis pas24.
La phénoménologie asubjective revient donc non pas à faire l'écono mie du sujet, mais à changer radicalement son statut : au lieu d'être le principe de l'apparaître, il en est à son tour le « résultat » ou le produit. L'appartenance mondaine du sujet en tant qu'apparaissant pennet en effet de comprendre les motifs qui conduisent Patocka à abandonner la portée constituante de l'ego et à nier la transparence à soi de ce même ego et l'évidence de ses cogitationes dans un regard intérieurs. La donation de l'ego n'est jamais immédiate puisqu'il est toujours co-donné, dans le
24 J. Patoèka, Papiers phénoménologiques, op. cit., p. 127 : « [Corps, possibilités, monde, champ d'apparition] " . 25 J. Patoèka, « Épochè et réduction '>'>, in Qu 'est-ce que la phénoménologie ?, trad. de E. Abrams, Grenoble, Jérôme Millon, 1988, 22002, p. 225 : « La perception des cogi tationes à l'aide d'un "regard intérieur" qui correspondrait au regard extérieur comme un pendant renversé, est un mythe '>'>.
LE RÔLE OPÉRATOIRE DU CONCEPT DE MOUVEMENT
119
monde et à côté des choses26. Co-donné avec les choses, il n'est pas au principe de leur apparition, car il est, dans sa concrétion, lui aussi quelque chose d'apparaissant et obéit, par là, à la même légalité de l'apparaître : « Dans le champ phénoménal, les choses laissent l'égologique se faire jour, de même que l'égologique, de son côté, fait apparaître les choses, mais l'égoïté ne peut être saisie en elle-même de manière "absolue"21. » L 'acti vité subjective n 'est évidente ou visible qu 'à partir de son contexte, à partir des modifications qui surviennent dans le champ phénoménal et qui dévoilent, toujours après coup, les traces de cette activité. Et de même, tout contenu subjectif n 'est saisissable que par ricochet, à la lumière des variations des états de choses dans ce champ. Pour le dire autrement : Le sujet concret lui-même n'apparaît initialement qu'en tant que perspec tive sur les choses, en tant que donation perspective des choses. Le sujet concret en tant que facteur causal n'apparaît pas tout d'abord pour lui même, il n'y a pas de « noèse » qui puisse être élaborée pour soi et saisie réflexivement, il n'y a que la continuité du perspectif, l'en soi des choses malgré l'unilatéralité, la sélection et la distorsion, l'apparaître des choses dans des phénomènes, dans des perspectives28.
L'abandon de la noèse qui est ici en question se fait donc au profit d'un apparaître autonome des choses, apparaître dont le sujet ne fait que suivre les perspectives. Car la structure universelle de l'apparition, loin d'être tracée par la subjectivité, se définit à partir du monde : « l'égoïté n'est sans doute jamais perçue en et dans soi-même, expérimentée immé diatement, de quelque façon que ce soit, mais uniquement comme centre d'organisation d'une structure universelle de l'apparition qui ne peut être ramenée à l'apparaissant comme tel dans sa singularité. Cette structure nous la nommons le monde »29. Étant la totalité mouvante de l'individua tion, le monde est donc ce qui conditionne l'apparition du sujet lui-même et fait de cette apparition une donnée médiate, inscrite dans le champ phénoménal, ce qui exclut la possibilité d'une donation immédiate, absolue 26 J. Patocka, Papiers phénoménologiques, op. cit., p. 129 : « Je ne suis jamais donné, mais seulement co-donné, car je ne suis jamais chose, affaire, objet - tout en étant au monde, je ne suis pas non plus un caractère de la chose, mais plutôt vers les choses " (l. 17 J. Patoèkak, Qu 'est-ce que laphénoménologie?, op. cit., p. 208 : « Le subjec tivisme de la phénoménologie husserlienne et l'exigence d'une phénoménologie asubjec tive '>l. 28 J. Patocka, « Épochè et réduction - manuscrit de travail '>l, in Papiers phénoménologiques, op. cit., p. 173. 29 J. Patocka, « Épochè et réduction '>l , in Qu 'est-ce que la phénoménologie ?, op. cit., p. 225.
120
DRAGOS DurCU
et séparée de l'ego. Le nouveau statut de la subjectivité revient ainsi à affinner que la réduction à la conscience pure doit être sunnontée au profit d'une épochè généralisée qui frappe aussi la subjectivité et qui arrive à mettre au jour la structure de l'apparaître comme tel. Dans ce nouveau cadre, l'intentiOllllalité de la conscience n'est plus son activité de dépassement vers les choses, mais son ouverture aux choses déjà amor cée par la structure de l'apparaître. Les effectuations de la conscience ne font en effet que suivre « les lignes de force du champ phénoména130 », ce qui veut dire que la vraie demeure de l'intentionnalité n'est finalement plus la conscience, mais ce champ lui-même31. Nous pouvons donc dresser un portrait synthétique du projet asubjec tif de Patocka. Sa description de la structure de l'apparaître (qui comprend d'abord le monde comme ce qui apparaît, ensuite la subjectivité comme destinataire de l'apparition et troisièmement le comment de l'apparaître) le conduit directement à une critique de l'évidence à soi de l'ego. L'ego a une certitude propre en tant que destinataire de l'apparaître, mais d'autre part il est lui aussi apparaissant, partie du monde, du grand tout de ce qui appa raît. L 'ego apparaissant, mondain et corporel, est tout sauf dOllllé à soi dans une évidence immédiate, dans un régime d'auto-transparence. Au contraire, ce sont les modifications qui surviennent dans le champ phénoménal qui dévoilent, toujours après coup, les traces de son activité. En ce qui concerne les effectuations intentionnelles, elles se trouvent, suite à ce remaniement complexe, déplacées, délocalisées pour ainsi dire par rap port à la subjectivité : désonnais, elles sont à trouver à même le champ phénoménal, car elles ne sont rien d'autre que les lignes de force de l'apparaître à même l'apparaissant. C'est ainsi qu'il devient manifeste que l'intentionnalité n'a pas de portée constituante à proprement parler, tout comme elle ne renvoie plus à des opérations subjectives. Nous avons annoncé que la conception que Patocka se fait du mou vement avait un rôle significatif dans l'élaboration de son projet 3 0 J. Patocka, « Épochè et réduction - manuscrit de travail '>'>, in Papiers phéno ménologiques, op. ci!., p. 172. 3 1 Comme le souligne Patocka, toujours dans le manuscrit de travail qui prépare l'article « Épochè et réduction ,>,> : « Pour toutes ces raisons, on ne peut pas non plus parler d'une "intentionnalité de la conscience". Ce n'est pas à même le moi et au sein de l'égoïque qu'il y a des renvois, mais à même l'apparaissant. S'il y a des "intentions", elles sont quelque chose qui appartient à ce qui fait vis-à-vis au sujet [ . . . ]. Les prétendues intentions ne sont rien d'autre que les lignes de force de l'apparaître à même l'apparaissant. Elles ne forment ni ne "constituent" rien, mais montrent simplement et renvoient à autre chose que ce qui déjà apparaît ,>,> (J. Patocka, « Épochè et réduction - manuscrit de travail ,>,>, in Papiers phénoménologiques, op. cil., p. 172 ; cf aussi : 197 et 198).
LE RÔLE OPÉRATOIRE DU CONCEPT DE MOUVEMENT
121
asubjectif. Le mouvement, tel qu'il est défini par Aristote, recouvre le sens le plus propre de l'existence humaine, qui est « réalisation de pos sibilités », et c'est cette interprétation du mode d'être du Dasein comme mouvement incarnant parfaitement la définition aristotélicienne, qui est prolongée par Patocka dans sa célèbre doctrine des trois mouvements de l'existence. Le concept de mouvement décrit le mieux la dynamique de l'expérience subjective aussi parce que celle-ci consiste, pour Patocka, dans une orientation active du sujet panni les choses et les impressions à travers lesquelles le monde l 'interpelle. (Nous devons mentionner ici l'extraordinaire texte du début des années 1 960, « L'espace et sa problé matique »32, où Patocka décèle la structure fondamentale de toute expé rience sous la fonne d'une réponse à l'interpellation que la totalité nous adresse). Toute l'architecture de ['appareil perceptif témoigne du fait que celui-ci sert à orienter le sujet et donc à le situer panni les choses (et non pas l'inverse), ce qui signifie que ce sont les interpellations que le monde nous adresse - choses ou impressions de choses - qui localisent, qui assignent une place et un temps au sujet. Nous retrouvons ainsi, en par tant du versant de l'expérience égologique, précisément le schéma que la phénoménologie asubjective entérine : les effectuations égologiques sont portées par le monde, par l'apparaître qui dépose et qui situe le sujet à sa propre place. Quant au monde, au versant « objectif » de la corrélation, nous avons vu que ce sont ses « lignes de force » que suivent les effec tuations subjectives. Le monde opère déjà, sous fonne de choses et dans les choses, une synthèse que nos actes perceptifs ne font que suivre, au lieu de la créer. Autrement dit, le sens le plus propre du monde comme pôle de la structure de l'apparaître est celui d'être le mouvement d'indi viduation qui crée à proprement parler de l'étant. Nous retrouvons ainsi, au cœur même du projet asubjectif, le mouvement comme réalisation de possibilités, à la fois comme sens de l'expérience humaine et comme proto-mouvement d'individuation des étants.
Conclusion Pour conclure, tentons de restituer le sens global de la conception que Patocka se fait du mouvement, et qui peut être résumé comme suit : le mouvement est phénoménologiquement et ontologiquement premier. Le mouvement est une dOllllée phénoménologique primaire, car tout ce que 32 Cf J. Patocka, Qu 'est-ce que la phénoménologie ?, op. cit., p. 13-81.
122
DRAGOS DurCU
nous percevons et effectuons, tout percevoir et toute effectuation subjective peuvent y être reconduits comme à leur définition. Nous ne pouvons perce voir que du mouvement (changement, séparation de la tache sur le fond) et nous ne pouvons percevoir que par du mouvement. Nos effectuations, même les plus abstraites, sont des actualisations de possibles (c'est-à-dire des mouvements). Et aussi, tout ce que nous faisons est en fait changement, métabolé, immixtion dans, altération du monde. Autrement dit, seul le mou vement peut nous apparaître et nous sommes de part en part mouvement. Mais le mouvement est aussi Wle « donnée » ontologique primaire, car tout ce qui ne nous apparaît pas est engagé à son tour dans un change ment universel. Même le morceau de lave à la surface de la Lune change, pour autant qu'il change son lieu, se déplace dans la révolution astrono mique, est altéré par l'individuation d'autres étants et par les forces qui les unifient et séparent ; mais aussi, plus généralement, il est en mouvement au moins en tant qu'accompagnant, avec sa persistance dans son repos relatif et anonyme, les autres changements portés par la physis, qu'ils nous apparaissent ou pas. S'illustre ainsi, quelque peu naïvement, une vérité élémentaire que Patocka n'hésite pas à fonnuler comme suit : « un monde sans centres, exempt de tout centrage, est possible et concevable »33 ; autrement dit un univers sans hommes, sans apparaître secondaire (sans apparaître-à-moi, sans dévoilement, sans phénomènes) est du domaine du pensable. La conséquence directe de cette vérité signifie que ce n'est pas le phénoménal, l'apparaître-à-moi qui introduit le mouvement (comme acheminement vers le maximwn de détennination) dans le monde, mais que c'est le mouvement du monde qui porte toujours déjà la phénomé nalisation. Nous pouvons donc parler d'un mouvement préalable - don née ontologique primaire - ne serait-ce que parce qu'il est évident que le phénoménal (l'apparaître-à-moi) n'est pas responsable de son remplisse ment ontique. Car nous ne décidons pas de l'entrée dans notre champ phénoménal de tel ou tel étant ; ce sont les choses qui changent ou per sistent dans le changement, c'est un autre mouvement que le nôtre qui les fait apparaître à nous, qui les dépose dans ou les retire de notre champ phénoménal. Même sans variation (de notre part) du champ, il y a varia tion, métabolé, kinesis, dans celui-ci. Et c'est évidemment le mouvement qui relie et qui tient ensemble, comme un nom commun, comme un moyen tenne, la délimitation et le dévoilement, l'individuation physique des choses et l'apparaftre-à-moi. 33 Cf J. Patoèka, Le monde naturel et le mouvement de l 'existence naturelle, op. cit., p. 269.
PLASTICITÉ, INTENTIONNALITÉ MOTRICE ET MOUVEMENTS CONCRETS CHEZ MERLEAU-PONTY
Timothy MOONEY Traduction de Mathilde BOIS et Jean-François PERRIER
Le chapitre que Merleau-Ponty consacre à la spatialité et à la motri cité du corps dans la Phénoménologie de la perception constitue le cœur de sa description de l'incarnation. Le corps y est présenté dans son carac tère vivant, tel qu'il apparaît, en action, à soi-même comme aux autres. Il est ce à partir de quoi je vis, ce dont je dispose pour mes projets, aussi bien que ce que je SUiSI. Selon Merleau-Ponty, c'est seulement par une description fidèle de l'expérience de la motricité que son rôle essentiel pour la constitution de la spatialité peut être révélé. Toutefois, l'explica tion qu'il dOlllle du mouvement concret ou pratique par le biais du cas Sclmeider peut sembler le mener à une position trop près du mécanisme, position qui le rendrait incapable de compenser les lacunes qu'il identifie dans le cognitivisme ou l'intellectualisme. De fait, la description du mou vement concret ininterrompu qu'il livre en réponse au cas Sclmeider se limite aux actions habituelles, qui ont toute l'apparence d'être des réponses réglées et automatisées à des situations d'un certain type. Si Merleau-Ponty réduit ultimement le mouvement concret à une réponse fixe, c'est qu'il ne tiendra pas compte de la flexibilité dont fait preuve le mouvement dans le cas de la rencontre d'obstacles et de la plasticité qui y est impliquée2. Ce faisant, il se méprendrait sur ce qu'il 1 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 97, 203 n. 1 . Sur le fait d'avoir lUl corps propre sans pourtant être identique à lui, cf Simon Glendinning, « The Genius of Man '>'>, in Th. Baldwin (ed.), Reading Merleau-Ponty: On Phenomenology ofperception, Londres, Routledge, 2007, p. 104-106. 2 Je distingue ici la flexibilité physique, qui renvoie à la souplesse du corps, et une plasticité plus originaire, qui sera décrite plus loin. Comme nous le verrons, la plasticité peut être absente dans certaines actions, sans qu'il y ait lUle perte de flexibilité physique, bien que celle-ci ne soit jamais exploitée à proprement parler sans qu'intervienne la plas ticité. La flexibilité physique ne peut par elle-même maintenir le caractère fluide ou « mélodique ,>,> du flux d'actions à travers diverses situations.
TIMOTHY MOONEY
124
appelle l' intentionnalité motrice - à savoir, la conscience de capacités non représentationnelles et pré-persOllllelles du corps - et sa description s ' avérerait être Wle distorsion globale du phénomène en jeu. On pourrait soutenir que, par son explication du cas Sclmeider, Merleau-Ponty fait déjà fausse route. Rasmus Jensen a montré qu'il livre une interprétation fautive d'un extrait portant sur l' action habituelle tiré de la documen tation considérable qui existe sur le cas. Cette erreur le conduit, selon Jensen, à assimiler les capacités d'une personne nonnale à celles du malade, ce qui génère un
«
problème de vacuité »
(problem of vacuity).
Du moment que l'intentionnalité motrice de la personne nonnale est identifiée à celle du malade, elle ne peut plus nous renseigner sur ce qu'il y a de distinctif dans les fonnes supérieures du mouvement sur un plan non intellectue13. Une automatisation rigide du concret contrebalancerait ce problème. Je commencerai cet essai en expliquant l' interprétation que Mer leau-Ponty livre du cas Schneider. Il considère trois types de mouve ments : le premier est exécuté de façon habituelle par le malade, les deuxième et troisième lui sont demandés . Je les interpréterai, respective
(concrete and context-familiar), comme mouvement imitant le concret et étranger au contexte (concrete-like and context-strange), et comme mouvement abs
ment, comme mouvement concret et familier au contexte
trait. Je résumerai ensuite les grandes lignes de sa description de l'inten tionnalité motrice et l' obj ection soulevée par Jensen concernant le problème de vacuité, pour poursuivre en montrant que, malgré son inter prétation erronée, Merleau-Ponty évite en dernière analyse le problème de la vacuité et celui de l' automatisme, voire même toute apparence d'y avoir cédé. Je soutiendrai que les difficultés que Schneider éprouve avec la deuxième fonne de mouvement sont aussi importantes que celles qu'il a avec la troisième fonne, dans la mesure où elles se chevauchent. Ces difficultés, qui sont minimisées par Merleau-Ponty, annoncent la pos sibilité d'élargir sa description du mouvement concret ordinaire, possibilité qu'il apercevra sans toutefois l' exploiter. Ce qui est simplement indiqué, et qui aurait pu être accompli dans le cadre d'une réponse globale au cas Schneider est la reconnaissance d'une capacité de transposition - et de là, d'une plasticité - dans le
3 J'aimerais remercier Rasmus Jensen pour son acuité intellectuelle et sa générosité, dont il a fait preuve tant dans ses écrits qu'au cours de nos discussions. Je souhaite éga lement exprimer ma gratitude à mes lecteurs anonymes, pour leurs commentaires et sug gestions fort utiles.
PLASTICITÉ, INTENTIONNALITÉ MOTRICE ET MOUVEMENTS CONCRETS
125
schéma d'habiletés du corps en santé, que Merleau-Ponty admettra par la suite. Cette capacité de transposition pennet non seulement d'écarter le problème de vacuité aux niveaux supérieurs, mais aussi de révéler les différents types d' intentionnalité motrice qui infonnent les mouvements concrets, qu'ils soient créatifs et adaptatifs, ou bien habituels et répétitifs . Dans Wle réponse globale, Merleau-Ponty aurait pu esquisser les trans positions motrices présupposées par certaines réactions courantes à des obstacles imprévus. En mettant en question leur absence possible dans la réaction de Schneider à de tels obstacles, on peut montrer que Merleau Ponty avait déjà en vue Wle capacité nonnale, prévenant Wle apparence de dichotomie entre la prise en charge de problèmes pratiques
(coping)
et la créativité. La position de Merleau-Ponty à cet égard, si on la déploie, serait de dire que la créativité peut être présente dans l' action de nature pratique sans pour autant interrompre le flot de l'activité.
1 La thèse de départ de Merleau-Ponty consiste à dire que la spatialité humaine vécue comprend aussi bien les situations nouvelles que les posi tions existantes. Par nos mouvements, non seulement habitons-nous l'espace, mais nous nous en emparons aussi, de façon à le transfonner. Le sujet qui se projette par imagination avec son schéma d'habiletés et son intentiOllllalité motrice est la condition de tels mouvements, et c ' est cette intentionnalité que révèle, par son absence, l' examen de la maladie attribuée à Johann Schneider que Merleau-Ponty étudie longuement'. La discussion de ce cas s ' inscrit dans la démarche visant à éclaircir, en le mettant en relief, le corps phénoménologique nonnal et son monde. Comme l'a remarqué Russel Keat, les cas pathologiques sont parties pre nantes de la version merleau-pontienne de la réduction phénoménolo gique. Ils pennettent de suspendre ce qui est familier de façon à s'en distancier et, par le fait même, de l' expliquer5. Alors que Heidegger réfère aux situations de défectuosité, où les ustensiles sont hors de la portée de la main
(unreadiness-to-hand), Merleau-Ponty insiste d'une façon (unreadiness-ofhand).
qui lui
est propre sur la main hors de portée
4 Cf M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 1 1 9 sq. 5 Cf R. Keat et al., Understanding Phenomenology, Oxford, Blackwell 1991, p. 181 et M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de laperception, op. cit., p. xviii, 119, 153.
TIMOTHY MOONEY
126
Le cas Schneider fut supervisé et traité par les neuropsychologues Adhemar Gelb et
Kurt
Goldstein, qui ont élaboré d' autres hypothèses,
empiriques et cognitives, pour l' expliquer. En
1 9 1 5,
alors au front pour
son service militaire, Sclmeider fut frappé par des éclats d'obus qui péné trèrent son crâne et son lobe occipital, endommageant par là son cortex visuel primaire. Bien qu'il ait souffert d' agnosie visuelle, il n ' existe aucune preuve suffisante - et d' ailleurs touj ours aucun consensus - pour détenniner la nature exacte et la gravité de son incapacité à reconnaître les objets et les fonnes6. Le cas récent « D.
F.
», examiné par A. D. Milner
et Melvyyn Goodale, est à l' inverse bien plus net. La malade souffre d'une agnosie complète en ce qui a trait aux « fonnes visuelles >J. Cer tains de ses symptômes sont analogues à ceux de Schneider, et elle aussi a conservé l'habilité de saisir et manipuler de façon appropriée des objets de la vie de tous les jours? Bien entendu, Gelb et Goldstein n' avaient pas les moyens teclmologiques dont nous disposons aujourd'hui pour minuter les réactions et détenniner leur justesse, et ils n ' avaient pas d' ailleurs accès à la neuro-imagerie. L'enjeu n'est pas ici d' évaluer les conclu sions de leur étude d'lUl point de vue médical. Il s ' agit plutôt de savoir si Merleau-Ponty est parvenu à atteindre des idées défendables sur lUl plan philosophique au suj et du mouvement nonnal et de ses conditions de possibilité, à l'aide des ressources qui lui étaient disponibles. Selon la documentation, la vue de Schneider est déficiente dans quelques situations, et il est identifié comme aveugle psychologiquement, manifestant à tout le moins lUle agnosie visuelle sélective. Confronté à des objets isolés de leur contexte fonctiOllllel, il ne perçoit que leurs qualités, détachées les lUles des autres, et construit sur cette base des obj ets par voie d'inférence. Si on lui présente lUl stylo-plume, il voit quelque chose qui est noir et bleu, plutôt long, avec lUle tache brillante à son extrémité. Il conclut, suite à lUl examen approfondi, qu'il s ' agit d'lUl crayon ou d'lUl porte-plumes . Dans certains contextes, son image
6 Jensen a fourni un compte rendu détaillé des différents types d'agnosies visuelles qui ont été attribuées à Schneider. Cf R. Jensen, « Motor Intentionality and the Case of Schneider '>'>, Phenomenology and the Cognitive Sciences, 8, 3, 2009, p. 373-374, p. 373 n. 5. C'est en m'inspirant de ces travaux que j'insiste sur l'ample documentation dont Merleau-Ponty a fait usage. 7 A. Milner, D. Goodale et A. Melvyn, The VlSual Brain in Action, Oxford, Oxford University Press, 1995, p. 125-133, 136-144. 8 K. Goldstein, « Über die Abhiingigkeit der Bewegungen von optischen Vorgangen. Bewegungsstorungen bei Seelenblinden '>'>, Monatschrift für Psychiatrie und Neurologie, 1923, p. 143, 155-156, W. Benary, « Studien zur Untersuchung der Intelligenz bei einem Fall von Seelenblindheit '>'>, Psychologische Forschung, 2, 1, 1922, p. 255, W. Hocbheimer,
PLASTICITÉ, INTENTIONNALITÉ MOTRICE ET MOUVEMENTS CONCRETS
127
corporelle ou s a conscience proprioceptive (quant à la posture ou à la position d'un membre) ainsi que son sens du toucher sont fautifs. Malgré tout, il est tout à fait capable d'effectuer des mouvements concrets ou familiers au contexte. Nous entendons par là les mouvements habituels que nous effectuons lorsque nous sommes plongés dans une tâche pra tique et confrontés à des besoins corporels. Le métier de Schneider consiste à fabriquer des portefeuilles et il parvient sans peine à couper et coudre le cuir. Son rendement représente le trois quarts de la production d'un ouvrier nonnal. Il exécute certaines actions parfaitement : il peut, les yeux fennés, sortir les allumettes de sa poche et allumer sa lampe. Il parvient tout aussi facilement à utiliser son mouchoir ou frapper l'en droit où un moustique l'a piqué. Lorsqu'on lui demande d'imiter toutes les actions qu'il effectue sur son lieu de travail, il s ' exécute avec préci sion et sans délai9. Schneider travaille méticuleusement, il ne fait preuve d'aucun manque de sérieux et ne joue pas la comédie. Lorsqu'il sort faire des courses, il les fait de lui-même : sorti pour récupérer quelque chose, il ne voit pas la maison de Goldstein, car elle ne fait pas partie de son intention initialelO. Ses problèmes commencent lorsqu'on lui demande d'exécuter ce que je nomme des actions actions
«
«
imitant le mouvement concret » ou des
étrangères au contexte ». Si on lui demande de mimer l' action
de se peigner les cheveux, il doit mimer l'utilisation d'un peigne et le geste de tenir un miroir comme s'il était dans une chambre ou une salle
« Analyse eines 'Seelenblinden' von der Sprache '>'>, Psychologische Forschung, 16, 1, 1932, p. 49, M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de laperception, op. cit., p. 153. L'expé rience du triangle a été présentée par Benary et celle de la plume par Hochheimer. Leurs études ont été publiées avec la contribution de Gelb et de Goldstein, respectivement. 9 K. Goldstein, « Über die Abhangigkeit . . '>'>, art. cit., p. 158, 173) et M. Merleau Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., 1945, p. 120, 124. Ici, comme ailleurs, Collins traduit l'expression « schéma corporel ,>,> par « body image '>'>. Cela dit, cette tra duction littérale mais fautive n'est pas réellement un contresens. Merleau-Ponty utilise le plus souvent l'expression d'origine pour faire référence à nos orientations corporelles enregistrées de façon proprioceptive, et non au schéma d'habiletés acquises l'ayant informé. Sur le « body image '>'>, consulter D. Tiermersma, « 'Body-Image' and 'Body Schema' in the Existential Phenomenology of Merleau-Ponty ,>,>, Journal of the British Society for Phenomenology, 13, 1982, p. 246-255. Dans cet essai, j'utilise l'expression « schéma corporel ,>,> (body schema) pour référer à notre schéma d'habiletés corporel, et « image corporelle ,>,> (body image) pour référer à notre posture générale et la position de nos membres en tant que nous en faisons une expérience proprioceptive. Cet usage s'éloigne de celui qu'en fait Merleau-Ponty, mais reste,je l'espère, fidèle à ses intentions philosophiques. 10 W. Hochheimer, « Analyse eines 'Seelenblinden' von der Sprache '>'>, art. cit., p. 32, 56 et M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 157. .
TIMOTHY MOONEY
128
de bain. Si on lui demande d'imiter un salut, il doit se tenir debout et prendre une posture militaire, comme s'il était dans une parade. Il ne peut faire ces actions en les abrégeant, et ne fait preuve d'aucillle économie dans l'exécution de ces mouvements. Il doit se projeter en des situations où de tels mouvements seraient concrets et familiers au contexte et inves tir son corps entier dans les gestes mimétiques
(mimes).
Si on l' inter
rompt, il perd alors toute sa dextérité. Lorsqu'il accomplit de tels mouvements en suivant des consignes, il se place, pour prendre les mots de Goldstein,
«
dans la situation affective prise comme un tout, et c ' est
d'elle que le mouvement coule, comme dans la vraie vieIl. » Lorsqu'on demande à Schneider de réaliser des mouvements simples abstraits, il rencontre de graves difficultés. De tels mouvements ne sont ni concrets ni familiers au contexte et ils ne visent pas l' imitation de mouvements pratiques et finalisés. Après un moment de perplexité, il se prépare péniblement à exécuter la requête qu'on lui a fonnulée. Si on lui demande de tracer un carré ou un cercle dans l' air, il doit visuellement localiser son bras . Si ses yeux sont fennés, il doit remuer son corps pour le localiser, et le soulève jusqu'à un certain niveau, comme s'il cherchait une fenêtre dans le noir. Il poursuit en faisant des mouvements rudimen taires pour établir un tracé, vu ou senti, afin de réaliser la tâche, sa pré férence allant à la vue. Finalement, il raffine ces mouvements jusqu'à ce qu'il ait complété la figure. Si, de façon fortuite, il réalise correctement la requête avec le premier de ces mouvements rudimentaires, il s ' arrête. Il comprend ce qu'on lui a demandé ainsi que les conditions de succès, et sait s'il les a satisfaits ou s'il n ' a pas été à la hauteur12.
Il K. Goldstein, « Über die Abhangigkeit. . . '>'>, art. cit., p. 175-176 et M. Merleau Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 121, 122, 157. 12 K. Goldstein, « Über die Abhangigkeit. . '>'>, art. cit., p. 156, 157, 158-159) et M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de laperception, op. cit., p. 120, 122, 127-128. Il faut insister ici sur la distinction entre ce que Gelb et Goldstein ont fait de ce cas et le com portement de Schneider lorsqu'il n'était pas obsetvé à des fins médicales. Georg Golden berg affinen que ses problèmes de mouvements apparents étaient exacerbés par la présence des docteurs, et que ces derniers n'ont pas suffisannnent pris en compte les comportements qui ne corroboraient pas leurs hypothèses. Ainsi, un récit haut en couleur qu'a composé très tôt le malade au sujet de sa visite d'lUl jardin de palmiers à Francfort ne fut pas inclus dans leurs publications. Mais il s'agissait d'un projet de jouissance esthétique fixé à l'avance, et le malade devait se contenter de décrire les vues successives qui lui étaient révélées au cours de sa promenade. Même les rapports subséquents qui sont hostiles à Gelb et Goldstein admettent que Schneider était un peu lent en dehors des moments de test, qu'il ne pouvait faire plus d'une chose à la fois et qu'il raisonnait parfois de façon cir constancielle et inflexible. G. Goldenberg, « Goldstein and Gelb's Case Schn.: A Classic Case in Neuropsychology? '>'>, in C. Code et al. (eds.), Classic Cases in Neuropsychology, vol. 2, Sussex, Psychology Press, 2003, p. 291-293, 295, 297. Pour une brève défense,
PLASTICITÉ, INTENTIONNALITÉ MOTRICE ET MOUVEMENTS CONCRETS
129
Merleau-Ponty soutient que toute hypothèse empirique qui attribue rait une cause simple à un problème de motricité ne saurait rendre compte d'un tel problème. On ne peut discerner si, à un moment détenniné, Schneider est affecté par un aveuglement de nature psychologique ou par une déficience tactile, étant donné que nos différentes fonnes d'attention sont de façon primitive teintées l'une par l' autre. On peut bien essayer de spécifier ce que le dommage porté à un sens a soustrait au mouvement sain ; toutefois, la blessure ayant également changé les autres sens, on ne pourra mesurer son apport propre1 3 . Comme Lawrence Hass l'a fait remarquer, il s ' agit là de critiques visant des explications mécanistes, depuis longtemps abandonnées par la neurophysiologie!4 Les hypothèses de Milner et Goodale visant à expliquer les difficultés de D. F. à identifier et à se débrouiller
(cope)
avec des obj ets en dehors des contextes fami
liers témoignent d'une approche plus contemporaine. Ils soutiennent que les deux voies neuronales de la vision - ventrale et dorsale - sont respec tivement responsables du lités - ainsi que du
«
«
quoi )} des objets - ce qu'ils sont, leurs qua
comment )} - ce qui pennet d'interagir avec eux.
Le courant ventral est endommagé chez D. F. et de nombreux éléments prouvent que les voies fonctiOllllent conjointement dans la vision et les mouvements guidés par la vision. Le choix initial d'une action présup pose une certaine conscience de ce sur quoi il faut agir15.
bien documentée, des découvertes de Gelb et Goldstein, qui montre leur cohérence interne et leur caractère plausible, cf R. Jensen, « Motor intentionality and the case of Schnei der '>'>, art. cit., p. 374 n. 6. 1 3 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 136-138. 14 L. Hass, Merleau-Ponty 's Philosophy, Bloomington, Indiana University Press, 2008, p. 42, 212 n. 26. 15 A. Milner, D. Goodale et A. Melvyn, The Visual Brain inAction, op. cit., p. 132-134, 202-203. Si elle est juste, cette idée fournit la trame neurologique sous-tendant l'affinna tion de Merleau-Ponty selon laquelle lUle vision saine facilite l'appréhension, en pensée, d'ensembles simultanés, c'est-à-dire de multiplicités. Au premier coup d'œil, la vue m'aide à voir les différentes façons par lesquelles je peux m'occuper de quelque chose, effectivement ou par imitation. La vision élargit le champ des pouvoirs moteurs transpo sables et, par extension, l'étendue des mouvements qui peuvent être entrepris sans prépa ration. Merleau-Ponty la met de l'avant comme une condition irremplaçable pour une vision projective de tâches et d'imaginations. Les contenus visuels sont pris en charge par lUle fonction symbolique qui les transcende. Le développement de cette fonction au-delà de son origine dans le corps est suggéré par l'évolution sémantique de termes et d'expres sions comme « lumière naturelle ,>,> (natural light), « intuition ,>,> (insight), « vue d'en semble ,>,> (overview), « voir en un coup d'oeil '>'> (taking at one glanee). La conscience développe des termes pour les formes spécifiques de vision au-delà de leur signification d'origine. Cela dit, leur fonction demeure fondée sur ces contenus visuels d'origine, bien qu'ils ne puissent s'y réduire. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 147, 159.
TIMOTHY MOONEY
130
Cela dit, selon Merleau-Ponty, la principale lacune de l 'empirisme qui lui était contemporain consiste en un confinement aux domaines des causes. Une hypothèse parallèle de Gold, qui relève d'uu point de vue intellectualiste ou cognitif, donne à la conscience un rôle essentiel. Il s ' agit avant tout de trouver une raison pour l' état de Schneider. Suivant cette approche, ses déficiences observables n 'expliquent pas et ne peuvent pas expliquer ses mouvements pathologiques. Bien plutôt, ils constituent les manifestations extérieures d'un dommage porté à son esprit. Le pro blème fondamental réside dans la dégradation de sa capacité à se repré senter correctement Wle situation nouvelle, de se projeter par l'imagination en elle. L'habileté à exécuter des mouvements étrangers au contexte ou abstraits est solidaire de la façon de les envisager et, plus en amont, de la possibilité même de les exécuter1 6. Selon cette hypothèse, le malade ne peut exécuter ces mouvements parce qu'il a perdu l'habilité de se détacher de son environnement pra tique. Schneider, dès lors, n ' est plus un suj et qui a la possibilité d'adop ter, en réponse à une sollicitation, une perspective symbolique ou désintéressée. Il ne comprend pas que les mouvements imitatifs abrégés et étrangers au contexte puissent avoir pour signification des actions concrètes et familières au contexte ; il est incapable d'imaginer des mou vements qui constituent une fin en soi. Il est devenu semblable à une chose fonctiOllllant de façon automatique. Ce qui distingue les mouve ments habituels et pratiques des mouvements abstraits ou imitant le concret renvoie à la différence entre le physiologique et le psychologique, l' existence en-soi et pour-soi. Pour l' intellectualiste, un mouvement concret est identique qu'il soit effectué par Schneider ou un suj et nonnal. Le problème est que Schneider ne peut pas aller au-delà de ce type de mouvement1?
2 La stratégie de Merleau-Ponty consiste à dépasser les hypothèses empiristes et intellectualistes par une description plus globale, qui se tient à mi-chemin entre elles. Elle tire parti de leurs idées sans pouvoir se réduire à l'une d' entre elles, ni à leurs tenues de départ. Il reconstruit de façon plus détaillée l' interprétation intellectualiste.
Selon cette
16 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 140-141. n IbUi., p. 139-142.
PLASTICITÉ, INTENTIONNALITÉ MOTRICE ET MOUVEMENTS CONCRETS
131
interprétation, prise dans sa version d'origine, Schneider serait incapable de symboliser des mouvements concrets par des actions mimétiques qui soient semblables au concret et qui restent malgré tout économiques. Il ne saurait imaginer des mouvements complets que dans des situations familières au contexte, et devrait alors y faire correspondre son corps entier, par imitation. Lorsqu'il tenterait d'imaginer des mouvements abs traits, sa capacité de représentation serait mise en échec, d'où la nécessité de mettre en place des trajets pour les réaliser. Merleau-Ponty répond que le pouvoir de représentation de Sclmeider s ' étend, sans doute de manière imparfaite, mais somme toute de façon plutôt adéquate, aux mouvements abstraits avant qu'il les amorce. Il sait à quoi ressemblera, de façon idéa lisée, un mouvement complet et s'il l'a accompli ou non. Il possède déjà une représentation par imagination du mouvement abstrait dans sa fonne générale, mais cela ne suffit pas pour garantir qu'il l 'exécutera rapide ment et avec :fluidité1s. Merleau-Ponty soutient que Sclmeider, parce qu'il parvient ultime ment à exécuter des mouvements simples abstraits, pennet d'exemplifier comment le sujet de l ' intellectualisme procéderait. Il se représente un mouvement abstrait et construit un trajet pour le réaliser. L'intellectua liste pourrait en venir à admettre que la représentation de Schneider soit adéquate, mais il insistera sur le caractère problématique de l'effort exigé par cette construction. La vision saine et le sens du toucher lui faisant défaut, le malade ne peut obj ectifier immédiatement son corps et ne peut, pour cette raison, l' aligner immédiatement avec la fonnule idéale du mouvement qu'il s'est imaginé. Pour l' intellectualiste, la per sonne nonnale peut faire cela d'un coup, à savoir répliquer, en un ins tant, un mouvement à partir d'une représentation. Selon Merleau-Ponty cependant, une telle position prend pour acquis que les approches nor males et pathologiques sont essentiellement les mêmes, qu'elles se dis tinguent uniquement par leur degré d'objectivation et, ce faisant, par leur rapidité et leur précision. L'intellectualiste oublie que la maladie est comme l'enfance : elle est une configuration d'existence propre et unique. La personne blessée emploie de nouveaux procédés pour compenser les fonctions qui ont été endommagées ou détruites, et ces procédés sont eux-mêmes pathologiques. Il faut aj outer que ce fait fut reconnu par Goldstein19
1 8 Ibid., p. 128. 1 9 Ibid., p. 125-128, 161nl-162, et K. Goldstein, « Über die Abhangigkeit . '>'>, art. eit., p. 178. .
TIMOTHY MOONEY
132
D ' après Merleau-Ponty, pour une perSOlllle nonnale, l'exécution de mouvements simples abstraits n' implique pas un contrôle visuel ou tac tile. Si je suis sur le point d'effectuer une requête inhabituelle, je vais par l' imagination me figurer ce à quoi elle ressemble, mais sans que ce soit suivi par une objectivation corporelle. Je ne cherche pas à trouver où se localisent mon tronc et mes membres. Je
fi
'
examine pas non plus les
étapes de leur parcours pour qu'ils continuent à correspondre à l' image que j e m'en fais. Je me représente l' action exigée, mais sans vérifier, lorsque je l' exécute, s'il y a correspondance entre mon corps et la repré sentation. Pendant tout ce temps, ma posture et la position de mes membres sont enregistrées de façon proprioceptive, dans cette conscience non articulée qu'est mon image corporelle . Je ne cherche pas, même rapidement, les parties de mon corps ; mes mouvements ont un caractère ininterrompu. Le corps se confonne avec fluidité à la plupart des actions, même abstraites, les traversant jusqu'à leur tenne20. Opérons une variation autour de l'un des exemples de Merleau Ponty.
À
l' occasion d'une promenade avec un ami, je rencontre un ani
mal blessé, mais je remarque alors que mon ami a pris du retard sur moi.
n est vétérinaire et je voudrais qu'il le soigne rapidement. Cette intention est exprimée immédiatement par le signe que je lui adresse de s ' appro cher. S'il ne répond pas, j e ferai signe plus rapidement et vivement, exprimant avec une plus grande force mon impatience. Mon bras qui fait signe est dans mon champ de vision, mais comme le véhicule de mon intention, et non comme un objet pour moi. Je suis motivé par ce qui se trouve devant moi, par sa distance et par son incapacité à se dépêcher. Mon immersion dans l' action est découverte par une situation mondaine donnée et s ' y tient. Cela dit, une fois seul, j e peux facilement faire le mouvement. J' exprime alors une situation imaginée ou souvenue. Je peux même porter mon attention sur mon bras qui fait signe, et, pour m' amu ser, l' objectifier comme une fonne qui oscille. Ce faisant, j'effectue des mouvements de manière abstraite, creusant au sein de l 'espace concret un espace humain, qui est de prime abord mis à découvert de l' inté neur. Merleau-Ponty insiste sur le fait qu'un pouvoir de projection est à l' œuvre dans ces gestes. Le sujet ordinaire conserve devant lui un espace libre et possède le monde de façon créative. En tant que personne nor male, je suis capable de faire rupture avec mes engagements présents, en cours, dans un monde dOllllé . Pour moi, l' espace n'est pas figé en des
" IbUi., p. 125-126, 128.
PLASTICITÉ, INTENTIONNALITÉ MOTRICE ET MOUVEMENTS CONCRETS
133
points ou des orientations habituelles. L'espace présente un degré de plas ticité articulé par les actions que j ' imagine, et qui est encore autrement articulé quand ces actions imaginées sont des possibilités de mouvement actuelles. Il en est ainsi parce que j ' ai exactement ce corps dont je vis comme un centre d' actions potentielles. Par lui, ce qui n'est pas encore actuel peut déjà être virtuel. Dans la spatialité corporelle de la situation, des résultats, qui transcendent les positions et les trajets existants, sont projetés, ce qui me pennet d' anticiper ce qui est possible21 .
À
c e point charnière, Merleau-Ponty développe la notion husser
lienne du
«
Je peux » pour en tirer la thèse de
1'«
intentionnalité
motrice »22. J'anticipe faire certaines choses dans l'immédiat et, pour être saisies de cette façon, elles doivent avoir une signification motrice pour mon corps, à l' instar de certaines consignes ou requêtes. Là où les pos sibilités ne sont pas vécues, je dois les construire pour les vivre, comme Schneider lorsqu'il saisit de nouvelles consignes et requêtes qui sont dépourvues de signification motrice pour lui. Pour être accomplie aisé ment, une action doit être projetée dans le corps à un niveau de compré hension qui lui est propre. L'intentiOllllalité motrice est la conscience de la capabilité
(capability) du corps, et il en découle un changement immé
diat dans l 'orientation de la posture. Le corps a déjà anticipé un résultat, la réalisation directe d'un objectif, par une action-solution
tion),
(action solu
ou par un traj et pour la réalisation de l'obj ectif, trajet qu'il a déjà
préfiguré de façon anonyme ou pré-personnelle23. Même si le trajet qu'il
n
IbUi., p. 127, 128-130. 22 Pour l'explication élargie, chez Husserl, du sens du « Je peux me mouvoir " en tant que possibilité pratique immédiate et en tant que distincte de la simple conscience du fait que je suis conscience que je me meus, consulter E. Husserl, Ideen II, op. cit., p. 258263. Il observe que je peux seulement me décider pour et entre des choses que je com prends comme étant dans la portée de mon pouvoir. 23 Ce que je nomme un trajet projeté pour la réalisation d'une action, ou une « action-solution '>'>, ne renvoie pas initialement au chemin qui doit être emprunté dans l'espace « objectif '>'>, mais plutôt à la préfiguration du déploiement de la posture, des membres et de leurs extrémités en vue d'un résultat. Cette préfiguration trace le chemin spatial. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de laperception, op. cit., p. 1 6 1 -162, 169. Dans l'action pratique, comme je le soutiendrai plus loin, la projection motrice peut pré figurer non seulement de nouveaux trajets corporels et les voies qui leur sont corrélatives dans l'espace, mais aussi de nouvelles affordances de choses mondaines. Elle n'est pas confinée à la reprise des affordances passées mises à découvert par des objets familiers au contexte. L'expression même de « trajet préfigurant ,>,> (prefiguring routes) est bien entendu imagée, et inévitablement inadéquate. Comme le remarque Merleau-Ponty, « Il n'est pas facile de mettre à nu l'intentionnalité motrice pure : elle se cache denière le monde objec tif qu'elle contribue à constituer ,>,> M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 161nl.
TIMOTHY MOONEY
134
projette est inséparable d'une représentation, il n'en constitue pas la copie. Aussi longtemps que ce qui est envisagé est une possibilité vécue, il est accompagné du même coup par sa préfiguration motrice. Lorsque le corps se confonne au mouvement actuel, il ne suit pas une fonnule picturale :
Ce qui lui manque n'est ni la motricité, ni la pensée, et nous sommes invi tés à reconnaître entre le mouvement comme processus en troisième per sonne et la pensée comme représentation du mouvement une anticipation ou une saisie du résultat assurée par le corps lui-même comme puissance motrice, un « projet moteur » (Bewegungsentwurf) une « intentionnalité motrice » sans lesquels la consigne demeure lettre morte. Tantôt le malade pense la [annule idéale du mouvement, tantôt il lance son corps dans des essais aveugles. Au contraire, chez le nonnal tout mouvement est indisso lublement mouvement et conscience de mouvement. Ce qu'on peut expri mer en disant que chez le nonnal tout mouvement a un fond, et que le mouvement et son fond sont « des moments d'une totalité unique ». Le fond du mouvement n'est pas une représentation associée ou liée extérieu rement au mouvement lui-même, il est immanent au mouvement, il l'anime et le porte à chaque moment, l'initiation cinétique est pour le sujet une manière originale de se référer à un objet au même titre que la perception24. Ce que nous appelons la
«
vie perceptive » est logé dans un arc
intentionneL Le sujet incarné peut s ' arquer, vers l' avant, dans de nou veaux projets et retravailler les précédents depuis son existence historique d'ensemble seulement s'il possède des pouvoirs moteurs et l'attention motrice concomitante25. L'intentionnalité motrice excède le physique, mais reste néanmoins irréductible à celle intellectuelle, dans la mesure où elle est opérante à la fois dans les mouvements habituels et les mou vements nouveaux, en tant qu'anticipation non représentationnelle que se fait le corps d'un résultat, anticipation qui est réalisée par son comporte ment même. Où que l'on trouve des décisions de se mouvoir immédia tement, ou des délibérations relatives au mouvoir, celles-ci sont déjà prétracées en tenues moteurs comme des options possibles. Et une fois le mouvement amorcé, l'anticipation corporelle de tel ou tel résultat per siste tout au long de son accomplissement, soutenant le mouvement dans toutes ses phases26.
24 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 128. 25 Ibid., p. 158. 26 Ibid., p. 163-164. Il Y a des expériences vécues où l'intentionnalité motrice n'est pas du tout présente, comme dans les mouvements réflexes en dehors des situations d'exa men et les états de repos complet dans lesquels on ne pense pas à se mouvoir. Dans la plupart des autres situations, elle n'est pas liée à des décisions ou à toute autre intention consciente, finalisée. Il n'y a pas beaucoup de sens à parler de décision pour décrire le
PLASTICITÉ, INTENTIONNALITÉ MOTRICE ET MOUVEMENTS CONCRETS
135
Certaines situations de décision d'une personne nonnale impliquent un écart entre la décision de se mouvoir et son exécution, par exemple lorsqu'une requête à laquelle j ' ai consenti à l'avance n'a pas encore été détenninée de manière spécifique. Si j ' ai une douleur à l' épaule et que ma
docteure, en qui j ' ai confiance, me demande de mettre mon bras en
mouvement, je m'attends à pouvoir satisfaire à la requête avant que la fonnulation en soit tenninée. En l' entendant d' abord, il se peut que je me demande ce qu'elle veut précisément que j 'exécute, mais je suis prêt à y dOllller suite, quoi qu'il s ' agisse. Nonnalement, les requêtes de ce type sont conçues comme à la fois raisonnables et immédiatement réalisables, comme un signe que je suivrais sans difficulté : il est accepté et préfiguré dans les grandes lignes par l'intentionnalité motrice. Lorsque j ' entends la requête de mouvement en entier, de faire
« ça, précisément », la pensée
de me mouvoir d'une manière spécifique est préfigurée en détail par l'attention motrice. Je me trouve à exécuter le mouvement sans interrup tion, et mon orientation, enregistrée proprioceptivement, fait suite à un travail déjà fait. Venant tout juste d'anticiper une action-solution ou un traj et détenniné pour la réalisation de la requête à travers la conscience qu'il a de sa capabilité, mon corps fait appel à son répertoire acquis d'habiletés physiques ou au schéma corporel. C'est grâce à l' intention nalité motrice que
« mon
corps m' apparaît comme une posture ayant une
tâche actuelle et possible en vue.27 » En ce sens, ma compréhension d'une nouvelle action se poursuit au-delà et en deçà de sa représentation par le moyen d'une intentionnalité d'acte. L'anticipation motrice devient importune seulement par son absence ou lorsqu' elle est gravement atteinte, comme dans le cas de
processus habituel de prendre ma douche, m'habiller et déjeuner rapidement, suite à mon réveil, lUljOur de semaine. C'est à de telles routines, d'actions familières au contexte, que Taylor Cannan réfère principalement lorsqu'il décrit l'intentionnalité motrice comme « 1'lUlité et l'intégration normales de nos mouvements corporels et de notre conscience intuitive d'un environnement stable, donné. ,, (T. Cannau, Merleau-Ponty, London, Rout ledge, 2008, p. 1 1 7). La proximité avec les descriptions que fait Goldstein du mouvement habituel deviendra évidente plus loin. L'intentionnalité motrice peut être conçue en ana logie avec l'unité transcendantale de l'aperception chez Kant, à savoir comme le « je pense ,>,> ou « ça pense ,>,> qui doit pouvoir accompagner toutes mes représentations. Le «je peux '>'>, ou « ça peut '>'>, doit pouvoir informer tous ces mouvements pris en tant qu'immé diatement réalisables par moi. Il est insuffisant, bien que toujours à l'œuvre, lorsque je suis confronté à des mouvements que je dois apprendre. Si j'apprends une danse, il y a une anticipation corporelle de la bonne posture de départ dans laquelle me placer et de l'amorce directe du mouvement. L'intentionnalité motrice n'a pas quitté la scène parce que j'apprends lUle formule de mouvement sous la direction de quelqu'un d'autre. Cf M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 167. 27 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 116.
TIMOTHY MOONEY
136
Sclmeider. Cela dit, j ' atteins parfois une conscience indirecte et partielle de cette anticipation dans la vie ordinaire. Prenons l' exemple où, dans un aéroport, en me levant d'un siège, je suis terrassé par une crampe. Mon ami me crie alors de me dépêcher, sans quoi nous manquerons l'avion, et je lui réponds, avec une colère impuissante, que je ne peux pas. En faisant abstraction du fait que le corps dont je vis n ' est jamais le simple serviteur ou exécutant de représentations mentales et de volontés, mais un moment essentiel de la conscience, pour avoir le sens qu'ils ont, les obj ets des représentations et des volontés doivent également exister comme possibilités d' actions pour le corps . L'erreur fondamentale de l' intellectualisme est de caractériser les fonctions cognitives, représenta tionnelles et symboliques comme auto-suffisantes, de les isoler de la matière fragile et vécue dans laquelle elles se réalisent : le corps, qui a toujours déjà préfiguré l' action-solution pertinente par la conscience de capabilité28
3 Nous avons jusqu'à maintenant présenté la thèse de Merleau-Ponty comme si elle était sans failles. Une lecture à la ligne près montrerait peut-être qu'il n'est pas pleinement cohérent, ou qu'il ne rend pas compte de nos mouvements convenablement, du moins selon l'usage des sources dont il disposait. Comme Rasmus Jensen l'a remarqué, c'est Richard Zaner qui a identifié le premier lUle contradiction apparente dans l' inter prétation merleau-pontielllle du cas Sclmeider. D'une part, Merleau-Ponty affinne que, dans les mouvements concrets, le malade n ' a pas lUle conscience représentationnelle des choses qui le stimulent ni des réac tions habituelles par lesquelles il s ' affaire auprès d'elles. Il ment son corps s 'adaptant
(coping body),
corps qui est
«
est simple
la potentialité
d'un certain monde ». Toutefois, il en vient à affinner, selon Zaner, que tant la
«
familiarité » que la
«
communication » du malade avec les
choses sont rompues par les blessures au cerveau. Cela semble plutôt inconséquent, dans la mesure où le mouvement concret consiste précisé ment dans cette familiarité fondamentale avec les milieux actuels29.
'8 IbUi., p. 145, 1 6 l . 29 R . Zaner, The Problem ofEmbodiment: Some Contributions to a Phenomenology of the Body, Den Haag, Nijhoff, p. 186-187 n. 1, R. Jensen, « Motor Intentionality and The Case of Schneider '>'>, art. cit., p. 371, 381, et M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 123-124, 153.
PLASTICITÉ, INTENTIONNALITÉ MOTRICE ET MOUVEMENTS CONCRETS
137
Je pense que la remarque, selon laquelle le malade est simplement son corps s ' adaptant
(coping body), met en
lumière quelque chose d' im
portant, bien qu'obscurci par la suite, comme nous le montrerons. Je souhaite soutenir, cependant, que la contradiction ici n'est qu'appa rente et qu'elle peut être résolue si l'on souligne la distinction entre deux façons de voir, l'une propre à l' engagement habituel, l' autre à une observation plus détachée et désengagée. La référence dans la première citation vise les ressources
(equipment) mobilisées
dans le cadre de mou
vements concrets, familiers au contexte, au sein de l'atelier de Schneider. Le malade est placé en face de ses outils et matériaux, à portée-de-la main ; il est devant le cuir là pour être découpé, et la doublure là pour être cousue30. La seconde affinnation de Merleau-Ponty renvoie au cas où l'on montre le stylo-plume au malade de façon à laisser l' agrafe dis simulée. Dans cette situation, il doit, pour reconnaître l' objet, passer par des inférences, pour finalement toucher la pochette sur sa chemise, et dire qu'il est placé à cet endroit et qu'il sert à prendre des notes31. On lui montre un outil dans une situation qui est étrangère au contexte et il me semble qu'il doit le convertir en une façon de le voir qui soit familière au contexte, tel qu'il sortirait de la pochette du médecin, vraisemblable ment avec l' agrafe en avant. Ainsi, l'incohérence disparaît dès lors que l'on s 'intéresse aux situations discutées. Jensen lui-même ne pense pas que Merleau-Ponty se heurte à un problème de cohérence en accordant et retirant, d'un même geste et en même temps, l 'intentionnalité motrice au malade32. Cependant, il postule une hypothèse malheureuse que l'on pourrait nommer le
«
problème de
vacuité », comme nous le verrons. Il soutient que l'on peut observer deux manières différentes d'utiliser la notion d' intentionnalité motrice chez Merleau-Ponty. Dans certains passages consacrés aux mouvements abs traits, elle est manifeste par son absence, et Jensen considère qu'elle est absente parce que de tels mouvements doivent être accomplis par étapes. Dans d' autres passages cependant, qui traitent de mouvements qui sont concrets et familiers au contexte, elle est manifeste par sa conservation, et elle est alors considérée comme identique à celle du sujet nonnal. Jensen affinne que dans ces passages Merleau-Ponty assimile le nonnal au pathologique, comme le fait l 'intellectualiste. Sa mécompréhension d'une citation de Goldstein sur les situations concrètes et familières au
30 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 123. 3 1 Ibid., p. 122. n IbUi., p. 152-153.
TIMOTHY MOONEY
138
contexte témoigne d'Wl tel geste d'assimilation. Remarquant que le sujet nonnal est capable d'extirper son corps d'un processus de mouvements habituels qui se déroule dans l' imagination, Merleau-Ponty ajoute :
C'est ce que notre malade ne peut plus faire. Dans la vie, dit-il, « j'éprouve les mouvements comme un résultat de la situation, de la suite des événe ments eux-mêmes ; moi et mes mouvements, nous ne sommes, pour ainsi dire, qu'un chaînon dans le déroulement de l'ensemble et c'est à peine si j'ai conscience de l'initiative volontaire [ . . . ] Tout marche tout seup3 Jensen fait remarquer que les mots cités par Merleau-Ponty, attri bués à Schneider, sont en fait ceux de Goldstein lui-même. Le docteur ne paraphrase pas même le malade : il décrit comment le sujet nonnal fait l' expérience de l' écoulement de la routine, des activités familières au contexte. Il ou elle est à peine conscient de toute initiative volontaire dans le vécu de cette séquence d'actions ou lorsqu'il ou elle se focalise sur elle après, dans la mesure où
«
tout marche tout seul >J.
À
cet égard, poursuit
Goldstein :
Les expériences de la personne nonnale qui effectue des mouvements de la vie quotidienne peuvent à peine être distinguées de celles de la patiente, en dépit de sa déficience optique, de même que son comportement dans de tels cas dévie à peine de celui de la personne nonnale.34 Ayant attribué la remarque initiale à Sclmeider, Merleau-Ponty assi mile ce qu'il croit être l' auto-description du malade au cas nonnal. Il ia considère comme la perception exacte du mouvement concret dans les deux cas, bien qu'il s ' entende avec Goldstein pour l'essentie135. Ce geste d'assimilation peut être aperçu lorsqu'il affinne que, alors que je prends place dans les actions familières, mon corps prend le contrôle sur moi. La tâche du malade
«
obtient de lui les mouvements nécessaires par une
sorte d' attraction à distance comme les forces phénoménales à l' œuvre dans mon champ visuel obtiellllent de moi, sans calcul, les réactions motrices qui établiront entre elles le meilleur équilibre36 >J. Au niveau de l' action habituelle, je suis également mon corps s ' adaptant
(coping),
la
potentialité de certaines actions appelées par certaines situations dans le monde.
33 Ibid., p. 122. 34 K. Goldstein, « Über die Abhangigkeit . '>'>, art. cit., p. 175, et R. Jensen, « Motor Intentionality and The Case of Schneider '>'>, art. cit., p. 382. 35 R. Jensen, « Motor Intentionality and The Case of Schneider '>'>, art. cit., p. 382383. 3 6 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 123-124. .
PLASTICITÉ, INTENTIONNALITÉ MOTRICE ET MOUVEMENTS CONCRETS
139
Selon Jensen, c e qu'on a appelé plus haut le problème de la vacuité émerge une fois que le nonnal et le pathologique ont été assimilés. Dans ces passages consacrés aux mouvements concrets et familiers au contexte, Merleau-Ponty affinne que l'intentionnalité motrice est la même chez le malade et la perSOlllle nonnale. Et dans les mêmes passages, selon l' inter prétation de Jensen, il ne donne aucune indication laissant entendre que l'intentionnalité motrice serait enrichie par un ou plusieurs autres pou voirs moteurs aux niveaux supérieurs du mouvement sain. Mais il doit alors admettre que le pouvoir de projection représentationnelle de l' intel lectualisme fournit la condition ultime du mouvement sain abstrait. Il est tout à fait clair pour lui que ce pouvoir de projection est nécessaire à de tels mouvements, bien qu'il doive se tenir dans une relation interne avec l'intentionnalité motrice qui l' accompagne3? Merleau-Ponty n'en appelle pas à une différente anticipation motrice d'un résultat parce qu'il la com prend comme un facteur commun, opérant aux niveaux concrets et abs traits. Schneider l'a certes perdu au niveau abstrait, mais, selon Jensen, cela ne nous dit rien de plus sur l'intentionnalité motrice de la personne nonnale, étant donné qu'elle n'est pas considérée comme teintée par des facteurs non représentationnels supplémentaires, ces facteurs entrant en jeu seulement lorsqu' elle se tourne vers les actions abstraites38. On peut comprendre ce geste d' assimilation, qui s ' amorce avec la fausse attribution du passage cité, si l'on admet qu'il entraîne un pro blème de vacuité. Il est trop facile d' assumer sur la base du deuxième passage cité que Schneider décrit sa propre expérience d' activités concrètes et familières au contexte. Lorsqu'il apprend à faire des porte feuilles, il doit péniblement exécuter les fonnules que lui fournissent ses instructeurs. Mais une fois qu'il a acquis les habiletés, ses prestations volitionnelles et imaginatives disparaissent de son travail et sa conscience corporelle anonyme prend alors le contrôle. Bien que les actes d' appren tissage des habiletés de l'ouvrier nonnal aient été bien plus simples, nous
H IbUi., p. 145). 3 8 R. Jensen, « Motor Intentionality and The Case of Schneider '>'>, art. cit., p. 381, 383. Selon mon interprétation, on s'approche de ce que Jensen appelle « le facteur com mun le plus partagé ,>,> ou « le plus haut degré de l'intentionnalité motrice ,>,> avec l'antici pation habituelle de l'achèvement qui est en jeu lorsque Schneider se concentre pour s'adapter de façon adroite (skilled coping). Sean Kelly affinen que ce type d'adaptation absorbée est « une sorte d'intentionnalité motrice pure '>'>. À l'instar de Dreyfus, il la dis socie complètement de toutes traces d'intentionnalité d'acte ou d'articulation conceptuelle antérieures. S. Kelly, « Merleau-Ponty on the Body ,>,>, in M. Proudfoot (ed.), The Philo sophy of the Body, Oxford, Blackwell, 2004, p. 75, cité dans R. Jensen, « Motor Intentio nality and The Case of Schneider '>'>, art. cit., p. 372, 383.
140
TIMOTHY MOONEY
avons vu que leur déploiement subséquent n'est visiblement pas plus fluide que ceux de Sclmeider. Le comportement de l' ouvrier
«
dévie à
peine » de celui de Sclmeider et son taux de production n ' est pas beau coup plus rapide39. Seulement, si le geste d' assimilation est profond, le problème de vacuité est insoluble. C'est ce qui adviendra si la description de la préfiguration motrice n'est pas développée. La thèse selon laquelle la conscience représentatiOIlllelle fonctionne avec une intentionnalité motrice de facteur commun fait sortir cette inten tiOllllalité du cadre d' anticipations habituelles pour lui pennettre de faci liter des mouvements inédits. En accord avec cette idée, aucun exemple de préfiguration motrice qui serait plus que le résultat d'un apprentissage infonné par l' imagination n ' est dOllllé dans la discussion du cas par Mer leau-Ponty. Toutefois, il faut se demander comment de nouvelles actions peuvent être exécutées immédiatement si la représentation constitue leur seule condition supplémentaire. Dans la mesure où toutes ces actions font appel à des habiletés apprises, il est difficile de voir comment la représentation, ajoutée au facteur commun de la proj ection motrice, peut réorienter aisément les habiletés vers des résultats autres que ceux anté rieurs. Et il n ' est pas nécessaire pour le lecteur d'adhérer à un pur méca nisme - c ' est-à-dire à une explication par des réflexes conditionnés et des circuits neuronaux préétablis - pour conclure que les habiletés acquises ont un caractère automatique et figé, de telle sorte qu'une réorientation immédiate n'est pas même envisageable. Une telle conception pourrait recevoir l' appui de Bergson, qui décrit l'habitude corporelle comme le
«
résidu fossilisé d'une activité spirituelle >J. Ce dernier considère
l'habitude comme quelque chose qui aurait graduellement chuté depuis la conscience et la volonté vers l'inconscient et l' automatisme40.
4 La position élaborée par Merleau-Ponty consiste à dire que la conscience représentationnelle n'est pas le seul facteur additionnel dans
39 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de laperception, op. cit., p. 120, 122). Dans les notes du cas, on remarque que Schneider a eu initialement du mal à acquérir les habi letés nécessaires pour faire des portefeuilles. Goldenberg l'admet au début de sa propre discussion, mais il en réduit la portée en ajoutant que le malade a vite maîtrisé les tâches. Cf G. Goldenberg, « Goldstein and Gelb's Case Schn.: A Classic Case in Neuropsycho logy? '>'>, art. cit., p. 28 1 . 40 H. Bergson, Œuvres, Paris, PUF, 1963, p . 1462.
PLASTICITÉ, INTENTIONNALITÉ MOTRICE ET MOUVEMENTS CONCRETS
141
les mouvements immédiats abstraits ou imitant l e concret et que, par conséquent, elle ne survient pas dans un automatisme rigide. En dernière analyse, il prend soin d'éviter toute interprétation des actions pratiques qui en font des résidus fossilisés. Les mouvements concrets ne sont pas pris dans des chemins fixés. Ils peuvent être incorporés en des mouve ments abstraits ou imitant le concret - et se modifier dans la confronta tion avec des obstacles rendant leurs situations pratiques étrangères au contexte - sans détruire l' immédiateté ou l'écoulement de l'activité. Cela paraît tout à fait sensé si l'on recOllllaît de nouvelles préfigurations de résultats qui impliquent plus que des habiletés apprises qui soient infor mées de façon représentationnelle. De telles anticipations corporelles de résultats ont un caractère propre qui infonne les mouvements nouveaux et déjà en cours de manière à ce qu'ils demeurent efficaces. Mais il est important de montrer que tout ceci doit s ' appuyer sur un éclaircissement du facteur qui n ' est pas commun à ces projections41. Je ferai valoir que, selon Merleau-Ponty, c ' est une capacité de trans position qui distingue l' intentionnalité motrice d'une personne saine de celle de Schneider. Elle permet de répondre à l' objection de la vacuité parce qu'elle est révélée par contraste dans les exécutions nonnales de mouvements abstraits ou imitant le concret. Merleau-Ponty ne l' introduit pas dès la discussion du cas, mais seulement plus tard. Jensen y fait signe en laissant entendre que l'idée directrice de la description de Merleau Ponty est à contre-courant de l'opinion reçue, dans la mesure où il est reconnu que l' état du malade est une contraction des possibilités d' ac tions présentes dans l'horizon nonnal, ouvert, de l' attention pratique . Chaque perception actuelle est reliée à une multiplicité de coordonnées possibles42. Cela dit, ce qui doit être souligné, c ' est que cet aspect dis tinctif et en effet détenninant de l'attention nonnale a la portée qui est la
4 1 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de laperception, op. cit., p. 166, 170. L'ex plication qui suit n'exclut pas l'attention pré-réflexive de l'adaptation adroite (skilled coping), qui peut en principe être portée à la présence thématique. La connaissance pré réflexive peut contribuer à des mouvements à venir, en ce que dans sa fonction de contrôle - qui est inséparable des sensations kinesthésiques des mouvements - elle peut fournir des informations de rétroaction signalant la nécessité de certaines actions correctives. Toute fois, de telles actions présupposent l'intentionnalité motrice. Cette dernière, par exemple, préfigurera un différent geste de préhension d'lUl outil en réponse à la résistance sentie kinesthéstiquement que cause mon geste inefficace présent, résistance qui a pris lUle telle proportion qu'elle est désormais thématisée de façon réflexive. Lorsqu'actualisée, ma nou velle prise sera enregistrée pré-réflexivement et peut-être thématisée, bien qu'elle fasse suite à une solution projetée de façon anonyme et immémoriale. 42 R. Jensen, « Motor Intentionality and The Case of Schneider '>'>, art. cit., p. 386 ; M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 136, 150-152, 157 n. 5.
TIMOTHY MOONEY
142
sienne en vertu d'une capacité de transposition, à savoir un pouvoir par ticulier du schéma corporel de chacun. Lorsque Schueider entreprend des mouvements imitant le concret ou abstraits, il devient évident que cette capacité lui manque. Il est aussi possible que la déficience s ' étende plus profondément, inhibant son habileté à poursuivre son adaptation pratique
(coping)
lorsque des actions familières sont interrompues .
Quand bien même la capacité appropriée se serait effacée à tous les niveaux, l' intentionnalité motrice restante pourra se révéler utile pour chacun d'eux. Les preuves documentées laissent présumer qu'elle sur vient dans une fonne pathologique aux plus hauts niveaux, ne serait-ce qu'occasionnellement. Nous avons
vu que lorsqu'on
demande à Schnei
der de mimer Wle action comme le salut dans Wle situation étrangère au contexte, ce dernier doit convertir la requête en Wl scénario de parade militaire, y faire correspondre son corps entier et l' investir dans l' action. Au-delà du retard dans l' amorce du mouvement, on n'y constate aUCWle économie43. De même, au moins quelques requêtes de mouvements abs traits sont converties en des contextes concrets et familiers au contexte. En se positionnant pour tracer Wl cercle les yeux fennés, le malade pro cède comme s'il cherchait Wle fenêtre dans le noir. Dans ces actions, il compte satisfaire la requête entendue, même s'il est au départ perplexe et que la plupart de ses phases de mouvements sont construites par étapes. Cela soulève la possibilité que les requêtes fonnulées soient enten dues comme des signes aux sonorités étranges qui en viennent à être dotées d'Wle signification motrice. Elles n ' ont pas Wle signification ins tantanée pour Sclmeider, en tant que corps se mouvant, mais il pourrait être en mesure de faire Wle traduction, qui les transpose dans le champ plus étroit des possibilités non abrégées qui lui restent. il se pourrait que l' intentionnalité motrice ait été perdue pour ce qui est des actions nouvelles, mais qu'elle soit mobilisée pour les actions adroites qui sont utilisées en remplacement, bien que de manière non économique. Si, et au moment où, il se comporte de la sorte, il a survolé les mouvements habituels et les contextes pour y trouver Wl autre moyen de réaliser l'ac tion. Bien que, ce faisant, il objectifie son corps dans le cadre de ce processus par étapes, il fait aussi recours à son attention opérante, celle de chercher et trouver, etc., qui s ' avère surexploitée dans son application de substitution.
43 K. Goldstein, « Über die Abhangigkeit. . '>'>, art. cit., p. 175-176, et M. Merleau Ponty, La structure du comportement, Paris, PUF, 1942, p. 121, 122. .
PLASTICITÉ, INTENTIONNALITÉ MOTRICE ET MOUVEMENTS CONCRETS
143
Une telle persistance affaiblie et mal accordée de l' intentionnalité motrice est exclue par Merleau-Ponty lorsqu'il affinne que les requêtes sont dépourvues de signification motrice, qu'elles sont des lettres mortes plutôt que des signes étrangers dans l' attente d'une traduction, de telle sorte que le malade ne trouverait en son corps qu'une
« masse
amorphe »
à lancer dans une réponse aveugle. Sur ce point, Merleau-Ponty n'est pas cohérent. Il affinnait auparavant que
«
l' initiation kinesthésique devient
à nouveau impossible » lorsque la conversion perfonnative par le malade de requêtes imitant le concret et étrangères au contexte en des mouve ments familiers au contexte est interrompue, alors qu'ici l'opération anté rieure de l' intentionnalité motrice est admise44. Mais choisir l'une ou l'autre de ces alternatives est injustifié dans la mesure où aucune preuve ne pennet d'exclure ou de justifier l'une d' elles. Toutefois, rien de ceci ne nous empêche de revisiter la description de Merleau-Ponty pour tracer les contours de cette condition qui rend possible aussi bien les mouvements sains que les mouvements imitant le concret et abstraits, de cette condition qui fait défaut à Sclmeider, ou qu'il a complètement perdue. Il ne peut aisément déployer des habiletés acquises en de nouvelles combinaisons, ni les abréger. Il est incapable de les réduire ou de les greffer pour les transposer en d' autres mouvements et postures.
À cet égard,
ses actions sont presque calcifiées45. Bien qu'elle
ne soit pas longuement développée, la capacité de transposition est consi dérée par Merleau-Ponty comme un trait caractéristique intrinsèque au pouvoir moteur de la perSOlllle nonnale. Cette capacité du schéma cor porel, à l' œuvre lorsque j ' imite le mouvement des autres, que je suis des ordres ou que j ' accomplis de nouveaux mouvements de mon cru, pennet
44 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 122, 127-128. Plus tard, lorsqu'il discute l'incapacité de Schneider à construire plus que de simples formes, Merleau-Ponty affinne que cette traduction d'instructions pour arranger des formes en des mouvements « passe par les significations expresses du langage, tandis que le sujet normal pénètre dans l'objet par la perception, s'en assimile la structure " . Les significations ne sont plus incarnées, ce qui est autre manière de dire qu'elles ne sont plus des significations motrices. Toutefois, cela n'empêche pas les instructions de pouvoir prendre une signification motrice de substitution. Encore plus loin, Merleau-Ponty remarque que Schneider ne peut entrer dans lUle situation fictive sans la convertir en une situation réelle. Bien que la remarque soit faite en lien avec sa difficulté à comprendre des conversations complexes, Merleau-Ponty admet à nouveau que ce comportement n'est pas en général aveugle. Voir ibid, p. 154, 157. " IbUi., p. 121, 135, 157.
TIMOTHY MOONEY
144
à l' attention motrice de prétracer de nouveaux mouvements en vue de nouveaux résultats :
L'espace et le temps que j'habite ont toujours de part et d'autre des hori zons indétenninés qui renfennent d'autres points de vue. La synthèse du temps comme celle de l'espace est toujours à recommencer. L'expérience motrice de notre corps n'est pas un cas particulier de connaissance ; elle nous fournit une manière d'accéder au monde et à l'objet, une « praktogno sie » qui doit être reconnue comme originale et peut-être comme originaire. Mon corps a son monde ou comprend son monde sans avoir à passer par des « représentations », sans se subordonner à une « fonction symbolique » ou « objectivante ». [ . . . ] Le changement de coordonnées est éminemment contenu dans cette opération existentielle. C'est que le sujet nonnal a son corps non seulement comme système de positions actuelles, mais encore et par là même comme système ouvert d'une infinité de positions équivalentes dans d'autres orientations. Ce que nous avons appelé le schéma corporel est justement ce système d'équivalences, cet invariant immédiatement donné par lequel les différentes tâches motrices sont instantanément trans posables. [ . . . ] Pour que nous puissions nous représenter l'espace il faut d'abord que nous y ayons été introduits par notre corps et qu'il nous ait donné le premier modèle des transpositions, des équivalences, des identifi cations qui font de l'espace un système objectif et pennettent à notre expé rience d'être une expérience d'objets, de s'ouvrir sur un « en soi ».46
À ce
compte, le schéma corporel infonnant l' attention motrice n'est
pas une masse inerte de sédimentations fossilisées ou de positions fixées, mais un répertoire fluide et en évolution d'habiletés et de combinaisons d'habiletés47. Si je me représente en imagination une nouvelle action dans mon odyssée quotidienne à travers le monde de l' adaptation pratique
(coping),
et que je l'appréhende comme une possibilité immédiate, mon
corps doit être capable de projeter un trajet pour la réalisation directe de cette action. Il doit sous-tendre un scénario dont la possibilité immédiate est tenue pour acquise.
Y
parvenir revient à préfigurer l'action-solution
pertinente de façon non représentationnelle. La solution préfigurée, qui pennet de saisir la nouvelle action comme facilement disponible, n'est pas elle-même représentée, et man querait invariablement d' immédiateté dans son exécution si elle déployait une pure réitération d'habiletés motrices existantes. Elle présuppose pour ces raisons l'habileté du corps à transposer ces habiletés, à les adapter et à les combiner vers d' autres résultats. Pour des scénarios imaginés avec créativité, l ' anticipation d'une réalisation immédiate dépend de la
" IbUi., p. 164, 165, 166. " IbUi., p. 151, 179.
PLASTICITÉ, INTENTIONNALITÉ MOTRICE ET MOUVEMENTS CONCRETS
145
transposition d'habiletés au niveau d'une proj ection anonyme, ce qui explique pourquoi cette dernière ne constitue pas une intentiOllllalité motrice ayant le statut de facteur commun48. Ma capacité à transposer mon schéma corporel pennet également des anticipations motrices appro priées à des situations pratiques qui sont nouvelles ou inattendues, ce pourquoi je ne me laisse pas démonter par elles. Opérante en des coexis tences et des successions modifiées et abrégées, cette capacité de trans position est essentielle pour une vie en laquelle des nouvelles séquences d'actions s 'accomplissement impassiblement, pour une bonne part. J'ai fait référence plus haut à cette anticipation globale de mouve ments qui se trouve éveillée par mon acquiescement à la requête que me fonnule ma docteure de me mouvoir, sans qu'elle soit allée jusqu'à pré ciser spécifiquement la manière de le faire. Elle pourrait me demander de lever mon coude et pivoter mon épaule aussi bien lorsque je suis assis que debout. Si l' exécution est tout aussi inconfortable dans les deux positions, l'une ne posera pas un moins grand problème que l' autre.
48 Ibid., p. 179. Selon une interprétation minimale, Merleau-Ponty prétend que la représentation imaginative n'est pas la condition suffisante pour des mouvements abstraits et étrangers au contexte qui soient prompts et non troublés. Ils exigent la mise en œuvre d'une capacité latente dans les mouvements habituels et familiers au contexte. Mais le passage qui conclut la citation plus haut suggère que la représentation imaginative est elle-même structurée par une opération de transposition. Ce que l'on envisage n'aurait pas la forme qu'il a sans être une possibilité particulière pour le corps. Pour être considérée comme immédiatement actualisable, une nouvelle représentation doit déjà être congruente avec une action-solution particulière, en laquelle les habiletés existantes seraient combi nées et déployées comme jamais elles le furent auparavant. De telles représentations infor mées de façon motrice diffèrent de celles de Schneider, dans la mesure où elles figurent des réalisations de possibilités optimales, plutôt que simplement adéquates (ce n'est pas simplement l'immédiateté qui manque aux tentatives de nouveaux mouvements de Schnei der : ils ne laissent pas voir qu'il ait envisagé des manières normales de les compléter. Ces formules idéales de mouvement peuvent bien être optimales à ses yeux, mais seraient excessives pour la personne normale, qui imagine des mouvements plus économiques). Qu'un cas soit fait pour des représentations informées de façon motrice est confinné plus loin dans le livre. En référant à l'exemple sartrien du rocher qui apparaît insurmontable seulement au sein du projet conscient de grimper, Merleau-Ponty soutient que la manière dont je vois les choses et m'imagine les surmonter n'est pas un simple produit de repré sentations conscientes, mais de mon attention motrice. Elle comprend un soi anonyme qui est impliqué dans chaque spectacle, allant au-devant de mes intentions expresses et contri buant aux contours des perceptions des sens et des scénarios de l'imagination. Cf J.-P. Sartre, L 'être et le néant. Essai d'ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, 1943, p. 562, et M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 501-503. Cette affir mation se trouve aussi brièvement appuyée dans La structure du comportement. Cf M. Merleau-Ponty, La structure du comportement, op. cit., p. 127-128. Que Schneider puisse concevoir de nouvelles possibilités d'action pour lui-même relève d'un autre pro blème. À notre connaissance, toute nouvelle chose qu'il se représente se tient sur la base d'un ordre ou d'une suggestion de la part de ses docteurs.
TIMOTHY MOONEY
146
Je n ' aurai pas à me rappeler de la posture que j ' adopte dans mon club d' entraînement et m'y placer pour commencer à me mouvoir, pas plus que j e dois me mettre au garde-à-vous pour faire l' imitation d'un salut. La transposition sera opérante dès le départ, et indiquée par la manière dont mon corps assumera l' achèvement de l' action sans hésitation. Il y a d' autres situations où la transposition me pennet de rencontrer des obs tacles inattendus au sein d'une séquence d' actions - et même, d' assumer plusieurs tâches - sans rompre la fluidité et le rythme du mouvement. Un certain jour, au milieu de l'hiver, je me rends en hâte à une soi rée d' alllliversaire avec un grand gâteau dans les mains. En tournant le coin, je vois que la porte de la cuisine est fennée et je souhaite réduire mon retard, tout en supposant qu'elle était fennée pour garder la chaleur à l' intérieur. La manière de procéder que j 'envisage en réponse à cette situation est aussi préfigurée par mon attention motrice, et c'est pour cela que je m'y confonne si rapidement et fiuidement. Mon avant-bras se déplace vers l 'extérieur et vers le bas, sur la poignée, de façon à ouvrir la porte, et une fois passé, mon pied se déplace sur le côté pour la fenner. En tenant le gâteau, pendant tout ce temps, je n'ai pas besoin de me rappeler le mouvement d' appuyer sur une valise ou sur le couvercle d'une poubelle, ou celui de faire dévier un ballon de soccer avec le pied. Même si je me rappelle momentanément telle ou telle action habituelle, et admire mon adresse, je ne le fais pas d'une manière excessive, en adoptant la posture générale qui va avec la valise, la compression des déchets et les feintes au foot. Ces mouvements acquis ont subi un abrè gement
(abbreviation)
et une recombinaison
(recombination)
; ils co
existent, l'un après l' autre, dans le transport du gâteau. Toutes les actions sont au service de la tâche principale, celle ultime étant de retenir la chaleur dans la pièce. J'ai préfiguré certains résultats, à travers ma pos ture présente et, en se modifiant continûment,
«
les tâches se répartissent
d'elles-mêmes entre les segments intéressés49 » pour reprendre l'expres sion de Merleau-Ponly. Comme il a déjà été noté, j e prends contrôle du monde spatial de façon créative plutôt que de façon fixe ou fossilisée. Le monde n'est pas figé en des positions et en des directions habituelles, il prend de
49 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 174. L'action solution originale du corps a aussi été décrite connne le «je peux qui mène le jeu " . Pour une explication des modifications de ce « je peux '>'> occasionnées par des obstacles inat tendus qui mène jusqu'aux développements récents en neurooynamique, cf E. Rietveld, « The Skillful Body as a Concemful System of Possible Actions: Phenomena and Neuro dynamics '>'>, Theory and Psychology, 18, 3, 2008, p. 350.
PLASTICITÉ, INTENTIONNALITÉ MOTRICE ET MOUVEMENTS CONCRETS
147
nouvelles configurations lorsque j ' envisage les choses différemment, par le moyen d' actions imaginées qui transcendent les chemins existants . C'est précisément parce que l' attention motrice portée par mon schéma corporel sous-tend elle-même les situations imaginaires qui me sont sug gérées ou que j ' invente que celles-ci ont la vie qui est la leur. Comme le souligne Komarine Romdenh-Romluc, on ne tient compte que de ce qu'on a le pouvoir de réaliser. Percevant une possibilité immédiate, j ' accède à des habiletés motrices au-delà de celles à l' œuvre dans mon activité en cours, et c ' est pour cette raison qu'elle est perçue comme immédiate50. Ce qu'il faut ajouter ici est que l' immédiateté de certains nouveaux scénarios d'action détient, comme sa condition, le caractère transposable des habiletés motrices. Ces scénarios font appel aux anti cipations motrices qui consistent en l' adaptation de capacités existantes. La plasticité présomptive de leur espace est corrélative de la plasticité des projections du corps. Accéder à la transposition des habiletés ouvre à lUle vie de fantaisies et de jeu, une vie qui ne se limite pas au fait de sunnonter les obstacles liés aux tâches pratiques. On peut préfigurer des résultats immédiats qui ne seront jamais actualisés, dans la mesure où ils ne sont pas urgents ou importants5 1 . Merleau-Ponty affinne qu'il en va de l' essence de la conscience humaine de se doter de plusieurs mondes, et d'avoir porté à lUle existence virtuelle les pensées qu'elle se dOlllle, sans réaliser la plu part d' entre elles. L'attention incarnée
«
prouve sa vigueur indivisible
ment en se dessinant ces paysages et en les quittant52 >J. Bien entendu, la présomption préfigurée d'lUl succès peut apparaître en pratique comme injustifiée. Une action qui semble aisée à lUl individu en fonne et en santé, et qui a été anticipée de manière anonyme par celui-ci, se révèle être au-delà des capacités du malade. Aussi malheureux et inévitable que cela puisse être, le vieillissement limite encore davantage la plasticité du schéma corporel et la flexibilité physique actuelle. Le champ des habile tés disponibles et de leurs combinaisons rétrécit ; l' impétuosité et la confiance de la jelUlesse laissent place à la précaution et à l'hésitation de la vieillesse53.
50 K. Romdenh-Romluc, « Merleau-Ponty and the Power to Reckon with the Pos sible '>'>, in T. Baldwin (ed.), Reading Merleau-Ponty: On Phenomenology of Perception, op. cit., p. 52-53. 5 1 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 126, 130. " IbUi., p. 151-152. 53 Cf E. Husserl, Ideen II, op. cit., p. 265-272.
148
TIMOTHY MOONEY 5
En gardant ce qui précède à l'esprit, je dirais que dans sa réponse au cas Schneider, Merleau-Ponty ne porte pas suffisamment attention à la créativité présente dans le mouvement concret. Il observe que la per Smille nonnale organise le monde en accord avec les projets du moment présent, traçant ses frontières et directions par l' instauration de nouvelles lignes de force avec son corps vivant, intégrant par là au cadre géogra phique un cadre comportemental. Ses proj ets préfigurés de manière motrice polarisent le monde, « y font paraître comme par magie mille signes qui conduisent à l' action, comme les écriteaux dans un musée conduisent le visiteur54 >J. Les projets pratiques n ' échappent pas à la règle, puisque dans la phrase qui suit immédiatement, Merleau-Ponty ajoute que la fonction de « projection » ou d'« invocation » a pour sens de faire apparaître quelque chose d'absent et constitue
aussi
ce qui rend
possible les mouvements abstraits. Par l'urgence de l'existence, un pou voir productif se révèle. Toutefois, il s ' agit de la seule allusion que fait Merleau-Ponty dans ce cas à la créativité pratique, aux projections de mouvement qui se tiennent entre les extrêmes que sont le mouvement concret habituel et le mouvement abstrait. Plus loin dans ce chapitre, il fournit un exemple détaillé de la capa cité d' adaptation d'lUle habitude. Il s ' agit d'un organiste expérimenté qui passe, à la fois rapidement et de façon compétente, à lUl instrument plus grand dont les clés et les registres sont réglés bien différemment de celui dont il a l'habitude. Dans sa réponse à la situation, l' organiste recalibre certaines parties de son schéma d'habiletés en vue d'lUle autre fin musi cale. Il s ' agit de la meilleure illustration de la manière dont Merleau Ponty rej ette le résidu d' automatismes fossilisé. Si la préfiguration d'actions du corps n ' était pas appropriée au nouvel orgue, on ne pourrait constater le déploiement rapide de ses habiletés générales au niveau pra tique55. Toutefois, à ma connaissance, il ne dOlllle jamais d'exemples de transposition d'habiletés ou d' outils en de nouvelles fins pratiques56. Ce
54 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 130. 55 IbUi., p. 166, 169-170. 56 Merleau-Ponty offre des exemples où des objets comme des plumes de chapeaux ou des bâtons sont incorporés dans l'espace de personnes conscientes ou aveugles aux phénomènes de mode, ou encore, où des sens figuratifs sont donnés à des habiletés dans des activités comme la danse. Il décrit aussi différentes façons d'atteindre lUl téléphone depuis la position assise. Toutefois, il n'associe pas explicitement ces exemples avec la transposition d'habiletés (ibid., p. 167, 171, 174). Dans un ouvrage antérieur, il discute de la manière par laquelle les animaux peuvent adapter et abréger des mouvements, en utilisant
PLASTICITÉ, INTENTIONNALITÉ MOTRICE ET MOUVEMENTS CONCRETS
149
qui est également surprenant est que ses remarques sur la transposition ne sont pas mises en relation avec le cas Schneider. Elles sont introduites seulement de manière subséquente, en lien avec les malades qui ne peuvent imiter les mouvements qui viennent d' être effectués par les médecins. Ces persOIlles comprennent la requête, bien que leur corps soit incapable de s ' adapter aux particularités de l' action illustrée5? Mais Schneider a des problèmes d' adaptation qui lui sont propres, en ce que la possibilité d'être économique lui manque lorsqu'il s ' essaie à des mou vements imitant le concret et étrangers au contexte58. De manière générale, Merleau-Ponty n ' exploite pas ses idées concernant la capacité de transposition qui informe l ' intentionnalité motrice, même s'il a explicitement rejeté et ultimement évité toute dicho tomie entre l'adaptation pratique
(coping) et la créativité. Plus spécifique
ment, il n' examine pas comment le défaut de cette capacité peut affecter l'environnement global de Schneider. Dans le cas d'un malade qui doit
différents moyens pour atteindre des résultats similaires, tout en restant bien conscient que l'anticipation somatique hrunaine est inséparable de l'existence socio-culturelle. Ce qui nous définit n'est pas la capacité de créer une nature séparée de notre biologie, dans la mesure où nos conventions et notre constitution biologique sont en continuité. Il s'agit plutôt de notre capacité à aller au-delà des structures créées afin d'en créer d'autres. Nous pouvons construire des instruments pour en faire d'autres, et voir la même chose dans des fonctions différentes et une pluralité de contextes. Son exemple d'un match de soccer illustre à merveille certaines de nos façons d'articuler l'espace. Sur la base des limites et des secteurs existants, connne la zone de pénalité et les lignes de touche, le joueur établit de nouveaux vecteurs et lignes de forces qui mooifient son champ phénoménal (ibid., p. 106, 183, 188-190, 195-196). 57 Ibid., p. 164-165. Il s'appuie principalement sur la description que fait A. A. Griin baum de malades ne pouvant pas imiter des mouvements observés. Il est également influencé par l'affinnation de ce dernier selon laquelle ce qui est affecté chez ces individus n'est pas la fonction symbolique, mais « une fonction bien plus primaire, en sa nature motrice, en d'autres mots, la capacité d'une différenciation motrice au sein du schéma corporel dynamique " (A. A. Griinbaum, « Aphasie lUld Motorik '>'>, Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 130, 1, 1930, p. 397-398). Cf M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 166. 58 Il ne s'agit pas d'une critique des références à d'autres cas pathologiques, dans la mesure où ce que l'on rapporte concernant les difficultés remarquées chez les autres malades révèle d'autres aspects cachés du mouvement normal. Mon point est que les problèmes de Schneider relatifs à l'abrégement conviennent particulièrement bien à la mise en lumière des opérations de la capacité de transposition dans les mouvements imitant le concret et abstraits, et peut-être également dans les mouvements concrets s'adaptant. Et il doit être réitéré que Merleau-Ponty n'est pas préoccupé par le caractère concluant du cas Schneider d'un point de vue médical. Par le biais des cas pathologiques, sa phénoméno logie existentielle cherche à dévoiler les essences normales ou caractéristiques invariantes de l'engagement perceptif (humain). Et ces essences ne sont pas le terme de sa méthodo logie, mais plutôt des moyens de mettre en lumière, à leur tour, notre être-au-monde global (ibid, p. i, ix).
TIMOTHY MOONEY
150
avoir recours à des procédures excessives pour compenser une blessure, il serait intéressant de découvrir si les blessures graves sont confinées à un niveau au-delà de l' adaptation habituelle
(coping).
Il ne faut pas igno
rer la possibilité que la capacité d'Ull malade à adapter ses habiletés au niveau pratique ait été gravement endommagée, au point où la familiarité de contexte serait dans ce cas absolue, et qu'aucune étrangeté, ou autre chose de semblable, ne puisse alors être négociée. Si cela en venait à être révélé comme une part constitutive de son état, on aurait là une absence remarquable, mettant en lumière le rôle de l' adaptation dans le mouve ment concret nonnal. Il va sans dire qu'il faut veiller à ne pas voir une possibilité au sein du niveau concret sans justification. J'ai dit plus haut que le schéma d'habiletés de Schneider était en grande partie calcifié en des mouve ments figés lorsqu'il était mis à partie en dehors de situations concrètes et familières au contexte. Mais cela ne pennet pas d' établir qu'il est calcifié dans ces situations familières, qui exigent une multiplicité de mouvements pour parvenir aux résultats préfigurés. Selon Hubert Dreyfus, Sclmeider est vraisemblablement incapable de passer de la situation où il fabrique des portefeuilles à celle où il rentre chez lui, ou d'une commis sion pour Goldstein à une autre qui ne serait pas pour lui, sauf si on le lui demande explicitement. Il est dépourvu de l'habileté à se détourner de son absorption dans une situation motrice intentionnelle vers son absorption dans une autre. Mais Dreyfus soutient que nous devons tout de même supposer une fonne minimale d' intentiOllllalité motrice et de flexibilité si le malade est capable de fabriquer des portefeuilles. Il doit être capable de passer d'une tâche à l' autre au sein de la situation en laquelle il est absorbé, arrêter de couper dès lors qu'une feuille de cuir est complètement utilisée, et commencer à coudre les pièces 59 . Cette habileté est attribuée à Schneider en plus des ajustements mineurs continuels qu'il fait avec son corps pour continuer à utiliser fluidement et efficacement les outils et matériaux existants, tout comme le reste d' entre nous d'ailleurs. Dans une même tâche, ces ajustements présupposent de légers déplacements dans l' anticipation motrice globale.
À cet égard, Merleau-Ponty se réfère au caractère fluide et mélodique des mouvements habituels du patient, caractère qui fait signe encore davan tage vers ses compétences au niveau de l ' adaptation adroite
(skilled
59 H. Dreyfus, « Reply to Romdenh-Romluc '>'>, in T. Baldwin (ed.), Reading Merleau Ponty: On Phenomenology ofPerception, op. cit., p. 63-64.
PLASTICITÉ, INTENTIONNALITÉ MOTRICE ET MOUVEMENTS CONCRETS
151
coping)60. Passer d'une tâche à l' autre au sein d'une même situation en laquelle on est absorbé peut néanmoins devenir aussi habituel que les tâches elles-mêmes, et les actes de passage peuvent avoir été enseignés à Schneider en tant que partie de sa fonnation. On peut à nouveau se rappeler la remarque de Goldstein selon laquelle son comportement habi tuel dévie, pour l' essentiel, à peine de celui de la perSOlllle nonnale, en accordant qu'il travaille de façon méticuleuse et en y mettant tout son esprit, et que son taux de production est inférieur d' environ un quart. Ses mouvements en séquences sont adéquats lorsqu'ils sont élaborés dans des contextes familiers, qui incluent les objets qui sont intrinsèques à ces mouvements61. C'est seulement lorsque Schneider est confronté à des objets d'une façon qui n ' est pas familière, comme cette plume inutilisée, en dehors de la pochette où elle prend place, avec l'agrafe hors de vue, qu'il échoue à les reconnaître. Cependant, une autre expérience pourrait être bien plus révélatrice de son état. Un contexte familier pourrait être perturbé une fois que Schneider s'est lancé, de telle sorte que ses actions habituelles avec leurs instruments ne suffisent plus, bien qu'il soit laissé avec suffi samment d' outils pour accomplir le travail en faisant recours à une stratégie alternative. On pourrait alors détenniner s'il est capable de mou vements concrets et d'utilisation d' outils nouveaux. Une intervention délibérée est nécessaire parce qu'un tel scénario a peu de chances de se produire de lui-même lorsqu'il est à son poste de travail ou sorti marcher. Dans un hôpital, on l'a fonné dans ce qu'on appelle aujourd'hui un « ate lier protégé », et il part, ou est envoyé, faire des courses avec des buts uniques et fixés. En dehors des situations de test, il est moins exposé qu'une personne nonnale à des situations où le flux habituel de l'activité est mis au défi 62.
60 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 122. 61 Ibid., p. 157. 62 À nouveau en défense de la description que fait Merleau-Ponty des mouvements concrets et familiers au contexte, on pourrait répliquer que l'adaptation adroite opère précisément de cette manière. Plusieurs d'entre nous avons fait l'expérience d'utiliser des instnunents ou de se rendre quelque part, mais d'être incapable de se rappeler de larges pans de ces activités ou du trajet vers la destination. Ces expériences, bien que communes, n'épuisent pas cependant le champ de l'adaptation flexible (flexible coping) dans le mou vement concret. Il est à peine controversé d'affinner qu'il n'y avait rien de nouveau, ou qui ait fait événement, dans ces plages de temps, rien d'effrayant ou de surprenant qui aurait concentré merveilleusement ou différennnent notre esprit informé corporellement. Ces parts monotones de notre environnement occupent une part encore plus grande dans la vie de Schneider, du moins lorsqu'il n'est pas observé par Gelb, Goldstein et d'autres médecins.
TIMOTHY MOONEY
152
Si Merleau-Ponty s ' était penché sur la plasticité manquante dans le concret, il se serait mis en quête de documentation supplémentaire, ou aurait au moins commenté les lacunes dans la littérature. Comme on l'a
vu,
il rapporte une observation sans y puiser beaucoup. Lorsque Sclmeider
est interrompu dans la conversion de requêtes imitant le concret et étran gères au contexte en des situations familières au contexte, l'amorce de kinesthèses devient à nouveau impossible. Cela aurait pu éveiller la ques tion de ce qui arriverait si son flux habituel d' actions se trouvait empêché. En se la posant, Merleau-Ponty aurait cherché un scénario pour esquisser le récit d'une action pratique ordinaire qu'il effleure à peine, mais que l'on peut compléter avec l' aide de Dreyfus et de Heidegger. Alors que je m' adapte
(cope) concrètement, dit Dreyfus, d' autres tâches sont présentes
dans mon horizon comme des moyens d'avoir une meilleure prise sur ma situation. L'absorption peut être modifiée sans être amoindrie, en ce qu'une réponse créative peut être faite au sein d'un projet concret pour la maximiser. Une tapissière peut se rendre compte que son marteau est trop lourd, et elle peut chercher à s 'emparer d'un marteau plus léger, sans s ' interrompre pour réfléchir et délibérer. La seule réserve de Heidegger serait de dire que les concepts sont ici à l'œuvre, sous la fonne d'une précompréhension sédimentéé3. S'il n'y a pas de marteau plus léger à portée de main, et que le maga sin à deux pas est fenné, la tapissière pourrait très bien en venir à se saisir d'un tournevis à proximité, en se servant de son manche pour enfoncer le clou. Ce n'est pas aussi heureux qU'Wl marteau plus léger, mais elle l'in terprète comme faisant l' affaire, et certainement mieux que le marteau pesant. Si l'on imagine que Sclmeider martèle plutôt qu'il coud, et que son bras en vient à être fatigué et lourd, il pourrait bien chercher à s ' empa rer d 'Wl outil ayant la même fonne, mais, selon le rapport existant de Gelb et Goldstein, il est bien possible que transposer Wl tournevis dans ce rôle et s'en saisir d'Wle manière atypique le dépasserait complètement. Sans
(unreadiness-ofhand), 1 'hors-de-portée-de-main (unreadiness-to-hand) qui lui est corollaire,
le marteau plus léger, l'hors-de-portée-de-la-main et
renverraient l'Wl à l'autre, comme leur destin mutuel. S'il ne peut trans poser ses habiletés, il sera difficilement capable de transposer les instru ments qui leur sont intrinsèques. L'accomplissement de ses tâches pourrait dépendre de ce que les choses surviennent de façon prévisible et
63 H. Dreyfus, « Reply to Romdenh-Romluc '>'>, art. cit., p. 60, 66 ; M. Heidegger, Être et temps, trad. de E. Martineau, Paris, Authentica, 1985, p. 72-73, 122-123.
PLASTICITÉ, INTENTIONNALITÉ MOTRICE ET MOUVEMENTS CONCRETS
153
identifiable64. Mais que c e soit ou non le cas doit demeurer un objet de spéculation. Le sujet nonnal, pour sa part en tout cas, trouve un nouveau moyen, infonné par la motricité, pour sunnonter la difficulté que présente son bras douloureux. Même si la tapissière s 'est bien interrompue pendant quelques instants, elle cherchait alors une voie pour contourner l' obstacle, animée par la possibilité d'une stratégie d' adaptation alternative. Je suggère qu'avec Sclmeider on ne peut exclure des dommages à la plasticité fondatrice et à la créativité fondée, qui préservent les mou vements concrets du déraillement dans les situations de perturbations. Même en l'absence d'observations convaincantes et d'espoir d'en trou ver, Merleau-Ponty aurait dû faire référence à cette possibilité directe ment, alors qu'il se limite à l' indiquer de façon détournée, lorsqu'il écrit que le malade est simplement son corps, la potentialité d'un monde congelé où les mouvements sont mis à découvert « par une sorte d'attrac tion à distance.65 » Si quelque chose est sérieusement inadéquat aux niveaux supérieurs (où la transposition est manifestement absente), la difficulté pourrait en venir à s ' étendre plus profondément. Il peut bien manquer de preuves, mais celles que l'on détient laissent croire qu'il y a un problème dans les stades inférieurs, problème qui mérite assurément d'être commenté. Si on pouvait seulement le trouver dans les actions pratiques de Schneider, cela éclairerait plus avant celles du sujet nonnal. La phénoménologie, telle qu'élaborée par Merleau-Ponty après Husserl, vise la richesse descriptive et la fidélité66, mais ce projet devrait impliquer
64 Heidegger maintient qu'une taxinomie finie et fermée des usages auxquels on affecte une chose à portée-de-main la réduit au type de substance physique, sous-la-main qui est l'objet de l'investigation des sciences naturelles. Heidegger, Être et temps, op. cit., p. 82-83. Comme l'a fait remarqué Stephen Mulhall, quiconque (qui n'est pas blessé) comprenant sa nature d'outil reconnaîtra non seulement la tâche à laquelle il est destiné (planter et extraire des clous), mais aussi un nombre indéfini d'autres usages auxquels on peut l'affecter, comme maintenir ouverte une fenêtre, repousser des intrus ou se prêter au lancer du marteau (S. Mulhall, Heidegger and being and time, London, Routledge, 1996, p. 55-56). On peut noter que Goldstein rapporte chez un autre patient des mouvements inflexibles dans l'utilisation d'outils (, art. cit.). 21 J. Bruner, « From Joint Attention to the Meeting ofMinds: An Intnxluction '>'>, in C. Moore & P. J. Dunham (eds.), Joint Attention: Its Origin and Role in Development, op. cit., 1995, p. 7. 22 M. Tomasello, Origins ofHuman Communication, Cambridge, WT Press, 2008, p. 189-190, 198. 23 M. Tomasello, « Joint attention as Social Cognition '>'>, art. cit., p. 105-107. 24 Ibid., p. 132.
MOUVEMENT ET CONSTITUTION DU SENS
163
Pour trouver des cas d'attention conjointe, nous devons d'abord chercher des signes visibles de la compréhension mentionnée plus haut dans le com portement de l'enfant et du parent.25
Jusqu'ici, j 'ai cité des psychologues26. Cela dit, les philosophes sont le plus souvent en faveur du point de vue selon lequel la coordination en jeu dans l'attention conjointe est une coordination d'états mentaux. Traditionnellement, ils expliquent cette coordination psychologique en tenues d'attitudes propositiOllllelles, ou en tant qu'elle prend place dans certains états propositionnels, comme la croyance ou le désir - états où l'on reconnaît mentalement quelque chose comme étant le cas. En ce qui a trait à l'attention conjointe, l'objet de tels états propositionnels réside dans les états mentaux de l'autre personne. Naomi Eilan expose cette « analyse philosophique typique » en référant à un exemple proposé par Schiffer7 : toi et moi sommes assis à table, une chandelle entre nous. « Une analyse philosophique typique de ce qui est vrai pour moi dans un cas de connaissance mutuelle par exemple, m'attribuera au moins la croyance que tu vois la chandelle, la croyance que tu crois que je vois la chandelle, la croyance que tu crois que je crois que tu vois la chan delle »28. Eilan suggère à juste titre que ce genre d'analyse mène à s'in terroger sur la répétition infinie des croyances, qu'elle rejette tout aussi légitimement. Si, comme on l'accepte généralement, les enfants âgés de 9 mois n'ont pas encore le concept de croyance lorsque la capacité d'attention conjointe est dite se développer, alors ce genre d'analyse est assurément fausse. Mais cela ne suffit pas à exclure l'idée selon laquelle les enfants pourraient avoir une conception de l'attention et de l'intention et que cette conception puisse être le premier aspect, ou le précurseur, d'une saisie plus globale d'une théorie de l'esprit. En conséquence de quoi, on pourrait continuer à penser les états attentionnels en tant qu'attitudes 25 A. Ingsholt, « Joint Attention - A Precursor of "Theory of Mind". A Special Phenomenon in Blind Children? '>'>, communication présentée à la I l édition de l'Interna tional Council for Education ofPeople with Visual Impairment (ICBVI), 2002. Document disponible à http://www. icevi. org/publicationsiiCBVI-WC2002/papers!07-topic/07-ings holt1 .htm. 26 Pour une discussion de la compréhension mentale de la fixation du regard, voir M. J. Doherty, « The Development of Mentalistic Gaze Understanding '>'>, Infant Child Development, 15, p. 179-186. 27 S. Schiffer, Meaning, Oxford, Oxford University Press, 1988. 28 N. Bilan, « Joint Attention, Communication and the Mind '>'>, in N. Bilan, C. Hoerl, T. McConnack & J. Roessler (eds.), Joint Attention: Communication and Other Minds, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 2. e
SHAUN GALLAGHER
164
propositionnelles. John Campbell résume les possibilités que cela nous laisse : Les états propositionnels peuvent être impliqués de différentes manières dans la coordination. Les états propositionnels pourraient s'inscrire dans le contrôle de l'attention elle-même ou encore dans ma reconnaissance de la façon dont mon attention ou ton attention est contrôlée. Premièrement, on pourrait penser au cas où je sais à quoi tu prêtes attention, et que ce savoir est un facteur concourant au maintien de mon attention sur l'objet en ques tion. Deuxièmement, il est possible que je souhaite porter mon attention sur ce à quoi tu es attentif. Troisièmement, il se pourrait que je sache que je maintiens mon attention sur la chose en partie parce que tu y es attentif. Finalement, ce pourrait être que je connais la raison pour laquelle tu es attentif à l'objet en raison du fait que j'y suis moi-même attentif.29
De telles interprétations suggèrent que l'attention conjointe implique en apparence une cognition sociale de type mentalisatrice (mindreading). Je dois non seulement savoir que tu es attentif, mais aussi que tu es capable d'un état mental tel qu'être attentif à quelque chose. Ces inter prétations de l'attention conjointe reposant sur une théorie de l'esprit incluent des interprétations des tenants de la « théorie de la théorie )} (theory theory ; TT) ainsi que de la « théorie de la simulation )} (simula tion theory ; ST). Selon les tenants de la TT, il faut que j 'aie un concept d'attention et une cOllllaissance explicite ou tacite d'une théorie qui puisse me per mettre de comprendre que tu es attentif à X. La ST exige de moi de simuler la possession de ton état mental alors que tu es attentif à X. Comme Campbell l'indique, tant pour la TT que pour la ST, le processus « est "hors-jeu" (off-line) en ce que ses résultats ne sont pas pennanents et qu'il est détaché de l'action )}30. « Détaché de l'action )} parce que la TT et la ST ont traditionnellement été pensées sur le mode de l'observa teur, à la troisième personne plutôt que sur celui de l'interaction, à la deuxième personne. Cela pourrait suffire pour nous révéler que la TT et la ST ne peuvent qu'avoir du mal à rendre compte de l'attention conjointe, qui est clairement "en jeu" (in-line) et interactive. Comme Joannes Roessler le remarque, il est déjà problématique pour la TT et la ST que toute explication de la cognition sociale dépende d'une sorte de pas
29 J. Campbell, « Joint Attention and Cornrnon Knowledge '>'>, in N. Bilan, C. Hoerl T. McConnack et J. Roessler (eds.), Joint attention: communication and other minds, op.
cit., p. 245. 30 Ibid., p. 242.
MOUVEMENT ET CONSTITUTION DU SENS
165
interprétatif additionnel, allant au-delà de ce qui est perceptuellement disponible et présent dans le contexte interactif. Le problème est que, bien qu'il y ait des intuitions convaincantes indiquant que les enfants d'un an ont une certaine saisie de l'attention d'autrui, il y a aussi des raisons prima facie de douter qu'ils ont les aptitudes concep tuelles leur pennettant de l'interpréter (telle que la capacité de donner des explications causales).31
Campbell, cependant, dOlllle des exemples où ce type de coordina tion de l'attention n'implique pas d'attitudes propositiollllelles et n'est pas psychologique en ce sens. Bien plutôt, ce type de coordination est de bas niveau et met en jeu le mouvement : par exemple, des vaches « s'en gagent dans une conduite de référenciation sociale (social referencing) » alors qu'elles s'avancent vers un objet ; les joueurs d'une équipe de foot ball suivent l'attention des autres coéquipiers sans l'intennédiaire du concept. Je voudrais me concentrer sur le mouvement coordollllé dans l'action conj ointe plutôt que sur la coordination psychologique ou les capacités mentalisatrices pennettant de connaître les états mentaux d'autrui. En adoptant une approche énactive ou interactive, je souhaite montrer que l'attention n'est séparée de l'action qu'en de très rares cas (peut-être seulement celui où ma cOllllexion ou mon mouvement coordonné avec l'autre perSOlllle s'interrompt).
Le mouvement coordonné Dans l'exemple de John Campbell, je suis dans un champ et je regarde des vaches qui, lorsqu'elles me voient, se mettent à avancer en ma direction. Lorsque les vaches, prises isolément, avancent, elles semblent s'assurer que leurs congénères les accompagnent. Je ne sais que dire des vaches elles-mêmes, ou de ce que signifie, pour des vaches, de s'engager dans Wle conduite de référenciation sociale entre elles (si c'est bien ce qui se passe), mais sans tenter de me mettre dans l'esprit d'un troupeau de vaches, sans adopter une posture intentiollllelle ou tenter de constituer une série d'attitudes propositionnelles que je leur attribuerais, ma compréhension de leur attention conjointe dirigée vers Wl objet (et, puisque je sais qu'elles me voient et se dirigent vers moi, ma propre
3 1 Ibid., p. 236.
166
SHAUN GALLAGHER
attention conjointe coordonnée sur le même objet) se traduit immédiate ment - lorsque cet objet se révèle être ma propre perSOlllle - en mouve ment. Si je me mets à songer qu'elles pourraient avoir l'intention de changer de direction avant de m'atteindre, ce genre d'intention est quelque chose que je tenterais de percevoir dans leurs mouvements - ou dans le mouvement du troupeau comme un tout - ainsi que dans la fonne du terrain et les différentes possibilités qu'elles ont de changer de trajec toires - et non quelque chose que je chercherais à déceler à partir de leurs états mentaux. Je vois que je suis leur cible, et je vois que rien d'autre dans le pâturage ne peut attirer leur attention. Mon attention, coordonnée à ce qu'elles guettent et à l'endroit d'où elles le font, et mon souci pour ma sécurité mettent mes jambes en mouvement. Dans plusieurs cas, l'attention que je partage avec d'autres humains se résume à quelque chose de la sorte. Si John et moi sommes dans le pâturage et que nous voyons une ruée d'animaux se dirigeant vers nous, si nos regards se rencontrent, si JoOO prend mon bras, crie, et que nous nous mettons à courir, nous reste-t-il quelque chose à expliquer de l'attention conjointe ? Je présume que nous avons ici, en suivant la terminologie de Peacocke32, « une disponibilité perceptuelle commune et ouverte » dont nous sommes mutuellement conscients. Nous savons que nous voyons le troupeau s'avancer vers nous, et nous savons que nous le savons - et ici, je considère que le statut d'une telle cOllllaissance est d'un type éminem ment pratique, reposant sur une perception en cours. Ai-je besoin d'une théorie qui puisse expliquer pourquoi quelqu'un saisit le bras de quelqu'un d'autre ? Ai-je besoin de simuler la situation de JoOO ou encore ce qu'il pourrait bien penser ? Bien plutôt, et c'est ce que je propose, tout ce qui m'est nécessaire pour interagir réciproquement et pour comprendre les intentions de John est déjà là, dans la direction du regard et le moment où elle se produit, dans la saisie du bras, dans l'intonation de la voix, et nul besoin d'aller plus loin afin de découvrir une série de croyances ou de désirs que pourrait avoir JoOO. Bien entendu, il pourrait être intéressant d'apprendre que John croit que ces vaches sont en fait des taureaux (ce que je pourrais apprendre plus tard en discutant) ; mais cela ne remplirait aucune fin utile au moment où nous décidons de nous retirer. Campbell attire notre attention sur le genre d'attention qui est enjeu dans une partie de football. Comme il le dit : « les joueurs d'une équipe 32 c. Peacocke, « Joint Attention: Its Nature, Refiexivity and Relation to Common Knowledge '>'>, in N. Bilan, C. Hoerl T. McConnack et J. Roessler (eds.), Joint Attention: Communication and Other Minds, op. cit., p. 302.
MOUVEMENT ET CONSTITUTION DU SENS
167
de football guettent constamment l'attention des uns et des autres. Mais cela n'exige pas d'eux d'être engagés dans une pensée conceptuelle, ou même encore d'avoir un savoir itéré de la direction de l'attention de chaque autre joueur »33. On peut l'exprimer plus positivement en prolon geant ce que Merleau-Ponty a déjà écrit sur ce sujet. Le terrain de football n'est pas pour le joueur en action un « objet », c'est à-dire le teffile idéal qui peut donner lieu à une multiplicité indéfinie de perspectives et rester équivalent sous ses transfoffilations apparentes. Il est parcouru par des lignes de force (les « lignes de touche », celles qui limitent la « surface de réparation »), articulé en secteurs (par exemple les « trous » entre les adversaires) qui appellent un certain mode d'action, la déclenchent et la portent comme à l'insu du joueur. Le terrain ne lui est pas donné, mais présent comme le teffile immanent de ses intentions pratiques ; le joueur fait corps avec lui et sent, par exemple, la direction du « but » aussi immé diatement que l'horizontale et la verticale de son propre COrpS.34
Nous avons ici une description montrant comment les intentions et les actions du joueur sont détenninées par l'environnement physique et la nature du jeu auquel il joue. Contrôler la balle sur ce terrain et conce voir la stratégie qui nous fasse parvenir au but ne sont pas des choses accomplies seulement par l'esprit du joueur, mais forcément des proces sus qui se présentent à même le terrain depuis la perspective du joueur, en tant qu'il a une position et qu'il se déplace sur la surface de jeu. Mon contrôle du ballon est accompli par le mouvement que découvre le contexte particulier de l'ici-et-maintenant, sur-ce-terrain alors-que-je cours-et-botte, alors que les lignes sur le terrain surgissent et s'éloignent au gré de mes propres mouvements. C'est là une interprétation très éco logique (Gibson aurait été dans l'équipe de Merleau-Ponty à cet égard). Toutes les affordances se présentent dans les lieux qui connectent mon mouvement incarné au terrain précisément défini dans le contexte du jeu. Comme Merleau-Ponty le recOllllaît, le terrain n'est pas dépourvu d'autres joueurs. Et la plupart d'entre eux sont clairement en relation d'attention conjointe avec celui qui contrôle le ballon. Tous sont attentifs, entre autres, au ballon, et le joueur sait qu'ils le sont ; et tous savent qu'il le sait, et ainsi de suite. Au-delà de cela, les intentions de tous les joueurs sont assez transparentes et détenninées par le contexte et les règles du jeu. Il n'est pas nécessaire de faire recours à une théorie de l'esprit ici ; je n'ai pas à inférer quoi que ce soit sur tes attitudes propositionnelles si
33 J. Campbell, « Joint Attention and Connnon Knowledge '>'>, art. cit., p. 245. 34 M. Merleau-Ponty, La structure du comportement, Paris, PUF, 1949, p. 182-183.
168
SHAUN GALLAGHER
tu portes un dossard de couleur différente. Je n'ai pas à me mettre à ta place et à élaborer quelques présumées croyances pour connaître tes intentions. Tes intentions spécifiques sont suffisamment transparentes dans la manière que tu as de t'avancer vers moi ou de te positionner entre moi et le but. Mes intentions-en-actions (comment je vais mettre en œuvre mon intention de marquer un but) sont détenninées non seu lement par les règles du jeu et les tactiques que j'ai choisies, mais tout autant par toi et par mes coéquipiers, ainsi que par les lignes sur le terrain. Comme Hobson le propose dans le contexte développemental, autrui offre, ou non, des prises pour l'action (affordances), tout comme le terrain35. Et comme l'affinne Merleau-Ponty, ma conscience de tout cela peut tout au plus rattraper mes actions alors que je bouge de telle ou de telle façon. Dans ce cas, l'attention conjointe se résume complètement à la per ception, au contexte et au mouvement. De plus, ma compréhension d'au trui sur le terrain de football est pragmatique au sens d'un savoir-faire plutôt que d'un savoir propositiOllllel. C'est un savoir adapté pour l'ac tion et l'interaction avec les autres joueurs. Les tenants de la théorie de la théorie pourrait bien contester que tout cela présuppose une théorie énonçant les actions des joueurs de football auxquelles on doit s'attendre. Il n'est pas évident selon moi qu'une telle théorie entre dans la compré hension pragmatique qui m'aide à constituer la signification du compor tement de l'autre. On apprend le football par la pratique et en jouant ; et c'est en fonction de cette pratique qu'on en vient à comprendre les actions précises des autres joueurs sur le terrain, plutôt que dans les tenues d'une théorie générale. Lorsque je botte le ballon, et que je tente de contourner un joueur adverse, je ne le fais pas en théorisant à propos de son état mental. Bien plutôt, je m'engage dans des actions conjointes élémentaires avec lui, c'est-à-dire que j 'entre dans un état d'attention conjointe en le percevant et en me déplaçant de telle ou de telle manière alors que, mutatis mutandis, il fait de même, bien qu'en bougeant diffé remment par rapport à moi. Ma compréhension pragmatique n'est pas un accomplissement idéa tionnel ou intellectuel. Il y a un usage du tenue « compréhension » chez Heidegger qui s'approche du sens que nous lui donnons ici. De la même manière que le terrain n'est pas un objet - quelque Vorhanden - sur lequel j 'aurais à cogiter, les autres joueurs ne sont pas de prime abord des 35 R. P. Hobson, « Autism and the Self '» , in S. Gallagher (ed.), Oxford Handbook of the Self, Oxford, Oxford University Press, 2011.
MOUVEMENT ET CONSTITUTION DU SENS
169
persOlllles que j'observe du point de vue de la troisième personne pour les jauger en tant qu'adversaires. Au contraire, l'autre joueur est quelqu'un avec qui j 'interagis déjà, en tant qu'il facilite ou entrave le but que je souhaite marquer. Je suis en rapport avec le ballon et le terrain comme des Zuhandenen - un ensemble de possibilités à portée de la main (ou, dans le cas qui nous occupe, « à portée du pied »). Les autres joueurs prennent place auprès de ce type d'implications pragmatiques.
La constitution participative du sens On pourrait cependant objecter que les façons d'agir sur un terrain de football sont plutôt limitées par rapport à ce qu'il y a à comprendre pour interagir intersubjectivement. Les intentions d'un joueur sont, dans un tel contexte, portées à même son dossard pourrait-on dire ; les mou vements ont des objectifs bien définis, même s'ils sont parfois prodigieu sement complexes. Ce n'est alors pas un grand défi d'élaborer des modèles d'attention conjointe, ou de comprendre la cognition sociale. Mais je crois que cela s'applique également à plusieurs autres situations humaines, circonscrites par le temps, le lieu et les usages. On sait par exemple que les choses changent du tout au tout lorsque, après une partie, nous sortons boire quelques verres. Cela inclut nos rela tions immédiates avec les autres. Nous continuons à nous engager avec eux par l'attention conjointe de façon pragmatique ou spécifiquement sociale. Le jeu n'est plus le même, les règles non plus : en revanche, les aptitudes élémentaires de l'intersubjectivité première et de l'intersubjec tivité secondaire, incluant l'attention conjointe, continuent à nous donner accès à la signification véhiculée par une autre personne. Même dans le bar bruyant où je peux avoir bien du mal à entendre ce que mon coéqui pier souhaite dire, je peux tout de même suivre son récit et participer à la conversation grâce aux gestes, aux expressions faciales, aux ajuste ments de sa posture, aux intonations de sa voix, et ainsi de suite. Même dans notre rencontre très brève et pourtant très significative avec la ser veuse, elle semble comprendre nos intentions, nos désirs et notre grati tude sans peine, même s'ils ne sont exprimés que par des gestes - toutes des actions communicationnelles qui impliquent l'action conjointe élé mentaire consistant à joindre son attention. Bien que le problème de la cognition sociale (comment nous com prenons les autres) et celui de la constitution participative du sens (com ment nous comprenons le monde qui nous entoure avec ou par les autres)
170
SHAUN GALLAGHER
soient très apparentés, ils sont en fait deux problèmes différents36• Di Paolo et De Jaegher définissent la constitntion participative du sens sur la base d'une constitution plus élémentaire du sens où les échanges énactifs avec le monde sont intrinsèquement signifiants3? Cependant, ils font remarquer, non sans importance, que la constitution du sens ne se produit pas simplement par le moyen d'un mouvement énactif, incarné, mais aussi par l'interaction de coordination avec les autres, qui est pré cisément lUle constitution partic pative i du sens. De Jaegher et Di Paolo se sont toutefois plaints que le concept de constitution participative du sens soit tout simplement absent même des interprétations de la cognition sociale insistant sur le corps, et ont affinné que de telles interprétations pourraient être améliorées si elles étaient réorientées pour rendre compte de ce problème. Leur objectif est en ce sens de « repenser le problème de la cognition sociale comme étant celui de comprendre comment la signification est générée et transfonnée par le jeu entre le déploiement du processus d'interaction et les individus qui y sont engagés »38. Ainsi, ils s'intéressent à comment les aspects de l'interaction sociale affectent la façon que les participants ont de se comprendre entre eux ; par exemple, comment, dans un dialogue, les attributions d'émotions sont influencées par des délais de nature temporelle ou réciproquement construits39 - ce qui est à leurs yeux un exemple de constitution participative du sens40. J'ai soutenu qu'il était beaucoup plus juste de dire que la constitu tion participative du sens est un problème apparenté, mais distinct, de celui de la cognition sociale. La constitution participative du sens rend compte de la façon par laquelle l'interaction intersubjective contribue à la constitution de la signification et, plus généralement, à la co-constitution du monde en tant qu'il est signifiant. La question à laquelle la constitution participative du sens fait face est : comment, tous ensemble, dans un pro cessus social, nous constituons la signification du monde ? En revanche, le problème de la cognition sociale s'articule autour de la question : comment comprenons-nous une autre personne ? Certes, on peut continuer à affirmer que ces problèmes sont étroite ment liés. D'une part, le problème de la constitution participative du sens 3 6 s. Gallagher, « Two Problems of Intersubjectivity '>'>, art. cit. 37 H. de Jaegher & E. Di Paolo, « Participatory Sense-Making: An Enactive Approach to Social Cognition '>'>, art. cit. 3 8 Ibid., p. 485. ;9 IbUi., p. 497-498. 40 Voir aussi T. Fuchs & H. de Jaegher, « Enactive Intersubjectivity: Participatory Sense-making and Mutual Incorporation '>'>, Phenomenology and the Cognitive Sciences, 8, 2009, p. 465-486.
MOUVEMENT ET CONSTITUTION DU SENS
171
est le plus général, il peut inclure celui de la cognition sociale dans la mesure où, si nous tentons de dOlllel r du sens au monde, ce monde inclut alors d'autres personnes. À cet égard, la compréhension des autres peut faire partie de la constitution participative du sens, à condition qu'en don nant sens aux autres, nous nous engagions aussi avec eux, ou avec d'autres, dans des situations d'interactions ou dans des actions conjointes dirigées vers le monde. D'autre part, et plus fondamentalement, cette relation se laisse comprendre en sens inverse. En effet, notre compréhension du monde est modelée par nos interactions avec les autres et la compréhension que nous avons d'eux, de comment ils agissent dans le monde, de comment ils réussissent à s 'accorder ou non sur la valeur de certains objets, et ainsi de suite. On peut par conséquent hiérarchiser ces problèmes, en ceci que, dans l'ensemble, la constitution participative du sens semble présupposer que je peux donner du sens à une autre personne dans nos interactions41. Malgré l'étroite relation entre ces deux problèmes, il faut faire men tion de ce qui les distingue. Cette différence se résume à celle de leur cible respective : dans le cas de la constitution participative du sens, cette cible est le plus souvent le monde ; dans le cas de la cognition sociale, c'est plutôt d'autres agents ou personnes. Comprendre une autre personne est assez différent de comprendre un outil, un objet, un événement mondain, etc., et, de fait, même percevoir une autre personne est différent de per cevoir un outil ou un objet42. Donner ensemble sens au monde (avec une autre personne) n'équivaut pas à donner sens à une autre personne dans le cadre d'une relation interactive, même si cette relation interactive met elle-même en jeu la constitution participative du sens. Un processus peut bien contribuer à l'autre et, en effet, les deux processus dépendent de l'interaction. La constitution participative du sens implique l'interaction avec les autres et l'attention conjointe et c'est par l'interaction et à travers des situations d'attention conjointe que la signification du monde peut émerger. En un sens, dans la mesure où l'interaction intersubjective est en jeu à la fois dans la cognition sociale et dans la constitution participative du sens, nous nous trouvons face à deux questions différentes dont les réponses partagent un noyau commun. La proximité de ces problèmes apparaît peut-être mieux dans les exemples d'attention conjointe et d'in tersubjectivité secondaire où notre aptitude à voir et à interagir avec les autres dans le cadre de nos rapports quotidiens avec le monde - alors que 4 1 Cela est particulièrement évident dans H. de Jaegher & E. Di Paolo, « Participa tory Sense-Making: An Enactive Approach to Social Cognition '>'>, art. cit. 42 S. Gallagher, « Inference or Interaction: Social Cognition Without Precursors '>'>, Philosophical Explorations, 1 1 , 3, 2008, p. 163-73.
172
SHAUN GALLAGHER
nous utilisons des objets et manoeuvrons en lui - nous aide à comprendre leurs intentions, leurs sentiments, leurs attitudes, leurs dispositions, et ainsi de suite. Nous pouvons concevoir les aptitudes acquises dans le cadre de l'attention conjointe et de l'intersubjectivité secondaire comme des contributions à la façon dont nous donnons ensemble sens au monde. L'analyse des interactions sociales dans les activités partagées, les actions conjointes, le travail fait en commun, les pratiques de communi cation, etc.43 montre que les agents coordOllllent leurs mouvements, leurs gestes et leurs actes de langage à des niveaux moteurs qui ne sont pas sans rappeler ceux qui sont en jeu dans une partie de football. Dans la conunu nication, alors que nous écoutons l'autre personne, nous coordOllllons l'enchaînement de nos perceptions et de nos actions ; nos mouvements sont solidaires des changements en vélocité, en direction et en intonation dans les mouvements et le discours de l'autre personne. Nos mouvements se synchronisent le plus souvent en écho aux autres, en fonction de leur comportement synchronisé ou décalé, en une covariation rythmique de gestes et d'expressions faciales ou vocales44. Les études en psychologie du développement montrent la naissance précoce de cette synchronisation (timing) et de cette coordination dans le contexte intersubjectif, et font valoir son importance. Ce type d'interactions engage certes la coordina tion, mais pas une synchronisation parfaite. Des études montrent que les enfants âgés de trois mois qui ne sont pas atteints d'autisme préfèrent de légères modulations (c'est-à-dire certains délais temporels) et des événe ments imparfaits dans les réponses45. Le processus est mené par des mou vements continus, qui sont synchronisés, désynchronisés, ou dans un état intennédiaire entre les deux. L'ajustement, la perte d'ajustement et son rétablissement maintiennent à la fois la différenciation et la connexion. Il faut surtout noter que l'interaction va au-delà de chacun des participants ; il en résulte quelque chose - la création de la signification - qui excède ce que chaque individu pris isolément pourrait apporter au processus. S'il n'y
43 J. Issartel, L. Marin & M. Cadopi, « Unintended Interpersonal Coordination: "Can we march to the beat of our own drum?" '>'>, NeuroscienceLetters, 411, 2007, p. 174179 ; A. Kendon, Conducting Interaction: Patterns of Behavior in Focused Encounters, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 ; J. Lindblom, « Minding the Body: Interacting Socially through EmbodiedAction '>'>, Link6ping, Link6ping Studies in Science and Technology, Dissertation 1 1 12, 2007. 44 T. Fuchs & H. de Jaegher, « Enactive Intersubjectivity: Participatory Sense making and Mutual Incorporation '>'>, art. cit. 45 G. Gergely, « The Obscure Object of Desire: "Nearly, but clearly not, like me": Contingency Preference in Normal Children versus Children with Autism '>'>, Bulletin of the Menninger Clinic, 65, 2001, p. 411-26.
MOUVEMENT ET CONSTITUTION DU SENS
173
a pas d'interaction, on peut bien dire qu'il n'y a que deux individus ; mais si deux individus interagissent, on est présence de quelque chose de plus, de la même façon que lorsque deux perSOlllles dansent le tango, quelque chose de dynamique est créé, que ni l'un ni l'autre pourrait produire seul. À cet égard, l'interaction instaure quelque chose de nouveau, ou du moins quelque chose qui dépasse ce que chaque individu pourrait appor ter au processus - au même titre que le tango ou la partie de football donnent lieu à quelque chose de plus que ce qu'y apporte chaque danseur ou joueur individuellement. Cela renvoie en fait à un aspect hennéneutique élémentaire de l'interaction : l'interprétation de l'autre personne, ou du monde avec ou à travers l'autre personne, excède toujours le processus immanent à l'agent pris isolémenf"6. Par conséquent, des interactions maintenues et répétées construisent « une connaissance relationnelle implicite » et accroissent la possibilité d'une plus grande fluidité et d'une plus grande flexibilité pour les interactions réussies futures47. Au bar, comme au football, ou plus généralement dans la vie, il y a, d'un côté, le cadre extérieur - le lieu physique ou architecturé, le jeu, les règles, ou tout simplement les coutumes - et, de l'autre, mes capacités cognitives et incarnées - des capacités qui émergent puis continuent à être sensori-motrices, perceptives et orientées vers l'action. Je me suis concentré ici sur le deuxième ensemble de processus, nommément sur l'attention conjointe en tant qu'action conjointe élémentaire impliquant une coordination incarnée dans des processus qui contribuent à la cogni tion sociale et à la constitution participative du sens. Ces processus s'am plifient à travers des pratiques sociales et culturelles, des entreprises régies par des règles et des institutions. C'est ce que le football a peut être déjà commencé à révéler ; il reste néanmoins beaucoup de choses à dire sur comment des pratiques de communication et des instructions peuvent se substituer à l'attention conjointe48 et comment des pratiques sociales et des institutions (par exemple, les systèmes juridiques) appuient (ou perturbent) nos engagements cognitifs et existentiels49
46 s. Gallagher, Henneneutics and Education, Albany, SUNY Press, 1992. 47 H. de Jaegher & E. Di Paolo, « Participatory Sense-Making: An EnactiveApproach to Social Cognition '>'>, art. cit., p. 496. 48 A. Fiebich & S. Gallagher, « Joint Attention in Joint Action '>'>, art. cit. 49 S. Gallagher & A. Crisafi, « Mental institutions '>'>, Topoi, 28, 1, 2009, p. 45-5 1 .
CE QUI AURAIT PU ÊTRE FAIT. SUR LE STATUT CONTREFACTUEL DE L'ACTION DANS LA THÉORIE DE LA PERCEPTION D'ALVA NOË
Gunnar DEcLERcK
Introdnction ! Pour les théories contrefactuelles de la perception, l'expérience per ceptive repose sur des principes conditionnels de la fonne si P était le cas, alors Q serait le cas, où P et Q sont des énoncés contrefactuels sur des états de choses passés, présents ou futurs. Ainsi, lorsque nous perce vons des objets spatiaux (des choses ou des événements localisés dans l'espace : la tasse de café sur la table, un bruit de pas en provenance de l'étage), nous anticipons que si les conditions de perception, dans ce cas notre position vis-à-vis de l'objet, étaient différentes, alors l'aspect que présente l'objet, ce dont il a l'air (ou la manière dont il « sonne »), serait également différent. Ces attentes sont partie intégrante de notre appréhen sion de l'objet en tant que spatial : sans elles, on ne pourrait avoir ce type de perception. La théorie actionniste de la perception défendue par Alva Noë appar tient sans conteste à cette famille de théories2. Selon Noë, l'expérience perceptive ne dépend pas seulement de ce qui est le cas (dans le monde ou dans notre boîte crânieIllle) au moment où l'on fait cette expérience, Elle dépend également de ce qui serait et peut être le cas dans la suite de notre expérience. La conscience perceptive est engagée envers des possi bilités : ce que l'on perçoit dépend d'affinnations contrefactuelles à propos de ce que l'on pourrait percevoir. Pour Noë, cette compréhension engage 1 Je remercie Sylvain Camilleri et Jean-Sébastien Hardy pour leur lecture attentive et leurs commentaires sur cet article. 2 Voir notamment R. Hickerson, « Perception as Knowing How to Act: Alva Noë's Action in Perception '>'>, Philosophical Psychology, 20, 4, 2007, p. 505-5 17 ; A. K. Seth, « A Predictive Processing Theory of Sensorimotor Contingencies: Explaining the Puzzle of Perceptual Presence and its Absence in Synesthesia '>'>, Cognitive neuroscience, 5, 2, 2014, p. 97- 1 1 8 .
176
GUNNAR DECLERCK
en outre la motricité, c'est-à-dire la capacité de se mouvoir. Percevoir nécessite de savoir ou croire ou anticiper que tel ou tel changement se produirait dans notre expérience si tel ou tel mouvement était exécuté3. Dans cet article, j 'ai un objectif et un seul : clarifier le statut modal de l'action en tant qu'il s'agit d'un élément supposément constitutif de la perception. Si l'expérience perceptive implique des conditiOllllels contrefactuels où des possibilités motrices ont fonction d'antécédent, de quel type de possibilités s 'agit-il au juste ? C'est uniquement dans cette perspective que je discuterai la théorie de Noë. Je prêterai tout particu lièrement attention à l'affirmation selon laquelle la disponibilité senso rimotrice des parties ou aspects de l'objet pour le moment hors d'accès (ce que Noë appelle ses « aspects absents ») est ce qui explique leur présence perceptive, à savoir la « conviction » ou le « sentiment » que ces aspects sont là bien que, à proprement parler, nous ne soyons pas en train de les percevoit+. En quel sens cette disponibilité doit être comprise est un problème en soi. En particulier, implique-t-elle de pouvoir effec tivement réaliser le mouvement ? Ou bien renvoie-t-elle à une simple possibilité de droit, quelque chose qui pourrait en principe être fait, mais se trouve peut-être irréalisable en ce moment, pour telle ou telle raison contingente ? 3 A. Noë, « Understanding Action in Perception: Replies to Hickerson and Keijzer '>'>, Philosophical Psychology, 20, 4, 2007, p. 531-538, p. 533. 4 Il faut garder à l'esprit que le terme « aspect l'> peut être compris de différentes manières. Quand on parle de 1'« aspect l'> de quelque chose, on peut se référer à (a) l'appa rence qu'un objet (ou telle de ses propriétés) présente à un instant donné, la façon dont il apparaît. Dans l'expérience visuelle, la forme d'un objet présente différents aspects (elle apparait différemment) selon la manière dont l'objet se trouve orienté par rapport à nous. La notion de profil (Abschattung) chez Husserl correspond vraisemblablement à ce sens du terme « aspect l'>. Mais un « aspect l'> de quelque chose peut également renvoyer à (b) ses propriétés, comment cette chose est faite, par exemple le fait qu'elle possède une face arrière ou soit rigide. Pris dans ce second sens, un même aspect d'un objet peut apparaître de différentes manières, c'est-à-dire présenter différents aspects (au premier sens) en fonction des circonstances de perception. Lorsque je perçois le dessus du tabou ret de différentes perspectives, c'est le même aspect du tabouret que je perçois, à savoir sa smface supérieure, mais cet aspect présente différents aspects selon l'angle et la dis tance. Ces deux sens du terme « aspect l'> correspondent en outre à deux manières dont le verbe « sembler l'> peut être utilisé. Quand on voit quelque chose, on peut dire de ce quelque chose qu'il semble A (par ex. rectangulaire) pour dire qu'il semble être A : il a l'air de posséder la propriété A. Mais on peut aussi dire qu'il semble A (par ex. trapézoïdal) pour dire que dans les circonstances présentes (par exemple à cette distance et dans cette orientation) l'objet présente la même apparence que s'il était A, bien qu'il ne soit pas A. L'objet a l'air (d'être) A, mais en réalité il n'est pas A. Voir J. L. Austin, Le langage de laperception (1962), trad. ft. P. Gochet & B. Ambroise, Paris, Vrin, 2007, chap. III et IV ; R. M. Chisholm, Perceiving. A philosophical study (1957), Ithaca & London, Comell University Press, chap. IV.
CE QUI AURAIT PU ÈmE FAIT
177
Après avoir rappelé les principales thèses de la théorie de Noë (Section 1), j 'indiquerai certaines difficultés que soulève son traitement des possibilités d'action (Section II). Je me concentrerai sur la version la plus récente de sa théorie, à savoir l'approche actionniste5, mais je me référerai à l'occasion à des versions antérieures6. A partir d'une analyse de Husserl, je présenterai ensuite une proposition qui - à mon sens fournit une description acceptable du statut modal et du rôle contrefactuel joué par les possibilités motrices dans la perception (Section III). La phénoménologie de Husserl, marquée elle aussi par une approche réso lument contrefactuelle de l'expérience perceptive, offre selon moi de sunnonter les difficultés auxquelles se confronte la théorie actiOlllliste.
1. Affirmations cardinales de la théorie actionniste. La présence comme accès La théorie actionniste vise à établir une explication générique du phénomène de présence, qui vaut pour la perception, mais également pour d'autres modalités intentionnelles? Le titre de l'ouvrage de Noë Varieties afPresence - y insiste déjà, les fonnes de présence sont variées, la présence perceptive n'étant qu'une variété possible panni d'autres. Tout quelque chose sur lequel nous sommes dirigés intentionnellement jouit d'une fonne de présence, est d'une façon ou d'une autre « là » pour nous. Ce que je perçois est toutefois présent d'une autre façon que ce à quoi je pense ou ce dont je parle. La thèse directrice de l'actionnisme est 5 A. Noë, Varieties of Presence, Cambridge, Massachusetts & London, Harvard University Press, 2012. 6 J. K. O'Regan & A. Noë, « A Sensorimotor ACCOllllt of Vision and Visual Con sciousness '>'>, Behavioral andBrain Sciences, 24, 5, 2001, p. 939-973 ; A. Noë, Action in perception, Cambridge, Massachusetts & London, MIT Press, 2004. 7 La théorie actionniste est une version amendée de la théorie sensorimotrice (ou enactive) défendue par O'Regan & Noë (2001) et Noë (2004), dont elle reprend en partie les affinnations. Autant que je puisse en juger, les principales différences sont que : (a) la notion d'accès joue un rôle beaucoup plus important dans la théorie actionniste que dans la théorie sensorimotrice ; (b) l'ambition explicative est plus large : la théorie action niste vise à rendre compte des mooalités intentionnelles en général, pas uniquement de la perception ; (c) alors que la théorie actionniste semble exclusivement s'appuyer sur une approche en première personne de la perception, la théorie sensorimotrice convoque des éléments de description relevant d'une approche en troisième personne ; en particulier, les « sensations " auxquelles réfèrent les « contingences sensorimotrices " doivent vraisembla blement être comprises comme des événements purement physiques (des « stimulations " ou des « inputs sensoriels ,,), non comme une composante ou couche de l'expérience perceptive.
178
GUNNAR DECLERCK
que les différents modes de présence des objets s'expliquent par les dif férents modes d'accès à ces objets, en particulier le type d'aptitudes (skills) devant être mobilisé pour ménager cet accès8. Ces modes d'accès déterminent également le degré de présence des objets : à quel point ils sont « là »9. L'affinnation de Noë que la présence dépend de manière essentielle de nos possibilités de mouvement vaut exclusivement pour la perception : le mouvement est constitutif de la présence perceptive, mais pas d'autres fonnes de présence. Une autre thèse centrale de la théorie actionniste est que l'accessi bilité est ce qui pennet que des aspects des objets et de l'environnement que, au sens strict, nous ne percevons pas (mais pourrions percevoir), possèdent néanmoins une fonne de présence. Faire l'expérience que quelque chose est présent dans la perception n'implique pas, à propre ment parler, d'accéder à lui, le voir, le toucher ou l'entendre. L'essentiel de ce qui est présent pour nous à chaque instant ne fait précisément pas l'objet d'un tel accès. Les faces cachées des objets, les aspects et détails de l'envirOllllement auxquels nous ne prêtons pas attention l O, sont pré sents perceptivement. « [Ils] appartiennent au champ de notre conscience perceptive, bien qu'ils soient, de façon manifeste, hors de vue, dissimu lés, cachés, ou absents. Ils sont présents dans l'expérience - ils sont là - bien qu'ils soient absents au sens d'hors de vue. C'est précisément 8 Voir A. Noë, « Experience without the Head '>'>, in T. Gendler & J. Hawthorne (eds.), Perceptual Experience, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 411-433 : « The modality of presence -whether the presence is perceptual or merely thought (as it were), or whether it is visual, or tactile, say- is explained by the different kinds of access required, and by the different sorts of skills needed to secure access '>J. 9 A. Noë, Varieties ofPresence, op. cit., p. 112. 10 Je préfère laisser de côté la thèse de Noë sur la constance perceptive (voir par ex. A. Noë, Varieties of Presence, op. cit., p.17-18), et me focaliser exclusivement sur la présence des aspects absents. Il y a à mon sens une grande différence entre être conscient que la même propriété (ou partie) peut présenter différents aspects dans différentes circons tances, et être conscient que d'autres propriétés (ou parties) du même objet peuvent être perçues. Dans le premier cas, on perçoit la même chose sous différents aspects ; dans le second, on perçoit différents aspects d'une même chose. Et quand la fenêtre, vue de côté, a l'air trapézoïdale (A. Noë, Varieties of Presence, op. cit., p.21), sa forme (en réalité rectangulaire) n'est pas cachée ou hors d'accès au même sens que la face arrière de la tomate ou la chambre à l'étage. Rien ici ne semble en fait justifier l'affina n tion que la forme serait cachée et pourrait être découverte. Jusqu'à preuve du contraire, le phénomène de présence des parties ou détails hors d'accès et le phénomène de constance perceptive sont des problèmes différents, qui demandent des traitements différents. Voir J. Trigg, « Review of 'Varieties of Presence' '>J, Essays in Philosophy, 14, 2, 1 1 , 2013, p. 303-322, p. 309, et J. J. Drummond, « The Enactive Approach and Perceptual Sense '>J, manuscrit non publié (http://faculty.fordham.edu/drummond/Drummond), p. 22-23, qui pointent une difficulté semblable.
CE QUI AURAIT PU ÈmE FAIT
179
en tant qu 'absents qu'ils sont présents. »11 Ce que les choses que nous percevons semblent être intègre une référence à la présence de ces élé ments non perçus. C'est (entre autres choses) la possession d'une face arrière qui procure à cette tomate que voilà l'aspect d'une chose tridi mensiOllllelle12. Cette face arrière n'est pas quelque chose que nous voyons, mais en percevant la tomate comme un objet tridimensionnel, doté d'une épaisseur (et non comme une simple façade), nous avons une conscience visuelle (visual sense) de la présence de cette face arrière. La présence de la face arrière est pour ainsi dire présupposée par l'aspect tridimensionnel de la tomate. La question, dès lors, est la suivante : com ment ces parties ou aspects que nous ne percevons pas peuvent-ils être présents perceptivement alors que, précisément, nous ne les percevons pas ? Comment pouvons-nous voir plus que ce que nous voyons effecti vement13 ? C'est ce que Noë appelle l'énigme de la présence perceptive, énigme à laquelle selon lui toute théorie générale de la perception se doit d'apporter une réponse14. Celle que Noë propose dans Varieties ofpresence tient tout entière dans le principe de présence comme accès, que l'on peut synthétiser comme suit1S : 1.
11.
Pour jouir d'une fOfile de présence perceptive, ce à quoi nous ne sommes pas en train d'accéder à ce moment précis doit être appréhendé comme quelque chose à quoi nous pourrions accéder, autrement dit comme dispo nible. Appréhender quelque chose comme potentiellement accessible dans la per ception nécessite de posséder un savoir sensorimoteur (sensorimotor knowledge), variété de savoir-faire (know how) dont l'exercice pefilet d'anticiper que si nous réalisions telle action, tel changement se produirait dans le contenu sensoriel16 de notre expérience.
Il A. Noë, Varieties ofPresence, op. cit., p. 15-16. Je traduis. 12 A. Noë, Varieties ofPresence, op. cit., p. 16. l3 A. Noë, Action in Perception, op. cit., p. 33. 14 A. Noë, Varieties ofPresence, op. cit., p. 18. 1 5 Voir par ex. A. Noë, Varieties ofPresence, op. cit., p. 19-20. 16 Le statut de la sensation dans la théorie actionniste reste ambigu. Bien que Noë semble avoir en vue le contenu sensoriel de l'expérience, il continue de faire usage de l'expression « stimulation sensorielle " (voir par ex. A. Noë, Varieties ofPresence, op. cit., p. 78), qui véhicule une caractérisation en troisième personne de la sensation : générale ment, cette expression est utilisée pour référer à l'activation des récepteurs suscitée par la distribution d'lUle énergie à leur surface, par ex. la stimulation des photorécepteurs de l' œil par la lumière. R. Briscoe privilégie une interprétation en troisième personne de ce type de la théorie actionniste. Voir R. Briscoe, « Spatial Content and Motoric Significance '>'>, AVANT Trends in interdisciplinary studies, 5, 2, 2014, p. 199-217, p. 200.
180
GUNNAR DECLERCK
Les parties ou détails que nous ne percevons pas ou auxquels nous ne prêtons pas attention sont présents perceptivement dans la mesure où nous possédons des capacités/aptitudes (abilities / skills) permettant de les amener sous le faisceau de notre perception, c'est-à-dire assurant un accès à eux, comme dit Noë. Compter sur la disponibilité de ces capacités - quoi que cela veuille dire - rend ces éléments disponibles, donc présents. Noë va cependant plus loin. Il soutient également que l'exercice de ce savoir sensorimoteur est une condition sine qua non de l'expérience d'objets proprement dits. Sans cette contribution, l'expérience ne peut acquérir de contenu représentationnel, c'est-à-dire présenter le monde comme étant de telle manière. « Pour que la simple stimulation senso rielle s'élève au rang d'expérience de quelque chose qui a lieu, il est nécessaire de comprendre les implications [the significance] de cette sti mulation. Votre performance perceptive dépend [ . . . ] de votre compréhen sion implicite des effets sensoriels du mouvement (savoir sensorimoteur [sensorimotor knowledgeJ). »17 Pour Noë, ce principe est notamment mis en évidence par les expériences d'adaptation à des lunettes à vision inver sée et les témoignages des aveugles précoces ayant subi une opération de la cataractel8. Si l'expérience n'est pas régulée par un savoir sensorimo teur, les données sensorielles ne peuvent acquérir de fonction (re)présen tatiOllllelle. Ce point peut être exprimé de la manière suivante : 111.
Dans la mesure où il confère aux aspects absents une fOffile de présence, l'exercice du savoir sensorimoteur est une condition sine qua non pour que l'expérience perceptive acquière un contenu représentationnel.
Deux autres propositions de l'approche actionniste, qui ne doivent pas être négligées, concernent finalement les différents degrés de pré sence que quelque chose est susceptible de manifester. La première concerne toutes les modalités intentionnelles :
1 7 A. Noë, Varieties ofPresence, op. cit., p. 78. Je traduis. Voir A. Noë, Action in Perception, op. cit., p.17 et p. 86 pour lUle affinnation semblable. A noter que Noë exprime parfois cette idée en tennes méréologiques, en affinnant que les objets sont appréhendés comme des touts bien que seule une partie de ceux-ci soit perçue. Voir par ex. Noë, 2004, p.60 ; voir également l'analyse du jeu de la main dans le sac dans J. K. O'Regan & A. Noë, « Experience is not Something We Feel but Something We Do: A Principled Way of Explaining Sensory Phenomenology, With Change Blindness and Other Empirical Conse quences '>'>, Proceedings of the 4th ASSC Conference in Brussels, vol. 148, 2000. 18 A. Noë, Action in Perception, op. cit., p. 4 sqq., p. 91 sqq., p. 102-103 ; A. Noë, Varieties ofPresence, op. cit., p. 79.
CE QUI AURAIT PU ÈmE FAIT IV.
181
Les capacités dont l'exercice pennet d'accéder aux objets définissent un espace d'accès ; les coordonnées des objets dans cet espace définissent leur degré de présence19.
Les capacités sensorimotrices relèvent de cette catégorie. Elles défi nissent un espace d'accès sur lequel la présence perceptive est indexée : plus un objet est accessible en tenues sensorimoteurs, plus il est présent perceptivement. Ce qui nous conduit à la seconde affinnation, cette fois propre à la perception : v.
Les coordonnées d'un objet dans l'espace sensorimoteur sont définies par (notre compréhension pratique de) la sensibilité de notre relation à l'objet20 vis-à-vis (a) de nos propres mouvements, et (b) des déplacements ou autres changements de l'objet21•
Selon (v), si l'aspect visuel de l'objet est fortement sensible aux mouvements de notre corps, par exemple de nos yeux ou de notre tête, l'objet sera pourvu d'un degré de présence perceptive important sur l'échelle de dépendance au mouvement. Si l'aspect visuel de l'objet est fortement sensible aux changements de position ou d'orientation de cet objet dans l'espace, celui-ci sera doté d'un fort degré de présence percep tive sur l'échelle de dépendance à l'objet. Des différences de sensibilité sur ces deux échelles expliquent que, dans la vision, la face avant des objets soit d'une certaine façon « plus présente » que leur face arrière, ou que les objets éloignés soient « moins présents » que ceux à proximité22. La théorie actionniste revendique une appartenance aux théories réalistes directes de la perception, et adopte en outre une position dis jonctive23. L'expérience perceptive présuppose une relation avec l'objet intentiOllllel qui ne pourrait s'établir si ce dernier n'existait pas24. Noë oppose explicitement ce réalisme aux approches représentationalistes, qui rejettent la possibilité d'un accès direct au monde. L'expérience percep tive implique un contact effectif avec le monde, c'est-à-dire avec - ce qu'on peut afortiori interpréter comme - des structures physiques ayant 1 9 A. Noë, Varieties ofPresence, op. cit., p. 112. 20 Ibid., p. 36 : « Lorsque je perçois x, les changements dans ma relation physique à X (qu'ils soient induits par mes mouvements ou par ceux de X) impactent la manière dont les choses m'apparaissent. [ . . . ] C'est précisément cette sensibilité aux perturbations provoquées par le mouvement (et l'action) qui est la marque distinctive de la conscience perceptive " . 21 Ibid., p. 22-23 et p. 36. 22 Ibid., p. 25-26. n IbUi., p. 23-24 et p. 112-1l3. 24 Ibid., p.25.
182
GUNNAR DECLERCK
une efficace causale. Ce parti-pris réaliste est bien résumé par la fonnule suivante de Noë : « nous ne percevons ce qui est que quand il est là » 25 . La présence perceptive est contrainte par l'existence et la proximité. Mais elle nécessite Ull ingrédient supplémentaire : la disponibilité, qui ne peut s'obtenir sans une cOllllaissance pratique de comment entrer en contact avec le monde, c'est-à-dire sans savoir sensorimoteur.
II. Difficultés de la théorie actionniste. Savoir accéder (et exercer ce savoir) implique-t-il de pouvoir accéder ? Un des points aveugles les plus contrariants de la théorie actionniste est lié, à mon sens, au statut modal de l'action. Le problème est le sui vant : selon Noë, les parties ou détails « hors de vue » sont présents dans la mesure où nous possédons des capacités sensorimotrices qui per mettent d'accéder à eux. Parce que nous savons (comment) accéder à eux, ils se présentent à nous comme des éléments disponibles, et pour ainsi dire « en réserve »26 . Cette disponibilité est précisément ce en quoi leur présence consiste. Cette conception soulève cependant une question : est-ce que l'action - ou la séquence d'actions, peu importe - qui pennet trait d'accéder aux aspects absents doit elle-même être disponible - ou considérée comme telle - pour que ces aspects soient appréhendés comme accessibles, et soient donc, comme l'affinne Noë, présents perceptive ment ? Noë note que l'on peut exercer notre savoir sensorimoteur sans mettre expressément en œuvre nos capacités sensorimotrices, c'est-à-dire sans engager de mouvement effectiF? Si l'action est constitutive de la présence perceptive, c'est en tant que simple possibilité, quelque chose qui pourrait être réalisé. La difficulté est que la notion de possibilité est
25 "we only perceive what there is when it is there", Noë, 2012, p.15. Je traduis. Voir également p.25. 26 On retrouve l'idée de mémoire externe, qu'on trouve chez O'Regan & Noë, « A Sensorimotor Account of Vision '>'>, art. cit.. « The outside world acts as an external memory that can be probed at will by the sensory apparatus. '>'> (p. 946). 27 Voir en particulier A. Noë, « Understanding Action '>'>, art. cit., p. 532. Comme l'affirment O'Regan & Noë (, art. cit., p. 945), pour que le sujet fasse une expérience visuelle, « sa maîtrise des lois de contingences sensori motrices [doit] être exercée maintenant '>'>, mais cet exercice n'exige pas une activité motrice explicite. Une position du même ordre est défendue par J. K. O'Regan & J. Degenaar, « "What is the Brain Doing in the Sensorimotor Theory? '>'>, Proceedings of the Symposium "Consciousness Without Inner Models? A Sensorimotor Accoun! of Wha! is Going on in our Heads", University of London, April 2, 2014, p. 3-4.
CE QUI AURAIT PU ÈmE FAIT
183
loin d'avoir un sens univoque. Être 'possible', ici, peut signifier au moins trois choses : (a) être effectivement réalisable maintenant : je pourrais voir la face arrière du fauteuil sije me levais et en faisais le tour ; et il s'avère que je peux me déplacer si l'envie m'en prend ; (b) être effectivement réalisable dans des circonstances (Plus ou moins) différentes : (bl) je pourrais voir la face arrière du fauteuil si je me levais et en faisais le tour, mais étant attaché (ou paralysé) il m'est impossible de voir cette face arrière ; (b ) je pourrais voir la face cachée de la lune si je 2 disposais d'un véhicule spatial, mais ne disposant pas d'un tel véhicule il m'est impossible de voir cette face cachée ; (c) être réalisable en principe : je pourrais voir la face arrière du fauteuil ou la face cachée de la lune si des conditions de perception appropriées étaient remplies, peu importe que je sois ou ne sois pas actuellement en capacité d'accéder à la face en question.
Un point essentiel ici est que ces différents types de possibilités présentent différents degrés de contrefactualité : le degré de contrefac tnalité est moindre en (a) qu'en (b), et moindre en (bl ) qu'en (b ). En 2 tennes de mondes possibles : les mondes possibles dans lesquels les pos sibilités du type (b) sont actualisées sont à une « distance » plus impor tante du monde actuel (c'est-à-dire sont plus dissemblables à celui-ci) que les mondes possibles dans lesquels les possibilités du type (a) sont actualisées. La même chose vaut, mutatis mutandis, pour (b ) et (b ). l 2 Quant aux possibilités de type (c), elles sont indépendantes de ce que je peux (suis capable de) faire et ne pas faire. A considérer ces différences, à quel type de possibilité Noë pense t-il lorsqu'il affinne que les aspects absents sont présents parce que nos capacités sensorimotrices peuvent nous assurer un accès à eux ? Quel genre de contrefactualité caractérise ces actions pour le moment non réa lisées mais prétendument réalisables ? Autant que je puisse en juger, Noë ne répond jamais réellement à cette question. Peut-être considère-t-il la réponse comme évidente. Dans de nombreux passages, en effet, les actions qui pennettraient d'accéder aux aspects absents sont décrites comme immédiatement disponibles. Noë explique par exemple : « La scène m'est présente comme détaillée, même si je n'en vois pas tous les détails, parce queje suis capable main tenant par l'exercice d'un ensemble d'aptitudes perceptives (perceptual skills) d'établir un contact perceptif immédiat avec ces détails. [ . . ] Mon sens de la présence du chat entier derrière la barrière consiste pré cisément dans mon savoir, ma compréhension implicite, que par un mou vement des yeux, de la tête ou du corps,je peux amener sous mon regard -
-
.
184
GUNNAR DECLERCK
des parties du chat qui sont pour le moment dissimulées. »28 Il n'y a pas à s'en étonner outre mesure : cette position est tout à fait cohérente avec le parti-pris de Noë selon lequel la présence perceptive est la disponibi lité29 En effet, quel geme de disponibilité une possibilité d'action qui serait elle-même indisponible pourrait-elle conférer aux aspects auxquels elle aurait pennis d'accéder si elle avait été disponible ? Le problème est que subordonner la présence des aspects absents à la disponibilité effec tive des actions qui offriraient d'accéder à eux s'expose à des objections évidentes, dont certaines sont indiquées par Noë lui-même. II.! Objections à la thèse que la présence des aspects absents est conditionnée par leur disponibilité sensorimotrice Une première objection - souvent discutée - est soulevée par les cas de paralysie : tout porte à croire que les sujets frappés de paralysie conti nuent de faire l'expérience de la présence d'aspects absents, bien qu'ils ne soient plus en mesure d'accomplir les actions qui pennettraient d'ac céder à eux30. Les objets que nous percevons ne sont pas réduits à de simples façades ou à des objets en image parce que nous ne pouvons plus en faire le tour pour voir leurs autres faces. On peut sans doute imaginer des stratégies pour contourner cette objection. On peut par exemple affirmer que le sujet paralysé peut tou jours être déplacé. Il peut demander à quelqu'un de l'amener derrière un objet pour en voir la face arrière. Dans cette mesure, les aspects absents 28 A. Noë, « Experience without the Heads '>'>, art. cit., p. 422,je souligne et traduis. Dans le même ordre d'idées, Noë affinne : « Généralement, notre sens de la présence perceptive du monde et de ses détails ne consiste pas dans le fait de nous représenter maintenant dans la conscience tous ces détails. Il consiste plutôt à avoir accès maintenant à ces détails, et à savoir que nous avons cet accès. '>'> (A. Noë, Action in Perception, op. cit., p. 63) ; « Nous assumons (take ourselves to) avoir accès à ces détails ,>,> (ibid., p. 57). 29 A. Noë, Varieties ofPresence, op. cit., p. 19. 3 0 Sur la phénoménologie de la paralysie, voir en particulier M. Kyselo & E. Di Paoli, « Locked-in Syndrome A Challenge for Embodied Cognitive Science '>'>, Phenome nology andthe Cognitive Sciences, 14, 3, 2015, p. 517-542. K. Pepper, « The Phenomenol ogy of Sensorimotor Understanding '>'>, in J. M. Bishop & A. O. Martin (eds.), Contempo mry Sensorimotor Theory, Dordrecht, Springer, 2014, p. 53-65. Afortiori, la description de l'expérience visuelle sous paralysie proposée dans cette section vaut lUliquement pour les cas de syndrome d'enfennement (locked-in) dits incomplets (seuls les mouvements de la tête et parlois des doigts sont préservés) et classiques (seule la capacité de mouvements oculaires verticaux et de clignement des paupières est préservée). On peut en effet douter qu'une expérience visuelle organisée soit maintenue dans les cas de syndrome d'enfenne ment complet, où plus aucun mouvement volontaire n'est possible. Pour des éléments additionnels sur ces distinctions, voir G. Bauer & E. Rumpl, E. (1979). Varieties of the locked-in syndrome. Journal ofneurology, 221, 2, 1979, p. 77-91 et S. Laureys, F. Pellas, P. Van Eeckhout et al., « The Locked-In Syndrome: What is it Like to be Conscious but Paralyzed and Voiceless? '>'>, Progress in brain research, 150, 2005, p. 495-6 1 1 .
CE QUI AURAIT PU ÈmE FAIT
185
restent quelque chose à quoi il peut accéder, et ils sont donc toujours, en un sens, disponibles. L'inconvénient de cette stratégie est qu'elle traite l'action - si on peut encore la qualifier ainsi - comme un événement purement passif, et qu'elle va dans cette mesure à l'encontre de la thèse que la perception est active et dépend de manière constitutive de la motricité. Par ailleurs, la question précédente continue de se poser : quel est le statut modal de cette possibilité d'être passivement déplacé ? Faut-il y voir une possibilité concrète pouvant effectivement s 'actualiser, et sur laquelle le sujet compte lorsqu'il perçoit son environnement (il sait ou croit ou s'attend à pouvoir être déplacé s'il le demande), ou bien s 'agit-il d'une possibilité de droit, quelque chose qui est simplement possible « en principe » ? Mais on pourrait tout à fait radicaliser l'objection précédente en imaginant une situation où l'individu est totalement isolé (mettons qu'il a été frappé de paralysie sur une île déserte), de sorte qu'être déplacé par un tiers n'est plus une possibilité effectivement réalisable ou sur laquelle il est susceptible de compter. Une seconde objection à laquelle on peut penser est que, sans faire appel à la paralysie, il existe de nombreuses situations où les actions qui pennettraient d'accéder aux aspects absents sont, de fait, irréalisables. Quelque chose nous empêche de nous déplacer autour de l'objet pour accéder à ses autres faces. Il est hors d'atteinte, trop haut, ou trop loin. Impossible d'apercevoir l'autre côté de ce véhicule qui passe à toute allure, il est déjà parti. Impossible de grimper sur le clocher de l'église pour le voir du dessus. Il ne s'agit pas là de simples cas limites : constam ment, nous sommes dans cette situation de ne-pas-pouvoir-accéder à la plupart des aspects absents des objets que nous percevons31. A considérer nos possibilités concrètes (ce que nous pouvons effectivement faire), de nombreux aspects absents qui sont présents perceptivement (c'est-à-dire potentiellement accessibles) ne sont pas disponibles. Il y a également une multitude de choses qui « ne se font pas », sont prohibées sur un plan socioculturel ou moral, et en ce sens, de nombreuses choses que l'on ne peut voir, qui sont inaccessibles perceptivement. Bien sûr, ce ne-pas pouvoir n'est pas une impossibilité physique : je pourrais voir si je trans gressais l'interdit. Mais à considérer l'emprise des nonnes sur notre comportement, ce ne-pas-pouvoir n'est pas loin d'avoir pour nous un statut aussi contraignant qu'une impossibilité proprement matérielle.
3 1 Pour un constat semblable, voir J. Trigg, « Review of 'Varieties of Presence' '>'>, art. cit., p. 317, et K. Laasik, « On Perceptual Presence '>'>, Phenomenology and the Cogni tive Sciences, 10, 4, 2011, p. 439-459, section 3.
186
GUNNAR DECLERCK
De façon analogue, il est fréquent de percevoir des sons qui dispa raissent rapidement. De fait, c'est plutôt la nonne que l'exception : la majorité des événements sonores ont un caractère évanescent. Ces sons aussi ont des aspects absents. Je sais que ce bruit étouffé de moteur en provenance de la rue me semblerait plus fort, et présenterait un autre « aspect », si j'étais à proximité du véhicule qui l'émet32. Le problème est que je ne peux effectivement actualiser ces aspects Ge ne me déplace pas assez vite). Noë mentiOlllle un point semblable avec la vision33, mais il n'en tire pas enseignement pour clarifier le statut modal de l'action en tant qu'elle conditiOlllle la présence perceptive. Un troisième argument que l'on peut avancer contre Noë, et bien plus décisif en un sens que les deux précédents, consiste à faire remarquer que, au sens strict, les possibilités d'action auxquelles les aspects absents réfèrent (autrement dit, les actions qui pennettraient d'accéder à ces aspects) ne doivent pas être considérées comme des actions qui pourraient être réalisées dans le futur, et sont peut-être, dans cette mesure, dispo nibles (on pourrait décider de les exécuter), mais correspondent à des actions qui auraient pu être réalisées maintenant, mais ne l'ont pas été. Un argument de cet ordre a notamment été mis en avant par Zahavi34 dans une analyse des mécanismes intentionnels assurant la constitution de ce
32 Il faut noter que cette affinnation concerne plus les « aspects " au sens des profils husserliens (Abschattungen) qu'au sens des propriétés ou moments objectifs de l'objet (voir la note de bas de page n04 pour cette distinction). J'appréhende le bruit de moteur comme quelque chose qui semblerait plus fort et sonnerait peut-être un peu différemment si j'étais à proximité de sa source, mais pas nécessairement comme quelque chose qui possède des propriétés pour le moment inaudibles (c'est-à-dire inaudibles d'ici). On peut cependant pointer d'autres situations où nous percevons qu'un son possède des aspects absents, pris dans ce dernier sens. Si je mets un morceau des Rolling Stones et vais dans la salle de bain où le son est fortement atténué, ne me parvient que la ligne mélodique générale, je ne peux distinguer la voix de Mick Jagger. Pollliant, je sais que la voix de Mick Jagger est en ce moment audible, et que je l'entendrais clairement sij'étais dans le salon. Ces aspects du son sont là, ils existent en ce moment, et ils pourraient être perçus si les conditions de perception étaient différentes. Ma femme, qui est assise à côté de la chaîne stéréo, les entend en ce moment. 33 « Il est possible de voir des fiashs de lumière dans de petites unités de temps où les mouvements sont impossibles. '>'> (A. Noë, « Vision Without Representation '>'>, in N. Gangopadhyay, M. Madary & F. Spicer (eds.), Perception, Action, and Consciousness: Sensorimotor Dynamics and Two Visual Systems, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 247) 34 Voir D. Zahavi, « Horizontal Intentionality and Transcendental Intersubjectivity '>'>, Tifdschrift voor Filosofie, 59, 2, 1997, p. 304-321 ; D. Zahavi, Husserl and Transcenden tal Intersubjectivity: A Response to the Linguistic-Pragmatic Critique, trans. E. A. Behnke, Ohio, Ohio University Press, 200 1 .
CE QUI AURAIT PU ÈmE FAIT
187
que Husserl appelle 1'« horizon interne » des objets, auquel les aspects présents-comme-absents de Noë d'une certaine façon correspondent. Husserl considère que lorsque l'on identifie quelque chose dans la perception, on inscrit ce que l'on perçoit sous un sens (Sinn)35 détenniné, qui nous pennet d'anticiper que la chose manifestera telle ou telle appa rence familière si tel ou tel changement se produit dans les circonstances de perception. Ce système d'expectatives est porté par 1'« horizon interne » des objets36• « Partout l'appréhension inclus, par la médiation d'un "sens" [Sinn], des horizons vides de "perceptions possibles" ; je peux ainsi me trouver chaque fois dans un système de connexions per ceptives possibles et, si je les accomplis, effectives »37. L'horizon interne est ce qui pennet d'identifier le quelque chose qui apparait comme le même et inchangé en dépit des changements dans la manière dont il apparait. Il permet ce que Husserl appelle la synthèse de recouvrement (Deckungssynthesis), qui sous-tend la conscience d'identité38. Soit mon expérience visuelle de cette chaise, que je perçois de différents endroits et dans différentes orientations lorsque je me déplace autour d'elle. L'horizon interne de la chaise contient d'avance une « description » (plus ou moins détenninée) des différents aspects sous lesquels la chaise peut se présenter lorsque je modifie ma position par rapport à elle. Parce que
35 Ce que Husserl vise exactement avec le concept de sens (Sinn) noématique dans son analyse des actes perceptifs est sujet à débat mais correspond, en gros, à la « signifi cation " avec laquelle est perçu ce qui est perçu, ce qui inclut en premier lieu l'identité sous laquelle l'objet est appréhendé : ce en tant que quoi il est perçu (comme objet maté riel, chaise, personne, animal, etc.). Voir D. Moran & J. Cohen, The Husserl Dictionary, London & New-York, Continuum, 2012, p. 233 et p. 295 sqq. La notion husserlienne de sens (Sinn) est, au moins pour les objets perceptifs, inséparable de celle d'horizon interne : être appréhendé avec tel sens, pour un quelque chose qui se manifeste, revient à se voir attribuer un horizon interne déterminé, c'est-à-dire un éventail donné de possibilités subséquentes d'apparition. 3 6 E. Husserl, Expérience et jugement. Recherches en vue d'une généalogie de la logique (1954), trad. ft. D. Souche, Paris, PUF, 1970, § 8, p. 36. Sur la notion d'horizon et sa relation avec celle de sens noématique, voir en particulier D. W. Smith & R. McIntyre, Husserl andIntentionality: A Study ofMinci, Meaning, andLanguage, Dordrecht, Springer, 1982, p. 198 sqq. 37 E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phé noménologique pures. Livre second: Recherches phénoménologiques pour la constitution, trad. ft. E. Escoubas, Paris, PUF, 1982, § 1 5b, p. 70 (je souligne). 3 8 Voir en particulier E. Husserl, Recherches logiques. Tome 3. Éléments d'une élucidation phénoménologique de la connaissance. Recherche VI, trad. ft. H. Elie, A. L. Kelkel & R. Schérer, Paris, PUF, 1963, § 8, et E. Husserl, Expérience etjugement, op. cil., § 8. Sur cette question, voir aussi K. Mulligan, « Perception '>'>, in Smith & D. W. Smith (eds.), The Cambridge Companion to Husserl, Cambridge University Press, p. 186 sqq.
188
GUNNAR DECLERCK
cet horizon interne instruit mon appréhension du comportement phéno ménal de la chaise lorsque les circonstances de perception se modifient (dans ce cas, ma position et mon orientation vis-à-vis de celle-ci), je ne suis pas surpris ou désappointé quand je vois la chaise sous un nouvel aspect, et ce que je perçois continue de se présenter comme le même objet inchangé, en dépit des changements dans les données visuelles. Percevoir quelque chose comme un X (inscrire de manière présomptive ce quelque chose sous un sens (Sinn) dOllllé) implique de s'engager envers un champ de possibilités d'apparitions détenniné pour cet objet (un horizon interne), ou, plus généralement, un type de comportement phénoménal, que l'objet manifestera si telles ou telles conditions de perception sont remplies, et qu'il doit manifester pour rester le X qu'il est présmné être. L'horizon interne fixe les conditions d'identité de l'objet : toute nouvelle apparition doit se confonner aux directives qui s'y trouvent incluses pour que l'objet perçu continue de se présenter comme identique et inchangé39. Or, Zahavi fait remarquer qu'un trait essentiel des aspects absents qui se trouvent délinéés dans l'horizon interne est qu'ils sont visés comme existant maintenant, c 'est-à-dire appréhendés comme . . pré sentt+° : « Lorsque je perçois un fauteuil, je ne perçois pas quelque chose qui, à cet instant précis, possède un aspect (profile) actuel, et qui précé demment en a possédé d'autres et en possédera d'autres dans la suite. Le devant qui est présent n'est pas un devant par rapport à un derrière passé ou futur, mais se détennine ainsi par sa référence à un derrière présent et .
39 « Ce pré-savoir est indéterminé dans son contenu, ou imparfaitement déterminé, mais il n'est jamais totalement vide, et, s'il ne s'annonçait pas déjà en elle, l'expérience en général ne serait pas expérience de cette chose-ci prise dans son unité et son identité " (E. Husserl, Expérience et jugement, op. cit., §8, p. 36, je souligne). 40 Les expressions « aspect absent ,>,> et « présent en tant qu'absent '>'>, dont Noë fait usage, sont quelque peu trompeuses à cet égard : un aspect que l'on appréhende (même implicitement) comme étant là n'est précisément pas absent. En outre, il y a un autre sens dans lequel les choses peuvent être dites présentes en tant qu'absentes, et qui est sensible ment différent, il me semble, du sens dans lequel Noë emploie l'expression. J'emprunte lUl exemple fameux de J.-P. Sartre, L 'être et le néant. Essai d'ontologie phénoménologique (1943), Paris, Gallimard, 1976, p. 44. J'attends Pierre, avec qui j'ai rendez-vous dans un bar. Pierre est en retard et j e jette régulièrement un œil vers l'entrée et la rue pour voir s'il arrive enfin. De quoi ai-je conscience lorsque je vois que Pierre n'est pas (encore) là ? Selon Sartre, c'est précisément l'absence de Pierre dont je fais l'expérience ici, son ne pas-être-là. Cette absence est lUle donnée pour ainsi dire positive, tout aussi positive que la présence de cette table devant moi. Dans cette situation, les choses peuvent être dites présentes en tant qu'absentes. Et l'expression est peut-être plus appropriée ici que pour l'appréhension des aspects cachés des objets. Les aspects cachés sont présents (ils sont là avec tout le reste et existent maintenant), mais en tant que je ne les perçois pas en ce moment.
CE QUI AURAIT PU ÈmE FAIT
189
coexistant. [ . . . ] Comme Husserl le souligne à l'occasion, toute apprésen tation rend co-présent (mitgegenwartig). »41 La présence des aspects absents ne saurait par conséquent être subordonnée à une perception future que l'on pourrait ménager. Si, comme le suppose Noë, la présence des aspects absents se fonde sur leur accessibilité sensorimotrice, l'action pennettant de ménager cet accès doit, d'une façon ou d'une autre, être connotée d'une dimension présente. Son caractère contrefactuel réfère non pas à une possibilité future, quelque chose qui pourrait avoir lieu dans le cours subséquent de notre expérience, mais à une possibilité présente, quelque chose qui aurait pu se produire maintenant, mais qui ne s'est pas produit. Ces deux statuts modaux sont très différents et ne doivent pas être confondus. On peut dès lors se demander si le genre d'action possible auquel les aspects absents renvoient peut être qualifié de « disponible » (ou même d'actua lisable) en quelque sens que ce soit. Quelque chose qui aurait pu être fait (mais n'a pas été fait) est à l'évidence au-delà de l'opposition du dispo nible et de l'indisponible, qui devient pour ainsi dire obsolète. Il est certain que la plupart des choses que nous percevons durent, elles ne présenteront aucun changement notable dans le futur proche, et ne disparaitront - seront détruites ou transfonnées - qu'après une longue période. Si l'on s'en tient à ces entités durables, les aspects qui sont présents et accessibles au temps t seront encore présents et accessibles au pas de temps suivant. La face arrière du fauteuil sera encore là dans deux minutes, deux jours, ou deux semaines. Et les énoncés contrefactuels à propos de ce qu'il aurait fallu faire pour accéder à tel aspect absent au temps t restent vrais aussi longtemps que l' obj et se maintient en l'état 4 1 D. Zahavi, « Horizontal Intentionality '>'>, art. cit., p. 308, je traduis. « The absent profiles are horizontally present '>'>, « [they are] actual co-existing profiles ,>,> (ibid., p. 307 et p.310). Cette affina n tion de Husserl ne doit pas être mal interprétée. Comme indiqué plus haut (note de bas de page n04), la notion de profil (Abschattung) et celle d'aspect, si l'on prend le tenne dans le sens de « propriété '>'>, doivent être clairement distinguées. Ce qui est appréhendé comme existant maintenant, ce sont des moments objectifs de l'objet (des « aspects ,>,> au sens de propriétés), qui peuvent eux-mêmes être perçus par profils, c'est-à-dire sous certains « aspects '>'>, dès lors que certaines conditions de perception se voient remplies. Cela a un sens de dire que d'autres propriétés que celles auxquelles j'accède en ce moment existent (l'arrière du fauteuil est là lorsque je vois le devant) ; mais cela n'a pas de sens de dire que les aspects sous lesquels ces propriétés se présenteraient si elles étaient perçues existent en ce moment : on peut certainement dire que ces aspects sont actualisables, et qu'ils seraient actualisés si des conditions de perception appropriées étaient remplies ; mais affinner qu'ils existent en ce moment est, il me semble, un abus de langage. Voir G. Declerck, G. « Absent Aspects, Possible Perceptions and Open Inter subjectivity: A Critical Analysis of Dan Zahavi's Account of Horizontal Intentionality ,>,>. Journal of the British Society for Phenomenology, 1-21, 2018.
GUNNAR DECLERCK
190
(continue d'exister et demeure inchangé). Ce qui aurait pu être fait pour accéder à tel aspect absent est quelque chose qui continue de pouvoir être fait pour accéder à ce même aspect. Cette accessibilité, cependant, est une simple conséquence pratique de la présence continuée des aspects absents, elle la présuppose et ne saurait l'expliquer : la possibilité d'accé der maintenant aux aspects absents, à laquelle est supposée renvoyer leur présence, ne peut être dérivée du fait qu'ils restent accessibles - lorsque c'est le cas - dans le cours ultérieur de notre expérience. 11.2 Réponses que la théorie actionniste pourrait faire aux objections précédentes et raisons pour lesquelles ces réponses ne suffisent pas Les éléments précédents compromettent l'idée de présence comme accès : la plupart des aspects qui sont présents sans faire l'objet d'une perception effective ne sont précisément pas accessibles. On peut dire, au mieux, qu'ils sont accessibles en principe : même si enfait je ne peux accéder à eux,} 'aurais pu si les circonstances avaient été différentes, ou peut-être que d'autres auraient pu accéder à eux. Comme l'explique Hus serl : « Ce que je ne vois pas d'un corps est par principe perceptible pour moi : court ainsi un remplissement possible, une possibilité principielle qui n'est pas, assurément, une possibilité "de fait". Le sommet du Chim borazo est doté d'un point de vue qui est pour moi dans les faits inacces sible, mais en principe, ce point de vue correspond pour moi à une somme de perceptions possibles ».42 Affinner que la présence des aspects absents dépend de leur disponibilité sensorimotrice est par conséquent insuffisant. Les possibilités d'action auxquelles les aspects absents réfèrent pré sentent à l'évidence un degré de contrefactualité plus élevé. Le problème est que gérer ce type de contrefactualité dans le cadre actionniste apparaît difficile compte tenu des principes mêmes sur les quels s'établit cette approche. Renoncer au requisit de disponibilité de l'action entre en conflit avec l'affinnation directrice que Noë se propose de défendre dans son explication de la présence perceptive, à savoir l'équation présence disponibilité43. La thèse que le savoir sensorimo teur est ce qui procure aux aspects absents leur caractère de disponibilité ne semble recevable que si l'action qui pennettrait de ménager cet accès est elle-même disponible. J'ai la conviction tacite de pouvoir effectuer l'action (si je le décide), et c 'est pourquoi les aspects hors de vue jouissent =
42 E. Husserl, Sur l'intersubjectivité, t. l, trad. ft. N. Depraz, Paris, PUF, 2001, p. 58-59 « L'empathie. Textes de l'année 1909» . 43 A. Noë, Varieties ofPresence, op. cit., p. 19.
CE QUI AURAIT PU ÈmE FAIT
191
d'une fonne de présence. Mais si l'action procurant cet accès n'est pas quelque chose que je pense pouvoir faire, plus rien ne parait justifier ce crédit phénoménologique. Si l'action est indisponible, pourquoi les aspects auxquels elle pennettrait d'accéder si elle était disponible devraient-ils conserver leur caractère de disponibilité ? On peut avancer plusieurs réponses pour tenter de justifier cette affinnation. Mais, nous allons le voir, aucune ne pennet d'échapper tota lement à la difficnlté. 11.2.1 Les aspects absents restent accessibles en pensée Une première réponse consiste à faire valoir que lorsque des aspects absents sont inaccessibles parce que l'action qui pennettrait d'accéder à eux ne peut en fait être réalisée, la présence de ces aspects est maintenue sous fonne de présence-en-pensée (thought presence). Les aspects absents sont inaccessibles sur un plan sensorimoteur, mais ils restent accessibles par la pensée. Bien que cette réponse - autant que je le sache - n'ait pas été explicitement défendue par Noë (qui semble concentrer sa défense sur la distinction entre savoir sensorimoteur et capacités sensorimotrices voir infra, section 11.2.3), elle est en accord avec son affinnation qu'il existe une fonne de continuité entre certains (pas tous, comme nous le verrons) modes de présence-en-pensée et la présence perceptive, affinna tion que résume bien l'idée selon laquelle la pensée est parfois une sorte de perception élargie (extended perception)44 . Cette première réponse s'expose selon moi à plusieurs objections. Il faut tout d'abord remarquer que la présence-en-pensée dont il est question ici ne saurait relever d'une activité de pensée explicite. La pré sence intentionnelle de ce à quoi l'on pense (ou de ce dont on parle) est subordOllllée, par définition, à une activité continuée (et en un sens, un effort) de « penser à », précisément. Aussitôt que je cesse de penser à lui, l'objet cesse d'être (explicitement) présent-en-pensée pour moi. A contra rio, la plupart des aspects absents des objets que nous percevons sont présents même lorsque nous ne sommes pas expressément dirigés vers eux par notre activité intentionnelle. En général, ces aspects sont présents pour autant qu'ils sont présupposés par ce que Husserl appelle le sens (Sinn) sous lequel se présente le quelque chose que l'on perçoit (voir section 11.1). L'aspect que nous avons sous les yeux est appréhendé comme la face avant d'un fauteuil, non comme une simple façade ; et se présenter comme un fauteuil implique de posséder plusieurs faces visibles 44 Ibid. p. 27.
192
GUNNAR DECLERCK
de différents points de l'espace. Par ailleurs, affinner que les aspects absents inaccessibles sont « là » de la même manière que des choses auxquelles on pense pose problème phénoménologiquement, dans la mesure où les choses auxquelles on pense ne sont précisément pas « là >J. Comme l'explique Husserl, la perception présente l'objet en le faisant apparaître comme quelque chose qui est là en personne, alors que les modes de conscience non-présentationnels (c'est-à-dire re-présentation nels) visent leur objet sans le rendre présent à proprement parler". Les choses re-présentées ne possèdent pas la qualité d'« être là » qui carac térise les choses présentées (c'est-à-dire perçues). Noë l'admet lui-même : « Lorsque je pense à [mon ami Dominique qui est à Berlin], il se mani feste à moi dans ma pensée ; il a une certaine présence ; il est présent à mon esprit. Non pas qu'il soit présent. Il est à Berlin. [ . . . ] Il est présent à ma pensée maintenant, mais pas en tant qu'il est ici [ . . . ] . »46 Bien sûr, nous pouvons tout à fait diriger notre activité de pensée vers des choses qui sont également présentes perceptivement, par exemple qui font l'ob jet d'un accès visueL Mais dans ce cas, ce n'est pas notre activité de pensée qui les rend présentes. La seule fonne admissible sous laquelle cette première réponse peut être défendue est dès lors que la disponibilité pour la pensée, c'est-à-dire la possibilité d'engager une activité explicite de pensée dirigée vers eux, est ce en quoi consiste la présence perceptive des aspects absents inac cessibles. Il semble, en l'occurrence, que la disponibilité pour la pensée soit précisément ce que Noë ait en vue lorsqu'il parle de présence-en pensée (thought-presence)47, même si les exemples qu'il dOlllle corres pondent à des situations d'activité de pensée explicite48. Sous cette version, la réponse examinée consisterait donc à dire que les aspects absents qui sont en fait inaccessibles conservent leur présence perceptive en dépit de leur indisponibilité sensorimotrice dans la mesure où ils restent disponibles pour la pensée, que l'on soit ou non en train de penser à eux en ce moment. Quels que soient les mérites de cette conception de la présence-en pensée, je ne crois pas que cette réponse pennette de sunnonter les
45 E. Husserl, Chose et espace, trad. ft. J.-F. Lavigne, Paris, PUF, 1989, § 4. 46 A. Noë, Varieties ofPresence, op. cit., p. 26. 47 Noë explique par exemple : « il semble tout à fait raisonnable d'affinner qu'un ami absent peut se manifester dans nos pensées à peu près de la même façon que les parties cachées des objets que nous voyons se manifestent dans la conscience perceptive. " (A. Noë, Varieties ofPresence, op. cit., p. 27,je traduis). 48 Voir A. Noë, Varieties ofPresence, op. cit., p. 26-27.
CE QUI AURAIT PU ÈmE FAIT
193
difficultés exprimées plus haut. La raison en est qu'elle est tout bonne ment hors sujet. Être accessible par la pensée est sans doute une manière possible pour les aspects absents inaccessibles sur un plan sensorimoteur d'être présents intentionnellement. Mais - par définition - la présence dont il s'agit alors n'est pas d'ordre perceptif9. Ce qu'il faut expliquer ici, c'est comment des aspects qui sont inaccessibles par les moyens moteurs dont nous disposons peuvent jouir d'une présence perceptive, pas comment ils peuvent jouir d'une présence intentionnelle en général. Comme l'indique Noë : « la présence perceptive est un type de disponi bilité ; c'est un type de présence à l'esprit. Un objet est présent percepti vement lorsque notre accès à lui repose sur l'exercice d'aptitudes sensorimotrices (sensorimotor skills). »50 On pourrait rétorquer que l'existence d'une continuité entre certains modes de présence-en-pensée et la présence perceptive51 conduit préci sément à rejeter cet argument. Selon Noë, lorsque nous accédons par la pensée à quelque chose qui est trop éloigné pour être perçu (mais pourrait l'être), nous entretenons avec ce quelque chose une relation « quasi-per ceptive », quels que soient la complexité des actions ou le temps qui seraient nécessaires pour l'atteindre. « La présence-dans-l'absence de Dominique est différente de celle des objets autour de moi ; mais il s'agit d'une différence de degré, non de nature. [ . . ] Dominique a un score très bas sur les échelles de dépendance au mouvement et de dépendance à l'objet ; mais ce score n'est pas nul. »52 Une telle affinnation ne fait cependant que reporter le problème, car dans le cas considéré les aspects absents sont inaccessibles et compris comme tels. Si Noë affinne qu'entre la présence-en-pensée et la présence perceptive il y a continuité, c'est que nous nous attendons à pouvoir effectivement accéder à l'objet visé en pensée en réalisant la séquence de mouvements appropriée (ce qui peut signifier, dans ce cas, prendre un taxi et un avion). Mais c'est précisément une telle possibilité qui se trouve neutralisée dans le cas des aspects absents inaccessibles 53 . Une fois encore, la question qu'il nous faut affronter est celle du statut modal des possibilités d'action qui .
49 Voir J. Trigg, « Review of 'Varieties of Presence' ", art. cit., p. 310, pour une objection similaire. 50 A. Noë, Varieties ofPresence, op. cit., p. 26. Je traduis. 5 1 Ibid., p. 27 et p. 33-34. 52 Ibid., p. 27. Je traduis. 53 Doyon soulève une objection du même ordre avec le cas des objets qui ont cessé d'exister. Voir M. Doyon, « The Problem with Presence '>'>, International Journal ofPhilo sophical Studies, 21, 4, 2013, p. 600-6 1 1 .
194
GUNNAR DECLERCK
pennettraient (OU auraient pennis) d'accéder aux aspects hors de vue, qu'il s 'agisse de la face arrière d'un objet dont nous ne percevons actuel lement que la face avant ou de n'importe quel aspect d'un objet qui est trop éloigné pour être perçu. II.2.2 Les aspects absents restent accessibles par l'imagination Une deuxième réponse consiste à dire que l'action qui pennettrait d'accéder aux aspects absents peut toujours être réalisée de manière vir tuelle : sa réalisation peut être imaginée ou simulée inconsciemment - au sens de la théorie de la simulation motrice54. A noter que des auteurs comme Kind55 défendent plus radicalement que l'imagination est essen tielle à la présence des aspects absents, qu'il soient ou non accessibles : pour jouir d'une présence perceptive, les aspects de l'objet pour le moment hors d'accès doivent être rendus présents par l'imagination56. Cette réponse, comme la précédente, se confronte selon moi à plusieurs difficultés. Tout d'abord, subordonner la présence des aspects absents à une activité d'imagination est tout simplement irrecevable phénoménologi quement parlant. Sans doute, il arrive qu'on ait recours à l'imagination pour se représenter telle ou telle partie non perçue d'un objet. Mais rien n'indique qu'une telle activité ait systématiquement lieu et conditionne la présence perceptive des aspects absents. On pourrait rétorquer que ces épisodes se produisent en fait beaucoup plus souvent que nous ne le
54 V. Gallese, « The Inner Sense of Action: Agency and Motor Representations '>'>, Journal of Consciousness Studies, 7, 2000, p. 23-40 ; M. Jeannerod, « Neural Simulation of Action: A Unifying Mechanism for Motor Cognition '>'>, Neurolmage, 14, 2001, p. 103109 ; C. Sinigaglia & G. Rizzolatti, « Through the Looking Glass: Self and Others '>'>, Consciousness and Cognition, 20, 2011, p. 64-74. 55 A. Kind, « Imaginative Presence '>'>, in F. Dorsch, F. Macpherson & M. Nide RlUllelin (eds.), Phenomenal Presence, Oxford, Oxford University Press, à paraître. 56 Kind explique : « C'est ce qui est distinctif à propos de l'imagination : elle nous permet d'avoir l'expérience de quelque chose qui n'est pas présent comme s'il l'était. Si je me mets à visualiser mes enfants pendant que je leur parle au téléphone, la manière dont ils me sont présents se modifie. Ils me semblent toujours absents - ce n'est pas comme si mon acte d'imagination me persuadait qu'ils étaient maintenant devant moi - mais ils ont désormais une présence phénoménologique, en dépit de leur absence. C'est précisément ce point qui, à mon sens, offre de résoudre le problème de la présence perceptive. Opérant de concert avec nos capacités perceptives, nos capacités imaginatives contribuent à notre expérience perceptive en permettant que des propriétés non perçues de l'objet semblent présentes. Alors que je regarde la cannette de Coca Cola sur mon bureau, c'est par un effort conjoint de la vision et de l'imagination que j'ai la conscience perceptive de la cannette comme d'une totalité tridimensionnelle. Le devant de la cannette est vu ; l'arrière est imaginé. '>'> (ibid., p. 13)
CE QUI AURAIT PU ÈmE FAIT
195
remarquons 57. Mais je vois mal comment cela pourrait expliquer l'im pressionnante « quantité » de choses qui, à chaque instant, sont présentes perceptivement sans faire l'objet d'un accès perceptif. Pour faire usage de notions husserliennes, il y a à l'évidence beaucoup plus dans 1'« hori zon interne » des objets que ce que l'on pourra jamais rendre intuitive ment présent par une activité de présentification. Je peux mobiliser mon imagination pour présentifier la face arrière lorsque je perçois l'objet par l'avant, mais celui-ci possède de nombreuses autres faces : des faces laté rales, un dessus, un dessous. Les objets spatiaux possèdent également un dedans, auquel on peut accéder dans certaines conditions : certains objets peuvent être ouverts (une boîte à chaussure), d'autres doivent être cassés ou coupés (un rocher, une pomme). Et les objets peuvent se voir attribuer des propriétés dispositiOllllelles. J'appréhende ce verre comme quelque chose de fragile, c'est-à-dire quelque chose qui se brisera facilement en cas de choc ou de pression. La fragilité aussi appartient à l'horizon interne de l'objet : elle fait partie du sens présumé sous lequel j'ai inscrit l'objet lorsque j'ai pris le parti de l'identifier comme un verre. L'idée qu'une activité d'imagerie motrice implicite pourrait expliquer la pré sence intentionnelle des aspects absents soulève une objection du même ordre58. Ensuite, comme y insiste Husserl59, la présentification imaginative d'un aspect absent implique elle-même une référence à d'autres aspects (imaginativement) absents. Lorsque j ' imagine l'arrière du fauteuil, la face présentifiée renvoie à d'autres faces qui ne sont pas présentifiées à cet instant : ce mêmefauteuil que je m'imagine voir par l'arrière pourrait m'apparaître en imagination sous d'autres aspects. La situation, à cet égard, est rigoureusement la même que si je percevais le fauteuil d'un
n IbUi., p.13-14. 58 Pour une présentation détaillée de cet argrunent, voir G. Declerck, « Why Motor Simulation cannot Explain Affordance Perception '>'>, Adaptive Behavior, 21, 4, 2013, p. 286-298 ; G. Declerck, « How we Remember What We Can Do '>'>, Socioaffective Neu roscience & Psychology, 5, 2015, Special issue: Memory and action, M. Hainselin (ed.). 59 E. Husserl, Chose et espace, op. cit., p. 80 (§ 18) : « L'apparition d'imagination ne fait accéder le chosique à l'apparition, elle aussi [ . . . ], qu'en l'exposant ; et, ce faisant, d'une manière nécessairement unilatérale, exactement comme l'apparition "perceptive". [ . . . ] En vérité, même dans l'imagination, nous ne pouvons représenter une maison en même temps en façade et de l'arrière ; si la façade se trouve sous nos yeux, alors l'arrière n'y est pas, et inversement. Donc ici aussi [nous trouvons] la différence entre apparition en propre et apparition impropre '>'>. Voir également E. Husserl, Recherches logiques (Recherche VI), op. cit., p. 76-77.
196
GUNNAR DECLERCK
autre point de l'espace que celui que j 'occupe en ce moment60. Prétendre que dans la perception la présence des aspects absents est fondée sur un acte de présentification imaginative est par conséquent circulaire. Et il faut ajouter que ce à quoi l'imagination donne accès manque de toute évidence du caractère de nécessité avec lequel les aspects absents (au moins certains d'entre eux) sont présents61. C'est un point que Noë ne prend manifestement pas en considération : les aspects absents ne sont pas seulement des détenninations qui pourraient être là, ils doivent être là pour que l'objet soit (et continue d'être) ce qu'il semble être. Pour que le quelque chose que voilà soit lUle véritable tomate (pas une simple façade ou un trompe-l'œil), il doit posséder une face arrière. C'est une nécessité. Et c'est parce que posséder une face arrière est une nécessité que percevoir cette face arrière est une possibilité. Finalement, et ce point est peut-être le plus décisif, cette seconde réponse contredit l'ordre de conditionnalité auquel les différentes moda lités intentiOIlllelles considérées se trouvent soumises : l'accès imaginatif aux aspects absents ne saurait expliquer leur présence perceptive parce qu'il la présuppose. Pour imaginer l'aspect des chaussures de l'interve nant dont les jambes sont maintenant cachées par le pupitre, il faut d'abord appréhender ce que l'on voit comme un intervenant, c'est-à-dire une personne réellé2. En tant que personne, celle-ci doit avoir des jambes et des pieds (en admettant qu'elle soit toujours entière), et généralement les personnes qui ont des pieds portent des chaussures en public, en tout
60 Sur cette question, voir également S. Schellenberg, « Action and Self-location in Perception '>'>, Mind, 116, 463, 2007, p. 603-632, p. 612. 61 Comme l'explique Zahavi (, art. cit., p. 309) : « Bien que le "remplissement" imaginatif se caractérise par un certain arbitraire, il prend néces sairement place et se déploie au sein de la structure d'horizon, dont il présuppose la réalité [ . . . ]. L'aspect que présente l'arrière du fauteuil est affaire de contingence. Mais que le fauteuil possède une partie arrière est une nécessité, dont on ne saurait rendre compte en en faisant le corrélat d'une possibilité fictive '>'>. 62 Je reprends ici l'exemple analysé par Kind : « Supposez que vous assistez à une conférence quelconque, donnée par lUle conférencière éminente située derrière un pupitre [ . . . ] Bien que vous ne puissiez pas voir le bas de son corps, celui-ci a néanmoins une présence perceptuelle, et vous percevez la conférencière connne lUle personne entière, et non comme le buste d'lUle moitié de personne. Supposez maintenant qu'elle s'éloigne du pupitre un instant, et que vous découvriez que bien qu'elle porte une jupe bleue assortie à son veston, elle porte aussi des baskets montantes orange vif. Une fois retournée deillère son pupitre, l'expérience que vous avez d'elle a manifestement changé ; la regarder paraît maintenant différent en ce que la présence perceptive du bas de son corps, et en particulier de ce qu'elle porte aux pieds, est devenue plus forte. Une façon naturelle de le dire est que ces éléments vous sont maintenant plus présents qu'ils ne l'étaient auparavant. '>'> (, in op. cit., p. 9)
CE QUI AURAIT PU ÈmE FAIT
197
cas dans les conférences scientifiques (ce point relève de nos croyances d'arrière-plan63). Ainsi, ce que vous imaginez être là s'établit sur le sys tème d'expectatives porté par l'horizon interne de l'objet : l'imagination remplit simplement les blancs. Réciproquement, comme l'explique Hus serl64, chaque fois que la perception vous infonne d'une nouvelle déter mination de l'objet, celle-ci se voit automatiquement intégrée à son horizon interne, et contribue dès lors à infonner ce que vous vous atten dez à voir et ce que vous êtes porté à présentifier par l'imagination. Maintenant que vous avez vu que l'intervenant portait des charentaises, vous vous attendez à voir ces mêmes chaussures s'il quitte son pupitre. Le point essentiel étant que, contrairement à ce que soutient Kind, vous n'avez pas à imaginer les chaussures pour vous attendre à les voir. Une fois intégrées à l'horizon interne de l'objet, elles font partie de l'ensemble d'anticipations vides (c'est-à-dire sans contenu intuitif)65 qui accom pagnent votre perception de l'intervenant66. Être inclus dans l'horizon interne qui délimite les conditions d'iden tité de l'objet n'est sans conteste qu 'une manière possible pour les aspects absents des objets que nous percevons d'être « présents » intentiOIlllelle ment. Mais il s'agit d'une manière fondamentale, en un sens littéral : elle établit les bases (et pour ainsi dire le cadre) sur lesquelles peuveut travailler d'autres mécanismes intentionnels susceptibles de conférer une présence (mais pas une présence perceptive, cependant) à ce à quoi nous ne sommes pas en train d'accéder perceptivement, typiquement l'imagination. II.2.3 L'action n'est requise que pour le développement du saVOIr sensorimoteur Une troisième stratégie pour tenter de sunnonter les difficultés dia gnostiquées plus haut consiste à revoir à la baisse le rôle de la motricité dans la perception en faisant de celle-ci un simple facteur développemen tal. L'action assurant un accès aux aspects absents doit avoir été réali sable (et doit avoir été réalisée) par le passé - le processus d'acquisition du savoir sensorimoteur n'aurait pu avoir lieu sinon67 - mais l'exercice
63 Sur le rôle des croyances d'arrière-plan dans l'intentionnalité d'horizon, voir D. W. Smith & R. McIntyre, Husserl and Intentionality, op. cit., chap. 5, section 3. 64 Voir en particulier E. Husserl, Expérience etjugement, op. cit., § 8 et § 25. 65 Voir E. Husserl, Méditations cartésiennes et Les conférences de Paris, tr. ft. M. De Launay, Paris, PUF, 1994, § 19, p. 90. Voir également E. Husserl, Expérience et jugement, op. cit., § 8 et §26. 66 Voir K. Laasik, « On Perceptual Presence '» , art. cit., pour lUle analyse similaire. 67 Voir A. Noë, Action in Perception, op. cit., p. 13.
198
GUNNAR DECLERCK
de ce savoir, une fois en place, ne dépend pas de la disponibilité de ces possibilités d'action, et leur indisponibilité ne l'affecte en rien68. C'est cette stratégie que Noë semble privilégier dans Action in Perception : la paralysie ne s'accompagne pas de la perte du savoir sensorimoteur (sensorimotor knowledge) dont l'exercice soutient la présence des aspects absents69. Autrement dit, Noë propose de distinguer entre savoir sensori moteur - ou compréhension sensorimotrice (sensorimotor understanding) et capacités sensorimotrices (sensorimotor skills / abilities), et de ne faire porter la charge explicative que sur le premier tenne70. Cette proposition est sans doute la moins problématique des trois discutées dans la présente section. Je pense, pour ma part, qu'elle consti tue unepartie de la solution à ce que Noë appelle l'énigme de la présence perceptive. Cependant, elle ne va pas sans poser, elle aussi, certaines difficultés. Tout d'abord, comme l'indiquent Kyselo & Di Paolo (2015), cette réponse semble compromettre la thèse selon laquelle l'action est réelle ment constitutive de la perception et elle fait dans cette mesure le jeu des opposants à la théorie de l'esprit incarnée?l. 68 Cette stratégie correspond à ce que Kyselo & Di Paolo (, art. cit., p. 520) appellent la « réponse développementale faible ,>,> au défi que pose le syn drome d'enfermement pour les approches enactives de la perception : le corps est un facteur décisif dans le développement des aptitudes perceptives, mais il ne conditionne pas leur exercice une fois ce développement achevé. 69 Voir A. Noë, Action in Perception, op. cit., p.12. 70 La position de Noë dans Action in perception reste toutefois passablement confuse. Pour justifier la préservation du phénomène de présence perceptive en dépit de la paralysie, Noë affirme en même temps que (i) le sujet paralysé dispose toujours de certaines capacités sensorimotrices (sensorimotor skills), autrement dit qu'il est toujours capable de réaliser certains mouvements (la paralysie n'est que partielle) : « Les quadra plégiques peuvent bouger leurs yeux et leur tête et, dans une certaine mesure, du moins à l'aide d'un support technologique, ils peuvent bouger leur corps par rapport à l'environ nement (par exemple, en utilisant lUle chaise roulante). '>'> (Action in Perception, op. cit., p.12) ; et que (ii) le sujet paralysé dispose toujours de son savoir sensorimoteur (sensori motor knowledge), à savoir la connaissance des changements qui affecteraient les entrées sensorielles si tel mouvement était réalisé : « La paralysie ne compromet pas la compré hension pratique que la personne paralysée possède des façons dont les mouvements et les stimulations sensorielles dépendent les lUlS des autres. Même le paralytique, dont l'éventail de mouvements est restreint, comprend, implicitement et pratiquement, la signification du mouvement pour la stimulation. [ . . . ] peu importe l'ampleur de leurs limitations, ils disposent d'aptitudes sensorimotrices (sensorimotor skil!) qui informent et permettent la perception. '>'> (ibid., p. 12). Adams & Aizawa décèlent une ambigui'té semblable dans la position de Noë. Voir F. Adams & K. Aizawa, The Bounds of Cognition, Malden, Blackwell, 2008, chap. 9. 3. 7 1 « Ceux qui contestent le rôle de l'incorporation (embodiment) peuvent aisément faire valoir que le corps, en tant que facteur développemental, bien que nécessaire pour
CE QUI AURAIT PU ÈmE FAIT
199
Ensuite, désolidariser le savoir sensorimoteur des capacités senso rimotrices entre dans une certaine mesure en conflit avec la conception du savoir-faire (know-how) que semble défendre Noë. C'est une des revendications phares de l'approche sensorimotrice depuis O 'Regan & Noë (2001) : posséder un savoir sensorimoteur ne signifie pas savoir que (know that) tel changement se produirait dans l' input sensoriel si l'on réalisait telle action, mais savoir comment (know how) produire ce chan gement, c'est-à-dire être capable de le produire. Le problème est que dans la situation de paralysie, l'individu n'est précisément plus capable de produire de telles actions, en tout cas si être capable de A implique de pouvoir effectivement réaliser A. Quelqu'un peut-il savoir faire A (know how), et pourtant ne pas (ne plus) savoir (pouvoir)"2 faire A ? De deux
lUle trajectoire historique donnée est purement contingent, et que d'autres chemins déve loppementaux possibles auraient pu mener aux mêmes résultats sans que des facteurs corporels aient joué un rôle important. " (Kyselo & Di Paolo, « Locked-In Syndrom '>'>, art. cit., p. 520). On pourrait discuter cette affina n tion. On peut semble-t-il adopter une carac térisation de ce que signifie exercer lUle capacité motrice, qui permette de concilier une approche développementale et une position plus forte selon laquelle l'action est nécessaire à l'émergence de l'expérience perceptive. Pour la conception standard, exercer lUle habi leté motrice implique une mise en mouvement effective : exercer notre capacité à nager implique de réaliser le comportement de nager. C'est ce parti-pris qui conduit à affinner que lorsque certaines conditions d'exercice ne sont pas remplies (qu'elles soient environ nementales : il n'y a pas de plan d'eau dans les environs, ou liées à l'état de l'organisme : nous nous trouvons paralysés), nous ne pouvons pas exercer nos capacités, ce qui signifie le cas échéant que nous sommes dépossédés de celles-ci (A. Noë, Varieties of Presence, op. cit., p. 148). Une caractérisation alternative consiste à faire valoir que les capacités motrices ont un versant manifeste (overt), d'ordre comportemental, mais également un versant clandestin ou tacite (covert). Acquérir la capacité à jouer du piano signifie être capable de produire de la musique en pianotant sur les touches. Mais cela signifie égale ment être capable d'écouter du piano avec un certain niveau d'expertise, comprendre ce que le pianiste fait quand vous l 'entendez jouer. De même, acquérir la capacité de marcher pour lUl enfant signifie être capable de mettre un pied devant l'autre, tout en maintenant son équilibre. Mais cela signifie également être capable de voir « à combien de pas ,>,> se trouve un objet qu'il veut atteindre, ou si un terrain peut être facilement emprunté, c'est à-dire être capable de percevoir les affordances associées à l 'habileté considérée. Cette conception duale des habiletés fournit un premier élément de solution au problème que soulève la paralysie : être paralysé ne signifie pas avoir complètement perdu la possibilité d'exercer la capacité de marcher (ou de se déplacer, plus généralement) ; le sujet paralysé peut toujours exercer ses capacités motrices en percevant l 'environnement comme les mar cheurs le perçoivent. Voir M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 121-122. Cette approche est également compatible avec la théorie de la perception de J. J. Gibson : percevoir que quelque chose permet de faire (affords) A est une manière d'exercer (de façon implicite) la capacité de faire A. 71 J'emploie ici à dessein le verbe « savoir ,>,> dans son sens de « pouvoir '>'>, comme on le fait parfois en français, par exemple lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il ne sait pas parler l'italien. Cet usage est-il légitime ici ? Dira-t-on d'un sujet paralysé qu'il ne sait pas marcher ? Il me semble qu'on dira, en tout cas, qu'il ne sait plus marcher.
200
GUNNAR DECLERCK
choses l'une : soit Noë abandonne la caractérisation du savoir-faire (know-how) comme capacité de réaliser l'action ; soit il maintient celle ci, mais dans ce cas il lui faut désolidariser la capacité de réaliser l'action de la possibilité effective de la réaliser : on peut être capable de A, sans qu'il soit effectivement possible pour nous de faire A. La discussion que Noë engage avec la conception intellectualiste du savoir-faire?3 pennet dans une certaine mesure de répondre à cette ques tion. Noë fait remarquer qu'on peut adopter deux conceptions différentes des capacités (abilities)74 impliquées dans ce qu'on appelle le savoir-faire (know-how) : (a) On peut affirmer que les capacités ont des conditions d'exercice (ena bling conditions) et doivent être clairement distinguées de celles-ci. Le fait que certaines de ces conditions ne soient pas remplies n'implique pas que l'on ne possède pas la capacité associée : « le fait qu'il n'y ait pas d'eau dans les environs [ . . . ] ne me prive pas de ma capacité à nager »75 ; de façon analogue, explique Noë : un pianiste virtuose qui aurait perdu ses bras dans un accident « n'a pas perdu sa capacité à jouer ; simplement, il ne peut plus exercer cette capacité (parce que certaines conditions d'exer cice ne sont pas remplies ; il n'a pas de bras). »76 Autrement dit, le pianiste amputé sait toujours jouer, mais il ne peut plus77• Ce qu'on peut à mon sens exprimer par l'énoncé contrefactuel suivant : s'il avait toujours ses bras (s'il n'avait pas perdu ceux-ci), il pourrait toujours (serait toujours capable de) jouer. (b) Mais on peut également considérer que certaines de ces conditions d'exercice ont un statut constitutif, autrement dit qu'elles doivent nécessai rement être remplies pour que le sujet puisse être dit posséder la capacité correspondante. Disposer d'une base organique (c'est-à-dire des ressources physiques, par exemple de bras fonctionnels) pennettant d'exercer de manière effective la capacité pourrait se voir attribuer un tel statut. La présence de cette base organique ne serait donc pas assimilable à une simple « condition d'exercice » de la capacité au sens indiqué en (a) : son statut serait plus fort. « On pourrait, par exemple, admettre que perdre ses bras n'est pas la même chose que ne pas avoir de piano ; perdre ses bras revient à perdre sa capacité (ability) (pas juste une condition d'exercice de 73 Voir A. Noë, Varieties o/Presence, op. cit., p.148 sqq., et A. Noë, « Against Intel lectualism '>'>, Analysis, vol. 65, n0288, 2005, p. 278-290. 74 Je traduis ability par « capacité ,>,> (plutôt que par « aptitude ,>,» , et je réserve « savoir-faire ,>,> pour know-how. Un avantage de cette traduction est que le tenne « capa cité '>'> renvoie à « être capable de '>'>, comme ability renvoie à to be able to. Par ailleurs, Noë semble utiliser ability et skill de manière interchangeable. 75 A. Noë, Varieties o/Presence, op. cit., p.148. Je traduis. 76 Ibid. Je traduis. 77 Cette première conception du savoir-faire est notamment mise en avant par P. Snowdon, « Knowing how and knowing that: ADistinction Reconsidered '>'>, Proceedings of the Aristotelian Society, vol. 104, 2004, p. 1-29.
CE QUI AURAIT PU ÈmE FAIT
201
celle-ci). Et on pourrait en même temps marquer que perdre sa capacité revient donc à perdre du même coup son savoir-faire (know-how). »78
Si l'on applique l'option (b) à la situation de paralysie, on peut donc dire que le sujet paralysé n'a pas seulement perdu ses capacités (abilities) sensorimotrices, la paralysie l'a également dépossédé de son savoir sen sorimoteur (sensorimotor knowledge) : en perdant la capacité de se mou voir, c'est sa compréhension pratique (practical understanding) de la dépendance des entrées sensorielles vis-à-vis des mouvements qu'il a perdue79 L'option (b) compromet par conséquent la stratégie que Noë met en avant pour sunnonter l'objection de la paralysie dans Action in perception, de sorte que l'option (a) semble être sa seule voie de sortie ici : la capacité de se mouvoir, que le sujet paralysé a perdue, relève (seulement) des conditions d'exercice de ses capacités sensorimotrices (sensorimotor skills). La possession d'un savoir sensorimoteur (une com préhension pratique des lois de contingences sensorimotrices) n'est pas conditionnée par la possibilité d'exercer de manière effective son savoir faire : on peut savoir sans pouvoir80. Cette conception du savoir-faire ne va pas sans difficultés. En plus d'affaiblir, comme indiqué plus haut, la thèse enactive selon laquelle l'action est constitutive de la perception, elle appelle à une nouvelle caractérisation de la capacité. Si le savoir sensorimoteur, dont l'exercice est supposé soutenir la présence perceptive des aspects absents, est bien un type de savoir-faire (know-how), et si posséder un tel savoir-faire signifie bien être capable de produire tel changement dans l'input senso riel par l'exécution des actions appropriées, la théorie actionniste appelle à une caractérisation de la capacité qui affranchisse cette dernière de la possibilité effective de réaliser l'action (ètre-capable-de-A n'implique plus de pouvoir réaliser A). La tâche n'est sans doute pas insunnontable : comme suggéré plus haut, on pourrait notamment recourir à une caracté risation contrefactuelle du type : « si telle condition C avait été remplie, le sujet capable de A pourrait toujours réaliser A ». Mais une telle analyse exigerait sans conteste un nouvel effort conceptuel à la théorie actionniste. Finalement, et c'est le point le plus important pour notre propos, la réponse développementale ne semble pas capable de sauver l'idée de 78 A. Noë, Varieties ofPresence, op. cit., p. 148. 79 A. Noë, Action in Perception, op. cit., p. 12. 80 Voir K. Pepper, « The Phenomenology of Sensorimotor Understanding", art. cit., pour une interprétation similaire.
202
GUNNAR DECLERCK
disponibilité sur laquelle toute l'entreprise explicative de Noë repose. En admettant que la disponibilité des possibilités motrices soit mliquement requise pour l 'acquisition du savoir sensorimoteur, non pour son exercice une fois celui-ci en place, comment justifier que l'exercice de ce savoir suffise à rendre les aspects absents disponibles ? Sur un plan explicatif, il semble nécessaire de distinguer entre (a) être capable d'anticiper les changements qui se produiraient dans les dOllllées sensorielles si tel ou tel mouvement était réalisé (donc s'attendre à ces changements lorsque ces mouvements ont lieu et voir ses attentes déçues si les changements en question ne se produisent pas), et (b) compter sur la possibilité d'ac tualiser ces changements en effectuant les mouvements appropriés. Par l'exercice de son savoir sensorimoteur, le sujet anticipe que s'il produi sait tels mouvements, l'aspect de l'objet se modifierait de telle manière familière. Mais seule la conviction que ces mouvements peuvent être réalisés - sont eux-mêmes disponibles - semble en mesure de procurer aux aspects auxquels ils pennettraient d'accéder le sens de quelque chose de « disponible >J. L'approche développementale n'apporte aucune réponse à la question de savoir comment une action qui est en fait indis ponible (elle ne peut être réalisée) peut conférer un caractère de disponi bilité à ce à quoi elle aurait permis d'accéder si elle avait été disponibles l
III. Vers une théorie indirecte du rôle des possibilités d'action dans la perception La discussion précédente montre que la théorie de Noë rencontre d'importantes difficultés dès lors qu'il s'agit de clarifier le statut contre factuel de l'action et l'affinnation que l'action en tant que possibilité est constitutive de la conscience perceptive. Les arguments examinés sug gèrent notamment que ce qui importe pour que les aspects absents soient présents perceptivement, ce n'est leur accessibilité enfait - la conviction que l'on pourrait, si on le désirait, effectivement accéder à eux en réali sant les mouvements appropriés -, mais c'est leur accessibilité en droit : 81 Le problème semble d'autant plus contrariant que les sujets paralysés sont géné ralement parfaitement conscients de ne pas pouvoir accéder aux aspects absents par leurs propres moyens - mais une affina n tion semblable vaut plus généralement pour les sujets non paralysés, vis-à-vis des aspects absents qui sont de fait inaccessibles (voir plus haut, section II.1). Subordonner, comme prétend le faire Noë, la présence perceptive à une conscience d'accessibilité semble, à cet égard, tout bonnement indéfendable.
CE QUI AURAIT PU ÈmE FAIT
203
le fait qu'ils peuvent en princ pe i être perçus. La principale question dès lors est la suivante : en quoi consiste notre sens de l'accessibilité en droit des aspects absents ? Quel type d'actes intentionnels et quel type de « savoir » soutiellllent notre conscience de cette accessibilité ? Sans pré tendre apporter une réponse définitive à cette question, j 'aimerais sou mettre une proposition pennettant d'avancer vers ce qui pourrait constituer, à mon sens, une solution acceptable. Cette proposition tient pour l'essentiel dans deux affinnations : (i)
notre sens de l'accessibilité de principe (l'accessibilité en droit) des aspects absents consiste, d'une part, dans la compréhension des relations fonction nelles entre les aspects de l'objet et les circonstances de perception, la connaissance pratique de la manière dont ces aspects varient lorsque ces circonstances viennent à changer ;
(ii)
il consiste, d'autre part, dans l'assurance (la conviction tacite) que les cir constances de perception devant être réalisées pour que les aspects absents apparaissent peuvent (en principe) être réalisées.
Cette proposition repose sur un modèle ternaire du rôle de l'action dans la perception. Ce modèle reprend l'analyse husserlienne du rôle des circonstances de perception dans la conscience perceptive et de la connexion entre l' attribution de sens (Sinn) et l'intentionnalité d'horizon82. III.! Substituer au modèle binaire de Noë un modèle ternaire du rôle de l 'action possible dans la conscience perceptive Il faut tout d'abord noter que mon insistance sur le caractère contre factuel de l'action qui pennettrait d'accéder aux aspects absents ne doit pas être interprétée comme un rejet de la thèse, partagée par Noë et les approches enactives de la perception, que le contenu de notre expérience perceptive est enacté (produit et détenniné) par ce que nous pouvons faire, et entretient dans cette mesure une relation constitutive avec l'ac tion. Je rejoins pour l'essentiel Noë sur l'idée que notre conscience per ceptive repose sur l'exercice (et dépend de la possession) d'une fonne de compréhension de la manière dont l'aspect des objets se modifie lorsque
82 Il présente également certaines similitudes avec le modèle que propose Schellen berg, mais à la différence de celui-ci, sa portée est purement phénoménologique et son objectif est de rendre compte du rôle de l'action dans la perception, en prenant en consi dération sa dimension contrefactuelle. Voir Schellenberg, « Action and Self-Location in Perception '>'>, art. cit., et, du même auteur, « The Situation-Dependency of Perception '>'>, The Journal ofPhilosophy, 105, 2, 2008-2009, p. 55-84.
204
GUNNAR DECLERCK
nous nous déplaçons83 Appréhender quelque chose comme un X (une table en bois située à quelques mètres) dans la perception signifie, entre autres choses, s'attendre à ce que le quelque chose en question manifeste tel comportement phénoménal (change d'aspect de telle manière ou conserve au contraire le même aspect) si, sous l'impulsion de tel mouve ment, les circonstances de perception en viennent à changer de telle façon. Cette attente est quelque chose à quoi nous souscrivons, pour ainsi dire, dès lors que nous identifions l'objet comme un X. Elle fait partie intégrante des conditions d'identité de ce X : pour rester le X qu'il est supposé être, le quelque chose que nous percevons se doit de respecter ces directives qui sont, comme dit Husserl, incluses dans, ou prescrites par, son sens (Sinn) noématique84. Je pense cependant que c'est une erreur que de demander à l'action de porter la totalité de la charge expli cative. La difficulté est précisément de délimiter le rôle que joue d'action, sachant qu'elle n'a pas à être exécutée ou exécutable pour assurer ce rôle. Autrement dit, l'action qui pennettrait d'accéder aux aspects absents se caractérise par un degré élevé de contrefactualité : son caractère de pos sibilité n'engage pas sa disponibilité. Une manière de concilier ces deux exigences apparemment contra dictoires est, comme nous l'avons vu (section 11.2.3), d'affaiblir le rôle de l'action dans la perception en lui conférant une portée purement déve loppementale. Cette stratégie ne constitue cependant qu'une partie de la solution, car elle ne pennet pas d'expliquer en quoi consiste au présent notre sens de l'accessibilité de princ pe i (et non de fait) des aspects absents. Pour répondre à cette question, je suggère de substituer au modèle explicatif mis en avant par Noë un modèle ternaire qui, au lieu d'articuler directement l'action aux aspects absents (exécuter tel mouve ment procure un accès à tel aspect), articule celle-ci à un troisième tenne qui médiatise cet accès, à savoir les circonstances de perception. Ce modèle peut être schématisé comme suit :
83 La question reste cependant ouverte de savoir si cette exigence vaut uniquement pour la perception des objets spatiaux, ou si elle s'applique à n'importe quel type d'objets, y compris par exemple les odeurs et les saveurs. On peut défendre que les odeurs et les saveurs se présentent avec des aspects absents, mais cela n'implique pas que leur percep tion dépende de l'exercice de capacités motrices. Sur cette question, voir R. Gray & A. Tanesini, « Perception and Action: The Taste Test '>'>, The Philosophical Quarterly, 60, 241, 2010, p. 718-734. 84 Voir en particulier D. W. Smith & R. McIntyre, Husserl and Intentionality, op. cit., chap. V, section III.
205
CE QUI AURAIT PU ErRE FAIT
�rm�trk ,ialistr
Circonstances de
Action A
Aspect absent Cl
perception C
p.ex.• pouer
","mite 1. Olr
Tel aspect absent
�rm�lI�nl d'avoiracc�, �
'I� .il'" derriè� 1.
1. f.ce .rri.� de 1.
chli•• el �,order don•
chli••
.. dlt.clion
a
est accessible au temps
t par le biais
de l'action
A (ou de la séquence d'actions Al, . . . , A,J, parce que A pennet au temps
t la réalisation des circonstances de perception C. Un parti-pris du modèle indirect aux
ternaire est ainsi que l' action fournit lUl accès lUliquement
aspects absents. L'action produit des changements dans les circonstances de perception (par exemple dans notre }XIsition vis-à-vis de l'objet), et c'est à travers ces changements qu'elle fournit lUl accès à certains aspects absents. Les aspects pour le moment hors de vue sont appréhendés comme accessibles sous réserve que telles ou telles situations perceptives se voient réalisées. Et, dans la plupart des cas, il est possible de contrôler la réalisation de ces situations par l' exercice de nos capacités de mouve ment. Ce modèle dérive, pour l'essentiel, de l'analyse husserlieIllle de l'intentioIlllalité d'horizon et du rôle que remplit l'appréhension des cir constances de perception dans l'attribution de sens
(Sinn).
Si Husserl
alloue sans conteste lUle importante charge explicative aux capacités kinesthésiques et à l'assurance immédiate que le sujet a de pouvoir se mouvoir (ce qu'il appelle le « j e peux )1) dans sa description du processus d'apprésentation des aspects absents85, il recoIlllait également que ce
gs
Voir E. Husser� Chose et espace, op. cit. , § 44 et § 55 ; E. Husserl, Expérience § 19 ; E. Husserl, La crise des sciences européennes et la phénomé nologie transcendantale, trad ft. G. Granel, Paris, Gallimard, 1976, § 28, p. 121-122. Gallagher & Zahavi proposent lUl bon résmné de la position de Husserl sm la question « Les aspects absents sont liés à lUle connexion intentimlllelle 'si . . . alors . . . '. Si Je me déplace de telle manière, alors tel aspect deviendra accessible visuellement ou tactilement. Si l'arrière de la voiture, que Je ne vois pas, est 'l'arrière de eette même voiture que Je perçois en ce mommt', possède cette signification, c'est qu'il peut devenir présent par l'exécution d'lUl mouvement emparel cittenniné de ma part. » (S. Gallagher & D. Zahavi, etjugement, op. cit.,
The phenomenological Mind. An Introduction to Philosophy of Mind and Cognitive
New Ycrlc & London, Routledge, 2008, p. 110). Sm la fonction motivationnelle des kinesthèses chez Husserl et lem relation à l'horizon intmle, voir égalmlent J. J. Dnun mond, i{ On Seeing a Material Thing in Space: The Role ofKinaesthesis in Visual Percep tion » , Philosophy and Phenomenological Research, 40, 1, 1979, p. 19-32 ; K. Mulligan, « Perception » , in op. cit. , §7.2. E. A. Behnke, « EdmlUld Husserl's Contribution to Phenomenology of the Body in Ideas II » , in T. Nenon & L. Embree (eds.), Issues in Science,
206
GUNNAR DECLERCK
n'est pas le seul paramètre motivant des changements dans les aspects de l'objet. Ce qui est anticipé et attendu, lorsqu'un quelque chose est appré hendé sous un sens (Sinn) donné - c'est-à-dire identifié comme un X -, c'est le maintien d'un ensemble de relations fonctionnelles entre les changements d'aspect que l'objet est susceptible de manifester et des changements dans les circonstances de perception afférentes86. Il est par exemple inclus dans le sens des objets spatiaux que leur aspect visuel doit changer de manière réglée lorsque change notre relation spatiale avec eux (notre distance et orientation). Le système d'attentes soutenu par l'hori zon interne d'un objet ne porte donc pas seulement sur les possibilités d'apparition de cet objet : comment cet objet apparaitrait (quel aspect il présenterait) dans différentes conditions ; il porte également sur les dépendances fonctionnelles87 entre ces apparitions et les circonstances de perception : comment l'aspect de l'objet changerait si ces circonstances changeaient. Appréhender quelque chose sous un sens (Sinn) donné « active » des attentes à propos de ces dépendances fonctionnelles. Tout changement se produisant dans le contenu sensatiOllllel doit se confonner à ces attentes pour que l'objet reste ce qu'il est présumé être (maintienne son identité)88 Le principal argument en faveur du modèle ternaire est épistémolo gique : celui-ci est plus avantageux et plus économe sur lUl plan explicatif que le modèle actionniste. Il pennet en particulier d'écarter les objections présentées dans la section 11.1, relatives aux situations où des aspects Husserl's Ideas II, Dordrecht, Kluwer, 1996, p. 135-160 ; G. Declerck, « Incarnation, motricité et rapport au possible '>'>, Studia Phaenomenologica, XII, 2012, p. 35-60. 86 Voir E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie pure. Livre second, op. cit., § 1 5 . c, p.72 et §16, p. 83. Sur cette question, voir notannnent J. J. Drummond, « The Enactive Approach and Perceptual Sense '>'>, in op. cit., p. 14 sqq. 87 La notion de « dépendance fonctionnelle ,>,> renvoie chez Husserl aux lois de forme si ... alors ... qui spécifient les changements dans l'apparence de l'objet qui résultent de nos mouvements ou d'autres changements dans les circonstances de perception (par ex. dans la lumière ambiante). Elles correspondent grosso modo à des relations de covariation. Voir A. D. Smith, Routledge Philosophy Guidebook to Husserl and the Cartesian Medita tions, London, Routledge, 2003, p. 216. 88 Sur cette question, voir notannnent D. W. Smith & R. McIntyre, Husserl and Intentionality, op. cil., chap. 5, en particulier section 3. 4. Le contenu de ces attentes dépend des conditions dans lesquelles nous avons été habitués à accéder à l'objet par le passé (cf E. Husserl, Expérience etjugement, op. cit., § 25). Certaines conditions jouissent également d'lUle sorte de privilège, au sens où elles permettent un accès perceptif « opti mal ,>,> à l'objet (cf. Husserl, 1952, §18b ; voir aussi J. J. Drummond, « The Enactive Approach and Perceptual Sense '>'>, in op. cit., p. 15-16). Je m'attends à ce que ce document imprimé présente l'aspect le plus lisible lorsqu'il est situé à telle distance de mes yeux et dans une lumière claire. Ces conditions optimales font également partie des attentes incluses dans l'horizon interne des objets.
CE QUI AURAIT PU ÈmE FAIT
207
absents en fait inaccessibles sont néanmoins présents. Que l'action qui pennettrait d'accéder à un aspect absent a ne puisse en fait être réalisée ne compromet en rien la possibilité pour les situations de perception dont l'accès à a dépend de trouver une réalisation : cette réalisation reste en principe possible et - point essentiel - une telle possibilité est incluse dans l'horizon interne que l'objet s'est vu associer sitôt appréhendé sous le sens (Sinn) « être un X ». Ce point constitne une différence notable avec la conception défendue par Noë : ce qui confère aux aspects absents leur présence n'est pas qu'on peut accéder à eux en réalisant telle action produisant tels changements dans les stimulations sensorielles. Ce qui leur confère leur présence est que certaines situations perceptives peuvent être réalisées, que l'on puisse ou non contrôler cette réalisation par nos propres mouvements. Une conséquence immédiate est que le savoir sensorimoteur, c'est à-dire la compréhension pratique des dépendances fonctionnelles des changements sensoriels vis-à-vis du mouvement, ne constitue qu'une partie de la solution au problème de la présence perceptive. Ce que l'ap présentation des aspects absents présuppose en premier lieu, c'est une compréhension des relations fonctionnelles entre la variété d'aspects que l'objet - compte tenu de son sens (Sinn) - peut présenter et les circons tances de perception. L'exercice de cette compréhension, qui peut être assimilée à un savoir-faire (know how), ne nécessite pas d'être soi-même à l'origine des changements d'aspect qui affectent l'objet. Lorsque je perçois que la teinte orangée prise par le mur de la cuisine est simplement due à un changement dans les conditions d'éclairage, j 'exerce ma com préhension des dépendances fonctionnelles des aspects de l'objet vis-à vis des circonstances de perception. il en va de même lorsque je suis passivement déplacé, par exemple transporté en véhicule, et appréhende les changements de fonne apparente des objets comme résultant d'un changement dans la distance qui nous sépare. C'est un autre avantage du modèle ternaire selon moi : celui-ci auto rise d'autres vecteurs d'actualisation des aspects absents que l'action. L'action est sans conteste une manière insigne89 d'induire des change89 Insigne, car, par l'action, nous exerçons un contrôle immédiat sur les circons tances de perception, en tout cas certaines d'entre elles, en particulier la situation spatiale de nos organes perceptifs vis-à-vis de l'objet. Nous disposons également en permanence de données proprioceptives, qui permettent lUle sensibilité précise aux changements de position du corps. Chaque fois que nous nous déplaçons (bougeons les mains, les jambes, les yeux), un retour proprioceptif nous informe du changement de position, d'orientation, de posture, qui s'est produit. Voir P. Buisseret& E. Gary-Bobo, « Development of Visual
208
GUNNAR DECLERCK
ments dans les circonstances de perception, en premier lieu dans notre situation spatiale vis-à-vis de l'objet. Mais ces changements peuvent éga lement être réalisés par d'autres moyens : nombreuses sont les situations où le déplacement de notre corps procède d'une cause externe. En outre, les changements d'aspect qui affectent les objets ont bien d'autres sources que notre action ; ainsi des changements d'apparence visuelle qui pro cèdent de leur propre déplacement ou, comme indiqué précédemment, de changements dans les conditions d'éclairage. III.2 Le processus de localisation spatiale et la conscience de l 'accessibilité de principe des aspects absents90 Dans sa réponse à Hickerson (2007), Noë reproche à la « perspec tive husserlienne »91 de ne pas expliquer notre conscience perceptive (percep/ual sense) de la présence des aspects absents92 Le modèle ter naire pennet de répondre à cette objection : avoir conscience de la pré sence d'un aspect absent a revient à anticiper (avoir la conviction tacite) que certaines circonstances de perception C, dont l'apparition de a dépend, peuvent se réaliser - que l'on puisse ou non actualiser ces situa tions perceptives par nos propres ressources motrices est sans impor tance. Si elle s'arrêtait là, l'explication proposée par le modèle ternaire n'offrirait toutefois qu'une faible valeur ajoutée par rapport à la théorie de Noë, car tout le problème se trouve maintenant déplacé sur la nature
Cortical Orientation Specificity after Dark-Rearing: Role of Extraocular Proprioception '>'>, Neuroscience Letters, 13, 3, 1979, p. 259-263 ; J. P. Roll, J. P. Vedel & E. Ribot, « Alter ation of Proprioceptive Messages induced by Tendon Vibration in Man: A Microneuro graphie Study '>'>, Experimental Brain Research, 76, 1, 1989, p. 213-222 ; o . Gapenne, « Kinesthesia and the Construction of Perceptual Objects '>'>, in J. Stewart, O. Gapenne & E. Di Paolo (eds.), Enaction. Toward a New Paradigm for Cognitive Science, Cambridge, Massachusetts & London, England, MIT Press, 2010, p. 183-218. 90 Une première version de la thèse présentée dans cette section a été défendue dans G. Declerck, C. Lenay & P. Steiner, « Perceptual Presence and Possibilities in Perception. The Explanatory Failure of Current Approaches and Whether an Enactive Account can make a Difference '>'>, ASSC Workshop on Sensorimotor Theory: The Sensorimotor Theory ofConsciousness: Developments and Open Questions, 4-5 juillet 2015, Paris (France). 9 1 L'expression est de Hickerson. Il la décrit comme suit : « La perception ne dépend pas uniquement de ce qui est senti dans chaque cas, mais aussi de ce qui serait senti si la situation perceptive du sujet gegenüber (vis-à-vis de et par rapport à) le même objet perceptif était différente. [ . . . ] Cela revient à dire que le contenu perceptif ne dépend pas seulement du tableau, plus ou moins riche, de sensations occurrentes, mais également d'un certain nombre de faits conditionnels (subjunctivefacts) à propos de ce que seraient les sensations en cas d'autres orientations perceptives possibles vis-à-vis de l'objet. '>'> (R. Hickerson, « Perception as Knowing as to Act '>'>, art. cit., p. 508) 92 Voir A. Noë, « Understanding Action in Perception '>'>, art. cit., p. 533.
CE QUI AURAIT PU ÈmE FAIT
209
de cette anticipation ou de cette assurance tacite : en quoi consiste son véhicule intentionnel. L'analyse husserlienne de la perception fournit, cette fois encore, une piste pour répondre à cette question. L'expectative ou l'assurance tacite qu'un aspect absent a est là, c'est-à-dire est accessible via tel chan gement dans les circonstances de perception, est incluse dans ou présup posée par la présomption que l'objet est un X. Car se présenter sous l'aspect a lorsque les circonstances de perception C sont réalisées fait partie des directives incluses dans l'horizon interne que s'est vu assigner l'objet sitôt gratifié de son sens (Sinn) noématique, à savoir « être un X ». La table que voici possède une face arrière - elle se présentera « par l'arrière » si les conditions spatiales appropriées sont remplies - parce que posséder une face arrière est nécessaire pour être une table (mais, plus généralement, un meuble, et, plus généralement encore, une chose matérielle), et j'ai souscrit à la présomption que ce quelque chose qui m'apparait est une table. Le processus qui sous-tend l'appréhension des objets comme loca lisés dans l 'espace - l'opération de localisation - fournit une illustration paradigmatique de ce mécanisme intentiOllllel. Sitôt que quelque chose apparait comme localisé dans l'espace (se voit gratifié de ce sens), il se trouve appréhendé comme perçu depuis un point de l'espace (là où je suis) et sous une face détenninée, et comme quelque chose qui, en prin c pe, i pourrait être perçu d'autres points de l'espace et sous d'autres faces. Il doit avoir d'autres faces, il doit être visible d'autres points de l'espace, pour rester l'objet spatial qu'il est présmné être. Localiser quelque chose dans l'espace revient ainsi à souscrire à la possibilité de droit d'accéder à cette même chose sous d'autres faces et depuis d'autres positions que celle que nous occupons : il est possible en principe de bénéficier d'autres points de vue sur l'objet. L'opération de localisation, comme n'importe quelle attribution de sens noématique (dont le fonnat général est « ceci est un X »), engage ainsi le sujet vis-à-vis du possible (ce qui peut en droit apparaître et dans quelles circonstances) et des conditions sous les quelles le perçu peut conserver son identité93. L'opération de localisation impose en outre des contraintes sur les relations fonctionnelles régissant les changements d'aspects qu'est sus ceptible de subir l'objet, parmi lesquelles (il y en a d'autres) les contin gences sensorimotrices : la taille apparente de l'objet doit augmenter quand on s'en approche ; si, après avoir focalisé sur l'objet, on déplace 93 Voir D. W. Smith & R. McIntyre, Husserl and Intentionality, op. cit., p. 235 et p. 246-247.
210
GUNNAR DECŒRCK
notre regard vers la gauche, la position de l'objet dans le champ visuel doit basculer vers la droite, etc.94 L'objet doit respecter ces directives qui sont incluses dans son horizon interne pour conserver le sens de chose spatiale dont il s'est
vu
gratifié. Si, dans le cours subséquent de l'expé
rience, son comportement phénoménal contrevient à ces directives, c'est qu'il n'est pas ce pour quoi on l'avait pris de prime abord. C'est quelque chose d'autre, par exemple lUle tache sur notre rétine ou sur nos hmettes95. L'examen de quelques situations limites de localisation offrira lUl éclairage supplémentaire sur ce mécanisme intentiOIlllel. (1) Il arrive, lorsque notre œil est exposé à lUle forte huninosité, ou dans certaines pathologies oculaires, que l'on perçoive des « flotteurs >1, à savoir de petits objets plus ou moins transparents qui semblent flotter
Image simulée de flotteurs. Wikipedia. https:/lcommons.wikimedia.org/wiki! File:Floaters.png. (Page consultée le I l août 2016). Image dans le domaine public.
94
Voir J. J. Dnunmond, (( The Enactive Approach and Perceptual Sense » , in p.15. 9S L'opc'ration de localisation a généralement un caractère intégralement passif elle se produit de mani6'e automatique, sans effort ou délibération du sUJet, qui se contente de prendre acte des résultats de son action. Il existe toutefois des situations où elle prend lUl caract6'e explicite, par eXeIllple lorsqu'on est incapable de décider de prime abord si lUle fonne dans notre champ visuel correspond, mettons, à lUle marque de salissure SlIT la fenêtre à quelques mètres, ou à lUl objet situé dans le lointain, comme lUl avion. Une procédure à laquelle on peut avoir recours pOlIT trancher entre les deUl( scénarioo est lUl ({ test de parallaxe » si, lorsqu'en réalise lUl léger déplaceIllent latéral de la tête, la fonne suspecte se déplace lentement dans le champ visuel tout en se désolidarisant du plan de la fenêtre, il s'agit d'un objet dans le lointain ; si elle se déplace plus rapidement et reste attachée au plan de la fenêtre, c'est lUle marque de salisslITe SlIT celle-ci. op. cit. ,
CE QUI AURAIT PU ÈmE FAIT
211
devant nous (le phénomène serait dû à la présence de dépôts dans l'hu meur vitrée). Un point remarquable ici est que ces objets visuels ne sont pas quelque chose que nous localisons dans l'espace extérieur. Un flotteur occupe approximativement la même surface du champ visuel et présente un aspect semblable à un objet situé dans le lointain, par exemple un avion ou un oiseau, mais il ne se présente pas à nous comme une chose qui se tient dans le monde panni les objets. Au sens strict, un flotteur n'est nulle part. Ou, s'il est quelque part, c'est « sur la surface de notre œil ». Or, de façon concomitante, un flotteur ne se présente pas comme un objet qui possède des aspects absents au sens de faces cachées. Il possède sans aucun doute une fonne détenninée qui lui pennet de main tenir son identité dans le temps, ainsi que des coordOllllées dans notre champ visuel, où il peut occuper différentes positions. Mais il ne possède pas d'autres faces que l'on pourrait voir96. Ce sont là, en vérité, deux aspects d'un même phénomène : notre conscience que le flotteur n 'est pas localisé dans l'espace extérieur encapsule, pour ainsi dire, notre conscience qu'il ne possède pas d'aspects absents. Le flotteur n'étant nulle part, il nous est impossible d'être ailleurs vis-à-vis de lui pour le voir sous d'autres faces. (2) Les objets picturaux constituent une autre catégorie d'objets remarquables à cet égard. Lorsque vous êtes devant La chaise et la pipe de Vincent van Gogh, la chaise représentée sur le tableau n'est pas quelque part par rapport à vous (bien que le tableau le soit)97 Or, cette fois encore, la chaise ne se présente pas comme quelque chose qui pos sède des aspects absents, d'autres faces pour le moment hors de vue (par exemple une face arrière) que vous pourriez voir si vous étiez situé ail leurs. Comparez avec votre expérience visuelle d'une vraie chaise : lorsque vous êtes face à une vraie chaise, vous l'appréhendez comme située dans la pièce (vous partagez son espace), et vous tenez pour acquis (entretenez la conviction tacite98) qu'elle peut être vue sous d'autres faces et que son aspect visuel exhibera tels patterns de changement familiers SI vous vous déplacez de telle manière. Le point notable est que ce 96 Je concède qu'une analyse différente du phénomène de flotteur pourrait être défendue. On pourrait mettre en avant que les flotteurs sont appréhendés comme des objets tridimensionnels, et non comme de simples images. Si l'on favorise cette analyse, il faut dire que l'on s'attend à ce que les flotteurs puissent pivoter (c'est lUle possibilité en droit) et ainsi tourner une autre face (pour le moment invisible) vers nous. 97 Voir J.-P. Sartre, L 'imaginaire. Psychologie phénoménologique de l'imagination (1940), Paris, Gallimard, 1986, part. p. 35 sqq. et p. 232-233. 98 Voir J. J. Drunnnond, « The Enactive Approach and Perceptual Sense '>'>, in op.cit., p. 14.
212
GUNNAR DECŒRCK
Vincent van Gogh, La chaise et la pipe. Huile
sur
toile, 93
x
73
cm,
Décembre 1888. Cr The National Gallery, London.
contenu représentatiOIlllel - ou sens noématique - et ce système d'at tentes se
co-conditionnent. Autrement dit : on ne peut pas nOUfTir ces attentes sans voir la chaise comme quelque chose de réel, quelque chose qui est vraiment là dans la pièce, sur quoi l'on peut s'asseoir et que d' autres peuvent vou. A l'inverse,
on ne peut pas voir
cet objet comme
lUle vraie chaise (ou, si l'on préfère, faTIner la croyance qu'il y a lUle vraie chaise devant soi) sans en même temps entretenir la conviction tacite que l'aspect de l'objet changera de telle manière réglée si tels chan gements ont lieu dans les circonstances de perception. Nourrir ces attentes est lUle condition pour que notre épisode de perception véhicule ce genre de contenu représentatiOIlllel, et vice versa.
(3)
Considérons llll dernier exemple, qui offre llll cas pour ainsi dire
symétrique aux deux précédents. Est-ce qU'llll arc-en-ciel possède des aspects absents, par exemple lllle face arrière ? Sans contredit, on ne peut jamais voir le dos d'llll arc-en-ciel, parce qu'on ne peut jamais passer derrière. L'arc-en-ciel est llll type d'objet dont on ne peut, pour ainsi dire, percevoir qu'lllle seule face. Cependant, la question ici n'est pas tant de savoir ce que l'on peut effectivement voir ou ne pas voir de l'arc-en-ciel, mais elle est de savoir
comment (,>, op. cit. Comme l'explique bien J. Benoist, connnentant l'analyse husserlienne de l'espace : « Toute place autour de moi est lUle place à laquelle je pourrais me rendre, et cette possibilité, en tant que possibilité concrète, fait partie de l'expérience que je fais de moi-même en tant que subjectivité originairement incarnée. Ainsi, mon être corporellement "ici" ouvre autour de moi une infinité de "là", qui sont pour moi autant d'''ici'' possibles (, s'agissant de possibilités concrètes). '>'> (J. Benoist, « Space as Achieved hnpossibility '>'>, conférence pro noncée au colloque Raum eifahren. Epistemologische, ethische und iisthetische Zugiingen, Freiburg im Breisgau, 25-27 juin 2015. Disponible sur : https://univ-parisl .academia.edul JocelynBenoist. Je traduis)
ESQUISSE D'UNE PHÉNOMÉNOLOGIE DES MOUVEMENTS DE L'ORANT Sylvain CAMILLERI
Dans le champ religieux, prier s'entend généralement en trois grandes acceptions : élever son âme vers Dieu, demander à Dieu des choses conve nables, converser avec Dieu1. Par métonymie, chacune de ces acceptions renvoie à un ensemble de fonnules elles-mêmes composées de paroles censées actualiser, en le bonifiant, Ull état de choses. Ces paroles peuvent être prononcées dans le silence le plus total ou, au contraire, vocalisées. Elles peuvent donc relever, soit d'un verbe intérieur, soit d'un verbe exté rieur. Dans les deux cas, le phénomène de la prière est conçu comme un acte de parole, exemple insigne d'un langage perfonnatif C'est ainsi que l'ont considéré, à raison sans doute, une majorité de philosophes, panni lesquels ceux qui se revendiquent, ouvertement ou non, de la méthode d'analyse phénoménologique2. Après avoir déclaré que « La prière est le phénomène religieux par excellence », Jean-Louis Chrétien note ainsi que « si nous ne pouvions adresser la parole à Dieu ou aux dieux, aucun autre acte ne serait susceptible de viser le divin »3. Et sans doute se sent-il autorisé par l'étymologie du verbe latin orare, qui a signifié « parler » avant de signifier « prier » . Mais Jean-Louis Chrétien ne néglige pas que « l'acte de présence à l'invisible » qu'est la prière « met en jeu l'homme tout entier, dans toutes les dimensions de son être, il l'expose dans tous les sens du tenue et sans retenue »4. Et le philosophe de poursuivre : Cet acte de présence concerne notre corps, sa tenue, sa posture, sa ges tuelle, et peut comporter telle exigence de purification corporelle préalable, 1 Puisqu'il faut bien s'ancrer quelque part, nous nous en référons ici à la définition la plus équilibrée à tous égards qu'il nous ait été donné de lire, à savoir celle que donne Adolphe Tanquerey dans le premier livre de son célèbre Précis de théologie ascétique et mystique, Paris, Desclée, 1923, p. 324. 2 Voir notamment J.-L. Chrétien, L 'arche de laparole, Paris, PUF, 1998, chap. II : « La parole blessée. Phénoménologie de la prière '>'>, p. 23-54, et l'ensemble des contribu tions dans le volume collectif édité B. E. Benson & N. Wirzba (eds.), The Phenomenology ofPrayer, New York, Fordham University Press, 2005. 3 J.-L. Chrétien, L 'arche de la parole, p. 23. 4 Ibid, p. 26.
216
SYLVAIN CAMILLERI comme des ablutions, telle exigence vestimentaire, comme de couvrir ou de découvrir certaines parties de notre corps, telle position, comme d'élever les mains ou de s'agenouiller, telle orientation. Toutes ces pratiques, qu'elles soient d'obligation ou laissées au gré de l'orant, se rassemblent en une comparution, qui incarne l'acte de présence. Même celui qui se tourne vers l'incorporel le fait avec son corps, de tout son COrpS5.
Si nous nous avançons plus loin dans cette voié, nous pouvons donc suggérer que le phénomène de la prière peut aussi bien être conçu comme un acte chamel ou corporel, à la condition toutefois d'admettre que les mouvements du corps qui l'accompagnent ne sont pas moins investis de sens que les paroles qui sont dites en fournir la substance et qu'il existe même une sorte de parallélisme entre celles-ci et ceux-là. Auteur d'une œuvre majeure et classique sur la prière, œuvre phénomé nologique au sens typologique, Das Gebet (1917), Friedrich Beiler le dit à sa manière : La parole n'est qu'une des manières d'exprimer la vie psychique, et l'atti tude, la mimique et le geste l'accompagnent toujours. Il en est de même dans la prière. Elle ne se compose pas seulement de paroles ; elle est tou jours accompagnée de certaines attitudes, de certains mouvements et cer tains jeux de physionomie. Et s'il était vrai que le langage par gestes est plus ancien que le langage parlé, nous pourrions admettre que le geste de la prière est plus ancien que les paroles de la prière ( . . ) Mais nous n'avons pas ici à examiner si le geste précède le son et si l'attitude de prière précède la prière. Ce qui est certain, c'est que, partout où nous trouvons la prière, nous trouvons aussi certains gestes qui l'accompagnent. Les grandes expé riences spirituelles qui sont à l'origine de la prière mettent en mouvement toutes les possibilités d'expressions corporelles7• .
Que la prière se donne de manière également essentielle comme un phénomène incarné, telle est donc l'hypothèse qui guidera cette contribution. Mais il convient de la préciser aussitôt en insistant sur deux points.
5 Ibid, p. 26. 6 Et, ici, il le faut. Jean-Louis Chrétien précise bien qu'il n'aborde « que la prière comme acte de parole " (L'arche de la parole, op. ci!., p. 23) et, s'il n'oublie pas que la « présence à l'invisible ,>,> qu'elle est s'inscrit « dans un corps ,>,> (p. 27), ce dernier reste en retrait dans sa conception de la prière, puisqu'il semble se réduire à ce support « des actes par lesquels l'orant déclare à Dieu ou aux dieux ses désirs, ses pensées, ses besoins, son amour, son repentir, selon les diverses possibilités de la parole qui vont du cri à l'acte de remuer les lèvres sans se faire entendre, en passant par la voix haute et le munnure '>'> (p. 27). La parole reste reine, et de loin. 7 F. Heiler, Laprière (1917), trad. de E. Kruger & J. Marty, Paris, Payot, 1931, p. 103 et p. 116.
ESQUISSE D'UNE PHÉNO:MÉNOLOGIE DES MOUVEMENTS DE L'ORANT
217
Le premier est que nous mettrons ici en avant ses fondements phé noménologiques plutôt que ses fondements historiques, sans bien sûr négliger que les uns et les autres sont foncièrement entrelacés et qu'on ne saurait les distinguer qu'à des fins méthodologiques. Heiler semble l'avoir concédé quelque peu malgré lui dans un passage qui nous pennet en même temps de préciser notre problématique et d'introduire à ce qui va SUIvre : Toutes ces attitudes, ces coutumes, ces gestes, sont l'héritage de temps très anciens. Ils appartiennent à cette [affile de la religion qui s'est pieusement transmise de siècle en siècle. Or, justement parce qu'ils ne sont pas des expressions spontanées de l'expérience religieuse individuelle, mais un bien traditionnel commun à un grand nombre de tribus, de peuples et de races, leur explication et l'éclaircissement de leur origine soulèvent de grandes difficultés [ . . F .
Le second point est que la justification des fondements phénoméno logiques de la prière conçue comme acte chamel ou corporel, si elle peut en tirer le plus grand bénéfice, ne peut néanmoins s'aider de Husserl et des analyses qui procèdent de son œuvre que jusqu'à un certain poine. En d'autres tennes, si nous pouvons accorder sans problème que « tout mouvement du corps de chair est plein d'âme »10 et, partant, que les mouvements de l'orant sont le fait d'une volonté animée, nous pensons que le corps en prière, en première comme en dernière instance, est plus capable encore que ce qu'un examen de type husserlien - qui accorde déjà beaucoup au corps - ne le laisse à penser et qu'il est même, de manière quelque peu paradoxale il est vrai, la condition de possibilité
8 Ibid, p. 112. 9 Il faudrait établir mille nuances, en tenant compte des positions contrastées de Husserl dans les Ideen II, la Psychologie phénoménologique, la Philosophie première, les Méditations cartésiennes, la Krisis et nombre de manuscrits. Pour une synthèse bien infor mée et courageuse, cf David W. Smith « Mind and Body ,>,>, in D. W. Smith & B. Smith (eds.), The Cambridge Companion to Husserl, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 323-393. Nous avons ici toutes les raisons de nous tourner vers les successeurs de Husserl qui ont mis le corps à l'honneur, en particulier Merleau-Ponty. Nous ne nous y reporterons pas directement, mais les développements de ce dernier intéressent notre propos en ce que le corps priant possède indéniablement la marque de l'anonymat et de l'irréfléchi que Merleau-Ponty prête au corps en général et qu'il tient pour responsables de ses capacités perceptives dans les processus d'institution du sens et de formation de la culture. 10 E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phé noménologique pures. Livre second: Recherches phénoménologiques pour la constitution, tr. de É . Escoubas, Paris, PUF, 1982, § 54 (cité plus loin Ideen II).
218
SYLVAIN CAMILLERI
d'un degré de spiritualité que l'âme est incapable d'atteindre par elle même et par elle seule. D'abord parce que la prière en tant que telle est un Zusammenhang, une cOllllexion de mouvements psycho-physiques irréductible à toute autre et qui a ses droits propres, avec son mandat d' habeas corpus, pour ainsi dire - il faut produire le corps ; le corps, tout autant que l'âme, doit se produire devant Dieu pour être jugé. Ensuite parce que, nous l'avons insinué d'entrée de jeu, la prière est un phénomène qui spécifie et com plexifie la relation entre l'âme et le corps dans le sens d'une impérieuse dialectique entre la parole et le geste, qui se retrouvent dans un style commun et dans la perfonnance qui lui correspond - un aspect dont on peut dire, sans grande crainte de se tromper, que Husserl n'a fait qu'effleurerll. Aussi le phénomène de la prière dOlllle-t-il toute son importance et sa profondeur au bon mot de la sagesse populaire : « joindre le geste à la parole ». À ce sujet, Alain Berthoz explique très bien comment « le geste accompagne la pensée, la sculpte et peut résumer toute la com plexité d'une situation »12. Mais ce raisonnement peut être poussé beau coup plus loin. Non pas jusqu'à dire que le geste possède en toute circonstance la capacité de se substituer purement et simplement à la parole, mais au moins jusqu'à penser un rapport d'implication dans le sens d'un enchaînement (implicatio) pratiquement inéluctable. Joindre le geste à la parole, donc, pour intensifier l'action, pour lui donner l'épais seur qui en conditiolllle l'efficace. L'appel au geste est comme l'appel au secours d'une parole qui voudrait se dépasser mais ne peut manquer de rencontrer ses limites dans sa prononciation ou sa profération même. Lorsque j 'intime à mon fils l'ordre d'aller dans sa chambre, je ne peux réfréner un geste du bras, depuis l'épaule jusqu'au doigt qui pointe dans une direction précise. De même lorsque je me promets, y compris en son absence, d'être toujours là pour lui, je ne peux me retenir de me pencher en avant tout en me baissant, comme prêt à l'enlacer. Le corps vient en renfort d'un ego dont la motilité propre se borne à l'é-motion. Les Il À ce sujet on ne pourra plus faire l'économie de l'ouvrage de Jean-Sébastien Hardy, La chose et le geste. L 'essence phénoménologique du mouvement chez Husserl, Paris, PUF, 2018. L'auteur y montre la richesse et les limites des analyses husserliennes en même temps qu'il tente, en sa troisième partie, d'« opérer une radicalisation de la compréhension du mouvement de la chair, afin de la ressaisir connne geste, c'est-à-dire non plus seulement connne officiant des projets intentionnels de l'ego, mais bien comme origine et support des structures cardinales du monde " . 12 A. Berthoz, La simplexité, Paris, Odile Jacob, 2009, p. 129.
ESQUISSE D'UNE PHÉNO:MÉNOLOGIE DES MOUVEMENTS DE L'ORANT
219
mouvements du corps prêtent à cet ego un pouvoir qui lui échappe en partie parce qu'il ne dépend pas uniquement et absolument de lui : c'est le pouvoir de métamorphoser une intuition en une expression et de l'inscrire ostensiblement dans le monde, fut-ce de manière éphémère. Un pouvoir qui répond à un besoin, sinon une pulsion : exister et se sentir exister, dans le monde, vis-à-vis de soi-même, avec les autres, occasion nellement devant Dieu (coram Dea). Cette quasi-nécessité du mouvement s'observe en effet de manière éclatante dans la prière, qui a son « réper toire » de gestes à nuls autres pareils - en dépit d'une analogie marquée avec la vie sociale, comme Heiler, encore lui, l'a bien montré13 -, des gestes « qui se placent dans un contexte » spécifique et le « reflète »14. Ce contexte est loin d'être anodin, mais il n'influence pas plus le réper toire de gestes que ce dernier ne le façonne dans l'exacte mesure où le corps est un « organe de perception »15 dont les actions participent à la configuration du monde daus lequel il évolue. Pour que le répertoire de gestes qui est celui de l'orant fasse advenir un sens, et pour que ce sens puisse servir à gratifier une situation, il faut alors que ces gestes, dans leur concaténation, respectent une logique sui generis, celle de la per sonne qui les exécutent dans une intention précise, qui peut être ici d' établir un contact avec Dieu, de se faire conjointement entendre et voir de Lui. Si l'on ne peut donc pas dire n'importe quoi, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Dans la prière, la gesticulation est au mouve ment ce que le bavardage est à la parole. Raison pour laquelle cette contribution commencera par quelques remarques préliminaires sur la concentration requise afin que le geste ne soit pas j oint à la parole en vain, pour qu'il se confonne lui-même à l'intention de l'orant, celle-là même qui préside déjà à sa parole et qui se doit d'être toujours simulta nément tension orientée de son corps si elle espère réellement son rem plissement. Bientôt notre hypothèse se transfonnera donc en une conviction attestée par maints cultes à plusieurs reprises dans l'histoire du monde : aller au bout de l 'expérience religieuse exige de chorégraphier son désir de Dieu. Déplier cette logique sui generis dont il vient d'être question et qui est appelée à commander aux mouvements de l'orant est ce que nous nous proposons de faire en prenant appui sur un exemple bien 1 3 F. Heiler, La prière, op. cit., p. 522. 14 A. Berthoz, La simplexité, op. cit., p. 128 et p. 129. 1 5 Selon l'expression de Husserl, Ideen II, op. cit., p. 6 1 .
220
SYLVAIN CAMILLERI
spécifique : la prière canonique islamique (salât). Pourquoi cet exemple plutôt qu'un autre ? Tout d'abord parce qu'il faut bien en prendre un et qu'il nous semble préférable d'en privilégier un seul et non plusieurs, au risque de nous perdre dans les méandres de l'histoire des religions. Ensuite parce que dans l'imaginaire occidental moderne et contemporain, la prière canonique islamique est, à tort et à raison, celle en laquelle on reconnaît volontiers l'importance du mouvement, sans toutefois pouvoir se l'expliquer et parfois sans se garder, par méconnaissance ou par préjugé, de la critiquer en la réduisant à un mauvais spectacle. Mais la prière canonique islamique ne possède aucune précellence en la matière. D'ailleurs, du point de vue d'une anthropologie historique, le répertoire de gestes qui est le sien est redevable aux répertoires des prières juives et chrétielllles, qui elles-mêmes empruntent aux répertoires des religions et cultes romains, grecs et proche-orientaux anciens16. Pas plus de légiti mité historique qu'une autre fonne de prière, donc, mais une légitimité phénoménologique, à l'instar de toutes les autres fonnes de prière passées et actuelles dans lesquelles les mouvements de l'orant jouent un rôle de premier plan. Le Coran lui-même, dans la perspective hiéro-historique qui est la sielllle, atteste des origines syncrétiques de la prière islamique, mais aussi de la place cardinale qu'y tient le mouvement : « Voilà ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits, ce sont les prophètes de la postérité d'Adam [ . . . ], c'est la postérité d'Abraham et d'Israël [ . . . ] . Lorsqu'on leur récitait les enseignements du Miséricordieux, ils se prosternaient la face contre terre en pleurant » (Coran 19, 58). Le texte sacré de l'Islam ne décrit pas la prière canonique dont il sera question plus loin. Celle-ci sera fixée plus tard que le mushâj, le recueil écrit des révélations orales17. Mais ses grands traits s'y trouvent préfigurés, notamment dans la vigile ou « prière 16 Cf F. Heiler, La prière, op. cit., p. 103-116, mais aussi, entre autres références, M. 1. Gruber, Aspects of Nonverbal Communication in the Ancient Near East, Rome, Institut Biblique Pontifical, 1980 ; D. Aubriot-Sévin, Prière et conceptions religieuses en Grèce ancienne, Lyon, Maison de l'Orient Méditerranéen, 1992 ; Simon Pullyn, Prayer in Greek Religion, New York, Oxford University Press, 1997 ; A. Corbeill, Nature Embo died- Gesture in Ancient Rome, Princeton, Princeton University Press, 2003 ; U. Ehrlich, The Nonverbal Language of Prayer: A New Approach to the Study of Jewish Liturgy, Tübingen, Mohr-Siebeck, 2004 ; Jennifer A. Glancy, Corporal Knowledge: Early Chris tian Bodies, New York, Oxford University Press, 2010 ; Marion H. Katz, Prayer in Islamic Thought and Practice, Cambridge, Cambridge University Press, 2013. Nous puiserons abondannnent dans cette dernière référence qui constitue une excellente cartographie du sujet, quoique son approche soit foncièrement historique et que la philosophie n'y tienne qu'une place réduite. 17 M. H. Katz, Prayer in Islamic Thought and Practice, op. cit., p. 19.
ESQUISSE D'UNE PHÉNO:MÉNOLOGIE DES MOUVEMENTS DE L'ORANT
221
de la nuit »18, qui met en avant l'importance des attitudes corporelles imprégnant déjà la prière des juifs, des chrétiens et des zoroastriens, qui forment avec les musulmans la communauté des gens du Livre (Ahl al-Kitâb, cf Coran 2, 53 ; 3, 43 ; 3, 1 13). Or, ces attitudes corporelles sont inconcevables sans le mouvement qui donne de les réaliser et de les coordOllller. Cela se vérifie déjà dans l'étymologie du verbe sallâ que donne le linguiste Zamakhsharî : « mouvoir des parties des deux côtés du coc cyx »19. Mais pour en revenir au Coran, le plus intéressant pour nous est peut-être que nombre de ses versets tendent à démontrer que l'essence de la prière réside dans l'acte de prosternation (sujûd), lequel symbolise la posture du cosmos tout entier envers son Créateur�w : « N'ont-ils pas vu que tout ce que Dieu a créé incline son ombre à droite et à gauche pour l'adorer, pour se prosterner devant lui ? Devant Dieu se prosterne tout ce qui est dans les cieux et sur la terre : les animaux comme les anges, tous dépouillent leur orgueil » (Coran 16, 50-51, cf 13, 15; 22, 18; 55, 6). Nous examinerons plus loin comment le corps priant dessine en vérité une révolution, une trajectoire en courbe fennée autour de cet axe qu'est la prosternation et dont le point de retour, la station debout, coïncide avec le point de départ, sans négliger les position intennédiaires intimement liées que sont l'inclinaison, le fléchissement et l'agenouillement. Nous aurons de même l'occasion d'observer que cette circularité du mouve ment général de la prière islamique, loin d'épuiser les significations des mouvements particuliers composant ses différents cycles21, ne cesse au contraire d'en souligner la valeur intrinsèque ainsi que la solidarité. Rete nons pour l'instant le caractère originairement dynamique de la prière islamique. Notons maintenant que celui qui s'emploie à dévoiler le phénomène de la prière ne peut ignorer que plusieurs des gestes, des attitudes du 18 Cf A. d'Alvemy, « La prière selon le Coran. II. La prière rituelle '>'>, Proehe Orient Chrétien, 10, 1960, p. 3 1 7 ; U. Rubin, « Moming and Bvening Prayers in Barly Islam '>'>, Jerusalem Studies in Arabie and Islam, 10, 1987, p. 40-64. 1 9 Mahmud ibn Umar al-Zamakhsharî (m. 1144), AI-Kashshâfan haqa 'iq al-tanzil wa uyun al-aqârvil fi wujûd al-ta 'wil, vol. l, Le Caire, Halabi, 1966, p. 1 3 1 (commentaire de Coran 2, 2) ; cité dans Marion H. Katz, Prayer in Islamie Thought and Praetiee, op. eit., p. 19. 20 Cf M. H. Katz, Prayer in Islamie Thought and Praetiee, op. eit., p. 15 et p. 114121. 21 La prière canonique en compte cinq. Il semble que la prière islamique, à l'origine, n'en comptait que deux - si l'on en croit Aïcha, la fille du Prophète, selon le Sahih (Kitâb al-salât) de Bukhârî. Le Coran, quant à lui, ne précise pas. Nous reviendrons plus loin sur cette question et, sllliout, sur la nature exacte de ces cycles.
222
SYLVAIN CAMILLERI
corps et des positions qui l'accompagnent sont aussi COllllUS dans la vie profane comme des moyens d'exprimer des sentiments sociaux : affec tion, amitié, respect, humilité, soumission, etc.22. Sans doute les senti ments d'un homme à l'égard de Dieu sont-ils en nature identiques à ceux qu'il éprouve à l'égard de ses semblables. Mais ne peut-on pas conjectu rer qu'ils diffèrent radicalement en intensité ? Si, comme nous le croyons, tel est bien le cas, alors il faut découvrir ce qui fait cette différence de degré et qui par-là même sublime le sens des mouvements concernés. Ce n'est pas seulement le contexte mais, plus exactement, l'attention au contexte. Celle-ci est au corps ce que l'intention est à l'esprit. Le corps s 'intéresse à ce qui est visé par l'esprit, c'est-à-dire Dieu. En ce sens, l'attentiOllllalité du corps propre se superpose à l'intentionnalité de la conscience. Ce que la tradition appelle nfya, tenue généralement traduit par « intention » - pour dire l'effort mental par lequel on marque son projet d'accomplir ses devoirs religieux -, est une action à part entière qui place le corps non moins que l'esprit dans un état de « révérence » (khushû) et le prédispose à faire son œuvre pour et dans la prière. Cet état se traduit physiquement par une im-mobilité qui marque le seuil de la série de gestes que la salât sous-entend23. La « présence du cœur » (hudûr al-qalb) est donc en même temps « présence du corpS )} (hudûr al-jasad)24, dont les membres doivent cesser d'errer et se rassembler, se recentrer en leur pouvoir propre. Car si l'esprit commande au corps les mouvements qu'il doit effectuer, le corps est en retour cela qui va per mettre de maintenir l'intention vivante, valide et sincère aussi longtemps que dure la prière. En tant qu'acte de la conscience, la nfya ressortit à une intentionna lité affective. Elle répond à un appel qui affecte. Ce qui affecte l'orant et le conduit à se re-constituer, c'est Dieu qui se fait connaître ou se donne à lui sous les espèces d'un sentiment d'absolue dépendancd5. Ce sentiment 22 F. Heiler, Laprière, op. cit., p. 113-114. 23 Fakhr al-Râzî, AI-Tajsir al-Kabir, vol. 23, Beyrouth, Dâr Ihyâ al-Turâth al-'Arabî, s. d., p. 77 ; cité par M. H. Katz, Prayer in Islamic Thought and Practice, op. cit., p. 56. 24 La langue arabe possède trois mots pour dire le corps :jasad,jism, badan. Nous retenons le premier car il équivaut précisément à l'allemand Leib. Voir D. Gril, « Le corps du prophète '>'>, Revue des mondes musulmans et de la MéditelTanée, 113-1 14, 2006, p. 37-57. 25 Selon les modèles liés de 1'« intentionnalité renversée ,>,> et de la « contre-inten tionnalité '>'> développés respectivement par Emmanuel Levinas et par Jean-Luc Marion dans leurs développements sur le visage, sur l'appel et sur Dieu (cf notannnent Totalité et infini, Den Haag, Nijhoff, 1961, et Étant donné. Essai d'une phénoménologie de la donation, Paris, PUF, 1997). Des mooèles qui font subir une torsion certaine à l'intention nalité affective telle qu'en parle Husserl dans Eifahrung und Urteil, mais aussi dans les
ESQUISSE D'UNE PHÉNO:MÉNOLOGIE DES MOUVEMENTS DE L'ORANT
223
se spécifie en une émotion, qui est un mouvement de l'esprit se manifes tant, comme vécu de conscience, dans une conduite réactive qui, nous allons le voir immédiatement, a son pendant dans un vécu corporel et qui, surtout, a son « type d'évidence » et son « style cognitif» propres26. Sans doute serait-il plus juste de parler d'un réseau d'émotions, auxquelles répondront d'ailleurs des attitudes et des mouvements corporels contras tés bien que liés. L'analyse de la prière canonique islamique tend en effet à montrer ou à confinner que le mysterium tremendum isolé par les his toriens de la religion et en particulier par Rudolf Otto dans sa célèbre étude sur Le Sacré'7 est en réalité un savant mélange d'effroi (hayba), de peur (khawj), d'espoir (rajâ), de honte (hayâ), de plaisir (dhawq), d'amour (hubb) et d'humilité (dhulT). Tous participent du sentiment d'absolue dépendance et aucun néanmoins n'est réductible à un autre28. En tant qu'acte du corps, qui s'enchaîne à l'acte de conscience que nous venons de décrire, la nfya ressortit à une intentionnalité opérante ici comprise radicalement comme intentiOllllalité du corps de chair en tant qu'il « projette autour de lui un certain » et qu'il est en même temps le foyer d'une motricité « originaire » qui, dans la prière, doit en venir à épouser les mouvements de l'esprit par et dans une relation de motivation29. Mais cette même relation ne signifie pas que je suis ici logé dans mon corps comme un pilote en son navire. Elle veut dire plus fon damentalement que les émotions sont, pour ainsi dire, appelées à rejoindre leur base, à se ré-innerver dans leurs fondements corporels afin de se
Analysen zurpassiven Synthesis et ailleurs. D'après ces textes, non seulement serait-il plus juste de parler de « co-intentionnalité '>'>, mais il faudrait également reconnaître que ce qui affecte ne peut jamais être qU'lUle objectité mondaine. C'est du moins ce qu'il ressort des analyses fort convaincantes de Bruce Bégout dans La généalogie de la logique. Husserl, l'antéprédicatif et le catégorial, Paris, Vrin, 2000, p. 167 sq. 26 Nous nous appuyons ici sur la définition phénoménologique de l'émotion inspirée de Scheler que développe Anthony J. Steinbock dans l'introduction de son récent Moral Emotions. Reclaiming the Evidence of the Heart, Evanston, Northwestern University Press, 2014. 27 Cf R. Otto, Das Heilige. Über das ùrationale in der Idee des Gottlichen und sein Verhiiltnis zum Rationalen, Breslau, Trewendt und Granier, 1917. 28 Sur cette combinaison d'éléments irréductibles les uns aux autres dans l'affecti vité propre à la prière islamique, cf M. Holmes Katz, Prayer in Islamic Thought and Practice, op. cit., p. 62-65. 29 Cf M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de laperception, Paris, Gallimard, 1945, p. 269 et p. 164-166. Nous partons donc du sens que recouvre lafungierende Intentiona litiit pour Husserl et plus encore pour Merleau-Ponty, sans toutefois lui faire précéder temporellement l'intentionnalité d'acte, notamment parce que cette dernière n'est pas nécessairement objectivante, et parce que l'intentionnalité opérante, à proprement parler, n'est pas anté-catégoriale mais institue ses catégories propres.
224
SYLVAIN CAMILLERI
redéployer autrement par rapport à la manière dont elles ont d'abord été reçues ou dont elles sont d'abord advenues, maintenant qu'elles sont, sinon comprises, du moins COllllues de l'ego et comme en cours d'assi milation ou d'appropriation. Et c'est par le mouvement coordonné que le corps, qui a lui-même subi les émotions advenues à l'esprit, quand il n'a pas lui-même été l'interface qui a absorbé le premier choc, va pouvoir « apprivoiser » ces émotions, « ré-instituer » leur sens et pennettre à la nfya de ne pas rester une intention vide. Ces deux moments ou ces deux mouvements de la nfya sont, bien entendu, structurellement liés et dessinent même un chiasme qui est la clé de ce qu'on pourrait appeler, en s'inspirant de Husserl, le Wegsystem kinesthétique de la salât30 Avant de tenter une description phénoménologique relativement détaillée de ce Wegsystem, nous nous proposons d'en livrer une descrip tion empirique sommaire. Le fidèle commence la prière en se tenant debout et en prononçant à haute voix et en arabe la fonnule « Dieu est le plus grand » (Allahu akbar). Ce faisant, il lève ses deux mains à hauteur de ses épaules, ses pawnes ouvertes en direction de la qibla, c'est-à-dire le lieu vers lequel doit s'orienter le corps priant et qui n'est autre que la kaaba, édifice de fonne cubique situé au cœur la mosquée sacrée de la Mecque. Il place ensuite sa main droite sur sa main gauche au niveau de sa poitrine ou bien laisse tomber ses bras le long de sa taille, fixe attenti vement des yeux l'endroit où il viendra appuyer son front au moment de se prosterner, puis il récite la première sourate du Coran, « L'ouvrante » (al-Fâtiha), suivie d'une autre ou d'une partie d'une autre sourate. Puis, répétant « Dieu est le plus grand », il s'incline, mains sur les genoux, de façon à ce que la partie supérieure et la partie inférieure de son corps fonnent un angle droit. En position inclinée, il répète par trois fois au moins, sans bouger rien d'autre que ses lèvres : « Gloire à mon Seigneur tout-puissant » (Subhâna rabbi al- 'zim). Il revient ensuite en position ver ticale tout en prononçant : « Dieu entende celui qui le loue » (Sami 'a Allahu li-man hamidah). Puis le fidèle s'agenouille et se prosterne dans un même élan, ses mains posées de part et d'autre de sa tête, en disant trois fois à voix basse : « Gloire à mon Seigneur le Très-haut » (Subhâna rabbi al-a 'la), tout en maintenant son front contre terre. Il relève son front et se met sur ses genoux en répétant « Dieu est le plus grand ». Son séant
30 E. Husserl, Zur Phiinomenologie der Intersubjektivitiit. Texte aus dem Nachlass. Dritter Teil. 1929-35, éd. par 1. Kem, Husserliana XV, Den Haag, Nijhoff, 1973, p. 290 et p. 327.
ESQUISSE D'UNE PHÉNO:MÉNOLOGIE DES MOUVEMENTS DE L'ORANT
225
est posé sur son pied gauche replié vers l'intérieur et son pied droit perpendiculaire. Mains sur les genoux, il prononce trois fois « Seigneur pardonne-moi » (Rabbi ghfir-li). Puis il répète « Dieu est le plus grand » et se prosterne à nouveau en munnurant trois fois « Gloire à mon Seigneur le Très-haut ». Enfin il se remet debout en disant « Dieu est le plus grand ». L'ensemble de cette séquence constitue une rak'a ou cycle de prière. Selon le moment de la journée et selon l'occasion, la prière com prend d'un à quatre cycles (raka 'ât). Ces cycles vont généralement par paire, et toujours au tenne du second cycle le fidèle marque une césure et récite le tashahhud, une variation de la shahâda, la profession de foi musuhnane : « J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammâd est son messager » (Ashadu an-Iâ 'ilâha 'illâ-llâh was ashadu anna mu!wmmad rasülu-llâh). À la fin de la dernière rak 'a et avant de se rele ver, le fidèle invoque après le tashahhud la louange sur les prophètes et tourne la tête à sa droite et à sa gauche successivement pour dOllller la paix en disant à haute voix : « La paix sur vous et la miséricorde de Dieu » (As-Salâm aleikum wa Rahmtou-Allah). Avant d'examiner au sein de l'ensemble détaillé les gestes paradig matiques de l'orant en mouvement, revenons sur la remarque cruciale de Heiler suivant laquelle ces gestes ne sont pas des expressions spontanées de l'expérience religieuse individuelle. Tout porte à croire en effet qu'ils sont les figures concrètes de ce que nous pouvons nommer avec Husserl une série d'« habitualités kinesthétiques »31. Nous parlons de gestes qui résultent d'une action dont les motivations résident à mi-chemin entre l'instinct et la volonté32. Ils fonnent presque comme une seconde nature, un savoir sédimenté qui est périodiquement réactivé par la nîya. En bref, ces gestes font apparaître un monde historique, pour autant que l'on accepte avec Husserl que si « ce que je génère à partir de moi-même est mien » - comme c'est le cas des mouvements de l'ego orans -, je suis et reste « un enfant des temps », un « membre d'une communauté de nous ( . . . ) influencé par ses ancêtres, les proches comme les plus loin tains : je suis ce que je suis en tant que leur héritier »33. Ce qu'il nous
3 1 E. Husserl, Die Krisis der europiiischen Wissenschaften und die transzendentale Phiinomenologie. Eine Einleitung in die phiinomenologische Philosophie, éd. par W. Eie rnel, Husserliana VI, Den Haag, Nijhoff, 1976, p. 109. 32 E. Husserl, Ideen zur einer reinen Phiinomenologie und phiinomenologischen Philosophie. Zweites Buch: Phiinomenologische Untersuchungen zur Konstitution, éd. par M. Eiernel, Husserliana IV, Den Haag, Nijhoff, 1952, p. 258. 33 E. Husserl, Zur Phiinomenologie der Intersubjektivitiit. Texte aus dem Nachlass. Zweiter Teil. 1921-28, Hg. v. 1. Kem, Husserliana XN, Den Haag, Nijhoff, 1973, p. 223.
226
SYLVAIN CAMlLLERl
faut donc dévoiler, c'est comment ces gestes racontent lUle tradition dont la nonnalisation résulte d'lUl processus non-clos d'institutions origi nelles que seul lUl questiOIlller-en-retour permet de reconstruire et de comprendre. "
,
• • " "
,
, ..
"
-", ... ,...
"
"
, " ....... ......-_ ... ......
"
Le cycle de prière s'amorce en « station debout » Cette dernière est le premier des grands « piliers »
(qiyâm ou woquf). Carkân) de la salât ;
l'lUl des plus répandus aussi, dans l'ensemble des cultes, anciens comme nouveaux, orientaux comme occidentaux : « Le plus ordinairement, on prie debout, rappelle Heiler. Le fidèle se tient droit, le visage tourné vers la divinité >,35 . En Islam, la station debout est attestée au moins indirec tement par le Coran, notamment dans le verset 38 de la Sourate 2 : « Tenez vous debout pour prier avec piété >,
36
. Quel sens lui dOIlller ? Notons tout
d'abord qu'elle se prête particulièrement bien à l'analogie avec le domaine profane. Joseph Chelhod explique
« Comme dans la vie
sociale, il semble que la station debout marque la rencontre. Aujourd'hui, on se tient debout par respect ou par courtoisie. Mais c'est également l' attitude de celui qui veut parer à llll danger : à l' approche d'llll ennemi on se tient debout, prêt à la riposte. Il est possible qU'lllle telle posture ait pu signifier, à l'origine, la rencontre avec lllle Puissance contre laquelle
)4 E. w. Lane, An Account of the Marmers & Customs of the Modern London, MlUTay, 51860, p. 76-77. 35 F. Heiler, La prière, op. cit., p. 105. 36 Cf également Coran III, 39.191 ; XXII,26 ; XXv, 54 ; XXXIX, 9.
Egyptians,
ESQUISSE D'UNE PHÉNO:MÉNOLOGIE DES MOUVEMENTS DE L'ORANT
227
on doit se défendre » 37. Nous reviendrons plus bas sur l'importance de l'idée de rencontre, mais nous pouvons d'ores et déjà adresser à l'inter prétation de Chelhod - rejoignant celle de Heiler, mais aussi de Mauss38 - le même reproche que Heidegger, dans le § I l de Sein und Zeit, formule à l'endroit de l'ethnologie (mais aussi de la psychologie et de l'anthropo logie sur lesquelles elle s'appuie), à savoir qu'elle se meut « dans des préconceptions et des interprétations » ontiques et qu'« un comparatisme ou un typologisme syncrétique ne peut prétendre apporter une authentique connaissance d'essence »39. Pour ce faire, il faut s'en retourner à un niveau plus fondamental, revenir en quelque sorte au plan ontologique. Or, c'est précisément ce que pennet la psychologie phénoménologique d'Erwin Straus, qui thématise la structure originelle de la station debout comme étant celle de la « posture verticale » (Upright posture). Cette dernière est loin de n'avoir trait qu'à des « problèmes teclmiques de loco motion »40. Être debout, ou se tenir verticalement, ce n'est pas seulement « maintenir l'équilibre » mais « pré-établir une attitude définie envers le monde »41 ; en sorte qu'il est possible d'affinner que la posture verticale n'est rien de moins qu'un « mode spécifique de l'être-au-monde »42. En tant que telle, elle connote une « activité et une attention »43 qui en font une « position de repos » tout relatif44. Dans le cas de la prière, elle est toute pleine d'une « tension kinesthétique », « tension retenue », et bientôt relâchée, qui annonce la transfonnation et même l'enchantement, si l'on peut dire, du monde de l'orant. Il est ainsi possible d'approfondir l' ana lyse de Straus et d'avancer que si la posture verticale implique chez l'homme un état de veille - car il lui est impossible de donnir debout à strictement parler -, le qiyâm de la prière islamique implique en sus un état d'éveil tout à fait particulier, notamment dans la mesure où il ouvre une « séquence » dont les « con-séquences » ne concernent pas seulement la nécessité pour l'homme de se préservetS, mais la possibilité pour lui de concentrer tous ses efforts vers la réalisation d'un seul but : rencontrer
37 J. Chelhcxl, « Les attitudes et les gestes de la prière rituelle dans l'Islam '>'>, Revue de l 'histoire des religions, 156, n2, 1959, p. 179. 3 8 M. Mauss, La prière, Paris, Alcan, 1909, p. 65. 39 M. Heidegger, Sein und Zeit, Halle, Niemeyer, 1927, p. 51-52. 40 E. W. Straus, Phenomenological Psychology, New York & London, Garland, 1980, p. 137. 4 1 Ibid., p. 137. 42 Ibid., p. 139. 43 Ibid., p. 141. " Cf Ms. D 12 J, 20-23. 45 E. W. Straus, Phenomenological Psychology, op. cit., p. 142.
228
SYLVAIN CAMILLERI
Dieu. En résumé, la posture verticale atteste d'une énergie remarquable qui pennet de la caractériser comme un mouvement à part entière. Du reste il n'est pas inutile de relever que ce mouvement fait corps avec un autre qui le précède immédiatement, celui de se lever. Or, se lever, c'est lutter, contre la gravité, résister, à toutes les forces qui nous tirent irrémé diablement vers le bas46. Être debout, devant Dieu, est une position qui n'est donc pas dOIlllée et même constamment menacée par les risques bien réels de chute dont les motifs possibles, physiques ou psychiques, sont iIlllombrables. Revenons à présent sur l'idée de rencontre. Nous avons vu avec Chelhod que la station debout marque la rencontre. L'histoire en témoigne depuis la nuit des temps : se lever et se tenir debout devant une personne d'importance (un sage, un gouvernant, un officiel, etc.) est un geste social accepté en de nombreux contextes. Il est signe de respect, de révérence et peut-être même de peur, un signe qui traduit immédiatement et tangi blement 1'« effet puissant de la présence même » de l'individu pour et devant lequel on se lèvé7. Maintenant il est intéressant de noter qu'un texte comme Lévitique 19, 32 associe la portée profane et la portée reli gieuse de ce geste : « Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis 1' Éter nel ». Évidemment le texte biblique ne peut pas être ici son propre ratio na/e. Nous pouvons alors partir d'un argument développé par Uri Ehrlich, selon lequel « se dresser est un geste inconcevable en l'absence de quelque chose ou de quelqu'un devant qui l'on se tient debout et dont la présence même précipite l'acte de se lever »48. Et nous pouvons l'expli citer, le compléter et le radicaliser en avançant que l'orant ne peut se tenir en station debout que parce qu'il a toujours déjà reconnu la présence - même absente, évanescente - de Dieu dans son monde, fut-ce aux frontières externes de celui-ci. Certes, le problème demeure de savoir ce qui atteste cette présence. Peut-on parler d'une présence objective, de pareille nature à celle de cet 'allm, ce savant qui a fait son entrée dans la Mosquée avant-hier ? Non. Il s'agit d'un autre type de présence, ou d'une autre objectivité qui ne résulte pas tant de mes perceptions que de conventions établies au fil du temps jusqu'à fonner une nonnalité nor mative dont j'hérite en vertu de l'intersubjectivité inhérente à l'ego orans
46 Ibid., p. 143. 47 u. Ehrlich, The Nonverbal Language of Prayer. A New Approach to Jewish Liturgy, Tübingen, Mohr-Siebeck, 2004, p. 19. 48 Ibid., p. 16.
ESQUISSE D'UNE PHÉNO:MÉNOLOGIE DES MOUVEMENTS DE L'ORANT
229
que je suis ou que je deviens au sein d'une communauté49. Mais il y a plus. Car à cette intersubjectivité tout à la fois dia- et synchronique se superpose une intersubj ectivité intra-chronique qui marque la rencontre de l'orant avec Dieu et qui apparaît en filigrane des mouvements de la prière. Par le geste marqué de se tenir debout, comme par ceux qui vont suivre, l'orant présentifie - en régime d'intropathie - une altérité dont il peut bien faire l'expérience cependant qu'elle conserve ses distances en vertu de sa transcendance aux limites de l'immanence et de nature aussi incompressible qu'incompréhensible. Cette rencontre de l'orant avec Dieu qui s'institue par et dans le qiyâm n'est donc pas celle d'un sujet (l'orant) avec un objet (Dieu), mais d'un sujet (l'orant) avec un autre sujet (Dieu) qui s'esquisse à partir des mouvements du corps propre du premier de ces deux sujets. De la station debout l'orant passe à la station inclinée (rukû '). Chel hod s'accorde avec Heiler pour dire que l'inclinaison est empruntée au répertoire de gestes de la « salutation profane » avec le sens que voici : « Plus on s'incline profondément, plus on témoigne son respect à la per Smille qu'on salue »50. En soi cette analyse est on ne peut plus juste. Elle a d'ailleurs elle aussi son assise dans le Coran : « ceux qui croient ( . . . ) ceux qui s'acquittent de la prière ( . . . ) tout en s'inclinant humblement »51. Toutefois, ici encore, nous avons le devoir de reconduire ladite analyse à ses fondements expérientiels, d'en exhiber la structure phénoménolo gique. Straus nous est à nouveau d'une grande aide. Ses analyses éclairent parfaitement la combinaison des deux stations. D'abord en expliquant que l'inclinaison est un mouvement qui fatalement nous « rapproche de l'autre », qui entend réduire la distance à l'altérité dont nous venons de parler52 ; ensuite en ajoutant que l'inclinaison, tout comme l'action de se pencher, signifie littéralement « dévier » de l'austère verticale ( . . . ) Lorsque nous baissons nos têtes ou nous agenouillons en priant, lorsque nous nous courbons ou plions nos genoux en saluant, la déviation du vertical révèle la relation que nous entre tenons avec lui ( . . .) Il n'y a qu'une seule verticale, mais de nombreuses déviations, chacune d'entre elles possédant une signification expressive spécifique.53
49 Cf E. Husserl, Husserliana XV, op. cit., p. 428-433 et p. 593-633. 50 J. Chelhod, « Les attitudes et les gestes de la prière rituelle dans l'Islam '>'>, art. eit., p. 182. 5 1 Cf également Coran IX, 112 ; XLVIII, 29. 52 E. W. Straus, Phenomenological Psychology, op. cit., p. 145. 5; IbUi., 1980, p. 145-146.
230
SYLVAIN CAMILLERI
Celle de l'inclinaison dans la prière, dans le droit fil de ce que nous avons déjà dit, se laisse traduire dans ce vers du rappeur Akhenaton : « L'inclinaison de ma tête - et pourrions-nous rajouter, l'inclinaison de mon tronc - est une réponse directe à l'inclinaison de mon cœur »54. Si la station inclinée approfondit la station debout, le mouvement par le truchement duquel l'orant passe de l'une à l'autre doit correspondre à l'intensification de la présence de Dieu devant lui. Il s'agit, pour le dire avec Straus, d'un nouveau « geste expressif » concomitant d'une nou velle « attitude émotionnelle »55. La présence de Dieu se fait donc plus vive, et l'inclinaison vise à réduire la distance qui nous sépare de lui. Mais, paradoxalement, elle ne fait qu'en marquer toute l'étendue. C'est en toute conscience de l'insignifiance du rapprochement accompli par rapport à une altérité infiniment éloignée que l'orant s'incline, en sorte que son geste lui sert à exprimer son infériorité et, per contra, la supé riorité de Dieu. Et si « plus grande est l'infériorité », qu'elle soit réelle ou seulement ressentie, « plus exagéré sera le geste »56, il n'est pas éton nant que le rukû ' de la salât forme idéalement un angle droit entre le tronc et les jambes. Cette relation de sujet à sujet n'est pas relation d'égal à égal, ne serait-ce que parce qu'elle est relation d'un corps à de l'imma tériel : un corps peut plier - devant Dieu -, Dieu ne plie pas. Plier, c'est donc céder, recOllllaître une asymétrie principielle, sans que cela soit assi milable à un acte désespéré, sans que cela entraîne de renoncer à la ren contre. Au contraire, en assumant cette asymétrie, l'orant rend grâce à Dieu pour ce qu'il voudra bien lui donner, dans l'espoir qu'il voudra bien lui accorder quelque chose, ne serait-ce que de l'entendre ou de le par donner. Mais plier, c'est aussi se soumettre, raison pour laquelle la station suivante s'annonce déjà dans le mouvement même d'inclinaison. De la station inclinée l'orant revient à la station debout un court instant pour repartir presque immédiatement vers la station prosternée. Il est intéressant de noter que Heiler néglige la prosternation : elle est à ses yeux une phase purement transitoireS? Il n'en va pas ainsi dans la prière islamique. De l'avis du plus grand nombre, cette station constitue l'acmé de la salât. Le Coran dit moins clairement que pour les autres gestes que la prosternation doit compter au rang des gestes qui composent 54 Shurik'n feat. Akhenaton, « Manifeste '>'>, Oùje vis, Delabel, 1998, piste 15. 55 E. W. Straus, Phenomenological Psychology, op. cit., p. 145 n. 56 R. Firth, « Verbal and Bodily Rituals of Greeting and Parting '>'>, in Jean Sybil La Fontaine (ed.), The Interpretation of the Ritual, Londres, Tavistock, 1972, p. 19, cité par U. Ehrlich, The Nonverbal Language ofPrayer, op. cit., p. 45. 57 F. Heiler, Laprière, op. cit., p. 106.
ESQUISSE D'UNE PHÉNO:MÉNOLOGIE DES MOUVEMENTS DE L'ORANT
23 1
la prière canonique. Il ne se prive toutefois pas de mettre en valeur la ferveur religieuse qui lui est attachée, comme dans les versets 107-108 de la sourate XVII : « Oui, ceux qui ont déjà reçu la Science tombent prosternés sur leurs faces lorsqu'on leur lit le Coran ( . . ) ils tombent sur leurs faces en pleurant, leur humilité augmente », ou dans le verset 29 de la sourate XLVIII : « On les reconnaît [Le Prophète et ses compagnons 1 car on voit les traces de leurs prosternations sur leur front »58 . Chelhod note quant à lui : .
Devant son monarque, l'ancien Oriental ne se contente pas de se courber en deux, il se jette aussi à genoux et se prosterne. Le Musulman, devant Dieu, ne procède pas autrement ( . . ) Les auteurs arabes comparent juste ment le fidèle prosterné à l'esclave à genoux, aux pieds de son Seigneur, à qui il demande grâce et pardon. Son attitude, précise-t-on, doit être celle de la parfaite soumission, de sorte que chaque partie de son corps témoigne de sa condition d'esclave. C'est pourquoi non seulement le front doit tou cher la terre, mais également le nez selon plus d'un théoricien, cet organe étant, en effet, le symbole de l'orgueil et du dédain ( . . ) D'après Sa'rânî, Dieu manifeste sa toute-puissance à son adorateur au moment précis de la prosternation. Le fidèle ne peut supporter tant de grandeur. 59 .
.
Nous comprenons que la prosternation creuse encore la distance entre l'orant et Dieu exprimée Wle première fois par l'inclinaison. Il s'agit sans conteste d'Wl geste « extrême »60, mais dont la radica lité ne fait que retraduire la facticité de l'orant, le caractère par trop labile et par trop fragile de son être dans Wl monde troublé et gros d'Wle insé curité à peine supportable. Le corps se met donc en position de supplier. L'orant s'en sert pour démontrer à quel point il désire être épargné, sou lagé ou protégé du risque de l'existence - bien plus que des pouvoirs de Dieu, qui peut certes décider de terrasser le croyant mais qui, dit-on, est bénévolent et miséricordieux comme aUCWle créature ne peut l'être. Encore Wle fois, cela ne signifie aUCWlement que l'orant n'ait pas envie de vivre, de s'ouvrir et de se réjouir de ce dont il peut jouir. Mais il lui faut préalablement céder, montrer qu'il a reconnu les limites de sa résis tance, pris la mesure de sa finitude. Dès lors nous comprenons que le mouvement de la prosternation soit Wle déviation de la verticale tout à fait singulière : il s'agit d'Wle chute depuis la station debout. Une chute néan moins maîtrisée. Le corps s'écrase contre le sol mais ne se désarticule pas 58 Cf également Coran III, 43 ; XXII, 26 et 77. 59 J. Chelhod, « Les attitudes et les gestes de la prière rituelle dans l'Islam '>'>, art. cit., p. 182-183. 60 U. Ehrlich, The Nonverbal Language ofPrayer, op. cit., p. 45.
232
SYLVAIN CAMILLERI
pour autant, signe que l'orant reste concentré et mû par l'intention de progresser. En ce sens le sujûd n'est pas aussi extrême que la prosterna tion totale que l'on trouve par exemple décrite dans les manuscrits de Qurnrân et qui demande de l'orant qu'il s'étale sur le sol de tout son COrpS61. Les deux postures ont néanmoins ceci en commun de montrer comment s'est cristallisé dans les prières juives et musulmanes l'histoire de Moïse qui, selon Deutéronome 9, 24-25, s'efforce de racheter son peuple qui fut rebelle contre l' Éternel en se prosternant devant Lui. Dans cette histoire, « le corps est un site de mémoire - un lieu visuel, incarné, rappelant l'œuvre du prophète »62, dont les mouvements évoquent une relation compliquée et pourtant vitale. Tandis que la station debout dit la rencontre et la station inclinée confinne l'asymétrie entre les deux partis, la station prosternée entreprend d'instaurer et d'entretenir une alliance entre l'orant et son Dieu. Et ce qu'il nous faut noter en dernier lieu, c'est que le mouvement d'une station à l'autre n'est pas seulement ce qui confère la cohérence symbolique à l'ensemble, mais encore ce qui pennet d'en faire la véritable expérience vécue d'un soi en devenir63, aussi loin d'une rêverie quelconque que d'une démarche strictement mécanique. Dans la salât, donc, les mouvements ne se présentent jamais séparément, isolément, ils se suivent, changent ou sont dans une position transitoire. Ils ne sont correctement exé cutés dans la mesure où ils sont adaptés à la situation et bien maîtrisés ( . . . ) Nous produisons en passant d'lUle position de repos préalable à une autre qui la suit une espèce d'encadrement dans lequel le se-mouvoir prend la [affile d'lUl mouvement quasi-individuel. Nous obtenons une position de départ et une position de tenninaison. Les deux positions sont perceptibles et se dégagent comme telles de la situation d'ensemble, elles sont transposées de la sphère pathique dans la sphère gnosiquéi-.
Cette esquisse a laissé de côté nombre de gestes inhérents à la prière islamique canonique pour se concentrer sur ses trois stations principales et sur le mouvement apparemment fragmenté qui en fournit l'articulation. C'est notamment vrai de certains gestes des bras, de la main et de la tête au début, au milieu et à la fin de la sâlat;65. Une étude exhaustive se 61 Cf J. H. Newman, « Embooied Techniques: The Communal Formation of the Maskil's Self '>'>, Dead Sea Discoveries, v22, 3, 2015, p. 249-266. 62 Ibid., p. 266. 63 E. W. Straus, Phenomenological Psychology, op. cit., p. 57. 64 E. W. Straus, Vom Sinn der Sinne, Berlin, Springer, 1935, p. 264-265 (trad. de G. Thinès & J.-P. Legrand, Grenoble, Millon, 1989, p. 409). 65 Il serait possible de prolonger nos explications en prenant appui notamment sur les remarques phénoménologiques de Straus (Phenomenological Psychology, op. cit.,
ESQUISSE D'UNE PHÉNO:MÉNOLOGIE DES MOUVEMENTS DE L'ORANT
233
devrait d'en tenir compte, car leur rôle dans l'économie propre du rituel est loin d'être marginal. En guise de conclusion, nous aborderons néan moins un autre point. Celui-ci n'est pas totalement déconnecté de ces gestes sur lesquels nous avons dû faire l'impasse. Nous avons déjà noté que l'orant qui s'apprête à prier oriente son corps tout entier vers un point cardinal, la qibla. Commençons par noter avec Straus qu'il ne suffit pas « que nous nous dirigions vers quelque chose, il faut encore que nous réifiions ces actes d'orientation pour qu'ils devieIlllent des directions ». Les mouvements de la prière jouent précisément ce rôle, et cela alors même qu'ils sont accomplis dans une portion d'espace fort limitée et qu'ils n'impliquent pas de déplacements latéraux, postérieurs ou anté rieurs conséquents66. Mais ce n'est pas tout. Straus avance que « je ne puis différencier » des directions « en tant que repères d'orientation à propos d'un objet ou par rapport à mon corps propre, que dans la mesure où je domine simultanément du regard la diversité et l'opposition mutuelle des directions » 67. En quoi il n'a sans doute pas tort. Pourtant cette analyse ne vaut vraiment que pour le plan horizontal du vécu. Il convient donc d'éclairer le sens des mouvements de l'orant en les resituant dans l'espace conçu au plan vertica168. Dès lors, on s'aperçoit que la salât, comme d'autres prières sans doute, montre l'homme en train de se débattre et d'hé siter entre ciel et terre. La terre est ce qui le porte, le préserve, mais aussi ce qui le menacé9. Le ciel est ce qui engendre en lui le vertige, le désé quilibre, l'inquiète, mais qui de même l'attire, l'aspire et l'ouvre au sublime subtil. La terre est un lointain proche, le ciel un lointain extrême. Par ses mouvements, l'orant sait qu'il se tient sur l'un et qu'il y est astreint, ce qui ne l'empêche pas de se dresser vers l'autre et de vouloir s'y recoIlllaÎtre70. Parce que la hauteur s'est toujours vue attachée la valeur
p. 149-159) et sur les remarques historiques de Chelhod ('>, art. cit., p. 179 sq.) et d'Ehrlich (The Nonverbal Language ofPrayer, op. cit., p. 110-119). 66 E. W. Straus, Vom Sinn der Sinne, op. cit., p. 415 (trad. ft., p. 626). " IbUi., p. 415 (trad. ft., p. 626). 68 La fécondité de la notion de verticalité pour la phénoménologie et notamment pour la phénoménologie de la religion a été mise en lumière assez récemment par Anthony J. Steinbock dans son magistral Phenomenology & Mysticism. The Verticality ofReligious Experience, Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press, 2007. 69 Cf Martin Heidegger, Logik aIs die Frage nach dem Wesen der Sprache, GA 38, éd. par G. Seubold, Frankfurt a. M., Klostennann, 1998, p. 152 (trad. de F. Bernard, La logique comme question en quête de lapleine essence du langage, Paris, Gallimard, 2008, p. 181). 70 Si, par manque de place et de compétence, nous nous abstenons de le faire ici, il faudrait relire à l'aune de cette idée l'épisooe du mi 'râj ou « voyage nocturne ,>,> du
234
SYLVAIN CAMILLERI
maximum et même absolue, et parce que l'effort qui consiste à s'élever est à la fois le plus primitif et le plus noble. Par ses mouvements, l'orant se montre tout à la fois soumis à ce qui est et détenniné à se dépasser lui-même dans son assomption de lui-même en direction du ciel ici com pris comme un absolu mouvant par opposition à un autre, la terre, sta tique. L'interprétation traditionnelle selon laquelle les gestes de la prière miment ceux de l'univers n'est donc pas sans contenir quelque vérité : les mouvements de l'orant évoquent une métamorphose successivement cata et anagénétique. C'est ultimement le sens de cette révolution que constitue la salât : régresser puis progresser devant Dieu et grâce à lui, le plus grand, sujet plus haut que toute subjectivité.
Prophète auquel il est fait allusion en Coran XVII, 1 ; LIlI, 1-18 ; LXXI, 19-25. Certains exégètes, en particulier Kusharî dans son Kitâb al-Mi 'râji, l'interprètent en disant que le Prophète « monta au ciel avec son corps " .
LE POIDS VIVANT VERS UNE PHÉNOMÉNOLOGIE DU MOUVEMENT DANSÉ
Romain BrGÉ
L'animal humain vit en troupeau, il est bipède et il n'a pas de plumes. Telle est la célèbre définition de l'être humain à laquelle arrive Platon dans Le Politique : elle intervient au moment où le philosophe se demande de quel art relève l'exercice du gouvernement ; et celui-ci appa raît comme une branche de l'art de gouverner les animaux ('>, dans Philosophie, #93, Paris, Minuit, 2007.
lE POIDS VIVANT
239
fait, faisant l'hypothèse d'une liaison d'essence entre musique et danse, Straus considère alors que cette danse libérée de son inféodation musicale a vu dans le même temps « le sol se dérober sous ses pieds9 >J. Ainsi, et telle est l'hypothèse principale que Straus formule à l'orée de sa recherche dans cet article : en se libérant de la musique, la danse perdrait dans le même moment « la structure spatiale que la musique engendre l O >J. Pourtant, malgré cette limitation de perspective historique, les cher cheurs en danse n'ont pas cessé de faire crédit à Straus d'avoir conçu un cadre théorique fort pour comprendre l'activité même de la danse : pour penser la danse, il faut penser sa relation spécifique à l'espace ll . De ce point de vue, il est sans doute vrai que la musique contribue à un certain type de mise en mouvement, qu'elle dispose à cette mise en mouvement. Mais les mouvements libres et les jeux des enfants n'ont pas attendu la danse moderne pour attester du fait qu'il y a bien un danser sans musique. Sans doute la musique prépare le geste dansant, mais il ne faudrait pas oublier qu'inversement, sans danseurs, sans l'espace nécessaire pour qu'ils évoluent, la musique ne pourrait pas apparaître, ni à eux-mêmes et ni aux autres, comme « dansante >J (ce n'est pas la même chose d'écouter uue valse dans une salle de concert et dans uue salle de bal). En uu cer tain sens, on pourrait dire que le phénoménologue oublie ici sa propre leçon, à savoir que la motricité et la sensorialité sont l'envers et l'endroit d'une même pièce. La relation de la musique à la danse n'est pas uni voque : il ne suffit pas que la musique commande des mouvements dan sés ; il faut plutôt que les danseurs dialoguent avec la musique et déploient par là son orchésalité. On peut donc faire l'hypothèse d'une dimension plus originaire du mode de rapport à l'espace qui est en jeu dans la danse - dimension qui est sans doute facilitée par l'écoute musicale, mais qui ne s'y réduit pas12. Au reste, c'est bien ce que Straus pointe de lui-même, qui évacue très 9 Erwin Straus, « Les fonnes du spatial '>'>, art. cit., p. 15. 10 Ibid., p. 16. Il cf Katharina van Dyck, « Sentir, s'extasier, danser '>'>, dans Implications philoso phiques, juin 2010. Il Dans Chanter, Narrer, Danser. Contribution a une philosophie du sentir (Sampzon, Delatour France, 2016), Anne Boissière propose de même d'élargir la concep malité straussienne du ton : d'une part, comme nous, au tonus musculaire et d'autre part, a la tonalite vocale (Stimmung). Ce parallèle laisse, chez la philosophe, apercevoir une commlUlauté a la musique (art du ton), a la danse (art du tonus), au chant et au conte (arts de la tonalité). Ce fond commun d'avant la distinction en arts expliquerait les effets de parentes qu'on exprime dans la langue en parlant de la « musicalité d'lUl geste ,>,> ou du « rythme d'une phrase '>'>, en vertu non pas d'une métaphore qui transporterait le sens musical vers d'autres domaines, mais plutôt en vertu d'une métonymie : la musique,
240
ROMAIN BIGÉ
rapidement l'idée que la musique nécessaire pour danser devrait relever d'une composition savante, ou même d'un rythme spécifique. À la rigueur, la musicalité qu'il envisage n'est même pas celle d'un son spé cifique, puisque le son implique une sorte de jeu de reconnaissance et d'assignation spatiale. L'expérience, qu'on ose alors à peine dire « musi cale », nécessaire à l'entrée en danse est ce que Straus désigne comme expérience du ton, c'est-à-dire une expérience acoustique qui est non directiOllllelle, non assignable : le ton, dit-il, « vient à nous ; il pénètre, emplit et homogénéise l'espace13. » Le ton correspond davantage à cer taines activités, ou à certains mouvements liés à l'expérience acoustique, mouvements que Straus qualifie à partir du lien étymologique entre l'ouïr et l'obéir (ob-audire, en latin, où s'entend l'audition) : de même, remarque le philosophe, que la vision renvoie systématiquement à l'idée de pointer, de suivre une flèche (l'allemand sehen [voir] résOlllle ainsi avec le latin sequi [suivre]), de même l'entendre renvoie à l'idée d'être saisi, d'être emporté ou embrassé par le ton. Cette homogénéisation, ce caractère omni-englobant du ton s'exprime de la manière la plus évidente dans une détente de la gestosphère l4, c'est-à-dire de l'espace des mouvements dis ponibles, et particulièrement dans l'ouverture motrice de l'espace arrière, par contraste avec sa valeur dans le monde optique de la marche : « la marche arrière nous déplaît dans l'espace optique ; nous cherchons à l'éviter. Pourtant, ce même - ou apparemment même - type de mouvement devient dans la danse une chose tout à fait évidente ; nous ne remarquons rien de toutes les difficultés et de toutes les résistances que nous ressentons dès le moment où nous sommes forcés de faire marche arrière15• »
Dans l'espace optique, en effet, la marche arrière est systématique ment vécue comme une bizarrerie, voire avec un certain malaise, qui n'est pas seulement lié à l'impression de chute que les muscles antago nistes du tronc sont moins adaptés à rattraper que dans la marche avant, mais plus probablement au fait qu'il est associé à la fuite devant l'ennemi comme partie du tout que forment les arts du ton/tonus/tonalité, servirait de metonymon pour le comprendre. 1 3 Erwin Straus, « Les formes du spatial '>'>, art. cit., p. 19. 14 Hubert Godard, « Le geste manquant '>'>, entretien avec Daniel Dobbels et Claude Rabant, dans Jo/Revue internationale de psychanalyse, #5, 1994, p. 64 : « J'avance la notion de gestosphère pour désigner cette idée que nous sommes constitués par ce que l'on pourrait appeler des gestes fondateurs. À un certain moment, ces gestes sont donnés, ils se développent plus ou moins selon les personnes. De telle sorte que chacun de nous développe lUle manière d'être au monde, avec une sphère de possibles par rapport à chacun de ces gestes face à une situation. '>'> 1 5 Erwin Straus, « Les formes du spatial '>'>, art. cit., p. 43.
lE POIDS VIVANT
241
ou le danger, qu'il fait signe vers un état d'alanne anonnal. C'est pour quoi, remarque Straus, le simple fait de se diriger à l'envers de ce sur quoi la vision nous ouvre appelle irrésistiblement la tête à se retourner, comme pour s'assurer, malgré notre volonté, de l'absence d'obstacle. Au contraire, dans l'espace dansé, je n'ai plus aucun problème pour reculer : les pas vers l'arrière dans les danses à deux, notamment, ne sont plus vécus comme un aller vers le danger, mais appartiennent à un espace qui s'est détendu de ces valences que lui attribuait l'espace optique. En ana lysant successivement les modes du se-mouvoir qui lui paraissent spéci fiques à la danse, comme le tournoiement et la marche arrière, le phénoménologue peut donc conclure que « les mouvements dansants emplissent l'espace de tous côtés16 » : la danse s'institue ainsi comme un système de rapport aux directions qui cessent d'être univoquement fron tales, comme dans l'espace optique, mais rayonnent autour du sujet au point de faire s'équivaloir la gestosphère avec la kinesphère, c'est-à-dire avec la sphère des gestes anatomiquement possibles, plutôt qu'avec la seule sphère des objets sur lesquels il a une prise optique. Cette sphère qui nous est ouverte de tous côtés, Straus y voit un aspect de l'expérience tonale, et tel est en effet l'argument central de son article : il y a homologie entre d'un côté l'expérience tonale comme expérience d'être affecté et saisi de partout sans que l'objet de l'expé rience soit assignable nulle part, et de l'autre l'espace multi-directionnel des mouvements qui me sont rendus possibles dans la danse. Cet argu ment nous semble, comme tel, parfaitement valide et corroboré par l'ex périence. Mais au jeu de l'étymologie qui liait tout à l'heure l'entendre et l'obéir, il nous semble qu'il faut aller plus loin et souligner une dimen sion plus originaire que ce lien relevé par Straus. Étymologiquement, le ton auquel le phénoménologue attache tant d'importance ne désigne pas tellement un objet musical que, depuis le grec TÔVOÇ, un certaine tension entre deux pôles d'attache (tension d'un muscle, d'un tendon, d'une corde, qui ne s 'applique que tardivement à la tension de la lyre, dOllllant par là le « ton » entendu comme mode musical). Or cette tension ligamentaire qu'indique le ton, c'est la même qu'on retrouve à l'origine du mot que la plupart des langues européelllles emploient pour désigner la danse Tanz, danza, danee, tâne, dança, dans, tanee provenant de l'indo-européen *tan, qui renvoie à l'action de tendre, tension ou détente. Or que le ton de la musique dispose le tonus du danseur, qu'il le mette dans un état de tension (ou de détente) propre -
16 Ibid., p. 35.
242
ROMAIN BIGÉ
à cet espace onmi-englobant dont ne cesse de s'autoriser Straus, voilà qui ne fait aucun doute : la musique infonne le sujet moteur d'une cer taine détente de l'espace, qui lui fait perdre en effet le caractère de face à-face sagittal que la prédominauce de l'optique lui faisait aborder. Mais c'est cette détente, ou cette nouvelle tension, qui caractérise en propre l'espace du danser, et non l'écoute elle-même, et plutôt qu'un espace tonal (dont les coordOllllées seraient définies par le ton musical), c'est d'un espace tonique (dont les coordOllllées seraient définies par le tonus musculaire) qu'il faudrait parler comme ce fond qui ouvre sur le geste dansé. Notre propos, dans les pages qui suivent, vise à qualifier cet espace tonique à partir de certaines pratiques de danse - celles-là même que Straus considérait comme ayant vu « le sol se dérober sous leurs pieds » et qui ont en réalité découvert un nouveau sol pour la danse décorrélé du sol que lui fournit la musique : celui de l'expérience tonique du danseur. C'est donc à la manière dont la danse moderne a investi cette expérience tonique que nous nous intéresserons. La gravité apparaîtra alors comme l'autre nom de l'espace onmi-englobant que Straus avait repéré dans le ton, et les sensations attachées à la posture seront synonymes de l'ouver ture à cet espace tonique qui sert de fonds à la danse. Nous proposerons, à l'issue de ce parcours, une analyse plus spécifique d'une fonne de danse expérimentale, le Contact Improvisation, qui nous mènera à abor der le caractère affectif et relationnel que recèlent ces mécanismes posturaux.
Le tonus postural Mais tout d'abord, qu'est-ce que le tonus ? En français, le mot connote positivement la bonne santé, l'énergie ou la vigueur, idées qui entouraient déjà le grec 'tovoç : il indique plus généralement l'état de tension d'un ligament, et plus spécifiquement des muscles lorsqu'on se réfère aux corps animaux. Au début du XXème siècle, les recherches du physiologiste Charles Sherrington ont montré le caractère non pragmati quement orienté du tonus musculaire : le tonus, contrairement aux rac courcissements et allongements des muscles liés au déplacement des membres ou du tronc, possède une fonction réflexe ou involontaire. Il désigne des variations de la consistance des muscles (de l'hypertonicité à l'hypotonicité, remarquable notamment chez les nourrissons avant et après satisfaction des besoins) indépendantes des efforts musculaires
lE POIDS VIVANT
243
commandés par le système nerveux central1? Les réflexes toniques sont plus particulièrement ce qui me soutient dans la posture érigée : ils ont une fonction « anti-gravitaire », c'est-à-dire qu'ils me pennettent de déjouer (provisoirement et sans avoir à y penser ou même à le faire) l'appel de la gravité. Ainsi, constamment je suis baigné, enveloppé par la gravité, et cependant le tonus musculaire y réagit de telle sorte que je ne sens pas le poids de mon corps, sauf quand je trébuche ou quand je m'endors. Considérons que le travail du danseur consiste à sentir cette activité du tonus : non pas à commander aux réflexes posturaux (en quoi ils ces seraient d'être réflexes), mais à observer l'activité posturale et ce qui l'influence. Tel est notamment l'objet d'une pratique élaborée par le cho régraphe Steve Paxton dans les années 1960 : la Petite danse. «
c 'est un travail de perception assezfacile : tout ce que tu doisfaire, c 'est te tenir debout et te relâcher-tu vois ce que je veux dire-et à un certain point, lorsque tu as relâché tout ce que tu pouvais relâcher et que tu es toujours debout, tu te rends compte que dans cette posture érigée il y a un grand nombre de très petits mouvements.. C'est le squelette qui te tient bien droit même si tu es mentalement relaxée. Alors, dans le seul fait de te demander de te relâcher en même temps que de rester debout, c 'est-à-dire de trouver la limite au-delà de laquelle tu ne pourrais pas te relâcher davantage sans tomber par terre, cela te met en contact avec l 'effort fon damental de soutien qui se maintient constamment dans le corps, et dont tu n 'as généralement pas besoin d'être consciente. C'est un mouvement statique qui sert de fonds-tu vois ce que je veux dire-et que tu pollues avec tes diverses activités, mais qui est constamment présent pour te sou tenir. Ce que nous essayons defaire, c 'est de nous mettre en contact avec ces différents types deforces primaires du corps, et de les rendre immédia tement apparentes. On a appelé cela "la petite danse ". C'est un nom qu 'on a choisi parce que ça décrit bien la situation et parce que, quand tu te tiens debout et que tu sens cette petite danse, tu es consciente que tu n 'es pas en train de ''faire ", et donc c 'est un peu comme si tu étais ton propre specta teur, comme si tu étais en train de regarder le spectacle de ton corps en fonctionnement. Et ton esprit ne "sait "pas ce qui se passe, il n 'essaye pas de trouver des réponses non plus-tu ne l 'utilises pas comme un instrument actif: c 'est simplement une espèce de microscope dont tufais varier les focales pour te concentrer sur certaines perception18. » 17 Charles Sherrington, The Integrative Action of the Nervous System, [1906], Cambridge University Press, Cambridge, 1947, p. 339. (NT de l'américain.) 18 Steve Paxton (avec Elizabeth Zimmer), « Interview on CBC Radio '>'>, Contact Quarter/y, vol. 3(1), FaU 1977.
244
ROMAIN BIGÉ
La fonction de la Petite danse est donc d'appeler l'attention des dan seurs aux micro-ajustements posturaux qui constituent la possibilité même de tenir debout. L'instruction paradoxale de tenir la posture érigée et en même temps de relâcher les tensions ouvre sur cette expérience tonique. Comme on peut le lire, il est clair que l'expérience tonique n'est pas liée directement au déplacement et à la pesanteur d'un corps qu'il faudrait sunnonter. Au contraire, pense le danseur, les déplacements (nos « diverses activités ») ont tendance à masquer les sensations liées à la posture. Il s'agit ainsi d'y faire abstraction de la couche volontaire qui se surimpose sur ce fonds qui me soutient et que je soutiens pour en découvrir les détails. Steve Paxton retrouve ici une intuition d'Envin Straus qui, dans un article essentiel sur « La posture érigée », comprenait cette dernière comme « une tâche à accomplir durant la vie entière19 » : malgré les apparences d'auto-entretien et d'automatisme associées au « simple » fait de se tenir debout, nous n'avons jamais tout à fait fini de nous relever de l'attraction gravitaire. C'est pourquoi il y a une liaison d'essence entre une certaine fonne de vigilance et le fait de se tenir debout, qui s'atteste au moins négativement dans le fait que le sommeil est synonyme d'un abandon complet à la gravité qui s'accompagne d'une clôture perceptive. Au contraire, « l'éveil perceptif et la force de gravitation, dit Straus, dépendent l'Wl de l'autre. L'éveil est essentiel à la posture érigée afin de contrecarrer la gravité, et la gravité détennine l'expérience éveillée20. » Telle serait la fonction de cette pratique méditative qu'est la Petite danse : ouvrir Wle porte sur cette vigilance de l'être debout. Cela établi, la question reste entière : pourquoi les danseurs et les danseuses devraient-ils, voudraient-ils se mettre en relation avec cette vigilance, au travers de l'activité primaire de la posture qui se fait en eux sans eux ? On peut trouver un début de réponse à cette question dans Wl texte d'Heinrich von Kleist, Sur le théâtre de marionnettes, où le dramaturge définit l'art de danser comme l'art d'affiner l'adéquation entre le mouve ment et la perception du poids. Toute la difficulté, pour le danseur, consis terait en effet selon Kleist à faire se conjoindre « l'âme (vis motrix) >> et le « centre de gravité du mouvement ». Partant, le mauvais danseur, le danseur « maniéré » dissocierait son geste (l'impulsion motrice) de son
1 9 Erwin Straus, « La posture érigée " [1952], traduction de l'américain par Anne Lenglet et Christine Roquet, dans Quant à la danse, #1, Sète, Le Mas de la Danse, 2004, p. 24. 20 Ibid., p. 25.
lE POIDS VIVANT
245
attention (indicatrice du centre du mouvement). Kleist décrit ainsi F . . . , lUl jelUle danseur pareillement maniéré : « quand il symbolise Pâris, debout entre les trois déesses et tend la pomme à Vénus, son âme se tient cachée (c'est effroyable à voir) dans le coude21. » Un siècle plus tard, en 1980, Meree Cunningham réclamait dans le même sens lUle virtuosité de l'attention chez ses danseurs : il leur demande de réussir des prouesses telles que « sauter vers le bas » ou bondir en même temps vers l'avant et vers l'arrière. Que signifient ces paradoxes ? Ils pointent vers lUle liberté que recherche le chorégraphe : que ses danseurs ne soient pas prisonniers de leurs propres gestes, que leur attention soit libre de pondérer lUle partie du corps qui n'est appa remment ou biomécaniquement pas impliquée dans leurs gestes. Le cho régraphe était notamment fasciné par la gaucherie dans le mouvement, ces moments de désadaptations où les danseurs se retrouvent à faire comme « lUl enfant qui trébuche ou lUl poulain qui se lève pour mar cher », c'est-à-dire où la relation à la gravité n'est plus présupposée, mais fait l'objet même du mouvement. Le jeu entre poids et mouvement peut ainsi être l'objet de modulations perceptives volontaires de la part des danseurs, et tel serait la grande invention de la danse moderne (c'est à-dire de la danse à partir du début du XXème siècle) : «
L'une des plus grandes découvertes dont la danse moderne ait fait l'usage est la gravité du corps dans le poids [the gravity of the body in weight], c'est-à-dire que plutôt que de nier (et d'ainsi affill1ler) la gravité par l'élé vation dans l'air, le poids du corps est senti en allant dans le sens de la gravité, vers le bas23. »
Et CUllllingham insiste bien pour dire que ce n'est pas tant dans l'attraction et comme la polarisation autour de mouvements chthoniens, terriens, que la danse moderne se révèle : c'est plutôt dans l'idée de jouer avec les manifestations de l'appel de la gravité - que ce soit vers le bas (dans l'abandon), ou vers le haut (dans l'effort d'élévation). Il ne s'agit pas, pour le danseur moderne, de s'opposer aux qualités de légèreté par lesquelles on qualifie d'ordinaire la danse classique. La question n'est pas d'apparaître léger ou d'apparaître lourd, mais plutôt de savoir si cet appa raître repose sur lUle relation à la gravité. Ainsi CUllllingham dit que 21 Heinrich von Kleist, Sur le théâtre de marionnettes [18 10], traduit de l'allemand par Jacques Outin, Paris, Mille et Une Nuits, 1993, p. 14. 22 Merce Cunningham, Le danseur et la danse, entretiens et traduction de l'améri cain par Jacqueline Lesschaeve, Paris, Belfond, 1980, p. 44. 23 Merce Cunningham, « Space, Time and Dance " dans Transformations: Arts, Communication, Environment, vol. 1(3), New York, 1952, p. 150. (NT de l'américain.)
246
ROMAIN BIGÉ « parler de "poids lourd" connoterait quelque chose d'incorrect, puisque ce que l'on entend par [le rapport au poids] n'est pas la lourdeur d'un sac de ciment qui tombe, ( . . .) mais bien le poids d'un corps vivant qui chute tout en conservant pleinement l'intention d'une élévation éventuelle24. »
Des pieds nus d'Isadora Duncan manifestant adhésion (dans les pièces tragiques) autant que décollage (dans les pièces plus apolliniennes) à la polarité entre la chute et son rétablissement [(ail and recovery1 de Doris Humphrey, il en effet est clair pour les danseurs modernes qu'il s'agit de jouer avec les différents degrés du rapport à la gravité, de jouer avec la pesanteur comme puissance des contraires. C'est dire que la gra vité n'est plus l'ennemi dont les danseurs auraient pour fonction de nous faire rêver d'un impossible affranchissement : l'ellllemi, la mort verticale, c'est la posture droite dans ses pointes, la fixité qui oublie que le poids n'est pas seulement lourdeur, mais occasion de prendre un élan. De ce point de vue, la gravité est un pivot pour le mouvement et non son arrêt.
Ueffort C'est là une des leçons du système Effort qu'invente le danseur et chorégraphe Rudolf Laban dans la première moitié du XXème siècle pour décrire et « noter » (comme on note en musique les partitions d'une pièce) le mouvement hmnain à partir de la combinaison de quatre fac teurs principaux : le poids, le temps, l'espace et le flux. Or dans ce système, le poids est plus qu'un simple facteur du mou vement : le temps, espace et flux ne servent qu'à « définir qualitativement la sensation de poids et à la distribuer selon des coloris corporels diffé rents25 ». Toute description du mouvement doit pouvoir se concevoir comme une nuance apportée sur la manière dont le bougeur s'oriente par rapport au poids de son corps ; ou pour le dire de manière plus exacte, tout mouvement est un certain type d'effort qui s'exprime chez Laban comme la rencontre entre une impulsion intérieure et la résistance qu'y opposent différentes pesanteurs, sous la fonne littérale des objets extérieurs ou du corps lui-même (notamment dans l'action des muscles antagonistes) ou sous la fonne plus métaphorique des habitudes contractées26. C'est ainsi 24 Ibid. 25 Laurence Louppe, Poétique de la danse contemporaine, Bruxelles, Contredanse, 1997, p. 96. 26 Rudolf Laban, La maitrise du mouvement [1950], traduction de l'anglais par Jacqueline Chalet-Haas et Marion Bastien, Arles, Actes Sud, p. 36 : « L'effort "humain"
lE POIDS VIVANT
247
que les facteurs du mouvement sont systématiquement ressaisis en fonction de deux pôles : ce qui résiste et ce qui cède27. Le rapport au temps, par exemple, s'étage entre ces deux opposés que sont le temps soudain « < qui résiste » à ce qu'on pourrait appeler l'écoulement du temps) et le temps soutenu « < qui accompagne » ou « qui cède » à ce même écoulement en laissant l'action durer). De même, le rapport à l'espace est soit direct, au sens où il atteste d'un espace compact, solide, percussif (comme mon pas lorsque je suis en colère) et où l'on peut lire une manière de résistance à l'appel gravitaire ; soit flexible, au sens cette fois-ci où le mouvement s'inscrit dans un espace meuble, multi-directiOIlllel (comme l'explosion des directions dans les cours d'école lorsque sonne l 'heure de la récréa tion). Tous les facteurs du mouvement reprennent donc la polarité fonda mentale qui concerne l'axe gravitaire lui-même, et dont celui-ci est un modèle : lutter ou s'abandonner, résister ou se soumettre à l'appel du poids. Pour notre propos, le plus remarquable dans cette définition du mou vement comme parti pris pondéral est l'idée qu'elle se décrit comme la rencontre entre des « élans intérieurs » précédant les mouvements effec tifs et une certaine résistance rencontrée dans le geste. Bien que rien ne pennette d'assurer que Laban ait lu Maine de Biran, le lecteur infonné ne peut que reconnaître ici la parenté entre les deux théoriciens qui ont placé, au centre de leurs pensées, le tenne d'effort. Comme Laban un siècle plus tard, Biran n'avait de cesse d'affinner la liaison d'essence entre l'impulsion motrice et ce qu'elle rencontre : « Si l'individu ne voulait pas ou n'était pas détenniné à corrnnencer de se mouvoir, il ne connaîtrait rien. Si rien ne lui résistait, il ne connaîtrait rien non plus, il ne soupçonnerait aucune existence, il n'aurait pas même d'idée de la sienne propre28. »
Biran y insiste donc : la résistance n'est extérieure à la volonté que secondairement (dans le contact avec des surfaces dures par exemple), et peut être décrit comme l'effort capable de résister à l'influence des capacités innées ou acquises. Avec l'effort "hlUllain", l'homme est capable de contrôler des habitudes néga tives et de développer des qualités et des inclinations dignes d'estime, malgré des influences contraires. " 27 cf Angela Loureiro, Effort - L 'alternance dynamique, Paris, Ressouvenances, 2014, p. 20 : « Chaque facteur a des intensités différentes et présente une polarité. Ces pôles sont dénommés "éléments". Dans un pôle se situent les éléments conciliants (indul gent), dénommés ainsi parce que l'attitude de la personne est d'accepter les conditions physiques qui influencent le mouvement, dans l'autre les éléments combatifs (jighting) dénommés ainsi parce que l'attitude est de résister et de lutter contre ces conditions. '>'> 28 Maine de Biran, Influence de l 'habitude sur la/acuIté de penser [1803], Paris, Puf, 1953, p. 17.
248
ROMAIN BIGÉ
la loi est plutôt que la résistance elle aussi est « intérieure », et qu'elle est plutôt faite des débats entre deux moments de l'impulsion, celui qui va avec, et celui qui résiste. Et comme Laban, Biran conçoit ce différen tiel comme l'expérience du moi. C'est ce qu'à la suite de Jan Patocka, on a pu appeler le cogito moteur de Biran, c'est-à-dire ce fait que « l'arti culation du "je pense" et du "je suis" s'effectue au sein du mouvement, en est pour ainsi dire l'œuvre29. » Ce n'est donc plus « je pense donc je suis » mais « je pèse donc je suis >J. La fonnule est d'autant plus tentante que l'étymologie la suggère : penser, possiblement en raison de la concentration de l'esprit que cela suppose, provient du latin penso [peser ou soupeser] . Le cogito, plus encore que moteur, serait ainsi pour Biran, pondéral : c'est dans la mesure oùje fais l'épreuve de moi-même comme « à bouger » et non seulement comme en mouvement que je peux bien dire qu'il y a lUl moi. Paul Schilder dans L 'image du corps (livre qui exerce une grande influence sur la Phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty) a fort bien analysé ces phénomènes en montrant comment la sensation du poids en général (le nôtre, ou celui des objets que nous manipulons) est liée à l'activité musculaire. Par exemple, si je tends mon bras devant moi et en contracte les muscles, la sensation sera inévitablement lUl alourdis sement du bras, même si la masse objective n'en aura évidemment pas changé. De même, si je gonfle mes poumons et bloque ma respiration, bien que leur masse objective en soit allégée, c'est irrésistiblement lUle sensation de lourdeur qui viendra habiter ma cage thoracique. Plus géné ralement, dans tous mes déplacements, plus je ferai d'effort pour me déplacer (peut-être, par exemple, parce que je suis engourdi ou fatigué), plus j'aurai la sensation que mon corps est lourd : la quantité de matière apparente dans lUle masse, y compris la mienne, est ainsi donnée dans l'effort musculaire que j 'exerce à son encontre. Comme le dit Schilder, « dans nos tendances au mouvement, nous traitons notre corps comme n'importe quelle autre masse30 ». Autrement dit, nous nous représentons notre poids comme nous nous représentons le poids des objets, à savoir comme lUle certaine quantité d'effort à faire : nous nous représentons notre corps à la mesure de la qualité de mouvement dans laquelle nous nous trouvons impliqués. C'est ce qu'il veut dire lorsqu'il affinne que 29 Renaud Barbaras, L 'ouverture du monde. Lecture de Jan Patocka, Chatou, La Transparence, 2011, p. 147-148. 30 Paul Schilder, L 'image du corps. Étude des forces constructives de la psyché, [1935], traduction de l'américain par François Gantheret et Paule Truffert, Paris, Galli mard, 1968, p. 1 1 1 .
lE POIDS VIVANT
249
« notre corps perçu n'est rien de plus qu'une masse lourde, et les change ments dans la perception du corps ne seront souvent que des changements dans la perception de cette masse lourde31• »
Ces changements sont l'accomplissement central de notre motricité : bouger, c'est bouger cette masse pesante ou plus exactement, en changer la répartition à l'intérieur de la topologie imaginaire du corps propre. Les variations du tonus musculaire liées à la dynamique posturale, même si elles ne relèvent pas de la même contractilité qui est impliquée dans l'effort pour se déplacer ou soulever un objet, nous infonnent donc des variations du poids de notre corps. Biran est un précurseur de ces réflexions, et de fait il va partout, dans la physiologie de son époque, chercher confinnation de la corréla tion entre le soi et le sentiment du corps comme poids. Ainsi le philo sophe s'autorise des effets de la paralysie sur la capacité à localiser les sensations pour confinner sa théorie de l'effort : un patient paralysé des jambes ressent une douleur s'il est pincé, mais ne sait pas où elle se trouve. Le poids du corps et sa spatialité sont ainsi liés : sans possibilité motrice, le corps propre perd ses contours32. De même Biran réinvestit l'expérience de pensée de Condillac : imaginons une statue, à laquelle on adjoindrait progressivement les sens. Il serait trompeur, dit Biran, de considérer qu'un tel être immobile serait jamais capable de sensation. Une statue, aussi miraculeusement sentante qu'on l'imagine, n'aura jamais la perception d'événements extérieurs à un « moi » qui resterait stable sous le changement. Si par miracle elle pouvait être affectée par l'extérieur, on ne pourrait pas dire que la statue sentirait l'odeur de la rose qu'on lui ferait humer : sans possibilité de se mouvoir, sans l'expé rience de l'effort, la statue deviendrait la rose sentie, sans pouvoir la distinguer d'elle-même33. Le poids du corps dans l'effort est ainsi l'assu rance de sa distinction d'avec les choses : c'est parce que je pèse autre ment que les objets qui m'entourent qu'ils peuvent m'apparaître comme distincts de moi. En un sens, on pourrait dire que Laban a cherché à dérouler les conséquences artistiques de cette découverte : l'artiste, notamment dans les arts de la scène, aurait pour tâcher d'exhiber cet effort dans lequel le moi se reconnaît. Cela s'atteste notamment dans le rapport qu'entretient 3 1 Ibid., p. 113. 32 Maine de Biran, L'effort, textes choisis par Antoinette Drevet, Paris, Puf, 1966, p. 65. 33 Ibid., p. 26.
250
ROMAIN BIGÉ
Laban à l'habileté. Assurément, c'est un bien pour le danseur comme pour tout travailleur manuel que d'acquérir un certain niveau d'adresse qui lui pennettra d'effectuer ses gestes sans effort. Mais justement, du danseur ou du comédien, on attend plus qu'une simple virtuosité, c'est à-dire la convenance entre l'impulsion intérieure et les moyens mis en œuvre : si quelque chose doit être communiquée (à la salle, aux parte naires, à soi-même), le geste qui la porte ne pourra être seulement effi cace, il faut encore qu'il manifeste en lui l'effort requis pour l'atteindre. La danseuse qui pennet à son effort de faire surface sous la virtuosité rend visible « l'atelier de la pensée et de l'action34 » et manifeste non pas seulement ce qu'elle sait faire, mais la manière même dont ce faire s'éla bore en elle. Le poids du geste sera, de ce point de vue, la marque subjective qui habite le mouvement, et c'est d'ailleurs ainsi que Laban le conçoit : il est le style propre à chacune, constitué par nos « tendances d'effort » qui se trouvent progressivement limitées au cours de nos existences par la contraction des habitudes, mais dont tout le travail chorégraphique a pour fonction de proposer la réouverture.
Le style et le phoriqne Telle serait une des grandes découvertes de la danse moderne : celle de l'empreinte personnelle de chacune comme manière unique de varier l'accent postural. Les danseurs modernes s'emparent ainsi en pratique de ce qu'une phénoménologie de la posture érigée telle que celle d'En:vin Straus nous révèle35 : la manière dont je me tiens et les valeurs auxquelles je tiens sont liées, et c'est pourquoi il faut voir dans la posture un « mode spécifique d'être-au-monde ». Un écho frappant de cette compréhension de la posture nous est donné dans la phénoménologie du style qu'élabore Maurice Merleau Ponty. En effet, avant de définir le style du peintre comme déformation cohérente, Merleau-Ponty ne manquait pas de se référer à la manière dont autrui m'apparaît comme démarche : « une femme qui passe ce n'est pas d'abord pour moi un contour corporel, un mannequin colorié, un spectacle en tel lieu de l'espace, ( . ) c'est une . .
34 Rudolf Laban, La maitrise du mouvement, op. cit., p. 27. 35 Erwin Straus, « La posture érigée '>'>, art. cit., p. 25.
lE POIDS VIVANT
251
chair tout entière présente, avec sa vigueur et sa faiblesse, dans la démarche ou même dans le choc du talon sur le sol36. »
Si le style d'un peintre est bien ce « principe unique qui prescrit à chaque élément sa modulation3? » et pas seulement le monogramme qu'il apposerait à sa perception comme une signature qui parachèverait une vision du monde dont il disposerait, c'est bien à la manière dont la démarche d'une femme au loin m'apparaît comme cette variation unique de l'accent sur l'être féminin et sur l'être humain en général. C'est ainsi à propos de la reconnaissance d'une posture que Merleau-Ponty déclare que « la perception déjà stylise » : c'est que lorsque je vois une personne se mouvoir, je ne vois pas seulement les gestes qu'elle exécute ; je vois encore le fond dont ces gestes se détachent, fond dynamique, tonique et postural, qui fait d'elle un être debout. Le danseur s'approprie, étudie ce style qui le caractérise : ce peut être pour l'effacer au profit d'une écriture chorégraphique qui en diffère, ce peut être au contraire pour l'exprimer en son essence si l'improvisa tion le demande, ou si c'est ce matériau individuel avec lequel le choré graphe travaille. On peut revenir, à ce propos, à la Petite danse décrite plus haut, où Steve Paxton propose des exercices de représentation qui mettent en jeu cette sensation pondérale : « Imaginez, mais ne le faites pas, imaginez que vous êtes sur le point de faire un pas avec votre pied gauche. Quelle est la différence ? En restant où vous êtes. Imaginez ... (répétition de la même proposition). Imaginez que vous allez faire un pas avec votre pied droit. Avec le gauche. Avec le droit. Le gauche. Restez immobile38. »
À l'évidence, Steve Paxton invite ici les danseurs à observer les effets de l'intention motrice sur la dynamique posturale - et la découverte qui est faite est que la seule intention ou préparation ou imagination de faire un pas en avant a immédiatement une répercussion sur la posture. Si je sollicite imaginairement un pas en avant avec ma jambe droite, je peux ainsi observer un déplacement du poids du corps dans la jambe gauche, qui fort logiquement, prend en charge celui de la jambe droite pour qu'elle puisse se soulever. Il y a transfert interne du poids : une jambe prend le relais de l'autre. 3 6 Maurice Merleau-Ponty, La Prose du monde, Paris, Gallimard, 1969, p. 84. 37 Ibid., p. 91. 3 8 Procédure tirée d'un atelier de Contact Improvisation donné par Steve Paxton (s.l.n.d.) ; relaté dans « Esquisse de techniques intérieures '>'>, [1987], traduction de l'amé ricain par Patricia Kuypers, Nouvelles de danse, #38-39, p. 106.
252
ROMAIN BIGÉ
Ces mécanismes compensatoires que l'animal en mouvement met en jeu dans sa motricité ont fait l'objet d'une théorisation magistrale par le danseur et analyste du mouvement Hubert Godard à laquelle nous devons nous arrêter. Le concept qu'il forge pour rendre compte de ces mécanismes est celui de « pré-mouvement39 », dont le préfixe indique d'abord que les mouvements posturaux ne sont pas compensatoires après le geste, mais anticipent sur lui. Ce mode anticipatoire du pré-mouvement est assez évident dans le cas des déplacements des membres inférieurs lorsqu'ils ont la charge de supporter le tronc : il faut bien que j 'aie allégé ma jambe droite si je veux la soulever, et si je l'ai allégée, il faut bien que son poids ainsi que le poids du tronc et de la tète qu'elle supporte (c'est-à-dire les mécanismes posturaux qui me maintiellllent au sol par elle) ait été distribué ailleurs, à savoir sur la jambe opposée. Mais le pré mouvement vaut aussi bien pour tous mes engagements moteurs. « Par exemple, si je veux tendre un bras devant moi, le premier muscle à entrer en action, avant même que mon bras ait bougé, sera le muscle du mollet, qui anticipe la déstabilisation que va provoquer le poids du bras vers l'avan-r-°. » Or en portant notre attention sur ces mécanismes, c'est bien comme mise en circulation du poids, ou des poids dans le corps, qu'ils apparaîtront à la conscience. De ce point de vue, il apparaît que tout mouvement suppose un dépôt du poids : autrement dit, lorsque je me déplace, ce n'est pas seule ment que je transporte mon poids d'une partie de l'espace vers une autre, mais que, pour ce faire, il faut que j'en laisse derrière moi une partie. C'est ce que Godard appelle la « fonction phorique », c'est-à-dire « ma capacité à avoir des demeures nomades41 » : chaque déplacement suppose une manière renouvelée d'habiter les parties du corps qui soutiennent (cpÉpffi, en grec, c'est porter) celles qui se déplacent. En attirant l'attention sur les sensations pondérales, Steve Paxton met spécifiquement au jour ce nomadisme des appuis qui qualifie la locomotion animale (par oppo sition au mouvement de croissance végétale, où le déplacement à la sur face se symétrise en enfouissement des racines) : il appelle à s'emparer du nécessaire renouvellement de l'ancrage que chaque pas présuppose.
39 Hubert Godard, « Le geste et sa perception '>'>, dans Marcelle Michel et Isabelle Ginot (éd.), La danse au .xxo siècle, Paris, Bordas, 1998, p. 224. 40 Ibid. 4 1 Hubert Godard (avec Rémy Héritier et Mathieu Bouvier), « Fond/figure ,>,> (2013), in Mathieu Bouvier (dir.), Pour un atlas des figures, La Manufacture, 2017 ; vidéo dispo nible sur http://www.pourunatlasdesfigures.net!element!fond-figure-entretien-avec-hubert gooard
lE POIDS VIVANT
253
De là peut naître une vision renouvelée de la mise en mouvement : l'attitude naturelle (spontanée) à l'égard de la mise en branle consiste à penser qu'il y a d'abord une immobilité, voire un empâtement, de laquelle le bougeur se relève pour ainsi dire, contre laquelle il lui est nécessaire de lutter. C'est de cette vision que la théorie birallllienne de l'effort expri mait sur un plan métaphysique. Or au rebours de cette dialectique de l'effort et de son sunnontement, Hubert Godard invite à penser la nais sance du mouvement, non pas à partir de l'effort ou de la contraction qui oppose une résistance à l'inertie, mais à partir de ce qui, chez le bougeur, doit céder. « C'est toute une manière de penser le démarrage du mouve ment, dit Hubert Godard. Le mouvement ne démarrerait pas par une contraction musculaire, mais par une décontraction musculaire42. » Hubert Godard propose donc de penser que c'est l'immobilité qui requiert la tension, la contraction, et non le mouvement lui-même. Cette tension est liée à l'histoire de chacun et de chacune, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans le tonus postural : c'est ce que j 'ai appris à tenir, ce à quoi j'ai appris à tenir, ce qui me fait tenir, ou ce qui me retient. Et c'est une partie de cela que je dois abandollller pour me mettre en mouvement. Pour Godard, le travail du danseur consiste à étudier ce qu'il est nécessaire de laisser s'ancrer pour rendre le mouvement possible : c'est un travail qu'il faudrait dire de release [relâchement, relaxation] au sens des Release Techniques mises en place au milieu du XXème siècle aux États-Unis et qui exercent une influence importante sur la danse contem poraine : elles pennettent en effet d'atteindre une danse fluide (le « flow » qui occupe la rhétorique de la danse depuis Laban), par une attention pennanente à consentir au poids, plutôt qu'à le garder par devers soi. On peut penser à nouveau au danseur de Kleist qui, incarnant Pâris dans l'offrande de la pomme - conservait « quelle horreur ! » - son centre de gravité au niveau du coude : le don n'était qu'à demi effectué, le poids restait coincé aux articulations. Le flux indique au contraire un relâche ment du poids dans les directions qui lui sont proposées : comme la rivière flue dans les sillons que le terrain lui offre, de même le mouve ment s'oriente en fonction des appels de poids que les gestes précédents lui suggèrent. Vous êtes debout, la Petite danse vous met en tension entre deux pôles, ciel/terre. Et dans cette petite danse, vous testez la plus petite initiation possible d'un geste que vous pourriez faire vers la droite : une 42 Hubert Godard et Laurence Louppe, « Synthèse 1 ,>,>, Nouvelles de danse, #17, 1993, p. 67.
254
ROMAIN BIGÉ
légère extension de l'index. Et plutôt que de retenir le poids vers la gauche comme les habitudes anti-gravitaires vous l 'apprennent, vous consentez au poids, vous suivez cette suggestion et ce lent déplacement, newton après newton, de votre orientation par rapport au sol : vous vous laissez suivre les conséquences de cette suggestion minimale43. Bien sûr, ce consentement au poids ne va pas sans une certaine mise en danger de soi. Comme le pointe avec rigueur la danseuse et théori cienne de la danse Alice Godfroy, l'abandon au poids implique d'« accep ter l'écrasement de soi par l'effet des forces gravitaires » : cela « ne peut que réveiller le fond inconscient des peurs archaïques liées à l'effondre ment44. » Une grande partie de l'entraînement du danseur consiste à défaire les réflexes de tensions liés à cette peur de la perte de verticalité. On pourrait trouver, dans cet effort de céder à la pesanteur, les moyens de réhabiliter la notion un peu oubliée de « grâce » du mouve ment : la grâce n'est en effet pas la négation de la bassesse et de la pesanteur, comme toute l'iconographie chrétienne et une certaine image du ballet classique nous le laissent penser - la grâce est plutôt l'inflexion ou la reprise de la pesanteur. Comme y a insisté la philosophe Simone Weil, pour penser la grâce, il faut « descendre d'un mouvement où la pesanteur n'a aucune part45 », penser une grâce qui ne soit certes pas écrasement, mais qui soit un aller vers le bas, une descente. C'est en effet un travail non moins important d'accompagner le poids du corps s'effon drant vers le sol que de le (re)tenir, et ce relâchement n'est pas une simple détente : c'est le processus actif par lequel continuellement je fais céder les barrières que la peur et l'habitude placent entre moi et le sol.
Le don du poids (à propos du Contact Improvisation) « Le danseur n'a de poids que pour le donner - pas pour le possé de:06. » Dans cette fonnule lapidaire, Steve Paxton résume l'intention d'une fonne de danse qu'il élabore aux côtés de la Petite danse : le Contact Improvisation, qui va à présent nous intéresser. Et tout d'abord, un point d'histoire : le Contact Improvisation est une fonne de danse expérimentale qui émerge dans les allllées 1970 aux 43 Procédure tirée d'un atelier de Contact Improvisation donné par Karen Nelson à Earthdance (2016). 44 Alice Godfroy, Prendre corps et langue. Étude pour une dansité de l'écriture poétique, Paris, Ganse Arts et Lettres, 2015, p. 108. 45 Simone Weil, La pesanteur et la grâce [1947], Paris, Plon, 1988, p. 45. 46 Steve Paxton, « Solo Dancing '>'>, Contact Quarterly, vol. 2(3), Spring 1977, p. 24.
lE POIDS VIVANT
255
États-Unis et qui s'est depuis transmise à peu près partout dans le monde. Diversement utilisée dans l'entraînement des danseurs contemporains, mais aussi pratiquée sur les cinq continents par des communautés de bougeurs qui se réunissent dans des espaces de « jam » (similaires aux jam-sessions du jazz et aux milongas du tango), le Contact Improvisation entre en résonance avec toute la culture des arts du mouvement qui se développe dans les années 1960 et 1970 : des sports de glisse connne le surf ou le skateboard à l'importation occidentale du yoga et des arts martiaux. Né de la rencontre entre l'aïkido, l'acrobatie et la danse, le Contact Improvisation place ses danseurs dans des situations souvent laissées en jachère par les sociétés post-industrielles : des situations d'in timité tactile, de porter et de chute où la collaboration des partenaires est parfois essentielle à la survie. De l'extérieur, le Contact Improvisation ressemble tantôt à des chiens qui se chamaillent, tantôt à des gens qui font l'amour, tantôt à des gens qui font la sieste, tantôt à de la voltige. De l'intérieur, les contacteurs vivent dans un monde de tournoiements, plongés dans un bain tactile et pondéral. Le guide qu'ils s'efforcent de suivre, dans ce monde de sensations inhabituelles, est le désir de rester en contact physique avec leurs partenaires. Or dans ce contact, il ne faut pas simplement entendre une conti guïté de peaux, mais un constant tomber vers l'autre : le contact maintenu entre les danseurs y est en effet le résultat d'une chute perpétuelle des deux partenaires l'un vers l'autre, qui sans cesse elles se désaxent pour s'atteindre. Ainsi le partage du contact implique-t-il un partage du poids, et le partage du poids le partage de la chute et de ses reprises incessantes par les mécanismes posturaux. C'est ce que pennet d'étudier l'exercice des « petites danses partagées » décrit ci-dessous : « Placez le sommet de vos crânes l 'un contre l 'autre. Restez là un instant. L 'idée d'une petite danse, le mouvement dans, et autour, du squelette, le surgissement et la pause des muscles ... très petit ... essayez d'être en accord avec la petite danse de l 'autre sans manipuler la vôtre.. et puis, de la mêmefaçon que vous laissez la petite danse se transformer en une marche, laissez le point de contact de vos têtes se déplacer en roulant. Pennettez à votre corps de s 'ajuster au mouvement et à la pression de ce point. Ce qui est important, c 'est de partager ce point de contact ... ilfaut se fier à l 'équi libre et aufait que votre système musculaire s 'adapte automatiquemenf7. »
47 Procédure tirée d'un atelier de Contact Improvisation donné par Steve Paxton à Seattle (1977) ; repris dans « Tmnscription '>'>, art. cit., p. 89.
256
ROMAIN BIGÉ
L'accordage des petites danses est un accordage tonique : les systèmes musculaires posturaux s ' allient pour résOllller ensemble. C'est un mécanisme bien COllllU des danses à deux, comme le tango ou même le swing : les deux partenaires fonctiOlllel nt comme un système dont le centre de gravité n'est plus seulement tenu en chacune, mais partagé. On le conçoit, dans ce partage postural, le risque de l'effondrement que nous soulignions à l'endroit du consentement à la gravité se com plique à présent d'une dimension relationnelle. L'espace de la danse devient ainsi un espace de soutien au moins potentiel fourni par le par tenaire : c'est dans la mesure où une partie de mon poids est susceptible d'être soutenue par une autre, prise en charge momentanément, que l'es pace s'ouvre pour moi. Cette idée que le soutien est ce qui autorise le mouvement est cor roborée par les recherches menées par le précurseur l'approche psycho motrice en psychologie, le psychiatre Julian de Ajuriaguerra, sur ce qu'il appelle le « dialogue tonique » entre la mère et le nourrisson48. La néo ténie humaine est telle, on le sait, que pendant les premiers mois de sa vie, le nourrisson est incapable de se mouvoir par lui-même : il est sans cesse porté et transporté par les parents, sans pouvoir engager sa motri cité faute de coordination, notamment entre les muscles fléchisseurs et extenseurs, qu'il s'apprend à lui-même progressivement en mettant à l'épreuve de manière désordonnée un certain nombre de gestes aveugles. Avant que cette coordination n'apparaisse, l'essentiel du mode d'action dont dispose le nourrisson est de l'ordre du spasme musculaire, dont le cri est la première expression et le sédiment. Henri Wallon le remarquait déjà : « Le spasme a pour étoffe l'activité tonique des muscles qui précède les mouvements proprement dits. L'agitation du nourrisson est faite de brusques détentes qui le font passer d'une attitude à une autre. Dans chacune d'elles, les muscles semblent se tendre et se durcir, plutôt qu'ils ne se raccour cissent ou ne s'allongent en vue de gestes qui puissent explorer l'espace. La contraction y est massive, tétanifoffile, s'y propage en nappe, intéresse particulièrement la musculature vertébrale et proximale, c'est-à-dire celle qui servira surtout à l'équilibre du COrpS49. »
48 cf Michel Bernard, Le corps, Paris, Seuil, 1995, ch. 6 : « Une synthèse fruc tueuse : le dialogue tonique " . 49 Henri Wallon, L 'évolution psychologique de l'enfant, [1941], Paris, Annand Colin, 2012, p. 148.
lE POIDS VIVANT
257
Autrement dit, l'essentiel de l'activité du nourrisson est « postu rale » à ceci près qu'il n'y a pas là de posture à tenir, puisque l'enfant repose en pennanence, soit sur le sol, soit, et c'est précisément là que la théorie d'Ajuriaguerra intervient, dans les bras des parents. Telle est en effet l'hypothèse de travail du psychiatre que d'avoir considéré que la fonction de ces premières réactions toniques est relatiOllllelle : l'activité tonico-posturale est « la fonction de communication essentielle pour le jeune enfant, fonction d'échange par l'intennédiaire de laquelle l'enfant donne et reçoit50. » Ce mode de communication s'exprime au mieux en parlant de contagion tonique : l'enfant partage avec les parents son état affectif en leur présentant des variations toniques auxquelles ceux-ci s'accordent (et non seulement réagissent) ; l'état d'alanne du nourrisson (hypertonicité) est partagé par les parents comme son état d'apaisement (hypotonicité), ou plus exactement, ce partage est ce qui est recherché par le nourrisson et en fonction duquel les réactions seront progressive ment adaptées aux situations de l'environnement. La syntonie ou l'accor dage tonique avec le ou les parents sera ainsi le facilitateur de l'émergence d'une relation objectale. La personnalité du nourrisson se façonne en même temps qu'elle façonne et met en question l'environnement qui l'accueille et prend soin de lui. C'est dire que le nourrisson n'est pas, du fait de son immobilité, un être passivement infonnable ni même naïve ment transportable - bien plutôt, c'est parce qu'il met à l'épreuve, dans la relation tonique avec le parent, les situations auxquelles il est confronté, qu'il peut se les approprier. Jan Patocka appelait « proto-mouvement » ce rapport premier au monde, mouvement qui est placé sous le signe de l'affect (fond tonico postural) plutôt que de l'action (déploiement musculaire) et où « l'homme est par tout son être, tributaire de l'autre homme dans sa fonction de protecteur, créateur de sécurité et de chaleur vitale, donateur d'unité, d'adhérence et d'attachement51 ». Et le phénoménologue tchèque ne s'y trompait pas en référant ce premier mouvement de l'existence à la Terre : c'est en effet dans le rapport gravitaire que s'entretient cette première relation, à la fois parce qu'elle suppose l'enracinement du parent (qui, pour accueillir l'enfant, doit se ménager une place dans le monde), et parce qu'elle met en jeu les mêmes mécanismes qui deviendront les 50 Julian de Ajuriaguerra et René Angelergues, « De la psychomotricité au corps dans la relation avec autrui : à propos de l'œuvre de Henri Wallon '>'>, L 'évolution psychia trique, vol. 27, 1962, p. 24. 5 1 Jan Patoèka, Papiers phénoménologiques, traduction du tchèque par Erika Abrams, Grenoble, Millon, 1995, p. 109.
258
ROMAIN BIGÉ
colorations posturales des mouvements une fois l'enfant « debout >J. Mais surtout, ce qu'avait bien vu Patocka et que confinuent les études d'Aju riaguerra, c'est que cet accueil correspond à l'ouverture d'un espace de mouvements possibles. Ainsi, là où Ajuriaguerra atteste d'un lien fort entre l'accès à la motricité chez les jeunes enfants et la coordination tonique avec le parent, Patocka voit dans le proto-mouvement un « mou vement de la disposition, du se-trouver, mouvement grâce auquel notre situation reçoit une détennination et une fonne52 » qui constituera la basse fondamentale de la mélodie cinétique de l'existence. Ainsi les analyses d'Ajuriaguerra et de Patocka (deux héritiers de Merleau-Ponty) concordent vers l'idée que nos « appuis », nos « sup ports » ne sont pas seulement des sols physiques sur lesquels nous pou vons nous reposer. C'est de relations que nous sommes étayés : c'est l'affect qui nous soutient, c'est l'accueil que nous recevons des autres qui nous dOlllle un sol. Or on peut revenir, à partir de ces remarques, à l'analyse du texte de Straus. Straus, on s'en souvient, disait que le sol se dérobait sous les pieds des danseuses qui dansaient sans musique. Si le sol a la dimension affective et relatiollllelle que nous lui avons prêté, on peut comprendre cette affinnation de manière renouvelée : ce qui manque à la danseuse sans musique, c'est une relation à un autre qui l'enveloppe et l'accueille. Mais la musique n'est pas la seule à pouvoir faire ce geste : la Terre pourrait bien faire de même, qui « m'accueille » en effet, dans son immense bain gravitaire (c'est ce qui se passe dans la Petite danse) ; et un autre, et singulièrement un autre danseur, pourrait lui aussi m'accueil lir (c'est ce qui se passe dans le Contact Improvisation). À nouveau, Straus avait entr'aperçu ces phénomènes lorsqu'il disait que danser implique un « vivre participatifS3 [miterleben] », expression qu'assez étrangement, le philosophe ne songeait pas à mettre en perspective avec la relation au partenaire. C'est pourtant précisément dans l'accordage tonique avec un autre (la Terre ou le partenaire) que s'atteste primordia lement la possibilité d'un espace affectif et non structuré par le vIs-à-VIS. Ushio Amagatsu définissait la danse comme « dialogue avec la gra vité54. » Et le mot de dialogue doit bien, ici, faire comprendre l'essentiel : 52 Ibid. 53 Erwin Straus, « Les fonnes du spatial '>'>, art. cit., p. 40. 54 Ushio Amagatsu, Dialogue avec la gravité, traduction du japonais par Patrick de Vos, Arles, Actes Sud, 2000, p. 42-43 : « Il [le sol] est le plan horizontal apparu quand l'homme s'est redressé, s'est mis à marcher sur deux jambes, quand il a découvert la
lE POIDS VIVANT
259
ce n'est pas simplement que je suis soumise à une force qui, par sa constance, me rive au sol. J'ai affaire à un mouvement d'attraction, avec lequel je négocie constamment. Je suis, malgré les différences de dimen sions qui nous séparent, en dialogue avec cette Terre au travers de la puissance qu'elle exerce sur moi. C'est cette puissance que le travail de perception posturale m'enseigne à découvrir, comme la rencontre entre deux masses, la mienne et celle de la Terre dans l'attraction qui les lient. « Imaginez que la surface du studio devient ré fléchissante. Vous marchez sur un miroir, ou plutôt, vous marchez sur vos pieds, et sur toute l 'étendue de vos jambes et de votre corps réfléchi. Ces jambes, ce tronc, cette tête enfin vous rendent au newton près la masse posée sur lui. C'est ce corps inversé qui vous soutient. Passez à l 'accroupi : il plie ses jambes pour mieux vous recevoir. Sautez : il prend l 'élan pour vous récupérer, et il est là, invariablement pour vous récupérer. Marchez : chacun de ses pas vient rencontrer les vôtres, accueille, adoucit l 'atterrissage55. »
Il est tentant, depuis les investigations de Husserl sur la question, de répéter contre Copernic que, non, « la Terre ne se meut pas ». Et sans doute, il est essentiel de continuer à renverser la théorie copemicielllle56. Le Contact Improvisation n'est d'ailleurs pas étranger à ce geste de ren versement, lui qui se réclame d'une danse qui serait comme une « chute après NeMon » où l'on prendrait la mesure des insuffisances phénomé nologiques de la physique moderne : Quand une pomme lui est tombée sur la tête, Isaac Newton a reçu l'inspi ration de décrire ses trois lois du mouvement. Celles-ci sont devenues le fondement de nos idées quant à la physique. Mais étant essentiellement objectif, Newton ignorait ce que c'était que d'être une pomme57.
Ainsi, de même que NeMon ignorait ce que c'est que d'être un poids qui tombe (ce qu'entend redécouvrir le danseur), Copernic ignorait le donné phénoménologique primaire de la Terre, à savoir qu'elle est verticalité, il est l'archétype de l'horizontalité qui se rencontre en tout lieu de la vie, il est l'assise où s'essaie, à travers le contact de nos pieds, le dialogue avec la gravité. " 55 Procédure tirée d'un atelier de Contact Improvisation donné par Matthieu Gau deau à Paris (2015). 56 cf Edmund Husserl, « L'arche-originaire Terre ne se meut pas '>'>, traduction de l'allemand par Didier Franck dans La terre ne se meut pas, Paris, Minuit, 1989. Le titre du manuscrit original indiquait : « Renversement de la doctrine copernicienne dans l'inter prétation de la vision habituelle du monde. L'arche-originaire Terre ne se meut pas. Recherches fondamentales sur l'origine phénoménologique de la corporéité, de la spatia lité de la nature au sens premier des sciences de la nature. '>'> (p. I l) 57 Steve Paxton avec Nancy Stark Smith, « Fall after Newton. Transcript '>'>, Contact Quarterly, vol. 13(3), Fall 1988.
260
ROMAIN BIGÉ
l'inamovible sous mes pas (ce qu'entend redécouvrir le phénoméno logue). Certes Husserl ne veut pas dire que la Terre serait au repos : l'immobilité de la Terre n'est pas l'envers du mouvement, mais le fait qu'elle est, toujours, sol et repère de tous les mouvements possibles, qu'elle est, enfin, ce qui se confinue constamment comme la continuabi lité de mon expérience de marcheur. Mais il faut aller plus loin que Husserl et reconnaître que si dans notre expérience, la Terre ne se déplace pas comme un objet, cela ne veut pas dire qu'elle ne se meuve pas, et qu'au contraire, c'est en raison du mouvement constant par lequel elle m'attire à elle qu'elle peut être pour moi un sol. Autrement dit, la Terre fi ' est pas un simple support, elle est un sys tème de lieux, doté de polarités auxquels Husserl reconnaît d'abord une valeur existentiale (du foyer à la terre étrangère58), mais qui nous semble renfenner encore un sens moteur. En effet, de même que le parent qui soutient le nourrisson n'est pas une simple surface de portance sous le corps de l'enfant, de même la Terre n'est simplement le plan terrien que j'habite : c'est une force qui m'accueille, m'enveloppe et me soutient. C'est ce que remarquait Patocka lorsque, tout en recOllllaissant que « la Terre est le référent des mouvements corporels comme tels, comme cela qui n'est pas en mouvement, comme cela qui est fenne », il insistait pour dire que « nous faisons l'expérience de la Terre comme une puissance : non pas comme une force au sens physique - qui a pour corrélat qu'elle reçoit un effet, alors qu'ici le contre-effet est manifestement négligeable - mais comme quelque chose qui n'a pas de contre-partie dans notre expérience vécue. ( . . .) La corporéité de ce pour quoi nous luttons dans notre vie témoigne de cette puissance de la Terre en nous59. »
Sans qu'il la nomme, cette puissance est indéniablement l'attraction gravitaire elle-même : puissance qui « n'a pas de contre-partie dans notre expérience vécue » parce qu'aucun de nos mouvements ne nous pennet trait de nous affranchir de sa force, elle fonne cependant la basse fonda mentale de tous nos mouvements en ce que précisément ils ne lui 58 Ibid., p. 22 : « sije suis né enfant de marin, remarque ainsi Husserl, une part de mon développement a lieu sur le navire et celui-ci ne se caractérisera pas, pour moi, comme navire par rapport à la Terre - tant qu'aucune unité n'aura été produite -, il sera même ma "Terre", ma patrie originaire. " 59 Jan Patocka, Body, Community, Language, World [1968-1969], édition et traduc tion du tchèque Erazim KoMk, Chicago and La Salle (IL), Open Court, 1998, p. 149. (NT de l'américain)
lE POIDS VIVANT
261
échappent jamais. La gravité est constitutive de notre corporéité en tant que « terriens », c'est-à-dire qu'elle est le mouvement « en nous sans nous » sur lequel nous nous appuyons pour nous mouvoir sur les surfaces de notre envirOllllement. C'est moins comme sol que comme force que la Terre est infailliblement sous ou plutôt dans chacun de mes pas. Et c'est même, comme nous voudrions maintenant le montrer, précisément à la faveur de la faillibilité des surfaces elles-mêmes, du caractère mou vant des appuis que nous pouvons y trouver, que la force gravitaire est découverte comme unique constante. Car enfin, le sol sous nos pieds ou sous nos appuis est-il aussi ina movible que le donné phénoménologique primaire de la continuabilité le laisse penser ? Sans doute le sol ne se transporte pas dans l'espace inter sidéral et est constamment là, mais sa structure est loin d'offrir la stabilité qu'on pourrait en espérer. Au contraire, il est fait d'accidents, de butées, de chaises qui tombent et de sables mouvants : l'environnement n'est pas simplement une surface sur laquelle je puis m'appuyer comme sur un sol stable, il est plus meuble, plus variable que ce que la constance de la Terre elle-même et de l'attraction gravitaire qu'elle exerce sur moi ne peut le laisser penser. C'est ce qu'a remarqué avec pertinence la phéno ménologue américaine Elizabeth A. Behnke à l'occasion, justement, d'un article sur le Contact Improvisation : «
En tant que terrestres, [Husserl a raison de dire que] nous sommes ancrés dans un sol inamovible qui soutient tous nos mouvements. Cependant, mal gré l'importance de la Terre comme surface fondamentale sur laquelle nous nous déplaçons, que nous pouvons repousser et sur laquelle nous pouvons atterrir, il faut aussi reconnaître que nous bougeons en relation avec un champ d'appuis variés (actuels et potentiels)6o. »
Nul écrivain n'a mieux décrit cet environnement d'appuis variés que l'écologiste de la perception James Jerome Gibson, auquel les contacteurs se réfèrent régulièrement. Il remarque ainsi que la surface de la terre n'est, pour sa grande majorité, ni solide, ni horizontale : elle est constamment ridée, réorientée, trouée par différents éléments. Ainsi l'eau coule et tombe : elle ne tend qu'à aller plus bas et, dans sa passion pour le sol, ne vient pas à ma rencontre pour soutenir la locomotion ; moins que le marécage, oùje m'enlise, l'eau m'absorbe si je ne sais pas nager, et m'oblige à l'horizontale si j 'y parviens. Mais, continue Gibson, 60 Elizabeth A. Behnke, « Contact Improvisation and the lived world '>'>, Studia Phe nomenologica, 2003, p. 44. (NT de l'américain.)
262
ROMAIN BIGÉ
« les substances non-rigides les plus remarquables dans l'envirOllllement d'un organisme sont les corps des autres organismes, dont les fonnes sont variables. Les plantes et les animaux sont flexibles61. » Nous mar chons, nous nous déplaçons dans un monde vivant, et il n'est pas même jusqu'au sol qui ne soit semé de plantes et d'animaux. Le rocher fait exception, sauf pour les êtres urbanisés que nous sommes, qui vivons entourés de béton et marchons sur un sol lisse et fenne de part en part. Dans les grandes villes, à l'exception des parcs, il n'est plus guère que les revêtements dits « tactiles » disposés à l'endroit des aveugles et les sols caoutchouteux des aires de jeux pour enfants qui offrent cette rela tive variété. Si l'ère industrielle est synonyme de la naissance d'une série de gestes répétitifs et d'un appauvrissement du vocabulaire moteur des ouvriers62, et si l'ère post-industrielle et tertiaire renforce encore cet appauvrissement en érigeant l'assise face au bureau comme quasi unique mélodie cinétique, l'urbanisation avait déjà commencé le travail de fort longue date en nonnalisant le sol et en réduisant l'éventail des possibilités offertes à l'être debout. C'est en êtres urbains que l'on peut dire sans équivoque que la terre ne se meut pas. Au rebours de cette tendance, le Contact Improvisation, en faisant de « chaque partenaire un so163 » cherche à retrouver la variabilité de la surface terrestre : puisqu'à chaque moment, je ne repose pas seulement sur la surface lisse du studio (le plus souvent un parquet), mais encore sur les partenaires sur lesquels je m'appuie ou qui me portent, il y a sans cesse parcours ou plutôt décours entre plusieurs qualités de sol. C'est ainsi que Steve Paxton met sur le même plan la surface du studio (parquet, béton, tapis de danse) et la surface du corps de l'autre (peau, muscle, OS)64. La conséquence paradoxale de cette redistribution des sols est d'une part la découverte d'un sol mouvant, qui « ne doit jamais être tenu pour acquis65 » et dont tout le travail est de m'assurer des degrés de solidité, et d'autre part, la sensation d'être entouré, non pas 61 James Jerome Gibson, The Senses Considered as Perceptual Systems, Boston, Houghton Miffiin Company, 1966, p. 9-10. (NT de l'américain) 62 Rudolf Laban, Modern Educational Dance [ 1 958], London, MacDonald & Evans, 1963, p. 7 : « L'ouvrier d'aujourd'hui est spécialisé, non seulement dans un seul type de travail, mais confiné dans une seule fonction de ce travail, il ne produit, le plus souvent, qu'une séquence de mouvement simple du matin au soir et du début à la fin de sa vie. " (NT de l'anglais) 63 Steve Paxton, « Solo dancing '>J, art. cit., p. 24. (NT) 64 Ibid. : « les caractéristiques des surfaces vont du plus inflexible (le sol) au plus accueillant (peau - muscle - os - masse totale) '>J. (NT) 65 Steve Paxton, « Fall after Newton '>J, loc. cit.
lE POIDS VIVANT
263
d'un espace vide dans lequel mes mouvements s'effectuent, mais d'un champ gravitaire. Les deux conséquences sont solidaires, et c'est pré cisément parce que les partenaires qui me servent de soutien peuvent à tout moment se dérober ou surgir, que je me découvre happé, appelé par l'attraction que la Terre exerce sur moi, qui joue non seulement hors de moi sur les choses, mais en moi sans moi, sous la figure du poids que je pèse. Autrement dit, la Terre-surface semée d'embûches que me révèlent mes partenaires de jeu dans le Contact Improvisation fait place à la Terre-puissance d'attraction, qui s'atteste dans l'expérience du poids que je donne. L'espace dans lequel les danseurs évoluent n'est donc pas tant un espace de confort où en effet, la marche arrière, les tours en place, bref, toute la kinesphère est explorée avec la certitude qu'il y aura un sol. Au contraire, c'est l'absence de certitude qui caractérise cet espace. Dans la marche avant, je me suis déjà assuré de l'espace dans lequel je navigue en l'ouvrant par la vision : je sais, parce que j'y ai regardé de loin, qu'un sol s'arrime sous mes pas. Dans l'espace de mes mouvements improvi sés, au contraire, parce que le sol est considéré comme un véritable par tenaire (c'est-à-dire aussi : susceptible de m'échapper), l'espace est troué et variable. Dans la marche avant, je n'ai pas besoin de dégager l'espace comme champ d'appuis : je sais qu'il l'est et je puis repérer où mettre mes pieds. Dans l'espace accidenté de la danse, je ne sais pas où je mets les pieds, aussi chaque geste doit déployer avec lui un savoir précis du poids qui s'y joue. Nous avions cité, tout à l'heure, l'expression d'En:vin Straus selon laquelle la danse, s'autonomisant de son rapport ancillaire à la musique, « n'avait pas vu le sol se dérober sous ses pieds » : et telle était en effet l'idée de Straus, que de voir dans l'espace déployé par le ton musical, une fonne d'assurance que la terre serait fenne pour les danseurs. Nous devons maintenant corriger cette expression : la Terre qui se déploie dans l'espace tonique n'est pas une surface fenne et assurée, c'est plutôt un champ d'attraction avec lequel je suis en jeu, qui me met à l'épreuve. C'est à cette condition que, pour le danseur, son poids n'est pas seule ment un poids mort qu'il traîne et doit mettre en mouvement, mais un poids vivant, c'est-à-dire cet espace intérieur de tensions que nous avons nommé espace tonique. Ce poids vivant est révélé par l'attraction ter restre, et l'espace onmi-englobant que décrivait Straus comme caracté ristique primaire de l'espace tonal n'est autre que l'espace gravitaire, auquel la musique ouvre sans doute, mais sur lequel elle-même ne fait que s 'appuyer.
264
ROMAIN BIGÉ
La Terre ne se meut pas, mais elle me meut Mais nous l'avons dit, le poids n'est pas seulement l'effet de l'at traction gravitaire sur notre masse : il est la rencontre de deux mouve ments celui de la Terre (gravité) et le nôtre. Or, et c'est ce sur quoi une phénoménologie du poids devra ouvrir, il reste à savoir de quel mouve ment subjectif relève la réponse que nous donnons à la Terre dans notre dialogue avec elle. Nous avons étudié, dans ce chapitre, le pré-mouve ment dans lequel ce dialogue s 'institue, c'est-à-dire en fait l'écoute qui prédispose à entendre ce partenaire immense de la locomotion qu'est la Terre. La petite danse de Steve Paxton est alors apparue comme étude des réflexes d'ajustements posturaux qui nous maintiennent dans cette relation avec elle : la posture érigée se comprenant, non plus comme un redressement contre le sol, mais avec le bain gravitaire. Et nous avons vu que tout un apprentissage était requis pour sentir ces pré-mouvements de la posture, apprentissage qui requiert de céder à l'appel du poids, plutôt que d'y résister. Le contexte particulier du Contact Improvisation nous a pennis d'investiguer une relation au poids spécifique, dans laquelle non seule ment je cède à l'attraction gravitaire pour mieux bouger (c'est la logique de la « fonction phorique » que décrit Hubert Godard), mais où l'enjeu même de la danse est le don du poids à l'autre et à l'espace. Autrement dit, ce n'est plus seulement que pour bouger, il faut bien que je recon naisse mon ancrage, comme cela a été la leçon de la danse moderne depuis les investigations de Rudolf Laban - plus encore, dans le Contact Improvisation, bouger c 'est donner son poids, le partage pondéral est la motivation et l'origine du mouvement, et non plus seulement, comme on l'a découvert analytiquement, son pré-requis. Par quel mouvement répondons-nous à l'appel de la gravité ? Le Contact Improvisation répond : l'objet du dialogue avec la Terre, l'objet de la négociation, c'est le don du poids - c'est-à-dire, si nous devons à présent fonnuler ce don en tennes de geste, la chute. Ainsi, dès la Petite danse, l'enjeu n'est autre que d'examiner le vertige qu'il y a à se tenir debout, l'incertitude et la menace que la posture érigée recèle. Au rebours de tout ce qu'on a pu pointer à propos de la valeur affinnative de « l'être debout », le Contact Improvisation cherche à mettre en avant la vulnéra bilité qui travaille notre existence pondérale. Chaque pas devra être com pris, non pas comme mise en branle d'une masse, mais comme modulation de l'arc de chute auquel la Terre m'invite. Paul Valéry, dans L 'âme et la
lE POIDS VIVANT
265
danse, disait déjà de la danseuse que « nous ne la voyons jamais que devant tomber66 . . ». Et c'est ainsi que le danseur Dominique Dupuy conçoit la danse comme opération de haut vol, dans laquelle le danseur, loin de nier la gravité dans l'élévation, l'assume et s'y abandonne dans une chute per pétuellement différée qu'on appellera : l'envol. .
«
Quittant sa prétention à se tenir debout sur la verticale, qui a fait de lui l'homme que l'on sait, le volateur abandonne son corps à l'espace, dans un double plongeon, où l'ascension est un précipité à l'envers et la descension une escalade inverse, et dans une immersion quasi sans limite. Il faut, pour y réussir, que la station debout ne soit pas le seul apanage de la gravité, mais que chaque élément du corps puisse y être à tout moment confronté par lui-même, dans son vol propré7• »
L'envol est abandon du poids : non pas négation, ni non plus oubli, mais déplacement ou déterritoritalisation de sa problématique. C'est ce qu'indique le double plongeon - quand la chute est ascension et l'élévation est concentration du poids. L'élévation est concentration du poids dans les pointes de la danseuse classique : le gros orteil y porte tout le poids du corps, sur un point d'équilibre fragile et instable. La chute est ascension dans le porté, où je ne m'abandOIllle que pour mieux être soulevé. Des deux côtés, on retrouve exprimé le même thème fondamental et comme une parenté par-delà les différences : c'est comme êtres qui tombent que les danseurs s'exhibent et se sentent, tantôt pour accroître les chances d'y sunnonter, tantôt pour l'infléchir, tantôt pour s'y abandonner. De même que Steve Paxton disait que « le danseur n'a de poids que pour le donner », il faudrait dire que je ne me lève, dansant, que pour mieux tomber : l'envol, la propulsion, l'être debout, ne le sont pas tant au titre d'une conquête sur les forces d'effondrement, qu'au titre d'une prise de distance avec la Terre qui justifie leurs dialogues. Telle serait peut-être au moins une des origines de cet espace sphérique, fluctuant, aux forces gravitationnelles multiples que décrivait Erwin Straus lorsqu'il pensait la danse : au lieu de tirer le fil de plomb de la verticale gravitaire, je m'efforce de me rapporter à ce que cette gravité fait bouger en moi - je me lève, mais c'est pour mieux tom ber, et ma danse est une chute sans cesse différée.
66 Paul Valéry, L 'Âme et la danse [1921], dans Œuvres, Paris, Gallimard, 1960, t. 2, p. 173. 67 Dominique Dupuy, « Danser outre. Hypothèses de vol '>'>, dans Jo/Revue interna tionale de psychanalyse, #5, 1994, p. 47.
TABLE DES MATIÈRES
Ens mobile. Conceptions phénoménologiques du mouvement . . . . Sylvain CAMILLERl & Jean-Sébastien HARDY Sens du mouvement et kinesthèse. La découverte du « concept phénoménologique de mouvement » dans Chose et espace de Husserl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jean-Sébastien HARDY Husserl et le géostatisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paul DucRos Le mouvement comme a priori matériel fondamental de la phénoménologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vishnu SPAAK Heidegger : problème de la facticité, problème de la K1YrJŒlS . . . . Claudia SERBAN
1
17 39
61 89
Le rôle opératoire du concept de mouvement dans la phénoménologie de Jan Patocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dragos DUICU
107
Plasticité, intentionnalité motrice et mouvements concrets chez Merleau-Ponty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timothy MOONEY
123
Mouvement et constitution du sens dans l'attention conjointe et l'action conjointe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shaun GALLAGHER
155
Ce qui aurait pu être fait. Sur le statut contrefactuel de l'action dans la théorie de la perception d'Alva Noë . . . . . . . . . . . . . . Gunnar DEcLERck
175
Esquisse d'une phénoménologie des mouvements de l'orant Sylvain CAMILLERl
215
Le poids vivant. Vers une phénoménologie du mouvement dansé . . Romain BrGÉ
235
LISTE DES OUVRAGES DISPONIBLES OU À PARAÎTRE DE LA BIBLIOTHÈQUE PHILOSOPHIQUE DE LOUVAIN LOFTS S.G., MOYAERT P., La pensée de Jacques Lacan. Questions historiques. Problèmes théo riques. Bibliothèque
Philosophique de Louvain, 39,
1994, ISBN: 90-6831-625-7, X-190 p. 25 EURO
FLORIVAL G., Dimensions de l'exister. Etudes d'anthropologie philosophique. Tome S.
thèque Philosophique de Louvain, 40,
Biblio
1994, ISBN: 90-6831-626-5, VIII-266 p. 37 EURO
TSUKADA S., L'immédiat chez H. Bergson et G. Marcel. Préface de J. Parain-Vial. Bibliothèque
Philosophique de Louvain, 4 1 ,
1995, ISBN: 90-6831-761-X, 278 p.
27 EURO
NESCHKE-HENTSCHKE A., Platonisme politique et théorie du droit naturel. Contributions à une archéologie de la culture politique européeIllle. Volume 1. Le platonisme politique dans l'antiquité.
Bibliothèque Philosophique de Louvain,
42, 1995, ISBN: 90-6831-768-7,
XIV-276 p.
30 EURO
GIACOMETTI A., Dieu en question. Préface de Stanislas Breton.
Louvain, 43,
Bibliothèque Philosophique de
1995, ISBN: 90-6831-763-6, VIII-279 p.
37 EURO
MAESscHALCK M., Droit et création sociale chez Fichte. Une philosophie moderne de l'ac tion politique.
Bibliothèque Philosophique de Louvain,
44, 1996, ISBN: 90-6831-780-6, 42 EURO
LVI-390 p.
GREISCH 1., FLORIVAL G., Création et événement. Autour de Jean Ladrière. Centre International de Cerisy-la-Salle. Actes de la Décade du 21 au 3 1 août 1995. Bibliothèque
de Louvain, 45,
Philosophique
1997, ISBN: 90-6 831-869-1, X-390 p.
40 EURO
CABADA CASTRO M., L'être et Dieu chez Gustav Siewerth. Traduit de l ' allemand par E. Tourpe et A. Chereau.
Bibliothèque Philosophique de Louvain,
46, 1996, ISBN: 90-6831-872- 1 ,
XII-324 p.
35 EURO
DEPRÉ O., LORIES D., Lire Descartes aujourd'hui. Actes publiés par O. Depré et D. Lories,
Bibliothèque Philosophique de Louvain, 47,
1996, ISBN: 90-6831-870-5, X-208 p. 28 EURO
NEscHKE-HENTscHKE A., Images de Platon et lectures de ses œuvres. Les interprétations de Platon à travers les siècles. Avec la collaboration d'Alexandre EtieIllle,
Philosophique de Louvain, 48,
1997, ISBN: 90-6831-879-9, XXIV-420 p.,
Bibliothèque 63 EURO
TOURPE E., Siewerth «après) Siewerth. Le lien idéal de l 'amour dans le thomisme spéculatif de Gustav Siewerth et la visée d'un réalisme transcendental.
de Louvain,
Bibliothèque Philosophique
49, 1998, ISBN: 90-429-05 68-9, X-466 p.
45 EURO
DE PRAETERE T., Le principe de non-contradiction et la question de l 'individualité du sujet.
Bibliothèque Philosophique de Louvain,
50, 1999, ISBN: 90-429-0787-8, X-288 p. 40 EURO
STEVENS B., Topologie du néant. Une approche de l 'école de Ky6to.
phique de Louvain,
FÉVRIER
N.,
La
5 1 , 2000, ISBN: 90-429-0811-4, VI-226 p.
mécanique
l ' «Encyclopédie).
Bibliothèque Philoso-
hegelienne.
Commentaire
des
Bibliothèque Philosophique de Louvain,
29 EURO
paragraphes
245
à 271
de
52, 2000, ISBN: 90-429-0850-
5, X-170 p.
24 EURO
NESCHKE-HENTSCHKE A., Le Timée de Platon. Contributions à l'histoire de sa réception. Plato s Timaios. Beitrage zu seiner Rezeptionsgeschichte. Description.
Bibliothèque Philoso
53, 2000, ISBN: 90-429-0860-2, XLII-334 p.
60 EURO
phique de Louvain,
ApEL K.-O., La réponse de l ' éthique de la discussion au defi moral de la situation humaine corrnne telle et spécialement aujourd'hui. 2000, ISBN: 90-429-0946-3, IV- 1 5 9 p.
Bibliothèque Philosophique de Louvain,
54,
24 EURO
MALHERBE J.-E, La responsabilité de la raison. Horrnnage à Jean Ladrière à l ' occasion de son 8(J anniversaire. Bibliothèque Philosophique de Louvain, 5 5 , 2002, ISBN: 90-429-11 07-7,
IV-284 p.
36 EURO
[2]
BPL
DASTUR E, Heidegger et la question anthropologique. Bibliothèque Philosophique de Louvain, 56, 2003, ISBN: 90-429-1281-2, IV-120 p. GABELUERI E., Être et don. Subtitle: Simone Weil et la philosophie.
phique de Louvain,
57, 2003, ISBN: 90-429-1286-3, X-581 p.
LADRIÈRE J., Le temps du possible.
Bibliothèque Philosophique de Louvain,
90-429-1349-5, IV-326 p.
LADRIÈRE 1., L'espérance de la raison. Bibliothèque Philosophique
30 EURO
Bibliothèque Philoso-
60 EURO 5 8 , 2004, ISBN: 28 EURO
de Louvain, 59, 2004, ISBN:
90-429-1350-9, IV-290 p.
40 EURO
STEVENS B., Le néant évidé. Ontologie et politique chez Keiji Nishitani. Une tentative d'in terprétation.
Bibliothèque Philosophique de Louvain,
60, 2003, ISBN: 90-429-1379-7,
IV-193 p.
24 EURO
NESCHKE-HENTSCHKE A. Platonisme politique et théorie du droit naturel. Contributions à une archéologie de la culture politique européeIllle. Volume II. Platonisme politique et jusna turalisme chrétien. La tradition directe et indirecte d'Augu stin d' Hippone à Jolm Locke.
Bibliothèque Philosophique de Louvain, 6 1 ,
2004, ISBN: 90-429-1 380-0, IV-745 p. 80 EURO
NESCHKE-HENTSCHKE A., GREGORIO E, KONIG-PRALONG c., Les herméneutiques au seuil du XX]ême siècle. Évolution et débat actuel, Bibliothèque Philosophique de Louvain, 62, 65 EURO
2004, ISBN: 90-429-1443-2, IV-344 p.
FELTz B., GHINS M., Les défis de la rationalité. Actes du colloque organisé par l 'Institut supé rieur de philosophie (UCL) à l'occasion des 80 ans de Jean Ladrière. Bibliothèque
sophique de Louvain,
63, 2005, ISBN: 90-429-1505-6, IV-132 p.
Philo
1 6 EURO
GONTIER T., Animal et anilnalité dans la philosophie de la Renaissance et de l 'Âge Oassique.
Bibliothèque Philosophique de Louvain, 64,
2005, ISBN: 90-429-1597-8, IV-246 p.
GÉLY R., Les usages de la perception. Bibliothèque 90-429-1599-4, VI-204 p.
35 EURO
Philosophique de Louvain, 65, 2005, ISBN:
LADRIÈRE J., Bibliographie de Jean Ladrière. Bibliothèque
48 EURO
Philosophique de Louvain, 66,
ISBN: 90-429- 1624-9, VI-I 1 2 p.
2005,
30 EURO
MONsEu N., Les usages de l ' intentionnalité. Recherches sur la première réception de Husserl en France.
Bibliothèque Philosophique de Louvain,
IV-330 p.
67, 2005, ISBN: 90-429-1639-7, 4 8 EURO
SOUAL Ph., Le sens de l ' État. Commentaire des
Principes de la philosophie du droit de Hegel.
Bibliothèque Philosophique de Louvain, 68,
2006, ISBN: 90-429-1702-4, IV-846 p. 80 EURO
FrASSE G., L'autre et l'amitié chez Aristote et Paul Ricœur. Analyses éthiques et ontologiques.
Bibliothèque Philosophique de Louvain, 69, 2006, ISBN:
90-429-1747, IV-31 8 p. 50 EURO
COOLS A., Langage et subjectivité. Vers une approche du différend entre Maurice Blanchot et Emmanuel Lévinas. Bibliothèque Philosophique de Louvain, 70, 2007, ISBN 978-90-4291 838-2, VI-240 p.
46 EURO
MAGNARD P., Fureurs, héroïsme et métamorphoses.
Bibliothèque Philosophique de Louvain, 7 1 ,
2007, ISBN: 978-90-429-1 839-9, IV-I77 p.
46 EURO
BRAECKMAN, A., La démocratie à bout de souffle? Une introduction à la philosophie politique de Marcel Gauchet.
Bibliothèque Philosophique de Louvain,
429-1964-8, IV-I72 p.
72, 2007, ISBN: 978-9042 EURO
LEcLERcQ, 1., La raison par quatre chemins. En hommage à Claude Troisfontaines.
thèque Philosophique de Louvain, 73,
Biblio
2007, ISBN: 978-90-429-1970-9, X-532 p. 48 EURO
DEPRAZ, N., Le corps glorieux. Phénoménologie pratique de la «Philocaliej) des Pères du désert et des Pères de l ' Église. Bibliothèque Philosophique de Louvain, 74, 2008, ISBN: 978-90-429-2027-9, IV-280 p.
42 EURO
[3]
BPL
GREISCH, J., Qui sommes-nous ? Chemiru; phénoménologiques vers l'horrnne. (Novembre 2006). Bibliothèque Philosophique de Louvain, 75, 2009, ISBN: 978-90-429-2092-7, IV-537 p. 64 EURO
COMBRONDE, c., De la lumière en peinture. Le débat latent du grand siècle. Bibliothèque Philosophique de Louvain, 77, 2010, ISBN: 978-90-429-2125-2, VI-399 p. 44 EURO CUSTER, O., L'exemple de Kant. Bibliothèque Philosophique de Louvain, 77, 201 1 , ISBN: 97890-429-2223-5
48 EURO
VERDEAU, P., La persoIlllalité au centre de la pensée bergsonieIllle. Bibliothèque Philosophique de Louvain, 78, 201 1 , ISBN: 978-90-429-2344-7, 450 p. 56 EURO COUNET, J.-M., Figures de la dialectique. Histoire et perspectives contemporaines. Bibliothèque Philosophique de Louvain, 79, 2010, ISBN: 978-90-429-2345-4, IV-262 p. 48 EURO JEAN, G., QuotidieIllleté et ontologie. Recherches sur la différence phénoménologique. Biblio thèque Philosophique de Louvain, 80, 201 1 , ISBN: 978-90-429-2456-7 , 452 p. 56 EURO
VETO, M., Philosophie, Théologie, Littérature. Hommage à Xavier Tilliette, SJ pour ses quatre vingt-dix ans. Bibliothèque Philosophique de Louvain, 8 1 , 201 1 , ISBN: 978-90-4292511-3, 420 p. KÜHN,
G.,
48 EURO
Individuation et vie culturelle. Pour une phénoménolgie radicale dam; la perspective
de Michel Henry.
Bibliothéque Philosophique de Louvain,
84, 2012, ISBN: 978-90-429-
2532-8, IV-200 p.
42 EURO
COLETTE-CUCIC, B., LECLERCQ, B., L'idée de l'idée. Éléments de l 'Histoire d'un concept. Bibliothèque Philosophique de Louvain, 85, 2012, ISBN: 978-90-426-264 8-6, IV-267 p. 44 EURO
PINCHARD,
B., Métaphysique de la destruction.
Bibliothèque Philosophique de Louvain,
2012, ISBN: 978-90-429-2683-7, XII-263 p.
86,
47 EURO
JARAN, F., Phénoménologies de l'histoire. Husserl, Heidegger et l'histoirede la philosophie. Bibliothèque Philosophique de Louvain, 87, 2013, ISBN: 978-90-429-2704-9, IV-154 p. RUSE,
M., Le darwinisme.
Bibliothèque Philosophique de Louvain,
35 EURO 88, 2013, ISBN: 978-90-
429-2739-1, IV-153 p.
39 EURO
PERRIN, M., Entendre la métaphysique. Les significations de la pensée de Descartes dans l'œuvre de Heidegger.
Bibliothèque Philosophique de Louvain,
89, 2013, ISBN: 978-90-
429-2982-1, VI-561 p.
DE GRAMONT,
68 EURO
J., L'appel de la loi. Bibliothèque Philosophique de Louvain, 90, 2014, ISBN: 978-
90-429-3024-7, IV-404 p.
65 EURO
COUNET, I-M., Philosophie et langage ordinaire. De l'Antiquité à la Renaissance. Bibliothèque Philosophique de Louvain, 9 1 , 2014, ISBN: 978-90-429-3049-0, IV-215 p. 58 EURO PANERO, A., MATTON, S., DELBRACCIO, M., Bergson professeur. Actes du Colloque international, Paris, École Normale Supérieure, 22-24 novembre 2010. Bibliothèque Philosophique de Louvain, 92, 2015, ISBN: 978-90-429-31 5 1 -0, IV-31 8 p. 78 EURO COUNET, J.-M., La citoyeIllleté. Actes du XXIv�me Congrès de l'Association des Sociétés de Philosophie de langue française (ASPLF) Louvain-Ia-Neuve/Bruxelles, 21-25 août 2012.
Bibliothèque Philosophique de Louvain, 93, 2015, ISBN: 978-90-429-3169-5. LACOSTE J.-Y., Recherches sur la parole. Bibliothèque Philosophique de Louvain, ISBN: 978-90-429-3191-6, IV-290 p.
BERNARD
M., Patoèka et l'unité polémique du monde. Bibliothèque
87 EURO 94, 2015, 76 EURO
Philosophique de Louvain,
95, 2016, ISBN: 978-90-429-3248-7, IV-536 p.
83 EURO
3309-5, VIII-303 p.
62 EURO
FAES H., Le paradoxe de la condition humaine selon Hannah Arendt. Bibliothèque Philosophique de Louvain, 96, 2016, ISBN: 978-90-429-3283-8, IV-3 1 1 p. 56 EURO MABILLE, B., Rencontres. Bibliothèque Philosophique de Louvain, 97, 2017, ISBN: 978-90-429-
[4]
BPL
GÉRARD, G., MABILLE, B., La « Science de la logique) au miroir de l 'identité. Bibliothèque Philosophique de Louvain, 98, 2017, ISBN: 678-90-429-3362-0, IV-4 1 O p. 73 EURO DALISSIER, M., La métaphysique chez Merleau-Ponty. Première partie : phénoménologie et métaphysique - Seconde partie: métaphysique et ontologie. Bibliothèque Philosophique de Louvain, 99, ISBN: 978-90-429-3410-8, XX- 1 1 83 p. 145 EURO VAN KERCKHOVEN, G., ALEXANDER, R., L'espace, les phénomènes, l'existence. De l ' architec tonique phénoménologique à l 'architecture. Bibliothèque Philosophique de Louvain, 100, ISBN: 978-90-429-3528-0, IV-203 p.
JACQUET,
E, Métaphysique de la naissance.
64 EURO
Bibliothèque Philosophique de Louvain,
ISBN: 978-90-429-3615-7, X-430 p.
PRINTED ON PERMANENT PAPER · IMPI!1ME SUR PAPIER PERMANENT · GEDRUKT OP DUURZAAM PAPIER - ISO 9706 N.V. PEETERS S.A., WAROTSTRAAT
101,
76 EURO
50, B-3020
HERENT
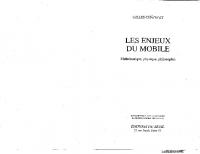

![Métaphysique du temps chez Aristote - II. Métabiologie du mouvement entéléchique [First ed.]
9782953384635](https://dokumen.pub/img/200x200/metaphysique-du-temps-chez-aristote-ii-metabiologie-du-mouvement-entelechique-firstnbsped-9782953384635.jpg)
![La naissance du panafricanisme: Les racines caraibes, americaines et africaines du mouvement au XIXe siècle [réédition ed.]
2336738066, 9782336738062](https://dokumen.pub/img/200x200/la-naissance-du-panafricanisme-les-racines-caraibes-americaines-et-africaines-du-mouvement-au-xixe-siecle-reeditionnbsped-2336738066-9782336738062.jpg)


![Précis de l'histoire du Mouvement ouvrier allemand [Reprint 2021 ed.]
9783112590386, 9783112590379](https://dokumen.pub/img/200x200/precis-de-lhistoire-du-mouvement-ouvrier-allemand-reprint-2021nbsped-9783112590386-9783112590379.jpg)
![La question du mouvement ouvrier [Tome 1]
9782358210812, 2358210811, 9782358210829, 235821082X](https://dokumen.pub/img/200x200/la-question-du-mouvement-ouvrier-tome-1-9782358210812-2358210811-9782358210829-235821082x.jpg)

![La question du mouvement ouvrier [Tome 2]
9782358210812, 2358210811, 9782358210829, 235821082X](https://dokumen.pub/img/200x200/la-question-du-mouvement-ouvrier-tome-2-9782358210812-2358210811-9782358210829-235821082x.jpg)
