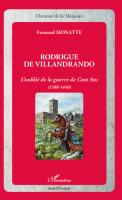Rodrigue De Villandrando: L'oublié de la guerre de Cent Ans (1388-1448) (French Edition) 9782336290638, 2336290634
Et Jeanne d'Arc sauva la France... Pour beaucoup de Français, ce cliché résume à lui seul la guerre de Cent Ans...
200 122 11MB
French Pages [396]
Polecaj historie
Table of contents :
VALLADOLID Monasterio de la Merced
ENTRE DEUX ROYAUMES
Première partie L’EPOPEE FRANÇAISE
ARMAGNACS ET BOURGUIGNONS La maudite guerre
LES SEIGNEURS DE GUERRE Rodrigue crée sa propre compagnie
DU SIEGE DE VILLENEUVE-LEROI A L’AVENEMENT DE CHARLES VII
ESCARMOUCHES ET CHASSES-CROISES PERMANENTS
LE DESASTRE DE VERNEUIL 17 août 1424
LE TROISIEME CONFLIT La guerre des grands féodaux
LA COMPAGNIE DE RODRIGUE Le temps de la survie pour des routiers sans contrat
PRELUDE À UNE GRANDE BATAILLE
LA BATAILLE D’ANTHON
LE PRIX DE LA DEFAITE La capitulation de la principauté d’Orange
EPISODES BOURGUIGNONS
LES CROISADES CONTRE LES HUSSITES Et leur extension dans le Mâconnais, le Forez et le Velay
PROLONGEMENT DES CONFLITS SOCIAUX Différends entre le clergé et la noblesse du Velay
RODRIGUE Seigneur de Pusignan, de Talmont, comte de Ribadeo
LE SIEGE DE LAGNY 10 août 1432
LA DETROUSSE DES PONTS-DE-CÉ
RODRIGUE EPOUSE MARGUERITE DE BOURBON
« L’AFFAIRE » DU CARDINAL DE CARILLO
LA GUERRE DES DUCS
COOPERATION ENTRE LA FRANCE ET LA CASTILLE
LES « ECORCHEURS » Les conséquences d’un traité de paix qui plonge le royaume dans les affres d’une guerre sans nom
LA RECONQUÊTE DE PARIS
ALBI Deux évêques pour un siège épiscopal
LE CONCILIABULE D’ANGERS ET LA DISGRÂCE DE RODRIGUE
LA CAMPAGNE DE GUYENNE ET L’ENTREVUE AVEC LE COMTE D’HUNTINGDON1
L’ATTAQUE DU ROUSSILLON novembre 1438
Deuxième partie L’EPOPEE ESPAGNOLE
LES RAISONS D’UNE MISSION SANS RETOUR
LA REVOLTE DES GRANDS D’ESPAGNE
UN REDOUTABLE HOMME D’AFFAIRES
TOLEDE Rodrigue revêt les habits du roi et sauve le souverain
MEDINA DEL CAMPO Le piège se referme autour du connétable de Castille
LES DERNIERS COMBATS DU COMTE DE RIBADEO Du siège de Cuellar à la bataille d’Olmedo
LA CHUTE D’ALVARO DE LUNA
VALLADOLID Monasterio de la Merced 14 Avril 1448
ANNEXES DONNEES HISTORIQUES COMPLEMENTAIRES
Annexe 1 LA FRANCE DE RODRIGUE
Annexe 2 L’ESPAGNE DE RODRIGUE
Annexe 3 L’EUROPE DE RODRIGUE
Annexe 4 LA MAISON DE VILLANDRANDO
Annexe 5 CONTRAT DE MARIAGE DE RODRIGUE
Annexe 6 RODRIGUE ET LA MAISON DE BOURBON
Annexe 7 LE CHATEAU DE CHATELDON Le séjour de Rodrigue et de Marguerite de Bourbon
Annexe 8 FAC-SIMILE Lettre adressée au conseil de ville de Lyon, écrite de la main de Rodrigue
Annexe 9 PEDRO DE CORRAL Frère de Rodrigue
Annexe 10 HYPOTHESES SUR LES DATES DE LA NAISSANCE ET DE LA MORT DE RODRIGUE
Annexe 11 ESSAI DE LOCALISATION DU REPAIRE DE RODRIGUE DANS LES CEVENNES
Annexe 12 ORDONNANCE Attestant de la propriété de navires marchands par Rodrigue (1432)
Annexe 13 MANGER A LA TABLE DU ROI
Annexe 14 LE TOMBEAU D’ALVARO DE LUNA
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES MATIERES
Citation preview
Chemins de la Mémoire Fernand MONATTE
RODRIGUE DE VILLANDRANDO L’oublié de la guerre de Cent Ans (1388-1448)
Série XVe siècle
RODRIGUE DE VILLANDRANDO L’oublié de la guerre de Cent Ans (1388-1448)
Chemins de la mémoire Nouvelle série
Cette nouvelle série d’une collection qui fut créée par Alain Forest est consacrée aux travaux concernant le domaine historique des origines à nos jours. Ouvrages parus BUNARUNRAKSA (Simona Somsri), Monseigneur Jean-Baptiste Pallegoix. Ami du roi du Siam, Imprimeur et écrivain (1805-1862), 2013. PAVÉ (François), Le péril jaune à la fin du XIXe siècle. Fantasme ou réalité ?, 2013. BERRIOT (François), Autour de Jean Moulin, Témoignages et documents inédits, 2013. VIGNAL SOULEYREAU (Marie-Catherine), Le trésor pillé du roi. Correspondance du cardinal de Richelieu (1634), Tome 1 et 2, 2013. MARIN (Gabriel), Apprendre l’Histoire à l’école communiste. Mémoire et crise identitaire à travers les manuels scolaires roumains, 2012. POINARD (Robert), L’aumônier militaire d’Ancien Régime. La vie du prêtre aux armées des guerres de religion à la Première République (15681795), 2012. LAGARDÈRE (Vincent), Le Commerce fluvial à Mont-de-Marsan du XVIIe au XVIIIe siècle, 2012. ZEITOUN (Sabine), Histoire de l’O.S.E., De la Russie tsariste à l’Occupation en France (1912-1944), L’Œuvre de Secours aux Enfants du légalisme à la résistance, 2012. HARAI (Dénes), Journal d’un officier de Louis XIII sur le siège de Montauban (1621), 2012. PRIJAC (Lukian), Lagarde l’Éthiopien, Le fondateur de Djibouti (1860 – 1936), 2012. TARIN (Jean-Pierre), Joseph Lakanal, apôtre de la République (17621845), 2012. ROSIER (Michel), Vie politique et sociale de la Sarthe sous la IVe République (1944-1958), 2012. BERTRAND-CADI (Jean-Yves), Le Colonel Ibrahim Depui, Le pèlerin de la mer Rouge, 1878-1947, 2012. BLANQUIE (Christophe), Une enquête de Colbert en 1665, 2012.
Fernand MONATTE
RODRIGUE DE VILLANDRANDO L’oublié de la guerre de Cent Ans (1388-1448)
L’Harmattan
Du même auteur Coubon… Autrefois, Éditions Jeanne d’Arc, 2008. Le Puy et le Velay sous le règne de Louis XIII, 1610-1643, Éditions Jeanne d’Arc, 2011.
© L’Harmattan, 2013 5-7, rue de l’École-Polytechnique ; 75005 Paris http://www.librairieharmattan.com [email protected] [email protected] ISBN : 978-2-336-29063-8 EAN : 9782336290638
VALLADOLID Monasterio de la Merced Les ouvriers donnèrent un dernier coup de pioche pour dégager le reste d’un aménagement étrange, d’une sorte de niche qui s’inscrivait à hauteur d’homme dans la paroi de la chapelle. Au milieu des gravats, ils interrompirent brusquement leur geste. Un corps reposait au fond de l’enfeu sculpté. Il était étonnamment momifié. Une barbe et des cheveux entouraient son visage à la peau parcheminée. Il portait les insignes de chevalier de la Banda, et arborait encore le ruban, l’épée et les éperons d’or de l’ordre créé en 1332 par le roi Alphonse XII de Castille. Le corps décharné était recouvert d’une armure luisant faiblement dans la pénombre.1 Nous étions en 1836, le vieux couvent menaçait de ruine et la municipalité de Valladolid avait décidé de le transformer en caserne en démolissant l’église abbatiale pour ouvrir la rue. Cet édifice remontait au haut Moyen Âge. L’église possédait alors de nombreuses chapelles appartenant aux principales familles de la ville. Comtes, marquis et évêques y avaient élu sépulture sous les dalles ou dans de somptueux mausolées que l’on croyait faits pour résister aux siècles. Mais la loi implacable du temps qui passe avait pour la plupart gommé leur appartenance. C’est ainsi qu’au cours de ces travaux, de nombreux ossements furent retirés de leurs tombes, transférés dans d’autres, ou tout simplement enterrés on ne sait où, pour y être à jamais oubliés. Pourtant, quatre siècles plus tôt, un personnage de haut rang, humblement vêtu d’une simple robe de bure, s’était retiré loin des vicissitudes de ce monde pour finir ses jours dans l’isolement froid du monastère…
1
Juan Carlos UREÑAS PARADES, Rincones con Fantasma. Un paseo por el Valladolid desaparecido, Casa Revilla, Valladolid, 2006.
7
Monasterio de la Merced, 1448 L’homme avançait à pas comptés dans la nef. Accrochée sur le fond de la chapelle qui lui faisait maintenant face se déroulait une bannière rouge et noire rehaussée d’un soleil d’or. Ces armes n’étaient pas les siennes, mais celles d’un prince français. Pourquoi étaient-elles donc exposées ici ? L’homme regarda longuement ce pennon de tissu qui semblait percer la pénombre de ses tons lumineux, puis il fit le signe de croix et s’agenouilla pour se mettre en prière. Des souvenirs de jeunesse vinrent soudain troubler son recueillement, du temps où il avait quitté sa terre natale et franchi les Pyrénées pour rejoindre le royaume de France. Là, au cœur des montagnes, il avait éprouvé le besoin de faire halte, dans un endroit merveilleux où la vue embrassait les deux États, lui qui fut le serviteur de deux rois, lui qui était le fils de ces deux royaumes. Au cours de sa prière, la même image venait l’obséder sans cesse : Il me ressouvient toujours d’un prieuré, assis dans les montaignes, que j’avais vu autresfois, partie en Espaigne, partie en France, j’eusse aimé avoir la fantaisie de me retirer là au soir de l’existence. Ainsi, j’eusse vu la France et l’Espaigne en mesme temps.2 Quelques années auparavant, lassé des intrigues et des drames de cour qui se jouaient autour de lui, il avait délaissé l’hôtel cossu qu’il occupait dans la rue Riego pour gagner ce monastère qu’il avait richement doté et fait reconstruire à ses frais. Dieu ne laisse l’homme ni sans punition ni sans miséricorde, ores me voilà vieux, assailli de maux auxquels je ne puis échapper, je laisse mourir le corps, mais ne veux point fuir les tempêtes de l’âme. Qu’il plaise à Dieu de m’accorder le temps du repentir. Le 14 avril 1448, l’homme fut pris de malaise et gagna sa chambre. Dans la pénombre qui enveloppait sa cellule monacale, autour de sa couche de mourant, se pressaient deux silhouettes 2
ACADEMIE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS D’AGEN, Revue de l’Agenais, P. Noubel, Agen, 1874, nº 1.
8
fantomatiques. Un notaire accompagné de son clerc était venu recueillir ses dernières volontés. L’homme s’éteignit peu après, calmement, paisiblement, avec cette sorte de sérénité qui semble toujours accompagner les vies étonnamment remplies.3 Il fut enterré selon son souhait dans le sol de la chapelle principale de l’église conventuelle du monastère de la Merced, sous une simple dalle de pierre avec son seul nom gravé dessus. Cet homme s’appelait Rodrigue de Villandrando, comte de Ribadeo, et ce fut l’un des plus grands, des plus influents et des plus redoutables capitaines de compagnie de la guerre de Cent Ans.
3
M. TELLO, « Don Rodrigo de Villandrando, conde de Ribadeo », Discurso leído en la junta publica de aniversario de la Real Academia de la historia, el 24 de mayo de 1882,Por D. Antonio Maria Fabié académico de número, Madrid, 1882, p. 374.
9
ENTRE DEUX ROYAUMES Rodrigue naquit en 1388. Sa famille était originaire d’un village de la vieille Castille situé entre Burgos et Valladolid et dénommé Villandrando ou, conformément à la signature même de Rodrigue qui paraphait son nom en deux parties : Villa-Andrando. Le généalogiste Josef Pellizer1 assigne à cette famille une illustre origine : elle serait descendue des comtes de Biscaye, dont le domaine s’étend sur un territoire montueux inscrit en bord de mer du Pays Basque espagnol. Le même auteur ajoute qu’elle fut partagée, depuis le treizième siècle, en deux branches, dont l’une se perpétua à Valladolid, tandis que l’autre émigra en France. Contrairement à ce que l’on peut penser, les Pyrénées n’ont jamais constitué une barrière pour les peuples qui s’établirent de chaque côté de ses versants. Dès l’origine, les premiers pasteurs trouvèrent naturel de migrer selon la saison d’une pente à l’autre, vers les plus riches pâturages, pour eux la frontière n’existait pas, la ligne de faîte ne signifiait rien2. Plus tard, sur cette mouvance des lignes territoriales, les échanges commerciaux, les accords royaux ou encore les mariages princiers, accentuèrent le phénomène. Ce fut le cas notamment au XIIe siècle où, encouragées par un resserrement des relations entre les deux royaumes, des familles notables franchirent à leur tour les montagnes. C’est ainsi qu’une branche des Villandrando vint se fixer sur la terre de France. Selon Pellizer, elle serait apparentée au Pape Clément V. Alonso Lopez, cadet de Biscaye, apanagé de Villandrando qui vivait vers l’an 1200 avait deux fils. Don André, le plus jeune, suivit Blanche de Castille en France, s'arrêta en Guyenne, et là, acquit une seigneurie près de Bazas à laquelle il donna la forme francisée de son nom : Villandraut. Moins d’un demi-siècle plus tard, cette seigneurie fut portée dans la maison de Goth par le mariage de sa fille (ou sa petite fille) avec Béraud de Goth. De cette union serait né Bertrand de 1
Josef PELLIZER, Informe del origen antigüedad, calidad y sucesión de la excelentísima casa de Sarmiento de Villamayor, Madrid, 1663, fol. 94. 2 Jules MATHOREZ, Notes sur la pénétration des Espagnols en France, du XIIe au XVI e siècle, Bulletin Hispanique, année 1922, Vol. 24, N° 1, p. 42.
11
Goth devenu le fameux pape Clément V, si bien que les Villandrando, fiers de cette illustre parenté, n’omettaient point de dire, en parlant de lui : Notre cousin le pape Clément. Cependant, cette hypothèse, pour séduisante qu’elle soit, est contestée par la plupart des généalogistes français qui attribuent la maternité du pape Clément V à Ida de Blanquefort, seconde épouse de Béraud de Goth. Ce qu’on rapporte des Villandrando de Valladolid offre plus de certitude. De père en fils, ils exercèrent dans cette ville des fonctions administratives. Mais un évènement de portée nationale allait hisser le lignage de Villandrando au premier rang de la noblesse du pays. Pour cela, ouvrons la page qui vit naître la première guerre civile de Castille. Henri de Trastamare fils illégitime du roi Alphonse XI, était le demi-frère de Pierre Ier, roi de Castille, dit Pierre le Cruel. Lorsque les Français entrèrent en Espagne sous le commandement de Du Guesclin accompagné de Pierre le Besgue de Villaines à la tête des compagnies blanches, don Juan García Gutiérrez de Villandrando, caballero de la Orden de la Banda, se joignit à eux comme partisan du prince Henri de Trastamare. Il se lia d’amitié avec Pierre de Villaines. Ce fut ce chevalier qui, au dire de Froissart, captura le roi Pierre le cruel, alors que ce dernier cherchait à s’évader du château de Montiel. Pressé par les troupes de son demi-frère, le roi de Castille s’était, en effet, réfugié en toute hâte à l’intérieur de la forteresse assiégée. Dans la nuit du 23 mars 1369, à court de forces et sans vivres, il tenta de s’évader accompagné de quelques hommes d’armes. Pierre de Villaines l’ayant reconnu, le saisit au corps alors qu’il franchissait une brèche aménagée dans l’enceinte. Il fut conduit sans attendre auprès de son rival. Aux premières lueurs de l’aube, Henri provoqua son frère en duel. Ce dernier fut lacéré, et sur ordre du vainqueur, on laissa sa dépouille pourrir trois jours avant d’être inhumée. Sa victoire consommée, Henri de Trastamare s’installa sur le trône de Castille, et prit le nom d’Henri II. En récompense et au nom de l’immense service rendu, le gentilhomme français reçut du nouveau roi le comté de Ribadeo en
12
Galice avec le rang de Grand de Castille3. Juan García Gutiérrez de Villandrando et Pierre de Villaines avaient combattu sous la même bannière et une amitié indéfectible était née entre les deux hommes. C’est tout naturellement ce qui amena Villandrando à rencontrer Thérèse de Villaines, la sœur de Pierre. Un mariage fut conclu et ce fut, dit-on, une union brillante. Thérèse de Villaines donna le jour à Ruy Garcia de Villandrando, qui fut regidor de Valladolid, et à don Pedro, seigneur de Bambiella, qui mourut en 1400, jeune et veuf déjà depuis plusieurs années, laissant de feu Aldonça de Corral, sa femme, trois fils et une fille dont l’aîné est Rodrigue. Lors du décès de son père, Rodrigue était âgé seulement de douze ans. Ses frères et lui furent donc placés sous la tutelle de leur oncle, Ruy Garcia, et de leur grand-mère, Thérèse de Villaines. Il semble que quelques biens leur aient été assignés sur le revenu du comté de Ribadeo par Pierre le Besgue, qui vivait toujours. Mais ce seigneur accablé de vieillesse, ressentant le mal de son pays d’origine décida de vendre son comté au plus offrant. Grâce au prix qu’il en tira, il acheta par contrat passé au Châtelet de Paris le 2 mai 1401, la riche et indépendante seigneurie normande que l’on appelait alors le « royaume d’Yvetot ».4 Après son départ, sa sœur, désespérée, fit tout ce qu’elle put pour conserver ce que cette aliénation faisait perdre à ses petits-enfants : elle prétendit la vente nulle et non avenue et, se fondant sur les termes de la donation, revendiqua la possession du comté de Ribadeo pour ses fils et leur descendance. Elle intenta un procès pour essayer de recouvrer les droits de ses petits-enfants. Mais ce procès n’eut pas une heureuse issue pour les Villandrando. Thérèse de Villaines mourut sans parvenir à ses fins et les pauvres orphelins ne purent compter que sur l’appui de leur oncle le « regidor ». Toutefois, on peut supposer que celui-ci donna à ses neveux une instruction et une formation 3
Josef PELLIZER, Informe del origen antigüedad, calidad y sucesión de la excelentísima casa de Sarmiento de Villamayor, Madrid, 1663, fol. 94. 4 Un arrêt de l'Échiquier de Normandie en l'an 1392 donne le titre de Roi au Seigneur de cette Terre du pays de Caux. L'Historien Froissart raconte que « Clotaire I, Roi de France, ayant tué Gautier, son sujet et Seigneur d'Yvetot, dans l'Église de Soissons, le jour du Vendredi saint, dans le temps qu'on faisait la cérémonie de l'adoration de la Croix, le Pape Agapet, premier du nom, enjoignit à Clotaire de réparer cette faute. Ce Roi, pour l'expiation de ce crime, érigea en Royaume indépendant la Terre d'Yvetot ».
13
universitaire solides, car on connaît à cette époque le rôle primordial joué par les autorités municipales face à l’institution universitaire dans les villes castillanes. De bons rapports existaient alors entre la ville et l’université, car les habitants manifestaient le plus grand intérêt pour le centre intellectuel qui vivait entre leurs murs. Le « regidor » Ruy García de Villandrando ne pouvait donc manquer de s’occuper des enfants de son frère défunt. Il en avait les moyens, car l’on sait que les oligarchies urbaines, qui monopolisaient alors le pouvoir municipal, contrôlaient aussi indirectement l’université par le biais de son financement. Elles exerçaient ainsi un encadrement plus direct sur cette institution en occupant souvent les charges de « conservateurs royaux » et même de « bedeaux ». À Valladolid, à la fin du XIVe siècle, « les conservateurs » dont les noms nous sont parvenus, les « caballeros » Juan Manso et Ruy Garcia de Villandrando, appartenaient aux deux puissants lignages qui se partageaient le pouvoir dans la ville.5 Le témoignage de cette solide instruction dont ont pu bénéficier les neveux du « regidor » est encore illustré, nous le verrons plus tard, par le frère cadet de Rodrigue, appelé Pierre de Corral, du nom de leur mère, qui est l'auteur de Crónica del Rey Don Rodrigo connue sous le nom de Crónica sarracina, un des textes majeurs du Moyen Âge espagnol. Rodrigue lui-même sut écrire en espagnol et en français. Sa signature nous a été conservée au bas de plusieurs actes. Elle est élégante et dénote une main assurée. Sur une lettre que possèdent les archives communales de Lyon, elle est accompagnée de quelques mots dont l’écriture est meilleure que celle du scribe qui a tracé le reste6. Rodrigue tenait sa correspondance et administrait ses affaires sans le secours de personne. Quand il deviendra capitaine, et plus tard grand seigneur, il contrôlera et entretiendra à son service une véritable administration : des secrétaires, un trésorier, un maître des comptes, enfin tout le personnel d’une maison bien ordonnée. Nul doute que les traditions de famille n’aient été pour beaucoup dans la destinée de Rodrigue. Bercé par les récits des exploits 5
Adeline RUCQUOI, « Sociétés urbaines et universitaires en Castille au Moyen Âge », Milieux universitaires et mentalité urbaine au Moyen Âge, Presses Universitaires de Paris Sorbonne, p. 105. 6 Voir dans cet ouvrage, Données historiques complémentaires, Annexe 8, p. 348.
14
guerriers de son grand-père, épaulé par son oncle le « regidor », il décida encore jeune homme, d’embrasser la carrière de marchand et de courir les mers à bord d’un navire. « Le regidor », bien que résidant à Valladolid, ville pourtant moins commerçante que Burgos, était bien placé pour voir comment les riches commerçants s’intégraient à l’oligarchie citadine. Ils entraient dans les linajes et nous en avons même le témoignage dans sa propre famille7. Rodrigue, poussé par cette opportunité familiale, avec l’appui de son oncle, pouvait donc tenter l’aventure marchande à bord de l’un des nombreux navires croisant de la mer Cantabrique jusqu’au golfe de Gascogne. Avec la volonté farouche de réussir, le jeune homme se rendit donc en compagnie d’un de ses frères sur les franges rocheuses de la côte océanique. Les deux garçons arrivèrent un matin à Santander. Deux digues délimitaient un plan d’eau intérieur relativement abrité. Seules les petites embarcations pouvaient remonter l’embouchure du Becedo, car le pont reliant la Puebla Vieja à la Puebla nueva limitait l’accès à ce port intérieur. Au nord, la plage au pied de l’Arrabal de la Mar, faubourg peuplé essentiellement de pêcheurs, servait de zone d’échouage et de lieu de séchage pour les filets. Au centre, un quai permettait aux barques d’accoster et de s’amarrer, tandis qu’une esplanade en avant de la muraille autorisait le stockage et la manutention des marchandises. Rodrigue et son jeune frère furent frappés par l’activité qui régnait en ces lieux. On eut dit une fourmilière. Un peu plus à l’est, une grande digue accueillait des navires de gros tonnage. On y voyait la foule travailleuse, aller et venir, décharger les marchandises, les acheminer dans la cité à dos d’homme ou dans des charrettes pour les entreposer enfin dans une halle. Le port médiéval était la plupart du temps affecté à la pêche, au commerce, mais aussi à la piraterie, des secteurs économiques souvent complémentaires qui permettaient de rentabiliser au mieux le coût de la construction des navires. Le « Regidor » avait dirigé ici ses neveux, car il savait qu’à l’éventail de ces tâches économiques s’ajoutaient encore des activités militaires8. Les jeunes garçons auraient ainsi tout le choix de construire leur avenir. Rodrigue et son frère, ayant conclu l’affaire avec un marchand, s’embarquèrent sur un navire qui croisait au large de la côte de 7
Ibid. Adeline RUCQUOI, p. 105. PUBLICATIONS DE LA SORBONNE, Ports maritimes et fluviaux au Moyen Âge, Paris, 2005, pp. 26-68.
8
15
Gascogne afin de commercer avec les Anglais de Guyenne. Il est inutile d’insister sur l’importance des marchands, tant en Aquitaine qu’en Castille au XVe siècle. Ils sont nombreux à aller et venir. On sait que le commerce des vins qui n’était pas, il s’en faut, la seule denrée commercialisée, permit à certains marchands de Bordeaux d’amasser de grosses fortunes. Or, ce commerce s’exerçait aussi sur des bateaux d’autres ports océaniques, parmi lesquels figuraient des navires basques et cantabres9. Toutefois, en cette période d’instabilité politique, les échanges commerciaux ne s’opéraient pas sans risque. Il faut dire que l’estuaire girondin était un espace contesté étant donné la situation géopolitique des XIIIe-XVe siècles qui voyait s’affronter une Guyenne anglaise et une Saintonge française. Cependant, cette guerre navale se résuma la plupart du temps à opérer un contrôle de la frontière et de l’axe commercial girondin. Elle prit surtout l’aspect d’escarmouches, les attaques d’envergure étant plutôt rares en dehors du siège de Mortagne et de l’offensive française de 1405 durant laquelle fut mené un raid sur Bordeaux par des galères castillanes. On relève quelques attaques répétées par la flottille bordelaise contre Talmont au début du XVe siècle, mais il faut dire que les deux belligérants recouraient le plus souvent à des mercenaires qu’ils munissaient de lettres de marque. Manquant le plus souvent de moyens et d’hommes pour entamer une reconquête, le roi de France fermait les yeux, voire encourageait tacitement les exactions menées par les marins relevant de sa couronne.10 Dans ce contexte mouvant et incertain, le navire sur lequel se trouvaient les deux frères fut attaqué et pillé par des pirates qui, par bonheur, firent grâce de la vie à l’ensemble de l’équipage. Froissé par ce fâcheux évènement, touché dans son honneur, Rodrigue dont la vocation semblait déjà plus guerrière que commerçante, décida d’aider le marchand à récupérer sa fortune. Très rapidement, il parvint à arraisonner d’autres bateaux de pirates chargés de richesses.
9
Madeleine PARDO, « L’historien et ses personnages », Études sur l’historiographie espagnole médiévale, ENS Éditions, Lyon, 2006, p. 87. 10 REVUE D’HISTOIRE MARITIME, Risque, sécurité et sécurisation maritimes depuis le Moyen Âge, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, Paris, 2008, pp. 102103.
16
Le marchand avant de décéder avait couché Rodrigue sur son testament pour en faire son héritier11. Mais, malgré ces succès, le souvenir de son grand-père, fier combattant et héros des grandes épopées guerrières, ne tarda pas à le ramener vers la terre ferme. Il décida de céder ses navires à l’un de ses compagnons de piraterie qui lui sembla le plus apte à en prendre le commandement. Le jeune Villandrando fit donc là une première grande opération financière. Un jour de l’année 1410, ayant appris que la guerre civile en France offrait aux hardis aventuriers de meilleures occasions d’acquérir richesses et honneurs, Rodrigue, animé par la fougue et l’inépuisable énergie de ses vingt-deux ans, passa les monts12. Parvenu au faîte d’une montagne pyrénéenne, là où la vue embrassait l’horizon des deux pays, il se trouva face à un prieuré joliment assis sur un ourlet de terre et qui lui sembla bâti partie en France, partie en Espagne... Rodrigue trouva cet endroit merveilleux. Tout semblait étonnamment paisible. Le jeune aventurier fit une pause, puis plein d’espoir, dévala la pente, bien décidé à sceller son propre destin au destin du royaume de France.
11
Alonso de PALENCIA, Crónica de Enrique IV, escrita en latín, traducción castellana por D. A. Paz Y Melia, Editeur Tip. De la « Revista de Archivos », Madrid, 1904-1908, tome 1, p. 21. 12 M. TELLO, « Don Rodrigo de Villandrando, conde de Ribadeo », Discurso leído en la junta pública de aniversario de la Real Academia de la historia, el 24 de mayo de 1882, Por D. Antonio Maria Fabié académico de número, Madrid, 1882, pp. 374375.
17
Première partie L’EPOPEE FRANÇAISE
ARMAGNACS ET BOURGUIGNONS La maudite guerre Lorsqu’en 1410, Rodrigue pose le pied sur la terre de France, la guerre entre les maisons d’Orléans et de Bourgogne bat son plein. Deux assassinats vont faire basculer le destin de la France Trois ans auparavant, Louis d’Orléans, frère du roi Charles VI, qui hennissait comme un étalon après presque toutes les belles femmes, est accusé d’avoir voulu séduire, ou pis esforcier, la duchesse de Bourgogne, épouse de Jean sans Peur. De plus, même s’il ne s’agit que d’une rumeur, le bruit court que cet incorrigible séducteur aurait été l’amant de la reine. Aussi, en représailles, la propagande de Bourgogne se plaît à le présenter comme le véritable père du dauphin Charles, futur Charles VII. C’en est trop ! Le 23 novembre 1407, Jean sans Peur décide de faire assassiner son exaspérant rival. Dans un guet-apens, ce dernier est poignardé par une quinzaine d’hommes masqués, rue Vieille-du-Temple à Paris. Deux ans plus tard, le 15 avril 1410, Charles d’Orléans, le fils de Louis, épouse la fille de Bernard VII, comte d’Armagnac. Dans le désir de venger son père, il forme à Gien, à l’occasion de ses noces, une ligue contre le duc de Bourgogne et ses partisans, dans laquelle entrent, outre le duc d'Orléans et son beau-père, les ducs de Berry, de Bourbon et de Bretagne, ainsi que les comtes d'Alençon et de Clermont. Bernard VII recrute alors dans le Midi des mercenaires qui, rassemblés au sein des fameuses compagnies de routiers, font la guerre avec une férocité inouïe. À leur tête, il ravage les environs de Paris en mengeant le povre peuple. Les Anglais vont profiter de la situation pour soutenir ponctuellement les deux partis ou acheter leur neutralité. Alentour de la capitale, le combat fait rage, les deux partis s’affrontent sans concession. Les Armagnacs ravagent les campagnes jusqu’aux portes de la ville, pillant et massacrant sans merci, allant jusqu’à pendre au chêne de Meaux une cinquantaine de pièces de
21
gibier humain que l’on voyait brandiller tous les matins16. C’est le chaos politique. Sur fond de guerre civile, Paris va connaître des heures sombres. C’est dans ce contexte troublé que Rodrigue arrive au pays de ses ancêtres maternels, peu d’éléments nous sont parvenus concernant ses premières armes. Vers 1412/1413, on trouve la trace d’un certain Rodrigue dans les compagnies du Rouergue17. Cependant, il est mentionné sans nom de famille et bien qu’il œuvre au service d’Amaury de Séverac, du parti des Armagnac18, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit de Villandrando. En effet, en vertu des bons accords qui lient la France à la Castille, nombre d’Espagnols, prénommés aussi Rodrigue, sont venus chercher fortune en France. Il est plus probable que Rodrigue ait choisi de se rendre là où ses ancêtres avaient vécu, soit par attachement familial, soit par recommandation. Son histoire commence en effet au pays de son grand-père, le pays de Villaines près de Paris où l’on repère avec certitude son passage : Rodrigue fut introduit de bonne heure auprès d’un capitaine redouté, qui était en même temps l’un des puissants seigneurs de cette même contrée d’origine. C’est Villiers de L’IsleAdam, de sinistre mémoire, qui au début de sa carrière avait servi le roi de France Charles VI avant de devenir un inconditionnel des Bourguignons, nous dit Jules Quicherat. C’est dans ces campagnes où on le trouve successivement guerroyant dans l'Orléanais, en Picardie, à Paris et enfin à Pontoise, que Rodrigue de Villandrando établit sa réputation de hardi combattant en affichant en toutes circonstances un courage sans faille. Il était toujours le premier à s’avancer sur les positions dangereuses et à se proposer pour les missions difficiles. Plus d’une fois, lorsqu’on était en présence dans l’attente de la bataille et qu’un champion du parti ennemi venait dans les rangs appeler qui osât se mesurer avec lui, on vit le Castillan accepter le
16
Georges SAND, Jean Ziska épisode de la guerre des Hussites, Meline, Cans et Cie, librairie imprimerie et fonderie, Bruxelles, 1843, p. 9. 17 Paul DURIEU, Procès-verbaux des séances de la Société des lettres, science et arts de l’Aveyron, « Communication de M. Paul Durieux », Rodez, 1891. 18 BIBLIOTHEQUE de L’ECOLE des CHARTES, Revue du Moyen Âge, Paris, 1864, tome 1, p.123.
22
défi, vaincre son adversaire et en rapporter les dépouilles à son capitaine, qui l’honorait publiquement de ses éloges.19 L’Isle-Adam, comme tant d’autres gentilshommes, n’eut point d’abord d’opinion arrêtée. Il prit les armes dans l’intention de servir le roi, et changea volontiers de parti, suivant l’ascendant que chacune des factions pouvait prendre sur la personne de Charles VI en proie à de soudaines crises de démence. Puis, au cours des diverses campagnes, hésitant toujours sur le parti à embrasser, il offrit enfin ses services au comte d’Armagnac qui le repoussa. Alors, en représailles, il devint l’implacable bourguignon que nous ont fait connaître les chroniques. Le 28 mai 1418, durement éprouvée par les exactions des Armagnacs, la population de la capitale se soulève. Le soir même, à la nuit tombée, un certain Perrinet Leclerc, demeurant sur le Petit-Pont et qui estoit marchand de fer, subtilise les clefs à son père qui avait la garde de la porte Saint-Germain20. À la tête d’une dizaine de jeunes conjurés, il favorise discrètement l’entrée de Jean de Villiers de L’Isle-Adam, capitaine maintenant affiché du parti bourguignon. Un bataillon de huit cents hommes pénètre à la suite. Effet de surprise : aux cris de Vive Bourgogne ! Orléanais et Armagnacs sont massacrés et le 12 juin Bernard d’Armagnac est tué à son tour. Le même jour, la faction bourguignonne assiège le grand Châtelet et massacre tous les prisonniers Armagnacs qui y étaient enfermés. Leurs corps, jetés du haut des tours, étaient reçus à la pointe des piques. Dans cette anarchie, des scènes épouvantables s’ensuivent. Pendant l’été, la capitale fut ensanglantée par les exactions du bourreau Capeluche. Ce dernier, chef d’une simple bande qui terrorisait les habitants, entreprit de massacrer les derniers Armagnacs se trouvant dans la capitale. Cette sédition commença le 13 août et dura jusqu’au 21. Capeluche qui avait revêtu sa robe de bourreau en velours rouge égorgea de sa
19
Jules QUICHERAT, Rodrigue de Villandrando, l’un des combattants pour l’indépendance de la France au XVe siècle, Librairie Hachette et Cie, Paris, 1879, p. 12. 20 Jean JUVENAL des URSINS, Chroniques de Charles VI, dans Chroniques et Mémoires de l’Histoire de France, par J. A. C. Buchon, Auguste Desrez, Paris, 1838, p. 541.
23
propre main tous ceux qui lui parurent suspects21. Et lorsqu’il jugea ne plus avoir d’adversaires, il décida de s’en prendre aux femmes enceintes, se complaisant à leur transpercer le ventre de part en part. On comptabilisa deux mille morts. Jean sans Peur, horrifié par ces tueries, le fit alors arrêter et exécuter. Quant au dauphin Charles, il avait été entraîné hors de la capitale par ses proches dès le premier juin 1418. Le 21, il était réfugié à Bourges, et le 24, de sa propre autorité, il se déclarait régent du Royaume de France. Nouveau maître de Paris, Jean sans Peur entre en négociations avec les Anglais et semble tout disposé à accueillir les prétentions du roi d'Angleterre au trône de France. Il devient alors impérieux pour Charles de négocier un rapprochement avec les Bourguignons pour éviter une alliance anglo-bourguignonne. Un rendez-vous est donc fixé. Le 10 septembre 1419, les armées arrivent vers 15 heures sur les deux berges de l’Yonne, de part et d'autre du pont de Montereau. Au milieu de l’ouvrage, des charpentiers ont élevé une sorte d’enclos avec trois barrières de sûreté et une porte de chaque côté. Il est convenu que les deux rivaux entreront à l’intérieur suivis chacun d’une escorte de dix personnes et que les portes seront fermées pendant toute la durée de l'entrevue. Malgré les dispositions prises, Jean sans Peur réfléchit encore sur le bien-fondé de cette dangereuse rencontre. De chaque côté de l'Yonne, les deux princes s'épient. Enfin, à 17 heures, le duc de Bourgogne se décide : il s'avance vers le pont de Montereau. Lorsque les conseillers de Charles le voient enfin apparaître, ils vont au-devant de lui et lui disent : « Venez devers Monseigneur, il vous attend » Jean sans Peur s’avance sans protection sur le pont. L'atmosphère est tendue. Le duc s'agenouille avec respect devant le dauphin, qui feint l'indifférence. Se relevant, Jean cherche un appui en posant la main sur le pommeau de son épée. « Mettez-vous la main à votre épée en présence de Monseigneur le Dauphin ? », questionne l'un des compagnons de celui-ci. Tanneguy du Chastel n'attend que ce prétexte pour porter un coup de hache au visage du duc en criant Tuez, tuez ! C’est alors la curée. Par la porte 21
Nicolas BAUDOT de JUILLY, Histoire de Charles VII, Didot, Paris, 1765, tome 1, p. 82.
24
du côté du dauphin, qui a été maintenue ouverte, des hommes en armes s'engouffrent dans l'enclos. Le duc est lardé de coups de couteau. Selon certains dires, il eut même la main droite sectionnée comme il le fit quelques années auparavant à son cousin Louis Ier d'Orléans.22 Le dauphin fut désigné comme le principal instigateur de l'assassinat du duc de Bourgogne. Malgré ses dénégations, malgré ses excuses, il ne put se justifier. Les conséquences furent catastrophiques. Cet acte empêcha tout apaisement et fit s'effondrer ce qui restait du royaume de France : un an plus tard, le traité de Troyes donnait la couronne de France à Henri V d'Angleterre. Dès lors, les Armagnacs contesteront ce traité, mais ne contrôleront plus que le sud du Pays. Où se trouvait Rodrigue pendant ces mois terribles ? Fut-il le témoin probable de ces exactions ? Au milieu de toutes ces fluctuations, il semble qu’il ait toujours gardé la même ligne directrice, ce qui amènera sa disgrâce et son exclusion de la compagnie : cela, alors qu’il venait pourtant de s’acquitter avec succès de la garde d’une petite forteresse du Gâtinais, où L’Isle-Adam l’avait posté23. Selon toute apparence, cette disgrâce se place à la fin de 1419 ou au commencement de 1420. Au moment où la défection entama les troupes du parti bourguignon à propos de la question, qui se posait déjà, d’exclure le Dauphin Charles de la succession à la couronne. La chose fut trouvée si excessive, même parmi les exécuteurs des vengeances bourguignonnes, que plusieurs d’entre eux désertèrent plutôt que d’avoir à y souscrire. Le gouvernement qui se réclamait encore du nom de Charles VI s’inquiéta fortement de ces prises de position et menaça de sévir avec une impitoyable rigueur contre les transfuges. Tous les Castillans devinrent suspects, parce que le roi de Castille s’était déclaré pour le Dauphin et qu’on savait qu’il avait fait voter par ses Cortès l’armement d’une flotte destinée à soutenir la cause du 22
Ibid. Nicolas BAUDOT de JUILLY, p. 123. KERVYN DE LETTENHOVE sous le titre de Livre des trahisons de la France contre la noble maison de Bourgogne, volume de la grande collection des documents inédits belges intitulé Chroniques relatives à l’histoire de la Belgique sous la domination des ducs de Bourgogne, p. 162. 23
25
prince déshérité24. Il avait ordonné à l’Amirante Alfonso Henriquez d’assembler plusieurs navires qui partirent armés de Santander sous le commandement du propre fils de celui-ci, don Juan Henriquez25. Ces Espagnols ne voient que par les yeux de leur prince et nous trahiront comme lui, murmurait-on à la cour d’Isabeau ; mieux vaut s’en défaire26. La preuve que les craintes des Bourguignons à l’égard des Espagnols n’étaient pas sans fondement est dans ce fait, consigné par le religieux de Saint-Denis, que plusieurs arbalétriers castillans furent suppliciés à Saint-Denis, pour avoir abandonné leur compagnie dans l’intention de passer aux Armagnacs. La fidélité de Rodrigue envers son ancien capitaine aurait-elle été ébranlée ? Un trait de caractère, que nous allons évoquer, rend inadmissible un pareil soupçon. Mais il est possible que dans sa franchise, il ait désapprouvé tout haut le parti vers lequel il voyait s’incliner ses compagnons de lutte. Il n’en fallut pas davantage pour le représenter comme un traître.
24
Fernán PEREZ de GUZMAN, Crónica del Rey don Juan el II, pp. 157 et 174. M. d’HERMILLY, Histoire générale d’Espagne, traduite de l’espagnol de Jean de Ferreras, Chez Gissey/Le Breton/Ganeau, Paris, 1751, tome VI, p. 241. 26 Jules de GLOUVET, France 1418-1429, Histoire du bâtard de Montorel, A. Colin, Paris, 1895, p. 108. 25
26
LES SEIGNEURS DE GUERRE Rodrigue crée sa propre compagnie Toujours est-il que Rodrigue se le tint pour dit. Dès le lendemain, il quitta la compagnie de L’Isle-Adam avec deux rudes gens d’armes castillans, et pénétra en Île-de-France, bien armé, dépourvu d’appuis, mais avec l’ambition en croupe. Il en avait maintenant les moyens. Sûr de lui, d’un caractère bien trempé, notre homme joignait à la science militaire une faculté d’anticipation extraordinaire. Il sentit que le moment était venu de concrétiser un projet qui depuis longtemps lui tenait à cœur. En cet automne frileux de 1419, Rodrigue, rendu à ses convictions premières, recouvrait une totale liberté d’action. Son cœur de Castillan battit très fort. – « Fidélité à mon roi », décida-t-il, affirmant ainsi les principes de loyauté qui semblent l’avoir toujours habité. Il se tourna vers le parti du Dauphin pour lequel s’était prononcée la politique de son pays. En prenant son indépendance, il se sentait désormais au-dessus des intrigues et à couvert des avanies. Il allait constituer ses propres troupes, un corps armé suffisamment puissant pour que les plus grands comptent avec lui. Il se présenterait à eux seulement lorsqu’il aurait réuni une suite avec laquelle il aurait fait ses preuves et qui lui permettrait de poser ses conditions. Il se sentait né pour le commandement et les circonstances favorisaient ses vues ambitieuses. Il savait par expérience que les corps de compagnies étaient inconstants et fort difficiles à manœuvrer en raison des origines diverses des routiers. Dans leur diversité linguistique et culturelle, ils pouvaient surtout s’avérer peu fiables. Alors, son dessein fut de créer une compagnie où n’entreraient que des sujets de son choix, astreints à l’obéissance, liés à lui par contrat moral, et sur lesquels il exercerait un pouvoir maîtrisé. Sûr d’arriver à ses fins, il se mit à l’œuvre en homme que rien ni personne ne pourrait décourager. Pour Rodrigue, l’époque est favorable. Dans le chaos et l’anarchie de ce début de siècle, les compagnies jouent en effet un rôle important dans l’équilibre des forces. Certes, il ne manque pas de gens pour vouloir la paix, mais quels que soient leurs titres ou leurs fonctions, ils 27
ne peuvent vraiment être écoutés, car la guerre se nourrit d’elle-même. Ni la raison, ni la peur, ni la force ne suffisent à imposer la paix. Aucun des belligérants n’est assez puissant ni surtout assez riche pour venir à bout du conflit. De plus, les puissants ont abandonné la conduite des opérations à une quantité toujours plus grande de petits chefs qui, devenus autonomes, ne veulent en quelque sorte pas casser leur « fonds de commerce » ni entendre un mot à propos de la cessation des hostilités. Alors, la guerre se disperse, devient locale, minuscule, mais toujours féroce. Elle se répand sur tout le territoire.1 Le capitaine de compagnie devient un véritable « entrepreneur de guerre ». Il recrute des aventuriers, accourus de tous les pays dans l’espoir du butin et s’il peut les payer, ils combattent sous son commandement. C’est là toute la difficulté du pouvoir royal. Il est certain par exemple que pendant toute une génération, correspondant à la première partie de son règne, Charles VII fut incapable de solder régulièrement ses troupes, qui durent vivre sur le pays. Avec cette excuse, vraie ou fausse, répétée à l’envi par des gens de guerre : Il faut bien vivre, en dépit de vos engagements vous êtes impuissants, notamment faute d’argent à nous entretenir correctement en fonction de nos besoins et de nos appétits.2 Sous la conduite de chefs aguerris, nous verrons plus tard que ce sera le cas de Rodrigue, certaines compagnies deviennent plus puissantes que les forces armées du roi et en viennent à exercer un véritable contre-pouvoir.3 Partout sur le territoire, des armées, ou plutôt des bandes armées, surgies d’on ne sait où, combattent pour le royaume en temps de guerre et le dévastent en temps de paix. Il semble ne rester pour le menu peuple, situé malencontreusement sur leur trajet, aucun temps de calme ou de repos. Trois fléaux de nature différente s’exercent principalement : le feu, le viol et la razzia des troupeaux. À l’époque,
1
Jean Marc SOYEZ, Quand les Anglais vendangeaient l’Aquitaine, « collection Les mémoires de France, les dossiers de l’Aquitaine », Bordeaux, p.141. 2 Christian DESPLAT, Les villageois face à la guerre XIVe-XVIIe siècle, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 2002, pp. 19, 20, 21. 3 Paul LACROIX, Romans relatifs à l’histoire de France aux XVe et XVIe siècles, Auguste Derez, Paris, 1838, p. 135.
28
on compare ce phénomène à l’invasion des sauterelles, à la prolifération des sangsues. Évidemment, les populations et les espaces les plus vulnérables furent frappés au premier chef, autrement dit les campagnes, les hameaux et les villages. Ceux-ci étaient alors appelés couramment le plat pays, ou pays sans défense, comme on parle d’une maison plate par opposition à une maison forte4. Sur ces terres dénuées de toute présence humaine, on ne cultivait que dans les alentours des villes, ou le voisinage des lieux fortifiés et des châteaux. À distance seulement où, du haut d'une tour ou d'un poste d'observation, le regard d'une sentinelle pouvait voir l'arrivée des bandes pillardes. Le tintement d'une cloche, une corne de chasse, tout autre son servait de signal pour inviter sans attendre les vignerons et les laboureurs à venir chercher un abri en lieux sûrs. Dans bien des endroits, le signal d'alarme se fit si souvent entendre, qu'aussitôt donné, les bœufs et les bêtes de somme libres de la charrue se précipitaient spontanément, par effroi et sans guide, dans des lieux de sûreté. Ce que faisaient également les brebis et les porcs, tant ils y étaient habitués. Toute forme d'État régulier a péri dans ce royaume ; plus de finances ; oubli de l'agriculture ; les champs en friche ne donnent plus de récolte, les cultivateurs les ont quittés ; ne semant plus, l'on ne moissonne plus ; c'est à la dérobée, clandestinement, qu'on fait encore quelque agriculture. Ce ne sont pas seulement les bêtes de labour, ce sont les instruments mêmes qu'on enlève, en sorte que ceux qui voudraient encore remuer la terre devraient le faire avec leurs ongles.5 Les conséquences de cette désertification des sols, rendus à la nature sauvage, sont ressenties dans la plupart des villes et dans la capitale même. À tel exemple que le Journal du Bourgeois de Paris nous décrit à plusieurs reprises des loups rôdant dans les rues : La ville se dépeuple, des milliers de maisons sont vides et croulantes, l’herbe pousse parmi les rues, et les loups entrent dans la ville nageant par la rivière. Pour l'année 1423, il écrit encore : En ce temps venaient à Paris les loups toutes les nuits, et en prenait-on souvent trois ou quatre en une seule nuit, et étaient portés parmi Paris pendus par les pattes de derrière.6 4
Ibid. Christian DESPLAT, pp. 19-21. Jean-Baptiste-Joseph AYROLES, La vraie Jeanne d’Arc, la paysanne et l’inspirée, Caumes et Cie, Paris, 1894, tome II, p. 59. 6 Ibid. AYROLES, p. 59. 5
29
Pourtant, il faut survivre, désespérément ! Alors, à l’intérieur des agglomérations, la campagne se fait présente, elle s’est transportée avec les bestiaux, les cuves à vendanges, et même les jardins et les parcelles labourées parmi les maisons, peut-être parce que la densité des constructions est souvent moindre et la hantise de la faim plus obsédante. La cité devient un refuge ultime, un îlot de sécurité dominant le territoire des friches et des bêtes sauvages, un îlot où les plus misérables, les déracinés, les épaves de la société rurale essaient, souvent sans succès, de se glisser.7 Alors quand il est encore temps, l’enrôlement au sein des groupes armés permet aux plus humbles d’assurer leur survie, à l’abri des attaques et de la disette, en exerçant à leur tour la guerre, les brutalités et le pillage. Lorsqu’on n’est pas un combattant, il est encore des tâches d’intendance, de maintenance ou autres qui permettent de gagner dans une sécurité relative la cohorte des gens attachés au service de la compagnie. La compagnie est donc un peuple nomade dont l’effectif fluctue au gré des nécessités et des déplacements. Si les routiers pillent tout ce qui est à leur convenance, ils retiennent au passage un grand nombre de femmes et de jeunes filles pour leur service. A leur suite marchent une nuée de vagabonds, de gens sans aveu, de femmes perdues et de bêtes de somme pour charger et porter le butin. On comprend ce que les pays qu’ils visitaient pouvaient attendre de gens de sac et de corde, marchant en pareil équipage ; aussi telle était l’épouvante qu’ils répandaient au loin.8 Ainsi, le problème éternel de la survie concerne aussi les cohortes armées. La question capitale pour des troupes étant de subsister, les dévastations et le pillage généralisé ne s’avèrent pas suffisants. S’ils permettent le plus souvent d’assurer la survivance matérielle à court terme, ils n’apportent pas suffisamment de devises. Or, il faut de l’argent frais pour assurer la solde de tous ces mercenaires. Alors après avoir vidé les granges et les étables, pillé des villages, assiégé les châteaux, rançonné les marchands, les routiers lorsqu’ils sont rassemblés au cœur de puissants groupes armés, s’attaquent aux villes 7
Georges DUBY, Le journal de la France, « le marasme des villes », Jules Tallandier, Paris 1984, tome II, p. 658. 8 Paul ALLUT, Les Routiers au XIVe siècle, les Tard-Venus et la bataille de Brignais, N. Scheuring, Lyon, 1859, pp. 95, 96, 109.
30
pour les investir. Des cités populeuses et protégées par de bonnes murailles, mais qui se défient de la solidité de leurs milices, entrent maintes fois en négociation, lorsqu’elles se voient bloquées sans espoir d’être secourues. Sous la peur et la contrainte, elles achètent leur libération à prix d’argent. Rodrigue parvenu au faîte de sa puissance, nous le verrons plus loin, usera plusieurs fois de cet expédient en obligeant notamment la grande cité lyonnaise à se mettre à contribution et composer avec lui. Les archives nous ont conservé de nombreuses traces de ces traités, qu’on désigna par un terme particulier, celui de pactis (pacte) ou patis, qui donna le terme apatiser9. Ces transactions avaient été mises sur pied dès le début de la guerre de Cent Ans par les nombreuses compagnies du quatorzième siècle, celles dont Froissart a raconté les prouesses.10 Mais revenons en 1419. Au cours des années terribles qui avaient vu basculer le destin de la capitale, Rodrigue avait acquis une solide expérience au service de L’Isle-Adam et il avait bien l’intention de s’en servir. Le biographe espagnol Hernando del Pulgar rapporte les débuts de Rodrigue en termes quelque peu romancés, loin de la réalité historique : errant sur les grands chemins, il rencontra un premier vagabond brave comme lui, pauvre comme lui, également incapable de perdre, également désireux de gagner, qui ne demanda pas mieux que de suivre sa fortune. Un autre se joignit bientôt à eux. Les voilà tous les trois, associés d’industrie et d’audace. Dans des lieux solitaires, à des heures choisies, ils épient de loin les pelotons en marche, ou bien ils font la ronde autour des campements ennemis. Sur les traînards, sur les imprudents qui s’écartent, ils accourent la lance en arrêt. Vainqueurs, ils emportent la dépouille ; vaincus ils s’enfuient par les chemins creux ou à travers les forêts, dans des retraites connues d’eux seuls. Réduits d’autres jours à de moins nobles 9
Jules QUICHERAT, Rodrigue de Villandrando l’un des combattants pour l’indépendance de la France au XVe siècle, Hachette et Cie, Paris, 1879, pp.15, 17, 18. Le verbe « apatiser » appartient à la langue militaire du quatorzième et du quinzième siècle, et signifie « l’action de faire contribuer une ville ou un pays ». Il vient du mot patis, qui était la dénomination du contrat passé entre le chef de compagnie et la partie mise à contribution. 10 FREVILLE (comte de), Des grandes compagnies au quatorzième siècle, Bibliothèque de l’École des Chartes, Ire série, tome III, pp. 133, 258.
31
exploits, ils détroussent les marchands en voyage, surprennent les chaumières isolées, mettent à rançon le paysan. Toutefois, il y a lieu de penser que Rodrigue, maintenant combattant averti et aguerri au commandement, quitta volontairement la compagnie de son capitaine par idéologie tout autant que par contrainte politique. En effet, n’oublions pas que L’Isle-Adam avait été élevé à la dignité de maréchal de France, dès 1418, par la coalition anglo-bourguignonne. D’autre part, les exécutions sommaires de certains de ses compatriotes à l’abbaye de Saint-Denis le poussèrent forcément à faire un choix. De plus, il ne manquait pas de partisans en ralliant sous sa bannière tous ceux dont l’inclinaison idéologique ou naturelle n’allait pas vers le parti bourguignon. Il décida donc de partir avec une escouade de ces exclus et il se trouva bien vite à leur tête. Ses qualités, son engagement, son charisme furent suffisants pour que ceux-ci le considèrent immédiatement comme leur chef. C’est donc volontairement que Rodrigue, lassé des louvoiements de son capitaine, fit le choix de rester dans le camp du Dauphin, pour former dès ses débuts une compagnie d’effectifs modestes. Cette troupe était composée d’une vingtaine d’hommes d’armes accompagnés de leurs pages et écuyers, soit une cinquantaine de soldats.11 Un fait est curieux à relever : à peine sa compagnie fut-elle constituée qu’elle fut précédée d’une redoutable renommée dans l’imagerie populaire. L’effroi s’attacha bien vite à son nom. On sait que les premiers routiers qu’enfanta la guerre civile avaient fait leur apparition sous la conduite de plusieurs chefs étrangers. Un certain Rodrigo de Salzero fut supplicié en 1411, il s’intitulait conduiseur d’arbalestriers au service du duc d’Orléans12. Il fut défait, capturé avec tout son état-major, et amené en équipage depuis trente lieues jusqu’à Paris, afin d’y être pendu haut et court, au gibet de Montfaucon. Le souvenir de cet évènement, présent encore dans toutes les mémoires, ne mettait pas en recommandation le nom de Rodrigue. Loin toutefois de reculer devant cette sinistre renommée, notre Castillan s’en servit comme le signe d’un terrible présage, capable de remplir d’effroi toux ceux qui allaient se trouver sur sa
11
Marcelin DEFOURNEAUX, Le journal de la France, « Quand Rodrigue sème l’épouvante », Jules Tallandier, Paris, 1984, tome II, pp. 664-666. 12 Jean JOUVENEL des URSINS, Chroniques, on y lit en l’an 1411 : Y avoit deux capitaines principaulx, lesquelz avoient larrons et meurtriers en leur compagnie en assez grand nombre. L’un estoit nommé Polifer et l’autre Rodrigo.
32
route. C’est donc sous son prénom seul qu’il inaugura sa vie d’aventure. Rodrigue venait d’avoir 31 ans, l’âge de la pleine maturité des combattants et son sens de la parole donnée, cette loyauté que nous lui connaissons maintenant, s’affirmaient de plus en plus. Le siège de Villeneuve-le-Roi allait lui donner l’occasion d’illustrer pleinement ce trait de personnalité.
33
DU SIEGE DE VILLENEUVE-LEROI A L’AVENEMENT DE CHARLES VII Le théâtre des premiers exploits de Rodrigue à la tête de sa modeste compagnie d’armes paraît avoir été la frontière de l’Auxerrois, du côté du Gâtinais. Villeneuve-le-Roi, 21 février 1421 L’hiver 1421 s’annonçait particulièrement rude. Un froid mordant enserrait les environs de Paris et ce fut la plus forte année à passer en France, et en Normandie que oncques homme ne vit, (il manquait) de tous vivres et de toutes choses nécessaires à corps d’homme, nous disent les chroniqueurs1, et il était notoire qu’à une journée de marche autour de Villeneuve, on n’aurait pas trouvé de quoi nourrir seulement un cheval, à moins de lui faire paître la neige. Villeneuve-le-Roi s’étire sur le revers d’un plateau surplombant la Seine en amont de la capitale. Cette place forte fut perdue puis reprise tour à tour par les deux partis. La cité fortifiée représentait un intérêt hautement stratégique, car la voie navigable permettait de relier commercialement le duché de Bourgogne à la ville de Paris. C’était là une partie de la clef de l’approvisionnement de la capitale, c’est pourquoi en 1420, quand le roi Henry eut achevé son pèlerinage de Chartres, il s’en alla à une autre forteresse, oultre Melun, nommée Nove-ville-o-Roy, qui interceptait les biens qui descendaient la Seine de Bourgogne à Paris.2 Les partisans du Dauphin s’en étaient emparés dès le début de février 1421, et les souffrances de Paris furent accrues. Mais très peu de temps après, le 21 février, chevauchant dans la neige arrivèrent des 1 2
VALLET de VIRILLE, Chronique de Cousinot, Delahays, Paris, 1859, p. 443. Ibid. VALLET de VIRILLE, p. 442.
35
troupes bourguignonnes en petit nombre. Commandées par le seigneur de L’Isle-Adam assisté d’autres capitaines, elles se logèrent dans les villages environnants dans le but évident de couper les communications et d’entamer le blocus de Villeneuve3. Ce siège fut bien l’entreprise la plus téméraire qu’on puisse imaginer. Malgré les rigueurs et la froidure, L’Isle-Adam osa venir et prit position sur les hauteurs avec une poignée d’hommes d’armes et une grosse bombarde. L’acheminement fut rendu difficile par son poids considérable et la nature même du sol défoncé par les ornières des chevaux. Mais une fois en place, l’engin de guerre incommoda tellement la ville qu’il n’y eut bientôt qu’un vœu parmi les bourgeois, celui de voir le capitaine de la place capituler. Il fallait se hâter. Le vicomte de Narbonne, commandant pour le Dauphin dans la contrée, forma pour la délivrance de Villeneuve un corps d’armée qui allait se mettre en route. Comme Rodrigue avait des espions à sa solde et qu’il était informé de tout ce qui se faisait autour de lui, il eut connaissance suffisamment tôt de cette expédition. Le coup ne pouvait que réussir. L’Isle-Adam et sa petite troupe allaient être enveloppés, ils allaient tous être passés par les armes. La fureur entre les belligérants avait atteint son paroxysme, de sorte que dans les deux partis, on ne faisait plus de prisonniers. On ne parlait même plus de rançon.4 Les capitaines et les grands seigneurs étaient mis à mort aussi bien que les soldats. Les partisans du Dauphin ne se seraient certainement pas épargné la joie d’immoler le cruel et impassible témoin des massacres commis par les bouchers de Paris en 1418 ! Pourtant, Rodrigue entendit la voix de sa propre conscience en apprenant la détresse de L’Isle-Adam : ce fut celle de la reconnaissance. Oubliant la suspicion dont il avait été victime, il ne se souvint que des combats passés et de tout ce qu’il devait à ce seigneur. Comme aucun serment ne l’attachait encore au parti du Dauphin, il pensa qu’il était de son honneur d’empêcher qu’un homme de guerre éminent, son ancien maître, puisse périr sans gloire dans un vulgaire égorgement. S’il refusa de s’engager militairement, il dépêcha
3
MONSTRELET d’ARCQ, Chroniques, publiées par la Société de l’Histoire de France, Paris, 1861, tome IV, p. 35. 4 Ibid. Si ce n’uist fait, il estoit mort ; car à cest heure, comme dit est, ne falloit parler de raenchon.
36
néanmoins un messager auprès du maréchal pour l’instruire de ce qui se préparait. L’Isle-Adam ne se le fit pas dire deux fois. Il ordonna à ses hommes de ramasser leurs équipages et, la nuit venue, il se retira à Sens où le reste de sa compagnie tenait garnison. Le vicomte de Narbonne, arrivé le lendemain, ne trouva à la place de l’ennemi qu’un monceau de cendres qui fumait. Les Bourguignons en s’en allant avaient eu soin de mettre le feu à leurs tentes et baraquements, afin que l’ennemi ne fasse pas de butin de tout ce qu’ils n’avaient pu emporter dans leur fuite précipitée.5 Cette aventure eut beaucoup de retentissement, puisque c’est d’un chroniqueur flamand que nous en tenons le récit. Elle donna l’éveil aux capitaines français sur le danger qu’il y avait à laisser hors des cadres un combattant indépendant et résolu comme était cet aventurier espagnol. Le Dauphin reçut le conseil de le prendre à sa solde. L’été suivant, Rodrigue fut incorporé dans la compagnie du maréchal de Séverac avec sa petite compagnie qui, nous l’avons dit, formait une chambrée de vingt écuyers et hommes d’armes, c’est-à-dire une cinquantaine au moins de combattants. Enfin reconnu, il eut la gloire de faire flotter un pennon à ses armes à la suite du grand étendard royal, qui marchait déployé devant le maréchal de France.6 31 août 1422 Un an plus tard, les évènements, qui allaient servir les intérêts du Dauphin, se bousculèrent sur la scène internationale. Un motif d’une immense gravité empêchait les capitaines anglais d’entreprendre quoi que ce soit. Ils étaient dans l’attente d’un évènement dont on ne pouvait mesurer la portée : le duc de Bedford venait de recevoir la nouvelle que le roi, son frère se mourait au château de Vincennes. Le duc chevaucha en hâte jusqu’au château, et là, il trouva le roi Henri moult aggravé de sa maladie, c’est à dire d’un feu qui lui étoit venu au fondement.7 5
Jules QUICHERAT, Rodrigue de Villandrando, l’un des combattants pour l’indépendance de la France au XVe siècle, Librairie Hachette et Cie, Paris, 1879, pp. 19, 20. 6 Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, p. 20. 7 C’était une fistule accompagnée de dysenterie, on appelait cette maladie le « mal Saint-Fiacre ».
37
Le Roi rassembla autour de son lit d’agonie son frère Bedford, son oncle d’Exeter, son cousin de Warwick et ses plus féables amis et conseillers. Il recommanda son fils Henri, que Catherine de France avait mis au monde à Windsor le 6 décembre précédent, au duc de Bedford. Il lui confia aussi la régence du royaume de France. Quant au gouvernement de l’Angleterre, il le destinait à son autre frère de Glocester et confia l’éducation de son fils au comte de Warwick. De tristes pressentiments pour l’avenir de cet enfant assiégèrent Henri V sur son lit de mort. Hollingshead lui attribue le propos suivant : Henri, né à Monmouth, aura régné peu et conquis beaucoup : Henri, né à Windsor, règnera longtemps et perdra tout. Etait-ce là le regard prophétique d’un mourant ? Il recommanda enfin au-delà de toutes choses, à ses parents et amis, d’éviter tout sujet de débat avec le duc de Bourgogne, car les besognes moult avancées du royaume de France en pourroient être empirée. Il demanda de ne point rendre la liberté au duc d’Orléans, ni à quatre ou cinq vaillants capitaines dauphinois actuellement prisonniers, jusqu’à la majorité d’Henri VI. Puis, le 31 août 1422, il tourna ses pensées vers Dieu et expira quelques heures après à l’âge de trente-quatre ans. Le lendemain, son corps fut mis par pièces, et bouilly en une poesle, tellement que la chair se sépara des os ; l’eau qui en restoit fut jetée en un cimetière, et les os avec la chair furent mis en un coffre de plomb avec plusieurs espèces d’espices, de drogues odoriférantes, et sentant bon. Après cela ledit coffre fut mis en un chariot couvert de drap noir, puis mené à Saint-Denys.8 Charles VI ne lui survécut que sept semaines, il mourut à l’hôtel Saint-Pol, le 21 octobre suivant, âgé de cinquante-quatre ans. Il avait porté quarante-deux ans le vain titre de roi, pour son malheur et celui de son peuple. Sa folie dégénérant au fil du temps s’était prolongée trente ans entiers. Son corps embaumé resta vingt jours déposé dans la chapelle de l’hôtel Saint-Pol, en attendant le retour du duc de Bedford, nouveau régent de France, qui était allé conduire à Westminster les restes d’Henri V. Le clergé séculier et régulier, l’université, le chapitre, les prévôts et échevins et tout le peuple convoyèrent Charles, le bien aimé à Saint-Denis. Mais nul prince du sang de France, pas 8
Jean JUVENAL des URSINS, Chroniques de Charles VI, dans Chroniques et Mémoires de l’Histoire de France par J.-A.-C. Buchon, Auguste Desrez, Paris, 1838, p. 571.
38
même le duc de Bourgogne, n’assista aux funérailles qui furent menées seulement par le duc de Bedford, chose moult pitoyable à voir ! Le peuple de Paris, depuis longtemps habitué aux changements, ne réagit pas en voyant disparaître cette dernière ombre des Valois. Au retour des funérailles, à peine quelques voix s’élevèrent quand les témoins virent porter l’épée du roi de France devant le régent anglais.9 Quant au Dauphin, il était dans le Velay, à Espaly près du Puy, lorsqu’il apprit le 25 octobre, à sept heures du soir, la mort du roi Charles VI son père, survenue cinq jours auparavant. Le Dauphin Charles sembla en témoigner quelque douleur et fit chanter sur le champ le De profundis dans la chapelle du château. Le lendemain, tout de noir vêtu, il prit le deuil et ordonna la célébration des obsèques du roi son père dans cette même chapelle. Le 27, il quitta le deuil et s’étant revêtu d’un habit de pourpre, il fit célébrer une messe solennelle, à laquelle tous les officiers assistèrent avec lui, portant des cottes d’armes chargées de leurs blasons. Après la messe, on leva la bannière de France ornée à trois fleurs de lys d’or sur fond d’azur, et une douzaine de serviteurs crièrent « vive le Roi ! ». Et voilà un prince devenu roi de France dans un château obscur d’une province centrale.10 Aucun règne n’eut de plus tristes commencements : voilà un roi tout jeune encore devenu le chef responsable du salut de tous. Le père était fou, la mère folle de son corps, la sœur est mariée au roi d’Angleterre, le premier Dauphin est mort, le deuxième Dauphin est mort ; la couvée a disparu, et le dernier a dû fuir à tire-d'aile jusqu’à Bourges. De tout l’art de régner, il n’a guère appris que la dissimulation. Hésitant entre les Armagnacs assassins, les ennemis fardés, les favoris peu sûrs, les ministres tremblants et les maîtresses cachées, il vit sur son hérédité dont il doute…11
9
MARTIN Henri, Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789, Furne, Paris, 1855-1860, Tome 6, pp. 83, 85, 86. 10 CHATEAUBRIAND, Œuvres complètes de Chateaubriand, « Analyse raisonnée de l’histoire de France », P. H. Krabe, libraire-éditeur, Paris, 1852, pp. 177, 178. 11 BULLETIN DE LA SOCIETE D’EMULATION DU BOURBONNAIS, Lettres, sciences et arts, Imprimerie E. Auclaire, Moulins, 1930, tome 33, p. 42.
39
Le traité de Troyes avait donné la couronne de France au roi d’Angleterre. Signé le 21 mai 1420, il avait suivi le désastre d’Azincourt où la chevalerie française s’était enlisée dans la boue « jusqu’au gros des jambes », littéralement étouffée sous le poids de ses propres armures. Une terrible hécatombe avait décimé la noblesse du royaume. Les Anglais étaient maîtres de Paris et d’une grande partie du littoral, surtout grâce à l’inimitié si longtemps implacable du duc de Bourgogne qui faisait cause commune avec eux. Les quelques provinces qui avaient reconnu le nouveau roi étaient ravagées en tous sens, moins encore par les Anglais et les Bourguignons dans leurs raids guerriers, que par les hommes d’armes qui suivaient la bannière de Charles VII : C’est le règne de la nuit, la nuit sanglante, mais la nuit toujours. Confusion, anarchie, désordre. On ne sait où est le royaume, qui est le roi ou est Dieu !12 Dans les années qui vont suivre, Jeanne d’Arc aura surtout à guerroyer dans le Nord pour bouter hors les Anglais. Et si elle a fait en quelque sorte un coude vers les provinces du centre, c’est uniquement parce qu’ici se trouvait un flanc de la grande bataille du royaume dont le front principal était à Orléans, à Reims ou encore à Paris. Dans le Centre et dans le Midi, sa présence n’était pas au même point indispensable. Pourquoi ? Parce que, dans la France divisée, éclatée, les partisans de Charles VII étaient justement les « Armagnacs », les hommes du Midi. Dans cette crise extraordinaire de notre histoire, le Midi et le Centre ont joué un rôle infiniment plus considérable que les apparences ne le feraient penser. Dans ce contexte troublé, Rodrigue, capitaine castillan au service du royaume de France, allait pouvoir s’exprimer…
12
Ibid., BULLETIN DE LA SOCIETE D’EMULATION DU BOURBONNAIS, 1930, T. 33, p. 36.
40
ESCARMOUCHES ET CHASSES-CROISES PERMANENTS Au plein de l’été 1421, Rodrigue et sa troupe avaient rejoint la compagnie du maréchal de Séverac. Cette redoutable compagnie fut attachée à une armée qui envahit le Mâconnais au moment où Charles VII prenait le titre de roi. On voulait, en effet, chasser les Bourguignons du pays, car le Mâconnais ne faisait pas partie du duché de Bourgogne : il relevait directement de la couronne. Un atelier monétaire royal était d’ailleurs implanté dans la ville. Il s’agissait avant tout d’investir les places fortes à partir desquelles on pouvait impunément lancer des raids éclair sur le « plat pays ». Le sac de Tournus Dans les mois qui précédèrent cette offensive, le Dauphin était encore à la recherche de fonds nécessaires pour l’engagement de troupes importantes. Le 4 août 1422, il envoya des députés à Lyon pour solliciter un secours en bonne monnoye. Leur plaidoyer fut entendu par tous les pays relevant de son obéissance, ainsi que des gens d’Église et des nobles du plat pays1. Enfin, au cours du mois de septembre qui précéda la mort du roi son père, le Dauphin, qui ne voulait toujours pas reculer devant ses redoutables ennemis, réussit à mettre debout toutes les forces qu’il avait à disposition. À l’automne 1422, il pousse en avant sur la Bourgogne une imposante coalition de 20.000 hommes qui franchit la Loire, envahit le Charollais sous la conduite du maréchal de Séverac, opère sa jonction avec les forces du comte de Pardiac2 et du sénéchal de Lyon, Imbert de Groslée. Rodrigue et ses hommes en font partie. 1
J.-B. MONFALCON, Histoire monumentale de la ville de Lyon, Firmin Didot, Paris, 1866, T. II, pp. 281, 282. 2 Second fils de Bernard VII d’Armagnac qui fut, rappelons-le, assassiné en 1418, lors de la prise de Paris.
41
Uchisy, village bâti sur les contreforts orientaux de Mâcon se trouvait pour son malheur sur le passage des troupes. Les habitants n’eurent que le temps de franchir la Saône avec femmes et enfants sur des embarcations de fortune, pour se réfugier dans une forêt qui couvrait de sa masse sombre la berge opposée3. Là, ils se retirèrent dans des cabanes cachées au plus profond des bois. Mais, craignant plus tard les rigueurs de l’hiver, ils demandèrent l’hospitalité aux habitants d’Arbigny qui les reçurent dans leurs foyers. En contrepartie, ces derniers furent autorisés à couper du bois dans leurs forêts et à faire paître leurs maigres bestiaux dans leurs prairies. Mais revenons à notre armée qui continuait sa progression vers le nord Dans la nuit du 22 au 23 septembre 1422, la formidable coalition arriva au pied des murailles de Tournus. Sans plus attendre le commandement décida de prendre la ville par escalade. Les assaillants avaient des échelles composées de plusieurs morceaux, dont le plus grand était de trois échelons, et tous s’emboitaient l'un dans l'autre à la façon d'une pompe, de manière qu’en les adaptant, ils pouvaient atteindre les plus hautes tours. Pour son malheur, ce soir-là, la ville n’était pas défendue. La surveillance devait être assurée par les habitants des places environnantes, mais à la suite d’un petit désaccord interne, les habitants de Plottes, Ozenay et du Villars à qui était dévolue cette mission, n’avaient pas jugé utile de faire la garde. Ce fut une surprise totale. Pris dans leur premier sommeil, nombre d’habitants tentèrent désespérément de s’enfuir. Dans la cohue qui suivit, quatre-vingts hommes, femmes, enfants se noyèrent dans la Saône. Ils s’étaient mis en un bateau pour s’enfuir à Mâcon, et aujourd’hui l’on a fait pêcher et en a-t-on bien trouvé quatre-vingts.4 En dépit du terrible prix humain que connut cette entreprise, le pays ne fut pas reconquis, mais selon les mœurs du temps seulement ravagé d’un bout à l’autre. De Tournus, il ne resta debout que l’abbaye et les églises. Alors, continuant ses raids dévastateurs, l’armée du maréchal de Séverac mit les villes environnantes à feu et à sang.
3
M. de LATEYSSONNIERE, Recherches historiques sur le département de l’Ain, Libraire Martin-Bottier, Bourg-en-Bresse, 1843, p. 171. 4 Ibid., J.-B MONFALCON, p. 282.
42
Cette campagne eut pour Rodrigue l’avantage de le rapprocher de deux personnes avec qui il nouera par la suite des liens étroits : Imbert de Groslée, bailli nominal de Mâcon, mais sénéchal effectif de Lyon, et le puîné de la maison d’Armagnac, le comte de Pardiac. Ce dernier est le même qu’on appelait familièrement le cadet Bernard, parce qu’il portait le prénom de son défunt père, le connétable d’Armagnac. Par son entremise, Rodrigue fut introduit dans la maison de Bourbon, car Bernard d’Armagnac, en ce temps-là, fut fiancé avec une princesse de cette famille. En considération de cette illustre alliance, le nouveau roi décerna à Pardiac le titre de « Lieutenant général en Charollais, Mâconnais et pays environnants ».5 L’incendie de Serverette Un titre comme celui-là était une pure provocation à l’adresse du duc de Bourgogne, héritier légitime du Charollais et seigneur en espérance du Mâconnais, dont il comptait obtenir la cession du gouvernement anglo-français. Le duc n’étant pas d’humeur à se dessaisir ni de son droit ni de ses prétentions se prépara à la contreattaque pour maintenir dans son giron les pays menacés. Comme ses adversaires continuaient inlassablement de leur côté à les attaquer, il s’établit là une lutte sans fin, dont le théâtre conflictuel s’élargit à son tour et à maintes reprises, aux contrées voisines. De sorte que le Beaujolais, le Forez, le Velay même, eurent à subir la vague destructrice des dégâts collatéraux, isolément ou encore par moments tous ensemble. Peu de temps auparavant, le 27 mai de cette même année, on avait d’ailleurs assisté à un chassé-croisé permanent entre Bourguignons et Armagnacs au cœur du Velay dans la région du Puy. Un seigneur local, le sire de Rochebaron, qui tenait le parti de Bourgogne, à la tête d’une horde de mercenaires lombards et savoyards composée de huit cents hommes parcourait en les saccageant les pays environnant la cité ponote. Le comte de Pardiac ayant réuni ses forces à celles d’Humbert de Groslée se lança à sa poursuite. Rochebaron et ses hommes se réfugièrent dans une petite ville close du Gévaudan : Serverette. Le comte de Pardiac mit le siège devant la ville. Amphithéâtre sur un penchant abrupt dont les pieds baignent dans la rivière la Truyère, le site est un endroit idéal pour 5
Ibid., VALLET de VIRIVILLE, Histoire de Charles VII, P. Jannet, Paris 1853, p. 391 et suivantes.
43
résister aux attaques. Tandis que la place était serrée de près, un arbalétrier qui avait pris position dans un moulin voisin y mit le feu. Les flammes gagnèrent rapidement la ville et de là le château, puis se répandirent en crépitant de maison en maison. Dans le désordre épouvantable qui s’ensuivit, un grand nombre de Bourguignons furent faits prisonniers, d’autres réussirent à s’enfuir, mais perdirent leurs bagages. Profitant de l’affolement général, le sire de Rochebaron réussit à s’échapper, sous la protection d’une poignée d’hommes et s’en alla rejoindre le duc de Bourgogne.6 Rodrigue joua un rôle efficient dans ces guerres d’escarmouches, dont les péripéties continuelles rendirent le pays exsangue. Il y acquit une solide expérience et ne tarda pas à y paraître avec le titre et la fonction reconnue de capitaine. C’était là pour lui une juste reconnaissance, car il avait déjà sous son commandement une compagnie entière se disant au service du comte de Pardiac. Ces succès militaires apparents n’étaient en vérité constitués que d’escarmouches accompagnées comme toujours d’incessantes dévastations. La situation du royaume ne faisait qu’empirer. Réduit déjà à moins du tiers de la France actuelle, il s’amenuisait tous les jours de quelque nouveau lambeau, soit par l’avancée des armées ennemies, soit par la défection des villes qui répudiaient un gouvernement manifestement incapable de les protéger. Le jeune monarque, qui avait à se débattre au milieu de ce naufrage, ne sachant où donner de la tête, cédait à toutes les suggestions. Son entourage, conseillers et favoris, profitaient de sa faiblesse pour comploter, régler des comptes ou bien encore satisfaire des ambitions très personnelles. C’était là, pour les proches du roi, le moyen d’abaisser l’influence de certains pour affermir celle des autres. Charles VII se laissa persuader que le mal venait de ce qu’il y avait trop de sujets du royaume sous ses armes, que ceux-ci n’étaient bons qu’au pillage et que, s’il voulait reconquérir ses États, il fallait qu’il fasse appel à des troupes de mercenaires étrangers. Alors il envoya demander des Écossais au roi d’Écosse, des Lombards au duc de Milan, et il décréta le licenciement de toutes les compagnies qui 6
Jean André Michel ARNAUD, Histoire du Velay jusqu’à la fin du règne de Louis XV, Le Puy, 1816, tome 1, p. 243.
44
couraient les champs, à l’exception de quatre cents lances, soit environ deux mille hommes, qui seraient conservées pour désarmer les autres. Rodrigue de Villandrando, en sa qualité d’étranger et sans doute aussi par le crédit du comte de Pardiac, fut du nombre des capitaines maintenus. La prise de Cuffy C’est ainsi que le 23 avril, jour de Pâques de l’an 1424, on le voit rejoindre une petite armée rassemblée sous le commandement de Louis de Culant, amiral de France, pour agir, non pas contre les routiers, mais contre les Anglais et Bourguignons. En effet, ceux-ci s’étaient concentrés dans le Nivernais. Par une enclave de cette province, située sur la rive gauche de la Loire, ils tenaient en échec Bourges, fief reconnu du roi et considéré à l’époque comme capitale du royaume. C’est pour les chasser de cette position que l’amiral arriva en toute hâte. Cuffy eut au Moyen Âge une emprise féodale importante. L’ensemble castral établi sur une falaise couvrait un vaste développement de terrain avec ses tours puissantes, ses murailles crénelées et son donjon formidable. Le site redoutablement aménagé, présentait un intérêt stratégique évident dont le rôle économique et l'efficacité défensive étaient manifestes. Surplombant le confluent de la Loire et de l'Allier, là où les deux rivières confondent leurs eaux, au lieu appelé « Bec d’Allier », l’imposante forteresse constituait un observatoire permettant de surveiller la navigation sur les deux fleuves. De plus, cette position constituait une tête de pont du Nivernais aux confins du Berry et du Bourbonnais et protégeait ainsi l’importante cité commerçante de Nevers. Au Bec d’Allier sur Loire, il y avait un chastel moult fort nommé Cuffy, dedans lequel étaient Anglois et Bourguignons faisant grande guerre, et qui gastoient le pays de Berry. Laquelle chose étant venue à la connaissance du roi, il envoya Louis de Culant, chevalier, lors amiral de France, et le vicomte de Narbonne et Rodrigue et autres capitaines et le Borgne de Caqueran et Thibaud de Valpigne,
45
capitaines avec cinquante lances de Lombards, qui étaient venus en France au service du roi.7 Au cours de ce siège, Rodrigue avait redoublé d’ardeur, car il portait une admiration, une sorte de reconnaissance notoire, envers l’amiral qui avait combattu pour la Castille contre les Maures. Il était à ce fameux siège d’Antequera qui reste l’un des plus glorieux faits militaires de l’Espagne médiévale. Aussi, notre capitaine castillan mitil un point d’honneur à faire aussi bien pour le royaume de France que l’amiral avait fait naguère pour son propre pays. Cependant, les choses s’éternisaient, et le siège, commencé le 23 avril, était encore en cours au mois de juillet 1424. Bien que les assiégeants en aient verrouillé tous les accès, la place n’était pas prête à se rendre. Charles VII ne pouvait se permettre d’immobiliser trop longtemps une si grande faction de son armée. Aussi on entra en négociations : laquelle place fut prise par traité tel que ceux de dedans s’en allèrent avec tous leurs biens.8 À la limite septentrionale de ce qui restait du royaume, l’horizon, précurseur d’une terrible tempête, s’était encore assombri. Le jeune monarque allait devoir mobiliser tout ce qui lui restait de forces pour faire face à l’orage qui allait éclater sur le sol de Normandie. Pressé par un entourage de courtisans et favoris, plus opportunistes et avides les uns que les autres, Charles VII, nous venons de le voir, s’était défait d’une partie de ses mercenaires dans le but d’assainir l’état d’esprit de ses troupes… Fatale décision !
7
VALLET de VIRILLE, Chronique de Jean Raoulet, Jannet Libraire, Paris, 1858, T. 3, p. 183. 8 Henri Adam de FLAMARE, Le Nivernais pendant la guerre de Cent Ans : le XVe siècle, Gremion, Nevers, 1913-1925, T. 1, p. 177. Notons pour conclure que Rodrigue fut payé par la ville de Nevers, le 28 janvier 1425, car son nom est cité dans différentes dépenses qui se rapportent au siège de Cuffy.
46
LE DESASTRE DE VERNEUIL 17 août 1424 Les évènements que nous venons de relater s’étaient déroulés peu de temps avant la terrible bataille de Verneuil à laquelle Rodrigue participa probablement. Concernant cette période, la trace de notre capitaine castillan devient sporadique, néanmoins elle semble suivre les grands mouvements conflictuels de l’époque. En effet, l’histoire nous rapporte que les troupes, qui avaient fait la campagne du Nivernais et participé au siège de Cuffy, rejoignirent la coalition mise en place par Charles VII. Il est même spécifié que les Espagnols y furent réunis en seul corps, sous le commandement du vicomte de Narbonne.1 On sait que Charles VII, poussé par ses proches, avait fait appel à des troupes de mercenaires étrangers. C’est ainsi que les Écossais avaient répondu en masse à l’appel. Audacieux, avides d’aventures et de butin, ils descendaient par colonies entières pour combattre sur les ruines du royaume Valois. Leur chef, le comte Douglas, avait déjà débarqué à La Rochelle, à la tête de cinq mille guerriers d’élite. A l’opposé, venant de l’autre bout du royaume, cinq cents lances et mille archers lombards, envoyés par le duc de Milan, entrèrent par Lyon. Ils furent bientôt rejoints par la plus grande partie de la noblesse dauphinoise toujours fidèle à Charles VII.2 Au milieu de l’abandon général que connaissait le royaume, peu de provinces semblaient soutenir encore les tentatives désespérées de Charles VII. Le Dauphiné, quoique récemment rallié à la couronne de France, fut cependant une des plus intrépides dans la lutte pour la cause du roi. Cela s’avèrera de première importance pour les engagements futurs de Rodrigue.
1
« Le visconte de Narbonne et sa bataille, en laquelle estoient touz les Espaignols ». Chronique de Jean Raoulet, Jannet Libraire, Paris, 1858, p. 186. 2 Henri MARTIN, Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789, Furne, Libraire-éditeur, Paris, 1855, T. VI, pp. 97, 98.
47
La bataille Dans les derniers jours de juin 1424, le château d’Ivry, dernière place encore conservée par Charles VII sur les confins de la HauteNormandie fut attaqué par les Anglais. Après un mois de résistance, les assiégés capitulèrent et promirent de livrer leur forteresse au duc de Bedford, au plus tard dans la nuit de l’Assomption de Notre-Dame, au cas où ils n’auroient secours du roi Charles. Il fallait leur porter aide et assistance de toute urgence. Les capitaines de Charles VII décidèrent de lancer une grande offensive pour reprendre Ivry. Dix-huit mille combattants furent rassemblés sous les bannières des capitaines royaux et de leurs alliés. Il y avait là tout le fleuron de la noblesse : le connétable écossais John Stuart comte de Buchan, lord Douglas duc de Touraine, les comtes d’Aumale, de Tonnerre, et le vicomte de Narbonne. Mais dans le contexte militaire de l’époque, la coordination de cette formidable armée n’était pas simple, car les compagnies qui la composaient ne répondaient pas à un commandement unique. Ses capitaines, habitués à l’indépendance d’une guerre de partisans, formaient au contraire une armée hétéroclite. Aucun d’eux ne voulait se plier à la discipline de l’autre, la discorde entre les chefs ne tarda pas à s’installer. Les partisans de Charles VII refusaient d’obéir à l’Écossais Buchan, et les Écossais firent de même en s’opposant à toute autre autorité. Le 15 août, cette armée désorganisée arriva en vue d’Ivry, mais le duc de Bedford l’y avait devancée avec mille huit cents hommes d’armes et huit mille archers. Sa position était si forte que les capitaines de l’armée de Charles VII n’osèrent attaquer. Pire, ils donnèrent à leurs troupes l’ordre de se retirer, abandonnant Ivry à son sort. Pour compenser ce manque d’engagement, ils décidèrent de se présenter devant une petite place forte de Normandie, Verneuil, tenue par une garnison anglaise. Là, ils usèrent d’un stratagème : un grand nombre d’Écossais des « basses terres » parlaient anglais. On saisit cette opportunité. Les soldats écossais se laissèrent lier les mains et attacher à la queue des chevaux. On leur barbouilla le visage et les vêtements de sang, puis on les traîna à la suite de la cavalerie comme des prisonniers. Ils crièrent en passant sous la garnison de Verneuil que tout était perdu, que l’armée du duc de Bedford était détruite. Les défenseurs, épouvantés, espérant la clémence des assaillants, ouvrirent les portes de la cité. 48
Tandis que les capitaines français prenaient possession de Verneuil sans coup férir, le duc de Bedford s’était mis à leur poursuite. Il les rejoignit le 17 août en rase campagne, dans la plaine de Charnelle, à proximité immédiate de Verneuil. Toute l’armée française fut ordonnée en un seul bataillon à pied, avec deux ailes à cheval, très inégales, composées l’une des auxiliaires lombards, l’autre de français. En face, les Anglais se rassemblèrent aussi en une seule grosse unité, les hommes d’armes derrière. Les archers, faisant face à l’aile gauche française, tentèrent de planter des pieux dans le sol pour se protéger. Cependant, la chaleur ayant durci la terre, ils eurent du mal à s’acquitter de leur tâche. Bedford plaça ses chevaux en arrière avec le bagage et deux mille hommes de traits. Les Anglais avaient depuis longtemps démontré la supériorité de l’arc sur les champs de bataille. Certes moins puissant que l’arbalète, il compensait par la rapidité et la cadence avec laquelle les flèches étaient propulsées sur l’ennemi. Un bon archer pouvait tirer dix flèches à la minute. Un arc long anglais pouvait percer une armure de plaque et sa mobilité permettait de tirer en cloche pour abattre une pluie continue de traits meurtriers sur les rangs opposés. Si l’arbalète était supérieure comme arme de siège, elle était inférieure comme arme de campagne. Pendant qu’un archer lançait dix ou douze traits, l’arbalétrier n’en pouvait guère tirer plus de trois3. De plus, il fallait trois hommes et deux arbalètes pour réaliser le tir d’un seul arbalétrier, à qui deux aides étaient nécessaires pour recharger ses armes et le couvrir d’un pennart, ou bouclier, ainsi nommé en raison de son aspect étiré en forme de plume. Le duc de Touraine et les autres capitaines de compagnie, en ordre de bataille, attendaient résolument que l’Anglois soit positionné devant la ville. Mais le vicomte de Narbonne impatient déclencha seul l’attaque en se précipitant au-devant de l’ennemi avec une aveugle impétuosité. Les autres chefs furent forcés de le suivre et quand on en vint aux mains, les Franco-Écossais étaient déjà hors d’haleine, tandis que Bedford faisait avancer ses troupes lentement et sagement en bel arroi sans se trop échauffer. Le choc fut d’une rare violence et 3
Jean JUVENAL des URSINS, Chroniques de Charles VI, dans Chroniques et Mémoires de l’Histoire de France par J. A. C. Buchon, Auguste Desrez, Paris, 1838. // Ecrits politiques, T. 1, Paris, réédition, 1978.
49
pendant que les deux troupes s’assemblaient l’une à l’autre le sort du combat fut longtemps indécis. Alors, les deux ailes françaises chargées de contourner l’ennemi s’élancèrent. Les cavaliers lombards, partis les premiers, fondirent sur les deux mille archers de l’arrière-garde anglaise, les repoussèrent « sans les entamer » et s’emparèrent d’une partie des chevaux et des bagages. Dès cet instant, oubliant le sort de la bataille, ces mercenaires ne songèrent plus qu’à mettre en sûreté ce qu’ils avaient gagné. Ils laissèrent le champ de bataille comme si tout combat eut été terminé. L’autre aile française, qui ne comptait que deux à trois cents lances, se trouva beaucoup trop faible, non seulement pour exécuter la manœuvre qui lui était confiée, mais même pour empêcher les deux mille archers qui s’étaient ressaisis, de renforcer le principal corps de Bedford. Et lors, assez brief ensuivant, se commencèrent les François à déconforter, et les Anglois, en grand hardiesse, se boutèrent entre eux, les séparèrent et ouvrirent leurs bataillons en plusieurs lieux ; et tant continuèrent qu’ils obtinrent la victoire, non pas sans grand peine et effusion de sang en chacune des deux parties. L’élite de l’armée franco-écossaise périt dans cette funeste journée. Tous les grands seigneurs furent tués, à part quelques-uns qui tombèrent aux mains de l’ennemi. Près de sept mille combattants du parti de Charles VII gisaient morts sur la place, dont quatre mille Écossais. La victoire avait, si l’on peut dire, seulement coûté aux Anglais mille six cents hommes d’armes et archers.4 Au milieu du carnage épouvantable, on retrouva le corps du vicomte de Narbonne qui gisait, percé de coups, parmi les morts. On lui trancha la tête, et son corps fut écartelé puis suspendu à un gibet. Il s’agissait là d’exercer quelques représailles pour son implication dans le meurtre de Jean-sans-Peur, au pont de Montereau. Quant à notre capitaine castillan, Rodrigue de Villandrando, il avait miraculeusement survécu.
4
Ibid., Henri MARTIN, Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 178, pp. 100, 101.
50
Un silence de trois ans Véritable tragédie humaine, cette bataille venait de jeter un voile de sang sur une des périodes les plus tristes de notre histoire. Charles VII fut atterré. Les Écossais avaient été exterminés, les Lombards plus occupés à piller le bagage des Anglais qu’à combattre n’avaient été d’aucun secours, et la majeure partie de la noblesse dauphinoise qui lui était si fidèle avait péri. Le jeune monarque avait dû se retirer devant l’Anglais triomphant et peu à peu il voyait son parti diminuer en force et en nombre devant l’étranger, dont le succès et la fortune commençaient à rallier les grands vassaux autour du roi de France et d’Angleterre. Charles VII, la mort dans l’âme, fut contraint de remettre à plus tard ses projets de réforme militaire et le désarmement des compagnies franches. Alors, livrés à eux-mêmes, les routiers reprirent de plus belle le cours de leurs exploits. À partir de cette époque, un étrange silence enveloppe les actions de notre capitaine castillan, et se prolonge pendant trois ans. Qu’étaitil devenu ? Avait-il été blessé au point de disparaître de la scène des combats ? Ou bien est-ce que l’histoire le concernant ne nous est pas parvenue ? Pourtant, il nous est permis d’affirmer que ces années d’absence ne se passèrent pas pour lui dans l’inaction, car aucun des hommes qui eurent alors la lance au poing ne trouva un seul jour pour se reposer. Si aucun grand fait militaire ne couvre cette période, ce fut à nouveau pour les compagnies en quête de survie le temps des pillages, des actions éclair, sporadiques, menées ponctuellement contre les Bourguignons et les Anglais. Ce fut aussi pour les routiers le temps des patis avec les villes ennemies. Ce fut même le temps des rançons avec les villes de leur propre parti et lorsque la faim se faisait trop pressante, ce fut encore le ravage de terres qu’ils avaient pourtant mis tant de cœur à défendre. Il semble que Rodrigue ait traversé cette période sans trop importuner ses protecteurs. Empruntons un texte à Hernando del Pulgar pour parler de ces années enveloppées d’un voile obscur, comme d’un temps qu’il mit à profit pour gagner en puissance et asseoir sa renommée : le cœur lui croissait en raison de ses prouesses, et ses prouesses en raison de ses recrues, et ses recrues en raison des profits qu’il procurait aux gens d’armes. Le castillan fut bientôt en mesure d’appeler sous sa bannière autant d’hommes qu’il pouvait en 51
souhaiter. Il lui fut alors possible de maintenir l’effectif de sa compagnie à l’égal d’un corps d’armée imposant, malgré les pertes inévitables qu’il devait compenser. Il ne faudrait pas attribuer le succès de Rodrigue seulement au hasard ou à sa seule audace. Au dire d’Hernando del Pulgar, il possédait au suprême degré les qualités et les talents nécessaires pour le métier qu’il avait choisi : juste, d’une sévérité inflexible, fidèle à sa parole, par-dessus tout cela, capitaine vigilant doublé d’un fin stratège. Il ne souffrait dans son camp ni querelle, ni violence ni pillerie. Impossible avec lui que le partage du butin amenât des discordes, parce que rien n’appartenait à personne avant qu’il n’eût entendu les rapports de ses lieutenants. Jusque-là toutes les prises de la journée étaient tenues en réserve, pour être ensuite distribuées à chacun selon son mérite. Avait-il donné sauf-conduit à quelqu’un ou passé contrat avec une ville : malheur à celui des siens qui l’enfreignait, car à moins de fuir, le coupable était pendu infailliblement.5 Mais ce capitaine, intransigeant lorsqu’il s’agissait de maintenir la discipline, était en revanche particulièrement attentif au bien-être de la compagnie. Il vérifiait lui-même l’état des vivres, du fourrage, de l’équipement et s’il y manquait quelque chose, il n’avait de cesse d’y pourvoir. Avant un engagement, toutes les mesures étaient prises pour évaluer le danger et mettre en balance le rapport qu’on pouvait en tirer. Nul ne savait mieux dresser une embûche, ni asseoir un camp, ni trouver le point faible pour attaquer, le côté fort pour se défendre. Attentif, calculateur, impassible, jusqu’au signal du combat, où alors il se jetait au milieu de l’ennemi avec une fureur de lion, si plein d’assurance en son impétuosité qu’il avait coutume de dire : Il n’est puissance qui tienne quand la tête d’un Espagnol est en colère.
5
Hernando del PULGAR, Cresciendo de dia en dia el coraçon con las hazanas, y las hazanas con la gente, y la gente con el interese, cité par Quicherat, Note 2, p. 26.
52
LE TROISIEME CONFLIT La guerre des grands féodaux Avant d’aller plus loin, dressons un tableau schématique du conflit. Globalement nous allons placer la situation du royaume sous le signe du chiffre trois : il y a trois fronts principaux, il y a trois causes, et pour y faire face, il y a trois armées. Il y a trois fronts : contrairement aux clichés reçus, tant s’en faut que tout se concentre autour d’Orléans… L’objectif que se propose de ce côté l’armée anglaise est des plus clairs : en s’avançant sur la Loire, elle coupe le « roi de Bourges » de ses possessions du nord, du secours qu’il peut encore attendre de la Bretagne et de la Normandie. Plus au sud, un autre champ d’affrontement entoure les possessions anglaises d’Aquitaine. Enfin, partant de la haute Seine et de l’Yonne, poussant jusqu’au sud de Lyon, les conflits s’étendent aussi de la Bourgogne au Dauphiné, Orange et même Avignon. La lutte ne se déroule donc pas seulement contre l’« Anglois », elle est partout à la fois, l’issue en est incertaine. S’il fallait déterminer le point de rencontre des trois forces opposées, ce serait plutôt dans le voisinage du Bec d’Allier où le domaine du « roi de Bourges » s’imbrique dans les possessions de son plus dangereux adversaire, le duc de Bourgogne. Il y a trois causes : la cause de Charles VII, en face la cause de l’Angleterre, mais entre les deux et faisant pencher la balance selon qu’elle se porte d’un côté ou de l’autre, celle des derniers grands féodaux sous la conduite des « principautés apanagères ». L’apanage était une concession de fief prise sur le domaine royal, faite par un souverain régnant à ses plus jeunes fils dans le but de les détourner de toute prétention sur la succession au trône. Ce système était utilisé pour calmer les velléités des fils cadets ou encore des grands vassaux, tout en évitant un affaiblissement du royaume, car ces domaines devaient, en effet, revenir à la couronne à la mort du roi… Du moins en principe, et ce fut bien souvent là toute la difficulté… Enfin, il y a trois armées : les forces de Charles VII tentent de constituer un territoire souverain. Face à elles, la dynastie anglaise tâche de conquérir ce même territoire. Et pour compliquer les choses à 53
l’infini, une troisième armée roule, en quelque sorte, d’un bout à l’autre du royaume et superpose à l’horreur de la guerre étrangère et de la guerre civile, l’indicible souffrance d’une guerre de partisans : c’est l’armée des routiers. Peut-être à elle seule est-elle aussi nombreuse que les autres, mais à coup sûr, elle est infiniment plus active et plus dangereuse que les armées principales. Dans le trouble profond qui naît de ces revendications contraires et acharnées, dans cette lutte à mort, les provinces, les conseils, les corporations, les groupements, les familles hésitent et sont partagés. Les individus euxmêmes ont des attaches et des passions contradictoires. Rodrigue s’inscrit dans ce schéma et c’est dans ce contexte qu’il allait pouvoir donner libre cours à la puissance de ses troupes de mercenaires et concrétiser ses ambitieux objectifs. À la tête de sa compagnie, il s’était maintenu plusieurs années au service du maréchal de Séverac. Mais au mois de janvier 1427 survint un évènement tragique qui allait curieusement servir les intérêts de notre capitaine. L’assassinat du maréchal Amaury de Séverac Amaury de Séverac était devenu immensément riche, par ses campagnes guerrières bien sûr, mais aussi par l’héritage qu’il avait reçu en 1416 de son cousin Guy, IXe du nom et chef de la maison de Séverac. C’est pourquoi on le ménageait à la cour. On prétend en effet que s’il avait voulu, ce puissant seigneur du Languedoc aurait pu acheter la province entière, car il apparaissait aussi intraitable en chef de guerre qu’en homme d’affaires. Après le traité de Troyes, il envoya au Dauphin un mémoire effroyable des sommes qu’il disait avoir dépensées à son service : cent mille francs d’une part, dix-huit cents écus d’or d’autre part.1 De plus, Amaury de Séverac avait tissé des liens étroits avec les comtes d’Armagnac. On sait en effet qu’Amaury était au siège de Paris en 1418. Il était aux côtés de Bernard VII d’Armagnac, avant que Paris ne soit livré à la faction bourguignonne. Bernard VII avait eu deux fils : Jean IV et Bernard, comte de Pardiac. 1
Jules QUICHERAT, Vie de Rodrigue de Villandrando, capitaine de compagnie sous Charles VII, Imprimerie Firmin Didot Frères, Paris, 1845, p. 126.
54
Amaury était sans enfants, n’ayant guère l’espérance d’en avoir. Sensible à l’affection que lui avait toujours témoignée le connétable d’Armagnac, qui dans ses lettres le traitait de frère, il voulut donner après la mort de celui-ci des marques de sa reconnaissance. À Poitiers, le 11 avril 1421, il fit un testament par lequel il donnait tous ses biens au comte de Pardiac, second fils du connétable. Mais, éloigné de ses terres, alors qu’il était en campagne pour le service du roi et dans l’impossibilité de défendre lui-même ses intérêts locaux, un lointain cousin, le duc d’Arpajon se prétendit maître des terres de Séverac. Celui-ci lui intenta d’ailleurs un procès en le faisant appeler au parlement pour cette affaire, pour contrer ce qu’il considérait à juste titre comme une usurpation. Séverac chargea Jean IV de défendre ses propres intérêts face aux prétentions du duc d’Arpajon. C’est pourquoi pour remercier Jean IV, il se rétracta et fit annuler la première donation en faveur du comte de Pardiac. Le 8 mai 1426, étant à Auch, il fit donation à Jean, vicomte de Lomagne, fils aîné de Jean IV, alors seulement âgé de cinq ans, des terres de Séverac et de tous ses fiefs et biens. Le testament qu’il avait fait en 1421, en faveur du comte de Pardiac, devenait ainsi caduc. Ce dernier se voyant frustré sans retour de ses espérances sur la succession d’Amaury dissimula sa déception face à cette terrible nouvelle, mais l’année suivante il se vengea cruellement. Au mois de janvier 1427, Amaury se rendit, sans précaution parce qu’il était sans défiance, au château de Gages où se trouvait Pardiac. Celui-ci le fit assassiner par ses gens, puis ajoutant l’insulte à l’atrocité, il le fit pendre à une croisée et son cadavre attaché aux fers fut exposé plusieurs jours durant.2
2
Joseph de BONALD, La Maison d’Armagnac au XVe siècle, Imprimerie de Carrère, Rodez, 1909 et Baron de GAUJAL, Études historiques sur le Rouergue, imprimerie Paul Dupont, Paris, 1858, tome II, p. 292. Toutefois, plusieurs historiens formulent une opinion contraire. C’est l’avis du Père Anselme qui cite un acte authentique de 1445 reproduit par Mathieu d’Escouchy, dans lequel le comte d’Armagnac (Jean IV) est déclaré formellement l’auteur de ce crime qu’il faut probablement attribuer à la crainte qu’il avait de voir le maréchal révoquer la donation de 1426. Par ailleurs, il n’est pas impossible de supposer qu’il y ait eu accord entre les deux frères et que cet assassinat ait été commis vraisemblablement sur l’ordre de Jean IV, afin de permettre à la famille d’Armagnac de prendre possession au plus vite des baronnies et châteaux des Séverac. Un procès fut d’ailleurs intenté à la suite de cet épisode tragique qui trouva son épilogue seulement 93 ans plus tard.
55
Cette tragédie eut une conséquence inattendue pour Rodrigue. Depuis longtemps au cœur des troupes du Maréchal, il avait su par sa personnalité s’attirer le respect de bien des combattants. C’est ainsi qu’après cet assassinat, les compagnies orphelines de leur chef se dispersèrent, et la plupart des routiers qui les composaient, se souvenant de Rodrigue, leur ancien compagnon d’armes, vinrent se rallier à lui, le jugeant comme le plus digne de les conduire. Ainsi, le Castillan vit-il tripler en un seul jour le contingent de ses forces. Voilà pourquoi, dès le début de l’année 1427, il put mettre un imposant détachement d’hommes d’armes au service de Jacques de Bourbon, comte de La Marche, qui guerroyait aussi pour Charles VII. Rodrigue, intentionnellement, calculateur ou pas, se rapprochait un peu plus de la puissante maison de Bourbon, jusqu’à y avoir ses entrées. Il allait pouvoir agir maintenant avec l’appui, la considération des plus grands et traiter d’égal à égal avec eux André de Ribes, dit « le bâtard d’Armagnac » Mais bien vite une seconde et étrange affaire allait se présenter. Jacques de Bourbon sollicita le roi pour qu’il accepte de lui prêter l’assistance de Rodrigue dont il disait avoir le plus urgent besoin. Comment en était-on arrivé là ? Remontons quelques années en arrière. La province du Languedoc souffrait de la rivalité de deux maisons. Le comte d’Armagnac et le comte de Foix s’étaient longtemps disputé la protection de cette province, qui n’eut en vérité besoin d’assistance que contre ses propres protecteurs. Dès 1422, le Dauphin, devenu roi, avait gagné à sa cause Jean, comte de Foix. En 1425, en reconnaissance de ses services, il lui donna la vicomté de Lautrec et le nomma lieutenant général du Languedoc. Le pouvoir royal étant toujours dans une extrême faiblesse, celui-ci en profita pour se conduire en véritable souverain dans sa propre province3. Ayant converti l’évêché de 3
L’année 1428 est remplie de curieux actes arbitraires du lieutenant général, ce sont : le 1er avril, la défense à ses officiers d’exécuter, sans son assentiment, les ordres royaux ; en août, à Béziers, la prise de l’hôtel épiscopal que l’évêque lui avait gracieusement offert pour la tenue des États et qu’il ne voulait plus quitter, etc. VAISSETTE, Histoire du Languedoc, Toulouse, 1860, tome IV, pp. 474 et 477 et REVUE du Béarn, Navarre et Lannes : Partie historique de la revue des BassesPyrénées et des Landes, éditeur S.N., Paris, 1884, pp. 452-453.
56
Béziers en citadelle, il assemblait là les États de la province au milieu de ses gens d’armes, sous la protection des canons dont il avait garni la cathédrale. Il faisait voter les impôts, prélevait sa part, et permettait seulement aux commissaires de Charles VII de se partager le reste. Cependant, le comte d’Armagnac en mourait de dépit. Pour troubler la joie de son rival, il appela sur ses terres des bandes de Gascons qui avaient ravagé la Guyenne au nom du roi d’Angleterre. Ces aventuriers arboraient sur leur cotte la croix rouge de Saint-Georges, car André de Ribes, leur chef, agissait en tant que capitaine anglais. Pendant ce temps, le comte de Foix s’en été allé en France après les États de Montpellier, rejoindre le roi avec de grandes forces, et il tenait encore la campagne au mois de septembre 1426. Durant son absence, le comte d’Armagnac en profita pour lâcher les hordes d’André de Ribes sur la province. Les bandes incontrôlées de routiers couraient la campagne, incendiaient force fermes et métairies qui jusque-là avaient réussi à passer au travers des malheurs. Et quand il n’y eut plus rien à piller, on se mit à tout brûler parce qu’il fallait bien marquer son passage et si l’on assassinait moins, c’est tout simplement parce que les campagnes étaient vides. Partout, les flammes sinistres consumaient l’horizon jusqu’aux lointains pourtours de la province anglo-gasconne. La Dordogne et le Lot avaient été franchis. Le 20 août, André de Ribes était aux portes de Toulouse et avait réussi à enlever quarante habitants. Dans la ville épouvantée, la population refusait de prêter main-forte aux hommes d’armes par crainte des vengeances du terrible routier. Et comme le pays était sans défense, ce capitaine s’empara de divers châteaux par la force, entre autres de Pavie dans le diocèse d’Auch, de la judicature de Rivière dont il fit une place d’armes, du château de Combefa en Albigeois et enfin de la ville de Lautrec. Il fit de cette magnifique cité fortifiée son quartier général. De là, il apatisait Lombez, menaçait Castres, poussait des reconnaissances éclair jusqu’en limite septentrionale du Languedoc. André de Ribes poussa même l’audace jusqu’à pénétrer sur les terres acquises à Charles VII, en menaçant la citadelle de Châteauneuf de Randon en Gévaudan. Une étrange filiation Curieusement, ce capitaine se faisait appeler le bâtard d’Armagnac avec l’assentiment du chef de la famille bien que, d’après 57
ce qu’on savait de son origine, rien ne permettait de justifier cette qualité. Quoi qu’il en soit, il était sans conteste favorisé secrètement par le comte d’Armagnac. Des choses étranges se passaient à son égard. Les châteaux du comte d’Armagnac lui étaient ouverts pour mettre en sûreté le fruit de ses déprédations. Plusieurs places fortes du domaine de la maison d’Armagnac, dont il s’était rendu maître dans l’Agenais et le Quercy, lui avaient été cédées en légitime propriété, et il en montrait les contrats. Alors, comment expliquer que le chef de la maison d’Armagnac, dont le nom servait encore à rallier le parti de Charles VII, couvre tous les attentats commis contre ce qu’il était luimême censé protéger ? En fait, le soutien inconditionnel donné à André de Ribes par le comte d’Armagnac ne peut s’expliquer que par la rivalité de celui-ci avec le comte de Foix.
1- La cité médiévale de Lautrec. Au sommet de la butte de Montlaussin, aujourd’hui surmontée d’une croix, l’emplacement du château conquis par André de Ribes en 1426. Photo F. Monatte.
D’ailleurs, Jean IV d’Armagnac touchait sa part des contributions de guerre levées par André de Ribes. De plus, en protégeant les courses de ce partisan, il se donnait l’insigne plaisir de provoquer des
58
insomnies au comte de Foix son rival, qui venait d’être préféré à lui pour la gouvernance du Languedoc. À son retour de campagne, le comte de Foix, voulant remettre sous l’obéissance du roi les places dont André de Ribes et les Anglois s’étaient emparés dans le pays, entreprit une contre-offensive. Il convoqua à Puylaurens, pour le premier avril 1427, les milices de la province dans le dessein d’entreprendre le siège de Lautrec. Il soumit en attendant la plupart de ces places qui étaient les moins fortes si bien qu’André de Ribes n’occupa bientôt plus en Albigeois que la ville de Lautrec et les châteaux de Courbarrieu et de Combefa. Peu de temps après, le 26 du même mois, le comte de Foix, étant à Béziers, rompit de son autorité tous les patis ou souffrances de guerre que ce chef de brigands avait faits avec divers lieux du pays, et ordonna aux peuples de leur courir sus et de leur livrer une guerre sans merci. Il fit en outre la promesse de donner quatre marcs d’argent de récompense pour chaque gentilhomme ou partisan anglais qui serait pris et qu’on lui amènerait, deux marcs d’argent pour chaque varlet ou arbalétrier, et cinq cents livres tournois pour chaque capitaine, avec défense de délivrer ces prisonniers. Enfin, André de Ribes, capitaine de gens d’armes et de trait pour le roi d’Angleterre, convint, moyennant la somme de sept mille écus d’or, dont il donna quittance à Lautrec le 20 mai 1427, d’évacuer les places de Lautrec et de Courbarrieu occupées par lui et autres de ses compagnies anglaises, avec promesse de tenir le patis et trêve, jusqu’à Toussaint prochain.4 Au mois de juillet 1427, le château de Montorsier dans la judicature de Rivière, encore occupé par une garnison anglaise aux ordres d’André de Ribes, fut pris d’assaut. Les hommes d’armes qui tenaient la place furent faits prisonniers. Mais au mois de septembre suivant, ce même capitaine rompit la trêve qu’il avait conclue, sous prétexte qu’on ne lui avait pas encore payé la somme de trois mille écus d’or sur celle qui lui avait été promise pour l’évacuation de la ville de Lautrec.5
4 5
Ibid., Dom Claude VIC et Dom VAISSETE, tome IV, p. 469. Ibid., Dom Claude VIC et Dom VAISSETE, tome VIII, pp. 35-36.
59
Charles VII fait appel à Rodrigue Mais, laissons là un instant André de Ribes et allons retrouver Rodrigue quelque part entre l’Angoumois et le Poitou. Nous sommes au déclin de cette même année 1427. Toute la région de l’ouest, entre Loire et Guyenne, est dans le chaos en raison d’un énième conflit qui secoue d’autres clans féodaux. Des luttes intestines orchestrées par M. de La Trémoille, ministre favori du roi, mettent la région au bord de la guerre civile. Pour se prémunir contre l’attaque de ses adversaires, La Trémoille a rempli la plupart des châteaux de la région d’hommes d’armes acquis à sa cause. Ses partisans occupent le Poitou. Il défend aux villes et aux garnisons de donner accès aux conspirateurs. Contre lui s’est organisée depuis le 4 août précédent une ligue au sein de laquelle figurent le connétable Arthur de Richemont, Charles de Bourbon et le comte de Pardiac6, trois grands féodaux éminents, influents à la cour et auxquels Rodrigue, nous le savons, a attaché son destin. Les mécontents semblent n’avoir eu aucun scrupule pour régler cette affaire d’ordre privé. Ils ont tout simplement décidé de retirer les lignes armées qui font face à l’ennemi de Guyenne pour les engager dans leur propre lutte. On s’observe des deux côtés et, le cas échéant, on escarmouche. Le sort du royaume, si amoindri, si cruellement maltraité sur tout son pourtour, s’en trouve encore un peu plus fragilisé, victime de l’action de ses propres défenseurs qui s’arment les uns contre les autres. À cette époque, Rodrigue campe avec ses troupes aux environs de Ruffec sur la route entre Poitiers et Angoulême. Là se déroula un fait qui nous replace sur sa trace : deux Castillans, hommes d’armes de sa compagnie rencontrèrent, en courant les chemins, un gentilhomme et son page qui leur semblèrent suspects. Cet homme se nommait Du Plessis, il était capitaine pour le roi du château d’Angles en Poitou. Il allait, disait-il, visiter une de ses terres en Angoumois. Les soldats de Rodrigue ne furent pas dupes et pensèrent plutôt qu’il effectuait quelque mission pour Monsieur de la Trémoille. L’affaire leur sembla intéressante. Considérant que c’était une bonne prise, ils le capturèrent et exigèrent une rançon. La somme était forte. Le prisonnier réussit néanmoins à en payer une partie et demanda à être relâché pour aller recueillir le reste. Lorsqu’il fut libre, il alla porter plainte au roi, le suppliant d’user de son autorité pour lui faire rendre ce qu’il avait déjà soldé. Charles VII, en effet, fit rédiger un ordre de restitution dont un poursuivant d’armes porta la 6
VALLET de VIRIVILLE, Histoire de Charles VII, Paris, 1862, tome 1, p. 458.
60
signification à Rodrigue7. Notre capitaine qui savait toujours où était son intérêt s’empressa d’obtempérer, car ses hommes avaient agi de leur propre chef. Prenant acte de cette sage décision, Charles VII le chargea aussitôt de s’acquitter d’une autre mission : éliminer André de Ribes ! Parallèlement, nous avons vu que la mort du maréchal de Séverac avait déchaîné sur le Languedoc des compagnies orphelines qui, pour survivre, mettaient à sac la province. D’autres unités avaient fait un choix différent en venant grossir l’effectif de Rodrigue qui avait réussi à fédérer sous sa bannière les deux tiers de ces redoutables routiers. Sur ordre du roi, le Castillan lança ses troupes à la poursuite du « bâtard d’Armagnac ». Les choses allèrent très vite. André de Ribes fut rejoint en rase campagne, battu et pris. Cette capture glorieuse fournit encore au vainqueur l’occasion de montrer une fois de plus sa loyauté, car Rodrigue refusa tout compromis, malgré les instances et les offres magnifiques du comte d’Armagnac qui réclamait son cher bâtard, afin de le punir, disait-il. Le comte alla jusqu’à affirmer, dans l’espoir de le sauver, qu’André était de son sang, et proposa une énorme rançon au roi. Mais Charles VII ne voulut rien entendre. Alors, Rodrigue le livra au comte de La Marche, qui le fit mettre à mort sur-le-champ, sans autre forme de procès. Un éternel recommencement Mais, comme beaucoup de seigneurs, le comte de la Marche était en proie à de sérieux embarras financiers, à tel point qu’il ne pouvait payer Rodrigue. On connaît les répercussions malheureuses que cela pouvait entraîner sur les populations, car dans le même temps Rodrigue venait de rallier encore deux bandes supplémentaires, elles aussi orphelines de la compagnie de Séverac. Rodrigue atteignait enfin, en ces circonstances particulières, la puissance militaire dont il avait toujours rêvé. Il était donc pour lui impossible de faire un retour en arrière. Alors, le Castillan prit la conduite des opérations et décida de se payer sur la malheureuse province du Languedoc. Jamais guerre de pillage ne fut menée avec un tel ensemble. Le nom du Castillan, devenu inséparable de celui des deux chefs avec lesquels il avait fait
7
Ibid. Jules QUICHERAT, Firmin Didot Frères, Paris, 1845, p. 31.
61
alliance, résonna comme un glas incessant aux oreilles des populations terrorisées : Rodrigue, Valette, Andrelin ! Éternel recommencement : privé de ressources, le Castillan avait retourné ses armes contre les régions qu’il venait de conquérir en libérateur. Désormais, dans la province, on ne put avoir la paix qu’en faisant un accord avec lui. Les villes, moyennant beaux deniers comptants, pouvaient espérer se mettre à l’abri du pillage, mais pour un temps seulement, du moins jusqu’au changement d’oppresseur. C’était là une opération dans laquelle Rodrigue de Villandrando excella entre tous les hommes de guerre. Organisateur hors pair, payant régulièrement son monde, il semble avoir été un des premiers chefs de guerre capables de résoudre, certes à sa manière, le problème des approvisionnements. Pour parfaire cela, il avait décidé d’occuper une région hautement stratégique dans la configuration géopolitique de l’époque. Une place forte, cachée au cœur de montagnes escarpées, suffisamment retirée, barrée de monts inaccessibles, entrecoupée de gorges profondes, mais à la fois suffisamment proche des riches plaines languedociennes et de l’opulente vallée du Rhône. Ce quartier général était situé au pied du mont Lozère quelque part dans la chaîne des Cévennes. De là, les routiers de Rodrigue purent impunément diriger leurs courses tantôt au nord, à des distances considérables, tantôt dans la sénéchaussée de Nîmes ou dans celle, encore plus éloignée, de Carcassonne. La rapidité de leurs mouvements avait quelque chose de surprenant et semblait tenir du prodige, on les voyait partout, un jour ici, le lendemain là et paraissant quelquefois aux deux endroits à la fois.8
8
MENARD Léon, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nîmes, H. D. Chaubert, Paris, 1758, tome III, p. 145.
62
LA COMPAGNIE DE RODRIGUE Le temps de la survie pour des routiers sans contrat Au cours de l’hiver 1428, Rodrigue s’était donc retiré dans les replis cachés des Cévennes, dominés par le massif imposant des Monts Lozère. Lorsqu’on connaît les rigueurs climatiques qui peuvent régner au cœur de ces montagnes lors des longs mois d’hiver, on a peine à croire que Rodrigue ait choisi cette région pour se retirer avec ses hommes. Pourtant, dans ce paysage de montagne tressé de vallées profondes où la roche taillée à coups d’épée bascule soudain vers la vallée du Rhône, il est des combes cachées, protégées du froid, au fond desquelles règne une douceur hivernale. Si Rodrigue avait établi son quartier général à Génolhac9, il y avait plusieurs raisons à cela. Cette petite place forte possédait un château situé près de l’Église. À cette époque, le sentiment religieux dominait partout, ainsi l’église devenait une annexe nécessaire au château. Ces deux symboles de la féodalité se construisaient à proximité et se soutenaient l’un l’autre. La forteresse sur la hauteur, en avant-poste, s’entourait de fossés, se hérissait de tours et de créneaux, l’église à son tour était ceinte d’épaisses murailles, comme pour être prête à la défense. Génolhac correspondait à ce plan architectural et était de plus situé sur une voie de communication importante, « la Régordane », qui reliait à travers plateaux et gorges resserrées, les provinces méditerranéennes au nord du Royaume. De ce poste avantageux, Rodrigue pouvait ainsi contrôler les mouvements de troupes tout autant que les échanges commerciaux. Le site était donc hautement stratégique et lui permettait de lancer des raids éclairs dans le Languedoc distant de quelques lieues seulement, sur le Vivarais à l’est puis sur la vallée du Rhône, ou encore dans la direction du nord vers le Velay, le Forez et le Lyonnais. Ainsi à la fin de septembre 1428, le comte de Foix qui séjournait à l’autre extrémité du Languedoc reçut la nouvelle des ravages de 9
Voir dans cet ouvrage, Données historiques complémentaires, Annexe 11, p. 360.
63
Rodrigue autour de la ville du Puy. Le 16 octobre, la ville de Lyon délibérait sur les moyens de l'éloigner du Lyonnais puis des marches du Beaujolais. En novembre, il occupait les routes entre Avignon et Nîmes.10
2- Place forte de Génolhac. Tour du XIe, rénovée au XIIIe siècle, faisant partie du fief occupé par Rodrigue de Villandrando lors de ses retraites dans les Cévennes. Photo F. Monatte.
Le pacte de Lyon Les registres consulaires le Lyon nous renseignent sur l’attitude de la ville face à la présence de cette puissante compagnie. La seule nouvelle de son approche a semé l'épouvante. Le conseil de ville s'est réuni : essaiera-t-on de résister par les armes, ou acheta-t-on son 10
Ibid. MENARD Léon, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nîmes, tome III, p. 149.
64
départ au prix qu'il a lui-même fixé, soit quatre cents écus d'or ? 11. Lorsqu’on commença à entrer en négociations, Rodrigue et son lieutenant Valette étaient postés sous les murs d’Anse. C’était une petite place forte située à six kilomètres au sud-ouest de Villefranche, dont les habitations remontaient la vallée de l’Azergue en rangs serrés à partir de son confluent avec la Saône. Selon le rapport d’un gentilhomme qui s’était fait l’intermédiaire officieux des routiers, ceux-ci étaient prêts à se retirer, pourvu qu’on leur paie la somme convenue. Le corps de ville délibéra le 16 octobre. L’archevêque et le clergé étaient prêts à contribuer pour une bonne partie des quatre cents écus réclamés. La majorité jugeait le marché assez avantageux lorsque les débats furent interrompus par trois ou quatre conseillers, à la tête desquels se trouvait le bailli Gilet Richard, sieur de Saint-Pierre. Celui-ci, refusant ce qu’il considérait être un aveu de faiblesse, proposa d’employer plutôt la somme demandée au recrutement d’une force capable de repousser ces gens d’armes. Il ajouta par ailleurs qu’une telle décision allait faire entrer la ville dans une voie déplorable que jamais la cité n’avait souscrit à de semblables accords et que, si l’on commençait une fois, la servitude n’aurait plus de fin ; enfin, il affirma que les routiers congédiés de la sorte ne tarderaient pas à revenir, ou d’autres à leur place. On se sépara donc sans avoir rien résolu. Rodrigue ne recevant pas de réponse, lança sa compagnie sur un vaste territoire situé entre les villages de Chazey implanté sur la rive extérieure d’un méandre de l’Ain et Bibost qui limitait la bordure des monts de Tarare à trente-sept kilomètres au nord-ouest de Lyon. Après plus d’une semaine de pillages, on lui envoya dire que les quatre cents écus étaient prêts, et qu’il les recevrait aussitôt contre la promesse de battre en retraite. Mais à cela Rodrigue et ses hommes répondirent que ce n’était plus quatre cents écus qu’il leur fallait, mais huit cents, et que jusqu’au total règlement de la somme, ils continueraient à rançonner le pays. Ils précisèrent de plus qu’ils n’entendaient pas d’ailleurs que l’argent qu’ils avaient déjà levé compte dans les huit cents écus. Ces paroles rapportées au consulat de Lyon mirent les conseillers en grande indignation. Les voix furent unanimes pour dire qu’il valait mieux recourir à la force et entrer en résistance. 11
Voir dans cet ouvrage, Données historiques complémentaires, Annexe 8, p. 348.
65
Le bailli Gilet Richard rappela alors sa proposition en affirmant qu’avec huit cents écus d’or, on se procurerait une compagnie d’hommes d’armes, laquelle, secondée par les milices du pays, suffirait bien pour donner la chasse à un ramas de bandits. La seule difficulté était de se procurer de l’argent au plus vite. On prit la décision de recourir aux emprunts. Cependant le lendemain, il fallut bien se rendre à l’évidence : les prêts ne se faisaient pas avec autant de rapidité qu’on se l’était imaginé. On chercha à nouveau des solutions. On proposa de mettre seulement en campagne la noblesse du pays, en attendant d’avoir de quoi solder des hommes d’armes. Mais le capitaine qui avait accepté de commander cette troupe armée contre les routiers refusa d’y conduire des gentilshommes insuffisamment expérimentés dans l’art de la guerre. Ce capitaine était un homme fort averti en la matière et qui savait de quoi il parlait. C’était le sénéchal de Lyon, Imbert de Groslée, que nous avons vu servir à Tournus et dans le Mâconnais sous le même commandement que Rodrigue en 1422. Le sénéchal de Groslée, homme de grande expérience et ancien compagnon d’armes du capitaine castillan, connaissait trop bien la valeur militaire de Rodrigue pour se lancer dans une campagne dont l’issue pouvait s’avérer hasardeuse, voire fatale pour sa ville… Le conseil de ville finit par convenir que ce qu’il avait de mieux à faire était de fournir l’argent au sénéchal et de le laisser conduire seul la négociation pour préserver au mieux les intérêts de la cité lyonnaise, ainsi que ceux du plat pays environnant. On arrive toujours à s’entendre entre compagnons d’armes ! L’accommodement eut lieu et Rodrigue se retira sans laisser, semble-t-il, une trop mauvaise impression. En effet, on le voit à quelques années de là, placer les fonds chez un habitant de Lyon et correspondre avec le consulat, pour le soin de ses affaires, dans les termes d’une bienveillance affectueuse12. Mieux que cela : nous avons le compte acquitté d’une 12
Ibid. Voir dans cet ouvrage, Données historiques complémentaires, Annexe 8, p. 348. D’autre part, une délibération du Consulat du 2 novembre 1433 permet de préciser la date de cette lettre de Rodrigue de Villandrando aux Lyonnais, dont Quicherat a donné un fac-similé. Cette lettre a été écrite par Rodrigue à Châteldon le 13 mars 1433. Elle avait pour objet le recouvrement de divers dépôts d’argent effectués par lui chez Eustache de Pompierre, « Le Moyen Âge », Bulletin mensuel d’histoire et de philologie, A. Marignan, G. Platon, M. Wilmotte, A. Picard, Paris, 1888. No°1 : 1909 ; SER2, T. 13-T. 22, pp. 283, 284, 385, 387.
66
livraison de confitures et de torches de cire dont la ville lui fit faire présent13. Il faut dire qu’entre ces deux épisodes, l’implication et l’engagement personnel de Rodrigue dans la victoire d’Anthon que nous allons bientôt aborder allaient avoir un retentissement national et permettre à la grande cité rhodanienne de rester dans le giron du royaume de France. L’embuscade des Cévennes Après cet épisode lyonnais, Rodrigue s’en retourna dans les montagnes cévenoles, toujours accompagné de Valette. Dans le Languedoc, son comportement ne fut pas des plus complaisants à l’égard des consuls des villes. Nîmes, Uzès, ou encore Alès eurent à souffrir de ses exigences sans cesse renouvelées. La seule évocation de son nom emplissait de terreur les campagnes et faisait trembler les cités closes. Ces villes auraient volontiers payé sa tête au poids de l’or à celui qui la leur aurait apportée. Rodrigue cantonna ses troupes assez longtemps autour de Nîmes. La ville subissait alors bien des tourments. Tandis qu’elle était assiégée à l’extérieur, elle était maltraitée à l’intérieur. Elle devait faire face aux troubles provoqués par les débordements intempestifs d’une garnison de Gascons que le comte de Foix avait logée aux arènes. Ces hôtes incommodaient la ville de façon épouvantable, tant et si bien que les habitants commencèrent à se lever contre eux. Toutefois, la terreur des routiers hors les murs apaisa les discordes et l’on fit si bonne garde, que Rodrigue et Valette, fatigués d’inutiles évolutions autour de la ville, prirent la résolution de se retirer. Pour ne pas souffrir de la rareté des vivres qu’allait inévitablement provoquer l’arrivée de l’hiver, ils divisèrent leurs compagnies en petites brigades qui disparurent l’une après l’autre dans la montagne. On commença à respirer à Nîmes seulement lorsqu’on sut que la dernière bande avait dépassé Anduze. Le dessein de Rodrigue était alors de gagner à petites étapes le Velay puis le Gévaudan, pour le printemps suivant y faire sa jonction avec Valette, qui était resté dans ces parages avec le reste des compagnies de Séverac. Les deux corps d’armée réunis auraient opéré une descente dans la plaine du Languedoc. 13
Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, p. 37.
67
Nous arrivons à la mémorable année 1429, qui fut marquée par l’apparition de Jeanne la Pucelle. La fièvre d’enthousiasme qui se répandit partout fit partir pour les armées de la Loire tous les Méridionaux qui se sentaient le goût des aventures, nous dit l’historien Ménard.14 Pour quelle raison Rodrigue ne fut-il pas compagnon de Jeanne d’Arc ? Pourquoi, parmi les grands capitaines de l’époque dont il faisait maintenant indéniablement partie, ne fut-il pas associé à la chevauchée victorieuse vers Orléans ? Sans doute parce que le Castillan et les autres capitaines de son alliance s’étaient disposés à suivre le comte de Pardiac. Mais ce seigneur, alors qu’il s’était déjà avancé jusqu’à Beaugency, reçut l’ordre royal de revenir en arrière15. Sa place, lui fut-il dit, était d’aller sur le flanc de la Guyenne, du côté de Bordeaux. Le comte de Pardiac, mécontent et réduit d’ailleurs à de faibles ressources, décida d’abandonner à elles-mêmes les compagnies de routiers et nous savons tout ce que cela pouvait entraîner chez ces mercenaires. C’est donc parce qu’ils étaient privés d’employeur que les hommes d’armes, rassemblés sous la bannière de Pardiac, retournèrent du côté du Languedoc et vinrent grossir les troupes de Rodrigue. En effet, celui-ci dans l’attente d’une directive de Pardiac n’avait pas encore bougé. Le choix de courir cette province ne relevait pas du hasard. Le comte de Foix, gouverneur du Languedoc, avait tenté d’y établir une bonne garde, du moins lorsqu’il pouvait y être présent avec ses troupes. Cependant, les conseillers de Charles VII firent valoir au roi l’absolue nécessité de rallier le gouverneur à sa cause. Celui-ci était en effet à la tête de troupes nombreuses et expérimentées capables de renforcer efficacement son armée. Comme celui-ci ne s’y montrait pas disposé, on acheta par des faveurs son obéissance. Son départ fut marqué par un étrange incident. Valette, ce téméraire aventurier qui semble-t-il ne doutait rien, se risqua jusqu’à lui tendre une embuscade sur le trajet de la fameuse voie « Régordane » qui remontait à travers monts, de Nîmes vers le nord de la province. Le comte en fut averti, 14
Ibid. MENARD, Histoire de Nismes, tome III, qui cite la marche des courriers envoyés par les consuls de cette ville, depuis le commencement d’octobre jusqu’à la fin de décembre, per saber novelas des las gens. 15 SOCIETE DE L’HISTOIRE DE FRANCE, Chronique du connétable de Richemont par Guillaume Gruel, Année 1429, Achille Le Vavasseur, Librairie Renouard, Paris, 1890.
68
alors qu’il venait de se mettre en route au sortir de Montpellier16. Fort bien renseigné, il n’hésita pas une seconde. Il fit doubler aussitôt le pas à son escorte, et toujours au trot, il pressa sa cavalerie jusqu’à faire dix-sept lieues en une seule nuit. Dans le froid glacial de ce mois de décembre 1429, il arriva au lever du jour sur le lieu de campement des routiers qu’il surprit dans leur retranchement. Les routiers ne s’y attendaient pas. Un vigoureux assaut fit tomber le plus grand nombre d’entre eux. Valette fut fait prisonnier. Aussi déconcerté qu’un loup pris au piège, il confessa toute la conduite de sa coupable entreprise. Son procès fut promptement expédié, sans écritures ni plaidoiries. Le surlendemain, il fut pendu à Nîmes.17 Mais dans ce monde où rien n’était jamais réglé et où les troubles succédaient aux troubles, l’inévitable se produisit. Lorsque les autres compagnies de routiers se furent assurées de l’éloignement du comte de Foix, elles se mirent à nouveau à ravager impitoyablement la province. Elles avaient à venger la défaite infligée à l’une d’entre elles. Rodrigue se réserva le Gévaudan et le Velay, tandis qu’un second Valette, Guilhem, le frère du précédent18, prit le commandement des gens d’armes de son aîné défunt. Pour se venger, il les conduisit plus avant dans la plaine languedocienne, là où ils n’étaient encore jamais allés. À partir d’une place forte nommée Cabrières, près de Pézenas, dont il se rendit maître, il commit d’épouvantables ravages, pilla d’abord les alentours, puis poussa ses
16
Ibid. VAISSETTE, Histoire de Languedoc, tome IV, p. 475. Miguel del VERMS, Chroniques béarnaises, dans le Panthéon littéraire, volume intitulé Chroniques et mémoires sur l’histoire de France au quatorzième siècle, Paris, 1811, p. 594. « Quicherat mentionne cet évènement en 1432, mais il semble avoir eu lieu en 1428, car à partir de cette date c’est bien Guyonet ou Guilhem Valette, frère et successeur du premier, qui est mentionné comme compagnon d’armes de Rodrigue », voir Guillaume de Flavy capitaine de Compiègne par un collectif d’auteurs, Genève, 1975, p. 94. 18 Le dénommé Valette supplicié par l’ordre du comte de Foix avait pour prénom Jean, au témoignage des actes conservés dans les Archives de Nîmes, dont Ménard a fait usage dans Histoire de Nîmes, tome III, p. 152. De son côté, Quicherat mentionne dans l’édition de 1879, note 2, p. 39 : Le volume CIX des Titres scellés de Clérambault, à la Bibliothèque nationale, contient plusieurs quittances des deux Valette servant comme écuyers chargés de commandements : l’un capitaine des arbalétriers, l’autre chef de chambre dans la compagnie du vicomte de Narbonne. Guilhem y est toujours appelé Guillonnet, et l’autre Forton. 17
69
dévastations jusqu’aux portes de Montpellier19. Dans cette contrée qui avait eu le bonheur de passer à travers les exactions, deux autres capitaines, Oudinet de la Rivière et Archambault, vinrent se joindre à Valette pour allumer les feux de la désolation et tout mettre à sac.20 Cependant, à quelques lieues de là, la ville de Nîmes était menacée en permanence par un des détachements du corps de Rodrigue, qu’on voyait à tout moment descendre dans le plat pays vers Alès et Anduze. Les habitants épuisés demandèrent secours au comte de Foix en lui envoyant messager sur messager munis de lettres qui le pressaient de revenir. Mais ce fut sans espoir de retour, car parallèlement à sa mission guerrière, le comte s’était impliqué dans certaines intrigues de cour. Il n’entendait pas perdre le fruit de ses agissements. Il ne bougea pas. Le temps de Pâques 1430 était arrivé et le comte annonça enfin son retour. Les routiers, qui furent les premiers à en avoir la nouvelle, reprirent le chemin de la montagne pour gagner le Vivarais. Le Castillan leur avait donné rendez-vous. En effet, Rodrigue venait d’être contacté pour remplir une mission qui devait le rendre célèbre et incontournable, une affaire où il y avait à gagner à la fois le butin et la gloire.
19 20
Ibid. VAISSETTE, Histoire de Languedoc, tome IV, p. 476. Ibid. MENARD, Histoire de Nîmes, tome III, p. 152.
70
PRELUDE À UNE GRANDE BATAILLE Avant toute chose, donnons un coup de balai sur notre perception de l’histoire : le grand mouvement national initié par la pucelle a remis Charles VII sur le chemin de la reconquête du royaume. Nous sommes en 1430, et pour cette époque, il est certainement prématuré de parler de « mouvement national », car au Moyen âge, on ne dépend pas d’une nation, on agit au nom du sentiment religieux. Jeanne d’Arc n’entendit-elle pas des voix et le roi n’est-il pas lui-même d’essence divine ? Ce qui préoccupe les souverains de cette époque, ce sont d’abord leur filiation divine, leurs origines, leur généalogie, et à travers leur succession, la continuité de la Maison régnante... C’est pourquoi, tout autant que l’administration d’un territoire dépend des possessions d’un seigneur, l’étendue du domaine royal fluctue au gré des rivalités et des alliances familiales. Ce n’est qu’à partir de la Révolution que l’on évoquera « l’esprit de Nation ». Dès lors, on fédère, on rassemble au nom du territoire et de l’appartenance à un même peuple tourné vers une destinée commune. Le sentiment nationaliste sera surtout exacerbé au XIXe siècle, notamment sous la « grandeur » de la France coloniale et c’est l’enseignement de l’histoire qui plus tard viendra glorifier le héros, le transformer en mythe exemplaire. Devenu ainsi un symbole pour les générations futures, on n’hésitera pas à le revêtir du bel habit de « fondateur de la Nation ». Voilà pourquoi l’Histoire a malheureusement occulté une grande bataille dont Rodrigue fut le héros, une bataille toujours ignorée de la majorité du grand public. Pour la connaître, il faut dépoussiérer un coin confidentiel de l’histoire locale. Elle est comme anecdotique, alors qu’elle fut décisive pour infléchir le cours de la guerre de Cent Ans. Cette bataille se déroula le 11 juin 1430 à Anthon, au confluent de l’Ain et du Rhône. Son importance fut, sans nul doute, de premier plan et son issue scella le destin du royaume de France. Sans cette victoire, le bénéfice engrangé par les campagnes victorieuses de Jeanne d’Arc se serait effondré et Charles VII en aurait perdu l’avantage. 71
Les raisons obscures qui conduisirent à la bataille d’Anthon constituent un écheveau où s’entremêlent sous les codes de la féodalité, intérêts stratégiques, géopolitiques et ambitions personnelles. En effet, le contrôle du Dauphiné1 est précieux non seulement pour le royaume de Charles VII, mais aussi pour tous les territoires qui bordent ou empruntent le couloir rhodanien. Depuis l’Antiquité, cette région occupe dans la vallée du Rhône un axe commercial majeur entre Méditerranée et nord de l'Europe, les mettant en contact direct avec Avignon, ville papale et centre diplomatique incontournable de l'Europe médiévale. Les raisons qui amenèrent le Prince d’Orange à convoiter le Dauphiné Moins d’un siècle plus tard, un seigneur franc-comtois, Louis de Chalon2, seigneur d’Arlay, prince d’Orange, probourguignon, descendant d’un héritier potentiel se déclare lésé par la donation du Dauphiné à la France en 1349. Il prétendait à la possession de divers biens légués par Blanche de Genève et Guillaume Rolan, dont il était l’unique héritier. Amédée VIII de Savoie le soutient en sous-main. Il profite alors de la faiblesse régionale pour s’emparer de châteaux dans la région du Velin entre Crémieu et le Rhône. Le prince d’Orange et le duc de Savoie, Amédée VIII, avaient flotté entre le parti de France et le parti de Bourgogne jusqu’au terrible carnage de la bataille de Verneuil le 17 août 1424 qui fit sept mille morts dans les rangs de la coalition française. 1
Le Dauphiné était alors érigé en souveraineté indépendante. Les comtes de Viennois, appelés Dauphins parce qu’ils portaient un dauphin dans leurs armes, en assurèrent la souveraineté jusqu’en 1343, date à laquelle la province fut acquise par la France aux termes d’un traité confirmé le 31 mars 1349. Humbert II, le dernier dauphin de Viennois, prince magnifique et dissolu, qui avait par trop pris goût aux fastes et aux plaisirs du « Quattrocento » italien, dépensa des sommes considérables, jusqu'à ne plus pouvoir s'acquitter de ses dettes. Ruiné, sans héritier et sans espoir, Hubert céda alors le Dauphiné à Charles, fils aîné du duc de Normandie (Jean le Bon) et petit-fils du roi Philippe VI, moyennant la somme de quarante mille écus d’or et une pension annuelle de dix mille livres. Il stipula, en outre, qu’un fils de France porterait toujours le nom de Dauphin, et en écartèlerait les armes. 2 Louis de Chalon naît en 1390-1463, fils du seigneur Jean III de Chalon-Arlay qui devint prince d’Orange en épousant la princesse Marie des Baux, héritière de la principauté d’Orange, fille de Raimond V des Baux et de Jeanne de Genève.
72
Après cette catastrophe, Louis de Chalon n’hésita plus. Le moment opportun lui sembla venu d’agrandir ses petits états par la conquête d’une riche contrée limitrophe. Ce prince ambitieux rêvait de se tailler une vaste principauté en Dauphiné, et peut-être même de mettre la main sur Lyon. Pour cela, il fit valoir plusieurs arguments tout d’abord par voie légale : par sa mère, il était apparenté à Béatrix de Viennois, fille du dauphin Humbert II qui céda le Dauphiné à la France, et il affirmait tenir d’elle deux mille livres de rente que les rois avaient octroyés à Béatrix, pour obtenir son consentement. Il demandait l’assignation de huit cents livres de cette rente, auxquelles il avait encore droit, sur la place d’Auberive. Dans un deuxième temps, il œuvra par calcul purement stratégique : il lui fallait un port sur le Rhône, qui puisse lui servir de clef pour entrer en Dauphiné. Les conséquences de la bataille de Verneuil ne tardèrent pas à lui en offrir l’occasion : Bertrand de Saluces, tué au combat, laissait à sa veuve les terres d’Anthon, Colombier, Saint-Romain et autres, sises sur ce territoire. Ces terres étaient tenues en fief par les Saluces (ou Saluzzo) originaires du marquisat du même nom situé sous les pentes enneigées du Monte Viso. À défaut d’héritier direct, elles étaient réversibles à la couronne. Louis de Chalon acquit donc de la veuve, Anne de la Chambre, ces tenures : elle lui céda aussi les droits ou prétention qui pouvaient s’y rattacher. Le prince se réserva la capacité de les faire valoir par la force. Mais dans cette stratégie géopolitique, rien ne pouvait être acquis sans l’accord et l’appui de ses puissants voisins. Dès 1426, Louis de Chalon se lia donc par une convention secrète au duc de Savoie, Amédée VIII, en vue de dépecer le Dauphiné. Depuis le désastre de la bataille de Verneuil, Amédée VIII pensait que la conquête du Dauphiné par Louis de Chalon était une chose tout à fait réalisable puisque l’élite dauphinoise avait été complètement anéantie. Il considérait à tort le Dauphiné, comme le maillon le plus faible du royaume de Bourges. Ainsi, il envoya trois cents lances triées sur ses réserves, tout en prenant la précaution de bien se tenir à l’écart. Bien qu’appuyant son vassal ambitieux, le duc de Savoie rêvait toujours de la grande Savoie qui s’étendait autrefois des Alpes à Lyon. Il trouva ainsi l’occasion de remettre en cause le traité de Paris, du 5 janvier 1355, qui établissait la limite entre la Savoie et le Dauphiné. Il espérait sans doute récupérer ses possessions en Viennois et en Velin.
73
Louis de Chalon avait négocié à Saint-Claude, non loin de son fief d’Arlay en Franche-Comté, le secours du duc de Savoie. Comprenant l’un et l’autre l’importance de leur réunion, ils oublièrent un instant leurs querelles et se lièrent d’amitié, bien convaincus qu’ils n’avaient qu’à entrer en Dauphiné pour s’en rendre maîtres. Ils se le partagèrent, du moins dans l’hypothèse d’une victoire. Le duc de Savoie se réservait Grenoble, le Grésivaudan et les montagnes qu’on appelait alors le « Haut-Pays » et en contrepartie, il abandonnait à Louis de Chalon, le Viennois et la vallée du Rhône jusqu’à Orange. Amédée VIII se prêta en secret à ce complot. Le duc de Bourgogne, qui voyait cette coalition d’un bon œil, rejoignit Amédée dans la démarche et les deux ducs s’engagèrent à fournir des troupes au prince d’Orange.3 Le prétexte dit : « des quatre coursiers de la ville de Lyon » Mais il fallait un prétexte pour déclencher les hostilités. Il existe dans les délibérations consulaires de la ville de Lyon, concernant les années 1428 à 1434, un épisode de l’histoire de cette ville moins connu que les autres. Il s’agit de l’épisode dit des quatre coursiers du prince d’Orange enlevés en Dauphiné, en 1426, par les gens d’Humbert de Grolée, bailli de Mâcon, sénéchal de Lyon. Le prince vit là l’occasion de déclencher un litige contre les Lyonnais. Ces quatre chevaux devaient servir de monnaie d’échange afin d’obtenir la délivrance de trois bourgeois lyonnais que le prince d’Orange avait arrêtés en représailles. Mais quand on en eut besoin, les chevaux avaient disparu. Ils avaient été envoyés à Grenoble et placés sous la garde du gouverneur du Dauphiné, Mathieu de Comminges, qui en avait remis deux à Humbert de Grolée et donné deux autres à un ami. C’est du moins ce qu’il répondit le 5 janvier aux Lyonnais, qui le priaient de donner satisfaction au prince d’Orange, afin d’obtenir la délivrance des otages4. On dispose de renseignements très détaillés sur cette affaire.
3
Vicomte de LEUSSE, dans Revue du Dauphiné, Borel, Valence, 1837, tome 1, pp. 291 à 297. 4 Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques, section d’histoire et de philologie, Comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, 1883-1884. No 1, 1909, p. 27.
74
C’est au début de l’année 1426 qu’avait eu lieu l’enlèvement de ces chevaux qui, au dire des gens du bailli, avaient été simplement « abandonnés » par leurs conducteurs à leur vue. Louis de Chalon était au plus mal avec le gouvernement de Charles VII. Comme les agents du roi ne faisaient pas assez vite droit à ses requêtes, il préparait, de connivence avec le duc de Bourgogne et le duc de Savoie, un hardi coup de main sur le Dauphiné. On conçoit que ses allées et venues aient été surveillées. Le prince d’Orange saisit le prétexte de la retenue de ces chevaux pour montrer une attitude arrogante et belliqueuse. Le 15 novembre, dans une lettre datée de Lille en Flandre, il somma les Lyonnais de lui restituer ses chevaux. Dès le 26 décembre, les consuls déclinèrent leur responsabilité. Le bailli seul devait répondre de cette affaire. Pierre Chenevrier, qui assistait avec Pierre Copier à la capture des chevaux du prince, était un parent d’Humbert de Grolée, et la ville ne pouvait ainsi dire rien contre lui. Ce qui compliquait le conflit, c’est que le conducteur des coursiers était, au dire du prince, muni d’un sauf-conduit du connétable de Richemont, ce que niait le bailli. Le prince d’Orange usa alors du système des représailles. Ses gens prirent Antoine de Chaponnay, le tabellion Petrus Pascal et le cordonnier Pierre Bauchet, d’Anse, et il déclara qu’il ferait capturer d’autres bourgeois de la ville, si on ne lui rendait pas justice. Il exigeait la restitution des chevaux ou 1500 écus pour remettre en liberté les personnes arrêtées. C’est le 9 novembre 1427 que les consuls connurent ses conditions : c’est alors qu’ils décidèrent de faire intervenir le duc de Savoie. Les Lyonnais envoyèrent, le 31 décembre 1427, une ambassade à Amédée VIII. Sur ces entrefaites, ils reçurent du prince d’Orange une nouvelle lettre envoyée le 2 janvier 1428, de Bletterans, petite cité située non loin de son fief d’Arlay dans les Dombes jurassiennes. Il réclamait toujours ses chevaux ou 1500 couronnes d’or. Et aimerais mieux, disait-il, que ceulx qui l’ont fait paiassent cette somme et que les aultres bons bourgeois et habitants qui n’en peuvent mais en fussions quittes. Et, à telles fins que vous cognaissiez que je ne vouldrais rien demander à vous et à vos subgets sinon par raison, je vous offre, si vous me voulez baillier et délivrer le dit bailli de Lion, ensemble Pierre Chenevrier et Jehan Copier, lesquels sont continuellement en votre puissance et aussi les biens et héritages
75
qu’ils ont en la ville et territoire de Lyon, pour moi me dédomagier… Si vous refusez, c’est que vous supportez les faits desdits…5 C’est alors qu’Amédée VIII, duc de Savoie, intervint dans ce conflit en jouant le rôle de médiateur entre les protagonistes et le roi de France, vers qui « l’affaire » était remontée. Amédée avait deux raisons pour agir ainsi : il était en relations fréquentes avec les Lyonnais dont le pays touchait au sien et il entretenait d’excellents rapports avec le prince d’Orange. De plus, il avait fait signer la trêve du 5 octobre 1428 et comme Louis de Chalon était aussi vassal du duc de Bourgogne, tout ce qui était susceptible de soulever un conflit entre le roi de France et Philippe le bon l’intéressait. Amédée imposa donc son arbitrage. Cet arbitrage fut peu apprécié par les Lyonnais, car tous savaient le duc inféodé à la cause du prince d’Orange. La ville de Lyon contesta toute implication en rappelant qu’elle était entièrement étrangère au conflit, et le 2 mars, les consuls renouvelèrent leurs protestations d’innocence. Charles VII intervint à son tour, dans le courant du mois d’avril, mais son intervention resta sans effet dans une « dispute » qu’il jugea peut-être à tort de peu d’importance. Pourtant, nous le savons aujourd’hui, ce conflit n’était qu’un prétexte. Il déboucha sur la bataille d’Anthon dont les conséquences furent considérables sur l’échiquier politique. Le royaume de France allait en retirer un énorme bénéfice. Louis de Chalon se décide à agir Dès lors, Louis de Chalon se décide à agir seul, sans tenir compte de la trêve intervenue entre Charles VII et le duc de Bourgogne. Il fait passer le Rhône à deux cents hommes d’armes qui pénètrent en Dauphiné. Il faut dire que la conjoncture lui est particulièrement favorable et que tout concourt à pousser le prince vers la réalisation de son entreprise. En effet, vers le mois de juillet 1428, les Orléanais, se voyant menacés par les Anglais, font appel aux Viennois et aux Dauphinois. Charles de Bourbon, inquiet pour ses possessions du Beaujolais, se joint à ces instances. En conséquence, le gouverneur du 5
Ibid. Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques, p. 27-28. « Communication de M. L. Caillet », Nouveaux documents relatifs à l’intervention du duc de Savoie, Amédée VIII, dans le conflit des Lyonnais avec Louis de Chalon, prince d’Orange.
76
Dauphiné dégarnit encore sa province, afin d’envoyer des soldats au cœur du royaume. Louis de Chalon, en parfait calculateur, saisit alors cette nouvelle opportunité. Dépourvu de force, Mathieu de Comminges, gouverneur du Dauphiné, n’est pas en mesure d’opposer une quelconque résistance. Pressé de toutes parts et sans solution, il conclut un traité avec l’envahisseur. Il reconnaît et accepte toutes les prétentions que revendique le prince. Chacune des terres usurpées lui est cédée, à charge d’hommage. Pour ne pas être inquiété, Louis de Chalon exige, en outre, l’obtention de lettres d’abolition. Selon la géostratégie qu’il avait élaborée, le prince voulait ménager des communications terrestres entre la Bourgogne et la Savoie. Il se retrancha donc dans la partie nord du Dauphiné qui s’imbriquait étroitement au cœur de ces deux puissants duchés. Le Rhône, axe stratégique majeur, touchait aux limites de tous ces territoires, c’est pourquoi sa berge dauphinoise était hérissée de forteresses. Des hommes d’armes occupèrent dès lors la forteresse principale de la région : Anthon. Louis de Chalon disposa partout de nombreuses garnisons, et put ainsi, à la manière d’un routier, parcourir la contrée à la tête d’une armée composée de Bourguignons, d’Anglais et de Savoyards.6 Dans la même année 1428, soutenu par un certain nombre de seigneurs, il s’empare encore des châteaux de Pusignan et d’Azieu. Une fois ces places conquises, il adopte la même tactique en laissant partout des garnisons. Durant l’hiver 1429-1430, il fait de plus fortifier le port d’Anthon. Ce lieu, dit un historien du pays, estoit si bien fortifié sur le Rhosne, que pour peu qu’il y eust de gens, Anthon mettoit cette rivière et par elle la ville de Lyon en subjection et toutes les terres voisines en servitude. L’inquiétude se répand à travers tout le pays, même jusqu’à la cité de Vienne, qui se prépare à résister aux assauts des hommes d’armes du prince d’Orange. Continuant sa chevauchée conquérante dans les premiers mois de 1430, Louis de Chalon s’empare encore de diverses places, sur la rive gauche du Rhône. Il met une garnison à Auberive7 et prend ainsi un pied solide en Dauphiné. Antoine de Ferrières, 6
Ibid. Vicomte de LEUSSE, dans Revue du Dauphiné, tome 1, p. 291 à 297. Aujourd’hui Auberives-sur-Vareze, situé à 12 km de Vienne dans le département de l’Isère, le château fut démantelé en 1430 par Raoul de Gaucourt, gouverneur du Dauphiné, depuis cette date il n’est plus qu’une ruine.
7
77
capitaine d’Anthon à la solde du prince Louis, continue en février-mai de la même année les ravages sur le Dauphiné. Face à ces troubles qui agitent durement la province, l’archevêque de Vienne, Jean de Norry, craint pour la sûreté de sa ville. Il restaure les fortifications et pourvoit à sa défense.8 Enfin, en dernier lieu, Louis de Chalon obtient du duc de Savoie, un secours supplémentaire de trois cents lances, soit environ deux mille hommes de cavalerie9. Dès les premiers mois de 1430, on signale des levées d’hommes d’armes en Bourgogne. Le duc Philippe le Bon se décide enfin à mener une guerre totale contre le Dauphiné et le royaume de France. D’ailleurs, Louis de Chalon écrit à son châtelain d’Anthon, Antoine de Ferrières, en ces termes : très cher et bien aimé escuier… Lettres de Monsieur de Bourgogne, lesquelles contiennent, qu’il veut que nous fassions la guerre au Dauphiné le plus fort que nous pouvons…10 La période semblait de plus en plus favorable pour la concrétisation des projets ambitieux du prince. Le conflit général était inéluctable. Tout allait éclater au printemps de 1430. Charles VII nomme un nouveau gouverneur et, pour sauver le Dauphiné, fait appel à Rodrigue Devant la réaction peu convaincante du gouverneur Mathieu de Foix lors des évènements que nous venons de relater, le roi Charles VII décida de pourvoir à son remplacement par Raoul de Gaucourt, le défenseur d’Orléans. Ainsi, fin février 1430, Gaucourt se rendit dans le Dauphiné pour en prendre la gouvernance. Les hostilités engagées par Louis de Chalon se rouvrirent au printemps. Gaucourt tenta une dernière médiation en envoyant des émissaires auprès du duc de Savoie. Ceux-ci l’exhortèrent à désavouer 8
Ibid. VALLET de VIRILLE, Histoire de Charles VII et de son époque 1403-1461, Renouard Éditeur, Paris, 1863. Tome II, pp 256 à 262. 9 Chaque compagnie compte 100 lances, et chaque lance est organisée autour d’un homme ou sergent d’armes, le lancier, et est composée de 6 hommes montés : 1 lancier, 1 coutilier, 2 archers, 1 page, 1 valet d’armes. Seuls les quatre premiers étaient des combattants. 10 Olivier PETIT, Magazine Citadelle, un autre regard sur le Moyen Age, No°3, Juillet 2000.
78
Louis ou tout au moins, à ne point l’assister. C’est alors que les réponses équivoques et embarrassées d’Amédée lui ouvrirent définitivement les yeux. Raoul de Gaucourt et Humbert de Groslée, sénéchal de Lyon, comprirent la gravité de la position où les plaçait l’invasion du prince d’Orange. Au mois de mai, le gouverneur opéra sa jonction avec le sénéchal de Lyon. Mais leurs forces réunies à celles du ban dauphinois, épuisées par les précédentes campagnes, apparaissaient bien insuffisantes11. Gaucourt en informa le roi et souligna combien la situation était périlleuse. Il lui rappela que la chevalerie dauphinoise était détruite. Tout ce qu’il pouvait faire était de réunir à ce qui restait de la noblesse du pays, deux compagnies de Lombards indisciplinées que commandait Imbert de Groslée, sénéchal de Lyon. Le gouverneur attendit vainement les secours du roi, qui, écrasé par ses autres charges, semblait l’abandonner aux seules ressources locales. Charles VII répondit en effet que pour le malheur du Dauphiné, il n’avait pas de troupes disponibles.12 Dans cette extrémité, Gaucourt, qui était un homme de résolution, eut tôt fait de prendre ses responsabilités. Il contracta un emprunt sur l’impôt à voter par les États de la Province, qui étaient à la veille de se réunir, puis muni d’une bonne somme d’argent, il s’éloigna mystérieusement en compagnie du sénéchal de Lyon. Les deux hommes n’avaient dit à personne où ils se proposaient d’aller. Afin de ne pas attirer les regards, ils avaient poussé la précaution jusqu’à se travestir pour mieux se fondre dans l’anonymat des gens du peuple. Ils prirent sans être remarqués le chemin d’Annonay13. C’est là qu’ils avaient donné secrètement rendez-vous à Rodrigue. Descendant des rudes montagnes du Velay, notre capitaine castillan accompagné de Guilhem Valette et de plusieurs de ses lieutenants avait établi pour le moment ses quartiers autour de cette ville. Gaucourt et Imbert de Groslée venaient lui faire une proposition. Il s’agissait d’enrôler la puissante armée du routier pour la défense du 11
Ibid. A. VALLET de VIRILLE, Histoire de Charles VII et de son époque, Tome II, pp. 256 à 262. 12 Jacques BERRIAT SAINT-PRIX, Jeanne d’Arc, fragment du registre delphinal de Thomassin, Biblio life, United States, 2009, p. 321. 13 Ibid. Vicomte De LEUSSE, dans Revue du Dauphiné, Tome 1, pp. 291 à 297.
79
Dauphiné. Les offres du gouverneur furent trouvées acceptables. Dans cette extrémité, Rodrigue fut désigné au conseil du roi comme l’homme indispensable auquel il fallait avoir recours. Pour aplanir toute difficulté, ou cas où le pointilleux capitaine en aurait soulevé à propos de ses arrérages, ses nouvelles lettres patentes furent accompagnées d’un brevet qui le constituait « écuyer de la maison du roi », avec les émoluments et honneurs attachés à cet office. Ce dernier argument fut jugé efficace puisque les bandes ne tardèrent pas à s’ébranler pour descendre vers la vallée du Rhône.14 Quelques jours plus tard, le 26 mai 1430, Rodrigue, capitaine de compagnie et nouvel escuier du roi, passa le pont de Vienne pour entrer en Dauphiné. Il était suivi de trois cents lances, commandées par Jean de Salazar, l’un de ses lieutenants. Rodrigue joignit le sénéchal et le gouverneur sous les murs d’Auberive où ils s’étaient donné rendez-vous. Les armées qui venaient d’opérer leur jonction étaient formées de combattants à cheval, auxquels s’ajoutait un tiers ou un quart de fantassins qui maniaient l’arc ou l’arbalète. Dans cette coalition, on distinguait deux sortes de cavaliers : les uns appelés hommes d’armes, parce qu’ils étaient armés de pied en cap, les autres plus légèrement équipés, donc plus mobiles, étaient tenus pour les servants des premiers. Chaque homme d’armes en menait deux, trois, quatre à sa suite, selon son rang ou sa richesse. Maîtres et servants, groupés ensemble, constituaient autant d’unités désignées sous le nom de lances. La lance était le signe distinctif de l’homme d’armes, longue de quatorze pieds soit environ quatre mètres cinquante, elle permettait aux lourds cavaliers d’atteindre leur cible sans être touchés tout en étant protégés par la mobilité des autres. La garnison ennemie logée à Auberive avait depuis longtemps engagé les hostilités. On ne s’aventurait plus aux alentours sans risquer d’être capturé et mis à rançon. Plus de trente notables du pays attendaient dans les prisons du château que leurs familles puissent les racheter. L’attaque des coalisés fut d’une vigueur extrême. En quelques heures les routiers emportèrent le bourg, puis la première cour du château, puis la seconde. Le donjon, tenu par une centaine d’hommes qui s’y étaient retranchés, résista pendant deux jours. Alors 14
Ibid. Maurice MAINDRON, Récits du temps passé, Nouvelle édition A. Maime et fils, Tours 1924, p. 196, et Jules QUICHERAT, Vie de Rodrigue de Villandrando, Paris 1845, pièce justificative no°1 où le roi le qualifie de « nostre bien amé escuier d’escurie ».
80
pour amener ces gens à se rendre, on le noya sous un déluge de projectiles et de coups de canon. Gaucourt, vainqueur au nom du roi, fit détruire la forteresse de fond en comble. Il fit appel à de simples habitants, partisans de sa cause, pour travailler à la démolition de ce qui lui apparaissait comme un dangereux repaire. Toutefois, il donna l’ordre qu’on laisse debout de grands pans de muraille en signe que la place et le seigneur avaient été rebelles à leur prince et inféaux, et afin qu’il en fût grande souvenance et mémoire perpétuelle. Ce succès obtenu, le gouverneur et Rodrigue se présentèrent à la côte Saint-André, une petite place forte qui devait son nom à son implantation sur le flanc sud d’une colline du pays de Bièvre. Les États du Pays, assemblés dans cette ville, votèrent un subside de cinquante mille florins pour couvrir les frais de la campagne. Ordre fut donné à tous les Dauphinois de s’armer pour la défense. Puis, les États envoyèrent à Chambéry, auprès d’Amédée, une nouvelle ambassade. Le duc alors fit répondre par son chancelier Jean de Beaufort que l’un des privilèges de la noblesse de Savoie était de servir indifféremment ceux qu’il lui plaisait, et que la voie la plus sûre pour l’avoir de son côté était de lui faire les offres les plus avantageuses.15 Le 7 juin, le château de Pusignan fut enlevé sous le commandement de Rodrigue, la Bâtie d’Azieu, dont il ne subsiste aujourd’hui qu’un seul pan de muraille près de l’étang de Mathan, tomba le 8 et, dans la nuit du samedi au dimanche 11 juin, après un semblant de siège, Colombier rendit les armes. Le château de Colombier était situé sur une petite élévation qui dominait une plaine immense16 limitée seulement à l’horizon par les montagnes des Cévennes, du Jura et des Alpes. L’ost des coalisés rencontra là une garnison de l’armée du prince d’Orange. Les soldats du prince purent alors juger des forces et de la résolution de leurs ennemis. Ils se rendirent après une faible résistance. Le château, comme les précédents, fut totalement détruit et ses ruines ne furent jamais relevées.17 15
Ibid. A. VALLET de VIRILLE, Histoire de Charles VII, pp. 256 à 262. Aujourd’hui Colombier-Saugnieu. C’est sur cette plaine qu’est implanté l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. 17 Ibid. Vicomte de LEUSSE, dans Revue du Dauphiné, pp. 291 à 297. 16
81
Deux jours avant ces derniers évènements, le prince d’Orange était arrivé selon son plan de campagne du duché de Bourgogne. Il traversa le Rhône au bac d’Anthon pour rejoindre la forteresse de la ville. Une partie de ses troupes l’avait précédé. Sensiblement du même âge que Rodrigue, Louis de Chalon était dans toute la force de l’âge et des passions. Il était à la tête d’une puissante armée. Venant de lieux et d’horizons divers, les hommes d’armes de sa suite se rassemblèrent aux abords de la cité fortifiée. Il y avait là seize à dix-huit lances d’élite composées d’autant de Bourguignons que de Suisses et de Savoyards. Ces chevaliers et écuyers étaient suivis chacun de leurs coustiliers et valets d’armes, sans compter les gens de trait et d’infanterie.18 Anthon, situé sur la rive gauche du Rhône, fait face à la confluence de l’Ain en un lieu où le Rhône s’assagit quelque peu. La berge dauphinoise, peu élevée en cet endroit, forme le premier gradin d’un massif montueux appelé « le bois des Franchises » qui s’étend en longueur du nord au Midi. Plus à l’ouest, c’est la vaste plaine jusqu’à Lyon, seulement entrecoupée par un étroit promontoire que couronne le château de Pusignan. Reçu en grande révérence dans le château d’Anthon, le prince d’Orange tint dès le lendemain de son arrivée une cour plénière où il se parait déjà du titre de « dauphin de Viennois ». Sûr de son fait, il alla même jusqu’à distribuer entre ses fidèles les offices de la province. Mais l’important était de se hâter. Dès le lendemain matin, bien que ce soit un dimanche, jour de la fête de la Trinité, son armée marcherait triomphante à la délivrance de Colombier que le prince pensait seulement assiégée.19 Humbert de Groslée et Rodrigue ignoraient de leur côté la présence du prince. Néanmoins, en cette période de tension extrême, ils envoyèrent le matin même de la capitulation de Colombier, un héraut en reconnaissance au château d’Anthon. Ce messager, à peine arrivé sur les lieux, fut capturé et détenu par Louis de Chalon. Il apprit alors au prince que la forteresse de Colombier venait de tomber. Le prince pâlit, mais il se ressaisit aussitôt et fit sonner le rassemblement de ses troupes. Malgré cette déconvenue, Louis de Chalon restait 18 19
Ibid. MONSTRELET, Chroniques, T. IV, p. 408. Ibid. Jules QUICHERAT, Paris, 1879, pp. 40 à 52.
82
totalement confiant, car pour lui l’issue de la bataille ne faisait aucun doute. Et il y avait de quoi ! Son armée, forte de 4000 hommes, dont 1500 chevaliers, était trois fois plus importante et mieux organisée que l’armée dauphinoise qui alignait en face seulement 1600 hommes. Le prince croyait en son étoile, tout ne serait que formalité ! Pour compléter cette machine de guerre impressionnante, Louis avait de plus mandé à son secours une compagnie de Suisses, commandée par François de Neuchâtel. Ces derniers étaient armés de leurs formidables épées à deux mains, principalement utilisées dans un mouvement tournoyant pour faucher la cavalerie souvent hors d’atteinte ou dans le cas inverse pour créer un cercle de vide autour du chevalier s’il était désarçonné. Louis avait aussi fait venir de Bourgogne sept mulets chargés de maillets de plomb pour son infanterie. Alors, sous son commandement général, les puissantes colonnes s’organisèrent dans un cliquetis d’armes continu qui se répercutait sous les murailles de la ville. Puis, aux pas lourds des chevaux, l’armée orangiste enveloppée de poussière se mit en marche vers Colombier. Nous étions le 11 juin 1430. Il était presque midi. L’heure du terrible affrontement venait de sonner…
83
LA BATAILLE D’ANTHON Lors de la veillée d’armes, pour pallier leur infériorité numérique évidente, les trois chefs dauphinois avaient mis en place une tactique où la ruse et l’effet de surprise devaient jouer le premier rôle. Ils connaissaient très bien le terrain et notamment les bois. Deux points situés sur le parcours d'Anthon à Colombier leur apparurent hautement stratégiques. C’étaient l’endroit précis du croisement du chemin de Colombier avec la route de Lyon et celui où ce chemin sortait du bois, en un lieu appelé « la Batterie ». Il s’agissait dans un premier temps d’arrêter la marche de la colonne ennemie et de paralyser son action combative en la bloquant dans les taillis impénétrables qu'elle devrait traverser. Cette action serait facilitée par la conformation des lieux, car le chemin menant à Colombier passait au milieu du bois des Franchises. En second lieu, on tenterait d’opérer avec les deux ailes un mouvement de tenaille afin de prendre à revers une armée orangiste désorganisée. L'immobilisation des Orangistes sur le chemin et la présence des troupes dauphinoises invisible tout autour provoqueraient l'inquiétude dans les rangs ennemis. Pour accentuer la peur parmi les Orangistes, les Dauphinois hurleraient et les bombardes venues de Crémieu seraient là pour faire beaucoup de bruit. Cette manœuvre provoquerait un sauve-qui-peut général et les hommes du prince s'en retourneraient vers Anthon. Cette stratégie, très théorique, devrait permettre de donner la victoire au camp dauphinois. Il n’y avait pas d’autre choix car si la bataille se perdoit, tout ce pays seroit perdu et en après Languedoc et Lyonnois. Par ainsi, le demourant du royaulme seroit en branle d’estre du tout perdu !1 Pendant qu’on réglait l’ordre de bataille, l’intrépide capitaine castillan demanda que la conduite de l’avant-garde lui soit confiée. Rodrigue savait que ce commandement appartenait de droit à Raoul de Gaucourt, gouverneur du Dauphiné. Mais il espérait qu’on voudrait bien pour cette fois déroger à l’usage en considération de son aptitude au commandement de troupes mercenaires. Ses hommes qu’il avait 1
Ibid. Vicomte de LEUSSE, dans Revue du Dauphiné, Borel, Valence, 1837, T. 1, p. 293.
85
maintes fois menés au combat lui vouaient une obéissance absolue. Il y avait là, en effet, des combattants de divers horizons qu’il importait de ne pas laisser un seul instant dans l’inaction. En les engageant tout d’abord, on confiait à Rodrigue la maîtrise du premier affrontement. Tout reposait donc sur la conduite décisive de cette action. Si par malheur le Castillan ne dominait pas la bataille, la chevalerie dauphinoise et les Lombards commandés par Burnon de Caqueran pourraient, en se retirant à temps, conserver encore le noyau d’une force nécessaire pour relever le combat. Raoul de Gaucourt et Humbert de Groslée connaissaient bien la valeur militaire de Rodrigue. Le sénéchal de Lyon qui avait été son ancien compagnon d’armes avait pu maintes fois juger des engagements audacieux du Castillan sur le théâtre des combats. Cette générosité, Rodrigue l’exprima une nouvelle fois en disant que s’il succombait, sa perte et celle de ses compagnons sauveraient la noblesse dauphinoise.2 Le long du fleuve qui poussait la puissance de ses flots en direction de la grande cité lyonnaise, le temps semblait suspendu. La plaine renvoyait seulement le bruit d’une agitation contenue. Tout était étonnamment calme. A peine entendait-on le cliquetis de quelques armes et le souffle sourd des chevaux. Humbert de Groslée s’agenouilla. Il désarma son heaume, puis, tête nue et les mains tendues vers le ciel, il se mit en prière : Dieu, par ta sainte justice, bonté et miséricorde plaise-toy de faire droit en ceste journée. Les capitaines s’agenouillèrent à leur tour, alors chacun des combattants, de pied ou monté, entendit la messe, put se confesser et but légèrement. Après, fut dit publiquement que s’il y eut personne qui eust point de paour, qu’il se retirast. Puis leur fut dict vous serez tous riches en ceste journée… Nous avons juste et raisonnable cause. Dieu nous aidera !3 L’étrange spectacle de ces hommes dont les armures luisaient au soleil de juin donnait toute la dimension du terrible évènement qui allait suivre. Il faut dire que dans leurs habits de fer, armés de dagues et d'épées solides ou encore d'une lance dont ils se servaient volontiers, même à pied, ces hommes semblaient perdre toute allure humaine. Chez les cavaliers, le heaume cylindrique qui 2 3
Ibid. Vicomte de LEUSSE, pp. 294, 295. Ibid. VALLET de VIRILLE, Histoire de Charles VII, Tome II, p. 264.
86
coiffait leurs têtes avait pris depuis peu une forme nouvelle, conique, destinée à faire glisser les coups de lance et d’épée. Leurs chaussures étaient en métal, aux pointes aiguës pour se défendre à coups de pied contre les fantassins. Mais cela pouvait aussi devenir un piège terrible en rendant la marche quasi impossible au cavalier désarçonné. Chacun d'eux avait un ou deux pages, selon ses ressources et aussitôt qu'ils avaient déposé leurs armes, les jeunes garçons s'occupaient de les polir, de telle sorte qu’au moment du combat, elles brillaient comme des miroirs, ce qui donnait aux guerriers un aspect encore plus redoutable. Gaucourt donna le signal du départ et il se plaça au centre aux côtés d’Humbert de Groslée. Il était à peine midi, et le plus beau soleil éclairait la marche de ces guerriers, qui s’avançaient au combat. A cet instant, deux hommes arrivèrent poussant leurs montures au galop. C’étaient des éclaireurs qui venaient les informer du départ imminent de l’armée du prince. Rodrigue prit donc les devants et se mit en embuscade à la lisière d’un bois qui couvrait de sa masse sombre presque tout le massif depuis Anthon jusqu’au creux de la plaine. L’ordre avait été donné pour que l’avant-garde s’appuie sur les compagnies de Valette et d’un autre routier nommé Churro4. Ceux-ci étaient positionnés à l’orée du bois aux côtés de Rodrigue. Les Lombards, sous les ordres des deux capitaines piémontais Georges Boys et Burnon de Caqueran, devaient se tenir à gauche et surveiller le charroi chargé du transport du bagage et de l’artillerie orangiste. Celui-ci leur apparut bientôt roulant au loin du côté d’Anthon et escorté d’un fort détachement d’infanterie. Le sire de Gaucourt et Imbert de Groslée avaient confié le commandement de la division de droite au baron de Maubec5. Ce corps fut le dernier à se mettre en marche pour occuper d’abord un espace stratégique longeant le marais de la Léchère. Il était composé de six cents hommes qui représentaient tout ce qui restait de la noblesse dauphinoise et lyonnaise du pays.
4
Ibid. QUICHERAT, 1879, Note 2, p. 45 : Vocatum Valette et Petrum Churro, capitancos rucularum. « Processus super insultu ». Ce nom de Churro, à la consonance espagnole, figure sous la forme française Churre dans le contrat de mariage de Rodrigue. 5 Hugues II de Maubec était le neveu d’Imbert de Groslée. Fils de François de Maubec et d’Alix de Groslée, il épousa le 21 janvier 1425, Jeanne de Montlaur, héritière de Louis de Montlaur et de Marguerite de Polignac.
87
C’est alors que la bannière rouge et noire du prince d’Orange apparut par intermittence à travers l’épais feuillage du « bois des Franchises ». Ce pennon de tissus était rehaussé en signe de triomphe par le jaune éclatant d’un soleil levant. L’armée ennemie s’avançait en direction de la forêt, puis pénétra sous le couvert ombragé croyant surprendre les Dauphinois. Avec un calme étonnant, Rodrigue et ses hommes laissèrent le détachement progresser jusqu’au sortir du bois. Les gens du prince allaient bientôt déboucher dans la plaine, un halo de ciel bleu apparaissait déjà entre les frondaisons, lorsqu’une pluie de traits volant de toute part s’abattit sur eux. Les fourrés entre lesquels ils s’étaient dangereusement avancés n’étaient pas ceux d’une forêt déserte. Rodrigue avait en effet posté ses hommes partout dans le sous-bois. Devenus combattants invisibles, ils étaient positionnés en un endroit stratégique choisi par leur capitaine, aux abords immédiats d’un étroit passage. L’armée orangiste tenta de faire face, mais empêtrée dans ses mouvements, elle dut subir un premier assaut meurtrier. Le trouble commença à gagner les rangs de l’avant-garde du prince. Les chevaux affolés par les hommes qui ne savaient où aller se cabraient dangereusement en désarçonnant leurs cavaliers. Totalement surpris, les Orangistes cherchèrent à échapper à la souricière. Mais il était trop tard ! Rodrigue se présentait déjà avec ses hommes d’armes, la lance en avant. Et le voilà poussant à revers cette cavalerie, massée dans le chemin montant, empêtrée entre deux rangées d’arbres qui l’emprisonnaient autant que des murailles. La position n’était pas tenable. Les Orangistes reculèrent pêle-mêle en cherchant d’autres issues. Et c’est là, au sortir du bois, que les attendait la tenaille de l’armée dauphinoise. Les malheureux débouchèrent quasiment à la file et, dans un désordre épouvantable, ils arrivèrent hagards sur le champ de bataille déjà occupé par l’ennemi.6 Le prince, alerté par ses éclaireurs, tenta de dissimuler son étonnement. En vertu des grands principes chevaleresques et surtout pour donner le change, il envoya demander la bataille au gouverneur du Dauphiné, comme si aucun engagement n’avait encore eu lieu.
6
Ibid. QUICHERAT, 1879, note 1, p. 46, qui cite le chroniqueur Monstrelet : Les Bourguignons venoient par mi ung bois, et ne se porrent bonnement du tout rassembler ne mettre en pleine ordonnance de bataille, pour ce que iceulx François les envayrent soubdainement et vigueureusement.
88
Mais Rodrigue avait déjà si bien entamé la résistance ennemie que le temps n’était plus aux codes de combat. Le corps principal de l’armée du prince était dans un désordre tel qu’il était impossible de reconstituer ses lignes. Pressé de toutes parts, il n’en avait ni le temps ni les moyens. Chacun de ses hommes semblait combattre individuellement pour essayer d’échapper aux coups ennemis. Pourtant ! Lorsqu’il avait aperçu dans cette vaste plaine l’armée ennemie, Louis de Chalon, prince d’Orange, avait d’abord souri. La coalition armée, soustraite du bataillon de Rodrigue qui avait déjà pris secrètement position dans le bois, lui avait semblé étonnamment réduite. Son petit nombre lui avait fait si peu d’effet que le prince ne crut pas un seul instant qu’elle puisse prendre l’initiative de l’attaque. Alors, le prince d’Orange tenta une dernière fois de remettre de l’ordre dans ses troupes. Il laissa ce soin à ses chefs de corps et s’arrêta seulement à conférer la chevalerie à de jeunes seigneurs qui la demandaient. Il n’en eut pas le temps. Continuant son effet de tenaille dévastateur, l’armée dauphinoise fondit en un instant sur les lignes non reconstituées de ses adversaires. Pour couronner le tout, venant de l’arrière, sortant du bois comme un chef de meute à la tête d’une harde de loups affamés, Rodrigue et ses hommes étaient maintenant en mesure de refermer totalement le piège. Au premier choc, Louis de la Chapelle et quelques autres chevaliers bourguignons mirent pied à terre, jurant de mourir plutôt que de reculer d’un pas. Ils amortirent ainsi, quelques instants, l’impétuosité de l’attaque. Mais ils payèrent de leur vie une résistance inutile. Peu à peu, la plaine se remplit de combattants des deux partis. Une terrible mêlée s’ensuivit bientôt dans un fracas et un acharnement effroyables. Mais l’armée du prince n’eut jamais le temps de réparer le défaut de ses premiers mouvements. Elle fut rompue dès que les trois divisions dauphinoises eurent opéré leur jonction. Une heure à peine s’était écoulée depuis le début des combats, et l’on assistait à une chasse plutôt qu’à un combat. Des cavaliers laissaient là chevaux et armures. Les fantassins en faisaient autant de leurs arbalètes, de leurs épées, des maillets de plomb dont on les avait pourvus pour briser les bassinets et les cuirasses sur le corps des
89
coalisés7. Ce n’était que gens éperdus courant dans tous les sens, ceux-ci pour gagner le Rhône, ceux-là pour se cacher dans les blés ou dans les bois. Déjà, les sires de Beaufremont, de Mirabel, de Moulent, de Basseys, les chevaliers de Troyes et de la Chapelle étaient étendus sans vie sur le champ de bataille. D’autres, tels que le comte de Fribourg et les sires de Montaigu et de Virieu, fuyaient à travers la plaine et les bois8. De très vaillants hommes, qui n’avaient jamais reculé devant l’ennemi, perdirent la tête et tournèrent bride comme les autres : ainsi le comte de Fribourg, ainsi le seigneur de MontaguNeufchâtel chevalier de l’ordre tout nouvellement créé de la Toison d’Or. Les Anglais l’avaient élevé à la dignité de « Grand-Bouteiller »9 de France, mais pour avoir cherché son salut dans la fuite, il fut dégradé de l’ordre10, et s’en alla plus tard mourir de chagrin en Terre Sainte. Au milieu de cette déroute générale, le prince d’Orange combattait encore. Il était touché au visage et atteint de plusieurs blessures au corps. Autour de lui, ce n’était que monceaux de cadavres, empêtrés dans leurs armures, étendus, enchevêtrés, figés dans une dernière tentative pour échapper à la mort. Alors, le prince cédant enfin à sa mauvaise fortune abandonna à son tour le champ de bataille, emporté par son vigoureux destrier. Personne n’aurait pu le reconnaître dans cet état de meurtrissure. Galopant au plus fort, il n’était plus qu’un personnage fantomatique, couvert du sang de la défaite qui ruisselait jusqu’aux flancs de sa monture11. C’est dans cet équipage surréaliste, seul et abandonné de tous, que le prince en arrivant au château d’Anthon sauta de son cheval aux naseaux écumants.
7
Ibid. QUICHERAT, 1879, Note 1, p. 48 : Grossos malleos plumbeos deferentes, de quibus adduci dictus d. Ludovicus de partibus suis Burgundie septerm mulos oneratos focerat. « Processus super insultu », C. XXX. 8 Ibid. Vicomte de LEUSSE, Revue du Dauphiné, Valence, 1837, T. 1, p. 296. 9 Le « Grand-Bouteiller » était chargé d'administrer le vignoble du domaine royal, fonction pour laquelle il percevait une redevance sur certaines abbayes fondées par le roi. Le bouteiller était un des principaux officiers de la cour : il attestait très souvent les chartes royales. 10 Ibid. QUICHERAT, 1879, Note 2, p. 48, « Attendu qu’il s’estoit trouvé en journée de bataille où cottes d’armes et bannières avoient esté desployées, et avoit procédé si avant jusques à combattre sans estre victorieux, mort ni prins, etc. » Chronique de Jean Lefèvre de Saint-Rémy, ch. CLXX. 11 Ibid. Vicomte De LEUSSE, Revue du Dauphiné, T. 1, p. 29.
90
Une autre désillusion l’attendait : Antoine de Ferrières qui était à la tête de trente hommes de garnison avait délaissé la place, bien décidé à se rendre, malgré les munitions et les vivres qui étaient encore en réserve. Alors, le malheureux prince ne resta même pas le temps nécessaire pour panser ses blessures. Désespéré, sentant le souffle de l’ennemi qui était à ses trousses, il se déroba à nouveau et prit la résolution de traverser le Rhône. Le bruit d’une cavalcade résonna à ses oreilles. Ses poursuivants étaient sur ses talons. Alors, le prince poussa son cheval dans le fleuve qui est pourtant large et tumultueux en cet endroit où ses eaux se marient avec la rivière d’Ain. Il n’avait plus d’autre choix : Le prince d’Orange se sauva à la nage ayant esté contrainct de fere saulter son coursier dedans le Rhône combien que luy et le cheval fussent armez de toutes pièces12. Au milieu des flots qui se brisaient sur son échine, le cheval surnageait à peine, puis miraculeusement il réussit à atteindre la rive bressane. Plusieurs chroniques nous livrent la suite de l’histoire : lorsqu’il mit pied à terre, prenant dans ses mains la tête du noble animal, il lui donna un baiser en pleurant. La Pise, l’historien d’Orange, dit simplement que le prince fit nourrir longtemps ce cheval avec un soing extraordinaire en sa ville de Lons-le-Saulnier en Bourgogne. Un autre signale qu’il était accompagné dans sa fuite éperdue par un écuyer, et que celui-ci « dans un geste de désespoir pour ne pas se noyer s’était accroché à la queue de l’animal. Étrange équipage en train de traverser les flots impétueux, mais le cheval déjà lourdement surchargé menaçait de sombrer. Alors, le prince fut moins généreux envers son écuyer, il lui trancha la main d’un coup d’épée.13 Quelle terrible disgrâce pour un homme si puissant qui avait si pompeusement annoncé sa victoire ! Sa gloire s’était tournée en honte, et son assurance de la veille n’allait plus être aux yeux de tous qu’une ridicule forfanterie. Quatre mille hommes pourtant expérimentés qu’il avait rassemblés venaient quasiment de disparaître devant une armée
12
REVUE DU MIDI, Religion, littérature, Histoire, Gervais-Bedot, Nîmes, No 1, 1914/01, p. 240. 13 Ibid. REVUE DU MIDI No 1, 1914/01, p. 240/Vicomte de LEUSSE, Revue du Dauphiné, T. 1, pp. 296, 297/LA PISE, historien d’Orange cité dans Vicomte de LEUSSE, revue du Dauphiné, T. 1, pp. 296-297.
91
plus faible d’un tiers14. Cinq cents des siens avaient mordu la poussière, deux cents s’étaient noyés dans le Rhône, on ne pouvait pas chiffrer le nombre de prisonniers. Et lui, prince d’Orange, abandonné de tous, avait fui, seul, laissant aux mains de l’ennemi ses châteaux, son armement de guerre et toutes ses enseignes. Son grand étendard de soie rouge et noire, sur lequel il avait fait broder un soleil d’or dardant ses rayons jusqu’au bout de l’étoffe, fut exposé le lendemain comme trophée à la cathédrale Saint-Jean à Lyon. Plus encore, pour bien souligner l’appartenance du Dauphiné à la couronne de France, on le vit suspendu à Grenoble, dans la chapelle dauphinoise de Saint-André. Louis de Chalon perdit toutes les places qu’il occupait sur le territoire du roi de France. Plus tard, sa bannière aux armes de Chalon, de Genève et d’Orange, échut en partage à Rodrigue, qui l’envoya comme offrande à l’église du monastère de la Merced à Valladolid où reposaient ses ancêtres. Gloire et richesse Il est un fait indéniable : Rodrigue venait d’attacher son nom à l’histoire du royaume de France. Sans son subterfuge et au regard de la puissance des deux armées, tout semblait perdu d’avance pour la coalition dauphinoise. Et pourtant, au bout d’une à deux heures de combat, la déroute de la puissante armée du prince d’Orange s’était dessinée complètement. Et notre capitaine castillan sut en profiter ! Rodrigue, dit un chroniqueur admiratif de ses faits d’armes, homme plein de malicieux engins, exploita merveilleusement en la défense, sans oublier son profit15. Il faut savoir que l’issue des batailles, si le sort en était favorable, permettait au vainqueur de faire des gains substantiels. Les prisonniers représentaient pour les capitaines de compagnies, outre l’enrichissement personnel, un revenu de premier ordre pour pouvoir solder les troupes dont ils avaient la charge. Les détenus ne 14
Les Dauphinois et les Lyonnais de Hugues II, baron de Maubec, rassemblaient environ 600 hommes dont 100 chevaliers, 300 archers et arbalétriers et 200 piquiers. Rodrigue de Villandrando environ 400 hommes et les Lombards de Burnon de Caqueran à peu près 600 hommes dont un tiers de cavaliers. Soit un total évalué à 1600 hommes qui se trouvaient face aux 4000 combattants du prince d’Orange. (Olivier PETIT, « La bataille d’Anthon », Magazine Citadelle, un autre regard sur le Moyen Âge, no° 3 juillet 2000). 15 Chronique Martinienne, citée par QUICHERAT, 1879, Pièces justificatives no I.
92
recouvraient la liberté qu’au moyen d’un échange ou d’une rançon. La rançon était proportionnée au rang et à la richesse du prisonnier. Quelquefois, il fallait plusieurs années pour pouvoir recueillir chez ses parents, ses amis et ses vassaux la somme nécessaire. Le prisonnier était ordinairement la propriété de celui qui l’avait pris. Mais certaines fois, les souverains se réservaient le droit de disposer des personnages les plus importants. Surtout si ceux-ci représentaient un enjeu politique. Lorsque le sort des armes mettait en leur pouvoir un prince ou un grand baron, les chefs de guerre pouvaient parfois se montrer très cruels. L’histoire de cette époque nous en a laissé quelques témoignages : par exemple, le tenir enfermé dans une cage, au fond d’une prison, sans vouloir le rendre à aucune condition.16 Si la journée fut belle pour quelqu’un, c’est bien pour le capitaine castillan ! Cent vingt à cent quarante Orangistes avaient perdu la liberté. Sa contenance sur le champ de bataille fut celle d’un lion. Il promenait devant lui l’épouvante et la mort, et les groupes sur lesquels il se jetait semblaient perdre la force de se défendre. Il ne perdit que très peu d’hommes, tandis que le gain lui arriva sous toutes les formes. Hernando del Pulgar nous apprend en quoi le savoir-faire de son avisé compatriote se montra ce jour-là d’une manière si notable. Lorsque la bataille fut finie, il s’entendit avec un de ses prisonniers et lui extorqua, contre la promesse tenue d’une liberté sans rançon, les noms et qualités des autres captures qui avaient été faites. De cette façon, il acheta au comptant et bien en dessous de « leur valeur » tous ceux qui lui furent désignés comme de grands seigneurs, pour les taxer au décuple une fois qu’il les eut en son pouvoir. On peut ainsi citer : Jean de Ray, François de la Palud-Varembon, Guillaume de Vienne, sieur de Saint-Georges et de Sainte-Foix, Claude de Toches et de la Frête, Thiébaud de Rougemont, Jean de Rupt, le Sieur d’Estrabonne, Jean de Vienne, le sire de Gicon, Girard de Beauvoir, Jean de Longwy, le sire de Rahon, le Sire de Toulongeon, frère du maréchal de Bourgogne, Jean de Chissey, Guillaume d’Andelot, Jean de Chauvirey, et Jean-Louis de Montjoye tombés aux mains de leurs ennemis.17
16
Louis CIBRARIO, Économie politique du Moyen Age, Librairie de Guillaumin, Paris, 1859, p. 217. 17 Revue des sociétés savantes de la France et de l’étranger par le ministère de l’Instruction publique, [S. N.] Paris, 1856-1882, p. 31.
93
Parmi ceux que Rodrigue mit à rançon, relevons particulièrement les noms de deux personnages de haute lignée : François de la Palud et Guillaume de Vienne. Le premier de ces chevaliers était plus connu sous le nom de son fief d’origine : Varambon, petite cité fortifiée, baignée par la rivière d’Ain. François de La Palud conduisait les troupes de Savoie. La journée d’Anthon lui fut particulièrement funeste. L’issue de la bataille le réduisit à la ruine totale. Sa mère fut en effet obligée d’ajouter huit mille florins en or de bon aloi à la somme que Varambon avait déjà donnée pour se tirer des mains du Castillan. Mais le plus horrible pour lui, c’est qu’il eut le visage ravagé par une si effroyable taillade, qu’elle lui emporta le nez. Depuis lors, pour se montrer sans que l’effroi gagne son entourage, il dut porter un nez d’argent. Quand à Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges, bailli général de Bourgogne, il sut ce qu’il en coûtait d’être l’héritier du nom le plus illustre du duché. Sa délivrance fut mise à un prix si élevé que, pour parfaire la somme, il fallut quêter partout. La famille était épuisée par ce genre de dépense : une rançon du père, quelques années auparavant, avait coûté soixante mille écus. Le duc et la duchesse de Bourgogne consentirent à tendre l’escarcelle en faveur du prisonnier. La preuve des démarches accomplies par eux auprès du gouvernement anglais existe dans une lettre de la duchesse au cardinal de Winchester.18 Mille deux cents chevaux harnachés et quantité d’armures furent vendus, trois jours après, sur la place de Crémieu. Raoul de Gaucourt, Imbert de Groslée et Rodrigue de Villandrando se partagèrent cent mille florins d’or et de rançons. Le reste du butin fut distribué aux vainqueurs. Des chants populaires qui, dit-on, se répétèrent longtemps dans les montagnes dauphinoises, célébrèrent la bataille d’Anthon. Tout autant que la victoire de Jeanne d’Arc à Orléans, cet évènement eut une portée considérable. Il sauva l’entière province du Dauphiné de la domination anglo-bourguignonne en coupant toute possibilité de communication ennemie sur le flanc est du royaume. Son importance fut décisive pour l’avenir de Charles VII et la dynastie des Valois. De plus, la victoire conserva au roi de France la grande cité lyonnaise à une époque où les affaires étaient si désespérées. 18
Ibid. VALLET de VIRILLE, Histoire de Charles VII, Tome II, p. 265.
94
Le 9 juillet suivant, Humbert de Groslée écrivit de Vinzelles non loin de Mâcon, aux conseillers de sa ville de Lyon, pour les informer que lui et le gouverneur avaient reçu l’obéissance de plusieurs lieux et villages, et, Dieu merci ! L’on peut venir de Lyon à Mâcon sans trouver forteresse qui ne soit de l’obéissance du roi. À la fin du mois, Rodrigue de Villandrando, Raoul de Gaucourt et Humbert de Groslée firent une entrée triomphale à Lyon. La ville entière, les bourgeois et les consuls en tête leur offrirent des présents. Enfin, un an plus tard, des chansons populaires circulaient dans les cabarets. Charles VII veilla personnellement à ce qu’elles ne soient pas réprimées. Par lettres données à Poitiers et datées du 17 juillet 1431, il défendit aux officiers de l’archevêché de mettre par amende les habitants de Lyon, et de les laisser chanter des chansons de réjouissance sur la défaite du prince d’Orange.19 Épilogue Peu échappèrent au fer des vainqueurs, et ceux qui cherchèrent un refuge dans les bois ne furent pas plus heureux que ceux qui périrent dans les flots du Rhône. Lorsqu’en 1672, les paysans abattirent un chêne de la forêt des Franchises, ils trouvèrent, à leur grande surprise, dans le creux de celui-ci le corps d’un combattant orangiste qui avait voulu échapper aux Dauphinois en s’y cachant. Dans la débandade, l’homme s’était réfugié dans le creux du grand tronc. Malheureusement pour lui, empêtré dans son armure, il y était resté bloqué. L’arbre, coupé deux siècles plus tard, laissa à découvert ce pauvre guerrier dont les os à demi consumés étaient pourtant encore enveloppés de leur linceul de métal.20 « À la fin du XIXe siècle, un historien régional, Jean François Payet, a établi un plan des charniers qu’il avait découverts à proximité du champ de bataille. En 1954, des habitants ont encore mis à jour une
19
A. PERICAUD Ainé, Notes et documents pour servir à l’histoire de Lyon 13501493, Imprimerie de Pélagaud et Lesne, Lyon, 1839, p. 47. 20 Vicomte de LEUSSE, dans Revue du Dauphiné, Borel, Valence, 1837, T. 1, pp. 291 à 297 et Olivier PETIT, Magazine Citadelle, un autre regard sur le Moyen Âge, No° 3, juillet, 2000.
95
dague avec un pommeau fleurdelisé près de laquelle gisait un squelette ».21
21
Jean-Jacques TIJET, Les batailles près de Lyon, la bataille d’Anthon, 2011, p.13. www.slideshare.net/JeanJacquesTijet.
96
-3 Un pan de mur sur un promontoire Dominant la confluence Ain/Rhône, les ruines fantomatiques de la forteresse d’Anthon dressent leur squelette de pierre et demeurent aujourd’hui l’ultime témoin de la perte du prince d’Orange. Photo F. Monatte. En 1601, le rattachement de la Bresse et du Bugey à la France fait perdre à Anthon son statut de poste frontière. En 1633, la forteresse est détruite sur ordre de Richelieu.
97
-4 La bataille d’Anthon 11 juin 1430 Croquis F. Monatte, d’après des données communiquées par les responsables du musée de Hières-sur-Amby. -1 Aile gauche lombarde commandée par Georges Boys et Burnon de Caqueran. -2 Avant-garde commandée par Rodrigue de Villandrando et les routiers Valette et Churro. -3 Aile droite dauphinoise et lyonnaise commandée par le baron de Maubec. -4 Mouvement de tenaille exécuté par Raoul de Gaucourt et Imbert de Groslée. -5 Arrivée et fuite de l’armée orangiste. -6 Les pointillés représentent les taillis et les bois disparus depuis 1430.
98
COLLECTION D’ARMES RETROUVEES SUR LE SITE DE LA BATAILLE D’ANTHON1
-5 Nomenclature de gauche à droite et de haut en bas : -
96-11-12 : Carreau d’arbalète triangulaire en fer, 66 mm. 96-11-16 : Carreau d’arbalète triangulaire en fer, 62 mm. 96-11-10 : Carreau d’arbalète pyramidal en fer, 74 mm. 96-11-5 : Pointe de lance en fer, 112 mm. 96-11-7 : Pointe de lance en fer, 115 mm.
Le plus grand objet ne possède pas de numéro d’inventaire et mesure 370 mm. Il pourrait s’agir d’une hallebarde. À sa base, on distingue ce qui pourrait être une douille (éclatée), permettant d’emmancher ce fer à l’extrémité d’une hampe de bois. -
96-11-11 : Dague en fer, 284 mm. 96-11-8 : Long carreau d’arbalète en fer, 144 mm. 96-11-15 : Carreau d’arbalète triangulaire en fer, 68 mm. 96-11-13 : Carreau d’arbalète pyramidal en fer, 51 mm. 96-11-14 : Carreau d’arbalète pyramidal en fer, 59 mm.
1
Les clichés de la collection d’armes de la bataille d’Anthon sont reproduits avec l’aimable autorisation du musée de Vienne et de la maison du patrimoine de Hières-sur-Amby.
99
-6- Dague à double tranchant.
100
-7- Pommeau de dague avec sa fusée de fer (gaine de fil enroulé sur le fuseau).
101
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 2
Fig. 4
- 8 Le pommeau comporte quatre décors mettant en scène des personnages. Ils composent une sorte de fresque qui peut être interprétée comme le reflet de l’existence de leur énigmatique propriétaire. - La figure 1 est particulièrement intéressante avec la représentation d’une ancre de marine. Cet élément nous indique que son possesseur avait des liens ou des racines maritimes auxquels il était visiblement attaché. Ceci souligne l’extrême diversité d’origines et la mixité des combattants de la bataille d’Anthon qui, comme nous l’avons vu, venaient tous d’horizons différents. Rodrigue lui-même n’avait-il point commencé sa carrière sur des navires marchands ? - La figure 2 représente un personnage féminin. - La figure 3, endommagée par la corrosion, est difficile à interpréter. - La figure 4, en soulignant parfaitement la forme ovale de l’écu, permet de penser qu’il peut s’agir d’une représentation féminine. Les formes circulaires, en vogue au XVIIIe, apparaissent cependant dès le XIIIe siècle2 avec les premiers Valois. 2
Hervé PINOTEAU, Introduction à l’héraldique, « Dictionnaire des noms de famille », Vernoy-Arnaud de Vesgre, Athena & Idegraf, Suisse, 1980, p. 758.
102
- 9 Stèle commémorative de la bataille d’Anthon. Photo N. Bourg.
- 10 La confluence Ain/Rhône qui vit la fuite éperdue du prince d’Orange. Photo N. Bourg.
103
- 11 Ruines du château de Pusignan. À la suite de la victoire d’Anthon, Rodrigue reçut par décret royal, le 7 mars 1431, la concession en règle de la seigneurie de Pusignan. Photo N. Bourg.
104
LE PRIX DE LA DEFAITE La capitulation de la principauté d’Orange Transcendés par le goût de la victoire, les capitaines de Charles VII semblaient bien décidés à poursuivre un avantage si nettement acquis. À peine la bataille d’Anthon était-elle consommée qu’ils se séparèrent, dans un premier temps, afin d’aller chacun de son côté réduire les places où le prince aurait encore pu trouver des points d’appui. Il fallait en quelque sorte assainir la province en coupant toutes les bases de ce qui pouvait rester de l’entente orangiste, du moins en apparence. En effet, pour sa part, Rodrigue prit la direction de Lyon comme s’il se proposait de porter la guerre en Bresse1. Il laissa courir le bruit dans son camp qu’il avait reçu pour mission de punir le duc de Savoie de sa connivence avec le prince d’Orange. Tous les rapports des espions bressans évoquèrent alors avec terreur l’irruption de ses routiers comme imminente. Mais l’intention première de notre capitaine n’était que de déjouer un dessein qu’on attribuait au duc de Savoie lui-même. La rumeur disait que celui-ci souhaitait s’emparer de Belleville en Beaujolais, enclave de la maison de Bourbon en plein pays bourguignon. Le duc de Bourgogne aurait d’ailleurs vu volontiers passer ce territoire en d’autres mains. L’engagement de Rodrigue se termina sans coup férir par l’occupation de Belleville, où Valette alla se loger avec sa compagnie. Lorsque tous les capitaines furent certains de ne plus avoir d’inquiétudes, ils se réunirent à nouveau du côté de Valence pour fondre sur la principauté d’Orange. L’armée qui avait combattu si glorieusement à Anthon se trouva encore grossie du renfort inattendu du marquis de Saluces, héritier de cette maison que Charles VII venait de rétablir dans ses droits, du vicomte de Tallard, du sire de Grignan, et d’une foule d’autres nobles dauphinois qui avaient de vieilles dettes
1
Ibid. Jules QUICHERAT, 1845, Pièces justificatives no I.
105
à régler avec le prince2. Le verrou d’Anthon ayant sauté, la route vers la principauté d’Orange était ouverte. Rodrigue et le sire de Gaucourt à la tête de troupes considérables prirent la route du sud. Dès la fin juin, quinze jours à peine après la bataille d’Anthon, l’armée conquérante poussant son inexorable avancée fit tomber une à une les positions tenues par les hommes du prince. Elle s’empara successivement du château de Fallavier, du vieux village fortifié de Condorcet, du fief de Curnier, de la baronnie d’Ancedune et de SaintRoman situé à cinq kilomètres à l’ouest de la petite cité fortifiée de Châtillon-en-Diois. Puis elle arriva sans obstacle majeur en vue du couvent des franciscains de Saint-Florent sous Orange qui constituait alors un faubourg au-devant des fortifications. Cette position fut enlevée « par escalade » dès le premier jour et le siège posé sur six points à la fois autour de la ville. La ruine colossale du théâtre romain formait le noyau d’une citadelle imposante. L’enceinte qui courait sur le pourtour de la cité était hérissée de tours défensives rondes, échelonnées de cinquante en cinquante pas. À leurs pieds, on voyait un grand et large fossé courant en droite ligne du levant au couchant, tandis que la muraille gagnait par des ouvrages avancés le sommet du mont. Dans certains endroits, elles étaient hautes de plus de quinze pieds. Après s’être élevées en direction du plateau, les fortifications descendaient du côté du levant, en suivant le penchant de la montagne. Elles semblaient indestructibles, car les pierres qui les constituaient étaient scellées par un ciment plus dur que le rocher. Cette situation défensive apparaissait des plus sûres. À son sommet, la colline SaintEutrope était couronnée par un château bâti en forme carrée, composé de quatre corps de logis. Celui du côté de l’orient bâti à l’antique constituait le logement du prince3. Ce château avait été construit par Jean Ier de Chalon, père du prince, sur l’emplacement d’un vieux castel du XIIe siècle. Il en avait fait consolider le donjon et les remparts pour résister aux assauts des « grandes compagnies » qui dévastaient alors toute la Provence. La population pouvait ainsi se rassembler autour de la forteresse à l'intérieur d'une enceinte dont le périmètre, en
2
Joseph de la PISE, Tableau de l’Histoire des princes et de la principauté d’Orange, Imprimerie Théodore Maire, La Haye, 1640, p. 122. 3 L. BONAVENTURE de SISTERON, Histoire de la ville et Principauté d’Orange, chez Marc Chave libraire, La Haye, 1761, p. 194.
106
raison de l’insécurité permanente, était beaucoup plus restreint qu'à l'époque romaine.
-12 Ruines de la demeure seigneuriale dominant le village médiéval de Condorcet. La famille des Baux dont est issu Louis de Chalon, prince d’Orange, améliora les fortifications au XIVe siècle, ce qui n’empêcha pas Rodrigue de Villandrando de s’en emparer au mois de juillet 1430. En 1831, le village médiéval comptait encore 600 habitants « intra-muros» avant d’être démantelé et abandonné définitivement à la fin du XIXe siècle. Photo F. Monatte.
La malheureuse capitale de la principauté, avertie des évènements terribles du Dauphiné ponctués par la déroute de leur prince, dut prévoir un nouvel assaut. Elle n’était plus seulement menacée de bandes isolées dont on annonçait facilement l’approche, mais c’était maintenant une armée colossale qui venait assaillir ses murailles pour s’emparer du château. Un mois auparavant, dès le 15 mai 1430, pressentant les évènements, le gouverneur Jacques d’Aubépine avait réuni le conseil de ville et les syndics, Jean d’Alençon, Louis Allier et Antoine Tibaut. Il y avait urgence à les entretenir du mauvais état des murailles et de l’absolue nécessité de procéder à de grosses réparations. À sa 107
demande, on nomma un conseil de guerre composé de huit délégués pour remédier à ce périlleux état de choses. Le 26 mai, le gouverneur lui-même communiquait au conseil des nouvelles alarmantes. Des gens de guerre se rassemblaient, non seulement en Dauphiné, mais en Provence et dans le Comtat Venaissin. Il disait ignorer pour quelle cause, mais la ville manquait cruellement de défenseurs et il était urgent d’en engager les travaux. La cité fut donc en état de siège complet : on répara à la hâte le château, les remparts, le vieux mur de La Clastre, les tours du Rhône et de Courthezon, les portes du pont vieux, du pont neuf, de SaintMartin, de Tourres et de Pourtoules. On acheta de l’artillerie et des armes à Avignon, des « viratons » ou traits d’arbalètes et de la poudre pour les bombardes. On enrôla des mercenaires arbalétriers et balistiers. Le trésor de la ville ne suffisant pas pour effectuer toutes ces dépenses, on frappa une taille sur les habitants et on emprunta à gros deniers. On usa de toutes les ressources possibles, on aliéna même les objets précieux. L’armée des vainqueurs d’Anthon approchait à grand renfort de troupes et les informations les plus inquiétantes couraient dans la principauté. Pendant que la ville organisait ainsi la résistance, des négociations relatives à son sort étaient entamées avec Rodrigue et Raoul de Gaucourt. Ce rapport, reproduit ci-dessous, nous renseigne précisément sur l’état des forces engagées par le Castillan. Le 29 juin, l’envoyé de la ville, Nicolas Joannis, exposa aux syndics et au conseil que l’ennemi était aux portes de la ville, mais que moyennant vingt mille florins, on pourrait le détourner de son entreprise. Le 29 juin 1430, feste de sainct-Pierre et sainct-Pol, vindrent contre la cité d’Orange, pour la prendre et destruire, avec engins, bombardes et eschelles et aultres, le sieur de Gaucourt, gouverneur du Dauphiné avec plusieurs, mesme un capitaine de rotiers appelé Rodrigue conduisant onze cents hommes de traict et deux cents hommes d’armes, le sieur de Grignan, marquis de Saluces, lesquelz assiégèrent la ville en diverse parties, tellement que la ville fut contraincte de se rendre audit gouverneur et aussi le chasteau de Monseigneur le prince duquel estoyt gouverneur Jacques de Laubespine.4 4
L. DUHAMEL, dans Revue du Midi, Religion, Littérature, Histoire, GervaisBedot, Nîmes, 1887-1914, No°1, 1914/01, pp. 239-241 et pp. 287-300.
108
Lorsque les habitants d’Orange virent l’ennemi envelopper la ville de tous côtés, ils réalisèrent que leur prince était bien loin, que les passages lui étaient fermés pour venir les secourir, enfin qu’il valait mieux abdiquer plutôt que de subir l’assaut dévastateur de ces hommes d’armes qui se réclamaient du royaume de Charles VII. Le 3 juillet, Raoul de Gaucourt reçut les clefs de la ville, des mains des syndics en gage de soumission. Les vainqueurs firent leur entrée au-devant d’une foule craintive et angoissée que les autorités avaient rassemblée en signe de bonne volonté sur leur passage. Lorsqu’on fut arrivé à la grande salle du château, Gaucourt, entouré de Rodrigue et de l’ensemble des capitaines dauphinois, nomma de nouveaux fonctionnaires. Au nom du roi Charles, il reçut les serments d’allégeance des places de Jonquières, Gigondas et Courthézon, qui se soumirent sans concession à l’exemple de leur capitale. Cette conquête, rendue si facile par l’absence et l’anéantissement des troupes du prince, fut conclue sans violence. Sa mission accomplie, Raoul de Gaucourt se retira, laissant au nom du roi deux gouverneurs pour la ville. Mais à peine était-il parti qu’une sédition éclatait à Orange. Les gouverneurs furent expulsés. Le gouvernement de Charles VII fut contraint de transiger. Deux arbitres furent désignés : François de Conzié, archevêque de Narbonne et légat d’Avignon ainsi que l’évêque d’Orange. Mais les souffrances n’étaient pas encore terminées pour les malheureux habitants des terres de la principauté. Il faut dire que notre capitaine castillan n’abandonnait jamais rien des opportunités qui lui étaient offertes. Malgré les clauses de sa capitulation, la ville était accablée de charges car Rodrigue et ses compagnons avaient laissé là des bandes à leur solde qui ne cessaient d’occuper et de rançonner alentour villes et territoires. De plus, il avait fallu réparer les dommages causés par le siège et se concilier les faveurs des occupants par des présents al guovernador dal Daufinat et ha Rodrigo.5 Et pourtant, Orange ne devait pas tarder à se relever et c’est bien là un des exemples des revirements constants de cette époque, où rien n’était définitivement acquis ! Les plus belles marches victorieuses d’un jour pouvaient se défaire le lendemain, en raison des mouvements incessants de troupes indépendantes, conduites par des chefs affranchis de l’autorité monarchique. Mais aussi en raison du 5
Ibid. L. DUHAMEL, No 1, 1914/01, pp. 239 à 241 et pp. 287 à 300.
109
morcellement des domaines ou bien des alliances qui se faisaient et se défaisaient au gré des intérêts de chacun. On voit donc que cette conquête fut une suite brillante, mais peu durable, de la défaite du prince d’Orange. Aussi n’en parla-t-on guère dans le Royaume. Toutefois, Rodrigue retira beaucoup d’avantages de l’ensemble de ces campagnes et à cela, il n’y avait pas que des raisons militaires. Au lendemain de la défaite de Jeanne d’Arc devant Compiègne, il fut l’objet de toutes les conversations, car il est à noter que la Pucelle fut capturée le jour même où les routiers de Rodrigue quittaient Annonay pour se lancer à la conquête du Dauphiné. Contrecarrant l’amère défaite de Jeanne d’Arc, le bonheur fut pour lui de remporter une éclatante victoire au nom de Charles VII. On sut partout la part considérable que Rodrigue de Villandrando avait eue dans le gain de la bataille. Quelques-uns allèrent même jusqu’à lui en attribuer tout l’honneur6. Si la grande Histoire ne l’a pas retenu, il est une certitude : ses contemporains le connaissaient bien. Redouté ou admiré, ils le hissaient au niveau des plus grands capitaines de leur temps. Par une distinction rare pour l’époque, il reçut le témoignage public de la reconnaissance du Dauphiné. Un vote des États de cette province lui adjugea la propriété du château et de la châtellenie de Pusignan, confisqués à Alice de Varax pour forfaiture7. C’est cette dame en effet qui avait ouvert le château aux Orangistes. On ne peut pas douter que Charles VII n’ait accueilli avec une extrême satisfaction la nouvelle de la victoire remportée au nom de ses armes. Mais une autre personne de l’entourage immédiat du roi dut aussi s’en réjouir au plus haut point. Ce fut le seigneur de La Trémoille. Ce favori était investi d’un pouvoir de plus en plus absolu sur la direction de toutes les affaires du royaume. Et depuis peu, il portait lourdement la responsabilité d’une suite de revers essuyés par le roi, alors qu’il avait intrigué pour la mise à l’écart de Jeanne d’Arc. La défaite du prince d’Orange arrivait donc à point nommé ! Elle allait lui servir à justifier sa politique. Il sut même y puiser l’audace et la force de se débarrasser, par un coup 6
Don CALMET, Chronique de Metz, Histoire de Lorraine, 1728, preuves 207, T. II : « En celle année fu vaincus le princeps d’Orange par Rodrigo, ung capitaine de France ». 7 Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, Note 2, p. 55 : « La plassa et terra de Pusignac en el Dalphiné, que le fu ballea et dounaa per les trois Etats du Dalphinea et confimea per le roy et le daulphin. ».
110
d’État, de plusieurs familiers du roi qui lui portaient ombrage8. Un service de cette importance rendu au monarque et à son ministre semblait appeler une récompense peu commune. Cependant, on ne relève pas que Rodrigue de Villandrando, après la victoire d’Anthon, ait reçu autre chose que le titre d’« écuyer de l’écurie du roi » dont le principal avantage était de donner au titulaire ses entrées à la cour. La vérité est probablement attachée à son caractère. Rodrigue était avant tout un guerrier, bien loin des intrigues et des complots de cour comme il saura le démontrer tout au long de son existence. Cependant, un point reste obscur. Rodrigue, si peu rémunéré pour ses services, si fermement résolu à ne jamais échanger sa vie de combattant contre une vie de courtisan, ne cessa cependant de mettre sa personne et son épée au service de Georges de La Trémoille. On peut penser que le puissant ministre se servit de la victoire remportée par Rodrigue pour s’attirer les faveurs du roi. En effet, en s’attachant la fidélité de Rodrigue, il s’attribuait une part de ce succès, repoussait l’influence des grands féodaux et courtisans en arguant que, par les mains du capitaine castillan, le royaume de France avait été préservé du démembrement. Rodrigue n’en fut probablement pas dupe, mais cela servait ses propres intérêts. Rodrigue se lia avec ce seigneur comme s’il avait été reconnaissant de quelque obscur bienfait, et cela au risque de compromettre l’amitié que lui avait témoignée jusque-là le comte de Pardiac. Mais notre capitaine, en fin stratège, en prévoyait la conséquence, ce fut l’impunité assurée à ses routiers pour tous les désordres auxquels ils pourraient se livrer tant que le seigneur de La Trémoille resterait au pouvoir. Il assurait ainsi la continuité de sa compagnie et consolidait sa puissance. Rodrigue, en vertu du titre dont il venait d’être décoré, fut incorporé à nouveau dans l’armée royale. On le chargea conjointement avec Humbert de Groslée, de la défense de la frontière bourbonnaise. À partir du mois de septembre 1430, les deux compagnons de combat ne cessèrent en effet de courir en avant sur la frontière du duché.
8
Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, note 1, p. 56 : Arrestation et mise en jugement d’Antoine de Vivonne, André de Beaumont et Louis d’Amboise, au mois d’août 1430.
111
Le prince d’Orange, artisan du rapprochement entre la Bourgogne et la France. Il convient de souligner ici que dans le combat pour la prise du Dauphiné, le prince d’Orange s’était néanmoins abstenu de suivre l’exemple du duc de Bourgogne qui avait pris parti pour les Anglais contre le roi Charles VII. L’échec qu’il venait d’éprouver en Dauphiné lui fit comprendre qu’il n’y aurait de trêve pour lui, ni sécurité pour ses domaines, tant que le duc n’abandonnerait pas ce parti pour se rapprocher du roi de France. Il œuvra donc pour amener ce rapprochement qui, d’ailleurs, était vivement désiré par la noblesse de Bourgogne. À cet effet, Louis de Chalon se rendit auprès du roi Charles VII, qui promit de lui remettre les terres de Dauphiné à condition qu’il s’emploie à ménager l’accord entre le Roi et Monsieur le duc de Bourgogne, et qu’il serve le roi contre l’Anglois. Enfin, le 22 juin 1432, au château de Loches, un arrangement final passé entre Charles VII et le prince d’Orange fut signé par La Trémoille et les autres membres du grand conseil. Aux termes de cet acte, le prince d’Orange rentra en grâce auprès du roi de France. Louis de Chalon s’engageait à servir Charles VII avec trois cents lances garnies et trois cents hommes de traits. Il devait également s’entremettre, comme médiateur et allié, auprès du duc de Bourgogne. Une rente de 852 florins d’or était, en outre, allouée au prince sur le Dauphiné. De nouveaux juges furent nommés pour terminer judiciairement le litige. Louis de Chalon, finalement, retournait en possession de ses terres dauphinoises, à charge d’hommage envers la couronne. Il les recouvra toutes, sauf quelques places, que lui disputait le bâtard d’Orléans. Orange retourna définitivement sous la domination du prince Louis en 1436.9
9
Ibid. VALLET de VIRILLE, Histoire de Charles VII, Tome II, pp. 267, 268.
112
EPISODES BOURGUIGNONS La victoire d’Anthon avait livré l’entrée du Mâconnais et du Charollais aux troupes de Charles VII. À partir de ce moment, ces deux provinces devinrent le théâtre d’une guerre qui dura quatre ans et les couvrit de ruines. Mais revenons en cette fin d’année 1430, où le prince d’Orange ayant regagné la Bourgogne ne rêvait encore que de reconquérir ses biens perdus. La compagnie de Rodrigue enrôlée dans l’armée du roi aux côtés des troupes d’Humbert de Groslée, fut chargée par le souverain de poursuivre son avantage sur les terres mêmes de l’ennemi bourguignon. Rodrigue prit donc ses quartiers sur un territoire qui s’étendait du Charolles à Mâcon. Les ravages des deux compagnies réunies s’exercèrent principalement sur les terres de l’abbaye de Cluny. On connaît les tactiques militaires éprouvées de cette époque. Il s’agissait de s’emparer de proche en proche de fiefs fortifiés et, à partir de ces bases, de multiplier les incursions dévastatrices sur les environs. Le 14 septembre, Rodrigue jeta avec succès son armée à l’assaut de la petite cité fortifiée de Mazille, située au sud-ouest de la célèbre abbaye. Puis ce fut le tour du château de Pierreclos, propriété du duc de Savoie, solide bastion médiéval qui constituait un avantposte sur les terres clunisiennes. Ces conquêtes éclair furent encore suivies par la prise de Bois-Sainte-Marie dans le Brionnais et enfin par celle du château de Sancenay. Le pays aurait été entièrement conquis, si les deux capitaines avaient pu s’emparer de Cluny et de Paray-leMonial, mais ils tentèrent sans succès le siège des deux villes.1 Deux seigneurs avides de revanche Dans le parti bourguignon, la résistance ne tarda pas à s’organiser et bientôt les deux capitaines furent forcés de se tenir strictement sur la défensive. Le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, avait envoyé de Dijon un puissant renfort sous la conduite du vicomte d’Avallon et du 1
Joseph GARNIER, Inventaire sommaire des archives de la Côte-d’Or, antérieures à 1790, Imprimerie Paul Dupont, Paris, 1864, tome II, p. 5.
113
prince d’Orange. Le vaincu d’Anthon espérait trouver là l’occasion de racheter sa défaite. Pour seconder ces deux grands seigneurs, un troisième capitaine, issu du peuple et fort redouté, fut appelé de la Charité-sur-Loire, dont il s’était emparé depuis le mois de décembre 1423. Il tenait depuis cette date les marches de Bourgogne en fermant ainsi le passage de la Loire. Ce personnage est célèbre dans les chroniques sous le nom de Perrinet Grasset. Son véritable nom était Gressart. Il était maçon de son état2. Comme beaucoup de ses contemporains, les évènements en firent un homme de guerre que son talent et ses capacités élevèrent plus tard à la dignité de grand capitaine. En 1431, il portait le titre d’écuyer et panetier de la maison de Bourgogne. Il fit de la redoutable forteresse de Montcenis son centre d’opérations pour la défense du Charolais. Rodrigue, retranché de l’autre côté de la Loire, sut protéger à distance les places dont il s’était emparé. Par ses mouvements incessants, simulant de fausses attaques, lançant de fausses nouvelles dont s’emparait la rumeur, il réussit à tenir les Bourguignons en échec pendant plus de six mois. L’un des stratagèmes fut de faire croire à une jonction concertée entre lui et Guilhem de Barbazan, capitaine français qui guerroyait alors en Champagne pour le duc de Bar, allié du roi de France. L’état-major bourguignon fut contraint de diviser ses troupes en envoyant même des gens sur la Loire, où l’on disoit estre Rodrigue et autres ennemis à grant compaignie, pour venir devers ledit Barbazan.3 L’ennemi fut longtemps paralysé par la surveillance à laquelle cette feinte l’obligea4. Mais au bout de quelque temps, les Bourguignons ne furent pas dupes. Ils réussirent à effectuer une contre-attaque savamment orchestrée qui contraignit à son tour le
2
Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, Note 3, p. 58 : « En ce temps fu prinse la Charitésur-Loire par subtiveté et sans deffense par ung nommé Perrinet Grasset, machon et capitaine de gens d’armes de la partie des Bourguignons ». 3 Marcel CANAT, Documents inédits pour servir à l’histoire de la Bourgogne, publiés par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône, Dejussieu, Chalon-sur-Saône, 1863, tome 1, note 1, p. 307. 4 Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, note 1, p. 59 : « A Martin Jourdain, le VIIIe jour dudit mois de décembre, la somme de six frans pour aller, lui vingtiesme de hommes d’armes, sur les marches de la rivière de Loire, où l’on disoit estre Rodrigue et autres ennemis à grant compaignie pour venir devers ledit Barbasan ».
114
Castillan à partager l’effectif de ses forces. L’avantage, conservé jusque-là, fut perdu. Dans cet épisode guerrier, un autre personnage rêvait aussi de revanche et vouait une haine farouche à Rodrigue : Varambon, l’homme au nez d’argent, qui paya si cher l’échauffourée du prince d’Orange. Prisonnier de Rodrigue, on sait qu’il fut rendu à la liberté contre une énorme rançon. Dès lors, il ne songea qu’à réparer ce désastre financier par la première belle prise qui se présenterait à lui. Totalement ruiné, il l’était au point qu’on manquait de tout dans son château de Varambon. On disait même que sa fille, qui vivait à l’abandon dans cette résidence, n’avait plus de quoi s’habiller pour sortir5. Le duc Philippe de Bourgogne lui ayant confié d’abord la défense de Mâcon, il se comporta dans cette ville en vrai chef de routiers. On l’en retira sur plainte des habitants6. C’est alors qu’il prépara avec l’approbation du gouvernement anglais le coup qui devait lui rendre, selon ses calculs, l’équivalent de ce qu’il avait perdu. Ayant ses propriétés en Bresse, il connaissait l’état du pays des Dombes, dépendance de la couronne ducale de Bourbon. Mais cette enclave était défavorablement placée à cause de son isolement sur la rive gauche de la Saône. Sans tenir compte de la paix qui s’était rétablie entre le duc de Bourbon et le duc de Savoie, Varambon, vassal de la Savoie, mais plus bourguignon que bressan, trouva légitime de porter la guerre dans les Dombes. En conséquence, il réunit une armée de pillards qu’il amena sous les murs de Trévoux dans la nuit du 18 mars 1431. La ville, où l’on ne s’attendait à rien de pareil, fut prise par escalade. Le vainqueur après l’avoir dévastée, s’y établit fortement, sans toutefois pouvoir s’emparer du château. Le duc Charles de Bourbon n’eut pas assez des forces conjuguées de ses vassaux pour le chasser de là. Il lui fallut l’assistance des routiers de Rodrigue. Le Castillan abandonna donc ses positions pour se porter au secours du duc vers la ville de Chalon. Si bien que, pendant qu’on recouvrait Trévoux, on fut obligé de se découvrir et d’évacuer les places conquises du Mâconnais et du Charolais. 5
Ibid. Joseph GARNIER, Inventaire sommaire des archives de la Côte-d’Or, antérieures à 1790, Imprimerie Paul Dupont, Paris, 1864, tome III, p. 85 : « Dépense du bailli de Bresse, qui était allé en armes avec quelques chevaliers à Varambon pour y prendre la fille de Varambon et la conduire à sa grand-mère, Aymarde de La Baume. Cette commission ne put être exécutée, parce que la jeune fille fut trouvée dépourvue de vêtements et presque nue ». 6 Ibid. Marcel CANAT, Documents inédits, etc., pp. 202-204.
115
Au même moment, Louis de Chalon, prince d’Orange, qui se trouvait au Mont Saint-Vincent, fut averti du mouvement de Rodrigue par le bailli de Chalon. Il leva aussitôt des gens d’armes et fixa la concentration des troupes au 20 mars 1431, près de Chalon. On amena également vers cette ville plusieurs engins de guerre et de l’artillerie : la bombarde du prince d’Orange fut charroyée de Lons-le-Saunier à Tournus et de là, à Chalon. On expédia, de Dijon à Saint-Jean-deLosne, une autre bombarde appelée Prusse, puis de Saint-Jean-deLosne un « navetier » mit encore neuf jours pour l’acheminer jusqu’à Chalon. Les pierres, destinées à remplacer les boulets trop coûteux, furent fabriquées à Saint-Laurent-les-Chalon. On se procura encore quatre couleuvrines et plusieurs veuglaires qui étaient des pièces d’artillerie de petit calibre plus aisément maniables que la bombarde. Louis de Chalon fit conduire une partie de cette artillerie devant le fort de Sancenay, près de Paray-le-Monial, dans lequel résidait une garnison laissée par Rodrigue. Il vint ensuite diriger les opérations. Le prince d’Orange avait établi son quartier général à Oyé. De là, il envoyait des espions qui le servoient fidèlement, surtout ceux qui étaient à Lyon, à Anse et à Villefranche. Les troupes du prince d’Orange attaquèrent Sancenay, s’en emparèrent et délogèrent les ennemis du fort ; le prieur de Sancenay ayant été pris dans l’affaire, ledit prince le fit brûler7. Ce prieur avait, disait-on, « des intelligences » avec les partisans du Roi et favorisait leurs entreprises en Charollais. Comme nous le voyons, recourir au service de l’espionnage était une pratique fort usitée à cette époque. La guerre de Cent Ans fut une période d’emploi fréquent d’observateurs, souvent des « gens du cru » soudoyés et qualifiés dans les sources d’espié. Celui qui veut fomenter se sert d’émissaires, celui qui veut savoir se sert d’espions, disait-on. Mais ces gens couraient à coup sûr un risque énorme. On employait souvent des moines et des femmes pour épier les mouvements de l’ennemi, pour porter des avis et pour demander des secours. L’habit des uns et le sexe des autres étaient une sauvegarde au milieu d’hommes au cœur religieux et au caractère chevaleresque. Et lorsqu’il s’agissait de faire soulever un pays ennemi, de s’emparer d’une forteresse au moyen d’un accord avec ceux qui l’occupaient, souvent un guerrier hardi risquait sa vie sous les vêtements empruntés à un moine. La plupart du temps, les espions capturés étaient 7
Ibid. Marcel CANAT, Documents inédits, etc., pp. 210 et 311.
116
condamnés à périr, étouffés par la corde ou consumés par le feu. Mais c’était quelquefois pire ! : L’espion pris dans les camps assiégeants était lancé au moyen d’une machine de guerre, dans la ville assiégée. Quant aux traîtres qui avaient servi de guide aux ennemis et aux fauteurs de troubles, ils perdaient le pied ou la main ou bien alors on les enterrait vivants la tête en bas, les pieds sortant de terre8. Seuls les personnages importants pouvaient espérer garder la vie sauve contre le versement d’une énorme rançon. Le 22 avril, le comte de Clermont, après avoir quitté Villefranche, se replia sur le Charollais. Il se trouvait à cette date à Thizy-enBeaujolais. Une autre partie de son monde, sous la conduite de Rodrigue, de Valette, du bailli de Lyon et de Pierre de Charre, était logée à Charlieu, mais personne n’était en mesure de savoir ce qui allait se passer, car le dessein dudit comte n’était pas encore bien décidé. Curieusement, Charles de Bourbon n’inquiéta pas le Charollais. Accompagné du seigneur d’Albret, du bâtard d’Orléans, il prit, peut-être de guerre lasse, la route de Moulins en Bourbonnais. Les forces du duc de Bourbon étaient pourtant fortes de six à sept mille hommes, mais il leur défendit de courir sur les pays du duc de Bourgogne jusqu’à un certain temps.9 Dans toute cette région, il ne serait pas resté aux partisans de Charles VII un seul pouce de terrain, si quelques-uns, au cours de la retraite, n’avaient trouvé l’occasion de se saisir de la ville de Marcigny. Ils y postèrent une garnison que tous les efforts des Bourguignons ne parvinrent point à déloger. Contrairement aux ordres du duc de Bourbon, nécessité faisant loi, cette garnison opéra encore quelques ravages et pillages dans les campagnes. Ainsi, dans une tentative sur Charolles, elle prit environ deux cents grosses bêtes, et fit encore une vingtaine de prisonniers.10 On constate que dans ces escarmouches sans fin, où l’on conquiert, puis l’on perd pour reprendre à nouveau villes et places 8
MEMOIRES, Société d’Histoire, d’Archéologie et de Littérature de l’arrondissement de Beaune, 1874-1904, Vol. 1897, p. 213. 9 Ibid. MEMOIRES, Société d’Histoire, arrondissement de Beaune, 1897, pp. 213, 214. 10 Ibid. MEMOIRES, Société d’Histoire, arrondissement de Beaune, 1897, pp. 213, 214.
117
fortes, il semble n’y avoir jamais eu de vainqueurs définitifs. Cet épisode bourguignon se solda par des mouvements et des positions prises sans aucune bataille décisive. Rodrigue y trouva cependant encore un avantage, ce fut de resserrer un peu plus ses liens avec la maison de Bourbon. Mais notre héros venait d’être appelé par la noblesse de son camp pour régler, toujours par la force, un énième conflit. Un conflit étrange qui n’avait plus rien de commun avec ceux dont nous venons de retracer l’histoire. C’était à la fois un soulèvement populaire et social, une sorte de jacquerie sur fond de doctrine religieuse que propageaient d’énigmatiques prophètes. Ces troubles sociaux secouaient plusieurs parties du royaume.
118
LES CROISADES CONTRE LES HUSSITES Et leur extension dans le Mâconnais, le Forez et le Velay Revenons au tout début du mois d’avril 1431, Rodrigue de Villandrando est encore à Charlieu assisté de son lieutenant Valette, à la tête de sa compagnie au grand complet. Ils poussent au-devant d’eux six chariots d’artillerie. Par une lettre datée du même jour, le capitaine du château de Charolles transmet aux gens du conseil de Dijon, toute son inquiétude de voir lesdits capitaines, investir les places environnantes, pourquoi il les prie d’y pourvoir.1 Au moment où Rodrigue s’apprêtait à renforcer la défense de la place forte de Charlieu, on le vit soudain quitter les lieux à la hâte et sans raison apparente. Le Mâconnais, le Forez et le Velay étaient bouleversés par un mouvement qui voulait réformer en profondeur les dogmes de l’Église.2 Les origines du mouvement Ce mouvement puise son origine à Prague en Bohême au début du XVe siècle, où un religieux nommé Jan Hus, jeune recteur de l’université de cette ville, traduisait en bohémien les livres de l’anglican Wicklef, et prêchait une doctrine appelée le « wickléfisme ». La pensée de Wicklef représentait une rupture complète avec les dogmes de l'Église catholique romaine, alors seule institution chrétienne. En effet, celui-ci affirmait qu'il existait une relation directe entre l'humanité et Dieu, sans l'intermédiaire des prêtres. En se conformant aux Écritures, Wicklef pensait que les chrétiens étaient en mesure de prendre en main leurs vies sans l'aide du pape et des prélats. Il dénonçait de nombreuses croyances et 1
Ibid. Marcel CANAT, Documents inédits pour servir à l’histoire de la Bourgogne, 1863, Tome 1, p. 311. 2 Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, p. 61.
119
pratiques de l'Église catholique. Condamnant l’esclavage et la guerre, il soutenait que le clergé chrétien devait suivre l'idéal de la pauvreté évangélique, à l'instar du Christ et de ses disciples. On prétend que Jan Hus repoussa d’abord avec horreur la pensée de l’hérésie, mais qu’il fut séduit par deux jeunes gens arrivés d’Angleterre, pour suivre l’enseignement de l’université de Prague. Nos deux écoliers « wickléfistes » prièrent leur maître et leur hôte de leur permettre d’orner de quelques fresques le vestibule de sa maison. Ce qu’ayant obtenu, ils représentèrent, d’un côté Jésus-Christ entrant à Jérusalem sur une ânesse, suivi de la populace à pied ; et, de l’autre, le pape monté superbement sur un beau cheval caparaçonné, précédé de gens de guerre bien armés, de timbaliers, de tambours, de joueurs d’instruments, et des cardinaux bien montés et magnifiquement ornés. Jan Hus aurait donc été frappé de l’antithèse ingénieuse que cette image lui mettait sous les yeux à toute heure. Il aurait médité sur la simplicité indigente du divin maître et de ses disciples, sur « les pauvres de la terre et les simples de cœur » en opposition à la corruption et au luxe insolent de l’autocratie catholique. Il aurait été ainsi conquis par les idées de Wicklef. Aussitôt qu’il se fut mis à en répandre et à en expliquer le message, de nombreuses sympathies répondirent à son appel. En peu d’années, Jan Hus devint le prophète de la Bohême. Il prêcha ouvertement le mépris de la papauté, la liberté de la communion et des rites… L’inquisition le réprimanda et fit brûler tous les livres de Wicklef. Il n’en prêcha que plus haut et souleva maintes fois le peuple enclin aux nouveautés. Les âmes populaires, plus pressées par leur feu intérieur et par leurs souffrances matérielles, avaient vite songé à réaliser l’idée cachée au fond de cette question de dogme. Et, tandis que les classes patientes par nature et par position se contentaient de réclamer la coupe, simple symbole du jugement divin, les pauvres conduits et agités par divers types de fanatiques, s’apprêtaient au contraire à réclamer dans les actes et les faits, l’égalité et la communauté de biens et de droit. Ces exaltés avaient émis l’opinion que le prêtre était un homme comme les autres, et que tout chrétien était prêtre de son plein droit pour interpréter les mystères et administrer les sacrements.3
3
George SAND, Jean Ziska, Bruxelles, 1843, p. 31.
120
Une conséquence aggravante : le schisme pontifical et la crise religieuse Pour comprendre cette situation, il faut remonter quelques décennies en arrière. Dès le XIVe siècle, une sorte de crise intime avait agité jusque dans ses fondements la société religieuse. Le schisme pontifical durait depuis 1378. La chrétienté, pour guérir ce mal, avait eu recours aux conciles. Les grandes assemblées de Pise, de Constance et de Bâle se succédèrent sans achever cette tâche difficile. Trois principaux objets composaient le programme jalonné de longues délibérations : 1°) pacifier les princes chrétiens ; 2°) extirper les hérésies ; 3°) réformer l’Église dans son chef et dans ses membres.4 Les conciles, et en dernier lieu les papes Martin V, puis Eugène IV, s’employèrent donc avec succès à résoudre le premier de ces problèmes. Sur le second point, les rigueurs prononcées contre Jean Wicklef et Jan Hus eurent en effet raison, au moins momentanément, des novateurs. Mais ce second point se liait étroitement au troisième. Or, la réforme de l’Église s’était heurtée, surtout de la part de la papauté, à une inertie notoire et à des difficultés jusqu’alors invincibles. De graves abus régnaient autour du trône pontifical, descendant les degrés de la hiérarchie. Des enfants à peine pubères, de jeunes sous-diacres, étaient investis de l’épiscopat, entraient au Sacré Collège et revêtaient la pourpre des cardinaux. Alors, certains esprits cultivés s’ouvrirent vers de nouveaux horizons dans la pensée, la littérature, la philosophie et y introduisirent aussi le scepticisme. Tandis que les bûchers s’allumaient à Constance et ailleurs, les docteurs qui condamnaient ces hérétiques tonnaient paradoxalement contre les vices de l’Église. Appelant à haute voix la réforme, ils faisaient entendre à leur tour des nouveautés tout aussi hardies que celles de Wicklef et de Jan Hus. Cette situation générale eut en France un retentissement notable et spécial. Les grands dignitaires ecclésiastiques y donnaient l’exemple du relâchement des mœurs. Les archevêchés, les fiefs ou domaines spirituels, et beaucoup d’évêchés, avaient pour titulaires des prélats de cour, qui tout entiers attachés à la politique et à l’ambition des partis, ne connurent jamais les devoirs du ministère sacré. L’anarchie la plus 4
Ibid. VALLET de VIRILLE, Histoire de Charles VII, 1863, Tome II, pp. 389-391.
121
complète régnait quant à la nomination des prélats. Non seulement le droit d’élire était disputé aux chapitres, mais les deux rois de France, les deux ou trois papes ou antipapes, nommaient respectivement aux mêmes sièges, autant de compétiteurs. Enfin, la cour de Rome, pour alimenter le luxe et la puissance du pape temporel et des cardinaux, multipliait les actes de complaisance : la vente des indulgences, la collation des bénéfices vacants et futurs, étaient devenues entre leurs mains un vaste trafic de charges et de biens spirituels. Après avoir subi en Bohême plusieurs persécutions5, Jan Hus fut appelé devant le concile. Il comparut sur la foi d’un sauf-conduit de l’empereur Sigismond qui par cet acte voulait consolider son alliance avec Rome. Il n’en fut pas moins emprisonné dès son arrivée à Constance, pendant qu’une commission examinait ses écrits. Il fut condamné en même temps que la mémoire de son maître Wicklef. Jan Hus ne voulut point se rétracter, à moins qu’on lui prouvât ses erreurs par l’Écriture. Au-delà du concile, il en appela donc au tribunal de Jésus-Christ, et déclara qu’il aimerait mieux être brûlé mille fois que de scandaliser, par son abjuration, ceux auxquels il avait enseigné la vérité. Il fut dégradé des ordres sacrés, livré au bras séculier et conduit au bûcher sur la directive de ce même empereur qui lui avait pourtant garanti par le serment la vie et la liberté. De la pensée religieuse vers l’idéologie sociale et politique Les hussites comptaient des riches parmi eux et il y avait des pauvres chez leurs adversaires. Leurs théories socialisantes, voire communisantes, se mêlaient à des sentiments, de caractère politique autant que social, hostiles aux seigneurs d’origine allemande. La saisie du rôle spécifique de la pauvreté dans l’affaire hussite a donc exigé
5
« Les croisades contre les hussites » sont des campagnes militaires des féodaux et de l'Église catholique contre les paysans et les partisans de Jan Hus en Bohême de 1420 à 1434. Il y eut cinq croisades (1420-1421), (1421-1422, suivie d’une guerre civile en Bohême), (1425-1426), (1427-1430) et enfin la cinquième (1431-1433). La suite ininterrompue des victoires hussites semblait rendre vaine toute tentative de les faire plier par la force. De plus, le caractère populaire et égalitaire des hussites rendait les princes des pays environnants nerveux et ils craignaient la contagion de ces idées à leurs sujets. Jan Hus et Hierosme de Prague, lesquels après avoir été emprisonnés furent brûlés, le dernier ayant été enfermé un an dans un cachot.
122
des historiens une analyse sociologique du mouvement, de ses actions, des discours et des écrits de ses chefs.6 Le mouvement hussite assuma un caractère révolutionnaire dès que la nouvelle de la mort de Jean Huss, le 6 juillet 1415, atteignit Prague. Elle déclencha une guerre civile et c’est vers cette époque qu’une partie des révoltés quitta le pays tchèque. Obtenant un saufconduit de l’empereur Sigismond, convertis et prophètes parcoururent le Saint-Empire pour arriver en France, où dans les souffrances de la guerre de Cent Ans, la sédition allait revêtir au-delà du précepte religieux, un caractère social prononcé. Divers mouvements allaient s’implanter durablement sur le territoire, menaçant les seigneurs dans leurs biens et leurs fiefs, contestant leurs privilèges. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les forces militaires, et les capitaines du temps aient été appelés pour les réduire. On sait que Rodrigue fut de ceux-là. De fait, on attribue même une lettre à Jeanne d’Arc, par laquelle elle menace les hussites de tourner ses efforts contre eux s’ils n’abandonnent pas l’hérésie pour rentrer dans le sein de l’Église.7 D’autres mouvements de troupes sur le territoire témoignent encore des préoccupations, tant anglaises que françaises, dans ce combat contre l’hérésie. Ainsi, au mois d’août 1429, à son retour de Reims, Charles VII traversait le Valois. Une armée anglaise venait de débarquer en France. Très curieusement, elle semblait n’avoir aucune hostilité et ne pas vouloir combattre, elle se contentait seulement de suivre la même route que l’armée de Charles VII. Cette armée anglaise, chose surprenante, était une armée de croisés. Le cardinal de Winchester, légat du Saint-Siège contre l’hérésie de Jan Hus, venait de la lever aux frais de l’Église, dans le but déclaré de la conduire en Bohême pour la cinquième croisade contre les hussites. Mais aussitôt qu’elle fut sur pied, le régent du roi d’Angleterre lui réclama cette armée en renforcement des troupes qu’il avait déjà sur le royaume de France. Le prélat consentit à la prêter pour six mois, moyennant que l’on rende au pape l’argent
6
MOLLAT Michel, Les pauvres au Moyen Âge, Éditions Complexe, (www.editionscomplexe.com), Vol. 1, 2006, p. 256. 7 Theodor SICKEL, Lettre de Jeanne d’Arc aux Hussites, Bibliothèque de l’école des Chartes, 1861, Vol. 22, No 22, p. 81.
123
qu’elle avait déjà coûté. Elle fut donc « détournée » sur Paris et mise aux ordres du duc de Bedford par le cardinal lui-même.8 Les sources du conflit à travers le paysage rural du royaume de France Au XIVe siècle, à la grande épidémie de la Peste noire qui a décimé les populations s’ajoutent les malheurs de la guerre de Cent Ans. Les campagnes se vident, les terres sont abandonnées aux broussailles et aux bêtes sauvages. On estime que la moitié des terres cultivées, soit 5 millions d’hectares, sont retournées en friche et que de 1000 à 3000 villages sont rayés de la carte.9 À l’arrivée du conflit centenaire, ce furent les populations et les espaces les plus vulnérables qui furent frappés au premier chef, autrement dit les campagnes et les villages. Il est certain qu’au cours des dévastions sans fin menées par une soldatesque incontrôlable, des villageois, hommes, femmes, enfants connurent une mort violente, éventuellement après avoir été emprisonnés et torturés. La guerre entraîna des déplacements de population, souvent opérés dans les pires conditions, d’où la forte mortalité qui parfois les accompagnait. Les exemples ne manquent pas de pays ou de villages presque vidés d’hommes en raison de la guerre endémique. Dans les années 1430, Jean Juvénal des Ursins, évêque-comte de Beauvais, expose par exemple que dans sa région il ne reste qu’un habitant sur cent et qu’un habitant sur dix pour l’ensemble du royaume10. Le peuple du « plat pays » n’en peut plus ! Au début des années 1400, le manque de main-d’œuvre se fait cruellement ressentir. La famille traditionnelle n’a plus assez de bras pour exploiter une terre devenue trop vaste, qu’il fallait de surcroît à nouveau défricher. On assiste alors à un regroupement des communautés familiales qu’on appelait parsonnières ou frérèches. Ces communautés familiales qui pouvaient compter jusqu’à 40
8
Jules QUICHERAT, La chronique des Cordeliers de Paris, « Revue historique », Paris, 1882, T. 19. 9 E. LE ROY-LADURIE, Histoire des paysans de France, Seuil, Paris, 2002, pp. 41-43. 10 Jean JUVENAL des URSINS, Écrits politiques, T. 1, Paris 1978, p. 58.
124
personnes, parfois jusqu’à 16 ménages11, habitent pour partie sous le même toit et prennent leurs repas en commun. Ces frérèches formeront à partir de 1420 environ et jusqu’au XVIIe siècle, la structure de base du fermage et du métayage. Entre Loire et Rhône Sur ce terreau favorable, l’hérésie rassembla alors de nombreux adeptes et essaima depuis le Mâconnais, jusqu’en limite des régions bordant la Saône et la Loire. Ses débuts furent singulièrement orageux car elle servit de centre de ralliement, non seulement à ceux qui voulaient pousser à l’extrême les principes contenus dans la doctrine, mais encore à tous ceux qui, souffrant des iniquités sociales, aspiraient à la rédemption de toutes les servitudes. Il semble que dès 1422, la région de Mâcon ait été touchée. Une fermentation dangereuse s’était manifestée dès le temps de la mort du feu roi Charles VI. À plusieurs reprises, pendant les dix dernières années, la force dut être employée, dans le Mâconnais et autour de Lyon, à disperser des rassemblements excités par des prédicateurs de robe courte, qui démontraient que la malédiction prononcée contre Adam avait atteint tous les hommes, sans exception de nobles ni de clercs ; que chacun était tenu de gagner son pain à la sueur de son front ; qu’il ne fallait plus de seigneurs et qu’un seul prêtre suffirait pour le service de chaque paroisse.12 La même année, Humbert de Groslée, compagnon d’armes de Rodrigue, bailli de Mâcon et sénéchal de Lyon, écrivait une lettre à ses très chers frères et bons amis les conseillers de la vile de Lyon, de Saint Jehan de Pannetière, datée du 8 juin, dans laquelle il rendait compte de la poursuite qu’il avait faite des bandes de brigands dans le Forez. Il avait interrogé leur chef, lequel lui avait répondu, qu’il estoit d’intention de destruire toute noblesse, puis après les prestres, excepté en chacune paroisse ung, et puis après tous les bourgeois, marchands, gens de conseil et autres notables de bonnes villes.13
11
Mario ROSSI, Les noms de lieux du Brionnais-Charolais, témoins de l’histoire du peuplement et du paysage, Publibook, Paris, 2009, pp. 168-169. 12 Pierre de SAINT-JULIEN de BALLEURE, De l’origine des Bourgongnons, Nicolas Chesnay, Paris, 1580, p. 476. 13 Ibid. J.-B MONFALCON, Histoire monumentale de la ville de Lyon, 1866, tome II, p. 285.
125
Entre Loire et Rhône, le mouvement hussite vint inévitablement se superposer aux problèmes sociaux insurmontables. En effet, les impositions extraordinaires concédées aux efforts de guerre, suivies de pillages et exactions ; la magnificence de la religion affichée face à la misère ; les privilégiés échappant aux charges dont le pauvre était écrasé : tout cela ne fit que renforcer dans l’opinion populaire l’idée d’une nécessaire réforme. Dans le Forez et le Velay L’hérésie, propagée dans les montagnes du Forez et du Velay, aboutit à une explosion populaire d’une violence extrême. L’historien De La Mure a mentionné cette perturbation sans en dire autre chose, sinon qu’elle fut l’ouvrage de bandits qui étaient de la secte dont il est parlé au troisième tome des Conciles, lesquels, soutenant qu’il ne devait point y avoir d’inégalité de condition parmi les hommes, s’attaquaient aux gens d’Église et aux nobles, assaillaient les châteaux et maisons fortes et y faisaient des hostilités épouvantables14. Ces insurgés furent taillés en pièces par la noblesse forezienne. On peut hardiment donner pour auxiliaires aux nobles du Forez, ceux du Bourbonnais assistés par les routiers de Rodrigue, c'est-à-dire toute l’armée réunie à Charlieu. Il est à noter que celle-ci fut empêchée par cet incident de servir à la guerre de Bourgogne en vue de laquelle elle avait été formée. Outre la levée d’un impôt extraordinaire dont le capitaine espagnol eut sa part15, un autre indice désigne l’implication de ses routiers dans les actions répressives. Il est dans ce fait avéré que, vers ce temps-là, ils se transportèrent, en remontant la Loire, jusque dans le Forez et le Velay.16 Dans ces deux provinces, si les cités closes recevaient quelque soulagement dans leurs misères à l’abri des murailles dont elles se couvraient, dans les campagnes régnait une totale désolation. Sous la 14
MURE (de La), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, Potier, Paris, 1809, tome I, p. 147. 15 Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, note 2, p. 62 : « Notice des sommes payées à Georges Boix, à Rodrigo, au comte de Clermont, à Guichard de Mazé seigneur de Greysieu, et autres, sur les impôts levés en Forez au mois de septembre 1431 et au mois de juin 1432 ». 16 Ibid. Jean JUVENAL des URSINS, Écrits politiques, tome 1, Paris, 1978, p. 58.
126
conduite de prédicateurs, les peuples du plat pays se soulevèrent en masse et émurent grand tumulte, tuant autant de gens d’Église et de nobles qu’ils en pouvaient atteindre, sans discrétion d’âge ni de sexe ; ils assaillaient les châteaux et maisons fortes, et, s’ils pouvaient entrer, les détruisaient, brûlaient les titres, livres, terriers et tout autre enseignement, sans oublier de piller les meubles et butiner tout ce qu’ils rencontraient. Avec, ils mettaient en fait que quand il fut dit à Adam qu’il mangerait son pain à la sueur de son visage, tous hommes furent compris dans cette malédiction, et partant, que les nobles n’en sont exclus, mais doivent travailler s’ils veulent vivre. Et quant aux gens d’Église, qu’il y aurait assez de deux presbytères en chacun desdits comtés ; de sorte qu’ils prétendaient une égalité entre les hommes, et partant, la distinction d’état non recevable, à moins que les uns soient seigneurs et les autres sujets, ou que les uns travaillent et les autres ne fassent rien. Cette idéologie fut considérée comme des plus dangereuses pour le système féodal ! Alors, contre eux, on assembla des troupes en masse, composées de quantité d’hommes de fer, lesquels, aidés et secondés par les deux états assaillis, firent en sorte que les mutins et rebelles furent mis en déroute, écartés comme perdreaux, et autant on en trouvoit, autant on en tuoit.17 D’autres actes nous ont conservé la mémoire d’une dévastation commise près de la ville fortifiée de Montbrison qui semble bien se rapporter au soulèvement du Forez. Une montagne isolée, appelée à cause de sa configuration Saint-Romain-le-Puy, se présentait avec un triple étage de fortifications : au sommet un redoutable château protégeait un prieuré bénédictin, au-dessous le bourg primitif était enveloppé de murailles élevées, tandis qu’au bas une autre enceinte fortifiée entourait la basse-cour qui était en temps de guerre le refuge des habitants de la campagne. Au moment où cette basse-cour était pleine de fugitifs qui tentaient d’échapper aux persécutions sociales et religieuses, les gens d’armes de Rodrigue fondirent sur eux. Ils éliminèrent les hommes, firent leur proie des provisions et du bétail. Ils laissèrent les lieux dans un état de délabrement que d’autres compagnies, « finissant l’ouvrage », changèrent en destruction complète. La relation n’ajoute rien de plus, sinon que la population
17
Auguste BERNARD Jeune, Histoire du Forez, Bernard Aîné, Montbrison, 1835, volume II, pp. 44-45.
127
rurale, qui commençait à reparaître en 1433, demanda pour sa sécurité le rétablissement du refuge de Saint-Romain.18 C’est au cours d’une des expéditions de Rodrigue en Velay, destinée à extirper les hussites, que s’est propagée la légende suivante. Sur une sinuosité du fleuve qui séparait autrefois les deux provinces, le village d’Aurec s’accroche au flanc d’un petit promontoire. L’église est une des plus anciennes de la contrée. On y voyait autrefois, plantée dans l’un des battants de la porte, une bossette en cuivre doré, au sujet de laquelle se débitait un conte que nous allons rapporter, car Rodrigue en est le personnage central. Un certain seigneur espagnol, nommé Rodrigue de Villandrando, étant entré, avec un faste impie, dans l’église d’Aurec qui est sur l’extrémité du Velay, près de ce pays de Forez, et ayant sacrilègement attaché son cheval à l’image en relief de Saint-Pierre qui était sur l’autel, ce cheval devint si furieux que Rodrigue de Villandrando s’opiniâtrant à le monter, le transporta par force dans le fleuve de Loire, où il se noya. Et les paysans de Cornillon-en-Forez, ayant pêché et trouvé son corps auprès dudit lieu et s’étant saisis du cheval, qui s’était échappé, en signe de mémoire de cet évènement, qui fait voir que la vengeance que Dieu tire des impies, attachèrent la bossette de cuivre doré du mors de bride de ce cheval à la porte de l’église, ainsi qu’on l’y voit encore aujourd’hui.19 Mais nous sommes là très loin de la réalité qui vit Rodrigue sortir indemne de cette expédition. Pourquoi cette légende a-t-elle été véhiculée ? Est-ce en réaction à l’intense répression des routiers de Rodrigue sur ce territoire ? Notre capitaine est qualifié d’« impie » au cours de cet épisode. Or, nous savons aujourd’hui que c’est à la demande du clergé du Velay que Rodrigue était intervenu en compagnie de Guy de Bourbon20. Mais il est un fait : dans l’opinion populaire, les malheureux qui ont eu à subir le passage dévastateur de ses troupes, n’ont pu faire aucune distinction entre les actions de « réduction » du mouvement hussite et le pillage généralisé. Les routiers eux-mêmes ne la faisaient certainement pas. D’une exaction à 18
Ibid. QUICHERAT, 1879, Pièce justificative n° XXX, p.257. Ibid. De La MURE, tome II, p. 151 et note. 20 Francisque MANDET, Histoire du Velay, les récits du Moyen Âge, Livre VIII, Imprimerie Marchessou, Le Puy, 1861, pp. 341-347. 19
128
l’autre, quelle pouvait être la différence pour le peuple qui eut à en souffrir ? L’histoire n’a donc rien à démêler dans cette légende, elle est purement anecdotique. Si elle n’a aucune valeur historique, elle témoigne cependant du passage des troupes de Rodrigue dans le Velay à cette époque. Nous la transcrivons ici uniquement parce qu’elle met en scène notre héros. Elle nous semble d’ailleurs bien postérieure aux évènements, car elle revêt un accent moralisateur, caractéristique d’une reprise en main plus tardive de l’Église. Les Jacquiers du Mâconnais, du Forez et du Velay furent donc vaincus ou plutôt détruits. Leurs bourreaux portèrent contre eux une terrible et sauvage réaction21. Si ces révoltes s’achevèrent dans le sang sous l’épée conjointe de « l’armée de Charlieu » et des troupes de Rodrigue, on sait que ces mouvements religieux ne furent pas pour autant extirpés. Ils allaient au contraire être repris avec force. Sous l’impulsion d’autres théologiens et prédicateurs, ils ne tarderaient pas à renaître au siècle suivant, prélude aux terribles guerres de religion qui ensanglanteraient la France.
21
SAINT-JULIEN de BALEURRE Pierre (de), De l’origine des Bourgongnons, Nicolas Chesnay, Paris, 1580.
129
PROLONGEMENT DES CONFLITS SOCIAUX Différends entre le clergé et la noblesse du Velay Dans le même temps se déroulait un conflit d’intérêts entre la noblesse et le clergé, qui déboucha rapidement sur un affrontement armé. Il est difficile de démêler les évènements précédents des actions de représailles qui eurent pour théâtre principalement la province du Velay. On sait seulement que les compagnies de Rodrigue ravagèrent la contrée. Il est permis de croire que Villandrando, très irrégulièrement remboursé de ses frais de guerre chercha « des débouchés complémentaires » à son activité militaire. Les conflits se superposant aux conflits dans un inextricable écheveau, il régnait audelà des « jacqueries hussites », une agitation complémentaire dans le petit état montagneux. Ce conflit durait depuis longtemps déjà et Rodrigue par des actions sporadiques décida d’en profiter pour essayer d’assainir ses finances. Il mit son épée au service du clergé local. Dans la pyramide des pouvoirs, son action semble avoir paradoxalement contribué à équilibrer les rapports entre les factions en présence. Le rôle des compagnies dans l’équilibre des forces militaires. Les chroniqueurs de cette contrée1 nous disent que, de 1425 à 1440 environ, et particulièrement dans la période que nous venons d’évoquer, il s’éleva dans le pays de violentes dissensions entre les prélats, les barons et les nobles. Ces dissensions furent même assez vives pour que, de part et d’autre, on soit obligé de recourir aux armes. Après de longs mois de famine où avaient sévi conjointement la guerre et la peste, la province était ruinée. La noblesse avait servi le roi contre l’Anglais, elle n’avait plus ni biens ni argent et résolut donc 1
Étienne MEDICIS, Chroniques par Augustin Chassaing, Société Académique du Puy, Imprimerie Marchessou, Le Puy, 1869, Tome I.
131
de se dédommager. C’est pourquoi, au fur et à mesure que l’ennemi était débusqué des positions qu’il occupait, la noblesse locale s’en emparait à son tour. Tout pouvoir étant fondé sur la terre, elle alléguait des droits anciens de propriété, et ce qui était plus sûr pour elle, des droits nouveaux dus à la conquête. De son côté, l’Église réclamait sa part se disant pauvre, souffrante, dépouillée et se plaignait amèrement des hommes d’armes qui faisaient main basse sur des terres qu’elle aussi revendiquait. Seul le plus fort devait l’emporter, car la force était la raison décisive à cette époque. Or, si le clergé n’avait pas de forces militaires, il possédait en revanche de nombreux revenus. Il lui était donc facile d’obtenir le concours de troupes mercenaires qui couraient le royaume, vendant leurs services à qui voulait les acheter. Paradoxalement, cette situation avait aussi ses avantages, car suivant la cause à soutenir, on s’adressait à tel chef de bande plutôt qu’à tel autre. De leur côté, les capitaines de mercenaires opéraient des choix dans leur soutien, car, disaient-ils, les bannières ont aussi leur couleur et leur préférence. Voilà ce qui explique comment à la suite de ces dissensions internes, Guy de Bourbon et Rodrigue de Villandrando, dont on connaissait les sympathies politiques, furent appelés à différentes reprises. Ils lancèrent leurs courses dévastatrices depuis les alentours du Puy jusqu’aux confins du Forez, chevauchant les âpres montagnes du Velay jusqu’à la ligne de crête des Cévennes. Là, ils inquiétèrent sérieusement les domaines de la noblesse hostile au clergé. Cependant, Charles VII était profondément affecté par ces luttes locales, surtout lorsqu’elles avaient besoin pour être apaisées de l’intervention des compagnies. Il envoya donc le sénéchal de Beaucaire, Raymond de Villa, dans le Velay, avec mission d’y concilier autant que possible tous les intérêts. Le sénéchal arriva au Puy au cours de l’année 1432 et parvint sinon à éteindre, du moins à calmer l’irritation des partis. Trois ans plus tard, en 1435, Rodrigue et Guy de Bourbon revinrent à la tête d’une troupe de huit cents hommes. Probablement que cette fois encore ils avaient été appelés par les chapitres et les abbayes du diocèse, afin de réprimer les déprédations et les envahissements des seigneurs séculiers. Quoi qu’il en soit, leur concours obtint un résultat aussi prompt que décisif et cela nous 132
démontre, si besoin est, la « capacité de persuasion » de notre capitaine. Sa réputation le précédant, Rodrigue ne fit en quelque sorte qu’apparaître, et la noblesse et le clergé furent définitivement pacifiés.2 Sous ce rapport, on le voit, les compagnies offraient de précieuses ressources dans l’équilibre des groupes sociaux ou des factions rivales. Elles permettaient aux diverses composantes de l’organisation féodale de contrebalancer la domination d’un groupe à l’autre en maintenant les forces dans un équilibre relatif. Aussi, quoique nos chroniqueurs ne désignent presque toujours les routiers que sous le nom de brigands, il n’en est pas moins vrai que ce serait apprécier d’une façon fort inexacte le rôle qu’ils ont joué pendant le XVe siècle. En tenant compte des mœurs et des nécessités de ces temps obscurs, on se fera une idée plus juste de cette espèce d’industrie militaire, née au sein des discordes civiles, puis acceptée, propagée, régularisée, nationalisée en quelque sorte suivant les conditions et les besoins du pays féodal. Quand on étudiera la raison d’être et le mode d’existence de toutes les individualités qui se disputaient avec acharnement chaque portion de territoire du royaume, quand on apercevra surtout l’impossibilité dans laquelle étaient les pouvoirs rivaux de maintenir en permanence des forces suffisantes à leur défense réciproque, on aura l’explication logique du développement de cette institution belligérante, à la fois protectrice et ennemie de la sécurité publique. On comprendra le secret de ces invasions soudaines, de ces capitulations empressées de la part de ceux-là qui semblaient en apparence les dominateurs d’une province. Enfin, on s’expliquera comment les deux bâtards de Bourbon, présentés par les historiographes comme les ravageurs du Velay pendant cette période, n’en laissèrent pas moins dans tout le clergé de réels souvenirs de gratitude. En effet, lorsqu’en 1443, l’évêque Guillaume de Chalencon vint à mourir, six chanoines furent envoyés par le chapitre de Notre-Dame pour se rendre à Saint-André-les-Avignon et y supplier l’abbé Jean, bâtard de Bourbon, frère des précédents et beau-frère de Rodrigue, de
2
Francisque MANDET, Histoire du Velay, les récits du Moyen Âge, Livre VIII, Imprimerie Marchessou, Le Puy, 1861, pp. 341-347.
133
bien vouloir accepter la mitre épiscopale que l’église du Puy venait de lui donner par acclamation3. Mais il est temps de revenir à cette fatidique année 1431 où après avoir couru le Velay, notre capitaine reçut par un étrange retour de l’histoire, le titre et le comté de Ribadeo en Galice. Ce titre de noblesse allait bientôt lui ouvrir les portes de la Maison de France en le faisant entrer par alliance dans la puissante famille de Bourbon.
3
Jean, bâtard de Bourbon, succéda le 2 décembre 1443 à Guillaume de Chalençon. Le chapitre de Notre-Dame-du-Puy fixa ses préférences sur le beau-frère de Rodrigue plus que sur tout autre prétendant, aussi ne mit-il (le chapitre) pas longtemps à se décider, puisqu’il s’écoula moins d’une semaine entre la mort de Chalençon et le choix de son successeur.
134
RODRIGUE Seigneur de Pusignan, de Talmont, comte de Ribadeo Ce qui va suivre montre la place incontournable que Rodrigue, capitaine de compagnie, « écuyer du roi » avait prise dans le royaume de France. Notre homme, « à cheval » sur deux royaumes, n’en avait point pour autant oublié son pays d’origine et sa renommée allait rejaillir d’une façon inattendue à la cour de Castille. Peu avant les obscures opérations de représailles contre l’hérésie hussite, notre capitaine avait enfin reçu, le 7 mars 1431, la concession en règle de la seigneurie de Pusignan. Cependant, l’acte royal qui consacra ses droits sur cette propriété ne mentionnait rien du don qui lui en avait été fait par les États du Dauphiné1. La chose y est seulement présentée comme une faveur venant de l’initiative du roi. Rodrigue bénéficiait donc des bonnes grâces royales, néanmoins Charles VII jugea plus prudent de maintenir à sa solde l’effectif des troupes du tout nouveau seigneur de Pusignan. À la cour, on ne le savait que trop : laisser sans contrat les routiers du hardi capitaine, c’était courir un risque énorme. On en avait d’ailleurs déjà fait plusieurs fois l’amère expérience dans plusieurs provinces du royaume et on savait Rodrigue peu enclin à faire la moindre concession lorsqu’il s’agissait de la survie de son armée. Payé très irrégulièrement, nous l’avons dit, les propositions n’arrivant pas, Rodrigue menaça bientôt de mettre le Languedoc au pillage. Qui connaissait bien le capitaine savait qu’aucune menace n’était proférée sans être suivie d’exécution immédiate. Pour montrer toute sa détermination, Rodrigue amorça par un mouvement de ses troupes le début d’invasion du Rouergue. Aussitôt, un supplément de quatre mille écus lui fut alloué par cette province. Enfin, sur les conseils intéressés du favori Georges de La Trémoille, on prit le parti de l’envoyer contre les Anglais de Guyenne. L’ennemi s’était 1
Ibid. QUICHERAT, 1879, Pièce justificative nº VI, p. 216.
135
dangereusement avancé et tenait garnison dans les châteaux de SaintExupéry et Charlus2, bases à partir desquelles il lançait des raids dévastateurs sur le Limousin. L’ombre de Georges de La Trémoille. La suite des évènements donne à penser qu’à cette mission fut ajoutée une autre, qui consistait, au passage, à faire payer cher l’opposition de certains seigneurs dont avait à se plaindre l’omnipotent ministre de La Trémoille. Il faut savoir que le favori du roi revendiquait en ce temps-là la succession du comté d’Auvergne, qu’il prétendait lui être échu par la filiation de sa défunte femme, Jeanne de Boulogne. Sur sa demande, Rodrigue prit donc le chemin de la Basse Auvergne au temps de la récolte, ce qui était somme toute « la bonne saison » pour les routiers. Ayant renvoyé Valette dans les Cévennes, il menait son armée en compagnie de deux autres de ses lieutenants, Andrelin et Chapelle. Sous la chaleur de cette fin août 1431, il arriva aux environs de Montpensier3. Au passage, il fit exécuter une sorte de battue générale, lançant ses hommes comme des chasseurs à la poursuite du gibier. Toute personne arrêtée fut mise sous séquestre et emmenée en captivité. Ce n’étaient là, dirons-nous, que des pressions courantes selon les us et coutumes du temps dont notre capitaine maîtrisait fort bien l’usage. Alors, la province s’émut fortement. Jean de Langeac, sénéchal d’Auvergne, lui envoya aussitôt des propositions d’accommodement, puis vint le trouver lui-même avec un banquier de Clermont pour fixer à l’amiable le chiffre du patis. Les villes joignaient leur soumission aux politesses du sénéchal. Le Castillan inspirait une telle terreur que la plupart des cités closes envoyèrent des présents pour se mettre sous sa protection. Elles poussèrent même leur soumission jusqu’à commettre des violences afin de se procurer au plus vite les objets qu’elles destinaient au
2
Saint-Exupéry les Roches en Corrèze et Charlus situé sur la même commune, surplombant la vallée de la Diège. 3 Village situé à 30km au nord de Riom sur la RD 2009 ex N9 à côté d’Aigueperse. Sur une butte calcaire d’où l’on peut voir un beau panorama se trouvait le château de Montpensier. En 1434, à la mort de Marie de Berry, dont Montpensier constituait la dot, le comté passa à la maison de Bourbon.
136
terrible capitaine. On trouve ainsi les consuls d’Ambert venant lui offrir un cheval qu’ils avaient pris de force au bailli d’Allègre4. Pourtant, en vertu d’une délibération adoptée par les États d’Auvergne en 1430, la province, en accord avec celles du Bourbonnais, Beaujolais et Forez, avait crée pour la défense commune un comité de cinq personnes dotées d’attributions financières. Ces trésoriers devaient tenir à disposition permanente un fonds spécial destiné à entretenir un contingent fixe d’hommes d’armes et de fantassins. Il était convenu que l’argent serait conservé avec toutes les précautions d’usage en ce temps-là, c'est-à-dire mis dans un coffre fermé de cinq serrures, soit autant qu’il y avait de commissaires, et que chacun de ceux-ci en garderait une clef5. Si ce coffre fut confectionné, il ne reçut pas l’emploi auquel on l’avait destiné puisque nous voyons, au bout d’un an, la province agressée n’avoir pas un soldat à opposer à ses envahisseurs. De l’Auvergne, Rodrigue passa en Limousin, ayant pour mission de compléter sa moisson sur les terres de la maison de Ventadour dont était titulaire la comtesse d’Auvergne. Inutile de préciser que c’était elle avec qui La Trémoille se trouvait en conflit d’intérêts. La ville d’Ussel, capitale du comté de Ventadour, éloigna la menace d’un siège en payant une contribution qu’elle ne put parfaire qu’à force d’emprunts. Quicherat cite les pièces d’un règlement de compte daté de 1431. Elles constatent que le comte de Ventadour avait prêté sa vaisselle d’argent pour aider ses sujets à se racheter. La malheureuse ville ne s’était pas encore libérée en 1439. On peut donc juger encore une fois, des « capacités de persuasion » du Castillan. Les bandes poursuivant la campagne qui leur avait été tracée réussirent-elles à délivrer le Limousin de la présence des Anglais ? On serait tenté de le croire quand on voit leur chef, à peu de temps de là, gratifié d’une seconde seigneurie. Le 3 avril 1432, Rodrigue reçut, à titre de propriété transmissible seulement à sa descendance masculine, le château et la châtellenie de Talmont-sur-Gironde6. C’était là un domaine d’une véritable 4
Ibid. QUICHERAT, 1879, Pièce justificative no III, p. 212. Ibid. De La MURE, Histoire des ducs de Bourbon, tome III, p. 196. 6 Commune dans le département de la Charente-Maritime au sud de Royan, ancienne bastide fondée par le roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine Édouard 1er en 1284. Elle s’étend sur un promontoire dominant l’estuaire de la Garonne. 5
137
importance par son étendue et par la position maritime qui en dépendait. Située sur la rive droite de l’estuaire girondin, faisant face à la Guyenne anglaise, la place revêtait une importance stratégique et commerciale de premier ordre. Il est permis de supposer que c’était là une récompense à la hauteur d’une action d’éclat. Mais les annales de l’Histoire ne mentionnent rien de tel. Il y a là un mystère, car l’ensemble des alinéas de l’acte de donation n’allègue point de succès récent obtenu sur l’ennemi. Et pourtant, Rodrigue y est nommément désigné en tant que « seigneur de Talmont ». La seule raison qui puisse être évoquée vient de la bouche du roi. Le monarque entendait que Rodrigue fût désormais son homme, et plus astreint à le servir : langage révélateur, qui prouve que le souverain avait pris la juste mesure de son capitaine. Après avoir évité le démembrement de son royaume sur le flanc est, le Castillan était maintenant en mesure de contrer « l’Anglois » sur ses possessions de Guyenne. Dans la mouvance politique de l’époque, la victoire générale n’était cependant pas encore possible, car le pays était toujours miné de l’intérieur par des dissensions insurmontables. Si, à la suite des conquêtes nouvellement effectuées, on avait à se défendre sur une plus grande ligne de frontières, quatre guerres civiles étaient engagées ou menaçaient l’intérieur : guerre pour la possession du pouvoir entre la Trémoille et les princes de la maison d’Anjou ; guerre pour des intérêts de famille entre le duc d’Alençon et le duc de Bretagne ; guerre de voisins entre le comte de Foix et le comte d’Armagnac qui ne pouvaient se souffrir ; guerre entre les prélats et la noblesse du diocèse du Puy que nous venons d’évoquer. Nous ignorons trop de choses pour voir clair dans ce trouble général. Tout ce qu’il est possible de discerner au sujet de Rodrigue, ce sont des mouvements incessants tant de sa part que de celle de son entourage : c’est d’abord le voyage d’un de ses écuyers envoyé comme ambassadeur auprès du duc de Bretagne7. C’est ensuite la présence de son associé Chapelle dans une armée qui combattait en Poitou sous la bannière de Bretagne, tandis qu’au contraire le bâtard de Bourbon, l’un de ses meilleurs amis, défendait le duc d’Alençon 7
Ibid. QUICHERAT, 1879, note 1, p. 69 : « A un escuier de Rodrigo de Villandro, nommé le Begue, venu vers le duc en ambassade à Moncontour de par son maistre ».
138
dans Pouancé, position hautement stratégique qui marquait alors une véritable frontière entre la Bretagne et l’Anjou. C’est enfin une marche exécutée par Rodrigue en personne en Gévaudan probablement pour peser sur un conflit entre prélats et noblesse qui comme en Velay menaçait le diocèse de Mende. La capacité d’intervention de l’armée de Rodrigue ne semblait alors plus connaître de limite. Ses divisions se portaient partout à la fois. Mais il n’eut pas le temps d’agir dans cette province. Non seulement le conflit fut apaisé par une habile négociation, mais un ordre du roi lui fit cesser toute avancée. Le souverain venait de l’appeler dans le Nord pour prendre part à une entreprise de première importance. Mais, avant d’aborder cette nouvelle expédition, il faut parler d’une distinction que l’heureux aventurier venait de recevoir de son pays et qui lui assigna un rang à part entre tous les capitaines de routiers. Rodrigue recouvre ses droits et hérite du comté de Ribadeo On a vu que la sœur de Pierre de Vilaines, grand-mère de Rodrigue de Villandrando, avait plaidé sans succès pour rétablir le droit de sa descendance sur le comté de Ribadeo. Nous savons en effet que la terre et le titre furent confirmés par le roi de Castille Henri III à l’acquéreur, qui était Ruy López d’Avalos8, l’un de ses chambellans dont il ne tarda pas à faire son connétable. Ruy López « fit mauvaise fin » comme ce fut souvent malheureusement le cas des grands favoris. En 1423, le roi Juan II le chassa de sa cour, dépouillé de toutes ses dignités et seigneuries, de sorte que sa chute raviva les espérances conçues jadis par les collatéraux de Pierre de Vilaines. Or Rodrigue, qui était l’un des héritiers de ces prétentions, ne tarda pas à s’illustrer en France, et le bruit de ses exploits se répercutant en un écho flatteur jusqu’en Espagne plaida pour lui beaucoup mieux que les droits problématiques invoqués par sa famille. Pour cette affaire, Rodrigue, qui entretenait des relations étroites avec Alvaro de Luna, le nouveau connétable de Castille, allait recevoir un coup de pouce du destin. Le roi Juan II de Castille songeait, sur les conseils de ce même connétable, à entraver les projets du roi d’Aragon 8
Ibid. QUICHERAT, 1879, note 1, p. 69 qui cite Estéban de Garibay, dans La Rexista europea de 1876, tome VII, p. 211.
139
sur le royaume de Naples. Il conçut pour cela un plan d’invasion auquel Rodrigue de Villandrando devait coopérer en attaquant le Roussillon avec ses compagnies. Dans cette entreprise, on comptait aussi sur le comte d’Armagnac, parce qu’il était lié par des liens du sang à la maison de Castille, et encore plus en raison de son inimitié bien connue contre le comte de Foix. Ce dernier, à l’opposé, se trouvait dans les relations les plus intimes avec le roi d’Aragon, Alphonse le Magnanime qui eut connaissance de l’agression projetée contre ses États. Le secret à peine dévoilé, le souverain tenta une médiation en envoyant des ambassadeurs en France, les uns pour tâcher de réconcilier par un mariage les maisons d’Armagnac et de Foix, les autres pour tenter d’infléchir la décision de Rodrigue. Mais le Castillan, en fin négociateur, avait décidé de soumettre l’éventualité de son engagement à condition. Voilà pourquoi, dans un premier temps, il répondit favorablement à la démarche engagée par le roi d’Aragon. Il alla même jusqu’à promettre au roi Alphonse de le servir envers et contre tous, sauf cependant contre le roi de Castille9. C’est le cadet de Villandrando, Pedro de Corral, qui porta cet engagement de la part de son frère. Pedro de Corral est mentionné par l’historien du seizième siècle Jerónimo Zurita comme un émissaire envoyé par Rodrigo de Villandrando pour offrir ses services au roi d'Aragon en 1431, avant son retour dans la péninsule ibérique.10 Si tout cela semble à priori bien contradictoire de la part du sujet du roi de Castille, c’est tout simplement que, sans se départir de sa fidélité, Rodrigue entendait monnayer une contrepartie à son engagement. Il exigea la rétrocession du comté de Ribadeo. Le coup était risqué, mais le Castillan avait vu juste. Lorsqu’on fut informé de cela à la cour de Castille, Alvaro de Luna n’eut de cesse de mettre tout en œuvre pour rompre les alliances que le roi d’Aragon tentait d’établir. La concession du comté de Cangas de Tineo au comte
9
Ibid. QUICHERAT, 1879, note 1, p. 71, cite Zurita, Anales de la corona de Aragón. 10 Jerónimo ZURITA Jerónimo, Anales de la corona de Aragón, Libros postreros de la Historia del Rey Don Hernando el Católico, Impresos en Zaragoza Colegio San Vicente Ferrer, 1610, I. XIII, C. LXXI.
140
d’Armagnac, et celle du comté de Ribadeo à Rodrigue de Villandrando, conclurent cet étonnant coup politique.11 Ces évènements se passaient en 1431. Rodrigue fut fait comte le 22 février de cette même année. Mais il faut croire qu’il y eut pour notre capitaine de longues formalités à remplir, peut-être l’obligation d’un voyage en Castille puis en Galice, où est situé Ribadeo, qui l’empêcha d’entrer immédiatement en possession de la dignité qui lui était échue. C’est en effet seulement à partir du mois de juillet 1432 qu’il s’intitula, dans les actes, comte de Ribadeo, et quelquefois de Ribedieu, qui est la forme francisée du nom espagnol.12
11
Ibíd. QUICHERAT, 1879, note 2, p. 71 : « Centon epistolario del bachiler Fernan Gomez de Cibdareal », p. 63. 12 Ibid. QUICHERAT, 1879, p. 71.
141
LE SIEGE DE LAGNY 10 août 1432 Après avoir relevé les armes du comté de Ribadeo grâce au titre de noblesse qui venait de lui échoir, le tout nouveau comte qui ne chômait décidément pas allait être appelé en renfort dans un conflit armé de première importance pour l’avenir du royaume. Notre capitaine allait s’y illustrer brillamment en y tenant une fois de plus les premiers rôles. Mais pour bien en saisir toute la teneur, revenons quelques années en arrière. Dès le mois d’août 1429, Jeanne d’Arc, qui venait d’entamer avec succès le mouvement de reconquête du territoire, avait rendu la ville de Lagny au roi Charles VII. Elle y revint par deux fois, en septembre de la même année puis au printemps 1430. Celle-ci avait en effet marqué son séjour par de nouveaux exploits et les Français, depuis lors, s'y étaient fortifiés. La cité, située entre Paris et Melun, occupait un point stratégique sur une voie navigable qui mène à la capitale. Elle possédait à l’intérieur une garnison armée qui incommodait fort les Anglais. Les Anglais tentèrent plusieurs fois de reprendre la place. Vers la fin mars 1431, ils dirigèrent une offensive avec mission de rompre et démolir le pont de Lagny qui vient par-dessus l’eau vers l’île-deFrance1. Les Anglos-Bourguignons à la tête desquels se trouvait le seigneur de L’Isle-Adam, maréchal de France, pour le roi Henry, fit asseoir une grosse bombarde contre l’arche du pont, laquelle du premier coup qu’elle jeta, rompit l’arche de telle manière, que ceux de dedans ne pouvaient bonnement venir à leur boulevard, qui était de l’autre côté du pont qui passe par-dessus l’eau. Isolés de leur base, les défenseurs du boulevard furent pris au piège et malgré une défense héroïque ils furent taillés en pièces. Pour parachever leur attaque, les Anglais rompirent le pont en plusieurs endroits. Les jours suivants, ils noyèrent la ville sous un déluge de projectiles. Messire Jehan de 1
Ibid. MONSTRELET, Chroniques, publiées par la Société de l’Histoire de France, Paris, 1861, Vol. V, p. 27.
143
Luxembourg, bâtard de Saint-Pol, qui portait un soleil en sa devise et en son étendard, dit tout haut, qu’il faisait vœux à Dieu que ce soleil entra en la ville. Mais dans l’assaut qui suivit, ce fut le contraire qui se produisit car ils furent bien et vaillamment reçus. Et il en y eut plusieurs des dits assaillants, morts et grièvement navrés, et avec ce perdirent quatre ou cinq de leurs étendards et pennons, qui furent tirés à force de bras dedans la ville par les deux bouts. Desquels furent la bannière de L’Isle-Adam, maréchal, et l’étendard et enseigne du soleil, appartenant audit messire Jehan, bâtard de Saint-Pol. Cet évènement fut fatal, les assaillants battirent en retraite et se retirèrent à grande honte et confusion en leurs logis, certains même désertèrent, s’en allèrent secrètement, sans le congé de leurs capitaines, voyant qu’ils perdaient leur temps. Mais avant de lever le siège, le commandement anglais fit jeter par-dessus les murailles jusqu’à quatre cent douze pierres, ou boulets de canon. Un coq tué par ces projectiles fut, dit le journal d’un bourgeois de Paris, la seule victime que fit cette dernière attaque et, quand ils revinrent en la capitale, on disait que c’était seulement pour se confesser et faire leurs Pâques.2 Or, au-delà de ces railleries populaires, plusieurs revers venaient encore affaiblir la position du duc de Bedford, jusqu’à menacer son autorité sur Paris. En effet, la ville de Chartres venait de tomber… La surprise de Chartres Le 12 avril 14323, Jean de Dunois, bâtard d’Orléans et le sire Florent d’Illiers4 nouèrent des intelligences dans la ville. En effet, il y avait dans la cité un fort parti opposé aux Anglais. Nous étions la veille du dimanche des Rameaux. Un bourgeois nommé PetitGuillaume, qui faisait d’habitude le commerce de sel avec ses charrettes roulant d’Orléans à Blois puis à Chartres, se présenta le 2
BRUGIERE DE BARANTE Amable Guillaume Prosper, Histoire des Ducs de Bourgogne de la maison de Valois, 1364-1477, Dufey, Paris, 1867, Vol. V, pp. 305306. 3 Concernant cet évènement, Monstrelet donne la date du 20 avril 1431. 4 Compagnon de Jeanne d'Arc, aux côtés de Dunois, de La Hire, de Gilles de Rais et de Jean d'Alençon, il prit part, à la tête d'une compagnie des ordonnances du roi, à la délivrance d'Orléans (1429). En 1432, il reprit Chartres et défendit Louviers contre les Anglais ; en 1435, il se signala à la prise du pont de Meulan. Le roi Charles VII, qui l'avait déjà fait gouverneur de Châteaudun, le nomma gouverneur et bailli de Chartres.
144
matin de bonne heure à la porte Saint-Michel. Il amenait avec lui plusieurs charrettes lourdement chargées de tonneaux. Le marchand était fort honorablement connu. On ne se défia de rien. Plusieurs portiers étaient dans le secret de la conjuration. Petit-Guillaume, accompagné d’un certain Jean Ansel, pour mieux les abuser prit un panier d’aloses en leur disant voilà pour votre diner, prenez en gré ; nous faisons souvent des peines beaucoup, aulcunes fois de vous retarder à la porte pour nous attendre, et autre pour ouvrir les barrières5. Les gardes se mirent aussitôt à emporter des paniers d’aloses que le marchand leur tendait. Au même moment, une des charrettes s’arrêta sur le pont-levis. Des hommes d’armes déguisés, vêtus de blouses, chaussés de guêtres, le fouet à la main, conduisaient les voitures. D’autres étaient enfermés dans des tonneaux. Ils jaillirent soudain hors des fûts en faisant sauter le couvercle et tombèrent sur les gardiens des portes. Florent d’Illiers et cent vingt des siens les avaient suivis. Se tenant en embuscade, ils arrivèrent aussitôt à la rescousse. Un autre bataillon accourut à bride abattue et se fraya un chemin jusqu’à la cathédrale, qui avait été secrètement choisie comme point de ralliement. Jean d’Orléans et La Hire enfin, avec deux cents des leurs, firent à leur tour irruption. Ils occupèrent les points stratégiques et s’emparèrent du gouverneur de la place, Gilles de l’Aubépine. Pour parfaire le plan de cette attaque, on avait rallié la complicité d’un prédicateur dominicain, renommé et bon partisan, maître Sarrazin, qui se trouvait à Chartres, à l’occasion des fêtes de Pâques. Pour attirer la foule, celui-ci accepta de prêcher dans un quartier opposé à celui où les forces de Charles VII se présenteraient. Il avait justement fixé l’heure de son sermon au moment où devait se faire l’attaque, et avait choisi une église située à l’autre bout de la ville.6 La garnison et les bourgeois du parti anglais, totalement surpris, mirent donc longtemps à se mettre en défense. Toutefois, on entendit les premières escarmouches résonner du cliquetis des armes dans la rue. L’évêque d’origine anglaise, Jean de Festigny, se mit vaillamment à la tête des défenseurs de la ville, mais à peine s’était-il dressé audessus de ses hommes qu’un coup d’arbalète lui ôta la vie. Le bailli se 5
Ibid. MONSTRELET, Chroniques, Paris, 1861, Vol. V, pp. 22, 23. CAFFIN DE MEROUVILLE Michel, Le beau Dunois et son temps, Nouvelles Éditions Latines, Paris, 2003, p. 233.
6
145
sauva par-dessus les murs tandis que le bâtard d’Orléans arrivait à la tête de la seconde embuscade. La ville fut entièrement soumise. La prise de Chartres, position clé, était d’une importance capitale pour le parti de Charles VII. Paradoxalement, ce fut une mauvaise nouvelle pour les Parisiens. Chartres n’est pas éloigné de Paris et de là arrivait la plus grande partie des farines, le pain allait être donc encore plus cher. Tout semblait dégoûter les bourgeois de cette domination anglaise, à laquelle il n’arrivait plus que de fâcheuses aventures. Le siège de Lagny La perte de la ville de Chartres constitua un élément décisif pour le duc de Bedford. Face au mécontentement des Parisiens coupés d’une partie de leurs approvisionnements, il fallait à tout prix stopper l’avancée des troupes ennemies en réduisant la poche de Lagny que commandait le sire de Foucault. Pour en desserrer l’étreinte chaque jour plus menaçante, le duc de Bedford y lança ses troupes le premier mai. Régent au nom du roi Henry VI d’Angleterre et de France, il voulut réparer l’échec essuyé l’année auparavant. De nouveaux préparatifs furent faits. Le second siège posé devant Lagny le 1er mai 1432 dura quatre mois. Le sire de L’Isle-Adam, à qui le roi d’Angleterre venait de reconnaître la charge de maréchal de France, s’en alla commander le siège. Un fort contingent anglais se rangea dans les plaines et la campagne environnante. Il y aménagea un véritable camp retranché, d’où partiraient les attaques. Mais rien n’y fit, le duc se heurtait à une défense invincible et il y était depuis deux mois sans profiter en rien. Toutefois, au fil des jours, les assiégeants avaient réussi à resserrer leurs approches. Et Lagny finit par se trouver étroitement pressée par la famine, noyée sous la pluie des projectiles de l’artillerie ennemie. Bedford pressentant un dénouement proche partit de Paris et vint placer dans la balance tout le poids de son commandement personnel. Pour ce faire, il s’était pourvu de plusieurs machines de guerre et d’une grande quantité de canons qu’il avait retirés de Paris. Il arriva sur la place au mois de juillet. Devant les murs de la cité, une armée impressionnante était rassemblée. Elle était composée essentiellement de Bourguignons conduits par le maréchal de L’Isle-Adam, les bâtards de Saint-Pol et d’Aunay et les seigneurs d’Orville, de Vaudrey et 146
d’Amont. Bedford jura de ne pas abandonner les lieux du siège tant que la cité ne serait pas prise. La ville fut entourée de toutes parts. Le camp anglais fortifié fut mis à l’abri de toute attaque. En face, afin d’assurer sécurité et ravitaillement, les assiégés avaient fait un pont de bateaux sur la Marne, pour passer à leur aise, de l’un des côtés à l’autre. Et à chacun des bouts dudit pont avaient fait boulevards7 pour la garde d’icelui. Dedans lesquels étaient commis gens d’armes en certain nombre pour le garder. Mais cela constituait un point vulnérable8. Alors, pour isoler un peu plus la citadelle, le duc fit bombarder par ses machines de guerre une arcade du pont qui s’abattit. Après quoi, il se retourna contre la muraille de Lagny qu’il endommagea fortement, sans toutefois ouvrir une brèche. Ambroise de Loré, gouverneur de Lagny attaché à la défense de la cité, effectua plusieurs « chevauchées » avec sept à huit cents hommes d’armes et repoussa à chaque fois les assiégeants anglais avec beaucoup d’avantages. À l'intérieur des murs, pour soutenir Ambroise de Loré, la résistance était menée par deux capitaines expérimentés Jean Foucaut et Hugh Kanedy ou, Hughes Kennedy, un capitaine écossais qui commandait un millier de combattants environ. Au bout de plusieurs mois de siège et d’escarmouches, les forces et les vivres commencèrent à manquer dans la ville, mais l’espoir de troupes supplémentaires qui viendraient au secours des assiégés maintenait ces derniers dans un courage sans faiblesse. Les conditions climatiques du mois de juillet 1432 furent déplorables : il y eut des pluies continuelles durant près de 23 jours. Les assaillants anglais passèrent une bonne part de leur temps sous leurs tentes. Mais le mois d’août venu, le soleil se mit enfin à briller. Les secours arrivent Dans cette extrémité, le gouvernement et le conseil de Charles VII déjà alertés avaient procédé non sans mal à un rassemblement de troupes pour voler au secours de la cité assiégée. Mais l’argent manquait et il fallut un dernier effort pour en assurer le succès : de nouvelles dettes, des emprunts multipliés, furent contractés au nom du 7
Ouvrage de fortification extérieure d’une place forte, rempart de terre ou terreplein en avant d’un rempart, Littré ancien français. 8 BUCHON J. A., Chroniques d’Enguerrand de Monstrelet, Verdière, nouvelle édition, Paris, 1826, tome VI, p. 49.
147
roi. La Trémoille se rangea, comme par le passé, au nombre des prêteurs. Charles VII parvint à rassembler une imposante coalition, qu’il expédia sous les murs de Lagny.9 Rodrigue venait à peine de relever la bannière de comte de Ribadeo lorsqu’il reçut une commission de Charles VII. Le roi l’enjoignait de se rendre immédiatement à Orléans pour y effectuer sa jonction avec le bâtard d’Orléans qui était à la tête de huit cents cavaliers. Une vieille connaissance attendait le comte de Ribadeo : le sire de Gaucourt, auquel s’étaient joints le maréchal de Rais et l’aîné des Xaintrailles. Il s’agissait d’aller affronter, dans son camp défendu par dix mille hommes, le duc de Bedford, régent du royaume de France et d’Angleterre, l’homme dont le talent seul prolongeait la durée de la domination anglaise sur le continent. Une armée de onze mille auxiliaires fut donc rassemblée et expédiée sous les murs de Lagny. Rodrigue menait à lui seul une compagnie de cinq mille combattants10. L’armée traversa la Seine à Melun et parcourut la Brie en direction de Lagny. Lorsqu’on marche dans cette direction, on arrive tout près de la ville sans l’apercevoir, parce qu’on a devant soi un coteau au revers duquel la ville est adossée. Mais il ne se prolonge qu’à un quart de lieue vers le couchant, de sorte qu’il laisse ouverte la prairie de la Marne, et c’est par là qu’on tourne pour gagner la ville après avoir traversé un ruisseau qui va jusqu’à la rivière. Si le camp des Anglais avait été établi sur ce point, la délivrance de Lagny serait devenue presque impossible. Mais le duc de Bedford, s’attendant à être attaqué par la Champagne plutôt que par la Brie, s’était posté en amont dans la direction opposée. Ce fut une première erreur de calcul, qui fut suivie d’une seconde, car le duc jugea qu’il aurait à soutenir une bataille frontale, et qu’il prit toutes ses dispositions en conséquence. Bien au contraire, le plan du comte de Ribadeo et de ses compagnons d’armes était d’éviter la bataille, tout en feignant de la vouloir livrer. Ils passèrent la nuit hors de vue de l’armée anglaise, dans le village de la Gouverne, sur les bords d’un ruisseau qui court au sud de la Marne, sous un ultime rebond du grand plateau briard. Ils se 9
Ibid. VALLET de VIRILLE, Histoire de Charles VII, Paris, 1863, tome II, pp. 294-295. 10 Ibid. QUICHERAT, 1879, note 2, p. 72 : « Le bastart d’Orléans en la compaignie de plusieurs capitaines… avec six mille combattants, et Rodrigue de Villandrando qui avoit aussi bien dessoubz lui en sa compaignie cinq mille combattants ».
148
partagèrent dès le lever du soleil en trois corps, dont deux devaient menacer le camp anglais, tandis que le troisième, composé de routiers sous le commandement de Rodrigue, devait se lancer par le village de la Gouverne, à travers la prairie de la Marne, et introduire dans Lagny un convoi de vivres et de munitions. Pour couvrir cette manœuvre, le reste de l’armée pousserait une pointe sur le camp anglais dressé dans la direction opposée. À peine ce mouvement eut-il été aperçu par le duc de Bedford, qu’il forma aussi son armée en trois corps dont chacun s’avança à la défense des points menacés. L’avantage du nombre n’était pas du côté des Anglais, à cause des hommes laissés pour la garde du camp et des lignes du siège. C’est la raison pour laquelle le commandement anglais avait résolu de s’en tenir à une action générale, pour autant qu’elle soit engagée par l’ennemi. Le duc commandait une partie de la chevalerie qui allait faire face au corps principal de l’armée de Charles VII. Le comte de Ribadeo dut surmonter une désagréable surprise. Le capitaine détaché sur la droite, afin de lui barrer le passage, était son ancien chef de compagnie, le maréchal anglo-bourguignon Villiers de L’Isle Adam ! Est-ce une combinaison fortuite, est-ce une provocation comme on s’en faisait alors à la veille des batailles qui mit ainsi en présence le maître et le disciple ? Les chroniqueurs n’en disent rien, mais ils laissent entrevoir très clairement que l’action décisive de la journée se passa entre ces deux capitaines, tandis que sur les autres points, il n’y eut que des feintes ou des escarmouches. L’engagement commença sur le ru de Gouverne. Là, le combat prit la forme d’une mêlée opiniâtre. Longtemps on resta dans l’indécision, car on vit tour à tour les deux partis gagner, perdre, ressaisir la rive opposée, ondoyant comme l’eau d’une mer poussée et reprise par le flux et le reflux des vagues successives. Enfin, l’effort des routiers l’emporta. Les Anglais, culbutés et dispersés, leur abandonnèrent la possession de la prairie, où Rodrigue refit bien vite son corps de bataille pour courir aux lignes des assiégeants et tenter de les traverser. Mais le plus dur restait à faire : on avait décidé d’introduire un petit convoi de bœufs et de farine aux assiégés affamés. Alors, le Castillan perça les lignes ennemies et à la tête d’un fort contingent armé, il s’abattit comme la foudre, armes en avant, vers un deuxième bataillon anglais posté devant la ville qui avait pris l’offensive contre les assiégés. 149
Ce bataillon s’était emparé d’une forte redoute qui constituait le dernier bastion défensif avant la porte par où devait entrer le convoi. L’étendard d’Angleterre, planté sur ce point en signe de conquête, portait au loin l’annonce d’un succès qui aurait entraîné de graves conséquences, si par malheur le comte de Ribadeo avait été repoussé. Au contraire, avec cette arrivée inattendue, les vainqueurs de la redoute furent écrasés entre les gens de Lagny qui firent irruption parderrière et les routiers qui les pressaient de face. La position perdue fut reconquise par Rodrigue, le terrain nettoyé et rendu libre pour la marche du convoi. Sous la protection du Castillan, les fouets claquent, les jurons montent, les charrettes s’ébranlent lentement, difficilement et roulent cahin-caha, se frayant un chemin dans le tourbillon de la bataille. Et de fait, par force et malgré tous leurs adversaires, se boutèrent en avant, et en passa certain nombre qui allèrent jusques à la porte, et boutèrent dedans de vingt à trente bœufs, et aucune quantité de sacs de farine, et si entrèrent dedans environ quatre-vingts combattants ; mais cette besogne ne fut pas faite sans effusion de sang11. En effet, le transport ne se fit pas aussi rapidement que souhaité. Les dernières charrettes se trouvaient encore en attente à la tête du pont-levis, prenant passage l’une après l’autre, quand le duc de Bedford arriva. Il était suivi de nouveaux pelotons composés d’une partie des hommes ralliés de L’Isle-Adam et d’autres unités retirées de la garde des retranchements. Le comte de Ribadeo, avec une étonnante promptitude de conception et d’exécution, fit volte-face, emmena la moitié de son monde à l’ennemi, jeta l’autre dans un ouvrage de terre récemment abandonné par les assiégeants. Alors commença un troisième engagement, plus meurtrier que les deux autres et plus pénible à cause de l’intensité de la chaleur. On sait que le soleil était revenu, lourd, écrasant. On était au milieu de la journée, d’une journée d’août, une journée brûlante où, même au repos, les hommes pris dans leurs armures suffoquaient. La plupart des hommes d’armes avaient mis pied à terre, pour s’affronter sur un espace très étroit, à travers les ouvrages du siège. De part et d’autre, on se tenait main à main, la pointe de l’épée sur la gorge. Heureusement pour les routiers, ils 11
Ibid. BUCHON J. A., Chroniques d’Enguerrand de Monstrelet, Paris, 1826, tome VI, p. 51.
150
avaient le retranchement de la redoute qui leur servit pour reprendre haleine. Leurs chefs les y envoyèrent dix par dix, vingt par vingt, faire chacun à leur tour une pause de quelques instants. Ainsi, des hommes rafraîchis et reposés ne cessaient de tenir le premier rang. Les Anglais, qui n’eurent pas la même ressource, d’autant qu’ils étaient dans le mauvais sens de la pente, s’épuisèrent sans gagner un pouce de terrain. De-ci, de-là, suants, rôtis dans leurs armures, étouffés sous leurs visières baissées, ils tombaient un à un foudroyés par la chaleur. Enfin, le duc de Bedford, qui était sanguin et replet, disait-on, se sentant lui-même très incommodé donna le signal de la retraite. On vit bientôt toutes les divisions anglaises tenter en même temps de se rassembler en bon ordre et reculer en direction de leur camp. On ne commit pas l’imprudence de pousser l’avantage en les attaquant. Lorsque toutes les voitures du convoi furent entrées dans la ville, Rodrigue rejoignit le reste de l’armée, et on alla coucher au village de Gouverne. On s’était battus depuis huit heures du matin jusqu’à quatre heures de l’après-midi. Telle fut l’action du ravitaillement de Lagny, action dont le résultat valut le gain d’une bataille. Elle eut lieu le 10 août 1432, c’était un dimanche, un jour de gloire comme à Anthon, un jour décidément propice aux entreprises de notre capitaine. Est-ce que la victoire tint à la présence et aux conseils du comte de Ribadeo ? Toujours est-il que les combattants de la coalition de Charles VII montrèrent dans toute cette campagne une conduite exemplaire, voire même un talent de stratégie, dont ils n’étaient pas coutumiers. La ville ravitaillée, comme on vient de le voir, ils décidèrent d’en lever le siège. Étonnamment, ils n’attaquèrent pas les Anglais dans leur camp qui était plus étendu que Lagny même12. Ils ne tentèrent pas non plus le sort incertain d’une bataille que le duc de Bedford leur envoya demander à plusieurs reprises. Non, rien de cela ne se passa, au grand dépit du commandement anglais. Sous l’impulsion de Rodrigue, les chefs de l’armée coalisée avaient une autre idée en tête. Pour cela, ils allèrent chercher un passage sur la Marne, aux environs de la Ferté, et remontèrent quelque temps sur la rive droite, comme 12
Ibid. QUICHERAT, 1879, note 1, p. 77 : « A l’autre bout, en l’abbaye, il avoit fait faire ung pare fossoyé tout autour, plus grant que toute ladicte ville de Lagny ».
151
s’ils avaient émis le dessein de s’enfoncer dans la campagne. Puis, par un brusque changement de direction, ils se rabattirent sur les terres du royaume de France qu’ils parcoururent jusqu’à Mitry13. Bedford fut affolé, dans la crainte de voir Paris attaqué, il y emmena précipitamment toutes ses troupes, laissant devant Lagny camp, artillerie et provisions14. Cette tactique permit de libérer la ville sans combat supplémentaire. On imagine bien que les assiégés ne laissèrent pas, à toutes ces choses abandonnées par l’ennemi, le temps de se gâter. Mille bras se mirent à l’œuvre pour transporter le matériel dans la ville et pour détruire les travaux consécutifs au siège. Le 20 août, Jean, duc de Bedford, revint à Paris le cœur navré et profondément atteint par cet échec. Ce retour parut bien honteux aux Parisiens. Ils avaient payé de leurs deniers tant de préparatifs qui se trouvaient inutiles : Lequel siège, gens à ce connaissant affirmaient que bien avoit cousté plus de cent cinquante mil saluts d’or. Cet échec exaspéra un peu plus les Parisiens contre le gouvernement anglais. Aux alentours de la capitale, la campagne était plus que jamais livrée au parti des Armagnacs. Les arrivages étaient gênés de toutes parts. La disette y était grande. Les maladies y faisaient des ravages épouvantables. Aussi, les murmures et le mécontentement s’en allaient croissants. L’abbesse de Saint-Antoine et plusieurs de ses religieuses furent mises en prison parce qu’on les soupçonnait d’avoir, en l’absence du régent, formé un complot pour ouvrir les portes de la ville aux Français15. Rodrigue et les autres capitaines voulurent avoir leur part du butin anglais qui avait été récupéré à Lagny. Ils se la firent donner quelques semaines après, étant revenus pour mettre dans la ville un renfort de garnison. Si la campagne était finie pour le roi, elle ne l’était pas pour Georges de La Trémoille qui n’appréciait les victoires que lorsqu’il y trouvait son profit. L’ambitieux et intriguant ministre, que l’on savait en opposition avec la maison d’Anjou, avait déjà imaginé une autre manœuvre politique. Suivant ses conseils ou au moins avec son 13
Mitry-Mory dans le département de la Seine-et-Marne. Ibid. QUICHERAT, 1879, note 3, p. 77 : « Furent si près prins, qu’ils laissièrent leurs canons et leurs viandes toutes prestes à mangier, et si grant foison de queues de vin, dont on avoit si grant disette à Paris, et de pain par cas pareil, dont le blé à Paris enchery tellement, car le sextier monta le sabmedy ensievant de seize solz parisis ». 15 Ibid. VALLET de VIRILLE, Histoire de Charles VII, Paris, 1863, tome II, pp. 294-295. 14
152
autorisation, le comte de Ribadeo, à son retour de Lagny, se jeta en belligérant sur la province angevine.
153
LA DETROUSSE DES PONTS-DE-CÉ Les plus belles victoires, nous l’avons déjà vu, n’étaient malheureusement pas toujours suivies d’effets. Malgré l’exemple de ces succès éclatants, qui venaient de temps en temps consoler et ranimer les partisans de la cause royale, la guerre traînait toujours, incessante et éternelle. Elle étendait son cercle de feu ravageant les provinces sans leur accorder un seul moment de répit. Le pays souffrait toujours. Les auxiliaires du roi le servaient d’une main et le combattaient de l’autre : les gens de guerre français n’épargnaient personne, même sur le territoire royal. Ainsi, les religieux de la Prée (châtellenie d’Issoudun) furent autorisés à se fortifier. Les gens des compagnies allaient jusqu’à faire manger leurs chevaux sur le maîtreautel.1 Ainsi, Rodrigue le Castillan, après avoir servi si vaillamment et si utilement au siège de Lagny, envahit la Touraine et se mit tranquillement à la ravager. Il est vrai qu’il ne pouvait guère en être autrement : en dépit de son étonnante implication, le comte de Ribadeo n’avait pas reçu de solde régulière2. Dans le pays, tout semblait laissé au hasard, et la plupart du temps, quand l’administration se mêlait de se substituer au pouvoir royal, c’était pour faire plus de mal encore. Les historiens sont unanimes pour nous représenter cette période comme l’une des plus tristes de l’histoire. Les finances sont dans un état déplorable : aliénations du domaine, emprunts répétés, engagement de fonds territoriaux, de revenus, de meubles même, on fait appel à tout. Le roi de France lui-même a recours à des expédients. La valeur des monnaies est livrée à des fluctuations
1
STEENACKERS F.-F., Agnès Sorel et Charles VII, essai sur l’état politique et moral de la France au XVe siècle, Didier et Cie, libraires-éditeurs, Paris, 1868, pp. 198, 199, 200. 2 Thomas BASIN, Histoire des règnes de Charles VII et Louis XI, par Jules Quicherat, Renouard Libraire, Paris, 1855, tome 1, p. 10.
155
perpétuelles, qui durent depuis plus d’un demi-siècle3. Cela ne remplit pas les coffres du roi. Il ne paye pas plus les charges de la cour que celles de l’État. Les sources du revenu se tarissent et le peu qui en sort tombe dans l’escarcelle toujours vide et avide de quelques favoris. Dans les provinces morcelées, le menu peuple ne saisit rien de la raison ni du but des combats qui se croisent et se recroisent sans cesse. Il ne pense qu’à survivre. Les seigneurs usurpent l’autorité royale affaiblie et sans prestige en soumettant leurs sujets ou vassaux à des taxes illégales. Les antiques redevances de la féodalité sont aggravées ou multipliées arbitrairement4. Et chose singulière, l’exemple en est donné par le premier des ministres du roi qui, en essayant de réagir contre le mal par ordonnance, a grand soin de stipuler une exception de fait pour lui-même ! Les dessous d’une dangereuse manœuvre Ce fut bien là une des manœuvres politicienne qui poussèrent La Trémoille à encourager la compagnie du Castillan à se lancer sur la Touraine et l’Anjou. Yolande d’Aragon et Charles d’Anjou, son fils puîné, gouvernaient alors ce pays en l’absence de Louis d’Anjou, appelé en Italie comme héritier présomptif de la couronne de Naples. Yolande était la belle-mère du roi. Le 14 octobre 1404, elle avait mis au monde Marie d’Anjou, presque du même âge que son futur époux Charles VII, né l’année précédente. Charles VII fut élevé par Yolande d’Aragon qui palliait ainsi la déficience de son père en proie à la folie. Dans ce contexte, l’avenir de Charles s’annonçait plus qu’incertain, dès son berceau, il se trouvait placé entre un père dément et une mère que ses contemporains disaient adonnée au vice. La rumeur publique mettait en doute l’hérédité du futur roi en attribuant la paternité de celui-ci au duc d’Orléans. Et pour couronner le tout, cette mère indigne, la reine Isabeau, avait épousé la cause bourguignonne. L’enfant royal semblait ainsi plus exposé à servir d’enjeu ou de victime aux querelles sanglantes des partis, qu’à régner. En arrachant le jeune Charles à ce milieu lugubre, Yolande d’Aragon 3
Pierre CLEMENT, Jacques Cœur et Charles VII, Librairie de Guillaumin, Paris, 1853, p. 71. 4 Ibid. VALLET de VIRILLE, Histoire de Charles VII, Paris, 1863, tome II, p. 280.
156
prenait une influence prépondérante pour asseoir la continuité de la maison régnante des Valois. Ce fut une des personnalités les plus importantes de son temps. L’histoire ne l’a pas retenue à sa juste valeur pour son génie et son influence durant le règne de Charles : le soutien fort et précoce à Jeanne d’Arc, alors que d’autres avaient des doutes, suggère que la duchesse joua un rôle dans « l’apparition » de la jeune fille. Pourtant, celle qui fut probablement à l’origine du « mythe » n’est mentionnée qu’en passant. Elle fut le pivot de tous les évènements importants de quarante-deux années d’Histoire de France, alors que Jeanne d’Arc, « sa probable création », disent certaines controverses5, fut sous les feux de la rampe durant onze mois seulement. Charles ne quitta presque plus sa belle mère, ainsi qu’il l’appelait, comme pour la distinguer de celle qui se montra si mauvaise mère à son égard. Il la suivit dans ses pérégrinations, séjournant avec elle et ses enfants dans ses châteaux d’Anjou et de Provence, c’est ici que nous retrouvons René, le futur « bon roi René »6. Mêlant leurs occupations et leurs jeux, les deux jeunes princes grandirent côte à côte, au milieu de saines distractions, de l’étude, de l’apprentissage des armes et des voyages. Ils reçurent, pendant plusieurs années, la même éducation.7 On voit bien que de par les liens étroits qui unissaient le roi à la maison d’Anjou, Rodrigue semblait prendre un risque énorme, en mettant au pillage les possessions de la reine de Sicile. Mais il était soutenu dans cette affaire par Georges de La Trémoille et le duc de Bourbon. On était au mois de septembre 1432. Abusant de l’absence du duc et du roi Louis III, qui était alors en Italie, Rodrigue poussa ses ravages jusqu’aux portes d’Angers, sans respect pour la reine Yolande et son fils Charles. Le prétexte de ces violences était une prétendue créance dont le Castillan poursuivait le recouvrement et dont il venait, disait-il, pour se payer sur les sujets du duché, si ses débiteurs ne le satisfaisaient pas dans le plus bref délai. 5
Marcel GAY et Roger SENZIG, L’affaire Jeanne d’Arc, une manipulation d’État supposée et fomentée par la couronne de France, Le livre de poche, édition de poche Jules Tallandier, Paris, 2009. 6 Il conservera ce titre après avoir tenté en vain de recouvrer l’héritage du royaume de Naples contre la couronne d’Aragon. 7 Albert LECOY de la MARCHE, Le Roi René : sa vie, son administration, ses travaux artistiques et littéraires, BiblioBazaar, LLC, 2008, p. 5, 21, 32.
157
L’intérêt de La Trémoille, dans cette affaire, était de susciter des embarras suffisants à Charles d’Anjou pour le contraindre à s’éloigner de la cour, parce qu’il voyait ce prince s’insinuer dans la confiance de Charles VII d’une manière alarmante pour son propre crédit. Mais, malgré tout ce qu’on fit pour l’épouvanter, en dépit des lettres provocantes du comte de Ribadeo, Charles d’Anjou ne quitta pas la place. Il comptait assez de bras à son service pour être sûr que la résistance à opposer au Castillan se ferait sans lui. Son espoir reposait principalement sur Jean de Bueil, ami dévoué de sa maison et de sa personne, qu’il avait appelé à son aide à la première annonce du danger. Chargé par la noblesse du pays de mener une troupe pourtant six fois inférieure à celle de l’envahisseur, Jean de Bueil en prit le commandement. Le comte de Ribadeo s’était établi dans un camp redoutablement fortifié, en avant des Ponts-de-Cé sur le chemin de la capitale angevine. Jean de Bueil était un jeune homme de grande espérance, qui avait déjà une solide expérience de la guerre. Yolande et Charles d’Anjou lui firent confiance, et on le laissa se mettre en campagne avec cent lances, contre le Castillan qui en avait six cents. Cela apparut à beaucoup comme un pari suicidaire, et pourtant… Parti de la Touraine, il sut dissimuler sa marche jusqu’à Angers, et lorsqu’il fut dans cette ville, il dépêcha son poursuivant d’armes au camp des Ponts-de-Cé pour intimer à Rodrigue l’ordre de se retirer dans les vingt-quatre heures, lui proposant même un sauf-conduit pour exécuter sa retraite à l’abri de toute agression8. Ce fut là une pure bravade ! Jean de Bueil ne pouvait douter de l’inutilité de sa démarche. La sommation du jeune capitaine fit sourire le comte de Ribadeo. Il répondit qu’il soumettait l’affaire à son conseil pour en délibérer dans la quinzaine. Cela dit, conscient du danger, il fit sonner le « boute-selle » pour avertir les cavaliers de harnacher leurs chevaux et de se tenir prêts, car il savait que l’ennemi ne tarderait pas à paraître. Effectivement, Jean de Bueil suivit de près son émissaire. Il s’était pourvu de trois cents arbalétriers d’élite. Lorsqu’il fut devant le camp, il vit des cavaliers en masse, remplissant un espace long et étroit coupé à l’extrémité par une barricade de charrettes qui en défendait l’accès. Se rendant compte de la difficulté qu’il y aurait à 8
Ibid. Jules QUICHERAT, Pièces justificatives nos XV et XVI, p. 80.
158
combattre dans une aire aussi étroite, il fit mettre pied à terre à une partie de ses hommes, donnant aux autres qui restèrent à cheval, l’ordre de simuler plus loin une seconde attaque. Prenant lui-même le commandement des arbalétriers et de ses cavaliers mis à pied, il les conduisit délibérément vers la barricade. La situation des hommes d’armes de Rodrigue fut la même que celle de la cavalerie du prince d’Orange dans le bois d’Anthon. Agglomérés en masse profonde, les coudes serrés et la lance sur la cuisse, ils furent mis en difficulté par leurs chevaux qui ruèrent sous l’atteinte des traits. Avant que le capitaine castillan eût tenté un autre mouvement, la barricade fut franchie et les premiers rangs, qui seuls avaient la possibilité de combattre, furent enfoncés sous la charge impétueuse des assaillants. Plusieurs des combattants d’élite qui tenaient la tête des routiers, entre autres un Villandrando, frère de Rodrigue9, tombèrent percés de coups. Pendant cette mêlée, les gens de trait eurent le temps de se jeter sur le bagage et de faire main basse sur ce butin. Comme cela ne pouvait pas être de longue durée, le jeune capitaine qui savait pertinemment que le comte de Ribadeo allait se ressaisir donna le signal de la retraite. Et sa troupe, fière d’avoir bafoué l’autorité du vainqueur d’Anthon et de Lagny, profitant du désordre, s’éloigna au plus vite comme elle était venue. Cette action fit grand bruit et, pour les Angevins, la « détrousse des Ponts-de-Cé » fut l’une des prouesses qui défrayèrent les conversations des bivouacs. Rodrigue avait-il péché par orgueil ? Se croyait-il après toutes ses victoires au-dessus de la défaite ? Il faut, pour répondre à ces questions, ouvrir une parenthèse : ces faits sont relatés par Jean de Bueil lui-même qui en a fait entrer le récit dans son roman Le Jouvencel10. L’ouvrage de Jean de Bueil se présente d’abord comme un récit de type romanesque et relate sur de longues années la carrière par les armes d’un povre jeune gentilhomme que l’auteur rencontra au cours d’un voyage accompli dans une région désolée et 9
S’agit-il du deuxième frère de Rodrigue signalé par Josef PELLIZER dans Informe del origen antiguedad, calidad y succession de la excelentissima casa de Sarmiento de Villamayor, Madrid, 1663 ? Pellizer écrit : « Don Pedro de Villandrando, seigneur de Bambiella, mourut en 1400, jeune et veuf déjà depuis plusieurs années, laissant de feu Aldonça de Corral, sa femme, trois fils et une fille dont l’aîné est Rodrigue ». 10 Ibid. Jules QUICHERAT, Pièces justificatives, no XV, p. 237.
159
ravagée par la guerre. Mais les faits rapportés par l’auteur qui est luimême le combattant opposé à Rodrigue ne sont-ils pas embellis et entachés d’esprit partisan ? Le Jouvencel s’est enrichi, et ce, dès sa diffusion, d’une dimension autobiographique, en raison du commentaire qui figure dans quelques manuscrits aux côtés du petit traictié narratif de Jean de Bueil et qui est l’œuvre de Guillaume de Tringant. En effet, cet écuyer du seigneur de Bueil a jugé bon d’éclairer le lecteur et de lui montrer que faits et personnages, « déguisés » sous des appellations de fantaisie ou codées, renvoyaient à des événements et personnes historiques gravitant autour de la vie de son maître, qui tient bien entendu le premier rôle, celui du Jouvencel.11 Il y a lieu de s’étonner qu’un combattant aussi expérimenté que Rodrigue n’ait pas répondu sur-le-champ à la manœuvre de son adversaire par une manœuvre semblable. Faire descendre de cheval des hommes d’armes n’était pas une chose si extraordinaire. Luimême l’avait fait à Lagny avec promptitude et succès. C’était une habitude des Anglais. Dans les batailles, les plus vaillants de leur chevalerie, mettant pied à terre, venaient se ranger parmi les archers pour les épauler et leur donner du courage12. Il est vrai que le comte de Ribadeo n’avait pas en ce moment-là ses archers sous la main. Probablement aussi pécha-t-il par excès de confiance, en jaugeant mal la force de son adversaire. Quoi qu’il en soit, il se trouva singulièrement blessé dans son amour-propre. On peut imaginer sans peine que le comte de Ribadeo en fut profondément affecté, d’autant que cette défaite devint fameuse, car une chanson populaire vint railler comme une injure la détrousse des Ponts-de-Cé. L’invincible Rodrigue, ainsi « frotté », on s’en doute, ne pouvait rester sans réaction. Il défia Charles d’Anjou ! Et décida d’exécuter un raid ravageur jusqu’à l’extrémité méridionale de la Touraine. Ce n’était pas un hasard, car là étaient les plus belles 11
Marie-Thérèse de MEDEIROS, « Le Jouvencel de Jean de Bueil », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, université d’Orléans, 1998, pp. 139-152. 12 Mlle DUPONT, Mémoires de Philippe de Commines, Chez Jules Renouard, Paris, 1840, tome I, c. III. « Entre les Bourguignons, lors c’estoient les plus honnorez que ceulz qui descendoient avec les archiers, et tous jours s’y en mettoit grant quantité de gens de bien, affin que le peuple en fust plus asseuré et combasttist mieulx ; et tenoient cela des Anglois ».
160
propriétés de Jean de Bueil. L’auteur du Jouvencel le paya très cher, il ne fut jamais en capacité militaire de s’opposer au ravage de ses terres. Des personnes estant en auctorité autour du roy, selon l’expression d’un contemporain bien informé13, c'est-à-dire le seigneur de La Trémoille et ceux de sa faction, furent très mécontents de l’affaire des Ponts-de-Cé. Ils détachèrent une compagnie du roi aux trousses de Jean de Bueil, qui était allé se réfugier dans sa terre de Mirebeau, baronnie remarquablement située à la croisée des marches de trois régions : l’Anjou, la Touraine et le Poitou. Dans sa fuite, le jeune capitaine n’avait pas eu le temps de mettre à l’abri le butin raflé aux Ponts-de-Cé. Le bagage fut aussitôt récupéré par un petit groupe de poursuivants. Jean de Bueil tenta de le reprendre, se mettant à son tour à la poursuite des voleurs, mais alors qu’il galopait comme un forcené, il stoppa net son avancée. Le cantonnement de Rodrigue était en vue. En effet, celui-ci campait avec toute la puissance de ses effectifs sur les bords de la Creuse autour de La Haye en Touraine14. On ne pouvait faire deux fois l’affront au comte de Ribadeo. Jean de Bueil rebroussa chemin sur le champ et s’enfuit à toute bride. Alors Rodrigue, à la tête d’une véritable armée grossie des effectifs de La Trémoille, exerça ses représailles tout à son aise, en regagnant à petites journées la vallée de la Loire. Comme si ce n’était pas assez du dégât qu’il fit dans la région, il assigna en réparation de son dommage toutes les villes situées sur son passage. Il dépêcha en outre des messagers dans chaque cité pour les contraindre à lui fournir au plus vite tel ou tel objet qu’il avait perdu en Anjou. La cité de Tours, taxée pour sa part du don d’un cheval, en appela au roi, qui écrivit à Rodrigue de renoncer à sa demande. Rodrigue savait jusqu’où il pouvait aller, protégé certes par le favori, mais ne désirant nullement se mettre en opposition avec le roi. Alors, il se fit seulement livrer passage par la même cité de Tours, non pas pour quitter le pays plus vite, comme on aurait pu le croire, mais pour aller s’établir à l’autre bout du pont, sur la rive droite de la Loire. Là, maître de toutes les voies de communication, il leva un tribut 13
Guillaume TRINGANT, Commentaire sur le Jouvencel, chez Jules Renouard, Paris, 1887. 14 Aujourd’hui « La Haye Descartes » en hommage au philosophe, qui y est né.
161
pendant plusieurs semaines sur les passants et sur les convois. On voit décidément ce qu’il pouvait en coûter de blesser l’orgueil du Castillan ! Pourtant, il ne compromit en aucune façon sa faveur auprès du roi. Certainement soutenu en sous-main par La Trémoille, on le voit au contraire avancer en dignité, car pendant l’hiver qui suivit sa campagne de Touraine, il porta le titre de conseiller et chambellan du roi. C’était un office de cour supérieur à celui d’écuyer d’écurie. Qu’il l’ait reçu comme dédommagement des pertes aux Ponts-de-Cé ou bien en raison de ses services rendus à la couronne, peu importe, le comte de Ribadeo, fidèle à sa ligne de conduite, continua à servir le roi.15 Rodrigue recouvre les faveurs royales Cette courte défaite ne fut qu’une péripétie dans l’ascension de Rodrigue. Les évènements n’allaient pas tarder à lui donner l’occasion de se racheter totalement. Le comte de Foix était toujours investi de la lieutenance générale du Languedoc, toujours aussi au plus mal avec le comte d’Armagnac, sans être mieux pour cela avec le sire de La Trémoille. Cet intraitable Méridional gouvernait sa province en toute indépendance sans tenir compte de la souveraineté du roi. Cet état de fait durait depuis plusieurs années, nous l’avons abordé précédemment en 1428. Quatre ans plus tard, rien n’avait changé : il continuait toujours à assembler les États de la province dans l’évêché de Béziers et cela au milieu de ses gens d’armes, sous la menace d’une batterie de canons dont il avait garni la plate-forme de la cathédrale. Il faisait voter les impôts, prenait sa part et laissait le reste à la disposition du commissaire du roi.16 Charles VII hésita : lâcher les routiers contre un pareil despote n’eût été que demi-mal, si lui seul et les siens avaient dû en souffrir, mais le plus fort des malheurs allait retomber sur les populations confiées à sa garde17. Pourtant, il semble bien que l’intrusion de Rodrigue ait été tolérée en haut lieu, car un appel aux armes de la noblesse et des communes du Bas-Languedoc, au mois de décembre 15
Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, pp. 78-84. VAISSETTE (Dom), Histoire du Languedoc, Imprimeries J.-B. Paya, Toulouse, 1860, tome IV, pp. 474-477. 17 MENARD Léon, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nîmes, H. D. Chaubert, Paris, 1758, tome III, p. 236. 16
162
1432, confirme l’approche des bandes. Celles-ci se cantonnèrent dans leurs retranchements accoutumés des Cévennes. L’hiver, qui fut l’un des plus rigoureux du siècle, les empêcha de faire d’abord trop parler d’elles. Mais dès la fonte des neiges, au printemps revenu, les hordes déferlèrent en vagues successives dans toutes les vallées à la fois, par Saint-Ambroix, par Alès, par Anduze, par Ganges, et même descendant du plateau du Larzac par le Caylar. La compagnie qui était sous le commandement direct de Rodrigue s’enfonça plus à l’ouest, et pénétra jusqu’en Albigeois. Le château de la Garde-de-Viaur, près de Montirat, devint le quartier général du capitaine. L’alarme fut chaude à Albi. Le consulat fit restaurer à la hâte les fortifications et se prépara à l’état de siège. A l’autre extrémité de la ligne d’invasion, Nîmes éprouvait aussi de grandes inquiétudes. On mit en état les engins de défense. Des hommes placés en observation sur la Tour-Magne et dans le clocher de la cathédrale eurent à signaler d’heure en heure l’état de la plaine. Des messagers partaient dans toutes les directions, cherchant à s’informer sur la progression des gens d’armes de Rodrigue, ou annonçant dans les villages la visite prochaine de ces hôtes redoutables.18 Cependant, le comte de Foix, à qui était confié le salut de la province, n’apparaissait pas. Pourquoi n’amenait-il pas les troupes qu’il avait sous son commandement ? Où était-il ? Que faisait-il ? On constate seulement qu’éloigné des lieux où son devoir l’appelait, il entretenait une correspondance secrète dans laquelle Rodrigue et ses routiers étaient l’objet de tous ses soucis.19 En vérité, cette invasion n’était qu’un prétexte, car lorsqu’on connaît le dessous des cartes, la raison en est tout autre. Suite à la mort du légat du pape en Avignon en décembre 1431, plusieurs prétendants à la succession allaient s’affronter. Pour leur malheur, les Avignonnais se mêlèrent à la querelle qui opposait le pape Eugène IV au concile de Bâle, chacun proposant son candidat. Le cardinal de Foix, frère du comte, était soutenu par le pape. À l’opposé, Rodrigue allait être appelé pour aider le candidat du concile. On le voit : cette affaire, entamée par de simples courses de routiers en Languedoc, allait atteindre les frontières de l’Église et de l’État.
18 19
Ibid. MENARD, Histoire de Nîmes, t. III, p. 160 et suivantes. Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, Pièce justificative n° XX, p. 244.
163
Le comte de Foix, trop préoccupé à amasser des fonds pour constituer son armée, n’avait donc ni le temps, ni des hommes à perdre pour la défense du Languedoc. C’était pourtant ce qu’avaient espéré ses adversaires qui, dans ce but non avoué, avaient déchaîné les foudres des routiers contre la malheureuse province. Mais avant d’entrer dans le détail de « l’affaire des cardinaux d’Avignon », suivons Rodrigue dans l’un des évènements les plus importants de sa vie.
164
RODRIGUE EPOUSE MARGUERITE DE BOURBON Rodrigue est maintenant bien entouré. Il possède une véritable administration et peut confier les tâches subalternes à des lieutenants. Sa renommée, sa position, qui n’ont cessé de croître, lui imposent alors d’autres objectifs que celui de diriger de simples razzias. Dès cette époque, il porte une attention toute particulière à contracter nombre d’alliances supplémentaires tout en resserrant davantage celles qu’il a déjà scellées. C’est ainsi qu’on le voit côtoyer les grands du royaume qui ne l’ignorent plus. Un échange de correspondance se fait alors jour avec l’assistance de scribes attachés à son service. Il y exprime par exemple, sous l’obligation des serments les plus solennels, son attachement et son amitié au vicomte de Turenne, alors le plus puissant seigneur du Limousin20. On sait que ce genre d’amitié se concrétisait toujours par des accords militaires avec la promesse, en cas de besoin de se porter mutuellement assistance avec les armes. Le cardinal espagnol don Alfonso Carrillo se portait candidat à la succession du légat pontifical pour la gouvernance d’Avignon, alors on voit Rodrigue entretenir une correspondance affective avec ce prélat, qui s’est rendu son obligé en lui empruntant de l’argent21. Il n’en oublie point pour autant sa terre d’origine, il envoie des missives dans son comté et reste en communication écrite permanente avec la cour de Castille. Il correspond avec le sire de La Trémoille, avec la plupart des barons de la France méridionale, et surtout avec la famille de Bourbon, où il poursuit une affaire de première importance pour lui, et qui est sur le point d’aboutir : celle de son mariage.22
20
Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, Pièce justificative no XIX, p.244. Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, La somme considérable de 2000 ducats. Voir Pièces justificatives no XIII, p. 226. 22 Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, Paris, 1879, p. 88. 21
165
Rodrigue apparaît comme un prétendant des plus honorables, car le Castillan, qui avait toujours gardé un pied de part et d’autre des Pyrénées, vient de recouvrer nous l’avons vu, ses droits sur le comté de Ribadeo en Galice. Ce titre de noblesse ne peut que contribuer à lui apporter la considération et les faveurs bienveillantes de la maison de Bourbon. Comment Rodrigue fut introduit dans la maison de Bourbon Cette relation remonte à l’année 1422, où Rodrigue, enrôlé dans la compagnie de Séverac, participe à la dévastation du Mâconnais. Nous avons vu que c’est au cours de cette campagne que Rodrigue fut introduit dans l’entourage des Bourbon par l’entremise de Bernard d’Armagnac. Cette relation devint progressivement plus intime, grâce à des circonstances qu’il faut connaître : Le duc Jean Ier, chef de la Maison, fut fait prisonnier à la bataille d’Azincourt, et rançonné à hauteur d’un montant si considérable que depuis dix-huit ans, on cherchait à le compléter. On n’y était pas encore parvenu et l’on n’y parvint jamais. Huit jeunes enfants, tant légitimes que naturels, furent élevés sous l’autorité de leur mère, Marie de Berry. Il faut souligner ici que dans la sphère gouvernée au XVe siècle par les princes de la maison de Valois, on constate un phénomène qui fut sans précédent dans son intensité et dans son amplitude : c’est un puissant essor social et politique des enfants engendrés hors mariage par des pères appartenant à la noblesse. Assez graduellement, puis à un rythme de plus en plus accéléré, ces bâtards remplirent des fonctions de conséquence dans la défense des intérêts de la maison paternelle23. Ce fait est probablement dû à la chute de la démographie, sous l’influence conjuguée des épidémies et de la guerre, à une époque où les chefs de maison devaient assurer la pérennité de leur clan. Nous étions au plus fort de la guerre civile aggravée de la guerre étrangère. Dans les rares moments de répit où le Bourbonnais n’avait pas besoin d’être défendu contre les Bourguignons ou les Savoyards, il fallait alors se rendre aux armées du roi. Les frais de guerre
23
Mikhaël HARSGOR, « L’essor de bâtards nobles au XVe siècle », Revue Historique, Presses Universitaires de France, T. 253, fasc. 2 avril 1975, p. 319.
166
retombaient sur le malheureux duché dont les rentes annuelles suffisaient à peine à couvrir les charges du seigneur. Louis, l’aîné des Bourbons, mourut à l’âge de neuf ans. Son frère puîné, Charles, qui portait le titre de comte de Clermont, dut à sa sortie de tutelle prendre en main l’administration du duché, et l’on sait au milieu de quels embarras ! Il se trouvait face à de lourdes difficultés de gestion. Il jugea alors opportun de cultiver l’amitié d’un capitaine comme Rodrigue. Il comptait par là disposer d’une force militaire respectable, pour laquelle il obtiendrait certainement des facilités de mise à disposition et de paiement. Le Castillan, reçu dans les châteaux de Charles de Bourbon, y fut donc l’objet d’attentions d’autant plus marquées, qu’il répondit pleinement à ce qu’on attendait de lui. Compte tenu de sa forte personnalité, il prit de l’ascendant dans la maison. Il se lia notamment avec Gui, un frère bâtard du comte de Clermont, un homme né pour la guerre : il lui donna un commandement dans ses compagnies. Alexandre, un second frère, qui avait été fait chanoine à Beaujeu, fut conquis par les exploits guerriers de Rodrigue. Alors, il abjura de la profession ecclésiastique et le comte de Ribadeo le prit également à son service. Mais, contre toute attente, il se signala bien vite par une insensibilité et une cruauté légendaires. La maison de Bourbon comptait en outre deux filles naturelles. Lors de ses fréquentes visites dans les propriétés ducales, le comte de Ribadeo ne fut pas insensible à la beauté et, dirons-nous peut-être aussi au blason, de l’une des deux filles du duc. Marguerite, que sa naissance condamnait à la vie claustrale, fut l’objet de toute l’attention de Rodrigue. Il fit part de sa prétention qui ne fut pas repoussée. C’est ainsi que Marguerite de Bourbon épousa en mai 1433 notre aventurier espagnol. L’unique difficulté fut de trouver ce que l’on détacherait du domaine ducal pour constituer une dot à la jeune fille. Le mariage semble s’être fait avec la plus grande célérité, il semble même que Charles, comte de Clermont, se soit passé du consentement de son père Jean Ier de Bourbon, toujours détenu dans la capitale anglaise. Il est en effet le seul mentionné dans toute la conduite de cette affaire. Le contrat de mariage Le 24 mai 1433, Charles de Bourbon, agissant en son titre personnel, présenta à l’enregistrement de la chancellerie de Cusset les conventions arrêtées entre Rodrigue de Villandrando et lui, pour 167
l’établissement de sa sœur naturelle. Outre la présence du comte de Clermont et de Rodrigue, plusieurs nobles et puissants seigneurs et sages avaient répondu présents en tant que témoins requis et appelés. Il y avait là, entre autres, messeigneurs Béraud Dauphin, seigneur de Combronde ; Guy, seigneur de Saint-Priest ; Jehan de Chauvigny, seigneur de Blot ; Jehan de Langeac ; Pierre et Loys de Thoulon, chevaliers ; Pierre Churre ; Estienne, seigneur de la Farge, escuier. Sous les tentures d’apparat, dans la grande salle de la chancellerie, quatre magistrats faisaient face aux nobles gentilshommes : maistres Philippe Marjas et Jehan Trichon, notaires, entourés de Pierre de Carmonne et Jehan La Bise, licenciés en lois. Pierre de la Chiese, conseiller du Roy et tenant le sceau royal de la cour de la chancellerie des exceptions d’Auvergne, les salua avec respect et fit connaître à voix haute les termes du contrat qui liait les deux parties : Nous faisons savoir par devant nos aimés et féaux jurés notaires de ladite cour et chancellerie, usant de nos autorité et pouvoir, établis personnellement hault et excellent prince et seigneur, monseigneur Charles de Bourbon, comte de Clermont, fils aîné de très haut et excellent prince, monseigneur le duc de Bourbonnais et d’Auvergne et ayant le gouvernement de ses pays, terres et seigneuries et très noble Marguerite, sœur naturelle de mon dit seigneur comte et les leurs d’une part ; et noble et puissant homme Rodrigo de Villandrando, seigneur de Ribedieu, pour lui et les siens d’autre part… La dot se composait de la seigneurie d’Ussel en Bourbonnais, avec un revenu garanti de mille livres, plus une somme, une fois payée, de deux mille pour le trousseau. Vu le mauvais état du château d’Ussel, celui de Châteldon fut provisoirement assigné comme demeure aux conjoints. En effet, les revenus de celui-ci apparaissaient plus réguliers. Châteldon était à l’époque un bourg peuplé où régnait une grande activité économique : couteliers, papetiers et tanneurs en faisaient la richesse. De son côté, le futur époux versa une somme de huit mille écus d’or pour constituer le douaire de sa femme, et il prit sur lui l’engagement d’enjouailler la dite demoiselle et deument, selon son estat, c’est-à-dire de lui acheter les parures et bijoux seyant à une princesse de sang royal et femme de comte. Une clause rajoutée à la demande du comte de Clermont nous apparaît intéressante. Charles de Bourbon profita de cet acte pour 168
s’attacher contractuellement les services de Rodrigue. Il consentit la cession de la place d’Ussel uniquement du vivant de Rodrigue qui aura l’habitation de ladite place de Ussel et l’usufruit des dites mil livres de rente, par le cours de sa vie seulement et lui estant au service de mondit seigneur le comte. L’objectif pour Charles était clairement affiché : grâce à cette union, il s’attachait la puissance militaire de son futur beau-frère. Par son mariage, le comte de Ribadeo fut seigneur de vingt-sept places en Bourbonnais24. Ces vingt-sept villages, si tant est que Châteldon et Ussel n’en aient jamais contenu un si grand nombre dans leurs juridictions, représentaient un revenu de mille livres, et cela sur le papier. Mais en réalité, il fallut en rabattre cette somme de deux bons tiers. La cession d’Ussel, bien qu’Ussel ait le rang de ville fermée, était loin de constituer une fortune. Outre la demeure seigneuriale reconnue inhabitable, le revenu de la terre était si loin du compte que l’on dut faire une retouche de ce contrat à la date du 2 août 1436. En effet, durant les trois premières années de son mariage Rodrigue ne put apparemment s’assurer que trois cents livres de revenu sur les mille qui avaient été stipulées. Mais notre Castillan possédait, par ailleurs, suffisamment de rentes pour subvenir à l’entretien de son épouse. Et puis, disons-le, il mit au-dessus de toute question d’argent, l’insigne honneur de s’allier à la maison de France. Le couple prit possession de la forteresse de Châteldon et Marguerite en accord avec le comte de Ribadeo, entreprit une rénovation intérieure qui devait représenter le symbole de leur toute nouvelle union. Il y avait alors dans le château une immense pièce qui prenait place au plus haut des murailles de l’imposante bâtisse, quasiment sous les combles. Cette salle fut baptisée plus tard : « Salle des États » Les jeunes époux y firent réaliser sur les quatre parois une décoration murale où leurs armes respectives s’entremêlaient en alternance, créant un tableau du plus bel effet. Ce décor traversa les siècles puisqu’il subsistait encore en 1929. À cette date, un témoin rapporte : la décoration murale de cette salle des États est très intéressante au point de vue du séjour de Villandrando, car toute la muraille sur les quatre faces est peinte à rinceaux, avec les armoiries
24
D’après son biographe espagnol Hernando del Pulgar.
169
alternées de Villandrando et de Marguerite, bâtarde de Bourbon, sa femme.25
-13 Château de Châteldon en Auvergne où séjournèrent Rodrigue de Villandrando et son épouse Marguerite de Bourbon. Photo F. Monatte.
Ensuite, Rodrigue se fit assigner sur les meilleures recettes du Bourbonnais la rente, jusque-là si mal servie, qui avait été constituée en dot à sa femme. Mais trois ans plus tard, en 1436, cette résidence provisoire fut redemandée par le possesseur légitime, Philippe de Vienne, fils d'Isabeau de Montaigut-Listenois. La maison de Vienne, qui avait joué un rôle considérable dans l’histoire de la Bourgogne, se trouva, à la faveur de la réconciliation de Charles VII avec le Duc de Bourgogne, en position de recouvrer les possessions de Châteldon. Rodrigue et Marguerite eurent à se faire pourvoir d’une autre demeure. 25
BULLETIN de la Société d’Émulation du Bourbonnais, lettres, sciences et arts, Imprimerie E Auclaire, Moulins, 1930, p. 77, voir Données historiques complémentaires dans cet ouvrage, Annexe 6, p. 338.
170
Cet état de choses avait été prévu au contrat : Au cas que le dit lieu de Châteldon serait mis hors des mains des dits Rodrigo et damoiselle Marguerite, en le baillant à ceux qui s’en disent seigneurs ou autrement, mon dit seigneur le comte sera tenu de bailler aux dits Rodrigo et damoiselle une autre demeure, bonne place et aussi forte comme est le dit Châteldon, ensemble autant de terre que lui aura été baillé sur la terre du dit Châteldon, pour accomplir les dites mille livres de rente, ainsi que dessus est dit. Il devait avoir, et eut en effet, mais sans pouvoir entrer aussitôt en jouissance, le château de Saint Bonnet de Rochefort en Bourbonnais26, celui dont la masse imposante se dresse encore au-dessus du cours de la Sioule. Au gré de déplacements permanents, Rodrigue occupa aussi périodiquement une troisième demeure de 1434 à 1439 : le château de Montgilbert. Ce château, idéalement placé en limite des comtés de Forez et d’Auvergne, appartenait à Jean de Vienne, mais en l’absence de celui-ci, Charles de Bourbon laissa le château en gage à Rodrigue. Le duc était en effet débiteur de 6000 écus d’or que lui avait prêtés le Castillan. Celui-ci put ainsi profiter du château jusqu'au remboursement complet de la somme prêtée. En 1439, date qui coïncide avec le retour de Rodrigue en Espagne, Jean de Vienne, devenu majeur, retrouva ses biens et son château avec des défenses renforcées, car pendant son séjour, Rodrigue avait ordonné la construction d’un bastion pourvu de canonnières. Le château comportait alors deux formidables parties défensives. Une première enceinte enserrait le « château du haut ». Avec l’apparition de l’artillerie, il fallait en effet des murs encore plus épais, moins hauts et des « bouches à feu ». À Montgilbert, cette révolution se manifesta principalement par la construction du bastion voulue par Rodrigue. L’entrée par la tour du porche, alors trop vulnérable, fut condamnée. L’accès se fit probablement en contournant le château du haut par des « lices » ou terrasses qui longeaient les murailles à l’est et au nord. Ce cheminement en spirale ordonné par le comte de Ribadeo, à l’image du système défensif de bien des châteaux de Castille, posait un réel problème aux assaillants. Il comportait plusieurs obstacles,
26
Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, Pièce justificative no XII, p. 224.
171
murs et chicanes, et passait à portée des meurtrières du « château du haut ».
-14 et 15 Ruines du bastion défensif de Montgilbert (vues intérieure et extérieure) construit sur ordre de Rodrigue de Villandrando. Sa destruction partielle nous laisse entrevoir le « château du haut ». Photos F. Monatte.
172
L’étrange silence d’une femme Aucun élément concernant Marguerite de Bourbon n’est parvenu à franchir les limites imposées par l’histoire officielle. Qui était-elle ? Quel fut son rôle auprès de son chef de guerre de mari, dont les exploits nous sont comptés par les chroniqueurs sans qu’aucun élément ne soit rapporté sur l’existence de son épouse ? Il faut noter que pour cette période de l’histoire, au-delà de l’image d’une Jeanne d’Arc, magnifiée par « les historiens de la Nation française », l’idée de la passivité des femmes sur la scène sociale ou publique a la vie dure. Il y a là sans conteste un coin obscur qu’ils se sont refusé à mettre en lumière, laissant aux hommes la noble tâche d’assumer seuls la destinée de la Nation. Pourtant, les nombreux récits évoquant des femmes parmi les premières victimes de la guerre cachent les exemples, peut-être isolés, de la participation d’espionnes, de messagères, voire d’opposantes actives ou encore d’épouses réunissant l’argent de la rançon nécessaire à la libération de leur mari. Un des prisonniers de Rodrigue, Varambon, l’homme au nez d’argent, ne fut-il pas sauvé par sa propre mère, celle-ci rassemblant la rançon nécessaire pour le tirer des griffes du capitaine castillan ? Cependant, le rôle important qu’ont probablement joué les femmes lors de ce conflit séculaire ne peut être qu’imaginé tant les sources restent silencieuses. Si l’absence de leur mari permet à certaines de manifester leur aptitude à gérer les situations auxquelles elles sont confrontées, l’évidence veut que les sources « oublient » ou dissimulent toujours les activités féminines qui ne correspondent pas à ce que l’on attend de leur genre. Ce sont en effet, ordinairement, des hommes qui nous ont laissé ce que l’on peut savoir des femmes, les hommes n’apprécient pas le plus souvent que les femmes sortent d’attributions si traditionnelles qu’on se plait à les croire naturelles27. C’est pourquoi nous ne saurons rien de plus que les seuls éléments
27
Adrien DUBOIS, Femmes dans la guerre (XIVe-XVe siècles) : un rôle caché par les sources ?, Université de Paris I.
173
généalogiques que nous ont rapportés les historiographes concernant la vie de Marguerite de Bourbon, épouse du comte de Ribadeo. Il est vrai que les absences de mention, ces « oublis de mémoire » en quelque sorte, sont souvent réels, volontaires ou pas, mais toujours dictés par les mœurs du temps. Une anecdote qui se trouve consignée sur l’un des registres capitulaires de la cathédrale de Lyon évoque l’absence de Marie de Berry, qui, après la prise en otage de son époux Jean Ier, se retira de la gestion du duché. Elle semble, en effet, n’avoir joué aucun rôle auprès de Marguerite. Même plus, elle a été tenue totalement à l’écart des transactions du mariage qui voyait une princesse de sang royal épouser ce qui ne pouvait être pour elle qu’un simple aventurier castillan. Elle y tient même le rôle lointain d’une femme totalement retirée des réalités de son siècle : au moment où l’on se livrait à tant de commentaires sur les évolutions probables du comte de Ribadeo, les mêmes terreurs dont tout le monde était assiégé en Bourgogne troublaient le sommeil de la duchesse de Bourbon, l’épouse affligée du duc prisonnier. Cette princesse alors en résidence à Lyon était logée dans le cloître de la cathédrale. Entendant dire autour d’elle que les gens d’armes de Rodrigue étaient convoqués pour porter la guerre en Savoie et qu’ils allaient venir camper près de Lyon, à tort ou à raison elle se figura qu’il y aurait du danger pour elle dans ce voisinage, et elle fit présenter une requête au chapitre pour que les portes du cloître fussent fermées pendant la nuit. Les chanoines s’empressèrent de faire droit à cette demande. Ainsi donc, on peut supposer que ce mariage n’eut certainement pas l’approbation de la duchesse. Il faut que celle-ci ait ignoré jusqu’au dernier moment une union dont on lui avait fait mystère, ou qu’en en étant instruite elle ait préféré s’éloigner de sa Maison plutôt que d’y donner son consentement. On conviendra que cette dernière supposition expliquerait bien mieux la crainte que lui inspirait l’approche des routiers à la veille du mariage de leur chef. Marguerite s’éteignit probablement vers la fin de l’année 1436, après moins de quatre ans de mariage. La plupart des généalogistes s’accordent sur cette date. Trois enfants naquirent de cette union : Charles de Villandrando qui hérita des biens paternels en France et deux filles qui s’établirent en Espagne : Isabelle, mariée à Don
174
Lorenzo Suárez de Mendoza et Marie, religieuse au monastère de SanQuirse de Valladolid.28
28
Voir dans cet ouvrage, Données historiques complémentaires, Annexe 4, p. 338.
175
« L’AFFAIRE » DU CARDINAL DE CARILLO Par ce mariage princier, Rodrigue avait aussi épousé la cause des Bourbons. Nous avons vu que le duc possédait des fiefs en Bresse, jusqu’au pays des Dombes. Or, ces territoires, isolés sur la rive gauche de la Saône, étaient menacés par l’avancée d’un partisan ennemi. C’était aussi un Espagnol, mais non pas Castillan. On l’appelait François l’Aragonais, ou de son nom de famille, François de Surienne. Dans ces temps de troubles, François l’Aragonais était aussi surnommé Poliorcète1 ou « preneur de villes », car qualifié d’aventurier à la solde des Anglais, il s’était déjà emparé de trentedeux places fortes sur le territoire ennemi. La politique extérieure de la puissance sous laquelle il était né explique son hostilité contre tous ceux qui soutenaient la cause de Charles VII. Il porta pendant tout le temps des guerres la croix rouge des Anglo-Bourguignons. Son dévouement aux Anglais lui valut même d’être élevé par ceux-ci à la dignité de « chevalier de la Jarretière ».2 François l’Aragonais occupait Marcigny qu’il avait eu l’habileté de reprendre aux troupes favorables à Charles VII. Aussitôt, celles-ci se dédommagèrent de cette perte par la prise du château de Solutré près de Mâcon. On se poursuivit alors d’un côté et de l’autre avec un acharnement si préjudiciable au pays, que les habitants décidèrent le versement d’une contribution pour une trêve, dont la première condition était l’évacuation des deux places. Mais lequel des deux partis allait accepter de s’exécuter le premier ? L’Aragonais insista pour être payé d’abord. On lui compta son argent, mais Marcigny ne fut pas rendu !3
1
Du grec ancien : « assiéger ». Stratège militaire spécialisé dans l’art de mener un siège. 2 Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, p. 92. 3 Ibid. Marcel CANAT, Documents inédits pour servir à l’histoire de Bourgogne, pp. 217-220.
177
Son mariage à peine célébré, Rodrigue, en infatigable combattant, décida, nous dit Quicherat, de célébrer ses noces par une danse générale de ses bandes sur les terres du duc de Bourgogne. Il jugea qu’au lieu d’attendre de l’Aragonais un résultat qu’on n’obtiendrait jamais de lui, au lieu de continuer indéfiniment la guerre d’escarmouches, il valait mieux tenter un grand coup. Ses compagnies, cantonnées dans le Lyonnais et le Beaujolais, étaient prêtes à se mettre en mouvement. La terrible réputation du comte de Ribadeo le précédait maintenant en toute circonstance. La rumeur bourguignonne s’en empara et on le disait estre à grant puissance sur les frontières de Charrolois et Masconnois, en intencion d’entrer ès pays de Bourgogne4. L’inquiétude fut à son comble. Des convocations furent envoyées à l’adresse de la noblesse bourguignonne, afin de mobiliser toutes ses forces pour venir à la défense des pays menacés. Puis étonnamment, contre toute attente, le danger se détourna. Des intérêts majeurs venaient de se manifester ailleurs : la Bourgogne eut à se porter contre une autre armée à la solde de Charles VII qui s’avançait par la Champagne5. Quant aux routiers de Rodrigue, ils avaient tout bonnement disparu. Ils étaient partis pour une expédition qui était le résultat d’une négociation de leur capitaine avec le cardinal de Carrillo. À grand renfort de troupes, sous les bruits résonnant du pas des fantassins et de la cavalcade militaire, notre infatigable aventurier avait maintenant pris la route en direction du Comtat Venaissin. « L’affaire » du cardinal de Carrillo Anciens territoires démembrés de la Provence et du Languedoc pour devenir terre papale, « le Comtat Venaissin » et Avignon possédaient avec les provinces limitrophes, une origine, une langue, des coutumes et des intérêts communs. Resserré dans des limites trop exiguës, le sol, bien que riche et très fertile, ne pouvait produire les ressources suffisantes pour alimenter toute la population. C’est donc par la permanence d’échanges commerciaux avec leurs proches voisins que vivaient les sujets du pape. Cette communauté d’intérêts amenait forcément des relations d’État à État et des rapports 4
Ibid. Jules QUICHERAT, p. 92, Note 2, Septième compte de Mathieu Regnault. ANNUAIRE Historique du Département de l’Yonne, Recueil de documents authentiques, Perriquet et Rouillé, Auxerre, 1893, p. 229.
5
178
incessants au-delà des limites du Comtat. Ainsi, les Avignonnais et les Comtadins se trouvèrent, par la force des évènements, par le jeu même de leurs intérêts et aussi par la position topographique de leur territoire, mêlés à tous les grands faits de l’histoire.6 Le Comtat Venaissin était en pleine révolte contre la cour de Rome. En effet, à l’automne 1431, en l’espace de quelques mois, venaient de mourir l’évêque d’Avignon Guy III de Roussillon et le recteur du Comtat Venaissin Pierre de Cottini. Puis, le 31 décembre de la même année, s’éteignait à son tour le vicaire général apostolique François de Conzié.7 Ces trois successions allaient donner aux Avignonnais le motif de se mêler à la querelle qui opposait alors le pape Eugène IV et le concile. Ils se déclarèrent les adversaires du pontife. Malheureusement pour eux, cette prise de position allait leur coûter bien des désagréments. Après la mort du recteur, l’assemblée des États du Comtat prie Eugène IV de lui donner comme successeur Jean de Poitiers, évêque de Valence. Mais sans tenir compte de ces demandes, le pape décide de le remplacer par le Vénitien Marc Condulmero, son neveu. Les Avignonnais ont beau rappeler au pape qu’aucun étranger ne peut être nommé officier des États, le 9 janvier 1432, Eugène IV passe outre et nomme son neveu évêque d’Avignon. Puis le 21 janvier, il l’appelle aux fonctions de vicaire général. Ainsi, sur la tête de Condulmero se trouvent réunies trois fonctions distinctes, au grand mécontentement des Avignonnais qui décident de transmettre une plainte au concile de Bâle. Cette célèbre assemblée siégeait depuis deux ans déjà et son hostilité contre le Vatican s’était manifestée plus d’une fois. Le concile déclara le choix du pape inacceptable, et nomma de sa propre autorité le cardinal Carrillo.8 Le pape Eugène IV, conscient que cette triple nomination ne répondait point aux vœux des Comtadins, ne la leur avait communiquée que trois mois après, ce qui augmenta encore leur colère. Ceux-ci lui envoyèrent de véhémentes protestations. Les États 6
R. REY, Louis XI et les états pontificaux de France au XVe siècle, Imprimerie de Allier frères, Grenoble, 1899, pp. 55-58. 7 Charles Louis RICHARD, Dictionnaire universel dogmatique, canonique historique et chronologique des sciences ecclésiastiques, Paris, 1740, tome 1, p. 434. 8 Ibid. Jules QUICHERAT, p. 94.
179
du Comtat furent convoqués pour prêter serment de fidélité, ils s’insurgèrent encore et, après avoir sollicité la révocation de Condulmero, demandèrent à nouveau la nomination d’Alphonse de Carrillo. Or, il faut savoir que le cardinal Carrillo, diacre du titre de SaintEustache, avait fait preuve par le passé des sentiments les plus conciliants vis-à-vis de la cour de France. Il avait intercédé avec bienveillance en faveur du royaume dans le règlement de différends soulevés à propos des limites du Rhône que le Saint-Siège lui avait donné mission de résoudre en 1430. Le cardinal de Carrillo se présentait donc comme l’homme des intérêts français, et Charles VII était dans l’obligation de le ménager. Aussi, le roi, désireux de voir nommer à titre définitif un haut dignitaire ecclésiastique servant les desseins de sa politique, pria les syndics d’Avignon d’user de toute leur influence pour obtenir la nomination du cardinal de SaintEustache. Charles VII insistait, en faisant valoir les avantages que procurerait ce choix tant au royaume de France qu’aux États de l’Église. Pour complaire à la demande du roi, les Avignonnais s’empressèrent d’appuyer auprès du Saint-Siège la candidature du cardinal de Carrillo. Cependant, Eugène IV tenta une ultime manœuvre. Il leur fit savoir que la présence du cardinal castillan comme légat du Saint-Siège en Espagne était indispensable à un moment où la papauté se trouvait aux prises avec tant de difficultés. En même temps, le 31 mars 1432, pour mettre fin à toutes ces démarches dictées par le royaume de France, Eugène IV confirma à ses sujets « d’en deçà » la triple promotion de son neveu Marc Condulmero aux fonctions d’évêque d’Avignon, de légat du SaintSiège et de recteur du Venaissin. Le nouveau légat vint aussitôt prendre possession de son siège, et les États furent convoqués pour prêter serment de fidélité. De violentes contestations s’élevèrent alors à Carpentras et à Avignon contre cette effarante situation de cumul qui ne pouvait être que préjudiciable à l’intérêt du pays.9 Dans le même temps, la rumeur avignonnaise attaquait violemment les mœurs privées du nouveau représentant de la papauté. La guerre éclata à nouveau dans les domaines de l’Église. D’un côté Eugène IV, décidé à maintenir son neveu envers et contre tous et de
9
Ibid. R. REY, p. 58.
180
l’autre les Avignonnais se plaçant sous la protection du concile de Bâle. Le schisme qui divisait l’Église sembla renaître de ses cendres. La position du roi de France était fort embarrassante. Son cœur penchait pour les Avignonnais et pour le candidat du concile, mais il lui répugnait d’engager directement la lutte contre le Pape. C’est pourquoi officiellement, dans ses lettres patentes données à Amboise le 20 juillet 1432, Charles VII s’empressa-t-il de déclarer que les sujets du roi devaient garder une stricte neutralité à l’occasion de la querelle qui s’était élevée entre les sujets de l’Église et leur légat. Si le souverain semblait ainsi se défausser, il ne voyait cependant pas d’un mauvais œil l’intervention éventuelle dans ce conflit d’un « sujet indépendant de son royaume », comme l’était Rodrigue. Cela l’arrangeait même dans ses convictions intérieures. Le 20 juin 1432, le concile de Bâle qui avait accueilli très favorablement la demande d’intervention des Avignonnais nomma donc, avec mission temporaire, comme légat d’Avignon, Alphonse Carrillo à la place de Condulmero. Ce dernier, seul contre l’hostilité générale des Avignonnais, fut obligé de quitter son siège et se réfugia à Rome10. Comme on pouvait s’y attendre, Eugène IV ne voulut pas pour autant reconnaître l’élu du concile. Alors, pour contrer cette assemblée, il résolut d’opposer un nouveau postulant, un prélat énergique, diplomate de premier ordre, qui était à Rome le confident du Saint-Siège : le cardinal Pierre de Foix11. Le 16 août 1432, celui-ci était nommé légat du Saint-Siège à Avignon. 10
Ibid. R. REY, p. 59. Pierre de Foix, né en 1386 ou 1387, était fils de Gaston de Foix et d’Éléonore de Navarre, qui fut reine de Navarre, succédant à son père Jean d’Aragon. Nommé cardinal par Benoît XIII, en 1409, à l’âge de vingt-deux ans, il fut successivement évêque de Lescar, de Comminges, d’Albano, administrateur de l’archevêché de Bordeaux, et de l’évêché de Dax, archevêque d’Arles et abbé de Montmajour. Abandonnant le parti de Benoît XIII, il assista au concile de Constance où il se fit remarquer comme orateur, prit part à l’élection de Martin V (1417) qui le légitima comme cardinal en 1418 ou 1419. Il fut envoyé en 1425 en Espagne par Martin V, auprès d’Alphonse d’Aragon et fit preuve d’une grande finesse diplomatique. Ce fut lui encore, par ses voyages en Espagne, en 1426 et 1428, après la mort de Benoît XIII, qui obtint que le pseudo-pape Clément VIII (Gilles Munoz) se démette (26 juillet 1429). Le succès de cette ambassade prépara la fin du schisme. Eugène IV le nomma légat d’Avignon (16 août 1432). Installé dans son siège par la force des armes (juin 1433), Pierre de Foix administra avec la plus grande sagesse les États du Saint-Siège et sut, même dans les circonstances les plus difficiles, concilier les intérêts de l’Église avec ceux des rois de France. 11
181
Pendant ce temps, Carrillo, sans attendre l’approbation de Rome, avait pris possession du Comtat, puis il avait quitté Avignon pour se rendre à Bâle, laissant le gouvernement de la ville à Philippe de Lévis, archevêque d’Auch. Philippe était un fidèle du comte d’Armagnac, de sorte que la contestation s’envenimait encore de l’animosité des deux maisons rivales, Armagnac et Foix. Le but du voyage d’Alphonse Carrillo était de demander au concile les subsides nécessaires pour soutenir, à main armée, la lutte contre le représentant légitime du Pape. Carrillo s’adressa d’abord personnellement à son compatriote, Rodrigue de Villandrando, auquel il emprunta deux mille écus d’or. La ville d’Avignon dut se porter garante, comme il apparaît dans un acte en date du 6 juin 1442, figurant dans l’inventaire des papiers de la maison de Bourbon.12 Carrillo éprouvait une considération particulière pour le comte de Ribadeo. Il jugea le moment venu de lui de lui faire part de son ambitieux projet. Il lui exposa que l’intérêt de la chrétienté tout entière était engagé dans cette question du gouvernement d’Avignon. La reconnaissance des pères du concile et de tous les vrais fidèles, disaitil, serait acquise à celui qui prendrait la défense du droit contre les violences d’une famille criminelle13. Finalement, il l’exhorta à se proposer auprès du concile pour l’accomplissement de ce rôle. Rodrigue ayant écrit à l’assemblée de Bâle conformément au conseil du prélat, une délibération suivit de près sa lettre. Dès le 6 mars 1433, Rodrigue qui était cantonné au sud du plateau de l’Aubrac répondit encore de Saint-Martin de Lennes pour aviser le concile qu’il se tenait à sa disposition promptum et paratum, autrement dit prompt et préparé14. Par un décret rendu peu avant son mariage en Bourbonnais, le concile, au nom de l’Église universelle, décida d’engager la force armée du comte de Ribadeo. La guerre se transporta dans les États de l’Église. Le cardinal de Foix ne recula pas, comme le dit Quicherat, devant l’emploi de ce qu’on appelait alors « le bras séculier » et fit appel à ses deux frères, le comte Jean de Foix et Mathieu de Comminges. Nous avons ici 12
Ibid. R. REY, pp. 60-61. F. de GRAILLY, Les États du Comtat Venaissin depuis leurs origines jusqu’à la fin du XVIe siècle, « Mémoires de l’Académie de Vaucluse », Seguin, Avignon, 1882. N° 1, 1906, p. 330. 14 Ibid. F. de GRAILLY, Les États du Comtat Venaissin, 1882, N° 1, 1906, p. 330. 13
182
l’explication du déferlement sauvage des hordes de routiers sur la province du Languedoc. Comme nous l’avons vu, le concile, à l’instigation de Carrillo, avait demandé à Rodrigue de Villandrando de faire diversion sur les terres méridionales relevant de la gouvernance du comte de Foix, Invadere patriam linguae occitaneae15. Et l’on comprend aussi maintenant la raison de l’inaction du comte de Foix face aux désordres dont le Languedoc fut le théâtre pendant l’hiver 1433. Retiré dans son château de Mazères, en plein comté de Foix16, il faisait des préparatifs pour la guerre du Comtat Venaissin et avait garde de ne pas dépenser à l’avance ses hommes et ses ressources. Aux supplications qui lui étaient adressées de toutes parts, il répondait par la promesse d’une action énergique aussitôt que le subside annuel serait octroyé par la province. Les États se réunirent à Béziers au mois de mars, malheureusement les fonds votés ne furent pas disponibles avant le mois de mai. Les habitants de la province firent donc les frais de ce qui n’était en réalité qu’une instrumentalisation politique. Rodrigue se porta audevant des troupes du comte de Foix. Pendant ce temps, ce dernier qui avait établi son quartier général à Villeneuve-lès-Avignon s’engagea dans une démarche abusive : il convoqua à nouveau les États du Languedoc, les contraignant à venir dans son propre camp. Il obligea l’assemblée à lui octroyer « par acclamation », le surcroît d’une contribution de guerre énorme : soixante-dix mille moutons d’or qui s’ajoutaient aux cent vingt mille déjà payés. Le seul motif allégué pour justifier cette extorsion fut la nécessité de résister à Rodrigue. Ce n’était évidemment là aussi qu’un prétexte. La province du Languedoc fut pour la deuxième fois le jouet de la puissance des grands. En réalité, cet argent devait servir à s’emparer d’Avignon. Fin mars 1433, l’armée du comte de Foix est prête. Le 24 mars, de son fief de Mazères, il avertit les villes du Languedoc de son prochain passage et les prie de ne point contrarier sa marche17. Aux premiers jours du printemps, des troupes importantes avancent vers Avignon. Elles comprennent plus de deux mille cavaliers et plus de deux cents fantassins. Elles sont dirigées par les capitaines Jean de Bonnay, 15
Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, Pièce justificative no XXV, p. 97. Ibid. VAISSETTE (Dom), Histoire du Languedoc, Imprimerie J. B. Paya, Toulouse, 1860, tome IV, p. 481. 17 « LA FRANCE FRANCISCAINE », Mélanges d’archéologie, d’histoire et de littérature, Éditeur SN Lille, Paris, 1912, No 1, 1921, pp. 17-20. 16
183
Bernard de Coarraze, Fortaner de Serres, le sénéchal de Nebouzan, le chevalier de Brion et plusieurs autres. Guillaume de Champeaux, gouverneur des finances du Languedoc accompagne cette armée. Pour renforcer la démarche partisane envers le cardinal de Foix, dans les rangs sont venus encore se joindre des prélats. Il y a là cinq évêques et deux abbés : l’évêque de Laon, l’évêque de Couserans, l’évêque de Pamiers, l’évêque d’Aire, l’évêque de Bethléem accompagnés de l’abbé Jean Roques et de l’abbé de Lézat18. Au début d’avril, l’armée traverse les plaines du Toulousain et passe devant Albi. Pierre de Foix arrive à Montpellier et envoie aux Avignonnais un dernier avertissement. Cette lettre a pour seul résultat de les épouvanter, car ils implorent la protection de Charles VII et prennent de sérieuses mesures de défense. Le 28, les vigies placées au sommet de la tour Magne de Nîmes purent voir au loin, par-delà la garrigue, poudroyer les plaines du Gardon sous les pas de l’armée pontificale. Alors qu’elle longeait le Rhône, le sénéchal de Beaucaire vint encore rallier avec ses contingents les bataillons armés. Le 3 mai, à l’assemblée des Trois États du Comtat, le recteur Jean de Potiers expose une situation fort préoccupante pour la ville. Les hommes d’armes en grand nombre, fantassins, cavaliers et arbalétriers se trouvent au-delà du Rhône. La situation est critique. Il exhorte la cité d’Avignon à réunir au plus vite des troupes pour sa défense. Parallèlement, il démontre qu’il faut pourvoir au salut du Comtat bien plus qu’à celui d’Avignon, le pays étant plus vaste, plus ouvert et contenant beaucoup de châteaux peu défendus et mal pourvus d’hommes et de munitions. Il ajoute que des évènements malheureux peuvent se produire de jour en jour. Les États apeurés promettent de faire bonne garde, votent une contribution de mille florins et nomment des « élus de la guerre ». Le 6 mai, ils vont couvrir par des forces suffisantes Mondragon et Caderousse, s’assurent le concours de notables bourgeois et prennent à leur solde des routiers et hommes de guerre : Guillaume le Bastard, Marot Hug, Philippe le Bastard. Le 9 mai, le comte de Ribadeo, averti du mouvement des troupes du comte de Foix, se porte au pont Saint-Esprit, mais son adversaire le devance et peut franchir le Rhône sans encombre19. Le lendemain, dimanche, toute l’armée est sur les terres pontificales. 18 19
Ibid. « La France franciscaine », p. 17. Ibid. F. de GRAILLY, p. 331.
184
De son côté, Rodrigue pénétra apparemment avec quelque retard dans le Comtat. Cela paraît inhabituel de sa part, mais il faut souligner que le comte de Ribadeo était dans le même temps en pleins préparatifs de mariage. Quelles opérations poursuivit-il pour l’accomplissement de sa mission ? Nous n’avons malheureusement que des informations partielles à ce sujet. On sait seulement qu’en fin stratège, il divisa ses troupes en deux. Dans un premier temps, une partie de ses routiers prit position dans la sénéchaussée de Nîmes, pour tenter de prolonger la diversion et inquiéter le comte de Foix. En revanche, le gros de ses troupes traversa le Rhône, probablement aussi au Pont Saint-Esprit pour déferler dans le Venaissin. Cela nous est prouvé par une plainte d’Eugène IV contre le concile qu’il accuse d’avoir déchaîné sur les terres de l’Église le meurtre, le pillage et l’incendie.20 En fait, il n’y eut jamais d’affrontement direct entre les deux armées. On sait seulement que Rodrigue, occupé par ses obligations personnelles, détacha au début du mois de mai des corps armés pour le suppléer. L’armée du comte de Foix n’eut donc pas de réelle opposition dans le Venaissin. Elle précéda constamment les détachements de Rodrigue. Il faut dire que devant la tournure des évènements, le roi de France hésitait de plus en plus à afficher une trop visible opposition au pape. Il n’engagea donc pas le comte de Ribadeo à poursuivre cette entreprise. Tout va alors très vite. Le dimanche 10 mai au soir, les troupes du comte de Foix arrivent devant Bollène. Elles s’en emparent aussitôt et sur les conseils de l’évêque de Couserans, elles placent au plus haut de l’église, les armes du pape et de Pierre de Foix. On fait sonner les cloches. Puis, après avoir laissé là une garnison, l’armée continue sa marche, prenant de la même façon, sans coup férir, villes et bourgades. Le pays possède peu de vivres, les localités sont nombreuses, dépeuplées et mal protégées. Elles ne peuvent résister ! Malaucène se rend le 12 mai, après un semblant de lutte. On y fait quelques prisonniers et les habitants prêtent obéissance au Cardinal en lui offrant douze chevreaux et un baril de vin.21
20 21
Ibid. MENARD, Histoire de Nîmes, tome III, p. 160. Ibid. R. REY, pp. 258-259.
185
Le lendemain, 13 mai 1433, l’armée continue sa marche victorieuse à travers le Comtat, en suivant la même tactique et avec le même succès. Le cardinal et ses frères arrivent devant Carpentras. La ville est bien fortifiée, défendue par ses habitants et par un nombre assez important d’hommes d’armes. Le comte Jean, prévoyant qu’il lui faudrait faire un siège régulier, vient établir son armée à Monteux sur le chemin d’Avignon à Carpentras de façon à empêcher ces deux villes de communiquer. Pendant ce temps-là, l’évêque de Couserans continue ses prédications fulminant les habitants de menaces terribles contre leurs âmes, leur ouvrant les perspectives d’une damnation et d’un enfer éternels s’ils ne se laissent convaincre. Et il les menace aussi dans leur corps et dans leurs biens, leur désignant de la main la forte armée qui allonge ses colonnes profondes derrière eux22. Le sénéchal de Beaucaire et le sénéchal de Nebouzan, Fortaner de Serres ont mission d’entamer des pourparlers réguliers pour le Cardinal et le comte de Foix. Le parti de la résistance ne se sent pas capable de lutter contre le sentiment populaire. Les pourparlers aboutissent, et le lendemain, le Cardinal, entouré de ses prélats, de ses deux frères et d’un nombre imposant d’hommes d’armes, est reçu dans Carpentras avec toutes les marques solennelles d’allégresse publique. Plus aucune ville n’ose opposer de résistance. Les troupes s’avancent précédées de la bannière pontificale aux cris de vive le Pape, et le cardinal de Foix, son vicaire. Les deux abbés et les cinq évêques, surtout l’évêque de Couserans, sont les porte-parole. Ils entament des négociations, tiennent des discours très engageants, méprisent le concile, louent le pape. Si l’on hésite, ils menacent de peines ecclésiastiques terribles et annoncent la destruction des campagnes, l’anéantissement des blés et des vignes. Ce sont là des arguments auxquels on ne sait résister ! Enfin, l’armée se prépare à emporter d’assaut le château du Pont de Sorgues, qui est la clef de la défense d’Avignon. Pendant ce temps, Jean de Grailly, un des plus audacieux capitaines de l’armée du comte de Foix, est venu en avant-garde mettre le siège devant Avignon. Le 15 mai, le comte de Foix est devant la ville et le siège va durer presque trois mois.
22
Ibid. F. de GRAILLY, p. 331.
186
Avignon était en vérité le seul objectif du comte de Foix, mais s’emparer d’Avignon n’était pas une petite affaire. Face à lui se dressait une formidable enceinte. Il n’y avait pas d’attaque-surprise à tenter face à ce palais colossal dressé tel un château fort, avec ses murailles si bien crénelées, si bien gardées par une population qui avait juré de ne pas recevoir d’autre gouvernement que celui qu’elle tenait du concile. Le comte poussa alors le siège de la ville avec une vigueur extrême. À défaut de gros canons, dont des armées mieux pourvues que la sienne faisaient usage pour pratiquer une brèche, il employa contre Avignon les ressources de l’ancienne artillerie. Il fit construire de ces grandes catapultes, appelées trébuchets, au moyen desquelles des quartiers de roche pouvaient être lancés à des distances considérables. Une grêle de ces projectiles tombant sur la ville produisit l’effet d’un bombardement23. Des maisons furent effondrées, des personnes écrasées, et les Avignonnais commencèrent à trouver leur sort bien cruel. La panique gagna les habitants. Les uns, partisans de Carrillo et du concile, prêchaient la résistance à outrance. Les autres, au contraire, gagnés par les propositions du cardinal de Foix, étaient d’avis d’ouvrir les portes aux assiégeants. Sur ces entrefaites, une sédition éclata dans la ville et grâce à cette diversion, le cardinal de Foix entra par une brèche. Les armes de Carrillo furent abattues. L’archevêque d’Auch, jeté hors du palais des papes, n’eut d’autre ressource que de s’enfuir précipitamment de la ville par une poterne que ses derniers partisans lui avaient ouverte. Le cardinal de Foix fit alors une entrée triomphale sous l’étendard de ses deux frères. Ainsi se terminait l’expédition des frères de Foix : c’était l’anéantissement des espérances du concile. Le pape devait sa victoire à la neutralité bienveillante du roi de France et à la non-intervention de Rodrigue qui avait décidé de rester fidèle à la volonté du souverain. Motifs complexes, mais réels. La cour de France, bien qu’ayant observé une prudente réserve, y trouvait son compte, car le pays reçut en la personne du cardinal de Foix, un légat dévoué à sa cause. Dans tout le cours de sa longue carrière (1432-1464), sans oublier ce qu’il devait aux papes et à 23
Ibid. VERMS Miguel (del), Chroniques béarnaises, dans le Panthéon littéraire, Paris, 1811, p. 593 : « Grans engens ab los quals abatia et derocava los hostals de la dita ciutat d’Avinho ».
187
l’Église, Pierre de Foix servit, avec un zèle constant, la politique de Charles VII.24 Cependant, le comte de Ribadeo, qui savait toujours jusqu’où il pouvait aller, n’avait pas jugé utile de pousser plus loin son action. Il s’était même absenté quelques jours au beau milieu de la guerre. Mais son excuse était valable : il venait sagement de convoler en justes noces…
24
Ibid. R. REY, Louis XI et les états pontificaux de France au XVe siècle, pp. 63-64.
188
LA GUERRE DES DUCS A la fin de l’expédition d’Avignon, les hommes d’armes prirent leurs quartiers d’hiver dans le Rouergue, tandis que d’autres troupes s’en allaient avec Rodrigue batailler sous la bannière du comte de Clermont, contre le duc de Bourgogne.1 Lorsqu’une campagne militaire était terminée, Rodrigue divisait son armée en plusieurs unités ayant chacune à sa tête un lieutenant. C’était là un fonctionnement nécessaire à la survie des grosses compagnies qui reprenaient la totalité de leurs effectifs, sur ordre de leur capitaine, seulement quand celui-ci avait réussi à négocier un contrat d’intérêt ou d’envergure suffisant. Le comte de Ribadeo solutionnait ainsi les éternelles difficultés d’approvisionnement, multipliant ses points d’actions sur des aires ciblées et des territoires diversifiés. Cette tactique de morcellement lui permettait aussi de s’assurer des revenus suffisants en multipliant les « patis » contractés avec les villes. Et il y a de quoi se perdre dans le dédale des archives ! Voilà pourquoi les chroniques signalent Rodrigue partout à la fois, doté d’un don d’ubiquité étonnant. Plusieurs auteurs le citent ici et là dans le même temps, parce que les témoignages des malheureux habitants des contrées ravagées par ses troupes ne mentionnent d’une façon générale que le seul nom du redoutable capitaine. C’est ainsi qu’en cette fin d’année 1433, une partie des routiers de Rodrigue fut dirigée vers le Rouergue. Pourquoi cette préférence régionale ? Le comte d’Armagnac, comte de Rodez, exerçait sur cette partie de la province une sorte de protectorat qui aurait dû la préserver de cette visite encombrante, car Rodrigue n’avait pas rompu avec le chef de la maison d’Armagnac. Bien au contraire, il venait de servir l’intérêt du comte d’Armagnac dans sa lutte contre le cardinal de Foix. Et voilà qu’au retour de cette guerre, il livre au ravage un pays couvert des possessions de ce même seigneur, et qu’il expose ses sujets à des violences inconcevables. Encore une fois, tout cela semble bien 1
Maurice MAINDRON, Récits du temps passé, Nouvelle Édition, A. Maime et fils, Tours, 1924, p. 205.
189
contradictoire. Malheur à celui qui laissait une dette impayée au comte de Ribadeo ! Il était irrémédiablement attaqué pour être mis à contribution. Et de fait, Rodrigue semble avoir toujours conservé en réserve quelques-uns de ces impayés, en justification de ses éternels mouvements de pillages. Mille moutons d’or, dix mille écus et deux coursiers n’avaient pas été réglés et le Rouergue ne se pressant pas pour lui accorder la moindre avance, Rodrigue le livra au pillage de ses troupes. Durant plusieurs années, elles le parcoururent sur tous les points.2 Mais il y avait pire encore : lorsque le désordre semblait à son comble, il y avait l’effet « boule de neige ». Le mal se rajoutait au mal. Des petits groupes armés se tenaient prêts, suivant de proche en proche les pillages, tels des vautours qui attendent la fin de la curée. De petites bandes opportunistes venaient se superposer aux conflits, consumant ce qui pouvait rester encore sur les cendres fumantes du désespoir. Il en fut ainsi dans le sillage des troupes de Rodrigue lors de cet épisode du Rouergue. Une famille de chevalerie du nom d’Apchier, qui fut l’une des premières en Gévaudan, se composait alors du père, de deux fils légitimes et d’un bâtard. Tous les quatre s’étaient attachés à la cause de Charles VII et servirent avec valeur, tantôt dans les compagnies régulières, tantôt à la tête d’une bande qu’ils firent et défirent tour à tour, suivant que leur convenance ou la nécessité les y portait. Ils étaient de toutes les parties où il y avait des coups à donner, et aussi de celles au bout desquelles on était sûr de trouver son profit. Aucune entreprise de routiers conduite dans leur voisinage ne les trouva indifférents. Ils s’y rendirent toutes les fois, sans qu’on eût besoin de les inviter. Or, tandis que les bandes de Rodrigue amenées en Rouergue dévastaient les villages entre Milhau et Entraigues, le bâtard d’Apchier accourait à sa suite à la tête d’une vingtaine d’individus armés.3
2
M. L’Abbé Joseph ROUQUETTE, Le Rouergue sous les Anglais, Imprimeurs d’Artières et J. Maury, Millau, 1887, p. 431. 3 Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, pp. 100-101.
190
Le Mont Saint-Vincent Revenons aux Bourguignons que nous avons laissés aux prises avec un fort contingent français du côté de la Champagne. Le mois de novembre 1433 touchait à sa fin et le duc de Bourgogne Philippe le Bon donnait à Dijon des fêtes somptueuses pour la naissance de son fils Charles4. Pourtant, à peine ces réjouissances terminées et malgré la mauvaise saison, le duc se remit en campagne. Il fit venir de ses États du nord une armée composée de Flamands et de Picards pour rétablir l’intégrité de la frontière occidentale du duché et donner la chasse aux ennemis infiltrés qui infectaient les abords de l’Auxois et du Nivernais. Il faut dire que la pénétration en était facilitée, car les limites des pays, dans cette région en particulier, étaient mal connues des contemporains eux-mêmes, avec des enclaves et des territoires contestés. Quoi qu’il en soit, face à cette subite avancée bourguignonne, le duc de Bourbon éprouva les craintes les plus vives pour l’intégrité de ses terres. Nous l’appellerons désormais ainsi, car le comte de Clermont venait d’être élevé à la dignité de duc de Bourbon par la mort de son père. En effet, après dix-neuf ans de captivité et faute de n’avoir jamais pu rassembler la rançon, le duc Jean 1er s’était éteint à Londres, sans jamais revoir la terre du royaume de France. Et voici qu’à peine investi de sa gouvernance, le jeune duc voyait son duché fragilisé à la marge. Il appela aussitôt à la rescousse son beau-frère, Rodrigue. Celui-ci, tout juste sorti du conflit d’Avignon rassembla en toute hâte le gros de son armée et vint exécuter « sa diversion accoutumée » sur les limites des deux duchés, au plein de l’hiver 1434. Rodrigue prit résolument l’offensive. Il envahit encore une fois le Mâconnais, et se trouva le 6 janvier 1434, jour des Rois, au pied du Mont Saint-Vincent, avec mille quatre cents hommes que commandaient son lieutenant Salazar et le capitaine Chapelle5. La citadelle du Mont-Saint-Vincent couvrait le sommet d’une colline redoutablement défendue, occupant ainsi une position stratégique de premier plan. Depuis le haut Moyen Âge, elle avait été érigée en 4
Futur Charles le Téméraire. M. GARNIER et ROSSIGNOL, Inventaire sommaire des archives départementales de la Côte-d’Or, Chalon, Comptes de Jean de Genlis, 1433-1434, Paul Dupont, Paris, 1864, tome II, p. 6.
5
191
véritable forteresse par les Bourguignons et elle se sentait fort capable de faire ombrage à l’autorité du roi. Un imposant château couronnait cet ensemble. Le comte de Ribadeo jugea de l’importance de la place, puis décida de porter son action en certains points vulnérables de la muraille. Ville et château furent emportés par une audacieuse escalade, et les routiers prirent possession de cet endroit admirablement positionné qui allait pouvoir servir de base aux terribles opérations lancées sur le pays. La nouvelle de cet évènement mit le duc de Bourgogne dans une inquiétude extrême. Le soir même, il fit partir de Dijon le bâtard de Saint-Pol et les sires de Noyelles et d’Auxy avec cinq cents hommes d’armes de l’Artois ignorant toutefois quelle était la force de l’ennemi. Le 15 du même mois, le duc écrivait à Jean de Rochefort, écuyer, maître de son artillerie, de lui envoyer à Chalon les bombardes qui étaient encore dans l’Auxerrois, mais l’expédition n’osa pas avancer lorsqu’elle apprit que Rodrigue tenait le Mont Saint-Vincent à la tête de ses redoutables mercenaires. Alors, le duc convoqua en toute hâte le ban de la Bourgogne et de la Franche-Comté pour seconder les Artois, qui par crainte d’un affrontement avec le comte de Ribadeo, s’étaient arrêtés à Buxy en attendant du renfort. La brillante chevalerie qui répondit à cet appel n’employa pas la meilleure tactique face au comte de Ribadeo. Au lieu de surprendre son adversaire, elle joua au contraire la carte de la provocation et vint tournoyer au pied de la montagne afin de reconnaître les lieux et tenter d’impressionner le Castillan. Rodrigue compta tranquillement ses adversaires et en homme averti mit au point son plan d’action. Sur-lechamp, il ordonna la fermeture des portes de la ville et envoya ses hommes dans les maisons faire main basse sur les rares objets et valeurs qui pouvaient encore rester, puis il se prépara calmement à opérer une retraite stratégique. Rodrigue, bien avisé, n’attendit pas l’attaque des Bourguignons, qui à peine arrivés sous les murs de la place, furent étonnés d’apprendre un matin que l’ennemi l’avait abandonnée pendant la nuit.6 6
Ibid. Marcel CANAT, Documents inédits pour servir à l’histoire de Bourgogne, « Société d’histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône », Dejussieu, Chalon-surSaône, 1863. Vol. I., p. 340.
192
On avait fait des ballots de tout ce qui en valait la peine et un soir, pendant que les Bourguignons se concertaient autour des feux de camp sur les manœuvres du lendemain, nos gens délogèrent sans bruit. Ils s’éloignèrent avec leur butin par des chemins perdus qui empruntaient la ligne obscure des bois. Peu avant l’aube, les Bourguignons dépités se rendirent à l’évidence : la place était déserte et le comte de Ribadeo était parvenu à se réfugier dans le Bourbonnais. L’éloignement du Castillan ne fut pas de longue durée, car Rodrigue apprit par ses informateurs que le duc de Bourgogne, jugeant la conquête terminée, avait rappelé son armée. En effet, étant maître du Mont Saint-Vincent, Philippe le Bon y laissa une simple garnison et s’en retourna vers des préoccupations plus mondaines. Le 4 février, il se rendit à Chambéry pour assister aux noces du comte de Genève avec Anne de Chypre, fille de Janus, roi de Jérusalem et d’Arménie7. Rodrigue profita de cet intermède pour aller chercher le reste de ses bandes, toujours cantonnées dans le Gévaudan, à partir duquel elles continuaient à lancer des raids dévastateurs sur le Rouergue et tout le Bas-Languedoc. L’alarme était entretenue à Nîmes par des lettres du consulat de Millau8. La rumeur signalait le comte de Ribadeo dans les parages9. Mais loin de songer à porter ses pas de ce côté, quand il se mit en route, ce fut pour retourner à la frontière bourguignonne. Dès les premiers jours de mars, on apprit avec effroi à Dijon qu’il stationnait à proximité de Charlieu avec des forces considérables10.
7
Ibid. Marcel CANAT, Documents inédits sur la Bourgogne, Vol. I, p. 340. Ibid. MENARD, Histoire de Nîmes, tome III, p. 183. 9 Jules QUICHERAT, 1879, Note 3, p. 105. « Par devant le viguier de Nismes, François Aurillac a reçu, le 4 avril 1433, du trésorier de Nismes 22 moutons d’or taxés par mandement du sénéchal de Nismes et de Beaucaire, du 21 mars précédent, pour avoir été de Nismes à Mazères (Château du comte de Foix) porter au dit sénéchal certaines lettres des gens du Conseil du roy, estans audit lieu de Nismes, et de plusieurs barons, nobles, sindicz et consulz, manans et habitans de la ville du Puy et des pays de Velay et de Gévaudan, faisans mention de Rodrigo et plusieurs autres gens d’armes et de traict, lesquels se efforcent d’entrer au présent païs de Languedoc, et dès jà sont près des fins (limites) de ladite séneschaucié ». 10 Ibid. Marcel CANAT, Documents inédits, p. 310/Garnier, Inventaire sommaire, p. 6. 8
193
L’assemblée de Vienne La reprise des hostilités fut différée à cause d’une grande assemblée qui allait se réunir à Vienne11, où l’on espérait entrevoir quelques perspectives de changement quant à la situation du royaume. Pour la première fois depuis son sacre, Charles VII s’était décidé à tenir cour plénière. Il en trouvait l’occasion dans sa réconciliation récente avec son connétable Arthus de Richemont, et dans les adieux qu’il convenait de faire à la reine présomptive de Naples et de Sicile, qui allait rejoindre son époux en Italie. Le roi avait choisi Vienne, la grande cité du Dauphiné, pour y réunir les députés de ses pays d’États du midi12. Pour la tenue de cette assemblée, il avait invité les princes français et les ambassadeurs des puissances amies. Les représentants du concile de Bâle étaient aussi conviés. Nous savons que Charles VII avait été un de leurs soutiens, aussi poursuivaient-ils l’espoir de pacification du royaume avec autant d’ardeur que la réforme de l’Église. Rodrigue assista à la réunion de Vienne en compagnie des Bourbons qui y étaient venus tous ensemble. Consécutivement à la succession de son père, le tout nouveau duc de Bourbon avait hérité de l’office de grand chambrier de France. Il exerça donc en grande pompe les devoirs de cette fonction, le roi siégeant à table. Quant à son beau-frère « le routier », on ne sait pas quel rang lui fut assigné dans les cérémonies. Mais des actes témoignent que le comte de Ribadeo fit, en cette occasion, figure d’un grand et riche seigneur. Plusieurs grands personnages, et le duc tout en premier, furent très heureux de recourir à ses finances. La terre de Montgilbert en Bourbonnais lui fut cédée en gage par Charles de Bourbon contre la garantie d’une somme de six mille écus d’or. Rodrigue accepta la transaction et peut-être par simple faveur familiale avança immédiatement une partie de ces fonds à son beau-frère. Le Castillan prêta en outre mille écus d’or supplémentaires au vicomte de Comborn, seigneur d’Orgnac-sur-Vézère en Limousin. 11
Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, p. 105. Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, Note 1, p. 106. « Fist et tint le roy de France ung conseil, à Lyon sur le Rosne, des trois estaz du pays, c’est assavoir du Languedoc, du Daulphiné et du Limosin ». L’auteur a nommé Lyon à la place de Vienne, trompé sans doute par les lettres d’une première convocation, où Lyon avait été désigné comme lieu de l’assemblée. 12
194
La conclusion de ces conférences où l’on était venu s’entretenir de la paix fut en définitive qu’il fallait plus que jamais se préparer à la guerre. Les États votèrent de quoi y subvenir et désignèrent les capitaines qui en dirigeraient les opérations. Rodrigue fut du nombre de ces élites militaires13. À vrai dire, l’ordre de mission qu’il reçut ne fut pas autre chose que la régularisation du commandement dont il avait été déjà investi par le duc de Bourbon sur la frontière bourbonnaise : aussi n’eut-il qu’à retourner au milieu de ses troupes. La place forte de Charlieu Il les cantonna à l’intérieur et autour de Charlieu, ville désormais acquise à sa cause, dont il fit une forteresse imprenable. Les murs étaient cependant tout délabrés. Il les fit remettre à neuf. Il disposa sur leurs lignes crénelées un système de « machines volantes », à l’action desquelles devait s’ajouter celle d’une grosse bombarde qu’il fit fondre dans ce but. Quand la cité fut bien fortifiée, il lança ses hommes par petites escouades sur le Mâconnais et sur le Charolais, qui furent ravagés en même temps. La ville de Mâcon, craignant pour sa sûreté, jugea nécessaire elle aussi d’ajouter des machines de guerre à la force de ses remparts14. L’année précédente, elle avait d’ailleurs rehaussé sa muraille audessus des créneaux moyennant une construction en pierres sèches dans laquelle on avait planté, à des intervalles rapprochés, des douves de tonneau taillées en pointe par le bout15. On faisait ces ouvrages pour se prémunir contre l’escalade dans un cas pressant, mais ils ne duraient pas et à moins d’être réparés sans cesse, ils tombaient rapidement en ruine. C’est pourquoi les habitants de Mâcon trouvèrent que le mieux pour leur sécurité était de s’imposer la dépense d’une 13
Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, Note 2, p 107 : « Auquel conseil ilz ordonnèrent le duc de Bourbon, Rodrigue, Fortespice et plusieurs aultres pour faire la guerre et tenir frontière ». 14 Ibid. Marcel CANAT, Documents inédits, p. 234. 15 Ibid. Marcel CANAT, Documents inédits, p. 219 « Pour obvier à emblée d’eschielles (le bailli) avoit advisé qu’il estoit nécessaire occuper les murs autour de la ville, c’est assavoir fermer les crénaux, excepté un pertuis à mectre la teste dehors, et par-dessus mectre duelles de boysseaux épuisiées par devant, à un tour l’une de l’autre, et chargier par-dessus de pierres… un pied d’aut ; et pardessus les premières d’icelles, mectre d’autres en forme d’un ratel. Et se divisera par cinquantaines et dizaines, comme sera advisé ».
195
construction durable. Ils y pourvurent au moyen d’une collecte de fonds hebdomadaire. Rodrigue, malgré la peur que semait la seule évocation de sa puissance armée, ne souhaitait pas s’attaquer à une grosse ville déterminée à se défendre. Prudent, il ne fit aucune tentative sérieuse sur Mâcon. C’est sur les bourgs et sur les châteaux que, comme toujours, il dirigea ses détachements en appliquant la tactique éprouvée de la terre brûlée qui lui réussissait si bien. Les captures et les prises furent nombreuses. Le grand succès de la campagne fut la capitulation du château de Chaumont-la-Guiche, remarquablement édifié sur une petite éminence rocheuse en limite du Charolais et du duché de Bourgogne. Cependant, le duc de Bourgogne, qui était allé faire des « levées » de combattants, arrivait avec le dessein de harceler le duc de Bourbon en l’attaquant à la fois dans le Beaujolais et dans les Dombes. La perte de Chaumont le blessa d’autant plus qu’il était exaspéré contre les routiers. Il avait juré d’en finir avec eux. Il donna à ses troupes des ordres impitoyables. Elles devaient procéder par le fer et par le feu, sans prêter à leurs actions de représailles une quelconque considération de pitié. En signe d’exemple, il fit d’abord noyer dans la Saône ou « accrocher » aux arbres plusieurs centaines de prisonniers, en expiation d’outrages qu’avaient essuyés certains de ses ambassadeurs. Au siège de Chaumont, dont il voulut suivre les opérations en personne, deux cents combattants qui tenaient cette place se rendirent, espérant être saufs. Ils furent tous pendus. Monstrelet rapporte que dans le nombre il y avait un neveu de Rodrigue dont l’identité ne nous est pas parvenue.16 Les routiers, bousculés de toutes parts par la fureur de ces représailles, ne purent trouver aucun refuge parmi les populations. Leurs dérèglements les avaient rendus odieux à tous les habitants de la contrée. Le vœu des villageois était de les voir exterminés, et loin de leur prêter assistance, les paysans du plat pays étaient prêts à tomber sur eux, s’ils en avaient la possibilité. Une lettre de rémission, accordée par Charles VII, contient le récit d’une de ces vengeances secrètes dont furent victimes deux hommes enrôlés par Rodrigue de
16
Ibid. MONSTRELET d’ARCQ, Chroniques, 1861, T. I. II, ch. CLVI, p. 90.
196
Villandrando17. Le fait se rapporte à cette campagne militaire de 1434. Il eut précisément pour théâtre le Beaujolais, enclave bourbonnaise en plein territoire bourguignon que les compagnies de Rodrigue s’employaient alors à défendre. L’unité à laquelle appartenaient ces routiers, s’étant rassemblée autour de Villefranche, y commit tant de dégâts, que les habitants d’un village de la contrée, appelé Saint-Just d’Avray, abandonnèrent la plupart leurs maisons pour se barricader dans l’église du lieu, d’où ils n’osèrent plus sortir. Un laboureur de la même paroisse, qui demeurait dans un lieu écarté fut cependant assez brave, ou assez pauvre, pour oser rester chez lui, quoi qu’il dût arriver. Deux hommes d’armes frappèrent un soir à la porte : par aventure c’étaient des gens paisibles qui demandèrent, moyennant rétribution, à souper pour eux, et du foin pour leurs chevaux, contents d’ailleurs de boire de l’eau et de coucher sur la paille, si on n’avait ni du vin ni lit à leur offrir. Ces procédés d’honnêtes gens qui, à cause de leur rareté seule, eussent commandé des égards, ne firent qu’affriander la vindicte du paysan. Il se mit à considérer « les afflictions, rançons, pilleries et battures, et aux autres maux énormes et innumérables dommages » que le pauvre peuple de son pays avait supportés et supportait encore, tellement qu’il en vint à conclure que ce serait justice rigoureuse de tuer ces gens d’armes et de les voler, comme eux ou leurs pareils en avaient tué et volé tant d’autres. Il sortit donc quand il fut assuré que ses hôtes étaient endormis, et s’en alla quérir aux environs plusieurs de ses amis, tant pour arrêter en leur compagnie l’exécution de son dessein, que pour l’accomplir avec leur assistance. À cinq qu’ils étaient, ils entrèrent furtivement dans l’étable où dormaient les routiers, enlevèrent leurs armes, les garrotèrent, et les emmenèrent bien loin avec leurs chevaux. Arrivés dans un bois, sur le coup de minuit, ils firent une halte, puis ordonnèrent à leurs prisonniers de se confesser l’un à l’autre. C’était leur dire le sort qui les attendait ; dont les autres, bien loin de se réjouir, commencèrent à remuer les bras, comme s’ils pensaient se dégager de leurs liens ; mais aux premiers mouvements qu’ils firent, on les tua avec leurs propres épées qu’on avait eu soin d’apporter à cet effet. Leurs assassins, après les 17
Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, « Charles VII, lettre de rémission de 1448, se rapportant à l’année 1434 », Pièce justificative no XXXVI, p. 266.
197
avoir dépouillés jusqu’à la chemise, délibérèrent que deux d’entre eux iraient déguisés vendre les deux chevaux, non pas à Villefranche, non pas à Beaujeu, non pas même à Lyon où on aurait pu les reconnaître, mais à Vienne en Dauphiné.18 Ainsi fut-il fait, les neuf écus de la vente furent partagés entre les cinq comparses et personne ne sut rien de l’assassinat des routiers. Mais le laboureur de Saint-Just, pris par la peur et redoutant d’être inquiété un jour par la justice du duc de Bourbon, alla se dénoncer et demander grâce au roi. La bonne fortune ne pouvait sourire éternellement au Castillan. Rodrigue cessa de progresser quand il fut face à l’armée renforcée du duc de Bourgogne. La situation où il s’était trouvé en 1431, lors du précédent conflit bourguignon, se renouvela en tous points. Il devait répondre à l’ennemi à la fois dans le Charolais, le Mâconnais et dans les Dombes. Ses compagnies trop disséminées ne purent porter aucun coup décisif. Elles n’empêchèrent ni la concentration de forces bourguignonnes à Mâcon, ni l’invasion du Beaujolais, ni la prise de la place forte de Belleville. L’hiver approchant, les vivres commencèrent à manquer sur le terrain des opérations. Rodrigue fut obligé de conduire ses unités dans une retraite plus sûre. Il les dirigea à l’abri des montagnes, vers le pays de Velay.19 Un curieux évènement se produisit au moment de la prise de Belleville. Le roi de Castille avait envoyé au duc de Bourgogne l’un de ses hérauts d’armes. À quelles fins ? On sait que ce genre d’émissaire était envoyé en principe pour traiter une affaire grave, négocier une rançon ou encore porter quelque réclamation concernant un fait de guerre. La coutume castillane voulait que l’on désigne ces hérauts d’armes par un sobriquet, les affublant d’un nom de fief ou de seigneurie. Or, ce messager s’appelait curieusement... Villandrando. Ce nom d’emprunt le désigna malheureusement à la vindicte bourguignonne et cette démarche fit naître des soupçons. À peine était-il arrivé à Chalon où se trouvait alors le duc, qu’il fut fait prisonnier. Et là, bizarrement sur ordre du même duc, on le relâcha aussitôt. On le dédommagea même des dépenses qu’il avait engagées 18
Ibid. MONSTRELET d’ARCQ, Chroniques, p. 90. Ibid. VAISSETTE (Dom), Histoire du Languedoc, Imprimerie J. B. Paya, Toulouse, 1860, tome IV, p. 483. 19
198
lors de sa courte captivité. L’aventure semble d’un mince intérêt, mais elle souligne la notoriété dont le comte de Ribadeo jouissait dès lors dans son pays natal. C’est assurément en considération de sa personne que le nom de Villandrando fut attaché à l’une des démarches diplomatiques engagées par le roi de Castille. On était en décembre. Le duc de Bourbon, enfermé dans Villefranche et serré de près par une armée de Picards, semblait perdu lorsque le bruit se répandit tout à coup qu’il était en pourparler pour faire la paix avec le duc de Bourgogne. La guerre se prolongea encore dans le Beaujolais jusqu’à la fin de l’année, mais la lassitude amena le duc de Bourgogne et le duc de Bourbon, non seulement à convenir entre eux d’une paix durable, mais encore à jeter les premières bases du fameux traité qui, six mois après, devait réconcilier la Bourgogne et la France. Un contentieux familial motiva la décision du duc de Bourgogne pour rompre l’alliance anglo-bourguignonne. En effet, sa sœur Anne de Bourgogne, mariée au duc de Bedford décéda à Paris le 13 novembre 1433. Suite à ce décès, le duc anglais chercha une autre alliance et contracta un nouveau mariage utile à son pouvoir, avec la nièce de Louis de Luxembourg, évêque de Therouanne, chancelier de France pour les Anglais. Cette alliance avec la maison de Luxembourg, vassale du duc de Bourgogne, fut conduite avec discrétion. Mais, faute impardonnable en de telles circonstances, le duc de Bourgogne, ex-beau frère du duc de Bedford, n’avait pas été consulté… Ce fut le début et la cause probable de la rupture de l’alliance anglo-bourguignonne. Le dénouement en effet ne se fit pas attendre. Il eut pour conséquence, non seulement la cessation des hostilités sur les deux rives de la Saône, mais encore la réconciliation des Français et des Bourguignons qui fut scellée plusieurs mois après par le traité d’Arras.20
20
Ibid. QUICHERAT, 1879, p. 113.
199
COOPERATION ENTRE LA FRANCE ET LA CASTILLE Nous l’avons vu, Rodrigue n’avait cessé de conserver et d’entretenir d’étroites relations avec son pays d’origine. Le comte de Ribadeo percevait les rentes attachées à son fief galicien et avait donc l’obligation d’en conduire l’administration. Et même si l’histoire se tait sur ses déplacements d’ordre privé, il est intéressant de relever « certaines absences » du comte sur les terres du royaume de France. Il est permis de penser que ces courtes périodes ont été mises à profit pour le règlement d’affaires personnelles dans son comté ou à la couronne de Castille. Rodrigue occupe ainsi une situation singulière dans la hiérarchie militaire et la noblesse des deux États. Reconnu et anobli de chaque côté des Pyrénées, il est bien le fils de ces deux royaumes. Ses liens personnels entre les couronnes respectives suivent donc leur politique générale, car en ce début du XVe siècle les rapports, déjà excellents entre ces pays, deviennent plus nombreux et plus suivis. L’honneur de la Castille est de collaborer aux guerres soutenues par le roi de France contre le roi d’Angleterre, par des contingents armés et surtout par la participation de la flotte.1 On peut même dire que l’accord franco-castillan doit sa naissance au début de la guerre de Cent Ans. Il paraît évident que Philippe de Valois, prévoyant le conflit qui allait le mettre aux prises avec un ennemi redoutable, rechercha l’appui d’Alphonse XI. Celui-ci était maître de la majeure partie de la péninsule ibérique et possédait une marine considérable. De plus, ses états touchaient aux domaines anglais de la Gascogne. Il pouvait pour ces deux raisons avoir sur l’issue de la lutte une grande influence2. Dès cette époque, de part et d’autre les regards se tournent par-dessus l’épaule des Pyrénées. Castillans et Français commencent alors à s’observer de plus près et à 1
Béatrice LEROY, Histoire et politique en Castille au XVe siècle, Pulim, Limoges, 2000. 2 Georges DAUMET, Études sur l’alliance de la France et de la Castille aux XIVe et XVe siècles, E. Bouillon, Paris, 1898, Introduction, p. VIII.
201
se comparer et, comme l’on se met à en transcrire les annales, les nombreux témoignages sur ces visites réciproques ne font pas défaut. Parallèlement, le groupe des trois royaumes chrétiens, Castille, Navarre et Aragon avec ses prolongements en Italie, devient imposant. L’infidèle est refoulé sur ses dernières positions, l’issue de la lutte entre l’Islam et la Croix n’est plus douteuse. Aussi, les royaumes ibériques peuvent-ils maintenant s’ouvrir aux puissances européennes et quand leurs intérêts le leur commandent, prendre part aux démêlés des princes chrétiens, s’unir à l’un pour combattre l’autre. Ils n’appellent plus les croisés à leur aide. Leurs guerriers, leurs marins, que n’absorbe plus la reconquête, vont volontiers chercher gloire et fortune en France. On sait que Rodrigue fut de ceux-là. De son côté, Charles VII ne restait pas inactif. Les pièces avaient bougé sur l’échiquier politique. De Chinon comme de Tours, le roi et son Conseil organisaient la lutte, qui semblait plus acharnée et plus favorable que jamais. L’espoir renaissait. Le roi obtint enfin les subsides nécessaires, développa les relations en direction de plusieurs pays : avec l’empereur Sigismond, Frédéric duc d’Autriche, le marquis de Ferrare, le duc de Milan, le doge de Venise, et surtout avec Juan II de Castille, en envoyant auprès de chacun de ces monarques, de véritables ambassades.3 Entouré de toutes parts par des puissances hostiles, le roi de France désirait, plus que tout, se rappeler aux bons soins de son homologue et puissant voisin, le roi de Castille. Contrairement aux usages jusqu’alors suivis, les pactes qui unissaient les deux souverainetés n’avaient pas été renouvelés depuis l’avènement de Charles VII. Il faut dire que ces monarques avaient été, chacun de leur côté et au-delà des luttes d’États, en proie à de grosses difficultés intérieures qui les avaient empêchés de renouveler leurs alliances. On voulut sans doute réparer cet oubli. Dès qu’il en eut le loisir, Charles VII, étant à Lyon le 28 juin 1434, chargea Denis du Moulin, archevêque de Toulouse, Jean de Bonnay, sénéchal de Toulouse, Thierry Lecomte, chevalier, et le secrétaire Hervé du Fresnoy, de se 3
Michel CAFFIN de MEROUVILLE, Le beau Dunois et son temps, Nouvelles Éditions Latines, Paris, 2003.
202
rendre en Castille afin de régulariser cette situation anormale4. C’est à l’Alcazar de Madrid5 que fut reçue avec magnificence cette délégation envoyée par le roi de France Madrid 1434 Quand Juan II apprit que les ambassadeurs étaient proches de Madrid, il envoya son connétable, don Alvaro de Luna, en compagnie de tous les comtes, chevaliers et prélats qui se trouvaient à la cour. Ces personnages s’avancèrent jusqu’à une lieue de la ville, puis faisant cortège aux Français, les conduisirent à la résidence royale où on arriva à la tombée de la nuit. Le roi fit aussitôt sortir vingt damoiseaux tenant chacun un flambeau allumé pour les accueillir. Les ambassadeurs pénétrèrent dans une salle de l’Alcazar, tendue de tapisseries et éclairée par des torches. Le roi siégeait sur une haute estrade, assis sur une chaise ornée abritée par un dais de velours cramoisi et à ses pieds on voyait couché un grand lion apprivoisé, chose toute nouvelle pour les ambassadeurs, et dont ils s’émerveillèrent fort. A leur entrée, le Prince s’était levé, mais l’archevêque, effrayé par la présence du fauve, n’osait s’avancer. 4
Georges DAUMET, Études sur l’alliance de la France et de la Castille aux XIVe et XVe siècles, E. Bouillon, Paris 1898, note p 83 : Cette pièce contient le texte de l’alliance et le pouvoir des ambassadeurs. Thierry Lecomte n’arriva pas en Castille, car son nom ne figure pas parmi ceux des plénipotentiaires qui jugèrent l’observation du traité au nom de Charles VII. Le 20 novembre 1435, l’archevêque de Toulouse reconnaît avoir reçu 1.200 livres moutons d’or pour son voyage qui avait duré six mois. 5 Durant la seconde moitié du XIVe siècle, les monarques de la dynastie Maison de Trastamare Enrique III, Juan II et Enrique IV fréquentent assidument la ville de Madrid pour pratiquer la chasse. Ils y maintiennent une maison, située dans l'actuelle rue de Santa Clara, qui se convertit durant leurs règnes en une des résidences habituelles des souverains de Castille. Notons le fait que les Cortes de Castille se réunirent jusqu'à trois fois dans la cité madrilène durant cette période, preuve de la prédilection spéciale de la dynastie Trastamare pour cette ville qui atteint alors près de cinq mille habitants. Sous le règne d’Henri IV de Castille, El Impotente (l’impuissant), la monarchie commence à passer des séjours de plus en plus longs dans cette ville. Pour cette raison, le monarque met en ordre l’Alcazar, résidence royale à l’emplacement de l’actuel Palacio Real et lieu habituellement utilisé par la royauté et sa Cour pour célébrer les fêtes et défilés. Son successeur au trône Juan II, le contemporain de Rodrigue, fait de Madrid le siège de la Casa de la Moneda, où l’on frappe monnaie, renforce le Consejo de la Villa (Conseil de la Ville), réaffirme le marché hebdomadaire et réalise d’importantes améliorations urbaines.
203
Il fallut que le roi lui dise de s’approcher sans crainte. Il se décida enfin et Juan II l’embrassa ainsi que le sénéchal qui avait voulu d’abord baiser la main du souverain. On fit asseoir les délégués de Charles VII sur des escabeaux garnis de coussins de soie. Le roi demanda des nouvelles de son allié et de quelques-uns des grands seigneurs du royaume, après quoi il fit servir une collation qui, au dire du chroniqueur, fut tal como convenía en sala de tan gran príncipe et de tales embaxadores (comme il convenait en la demeure d’un si grand prince et pour de tels ambassadeurs). L’archevêque et le sénéchal prièrent ensuite le souverain de bien vouloir fixer un jour où ils pourraient s’acquitter de leur mission : le mercredi suivant fut désigné. Ils vinrent ce jour-là au palais et en présence du roi, du connétable Alvaro de Luna6 de don Enrique de Villena7, des comtes de Benavente et de Castaneda, de l’adelantado Pedro Manrique8, de l’archevêque de Tolède, don Juan de Cerezuela et de don Pedro de Castille, évêque d’Osma, Denis du Moulin exposa l’objet de son ambassade. Il montra les raisons pour lesquelles les deux princes se devaient aider mutuellement. Il rappela la guerre anglaise et le besoin qu’avait le roi de France d’un secours effectif. Il parla longuement. Juan II répondit qu’il prenait acte des requêtes qui lui étaient adressées, qu’il y réfléchirait et ferait connaître sa volonté. Le dimanche suivant, les délégués de Charles VII dînèrent à la table royale et furent traités avec magnificence. Ils soupèrent aussi chez le connétable et chez l’archevêque de Tolède. Le 20 janvier, Juan II 6
CRONICA de don Alvaro de Luna, D. Josef Miguel de Flores, Madrid, 1784 et Fernan Perez de Guzman, p. 75 : « Alvaro de Luna, connétable de Castille et grand Maître de Santiago, est un des personnages les plus fameux du XVe siècle espagnol. 7 Ibid. CRONICA de don Alvaro de Luna, D. Josef Miguel de Flores, Madrid, 1784, p. 519 : « Don Enrique de Villena était fils de Don Pedro et petit-fils de don Alonso, marquis de Villena et duc de Gandia, premier connétable de Castille, il avait épousé une fille naturelle du roi Henri II. C’est une des figures les plus originales de cette époque : homme d’étude, esprit curieux, il s’occupa de littérature et s’adonna aux sciences, négligeant complètement la politique et délaissant ses propres intérêts. Amis des poètes ses contemporains, il fut loué par le marquis de Santillana et Juan de Mena ; il s’acquit d’autre part un mauvais renom, fut accusé de pratiquer l’astrologie et la sorcellerie. Après sa mort, survenue à la fin de 1434, Juan II ordonna que ses livres fussent examinés par frère López de Barrientos, qui en fit brûler un certain nombre ». 8 Don Pedro de Manrique, quatrième du nom, huitième seigneur d’Amusco, adelantado de Léon, appartenait à la famille des Manrique, sa mère était Dona Juana de Mendoza. Il naquit en 1381 et mourut à Valladolid en 1440.
204
chargea don Alvaro de Luna, don Juan, archevêque de Séville, et don Rodrigo, comte de Benavente, de renouveler les alliances avec la France et d’y apporter les modifications qui seraient nécessaires. Le 29 janvier le traité fut rédigé et le 31, Juan II, après avoir pris connaissance du texte, exprima sa ferme volonté de maintenir l’ancienne amitié, jura de mettre les articles du nouveau pacte en pratique et de fournir les secours qui y seraient stipulés. La mission de l’archevêque et du sénéchal de Toulouse était terminée : ils prirent congé du roi et s’en retournèrent porter la bonne nouvelle au royaume de France. Ainsi grâce à ses origines, le comte de Ribadeo put jouir, au-delà des services rendus à la couronne de France, de toutes les marques de l’indéfectible faveur de Charles VII… Du moins tant que ses actions ne contrariaient pas le monarque.
205
LES « ECORCHEURS » Les conséquences d’un traité de paix qui plonge le royaume dans les affres d’une guerre sans nom « La paix menace la paix ! » Avec elle, les armées indépendantes sont privées de tout cadre officiel d’évolution. Pour éviter la dislocation de ses compagnies, Rodrigue ne peut laisser ses hommes inactifs. Chaque chef de guerre se voit ainsi contraint de fournir de « l’emploi » à ses gens d’armes par tous les moyens, sous peine de « déposer le bilan de son entreprise ». Ce paradoxe explique pourquoi aucun accord ne semble en mesure d’arrêter les conflits. Malgré la paix décrétée, une guerre sans nom, marginale, larvée, obscure continue, se transforme peu à peu en une sorte de « guerre dans la guerre » se déplaçant au gré des besoins de survie et de financement des compagnies. En attendant la paix, on se hâte vers la guerre Alors que les émissaires des deux partis s’efforçaient de jeter les premières bases du rapprochement tant désiré entre le duc de Bourgogne et le duc de Bourbon, Rodrigue privé subitement de l’action nécessaire à ses troupes les détourna en masse vers la province du Limousin, et plus précisément vers Ussel1. Alertés, les États du Bas-Limousin accordèrent le vote d’un subside au mois d’août 1435 pour payer les frais de la résistance opposée au routier. Le 1
M. JOULLIETTON, Histoire de la Marche et du pays de Combrailles, P. Betoulle, Guéret, 1814, note p. 400 : « La place d’Ussel était entrée en 1371 dans la maison de Bourbon par la suite du mariage de Louis de Bourbon avec Anne d’Auvergne qui apporta des biens importants dans la maison de Bourbon. Celle-ci était la petite-fille d’Anne d’Ussel. Voilà pourquoi Charles Ier de Bourbon put céder place à Rodrigue lors de son mariage avec Marguerite de Bourbon en 1433. La famille d’Ussel était riche et puissante dans le Limousin depuis le XIIe siècle, et figurait avec celle des Ventadour. Ces deux maisons possédaient en commun la seigneurie d’Ussel, ce qui explique aussi la revendication du domaine par la maison de Ventadour ».
207
vicomte de Ventadour fut l’un des combattants mentionnés sur l’état de réparation. Les deux places principales de son domaine, Ussel et Meymac, avaient été assiégées pendant deux mois. Si le motif de l’invasion du Limousin par l’armée du comte de Ribadeo apparaît au premier abord comme l’intention d’aller guerroyer contre les Anglais en Guyenne, il semble en vérité que ses troupes se cantonnèrent en cet automne 1435 uniquement dans les environs de Limoges. Là, comme à l’ordinaire, les routiers sous couvert de servir le roi, faute d’être payés bien régulièrement, allèrent chercher dans la huche du paysan leur pain et leur solde.2 Ce fut un des lieutenants du comte de Ribadeo qui conduisit ses troupes en Limousin3. En effet, rien n’atteste de la présence de Rodrigue lors de ces évènements. Il est certain que nous retrouvons seulement sa trace dans les environs de Tour, confirmée par une lettre royale au mois de septembre de la même année. Il y a là une nouvelle absence de quelques mois. Le comte de Ribadeo, à la tête de nombreuses affaires, délègue maintenant les tâches subalternes à ses lieutenants. Il n’apparaît plus sur le théâtre de l’ensemble des opérations confiées à ses troupes, ce qui n’ira pas toujours sans lui poser certains problèmes… Cependant, il est intéressant de noter que la juxtaposition des personnages fait que seul son nom revient sous la plume des chroniqueurs. Le comte de Ribadeo sera souvent victime de ces méprises, engendrées par sa réputation d’« intraitable routier ». Elles feront souvent l’objet de récits orientés et anecdotiques écrits postérieurement à ses exploits. Après le ravage de la vicomté de Ventadour, le Haut-Limousin eut à son tour de donner asile à des hôtes malfaisants, de voir rançonner ses habitants, et le pillage de ses campagnes s’accomplir jusque sous les murs des plus grosses villes. Limoges cependant ne se résigna pas à contempler dans la sécurité qu’elle devait à ses fortifications, le ravage de ses terres environnantes. Lorsqu’elle fut informée de l’approche du capitaine, elle lui envoya dire qu’il eût à prendre le 2
Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, p. 115. R. Père BONNAVENTURE de SAINT-AMABLE dit très explicitement en parlant de Rodrigue : « lui ou un de ses lieutenants », dans Histoire de Saint-Martial apôtre des Gaules et notamment de l’Aquitaine et du Limousin, par A. Voisin, Limoges, 1685, tome III, p. 701.
3
208
large. Celui-ci, blessé d’une semblable injonction, ordonna au contraire de faire tout le mal possible aux abords de la ville, après quoi il affecta de passer avec ses équipages sous les yeux des habitants. Très imprudemment il s’engagea, lui ou l’un de ses lieutenants, entre la Vienne et les coteaux, quand tous les chemins et passages en avant du faubourg avaient été barricadés. Partout se présentèrent des enchevêtrements de voitures chargées de blocs de pierre. Les routiers, n’étant pas assez de bras pour débarrasser la voie, reconnurent bientôt qu’il fallait revenir sur leurs pas ou bien prendre leur chemin par la traverse, au milieu des vignes dont la côte est couverte autour de Limoges. Ils s’arrêtèrent à ce dernier parti qui était le pire. Leurs charrettes s’empêtrèrent dans les vignes sans pouvoir avancer, et les hommes, occupés autour des roues et des chevaux, ne présentèrent plus bientôt que des groupes en désordre. Alors, les paysans qui s’étaient réfugiés dans Limoges sortirent accompagnés de la milice communale. Ils eurent bientôt enveloppé les hommes et les voitures. Leur nombre les rendit maîtres de tout sans coup férir, et ils n’eurent qu’à faire sauter les toiles des charrettes pour reprendre chacun, soit ses propres effets, soit l’équivalent de ce qu’il avait perdu. Les routiers interdits, non seulement se laissèrent enlever leur butin, mais consentirent encore à relâcher les prisonniers qu’ils emmenaient avec eux. Ce récit du père Bonnaventure4 ne brille pas par l’exactitude. Il n’est pas sans laisser un doute dans l’esprit. On se demande si toutes les circonstances qui étaient consignées au manuscrit ont été exactement interprétées. L’imprudence du chemin pris à travers les vignes paraît injustifiable, surtout de la part du vainqueur d’Anthon et de Lagny. Laissons-en la responsabilité au Père Saint-Amable. Il ajoute une chose que l’on croira plus aisément. C’est que les routiers, au sortir de ces fourches caudines, firent payer cher au reste du pays l’avantage que la cité de Limoges avait obtenu sur eux. Toujours est-il que ces faits, avérés ou pas, démontrent l’importance de la juxtaposition des conflits régionaux aux conflits nationaux. Si dans cet épisode « Rodrigue échoue devant Limoges » et se venge en saccageant les vignes de sa banlieue, s’agit-il pour autant 4
Ibid. P. BONNAVENTURE de SAINT-AMABLE, Histoire de Saint-Martial, Limoges, 1685, tome III, p. 701.
209
toujours de « guerre anglaise » ? Ou simplement de conflits régionaux ? Ou encore d’obscurs conflits, de si modeste envergure qu’ils ne sont connus, sauf exception, que par ceux qui en ont souffert ? On notera simplement que ces guerres marginales, en quelque sorte des « guerres de village », multipliées dans le temps et partout à la fois, ont pu peser aussi lourd dans le destin des campagnes que des conflits plus connus et plus spectaculaires.5 Le traité d’Arras, 21 septembre 1435 La guerre continuait toujours, mais pour le parti de Charles VII, il était évident qu'elle ne pourrait aboutir tant que les Anglais conserveraient leur précieuse alliance avec Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Cependant, comme nous l’avons évoqué, les relations du duc de Bedford et de Philippe s'étaient bien refroidies. Charles VII résolut d'en profiter. Philippe le Bon songeait à délaisser l’alliance anglaise. S’il faut en croire Olivier de La Marche, le sang royal de France luy bouilloit en l'estomac (car il avait) petite affinité et amour aux Angloix. La mort de sa sœur, Anne de Bourgogne, duchesse de Bedford, survenue le 14 novembre 1432, rompit le lien de parenté qui l'unissait au régent. Enfin, son intérêt lui dictait d'abandonner les Anglais, maintenant que la fortune tournait. La promesse qu'il s'était faite de venger son père, le serment qu'il avait prêté aux Anglais d'observer le traité de Troyes, le retenaient encore, mais il ne ménageait plus ses alliés. Des conférences se tinrent à Nevers, en janvier 1435. Le duc de Bourgogne y rencontra le duc de Bourbon, le chancelier Renault de Chartres et Arthus de Richemont, alors connétable de France. Les anciens adversaires se faisaient si gracieux visage que les assistants en estoient tout ébahis. Il estoit fol, disait-on, celui qui en guerre se boutoit et se faisoit tuer pour eulx.6 Bien que le parti du roi ait évalué et prévu les exigences du duc de Bourgogne, certains trouvèrent dans l'entourage de Charles VII que ses ambassadeurs s'y étaient trop facilement pliés. Les menaces 5
Jean TRICARD, Les campagnes limousines du XIVe au XVIe siècle, « Publications de la Sorbonne », Paris, 1996, p. 31. 6 Ernest LAVISSE, Histoire de France, Tome IV/Charles PETIT-DUTAILLIS, Charles VII, fin de la guerre de Cent Ans, livre premier, Paris, 1902, p. 312.
210
formulées contre les meurtriers de Jean sans Peur irritaient le parti des Armagnacs. Les plus obstinés d'entre eux étaient par principe opposés à toute réconciliation. Charles d'Anjou et le bâtard d'Orléans refusèrent d'accepter le traité. Mais le roi, conscient de l’enjeu, ne voulait plus reculer, il en allait de l’intérêt du royaume. La paix d'Arras marquait une étape décisive sur le chemin de la délivrance. La mort du duc de Bedford, survenue le 14 septembre 1435, décida plus encore le roi à passer sur les scrupules de certains dignitaires de son parti. Cet évènement fut décisif. Une semaine plus tard, le 21 septembre, le traité fut enfin signé. Fort de cette union qui entraînait un basculement des alliances, le royaume de France ne se trouvait plus menacé sur ses frontières de l’Est. Charles VII allait pouvoir concentrer ses efforts de guerre uniquement contre l’Anglais du Nord ou de Guyenne. Cependant, afin d’y parvenir, le roi dut faire amende honorable pour le meurtre de Jean sans Peur. Ce ne fut certainement pas chose facile que de s’incliner devant son vassal et ancien rival, mais face à l’importance de l’enjeu, le monarque accepta bien volontiers. Le traité débuta par cette confession : Premièrement, le roi dira, ou par ses gens notables suffisamment fondés fera dire à monseigneur le duc de Bourgogne, que la mort de feu le duc Jean de Bourgogne, son père, que Dieu absolve, fut iniquement et mauvaisement faite par ceux qui perpétrèrent ledit cas, et par mauvais conseil ; qu’il lui en a toujours déplu et à présent lui en déplait de tout son cœur ; et que s'il eût su ledit cas, et en tel âge et entendement qu'il a maintenant, il y eût obvié de tout son pouvoir.7 Désormais la reconquête est en marche, et Charles VII, que l’on ne tardera pas à surnommer « Charles le victorieux » peut enfin suivre sa bonne étoile. Au fond, il ne cède rien sur les principes, tandis que Philippe le Bon garde le contrôle effectif des territoires qu’il a conquis pendant la guerre. La conférence du Mont-Lozère Revenons quelques jours en arrière. Au temps des vendanges 1435, Rodrigue était cantonné dans les environs de Tours en compagnie d’un de ses beaux-frères à la sinistre réputation, Guy de 7
M. de BARANTE, Histoire des ducs de Bourgogne de la Maison de Valois, 13641477, Société Typographique Belge, Bruxelles, 1838, p. 864.
211
Bourbon. Charles VII était alors à Bourges en attendant la conclusion du traité de paix que ses ambassadeurs étaient allés négocier à Arras. Dans le même temps, il reçut avec une attention toute particulière la supplique d’un moine bénédictin venu lui demander au nom des habitants de la Touraine l’arrêt des exactions des routiers sur la province. Les pourparlers de paix avançaient favorablement et le roi sentit là l’opportunité de jeter les bases d’une nouvelle organisation militaire. Il envoya aux routiers un ordre de lever le camp qui fut exécuté sans difficulté par le comte de Ribadeo. Les compagnies plièrent bagage après un séjour d’une semaine, regrettant sans doute de n’avoir pas exploité plus longtemps cette riche vallée de la Loire, certainement fort préoccupées par le grand évènement qui était en ce moment l’objet de toutes les conversations. Si le rapprochement des deux partis qui divisaient le royaume réjouissait les populations, il sema en revanche la plus grande inquiétude parmi ces soldats d’aventure. Ils comprirent parfaitement que, bien que la guerre doive continuer avec les Anglais, elle n’occuperait plus un aussi grand nombre d’hommes, et que le gouvernement de Charles VII, ayant les coudées franches, pourrait bien revenir à son ancien projet d’éliminer les routiers au profit d’une véritable armée royale. Lors de « la guerre des ducs » et devant les difficultés de Charles de Bourbon, le roi avait détaché de l’armée du nord un grand nombre de capitaines pour renforcer l’armée du duc et du comte de Ribadeo8. Il y avait là de puissants renforts avec à leur tête quelques célèbres capitaines tels qu’Antoine de Chabannes, Gui de Blanchefort, Gauthier de Bruzac et le bâtard d’Astarac. Ils arrivèrent en Beaujolais pour être seulement témoins de la cessation des hostilités. Obligés de s’en retourner avec des frais de route insuffisants, ils recoururent à la ressource des patis. Ils en possédaient la pratique tout aussi bien que Rodrigue. Dans le même temps, Rodrigue s’était rendu à l’extrémité est du Gévaudan, plus précisément dans les environs de Génolhac, son repaire des Cévennes. Il évaluait les conséquences qu’allait engendrer la signature de la paix pour l’avenir des troupes indépendantes. Il revenait en ces lieux retirés pour initier le rassemblement de tous les 8
Ibid. VAISSETTE (Dom), Histoire du Languedoc, 1860, tome IV, p. 486.
212
capitaines et tenter d’aborder une démarche commune. L’assemblée fut au complet quand arrivèrent d’autres capitaines de compagnies venant de la limite de Guyenne, avec à leur tête, le sire de Lestrac et le bâtard de Noailles9. Malgré la paix politique décrétée, la nouvelle situation n’apporta pas la paix sociale. Ce fut même le contraire, car il subsistait partout des bandes incontrôlées agissant en dehors de tout cadre et à la marge du fonctionnement institutionnel. Pire, les capitaines des compagnies que le pouvoir tentait de dissoudre, décidèrent en réaction de jeter les bases d’un accord leur permettant de perpétuer les actions guerrières en dépit de la puissance étatique. À la nouvelle du dangereux rassemblement qui se formait dans le pays, les États particuliers du Gévaudan prirent la décision d’acheter la retraite de Rodrigue et des autres capitaines. Ceux-ci acceptèrent de lever le camp, contre un somme importante. L’avènement des « Ecorcheurs » Aussitôt après la publication du traité d’Arras, les bandes « de deçà » la Loire constituèrent au vu et au su de tout le monde, une société fortement unie, qui eut pour chefs principaux les personnages qui viennent d’être nommés, et dont les mercenaires de toute arme et de tout grade furent baptisés du terrible nom d’Écorcheurs. Écorcheurs voulait dire des bandits qui dépouillaient jusqu’à la chemise de ceux auxquels ils s’attaquaient10. Si la pratique n’était pas nouvelle, le nom fut nouveau. Il prit naissance dans une contrée qui, avant la guerre des ducs, avait été relativement épargnée. Il s’étendit à la langue populaire et devint d’un usage universel. Les Écorcheurs étaient réputés pour leurs ravages, ne laissant que désolation et ruines fumantes dans les lieux où ils passaient, et il y avait encore à leur suite quelques compagnies de Bourguignons qui, sous prétexte de faire la guerre aux autres, s’en venaient après eux et trouvaient encore le moyen de prendre ou de se procurer du pillage à force de
9
Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, note 2, p. 120 : « Quittance de Ode de Vila, frère du sénéchal de Beaucaire, envoyé de Nîmes en Gévaudan et Velay, dans les derniers jours d’avril 1435, auprès de ces capitaines ». 10 Ibid. MONSTRELET d’ARCQ, Chroniques, Paris, 1861, tome II, ch. CCXXII.
213
maltraiter les habitants. On appela donc ceux-là les Retondeurs, car ils venaient, si l’on peut dire, terminer « l’ouvrage » des premiers.11 En vérité, ce n’est qu’en Bourgogne et dans les territoires du nord que l’on appliqua ces qualificatifs à ces hordes sauvages et incontrôlées. Pour désigner ceux-ci, les gens du Languedoc avaient dit tout ce qu’il y avait de pire en prononçant le vocable de routiers. Dans les provinces du centre, on les distingua encore par le nom de Rodrigois, ou Rodrigais12. Le fait d’une solidarité qui lia ensemble les Écorcheurs et les Rodriguais ne saurait être mis en doute. Si ce ne fut pas une alliance offensive et défensive dans toute la rigueur du terme, ce fut au moins une entente propre à favoriser, quand il le fallait, une action commune. Les Écorcheurs, à leurs débuts, n’étaient pas plus de trois à quatre mille, tandis que les forces de Rodrigue, évaluées alors à huit mille chevaux13, représentaient un effectif d’environ dix mille hommes. La réunion des uns et des autres aurait formé une armée qu’aucun souverain d’Europe n’aurait été capable de mettre sur pied. Mais ce n’était pas le but du comte de Ribadeo qui se considéra toujours comme le serviteur fidèle de deux États. Il est important de dire ici que Rodrigue, conscient de la redistribution des cartes sur l’échiquier politique, avait initié ce mouvement dans le but de fédérer les troupes indépendantes et limiter l’anarchie de leur comportement. Ce fut un échec : les Écorcheurs déferlèrent principalement sur la Bourgogne et les provinces limitrophes. On constate cependant que le comte de Ribadeo veilla personnellement, du moins tant qu’il le put, à toujours diriger son action en direction des conflits majeurs, pour le soutien du roi et du royaume. Quoi qu’il en soit, les chroniqueurs nous ont rapporté nombre de récits illustrant les violences des Écorcheurs. Si la population des villes n’avait pas trop à souffrir de ces excès, elle en était quitte pour vivre constamment enfermée, n’osant s’éloigner des remparts qui la 11
Olivier de La MARCHE, Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France, Imprimerie de Rignoux, par M. Petitot, Paris, 1825, tome IX, p. 290. 12 Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, note 1, p. 122 : « Si se nommoient Escorcheurs et les conduisoient pour capitaine Rodrigue, Dimenche de Court, Pierre et Joachin Rohaut ». 13 C’est le chiffre donné par les auteurs espagnols : Hernando del Pulgar, p. 208 et Garcia de Rezende p. 183. Jean Chartier dit : « huit mille hommes » dans Godefroy, p. 96. Le héraut du Berri constate p. 394, en termes plus généraux, « qu’il avait la plus grande compagnie de tous les capitaines de France ».
214
protégeaient ou tout du moins, ne les perdant guère de vue. Non contents de faire main basse sur tous les animaux domestiques, les Écorcheurs forçaient les paysans à les suivre avec les victuailles et les provisions qu’ils n’avaient pas pu consommer sur place. L’efforcement, l’enlèvement des femmes et des filles, suivait inévitablement ces exactions. Alors, nombre de malheureux, ruinés, dépouillés, réduits au désespoir et à la misère, se joignaient à leurs bourreaux dans le désir de recouvrer par le vol ce que le vol leur avait enlevé. À ce propos, Juvénal des Ursins, évêque et comte de Beauvais, adressa au roi une touchante complainte relative aux hordes de guerre qui ravageaient la Bourgogne : Dieu sait les tyrannies qu’a souffert le pauvre peuple de France par ceux mêmes qui devaient le garder, car entre eux il n’y a ni ordre ni forme de conduite de guerre… Ce faisant, nombre d’églises ont été par eux brûlées et détruites, les bonnes gens consumés et desrompus dedans ! Les autres par eux consolidées et fortifiées, ordonnées à être hébergement et réceptacle à larrons, ribaux, meurtriers et toutes mauvaises gens, estables à chevaux, bordeaux public… Et au regard des pauvres prestres, gens d’Église, religieux et autres pauvres laboureurs tenant votre parti, on les prend et emprisonne, et les met en fers, en fosses, en lieux pleins de vermine et les laisse-t-on mourir de faim. Hé Dieu ! Les tyrannies qu’on leur fait ! On rôtit les uns, aux autres on arrache les dents, les autres sont battus de gros bastons, et jamais ne seront délivrés jusques à ce qu’ils ayent payé argent plus que leurs moyens : et encore quand on les délivre, ils sont tellement affaiblis de leurs membres, que jamais ne feront bien. Et ne prennent pas seulement hommes, mais femmes et filles et les emprisonnent ; et certaines fois en font par force leur plaisir, en la présence des maris, pères ou frères, et s’ils en parlent ils seront battus et blessés et quelques fois tués.14 En 1435, le même évêque fit parvenir aux états généraux réunis à Blois une nouvelle supplique : tous ces délits ont été faits et commis, non par les ennemis, mais par certains de ceux qui se disaient au Roi, lesquels sous couvert des rançons et autrement prenoient hommes, 14
Antoine LOISEL, Mémoires de pays, villes, comtés et comtes de Beauvois et Beauvoisis, Paris, 1617, p. 229.
215
femmes et petits enfans, sans différence d’âge ou de sexe ; efforçoient les femmes et les filles, prenoient les maris et pères et les tuoient en présence des femmes et des filles ; prenoient les nourrices et laissoient les petits enfans qui, par faute de nourriture mouroient ; prenoient les femmes grosses, les mettoient en ceps15, et là ont eut leur fruit, lequel on a laissé mourir sans baptesme. Et après on a jeté femmes et enfans en la rivière... On conçoit l’effroi de ces contrées sur lesquelles s’abattaient ces troupes d’aventuriers. Au moindre indice de leur présence, les paysans accouraient s’entasser dans les villes. Ils n’y trouvaient pas toujours un refuge assuré. On aura une idée de leurs exactions en parcourant des enquêtes faites en quelques localités après le départ des Écorcheurs et dont le texte porte çà et là des rubriques significatives : homme pendu, homme crucifié, homme roty, gens crucifiés, rotys et pendus. Tantôt, en effet, il est question, dans ces enquêtes, d’un malheureux qu’on lie en façon de crucifix et à qui on brûle le visage. Tantôt il s’agit d’un homme dont s’emparent ces brigands, qu’ils ardirent (brûlèrent) tellement, que les pièces de son corps, de son dos et de ses naiges (cuisses) churent par granz pièces devant les diz gens d’armes.16 Citons encore dans les registres de la ville de Mâcon : Ils ont pris et mis à rançon les habitants, violé les pucelles, efforcié les femmes, fourragé la ville, coupé les gorges à plusieurs jeunes femmes après les avoir cogneues, mis toutes nues et fait plusieurs autres abominations, telles que les Sarrazins n’en font pas aux Chrétiens.17 Le bâtard Alexandre de Bourbon, beau-frère de Rodrigue fit une fin peu glorieuse. Destiné primitivement à l’Église, il avait renoncé au canonicat et abjuré de ses vœux pour suivre Rodrigue de Villandrando. Mais son caractère emporté, ses inclinaisons personnelles ne tardèrent pas à le diriger vers le « noble métier de pillard ». On le retrouve en effet, après la publication du traité d’Arras, au sein des fameuses compagnies d’Écorcheurs. Le bâtard de Bourbon se distingua entre tous par les atrocités les plus odieuses, et il 15
Pièce de bois percée de trous dans laquelle on passe les jambes d’un prisonnier. Synonyme : carcan. 16 ROCQUAIN Félix, Études sur l’ancienne France, Didier, Paris, 1875, p. 296. 17 Ibid. ROCQUAIN Félix, p. 297.
216
fut, en outre, un de ceux qui, en 1439, entraînèrent le Dauphin (futur Louis XI) dans sa première rébellion contre son père Charles VII. Celui-ci ne l’oublia pas. En 1440, le bâtard de Bourbon ravageait la Champagne à la tête de ses bandes. Il annonçait même son intention de passer avec elles à l’ennemi. Vers le même temps, dit un chroniqueur, un homme et sa femme se vinrent plaindre au Roi et à monseigneur le connestable d’un grand oultrage que ledict bastard de Bourbon leur avoit faict : car il avoit forcé la femme sus l’homme, et puis l’avoit fait battre et découper, tant que c’estoit pitié à voir. Cette action abominable décida le souverain et parut sans doute un prétexte suffisant pour mettre fin à tant de violences. Sur l’ordre du roi, le connétable s’empara du bâtard de Bourbon. On lui fit un semblant de procès. Condamné à mort, il fut cousu dans un sac et jeté par-dessus un pont dans la rivière de l’Aube.18 Dans le duché, les réactions furent tout aussi vives et prirent la forme de représailles. Le comte de Fribourg, gouverneur de la Bourgogne, recourant à une levée en masse, réussit à débarrasser sa province de ces bandes effroyables : il en fit un tel massacre, que la Saône et le Doubs regorgeaient de leurs charognes, et que les pêcheurs les tiraient dans leur filet au lieu de poissons.19 Quant au comte de Ribadeo, il n’avait pas attendu la débâcle. Dans une époque à l’instabilité permanente, faite d’intrigues et de compromissions, il fit encore preuve d’une grande faculté d’adaptation. Sûr de son indispensable puissance, il venait de s’assurer d’autres missions…
18
Ibid. CLEMENT Pierre, Jacques Cœur et Charles VII, ou La France au XVe siècle, Guillaumin, Paris, 1853, tome 1, chap. IV, pp. 107-20. 19 Henri MARTIN, Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789, Furne, Paris, 1855, tome VI, p. 363.
217
LA RECONQUÊTE DE PARIS Le contrecoup du traité d’Arras semblait mettre un frein définitif à l’emploi des routiers indépendants au sein des armées nationales. Rodrigue le savait et l’avait anticipé. Comment pouvait-il en la circonstance maintenir le colossal effectif de ses troupes sachant, nous disent ses contemporains, qu’il avoit la plus grande compagnie de tous les capitaines de France et qu’il pouvait aligner sur les champs de bataille plus de huit mille chevaux ? 1. Dans un premier temps, nous venons de l’évoquer, ce fut la tentation de fédérer les compagnies, puis de les répandre sur les territoires encore épargnés. Mais quel ordre militaire pouvait survivre à cela : des hordes de plus en plus incontrôlables déferlaient du nord vers le Midi en ravageant les terres qui venaient soi-disant d’accéder à la paix. Dans sa clairvoyance, Rodrigue en avait évalué le risque et ne désirait pas s’aventurer vers une voie qu’il considérait sans issue. Où se trouvait-il lors de ces troubles ? Nous retrouvons sa trace auprès du ministre déchu Georges de La Trémoille. En effet, son dévouement à la personne de M. de La Trémoille paraît l’avoir amené à Sully-sur-Loire vers Pâques 1436. À Sully en effet, dans l’un des riches châteaux de la France centrale, ce seigneur méditait alors sur sa déchéance, prononcée depuis bientôt trois ans. Une révolution de palais, habilement menée pendant que le comte de Ribadeo était occupé dans le Comtat Venaissin en 1433, avait eu pour résultat la séquestration, puis la disgrâce du ministre favori. Celui-ci avait réussi à recouvrer sa liberté moyennant la promesse expresse de ne plus aspirer désormais au pouvoir et il faut aussi le dire : moyennant une grosse rançon que lui fit payer Jean de Bueil, son propre neveu, qui avait fourni la prison pour l’incarcérer. Mais peut-on se résigner au sacrifice de ce qui vous a été arraché par la violence ? L’ambitieux La 1
Denys GODEFROY, Jean Chartier, histoire de Charles VII Roy de France, Jacques le Bouvier dit Berry, Mathieu de Coucy et autres auteurs du temps, Imprimerie royale, Paris, 1661, p. 97.
219
Trémoille usa le reste de ses jours à fomenter des intrigues pour ressaisir l’autorité qu’il avait perdue. Néanmoins, au cœur des craintes éprouvées par sa disgrâce, il prendra toujours d’infinies précautions. Ainsi, la visite de Rodrigue qu’il avait peut-être sollicitée, lui fit commettre une démarche tortueuse. Elle est consignée sur l’un des registres de l’Hôtel-de-Ville d’Orléans2: il envoya prévenir le premier personnage de la ville de la présence des Rodrigois sur ses terres, comme quelqu’un qui cherche à se ménager un alibi avec un témoin à décharge au cas où les choses tourneraient mal. Ce fait coïncide avec la reconquête de Paris par les troupes de Charles VII et il se trouve précisément que le bâtard Guy de Bourbon fit partie de l’armée du connétable Richemont qui, par son approche, entraîna la révolte des habitants de Paris.3 Pourtant, le connétable de Richemont qui dirigea cette heureuse entreprise avait mis une attention particulière à en écarter les troupes mal famées. Il est à croire que, s’il accepta le concours du bâtard, ce fut sur les recommandations venues « d’en haut », lui dictant les conditions quant au nombre d’hommes qu’il amènerait avec lui et l’emploi qu’il en ferait. Il y a là un aveu sur la présence d’un contingent armé du comte de Ribadeo lors de la prise de Paris. Mais, voulant conserver la totale maîtrise des événements, le connétable jugea bon de ne faire appel à cette unité qu’en cas de recours extrême. Au moment où était conclu le traité d'Arras, la détresse était à son comble dans la capitale. On n'osait plus franchir les portes, de peur de tomber aux mains des Armagnacs ou des Anglais, qui s'étaient mis à piller méthodiquement les environs de la capitale. Le blé que on avoit pour vingt solz parisis, dit le bourgeois de Paris, monta tanlost après à deux frans ; fromaige, beurre, huille, pain, tout enchery ainsi de près de la moitié ou du tiers. Les complots étaient réprimés sans pitié : On
2
QUICHERAT, Note 1, p. 124 : Registre de 1435-1436 à la Bibliothèque d’Orléans où l’on trouve trace de « certaines lectres que Mgr. De Suli avoient envoyées à Mgr le chancelier d’Orliens, pour les Rodrigoys qui estoient à Suli ». 3 Ibid. Denys GODEFROY, Histoire de Charles VII Roy de France, Mémoires d’Artus de Richemont par Guillaume Gruel, Imprimerie royale, Paris, 1661, p. 766.
220
faisoit a secret et en appert moult mourir de peuple, ou par noyer ou autrement, sans ceulx qui mouroient par bataille.4 Mais tout venait de basculer. Le duc de Bourgogne s’engageait militairement auprès du roi de France. Dès le 26 février 1436, plusieurs missives du duc informaient Jean de L’Isle-Adam de la nouvelle situation. Le maréchal jouissait d’une grande popularité auprès des Parisiens. Il fut donc l’intermédiaire naturel entre Paris et les lieutenants du roi Charles. Vers les premiers jours d’Avril, le connétable Arthus de Richemont vint se poster à Pontoise où il fit sa jonction avec L’Isle-Adam. Le moment décisif approchait. Le connétable entretenait depuis quelque temps des correspondances secrètes avec les principaux citoyens. Au mois de mars 1436, le gouvernement anglais exigea des Parisiens un nouveau serment de fidélité. Il avait si peu confiance en eux qu'il leur demanda en cas d’attaque, de ne point se porter au lieu du combat, à moins d'un service militaire commandé. Dans le parti bourguignon maintenant gagné à la cause de Charles VII, Jean de Villiers de L'Isle-Adam, un des principaux capitaines de Philippe le Bon, était une veille connaissance de Rodrigue que nous avons rencontré au début de cet ouvrage. Du temps de la domination bourguignonne sur la capitale, celui-ci avait été capitaine du Louvre, puis capitaine de Pontoise. Ainsi, par un curieux retour du destin, Jean de Villiers de L’Isle-Adam revenait conquérir Paris où il s’était illustré dix-huit ans auparavant, lors des terribles évènements de 1418. Les assaillants gagnèrent la confiance d’un riche bourgeois de Paris, Michel Laillier, conseiller de la Chambre des comptes, personnage éminemment important de la capitale qui avait même eu en son temps ses entrées à la cour du roi d’Angleterre. Le 13 avril 1436, le connétable s’approcha de la capitale. L’aube dessinait à peine les contours de l’horizon. Tout était prêt. Sous le couvert du secret, des communications de plus en plus fréquentes s’étaient établies entre la ville et les capitaines du roi. Richemont avait laissé des forces à Saint-Denis. Dans le cadre de la nouvelle organisation militaire voulue par Charles VII, il préféra garder les unités de routiers en réserve. Il s’agissait pour une grande part des 4
Ernest LAVISSE, Histoire de France, tome IV, livre premier/Charles VII, fin de la guerre de Cent Ans, par Charles PETIT-DUTAILLIS, Paris, 1902, p. 313.
221
hommes de Rodrigue qui agissaient sous le commandement du bâtard de Bourbon. Si le bâtard est mentionné, rien n’atteste de la présence de Rodrigue lors de cet épisode, toutefois les documents relèvent bien l’arrivée de sa compagnie. Le connétable, qui avait envoyé son infanterie en première ligne, se rendit à la porte Saint-Jacques. Dès le matin, Laillier était sur pied assisté de son propre fils et de plusieurs autres bourgeois influents. Des émissaires répandus dans Paris rassemblèrent alors le peuple. Des groupes se formèrent, écoutant ces orateurs qui les appelaient aux armes. Les Anglais avertis par ce tumulte déclenchèrent l’alerte, mais déjà à l’intérieur même de la ville, les voies étaient encombrées de barricades improvisées. Les chaînes des rues furent tendues par les bourgeois. Composée de mille cinq cents hommes, la garnison anglaise ne s’attendait pas à un tel soulèvement. Les détachements de la garde parcoururent avec une peine infinie l’itinéraire qui leur était tracé. Pendant ce temps, L’Isle-Adam précédant le connétable apparut sous les murs de la porte SaintJacques. Des pourparlers s’engagèrent avec les hommes qui montaient la garde sur les remparts. Le maréchal tenait à la main les lettres d’abolition, marquées du sceau royal qui garantissait toute amnistie à ceux qui collaboreraient avec lui. Ces propositions eurent l’effet escompté et les hommes de garde ouvrirent une poterne. On rompit les serrures du pont-levis et le connétable entra par cette porte. En même temps, L’Isle-Adam fit prendre position à ses hommes sur les remparts grâce à une échelle que lui tendirent les Parisiens gagnés à leur cause. Il était tout juste entre sept et huit heures du matin. L’IsleAdam, devenu maître de la plate-forme, fit arborer la bannière aux trois fleurs de lys en criant Ville gaignée ! Il pénétra ensuite triomphalement dans Paris accompagné du connétable.5 Au bruit des cloches qui sonnaient, les routiers cantonnés à SaintDenis accoururent vers la capitale, mais le connétable inflexible leur en défendit expressément l’entrée. Il s’agissait en effet de ne pas ternir la victoire par des actes de brigandage ou de pillage. Sous le commandement du bâtard de Bourbon, les routiers de Rodrigue avaient peut-être espéré faire là des prises intéressantes. Il n’en fut 5
Ibid. A. VALLET de VIRILLE, Histoire de Charles VII, Paris, 1863, p. 358.
222
rien et ils durent s’en retourner sans combattre. Cependant, sur le chemin du retour ils ne manquèrent pas de se venger sur une petite garnison anglaise en fuite qui eut le malheur de croiser leur chemin. La population parisienne fut préservée de toute action de représailles. Les lettres d'abolition accordées par le roi furent lues et relues dans les carrefours. Les bourgeois les plus suspects furent seulement exilés pour quelque temps. Michel de Laillier devint prévôt des marchands. Les conseillers du Parlement et de la Chambre des comptes furent autorisés à rester en fonction. Au grand bonheur des habitants, les vivres purent enfin entrer dans Paris. Les Anglais quant à eux s'étaient réfugiés à la Bastille, avec quelques partisans de la ville. Richemont les laissa partir. Ils s'embarquèrent le 17 avril pour Rouen, sous les huées de la foule. La nouvelle de la prise de Paris par les troupes de Charles VII fut d’une portée considérable. Cependant, il est important de noter que le roi ne retourna pas immédiatement dans la capitale. Ce n’est finalement qu’au mois de novembre 1437 que Charles VII se décida à rentrer dans Paris, après plus de dix-huit ans d’exil. A quelque temps de là, Rodrigue alla se reposer dans ses terres du Bourbonnais. Dès lors, les seules missions guerrières qu’il devait assurer allaient être celles mandatées par le souverain ou les grands du royaume. Au début du mois d’août 1436, nous le trouvons entre Loire et Allier à Saint-Pierre-le-Moûtier, puis à Moulins, occupé au règlement de diverses affaires d’intérêt. Derrière l’impitoyable combattant transparaissait l’homme d’affaires pourvu de ces qualités indispensables qui lui avaient permis de hisser sa réputation au plus haut dans le royaume. L’heure était venue pour lui d’évacuer enfin la place de Charlieu, qu’il avait maintenue jusque-là sur le pied de guerre. Il la remit, moyennant finances, entre les mains du duc de Bourbon.6
6
Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, p. 125.
223
ALBI Deux évêques pour un siège épiscopal Dans la tour carrée du palais ducal de Moulin, que l’on appelait alors « la mal coiffée »1, le comte de Ribadeo faisait face au duc Charles, son beau-frère. Ils étaient en négociations serrées pour quelques affaires financières, lorsque le duc, inclinant soudain la tête vers son invité, l’interpella à voix basse. Sur le ton de la confidence, il lui fit part de quelque chose qui semblait lui tenir particulièrement à cœur. Il s’agissait d’assurer une mission militaire dont la maison de Bourbon tout entière désirait le succès. Le duc proposa à Rodrigue d’aller conquérir le siège épiscopal d’Albi, disputé entre deux prétendants dont l’un se trouvait être justement l’oncle de la famille. Cet engagement devait déboucher sur une interminable querelle qui allait rallumer dans la contrée, et pour longtemps, le feu de la guerre civile. Comment en était-on arrivé là ? Au mois de septembre 1434, l’évêque d’Albi, Pierre Neveu, venait de mourir2. Cet évènement posait un difficile problème de succession. En effet, les conséquences du schisme qui avait agité la papauté étaient encore présentes dans tous les esprits et le clergé restait intensément divisé. Certains soutenaient le concile qui exprimait une farouche volonté de réforme et d’autres, le pape, qui y était fermement opposé. Chaque parti avait son « poulain » : Bernard de Cazillac3 candidat du concile proposé par le chapitre cathédral et, face à lui, Robert
1
Alors qu’il contemplait la tour carrée du château des ducs de Bourbon, Louis II (le grand-père de Charles 1er de Bourbon) se serait exclamé en considérant la toiture : « c’est une belle tour, mais elle est mal coiffée ». Ce surnom lui est resté à travers les siècles. 2 Il avait été évêque de Lavaur de 1408 à 1410 avant d’être évêque d’Albi. 3 Le château de Cazillac, situé aujourd’hui dans la commune de ce nom, canton de Martel, arrondissement de Gourdon (Lot), se dresse au sommet d’un mont. Un donjon éventré, quelques vieilles murailles dans lesquelles se sont incrustés des lierres indiquent nettement la position de ruines anciennes.
225
Dauphin4 soutenu par le pape Eugène IV sur la demande du roi de France. La situation du chapitre cathédral d’Albi était donc assez embarrassante. Il se trouvait, suivant l’expression consacrée, entre l’enclume et le marteau. Élire un successeur à Neveu, c’était s’insurger contre la papauté, et même contre le roi, puisque Charles VII était en accord avec le pape. Ne pas procéder à l’élection, c’était renoncer aux principes fondamentaux de l’Église, c’était surtout renier la suprématie des conciles sur la papauté.5 À Albi, aussitôt que les consuls furent informés de la mort de Pierre Neveu, ils se réunirent dans la maison commune. Redoutant la suite des évènements, ils envoyèrent deux d’entre eux au chapitre pour prier le collège des chanoines de bien veiller à la protection du palais épiscopal de la Berbie. Les chanoines qui devenaient, en vertu de la vacance du siège, administrateurs du diocèse s’empressèrent d’affirmer leur volonté d’agir aussi sur le temporel. Ils firent placer les armes de leur communauté sur la porte du palais épiscopal et appelèrent, pour garder cette forteresse, des seigneurs qui leur étaient dévoués. Enfin, après de longues délibérations, ils résolurent de revendiquer le droit d’élection que le concile de Bâle venait de reconnaître aux églises malgré les protestations du pape. Bernard de Cazillac, prévôt du chapitre et en même temps prieur de Notre-Dame de Fargues, fut le promoteur de cette résolution, qui était une rupture avec le Saint-Siège. C’était là une vraie déclaration de guerre. Mais Bernard de Cazillac avait pris ses précautions. Il avait mis en état de défense l’imposante forteresse de la Berbie où les chanoines s’étaient retirés. Il en avait ensuite confié la garde à une compagnie entière commandée par son frère Bertrand, seigneur de Cazillac.6 Mais, comme nous l’avons vu, un deuxième prétendant s’était adressé à Rome : c’était l’évêque de Chartres, Robert Dauphin, un grand seigneur de la famille des Dauphins d’Auvergne. Eugène IV, 4
Robert d’Auvergne, évêque de Chartres surnommé Robert Dauphin, parce qu'il est le fils du dauphin d'Auvergne, membre de la maison de Bourbon. 5 MÉMOIRES de la Société archéologique du Midi de la France, Société archéologique du Midi de la France, Éditeur SN Toulouse, 1834, N° 1, 1908 et tome 16, pp. 228-231. 6 Ibid. REVUE historique scientifique et littéraire du département du Tarn, No 4, 1877, Vol. 1, pp. 273 à 277 et 289 à 290.
226
sur la recommandation de Charles VII, s’empressa de lui délivrer des bulles de provision et Robert, après avoir prêté serment entre les mains du roi, envoya un délégué prendre possession par procuration du siège épiscopal en décembre 1434. Les seigneurs qui tenaient la Berbie refusèrent de lui ouvrir les portes de la ville. Alors, l’émissaire du prélat en appela à l’autorité du sénéchal de Toulouse et d’Albigeois qui vint au nom du roi l’introduire dans Albi et le mettre en possession de la cathédrale. Les habitants en majorité s’étaient déjà déclarés pour l’évêque nommé par le pape. Ils lui prêtèrent serment de fidélité et envoyèrent deux consuls à Issoire pour lui faire la révérence au nom de la ville7. Parallèlement, une autre délégation alla trouver le comte de Pardiac au château de Carlat, siège de la puissante vicomté du Carladès, afin de prendre toutes les mesures pour rendre Robert Dauphin entièrement maître de la ville. Ces évènements se déroulaient au début du mois de décembre. Cependant, les gens d’armes de Cazillac occupaient toujours la Berbie où le chapitre, hostile à Robert, continuait à tenir ses assemblées. Mais il commit une lourde faute : ce fut de tergiverser et de ne pas aller jusqu’au bout, de ne pas procéder à l’élection de l’évêque aussitôt sa détermination prise. L’élection avait été reculée jusque-là, sans doute à cause des difficultés qui résultaient d’un trop grand nombre de candidatures, car le prévôt de Saint-Salvi, le fils du seigneur d’Arpajon, un sire de Castelpers et d’autres encore briguaient les suffrages des chanoines. Enfin, l’arrivée du sénéchal de Toulouse pour le parti adverse souligna l’urgence de clore les débats en faisant taire toutes ces rivalités. Le scrutin fut ouvert, les choses traînèrent encore en longueur et après d’interminables pourparlers, le prévôt, Bernard de Cazillac fut élu seulement par cinq voix sur treize, les autres suffrages étant répartis sur les autres candidats.8 Le concile de Bâle reconnut et confirma cette élection le 19 décembre. Deux mois plus tard, Bernard de Cazillac entreprit un voyage pour se faire consacrer dans l’église des Cordeliers à Bâle le 7
Les consuls de 1434-1435 étaient : Pons Combettes, Michel de Fleras, Paul Gasc, Guillaume Chabert, Guillaume Cavalo, Barthélémy Frachieu. 8 Ibid. MÉMOIRES de la Société archéologique du Midi de la France, Toulouse, 1834, No 1, 1908, tome 16, pp. 228-231.
227
12 février 1435, par les évêques de Lectoure et de Lausanne. L’archevêque de Bourges, consulté par le concile, confirma la décision de Bâle. La guerre des deux évêques Albi avait donc deux évêques, celui du pape et celui du concile, revendiquant chacun une légitimité de droit divin, et bien disposés à la faire triompher coûte que coûte, y compris par la force. Cazillac, désigné simplement sous le nom de l’« élu », comptait dans son parti les seigneurs de Montbrun, de Monclar, de Cestayrols, de Tonnac, de Monestiès, de Mailhoc, de Sayssac, de Milhars, du Verdier, soit presque toute la noblesse de l’Albigeois. Le roi restait un soutien inconditionnel de Robert Dauphin et il avait donné mission au comte de Pardiac de le protéger, même par les armes. Le comte était d’autant plus disposé à remplir cette mission que Robert était allié à la maison de Bourbon, dans laquelle lui-même venait d’entrer. Bernard d’Armagnac, comte de Pardiac, vicomte de Carlat et de Murat, avait épousé, en 1424, au château de Roquecourbe, Éléonore de Bourbon, fille unique de Jacques, comte de Castres. Bientôt les seigneurs qui protégeaient Cazillac à la Berbie éprouvèrent des craintes pour leurs châteaux délaissés, menacés maintenant par les troupes royales. Les habitants d’Albi, fatigués par tant de tergiversations autour de la nomination de leur prélat, avaient hâte de sortir de cette situation embarrassante, aussi se prononcèrentils en faveur du candidat du roi. Le moment était donc favorable. Pardiac conseilla à Robert Dauphin de venir en personne dans son évêché. Celui-ci arriva à Albi le 28 avril 1435 et reçut de ses nouveaux sujets, selon l’usage, une coupe d’argent en témoignage de bienvenue. Il s’installa dans un hôtel qu’il avait acheté tout exprès et laissa généreusement le palais au chapitre, persuadé que dans peu de temps les négociations, qui étaient déjà entamées, aboutiraient à un arrangement. En effet, l’accord fut conclu entre Pardiac, Robert, le chapitre et les habitants. L’évêque prit possession de son siège le 3 juin 1435 et promit de se conduire en bon pasteur, de gouverner au mieux son diocèse, et surtout d’oublier tout ce qui s’était passé depuis la mort de Pierre Neveu. Il entrait en possession de la Berbie et de tous les biens et rentes liés à son exercice temporel. Il s’engageait à prêter, lors de son installation, le serment accoutumé devant chapitre. 228
Robert accepta en plus de payer toutes les dépenses qui avaient été faites pour la garde du palais. Enfin, on le supplia d’apaiser toutes les tensions et d’avoir tous les égards possibles pour son compétiteur. Tout semblait donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais rien en vérité n’était définitivement réglé ! De son côté, Cazillac était fermement décidé à user jusqu’au bout de la procédure. Il en appela à nouveau au concile et alla lui-même y défendre sa cause. Pour le contrer, Robert Dauphin s’y fit recommander par quelques chanoines dont il avait, dit-on, acheté les voix. Mais on s’en doute, cette recommandation fut inutile et l’assemblée opposée au pape remit tout en cause. Elle se prononça en faveur de Bernard de Cazillac le 19 février 1436. Pour parfaire le tout, elle lui donna l’ordre d’aller immédiatement prendre possession de son diocèse. Et voilà le conflit reparti ! Dans la permanence de ces affrontements, Robert Dauphin commit à son tour une erreur extrême. Il crut son autorité établie à tout jamais, parce qu’il en avait joui sereinement pendant une année. Confiant, il avait cautionné le départ des troupes de Pardiac et le diocèse semblait totalement apaisé. C’était sans compter sur les partisans de l’évêque élu par le concile. Ils couvaient leur ressentiment et n’attendaient qu’une occasion pour prendre leur revanche. Elle leur fut offerte par Robert lui-même au mois de juillet. Au moment où son rival arrivait de Bâle, il eut l’imprudence de quitter Albi, sans prendre aucune mesure de sûreté, pour aller en Auvergne régler des affaires de famille. Il s’éloigna tranquillement de la cité épiscopale, à l’indicible joie de son adversaire. Bernard de Cazillac, escorté d’une armée commandée par son frère Bertrand, se mit aussitôt en route, bien décidé à prendre sa revanche et à faire trembler la ville. Ce fut à nouveau l’affolement dans Albi. Les consuls, informés de cette prise d’armes, demandèrent en toute hâte du secours aux autres villes du diocèse. Ils envoyèrent des émissaires à Pardiac et au comte d’Armagnac, mais il était trop tard ! Déjà les bandes de Cazillac, composées de Gascons portant la croix rouge des Anglais, s’étaient emparées de Montirat, de Combefa et d’autres châteaux. Elles arrivèrent devant la cité épiscopale avec leurs bombardes et leurs canons dans la nuit du 6 juillet 1436 et y pénétrèrent par escalade, en franchissant les murs d’enceinte. L’hôtel de Robert Dauphin, l’officialité, la trésorerie et plusieurs maisons particulières furent
229
incendiés. Le 11, une centaine d’hommes s’emparèrent du cimetière et enfoncèrent les portes de la cathédrale qui fut livrée au pillage. Les Cazillac firent une vente de tout ce qu’il y avait de précieux dans le trésor : mitres, crosses, calices, burettes, et ils en tirèrent plus de cinq mille écus d’or qui servirent à payer leurs gens d’armes. Maîtres de cette position, ils commencèrent le siège de la Berbie où s’étaient retirés les partisans de Robert et ils le continuèrent pendant deux mois. Le blocus ne cessa que grâce à une transaction consentie sur les insistances des habitants : on décida que la forteresse de la Berbie, remise entre les mains du seigneur de Cardaillac, deviendrait un territoire neutre. La garde en fut confiée à Guérin de Lescure. En vertu de l’accord passé avec les habitants, l’évêque du concile ne pouvait donc plus s’installer à la Berbie. Alors, il abandonna la garde de la ville épiscopale à son frère et alla établir sa résidence à Cordes. Cette extraordinaire cité médiévale, ceinte de plusieurs rangées de fortifications, semblait lui offrir un asile plus sûr. D’ailleurs, une partie de sa famille y résidait et il y connaissait beaucoup de partisans. Bertrand, chargé de la défense d’Albi n’y resta que quelques jours. Il y laissa une importante garnison. Il la chargea de ne laisser pénétrer aucun envoyé dans la cité et d’intercepter tout message provenant du roi ou du pape. Ses ordres donnés, il alla tranquillement parcourir l’Albigeois et mettre à rançon tous ceux qui ne s’étaient pas ouvertement déclarés pour l’évêque du concile. L’intervention du comte de Ribadeo Revenons à la fin du mois d’août 1436, où dans le donjon du palais ducal de Moulin, Charles de Bourbon s’entretenait avec le comte de Ribadeo. Robert Dauphin en raison de son imprudence avait perdu le siège épiscopal. Il réclama donc la protection du roi. Le souverain était d’ailleurs parfaitement au courant de la situation chaotique qui secouait l’évêché d’Albi. Nombre de plaintes lui étaient parvenues de la part de personnes rançonnées par Bertrand de Cazillac qui courait impunément la campagne albigeoise à la poursuite des opposants de son frère. Charles VII donna l’ordre à ses sénéchaux de se saisir des coupables. Mais que pouvaient faire ces officiers qui n’avaient ni hommes, ni argent ? Alors Robert Dauphin, n’obtenant du roi que de vaines promesses sans même une escouade pour les exécuter, s’en 230
ouvrit à Charles de Bourbon. En ces circonstances, il se souvint même que le comte de Ribadeo était aussi son neveu par alliance. Voilà pourquoi, sur le ton de la confidence, le duc de Bourbon fit part à Rodrigue des propositions de leur oncle commun : L’évêque s’engageait à laisser six mille écus, les profits de la guerre et deux places fortes en caution, si le Castillan acceptait de le remettre en possession de son évêché.9 Le cas était délicat parce que le prélat, tout en se servant des routiers, tenait fort à ce qu’on ne sache pas qu’il les avait appelés. Il désirait que l’affaire soit faite au nom du duc de Bourbon. D’autre part, le comte de Pardiac était déjà intervenu dans cette affaire. Il fallait donc concilier les nécessités d’une action énergique avec le respect des garanties déjà stipulées. Après mûre réflexion et quand il en eut évalué tous les risques, le comte de Ribadeo accepta. La lutte ne pouvait s’éterniser : Rodrigue envahissait le diocèse à grande puissance avec une armée de sept à huit mille hommes10, dont il partageait le commandement avec le bâtard de Bourbon. Le trajet se fit par le chemin le plus court. On connaît les risques inhérents au passage des troupes dans les malheureuses contrées situées sur leur trajet. Aussi peut-on lire dans l’état de répartition de l’aide votée à la fin de la même année 1436 par les États de la Basse-Auvergne, que vingt et un marcs d’argent avaient été payés au bâtard de Bourbon quand il passa par le pays, afin que lui ni ses gens n’y fassent dommaige. Rodrigue à la tête de son impressionnante cohorte se dirigea en droite ligne sur Lescure situé à six kilomètres d’Albi, entre le Tarn et les collines avoisinantes. Il s’empara du château pour s’assurer le libre passage de la rivière et établit là son quartier général. Sa cavalerie couvrait les deux rives et cernait la ville épiscopale. Il décida de se cantonner à l’ostallaria Saint Antoine que ses routiers
9
Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, note 1, p. 127, Plaidoiries de Luillier pour Cazillac, prononcées au Parlement de Paris, le 10 juillet 1438 et le 1er septembre 1439. 10 Ce nombre de combattants, donné d’ailleurs par les auteurs de L’histoire de Languedoc, est certainement exagéré. Il résulte d’un document publié par Charles Portal, archiviste du Tarn, dans les annales du Midi de la France, que les troupes de Villandrando étaient, « segon lo dich comu de III melia a V melia » (c’est-à-dire de 4 à 5.000).
231
vidèrent de toutes ses réserves de lards, jambons et vins11. Afin de libérer le champ à partir des remparts, les Cazillac, en prévision d’un siège, avaient dégagé le pourtour de la ville en abattant toutes les maisons isolées. Rodrigue dans son implacable avancée compléta leur ouvrage en livrant aux flammes un hôpital qu’ils avaient laissé debout, ainsi qu’une partie des faubourgs y attenant. C’était faire comprendre aux assiégés qu’il ne prendrait pas le risque d’aller vers un affrontement direct. Rodrigue avait tout son temps ! Sa pression militaire allait, au contraire, s’exercer sur les alentours. Son intention était évidente : il ne voulait pas commettre l’erreur de s’attaquer au palais de la Berbie et à la cathédrale. On sait, en effet, qu’aux termes d’un accord confirmé par le comte de Pardiac, le château épiscopal avait été remis en mains neutres. Et puis, Rodrigue connaissait cette redoutable forteresse qui dominait de sa masse puissante le profond ravin du Tarn. Il avait évalué toute la difficulté de s’attaquer à une telle bâtisse. Le Castillan savait très bien qu’avec ses murs immenses, le bloc de ses deux donjons massifs accolés et sa cour redoutablement protégée, le palais épiscopal constituait un piège qui se refermerait sur quiconque aurait l'audace de s'y aventurer. Alors, selon une tactique qu’il avait longtemps éprouvée, Rodrigue entama une sorte de blocus de la ville plutôt qu’un véritable siège, en prenant soin de se tenir hors de portée de l’artillerie. Du haut des remparts de la ville rouge, les défenseurs assistèrent impuissants aux évolutions du comte de Ribadeo. Il laissa ses cavaliers exercer dans les environs une guerre de dévastation, qui mit à sac les contrées les plus fertiles et les plus populeuses. Dans la pénombre du soir venu, les habitants d’Albi purent voir le rougeoiement des feux destructeurs qui embrasaient le plat pays. La nuit se refermait sur l’angoisse du lendemain, et lorsque le jour se levait enfin, de simples fumeroles montaient en volutes, çà et là, dans l’air du matin, décrivant un cercle sinistre tout autour de la ville. Alors, après tant de malheurs déjà accumulés, les Albigeois voyant l’incendie dévorer leurs métairies et leurs vignes se portèrent en foule à la Berbie pour demander à grands cris la capitulation. On sait que la garnison de la forteresse, dans la neutralité qu’on lui avait imposée, 11
BULLETIN de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, 1874, no 2, 1905, tome 27, pp. 475, 495, 496.
232
n’était dévouée à aucun des partis. Elle céda sans peine sous la pression populaire et accepta de s’en aller avec armes et bagages. Rodrigue entre à Albi Les portes d’Albi s’ouvrirent à double battant comme pour mieux marquer la soumission de la ville au vainqueur. Non loin se dressait la cathédrale, église-forteresse en briques rouges, dominée par un clocher-donjon de soixante-dix-huit mètres de haut. Afin de ne laisser aucune prise à l'assaillant, le bâtiment était un édifice lisse, dépourvu de ces arcs-boutants qui habillaient pourtant la plupart des cathédrales. Rodrigue de Villandrando fit une entrée digne du succès qui venait de lui ouvrir les portes de la cité albigeoise. En grand ordonnancement, à la tête de sa cavalerie, le comte de Ribadeo parcourut les rues en direction de la cathédrale. Les sabots des chevaux caparaçonnés claquaient sur le pavé, couvrant à peine le cliquetis métallique des armes qui s’entrechoquaient contre les cuirasses. Arbalétriers et hommes de traits suivaient dans un hérissement de piques pointées vers le ciel. La foule anxieuse regardait passer cette cohorte en grand équipage, ne sachant ce qui allait advenir. Arrivé devant le porche latéral de la cathédrale, Rodrigue ordonna le rassemblement de tous les notables, religieux et dignitaires de la ville. Il attendit patiemment que ceux-ci prennent place à l’intérieur de l’église, dans les travées, sous la nef immense. Alors seulement, il consentit à descendre de cheval, mit son heaume sous le bras et tout armé, tout éperonné, franchit le seuil de l’édifice. Il n’y avait plus un souffle, plus un murmure, rien que le bruit des pas du comte de Ribadeo résonnant sur le dallage. Le jubé n’existait pas encore et le colossal édifice répercutant sous ses voûtes l’écho de la marche de Rodrigue semblait donner une gravité exceptionnelle au moment qui allait suivre. Le comte de Ribadeo, le port noble, la tête haute, le regard glacial, traversa le chœur et, face à la multitude effarée qui se demandait s’il allait violer le tabernacle, il monta jusqu’à la chaire épiscopale. La foule retenait son souffle. Rodrigue se retourna et osa commettre l’impensable. Prenant la place de l’évêque, il déclara d’une voix forte et assurée, aux accents castillans qui roulaient sous l’arc monumental, qu’il prenait possession des lieux au nom de messire Robert Dauphin.
233
Les consuls effrayés crurent voir dans cette cérémonie la menace d’une sauvage réaction. Pour apaiser leur hôte intraitable, ils se hâtèrent de mettre la ville sous la sauvegarde du roi en arborant les fleurs de lys au-dessus des portes. Mais le comte de Ribadeo alla plus loin encore et pour qu’il n’y ait point d’équivoque sur le véritable vainqueur, il fit jeter bas le pennon de France et mettre à sa place celui des Dauphins d’Auvergne ! Ainsi se terminait la prise d’Albi. Rodrigue, après avoir rétabli l’autorité de Robert Dauphin dans la ville, jugea ses engagements remplis et, dans un premier temps, décida de ne pas s’inquiéter du sort de l’évêque du concile qui siégeait toujours à Cordes. Il avait mieux à faire. Le fameux « Pays de Cocagne »12 était riche et il jugea qu’il pouvait encore lui rapporter un complément financier. Il dispersa ses gens dans le diocèse sous le prétexte de réduire les châteaux occupés par l’ennemi. Pour ne pas compromettre sa victoire, il laissa une garnison à Albi et, avec le reste de sa troupe, il s’en alla mettre le siège devant les places que tenaient encore plusieurs seigneurs du parti de Cazillac. Flotard de Bar, chevalier, sommé de rendre la forteresse de Montirat, ayant dédaigné les menaces du capitaine, eut sa terre mise à feu et à sang. Il perdit son château, qui devint une base de plus pour les évolutions du Castillan dans le pays. Ces actions consommées, Rodrigue laissa une petite unité s’avancer vers Cordes, la ville où s’était réfugié l’évêque déchu Bernard de Cazillac. L’épisode de Cordes Plusieurs mois s’écoulèrent entre la soumission d’Albi et le retour de l’évêque restauré, parce que, un an auparavant, après la mise à sac d’Albi par les troupes de son frère le 11 juillet 1436, Cazillac, nous l’avons vu, courut se mettre à l’abri dans l’enceinte de Cordes.13 La cité cordaise avait déjà connu une première alerte. En novembre 1436, l’arrivée de Rodrigue semblait imminente et les consuls avaient pris les mesures les plus minutieuses pour organiser une défense contre une armée forte, disait-on, de plusieurs milliers 12 13
Nom qui servait à désigner la région productrice du pastel. Aujourd’hui Cordes-sur-Ciel.
234
d’hommes. Le document qui fournit ce renseignement prouve aussi que, selon toute vraisemblance, les préparatifs de mise en défense des Cordais furent initiés par Bernard de Cazillac en personne et qu’en cette occasion, on procéda à une véritable levée en masse de la population. Cette fois-là, le péril fut conjuré ou plutôt simplement différé. Mais le 18 mars 1437, Rodrigue envoya à nouveau un petit détachement armé vers le refuge de l’évêque déchu. Cette unité fit sa jonction avec une autre mandatée par Charles VII. En effet, Robert Dauphin, lors de son retour à Albi, constata qu’il n’avait toujours pas recouvré la totalité des domaines de l’évêché. Il porta plainte devant le roi. Les trois sénéchaux de Toulouse, Carcassonne et Beaucaire furent commis pour rechercher et démasquer les « complices » de Cazillac, puis sommer Cordes de se rendre.
- 16 La cité médiévale de Cordes (sur Ciel), qui fut le refuge de Bernard de Cazillac. Photo N. Bourg.
235
Cependant, les choses n’étaient pas aussi simples, car Cordes était une place forte exceptionnelle. Occupant la partie sommitale d’un étroit plateau, elle était entourée de quatre enceintes, qui couraient en cercles concentriques sur le flanc de la montagne. Ces aménagements défensifs étaient complétés par des hourds en bois, dressés en encorbellement au sommet des courtines et des tours. À partir de cette position, les défenseurs pouvaient s’avancer, surplombant par une avancée de pied la maçonnerie. Les portes étaient munies de pontslevis constitués par des planchers qui se rabattaient à l’aide d’une chaîne contre la façade. Curieusement, il n’existait pas de meurtrières permettant de tirer dans la direction de la barbacane. Cette particularité amènerait à croire que l’on comptait plus sur l’effet de projectiles massifs agissant par leur poids et par ricochet que sur les traits. Les hommes logés dans les guettes du Plagnol en 1436 avaient à leur disposition une provision de pierres et il n’était pas question d’arbalètes où d’arcs. Un moellon tombant sur un terrain en pente devait être plus dangereux pour l’assaillant qu’une flèche tirée de haut en bas et dont le bouclier protégeait suffisamment.14 On le voit, pour réussir cette opération, il n’était nul besoin de tenter un siège, jugé par ailleurs trop hasardeux face aux capacités de défense d’une telle citadelle. Ce blocus risquait surtout de s’éterniser sans résultat. Et puis, il s’agissait selon le désir royal de s’assurer simplement de la prise de quelques personnages, sans porter atteinte à la population. Il fallait donc pour cela trouver des complicités à l’intérieur de la cité. Ce fut aisé, car devant la menace, les consuls, requis de livrer Cazillac, semblèrent oublier les lois de l’hospitalité due à leur prélat et laissèrent pénétrer dans leurs murs, au milieu d’une nuit sans lune, quarante gens d’armes ou plus. Le roi ayant mandaté pour ces prises les autorités de la province, on aurait donc pu croire que les choses se passeraient avec une certaine décence. La présence de ces hauts personnages aurait dû imposer aux routiers une certaine retenue, c’est au contraire leur mauvais comportement qui gagna les officiers du roi et leur suite. La ville de Cordes fut maltraitée. Les consuls, en livrant Cazillac, avaient espéré sans doute, au prix de la trahison, sauver la cité du 14
Charles PORTAL, Histoire de la ville de Cordes 122 – 1799, Société des amis du vieux Cordes, 4e édition, 2010, p. 423.
236
pillage. Cet espoir fut déçu. Les quarante combattants s’étaient d’abord acquittés de leur mission en remontant furtivement la grand’rue jusqu’au château de la Bride, refuge de Cazillac15. Curieusement, les portes n’offrirent pas de résistance, et les hommes pénétrèrent en masse jusqu’au logement. Une mauvaise surprise les attendait, la place était vide, la chambre brillait encore sous la lueur d’une chandelle, le lit conservait l’empreinte d’un corps, mais le prélat avait disparu. Cazillac, prévenu par des fidèles, avait trouvé le moyen de s’évader, en toute hâte, ayant à peine le temps de jeter une simple cape sur sa chemise. Les routiers avaient espéré le faire prisonnier et le mettre à rançon, avec la certitude d’un gain important qu’ils évaluaient pour chacun à cent moutons d’or. Ce fut une énorme déconvenue ! Ils le cherchèrent partout dans les corridors et les pièces, remontant les étages, descendant jusque dans l’obscurité des caves. Personne ! Aucune présence palpable. Alors, ils passèrent leur colère sur le mobilier de la riche demeure puis, étant redescendus dans la ville, ils continuèrent leurs exactions, saccagèrent les maisons et mirent la cité au pillage. Cependant, au cours de leur fouille minutieuse dans les appartements du prélat, les assaillants s’étaient saisis des habits de l’évêque. C’est ainsi que le jour naissant, ils parcoururent les rues avec mille dérisions et blasphèmes, accompagnant le sénéchal de Toulouse qui chevauchait une mule et s’était ridiculement affublé de la chasuble et des habits d’église du fugitif. L’officier du roi s’était en outre coiffé d’un grand chapeau usagé en guise de mitre. Et voilà un drôle d’évêque en curieux équipage, déambulant par les rues et autour duquel vociférait une bande de soudards ! Étrange cérémonial auquel durent assister les Cordais médusés. Robert Dauphin fut profondément heurté par ces comportements blasphématoires qui tournaient en ridicule les ministres de la religion. Il les désavoua publiquement. Mais, malgré ce soutien apparent, les Cordais ne furent pas absous de leur faute, ils avaient à se faire pardonner leur désobéissance. Ils adressèrent à cet effet une humble supplique au roi, qui était encore en Languedoc, lui avouant que s’ils avaient donné asile à Bernard de Cazillac, c’est parce qu’il était un 15
Ibid. Charles PORTAL, Histoire de la ville de Cordes, 2010, p. 424. L’auteur cite Viollet-le-Duc qui fait allusion dans un document à « un vieux château ruiné » dont les débris seraient situés sur la « Bride », c'est-à-dire au point le plus élevé.
237
enfant du pays dont la famille avait rendu de grands services à leur ville. Ils se dédouanaient d’ailleurs en affirmant que s’ils l’avaient reçu comme prélat, ce n’était qu’à l’instigation des nobles du pays. Ils ajoutaient que lorsque les sénéchaux s’étaient présentés pour le capturer au nom du roi, les consuls avaient montré leur obéissance et leur attachement à la couronne en ouvrant les portes de la ville. Charles VII accueillit favorablement cette supplique et accorda à la ville des lettres d’abolition, datées de Pézenas, le 30 avril 1437. Néanmoins, vu l’état des finances royales, cet acte de repentir ne semble pas avoir été gratuit. On voit en effet, le 4 juillet 1438, les consuls de Cordes dans l’obligation de décréter une imposition de cinq cents francs or, à l’occasion de ce pardon. Encore de coupables excès à Albi À la même époque, des excès non moins coupables démontrent une nouvelle fois la présence des routiers dans Albi. Ici encore, selon la même tactique, les sénéchaux introduisirent nuitamment des troupes, pour calmer les inquiétudes de Robert Dauphin, qui venait de rentrer dans sa ville épiscopale. Ils prirent logis chez les habitants, en faisant, la plupart, sauter les maris par les fenêtres et non contents d’avoir levé une forte contribution pendant leur séjour, ils rançonnèrent encore leurs hôtes au moment du départ. On reprit facilement plusieurs châteaux. Mais il fallut traiter avec quelques seigneurs et notamment le seigneur de la Coste, qui occupait celui de Combefa. Il consentit à livrer la forteresse moyennant mille cinq cents réaux d’or que paya Robert Dauphin. Montirat résista jusqu’au 3 mai et fut emporté d’assaut par Guillot d’Estaing, sénéchal de Rouergue. Les habitants d’Albi avaient aussi d’importantes affaires à régler, surtout au regard de leur situation financière désastreuse. Non seulement les coffres de la communauté et les réserves des bourgeois étaient vides, mais la ville avait encore contracté des dettes considérables. Il est intéressant de noter que pendant les derniers troubles, la cité épiscopale avait dû fournir trente-deux pièces de drap anglais de diverses couleurs exigées par les routiers de Rodrigue. Elle avait été obligée pour cela de mettre en gage, à Toulouse, une image d’argent d’une valeur de cent soixante-douze marcs deux onces ou environ qui représentait une vierge à l’enfant. Cette image appartenait au prieuré Notre-Dame de Fargues. Une profonde dévotion l’entourait 238
et les fidèles accourant de toutes parts la tenaient en grande vénération. Cependant, face aux terribles exactions que la ville avait eu à subir, les consuls l’avaient livrée aux usuriers sans autorisation du clergé. Les administrateurs de la cité se justifièrent auprès de l’évêque en argumentant qu’en agissant ainsi, ils avaient évité aux habitants de courir le risque d’être affamés. Robert Dauphin éprouva de la compassion face à ce récit, et le prélat leur fit simplement promettre de tout tenter pour recouvrer la précieuse image dans l’année. Par le même acte du 28 avril 1437, le prieur de Fargues joignit son approbation à celle du prélat. Cependant, le tableau de la Vierge à l’enfant faillit être vendu. En effet, à l’expiration de l’année, la ville n’était toujours pas en mesure de payer les sept cent quatre-vingtquatre écus d’or que représentait la caution de la sainte image. Alors, pour gagner du temps, on fit valoir une prétendue irrégularité dans la rédaction de l’acte d’engagement et, malgré les censures ecclésiastiques qui frappèrent les consuls d’excommunication, l’affaire fut portée devant les tribunaux où elle n’était toujours pas résolue sept ans après16. Mais comment la malheureuse ville d’Albi, animée par la meilleure volonté du monde, aurait-elle pu contenter ses créanciers ? Les compagnies, bien que les hostilités aient officiellement cessé, continuaient sans relâche à ravager le pays. Rodrigue, le bâtard de Bourbon, Xaintrailles, Salazar exerçaient toujours des pressions sur la région et il fallait satisfaire à leurs exigences sans cesse renouvelées. Alors, on vit les habitants engager d’avance la récolte du pastel pour fournir à ces chefs redoutés des munitions, des vivres, du vin, et même des fournitures en tissu pour leurs habits. Il fallait encore payer les tailles, les aides. La cité épiscopale croulait sous les charges. Un instant on reprit espoir, on crut même le diocèse délivré de ces terribles occupants, lorsqu’ils furent dirigés sur Bordeaux contre les Anglais. Mais quelque temps après, la campagne de Guyenne n’ayant pas atteint ses buts, ils revinrent en masse finir l’ouvrage qu’ils avaient commencé.
16
Ibid. REVUE historique, scientifique et littéraire du département du Tarn, No 4, 1877, Vol. 1, pp. 273 à 277 et 289 à 290.
239
Rodrigue, qui s’était pourtant couvert de gloire dans cette courte expédition, poussa ses dévastations jusque sous les murs de Toulouse. La grande ville ne réussit à l’éloigner qu’en lui versant deux mille écus d’or complétés de mille écus remis au bâtard de Bourbon, son lieutenant. Alors, se détournant sur le piémont pyrénéen, il se jeta sur le Comminges avant d’opérer au tout début de l’année 1437 une retraite soudaine vers le Berry où Charles de Bourbon semble l’avoir appelé pour une mission qui s’annonçait des plus délicates. Épilogue du conflit Après le départ de Rodrigue, Robert Dauphin resta en possession paisible de sa charge pendant dix-huit ans. Le pape nomma le 26 janvier 1453, par mesure de pacification, Bernard Cazillac au siège de Lodève. Les Cazillac étaient ruinés et durent emprunter de fortes sommes à Jean de Pradal, riche bourgeois d’Albi. La lutte pour la conquête du diocèse coûta une fortune aux deux évêques. Elle trouva son épilogue aux termes d’un procès interminable, sur des monceaux de ruines et de sang répandu. Le Parlement qui avait été saisi publia les arrêts définitifs en faveur de Bernard de Cazillac seulement en 1454 et 1456. Celui-ci était enfin autorisé à officier le 1er novembre 1455 à la cathédrale Sainte-Cécile. Le pape Calixte III autorisa Bernard à disposer des biens du diocèse par une bulle de l’an 1458. Robert Dauphin, désavoué, se retira. Mais il fit encore une instance devant le Parlement et fut condamné par un nouvel arrêté du 1er avril 1461. Lassé et usé, il mourut en octobre 1461 à Brioude près de Brive où il s’était retiré. Bernard Cazillac fut reconduit dans sa charge le 12 octobre 1461 par le Pape Pie II qui avait succédé à Calixte III. Mais, décidément, le destin des deux évêques devait se suivre : Bernard ne put jouir longtemps de son évêché. Il mourut le 12 novembre 1462 et fut inhumé devant le grand autel, dans le chœur de sa cathédrale si longtemps convoitée. Ce conflit des deux obstinés prélats s’étale sur une période de vingt-quatre ans, et ne se solde que par la mort des deux compétiteurs. Il illustre les répercussions locales du conflit entre le pape et le concile pour le pouvoir dans l’Église en ce début du XVe siècle. Il marque aussi l’antagonisme de la petite aristocratie locale face à la « noblesse d’État », qui l’une comme l’autre assoient leur propre ambition sur l’éternelle souffrance du peuple. 240
LE CONCILIABULE D’ANGERS ET LA DISGRÂCE DE RODRIGUE Mars 1437, sur l’appel de Charles de Bourbon, Rodrigue venait de retirer ses troupes du Comminges et opérait une marche forcée vers le nord. En entrant dans le Berry, son intention était de traverser cette province et de se hâter vers la Touraine pour se rendre quelque part où il se disait pressé d’arriver. Le but du voyage avait été tenu secret par le capitaine, cependant personne dans son camp n’ignorait l’itinéraire. Comme toujours en pareil cas, des indiscrétions furent commises, la rumeur s’en empara et le bouche à oreille fit le reste. On savait déjà qu’il se dirigeait sur la Touraine alors que sa compagnie n’était encore qu’à La Châtre. Sur les bords de Loire, on se mit à trembler. Dans la cité tourangelle dégarnie de troupes se trouvait la reine Marie d’Anjou, épouse de Charles VII, en compagnie de sa belle-fille Marguerite d’Écosse, qui venait d’épouser en 1436 le dauphin Louis, futur Louis XI. Affolés par cette nouvelle qui arrivait au moment le plus fâcheux, les habitants de Tours supplièrent la reine et la dauphine d’intercéder auprès du redoutable visiteur qu’ils ne connaissaient que trop ! Par deux fois, ils avaient eu déjà affaire à lui. Ces dames écrivirent en effet en avril, une lettre qui fut portée à La Châtre par un certain Philipot Bigot chevaucheur de l’escurie du roy. Il est intéressant de noter qu’à partir de cette époque, le comte de Ribadeo semble fréquemment accaparé par la gestion de ses nombreuses affaires personnelles. Il délègue de plus en plus, ce qui ne va pas sans risque. En effet, à l’arrivée du messager, le Castillan n’était pas là. L’émissaire fut reçu par un de ses lieutenants et attendit patiemment la venue du comte pendant trois jours. Rodrigue arriva enfin et répondit aussitôt à la reine avec une courtoisie toute chevaleresque. Il déclara au messager que, malgré l’importance de son dessein, il renonçait à passer par la Touraine pour l’honneur et révérence qu’il devait à de si grandes dames. Il ajoutait par ailleurs qu’il était fort aise de donner cette marque de déférence au dauphin, dont il se disait être le 241
serviteur et l’obligé1. À la suite de ces paroles, il rédigea une réponse des plus aimables. Mais il est temps de dévoiler maintenant ce que pensait faire le comte de Ribadeo en prenant le chemin de la province tourangelle. Plusieurs princes du sang, mécontents de voir depuis la disgrâce de La Trémoille faveurs et crédits royaux aller à Charles d’Anjou, s’étaient donné le mot pour tenir un conciliabule à Angers. Ils se réunirent au mois de mai 1437. Le duc de Bourbon conduisait cette intrigue, secrètement élaborée sous couvert du mariage de sa fille avec le fils de René d’Anjou. Dans le même temps, Rodrigue arriva comme par hasard en vue de la ville où s’agitaient les comploteurs. Il effectuait ainsi une diversion en mobilisant l’attention autour du mystère entretenu de son action. Jacques de Chabannes, frère du terrible capitaine des Écorcheurs et vassal du duc de Bourbon, avait reçu l’ordre de converger vers les bords de Loire avec la totalité de ses gens d’armes pour se joindre au comte de Ribadeo.2 Quinze jours plus tard, il y eut à Tours une nouvelle alerte. On apprit que les routiers, au lieu de s’éloigner, suivant la promesse de leur capitaine, avaient simplement reflué aux abords de la forteresse de Chatillon-sur-Indre, à huit lieues de Loches. Le comte de Ribadeo était une nouvelle fois absent. Ses ordres furent-ils mal interprétés ? Ou bien voulait-on encore profiter quelques jours de cette opulente région ? On sait seulement que ce mouvement avait été conduit par le bâtard de Bourbon, son remplaçant. La reine et sa belle-fille écrivirent encore, et leur lettre, remise à Guy de Bourbon, amena la retraite définitive de la compagnie. Après trois jours d’hésitation et d’attente, elle rebroussa chemin d’une traite jusqu’au hameau de Déols, à côté de Châteauroux. Puis de là, elle se mit en marche vers le Bourbonnais. Mais essayons tout d’abord de comprendre pourquoi dans l’entourage du roi les complots furent permanents. En effet brigues, conspirations, intrigues se succèdent et sont pour cette période une réalité bien concrète. Les révoltes nobiliaires sont monnaie courante. Les mécanismes et les méthodes d’action des alliances seigneuriales, groupes à la fois familiaux, politiques et passionnels, s’insèrent dans 1 2
Ibid. Jules QUICHERAT, 1845, p. 85, Pièce justificative, no XIII. Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, note 1, p. 136, Pièce justificative, n° LI.
242
la mouvance de la guerre générale. Leur but unique est de contrôler la personne et le conseil du roi afin d’exercer la réalité du pouvoir. Tour à tour, chacun des favoris de Charles VII n’hésita pas en effet à user de tous les moyens pour asseoir son influence auprès du souverain. La valse des favoris Le premier et le plus célèbre de ces favoris, Pierre de Giac, était en 1426, au plus haut degré de la faveur royale. C’était un homme d’un caractère violent et emporté, qui avait joué un rôle dans l’affaire du pont de Montereau. Dans une assemblée des trois États qui eut lieu à Mehun-sur-Yèvre, près de Bourges, un évêque nommé Hugues Comberel voulut bien s’acquitter d’un nouvel impôt mis en place par le favori, à la condition qu’on osteroit les pilleries, et non autrement. Le sire de Giac conseilla au roi de France de faire jeter monseigneur Comberel à la rivière, avec tous ceux qui avaient été de son avis. On racontait par ailleurs que pour se débarrasser de sa femme, ancienne maîtresse du duc Jean sans Peur, Pierre de Giac lui avait donné un breuvage empoisonné, puis l’avait prise en croupe et avait chevauché ainsi avec elle plus de quinze lieues. Elle en mourut avec son enfant, car elle était grosse, ce qui permit au favori d’épouser la comtesse de Tonnerre dont il était amoureux. Ses exactions et son insolence lui avaient attiré des ennemis puissants, en tête desquels figuraient le connétable de Richemont et Georges de La Trémoille. Ils résolurent de le mettre à mort. Une nuit de janvier à Issoudun, ils pénétrèrent dans sa chambre, l’arrachèrent aux bras de sa femme qui s’empressa, disent les chroniques de sauver la vaisselle. Quant à lui, ils l’entraînèrent sans estre vestu ni chaussé, sinon d’un manteau et d’une botte. Il avoua qu’il avait vendu une de ses mains au diable, empoisonné sa première femme, enfin tout ce qu’on voulut. Condamné à mourir, le sire de Giac demanda grâce de sa vie en proposant pour otage sa femme, ses enfants, ses places et cent mille écus d’or. Il aurait tout l’argent du monde, répondit le connétable, que je ne le laisserais pas aller, puisqu’il a mérité la mort. Le bourreau de Bourges fut chargé de mettre le favori dans un sac et de le jeter à la rivière. Ne demandez pas si le Roy fut bien courroucé, dit un chroniqueur, mais dès qu’il fut bien informé du gouvernement et de la vie dudit Giac, il fut très content. Quant à la veuve du favori, elle
243
épousa, assez tôt après, le sire de La Trémoille, qui d’après ce que rapporte un autre chroniqueur, en eut plusieurs beaux enfants.3 Lecamus de Beaulieu qui succéda à Pierre de Giac, fit une fin aussi tragique. En peu de temps, il trouva le moyen d’indisposer contre lui toute la cour. Il gastoit tout, ne vouloit que homme approchast du Roy, et faisoit pire que Giac. Le connétable ne s’était point débarrassé de ce dernier, pour supporter patiemment les impertinences de son successeur. Trahi par un des siens, Lecamus de Beaulieu fut conduit à la promenade, près du château de Poitiers. Deux hommes du connétable l’y attendaient. Ils lui donnèrent sur la teste tant qu’ils la luy fendirent et luy coupèrent une main ; de sorte que plus il ne bougea, et s’en alla celuy qui l’avoit amené, et ramena son mulet au chasteau, là où estoit le Roy, et Dieu sçait s’il y eut beau bruit.4 Mais ce bruit dura peu. Il fallait un favori à Charles VII. Le connétable lui donna Georges de La Trémoille, le même qui l’avait si bien secondé dans son expédition nocturne contre Giac, et qui avait épousé sa veuve. Bientôt, ce favori devint plus nécessaire au roi que ne l’avaient été les deux autres. Trahi à son tour par son ex-associé, le connétable de Richemont n’eut pas alors d’ennemi plus puissant. Instruit par le sort de ses devanciers, La Trémoille prit ses précautions. Grâce à elles, son crédit se maintint environ six ans. Mais son tour n’était pas loin, en 1434, une conspiration fut ourdie contre lui, à la cour même, et en quelque sorte avec l’assentiment de la reine. Une nuit, quelques Bretons dévoués au connétable pénétrèrent dans la demeure du favori, et l’un d’eux lui donna dans le ventre un coup d’épée qui l’eût tué, sans son embonpoint. Un de ses neveux, Jean de Bueil, qui était de la conspiration, lui sauva la vie. La Trémoille fut finalement enlevé par le connétable de Richemont qui l’emprisonna au château de Montrésor, situé à une soixantaine de kilomètres de Tour. La Trémoille ainsi détenu se racheta moyennant quatre mille écus d’or qu’il dut payer à son propre neveu. Il eut la vie sauve, mais à condition de ne plus s’approcher du roi et de renoncer au gouvernement. Charles VII n’intervint pas. Richemont retrouva alors sa charge de connétable. Le 8 mars 1436, 3
Ibid. Denys GODEFROY, Jean Chartier, Histoire de Charles VII Roy de France, Jacques le Bouvier dit Berry, Mathieu de Coucy et autres auteurs du temps, Imprimerie royale, Paris, 1661, pp. 15, 374, 493. 4 Ibid. GODEFROY, pp. 751 et 752.
244
nous l’avons vu, Charles VII le nomma lieutenant-général en Île-deFrance, Normandie, Champagne et Brie, avec la charge de reprendre Paris.5 C’est donc dans ce contexte de conspirations permanentes, que Rodrigue pour conserver son armée, ses alliances, mais aussi par pure fidélité à son beau-frère Charles de Bourbon, se laissa entraîner dans une intrigue qui risqua de lui coûter fort cher. Cet épisode en apparence anodin le fera passer tout près de la catastrophe, mais dans sa clairvoyance il réussira, nous allons le voir, à maintenir le cap pour regagner rapidement les faveurs royales. Le meurtre de Giraud de Goulart, bailli de Berry Le passage des routiers du comte de Ribadeo fut signalé, comme à l’ordinaire, par des pillages, des mises à rançons, des incendies… Mais il y eut quelque chose de plus, une action qui échappa au contrôle de Rodrigue. Le meurtre d’un officier du roi, qui connut un énorme retentissement.6 Charles VII était alors en pays de Languedoc, lorsqu’il apprit que Rodrigue et le bâtard de Bourbon étaient en Berry avec une grande compagnie composée d’hommes d’armes et de traits et qu’ils y causaient de grands dommages et oppressions innombrables au pauvre peuple. Il donna aussitôt l’ordre au chevalier Giraud de Goulart, son chambellan et bailli de Berry qui était justement avec lui, de se rendre de toute urgence à Bourges afin de débarrasser le pays de ces hôtes indésirables. Une fois sur place, le bailli était chargé de rassembler le plus grand nombre de nobles et gens d’armes pour délivrer les habitants de la terreur où ils vivaient, et d’expulser définitivement les pillards rodriguais. Giraud de Goulart se rendit en effet à Bourges, où il rassembla à la hâte une troupe d’hommes d’armes qu’il équipa, en réquisitionnant sur place les harnachements et les armes nécessaires. Après quoi, il se mit en campagne pour exécuter la mission dont le roi l’avait chargé.7 5
CLEMENT Pierre, Jacques Cœur et Charles VII, ou La France au XVe siècle, Guillaumin, Paris, 1853, tome 1, chap. II, pp. 58-60. 6 Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, p. 137. 7 Philippe de LAUER, Un nouveau document sur Rodrigue de Villandrando, Bibliothèque de l’école des Chartes, Droz, Imprimerie de Decourchant, Paris, 1919, tome 80, p. 148.
245
Un soir de mars 1437, alors que la pénombre s’emparait du « plat pays » berrichon, le bailli s’engagea dans un chemin creux. Pour son malheur, des hommes de Rodrigue s’étaient postés là en embuscade. L’officier de Charles VII fut tué dans l’exercice d’une mission « au nom du roi ». Terrible méprise, à laquelle vint encore s’ajouter une circonstance aggravante ! Le crime avait été commis par un homme d’armes castillan renommé dans la compagnie, parce qu’il portait le même prénom que son chef. On l’appelait, le « Petit Rodrigue »8. Ce Petit Rodrigue était un lieutenant du comte de Ribadeo, et on l’avait nommé ainsi parce que, par son courage et son engagement, il ressemblait au grand chef castillan. Ce n’est pas tout : ce qui rajouta encore à la gravité de cette action, ce fut d’avoir osé semer le trouble au cœur même du royaume, qui plus est autour des résidences royales et cela dix-huit mois à peine après la pacification tant souhaitée du traité d’Arras. Les maux dont le royaume avait souffert pendant tant d’années n’étaient donc pas encore parvenus à leur terme ! À la cour, on ne se gêna plus pour dire la lassitude qu’on éprouvait. Mais que faire face à cette armée indépendante dont la puissance pouvait aisément contrer les actions des troupes royales ? Au milieu de la mouvance des complots, la participation aux guerres seigneuriales était un des éléments dont dépendaient le financement et la survie des armées indépendantes. L’état des finances du royaume ne permettait toujours pas de les intégrer, ce qui faisait dire au chroniqueur Jean Chartier, qu’en ce temps-là, plus un homme de guerre était en force pour dévaliser les pauvres gens, mieux il était posé pour obtenir du roi ce qu’il voulait.9 Cependant, à la nouvelle de ce dernier attentat contre son autorité, le roi déclara qu’il marcherait en personne contre les fauteurs de troubles, et qu’il ne prendrait de repos avant d’en avoir purgé complètement le royaume.
8
Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, p. 137. Ibid. A. VALLET de VIRILLE, Histoire de Charles VII et de son époque 14031461, Librairie de la Société d’Histoire de France, Renouard, Paris, 1863, Tome I, p. 241 : « Qui povoit avoir plus de gens sur les champs et plus povoit pillier et rober les povres gens estoit le plus craint et le plus doublé, et qui plus tost eust obtenu quelque chose du roi de France que nul autre ». 9
246
La détrousse des fourriers du roi Lancé dans sa mission auprès du duc de Bourbon, Rodrigue n’en stoppa pas pour autant son avancée vers la Touraine. Il est même probable que le comte de Ribadeo avait déjà rejoint son beau-frère à Angers lorsque Philipot Bigot, messager de la reine se présenta pour la deuxième fois au camp de Châtillon-sur-Indre. Celui-ci fit savoir au bâtard de Bourbon que le secret de la coalition avait été dévoilé, et que le roi était au courant. Il était plus qu’urgent de prendre le large !10 En effet, Charles VII revenait alors de Montpellier, parlant en termes irrités à tous ceux qui voulaient l’entendre, tant du duc de Bourbon que de son beau-frère « le routier ». Son courroux ne se traduisit pas seulement en paroles, car il fit preuve en ces circonstances d’une volonté implacable. Pour compléter son armée, on le vit recruter des mercenaires dans le Languedoc et embrigader à son service tous les volontaires qu’il put. Sa fureur était à la hauteur de la déception qu’il éprouvait. Comment ceux qu’il considérait comme ses plus loyaux sujets avaient-ils pu basculer dans cette conjuration ? De Saint-Flour, il fut en un clin d’œil à Clermont, de Clermont à Aigueperse, puis à Montmarault près de Montluçon où il dressa son camp. Les routiers, sous le commandement du bâtard de Bourbon, avaient été attardés par leur chef qui revenait à la hâte d’Angers. Lorsque le comte de Ribadeo les rejoignit enfin, ils venaient de poser le pied en Bourbonnais, sur les bords de la Marmande, à SaintAmand-Montrond.11 Le jour même où il quittait le Midi, le roi avait appris avec effarement que le conciliabule des princes qui se tenait à Angers était présidé par le duc de Bourbon en personne. Celui-ci avait rallié à sa cause le duc d’Alençon, le duc de Bretagne et même René d’Anjou, beau-frère du souverain. Charles de Bourbon avait joué de son influence auprès de celui-ci. En effet, il s’était fortement impliqué dans la libération de René, lorsque celui-ci était prisonnier de Philippe 10
Ibid. Denys GODEFROY, Jean Chartier, histoire de Charles VII, Paris, 1661, p. 395. Le héraut du Berri, qui se tait sur l’intrigue des princes du sang, dit seulement que Rodrigue, en apprenant l’approche du roi, « partit hastivement des pais de Touraine et d’Anjou, où il estoit alé pour piler le peuple ». 11 Ibid. Denys GODEFROY, Jean Chartier, histoire de Charles VII, Chronique du héraut du Berri, Paris, 1661, p. 395.
247
le Bon. René ne pouvait donc plus reculer, car en application des fameuses alliances seigneuriales chères à cette époque, on venait de marier deux enfants. Par contrat du 2 avril 1437, Marie de Bourbon, âgée de dix ans, avait épousé Jean d’Anjou, fils de René, duc de Calabre qui était du même âge que sa fiancée.12 Charles VII cependant n’avait pas encore fait connaître le fond de sa pensée. Voulait-il seulement surveiller la marche de Rodrigue, voulait-il l’empêcher de prendre refuge sur les terres du duc de Bourbon ? Pendant que les deux partis, arrêtés à seize lieues l’un de l’autre, attendaient réciproquement de leurs nouvelles, un détachement de routiers, envoyé en reconnaissance, rencontra aux portes de Hérisson les fourriers et plusieurs domestiques du roi qui venaient préparer son logis. Le château de Hérisson, accroché sur un roc vif dominant l’Aumance, constituait alors une redoutable place défensive. Il lançait vers le ciel sept tours rondes, et comportait deux donjons carrés d’où l’on pouvait placer des machines de guerre capables de battre la haute colline avoisinante. Le roi souhaitait gagner au plus vite cette imposante forteresse et avait envoyé ses hommes préparer son arrivée. Sans respect pour la livrée des fourriers du roi, les éclaireurs à la solde du comte de Ribadeo agirent sur leur propre initiative. L’occasion faisant le larron, ils rossèrent les hommes et s’emparèrent du bagage royal au moment où les malheureux serviteurs s’apprêtaient à entrer dans la forteresse. Ces bandits trouvèrent de bonne prise le mobilier portatif, le linge, la garde-robe, l’argenterie du roi. La détrousse des fourriers royaux fit grand bruit. Le roi, pour le coup et on l’imagine aisément, fut pris d’une grande colère. Il donna l’ordre d’une répression aussi rapide qu’énergique. Une armée, forte de quatre mille hommes de traits et de plus de cinq cents chevaliers se leva sans attendre. Voilà Rodrigue de Villandrando placé dans l’alternative de tirer l’épée contre son souverain ou de fuir… et il fuit, mais cependant sans tourner le dos. Plus au fait du pays que les capitaines du roi, il passe au milieu d’eux et va chercher le passage de l’Allier à Varenne, celui de la Loire à Roanne, celui de la Saône en face de Trévoux, là où finissait le royaume de France. Il existait en cet endroit un bas-fond que le Castillan connaissait pour s’en être maintes fois servi dans le temps de ses guerres contre la Bourgogne. 12
Ibid. A. VALLET de VIRILLE, Histoire de Charles VII, 1863, Tome II, p. 380.
248
-17 Château de Hérisson, construit par les ducs de Bourbon sur une boucle de l’Aumance. Photo F. Monatte.
-18 Vue panoramique de la plate-forme sommitale. Photo François Monatte.
C’était, pour lui, l’une des issues qui conduisaient hors du royaume de France, certes sur les terres de l’Empire, mais sur une 249
portion de territoire qui appartenait au duc de Bourbon. Ce fut là son seul refuge. Il y précipita ses escadrons, et réussit à mettre tout son monde en sûreté, bien avant que les troupes royales ne paraissent sur l’autre rive de la rivière. En agissant ainsi, Rodrigue avait réussi à maintenir ses forces intactes, se rendant compte un peu tard que le jeu risqué des alliances pouvait comporter quelquefois bien des revers. Devant ce déploiement de force et l’esprit de décision de Charles VII, les princes sont déconcertés. Les ducs de Bretagne et d’Alençon regagnent prudemment leurs domaines, René d’Anjou s’explique le 2 août à Gien sur son attitude hésitante. On dira plus tard que René d’Anjou avait été trompé par les insinuations des conspirateurs sur les circonstances de sa libération. Charles de Bourbon doit, pour obtenir la grâce royale, se séparer de son bras armé en éloignant son frère « le bâtard » et son beau-frère le comte de Ribadeo. La transformation du souverain, qui s’est opérée lentement jusqu’ici, est complète et surprend ses contemporains. Partout son autorité personnelle s’accroît. En deux mois, il a réussi à étouffer dans l’œuf la formation d’une dangereuse conspiration. Et voici qu’il se prépare à combattre à la tête de ses troupes ! Les princes compromis dans l’intrigue d’Angers tentèrent de se racheter en affirmant une soumission totale à leur souverain. Quand ils virent la façon dont Charles VII procédait à l’égard du comte de Ribadeo, ils firent amende honorable. Charles de Bourbon, à qui la crainte fit épuiser toutes les formes de l’humilité, s’empressa d’atténuer par un désaveu les griefs que la conduite de son beau-frère faisait peser sur lui. Si le duc de Bourbon était tombé en disgrâce, ainsi que le roi René d’Anjou, pour s’être mêlés à ces intrigues, Rodrigue risquait bien plus. Charles VII, dans cette affaire, poursuivait autant le protégé que le protecteur. Le duc de Bourbon dut s’humilier devant le roi et abandonner son beau-frère à son mauvais sort. Rodrigue est banni du royaume Le roi ordonna une rupture immédiate de toute alliance contractée entre Rodrigue et les sujets du duc, avec le serment de n’en plus jamais contracter de semblables à l’avenir. Jacques de Chabannes et le bâtard de Bourbon, rappelés par son ordre, vinrent avec leurs gens d’armes prendre place dans une armée rassemblée sous ses yeux pour 250
la conquête du Gâtinais. Ce fut pour le roi le moyen de contrôler au moins ces deux-là. Quant au comte de Ribadeo, il ne pouvait en faire partie. Il était allé trop loin. Le souverain déclara aux termes d’un édit Rodrigue de Villandrando banni de son royaume13. Le contenu défendait à toute personne, et nommément aux princes de sang, de lui accorder aide, protection et confort, donnant en outre autorisation à quiconque de courir sus à ses routiers, s’ils réapparaissaient sur le territoire, et de les tuer comme bêtes nuisibles. Le roi partit ensuite pour aller commander le siège de Montereau, démontrant par ce comportement spontané une détermination qu’on ne lui connaissait pas jusqu’alors : comme s’il avait trouvé dans l’immense déception qui était la sienne, le courage de réagir pour le bien de son royaume. La saison, on s’en doute, fut mauvaise pour les Rodrigais à la suite de l’édit rendu contre eux. Plusieurs de leurs bandes qui refluèrent sur l’Auvergne furent contraintes de s’en éloigner bientôt, parce qu’il se forma contre elles une alliance offensive et défensive de la province à laquelle s’étaient joints le Velay et le Gévaudan. Les populations, pour s’affranchir des souffrances passées, étaient déterminées à faire flèche de tout bois. On détourna même des fonds alloués par les États provinciaux destinés à améliorer la navigation de l’Allier, afin de payer une partie de la dépense nécessaire à la défense des territoires. Qu’on juge des périls pour les Rodriguais à s’aventurer, surtout en ordre dispersé, au milieu d’un pareil soulèvement ! Les vengeances privées se multiplièrent en raison de l’impunité qui leur était garantie. Les traînards, les hommes d’ordonnance, les maraudeurs, tous ceux qui s’écartaient pour une cause ou pour une autre durent s’attendre à périr misérablement. Les plus exposés furent ceux des détachements que le grand capitaine avait laissés derrière lui pour garder un certain nombre de positions aux abords de la Guyenne et du Languedoc. Faute de pouvoir se déplacer, le comte de Ribadeo, par des commandements interposés, continuait à régler des affaires et à contrôler des zones stratégiques. Cependant, il n’était pas là, alors une véritable chasse à l’homme, avec son lot d’exactions, fut organisée par des 13
Ibid. QUICHERAT, Note 1, p. 143 : « Et fist le roy bannir ledit Rodrigues hors de son royaulme ».
251
gentilshommes et même des paysans. Mais l’ombre du terrible capitaine planait encore dans tous les esprits. Alors, autant que possible, on fit disparaître les victimes par le feu, sous terre ou par noyade dans la crainte des représailles qu’entraînerait inévitablement la découverte de leurs cadavres. La Dordogne, le Lot et leurs affluents furent le tombeau d’un grand nombre de ces victimes isolées. D’autres furent accrochés aux gibets des villes ou des justices seigneuriales. Or, dans ces temps difficiles, Jean de Goulart, seigneur de l’IsleBouzon, apprend que le Petit Rodrigue, meurtrier de son frère le bailli, vient de passer sous les murs de Lectoure et se dirige vers Toulouse en compagnie de six autres routiers et d’un héraut du comte d’Armagnac. À cette nouvelle, son sang ne fait qu’un tour. Il prend avec lui cinq hommes d’armes, parmi lesquels un certain Richard Dayme, qui rapportera plus tard le récit des faits. Il se précipite à ses trousses, le rejoint à deux lieues de Lectoure, près de Castelnau-d’Arbieu, et sans lui laisser le temps de le reconnaître, il le perce de coups dans le dos et jette son cadavre dans un buisson. Richard Dayme, qui prétend avoir accompagné Jean de Goulart pour lui être agréable et sans connaître l’objet de l’expédition, dit n’avoir même pas eu à se battre. Selon toute vraisemblance, les routiers de Villandrando s’enfuirent comme une volée de moineaux, malgré l’avantage du nombre. Ils crurent probablement être tombés dans une de ces embuscades où seigneurs et paysans s’unissaient pour les exterminer.14 Le retour des Écorcheurs On aurait pu s’attendre à voir le brigandage en baisse, après une si rude correction. C’est pourtant le contraire qui eut lieu. La saison qui suivit enregistra une recrudescence de ce fléau. Les Écorcheurs se multiplièrent et des hommes qui s’étaient illustrés dans les plus glorieux exploits, un Poton de Xaintrailles, un Bernard d’Armagnac, un Louis de Bueil, n’eurent pas de scrupules à se mettre à la tête de ces hordes, en concurrence avec d’obscurs capitaines sans foi ni loi. Louis de Bueil prit même le commandement général de tous les Écorcheurs. Privées d’emploi par le traité d’Arras, rappelons-le, des compagnies indépendantes continuaient à parcourir les territoires en 14
REVUE de GASCOGNE, Bulletin mensuel du Comité d’histoire et d’archéologie de la province ecclésiastique d’Auch, Société historique de Gascogne, S. N. Auch 1864-1939, N° 2, 1929/01, p. 64.
252
tous sens dans le seul but d’exister encore. Des bandes d’obédiences diverses se rassemblèrent pour occuper les cantonnements du Midi délaissés par les Rodrigais. En cette même année 1437, à l’abri de sa retraite bourguignonne, le comte de Ribadeo continue à diriger des opérations. Allié à d’autres compagnies, il se joint à Jacques de Chabannes et dévaste la Champagne. À la fin de 1437, il partage fraternellement avec ces mêmes capitaines la frontière champenoise de la Bourgogne. Nous les trouvons campés dans la vallée des Riceys. Le bâtard de Bourbon, en dépit de ses serments, est venu se remettre avec eux, et leur nombre croît bientôt d’un nouveau contingent qu’amène le comte de Pardiac. Ils ont projeté à eux trois, Pardiac, Rodrigue et le bâtard de Bourbon, une irruption en Bourgogne, dont ils font grand bruit, plusieurs semaines à l’avance. Charles VII doit se rendre à l’évidence : en bannissant Rodrigue, il n’a fait que déplacer le problème et il semble n’avoir d’autre choix que de le rappeler à son service pour que cessent ces hostilités. Mais ses finances sont exsangues… Des détachements d’avant-garde traversent alors la région de Châtillon-sur-Seine et vont prendre position autour de Dijon, à Gemeaux, à Is-sur-Tille, à Talmay en limite de la Franche-Comté, puis encore à Pontarlier15, tandis que le gros de la compagnie gagne d’une traite le Mâconnais. C’est au Mâconnais effectivement que Rodrigue en veut pour le moment. La rumeur rapporte qu’il fera à ce pays plus de maux qu’il n’en a jamais éprouvés. D’autre part, l’intention prêtée au comte de Pardiac était la conquête du Charolais, ancienne propriété de sa Maison qu’il désirait recouvrer. On le voit ici, le roi qui avait voulu assainir son armée sans pouvoir assimiler les autres avait en fait livré le pays à l’anarchie la plus complète Dans le Mâconnais, les voies de fait commencèrent par la détrousse du bailli de Mâcon, lorsque environ la my caresme passée ce magistrat traversait la ville de Bois-Sainte-Marie pour aller tenir ses assises, accompagné d’une suite considérable de clercs, de sergents et
15
Ibid. TUETEY M. (de), Les Écorcheurs sous Charles VII, Montbéliard, 1874, tome I, p. 21.
253
d’archers16. Les gens de Rodrigue dérobèrent entre autres biens, les chevaux de l’escorte. Le duc de Bourbon en dépit de son allégeance au roi continuait à agir par l’intermédiaire de son beau-frère. À ce sujet, un échange de correspondance qui eut lieu fin mars de l’année 1437 démontre sa pleine implication dans ces campagnes. « Un chevaucheur » fut envoyé par le conseil de Mâcon à Molin en Bourbonnois, devers Monseigneur de Bourbon, pour lui porter certaines lettres faisant mention de la détrousse que les gens de Rodrigue firent sur le Bailli et les gens du conseil et autres officiers. Il alla ensuite de Mascon vers Charlieu pour porter certaines lettres à Rodrigue que le bailli et les gens du conseil lui escrivoient, faisant mention de la détrousse. Puis, le même messager porta de Mâcon à Beaune les lettres de refus que leur faisoit Monseigneur de Bourbon quand le bailli et ses gens réclamèrent une partie des chevaulx qui leur furent ostés.17 Enfin, d’autres lettres furent encore adressées à Charles de Bourbon sur cette affaire, sans que rien ne soit résolu. Les représailles ne tardèrent pas. Le 29 juin 1437, des gens de Rodrigue s’étant aventurés en territoire bourguignon furent pris huit hommes de guerre, qui estoient venus ici pour piller et rober, et avoient laissé Rodrigue et ses gens vers Anse et Villefranche, qui menoit bien mille chevaux. Ils furent amenés sur le champ à Mâcon en tout début d’après-midi. Trois heures après, ils se balançaient au bout d’une corde, pendus aux fourches de Mâcon. Envahir la Bourgogne à main armée, alors que le grand duché avait repris ses attaches avec la couronne, c’était profondément offenser Charles VII, plus gravement peut-être que si l’on s’était attaqué à ses propres sujets. Il est inexplicable que le comte de Pardiac, alors l’homme de confiance et l’ami du roi, soit entré dans une semblable entreprise. Les choses toutefois ne furent pas poussées plus loin. Pas plus d’ailleurs que de la part du comte de Ribadeo, car Rodrigue souhaitait plus que tout faire la paix avec son roi. Grâce aux démarches de beaucoup de grands personnages, qui voulaient voir finir la disgrâce du Castillan, celui-ci, après avoir laissé rendre par le 16
Ibid. GARNIER Joseph, Inventaire sommaire des archives de la Côte-d’Or, Paris, 1864, tome II, p. 211. 17 Ibid. Marcel CANAT, Documents inédits pour servir à l’histoire de la Bourgogne, tome I, p. 376.
254
duc de Bourbon les chevaux dérobés au bailli de Mâcon, prit subitement avec ses hommes le chemin de la Guyenne. Le comte de Ribadeo allait mettre tout en œuvre pour reconquérir les faveurs royales : l’Anglais paiera !
255
LA CAMPAGNE DE GUYENNE ET L’ENTREVUE AVEC LE COMTE D’HUNTINGDON1 La disgrâce de Rodrigue dure peu. Dans la lutte contre l’Anglois sa puissance apparaît incontournable et le souverain le sait bien ! Voilà pourquoi en 1438, le comte de Ribadeo lance au nom du roi de France une vigoureuse offensive en Guyenne. Avec d'autres capitaines, il prend Fumel, Issigeac, Eymet, Lauzun, Tonneins, et marche à grand renfort de troupes vers le Médoc. Il s’empare de l’imposante forteresse de Blanquefort et s'établit à Castelnau au cœur de la province, à une trentaine de kilomètres à peine de Bordeaux. Et le voilà déjà face à la grande ville anglaise. Mais celle-ci possède un atout de taille, c’est une ville portuaire et nul ne peut prétendre la conquérir sans le concours d’une flotte capable d’apporter un soutien effectif par voie maritime. Lorsqu’il s’était engagé dans cette campagne, Rodrigue avait plusieurs raisons d’être satisfait. Par cette opération, il pensait reconquérir les faveurs de Charles VII et renouer avec ce qu’il avait de plus cher : sa nation d’origine. Sa détermination semble avoir été motivée par la perspective d’une grande opération militaire à laquelle allait s’associer le gouvernement de Castille. Ce royaume apporterait le concours d’une flotte, afin d’inquiéter les possessions anglaises du golfe de Gascogne, tandis que les Français les attaqueraient par voie 1
Jean Holland, comte d’Huntingdon (1395-1447), neveu d’Henri IV et donc cousin d’Henri V, rois d’Angleterre, lieutenant du roi en Guyenne, puis gouverneur de cette province à partir de 1439. En ce qui concerne sa confrontation avec Rodrigue, la plupart des auteurs citent le capitaine Talbot, mais c’est une erreur, car celui qui fit face au Castillan était le comte d’Huntingdon. Quicherat a lui-même rectifié en ce sens dans son édition de 1879, en s’appuyant sur les écrits de Monstrelet qui démontrent qu’à l’époque concernée, Talbot n’était pas en Guyenne : « Talbot s’employa pendant toute cette année 1438 à recouvrer pour son gouvernement les frontières de la Haute-Normandie, envahie par les Français ». (Monstrelet, I, II, chap. CCXXVIII).
257
terrestre. En attendant que tout soit prêt, Rodrigue fut autorisé à « lever contribution » sur son passage, notamment lors de sa traversée du Gévaudan où il put contracter plusieurs « patis » avec les malheureuses cités se trouvant sur sa route2. Sa mission consistait à harceler l’ennemi, et tenter par d’heureux coups de main de mériter sa réhabilitation publique. C’est pourquoi son but avoué, en s’éloignant de la Bourgogne, fut tout d’abord d’aller se mêler à la guerre de partis qui s’était ranimée entre la Dordogne et le Lot, aux confins des pays d’Agenais, Périgord et Quercy. La grande opération militaire pour la conquête de la Guyenne se préparait en coulisse. Elle était combinée depuis longtemps entre la Castille et la France avec le concours du gascon Poton de Xaintrailles et de Rodrigue.3 Dans les premiers mois de l’année 1438, une flotte castillane hissa les voiles et sortit de Santander pour croiser au large de la Guyenne. Au même moment, Charles VII partit pour la Saintonge afin de surveiller de plus près les opérations4. Cette flotte se porta notamment sur Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Capbreton. Puis, l’escadre arborant le pavillon castillan croisa au large de l’estuaire girondin en vue de Talmont qui relevait de la couronne de France. Cette place forte bordant la côte saintongeaise de l’estuaire joua un rôle de premier plan dans ce conflit maritime. Rodrigue, rappelons-le, avait reçu le 3 avril 1432 le château et la châtellenie de cette citadelle qui contrôlait l’ouverture de l’espace girondin. Le comte de Ribadeo pouvait espérer ainsi prendre en tenaille la cité bordelaise par mer et par terre. Cependant, la pénétration par voie terrestre s’annonçait plus délicate, car si la Castille avait décidé d’agir contre l’Anglais, l’Aragon en revanche s’était déclaré en sa faveur. Dans la continuité de cette démarche, le roi d’Angleterre avait fait de grands avantages
2
Ibid. Jules QUICHERAT 1879, note 2, p. 147, Pièces justificatives, no LIII. Germain LEFEVRE-PONTALIS, La petite chronique de Guyenne, Bibliothèque de l’École des Chartes, No 8, 1886, tome 47, p. 79. 4 Mathias TRANCHANT, Revue d’histoire maritime : risque, sécurité et sécurisation maritimes depuis le Moyen Âge, Presses de l’Université ParisSorbonne, Paris, 2008, p. 102. 3
258
sur le marché de Bordeaux aux Aragonais et aux Navarrais, qu’il appelait benevolentes et amigos nuestros.5 Comme toujours à cette époque, des relents de féodalité se rajoutaient encore à la complexité des alliances. La maison d’Armagnac resserrait ses liens avec la Castille et à l’opposé, celle de Foix affirmait plus que jamais son alliance avec l’Aragon. Ce conflit d’intérêts, se rattachant plus ou moins directement au conflit qui allait agiter la Guyenne, procura aux routiers de l’emploi pour le reste de la saison. Le théâtre des combats, dont nous allons maintenant relater les faits, se situe principalement dans un triangle entre les trois rivières le Dropt, la Garonne et le Lot. L’engagement terrestre Pendant que l’instabilité maritime créée par la flotte castillane affolait les Bordelais, le conflit terrestre fut déclenché. Les Anglais occupaient l’enceinte castrale de Camboulit en aval de Figeac. Rodrigue adapta sa tactique aux particularités du terrain et partagea son armée en deux factions égales. Il en établit une partie sur la frontière du Limousin, tandis que l’autre prit ses quartiers sur la rive gauche du Lot, à la Capelle-Balaguier et dans la campagne environnante. Cette seconde division était sous le commandement de deux chefs espagnols, qui acquirent par la suite une certaine célébrité dans le pays. Ils s’appelaient Sancho de Tovar et Alonso de Zamora. Ils sont les héros peu glorieux d’une aventure qui se place au début de la campagne. À une journée de marche de leur cantonnement, au-delà du Lot, se trouvaient les terres de Mathurin de Cardaillac, seigneur de Montbrun, qui disposait de quelques hommes d’armes à la solde du roi, et à ce titre était considéré comme gardien de la frontière du Quercy. Rappelons-nous, les « Rodrigais » et lui se vouaient une haine réciproque. Ils avaient fait connaissance à Albi où le seigneur de Montbrun était chargé d’assurer la défense et la neutralité du palais de la Berbie. Aux termes des combats, appuyés par les habitants de la ville épiscopale, on se souvient que les « Rodrigais » l’avaient chassé de cette forteresse. 5
Georges DAUMET, Études sur l’alliance de la France et de la Castille aux XIVe et XVe siècles, E. bouillon, Paris, 1898, p. 83.
259
D’autres griefs sans doute s’ajoutèrent à celui-ci si bien qu’une bande, conduite par Alonso de Zamora, se jeta un jour sur la terre de Cardaillac, mit le feu à un village qui en dépendait, et ne se retira qu’après avoir fait beaucoup de butin et de prisonniers. Le seigneur de Montbrun fut pris d’une violente colère. Il se rendit sur-le-champ à la Capelle pour se plaindre et demander la restitution des hommes et des objets volés. Il s’adressa à Sancho de Tovar, parent du comte de Ribadeo, qui commandait l’unité au sein de laquelle avait agi Zamora. Ce capitaine reçut le plaignant, mais daignant à peine l’écouter, il lui déclara que les prises de guerre ne se rendaient que pour de l’argent. Cardaillac se retira fou de rage, et promit que l’heure de la vengeance viendrait. Elle ne tarda pas en effet. Les mêmes maraudeurs, guettés à leur tour, furent pris à quelque temps de là dans une embuscade où ils perdirent, avec chevaux et bagages, les uns la vie, les autres la liberté. Le seigneur Alonso, capturé dans cette rencontre, se vit mener pieds et poings liés au château de Cardaillac. La chance était cependant avec lui, à la faveur d’une pause, il réussit à s’évader, trop heureux d’en être quitte pour la perte de son équipement qu’il n’alla jamais réclamer au gentilhomme quercinois. Il fallait, on s’en doute, des exploits plus méritoires que ceux-là pour valoir aux « Rodrigais » le pardon qu’ils étaient venus chercher en Guyenne. Le comte de Ribadeo s’en chargea par une suite d’opérations heureuses, dont la première fut de prendre Lavercantière. Un partisan redoutable, qui se faisait appeler « le Baron », l’occupait depuis des années avec la connivence du comte d’Armagnac. Ce dernier continuait avec lui le double jeu dans lequel avait servi autrefois André de Ribes6. « Le baron » n’eut pas le loisir de résister, il fut éliminé. Puis, le comte de Ribadeo se rendit dans les environs de Puy-L’évêque, avant-poste formidable pour fondre sur Fumel. Cette ville située sur la rive droite du Lot, avec une grosse tour qui lui faisait face de l’autre côté de la rivière, était alors une place très forte, la première à l’entrée de l’Agenais quand on venait du Quercy. Rodrigue profita d’une faute de surveillance pour l’enlever et lorsqu’il en fut maître, il ne laissa plus de repos aux capitaines du parti anglais. Il les
6
Du FRESNE de BEAUCOURT G., Chronique de Mathieu d’Escouchy, Nouvelle édition, Libraire Jules Renouard, Paris, 1864, tome III, p. 141.
260
poursuivit partout, sur les champs de bataille ou les assiégea dans les châteaux. Par la prise d’Eymet et d’Issigeac, il mit un pied dans le Périgord. La conquête de Tonneins lui ayant livré l’un des passages de la Garonne, il remplit alors de terreur les trois diocèses de Périgueux, d’Agen et de Bazas. Cette attitude énergique favorisa singulièrement l’exécution du plan de campagne qui s’élaborait depuis plusieurs mois. L’espoir d’une victoire prochaine avait encouragé les partisans de Charles VII, tandis que chez l’adversaire n’apparaissaient que des signes de lassitude et de découragement. Les États du Languedoc votèrent avec allégresse les subsides qui leur furent demandés pour porter la guerre en Guyenne. Rodrigue, entré en grâce avec promesse d’être bientôt rétabli dans la dignité de conseiller et chambellan7 reçut la mission de pousser plus avant pour conquérir le Bordelais et sa région. Dans le même temps, Poton de Xaintrailles, à la tête d’un autre corps d’armée recruté parmi les écorcheurs, traversait la France à marche forcée pour prendre à revers le pays de Gascogne. Le sire d’Albret fut investi des pouvoirs de lieutenant-général. Charles VII lui donna ce titre non pas pour diriger les opérations militaires, mais pour le représenter dans les traités à conclure, et dans toutes les mesures à prendre pour l’administration des pays conquis. Un fort sentiment anti-français Pourtant, les choses ne se déroulèrent pas aussi facilement face à la population. Encore une fois, soulignons que l’esprit de nation était absent des pensées de l’époque. Au cœur du long désordre de la guerre, on constate seulement que toutes les forces sont en concurrence. Ce qui compte le plus, en dehors du sentiment d’appartenance à la chrétienté, ce sont les liens que détermine le domicile. Le sol l’emporte donc sur l’origine. Le sentiment, l’idée même de nation n’existent pas. Les habitants font allégeance au seigneur qui est censé leur procurer sûreté et prospérité. Le peuple de Guyenne et de Gascogne ne supportait donc pas sans maugréer les allées et venues de ces gens de guerre qui, sous l’éternel prétexte de reconquête, venaient les rançonner. Les populations de ces contrées 7
Ibid. Dom VAISSETTE, Histoire du Languedoc, I. V, p. 489.
261
qui avaient réussi à accéder à une certaine prospérité commerciale au cours de deux siècles de présence anglaise étaient depuis longtemps acquises à leur cause. Voir débouler des hordes de combattants mettant à mal l’équilibre établi n’était pas fait pour les rassurer. Aussi ne faut-il pas s’étonner si le mouvement majoritaire fut anti-français. Les Anglais, par leur gouvernement régulier et ordonné, avaient donné à la Guyenne et aux contrées voisines une paix et une prospérité qu’elles furent bien longues à recouvrer après la reconquête française. Jamais, semble-t-il, les armées anglaises ne s’étaient comportées, dans ces pays conquis, comme le firent les soudoyés de Charles VII qui venaient soi-disant œuvrer à leur délivrance. Il existait par ailleurs d’étroites relations entre le Béarn et la Guyenne. Pour les habitants de ces contrées, il y avait une question capitale : le maintien des relations amicales avec les Anglais. Or, ce maintien devenait chaque jour plus précaire en raison de l’état d’hostilité qui allait s’aggravant entre l’Angleterre et le comte de Foix, représentant du roi de France. Celui-ci sut résoudre la difficulté. Il s’attacha particulièrement à ne jamais compromettre les intérêts de ses sujets, et grâce à lui, pendant les dernières années de la domination anglaise dans le sud-ouest de la France, le Béarn put conserver avec l’Angleterre ses vieilles et excellentes relations. Les rapports commerciaux étaient si fréquents, si nécessaires à la prospérité des deux pays, que dans les temps des troubles continuels du XVe siècle, leur intérêt commun était de les rendre plus étroits encore par des traités souvent renouvelés8. Dans un tel contexte, il semble donc bien naturel que les habitants du Médoc aient fait cause commune avec les Anglais et chassé les gens de guerre français, qui s’étaient abattus sur leur province comme une bande d’oiseaux de proie.9 La rencontre avec Huntingdon La campagne qui avait commencé au mois de mai 1438 sous les plus heureux hospices continua sa progression, sans véritable opposition. Rodrigue sans se dessaisir de Fumel, où il laissa une garnison, réduisit tout en son pouvoir jusqu’à la Garonne qu’il 8
Henri COURTEAULT, Gaston IV Comte de Foix, Vicomte du Béarn, Prince de Navarre, Privat, Toulouse 1895, p. 45. 9 Ibid. Maurice MAINDRON, Récits du temps passé, Tours, 1924, p. 213.
262
traversa victorieusement. Aussitôt, le Bordelais fut parcouru dans toute sa longueur. Le Médoc, mis hors d’état de se défendre après la prise de Blanquefort et de Castelnau, fut ravagé jusqu’à la pointe de Grave.10 Il semble cependant qu’il n’y eut de résistance nulle part. Un des meilleurs capitaines de l’Angleterre, le comte d’Huntingdon qui tint la campagne, ne trouva jamais l’occasion propice pour se mesurer avec les Rodriguais. Il tentait de les harceler de loin, car sa troupe étant en nombre insuffisant face à l’imposante coalition du comte de Ribadeo, il jugeait plus à propos de ne pas engager le combat. Hernando del Pulgar a fait de l’une de ces approches un récit que l’on croirait emprunté à un roman de chevalerie. Voici ce qu’il écrit : Rodrigue étant dans la province de Guyenne, il lui advint de se trouver un jour sur le point de combattre avec un grand capitaine d’Angleterre, qui s’appelait Talbot11. Le capitaine anglais, qui savait par ouï-dire les prouesses de ce chevalier, eut envie de connaître aussi sa personne, pour savoir ce que semblait un homme qui, de si petit état, s’était élevé si haut en fortune. Ils convinrent donc tous deux, par leurs poursuivants, qu’ils s’aventureraient en vue de leurs osts retranchés en bon ordre de bataille, et qu’ils se parleraient seul à seul sur le bord d’une rivière appelée Leyre. Et quand ils furent en présence, le capitaine Talbot dit : - « Je désirais voir ta personne, et puisqu’à présent nous avons fait connaissance, qu’il te plaise pendant que nous nous trouvons ensemble de manger et de boire un trait de vin par-dessus ; et après sera la bataille au plaisir de Dieu et à l’aide de Monsieur SaintGeorges ». Mais le capitaine Rodrigue lui répondit : - « Si c’est là tout ce que tu as à me demander, ma volonté est de ne rien faire ; car, si nous devons en venir aux mains, je n’aurais plus 10
Ibid. QUICHERAT, note 1, p. 157, qui cite Monstrelet à propos de l’enquête pour la canonisation de Peyre Berland, archevêque de Bordeaux : « Fuit magna caristia et devastatio in patria et diocesi bordeglensi per gentes annorum, et specialiter par quandum capitaneum vocatum Rodericum de Vinhandando, cum magno et feroci exercitu ; qui applicuit ad partes burdegalenses quas crudeliter desvastavit et specialiter terram de Esperra et patriam de Medulco, sic et taliter quod gentes peribant fame ». 11 Hernando del Pulgar commet la même erreur que nous avons signalée au début de ce chapitre. Il s’agit du capitaine Huntington.
263
la fureur qui convient avoir en bataille, ni mon épée ne frapperait assez fort sur les tiens, s’il me souvenait d’avoir partagé le pain avec toi. Et en disant ces mots, il tourna bride et alla se remettre en ordre avec sa compagnie. Le capitaine Huntingdon, quoiqu’il fût un chevalier accompli, conçut telle opinion de ces paroles que, à cause d’elles, comme aussi parce que sa position en ce lieu n’était pas la meilleure, il résolut de ne pas combattre. Offrir à boire à l’ennemi, avant de combattre, était une coutume anglaise qui fut maintes fois observée sur les champs de bataille. Quant au lieu où doit être placée l’entrevue de deux capitaines, il faut le chercher sur la petite rivière qui va se jeter dans le bassin d’Arcachon après avoir traversé les landes bordelaises. C’est un petit cours d’eau qui porte le nom de Leyre.12 La tentative sur Bordeaux Cependant, la Gascogne était menacée sur toute l’étendue de ses côtes par la flotte castillane et elle était fort occupée à défendre ses ports, grands et petits. Le 11 juillet 1438, le gouvernement anglais fit défense aux habitants de Biarritz, de Capbreton et de Saint-Jean-deLuz, de conclure une quelconque trêve avec les Castillans sans l’autorisation du gouverneur de Bayonne. La région subit avec encore moins de résistance que la Guyenne l’assaut des routiers. Poton de Xaintrailles et le sire d’Albret entrèrent par la frontière du Béarn, en provoquant d’énormes ravages et en s’emparant de toutes les « bonnes forteresses » situées à proximité des grandes villes. Ils traversèrent ainsi le pays dans toute sa longueur, pressés d’atteindre le Bordelais, car ils avaient rendez-vous avec le comte de Ribadeo, afin de tenter ensemble le coup décisif de cette campagne : la prise de Bordeaux ! Lorsqu’ils eurent réalisé leur jonction, ils s’emparèrent sans beaucoup de peine de la paroisse de Saint-Seurin qui, dans ce tempslà, était un faubourg situé seulement à cinq cents mètres de la ville. Mais ce succès alerta l’ennemi qui se tint sur le qui-vive et rendit vaine toute tentative d’escalade ou d’attaque surprise. C’était là 12
Et non la Loire ou encore le Lot, comme l’ont écrit certains auteurs.
264
pourtant la seule possibilité de mettre Bordeaux en échec. L’armée qui avait joué la carte de la mobilité et de la rapidité des mouvements n’avait ni canons ni matériel nécessaire pour aborder un siège dans les règles. Et il faut bien avouer que le blocus qui avait provoqué la capitulation d’Albi perdait son efficacité avec l’ouverture de la Garonne. Le ravitaillement des assiégés ne posait aucun problème, tant qu’une force navale n’aurait pas engagé de blocus maritime. Mais ce cas de figure n’avait pas été prévu dans l’accord franco-castillan. En effet, vu l’étendue de l’estuaire de la Gironde, large comme un bras de mer mordant l’intérieur des terres, il aurait fallu une flotte, voire une armada en capacité de livrer un véritable combat naval contre l’Anglais. Nous étions là sur une autre échelle… Cependant, il apparaît invraisemblable que des hommes de guerre aussi expérimentés que Xaintrailles et Rodrigue se soient engagés si loin en amont pour mener une attaque frontale sur Bordeaux. Manifestement, ils devaient avoir reçu des assurances quant au soutien humain et logistique pour mener à bien cette grande entreprise. Sans doute, leur avait-on promis de leur envoyer des munitions et de l’artillerie, qui n’arrivèrent pas. Voilà pourquoi ils n’eurent rien de mieux à faire qu’à convertir le faubourg Saint-Seurin en un camp de base à partir duquel ils pourraient lancer des manœuvres dévastatrices. Des détachements allaient dans toutes les directions ravager les rares lieux où il restait encore quelque chose à prendre. On relate une expédition qui fut poussée jusqu’à l’Adour par le comte de Ribadeo lui-même. Un acte du roi d’Angleterre, daté du 11 juillet 1438, reconnaît les charges supportées par les habitants de Bayonne, afin de résister à l’ennemi nommé Rodrigo. Ce sacrifice est représenté comme d’autant plus méritoire, que dans le même temps, la ville faisait assiéger les forteresses d’Arien et de Gamarthe dans le piémont pyrénéen, et qu’elle entretenait six cents hommes d’armes sur ses vaisseaux pour tenir tête à l’escadre castillane. Les fortifications de Bordeaux, du côté des champs, étaient percées de huit portes, précédées chacune d’une barbacane entre deux ponts-levis. Trois de ces portes s’ouvraient sur l’extérieur dans la direction de Saint-Seurin. Du haut des tours dont elles étaient flanquées, les Anglais plongeaient le regard sur les positions ennemies qui usaient de tous les artifices pour rendre la vue impénétrable dans leurs retranchements. De part et d’autre, on redoublait de vigilance 265
pour ne pas se faire surprendre, et tandis que les uns multipliaient les sorties, les autres affichaient la ferme résolution de se tenir enfermés. L’obsession constante des assiégeants fut d’imaginer des stratagèmes, de lancer de fausses attaques ou encore des manœuvres de diversion afin d’attirer les Anglais dans la campagne. Ils y réussirent une fois, avec un succès dont ils purent se réjouir comme d’une victoire en bataille rangée. Ayant avisé combien les vignes qui entouraient la ville étaient hautes et commodes pour se cacher, ils y envoyèrent pendant la nuit un fort parti de leurs gens. Le lendemain matin, le reste des bandes sortit de Saint-Seurin et feignit de battre en retraite dans la direction de l’embuscade. Alors, les Anglais de se précipiter hors de Bordeaux par toutes les portes et de disputer vitesse entre eux à qui enfoncerait le premier l’arrière-garde ennemie. Mais, au lieu de chasser, ils furent chassés eux-mêmes ; car à un signal convenu, les traits commencèrent à pleuvoir sur eux, en même temps que les censés fuyards, recevant dans leur rang ceux de l’embuscade, firent volteface et repoussèrent les Anglais jusque dans leurs redoutes. Ceux-ci rentrèrent huit cents de moins qu’ils n’étaient sortis.13 Néanmoins, les Anglais restèrent les maîtres incontestés de la capitale bordelaise. Les semaines s’écoulèrent sans que l’armée royale ne perçoive la moindre solde. Charles VII se heurtait à l’éternel problème du recours aux finances et les compagnies, pour survivre, durent user d’expédients que l’on connaît très bien. De plus, l’année courante 1438 et celle d’avant avaient été très mauvaises. Quand vint le milieu de l’été, la disette fut universelle. Bordeaux en souffrit beaucoup : on y consommait plus de millet que de blé, sous forme de bouillie ou de farine, mais celle-ci devenant rapidement rance était quasiment impropre à la consommation. Les Français eux-mêmes, malgré l’étendue des contrées qu’ils balayaient en tous sens, virent fondre leurs approvisionnements. Pour rajouter à cet embarras, une nouvelle compagnie de routiers amenée sur le Bordelais vint augmenter le nombre de bouches. Rodrigue, en quittant la Bourgogne, s’était séparé du bâtard de Bourbon. Celui-ci, toujours sous le coup de la colère royale, avait gagné le Languedoc. Plusieurs petites bandes insoumises, qui n’avaient jamais été atteintes par la sentence de bannissement naguère 13
Ibid. MONSTRELET d’ARCQ, Chroniques, 1861, tome II, chap. CCXXXVIII.
266
édictée contre les Rodrigais, erraient dans la province. Leurs capitaines firent alliance avec le bâtard de Bourbon, et ensemble ils établirent leur base dans le bourg de Sainte-Gabelle. De là, ils exercèrent des raids dans le voisinage de Toulouse et vécurent pendant plusieurs mois aux dépens de la ville rose.14 Plus tard, ils acceptèrent de se retirer, moyennant un patis avantageux dont dut s’acquitter la grande cité languedocienne. L’une des conditions du traité était qu’ils iraient rejoindre l’armée de Guyenne. Par ordre du Roi, Poton de Xaintrailles vint exprès à Toulouse pour les emmener et veiller à ce qu’ils suivent leur chemin sans s’écarter. Dans un mémoire adressé par la noblesse de Guyenne au gouvernement anglais, on porte à quatorze mille chevaux la force qui se trouva réunie, après leur jonction, sous l’étendard du roi de France. Une cavalerie aussi imposante ne pouvait être nourrie longtemps par un territoire déjà affamé. En effet, la nécessité de se séparer pour aller chercher leur survie ailleurs s’imposa bientôt aux capitaines. Ils en prirent à regret leur parti. Le sire d’Albret, en vertu de ses pouvoirs et avec le concours des garnisons qui furent laissées dans les places qu’elles occupaient, se chargea de garder ce qu’on avait fait de conquêtes. Rodrigue, Poton de Xaintrailles, le bâtard de Bourbon et les autres, se mirent en devoir de quitter le pays. Ils s’éloignèrent, ne pouvant pas douter du résultat qu’entraînerait leur retraite. Il était trop évident qu’avec Bordeaux pour point d’appui les Anglais reprendraient le dessus, dès qu’ils pourraient envoyer de nouvelles troupes en Guyenne. C’est ce qui arriva effectivement l’année suivante. De toutes les places conquises, on ne conserva que Tartas, au bord des landes de Gascogne. Que de morts d’hommes, de violences commises et de souffrances infligées pour peu de profit ! Quel argument de plus pour les mécontents qui imputaient au gouvernement le dessein d’éterniser la guerre afin de procurer de l’occupation aux gens d’armes ! Il semble regrettable pour l’histoire que Charles VII n’ait pas mieux secondé des armées qui, avec quelques ressources de plus, lui auraient gagné la 14
VERMS Miguel (del), Chroniques béarnaises, dans le Panthéon littéraire, volume intitulé Chroniques et mémoires sur l’histoire de France au quatorzième siècle, Paris, 1811, p. 596.
267
province entière. Mais il ne put ou ne voulut pas envoyer ses chevaliers et son artillerie absorbés par la conquête de l’Île-de-France qu’il venait de recouvrer avec peine. Les subsides qu’il accorda pour les frais de cette guerre se bornèrent aux seules sommes votées par les états provinciaux du Midi, soit à titre de patis, soit comme allocations spéciales, sans veiller en aucune manière à la célérité des recouvrements. Le résultat de tout cela fut que les capitaines ne touchèrent l’argent qui leur était destiné qu’après clôture de la campagne. À l’opposé, le gouvernement anglais procura aux cités de l’Aquitaine de nombreux avantages pour les engager à la résistance. Ainsi, Bordeaux et Bayonne, revenues de leur première surprise, furent en mesure d’accroître leurs forces au moment où les Français diminuaient les leurs en raison du grand nombre de garnisons qu’ils devaient entretenir. Enfin vint le moment où le Médoc, complètement dévasté, n’offrit plus de quoi vivre à ses conquérants. Il fallut repasser la Garonne et laisser les corps d’occupation gouverner comme ils pouvaient dans les châteaux conquis. Pour couronner le tout, le comte d’Huntington eut le temps de venir d’Angleterre avec quinze mille hommes et purger ainsi le pays de toute présence ennemie. Quel gâchis pour tous ceux qui s’étaient investis dans la conquête de Guyenne ! C’est ainsi que par la mauvaise administration de ce temps-là, une guerre commencée admirablement finit par n’être plus qu’une course d’aventuriers. Mais, pour avoir poussé son avancée jusqu’aux portes de Bordeaux, le comte de Ribadeo n’en resta pas moins couvert de gloire.15 En marge de cette guerre : la rançon du baron d’Heinsberg Malheur à celui qui croise la route de Rodrigue ! Il nous faut ouvrir ici une parenthèse dans cette guerre pour souligner que notre capitaine ne manquait jamais une occasion de tirer profit de toutes les situations. Quand bien même étaient-elles dues au plus pur des hasards. C’est dans cette campagne que Rodrigue captura le baron d’Heinsberg, propriétaire du redoutable château d’Ehrenbreitstein qui surplombe du haut d’une imposante falaise la confluence du Rhin avec la Moselle. Ce seigneur était en route pour effectuer un pèlerinage à Compostelle pendant qu’on se battait sur la frontière franco15
Ibid. QUICHERAT, 1845, p. 50.
268
espagnole. On l’arrêta comme sujet d’une puissance alliée de l’Angleterre. Conduit à Burgos, il fut jeté en prison jusqu’à ce que sa famille négocie un échange de prisonniers avec des marchands castillans arrêtés dans le Saint-Empire. Sa mauvaise fortune voulut qu’à peine libéré, la route par laquelle il entra dans le royaume de France fût occupée par des Rodrigais. Voilà une liberté à peine gagnée et déjà perdue. Nouvelle prison, nouvelle rançon. Mais cette fois, il eut affaire à un maître qui n’acceptait pas les paiements sans valeur numéraire. Il n’obtint sa liberté qu’en échange d’une grosse somme de florins du Rhin, en bonnes pièces sonnantes et trébuchantes.
269
L’ATTAQUE DU ROUSSILLON novembre 1438 À l’époque où Rodrigue s’illustrait dans le royaume de France, la couronne d’Aragon était devenue une puissance maritime de premier plan qui contrôlait la majeure partie du bassin méditerranéen. Elle dominait le nord-est de la péninsule ibérique, le sud de l’Italie actuelle, ainsi que certains territoires à travers la Méditerranée, jusqu’en Grèce. Pour en saisir tous les enjeux géopolitiques, résumons rapidement son histoire. La couronne d’Aragon fut établie en 1137, lorsque ce royaume et le comté de Barcelone unifièrent leurs dynasties. Cette nouvelle force contrôla rapidement les mers en annexant le royaume de Sicile. Mais en 1282, le conflit dit des « vêpres siciliennes » déboucha sur une partition du territoire. Le roi Charles d’Anjou, frère de Saint Louis, fut chassé de Sicile par les armées de Pierre III d’Aragon, ne parvenant à maintenir son autorité que sur la partie sud de la botte italienne. Le royaume de Naples était né de cette scission et fut à nouveau le fruit de multiples affrontements entre Angevins et Aragonais. Les deux protagonistes s’en emparèrent tour à tour. Dès 1412, le royaume de Sicile fut annexé au royaume d’Aragon. À l’époque de Rodrigue, deux souverains en assurèrent la gouvernance : Ferdinand Ier (1412-1416), puis son fils Alphonse V, dit « le Magnanime » (1416-1458). En 1423, un évènement met le feu aux poudres entre la Castille et l’Aragon. Alphonse V, alors en guerre contre Louis III d’Anjou, est appelé précipitamment dans son royaume. A l’origine, une simple affaire de famille : pendant que le roi d’Aragon était à Naples, son frère, le prince Henri épouse secrètement la propre sœur du roi de Castille. Celui-ci, mis devant le fait accompli, entre alors dans une colère folle et fait arrêter puis emprisonner le prince indélicat. Alphonse d’Aragon décide de se porter au secours de son frère. Mais il n’y a pas de retour inutile ! Au passage, c’est l’occasion inespérée de piller Marseille, alors sous la domination de ses ennemis angevins. 271
Il s’embarque le deuxième jour d’octobre, à la tête d’une puissante flotte composée de dix-huit galères et de douze vaisseaux de charge. Au mois de novembre, après avoir essuyé plusieurs tempêtes, ses navires longent la côte sud de la Provence. Il sait que la ville n’est pas sur ses gardes, et que le duc d’Anjou en a dégarni la défense en mobilisant les soldats les plus expérimentés pour la guerre de Naples. Il décide de la surprendre. La chaîne du port est rompue malgré la résistance de quelques Marseillais. Aussitôt, les galères d’Alphonse s’y engouffrent. C’est le milieu d’une nuit sans lune. Les soldats débarquent. Surpris dans leur sommeil, les Phocéens tentent de se défendre avec plus de courage que d’ordre. Mais déjà, le feu dévore les maisons voisines du port. Les flammes poussées par la violence du vent gagnent en peu de temps une grande partie de la ville. Dès lors, quatre mille maisons, pour la plupart couvertes de bois, sont réduites en cendres. Alphonse resta trois jours seulement à Marseille. Il n’y laissa aucune garnison parce qu’il craignait d’avoir besoin de toutes ses troupes pour son expédition en Castille. Arrivé dans son royaume, Alphonse tenta de conclure un traité avec Juan, mais celui-ci refusa tout arrangement. Voilà réunis tous les ingrédients d’une guerre. Alphonse entra avec son armée en Castille. Effrayé, Juan II rendit la liberté au prince Henri par un traité conclu le 3 septembre 1424.1 En 1435, un second évènement allait rallumer le conflit : voilà que le 2 février, une cousine de la maison d’Anjou, la reine de Naples Jeanne II, vint à mourir à l’âge de soixante-cinq ans. Elle léguait son royaume à son cousin René d’Anjou avec le titre pompeux de « roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem » ! Cette succession est aussitôt disputée par les différentes lignées européennes. Le royaume de Naples, faut-il le préciser, est à l'époque l'un des plus prospères d'Europe et sa capitale est une métropole culturelle riche et enviée. Dès lors, Aragonais et Angevins vont se disputer la couronne napolitaine. Le « bon roi René » s'épuise pendant trois ans pour tenter de s'imposer à Naples où il s'est installé dès 1438. Mais les choses prennent une mauvaise tournure. Battu en 1442, René 1
Mr de BURIGNY, Histoire générale de Sicile, Isaac Beauregard/Pierre Gosse, La Haye, 1745, Tome II, Livre X, pp. 309-310.
272
Ier retourne en France sans pour autant renoncer officiellement à son titre royal, ne gardant du royaume de Naples que le titre de Roi de Jérusalem et de Sicile. Alphonse V réunit dès lors ses royaumes de Naples et de Sicile sous le nom de « royaume des Deux-Siciles ». Ce nom quelque peu bizarre perdurera jusqu'au XIXe siècle. Rodrigue : un rôle caché dans le conflit ? Mais, revenons à Rodrigue… En apparence minime, le rôle qu’il joua dans ce conflit n’est pourtant pas négligeable sur l’échiquier politique international. Le Castillan a été manifestement appelé afin de peser de tout le poids de son armée et de sa réputation, dans le confit qui opposait René d’Anjou à Alphonse d’Aragon. Alors pour quelle raison Rodrigue intervient-il en marge de cette affaire ? Est-ce à la demande de René d’Anjou ? Cela a été avancé par plusieurs auteurs, dont Zurita2, mais nous n’avons aucune assurance quant à cette hypothèse. Celui-ci rapporte pourtant que l’instigateur de cette course lointaine aurait bien été René d’Anjou. Assailli dans la péninsule italienne par l’armée d’Alphonse le « Magnanime », « le bon roi René » se voyait menacé dans la possession du trône de Naples. Il aurait cherché à éloigner son rival en lui suscitant des embarras en Aragon. Mais comment René, ou ceux qui œuvraient pour sa politique, auraient-ils pu espérer qu’une simple irruption de routiers soit en mesure de détourner le Magnanime de sa conquête ? Lorsqu’on informa ce souverain de la rumeur publique qui courait en Catalogne, il fit la réponse à laquelle on devait s’attendre, à savoir qu’il ne quitterait point le royaume de Naples pour si peu. En revanche, il apparaît avec certitude que Rodrigue intervint à l’instigation d’Alvaro de Luna. L’engagement supposé de la maison d’Anjou dans cette affaire apparaît alors comme un faux bruit derrière lequel se serait caché le véritable ordonnateur de l’entreprise, le connétable de Castille. Nous l’avons déjà vu complotant dans le même but, dès 1431, lorsque pour infléchir la décision de Rodrigue, il lui fit recouvrer le comté de Ribadeo. Ministre tout-puissant de Juan II, il exerçait les pleins pouvoirs de l’exécutif en lieu et place du monarque. Alvaro de Luna poursuivait depuis quinze ans, au milieu des périls et 2
ZURITA Jerónimo, Anales de la corona de Aragón, Libros postreros de la Historia del Rey Don Hernando el Católico, Impresos en Zaragoza Colegio San Vicente Ferrer, 1610, I. XIII, C. LXXI.
273
au mépris des factions, une politique invariable dont le but était de soustraire la Castille à l’insolence des grands et à l’influence de la Maison d’Aragon. Il croyait avoir réduit pour toujours les partis à l’impuissance et commençait à savourer son triomphe lorsqu’une ligue, dont l’instigateur était justement l’infant d’Aragon, frère du roi Alphonse, se déclara contre lui. Poussé par le danger que faisait courir cette coalition, il appela ses amis à son aide. Le comte de Ribadeo était au nombre de ceux-ci. Il lui envoya pour sa part un secours de trente-six lances sous le commandement de son fils.3 Ce secours de trente-six lances, soit environ deux cents hommes, semble bien maigre pour une telle entreprise. Mais pour le comte de Ribadeo, il était difficile d’en majorer le nombre. En effet, dans cet affrontement qui mettait en présence deux factions rivales, il n’avait le droit de s’immiscer qu’au titre de sujet de Juan II, avec l’aval et l’appui de la Maison militaire de Castille. Il ne lui était pas permis d’agir pour son pays d’origine à la tête d’une armée étrangère à la couronne. Cependant, rien ne l’empêchait, hors du royaume de Castille, de servir Alvaro de Luna par des moyens indirects. Voilà certainement la véritable raison de l’implication du comte de Ribadeo dans l’attaque du petit état catalan. L’attaque du Roussillon Lancer Rodrigue à l’attaque du Roussillon, c’était avancer des pions importants sur l’échiquier politique international. Pour le connétable de Castille, l’affaire apparaissait stratégiquement intéressante, car cette province, rattachée au royaume d’Aragon, était alliée des Anglais et restait un voisin malveillant de la couronne de France.
3
Fernán GOMEZ de CIBDAREAL, Centon epistolario del bachiller, en la Imprenta Real de la Gazeta, Madrid, 1775, p. 79 : « También el llamamiento que el Condestable a fecho de los que llevan su acostamiento, son venidos bien guarnidos e diligentes a punto el fijo del conde de Ribadeo con XXXVI lanzas, el mariscal Gomez Carillo con XXV lanzas… ». Pour notre part, nous avons relevé le nom d’un fils illégitime : Sebastian de Villandrando. S’agit-il de celui-ci ? Voir dans cet ouvrage, Données historiques complémentaires, généalogie de la maison de Villandrando, p. 339.
274
Pour Rodrigue, le contexte avait changé en 1438. Devenu comte de Ribadeo, ayant retrouvé la confiance du roi de France allié de la Castille, il accepta de lancer ses compagnies en direction des riches contrées du Roussillon. En quittant la Guyenne, ses troupes s’écoulèrent par le pays de Marsan pour gagner Condom et les lieux alentour où elles s’arrêtèrent plusieurs jours4. Il y avait là un calcul : évoluer à grande puissance à la marge des terres de France et courir constamment sur la limite du Roussillon, cela constituait une démonstration de force qui allait forcément affoler le royaume d’Aragon. De plus, Charles VII n’était probablement pas mécontent de voir les routiers prendre ce chemin. Dans la crainte de les voir revenir sur ses terres sans combat à leur offrir, il avait décrété la levée d’un subside à répartir entre eux pour les empêcher d’entrer en Languedoc. Les routiers préférèrent donc les opportunités que leur offrait une nouvelle guerre dans des contrées préservées jusqu’alors de la dévastation. Leur bonne fortune voulut que cette perspective s’ouvre des deux côtés à la fois. Dans la permanence du conflit qui les opposait, le comte d’Armagnac et les comtes de Foix étaient aux prises dans le comté de Comminges. Les habitants de ce petit pays s’étaient mis en révolte pour obtenir la délivrance de leur comtesse, séquestrée par Mathieu de Foix, son jeune mari qui ne l’avait épousée que par intérêt. Pour la petite histoire, signalons que Marguerite de Comminges, qui fut emprisonnée pendant vingt ans, avait vingt ans de plus que Mathieu. Quelques mois à peine après la célébration des noces, celui-ci la fit enfermer dans une tour du château de Bramevaque, une vieille bâtisse perdue au bout de chemins torturés dans une vallée lointaine des Hautes-Pyrénées. Ainsi, Mathieu de Foix s’appropria et gouverna seul le comté.
4
Ibid. Miguel del VERMS, Chroniques béarnaises, p. 596. Le passage à Condom est attesté par une note manuscrite du livre des coutumes de la Ville, conçue en ces termes : « Anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo octavo, vengo en aquest pahis Radigo ab gran re de gens d’armas sus la pahis, en la compagnhia deu noble Poton de Santa-Ralha, loqual menaba la ensenha, so ès à dise l’estendart deu rey nostre senhor, en que estan ix jorns esta biela deforas ; e l’estendart demorec aus Predicados, aus despens de la biela ».
275
Le comte d’Armagnac vit là une occasion d’affronter son éternel rival en se rangeant du côté de l’opprimée. Il appela en conséquence les compagnies lorsqu’elles terminaient leur campagne de Guyenne. Il fut si persuasif que les habitants du comté de Comminges laissèrent entrer le loup dans la bergerie en acclamant ces dangereux auxiliaires, sous la promesse de délivrer leur comtesse. Rodrigue et Poton de Xaintrailles pénétrèrent dans la contrée par Montréjeau où le bâtard de Bourbon les avait devancés. Pendant que Xaintrailles s’établit à Samatan, Villandrando alla prendre position à Saint-Julia à l’autre extrémité du pays. Avec les arguments et la détermination qu’on leur connaît, ils chassèrent bientôt les Béarnais de toutes leurs positions, excepté de Muret, de Saint-Lizier et du château de Castillon en Couserans, trois citadelles extrêmement fortes, dont ils s’étaient engagés à ne pas entreprendre le siège.5 Ils envahirent plusieurs places, mettant partout des garnisons, occupant les châteaux qu’ils entendaient garder en gages. Assurés d’un repli éventuel sur ces bases arrière, ils laissèrent le comte d’Armagnac s’arranger du reste, et continuèrent leur route le long des Pyrénées s’avançant toujours plus à l’est. La seconde partie de leur mission les appelait en Roussillon. C’était bien là le véritable but de leur voyage. La conquête du Comminges était purement anecdotique. Rodrigue était en réalité bien décidé à « entamer » la frontière aragonaise. En s’éloignant du pays de Comminges, le Castillan et ses deux associés entrèrent sur les terres du roi. Charles VII était resté leur débiteur en raison de la campagne de Guyenne, qu’il n’avait toujours pas soldée. Alors, les routiers trouvèrent légitime en passant de se payer des arrérages royaux sur les populations. Au point de convergence du Toulousain, du Comminges et du Carcassonnais, il existait au cœur d’une enceinte fortifiée le château de la Pomarède. Avant que ses troupes ne repassent la Garonne, Rodrigue y avait envoyé une avant-garde sous la conduite d’un de ses lieutenants. Une mauvaise surprise attendait ce détachement, il fut mis en déroute par les seigneurs du pays. Ce fut là, pour le comte de Ribadeo, un prétexte de plus pour mettre la sénéchaussée de Carcassonne à contribution.
5
Ibid. Miguel del VERMS, Chroniques béarnaises, p. 596.
276
Continuant sa progression à la tête de mille chevaux, Rodrigue s’empara d’Alzonne. Cette ville, située à trois lieues de Carcassonne, fut sa place d’armes et le centre de ses opérations pendant dix-sept jours.
-19 L’église de Saint-Pierre de Castillon-en-Couserans, datée des Xe et XIe siècles, fut la chapelle de l’ancien château des comtes de Comminges. Photo N. Bourg.
Les milices de Carcassonne et des autres villes du pays tentèrent sans résultat de l’assiéger. Toutefois, la résistance locale s’organisa, le nombre des milices fut renforcé par un apport non négligeable de troupes aux ordres d’une coalition nobiliaire qui craignait pour ses propres intérêts. Alors, face à la difficulté qu’il y aurait à sauvegarder le butin s’il fallait un jour rompre leurs lignes, les routiers décidèrent de vider les lieux pendant la nuit afin d’aller chercher une retraite plus sûre.6 Charles VII, informé, envoya à ses agents les instructions les plus pressantes pour obtenir que la province du Languedoc se résigne à un nouveau sacrifice financier. « Payer » était le moyen le plus efficace 6
Ibid. BOUGES, Histoire de la ville et diocèse de Carcassonne, 1761, p. 275.
277
pour mettre à la raison ces créanciers implacables. Une aide supplémentaire fut octroyée en effet, à Carcassonne même, on ne sait trop par quelle formalité7, mais certainement sous la menace du comte de Ribadeo, qui ne continua sa route que lorsqu’il fut satisfait. Malheureusement, son éloignement n’apporta pas la délivrance souhaitée, car son fidèle lieutenant Salazar, en compagnie d’un autre capitaine qu’on appelait le bâtard de Béarn, élut domicile pour plusieurs mois dans les montagnes du Lauragais. De là, ils opérèrent des raids dévastateurs, tantôt à Carcassonne, tantôt à Limoux.8 Il semble curieux de constater que cette expédition du Roussillon, entamée sous de grands auspices, revêt au final l’aspect d’une simple course de routiers. La renommée des capitaines, ces remarquables stratèges que l’on a vus s’impliquer avec succès dans les plus grandes batailles, les enjeux politiques forts entre les royaumes de Castille et d’Aragon, soulignent à l’évidence qu’il s’agissait là d’une simple diversion orchestrée par le connétable de Castille. À aucun moment, l’engagement ne semble avoir été à la hauteur des enjeux. A l’appui de ceci, citons Zurita : Le corps principal des routiers, toujours commandé par Rodrigue, par Xaintrailles et par le bâtard de Bourbon, opéra enfin son entrée dans le Roussillon à la fin du mois de novembre 1438. Ils arrivèrent au galop jusqu’à quatre lieues de Perpignan. Ils tentèrent sans succès de prendre une petite place par escalade. Contraints de se replier vers la forteresse de Salces, ils subirent un deuxième échec. Alors, il leur devint si difficile de s’assurer d’aucune ville fermée ou forteresse, qu’ils y renoncèrent. Ils prirent leurs quartiers d’hiver à proximité des frontières du pays, dans l’intention fut-il dit, de recommencer leur attaque et même d’entamer la Catalogne, dès que le printemps serait venu.9 Le but recherché avait été atteint. L’effet produit par cette incursion inattendue dans un pays de la couronne aragonaise eut d’énormes répercussions. La France tout entière se serait avancée contre les Pyrénées que l’émotion n’eût pas été plus grande, nous dit Quicherat. La reine d’Aragon était à Barcelone. Elle fit appel à tous les Catalans pour effectuer une levée en masse. Le roi de Navarre, frère du roi d’Aragon, fut sollicité pour venir en toute hâte à Saragosse 7
Ibid. Dom VAISSETTE, tome IV, p. 490. Ibid. BOUGES, Histoire de la ville et diocèse de Carcassonne, 1761, p. 46. 9 Ibid. ZURITA, Anales de Aragón, 1610, XIII. C. LI. 8
278
et y convoquer les Cortes. Il prit en attendant les mesures militaires jugées nécessaires au salut du royaume de son frère. Les Cortes se réunirent au mois de février 1439. Mais délibérations et armements devinrent bientôt inutiles parce que l’ennemi avait disparu. Il avait tout bonnement délogé sans avoir rien tenté. On s’était attendu au pire et rien n’était arrivé. Pour le comte de Ribadeo, la campagne aurait été bien médiocre, si elle n’avait été entreprise que pour le butin. Mais on avait voulu faire une diversion utile au connétable de Castille et on avait parfaitement réussi. L’infant don Enrique avait quitté la Castille pour se rendre en toute hâte à la défense de l’Aragon, rappelé par un ordre que le roi Alphonse lui envoya de Gaète.
279
Deuxième partie L’EPOPEE ESPAGNOLE
LES RAISONS D’UNE MISSION SANS RETOUR Le temps du retour vers sa mère patrie était arrivé. La situation administrative du royaume de France était en pleine évolution. Rodrigue le savait, il allait devoir s’adapter. Il faut dire que Charles VII s’affirmait de plus en plus, quittant son trône de simple suzerain pour s’asseoir sur celui d’un souverain de droit divin et absolu. En effet, le roi de France tentait depuis peu d’imposer une ordonnance dont il poursuivait l’application avec la plus grande vigueur. Dès 1438, il avait rendu un premier texte portant sur des clameurs et complaintes qui lui arrivaient de tous côtés au sujet des griefs, maux et dommages causés par les gens de guerre dans les environs de la capitale. Un an après, le 2 novembre 1439, lors de l’assemblée des trois États réunie à Orléans, à laquelle assistaient Charles de Bourbon et les grands du royaume, une nouvelle ordonnance précisa encore les intentions de Charles VII. Le roi, disait-elle, ayant égard à la pauvreté, oppression et destruction de son peuple, ne voulait pas tolérer plus longtemps de pareils excès. En conséquence, il décida qu’à l’avenir nul ne pourrait lever une compagnie sans son consentement formel et que tous les capitaines seraient soumis à sa propre nomination. En même temps, il défendit aux gens de guerre de rançonner les laboureurs et les marchands, de s’emparer des bestiaux, des blés ou autres marchandises, de mettre le feu aux gerbes ou aux maisons, d’aller dans les champs en « estrade »1 pour piller, rober et destrousser les passants et jusque dans leurs maisons. Le roi priva les nobles du droit d’imposer une taille, car la problématique de la création d’une armée permanente et la levée d’un impôt central étaient étroitement liées. L’article 36 enjoignait les seigneurs de restituer les forteresses, églises et châteaux dont ils s’étaient emparés et à partir desquels ils exécutaient des coups de main en toute impunité. Il leur était également ordonné de supprimer un grand nombre de péages qu’ils avaient établis pour leur propre 1
Du mot Estradiot, sorte de cavalerie légère chargée de battre l’estrade, Dictionnaire Godefroy, Ancien français, Vol. 3, p. 636.
283
compte au préjudice du commerce. En quoy, disait l’ordonnance, les marchands et le peuple du royaume avoient été moult opprimez et grevez. L’article 41 de cette même ordonnance constate que précédemment, Charles VII avait établi des tailles pour les affecter aux gens de guerre et que cela n’avait jamais été suivi d’effet. Les seigneurs prélevaient leur écot au passage soit en s’attribuant le montant de ces tailles, soit en les augmentant à leur profit. Charles VII proscrivit sévèrement le retour de pareils abus. Enfin, l’ordonnance de 1439 enjoignit aux officiers du parlement, aux baillis, aux sénéchaux et à tous les autres justiciers du royaume d’exécuter strictement la volonté du roi, sous peine d’être privés de leurs offices et de voir leurs biens confisqués2. Le décret résumait par son titre toute l’exigence royale : Lettre de Charles VII pour obvier aux pilleries et vexations de gens de guerre. On s’en doute, le contenu ne fut pas du goût des chefs de guerre et des nobles. L’ordonnance les privait de beaucoup de leurs privilèges et de l’indépendance dont ils jouissaient. Comme cela était prévisible, la noblesse s’agita. Des troubles éclatèrent un peu partout, réunissant contre le roi, son fils le dauphin Louis et la plupart des chefs de guerre qui l’avaient servi jusque-là. Cette révolte, plus connue sous le nom de « Praguerie », en référence à la sédition hussite qui avait agité la capitale de bohème, fut réprimée par Charles VII avec la plus grande énergie. Ces troubles empêchèrent cependant la mise en application immédiate de cette ordonnance. Voilà pourquoi la loi ne fut suivie d’aucun effet. Dans le meilleur des cas, elle n’avait remédié au mal qu’en partie et il fallut attendre six longues années pour que la question soit définitivement résolue. En 1445, Charles VII fit, en effet, adopter la création de quinze compagnies que l’on nomma à cause de leur origine, « Compagnies d’Ordonnance ». Elles étaient commandées chacune par un capitaine nommé par le roi et composées de cent lances. Chaque lance était constituée d’un groupe de six personnes : l’homme d’armes, son page ou valet, trois archers et un « coustelier », c'est-àdire un écuyer armé d’une « coustelle », sorte de long poignard, qu’il portait au côté. Chaque compagnie formait un corps de six cents 2
Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, note 1, p. 186, Ordonnances des rois de France, tome XIII, p. 293 et 306 et Pièce justificative no IV.
284
hommes tous à cheval. On vit bientôt ces unités s’accroître d’un grand nombre de volontaires qui virent dans cette intégration l’unique possibilité de continuer leur activité guerrière. Après avoir réorganisé la cavalerie, Charles VII s’occupa des milices. Au cours des règnes précédents, excepté quelques troupes d’arbalétriers et d’archers, pour la plupart génois, l’infanterie royale n’était, disait-on, composée que de marauds et bellistres, mal armez, mal complexionnez, fénéans, pilleurs et mangeurs de peuples.3 L’effet de cette organisation fut immédiat. « Au bout de quinze jours, disent les chroniqueurs, tous les soldats qui n’avaient pas été désignés pour faire partie des compagnies étaient rentrés dans leurs foyers, et les routes étaient devenues plus sûres qu’elles ne l’avaient été depuis plus d’un siècle ». Parallèlement, l’influence des grands vassaux de la couronne décrut sensiblement. La chevalerie, longtemps toute-puissante à cause des services qu’elle rendait au pouvoir royal, cessa bientôt d’exister.4 Avant de prendre le commandement de leurs compagnies, les capitaines durent prêter ce serment : Je promets et jure à Dieu et à Notre-Dame que je garderai la justice et ne souffrirai aucune pillerie et punirai tous ceux de ma charge que trouverai avoir failli, sans y épargner personne, et ferai faire réparation des plaintes qui viendront à ma connaissance, à mon pouvoir avec la punition des susdits ; et promets de faire faire à mon lieutenant semblable serment que dessus.5 Chaque capitaine devenait en quelque sorte un prévôt, un officier de justice institué par la royauté pour protéger la société. Ainsi structurée, l’autorité militaire était appelée à sauver le royaume du chaos où l’anarchie et la superposition des guerres « privées » l’avaient plongé. En outre, chacune des seize mille paroisses du royaume fut tenue d’avoir un archer toujours prêt à entrer en campagne sur l’injonction du roi. On y avait ajouté le régime de la garnison : chose très importante, plus importante assurément que tout le reste. C’était là le moyen d’exercer un contrôle efficace sur les compagnies, à partir du moment où on allait les tenir à demeure dans des lieux fermés et sous 3
Ibid. Pierre CLEMENT Pierre, Jacques Cœur et Charles VII, 1853, tome 1, chap. IV, 125. 4 Père DANIEL, Histoire de la milice française, Paris, 1773, tome 1, p. 215. 5 Ibid. Père DANIEL, tome I, p. 227.
285
les yeux de beaucoup de témoins. Pourtant, ces mesures salutaires allaient prendre encore beaucoup de temps pour s’affirmer, la difficulté étant de forcer à résidence des hommes qui avaient l’habitude de vagabonder.6 Rodrigue qui avait été longtemps dans les arcanes du pouvoir ne pouvait ignorer les conséquences d’une telle réforme. Son analyse, sa vision, son sens aigu de l’anticipation lui avaient jusque-là permis de triompher de toutes les embûches et de conserver la vie sauve au cours d’une existence mouvementée. Un évènement fortuit hâta cependant sa décision. Aux environs du mois de juin 1439, Rodrigue s’était rendu à Toulouse pour régler quelques affaires. Au moment de son arrivée, notre capitaine était attendu par l’archidiacre de Cuenca, qui venait de la part du roi don Juan II, pour l’emmener en Castille avec tout ce qu’il pourrait réunir de gens d’armes. Cette injonction, donnée dans les termes les plus pressants, ne pouvait comporter ni excuse ni délai, attendu que l’opposition des « Grands de Castille » avait dégénéré en guerre civile, et que dix mille hommes demandaient, la lance au poing, la perte du connétable Alvaro de Luna.7 L’appel de sa terre d’origine fut le plus fort, il jugea que le temps était venu pour lui de franchir à nouveau cette barrière pyrénéenne qui ondulait sur la toile d’horizon et qui semblait l’attirer sans cesse. Nous étions à la mi-juin, car le dernier acte qui témoigne de la présence de Rodrigue est une quittance qu’il donna à Toulouse le neuf de ce mois pour une allocation que les États d’Auvergne lui avaient précédemment accordée8. Rodrigue ne traîna pas, son départ suivit de peu l’intervention de l’archidiacre de Cuenca. Quelques jours après seulement, sa compagnie se mit en route en direction du sud. Son regard se porta au loin sur les montagnes couronnées de brume. Il se sentit attiré vers elles, comme poussé par un appel irrésistible. Vingt-neuf ans s’étaient écoulés depuis son entrée anonyme sur la terre de France, vingt-neuf ans de combats implacables qui avaient décidé de son incroyable ascension sociale. Alors, au moment de franchir les monts, le comte de Ribadeo appelé au secours du roi de 6
Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, p. 186. Fernán PEREZ de GUZMAN, Crónica del señor rey D. Juan segundo de este nombre, Imprenta de Benito Monfort, Valencia, 1779, p. 396. 8 Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, p. 174. 7
286
Castille, s’arrêta un instant sur l’épaulement de la montagne, là où la vue embrassait les deux pays, était assis un prieuré qui lui sembla bâti partie en France, partie en Espagne... Rodrigue trouva cet endroit merveilleux, tout semblait étonnamment paisible… Rodrigue ordonna une pause, puis à la tête de ses quatre mille combattants9 entama la descente sur le revers espagnol pour une mission qu’il savait sans retour. Il venait d’atteindre l’âge de cinquante et un ans, mais sa santé morale, sa constitution physique exceptionnelle en faisaient un homme encore jeune au regard de ses contemporains. Il continuait à chevaucher par monts et par vaux, au gré des combats et de ses affaires, ne redoutant rien et affrontant sans sourcilier les conditions les plus hostiles.
9
C’est le chiffre donné par Fernán Perez de Guzman, p. 396 et par Zurita, I. XIV, c. LVIII.
287
LA REVOLTE DES GRANDS D’ESPAGNE Parlant de Juan II de Castille, le chroniqueur Fernán Pérez de Guzmán écrivit qu’il aimait le latin, la musique, la poésie, la chasse et les joutes, mais que, en ce qui concerne celles qui sont réellement des vertus, qui sont nécessaires à tout homme et surtout aux rois, il en manqua beaucoup, car, ajoute-t-il, alors qu’il possédait toutes les grâces susdites, il ne voulut pas un seul moment entendre et travailler au gouvernement du royaume. Pérez de Guzmán, qui avait connu le roi et son connétable, en arrivait à se demander laquelle de ces deux choses est la plus admirable, la condition du roi ou le pouvoir du connétable ? Dès le milieu du XVe siècle, l’idée est donc lancée d’un roi incapable et d’un connétable qui exerce le pouvoir à sa place1. La politique d’Alvaro de Luna, envers l’abaissement des grands s’était heurtée à un fort mécontentement et à une opposition farouche de la part des dignitaires du pays. Ils avaient formé une coalition qui avait juré sa perte. Ce dernier occupe donc dans l’histoire castillane du règne de Juan II une place à la fois prépondérante et problématique. Considéré par certains de ses contemporains comme le meilleur des défenseurs d’une monarchie chancelante et, par d’autres, comme un noble ambitieux et cupide. Fils d’un noble castillan et d’une prostituée, Alvaro de Luna, en dépit de ses origines paternelles, n’était au fond qu’un bâtard issu d’une femme de mauvaise vie2, disait-on dans le camp opposé au connétable. Au moment où Rodrigue, curieusement muni d’un sauf-conduit pour traverser l’Aragon3, s’avançait à grande puissance vers la Castille, le roi don Juan traitait avec les révoltés pour un armistice de 1
Adeline RUCQUOI, Privauté, fortune et politique : La chute d’Alvaro de Luna, « publications du CNRS », Paris, 2004. 2 Jean-Pierre JARDIN, Voix et échos du monde nobiliaire dans l’historiographie Trastamare, « cahiers de linguistique médiévale », revue Persée, Fr, Vol. 25, 2002, p. 207. 3 Mr d’HERMILLY, Histoire générale d’Espagne, traduite par Jean de Ferreras, chez Gissey/Le Breton/Ganeau, Paris, 1751, tome VI, p. 451.
289
quarante jours. Une simple affaire de famille en quelque sorte. Il s’agissait d’une tentative pour établir la paix entre un « parti royal », conduit par Álvaro de Luna et un parti « nobiliaire », souvent mené par l’un ou l’autre des infants d’Aragon qui étaient à la fois les cousins germains et les beaux-frères du souverain castillan. Rédigé sous l'arbitrage du comte de Haro, cet événement est connu sous le nom de Seguro de Tordesillas, petite ville assise sur la rive droite du Duero à vingt-cinq kilomètres au sud-ouest de Valladolid. La conférence débuta le 7 juin et dura dix jours. Le climat qui devait présider à ces débats fut excessivement tendu. Par sécurité, on avait désarmé les troupes et les gens qui accompagnaient les participants. Ainsi, sous le règne de Juan II se faisait entendre, pour la première fois d’une façon aussi directe, la voix contestatrice de la noblesse. Elle était persuadée qu’il était de son devoir d’intervenir face à l’attitude jugée tyrannique de l’un des siens, qui confisquait indûment à son profit les prérogatives dévolues au souverain. Ces troubles, depuis quelque temps, avaient atteint leur paroxysme, secouant et ensanglantant la Castille. On voyait s’affronter avec une extrême violence, ouverte ou cachée, les deux camps nobiliaires. Le Seguro de Tordesillas, rédigé par Pedro Fernandez de Velasco, premier comte de Haro, narre ces évènements survenus en 1439. Les acteurs de l’époque conduisirent leur réflexion sur cette situation « de décadence des valeurs de la société médiévale » où les riches sont mieux considérés que les gens bien nés, où les catégories sociales sont bouleversées. Celle-ci les amena à conclure que les désordres politiques de la Castille étaient dus à deux facteurs essentiels : en premier lieu, qu’un homme, qui par sa naissance ne devait pas commander, puisse se retrouver en position d’imposer sa volonté à tous les membres de la société ; en deuxième lieu, qu’un roi puisse renoncer à ses prérogatives en matière de gouvernement.4 Un double jeu On savait en Castille que des troupes avaient été appelées de France. On fit promettre au roi qu’aussitôt informé de leur approche, il leur enverrait l’ordre de s’arrêter. Mais les routiers allèrent-ils plus 4
Ibid. Jean-Pierre JARDIN, Vol. 25, 2002, p. 207.
290
vite que les courriers du roi ? Le roi feignit-il l’ignorance jusqu’au dernier moment ? Toujours est-il que Rodrigue avait déjà traversé la partie nord des terres castillanes et s’approchait de Roa, lorsque sa venue fut ébruitée par la rumeur publique. L’enceinte fortifiée de Roa s’accrochait fièrement sur une colline dominant les eaux du Duero, à une journée de marche de Valladolid. L’imposante cité servait à ce moment-là de quartier général aux insurgés, tandis que le roi avait pris position au cœur de la gigantesque forteresse de Medina del Campo, située plus en aval, de l’autre côté du fleuve. À la nouvelle du danger que courait Roa, les grands de Castille envoyèrent pour la défendre mille cinq cents hommes de cavalerie sous le commandement de Pedro de Zuñiga, comte de Ledesma5. Le jour suivant l’Almirante6 et Pedro de Quiñones se mirent aussi en campagne à la tête d’un second renfort de mille trois cents lances supplémentaires7. Mais avant que ces deux détachements n’arrivent en vue de Roa, il n’y avait plus rien à défendre. La ville avait ouvert ses portes au comte de Ribadeo sur présentation des lettres royales dont l’archidiacre de Cuenca était porteur. Ledesma, s’arrêtant assez loin de Roa, détacha de sa troupe un corps de « génétaires ». Ces cavaliers qui portaient un nom issu de leurs chevaux « les genets », constituaient une cavalerie très mobile empruntée aux Maures. Ils combattaient avec un équipement léger et se servaient de javelots. Sur ordre de Ledesma, ils allèrent porter des escarmouches sous les murs. Salazar, le lieutenant de Rodrigue, chargé de répondre à ces premiers venus, leur opposa l’avantage de troupes aguerries depuis longtemps au combat. Après s’être tenu hors de portée de leurs javelines grâce au soutien de ses archers, Salazar fit une sortie, engagea une violente contre-attaque et les rompit avec ses gens d’armes. Cet engagement stoppa net les prétentions de l’armée insurgée. Elle dut battre en retraite et se retirer une lieue en arrière. Elle resta campée là quelques jours, en attendant du renfort. Mais dans ses rangs, une rumeur se répandit bientôt. Le roi Juan II s’avançait en personne sur Roa à la tête de troupes importantes pour assurer un 5
Ibid. Jules QUICHERAT, 1979, p. 175. Fadrique Enriquez de Mendoza 1390-1473, Amiral de Castille, faisait partie de la coalition nobiliaire qui s’opposait à Alvaro de Luna. 7 Ibid. Mr. d’HERMILLY, Histoire générale d’Espagne, 1751, Tome VI, p. 452. 6
291
soutien à Rodrigue de Villandrando. Alors, les coalisés levèrent le siège et se retirèrent en toute hâte à Valladolid. Ils firent bien, car le roi et son connétable, partis à grand renfort de Medina del Campo, avaient déjà atteint Olmedo. Là, le roi céda aux remontrances polies du comte de Haro. Le rédacteur du traité de Tordesillas lui rappela la promesse d’apaisement que sa majesté avait tenue lors de cette assemblée. Juan II voulut bien accepter de retourner à Médina, après avoir donné son scellé pour que le comte de Ribadeo reste confiné jusqu’à nouvel ordre à l’intérieur de Roa. En contrepartie, le comte de Ledesma consentit à se retirer dans Valladolid8. Les opposants pouvaient à nouveau se regarder de loin à l’abri de leurs murailles respectives. Rodrigue était entré en Castille avec ses combattants d’une façon en quelque sorte illégale. Comment le roi Juan II pouvait-il expliquer sa présence dans le royaume, venant ouvertement prendre part dans un conflit interne ? Le rôle du roi n’était-il pas de refuser la présence de troupes étrangères sur son sol et de chasser leur capitaine avec le concours de tous ses sujets ? En vérité, sous la pression de son connétable, Juan II avait tout prévu. L’acte du Seguro de Tordesillas, c'est-à-dire les dispositions arrêtées pour la tenue du congrès où la paix devait se conclure, porte une clause spéciale en faveur de Rodrigue de Villandrando9. Il y est dit qu’il pourra venir faire la révérence au roi à Tordesillas, avec un équipage de trente bêtes de somme. Que par ailleurs il bénéficiera d’un délai de cinquante jours pour aller, venir, séjourner et sortir du royaume avec ses gens, ou ses gens sans lui. Mais, sauf le cas de sa visite au roi et celui de sa retraite hors de la Castille. Un simple titre de séjour en somme ! Le traité de Tordesillas enchaînait donc le comte de Ribadeo à Roa10. Clauses officielles auxquelles Rodrigue ne se conforma pas scrupuleusement, encouragé secrètement par le connétable et cautionné par le roi. En effet, on ne tarda pas à apprendre qu’il exerçait sans cesse des courses de l’autre côté du Duero. Pour les observateurs, il était facile de s’en rendre compte, la porte sud de la ville s’ouvrait sur le « Puente Mayor », passage obligé pour le franchissement du fleuve. Rodrigue envoyait secrètement de 8
Don Pedro FERNANDEZ de VELASCO, Seguro de Tordesillas, Segunda edición, Imprenta de Don Antonio de Sancha, Madrid, 1784, Capítulo XXV, p. 37. 9 Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, p. 175. 10 Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, p. 175 et Pièce justificative no LXXIV.
292
petits détachements à Medina, et s’efforçait de préparer le terrain pour le roi, comme s’il avait été informé que le congrès de Tordesillas allait être bientôt contesté. Effectivement, à Medina, le connétable tentait de persuader le roi que les conférences n’aboutiraient à rien. Alvaro de Luna ne voulait plus se tenir à l’écart comme on l’avait engagé à le faire jusque-là. Le renfort que Rodrigue avait amené au roi contribuait d’ailleurs à renforcer sa détermination. Cette rupture unilatérale des négociations entraîna de nouvelles hostilités. Alors, on parla d’un autre congrès qui cette fois se tint à Castronuño, une autre place forte perchée sur une impressionnante falaise sur laquelle viennent buter les eaux du Duero. Le roi de Castille se rendit dans cette citadelle. L’infant don Enrique, l’Almirante et les autres mécontents se cantonnèrent quant à eux à Aluejos, dans le voisinage de Castronuño. Tous les participants s’y assemblèrent dans l’église pour tenir leur conférence. Ils s’y rendaient le matin et se retiraient le soir, chacun en sûreté dans sa résidence séparée. Alvaro de Luna vint lui-même plaider sa cause, mais son talent d’orateur se heurta à la haine de ses ennemis. Sous la pression, le roi fut forcé de consentir à l’exil temporaire de son connétable qui devait durer six mois, sans qu’il lui fût permis durant ce temps de parler ni d’écrire au roi, en personne ou par tiers11. Alvaro dut quant à lui consentir à se dessaisir de la grande Maîtrise de Saint-Jacques, et surtout rétablir auprès du roi le crédit et l’autorité des princes aragonais dont ils avaient été privés depuis dix ans. Juan II, fort peiné, tenta d’adoucir l’amertume de cette disgrâce en publiant, sous forme de sauvegarde, une apologie de son favori. Il l’adressa à tous les grands de son royaume, et nommément au comte de Ribadeo. Le traité de Castronuño fut signé par tous les intéressés, et fin octobre le connétable don Alvaro prit congé du roi et se retira à Sepúlveda, où il fut accompagné par l’archevêque de Tolède son demi-frère. Quelques seigneurs ne voulurent point le quitter par fidélité, ou peut-être plus encore parce que connaissant bien la
11
Ibid. Mr. d’HERMILLY, Histoire générale d’Espagne, Paris, 1751, Tome VI, p. 452.
293
personnalité du connétable, ils comptaient le voir rallier à nouveau le cœur et les bonnes grâces du roi. Avant de partir, le connétable parla longuement en aparté avec l’Almirante, ce qui donna de l’ombrage au roi de Navarre et à l’infant don Henri, qui soupçonnèrent entre eux quelque liaison ou négociation secrète. Ainsi finit le premier combat de Rodrigue dans son pays natal. Quelques escarmouches, pas de siège, ni de sac de ville, voilà comment fut conclue la révolte civile qui amena en 1439 les routiers de France en Castille. La présence de troupes aguerries, tombées du ciel en quelque sorte au cœur de ce royaume, posa certainement quelques problèmes au parti des mécontents. La sédition entre le connétable et le parti nobiliaire, unique raison de la venue du comte de Ribadeo, a toujours été considérée comme l’un des plus notables évènements du règne de Juan II. La matière en a même paru assez importante pour devenir au seizième siècle, l’objet d’un ouvrage spécial, de la part d’un intéressé, il est vrai. Don Rodrigo Gomez de Sarmiento, arrière-petit-fils de Rodrigue, est l’auteur de cette relation12. Don Josef Pellizer en a vu le manuscrit, qui existe peut-être encore dans quelque obscure bibliothèque d’Espagne.13
12
Voir, Données historiques complémentaires dans cet ouvrage, « La Maison de Villandrando», Annexe 4, p. 338. 13 Joseph PELLIZER DE OSSAU Y TOVAR, Informe del origen antigüedad, calidad y sucesión de la excelentísima casa de Sarmiento de Villamayor, Madrid, 1663. Pellizer cite un ouvrage qui a pour titre: El socorro del conde de Ribadeo don Rodrigo de Villandrando al rey don Juan el segundo, con todos los privilegios, cédulas y cartas reales pertenecientes a aquella acción.
294
UN REDOUTABLE HOMME D’AFFAIRES Derrière l’inépuisable combattant, n’oublions pas l’homme d’affaires omniprésent. Au fil des guerres, au cours de ses conquêtes, mais aussi des exactions inhérentes à tous les combats, le comte de Ribadeo appliquant bien sûr les méthodes de son temps avait acquis la maîtrise et la gestion de nombreuses affaires parallèles. Son aisance financière lui avait permis non seulement de gérer des troupes considérables, mais encore d’opérer certains choix financiers. Dans cette société où la guerre était un métier comme un autre, Rodrigue avait vécu pour le combat afin d’accéder à la reconnaissance de ses pairs, puis à la fortune. La pratique du pillage était le socle des relations entre les soldats et leurs chefs, y compris entre un roi et ses principaux vassaux, le souverain étant disposé à céder certains fiefs conquis au vainqueur. Participer à l’assaut d’une ville ou d’un château était synonyme d’enrichissement, en particulier quand les places fortes résistaient : elles étaient systématiquement mises à sac. Les batailles rangées permettaient également de s’enrichir, car les armures, et les chevaux des victimes pouvaient être revendus. De plus, au-delà des « patis » imposés aux villes, il y avait surtout la rançon des prisonniers. À titre d’exemple, nous savons qu’en 1415, Charles 1er d’Orléans, prisonnier à la bataille d’Azincourt, fut libéré en 1440 après le paiement d’une rançon de 220.000 écus. Le chevalier John Fastolf gagna 13.400 livres à la seule bataille de Verneuil, en 1424. À titre de comparaison, le commerce de la laine entre la Norvège et l’Angleterre lors de son apogée au XIVe siècle ne dépassait pas 4.000 livres tournois par an. À la bataille d’Anthon, nous l’avons vu, Rodrigue lui-même retira 8.000 florins en or de bon aloi pour la capture du sire de Varambon. On le voit, la guerre était une industrie hautement rentable. Mais encore fallait-il bien placer son argent, spéculer, gager ou accorder des prêts aux seigneurs les plus démunis. Nous savons que le comte de Ribadeo fut un maître en la matière. À l’heure où il venait de
295
regagner sa terre d’origine, arrêtons-nous un instant pour tenter de recenser quels étaient ses rapports avec l’argent. Depuis la Castille, Rodrigue passe un accord financier avec son lieutenant Salazar chargé du commandement de sa compagnie en France. Un article du traité de Castronuño vint compliquer sérieusement la situation du comte de Ribadeo. Cet article prescrivait en effet, la dissolution immédiate des corps de troupe rassemblés en Castille par chacun des belligérants. En conséquence, Rodrigue se trouva à nouveau dans l’alternative qui lui avait été faite à Tordesillas : soit retourner avec sa compagnie en France soit, s’il préférait rester en Castille, la renvoyer immédiatement sous la conduite d’un autre. Il fit ce dernier choix, sans doute parce qu’il en fut prié par Alvaro ou par le roi lui-même, en prévision d’un revirement de situation auquel travaillait en secret le connétable. Renoncer à la position importante qu’il avait prise en France l’effleura pour la première fois. Peut-être son âge avançant et la réforme militaire entreprise par Charles VII le firent hésiter à retourner sur le champ habituel de ses exploits. Mais, provisoirement, il ne songea qu’à déléguer auprès d’un lieutenant fidèle, le commandement de l’ensemble des hommes d’armes qu’il entretenait des deux côtés des Pyrénées. Salazar fut cet homme de confiance. Après avoir fait jurer à ses braves qu’ils obéiraient au nouveau capitaine comme à lui-même, il les congédia en les exhortant à soutenir, comme ils le devaient, le prestige de son nom et l’honneur de sa bannière. Mais le comte de Ribadeo ne se contenta pas uniquement de promesses. Il signa avec son lieutenant un accord de partage des revenus liés aux futures campagnes militaires, ainsi gardait-il toujours un œil aiguisé sur ses affaires. Une partie de ses compagnies franches prolongeant leur existence, le comte de Ribadeo trouva bon de partager le gain de celles qui continuaient à se décorer de son nom.1 Jean de Salazar est un Castillan qui appartient à l’histoire de France encore plus que Rodrigue, car sa vie entière se passa dans le royaume de France et il y laissa toute sa descendance. Son fils Tristan de Salazar fut même archevêque de Sens. Dans sa jeunesse, Salazar 1
Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, p. 190.
296
fut le compagnon de Rodrigue dès la bataille d’Anthon, où il se distingua en combattant comme page à ses côtés2. Son avancement fut rapide. Dans les commandements qui lui furent confiés, il se comporta de façon à devenir en peu de temps l’homme de confiance incontournable du capitaine castillan. À son retour en France, Salazar fit à nouveau flotter la bannière du comte de Ribadeo. Charles VII, considérant l’importance militaire de ses troupes, lui fit voter par les États du Languedoc une gratification considérable : il devint ainsi l’un des plus fermes soutiens de la couronne. Ni suggestions secrètes ni promesses ne furent capables de détourner le nouveau capitaine de son engagement. À la demande du souverain, son armée opéra, au jour convenu, sa jonction avec l’armée royale qui était dans le Languedoc. L’étendard du comte de Ribadeo flottant à côté de celui du roi de France produisit, sur ceux qui contestaient encore la réforme militaire engagée par Charles VII, un effet des plus impressionnants. Ce spectacle inattendu scella définitivement l’avènement de cette nouvelle armée, que le mouvement nobiliaire dit de « la Praguerie » tentait pourtant de contrer. Le roi de France entérina définitivement sa réforme grâce au ralliement de la plus grande compagnie de France : l’armée des routiers de Salazar3. L’unité où fut incorporée une partie de l’effectif de ceux que l’on appelait toujours les Rodrigais fut appelée, à cause de sa composition, la compagnie des Espagnols4. Cette intégration mit un arrêt définitif à l’accord financier que Rodrigue avait contracté avec son lieutenant. En effet, il est notoire que le comte de Ribadeo cessa d’exercer toute implication en France, à compter de l’année 1442. Depuis lors, son nom n’apparaît plus dans les documents où il est question de routiers. Le nom de Salazar a définitivement remplacé le sien5. Il faut simplement noter qu’à compter de son retour en Castille, il partagea encore pendant trois ans les bénéfices liés aux activités guerrières de son ancienne compagnie avec son ancien lieutenant.
2
Louis RAYNAL, Histoire du Berry, Librairie de Vermeil, « Au grand Bourdaloue », Bourges, 1844, tome III, p. 43. 3 Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, note 1, p. 194. 4 Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, p. 197. 5 Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, p. 192.
297
La créance du comte de Foix Dès l’année 1441, le comte de Ribadeo prit toutes les mesures pour la liquidation de ses affaires en France. Il signa une procuration en bonne et due forme à un écuyer, pour recouvrer les créances ou dépôts qu’il avait en plusieurs endroits du royaume. L’opération fut longue et laborieuse. Le mandataire qui en avait la charge sollicita plus d’une fois la possibilité d’être secondé par des substituts, tant les affaires à négocier étaient nombreuses. Cette demande apparaissait d’une absolue nécessité pour traiter l’ensemble des dossiers, car quantité de transactions se poursuivaient simultanément à de grandes distances.6 Au nombre des créances, il y avait les sommes qui restaient dues à Rodrigue en vertu du traité conclu pour l’évacuation du Comminges. Il n’en avait pas touché la moindre part depuis son retour en Castille. Aux premières réclamations, les comtes de Foix et de Comminges sollicitèrent des délais, qui se transformèrent en refus catégorique, dès lors qu’ils eurent la certitude de ne plus jamais avoir la visite du terrible capitaine. Mais par quel moyen pouvaient-ils se soustraire à une obligation qui avait été contractée sous les serments les plus solennels ? Les deux comtes décidèrent de faire appel au cardinal Pierre de Foix. Frère de l’un et oncle de l’autre, le prélat vivait toujours, et n’avait certainement pas oublié la guerre du Comtat Venaissin soutenue contre lui par le Castillan. Le comte de Comminges et le comte de Foix le pressèrent de faire parvenir une supplique à la chancellerie romaine. Ils demandaient à être relevés d’un serment, non valable disaient-ils, attendu qu’il leur avait été extorqué sous la pression des Écorcheurs. Pour montrer jusqu’à quel point leur prétention semblait légitime, ils se déclaraient déterminés, non seulement à ne pas solder le reliquat des sommes stipulées, mais encore à poursuivre par toutes les voies légales la restitution de ce qu’ils avaient déjà payé. Souvenons-nous, dans cette affaire du Comtat, par sa prise de position, Rodrigue s’était dressé contre le pape. Il va sans dire que l’exonération sollicitée par les comtes fut accordée dans les plus brefs délais par une bulle d’Eugène IV. Le 13 septembre 1443, l’exécution en fut confiée à l’évêque de Rieux, délégué apostolique. Une telle 6
Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, p. 190.
298
façon de payer ses dettes, tout à fait au goût des débiteurs, fut certainement trouvée moins plaisante par le créancier. On ne peut douter que le comte de Ribadeo ait engagé un pourvoi pour contester la décision dont il était victime. Ses démarches restèrent sans effet de son vivant. Après sa mort, l’archevêque de Tolède reprit le dossier auprès des puissances temporelles, pour le comte Pedro de Villandrando, fils de Rodrigue. Le prélat écrivit à Louis XI, afin de lui demander un soutien en faveur du successeur injustement frustré. C’était en 1462, au moment où Louis XI resserrait ses liens avec le Saint-Père et avec le comte de Foix. Il va sans dire que les réclamations apportées au nom du fils eurent le même sort que celles du père. La gestion de ses affaires maritimes Nous allons parler ici d’une singulière faveur que le comte de Ribadeo se fit accorder par le roi de Castille. L’exemple est fort intéressant, car Rodrigue nous démontre ici sa vision élargie du monde des affaires et une parfaite connaissance des échanges marchands de son époque. Le comte de Ribadeo ne mettait pas tous ses œufs dans le même panier. En gestionnaire avisé, il ne se contentait pas de thésauriser, il s’était en effet engagé dans une autre activité de rapport : le commerce maritime. À cette époque, considérée dans son ensemble, la flotte ibérique était puissante et nombreuse. Paradoxalement malgré la guerre, malgré les risques inhérents à la piraterie, le commerce maritime était européen, à l’image de celui de la Castille. Partant des ports basques, asturiens, ou encore galiciens, des navires marchands voguaient en direction du nord, poussant des pointes jusqu’en Scandinavie. Ils cabotaient le long des côtes chargeant et déchargeant des marchandises, puis repartaient en direction de la péninsule ibérique. Les marins des ports cantabriques et galiciens furent non seulement des précurseurs sur les routes atlantiques, mais ils furent aussi ceux qui les fréquentèrent de la manière la plus assidue et la plus intense. Cette région côtière battue par l’océan offre de nombreuses anses propices à l’établissement de ports militaires ou commerciaux. Relevant de la couronne de Castille, le littoral entretenait de plus des échanges intenses avec un arrière-pays peuplé qui offrait une gamme étendue de produits. Sans doute cette situation marchande influença-t299
elle les personnes entreprenantes. Comme le comte de Ribadeo, qui dans sa jeunesse alla faire des courses en mer et n’avait, semble-t-il, rien oublié de ses expériences passées. Ainsi, il était propriétaire d’une petite flotte marchande. L’avait-il conquise pendant la guerre du Bordelais, l’avait-il reçue comme dépendance de son comté de Ribadeo dont le fief est un important port de mer, ou enfin se l’était-il tout simplement procurée pour se livrer à la spéculation ? Les actes n’en disent rien. Se trouvant à une période charnière de son existence, il songea à en tirer parti. La Castille, de par sa situation géopolitique avec l’Aragon, n’avait guère de débouchés autres que sur sa face nord-océanique. En raison de l’omniprésence des conflits, le marché de la France stagnait et celui de l’Angleterre était fermé par suite de l’hostilité entre ces deux États. Cependant, les Anglais avaient grand besoin du fer de la Biscaye, et les sujets de la couronne de Castille souffraient de la disette des draps anglais. J'ordonne aussi de laisser rapporter librement sans les saisir les étoffes et autres produits du royaume d'Angleterre pour mes terres et mon royaume, de les laisser les y vendre et les y distribuer, écrivait le roi Juan II.7 Quels bénéfices pour un Castillan qui serait autorisé exceptionnellement à pratiquer les échanges commerciaux entre les deux pays ! Cette faveur extraordinaire, Rodrigue osa la solliciter, grâce à une mésaventure qu’il avait connue en 1431, au cours d’un trajet qui le conduisait de France en Castille. La faction arrière de ses troupes qui suivait à une journée de marche fut attaquée au passage des Pyrénées par un détachement anglais qui se trouva sur sa route. Rodrigue s’était vu enlever plusieurs personnages importants de sa suite, entre autres Pedro Carrillo et Fernando de Tovar, qui était son propre neveu. Tous deux furent bien sûr mis à rançon. Celle-ci aurait dû être payée par l’administration de Juan II, car la capture avait été faite dans une démarche exécutée pour le roi de Castille, à la sollicitation d’Alvaro de Luna. L’opportuniste comte de Ribadeo fut d’accord pour s’acquitter du paiement de la rançon, à condition que Juan II veuille bien lui accorder une concession 7
Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, La Marina de Castilla, El progreso editorial, Madrid, 1894, p. 447.
300
commerciale avec l’Angleterre. C’est ainsi que quelques mois plus tard, partant de Santander, son navire appareilla et mit les voiles en direction des ports anglais pour effectuer quatre voyages marchands sur une période de trente mois.8 À ce sujet, le roi déclarait dans sa Cédula ou ordonnance adressée à ses sujets : Sachez que Don Rodrigo de Villandrando, comte de Ribadeo, mon vassal et membre de mon conseil, m'informa de comment, alors qu'obéissant à mes ordres, se rendant à mon service, son neveu Fernando de Tovar, Pedro Carrillo et certains de mes sujets membres de sa compagnie furent faits prisonniers par les Anglais. D’importantes rançons en maravédis et en marchandises sont exigées pour leur libération. Afin de pouvoir les libérer, il me pria de bien vouloir autoriser l'un de ses navires nommé la « Nao de Santiago », dont il est l'armateur, à transporter les marchandises réclamées par le Roi et les Seigneurs d'Angleterre en toute sécurité lors des trajets que je voudrais bien lui accorder. J'ai accédé à ses demandes. Il est de ma bonne grâce et de ma volonté que ce navire puisse effectuer quatre voyages, embarquer et débarquer du royaume d'Angleterre avec ses marchandises, sans risque, en toute sécurité sur la totalité de mes mers. De même, afin qu’il puisse mener à bien le projet sans être confronté à des difficultés civiles ou criminelles, par cette lettre je lui donne l'autorisation, les moyens et le pouvoir nécessaires aux susdits quatre voyages.9 Parallèlement à ses engagements militaires, Rodrigue nous donne ainsi une idée plus précise de la gestion de son immense « entreprise ». Cependant, les évènements se bousculaient en Castille. Le ciel restait désespérément sombre, car le roi continuait à agir sous l’influence de son connétable qui le conseillait toujours en sous-main, malgré son exil exigé par la faction nobiliaire de Castille. Plus d’un an s’écoula avant qu’on osât parler du rappel d’Alvaro de Luna. À la fin, les amis du connétable perdirent patience. Ils conseillèrent au roi de le faire redemander par les Cortes, croyant éviter l’orage. Mais les haines 8
Madeleine PARDO, Réflexions sur la Crónica Sarracina, Cahiers d’Études Médiévales Hispaniques, Presses de la Sorbonne, Paris, 1993, No 4, Note 71, p. 32. 9 Ibid. Cesáreo Fernández DURO, La Marina de Castilla, El progreso editorial, Madrid, 1894, p. 447. Traduction N. Bourg.
301
n’étaient toujours pas assoupies. À la nouvelle d’un possible retour du détesté favori, les grands reprirent les armes. L’infant d’Aragon ouvrit la campagne sans attendre par une marche précipitée sur Tolède.
302
TOLEDE Rodrigue revêt les habits du roi et sauve le souverain Dans une boucle du Tage, protégée par des gorges profondes qui obligent à une approche par le nord, Tolède resplendit dans un univers minéral écrasé de lumière. Le 6 janvier 1441, la formidable cité fut le théâtre d’un acte héroïque du comte de Ribadeo. L’infant d’Aragon, don Enrique, qui était en étroites relations avec Pedro López de Ayala, alcalde de Tolède1, fit prévenir celui-ci de sa ferme intention de se rendre dans cette ville afin d’organiser la résistance du parti nobiliaire. Un détachement des « mécontents » conduit par Gabriel Manrique sortit de la cité à la tête de deux cent cinquante chevaux, et alla au-devant d’Enrique jusqu’à Mostoles2. Après l’avoir reçu dans cette petite place forte, ils l’accompagnèrent jusqu’à Tolède, où l’on donna entrée à l’infant, contre l’ordre du roi qui avait pourtant recommandé à Pedro López de Alaya de lui conserver cette ville. Il lui en avait même fait prêter serment ! Malgré les dispositions restrictives du traité de Castronuño le connétable avait recouvré le pouvoir après son exil temporaire. Dès sa libération, les flammes du conflit s’étaient rallumées, si bien que tout était en désordre et en combustion dans le royaume de Castille. Il n’y avait donc rien d’étonnant à ce que l’on ouvre les portes de Tolède à l’infant d’Aragon. Le Conseil de Castille déchiré entre les partisans et les adversaires de don Alvaro ne gouvernait plus, en rien3. La noblesse de Castille était toujours et plus que jamais partagée en deux camps : pour ou contre le connétable. Il faut dire que le favori s’était 1
Maire. Autrefois, juges et magistrats qui occupaient les charges civiles et judicaires correspondant à la fois à celles de juge de paix, de lieutenant de police et de maire. (Littré 1872). 2 Mostoles : Aujourd’hui inclus dans la communauté autonome de Madrid, situé à dix-huit km au sud-ouest du centre de la capitale. 3 Béatrice LEROY, Le triomphe de l’Espagne catholique à la fin du Moyen Âge, Presses universitaires de Limoges, 2004, p. 144.
303
fait octroyer au cours du temps toutes les seigneuries, les châteaux les plus stratégiques et tous les titres, dont la fonction de connétable, jusqu’à obtenir par usurpation et menace armée la « maîtrise de Santiago ». Il avait placé dans son clan parents, frères, gendres, beauxfrères et ses propres favoris, à tous les postes-clés du gouvernement. Il était devenu le véritable souverain. Juan II, qui trouvait cet arrangement confortable, le laissait agir, préférant une vie de plaisir et de gloire. En effet, don Alvaro sut lui organiser des fêtes, des entrées somptueuses dans les villes, de superbes rencontres diplomatiques, jusqu’à ménager sa présence dans les batailles en des points protégés, le maintenant ainsi, loin des réalités et des fatigues du pouvoir. Exaspéré, le parti des nobles contestataires décida d’envoyer une lettre au roi, osant mettre en cause son laisser-aller et son désintéressement du pouvoir. Dans cette missive, les nobles souhaitaient aller au-delà de la sentence d’exil de six mois prononcée à Castronuño. Ils réitérèrent leur demande de renvoi du connétable. Juan II prit mal la chose et la traita de très haut en répondant que lui seul, le souverain, entend où est le bien du royaume, et qui il convient d’appeler à ses côtés pour gouverner.4 Mais les choses tournaient mal pour le parti de Juan II et de son connétable, car les « mécontents » s’étaient saisis de plusieurs places. Les administrations des villes venaient de tomber les unes après les autres sous les assauts conjugués de la faction nobiliaire : Pierre de Quiñones, « Grand-Mérin des Asturies »5, s’était emparé de la ville de Léon ; Ruy Diaz de Mendoza de Ségovie ; don Henri frère de l’Almirante de Zamora ; l’Archidiacre Jean Gomez de la plus grande partie de Salamanque ; le comte don Pedro Niño et Diego de Zuñiga de Valladolid ; le roi de Navarre d’Avila ; le comte de Ledesma de Burgos et de Palencia ; et enfin Iñigo López de Mendoza et de Guadalajara6. Il fallait réagir, le souverain poussé par son connétable s’engagea à opposer une réaction immédiate. Il nomma plusieurs nobles de son parti à différentes fonctions stratégiques. Le comte de Ribadeo fut élevé à la charge de maréchal des Asturies, titre attaché à
4
Ibid. Béatrice LEROY, p. 145. Ou « Adelentado Mayor », officier de la Couronne de Castille qui exerce des fonctions judiciaires et gouvernementales sur un territoire donné (de l’arabe almuqaddàm et almocadén devenu el Merin en castillan). 6 Ibid. Mr. d’HERMILLY, Histoire générale d’Espagne, 1751, Tome VI, p. 462. 5
304
la Maison de l’infant Henri de Castille, fils du roi et prince des Asturies. Malgré l’urgence de la situation, Juan II n’abandonna pas pour autant ses plaisirs laissant au connétable le soin de conduire son gouvernement. Ainsi, on le vit quelquefois encore pendant ces évènements se rendre à Piedrahíta, petite cité fortifiée située sur un plateau au pied de la sierra de Gredos où en compagnie de son grand fauconnier, il se plaisait à venir chasser la palombe. Mais au tout début de l’année 1441, les évènements se précipitèrent. La nouvelle du mouvement de l’infant d’Aragon vers Tolède lui parvint alors qu’il séjournait au château d’Arevalo, forteresse érigée à la confluence des fleuves Arevalillo et Adaja. Cette fois, le roi n’avait plus le choix, il devait réagir en personne. Le souverain fit aussitôt mettre à cheval tout le personnel armé dont il disposait, et prit lui-même avec cette escorte le chemin de Tolède. Il espérait gagner don Enrique de vitesse, et arriver assez tôt pour organiser la défense de la ville. Mais il avait compté sans la trahison de López de Ayala qui avait accueilli le prince aragonais de sa propre initiative. Arrivé à Bargas, située à deux lieues à peine au nord de Tolède, Juan II fit une dernière tentative de conciliation. Il envoya devant lui Nicolas de Villamizar, pour intimer l’ordre à Pedro de Alaya, de lui préparer un logement convenable. Villamizar trouva à la porte de Bisagra, entrée principale de la cité de Tolède, un émissaire qui lui dit qu’on ne pouvait ni parler à López de Ayala, ni entrer dans la ville. Villamizar effectua un rapide demi-tour, éperonna sa monture et s’en retourna rendre compte au roi de l’échec de son entrevue. Le courroux du souverain ne fit qu’empirer, il partit sur-le-champ de Bargas pour se rendre en personne à Tolède. Ce faisant, il dépêcha trois nouveaux émissaires avec ordre de sommer juridiquement l’infant don Enrique et Pierre López d’Alaya, de sortir de la ville et d’en retirer les troupes. Rien ne se passa comme prévu. Les portes s’ouvrirent en effet pour laisser entrer les trois seigneurs, mais à peine étaient-ils dans la place qu’ils furent arrêtés et mis sous bonne garde. Sur ces entrefaites, le roi arriva dans les faubourgs face à l’ermitage de Saint-Lazare. Son escorte était bien maigre. Accompagné seulement du comte de Ribadeo et de quelques officiers de sa Maison, il avait avec lui une trentaine de cavaliers à peine7. 7
Ibid. Mr. d’HERMILLY, Histoire générale d’Espagne, Paris, Tome VI, p. 470.
305
L’infant d’Aragon sortit avec sa cavalerie à la tête de deux cents lances pour opposer un rempart humain au-devant de la porte de Bisagra. Les deux troupes se faisaient maintenant face, à vue, mais suffisamment loin pour qu’un émissaire de chaque camp soit envoyé tour à tour afin de porter questions et réponses au galop de son cheval. On vit ainsi un étrange dialogue s’engager. L’infant, s’étant rangé en ordre de bataille, envoya dire au roi assez insolemment que, s’il voulait entrer dans la ville, il le pouvait, parce qu’elle lui appartenait et qu’elle était très dévouée à son service. Avec raison, le roi pressentit un piège. S’il tentait d’avancer avec une si petite armée, il serait à coup sûr fait prisonnier ! Juan II apporta une réponse cinglante : il entrerait dans la ville, quand l’infant n’y aurait plus de troupes. Sûr de sa force et de sa position, l’infant d’Aragon ironisa encore. Il envoya répondre au roi que le bien du royaume exigeait sa présence dans cette ville ; que d’ailleurs, pour témoigner de son respect envers le roi son souverain seigneur, il irait lui baiser la main, si toutefois il en avait la permission8. Sur ces entrefaites, il fit avancer ses gens de quelques pas. Ceux qui accompagnaient le roi mirent l’épée à la main, craignant une attaque. Un profond sentiment d’inquiétude s’empara de l’escorte royale. Le faubourg que l’on découvre en venant de Madrid, au pied de la formidable cité, constituait l’ensemble d’un hôpital dédié à Lazare. L’effroi général inspira au comte de Ribadeo une soudaine résolution. L’édifice était imposant, semblait bien bâti et solide. Dans un brusque mouvement de retrait, Rodrigue y fit entrer le souverain et sa suite. L’escorte s’engouffra à l’intérieur par une lourde porte qui s’ouvrait sous la voûte massive du corridor. Alors seulement, le comte de Ribadeo prit le temps de s’entretenir brièvement avec son roi. Il lui fit part d’une ruse qu’il venait d’imaginer. Il demanda humblement à sa majesté qu’elle veuille bien accepter de lui céder sa tunique afin de s’en revêtir pour tromper l’ennemi9. Cet artifice donnerait aux gens de la Maison du roi le temps de barricader tous les accès de la bâtisse, de
8
Ibid. Jules QUICHERAT, p. 181. FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA, Estudios en homenaje a Elida García García, Universidad de Oviedo, 1998. 9
306
dresser à la hâte des palissades autour de l’église et de mettre les lieux en état de défense.10 Ainsi, Rodrigue, les épaules couvertes de la tunique de Juan II, s’avança au galop du cheval royal, face à l’infant d’Aragon, mais à distance suffisante pour ne pas être reconnu. Étrange spectacle d’un roi évoluant seul, au galop de sa monture, sous les murs de Tolède ! L’effet de surprise fut tel que les gens du roi eurent le temps de se barricader efficacement. Lorsqu’il se fut assuré de tout cela, « le roi » qui n’était autre que le comte de Ribadeo, fit volte-face, éperonna son cheval et enveloppé de poussière, s’engouffra à son tour dans l’enceinte de l’hôpital pour y attendre des renforts Les Castillans furent émerveillés de cette savante et prompte opération, le roi surtout, qui, joignant la reconnaissance à l’admiration, déclara devant tout le monde que, quelque grâce que le comte de Ribadeo lui demandât en retour d’un si grand service, elle lui serait immédiatement accordée. Alors, Rodrigue mit un genou en terre et dit que, puisqu’il plaisait au roi d’agréer ce qu’il venait de faire pour son service, il le suppliait d’en perpétuer la mémoire dans sa maison, en lui accordant à lui et aux comtes de Ribadeo, ses successeurs, la faveur de s’asseoir tous les ans, à pareil jour, à la table du roi, et d’avoir, à titre de gratification également annuelle, le vêtement porté le même jour par Sa Majesté. Cela se passait le jour des Rois, 6 janvier 1441. Depuis et en remerciement d’un tel acte de bravoure, la Maison de Ribadeo eut le privilège de manger à la table du roi le jour de l’Épiphanie et sa majesté lui fit cadeau chaque année de sa robe en ce jour de lumière11. Les ducs de Hijar, de la branche des Sarmiento issus
10
Ibid. Jules QUICHERAT, note p. 181, cite Hernando del Pulgar, Pièces justificatives n° I. 11 Ibid. QUICHERAT, note p. 182 : Il y eut interruption au commencement du XIXe siècle. La reine Isabelle a rétabli le privilège en 1841. Josef Pellizer a publié le procès-verbal du repas dont Philippe IV fit les honneurs à Rodrigue Sarmiento, le jour des Rois 1626, cent quatre-vingt-cinquième anniversaire de la rescousse de Tolède.
307
de Rodrigue par les filiations maternelles, jouirent à titre héréditaire jusqu’au XIXe siècle de la faveur sollicitée par leur ancêtre.12
-20 Statue de Juan II de Castille à Ciudad Real réalisée par le sculpteur Sergio Blanco, 2007.
12
Voir, Données historiques complémentaires, dans cet ouvrage, annexe 13, p. 366. « En 1973, on pouvait encore contempler une collection d’habits royaux, conséquence de ce cadeau traditionnel, qui étaient exposés dans une des vitrines de bois ouvragé du palais des Hijar-Aranda à Epila, descendants et héritiers de la maison Sarmiento-Villandrando ».
308
Manger aux côtés du roi, recevoir en souvenir des habits qui avaient touché le corps du roi, étaient le plus grand honneur qu’on puisse imaginer dans un pays comme la Castille où, déjà au XVe siècle, la rigueur du cérémonial interdisait au souverain toute communauté de vie avec ses sujets. Aussi, l’extraordinaire ampleur de la récompense contribua-t-elle à amplifier dans l’opinion publique le mérite de l’action qui l’avait provoquée, tellement que les sujets de Castille considérèrent la défense de l’hôpital Saint-Lazare comme le plus sublime exploit de Villandrando. C’est avec ce sentiment qu’en parle le poète Garcia de Rezende : et nous avons vu la grande action du comte de Ribadeo, pour laquelle le roi lui accorda de manger à table avec lui, et lui fit don aussi de son vêtement. Selon Rafael del Castillo13, Rodrigue aurait épousé doña Beatriz de Zuñiga à la suite de ce fameux exploit du 6 janvier 1441. Le roi lui ayant demandé quelles bonnes grâces il aimerait qu’il lui accorde, Rodrigue répondit : « Sire, je vous prie de m’accorder deux faveurs. La première est que moi-même et mes successeurs ayons l’honneur de manger chaque année en ce jour à la table de Votre Altesse et que vous nous offriez le vêtement que vous portez à chacun de ces anniversaires. - Bien, dit le roi, je vous l’accorde, et la seconde ? - L’autre, Sire, est que vous m’accordiez la main de doña Beatriz de Zúñiga, la dame que je mis récemment sous la protection de Votre Altesse afin qu’elle échappe aux persécutions du prince don Enrique. - Bravo ! Comte, c’est moi qui serai votre témoin. Et se retournant vers les chevaliers, il leur dit joyeusement : - À Valladolid, messeigneurs, allons conter vos faits d’armes au bon connétable et après nous assisterons au mariage du comte de Ribadeo avec l’héritière de Zúñiga. » Quelques jours après, le comte de Ribadeo convolait en justes noces et devenait l’heureux époux de Doña Beatriz… Quoi qu’il en soit, c’est bien sur l’implication personnelle du comte de Ribadeo que Juan II put se sortir de ce mauvais pas. En ces circonstances difficiles, Rodrigue avait fait preuve d’une loyauté sans faille à l’égard du roi. L’ancien routier espagnol revenu de France, 13
CASTILLO Rafael (del), Don Rodrigo de Villandrando, Novela Histórica, publicada bajo la dirección de Don Joaquín Ruiz de Morales, Madrid, 1859, p. 407.
309
Rodrigue de Villandrando, comte de Ribadeo, maréchal des Asturies, et depuis peu allié à la puissante maison de Zuñiga, était maintenant un personnage incontournable de Castille. Épilogue Une suite tragique ponctua ces évènements. Au cours des années 1441/1442, il y eut de grandes violences dans la ville de Tolède. L’infant d’Aragon qui tenait toujours la ville, étant à court d’argent, cherchait le moyen de pouvoir payer ses troupes. Il y eut des gens qui lui firent entendre que l’expédient le plus sûr était de piller les maisons des juifs et des nouveaux conversos14 de la ville de Tolède. Il est vrai que les juifs avaient déjà eu à souffrir de mesures visant à limiter leur rôle socio-économique au sein de la chrétienté et dans les régions où leur résidence était encore tolérée. Le pape Eugène IV, constatant que les mesures envers les juifs et les musulmans n’avaient pas été suffisamment respectées dans les royaumes de Castille et Léon, condamna à nouveau dans la bulle Super gregem Dominicum du 8 août 1442, leur promiscuité avec les chrétiens, qui mettait en danger les âmes chrétiennes15. Le prétexte était tout trouvé. L’infant goûta le conseil et le suivit sans aucune opposition de la part de Pedro López de Ayala. À son exemple, les autres citoyens en firent de même, malgré tout ce que purent faire quelques ecclésiastiques et gentilshommes bien intentionnés pour tenter de les en empêcher. La crainte du châtiment qui pouvait suivre ces attentats lia un peu plus la ville, ou du moins ceux qui en étaient les auteurs, au parti de l’infant don Enrique.16
14
Musulmans et juifs convertis au christianisme. Nathalie NABERT, Le Mal et le Diable : leurs figures à la fin du Moyen Âge, Université Catholique, Beauchesne, Paris, 1996, p. 128. 16 Ibid. Mr. d’HERMILLY, Histoire générale d’Espagne, Paris, 1751, tome VI, p. 471. 15
310
MEDINA DEL CAMPO Le piège se referme autour du connétable de Castille Dans la journée du 28 juin 1441, une trahison permit aux « mécontents » de s’introduire dans la forteresse de Medina del Campo. Ils désiraient contraindre le roi à accepter enfin leurs exigences. Quelques jours auparavant, l’infant d’Aragon, don Enrique, avait rejoint le roi de Navarre, son frère1 et les autres coalisés avec mille trois cents lances. Ils allèrent tous ensemble d’Olmedo à Médina. Informé de leur approche, le Roi don Juan sortit à la porte d’Arcillo avec des troupes d’égale puissance qu’il mit aussitôt en ordre de bataille. À ses côtés, il y avait les « Grands de Castille » attachés à son parti, dont le comte de Ribadeo chevauchant un destrier qui piaffait d’impatience. Les troupes du roi de Navarre hésitèrent à se lancer dans une confrontation armée, d’autant que leur cible n’était point d’attenter à la personne du roi de Castille comme on le sait, mais plutôt de réduire à néant l’emprise du détesté connétable sur sa personne. Désirant tout d’abord exécuter une démonstration de force, les troupes du roi de Navarre défilèrent simplement à distance respectable du roi de Castille. Puis, elles se retirèrent pour aller camper à Carrioncillo, lieu de villégiature des souverains à peu de distance de Medina del campo. Don Juan se retira avec les siennes dans la ville où il fut rejoint peu après par son fils, le prince Henri, et la reine, qui prirent leurs logements dans le monastère de Las Dueñas. 1
Jean II d’Aragon né le 29 juin 1398 à Medina del campo, mort le 19 janvier 1479 à Barcelone, fut roi de Navarre par mariage entre 1425 et 1441, puis par usurpation de 1441 à 1479. Il était le fils de Ferdinand Ier d’Aragon qui eut sept enfants dont : son héritier le roi Alphonse V (roi d’Aragon), Jean (roi de Navarre dont nous venons de parler) et l’infant don Enrique qui tinrent absolument à jouer un rôle en Castille. Ces deux derniers tentèrent en vain de s’imposer dans le gouvernement du jeune roi à la place du favori Alvaro de Luna. Dès lors, Juan II de Castille dut constamment lutter face aux infants d’Aragon et leurs clans.
311
Face au rapport de force équilibré qui venait de s’établir, on parla aussitôt de traité d’accommodement, et chacun consentit à la tenue d’une conférence. Le comte d’Alba2 et l’évêque de Ségovie furent nommés plénipotentiaires pour le roi. Ils prirent place face à l’Almirante et à l’évêque de Palencia qui représentaient le parti opposé. Les discussions furent âpres et rudes. Chacun restant inflexible sur ses positions, la conférence se clôtura sur un échec. Pedro de Quiñones, Grand-Mérin des Asturies, étant arrivé avec deux cents chevaux, vint renforcer les troupes des mécontents. Profitant de cette opportunité, l’infant Enrique d’Aragon et son frère le roi de Navarre, se portèrent avec leurs armées à environ cent pas de la ville. On hésitait toujours à s’engager dans une confrontation directe. Aussi, l’obscurité venue, un petit groupe de soldats sortit de la place et porta quelques escarmouches contre les assaillants. Il en périt quatorze de part et d’autre. La même nuit, alors que tout respirait le calme, la campagne environnante résonna du bruit sourd d’une cavalcade. Des chevaux de guerre approchaient. Le connétable don Alvaro et l’archevêque de Tolède, son frère, entrèrent dans Medina avec mille six cents lances. Ce secours arrivait très à propos, car le roi était en situation d’infériorité Il y avait alors à Medina deux gentilshommes de la maison du roi de Navarre, nommés Alvaro de Braquemont et Ferdinand Rejon. Les « mécontents » entretenaient avec eux une correspondance secrète dans le but de s’introduire par surprise dans la ville. Les deux gentilshommes promirent de coopérer, la nuit venue, du côté où ils exerceraient la garde. Les heures s’écoulèrent sans que les assiégés ne se doutent de rien. Malgré une vague promesse d’aurore, une obscurité pesante enveloppait encore la cité lorsque des ombres furtives coulèrent soudain le long de la muraille. Les premiers coalisés pénétrèrent par une brèche qui venait d’être aménagée. Six cents hommes d’armes s’engouffrèrent à leur suite dans l’étroit passage. À l’opposé, l’horizon s’illuminait à peine des pales lueurs du jour quand un deuxième groupe d’assaillants fit une percée à proximité de la porte Saint-Jacques. Opérant un mouvement de tenaille, une deuxième escouade d’assaillants venait de pénétrer dans la ville. 2
La cité d’Alba de Tormes est située au sud-est de Salamanque, sur le penchant d’une colline qui domine la rivière de Tormes. Elle fut érigée en duché au XVe siècle par Henri IV de Castille. On y trouve le tombeau de Thérèse d’Avila.
312
Réveillé par cette terrible nouvelle, le Roi se leva promptement, se fit apporter son habit de guerre, monta à cheval, et alla se poster sur la place de Saint Antolien, en compagnie de Juan de Silva, son porteétendard. Là, les prélats, les seigneurs et les gentilshommes qui lui étaient attachés s’empressèrent de se ranger à ses côtés. Les gens du roi de Navarre s’avançaient par la rue de Saint-François, tandis que le deuxième corps de troupe arrivait par un endroit appelé La Rua. Il fallait faire vite, Juan II envoya dire au connétable Alvaro, à l’archevêque de Tolède, son frère et leur suite de se sauver au plus tôt avec la noblesse et toutes les troupes qu’ils pourraient rallier. Mais le connétable avait, semble-t-il, déjà devancé les ordres du souverain. Il était parti sur-le-champ emmenant avec lui la plupart des grands seigneurs. Sur le passage des fuyards, il y eut quelques escarmouches, mais ils réussirent à s’ouvrir un passage en sortant par la porte d’Arzillo et se retirèrent tous ensemble à Escaloña, formidable demeure défensive appartenant au connétable. Rodrigue quant à lui n’avait pas quitté le souverain. Il faisait partie des rares fidèles qui avaient fait le choix de rester avec lui. Ils étaient une poignée sur la place, face à leurs agresseurs avec seulement cinq cents hommes d’armes. Alors, Juan II ordonna à l’archevêque de Séville d’appeler dans les rangs ennemis l’almirante et le comte de Ledesma. Ceux-ci voulurent témoigner une nouvelle fois que leurs griefs ne s’adressaient pas au souverain, mais uniquement au connétable. C'est pourquoi ils s’approchèrent, mirent un genou en terre et lui baisèrent respectueusement la main. Les deux seigneurs eurent avec le roi un court entretien, puis ils retournèrent voir le roi de Navarre, l’infant don Enrique et les autres seigneurs de la coalition. Ceux-ci vinrent tour à tour faire la révérence au roi et l’accompagner jusqu’au palais. Le piège se refermait inexorablement sur le connétable. Don Juan n’était plus en mesure de lui assurer son soutien inconditionnel. Il ne pouvait plus rien pour lui. D’autant que la reine, son épouse, et le prince Henri, son fils, le pressèrent au nom de toute la faction du roi de Navarre de l’abandonner. Alors, le roi de Castille, acculé dans ses derniers retranchements, ordonna que tous les partisans d’Alvaro de Luna et tous les officiers de sa maison royale qui avaient été placés aux ordres de ce seigneur, quittent la cour.
313
On mit aussitôt en place une série de mesures pour en terminer avec tous les différends. Le roi Juan accepta tout, du moins en apparence. Il consentit même en accord avec le roi de Navarre de s’en tenir à ce que décideraient la reine, le prince et leurs partisans tant au sujet du connétable qu’à l’égard des gens de son parti. Il fut décrété que durant six années, Alvaro de Luna ne devrait, ni voir le roi, ni lui parler, ni même lui écrire, que ce soit en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers. Pendant ces années, il serait, en outre, assigné à résidence dans son château de la Coracera qu’il avait fait bâtir à San Martín de Valdeiglesias. Il lui fut, de plus, expressément défendu de se rendre dans une autre place à moins qu’il y eût dans l’une de celles-ci une maladie épidémique.3 Pour plus de sûreté, les mécontents exigèrent qu’il laisse en otage, don Juan, son fils aîné sous la surveillance du comte de Benavente. Enfin, pour en terminer avec cette liste exhaustive, il devait encore livrer aux personnes qu’on lui désignerait neuf forteresses dont il s’était rendu indûment propriétaire. Le roi, de plus en plus isolé, fut obligé de souscrire en tous points à ces exigences. Il était tombé sous la domination de ses plus grands ennemis, auxquels s’étaient ralliés la reine, sa propre épouse et son fils l’infant Henri. Les choses avaient été rondement menées, car nous étions à peine au lendemain de cette fatidique journée du 28 juin 1441. Le roi quitta Medina pour Valladolid, puis il se rendit à Burgos, où, abandonnant le connétable à son sort, il ordonna contre toute attente de grandes réjouissances. Cependant, comme on pouvait s’en douter, l’inépuisable connétable don Alvaro travaillait déjà secrètement à semer la discorde et à désunir ses terribles ennemis. Malgré les accords, il tenta de se ménager des correspondances avec son roi, puis avec le roi de Navarre et l’infant don Henri. Il envoya des missives séparées à ses destinataires, jeta le trouble entre eux et intrigua de nouveau. Mais son action fut dévoilée et cette fois-ci, ses ennemis jurèrent de l’abattre définitivement. Mais l’Histoire, qui possède des ressorts insoupçonnés en matière de revirements, repoussera cette perte à quelques années plus tard.
3
Ibid. Mr. d’HERMILLY, Histoire d’Espagne, Paris, 1751, tome VI, p. 484.
314
Que devenait le comte de Ribadeo au milieu de toutes ces intrigues ? Force est de constater que Rodrigue n’était plus très actif dans les campagnes guerrières. Peut-être était-il lassé. Peut-être aspirait-il à une sorte de repos intérieur. Peut-être sentait-il peser sur lui le poids des ans, car on le vit dans cette période s’attacher surtout au règlement de ses affaires personnelles. On sait seulement que le comte de Ribadeo n’apparaît jamais au côté du connétable dans ce conflit. Seule sa fidélité au roi de Castille fut retenue. Nous en avons pour preuve que dans le traité obligé auquel Juan II avait dû souscrire, il préserva les droits du comte de Ribadeo par une clause spéciale que les confédérés acceptèrent. Toute concession de terre faite depuis trois ans étant déclarée nulle, on convint néanmoins que la révocation n’atteindrait ni Rodrigue de Villandrando ni Diego Fernando de Quiñones, parce que tout ce qu’ils avaient reçu de la magnificence royale dans les derniers temps était considéré comme une compensation des nombreux services rendus à la couronne de Castille. Le jugement retint simplement que c’était Alvaro de Luna qui, en 1431, avait mis tout en œuvre pour rompre le pacte de non-agression qu’Alphonse d’Aragon avait pu contracter avec Rodrigue. Bien que le connétable, pour s’assurer les faveurs de Rodrigue, ait hâté la décision du roi Juan II dans la cession du comté de Ribadeo, on considéra que ce titre n’était nullement usurpé et il fut conservé à son détenteur.
315
LES DERNIERS COMBATS DU COMTE DE RIBADEO Du siège de Cuellar à la bataille d’Olmedo Après la victoire du parti des « mécontents », le roi Juan fut en quelque sorte assigné à résidence. Certes, il pouvait se déplacer, gérer les affaires du royaume, mais sous un contrôle de tous les instants. On le maintint ainsi dans une espèce d’esclavage honteux, en plaçant auprès de lui des gardiens permanents en la personne de grands seigneurs avec ordre de le surveiller et de ne jamais le laisser seul, sinon pour manger et dormir, afin qu’il ne pût parler à personne, sans qu’on sût ce qu’il aurait dit. On ne voulait pas, en effet, qu’il puisse établir le moindre contact avec son connétable. Le roi en souffrit beaucoup, aussi, dans les premiers mois de 1442, il décida de se plaindre aux représentants des États de Castille. Il convoqua pour cela les procureurs des provinces qui formaient le royaume de Castille. Ceux-ci se rendirent à l’est de Valladolid, jusqu’à la cité fortifiée de Toro, ville natale du souverain, qui déroulait ses imposantes murailles en forme d’éventail sur la rive droite du Duero. Quand ils furent assemblés, le roi leur exposa les tracas que lui causaient les « mécontents », par leur attitude insolente et leur refus d’obéissance. Malgré ces circonstances défavorables, l’inépuisable connétable entretenait toujours l’espoir d’un possible retour. Dans son entourage, on complotait encore. On découvrit que Pedro d’Acuña, seigneur de Dueñas, entretenait des correspondances secrètes avec des partisans d’Alvaro de Luna, pour tenter de le rétablir dans son crédit auprès du roi et le faire rappeler à la cour. Juan II fut contraint de faire arrêter et conduire le coupable au château de Dueñas, où on l’enferma, mais pour peu de temps… En 1443, un évènement fortuit allait ramener le roi auprès de son cher connétable. Alors que le souverain était à Tolède, doña Juana Pimentel, épouse d’Alvaro, accoucha d’une fille. Le connétable saisit 317
cette occasion. Il fit porter la bonne nouvelle sur le champ au roi et à la reine de Castille, qui se rendirent à Escaloña et acceptèrent de tenir l’enfant sur les fonts baptismaux. Nul ne pouvait s’opposer à une démarche qui s’inscrivait dans le respect des grands préceptes religieux. Cette visite provoqua une vive inquiétude au roi de Navarre et aux seigneurs de son parti. Ils comprirent que le connétable, malgré son absence forcée, avait toujours la même emprise sur l’esprit du roi. Le prince héritier don Henri, fils de Juan II, fut dans un premier temps, nous l’avons vu, attaché aux intérêts du roi de Navarre, contre le connétable. À Madrigal, le prince incita même son père à réunir le conseil pour demander l’exclusion de plusieurs nobles de son entourage que l’on accusait de machinations préjudiciables à la monarchie. En fait, ces gentilshommes étaient accusés d’une seule chose : avoir été placés à certains offices par le connétable. Juan II refusa tout d’abord de donner son assentiment à cette sorte d’épuration. Il savait bien que le prince agissait sur les conseils et la sollicitation du roi de Navarre. Pourtant, il y souscrivit à contrecœur pour ne pas provoquer de plus grands troubles dans le royaume. Ce fut alors une véritable chasse aux sorcières : Alfonso Pérez de Vivero, Ferdinand Yañes de Xerez, Pierre de Lujan et Alvaro de Braquemont furent arrêtés et mis à la disposition de deux seigneurs de la faction du roi de Navarre. C’est ainsi qu’on renvoya de la cour tous les officiers de la Maison du roi qui devaient leur situation à la bienveillance du connétable. Au cours de cette même année 1443, le Roi de Castille quitta Madrigal pour se rendre à Tordesillas, où il était toujours surveillé à vue, sur ordre du roi de Navarre. L’évêque d’Avila, en bon sujet, fut choqué par les agissements du prince don Henri envers son père. Le connétable, qui savait que tous les opposants du roi n’aspiraient qu’à sa ruine, n’entrevoyait plus de solution et pensait sérieusement à s’exiler au Portugal. Mais l’évêque d’Avila lui déconseilla de tenter une telle démarche parce qu’il lui soutint que dans peu de temps tout serait arrangé à l’avantage du roi et au sien. Le prélat avait, en effet, arraché au prince la promesse de tirer son père de la séquestration et de se rendre à Bonilla, afin de s’entretenir avec les « mécontents ». Le prince s’y rendit effectivement. Le connétable, malgré ses mises à l’écart successives, semble avoir été un acteur permanent sur la scène 318
politique, car il envoya d’Escaloña une personne de confiance pour remercier le prince. Il confia même à l’évêque et par écrit son analyse de la situation. Il pensait en effet que pour redonner la liberté au roi, le prince et le prélat n’avaient pas assez de troupes à opposer au roi de Navarre. Mais par quels artifices, le connétable, si malmené par ses opposants, avait-il pu reconquérir les faveurs du prince ? L’explication de cette curieuse et soudaine alliance avec don Henri est fort simple : Alvaro de Luna avait promis de lui donner, en contrepartie de la liberté du roi, rien de moins que les villes de Jaén en Andalousie, Cáceres en Extrémadure, Ciudad-Rodrigo et Logroño aux portes de la Navarre. Jusqu’alors, ni le prince ni l’évêque d’Avila n’avaient pu trouver l’occasion de parler en secret au roi. Mais, par l’intermédiaire d’un valet de chambre, le prélat fit dire au roi de l’envoyer quérir parce qu’il avait quelque chose d’important à lui communiquer. Le jour suivant, le roi fit donc appeler l’évêque d’Avila. Une fois dans la place, celui-ci attira confidentiellement le souverain à l’écart, dans un coin feutré de la pièce. Il lui fit savoir que le prince s’était réconcilié avec don Alvaro et qu’il était prêt à le tirer de ce mauvais pas. Le prélat adressa un dernier regard autour de lui comme pour s’assurer que personne ne puisse surprendre leur conversation, puis baissant d’un ton, il dévoila son plan à voix basse. Il fallait que le lendemain le roi feignît d’être indisposé et restât au lit, afin que le prince prenant ce prétexte puisse lui rendre visite, et l’instruise succinctement de ce dont il était convenu avec le connétable don Alvaro et de ce qui concernait sa libération. Cette médiation fut longue à mettre en œuvre et réussit après bien des péripéties. Le cardinal Cervantes, administrateur de l’évêché de Ségovie, avait été mis dans la confidence par l’évêque d’Avila. Il voulut bien assurer son concours dans cette libération. Le cardinal était alors à Mojados, dans sa résidence de campagne. Comme il était proche de Portillo, il allait parfois consoler le roi sans que son gardien, le comte de Castro, n’en prenne aucun ombrage. Le roi lui laissait entendre qu’il souhaitait ardemment sortir de l’oppression dans laquelle on le tenait. Le cardinal lui dit que puisqu’il avait la liberté d’aller chasser, il n’avait qu’à venir à Mojados, sous prétexte de dîner, et l’avertir du jour qu’il choisirait, et qu’il lui tiendrait des troupes prêtes à favoriser son évasion. Ce projet ainsi dévoilé, le 319
cardinal fit dire à plusieurs autres seigneurs de Valladolid de s’approcher de Mojados le plus discrètement possible, avec armes et escorte, pour prêter main-forte au roi le jour qu’il leur ferait savoir. De nombreux seigneurs qui avaient perdu leurs prérogatives, dans l’espoir de les recouvrer, saisirent cette occasion pour donner des preuves de leur fidélité. Au jour dit, le roi sortit de Portillo pour chasser, accompagné du comte de Castro qui somme toute s’avérait être un « geôlier » complaisant et respectueux. La partie de chasse terminée, celui-ci alla dîner avec le roi chez le cardinal. Le repas venait de se terminer quand on entendit dans l’antichambre un fracas d’armes suivi d’un bruit de pas pressés résonnant sur le dallage. Les seigneurs de Valladolid étaient dans la place et avaient investi le palais avec l’accord caché de l’évêque. Ils avaient ouvert violemment les portes derrière le comte de Castro, mais le roi les arrêta d’un simple geste de la main. Juan II se leva et, avec toute la dignité qu’il sied à un souverain, donna congé au comte de Castro, son gardien, l’engageant à retourner seul à Portillo. Il rajouta qu’en ce qui le concernait, il allait à Valladolid. Le comte de Castro, voyant qu’il n’avait pas d’autre parti à prendre, fit la révérence au roi et se retira avec sa troupe. Juan II fut immensément joyeux de rejoindre Valladolid avec le cardinal et en compagnie de ses libérateurs. La nouvelle se répandit. Aussitôt qu’il en fut informé, le comte de Ribadeo vint assurer le roi de son plus loyal soutien. D’autres seigneurs firent allégeance au souverain, lui promettant aide et appui. Le roi engagea une vigoureuse contre-attaque et alla s’emparer des possessions du roi de Navarre. Medina del Campo lui ouvrit ses portes, Olmedo l’appela. Juan II, après avoir pris ces deux places, s’engagea sur la route de Cuellar pour dresser le siège de la ville. Rodrigue l’accompagnait chevauchant à la tête d’une unité considérable. Le roi confia la conduite et l’organisation du siège de Cuellar au comte de Ribadeo. C’était là le témoignage d’une confiance extrême et de l’estime dans laquelle il tenait Rodrigue. De son côté, Juan II conduisit le reste de l’armée à Peñafiel, qu’il emporta de force, après un assaut de trois heures. Fort de ces victoires, le roi retourna à Burgos. Pendant qu’il était dans cette ville, le roi Alphonse d’Aragon (rappelons qu’Alphonse V était le frère du roi de Navarre et de l’infant don Enrique) envoya trois ambassadeurs pour tenter une médiation, 320
mais le roi de Castille répondit avec juste raison qu’il ne se prêterait jamais à aucun accommodement, à moins que le roi de Navarre ne s’engageât d’une manière solennelle, à ne plus remettre le pied en Castille, et à ne donner aucun secours à l’infant don Enrique, son frère. Les ambassadeurs s’en retournèrent porter la réponse à Alphonse V et lui tendirent cette ferme résolution scellée aux armes du roi de Castille. Jean II de Navarre chercha à se justifier, mais finit par promettre de ne plus rentrer dans le royaume de Castille. Le rapport de forces avait basculé. Le roi de Navarre proposa une suspension générale des hostilités, pour jeter les bases d’une paix durable. Mais Juan II qui avait eu à souffrir pendant plusieurs années du régime de la séquestration, se défia de l’esprit turbulent du Navarrais et ne voulut se prêter à rien. Il avait raison, car en 1445, le roi de Castille fut averti que le roi de Navarre rassemblait des troupes avec le dessein de rentrer à nouveau sur ses terres. Et nous voilà retournés quelques années en arrière avec le même scénario et les mêmes acteurs. Appuyé par son frère l’infant don Enrique, le roi de Navarre s’empara à nouveau de nombreuses places en Castille. Comme il comptait encore un grand nombre de partisans à Olmedo, il poussa ses troupes jusqu’à cette ville dont il s’empara facilement. De son côté, le connétable Alvaro avait profité de la situation pour sortir de sa retraite forcée et revenir exercer son ministère d’État auprès de Juan II. Alors, tout recommença. Mêmes maux, mêmes remèdes. Le roi de Navarre envoya encore un médiateur prier le roi de Castille de bien vouloir écouter les mécontents en éloignant d’auprès sa personne le connétable don Alvaro, afin de les délivrer de sa tyrannie, promettant en cas de refus que sa majesté ne pourrait s’en prendre qu’à elle-même de tous les désordres et les maux qui suivraient. Mais une simple anecdote allait rendre bientôt le combat décisif. Le 19 mai 1445, le prince héritier de Castille monta à cheval et alla, pour se divertir, avec une compagnie de chevaux légers, voltiger dans la campagne proche d’Olmedo. Il s’agissait là néanmoins d’une sorte de provocation à l’égard des mécontents qui occupaient la ville. Don Rodrigue Manrique sortit aussitôt de la place à la tête d’un nombre équivalent de chevaux légers, soutenus par quelques lances et marcha droit sur lui. Le prince prit le parti de se retirer, et Manrique, après lui avoir donné la chasse, retourna dans la ville. 321
Juan II, fort irrité par cette audace, fit aussitôt sortir son étendard et alla avec ses troupes en ordre de bataille se présenter devant Olmedo. Le comte de Ribadeo était avec lui. Après avoir longtemps attendu les ennemis, qui restèrent étonnamment silencieux derrière les remparts, il ramena son armée. Que d’énergie dépensée pour rien ! Mais il s’agissait en fait d’une manœuvre orchestrée par les mécontents. Il restait à peine deux heures de jour, quand on vit sortir d’Olmedo en bon ordre, le roi de Navarre, l’infant don Enrique, le comte de Benavente, Pedro de Quiñones et les autres seigneurs de leur parti. Un observateur rejoignit Juan II au galop de son cheval pour l’avertir que l’armée ennemie marchait dans son dos pour le prendre à revers. Le roi fit aussitôt faire volte-face à ses hommes. Son armée était imposante. Il y avait là, au commandement de l’aile droite, le prince Henri avec ses hommes d’armes. À l’aile gauche, le connétable conduisait une unité composée de soldats d’élite. Au centre, un peu en arrière entre ces deux corps, était placé le gros des troupes que le roi commandait en personne, avec le comte de Ribadeo. Cette disposition rappelait étrangement la tactique employée bien des années auparavant à la bataille d’Anthon. Curieuse similitude. Si pour ses derniers combats Rodrigue semblait se contenter d’un rôle secondaire, il est probable que le roi lui donna encore la possibilité de communiquer sa science militaire et sa solide expérience des combats. Nul doute que le roi de Castille dut se référer plus d’une fois à lui pour conduire la bataille. Dès qu’on eut donné le signal du combat, les troupes du prince chargèrent celles qui étaient commandées par le roi de Navarre et le comte de Castro. Sur l’aile opposée, les gens de don Alvaro fondirent sur l’unité commandée par l’infant d’Aragon. Au premier choc, on montra beaucoup d’ardeur de part et d’autre. Puis, le bataillon central se mit en marche et le mouvement de tenaille qui avait si souvent réussi au comte de Ribadeo commença à produire ses effets. Les « mécontents » commencèrent à lâcher prise de toutes parts. Alors, le roi de Castille fit avancer ses gens de pied, qui achevèrent d’enfoncer l’armée ennemie déjà en déroute sur ses flancs. Les rebelles furent taillés en pièces et les débris de leur armée jonchaient le sol environné de poussière. Ceux qui avaient la vie sauve s’enfuirent à toute bride, tandis que les malheureux fantassins firent le plus gros des frais de la charge royale. Un grand nombre de combattants étaient étendus raides sur le champ de bataille, plus de deux cents furent faits prisonniers. On prit les étendards de l’infant
322
don Enrique, du comte de Benavente, de Manrique et de bien d’autres seigneurs encore. Le roi de Navarre et l’infant don Enrique eurent à peine le temps de se retirer à Olmedo, avec tous ceux qu’ils purent rallier. Enrique était blessé à une main. Une vilaine et large blessure par laquelle s’écoulait beaucoup de sang.Vers le milieu de la nuit, les deux frères sortirent furtivement et réussirent à déjouer la surveillance, en prenant par Atienza la route d’Aragon. Mais l’infant souffrait énormément, il continuait à perdre son sang et malgré les pansements de fortune, il semblait s’affaiblir d’heure en heure. La gangrène lui rongeait la main1. Quand ils arrivèrent à la forteresse de Daroca, lieu stratégique de défense d’Aragon, surnommé « la porte de fer », Enrique respirait à peine et n’était plus que l’ombre de lui-même. Il rendit le dernier soupir en entrant dans cette ville. Après la victoire, le roi de Castille ordonna de répandre la nouvelle dans toutes les villes. Elle fut célébrée par de grandes réjouissances publiques. Afin d’en perpétuer la mémoire, Juan II fit bâtir sur la colline où eut lieu la bataille une chapelle sous l’invocation du Saint-Esprit. Il y attacha même des revenus pour assurer la subsistance de quelques ermites.2 La dernière bataille du comte de Ribadeo eut lieu en 1446, au siège d’Atienza3, place forte située entre Madrid et Soria. L’inexpugnable forteresse d’Atienza, véritable nid d’aigle perché sur un piton rocheux, était un passage obligé sur la route d’Aragon. Elle entretenait encore une dernière garnison de factieux à la solde des ennemis du roi de Castille. Désirant pousser l’avantage jusqu’au bout et en terminer enfin avec ses infatigables opposants, le connétable Alvaro de Luna poussa le roi à en entreprendre le siège. Mais l’entreprise s’avérait extrêmement difficile en raison de la situation du château et de la force des détachements qui l’occupaient. Juan II s’y rendit donc avec ses troupes en compagnie du comte de Ribadeo. On dressa, face aux 1
Cristina HERNANDO POLO, Isabel la Católica, Grandeza, carácter y poder, Nowtilus pocket Madrid, 2011, p. 49. 2 Ibid. Mr. d’HERMILLY, Histoire générale d’Espagne, Paris, 1751, tome VI, p. 492 et suivantes. 3 Ibid. Jules QUICHERAT, 1879, p. 199.
323
murailles, des machines de guerre que l’on avait fait venir de Soria. Puis, on commença à battre le château, mais cette tentative resta sans effet à cause de l’élévation de la forteresse. Alors, on mina la muraille de la ville qui s’étendait au-dessous. Le 12 août 1446, le roi pénétrait dans la dernière cité s’opposant encore à son pouvoir. Le lendemain, par mesure stratégique, il fit mettre le feu à quelques maisons et abattre une grande partie de la muraille.4 Quel fut le rôle de Rodrigue, lors de ce siège ? Les chroniques mentionnent seulement sa présence. Il est probable que son action fut celle d’un conseiller stratégique, en dehors de tout engagement physique, car le temps continuait sa marche inexorable. Le comte de Ribadeo venait d’avoir cinquante-huit ans. Pour le Connétable, les ennuis semblaient terminés, du moins en apparence, car après ces succès militaires et l’élimination de la faction des infants d’Aragon, une nouvelle coalition de puissants s’organisait à nouveau, conduite cette fois par le prince héritier en personne et son « privado » don Juan Pacheco5. Ce nouveau favori rêvait depuis longtemps d’éliminer Alvaro de Luna pour étendre une emprise identique auprès du prince héritier. Simple changement de génération ! Pour un même combat personnel avec une même ambition. Il y parviendra quelques années plus tard, ce qui conduira le connétable sur les marches de l’échafaud.
4
Ibid. Mr. d’HERMILLY, tome VI, p. 553. Raphael CARRASCO, L’Espagne au temps des Validos, Presses universitaires du Mirail, Université de Toulouse, 2009, p. 53. 5
324
LA CHUTE D’ALVARO DE LUNA À compter de son retour vers sa terre d’origine, l’histoire du comte de Ribadeo est étroitement liée à celle de la cour de Castille et cela pour plusieurs raisons. Son engagement personnel l’avait tout d’abord conduit vers le connétable, qui le porta en grande recommandation auprès du roi. On sait que l’inclinaison de Rodrigue l’entraîna plus sur les champs de bataille que dans les intrigues de cour. Et pourtant, c’est bien à la cour qu’apparaît un lien indirect entre le comte de Ribadeo et la chute d’Alvaro de Luna. Devenu veuf, Rodrigue, nous l’avons vu, fit une alliance remarquable en contractant un mariage dans la puissante maison de Zuñiga avec doña Beatriz, fille du seigneur de Monterrey en Galice. Doña Beatriz était la confidente de la reine Isabelle de Portugal, deuxième épouse de Juan II1. Les deux femmes jouèrent un rôle de premier plan dans la déchéance du connétable. Dans les troubles de cette première moitié du XVe siècle, Alvaro de Luna incarne, nous venons de le voir, la figure achevée du favori sur fond de révolte des princes, de guerre civile, de volonté de puissance, et d’abominables secrets d’alcôve. Personnalité brillante et complexe, il domina la vie politique castillane pendant plus de trente ans. Il exerça un incroyable ascendant sur la personnalité du roi et leur relation demeure étrange sinon ambiguë pour bien des historiens. Pour en comprendre les raisons cachées, il faut remonter à l’enfance commune aux deux hommes. Alvaro de Luna fut introduit en 1408 en tant que Doncel (Damoiseau) du roi Juan qui n’avait pour lors que trois ans. Alvaro était son aîné de treize ans. Pour ce garçon pétri d’ambition, il fut sans doute relativement facile de dominer et de pénétrer le cœur d’un tout jeune enfant déjà fragilisé par son éducation. Alvaro de Luna fit beaucoup d’efforts pour se faire connaître de tous les grands et les petits à la cour du roi de Castille, puis il s’attacha aux fils des plus nobles chevaliers et des plus grands personnages qui y vivaient, et de 1
Juan II et Isabelle de Portugal sont les parents d’Isabelle 1re de Castille dite Isabelle la catholique (1451-1504).
325
ceux qui à son avis étaient les mieux éduqués et avaient les meilleures manières”, nous dit son chroniqueur, qui ajoute qu’« il se comportait avec eux de telle façon, et avait si gracieuse et si douce conversation bien qu’il fût encore petit, qu’en peu de temps il gagna l’amour et les cœurs de tous ceux qui étaient importants, et dans toutes les fêtes et les danses et les jeux d’enfant il était si gracieux et à l’aise que tous l’appréciaient beaucoup et voulaient lui ressembler, et tous le suivaient et ne voulaient pas le quitter.2 Il devint donc l’intime d’un Juan II, peu doué pour l’exercice du pouvoir et que l’histoire a considéré avec peu d’indulgence. Le roi ne pouvait se passer de son favori, estaba fascinado, commente un chroniqueur, relation exclusive, car on prêtait à cet homme d’étranges pouvoirs lui permettant de soumettre la volonté du roi. Don Alvaro entreprend en s’appuyant sur les villes, autrement dit les bourgeois souvent d’origine judéo-converse, de raffermir le trône et de restaurer le prestige et l’autorité du monarque face à une noblesse territoriale rendue très puissante par les « mercedes enriqueñas » et qui entend gouverner. Les fameuses mercedes enriqueñas qui, à la fin du XIVe siècle, récompensaient ceux qui avaient aidé les Trastamare à renverser Pierre le Cruel. C’est alors que se fondèrent quelques-unes des grandes maisons nobiliaires de Castille qui vont disputer au souverain, une partie du pouvoir. Pour s’attacher des partisans, les rois sont donc amenés à aliéner une partie du patrimoine de la couronne : ils cèdent villes et domaines qui viennent renforcer les fiefs déjà existants.3 Deux mariages Juan II perdit sa femme Marie d’Aragon à la fin de février 1445. Le roi l’avait peu regrettée, car dans toutes les circonstances elle s’était montrée plus dévouée aux infants d’Aragon, ses frères, qu’à la cause de son mari4. Deux ans plus tard, le 14 août 1447, Alvaro « remaria » Juan II avec Isabelle de Portugal, malgré la résistance du 2
Ibid. Adeline RUCQUOI, La chute d’Alvaro de Luna, cahiers du CNRS, Paris, p. 1. 3 Ibid. Raphael CARRASCO, L’Espagne au temps des Validos, Toulouse, 2009, p. 53. 4 Joseph Adrien Félix LAVALLEE, Espagne, Firmin Didot, Paris 1864, Vol. 1, p. 432.
326
roi, épris d’une princesse française, Radegonde, fille de Charles VII. Il n’osait faire autre chose, sinon ce que voulait le connétable, et ainsi se conclut ce mariage.5 Cette princesse avait été choisie « secrètement » par le maître de Santiago qui considérait que l’alliance avec le pays voisin était importante pour la Castille, ce qui est certainement vrai. Mais en réalité, le connétable avait considéré aussi, pour sa propre sécurité, qu’il était important de s’appuyer sur un pays ami, d’où il pouvait espérer du secours, ou encore en cas de besoin se ménager une retraite assurée. Mais c’était sans compter avec les yeux de l’amour, car à la vue de sa future épouse qui était beaucoup plus jeune que lui, le roi fut tout simplement charmé. La jeune princesse gagna bientôt le cœur de son époux et le roi gagna à son tour une confidente. Il s’ouvrit sur les griefs qu’il nourrissait à l’encontre de son connétable. Dès ce jour, Juan II sembla le haïr secrètement, tout en tremblant devant lui. Ainsi, le calcul du connétable se retournait contre lui. Voulu et exigé par lui, ce mariage fut en fait à l’origine de la distance qui se créa entre le roi et son « privado ». Il faut dire que la relation étroite de « privauté » qu’il avait avec son favori durait depuis près de quarante ans. Dès la majorité du roi, comme nous l’avons évoqué, Álvaro de Luna gouvernait en son nom, l’obligeait à prendre des décisions politiques, militaires ou même personnelles, organisait ses loisirs et dirigeait sa vie. Au lendemain de la bataille d’Olmedo où nous avons vu la victoire du « parti royal » sur la ligue nobiliaire, le monarque semblait nourrir envers son connétable quelque étrange rancœur. Sincèrement épris de la jeune Isabelle de Portugal, il aurait trouvé en elle une alliée qui prit rapidement son parti et organisa, en compagnie de Beatriz de Zuñiga, comtesse de Ribadeo, la chute du favori.6
5
Ibíd. PEREZ de GUZMAN Fernán, Crónica del rey D. Juan II, Valencia, 1779, p. 499. 6 Ibíd. Adeline RUCQUOI, Note p. 20 : Crónicas de los Reyes de Castilla, tome II, p. 654 : “E como el Rey Don Juan ya tuviese gran desamor al Maestre de Santiago, como quiera que lo encobría con gran saber e sagacidad, e como amase mucho a la Reyna Doña Isabel, habló con ella como su voluntad era de prender al Maestre de Santiago por muchos y muy grandes deservicios que le había hecho”.
327
La chute d’Alvaro de Luna Beatriz de Zuñiga était en grande autorité auprès de la reine et toutes deux éprouvaient souvent de grands agacements à l’égard du connétable. Alvaro de Luna commit une seconde erreur. Rappelons que la reine Isabelle était portugaise, aussi finit-elle par l’avoir tout à fait en aversion lorsqu’elle sut qu’il donnait des conseils au roi, son mari, contre l’extension des établissements portugais sur la côte d’Afrique.7 Cela se passait dans la période faste pour le connétable, car il avait réussi à mettre sous sa domination obligée une grande partie de la noblesse. Il était un noble, cependant, qui ne s’était pas plié à ses exigences et qui lui était resté profondément hostile : Pedro de Zuñiga, comte de Ledesma et Plasencia. La jeune épouse de Rodrigue était la nièce de ce seigneur, et c’est par son entremise que la reine échangea ses ressentiments et complota avec lui. En 1449, troubles et séditions recommencèrent en Castille. Tolède se souleva contre don Alvaro, sous prétexte de défendre ses privilèges. Deux ans plus tard, le bruit courait que don Alvaro était impliqué dans la mort de la précédente souveraine María d’Aragon8. Les évènements se succédèrent rapidement. Le connétable sentit le vent tourner. Afin d’échapper aux intrigues, il donna l’ordre à la cour, qui était à Valladolid de se rendre à Burgos La reine comprit alors qu’il fallait brusquer le dénouement. Elle obtint, ou peut-être contrefit, une lettre à l’adresse du comte de Plasencia dans laquelle le roi se plaignait de la tyrannie de son connétable et assurait de sa reconnaissance le sujet fidèle qui l’en délivrerait. Cette lettre contenait des instructions pour agir en conséquence. Elle fut confiée à la comtesse de Ribadeo, qui s’échappa dans le plus grand mystère alors que la cour quittait Valladolid. Beatriz arriva au château de Bejar, résidence de son oncle, dans la nuit du 12 avril 1453. Là, elle expliqua longuement la raison de sa venue. Et quand enfin elle se tut, la nuit était déjà fort avancée, il était deux heures du matin. Le vieil homme regarda sa nièce en silence, longuement, intensément, puis il ordonna que l’on aille 7
BIBLIOTHEQUE DE L’ECOLE DES CHARTES, Libraire J. B. Dumoulin, Paris, 1844, note 4, p. 227, Histoire du connétable de Lune, Paris, 1720. p. 308. 8 Cristina HERNANDO POLO, Isabel la Católica, Grandeza, carácter y poder, Nowtilus pocket Madrid, 2011, p. 15.
328
chercher son fils aîné, Alvaro de Zuñiga. Le comte lui montra la lettre du roi et lui dit d’une voix grave : « Mon fils, si j’étais libre de mes mains, je ne cèderais à personne la gloire ni le danger de cette entreprise. Mais puisque Dieu le ToutPuissant a éteint la force de mon corps, je ne puis mieux montrer l’affection que j’ai au service du roi, mon souverain seigneur, qu’en exposant la vie de mon premier-né pour que son plaisir soit accompli. Allez donc, faites de votre mieux comme il convient à un loyal chevalier, et que l’étoile qui guida les rois vous conduise ».9 Le Vendredi saint 1453, le favori, aux abois, fit assassiner Alonso Pérez de Vivero, grand trésorier de Castille, qu'il soupçonnait d'avoir conseillé au roi de lui retirer le pouvoir. Cet acte signa son propre arrêt de mort. Revenu à Valladolid, le roi ordonna de prononcer la sentence contre le connétable. Les jurisconsultes et les seigneurs de son conseil s’étant assemblés, condamnèrent tous d’une commune voix le Grand Maître à mort, et déclarèrent tous ses biens et revenus confisqués. La sentence confirmée, le roi ordonna sa mise en œuvre. Don Diego de Zuñiga fut chargé d’amener le grand Maître don Alvaro avec bonne escorte, de Portillo à Valladolid. Deux religieux du couvent de l’Abrojo, dont Alfonso d’Espina, professeur en théologie, allèrent à sa rencontre, afin de le préparer au terrible sort qui l’attendait à Valladolid. Les deux religieux s’acquittèrent de leur mission avec tant de zèle et de prudence, que le Grand Maître arriva à cette ville, parfaitement instruit qu’il allait être condamné à mourir ; de sorte qu’il commença à se disposer à la mort en parfait chrétien, par un grand repentir de ses fautes. Arrivé dans la cité royale, il fut logé dans l’hôtel particulier d’Alfonso de Zuñiga. Il savait qu’il devait être conduit au supplice le jour suivant. Il resta en prières une grande partie de la nuit. Au petit matin, il fit une confession générale à Alfonso d’Epina, qui l’aida de son mieux à se préparer en chrétien pour un si terrible passage.10 Avant de partir dans ce matin blafard du 2 juin 1453, le Grand Maître se sentant un peu faible demanda quelques cerises et un verre de vin. Au même moment, le roi fut en proie à une crise de désespoir. Torturé par le souvenir du connétable, hanté par son image et la 9
Ibid. Jules QUICHERAT, note p. 200, d’après Fernán Perez de Guzman, p. 557. Ibid. Mr. d’HERMILLY, Histoire d’Espagne, Paris, 1751, Tome VI, p. 627.
10
329
fidélité qu’il lui avait toujours témoignée, le roi appela deux fois Solis, son Grand Maître des Cérémonies et lui donna un papier cacheté à l’adresse de don Alfonso de Zuñiga. Puis il se ravisa, le rappela en lui disant : « Non, non, laissez là, laissez là», après quoi il se jeta en larmes sur son lit. De son côté, la reine avertie de l’agitation du roi fit tout ce qu’elle put pour l’empêcher d’arrêter l’exécution de la sentence. Le Grand Maître partit donc de la maison pour l’échafaud entouré par les deux religieux qui ne l’avaient pas quitté. Sur son passage, un de ses pages appelé Morales pleurait amèrement la triste fin de son maître. Le connétable retira un anneau qu’il avait au doigt, et le lui donna comme le dernier témoignage de son amitié. Le malheureux fut conduit au supplice sur une mule, précédé de crieurs qui proclamaient la sentence royale. Une foule innombrable se pressait au pied de l’échafaud. Mais en voyant arriver le supplicié, un long murmure empreint de sentiments contradictoires parcourut l’assistance. Était-ce là une justice équitable ou une justice partisane ? Le connétable monta sur l’échafaud et s’agenouilla devant la croix. Le bourreau voulut lui lier les mains avec une corde. Mais Alvaro de Luna le devança et tira de sa chemise un ruban qu’il lui donna pour l’attacher. Il se coucha ensuite sur un drap noir. Le bourreau, pour abréger ses souffrances, lui plongea un couteau dans la gorge. Et quand il fut mort, l’exécuteur lui trancha la tête et l’exposa à la vue du peuple, pendue à un crochet de fer qui avait été fixé à cet effet sur un morceau de bois11. Elle y resta neuf jours durant. Son corps resta trois jours sur l’échafaud avant d’être porté à l’église de Saint André, pour être enterré dans la fosse commune réservée aux malfaiteurs.12 Quelques années plus tard, sa famille désirant réhabiliter sa mémoire fera transporter ses restes dans la cathédrale de Tolède13. Le roi ne se remit point de la mort de son connétable. L’étrange relation fusionnelle qu’il avait entretenue avec son favori ne put jamais s’effacer. Il fut pris de troubles, effrayé par sa propre responsabilité dans la sentence qui conduisit son cher connétable sur les marches de 11
Ibid. Mr. d’HERMILLY, tome VI, p. 629. Ibíd. Cristina HERNANDO POLO, Isabel la Católica, Grandeza, carácter y poder, Madrid, 2011, p. 50. 13 Voir dans cet ouvrage, Données historiques complémentaires, annexe 14, p. 370. 12
330
l’échafaud. Juan II ne survit que de peu à sa disparition. Il s’éteignit un an après à Valladolid, le 20 juillet 1454, en proie à d’horribles tourments. Quant à Rodrigue, il ne connut pas le terrible dénouement qui venait de frapper d’une manière si cruelle son bienfaiteur et ami. À la mort du connétable, il avait quitté ce bas monde depuis cinq années déjà.
331
VALLADOLID Monasterio de la Merced 14 Avril 1448 Ayant combattu jusqu’au bout de ses forces, des terres de France jusqu’au sol Castille, après avoir dirigé des affaires considérables, après avoir traversé la rudesse d’un siècle implacable, le comte de Ribadeo s’était retiré des réalités temporelles de ce monde vers la fin de l’année 1446. Dans le monastère de la Merced à Valladolid qu’il avait fait reconstruire à ses frais, seuls les murs de la grande nef de l’église pouvaient encore entendre le chuchotement de ses prières. Accrochée sur le fond de la chapelle qui lui faisait maintenant face se déroulait une bannière rouge et noire rehaussée d’un soleil d’or. Ces armes n’étaient pas les siennes, mais celles de Louis II de Chalon, prince d’Orange. Pourquoi étaient-elles donc exposées ici ? En vérité, ces armoiries n’avaient jamais quitté le comte de Ribadeo, car elles lui avaient ouvert un jour le chemin vers la fortune et la gloire. Elles symbolisaient à elles seules la fabuleuse victoire d’Anthon sans laquelle le destin des Valois aurait basculé devant la coalition anglobourguignonne. La terre de France ne serait plus et Charles VII aurait perdu son royaume. Rodrigue de Villandrando regarda longuement ce pennon de tissus qui semblait percer la pénombre de ses tons lumineux, puis il fit le signe de croix et s’agenouilla pour entrer en prière. Il voulait mettre le temps à profit en accumulant sur le peu qui lui restait à vivre toutes les rigueurs possibles, toutes les œuvres capables de lui faire trouver grâce devant Dieu. Il souhaitait ainsi s’acheminer vers l’éternité par la prière, le jeûne et la contrition. Son visage, durement marqué par les épreuves d’une vie tumultueuse, semblait cependant dégager toujours cette force incroyable et cette volonté implacable qui l’avaient accompagné tout au long de sa vie.
333
Le 14 avril 1448, le comte de Ribadeo fut pris de malaise et gagna sa chambre. Il fit appeler son notaire afin d’ajouter un codicille à son testament. Le magistrat confirma dans le document qu’il avait recueilli les dernières volontés du testateur alors que celui-ci était alité, puisque le notaire apposa au bas du document la mention : acostado en cama. Rodrigue de Villandrando s’éteignit peu après. Le 12 juin suivant, confirmant le décès, le notaire ajouta à la mention de son nom « Dieu ait pitié » Dans la froideur et la solitude de ce jour, Rodrigue de Villandrando, comte de Ribadeo, Grand de Castille, maréchal des Asturies, et en son temps capitaine de compagnie, allié à la maison de France, écuyer de l’Écurie royale, conseiller et chambellan du roi de France, seigneur de Pusignan, de Talmont, de vingt-sept places de ce royaume, venait de s’éteindre. Il était âgé de soixante ans. Il fut enterré selon son souhait dans la chapelle familiale de l’église de la Merced, auprès de son grand-père el caballero del orden de la Banda, sous une simple dalle de pierre avec son seul nom gravé dessus.
334
ANNEXES DONNEES HISTORIQUES COMPLEMENTAIRES
Annexe 1 LA FRANCE DE RODRIGUE
-21 Carte F. Monatte. 1 : Prise de Paris, 1418. 2 : Siège de Villeneuve le Roi, 1421. 3 : Le sac de Tournus, 1422. 4 : Prise de Cuffy, 1424. 5 : Le désastre de Verneuil, 1424. 6 : Le repaire de Génolhac, 1428. 7 : La bataille d’Anthon, 1430. 8 : La capitulation d’Orange, 1430. 9 : Croisade contre les hussites Forez, Velay, 1431. 10 : Différend noblesse clergé Le Puy/Velay, 1431. 11 : Estuaire de la Gironde Talmont, 1431. 12 : Le siège de Lagny, 1432. 13 : La détrousse des Ponts-de-Cé, 1432.
336
15 : « l’affaire » du cardinal Carrillo, Avignon, 1433. 16 : Le Mont Saint-Vincent, 1433. 17 : La place forte de Charlieu, 1433/1436. 18 : Limoges, 1435. 19 : Tours, 1432/1435. 20 : Conférence du mont Lozère, 1435. 21 : La guerre des deux évêques, Albi, 1436. 22 : Épisode de Cordes, 1437. 23 : Le conciliabule d’Angers, 1437. 24 : La détrousse d’Hérisson, 1437. 25 : La rencontre avec Huntingdon, 1438. 26 : Siège de Bordeaux, 1438. 27 : Châtillon en Couserans, 1438.
Annexe 2 L’ESPAGNE DE RODRIGUE
- 22 La péninsule Ibérique. Avant la création du royaume espagnol par les Rois Catholiques. Carte. F. Monatte.
337
Annexe 3 L’EUROPE DE RODRIGUE
Les puissances du bassin méditerranéen
- 23 Carte F. Monatte.
338
Annexe 4 LA MAISON DE VILLANDRANDO Don Juan Garcia Gutierrez de Villandrando - Seigneur de Villandrando, Chevalier del « orden de la Banda » Marié avec Doña Thérèse de Villaines - Sœur de Pierre de Villaines, comte de Ribadeo Par donation d’Henri II de Castille en 1369
Don Ruy García de Villandrando - Seigneur de Villandrando y Fuensaldaña - Regidor de Valladolid de 1399 à 1401 Marié avec
Armes des Villandrando D’après don Francisco Lanza Alvarez.
Don Pedro Garcia de Villandrando - Seigneur de Bambiella + 1400 Marié avec Doña Aldonza Díaz de Corral + 1390
Doña Maria Rodriguez Osorio Doña Beatriz Don Rodrigo de Garcia de Villandrando (I) Villandrando (Né en 1388 + 1448) Mariée avec Troisième comte de Don Juan de Ribadeo (1), Perea Maréchal des Comte de Asturies et Santisteban, seigneur de la Regidor de Pobla de Valladolid Navia y Coto + 1490 de Pereiras Costeiras con 150 vasallos en Lourenza
Pedro de Corral (Né entre 1380 et 1390) Écrivain auteur de la « Crónica sarracina» ou « Crónica del rey don Rodrigo » Émissaire pour son frère auprès du roi d’Aragon en 1431.
Doña Maria de Villandrando Mariée à Palencia avec Don Juan Sarmiento - Comte de Ayala, Comendador de Santiago
Un quatrième enfant mâle serait né de cette union (Mentionné sans autre précision par Joseph Pellizer )
339
Marié en 1res noces en 1433 avec
Marié en 2es noces en 1441 avec
Marguerite de Bourbon (II) + 1436 Fille naturelle du duc Jean 1er de Bourbon
Doña Beatriz de Zuñiga
Charles de Villandrando Héritier des biens paternels en France
Doña Isabelle de Bourbon Mariée avec Don Lorenzo Suarez de Mendoza Comte de Coruña
Doña Maria de Bourbon Religieuse
Doña Marina de Villandrando -Camarera Mayor de la Reina Doña Juana de Castilla dotée de 10 000 florins d’or Marié avec Don Diego Sarmiento Deuxième Comte de Salinas
Don Diego Sarmiento de Villandrando (IV) Cinquième comte de Ribadeo et comte de Salinas, de Coruña. Héritier en 1512 par son oncle de la faveur royale accordée à Rodrigue par Juan II de manger à la table royale et de recevoir les habits portés par le roi chaque année le jour de l’Épiphanie. + 1518.
340
Sebastián de Villandrando (III) Fils illégitime
Don Pedro de Villandrando y Zúñiga + 1516 Quatrième Comte de Ribadeo, seigneur de Navia. Héritier par son père de la faveur royale accordée par Juan II de manger à la table royale et de revêtir les habits du roi chaque année le jour de l’Épiphanie Marié avec Doña Leonor Rodríguez
Don Rodrigo de Villandrando - Bien que son père déclara dans son testament qu’il était légitimement marié à la naissance de son fils, Don Rodrigo fut tenu pour bâtard. À sa mort, les comtés de Coruña et Salinas furent mis en litige ainsi que le comté de Ribadeo. Tous ces titres revinrent à son cousin. Mort sans postérité.
Doña María de Villandrando Mariée avec Don Fernando Enríquez de la Carrera - Seigneur de Villaverde de Arcayos.
-I Rodrigue de Villandrando est le troisième comte de Ribadeo : - Le premier comte, nous l’avons vu, fut Pierre de Villaines, grand oncle de Rodrigue qui reçut le comté en 1369, en récompense de son engagement dans la conquête de la couronne de Castille par Henri de Trastamare. Le premier comte de Ribadeo vécut quelques années dans la péninsule avant de revendre son comté au plus offrant. - Le second comte de Ribadeo fut Ruy López de Avalos, connétable de Castille à Murcie, qui se porta acquéreur des terres et du titre pour cent mille maravédis. Mais López de Avalos, accusé de soutien au royaume de Grenade et de complot contre le jeune roi Juan II, fut déchu de ses titres et dépossédé du comté qui revint à la couronne de Castille. - Le troisième comte est donc Rodrigue de Villandrando. Trois ans après la mort de López de Avalos, le 22 décembre 1431, Juan II signa à Zamora un acte offrant la concession et le titre de Comte de Ribadeo à Rodrigue de Villandrando. - II Les enfants de Marguerite de Bourbon furent au nombre de trois : un fils Charles et deux filles, Isabelle et Marie. Jules Quicherat, qui ne connaissait que la mention d’un legs de très médiocre importance fait par Rodrigue à ce fils, avait supposé ce dernier diminué mentalement : « il faut qu’il ait été contrefait ou idiot, car son père le laissa en France et le déshérita ». Or, le texte du testament ne confirme pas cette hypothèse. Rodrigue, il est vrai, n’emmena pas le fils de Marguerite en Espagne, mais il ne le déshérita point. Charles de Villandrando au contraire recueillit toute la partie de l’héritage paternel situé en France, à l’exception de certaines créances sur le comte de Foix et d’une somme de cinq mille doubles dues à Rodrigue par la ville d’Avignon. Ces sommes ont probablement constitué la dot d’Isabelle, mariée en Espagne à don Lorenzo Suarez de Mendoza. La fille cadette, religieuse au monastère de San Quirse de Valladolid, ne reçut aucune part des biens sis en France, mais son père assura son entretien sur d’autres biens qu’il possédait à Valladolid. Pour ce qui concerne la rentrée de Rodrigue en Espagne en 1439, A. Fabié doute que Marguerite de Bourbon ait accompagné son mari en Castille et ne voit pas sur quoi a pu s’appuyer Quicherat pour écrire : « Marguerite de Bourbon n’avait pas longtemps vécu en Espagne où elle était allée s’établir avec son mari ». Tout porte à croire en effet que la première femme de Rodrigue mourut en France trois ans plus tôt. Alfonso de Palencia dit expressément : « jam viduatus uxore, exercitum in hispaniam duxit », etc., et comme aucune mention n’est faite de Marguerite dans les documents espagnols de l’époque, ce chroniqueur doit être dans le vrai.1 D’autre part, à l’appui de ceci, les dates de la mort de Marguerite et celle du retour en Espagne de Rodrigue ne coïncident pas. Rodrigue serait entré en Espagne bien après la mort de sa femme. Jules Quicherat cite un acte selon lequel elle était vivante encore le 2 août 14362. Il est probable que le décès de Marguerite soit intervenu vers la fin de l’année 1436 ou au tout début de 1437.
1 Alfred MOREL FATIO, Don Rodrigo de Villandrando, conde de Ribadeo por don Antonio Maria Fabié, Bibliothèque de l’École des Chartes, 1884, Vol. 45, pp. 372 à 376. 2 QUICHERAT, 1879, Pièce justificative n° XLI.
341
- III Sebastián de Villandrando, fils illégitime du comte de Ribadeo don Rodrigo de Villandrando, se maria avec la fille d’un avocat de La Cadena, célèbre conseiller de don Enrique « el franco ». De cette union naquit une fille unique, mariée à Alvaro Gómez de Sotomayor, fils de doña Maria Mejia et petit-fils de Pedro Gómez, ambassadeur de Tamorlan.3 - IV Don Diego Sarmiento de Villandrando, petit-fils de Rodrigue, épousa en 1484 doña Maria de Ulloa y Castilla, camarera Mayor de la Reina doña Juana de Castilla. De cette union naquit Don Diego Gómez Sarmiento de Villandrando, mort en 1562, qui est l’auteur de l’ouvrage cité par Pellizer : « El socorro del conde de Ribadeo don Rodrigo de Villandrando al rey don Juan el secundo, con todos los privilegios, cedulas y cartas reales pertenecientes a aquella acción ».
3 Antonio PAZ y MELIA, El cronista Alonzo de Palencia, Elibron Classics series, Adaman media Corporation, fac-similé de l’édition de 1914, publié par la Société Hispanique Américaine de Madrid, 2006, p. 473.
342
Annexe 5 CONTRAT DE MARIAGE DE RODRIGUE Contrat de mariage de Rodrigue de Villandrando, comte de Ribadeo, et de Marguerite, bâtarde de Bourbon.1 24 mai 1433 A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Pierre de la Chiese, conseiller du roy nostre sire et tenant le seel royal de la court de chancellerie des exempcions D’Auvergne establi à Cuci en Auvergne, salut. Savoir faisons (que) pardevant noz amez et fléaux jurés notaires de ladite court et chancellerie, Philippe Marjas et Jehan Trichon, usans de nos auctorité et povoir, establis personnelment ault et exellent prince et seigneur, monseigneur Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné fils de très ault et exellent prince, de monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne et aiant le gouvernement de ses païs, terres et seignories ; et très noble damoiselle Marguerite, suer naturelle de mondit seigneur le conte, pour eulx et les leurs d’une part ; et noble et puissant homme Rodrigo de Villandrando, seigneur de Ribedieu, pour lui et les siens d’autre part ; lesdictes parties deçà et delà ont cogneu, et confessé, de leurs bons grés et certeines sciences, que, puis nagueres il ont traictié entreulx mariage, en entencion de le faire et complir soubz le plaisir de Dieu, desdiz Rodrigo, seigneur de Ribedieu, et damoiselle Marguerite. Auquel traictié ont esté faictes et accordées les convenances et choses contenues, déclarées et escriptes en une cédule de papier, baillé en la main desdiz notaires, et leue aultement et entendiblement devant mesdiz seigneur et damoiselle, establiz et en la présence des tesmoins ci dessoubz nommez. De laquelle cédule ou feuit de papier, de mot à mot, la teneur est tele : « Monseigneur le conte de Clermont donne en dot et mariage à damoiselle Marguerite, sa suer naturelle, le lieu et place de Ussel en 1
D’après Jules QUICHERAT, Paris, 1845, pp. 159-160.
343
Bourbonnois et mil livres de prinse et value chascun an, et par elle, à Rodrigo de Villandrando, seigneur de Ribadeo, son espoux avenir ; lesquelz lieu et mil livres seront et demorront en fié et ressort de mondit seigneur. Et, pour ce que de présent ledit lieu de Ussel n’est mie bien basti, mondit seigneur de Clermont bauldra esdiz Rodrigo et damoiselle Marguerite, pour leur demorance et habitacion, le chastel et forteresse de Chasteledon, ensemble de la rente et revenue ce que restera pour venir èsdictes mil livres de prinse, rabatu ce que la terre de Ussel vauldra. Ou cas que ledit lieu de Chasteledon seroit mis hors des mains desdiz Rodrigo et damoiselle Marguerite, en le baillant à ceulx qui s’en dient seigneurs out autrement, mondit seigneur le conte sera tenu de bailler esdiz Rodrigo et damoiselle autre demorance, bone place et aussi forte comme est ledit Chasteledon, ensemble de terre que lui ara esté baillé sur la terre dudit Chasteledon, pour acomplir lesdictes mil livres de prinse, ainsi que dessus est dit. Avec ce a voulu et veult mondit seigneur le conte de Clermont que, après ce que le chastel de Rochefort en Bourbonnois, ensemble la terre que de présent la dame de Revel tient à cause de doaire et usufruit, par sa mort, lesdiz chastel et terre seront revenuz à la main mondit seigneur ou des siens, si lesdiz Rodrigo et damoiselle Marguerite veulent avoir lesdiz chastel et terre de Rochefort, il les pourront avoir et le aront en rabat et acquiet de ce que pourront valoir, touchant les mil livres de prinse dont dessus est parlé, pourveu que lors il se départiront du Chastel et terre de Ussel ; et, en cas, mondit seigneur le conte sera tenuz de rendre audit Rodrigo ce qu’il ara frayé et despendu au bastiment de la place dudit Ussel, qu’on lui baille à présent. Mondit seigneur le conte done, avec ce, deux mille escuz pour meuble à ladicte damoiselle Marguerite et par elle audit Rodrigo, dont les cinq cens seront paiez le jour des nopces et les autres cinq cens l’an révolu, et en suivant, chascuns an, cinq cens jusques le payement desdiz deux mille excuz sera achevé. S’il advient que ladicte damoiselle Marguerité tespasse sans hoir ou hoirs masles et fille ou filles, ou lesdiz filz et filles trespassent sanz descendens d’eulx, ladicte palce et terre d’Ussel, à elle donnée, reviendront à mondit seigneur le conte et ès siens. Si la dicte damoiselle trespasse sanz hoir ou hoirs masles, ou lesdiz masles tespassent sanz masle ou masles descendens d’eulx, et qu’il y ait fille ou filles, en ce cas la terre de Ussel et autres terres, baillés pour lesdictes mil livres de prinse, reviendront à mondit seigneur le conte, et icellui monseigneur le conte ou les siens seront tenuz de bailler et rendre, s’il y a une fille, deux mille escuz, et s’il y 344
en a deux ou plus, trois mille escuz. Et, en tous cas que ladicte place de Ussel et mil livres de prinse reviendront à mondit seigneur le conte ou les siens, vivant ledit Rodrigo, icellui Rodrigo ara l’abitacion de la dicte place de Ussel et le usufruit desdites mil livres de prinse, par le cours de sa vie seulement et lui estant au service de mondit seigneur le conte. Mondit seigneur le conte fera vestir ladicte damoiselle bien et convenablement. Et ledit Rodrigo sera tenuz de la enjouailler bien et deuement, selon son estat. Ledit Rodrigo mettra en despost jusques la somme de huit mille escuz d’or, pour acheter une place et cinq cens livres de prinse, ou cas que tant cousteront. Desquelz place et cinq cens livres de prinse ladicte fille sera douée. Tout le surplus dont n’est faicte mencion en ces présentes, tant au regart de meubles et conquestz comme autrement, est et demeure ès us et coustumes du païs du Bourbonnois. Lesquelles convenances et choses ci-dessus escriptes et incorporées, les dictes parties, pour contemplacion et en faveur dudit mariage pour parlé et accordé, ont passé, voulu et accordé, etc. A ces choses estoient presenz avec lesdiz jurez notaires, nobles et puissans seigneurs et sages, messeigneurs Béraud Daulphin, seigneur de Combronde ; Guy, seigneur de Saint-Priest ; Jehan de Chauvigny, seigneur de Blot ; Jehan de Langeac, seigneur de Brassat ; Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, chevaliers ; Pierre Churre ; Estienne, seigneur de la Farge dit Fragete, escuiers ; maistres Pierre de Carmonne, Jehan La Bise, licenciez en lois ; Laurent Audrant, Estienne de Bar ; Guillaume Cadier ; Marguerite de Beaumont, damoiselle ; mestre Jacques Dubois, aussi chevalier, et Loys de Thoulon, escuier et autres tesmoins requis et appellez, si comme iceulx jurés notaires nous ont rapporté par cet escript. En tesmoin de laquelle chose, nous, au rapport desdiz jurés notaires, ausquelz adjoutons plenière foy et croions, publiquement le seel royal dessus dit que nous tenons, avobs mis et apposé à ces présentes lettres. Donné le vingt quatriesme jour du mois de May, l’an mil quatre cens trente trois.
345
Annexe 6 RODRIGUE ET LA MAISON DE BOURBON Jean I de Bourbon - duc de Bourbon et d'Auvergne, comte de Clermont, de Montpensier, de Forez et de l'Isle-en-Jourdan, prince souverain de Dombes, seigneur de Beaujolais, de Château-Chinon et du pays de Combrailles, capitaine général de Languedoc et de Guyenne, pair et chambrier de France. • • • •
Né en mars 1381. Décédé le 5 janvier 1434 – Londres. Inhumé - prieuré de Souvigny. Épouse : 21/06/1400 Marie de Berry (1375-1434), inhumée au prieuré de Souvigny. Fille de Jean de France duc de Berry et de Jeanne d’Armagnac.
1.
Louis 1403-1412 comte de Forez inhumé dans l'église des Cordeliers de Senlis. Charles Ier qui suit, Louis mort en 1486 comte de Montpensier. Isabelle. Guy bâtard de Bourbon mort en 1442 gouverneur du pays de « Rouannais ». Jean décédé au prieuré de Saint-Rambert en Forez 02/12/1485, bâtard de Bourbon. Abbé régulier de Saint André les Avignon (1439), évêque de Puy (1443), abbé de Cluny (1456), inhumé dans l'abbaye de Cluny. Alexandre, exécuté en 1440 bâtard de Bourbon. Marguerite, morte en 1436, bâtarde de Bourbon, épouse de Rodrigue de Villandrando.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Charles I de Bourbon - duc de Bourbon et d'Auvergne, comte de Clermont, Forez et de l'Isle-Jourdain, prince de Dombes, seigneur de Beaujolais, du pays Combrailles et de Château-Chinon, gouverneur de Languedoc, capitaine général Bourbonnais, d'Auvergne, de Forez et du Lyonnais, de Champagne, de Brie et l'Île de France, pair et chambrier de France. • • • •
346
de de de de
Né en 1401. Décédé le 4 décembre 1456-château de Moulins. Inhumé-prieuré de Souvigny. Épouse en 1425 Agnès de Bourgogne (1407-1476), inhumée au prieuré de Souvigny, fille de Jean Ier de Bourgogne et de Marguerite de Bavière.
Annexe 7 LE CHATEAU DE CHATELDON Le séjour de Rodrigue et de Marguerite de Bourbon Extrait d’une lettre du 7 avril 1929 :1 « … hier, j’ai visité le château de Châteldon, au moment où un monsieur Lesage, imprimeur, qui venait de l’acheter à notre ami Aubert de la Faige, le faisait réparer à grands frais. Il y avait alors une immense pièce intacte sous les combles, que le nouveau propriétaire avait baptisé la salle des États, et qu’il proposait de transformer en salle mauresque. Je ne sais si ce funeste projet a été mis à exécution. Mais la décoration murale de cette « salle des États» était très intéressante au point de vue du séjour de Villandrando, car toute la muraille sur les quatre faces était peinte à rinceaux, avec les armoiries alternées de Villandrando et de Marguerite, bâtarde de Bourbon sa femme. … Il serait intéressant de rechercher si cette décoration à fresque a été respectée ou si avant de la « détruire », l’architecte ne l’a pas relevée. Vous savez que Villandrando a quitté Châteldon pour habiter Montgilbert, et que c’est de là qu’il est parti pour l’Espagne ». Les armes des deux familles D’après le croquis de M. Duchon, joint à sa lettre, Marguerite de Bourbon portait : « d’azur semé de fleurs de lys d’or, à la cotice de gueules en barre brochant » ;
1
« Le château de Châteldon », Extrait d’une lettre du 7 avril 1929 adressée à monsieur Philippe Tiersonnier, présentée par monsieur Pierre Duchon », Bulletin de la Société d’émulation du Bourbonnais : lettres, sciences et arts. Imprimerie E Auclaire, Moulins, 1930. p. 77.
347
Quant à Rodrigue de Villandrando, ses armes étaient : « écartelé aux 1er et 4e d’argent, à un croissant versé échiqueté d’or et de sable ; aux 2e et 3e d’or, à trois fasces d’azur ».
348
Annexe 8 FAC-SIMILE Lettre adressée au conseil de ville de Lyon, écrite de la main de Rodrigue
- 24 Fac-similé d’un document avec signature écrit de la main de Rodrigue de Villandrando le 13 mars 1433 pour hâter le recouvrement de diverses créances ou dépôts que lui et les siens avaient dans la ville. Original en papier des archives communales de Lyon.1
« Très chiers seigneurs et grans amis, je me recommande à vous. Et veuillez savoir que Jehan de Salles m’a dit que vous lui avez dit qu’il me dise que j’anvoisse à Lion, que me feriez faire raison tant à 1
Ibid. Cité par Jules QUICHERAT, Vie de Rodrigue de Villandrando, capitaine de Compagnie sous Charles VII, Firmin Didot Frères, Paris, 1845.
349
moy come à mes gens de ceulx qui me sont tenus et à eulx. Sy vous prie que ainsy le fassiez, et de Hutasse (Eustache) de Pontpierre qui a le mien en garde, comme vous savez, et n’en puis riens avoir ; car an bonne foy, il me despleroit de faire desplesir à home de lui, car j’aime bien la ville et savez bien que je vous ey tousgours fait plaisir en tout ce que me avez requis tousgours, et sachez que je vous puis bien servir. Sy vous prie que fassiez an manière que je connoisse qu’il soit ainsy comme le dit Jehan de Salles m’a rapporté de par vous. Et sy chose vous plest que fere puisse, faites le moy savoir pour le accomplir de bon cuer, priant notre seigneur qu’il vous aie en la garde. Escrit à Chastelledon, le XIIIe jour de mars. » Le tout de vostre Rodrigo de Villa Andrando Sur l’adresse il est inscrit : « A mes très chiers seigneurs et grans amis les conseillers, manans et abitans de la ville de Lion ». Ce texte confirme qu’après avoir rançonné dans un premier temps la cité lyonnaise, notre capitaine sut à partir de la fabuleuse victoire d’Anthon entretenir de bonnes relations avec la ville.
- 25 et 26 : Sceau de la famille de Villandrando et signature de Rodrigue. Sceau et signature, 14392
2
P. Raymond, Sceaux des Archives des Basses Pyrénées, Cité par Quicherat : N° 432. Cl Picard.
350
Annexe 9 PEDRO DE CORRAL Frère de Rodrigue Pedro de Corral et Rodrigo de Villandrando, nous l’avons vu, sont les petits-fils de Juan Garcia Gutiérrez de Villandrando, caballero de la Orden de la Banda3, et les fils de Pedro García de Villandrando et d’Aldonza Diaz de Corral. Pedro de Corral : sa relation avec Rodrigue Pedro de Corral n’a pas connu la même fortune que son frère. Être le cadet de la famille laissait peu de chance sur la possibilité d'hériter de la succession de son père. Pedro de Corral a donc choisi d'utiliser le nom patronymique de sa mère. Sur le linaje de Corral, on possède une bonne information grâce aux travaux d’Adeline Rucquoi4. Selon José Joaquin Satorre Grau, Pedro de Corral serait né en un período máximo comprendido entre los años de 1380 y 1390.5 Pedro de Corral est mentionné par l’historien du seizième siècle, Jerónimo dans ses Anales de la corona de Aragón comme un émissaire envoyé par Rodrigo de Villandrando pour offrir ses services au roi d'Aragon, en 1431. Dans ce rôle, Pedro de Corral aurait également représenté les intérêts de l’oligarchie dont il était issu. La concession du titre de noblesse et du domaine attaché au comté de 3
Le corps momifié, retrouvé dans le monastère de la Merced à Valladolid et dont nous avons parlé en introduction de ce livre, pourrait être celui du grand-père de Rodrigue : en effet, il portait les insignes de l’ordre de la Banda et l’on sait, à l’image de Rodrigue, que la plupart des notables de la ville avaient élu leur sépulture dans ce monastère. Par le choix de son lieu de repos, Rodrigue respectait une tradition familiale. 4 Adeline RUCQUOI, Valladolid en la Edad Media/La Junta de Castilla y León, Valladolid, 1987, II, pp. 59-61, 196-198 et généalogie n° VII. 5 José Joaquin SATORRE GRAU, Pedro de Corral y la estructura de su Crónica del Rey Don Rodrigo, al Andalus, 1969, 34, 159-73, p. 164.
351
Ribadeo, accordée à par Juan II aurait provoqué un changement d’alliance chez Rodrigue. A compter de cette date, il fait en effet allégeance au parti royaliste de Castille. Cette prise de position a dû très probablement le mettre en contradiction politique avec les membres de la famille de sa mère, qui étaient par leurs origines probablement des partisans des infantes d'Aragon6. A compter de cette époque, les chroniques ou les annales semblent ne plus relever de relations entre Rodrigue et son frère. De quelles façons, Pedro de Corral a-t-il été affecté par la bonne fortune de son frère ? Nous ne le savons pas. Cependant, il est permis d’émettre les hypothèses suivantes : pris en tenailles entre la monarchie et la faction nobiliaire, les membres des familles patriciennes des villes de Castille ont été confrontés à deux options : soit monter dans les couches supérieures de l'aristocratie, ouêtre relégués vers le bas. Pour ceux qui eurent la chance de s’élever dans les échelons de lanoblesse, comme Rodrigue, l’adhésion aux valeurs du parti royaliste semble avoir été un passage obligé. Dans le cas précis du comte de Ribadeo, cela suppose une cassure avec les membres de sa famille qui n'ont pas été en mesure de partager toutes ses priorités idéologiques. Pedro de Corral : l’écrivain Pedro de Corral est dans cette première moitié du XVe siècle un écrivain préfigurant l’évolution des premiers récits versifiés ou chansons de geste vers le roman. Son œuvre unique est la grande Crónica sarracina ou Crónica del rey don Rodrigo écrite en 1443 et publiée probablement à Séville en 1499. Une réédition a été imprimée à Tolède en 1549. Cette œuvre est considérée par certains critiques comme le premier roman chevaleresque de la littérature espagnole. Elle a inspiré par la suite de nombreux romans et drames à des écrivains comme José Zorilla (la leyenda del Cid) ou Hartzenbusch. La Crónica del rey don Rodrigo se compose de deux parties qui ont respectivement 262 et 256 chapitres. Le nombre et le découpage des chapitres peuvent légèrement varier selon les éditions. Il s’agit 6
Jerónimo ZURITA, Pedro Lanaja LAMARCA, Los cinco libros primeros de la segunda parte de los anales de la corona de Aragón, tomo III, Libro XIII, cap. LXXI, p. 206.
352
d’une œuvre aux dimensions considérables. Elle a connu un certain succès comme l’attestent les nombreuses éditions du XVIe siècle. Mais aucune ne semble avoir été faite depuis. Pourtant, pour reprendre les termes de Juan Manuel Cacho Blecua, elle est uno de los intentos más singulares de toda la Edad Media española.7 Pedro de Corral rendrait-il ainsi un éminent service à ce qu’il est convenu d’appeler l’idéologie gothique, reprise avec vigueur une décennie avant cette publication ? L’éloge des Goths et l’exaltation d’une filiation ininterrompue semblent en effet connaître un regain de faveur en ce début du XVe siècle et, plus précisément, aux alentours de 1430-1434. C’est en 1434 qu’Alonso de Cartagena, au concile de Bâle, utilise, entre autres arguments, celui de la filiation gothique pour prouver la prééminence du royaume de Castille sur le royaume d’Angleterre. C’est en 1435-1436 qu’il fonde sur l’héritage gothique les droits castillans sur les Canaries et un an plus tard cette thèse trouve sa pleine expression. La crónica sarracina serait donc un témoignage plutôt précoce de l’exaltation du linaje de los Godo au XVe siècle. Elle montrerait, en tout cas, que vers 1430-1434 ces idées habitaient la pensée de l’époque, comme y étaient d’ailleurs les derniers vents de reconquête.8 La crónica sarracina : l’œuvre L’histoire débute ainsi : Pelayo, né en secret de Luz et de Favila, a été confié par sa mère aux eaux du fleuve. Luz a baptisé son fils, et l’a placé sous la protection de Dieu afin qu’il vive et que, par lui, vive sa lignée. Une voix venue du ciel a dit qu’il en serait ainsi, et la petite arca, arche et châsse à la fois, s’éloigne, auréolée d’une merveilleuse lumière.9 Pelayo ou Pélage était le premier roi des Asturies, mort en 737. Les chroniqueurs espagnols contemporains ne font pas mention de lui. Aussi, sa vie, sur laquelle rien n'a été écrit avant 911, est-elle en partie 7
CACHO BLECUA Juan Manuel, Historias y ficciones, Los Historiadores de la crónica sarracina, Coloquio sobre la literatura del siglo XV, Universitat de Valencia, 1992, p. 55. 8 Ibid. Madeleine PARDO, Annexe des cahiers d’études hispaniques médiévales, ENS Éditions, Lyon, 2006, vol 17, p. 110. 9 Ibid. Madeleine PARDO, Annexe des cahiers d’études hispaniques médiévales, ENS Éditions, Lyon, 2006, vol 17, p. 61.
353
légendaire. Sous le règne du dernier roi wisigoth Roderick (qui sera hispanisé en Rodrigo), l'Espagne avait été conquise par les Arabes (711-715). Un grand nombre de nobles et d'évêques goths se réfugièrent dans les Asturies et, selon la tradition, choisirent pour roi don Pelayo, peut-être descendant des anciens rois goths, peut-être d'ascendance hispano-romaine (Les Arabes l'appellent Belaï-elRoumi). Pelayo demeura dans les montagnes appelées Picos de Europa. Sous le gouvernement pacificateur de l'émir Abd-al-Aziz, il se rendit même à Cordoue pour traiter avec les conquérants, mais à Abd-alAziz succéda le belliqueux El-Horr-Ben-Abd-el-Rahman, et la guerre recommença. Une version de la légende ajoute des circonstances romanesques : c'est un chef maure local qui aurait voulu prendre pour femme la sœur de Pelayo. Devant son refus, Pelayo aurait été déporté comme otage à Tolède, et, après s'être évadé, serait revenu au pays pour se venger… Quoi qu'il en soit, les auteurs s'accordent pour dire qu'en 749, Pelayo battit l'émir Alkhamah à la journée restée légendaire de Cueva de Santa Maria de Covadonga. Il s'empara également de la ville de Léon. Ainsi, la monarchie wisigothe ressuscita dans le petit royaume asturien. Pelayo mourut en 737 et eut pour successeur son fils Favila. En 1901, une riche basilique a été inaugurée à Covadonga, en mémoire de la victoire de Pelayo. Au-delà de la question du genre auquel appartient la crónica sarracina se pose celle qui a trait au contexte d’écriture de l’œuvre et à sa portée : pourquoi reprendre, vers 1443, l’histoire du roi don Rodrigo ? On peut proposer deux interprétations complémentaires. D’une part, à une époque où la péninsule est partiellement occupée par les Maures, la crónica sarracina aurait pu constituer un appel à la victoire définitive sur les infidèles par Juan II de Castille. Ceci expliquerait pourquoi Corral ne cite à aucun moment l’auteur de l’une de ses sources, le Maure Al-Razi : l’historien, de confession musulmane, n’était peut-être pas le garant le plus approprié de la crédibilité de la « Crónica sarracina » en la matière. D’autre part, on est tenté d’entrevoir dans le couple roi/favori, don Rodrigo et Julián – même si l’hypothèse paraît quelque peu audacieuse – la paire formée par Juan II et son homme de confiance, Alvaro de Luna. Corral inviterait-il Juan II à ne pas trop écouter le connétable pour ne pas subir la même déconvenue que don Rodrigo ? Certains critiques ont 354
délibérément penché pour ce sens de l’histoire : pour Fernando Gómez Redondo, la crónica sarracina reflète bien l’idéologie du connétable et ses efforts pour protéger Juan II.10 Quelles que soient les raisons de la reprise de cette matière historique, la maîtrise et le talent de Pedro de Corral sont incontestables : l’œuvre de l’auteur rivalise en qualité avec ce qui l’a précédé.11
10
Fernando GOMEZ RETONDO, Historia de la Prosa Medieval Castellana, Cátedra, Madrid, 2002, vol. III. 11 Frédéric ALCHALABI, « L’écriture de l’histoire dans la Crónica Sarracina de Pedro de Corral, 2011, Université de Nantes, CLEA (EA 4083), AILP (GDRE 671, CNRS). URL : http://e-spania.revues.org/
355
Annexe 10 HYPOTHESES SUR LES DATES DE LA NAISSANCE ET DE LA MORT DE RODRIGUE Le premier travail consacré par Jules Quicherat au fameux routier espagnol a été publié en 1845. Ce mémoire eut quelques peines à franchir les Pyrénées, longtemps il passa presque inaperçu en Espagne. Dans ces dernières années seulement, deux Espagnols MM. Jimenez de la Espada et José Maria de Eguren, témoignèrent qu’ils en avaient pris connaissance en s’y référant et en ajoutant aux renseignements recueillis par Quicherat quelques données nouvelles sur Villandrando lui-même, sur sa famille ou sur le titre de comte de Ribadeo qui lui fut conféré par le roi Juan II de Castille.1 Cet apport toutefois n’était pas considérable, aussi, l’ancien directeur de l’Ecole des Chartes, en terminant en 1879 l’impression de la biographie entièrement remaniée de son héros, était-il bien autorisé à écrire : il me semble difficile que l’Espagne ne fournisse rien de plus de ce que j’ai pu en obtenir. L’appel cette fois a eu plus d’écho : un membre de l’académie d’histoire a jugé qu’il convenait d’étendre aux documents espagnols l’enquête si bien menée, presque épuisée on peut le dire, pour la partie française du sujet. L’enquête de M. Fabié, rédigée à l’aide de pièces d’archives, de quelques notices historiques inédites, confirme, complète et corrige aussi sur certains points le livre de Quicherat. En effet, les conclusions proposées par l’érudit espagnol s’écartent de celles qu’avait obtenues, avec les ressources dont il disposait, le premier biographe de Villandrando. Ce sont les archives du duc de Hijar, héritier du titre de comte de Ribadeo, qui ont fourni à M. Fabié les renseignements les plus authentiques et les plus importants. Citons le testament et les deux 1
PERO TAFUR, Andanças e viajes de Pero Tafur, traduit par Marcos Jiménez de la Espada, Miraguano, Madrid, 1995, p. 544.
356
codicilles, dictés par Rodrigue de Villandrando à Valladolid le 15 mars, le 2 et le 15 avril 1448, rapprochés d’un acte du 12 juin de la même année. Ces documents mentionnent que doña Beatriz de Zuñiga, femme de feu Rodrigue de Villandrando, est nommée tutrice des enfants qu’elle avait eus de cet époux. Monsieur Fabié a tiré la date approximative de la mort de Rodrigue, que Quicherat avait placée dix ans trop tard. « D’après l’époque de sa naissance, disait-il, supputée en combinant sa grande jeunesse au début de nos guerres civiles (1409) et la mort de sa mère arrivée en 1390, il mourut lui-même au commencement du règne de Henri IV de Castille, en 1457 ou 1458 ». Or, il est maintenant avéré que Rodrigue a dû mourir entre le 15 avril et le 12 juin 1448. Et c’est en remontant le temps, à partir de cette dernière date, qu’il convient de calculer celle de sa naissance. En l’état de nos connaissances, aucun acte authentique ne la mentionne. Si, comme le prétend Hernando del Pulgar, Rodrigue est mort en 1448 à l’âge de soixante-dix ans, 1378 serait donc son année de naissance. Mais les soixante-dix ans de Pulgar éveillent quelques objections : cette donnée, il faut l’avouer, s’accorde mal avec l’âge tendre que le même historien attribue à Rodrigue, au moment de son entrée en France vers 1410. Né en 1378, il aurait eu alors une trentaine d’années. Autre difficulté : après avoir perdu sa première femme Marguerite de Bourbon qui vivait encore le 2 août 14362, Rodrigue épousa en Castille Beatriz de Zuñiga, apparemment entre 1440 et 14443. Elle lui donna deux enfants, qui en juin 1448 n’avaient ni l’un ni l’autre atteint l’âge de quatre ans4. En se rapportant donc à Pulgar, ce serait à soixante ans passés que Rodrigue aurait contracté ce second mariage, et à soixante-sept ans ou plus qu’il aurait eu de Beatriz ses deux enfants. Cela apparaît difficilement vraisemblable. Il y a là une possible erreur de transcription : dans son texte, Pulgar a certainement substitué soixante par soixante-dix. En effet, en
2
QUICHERAT, Pièce justificative n° XLI. La date de ce mariage n’est pas donnée par M. Fabié. 4 « Por quanto los dichos don Pedro e dona Marina, sus fijos, eran menores de los doce anos, et aun menores de cuatro anos », Acte de tutelle ; Fabié, append. XXII. 3
357
espagnol, entre setenta et sesenta, une seule lettre est différente et de cette façon tout concorderait mieux.5 En résumé, Rodrigue, né en 1388, est décédé entre le 15 avril et le 12 juin 1448, à l’âge de 60 ans. Précisons qu’il serait entré en France vers 1410, âgé d’une vingtaine d’années. Note complémentaire : deux interprétations supplémentaires Si Hernando del Pulgar fait naître Rodrigue à Valladolid, deux autres auteurs6 le font naître au sud de la Galice, dans la province d’Orense, à la frontière du Portugal dans un village proche d’Entrimo, dénommé « Illa » : le noble chevalier naquit à Illa, paroisse de San Lorenzo dans la première moitié du XVe siècle7 dans la maison de la famille dont on connaît d’ailleurs l’emplacement appelé place du Comte près de la propriété des Martinez. D’après Benito Fernandez Alonso, membre de la Royale Académie d’Histoire et fondateur de la Royale Académie Galicienne, lui aussi natif d’Entrimo, citant Hernando del Pulgar, ses parents étaient don Pedro de Villandrando et doña Inés de Corral, honnêtes gens biens nés… Ces auteurs désignent Rodrigue en tant que « Comte de Ribadeo » ce que nul ne conteste, mais lui attribuent aussi le titre de « Vizconde de Illa ». Il semble y avoir là confusion entre deux lieux portant le même nom. S’il existe bien un hameau en Galice dénommé « Illa », la « Vicomté d’Illa » est, quant à elle, située en Roussillon et désigne la ville « d’Ille sur têt ». Le nom d’Illa (Ad Yla) apparaît en effet pour la première fois en 887. Plus tard, à l’époque de Rodrigue, cette vicomté appartient au royaume d’Aragon. 5
Sources : Polybiblion, Revue bibliographique universelle, S. N., Paris, 1868-1939 ; N° 2 : 1883/01 ; (SER2, T17)-1883/06 par A. SAVINE et « Don Rodrigo de Villandrando, conde de Ribadeo », Discurso leído en la junta pública de aniversario de la Real Academia de la historia, el 24 de mayo de 1882, por D. Antonio María FABIE, académico de número, Madrid, M. Tello, 1882. 6 Benito FERNANDEZ ALONSO, Orensanos Illustres, Diputación Provincial de Ourense 1916 et Historia de Entrimo, d’après el boletín informativo do concello, N° 1 primeiro semestre de 1989, redacción segregarla Consello, p. 13 et pp. 21, 22. Et Benito PEREIRA DOMÍNGUEZ, Rodrigo de Villandrando conde de Ribadeo, Proditex & Consultaría Dirección : Valle Inclán, 5-4º A 32004, Ourense, 2006, Nú. Páginas 348. 7 Ibid. BOLETÍN INFORMATIVO DO CONCELLO ENTRIMO, N° 1 primeiro semestre de 1989, redacción segregarla Consello, p. 13 et pp. 21, 22.
358
Toutefois, en ce qui concerne le titre de « Vizconde de Illa », celui-ci apparaît bien dans la généalogie de la maison Villandrando, mais seulement en 1622 à la suite d’un mariage. Il est porté pour la première fois par Jaime Francisco Víctor Sarmiento de Silva Fernández de Hijar de Villandrando, à la mort de sa mère en 1642. Ce titre est entré dans cette maison à la suite de deux alliances : 1°) Le titre de « Vizconde de Illa » entre dans la maison de Híjar le 7 août 1596 par le mariage de : Francesca Castro Pinós y Fenollet y Zurita (+ 1663) vicomtesse de Illa. avec
Juan Francisco Cristóbal Fernández de Híjar y Fernández de Heredia (6/10/1552 + 13/04/1614)
2°) Le titre de Vicomte de Illa entre dans la maison de Sarmiento de Silva Mendoza y Villandrando le 3 octobre 1622 par le mariage de la fille des précédents : Isabel Margarita Fernandez de Hijar y Castro-Pinós Duchesse de Hijar (1603-1642) avec
Don Rodrigo Sarmiento de Silva Mendoza y Villandrando Neuvième comte de Ribadeo
3°) Leur fils : Jaime Francisco Víctor Sarmiento de Silva Fernández de Hijar de Villandrando de la Cerda y Pinós (Madrid 30/1/1625 + à Madrid le 25 février 1700) Dixième comte de Ribadeo devient à la mort de sa mère le XIVe vicomte de Illa.8
8
María José CASAUS BALLESTER, La Casa Ducal de Híjar y sus enlaces con linajes Castellanos, Boletín Millares Carlos, Número 27, Centro asociado UNED, La palmas de Gran Canaria, 2008, pp. 108, 112, notes 47 et 49.
359
Annexe 11 ESSAI DE LOCALISATION DU REPAIRE DE RODRIGUE DANS LES CEVENNES Le château de Génolhac aurait-il servi de repaire à Rodrigue ? Des actes officiels, relevés par l’abbé Nicolas, confirment cette hypothèse : En 1409, les prieurs-syndics élus, pour avoir soin des procès et affaires de la communauté de Génolhac, furent Guillaume de Valle et Bartholomée Brozeti, qui, par-devant Me Jean Doladilhe, notaire, font quittance, à Guillaume de Vern, de Génolhac des tailles qu’il a levées dans la ville pour réparation du château de Génolhac (23 avril 1406). Ces réparations étaient d’autant plus nécessaires, qu’aux archives de Nîmes J. J., j’ai trouvé une quittance délivrée aux consuls par Trophime Olivier de 18 gros pour un voyage à Génolhac, où il est allé s’informer le 5 mars 1433, des faits des gens d’armes et routiers du capitaine Rodrigue de Villandrando qui sont à Génolhac et occupent le château. Ce même Olivier a touché 19 parpaioles…1 Symbole d’un pouvoir seigneurial affirmé tout autant que de puissance militaire, le château constituait souvent une forteresse inexpugnable. Dans le cas de Génolhac, il se trouvait près de l’église et il n’en reste aujourd’hui que les anciennes voûtes qui remontent au XIe siècle. À cette époque, l’idée religieuse dominait partout : aussi l’église devenait une annexe nécessaire au château. Ces deux symboles de la féodalité se construisaient à proximité et se soutenaient l’un l’autre. La forteresse sur la hauteur, en avant-poste, s’entourait de 1
M. l’abbé C. NICOLAS, Histoire de Génolhac d’après les documents inédits, réédition de l’édition Chastanier Nîmes 1897 aux éditions Lacour, Nîmes, 1990, pp. 94, 117, 118.
360
fossés, se hérissait de tours et de créneaux, l’église était ceinte aussi d’épaisses murailles, comme pour être prête à la défense. L’édifice de Génolhac a été remanié au XIIIe siècle et la tour carrée, qui a trois étages, possède des murs de près de deux mètres de large dans toute la hauteur. Elle servait de prison pour la justice des seigneurs et comme c’était souvent le cas, dans l’enceinte, chaque habitant avait une petite maison pour se mettre en sûreté en cas de guerre…
361
Annexe 12 ORDONNANCE Attestant de la propriété de navires marchands par Rodrigue (1432) Sin fecha-Cédula del rey D. Juan concediendo licencia à D. Rodrigo de Villandrando, conde de Ribadeo, para comerciar seguramente en Inglaterra con la “ñao Santiago”, no obstante la guerra. « Don Juan, Sepades que don Rodrigo de Villandrando, conde de Ribadeo, mi vasallo e de mi consejo me fiço relación en como él, viniendo en mi servicio por mi mandado, los Yngleses le prendieron e tienen presos a Fernán de Tovar, su sobrino, e Pedro Carrillo e a otros mis subdictos e naturales, de su compañía que con el venían, los quales non se podían rescatar sin grandes contias de maravedises e otras cosas que por ellos les demandan. E pidiome por merced que para los rescatar le diese liçençia para una su ñao llamada la ñao de Santiago, que es fulano patrón della, pudiese entrar e salir con sus mercadurías al Rey e señoríos de Inglaterra, salva e seguramente por los viajes que a mi merced pluguiese. E yo touelo por bien. Es mi merced e mando que por quatro viajes la dicha ñao puede andar e ande salva e seguramente por qualesquier mis mares, e entrar e salyr al dicho reyno e señorío de Inglaterra con sus mercadurías. E es mi merced e mando que por lo asi fazer non caya ni incurra en pena nin en penas algunas ceuilles nin criminales, ca yo por esta mi carta les do licensia e facultad e poderío para ello durante los dichos quatro viajes como dicho es. Porque vos mando a toldos e a cada uno de vos que dexedes e consentades al dicho fulano maestre de la dicha ñao e a los mercaderes e otras personas que con él en ella fueren, andar en la dicha ñao del dicho conde, e llevar e sacar fierros e otras qualesquier mercadurías para el dicho reyno e señorío de Inglaterra, tanto que no sean cauallos nin 362
armas nin las otras cosas vedadas de sacar a los reynos comarcanos con quien yo he paz. E otrosi que le dexedes traer libre e desembargadamente paños e otras qualesquier mercadurías de dicho reyno et señoríos de Inglaterra para estos mis reynos y señoríos, e las vender e destribuyr en ellos o en otras qualesquier partes donde quisieren o por bien tovieren, non les demandando nin levando por ellas mas nin allende de los derechos por mi ordenados cerca de las mercadurías que se traen de los otros reynos e tierras donde yo he paz, durante los dichos viajes, los quales se fagan de día de la data desta mi carta fasta treinta meses complidos próximos siguientes. E non fagades nin consintedes fazer al dicho maestre de la dicha ñao, nin a los mercaderes e otra compaña de qualquier nación, estado o condición que en la dicha ñao venga o fueren, mal ni dapño nin otro desaguisado alguno en sus personas nin en sus bienes, sin razón y sin derecho, como non debades, non laciendo nin dañando nin buscando mal nin dapño, nin desonor mío nin de los mis súbditos e naturales, nin de mis amigos e aliados, nin de aquellos con quien yo he paz. Cayo por la presente tomo e rescibo la dicha ñao, e al maestre e mercaderes e otras cualesquiera personas que en ella fueren e venieren e a sus bienes e mercadurías e cosas, en mi guarda e amparo e so mi seguro e difendimiento real durante los dichos quatro viajes e el dicho tiempo en que se han de fazer. E mando a vos, las dichas justicias e a cada uno de vos, que si alguno o algunos de vos quisiere quebrantar este mi seguro, que pasedes e procedades contra ellos e contra cada uno de ellos, e contra sus bienes, a las mayores penas ceviles e criminales que fallardes por fuero e por derecho, así como contra aquel o aquellos que quebrantan seguro puesto por su rey e señor natural. Otrosi vos mando que non embarguedes nin detengades, nin consentades embargar nin detener a los sobredichos, nin algunos de ellos, nin a sus bienes e mercadurías, por razón de marcas nin represarías que qualquier personas hayan tenido e tengan, nin por razón de la guerra quel Rey de Francia mi muy caro e muy amado hermano, amigo e aliado, e yo por cabsa del, avernos con los ingleses…”1 1
Formulaires de lettres et de grâces du règne de don Juan II et du début de celui d’Enrique IV, publiés par don Marcos Jiménez de la Espada. Et Cesáreo Fernández DURO, La Marina de Castilla, El progreso editorial, Madrid, 1894, pp. 447, 448, 449.
363
Sans date-Ordonnance du roi D. Juan accordant licence à D. Rodrigo de Villandrando, comte de Ribadeo, pour commercer en sécurité avec l’Angleterre avec « la ñao Santiago », malgré la guerre. “Don Juan, Sachez que Don Rodrigo de Villandrando, Comte de Ribadeo, mon vassal et membre de mon conseil, m'expliqua comment, alors qu'obéissant à mes ordres se rendant à mon service, son neveu Fernando de Tovar, Pedro Carrillo et certains de mes sujets membres de sa compagnie furent faits prisonniers par les Anglais. D’importantes rançons en maravédis et en marchandises sont exigées pour leur libération. Afin de pouvoir les libérer, il me pria de bien vouloir autoriser l'un de ses navires nommé la « Nao de Santiago », dont il est l'armateur, à transporter les marchandises réclamées par le Roi et les Seigneurs d'Angleterre en toute sécurité lors des trajets que je voudrais bien lui accorder. J'ai accédé à ses demandes. Il est de ma bonne grâce et de ma volonté que ce navire puisse effectuer quatre voyages, embarquer et débarquer du royaume d'Angleterre avec ses marchandises, sans risque, en toute sécurité sur la totalité de mes mers. De même, afin qu’il puisse mener à bien le projet sans être confronté à des difficultés civiles ou criminelles, par cette lettre je lui donne l'autorisation, les moyens et le pouvoir nécessaires aux susdits quatre voyages. J'ordonne donc à tous et chacun de vous, de laisser et d’autoriser le capitaine dudit navire, ainsi que les marchands et toute autre personne à son bord, à voyager sur le navire du comte, à transporter et emporter du fer ou toute autre marchandise pour les seigneurs et le royaume d'Angleterre, excepté des chevaux, des armes ou certaines marchandises interdites de sortie vers les royaumes voisins avec lesquels je suis en paix. J'ordonne aussi de leur laisser rapporter librement, sans les saisir, les étoffes et autres produits du royaume d'Angleterre sur mes terres et mon royaume, de les laisser les y vendre et les y distribuer, ailleurs aussi s’ils le veulent sans leur réclamer de taxes en plus des droits que je réclame habituellement sur les marchandises importées sur mes terres des autres royaumes avec lesquels je suis en paix. Ceci pour les susdits voyages, à compter de la date de cette ordonnance et durant les trente mois qui suivront. 364
Ne laissez pas faire ni ne faites de mal ni de tort sans raison, ne portez pas atteinte aux biens ni aux personnes que ce soit le capitaine dudit navire, les marchands ou autres individus se trouvant à bord quelles que soient leurs nationalité, origine ou condition. Pas plus que vous ne devez me nuire, agresser, blesser, me chercher du mal, ni me déshonorer, ni moi ni mes sujets, natifs, amis et alliés, ou ceux avec qui je suis en paix. Donc, moi, par la présente, je reçois et prends sous ma surveillance et ma protection ledit navire, son capitaine, marchands et toute autre personne à bord, ainsi que les biens, marchandises et objets s'y trouvant, et je m'engage à en en assurer la défense royale pendant la durée des quatre traversées. Soyez certains que si l'un d'entre vous désobéissait ou portait atteinte à leurs biens ou à leurs personnes, je leur ferais justice et les punirais des plus grandes sentences civiles et criminelles par coutume et par droit comme s’il avait trahi son roi et seigneur. Je vous ordonne aussi de ne pas arrêter ni taxer les hommes ou marchandises pour des raisons de territoire ou de vengeance éventuelle de l'un de vous, ni à cause de la guerre que le Roi de France, mon très cher et très apprécié frère, ami et allié, et moi même pour le soutenir, livrons contre les Anglais… »2
2
Traduction N. BOURG.
365
Annexe 13 MANGER A LA TABLE DU ROI - I Comment la faveur royale accordée à Rodrigue le jour de l’Épiphanie fut-elle perpétuée à ses descendants 1 L’extraordinaire privilège dont jouissent les comtes de Salinas (en qualité de comtes de Ribadeo), de partager publiquement le repas de ses Altesses les Rois Catholiques d'Espagne chaque année au Saint jour de l'Épiphanie, est un honneur accordé à cette maison et ses lignées que l'on ne peut passer sous silence. Don Rodrigo de Villandrando, premier comte de Ribadeo en est à l'origine. C’est à lui que Son Altesse le Roi Juan II l'accorda de façon pérenne en son nom ainsi qu'en celui de ses descendants. Il l'autorisa de même à conserver les atours que les rois portaient ce jour-là en reconnaissance de ses grands et loyaux services tout particulièrement pour son intervention à Tolède un 6 janvier, comme le mentionne le privilège royal fait à Torrijos et daté du 9 janvier 1441. Privilège conservé par le comte don Rodrigo et ensuite par don Pedro de Villandrando son fils jusqu'en l'an 1512. À cette date, il y renonça en faveur de don Diego Gomez Sarmiento, troisième comte de Salinas, son neveu, qui était héritier de la Maison en qualité de fils de la comtesse doña María de Villandrando, sa sœur, et de son mari don Diego Gómez Sarmiento, deuxième comte de Salinas. La Reine doña Juana accorda et ratifia cette transmission dans un rapport royal qu'il me semble intéressant de mentionner ici : « Doña Juana par la grâce de Dieu, Reine de Castille, de Leon, de Grenade, de Tolède, de Galicie, de Séville, de Cordoue, de Murcie, de Jaen, des Algarves, d'Algesiras, de Gibraltar, des îles Canaries, des Indes, îles et terre ferme de la mer océane, Princesse d'Aragon et des deux Siciles, et de Jérusalem, Archiduchesse d'Autriche, Duchesse de Bourgogne et de Brabant, Comtesse de Flandres et du Tyrol, dame de 1
Pedro PELLIZER de OSSAU I TOVAR, Informe del origen, antigüedad, calidad, i sucesión de la excelentísima casa Sarmiento de Villamayor, Madrid, 1663, pp. 29, 30.
366
Viscaye et de Molina, etc. Vous, Don Pedro de Villandrando, m'avez priée, compte tenu des services que vous et vos ancêtres avez rendus à la couronne royale et pour vous en récompenser, de donner l'autorisation à Don Diego Gómez Sarmiento de Villandrando, votre neveu et héritier de votre Maison, de bénéficier du privilège accordé au mérite de votre père le jour des Rois, dont ce dernier et vous-même comme successeur avez joui, pour qu'à son tour le comte de Salinas votre neveu en ait la jouissance. Souhait de renoncement et de transmission que vous exprimez dans votre demande de désistement soumise à certains membres de notre Conseil et signée de votre nom ainsi que de celui de l'écrivain public. Moi, compte tenu de vos nombreux et loyaux services ainsi que de ceux du Comte, Monsieur votre père, pour que son souvenir en soit conservé, j’ai décidé d'accéder à votre demande. N'ayant pas en mon pouvoir les titres ni les écritures de ce privilège pour en faire la modification, je déclare, en attendant qu'ils soient en ma possession, qu’il est de ma grâce et de ma volonté d'accorder à votre neveu le Comte de Salinas de posséder ce privilège et d'en jouir à votre place, comme vous et votre père en avez bénéficié. Pour qu'il puisse jouir de ce privilège, j'ai rédigé cette ordonnance, signée par le Roi mon père et cachetée de mon sceau, Rédigée à Burgos, le 5 janvier 1512 Moi, le Roi Moi, Lope Conchillos, secrétaire de la Reine, la lui fit écrire sur ordre du Roi, son père » Le lendemain de la date de cette ordonnance, le comte don Diego Gómez Sarmiento prit son repas à la table de son altesse le Roi catholique à Burgos, au nom de son altesse la Reine doña Juana, en lieu et place de son oncle le comte. Par la suite, ce privilège lui fut confirmé, pour lui et ses héritiers, alors qu’il était déjà à la tête de la Maison et de l'État de Ribadeo. L’ordonnance royale transcrite cidessus fut rajoutée sur le privilège royal de la première grâce faite au comte Rodrigue de Villandrando en date du 16 avril de l'an 1515 à Olmedo, document signé par son altesse le Roi catholique ratifié par Lope Conchillos. Ainsi, depuis 151 ans, la Maison de Salinas jouit du privilège de manger à la table des rois. De nombreuses mentions de ces repas sont faites dans les récits historiques et les plus grands poètes d'Espagne les 367
célèbrent. La famille conserve dans ses archives de nombreuses copies des actes de rois d'armes parmi lesquelles nous citerons celle-ci : « Nous, Geronimo de Villa et Don Juan de Heredia, Rois d'Armes ici présents, nous signons en bas de cette ordonnance et certifions que le jour des rois, mardi six janvier 1626 Sa Majesté, le Roi Philippe IV Notre Seigneur, fit un repas public empreint de la solennité habituelle en ce jour. Le repas fut apporté en présence des majordomes et gentilshommes de bouche, au son des timbales et des trompettes. Sa Majesté apparut avec les Rois d'Armes et les bedeaux. Nous vîmes Sa Majesté se laver les mains et remettre la serviette à l'Amiral de Castille. Avant de s'asseoir, le Roi attendit la bénédiction de la table par don Francisco Ursino, chapelain royal, puis se tourna vers don Rodrigo Sarmiento Villandrando de Silva et de la Cerda, Comte de Salinas et Ribadeo, Duc et Seigneur de Hijar, Comte de Belchite et Aliaga, Gentilhomme de la Cour de Sa Majesté qui s'était rendu au palais, accompagné des dignitaires et chevaliers présents à la Cour. Sa Majesté lui ordonna de s'asseoir à sa table. Il prit place en tête de table à gauche de Sa Majesté qui commença à manger et lui tendit son assiette personnelle. Don Rodrigo Sarmiento mangea dans l’assiette royale ce qu'il lui plut. Le repas se poursuivit de la sorte, le roi demanda à boire, quand il eut bu, don Rodrigo Sarmiento fit un signe à don Bernardino Sarmiento de Sotomayor, chevalier de l'ordre de Saint Jago, Grand Écuyer de la Reine, pour qu'il lui servît à boire, et à son tour il but dans la coupe. C'est ainsi que le repas se déroula. À la fin de celui-ci, Sa Majesté se lava de nouveau les mains, se leva, attendit que don Francisco Ursina rendît grâce, et se tourna vers don Rodrigo Sarmiento. Ce dernier s'agenouilla et demanda l’accolade de Sa Majesté, ce qu'elle fit en posant son bras droit sur son épaule. Après s'être levée, Sa Majesté regagna ses appartements accompagnée de don Rodrigo Sarmiento et autres grands du royaume Nous en donnons foi et le certifions Signé de nos noms, à Madrid le 9 janvier 1626, Geronimo de Villa et don Juan de Heredia. » Si pour un empêchement quelconque l'événement ne peut avoir lieu, le souverain fait la grâce d’en faire connaître la raison pour ne pas causer préjudice à la Maison Salinas et Villandrando, comme on peut le voir dans une lettre authentique du Roi, Notre Seigneur :
368
« Le Roi. Illustre Duc et Seigneur de Hijar, Comte de Salinas et Ribadeo, Cousin. Le 5 janvier de l'an en cours, le Comte de Olivares vous avisa sur mes ordres que le lendemain, fête des Rois, vous pouviez venir manger avec moi et jouir du privilège dont bénéficie votre Maison de Salinas et Ribadeo, que vous méritez de part vos services et que je veux perpétuer. Mais étant souffrant, vous ne putes venir. Informé de cette indisposition qui vous priva de l’honneur et de la grâce que je vous faisais, j'envoyai le Comte pour vous dire de ne pas en être contrarié. Je tiens à ce que ce privilège soit conservé, en tout et pour tout, aujourd’hui comme à l’avenir, ainsi que le firent mes prédécesseurs avec les vôtres. Il aura lieu l'an prochain. Comme garantie de vos droits, vous m'avez prié de rendre compte par écrit de ces faits. Je vous fais donc envoyer ce courrier signé de ma main et contresigné par mon secrétaire. Madrid, le 26 juin 1624 Moi, Le Roi Contresigné Pedro de Contreras »2 - II La transmission du privilège accordé à Rodrigue par Juan II de Castille en 1441.3 Don Diego Sarmiento de Villandrando Sixième comte de Comte de Ribadeo, comte de Salinas et de Coruña. Héritier en 1512 par son oncle de la faveur royale accordée à Rodrigue par Juan II de manger à la table royale et de recevoir les habits portés par le roi chaque année le jour de l’Épiphanie. + 1518. Marié en 1484 avec
Doña María de Ulloa y Castilla Camarera Mayor de la Reina Doña Juana de Castilla en 1508
Don Diego Gomez Sarmiento de Villandrando septième comte de Ribadeo y Salinas, Seigneur de Villarrubia de los Ojos 2
Traduction : N. BOURG. José Luis LAMIGUEIRO, Xenealoxias Hispana do Ortegal, Edición datos y árbol www.xenealoxiasdoortegal.net 3
369
Héritier de la faveur royale accordée à Rodrigue par Juan II + 1562 Marié à Burgos le 6 décembre 1530 avec
Doña Brianda de la Cerda Don Diego Gomez Sarmiento de Villandrando Décédé avant d’hériter Marié avec
Doña Ana Pimentel Comtesse de Salinas en 1563 comme tutrice de ses enfants. Décédée avant d’hériter
Don Rodrigo Sarmiento de la Cerda Villandrando Huitième comte de Ribadeo et de Salinas Héritier de la faveur royale accordée à Rodrigue par Juan II Marié avec
Doña Antonia de Ulloa + 25/09/1625 à Valladolid
Doña Mariana Sarmiento de la Cerda Villandrando comtesse de Ribadeo, héritière de ce comté par sa sœur aînée. Mariée avec son beau-frère
Don Diego de Silva y Mendoza Duc de Francavilla et Marquis de Alenquer + à Madrid le 15 juin 1630 Dernier héritier par sa femme de la faveur royale accordée à Rodrigue par Juan II.
Don Rodrigo Sarmiento de Silva Mendoza y Villandrando Neuvième comte de Ribadeo Comte de Salinas Marié à Zaragoza le 3/10/1622 avec
Isabel Margarita Fernandez de Hijar y Castro-Pinós Duchesse de Hijar (1603-1642) Ceci explique pourquoi les ducs de Hijar possédaient encore en 1973 une collection d’habits royaux, témoignage de ce cadeau traditionnel, qui étaient exposés dans une des vitrines de bois ouvragées du palais des Hijar-Aranda à Epila, descendants et héritiers de la maison Sarmiento-Villandrando.
370
Annexe 14 LE TOMBEAU D’ALVARO DE LUNA Les tombeaux du connétable don Alvaro de Luna et de sa femme Juana de Pimentel occupent le centre de la chapelle Saint-Jacques, dans la cathédrale de Tolède. Ces tombeaux, élevés par la fille du connétable en 1489, sur les dessins de Pablo Ortiz, auraient remplacé un précédent cénotaphe que don Alvaro de Luna se serait élevé à luimême et qui présentait une particularité étrange : « La statue, faite de bronze doré, était un automate. Elle pouvait se dresser d’assise ou couchée qu’elle était, et s’agenouiller. On pressait un ressort au moment de la messe, et l’effigie effectuait son évolution ».1
1
Édouard DIDRON, Annales archéologiques, Librairie archéologique, Paris, 1869, tome XXVI, p. 180.
371
BIBLIOGRAPHIE ACADEMIE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS D’AGEN, Revue de l’Agenais. P. Noubel, Agen, 1874, Nº 1. ALCHALABI Frédéric, « L’écriture de l’histoire dans la Crónica Sarracina de Pedro de Corral, 2011, Université de Nantes, CLEA (EA 4083), AILP (GDRE 671, CNRS). URL : http://e-spania.revues.org/ e
ALLUT Paul, Les Routiers au XIV siècle, les Tard-Venus et la bataille de Brignais, N. Scheuring, Libraire-éditeur, Lyon, 1859. ANNUAIRE HISTORIQUE DU DEPARTEMENT DE L’YONNE, Recueil de documents authentiques, Perriquet et Rouillé, Auxerre, 1893, p. 229. ARNAUD Jean André Michel, Histoire du Velay jusqu’à la fin du règne de Louis XV, Le Puy, 1816, tome 1. ATALAYA, Revue Française d’Études Médiévales Hispaniques, Réflexions sur la « Crónica sarracina », par Madeleine Pardo, Presses de la Sorbonne nouvelle, Nº 4, automne 1993. AYROLES Jean-Baptiste-Joseph, La vraie Jeanne d’Arc, la paysanne et l’inspirée, Caumes et Cie, Paris, 1894, Tome II. BARANTE (M. de), Histoire des ducs de Bourgogne de la Maison de Valois, 13641477, Société Typographique Belge, Bruxelles, 1838. BASIN Thomas, Histoire des règnes de Charles VII et Louis XI, par Jules Quicherat, Renouard Libraire, Paris, 1855, tome 1. BAUDOT de JUILLY Nicolas, Histoire de Charles VII, Chez Didot, Paris, 1765, tome 1. BERNARD Auguste (Jeune), Histoire du Forez, Imprimerie Bernard aîné, Montbrison, 1835, volume II. BERRIAT SAINT-PRIX Jacques, Jeanne d’Arc, fragment du registre Delphinal de Thomassin, Réédition Biblio life, United States, 2009. BIBLIOTHEQUE de L’ECOLE des CHARTES, Revue du Moyen Âge, Paris, 1864, tome 1. Histoire du connétable de Lune, Libraire J. B. Dumoulin, Paris, 1844. BOLETÍN INFORMATIVO DO CONCELLO ENTRIMO, N° 1, primeiro semestre de 1989, redacción segregarla Consello, p. 13, et pp. 21-22.
373
e
BONALD Joseph (de), La Maison d’Armagnac au XV siècle, Imprimerie de Carrère, Rodez, 1909. BONNAVENTURE de SAINT-AMABLE (R. Père), Histoire de Saint-Martial apôtre des Gaules et notamment de l’Aquitaine et du Limousin, par A. Voisin Imprimeur et libraire, Limoges, 1685, tome III. BONAVENTURE de SISTERON L., Histoire de la ville et Principauté d’Orange, Marc Chave libraire, La Haye, 1761. BOUGES (R.P.), Histoire civile et ecclésiastique de la ville et diocèse de Carcassonne, Paris, 1761, p. 274. BOURGUEVILLE Charles (de), Les recherches et antiquités de la province de Neustrie, Caen, 1588. BRUGIERE DE BARANTE Amable Guillaume Prosper, Histoire des Ducs de Bourgogne de la maison de Valois, 1364-1477, Dufey, Paris, 1867, Vol. V. BUCHON J. A., Chroniques d’Enguerrand de Monstrelet, Chez Verdière Libraire, nouvelle édition, Paris, 1826, tome VI. BULLETIN DE LA SOCIETE D’EMULATION DU BOURBONNAIS, Lettres, sciences et arts, E. Auclaire, Moulins, 1930, tome 33. BULLETIN DE LA SOCIETE SCIENTIFIQUE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DE LA CORREZE, Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze : 1874, N° 2, 1905, T27, pp. 475, 495, 496. BULLETIN DU COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES, Section d’histoire et de Philologie, « Communication de M. L. Caillet », Paris, 1883-1884, Nº 1, 1909. BULLETIN MENSUEL D’HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE, « Le Moyen Âge », A. Marignan, G. Platon, M. Wilmotte, A. Picard, Paris, 1888, nº 1, 1909, SER 2, T. 13-T. 22. BURIGNY (Mr de), Histoire générale de Sicile, Isaac Beauregard/Pierre Gosse, La Haye, 1745, Tome II, Livre X. CACHO BLECUA Juan Manuel, Historias y ficciones, Los Historiadores de la crónica sarracina, Coloquio sobre la literatura del siglo XV, Universitat de Valencia, 1992. CAFFIN DE MEROUVILLE Michel, Le beau Dunois et son temps, Nouvelles Éditions Latines, Paris, 2003.
374
CALMET (Dom), Chronique de Metz, Histoire de Lorraine, 1728, tome II, preuves 207. CANAT Marcel, Documents inédits pour servir à l’histoire de la Bourgogne, publiés par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône, Dejussieu, Chalon-sur-Saône, 1863. CARRASCO Raphael, L’Espagne au temps des Validos, Presses universitaires du Mirail, Université de Toulouse, 2009. CASAUS BALLESTER María José, La Casa Ducal de Híjar y sus enlaces con linajes Castellanos, Boletín Millares Carlos, Número 27, Centro asociado Uned, pp. 108, 112, note 49. CASTILLO Rafael (del), Don Rodrigo de Villandrando, Novela Histórica, publicada bajo la dirección de Don Joaquín Ruiz de Morales, Madrid, 1859. CLEMENT Pierre, Jacques Cœur et Charles VII, Librairie de Guillaumin, Paris, 1853. CHATEAUBRIAND, Œuvres complètes de Chateaubriand « Analyse raisonnée de l’histoire de France », P. H. Krabe, libraire-éditeur, Paris, 1852, pp. 177-178. CIBRARIO Louis, Économie politique du Moyen Âge, Librairie de Guillaumin, Paris, 1859. CONTAMINE Philippe, « L’impact de la guerre de Cent Ans en France sur le plat pays et sur la vie au village », Les villageois face à la guerre, Presses universitaires du Mirail, Toulouse, 2002, pp. 21-22. COURTEAULT Henri, Gaston IV Comte de Foix, Vicomte du Béarn, Prince de Navarre, Privat, Toulouse 1895. CRONICA de Don Alvaro de Luna, édition de D. Josef Miguel de Flores, Madrid, 1784. DANIEL (Père), Histoire de la milice française, Hôtel de Thou, Paris, 1773, T1, p. 215. DAUMET Georges, Études sur l’alliance de la France et de la Castille aux XIVe et XVe siècles, E. bouillon, Paris, 1898. DEFOURNEAUX Marcelin, Le journal de la France, « Quand Rodrigue sème l’épouvante », Jules Taillandier, Paris, 1984, tome II. DESPLAT Christian DESPLAT, Les villageois face à la guerre XIVe-XVIIe siècles, Presses universitaires du Mirail, Toulouse, 2002.
375
DIDRON Edouard, Annales archéologiques, Librairie archéologique, Paris, 1869, tome XXVI. DUBY Georges, Le journal de la France, « Le marasme des villes », Jules Taillandier, Paris, 1984, Tome II. e
DUBOIS Adrien, Femmes dans la guerre (XIV -XV les sources ?, Université de Paris I.
e
siècles) : un rôle caché par
Du FRESNE de BEAUCOURT G., Chronique de Mathieu d’Escouchy, Nouvelle édition, Libraire Jules Renouard, Paris, 1864, tome III. DUHAMEL L. dans Revue du Midi, Religion, Littérature, Histoire, Gervais-Bedot, Nîmes, 1887-1914, Nº 1, 1914/01, pp. 239 à 241 et pp. 287 à 300. DUPONT Mlle, Mémoires de Philippe de Commines, Jules Renouard, Paris, 1840, T. I. DURIEU Paul, Procès-verbaux des séances de la Société des lettres, science et arts de l’Aveyron, « Communication de M. Paul Durieu », Rodez, 1891. FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA, Estudios en homenaje a Elida García García, Editor Universidad de Oviedo, 1998. FERNANDEZ ALONSO Benito, Orensanos Ilustres, Diputación Provincial de Ourense, 1916. FERNÁNDEZ DURO Cesáreo, la Marina de Castilla, El progreso editorial, Madrid, 1894, p. 447. FERNANDEZ de VELASCO (Don) Pedro, Seguro de Tordesillas. Segunda edición, Imprenta de Don Antonio de Sancha, Madrid, 1784, Capitulo XXV. FLAMARE Henri Adam (de), Le Nivernais pendant la guerre de Cent Ans : le XVe siècle, Gremion, Nevers, 1913-1925, tome 1. FOUILHAC Abbé Raymond Antoine de, Fragments de l’Histoire du Querci 12601560, Cahors, 1686. FREVILLE (comte de), Des grandes compagnies au quatorzième siècle, Bibliothèque de l’École des Chartes, Ire série, tome III. GARIBAY Estéban, Revista europea, Eduardo de Medina, 1876, p. 214. Original Université du Minnesota (numérisé le 15 février 2012). GARNIER Joseph et ROSSIGNOL, Inventaire sommaire des archives de la Côted’Or antérieures à 1790, Paul Dupont, Paris, 1864, tome II. Chalon, Comptes de Jean de Genlis, 1433-1434, Paul Dupont, Paris, 1864, tome I.
376
GAUJAL (Baron de), Études historiques sur le Rouergue, Paul Dupont, Paris, 1858, tome II. GENOUDE Eugène, Voyage dans la Vendée et le Midi de la France, Périsse Frères, Lyon, 1821. GLOUVET Jules (de), France 1418-1429, Histoire du bâtard de Montorel, A. Colin, Paris, 1895. GODEFROY Denys, Jean Chartier, histoire de Charles VII Roy de France, Jacques le Bouvier dit Berry, Mathieu de Coucy et autres auteurs du temps, Imprimerie royale, Paris, 1661. GOMEZ de CIBDAREAL Fernán, Centon epistolario del bachiller, en la Imprenta Real de la Gazeta, Madrid, 1775. GOMEZ RETONDO Fernando, Historia de la Prosa Medieval Castellana, Cátedra, Madrid, 2002, Vol. III. GRAILLY F. (de), Les États du Comtat Venaissin depuis leurs origines jusqu’à la fin du XVIe siècle, dans Mémoires de l’Académie de Vaucluse, Académie de Vaucluse, Seguin, Avignon, 1882, Nº 1, 1906. HARSGOR Mikhaël, « L’essor des bâtards nobles au XVe siècle », Revue Historique, Presses Universitaires de France, tome 253, fasc. 2 avril 1975, p. 319. HERMILLY M. (de), Histoire générale d’Espagne, traduite de l’espagnol de Jean de Ferreras, Chez Gissey/Le Breton/Ganeau, Paris, 1751, tome VI. HERNANDO POLO Cristina, Isabel la Católica, Grandeza, carácter y poder, Ediciones Nowtilus pocket Madrid, 2011. HUGO A., Histoire générale de France depuis les temps les plus reculés, jusqu’à nos jours, Delloye éditeur, Paris, 1841. IMAGO MUNDI, Encyclopédie en ligne. JARDIN Jean-Pierre, Voix et échos du monde nobiliaire dans l’historiographie Trastamare, « cahiers de linguistique médiévale », revue Persée, Fr, Vol. 25, 2002. JOULLIETTON M., Histoire de la Marche et du pays de Combrailles, Chez P. Betoulle, Guéret, 1814. JUVENAL des URSINS Jean, Chroniques de Charles VI, dans Chroniques et Mémoires de l’Histoire de France par J-A-C. Buchon, Auguste Desrez, Paris, 1838. Écrits politiques, tome 1, Paris, réédition, 1978, p. 58.
377
KERVYN DE LETTENHOVE sous le titre de Livre des trahisons de la France contre la noble maison de Bourgogne, volume de la grande collection des documents inédits belges, intitulé Chroniques relatives à l’histoire de la Belgique sous la domination des ducs de Bourgogne, p. 162. LACROIX Paul, Romans relatifs à l’histoire de France aux XVe et XVIe siècles, Auguste Derez, Paris, 1838. LA FRANCE FRANCISCAINE, Mélanges d’archéologie, d’histoire et de littérature, SN Lille, Paris, 1912, N° 1, 1921. LAMIGUEIRO José Luis, Xenealoxias Hispana do Ortegal, Edición datos y árbol www.xenealoxiasdoortegal.net. LANZA ALVAREZ Francisco, Ribadeo antiguo, Madrid, 1933, reedité par Edicios do Castro, la Coruña, 1973. LATEYSSONNIERE (M. de), Recherches historiques sur le département de l’Ain, Martin-Bottier, Bourg-en-Bresse, 1843. LAUER Philippe (de), Un nouveau document sur Rodrigue de Villandrando, Bibliothèque de l’école des Chartes, Éditeur Droz, Imprimerie de Decourchant, Paris, 1919, T 80. LAVALLEE Joseph Adrien Félix, Espagne, Firmin Didot, Paris, 1864, Vol. 1. LAVISSE Ernest, Histoire de France, tome IV, livre premier, Charles VII, fin de la guerre de Cent Ans, par Charles Petit-Dutaillis, Paris, 1902. LECOY de la MARCHE Albert, Le Roi René : sa vie, son administration, ses travaux artistiques et littéraires, Bibliobazaar, LLC, 2008. LEFEVRE-PONTALIS Germain, La petite chronique de Guyenne, Bibliothèque de l’École des Chartes, N° 8, 1886, T. 47. LE QUIEN DE LA NEUFVILLE, Histoire des Dauphins de Viennois, d’Auvergne et de France, Paris, G. Desprez, Paris, 1760. LEROY Béatrice, Le triomphe de l’Espagne catholique à la fin du Moyen Âge, Presses universitaires de Limoges, 2004. LE ROY-LADURIE E., Histoire des paysans de France, Seuil, Paris, 2002. LEUSSE (Vicomte de), dans Revue du Dauphiné, Borel, Valence, 1837, tome 1. LOISEL Antoine, Mémoires de pays, villes, comtés et comtes de Beauvois et Beauvoisis, Paris, 1617.
378
MATA CARRIAZO ARROQUIA Juan de, Falconer Chronique de Jean II, Pedro Carrillo de Huete, Madrid, Espasa-Calpe, 1946. MAINDRON Maurice, Récits du temps passé, Nouvelle Édition A. Maime et fils, Tours, 1924. MANDET Francisque, Histoire du Velay, les récits du Moyen-âge, Livre VIII, Marchessou, Le Puy, 1861. MARCHE Olivier (de La), Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France, Imprimerie de Rignoux, par M. Petitot, Paris, 1825, tome IX. MARTIN Henri, Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789, Furne, Paris, 1855-1860, tome IV et tome VI. MATHOREZ Jules, Notes sur la pénétration des Espagnols en France, du XIIe au XVIe siècle, Bulletin Hispanique, année 1922, Vol. 24, Nº 1. MEDEIROS Marie Thérèse (de), « Le Jouvencel de Jean de Bueil », Cahiers de recherches médiévales et Humanistes, Université d’Orléans, 1998. MEMOIRES DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI DE LA France, Société archéologique du Midi de la France, SN Toulouse, 1834, Nº 1, 1908 et T. 16. MEMOIRES SOCIETE D’HISTOIRE, D’ARCHEOLOGIE ET LITTERATURE de l’arrondissement de Beaune, 1874-1904, Vol. 1897.
DE
MENARD Léon, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nîmes, H.D. Chaubert, Paris, 1758, tome III. MOLLAT Michel, Les pauvres au Moyen (www.editionscomplexe.com), Vol. 1, 2006.
Âge,
Éditions
Complexe.
MONFALCON J.-B, Histoire monumentale de la ville de Lyon, Firmin Didot, Paris, 1866, tome II. MONSTRELET d’ARCQ, Chroniques, publiées par la Société de l’Histoire de France, Paris, 1861, tome IV. MOREL FATIO Alfred, Don Rodrigo de Villandrando, conde de Ribadeo por don Antonio Maria Fabié, Bibliothèque de l’École des Chartes, Année 1884, Vol. 45. MURE (de la), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, Potier, Paris, 1809, tome I. NABERT Nathalie, Le Mal et le Diable : leurs figures à la fin du Moyen Age, Université Catholique, Éditions Beauchesne, Paris, 1996.
379
NICOLAS (M. l’abbé C), Histoire de Génolhac d’après les documents inédits, réédition de l’édition Chastanier, Nîmes, 1897, aux Éditions Lacour, Nîmes, 1990. PALENCIA Alonso (de), Cronica de Enrique IV escrita en latín, traducción Castellana por D.A Paz Y Melia, Tip, De la « Revista de Archivos », Madrid, 19041908, tome 1. PARDO Madeleine, « L’historien et ses personnages », Études sur l’historiographie espagnole médiévale, ENS Éditions, Lyon, 2006. Annexe des cahiers d’études hispaniques médiévales, ENS Éditions, Lyon, 2006, vol 17. PAZ y MELIA Antonio, El cronista Alonzo de Palencia, Elibron Classics series, Adaman media Corporation, fac-similé de l’édition de 1914, publié par la Société Hispanique Américaine de Madrid, 2006. PELLIZER DE OSSAU Y TOVAR Josef, Informe del origen antigüedad, calidad y sucesión de la excelentísima casa de Sarmiento de Villamayor, en Madrid, 1663. PEREIRA DOMÍNGUEZ Benito, Rodrigo de Villandrando conde de Ribadeo, Proditex & Consultaría Dirección, Valle Inclán, 5-4º A 32004, Ourense, 2006. PEREZ de GUZMAN Fernán, Crónica del señor rey D. Juan segundo de este nombre, Imprenta de Benito Monfort, Valencia, 1779. PEREZ de VILLAAMIL y DUGUET Jenaro, Album artistique et monumental d’Espagne, Paris, 1842. PERICAUD A. Ainé, Notes et documents pour servir à l’histoire de Lyon 13501493, Imprimerie de Pélagaud et Lesne, Lyon, 1839. PERO TAFUR, Andanças e viajes de Pero Tafur, traduit par Marcos Jiménez de la Espada, Miraguano, Madrid, 1995. PINOTEAU Hervé, Introduction à l’héraldique, « Dictionnaire des noms de famille », Vernoy-Arnaud de Vesgre, Athena & Idegraf, Suisse, 1980, p. 758. PETIT-DUTAILLIS Charles, Charles VII, fin de la guerre de Cent Ans, livre premier, Paris, 1902. PETIT Olivier, Magazine Citadelle, un autre regard sur le Moyen Âge, No 3, Juillet 2000. PISE Joseph (de La), Tableau de l’histoire des princes et de la principauté d’Orange, Imprimerie Théodore Maire, La Haye, 1640, p. 122. PORTAL Charles, Histoire de la ville de Cordes, 1222-1799, Société des amis du vieux Cordes, 4e édition, 2010.
380
PUBLICATIONS DE LA SORBONNE, Ports maritimes et fluviaux au Moyen Âge, Paris, 2005. QUICHERAT Jules, Vie de Rodrigue de Villandrando, capitaine de Compagnie sous Charles VII, Firmin Didot Frères, Paris, 1845. QUICHERAT Jules, Rodrigue de Villandrando, l’un des combattants pour e l’indépendance de la France au XV siècle, Librairie Hachette et Cie, Paris, 1879. La chronique des Cordeliers de Paris, « Revue historique », Paris, 1882, tome 19. RAOULET Jean, Chroniques, Janet Libraire, Paris, 1858. RAYNAL Louis, Histoire du Berry, Librairie de Vermeil, Éditeur « Au grand Bourdaloue », Bourges, 1844, tome III. REVUE D’HISTOIRE MARITIME, Risque, sécurité et sécurisation maritimes depuis le Moyen Âge, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, Paris, 2008. REVUE DU BEARN, NAVARRE ET LANNES, Partie historique de la revue des basses Pyrénées et des Landes, Éditeur : S.N., Paris, 1884. REVUE de GASCOGNE, Bulletin mensuel du comité d’histoire et d’archéologie de la province ecclésiastique d’Auch, Société historique de Gascogne, Éditeur : S. N. Auch 1864-1939, N° 2, 1929/01, p. 64. REVUE HISTORIQUE SCIENTIFIQUE ET LITTERAIRE DU DEPARTEMENT DU TARN, Nº 4, 1877, Vol. 1. REVUE DU MIDI, Religion, littérature, histoire, Gervais-Bedot, Nîmes, Nº 1, 1914/01. e
REY R, Louis XI et les États pontificaux de France au XV siècle, Imprimerie de Allier frères, Grenoble, 1899. ROCHAS Adolphe, Biographie du Dauphiné, Charavay, Paris, 1856. ROSSI Mario, Les noms de lieux du Brionnais-Charolais, témoins de l’histoire du peuplement et du paysage, Publibook, Paris, 2009. ROCQUAIN Félix, Études sur l’ancienne France, Didier, Paris, 1875, p. 296. ROUQUETTE (M. L’abbé) Joseph, Le Rouergue sous les Anglais, Imprimeurs d’Artières et J. Maury, Millau, 1887, p. 431. RUCQUOI Adeline, « Sociétés urbaines et universitaires en Castille au Moyen Age », Milieux universitaires et mentalité urbaine au Moyen Âge, Presses de
381
l’université de Paris Sorbonne 1987. Privauté, fortune et politique : La chute d’Alvaro de Luna, publications du CNRS, Paris, 2004. SAINT-JULIEN de BALEURRE Pierre (de), De l’origine des Bourgongnons, Chez Nicolas Chesnay, Paris, 1580. SAND Georges, Jean Ziska, épisode de la guerre des Hussites, Meline, Cans et cie librairie imprimerie et fonderie, Bruxelles, 1843. SATORRE GRAU José Joaquin, « Pedro de Corral y la estructura de su Crónica del Rey Don Rodrigo », al Andalus, 1969, 34, 159-73. SICKEL Théodor, Lettre de Jeanne d’Arc aux Hussites, Bibliothèque de l’école des Chartes, 1861, Vol. 22, Nº 22, pp. 81-82. SOCIETE DE L’HISTOIRE DE FRANCE, Chronique du connétable de Richemont par Guillaume Gruel, Année 1429, Achille Le Vavasseur, Librairie Renouard, Paris, 1890. Chronique de Monstrelet, Paris, 1861, tome IV. SOYEZ Jean Marc, Quand les Anglais vendangeaient l’Aquitaine, « collection Les mémoires de France, les dossiers de l’Aquitaine », Bordeaux, ISBN : 2-846220-948. STEENACKERS F.-F., Agnès Sorel et Charles VII, essai sur l’état politique et moral de la France au XVe siècle, Chez Didier et Cie, libraires-éditeurs, Paris, 1868. TELLO M. « Don Rodrigo de Villandrando, conde de Ribadeo », Discurso leído en la junta pública de aniversario de la Real Academia de la historia, el 24 de mayo de 1882, por D. Antonio Maria Fabié académico de numero, Madrid, 1882. TIJET Jean-Jacques, Les batailles près de Lyon, La bataille d’Anthon, 2011, p.13. www.slideshare.net/JeanJacquesTijet. TOUCHARD-LAFOSSE Georges, La Loire historique, pittoresque et biographique. Tome Ier, Suireau, Nantes, 1840. TRANCHANT Mathias, Revue d’histoire maritime : risque, sécurité et sécurisation maritimes depuis le Moyen-Âge, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, Paris, 2008. e
e
TRICARD Jean, Les campagnes limousines du XIV au XVI siècle, Publications de la Sorbonne, Paris, 1996. TRINGANT Guillaume, Commentaire sur le Jouvencel, Chez Jules Renouard, Paris, 1887. TUETEY M. (de), Les Écorcheurs sous Charles VII, Henri Barbier, Montbéliard, 1874, tome I, p. 10.
382
UREÑAS PARADES Juan Carlos, Rincones con Fantasma. Un paseo por el Valladolid desaparecido, Casa Revilla, Valladolid, 2006, ISBN : 84-95389-97-5. VAISSETTE (Dom), Histoire du Languedoc, J.B. Paya, Toulouse, 1860, T. IV et T. VIII. VALLET de VIRILLE, Chronique de Cousinot, Delahays, Paris, 1859. Histoire de Charles VII, P. Janet, Paris, 1853. Chronique de Jean Raoulet, Janet Libraire, Paris, 1858, T. 3. Chroniques de Charles VII, roi de France par Jean Chartier P. Janet, Paris 1853. Histoire de Charles VII et de son époque 1403-1461, Librairie de la Société d’Histoire de France, Renouard, Paris, 1863, tome II. VERMS Miguel (del), Chroniques béarnaises, dans le Panthéon littéraire, volume intitulé chroniques et mémoires sur l’histoire de France au quatorzième siècle, Paris, 1811. VIDAL Auguste, correspondant de la société, Revue historique scientifique et littéraire du département du Tarn, Nº 4, 1877, Vol. 1. ZURITA Jerónimo, Anales de la corona de Aragón, Libros postreros de la Historia del Rey Don Hernando el Católico, Impresos en Zaragoza Colegio San Vicente Ferrer, 1610, I. XIII, C. LXXI. Jerónimo ZURITA, Pedro Lanaja LAMARCA, Los cinco libros primeros de la secunda parte de los anales de la corona de Aragón, tomo III, Libro XIII, cap. LXXI.
383
TABLE DES MATIERES VALLADOLID Monasterio de la Merced
p. 7.
ENTRE DEUX ROYAUMES
p. 11.
Première partie L’EPOPEE FRANÇAISE -I-
ARMAGNACS ET BOURGUIGNONS La maudite guerre.
p. 21.
LES SEIGNEURS DE GUERRE, Rodrigue crée sa propre compagnie.
p. 27.
DU SIEGE DE VILLENEUVE-LE-ROI A L’AVENEMENT DE CHARLES VII.
p. 35.
ESCARMOUCHES ET CHASSES-CROISES PERMANENTS.
p. 41.
-V-
LE DESASTRE DE VERNEUIL, 17 août 1424
p. 47.
-V-
LE TROISIEME CONFLIT La guerre des grands féodaux.
p. 53.
LA COMPAGNIE DE RODRIGUE Le temps de la survie pour des routiers sans contrat.
p. 63.
-VII-
PRELUDE À UNE GRANDE BATAILLE.
p. 71.
-VIII-
LA BATAILLE D’ANTHON.
p. 85.
-IX-
LE PRIX DE LA DEFAITE La capitulation de la principauté d’orange.
p. 105.
EPISODES BOURGUIGNONS.
p. 113.
-II-III-IV-
-VI-
-X-
-XI-
LES CROISADES CONTRE LES HUSSITES et leur extension dans le Mâconnais, le Forez et le Velay.
p. 119.
PROLONGEMENT DES CONFLITS SOCIAUX Différends entre le clergé et la noblesse du Velay.
p. 131.
RODRIGUE Seigneur de Pusignan, de Talmont, Comte de Ribadeo.
p. 135.
-XIV-
LE SIEGE DE LAGNY 10 août 1432.
p. 143.
-XV-
LA DETROUSSE DES PONTS-DE-CE.
p. 155.
-XVI-
RODRIGUE EPOUSE MARGUERITE DE BOURBON.
p. 165.
-XVII-
« L’AFFAIRE » DU CARDINAL DE CARILLO
p. 177.
-XVIII-
LA GUERRE DES DUCS.
p. 189.
-XIX-
COOPERATION ENTRE LA FRANCE ET LA CASTILLE.
p. 201.
LES « ECORCHEURS » Les conséquences d’un traité de paix qui plonge le royaume dans les affres d’une guerre sans nom.
p. 207.
-XXI-
LA RECONQUÊTE DE PARIS.
p. 219.
-XXII-
ALBI Deux évêques pour un siège épiscopal
p. 225.
-XXIII-
LE CONCILIABULE D’ANGERS ET LA DISGRÂCE DE RODRIGUE.
p. 241.
LA CAMPAGNE DE GUYENNE ET L’ENTREVUE AVEC LE COMTE D’HUNTINGDON.
p. 257.
L’ATTAQUE DU ROUSSILLON novembre 1438.
p. 271
-XII-XIII-
-XX-
-XXIV-
-XXV-
Deuxième partie L’EPOPEE ESPAGNOLE -I-
LES RAISONS D’UNE MISSION SANS RETOUR.
p. 283.
-II-
LA REVOLTE DES GRANDS D’ESPAGNE.
p. 289.
-III-
UN REDOUTABLE HOMME D’AFFAIRES.
p. 295.
-IV-
TOLEDE Rodrigue revêt les habits du roi et sauve le souverain.
p. 303.
MEDINA DEL CAMPO Le piège se referme autour du connétable de Castille.
p. 311.
LES DERNIERS COMBATS DU COMTE DE RIBADEO du siège de Cuellar à la bataille d’Olmedo.
p. 317.
-VII-
LA CHUTE D'ALVARO DE LUNA.
p. 325.
- VIII-
VALLADOLID Monasterio de la Merced 14 Avril 1448.
p. 333.
-V-VI-
Troisième partie DONNEES HISTORIQUES COMPLEMENTAIRES Annexes - Annexe 1
LA FRANCE DE RODRIGUE.
p. 336.
- Annexe 2
L’ESPAGNE DE RODRIGUE.
p. 337.
- Annexe 3
L’EUROPE DE RODRIGUE.
p. 338.
- Annexe 4
LA MAISON DE VILLANDRANDO.
p. 339
- Annexe 5
CONTRAT DE MARIAGE DE RODRIGUE.
p. 343.
- Annexe 6
RODRIGUE ET LA MAISON DE BOURBON.
p. 346.
- Annexe 7
LE CHATEAU DE CHATELDON, Le séjour de Rodrigue et de Marguerite de Bourbon.
p. 347.
FAC-SIMILE Lettre adressée au conseil de ville de Lyon, écrite de la main de Rodrigue.
p. 349
PEDRO DE CORRAL Frère de Rodrigue.
p. 351.
- Annexe 8 - Annexe 9
- Annexe 10 HYPOTHESES SUR LES DATES DE LA NAISSANCE ET DE LA MORT DE RODRIGUE.
p. 356.
- Annexe 11 ESSAI DE LOCALISATION DU REPAIRE DE RODRIGUE DANS LES CEVENNES.
p. 360.
- Annexe 12 ORDONNANCE Attestant de la propriété de navires marchands par Rodrigue (1432).
p. 362.
- Annexe 13 MANGER A LA TABLE DU ROI.
p. 366.
- Annexe 14 LE TOMBEAU D’ALVARO DE LUNA.
p. 371.
BIBLIOGRAPHIE
p. 373.
L’histoire aux éditions L’Harmattan Dernières parutions mensonges (Les) de l’Histoire
Monteil Pierre
Chaque génération hérite des a priori et des idées reçues de la génération précédente. Ainsi, nombreux sont les mensonges de l’Histoire qui ont survécu jusqu’à nos jours. Nos ancêtres les Gaulois ? Napoléon était petit ? Au Moyen Age, les gens ne se lavaient pas ? Christophe Colomb a découvert l’Amérique ? Ce livre revient sur 80 poncifs considérés par beaucoup comme une réalité... (Coll. Rue des écoles, 28.00 euros, 282 p.) ISBN : 978-2-336-29074-4, ISBN EBOOK : 978-2-296-51351-8 Flavius Josèphe – Les ambitions d’un homme
Cohen-Matlofsky Claude
Quelles furent les ambitions cachées de Flavius Josèphe, historien Juif de l’Antiquité ? Il prône, à travers ses écrits, le retour à la monarchie de type hasmonéen, à savoir d’un roi-grand prêtre, comme réponse à tous les maux de la Judée. La question fondamentale est la suivante : comment les élites locales ont-elles géré leurs relations avec la puissance romaine et quel rôle les membres de l’élite ont-ils assigné à leurs traditions et constitution politique dans cet environnement d’acculturation ? (Coll. Historiques, série Travaux, 15.50 euros, 152 p.) ISBN : 978-2-336-00528-7, ISBN EBOOK : 978-2-296-51387-7 mer (La), ses valeurs
Groupe «Mer et valeurs» Sous la direction de Chantal Reynier – Préface de Francis Vallat
La mer, plus que jamais, est la chance des hommes et la clef de leur avenir. Elle leur apprend la responsabilité, suscite l’esprit d’initiative, mais elle oblige tout autant à rester humble devant ses forces naturelles. Le groupe de réflexion «Mer et Valeurs», réunissant navigants et universitaires, examine l’influence de ces valeurs rapportées à toutes les activités humaines. Des références historiques et géographiques illustrent le développement intellectuel et économique des pays qui se sont tournés vers la mer. ISBN : 978-2-336-00836-3, ISBN EBOOK : 978-2-296-51412-6 (21.00 euros, 188 p.) Métamorphoses rurales Philippe Schar : itinéraire géographique de 1984 à 2010
Sous la direction de Dominique Soulancé et Frédéric Bourdier
Philippe Schar était convaincu que la géographie ne saurait exister sans la dimension du temps et la profondeur de l’histoire, seules capables de mettre pleinement en lumière le présent et de le restituer dans toutes ses dimensions. On retrouve en filigrane dans ses recherches concises et pointues la volonté de replacer les opérations de développement à l’interface des logiques promues par les décideurs d’un côté et par les populations de l’autre. Cet ouvrage présente une sélection de ses écrits. (33.00 euros, 320 p.) ISBN : 978-2-296-99748-6, ISBN EBOOK : 978-2-296-51501-7 Pouvoir du Mal – Les méchants dans l’histoire
Tulard Jean
L’Histoire n’est pas une magnifique suite d’actions héroïques et de gestes admirables. Sans le Mal pas d’Histoire. Et il faut l’avouer, les méchants sont les personnages les plus fascinants de
la saga des peuples. En voici treize, présentés à travers des dramatiques interprétées jadis sur les ondes. Treize portraits où l’on retrouve méchants célèbres comme Néron ou Beria et héros insolites comme Olivier Le Daim ou le prince de Palagonia. Ils illustrent le pouvoir du Mal. (Coédition SPM, 25.00 euros, 270 p.) ISBN : 978-2-917232-01-9, ISBN EBOOK : 978-2-296-51010-4 vies (Les) de 12 femmes d’empereur romain Devoirs, intrigues et voluptés
Minaud Gérard
Grâce à un méticuleux travail de recherche se redéploie ce que furent les vies de 12 femmes d’empereur et leur influence, non seulement sur leur mari mais aussi sur le destin de Rome. Les pires informations se mêlent. Un amour maternel allant jusqu’à l’inceste, un amour conjugal virant au meurtre, un amour du pouvoir justifiant tout. D’un autre côté, un sens du devoir exceptionnel, une habileté politique remarquable, un goût du savoir insatiable. ISBN : 978-2-336-00291-0, ISBN EBOOK : 978-2-296-50711-1 (34.00 euros, 332 p.) monde (Le) des morts Espaces et paysages de l’Au-delà dans l’imaginaire grec d’Homère à la fin du Ve siècle avant J.-C.
Cousin Catherine
Ce livre propose d’étudier l’évolution des conceptions que les Grecs ont pu se former des espaces et des paysages de l’au-delà, jusqu’à la fin du Ve siècle avant J.-C. Monde invisible, interdit aux vivants, mais sans cesse présent à leur esprit, les Enfers relèvent pleinement de l’imaginaire. Une comparaison entre productions littéraires et iconographiques enrichit cette étude et laisse entrevoir l’image mentale que les Grecs se forgeaient du paysage infernal. (Coll. Kubaba, série Antiquité, 39.00 euros, 402 p.) ISBN : 978-2-296-96307-8, ISBN EBOOK : 978-2-296-50624-4 Corps et âmes du mazdéen – Le lexique zoroastrien de l’eschatologie individuelle
Pirart Eric
Selon les conceptions mazdéennes, l’individu posséderait plusieurs types d’âmes. Est-ce vrai ? Et qu’advient-il de telles âmes au-delà de la mort ? De quel sexe sont-elles ? Et le corps ? Pour répondre à de telles questions, Éric Pirart analyse les textes zoroastriens des diverses époques anciennes ou médiévales et y décrypte le lexique de l’eschatologie individuelle. (Coll. Kubaba, 29.00 euros, 294 p.) ISBN : 978-2-296-99286-3, ISBN EBOOK : 978-2-296-50580-3 3000 ans de révolution agricole Techniques et pratiques agricoles de l’Antiquité à la fin du XIXe siècle
Vanderpooten Michel
De la Grèce et la Rome antiques à l’Andalousie arabe, des campagnes gauloises à la France des Lumières et de la Révolution industrielle du XIXe siècle, l’évolution des connaissances et des pratiques agricoles est ici retracée à travers l’étude de près de 4000 documents. Les étapes de la production agricole, à différentes époques, sont étudiées, ainsi que l’entrée de l’agriculture dans l’ère de la chimie et du machinisme. (Coll. Historiques, série Travaux, 34.00 euros, 332 p.) ISBN : 978-2-296-96444-0, ISBN EBOOK : 978-2-296-50329-8 Antiquité (L’) moderne
Wright Donald
Ce livre étudie le regard que l’homme de la Belle Époque porte sur l’Antiquité. Il analyse la modernité de la Troisième République et ce que celle-ci doit à une interprétation systématique et scientifique des apports grecs et romains. Au travers des textes littéraires et scientifiques ainsi que de nombreux documents ensevelis puis retrouvés dans les archives françaises, ce livre est une étude sociologique d’une époque moderne par excellence qui se veut «classique». (Coll. Historiques, série Travaux, 27.00 euros, 274 p.) ISBN : 978-2-296-99168-2, ISBN EBOOK : 978-2-296-50407-3
Grandeur et servitude coloniales
Sarraut Albert - Texte présenté par Nicola Cooper
Albert Sarraut fut l’un des maîtres-penseurs du colonialisme de la période de l’entre-deuxguerres. Cet ouvrage de 1931 est l’un des meilleurs exemples de la justification du colonialisme français : il touche à tous les impératifs coloniaux de la France, du tournant du siècle aux débuts de la décolonisation. C’est essentiellement Sarraut qui façonna le langage avec lequel les Français parlaient de leur empire colonial. (Coll. Autrement mêmes, 24.00 euros, 200 p.) ISBN : 978-2-296-99409-6, ISBN EBOOK : 978-2-296-50121-8 Homo Sapiens (L’) et le Neandertal se sont-ils parlé en ramakushi il y a 100000 ans ? Paléontologie génétique et archéologie linguistique
Diagne Pathé
Cet ouvrage présente les découvertes qui permettent pour la première fois d’éclairer de manière factuelle la révolution culturelle et linguistique, qui a planétarisé avec l’avènement de la parole de Sapiens, voire de Néandertal, le monothéisme et les cultes bachiques de bonne fortune et de fécondité, à partir de 300000 et 200000 ans av. J.-C. Les faits qui rendent compte de manière précise de cette révolution sont portés par le ramakushi et son vocabulaire comme langage datable matériellement entre 8000 et 10000 ans av. J.-C. (Editions Sankoré, 14.50 euros, 138 p.) ISBN : 978-2-296-99334-1, ISBN EBOOK : 978-2-296-50189-8 Histoire des peuples résilients (Tome 1) Traumatisme et cohésion VIe-XVIe siècle
Benoit Georges
Ce livre revient sur l’histoire de communautés éparses qui, surmontant le traumatisme de leur naissance improbable, firent preuve de résilience collective. Histoire particulière, marginale, de rescapés et de fuyards qui se prirent en charge pour se sauver, trouvant en eux-mêmes, dans leur cohésion intime, cette énergie qui les hissa au-dessus de l’ordinaire. Histoire de petites sociétés horizontales qui, vivant en périphérie du continent européen, irradièrent au loin jusqu’à se poster en économies-monde, quand la société médiévale, toute pétrie de verticalité hiérarchique, clouait la population au sol. (Coll. Historiques, série Essais, 23.00 euros, 222 p.) ISBN : 978-2-296-99201-6, ISBN EBOOK : 978-2-296-50168-3 Histoire des peuples résilients (Tome 2) – Confiance et défiance XVIe-XXIe siècle
Benoit Georges
Au XVIe siècle, la Contre-Réforme déclara le meilleur de la bourgeoisie persona non grata et, poussant des communautés entières à l’exil, elle les contraignit à se réfugier dans une Eglise plus sociétaire, à tramer du lien social - source de cohésion et de puissance, à faire preuve de cette résilience collective qui fit la fortune de l’Amérique puritaine. Dans ce second tome, cette histoire dit aussi ce que - privées d’une aventure commune - l’Inde des castes et l’Italie du Mezzogiorno ne furent pas ; ce que - par esprit de défiance - l’Amérique des temps modernes pourrait ne plus être. (Coll. Historiques, série Essais, 23.00 euros, 224 p.) ISBN : 978-2-296-99200-9, ISBN EBOOK : 978-2-296-50167-6 vagabond (Le) en occident. Sur la route, dans la rue (Volume 1) – Du Moyen Age au XIXe siècle
Sous la direction de Francis Desvois et Morag J. Munro-Landi
Les textes ici réunis se proposent de fixer une image du vagabond dans les cultures occidentales. Du Moyen Age à nos jours, les sociétés occidentales ont hésité entre fascination et répulsion pour le nomadisme, enviable quand il est choisi, détestable et harassant quand il est imposé. Ces contributions reviennent sur l’histoire de ce phénomène, son accueil et sa pénalisation, ainsi que sur ses représentations dans la littérature et les arts plastiques. (38.00 euros, 378 p.) ISBN : 978-2-296-99153-8, ISBN EBOOK : 978-2-296-50110-2
vagabond (Le) en occident. Sur la route, dans la rue (Volume 2)
Sous la direction de Francis Desvois et Morag J. Munro-Landi
Ce volume s’interroge sur l’esthétisation progressive et simultanée, partout en Occident, du vagabond. Bohème et poète, on le voit dériver lentement d’une recherche d’identité plus ou moins consciente et assumée vers la désagrégation personnelle et le désenchantement incarnés par les bandes de voyous et les punks. Le vagabondage retrouve alors sa fonction première de quête de la survie, mais avec un horizon beaucoup plus sombre désormais. (35.00 euros, 346 p.) ISBN : 978-2-296-99154-5, ISBN EBOOK : 978-2-296-50111-9 baleines (Les) franches
Soulaire Jacques
Véritable encyclopédie richement illustrée, ce livre nous plonge dans les mers froides, à la découverte de l’univers passionnant des baleines franches. Un premier volet détaille l’anatomie et la physiologie de ces géants du monde animal, un second déroule l’histoire de leur pêche par pays de manière chronologique, ce qu’aucune histoire de la chasse à la baleine n’avait fait auparavant. (SPM, 39.00 euros, 560 p.) ISBN : 978-2-901952-93-0, ISBN EBOOK : 978-2-296-50078-5 Historique de l’artillerie de marine et de la colonisation française
Laloire Jean-Claude - Préface du général de brigade Bertrand Noirtin
Cet ouvrage présente les Bigors, les Artilleurs de Marine, engagés hors du territoire métropolitain, en particulier sur les continents africain et asiatique, depuis leur création officielle en 1692. Ils ont apporté une contribution décisive à la constitution des empires coloniaux successifs, et à leur gestion. L’artillerie de Marine constitue aujourd’hui une armée d’excellence face aux menaces actuelles. (11.50 euros, 94 p.) ISBN : 978-2-296-99254-2 Histoire navale histoire maritime Mélanges offerts à Patrick Villiers
Textes réunis par Christian Borde et Christian Pfister
Ces contributions traitent de l’histoire navale et maritime de l’antiquité romaine à la période contemporaine. Transgressant la frontière entre marine de guerre et de commerce, P. Villiers a ensuite mené des travaux sur l’archéologie du vaisseau de guerre à l’âge classique, la bataille navale, les dynamiques portuaires, le commerce colonial et la traite des esclaves, les convois atlantiques et la guerre de course, sans oublier la marine de Loire. ISBN : 978-2-901952-92-3 (SPM, 21.00 euros, 210 p.) royaumes (Les) néo-hittites à l’âge du fer Les Hittites et leur histoire
Freu Jacques, Mazoyer Michel
Ce livre présente l’époque dite néo-hittite et fait une conclusion globale sur l’histoire et la civilisation hittites. L’histoire des États «néo-hittites» débute après l’effondrement, vers -1180, du grand royaume de Hatti. Elle a connu plusieurs phases : l’âge d’or, celui des contacts réguliers avec les Assyriens et les rois d’Urartu, d’Israël et de Phrygie ; la période finale et la conquête assyrienne, de la seconde moitié du VIIIe siècle à la fin du VIIe siècle avant JC. (Coll. Kubaba, série Antiquité, 36.00 euros, 366 p.) ISBN : 978-2-296-99244-3 Soleil (Le) et la Lune dans le paganisme scandinave du mésolithique à l’âge du bronze récent (de 8000 à 500 av.J.-C.)
Ettighoffer Patrick
Le Soleil et la Lune jouent un rôle déterminant dans les structures mêmes du paganisme nordique. Les deux luminaires sont indissociablement liés sous le terme de «cycle vital», autrement dit l’alternance vie-mort-renouveau. Voici un exposé historique, archéologique et iconographique, enrichi de recours à l’ethnographie, la tradition littéraire, la linguistique, l’étymologie et la toponymie. (Coll. Kubaba, série Antiquité, 36.00 euros, 348 p.) ISBN : 978-2-296-96990-2
L'HARMATTAN, ITALIA Via Degli Artisti 15; 10124 Torino L'HARMATTAN HONGRIE Könyvesbolt ; Kossuth L. u. 14-16 1053 Budapest ESPACE L'HARMATTAN KINSHASA Faculté des Sciences sociales, politiques et administratives BP243, KIN XI Université de Kinshasa
L’HARMATTAN CONGO 67, av. E. P. Lumumba Bât. – Congo Pharmacie (Bib. Nat.) BP2874 Brazzaville [email protected]
L’HARMATTAN GUINÉE Almamya Rue KA 028, en face du restaurant Le Cèdre OKB agency BP 3470 Conakry (00224) 60 20 85 08 [email protected] L’HARMATTAN CAMEROUN BP 11486 Face à la SNI, immeuble Don Bosco Yaoundé (00237) 99 76 61 66 [email protected] L’HARMATTAN CÔTE D’IVOIRE Résidence Karl / cité des arts Abidjan-Cocody 03 BP 1588 Abidjan 03 (00225) 05 77 87 31 [email protected] L’HARMATTAN MAURITANIE Espace El Kettab du livre francophone N° 472 avenue du Palais des Congrès BP 316 Nouakchott (00222) 63 25 980 L’HARMATTAN SÉNÉGAL « Villa Rose », rue de Diourbel X G, Point E BP 45034 Dakar FANN (00221) 33 825 98 58 / 77 242 25 08 [email protected] L’HARMATTAN TOGO 1771, Bd du 13 janvier BP 414 Lomé Tél : 00 228 2201792 [email protected]
Achevé d’imprimer par Corlet Numérique - 14110 Condé-Sur-Noireau N° d’imprimeur : 96879 - Dépôt légal : avril 2013 - Imprimé en France
Chemins de la Mémoire Série XVe siècle
Et Jeanne d’Arc sauva la France… Ce cliché demeure à jamais inscrit dans l’histoire. Pour beaucoup de Français, il s’impose à lui seul comme le résumé de la guerre de Cent Ans. Pourtant durant cette période les acteurs furent nombreux. Certains oubliés de l’histoire ont eu un rôle capital pour amorcer la reconquête du sol qui, plus tard, deviendra la France. Rodrigue de Villandrando est de ceux-là, lui qui exerça une action de premier plan dans la stratégie militaire du roi Charles VII. Pour comprendre ces évènements, suivons Rodrigue entre France et Castille, dans une véritable épopée guerrière, sur le théâtre des combats, des malheurs et des exactions. Simple mercenaire puis capitaine d’une compagnie de routiers, il gravira tous les échelons dans une destinée hors du commun. A l’apogée de sa puissance, il commande une compagnie de 10 000 hommes qu’il met, tantôt au service des plus grands, de l’Eglise, ou du Roi. Puis un jour de 1439, il franchira à nouveau les Pyrénées appelé au service de Juan II, roi de Castille. Il terminera son existence paré des titres de Grand d’Espagne et Maréchal des Asturies.
Fernand Monatte est un enfant du Velay. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages historiques dont une étude portant sur la vie quotidienne des habitants du Puy-enVelay sous le règne de Louis XIII. Il a comme champ de travail complémentaire une implication active dans le domaine de la préhistoire. A ce titre il a participé à des chantiers de fouilles, recherches et publications en haute vallée de la Loire. Image de couverture d’après une aquarelle originale de Jean-Paul MONATTE.
ISBN : 978-2-336-29063-8
38,50 €