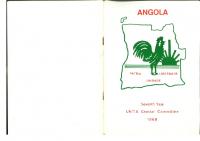Pesquisas arqueológicas na Baía-Farta (Benguela, Angola) 9782343174419, 2343174415
Présentation de l'éditeur : "Cet ouvrage retrace une longue période de collaboration scientifique en archéolog
126 56 220MB
French Pages 209
Polecaj historie
Table of contents :
Page vierge
Citation preview
..\ _
echchsArchcolog1qes
BenguelaAngola ‘ _
raducfion: Michèle Moreira .
«
.\\....
«mpeEd1nologîçgréhismfiqæ-Ar ' * cNmonä‘d‘ a
ologæDëBc ;;_
, ,,, 0/
‘
_; --—
" ‘ / , ‘ J
//._/'
Recherches archéologiques à Baia Farta (Benguela-Angola) Pesqaisas Arqaeolôgicas na Baia Farta ( Bengaela-Angola ) Traduction Michele Moreira / Traduçâo Michele Moreira
© L’Harmattan, 2019 5—7, rue d e l’École-Polytechnique — 75005 Paris www.editions-harmattan.fr ISBN : 978—2—343-17441-9 EAN : 9782343174419
Recherches archéologiques à Baia Farta (Benguela-Angola) Nanterre - 2019 ArScAn - Archéologies et Sciences de l’Antiquité, CNRS - Université de Paris I Panthéon Sorbonne, Université de Paris Ouest Nanterre la Défense - Ministère de la Culture, Maison René Ginouvès,
Archéologie et Ethnologie, 21 allée de l’Université, F92023 Nanterre Cedex. Tél : 33 (0)1 46 69 2418 Fax : 33 (0)1 46 69 24 92
Site : www.arscan.fr Mél : [email protected] Mél. générique : [email protected]
Édition & Conception Graphique : Edmond MAGNIFIQUE (ArScAn - UMR 7041)
Recherches archéologiques à Baia Farta (Benguela-Angola) Pesquisas Arqaeolôgicas na Baia Farta ( Bengaela-Angola ) Traduction Michele Moreira / Traduçâo Michele Moreira
SOUS LA DIRECTION DE / COORDENAÇÂO DE Manuel Gutierrez Maria Helena Benjamim Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Équipe Ethnologie Préhistorique - ArScAn-UMR 7041 Musée National dÀrchéologie de Benguela / Musea Nacional de Arqueologia de Bengaela
EDITIONS L’ HARMATTAN
«sa-«9»
En hommage à Luis Fais Pinto, premier directeur du Musée National d’Archéologie de Benguela. Em homenagem a Luis Puis Pinto,
Primeiro Director do Museu Nacional de Arqueologia de Benguela
PRÉFACE
PRÉPACE
SYLVAIN ITTÉ
]oÀo BERNARDO DE MIRANDA
e suis extrêmement heureux et honoré de préfacer avec mon homologue angolais cet excellent ouvrage qui part a la découverte du passé enfoui de l’Angola. L’ironie de nos fonctions veut que nous ayons des regards croisés entre celui d’un Français en Angola et celui d’un Angolais en France, faisant de l’un et de l’autre, le spécialiste d’un pays qui n’est pourtant pas le sien.
e crois qu’il n’existe aucune règle pour préfacer une œuvre, qu’elle soit littéraire ou scientifique, comme celle u’a le lecteur entre ses mains. Toutefois, il semble tout à fait avisé et judicieux que l’auteur de la préface ait une connaissance précise du sujet de la publication qu’on lui a demandé de commenter.
L’autre ironie, c’est qu’en fouillant dans le passé pour vivre le présent et définir l’avenir, les Ambassadeurs contribuent, à leur manière, à une large anthropologie au même
rang que l’historien, l’ethnologue ou le sociologue dont les compétences sont mobilisées pour croiser les sources, interpréter et travailler sur un futur qui sera lui aussi — un jour - celui du passé. Pour autant, nous faisons partie de l’histoire présente, de celle que nous vivons aujourd’hui au moment où la relation entre la France et l’Angola se consolide et se développe. le suis dont touché ’être le témoin de ce qui semble être une nouvelle histoire de l’Angola, car il y en aurait plusieurs. Celle que l’on appelle « la courte » tient à la lutte contre l’Indépendance dont les conséquences ont duré jusqu’en 2002 et engendré la plus longue guerre civile du 20ème siècle. Celle que l’on appelle « la longue » est ancienne et trouve une nouvelle place et un nouvel intérêt à travers le classement en 2017 par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité du site historique de la ville de Mbanza Kongo - ancienne capitale du vaste Royaume du Kongo - dont les objectifs sont aujourd’hui de revitaliser son existence et son passé grandiose. Ces deux pans de l’histoire récente ont trop longtemps caché les vestiges archéologiques de l’Angola et limité les recherches possibles alors même que le pays compte un riche passé préhistorique. Les travaux récents ont révélé des pièces enfouies qui nous permettent de penser qu’il s’agit de Paléolithique très ancien. L’archéologue observe, enregistre et capitalise, il nous fait voyager dans le temps. La collaboration franco—angolaise dans la coopération archéologique est ancienne et a permis d’ouvrir deux chantiers écoles au sud du pays. Ces fouilles posent de nouveaux jalons dans la connaissance du passé encore flou de l’Angola en les inscrivant dans un cadre de collaboration scientifique internationale à l’heure où le pays s’ouvre et où la France réaflirme fermement son engagement à dé— fendre et promouvoir le patrimoine culturel et historique de l’Afrique. Les nombreuses missions archéologiques confrontent depuis quelques années leurs analyses et font parler les vestiges. Lorsque les archéologues et les étudiants fouillent,
Donner mon avis sur des recherches archéologiques, bien que d’une façon très générale, constitue, pour le moins, une aventure pour une personne qui, comme moi, n’a pour quasi seule habitude que de manier slogans politiques et jargons diplomatiques. Le professeur Manuel Gutierrez, citoyen et chercheur français, co—auteur de cet ouvrage, a cependant tenu à m’inviter à apporter mon témoignage sur le remarquable travail de recherches archéologiques entrepris en Angola, notamment à Baia Farta, province de Benguela, sous sa direction en sa qualité de Maître de conférences de la prestigieuse Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Des chercheurs des deux pays sont engagés dans ce projet et c’est en qualité de représentant de la République d’Angola en France que le Professeur Gutierrez a jugé bon de m’associer à ce projet, ce que j’ai accepté, pour accomplir mon devoir et aussi par fierté patriotique, afin d’exprimer ma grande satisfaction quant à la publication de ces recherches. Cette invitation, qui m’honore beaucoup, ne pouvait arriver à un moment plus opportun et je souhaiterais, dès maintenant, remercier le Professeur Manuel Gutierrez pour cette déférence, tout comme je souhaiterais féliciter les scientifiques angolais engagés dans ces recherches, pour la qualité du travail présenté, dont l’importance est capitale pour le Peuple angolais et pour l’Afrique en général. Sur notre propre continent, on parle peu d’archéologie, sans doute en raison de l’absence publications suffisamment nombreuses sur notre passé lointain, qui s’est fait connaître grâce à des expositions d’objets archéologiques ou ayant une valeur archéologique. Outre l’égyptologue africain le plus connu, le sénégalais Cheikh Anta Diop (dont on a célébré les 33 ans de sa mort, le 7 février dernier), rares sont les scientifiques africains en la matière, en partenariat ou non avec des cher-
cheurs d’autres continents, qui divulguent largement leurs recherches sur les civilisations préhistoriques d’Afrique, en particulier celles des peuples qui ont marqué leur existence dans les vastes territoires situés au sud du désert du Sahara. Hormis quelques exceptions, les plus importantes recherches publiées autour du passé lointain et récent du
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES A BAIA FARTA (BENGUELA—ANGOLA) -— A PESQUISAS ARQUEOLÔGIÇAS NA BAIA FARTA (BENGUELA-ANGOLA) — 7
c’est l’histoire du pays qui se met à jour. Des premières fouilles empiriques à partir de l’activité minière aux chantiers écoles, il s’est écoulé plus d’un siècle. En raison de la
guerre, la discipline archéologique s’est construite sur la base de contributions sporadiques, mais sans réellement s’arrêter. L’enseignement de l’archéologie dans les universités du pays permet progressivement de rapprocher les enjeux sociaux et idéologiques. En effet, les connaissances et les interprétations archéologiques, même les mieux établies ou les plus pondérées, ne sont exemptes ni de dérives ni d’appropriations politiques. Le parcours d’un vestige ou d’une découverte se déroule toujours dans un contexte socio—économique ou politique
loin d’être neutre ou anodin, qu’il s’agisse des conditions d’accès aux fouilles aux collections, mais également des présentations qui sont faites dans un musée à des publications. Les sites et les vestiges archéologiques deviennent ainsi « patrimoine » dès lors qu’il s’agit de les protéger et de les partager parce que les vestiges ou les monuments du passé voient s’affirmer leur valeur culturelle et identitaire. Ils ont donc une valeur politique et sociologique de première importance dans la constitution des identités natio-
nales. L’Angola fait ainsi face à son futur en fouillant son passé pour faire face elle aussi à de multiples civilisations installées sur une échelle temporelle de plusieurs centaines de millénaires. A partir du moment où l’on fouille, les frontières physiques et temporelles évoluent autant qu’elles interrogent. Des gisements de trésors à venir, de l’observation à l’en-
registrement progressif, de la stratigraphie à la formation des sites de fouilles, l’apport du terrain angolais est en train de structurer définitivement l’archéologie en Angola et de faire rentrer la discipline au rang et au rôle qui est le sien pour mieux comprendre la construction du savoir sur son passé ainsi que les différents rôles que peut jouer ce passé dans ses sociétés. Manuel Gutierrez, Maria Helena Benjamim, Maria da Piedade de ]esus et Claudine Karlin, sont d’illustres spécialistes qui nous apportent dans cet ouvrage bilingue des connaissances techniques et scientifiques expliquées à la fois pour les érudits, les étudiants et les amateurs de manière remarquable. Ils stimulent notre imaginaire et nous plongent dans les histoires possibles d’un pays largement méconnu mais qui prend progressivement la place qu’il
continent africain sont celles compilées dans les 8 tomes de l’Histoire générale de l’Afrique, parrainée et publiée par l’UNESCO. Celle—ci contient peu d’informations sur le passé le plus reculé des peuples du territoire angolais. La publication des recherches archéologiques faites à Baia Farta revêt donc une importance particulière car elle aurait été une des plus importantes zones de convergence des migrations, de l’intérieur du pays vers le littoral, des
ancêtres qui ont peuplé l’Angola de nombreuses années avant les contacts établis avec d’autres civilisations, résul-
tant de l’invasion et de l’appropriation coloniales de leurs terres.
Les vestiges archéologiques qui ont déjà été trouvés un peu partout en Angola révèlent de manière évidente la présence humaine millénaire sur ce qui constitue aujourd’hui le vaste espace territorial de la République d’Angola. Toutefois, cette conclusion scientifique irréfutable à tout point de vue n’est pas suffisante. Il faut encore faire plus de publicité autour de ces recherches, afin que les Angolais d’aujourd’hui, de demain et d’après-demain aient de plus en plus conscience qu’ils font partie d’un ensemble de plusieurs civilisations qui font de l’humanité une magnifique mosaïque d’histoires et de cultures, qui mérite d’être préservée pour une connaissance mutuelle des peuples du monde et pour pérenniser le passé de chaque époque historique de l’espèce humaine, sur toutes les parcelles de terre dispersées à travers les cinq continents de notre planète. Que Baia Farta soit juste le début d’un partenariat scientifique que nous souhaitons durable entre l’Angola et la France, tant dans ce domaine spécifique de l’archéologie que dans bien d’autres domaines, également très importants pour le développement intégré de l’Angola.
Paris, le 8 mars 2019.
Ioäo Bernardo de Miranda Ambassadeur de la République d’Angola en France
mérite sur la scène internationale.
Sylvain Itté Ambassadeur de la République Française en Angola
«&
99
8 - RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES À BA|A FARTA (BENGUELA-ANGOLA) -— A PESQUISAS ARQUEOLÔGICAS NA BAIA FARTA (BENCUELA—ANGOLA)
PREFÂCIO
PREFÂCIO
IoÀo BERNARDO DE MIRANDA
SYLVAIN ITTÉ
reio na inexistência de uma qualquer regra especi-
fica para se prefaciar uma obra seja ela literâria ou cientifica como esta que 0 leitor tem em mâo, mas parece
de todo avisado, judicioso que o prefaciador tenha conhecimento balizado da matéria da publicaçäo que lhe é dada para comentar. Opinar sobre pesquisas arqueolôgicas, ainda que de
enho a honra e a imensa satisfaçâo de prefaciar, com o meu homôlogo angolano, esta excelente obra que vai à descoberta do passado soterrado de Angola. A ironia das nossas funçôes faz que tenhamos perspectivas cruzadas entre 0 olhar de um francés em Angola e o de um angolano em França, fazendo de ambos especialistas de paises dos quais näo säo oriundos.
uma maneira muito genérica, é no minimo uma aventura
Outra ironia e que, pesquisando no passado para viver
para quem como eu, em grande medida, esté apenas habituado a lidar com chavôes politicos e jargôes diplométicos.
o presente e definir o futuro, os Embaixadores contribuem à sua maneira numa larga antropologia de mesmo nivel que o historiador, 0 etnôlogo ou 0 sociélogo cujas competências säo mobilizadas para cruzar as fontes, interpretar e trabalhar num futuro que por sua vez, também um dia farâ parte do passado.
Mas, 0 Professor Manuel Gutierrez, cidadäo e investigador francés, coautor da presente obra, fez questäo de me
convidar para deixar o meu testemunho sobre o louvâvel trabalho de pesquisas arqueolôgicas que se leva a cabo em Angola, nomeadamente na Baia Farta, provincia de Benguela, sob sua orientaçäo na qualidade de docente da prestigiada Universidade Paris 1 Panthéon Sorbonne. Estäo envolvidos nas pesquisas estudiosos dos dois paises, sendo na qualidade de representante da Repûblica de Angola na Repûblica francesa que o Professor Gutierrez entendeu por bem associar-me, e eu aquiesci, em jeito
de cumprimento de dever ao qual atrelei a minha altivez patriôtica para manifestar a minha grande satisfaçäo pela publicaçâo das pesquisas. O convite, que muito me honra, näo podia chegar no momento mais oportuno e, desde logo, ao agradecer 0 Professor Manuel Gutierrez pela deferência, deixo também expressos os meus parabéns aos cientistas angolanos envolvidos nas pesquisas, pela qualidade do trabalho apresentado de transcendental importância para o Povo de
Angola e para a Africa em geral. No nosso proprio continente fala-se pouco da arqueologia, talvez devido a ausência de muitas publicaçôes sobre o nosso passado longinquo dado a conhecer através de exposiçôes de materiais arqueolôgicos ou com valor arqueolôgico.
Além do mais conhecido egiptôlogo africano, 0 senegalês Cheikh Anta Diop, (fez 33 anos no dia 7 de Fevereiro ultimo desde o seu falecimento) pouces sâo os cientistas africanos da matéria, em parceria ou näo com estudiosos de outros continentes, que fazem ampla difusâo das suas pesquisas sobre as civilizaçôes pré-histôricas de Africa, particularmente as dos povos que marcaram a sua existência nos vastos territôrios situados abaixo do deserto do Sahara.
Por enquanto fazemos parte da histôria presente, aquela que vivemos hoje, na altura em que a relaçâo entre a Franca e Angola é consolidada e desenvolvida. E com emoçäo que sou testemunha do que apresenta ser uma nova historia de Angola, porque pelos vistos tem muitas mais. Aquela que chamamos « a curta » condiz com a luta pela independência cujas consequências persistiram até 2002, engendrando a mais longa guerra civil do 20° século. Aquela que chamamos «a longa» é antiga e acha um novo lugar e um novo interesse com a classificaçâo em 2017 pela UNESCO ao patrimônio mundial da humanidade, da cidade histôrica de Mbanza Kongo, antiga capital do extenso Reino do Kongo, cujos actuais objectives säo de revitalizar a sua existência e seu glorioso passado. Esses dois trechos da historia recente ocultaram demasiadamente tempo os vestigios arqueolôgicos de Angola e limitaram as possiveis investigaçôes enquanto que o pais detém um prôspero passado pré—histôrico. As recentes investigaçôes revelaram artefactos soterrados que nos per-
mitam pensar que se trata de um Paleolitico muito remoto. O arqueôlogo observa, regista e capitaliza, fazendo-nos
viajar através o tempo.
A colaboraçäo franco-angolana no sector da arqueologia é antiga e permitiu abrir duas escolas de campo no sul do pais. Essas pesquisas estabelecem novos limiares no conhecimento do passado ainda bastante desconhecido de Angola inscrevendo-os num quadro de colaboraçâo cientifica internacional na hora em que o pais se abre e que a Franca reafirma resolutamente o seu engajamento para defender e promover 0 patrimônio cultural e histôrico de Africa.
Salvaguardadas algumas excepçôes, as mais importantes
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES A BAIA FARTA (BENGUELA—ANGOLA) -— A PESQUISAS ARQUEOLÔGIÇAS NA BAIA FARTA (BENGUELA-ANGOLA) — 9
pesquisas publicadas em terne de lenginque e recente passades de continente africano, säe as que se resumem nos 8 tomes da Histôria Geral de Africa, patrocinada e publicada pela UNESCO. Nela encentramos poucas neticias sobre a parte mais recuada de passado des povos de territôrie de Angola. Reveste-se, pois, de particular importância a publicaçâe das pesquisas arqueelôgicas na Baia Farta, que teria side uma das grandes zenas de cenfluência das migraçôes de interior para o literal, des ancestrais que pevoaram Angola muitos anos antes des contactes estabelecidos com outras civilizaçôes per força da invasâe e usurpaçâo coleniais das suas terras.
Os vestigios arqueelôgices jâ encentrados um pouce
per muitas partes de Angola, censtituem a maior evidência da presença milenar humana ne que é heje e vaste espace territorial da Repùblica de Angela. Perém, näe basta esta cenclusâo cientifica a todas as luzes irrefutâvel, tema-se ainda mister uma ampla publicitaçäe das pesquisas para que es angolanes de heje e de amanha prôxime e distante, tenham cada vez mais a censolidada consciência de que sâe parte de um conjunte de vérias civilizaçôes que fazem de universe humane, um grandiose mosaice de histôrias e culturas que vale a pena preservar para efeito de conhecimento mütue des povos de mundo e tornar perene e passado de cada época histôrica da espécie humana, em todas as porçôes de terra dispersas pelos cince continentes de messe planeta. Que Baia Farta seja apenas um cemeço de uma par-
ceria cientifica que se deseja continuada entre Angola e França, quer messe particular deminie de arqueelogia quer em muitos outros também de capital importância para o desenvolvimento integrade de Angela.
Paris, 8 de Marco de 2019
Ioäe Bernardo de Miranda Embaixador da Repùblica de Angela na Repûblica Francesa
As numerosas
missôes
arqueelôgicas
cenfrentam
desde alguns ames as suas anâlises e fazem falar os vesti— gios. Quando os arqueôlegos e os estudantes pesquisam, é a histôria de pais que renasce. Das primeiras escavaçôes
empiricas a partir da actividade mineira até as escelas de campe, decerreu-se mais de um sécule. Em razäe da guerra, a disciplina arqueelôgica edificeu-se sobre a base de centribuiçôes esperâdicas, mas sem parar de facto. O ensino da arqueelogia nas universidades de pais permitiu a apreximaçäo des desafios seciais e ideolôgices. Com efeito, es cenhecimentes e as interpretaçôes ar-
queelôgicas, mesme sende es melheres estabelecidos ou es mais penderados, nâe sâe isentes de derivas nem de apropriaçôes politicas. O percurse de um vestigio ou de uma descoberta desenrola-se sempre num contexte se— cieecenômico ou politice longe de ser neutre ou anôdine, quer se trata das condiçôes de acesso ae local de escavaçôes com às colecçôes, mas também das apresentaçôes que säe feitas num muscu até as publicaçôes. Os sities e os vestigios arqueelôgices tornam-se assim « patrimônio »
desde que se trata de es proteger e de es dividir, perque os vestigios ou es monumentos de passado vêm afirmar-se e seu valor cultural e identitârie. Adquirem assim um valor politice e socielôgico de primeira importância na consti— tuiçäe das identidades nacionais. Assim ao pesquisar seu passado Angola faz fronte ao seu future para também fazer face às mûltiplas civilizaçôes posicienadas numa escala temporal com värias centenas de milénios. A partir de momento em que se escava, as fronteiras fisicas e temperais eveluem tanto quante interrogam. ]aziges de teseuros vindoures da observaçäo ae registe progressive, da estratigrafia à formaçäo des locais de investigaçôes, a centribuiçâo de terrene angelano esté a es— truturar definitivamente a arqueelogia de Angola e ae lec— cienar esta disciplina para ae nivel e desempenhe que lhe cabe para melher entender a aquisiçäe de conhecimento sobre seu passado assim como as diferentes funçôes pede assumir este passado nas suas seciedades. Manuel Gutierrez, Maria Helena Benjamim, Maria da
Piedade de ]esus e Claudine Karlin sâe ilustres especialistas que nos trazem nesta ebra bilingue, cenhecimentes técnicos e cientifices que tanto se dirigem a um pûblice erudite come para estudantes e amadores. Eles estimulam e nesse imaginârie mergulhando-nes nas pessiveis histôrias de um pais bastante desconhecido mas que pregressivamente ocupa o lugar que merece na plateia internacional.
Sylvain Itté Embaixader da Repùblica Francesa em Angela
«&
99
| 0 - RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES À BA|A FARTA (BENGUELA-ANGOLA) -— A PESQUISAS ARQUEOLÔGICAS NA BAIA FARTA (BENCUELA—ANGOLA)
AGRADECIMENTOS
REMERCIEMENTS L a recherche archéologique nécessite la participation de nombreux acteurs à différents moments et dans différents domaines. Il y a d’abord la recherche documentaire concernant les régions et sites qui feront l’objet des actions de terrain. Puis les premières mesures de prospection et par la suite la fouille archéologique proprement dite. La recherche se poursuit jusqu’à la publication des résultats de ce travail collectif.
Apesquisa arqueolôgica requer a participaçâo de muitos autores em momentos diferentes e nos diferentes dominios. Em primeiro lugar, existe uma pesquisa
Les déplacements sur le terrain et la pratique de la discipline mobilisent également des moyens humains et financiers considérables qu’il faut trouver. Sans l’aide des institutions qui nous font confiance nous n’aurions pas pu conduire les recherches qui sont à l’origine de ce livre.
As deslocaçôes no campo e a prâtica da disciplina, também mobilizam meios humanos e financeiros que devem ser encontrados. Sem a ajuda de instituiçôes que confiam em nés, nâo teriamos sido capazes de conduzir as pesquisas que estäo na origem deste livro.
Pour ce qui est de la recherche de terrain, nous souhai-
Em termos de pesquisa de campo, queremos agradecer as instituiçôes que nos ajudam desde os primeiros passes em Angola. Do ponte de vista regional, devemos mencionar o Museu Nacional de Arqueologia em Benguela (MNAB Ministério da Cultura de Angola) e o seu primeiro director
documental sobre as regiôes e locais que seräo objecto das acçôes de campo. Em seguida, as primeiras medidas de prospecçäo e, posteriormente, a escavaçäo propriamente
dita. A pesquisa tem continuidade até a publicaçâo dos resultados desse trabalho colectivo.
tons remercier les institutions qui nous aident depuis nos premiers pas en Angola. Du point de vue régional il faut citer le Musée National d’Archéologie de Benguela (MNABMinistère de la Culture d’Angola) et son premier directeur à qui nous dédions ce livre. Il y a ensuite la Mission de Coopération et d’Action Culturelle, devenue Service de Coopération et d’Action Culturelle, de l’Ambassade de France en Angola que nous remercions pour son soutien sans faille.
à Missäo de Cooperaçâo e Acçäo Cultural, hoje Serviço de Cooperaçäo e Acçäo Cultural da Embaixada de França em Angola, a quem agradecemos pelo apoio infalivel.
Il y a ensuite nos institutions en France, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et notre laboratoire de recherches
mente, a Universidade Paris 1 Panthéon Sorbonne e 0 nos-
Equipe d’Ethnologie Préhistorique —UMR 7041 du CNRS.
so laboratôrio de pesquisas e a Equipa de Etnologia Pré-
Pour ce qui est de la pratique de la discipline, c’est — à — dire le travail de terrain et en particulier les fouilles archéologiques, nous avons bénéficié d’une équipe qui a été capable de gérer les chantiers de fouille et aussi de transmettre les savoir-faire des archéologues ‘a des acteurs plus jeunes. Nous souhaitons remercier ici toutes les personnes qui ont participé aux nombreuses campagnes de prospection
et ensuite à la fouille des sites des complexes Dungo et Cachama. En ce qui concerne l’actualité nos remerciements s ‘adressent également à l’Université Katyavala Bwila pour son engagement dans la tenue du chantier école de Baia Farta. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre reconnaissance. La recherche archéologique implique également des frais, que se soit pour les déplacements d’un pays à un autre, pour le séjour sur place et pour le quotidien du chantier. Le Service de Coopération et d’Action Culturelle
(fundador), a quem dedicamos esta obra. Posteriormente
Existem as nossas instituiçôes em França, respectiva-
histôrica - UMR 7041 do CNRS.
No que diz respeito a prética da disciplina, ou seja, o trabalho de campo e em particular as escavaçôes arqueolôgicas, nos beneficiamos de uma equipa que tem side capaz de gerenciar os trabalhos de escavaçâo e também de transmitir o saber-fazer dos arqueôlogos para actores mais jovens.
Gostariamos de agradecer a todas as pessoas que participaram das inûmeras campanhas de prospecçäo e de escavaçäo dos sitios arqueolôgicos dos complexes Dungo e Cachama. Em relaçâo a actualidade, os nossos agradecimentos väo também para a Universidade Katyavala Bwila pelo seu compromisso em manter a escola prâtica de campo da Baia—Farm. A quem expressamos a nossa profunda gratidäo. A pesquisa arqueolôgica envolve custos, sejam para
(SCAC) de l’Ambassade de France en Angola a financé
viagens de um pais para outro, para a estadia no local e para o quotidiano dos trabalhos no campo. O Serviço de
d’une manière active et continue nos recherches sur place
Cooperaçäo e de Acçâo Cultural (SCAC) da Embaixada de
et nous le remercions ici.
França em Angola tem financiado de forma activa e continua as nossas pesquisas no local e o agradecemos.
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES A BAIA FARTA (BENGUELA—ANGOLA) -— A PESQUISAS ARQUEOLÔGIÇAS NA BAIA FARTA (BENGUELA-ANGOLA) — 1 1
En ce qui concerne la publication de ce livre, que nous souhaitions bilingue, nous avons une très grande dette
No que diz respeito a publicaçâo desta obra, que queriamos que fosse bilingue, temos uma grande divida para com
envers Madame Michèle Moreira (SCAC) qui a assuré bé—
a Sra. Michèle Moreira (SCAC), que assumiu voluntaria-
névolement la lourde tâche de traduire en portugais des textes souvent complexes. Sa participation et la qualité de son travail ont été fondamentales pour rendre la ver— sion portugaise accessible au plus grand nombre. Nous lui adressons nos sincères remerciements.
mente a dificil tarefa de traduzir para o português textos, muitas vezes complexes. A sua participaçäo e a qualidade do seu trabalho foram fundamentais para tornar a versäo em português acessivel ao maior numero de leitores pos-
Une fois le manuscrit terminé, il reste le travail de mise en forme qui est particulièrement long et précis. La mise en page soignée a été assurée par M. Edmond Magni— fique (UMR 7041), et nous lui exprimons ici toute notre
gratitude. La publication de ce livre a été possible grâce à l’aide des institutions suivantes :
siveis. Endereçamos os nossos mais sinceros agradecimentos.
Uma vez concluido o manuscrito, resta o trabalho de formataçäo que é particularmente longo e preciso. A paginaçäo foi assegurada pelo Sr. Edmond Magnifique (UMR 7041), a quem expressamos a nossa gratidâo. A publicaçäo deste livro foi possivel graças a ajuda das seguintes instituiçôes:
' Ambassade de France en Angola
' Embaixada de França em Angola;
' Ambassade d’Angola en France
' Embaixada de Angola em França;
' —Equipe Ethnologie Préhistorique-UMR 7041-CNRS
' Equipa Etnologia Pré-histôrica — UMR 7041- CNRS;
' Les Editions Sépia—L’Harmattan qui ont accepté de publier ce livre dans un format de belles dimensions avec des illustrations de très bonne qualité.
' Ediçôes Sépia-L'Harmattan, que concordaram em publicar este livre em um formate de boas dimensôes incluindo ilustraçôes de muito boa qualidade.
Que ces institutions trouvent ici l’expression de notre
profonde gratitude Nos remerciements s’adressent également à nos familles respectives qui nous ont soutenu pendant nos recherches
et qui ont souvent souffert de nos absences. Enfin, nos remerciements s’adressent également à toutes les personnes et amis qui d’une manière ou d’une autre ont contribué à la réalisation des missions de terrain et à la publication du livre que vous avez entre les mains.
Que essas instituiçôes encontrem aqui a expressäo da
nossa profunda gratidäo. Os nossos agradecimentos väo também para as nossas respectivas familias que nos apoiaram durante a pesquisa e que frequentemente sofreram pelas nossas ausências. Finalmente, os nossos agradecimentos à todas as pes-
soas e amigos que de uma forma ou de outra, contribuiram para a realizaçâo das missôes de campo e a publicaçâo do livro que têm em suas mäos.
| 2 - RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES À BA|A FARTA (BENGUELA-ANGOLA) -— A PESQUISAS ARQUEOLÔGICAS NA BAIA FARTA (BENCUELA—ANGOLA)
INTRODUCTION
INTRODUÇÂO
NTRODUCTION / INTRODUÇÂO
L e livre que nous présentons ici, Recherches archéologiques à Baia Farta (Benguela-Angolu), retrace une longue période de collaboration scientifique en archéologie entre institutions françaises et angolaises et répond à une nécessité et à une obligation déontologique. Le besoin de littérature actuelle concernant l’archéologie nationale s’exprime aussi bien au niveau universitaire dont les rayons à la bibliothèque sont presque vides ou avec des ouvrages très anciens, qui au niveau du grand public ne dispose pas ou très peu de données sur les recherches actuelles.
Olivro que aqui apresentamos, Pesquisas arqueolô—
Du point de vue déontologique il s’agit d’un devoir pour tout chercheur de rendre compte des résultats de la recherche, une fouille archéologique doit faire l’objet d’une
Do ponto de vista deontolôgico trata-se de um dever para todo investigador, dar a conhecer os resultados da investigaçâo, uma pesquisa arqueolôgica deve ser objecto de uma publicaçäo, de outra maneira os conhecimentos adquiridos permanecem no segredo de uma gaveta, ou seja perdidos.
publication, autrement les connaissances obtenues restent
dans le secret d’un tiroir, autrement dit perdues. L’ouvrage présente les résultats des recherches archéologiques conduites par une équipe franco angolaise depuis le début des années 1990 jusqu’à aujourd’hui dans la province de Benguela. La publication a également comme finalité le souhait de rendre les données accessibles à un vaste public francophone et aussi lusophone, c’est la raison du choix d’une édition bilingue. Les recherches conduites depuis presque trois décennies sont présentées en cinq chapitres qui concernent
respectivement l’histoire des données archéologiques, les recherches sur le matériel lithique, ’étude des céramiques, la création d’un chantier école, l’approche chronologique des faits archéologiques et une conclusion qui synthétise les acquis de la recherche. Le chapitre 1 aborde l’historique des données disponibles sur les vestiges archéologiques découverts depuis un peu plus d’un siècle. Au départ il s’agit de trouvailles sporadiques et souvent individuelles, pour passer un demi siècle plus tard à des recherches organisées dans le cadre du musée de Dundo à l’est du pays. La recherche archéologique connaîtra, quelques années plus tard, un cadre encore plus structuré avec l’enseignement de la discipline dans les facultés de Luanda et de Lubango, accompagnée des recherches de terrain et des publications universitaires. Puis un brusque arrêt au milieu des années 1970 à cause du départ du pays d’enseignants et chercheurs.
gicas na Baia Farta (Benguela—Angolæ), retraça um longo periode de colaboraçâo cientifica em arqueologia entre instituiçôes francesas e angolanas e responde à uma necessidade e obrigaçâo deontolôgica. A necessidade de literatura actual sobre a arqueologia nacional exprime—se tanto à nivel universitârio cujas estantes da biblioteca estâo à bem dizer vazias ou com obras muito antigas, que à nivel do grande pûblico nâo dispôem ou parcamente de dados sobre as actuais investigaçôes.
A obra apresenta os resultados das investigaçôes arqueolôgicas dirigidas por uma equipa franco-angolana desde o inicio dos anos 1990 até hoje na provincia de Benguela. A publicaçäo também tem por finalidade o desejo que os dados sejam acessiveis para um vaste pûblico francôfono e também lusôfono, razäo pela qual a escolha de uma ediçâo bilingue. As investigaçôes realizadas desde aproximadamente très décadas säo apresentadas em cinco capitulos respectivamente dedicados à historia dos dados arqueolôgîcos, as investigaçôes efectuadas sobre o material litico, o estudo da s cerâmica s, a criaçâo de uma escola de campo, a abordagem cronolôgica dos factos arqueolôgicos e uma conclusâo que sintetiza os adquiridos da investigaçäo. O capitulo I aborda o histôrico dos dados disponiveis sobre os vestigios arqueolôgicos descobertos desde pouce mais de um século. No inicio tratava-se de achados esporâdicos geralmente individuais, para evoluir meio século mais tarde em investigaçôes organizadas no âmbito do museu do Dundo ao Este do pais. A investigaçäo arqueolôgica conheceu, alguns anos mais tarde, um quadro ainda
mais estruturado com o ensino da disciplina nas faculdades de Luanda e Lubango, acompanhada de pesquisas no terreno e de publicaçôes universitârias. Houve depois uma
L’historique des recherches se termine avec la création du Musée national d’archéologie de Benguela et la consti— tution d’une équipe de recherches franco-angolaise qui conduit les recherches actuelles dans la province de Ben— guela. L’étude du matériel lithique issu des fouilles conduites dans l’ensemble archéologique Dungo est abordée en cha— pitre II. L’orientation générale du chapitre est de présenter une approche unique en Angola qui est celui de la tracéolo— gie sur des pièces préhistoriques en quartz. L’archéologie et plus particulièrement les préhistoriens, cherchent depuis longtemps à connaître les fonctions que pouvaient avoir les outils lithiques. L’une des tentatives la plus ancienne est de grouper les pièces lithiques dans des séries typolo— giques dont la fonction était supposée. Ibbservation du matériel lithique à l’oeil nu, puis au microscope permet de supposer la fonction ancienne d’une manière plus précise, mais l’expérimentation et l’observation au microscope des objets expérimentaux va permettre de comparer les traces issues de l’expérimentation, dont on connaît l’origine, avec les traces observables dans les objets archéologiques. C’est cette approche qui a été tentée avec un échantillon impor— tant issu des sites Dungo, ce qui constitue une première en
archéologie d’Angola.
brusca paragem no meio dos anos 1970 em razâo da saida do pais de docentes e investigadores.
0 histôrico das investigaçôes termina com a criaçäo do Museu Nacional de Arqueologia de Benguela e a constituiçäo de uma equipa de investigadores franco—angolana que dirige as actuais investigaçôes na provincia de Benguela.
0 estudo do material litico proveniente das escavaçôes realizadas no complexe arqueolôgico Dungo é abordado no capitulo II. A orientaçâo geral do capitulo é de apresentar uma abordagem ûnica em Angola que é a traceologia sobre artefactos pré-histôricos em quartzo. A arqueologia e particularmente os pré-historiadores, tentam desde longos anos conhecer as funçôes que podiam ter as ferramentas liticas. Um das tentativas mais remotas foi de reagrupar os artefactos liticos em séries tipolôgicas cuja
funçâo supunha—se. A observaçâo do material litico a olho nu, depois ao microscôpio permite supor a funçäo anti-
ga de uma forma mais precisa, mas a experimentaçäo e a observaçäo ao microscôpio dos artefactos experimentais permitirâ mais tarde comparar os rastos provenientes da experimentaçäo, cuja origem é conhecida, com os rastos
observâveis nos artefactos arqueolôgicos. E esta abordagem que foi experimentada com uma amostra importante proveniente das estaçôes Dungo, o que constitui u uma no-
L’étude de la céramique archéologique issue des fouilles de l’ensemble Cachama est abordée dans le chapitre III, où l’on trouve un historique des recherches sur la céramique dans le pays avec des données concernant aussi les chronologies proposées jusqu’à aujourd’hui. Le chapitre rend compte des approximations que l’on se faisait dans le passé du Néolithique et de la rareté de données fiables pour bien caler dans l’espace et dans le temps les premières sociétés de production en Angola.
vidade na arqueologia de Angola.
L’un des aspects des plus novateurs proposé dans la méthode d’étude de la céramique est l’approche ethnoarchéologique. L’auteure a pu observer et questionner des potières et des potiers actuels dans la province de Benguela, avant, pendant et après la production des objets en terre cuite. Les données obtenues montrent les phases d’élaboration, de gestes souvent difficilement déductibles de l’observation de la céramique archéologique mais aussi des questions liées à la transmission des savoirs dans la production actuelle, données qui vont permettre d’interroger le passé d’une manière plus pertinente.
Um dos aspectos mais inovadores proposto no método de estudo da cerâmica é a abordagem etno—arqueolôgica. O autor pôde observar e questionar oleiros e oleiras actuais na provincia de Benguela, antes, durante e apôs a produçâo dos artefactos em barre cozido. Os dados recolhidos mostram as fases de elaboraçäo, gestos normalmente dificeis de se deduzir com a observaçäo da cerâmica arqueolôgica e também questôes ligadas à transmissäo dos conhecimentos na produçäo actual, dados que permitiräo interrogar o passado de maneira mais pertinente.
La formation en archéologie est abordée au chapitre IV, du point de vue historique et pratique. L’histoire de la formation intègre deux volets différents mais complémentaires. L’un est la formation universitaire, l’autre est la formation pratique sur le terrain. La formation universitaire
conduisit des étudiants angolais jusqu’à l’université de Paris, Paris 1, dont trois d’entre eux ont obtenu des diplômes
O estudo da cerâmica arqueolôgica proveniente das escavaçôes do Complexo Cachama é abordado no capitulo III, a onde esté exposto um histôrico das pesquisas sobre a cerâmica 5 do pais e também dados sobre as cronologias propostas até hoje. 0 capitulo inteira as abordagens que se faziam no passado sobre o Neolîtico e a escassez de dados fiâveis para posicionar no espace e no tempo as primeiras
sociedades de produçäo em Angola.
A formaçâo em arqueologia é abordada no capitulo IV, sob o ponto de vista histôrico e prâtico. A histôria da formaçäo integra duas vertentes diferentes mas complementares. Uma delas é a formaçâo universitâria, a outra
é a formaçäo prâtica no terreno. A formaçäo universitéria conduziu estudantes angolanos até a universidade de Paris, Paris 1, e trés deles obtiveram diplomas de doutoramento.
| 6 - RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES A BAIA FARTA (BENGUELA—ANGOLA) —- A PESQUISAS ARQUEOLÔGICAS NA BAIA FARTA (BENCUELA—ANGÛLA)
de doctorat. La formation de terrain et plus particulièrement la création d’un chantier de fouille archéologique à Baia Farta fait l’objet d’un long développement qui intègre la réalité du pays au début de notre collaboration scientifique jusqu’à aujourd’hui. L’actualité est que le chantier école fonctionne d’une manière régulière tous les ans avec de plus en plus de stagiaires et que cette formation pratique est intégrée à la formation théorique universitaire en archéologie à Benguela. La question de la mesure du temps et de la place des faits archéologiques dans l’histoire longue de cette partie d’Afrique est abordée au chapitre V. Des tentatives très variées ont été proposées pour placer les productions humaines dans l’histoire ancienne du pays. Le matériel lithique par exemple a fait l’objet des classements selon ’état d’usure de la surface des instruments et éclats. Or ’état d’usure résulte plutôt des conditions physiques de conser— vation, en surface ou enfouis, que nécessairement de leur âge. D’autres tentatives de datation ont été proposées en
A formaçäo no terreno e mais particularmente a criaçâo
de uma escola de investigaçäo arqueolôgica na Baia Farta foi objecto de um longo desenvolvimento que integra a realidade do pais no inicio da nossa colaboraçäo cientifica até nossos dias. A actualidade é que a escola de campo funciona de maneira regular todo os anos com cada vez mais estagiârios e que esta formaçäo prâtica é integrada na for-
maçâo teôrica universitâria em arqueologia de Benguela. A questâo da medida do tempo e do local dos factos arqueolôgicos na longa historia desta parte de Africa é exposta no capitulo V. Tentativas muito diversas foram
propostas para situar as produçôes humanas na remota historia do pais. O material litico por exemplo foi objecto de classificaçôes segundo o estado de desgaste da superficie dos instrumentos e lascas. No entanto o estado de desgaste resulta mais das condiçôes fisicas de conservaçâo, em superficie ou soterrados, do que necessariamente a sua idade. Outras tentativas de dataçâo foram propostas reenviando um tipo de produçäo para uma outra actividade.
renvoyant un type de production vers une autre activité. La
A cerâmica datada pela idade do ferro, e a idade do ferro
céramique datée par un âge du fer, l’âge du fer daté par la céramique, sans dater avec précision ni l’un ni l’autre.
datada pela cerâmica, sem que nenhum fosse datado com
Placer les créations humaines dans le temps devient plus aisé quand on utilise correctement les outils de l’archéologie qui sont la fouille méthodique d’abord et ensuite, et seulement ensuite, les données de laboratoire pour proposer des chronologies cohérentes. Ce sont ces deux outils qui ont été employés à Baia Farta pour élaborer les chronologies présentées dans ce volume. Le livre se termine par une conclusion en forme de bilan et avec des propositions pour l’avenir. L’aspect bilan apparaît dans les choix opérés dans la conduite des fouilles ar— chéologiques, dans l’étude du matériel issu de ces fouilles et les résultats correspondants. Aspects que nous avons consi-
dérés comme des ruptures avec les pratiques anciennes. L’aspect ouverture vers l’avenir est surtout exprimé dans le vœu d’un développement constant et durable de la formation et de la pratique de l’archéologie en Angola.
precisäo. Situar as criaçôes humanas no tempo torna—se mais sim-
ples quando se utiliza correctamente as ferramentas da arqueologia que sâo em primeiro lugar a investigaçäo metô-
dica e depois, somente depois, os dados de laboratôrio para proper cronologias coerentes. Säo essas duas ferramentas que foram utilizadas na Baia Farta para elaborar as cronologias apresentadas neste volume. 0 livre termina-se com uma conclusäo sob forma de balance e com propostas para o futuro. O aspecto balanço aparece nas escolhas operadas durante na conduta das escavaçôes arqueolôgîcas, no estudo do material proveniente s dessas escavaçôes e os resultados correspondentes. Aspectos que consideramos como sendo rupturas com as antigas prâticas. O aspecto abertura para o futuro é sobre-
tudo expresso no veto para um desenvolvimento constante e durével da formaçäo e da prética da arqueologîa em Angola.
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES A BAIA FARTA (BENGUELA—ANGOLA) -— A PESQUISAS ARQUEOLÔGIÇAS NA BAIA FARTA (BENCUELA-ANGÛLA) — 1 7
CHAPITRE I / CAPÏTULO I
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES EN ANGOLA INVESTIGAÇÔES ARQUEOLÔG1CAS EM ANGOLA
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES EN ANGOLA INVESTIGAÇÔES ARQUEOLÔGICAS EM ANGOLA Manuel Gutierrez
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et Equipe Ethnologie Préhistorique —UMR 7041 LE PAYS
0 PAÏS
’Angola se situe sur la côte occidentale de l’Afrique, au sud de l’Équateur. Son territoire de 1 246 700 km2, est limité au nord par la République du Congo et la République Démocratique du Congo, à l’est par cette même République et la Zambie, au Sud par la Namibie (figure 1). Dans le passé le territoire était divisé en trois grandes zones écologiques qui devaient correspondre à des occupations préhistoriques (zone Congo, zone Zambèze, et
ngola situa-se na costa ocidental de Africa, ao sul do Equador. O seu territôrio de 1 246 700 km2, é fronteiriço com a Repûblica do Congo e a Repùblica Democrâtica do Congo ao Norte, com a RDC e a Zâmbia ao Este e a Namibia ao Sul (figura l). Pelo passado, esse territôrio
estava dividido em très grandes regiôes ecolôgicas cujas âreas deviam corresponder a zonas de ocupaçôes pré-histôricas (zona Congo, zona Zambeze e zona Sul-oeste,
zone Sud-ouest, (Clark, 1966) (figure 2). Aujourd’hui on se
(Clark, 1966) (figura 2). Actualmente, descortinamos essas
rend compte que ces « zones » couvrent de vastes espaces
« zonas >> recobrem vastes espaços integrando paisagens
,gäæa:
N A M
Figure 1— Carte de l’Angola / Mapa de Angola
ANGOLA PREHISTORIC
CULTURE
REGIONS
WESTERN
Figure 2 — Les zones écologiques proposées par ]. D. Clark en 1966 / As zonas ecolôgicas propostas par ]. D. Clark em 1966
qui intègrent des paysages, des climats très diversifiés qui peuvent difficilement être regroupés dans une seule entité. Si l’on prend par exemple la « zone Sud-ouest » on note qu’elle inclut la bande côtière au sud du pays et une grande partie du plateau central. Or la bande côtière est particulièrement aride, avec de très faibles précipitations, une végétation de désert et une faune qui correspond à ce type de paysage. C’est tout—à—fait normal puisque nous sommes au début du désert de Kalahari. Si l’on s’éloigne vers l’Est, le plateau de Humpata (seulement à une centaine de km de la côte), tout change. Nous sommes à plus de 1000 mètres d’altitude par rapport au niveau de la mer, les précipitations sont importantes, la végétation également et la faune aussi. Le milieu est complètement différent et il est très dif— ficile de pouvoir imaginer que pendant la « préhistoire » la
e climas bastante diversificados que dificilmente podem ser reagrupados numa sé e ûnica entidade. Por exemple, se considerarmos a (Breuil, 1950).
L’observation de terrain et le traitement du matériel lithique des collections du Musée de Dundo permettaient, en théorie, d’établir une succession chronologique, à travers une méthode de classement par séries, basée sur le degré d’usure des pièces lithiques dont le principe était « plus un objet est roulé plus il est ancien ». L’un des sites les plus complets d’après les auteurs était celui de Cauma car il comprenait « toutes les cultures préhistoriques connues
A observaçäo do terreno e 0 tratamento do material litico presente nas colecçôes do Museu do Dundo permitiu, teoricamente, estabelecer uma sucessâo cronolôgica, utilizando um método de classificaçâo por séries, baseado no grau de desgaste dos artefactos liticos cujo principio era > Série A], à >. Sa séquence est la suivante : ESA, avec les industries acheuléennes et pré—acheuléennes, suivi d’une période intermédiaire (1èr RI.) in-
cluant l’industrie Sangoenne et le Lupembien inférieur
-se bifaces, picos, nücleos, machadinhas, nücleos Levallois,
Outros investigadores tais como ]. D. Clark trabalharam também nessa regiâo a partir dos anos 1960. O pri-
meiro trabalho geral sobre as indûstrias liticas de Angola foi produzido por ]. D. Clark que, empreendeu no decurso daquela década, um estudo de distribuiçâo cultural das indûstrias conhecidas em todo o territôrio. Realizou duas longas estadias de investigaçôes arqueolôgicas, mais especificamente no Este do pais, com uma equipa do Museu do Dundo. Dessas investigaçôes emergiu primeiramente um
livro consagrado a regiäo do Norte—Este de Angola (Clark, 1963) seguido de outre livro tratando da integralidade das indûstrias do pais (Clark, 1966).
O método de classificaçäo de D. Clark assenta de uma parte, no estudo do material litico ja existente nas colecçôes
du Museu do Dundo, em outros museus e/ ou em colecçôes privadas, cuja recolha provêm quase sempre da recolha de superficie e de outra parte, o resultado de escavaçôes: assim por exemple é 0 caso para o material litico extraido da gruta Leba situada ao Sul do pais. A classificaçäo é tipolôgica é baseada no desgaste e na patina das artefactos. Do ponto de vista metodolôgico, o Este do pais oferecia boas condiçôes de trabalho visto que se podia examinar o material litico das colecçôes e seguidamente utilizar a ex— ploraçâo mineira diamantifera a céu aberto para comparar segundo os cortes, os artefactos tipologicamente prôximos. O método permitia ao menos obter uma indicaçâo sobre a estratigrafia provävel do material. Para as outras regiôes do pais é regularmente sobre a base de colecçôes jé existentes e certas vezes com observaçôes no terreno e nas recolhas de superficie que a reflexäo sobre as épocas e culturas seré formada. A classificaçâo desse material feita por ]. D. Clark, é cro-
nolôgica e regional. Cronolôgica com base numa normalizaçâo da terminologia que ele propôs desde 1963 e que abrange trés « idades >> 6 duas « épocas intermediärias ». A sua sequência é como segue : ESA, com as indüstrias acheulenses e pré-acheulenses,
seguida de um periodo intermediârio (1° RI.) que inclui a
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES A BAIA FARTA (BENGUELA—ANGOLA) -— A PESQUISAS ARQUEOLÔGIÇAS NA BAIA FARTA (BENCUELA-ANGÛLA) — 2 7
qui établissent le lien avec le MSA caractérisé par l’industrie Lupenbienne, suivi d’une deuxième période intermé— diaire (2ème R1), ou transition Lupembo-Tshitolienne ; la séquence se termine par le LSA, dont le microlithisme en
est la caractéristique principale et, à l’Est, l’industrie Tshitolienne la plus caractéristique. Du point de vue spatial ].D. Clark partait du principe que les industries lithiques avaient évolué dans l’espace à cause, entre autres, des contraintes écologiques et que les trois « zones écologiques » présentaient des industries diversifiées à partir de la première période intermédiaire, différences qui iraient en s’accentuant jusqu’au LSA. Bien que cette hypothèse puisse paraître audacieuse pour l’époque il est très difficile de l’accepter à partir des éléments de preuve proposées pour la confirmer. Ainsi, par exemple, pour les sites de l’Est du pays, le corpus qu’il présente est très important et, bien que hors contexte stratigraphique, mais replacé par lui avec de bonnes possibilités de pertinence pour se placer dans un contexte réel et donc proche de la stratigraphie initiale, ce n’est pas le cas pour les autres régions du pays. Le matériel MSA de la zone sud-ouest par exemple, est très majoritairement de surface et se trouve déjà dans des collections sans références précises sur leur origine. Par ailleurs, le critère chronologique de classification est celui de son état d’usure, ce qui le conduit à difiérencier deux groupes : une série plus ancienne et une série plus récente. C’est à partir de ces données qu’il cherche à établir des différences régionales entre les industries lithiques en rapport avec les différents milieux. Il nous semble aujourd’hui diflicile d’admettre cette logique qui serait de considérer qu’un changement de milieu serait nécessairement lié à une m0dification importante de l’industrie lithique. Certes le milieu a dû jouer un rôle dans les adaptations aux situations changeantes, mais nous sommes un peu démunis pour établir un rapport si court de cause à effet. Plus inquiétant
indûstria Sangoense e o Lupembense inferior que estabelecem o vinculo com o MSA caracterizado pela indûstria Lupenbense, seguido de um segundo periode intermediârio (2° R1), ou transiçäo Lupembo-Tshitolense ; a sequência
termina com o LSA, cujo microlitismo é sua caracteristica principal e, ao Este, a indûstria Tshitolense a mais carac— teristica.
Do ponto de vista espacial, ]. D. Clark partia do principio que as indûstrias liticas tinham evoluido no espaço em razâo dos constrangimentos ecolôgicos, entre outros,
e que as très « zonas ecolôgicas » apresentavam indûstrias diversificadas a partir do primeiro periode intermediârio, diferenças que iriam acentuando—se até ao LSA. Bem que essa hipôtese possa parecer audaciosa para a época, é mui-
to dificil aceitâ-la a partir dos elementos de provas propostos para que possa ser confirmada. Assim por exemplo, para os locais do Este do pais, o corpus que apresenta é muito importante e bem que fora do contexto estratigrâfico, mas com boas possibilidades de pertinência para colocar-se num contexto real e por isso prôximo da estratigrafia inicial, o que nâo é o caso para as outras regiôes do pais. O material MSA da regiäo Sul-Geste por exemplo, é largamente maioritârio em superficie e jé se encontra em colecçôes sem referências especificas quanto à sua origem. Ademais, 0 critério cronolôgico de classificaçäo baseia-se
no estado de desgaste, 0 que leva à diferenciâ—lo em dois grupos : uma série mais antiga e outra mais recente. É com
base nesses dados que tentou estabelecer diferenças regio— nais entre as indûstrias liticas relacionadas com os diferentes meios. Hoje em dia seria dificil admitir esta légica que consistiria considerar que uma mudança de ambiente seria necessariamente ligada à uma modificaçâo importante da indûstria litica. E légico que o meio ambiente tivesse a sua importância nas adaptaçôes em situaçôes de mudanças, mas estamos um pouco desprovidos para estabelecer uma
encore, comparer des régions si éloignées, avec des don-
relaçäo tâo curta de causa para efeito. Mais inquietante
nées si différentes et avec des corpus très inégaux ne paraît pas raisonnable.
ainda e pouco razoâvel é 0 facto de comparar regiôes tâo distantes com dados täo diferentes e corpus tâo desiguais.
Du point de vue méthodologique, et bien que ces démarches soient le reflet d’une époque, il y a des cas extrêmes où une seule pièce lithique deviendra synonyme de changement culturel. Ainsi, par exemple, ].D. Clark
Do ponto de vista metodolôgico, e bem que essas abordagens reflectem uma época, também existem cases extremos em que um finico artefacto litico seré sinônimo de mudança cultural. Por exemplo, ].D. Clark indicava que no Dande, na regiäo do rio Kwanza, uma machadinha com rebordos paralelos era indicadora do Primeiro Periodo Intermediârio; ou ainda que a presença de um ünico pico na mina de Mufo situado ao Este do pais, indicava que a
indique qu’à Dande, dans la région du fleuve Kwanza, un
hachereau à bords parallèles est l’indicateur de la Première Période Intermédiaire; ou encore que la présence d’un seul pic à la mine de Mufo, à l’Est du pays, indique que la « tran— sition de l’Acheuléen vers le Sangoen avait déjà commencé » (cité par Ervedosa, 1980).
« transiçäo do Achelense para 0 Sangoense jâ tinha iniciado >> (citado por Ervedosa, 1980).
Dans d’autres cas, des régions qui fournissent beaucoup de matériel lithique diversifié font l’objet de propositions concernant l’existence des sites d’habitat ou des ateliers
rial litico diversificado, tornaram-se assunto para propostas visando a existência de locais de habitat ou de oficinas
Em outros casos, regiôes que forneciam bastante mate-
28 - RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES À BA|A FARTA (BENGUELA-ANGOLA) -— A PESQUISAS ARQUEOLÔGICAS NA BAIA FARTA (BENCUELA—ANGOLA)
de taille lithique, sans autre vérification que l’observation
liticas, sem outra verificaçäo que a simples observaçäo das
des accumulations de surface. C’est le cas de sites côtiers comme Palmeirinhas au sud de Luanda et de Baia Farta au
acumulaçôes na superficie. Dei-se o mesmo caso para os
sud de Benguela. Cette tendance à voir des structures complexes à partir du matériel de surface est devenue une quasi certitude dans l’analyse de sites et c’est ainsi que Palmeirinhas qui ne fut l’objet d’aucune fouille archéologique, à notre connaissance, est devenu un « atelier de taille ». Par la suite, quelques années plus tard seulement, C. Ervedosa et S. Junior qui ont travaillé sur ce site et fait une importante récolte de surface (701 pièces lithiques) reprennent cette idée « d’atelier lithique » et la développent considérant que Palmeirinhas était un atelier de taille de la deuxième période intermédiaire et qu’une longue tache horizontale à mi-hauteur de la falaise était un probable « sol d’habitat » (Ervedosa, 1980).
locais costeiros como as Palmeirinhas ao Sul de Luanda e da Baia Farta ao Sul de Benguela. Essa tendência de ver estruturas complexas a partir de material de superficie tornou-se uma quâsi certeza na anélise dos locais, foi assim que a estaçäo Palmeirinhas, aonde nunca houve qualquer escavaçâo arqueolégica pelo menos ao nosso conhecimento, tornou—se uma « oficina de lapi-
daçâo ». Em seguida e somente anos mais tarde, C. Ervedosa e S. Junior que trabalharam neste local e que fizeram uma importante recolha de superficie (701 artefactos liticos) retomaram e desenvolveram essa ideia de « oficina
litica », estimando que o local das Palmeirinhas era uma oficina de corte do segundo periodo intermediârio e que a longa mancha horizontal situada à meia-altura da falésia era um provâvel «piso de habitat» (Ervedosa, 1980).
Des prospections réalisées sur place au début des
Prospecçôes realizadas no tereno, inicio dos anos 1990,
années 1990 montrent que cette tache correspond à des sédiments de fond de lac ou de lagune qui se sont décomposés sur place laissant cette tache qui n’a aucun rapport
demostram que esta mancha corresponde a sedimentos de fundo de lago ou de laguna que se descompuseram in situ, deixando essa mancha sem qualquer relaçâo com uma qualquer actividade antrôpica. 0 mais interessante ainda,
avec une activité anthropique. Plus intéressant encore, les
accumulations de matériel lithique sont en réalité le résultat de l’érosion qui a permis, ou facilité, le déplacement des pièces lithiques de haut vers le bas laissant croire qu’il s’agit des dépôts anthropiques tandis qu’il s’agit tout simplement d’un fait naturel, bien que les pièces lithiques sont elles d’origine anthropique, mais pas en place (figure 6).
é que as acumulaçôes de material litico resultam na re-
alidade da erosäo que permitiu ou facilitou 0 a remoçâo dos artefactos liticos de cima para baixo, deixando pensar que se tratava de sedimentos antrôpicos, quando se trata simplesmente de um facto natural, mesmo se os artefactos liticos quanto & cles sâo de origem antrôpica, mas fora de posiçâo (figura 6).
Figure 6 — Aspect du site Palmeirinhas ( ©M. Gutierrez.). / Aspecto da estaçäo Palmeirinhas ( ©M. Gutierrez).
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES A BA|A FARTA (BENGUELA—ANGOLA) -— A PESQUISAS ARQUEOLÔGIÇAS NA BAIA FARTA (BENCUELA-ANGÛLA) — 29
Enfin, la classification de ].D. Clark inclut une dernière
Enfim, a classificaçâo de ]. D. Clark incluia um ultimo
période, le LSA, caractérisée par la « microlithisation » des pièces et l’utilisation accrue des éclats. Par ailleurs cette industrie, le Tshitolien à l’Est du pays, se trouve souvent associée à de la céramique, à des traces de métallurgie et aussi à des éléments d’origine exogène, comme à Tchi— tundo-hulo, au Sud du pays, où on la trouve dans des fonds de cabane mélangée à des perles en verre d’origine euro— péenne (Ervedosa, 1980). Elle est présente aussi dans des sites d’art pariétal.
periodo, o LSA, caracterizado pela « microlitizaçäo >> dos artefactos e a utilizaçäo acentuada de lascas. Ademais, essa indûstria denominada Tshitolense ao Este do pais é regularmente associada com cerâmica, vestigios de metalurgia e com elementos de origem exôgena, como é 0 caso em Tchitundo-hulo, ao Sul do pais, aonde é encontrada em restos de cabana amalgamada juntamente corn pérolas
Les recherches de ].D. Clark permirent d’établir d’une part un cadre général pour les industries lithiques du pays et, d’autre part, de visualiser des zones de fréquence de matériel lithique. C’est ainsi que la région qui apparaît comme la plus fortement pourvue d’industrie lithique est celle de l’Est du pays où la recherche a été faite autour du musée de Dundo et de l’activité minière. Tandis que d’autres régions,
As investigaçôes de ]. D. Clark permitiram de uma parte estabelecer um quadro geral para as indûstrias liticas do pais e, de outra parte visualizar sectores apresentando
peu prospectées, comme le Sud-est du pays, apparaissent
de vidro de origem europeia (Ervedosa, 1980). E também
presente em locais de arte parietal.
frequente material litico. E assim que a regiäo que aparece
como a mais provida em indüstria litica esté localizada no Este do pais aonde a investigaçäo foi feita em torno do Museu do Dundo e da actividade mineira. Se bem que outras
regroes pouco prospectadas como é 0 caso para o Sul-este
comme plus « pauvres » en vestiges préhistoriques mais que des prospections et fouilles pourraient dévoiler aussi comme riches en vestiges archéologiques. Enfin le Sudouest apparaît comme une zone où les hommes ont vécu d’une manière presque permanente depuis des périodes les plus anciennes de la préhistoire jusqu’à nos jours.
do pais, afiguram-se mais « pobres » a nivel de vestig10s pré—histôricos, poderiam todavia apôs escavaçôes e investigaçôes, revelarem-se ricas em vestigios arqueolôgicos. En-
LA ZONE SUD-OUEST
A REGIÂO SUL-OESTE
A la fin des années 1960, M. Ramos effectue des recherches archéologiques au sud du pays et fouille le site Capangombe, dans la province de Namibe.
No fim dos anos 1960, M. Ramos realizou investigaçôes arqueolôgicas no Sul du pais e fez escavaçôes em Capangombe na provincia do Namibe.
Lors d’une communication au IXème Congrès de l’Union Internationale des Sciences Pré et Protohistoriques à Nice, l’auteur indiquait que l’industrie présentait dans son ensemble > (idem). Ao seu ver, essa
conditions écologiques peu favorables à la vie humaine
situaçâo resultava das condiçôes arqueolôgicas pouco favorâveis para o desenvolvîmento da vida humana nessa
dans la région, surtout loin des côtes » (ibid).
fim o Sul—oeste aparece como uma regiäo aonde os homens viveram a bem dizer de maneira permanente desde as eras mais remotas da pré-histôria até os nossos dias.
tos sem residuos de lascagem näo obstante a proximidade eventual de oficinas de talhe. O autor acrescentava que « excepçâo feita da Baia—Farta, a maioria dos jazigos do Acheulense superior conhecidos no Sul-oeste de Angola
regiâo, ademais longe das costas >> (ibid).
Parmi l’ensemble lithique composé d’éclats, lames, choppers, d’une grande variété de bifaces et de hachereaux ainsi que de nucléus « proto-levallois >>, l’auteur avait fait l’étude d’une série de 196 hachereaux. A partir de la clas-
como machados e nücleos « proto-levallois >>, 0 autor fez o
sification proposée par Tixier, M. Ramos trouvait 8 types
estudo de uma série de 196 machadas. A partir da classifi-
de hachereaux (du type 0 à VI, plus un « non-déterminé »), dont le type Il était le plus nombreux, 100 pièces représentant 51% de l’ensemble, et qui montrait, selon lui, « une
de machados (de tipo 0 à VI, e um outro « sem determinaçäo), cujo tipo II era mais abundante, 100 artefactos repre-
Neste conjunto litico composto de lascas, lâminas, gumes unifaciais, de uma grande variedade de bifaces assim
caçäo proposta por Tixier, M. Ramos identificou 8 espécies
30 - RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES A BAIA FARTA (BENGUELA—ANGOLA) —- A PESQUISAS ARQUEOLÔGICAS NA BAIA FARTA (BENCUHA—ANGÛM)
occupation humaine significative »... . ..


![Na Gira da Umbanda: nos toques de Angola e Congo [1 ed.]
9788537009109](https://dokumen.pub/img/200x200/na-gira-da-umbanda-nos-toques-de-angola-e-congo-1nbsped-9788537009109.jpg)