Le sang des Carnutes: Tome 2 Pour la liberté ! (French Edition) 9782343154299, 2343154295
La Gaule est en pleine ébullition. La plus grande insurrection qu'elle ait connue - celle de -52 - s'apprête à
213 55 9MB
French Pages [388]
Polecaj historie
Table of contents :
I LES CONJURÉS
II L’AMOUREUX
III L’INITIÉ
IV LES CHASSEURS
V LA PRISONNIÈRE
VI LES MASSACRÉS
VII LES VAINQUEURS
VIII LE PROCONSUL ET LE PROTÉE
IX LES FUGITIFS
X LE DEVIN
XI LES ASSIÉGÉS
XII LE CONQUÉRANT
Citation preview
LE SANG DES CARNUTES
Romans historiques Cette collection est consacrée à la publication de romans historiques ou de récits historiques romancés concernant toutes les périodes et aires culturelles. Elle est organisée par séries fondées sur la chronologie. SIBRA (Michel), L’Indien blanc. Un chapelier breton dans l’ouest sauvage canadien, 2018. DE LISSER (Herbert George), La sorcière blanche de Rosehall, 2018. DREZE (Alain), La passion des oblats. Des religieux résistants au couvent de la BrosseMontceaux. Juillet 1944, 2018. SUDRE (Jacques), L’or de Malte, 2018. CASTELLS (Raymond), La danse de Zalongo, 2018. DÉCLÉRY (Anne), Les comploteurs de la Révolution, 2018. GÉRARD (Laurent), Le comptoir de la Hanse, 2018. MILLOT (Georges), Un après-guerre sans la paix, 2018. GODEL (Roland), Le chant de Smyrne. Il y a cent ans, la fin tragique de la Perle du Levant, 2018. CHATELIN (Yvon), Le vrai voyage de Monsieur de Combourg. Chateaubriand en Amérique 1791, 2018. SILVEIRA (Vincent), Quand le Tage s’arrêtait à Tolède, 2017. SILVEIRA (Vincent), La nièce de don Quichotte. La pucelle à la triste figure. Roman picaresque, 2017.
Ces douze derniers titres de la collection sont classés par ordre chronologique en commençant par le plus récent. La liste complète des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consultée sur le site http: //www.editions-harmattan.fr/
Armand Cléry
LE SANG DES CARNUTES Tome 2 : Pour la liberté !
Du même auteur Europa, Société des Écrivains, 2011. Le sang des Carnutes. Tome 1 : L’or et le sacrifice, L’Harmattan, 2018
© L’Harmattan, 2018 5-7, rue de l’Ecole-Polytechnique, 75005 Paris http://www.editions-harmattan.fr ISBN : 978-2-343-15429-9 EAN : 9782343154299
À celle qui est Calroë.
I LES CONJURÉS
C’était une de ces nuits où l’hiver aussi est une belle saison. La nature s’était enveloppée d’une obscurité très partielle. Là-haut, les étoiles innombrables émaillaient le ciel sombre ; certaines scintillaient, d’autres y formaient entre elles des dessins obscurs étonnants. La lune, presque entière, n’était gênée d’aucun nuage et laissait paraître distinctement les légères taches brunes qui maculent sa surface. Une clarté douce en émanait, descendant sur la forêt où l’on percevait tout jusqu’au hibou qui, immobile dans les branches, tend souvent son corps pour se fondre parfaitement. Les arbres dénudés, les frimas estompés n’empêchaient même pas la lueur de s’étendre. Au sol, des plaques de givre, formées après la neige et les pluies de riuros – le mois des glaces –, brillaient et faisaient, sous les astres, des étangs glacés dans les clairières. On y voyait comme en plein jour. C’était la nuit où aucun secret ne pouvait être celé bien longtemps. C’était pourtant la nuit des complots et des manœuvres cachées, l’heure où sortent les créatures des légendes et les conjurés de l’histoire. Le rendez-vous était fixé, nul ne serait en retard. Un homme jaillit d’un buisson et s’avança dans ce noir éclairé. Il était entièrement couvert d’un long manteau, jusqu’au capuchon rabattu sur sa tête, si bien que malgré la faible obscurité il ne laissait rien deviner de lui. Il portait une lance en guise d’arme dont il s’aidait pour progresser quand il avait à enjamber les pentes glissantes des sentiers. Il marchait en silence, à pas de loup, se retournait fréquemment pour voir si personne ne le suivait. Comme il allait depuis un moment, il entendit soudain l’herbe craqueler dans son dos, se retourna tout à coup avant de se tranquilliser : – Ah, c’est toi. – C’est moi. Allons-y. Et ils furent deux à continuer de marcher. Un autre les rejoignit bientôt, et ils furent trois. Puis un autre, et un autre encore, et tout un groupe au hasard du trajet. Tous confluaient vers un même point de rencontre, muets
et discrets dans leurs foulées étouffées, défilant côte à côte avec la discipline de fantômes dans la campagne encore blanche. Il avait neigé tout l’hiver, si abondamment que l’on s’était enfoncé à certains moments, en de certains endroits, jusqu’à mi-cuisses, voire à l’aine. Puis, à l’approche lointaine du printemps, la neige avait fondu pour laisser place à des congères et de larges gelées sous l’effet des averses et de la bise glaciale. Quand les intempéries eurent cessé, il en résulta un froid marmoréen sur une terre sépulcrale très belle. Ils prirent enfin un chemin caillouteux à travers champs, un second ensuite à peine perceptible, envahi par les prés qui longeaient les sous-bois. Au terme se dressait une butte, un de ces tertres abrupts si rares dans la région, poussé là comme une anomalie du paysage et hérissé d’arbres morts. Ce n’était pas la tombe d’un ancêtre ni un autre monticule à vocation religieuse et le lieu était trop étroit pour imaginer une forteresse quelconque. Mais les humains l’avaient aménagé à leur profit. Car, en se présentant au pied de la colline, on y découvrait une entrée creusée dans la terre, ouvrant à l’intérieur un couloir étayé de poutres épaisses, obstruée au-dehors de buissons et gardée ce soir-là par des hommes en armes. L’endroit se situait quelque part en territoire carnute. Devant, l’affluence était nombreuse ; on devait être une centaine. Des pelotons de troupes avaient convergé de partout en des grappes compactes. Tous se retrouvèrent, se saluèrent en serrant le bras d’un autre avec honneur comme s’ils étaient de la même famille, mais il n’y eut pendant longtemps aucune parole échangée. À peine quelques chuchotements. Les mouvements étaient limités, le bruit inexistant. On patienta en silence en attendant que l’identité de chacun fût vérifiée. Pour cela, on montrait seulement, à la lumière d’une torche, un tatouage dans le cou, sur le poignet, le torse, qui semblait un gage de confiance plus fiable que les couleurs des sayons. À de premiers, l’on disait à voix basse : « Un pygargue : tu obéis au chef » ; à de seconds : « Un cheval au galop : c’est bon, il compte parmi ceux d’Acutios qui nous a rejoints » ; à de derniers : « Une grue, comme Conconnétodumnos qui est notre adjuvant depuis le début ». Certains groupes qui n’avaient pas de tatouages ou alors des triskèles, des triquètres, des taureaux tricornes qui ne faisaient pas partie des symboles attendus, ces groupes qui participaient néanmoins aussi à la conspiration se présentaient par dizaines en même temps. Ils venaient de loin, surtout quand les terrains de marche étaient peu praticables en cette saison, et trompaient l’attente en se dandinant de côté pour se réchauffer : – Nous sommes de Maroialon des Carnutes. – C’est vrai, on nous a dit que vous étiez avec nous. 8
– Nous, de Garrigoialon. Notre tatouage, le voici : un serpent à deux têtes qui vaut les autres animaux. – Alors, soyez des nôtres. – Nous, de Magodunon que gouverne Épotsorovidios. – Et nous, de Brivoduron qui possède un des rares ponts sur le fleuve. – Nous aurons besoin de vous. Rangez-vous par ici. Celui qui parlait à ce peuple d’hommes en armes et tâchait de l’ordonner était Volomir, le fils d’Indiomar et frère de Cotuatos qu’il appelait ce soir le chef comme s’il n’y avait pas de lien de sang entre eux deux. Emmitouflé de braies et d’une tunique rembourrée de laine à cause du froid, il avait laissé la garde des portes de la ville pour cet autre point de passage, plus important, qu’il avait tenu à commander lui-même avec intransigeance parce qu’il faisait basculer ceux qui y pénétraient dans le complot qui libérerait le pays. La galerie qui trouait la colline devait en effet déboucher sur un endroit que personne n’avait encore vu, mais qui serait le lieu grave de toutes les décisions. Il fallait être sûr de chacun et on n’en pouvait laisser la tâche à un subalterne. C’est pourquoi, en même temps qu’il vérifiait la marque de ceux qui se montraient à lui et y retrouvait l’indice d’un clan ou d’une clientèle alliée, il les fixait, comme pour mieux les mémoriser, de ses yeux perçants dont le vert-de-gris inquisiteur semblait sur son visage enténébré comme ces gemmes fantastiques avec lesquelles les mages font dire la vérité à quiconque. – Et moi ?, dit soudain une voix. Tout le monde tourna la tête en arrière. C’était Conconnétodumnos aux longs rires, que certains de ses hommes avaient devancé. On ne l’avait d’abord pas remarqué. Il n’était pas venu à cheval mais à pied comme les autres, et la modestie de sa taille et sa jeunesse évidente ne le désignaient pas à première vue comme un chef notable. Il paraissait en effet chétif dans son lourd manteau de fourrure, sa voix prenait des accents aigus chaque fois qu’il parlait, il avait les joues glabres d’un garçon de quinze ans et les cheveux blonds frisés d’un enfant en bas âge. Mais ces traits ne signifiaient rien : Conconnétodumnos était un guerrier redoutable et un seigneur sans pitié en même temps qu’il montrait une méchanceté de femelle. Malgré le sentiment vif de liberté chez les Celtes, ses serviteurs, ses hommes de main baissaient le regard en sa présence comme des esclaves devant leur maître. Il avait devant eux des attitudes superbes d’orgueil. Il les battait, les injuriait, les humiliait comme s’il les eût dépassés de plusieurs têtes et qu’il eût tous les droits ; on racontait même qu’il avait défiguré en le griffant au sang un valet parce qu’il jugeait qu’il l’avait mal regardé. En revanche, sa troupe, si elle n’était pas des plus nombreuses, était précieuse aux conjurés 9
parce qu’il nourrissait une fidélité aveugle à Cotuatos dont il était l’ami intime et devant lequel seul il pliait. Un des siens se jeta soudain sur son passage, l’implorant de lui pardonner d’être venu avant lui. En le voyant faire, Volomir eut un geste de répugnance : un homme libre digne de ce nom n’agissait pas ainsi, ne rampait devant personne, fût-ce le compagnon de son frère. On ne chassait pas les Romains pour s’aplatir devant un Celte. Mais il n’eut pas à le souffrir longtemps car ce soir-là, le fils d’Agédomopas, contre son habitude, affecta de vouloir être l’égal de tous. Cela le mettait en joie visiblement ; il devait trouver cette posture plus convenable au moment d’un complot où tous devaient avoir la même part. – Ce n’est rien, rassura-t-il son compagnon d’une voix sifflante en le relevant, je viens comme toi prouver mon appartenance au groupe. – Pas besoin de vérifier ton tatouage, s’empressa de lui dire Volomir, on sait qui tu es. Passe et sois le bienvenu parmi nous, Conconnétodumnos. – Non, j’insiste. Je veux être traité comme mes hommes. Vérifie ce que tu as à vérifier, ce sera un exemple d’équité. – Alors, ton tatouage, montre-le-moi. – Le voici. Il en avait déjà un qui lui entourait l’œil droit d’un cercle bleuté. Pour montrer celui qui importait, il dut ôter sa tunique dans le froid, défaire son collier d’amulette en crocs d’animaux. Les lignes de son buste étaient tracées d’une musculature flagrante, mais son corps, qui faisait songer par sa finesse à celui d’une femme, restait sec et délicat. Il se tourna, arbora à la vue de tous la partie haute de son dos : une magnifique grue y était représentée sur chacune des deux omoplates et, à la lueur de la lune, la tête symétriquement tournée vers la colonne vertébrale, les oiseaux semblaient se regarder. Il esquissa un sourire grimacier, fit retomber instantanément la tunique qu’il avait soulevée aux épaules. Puis il alla retrouver les autres brenns qui étaient déjà là, entourés chacun d’une poignée d’hommes sûrs, eux aussi venus sans char ni monture, et il les salua avec respect. Le pommeau de leur épée revêtu de feuilles d’or, leur ceinturon et l’agrafe de leur manteau brillaient dans la nuit. Il y en avait de très illustres, jeunes ou vieux, unis les uns aux autres par des liens de clientèle ou de parenté : Marulos dont les champs s’étendaient si loin qu’ils étaient limitrophes du pays des Éburovices tout au nord ; Villu qu’on reconnaissait facilement à son casque à cornes de bœuf dont il ne se séparait jamais ; Égérax, un géant à barbe blonde qui, quand il jouait de la hache, tranchait de sa lame ou écrasait de son manche sur les champs 10
de bataille. Il y avait encore Exobnos le sans peur, Acutios dont la richesse résidait dans le convoyage de l’étain, Galatos ingénieux à la guerre parce qu’il était l’ancien compagnon de tente des Romains, Lugurix le protecteur d’une clientèle qui s’étendait très à l’ouest jusqu’au pays des Aulerques Cénomans et comptait parmi elle un certain Cillimax, marchand de quatre saisons. Ansila, Cloduar, Calpovix le dur complétaient la prestigieuse assemblée et ce dernier, porteur du bouclier suprême, seigneur de cinq cents lances, représentait, au sein de la confédération carnute, la tribu lointaine des Durocasses qui était inféodée. C’est dire si le complot dépassait de beaucoup les rives de la Loire. Il y eut entre eux ce seul mot d’impatience : – Ça y est, il va l’annoncer ? On va enfin passer à l’action ? – Oui, c’est pour ce soir, répondit Conconnétodumnos en montrant ses dents blanches dans un large sourire. Ce fut tout. Ils se tenaient devant l’entrée de la galerie, attendant d’y pénétrer, plantés sur leur épée étincelante aux flambeaux, le visage magnifique, gardant en silence des poses fières propres à leur rang. Ils étaient de la noblesse la plus conservatrice, celle qui inclinait derrière Cotuatos à un retour à l’ancienne royauté, celle que l’on voyait moins réunie dans les conseils tribaux ou les banquets festifs qu’en forêt où leurs complots, nécessitant des lieux secrets, ravivaient la vieille tradition celte. À leur spectacle, Volomir ne dit mot, opina seulement du menton. C’était l’heure, il fallait y aller. De toute façon, on était quasiment au complet et, si des retardataires se présentaient, on viendrait le chercher. Volomir laissa quelques hommes en arrière, introduisit dans la galerie tous les admis à l’assemblée. Les seigneurs marchèrent en tête, avec hâte. Mais, le dos voûté en raison de la hauteur basse des poutres, à peine s’y engagèrent-ils qu’ils en virent la fin car le corridor excavé était moins profond qu’il n’y laissait paraître de dehors. Pourtant, ce qu’ils découvrirent en sortant les ébahit longuement. Lors des trois réunions précédentes, on s’était retrouvé sur une île, dans une grotte et une ferme à l’abandon. Cette fois-ci, c’était encore un autre endroit isolé. Le couloir n’était pas celui d’une mine ou d’un abri souterrain. Il ne faisait que traverser la colline et débouchait, de l’autre côté, sur une vaste clairière. On descendait alors simplement un petit talus sur le flanc du coteau dans la mesure où la galerie n’avait pas été creusée droit et s’élevait un peu. En bas, des hommes en armes, plus immobiles que des statues et espacés de plusieurs pas les uns des autres, tenaient, sur toute la circonférence du lieu, de nouveaux flambeaux allumés, donnant 11
l’impression d’entrer dans un monde funèbre. Il n’y avait pas d’autre chemin, pas d’autre issue. Au-delà, les bois étaient très denses autant que la nuit permettait de le deviner parce que même les belles nuits paraissent opaques quand on y jette une flamme. On aurait pu multiplier les feux ; l’océan de ténèbres qui les bordait les aurait cachés à quiconque, surtout aux Romains qui, de toute façon, ne sortaient jamais la nuit dans ces forêts gauloises terrifiantes à leurs yeux. L’effet de surprise ne s’arrêta pas là. Au centre de cette caverne à ciel ouvert se trouvait un énorme amas de rochers – deux pierres dressées, une troisième couchée à l’horizontale dessus – qu’on avait toujours connu et dont l’âge se perdait dans les mémoires. Cotuatos aux bras d’yeuse s’y tenait debout, seul, poings sur les hanches, torse bombé, regard fixe, guettant gravement l’arrivée de ses soutiens. Il avait remisé la cuirasse et le casque de facture romaine qu’il portait d’ordinaire pour des parures typiquement celtes dont la cotte de mailles finement ouvragée luisait de reflets argentés tandis que son cimier arborait deux aigrettes mêlées de rouge et de blanc comme le sang et la neige. Sa barbe, sa chevelure avaient encore poussé depuis la dernière assemblée ; d’amples, ses cheveux étaient devenus longs sous sa coiffe et il avait pris soin de les lisser pour en faire ressortir la brillance. Le silence autour de lui était lourd, bien plus lourd que l’instant précédent devant la galerie. À ses pieds, un inconnu était accolé à la roche, encapuchonné et muet lui aussi, tant et si bien que personne ne le remarqua d’abord et, quand on s’aperçut de sa présence, nul ne sut dire qui il était. Cotuatos avait pris la tête du complot parce qu’il dépassait les autres chefs en mérite et en charisme. Il les dominait et la position surélevée de la pierre sur laquelle il se tenait lui convenait très bien. Tous connaissaient ses talents, admettaient sa supériorité ; les Romains eux-mêmes avouaient qu’il eût fait un bon général s’il s’était trouvé dans leurs rangs. Nombreux étaient ceux qui étaient prêts à le suivre n’importe où, dans n’importe quelle folie, quoi qu’il leur annonçât. Par sa naissance, par ses alliances, par la confiance qu’il inspirait, il avait à lui seul plus d’hommes que les plus grands seigneurs de sa nation, une troupe de guerriers innombrable et plus encore si on ajoutait la multitude de ses fidèles dont chaque noble présent ce soir faisait partie et qui n’espérait qu’un mot pour se rallier à lui. En attendant, la mise en scène de ce cercle de feux entouré de forêt avec un chef magnifique en son centre avait été préparée, c’était évident. Elle fit néanmoins effet car ceux qui arrivèrent en furent fortement impressionnés et demeurèrent un moment sans oser s’approcher. Cotuatos ôta son casque pour parler. Après de derniers instants qui furent comme un besoin de recueillement précédant des paroles décisives, il 12
rompit enfin le silence, s’abstenant de crier, mais s’exprimant d’un timbre ferme où l’on sentit son ascendant sur les autres en même temps que sa détermination : – Puissants Seigneurs, Gaulois libres, les appela-t-il d’une voix tonnante, venez, mes amis. Approchez, vous êtes ici sous la protection d’Ésos le défricheur. Approchez, n’ayez pas peur car ce soir, l’heure de la révolte a sonné. À ce mot, on entendit un rire à la tête du groupe. Conconnétodumnos avait acquiescé d’un ricanement retenu qui signifiait non pas le mépris, mais une joie plus terrible. Tout le monde s’approcha, lentement, sur le terrain détrempé de flaques de fondrières. Puis chacun se positionna sur un bout de terre sèche qu’il trouva à ses pieds et leva le visage vers Cotuatos juché sur son rocher. Son front éclairé des flambeaux tout autour donnait l’impression de rougir des blessures qu’il lui fallait dorénavant venger. Il commença : – Rappelez-vous, il y a bien des lunes de cela ! Rappelez-vous, vous y étiez nécessairement, sinon vous l’avez forcément entendu raconter tant la tension est vive depuis chez les nôtres, d’ici à Autricon ! Rappelez-vous cet homme, ce Biturige que personne ne connaissait et que les Romains ont condamné à mort en toute injustice. Il parlait de Sagéra. Depuis son exécution, il s’était écoulé plusieurs mois, d’octobre à février selon le calendrier des Romains. Mais le souvenir en était encore très présent dans les esprits marqués par l’événement, non seulement à Génabum et ses environs, mais même dans tout le pays carnute où la nouvelle s’était répandue très vite, et au-delà. – En plein milieu des rues, sans tenir compte de nos us, ou plutôt en les détournant, ils l’ont fait brûler, ils l’ont fait battre, ils l’ont laissé être exhibé à la foule. Ils cherchaient l’assassin d’un des leurs, ils ont saisi n’importe qui du moment qu’il fît l’affaire. Mais ils ont eu tort car, en commettant ce crime, ils nous ont blessés et nous ont liés à jamais à cet inconnu en nous rappelant que nous tous avons à souffrir le joug des fils de la louve. Je vous dirais, puissants Seigneurs, Gaulois libres, que cet assassin, ç’aurait pu être moi, ç’aurait pu être toi, Conconnétodumnos, ou toi, Ansila, ou toi, Villu, ou toi encore, Égérax ; ç’aurait pu être n’importe lequel d’entre nous si bien qu’en frappant cet inconnu, c’est nous-mêmes qu’ils ont manqué de frapper. Réveillons-nous ! – Bien dit ! Exact !, répondirent les brenns qui seuls avaient droit à la parole et en usaient avec cette goguenardise que l’on montre quand on sait que l’on va bientôt se jeter dans l’action. – À ceci près qu’un Biturige ne vaut pas un Carnute, crut néanmoins devoir préciser Marulos en grognant dans sa moustache jaunasse en forme 13
de fer à cheval. Chez lui ils sont les pions des Romains, il a peut-être eu ce qu’il méritait. Sa superbe était légendaire et tournait à l’arrogance. Cotuatos le foudroya du regard. S’il supportait d’être interrompu, il ne tolérait pas que l’on nuisît à son argumentaire. Un Biturige valait ce soir un Carnute et n’importe qui ici aurait pu remplacer la victime car les Bituriges, on le savait bien, souffraient d’être assujettis aux Éduens et donc à Rome ; ceci était dit et ne devait souffrir aucune contestation. Quelques retardataires arrivèrent, essoufflés. Qui les avait laissé rentrer ? On vit à la tête de Volomir qu’il était furieux de ne pas avoir été appelé pour vérifier en personne leur identité. Comme il n’y avait aucun chef glorieux à saluer parmi eux, Cotuatos poursuivit, simplement, une fois que les nouveaux venus se furent fondus dans l’assemblée : – À qui y aurait réfléchi, il était évident que ce Biturige n’était à la tête d’aucune bande et que même une bande, surtout d’être minables comme on s’est plu à le souligner, n’aurait pas suffi à terroriser notre confédération si peuplée, si prospère, si sûre de sa force. Mais les esprits s’embrigadent vite quand ils sont ensommeillés ; les mensonges les plus gros passent aisément quand un État est en guerre car un État en guerre, plus encore un État qui sent sur lui le poids de la défaite ne pense plus, mais veut agir et souvent gesticule dans la précipitation au risque de commettre l’irréparable. Je le répète : réveillons-nous ! Cotuatos avait raison. Il oubliait seulement de préciser le rôle ambigu qu’il avait joué dans ce drame et les calculs cyniques qu’il y avait échafaudés. Il était, comme les autres, responsable des gesticulations qu’il dénonçait. Il avait, comme tous, exploité la mort de Sagéra pour en tirer avantage. Dès que l’innocent avait été arrêté dans la maison d’Anéroeste au prix d’un massacre sans nom, il avait pénétré en personne sur les lieux et, avec l’intelligence qui le caractérisait, avait immédiatement compris qu’il n’y avait jamais eu de danger réel encouru – ni complot, ni brigandage, ni renversement de pouvoir –, que Sagéra n’avait été à la tête que d’une meute de médiocres, voire d’aucune meute du tout. Mais il se garda bien d’en rien dire, décida d’utiliser son avance pour parvenir à ses fins. Il connaissait les relations houleuses que les Carnutes entretenaient avec leurs voisins bituriges et turons pour la suprématie dans le centre de la Gaule ; il savait aussi que la foule serait facilement encline au courroux face à un coupable qui risquait d’amener sur elle le malheur, mais qu’elle serait tout autant versatile dès lors qu’on lui présenterait un autre coupable qui lui convînt mieux : il voulut utiliser ce formidable potentiel pour transformer une simple colère en un déchaînement capable de soulever tout un peuple. Il s’agissait au bon moment, un moment que lui seul 14
choisirait, de retourner l’exaspération contre un Biturige à l’encontre des Romains qui avaient déclenché cette affaire et à qui les conséquences échapperaient désormais. Pour cela, quand il monta sur l’estrade avant que le malheureux marchand fût condamné à périr par le feu, devant une foule où s’étaient glissés ses partisans pour appuyer son propos, il se refusa à contredire son rival Taurillos qui venait de faire l’éloge de l’alliance avec les légions. Il alla à l’inverse en son sens, en montrant que les Gaulois avaient obéi à ceux qui devaient être normalement leurs adversaires et qu’ils y avaient perdu leur âme. Il prit soin encore de ne dévoiler qu’en temps voulu une information catastrophique qu’il tenait secrète depuis plusieurs jours : il ne laissa annoncer la mort d’Acco, l’artisan respecté de la révolte antérieure, en apparence pardonné et supplicié traîtreusement par César, qu’au moment où la foule brûlante le recevrait comme un fer rouge plaqué sur la peau, et il s’arrangea pour que la nouvelle, interceptée par des crieurs des champs, fût portée dans la ville par un messager à cheval afin de lui conférer une gravité poignante propice à soulever l’indignation. Le résultat fut parfait. L’émeute qui s’ensuivit tourna court. C’était ce qu’il cherchait. Car une émeute spontanée, menée jusqu’au bout et brutalement réprimée, aurait tué dans l’œuf toute rébellion en rappelant la supériorité incontestable des Romains alors qu’une action avortée, insufflant un sentiment d’humiliation chez ces Gaulois si fiers, permettait de laisser s’installer un ressentiment profond exaspéré à la venue de l’hiver, une rancune tenace qui mènerait à une révolte préparée, aux formidables chances d’aboutir, qu’il n’y aurait plus eu qu’à commander. Il continua sa harangue sur le même principe, ne rappelant que les souvenirs qu’il voulait évoquer, selon le point de vue qui l’arrangeait. Il fit rêver l’esprit de ses hommes au cœur large, pressés de passer à l’action. Et comme il parlait bien, savait faire oublier des pans énormes de la vérité en la travestissant un peu, la mémoire collective se troubla. Les grands arbres faisaient cercle pour couvrir ses mensonges, les feux allumés dans la plaine continuaient de rendre par contraste la nuit claire très opaque. – J’aurais aimé le sauver, dit-il en feignant la compassion, mais je n’ai pas pu, tandis que, comble de l’impuissance, l’annonce de la mort d’Acco est venue nous assommer davantage. Ce fut non pas un, mais deux malheurs simultanés qui nous ont accablés, celui-ci n’ayant que l’avantgoût de cet autre plus désastreux. Acco le fougueux n’est plus et vous le savez comme moi, ce n’est pas son fils le fol qui prendra sa relève. Il était un chef valeureux pour les Sénons, pour nous un modèle à suivre. Il avait seulement voulu défendre la liberté de son peuple, et les Romains l’ont puni perfidement pour sa noblesse, et ils ont décrété contre nous 15
l’interdiction de l’eau et du feu. Mais je le dis bien haut, cette sentence est nulle et non avenue ! Il faut venger Acco ! Réveillons-nous ! L’assemblée marqua son approbation. Ce ne fut pas un tonnerre d’applaudissements, mais quelque chose de plus sombre, comme une résolution funeste qui se diffusa dans les membres et se lut dans les yeux. D’aucuns empoignaient fortement le pommeau d’ivoire de leur épée où luisaient des incrustations d’ambre ; ils étaient déjà en train de se libérer des Romains. – Acco n’est pas le plus à plaindre. Pour nous qui avons échappé au soi-disant pardon des Latins, les conséquences de la paix sont pires encore que la mort : elles confinent à la honte. Le mal que je désigne, ce ne sont pas les légions qui le portent ; non, c’est un mal autrement plus pernicieux qui est l’œuvre de personnes autrement plus dures à déloger que de simples soldats. Je veux parler des commerçants romains et italiens, cette lie rampante qui s’est installée dans notre cité. Autrefois ils étaient itinérants et il n’était pas besoin de les chasser pour les voir s’en aller ; aujourd’hui ils se sont implantés pour de bon dans les villes, ils les colonisent comme des parasites et ils n’en partiront que lorsqu’on les expulsera avec violence. Ce qu’ils vendent, ce que nos pairs s’arrachent comme des marques de luxe pourrit la santé des hommes, ramollit la vigueur des peuples et les fait devenir pires que des bonnes femmes honteuses : des bêtes émasculées ! Accepterons-nous cela plus longtemps, nous qui avons autrefois fait partie des tribus qui ont envahi l’Italie ? Je vous y exhorte, mes amis, réveillonsnous, réveillons-nous, réveillons-nous ! L’assemblée approuva une fois de plus, attisée de colère. Elle eut même du mal à contenir son empressement d’en découdre. Elle se calma assez vite pourtant car en pleine nuit, en pleine forêt, on craignit instinctivement qu’un vacarme trop important ne fût surpris de loin et que son écho n’attirât l’attention. Il en résulta un tumulte bâtard qui mourut dès sa naissance. Alors, pour pallier l’impossibilité d’hurler et exprimer leur pleine satisfaction aux paroles qui venaient d’être dites, tous brandirent leurs lourdes épées en l’air et donnèrent l’impression de vouloir piquer les astres tellement ils les élevèrent haut. La nuit se hérissa de lames étincelantes dont le cliquetis fit un concert assourdi d’ovation. Ce fut une vision solennelle émouvante. Cependant, une fois qu’ils les eurent baissées, quelques hommes vigilants groupés autour d’Ansila se mirent à regarder l’un de ceux qui étaient arrivés en retard. Ils le dévisagèrent bientôt avec insistance. Les cheveux blond cendré très raides autant que son bonnet en peau d’ours le laissait entrevoir, les traits fins et la moustache plate comme un mince ruban de tissu, l’individu avait certes un visage anodin, une taille normale, 16
un vêtement ordinaire. Mais il semblait être venu seul, armé d’une simple lance, et, malgré la foule, il n’était parvenu à se fondre dans aucun groupe. À l’écart au milieu de tous, il extériorisait sa joie comme les autres ; pourtant ses paroles, ses gestes avaient quelque chose de déplacé, de maladroit, d’imperceptiblement faux que seuls ceux manifestant une totale sincérité pouvaient déceler. Il détonnait et cela n’avait pas échappé aux témoins les plus avertis de la scène. – Car il n’est pas trop tard, reprit Cotuatos. Nous pouvons encore rétablir la justice et notre honneur. À la condition de n’être lâches et aveugles plus longtemps ! À la condition d’attaquer ! – Que proposes-tu ?, demanda Villu dont le casque à cornes de bœuf semblait vouloir donner la charge. – Un bain de sang. Un massacre. La seule solution qui contentera Teutatès et dont vous vous doutez bien depuis nos réunions précédentes. Tout le monde se regarda, la mine réjouie par ce projet qu’en effet chacun attendait depuis les premières assemblées secrètes. On se frotta les mains, on se tapa sur l’épaule pour se féliciter, on voulut en savoir davantage. Et Conconnétodumnos laissa échapper un nouveau rire aigu comme un bruit de lames effilées que l’on croise. L’intrigue visait à cela, chasser les Romains, et, si l’on s’était contenté des premières paroles de Cotuatos, on était enchanté à présent de l’entendre aborder les détails pratiques du passage à l’acte. La stratégie évoquée était d’ailleurs celle attendue de la surprise et de la terreur effroyables. Il eut du mal à calmer les esprits pour exposer la suite de son plan. Mais quand on se reconcentra pour l’écouter, il ne s’arrêta plus : – Comprenez-moi, comprenez-moi ! J’ai beaucoup parlé avec Galatos ici présent. Il a été le compagnon de tente des Romains dans leur manie d’exiger les meilleurs d’entre nous à leurs côtés. Outré de leurs exactions, il les a quittés voilà un an, mais n’a rien oublié de leur tactique. Grâce à lui, j’ai compris que nos ennemis nous sont supérieurs, il me faut l’avouer, sur le champ de bataille. Non pas en bravoure, pour cela rien n’égale un de nos hommes, même le plus vil ; mais en fourberie puisqu’ils s’abritent derrière des trahisons et des machines pour se battre. Il faut donc les affronter en usant de leurs propres stratagèmes : une révolte gauloise n’a de chance de connaître le succès que si l’on joue à armes égales avec les Romains. Galatos, dans sa science, m’a également raconté l’histoire d’un roi d’Orient appelé Mithridate. Son peuple, m’a-t-il dit, avait lui aussi été jadis envahi de marchands romains en tous genres et s’en trouvait gangrené. Mithridate savait à quelles basses activités ces boutiquiers se livraient, à quel point ils étaient devenus impopulaires auprès de sa population qui 17
s’en plaignait chaque jour. Il les considéra vite à leur juste valeur : ils devinrent pour lui une légion invisible, une cinquième colonne chargée de transmettre, tout en feignant des liens d’amitié, des informations à Rome sur son royaume pour le jour où il faudrait en faire la conquête. Alors il prit la plus sage des mesures : la tuerie, mais la tuerie orchestrée. Au signal donné, dans toutes les villes du pays, les rues ruisselèrent de sang ; il parvint à se débarrasser de tous en une journée et le butin fut considérable ! Il n’est qu’un exemple parmi tant d’autres ! Galatos pourrait vous raconter le même massacre qui eut lieu il y a cent ans dans une ville opulente d’Afrique qui craignait de disparaître sous l’oppression des Romains ! Là n’est cependant pas le plus important. Comme Acco tout à l’heure, je veux croire que ce Mithridate que nous ne connaissons pas peut être un modèle à suivre, dès à présent. Soyez-en sûrs, c’est maintenant qu’il faut agir ; le contexte est favorable et ne le sera sans doute plus jamais pareillement. La neige a entamé sa fonte, mais l’armée romaine est encore dans l’inertie de l’hiver. Les légions n’ont pas pris leurs quartiers dans notre pays et vous savez que César n’est pas en Gaule au moment où je vous parle, mais en Italie où le plus grand désordre règne et l’empêche de rejoindre ses troupes. Le marchandage aussi a marqué sa pause et les commerçants romains n’ont pas encore repris contact auprès des Gaulois avec qui ils font affaire et qui pourraient prendre leur parti. Pendant qu’il parlait, des têtes plus nombreuses s’étaient tournées vers l’individu arrivé en retard et demeuré à part de tout groupe. Nul ne le reconnaissait décidément et il avait quelque chose de louche qu’on peina d’abord à définir. L’insistance virait maintenant à la méfiance, une rumeur se répandit de bouche en bouche à mots couverts. L’homme ne parut néanmoins pas s’en soucier, à peine s’en aperçut-il et il n’y fit attention. – Il nous faut frapper fort, nos victimes seront nombreuses. Aucun Romain ne doit en réchapper. Ni les légionnaires : ils ne sont pas même cent et sont emmenés par un vaurien dont on sait qu’abusant de son pouvoir, il pense plus à piller les biens des faibles pour son compte qu’à entretenir sa troupe dans l’effort et la discipline. Ni les commerçants dont l’intendant de César supervise les trafics et qui drainent nos richesses pour nous les arracher et les envoyer jusqu’à Rome. Les redoutes et les entrepôts sur les rives du fleuve seront des lieux où ils essaieront de se retrancher comme des rats effarés par la mort ; il faut en abattre le plus possible dans les rues et les maisons avant qu’ils n’y parviennent. À nous tous, nous sommes quatre cents, c’est-à-dire deux fois plus ; nous pouvons réussir ! – Nous pouvons ! Nous pouvons !, répétèrent en chœur les autres. 18
– Moi, la victoire m’est secondaire, hurla soudain quelqu’un. Je veux le dénommé Asinus. Un bossu aux cheveux blancs accompagné toujours d’un esclave des provinces de l’est. Si vous le reconnaissez, retenez votre coup. Il m’appartient. C’était Volomir. À la différence des autres chefs, il n’avait pas bougé, paraissait très calme si l’on exceptait ses poings qu’il tapait frénétiquement l’un dans l’autre. De fait, il n’avait pas oublié l’offense publique dont Asinus l’avait sali à son entrée dans Génabum, et il voulait s’en laver définitivement. Souvent, depuis les mois écoulés, il avait rêvé d’égorger son ennemi juré, de lui crever les yeux, de se gorger de ses entrailles parce que son existence lui était insupportable et qu’il lui semblait être derrière l’arrestation du Biturige – un piège grossier dans lequel tous étaient tombés. Cotuatos le savait ; il connaissait l’injure subie, n’était pas dupe des bouffonneries de ce Romain, voulait motiver ses troupes du haut de son rocher. Mais au moment où il allait lui répondre, un autre chef se manifesta, d’une voix aigre : – Non ! Ce chien est à moi ! Je le réclame ! C’était Lugurix, le patron de Cillimax avec lequel Asinus avait conclu un contrat. Il possédait des droits de douane et d’impôt, ce qui le rendait prétentieux. Il cria à Cotuatos autant qu’à l’assistance : – Moi aussi, j’ai droit à la vengeance ! J’en atteste devant vous ! Cet escroc a bafoué l’accord passé avec l’un de mes protégés ; il m’a ridiculisé, moi, en me prenant pour un niais qu’on peut rouler ouvertement ! Volomir ne s’en laissa pourtant pas compter. Il s’avança et s’adressa avec aplomb à son rival : – Ton marchand de légumes, Lugurix, je m’en fous ! Je travaille depuis des mois à ma vengeance, je ne te laisserai pas me la voler si près du but. J’ai trouvé la pire arme dont un homme puisse souffrir, celle qui l’humiliera le plus terriblement. – Et de quelle arme parles-tu pour être si fier de toi ? – La femme. Je suis sûr de ma victoire. Il y eut un pouffement. – La femme ? Tu plaisantes ? – J’ai bien dit : la femme ! Figurez-vous qu’il s’est amouraché d’une des nôtres et ses illusions le mèneront à sa perte. Parce qu’il fait partie de ce genre d’hommes qui sacrifient tout pour l’étroitesse d’un vagin ou la senteur d’une chevelure. Ta rébellion, ô Cotuatos mon frère, ne sera complète que si en même temps je fais payer à cet homme l’injure qu’il m’a fait subir il y a des mois. Je ne parle pas d’une simple tromperie comme 19
Lugurix, mais d’une injure. Quand un homme est injurié, le monde reste en suspens jusqu’à ce qu’il obtienne réparation. Cotuatos réfléchit. Il trancha : – Alors il est à toi, mon frère, tu l’auras, je t’en fais le serment. Les cibles ne manquent pas, chacun de vous aura sa part et il y a place pour votre vengeance personnelle du moment qu’elle sert l’intérêt commun. Quant à toi, Lugurix, seigneur des plaines de l’ouest, je veux t’honorer et te prouver mon estime : je te promets de doubler ton butin pour te dédommager ! Le souffle de son haleine se cristallisait sous le froid, mais ses paroles enflammèrent l’auditoire. Il avait tranché non pas parce qu’il s’agissait de son frère et que les liens du sang passent avant tout, mais parce que l’idée qu’un Romain souffrît par la pire arme qui fût, bien plus terrible qu’une simple épée, lui plaisait. On vit cependant Lugurix donner des ordres à voix basse à ses hommes, ce qui laissa penser qu’il n’avait pas dit son dernier mot. – Ne compromettez pas tout, reprit Cotuatos en le voyant faire, prenez conscience à quel point la tâche est haute. En plus des Romains, nous devons nous débarrasser des traîtres parmi les nôtres qui ont pactisé avec l’ennemi pour s’enrichir ou confisquer le pouvoir au prix des vexations de notre peuple. Je veux parler de Taurillos et Crasovir qui ont usurpé les titres de vergobret et d’argentier et trempé dans l’assassinat de Tasgétios ! Ils sont aujourd’hui si soumis qu’ils n’ont pas hésité à sacrifier de nos hommes pour arrêter un innocent et le livrer aux Romains ! – Non, pas Crasovir !, se récrièrent quelques voix indignées. Tu ne peux pas nous demander de le tuer. C’est un sage, il rejette ce qui est romain. – Il m’a vu naître !, ajouta le jeune Ansila d’une voix suppliante. – Crasovir aussi !, martela Cotuatos. Non pas pour ce qu’il est mais pour ce qu’il représente. Il rejette peut-être ce qui est romain dans l’intimité, mais il sert César et ses lieutenants en public parce qu’il est persuadé qu’ils nous sont supérieurs. Et si vous ne me croyez pas, vous le ferez au moins en mémoire d’Elkésovix, l’argentier de Tasgétios dont il a pris la place et que mon père, Indiomar, connaissait depuis l’enfance et admirait. Notre roi paraissait soumis aux Romains, mais ce n’était qu’un faux-semblant pour dissimuler son véritable projet, vous le savez bien : il souhaitait en réalité attendre le moment idoine et commençait à mûrir son dessein quand il fut poignardé. Cotuatos résumait ainsi les événements récents qui avaient secoué la confédération carnute. Tasgétios était l’ancien souverain installé par César qui pensait pouvoir le manipuler pour piller sciemment les richesses de la contrée. Même si elle comptait encore de nombreux partisans, la royauté était pourtant abolie depuis plusieurs générations. Le général romain l’avait 20
restaurée parce qu’il pensait qu’un changement de régime portant à la tête de l’État un chef unique lui rendrait la tâche plus facile tant il est vrai qu’il est souvent plus simple de contrôler un seul homme qu’un sénat tout entier. Mais le dernier roi était rusé et, quoiqu’il eût assisté César avec valeur et dévouement dans ses guerres, il n’entendait pas lui obéir servilement une fois sur le trône. Au contraire, il donna des gages de confiance au proconsul pour mieux œuvrer subrepticement contre lui. L’erreur du conquérant fut grave, surtout dans le besoin de blé où se trouvaient ses légions. D’une tribu qui manifestait de la mauvaise volonté, il en avait façonné une autre qui développait des sentiments anti-romains. Les relations se détériorèrent progressivement, en vinrent à un point de non-retour. Lorsqu’il en eut vent par ses indicateurs, César dut agir sans perdre de temps ni vérifier ses renseignements. Alors même que Tasgétios régnait depuis trois ans, il encouragea ses rivaux à l’en débarrasser. En contrepartie, il renonça à donner un roi aux Carnutes et préféra leur accorder le retour à un régime oligarchique du moment qu’il le servît entièrement. Le complot fut ourdi à Génabum où l’ironie voulut que l’on frappât en même temps les dernières pièces à l’effigie royale. Tout alla très vite. Tasgétios fut assassiné un jour de pluie en pleine séance du Sénat, à Autricum. Taurillos fut celui qui lui porta le premier coup de couteau. César clama tout haut son indignation, envoya des troupes arrêter les meurtriers, se contenta d’une enquête inaboutie puisqu’il avait précisément encouragé en secret ces mêmes meurtriers. La population ne bougea pas, soutint au contraire le régicide, flattée dans ses penchants pour un partage du pouvoir et une apparente égalité. Tout rentra dans l’ordre. Tandis que le roi périssait sur son trône, les flancs percés, la tête tombante, la bouche coulante de sang, sans même avoir pu porter la main à l’épée pour se défendre, ses partisans qui étaient présents sur les lieux se comportèrent avec bravoure. L’ancienne noblesse coulait dans leurs veines, mais piégés par la plus vile des trahisons ils n’étaient pas suffisamment armés. Ils résistèrent comme ils purent, comme ils durent, furent finalement criblés de flèches à gibier. Aucun ne se sauva ni ne trahit son sens du courage ; tous trépassèrent. Ils firent face à la mort en faisant preuve du sacrifice le plus honorable. Trois jours plus tard, une dernière bataille s’ensuivit dans la plaine qui s’étend entre les deux cités des Carnutes. Elle fut surtout un baroud d’honneur pour les partisans de Tasgétios absents au moment du massacre qui, décontenancés par la catastrophe, préférèrent mourir par les armes que chercher à raisonner ou se sauver dans la honte. Compagnons de toute une vie, ils avaient grandi 21
ensemble, mourraient ensemble. Parmi ceux-là figuraient Elkésovix, sorti de Génabum en retard, et Indiomar, revenu de ses terres, qui ne rentrèrent pas chez eux. Le pouvoir s’appuya sur les familles les plus riches, non les plus vieilles. Le vainqueur et nouveau maître de la confédération, Taurillos, fils d’Astorix, était pourtant d’une lignée illustre dont les ancêtres, prétendant descendre du dieu Taranis, avaient eux aussi servi les anciens rois. L’époque n’était toutefois plus à asseoir sa puissance sur des origines mythiques, mais sur la faculté de chacun d’acheter ce qu’il voulait et d’en jouir. D’une nature lourdaude et vulgaire, Taurillos était capable de coups d’éclat inattendus comme un taureau ensommeillé qu’un taon pique et réveille. Rien ne le poussait vers le gouvernement de l’oligarchie, sinon un calcul pragmatique et cynique qui lui faisait considérer ce changement de régime comme un moyen certain de prendre le pouvoir en étant soutenu par le peuple et se prémunir des attaques en faisant semblant de le partager avec ses pairs. Il rétablit le titre de vergobret qu’il justifia par l’entremise d’Itas, le gutuater, et se déclara protégé des dieux. En vérité, être roi ne lui aurait pas déplu parce qu’il avait un tempérament tyrannique et il avait la ferme intention d’être réélu à son poste tous les ans comme la loi des Carnutes l’autorisait. Mais il trouva plus précieux encore qu’une couronne d’or : l’argent qui corrompt tout. Il fit confisquer les biens de Tasgétios et ses soutiens, s’enrichit considérablement et, devenu un allié indéfectible des Romains, tira tous les bénéfices d’un commerce avec eux. Les fils d’Indiomar, Cotuatos et Volomir, furent, quant à eux, inquiétés parce qu’ils étaient en âge de porter les armes depuis plusieurs années. Avec leur sœur, ils furent obligés de se cacher un moment, vivant comme un déshonneur de fuir devant des lâches. La société celte n’était pourtant pas rancunière et la terreur ne durait jamais longtemps. S’ils purent rapidement réintégrer leur place en jurant de prêter allégeance au nouveau pouvoir, ils firent aussi le serment secret de se venger. Ils avaient été marqués différemment par les événements : Volomir en éprouva une colère perpétuelle contre tout ce qui était romain parce que les Romains étaient toujours derrière les meurtres et les ruses ; Cotuatos, lui, en conçut une réaction plus calme et résolut d’adopter un plan de représailles méthodique. Il délaissa à son tour la noblesse des belles actions, jugea la trahison plus efficace, accepta de jouer le jeu des vainqueurs quand Taurillos lui proposa d’être stratège pour l’éloigner à l’étranger et feindre la concorde retrouvée dans la nation. Mais, contrairement aux calculs du vergobret, il n’y eut, durant cette période, aucun conflit où les Carnutes furent directement engagés et César ne réclama pas la présence de leur stratège à ses côtés. Cotuatos fut donc 22
libre d’élaborer son plan tout en jouissant d’une magistrature puissante qui lui assurait des soutiens parmi les notables et lui permettait de contrôler l’armée. Il laissa se développer un ressentiment ambiant contre l’occupant et les usurpateurs, n’eut qu’à attiser les mécontentements lorsqu’il sentait la colère retomber et affecta en même temps un grand respect des Romains, misant sur le sens politique de ses concitoyens qui devaient comprendre son double jeu. Ce fut un travail en profondeur dont la mort de Sagéra fut le point d’orgue. Malgré sa jeunesse, il œuvra efficacement. Tasgétios n’avait pas eu de fils, la royauté n’était de toute façon pas héréditaire ; une voie idéale s’offrait à lui : il devint l’espoir des survivants du massacre, presque un dieu pour Conconnétodumnos qu’il prit sous sa protection. Il parvint enfin à ressouder le parti monarchique décimé. Les deux hommes, Conconnétodumnos et Cotuatos, ne se connaissaient d’abord pas. Le premier en particulier était à ce moment de la vie où l’on passe de l’enfance à l’âge d’homme et ignorait tout de la société des guerriers. Il avait perdu son père et son oncle, avait été quelques mois otage des Rèmes, était l’héritier d’une maison dont tous les représentants mâles avaient succombé dans le complot. Cotuatos l’accepta comme échanson, reconnut vite en lui une noblesse de caractère qui lui plut particulièrement. Il entreprit de l’éduquer. Un soir, il le fit venir sous sa hutte et, devant sa maisonnée, l’invita à partager une coupe de vin, un filet du sang de ses veines et sa couche qu’il réservait d’ordinaire à ses femmes. Ce fut un amour, une amitié, une alliance comme seuls des barbares pouvaient le concevoir ; il n’y eut rien de honteux ni de dégradant entre eux deux à la différence des ruts immondes que goûtaient les Romains. Le plus jeune apprit beaucoup de son aîné ; il apprit à se battre, il apprit à raisonner, il apprit que peu importe la manière dont on triomphe du moment qu’on emporte la victoire et il montra de réelles qualités en même temps qu’une perversité certaine. Le gamin dont tout le monde riait un an auparavant finit par être respecté des siens comme de ses ennemis. Enfin, dans tout cela, Crasovir fut le seul à se démarquer. Il n’avait pas participé à l’assassinat de Tasgétios, et Taurillos qui avait permis à des lâches de vaincre fit appel à lui, lui proposa d’être son argentier uniquement pour avoir une caution de sérieux tant la réputation de modération de Crasovir était grande. L’homme accepta dans l’intérêt du pays, soulagé d’ailleurs à l’idée de résider à Génabum où se battait la monnaie tandis que Taurillos aurait résidé loin à Autricum, la capitale politique. Mais il fut surpris de voir que le nouveau maître du pays s’installa finalement dans la même ville que lui, plus attiré maintenant par le luxe que par les soucis de la politique. Il en conçut une certaine amertume, tout le monde le savait. Pourtant il n’en avait pas moins participé au 23
gouvernement de Taurillos en tant que second magistrat civil ; il devait donc mourir, Cotuatos le voulait. Au nom des trépassés, l’assemblée des conjurés dont chacun avait eu un parent, un ami ou l’ami d’un parent assassiné fit concession du sacrifice de Crasovir. – Alors c’est moi qui le tuerai, décida Ansila, pour que je sois sûr qu’il meure dignement. Tout autre qui portera la main sur lui versera son sang sur la lame de mon épée. Personne ne répondit à cela. On entendit un hululement parcourir les grands bois. La requête fut entérinée. – Et que fait-on des Grecs, des Étrusques, des Africains ?, demanda encore quelqu’un d’autre. – Nous sommes en contact avec ces peuples de longue date ; eux aussi ont eu à subir le joug des Romains, déclara d’abord le stratège qui avait pensé à tout. Mais aujourd’hui la donne a changé car ils ont pris leur place dans le système imposé par Rome et s’en accommodent très bien. Ils ne commercent plus équitablement comme autrefois mais participent eux aussi au pillage de notre pays. Il faut donc les traiter comme leurs maîtres, et ainsi de tous les étrangers. Personne ne doit en réchapper, pas même les druides, pas même le gutuater ! Il y eut ici une nouvelle hésitation. On avait déjà accepté à regret la mort de Crasovir. L’idée de faire périr les druides, des hommes porteurs de savoir et de religion, a fortiori de mettre à mort le plus important et le plus révéré d’entre eux, créa un malaise certain parmi tous. Cotuatos le sentit bien, maintint néanmoins l’appel au meurtre terrifiant qu’il venait de lancer : – N’ayez aucune crainte ! Les dieux ne nous en protègeront pas moins ; au contraire, j’ose affirmer qu’ils nous en sauront gré ! Car ceux qui se font appeler druides de nos jours ne le sont pas comme ils l’étaient jadis ; leur pouvoir lui-même a fortement diminué. La fonction avait déjà perdu de son aura, elle n’en a plus du tout depuis qu’ils se sont compromis avec l’envahisseur. Itas, quant à lui, est, sous ses allures redoutables, le plus corrompu, le plus indigne de sa fonction. Il incarne peut-être ce qu’il reste de nos devins autrefois capables de communiquer avec la divinité. Mais le titre qu’il porte, qui devrait signifier avoir le verbe noble, consiste en réalité à se répandre en messes basses et s’abaisser devant Rome sous prétexte de culture et de raison. Vous savez bien qu’il s’est enfermé aujourd’hui dans une religion d’apparence pour participer, comme tous, aux intrigues du pays, qu’il ne vaut guère mieux que le Diviciacos des Éduens… Allez ! Les saies blanches ne sont pas de vrais druides, mais des perfides, mais des soumis qui ignorent la volonté divine et se contentent de confirmer, en mentant, les imposteurs en place. S’ils ont évoqué Taranis 24
en brûlant ce malheureux il y a des mois, ce n’est pas pour honorer le Gardien de l’ordre sur terre et dans les cieux, mais bien pour lécher les pieds du vergobret dont la famille se targue impunément de descendre de ce grand dieu. D’ailleurs, en voyez-vous un seul ici, parmi nous, de ces hâbleurs à longues barbes ? Non, en vérité, aucun n’est là ce soir et je me suis passé de leur prétendue sagesse comme de la prédiction des devins pour être votre chef et vous mener. Croyez-moi, il en va des hommes comme des herbes qu’on cultive : mieux vaut éliminer les pousses malsaines pour en voir germer de plus fortes et de plus belles. Son conservatisme politique ne préjugeait en rien de craintes arriérées. Au contraire, il clamait haut ses idées, sans y concéder le moindre renoncement, et voulait se donner l’image d’un homme qui ne connût pas la langue de bois. La vérité était qu’à titre personnel, il vivait les choses de la religion dans un rapport direct et se méfiait de tout ce qui fût un intermédiaire entre les dieux et les mortels, y voyant un risque de manipulation et de tromperie. D’ailleurs l’évolution des sociétés gauloises lui donnait raison puisque la fonction de druide, déjà inexistante en Aquitaine et Transalpine, se réduisait depuis des années à un titre symbolique où le savoir ancestral comptait de moins en moins. Seuls quelques obstinés, réfugiés dans les bois ou les montagnes, perpétuaient encore l’ancienne connaissance des dieux en ne s’occupant que de cela ; dans les cités et les villages, les autres s’étaient tournés pour de bon vers la politique et n’usaient de leur titre qu’afin d’interférer comme ils l’entendaient dans les luttes entre les hommes. Le sacrifice de Sagéra l’avait tragiquement prouvé. L’enthousiasme ne fut toutefois pas aussi grand que Cotuatos l’espérait. Il en fut vexé, répéta sa phrase en haussant le ton et les autres tâchèrent d’être emportés par sa véhémence. Pendant ce temps, la méfiance grandissait vis-à-vis de l’inconnu isolé au milieu de la foule autour duquel on avait peu à peu laissé une place importante pour ne pas le toucher et mieux se défendre au cas où. À force de l’observer, on finit par remarquer un détail terrible sur lui : l’homme portait, dissimulé à la hanche, un poignard romain. On n’en était pas sûr car la lame était cachée sous son manteau, mais quelqu’un chuchota qu’on ne pouvait pas se tromper : la poignée de métal et de corne en avait la forme avec ses têtes de rivets qui lui donnaient un motif en gouttes caractéristique. On se poussa du coude pour se le montrer discrètement. La méfiance à son encontre en devint une malveillance prête à éclater. Les principaux chefs en furent informés à voix basse, relayèrent l’information à leurs hommes. Bientôt, plus personne n’écouta Cotuatos. Sans y paraître, tous les regards se portèrent sur l’individu ; ils furent si lourds d’animosité, 25
si aigus de haine que l’homme sembla les sentir, se retourna, parut inquiet de l’espace soudain laissé vide entre lui et les autres et donna l’air d’avoir compris. Alors ses mains tremblèrent, il parut devenir blanc comme une lune d’argent. Conconnétodumnos lâcha un rire au bruit de pierres qui ricochent. Du haut de son rocher, Cotuatos qui, emporté par son discours, n’avait pas perçu le trouble croissant de l’auditoire empêcha encore la situation d’empirer en continuant à développer les détails pratiques de son plan pour galvaniser ses troupes. On fit effort pour se reconcentrer et l’on n’y parvint qu’avec peine, en restant sur ses gardes : – Vous voyez la couleur du ciel ce soir, ce fin liseré vert qui vient de plus loin que les astres : il annonce de prochaines neigées, les toutes dernières avant la fonte définitive. Elles tomberont bientôt. Puissants Seigneurs, Gaulois libres, c’est maintenant qu’il faut agir, il n’y a pas de temps à perdre ! Écoutez-moi bien : lorsque deux nuits se seront écoulées, avant les premiers rayons du soleil, vous vous réunirez dans le bois de Kunoval au nord de Kénabon. C’est là que nous frapperons car c’est la seule de nos cités qui concentre autant de Romains. Aux quatre entrées de la ville, au moment précis où l’aube pointera, le signal sera donné par une sonnerie de carnyx. Les hommes de Volomir tiennent les portes ; ils les ouvriront pour vous. Alors vous vous précipiterez à l’intérieur et l’on fermera la souricière. Vous attaquerez tous les Romains que vous rencontrerez dans votre avancée, citoyens, affranchis, jusqu’aux catins et aux gosses s’il y en a. Vous les surprendrez dans leur sommeil ou dans les premiers pas qu’ils feront hors du lit. Répartissons-nous les cibles à abattre : Conconnétodumnos et ses hommes fondront sur les légionnaires ; Marulos, Égérax envahiront le port à sa suite ; Cloduar enfoncera cette taverne que les marchands ont élue pour repaire ; Ansila trouvera Crasovir ; moi, je me charge de ce renard de Taurillos. Les autres, vous nettoierez les rues et tout ce qui vous semblera un abri. Vous n’avez qu’à tuer sans vous poser de questions, nul ne vous résistera et peu importe si des innocents périssent sous vos coups. Tuez, tuez, transpercez encore pour vous assurer que ces galeux ont bien crevé, et laissez leurs corps sans sépulture ! On punira sévèrement ceux qui enseveliront les morts ou cacheront les vivants, on offrira des récompenses aux délateurs, aux débusqueurs et la liberté aux esclaves qui trahiront leur maître ! Quand vous aurez plus de sang sur la face que de barbe, quand vous serez repus d’avoir trempé dans les boyaux de l’ennemi, alors seulement notre point de rencontre sera la rive de la Loire que nous rougirons en nous purifiant 26
dans son eau terreuse ancestrale ! Nous les aurons tous mangés, ces Romains qui dévorent nos greniers ! Cette fois-ci, ce fut un déferlement de joie, un torrent d’allégresse qui emporta toutes les hésitations précédentes et fit oublier qu’un traître pouvait être présent. Chez ces seigneurs las des lointaines défaites et de l’inaction récente aux combats, l’appel du meurtre aveugle était plus fort que tout et les enivrait désormais. Ils avaient le cœur chaud, ne ressentaient plus l’hiver qui glaçait leurs pieds et leurs jambes. D’avoir ployé sous le joug des médiocres et des odieux les exaspérait et les poussa à laisser leur liberté se débrider avant l’heure, en encourageant même leurs hommes à exulter avec eux. Ils pointèrent à nouveau leurs épées en l’air, mais cette fois-ci plus violemment, les lançant presque, exécutant des pointes, des moulinets, des mouvements larges avant de les ficher furieusement dans le sol comme s’ils massacraient déjà. Et, quand les porteurs de torches qui faisaient cercle autour d’eux firent pareil, agitant leurs flammes en même temps que leurs lames, on eut l’impression de la danse d’un soleil craché en pleine nuit. Ils étaient déjà au jour du massacre, rien ne devait les détourner de leur geste. Ils entonnèrent ensemble des chants horribles où des notes lourdes, aiguës, inouïes se mêlèrent, sans se soucier du vacarme provoqué et oubliant toute discrétion ; le rire de Conconnétodumnos, semblable au hurlement d’effroi d’une femme qui voit la mort l’embrasser, fut particulièrement remarquable. Cotuatos en fut enfin très satisfait. – Et après, que se passera-t-il ?, demanda Calpovix au bout d’un long moment quand cette gaieté barbare fut un peu retombée. – Après ? Après il faudra élargir notre lutte parce que la libération de notre ville ne doit être qu’un point de départ à celle de notre territoire, puis de la Gaule entière. Il me faut pour cela vous présenter Critovax, fils d’Asios le roux de Némossos. Avance-toi, mon ami. À cette invitation, l’homme qui s’était tenu pendant toute la harangue de Cotuatos au pied du rocher transformé en tribune esquissa quelques pas en direction des conjurés qui l’avaient complètement oublié. Il leur fit l’effet d’une pierre verticale qui eût pris vie. Il découvrit sa tête qu’il avait jusque-là maintenue encapuchonnée, révéla son visage terne et bouffi qu’une moustache longiligne barrait d’un gros trait. Mais il ne prit pas la parole, aurait d’ailleurs eu du mal à convaincre dans son dialecte des monts arvernes, laissa le chef des conjurés dire son identité et la raison de sa présence. Cotuatos avait grisé l’assistance, il lui restait à expliquer la partie la plus ambitieuse de sa stratégie : – Critovax est l’envoyé d’un jeune prince de Gergovie. Ce prince, certains l’appellent Keltillos comme son père, d’autres Nertos comme son aïeul. Peu importe car depuis peu il a reçu de ses partisans le nouveau nom 27
de Verkinngétorix. Retenez bien ce nom : Verkinngétorix ! Verkinngétorix, maître à vingt ans d’une armée de libération et prochainement d’un peuple de presque un demi-million d’habitants ! Au moment où je vous parle, il est en passe de délivrer son pays où son père, parce qu’il ambitionnait le titre de roi, fut lui aussi assassiné par des traîtres vendus aux Romains. Des traîtres dont faisait partie son propre frère, tant la fourberie n’a pas de limite quand les hommes du Sud achètent leurs complices ! Les colporteurs qui passent sur nos terres vous l’ont sans doute appris. Mais sachez aussi que ce jeune prince dont le nom signifie le grand roi des fantassins, dont le nom semble fait pour engendrer l’épouvante, je l’ai rencontré il y a plusieurs mois et j’ai reconnu en lui une intelligence rare, un allié de taille pour chasser l’envahisseur. Depuis quelque temps, il a lancé des ambassades auprès des peuples de Celtique afin de les rallier. Luctérios le lutteur a été envoyé jusque chez les Rutènes ! Moi-même j’ai beaucoup voyagé ces derniers mois, toujours sur de courtes durées pour ne pas éveiller l’attention, et j’ai participé en votre nom à plusieurs assemblées organisées par ce prince dans toute la Gaule mécontente. Critovax est revenu avec moi de la dernière où dans une assemblée des Arvernes, des Sénons, des Parisiens, des Pictons, des Cadurques, des Turons, des Aulerques, des Lémovices, des Andes et tous les peuples qui touchent au grand Océan, j’ai raconté les affres de notre cité et demandé que nous soyons les premiers à prendre les armes pour le salut commun. Les Éburons, les Nerviens, les Trévires ont déjà entamé la révolte ; c’est à nous de la poursuivre et de la rendre générale en frappant fort. À nous revient l’honneur de déclencher les hostilités ! Car le massacre que je vous promets ne sera que l’offrande réclamée par Teutatès pour commencer une guerre. La lutte va être poursuivie à l’échelle nationale avec nos alliés, dans une armée libre où chaque tribu affranchie sera représentée ! – Et qui nous dit que ceux dont tu nous vantes l’alliance vont nous suivre réellement ?, demanda Marulos toujours acrimonieux et qui décidément aimait à contester. Il possédait, sur ses terres, des gisements de fer qu’il exploitait ; sa famille avait participé à tous les gouvernements royaux antérieurs, ce qui lui conférait, croyait-il, le droit de discuter les décisions. Il se tenait au milieu de ses hommes, tous frontaliers des Éburovices dont ils avaient emprunté les arcs en bois d’if, les traits belges du visage, l’insolence des ancêtres germains. On sentait dans chacune de ses phrases le désir de disputer l’autorité à Cotuatos. Mais celui-ci ne le releva pas : il y en avait toujours dans les conjurations qui prétendaient remettre en cause le chef 28
et mener eux-mêmes le complot. Il préféra rire de la critique et la tourner en ridicule pour répondre à cette attaque à peine voilée. – Marulos, tu me rappelles l’enfant que j’étais quand j’avais peur qu’on ne me suive pas dans mes jeux. Mais veux-tu que je te dise ? On m’a toujours suivi, même les jaloux, même les pleutres et mes bêtises de gamin n’ont été que des actes salutaires pour l’adulte que je suis. Il n’en est jamais sorti que des conséquences qui m’ont grandi et rendu plus fort. Aujourd’hui, dans l’alliance dont je vous parle, il n’y a certes pas eu échange d’otages parce qu’un tel procédé aurait éveillé l’attention des Romains, mais, comme c’est l’usage ancestral chez nous, toutes les tribus impliquées ont juré solennellement sur nos enseignes pour nouer les liens les plus sacrés. – En toi, l’enfant que je suis a confiance, insista encore l’autre avec aplomb, mais pourquoi remettrions-nous nos vies entre les mains de ce puceau imberbe dont tu nous parles ? – Je ne te citerai pas les grands guerriers qui déjà le soutiennent et forcent l’admiration : Commios l’Atrébate, Camulogénos l’Aulerque, Corréos le Bellovaque. Non, je te parlerai plutôt de son plan. Vous vous souvenez de Keltillos qui eut autrefois le commandement suprême sur la Gaule ? Eh bien, son fils aussi a droit à ce titre par le plan qu’il entend appliquer. Ne vous fiez pas à son âge : un jeune homme cache parfois la maturité d’un vieillard. Celui que je vous demande de suivre connaît bien les Romains ; comme Galatos, il a frayé avec eux avant de s’en séparer, il a été à la tête d’un escadron de cavalerie à leurs côtés. Il sait leurs points forts, leurs points faibles. Il a compris que les Romains sont dépendants de leur logistique de ravitaillement, qu’il faut la leur supprimer et, pour cela, les harceler, les attaquer par surprise plutôt que de les affronter en des batailles rangées inutiles ! Être impitoyable quand on peut et s’abstenir quand la victoire est périlleuse, couper les vivres sans attaquer les légions ! C’est une guerre raisonnée qu’il nous propose, la seule capable de nous faire remporter la victoire ! Et puis rappelez-vous l’empire arverne d’autrefois, rappelez-vous les batailles magnifiques qu’il a livrées à l’envahisseur ; si le parti anti-romain que le fils de Keltillos dirige revient au pouvoir, cet empire va renaître de ses cendres et nous donner une chance unique d’expulser l’ennemi hors de nos frontières. N’ayez crainte si j’évoque devant vous un empire, une hégémonie ; les Arvernes ne seront jamais une menace pour les Carnutes. Bien au contraire, ils nous sont depuis longtemps un allié solide contre la confédération éduenne dont la puissance a pris de l’ampleur ces dernières années et qui a plié sous sa coupe nos voisins bituriges et boïens. C’est un 29
soulèvement général de la Gaule, un renversement des équilibres actuels qu’ils nous offrent ! Il dut néanmoins s’arrêter. En bas, un compagnon d’Égérax venait de bousculer le porteur de poignard romain en criant « il n’a pas levé sa lance, il n’a pas levé sa lance avec nous ! ». Même en haut du rocher, il aurait fallu être aveugle pour ne pas le remarquer. De nouveau plus personne d’ailleurs n’écouta ; sans s’en cacher, on s’était tourné vers l’individu pour percer à la fin le mystère de sa présence. Cotuatos en fut surpris : – Que signifie ce… Mais un fait extraordinaire l’arrêta dans sa question. Au moment précis où les regards venaient de passer du chef des conjurés à l’homme bousculé, un rapace nocturne, suivant la même trajectoire, traversa le ciel et s’abattit, dans un cri strident prolongé, sur l’individu au sol qu’il effleura avant de disparaître. Tout le monde vit ses serres crochues, son bec grand ouvert, ses yeux jaunes ; tout le monde en conçut un frisson, voulut y lire un signe divin, non l’effet du hasard. C’était comme si l’oiseau avait voulu pointer un danger avant de s’enfuir dans la nuit. C’en fut trop. Exobnos se haussa vers Cotuatos avant qu’il ne reprît ses esprits et, à son oreille penchée, lui murmura quelques mots pour l’informer de la situation. Aussitôt Cotuatos sauta du rocher, fondit sur celui qu’on venait de lui désigner. On crut retrouver dans sa marche l’allure du rapace. C’était l’occasion de prouver que les dieux étaient bien avec eux. Il fendit la foule, se planta devant l’homme qui venait de se relever et que l’on encerclait à présent de très près. Alors qu’il avait ramassé son bonnet et s’en recouvrait, Cotuatos le lui arracha violemment : – Qui es-tu, toi ? On me dit que tu es arrivé parmi les derniers ici, que nul n’est capable de te reconnaître comme un des siens et que mon frère Volomir n’a pas vérifié ton identité. L’homme n’eut pas même le temps de répondre. Volomir qui était tout proche et qui, à la mention de son nom, crut bon de rattraper son erreur lui découvrit brutalement les manches, le cou, en faisant sauter la fibule de son vêtement : – Il n’a pas de tatouage, il a dû s’infiltrer avec un groupe sans en faire partie. Alors Cotuatos demanda très haut, en tournant sur lui-même, pour s’adresser à tous en même temps : – Qui l’a amené avec lui ? Parlez ! Personne ne répondit. Il répéta, comme s’il se fût adressé à la forêt, à l’horizon, à la nuit noire : – Qui l’a amené ? Qui ? 30
C’était comme si l’individu était tombé du ciel ou sorti de la terre. Cotuatos s’approcha plus encore de lui, s’arrêta si près de sa face que leurs nez se touchèrent presque. Il le regarda droit dans les yeux, le défia de trouver une défense valable : – D’où viens-tu, loup puant ? Qui es-tu si personne ne peut répondre de toi ? C’est lui qui te dépêche parmi nous ? Avoue ! Il a des soupçons ? Il parlait de Taurillos dont il se méfiait des espions envoyés. Il le savait fourbe, capable de reprendre les techniques des Romains. L’autre se tétanisa, fut incapable de rien répliquer. – Et ça ? Qu’est-ce que c’est ? Il tira une courte lame d’un fourreau que l’individu tenait caché sous son manteau et la regarda à la lumière de la lune en faisant jouer le reflet du métal. L’autre ne résista pas ; il était bloqué, incapable d’opposer le moindre geste. – Un poignard romain ! Pourquoi ? Qui te l’a donné ? Qui voulais-tu frapper ce soir avec ça ? Paniqué, l’homme dut comprendre enfin qu’il devait parler, dire quelque chose, que rien ne serait pire que le mutisme. Il balbutia un semblant d’explication. – Je…je l’ai acheté… Mais comme les regards se durcissaient davantage et que personne ne voulut s’en satisfaire : – Plutôt je l’ai trouvé…je l’ai pris sur un cadavre quand j’ai voyagé du côté des Éburons dont tu as parlé…enfin, après un combat…je ne suis pas un détrousseur. Mes terres sont à Noviodunon ! Je suis Martialis, cousin de Brixianos, lui-même parent lointain d’Amorix le fort qui a péri avec notre roi Tasgétios. Demandez à qui vous voudrez, c’est la vérité ! Je le jure ! La buée qui sortait de sa bouche semblait un moyen nébuleux de couvrir ses mensonges. Il s’embrouilla, se perdit, fut incapable de fournir des détails cohérents. Il aggrava même sa situation en ajoutant une parole téméraire : – Tu portes bien une cuirasse romaine, toi ! Alors Cotuatos, contre qui il avait osé retourner l’accusation qui l’accablait, l’arrêta d’un geste de la main. On eût dit qu’il allait le frapper. Mais il voulut le braver à la place : – Vas-tu te taire, maudite vermine ! Brixianos ? Je n’ai pas connu à Amorix le fort un parent de ce nom. Quant à ce poignard, si tu n’as fait que le prendre sur une dépouille ennemie, alors il ne vaut plus rien pour toi parce que des cadavres romains, tu vas en ramasser à la pelle dans les prochains jours, leurs armes avec, et de plus belles encore. Mais tu as 31
raison : ma cuirasse à moi aussi est d’inspiration romaine. Qu’on me l’apporte ! Martialis, si c’était là son vrai nom, ne bougea pas, incapable de savoir s’il était tiré d’affaire ou si les ennuis ne faisaient que commencer pour lui. On apporta son armure à Cotuatos, avec son épée qu’il avait déposée ce soir-là pour être libre de ses mouvements pendant qu’il parlait. Il la considéra longuement devant tous, la caressa pour en tâter le prix du bout des doigts. En acier patiné de laiton, rehaussée de nombreux motifs en relief jusqu’aux boucles des attaches figurant des griffons, elle était plus un thorax d’apparat que de guerre – les Gaulois n’en portant d’ailleurs pas ordinairement au combat. – Quand les troupes de César sont arrivées pour la première fois chez nous, dit Cotuatos calmement, j’ai vu un Romain habillé d’une semblable cuirasse. J’ai fait fabriquer celle-ci sur le même modèle, à ma mesure, changeant simplement les dessins. Regarde attentivement. Nos dieux y sont représentés, comme les hommes du Sud aiment à le faire : ceux de la lumière et de la lune en haut et, en bas, ici Bélisama la Très Brillante qui forge les armes dans le feu, là Borvo qui guérit les blessures par l’eau. Au centre il y a aussi ce sanglier qui terrasse une louve et dont je n’ai pas besoin de t’expliquer le sens. Elle est très belle, cette cuirasse. Vraiment, je regrette qu’elle puisse apparaître comme un indice de compromission ou d’allégeance. Qu’ainsi périssent les souvenirs de Rome sous une épée gauloise ! D’un coup, sans même paraître réfléchir, il lâcha la cuirasse au sol, tira son épée du fourreau et l’abattit dessus. L’armure fit un bruit d’arbre craquant sous la foudre, se déchira en deux. Il y eut un silence glaçant, le temps fut suspendu. Plus personne ne sembla même respirer devant ce geste. Cotuatos resta un instant sans rien dire, jeta son épée, s’adressa à tous : – N’ayez crainte, je n’ai offensé personne ! Nos dieux ne sont pas enfermés dans des images et ils savent que je n’ai agi que pour vous prouver ma loyauté ! Puis il s’approcha de nouveau de Martialis qui suait à grosses gouttes et cherchait en tous sens une issue. – Martialis, cousin de Brixianos, parent fantoche d’Amorix le fort, cette cuirasse comptait beaucoup à mes yeux et je l’ai brisée sans un regret pour prouver qu’elle n’était rien si l’on devait m’en soupçonner d’être un traître. À toi de faire pareil ! Nous ne te connaissons pas, nous te soupçonnons toi aussi, alors brise ce poignard comme je viens de faire de ma cuirasse. Je te l’ordonne ! Tords sa lame, jette-le ici, devant nous ! Nous ne t’en demanderons pas plus pour t’accorder confiance ! 32
Mais l’autre hésita, alors qu’il aurait dû obéir sans attendre. – Eh bien ?, s’impatienta Cotuatos. Martialis ne bougea pas. Pour une raison que tout le monde ignorait, la dague lui était visiblement précieuse, plus précieuse que la vie ; il n’osa la sacrifier. Il n’en fallut pas plus pour le déclarer coupable selon tous. Déjà des mains s’apprêtaient à le saisir, à le rosser. Soudain, se sentant acculé, il eut un geste maladroit qui fut mal interprété. Voulant se dégager, retrouver un peu d’espace au milieu du cercle restreint que l’on faisait autour de lui, il avança la main brusquement et l’on crut qu’il essayait de frapper. Cotuatos aux bras d’yeuse, le premier, se méprit. Il le saisit à la gorge, le serra à faire éclater les veines de son cou, le relâcha en le repoussant violemment au sol. Derrière lui, la terre était détrempée ; il le projeta dans une flaque où sa masse tomba de tout son poids en de grandes éclaboussures ; il lui sauta dessus, lui maintint la tête sous l’eau. Le malheureux ne put rien faire. Ses membres se débattirent atrocement, on entendit le liquide boueux entrer dans son corps comme dans une gourde vide. Mais Cotuatos était plus lourd qu’une pierre chutée, plus dur qu’un père châtiant son fils fautif. Immergé jusqu’à la taille, les bras et les jambes enfoncés dans les remuements de la mort, agité parce que l’autre sous lui s’agitait de derniers soubresauts, il hurla : – Que périssent ainsi tous ceux qui s’opposeront à nous ! Ses spasmes seront notre ultime divination ! Les muscles du noyé se contractèrent encore de vains efforts pour se libérer. On les vit se tordre à droite, se lever à gauche, se tendre une dernière fois, retomber dans un grand souffle, et puis plus rien. Le corps resta inerte. Aucun ne s’en émut. Cotuatos alors se releva, regarda l’assemblée avec des yeux farouches et très calmes à la fois. Il ne grelottait même pas sous l’effet de l’eau glaciale. Il ramassa son épée, brusquement l’enfonça dans le flanc du noyé. Et comme on ne comprenait pas encore la portée de son geste, il cria : – Il s’appelait Martialis, nous a-t-il dit. Eh bien, sa mort sera le prélude de ce qui attend le Mars des Romains à qui nous allons déclarer la guerre ! Un devin aurait lorgné les convulsions de son corps. Moi, je m’en moque. Ce qui m’intéresse, c’est si vous me suivez ou non. Si oui, les dieux seront avec nous. Pour le savoir, pour savoir si je peux compter sur vous, si je peux sceller ce soir avec vous une alliance définitive, je vous demande à vous, les chefs de clans, de faire comme moi. Fondons notre unité dans le sang versé de cet homme car si l’un de nous perd la vie, nous devrons faire en sorte de perdre la nôtre pour le venger. Et il ressortit sa lame brune et fumante des entrailles percées du mort. Martialis, cet homme que personne ne connaissait ni n’avait voulu 33
défendre, dont la mort résultait de suspicions et non de preuves, Martialis, peut-être cafard mais peut-être innocent, devint à cet instant un immolé à la guerre, un sacrifice commun à Teutatès pour les massacres à venir. Tous s’exécutèrent, sans répugnance, à la suite, tirant leur lame de leur fourreau à tête de dragon, de chien ou de tarasque ; certains prononcèrent des paroles impitoyables en frappant telle ou telle partie, d’autres donnèrent même des deux et trois coups, se couvrirent les joues du sang qu’ils firent couler. Le cadavre fut pénétré de toutes parts, troué, abîmé, rendu méconnaissable, laissant dans l’air comme un bruit de fruit éclaté. Il ne fut bientôt plus qu’un morceau de boucherie au milieu d’une flaque si rubescente de sang que la lune parut, dans son reflet, en rougir. Égérax ferma le défilé des chefs ; de sa hache, il trancha finement les phalanges des deux mains qu’il jeta à la volée pour les Furies de Rome, dit-il. Conconnétodumnos eut un rire de chienne qui dévore les chairs. Fort du symbole, Cotuatos clôtura la séance en renouvelant une dernière fois ses conseils et ses ordres. Tout le monde se sépara, laissant la dépouille à l’abandon et retrouvant peu à peu le silence. On repartit d’abord ensemble dans le tunnel creusé à travers la colline, puis on se dirigea en des directions différentes par affiliations de clans et de brenns. Au milieu des champs enfin, tandis que les bois et l’assemblée étaient déjà loin derrière eux, les groupes se dispersèrent tout à fait sans plus même discuter de ce qu’ils avaient à faire les jours suivants ou des appréhensions qu’ils pouvaient en concevoir. Ils furent souvent cinq, puis quatre, puis trois, puis d’un coup un à disparaître dans la nuit, la capuche des manteaux de nouveau sur la tête. La nuit, précisément, n’avait plus cette belle clarté que le crépuscule avait eue à leur arrivée. Était-ce l’effet de nuages ? Ou celui du contraste avec les feux qui les avaient éclairés pendant des heures et qui une fois éteints les laissaient privés de lumière ? C’était en tout cas comme si le dessein des hommes avait assombri l’obscurité au point de la rendre ténébreuse. Tout était changé maintenant. Au sol, les lueurs astrales semblaient avoir pris une teinte cendrée qu’elles n’avaient pas auparavant. Les cailloux du chemin, les brins d’herbe gelés qu’écrasaient les pas fatigués de ceux qui n’avaient pas dormi faisaient des couinements d’agonie. Les branches des arbres étaient des doigts d’assassins. Dans le ciel, la lune et les astres se percevaient encore ; mais la première, émaciée et grisâtre, dessinait un visage cadavérique tandis que les seconds piquaient l’espace comme un manteau sous lequel des yeux d’espions auraient observé en secret ce qui se tramait sur la terre. 34
Le jour se levait, un jour douteux où l’on ne pouvait plus distinguer les amis des ennemis, quand un homme, qui était présent à l’assemblée des conjurés, sortit d’un bosquet et retrouva la route de Génabum. Il n’était qu’à une lieue de l’oppidum, il le gagna rapidement. Les quatre portes en étaient fermées comme de coutume si bien qu’il n’aurait pu normalement y pénétrer. Pourtant, il y parvint contre toute attente, parce qu’il connaissait, du côté est où la défense n’était qu’une simple palissade, une infime brèche entre deux maisons qui n’étaient pas gardées. Il parvint à s’y faufiler en toute quiétude. Il rôda dans la ville, n’emprunta que les ruelles, les intervalles étroits entre les huttes, se cacha derrière des tas de foin, des charrettes stationnées, des tentures d’échoppes non rentrées. Tout était désert mais l’aube approchante ferait bientôt se lever les premiers travailleurs. Lentement, d’une discrétion absolue, il se coula ainsi jusqu’au port où les légionnaires de faction le laissèrent venir sans lui poser de question et s’introduire chez leur centurion comme s’ils ne l’avaient pas même vu passer. Les bêtes en cage, des sangliers et des brocards destinés à être envoyés pour les carnages de quelque arène de l’empire, ne se levèrent sur son passage. Manius Sévius Latro, lui, ne dormait pas et l’attendait. Il l’accueillit avec empressement, en le dévisageant dans un sourire peu rassuré. Il avait une coupe à la main pour se donner l’allure d’un homme tranquille mais il ne buvait pas, trop soucieux de savoir ce qui allait lui être révélé. L’homme qui se présenta devant lui portait une moustache énorme et des cheveux hirsutes sous son bonnet. Il était vêtu d’une tunique quelconque et d’amples braies serrées aux chevilles comme des sacs. Ainsi que Martialis, rien ne le différenciait des autres conjurés présents dans l’assemblée cette nuit. – Alors Éponax ?, demanda le Romain. Ou devrais-je dire Chéréas… L’homme arracha sa moustache et sa chevelure. Elles étaient postiches. Il y avait bien eu un traître ce soir-là, mais ce n’était pas celui que tous avaient cru démasquer. C’était en effet Chéréas, l’espion grec au visage polymorphe auquel avait déjà eu affaire Asinus, qui se cachait sous un déguisement de Gaulois. Il fallait croire que l’ardent pompéien qu’il était agissait cette fois-ci en faveur d’un homme de César, Latro, que ce fût dans le souci de servir son champion ou ses propres intérêts. Car à l’heure où Pompée levait des troupes en Italie, favoriser une insurrection de la Gaule, c’était obliger César à combattre sur deux fronts ; avertir au dernier moment un centurion sans honneur ni soldats, c’était créer la panique dans les rangs du proconsul ; se faire passer pour un informateur zélé, c’était s’assurer d’une bonne rémunération. 35
Chéréas avança pour parler à voix basse. Comme les bêtes à l’extérieur, le chacal du centurion, pourtant plus fin, ne s’était pas dérangé à son entrée ; il n’avait presque pas senti sa présence, si commune qu’il en émanait l’odeur de tout le monde et de personne à la fois. Lorsque l’espion fit quelques pas, l’animal fixait les flammes de la pièce qui lui colorait en retour les yeux d’une teinte rougeoyante. Il ne bougea encore pas. Le centurion compléta sa phrase. Quelque chose toujours tremblait dans sa voix : – Que projettent-ils ? Mais Chéréas ne répondit rien. Latro comprit, lui lança une bourse d’argent pleine que l’autre reçut et prit soin d’entrouvrir pour vérifier. Le compte y était. – Alors que projettent-ils ? – Le massacre. – J’avais raison ! – Tu avais raison. Dans deux jours. Il vous faut fuir ou vous apprêter à vous battre. Mais pour la gloire, car vous n’avez aucune chance. Le regard fixe, le corps raide, Latro brusquement lâcha sa coupe dont le vin se répandit au sol et dessina une grosse tache de sang. Pour la première fois depuis longtemps, un sentiment de peur venait de l’envahir.
36
II L’AMOUREUX
Le lendemain matin, quand Asinus sortit de la copona, il savait qu’il avait beaucoup à faire et que l’ensemble de ses activités l’occuperait au moins la matinée. Il eut un instant de découragement. L’âge ne lui permettait plus d’être aussi actif, même lorsqu’il connaissait le succès. Puis il faisait froid dehors, l’aube à peine naissante n’avait pas encore réchauffé l’air. Ses rhumatismes en étaient ravivés et, quoiqu’il fût abrité sous l’auvent où pendait l’enseigne délavée de la maison, il sentait une désagréable brise glaçante lui mordiller les lobes et lui picoter les narines. Il fallait pourtant y aller. Les rues commençaient à s’éveiller lentement de visages hâves fatigués. Le commerce n’attendait pas. La porte était entrouverte. Quelqu’un hurla derrière lui de la fermer. Il jeta un dernier regard à l’intérieur, dans cette grande salle commune où il avait passé tout l’hiver, n’en sortant que lorsque c’était nécessaire dans la ville recouverte de ses haillons de neige sale. Quatre mois déjà ! Quatre mois passés à dormir dans le pucier de sa chambre, à s’enrhumer de courants d’air ! Il songea à regret aux matelas et traversins de Rome dont la bourre était faite du duvet des cygnes, en demeura rêveur un court instant. Le jeu en valait-il seulement la chandelle ? À cette heure-ci, la copona tournait déjà à plein régime et les soûlards buvaient du vin comme si l’on fût à midi ou le soir. C’était ça le plus étrange, pensa-t-il, avec ce genre d’établissements ; le temps ne semblait pas avoir prise sur eux et, dès le lever, les piliers de comptoir, comme des esclaves surveillant une machine, les faisaient fonctionner, au sacrifice de leur sobriété, en commandant à boire, à manger, à baiser sans limite. À vrai dire il n’y avait même plus de lever, ni de coucher ; là résidait le génie d’Éroticus qui entretenait une confusion perpétuelle entre le jour et la nuit. Sa copona, à la fois auberge, lupanar, poste relais, ne désemplissait pratiquement jamais et l’on se demandait quand le tenancier allait se reposer. Plutôt, pour obéir aux autorités de la ville, le tripot fermait au crépuscule, mais à l’intérieur, comme chez un particulier, l’orgie ne faisait que continuer, les clients se contentant d’être plus silencieux et de sortir
moins souvent uriner. C’était une stratégie voulue, non l’effet d’ivrognes qui refusaient de partir, mais qu’on retenait au contraire ; depuis des mois qu’il y logeait, Asinus l’avait bien compris, se demandant simplement si Éroticus montrerait la même activité infatigable quand il serait arrivé à son âge. Esca, vina, Venus corrumpunt sed vitam faciunt ! Les mets, les vins, les filles détruisent mais font la vie ! Il regretta son siège attitré, les mauvais crus du Vatican ou de Marseille, les paris qui reprenaient. Il adressa un cillement à Scythès qui se tenait toujours dans son dos : comme à l’ordinaire, les traits de son esclave n’exprimaient rien, demeuraient inchangés. Il en souffla d’abattement, s’en alla, claudiquant sous sa bosse, les pieds enfoncés dans la boue, rendre visite au vergobret Taurillos sur la Butte-aux-rats. Loin de la cheminée à l’odeur de graisse ruisselante, les tracas recommençaient. Il ressemblait à un vieil ours sorti de sa caverne avant l’arrivée du printemps. Les rues de Génabum n’avaient pas changé depuis son arrivée, à ceci près que le gravier qui couvrait la chaussée se mêlait à la terre roulée par les pluies et les fontes pour créer une sorte de gadoue glissante mélangée de cailloux. Il avait tellement gelé cet hiver-là qu’on avait vu les tonneaux éclater et le vin rester debout comme une masse de glace. Le redoux en avait été d’autant plus laborieux. Des traînées de neige persistaient çà et là. Les fossés qui bordaient les axes principaux étaient inondés et les trottoirs de bois qui les longeaient avaient visiblement souffert des intempéries. Pour le reste, c’était le même dédale de voies étroites, pratiquement couvertes du jour par la retombée des toits si bas que les murs des habitations en étaient dissimulés. À part quelques allées plus larges, c’étaient à peine des rues, plutôt l’espacement laissé libre entre les maisons, empêtré de mendiants affamés. On y retrouvait toujours les mêmes échoppes, les mêmes ateliers aux portes grandes ouvertes malgré le froid, tant il faisait sombre en leur intérieur sans fenêtres. Sous les auvents de planches ou de simples tissus étendus, les vendeuses d’étoffes, les vanneurs, les tisserands, les orfèvres rassemblaient, tous, leurs commerces démontés pour la nuit, tandis que porcs et volatiles de basse-cour, nettoyant les ordures ou picorant les façades, réapparaissaient au milieu des chiens errants qui n’avaient pas dormi. Asinus en fit se sauver plusieurs en leur distribuant des coups de pied et les faisant couiner par plaisir. Il était pressé. Des Gaulois qui, passant là, le virent faire l’observèrent alors fixement en ayant l’air de méditer quelque chose de funeste. Il remarqua leur regard noir. C’était le même depuis des semaines ; il avait changé peu à peu, reflétait non plus l’indifférence ou la curiosité manifestées pour lui à l’automne mais une forme d’inimitié sourde. Peuh ! Il l’attribua dans 38
l’immédiat à son geste violent envers les cabots des rues ; puis, sans s’arrêter, il y vit plus largement une conséquence de sa réussite croissante dans la ville car il pensait n’avoir rien à craindre. Il s’était fait une raison. Ça n’avait finalement jamais cessé, certains avaient toujours nourri de la méfiance à son égard et maintenant de la jalousie envers lui, l’homme des ravitaillements impossibles car, même chez les Carnutes, les hivers étaient rigoureux et les réserves bien maigres. Il se souvenait encore de l’altercation qui avait failli éclater le premier jour à la porte gardée par Volomir. Mais ça ne l’avait pas empêché d’en trouver d’autres, de ces Gaulois, très amènes, bien disposés, et des nombreux ! En somme, pour peu qu’ils eussent un peu de jugeote et qu’ils comprissent où était leur intérêt, les gens de ce pays pouvaient être hospitaliers, en temps de paix qu’ils connaissaient depuis plus d’un an maintenant. Ses affaires étaient bonnes. Le plan qu’il avait mis en œuvre en dénonçant faussement Sagéra quatre mois auparavant avait fonctionné audelà de ses espérances et il se demandait encore, avec le recul, comment un stratagème si grossier, une folie à bien y réfléchir avait pu réussir à ce point. Grâce à lui, Taurillos aux bœufs gras avait renforcé son alliance avec les Romains en prouvant son efficacité à lutter contre les troubles du pays. Même si l’attaque de la ferme d’Anéroeste et l’exécution du Biturige avaient failli tourner à la catastrophe, tout avait été finalement maîtrisé et plus que jamais les autorités carnutes semblaient unies aux légions pour maintenir l’ordre. Le magistrat gaulois lui en avait su gré en l’acceptant dans le cercle de ses intimes. Il avait en fait besoin de cet étranger non pas pour écouler des marchandises mais se fournir en produits de luxe dont il était si friand. Le débrouillard Asinus en était précisément capable, même en cette saison, y ajoutant le tour de force de le faire sans bouger de la taverne où il traitait directement avec ses interlocuteurs, entre deux vins, entre deux filles, comme s’il fût dans un marché couvert ou au comptoir d’un grand port. Il lui avait ainsi dégoté, sans avoir l’air d’obtenir l’impossible, des bols d’étain, un éventail étrusque éburné, des flacons en verre d’Afrique, un brûle-parfum prétendu d’Inde et, pour une fête religieuse à laquelle il n’avait rien compris, il lui avait même fait porter une klinè grecque marquetée d’ambre aux appliques en forme de phalanges en ivoire et en os. Il en avait été grassement récompensé et on le vit par la suite parader dans les rues où il avait troqué le vêtement et les chaussures de son arrivée pour des bottes fourrées confortables et un gros manteau brodé de fils d’argent qui disaient sa nouvelle opulence. Tout le monde le reconnaissait dans cette cité de misère, en était venu à lui montrer du 39
respect – ce qui n’était pas incompatible avec l’animosité muette également ressentie. Aussi, quand il arriva devant la demeure de Taurillos, quoiqu’il fût crotté de boue et d’humeur maussade, on l’introduisit avec honneur. Dès l’extérieur, la maison avait changé elle aussi : il s’en fallait de beaucoup maintenant qu’Asinus reculât d’effroi. À force d’envier celle de Cita construite toute proche, le vergobret avait voulu que la sienne lui ressemblât et avait enjoint aux artisans romains qui avaient édifié les entrepôts d’œuvrer pour lui. Les têtes fichées sur des piques et alignées audevant avaient été enlevées, remplacées par une allée solennelle agrémentée de vigne qui pousserait au printemps. La hutte gauloise de manière générale tendait à disparaître sous une maçonnerie nouvelle qui la surchargeait, la dénaturait sans lui conférer pour autant l’allure d’une domus romaine. Les murs étaient restés de torchis et de bois, le toit était toujours en un matériau périssable, mais aux marches de marbre s’étaient ajoutés deux colonnes de granit récupérées on ne savait où ainsi qu’un fronton gravé d’une vilaine couronne de laurier. Il en résultait un ensemble bâtard d’assez mauvais goût. Puis, une fois qu’on fut entré, le logis apparaissait toujours plus spacieux qu’il n’en avait l’air de dehors. Dans la partie demi-obscure où le vergobret recevait, devant les cloisons d’osier, le sol était couvert de dalles de pierre tandis qu’on devinait encore, dans l’arrière-fond, un autre en terre brute. Surtout, sous une petite peinture ratée qu’on avait dissimulée, un amoncellement d’objets hétéroclites, clinquants, étourdissait le visiteur : la vaisselle grossière, les tables basses et bancales, les peaux de bêtes sur lesquelles les seigneurs mangeaient lors de la première venue d’Asinus avaient laissé place à des trépieds de Grande-Grèce, un candélabre d’Orient, des céramiques campaniennes, des couverts en argent qui jonchaient pêle-mêle l’espace. Quelques mois avaient suffi ; le changement avait été rapide. Même si certains de ces objets valaient moins que ceux qu’il avait possédés auparavant, Taurillos leur donnait plus de valeur car ils venaient du vaste monde, parfois de très loin, et étaient inconnus de l’immense majorité de sa population dont il voulait se démarquer. Un petit phallus de terre cuite notamment trônait en haut de son siège. Sa nature grivoise l’amusait beaucoup depuis qu’on lui avait expliqué que, porté en amulette ou accroché au harnais des chevaux, il servait dans le monde méditerranéen à écarter le mauvais œil. Il ne manquait pas de le prendre et le frotter pour se porter bonheur. Contrairement à Crasovir resté fidèle aux mœurs des ancêtres, Taurillos représentait ainsi cette frange de l’aristocratie gauloise émerveillée par l’art de vivre romain, y compris dans ses aspects les plus risibles. Les commerçants italiens, 40
pénétrant sur ces terres, avaient porté jusqu’ici leurs articles de luxe, faisant une cible de choix de la noblesse puisqu’il fallait être riche pour se les offrir. Les seigneurs ouverts au négoce devinrent des interlocuteurs privilégiés qui, en une génération, allaient s’imprégner peu à peu des conceptions et des modes de l’étranger si bien qu’ils se seraient crus déconsidérés aux yeux de leurs hôtes s’ils n’avaient offert lors de leurs fréquents banquets au moins l’un de ces produits. Asinus ne cessait de le penser, Cotuatos de le reprocher amèrement : la conquête romaine avait été entamée depuis longtemps, non pas sur un terrain militaire, mais économique et culturel plus redoutable. Le vergobret accueillit en personne son détaillant préféré, renvoya immédiatement les gens de sa suite. Il n’y avait pas que sa demeure qui eût changé. L’homme aussi n’était plus le même qu’à leur première rencontre et sa métamorphose était un argument de poids pour ses adversaires qui le taxaient de compromission avec les Romains. C’était comme s’il dénigrait de plus en plus ses origines, voulait qu’on le prît pour un des vainqueurs de cette guerre qu’il croyait terminée. Car s’il était toujours vêtu de ses habits de chef celte, il portait dorénavant une barbe et des cheveux ras à la romaine, des breloques grecques autour du cou, et il avait adopté les postures des soldats de Rome, les manies des voleurs d’Athènes, ce qui lui conférait une curieuse tournure contrastée. L’heure n’était plus aux torques lourds, ni aux longues tresses rousses qu’il avait coupées sans regret au milieu de l’hiver ; il aurait maintenant presque aimé souffrir de calvitie pour ressembler à César qu’il n’avait jamais vu que casqué. Il avait en outre redoublé son embonpoint à se bâfrer de mets rares, à circuler sur une litière de fortune en l’absence de la voiture dont il rêvait. Sa carrure était devenue celle d’un minotaure obèse et pataud ; ses yeux chafouins ne se voyaient presque plus, coincés entre ses paupières flasques et ses joues débordantes. On eût dit un silène ventripotent perpétuellement ivre. Comme chaque fois qu’il l’entendait parler, Asinus constata en revanche qu’il avait encore amélioré son latin si bien qu’il se passait désormais aisément d’un interprète, voulant d’ailleurs traiter seul à seul avec son fournisseur en articles de faste : – Asinus, voilà ! J’attendais toi depuis hier. Qu’apportes-tu à moi, l’ami ? Quel trésor fabuleux tu vas encore ingénier à vendre à moi ? Qu’il semblait loin, le temps où il l’avait reçu en lui crachant à moitié à la face et en lui tendant son petit-fils nu et braillant pour lui montrer ce qu’était un vrai mâle ! À présent, le moutard Ésugénos était toujours là – l’homme voulait avoir tout son lignage sous son toit – mais il avait grandi et fermait son clapet de poupon en regardant ceux qui se succédaient chez son aïeul. 41
– Eh bien ?, insista Taurillos, manifestement pressé de savoir ce qu’il pourrait acquérir aujourd’hui. Asinus se tourna vers Scythès demeuré à l’entrée de la maison avec les gardes. Il lui enjoignit de franchir le seuil. L’esclave portait deux sacs autour de sa poitrine : un premier à gauche où étaient toujours placés les volumina dont il ne se séparait jamais, un deuxième à droite, plus serré, où il tenait autre chose. Comme la porte était large ouverte, il avait suivi le début de la discussion et, sans même attendre une parole de son maître, il tira de ce deuxième sac un paquet entouré d’un linge soyeux qu’il tendit. Les yeux du Gaulois étaient grands écarquillés. – Seigneur, voici…, fit Asinus. Il savait ménager son attente. En même temps qu’il prononça ces deux seuls mots, il ferma d’abord la porte de la hutte. Puis il déroula avec précaution le tissu, eut encore une ou deux paroles pour faire languir Taurillos, lui présenta enfin comme sur un écrin un coffret doré à la feuille et ciselé, pas plus grand qu’un avant-bras de nourrisson et très léger, très fin, très beau. L’objet ne pouvait contenir que des bijoux délicats de femme ; il serait inutile au vergobret qui en fut pourtant béat d’admiration. – Il vient de Taprobane, ajouta Asinus pour en rehausser le prix. – Tapro…quoi ? – Taprobane, une île au-delà de l’Inde qui jouxte le pays des Sères. Une île de sept mille stades sur cinq mille. Une île aux cinq cents villes, plus riche en perles et en or que toute l’eau du Pactole en charrie. Le marbre ressemble là-bas à des écailles de tortue ; les fruits y sont si abondants qu’il n’y a qu’à se pencher pour les cueillir ; les fêtes si fréquentes qu’on ne les compte plus au milieu des parties de chasse dont les plus belles sont celles aux tigres et aux éléphants. Une vie de cent ans y est ordinaire. Le coffret ne venait pas du tout de Taprobane, mais de Gadès en Hispanie. Asinus l’avait acheté à un soûlard de Tarraco. On ne pouvait pas tout importer dans ce lieu de malheur ! L’important dans le commerce était toutefois que le client le crût. Le contentement n’est souvent qu’affaire d’illusion et, dans la pénombre de la hutte, l’objet brillant semblait venu d’un autre monde, plus lointain que l’Océan qui entourait l’univers. Taurillos n’avait aucune idée de ce qu’était Taprobane ni même de ce qu’étaient un tigre, un éléphant, une tortue ; mais il lui suffisait d’imaginer un pays mystérieux pavé d’or et de pierres brillantes pour qu’il fût transporté. Il devint fou, comme un enfant surexcité, s’assit en se frottant les paumes, invita Asinus à faire de même. Il faisait tiède dans la maison, un grand feu craquait en son centre. Le commerçant avança instinctivement les mains pour réchauffer ses doigts ankylosés par le froid. – Combien…combien tu en demandes ? 42
– Quatre mille sesterces. L’autre réfléchit un instant, mais un instant si rapide qu’on put se demander s’il réfléchit vraiment ou savourait déjà ce prix qui donnait toute sa valeur à l’objet. – Je t’en donne cinq cents deniers. – Sept cents et tu emportes l’affaire. – D’accord, sept cents !, pouffa le dupé dans un rire adipeux. Le coffret en valait deux fois moins, mais Taurillos ne pouvait marchander bien longtemps tant l’envie de posséder et de jouir était forte. Déjà quelques jours plus tôt Asinus lui avait fait croire qu’une vulgaire statuette du dieu Mars était sa représentation et il l’en avait rétribué d’une petite fortune. Il se leva aussitôt, alla ouvrir un bahut sombre où il celait des monnaies romaines en quantité. Il y puisa à pleines mains pour remplir une bourse qu’il donna à Asinus qui la donna à Scythès qui était le meilleur des coffresforts. Il n’y avait pas besoin de vérifier ; le compte y était, et même plus. Si tant est qu’ils aient un jour été sincères, les anciens scrupules de voler les autres s’étaient dissipés chez l’escroc. Il s’en consolait en se disant qu’il vendait du rêve à ses clients. Ceci négocié, le chef lui offrit à boire et à manger, qu’il accepta davantage pour ne pas le vexer que par soif véritable. Si tôt le matin, l’hydromel qu’il se vit proposer dans une corne de grande taille lui donna envie de vomir tandis que le morceau de viande froide qu’il dut déchirer de sa bouche lui fit affreusement mal aux dents. – Les chicots de toi sont fragiles et très laids, dit le Gaulois. Tu ferais mieux toi laisser pisser dans la bouche par Celtibère. Asinus fut surpris de la remarque. Il ne sut s’il devait en rire ou s’en indigner parce qu’il ignorait que les peuples d’Ibérie avaient effectivement coutume de se frotter les gencives de leur urine – ce que Taurillos avait reformulé avec la grossièreté qui le caractérisait. Il fut un instant tenté de lui demander si c’était ce qu’il avait fait pour avoir les siennes aussi blanches – et il est vrai qu’elles l’étaient réellement –, mais il eut la sagesse de retenir ses paroles pour une fois. Il l’interrogea avec négligence sur un autre sujet, banal, afin de ne plus penser à la douleur et mieux se détourner de la tentation de répondre sarcastiquement à ce qu’il pensait être une moquerie insolente : – En parlant de bouche, la fille que tu avais amenée prisonnière, où estelle ? J’ai souvenir d’un beau minois. – Je l’ai plus, répondit grossièrement Taurillos en ricanant : elle suçait mal, branlait comme une vache. J’ai donné elle à Latro, comme otage, en guise hommage mien à César. Symbole de l’ordre établi. 43
Ils eurent un ricanement simultané. Il était logique qu’ils finissent par s’entendre tous deux : ils avaient le même naturel vulgaire. – Eh, eh ! J’y vais tout à l’heure justement, voir Latro. Je la verrai bien. – Alors évite te faire sucer par elle ; elle capable de mordre. – Ne t’inquiète pas pour moi ; pour ce type de plaisir, je connais qui il faut chez l’Allobroge. – Ah, oui ! La petite traînée… – La petite, oui. Il songeait à Génabia à laquelle il ne pouvait plus résister, n’avait pas réagi au qualificatif de putain puisqu’elle l’était en effet. Mais sa pensée fut brusquement dissipée quand Taurillos, insatiable de luxe, émit une nouvelle demande : – Je veux questionner toi un autre service. Je sais que les Romains, vous avez des instruments pour dire moment de la journée grâce à l’eau ou par soleil. Comment le nom ? Ah, enfants de chiennes ! Qu’est-ce que vous pas inventer pour faire crever moi jalousie ? J’aimerais en avoir. L’idée se justifiait. La mesure exacte du temps était des plus pratiques et résumait à elle seule ce que la civilisation romaine pouvait apporter aux peuples qu’elle soumettait. Mais il ne fallait se méprendre. Ces objets, Taurillos n’en voulait pas pour améliorer sa gouvernance ou la vie de l’oppidum ; il les désirait ardemment pour cette seule raison qu’ils étaient inconnus à Génabum et qu’il serait le premier à se pavaner en les présentant comme la preuve manifeste de sa richesse et de sa distinction. Asinus était habitué à ces demandes. Il ne venait ici qu’en ce but. Ce petit commerce, ces petites magouilles qui n’avaient l’air de rien lui rapportaient en fait autant, sinon plus que son grand négoce avec la légion. Tandis qu’il fournissait en gros celle-ci, il vendait au détail à celui-là et les bénéfices n’en étaient pas moindres. Il ne s’engageait cela dit que sur un seul produit à la fois parce qu’il craignait toujours des difficultés à le trouver et parce qu’il savait que, s’il n’apportait pas ce qu’on lui demandait, c’était le meilleur moyen pour que Taurillos se rendît compte qu’il gonflait volontairement ses coûts. Il enregistra la commande : – Un cadran solaire ou une clepsydre… Il faut me laisser un peu de temps, mais tu l’auras si tu sais y mettre le prix. – Tu peux être sûr de ça. – Alors à bientôt. Et il prit congé sans que l’autre se donnât la peine de le raccompagner au-dehors. De nouveau il reçut la brise froide qui soufflait, mais avec plaisir cette fois. Les maisons gauloises, même parées d’objets grecs et italiens, sentaient toujours le bouc et la crasse et il eut le sentiment d’en être purifié. Son modeste succès lui avait donné l’entrain qu’il n’avait pas 44
en arrivant : il s’en était redressé, lui qui marchait toujours le dos rond comme s’il fût écrasé sous le ciel de Gaule, et il s’en alla, guilleret, à travers les rues. Il faut dire que le chemin était en pente et le mamelon de la Butteaux-rats lui semblait le sein lourd, gorgé de lait, de Génabum la très riche. Après cette visite, il devait se rendre aux entrepôts. Mais il progressa avec plus de difficulté ; tout le monde était sorti maintenant – les Gaulois vivant peu dans leurs maisons – et avait envahi, avec monture et charrette, chaque lacis de ruelle pour vaquer à ses occupations. Scythès dut jouer des coudes, frayer un passage. Les abords du fleuve étaient particulièrement bondés, c’était là que l’économie de la cité prospérait. Le jour peinait à s’éclaircir. Dans la lumière triste des rayons obliques du soleil, Asinus suivit des tanneurs, des pelletiers, des cordiers, des calfats, des menuisiers, des ébénistes qui, tous, descendaient dans la boue travailler sur le port. Et dans la foule, on commençait à parler d’autres langues. L’endroit n’appartenait plus tout à fait à la cité, Génabum étant une des rares villes de Gaule qui, sans être cosmopolite, attirait des représentants de tous peuples. Quand il déboucha enfin sur la Loire, des brumes masquaient le fleuve dont le lit s’obstruait encore de grosses glaces flottantes. En les regardant, il faillit rentrer dans le dos d’un badaud immobile. Une vente d’esclaves s’improvisait devant lui, qui faisait s’arrêter les premiers portefaix déjà fatigués de charger les bateaux. Une maigre dizaine de Germains, à peine vêtus malgré le froid, était présentée aux mariniers et débardeurs, et les Gaulois n’étaient pas insensibles à la servitude de ces ennemis héréditaires. Mais ils ne valaient pas un as, ces fils de Teutons, il en eut la certitude rien qu’en les voyant et il se dit qu’il n’était pas le seul à rouler son monde. L’homme qu’il avait bousculé lui tapota amicalement le dos. Il le traita de haut, poursuivit sa route, le pas léger. Non loin, le deuxième grenier romain était enfin achevé. Les blocs de marbre, les briques et les sacs de chaux n’entravaient plus son accès. Plus réduit que le premier auquel il était accolé, il lui ressemblait néanmoins en tous points avec sa colonnade et ses escaliers identiques à l’entrée, puis sa succession de magasins rudimentaires derrière. Il en comptait dix, ce qui était suffisant. Les échafaudages, les engins de levage, les trous de boulins avaient disparu juste avant la tombée des premières neiges ; on n’entendait plus les artisans manier leurs outils et œuvrer en sifflant au milieu des barbares. L’entrepôt, à peine terminé, était d’abord resté vide d’activité car les premiers temps de sa mise à disposition avaient coïncidé avec le plein hiver. Quoique l’autre bâtiment débordât de denrées et connût l’affluence, on n’avait pas voulu entreprendre un quelconque déménagement à la 45
mauvaise saison. Aussi les marchands ne s’étaient pas bousculés dans les nouveaux locaux ; aucune corporation n’avait encore loué d’emplacement et les esclaves affectés à son endroit n’avaient guère peiné en ne le remplissant que de billons de bois, de lainages et de peaux. Au printemps, à l’été suivant, on le garnirait, on le ferait vivre de l’activité intense qu’il méritait. Asinus avait bien remarqué ces lenteurs et en avait tiré profit. Parce qu’il avait permis à Latro de réaffirmer la puissance brutale de Rome en matant un complot imaginaire et une révolte populaire naissante, parce qu’il lui avait surtout permis de piller une ferme en toute impunité et sous couvert de légitimité, le centurion romain avait enfin cédé et lui avait délégué le ravitaillement de ses légionnaires. Aux alentours de samonios, ç’avait été sa première victoire. Certes ce n’était pas encore l’approvisionnement d’une légion entière, mais, par l’épi de Cérès !, c’était un point de départ dont il fallait se satisfaire puisqu’il lui permettait d’établir de premiers contacts solides avec des producteurs et renvoyer définitivement Cillimax et son panais qu’il traînait comme une plaie ouverte et honteuse. Il n’avait pas rompu clairement son association avec ce dernier, se contentant de le fuir, de ne pas répondre à ses demandes, désormais tout à son commerce nouveau et pensant qu’il se lasserait. Ses premiers résultats étaient d’ailleurs encourageants. Auprès de fermiers de la région, il avait su s’approvisionner en un grain de qualité, conservé dans des silos secs et propre à faire des crêpes, des galettes et du pain en plus de la mixture infâme qui valait aux légionnaires le surnom de pultiphagonides – mangeurs de bouillie. Puis il avait compris que s’il voulait gagner la légion, il devait conquérir le cœur de la troupe. Il s’était mis en quatre pour devancer ses désirs, flatter ses faiblesses. Grâce à un réseau de connaissances qu’il commençait à étoffer sérieusement, il avait découvert du bon lard – celui qui chante comme fillette quand il frit –, du fromage, de la biche, du sanglier, des poires juteuses et du vin buvable âprement négocié auprès d’Éroticus. Mais sa prouesse fracassante avait eu lieu au plus fort de l’hiver quand il avait apporté aux légionnaires des poireaux à l’huile, des choux sabins réputés les plus savoureux et du cresson qu’il présenta comme venant d’Arabie. C’étaient, dit-il, ses étrennes pour les hommes de mérite. Nul ne sut comment il les avait dénichés ; seul Scythès savait, parce qu’il le suivait partout comme son ombre, qu’il avait eu le bonheur d’entendre parler d’un convoi à destination des légions cantonnées chez les Lingons où de puissants personnages avaient un ventre délicat et glouton. Avec sa gouaille et moyennant beaucoup d’argent, il avait réussi à en détourner une très petite part. 46
Les effectifs de Latro à Génabum n’étaient précisément pas nombreux et la tâche d’Asinus en était facilitée. Les repas des unités ne furent plus les mêmes. D’abord méfiants, puis agréablement surpris, les soldats en vinrent à attendre chacune de ses venues avec empressement, le remerciant toujours chaleureusement de ce qu’il parvenait à leur trouver. Ils finirent par lui rendre de menus services en retour, dont le plus utile fut de lui ouvrir les portes des entrepôts s’il en avait besoin. Car la légion, si elle ne les dirigeait pas, devait assurer la défense des deux horrea et disposait, comme Cita, des clefs et du droit d’entrée sur les lieux. Alors, lorsqu’Asinus demanda à bénéficier de trois des salles du nouvel entrepôt et que l’intendant s’y opposa, Latro affirma qu’il en allait de l’intérêt de ses hommes et imposa qu’on les lui allouât. Asinus obtint celles situées les plus au fond, contre un loyer dérisoire, et l’on poussa la complaisance à y percer une porte sur l’extérieur pour qu’il n’eût pas à traverser tout le bâtiment afin d’y accéder. À la fin de novembre, il y installa un petit bureau à lui, prit d’autant plus possession de l’endroit que celui-ci était encore pratiquement vide et se remémora avec plaisir le temps où on lui avait refusé l’entrée du premier entrepôt, où il quémandait à la porte qu’on lui accordât écoute et qu’on lui fît visiter le lieu de ses ambitions ! Une fois qu’il en fût maître, il en confia la clef à son esclave parce qu’il refusait de porter la moindre charge matérielle et gratifiait son homme de main d’une confiance aveugle en toutes choses. La clef disparut dans un des deux sacs que portait en permanence le Scythe. Ses rapports avec l’intendant de César ne cessèrent durant cette période de se dégrader. Les deux hommes ne s’entendaient pas, ne pouvaient pas s’entendre – c’était le moins qu’on pût dire. Ils étaient opposés de caractères et l’un sentait bien que l’autre voulait le doubler. Gaius Fufius Cita était en effet honnête, consciencieux, compétent, dévoré de manies dans son angoisse de réussir ; Sextus Cornélius Asinus était à l’inverse un faisan louvoyant sans vergogne, manipulateur souvent brouillon, malhabile mais content du moment qu’il arrivait à ses fins. Surtout le premier avait de l’orgueil, tandis que le second n’avait aucun sens de l’honneur sauf quand il jouait la comédie des bons sentiments. Cita n’avait pas digéré l’affaire du panais. Non seulement Asinus n’avait pas honoré le contrat et avait méprisé Cillimax qu’il lui avait présenté, mais surtout il n’avait pas tenu compte de ses conseils d’abandonner le ravitaillement des troupes pour le commerce exclusif d’un légume et était même allé contre. L’homme de César en avait été profondément contrarié. C’était son autorité qui avait été contestée, comme l’équilibre économique qu’il avait mis en place entre producteurs locaux et négociants étrangers 47
afin qu’aucun ne fût lésé ni même laissé sans profit. Car le profit assure de toutes les victoires, il en était persuadé. Pourtant, par son adresse, son ingéniosité, son refus de ralentir l’activité en basse saison, avec un peu de chance aussi et beaucoup de ruse enfin, l’audace d’Asinus avait payé, il fallait le reconnaître. Pendant que les campagnes souffraient la disette, le grain étant partout réquisitionné, pendant que la ville elle-même souffrait, le bonhomme continuait de faire des miracles. Il parvenait maintenant à se diversifier puisqu’après les soldats, c’étaient, depuis quelques semaines, les habitués de la copona dont il connaissait tous les vices, pour les avoir fréquentés, qu’il approvisionnait en douceurs – des pâtisseries qu’il faisait faire lui-même, dans le plus grand secret, par une vieille bonne femme qui avait jadis été l’esclave d’un gastronome d’Ostie. Dans le microcosme de Génabum la riche, il était ainsi parvenu, mois après mois, à faire ombrage à tous les petits commerçants qui tentaient eux aussi la fortune par ici et il en avait déjà ruiné quelques-uns qui avaient eu la mauvaise idée de se lancer, comme lui, dans l’approvisionnement de leurs concitoyens. Maintenant sa réussite devenait si éclatante qu’elle menaçait la primauté de Cita dont il avait récemment dévoyé jusqu’au collaborateur Chrysogonus en lui offrant plus à gagner. Il ne semblait pas devoir s’arrêter. Il était l’homme qui montait et il ne soupçonnait pas que derrière lui la ville pût s’effondrer. On aurait presque pu écrire en haut du second entrepôt hic stas apud Asinum : « ici tu te tiens chez Asinus » ; et mox totum oppidum illi : « et bientôt c’est tout l’oppidum qui sera à lui »… Nouvel Alexandre, il se voyait déjà rebaptiser sa ville Asinopolis. Une explication devait forcément éclater tôt ou tard. L’affaire du panais en fut le prétexte. Asinus était arrivé dans ses salles en passant justement par la porte qu’on lui avait aménagée. Toujours protégé par son esclave silencieux, il travaillait à un chargement de jambons. C’était sa nouvelle affaire, conclue avec un propriétaire du sud, un certain Dannotalos fils de Toutissimos, dont les valets faisaient des salaisons et des fumages qui rappelaient ceux d’Italie. On lui avait vanté la qualité de sa production, il l’avait cru sans même la vérifier tant il était pressé d’élargir son marché. Sa stratégie était d’ailleurs d’en proposer peu pour en faire vite monter le prix. Mais la première livraison qu’il destinait à Latro et ses officiers n’était pas concluante. Il fallait trier les pièces trop grasses, les morceaux trop secs, les cuisses trop petites, repeser le tout dans la balance. Entouré de trois hommes, Asinus tenait à tout surveiller lui-même, y mettant les mains, se montrant intransigeant sous l’œil de son fournisseur pour se donner la réputation d’un homme intraitable, intègre, qu’on ne pouvait voler et qui 48
voulait ce qu’il y eut de mieux pour ses clients. Dannotalos avait traversé toute la campagne, par temps de neige, pour les lui livrer à temps. Donc, tandis qu’Asinus s’affairait autour de ces jambons destinés aux légionnaires et réclamait de la lumière parce qu’il n’y voyait rien sous les fenêtres grillagées, Cita qui l’avait fait surveiller depuis la copona – tant les enjeux du commerce comme ceux de la politique nécessitent de mêmes manières – en profita pour faire irruption dans une danse dont lui seul avait le secret. Le sol était couvert de simples motifs losangés et il tâchait de marcher au milieu des dalles, mais comme elles étaient très larges, il bondissait presque pour passer de l’une à l’autre en prenant toujours soin d’y poser le pied droit en premier. Il était accompagné de son secrétaire qui le suivait, chargé de calculs et de consignes à transmettre, sans faire attention à ses lubies et marchant tranquillement. Il se créait un décalage bizarre entre leurs deux démarches. C’était agaçant ou ridicule. Cette foisci, Asinus, en le voyant arriver, pensa qu’on ne pouvait décidément pas le prendre au sérieux. Alors, quand, emporté contre son rival, Cita le salua avec aigreur : – Te voilà donc, roi des fourbes ! C’est plus difficile de mettre la main sur toi que sur…, il le coupa sur le ton de la plaisanterie pour lui répondre : – Que sur les seins d’Eunoé ? On dit qu’ils sont percés d’anneaux de cristal. – Laisse la princesse des Maures où elle est et arrête de rire, ce n’est pas le genre de conversation que je goûte ! Cita n’avait pas en effet un visage à plaisanter. Il paraissait plus las qu’en octobre, plus émacié aussi comme si l’hiver terrible des barbares ou les soucis de sa charge l’avaient affaibli et déprimé. Il avait le teint olivâtre. – Ce n’est que plaisanterie, dit Asinus, tu le sais bien, et la plaisanterie ne porte pas à conséquence. Tu sais aussi que je ne bouge jamais de ma chambre ou de cet endroit, alors tu n’as pas dû bien me chercher… Mais puisque tu m’as trouvé, enfin, que me veux-tu ? – Régler une fois pour toutes ton association avec Cillimax...Cillimax…Cillimax… Son mal n’avait pas disparu. Il avait beau essayer de résister ; il finissait toujours par céder à ses penchants maladifs comme un barrage rompt sous le torrent et il recommençait à réitérer ses paroles trois fois, choisissant surtout les termes qui désignaient une opération ou un associé censés lui porter chance. Se faire violence, s’en empêcher continuait de lui coûter un effort immense. On voyait son visage où pendaient ses éternelles touffes de barbe se contracter douloureusement, se gonfler de veines battantes avant de se relâcher devant l’impossibilité de désobéir à l’injonction sourde 49
qui venait de lui-même. Il n’y arrivait pas, répétait ses mots, était déjà vaincu devant son interlocuteur. Pire, son mal se confondait avec un bégaiement malheureux tant il parlait vite de colère. Si, aux dires des orateurs, une voix lisse est toujours ennuyeuse alors qu’un bredouillement produit une impression d’honnêteté – Démosthène lui-même zozotait –, ce qui était vrai en rhétorique ne l’étaient pas dans le commerce où tous les coups sont permis et Asinus s’étonna qu’un tel défaut de langue n’eût pas encore joué de tour pendable à Cita. – Il n’y a pas d’association, contesta-t-il simplement en profitant de cette faiblesse. – Comment pas d’association ? Est-ce que je dois te rappeler que tu as conclu un marché avec lui ? Il a couru après toi tout l’hiver pour te le faire honorer et maintenant il ne peut rester plus longtemps ici, il doit repartir chez lui. Tu oses dire pas d’association ? Il a d’abord essayé seul et puis, comme il n’avait aucune nouvelle, que tu t’enfuyais ou faisais la sourde oreille dès qu’il t’approchait, il en a référé à Lugurix sous la protection duquel il se trouve et qui l’a autorisé à venir me trouver, moi, parce que j’arbitre les négoces au nom de César…j’arbitre au nom de César…au nom de César… Espèce de vaurien, tu l’as laissé apporter ici sa marchandise par pleins tombereaux ; il en a fait empiler des charretées entières, et des caisses, et des sacs dans l’autre entrepôt, des tas si grands que je pourrais m’y cacher ! Tu lui as fait miroiter des débouchés jusqu’à Antipolis et Médiolanum. Et voilà des mois maintenant qu’il attend comme un idiot que tu te décides, et sa marchandise pourrit. Pourquoi le dédaigner ? C’est un commerçant respectable…respectable…respectable. Est-ce parce qu’il est barbare ? Mais le commerce n’a pas de frontières, tu le sais bien. – Pourquoi je ne traite pas avec lui ? Tu me demandes pourquoi ? Non, les barbares n’ont rien à voir là-dedans. Ce serait trop facile de me coller l’étiquette de l’idiot qui ne sait pas qu’un barbare peut valoir un Romain. Non, les meilleures affaires que j’ai faites ont souvent été avec eux. Il était coincé, voulait finir son travail, ne pouvait arguer de devoir partir précipitamment. Il voyait qu’il n’échapperait pas aujourd’hui à la discussion qu’il avait refusée tant de fois. Alors il décida de la mener luimême, à sa convenance. Il se concentra, sembla monter un argumentaire fallacieux dans sa tête. Comme Cita ne bougeait pas et attendait enfin des explications, il modifia subitement les traits de son visage, se recueillit un instant en histrion qui pense son rôle et, sans s’isoler, prenant au contraire ses collaborateurs à témoin, il déclama sur un ton juste mais si imprévisible que l’intendant en fut surpris : 50
– Je les connais, moi, ces types. J’en ai fréquenté d’autres, bien d’autres, tu peux me croire. Il y en a un spécialement que ton Gaulois me rappelle. Et si je te raconte son histoire, tu vas comprendre pourquoi je suis réticent à travailler avec lui. C’était en Sicile, à Syracuse, sur les pentes de l’Etna, il y a au moins vingt ans de ça. J’y avais accosté depuis quelques jours quand, par le plus grand des hasards, je suis tombé sur une payse à moi, une fille de Pisaure dont la famille entretenait des relations avec la mienne. Elle était méritante, très vertueuse ; elle s’appelait Titia et elle avait suivi dans la cité de Denys son mari, un honnête commerçant, qui avait vendu son patrimoine pour se lancer dans la vente en gros. Elle en avait eu deux fils. Elle m’a invité à leur rendre visite, c’est comme ça que je suis rentré dans l’intimité de leur quotidien. Oh ! Elle était adorable et ses enfants faisaient sa fierté ; son mari – Amantius, qu’il s’appelait – était lui aussi un bon bougre, ça, il n’y avait rien à dire, il n’aurait pas fait de mal à une mouche. Pourtant, je sentais un dénuement chez eux, tu vois, comme une gêne de chaque instant que je n’arrivais pas à définir tant elle était discrète. Était-ce vrai ? Était-ce faux ? Si Cita avait fréquenté davantage Asinus, s’il avait été présent chaque fois que celui-ci racontait sur ce ton un épisode de sa vie, il aurait compris que le marchand avait de réels talents de comédien et qu’il se plaisait à en user pour parvenir à ses fins. Mais il n’eut pas le temps d’y songer. Asinus en était au milieu de son histoire et entendait la déclamer posément mais d’une traite, comme une tirade magnifique. – Je n’ai d’abord pas bien compris, ça ne se voyait qu’à de petits détails qui auraient pu s’interpréter comme une façon de vivre. Je n’ai donc pas cherché à en savoir plus quand un beau jour, passant dans le quartier d’Achradine, je suis tombé nez à nez sur Amantius. Il ne m’avait pas vu et, je ne sais pas pourquoi, j’ai voulu l’observer, le suivre avant de l’aborder. Ce que j’ai appris alors m’a navré et m’a renseigné pour de bon. Parce que, figure-toi, quand il s’est retrouvé devant sa marchandise, un tas de pêches mûres et duvetées comme une fesse de femme au soleil, je l’ai vu, tel que je te vois, toi, s’absorber une heure durant dans sa contemplation. Et sa contemplation aurait duré encore longtemps si un acheteur n’était pas venu faire affaire pour ces fruits. Mais Amantius en a demandé un prix démesuré ; j’étais caché à côté, j’ai entendu son client se récrier. Il vendait ses pêches au prix de figues de Méroé ou de pommes des Hespérides ! Et même si elles étaient parties, il en aurait eu le cœur déchiré… Ç’aurait été des abricots de la Sabine, je ne dis pas, parce que ceux-là se sont vendus jusqu’à trente sesterces et qu’aucun fruit n’a jamais été payé davantage. Mais enfin, ce n’en était pas ! Il a tenté de le faire croire pourtant et s’est 51
lancé dans une véritable démonstration d’amour envers sa marchandise. Aux accents qu’il a pris, on ne pouvait douter de sa sincérité. Je me suis alors tout expliqué : il ne vantait pas ses fruits pour en tirer plus d’argent, mais parce qu’il refusait inconsciemment de les vendre ; il ne voulait pas s’en défaire par passion de son bien, et les revenus ne rentraient pas, et son foyer périclitait. Moi, j’ai repris la mer, je n’ai pas eu de nouvelles pendant un temps jusqu’à apprendre qu’ils avaient fini sur la paille, sa famille et lui, vivant chichement du moment que la marchandise s’envolât à prix d’or. Le problème, c’est qu’elle ne s’envolait pas. L’homme a été tué plus tard dans le Bruttium par des canailles de Spartacus ; je ne sais pas ce que sont devenus sa femme et ses fils. Il avait pris son temps pour raconter cette histoire. De fausses larmes étaient montées dans ses yeux, qui complétaient les tremblements de sa voix. Il fit semblant de devoir s’asseoir sur une chaise toute proche, chercha le ciel à fixer comme s’il dût détourner sa mémoire d’un souvenir douloureux. Autour de lui, ses collaborateurs attendaient, non sans curiosité, qu’il eût fini pour avancer leur travail. Dannotalos lui-même, dont la livraison de jambons était suspendue à ce récit qui ne le concernait pas et qu’il comprenait assez peu, semblait l’écouter et le suivre avec intérêt. Cita le laissa encore dire, ne sachant comment l’interrompre ; il était exaspéré, lui, l’homme franc et d’ordinaire efficace, par cette tergiversation insupportable. Son intransigeance devait forcément en souffrir et il s’était calmé en s’approchant, pendant la discussion, de la viande qu’il avait imperceptiblement griffée de ses ongles, ce qui, dans sa superstition folle, était signe de malheur à venir. Asinus abusa encore de sa patience et poursuivit dans la même veine : – Il y a un mot, vois-tu, pour dire les hommes amoureux d’une statue, d’un animal, d’une plante, mais il n’y en a pas pour qualifier ceux qui aiment leur marchandise au point de la laisser pourrir parce qu’ils ne veulent pas la voir partir. La marchandise n’appartient jamais à un marchand ; elle est en transit chez lui et il doit savoir s’en défaire, à perte ou à profit, mais s’en défaire toujours. Quel gâchis ! Ah, ça m’a servi de leçon !, et je me suis promis de toujours me méfier de ce genre de personnage. Quand tu m’as présenté ton Gaulois, j’ai voulu te croire, mais tout de suite, à la mine béate qu’il avait quand il regardait ses légumes, j’ai senti que je devais m’en garder. Il n’est pas mauvais ; c’est bien pire : il est brave et, pour cette raison, il est dangereux. Demande-lui s’il vendrait ses panais pour un as. – Mais personne ne ferait ça ! – Si, toute personne normalement constituée dès lors qu’elle ne pourrait vendre plus cher. Mieux vaut que la marchandise s’écoule à bas 52
prix que pas du tout. C’est un échec, certes, mais l’échec n’est jamais une impasse puisqu’il permet de recommencer. Regarde Dannotalos que voilà : il veut me rouler pour écouler son stock ; il a tout compris, à mon grand dam. Il l’embrouillait, lui racontait n’importe quoi, tenait des préceptes ahurissants qui se transformaient en leçon de commerce. Le mal de cet Amantius, insistait-il, c’était un travers que peu de gens soulevaient mais qui était plus fréquent qu’on ne le croyait et qui pouvait avoir des conséquences terribles. Ce travers, s’il ne l’avait pas inventé, il lui donnait des dimensions éhontées. À tel point que Cita comprit enfin qu’il était de mauvaise foi, qu’il n’y aurait rien à en tirer. Il n’était jamais entré dans son manège, n’était pas un homme d’intrigue, était étranger à toutes ses manipulations ; d’ailleurs il était un des rares Romains absents à l’exécution de Sagéra. Toutes les mises à mort le dégoûtaient, il avait été répugné d’apprendre la cause et les circonstances de celle-ci. Il brisa sèchement le dialogue : – Cesse tes histoires. Tu es un mauvais dramaturge. Asinus commençait lui aussi à se lasser. Le jeu durait un temps, il avait encore beaucoup de travail, et les journées passaient si vite ! Ce n’était plus lui qui dérangeait Cita comme à l’automne, mais l’inverse, et il comprenait mieux maintenant pourquoi l’intendant de César l’avait à l’époque expédié. Il voulut essayer autre chose, la comédie larmoyante : – Par les Dioscures, qu’avez-vous aujourd’hui tous après moi ? Celuici me roule, celui-là veut ma faillite ! La Gaule est si compliquée pour un honnête homme qui ne demande qu’à monter son entreprise ! Je ne suis pas rentier, moi ! Et on me tue ! On me tue ! Ah, non ! Ce n’est pas à Rome que ça arriverait ! Les horrea qui remplissent le ventre de l’Urbs sont autrement plus propices au commerce ! Mais ce fut inutile, il s’entendit répondre : – Arrête, maudit Roscius! Ça ne prend pas, je te dis ! Arrête ! Le ton monta. Asinus finit par sortir de son rôle, commit sans doute là un impair. Mais entraîné par sa position de supériorité, habité de ce sentiment de toute-puissance qui l’animait quand ses affaires florissaient, il s’emporta pour devenir outrageant : – La vérité, c’est que je vaux mieux qu’un tas de légumes ! – Oui, un tas de jambons ! – Me fait-il suer à la fin ; qu’il faut être bête pour ne pas comprendre ! Écoute-moi bien, en voilà assez ! Je me fous de ce benêt de Cillimax, je m’en bats les reins. Est-ce clair ? C’était ton idée au départ, assume-la. J’ai des hommes de Rome à ravitailler, moi ! Je ne joue pas à pacifier la région ! 53
– Eh, que crois-tu ? Moi aussi ! Mais si tu nous mets à dos tous les commerçants de Gaule, on ne pourra plus du tout les ravitailler… les ravitailler…les ravitailler…tes hommes de Rome. Je joue ? Je joue, moi ? Dire que je t’ai mis en relation parce que tu me suppliais de faire un geste quand tu étais dans le besoin. Maintenant que tu t’es acoquiné avec les puissants de la ville et que tu sautes ta Gauloise à gogo, tu fais le fier. Mais méfie-toi, à voler trop haut dans un ciel trop pur, on s’expose aux flèches des chasseurs. Tu ne m’injurieras pas comme ça. César va revenir. Dès son retour, je m’arrangerai pour qu’il t’expédie chez les Osismes ou les Bretons… En attendant, sois-en bien sûr, tu t’attires les foudres de Lugurix. Il l’avait menacé et le quittait en sautillant entre les dalles quand Asinus lui fit le grand geste d’aller se faire foutre. Le secrétaire de Cita, qui semblait pourtant de sang-froid, perdit alors toute mesure, lâcha ses écrits, le poussa à l’épaule pour le faire tomber. Il le menaça de son stylet de métal. Aussitôt Scythès, qui n’avait pas bougé jusque-là, dont on avait presque oublié la présence, attrapa l’homme à la clavicule qu’il brisa entre deux doigts comme on écrase une mouche. L’autre hurla plus qu’un fou. Des esclaves accoururent. La situation allait s’aggraver. Déjà Asinus se relevait, furieux, ses rares cheveux en bataille, en criant à quelques pouces seulement du visage de l’intendant : – Lugurix, je ne sais pas qui c’est ! Quant à César, je l’emmerde et j’engrosse sa Calpurnia ! Reprends ton éclopé, sors de ma vue ! Cita eut un instant de stupeur. Leurs relations prenaient une autre tournure avec cet acte de violence et ces mots orduriers. C’était un nouveau visage d’Asinus qui s’offrait à ses yeux, celui d’un homme ambitieux, prêt à tout, violent s’il fallait. Il semblait découvrir que l’avidité du gain pouvait mener à de telles extrémités, lui qui était plein de principes honnêtes. Il décida pour l’instant de calmer les choses, sortit en soutenant son secrétaire qui gémissait de douleur et en ramassant le polyptique de ses tablettes éparpillé au sol. Le commerçant retourna à ses jambons. Il partit d’un rire qui résonna dans les pièces vides de l’entrepôt. Mais il s’arrêta subitement, regarda autour de lui. Esclaves et employés, qui attendaient toujours pour finir le travail, le dévisageaient en silence. Il sourit encore, regretta d’avoir prononcé ces paroles d’outrage, d’en être venu aux mains. C’était imprudent et stupide. S’il y avait dans le coin des agents de Pompée, la place regorgeait surtout d’hommes de César et une telle phrase, même prononcée sous le coup de l’émotion, pouvait lui attirer de sérieux ennuis. Sa raison pourtant était combattue par un plaisir malsain d’avoir poussé à ce point de rupture. Il en fut ragaillardi, ne chercha pas à rattraper Cita 54
pour s’excuser, mais termina avec application de trier ses produits. Puis, sur-le-champ, il alla rendre visite à Latro, tant pour lui vendre son jambon que s’assurer de son soutien. Il prit avec lui un échantillon de sa marchandise, le plus gros et le plus appétissant, qu’il confia à Scythès. Dehors il montra un nouvel élan. Il avait repris de la vigueur, se sentait rajeuni. Plus encore qu’en sortant de chez Taurillos, il ne clopinait plus du tout, avait pour de bon rentré sa bosse et marchait droit. Ses poings le démangeaient, son estomac criait la faim. Il avait envie de cogner, de dévorer le monde pour prouver qui il était. Plus il faisait un pas dans les rues boueuses et encombrées, plus sa marche lui semblait légère. Heureusement que Latro résidait non loin parce qu’il aurait agressé le premier qui se fût mis en travers de sa route. Bien sûr, il était grotesque à côté de son esclave dont la stature disait à elle seule la force ; mais la castagne lui manquait, elle lui rappelait ses vertes années quand il s’imposait à coups de tête. La ville ne lui parut plus du tout aussi laide, ses habitants moins farouches. Après tout, ils avaient un bon fond. S’ils le fixaient du regard comme ils continuaient de le faire, c’était qu’ils étaient naïfs et curieux comme de grands enfants. Depuis son installation à Génabum, Latro avait réquisitionné une petite masure en forme de meule. La maison était très simple et n’offrait que le minimum pour y loger. Toutefois il n’en avait pas souhaité de plus grande ni de plus pratique ; celle-ci lui convenait parce qu’elle donnait directement sur le fleuve et son port. De là il pouvait contrôler les arrivées, les départs, les chargements pour la légion et seconder Cita dans sa tâche. Il s’acquittait d’ailleurs de sa fonction avec la sauvagerie qu’on lui connaissait. Alors que l’intendant de César faisait tout pour maintenir de bonnes relations avec les seigneurs de la région, lui montrait plus de violence, n’hésitant pas à rançonner les plus faibles et piller les fermes isolées. Si les paysans survivaient, s’ils se plaignaient à leurs protecteurs, il calmait ces derniers en les achetant ou en arguant d’un ordre venu de plus haut. On le craignait dans le pays comme l’homme au chien maigre ; ainsi désignait-on son chacal qu’on prenait pour un animal féroce parce qu’il avait dressé le sien et le lâchait avec un sourire pervers sur ses victimes. On prétendait qu’il avait dévoré une mère et ses deux nourrissons dont il n’avait laissé que les oreilles et le nez. Asinus ne savait qu’en penser. Il était sûr qu’il y avait dans tout ce qu’on colportait un fond de vérité. Mais il n’avait jamais été témoin de ces atrocités et songeait que les Gaulois se seraient révoltés, que César serait intervenu si elles avaient été bien réelles. 55
Ce qu’on racontait sur ses activités nocturnes était plus nébuleux encore. On prétendait que Latro trafiquait pour son compte, qu’il détournait des cargaisons entières de grain, de métal, de bois qu’il envoyait en secret dans le sud où un réseau d’intermédiaires, des hommes de confiance, se chargeait de les transformer en or. On racontait aussi qu’il faisait enlever des femmes, des enfants, des hommes même pour l’attendre chez lui et l’y servir plus tard, à son retour. Sa demeure était un palais perdu dans les déserts libyens, quelque part à la frontière avec les Nasamons et les Mazaces, plus luxueux que tous ceux des Ptolémées réunis. Enfin, il paraissait que Latro faisait prélever, avec la plus grande précaution, des animaux des régions froides pour les y exporter et organiser des combats, là-bas, dans les chaleurs brûlantes. On lui avait mentionné notamment un grand cerf des environs, une bête magnifique survécue des âges, qui ferait un beau trophée pour les jeux de son retour. Comme il avançait d’un pas sûr, Asinus fut arrêté par des légionnaires qui avaient ordre de ne laisser passer personne. – Eh bien, tança-t-il, c’est comme ça que vous me remerciez pour les barbeaux de l’autre fois. Ils avaient été pêchés du jour, je vous le jure, là où le fleuve est limpide. Il paraît que les Gauloises s’y baignent en été. On hésita à l’annoncer. Mais il s’entendit aussitôt crier depuis la hutte : – Qu’il patiente, par les dieux ! Ce n’est pas un forum ici ! Il entrait d’ordinaire sans problème. L’attente lui parut forcément longue. À l’intérieur, au milieu d’un lit et d’une table, les lampes projetaient une lumière jaune voilée tant le jour était lugubre. Il pensait trouver le centurion assis, occupé à donner posément ses instructions ou à nourrir son chacal. Au lieu de cela, il le trouva agité, rangeant des papiers, chuchotant des ordres à voix basse, se démultipliant en tous sens et très ennuyé de sa visite. Sa collation du matin était devant lui ; il n’y avait pas touché. La bête elle-même, dans sa cage derrière, semblait ressentir le trouble de son maître et tournait rapidement en rond, le museau bas, l’oreille aux aguets. Tout autour, des valets de camp rangeaient des couvertures, poussaient les meubles, décrochaient des armes de valeur, entassaient des livres de comptes. L’un d’eux renversa, dans sa précipitation, un poignard qui se ficha dans le sol, passa à d’autres objets sans même le ramasser. Quelque chose clochait, c’était évident. La situation ressemblait à un mouvement de panique. – Salut à toi, centurion ! Eh bien, Rome plie bagage ? Latro ne répondit rien. Il n’était pas Taurillos. Il se méfiait d’Asinus, ne le supportait, ne l’encourageait que parce qu’il avait reconnu en lui un homme de sa trempe qui contentait ses troupes. Mais il ne voulait pas le voir mettre le nez dans ses affaires. Il souffla un mot à son serviteur pour 56
qu’il ramassât le poignard qu’il avait fait tomber et le groupât avec un ensemble de jambières, de casques et d’épaulières dans une malle. Il dit enfin : – Nous faisons du rangement. C’est tout. Sa voix était hésitante ; il semblait inquiet, bouleversé, incapable de trouver une explication plus plausible. Son regard roulait en tous sens comme si les murs l’enserraient, que l’espace était trop étroit désormais et qu’il devait fuir mais ne pouvait pas encore. – Du rangement ? – Un soldat doit toujours avoir sa tente dégagée du superflu et un civil, aussi attentif soit-il au ventre de mes hommes, ne doit pas en savoir plus. Il transpirait, très légèrement, d’infimes gouttelettes qui perlaient à ses tempes. Asinus le remarqua, fut étonné de le voir dans cet état. – Et le cerf qu’on t’a vanté ? Tu « ranges » avant de l’avoir chassé ? – Il n’y a pas de cerf, il n’y en a jamais eu. Où était le soldat manipulateur, cruel, sûr de sa puissance ? Il fallait que ce changement eût une cause grave, autre que sa seule visite. Asinus soupçonna que le branle-bas qu’il surprenait devait avoir un rapport avec les trafics qu’on lui prêtait. Peut-être son agitation masquait-elle un nouvel arrivage ou au contraire un convoi en partance qui ne devait être découvert. L’imprévu devait être néanmoins réparable pour qu’il le reçût quand même. – Soit ! Je venais te voir pour… – Fais vite, j’ai peu de temps. Peu de temps. Il alla droit au but, posa son jambon sur la table, le déballa avec précaution comme si ce fût le coffret d’or qu’il avait vendu à Taurillos quelques heures plus tôt. Le jambon était proprement magnifique, lourd, compact, point trop gras et rosé à souhait. Pour séduire les troupes, il fallait d’abord séduire leurs chefs. – Qu’est-ce que tu veux que je fasse de ça ? – Prends un couteau, déguste-le. – Sans façon. – J’ai un chargement de viande de la plus grande qualité. Des jambons comme celui-ci, en comparaison desquels ceux des Ménapes sont imbouffables. Je veux les offrir à tes hommes contre pratiquement rien. L’autre eut un ricanement. Il sembla se reprendre comme s’il se rendait soudainement compte qu’Asinus, tout à ses histoires de jambons, ne pouvait rien savoir de ce qu’il cachait. Son œil parut s’arrondir et s’ouvrir comme une bouche qui s’esclaffe. – Pratiquement rien ? Je sais ce que rien signifie dans ta langue… Quant à mes légionnaires, ils ne sont qu’une poignée. Que veux-tu que je fasse 57
d’un chargement pour des agapes titanesques ? On m’a envoyé ici assurer l’ordre avec un nombre d’hommes juste bon à couvrir un marché de province. L’enjeu était pourtant de taille. – Était ? Tu parles au passé maintenant ? Asinus avait relevé ce changement de temps dans des paroles qui lui étaient plus mystérieuses que jamais. De quoi parlait-il ? Était-ce encore des jambons ou autre chose ? – Combien ?, demanda Latro impatienté et mécontent de s’être trahi sur un détail. Combien en veux-tu ? – À vrai dire… – Le prix que tu voudras, c’est entendu. Asinus fut stupéfait. Il n’avait pas eu à marchander, ni même à sacrifier son spécimen à le faire goûter. L’autre voulait tellement se débarrasser de lui qu’il lui donnait tout avant même qu’il l’eût réclamé. La chose était donc conclue, il n’avait pas de soucis à se faire pour ses jambons. Entre larrons, on s’entendait. Ce qu’il ignorait, c’était que la nervosité de Latro ne devait rien à ses trafics. Quelques heures plus tôt, au petit matin, il avait reçu dans le plus grand secret Chéréas qu’il avait débauché pour son compte. L’homme, déguisé en Gaulois et circulant sous le faux nom d’Éponax, lui avait appris qu’il était en danger, pour ne pas dire déjà mort. Il n’en avait pas dormi. Il se doutait depuis longtemps que l’exécution de Sagéra, dans un contexte de vives tensions, avait dû entraîner des remous et, ne voyant rien venir avant l’hiver, il s’était méfié d’une insurrection mûrement préparée qui éclaterait au printemps. Il avait demandé à l’espion de surveiller ce qui se tramait. Il apprit bientôt par lui que des assemblées secrètes avaient lieu, même au-delà du pays des Carnutes, et ses soupçons se confirmèrent jusqu’à ce que Chéréas lui apprît que les conjurés allaient passer à l’action. L’ampleur de la conspiration le paniqua, et son immédiateté qu’il n’avait pas vue venir. Le massacre était imminent, fixé au surlendemain. Il ne pouvait agir. Et puis que faire avec si peu d’hommes, en si peu de temps ? Il n’était pas idiot. Il savait que s’il organisait une résistance ou pire une fuite de ses troupes, son action serait désorganisée et tous seraient rattrapés, exécutés, avant même qu’ils n’aient atteint une légion. Alors, il avait pris le parti de régler ses affaires, de prétexter un déplacement idoine, de laisser tout le monde en plan et s’en aller au plus vite sauver sa peau. L’honneur de Rome ? Foutaises ! Seule comptait la survie des meilleurs dont il était. Asinus fut néanmoins heureux de son succès. Rien ne lui résistait. Il décida de pousser l’avantage pour en apprendre un peu plus. Sans un mot, il rôda en osant quelques pas, lorgnant l’air de rien jusque dans les coins 58
sur des papiers, des objets, des cartes qui semblaient anodins. Tandis qu’il furetait, il s’avança à bonne distance de la cage du chacal où il s’aperçut que l’animal, qui ne cessait de couiner et tourner en rond, avait lui aussi perdu son appétit puisqu’il avait laissé deux oisillons à moitié dévorés sous ses pattes. La porte était entrouverte, la bête n’en sortait pas. Derrière, entre un grand coffre et une tenture, il tomba soudain sur une forme recroquevillée dans la pénombre. La forme ne bougeait pratiquement pas, tremblait un peu, attendait comme affaissée sur elle-même. On aurait dit une cariatide prostrée de porter son poids sur sa nuque. D’un clin d’œil, il formula sa demande d’aller voir. Latro n’émit pas d’objection. Il semblait maintenant moins pressé qu’il partît parce que c’était l’occasion d’exhiber son bien le plus admirable. En dessinant un arc de cercle pour passer loin de la cage, Asinus découvrit alors une jeune femme enchaînée. C’était la prisonnière dont il s’était entretenu plus tôt avec Taurillos. Latro la maintenait là, près d’elle, comme un objet très précieux ; il ne s’en séparait pas depuis qu’on la lui avait offerte. Asinus ne l’avait à ce jour vue que d’assez loin quand les hommes du vergobret l’avaient ramenée en ville et qu’il lui avait rendu visite sous sa hutte. Il avait apprécié sa force de séduction. Il voulait la constater de plus près. Elle le vit venir, voulut se relever. Mais la chaîne qu’elle avait au cou et les liens à ses poignets l’en empêchèrent. Il s’accroupit à sa hauteur, dans un grand mal de dos dissimulé, l’observa attentivement comme on ferait du grain d’un bronze de Myron. Cette sculpture-là avait ses cheveux empagaillés, une rougeur à la joue, un peu de sang séché collé à la lèvre inférieure. Elle semblait une statue de Praxitèle qui aurait marmonné des mots dans sa langue. Une prière ? Une chanson ? Quelque injure ? Elle était foutrement belle, de la beauté de l’honnêteté jetée aux prises d’une crapule. – Elle est mignonne, ta prisonnière. Elle aussi est du rangement ? Comme si leur maître leur avait dit de ne pas s’arrêter, les serviteurs, tout à leur travail, continuaient de ranger. Latro se leva, s’approcha de la fille à son tour. Il avait complètement repris son assurance maintenant. Doucement il la saisit à la gorge, lui étira le cou, prit une dague qui traînait sur un coffre. Et promenant son nez de la racine de ses cheveux à ses bras, il la renifla comme un dogue ferait d’une chienne, agrippa brusquement son vêtement, mit sa poitrine à nu. Elle ne bougea pas, haletante, craintive, les yeux clos. Alors de sa lame, il lui rasa soigneusement la pointe du sein comme pour dire qu’il pourrait le lui couper à n’importe quel moment puisqu’elle lui appartenait toute, elle et chaque partie de son corps. On vit très nettement le téton durcir au contact froid de son arme. 59
Rasséréné, il prit une voix lascive où sonnaient des notes perverses : – Elle aussi est du rangement. D’otage officielle, elle va devenir mon esclave personnelle, obéissant à mes moindres désirs. Mais loin d’ici. Quand je partirai, je l’emmènerai avec moi. J’aime son côté probe et simple. Je saurai quoi en faire. Elle est sans doute mon trésor le plus cher aujourd’hui. Sa possession le bloquait en effet, mais il ne voulait pas s’en défaire. Il ne pouvait la réduire en esclavage puisqu’elle était un cadeau de Taurillos – en hommage à César de surcroît – dont un grand monde avait ouï la rumeur. Les Carnutes n’auraient jamais accepté qu’un des leurs, même une femme, soit ouvertement privé de son statut d’être libre chez eux ; il ne pouvait non plus la faire disparaître de nuit, l’envoyer loin d’ici, comme à son habitude, dans la mesure où tout le monde se serait interrogé sur son sort. Il la gardait donc cachée pour l’instant, au milieu de la ville, en attendant de partir avec elle. Ce fut justement le motif du départ qu’Asinus retint. La fille n’était qu’un prétexte à en savoir davantage. Il poursuivit, sans y paraître, essayant de lui faire dire l’important en parlant d’autre chose : – Tu l’as testée ? Je veux dire, physiquement ? Taurillos m’a dit peu de bien d’elle. – Pas encore. Je me la réserve pour le printemps. Elle est comme les abeilles : elle butine aux beaux jours… – Mais comme les abeilles, elle pique aussi. C’est la fille du rebelle, n’estce pas ? Mauvais sang ne saurait disparaître. Il se pencha un peu plus pour l’observer, les yeux dans les yeux. Latro la tenait toujours entre ses mains, son nez plaqué contre l’aisselle ; il avait remonté sa lame à la naissance de la gorge, là où le sternum fait un creux. Il en tenait la pointe appuyée dessus, prêt à l’y enfoncer au moindre geste qui eût déplu. Les tremblements de la fille se firent plus vifs. – Comment t’appelles-tu déjà, ma jolie ?, lui susurra Asinus. Tu comprends la langue de tes maîtres ? Elle hésita, sentit la poigne de Latro se durcir sous sa mâchoire, eut pour eux deux un regard simple qui disait sa certitude de se libérer tôt ou tard. – Aldéa… – Aldéa… Ce n’est pas Rosmerta ? Aldéa… Ça rime avec serva. Tu seras donc esclave dans les sables de Libye. Elle s’appelait en effet Aldéa. C’était la fille d’Anéroeste, tombée aux mains des canailles de la région. Asinus se releva, aucune fille ne valait Génabia à ses yeux. Il passa à un autre sujet en soufflant de douleur. Latro n’avait pas cillé à l’évocation de 60
la Libye. Son départ était donc définitif. Puisqu’il en ignorait la cause, mieux valait régler ses problèmes avant. – Je voulais aussi m’assurer de ton soutien. Face à Cita. Il s’est encore mêlé de mes affaires, ça a mal tourné. Il paraît que je me suis brouillé, sans le savoir, avec un sauvage du coin. Lugnorix…Gulurix… Ces énergumènes sont tellement incivilisés qu’on se fâche avec eux sans même les avoir jamais rencontrés. Latro n’aimait pas beaucoup Asinus, mais détestait plus encore Cita. Les deux hommes étaient rivaux, César ayant nommé l’un pour gérer son approvisionnement, l’autre pour fournir un appui militaire au premier. Au lieu de travailler de concert, ils avaient tout de suite laissé naître une animosité entre eux. Latro répugnait à Cita qui exécrait la violence inutile parce qu’elle nuit au commerce ; Cita répugnait à Latro parce qu’il le gênait dans ses trafics malhonnêtes. – Mon soutien, tu l’as…, dit le soldat. Sa voix avait pourtant changé, inquiétait plus encore. Elle n’avait plus l’accent lascif de tout à l’heure mais un timbre aigre menaçant. Il décrocha le cep de vigne qui pendait à un clou, le promena près d’Asinus. C’était le signe distinctif du centurion, à la fois symbole de sa dignité et outil pour forcer ses hommes à rentrer dans le rang. Il n’hésitait pas à en frapper quiconque au besoin. – Mais tâche, toi aussi, de ne pas fourrer ton nez où tu ne dois pas. Maintenant retire-toi, notre entrevue a assez duré. La cage de mon chacal est ouverte et je n’ai pas besoin de te rappeler que je n’ai qu’à siffler pour qu’il te saute à la gorge avant même que ton esclave resté dehors ne t’entende crier. C’est une femelle et comme toutes les garces, elle est mauvaise. Si elle n’a pas fini ses oisillons, ce n’est pas qu’elle n’a plus faim, c’est qu’elle veut mieux. Asinus comprit qu’il n’obtiendrait rien de plus. Il s’inclina : – Évidemment. – Va-t’en. – Encore une chose. Ton barbier, il est disponible ? – C’est ça. Va te faire raser le portrait. Pour la petite… Asinus ne répondit rien à l’allusion, se retira en remballant sa marchandise. En relongeant l’embarcadère, il croisa deux légionnaires qui achetaient de la boisson à une vendeuse ambulante pour mieux la lutiner. Ils avaient le cou gras, presque du ventre. Décidément, pensa-t-il, il les avait bien empâtés. Non seulement ils étaient gloutons mais en plus ils ne faisaient 61
aucune manœuvre d’exercice. Latro manquait à ce devoir. Depuis l’exécution de Sagéra, sa piétaille baissait plus que jamais la garde, repue de sang, voulant passer aux plaisirs du sexe et du ventre tandis que les autochtones, eux, n’étaient peut-être pas rassasiés de violence. Car un doute lui était venu, subitement. Il n’était plus optimiste, n’avait plus envie d’en découdre ; quelque chose l’inquiétait au contraire. Les brumes sur la Loire ne se dissipaient pas. À tourner et retourner dans sa tête l’attitude paniquée du centurion quand il l’avait accueilli, le climat de la ville lui parut de nouveau hostile, sa population secrète. Et s’il était tombé dans le plus grand des panneaux ? Si ces rues qui l’entouraient déployaient un piège ou à l’inverse orchestraient le trafic du siècle dont il ne serait pas ? Il marqua le pas. Son dos parut derechef se bosseler lourdement, son arthrose revenir si forte qu’il eut l’impression que ses os rouillés ne s’articuleraient qu’au risque de casser. Pourtant il songea tout à coup qu’il pourrait maintenant aller voir Génabia, et il oublia tout, ne sentit plus ses lourdeurs comme par miracle. Elle habitait tout près. Le temps d’un saut chez le barbier pour avoir les joues polies de frais, il attendrait à la porte de chez elle puisqu’aussi bien il en avait le droit à présent et, à cette porte, contrairement à celle de Latro, il savait qu’il devait patienter longtemps car il en avait toujours été ainsi. Il vivait une véritable idylle, involontaire, débutée à la copona où il avait goûté, un matin gris d’octobre, aux charmes irrésistibles de la jeune fille. Elle comptait au nombre de ces Gauloises paumées, appauvries par l’hiver ou les guerres, qu’Éroticus, suivant le principe du lupanar romain, faisait traîner sur le port ou le pont pour racoler marchands et soldats. Après qu’Asinus eut découvert ses faveurs – des baisers, des pipes, des culbutes d’une intensité telle qu’il n’en avait jamais connus de pareils –, les autres Vévila, Sansila, Manaé l’écœurèrent vite et cessèrent d’exister pour lui. Bien sûr, il n’avait d’abord pas compris ce qui lui arrivait, s’était lamenté sur son sexe amolli avec l’âge, lancé dans de folles parties à trois de Lesbos pour se rattraper. Mais il s’était aperçu que d’autres filles gâchaient toujours son plaisir. Même les créatures honnêtes qu’il croisait sémillantes dans la rue, une cruche ventrue en équilibre sur leur tête, ne le faisaient plus se retourner. En fait, il lui fallait Génabia seule ; il ne recherchait qu’elle car, pensait-il, il n’y avait que ses ébats à elle pour alléger sa vieillesse et rendre son gourdin dur comme une matraque de vigile urbain. Il y trouva la raison de la voir le plus souvent possible, de multiplier les passes avec elle jusqu’à trois par journée. Il y dépensa toute sa fortune. Mais il ne voulait pas être simple client. Il voulait exister à ses yeux, être autre chose qu’une pine en manque de trou. Comme chaque élément de son destin à Génabum, ce fut lors de l’exécution de Sagéra que son histoire 62
prit, à ce sujet, un nouveau tournant dont il espérait qu’il le conduirait au succès. Ce jour-là, en effet, quand la foule mécontente de voir le malheureux brûlé vif avait exprimé sa colère en jetant des projectiles et en se pressant contre tout ce qui était étranger, sa petite rousse, bousculée, avait chuté au sol, évanouie. Ni une ni deux, il avait envoyé son esclave la chercher et la sauver d’un piétinement inévitable. Longtemps après, une fois le calme rétabli, elle avait repris connaissance dans la copona au milieu des commerçants qui s’y étaient réfugiés et Asinus avait fait en sorte que le premier visage qu’elle vît en ouvrant les yeux fût le sien. Depuis, il pensait avoir droit de protection sur elle, de regard sur ses affaires. Ainsi s’était concrétisée sa passion. Car il s’agissait bien d’une passion dont il souffrait, où les progrès qu’il obtenait ne lui suffisaient plus l’heure d’après. C’était un désir permanent – celui d’être avec elle, d’œuvrer pour elle, d’en être remercié – qui créait en lui un vide immense tant qu’il ne le satisfaisait pas et plus immense encore dès qu’il l’avait satisfait. Il n’en dormait plus, en avait perdu la moitié de son appétit, se jetait à corps perdu dans ses affaires pour épargner, s’il le pût, le reste de ses forces. Cet état d’esprit, il ne le connaissait que trop bien pour avoir vu d’autres en dépérir avant lui. Il dut se rendre à l’évidence : il était amoureux. Comment était-ce possible à presque soixante ans, dans ce pays de sauvages ? C’était d’un grotesque. Il en fut très ennuyé. Ça ne lui ressemblait pas, il ne savait comment réagir, jugeait tout cela une perte de temps. Jamais plus qu’à cette époque l’indifférence de Scythès pour les filles des rues ne lui fut aussi insupportable. De fait, il s’y prit comme un gamin, très mal, sans voir à quel point il était ridicule. D’abord, il entreprit de se rendre beau, ce qui n’était pas une mince affaire. Il se fit couper les cheveux, tailler les ongles, parfumer et, chose rarissime dans ces contrées, mettre du fard et des mouches au visage. Il se fit aussi raser de près chaque matin comme César n’y manquait pas à ce qu’on disait. Mais le seul barbier qu’il trouva, celui de Latro, était lent, très lent, plus lent que ceux de Rome connus pour leur lenteur et travaillait en gougnafier. Un jour, tandis qu’il brûlait d’aller retrouver Génabia et tempêtait en s’exclamant « Par Janus, pendant que tu fais le tour de ma gueule, la barbe me repousse où tu as commencé ! », ce jourlà, le barbier, sursautant à sa mauvaise humeur, le gratifia d’une estafilade à la joue droite dont il se désola comme s’il eût perdu un œil. On le rassura en lui disant que les femmes aimaient ce genre de balafre ; pour la cicatriser, on lui conseilla d’appliquer un emplâtre de toiles d’araignées trempées d’huile et de vinaigre dont il fut plus ridicule encore. 63
Puis il eut pour elle toutes sortes d’attentions. À l’épier comme un enfant, à la suivre comme un petit chien, il découvrit ce qu’elle possédait, ce qui lui manquait. Elle n’avait pratiquement rien, devait désirer beaucoup. Il commença donc par lui offrir des présents, dépensa sans compter en vrai panier percé. Ce fut de la nourriture, des friandises, des vêtements chauds, un petit miroir, une bague qu’il marchanda au prix fort à un Corinthien revêche parce qu’aucun marchand celte ne vendait de perle assez brillante à son goût. Bientôt les cadeaux ne suffirent plus. Il voulut qu’elle ne couchât qu’avec lui, qu’elle passât ses après-midi entières en sa compagnie ; il se mit en tête d’avoir une intimité avec elle en des endroits retirés et charmants où il l’attira avec insistance tandis que son esclave recevait l’ordre de l’attendre à l’auberge. Il la fit ainsi s’asseoir sur la plage d’une petite île en amont du fleuve où nichaient des lapins, s’allonger dans un vallon abrité de grands arbres au milieu des champs pelés par le froid, se cambrer n’importe où pourvu que ce ne fût pas sur la paillasse de la chambre glauque où il pieutait depuis des mois. Et sur une nappe sale, il lui récita des vers incomplets de Catulle qu’il avait retenus tant bien que mal. Il aurait donné tout l’or des Parthes pour être en été, lui offrir des cerises confites et la voir se baigner dans le fleuve ou s’allonger nue parmi les blés. Enfin, il la crut sienne au point de lui donner un surnom affectueux : Psécas, la miette, comme ces infimes bouts de pain qu’il pouvait seuls manger à volonté sans avoir mal à ses dents. La belle, si elle lui donna chaque fois son corps, ne l’en aima pourtant pas plus. Il y eut certes un premier temps où elle répondit à ses gestes, accepta ses cadeaux, mais ce fut la marque d’une curiosité, non d’une tendresse naissante. Après tout la guerre avait fait des ravages ; il aurait fallu être fou pour tourner le dos à cette fortune tombée de nulle part. Ce ne dura pas. Rapidement elle changea d’attitude. Ce changement, dont il n’entrevit jamais la cause, résulta peut-être du sentiment de supériorité que prennent les femmes quand on les comble trop, sans doute aussi d’une entrevue qu’elle eut avec un homme puissant qu’elle ne connaissait pas en privé et qui n’était autre que Volomir. Le frère de Cotuatos se moquait pas mal des putains de la ville, mais il s’était intéressé à celle-ci dans la mesure où, décidé à se venger d’Asinus qui l’avait humilié au premier jour de sa présence, il avait fait espionner ses faits et gestes et avait eu vent que son ennemi juré s’était amouraché d’une rouquine appelée Génabia. Un matin qu’il le savait entièrement pris par ses affaires, il manda la fille sous son toit. Il inspecta la gourgandine, lui demanda de minauder, de prendre des poses mutines pour mieux comprendre le charme qu’elle pouvait exercer sur son ennemi. Il avait l’œil si terrible qu’elle s’exécuta sans poser de question. 64
– La cité t’a élevée, petite, dit-il enfin ; à toi maintenant de lui rendre la pareille. L’homme qui cherche à te séduire ne doit pas repartir vivant de la ville. Mais avant cela, je veux qu’il souffre les peines les plus dures, les plus humiliantes. Si tu ne veux pas être accusée de trahison au moment venu, écoute bien ce que je vais te dire et respecte mes instructions à la lettre… – Oui, Seigneur. Le pire tourment qu’avait vanté Volomir à son frère pour se venger d’Asinus était les peines du cœur dont même un Gaulois savait qu’on est toujours à la merci. À partir de ce jour, Génabia se montra plus difficile, plus distante, presque farouche sans en avoir l’air. Elle continua de recevoir les présents, les amabilités du grand niais mais avec une indifférence qu’elle peina à dissimuler. S’était-elle lassée ? Pensait-elle qu’elle n’aimerait jamais un Romain, même généreux ? Sans provoquer de rupture, elle finit par lui manifester un habile mépris. Elle l’évita, se cacha quand il la cherchait partout dans la ville ; elle laissa les autres filles se moquer ouvertement de lui lorsqu’il la suivait dans la rue ; elle coucha avec d’autres hommes pour presque rien alors que lui, qui espérait toujours intimement l’avoir déflorée, y laissait chaque fois la moitié de sa bourse. Jamais elle ne se soucia de savoir ce qu’il ressentait. Volomir la rencontra à plusieurs reprises en secret pour lui donner ses instructions et elle fit souffrir plus encore son prétendant pour l’humilier. – Elle se refuse à moi, baise avec d’autres. Eh, veux-tu que je te dise, je la trouve encore plus belle pour ça, disait Asinus à Scythès dégoûté. Il s’aveuglait, tolérait tout, endurant la situation, sans s’avouer qu’on se jouait de lui et préférant croire en ses chances au-delà des obstacles. Laissant sur son chemin un sillage de parfum safrané, il suscitait la goguenardise des Gaulois, la réprobation de ses compatriotes, la colère de tous. Bien sûr, les amours indigènes, comme on les appelait, étaient fréquentes ; mais elles se résumaient normalement au droit du vainqueur de prendre sa part de butin en chair féminine. À la rigueur, une relation d’égalité était acceptable si on n’en causait pas trop. Mais jamais un fils de Rome ne devait s’abaisser à devenir inférieur à un être femme et barbare à la fois. Même Éroticus, en ces cas-là plus romain que les Romains, s’en navra. Il n’y eut pas jusqu’à Scythès qui n’en perdît un jour son visage impassible et grognât. Néanmoins Asinus n’en eut cure. Il mettait un point d’honneur à conquérir la ville, le commerce de son port, l’alliance de ses chefs, le corps et le cœur de ses femmes. Il ne comprenait pas que c’était précisément l’inverse qui se produisait, que c’était une femme et, derrière elle, un chef qui gagnaient sa soumission tandis qu’il perdait un premier marché à snober le monde. Ce fut en effet à cette période qu’il dédaigna 65
Cillimax car nul n’est plus brutal envers les autres que le nouvel amoureux qui n’arrive pas à ses fins et se croit tout permis. Ce ne fut pas tout. Pour parfaire son ridicule, il adopta des postures hilarantes censées impressionner Génabia. Il prit des allures d’aurige pour monter à cheval devant elle, de gladiateur quand, protégé par Scythès, il bousculait les passants, de navigateur hardi quand il l’emmena sur l’île alors qu’il avait peur de l’eau. Il élabora ainsi tout un panel de rôles à mimer et c’est en jouant l’un d’entre eux, celui du minet rasé de frais, qu’il alla patienter devant sa porte. La maison était pitoyable, une bicoque branlante et penchée, un taudion nimbé de brumes, situé près du rempart derrière un tas de fumure, au-delà du Dépotoir, dans un endroit de la ville où la misère se cantonnait. Quand elle ne travaillait pas, la fille n’en sortait que rarement et il savait qu’elle était là parce qu’elle accrochait sa pèlerine à une pointe extérieure tellement le logis était petit et malpropre. Dehors, près de la porte, une grosse femme laide qui louchait avait égorgé un poulet et commençait à le déplumer. Des plumes voletaient en tous sens. Il n’avait pas oublié les premiers volatiles qui n’avaient pas mangé les miettes de pain le jour de son arrivée, ni l’innombrable basse-cour qui avait manqué le faire chuter tout l’hiver dans la rue. Pour lui, tout ce qui avait des ailes était signe de mauvais augure. – Sales bêtes, souffla-t-il, vivantes ou mortes elles me suivent partout. Il patienta près d’une heure, assis sur une pierre, maugréant d’impatience et suivant d’un œil las la cuisine infâme qui se préparait devant lui. Le louchon évidait maintenant l’animal, allait chercher ses entrailles fumantes jusqu’au fond de sa carcasse et lui se frottait ses doigts engourdis par le froid, contre ses joues, pour se les réchauffer et vérifier si le barbier l’avait bien rasé. Il allait renoncer – cela lui était déjà arrivé une ou deux fois – quand Génabia mit enfin le nez dehors. En l’apercevant, il se leva. Comme si elle avait attendu qu’il fût parti, elle sembla se désespérer de le trouver encore là. Il bondit aussitôt, sauta presque sur elle, fut incapable d’avoir une parole digne. Il ressentait du chaud, du froid, comme si la foudre s’était abattue sur son crâne. Son cœur d’adolescent battait la chamade. – Tiens, c’est pour toi. Il lui tendit le jambon qu’il avait porté avec lui une bonne partie de la matinée. Elle n’eut aucun mot de remerciement, prit le morceau de viande, disparut dans la maison, revint un long temps après. Elle mit son manteau sans lui accorder un regard. – Tu as froid, mon âme, c’est normal. Je pensais qu’on se promènerait sur la rive. J’ai entendu dire qu’avec la fin de l’embâcle, le fleuve charrie 66
plus haut des glaçons de la taille d’un bonhomme. On aurait pu les voir passer sous le pont. C’est très joli, un spectacle à ne pas manquer pour sûr. – Je ne peux pas. – Alors… – Toi pas comprendre moi. J’ai devoir à faire aujourd’hui. Il parut déçu ; on aurait presque cru qu’il allait se mettre à pleurer. Elle eut un coup d’œil rapide du côté des remparts, de la porte que gardaient Volomir et ses hommes, sembla se remémorer une parole, un ordre. Elle se rapprocha, se colla à Asinus qui sentit son cœur exploser à son contact. – Écoute, dit-elle en laissant perler sa voix légère, je veux, moi, être gentille avec toi. J’allais justement chercher toi pour dire. Demain, je serai moi à toi, à toi seul. C’est promis. Avant naissance du soleil, tu viendras chercher moi ici ; nous traverser le port et nous irons étendre nous là-bas, du côté autre de la rive, sur l’Île-avalante, pour voir aube. Où tu feras rire moi, boire, manger et je serai douce avec toi, tu veux, mon Seigneur ? Il ne pouvait lui résister quand elle l’appelait son Seigneur, elle le savait. Elle s’était faite soudainement chatte, lui caressa, pour conclure, l’entrejambe. Son physique n’avait rien d’irrésistible à proprement parler. Mais il se dégageait d’elle une finesse et un mystère liés au quotidien. Parfois les choses les plus familières suscitent l’intérêt quand on les regarde brusquement d’un autre œil comme si c’était un trésor que l’on découvrait alors qu’on l’avait depuis le début devant soi. Pour Asinus, Génabia était de cette beauté, anodine et surprenante. Ses cheveux roux, coiffés en tresse ronde, sentaient bon le miel, lui rappelaient des souvenirs agréables de sa vie. Il considéra son visage, les taches de son qui pommelaient ses joues, voulut trouver le secret de son ensorcellement dans ses yeux verts. Il ne l’avait jamais vue aussi convaincante. Il céda, ravi, transporté, s’en alla en sautillant comme un cabri. Il fut incapable de penser à rien d’autre pour le reste du jour. Le pas allègre, il s’échoua comme à l’accoutumée chez l’Allobroge où il retrouva Scythès et rêva, éveillé, aux galanteries qu’il aurait le lendemain pour sa belle. D’ailleurs, le ton était à la polissonnerie autour de lui. Les soulards habituels plaisantaient le patron sur les villes de son pays. Le nom de Cularo qui signifiait concombre en gaulois fit beaucoup rire lorsqu’on s’imagina Éroticus avec un membre raide et tout vert. Asinus, pris au jeu, mima Fannia Voluptas effarouchée, puis curieuse du fol engin. Le patron ne s’en offusqua pas ; il savait que les plaisanteries idiotes font boire et en effet, très joyeux de sa prestation, plus heureux encore de la promesse 67
inespérée de sa Psécas à laquelle il ne cessait de penser, Asinus se fendit de trois tournées de cervoise. Comme il réglait la deuxième, la tête alourdie par l’alcool, il trouva dans la ceinture de sa tunique une nouvelle écorce pliée. Il soupira ouvertement. Chéréas ! Encore lui ! L’homme était revenu peu après l’exécution de Sagéra – le temps sûrement d’être allé remettre en personne ses documents à qui de droit – et, comme prévu, Asinus l’avait revu une fois chaque mois depuis leur première entrevue, toujours averti par le même système agaçant, toujours la nuit, toujours en des endroits différents, pour lui remettre ses notes qu’il continuait de prendre quoique moins scrupuleusement qu’avant. Il déplia l’écorce, but une rasade avant de lire : « Minuit. Sous le pont. Dernière rencontre. Passe par la brèche du rempart derrière Borvu. » Dernière rencontre ? Vrai ? Tant mieux ! Bon débarras ! Le fatiguait-il assez ! Comme Cita, comme Cillimax ! Si ça n’avait tenu qu’à lui d’ailleurs, il ne serait même pas descendu sous le tablier du pont mais lui aurait balancé sa sacoche par-dessus bord en lui criant qu’il préférait désormais se faire crucifier que le revoir. Il était décidé à mettre de la mauvaise volonté pour manifester son mécontentement. Borvu le cordonnier ? L’animal habitait à l’autre bout de la ville, tout à l’est ! Hors de question d’y passer, de faire le tour des murs dans la campagne pour revenir. Non ! Il irait sur le port, au plus près ; il serait déjà bien bon de le faire, et si Chéréas voulait vraiment le rencontrer il n’avait qu’à se déplacer lui-même. Minuit venu, alors que la copona ne cédait pas au sommeil mais redoublait de beuveries derrière ses volets clos, il s’aventura dans la ville enténébrée. Une lune peureuse flottait au-dessus des toitures, alternativement cachée par les nuages comme si elle voulait fuir et ne le pouvait pas, tandis qu’au sol un brouillard léger envahissait les rues et barrait l’horizon à mesure qu’on approchait du fleuve. Il avait repris ses esprits, mollement décidé à s’acquitter comme il fallait de ses ultimes obligations envers l’agent de Pompée. Toujours suivi de Scythès, armé d’un seul glaive bien fragile pour déchirer la nuit sombre, il s’engouffra dans le dédale de rues que l’absence de lumière et de passants rendait lugubre. Vraiment, avait-on idée de lui faire traverser la ville à cette heure ! Il marcha sans faire de bruit, ordonna à son esclave de disparaître et de veiller incognito. Scythès recula d’un pas et ce fut comme si la nuit l’avait avalé. Bientôt son maître arriva en vue du port, désert après l’activité intense du jour. Il remarqua aussitôt que les sentinelles romaines n’étaient pas à leur poste et se troubla de leur absence. Mais plus encore, à une quarantaine de pas de la porte sud-ouest, là où les petits bateaux échappaient à la vue derrière la masse que formaient la 68
guérite des légionnaires et l’alignement des gros navires, là, une scène inattendue le surprit et l’obligea à sauter de côté pour mieux voir. Sous ses yeux, trois embarcations, frêles et basses, se remplissaient dans le plus grand des silences d’un chargement mystérieux. Leur mât démonté pour plus de discrétion, elles semblaient déjà pleines. Des hommes – une vingtaine au total – finissaient d’y empiler quelques coffres. Parmi les brouillards, on eût dit des fantômes tellement leurs silhouettes se confondaient dans l’ombre et leurs mouvements semblaient s’y glisser avec fluidité, couverts du seul léger clapotis du fleuve contre les coques. S’il n’était descendu des hauteurs de la ville en face d’eux, il ne les aurait certainement pas vus. Soudain la lune réverbéra sa pâle lueur sur la scène. Asinus entrevit quelques visages à travers les nappes de brume. Il n’en reconnut aucun, sauf un qui le glaça. À l’avant d’un des bateaux, regardant au-delà de la nuit comme s’il était loin d’ici ! À ses pieds, une bête des Enfers qui dressait ses oreilles pointues et, bâillonnée de la bouche aux chevilles, une ligne féminine qui se dessinait comme une proue de navire ! – Latro ! Et la gamine ! Ma parole, ils quittent la ville ! En même temps qu’il cria leur nom, il vit les amarres larguées et les trois embarcations s’éloigner sans jouer des voiles, emportées à la seule force muette des rames et des perches. Il les suivit comme s’il voulait les rattraper, les vit jeter sur leur chargement d’épaisses toiles avant de se coucher tous à bord, y compris le timonier. – Les fous ! Ils vont se faire repérer ! Il courut encore, put les observer remonter le courant au milieu des glaçons que la Loire faisait danser depuis la veille et s’éloigner dans la discrétion la plus totale. Il n’en revenait pas. Latro ! C’était bien Latro qui partait comme un voleur, sans ses troupes ! C’étaient donc les préparatifs d’un départ qu’il avait surpris le matin même. Que savait cet enfant de salop pour prendre la fuite ? Il voulut crier mais, au moment où un son allait sortir de sa bouche, une voix étrangère l’arrêta net : – Moi, je sais pourquoi il s’en va. C’est pour ça que je t’ai fait venir. La voix était anodine, sans timbre ni accent particulier. Elle venait de sous une barque accolée au rempart qui se jetait dans le fleuve. Une ombre en sortit, enfantée des ténèbres. Cette ombre, ce n’était personne, c’était l’homme multiface, c’était Chéréas. Comme ces bêtes de l’Inde qui changeaient, racontait-on, de couleur en fonction de l’endroit où elles étaient, il s’était fondu dans le paysage et semblait être le même que les fois d’avant et un autre sans qu’on pût dire exactement ce qui était changé ou demeuré chez lui. Il avait vraiment le physique de l’espion, toujours pareil, jamais le même, tout le monde à la fois et, pour cette raison, unique. 69
Depuis combien de temps ce protée nauséabond se planquait-il là ? Comment s’était-il glissé de l’extérieur de la ville où il était censé attendre à l’intérieur d’où Asinus n’avait bougé ? Au-delà des murailles, le pont était en effet plongé dans le noir. Une foule muette aurait pu le franchir sans être aperçue de l’une ou l’autre rive. Les veilleurs, sous les deux seules torches qui n’éclairaient rien, occupés à dormir ou à tromper l’ennui en jouant, étaient inaptes à donner l’alerte et il avait certainement dû trouver une autre brèche pour passer. – Laisse-moi deviner le moment où tu m’as glissé cette écorce que j’ai portée avec moi comme un idiot sans m’en rendre compte. – Ce matin, confia-t-il avec satisfaction en serrant sans poigne le bras d’Asinus, le badaud qui regardait la vente d’esclaves et qui t’a tapoté l’épaule… Tu as cru que c’était toi qui étais rentré dans lui, alors que celui qui a provoqué la rencontre, c’était lui, ou moi. Enfin, qu’importe ! La ville va connaître un grand chambardement, bien plus grand que la confusion que tu as provoquée à l’automne. Tu les as roulés dans la merde ; à leur tour, maintenant, de te la faire bouffer. Il souriait, content d’énoncer ainsi la menace, et ses dents jaunes se voyaient étonnamment bien dans le noir. Asinus n’avait pas envie de rire, lui. Toute révolution était mauvaise pour les affaires, surtout quand, à l’image des siennes, elles prospéraient sur l’ordre établi. – De quoi parles-tu ? C’est pour ça que Latro s’est enfui comme un rat ? – Disons que je l’y ai encouragé. – Toi ? – Les ordres, que veux-tu ? – Le lâche ! Ah, le lâche ! Il doit revenir. Au moins pour moi. Quelle manœuvre barbare peut effrayer un Romain à la tête de cent hommes et d’une légion de marchands plus farouches encore pour défendre la paix ? – Le genre de manœuvre qui cause le massacre des Romains, commerçants et légionnaires. Quand tout à l’heure je vais t’en dire plus, je vais t’effrayer comme une femme. Mais d’abord, tes notes… – Tu ne crois pas si bien dire. Rien ne m’effraie plus en ce moment qu’une femme, dit Asinus en lui tendant ses cylindres qu’il avait apportés comme à l’ordinaire. Il avait toujours la moitié du cerveau occupée par Génabia et la gravité du moment, loin de chasser son image, ne faisait que la renforcer comme une lumière qu’on cherche dans la brume. Chéréas parcourut rapidement les écrits, puis reprit : – Pompée a une dernière mission pour toi. Demain, quand les premiers rayons du soleil pointeront, les chefs gaulois, ceux qui ne sont pas 70
compromis avec Rome, vont se livrer à un bain de sang dans la ville. Ce sera le prélude à un soulèvement général de la Gaule. Aucun étranger ne doit en réchapper. Aucun, sauf toi et moi, si on la joue finement. – C’est-à-dire ? – C’est-à-dire que non seulement Pompée est au courant des événements à venir, mais il veut en plus que tu lui fournisses le témoignage le plus précis possible de l’insurrection. Pour avoir tous les éléments en main afin de présenter les faits sans les enjoliver au Sénat quand César demandera des renforts, ce qui ne manquera pas d’arriver. Ce sera ainsi pour lui l’occasion d’accabler un peu plus son rival, d’apparaître comme à l’époque de sa jeunesse en homme providentiel de Rome, de montrer qu’il est partout et qu’il sait tout de la situation de l’Empire. – Je vois ! Des notes, des notes, toujours des fichues notes ! Je n’ai jamais autant écrit que dans ce pays d’illettrés ! Et pourquoi ce ne serait pas à toi maintenant de jouer le scribouillard ? – Tais-toi, sombre idiot, répondit Chéréas en l’entraînant sous un abri de planches pour mieux s’y cacher, tu vas nous faire repérer. Écoute plutôt. Pour moi, Pompée a un autre projet dont tu es incapable : assassiner l’intendant de César pour être sûr de déstabiliser tout à fait l’approvisionnement des légions. Et si les Gaulois s’en chargent, être sûr que le travail est bien fait. Tu imagines : la fuite du centurion et la mort de l’intendant, c’est le désastre assuré pour le grand chauve ! Le grand chauve était César, la folle de Nicomède, l’ennemi juré. À l’évocation de cet assassinat, le ventre d’Asinus se serra. Il était gêné des risques extrêmes auxquels menait la politique et pressentait en même temps qu’il pourrait en tirer un immense bénéfice. Il ne dit rien, laissa l’autre poursuivre : – Quant à toi, tu vas te trouver une cachette suffisamment sûre et suffisamment éloignée pour embrasser d’un seul coup d’œil tout ce qui va arriver et le retranscrire ensuite. Tu connais un endroit pour ça ? Asinus réfléchit un court instant. Une idée lui vint : – Sur les îles du fleuve, on voit toute la ville, des hauteurs jusqu’au port. – Entendu. On se retrouvera ensuite dans trois jours à Gorgobina, chez les Boïens qui sont le peuple le plus sûr par ici, et je disparaîtrai tout à fait de ta vie tandis que toi, tu pourras revenir, si le cœur t’en dit, quand les choses se seront calmées. – Ton message laissait déjà croire que je ne te reverrais plus après ce soir… Mais qu’est-ce que j’ai à y gagner, moi, dans tout ça ? Je veux dire, à part aider celui à qui tout le Picénum voue un culte comme à un dieu. Je prends beaucoup de risques dans tes plans et tu ne me proposes même pas une nouvelle bourse d’argent... 71
– Cesse de faire l’enfant. De l’argent, tu en as suffisamment gagné par toi-même. Réfléchis. Cette révolte est désespérée, elle n’a aucune chance d’aboutir. César reviendra dans tous les cas, aidé par Pompée qui aura droit de regard sur la situation. Notre champion est toujours proconsul d’Espagne et, tiens-toi bien, il vient d’être nommé consul unique pour ramener l’ordre à Rome ! Il a plus de forces que César, des fraîches en outre, et les coudées franches. Mais il ne refera pas l’erreur de lui renvoyer des troupes comme il y a quatre ans ; il viendra en personne en franchissant les Pyrénées s’il le faut. – Il serait hors de son territoire. – Eh ! De toute façon il n’y a jamais mis les pieds. Il est resté à Rome. Rester à Rome, aller en Gaule, snober l’Espagne, c’est la même chose ; personne ne s’en offensera. Il semblait si sûr de lui qu’Asinus s’étonna de tels raccourcis. Il était meilleur espion que politique. Il reprit, sans même s’arrêter à ces détails : – Ce ne sera qu’une question de temps. Et quand il reviendra, tu seras le seul survivant, le miraculé du massacre, tous les marchés seront à toi. Les Carnutes ont la fibre commerçante, ils y reviendront ; et nous, nous savons nous souvenir de qui nous a aidés. Puisque tu m’en réclames, rappelle-toi les sommes que tu as reçues ces derniers mois de notre camp ; tu peux gagner bien plus, et tout seul, si tu sais y faire. Sur une de ces îles, en te cachant un peu, tu ne craindras rien ; et puis tu as ta grosse brute de Scythe pour te protéger. Asinus hésitait encore, n’osait refuser. Quoique l’action lui parût très dangereuse, la perspective de tenir enfin tous les marchés de la région le séduisait, surtout si l’on pouvait par la même occasion le débarrasser de l’autorité de Cita. Car Rome reviendrait de toute façon, il n’avait pas besoin de Chéréas pour le savoir : la romanisation était en marche, il l’avait suffisamment constaté. Cette insurrection, si elle éclatait, ne serait que le chant du cygne d’une nation à l’agonie, terrifiée de la mue qu’elle avait déjà entreprise et qui était irréversible. Il regarda la nuit sombre autour de lui. Tout dormait, tranquille, comme à la veille des grandes batailles ou des événements qui font l’histoire. Étaitil possible qu’une cité si paisible, si vouée au commerce sombrât le lendemain dans le carnage ? Étrangement il n’avait pas envie de fuir à son tour. Nulle part il ne voyait Scythès mais il sentait sa présence autour de lui comme un manteau épais qui l’eût mieux protégé que toutes les fourrures que l’argent peut offrir. L’invisibilité de son esclave le rassurait tout à fait. Et puis l’aura lointaine de Pompée l’entraînait, Pompée qui avait toujours protégé sa famille pendant la guerre civile, qui avait combattu les marianistes sans armure sous une pluie battante, qui était le dernier 72
rempart de Rome face aux ambitieux et à la raclure populaire – Pompée enfin qui était une légende. Il ne lui arriverait rien tant que ces deux hommes, l’un ici, l’autre là-bas, seraient à ses côtés. – C’est d’accord, dit-il simplement. – Parfait. À peine se furent-ils serré la main que soudain une bande d’inconnus, surgie du brouillard, les entoura. C’étaient six hommes hideux, armés jusqu’aux dents. L’un d’entre eux arbora un signe qu’Asinus ne reconnut pas dans l’obscurité : – Cet emblème, tu connais ? Notre seigneur Lugurix insulté par toi. Ce soir est avant-goût de demain. Tu vas être premier à payer humiliations faites aux nôtres. Mais aussitôt il y eut un mouvement derrière celui qui venait de parler. Une immense masse s’éleva en l’air et s’abattit sur son crâne qui éclata comme une souche. C’était Scythès, armé de son marteau de combat. Les deux canailles les plus proches furent éclaboussées de sang et de cervelle. Elles se ruèrent sur lui. L’esclave laissa alors paraître toute sa sauvagerie. D’un coup de tête, il envoya le premier dix pas plus loin ; il arrêta le second en le saisissant à la mâchoire et en la lui écartant si large qu’il lui en extirpa la langue à la lui déchirer de ses dents avant de lui rompre le cou. Deux autres l’attaquèrent encore, dans le dos. Il arrêta l’épée de l’un qu’il retourna, glissa sous l’aisselle de l’assaillant et remonta d’un coup pour la faire sortir à l’épaule opposée. L’autre, le dernier, voulut déguerpir mais glissa par terre. Le géant, d’un bond, lui enfonça alors un pli de son vêtement dans la gorge pour ne pas l’entendre gueuler, lui trancha comme une viande ses deux pieds, ses deux mains, le porta à bout de bras et le jeta dans l’eau pour l’y laisser s’y noyer. Tout s’était fait en silence, les Romains ne voulant attirer l’attention des gardes gaulois, les Gaulois celle des sentinelles romaines. – Où est Chéréas ?, dit Asinus à voix basse. Le chien, il s’est volatilisé ! Il pensa soudain : – Au fait, Scythès, ils étaient six, il en manque un ! Retrouve-le avant qu’il ne donne l’alerte ! Tandis qu’il lançait son ordre, le dernier homme de Lugurix bondit de nulle part et fonça sur lui. Scythès, encore sur la berge, était trop loin. Asinus ne parvint pas à tirer son glaive. Il était déjà mort quand un éclair inouï foudroya le Gaulois. Une lame venait de le transpercer du dos à la poitrine et le fit s’effondrer, les yeux grands ouverts de surprise. Asinus en tomba à la renverse, troublé, le souffle coupé d’avoir échappé au trépas de justesse. Il entrevit l’arme qui l’avait délivré. Elle était gauloise, venait d’être ramassée par terre. Une main se tendit à lui. Il la saisit, se 73
releva, retrouva ses sens. L’homme qui l’avait sauvé était vêtu comme n’importe quel indigène, ce qui l’empêcha de le reconnaître d’abord. Ce ne fut que lorsqu’il ôta la capuche de son manteau qu’Asinus s’écria : – Par Pluton, Magon ! C’était bien lui. – Il était temps, fit le jeune homme en jetant au sol son arme qui le dégoûtait. – Il était temps. Tu n’as donc plus ton bâton, celui dont tu devais me dire un jour le secret ?, dit Asinus soulagé comme si leur discussion à ce sujet datait de la veille. – Non, c’est une longue histoire. – Une autre s’en prépare. Figure-toi que tu es revenu au bon moment. Il paraît que cette drôlesse de cité va nous jouer quelques tours… Mais Magon s’en moquait ; il était venu venger un crime, récupérer son bâton, chercher celle qu’il aimait et qui était encore quelques instants plus tôt retenue dans ces lieux.
74
III L’INITIÉ
Magon avait passé de longs mois auprès d’Atis. Le soir même de son arrivée, après son échappée en pleine nuit, tandis qu’il se perdait en forêt, il avait cru leur entente brisée par sa faute. Il n’en fut cependant rien. Le druide, s’apercevant presque aussitôt de son départ, était certes parti à sa recherche, furieux comme un cerf en colère, frappant de son casque à grande ramure les branches basses et l’écorce des arbres en travers de sa route. À mesure qu’il marchait, il était même devenu ce cerf, mais un cerf féroce tenant davantage de ceux qui poussaient jadis l’homme au fond des cavernes que de ceux qui fuyaient aujourd’hui devant lui. Il piétinait la terre de ses sabots, s’apprêtait à raire au moindre obstacle et charger quiconque le croiserait. Pourtant, quand Magon, attaqué précisément par ce type d’animal et tombé évanoui, reprit ses esprits, Atis s’était tout à fait calmé. Le jeune homme était inerte devant lui, encore étourdi et blessé, ses vêtements en lambeaux comme s’il avait été tiré sur une longue distance. Le druide l’avait secouru, installé sur un lit de feuillage, avait attendu son réveil. Là, sans provoquer d’explications ni verser de reproches inutiles, il lui permit, en lui faisant boire un breuvage secret, d’aller à Génabum, mais de s’y déplacer en pensées pendant que ses membres restaient au repos, et de voir ce qu’y devenait la civilisation en son absence. À Zür Bakal en Assyrie, les mages d’Oribal n’avaient pas de potions plus puissantes. Ce fut un nouveau prodige dont Magon connut l’expérience. À peine éveillé, il eut la vision, à plusieurs lieues de distance, de l’exécution de Sagéra. Il vit tout, entendit tout, ressentit tout, non seulement comme s’il y était, mais comme s’il y était doué d’un impossible don d’ubiquité, présent à chaque endroit du lieu du crime, dans les yeux des bourreaux, des complices, des témoins jusque dans les veines brûlantes de peur du malheureux qu’on immolait. Quand la vision s’estompa et qu’il revint à lui, il lui sembla que les cris de douleur atroces de Sagéra battaient encore à ses tympans.
Il retomba sur son lit de feuillage, fut un temps hébété, se laissa remettre sans le sentir un emplâtre propre sur sa plaie encore vive à la tempe. Quelque chose venait de se briser en lui. Bien sûr il savait les crucifiés, les torturés, les jetés-aux-lions de tous royaumes ; mais c’est une chose d’entendre parler de supplices ailleurs et une autre de les voir infligés devant soi, sur celui avec qui on a partagé son repas peu auparavant. Lui qui donnait sa vie pour les autres, pour le savoir, la médecine, lui qui avait voyagé si loin afin d’aller à la rencontre du monde, apprendre de lui, et partager, et combattre les préjugés d’ignorance eut soudain envie de baisser les bras. Il eut envie de retourner dans la bibliothèque de son enfance, de s’y enfermer avec ses chers volumes. Mais il se souvint qu’il avait tout vendu avant de partir. Alors il se sentit seul, sans ressources, pris de regrets devant la cruauté de ses semblables, comme si, avec Sagéra, ç’avait été un peu de son ouvrage qui avait brûlé et son périple en Occident qui avait brutalement perdu sens. À quoi bon tout cela ? Les hommes lui semblaient des monstres pires que celui qu’il avait aidé à mettre au monde en venant dans ce pays, ce nouveau-né qui était innocent et que la nature avait eu la dure sagesse de faire disparaître avant même qu’on pût le voir à la lumière du jour. Il envia la pauvre mère du petit défunt qui avait eu la bonne idée de dormir, effondrée de fatigue, pour ne pas le voir périr. Il conçut une amertume poignante de tant d’ironie. Il se trouvait par hasard étendu dans un creux au milieu de rochers. Autour de lui, à l’exception de la flamme dans laquelle était apparue sa vision, il n’y avait que des cailloux énormes, hérissés ou lisses, tous dénués de végétation et apparemment de vie. Il en eut un profond frisson. Non pas qu’il fît froid mais, sans vêtements, les premiers mouvements des bras et des jambes qu’il eut lui firent toucher la roche et le sol d’une fraîcheur morbide. Une lointaine réflexion de sa jeunesse, selon laquelle les hommes sont des pierres, lui revint en mémoire et, pour la première fois de sa vie, il ne la trouva pas excessive mais juste. Il pleura de mélancolie. Ce fut à ce moment qu’Atis lui tendit la main : – Il est temps de m’en aller. Je retourne près de la Divona. Nous ne sommes pas très loin. Tu es libre de venir chez nous ou de repartir à Génabum pour recouvrer toutes tes forces. Magon eut pour lui un regard de gratitude. Alors qu’il ne savait plus à qui se fier devant tant de barbarie, cette main tendue malgré la faute, cette main qui pardonnait lui permettait de croire encore dans la science et suivre celui qui semblait le plus barbare et l’était sans doute le moins. Atis avait beaucoup à lui apprendre, c’était tout ce qui comptait. Cette issue inespérée, il s’y jeta même éperdument, y retrouva une force insoupçonnée quand il agrippa le bras du druide. Car il n’avait qu’elle. 76
La seule autre qui s’offrait à lui, celle du cœur et non de la raison, le terrifiait à vrai dire. Il n’osait y penser. Retrouver Aldéa – il s’agissait bien de cela – risquait de signifier que les sentiments réciproques qu’ils avaient éprouvés l’espace de quelques jours s’étaient peut-être envolés et qu’il pouvait n’être devenu pour elle qu’un poids dans la reconstruction de sa ferme ou, pire, qu’elle n’avait jamais été rien qu’une forme de réconfort pour lui, bercé de ces illusions amoureuses que l’on connaît lorsqu’on est dans la solitude et l’adversité à des milliers de stades de chez soi. Après tout, ils se connaissaient si peu, venaient d’horizons si lointains ; les vérités affectives, contrairement à la science, étaient choses si fugaces auxquelles il convenait de ne pas trop accorder créance. Il préféra emprunter la voie du travail et de la sagesse. – Tu acceptes que je revienne chez toi ?, demanda-t-il enfin. – Si je te dis qu’un homme s’est perdu en forêt, qu’un autre le retrouve, comment peut-il lui être bénéfique ? Est-ce en le soutenant et en l’emmenant où il le souhaite ? Ou en l’en empêchant au contraire et en lui montrant que le chemin qu’il a choisi est périlleux ? – En continuant sa route et en le laissant libre de le suivre ou non car l’homme qui marche est toujours un guide pour celui qui est immobile et veut bouger. – C’est exactement cela. Ton coup à la tête ne t’a pas fait perdre la justesse de ton jugement. Tu n’as pas besoin de demander si tu peux revenir car ce n’est pas une faveur que je te rends mais un effort que je fais sur moi-même de passer outre. La Déesse ordonne que je croie en ta sincérité. Ce n’est pas ma volonté qui parle. La Déesse : Magon se souvint. Le culte de Calroë, qu’il n’avait réussi à démêler que de loin sans bien le comprendre, imposait une forme d’abnégation que seuls les peuples du Nord avaient encore la pureté rare de manifester. Elle était la déesse du don de soi et imposait de sacrifier sa volonté, ses convictions à celles d’autrui. Il médita que ce pouvait être pour cette raison que, sans le décider mais obéissant inconsciemment à ces ordres supérieurs, il était amené à rester ici, apprendre, dire ensuite ce qu’il aurait appris pour aider les autres. Atis l’avait sans doute compris, donnant de sa personne à Magon afin que Magon donnât à son tour à qui en eût besoin, le soignant lui pour qu’il en soignât d’autres tant le sacerdoce du prêtre s’accordait avec celui du médecin. – La Déesse…pourquoi l’ordonne-t-elle ? Atis, j’aimerais savoir, j’aimerais enfin savoir qui elle est véritablement si c’est à elle que je dois de pouvoir revenir parmi vous… Il en avait le droit et Atis n’avait aucune raison de refuser de l’instruire. L’occasion était propice. Le druide accepta de parler, de donner tous les 77
détails que le jeune homme réclamait. Il commença, ne s’arrêta plus : il était enthousiasmé. Objet d’un culte ancestral que les Gaulois avaient oublié, Calroë était une divinité de l’amour, mais de l’amour fondamental qui fait en sorte que les choses s’assemblent, que la terre aille avec le ciel, que le sang aille avec la vie, qu’une femme s’unisse nécessairement à un homme pour former l’univers et lui donner sa cohérence. Elle ne connaissait la vieillesse ni la mort ; son action, féminine, stimulait les énergies premières, les principes complémentaires qui régissent le monde. Partant, elle était la déesse de la santé, de la beauté, du bien, de la fécondité, de la force qui ne fait pas frapper comme une brute, mais se lever, avancer, évoluer dans la plénitude de son être. Déesse nourricière, porteuse de fertilité, elle réveillait les vigueurs végétales quand la nue pénètre le sol de ses ondées et elle prodiguait les fruits de l’union des éléments aux mortels. Céleste ou populaire, immatérielle ou charnelle, elle était aussi la bienfaitrice des femmes qui se donnent, de celles qui offrent leur corps, leur âme, leur existence farouche et chaste, la protectrice des mères en couches, des femmes nubiles qu’elle accompagnait aux premières joies, des filles faciles qui cèdent leurs charmes et se perdent à jamais. Elle les encourageait à s’accoupler avec qui leur semblait bon pour assurer la perpétuité des races et la continuité des saines jouissances. Elle-même avait un mari, mais allait avec d’autres. Son époux d’ailleurs était son exact contraire, le dieu des faibles et des chétifs, qui autorisait la lâcheté et la mollesse dans le monde, un dieu si vil que son nom, tabou, avait été oublié au fil des âges ou qu’il ne s’était jamais su. Selon la tradition la plus répandue, elle en avait eu deux fils et une fille : Enjôleur et Désiré qui embellissaient ce qu’ils touchaient, Harmonie qui complétait l’œuvre de sa mère. Quant aux hommes, elle leur imposait le sacrifice de leur personne, un don d’eux-mêmes qui ne passait pas par une défloration ou un accouchement, mais par un renoncement provisoire de leurs qualités les plus hautes, une suspension momentanée de leurs idéaux et de leurs valeurs les plus chères en faveur d’autrui s’ils étaient sollicités. Car l’homme, disait Atis, est tout esprit quand la femme n’est que passion et il était normal qu’il offrît à la Déesse ce qui le caractérisait le plus. Aussi Calroë encourageait-elle physiquement ses fidèles à répandre dans le monde leur semence où résidaient leurs vertus pour les transmettre à leurs rejetons et en abandonner, croyait-on, une partie. Intellectuellement, elle appréciait l’abdication temporaire de toute volonté pour résister aux tentations faciles de haine, de colère, de violence puisque seuls les forts peuvent se montrer mesurés sur un terrain où ils sont sûrs au final de 78
gagner. Elle voulait que l’homme prouvât sa fermeté en faisant, sur luimême, l’effort d’accepter ce qu’il n’aurait jamais toléré par ailleurs ; elle demandait qu’un père sacrifiât ses rêves pour ses enfants, un guerrier sa vie pour sa tribu, un professeur ses secrets pour ses élèves et tous les curieux désireux de l’écouter. Pour cette raison, Atis, que cet impératif divin obsédait, avait retendu la main à Magon et l’avait accepté de nouveau près de lui. La théogonie de Calroë la disait née de bourgeons hors saisons. Son culte, qui ne dépassait pas le territoire des Carnutes, se rendait à l’air libre, en plein bois, sans sacrifice ni procession, le matin très tôt ou le soir très tard quand la rosée fertile coule comme coulaient d’elle les gouttes de plaisir. Elle était une divinité sauvage, étrangère aux villes et aux champs, qui hantait les forêts encore vierges où elle conduisait une compagnie tumultueuse et bondissante d’animaux autour d’elle. Son arbre était le chêne dur, et on l’appelait parfois la Dame de l’arbre ; quoiqu’elle eût des aptitudes à la chasse, la biche, la laie, la femelle coucou lui étaient associées et il fallait se l’imaginer affublée de pattes de biche, coiffée de tresses à la manière d’un nid, parée de défenses animales pour détourner le regard de sa nudité. Déesse des sources fécondantes, des cours d’eau, des prairies arrosées, elle déroulait sous ses pas un frais gazon humecté et toujours pour elle les chemins se couvraient de bosquets et de fleurs. Elle les faisait naître, les imprégnait du parfum de sa peau ; on la disait alors la Fleurie. Le paradoxe en revanche voulait qu’elle ne fût pas honorée par des prêtresses, mais par un seul homme qui avait la tâche de s’unir à elle, près d’une source ou sous un feuillage consacrés, lors de rites dont le spectacle était interdit à tout autre que lui. Si l’on ne pouvait y accéder, aucune règle n’empêchait véritablement d’en parler, mais l’usage s’était installé d’en taire les détails pour lui donner plus de mystère. Les populations s’y référaient comme à une lointaine légende dont les différents épisodes prenaient un goût énigmatique savoureux. La connaissance du commun s’éloignait, les élucubrations prenaient le pas sur la vérité. On prétendait ainsi qu’une fois par an, la Déesse venait chercher un fidèle avec qui elle couchait et qui en demeurait aveugle pour le reste de ses jours. Le fait en était devenu proverbial : on demandait souvent avec amusement à une personne pressée que l’on croisait si elle avait vu Calroë venir pour fuir de la sorte. Il fallait l’avouer, le culte était en perdition et l’absence de cérémonie officielle aggravait la situation, la Déesse n’étant jamais associée aux affaires de l’État ni à la vie publique. Chez ceux qui l’adoraient encore, il n’y avait d’ailleurs pas non plus de véritable culte. On se contentait de l’honorer dans l’intimité de chez soi par des gestes simples, modestes, 79
spontanés comme lorsque l’on lui dédiait le vêtement souillé d’une femme devenue mère pour la remercier de l’heureuse naissance qui venait d’avoir lieu. Le culte qui comptait, des siècles auparavant, parmi les plus importants du pays était devenu fragile. Il annonçait la fin d’un monde. Mais, se rassurait Atis, il valait mieux cela que le céder aux dévoiements des ignorants. Magon ne croyait guère à la mythologie. Sa religion était de pratique seulement et, s’il appréciait la poésie des fables, il n’en tirait aucune vérité. Les dieux qu’il se plaisait à imaginer et dont il parlait couramment n’étaient pour lui au pire que des personnages de théâtre inventés de toute pièce, au mieux des entités abstraites qui symbolisaient des principes naturels et c’était à ce titre qu’il les priait. Il ne put s’empêcher, en particulier, de sourire lorsqu’Atis évoqua l’union de la Déesse et de son prêtre. Il pensa qu’il s’agissait d’une représentation figurée de Calroë et l’idée qu’un homme copulât avec une statue de bois ou de pierre le dépassa véritablement. Dire que c’était pour cela que le druide lui avait interdit de se rendre à la source sacrée, voir de plus près l’eau merveilleuse qui y sourdait ! Mais il ne fallait s’en étonner : la romanisation avait introduit les représentations concrètes des divinités comme celles convoquées à l’exécution de Sagéra ; elle en avait aussi insufflé les vices inhérents comme les turpitudes auxquelles un esprit pervers peut se livrer avec une image sculptée. C’était dommage. Du reste, il ne vit en Calroë rien qu’une figure très connue – un mélange de Vénus, de Diane et de Tanit. Cependant Atis avait répondu honnêtement à sa demande, amèrement même quand il s’était agi de reconnaître l’évolution du culte dont il était le gardien. Après avoir songé que ses paroles concordaient avec toutes les fois où il avait entendu prononcer le nom de Calroë, Magon fut enfin satisfait. Enfin, il lui semblait discerner la vérité sur le mystère qui lui échappait depuis son arrivée par ici ! Enfin, il avait la pièce manquante pour reconstituer ce qui n’était qu’un pêle-mêle énigmatique, la clef interprétative pour ouvrir une porte qui se dressait depuis trop longtemps sur sa route et l’empêchait de pénétrer dans les arcanes de la Déesse ! Enthousiaste, il se leva, oubliant presque les douleurs dont il était perclus. Le cerf avait déchiré le vêtement qu’Aldéa lui avait offert : il en fut triste mais le prit pour le signe qu’il devait momentanément oublier la jeune fille et se concentrer sur ce qu’il pourrait apprendre dans cette forêt. Maintenu par le druide d’un côté, se servant de l’autre de son bâton qu’il n’avait pas perdu dans tous ces événements, il éprouva encore quelques vertiges, eut des frissons, tint bon. Atis lui passa sa cape sur les épaules. Ils entamèrent leur retour, l’un torse nu, l’autre habillé de la seule fourrure blanche qui lui avait été prêtée. 80
En sortant des rochers où il avait repris connaissance, dévalant une légère pente pour regagner le chemin qui devait les mener à la Divona et à l’arbre du maître, Magon s’aperçut alors que toutes ces pierres n’étaient pas aussi froides et arides qu’il avait cru les voir quand il y était allongé, mais si couvertes d’arbustes qui y poussaient, d’animaux qui y rampaient, d’eaux chantonnantes qui y coulaient qu’elles donnaient l’impression que même les rocs les plus durs peuvent respirer et frémir à l’unisson avec les bois qui les entourent. La cause en était simplement qu’il ne les voyait pas ainsi d’où il était étendu. Une seule position, allongée, debout, avait modifié fondamentalement l’aspect de ce qui l’environnait. On ne voit souvent que ce que l’on peut voir, que ce que l’on veut voir et l’apparence trompeuse des situations est alors le fait de nos propres erreurs d’interprétation, a fortiori quand la tête nous tourne comme elle lui tournait. Il reprit confiance. Il portait un regard nouveau sur toutes choses. La forêt d’ailleurs était belle – avec toute l’amplitude que peut revêtir ce mot banalisé. Elle provoquait chez lui un enchantement identique à celui qu’il avait connu à sa venue en son sein, lui rendait de premières forces. Il la sentait protectrice et sauvage, familière et mystérieuse comme les forêts des contes à dormir debout. Était-ce parce que son île natale n’en connaissait pas de pareilles ? Toujours est-il que ses arbres, des racines jusqu’au bout de leurs branches, étaient gigantesques. Ils auraient pu toucher le firmament où l’on raconte aux grands que passe le soleil et aux enfants que les étoiles de métal sont aimantées à la voûte céleste. La frondaison d’une infinité de spécimens enveloppait ceux qui marchaient sous les bois d’une tiédeur maternelle profonde. Ils allèrent toujours droit devant. L’itinéraire parut très simple, sans plus de méandres labyrinthiques, à tel point que Magon se demanda comment il avait pu s’y perdre l’avant-veille. Il était maintenant si facile de retrouver son chemin qu’Atis le laissa bientôt aller seul et adopta de nouveau son rythme de marche qui le fit avancer une trentaine de pas en avant. La futaie, où des brumes cuivrées flottaient toujours dans le refrain approchant de la source sacrée, était plus giboyeuse que la terre avant le déluge de Deucalion. Ils furent accompagnés de renards, de rongeurs, d’oiseaux multiples qui les suivirent sans s’enfuir ni sans rien avoir de terrifiant. Un seul animal troubla Magon, un grand cerf blanc d’une race inconnue, au poitrail épais, aux bois énormes, aux membres fins qui les suivit longtemps d’un pas silencieux entre les arbres. Magon le reconnut. C’était lui, l’animal qui avait failli le tuer et qui maintenant avançait si tranquille ! Il fut soudain frappé de la ressemblance qui existait avec l’allure d’Atis. Plus il les observait marchant tous deux à quelques enjambées de distance, plus il lui semblait voir en l’un le reflet de l’autre dans un miroir, 81
comme les parties animales et humaines d’un seul et même être. Le casque du druide, évidemment, ajoutait à la confusion. – Atis, ce cerf… Atis l’avait vu. Plutôt il avait eu d’emblée l’intuition de sa présence puisqu’il ne se donna pas la peine de tourner la tête pour le voir. – C’est le grand cerf, dit-il sans arrêter sa marche et en posant soigneusement le pied sur un tapis de mousse glissante. Il est le dernier représentant de son espèce. Elle était autrefois nombreuse quand les hommes vivaient en harmonie avec elle, quand ils habitaient dans les arbres ou les parois des montagnes et honoraient la Déesse biche. Mais l’homme a fait le choix des villes, de la technique, de la violence ; il a oublié ce que signifiait la piété véritable et la population du grand cerf a dépéri, à l’image de ces bois morts que je porte sur la tête pour rendre un mince honneur à celui qui fut le prince des forêts. Il ne reste sans doute plus que celui-ci aujourd’hui quoiqu’on m’ait rapporté qu’il en existait encore un ou deux spécimens dans les forêts plus au sud. Mais je n’en suis pas sûr. Voilà bien des années que je ne m’y suis pas rendu, que je ne suis d’ailleurs pas allé plus loin que les Pierres Rouges où tu m’as rencontré. Les us se perdent et les derniers sanctuaires semblent fragiles. – Mais, c’est ce cerf qui m’a attaqué… – C’est probable qu’il ait voulu t’attaquer, reconnut Atis, avant que la Déesse ne le rappelle à ses ordres. Nous avons tous nos faiblesses. Il baissa la tête, sembla navré. Le cerf en face parut faire de même. Il ne montrait plus aucune intention de nuire, allait paisiblement son chemin. Bientôt, tandis qu’Atis passait dans un bouquet de frênes, la silhouette claire de l’animal disparut derrière un arbre plus gros que les autres et ne réapparut plus comme s’il se fût uni au druide pour former un corps unique. Magon n’eut pas le temps d’y penser. Ils étaient arrivés. Aux premières rigoles d’eau claire qui couraient entre les herbes, Dagios, le jeune apprenti d’Atis, vint, comme la fois précédente, à leur rencontre. Il était coiffé d’un chapeau conique en écorce de bouleau. Il n’eut aucune question sur l’aspect lamentable de Magon, blessé et quasi nu, mais interrogea de nouveau sur sa présence. Quelles raisons avaient poussé le druide à accepter sa venue si près de la source sacrée ? Ou plutôt pourquoi avait-il simplement accepté son retour ? – C’est vrai, Dagios, dit le druide en ôtant ses bois ; comme tu le sousentends, j’ai d’abord été en colère contre notre ami. Puis j’ai compris qu’il avait été sincère dans son erreur et j’ai choisi de lui accorder une seconde chance. En fait c’est la Déesse qui l’a choisi car, retiens ceci, le culte de l’Adonnée consiste moins à rendre des bienfaits à autrui qu’à faire un 82
sacrifice de soi imposant que l’on pardonne à celui qui nous a trompés. Magon de Malte n’a même pas voulu nous tromper. Son erreur a été sincère ; il a le cœur pur, je le sens. Il est de nouveau le bienvenu et nous ne parlerons plus de ce qui s’est passé. Magon vit nettement les lèvres de Dagios se plisser comme si elles brûlaient de répondre. Mais le jeune homme garda le silence et, dans un sourire un peu contraint, tendit la main à son tour en signe de bienvenue. Ils pénétrèrent dans l’arbre-logis dont le Maltais eut les plus grandes difficultés à gravir les marches. Dans la partie basse enfin qui servait de pièce commune, il ne trouva plus le grand tronc creusé si inconfortable et miteux, ne se gêna pas des moisissures ni des toiles d’araignée. Il s’affaissa de lui-même sur ce qui était devenu sa paillasse et qui n’avait pas été enlevé. Il y dormit un jour de plus d’un sommeil réparateur. Dans la petite cage ouverte, le jeune pinson au bec gris bleuté chanta des notes brèves mais vigoureuses pour célébrer son retour. Quand il se réveilla, il trouva près de lui un petit tas d’habits appartenant à Dagios, des braies couleur châtaigne, un sayon cousu d’une capuche, des brogues souples qu’il enfila – autant de vêtements qu’il ne changerait pas durant tout son séjour. Dehors, l’enseignement d’Atis avait repris en marchant ou s’asseyant près du feu. Il s’y joignit, sans y participer. Au-delà de préceptes généraux tels qu’honorer les dieux, ne rien faire de mal, s’exercer à la bravoure, cet enseignement, que le druide n’était pas allé apprendre comme les autres en Bretagne, était constitué de trois pans majeurs qu’il fallait maîtriser avec une égale perfection et qui avaient chacun des objectifs intellectuels, physiques ou spirituels relatifs au culte de Calroë. Parce que celle-ci était la déesse des principes naturels simples et complexes, variant dans leur infinité des douleurs de la naissance à celles de la mort, il s’agissait d’abord de tout connaître de son environnement, que ce fût la faune, la flore, l’air qu’on respirait dans sa forêt, d’en connaître les noms, les propriétés, les vertus salvatrices ou dangereuses. Il était par exemple question de se familiariser avec la nature au point de se passer d’instruments parce que les animaux et les plantes, si on les choisit bien, peuvent être nos outils en même temps que la matière de nos drogues. Mais la verveine, le samole, la selago ne suffisaient pas. Atis ne reculait devant rien de périlleux ni de rebutant. Il apprenait à récolter très haut le gui qui parasite les arbres, à ramasser les champignons dits vénéneux, à user de la toxique datura, à manger les œufs de serpents et les viandes décomposées pour en tirer des bienfaits parce qu’il ne fallait pas craindre de tout utiliser de la terre nourricière que l’homme maltraite pour la rendre à son image alors que, vierge, elle regorge de ressources insoupçonnées. Il 83
disait souvent qu’il est normal que les plantes nutritives, celles qui sont les plus salutaires, soient les plus rebutantes et les plus dangereuses à recueillir : c’est pour que les mains effrontées ne les arrachent ni qu’un gros pied ne les foule. En les munissant d’aiguillons, en leur donnant des armes, la nature a mis à l’abri des atteintes les remèdes qu’elles portent et les a réservés aux seuls initiés – ce qui était, selon lui, une bonne chose. Il ramassait pareillement les excréments de renard, les fientes de chevreuil, l’urine des sangliers pour guérir les yeux ou soigner les pustules. Tout était ainsi objet d’étude, de découverte, d’optimisme. Dans sa science, le druide mêlait des constatations rationnelles à des élucubrations et des tournures poétiques qui le différenciaient de ses semblables. Il croyait au merveilleux et son enseignement incitait à y croire. Des astres par exemple qu’on entrevoyait à quelques endroits rares mais suffisants : il parlait de leur nature, de leur origine, de leur distance de la terre, il semblait au courant des théories et des calculs des savants grecs et, en même temps, il prétendait que certains avaient des pouvoirs divins sur le monde parce que, dans une constellation d’étoiles plus brillantes que les autres, il voyait Calroë allongée sur le coude, très désirable et bien nue, qui regardait les hommes et leur soufflait ses volontés. L’ascèse et la contemplation tenaient alors une proportion importante. Puis, la Déesse était aussi celle des corps sains autant qu’entretenus. Donc il fallait prendre soin de son corps pour l’honorer, s’exercer aux pratiques les plus endurantes, aux marches les plus longues, à l’escalade des arbres les plus élevés, à la course contre le lièvre rapide, au face à face avec le loup terrifiant aux marges du monde civilisé. Il ne s’agissait pas de se préparer à combattre pour répandre un jour la violence, mais de faire l’offrande de son ardeur et sa santé. On devait pour cela non seulement se rendre fort par cette gymnastique, mais aussi se rendre beau en sculptant ses muscles, en entretenant sa peau lisse et blanche, en choisissant soigneusement le tatouage qui la marquerait à jamais, retrouvant là le goût des Celtes pour les physiques virils soignés. Ils étaient conscients de la beauté de leur corps, du sentiment de puissance qui en émanait. Souvent ils se lavaient ensemble, se raclaient mutuellement le dos, le torse, les jambes, s’épilaient tout entiers, se taillaient la barbe ou la moustache pour plaire, disaient-ils, à la Déesse. À côté des exercices les plus rudes, les manipulations fines, les travaux délicats des doigts et des poignets n’étaient pas négligés. C’était la partie proprement esthétique de l’apprentissage. Savoir dessiner, ciseler, polir revêtait une grande importance et Atis insistait pour que Dagios entraînât aussi ces parties fragiles de son corps et sût représenter tel animal, telle plante sur une surface plane ou en relief. Les manières de faire allaient de 84
la simple trace laissée par la pointe d’un silex aux incisions plus profondes et à la sculpture à coups de burin. Les couleurs étaient celles du charbon de bois pour le noir et de l’argile dont la teinte ocre variait du rouge au brun-jaune ; il n’y avait pas de bleu, pas de vert, pas de blanc ; on peignait au pinceau naturel ou à la technique du soufflé. Avec le peu que la forêt offrait de matériel, le druide obtenait des résultats étonnants dignes des plus grands artistes de Grèce, Zeuxis ou Parrhasios qui faisaient payer des millions leurs œuvres et excellaient dans l’art du trompe-l’œil. Il était capable de représenter avec une si grande perfection un serpent ondulant sur une branche ramassée, un œil de lynx sur une pierre ronde qu’on eût vraiment cru voir la pierre ou la branche prendre vie et fixer les hommes ou ramper vers eux pour les mordre. Parfois, au contraire, il se contentait simplement de graver sur une écorce ou dans le sol le signe de la Déesse : trois cercles entremêlés percés de deux traits de chaque côté et d’un troisième rayé qui tombait du milieu. Enfin, Calroë étant l’une des divinités les plus ancestrales dont les derniers peuples installés en Gaule n’avaient même jamais entendu parler, il était nécessaire d’apprendre la langue adéquate pour oser s’adresser à elle, parler de sa personne, comprendre ses mystères. C’était une langue technique, archaïque, compliquée, propre au sacerdoce, que l’immense majorité de la population aurait prise pour un dialecte obscur. Et peut-être l’était-elle avec son vocabulaire spécifique, sa grammaire, ses métaphores. On ne pouvait en faire usage comme de n’importe quel idiome, mais uniquement pour mémoriser des centaines de récits et assimiler plusieurs milliers de vers à réciter sur la bonne mélodie si l’on voulait qu’ils eussent un sens. Tous concernaient bien sûr Calroë. Ils racontaient ses métamorphoses en animal, comment elle s’était offerte à la chasse du roi Danuar, comment elle avait aidé le dieu Smertrios pourfendeur de monstres, comment elle avait réconcilié les amants du Loing – cette rivière que l’ancien gaulois appelait Lupa pour désigner l’eau qui coule et que le latin traduisit par la louve avec tous les fantasmes érotiques qui lui étaient attribués. Quand ils ne relataient pas un mythe précis sur Calroë, les vers exprimaient de simples odes censées faire sentir sa puissance tout autour épandue. Dagios en connaissait déjà sept de ces histoires, qu’il était capable de réciter avec tant de justesse que sa prestation faisait frissonner ; le maître, lui, en avait trois cent cinquante grandes dans sa besace et un tiers de petites. À cela s’ajoutaient les leçons de musique et de danse. Calroë aimait le chant, le sifflement de la flûte de bois, les chorégraphies austères et vigoureuses. Cet enseignement occupait de longues journées qui ne souffraient d’aucune distraction. Ils pouvaient marcher très loin, jusqu’à des grottes 85
inconnues où le maître procédait à ses fumigations. Le soir, éreintés, ils dormaient d’un sommeil écrasant. Seul Atis en profitait occasionnellement pour quitter la forêt et aller cueillir ailleurs des herbes de prairie sans risquer une rencontre importune. D’autres fois, quand la lune était pleine, il semblait entendre une voix qui l’appelait, irrésistible. Il allait alors rendre son culte à Calroë, s’unir à elle comme il l’avait dit à Magon. La Déesse n’avait pas de temple, de lieu consacré autre que les rives de sa source. Au milieu de la forêt qui formait déjà sanctuaire, la Divona apparaissait comme une chapelle, une chambre féminine qu’il était interdit de pénétrer sans l’aval du druide. Les bois y semblaient plus sombres, plus épais. Aucun fidèle n’était autorisé à s’y rendre sinon le prêtre. Nul ne savait ce qui s’y passait exactement, les prières et les rites qu’on y menait et surtout comment se concrétisait la métaphore de l’union avec la Déesse. Car il s’agissait d’une image, évidemment, que Magon encore moins que quiconque n’aurait osé clarifier même si sa curiosité le taraudait. Ce qui en achevait le mystère, c’était qu’Atis rentrait toujours tard, à la limite du jour, en pouvant à peine se soutenir. Sa gorge pantelait, son corps exhalait une odeur animale, ses muscles contractés de crampes semblaient le faire souffrir jusqu’à se détendre tout à fait. Ces nuits-là, Magon faisait semblant de dormir. Dagios, lui, regardait son maître de ses yeux ahuris, se demandant s’il devrait livrer pareil effort le jour où il lui succéderait. Le jeune disciple justement écoutait, se concentrait pour apprendre. Magon l’observait comme si ce fût lui à sa place. Dagios montrait une application certaine, voulait bien faire. Il était très doué pour les exercices du corps, point trop mauvais pour ceux de l’esprit quand il s’attache aux choses concrètes ; il révélait en revanche des fragilités pour les questions philosophiques, les idées abstraites dont il ressentait un chagrin mêlé d’irritation. Comment pouvait-on prétendre être l’héritier de générations de grands sages si l’on ne pouvait défendre ses croyances face aux attaques des dialecticiens et des sophistes ? Souvent, dans une discussion qu’il tenait avec le druide, il peinait à avoir la réflexion juste, pertinente, qui mène loin et l’on devinait Atis un peu déçu des apories où il se cantonnait. La démonstration de la nécessité du bien conduisit ainsi à un désastre. Là où les autres druides en faisaient le fondement d’une morale, ce qui était déjà novateur chez les Gaulois, Atis le plaçait, lui, au cœur même du culte de Calroë en en faisant, pour la première fois, une fin religieuse. Il voulait prouver à son élève que du bien naît la force et que la Déesse voulait cela. Mais Dagios eut du mal à l’entendre. La discussion, renouvelée plusieurs fois, s’embrouilla toujours, s’enferma dans une situation où le maître imposa ses idées sans que l’autre en fût profondément convaincu. Magon aurait voulu, en ces instants, parler en son nom, lui qui avait tant à dire et 86
qui se taisait par politesse quoique bien souvent ce qu’il avait à dire s’avérât être au final conforme aux attentes du druide. D’ailleurs il aurait aimé participer à cet enseignement, ne pas en être le simple spectateur. S’abstenir de toute intervention, rester muet sans bouger de son siège au pied du grand arbre-logis, là était la condition de sa présence parmi eux, mais il aurait aimé opposer la science grecque, latine des plantes et des bêtes au savoir des barbares du nord ; il aurait aimé aguerrir son corps, montrer à ses hôtes l’usage étendu de son bâton qu’ils ne soupçonnaient pas ou la manière raffinée dont les anciens Carthaginois soignaient leur torse et leurs membres. Il en vint bientôt à souhaiter un geste d’Atis, un regard, un signe qui l’eût invité à prendre davantage part à son enseignement. Ce druide était si étrange, si différent de ceux qu’il cherchait à l’origine de son périple, mais finalement il était peut-être le plus intéressant de tous tant son savoir – il le pressentait sans en avoir la preuve puisqu’il n’avait rencontré aucun autre représentant de sa caste – différait de celui des autres sages. Ce signe ne vint pas tout de suite et Magon dut être patient. Tandis qu’il se mettait à pleuvoir, puis neiger au-dehors, la forêt, abritée de ses grands arbres, demeurait immuablement douce, propice à la poursuite de l’apprentissage. Il se passa des jours et des jours. Le Maltais écoutait, observait, ne touchait rien, ne parlait pas. Le maître et son élève en oubliaient sa présence, des heures durant, alors qu’il était à quelques pas d’eux et ils ne semblaient le retrouver qu’au moment du repas pour mieux l’oublier avant de sombrer dans le sommeil. Lui, mettait plusieurs heures à s’endormir ; il ressassait ce qu’il avait appris dans la journée, toutes les connaissances, les nouvelles réflexions découvertes qui tournoyaient confusément dans sa tête et qu’il tâchait d’ordonner pour mieux les retenir en l’absence de notes. Il ne désespérait cependant pas, travaillait aussi sa mémoire et, comme la science d’Atis formait un ensemble cohérent, il parvenait toujours à se rappeler ce qu’il avait malencontreusement oublié parce que le druide le répétait ou délivrait d’autres préceptes qui aboutissaient logiquement au premier que Magon n’avait plus en tête. Il progressa vite, finit par s’imprégner totalement de la pensée d’Atis, par ne plus regretter que ses affaires fussent restées à Génabum, certain de tout retenir puisqu’il adhérait à cet enseignement au point de le faire sien. Car il s’agissait bien de cela. On ne retient jamais parfaitement que ce à quoi l’on souscrit et Magon souscrivait, avec une certitude grandissante, à ce qu’il apprenait. Tout autre savant méditerranéen aurait ri à ces cours de botanique, de médecine, de philosophie et de mythologie mélangés, les aurait jugés ridicules. Pas lui. Il n’avait aucun de ces préjugés détestables qui font honnir ce qu’on découvre si l’objet de notre découverte n’est pas 87
conforme à nos attentes. À l’inverse, comme une éponge, il s’imbibait : il acceptait tout avec respect, ne se moquait de rien, ne s’indignait. Il avait toujours en tête la manière erronée dont il avait d’abord perçu les roches où il avait repris connaissance après sa blessure et qui, d’un côté, paraissaient stériles et funestes et, de l’autre, abritaient les indices même de la vie. Seul le culte de Calroë lui résistait encore ; il avait besoin d’une preuve pour y croire pleinement. Sa plaie à la tempe avait depuis longtemps cicatrisé. Atis n’était pourtant pas aveugle. Il devinait que la curiosité de Magon ne pouvait se satisfaire d’être un simple auditeur de son enseignement et réclamait plus, même s’il ne pouvait ni ne voulait devenir prêtre de la Déesse. Plusieurs fois, au cours de ce qui devait être ailleurs la fin de l’automne, il le surprit à s’enhardir et travailler dans son coin comme s’il était un élève à part entière. Il assimilait pour lui ce qu’il avait vu ou entendu de plus frappant. C’est ainsi qu’il l’observa un jour qui décortiquait soigneusement, dans la lumière tamisée du sous-bois, une fleur d’astranore pour en comprendre la substance, sans instrument, à la seule base de ses connaissances et de son envie de combler son ignorance. C’est ainsi qu’il le vit ramasser des insectes à même le sol, remercier la Déesse pour ce présent de la nature, manger gaiement comme si ce fût un mets des plus exquis. C’est ainsi qu’une après-midi il le vit, debout contre la table de la pièce à vivre, retrier seul les plantes de la journée, en silence, les yeux fermés, à l’unique perception de ses doigts, ses narines et sa langue. Un événement devait se produire, anodin en apparence, révélateur en réalité du bouillonnement intellectuel dans lequel se trouvait Magon. Alors que Dagios demeurait à nouveau perplexe devant un apophtegme du druide, il ne put s’empêcher d’en laisser échapper tout haut la signification. Il s’excusa aussitôt de son audace, se renfonça dans son mutisme. Dagios en fut surpris, Atis le dévisagea. Mais le Maltais avait des yeux si grands, si beaux, si humbles qu’il ne put rien lui opposer qu’un mince sourire qui semblait dire qu’il était temps que sa situation évoluât. Aussi le soir même, après le dîner, tandis que Magon méditait auprès du feu, le druide vint s’asseoir à ses côtés. Pour entamer la conversation, il prit son bâton, en examina la facture étonnante. L’objet restait des plus exotiques, même pour un être de prodiges tel qu’Atis. Long de quelques coudées, large du diamètre d’un poing et léger comme une branche de saule, il était d’un bois inconnu en ces régions et, sauf à ses trois quarts où s’entrecroisaient des lacets de cuir, l’absence de jointures sur toute sa surface indiquait qu’il était fait d’une seule et même pièce. Il était peint de jaune, de rouge, de vert avec des pigments inexploités, selon une technique 88
qui n’avait vogue par ici. Il était incrusté de morceaux finement sculptés en ivoire, lesquels couraient d’un bout à l’autre, enroulés comme les hiéroglyphes d’un sceptre, et figuraient des dessins mystérieux qui semblaient prendre vie si on le tournait assez vite. Une pointe de métal, de la taille d’un majeur et luisant curieusement, en terminait l’extrémité. Quoique les Gaulois fussent habitués aux objets colorés énigmatiques, il ne ressemblait à rien de familier. – Qu’est-ce que c’est ?, demanda le druide, une aide ou une arme ? – Je dois avouer qu’il s’agit, hélas, bien souvent des deux car je trébuche de moi-même autant que je rencontre l’ennemi sur ma route. Il se leva, montra comment on marchait d’un pas assuré, appuyé à ce bâton qui lui arrivait à hauteur du visage. Puis, en le faisant basculer en arrière et virevolter dans son dos, il démontra, en le reprenant devant lui, qu’il pouvait fendre de sa pointe le crâne de n’importe quel homme qui se présenterait ; il entailla sans peine la souche massive sur laquelle il était assis juste auparavant, y enfonça son bâton comme pour créer une nouvelle branche, se balança de chaque côté pour prouver que la lame ne casserait pas. Cette pointe d’ailleurs était amovible ; on pouvait l’étirer d’un doigt supplémentaire et la placer d’un côté, de l’autre, dans le prolongement même du bois si bien qu’on aurait fait le tour de l’ennemi en même temps qu’on lui transperçait la cervelle. Enfin, d’un coup de pouce, il fit sauter la lanière de cuir qui retenait la tête du bâton, en tira une épée fine comme une épine géante insérée à l’intérieur dans une sorte de fourreau inattendu. Il n’avait aucune technique de combat autre que celles lues dans ses livres et essayées dans ses entraînements solitaires, mais l’arme qu’il maniait à la perfection était des plus originales. Il retendit au druide son bâton pour le laisser l’observer en détail. – Nous n’avons pas cela chez nous, se contenta de dire Atis dont l’enseignement n’incluait nullement les armes mais ne les condamnait pas non plus. – Cet objet vient de loin, de très loin. Il m’a été remis par un oncle qui a voyagé au-delà du grand Océan, là où les peuples, le visage brûlé par le soleil, ont la couleur noire du charbon. – C’est de là-bas que vient ce métal qui brille étrangement ? Il indiqua la pointe du bâton et la fine épée qui semblaient toutes deux faites de la même matière. Ce métal avait une brillance légère qui ne ressemblait, elle non plus, à aucune autre. – Ce métal ? Je crois qu’il a été rajouté après… On m’a dit que c’est de l’orichalque refondu avec du fer car l’orichalque serait trop puissant et nocif si on l’employait pur. Il vient de Carthage, la cité de mes ancêtres que Rome a soumise et brûlée il y a cent ans. Tout ce que je sais, c’est qu’il 89
n’en subsiste plus aujourd’hui que le nom et quelques rares fragments dont cette pointe et cette épée. Il paraîtrait que ce métal ne provenait pas d’un gisement terrestre, mais d’astres tombés du ciel dans les montagnes maurétaniennes ou libyennes. Les nomades d’Égypte l’utiliseraient encore, lui ou un minerai céleste assez proche, pour chercher dans les grottes du désert les trésors qui y sont enfouis car il luit curieusement à tel point qu’on dirait une lampe, un flambeau discret dans le noir. Vois cette souche que j’ai fendue sans effort. L’orichalque est extrêmement solide, très dur à travailler en même temps que d’une incroyable légèreté. Il ne se ternit pas ni ne s’abîme. Il n’a aucun autre pouvoir, rien d’extraordinaire ; en tous les cas je ne m’en suis jamais rendu compte. Simplement résistant et luisant de la façon la plus singulière. Enfin je ne suis pas certain de tout cela... Tout ce que je peux te dire, c’est qu’il ne ressemble à rien d’autre et qu’il peut trancher bien plus de matériaux qu’une simple épée. – Même si tu ignores tout de ses vertus, un tel don du ciel paraît exceptionnel. – Il l’est et rend ce bâton inestimable. Plus encore parce que je le méconnais et qu’il reste pour moi un mystère. – Je te crois. Mais, dis-moi, le destin de cette cité, Carthage, tu en parles sans animosité… – Pourquoi le ferais-je ? Tout cela est du passé et je n’appartiens pas au monde qui connaît les guerres entre les peuples mais à celui qui brouille les frontières sous l’égide du savoir. Atis parut fortement impressionné de ce bref échange. Depuis un moment, il regardait avec attention les étranges dessins qui parsemaient le pourtour du bâton. À la lumière vacillante des flammes, ils étaient encore plus déconcertants. Il croyait y reconnaître une montagne en feu, des animaux effrayants et grotesques, des personnages couverts de plumes – toutes réalités qui n’avaient aucun sens pour lui. – Qu’est-ce qu’ils représentent ?, demanda-t-il une fois qu’il fut évident qu’il ne pourrait en percer seul le mystère. – Ce qu’ils représentent… Cela, par contre, je peux te le dire avec certitude. Ils représentent un moment de l’histoire de mes ancêtres et de Rome. Un épisode que tout le monde a oublié et qui fut pourtant des plus tragiques. Mais encore une fois, le passé est le passé, il m’intéresse moins que ce que je peux faire dans le présent. Et puis, ce que je te dirais n’évoquerait sans doute rien pour toi… Pourtant, le druide ne disait rien, le regardait. Il crut qu’il devait poursuivre, donner des détails qu’un habitant du centre de la Gaule ne pourrait pas comprendre. Il reprit le bâton et, à mesure qu’il parla, suivit 90
du doigt les dessins qui en parsemaient le contour comme s’il lisait une bande d’images enroulées. – Si tu veux savoir…tout commença il y a plusieurs centaines d’années dans cette cité, Carthage, dont je te parlais à l’instant. Là-bas, un navigateur courageux, Hannon, entreprit une expédition navale pour découvrir les côtes de l’Afrique. Il partit à bord de soixante pentécontères en emmenant trente mille colons, franchit les colonnes d’Hercule, fonda une demidouzaine de colonies sur la côte jusqu’au fleuve Lixus. Au-delà il suivit des guides locaux vers une petite île nommée Cerné qui fut son dernier établissement. Puis il reprit son exploration, descendit plus bas encore à l’embouchure d’un fleuve immense où il rencontra crocodiles et hippopotames, doubla des récifs couverts de forêts, traversa des golfes aux plages embrasées où des tambours résonnaient dans la nuit et empêchaient de dormir. Il poursuivit jusqu’à une très haute montagne dont le feu semblait toucher les astres, qu’il appela Théôn Ochima pour te donner son nom en grec : le Char des dieux. Vaincu enfin par les bonaces et la chaleur, il fit demi-tour. Ses exploits ont été gravés sur une stèle exposée dans l’ancien temple de Baal-Hammon. Il n’en reste plus rien aujourd’hui. Il observa une pause, fit tourner son bâton entre ses mains. Il caressait les motifs d’ivoire, semblait y chercher l’inspiration d’une histoire très ancienne : – Quel rapport avec ces dessins, me demanderas-tu. Figure-toi qu’il y a une cinquantaine d’années environ, peu après la destruction de Carthage, une petite ville nommée Icara qui avait échappé par miracle à l’anéantissement et continuait de prospérer dans le commerce fut en toute injustice prise et pillée par deux légions romaines. Ce fut un carnage épouvantable. Plus tard, une poignée de survivants conduits par un mage décida de se venger en empoisonnant, à Rome, les officiers responsables de ce massacre et les faisant sombrer dans une folie atroce. Ces officiers étaient prestigieux et précieux pour la République. Imagine-toi, d’anciens triomphateurs !, de futurs consuls !, des chefs de partis ! Alors les Romains, découvrant le complot et cherchant un contrepoison, envoyèrent une flottille dans les comptoirs carthaginois encore existants. Ils allèrent, diton, jusqu’à la lointaine Cerné. Dit-on, parce qu’ils n’en sont jamais revenus et l’on ne sait même pas où se trouve cette île ... C’est leur désastre que racontent les motifs de mon bâton. Ici tu peux voir l’attaque du camp qu’ils avaient monté en haut d’une côte escarpée, là les bêtes sauvages qu’ils ont rencontrées, des singes géants qu’ils ont pris pour des gorgones velues, là encore les indigènes alliés des nôtres parés de leurs coiffes de guerre. 91
Rome a préféré tout oublier de sa défaite, Carthage n’existe plus pour commémorer sa trop tardive victoire. Toute cette histoire, il n’y a plus guère que moi qui la connaisse encore par cœur. Un oncle me l’a racontée quand j’étais enfant, m’a forcé à la retenir en m’offrant ce bâton pour que je me rappelle toujours notre supériorité sur les Romains. Il était persuadé que nous regagnerions notre empire à partir de ces comptoirs disséminés comme des poussières dérisoires de gloire. Une sorte de base arrière pour livrer de nouvelles guerres, non plus sur la seule Méditerranée mais jusqu’aux confins du monde, à Cerné. Cette arme a été fabriquée là-bas ; son maniement mêle les techniques de guerre d’Afrique et d’Europe, le casse-tête et l’épée, parce que notre civilisation a toujours fait le lien entre les deux et c’est cela, selon mon oncle Abdosir, qui faisait notre force. Je ne partage pas ses convictions : Carthage ne renaîtra jamais de ses cendres et la guerre est un fléau qu’il faut éradiquer. Quant à ce bâton, je le garde au contraire avec moi pour me souvenir de l’absurdité de la violence des hommes tout en admettant parfois la nécessité de combattre. Grâce à ces gravures en ivoire, tous ces faits mémorables se présentent à moi par vignettes avec la précision de scènes illustrées. – Les dessins suppléent souvent la parole, conclut le druide d’un ton profond, et sont alors le plus beau des alphabets. Pour la première fois, Magon venait de livrer dans le détail la solution de l’énigme de son bâton, celle-là même qu’il avait si souvent refusée à Asinus pour ne pas susciter sa convoitise. Et il l’avait fait à quelqu’un qui n’avait jamais voyagé, qui ne savait même pas ce qu’était Carthage, un hippopotame, un crocodile. Il fallait qu’Atis appartînt à une autre classe d’hommes, autrement plus respectable et digne de confiance. Le druide ne s’y trompa pas. Même si tout cela était complexe pour lui parce qu’il manquait des connaissances géographiques et historiques nécessaires, il comprit de son côté que Magon avait aussi beaucoup à lui apprendre, qu’il n’était pas un simple voyageur en quête d’érudition mais peut-être un savant d’exception malgré son jeune âge. Déjà ils avaient naturellement commencé à partager leurs connaissances sur l’astranore et l’orichalque, dévoilant chacun un savoir dont nul autre ne disposait et confessant leurs lacunes tant les prodiges dont ils témoignaient les dépassaient de beaucoup. Magon lui avait raconté une légende oubliée de son peuple, celle de la vengeance désespérée des siens contre leurs vainqueurs ; il lui avait exposé le mythe de Calroë. La logique voulait qu’il l’inclût à présent dans son enseignement. Mais il le jugea prématuré, demanda encore d’attendre quoiqu’il fût sûr de l’intelligence intègre du jeune homme. Il reprit : 92
– Tu me dis tout cela sans me connaître vraiment. C’est pourtant une confidence importante. – C’est vrai… Je dois n’avoir livré cette histoire que deux ou trois fois dans ma vie. Toujours à des personnes de confiance même s’il n’y a pas grand-chose à en craindre. Mais tu sais, j’ai moins de piété pour les dieux de mes ancêtres que pour mes ancêtres eux-mêmes. Parce qu’il n’y a rien que les Anciens n’ont pas éprouvé, il n’y a aucun savoir qu’ils n’aient pas divulgué ou dont ils n’aient pas révélé l’utilité à nous qui sommes nés après eux. Souviens-toi d’Hannon qui fit tout graver de son périple, qui ne déroba rien à la connaissance, non pas pour vanter sa gloire, mais pour instruire ceux de son peuple qui étaient capables de le lire et voulaient le suivre, pour les faire rêver intelligemment, puissamment, et leur communiquer son ambition. Nous justement, que faisons-nous ? Tout le contraire. C’est ce qui m’indigne. Nous cherchons à cacher, à supprimer leurs travaux au lieu de les faire connaître à tous et nous privons nos semblables des bienfaits qu’on pourrait leur apporter. Aujourd’hui, je regrette que ceux qui ont quelques connaissances les taisent pour que les autres les envient. N’instruire personne, jouer au prétentieux en laissant croire que l’on connaît les choses mais qu’on ne veut pas les dire comme si on perdait de leur valeur en les partageant, c’est, croient-ils, donner une plus haute idée de leur personne. C’en est à un tel point que chez moi, il existe des herbes rares qui risquent de perdre leur nom parce que ceux qui le connaissent ne veulent pas le dire en public. Le monde est malade des savoirs réservés aux seuls initiés. C’est contre cela que je m’insurge et mon livre, quand il sera écrit, sera une démocratisation des connaissances pour servir à l’érudit de Rome comme au fermier de Messène ou d’Utique du moment qu’il sait lire ! Il regardait Atis comme s’il disait cela pour lui. Ses yeux étaient si doux, si grands qu’il était impossible d’y lire une critique sévère ; c’était plutôt comme s’il le mettait en face de ses propres contradictions, comme s’il le prenait aux propres exigences de son culte avec modestie. Atis ne devait pas craindre de divulguer son savoir pour qu’il lui survécût. – Un don de soi en somme, conclut le druide, pensif. Mais parfois les esprits compétents manquent et ce que l’on peut dire tombe en de mauvaises oreilles. Toi-même, tu avoues que tu n’as révélé les secrets de ton bâton que deux ou trois fois car sans doute sais-tu que rien n’est pire que la méprise qui conduit à des erreurs aux conséquences terribles. Il vaut mieux alors garder ce que l’on sait pour soi plutôt que de le voir dénaturer. Imagine l’usage que ferait un ignorant de ce métal qui éveille tant de curiosité et dont les vertus semblent si prometteuses… 93
– Ce me semble trop facile, pour tout dire un peu lâche, contesta Magon. Crois-moi, il y a toujours quelqu’un pour comprendre et il ne faut craindre qu’il se méprenne. S’il confère un tout autre sens à nos paroles, il nous appartient de rectifier sa méprise. L’erreur est un échec, les échecs sont destinés à être réparés. Moi, je n’ai révélé mes secrets que deux ou trois fois, c’est vrai, mais je les ai révélés quand même. Enfin, toi, n’as-tu pas cité l’autre jour ton maître qui reçut dans ta jeunesse un Mède et partagea avec lui son savoir ? – Mon maître avait une conception personnelle de ses obligations et de ses droits. Il paraît que la mienne est plus stricte, moins ouverte. J’ai accepté ta présence ici non pas par largesse personnelle envers moi-même et mon envie d’apprendre ce que j’ignore, mais pour honorer la Déesse qui ordonne de contenter son prochain si on le peut. Il est inutile de vouloir plus. Et puis l’hôte de mon maître lui avait apporté beaucoup parce qu’il était un grand savant en son pays… – Je peux apporter beaucoup moi aussi ! Il y a tant de choses que je veux partager. Ne retiens pas ma jeunesse. Tu sais qui je suis, tu sais que je n’ai aucune mauvaise intention et l’exemple de ce bâton prouve que je possède sans pavaner des connaissances que le reste du monde n’a pas. Atis, il ne s’agit pas d’hurler à la foule, mais dans la communauté des gens de bien, il faut savoir faire confiance, laisser parler son intuition. Rien n’est pire que le silence qui conduit à l’obscurantisme. À ne rien transmettre, vois-tu, on périt. Le druide ne répondit rien, se leva, disparut dans le soir. C’était la preuve que l’autre avait suscité en lui une remise en question importante. Il n’en laissa rien paraître dans l’immédiat, dut hésiter des heures durant. Mais à partir de ce jour, alors que sa présence n’était au départ qu’à peine tolérée, Magon fut autorisé à participer pleinement aux leçons et aux échanges. Ce fut un bouleversement inouï pour le prêtre dépositaire d’un usage qui ne tolérait que rarement la présence d’étrangers et la divulgation de secrets immémoriaux, et ce fut un enthousiasme immense pour Magon qui entra entièrement dans la vie du druide et ses croyances. Le jeune homme passa du statut d’auditeur à celui d’acteur. La logique même du culte de Calroë avait poussé vers cette évolution. Dorénavant, pendant les leçons, il ne chemina plus derrière Atis et Dagios, ne laissa plus de distance entre eux et lui pour s’asseoir, mais se plaça toujours à gauche du druide quand l’autre jeune homme était à droite. Il répéta en commun les poèmes en l’honneur de la Déesse en commençant par les plus simples et en en balbutiant la langue compliquée. Il ne resta plus dans son mutisme forcé, mais répondit aux questions, n’attendit même pas forcément qu’Atis lui donnât la parole, mais la prit 94
librement, sans hésiter à se montrer audacieux dans ses réponses, exposant ses idées et les comparant à celles du sage. Parallèlement il s’appliqua peu à peu aux exercices physiques qu’il regardait faire jusque-là. Il y acquit une forme pleine ; son corps s’affina, se muscla discrètement, gagna en souplesse et en agilité. En un mot, il s’épanouissait comme en son élément naturel, comme s’il fût au milieu de sa chère bibliothèque et du jardin où il avait passé les heures heureuses de son enfance. Il ne déçut pas. Au bout de quelques semaines, Atis le consultait de plus en plus, tenait compte de ses remarques, ses réussites, le mettait enfin en confiance en l’appelant son disciple et en le traitant d’égal à égal. Il sembla même qu’une différence – que personne ne souhaitait – s’installât avec Dagios qui resta, lui, dans la dépendance de l’élève parce qu’Atis continuait de lui parler comme à un jeune homme qui avait encore beaucoup à apprendre et parce que lui, jugeait irrespectueux de s’adresser à son maître comme s’il prétendait lui enseigner quelque chose. Dagios ne parvint pas non plus à fortifier sa silhouette, resta de constitution plus frêle. Magon venait de prendre une forme d’ascendant sur lui. Sans y paraître, le Maltais présenta humblement au druide ce que la science méditerranéenne pouvait lui apporter. Il privilégia les connaissances concrètes parce qu’il ne voulait pas passer pour plus sage que le sage et si ses paroles eurent moins de profondeur philosophique, elles n’en furent pas plus pauvres. Au contraire, il l’entretint d’une infinité de sujets, lui cita pêle-mêle ce que disaient des plantes Orphée, Musée, Hésiode, Pythagore, Démocrite ou Théophraste. Quoiqu’il en parlât avec passion et qu’Atis montrât une vive curiosité, il prit soin de ne pas développer outre mesure les matières qu’un Gaulois ne pouvait concevoir ni ceux dont un druide sylvain ne voulait entendre parler, mais il opposa la science punique et grecque à celle des barbares sur d’autres thèmes sur lesquels il était possible d’échanger et débattre. Il s’abstint ainsi de parler d’agriculture, de bêtes de somme ou de chevaux, de plantes potagères et de vin ; mais ensemble, ils évoquèrent longuement les misères de l’homme, sa gestation, sa croissance, sa mort, la survie de son âme ; ils s’intéressèrent aux grands arbres, aux remèdes tirés des animaux sauvages et des eaux ; ils citèrent le pouvoir merveilleux des pierres au naturel. Magon cita encore Xanthus, Hippocrate, Dioclès, Praxagoras, Chrysippe ou Hérophile. Il ne cachait rien de son savoir parce qu’il en était féru et concevait cet échange comme un contre-don à la bienveillance de son hôte. Une estime réciproque, sinon une forme d’amitié bientôt les réunit. L’équilibre de leur vie en commun en fut insensiblement rompu. Dagios souffrit peu à peu de la situation, en ressentit une jalousie compréhensible. Il passait après Magon ; sa parole comptait moins, même 95
quand elle était juste ; ses performances n’avaient plus rien d’éblouissant ; l’autre lui avait piqué jusqu’à ses vêtements. Il n’en parla pas, se soumit en apparence à la tournure que prenaient les choses, redoubla de zèle. Mais en secret il se demandait pourquoi un étranger rencontré par hasard en était venu à vivre auprès d’eux alors même que le culte de Calroë était interdit aux profanes, comment il avait gagné le privilège d’être initié comme s’il fût présent depuis des années et choisi par le prêtre. Atis cherchait-il un remplaçant ? Était-ce donc qu’il avait été déçu ? Les questions bourdonnaient dans sa tête et il devait souvent courir à perdre haleine dans la forêt pour les dissiper. Il était jeune, bien intentionné mais la jeunesse est souvent mauvaise conseillère et l’emporte sur les meilleures intentions. D’abord il essaya de faire abstraction de l’amertume qui montait en lui, puis il tenta de rivaliser avec le Maltais pour combattre son désarroi. Mais comme Magon s’avérait toujours intellectuellement plus fort, plus pertinent avec sa manière agaçante de vouloir rester modeste dans ses interventions, il ne put contenir sa colère, en conçut des pensées sombres. Maintenant c’était lui qui gardait le silence de peur de dire une sottise, qui allait, s’asseyait derrière eux et à qui le druide ne demandait pas de se rapprocher. Sa présence n’était plus désirée. Ce qui le dérangeait plus que tout, c’était que Magon prétendît les instruire à son tour et que, dans ces moments-là, Atis s’entretînt avec lui, dans une intimité exclusive, comme s’il donnait plus de prix à ce qu’il avait à apprendre qu’à l’enseignement qu’il devait transmettre. Lors d’un exercice physique auquel Magon entendait se prêter avec lui, il laissa entrevoir son humeur douloureuse. Pour entretenir leur corps, Atis les soumettait à des entraînements variés comparables à ceux des légions romaines les plus rompues à l’effort. L’un d’eux consistait à sculpter son allure et à en obtenir un alignement parfait de la nuque jusqu’aux pieds. Pour cela, il les faisait rester debout, nus, bras collés aux jambes, des heures durant sur une pierre fichée dans le sol. Afin de rendre l’exercice plus difficile et muscler plus encore leurs mollets et leurs cuisses, cette pierre, en forme de borne milliaire effondrée, de la largeur précise de deux pieds joints, était légèrement pentue et couverte de mousse, ce qui obligeait à se tendre inlassablement pour ne pas déraper. L’exercice, futile et simple en apparence, était en réalité une torture quand, au bout d’une, deux, trois heures se faisaient ressentir les fourmillements, les démangeaisons, les vertiges, l’ennui. Alors le physique, le mental pesaient au point d’être tenté de sauter de la pierre et de tout abandonner. Résister à la tentation, demeurer stable et droit comme si un gouffre s’étendait sous ses pieds, c’était là honorer symboliquement la Déesse qui apportait son équilibre 96
aux caprices du monde. Si l’on hurlait pour supporter les crampes, si l’on divaguait au point de délirer pour ne pas sentir la longueur du temps, elle n’en était que plus satisfaite puisque le corps souffrait pour devenir meilleur. C’était à peu près la cinquième fois que Dagios et Magon s’entraînaient à cet exercice qu’ils redoutaient plus que n’importe quel autre parce qu’il demandait une patience surhumaine. Ils avaient tous deux leur pierre et se tenaient dessus, face à face, puisant dans le regard de l’autre l’endurance pour tenir bon. Ce n’était pas une compétition, mais la disposition des supports et la nature du défi conduisaient à le voir comme tel. La dernière fois qu’ils s’étaient mesurés l’un à l’autre, ils avaient tenu presque un jour complet et si ce fut Magon qui céda le premier, Dagios l’avait suivi de peu. Par conséquent, il n’était pas serein. L’idée d’avoir Magon en face de lui pendant tant de temps, la crainte de céder peut-être avant lui cette fois-ci, sous les yeux d’Atis à qui il voulait prouver qu’il était le meilleur, lui furent insupportables. Ce jour-là donc, Dagios enfreignit les règles, dépassa les limites. Comme il savait qu’ils allaient s’adonner à ce qu’il nommait le supplice de la pierre, il profita d’un moment où Atis et Magon s’entretenaient entre eux deux d’un sujet qu’il n’avait pas droit d’entendre. Il déchira plusieurs touffes de mousse du rocher sur lequel se tiendrait son rival, étala en dessous un peu de boue et de feuilles, les redisposa comme si elles étaient intactes. Elles se détacheraient dès que Magon monterait dessus ; s’il avait pu se casser la cheville en tombant ! Il n’avait pas d’autre plan que cet acte de rébellion puéril, impréparé, guidé par une brusque exaspération. Quand Magon grimpa sur la pierre, il glissa, évidemment. Il chuta face contre terre aux pieds de son concurrent. Dagios vit son succès dans cette humiliation, mais n’esquissa aucun sourire pour n’en rien laisser paraître. Magon voulut remonter, glissa à nouveau sans tomber toutefois, remit le pied. La résistance physique qu’il avait acquise au cours des mois précédents ne lui servit à rien. Mais il fut persévérant. Au bout de six tentatives, quand toute la mousse arrachée fut tombée de la pierre et que la boue répandue fut essuyée, il put enfin tenir dessus. Il ne dépassa pas toutefois deux heures d’équilibre. Atis en fut très contrarié, Magon dépité car la compétition et la tricherie n’entraient pas dans son caractère. Le coupable, lui, sorti vainqueur de l’exercice, ne montra pas s’il regrettait son geste. Aucun des trois ne parla de cet incident, faute de preuves. Il fut clair cependant que le temps de la concorde était révolu. On était alors en plein hiver. Il était impossible de donner une date exacte ; mais à la pâleur du ciel entrevue sous de rares percées dans les arbres, on devinait qu’il neigeait au-dehors de la forêt. Pourtant le feuillage 97
restait le même, fourni, d’un vert légèrement cuivré par les nappes de brume qui semblaient en émaner. Autour des bois, la neige abondante formait une épaisseur ouatée qui enfermait le paysage, interdisait tout déplacement. Atis ne sortait pas de la forêt et, s’il en était sorti, il n’aurait rien su de toute façon des villes ou des villages puisqu’il refusait obstinément de s’y rendre. Ni Magon ni Dagios ne songeaient non plus à le faire. Ils ne pouvaient absolument pas se distraire en s’enquérant de ce que devenait le monde extérieur, s’il menaçait de s’écrouler – ce qui leur aurait paru moins difficile à supporter que la situation intenable dans laquelle ils vivaient. Il n’y avait donc pas de divertissement à leur peine. Ils étaient seuls, tous trois, pris dans une tension grandissante, une déchirure dramatique de leurs relations, comme un poison insufflé au cœur de la forêt. Pour la première fois, l’isolement sembla peser sur leur vie. La pièce commune où ils mangeaient, dormaient, se retrouvaient devint intolérable. Sous prétexte de réflexions intimes, d’entraînements individuels, ils préférèrent souvent travailler séparément. Le druide s’enfermait dans son cabinet d’étude pour mettre au point une nouvelle pharmacopée ou composer une prière inédite. Les deux autres allaient chacun de leur côté. Le rythme des enseignements ralentit. Ils souffraient de la situation, mais n’osaient provoquer de discussion franche et brutale parce qu’ils ne voulaient pas être responsables d’une dissension irréparable. Ce fut à cette époque qu’ils retrouvèrent le petit pinson mort dans sa cage, étendu sur le ventre comme s’il cherchait un sommeil éternel pour oublier. Atis fut bouleversé de voir un être si fragile mourir devant ce qui était comme le temple de Calroë censée le protéger. Durant cette période, Magon se réfugia souvent dans une sorte de vallon. En fait de vallon, il s’agissait plutôt d’une crevasse formée dans le sol par la chute d’un arbre – sans doute un chêne géant comme celui où résidait Atis – dont les racines prodigieuses avaient, en s’arrachant, creusé un trou béant aux parois escarpées. Tout à côté, l’arbre effondré avait disparu, mais on en devinait encore la trace par l’absence de végétation haute où il avait dû se coucher et par les résidus de bois pourri que la terre achevait d’ingérer en elle. L’endroit d’où il était tombé n’avait été que partiellement comblé ; la terre s’y étant éboulée, le trou avait fini par ressembler à une simple dépression du terrain, plus étalée que profonde, où avaient poussé un tapi frais de fougères ainsi qu’un ormeau qui n’occupait pas encore la totalité de l’espace laissé vacant mais ne demandait qu’à croître et s’étendre. Que de fois Magon y vint, presque tous les jours aux moments les plus critiques ! Il s’y asseyait, genoux relevés, dos contre la terre humide, et 98
demeurait silencieux. Il tâchait de reprendre avec sérieux les préceptes d’Atis, se récitait dans sa tête ce qu’il avait autrefois appris par cœur pour ne pas l’oublier, le recoupait avec la science du druide et avançait ainsi seul son enseignement. Mais dans cette nature caressante et secrète, sa pensée divaguait. Elle ramenait souvent le visage d’Aldéa à sa mémoire. Il se demandait ce que devenait la jeune femme, entrevoyait son labeur, ses peines, ses succès, et s’efforçait aussitôt de chasser son corps fragile de son esprit. Très chaste, il n’avait pas l’habitude de rêver aux femmes, encore moins à une unique qu’il aurait élue de ses vœux ; il craignait naïvement de se détourner de son travail s’il se laissait happer par le désir amoureux. Quand ce désir tournait à l’envie brutale de la posséder, il se lançait avec démence dans un entraînement épuisant et, pour calmer ses ardeurs charnelles, faisait une série de tractions au milieu d’un massif d’orties. Il en revenait rouge d’irritation mais serein. Il se faisait ainsi violence pour ne plus penser à elle. L’endroit resta cependant pour lui un refuge tant il y eut d’autres pièges tendus par Dagios et d’autres vexations. Le jaloux ne cessait ses attaques. Il voulait être premier en toutes choses, quitte à tricher à la course ou parler à tort et à travers pour dire des banalités. Il se montra capable de tout. Un jour il le bouscula carrément et s’en alla sur-le-champ sans s’excuser, en faisant mine de ne pas avoir regardé où il marchait. Une autre fois il se fâcha au nom d’un motif futile, cria « Maître ! » pour demander l’appui d’Atis. Magon crut l’occasion d’une explication franche arrivée – ce qui l’aurait soulagé. Il n’en fut rien. Atis refusa de trancher et Dagios se retira en fulminant de rage. « Il reviendra », se contenta de dire le druide qui, quoiqu’il ne laissât rien transparaître, fut d’une maladresse étonnante pour un homme de sa sagesse. Le Maltais ne fut pas convaincu. Il ne dormit dorénavant que d’un œil inquiet, particulièrement les soirs de pleine lune quand Atis sortait et que les deux jeunes gens restaient seuls sur leur paillasse à quelques pas de distance. Ce fut à cette époque qu’il tint en permanence un petit bouquet d’astranore, l’herbe guérisseuse, caché dans une manche de son sayon. Dagios s’ingéniait à lui nuire de la façon la plus sournoise, la plus violente qui fût. Tout ce qu’il osait, si fourbe, si mesquin fût-il, lui semblait d’ailleurs encore trop retenu, trop policé à côté de ce qu’il aurait aimé lui faire endurer. Il aurait voulu que le lynx si paisible qu’il croisait chaque jour en forêt lui sautât dessus et le lacérât de ses griffes ; il aurait aimé secouer les arbres pour faire chuter leurs énormes branches sur sa tête ; quand il considérait le ciel, il aurait voulu cacher les étoiles, les prendre dans sa main, les jeter loin de lui comme une poignée de terre pour le priver de lumière, de poésie, de la contemplation de la Déesse. Mais la nature restait 99
tranquille et maternelle pour Magon ; les fauves ne l’agressaient, les branches des arbres ne l’assommaient, les astres continuaient de briller dans ses grands yeux. Dagios seul faisait tout voler en éclat en son for intérieur. Il perdait peu à peu l’essence du culte de Calroë. Il ne put durant cette période sculpter quoi que ce fût sans l’abîmer d’un coup rageur de ciseau. Son entreprise fut vaine. Le maître non plus ne réagit pas ainsi qu’il l’espérait. Au lieu d’entendre sa détresse et lui renouveler sa confiance, il se rapprocha de Magon comme s’il appréciait la manière dont ce dernier acceptait de souffrir les brimades sans se plaindre. Il n’y eut bientôt plus de doute : leurs rapports prenaient la forme d’une protection, d’une préférence. Atis d’ailleurs savait tout. Il savait que son nouvel élève cherchait souvent refuge là-bas, près du jeune ormeau, et ce fut peut-être pour cela qu’il lui proposa une retraite plus proche qui leur fût commune à tous deux : son cabinet de travail, au deuxième niveau de l’arbre-logis, à quelque vingt pieds en hauteur du sol où nul autre que lui ne devait pénétrer. Les druides qui professaient à l’air libre n’admettaient normalement personne dans leur laboratoire. Atis, comme les autres, réservait le sien à des initiatives privées, des manipulations délicates dont il n’était pas sûr, qu’il ne pouvait encore inclure dans son enseignement et qui devaient demeurer secrètes non pas parce qu’elles étaient sacrées, mais parce qu’elles n’avaient pas encore totalement abouti. Tout naissait dans son arbre, s’irradiait ensuite dans la forêt. Mais après tout, Magon, par son intégrité et sa science, lui avait prouvé qu’il pouvait aussi lui être d’une assistance précieuse lorsqu’il concevrait de nouvelles potions ou des prières inédites et il est certain que la perspective de son aide joua beaucoup dans sa décision. Il profita d’une après-midi où Dagios s’exerçait à la lisière du bois pour demander à son jeune protégé d’aller lui chercher un bouquet d’astranore. D’ordinaire, après l’avoir trié en bas, les deux aides du druide déposaient ce qu’ils ramenaient sur le palier intermédiaire, quelques marches sous le cabinet dont ils trouvaient la porte close. Mais Atis, cette fois-ci, la laissa grande ouverte, tellement ouverte que Magon osa gravir les quelques marches et regarder à l’intérieur. Le druide ne s’en offusqua pas : – Entre donc, dit-il, puisque tes yeux sont déjà là, et ferme derrière toi. Depuis longtemps Magon se sentait pleinement chez lui au premier niveau de l’arbre : il ne le voyait plus comme un habitat sommaire, mais comme le plus beau des logements parce qu’il était au plus près de cette nature qu’il mettait tant de passion à explorer. C’était pour lui vivre dans un livre, mais un livre gigantesque et vivant où les veines du bois 100
semblaient des lettres inédites qu’il fallait déchiffrer sous l’écorce et les mousses. Quand il entra dans le cabinet, ce fut un nouvel étonnement. En raison de ce qu’il connaissait ailleurs et de l’importance personnelle qu’il conférait à l’étude, il s’attendait innocemment à trouver un lieu superbe, empli de trésors, en rupture totale avec la pièce à vivre où il évoluait en bas. L’endroit le frappa au contraire par l’extrême modestie de son mobilier et la pauvreté de ses affaires. Dans n’importe quelle autre pièce, il l’aurait accepté ; dans un cabinet de travail, il ne pouvait le concevoir. C’étaient ici des ustensiles en bois de toutes formes, de toutes tailles, là des plantes séchées, des animaux morts, des pierres de peu de valeur, là encore des rangements confectionnés de branchages assemblés à la manière des nids d’oiseaux. Une table était disposée au centre avec un unique tabouret et la faible lumière y tombait commodément. Atis n’y cachait rien car il n’y avait rien à cacher. Tout portait à croire qu’il n’affectionnait ce lieu qu’en raison du calme qu’il y trouvait et qui était nécessaire à ses compositions. Il y composait en effet, ses potions, ses poèmes qu’il mémorisait sans rien écrire. Les Gaulois étant ignorants de l’écriture, pas un volumen, pas une tablette, pas un stylet ne traînait par ici. Aucun objet par lequel la civilisation sert le savoir. Le lieu n’avait rien à voir avec le bureau d’un érudit grec ou romain. Un détail en revanche attira son attention. Il se trouvait tout au fond un recoin, plongé dans une demi-pénombre, où s’empilaient des sortes de plaques de bois coupées très fines et polies autant qu’il pouvait en juger d’assez loin. Il lui sembla que tout un attirail de pierres aiguisées, de ciseaux naturels, de charbons, de pigments posés chacun sur une large feuille d’arbre étaient disposés à côté. Des sculptures évoquaient des lignes féminines mais tellement rudimentaires, tellement différentes de ce qu’Atis faisait d’ordinaire qu’il n’arriva pas à savoir s’il s’agissait d’ébauches d’art ou de simples racines ramassées à la forme particulière. Il devait y en avoir une bonne dizaine. Ce devait être avec ce genre de statuaire que le prêtre disait s’accoupler avec la Déesse. Il n’osa, sans l’autorisation d’Atis, avancer pour y voir de plus près, en demeura perplexe. Ce fut le druide qui le tira de ses pensées en l’approchant de sa table. Elle était très rangée, à la différence de celle du premier niveau. – Regarde. Tu pourras venir ici si Dagios…enfin, si Dagios ne se raisonne pas. Tu y seras dans ton élément et, derrière la simplicité apparente des lieux, ta curiosité se satisfera parce que tu verras que l’érudition n’a nul besoin de bibliothèque ou d’un bureau cloisonné pour s’épanouir. C’est ici en effet que je mets à profit les ressources que la nature 101
nous tend et que je fabrique mes remèdes. C’est ici aussi que mon esprit agence les mots en l’honneur de la Déesse. – Et ces mots, comment les assembles-tu sans écriture ? – Ma tête est remplie de pages d’un livre qui s’écrit spontanément. Écoute par exemple ce à quoi je travaille aujourd’hui. Et il parla, naturellement, sans plus montrer les réticences qu’il avait encore quelques semaines auparavant dès qu’il s’agissait de révéler quelque chose des mystères de Calroë. Sur une harpe dont les cordes en boyaux de lynx passaient pour offrir un son divin, non seulement il lui récita sans aucune aide, avec une fluidité parfaite, le début du long poème qu’il avait composé mentalement, mais même il en improvisa devant lui la suite en retraçant l’histoire de l’union de la Déesse et du dieu Smertrios. Près d’une source, le grand Pourvoyeur, vêtu de la peau de cerf habituelle qui cachait sa nudité, avait posé sa massue pour boire et se désaltérer après une course qu’il avait faite avec le Soleil. Relâchant sa garde, il s’était alors laissé blesser par son ennemi juré, le serpent cruel qui s’enroula autour de lui au point de se confondre avec ses membres. Sa massue ne lui était d’aucune utilité ; il étouffait sous les attaques de l’animal qui dévastait le monde et le flétrissait de son venin. L’univers précisément allait s’effondrer quand Calroë intervint pour sauver Smertrios. Elle en demanda la permission à son divin époux qui l’encouragea en ce sens car il était trop lâche, lui, pour le faire. Pour le libérer, la Déesse avala d’abord le serpent, le tritura tant dans sa bouche qu’elle lui fit cracher ce qu’il avait dévoré auparavant et qui l’avait rendu si dangereux. Ce fut une épreuve de grande haleine. Ses lèvres arrondies, vermeilles, où pointaient quelques fois sa langue et ses dents blanches, se refermèrent pour empêcher toute fuite du reptile qui n’y tint pas. Prisonnier, essoufflé, hurlant après d’inutiles efforts, il fut irrésistiblement vaincu. Des montagnes, des forêts, des fleuves entiers jaillirent alors de sa gueule et le firent redevenir minuscule. Puis, débarrassée du monstre, la Déesse s’unit à Smertrios, blême et défaillant, pour lui rendre sa vigueur. Son corps lui apporta la douceur de ses seins lourds, la nourriture de son ventre rebondi et lactescent. Il était temps, les forces du dieu athlétique déclinaient à vue d’œil. Ils firent l’amour pendant trois jours et trois nuits où il se perdit dans ses cheveux, ses abîmes, ses jouissances. La puissance exceptionnelle de leur union ébranla le monde et le remit en place. La composition d’Atis s’acheva là. Il avait tout raconté de la manière la plus poétique qui fût, y ajoutant une mélodie nouvelle et tournant en des vers honorifiques et très beaux une histoire qui ne l’avait pas encore été. On eût dit une autre langue que le gaulois, compréhensible et plus belle 102
pourtant. Magon en fut impressionné, jusqu’aux parts les plus fermes de son corps et son esprit. L’érotisme de la Déesse surtout l’avait déstabilisé. Tandis qu’Atis parlait, il avait cru la voir apparaître sous ses yeux, évanescente et adorable, charmant les serpents comme les Psylles et les Marses mais aux seuls attraits de son corps. Il demanda au druide si ce mythe était avéré. Celui-ci hocha la tête, précisant même que c’était depuis ce temps que s’était institué le culte qui voulait qu’un prêtre athlétique s’unît à la Déesse pour reproduire son union mythique avec Smertrios. Une sorte de hiérodule gaulois – on y revenait – mais limité en nombre puisqu’il s’acquittait seul de son devoir et dont la tâche était plus sacrée puisque c’était avec la Déesse même qu’il s’accouplait et non l’un de ses fidèles. Magon n’y crut cependant toujours pas. Il continuait de penser que cette union était métaphorique, qu’elle se faisait, au pire, au moyen d’une image, ce qui était déjà très étrange et réprouvable. – Ces statues avec lesquelles tu procèdes au rite, ce sont celles que j’ai cru apercevoir, là-bas, dans ce qui ressemble à un atelier… Elles représentent la Déesse, n’est-ce pas ? – Non, non, tu te trompes. S’il m’arrive de représenter la Déesse comme tu le dis, pourquoi m’unirais-je avec les images dont tu parles ? Il ne serait pas honnête de croire qu’un être céleste comme elle puisse se laisser enfermer entre les murailles d’un temple ou sous la forme du visage d’une statue. – C’est pourtant ce que font les autres druides. Je les ai vus dans la vision que tu m’as suscitée, ils portaient des effigies en l’honneur de leurs dieux… – Les autres peuvent bien se figurer qu’une image peut enfermer la nature infinie d’un dieu. Il y a bien longtemps qu’ils ont perdu le modèle des croyances raisonnables sous l’influence des petits hommes du Sud. – Mais ce sont bien des images que tu emportes toi aussi pour symboliser la Déesse près de la source sacrée… Atis le regarda avec incompréhension, ne répondit rien. – Et au troisième étage, qu’y a-t-il ?, demanda enfin Magon pour changer de sujet. Il croyait qu’Atis lui ayant ouvert les portes de son laboratoire lui ouvrirait celles de ce lieu encore inconnu. – Cela, je ne peux vraiment pas te le dire… Je regrette… C’est trop crucial pour l’avenir de mon culte menacé chaque jour de disparaître à jamais. De même qu’il t’est interdit d’aller à la Divona, de même tu ne peux accéder à ce niveau fragile entre tous. Ce n’est pas la Déesse cette fois-ci qui l’interdit, c’est moi qui refuse de transiger sur ce point. 103
Magon n’insista pas, respectueux de ce refus. Sa soif insatiable réclamait certes toujours plus, mais il était déjà reconnaissant de ce qu’on lui permettait de connaître. Il se contenta de sortir pour regarder tout en haut de l’arbre le troisième et dernier étage dont la découverte lui échappait encore, entouré de brumes mordorées. De rares rayons du jour y tombaient à travers l’épaisse frondaison du grand chêne qui le rendait aussi mystérieux qu’en bas la Divona où s’honorait la Déesse. Une porte massive empêchait de voir ce qu’il renfermait et, à la différence des niveaux inférieurs, il n’y avait aucune autre ouverture. Surtout l’accès en était impossible. L’escalier de racines enroulé autour de l’arbre, déjà difficile d’accès en soi, s’arrêtait brusquement à quelques enjambées de l’unique entrée qui ne possédait pas de palier extérieur pour s’y agripper. Sauter était impossible car il aurait fallu non seulement franchir l’espace d’un bond immense sans élan, mais en plus le faire en épousant la forme cylindrique du tronc pour atteindre le seuil de la porte et non se précipiter dans le vide. Il y avait un autre moyen. En effet, des trous pratiqués dans l’énorme tronc indiquaient que des marches devaient exister et compléter les racines sous la forme de rondins, mais quelqu’un avait dû les ôter pour interdire d’y monter. Ces trous étaient nets, propres, signe d’un passage fréquent. Il y en avait quatre autant qu’on pouvait les compter et il aurait fallu trouver des branches suffisamment fortes, d’un diamètre correspondant à chaque entaille pour se substituer à ces marches manquantes. C’était là-haut, au sommet inatteignable de l’arbre, qu’Atis devait cacher un réel trésor pour prendre ce genre de précautions. Magon se laissa le temps, certain d’y parvenir un jour comme il était entré dans le laboratoire du druide. Il redescendit, joyeux, confiant dans l’ouverture d’esprit du genre humain et la nécessité de partager ses connaissances. Si Dagios ne s’était trouvé en ce moment à l’autre bout de la forêt, il serait presque allé le voir pour le ramener à la raison comme on raisonne un camarade. Pourtant les événements, qui coïncident souvent étrangement, devaient se précipiter. Il advint quelques jours plus tard un bouleversement extraordinaire, une catastrophe surnaturelle qui frappa la forêt et provoqua sa destruction. Une nuit où Dagios n’était pas rentré, où Atis était parti au sanctuaire accomplir son devoir, la futaie se transforma de la manière la plus brutale. Magon qui était depuis plusieurs heures seul dans l’arbre-logis entendit tout à coup des bruits inaccoutumés, comme des cris de femmes qu’on 104
violente. Il tendit l’oreille. La forêt hurlait, une plainte d’abord lointaine, puis grandissante qui sembla bientôt l’encercler. Subitement, la lumière douce des bois s’assombrit au point de tout plonger dans les ténèbres. Il vit passer des bandes d’animaux affolés, des nuées d’oiseaux, des essaims d’insectes accrochés au dos des herbivores et carnassiers qui fuyaient, pêle-mêle, en tous sens. Certaines bêtes tombaient dans les rigoles d’eau, s’y brisaient les pattes. D’autres s’arrêtèrent devant l’arbre du druide comme si elles cherchaient Atis pour être rassurées. Mais quand elles ne virent que Magon qui les regardait éberlué, elles filèrent dans des directions opposées, les plus grosses piétinant les plus faibles en poussant des cris de panique. Un vent assourdissant les balaya, qui se mit à souffler et abîmer les végétaux. Les feuilles virevoltèrent, tombèrent en une quantité impressionnante ; des branches craquèrent tout autour, des buissons s’arrachèrent, une parcelle entière d’astranore fut emportée. Soudain, le sol trembla lui-même, se bossela, s’enfonça, se retourna comme une mer déchaînée. La tempête devint un écroulement général. Magon n’eut même pas peur tant ces faits impossibles furent rapides. Il partit à droite, à gauche, dérapa sur le terrain instable pour chercher de l’aide. Il avait d’abord songé à Dagios en se disant qu’il était peut-être sur le chemin du retour et donc proche, le chercha partout, ne le trouva nulle part, revint sur ses pas en manquant d’être renversé par une troupe de sangliers épouvantés. Quand il fut devant le chêne du druide, il entendit le tronc craquer d’un bruit plus terrible que si la foudre s’était abattue sur lui. L’arbre tint cependant bon, mais il eut peur de s’y réfugier. Un des énormes rochers à côté s’était fissuré subitement devant lui. Il réalisa que la situation était grave. Alors seulement il paniqua et hurlant « Atis ! Atis ! », il prit le risque de courir à la Divona où il savait être le druide. Là les barrières d’arbres qui enfermaient la source sacrée étaient déjà tombées, il n’y avait plus de feuillage. Il courait, hurlait encore « Atis ! Atis ! » . Soudain ce fut plus qu’une apparition – un éblouissement. Calroë était là, devant lui, nue, offerte à Atis qui la possédait réellement et l’ouragan qui faisait rage derrière lui cessa un instant pour laisser libre cours au spectacle.
105
IV LES CHASSEURS
C’est plus qu’une apparition – un éblouissement. Calroë est là, nue, offerte à son prêtre qui la possède dans toute sa sensualité. Magon n’entend plus l’ouragan autour de lui, ne voit plus rien du cataclysme ; c’est l’accalmie dans sa tête. Absorbé par un silence soudain, il contemple la Déesse, ne peut qu’élever son regard et l’abaisser lentement pour saisir la perfection de son corps. Elle est admirable, légère comme un songe, merveilleuse comme un rêve. Non pas gracieuse ni belle, elle est simplement superbe, d’une sublimité que seuls les êtres supérieurs détiennent. Tout en elle fait sens, incarne les légendes et les pouvoirs qu’on lui prête. Ses jambes montent, blanches, lisses, longilignes, avec la finesse des jeunes bois. Sa taille est large, née du galbe de ses hanches, et s’amincit en une gorge splendide où les seins lourds pris entre ses doigts délicats sont les fruits fondants d’un arbre de vie entraperçus sous des ramilles. Ses paupières sont closes, un peu rosées ; sa chevelure nimbée d’or et de flammèches est abondante et parfume l’air jusqu’à ses bras. Elle est la beauté, la fécondité, la luxuriance. Elle n’a aucun vêtement, mais ce que la nature lui a fourni d’accessoires rehausse, s’il est possible, son érotisme tout-puissant. Des bijoux de bois lui font des boucles à ses oreilles, un collier ras, des bracelets ; un lierre riant de fleurs jaunes roule telle une chaîne à son nombril d’où il plonge au creux du sexe et descend l’une de ses cuisses pour anneler sa cheville. Des larmes, comme une sève suave, se mêlent au sourire de ses lèvres entrouvertes. – Magnifique…, ne peut que répéter Magon autant de fois qu’il voit la Déesse ondoyer comme un arbre sous le vent. Magnifique… Jamais le langage n’est si pauvre que lorsque la réalité déborde l’imagination. Elle n’a rien d’aveuglant comme le prétendent les mythes. Elle est plutôt captivante et il ne peut se détacher d’elle. Elle a rivé son regard, l’a marqué à jamais d’un éblouissement qui agrandit ses pauvres yeux de mortel sans qu’ils paraissent devoir se refermer un jour. Il lui semble qu’elle est la femme première, primitive et si pure, irrésistible, antérieure à
l’époque où l’homme a gâté ses rêves par les dérives des créatures féminines qu’il a modelées et gâchées. Son corps flotte, dessine des courbes sinueuses dans l’espace où elle semble danser. En fait, elle n’est pas seule, Magon l’a presque oublié. Enveloppé de son lourd manteau blanchâtre, Atis est bien là, derrière sa cambrure, qui l’honore pleinement et lui imprime ses mouvements. La tête de l’un repose dans le cou de l’autre. Il est en elle, nu sous sa pelisse, coiffé de sa seule ramure de cerf dont le crâne lui tombe entre les deux yeux. Elle reçoit son offrande et ses prières et lui, s’efforce d’être à la hauteur de sa piété, ses cuisses arquées, solidement plantées dans le sol, ses fesses contractées, les muscles saillant de son dos et sa mâchoire écrasant des syllabes saccadées et rugueuses. – Calroë !, ahane-t-il d’une voix rauque, ô Calroë ! Déesse des femmes adonnées, des hommes vigoureux ! Mon offrande, reçois-la ! Ma peine ! Mon dévouement ! Ma vie par ma semence ! Il emploie la langue de ses invocations, ce dialecte ancien que même les Gaulois ne comprendraient pas s’ils l’entendaient. La Déesse ne lui répond pas. Ou plutôt, elle lui a déjà répondu en faisant de sa voix le grand frisson de la forêt. Chaque feuille qui vibrionne, chaque branche qui s’élève et retombe autour d’eux, ce sont un peu les mots qu’elle dit dans une langue symbolique et très vraie où elle n’est plus seulement une femme, mais aussi la nature qui l’environne. Les bois gigantesques portés par le prêtre semblent envelopper de mystère leurs deux corps. La boue sur le flanc de la Déesse dessine des cercles emmêlés et le tatouage d’Atis un jeune cerf devenu mâle dominant. Atis enserre l’être divin, son membre prolonge son hommage. Magon en voit la hampe épaisse, brillante, dure, qui va et vient sans s’arrêter. La Déesse semble satisfaite, à la fois possédée et possédante. Elle tremble, brame, ploie sous le torse massif du druide et quand les honneurs se font plus forts, Magon croit voir des traits de biche lui paraître à son tour. Ses yeux s’affinent, ses oreilles pointent, sa bouche s’allonge ; sa chair entière se tend dans une posture animale avant qu’elle ne reprenne aussitôt forme humaine. Les amants – on peut les nommer ainsi – se cambrent, tantôt debout, tantôt presque à genoux au bord de la Divona. Les pieds mouillés, le sable collé à la peau, ils sont beaux ; l’univers ne semble en cet instant n’avoir aucune prise sur eux. De l’autre côté, Magon, tombé sur la rive, encore caché par un maigre buisson que le vent aplatit, fixe à loisir leur profil. La source sacrée les sépare, vaste de la taille de deux géants enlacés. Son eau se trouble elle aussi, s’agite bientôt de spasmes qui rident sa surface, de vaguelettes intenses qui ondulent au rythme de leur jouissance et tracent 108
comme un gouffre de plaisir. Au centre de l’onde tourbillonnante, seul un énorme rocher, transparent et oblong comme une pierre précieuse, se dresse, inébranlable. À mesure que la surface de l’eau se creuse autour de lui, que la Déesse et le prêtre se perdent dans le rite, il s’élève si haut qu’il semble gonfler, gonfler au point de devoir éclater. Soudain un râle brut d’Atis, un cri aigu de Calroë suffisent et un ruissellement de cristaux en jaillit qui s’épand en tous sens, s’échoue dans le sable et les herbes, se diffuse jusqu’au ruisseau que la source irrigue. Magon alors doit se rendre à l’évidence. L’eau de la Divona, comme le disait Atis, naît bien du sexe de la Déesse ; et cette eau tiède qui brille étonnamment, cette eau mystérieuse composée de myriades d’infimes minéraux surgit de son plaisir et portera ses vertus à travers monde. Tout autour, malgré les arbres tombés sous la tempête, le val où elle s’offre répercute l’écho de ses clameurs comme une caverne sauvage ou une chambre nuptiale émouvante. La contemplation ne dura que quelques secondes mais elle eut pour Magon, extatique et trempé d’eau sacrée, le temps d’une éternité délicieuse. C’était donc vrai, Atis n’avait pas usé d’une image pour lui non plus : c’était avec la Déesse, la Déesse faite de chair, de parfums, de moiteurs qu’il s’unissait. Il n’y avait aucune statue, aucun simulacre, mais un être véritable et merveilleux. À les voir tous deux rapprochés l’un contre l’autre, un fait si impossible semblait maintenant évident. Tout à coup ils durent sentir sa présence. Atis s’arrêta, tourna la tête, vit Magon. Mais au lieu de crier qu’il n’avait pas le droit d’être là, au lieu de s’interrompre et de défendre le corps saint de la Déesse, il resta impassible et concentré. Elle, pareillement, se redressa, se mit à hurler et sourire en même temps, comme inassouvie et comblée par l’irruption. Elle se dégagea de son amant, sembla grandir de vingt pieds et, sans qu’on sût si elle était furieuse ou au contraire clémente, voulut marcher vers l’intrus. Mais avant même que Magon pétrifié ne réalisât le danger qu’il courait, elle s’arrêta brusquement, respira, haleta en tenant sa gorge nue. Sa poitrine semblait meurtrie. Une petite tache rouge y apparut sous le sein, qui s’accrut, devint un trou, se mit à saigner. Un sang abondant en coula, noirâtre, épais, mêlé de feuilles mortes et de cris d’animaux qu’on écrase. Blême, la Déesse s’effondra sur la rive, ses longs cheveux brun clair tombés dans l’eau subitement calmée de la source. – Elle…elle saigne !, bégaya le druide en se jetant à son secours. Elle saigne ! Magon pensa en être responsable parce qu’il l’avait surprise en plein rite, en pleine osmose et qu’il ne le fallait pas. Pourtant le druide balbutia une autre cause : 109
– Une attaque… Ce ne peut être qu’une attaque ! Si elle est blessée, c’est que la forêt est attaquée ! Il regarda autour de lui, bouleversé, parut frappé de la tempête qui faisait rage, dut se couvrir les yeux. Ce fut comme si le cataclysme alentour le rattrapait soudain, qu’il le découvrait maintenant. La forêt était attaquée, en effet. On aurait dit une force de mort qui était en train de passer, traçant un large sillon dans le bois. Là où normalement la vue était obstruée on pouvait voir maintenant jusqu’au logis, et au-delà à l’horizon, tant le nombre d’arbres couchés était déjà important. D’autres tombaient encore, le chêne où Atis vivait résistait mais tanguait, et le vent continuait de souffler ! Il ne resterait bientôt plus rien de ce lieu sans pareil. Magon hurla : – Atis ! Atis ! Les animaux s’enfuient ! Tout s’écroule ! La forêt est en danger ! Regarde, ton arbre est en danger ! – L’arbre…en danger…, redit le druide à sa suite. Mais il avait de nouveau posé des yeux hagards sur la Déesse qui saignait dans ses bras comme la plus fragile des mortelles. Il lui avait logiquement donné la priorité. Car il fallait la sauver, c’était évident, pour secourir ensuite la forêt qui n’avait de sens sans elle. Comme il allait parler, elle se mit à trembler, son corps et ses cheveux secoués par les souffles. Bientôt elle convulsa et les contours vagues de sa silhouette s’agitèrent tellement qu’ils prirent de nouveau la forme d’une biche, mais blessée, agonisante, oscillant avec son apparence de femme. Il voulut la sauver coûte que coûte, tenter le tout pour le tout. Sans même penser se rhabiller, il se jeta vers un buisson que le vent n’avait pas encore emporté, y arracha des plantes, quelques pousses éparses d’astranore qu’on y trouvait. Il fallait faire vite, agir seul. À Magon qui faisait le tour de la source pour lui venir en aide : – Arrête !, cria-t-il. Moi, je dois rester là, près de la Déesse. La forêt est perdue si je ne la sauve pas. Mais toi, tu peux être utile ailleurs ! Magon, je t’en supplie, trouve Dagios, sauvez le dernier étage de l’arbre, mettez-vous à l’abri avec tout ce que vous aurez emporté ! Le Maltais ne sentit d’abord pas que c’était un ordre. Il s’approcha encore. Atis lui adressa un geste impérieux pour le renvoyer : – Vite ! Il n’y a pas de temps à perdre ! Alors Magon courut vers l’arbre-logis qu’il entreprit d’escalader jusqu’au troisième étage. S’il n’avait jamais douté d’y pénétrer un jour, il n’avait pas cru devoir le faire dans ces conditions. Son chemin fut semé d’embûches. La terre était balayée de vents si violents, elle semblait se soulever sous une houle si forte qu’il tomba plusieurs fois, eut les yeux piqués de poussière, fut frôlé par des troncs d’arbre brisés qui roulèrent 110
devant lui. Aidé de son bâton, il arriva au milieu d’un lit grouillant de musaraignes apeurées qui montèrent de panique sur ses jambes et qu’il dut chasser pour pouvoir avancer. Dagios n’était pas là, le temps manquait d’aller à sa recherche. L’arbrelogis en effet était déjà endommagé et hurlait de craquements. Beaucoup de branches étaient tombées et entravaient son accès ; le vent avait soufflé à travers les deux premiers niveaux et tout cassé en emportant le mobilier de peu sur son passage. Seul le dernier étage, que Magon devait atteindre, résistait car il n’avait pas d’ouverture et une porte solide. L’escalier de racines et les paliers de bois, eux, étaient dans un état déplorable. Soudain, le chêne craqua d’une secousse profonde. Il crut qu’il allait s’effondrer, recula instinctivement mais le vent le poussait en sens inverse. Avec lui, la voix d’Atis comme portée par les souffles résonna dans sa mémoire. Il redoubla de courage, monta dans le lieu de tous les dangers. Sous des rafales qui semblaient forcir à mesure qu’il montait, il manqua de chuter plusieurs fois, de se rompre le cou. Après le deuxième étage surtout, il se souvint que l’escalier de racines cessait. Il n’était plus abîmé, il était carrément inexistant et il était impossible en ce moment de savoir où Atis avait caché les quatre marches qu’il fallait emboîter dans les trous creusés pour le compléter. Il était impossible aussi d’utiliser les échelles qu’on trouvait en bas car leurs barreaux étaient brisés et il n’y avait de toute façon rien à quoi les accrocher. Magon crut qu’il allait devoir renoncer quand l’idée lui vint de se servir de son bâton et de l’orichalque. Comme il l’avait prouvé à Atis, ce métal était très résistant, pouvait trancher n’importe quelle matière, supporter n’importe quel poids. Avec l’épée qui était celée à l’intérieur, il avait justement deux pointes, plus ou moins larges, qui pouvaient former les marches pour monter. Il planta l’épée dans le premier trou heureusement si proche de l’escalier finissant qu’il put poser les genoux sur celle-là et les pieds encore sur celui-ci. Puis il étira au maximum la pointe amovible de son bâton, la fit basculer pour la placer dans le prolongement du bout de bois et la planta dans le second trou en guise de nouvelle marche. Il se cramponna à des mousses du tronc, posa ses genoux à son tour sur le bâton, crut tomber immédiatement. Il ne tomba pas pourtant, ça marchait ! Les trous étaient assez profonds pour que le métal s’y enfonçât solidement et l’orichalque, de la taille de deux majeurs ou d’une lame, pénétrait le chêne et supportait miraculeusement son poids ! Il lui fallut alors entreprendre l’action périlleuse de retirer d’une main, sans se retourner, l’épée plantée derrière lui et l’enfoncer au-devant pour créer la troisième marche. Il y parvint non sans peine, faillit être emporté par le vent. Par bonheur la distance était courte, les degrés de hauteur assez faibles et ce fut une chance 111
extraordinaire s’il put renouveler une autre fois la même action et progresser indemne jusqu’au dernier étage. Cet étage se situait là où les principales branches de l’arbre prenaient naissance ; leur épaisseur protégeait quelque peu du vent qui semblait par comparaison enfler tout en bas et siffler une plainte de mort. Une pluie de feuilles en revanche y tombait, rendait le sol glissant quand Magon atteignit enfin la porte. Par chance, quoique massive, elle était ouverte. Il entra. Quel trésor Atis renfermait-il donc ici qu’il devait sauver à tout prix ? Malgré l’urgence de la situation et l’écroulement autour de lui, sa découverte le retint un instant, avec un plaisir qui ne fut pas moindre que celui qui lui avait fait contempler Calroë. Car, dans une sorte de demiobscurité, il découvrit que le dernier étage, cette pièce dont Atis défendait farouchement l’entrée, cette pièce mystérieuse et précieuse entre toutes était en fait une bibliothèque. Elle n’avait rien à voir avec les bibliothèques romaines ; il n’y avait pas de casiers, de rouleaux de manuscrits ni d’étiquettes avec un nom d’auteur ; il n’y avait aucune armoire, aucun buste de décoration, aucun marbre, mais c’en était bien une, Magon le comprit tout de suite par cette intuition de l’érudit quand il entre dans un lieu de savoir. Plus exactement c’était ce qu’on aurait pu appeler une iconothèque puisqu’en lieu d’ouvrages écrits, c’étaient des images qui étaient préservées, des sortes de bas-reliefs gravés dans le bois, empilés par plaques mal dégrossies le long des cloisons creusées dans l’arbre. Il devait y en avoir une centaine. Elles étaient de tailles et d’épaisseurs différentes, mais sur chacune, on reconnaissait la Déesse, ciselée en des styles contrastés, des postures et des actions diverses dont certaines étaient à peine compréhensibles et qui jouaient avec l’axe du regard. Magon en souleva une de ses deux mains, celle qui avait été sculptée le plus récemment a priori tant les coupures du bois semblaient encore claires et fraîches. Elle était lourde. Il l’approcha pour mieux l’observer dans la pénombre. À gauche on y voyait la Déesse couchée près de l’eau, un sourire apaisant au coin des lèvres. Le travail en était délicat, le mouvement de l’onde simplement formé par le raclage du support et la chevelure par des teintes ocre estompées. Calroë était reconnaissable à son physique gracieux, ses cuisses allongées, sa poitrine opulente et la couronne de flammes autour de sa tête. Pourtant, selon que l’on bougeait l’image, son visage prenait la forme vague d’une hure et elle semblait dans les reflets de l’eau avoir plus de mamelles que trois femmes réunies. À droite, un personnage qui avait, quant à lui, le corps d’un homme mais la tête d’un sanglier abaissait des branches pour désigner la Déesse à un troisième personnage manifestement étranger, normalement vêtu et platement 112
humain. Magon effleura du pouce ce personnage à la marge, en demeura rêveur. Il lui semblait curieusement que c’était son histoire à quelques détails près, la scène de tout à l’heure près de la Divona qu’il regardait comme en un miroir gravé. La situation s’était-elle déjà déroulée ou étaitce la sienne qui avait été prédite sur ce morceau de bois ? Le personnage à l’extrémité, était-ce lui ou un autre qui avait fait montre longtemps avant d’une pareille témérité ? Il songea à la défense qui lui avait été faite d’aller près de la Divona. Contre tout ce qu’on pouvait penser, peut-être la Déesse appréciait-elle en réalité d’être vue, qu’elle en tirait son honneur et si la source était interdite aux étrangers, c’était pour que l’intrusion des voyeurs les plus audacieux lui donnât sa grandeur et son plaisir véritables. Même pour les dieux, la jouissance résidait sans doute dans la transgression des interdits. Magon reposa la plaque, en étudia d’autres. Le bois de celles placées tout au fond paraissait très ancien à la couleur poussiéreuse et la détérioration de leurs bords ; certaines, à la pigmentation carrément effacée, devaient avoir au moins cent ans, pouvaient remonter à l’époque où les Gaulois déferlaient sur l’Italie et la Grèce. À les parcourir, il comprit enfin. Elles n’étaient pas toutes d’Atis, il s’en fallait de beaucoup. Au contraire, tous les druides qui l’avaient précédé avaient enregistré tour à tour les légendes de Calroë, les prières adressées à la Déesse, non pas en les écrivant mais en les sculptant puisque les Gaulois ne maîtrisaient pas entièrement les subtilités du manuscrit. Voilà pourquoi le dessin, la sculpture, la manipulation fine tenaient une si grande place dans l’enseignement d’Atis ! Il y formait son élève ! Lui-même travaillait en bas, portait ici ses bas-reliefs et les plaques aperçues quelques jours plus tôt dans son laboratoire, les ébauches de femmes qu’il devait reporter ensuite sur les œuvres définitives, étaient sa contribution à lui, le dernier d’une longue liste de prêtres. Le jour où il avait accueilli Magon dans son atelier, il avait dû hésiter à lui révéler ce secret, consentant à lui montrer le lieu de fabrication mais pas encore celui plus précieux du stockage. Dagios luimême d’ailleurs n’y avait pas encore eu accès. C’était une mémoire collective qui était emmagasinée là, des archives étranges remontant peut-être aussi loin que le culte de Calroë lui-même. On avait choisi de conserver un savoir ancestral pour éviter qu’il ne tombât dans l’oubli, pour le sauver moins des Romains dont Atis ne parlait jamais que des Gaulois eux-mêmes qui rognaient d’année en année la forêt et déniaient toute vérité à l’existence de la Déesse. La préservation avait un objectif vague et précis à la fois car elle n’enregistrait pas des mots mais une matière. L’important n’était pas de sauver une langue figée, une prière exacte, une interprétation indiscutable, mais la trame générale qui formait 113
l’essentiel des mythes. Le dessin conférait à ce titre une plus grande souplesse qu’un texte puisqu’il ne faisait qu’indiquer un scénario sur lequel tout prêtre suivant serait libre de composer, de dialoguer avec les générations antérieures et maintenir ainsi vivant ce en quoi il croyait. C’était pour cette raison que Magon avait cru reconnaître, sur l’une de ces plaques gravée bien avant sans doute, une scène suffisamment vague pour penser l’avoir déjà vécue. Des discussions alors lui revinrent en mémoire, qui faisaient comme un écho dans sa tête. D’abord celle qu’il avait eue avec Atis après qu’il fut blessé par le cerf. « Écrire fige les mots et les réduit à néant en rendant nos pensées immobiles et mortes », avait-il dit avant d’ajouter « ces lieux ont peut-être plus de mémoire que tu ne le penses ». Puis, c’était la conversation qu’il avait eue à propos de son bâton. Les figures qui y constituaient comme une page incrustée du souvenir de Carthage avaient tant intéressé le druide qu’il avait eu ce mot mystérieux : « les dessins suppléent souvent la parole et sont alors le plus beau des alphabets. » Tout était limpide à présent, et dérisoire. Car qui croirait un jour qu’un tronc de chêne ou un simple bâton pût renfermer un trésor comme celui-ci ? Un trésor inestimable, justifiant les mille réticences à en livrer la lecture et dont la conservation paraissait pourtant bien fragile. Comme ces supports, comme les précautions prises pour en empêcher l’accès étaient vulnérables en comparaison de l’immensité du savoir qu’il contenait ! Parviendrait-il seulement à être préservé de la destruction ? Tout à coup tout parut mourir autour de lui, comme une accélération brutale du défrichement de la forêt. L’attaque évoquée par Atis venait de connaître un point de non-retour. Le vent soudain tomba ; dans le désert qu’il laissa, les feuilles se mirent à chuter comme une pluie, les branchages se rétrécirent, se fripèrent, cassèrent. La ruine laissa place à l’anéantissement, la mort. Magon se tourna du côté de la Divona, eut une pensée instinctive pour la Déesse. Mais un bruit fracassant l’empêcha d’y songer davantage. L’arbre où il se trouvait, ce chêne monstrueux, pluricentenaire, indestructible en apparence faiblissait lui aussi. Son écorce commença à tomber comme une peau de lépreux. L’intérieur du tronc qui soutenait le logis, qui en constituait le sol et les murs devint progressivement gris, sec, instable. Tout menaça de s’effondrer. Il était en danger ! Il fallait redescendre ! Il pensa à sauver un maximum du trésor d’Atis. Mais comment transporter ces plaques, pour certaines larges d’une coudée, sur l’escalier de fortune qu’il s’était inventé ? Il en attrapa trois petites qu’il jeta dans la capuche de son sayon rabattue et coincée dans son col comme une bourse. Il entreprit de redescendre, mais la manœuvre qui consistait à enfoncer 114
devant soi les marches d’un escalier était plus facile en montant qu’en descendant. Il fut entraîné par son poids et celui des plaques sur sa nuque. Comme il plantait son épée dans le trou pour former la dernière marche, il glissa, se rattrapa in extremis à ce qui était sur son arme l’équivalent de la garde, entendit sous lui une plaque chuter et se fracasser en bas au sol. Il se hissa péniblement, parvint à saisir son bâton qui formait la marche antérieure et à retrouver l’escalier de racines. Lorsqu’il toucha enfin la terre ferme, le vent ne soufflait plus. Il le prit comme la menace de quelque chose de pire à venir. La plaque qui lui avait échappé s’était brisée au pied du chêne et s’éparpillait en mille morceaux irrécupérables. Il ne lui en restait que deux. Quelle rage ! Il avait couru tant de dangers, frôlé la mort pour deux seules plaques et une troisième perdue à jamais ! Toutes les autres étaient encore là-haut ! Il fallait trouver un autre moyen mais, sous la pression d’un danger imminent plus grand encore que la tempête, il était incapable de réfléchir. Comme il tenait une des plaques dans sa main et regardait en l’air pour mesurer le chemin qu’il devrait faire au moins une trentaine de fois s’il voulait tout sauver, un projectile tiré de nulle part l’atteignit à la joue, puis un autre à l’épaule, puis une grêle d’autres au cou, à la tête, aux jambes qui le fouettèrent avec tant de violence qu’il tomba et perdit connaissance. Quand il se réveilla, il avait les chevilles et les poignets ligotés de liens de cuir, le corps couvert d’ecchymoses. Quelque chose le frappa d’emblée. Il ne régnait plus nulle part la clarté douce qui baignait la forêt auparavant. Un jour aveuglant et sale proche de l’aurore l’avait au contraire inondée, qui l’obligea à cligner des paupières plusieurs fois pour s’habituer. Il en conclut que les arbres majestueux qui protégeaient la futaie, ces grands arbres qui ne laissaient pas distinguer le jour de la nuit et créaient ici un monde protégé, ces arbres n’étaient plus. Abattus ou décharnés, les colosses étaient tous morts ; leurs cadavres laissaient dorénavant la lumière du monde extérieur envahir violemment les lieux. La forêt des Carnutes n’était devenue qu’un océan de ruines, un champ de désolation où toute caresse maternelle avait disparu. Il eut besoin d’un temps pour y voir. Puis il sentit que le sol était dur et glacial, qu’il exhalait une odeur forte, que les feuilles et les brindilles sur lesquelles il était allongé lui piquaient sa peau encore endolorie. Enfin il remarqua deux hommes accroupis devant lui, goguenards, qui tenaient chacun une fronde, faisaient sauter entre leurs mains des balles d’argile et se moquaient. Autour d’eux s’activait une foule d’individus, une trentaine, peut-être plus, que Magon observa à l’horizontale, encore étourdi et 115
incapable de se redresser. C’était, autant qu’il put s’en rendre compte, une bande louche d’indigènes auxquels se mêlaient des légionnaires sans armure ni bouclier, des auxiliaires berbères qu’il identifia à leurs habits et qui passaient parfois si près de lui qu’ils lui envoyaient, sous leurs talons, de la terre en plein visage. De leur bouche sortaient des plaisanteries graveleuses où des bribes de mots évoquaient des combats, des repas, des cuirs et des trophées. Magon saisit immédiatement le sens de leur présence. Ils étaient armés d’épieux, d’arcs, de lances, de filets ; plusieurs avaient les mollets et les mains égratignés par les ronces ; ils étaient venus pour la chasse. Il s’assit comme il put, regarda avec plus d’attention autour de lui. La chasse qu’il découvrait avait dévasté la forêt entièrement et pris fin au pied de l’arbre-logis où les hommes avaient fait halte, certains assis près d’un feu, d’autres tout à leurs prises, d’autres encore occupés à tenir leurs chiens ou faire leurs comptes pour s’acquitter de leur dette envers les dieux à qui appartenait le gibier. Un énorme dogue vint lui sentir la face et grogner comme s’il voulait le mordre avant de repartir en aboyant. Une douleur s’éveilla à son visage. Il s’aperçut qu’il avait la lèvre gonflée de coups. Au milieu de la troupe, là même où Atis avait l’habitude d’enseigner ses disciples, il vit trois animaux sauvages prisonniers de filets épais, alourdis de poids, qu’on forcerait sans doute à entrer dans les cages vides à côté. C’étaient deux sangliers énormes et un lynx gracile. Ce lynx, il le reconnut aussitôt. C’était celui qui accompagnait si souvent les soirées du druide et restait à se chauffer près de la flamme, immobile, les oreilles relâchées, les yeux clos. Étrangement les trois bêtes ne se débattaient pas, à peine montraient-elles un sursaut de révolte ; elles étaient blessées mais surtout elles semblaient tristes, résignées, comme si elles avaient perdu leur énergie et que la Déesse ne donnait plus élan à leur courage. Le lynx notamment n’avait pas les paupières fermées comme aux heures paisibles où il se prélassait à la flamme, mais il regardait dans le vide, étendu, apathique, presque inerte déjà à travers les mailles des rets. Il avait la moitié d’une oreille emportée, les poils de ses joues arrachés, un œil crevé sans doute par une balle de fronde. Deux rabatteurs s’amusaient à l’agacer en le piquant à sa blessure d’une branche aiguisée et rougie dans le feu. Mais l’animal ne réagissait pas. Il semblait comme ailleurs, presque mort. Alors ils l’appelèrent l’aveugle, Horatius Coclès, rirent en évoquant le nom du héros éborgné des premiers temps de Rome. – Peuh ! Il ne servira à rien, finit par se lasser l’un d’eux, personne n’en voudra au combat. Regarde, il ne bouge même pas.
116
– Borgne ou boiteux, ça n’a pas empêché Horatius d’accomplir ses exploits sur le Tibre. La gueule de celui-là n’en sera que plus effrayante pour les culs-assis du public. Un troisième se mêla à eux, un Osque qui snobait les goûts de la capitale. Dans un crachat répugnant, il ajouta son avis : – C’est pas chez moi, dans le Samnium, qu’il ferait recette. Mais les richards de l’Urbs, eux, font grand prix de cette bête depuis que Pompée l’a introduite au cirque il y a vingt ans. Regardez celui-là : avec sa forme de loup, sa robe de panthère, sa tête louche, il est bizarre et fascinant comme l’eunuque qu’ils aimeraient tous avoir. Le premier repiqua le lynx dans l’orbite sanglante de son œil pour prouver ce qu’il disait. Mais il n’y eut pas plus de réaction du félin. À ses côtés, dans quelques traînées de sang fraîches, des renards, des oiseaux, des chevreuils morts étaient alignés, frappés d’une plaie au cou ou à la tête et attachés à des branches solides pour être transportés. Manifestement le petit gibier avait été tué sur place, le gros préservé et destiné à être emmené vivant. Magon en eut le cœur brisé. Ainsi chassaient les hommes dénués de scrupules. Alors que les Gaulois encore un peu respectueux donnaient simplement, d’année en année, quelques coups de hache à la lisière de la forêt et l’entamaient d’une parcelle en dix ans, des étrangers n’avaient pas hésité, en seulement une battue, à pénétrer jusqu’en son cœur et s’ils n’avaient pas eux-mêmes détruit les arbres, tout portait à croire qu’ils avaient, par la violence, directement provoqué leur destruction sans s’en émouvoir. C’était la première fois en des siècles qu’on osait ce sacrilège. Il fallait vraiment que les Gaules abandonnassent leurs cultes ancestraux, connussent un tel bouleversement dans les guerres pour atteindre ce point de non-retour. Magon n’était pourtant pas au terme de son écœurement. Comme il se redressait un peu plus, un haut-le-cœur le souleva à la vue d’un nouveau spectacle. À sa droite, l’arbre-logis menaçait de tomber. Les rafales de vent avaient fait leur œuvre et s’il avait résisté dans le paysage ravagé, il avait néanmoins ployé de manière dangereuse. Des fissures étaient visibles un peu partout au milieu de son tronc ; les pièces qui y étaient aménagées avaient dû constituer des points faibles et de temps à autre un bruit sourd le traversait comme un long râle de titan à bout de souffle. Les chasseurs avaient bien vu qu’il n’était pas un arbre comme les autres, mais ni ses racines énormes, ni sa taille prodigieuse ne les avaient déconcertés. Ils ne semblaient avoir vu que l’habitation aménagée dans le bois même de l’arbre, en avaient tiré de nouvelles plaisanteries. Ils disaient que c’était la première fois qu’ils voyaient des rats vivre au-dessus du sol, qu’on pourrait en entasser beaucoup pour y foutre le feu. Ils l’appelèrent le petit phare, la 117
ziggouratine, le capitole des sauvages. Bientôt l’arbre pencha tellement qu’ils se prirent à vouloir l’abattre. Par bravade, trois ou quatre d’entre eux s’amusèrent à lancer le plus fort possible leur lance dans le tronc, lui jetèrent de grosses pierres pour l’écorcher ; un balourd s’amusa même à le pousser en disant qu’il était Hercule. Mais à sa gauche, Magon ne fut pas en reste. Derrière les hommes qui rajustaient les mailles des filets abîmés sous les chocs, il eut la vision atroce d’une poignée d’autres qui nettoyaient des dagues et des piques sanglantes dans le bouillonnement morne de la Divona. Au loin, le val érotique était devenu lui aussi un lieu macabre dont le ruisseau porterait désormais non plus l’eau tiède cristallisée, mais froide et souillée du sang des animaux. Ce sang des animaux, c’était aussi celui des arbres, des pierres, c’était celui de la Déesse. Calroë… Où était-elle ? Il ne pouvait s’empêcher de penser qu’il lui était arrivé malheur. Et Atis ? Nulle part il ne les voyait. Il fallait croire que le druide avait réussi à la secourir et qu’il avait pu la cacher à l’approche du danger. Il pressentait pourtant que c’était là une espérance vaine. La battue était finie. Cependant un homme continuait de s’agiter en tous sens. Cet homme, Magon le connaissait également. C’était l’homme au chacal, celui qui avait présidé, plusieurs mois auparavant, à la mort de Sagéra et qu’il avait vu dans la vision suscitée par Atis. Il était vêtu comme n’importe quel chasseur mais donnait des ordres avec la virulence d’un chef. – Il me le faut ! Il me le faut !, vociférait-il, je veux ce cerf ! Tous ceuxlà ne valent rien, c’est le grand cerf qu’il me faut ! Son charognard tout à coup sortit de nulle part et, mâchant sans doute quelque saleté, un peu de sang sur les babines, vint se frotter à ses jambes comme un chien obéissant. Alors seulement l’homme parut se calmer, le flatta d’une tape. L’animal répondit d’un aboiement rauque et, dressant ses oreilles triangulaires, se positionna à l’affût de la moindre proie nouvelle qui se présenterait. Magon l’ignorait, mais l’homme s’appelait Manius Sévius Latro. On le surnommait le Libyen, d’autres fois Encore un, en faisant référence à ses origines ou aux cadavres innombrables qu’il laissait derrière lui. Quoique centurion de légion, il s’adonnait au commerce des animaux dont il tirait de substantiels bénéfices en les revendant à de riches concitoyens pour leur agrément personnel ou les jeux qu’ils offraient au peuple. On lui avait dernièrement parlé d’un grand cerf qui vivait, solitaire et farouche, dans l’ancien bois sacré des druides dont l’entrée était encore interdite au commun des mortels. Il s’agissait d’un cerf rarissime, presque légendaire, vraisemblablement le dernier de sa race. Gigantesque, il mesurait un triple pas au garrot, presque le double en longueur. Son ossature était massive 118
quoiqu’élégante, sa robe blanche ; une protubérance lui bosselait le dos et il brandissait une ramure si immense, de pratiquement dix coudées, assurait-on, qu’on aurait pu y caler tout le butin de César. L’animal n’avait aucun prédateur en raison de sa taille et de sa majesté ; seul l’homme pouvait le mettre à mort. Latro n’avait aucune crainte religieuse. La forêt des Carnutes n’était rien pour lui ; il ne redoutait que la lame de l’épée et les châtiments du tribun s’il venait à découvrir ses agissements. Ce qui l’avait retenu jusque-là d’entamer cette chasse, c’était le dédain qu’il avait pour le cerf qui n’était à ses yeux qu’un animal peureux, sans noblesse. Il avait au début pris l’histoire pour une fable infondée, s’étonnant qu’un animal affublé de si grands bois vécût dans une forêt dense plutôt qu’en plaine. Il réfléchit cependant qu’il aurait été massacré depuis longtemps s’il ne s’était pas caché dans un endroit inaccessible. Puis il repensa à sa ramure surdéveloppée garnie d’empaumures impressionnantes. Combien paieraient les Lucullus, Hortensius, Lippinus pour avoir pareille bête dans leur ménagerie ? Combien plus encore verserait-on pour la voir aux prises avec les griffes ou les cornes d’un autre animal ? Il se plut à imaginer la foule en délire devant le spectacle de ses épois enfoncés dans les viscères d’un ours ou d’un buffle. Bientôt il y songea si souvent qu’il pensa finalement garder pour lui ce trophée, caressa l’idée de ne le pister que pour son propre plaisir dans une traque qui serait légendaire. Cette chasse alors devint une sorte de défi personnel à relever, une obsession qu’il devait assouvir. Il n’y tint plus, n’attendit pas même la fin de l’hiver, organisa une expédition dans cette forêt impénétrable en groupant une trentaine d’hommes avec qui il avait l’habitude d’œuvrer. Ils se présentèrent peu avant l’aube, à l’heure où le gibier est le moins sur ses gardes, encore ensommeillé ou fatigué de ses déplacements nocturnes. Normalement les Romains ne s’aventuraient pas dans les forêts gauloises la nuit, surtout avec si peu d’hommes. Mais Latro n’était pas un Romain comme les autres et, à un ou deux jours près, il aurait pu tomber sur des conjurés qui s’en revenaient, à travers la campagne, des forêts et des fermes isolées où ils avaient conspiré. Il prétexta un rabattage anodin, ordonna de ramener la faune ordinaire en espérant débusquer la créature qu’il cherchait tant. Dans un premier temps, il n’avoua pas à ses hommes que le grand cerf blanc était précisément l’objet de leur chasse parce qu’il n’était pas sûr de le trouver et se méfiait des crédulités idiotes face aux légendes. Depuis longtemps pourtant, les indigènes à qui il avait fait appel ne croyaient plus aux fables colportées sur la forêt et les étrangers ne les connaissaient même pas pour s’en inquiéter quelque peu. 119
D’ailleurs, pour ces mêmes raisons, la forêt qu’ils traversèrent ne leur parut en rien merveilleuse ; ils ne remarquèrent pas la luminosité si particulière des lieux, la hauteur prodigieuse des arbres et leurs fruits atemporels, les brumes étranges qui y flottaient. À aucun moment non plus ils ne virent les ravages qu’ils causèrent comme purent les voir Atis ou Magon. Il y a des endroits purs où pénétrer revient à détruire. L’aveugle ne le voit pas mais les méfaits sont irrémédiables et inéluctables les conséquences. Quand il y entra, Latro faucha symboliquement de son glaive le premier arbuste qu’il croisa, flatta son chacal comme un démon porteur de mort, anéantit la forêt ancestrale sans même y prétendre. Xerxès autrefois frappait l’eau pour la châtier ; lui, la fit saigner par simple plaisir. À la lisière de la forêt justement, là où les braconniers les plus intrépides osaient s’aventurer et poser des pièges, où quelques druides des villes osaient encore cueillir des herbes, à cette lisière se trouvait Dagios qui tâchait de s’éloigner de ses compagnons dont il ne supportait plus l’amitié. Il y venait souvent ces derniers temps, pouvait y passer des heures entières, ne rentrait à l’arbre-logis qu’au petit jour. Après avoir franchi le Divonant, ce ruisseau qui marquait la limite entre le monde des hommes et la forêt merveilleuse, il avançait de quelques pas seulement. Puis il s’arrêtait, tournait en rond, se défoulait de sa rage, insultait à voix haute Magon, faisait des reproches amers à Atis, hurlait dans les champs qui s’étendaient face au sous-bois. Son hurlement se répercutait alors dans la nuit alentour, semblait voler jusqu’aux cités qui connaissent la déception, la douleur et la haine. Parfois quand cela ne suffisait pas, il frappait même un tronc, battait un rameau et la forêt lâchait une longue plainte de souffrance. C’est dans ce contexte qu’il vit ce soir-là venir à lui des formes vagues que l’obscurité enveloppait. La plaine, blanchie par les frimas et la neige, se brouilla soudain d’étroits sillons. Des hommes s’avançaient et le sol, sous leur pas, résonna du bruit sec de la terre gelée qui craquelle. La réverbération de la lune sur le paysage clair les dispensait de feux. À plat ventre, caché derrière un frêne, Dagios les épia à mesure qu’ils s’approchaient. Il distingua des Gaulois, mais aussi des légionnaires habillés sans costume comme ils faisaient lorsqu’ils se lançaient dans des brigandages que leur hiérarchie ne cautionnait pas. La plupart étaient armés d’épieux et d’arcs, quelques-uns de javelines ou de simples bâtons ; les Romains avaient leur casque sur la tête. Des chiens nerveux, tenus en laisse, tiraient en avant ; des hommes en arrière portaient des cages vides, des bâtons solides de transport, des haches, des cordes longues, des filets de lin qui semblaient si légers qu’ils en avaient une grande quantité entassée sur une seule épaule. 120
Il comprit immédiatement que la chasse était le sens de leur présence. Puis il les observa faire. La moitié des hommes se détacha de l’ensemble, un groupe de chaque côté, et s’enfonça dans la forêt pendant que la moitié restante attendait avec les chiens. La manœuvre était simple et bien connue, même pour un jeune barbare comme Dagios. Les deux détachements progresseraient dans la forêt où, à une distance prévue de la ligne de départ, ils disposeraient leurs filets et encercleraient le gibier potentiel avant de recommencer plus loin et ratisser ainsi la forêt. La battue commença au bout d’un moment. Mais à peine avaient-ils pénétré dans le sous-bois qu’un des leurs aperçut Dagios qui s’enfuyait. Il ne fut pas difficile de le stopper d’un coup de javelot qu’il reçut à la surface de l’épaule avant de tomber. Légèrement blessé, il fut amené devant un Romain accompagné d’un chien étrange qui n’était pas tenu en bride. Le Romain lui demanda, à voix basse pour ne pas être entendu des autres : – Tu fais quoi, là, à pareille heure dans la forêt ? Tu relèves tes pièges ? Tu es chasseur ? Tu peux peut-être m’aider. Je cherche un cerf extraordinaire, une bête presque deux fois plus haute que toi, avec un pelage de la couleur d’une neige mélangée d’or et des bois à faire pâlir le plus cornu de tes dieux. Toi, quelque chose me dit, à ta gueule de Nordien honnête, que tu sais où le trouver et que tu vas me le dire. La vérité était que Latro ne souhaitait pas lancer une poursuite complète qui prendrait des heures, finirait par éveiller l’attention quand le soleil serait franchement monté dans le ciel et pourrait susciter la colère des plus religieux des sauvages. Il pensait que les druides avaient un pouvoir politique encore fort et ne voulait pas les indigner d’un sacrilège ni les pousser à fomenter une émeute, voire, pire, une révolte. La rencontre avec Dagios résultait à ce titre d’un heureux hasard. Le jeune homme était parfaitement le genre d’être à qui il aimait s’en prendre, faible, ne dépendant d’aucun seigneur dont il aurait sinon hurlé le nom et qui pouvait rapporter gros si on le brutalisait un peu. Il aurait donc apprécié qu’il lui livrât son secret. Car Dagios détenait ce secret, Latro ne se trompait pas ; il voyait bien à quel cerf le Romain faisait allusion, savait qu’il s’agissait d’un animal autant que d’un homme... Ce que l’autre ignorait en revanche. Le disciple d’Atis ne répondit cependant rien. Latro le frappa d’un, deux, trois coups de poing sous le sourcil. – Allons, allons. Tu en as forcément entendu parler. De toute façon tu sais bien qu’on va râteler ta foutue forêt, alors… Dagios ne répondit toujours rien. Instinctivement il se doutait qu’il n’y avait rien de bon à attendre d’un Romain et il préférait cette douleur à une autre bien pire. Du plat de son poignard, Latro alors l’attrapa au palais, souleva sa tête et abattit violemment ses dents sur sa lame. Dagios en eut 121
la lèvre et le bout de la langue coupés. Un flot de sang jaillit de sa bouche, se mit à couler abondamment sur le sol. L’espèce de chien aux pieds du centurion se prit à japper. – Tu n’es pas raisonnable, mon jeune ami… Un garçon comme toi, qui court cette forêt sacrée la nuit doit forcément savoir quelque chose. Tu vois, je n’ai pas envie de lancer une battue et contrarier tes coléreux compatriotes. Je veux juste cet animal, ni plus ni moins, comme un trophée de chasse qui me manque et que je ramènerai avec moi le jour où je rentrerai. Mais j’y pense, tu comprends ma langue au moins ? Ou il te faut un putain d’interprète ? Et ce disant, il lui saisit la sienne de langue comme pour la lui tirer de la gorge. – Tu m’obliges à me salir les mains, mais tu vas parler, je te le jure, même si je dois te tirer la lécheuse du gosier ! Il la lui aurait arrachée, réellement. Cette fois Dagios hurla sous la douleur, fit un geste pour dire qu’il fallait l’écouter. Latro le lâcha, lui laissa un temps pour reprendre son souffle et parler. Face contre terre, les yeux noyés de sang, l’adolescent regarda avec attention le visage du centurion. Le Romain avait la peau tannée, l’œil fourbe, le nez camard et il avait un sourire, oh ! un sourire si atrocement rare qu’il se souvint brusquement. Il se souvint de ce qui s’était passé trois ans plus tôt, de la nuit enneigée où il avait échappé aux légionnaires venus attaquer son village ; il se rappela subitement que c’était le même homme déjà qui avait commis ces exactions. L’homme au chien maigre lâché à ses trousses tandis qu’il courait pour survivre… Comment avait-il pu l’oublier ? Aucun doute n’était possible maintenant qu’il le voyait de plus près. Il eut l’impression de revivre la même épreuve – cette épreuve qui l’avait conduit à s’engager près d’Atis, pour rien puisqu’au final le druide lui avait préféré Magon de Malte. Mais cette fois-ci l’épreuve tournait au supplice. Cerné, blessé, Dagios ne s’en sortirait pas en s’enfuyant à toutes jambes et il était sûr que, même s’il parlait, sa parole ne le sauverait pas. Pourtant il voulut parler. Quelque chose de noir venait de pousser en lui, le désir malveillant d’emporter dans l’autre monde son ennemi juré et même son maître. Sa colère avait tourné à la haine contre ses deux compagnons. Il ne pouvait atteindre l’un, alors il saisit l’occasion de blesser l’autre, oubliant tout respect et toute hiérarchie comme si le contact, à la frontière du bois, avec le monde extérieur lui permettait de laisser libre cours aux bassesses qui y régnaient. Atis et le grand cerf ne formaient qu’un seul et même être, il le savait bien ; indiquer la piste de l’animal signifiait ouvrir la voie au meurtre de l’homme. 122
Il balbutia des mots ; sa plaie à la bouche, le sang qui en coulait donnèrent une allure onomatopéique aux paroles qu’il prononça en latin. Deux de ses dents étaient cassées, sa langue était abîmée, l’entaille produisait un petit sifflement. Il semblait lutter comme s’il se noyait dans ses propres phrases. – Ta langue, je…je comprends. Le cerf tu cherches vit…il vit dans cœur de forêt ; souvent…souvent, il s’abreuve près de source, où là les arbres très grands et l’ombre profonde. Encore avancer plusieurs lieues…au moins... Mais devoir faire vite. Un homme comme toi devance déjà pour chasser lui. Homme aux cheveux longs…vêtu en Gaulois, mais peau hâlée…lui armé d’un bâton bizarre pour chasse. Moi, je l’ai croisé ce soir…tu n’as pas un instant à perdre. Je jure que c’est la vérité… – Il vaudrait mieux pour toi. Sinon ce n’est pas la gueule que je t’abîmerai mais ce qu’on fourre d’habitude dedans. En quelques phrases, Dagios venait de livrer Atis et Magon à une mort certaine et tirer un trait définitif sur le sens de son apprentissage près de son maître. Il reposa sa tête contre le sol, épuisé de sa fourberie. Latro, lui, se tourna vers ses hommes, appela ses guides et, en s’essuyant la main à son vêtement, demanda où était le centre de la forêt. On changea de stratégie au grand étonnement de ceux qui n’avaient pas encore compris que ce n’était pas une chasse comme les autres. Il n’était plus question de parcourir toute la forêt, mais de se concentrer uniquement sur son centre. Au moment de partir, on rattrapa néanmoins le centurion trop pressé de traquer sa proie. Que faisait-on du garçon ? – Il nous est inutile. Renvoyez-le et coupez-lui le bout de langue qui pend encore. Ça le mettra au secret. Un homme approcha aussitôt et de son coutelas sectionna la langue de Dagios qui retomba inanimé au sol. Le petit bout sanguinolent de chair fut jeté dans la campagne où l’on vit l’étrange chien courir depuis les jambes de son maître, retraverser la lisière et venir le dévorer dans la lumière rose orangé de l’aube. « Atia, Atia ! Ici ! », se contenta d’appeler Latro une fois qu’il vit que sa bête s’était régalée. Le chacal obéit. On se remit en marche en envoyant de nouveau les rabatteurs au-devant. Leur chef semblait en joie d’avoir obtenu l’indice qu’il voulait. Ils franchirent le Divonant sans même y penser ni remarquer l’eau qui luisait d’une façon inaccoutumée. La forêt était étrangement calme. Aucun vent ne soufflait, aucun animal ne passait. On n’entendait pas même un hululement dans les lointains. Le chasseur n’a pas l’habitude d’une forêt complètement silencieuse. Elle doit bouger légèrement, être empreinte de froissements et de murmures, prouver qu’elle vit de sa vie coutumière pour qu’il pense qu’à lui seul est 123
réservé le droit supérieur de la troubler. Sinon il redoute facilement une mauvaise surprise, un piège. Pour cette raison, quand ils furent sûrs que les éclaireurs s’étaient bien avancés, ils entreprirent de faire le plus de bruit possible, en hurlant comme le vent, en frappant les grands arbres, en piétinant les rigoles d’eau qui coulaient à leurs pieds. Les animaux effrayés sortirent en grand nombre de leur retraite. Il y en avait beaucoup, qu’ils entendirent fuir dans le noir devant eux. Les rabatteurs étaient en poste, filets tendus, épieux dressés ; ils imitaient les cris des bêtes. Il n’y avait plus qu’à tomber sur les proies. Les chasseurs tuèrent de tout, Latro ne se décidant pas encore à dire hautement que seul le grand cerf l’intéressait. Ils retournèrent le cœur de la forêt, quitte à chasser deux fois, trois fois au même endroit et y passer plusieurs heures. Ils visèrent des oiseaux, décimèrent des perdrix égarées, comptabilisèrent deux chevreuils, six lièvres, un renard, capturèrent deux sangliers et un lynx qu’ils gardèrent vivants. C’est dire si la forêt regorgeait d’un gibier facile mais pas de grand cerf blanc. Latro fulminait, regrettait de n’avoir pris son cep de vigne pour battre sa troupe quand soudain, au pied d’un chêne, ils aperçurent un homme seul, équipé d’un grand bâton. Il n’était pas gaulois, manifestement. Il faisait des mouvements étranges, regardait en l’air, paraissait très inquiet et ne semblait pas les avoir entendus malgré tout le bruit qu’ils faisaient. Cet homme était bien celui que le garçon leur avait indiqué. Latro n’hésita pas, donna ses ordres et deux frondeurs qui l’accompagnaient lancèrent une pluie de grêle qui abattit l’individu. C’est ainsi que Magon s’était retrouvé pieds et poings liés devant le spectacle de la forêt anéantie. Maintenant le jour était franchement levé. Latro en rage exhortait les siens à continuer la battue en disant que ce gibier était digne de bouffeurs de truie, mais pas de vrais chasseurs. Il voulait son cerf, voulait au moins en trouver une trace, parlait de détruire la forêt s’il le fallait, de faucher tous les arbres, de retourner tous les fourrés pour enfin le débusquer. Ce fut alors qu’il dévoila à tous que cet animal seul était le but véritable de sa chasse, que les autres ne comptaient pas. Aucun ne s’en émut ; tout au plus prit-on son entreprise pour le caprice d’un fou comme il y en avait pléthore dans la légion. En face, assis sous ses paroles comme sous une bise glaciale, Magon demeurait silencieux, réfléchissait. Le grand cerf… Était-il possible qu’Atis fût menacé ? Quand il posait son regard autour de lui, la forêt était déjà détruite, il était impossible de la meurtrir plus. Que voulait donc cet 124
homme ? Pourquoi se butait-il à ce point ? Ne voyait-il pas qu’il avait déjà commis l’irréparable ? Il ne savait toujours pas si le druide et l’animal formaient un seul et même être. Dans son doute il ne comprenait pas non plus l’obstination et la brutalité du Romain, mais les craignait parce qu’il sentait qu’il en allait de la vie de son ami. Cependant une nouvelle agitation à sa droite attira son attention. Pendant que Latro parlait, ses hommes s’étaient pris à regarder d’un mauvais œil le chêne d’Atis auquel certains avaient déjà jeté des pierres et des lances. Il n’était pas tombé. Et lorsque leur chef s’emporta à demander s’il faudrait renverser la forêt tout entière, une colère sourde sembla poindre en eux et s’attiser contre cet arbre qui leur résistait et leur cachait peut-être le cerf que l’honneur réclamait de trouver. La cabane qui y était leur rappelait que d’autres vivaient ici et connaissaient mieux ces lieux où eux s’étaient montrés impuissants. Et puis il n’y avait aucun risque à s’en prendre à cet arbre tant il menaçait de s’effondrer. Les chasseurs se décidèrent pour de bon à l’abattre. Latro, qui lut leur brusque projet dans leurs yeux brillants de haine, les laissa faire pour relancer ensuite sa chasse. Ce serait leur sacrifice expiatoire, comme si le fait de voir cet arbre tenir droit malgré la lapidation et les coups était une offense qu’il fallait réparer. Certains parlaient du bois qu’ils pourraient en récupérer, d’autres de cette cabane sauvage qu’ils pourraient détruire avec, d’autres encore demandaient déjà qu’on leur passât les cordes et les haches. La hauteur prodigieuse du chêne ne sembla pas les inquiéter ; ils ne paraissaient pas même l’avoir remarquée en réalité. La cognée à la main, ils marchèrent tout autour comme une bande d’assassins prêts à fondre sur leur victime, se concertèrent simplement à voix basse pour déterminer la direction dans laquelle l’arbre penchait et tomberait. Ils ne prirent aucune précaution, ne firent pas résonner le bois, ne vérifièrent pas si une branche risquait de leur tomber dessus, ne regardèrent pas non plus si le terrain derrière était plat ou ferait rebondir le tronc. Ils l’attaquèrent de toutes parts, d’un coup, le bâillonnant de cordes et plantant leur lame en tous sens comme des ivrognes, des fous furieux. Magon hurla, les supplia, impuissant à faire autre chose. – C’est un arbre sacré ! Vous n’avez pas le droit ! C’est la demeure du druide ! Regardez sa taille, sa majesté, regardez la mort que vous avez déjà semée autour ! Tous regardèrent autour d’eux, avec incompréhension. Ils se moquèrent de Magon, dirent que c’était simplement une saloperie d’arbre mort qui menaçait de s’effondrer, qu’il était même bien maigre pour un chêne et qu’on en viendrait facilement à bout comme si on devait lui couper, à lui, son petit arbrisseau. Les guides gaulois rassurèrent les 125
quelques peureux en certifiant que les druides vivaient là autrefois mais plus maintenant et que l’espèce de cabane anciennement construite et à moitié démolie qu’on y voyait avait dû être habitée à la suite par un ermite ou un pestiféré venu chercher refuge dans les bois. Ils ne semblaient pas voir la même construction extraordinaire que Magon, le même escalier de racines, le même tronc creusé pour former ces étages. Ils ne semblaient pas voir les ravages qu’ils avaient commis partout, ne paraissaient pas même avoir senti le vent souffler comme une tempête. Le Maltais devina qu’il était le seul à avoir vu ces phénomènes. Il se demanda s’il n’était pas devenu fou. Mais il ne l’était pas ; s’il avait été présent, Atis lui aurait simplement dit que l’œil d’un profane est aveugle à ce que la prunelle d’un initié peut voir. Plongé dans une réalité qui n’était pas celle des hommes ordinaires, Magon songeait qu’ils en auraient de toute façon pour des heures à frapper tant le chêne était impressionnant. Pourtant quelque chose le troubla ; les coups portés à l’arbre furent l’ébranlement définitif de la vision du microcosme dans lequel il évoluait depuis des mois. L’échelle de la nature qui l’environnait devint soudain confuse dans sa tête. Les haches semblèrent rapidement faire des entailles gigantesques et, à mesure que l’arbre fut entamé, il parut rétrécir. Sa ramée, son tronc, ses racines diminuèrent au point de devenir normaux. Sa verdure disparut peu à peu. Le logis du druide s’effondra et ne fut plus à ras de terre qu’un simple tas de branches liées – celui dont parlaient les hommes de Latro. Une angoisse indicible prit Magon lorsqu’il vit au-dessus de lui les feuilles jaunir, tomber, disparaître en poussière avant de toucher le sol. Le chêne était petit en effet. Il n’avait jamais été géant, sauf dans l’univers merveilleux où la rencontre d’Atis avait entraîné le jeune médecin. Au bout d’une saignée furibonde, son tronc frêle montra des signes de chute imminente. Tous s’écartèrent. Les plus forts tirèrent alors sur les cordes mais en un mouvement qui parut si désorienté que les uns, sous l’effort, tirèrent vers la droite, les autres vers la gauche. L’arbre ne tomba pas d’un trait, dévissa sous la force de leur action contraire, manqua de peu d’en écraser un ou deux. Magon l’entendit pousser l’ultime plainte d’un colosse à qui l’on briserait le dos, puis il fit un bruit de montagne qui tombe et les secousses qu’il provoqua parurent se répercuter jusque dans les entrailles de la terre. Après un instant d’expectative au cas où il bougerait encore, les assassins se félicitèrent, s’encouragèrent, sautèrent sur leur victime comme pour l’achever. Latro les appela les meilleurs, ses optimates, les exhorta à finir le travail. Ce fut une véritable curée. Chacun voulut avoir sa part du massacre. On coupa les branches comme des membres, on fouilla les veines du bois, on se couvrit de copeaux, de 126
poussière, de terre ainsi qu’on l’aurait fait de viscères et de sang. Nerveux, les chiens eux-mêmes semblèrent vouloir s’y mettre et l’on eut le plus grand mal à les retenir de mordre le bois. Bientôt il ne resta plus qu’une triste carcasse amputée de ce chêne qui avait été aux yeux de Magon le plus beau de la forêt et le plus grand du pays. Le dernier étage de l’arbre s’était comme évaporé dans le fracas de la grande mutilation. Auréolé de quelques rayons dorés du jour, il avait toujours été une sorte de rêve pour Magon qui brûlait de l’atteindre et il venait de cesser d’être comme un songe qui s’estompe brutalement. Magon avait cru le voir s’écraser sur un des énormes rochers situés à côté ; il avait cru voir les plaques consacrées à la Déesse en jaillir comme un jet de matière grise et se répandre tout autour. Mais quand on en ramassa quelques-unes, il comprit sa méprise. Ces plaques, c’étaient en réalité des bouts d’écorce qui s’apparentaient à peine à des tablettes où des formes inidentifiables semblaient gravées. On n’y reconnaissait plus le travail qui en paraissait tellement brouillon, imparfait qu’on aurait hésité à dire s’il résultait de la main de l’homme ou avait simplement été prélevé ainsi dans la nature. De toute façon, les chasseurs ne s’en soucièrent pas, ne remarquèrent rien. Bientôt, les plaques brisées perdirent leur forme allongée et plate d’écorce, se confondirent même franchement avec des branchages éclatés dans la chute ou tranchés sur le chêne et Magon ne sut plus les distinguer. Elles aussi avaient disparu, emportant leur savoir dans la destruction pour échapper au monde banal qui envahissait dorénavant la forêt. Tout ce qu’il avait fréquenté, encore quelques heures auparavant, lui semblait maintenant si différent, si petit, si anodin, métamorphosé sous les injures et la violence des hommes. Il hurla, se débattit, parut un moment pouvoir se dresser mais retomba aussitôt. Et quand son corps s’effondra, il fut entièrement perdu, ne reconnut plus du tout l’endroit où il se trouvait. Ce n’était plus le seul chêne mais la nature entière qui était redevenue normale. Dans le champ de désolation qu’il semblait être le seul à avoir vu, les arbres avaient tous réapparu. À l’exception de celui d’Atis, ils n’avaient pas été détruits en fait, mais profanés et ils n’avaient jamais cessé d’exister. Les rigoles d’eau étaient devenues de simples flaques ; la source sacrée elle-même semblait avoir disparu derrière un marais aux eaux stagnantes et froides. Tout avait-il donc été faux ? Quelle drogue Magon avait-il bue, de quel sortilège avait-il été envoûté pour s’être ainsi laissé abuser ? Il avait été victime d’un mirage, d’un mirage étrange qui durait en vérité depuis plus longtemps que l’irruption des chasseurs puisque ce ne fut pas la forêt merveilleuse qu’il retrouva mais une forêt anodine, sans trésor, sans aucune végétation prodigieuse, soumise aux aléas des saisons, peuplée 127
d’arbres morts en hiver et couverte de neige et de glace. Un lieu qui n’avait rien à voir avec celui qu’il avait connu, comme si ces mois passés auprès d’Atis n’avaient jamais existé que dans ses rêves de savant avide de découvertes insolites. Tout s’expliquait cependant, sans que lui, décontenancé, pût rien expliquer du tout. Il voulait repousser les limites, rêvait de parcourir des territoires inconnus et merveilleux ; chaque nouvelle terre qu’il avait arpentée dans son voyage l’avait enthousiasmé en même temps que déçu parce qu’il cherchait toujours à aller au-delà. Dès lors, abreuvé de lectures sur la magie légendaire des druides, refusant rationnellement d’y croire et voulant y croire inconsciemment, seul un mirage comme celui-ci avait pu le retenir et lui faire penser qu’il pourrait y résider pour satisfaire sa soif de savoir. Tout se révélait maintenant faux mais tout avait eu l’air si vrai… Il ne savait plus que penser. Soudain il se mit à pleuvoir une averse abondante, circonscrite à l’endroit où l’on avait abattu le chêne. Les hommes de Latro furent étonnés de ce fait extraordinaire, d’autant plus extraordinaire qu’aucun ciel chargé de nuages n’était visible lorsqu’ils s’étaient mis en route. Les Romains l’attribuèrent à une bizarrerie du climat. Les Gaulois de la troupe semblèrent plus craintifs et commencèrent à reculer de peur d’avoir commis un sacrilège. Autour d’eux pourtant rien ne le laissait deviner, sinon la présence de l’homme qui avait crié au crime et qui restait maintenant muet devant l’irréparable. Car Magon s’était subitement tu et n’avait bougé en recevant les gouttes de pluie en plein visage. Le silence était l’unique conclusion de sa réflexion. Tout ce qu’il venait de vivre dépassait ce qui peut se voir par les yeux, se comprendre par la raison, s’exprimer par la parole. Il avait caressé ce monde, avait dormi en son sein, avait tenu entre ses mains ses richesses, et il n’en restait maintenant plus rien. Paradoxalement et peut-être pour détourner l’attention, ce fut à ce moment que Latro parut le remarquer de nouveau et entreprit le même interrogatoire qu’avec Dagios, brutal et vulgaire. La patience ne faisait pas partie de ses qualités. Il devinait le cerf tout proche, brûlait de le trouver, se moquait éperdument des signes néfastes que la nature pouvait lui envoyer. Il donna à Magon une première gifle avant de prononcer ses mots. – Toi qui as beuglé, tu comprends notre langue et ta peau te trahit, tu n’es pas d’ici. Je vais même te dire, tu es d’une région proche de la mienne. Je parierais pour la petite Syrte, Malte ou Cosyra. Je vous reconnaîtrais entre mille tant j’en ai baisé des minets et des garces de chez vous, et ton cul m’en dirait encore plus que ton visage. Alors, ça ne sert à rien de me 128
mentir ; tu fais quoi, là, dans cette forêt, en pleine nuit ? C’était quoi cet arbre qu’on vient de foutre par terre ? En posant sa question, il aperçut le bâton qu’on avait confisqué à Magon et posé en face de lui. Tombé avec l’arbre, il était encore défait en deux, d’un côté l’épée, de l’autre le fourreau et ce fut la lame qui, luisant étrangement, attira son attention. Il ramassa l’objet, l’étudia un instant sous tous ses aspects, regarda de nouveau Magon. – Où t’as trouvé ça ? Ce métal, je le reconnais, c’est de l’orichalque. Il y en a dans les hauts plateaux de mon pays. Ça n’a pas de prix. Il avait entendu parler des vertus fabuleuses de cet airain des montagnes, en avait vu un fragment dans un temple quand il était adolescent. D’une pensée rapide, il évalua tous les bénéfices qu’il pourrait en tirer à le monnayer au plus offrant ou à s’en servir pour se débarrasser de qui le gênerait. Il appela un de ses hommes, un certain Mettius, un grand gaillard à l’air benêt vêtu d’une pèlerine de laine noire, qui ferait l’affaire parce qu’il était très idiot et très fort. Il lui confia le bâton, lui fit jurer d’en prendre le plus grand soin jusqu’à leur retour à Génabum, au risque d’y perdre la vie. Latro le lui fit répéter, insista en lui attrapant la nuque et lui battant la tête de son front. La découverte de l’orichalque changeait tout. S’il n’avait pas le cerf, le métal compenserait son échec et pourrait même lui apporter un succès inattendu. Comme l’avait d’abord fait Dagios, Magon ne répondit rien aux questions et ne réagit pas à ce vol. Il était absorbé par le spectacle des autres hommes de Latro dont les plus téméraires étaient retournés, une fois leur étonnement passé, dépouiller le chêne sous la pluie. Son regard se posait alternativement sur la forêt qui avait ressurgi derrière. Le phénomène le désorientait complètement au point d’oublier pour le moment son bâton. Il ne comprenait toujours pas comment tout avait pu changer ainsi, comment ce qui était inestimable avait pu s’anéantir et laissé place à un environnement aussi anodin. Un nouveau coup de Latro sur l’oreille le ramena à lui. Le bandit en vint droit au but : – Maintenant qu’il est à moi, l’orichalque n’est plus le sujet. Tu cherches le grand cerf, toi aussi ? Tu sais où il est ? Dis-le-moi. C’est ça qui m’intéresse avant tout. Mais Magon ne parlerait vraiment pas. Même sous la torture, il n’aurait pas été en état de dire quoi que ce fût de sensé. Alors Latro hors de lui entreprit de le battre. Il le frappa une fois, deux fois, trois fois d’une myriade de coups qui semblaient ne devoir cesser. Son poing tomba et retomba sur Magon qui ne disait toujours mot ni ne suppliait d’arrêter. Et il aurait dégainé son poignard, l’aurait éventré pour chercher des réponses si un nouveau prodige ne s’était produit. 129
Au fond du paysage, dans toute sa splendeur, le grand cerf blanc apparut. Comme s’il exécutait une parade, il s’avança lentement vers Latro et ses hommes. C’était le plus beau cerf qu’on eût jamais vu, les pattes fines, le corps svelte et harmonieux, une légère bosse sur le dos qui le grandissait sans l’enlaidir. Il était surtout d’une blancheur écrue sans nulle autre pareille, à moins de croire aux mythes de Jupiter changé en taureau ou en cygne. Il y avait dans cette couleur une teinte qui rappelait l’origine du monde, comme un lait dans lequel on eût fait tomber des rayons de miel pour dire à la fois la naissance et la douceur d’un âge qui n’était plus. Ses bois étaient majestueux, dignes d’un roi, et son empaumure aurait facilement pu être une branche du chêne qui venait d’être abattu. Ils en furent ébahis, impuissants au moindre geste, gardant leurs haches, leurs flèches, leurs épieux abaissés. Il était là, à leur portée, facilement atteignable, et pourtant même le centurion fut incapable de rien faire. Tous étaient émerveillés, étonnés aussi de laisser l’animal leur faire face, habitués qu’ils étaient à voir plus souvent fuir les cervidés. Mais celuici était différent, superbe et magnifique. Il n’avait pas peur, manifestement ; il cherchait même l’affrontement dans un contre-tous suicidaire. Sa hardiesse alla si loin que tout d’un coup non seulement il sembla presque s’offrir au danger, mais se mit à charger et faucher les chasseurs les plus proches de lui. Il parut voler à vouloir les punir, rien ne l’arrêta. En un éclair, un homme eut la gorge transpercée par ses bois, la tête presque arrachée sous le choc. Un chien fut assommé par les sabots et roula par terre dans un cri aigu. Les autres s’écartèrent vivement, se jetèrent de côté pour échapper au massacre. Les chasseurs les plus éloignés, ceux que l’élan du cerf n’avait pas encore atteints sursautèrent comme s’ils s’éveillaient d’un songe. Tandis qu’il s’élançait vers eux, au milieu des clameurs, ils décochèrent avec panique leurs lances et les traits de leurs arcs fébriles. Il y eut vingt sifflements de toutes parts. Le cerf vola encore parmi eux, donna de la tête, fut criblé de flèches dans les cuisses et les flancs. Mais il n’eut pas l’air touché. Il avança encore, perdit une longue traînée de sang, tomba enfin sur ses pattes de derrière, glissa, redressa son poitrail. Latro qui voulait être le tueur de ce monstre magnifique lâcha tout à coup son chacal et simultanément saisit la hache d’un de ses hommes, la lança avec la puissance d’une phalarique. On vit la lame fendre l’air, tournoyer, s’enfoncer sous la gorge de l’animal et l’abattre dans un râle déchirant. Le chacal, en même temps, bondit, se mit à mordre et à déchirer des lambeaux entiers de chairs et de poils. 130
Le centurion hurla de joie, se précipita le premier. Il s’attendait à une chasse compliquée, ç’avait été facile finalement. Mais quand il arriva devant la dépouille de l’animal, sa dague en l’air pour achever sa proie, il vit son chacal, la queue basse, faire demi-tour en couinant. Au-dessus du cerf en effet, une sorte d’aura cuivrée s’éleva comme évaporée du corps. Elle flotta quelques instants dans les airs, puis s’estompa et disparut tout à fait. Alors un dernier fait inimaginable se produisit : la silhouette du cerf se modifia, son corps se transforma et, quand les pattes eurent rétréci, que la tête se fut affinée comme enfoncée en elle-même, que le cou et le dos se furent amoindris, ce fut un homme que l’on retrouva mort à la place du cerf. Cet homme était nu et casqué de grands bois. C’était Atis. Magon le reconnut aussitôt. On ne peut décrire la souffrance et le vide qu’il ressentit alors. Il ne fut pas interdit comme en voyant la forêt redevenir ordinaire, mais effondré, anéanti, vidé de tout son être parce qu’à la destruction des lieux s’ajoutait maintenant le deuil de l’être humain. Il ne bougea pas, ne versa aucune larme ; les grands désespoirs sont si brutaux, si douloureux qu’ils interdisent sur le moment de gémir ou se battre. Mais il pleura, il pleura en lui de tout son soûl. Il pleura celui dont il s’apercevait, maintenant qu’il l’avait perdu à jamais, qu’il aurait pu être un ami et un maître ; il pleura l’homme exceptionnel, le savant, le prêtre, le mage dont il n’avait qu’entraperçu l’étendue des compétences et de l’érudition. Atis était bien le grand cerf, le grand cerf était bien Atis. Il avait cru à un symbole avant d’en avoir la preuve définitive. Il ne saurait jamais comment une telle identité avait été possible ni pourquoi. Plus tard, une fois qu’il y aurait beaucoup réfléchi, il ne pourrait que deviner que c’était la Déesse elle-même qui, depuis la nuit des temps, établissait cette unité entre un druide et une faune totem qu’elle choisissait. Il ne pourrait que deviner que, lorsque ce druide devenait son prêtre, c’était elle qui trouvait dans son individualité l’animal qui lui correspondait le mieux et qu’elle en revêtait l’apparence femelle pour s’accoupler lors des rites près de la source sacrée. Il ne pourrait que deviner qu’auparavant, elle avait choisi pour certains le sanglier, l’ours ou le chevreuil, pour d’autres le loup, le renard, le chat sauvage, l’échassier et même la martre ou le papillon. Il ne pourrait que deviner que pour Atis elle avait choisi le cerf le plus beau, le plus rare, le plus fragile de tous, le dernier grand cerf blanc, parce qu’elle présageait qu’avec lui son culte devenait plus beau, mais aussi plus rare et plus fragile tant il était menacé de disparaître. Ils vivaient la fin d’un monde. À moins d’un sursaut national dont il y avait beaucoup à douter, l’intrusion des 131
dieux romains victorieux éloignerait plus encore les Gaulois de leurs anciens cultes déjà en partie oubliés. Dans sa grande sagesse, Calroë avait eu tragiquement raison et Magon pressentait qu’elle n’avait pas survécu à la profanation de la forêt. Elle était peut-être partie entre les bras du druide, dans la tempête ou dans quelque recoin encore calme, sur un parterre de mousse au pied d’un grand arbre, elle aussi sous la forme d’une biche. Mais comment la mort était-elle seulement possible pour un être si supérieur ? Magon avait beau chercher, il se souvenait d’Aphrodite blessée à Troie, de Perséphone emmenée dans l’au-delà mais aucun mythe n’avait jamais présenté une divinité mourante. Pourtant, les dieux et les déesses mouraient aussi, non pas d’eux-mêmes mais du fait de l’abandon de leurs fidèles qui cessaient de croire en eux et détruisaient leurs sanctuaires. Atis n’avait pu y remédier. Il s’était alors changé en cerf pour partir avec celle qui donnait sens à sa vie. Ce n’était pas un acte de résistance qu’il venait de livrer, c’était son sacrifice ultime. Magon ne pouvait le voir d’où il était, mais son visage était serein et le tatouage qu’il avait dans le dos, représentant un cerf à trois âges différents, s’était effacé. Latro ramassa sa ramure. Sans la bête magnifique qui la portait, elle lui sembla beaucoup moins prestigieuse. Il la dédaigna en la jetant furieusement de côté. Le prodige de la métamorphose ne l’avait pas ému le moins du monde et il allait s’en prendre à ses hommes quand, se retournant, il découvrit dans leurs yeux une peur terrible, indicible, glaçante. Les uns tremblaient, les autres avaient lâché leurs armes, les Gaulois balbutièrent des mots effrayés dans leur langue. Les chiens les premiers se mirent à courir, les hommes les suivirent en s’enfuyant à toutes jambes, abandonnant leur matériel et leur gibier. Latro voulut les retenir, tonna, les menaça. Rien n’y fit. Alors il retourna sa fureur contre le seul qui restât devant lui, Magon, toujours entravé de liens et d’un coup il lui enfonça, une fois, deux fois sa dague dans le bassin pendant que son chacal le saisissait à la gorge. En ressortant son arme rouge de sang, Latro la frappa sans le vouloir contre une pierre près de lui. La lame se brisa net. Il la regarda, ébahi. Exaspéré de cet énième coup du sort, il jura, s’en tint quitte en laissant sa victime pour morte et s’en alla rejoindre ses hommes qu’il exécrait et qu’il devait rattraper pour ne pas perdre tout honneur. Son chacal le suivit avec regret. Magon, blessé, attendit qu’il fût parti pour bouger. Sans son bâton qu’on venait de lui voler, il se traîna sur le sol, les pieds et poings liés, voulut rejoindre Atis. Il crut un instant que sa fin était arrivée. Pourtant il 132
ne voulait pas mourir. Il songea soudain à l’astranore qu’il gardait dans sa manche par crainte de Dagios. Il découvrit contre toute attente qu’elle y était encore ; les parterres naturels avaient disparu, mais pas le bouquet qu’il avait tenu caché. Comment avait-il pu résister alors que la forêt entière s’était métamorphosée ? C’était la preuve qu’il n’avait pas rêvé tout à fait, qu’il valait la peine de continuer à se battre. Il ne put piler les fleurs pour les appliquer comme un onguent sur sa plaie, se résolut à les mâcher directement. Une brûlure immense lui traversa le corps, le fit vomir, le contracta au point de le recroqueviller sur lui-même. Il avala de la neige pour se soulager, vomit encore. Blême, affaibli sur le sol sali de ses souillures et des blessures des animaux, au milieu des feux de camp allumés des chasseurs, il parvint encore à ramper, hurlant d’effort, se vidant à son tour d’une longue trace sanguinolente très brune. Puis il ne bougea plus, entre les cadavres déjà raides et les flammes qui vivotaient. Sa tête retomba à la renverse, ses membres crispés, son corps lâche. Inconscient, l’œil ouvert rivé au ciel, il demeura longtemps entre la vie et la mort, le cœur suivant Calroë, Atis, toute la forêt dans l’autre monde mais la pupille prise dans l’idée fixe de se venger. Le portrait des siens déjà morts qui l’entraînaient finit par s’estomper ; le doux visage d’Aldéa qu’il chérissait plus encore l’emporta pour lui donner la force de survivre.
133
V LA PRISONNIÈRE
Le jour même de ces événements, à l’heure où Latro était parti pour sa chasse maudite, Taurillos aux bœufs gras, lui, avait eu plus de mal à se lever de son lit. Dans sa demeure de Génabum, allongé sous des peaux de renards et de chiens, au milieu de ses femmes qu’il obligeait à se pincer les hanches pour affermir son érection matinale, il était encore engourdi d’un demi-sommeil où les ronflements avinés le disputaient à des meuglements salaces. Les membres de sa maisonnée qui dormaient dans la même pièce ne le dérangeaient pas. Bien au contraire, les galanteries l’égayaient, et il allait entrer joyeusement dans leur jeu quand il entendit de l’agitation audehors de chez lui. Des voix s’élevèrent, se répondirent à l’extérieur, parurent apporter des nouvelles importantes. Il était pourtant bien tôt : aucun rayon du jour ne perçait. La garde du vergobret interdisait à quiconque l’entrée de la hutte. – Charmolaos, mes chéries… Ce n’est que Charmolaos, mon neveu. Ne vous tracassez pas, mes toutes belles, continuez… Les deux femmes obéirent, se plongèrent la tête dans le cou l’une de l’autre et, gentilles comme il voulait, elles s’embrassèrent à pleine bouche le menton et les pis. Mais le raffut qui les avait dérangés se répéta. Taurillos réfléchit brusquement. Il se souvint que Charmolaos n’était pas en ville actuellement, mais en territoire turon. Il prêta une nouvelle fois l’oreille. Il reconnut pour de bon la voix de son neveu par alliance qui était aussi son homme de main le plus zélé. Zélé au point d’être revenu de toute urgence de sa mission pour l’empêcher de jouir des douceurs de la vie. Se concentrant, il saisit alors quelques bribes de paroles, se rembrunit. Et ruminant : – L’abruti !, souffla-t-il, il saurait à quel point il est abruti s’il avait deux génisses comme vous dans son lit ! Il se résolut à abandonner ses femmes, appela pour se faire habiller. Avec la lourdeur d’un bœuf qu’on éveille, il leva son ventre énorme, laissa fuser au nez de ses princesses un vent long et chaud comme un souffle
d’été dans l’hiver, qui emplit la pièce d’une forte odeur de fumier. Elles en rirent gaiement. – C’est signe de bonne santé, dit-il en les chatouillant, et vous auriez tâté de ma vigueur sans ce trouble-joie là-dehors. Une servante, déjà debout, vidait une aiguière d’eau tiède dans une cuvette d’argent pour sa toilette. Il la prit par la taille, la colla au châlit, lui planta un gros baiser bruyant sous la joue gauche. – Par le tricorne d’Ésos, voilà une journée qui aurait pourtant bien commencé, mon petit bousier ! Dans mes bras, il y a de la place et trois femmes valent mieux que deux : telle est la science du calcul que les druides m’envient. Il rota une fois, s’étira. Malgré l’insistance de Charmolaos à l’extérieur, il avait envie de plaisanter, de lutiner, de profiter du luxe comme il le faisait tous les matins depuis ce mois d’automne où il s’était résolu à suivre les mœurs des Romains. L’exécution de Sagéra avait signifié pour lui le commencement d’une existence nouvelle, comme la nouvelle année qui débutait en novembre dans le calendrier gaulois. L’homme aux bons bœufs était devenu l’homme aux bœufs gras dont l’existence était faite de relâchement et de plaisirs, et ce relâchement de ses plaisirs était fondé sur une mauvaise lecture des conflits qui agitaient la Gaule à cette époque. Le vergobret était en effet persuadé que les grands dangers étaient derrière lui, que les Carnutes avaient su s’épargner les pires malheurs en se tenant à l’écart des précédentes campagnes de César. En scellant une alliance indéfectible avec les troupes du proconsul, en s’imaginant que la guerre était terminée, que le temps était venu de la répartition des pouvoirs et des richesses dans le nouvel équilibre instauré, il avait peu à peu délaissé l’exercice de la politique et méprisé les intrigues qui faisaient et défaisaient les puissants. C’en était si grossier que même son ennemi juré, le stratège Cotuatos, était persuadé qu’il ne s’agissait que d’une façade pour cacher ses ruses et il se trompait en le croyant. La vérité était beaucoup plus simple et plus vile : répondant à une inclination naturelle longtemps contrariée, Taurillos s’était abîmé corps et âme dans l’étalage de son opulence. S’il nourrissait un regret, c’était de n’avoir pu le faire plus tôt. Les voix dehors ne cessaient pas. Enfin, vêtu des habits les plus riches, un rhyton de vin à la main, il sortit. Il faisait encore nuit, l’air était glacial. En bas de la Butte-aux-rats où était fixée la demeure, Génabum dormait, tranquille, ses toits blanchis par les dernières gelées, entourée de ses remparts où les sentinelles restaient en poste pour prévenir d’un ennemi qui ne venait pas. 136
Charmolaos attendait dans le froid, abrité d’un simple cucullus, sûr de voir au final son chef se déranger. L’empreinte confuse de ses brogues dans la neige indiquait qu’il avait fait les cent pas en tentant de convaincre les gardes autour de lui de faire venir leur maître. Les quatre hommes censés veiller avaient cet air bourru qu’ont les lourdauds qui viennent d’être méchamment tirés du sommeil ; seul le neveu du vergobret paraissait agité comme quelqu’un qui n’a pas dormi de la nuit. – Eh bien, que se passe-t-il, mon cher neveu ?, dit Taurillos. Tu es déjà de retour ? Ce n’est pas pour chanter mes louanges, j’imagine. Calroë vient donc en ville que tu arrives en courant ? J’aimerais bien la cajoler, par Taranis ! Ou alors Cotuatos ourdit un complot et tu l’as surpris au creux des arbres avec ses culs-larges de mignons ? Quoi qu’il en soit, ce n’est ni pour l’un ni pour l’autre que je t’ai engagé. Aucune de ces deux questions formulées avec la vulgarité coutumière du personnage n’en était vraiment une : la première était sa plaisanterie préférée, la seconde sa terreur absolue. Mais Charmolaos n’y prêta pas attention. Il prenait sa mission au sérieux. Il avait l’air inquiet et excité à la fois. Il lui répondit simplement, derrière ses moustaches jaune paille : – Elle revient. – Qui ? – Celle que tu m’as demandé de surveiller. La fille du fermier. Avec des hommes qu’elle a levés. Le vergobret redevint soudain grave : – Combien ? Où ça ? – Une troupe de Bituriges, encore. Elle a usé de ses liens de parenté, làbas, du côté de sa mère. L’histoire se répète, mon oncle, l’histoire se répète. – Mais où sont-ils ? Et combien ? Sois plus précis, nom d’un chien ! – Quatorze exactement. Ils sont actuellement à hauteur de Magodunon. Je les ai suivis depuis Gabris sur la Sauldre à la limite entre les pays turon et biturige. J’ai réussi à les doubler tandis qu’ils faisaient halte pour la nuit. Je suis venu au plus vite t’avertir. Ils parlaient d’Aldéa, la fille d’Anéroeste. Après l’exécution de Sagéra dont Taurillos savait qu’elle reposait sur un mensonge, Charmolaos avait été chargé de veiller sur elle. Le pouvoir était alors ennuyé. Il n’avait pas voulu paraître excessif en faisant arrêter ou disparaître la fille du faux coupable ; il n’avait pas non plus voulu la laisser parfaitement libre alors même qu’il avait appris avec crainte qu’elle prenait la succession de son père à la tête de sa ferme. Il se mêlait là des considérations économiques et politiques. Il faut dire que la ferme en question était opulente du temps du père et du grand-père d’Aldéa, si opulente qu’elle faisait de l’ombre à quelques terres que 137
possédait Taurillos dans les environs. Le vergobret était démesurément riche, n’aurait normalement pas dû s’en inquiéter ; néanmoins il vivait comme un affront cette autre prétention à la richesse tout près d’un de ses domaines tant le chanceux ne supporte jamais qu’on vienne lui faire de l’ombre. Chose rare surtout, Anéroeste n’appartenait à la clientèle d’aucun seigneur qui aurait pu chercher à réparer l’injustice dont il avait été victime ; mais l’indépendance de sa famille, objet légitime de fierté, pouvait justement pousser sa fille à concevoir l’orgueil de réclamer vengeance dès qu’elle le pourrait. L’effroi suprême de Taurillos était de s’imaginer qu’elle trouverait alors soutien auprès de son adversaire Cotuatos, qu’elle dévoilerait au grand jour ses manigances pour que l’autre le renversât et prît sa place. Dans l’indécision, trop occupé à croquer sa fortune et ne plus réfléchir aussi efficacement qu’il le faisait autrefois, le vergobret avait résolu de laisser passer l’hiver, sous la surveillance de l’empressé Charmolaos, pour voir comment les choses tourneraient. Charmolaos, comme beaucoup de ses concitoyens, ignorait que le supplice de Sagéra résultait d’une manipulation perfide. Son intelligence était à vrai dire limitée et son talent aussi. Il était le barde officiel de Taurillos, l’oncle de sa femme Dilakka, qu’il accompagnait normalement partout et dans la dépendance financière duquel il vivait. Mais jouant mal de la lyre, composant des panégyriques maladroits, vivant surtout à une époque où la parole de sa caste n’était plus sacrée comme jadis, il se bornait à ramasser l’or qu’on lui lançait généreusement et faire ce qu’on lui disait de faire ou dire ce qu’on voulait qu’il dît. Taurillos pouvait se passer de lui : par manque de culture, parce que l’hiver se prêtait moins aux banquets et aux éloges publics, parce qu’il rêvait désormais d’un poète latin qui aurait chanté ses louanges comme Orphée ou Ennius, son barde ne l’intéressait plus. Il lui avait donc confié la mission de surveiller Aldéa. Charmolaos qui attendait surtout après l’argent accepta après avoir reçu une bourse pleine de pièces. Or Aldéa ne fut pas inactive durant l’hiver. Bien au contraire, la morte saison fut pour elle celle d’une résurrection. Après le trépas de son père, le pillage de Samogaion, le départ de Magon auprès d’Atis, elle avait d’abord cru qu’elle n’arriverait jamais à faire face à tous les défis qui se présentaient à elle en même temps. Souvent elle avait pleuré, elle avait annoncé devoir tout abandonner. Il fallait se rendre à l’évidence. Les réserves avaient été vidées, les hommes avaient été massacrés, les bêtes volées ; seules demeuraient des femmes dénuées de tout – six en comptant une enfant à la charnière de l’âge adulte. Et puis l’une de ces survivantes était allée en ville pour tenter d’éclaircir les événements ; elle y avait appris 138
la mort de Sagéra, le rôle de chacun dans l’histoire, était revenue en catastrophe porter la terrible nouvelle à ses compagnonnes d’infortune. Les six femmes avaient alors craint de devoir s’enfuir, avaient envoyé les enfants en sécurité loin de là, de peur de voir un matin les sbires de Taurillos ou de Latro venir achever leur travail. Ces derniers ne vinrent cependant pas et les femmes de Gaule étaient plus industrieuses et courageuses qu’elles n’y paraissaient. Les unes les autres, elles s’épaulèrent, s’entraidèrent, s’interdirent de flancher. Après un premier découragement, ce fut une série de bonnes découvertes qui les tirèrent d’embarras. Les champs ensemencés n’avaient subi aucun dommage, les bâtiments étaient intacts, les silos enfouis n’avaient pas été ouverts, les deux métiers à tisser eux-mêmes avaient été brisés net et étaient facilement réparables. Puis elles retrouvèrent par miracle, plusieurs jours après les faits, une partie de la basse-cour qui avait survécu dans un bosquet non loin de là, réchappant aux hommes comme aux bêtes sauvages et au froid. C’était déjà suffisant pour faire vivoter la ferme, mais les choses s’améliorèrent pour de bon lorsqu’Aldéa se souvint que, devant elle, et elle seule, son père avait évoqué une ou deux fois, non sans mystère, un trésor à lui caché dans l’eau. Une mare se situait justement quelques pas derrière le fossé nord, où elle eut l’idée un jour heureux de planter un bâton à travers glace. Un son indiqua un objet et à en suivre le contour elle comprit que cet objet était volumineux. Avec toutes les peines du monde, elle sortit de la vase gelée un coffre qui contenait des monnaies gauloises, massaliotes, romaines en quantité – assez en tout cas pour prendre un nouveau départ au printemps. En attendant, les femmes se contentèrent de fortifier un peu plus l’enclos dont l’entrée resta néanmoins grande ouverte à qui voudrait y pénétrer par la force. Ce fut une petite communauté d’ouvrières joviales, ayant retrouvé le sourire, qui vécut en commun dans l’autarcie la plus totale, dormit ensemble, reconstruisit d’un seul élan l’exploitation isolée du reste du pays par une neige abondante. Seul Charmolaos observait le spectacle de leur tépidarium de loin, les membres engourdis par l’hiver et brûlant d’y pénétrer. Aldéa savait qu’elle était surveillée, comme en sursis. Elle avait beaucoup pensé à la fin atroce de Sagéra et devinait que ses ennemis ne s’arrêteraient pas là. Mais, si elle connaissait les responsables de ses malheurs, elle n’en savait toujours pas les raisons. Plus elle voulait comprendre la cause des événements qui l’avait frappée, moins elle y parvenait et l’envie la prenait seulement de se venger, de la plus intelligente des manières, en reconstruisant sa ferme à l’identique, la rendant même plus belle, plus prospère qu’avant, si connue dans le pays que s’y attaquer 139
de nouveau serait désormais un sacrilège. Survivre ne suffisait plus, il fallait vivre et rayonner. Pour cela elle avait besoin d’hommes capables d’effectuer les travaux les plus rudes des champs. Après le tressage des paniers et la cordonnerie, bientôt arriverait le moment de relancer l’élevage avec les bêtes qu’on aurait achetées, puis les récoltes et leur transport, et le bois qu’on couperait. Même les femmes les plus entreprenantes ne seraient pas à la hauteur pour remplir ces tâches au mieux. Ces hommes, ce fut naturellement, comme une bravade folle, qu’elle entreprit de les choisir en territoire biturige. À vrai dire, pas un Carnute n’aurait accepté un emploi de sa part. Tout le monde, même les brigands les plus paresseux, croyait la ferme ruinée et l’opprobre avait de toute façon été jeté sur elle. Après le procès de Sagéra, les partisans de Taurillos ne cherchaient plus à démêler la vérité, trop heureux d’une situation qui arrangeait leur champion ; ceux de Cotuatos faisaient mine d’approuver le supplice pour préparer en secret leur complot ; la populace, elle, malgré sa sympathie traditionnelle pour l’étranger, se disait qu’il devait y avoir un fond de vérité dans les accusations proférées, que les druides, ces sages d’entre les sages, ne pouvaient se tromper dans leur jugement et que là où un Biturige était passé, un Carnute ne ferait jamais fortune. Chez le peuple voisin en revanche, Aldéa avait encore des liens avec un oncle, un frère de sa mère qui lui avait assuré que le bruit de la mort de Sagéra n’était pas venu jusqu’aux oreilles des siens. Là-bas, les terres étaient pauvres, marécageuses, ravagées par la guerre. La jeune femme n’aurait aucun mal à y convaincre une dizaine d’hommes d’aller chercher du travail ailleurs. Et puis ce serait un joli pied de nez pour dire qu’elle ne craignait aucun seigneur malhonnête. Son endurance comportait une part d’entêtement dangereux. La frontière était infestée de loups qui n’hésiteraient pas à attaquer une jument attelée à une simple reda. Elle répondit qu’elle craignait moins les loups que les fils de la louve. Au moment des derniers froids, elle s’était mise en route, avait fait semblant de partir en territoire turon sous un prétexte futile pour mieux fausser chemin à ceux qui ne manqueraient pas de la suivre et elle avait bifurqué très vite vers le pays des bruyères et des boulaies monotones troublées des seuls vols de sarcelles ou des déambulations d’un héron allongeant ses pattes dans l’eau. Charmolaos, s’il avait bien failli perdre la trace de ses ornières à plusieurs reprises, avait réussi à se faire oublier tout en ne la lâchant pas. Son absence avait duré moins d’un mois au total ; elle n’avait rencontré aucun obstacle ; elle était revenue avec une dizaine d’hommes à son service. En apprenant la nouvelle, Taurillos réfléchit. Un éclair de lucidité parut traverser sa face épaisse. Pour reprendre le mot de Charmolaos, l’histoire 140
se répétait, en effet. À ceci près que les inventions sur le père devenaient cette fois authentiques à propos de la fille. Quand la vérité rejoint le mensonge, c’est toujours là l’occasion d’effacer de honteuses manœuvres et Taurillos songea aux siennes. La gamine venait de commettre une erreur ; elle lui offrait non seulement la possibilité de se débarrasser d’elle facilement, mais aussi de renforcer l’alliance avec les Romains pour être non plus bien vu d’eux, mais se laisser manger carrément dans la main. La chance était de son côté, il devait la saisir s’il voulait ensuite retourner à ses gaietés érotiques. Il sourit, but une grande rasade de vin au point d’en répandre sur sa barbe, et se parlant à lui-même : – C’est vraiment une bonne journée qui commence ! Quoi de mieux qu’avoir trois femmes dans son lit, si ce n’est piéger enfin une sauvageonne arrogante qui vous nargue depuis des mois ? Eh, qui sait ? Peut-être qu’elle aussi rejoindra ma couche ? – Je suis venu te prévenir aussitôt, continua Charmolaos comme s’il n’avait rien entendu. Ils entreront dans la ferme à l’aube. Il me semble qu’il vaut mieux intervenir dès leur arrivée pour bénéficier de l’effet de surprise, éviter les pertes de la dernière fois et… –… donner l’impression qu’on ne laisse pas le danger s’installer. Taurillos regarda fixement son neveu. Leurs pensées se complétaient. Pour la première fois depuis longtemps, il le trouvait moins bête qu’il n’en avait l’air. Pour l’honorer, il lui tendit la fin de sa coupe. L’autre but avidement de ce vin qui avait le goût du pouvoir. – Hmm… Tu as raison, mon neveu, tu as raison. Entre, nous allons régler notre plan et ne fais pas attention à mes femmes : elles ne sont pas encore vêtues. Satisfait, Charmolaos entra. Quelques instants après, il sortait et rassemblait les hommes au pied de la butte. Quand tout fut prêt pour partir, le jour se levait. Un jour implacable de laideur où la moindre espérance de soleil, le moindre rayon de joie était écrasé dès son apparition dans le ciel. Taurillos avait passé ses plus beaux atours, sa ceinture à revêtement de tôle de bronze, ses bracelets en feuille d’or, et pris son épée de prestige pour impressionner davantage que se battre. Il descendit à pas lourds la colline de sa hutte. Trente cavaliers, sa garde rapprochée, l’attendaient tout en bas. D’un œil sûr, il les inspecta rapidement. Puis on l’aida à enfourcher son cheval dont la bride dorée s’ornait de disques d’émail et s’alourdissait de pompons et grelots. Lui qui avait passé l’hiver à tenter d’imposer sa litière de fortune à ses concitoyens trouva soudain la peau d’ours qui recouvrait sa monture assez peu 141
confortable. Il ne voulut rien dire, mais Charmolaos, qui le secondait dans cette affaire, dut le deviner tant il eut une mimique d’étonnement. Ils attendirent longtemps une dernière personne, qui arriva sans se presser, le teint hâve, la démarche fantomatique dans ses vêtements blancs qui se confondaient avec la neige. C’était le druide Itas, suivi de ses assistants, celui qui avait jugé Sagéra et que l’on reconnaissait entre tous à sa barbe blanche longue comme une épée, ses cheveux rares et ses yeux noirs enfoncés dans ses orbites creuses comme les trous d’un crâne de squelette. Les hommes de Taurillos n’étaient pas au courant, manifestement, de sa présence. Le druide leur imposa une sorte de malaise quand ils le virent se joindre à eux. Mais ils se turent. La sacralité de sa caste et la puissance néfaste qu’ils lui prêtaient à lui en particulier les retenaient de toute parole. Dans la pénombre de l’aurore, il leur faisait peur plus qu’il ne leur donnait de l’assurance. Ils allaient cette fois se mettre en chemin quand une voix solennelle et grave les arrêta encore. C’était celle de Crasovir. Ils virent la silhouette efflanquée du vieillard approcher rapidement dans le petit jour. L’argentier avait l’air soucieux, portait sur ses vêtements rayés de glauque et d’ocre une fourrure fine comme s’il ne craignait pas les températures malgré son âge avancé. Son habit, très pauvre, ne le différenciait pas du reste de la population. Il était pourtant le second magistrat civil de la cité. Mais il semblait plus à l’aise parmi les gens simples que les insolents de la noblesse. Sa demeure d’ailleurs, proche d’ici, était, de toutes celles de pouvoir, la plus modeste, semblable aux huttes que l’on bâtissait des siècles plus tôt dans le pays, surtout si on la comparait à celle du vergobret où les ajouts romains tendaient à prendre le pas sur les éléments celtes de base. Chacune reflétait le caractère de son propriétaire. Les deux hommes s’opposaient en tout de manière générale. Mais à la différence de Cotuatos, ils avaient décidé de gouverner dans la meilleure intelligence possible, ce qui n’était guère aisé. Le temps que le druide Itas les rejoignît, Crasovir devait avoir entendu le rassemblement des gardes de Taurillos. Il était venu s’en rendre compte par lui-même, accompagné d’un seul adolescent qui guidait ses pas dans l’aurore car sa vue baissait avec les ans. – Où vas-tu, Taurillos ?, demanda-t-il avec autorité. La gorge d’où s’exhalait sa voix chevrotante était plissée de vieillesse. Ses bras étaient agités d’un léger tremblement causé moins par le froid que la colère. – Ça ne te regarde pas, Crasovir. – Dois-je te rappeler qu’en tant que vergobret, tu n’as pas la légitimité de t’éloigner du territoire de la cité ? 142
– Je ne m’en éloigne pas, rassure-toi. Une simple promenade matinale. Maintenant retourne à tes affaires. Il me semble que la monnaie à mon effigie attend toujours d’être frappée. – Je sais où tu vas. À la ferme du dénommé Anéroeste, parfaire ta besogne contre sa fille. Moi aussi, j’ai des informateurs. Crasovir le tempérant n’avait pas non plus été dupe de l’exécution de Sagéra. En entendant Asinus, le louche marchand étranger qui courait après la fortune, rapporter le premier l’attaque de son esclave scythe par des brigands, en voyant ensuite Latro, le centurion sans scrupules de la garnison romaine, intervenir dans l’affaire, il s’était douté que l’accusation était cousue de fil blanc. Les informateurs dont il parlait avaient achevé de lui ôter tous ses doutes quand ils lui avaient rapporté le massacre et le pillage de l’exploitation du père d’Aldéa. Mais parce que Cotuatos luimême semblait accepter la situation pour en faire son jeu, il renonça à dénoncer le forfait. Qu’aurait-il fait, seul, à son âge ? Les fous qui s’entredéchiraient pour le contrôle de la cité auraient été capables de l’accuser de trahison à son tour et de le condamner aux côtés du malheureux. Il avait été contraint de le laisser être brûlé vif. Des larmes lui étaient venues de colère. Jamais, devant les flammes, sous les cris atroces de la victime, il n’avait autant regretté sa compromission avec le pouvoir et son choix de reconnaître la supériorité des Romains. – Et après ?, répondit brutalement Taurillos. C’est le rôle du magistrat que je suis de protéger mes concitoyens. Contre n’importe quel danger. Même un bout de femelle comme celle qui vit là-bas. – Représente-t-elle seulement un danger ? Ou t’es-tu laissé une nouvelle fois aveugler par ce que t’offraient les Romains ? Au risque de nous entraîner encore avec toi dans l’erreur… – Tu outrepasses ton rôle, argentier ! Seul le Sénat a droit de juger mes actions et me donner ses conseils ! Ce n’est pas le moment de me justifier, dehors, alors qu’il fait encore nuit. Si tu veux t’assurer que je dis la vérité, à ta guise ! Tu n’as qu’à nous accompagner. J’oubliais ! Les couilles chenues que tu as sont-elles encore capables de tenir sur un cheval ? Il paraît que Vertiscos chez les Rèmes le peut toujours, lui. Mais toi ? – Ta vulgarité n’a d’égal que ton pouvoir, Taurillos. – Et la force de ma jument ! D’un adroit mouvement des rênes, Taurillos fit faire un déplacement menaçant à sa monture. Crasovir, surpris, tomba en arrière dans la neige au milieu de la troupe hilare à cheval. La situation était grave, l’injure irréparable même puisqu’au mépris de l’argentier, le vergobret avait répondu par la force et l’humiliation. Néanmoins l’outrageux ne s’en inquiéta pas, ordonna les siens en ligne comme si de rien n’était. Le 143
vieillard insulté ne s’emporta pas non plus, ne laissa pas même paraître une douleur dans sa chute. Il se contenta de se faire relever par l’adolescent qui l’accompagnait. Il eut ce simple mot, le dernier de sagesse : – Apaise la cité au lieu d’envenimer les choses, Taurillos. Apaise-la ou tout finira mal. À quoi Taurillos répondit : – On n’apaise le monde qu’en faisant taire les récalcitrants. Je ne devrais pas te l’apprendre. Enfin, on ouvrit le pas, dans un silence total avant que les rues ne s’emplissent. Le druide et le vergobret allaient en tête, suivis des autres cavaliers. Les portes de la ville s’ouvraient à peine quand ils se présentèrent devant elles. Sur la passerelle qui surplombait le chemin, Volomir était déjà à son poste qu’il prenait très à cœur. Quand la troupe à cheval passa, Taurillos n’eut pas même un regard pour lui. Le frère de Cotuatos en revanche lui jeta un coup d’œil aussi rapide que féroce. Ses soldats en faction firent de même ; l’un d’entre eux dégagea légèrement son cou pour laisser voir, comme une menace à peine voilée, l’oiseau qu’il y avait tatoué. Le vergobret et les siens se retrouvèrent au-delà des remparts. À l’ouest de la ville, sur la route principale, ils longèrent au pas une série de sépultures anciennes, y cherchèrent comme une inspiration pour porter la mort à leur tour. Puis ce furent les hameaux sans lumière ni bruit, encore assoupis aux environs de l’oppidum qu’ils traversèrent jusqu’à la campagne enneigée et solitaire qui, sans être belle, glaça les cœurs. Sous la lumière morne du ciel bas, leur itinéraire, glissant, difficilement empruntable à certains endroits, les obligea à des détours et Taurillos fulmina de ces contretemps. C’étaient autant d’efforts pour lui qui en faisait de moins en moins. Il ne s’était rendu qu’une seule fois dans l’hiver à Autricum, la capitale politique ; la ferme d’Aldéa, pourtant très proche, lui paraissait maintenant très lointaine. Il voulait y arriver au plus vite pour régler cette histoire qui le faisait enrager depuis des mois. Quand ils y parvinrent enfin, les traces fraîches de chevaux dans le sol leur indiquèrent que la jeune femme était déjà de retour avec les ouvriers qu’elle avait recrutés. Dans un galop terrifiant, ils firent aussitôt irruption au milieu de la cour. Une fumée tranquille s’échappait du toit de la maison principale ; une odeur de pain flottait dans l’air alentour. Des bagages et l’attelage d’un âne attendaient encore devant la porte d’entrée. Aldéa sortit précipitamment, entourée de ses gens. Les hommes nouvellement engagés n’étaient guère impressionnants. Ils ressemblaient plus à des crève-la-faim embauchés par nécessité. Leur figure trahissait la peur, l’incompréhension de voir, dès leur arrivée, des cavaliers menaçants surgir dans ce lieu qu’ils ne connaissaient pas. Aucun n’avait d’arme ; à les 144
regarder, on se demandait même s’ils auraient su en user. Les femmes avaient l’air presque plus fortes face au danger, quelques-unes portant d’ailleurs des broches de cuisson en guise d’arsenal de fortune. On était loin de la bande de brigands agitée comme un spectre à la populace. Aucun ne cria néanmoins ni ne s’enfuit. De toute façon, les cavaliers de Taurillos s’étaient répandus dans l’espace de la cour, encerclant chaque corps de la ferme et interdisant tout espoir de fuite. Aldéa s’avança parce qu’elle était celle qui commandait et voulait protéger sa maisonnée. Elle était vêtue d’une mince robe à carreaux rouge et or qui tranchait avec les habits ternes des autres femmes ; elle était la seule aussi dont les cheveux retombaient librement sur ses épaules. – Ne cherchez pas à résister, dit-elle, ça ne sert à rien. Attendez que je leur aie parlé pour tenter quelque chose. Bravement, elle marcha droit vers Taurillos qu’elle avait reconnu et dont elle devinait l’objet de la venue. Le vergobret descendit de cheval, dans une boue qui lui arriva aux chevilles et lui tira une grimace. Ils se toisèrent d’abord du regard, lui sûr de sa supériorité, elle rebelle et forte car sûre de son droit. Une discussion âpre s’engagea. – Tu me connais, petite ?, commença l’homme. – Je te connais : tu es l’un des responsables de la ruine de ma ferme et de la mort de mon père, un homme bon, travailleur, qu’aucune engeance de ton espèce ne pourra jamais égaler. Je te connais et tu ne me fais pas peur. Elle reçut une gifle pour toute réponse. Ses gens, derrière elle, montrèrent leur inquiétude mais, sur un geste de leur maîtresse, n’intervinrent pas. – La peur je m’en fous, mais tu me manques de respect, poursuivit Taurillos. Je suis surtout le vergobret chargé de veiller à la sécurité de mes concitoyens. Qui sont aussi les tiens, dois-je te le rappeler ? – Mes concitoyens ? Le peuple qui a approuvé par son silence la mort de mon père, qui a applaudi bruyamment à l’exécution de Sagéra, ce peuple n’est plus rien pour moi. Je l’affirme devant ton petit escadron, je n’ai désormais plus d’autres concitoyens que les femmes qui vivent sous mon toit et les hommes qui ont accepté de remplacer ceux que toi et tes complices avez fait massacrer. Taurillos rit. Avec son nez qui saignait un peu du coup qu’elle avait pris, elle était désirable dans sa naïve opposition. – En ce cas, tu n’es pas des nôtres, ma minette ! C’est encore plus simple. Il paraît que ces gueux que je vois là sont aussi bituriges. Si tu as ramené ces brigands, ça veut dire que tu n’as pas compris la leçon de l’automne dernier. 145
Cette fois-ci, ce fut elle qui rit comme si elle voulait montrer qu’elle ne se laisserait pas impressionner par si peu. Tout en lui la rebutait, viscéralement. – Des brigands ? Où les vois-tu ? Je ne vois que des gens honnêtes et laborieux. Je ne suis pas idiote, j’ai beaucoup réfléchi. Et si je ne sais pas encore ce que tu veux, j’ai compris que tu cherches un prétexte pour agir comme tu n’en as pas le droit. – Oh que si, j’en ai le droit ! Car tes menées sont une menace pour la cité. Il s’interrompit, donna l’ordre à Charmolaos d’aller inspecter chaque bâtiment de la ferme. Le neveu du vergobret s’exécuta. Quand il voulut aller là où l’on avait inhumé les cadavres de l’automne, une femme s’opposa à son passage ; elle reçut un coup de poing qui la renversa dans la boue. Les autres cavaliers descendirent à leur tour de cheval, maintinrent toute la fermée au respect. Seuls le druide et ses assistants restèrent sur leur monture. – Tu vois, reprit Taurillos, nous sommes les plus forts. Alors écoutemoi bien : il y a deux possibilités et je te laisse le choix dans ma grande mansuétude. Ou bien je vous tue tous sur-le-champ avant que le soleil ne se lève au-dessus des arbres et j’immole vos petits culs à Taranis, ou bien, par le vagin de Bélisama, je ne prends que toi qui les commandes et tu acceptes de te sacrifier pour les sauver. Il y eut des cris dans le dos d’Aldéa. Les femmes, fidèles, hurlèrent de ne pas céder au chantage, de les laisser l’accompagner jusque dans les pires supplices. Les hommes, qui n’avaient aucune attache sinon celle d’un contrat, braillèrent en retour de les épargner, de les laisser rentrer chez eux sans demander leur argent. Aldéa n’hésita pas un instant : – C’est bon, je te suis. Elle se tourna vers les siens : – Autrefois deux champions auraient réglé l’affaire par un duel. Mais le temps et les mœurs d’antan ne sont plus. Laissez, tout ira bien. Taurillos en fut satisfait. Il la dépassa et s’adressant à celles et ceux qui étaient derrière elle, il cria : – Vous avez entendu ? Déguerpissez, car ma clémence a des limites ! Les hommes ne se le firent pas répéter. Ils ramassèrent en vitesse les bagages qu’ils n’avaient pas encore défaits, s’en allèrent en se bousculant sous les rires des cavaliers qui les frappèrent du plat de l’épée sur les fesses pour les faire courir plus vite. De frayeur, plusieurs bougres en oublièrent leur monture quand ils en avaient une. Les femmes en revanche eurent une attitude très digne. Elles prirent leur temps comme si elles voulaient 146
dire à Taurillos que ses menaces avaient peu d’effets sur elles et qu’elles ne faisaient qu’obéir à la volonté de la propriétaire des lieux. Elles ramassèrent quelques affaires, défilèrent devant Aldéa qu’elles saluèrent en maîtresse respectée, retenant leurs pleurs, certaines lui baisant la main, d’autres l’embrassant chaudement à pleins bras. Taurillos fut grand seigneur. Il se retint d’exploser en se disant que ces marques de considération donnaient plus de prix encore à sa prisonnière. Bientôt, toutes furent parties. Ne restèrent plus qu’Aldéa, Taurillos et les trente cavaliers. La jeune femme ne se démonta pas cependant : – Je suis prête, allons-y, dit-elle sans trembler. – Patience, ma jolie. Si je n’ai pas tué les tiens, ça ne veut pas dire que je ne vais pas assurer pour de bon mes arrières. Ta ferme est un danger, tu comprends ? Qui me dit qu’elle ne servira pas de nouveau repaire à d’autres manigances ? Le plus sûr est de nous en débarrasser. Je ne vais pas refaire deux fois la même erreur. Il fit un geste. Ses hommes comprirent. Ils sortirent des sacs de leurs chevaux des marteaux, des burins, des maillets, des cordes. Puis ils se répartirent les tâches. Les plus vigoureux s’attaquèrent aux façades des bâtiments avec la violence de brutes et Charmolaos frappa en premier le logis principal qui était tout de bois. Quelques-uns, cherchant un résultat immédiat, brisèrent d’un coup les fours à pain, les portes, le mobilier à l’intérieur ; d’autres s’en prirent à l’écurie, à l’étable, aux greniers sur pilotis qu’ils firent s’effondrer en tirant avec leurs chevaux les poutres qui les soutenaient ; de derniers déterrèrent les silos qu’ils brisèrent comme ils purent. Ils ne voulaient pas mettre le feu, sans doute pour ne pas attirer l’attention. De la même manière, la basse-cour fut tuée sans ménagement, surtout sans laisser les bêtes pousser un cri ; l’absence de bétail simplifia la situation. Ils ne prirent rien, sinon l’argent qu’ils trouvèrent, et par réflexe puisque Taurillos était de toute façon très riche. Ils étaient là pour détruire, ne rien faire d’autre. Cela dura un long moment pendant lequel le druide Itas et ses assistants demeurèrent en retrait ; cette œuvre matérielle et basse ne les regardait pas. Aldéa, elle, les observa, fixement, s’arrêtant au visage de chacun, faisant effort pour le retenir malgré sa peine comme si elle voulait s’en souvenir trait pour trait jusqu’au jour où elle les punirait de leur crime. Pour elle aussi l’histoire se répétait ; la faillite recommençait, en pire même, et il était certain que son père qui reposait sous terre revivait lui aussi la destruction de son bien qui se déroulait au-dessus. Cependant elle garda la tête haute, ne broncha pas, ne tira pas même une plainte qui leur aurait fait trop plaisir. Elle sembla retenir son souffle le temps de la destruction. 147
Ce ne fut que lorsque tout fut en ruine qu’elle parut relâcher sa respiration. Elle prit un peu de terre au creux de ses mains, là où le sol était facile à prélever, la laissa retomber sous les yeux de son bourreau : – Samogaion n’est rien, dit-elle avec une dernière fierté, c’est la terre qui fait tout et elle ne t’appartiendra jamais. Taurillos, qui l’avait laissée faire sans intervenir, marcha alors vers elle et, lui saisissant le menton, il lui dit, de son haleine piquante de relents d’oignons, ses lèvres abjectes collées à son nez : – Patience, ma jolie : pour ce qui est de la terre, j’ai pensé à tout. Itas que voici est là pour ça, il a ses litanies. Ton orgueil est d’ailleurs déplacé au vu de la situation. Allons-y maintenant, tu es ma prisonnière. – Où m’emmènes-tu ? Tu ne me réserves pas un procès, j’imagine. Même un balourd comme toi ne ferait pas deux fois le même coup à son peuple. – Ne t’inquiète pas, j’ai mon idée. En route. Il était encore tôt. Le soleil, comme désabusé, était peut-être à son zénith mais des nuages diffus cachaient sa lumière. Les cavaliers repartirent ainsi qu’ils étaient venus, au galop, mais en se séparant de la moitié d’entre eux restée sur place pour s’occuper des cultures à ravager. On leur laissa les outils ; on confisqua les quelques montures abandonnées par les Bituriges débandés – des ânes, des chevaux faméliques impossibles à mettre à mort. Dans son dos, Aldéa aperçut encore cette poignée de démolisseurs sortir des blocs de sel d’autres sacs ; la fortune de leur maître le permettait. Elle comprit soudain. Ce sel, c’était pour brûler la terre, pour que rien ne repoussât après eux. Elle entendit au loin le druide et ses assistants déclarer le sol maudit sans autre cérémonie que celle improvisée de leur voix. Ils commencèrent par la maison, puis se tournèrent vers les champs où ils se rendirent en petite pompe. Elle ne voulut pas voir ce dernier désastre, regarda de nouveau devant elle. On la laissa chevaucher librement, les mains seulement entravées de liens qui se percevaient à peine dans les mouvements de la course. Elle n’en profita pourtant pas. Où serait-elle allée ? Qui aurait-elle appelé à l’aide ? Elle savait le vergobret très puissant et, ne s’intéressant pas à la politique, elle ignorait qu’il avait des ennemis haut placés qui auraient pu la secourir. D’ailleurs Taurillos allait à ses côtés, cette fois-ci au milieu de sa troupe. Elle fut emportée par l’allure des chevaux qu’on fit passer du trot au galop parce qu’on ne voulait pas s’attarder dans la campagne avec cette prisonnière encombrante. Ils arrivaient en vue de Génabum quand un incident se produisit. À un vol d’oiseau des remparts se trouvait un bosquet d’arbres qui restait touffu même en hiver. Ce fut là, au croisement de deux routes, que la colonne du 148
vergobret en rencontra une autre, à cheval elle aussi. La rencontre fut si inattendue, si brutale que les deux premiers cavaliers, Charmolaos en tête, se heurtèrent de plein fouet. Hommes et bêtes furent projetés au sol et, tandis que les chevaux gardaient leurs jambes emmêlées, les hommes se relevèrent, ébaubis. L’autre cavalier était indemne, mais le neveu de Taurillos hurlait. Il devait s’être démis l’épaule et en gémissant, il glissa sur une plaque de givre. Un tel acharnement du sort le rendit furibond : – L’enfant de salop !, brailla-t-il. C’est qui ? C’est qui ? Montrez-le-moi ! La malchance voulut qu’on reconnût la troupe adverse. C’était celle de Cotuatos aux bras d’yeuse. Le stratège en personne était présent, secondé de son fidèle Conconnétodumnos. Il toisa Charmolaos d’un regard de mépris. Le barde comprit son imprudence, se tut aussitôt, baissant la tête et contenant sa douleur. Tout le monde fit de même par stupéfaction et par crainte de trouver un tel personnage ici en cette heure. Il n’y eut que Taurillos qui prit la parole et attaqua son rival car il était politiquement son égal et ne le craignait pas : – Toi ? Que fais-tu sur mon chemin ? Je te trouverai décidément partout. Cette seule parole suffit à relever la tête des siens. Le ton était à l’affrontement et la gravité de la situation palpable. Les hommes du vergobret détestaient ceux du stratège et la réciproque était vraie. Derrière les moustaches, les barbes, les cheveux longs, tous s’observaient avec des yeux luisants de haine. Ils devaient être quarante, de quoi déclencher une bataille meurtrière. Chaque camp était reconnaissable aux tatouages que les hommes avaient dans le cou, aux poignets, sur le torse quand celui-ci était apparent. D’un côté, c’était la rouelle ; de l’autre, l’oiseau. Aldéa, qui ne savait comment la scène tournerait, ne pouvait, elle, défaire son regard du seul qui eût une prestance de chef. Cotuatos avait un visage noble, un visage de conquérant, un visage de vainqueur, elle le reconnut tout de suite. Elle le trouva très beau, ne s’étonna pas qu’il fût l’ennemi d’un être aussi abject que Taurillos. Conconnétodumnos lâcha un rire d’excitation morbide. La tension monta d’un cran quand Taurillos répéta son reproche : – Mon neveu a l’épaule abîmée, ton homme aurait dû freiner sa monture. Je suis sur les terres de la cité, j’ai la priorité. – Ton neveu ne vaut rien, répondit Cotuatos, et il hurle mieux qu’il ne chante. Regarde, il ne sait même plus marcher sans tomber quand il y a givre au sol. La blessure de mon cheval est autrement plus grave. En effet, si Charmolaos avait l’épaule luxée, le cheval qui l’avait percuté devait avoir une jambe foulée ou cassée. La pauvre bête boitait, hennissait une plainte triste, regimbait dès qu’on voulait l’approcher. Sans se soucier 149
de la conversation, son cavalier essayait, en la tâtant, d’identifier exactement sa blessure. – Il n’avait qu’à ralentir, répondit Taurillos. – Crois-tu qu’à la guerre on ralentisse ? Crois-tu que je ralentirai la prochaine fois que je tuerai ? – Que sous-entends-tu ? Ce disant Taurillos sortit son épée. Il avait pris la dernière phrase de Cotuatos pour une menace, et peut-être l’était-elle réellement. Ses hommes firent de même, prêts à l’affrontement. Cotuatos refusa pourtant le combat. Il fit un signe à ses hommes pour leur interdire tout mouvement agressif. Sans doute pensait-il que l’occasion n’était pas encore venue ; quelque chose comme de la patience se lisait dans ses yeux fixes et impassibles. Il se résuma avec dédain : – Je ne sous-entends rien, rassure-toi. Vois comme tu es habillé. Je ne fais pas la guerre à ceux qui se soucient plus de commerce que de gloire. – Alors, tiens, pour le cheval, si je me soucie du commerce comme tu dis. Et il lui lança une monnaie dérisoire en guise de dédommagement. Ils avaient refusé de faire parler les armes ; c’était maintenant à qui humilierait le plus l’adversaire. À ce jeu, Cotuatos fut supérieur ou plus insolent ; en tout cas, il eut le dernier mot. Il tourna le dos à son interlocuteur, preuve de son indifférence et, laissant l’argent jeté par le vergobret, dit simplement en faisant allusion à l’exécution de Sagéra : – C’est la monnaie des druides, je te la laisse. Adieu. Sa troupe le suivit, au pas, sans se retourner comme si elle ne craignait pas l’ennemi qu’elle laissait dans son dos. Le cavalier tombé monta sur un autre cheval, derrière l’un des siens. La pauvre bête blessée fut tirée par la bride, boitillant moins et se retenant même de hennir comme si elle ne voulait plus montrer, elle aussi, sa douleur par fierté devant l’ennemi. Taurillos attendit que son rival se fût tout à fait éloigné pour regagner enfin la ville et y entrer. Génabum bruissait maintenant de monde. Les premiers cavaliers eurent du mal à écarter la route pour laisser passer les autres au petit trot. Personne en revanche ne sembla faire attention à Aldéa. Charmolaos s’éloigna aussitôt pour aller trouver quelqu’un qui soulagerait son épaule. On s’arrêta au pied de la Butte-aux-rats où habitait le vergobret. Là Taurillos fut gêné en apercevant Sextus Cornélius Asinus qui venait comme chaque matin lui rendre visite. Le commerçant romain montait le chemin qui menait à la demeure, suivi comme à l’accoutumée de son esclave Scythès. Le maître se reconnaissait à sa bosse et ses claudications ; le garde du corps dépassait en taille la plupart des Gaulois qu’il croisait. 150
Descendu de cheval, Taurillos ne craignit pas de le recevoir, même s’il lui dérangeait d’être vu avec Aldéa. Devant sa porte, il ordonna à ses valets d’installer sa prisonnière au fond de la hutte sans trop la ménager. Puis il rentra en tapotant chaudement le dos d’Asinus. Le négociant entama tout de suite ses manières cauteleuses : – Je suis venu te vendre un objet rare qui devrait te plaire… Il claqua des doigts. Scythès resté dehors franchit la porte sans que les gardes ne pussent le retenir. Il sortit de son sac un petit objet, enveloppé dans un tissu, comme il en apportait presque chaque matin au vergobret. C’était une statuette de bronze, représentant un personnage barbu, casqué, vêtu d’une tunique, d’une cuirasse et équipé d’un bouclier et d’une lance. Elle était assez disgracieuse, les détails de sculpture n’étaient pas soignés, mais quelqu’un de suffisamment averti y aurait facilement reconnu le dieu Mars. Pourtant Asinus en fournit une autre explication : – Voici la première représentation officielle du vergobret des Carnutes, en costume de guerre romain. Toutes mes félicitations, noble Taurillos. Taurillos répéta, avec gourmandise : – Moi, par costume à guerre romain… Il le croyait, se voyait complimenté, bégayait dans son latin truffé de barbarismes. Un étranger avait réalisé ce que son argentier n’avait pas fait. En mieux même puisqu’au lieu de petites pièces de monnaie, c’était une statue qui réalisait son rêve d’être l’égal de César. Une statue qui n’avait rien à voir avec celles qu’on connaissait par ici, bien plus criante de réalisme et de finesse. C’était tellement novateur, typiquement romain ; aucun chef carnute n’avait reçu d’honneur semblable. Il n’était plus seulement flatté, il était émerveillé. La statuette prenait la dimension d’une taille réelle, la beauté d’une des sept merveilles du monde grec. Elle avait pourtant été achetée à bas prix, près de n’importe quel temple d’Italie ou de Cisalpine. – Pour une fois, je te l’offre. En guise d’hommage, ajouta Asinus d’une voix mielleuse. L’autre se leva, lui fit craindre un instant sa réaction : – Il sera rien de ça. Journée excellente décidément, mon ami, et ce sera pas dit que Taurillos, fils d’Astorix, récompenser les cadeaux ne sait pas ! Il jeta à Asinus une bourse d’or que le commerçant confia à Scythès qui la fit disparaître aussitôt dans sa manche. – Moi, pas compter ! Maintenant désolé devoir congédier toi après si beau présent, mais fort j’ai à faire, tu vois. Asinus jeta un coup d’œil sur Aldéa au fond de la hutte. Comme bien souvent la demeure du vergobret se composait d’une pièce unique quoique très vaste. Aussi, lorsque les cloisons d’osier étaient poussées de côté, 151
apercevait-on, même de loin, tous ceux qui étaient réunis sous le toit, les prisonniers, les visiteurs comme les gens de la maison. La jeune femme avait été introduite à l’autre bout et demeurait là, prostrée. Il ne la vit que de loin, n’osa s’approcher car il devinait quelles avaient été les heures précédentes pour elle. – Je comprends parfaitement, ne t’inquiète pas. De toute façon, je dois me rendre chez Latro. Permets-moi simplement de te complimenter pour ta… pour ta prise…qui m’a l’air de toute beauté. Satisfait, il prit congé. Taurillos resta seul avec sa prisonnière. Vautré dans un siège, une nouvelle coupe de vin à la main, il repensa au compliment d’Asinus, fit soudain sortir les quelques serviteurs qui œuvraient dans la maison. Combien de temps s’écoula-t-il avant qu’il ne bougeât ? Il aurait été incapable de le dire, songea qu’il demanderait la prochaine fois une clepsydre pour mesurer le temps. Cependant, ses yeux ne quittèrent le corps de sa captive. Du hiatus de sa bouche à ses chevilles menues, tout en elle finit par allumer son désir. Pour lui, rien n’était plus attirant qu’une femme indépendante et rebelle à dompter. Indéfiniment il parut attendre un geste de sa part, quelque chose, n’importe quoi qui l’aurait fait la convoiter plus durement encore. Aldéa restait immobile, recroquevillée, enfermée dans son silence comme une dernière marque de résistance. Elle n’était pas entravée de chaînes mais de plus lourdes invisibles semblaient peser sur son cou et ses poignets. La réflexion était épaisse, de plus en plus laborieuse dans le crâne de Taurillos. Il cogitait, soufflait et elle ne bougeait toujours pas. Soudain il n’y tint plus, voulut la saillir. Il se lève, marche droit sur elle, l’embrasse à pleine bouche de ses lèvres répugnantes. Elle se débat, crie, reçoit une gifle. Il veut aller plus loin, défait son ceinturon, lui plaque la tête à son entrecuisse. Elle se débat, étouffe, le mord. – Salope ! Salope !, beugle-t-il. Maudite salope ! Il la traîne par les cheveux, la jette dans un coin, se renverse de nouveau sur son siège en se tenant le sexe de douleur. La morsure lui fit reprendre peu à peu ses esprits. Bientôt il réfléchit qu’il serait impossible de la posséder. Qu’allait-il faire d’elle ? Il ne pouvait la garder claustrée au risque d’être honteusement blessé chaque fois qu’il la toucherait. Il ne pouvait non plus courir le risque d’un nouveau procès en place publique tant la versatilité de la foule l’effrayait. Le souvenir lui revint alors de Latro mentionné par Asinus juste auparavant. Il eut l’idée de la lui offrir comme otage au nom des paysans carnutes, en la présentant comme l’incarnation d’une nouvelle Rosmerta, le symbole de l’abondance et de la richesse du pays en même temps qu’une rebelle chef de bande. 152
À bien y réfléchir, c’était la meilleure solution. D’abord la gamine ne le gênerait plus sans qu’il ait à la surveiller, sans non plus qu’il ait envie de la prendre par la force dès qu’il poserait les yeux sur elle. Ensuite, il se rapprocherait un peu plus de ses alliés latins. En considérant la statuette de Mars qu’il croyait être à son effigie, il réfléchissait que le présent d’un Romain devait être rendu par un présent à un autre Romain et, à travers l’honneur fait à un centurion, par un hommage à César. Enfin, il flatterait en particulier Latro. Au-delà de l’alliance officielle, c’était l’occasion de tisser avec lui des liens personnels. Les deux hommes se connaissaient assez peu finalement. Ils s’accommodaient du pouvoir l’un de l’autre mais gardaient des rapports distants ni hostiles ni franchement amicaux du moment que l’ordre régnât et qu’ils eussent l’opportunité de s’enrichir. Il eut soudain une idée assez drôle pour mettre en œuvre son plan. – Par Taranis, c’est bien ça ! Cette journée n’en finit pas d’être bonne ! Il y avait des journées où tout se passait comme on voulait, où les erreurs se rattrapaient, où l’on se relevait des trébuchements. Plus le soleil courait sa course épuisée au milieu des nuages, plus il était persuadé que c’était le cas de celle-ci. Il ne pensait pas qu’en hiver les nuits tombent vite et que le lendemain les erreurs deviennent des catastrophes et les trébuchements des pièges. Aussi, alors que le soir tombait déjà lentement et que le ciel semblait peser sur la terre de toute l’ampleur de sa tristesse, le vergobret convoqua les mêmes hommes que le matin et ordonna qu’on habillât Aldéa sans tarder. Après s’être assuré que la destruction de la ferme et des champs alentour s’était bien déroulée, il entama une visite au représentant des légions de César dans l’oppidum. Le but était de venir lui offrir sa captive. Il ne voulait attendre le lendemain pour ne pas qu’on lui reprochât de l’avoir gardée prisonnière une nuit pour son plaisir. Il traversa la ville entière en direction du port, précédé d’Itas et suivi de ses trente gardes rapprochés. Aldéa était au centre, invisible à la vue de tous en raison des boucliers que chacun de ces colosses portait haut contre lui. Le petit peuple de toute façon rentrait, quittait la rue dès qu’il voyait au loin la troupe arriver ; il n’y avait sans doute rien de bon à rester dans les parages. Les légionnaires laissèrent passer. On s’arrêta devant la cabane où logeait le centurion. Ici aucun Gaulois ne venait sans l’accord des Romains, aucun œil réprobateur ne serait braqué sur ce qui allait suivre. Taurillos put demander à voir Latro qui ne se pressa pas pour sortir. Enfin, il parut, l’œil farouche, l’air agité, regardant autour de lui comme s’il se méfiait du 153
monde qui l’entourait. Après les salutations de rigueur, le vergobret parla du coup d’éclat qu’il avait réalisé à l’aube et de la prisonnière qu’il venait lui remettre. Sa troupe s’écarta alors, laissa voir la jeune femme. Aldéa se tenait au milieu des trente hommes, la tête basse, déchue, les cheveux en bataille, un peu de sang au visage. Elle n’avait aucune entrave, semblait fébrile, humiliée, son corps sur le point de s’effondrer au lieu de rester debout dans l’infamie. On l’avait fagotée d’une autre robe, crasseuse, déchirée, et on l’avait coiffée d’une sorte de diadème très pauvre en branches de sapin. De ses bras frêles, elle portait dans une main ce qui ressemblait à une corne d’abondance informe en écorce de bouleau enroulée, dans l’autre un simple panier, mais les fruits qui remplissaient chacun des deux objets étaient abîmés ou pourris. – Noble centurion de César, dit Taurillos, moi présenter à toi prisonnière que je t’offre. Elle, fille du fermier rebelle ; elle, ferment de destruction, de mort, inverse en tout de Rosmerta, la Grande Pourvoyeuse ; elle, gage de collaboration à nous pour l’ordre et la paix. Prends elle. Nous vêtir elle ainsi pour conjurer le sort, montrer au nom de peuple à moi ce qu’elle être vraiment. Rosmerta était la déesse de l’abondance et de la terre féconde. Là était la mascarade imaginée, une parodie de cérémonie, sans rien d’officiel et d’un humour douteux. Pour mieux faire accepter la remise de sa prisonnière à un Romain, Taurillos avait choisi de cacher cette scène aux regards intrus et de présenter Aldéa en fléau des campagnes en la déguisant en Rosmerta dégénérée – son exact contraire. Un nouveau pas était franchi dans l’instrumentalisation des choses de la religion. Il fallait que le druide Itas fût vraiment à la solde du pouvoir pour accepter de travestir ainsi un culte sacré. Il lui fit un geste justement. Celui-ci entama une prière à Rosmerta dans sa langue : – Ô Rosmerta, Grande Pourvoyeuse, Dispensatrice de félicité, nous te prions pour nos champs, nos troupeaux, notre commerce. Ô Rosmerta, Très Providentielle, Toi la Très Généreuse, aide-nous, donne-nous la fertilité des terres, la profusion des arbres, la richesse de nos élevages. Ô Rosmerta, Dubnocaratiaca qui réalises et achèves l’action de Ton Mari inventeur des arts, accorde-nous d’oublier les méfaits de ces impies qui ont voulu détruire ce que tu as créé de si bon. Cela suffisait pour donner une caution de sacralité à la supercherie. Taurillos reprit pour Latro, de nouveau en latin : – Considère elle comme otage. Otage de peu, otage quand même. Pour empêcher troupes à elle qui écument encore la région. Elle pas paysanne, elle chef d’une bande qui pousse, repousse comme têtes de l’hydre. 154
Latro les laissa dire, respectueusement mais avec impatience. En réalité, il n’avait pas la tête à ces honneurs. Il était encore bouleversé par le prodige de la mort d’Atis auquel il avait assisté le matin même, ne savait toujours pas s’il avait rêvé en voyant ce cerf se changer en homme au moment de mourir. Quand il était rentré de sa déconvenue en forêt, il avait été pris d’une réaction de panique qui l’avait gagné, à la différence des autres, en sortant des bois uniquement. Il avait intimé à ses hommes l’ordre de se taire, les menaçant de la peine capitale s’ils parlaient, le temps de réfléchir à ce qui venait de se passer. Il ne savait comment agir autrement. Maintenant, en entendant Taurillos parler, il pensait obstinément : encore leur foutue religion, leurs foutus mystères ? Pays de malheur ! Et puis, même en se concentrant, même en faisant effort pour analyser la situation froidement, il était sceptique sur ce que le vergobret lui offrait car le sort d’Aldéa lui était indifférent et il savait pertinemment qu’il n’y avait jamais eu aucune bande sous ses ordres ni ceux de son père. Un otage était normalement un personnage de marque que Rome prenait en contrepartie du calme des siens. Pourquoi le vergobret s’entêtait-il dans ce mensonge ? D’autres rebelles étaient beaucoup plus dangereux dans les parages, emmenés par Cotuatos dont il se méfiait de plus en plus. À mesure qu’il regardait la jeune femme, il lui trouvait néanmoins un charme fait de naïveté, de fierté et de force. Le monstre se plut à l’observer ; il n’écouta bientôt plus un traître mot des paroles du vergobret. – Les Gaulois, finit-il par dire, chassent peu, même les nobles. Mais le grand Taurillos a de beaux trophées, surtout quand il s’agit de femmes. J’accepte celui-là, au nom de César. Il n’en pensait rien, mais fit rire le vergobret et put lui rendre les honneurs d’usage. Puis il fit entrer la prisonnière dans sa cabane après avoir assuré le représentant du peuple carnute de la confiance qu’il lui accordait. Taurillos avait trouvé Latro curieux, changé. Il s’en retourna néanmoins, satisfait de s’être débarrassé pour de bon de la menace que représentait Aldéa, d’avoir abandonné la responsabilité de son devenir aux Romains, regrettant simplement de n’avoir pu profiter d’elle. La cabane de Latro était beaucoup plus petite que la grand-hutte du vergobret. Le centurion voulut garder la captive près de lui. Mais il se méfiait d’un acte désespéré de sa part. Alors, comme la liberté chère aux Celtes n’était rien pour lui et qu’il n’avait aucun scrupule à asservir brutalement un individu, il lui passa une lourde chaîne de fer au cou, une de ces chaînes qui servent à brider d’ordinaire les chiens, et rajouta des liens à ses poignets. Il la maintint ainsi dans une soumission totale, cachée derrière une tenture dans un recoin du logis, près de l’endroit où il avait celé dans un coffre le bâton volé à Magon. Il la trouvait très désirable dans 155
cette situation, mais il n’eut pas la tête à la violenter tout de suite. Son chacal la regardait de ses yeux jaunes, tendant son museau fin vers elle. – C’est une femelle, se contenta-t-il de dire. Méfie-toi, elle est jalouse. Plus rien ne se passa jusqu’au soir. Aldéa garda le silence, immobile. Latro resta assis à réfléchir, demandant qu’on ne le dérangeât en rien. Le silence de ces deux êtres, l’une affligée, l’autre absorbé dans des soucis et des doutes, devenait assourdissant quand le centurion hurla soudain et tapa sur la table : – Saloperie ! Ils ne m’auront pas avec leur cerf et leurs conjurés ! Aldéa leva son front de frayeur. Latro ne la remarqua même pas, appela son second, lui demanda de trouver quelqu’un dans la ville, de toute urgence. Ce ne fut que lorsque la nuit devint d’une épaisseur assassine qu’il reçut la visite d’un personnage étrange : Chéréas. Chéréas était de ces hommes que les soldats de faction ne voient jamais, même quand ils passent à un pouce de leur nez. Enveloppé d’un manteau qui semblait le rendre invisible, il était entré dans la cabane avec une facilité déconcertante. Latro ne l’avait même pas entendu venir ni le chacal n’avait bougé. Au fond, derrière la tenture, Aldéa restait figée dans sa torpeur, comme sourde. Latro ne se donna pas la peine de se lever de son siège, fit rester debout l’inconnu. – Je n’en ai pas pour longtemps. Tu es le fameux Chéréas ? – Je le suis en effet, répondit l’autre d’une voix qui semblait s’effacer dès qu’il avait parlé. – Tu es un vrai Romain ? Je veux dire, pas un traître ? Je peux te faire confiance ? – Sans doute, sinon tu ne m’aurais pas fait venir. – Un sous-officier m’a dit du bien de toi, mais il m’a dit aussi que tu roulais pour Pompée. – C’est vrai, je ne le cache pas. Cela te pose un problème ? Latro réfléchit. À la différence de beaucoup de ses co-légionnaires, il n’était pas lié par un rapport de fidélité à César ; il ne pensait qu’à lui, rien qu’à lui et sa fortune : – Aucun. Je ne veux pas savoir ce que tu fais par ici, ça m’est égal. J’ai en revanche une mission à te confier. Il se trouve que ce pays me baise de plus en plus, que ne je peux plus faire un pas sans me sentir piégé. Mais il n’est pas question pour moi de partir : il y a des ordres, une ville à tenir. Et cette ville n’est pas n’importe laquelle : c’est l’emporium des Carnutes ! Je veux donc reprendre la main sur les événements, devancer ceux qui veulent nous enfoncer leur poignard dans le dos. – Qu’attends-tu de moi ? 156
– Voilà. J’ai de forts soupçons d’une rébellion qui se prépare depuis le début de l’hiver sous l’égide du chef nommé Cotuatos. Tu le connais sans doute. Je n’ai pas de preuve formelle mais je suis persuadé que le temps presse, que les sauvages qui pensent leur moment venu vont bientôt commettre un acte de démence. Toi, tu as un physique passe-partout, tu es grec, cilicien, arabe, que sais-je, moi ? Un mâtiné de tous et de personne à la fois. Je te demande donc de trouver ces Gaulois rebelles, de te grimer, de t’infiltrer parmi eux sous un faux nom, mettons Éponax, et de m’en rendre compte au plus tôt. Le temps presse, je te le répète ; je sens que quelque chose de grave va se produire. L’oppidum est trop tranquille pour être honnête ; ce peut être pour demain, après-demain, dans quelques jours. – Pour cela, je peux être celui qu’il te faut. Simplement combien paiestu ? L’autre ricana. Ces espions étaient tous les mêmes, à se donner l’apparence d’être à part et en réalité obéissant au même désir d’argent que les autres. Il ouvrit son coffre, en tira une bourse pleine. Mais à côté se trouvait le bâton de Magon dont le métal luisit curieusement à la lumière des lampes allumées. La jeune fille n’avait pas eu l’occasion de le voir ; Chéréas, lui, fut aussitôt intrigué : – La bourse me convient, dit-il. Mais je préfère cet objet. Latro referma brutalement le coffre, se trahit : – Non, ça, ça vaut bien plus qu’une poignée de barbares, et c’est à moi. Chéréas prudemment n’en demanda pas davantage. Il s’éclipsa en prenant la bourse et promettant des renseignements au plus vite. L’argent des légions de César venait de servir à payer un homme qui soutenait Pompée en sorte que la campagne du conquérant de la Gaule était espionnée au moyen de son propre trésor pour son plus grand ennemi. Alors que la journée s’achevait sur ce fait étonnant, un autre plus prodigieux encore s’était produit dans la forêt qu’avait fuie Latro. L’astranore, mâchée à pleines dents, avait fait effet. Étendu au milieu d’une flaque de sang, la prunelle fixée sur le ciel, comme mort après avoir reçu les coups de dague du centurion, Magon était longtemps resté inconscient, perdu dans une sorte de rêve vague où il avait revu ce qui lui était cher avant de mourir. Des images s’étaient posées sur ses paupières et étaient reparties comme elles étaient venues, se succédant avec la douceur des bonnes choses. C’était son île de Malte avec ses plages, ses falaises, ses plaines fumantes au soleil ; c’étaient ses parents, sa maison, la chère 157
bibliothèque de son enfance ; ce fut le visage d’Aldéa qu’il vit de si près qu’il en ressentit la caresse sur ses joues et qui ne s’effaça pas. Il devina davantage qu’il ne comprit vraiment. Il devina quelque part dans son cœur que l’amour qu’il lui portait, cet amour impossible envers une femme qu’il n’avait côtoyée que quelques jours dans sa vie, dont il ne savait rien et dont il savait tout, cet amour qu’il avait voulu taire en se consacrant à l’enseignement d’Atis, cet amour était une force irrésistible s’il acceptait de s’abandonner à lui. Des phrases du druide lui revinrent en écho et il ne saisit jamais autant qu’en cet instant que se donner à un autre, c’était s’enrichir et se renforcer soi-même. Là était le véritable sens de l’existence de Calroë ; s’il le mettait en œuvre, la déesse n’aurait pas disparu sans avoir tout à fait imprimé sa marque dans le monde. Il sentit bientôt un flux vital parcourir à nouveau ses veines, des forces lui revenir, sous l’effet de la plante avalée ou du souvenir de la jeune femme. Il put d’abord serrer un poing, puis l’autre ; il eut ensuite la force de bouger ses bras, se retourner, se redresser ; enfin, il fut debout. Quand il examina son bassin sous son vêtement sanguinolent, la plaie achevait de se refermer laissant une cicatrice à peine perceptible sur la peau. Il avait l’impression de ne jamais avoir été frappé par la lame de Latro. C’était incroyable, à faire pâlir de jalousie tous les chirurgiens du monde. Hors de danger, il se pencha sur Atis près de lui. Il fut ému de le découvrir gésir nu dans une flaque de sang caillé, son casque à côté de lui. Le druide avait gardé dans la mort un visage crispé qui traduisait la douleur en même temps qu’une certaine sérénité d’achever ainsi sa vie. Le reste de son corps était effroyable à voir. Des flèches avaient frappé le grand cerf blanc aux cuisses et aux flancs, une hache à la gorge, et redevenu homme il en était resté criblé, les chairs en lambeaux, les muscles déchirés, au point d’être à peine reconnaissable. Il n’y avait rien à faire, sinon remarquer en le retournant – énième prodige – que le tatouage représentant dans son dos une triple tête de cervidé avait disparu comme emporté par les blessures de sa peau entaillée. Magon voulut d’abord brûler son cadavre comme on faisait dans son pays, puis l’enterrer pour que la forêt, merveilleuse ou non, le gardât en elle à jamais. Mais alors que la terre buvait à petites gouttes son sang, un insecte vint se coller à une joue du druide qu’il parcourut de ses infimes pattes et sembla examiner pour venir plus tard le ronger avec les siens. Le détail, terrifiant, fit songer à Magon qu’Atis vivant ne rechignait pas à manger des insectes et qu’il était logique que les insectes vinssent maintenant à leur tour le manger. Mort, il devait pénétrer non seulement le sol qu’il avait habité tant d’années, mais faire vivre aussi les animaux qui passeraient devant lui et qui formaient la troupe dont s’entourait la déesse 158
à laquelle il avait consacré son existence. Il avait voulu vivre en dehors de toutes les civilisations, de toutes leurs mœurs, de toutes leurs valeurs ; ce n’était pas lui faire outrage que de le laisser pourrir dans la nature parce que c’était ainsi que finissait et renaissait sans cesse l’univers. Il le coiffa une dernière fois de ses bois de cerf, le tira au pied du chêne abattu et l’y laissa dans la posture d’un animal massacré par les chasseurs. Il ne chercha pas Calroë, sûr de ne pas la trouver, sinon sous la forme d’une biche. Devait-il venger Atis, se venger lui-même des coups qui lui avaient été portés et qui l’avaient fait laisser pour mort ? Il le pensa sur le moment, eut besoin de le penser pour se remettre en route et quitter la forêt. Depuis qu’elle était redevenue ordinaire, cette forêt n’était plus pour lui un lieu de savoir et de découverte, mais un endroit comme les autres où la violence des hommes pouvait se déchaîner. Il la traversa vite, matraqué par la laideur pelée des arbres en hiver ; à travers les branches mortes, on voyait au loin l’horizon de la plaine. Quand il en sortit enfin pour la première fois depuis des mois, il se retourna : la forêt n’était qu’un grand massif grisâtre, dont on pouvait embrasser d’un coup d’œil les deux extrémités. Le monde extraordinaire que lui avait présenté Atis avait disparu pour de bon ; il tombait désormais dans le monde réel où le froid et la bise glaciale le fouettèrent immédiatement, sans même son bâton pour appuyer ses pas. La direction de Génabum s’imposa à lui. Hormis Samogaion, c’était sa seule attache dans la région parce que les assassins d’Atis s’y trouvaient sans doute et que là-bas étaient restées ses affaires – son cheval, son âne, sa pharmacie – même s’il n’avait pas grand espoir de les retrouver après tant de mois d’absence. Mais comment pouvait-il s’y rendre dans ses vêtements ensanglantés ? Il essaya de les nettoyer avec de la neige ; ce fut peine perdue, il ne parvint qu’à les tremper et les rendre insupportables quoique propices à attirer les bêtes sauvages. Il erra longtemps à distance, autour de l’oppidum, se cacha, hésita à demander de l’aide dans les hameaux qu’il voyait au loin mais se méfia car il redoutait l’accueil qu’on y ferait d’un étranger maculé de sang, le visage hâve et l’air douteux. On l’arrêterait aussitôt ; pire, on l’abattrait comme un loup qui rôde et il n’avait plus d’astranore pour guérir une blessure. Ses pas se faisaient lourds dans la neige, mais la volonté de tuer Latro lui permettait d’avancer. Il ne savait comment faire, avait déjà opéré, d’est en ouest, le tour complet de l’emporium des Carnutes quand, au milieu d’un champ enneigé, le hasard plaça sur sa route une femme. Il voulut d’abord se jeter de côté pour ne pas qu’elle le vît, mais il la reconnut brusquement. Il était impossible de se tromper : cette femme blonde, aux traits fins, aux yeux bleus transparents, qui marchait comme une silhouette esseulée, c’était celle qu’il avait aidée à accoucher le jour de son arrivée dans le pays. Il la 159
regarda, saisi de la coïncidence de la retrouver de nouveau, et elle dut lire la surprise sur son visage car elle-même le regarda avec une attention croissante. Elle ne pouvait le reconnaître étant donné qu’elle avait eu les yeux fermés durant son accouchement. Mais elle eut une sorte d’intuition naïve, s’approcha sans crainte de lui, lui prit ses mains raidies par le froid, violacées, entaillées de gelures. À les examiner elle sembla savoir à qui elles appartenaient parce que sans un mot elle lui tira doucement le bras et, en le poussant un peu, l’emmena dans un abri pauvre tout proche, une cahute de terre et de pierres pratiquement enterrée dans un pli du terrain. C’était un de ces refuges misérables que les paysans utilisent pour se protéger du mauvais temps ou d’une menace quand ils sont loin de chez eux en train de travailler aux champs. L’endroit était un trou, à peine plus grand, plus éclairé, plus propre qu’une grotte animale. Pour y pénétrer, il fallait presque y tomber comme on fait dans une mine ou un piège et il était si exigu qu’on n’y aurait tenu à cinq. Mais enfin, il y faisait bon et elle y possédait quelques hardes précieuses et de la nourriture sur laquelle il lorgna à peine entré. Elle le déshabilla, lui proposa à manger. Il se laissa faire et, quoique sa connaissance du gaulois se fût perfectionnée, à aucun moment il n’essaya de parler avec elle. Les rôles étaient renversés. Cette fois-ci, c’était le médecin qui se retrouvait nu devant la patiente. Mais c’était toujours sans ambiguïté puisqu’elle l’approcha du feu pour qu’il se réchauffât et lui tendit des braies et un manteau d’homme qu’elle voulait manifestement lui offrir. Il était possible que ce fussent ceux du garçon présent à son accouchement. Il ne le sut pas. Quoi qu’il en fût, elle n’avait pas de tunique à lui donner. Alors, poussant la générosité jusqu’à se mettre en difficulté, elle ôta ses propres habits, son péplos et les deux tuniques superposées qu’elle portait en dessous. Elle lui donna celle en lin, garda les deux autres vêtements en laine. Par chance, avec leur encolure simple et leur coupe droite, les tuniques gauloises étaient mixtes. Elle resta un instant le ventre apparent devant lui. À la légère rondeur qu’elle présentait, il remarqua qu’elle était de nouveau enceinte. D’à peine quelques mois. Le terme devait se prévoir au début de l’été. De quelle fatalité était-elle donc la prisonnière pour être ainsi condamnée à se montrer grosse chaque fois qu’il la rencontrait ? Elle était très belle à vrai dire, devait susciter beaucoup de convoitises et de violences. Il ne dit rien de plus, elle ne parla pas davantage, lui sans doute content de manger, de se réchauffer, de reprendre des forces, elle heureuse peut-être de ne pas être jugée par celui qui l’avait déjà libérée une fois de ses couches. Avant de se quitter, elle lui prit de nouveau la main, la posa sur son ventre, 160
rayonna d’un sourire innocent. Elle paraissait confiante. Qui était le père cette fois-ci ? Gaulois, Romain ? Ami, ennemi ? Il partit sans vouloir le savoir et remerciant d’un geste vague après avoir prié Ashtart, déesse de la fécondité qu’on adorait dans son île. Il regagna enfin Génabum. Comme il s’y dirigeait, le souvenir d’Aldéa le reprit et ses pas s’allégèrent à nouveau. Il crut retrouver dans l’horizon la trace de la ferme d’Anéroeste, se promit de la rejoindre après sa vengeance, très bientôt même si tout se passait facilement. Il avançait avec l’assurance des jeunes gens déterminés ; il n’avait même pas d’arme, se disait qu’il n’en aurait pas besoin pour étrangler le centurion. Quelle ne fut pas sa stupeur quand il entendit deux légionnaires en faction blaguer sur leur chef qui ne s’embêtait pas avec la fille du rebelle. Depuis la veille, il la détenait au chaud dans sa cabane et on disait déjà qu’il s’était offert les délices de Capoue avec elle. Ils savaient le marchand Asinus lubrique comme un âne avec sa Gauloise. Le Libyen, lui, devait être beaucoup plus brut ; on disait que son menu plaisir était d’arracher la pointe des nichons avec les dents. Ah ! Ils étaient servis avec des types comme ça ! Pendant qu’eux se les gelaient, d’autres savaient s’amuser et bien vivre… À la description qui fut faite de la captive, Magon comprit, serrant les poings, qu’il s’agissait d’Aldéa. Ses objectifs en étaient dédoublés : il devait maintenant venger son ami, récupérer son bâton, libérer celle qu’il aimait. Il prit le parti d’étudier la situation, resta plusieurs jours caché dans une grange désaffectée qui, par chance, donnait sur le port. Une petite barbe aux reflets roux lui poussa et, associée à ses nouveaux vêtements, acheva de le confondre avec un indigène de peu. Il guetta sa chance, ne dormit pratiquement pas, voulut se donner le temps d’observer les moindres faits et gestes de son ennemi pour le frapper d’un coup sûr. Son chacal lui parut dangereux ; il le compara à Anubis, le dieu funéraire de l’Égypte dont il avait visité le temple autrefois. D’ailleurs, il se représentait Latro comme le fléau de l’armée romaine, brûlait pour lui d’une haine saine qui ne contredisait pas l’enseignement d’Atis parce qu’elle lui permettrait de sauver celle qu’il aimait. Il ne faisait pas de politique, participait encore moins aux guerres ; il rêvait juste de s’en débarrasser comme le médecin rêve de se débarrasser d’une maladie. Il ne put remettre la main sur la pharmacie qu’il avait laissée là plusieurs mois auparavant. Agissant prudemment, il découvrit, au gré des va-et-vient de l’entourage du centurion, Sextus Cornélius Asinus qui avait entre-temps fait fortune dans la ville. Il le suivit, parfois prétentieux et brutal dans les rues, parfois talonné par les regards sombres d’indigènes qui manquaient de l’assassiner dans le dos. Il s’amusa encore à le voir enamouré de la petite 161
Gauloise rousse, mais il préféra ne jamais l’approcher tout en le surveillant de près car il se doutait que son ancien compagnon de voyage menait un jeu trouble et pouvait le trahir. Scythès sembla se rendre compte de quelque chose, mais n’arriva pas à le voir ou au moins le laissa faire. Durant ces quelques jours, il ne vit jamais Aldéa. Il était pourtant sûr qu’elle était dans cette cabane qu’il espionnait, que Latro l’y retenait prisonnière et que l’orichalque de son bâton devait y être également. Enfin, les événements s’accélérèrent. Un matin très tôt, peu avant les premières lueurs de l’aube, alors qu’il veillait, absorbé par l’idée fixe d’obtenir sa vengeance, il vit un Gaulois entrer en toute discrétion chez Latro. Ce Gaulois ne sortit jamais ou alors sous un autre aspect car ce fut un homme étrange, presque un fantôme, sans moustache et habillé à la grecque, qui réapparut quelques instants plus tard. Le lendemain se passa sans que le centurion sortît de son repaire ; mais en plein milieu de la nuit, sous une lune blafarde, Magon remarqua une agitation inhabituelle sur le port. Dans le plus grand silence et sans aucune lumière, une vingtaine d’hommes semblaient préparer sur le fleuve le départ de trois bateaux chargés de trésors. Il comprit vite que Latro s’en allait. Il pressentit qu’une occasion d’agir allait se présenter sans trop savoir ce qu’il pourrait faire néanmoins pour récupérer son bâton, délivrer Aldéa, frapper le centurion en même temps. Dissimulé derrière un chariot vide, encapuchonné pour mieux se fondre dans le noir, il tergiversait, se perdait en scénarios impossibles quand dans l’obscurité il discerna soudain, à quelques pas du pont, Asinus qui venait et qui bientôt observa la même scène que lui. Sa présence ajouta à son incertitude et, le temps d’y réfléchir, les bateaux de Latro s’en allèrent, tous mâts baissés, à la seule force des rames et des perches pour remonter le fleuve entravé de glaces. Asinus les poursuivit comme s’il voulait les rattraper ; lui ne bougea pas. Il aperçut seulement la silhouette d’Aldéa à l’avant d’une des embarcations, en eut le cœur brisé. Mais dans sa course inutile, Asinus venait de rencontrer un individu qu’il connaissait apparemment et avec qui il entama une conversation. Cet individu, Magon se demanda si c’était le même qu’il avait vu la veille sortir de chez Latro. Il ne put se prononcer, voulut écouter car la discussion pouvait lui être utile. Celle-ci fut tenue à voix basse ; il ne saisit que les mots de « Pompée », « César », « révolte » avant de se troubler en réfléchissant tout à coup que Scythès devait être à proximité, qu’il le tenait peut-être au bout de sa flèche même s’il n’agissait pas. L’esclave était là en effet car un nouvel événement se produisit qui le fit se montrer. Six Gaulois surarmés sortirent de nulle part et menacèrent son maître pour une querelle dont il ignorait tout. Scythès, bel et bien 162
caché dans les parages, bondit au milieu d’eux et fit un carnage comme lui seul en était capable. Il en abattit un sous son marteau de combat, en massacra deux autres comme de la vermine, et deux autres encore. Quand un dernier profita de son éloignement pour frapper Asinus dont le glaive s’était bloqué dans le fourreau, Magon s’élança, ramassa en un éclair une épée au sol, la lui planta dans le dos. Il jeta l’arme immédiatement, tendit la main à son compagnon renversé au sol et stupéfait d’avoir échappé de si peu à la mort. Et lorsqu’il ôta sa capuche : – Par Pluton, Magon !, s’écria le Romain qui le reconnut. – Il était temps, répondit le jeune homme sans se réjouir. – Il était temps, oui ! Tu n’as donc plus ton bâton, celui dont tu devais me dire un jour le secret ? – Non, c’est une longue histoire. L’autre se releva dans un grand mal de dos. Il regarda les cadavres massacrés autour de lui et, renonçant à savoir où s’était enfui l’homme avec qui il discutait avant l’attaque, il répondit, mi-soucieux mi-jovial : – Une autre s’en prépare, d’histoire. Figure-toi que tu es revenu au bon moment. Il paraît que cette drôlesse de cité va nous jouer quelques tours… Magon n’en avait cependant cure. Songeant à son échec, il avait à peine écouté la dernière phrase d’Asinus. Le centurion et Aldéa partis, il n’avait plus rien à faire ici. Il dit aussitôt, très résolu. – Je ne reste pas de toute façon. Je dois suivre l’embarcation qui vient de partir. – Celle de Latro, le centurion ? Décidément, cet enfant de putain a bien des secrets que j’ignore. Latro. Il imprima ce nom qui signifiait brigand dans sa tête. – Celle de Latro, exactement. – Tu as raison, mieux vaut que tu t’en ailles. C’est plus sûr, vu ce qui nous attend. Asinus fit un geste à Scythès qui comprit et alla chercher à pas de loup ce qu’il fallait. L’esclave revint très vite en portant une petite pirogue légère à pleins bras comme on tient un cure-dent. – Si c’est le bateau de Latro que tu veux suivre, prends cet esquif. Il n’a l’air de rien mais il est rapide, tu iras vite. Magon le remercia, regrettant de ne pouvoir prendre le temps d’échanger ce qu’ils étaient devenus pendant ces mois où ils avaient vécu séparés. À peine retrouvés, ils se quittaient déjà et ce fut Asinus qui lui tendit chaleureusement la main. Il était malhonnête, mais il avait peut-être aussi le sens de l’amitié. Le monde est si surprenant que les plus grands voyous font parfois les amis les plus fidèles. 163
– On ne se reverra sûrement pas, dit encore le commerçant. L’air de Génabum est moins propice à la richesse ces temps-ci. Je vais sans doute promener mes rhumatismes plus à l’est, du côté de Gorgobina pour y tenter ma chance. Magon le regarda dans les yeux, essaya d’y lire l’avenir de cet homme qu’il connaissait mieux que quiconque et dont il ignorait pratiquement tout. En finirait-il jamais avec l’itinérance ? Ses vieux jours n’étaient rien, seule la mort l’arrêterait. Il lui serra la main : – Qui sait ? Je n’ai pas de tessère d’hospitalité mais donnons-nous rendez-vous un jour chez Hélioclès, notre ami commun à Marseille. Il se pourrait d’ici là que j’aie retrouvé mon bâton et que je t’en raconte les secrets. Asinus eut un léger rictus, comme s’il n’y croyait pas lui-même. Magon monta dans la pirogue et les deux autres le poussèrent en silence. Le Maltais quitta la ville, obligé de partir encore, laissant sur la berge les seuls amis qu’il eût encore en vie dans ce pays et dont il ne savait ce qu’ils deviendraient.
164
VI LES MASSACRÉS
Asinus et Scythès étaient demeurés seuls dans l’ombre du fleuve, au milieu de la ville hostile, face à l’inconnu des événements qui allaient se précipiter. Un instant, le négociant voulut croire insolemment que Chéréas lui avait tenu des propos infondés, que l’espion louche n’avait aucune preuve de ce qu’il avançait, que son commerce ne pouvait s’arrêter si brutalement au moment où il prospérait enfin. Puis, maudite peuplade !, il réalisa avec regrets que tout était plausible, que l’attaque des hommes de Lugurix en était la preuve. Il se prit à y croire, s’étonna même que ce ne fût pas arrivé avant dans ce trou du cul de Gaule livré aux sauvages et il songea qu’il ne perdrait rien de toute façon à se cacher une journée, surtout si cette journée se passait en compagnie exclusive de Génabia. Il ne dormit pas de la nuit. Il restait à vrai dire peu d’heures jusqu’à cette aube incertaine où tout pourrait arriver et il choisit d’user de ce temps pour préparer l’impréparable. Une fois Magon parti, il ordonna d’abord à Scythès de faire couler en silence les dépouilles des hommes de Lugurix en les alourdissant de pierres, puis de lui trouver le même type d’embarcation que celle qu’il avait rapportée au Maltais et, avec sa discrétion coutumière, de la lui placer très en amont de la rive, près du lieu où résidait Génabia. L’esclave s’exécuta. Aucune sentinelle étrangement ne les dérangea, ni romaine ni gauloise ; c’était comme si elles avaient reçu l’ordre de dormir et d’épargner leurs forces avant de tomber dans l’inconnu du lendemain. Seul l’aboiement lointain d’un chien les fit sursauter et craindre d’être surpris. Ils rentrèrent ensuite à la copona où Asinus troqua prudemment ses habits tape-à-l’œil pour de plus discrets et plus pratiques, ne gardant que son grand manteau de fourrure qui impressionnerait sa belle lorsqu’il la verrait et lui permettrait de la couvrir au cas où elle aurait froid. Dans le plus grand silence, il s’occupa après cela de ses affaires matérielles. Longtemps auparavant, alors que son commerce ne marchait pas encore, il s’était un jour amusé, couché sur son lit et désœuvré, à lancer une pièce en l’air et la rattraper, et il l’avait lancée de plus en plus haut pour
appeler la fortune quand elle n’était pas retombée. En se haussant sur son grabat, il avait alors repéré, au croisement de deux poutres, derrière un grand bouclier d’apparat suspendu par une chaîne, un trou assez profond, de la largeur d’un poing, qui ne se voyait que d’en haut et était absolument invisible d’en bas. La pièce s’y était logée. Concluant de ce hasard que la richesse viendrait mais qu’il faudrait la cacher, il y avait déposé son argent au cours des mois suivants. Il l’y laissa cette nuit-là, se disant qu’il le retrouverait facilement parce que c’était le dernier endroit où des assassins viendraient le chercher. Il ne garda sur lui qu’une maigre somme, avec un petit poignard, pour sauver sa peau s’il avait à s’enfuir. Quant à son nécessaire d’écriture qu’il ne pouvait abandonner s’il voulait retranscrire plus tard les faits dont il serait le témoin, il jugea que le plus simple et le plus sûr était de le confier à Scythès. L’esclave se vit ainsi remettre les papyri enroulés autour d’une baguette de bois, les calames et l’encre noire sous sa forme solide qu’on ne diluait qu’au moment de l’utilisation. Il ne broncha pas du paquetage. Asinus prit encore une couverture et, la nouant en baluchon, il regroupa à l’intérieur une gourde de vin d’Albe rarement âpre, quelques provisions à manger la journée ainsi qu’une mixture flasque qu’on lui avait présentée comme de la chair d’escargot conservée dans du sel, qu’il avait achetée à prix d’or et qu’il lui faudrait délayer en prononçant une formule incantatoire pour servir d’aphrodisiaque. En outre, il garda un présent pour Génabia comme il avait l’habitude de lui en offrir, une petite flûte maladroitement sculptée pour chanter ses beautés, réalisée depuis longtemps, dont il s’imagina que l’occasion était venue d’en jouer devant elle avant de se rappeler que le bruit attirerait immanquablement l’attention. Son cadeau était à l’image de ses objectifs, proprement impossibles à concilier : espionner, survivre tout en menant une idylle illusoire. Il se sentit triplement piégé. Piégé par son accord avec Chéréas, par les barbares qu’il devinait aux portes de la ville, par sa petite Psécas à laquelle il n’avait pas la force de renoncer. En même temps, il ne s’imagina reculer sur rien, ni trahir Pompée le protecteur de son Picénum natal, ni nuire à son commerce dont il pouvait doubler les bénéfices si tous ses concurrents étaient éliminés, ni passer à côté des charmes de la jeunesse à son âge trop mûr. Après tout, les grands hommes misaient toujours leur succès sur la chance et ce n’était pas Sylla, celui qu’on avait surnommé Félix, qui l’aurait contredit. Le sentiment de toute-puissance acquis par ses succès dans Génabum le poussait à vouloir réaliser l’irréalisable. À la fin il pria, le dieu Priape autant que la Fortune. 166
On était aux Ides de février, ce mois de février que les siens entamaient en célébrant les trépassés par des sacrifices aux divinités infernales et qu’ils poursuivaient en fêtant la louve qui avait jadis recueilli Romulus et Rémus. Cette louve, tout le monde le savait, était une putain. Par pruderie envers les légendes anciennes, on la faisait passer, en jouant sur l’homonymie des mots, pour un animal noble. C’était dire la confusion qui pouvait exister entre grandeur et bassesse chez ses concitoyens. Il fit forcément le rapprochement avec sa situation, celle de Génabia. C’était vraiment le plus vieux métier du monde que celui de traînée, comme celui d’espion d’ailleurs, et celui sur lequel on pouvait le plus se méprendre. Les barbares savaient-ils seulement tout cela, eux qui fêteraient bientôt les morts à leur manière ? Maintenant, leur insurrection éclaterait dans quelques heures au plus. Il devait devancer tout le monde en espérant qu’aucun tueur ne rôdât déjà entre les bâtisses endormies. À pas furtifs, il sortit de la copona comme il y était entré, par la porte principale toujours ouverte, au milieu des derniers clients avachis et vaincus par l’alcool. Le feu de l’âtre mourait en braises rougeoyantes dans une lumière sale et des relents de cochons cuits à la broche. Pas un des habitués ne s’éveilla ; il ne songea à en secouer aucun, ni même le patron parti se coucher, pour leur conseiller de fuir ou se terrer puisqu’il avait finalement ordre de laisser se dérouler le massacre. Ce ne fut que lorsqu’il mit un premier pied dehors qu’il entendit une voix avinée dans son dos lui susurrer quelque chose. Près de lui, il découvrit Marcus le Tarentin, surnommé le glaireux, qui logeait ici depuis des mois et qui, avec l’hiver, était passé du statut de commerçant entreprenant à celui de noceur oisif. Le drille était tombé de sa table et allongé par terre, contre la porte, il passait la nuit, mi-conscient mi-abruti, au milieu des courants d’air, protégé de son seul vêtement dont il s’était fait un drap. Scythès montra immédiatement son poignard ; Asinus lui dit non de la tête et s’approcha de l’importun. Il n’était pas dangereux, ça ne servait à rien de perdre du temps à s’en débarrasser. Les barbares s’en chargeraient de toute façon. – Que veux-tu ?, demanda Asinus très bas. – Encore…encore dehors à…courir la gueuse, Asinus ?, fit Marcus sur un timbre pâteux, la joue collée au sol et obligé de chercher ses mots tant sa pensée était alourdie par le vin. – Non, je vais pisser. L’autre releva la tête péniblement, ahuri de la réponse, dévoilant une tache de bave ou de bile qui lui souillait le cou. Il racla sa gorge pour y chasser une de ces glaires qui lui avaient donné son surnom. Dans la 167
pénombre du coin où il s’était vautré, on ne pouvait voir s’il avait les yeux ouverts ou clos. – Avec Scythès ? En…en armes ? – Eh quoi !, répondit Asinus en s’efforçant de continuer à chuchoter, il protège ma bite comme le reste de mon corps. – Un garde-bite ! Ah, ah, sacré Asinus ! Et il retomba comme si le rire l’avait assommé pour de bon. Asinus regarda les lieux une dernière fois, se demanda s’ils seraient noyés de sang au soir du même jour. Qui survivrait ? Sans doute personne, et les cadavres remplaceraient les ivrognes dans la même immobilité lourde et la même déchéance. Il laissa là Marcus, sans sympathie. Il avait menti, condamné ce malheureux à une mort certaine pour sauver sa tête. Sûr de lui maintenant qu’il se lançait dans l’action, ne prévoyant que ses seuls intérêts, il ne faisait pas mieux que Latro qu’il avait traité de lâche quelques heures plus tôt. Accompagné de Scythès, il se hasarda au travers des rues en direction de la hutte de Génabia. Celle-ci habitait à l’intérieur des remparts ; c’était une chance sans laquelle il n’aurait pu se rendre auprès d’elle à une heure si matinale. Ils franchirent le Dépotoir, tellement obstrué par les immondices et les déchets qu’ils n’eurent pas l’impression d’enjamber un cours d’eau malgré la fonte des neiges. Asinus se remémora la première fois qu’il y était venu, le soir où Tubula avait été frappé par la flèche de Scythès, où les troubles de la cité avaient vraiment commencé. Le lieu avait quelque chose de lugubre, semblable aux Enfers. Sous la lune équivoque, il crut un instant voir le fantôme de l’ivrogne se dresser devant lui près d’un ormeau opaque et séculaire. Ils avançaient, enténébrés dans la nuit solitaire, à travers l’ombre des maisons sommeillant et le royaume de Dis. Quand ils furent arrivés, la proximité des murs de l’oppidum les força à se faire discrets. Aussi, encore à bonne distance, Asinus donna ses dernières directives à son esclave, le renvoyant pour être seul avec sa bien-aimée et l’exhortant à l’attendre dans quelque planque du port ou en dehors de la ville sans perdre la Loire des yeux au cas où les choses tourneraient mal. Comme toutes les fois, Scythès obéit et s’éclipsa, mais avec un dégoût muet que son maître ne vit pas. Il l’avait accompagné dans ce lieu périlleux, lui avait préparé sa barque, devrait l’en tirer au bon moment, tout cela pour une amourette. Il avait pris toutes ses armes avec lui tant il redoutait les effets d’une femme plus que ceux de cent guerriers réunis. Asinus patienta assez longtemps, la bouche douloureuse sous l’action des morsures du froid. Dans son état d’excitation mêlée d’inquiétude, il ne ressentit pas le sommeil de cette nuit blanche, mais, pressé, craignit que le 168
jour ne vînt plus vite que prévu. Étrangement il n’avait pas peur de rester seul dans le noir. Après l’attaque des hommes de Lugurix, il se disait au contraire que la chance ne pourrait qu’être avec lui, qu’on ne réchappait pas à un assassinat pour mourir le lendemain. Il pensa à Génabia pour chasser toute mauvaise pensée, Génabia dont l’image le hantait. Il songea aux raisons de sa présence, ici même en cette heure de tous les dangers, réalisa qu’il avait vraiment besoin d’elle, besoin d’être aimé par elle, par amour véritable, pour lutter contre l’âge ou contrer l’insuccès dont la menace ne le quittait pas. Et s’il revenait en roi de la région comme Chéréas le lui avait promis, il l’épouserait peut-être. Ça se faisait après tout dans les pays que Rome conquérait. Quand la fille sortit enfin, elle paraissait avoir attendu les premiers rayons timides de l’aube. Il fut émerveillé de voir leur infime lumière caresser ses cheveux roux et y prendre une intensité qu’ils n’avaient pas dans le ciel. Elle portait des vêtements simples mais propres et différents de la veille. Il fut touché de l’attention. Elle était plus belle que jamais. Elle lui posa un doigt sur les lèvres pour l’empêcher de dire un mot quelconque. Il comprit qu’elle ne voulait pas perdre de temps, s’en réjouit, la prit par la main à travers ces rues qu’elle aurait pu traverser les yeux fermés pour y avoir grandi et les avoir arpentées souvent en quête de clients. Elle habitait à deux pas de la Loire où l’embarcation volée par Scythès les attendait. Ils y montèrent sans problème, elle devant, lui derrière. Tout était facile ; il avait l’impression d’être seul en sa compagnie dans l’oppidum. Dans la pirogue les rôles s’inversèrent. Ce fut elle qui le dirigea dans l’embâcle du fleuve, lui indiquant tel danger, tel rocher près de l’île qu’il fallait contourner, et qui prit la perche pour accoster sans encombre. Il la laissa faire, ne lui montrant pas sa peur de l’eau, heureux de surcroît de la voir prendre des initiatives, se disant qu’elle voulait être au plus vite avec lui. De dos, elle semblait un nocher dont le manteau rapiécé faisait un haillon misérable ; il pensa qu’il lui donnerait bientôt le sien en fourrure et il eut l’impression qu’elle souriait en regardant devant elle. La barque se laissait emporter par le courant. Les îles, inhabitées, étaient dissimulées sous des brumes laiteuses. Autour, la Loire dessinait de vastes remous bouillonnants pareils à ceux du Styx, un gouffre tumultueux qui était celui de ses désirs perdus dans les brumes persistantes de la nuit. L’Île-avalante s’appelait ainsi parce qu’une famille entière y avait autrefois succombé sous la crue comme si le fleuve l’avait brusquement avalée. Pour cette raison, le lieu avait la réputation d’être maudit ; on s’y aventurait peu. Asinus l’ignorait, sinon il se serait étonné que Génabia lui eût proposé d’y venir. Pour lui, ce n’était qu’une mince langue de terre 169
abandonnée, enserrée de sables mouvants et de hauts-fonds, plantée d’une végétation touffue, sise au milieu du fleuve, qui s’étendait d’est en ouest suivant l’écoulement de l’onde et passait sous le pont au-delà duquel elle s’étendait encore. Aucune maison, aucun abri n’y avait été bâti car, hormis la légende, l’endroit était émergé ou recouvert d’eau selon les saisons. Quand le fleuve atteignait ses plus hauts niveaux, l’île disparaissait entièrement et l’on n’apercevait plus que la moitié supérieure des arbres ; quand il était au contraire très bas, l’île réapparaissait, déserte et nettoyée, avalée à son tour par le fleuve mais recrachée plus belle contrairement aux victimes humaines qu’on ne retrouvait jamais que le visage bouffi et le corps gonflé d’eau. Un embranchement de la Loire la scindait en son cœur et formait une sorte de crique secrète où, si l’on y parvenait malgré les dangers, on se sentait protégé loin de l’oppidum et de son agitation avec la possibilité de s’enfuir facilement vers l’autre rive en cas de besoin. Ce fut là qu’Asinus se rassura d’accoster sur une petite plage de sable fin. L’embarcation fut cachée sous les arbres, ils s’installèrent dans ce qui serait leur alcôve naturelle. Le décor y était au demeurant agréable. Faute de pieds pour la fouler, des pans entiers de neige étaient restés intacts, simplement transformés en une glace lisse et blanche au milieu de laquelle les herbes frissonnaient. Quelques traces de lapins s’y décelaient, des empreintes légères et précises qui indiquaient la tranquillité des léporidés dans les parages. De grands arbres coupaient l’île du vent et rendaient la température supportable. Surtout, le bruit de l’oppidum en était atténué et il régnait un silence relatif. L’air de rien, Asinus, devançant cette fois-ci sa Psécas, choisit précisément l’endroit où ils s’assiéraient sur la couverture qu’il avait emportée. Le terrain était légèrement bosselé par endroits. Ils s’installèrent dans un creux où, couché à plat ventre, il pourrait à la fois profiter du corps de sa maîtresse et observer la ville. De là, il lui était en effet loisible d’embrasser d’un seul coup d’œil l’oppidum qui n’avait pas de rempart sur le fleuve. Le terrain s’élevait du côté des terres où le port, les ateliers, les maisons seigneuriales se superposaient dans le paysage comme en une série d’étages successifs. C’était l’emplacement idéal pour observer sans courir de risque ; à l’inverse, derrière la végétation, il était difficile de deviner depuis la rive sa présence en ces lieux. Tout indiquait que les brouillards se dissiperaient et qu’il ferait beau. Un léger vent soufflait de l’est, ce qui était bon présage. Aucun nuage n’encombrait le lointain mais on devinait les prémisses d’un clair soleil frémissant sur le paysage gelé. Ils étaient venus voir à deux se lever l’astre timide, mais il n’y pensait déjà plus. La journée serait sans doute plus belle 170
dans le ciel que sur terre. Un corbeau tournoya au-dessus de la ville et fit retentir son croassement jusqu’à eux. Il étendit la couverture après avoir déblayé la neige. Le désir lui allégeait son mal de dos. – Veux-tu t’allonger ?, demanda-t-il. – Si tu veux. Il attendait un « mon Seigneur » qu’elle ne prononça pas. Il lui tendit sa gourde de vin doux. Elle en but une fière rasade. Alors, dans un large sourire, il lui présenta la flûte qu’il avait sculptée pour elle. Le pipeau était assez laid, blanc, rayé de fines lignes indigo et d’un embout écarlate. Elle l’accepta mais refusa de l’entendre en jouer comme il le craignait. Elle le posa à côté d’eux, sans remercier ni même l’examiner un instant. Elle avait l’air préoccupée, par quelque chose de sombre qui aggravait son regard. Il lui prit la main. – Tu as froid, dit-il avec regret. Je ne peux pas te réchauffer, malheureusement ; tu sauras bientôt pourquoi. À ces mots, elle eut un petit rire de fierté, de cette fierté gauloise face à un homme du Sud pour dire qu’elle ne craignait pas le froid. Et pour le prouver, elle se déshabilla devant lui. Le jour se levait à l’horizon. Au milieu des brumes, les premiers rayons du soleil parurent en un léger faisceau, semblèrent chercher son corps pour tomber sur sa peau laiteuse et ses cheveux reflets d’airain. Il lui donna son manteau ; elle fut nue sous la fourrure. Alors il découvrit qu’elle avait un tatouage sur sa poitrine, un tatouage récent, qu’il n’avait jamais vu, mais il était vrai qu’elle ne l’avait pas laissé la voir dans son simple appareil depuis longtemps. Ce tatouage, c’était un oiseau stylisé, dont le corps se terminait en longues arabesques, qui partait du sein droit et semblait picoter le mamelon gauche. Il en fut troublé, ne sut dire s’il était élégant. Quand l’avait-elle fait ? Pourquoi ? Que voulait-il dire ? Il avança son index pour le toucher, mais elle ne lui en laissa pas l’occasion. Elle s’échappa, s’allongea en travers de la couverture, se tournant, se retournant, se frottant à l’étoffe de laine, montrant tantôt ses fesses, tantôt sa poitrine et son sexe. Il oublia bientôt le tatouage, fut conquis par ses charmes. Il n’avait pas eu besoin de l’aphrodisiaque pour la voir les lui céder. Elle paraissait maintenant plus sereine comme si s’être exhibée au contact du froid l’avait ragaillardie. Son regard pourtant était étrangement vide, ailleurs. Il ne le remarqua pas, aveuglé par sa chair qu’il semblait découvrir pour la première fois. Il lui embrassa les seins, le cou, ses hanches parcourues de chair de poule, descendant délicatement, remontant à pleine bouche, redescendant sans arrêt comme un fou. Il voulut lui baiser les lèvres mais elle refusa et le repoussa brusquement ; il 171
n’insista pas de peur de lui être désagréable. D’ailleurs elle fermait les yeux, la tête tournée du côté de la ville comme si elle y attendait quelque événement qui viendrait la délivrer. Asinus, quoique tout à sa passion, jetait lui aussi des regards furtifs vers le port car il pressentait que l’alerte y serait bientôt donnée. Il voulait profiter auparavant du peu de temps qui lui restait. Son doute de la défloration de la jeune fille persistait, le taraudait depuis longtemps sans qu’il eût eu l’occasion de s’en ouvrir à elle. Il crut le moment de ces retrouvailles opportun pour lui poser enfin la question. Mais il s’arrêta aussitôt quand il sentit une pulsion de mâle secouer tout son corps et lui rappeler qu’il n’avait pas de temps à perdre en paroles hasardeuses. Sans se dévêtir, il sortit simplement sa verge, désirante et très dure. – Il n’y a pas de feu, souffla-t-il, mais de l’amour pour te réchauffer. Son sexe était bien droit, épais, violacé d’envie et rougeaud. De premières sécrétions avaient rendu son gland gluant qu’il frotta autour de l’entrée de sa maîtresse. Elle parut apprécier, lâcha un soupir. Il y pénétra une première fois, lentement, comme en reconnaissance. La porte s’ouvrit d’elle-même et l’accueillit. Il se retira, attendit un court instant pour appeler les forces nécessaires, puis s’engouffra tout à fait et entreprit de la posséder au milieu d’un long râle. Alors, au moment même où il commençait de la prendre, au moment où il entamait ses va-et-vient de mâle dominant, alors une sonnerie tonitruante et longue déchira l’air et retentit aux quatre coins de l’île. Chéréas avait raison ! Il reconnut le bruit, jeta un regard inquiet à l’oppidum, voulut se dresser. Mais Génabia redirigea brusquement son visage vers elle, l’obligea à ne penser qu’à elle, à ses charmes, à ses plaisirs et, dans un mince sourire sensuel, elle lui dit : – Enfin ! Enfin ! Il était temps. Le signal avait été donné. Pas de tragule ni de mot de passe, mais une sonnerie retentissante de carnyx, cette trompe celte de bronze qui produisait un bruit si effrayant qu’elle faisait fuir l’ennemi avant même le combat. Il devait y en avoir plusieurs car un fracas énorme, disharmonieux, prolongé, couvrit tout le paysage qu’il fit trembler des lieues à la ronde. On eût dit le rugissement du vent avant que l’océan ne déferle sur un roc et l’inonde de toute part. En effet, à peine le vacarme se fut-il tu qu’un autre lui succéda. On entendit au loin un vaste cri houleux s’élever du néant de la nuit et, dans les premiers rayons du soleil, on vit des vagues et des vagues de 172
combattants surgir de l’horizon qui entourait Génabum. C’étaient les conjurés, les rebelles, ceux qui s’étaient réunis tout l’hiver pour décider l’hécatombe et lancer la révolte des Gaules. Les uns étaient à cheval et lancèrent un rapide galop ; la majorité était à pied et courut sans ordre ni retenue vers la ville. Des bois, des hameaux alentour, il devait y avoir trois cents pas de distance qu’ils parcoururent comme un flot que rien n’arrête. Asinus les crut mille, dix mille, cent mille ! Et il fallait les voir déferler, innombrables, indiscernables, tous très hideux avec leurs barbes et leurs cheveux longs rehaussés sur la tête, faisant voler des mottes de terre dans leur assaut effréné. À mesure qu’ils s’approchèrent, certains même apparurent nus selon l’ancien usage, le visage peinturluré de bleu, la tignasse blanchie à la chaux et, s’ils paraissaient plus immenses que leurs voisins quand on tâchait de les fixer, on pouvait aussitôt les perdre de vue tellement la foule des guerriers était compacte. Les autres étaient casqués, vêtus de cottes de mailles ou de laines épaisses comme des cuirasses. Tous avaient leur épée, leur lance, leur hache brandie qu’ils entrechoquaient sur l’orbe ou l’umbo de leur bouclier. Ce ne fut que lorsqu’ils atteignirent les murs de la ville qu’Asinus saisit leur cri effroyable. Ils hurlaient « Teutatès, Teutatès, Teutatès ! » – le dieu de leur tribu. Et le Romain les épia venir ainsi, les yeux grands ouverts, croyant les voir courir à lui comme s’il était sur la muraille où le sang allait couler. Alors qu’il pénétrait mollement Génabia, il en fut paralysé de terreur. Les portes venaient d’être ouvertes par des comparses à l’intérieur. Tout de suite il reconnut au-dessus de l’une d’entre elles Volomir qui faisait de grands signes au-delà des remparts en agitant un tartan aux couleurs rouge et or de son frère. Soudain il jura l’avoir vu regarder en sa direction de ses petits yeux vert-de-gris. Un frisson le traversa, il se retira de sa Gauloise, voulut voir de nouveau. Mais sur le rempart assailli d’échelles Volomir ne le scrutait déjà plus. Un homme venait d’engager un combat perdu d’avance avec lui ; le frère de Cotuatos le terrassa, le jeta dans le vide. Plusieurs sentinelles périrent ainsi les premières parce qu’elles n’étaient pas du parti des conjurés et l’on entendit leur plainte déchirante basculer dans le vide où elles se perdirent dans la tempête qui envahissait le passage. Au loin, les carnyx reprirent leur sirène retentissante. Accompagnés des porteurs d’enseignes, on vit les musiciens sortir des bois, soufflant dans leur haute trompette verticale dont le pavillon en cuivre prenait l’apparence d’une hure de sanglier et permettait au son de se diffuser audessus des têtes. Un vrai flot, inarrêtable, emplit les rues, se dissémina en tous sens à travers le labyrinthe des venelles qui semblèrent soudain trop 173
étroites, prêtes à se fissurer sous le nombre. Des centaines, et l’on eût dit des milliers d’hommes, traversèrent chaque porte ; les cavaliers à eux seuls furent un torrent déchaîné. Les cris varièrent ; ce furent des « Kénabon ! », « Carnutes ! » qui ricochèrent en écho sur les palissades et les cuirasses. Puis l’on perçut des noms de chefs qui flottèrent au-dessus de la cohue et un semblant de discipline s’opéra autour des princes à cheval qui entrèrent après leurs hommes. Les guerriers freinèrent le pas, marchèrent d’une marche implacable comme le fleuve impétueux qui, après être sorti brutalement de son lit, enfle peu à peu et entame de toute sa force les êtres et les murs qui lui résistent. Les conjurés, forts de l’effarement qu’ils causaient, débutèrent alors la tuerie. À l’est, ce furent des fidèles de Taurillos qui, éveillés en panique, reconnaissables à la rouelle symbole de Taranis, furent exterminés avant même d’avoir compris que c’étaient leurs frères qui les frappaient. À l’ouest, dans un coude de la voie qui menait au pont, les assaillants tombèrent d’abord sur une patrouille de légionnaires qu’Asinus, d’aussi loin qu’il était, vit très distinctement blêmir, s’empêtrer entre le pilum et le glaive, être emportée par la foule comme un caillou sous une coulée de boue. Une tête vola en l’air, trois corps s’effondrèrent percés par des lames, les autres disparurent sans que personne ne pût dire ce qu’ils étaient devenus. Au port, une trompette romaine sonna. C’était celle du tumulte, pour marquer la surprise de l’attaque et prévenir trop tard du danger immédiat. Les dieux regardèrent le massacre, sans intervenir, un œil partout, la main nulle part. En bas, jamais le mot de mortel ne prit plus son sens tant les morts furent légion. Les différents brenns se répartirent les objectifs, les uns fondant sur le port et les entrepôts, les autres remontant la ville en direction des demeures des notables, tous emmenant avec eux leur horde sauvage. Des remparts aux fosses, des fosses aux remparts, chaque recoin fut envahi, il n’y eut pas un espace où dix hommes ne coururent, vociférant, avides de sang. Même le Dépotoir, le ruisseau plein de fange, fut remonté et retourné. Les attaquants étaient tellement nombreux que certains n’eurent personne à tuer mais, voulant tuer quand même, assassinèrent une deuxième, une troisième fois les cadavres. Sur leur chemin, les victimes, hommes, femmes, enfants, furent surprises dans leurs actes quotidiens, leur collation, leurs étirements, leur toilette, leurs prières. Beaucoup n’eurent pas même le temps de saisir une arme pour se défendre et furent égorgées, laissées dans la posture où la mort venait de les surprendre. Partout les cris, les pleurs, les supplications s’interrompirent atrocement sous le bruit des chairs entaillées, des entrailles percées auquel répondirent à nouveau les supplications, les 174
pleurs, les cris d’autres malheureux. Les portes furent éventrées, les intérieurs fouillés avec un soin expéditif jusqu’au fond des cours, des ruisseaux, dans le foin des granges et des chariots. La violence est grisante et appelle la violence. Les agresseurs perdirent toute mesure, détruisirent tout, tuèrent à l’aveugle comme s’ils avaient bu quelque drogue avant de combattre. Ils auraient vu l’univers en rouge, enivrés qu’ils étaient par le sang, reconnaissant aisément les légionnaires, les commerçants italiens à leurs costumes nationaux et frappant sans relâche indistinctement les innocents et les coupables. Les étrangers n’avaient aucune chance. Même les Gaulois qu’ils rencontraient devaient hurler les preuves de leur sincérité pour espérer survivre et protéger leur famille, et ce fut pour ne pas être exécuté que le petit peuple, d’abord terrorisé, massacra à son tour et devint complice du carnage. Plusieurs, qui se trouvaient à ce moment avec des Romains ou des Grecs, les dénoncèrent hautement et leur enfoncèrent un poignard dans le ventre ou entre les épaules. Échappés des robes affolées de leur mère, il y eut même des marmots vicieux pour en accuser d’autres et les pousser à la mort. Sur le port, la troupe de Latro avait entendu le piétinement approcher, le son métallique et effrayant des armes qui s’entrechoquent, et sut prendre de premières mesures à la hâte. Mais alors qu’elle se mettait en formation, bouclier plaqué à l’épaule, pilum en main droite, genou gauche en avant, le légionnaire parti chercher le centurion sortit en criant : – Il n’est pas là ! Il est parti ! La nouvelle se répandit aussitôt dans les rangs, on conclut à un abandon. Encore un était parti ! Encore un, le Libyen s’était enfui ! Ils étaient privés de commandement ! Il n’en fallut pas plus pour ces hommes amollis par des mois d’inaction. Au son puissant et rauque de leurs armes, les hommes de Conconnétodumnos joignaient maintenant leurs cris de guerre, provoquant l’effroi à l’idée du nombre que leurs voix suggéraient. Il y eut alors un mouvement de recul. L’optio essaya bien de ramener l’ordre mais à peine eut-il le temps de reformer un semblant de ligne que les barbares envahirent les lieux et le firent voler en éclats. Les Gaulois, tombant de toutes parts, de toutes les rues, retrouvaient face aux Romains la rage victorieuse qu’ils avaient eue quand ils guerroyaient dans l’armée d’Hannibal à Cannes ou La Trébie. En face, les pilums ne furent d’aucune utilité, les boucliers furent enfoncés, les glaives sortis trop tard. Ils n’étaient qu’une centurie de paresseux ; que pouvaient-ils ? La panique fit se sauver les soldats à la débandade ; beaucoup furent atteints dans le dos en essayant de s’enfuir comme des rats. Les plus lâches ou les plus pratiques eurent l’idée de se réfugier dans les redoutes fébriles érigées de chaque côté. Ils furent jusqu’à dix dans l’une d’entre elles dont ils furent délogés 175
comme des insectes pour mourir écrasés, et les postes de garde s’effondrèrent sous la poussée d’un seul de ces monstres. Les animaux capturés par Latro, encagés sur la rive, s’étaient réveillés en sursaut eux aussi et hurlaient de terreur, grattaient, tapaient contre les montants de leur prison. Quand les Gaulois arrivèrent, ils trouvèrent très drôle de les libérer. Il n’y avait qu’eux pour allier ainsi la blague et la tuerie. À coups de hache, ils fracassèrent les barreaux de bois, lâchèrent des sangliers affolés dans la foule. En face, Gaius Fufius Cita, caché derrière le grillage de sa fenêtre, vit les bêtes s’enfuir, tout culbuter, rajouter à la confusion. L’intendant de César se trouvait dans un des deux entrepôts, le plus petit investi par Asinus, qui jouxtait le port. Très tôt le matin, alors que son rival s’en allait folâtrer avec Génabia sur le fleuve, il s’y était introduit en secret par la porte dérobée que Latro avait fait percer au fond. Il était accompagné d’un nouveau secrétaire et de deux esclaves qui avaient brisé pour lui les verrous. Après l’altercation de la veille qui avait valu à son premier scribe une sérieuse blessure à l’épaule, il avait ressenti l’envie de rendre coup pour coup, le besoin d’asséner lui aussi une basse brutalité, n’importe quoi du moment qu’il fût vengé et qu’il freinât la progression de son adversaire contre lequel il avait l’impression de ne rien pouvoir. L’arrière des entrepôts n’était pas particulièrement surveillé. En tant qu’intendant général, il avait de toute façon le droit d’y pénétrer quand il le jugeait bon. On se serait simplement demandé pourquoi il n’était pas entré par la porte principale. Il avait en fait profité de l’heure où personne n’était encore présent dans les magasins pour lancer une attaque honteuse, et c’était un hasard chanceux s’il ne s’était pas heurté à Asinus au coin d’une rue. Mais une fois dans la salle, devant ce qui était le bureau de son ennemi, il n’avait plus su quoi faire. Voler la marchandise ? La remplacer par une autre abîmée ? Mettre carrément le feu aux locaux ? Cela n’entrait pas dans sa nature d’homme honnête ; cela lui semblait aller contre ses impératifs spontanés de gestionnaire efficace et impartial. Il n’était pas fait pour la trahison ; d’ailleurs son secrétaire portait son stylet et son diptyque de tablettes en mains comme s’il se fût agi de n’importe quelle inspection routinière de travail. Alors, éclairé de la seule lueur sinistre de l’aube, il tourna en rond avec ses hommes, cherchant ce qu’il pourrait entreprendre sans nuire à sa réputation ni sa fortune, arpentant les salles, se contentant d’examiner sans pouvoir les lire quelques écrits laissés là et palpant les jambons et les légumes entassés. Il sautillait au sol, caressait ce qu’il prenait, obéissait à ses troubles obsessionnels dans l’espoir que le soulagement que ses 176
incompréhensibles folies lui portaient lui donnerait une idée géniale pour frapper Asinus. Soudain les quatre hommes entendirent une bousculade, des hurlements, comme une bataille rangée au-dehors. Ne voulant pas trahir sa présence, Cita ordonna à l’un de ses esclaves de regarder discrètement à une fenêtre grillagée. La fenêtre était en hauteur. L’esclave, debout sur un escabeau, cria soudain « Maître ! Maître ! » et il sauta à terre comme s’il avait vu les geôles du Tartare vomies des Enfers. Cita courut jusqu’à lui, regarda à son tour, pâlit en bégayant : – Ils…ils…ils ont osé…ils…ils se révoltent… Devant lui, les Gaulois, ivres de fureur, submergeaient tout, faisaient un carnage de leurs épées quand les plus colossaux d’entre eux ne battaient pas à coups de poing les légionnaires. Il resta caché derrière son grillage, son front et ses yeux dépassant uniquement. Et pourtant, comme s’il y était, il entendit distinctement les cuirasses latines être enfoncées comme un brisement d’os ; il vit de chaque côté le sang voler, les premiers agonisants tomber au milieu des flaques de boue sans que leurs armes aient seulement pu rougir des blessures de l’ennemi. Sous ses yeux, un Romain eut un pied tailladé et la joue éclatée jusqu’à l’orle d’un bouclier. – Comment ? Comment est-ce possible ? Où est Latro ?, dit-il encore. Un bruit sourd retentit près de lui et lui coupa la parole. Un autre, puis un autre encore à l’autre bout de l’entrepôt que l’enfilement des salles faisait résonner en écho. Il comprit immédiatement le danger. Attirés par le butin, par l’idée de reprendre ce qu’ils croyaient leur appartenir, les barbares essayaient d’enfoncer les portes en bois. Celles du plus grand des deux horrea cédèrent en premier car ils étaient plus nombreux à les cogner à coups de hache. Le chêne massif vola en éclat ; ils s’engouffrèrent, se livrèrent au pillage. Cita savait qu’ils pénétreraient aussitôt après dans le second entrepôt. Il ne pouvait pas rester ici, il ne pouvait pas non plus s’enfuir puisque tous les abords étaient cernés. Il était fait comme un rat. Il paniqua, voulut se terrer pour gagner du temps, persuadé que Latro allait rétablir la situation avec des hommes revenus du choc. Ses esclaves et son secrétaire, montés à leur tour aux fenêtres, avaient pris peur eux aussi et se mirent à courir à travers salles. Les voyant faire, entendant les portes gronder et menacer de rompre, Cita regarda autour de lui, désespéré. Dans un angle de la pièce, il y avait par hasard des tonneaux emplis de noix, de noisettes, de marrons et de glands. Ils étaient assez profonds, pleins à moitié seulement et, avec une baguette, on retournait les fruits régulièrement pour éviter leur moisissure. Il n’était pas armé parce qu’il ne portait jamais d’arme ; de toute manière qu’aurait pu une seule lame dans ce déferlement ? Il n’y avait pas mieux que cette 177
cache ; le temps pressait. À l’aide de l’instrument, il plongea comme il put dans le tonneau qui était le plus renfoncé dans le noir, battit de ses mains, de ses cuisses flageolantes, entreprit d’y disparaître complètement en laissant simplement une aération discrète pour respirer. L’illusion fut réussie. Si ses compagnons étaient revenus dans la salle, ils n’auraient très sincèrement pu se douter de sa présence. À peine se fut-il caché que le verrou des portes sauta et les barbares firent irruption. Cita, perdu au milieu de ses fruits, impuissant à sortir la tête pour voir, entendit un fracas lointain, puis le cri strident de voix terrifiées qui moururent juste après s’être élevées. Les siens avaient dû être massacrés dès la première salle. Pourquoi, pourquoi fallait-il toujours qu’en voulant s’enfuir, on s’approchât du traquenard ? Il se retrouvait seul maintenant face au danger. Soudain pourtant quelqu’un de précipité passa près de lui. C’était trop léger pour un pas gaulois. Un de ses hommes avait réussi à s’échapper, manifestement. Il en eut un grand frisson, ne bougea pas, écouta pour savoir si on lui laisserait la vie sauve. Il l’ignorait, mais c’était son secrétaire qui légèrement blessé s’était réfugié au fond de l’entrepôt. Le premier barbare qui le poursuivait ne se pressa pas. Ordonnant aux autres Gaulois de le lui laisser, il marcha à travers salles d’une allure calme, lourde, impitoyable. Il arriva dans la dernière pièce, celle où se cachait Cita aveugle dans son tonneau. Là il ne tira pas même son épée, garda sa hache abaissée, resta un instant dans l’encadrement de la porte. Son torse massif et nu, sur lequel tombaient de longues tresses rousses, y semblait une pièce de bronze entre ses braies brun rougeâtre et la peau de loup grise qu’il avait jetée sur son dos. Son visage, informe et dur comme une pierre, portait des rayures de sang. Charpentés par d’épais sourcils, ses yeux étaient luisants et ricanaient en silence, s’accordant avec sa moustache rousse qui semblait devoir dévorer le monde et son casque bardé de deux ailes énormes pour mieux fondre sur sa proie. Le secrétaire se jeta sur la petite porte dérobée, celle qu’ils avaient forcée à l’aube afin de pénétrer dans les bureaux d’Asinus. Mais il s’aperçut avec effroi que d’autres Gaulois étaient derrière et lui barraient la route. Alors il recula jusqu’au mur du fond, piégé, épouvanté, les cheveux hérissés sur la tête, blême de peur dans l’ombre de la mort. Il n’avait aucun moyen de s’enfuir, regardant désespérément les fenêtres grillagées où un pan de ciel clair paraissait le narguer. Comme il tremblait, il s’aperçut qu’il avait encore à la main les tablettes de cire réservées à ses notes ainsi que son stylet pour écrire. Dans son épouvante, il ne les avait pas laissé tomber. Le Gaulois s’avança vers lui, du même pas lent, inhumain qu’il avait adopté depuis le départ : il en fut 178
tétanisé, incapable du moindre geste face à la fin qu’il sentait venir ; ses doigts glissaient tant il transpirait de partout. Le Gaulois s’approcha encore : tremblant toujours, grattant le mur pour y déceler une issue inopinée, il en lâcha enfin ses tablettes, mais pas son stylet comme une dernière arme dérisoire contre ce géant dont le poing faisait la largeur de sa tête. Quand ils se retrouvèrent si près l’un de l’autre que le plus grand aurait pu dévorer le plus faible en ouvrant seulement la gueule, il ne put que bégayer « la vie…la vie…la vie… » et l’autre ne sembla pas comprendre ce qu’il voulait dire. Le monstre le regarda dans un léger rictus, lui ouvrit les doigts, prit le stylet sans rencontrer un mouvement de résistance et le lui enfonça dans la gorge une première fois, puis à plusieurs reprises, brutalement comme une viande que l’on pique. Une ligne sanglante jaillit sur le mur, testamentaire de la victime. Cependant, Cita avait suivi toute la scène en transpirant à grosses gouttes dans son tonneau. Il n’avait pas bougé, se contentant d’écouter, et il était resté jusque-là invisible. Mais la sueur lui coulait le long des tempes dans les yeux, des fourmillements intenables se faisaient ressentir dans ses membres figés, une envie le prenait régulièrement d’éternuer. Soudain il eut l’impression que la poussière devenait irrespirable, que la mince couche de fruits secs qui le cachait pesait le poids d’un âne mort, que leur pointe lui entrait dans les chairs comme une torture pour le faire bondir et se découvrir. Quelque chose d’obscur grandit brusquement en lui, le besoin irrépressible de se retourner, de sortir de ce tonneau, de prendre les fruits un par un, de les caresser pour estomper le contact rugueux qu’il avait eu avec eux, les compter pour savoir si leur nombre était un multiple de trois. Il se fit violence, mordit les dents pour résister ; son cerveau lutta de toute son énergie afin d’empêcher ses muscles de remuer ; il sentit une lutte acharnée se dérouler dans ses bras pourtant immobiles. S’il bougea peu, fatalement il trembla et fit craquer une coque plus fragile que les autres. Le Gaulois qui venait de tuer le secrétaire et inspectait la salle pour y trouver justement un Romain dissimulé s’en aperçut. Il sourit encore de la bêtise des petits hommes du Sud, marcha droit vers le recoin de la salle, caressa la surface du tonneau. Là, après avoir fait un signe amusé aux siens, il enfonça son épée avec violence au milieu des fruits secs et l’en retira sanglante. Il n’y eut en dessous qu’un soubresaut, un cri suraigu, puis plus rien. Une foule d’hommes avait maintenant envahi la pièce et se repaissait du spectacle. Dans l’encadrement des portes et des fenêtres, les épaules larges, les crêtes des casques barraient la lumière. Et au milieu de cette pénombre, un homme plus petit, que nul ne connaissait, s’était avancé pour mieux voir. Aucun ne s’en soucia, trop occupé par le sort de 179
l’intendant de César. On ne voyait d’ailleurs pas son visage ni les couleurs de son clan. Il avait la face couverte de sang, venait visiblement de perdre un œil dans la tuerie – c’était son seul trait distinctif. Pourtant il souriait des événements comme s’il avait un intérêt particulier à la souffrance dont il était témoin et son sourire était un gage suffisant de confiance. L’heure n’était plus à soupçonner mais se réjouir d’être enfin passé à l’action. Devant tous, le barbare ne s’arrêta pas là. Cita n’eut aucune chance de s’en tirer. Le géant plongea sa main libre jusqu’à sa victime qu’il ressortit à bras levé comme s’il se fût agi d’une viande à trancher, sans même se demander s’il était encore vivant. Là, sans que l’autre pût faire un geste, il lui retira lentement de la bouche quelque chose, quelque chose qui s’avéra une petite noisette écrasée entre les dents pour ne pas crier. Alors, troquant son épée contre un long poignard, de l’air d’un homme qui veut en savoir plus, il lui fendit brusquement le ventre en deux, de bas en haut, jusqu’à la gorge. Et tandis qu’un ruissellement de sang sortait de la bouche de Cita, en même temps que ses entrailles tombaient au sol, il lui dit en un latin correct : – Il faut vérifier si tu n’en as pas mangé d’autres. Toute chose volée est due, Romain. Le cadavre retomba. Ainsi venait de périr l’intendant de César, Gaius Fufius Cita, honorable chevalier que l’on avait accusé à tort de piller la contrée. Dehors le massacre continuait. Dans la place les voix ne se taisaient pas. Derrière les murets, sous les charrois, dans les caves les plaintes d’innocents redoublaient les appels de guerriers désarmés et les cris bruts d’autres les désarmant. On égorgeait, on éventrait, on étêtait ; les tripes et les chairs se répandaient dans la boue. Il y avait de plus en plus de cadavres, à l’intérieur, à l’extérieur des maisons, et de moins en moins de vivants. Les hommes de Cotuatos et Ansila montaient vers les demeures des nobles ; ceux de Cloduar poussaient vers l’auberge d’Éroticus ; ceux de Marulos et d’Égérax ravageaient le port où ils achevaient de mettre à sac le logis des Romains. Et sur leur passage les uns étaient piétinés, aplatis, déformés en une masse inextricable ; à coups de boucliers, les autres étaient acculés contre les murs pour y mourir dans l’indifférence totale. Les corps s’entassaient en vrac. Le sang se mêlait à la neige, inondait les fossés, faisait déraper, trébucher ceux qui fuyaient comme ceux qui les traquaient. C’était tout l’oppidum qui paraissait s’empourprer des faîtes jusqu’au bas des maisons pour imbiber la terre et l’irriguer vers le fleuve. Les assaillants avaient gravi la Butte-aux-rats, à pied ou à cheval, et assassiné les gardes impuissants devant chaque hutte de seigneur. Les demeures furent violées sans déférence pour les chefs qui y résidaient, 180
dont les épouses, les concubines, les rejetons furent traînés dehors sans ménagement. Pour parer à une contre-attaque, l’ordre avait été donné de tuer tous les hommes rencontrés, quel que fût leur rang ; les nobles ne furent tirés de chez eux que pour sentir une épée décoller leur tête et avoir la neige glaciale pour dernière sensation au seuil de leur porte. La demeure de Cita, haute, blanche, couverte de tuiles, fut trouvée immédiatement, envahie, et des rustauds facétieux que la rage avait abêtis y dansèrent en sautillant du pas svelte des noces funèbres. Ansila, entouré de ses meilleurs guerriers, avait couru de toute la fougue de sa jeunesse. Il avait décidé qu’il tuerait lui-même Crasovir pour s’assurer qu’il mourrait dignement. Il pénétra sous le toit où il s’attendait à trouver l’argentier défendu par une escorte dévouée. Mais, contre toute attente, l’honorable vieillard était seul, debout, secondé de l’adolescent qui l’aidait d’ordinaire à marcher. Il attendait, vêtu d’une parure des plus modestes, regardant droit devant d’un regard lucide et douloureux. Le jeune garçon près de lui fut aussitôt emmené par deux hommes qui se le disputèrent sans que l’on sût s’il serait tué ou leur servirait de débauche. Crasovir ne bougea pas, se retrouva sans soutien comme s’il acceptait la loi du plus fort et les souffrances à venir. D’une voix chevrotante, il dit seulement à celui qui était venu le chercher : – Je te reconnais, Ansila, fils de Marossios, que j’ai vu naître. Il est bon que ce soit toi qui te charges de mes derniers instants. Permets au moins au vieillard que je suis de passer un manteau pour mourir dignement. Il montra un manteau posé sur un coffre, une sorte de haillon pauvre qui prouvait à lui seul le style de vie simple et dénué qu’il avait toujours adopté. Comme il étendait son bras, il parut soudain fléchir et l’on put voir à quel point son état physique s’était en réalité détérioré depuis sa chute face à Taurillos quelques jours plus tôt. Une simple chute dans la neige, il n’en avait pas fallu plus à l’âge qui était le sien pour faire de lui une moitié d’invalide, un demi-grabataire forcé de marcher et d’assumer son rôle. Ce manteau qu’il désignait, d’un geste de la main, Ansila le lui refusa mais, les yeux baignés de larmes, lui offrit plutôt le sien, riche et bien doublé, parce qu’il était plus approprié à sa condition. Jusqu’au bout, il se refusa à obéir aux ordres et à assassiner vulgairement celui qui avait en effet assisté à sa naissance. Il commanda que rien ne fût pillé ni brisé, menaça le premier qui irait contre sa parole. Il ôta son casque dont le cimier figurait un aigle, accompagna lui-même Crasovir dehors, l’embrassa une dernière fois en lui disant un mot chaleureux et, dans une prière de supplication, lui plongea sa lame au creux de la nuque sans même l’avoir fait s’agenouiller. Le vieillard s’effondra au milieu d’une mare de sang, les yeux clos du dernier sommeil qui lui était venu brutalement. Il fut la 181
victime la plus respectée de ce jour, arrêté uniquement pour montrer que tous les complices de Taurillos seraient exécutés, même les plus nobles, parce que l’intérêt collectif primait sur les valeurs personnelles. Non loin de là, le vergobret, lui, ne connut pas le même sort. Quand son habitation fut à son tour attaquée, son neveu Charmolaos qui la gardait s’enfuit en abandonnant les siens. Avec une rapidité insolente malgré son bras en écharpe, le barde échappa à tous les projectiles qui fusèrent sur lui. Déjà il se voyait sauvé, calculait les obstacles à venir pour sortir de l’oppidum lorsqu’une javeline puissante, plus fine, plus gracile, plus en avance que les autres, l’atteignit. Elle lui traversa le crâne d’une tempe à l’autre, le fit exploser contre la façade de la grand-hutte où elle se ficha. Cotuatos, sauté de sa monture, s’introduisit alors à l’intérieur de la demeure. Un beau feu de cheminée y flambait. Il surprit Taurillos, hagard et nu, à peine levé, comme à l’accoutumée, parmi ses maîtresses. Le vergobret était encore en érection. Les clameurs qui bruissaient de partout depuis le début de l’attaque, qui montaient telle une houle à l’assaut d’un roc ne semblaient pas avoir atteint son lit qui était, au sommet de la Butteaux-rats, le plus élevé de la cité. Lorsqu’il vit cette dizaine d’hommes surgie devant lui battre ses serviteurs, Taurillos chercha un moyen de défense. Mais interdit par l’outrage, décontenancé par l’attaque, à peine éveillé, il ne sut même pas où se trouvaient ses armes et par défi n’imagina rien de mieux que d’exhiber fièrement, au milieu des injures les plus graves, son sexe nu et encore raide aux audacieux. Jusqu’au bout il demeurait vulgaire, blâmable dans sa fonction dont il devrait rendre compte dans l’au-delà. Il ne semblait pas avoir mesuré la gravité de la situation, n’ayant d’yeux que pour Cotuatos au milieu des intrus, interprétant l’irruption de son ennemi juré comme une intrigue de palais davantage destinée à le renverser du pouvoir qu’à commettre un massacre. – Toi, toi ! Maudit animal ! Comment oses-tu entrer dans ma demeure ? Charmolaos !, appela-t-il, où est ce bon à rien de neveu ? Charmolaos ! Que quelqu’un aille me chercher Charmolaos ! Ou la légion ! Vite ! Mais nul ne se déplaça et, dans tous les cas, Charmolaos, comme la légion, n’aurait pu venir à son secours. – Taranis le Très Haut, qui protèges ma lignée depuis toujours, toi qui nuis aux imposteurs, viens donc m’aider à châtier moi-même ces insensés ! Le dieu, pas plus qu’un autre, ne se manifesta. Taurillos, attrapant une tunique qu’il n’enfila pas, sembla saisir enfin son isolement et le péril qu’il courait. Il n’y avait pas qu’outrage à sa personne mais menace sur sa vie. Son érection brusquement faiblit et laissa place à un membre chétif qui fit rire une première fois les hommes. 182
– Cesse tes enfantillages, dit Cotuatos lui aussi amusé, il est temps d’affronter seul ta fin. Tu n’entends pas qu’on meurt dehors, tout en bas ? Tu es en retard, Taurillos aux bœufs lourds : la place d’un brenn, même obèse, est à l’avant ; il est temps pour toi de rattraper les tiens et leur ouvrir la route. Le fils d’Indiomar le toisait, brûlant d’une haine vive. Bien décidé à ne lui montrer aucun égard, il l’était plus encore à ne pas se déshonorer par l’acte qu’il allait commettre. Il posa son casque, sa lance, son bouclier, ne garda que son épée et en jeta une à Taurillos qui se pencha, hébété, pour la ramasser. Il y aurait duel, ainsi que les Celtes en avaient l’habitude. Les guerriers firent cercle, les laissèrent tous deux face à face. À peine le vergobret eut-il saisi le pommeau qu’il se rua comme un bœuf. Cotuatos l’évita une fois en se jetant de côté ; Taurillos, énorme, fit demi-tour, bondit de nouveau, furieux d’impuissance, tête en avant pour bousculer son ennemi. Il fulminait de l’insulte, dédaignait l’arme généreusement accordée, ne cherchait qu’à culbuter son rival de son corps flasque. Et comme s’il se fût agi d’un animal fou qu’il voulait exciter, avec une agilité certaine, Cotuatos le piqua à son deuxième passage de la pointe de son épée dans le dos. Les hommes s’esclaffèrent à nouveau de cette botte comique. Taurillos hurla, fit une cabriole lourde, chuta ; sa hanche saignotait. Ses femmes braillèrent à leur tour, elles qui avaient d’abord été déconfites de stupeur. Elles furent frappées par les hommes de Cotuatos, encore et encore, comme si l’affaire ne les regardait pas et qu’on voulait leur faire rentrer leurs derniers cris dans la gorge. À ce moment seulement Taurillos sembla reprendre ses esprits, crut bon de se servir de son épée. Il se jeta sur Cotuatos, mais si maladroitement, en opérant de si larges mouvements de sa lame que le stratège recula, l’esquiva, le laissa frapper en vain les chaudrons grecs et les statuettes romaines au milieu desquels il vivait. Taurillos se fatigua rapidement. Il ramassa encore des objets qui traînaient et les lui jeta ridiculement au visage, déclenchant une nouvelle hilarité des guerriers qui assistaient à un combat grotesque et de plus en plus inégal. Il s’arrêta bientôt, hors d’haleine, en sueur, écumant, les yeux roulant des flammes de rage où se reflétait le feu du foyer. Il s’étranglait : – Chiens galeux ! Chiens ! Je vous tuerai tous ! Autour de lui les rebelles riaient encore. Braillards, ils lui lançaient des plaisanteries outrageantes sur son poids, son appétit, sa plus grande souplesse avec les femmes qu’avec l’adversaire. Leurs mots étaient des aiguillons ; ils faisaient aussi mine de l’exciter au combat de leurs lances. Taurillos ne le supporta pas. Pris d’une dernière énergie, il s’élança, abattit son épée, mais ne toucha qu’un tabouret qu’il détruisit. C’était l’attaque la 183
plus violente qu’il avait pu asséner, son coup ultime en quelque sorte. Cotuatos comprit que le combat n’aurait pas plus de noblesse de sa part et, comme le vergobret relevait péniblement son épée, il décida d’en finir. Dans une habile manœuvre, il avança avec une telle hargne qu’il le désarma, le bouscula, le vainquit. Taurillos, reculant, buta contre un des objets qu’il avait lancés et qui se trouvait sous son talon. Il fut déséquilibré. Le premier des conjurés en profita pour achever avec éclat, lui donna un coup du plat en plein visage, une sorte de gifle comme à une femme, et le fit tomber de toute sa masse contre un coffre – celui empli d’argent où il puisait des pièces sans compter. L’homme fut ébaubi par le choc. Le gagnant ne lui laissa aucun répit. Mais au lieu de frapper directement, sous l’œil admiratif de ses guerriers, il enfonça sa lame dans le bois et, par une seule pression sur la poignée, la fit pivoter vers la gorge du vergobret. Le cou fut tranché net. La face retomba, en un dernier regard consterné, la langue tirée, les cheveux en pagaille dans un bassin à anse près d’une statue qui avait, elle aussi, perdu sa tête dans le combat. Cotuatos venait de décapiter le chef des Carnutes, plongeant immanquablement l’État dans la guerre et le chaos. Il fit encore un tour de la salle, sublime et sali, trouva l’objet au sol qui avait déstabilisé Taurillos. Cet objet, c’était le phallus de terre cuite romain qui était censé porter bonheur. Il le promena sous le regard de ses hommes pour leur dire que les superstitions ne valaient rien. Puis il le jeta sur le corps de son ancien propriétaire. L’objet se cassa en deux et il le piétina pour le réduire en miettes. Il n’y eut aucun prisonnier. Personne ne sortit vivant de la grand-hutte. La laideur de la guerre s’y déchaîna plus que dans aucun autre endroit. Au milieu du pillage, les serviteurs furent assassinés, les femmes violées et suppliciées, l’enfant Ésugénos emmené à moitié mort pour être jeté du haut des remparts comme en son temps le petit Astyanax, fils du valeureux Hector dompteur de chevaux. Et dans le reste de la ville, les événements avaient aussi évolué. Ils devenaient plus sombres puisqu’aux combats brutaux succédaient maintenant les raffinements de représailles et de cruauté. Avec méthode, il n’y eut pas un pan de l’oppidum qui ne fût foulé. Partout on criait « Vengeance ! Justice ! Honneur ! ». Le temps n’était plus à l’effet de surprise, mais aux excès trop prévisibles qu’exercent les gagnants sur les malheureux. Les greniers, les bateaux, les demeures les plus riches furent visités ; des hommes en sortirent les bras chargés d’argent, d’étoffes précieuses, d’objets de prestige. Des femmes furent emmenées sur les épaules, parfois deux pour un même homme, sans distinction d’âge ni de noblesse. Des 184
individus reçurent des flèches empoisonnées au bois d’if et donnèrent satisfaction à se tordre de douleur. D’autres furent brûlés vivants, pour le simple plaisir de les voir courir et se rouler dans la neige à éteindre le feu. Ceux-ci épargnèrent les druides ; ceux-là arrivant derrière, galvanisés par le combat ou voulant respecter les ordres à la lettre, leur causèrent des souffrances plus cruelles encore qu’aux vauriens. Puis on lança quelques incendies, limités à une ou deux maisons, non pas pour embraser la ville mais signifier aux autres qu’il n’y avait plus rien à piller là où on était passé. Les chefs n’intervinrent pas ; quelquefois même, ils encouragèrent les crimes dont ils étaient les témoins car ils savaient qu’ils devaient récompenser les leurs et effrayer les bons bougres tentés de protester. Ce fut un déchaînement incontrôlé, une sombre page d’anarchie. Tous les habitants prirent réellement peur, se demandèrent si, quoiqu’innocents, voire même complices improvisés de la conjuration, ils n’allaient quand même pas tout perdre ce matin-là. Quand on a du sang sur les mains, on ne sait jamais si le sien ne va pas bientôt tacher celles des autres. Forcément la population commença à fuir mais, empêchée de quitter la ville par le flot de guerriers qui y avait afflué, courant en désordre sous les cris les plus inimaginables, elle s’agrégea sur la place centrale, le seul espace encore à peu près libre où elle pouvait tenir, comme si elle s’était souvenue instinctivement que l’union fait la force et que là serait son dernier refuge. Cette place, c’était celle-là même où elle avait approuvé la condamnation de Sagéra quelques mois auparavant. Elle y forma une foule compacte de blessés et de pleutres, sans cesse renforcée de fuyards réchappés, les plus exposés essayant de se cacher dans le dos de ceux de derrière pour ne pas être frappés en premier par les braves. Chacun, regardant la peau des plus proches, essayait de voir si un tatouage en forme de rouelle ne trahirait pas un homme de Taurillos à livrer pour sauver sa vie. Déboulés de toutes parts, les rebelles, telle une meute carnivore, allaient se jeter sur ce troupeau facile quand soudain, au milieu d’un ces étranges instants de silence que connaît parfois le tumulte, quelqu’un, des victimes ou des agresseurs, hurla en pointant son doigt par-dessus l’épaule d’un autre : – La copona ! La copona, là ! Personne n’y est encore allé ! C’était un nouvel appel au saccage ou une diversion. La copona : personne n’y était allé, en effet. Et pour cause, le bâtiment avait été le seul en mesure de résister à l’assaut, barricadé à temps, tous volets clos et portes fermées à l’autre bout de la place. Éroticus avait été sur pied dès les premiers retentissements des combats et avait mis debout ses clients en les arrosant d’eau gelée et en les bourrant 185
de coups de pied dans les côtes. Puis il avait sorti de nulle part un arsenal de fortune, comme s’il avait réfléchi à l’avance à l’éventualité d’une attaque, et, alors que les portes de Génabum venaient juste d’être enfoncées, alors qu’ailleurs Taurillos dormait encore, que Crasovir se préparait à mourir noblement, en un tour de main il avait organisé, lui, à l’avant comme à l’arrière, la défense de son établissement comme celle d’une citadelle imprenable. De ses broches et de ses pieux de cuisson, il avait fait des pointes acérées qu’on appelle cervi à l’armée et qu’il avait plantées dans les interstices du bois pour en hérisser la façade ; le plancher sous l’auvent avait été arraché et jeté au loin pour dévoiler à sa place un grand trou où il avait jeté du verre pilé et dont il se servirait comme d’un fossé et d’un remblai ; des tonneaux de vin, des jarres d’eau avaient été répandus un peu partout pour faire glisser sur la terre gelée. À l’intérieur, les tables, les bancs, le mobilier furent poussés contre les fenêtres rétrécies au moyen de planches clouées et une batterie de cuisine fut disposée, des couteaux, des tisons, des bûches pour que chacun se servît. Il était clair qu’Éroticus ne se rendrait pas, s’appuyant sur ses clients romains et grecs, moins pour les défendre que sauver son établissement, et tout était déjà prêt pour soutenir au mieux le siège que les assaillants étaient encore occupés à se débarrasser des sentinelles sur les remparts. Conformément aux plans, ce furent les hommes de Cloduar qui arrivèrent sur place. Ils ne s’élancèrent pas tout de suite, restèrent un temps étonnés de ce bâtiment qu’ils n’avaient pas trouvé grand ouvert comme les autres. Ce qu’ils appelaient « la maison des Italiens » semblait les observer, telle une bête sûre d’elle, un monstre à moitié enfoui dans le sol et prêt à dévorer qui l’agresserait. Ses fenêtres rétrécies étaient deux pupilles sournoises ; son enseigne décrochée y traçait comme un sourire narquois. Malgré le soleil levé, un pan d’ombre continuait d’envelopper le bâtiment, le rendant plus menaçant et mystérieux qu’en temps normal. On discuta. On se méfia notamment du patron, moins parce qu’il était un colosse que parce qu’on le savait retors et particulièrement farouche au combat. Le souvenir de Solonium, des carnages accomplis quand il taillait le menton des Romains sur la roche des montagnes était dans toutes les têtes. Et pour s’encourager, on se rappelait sans trop y croire qu’Allobroge voulait dire exilé, qu’Éroticus n’était pas un Carnute, qu’il avait abusé de l’hospitalité de leur peuple pour s’enrichir impunément en traitant avec les Romains. Dedans, la pénombre était grande et la panique avait d’abord gagné les clients, les uns après les autres, comme une maladie contagieuse. Éveillés à coups de pied et d’eau glaciale, les Marcus, Porius et autres ivrognes, habitués à boire et à jouir des plaisirs de la vie, n’avaient rien compris à ce 186
qui les tirait violemment du sommeil. Des hurlements lointains résonnaient à leurs oreilles, des appels au meurtre, à la vengeance qui les firent trembler quand ils comprirent enfin qu’une menace approchait. Certains vomirent sans savoir si la responsabilité en incombait à la peur ou à l’alcool qu’ils finissaient de cuver ; il y en eut même un pour uriner sur lui-même, la vessie pleine et le cœur soulevé par les événements. Aucun n’avait d’armure ni d’arme de valeur ; quelques-uns avaient des glaives, qui paraissaient bien fragiles en comparaison des lames solides des Gaulois. Assez vite pourtant Éroticus passa soutenir chacun en lui disant ce simple mot qu’il ponctua d’une bourrade : « ici la vie, dehors la mort », et les esprits s’affermirent quelque peu. Le patron avait décroché des poutres les boucliers suspendus en ornement. Il les distribua, avec les chaînes, à ceux qui sauraient le mieux s’en servir. Tous comprirent qu’ils devraient se défendre. Car dehors, sous la pression de leur prince, poussés par les derniers sons de carnyx et par la foule qui remarquait que la copona n’avait pas encore été prise, les assaillants recouvrèrent bientôt leurs esprits et chargèrent au cri sauvage d’« À mort, les étrangers ! ». Le vin répandu, la fosse devant la porte de l’auberge, les piques sur la façade ne les arrêtèrent pas et, si certains en furent blessés, ils franchirent ces obstacles de peu et attaquèrent aussitôt murs et ouvertures pour entrer. Alors les assiégés, par les maigres espaces laissés libres, ripostèrent en balafrant avec leurs couteaux et en tapant avec leurs bûches. Mais leur action ne servit à rien d’autre qu’à exciter la colère des barbares qui attrapèrent les bras des plus faibles et les extirpèrent carrément comme on ferait d’un enfant hors d’une cachette. Ce fut comme l’eau qui s’infiltre dans les navires par toutes les fentes et entraîne à chaque nouveau reflux des objets perdus ou des noyés. Il fut évident que la copona ne tiendrait pas. Plus vite encore que prévu, la porte fut enfoncée d’un coup et les assaillants reçurent une volée de vaisselle. Mais ce fut tout. Une débandade s’ensuivit. Les clients s’enfuirent en tous sens, dans les chambres, les cuisines, sur la mezzanine où ils furent traqués et exterminés. Seul Éroticus combattit vaillamment. Voir sa porte fracassée, son commerce mis à mal avait décuplé sa détermination. Autour de lui, trois ou quatre corps gisaient déjà, assommés, et il grognait « Solonion ! Solonion ! Solonion ! » du nom gaulois du carnage qu’il avait livré autrefois et qui était ses hauts faits. Il se voyait en pleine bataille. Il n’avait pas d’épée, mais n’en avait pas besoin tant il éclatait des tonnelets et des bûches sur les têtes folles qui s’approchaient de lui, retrouvant la même rage désespérée qu’il avait eue des années auparavant. D’ailleurs, au moment où les combats avaient commencé, sans que personne n’y fît 187
attention, il s’était lui aussi déshabillé, étouffant par la chaleur de l’engagement, et avait à la hâte retroussé ses cheveux, badigeonné son corps de suie de cheminée si bien que les attaquants crurent rencontrer l’un des leurs. Il était magnifique, les cuisses fermes, le torse bombé, la moustache ondoyante, le regard fixe et il emplissait la vaste pièce de sa carrure. Surtout, Fannia Voluptas, sa femme, l’avait rejoint et, nue elle aussi parce qu’un homme lui avait arraché sa robe, grasse et désirable dans l’effort, armée d’une broche de cuisson, elle se démenait joliment. Ils formaient un couple uni. Elle n’était plus Fannia, il n’était plus Éroticus, mais Agégorix et Bluenn, tous deux protégés d’un bouclier oblong et prêts à emmener le plus de monde avec eux dans la mort. Bientôt ils furent les derniers, encerclés par les hommes de Cloduar qui n’étaient pas les plus grands de la troupe. Et alors que les deux époux allaient être submergés, l’un des combattants baissa les armes et dit d’une voix où toute animosité avait disparu : – Par les dieux, qu’est-ce qu’on est en train de faire ? Regardez, il est comme nous ! Et elle, comme nos femmes ! Regardez, ce n’est pas un ennemi, c’est un des nôtres dans la lutte, c’est le fléau de Solonion ! Ce qu’il dit parut soudain une évidence que personne n’avait vue jusque-là et qui maintenant sautait aux yeux de tous. L’homme qui ne manquait pas de cran pour se tenir seul face à vingt individus surarmés, l’homme qui n’avait pas besoin de cotte de mailles pour se protéger, qui n’avait pas reculé d’un pas, qui en plus défendait sa femme et ne partirait dans l’au-delà que le corps couvert du sang de ses ennemis, cet homme était non seulement un guerrier véritable, mais surtout il demeurait le célèbre vainqueur des Romains, que tous enviaient parce qu’il avait fait, disait-on, des guirlandes de leurs tripes et des brocs de leurs crânes. Il y eut curieusement une pause où chacun se remémora en silence ses exploits. Et puis à voix haute, on changea brusquement de discours ; on affirma qu’aujourd’hui il ne faisait que continuer la lutte, mais sur un autre terrain, plus fourbe, plus méditerranéen, plus efficace peut-être, en enivrant à prix d’or les Romains pour en faire des mauviettes. Il ne fut plus le vendu, le traître, mais un héros méconnu qu’on avait failli assassiner dans la folie aveugle des combats. D’abord hésitant, l’un d’entre eux s’approcha et tapa finalement l’épaule du souteneur. On le félicita d’avoir si bien roulé les Romains ; on plaisanta même Fannia dont un coup de sein ou de fesse aurait ébranlé l’Italie. Agégorix souffla, accepta de poser son bouclier, offrit à boire à qui le désirait. Et les Gaulois ne touchèrent à rien, ne vandalisèrent pas la taverne, se contentèrent de lamper, goguenards, à même les tonneaux 188
restants tandis que quelques clients, ayant survécu à la tuerie, étaient emmenés sous le joug. La ville avait été entièrement mise à sac. Partout, on eut toutes les peines du monde pour que la situation se calmât peu à peu. Au final, quand on put enfin y voir plus clair, les assaillants ne comptèrent que dix morts et quelques blessés ; les cadavres des Romains et leurs alliés furent, eux, incalculables. Tous les prisonniers furent conduits vers le port, sans savoir s’ils auraient été plus chanceux de périr dans la cohue. Au bord du fleuve, devant les portes fracassées des entrepôts, au milieu des cadavres abandonnés, une colonne de captifs se forma, qu’on aligna à genoux, le visage tourné vers le sud et l’île où se cachait Asinus. Le commerçant ne manqua rien de l’horrible spectacle. Parce qu’il ne voulait se dévoiler, il ne put compter les malheureux, tâcha seulement de différencier les négociants des troupiers de Rome ou des Gaulois, ce qui ne fut pas aisé tant leurs vêtements étaient en lambeaux et leur visage défiguré par les coups et la défaite. Il vit encore un personnage passer les étrangers en revue et faire se relever et s’éloigner ceux qui étaient grecs, espagnols ou africains pour en faire sans doute des esclaves. La colonne se resserra. Un sacrifice alors commença puisque la guerre était conçue par les Celtes comme une activité essentiellement religieuse. Alors que des prières collectives étaient chantées à un de leurs dieux, un colosse longea la file et, à chaque fin de litanie, coupa la tête du prisonnier qui s’humiliait devant lui. Des cavaliers et des princes firent ramasser les crânes pour les accrocher à leurs montures. Les corps furent balancés dans l’eau où ils se mêlèrent aux glaçons que le fleuve charriait. Les principaux brenns justement étaient revenus sous les acclamations et chacun dans son coin, entouré de ses hommes, guetta le partage du butin qui commençait. On avait drainé et entassé pêle-mêle des caisses d’or et d’argent, des vêtements bigarrés, des meubles, des bêtes de somme et des chevaux, le fourrage, le grain, les récoltes, les viandes des entrepôts. Des hérauts bien renseignés égrenaient les noms des terres et des propriétés immobilières à confisquer. Bien sûr, chacun s’était d’abord emparé, autant qu’il l’avait pu, des dépouilles de ses victimes en vertu de cette loi du plus fort qui veut que le vainqueur ait un droit de propriété absolu sur le corps du vaincu. Mais maintenant, il s’agissait de bien plus que de parures ou d’armes, et les yeux de tous luisaient de convoitise. Beaucoup étaient entrés en rébellion uniquement attirés par l’espoir du pillage et du gain. 189
Cotuatos seul sembla dédaigner cet amas de trophées, regardant la ville fumante et non les richesses qui s’étendaient près de lui. Il semblait l’unique point fixe dans toute cette agitation. Pourtant, le partage obéissait à des règles hiérarchiques et ce fut à lui, en tant que chef de la révolte, de prendre le premier sa part de trésors. Il se servit raisonnablement en s’attribuant, comme il convenait, la plus grosse rétribution. Les autres princes l’imitèrent dans l’ordre de leur puissance respective. Conconnétodumnos s’avança en lâchant un rire pareil à l’écoulement de pièces d’or ; il fut suivi d’Ansila, Cloduar, Calpovix le dur, Marulos, Villu, Égérax, Exobnos le sans peur, Acutios, Galatos, Lugurix qui avait cherché en vain Asinus dans la ville et ne l’avait pas trouvé. Après les membres de la haute aristocratie, ce fut au tour des guerriers de valeur, ceux qui s’étaient distingués par leur bravoure et, sans surprise, ce furent les fantassins d’élite et les cavaliers qui se présentèrent. Enfin, ceux qui étaient entrés les derniers dans la ville, qui s’étaient battus laidement, la piétaille se partagea les restes. Et comme on coupait encore des têtes, il y eut de l’esclandre de la part de Marulos dont les terres s’étendaient aux confins des Éburovices et qui ne perdait pas une occasion de contester l’autorité de Cotuatos qu’il jalousait en secret. – Il faut refaire le partage !, s’écria-t-il soudain. Le premier en a pris trop ; le dernier n’en a pas eu assez pour honorer sa fougue au combat. Qu’on fût aristocrate ou simple homme de troupe, la puissance s’obtenait par la richesse qu’on pouvait étaler devant tous et qui permettait de s’entourer d’un nombre toujours plus grand de clients et de débiteurs. L’orgueilleux rival de Cotuatos contestait que le stratège se fût servi en premier et qu’il eût droit à une plus grande part de rapine, même si celleci était modérée. Il réclamait plus de justice et par là prétendait indirectement se faire reconnaître comme un brenn d’égale importance, lui dont les ancêtres avaient été capitaines et conseillers des rois et qui se vantait de la proximité de sa famille avec les puissants. Mais il ajoutait une injure à sa querelle. Car le dernier qu’il mentionnait était peut-être dans sa bouche le dernier prince à s’être servi ou le soldat le plus vil de l’armée. En ce cas, il sous-entendait que Cotuatos ne valait guère mieux. Ce fut ce que son rival comprit. La dispute, inévitable, éclata entre les deux hommes. – Comment oses-tu, Marulos ? Je vous ai apporté cette victoire qui non seulement vous enrichit mais répare une injustice dont vous tous, Carnutes, avez été victimes ! Et on allait en venir aux mains, des princes rappelant leur égalité de principe, d’autres au contraire se rangeant derrière Cotuatos, et déjà les 190
hommes de chacun remettaient la main à l’épée quand Volomir intervint. Il était resté jusqu’ici en retrait, occupé à d’autres réflexions. Il fit une étrange proposition : – Marulos a raison d’essayer de nier l’autorité de mon frère. C’est son droit le plus strict et peut-être que vous aussi, puissants Seigneurs, Gaulois libres, pensez ainsi. S’il n’y a aucune supériorité évidente de l’un de nous sur les autres, si Marulos fils de Tarbeisonios peut être l’égal de Cotuatos fils d’Astorix, remettons-nous-en aux dieux afin qu’ils tranchent. Pour une fois, il était moins emporté que son frère, plus réfléchi. Ses yeux vert-de-gris semblaient garder un calcul secret. Il fit un signe discret à Cotuatos pour lui signifier de lui faire confiance, pointa aussitôt les détenus qui n’avaient pas encore été décapités : – D’où nous nous tenons, cette file de prisonniers est très longue, impossible à dénombrer puisqu’elle se poursuit au-delà de ces maisons qui nous en cachent la vue. Alors je propose de faire tomber leur tête les unes après les autres en scandant à voix haute, tour à tour, le nom de mon frère ou de Marulos. Celui qui aura la dernière tête d’un Romain sera reconnu notre chef. Sa proposition reçut l’approbation générale. On fit donc tomber les têtes en alternant les noms de Cotuatos et Marulos. Cotuatos, Marulos. Il n’y eut plus de prière, seulement des noms et des têtes tranchées. Cotuatos, Marulos. On marquait un temps d’arrêt chaque fois pour qu’il n’y eût pas d’autre revendication et ce fut un supplice atroce pour les captifs qui tendaient leur nuque et dont tout le monde avait oublié la souffrance. Cotuatos, Marulos. Cotuatos, Marulos. On suivit l’hécatombe jusque derrière les maisons. Le dernier Romain exécuté le fut au nom de Marulos. Il avait gagné. Cotuatos avait perdu. – Un instant !, cria Volomir, il en reste un ! Mais il n’en restait aucun. – Et pourtant si !, insista-t-il. Il se tourna tout à coup vers l’Île-avalante où se cachait Asinus et parut le fixer du regard comme s’il avait toujours su sa présence là-bas. Toute la matinée le commerçant espion avait tressailli, manqué de se découvrir, en restant à observer le massacre et retenir par acquit de conscience ce qu’il pouvait, les informations que ses yeux enregistraient d’aussi loin, le rôle des chefs, le nombre d’hommes, les survivants. Ce n’avait pas été facile tant le carnage avait été confus, et il n’aurait su dire combien de temps il avait duré, si rapide et si long. On se battait en tous sens, tout était l’objet d’attaques ; il avait même cru voir des femmes folles à lier frapper à coups de pierres ce qui devait être des poissons entre les navires ! 191
Mais hébété, n’ayant pas dormi de la nuit ni du jour, sa tâche fut encore compliquée parce que Génabia se faisait inhabituellement chatte depuis qu’il avait cessé de la pénétrer et s’était rhabillé. À maintes reprises, comme s’il ne se passait rien sur les berges en face, elle essaya de le faire venir à lui, l’appela par des sourires, des mots doux, des parties dévoilées de sa féminité. Elle avait bu tout l’aphrodisiaque et tout le vin, et plusieurs fois, le membre à nouveau raide, il faillit céder à la tentation, s’en vint vers elle, repartit alors qu’elle le tenait déjà entre ses griffes, essayant d’être ainsi à l’aimer en même temps que de ne rien perdre des événements. Il craignait pour lui et surtout pour elle, s’imaginant les sévices que feraient subir ces barbares aux petites Gauloises qui avaient couché avec des Romains. S’il se disait que c’était encore sur cette île où elle était le plus à l’abri, il songeait également qu’il était trop tard de toute façon pour fuir et que mieux valait mourir ensemble, unis à tout jamais, si on les y découvrait. Alors il se prit à rêver, des rêveries grandioses et sottes où il expirait entre ses bras, et il conclut qu’il serait dommage de ne pas s’aimer une dernière fois. Elle le tente toujours, veut le faire s’abandonner. Au bout de tant de tentatives infructueuses, allongée sur le dos, elle se décide à lui ouvrir ses cuisses, carrément, et le bel oiseau qu’elle a tatoué sur la poitrine semble voler vers lui pour l’entraîner dans un gouffre. Elle n’a plus besoin d’aucun mot, d’aucun sourire : à la fin il n’y tient plus. Alors même que les combats au loin sont terminés et qu’il croit n’avoir plus rien d’intéressant à regarder, il capitule. Et entre deux lèchements : – Tu sais, lui dit-il, j’ai beaucoup d’argent encore. Caché dans la chambre où nous nous sommes aimés la première fois. Nous pourrons nous sauver tous les deux sitôt que j’aurai trouvé le moyen de le récupérer. Elle ne répond rien, lui plaque sa tête de sa main droite. Les Romains répugnent à ce genre de pratique tournée vers l’unique plaisir féminin, mais le sexe de cette créature, fauve, gonflé, tracé comme une œuvre d’Apelle, est si beau, si accueillant qu’il s’y jette pour le posséder à en avoir la gorge sèche. De sa langue aplatie et chargée de salive, il trouve d’abord les lèvres qu’il pourlèche goulûment, puis il remonte vers le bouton de chair qu’il frôle, baisote, soufflote, lape de bas en haut en ayant soin de varier la vitesse de ses mouvements. Elle ne jouit pas, semble vouloir se retenir. Alors il continue quoiqu’un peu fatigué, prend une pincée de neige dans sa bouche, descend de plus belle dans son antre amoureux. Il la supplie de le rappeler « Seigneur », de lui avouer le bien qu’il lui procure, mais elle demeure inflexible, muette, et il redouble d’efforts pour la faire craquer à son tour. Le carnage dans la ville, les cris, les flammes n’existent plus pour lui. Lorsqu’il se relève enfin 192
pour lui embrasser le ventre et relayer sa tendresse par des caresses de ses doigts, il est si peu sur ses gardes qu’il ne comprend pas l’origine de la douleur brusque qu’il ressent à l’abdomen. Il tâte, en retire une main ensanglantée, regarde Génabia qui lui dit : « Seigneur, voilà mon plaisir. Il est temps de t’en aller. » Elle vient de lui enfoncer au flanc gauche un poignard qu’elle a dissimulé tout ce temps. Un poignard ? Un poignard ! Tout bascula autour de lui. Choqué, frappé à mort, il se traîna, regarda la ville impuissant, entendit les hurlements au loin, sembla soudain réaliser qu’il était en train de tout perdre, la richesse et la vie. Où était Scythès ? Où était-il ? Il jeta des yeux éplorés vers la rive où le paysage paraissait s’effondrer. Sa terreur redoubla quand il aperçut Volomir qui, sur une barque, à la surprise générale des siens, traversait les glaces et ramait seul vers l’île. Il se retourna, chercha Génabia : elle avait disparu, emportant tout, jusqu’à la fourrure et même le pipeau qu’il ne retrouva pas. Comme si elle n’avait jamais été là. Il eut une douleur plus profonde encore au cœur. Scythès ! Scythès ! Il voulut se redresser, chuta, comprit qu’il n’aurait pas les forces suffisantes pour remettre son embarcation à l’eau. Tout vacillait autour de lui. Blessé, hagard, ne sachant pas nager, il ne pouvait s’enfuir. Il était pris. L’homme qu’il avait insulté à leur première rencontre ne lui avait pas pardonné et aurait sa peau... Volomir le dur sauta de sa barque, marcha droit à lui, lui trancha le cou. Sur la rive en face, tous les Gaulois avaient compris et gardé le silence en attendant que ce dernier Romain réchappé fût exécuté. Aux corps sans tête devait répondre une tête sans corps. Et quand Volomir brandit celle hideuse d’Asinus et clama le plus fort qu’il put le nom de son frère, tous, même Marulos qui l’enviait, même Lugurix qui aurait voulu se venger du commerçant, exultèrent, explosèrent de joie au spectacle sordide et reprirent le nom de leur chef : « Cotuatos ! Cotuatos ! Cotuatos ! »
193
VII LES VAINQUEURS
Génabum bruissait encore des voix des massacrés. Le soleil avait déjà parcouru la moitié du ciel quand Volomir, retraversant le fleuve, rapporta la tête d’Asinus et la lança, aussi ordinairement qu’une pelletée de crottin, aux pieds des chefs qu’il méprisait. Irrité mais s’inclinant devant ce qu’il considérait comme une fourberie, le prétentieux Marulos la ramassa pour la tendre à Lugurix qui put, avec l’assentiment de tous, l’accrocher à son cheval. Il en pendait déjà deux ; elle fut la troisième fixée contre la croupe de l’animal. Elle s’y balança un peu, puis s’immobilisa. Ses traits livides semblaient agités d’un tournoiement ultime qui était celui de la mort qui vient, effraie, bouleverse le visage en même temps qu’elle résume l’existence qui fut menée. Sur cette tête, on retrouvait des indices de la vie faste et miséreuse qui avait été celle d’Asinus. Devant, le cou avait été tranché net, mais derrière, des lambeaux de peau sous la nuque et les oreilles formaient un haillon sanguinolent qui indiquait que la décapitation n’avait été que partielle et que la tête avait fini par être arrachée. Ses rares cheveux argentés, tirés de main en main par tous ceux qui avaient voulu constater la fin du commerçant, s’éparpillaient en tous sens et, sur les joues molles et pendantes comme des bourses vides, l’ombre blafarde des premiers poils reparaissait parce que c’était le seul jour depuis longtemps où l’homme ne s’était pas fait raser de près. Et le reste de la face semblait figé en une certaine expression d’horreur, le front soucieux plissé d’effroi, les sourcils fournis déformés comme une pièce d’or que l’on croque, la bouche entrouverte en ovale où de la boue était venue tacher les chicots jaunis et où les lèvres semblaient comme aspirées, absorbées au fond du palais noir tel un puits sans fond où l’on jette son trésor. Dans les yeux enfin, ces petits yeux noisette roublards, brillait un regard terni comme jeté à rebours sur la vie dorée qu’il aurait pu avoir et qu’il n’avait pas eue, à moins que ce ne fût le butin amoncelé tout proche qui s’y reflétât pour le narguer. L’action de Sextus Cornélius Asinus s’était achevée sur un paradoxe qui sous-tendait, à la réflexion, toute son histoire chez les Carnutes. Plus il
avait pensé monter et toucher la fortune, plus la cité s’était enfoncée dans le chaos et avait couru à la catastrophe, l’entraînant au final avec elle. Et lui n’avait pas vu qu’à la manière d’une tragédie triviale, il avait en personne précipité le destin en pensant se prémunir contre les dangers. Il avait payé au prix fort sa faiblesse pour la chair, sa passion pour l’argent, son dédain des sauvages. Or, on ne survit dans un monde sauvage qu’en apprenant à respecter sa sauvagerie. Il ne laissait derrière lui presque aucun compagnon et une foule d’ennemis qui se souvenaient de ses vices, de ses faiblesses, non de ses qualités si tant est qu’il en ait eu. Les Gaulois, en voyant circuler sa tête, rappelèrent sa déloyauté, ses bassesses, sa vantardise ; et dire que c’étaient eux que les Romains qualifiaient de coqs ! Les Gauloises, à qui il fut défendu d’approcher mais qui assistaient à la scène de loin, rappelèrent sa brutalité, son langage obscène, les baisers dégoûtants de ses badigoinces lippues ; plutôt embrasser un porc qu’un type dans son genre ! Le présent était assurément laid ; le passé était, lui, beaucoup plus incertain. Parmi ceux qui avaient eu le plus affaire à lui et étaient les mieux informés, d’aucuns pouvaient à la rigueur retracer son itinéraire jusqu’à Corbilo des Namnètes où Asinus avait cherché bien des mois auparavant à marchander du sel. Mais au-delà, personne n’avait idée de ce qu’avait été son périple, d’où il venait, par où il était passé précisément. Quelle avait été sa vie ? Quelle avait été sa famille ? Étaient-elles autres que ce qu’il racontait chaque fois qu’il voulait rouler un partenaire ? Il était à peu près sûr que jamais un élément ne viendrait éclairer ces mystères. Comme tant d’autres aventuriers jetés sur les routes de Gaule en ces temps troubles, pareil à ces créatures sorties de l’imagination divine des poètes, il avait apparu, disparu brutalement le temps d’une saison. Connaître son parcours serait pour toujours impossible et il semblait que les rives sud de la Loire s’enveloppaient de brumes où sa silhouette se perdait. Surtout, même après sa mort, on continuait d’ignorer à Génabum le rôle d’espion qui avait été le sien. On ignorait que sa route avait certes été guidée par ses rêves de richesse, mais aussi pour suivre et rejoindre des troupes de César qu’on lui avait demandé d’observer. Avec plus ou moins de réussite, il avait mené une existence double, son naturel dispendieux et bougon assurant exprès sa couverture. Seuls Magon et Scythès se doutaient qu’il était un de ces hommes banals qui donnent, non sans hésitation, leur vie pour une cause qui les dépasse infiniment et que l’histoire oublie sitôt leur disparition. Le Maltais avait guetté en vain, à l’époque où ils voyagèrent ensemble, l’occasion d’en parler pour l’alléger de ses soucis ; le Scythe l’accompagnait dans tous ses déplacements sans jamais lui adresser un reproche ni lui exposer la dangerosité de ses actions. 196
Asinus ne s’en était entretenu avec aucun d’eux. Ils avaient noué des relations si particulières qu’on aurait eu du mal à les qualifier d’amis. Justement, où était Magon à l’heure du massacre ? Nul ne le savait ; parti la veille sur une embarcation de fortune, peut-être était-il déjà aux frontières des Bituriges ou des Sénons tant on pouvait aller vite en remontant les fleuves de Gaule. Quant à Scythès ? Volomir s’était posé la question en revenant vers l’oppidum. Le frère de Cotuatos s’était souvenu de cet hercule qui suivait Asinus comme son ombre et, craignant de le voir surgir au moment de tuer son maître, s’était étonné de ne pas l’avoir vu le défendre. Il avait conclu à une lâcheté de sa part. Mais la réalité était tout autre. Le matin du massacre, Scythès s’était séparé d’Asinus alors qu’ils arrivaient en vue de la masure de Génabia. Dans l’obscurité de la nuit finissante, le commerçant l’avait renvoyé sèchement, voulant être seul avec sa petite traînée, et lui avait enjoint de se cacher en un lieu sûr pour le secourir au besoin. Il lui avait tout expliqué de ce qui allait suivre, quel était son plan, comment il escomptait survivre à la journée qui débutait. L’esclave, portant sous son manteau ses armes et les précieux rouleaux de notes de l’espion, n’avait rien objecté à cette ultime humiliation et l’on n’aurait jamais su ce qu’il pensait réellement de cette situation grotesque sauf à lire son dégoût imperturbable et muet dans ses yeux. Il ne devait plus jamais revoir son maître. Longtemps il hésita sur l’emplacement où s’abriter et, ne trouvant rien, il songea même à préparer des chevaux pour fuir quand il faudrait. Car, toute brute rompue aux combats qu’il était, il ne doutait pas que la ville serait bientôt envahie, que résister serait inconcevable. Puis il réfléchit qu’Asinus s’en était allé sur une île, que l’attendre avec une monture ne lui serait d’aucune utilité s’il ne pouvait accoster en sécurité, alors qu’une embarcation pourrait être le moyen inespéré de s’éloigner du péril. Il jugea donc que l’endroit le plus à même pour patienter sans se faire surprendre était le port où les bateaux vides tirés sur la rive seraient un objectif inutile aux insurgés qui rechigneraient à les prendre d’abord d’assaut. Mais, comme les berges ne disposaient d’aucune cache vraiment infaillible, il résolut de s’avancer sur le ponton de bois, de descendre entre deux navires de taille moyenne qui étaient amarrés et s’y tenir à une rame couverte de givre, la quasi-totalité du corps plongée dans l’eau glaciale. Malgré les cylindres de cuir imperméables qui renfermaient les notes, il plaça sa seule sacoche de volumina sur le bateau au-dessus de sa tête pour la garder au sec et ne pas perdre les écrits de son maître. Et il demeura là où il avait jeté les cadavres des hommes de Lugurix la veille, ressentant moins le froid que les autres parce que, natif des steppes vierges du Grand 197
Nord, il était habitué depuis l’enfance à se jeter dans des rivières gelées, à se rouler dans la neige, à marcher sous le grésil comme tous ceux de son peuple. Il resta une heure durant immergé dans la Loire, immobile comme un roc, le menton posé sur la rame, un seul bras levé pour s’assurer de son sac, ne sentant même plus l’eau lui amollir les muscles et lui engourdir le cerveau. Bientôt les carnyx sonnèrent. L’insurrection débuta. Tandis que la ville était soumise au pillage, il était toujours dans le fleuve, caché par le ponton et les bateaux entre lesquels il avait disparu. Au bout de quelque temps cependant, malgré son endurance, il sentit son corps qui faiblissait tandis que ses armes pesantes l’entraînaient à chaque déplacement vers le fond. Même pour un colosse de sa nature, une telle épreuve était dangereuse. Son aspect ne tarda pas à devenir inquiétant. Quand ses cils et sa barbe eurent achevé de ressembler à des cristaux, sa peau se cyanosa ; les frissons de ses membres disparurent pour laisser place à des trémulations autrement plus graves ; ses pupilles se dilatèrent. Et ce ne fut là que la manifestation extérieure du ralentissement des battements de son cœur, de la pression du sang dans ses artères, des rouages de son psychisme déjà lourd et épais. Les combats faisaient rage devant les bateaux près de lui ; il demeurait dissimulé, n’entendant qu’un vacarme lointain tout autour comme celui d’un songe dans lequel on n’entre pas tout à fait. Personne n’avait encore remarqué sa présence. L’idée avait été bonne de se cacher dans le fleuve, mais elle était aussi très risquée. Tout autre que lui aurait déjà péri à sortir de l’eau ou se laisser envahir par le froid. Pour résister, il maîtrisa l’arrêt progressif de la vie qui le gagnait, devint un élément fixe du port comme les chaînes et les ancres, se pétrifia littéralement, la tête toujours tournée vers l’île où se trouvait Asinus. Soudain quelque chose ricocha sur la proue du bateau auquel il se tenait. Il perçut le bruit du bois frappé et de l’eau qui gicle. Il y eut un autre bruit, semblable, sur la rame même à quelques doigts seulement de sa main, qui le tira brusquement de son engourdissement et il reçut comme une grosse poussière de givre dans l’œil. Une pierre, c’était une pierre qu’on venait de lui jeter, et on le visait en plus, il n’y avait pas de doute. Il voulut se tourner, sentit tout à coup ses muscles se raidir et se bloquer, s’agrippa. Il n’avait pas prévu que le froid scléroserait à ce point ses bras et ses jambes. Incapable d’un mouvement rapide, il était à la merci de celui qui lui lançait ces projectiles. Quelle ne fut pas sa stupeur quand, ayant pu enfin se retourner, il réalisa que les pierres qui manquaient de l’atteindre venaient en réalité de la main d’une femme, de plusieurs même, une vingtaine peut-être, accourues sur la rive où elles formaient un demi-cercle pour le cerner et l’empêcher de 198
sortir de l’eau. Elles n’osaient aller plus près, sur le ponton, mais certaines étaient audacieusement montées sur des embarcations afin d’avoir une position dominante sur lui. Scythès alors les reconnut. Ces femmes, c’étaient les catins de la ville, celles qu’il n’avait cessé de croiser en suivant Asinus et aux demandes desquelles il était toujours resté de marbre. Combien de fois, attirées par sa carrure immense et forte, par ses vêtements bigarrés et soyeux, par sa barbe lisse et fournie, elles avaient voulu le séduire, même en échange de rien, pour l’unique plaisir de goûter à l’exotisme et la vigueur ! Elles l’avaient suivi, elles l’avaient trouvé, sans doute prévenues par la Psécas d’Asinus, et elles allaient se venger d’autant d’humiliations. L’une d’entre elles soudain hurla, la bouche ovale, les narines retroussées, les sourcils froncés au point d’écraser les paupières. C’était Vévila, la plus populacière, qui avait jeté les premiers cailloux et s’improvisait leur meneuse : – Frappez-le, mes chéries ! Frappez-le ! Ne manquez pas ce balourd de Scythe ! Frappez-le ! Elle rigolait. Ses paroles semblaient dictées par la farce comme par les violences qui avaient gagné l’oppidum. Et enhardie, chacune s’approcha, ramassa des cailloux, des galets qui se trouvaient à ses pieds et se prit à les lancer. Ce fut une pluie d’injures et de pierres qui vola autour de Scythès et cogna la coque des bateaux, leur chargement, parfois son sac, même son buste à travers l’eau. L’esclave les reçut toutes en même temps. Que pouvait-il faire, gêné par son corps ankylosé et la lourdeur de ses armes dans le fleuve chargé de glaçons ? Il fit néanmoins face comme un animal farouche, tâcha de ranimer son organisme et, à force de sentir les projectiles lui piquer les muscles, ses jambes, puis ses bras retrouvèrent progressivement un début de souplesse. Ayant ralenti l’activité de son corps pour endurer l’eau glaciale, il était maintenant étonnant dans sa capacité à lutter contre la paralysie de ses membres. Parvenu à éviter de nouvelles pierres qui frôlèrent son front, il se délesta de son manteau qui l’alourdissait, s’élança d’un bond insoupçonnable et, de son marteau de combat, attrapa les chevilles de la fille la plus proche qui était debout sur une barque instable. Il l’entraîna avec lui au fond de l’eau où, sous les volées de pierres, il la noya en lui serrant la cage thoracique à la lui briser. Malgré le poids, il maniait sa massue comme Smertrios en personne. Les autres filles furent un instant stupéfaites. Il n’y eut plus aucun mouvement à la surface. Elles attendirent, s’inquiétèrent de ne pas voir flotter leur camarade, vivante ou morte. Soudain, là où on ne l’attendait pas, Scythès ressurgit. Il venait de passer 199
sous un bateau plat, ressortit dans une immense éclaboussure, l’arc en main, et, s’appuyant sur une chaîne, décocha coup sur coup deux flèches qui frappèrent une femme à l’épaule et la seconde en plein ventre. Elles poussèrent une plainte commune, s’effondrèrent en hurlant comme une seule truie. Les autres alors, pareilles à des furies, devinrent folles de colère, redoublèrent leurs attaques et les pierres fusèrent à nouveau sur le fleuve. Scythès replongea. Avoir tué lui rendait sa puissance. Il surgit deux fois encore pour frapper sans faillir. Pourtant, une femme énorme, une blonde obèse qui avait rampé sur une barque se trouva par hasard tout près de lui sans qu’il la vît. Elle lui tomba dessus dans un long cri rauque, lui ouvrit le crâne d’une roche acérée, attrapant une ancre sans attache pour se donner plus de poids et emportant sous sa masse le sac qui renfermait les volumina. Scythès fut sérieusement touché, mais se défendit en brisant à son tour l’avant-bras de l’assaillante. Elle était pourtant résistante et son ample robe alourdie par l’eau entrava les mouvements et ralentit les coups. Il y eut entre eux deux une lutte acharnée, tantôt à l’air libre tantôt sous l’eau, si acharnée qu’ils lâchèrent toute prise et se laissèrent emportés par le courant. Il put seulement attraper le sac de notes qui prit l’eau pour de bon et ils s’en allèrent à la dérive. Ils passèrent sous le pont, roulant avec les vagues que l’entrechoc des glaces créait et, si Scythès crut un instant qu’il se débarrasserait facilement de l’ogresse, celle-ci lui prouva le contraire. Le mordant au cou comme une sangsue, lui enfonçant ses doigts dans les yeux, lui pesant sur les épaules de tout son poids, elle ne le lâcha pas, le força à abandonner son marteau, son arc, ses flèches et, chaque fois qu’il essaya de se raccrocher à une rive ou un bout de bois flottant, elle l’en arracha comme si elle acceptait de se sacrifier pour qu’il pérît lui aussi. Ils furent ainsi cahotés par le fleuve, emportés dans la noyade. Scythès ne se réveilla que bien plus tard et bien plus bas, sur une plage déserte et frimassée, en recrachant douloureusement l’eau qu’il avait avalée dans la lutte. Sa tête ne saignait plus, mais lui faisait atrocement mal. Il fut incapable de se rappeler l’issue du combat jusqu’à ce qu’il tombât sur son ennemie, la blonde énorme, étendue sur le sable, probablement morte, qu’il égorgea pour s’assurer de sa fin. Il n’eut aucune pitié, la considérant d’ailleurs comme une égale. Dans son pays, depuis la nuit des temps, les jeunes femmes montaient à cheval, tiraient à l’arc, lançaient le javelot, se battaient contre des hommes et mouraient comme eux. Il eut besoin de faire un feu pour se réchauffer, reprendre simplement des forces. Un gros rocher où des canards sauvages nidifiaient dans les roseaux lui servit d’abri contre toute surprise éventuelle. Il ne savait où il était, ne savait si des insurgés battaient la campagne à la recherche de 200
fuyards ; ses vêtements étaient en lambeaux ; il ne lui restait plus que son poignard et le fourreau de son épée pour survivre. Il tua un oiseau, le mangea, tâcha de réfléchir. Il se souvint brusquement des notes d’Asinus, tâta son flanc où sa sacoche pendait d’ordinaire. Les précieux volumina n’y étaient pas, il les avait perdus. Et même s’il les retrouvait, les papyri avaient certainement pris l’eau et seraient inutilisables. Devant lui la Loire coulait en charriant des glaçons et des cadavres sans têtes. Mais il n’eut pas le temps de céder à la déception ou la colère. Tout de suite il se rappela la protection de son maître, regarda vers l’oppidum, se demanda s’il avait échoué dans sa mission. Au loin, une fumée néfaste s’élevait dans la grisaille du ciel où le jour déclinait déjà ; des cris étranglés retentissaient encore dans le paysage. Il pressentit qu’il était arrivé malheur à Asinus. C’était la triste vérité et, de manière générale, les morts étaient légion à Génabum. Il se mit en route. Selon l’habitude des Gaulois, la nouvelle du massacre fut annoncée de champ en champ, de contrée en contrée par une clameur recueillie et relancée de proche en proche. On ne doutait pas que ce qui s’était passé ici au lever du soleil serait su avant la fin de la première veille en pays arverne qui en était pourtant éloigné de cent soixante mille pas. Critovax, l’émissaire de Verkinngétorix, était lui aussi bien présent. Il avait assisté à la dernière assemblée des conjurés, s’était volontairement tenu à l’écart des combats, avait constaté cette première victoire. Tout le monde l’avait oublié dans la folie de l’hécatombe et, quand on le remarqua de nouveau, il ne félicita personne, ne dit pas un mot de ce qui venait de se produire tant il avait été un observateur silencieux. Il semblait sortir d’un des murs de la ville où sa grosse moustache grise et son visage terne se fondaient. Il se contenta de serrer le bras de Cotuatos, de lui dire adieu. On le vit franchir les portes, passer le pont au galop, s’éloigner devers sud avec pour mission d’assurer la nouvelle colportée, de donner des détails du carnage et sonner le début de l’insurrection générale. Les Arvernes commettraient à leur tour le massacre de tous les Romains qu’ils trouveraient. Mais ce que pouvaient raconter les messagers, que leurs propos fussent relayés ou portés directement, serait bien en deçà de la réalité. Qui aurait survolé l’oppidum à la manière d’un oiseau aurait été frappé de l’ampleur de la tuerie, plus encore du traitement des cadavres. Partout gisaient des corps, des membres sectionnés, des flaques de sang qui se mêlaient à la boue et la neige sale. Dans certains endroits on ne pouvait faire un pas sans piétiner un mort, un bijou perdu, une arme ou ce qu’il en restait. Il faut avoir marché sur un chemin pavé d’os pour s’en faire une idée du craquement. 201
Matériellement, l’oppidum n’avait pas trop souffert. Il n’était pas la cible, mais le cadre de la bataille et n’avait de ce fait été soumis qu’au pillage de rigueur. La plupart des ateliers, qui étaient la propriété de riches aristocrates, avaient été épargnés ; les défenses militaires n’avaient pas été touchées et, si les entrepôts avaient vu leurs portes fracassées, on s’était bien gardé d’y déclencher un quelconque incendie. Bien sûr les plus brutaux avaient voulu s’en donner à cœur joie et, passé la fureur des combats, avaient prétendu recourir la ville pour s’enrichir tellement, dans ces situations-là, être d’un même pays, d’une même tribu ne signifie rien. Mais Cotuatos, faisant preuve d’autorité, leur avait interdit expressément tout débordement. Il défendit que l’on touchât aux biens des Gaulois. Il ne fallait surtout pas se mettre la population à dos et il ordonna de récupérer uniquement l’argent, les armes, les vivres en laissant le reste et en épargnant les vies. Surtout, il voulait garder Génabum intacte car il savait qu’il aurait besoin du riche oppidum dans la poursuite de la lutte. On se contenta de l’écouter en grommelant et le stratège, conscient de l’effort qu’il réclamait, autorisa en contrepartie à faire main basse sur les biens des étrangers. Ce qu’il restait des guérites enfoncées, les maisons réquisitionnées par la légion, celle de Latro en particulier, furent dévastées ; les navires dernièrement arrivés à Génabum ou prêts d’en repartir furent dévalisés ; les Grecs, les Africains, leurs concubines furent tous réduits en esclavage. Ce fut l’occasion de trouvailles. On s’arracha une falcata ibérique, une pharmacie portative, un cheptel entier de moutons ; on récupéra des bagues, des bracelets, des ceintures dont le prix valait pour l’ambre du Nord, l’ivoire de Méditerranée, le corail tyrrhénien ; une Maure, emportée par un gaillard d’Égérax, apparut si grasse qu’elle semblait avoir trois tétons et son ravisseur arbora sa poitrine à tous, heureux de cette aubaine. Mais ces quelques trésors ne suffisaient pas à des guerriers si nombreux. Il y eut forcément des déçus ; il en naquit un sentiment de frustration inévitable. Être vainqueur dans une ville si riche pour n’en tirer que des miettes ! Cotuatos n’y put rien ; pour toute récompense, il n’avait autre chose à offrir que la discipline face à la tentation d’hommes par nature indisciplinés. Il se contenta d’apaiser le ressentiment des chefs en faisant partager les fermes et les terres lointaines des perdants. Mais il savait que ce n’était pas satisfaisant et que la troupe bientôt gronderait. Les cadavres gaulois furent correctement traités. Les druides, le barde Charmolaos, Crasovir, Taurillos même eurent droit à des funérailles dignes de leur rang et c’est en les comptabilisant qu’on s’aperçut que le gutuater Itas manquait seul à l’appel. Personne ne l’avait croisé de la journée et un sentiment d’échec vint subitement ternir la fierté de la victoire. On eut 202
plus tard l’explication quand des hommes le trouvèrent en lisière de la ville : la veille assez tard il s’était par hasard rendu dans une cabane sienne où il avait passé la nuit avec quelques disciples avant de revenir le lendemain sans se douter des événements. Aussitôt Cotuatos voulut le faire arrêter, mais la population s’y opposa par crainte d’offenser les dieux. Le stratège soupçonna que le druide avait été prévenu du massacre ; les Génabiens y virent plutôt le signe que des forces supérieures avaient voulu l’épargner parce qu’il était leur porte-parole devant elles. Cotuatos résolut de régler les problèmes les uns après les autres, décida d’épargner momentanément l’ancien juge de Sagéra qu’il fit relâcher. En attendant, si tous les défunts reçurent l’honneur qu’on rendait aux aristocrates, ce fut pour éviter que la vue de leur mort ne soulevât elle aussi l’indignation. On pansa leurs plaies, on lava leur corps, on les revêtit d’habits somptueux. Et dans la même journée, le long de la route qui s’étendait vers le couchant, ils furent inhumés au milieu de parures, de vases, de couteaux et de rasoirs, de grils et de viandes prisées pour reproduire, selon le rite, l’organisation du repas funéraire. On leur adjoignit l’offrande d’agneaux, de béliers et de pygargues, l’animal totémique des Carnutes ; on leur refusa seulement leurs épées, pas même brisées en deux pour les rendre inutilisables, car de leur vivant ils n’étaient plus des guerriers. Mais personne n’y fit attention tant leur sort fut doux et respectable à côté de celui des Romains dont on avait, pour tromper la colère du pillage manqué, laissé les dépouilles sans sépulture, vouant leur corps à pourrir et leur âme à errer dans l’éternité. La dépouille de Cita fut empalée sur un pieu, plantée devant la Loire et les bateaux de commerce. Celle d’Asinus subit des outrages à nul autre pareils. Car Volomir n’avait rapporté que la tête du commerçant ; la couper lui avait suffi ; le reste lui importait peu. Les femmes de joie de la ville allèrent chercher sur l’Île-avalante le corps qu’elles ramenèrent elles-mêmes. Elles en firent leur trophée symbolique, le jetèrent sur la rive, le ligotèrent aux jambes. L’esclave leur avait échappé ; par dépit, elles parlèrent de punir le maître à coups de pierres. Mais elles ne le lapidèrent pas comme Scythès ; elles voulurent procéder autrement en imaginant le traîner par les rues caillouteuses et le vouer à la vindicte de tous. Elles se passèrent les cordes tour à tour, improvisèrent une chanson obscène sur la victime, insistèrent pour monter la colline de la Butte-aux-rats et descendre au Dépotoir. Comme le glorieux Hector jadis devant les murs d’Ilion, Asinus fut ainsi promené jusqu’à la tombée de la nuit, tiré par un baudet quand les filles faiblirent, chaque lambeau de sa peau heurtant le sol au moindre obstacle et s’écorchant dans les soubresauts de la marche. Parfois, certaines lardaient son torse à la lame de leur couteau. Symboliquement, 203
son cou tranché qui laissait une traînée inépuisable de sang subit, comme si la tête y était encore, des coups de bâton, des crachats, des morsures de chien au passage. Les guerriers approuvèrent la scène, non sans amusement, eux qui n’avaient pu se défouler sur les traîtres. Aux filles s’étaient ajoutés les enfants, les vieillards, les hommes de peu qui insultèrent le cadavre encore chaud avec des rires. Ce fut le plaisir du petit peuple, qui n’avait agi durant le massacre et voulait se rattraper par l’outrage des minables. Les pierres que la neige cachait et que le corps heurtait pour y abandonner un infime morceau d’épiderme furent d’un grand comique. Asinus payait pour l’impudence des siens, tous ces Romains qui avaient marché dans Kénabon comme en une terre conquise, qui avaient enfoncé les clous de leurs brodequins dans les pieds des Carnutes ! En se le disant, on redoubla les violences sur lui. Bientôt ce fut un tas de chair informe plus qu’un corps discernable qui fut tiré au milieu des décombres. Sur son passage, quelques-uns de ses compatriotes, blessés, peinant encore à mourir, n’expirèrent qu’après avoir vu le sort qui aurait pu les attendre et auquel, par bonheur, ils échappaient. Cependant, le point d’orgue du défilé fut au retour sur le port, quand la brune Vévila qui se faisait bavarde et putassière se moqua du sexe flasque du cadavre. Elle proposa soudain : – Faut le couper comme un cochon ! Ça, c’était une idée. Il fallait le couper comme un cochon. Asinus payerait maintenant pour le commerce nauséeux qu’il avait eu avec les filles, toutes ces passes avilissantes que les Romains exigeaient des Gauloises. Et la multitude répondit, hommes et femmes : – Oui, oui ! Comme un cochon ! Alors, ivre d’une gaieté terrible, Vévila sortit d’un pan de sa robe un petit couteau à peler les légumes. Elle se jeta sur Asinus et farfouilla entre ses cuisses d’où elle brandit un paquet de chair velue et sanglante qu’elle agita avec un rire de triomphe. – Je l’ai ! Je l’ai !, cria-t-elle en jetant l’objet de la mutilation à la foule qui l’entourait pour voir. Et tous reprirent, en essayant de l’attraper : – Elle l’a ! Elle l’a ! Ce fut un chien qui le chipa, auquel on voulut aussitôt retirer le larcin de la gueule. Il crut que l’on jouait, s’enfuit en jappant. On le poursuivit. Le spectacle fut cocasse de ces filles courant et gloussant après lui. Les guerriers pourtant ne riaient plus, bien qu’ils continuassent de laisser faire. Au-delà des haines, ils éprouvaient une sorte de solidarité 204
instinctive de mâles. Les courtisanes, de palais ou de ruisseaux, c’étaient comme les prêtres, les bardes, les assassins, un peu à part et très dangereux. Il fallait les redouter. Il y avait dans ces brutes farouches une méfiance de la femme quand elle ne s’appartient plus qui leur fit juger plus prudent de ne pas risquer l’ire de leurs compagnes lorsqu’elles arrachèrent bientôt le petit morceau de chair des dents de l’animal, s’amusèrent toutes avec et plaisantèrent. Seule Génabia, pourtant complice de la mort d’Asinus, semblait avoir le cœur grave et demeurait silencieuse. Vévila la prit chaleureusement dans ses bras. Elle dit à tous : – C’est parce qu’elle a eu à téter sa langue ! Quelle horreur ! Tiens, ma belle, voilà de quoi te faire oublier ! Et elle l’embrassa à pleine bouche d’un baiser abject qui fit à nouveau rire les hommes. Le spectacle s’arrêta sur cette scène infâme. La population fut poussée à quitter le port ; les filles emportèrent les restes de leur besogne sans que l’on sût ce qu’elles en feraient. Car Exobnos, l’un des nobles qui avaient conduit les rebelles, soit qu’il fût écœuré par ce qu’il venait de voir, soit qu’il jugeât avoir assez fait, annonça tout haut qu’il rentrait chez lui, sans même célébrer la victoire ni attendre l’assemblée des chefs du lendemain. Ses terres, fit-il valoir, étaient situées non loin ; il pouvait encore y être au soir. Exobnos était celui qui disposait du moins d’hommes et dont les possessions étaient effectivement les plus voisines. Cotuatos, tout à sa victoire, ne chercha pas à le retenir, persuadé qu’il reviendrait si les autres demeuraient. Et tandis que celui-ci partait en entonnant avec sa troupe un péan de victoire, ceux-là s’installèrent pour la nuit, cette nuit que l’oppidum passerait pour la première fois libéré d’une présence étrangère. On put enfin goûter le repos. Les heures qui suivirent furent celles de la fête comme seuls les Celtes savaient la célébrer. Les rues furent à nouveau envahies et, malgré le froid, on voulut y rester. Cette fois la foule ne ressembla plus à un torrent qui aurait tout renversé sur son passage, mais à un fleuve qui montait, grossissait de celles et ceux qui se joignaient au plaisir et inondait tout d’une crue joyeuse. La liesse fut générale ; il n’y eut pas jusqu’aux habitants des villages alentour qui, après avoir attendu la fin des combats, terrés dans leurs cahutes, ne vinrent dans la ville participer à cette nuit mémorable. On se félicita, on s’embrassa, on se porta en l’air ; on forma un peuple énorme et hétéroclite. Les guerriers qui auraient exterminé le matin même 205
les Génabiens fraternisaient maintenant avec eux parce qu’ils avaient eu leur ration de massacre et de saccage. On oublia la tuerie, le pillage avorté en demandant aux musiciens de troquer les carnyx pour des lyres, des flûtes, des cithares qui étaient des instruments de paix et de plaisir. Puis on s’installa pour de bon, on demanda aux artistes de jongler avec des poignards ou des flambeaux et l’on improvisa un immense banquet public dont les tables serpentèrent à travers toute la ville, de l’endroit ordinairement réservé aux festins jusqu’à la Loire en contrebas. En haut, le grand ciel étoilé avait retrouvé sa sérénité et braisillait de la lueur des astres ; sur la terre de l’oppidum, des feux s’allumèrent à chaque maison et même les remparts, où les sentinelles étaient de retour à leur poste, se constellèrent de torches qui formèrent un cercle enflammé autour de la ville comme lorsque les conjurés se réunissaient en plein bois. Enfin, les portes furent fermées pour fêter la victoire entre soi. Cette nuit-là, au sifflement des grelots et des cymbales, les commensaux furent passionnés. Contrairement aux fêtes saisonnières, les codes et rituels du repas en commun s’en trouvèrent négligés par toutes sortes de débordements et d’improvisations. L’heure était à l’excès. Si les princes, assis sur leurs peaux et leurs fourrures, formèrent une première ligne évidente et tranquille, leurs servants d’armes et leurs combattants les plus héroïques, étendus sur des litières de paille ou de branchages, en dessinèrent une seconde plus trouble. Au-delà, les règles de préséance devinrent confuses. Dans la presse on se réchauffa n’importe où, sans ordre, serré les uns contre les autres ; plus personne ne fut correctement installé, mais à quatre pattes, impudemment vautré à même le sol, quitte à se disputer des places de misère dans des pugilats aussi vite apaisés qu’ils avaient éclaté. Il y eut des bagarres riantes, bouffonnes. C’étaient pour certains la version dégénérée des combats de la journée, pour d’autres celle des joutes nobles qui animaient d’ordinaire les banquets. Ceux qui avaient combattu nus souhaitèrent rester nus. Les plus joyeux profitèrent de la mêlée pour copuler ouvertement dans les coins sombres, sans savoir avec qui, voulant faire, riaient-ils, les enfants de la victoire aux princesses de la ville. On chanta par-dessus les gifles, par-dessus les coups amollis et l’on aima les femmes qu’on avait l’impression de retrouver après des années d’absence. On but sans mesure, sans arrêt, sans finesse. On avait massacré des Romains mais on continuait d’apprécier leur vin, l’avalant dans des coupes communes, se gobergeant à pleins tonneaux à s’en faire couler le long des moustaches sur la gorge et la poitrine. Certains s’en badigeonnèrent leurs blessures, prétextant que ça les cicatriserait plus vite ; la plupart ne 206
voulurent pas en perdre une goutte et brisèrent les fûts vides pour en lécher le bois encore imbibé. À la lueur des feux qui donnaient une part d’ombre, une autre de rougeoiement à la peau des visages, on but ainsi jusqu’à l’enivrement, qui pour retrouver un contact avec les dieux ou les défunts, qui pour faire disparaître les visions de mort et de sang, qui simplement pour se délasser et chercher l’excitation et la chaleur dans le froid de l’hiver. Il n’y eut pas assez d’alcool pour tout le monde ; les plus pauvres, les plus vils, les plus fous burent jusqu’à l’eau frelatée du Dépotoir en croyant, abusés par l’ivresse générale, qu’elle les rendrait ivres à leur tour. La Loire elle-même semblait épaisse, très brune et liquoreuse comme une immense coulée de vin tombant dans la bouche d’un géant. On se goinfra aussi, de toutes les denrées qu’on trouva. On se servit dans les réserves et les quelques enclos de l’oppidum. On mangea des viandes excellentes, des jambons, des gigots, des abats. Des cinquantaines de moutons, de chèvres, de porcs furent tuées pour l’occasion afin de contenter tout le monde, et ce furent les propriétaires qui les donnèrent généreusement. Les chefs eurent droit à un poulain chacun selon l’antique coutume ; on leur servit en outre les sangliers libérés dans la ville qu’on avait retrouvés et tués entre deux bâtiments. Le petit peuple, lui, rogna des os gras, riches de moelle, qu’il disputa encore aux chiens qui y prétendaient également et il se réjouit de pouvoir récupérer des cornes ou des tendons pour en faire plus tard des coupes ou des lanières. Et au milieu de cette débauche, Éroticus semblait évoluer naturellement. Il avait une nouvelle fois troqué ses habits ; le guerrier Agégorix qui s’était réveillé le temps d’un combat était redevenu l’illustre tavernier bourru d’Allobrogie, trônant fièrement derrière son comptoir et circulant entre ses tables. La façade de son établissement devait certes être réparée, mais la grande salle et les chambres n’avaient pas été pillées ni envahies comme on aurait pu le craindre après les combats ; celle d’Asinus notamment était restée intacte. Mieux encore : après leur action d’éclat sur le cadavre du commerçant, aucune fille n’avait remis en cause son travail à la copona et toutes étaient revenues normalement proposer leurs services dans la soirée. Porté aux nues par les hommes qui l’avaient épargné, resté le maître des garces qui voyaient dans son établissement l’assurance de passes propres, le patron avait retrouvé son aplomb, sa gouaille, son succès. Fannia Voluptas se tenait toujours à ses côtés, unie à lui comme jamais, belle comme toujours. Toute la nuit, il distribua gratis de la cervoise, du vin, du gibier en laissant vider ses garde-manger et en faisant carrément porter ses plats dans les rues de la ville. Il parut le faire de bon cœur – son cœur insensible qui se fendait en réalité à voir partir ses vivres sans les faire payer. Fannia 207
eut moins de retenue ; elle pleura presque sur une amphore de Vélitres avant que son mari ne la reprît. Il fallait sacrifier beaucoup pour ne pas tout perdre. Là était la rançon de leur survie dont ils tireraient des bénéfices. Tous leurs clients étaient morts dans l’attaque, mais il pressentait qu’ils en auraient bientôt de nouveaux tant l’humanité court sans cesse à ses plaisirs. La soirée se déroula ainsi. Volomir qui ripaillait entre Villu et Calpovix dut sortir un instant de table. Il avait bu comme un cyclope au long du repas. Marulos l’avait joyeusement fait servir et resservir en complimentant celui qu’il nommait l’Ulysse gaulois, l’homme qui avait ouvert les portes de la ville aux vainqueurs, et le cuissot de sanglier qu’on lui avait proposé, si gros fût-il, n’avait pas permis d’atténuer dans ses veines les effets de la boisson. Il tituba en marchant, les tempes chaudes, les jambes flageolantes. Ses yeux vert-de-gris paraissaient délavés ; la terre tanguait, le sol tantôt en haut, tantôt en bas, lui donnant la nausée. Derrière la baraque d’un atelier, il vomit dans un courtil sombre une flaque à l’odeur de viande faisandée et de bière. Un tonneau, rempli d’une eau croupie gelée où se reflétait la lune, se trouvait à côté. Il y trempa ses mains en creux pour se rincer la bouche, soudain toute la face tant il était écœuré. Quand il releva la tête, il découvrit le visage figé de Génabia. Sa chevelure rousse dessinait le flamboiement d’une torche dans l’eau trouble. Après la mort d’Asinus, alors que la ville était encore à son massacre, la gamine, revenue en barque, avait d’abord pris soin de regrouper et d’emporter les provisions, la couverture, le chalumeau offerts par le commerçant sur l’Île-avalante en plus de sa petite bourse d’argent qu’elle avait volée par réflexe. Nul ne l’avait arrêtée et, parvenue sans encombre chez elle, le vêtement encore ensanglanté du coup porté à sa victime, elle avait croqué furieusement, instinctivement un bout de pain dont elle ne mangea cependant qu’une bouchée. Son estomac était noué, ses mains tremblantes, ses lèvres closes. Elle l’attribua aux dangereux combats qui se livraient autour d’elle. Un guerrier pouvait enfoncer sa porte et, sans chercher à comprendre, la tuer ou lui réserver un sort bien pire. Elle lâcha le pain, considéra son intérieur indigent. En voyant tous les présents d’Asinus conservés chez elle – des friandises, des bijoux, des vêtements, un miroir –, elle se fit la plate réflexion que le bonhomme avait quand même fortement contribué à améliorer son ordinaire. Il fallait bien lui rendre cette dernière justice. Alors elle décida d’aller voir ce qu’il advenait de son corps et elle fut désagréablement surprise de découvrir qu’il avait été ramené par les filles de joie pour subir les pires outrages. Les salopes, pensa-t-elle ; elles se faisaient plaisir. Elle suivit l’ignoble défilé à 208
travers la ville, se força à cracher sur son ancien soupirant, à le balafrer de coups de couteau comme faisaient les autres. Puis, quand la fureur générale fut passée et que la sienne n’avait jamais vraiment éclaté, comme la nuit tombait et qu’on évoquait un festin dans toutes les bouches, on abandonna le cadavre aux chiens au pied du rempart. Elle seule demeura à l’écart de la fête qui commençait, chassa des gamins qui s’amusaient à la guerre comme si tout n’était qu’un jeu, eut besoin de s’isoler. Quelque chose la poussait à rester près d’Asinus, entre un vague sentiment de culpabilité et celui improbable d’une dignité à retrouver face à l’ennemi. Se pouvait-il qu’une putain éprouvât de tels sentiments ? Les compliments, les petits surnoms de son amoureux transi lui revenaient sans cesse en tête, la taraudaient, lui comprimaient la cervelle. Il n’était pas méchant, juste benêt et repoussant. Elle l’avait trahi plusieurs mois durant sans qu’il s’aperçût de rien et, toute roulure qu’elle était, elle se disait qu’au-delà de la trahison d’un étranger, elle valait mieux que les brutes qui avaient injurié son corps et les fourbes qui avaient assassiné leurs propres compatriotes. La libération de Génabum, l’argent que Volomir lui avait promis pour assouvir sa vengeance personnelle au milieu du chaos n’avaient de sens pour elle que si elle se comportait maintenant noblement. Elle garda toute la soirée la petite flûte entre ses mains, la triturant, la faisant rouler, la portant à ses lèvres sans en jouer comme si le contact dur du bois l’aidait à calmer la rage qui montait en elle. Elle voulut enterrer le cadavre, ou plutôt la bouillie visqueuse qui le rendait à peine identifiable. Mais le sol était trop gelé pour ses bras frêles de femme, les endroits reculés trop rares et lointains pour ne pas être vue l’y traîner. Alors elle songea que près du rempart où gisait l’assassiné coulait, dans la nuit silencieuse, le Divonant. Ce qu’il restait de l’ancien ruisseau oublié n’était à ce niveau pas totalement obstrué, formant comme un goulot d’étranglement où son eau triste et peu profonde stagnait, dans une grande mare de boue, avant de s’écouler par le ruissellement infime du Dépotoir. L’endroit était déjà un charnier ; on y balançait fréquemment les carcasses inutiles et les bêtes mortes de maladie. Elle n’aurait qu’à y rouler le corps. L’eau lui ferait un linceul, la tourbe finirait par l’absorber lentement. À l’aide d’une torche, elle dut en éloigner les molosses qui continuaient de se régaler des membres sanguinolents. Elle se battit littéralement contre ceux qui refusaient de lâcher leur proie délicieuse. Puis elle fit tomber la masse dans l’eau, alourdie de grosses pierres glissées dans la tunique, et comme elle ne pouvait amener de la terre, elle récupéra les détritus les plus proches dont elle recouvrit les parties émergées du dos et des cuisses. Elle 209
s’assit enfin, harassée de sa peine. Sous les échos rieurs de la ville en fête, elle joua quelques notes fausses de flûte, soulagée d’avoir œuvré et retrouvant comme une quiétude intime qu’elle n’avait pas soupçonnée. Du haut de leur rempart, deux sentinelles qui la virent faire lui demandèrent en plaisantant si c’était là la dernière punition qu’elle réservait au Romain. Passablement ivres déjà, ils croyaient qu’elle désirait châtier Asinus pour l’éternité et qu’elle jouait du pipeau pour manifester sa joie. La vérité était qu’elle avait besoin de l’ensevelir pour lui offrir un semblant de sépulture, lui rendre une sorte d’honneur ; mieux valait être couvert de déchets mais reposer en terre que pourrir à l’air libre dévoré par les bêtes. – Toi ?, dit Volomir encore au frisson de l’eau gelée. – Moi, Seigneur. – Que veux-tu ? – L’argent promis, Seigneur. Mes statères. – Tes statères ? De l’or ! De l’électrum ! Ôte-toi de mon chemin, petite, j’ai autre chose à faire. La jeune femme ne bougea pas. Au contraire, ses bras salis de boue et de sang jusqu’aux coudes, elle osa avancer pour lui barrer la route. Ils s’étaient vus à de multiples reprises et chaque fois elle lui avait obéi par déférence envers un noble et parce qu’elle croyait sincèrement qu’elle serait récompensée à hauteur de sa tâche. Mais ce soir-là, elle osa traiter d’égal à égal avec lui, sans se rendre compte de son impudence. Elle avait le regard d’une chienne sournoise. Elle eut de la chance que Volomir ne fût pas en état de la punir de l’affront. – Mon argent, je le veux, répéta-t-elle fermement. – Tu seras payée quand je le déciderai et quand je pourrai te payer. Elle insista : – Tu n’as qu’à puiser dans les caisses de Taurillos. Il paraît qu’elles sont pleines là-haut, dans sa hutte. Elle avait des traits calmes, la peau blanchie dans le noir par les reflets de la neige. Volomir partit d’un éclat de rire qui le fit revomir soudain. Et s’essuyant cette fois de sa manche, il abrégea : – Tu crois que l’argent de la cité, pris sur un si grand homme, doit te revenir, à toi, petite traînée que ta mère a chiée dans la bouse ? Tu ne doutes de rien, ma naïve ! Tu devrais déjà t’estimer heureuse qu’une fille de plaisir ait contribué à la délivrance d’une place comme celle-là. Ce disant, il lui jeta une poignée de potins pour l’humilier. – Pourquoi devrais-je te verser plus ? Après tout, tu n’as fait que blesser cet idiot de Romain ; tu n’as que facilité ma vengeance personnelle, c’est moi seul qui lui ai tranché la tête. Je paie l’instrument que les dieux ont 210
placé dans mes mains. Maintenant barre-toi, va bouffer les restes du repas qu’on lance aux cochons ; j’ai des agapes à terminer et tes copines à baiser cette nuit. L’alcool le rendait mauvais à défaut de fin calculateur. Il la bouscula en passant devant elle sans qu’elle pût dire un mot et pousser son audace au point de le retenir. Elle entendit encore son rire ivrogne à l’angle de l’atelier. Et puis plus rien. Elle demeura seule dans l’obscurité, contrainte à ramasser les pièces dans la neige parce qu’elle venait de penser que les jours suivants, quand le festin serait terminé, quand tous auraient insouciamment vidé les garde-manger en une soirée, trouver de la nourriture serait compliqué pour les misérables comme elle. Elle se souvint alors qu’avant de mourir Asinus lui avait confié avoir caché son magot à la copona et elle tâcha de retenir l’information comme une issue valable à sa situation. Pendant ce temps, alors que les vainqueurs fêtaient le succès et que Volomir refusait à Génabia ce qu’il lui avait promis, Cotuatos leur chef s’était isolé au sommet de la Butte-aux-rats où une brume tombait et rendait le sol glissant. La colline était déserte, très calme, faiblement éclairée des feux lointains derrière l’épais rideau de bruine ; une immense odeur de rut et d’opulence y montait, mêlée des bruits confus et assourdis du festin. D’ici, l’on pouvait voir l’ivresse générale gagner les remparts où les torches vacillaient, rendant mouvante la ligne des défenses. Cotuatos avait assisté au début du banquet, puis s’était éloigné avec une escorte sans être remarqué de personne. La fête ne l’intéressait guère. Il voulait observer de plus près la hutte de Taurillos qu’il avait pourtant visitée maintes fois mais dont il était le maître à présent. Des braises qui achevaient de mourir dans l’âtre y jetaient un soupçon de lumière et rendaient la température appréciable. Les traces du duel entre le vergobret et le stratège y étaient encore visibles. Rien n’avait été bougé ni n’avait été soumis au pillage. Il y passa un long moment, pensif, essayant de remettre un peu d’ordre, considérant vaguement chaque objet que son ennemi avait récemment acheté à prix d’or. Dans la pénombre, il y avait, de chaque côté du grand coffre empli d’argent, des œnochoés d’Étrurie, un trépied de bronze, la représentation miniaturée d’un discobole grec et tant d’autres trésors. En même temps qu’il les prenait entre ses mains, des réflexions diverses lui vinrent sur l’enrichissement des puissants et la gestion de la victoire. Cette victoire, elle l’avait d’abord grisé comme les autres si bien qu’à l’heure où ses compagnons se saoulaient au-dehors, lui avait été encore plus ivre sans avoir bu une goutte de vin. Il caressa un instant l’idée de confisquer son 211
triomphe, de prendre la tête d’une troupe à lui pour bouter les Romains hors de Gaule. C’était possible. Il fallait juste avoir les idées claires pour en parler le lendemain et exposer son plan dans la grande salle du Conseil où se réuniraient les chefs. Il remonterait d’abord vers Autricon qu’il nettoierait de tous les opposants. Puis il forcerait le Sénat à convoquer immédiatement une assemblée des Carnutes où il saurait convaincre les nobles de lui accorder confiance en évoquant le souvenir de Tasgétios, des manœuvres de l’oligarchie et en promettant de rendre à la cité son indépendance et son lustre d’antan. Après l’affaiblissement du parti proromain, on aurait peur et, en l’absence de résistance, il se ferait élire roi, non pas pour profiter du luxe ou exercer un pouvoir inique et prétentieux, mais par simple amour de la force, par simple besoin d’entendre craquer les os des faibles sous sa lame ! L’étalage ne servait à rien d’autre ; il était un moyen, non une fin en soi et Cotuatos aurait tout donné de ces richesses pour sentir une puissance pure, brutale, absolue vibrer entre ses mains lorsqu’il écraserait ses adversaires et guiderait ses partisans ! Alors, avant même que César ou d’autres brenns ne réagissent, il marcherait sur les oppida carnutes restants – Maroialon, Magodunon et les autres –, puis s’étant assuré d’eux, il fondrait à l’est où se trouvaient les légions. Tous les peuples le rejoindraient peu à peu, au fur et à mesure de l’avantage acquis sur le terrain et chaque fois, il vaincrait, par la même technique, l’embuscade, la surprise, la trahison ; il déborderait la Celtique et, toujours avec la même rapidité foudroyante, il atteindrait le fleuve Rhin et, au-delà des Alpes, Rome ! Rome ! Rome ! Il rêvait cette cité interdite, jalousée en secret, haïe à voix haute. Ses yeux étincelaient dans la nuit de la hutte ; il se sentait grandir au point de tirer son épée, seul face à ses visions de conquête. L’ombre que sa carrure projetait jusqu’à la porte sembla un instant immense au point de dévorer le monde. Soudain il réfléchit, comme si l’alcool avait brusquement cessé de faire effet. Il venait de soulever une statuette à l’effigie de Mars qui orienta sa pensée dans une tout autre direction, plus modeste et réaliste. On lui avait dit en effet que le défunt vergobret avait vraiment cru qu’il s’agissait de lui quand un marchand italien avait eu le culot de la lui vendre. Se prendre pour Mars, quelle plaisanterie ! Les vainqueurs étaient toujours vaincus par excès de superbe ; Brennos, Bituitos, maintenant Taurillos pouvaient en témoigner. S’il ne voulait pas connaître le même sort, il en conclut qu’il ne fallait pas être dupe de ses songes, de l’image que l’on façonnait à tort de soi, s’imaginer un dieu lorsqu’on n’était à tout prendre qu’un homme. Et il dégrisa aussi vite qu’il s’était enivré. 212
Les chefs étaient toujours imbus de leur personne, orgueilleux dans leur licence. Il perdrait toutes ses forces à lutter contre eux ; mieux valait laisser un autre s’imposer et se concentrer sur l’unique ennemi commun : Rome. Qu’est-ce qui était le plus important, se débarrasser d’envahisseurs ou devenir un chefaillon de plus ? La réponse était évidente. L’unité des Gaulois était déjà suffisamment compliquée ; qui pouvait dire si le lendemain, après la fête, ses alliés de la veille, ceux qui l’avaient aidé à libérer Kénabon, ne suivraient pas Exobnos et s’en retourneraient chez eux en ne pensant qu’à leurs intérêts immédiats ? La politique noble, les visions à long terme, ils s’en fichaient pas mal, ils ne voulaient que s’enrichir. D’autres difficultés qu’il n’avait pas réalisées jusque-là surgirent alors dans sa tête. Il reconnut subitement ses faiblesses, se souvint que de tous ses clients un nombre insuffisant de soldats était mobilisable, se rendit compte aussi que la plupart des soutiens de Taurillos étaient restés à Autricon, que, loin d’avoir peur, ils s’attendraient à des manœuvres et qu’il ne pourrait, eux, les surprendre une nouvelle fois. Non, l’unité des Gaules, il valait mieux tâcher d’en être l’artisan que prétendre en être l’unique bénéficiaire. Il savait par ailleurs que ce jeune prince qu’il soutenait, ce Verkinngétorix fils de Keltillos, s’il était encore imberbe, la moustache fine, les cheveux ondulés, avait pourtant des chances de reprendre le pouvoir chez les siens. Il aurait alors derrière lui un peuple bien plus puissant, bien plus nombreux que les Carnutes, qui brûlerait de prendre sa revanche sur les Romains et pourrait y parvenir. Cotuatos avait rencontré à plusieurs reprises cet aspirant roi, avait été son hôte, l’avait écouté, s’était laissé convaincre, lui avait serré le bras en gage d’amitié. Verkinngétorix avait des idées très nettes sur la liberté de la Gaule ; il connaissait bien César pour avoir été l’un de ses compagnons de tente ; autant qu’on pouvait le croire en l’entendant parler, il en avait hérité une tactique militaire déjà bien arrêtée et un réel sens de la stratégie reposant sur une fédération des peuples, des opérations de harcèlement, une politique de la terre brûlée parce qu’il avait compris que l’armée romaine dépendait de son ravitaillement. C’était en cela que les événements de Génabon prenaient tout leur sens, n’étaient pas qu’un simple massacre mais le début d’une guerre des vivres. Verkinngétorix dépasserait tous les autres meneurs, Cotuatos le sentait, quand il serait vraiment dans le feu de l’action. Surtout, quelque chose d’indicible le séduisait dans son physique où se lisait, au profond de ses yeux, un regard particulier, à la fois déterminé et visionnaire, le même que celui des meilleurs brenns mais en plus abyssal et très bleu. 213
Les réflexions du stratège furent soudain troublées par un sifflement indiscret. C’était Conconnétodumnos aux longs rires, qui s’était battu toute la matinée avec la rage d’une harpie et s’était à peine débarbouillé des éclaboussures de sang. Il n’avait plus sa cotte de mailles trop inconfortable pour le repas, mais la gambison de cuir qu’il portait en dessous. – Je n’ai pas encore eu l’occasion de te féliciter de ce beau succès, dit-il à Cotuatos. Il augure sans doute de plus grandes conquêtes. Le protégé venait glorifier son protecteur et lui rappeler qu’il bataillerait toujours aussi bien à ses côtés. Son manteau de fourrure d’ours jeté sur les épaules, il était peut-être là depuis longtemps, à le regarder en silence rêver de son prince arverne et de leur victoire définitive. Il avait apporté une petite amphore qu’il lui tendit pour boire. Le vin était bon. Cotuatos le remercia. – J’ai renvoyé tes gardes qui attendaient au bas de la colline. Après tous ces événements, eux aussi ont droit de profiter de la fête ce soir. – Tu as bien fait. Ils doivent se détendre. Qui sait de quoi demain sera fait. – Que fais-tu ici tout seul pendant que la ville plaisante et chante ? – Je réfléchis aux dangers qui guettent les vainqueurs. – Et quels sont-ils ? – L’aveuglement, la précipitation, la trahison… Tant d’autres que je frémirais d’énoncer. Conconnétodumnos s’approcha, lui passa le bras autour du cou et, front contre front, le fixa d’un regard où se retraçait l’histoire qu’ils avaient eue ensemble et qui les avait menés des pires tourments à la vengeance. Son visage, mouillé par l’humidité du brouillard, semblait baigné de larmes ; ses lèvres violacées y étaient maculées de coulures de vin ; sa pupille, cerclée par le tatouage autour de son œil, semblait dilatée pour y lire la vérité de son for intérieur. – Crois-tu, demanda-t-il, crois-tu que moi, je pourrais te trahir ? – Toi, jamais, répondit Cotuatos en se dégageant doucement, je le sais bien. Ce qui nous unit est plus fort qu’un bain de sang. Mais eux au-dehors, combien seront-ils encore demain à nous suivre ? – Et tu crois que ton jeune prince est plus digne de confiance ? Marulos t’a dit qu’un Biturige ne vaut guère un Carnute ; on pourrait dire de même d’un Arverne… – Sans doute. Il t’aurait cependant fallu voir le fils de Keltillos pour être persuadé. Il est talentueux, il a une noblesse d’âme, il est… – Beau, tout simplement ? 214
Cotuatos ne répondit rien, se contenta de boire une nouvelle rasade de vin et de jeter la statuette de Mars qu’il tenait toujours entre ses mains. – Je t’ai apporté ceci, reprit l’autre sans lui tenir rigueur de son silence. Il tira d’une sacoche qu’il avait laissée à la porte deux cylindres de cuir en mauvais état, sur lesquels un sceau figurait un aigle abîmé. – Les miens les ont récupérés en aval du pont. Je ne lis pas le latin mais j’ai pensé que ce pourrait t’être utile. Intrigué, Cotuatos ouvrit un des deux cylindres, en sortit un papyrus enroulé et protégé d’une couche de laine. Les feuilles extérieures du volumen étaient inutilisables ; l’eau du fleuve avait dû commencer à s’infiltrer dans l’étui et, après avoir imbibé la laine autour, avait ramolli le papier et fait baver l’encre de plus en plus profondément. Mais la partie enroulée tout à l’intérieur était, elle, à peine humide. La sacoche avait dû s’échouer très vite et être récupérée avec chance. Un texte s’y présentait sous trois colonnes serrées. Cotuatos demeura pensif. – Qu’y lis-tu ? Il hésita un instant avant de répondre. Conconnétodumnos laissa échapper cette fois-ci un léger rictus désabusé. – Encore la peur de faire confiance et te trahir… Laisse tomber ces cylindres, va, ils ne m’intéressent pas de toute façon. Ce qui m’intéresse, c’est comment te montrer mon admiration pour toi. Il passa ses doigts dans ses cheveux qu’il descendit dans sa barbe soyeuse. – L’un des plus grands dangers qui guettent les vainqueurs, dit-il d’une voix molle, est précisément de trop penser aux dangers qui viendront tôt ou tard. À tendre un arc à l’excès il se rompt. Allez, tu dois aussi goûter aux délices de la vie. Cela fait si longtemps… – Si longtemps… Conconnétodumnos s’approcha tout à fait, l’embrassa, défit son manteau qu’il jeta au sol. La terre y avait bu le sang de la lutte et laissé une seule tache sombre à peine visible dans l’obscurité. Il l’en recouvrit, entraîna son protecteur à s’allonger et, si sa gorge ne laissa échapper aucun rire, son visage allumé de désir le fit pour elle. Enfin, une étrange nuit noire les enveloppa, nus et enlacés tous deux après tant d’épreuves. Dans l’âtre les braises s’éteignirent peu à peu tandis que leurs corps se mirent à rougeoyer et réchauffer à l’extrême l’intimité de la hutte. Le banquet continuait au-dehors, les clameurs semblaient ici couvertes et étouffées. Un seul martèlement sourd leur montait, sans qu’ils sussent si c’étaient les tambourins ou leurs cœurs qui battaient. Et pendant que çà et là les 215
feux continuaient de s’embraser, Conconnétodumnos aimait. Cotuatos, lui, songeait toujours aux yeux azur et limpides de son prince. Le lendemain, quand le fils d’Indiomar ressortit de la hutte, celui d’Agédomopas dormait encore. Il le laissa comme on laisse un enfant se reposer plus longtemps, redescendit la Butte-aux-rats en silence. Dehors l’air était glacial, le jour triste. Au pied de la colline, la ville, dont les portes étaient restées fermées toute la nuit, peinait à s’éveiller de l’énorme ronflement où elle s’était assoupie. Les remparts qui la ceignaient semblaient encore tassés sur eux-mêmes ; les maisons dont les toits se touchaient déjà en temps normal paraissaient vautrées les unes entre les autres ; la Loire coulait, inerte, comme si les glaçons rougis de sang qu’elle continuait de charrier étaient un peu d’eau sale pour adoucir les céphalées de la veille. Le paysage était partout immobile et pâle, rayé des seules fumées des feux éteints qui s’élevaient à travers ciel et semblaient y dessiner chacune une armée s’évaporant de son côté. En vérité, l’image correspondait à la situation. En arrivant tout en bas, attiré par des cliquetis de ferraille et des voix joviales qui se hélaient, Cotuatos découvrit un mouvement d’hommes sur le port. Son frère Volomir vint à sa rencontre, lui demanda où il était passé tout ce temps, assura l’avoir cherché partout. Il était méconnaissable, les cheveux hirsutes, les traits tirés, les paupières encore lourdes de fatigue. Il avait manifestement mal au crâne de sa nuit et peur d’avoir été négligent sur un point. Cotuatos réalisa que la situation était grave. Il regarda autour de lui, comprit soudain. Tandis que d’autres s’éveillaient à peine et achevaient de rendre leurs agapes dans les rigoles des rues, des soldats pliaient bagage autour de leurs chefs qui, loin de se diriger vers la grande salle du Conseil, leur montraient au contraire l’exemple. Il appela ses fidèles à se réunir derrière lui, exigea des explications en criant et bousculant ceux qui se trouvaient sur sa route. – Nous partons, s’entendit-il dire enfin. Il se retourna. Entouré de ses soudards identiques à des Belges ou des Germains, Marulos le regardait avec un sourire narquois qui semblait être la revanche d’une blessure inconnue mais profonde. – Vous partez ? – Nous partons, comme Exobnos hier. Tu as eu ta tuerie, nous avons libéré notre territoire. C’est fini, nous retournons chez nous. – Au contraire, ça ne fait que commencer ! – J’ai deux jours de marche pour m’en retourner chez moi. Ne me fais pas perdre de temps avec tes fariboles sur la délivrance des Gaules ; ce qui 216
se passe chez les autres ne nous regarde pas : nous ne sommes ni arvernes, ni parisiens, ni sénons. Cotuatos observa les autres chefs qu’il sentit indécis, médiocrement gagnés à la cause de son rival. Ils restaient les dirigeants d’un peuple commerçant davantage que guerrier et Marulos avait dû les travailler toute la nuit autour du festin tandis que lui, se prélassait dans l’inaction. L’assemblée qu’il lui revenait d’ouvrir avait déjà eu lieu de façon informelle. Il réagit fortement à ce début de trahison : – Toi, tu es un lâche. Mais vous, puissants Seigneurs, Gaulois libres ? Villu, Égérax, m’abandonnerez-vous ? Ansila, Galatos, Calpovix, mes amis ? Tous baissèrent les yeux, quelques-uns haussèrent les épaules. Ils n’eurent d’ailleurs pas à répondre car Marulos éclata : – Moi, lâche ? Putasserie ! Retire immédiatement ça de ta bouche. Qui es-tu pour juger mon courage ? Je ne me laisserai pas insulter par un homme qui préfère le cul d’un veau à celui des plus belles vaches ! – Tu es un lâche, une crevure, et je proclame hautement que tu veux les entraîner avec toi dans ta bassesse, uniquement pour me nuire ! Les multiples provocations qu’avait lancées Marulos à son encontre au cours des derniers mois devaient forcément aboutir à une altercation. Furieux tous les deux, ils voulurent en venir aux mains, mais on les retint et on les en empêcha. Il fallut trois hommes pour les maintenir chacun. Cotuatos fut le plus difficile à maîtriser jusqu’à ce qu’il renonçât en lâchant un puissant cri de rage. Il ne quitta pas le port cependant. Il tourna en rond, réfléchit et, au moment où les derniers guerriers, éveillés par la dispute, se tiraient enfin du sommeil, où les autres se remettaient à faire leur bagage, il bondit tout à coup sur la proue d’un navire pour s’adresser à eux : – Puissants Seigneurs, Gaulois libres, puisque vous ne voulez pas même tenir conseil, c’est donc ici que je vais vous parler. Je ne vais pas chercher à susciter en vous la haine des Romains pour vous retenir. Cette haine, je sais que vous l’avez dans les veines comme moi et que vous ne regrettez ni la mort des légionnaires, ni celles des commerçants, encore moins celle des traîtres qui allaient avec eux. Je vais simplement vous rappeler ce que nous avons fait hier. C’est à la fois très simple et complexe. Vous ne savez pas ? Hier, nous avons commis l’irréparable… Une nuée de protestations se souleva pour l’interrompre : – La faute à qui ?, hurla-t-on, la faute à qui, insensé ? – La faute à vous, la faute à moi, la faute à tous ! Je n’ai forcé ni l’un ni l’autre d’entre vous à plonger son épée dans la gorge des victimes et il est trop tard, maintenant que vous avez fait bombance sur leurs corps, pour 217
s’accuser mutuellement. Le temps presse. César a bonne mémoire, il n’oubliera pas. Rome va revenir, plus puissante que jamais, châtier les coupables. Elle a soumis, elle a fait disparaître bien des peuples avant nous et, quand elle déchaînera par ici sa colère, il s’en faudra de beaucoup qu’un seul échappe à l’extermination tant le massacre que nous avons perpétré est le prélude d’un autre plus grand ! Un silence glaçant parcourut la foule. Les visages blêmirent comme si tous réalisaient pour la première fois la portée de leur action. Ils eurent le sentiment qu’un piège se refermait sur eux. Ils ne l’avaient pas vu jusquelà, mais, une fois les Romains assassinés, il n’y avait plus guère de pardon à espérer de César et toute la cité risquait d’être massacrée en représailles. La boucherie n’avait eu d’autre but que d’obliger les Carnutes à soutenir la révolte en la radicalisant. On se rapprocha un peu plus, attendant que Cotuatos donnât sa solution à cette situation désespérée qui semblait ne pas en avoir. – Il arrive pourtant, reprit-il, que l’aigle romain soit parfois happé dans les airs par d’autres rapaces, plus petits mais plus agiles. Taranis m’en est témoin, le pygargue des Carnutes sera cet oiseau-là ! Vous le savez comme moi : dans son histoire, Rome a déjà été battue et à deux doigts d’être anéantie. Il n’y a là rien d’impossible, rien de très ambitieux même. Je suis votre stratège, vous connaissez mes qualités à la guerre, mon sens de la tactique, mon efficacité plutôt que la gloriole. Sachez que je ne prétends pas marcher vers le sud, mais simplement résister, aussi vaillamment que nos ancêtres savaient le faire pour défendre notre liberté, nos valeurs et nos coutumes. Cette romanisation qui nous guette depuis si longtemps, qui est un danger autrement plus rampant que les légions de soldats, il est encore temps de la rejeter en élargissant les massacres à toute la région. Il contempla soudain un pan du ciel au-dessus des toitures comme s’il voulait s’adresser à quelqu’un d’invisible très haut derrière les guerriers assemblés. Et d’un ton emphatique : – J’en appelle ici au Teutatès de notre tribu. Ô Roi des combats, toi le rouge, Seigneur de notre armée en guerre, Gardien de notre État en paix ! Ô Teutatès l’invincible, qui nous as déjà donné la victoire, que nous avons honoré par tant de têtes tranchées, prends ce bain de sang comme une exécution rituelle pour nous concilier ta bienveillance à l’aube d’une action plus importante encore ! Guide-nous, protège-nous ! Je te fais la promesse solennelle que nous écraserons pour de bon l’adversaire et que nous t’offrirons les armes prises en guise de remerciement ! Alors, au milieu du silence, l’improbable se passa. Une tête de Romain, puis une autre de Gaulois, sans doute mal fixées à la bride d’un cheval, tombèrent tout à coup comme deux grosses pommes au sol. Tout le 218
monde vit le prodige, en fut ébahi. C’était le deuxième après celui du rapace en forêt ! Les dieux semblaient encore et toujours avec Cotuatos, on pouvait le suivre ! – Voyez ! Notre Teutatès est avec nous ! Il s’est repu d’un massacre, il en réclame un second tant sa soif n’est pas assouvie ! Ne le lui accorderonsnous pas ? Eh quoi ! Vous ne vous souvenez pas des quartiers d’hiver des légions ? Des réquisitions, des impositions qui ont pressuré notre peuple ? Sans parler du comportement odieux des forces d’occupation… Vous pensez qu’ils en ont fini avec nous, qu’ils ne chercheront pas à refaire main basse sur nos biens si nous leur montrons le moindre signe de faiblesse ou même d’hésitation ? La liberté ne se gagne pas en un coup et il ne suffit pas d’avoir fait fuir une fois les loups pour les éradiquer de la forêt. Que croirez-vous défendre en retournant chez vous ? Comment penserez-vous résister à un contre mille sur vos terres ? Retrouver ses champs, en interdire l’accès à l’étranger, c’est bien quand c’est utile ; c’est suicidaire quand on le fait en vain. En vérité, ma proposition est celle de la raison, la seule qui ait un sens. Notre unique chance de vaincre définitivement est de conserver notre unité, cette belle unité qui nous a fait remporter ce beau succès. On meurt à tergiverser, à s’écharper sur des querelles de personnes. Tenez, afin de vous le prouver, je présente sincèrement mes excuses à Marulos pour l’avoir offensé car ce n’est pas lui mon véritable ennemi. Il m’est plutôt un soutien, un ami, un frère qu’un adversaire irréconciliable. Pour ponctuer son discours, il fixa Marulos sans ciller avec un regard de bienveillance. L’autre fut gêné de voir sa dispute perdre ainsi en vigueur, lui qui était d’esprit vétilleux et agressif et aimait au fond la querelle. Il n’avait manifestement pas renoncé à commander aux vainqueurs. Il monta à son tour sur un bateau amarré à côté de celui où se trouvait Cotuatos et, caressant sa moustache jaunâtre en forme de fer à cheval, ses cheveux encore épaissis et blanchis de la chaux de la veille, il s’adressa pareillement à l’assemblée qui l’encouragea à parler, certaine d’avoir en lui une alternative aux paroles du stratège. – Cotuatos aux bras d’yeuse chercherait-il à nous imposer ses volontés ?, commença-t-il sur un ton d’emportement. Se prendrait-il pour le roi que nous n’avons plus ? Il a du mérite certes, du courage, de l’intelligence. Mais qui n’en a pas par ici ? Égérax, Ansila sont tout aussi braves et la science guerrière de Galatos le dépasse infiniment. Je suis pour la noblesse, je suis pour la monarchie, je suis pour l’aristocratie, le meilleur de nos régimes. Mais je veux pouvoir user librement de ma liberté de choisir, cette liberté que mon « ami », ainsi qu’il se présente, cite à juste titre ! Je souhaite que ce soit notre Sénat qui décide 219
du roi des Carnutes comme il l’a toujours fait et non que l’un d’entre nous s’arroge ce titre parce qu’il pense le mériter plus que d’autres ! Je ne veux pas troquer le joug des Romains pour celui d’un Gaulois, qu’il soit notre stratège ou plus encore un jeune puceau étranger comme ce prince arverne que nous n’avons jamais vu et qu’on prétend nous faire suivre ! Voulezvous que je vous dise le fond de ma pensée ? J’ai l’intime conviction que notre grand stratège ne cite ce Verkinngétorix que pour masquer sa propre volonté de pouvoir. Peut-être même a-t-il engagé un émissaire factice pour le représenter. Après tout, on n’a jamais vu un homme en position d’être le maître confier sa force à un gamin dont le règne n’est même pas assuré et qui habite à des centaines de lieues de là. Ou alors les goûts amoureux feraient-ils perdre la tête à ce point ? Il fut interrompu par un rire jaloux. C’était Conconnétodumnos qui était redescendu de la colline et dont nul n’ignorait les relations avec le fils d’Indiomar. Tous savaient son côté femelle répréhensible et pour cela le méprisaient et le craignaient en même temps. Pourtant Conconnétodumnos ne rougit pas de l’allusion. Bien au contraire, suivi de quelques-uns de ses hommes, il fendit la foule d’un pas lent, toisant tout le monde du regard et, en armes, revêtu de sa magnifique fourrure, il se plaça bientôt sous Marulos, à quelques pouces seulement de la haute proue où il se tenait, les jambes fermes, clouant des yeux l’orateur pour lui signifier que ni sa stature ni ses paroles outrageantes ne l’impressionnaient. Marulos fut légèrement décontenancé de cette irruption au moment précis où il évoquait les amours honteuses de son adversaire. Il profita de cet instant de flottement pour laisser aux guerriers le loisir de s’interroger sur les visées de celui qui les avait entraînés jusqu’ici. Des murmures naquirent. Et si, après tout, la libération de Kénabon n’avait pas le but escompté ? Si Cotuatos n’était qu’un imposteur et le massacre un coup monté pour le reconnaître comme un commandant de génie ? Fallait-il attendre autre chose d’un chef de guerre qui attaque par surprise des hommes désarmés ? Un frisson de doute envahit la foule et, comme elle se perdait en hypothèses, Marulos reprit ses accusations éhontées. Il n’était maintenant plus dans l’insinuation mais dans l’attaque frontale. Volomir voulut réagir, le faire taire en lui rappelant le respect qu’il devait à son chef – ce chef réélu par acclamations la veille quand lui-même avait rapporté la tête d’Asinus. Il avait compris qu’il avait été sciemment enivré pour permettre aux chefs de se laisser convaincre de partir et, selon son habitude, il était près d’éclater de colère. Mais Cotuatos, toujours plus mesuré et plus fin, lui interdit d’intervenir et le força à écouter la fin de la harangue : 220
– Quant à Teutatès, qu’ordonne-t-il ? Mon « ami » Cotuatos a beau jeu d’interpréter ces têtes qui viennent de tomber après nous avoir fait tuer les seuls hommes, nos druides, qui étaient versés dans l’art de la divination. Et s’il lit le besoin d’un nouveau massacre, moi j’y lis au contraire le risque d’un danger pour nous. La première tête était romaine ; la deuxième, elle, est gauloise ! Un nouveau murmure parcourut l’assistance. C’était vrai ce qu’il disait, et bien pensé. Il y avait prodige dans ces deux têtes tombées, mais il ne fallait pas se précipiter pour l’expliquer. Le message des dieux nécessitait toujours d’être relu au moins deux fois. – Attendre ici que le temps passe ou même marcher sur d’autres oppida, sans façon ! Nous userions nos forces face à un ennemi qui, il l’a très justement dit, n’est pas notre adversaire potentiel. César est en Italie ; il a peut-être bonne mémoire, mais il ne reviendra pas avant des mois. En attendant, retournons chez nous, préparons le printemps, faisons fructifier nos terres, entretenons nos corps pour être en mesure de mieux nous battre à la belle saison. C’est dans notre prospérité, dans nos efforts domestiques que réside notre capacité de résistance. Allons ! Rappelezvous les piètres légionnaires que nous avons rencontrés. L’inaction est le pire des dangers car elle conduit à la fainéantise et au ramollissement. Cotuatos veut nous faire rester ici ? Bien sûr ! On voit ses terres de ces remparts ; il peut faire l’aller-retour entre le port et ses demeures en un matin. Mais nous qui avons plusieurs jours de marche pour retrouver notre toit, que ferons-nous si on nous informe bientôt que nos fermes, que nos femmes et nos enfants sont attaqués en notre absence ? Devrons-nous avouer que nous avons préféré festoyer au loin plutôt que les protéger ? Au contraire rentrons chez nous ! Parce qu’en nous sachant dispersés sur notre territoire, César lui aussi sera obligé d’éparpiller ses troupes et les affaiblir s’il voudra nous vaincre. C’est en cela que consistera notre piège : une guerre de harcèlement, d’escarmouches, de traquenards tant nous sommes meilleurs quand nous nous battons sur notre propre terrain où nous savons les embuscades que l’on peut tendre. Laissez venir un bâtard de Romain dans mes champs, dans mes marais, dans mes vals, vous verrez comment mon épée rougira de son sang ! Et si en attendant, quelques légionnaires affamés, en défaut de ravitaillement, s’avisent de venir piller nos cultures, nous saurons les recevoir. L’étranger, l’envahisseur, nous avons le droit de le saigner chez nous, que diable ! Tout homme doit défendre sa maison en priorité, avant sa ville ou son pays. Kénabon n’est pas ma ferme et, quoique carnute, je vous le dis, je ne mourrai pas ici. – Enfin !, éclata Volomir que les regards de son frère ne retenaient plus. Où est passé le serment que nous avons contracté en plantant chacun 221
notre lame dans le même cadavre ? Le serment de vouer notre vie les uns aux autres ? – Il ne valait qu’au combat et il vaudra de nouveau s’il faut livrer bataille ! En attendant, j’ai dit ce que je ferai et toute personne avisée agira comme moi. C’était l’immobilisme et le bloc contre le retrait et l’éparpillement, deux stratégies différentes, irréconciliables, qui avaient toutes deux leur légitimité. Quand Marulos eut fini, il se forma deux camps sur le port. À l’ouest, près du pont et de la porte qui menait à Autricum se regroupèrent ceux qui voulaient partir : à leur tête se trouvaient Marulos sauté du bateau et Égérax, frustré du peu de butin. Lugurix les rejoignit aussitôt : à l’aube, on lui avait apporté le cadavre de Cillimax le marchand de panais, péri lui aussi dans les combats, et il nourrissait toujours un ressentiment contre Volomir qui lui avait volé la mort d’Asinus, même s’il avait pu en récupérer la tête. À l’est au contraire, regardant vers les régions où hivernaient les légions romaines, ceux qui parlaient de rester furent moins nombreux autour de Calpovix le dur et Villu au fier casque à cornes. Au milieu les indécis demeuraient penauds, attendant un argument définitif qui les ferait aller à droite ou à gauche. Mais Galatos qui passait pour connaître les techniques de guerre des Romains pencha finalement pour les premiers. Il fut un argument à lui tout seul et entraîna tous les indécis à sa suite. Même Villu et Calpovix se ravisèrent ; Cloduar, Ansila, Acutios dont la richesse résidait dans le convoyage de l’étain s’excusèrent auprès de Cotuatos et ordonnèrent à leurs hommes de plier bagage. Tous suivirent leurs chefs, sans animosité pour les autres, et s’exécutèrent du côté de l’occident où il y eut bientôt une foule inégale. Cotuatos exigea un cheval pour ne pas paraître inférieur. Conconnétodumnos seul demeura avec lui et son frère à l’extrémité du port et lâcha un nouveau rire grinçant qui voulait dire qu’il se souviendrait de cet abandon. On ne fut pas long à achever les préparatifs de voyage. La plupart étaient venus sans rien d’autre que quelques affaires déposées au fond des bois avant l’attaque, qu’ils récupéreraient au passage. Satisfaits, tous repartaient les bras médiocrement chargés de butin, quelques esclaves à leur suite, de nouvelles armes en trophées et des têtes séchées, cette foisci bien attachées et pendant aux croupes des chevaux. Quelques-uns, mieux organisés, dégotèrent un chariot où ils mirent en commun leurs prises avant de se les partager chez eux. Aucun n’avait la mine basse et honteuse. Quand on fut prêt, les trompettes sonnèrent. La porte nord s’ouvrit. Ceux qui restaient regardèrent passer ceux qui partaient en deux longues 222
colonnes chantantes qui ne se séparèrent qu’au loin dans l’horizon. « Lâches, cœurs de lièvres ! », entendit-on une seule fois à leur adresse et cette unique accusation sembla trouver écho à travers leur défilé et couvrir le bruit de leur marche. Quant au petit peuple, il eut pour leurs silhouettes lointaines des yeux terrifiés, lui qui n’avait pas suivi les débats et qui réalisait, trop tard, qu’en plus d’une ville à reconstruire après la beuverie, il se trouvait maintenant pratiquement sans défense pour le jour où César reviendrait.
223
VIII LE PROCONSUL ET LE PROTÉE
Lorsque le massacre de Génabum éclata, César n’était pas en Gaule insoumise. Il se trouvait au-delà des Alpes, en Cisalpine, à Ravenne exactement, à la frontière lointaine de l’Italie que traçait le fleuve Rubicon. Proconsul des régions du nord s’étendant de l’Illyrie à la Transalpine, du port d’Aquilée jusqu’à la colonie de Narbo Martius, il revenait en administrer le territoire en hiver, à cette époque de l’année où il ne guerroyait pas en temps normal. Comme n’importe quel gouverneur, il tenait périodiquement ses assises dans les principales villes de sa province et administrait notamment les procès. L’histoire avait voulu cette ironie qu’à l’heure où des soldats et commerçants romains étaient massacrés dans un oppidum gaulois, le conquérant de la Gaule profitait de ses tournées à travers le pays déjà soumis à son autorité pour assembler, en divers chefslieux, les notables et principaux citoyens que leurs affaires ou leur commerce appelaient dans la région. L’année précédente, de manière exceptionnelle, la révolte des Belges l’avait retenu. Son retour n’en avait été attendu qu’avec plus d’empressement. Car ce n’était pas sa présence aux procès qui rendait sa venue importante, mais la manière qu’il avait de se concilier des partisans à chaque service rendu. Pendant ses séjours, César en effet amplifiait le nombre de ses soutiens. On se rendait en foule pour le rencontrer et il accordait libéralement ce que tous lui demandaient en les renvoyant comblés de présents ou remplis d’espérances. Il fournissait à ceux qui briguaient des charges les moyens nécessaires pour corrompre le peuple et se donnait par là des magistrats qui emploieraient toute leur autorité à accroître sa puissance. Ceux à qui César offrait de l'argent engageaient le Sénat à lui en fournir en retour. D’année en année, le proconsul domptait ainsi l’ennemi barbare avec les armes des Romains et gagnait ses adversaires romains avec l’or pris des barbares. Si près de l’Italie surtout, il pouvait surveiller les aléas de la politique, lui qui était empêché de se représenter dans la Ville sous peine d’être cité en justice par ses ennemis pour quelque abus de pouvoir. La Cisalpine était
devenue une nouvelle Rome où comploter. Antérieurement, il avait reçu à Lucques tout ce que la vie publique romaine comptait d’illustres personnages – Pompée, Crassus, Appius, Népos – en sorte qu’il s’y était trouvé jusqu’à cent vingt licteurs et plus de deux cents sénateurs réunis. Les audiences judiciaires se déroulaient dans la basilique à proximité du forum. Sous l’abside de marbre et les plafonds à caissons, le proconsul siégeait en pleine gloire, sur sa chaise curule, lorsqu’on vint le prévenir du malheur inattendu que son armée venait de subir à plus de sept cents milles de là. Il fit aussitôt ajourner la séance, s’en retourna dans son palais où il convoqua les conseillers qu’il avait à sa disposition. Plus tard, des témoins affirmèrent qu’il jetait, en marchant, un coup d’œil par-dessus son épaule comme si les barbares qu’on venait de lui citer le poursuivaient et qu’il les traitait avec mépris. Outre son secrétaire, il avait, dès cette époque, l’habitude de se faire escorter par une garde espagnole, mais à lire son orgueil dans son regard on comprenait vite qu’une telle précaution était inutile. Une fois rentré, on l’informa plus en détail de la situation, autant qu’on le pouvait car les renseignements arrivaient lentement et par bribes si loin des Gaules. La tribu des Carnutes chez qui César avait stratégiquement installé son centre de ravitaillement refaisait parler d’elle. Après le meurtre de Tasgétios, après la révolte d’Acco l’année précédente, elle venait une fois encore de se soulever. À Génabum, le grand emporium sur la Loire, elle avait perpétré un massacre indigne où l’on racontait que les partisans de l’alliance avec Rome avaient été exécutés en même temps que tout étranger présent dans l’oppidum. Sur la centaine de soldats et de commerçants, il y avait à craindre qu’aucun Romain n’eût survécu, que les ressortissants des autres peuples eussent été réduits en esclavage, que le chevalier Gaius Fufius Cita eût lui-même péri malgré son rang. Il était certain enfin que les réserves avaient été pillées, les routes coupées, l’armée laissée sans vivres au plus fort de l’hiver. C’était tout l’approvisionnement de l’ouest qui s’en trouvait interrompu et la sécurité des hommes qui devenait périlleuse. Dix légions étaient concernées : deux chez les Trévires, deux autres chez les Lingons, les six dernières autour d’Agédincum chez les Sénons. En tout, plus de cinquante mille hommes, sans compter les civils et vivandiers. César convoqua près de lui Marcus Junius Brutus et Marcus Antonius qui passaient eux aussi l’hiver en Cisalpine. Mais ce fut Lucius Munatius Plancus dont la présence lui fit alors défaut parce qu’il avait hiverné chez les Carnutes après la mort de Tasgétios et aurait pu lui fournir de précieux renseignements. Le revers était sévère, l’affront immense pour celui qui se croyait déjà le maître des Gaules. Sans doute pensa-t-il aux bandits qui l’avaient capturé 226
dans sa jeunesse en Cilicie, desquels il avait ri des misérables espoirs de fortune en se moquant ouvertement de leur ignorance et leur façon abjecte de vivre. Et il se dit certainement que les Génabiens ne valaient pas mieux si bien qu’il ne manquerait pas de faire pendre leurs meneurs comme jadis les pirates à Pergame. Mais il y avait plus grave. Ce coup d’éclat n’était que l’étincelle d’un incendie qui embraserait toute la Celtique si l’on n’intervenait pas aussitôt. Pour chasser définitivement les Romains, un jeune prince arverne qui venait de prendre le pouvoir chez lui entendait mener la révolte et fédérer autour de sa personne les cités gauloises normalement désunies. Alors qu’il n’était âgé que d’à peine trente ans, on rapportait qu’il venait d’être honoré d’un commandement suprême et qu’il avait réussi à entraîner derrière ses troupes tout l’ouest du pays, malgré l’animosité de chaque tribu envers l’autre. Les noms furent égrenés des Sénons, des Parisiens, des Pictons, des Cadurques, des Turons ; puis ceux des Aulerques, des Lémovices, des Andes, de tous les autres peuples qui touchaient au grand Océan et, au fur et à mesure que la liste de chacun d’entre eux s’allongeait, on eût juré que César s’était rembruni. On craignit qu’il ne fût repris de l’une de ses fréquentes céphalées. Il n’en fut rien, mais le proconsul laissa paraître son mécontentement. Les événements retarderaient une fois encore son triomphe, l’empêcheraient de jouer la partie suivante à une étape plus proche de la prise du pouvoir. Pourtant il se reprit immédiatement. La guerre qui n’avait jamais cessé depuis six ans recommençait, plus tôt que d’habitude, c’était tout, et il devait en sortir vainqueur. Il n’avait pas le choix. Les hostilités d’ailleurs étaient déjà entamées puisqu’à l’heure où César entrait seulement en connaissance des faits, Vercingétorix – tel était le nom de ce prince quand on le traduisait en latin – portait les armes contre les Bituriges. Ceux-là, dont le territoire séparait ceux des Arvernes et des Carnutes, étaient inféodés aux Éduens, eux-mêmes amis indéfectibles du peuple romain dans la région. On disait que les Éduens, sur l’avis des lieutenants laissés chez eux pour les conseiller, n’avaient pas tardé à envoyer du secours, mais que leurs cavaliers ainsi que leurs forces d’infanterie, arrivés sur la Loire, s’y étaient arrêtés quelques jours et, n’ayant pas osé passer le fleuve, s’en étaient retournés chez eux en rapportant que c’était la crainte d’une embuscade qui leur avait fait rebrousser chemin. Ils étaient persuadés, disaient-ils, que, finalement gagnés à la cause des tribus rebelles, les Bituriges avaient l’intention, s’ils franchissaient le fleuve, de les envelopper avec perfidie, eux d’un côté, les Arvernes de l’autre. Les Éduens disaient-ils vrai ? Ou doutaient-ils à leur tour, eux, les plus vieux alliés de Rome ? Étaient-ils même sur le point de s’associer à la 227
révolte ? Si tel était le cas, la situation devenait périlleuse. À supposer que les Bituriges se fussent laissé convaincre de prendre les armes, les rebelles unifiaient un peu plus les territoires sous leur dépendance et les richesses d’Avaricum, Argentomagus, Médiolanum tombaient dans leur escarcelle. D’autant que les événements s’accéléraient plus au sud où un chef cadurque de grand crédit nommé Luctérios avait été envoyé persuader non seulement les Rutènes, mais les Nitiobroges et les Gabales, clients des Arvernes dont les terres montagneuses dominaient l’arrière-pays transalpin. C’était au mieux une tentative de diversion, au pire l’ouverture d’un double front. La Province romaine était directement menacée de harcèlement, voire d’invasion. Jamais depuis le début de son intervention en Gaule, César n’avait eu contre lui une alliance si unie ni si vaste. Il était obligé de réagir. D’autres courriers avaient été dépêchés en urgence pour en savoir davantage. En apprenant ces nouvelles préoccupantes, les premières pensées de César furent politiques, non militaires. Il se demanda si Pompée, officiellement encore son soutien, ou quelque autre adversaire ne se cachait pas derrière tout cela. La coïncidence était en effet frappante entre les troubles que connaissait la Ville et ce soulèvement général de la Gaule qui lui interdisait de demeurer plus longtemps pour redorer son image et tenter de revenir en Italie. Car Rome, depuis des mois, versait dans le chaos. Les anciens tribuns de la plèbe Publius Clodius Pulcher et Titus Annius Milon s’y étaient livré une guerre sans merci qui venait de connaître, au début de la nouvelle année, un tournant lorsque le premier avait été assassiné sur une route en sortie de la ville. La colère du peuple s’en était suivie, et avec elle des massacres autour du forum, si semblables à ceux de Génabum, où la lie de Subure accompagnée d’esclaves s’en était prise aux notables et aux chevaliers. Dans la précipitation, quelques jours seulement avant l’arrivée de César à Ravenne, Pompée avait failli être nommé dictateur, mais, sur proposition de Caton, était devenu consul sans collègue, ce qui dans les faits revenait au même mais permettait au Sénat de conserver un semblant de droit de regard sur ses actes. À cinquante-quatre ans, le nouveau maître de Rome n’avait pas d’autre égal ; à lui reviendrait l’honneur de rétablir la concorde et César, courant le risque de s’empêtrer dans un conflit plus long que prévu, ne pourrait rien faire pour l’éviter. Il ne douta pas d’avoir vu juste. Mais, que ce fût un coup de Pompée ou de ses partisans, il fallait composer avec et faire de l’embûche un atout. L’ennemi pouvait être au courant de la situation précaire en Italie, il pouvait escompter soulever subitement la Celtique et se coordonner avec des adversaires à Rome, il avait tout simplement agi trop tôt. Si le chef des 228
Gaulois eût différé son entreprise jusqu'à ce qu’une guerre civile éclatât entre Pompée et César, il n'eût pas causé à l'Italie moins de terreur qu'autrefois les Cimbres et les Teutons. Il s’était hâté cependant et la guerre qu’il avait lancée, limitée à un théâtre d’opérations – la Gaule –, n’en serait que plus classique. Dès lors, sûr de vaincre, César entrevoyait un nouveau succès. Ambitieux, il devinait même, plus loin qu’un exploit immédiat, un renom éternel. Car une révolte d’ampleur en Gaule, si elle était matée avec succès, lui permettrait de revenir encore plus fort, d’apparaître comme le général dont Rome avait besoin, d’éclipser ses rivaux. Il se rappela les fêtes décidées par le Sénat après sa victoire contre les Belges et son amour de la gloire l’emporta. Il choisit de laisser Pompée profiter momentanément de son consulat unique et de se concentrer sur la Gaule. Il exigea un rapport approfondi sur ce Vercingétorix dont le nom se rappelait mollement à sa mémoire, ainsi que sur les responsables du massacre de Génabum. Sur la base des renseignements fournis par ses espions, on lui apprit que le prince arverne était de haute lignée, qu’il avait été chassé de son royaume à la suite d’intrigues obscures et avait été un compagnon de tente des légions au cours des campagnes contre les Aquitains parce que ces derniers n’étaient pas gaulois mais cousins des Ibères. Un fourbe de plus chez ces barbares ingrats ! Mais aussi un chef intelligent, appuyé sur une clientèle nombreuse, sûr de son autorité, qui venait de rentrer chez lui en vainqueur et accordait un soin particulier à sa cavalerie. Il n’hésitait pas, si jeune fût-il, à exiger de tous les états des otages, à ordonner qu’un nombre déterminé de soldats et d’armes lui soit rapidement envoyé, à joindre à une extrême diligence une implacable sévérité dans son commandement. Les hésitants, il les contraignait par le supplice. On murmurait que pour une faute légère, il renvoyait le coupable après lui avoir fait couper les oreilles ou crever un œil, afin qu’il servît d’exemple et que la grandeur du châtiment frappât les autres de terreur. Une telle rapidité d’action, une telle discipline alliées à une telle vigueur dans les préparatifs de guerre faisaient craindre un chef redoutable. Il fut en revanche beaucoup plus difficile d’obtenir des éclaircissements fiables sur les chefs carnutes parce que les informateurs en poste chez eux avaient été tués dans les combats. Un tribun qui avait autrefois traversé la contrée émit l’hypothèse qu’il s’agissait probablement des meneurs du parti anti-romain et un nom incertain revint aux oreilles de César : Cotuatus, Gutuatus, Gutuatrus ou quelque chose d’apparent. L’individu était partisan de l’ancien roi assassiné, ne respectait rien, était capable des pires folies. C’était à peu près tout ce que l’on savait de lui. Un préfet demanda s’il était le gutuater, cette sorte d’archidruide dont il avait 229
vaguement entendu parler ; personne ne sut répondre et César retint d’éclaircir ce point. Le second nom impliqué était tout aussi peu clair et oscillait entre Conconnétodumnus et Congonnétodubnus, fils d’un dénommé Agédomopas dont la famille avait noué des liens dans la tribu des Santons. Ces mêmes Santons en parenté avec les Helvètes que César avait eu à combattre lors de son arrivée ! Les chiens décidément rôdaient toujours ensemble. Le proconsul demanda enfin qui dirigeait la garnison censée protéger les réserves de blé parce qu’il s’étonnait qu’aucune rumeur ne fît mention de sa mort. Les Gaulois auraient pourtant eu à s’en vanter. On lui répondit qu’il s’agissait de Manius Sévius Latro, un centurion de la quatorzième recommandé par ses supérieurs qui ne l’avaient pourtant pas fréquenté personnellement. On le disait pointilleux avec les civils, mais ouvert au commerce et juste envers les barbares. Pourtant quelqu’un démentit cette image et prétendit à l’inverse que l’homme était emporté, improbe, paresseux. César songea à son intendant Cita dont il connaissait les vertus et qu’il avait lui-même mandé à Génabum en lui accordant sa confiance. Le nom de cet officier ne lui disait rien de bon et il redouta qu’il ne se fût enfui au contact de l’ennemi. Craignant d’avoir été ainsi abusé sur la valeur d’un de ses soldats, il s’agaça cette fois-ci, jura qu’il le retrouverait luimême pour démêler le vrai du faux. Il n’hésitait déjà plus, mais ce dernier coup du sort le révolta. Il prononça tout haut les comparaisons auxquelles son entourage songeait. Trois générations auparavant, sous le consulat de Gnéius Papirius Carbo et Gaius Cécilius Métellus, le roi Jugurtha avait massacré des citoyens romains à Cirta en Numidie avec la même férocité et le même mépris des alliances et des traités. Rome, frappée au cœur, lui avait déclaré la guerre et Gaius Marius l’avait vaincu et ramené enchaîné devant son char triomphal. Et trente années plus tard, qui ne se souvenait du massacre ordonné par le félon Mithridate que Pompée avait finalement chassé de ses terres au bout d’une longue guerre pour revenir à Rome plus puissant que jamais ? Il feignit de s’indigner. Alors quoi ! Le mari de sa tante, le vainqueur d’Aix et de Verceil avait accompli ces exploits et lui ne serait pas capable de les réitérer en d’autres lieux, à une autre époque ? Il avait déjà démontré le contraire contre les Germains d’Arioviste ! Son ennemi juré avait connu le même succès et lui ne serait pas à la hauteur ? Pompée devait se méfier car, si chaque fois les généraux vainqueurs y avaient trouvé l’occasion d’évincer leurs rivaux, Métellus pour l’un, Lucullus pour l’autre, c’était son tour à présent. Il en allait de l’honneur, de l’intérêt de Rome mais du sien propre également. Il soumettrait les rebelles, châtierait avec exemplarité 230
les coupables là où tout avait commencé, serait à son tour le triomphateur du monde. Les préparatifs de campagne furent décidés sans report. Rapidement, on leva des troupes et deux légions supplétives furent ajoutées à celles qui existaient déjà en Gaule. La première, créée en Cisalpine, fut appelée Ferrata, la porteuse de fer, et prit le numéro VI laissé vacant par celle de Crassus anéantie à Carrhes. La seconde, recrutée en Transalpine, fut pour la première fois composée de Gaulois de la Province ; elle ne reçut pas un numéro mais un simple nom, celui d’Alaudae, les alouettes en celte, en raison du panache des légionnaires qui les faisait ressembler à cet oiseau. Des Gaulois se battraient contre des Gaulois, sans être des traîtres tant ils n’avaient pas conscience d’appartenir à une même nation. C’était au contraire un honneur, une marque d’égalité entre les citoyens romains et les autres, une manière de montrer aux rebelles qu’ils n’avaient aucun intérêt à prendre les armes contre leurs maîtres d’aujourd’hui, leurs pairs de demain. Le départ fut laborieux. Les poulets sacrés mangèrent peu. César n’en eut cure parce qu’à la différence de ses compatriotes et surtout des Gaulois, il n’avait aucun scrupule religieux et il s’écria : « Emmenons-les puisqu’ils sont si exigeants. Le grain est meilleur chez les Carnutes que dans ces montagnes ! » Puis on perdit plusieurs jours à lever les renforts car aucun officier ne s’attendait à un mouvement si précipité. Au-delà des Alpes, les légions non plus ne songeaient pas au retour de leur général. En Gaule ou ailleurs, elles étaient en plein hivernage et l’usage voulait qu’on attendît mars pour lancer la saison militaire dont l’offensive culminerait normalement entre juillet et septembre. Mais si les Gaulois ne respectaient aucune loi de la guerre, César suivrait les règles qu’ils lui imposaient pour y exceller et voler vers la victoire. Alors qu’il quittait à peine Ravenne, il donna ses premiers ordres de marche aux troupes cantonnées au-delà des Alpes. Il était grand temps ; il lui arrivait souvent d’aller plus vite que ses courriers. Il alla des bords de l’Adriatique aux rives du Rhône en sept jours, dictant ses lettres à cheval et occupant plusieurs secrétaires à la fois. On était pourtant au fort de l'hiver : même dans l’arrière-pays méditerranéen, les rivières étaient glacées, les forêts ensevelies de neige, les campagnes inondées comme des torrents, les chemins couverts de marais et d'eaux débordées, impossibles à reconnaître. Tant de difficultés faisaient croire aux Gaulois que César ne pourrait les attaquer. Mais, en progressant, le proconsul réfléchissait de plus en plus qu’il profiterait de cette erreur d’appréciation. Lui qui tirait parti de tous les avantages que la guerre peut offrir et savait surtout profiter du temps imparti fit voir aux barbares, par 231
la célérité de sa marche dans une saison si rigoureuse, qu'ils allaient avoir affaire à une armée invincible à laquelle rien ne pouvait résister. Face à la double menace que Luctérios et Vercingétorix faisaient naître, quelques lieutenants lui conseillèrent de faire revenir ses légions stationnées dans le nord de la Gaule pour redescendre et défendre la Province avant tout ; d’autres, au contraire, plus audacieux, voulurent les rejoindre chez les Lingons, en plein cœur des territoires soulevés, et porter la guerre le plus loin possible des possessions de Rome. Que César rejoignît ses troupes ou qu’elles le rejoignissent à l’inverse, les deux plans présentaient des dangers qu’on ne pouvait ignorer en raison du peu de crédit accordable aux tribus qu’il faudrait traverser et qui se disaient pacifiées à un moment où toute la Gaule entrait en révolte. Si l’on suivait le premier, les troupes de César risquaient d’être attaquées et devraient soutenir les combats sans lui ; si l’on suivait le second, c’était le général luimême qui deviendrait une cible inévitable et il serait impossible aux seuls effectifs complémentaires de son armée, d’assurer sa protection contre des ennemis si nombreux. Mais le Cadurque faisait route vers Narbo Martius, rien ne semblait devoir l’arrêter et l’on craignait déjà pour Némausus, Arausio ou Arélate. César para finalement au plus pressé. Il jugea préférable de protéger d’abord les colonies en se raccrochant à l’endurance héroïque de ses soldats restés en Celtique qui devraient patienter en cas d’attaque. Il reprit la main dans le sud. La manœuvre de pré-campagne qu’il engagea fut un chef-d’œuvre d’intelligence et de maîtrise des risques, un mélange d’impétuosité et de calcul avec lequel il se lançait dans les plus grands dangers. Comptant sur l’inexpérience de Vercingétorix et le peu de temps que celui-ci avait eu pour asseoir son autorité sur les autres tribus et même sur l’ensemble des Arvernes, ayant par-dessus tout une haute idée de sa supériorité de Romain sur les barbares et plus encore foi en son génie personnel, il tenta un beau coup de joueur. Il fit lever et rassembler de la cavalerie à Vienne, sur le Rhône, mais se rendit, lui, à Narbo Martius et Tolosa. Là, il plaça des garnisons, renforça celles qui existaient chez les Rutènes, les Volques, les Tolosates pour faire barrage à l’adversaire. La manœuvre d’intimidation fonctionna puisque Luctérios, jugeant dangereux de s’enfermer ainsi entre des légions, ne s’avança plus et préféra même reculer. Parallèlement, César ordonna à une partie des troupes de la Province et aux renforts venus de la vallée du Pô de se réunir chez les Helviens dont le territoire, déjà romanisé, touchait à celui des Arvernes. Ce choix n’était pas dû au hasard. César connaissait bien le peuple helvien dont son traducteur et ambassadeur Gaius Valérius Procillus avait toute sa 232
confiance. Le pays était suffisamment sûr et prospère pour y recruter des guides de montagne, y acheter des animaux de bât, organiser des ravitaillements ultérieurs. Surtout, le proconsul y cultivait l’ambiguïté de ses intentions. Chez les Helviens en effet, il était impossible à ses ennemis de savoir s’il attaquerait Luctérios pour le vaincre définitivement à l’ouest ou remonterait vers le nord en longeant la vallée du Rhône. Il exploita jusqu’au bout cette incertitude par une feinte audacieuse. En plein hiver, malgré les difficultés de l’expédition, il franchit les Cévennes qui formaient une barrière naturelle et passa chez les Vellaves, clients des Arvernes. Sur une route où les chutes de neige pouvaient atteindre plus d’une coudée en une seule journée, il n’emmena qu’un léger détachement et veilla à n’être ralenti ni par des chariots, ni par du matériel lourd, sa faible logistique étant transportée sur les bêtes de somme qu’il s’était procurées. Son intention n’était pas d’occuper le pays mais d’exécuter un simulacre d’invasion. Dès son arrivée, il lança le plus loin possible des raids de terreur avec sa cavalerie, massacrant, incendiant, prenant soin de faire savoir qu’il dirigeait en personne cette opération. Les fantassins assurèrent la surveillance du camp, se firent plaisir par quelques ravages des habitats qui en étaient proches. Les Arvernes qui accompagnaient leur prince loin de chez eux en Biturigie tombèrent dans le piège. Ils apprirent que César, plus rapide qu’un simple courrier, arrivé en peu de jours avec toute son armée, pillait leur pays, détruisait leurs places fortes, recevait ceux qui venaient se rendre à lui. À l’annonce de ces dévastations, ils pensèrent, comme le proconsul l’espérait, qu’il s’agissait d’une invasion alors que ce n’était qu’une entreprise risquée de diversion. Stupéfaits de tant d’audace, ils pressèrent Vercingétorix d’abandonner sa campagne pour rentrer défendre leurs familles et leurs biens. Les Cadurques eux-mêmes maintenant craignaient pour leur territoire. Le fils de Celtillos ne se trouva sans doute pas dupe de la manœuvre, mais fut obligé de céder à ses hommes qui le suppliaient d’entendre leurs arguments. La ruse aurait pu échouer, mais César était sûr de son plan qu’il déroula avec la virtuosité d’un homme habitué aux leurres politiques de Rome. La situation étant en passe d’être rétablie dans le sud, il fallait désormais pousser l’avantage dans le nord. Avec un sang-froid inouï, escorté de quelques gardes du corps seulement, il quitta au bout de deux jours son détachement, sans même savoir encore si Vercingétorix s’était laissé prendre à son stratagème. Annonçant qu’il reviendrait sous trois jours avec des troupes fraîches et espérant que le bruit de son retour imminent se répandît pour concentrer l’attention des rebelles sur la région, il échafauda un tout autre projet dont il ne mit pas même Brutus au courant parce qu’il 233
redoutait les indiscrétions d’un jeune chef commandant une troupe parsemée d’indigènes. Et, sans s’arrêter en pays helvien, il poursuivit vers Vienne, y retrouva la cavalerie assemblée, galopa avec elle jusque chez les Lingons. Là, il reprit le commandement de ses troupes soulagées de le voir arriver et entama en position de force sa réelle campagne. Les Gaulois avaient échoué à l’isoler de ses légions. La première étape de la nouvelle guerre se déroulerait aux frontières de la Carnutie, quoique les opérations dépassassent de beaucoup ses simples enjeux. César, en remontant le Rhône, avait passé par le territoire des Éduens, ses satellites, pour raffermir leur alliance avant de rejoindre ses légions à qui il ordonna de se concentrer toutes chez les Sénons, autour d’Agédincum. Dès qu’il en fut informé, Vercingétorix fit demi-tour, retourna en pays biturige, décida d’attaquer précisément les Boïens en assiégeant la ville de Gorgobina à cent milles de Génabum. La cible n’était pas fortuite là encore : les Boïens étaient eux aussi clients des Éduens ; surtout c’était César qui les avait établis entre l’Allier et la Loire après sa victoire sur les Helvètes et en avait fait un soutien de Rome. Le prince arverne reprenait l’initiative ; le proconsul n’avait d’autre choix que se porter à sa rencontre. Il craignait en effet que s’il n’intervenait pas pour aider ce peuple qu’il avait lui-même placé sous l’autorité des Éduens, on méprisât à l’avenir l’alliance de Rome pour y trouver un prétexte supplémentaire de se rebeller. Il y avait certes danger à mettre en branle ses légions par mauvais temps : davantage que dans le sud, l’état des routes dans le nord gênerait leur ravitaillement. Déjà la prise de Génabum avait inquiété ; les hommes avaient cru en avoir le ventre vide alors même qu’ils mangeaient encore à leur faim. Il ne servait à rien d’en rajouter, mais il fallait au contraire rétablir la situation. Pourtant, dit-il, il était préférable pour un Romain de souffrir la faim que de subir l’infamie. La nouvelle guerre serait une guerre d’alliances et de vivres plus encore que les précédentes et, cherchant un moyen d’empêcher la disette, il engagea les Éduens à lui fournir du blé tandis que lui-même, habitué d’ordinaire à une table luxueuse mais résistant à la peine, entreprendrait de donner l’exemple en se rationnant. Il se mit en route. Une rencontre fortuite cependant changea ses plans. Un jour que ses légions étaient à quinze lieues de Gorgobina et que ses éclaireurs étaient partis reconnaître le territoire, un escadron tomba, au coude d’une route, en plein milieu d’un champ, sur un homme effondré près d’une pierre. L’homme pleurait, assis, les mains tremblantes, la 234
chevelure hirsute, le vêtement ensanglanté. Il lui manquait une botte, la moitié de son manteau ; son œil droit était crevé ; à considérer ses joues creuses, ses membres maigres et séniles, il semblait à l’article de la mort. À ses côtés se balançait, sous la branche d’un arbre, un cadavre qu’on avait mis au supplice, dont les pieds rasaient les racines mais ne les touchaient pas ; la tête était comme tant d’autres abîmée, la poitrine plantée d’une épée qui retenait un morceau d’écorce où des dessins obscènes avaient été tracés. À la vue des éclaireurs, l’homme qui se lamentait émit quelques mots en grec mais si raboteux, si cafouillants qu’il donna l’impression de ne pas avoir parlé depuis des jours. Au milieu de ses geignements, on parvint à comprendre qu’il était un rescapé des Gaulois, le compagnon de la victime pendue près de lui. Il fut interrogé sur place, sut répondre à des questions sommaires sur Gorgobina, les forces rebelles et ses renseignements parurent assez utiles pour le présenter au proconsul. Avant de partir, il demanda à détacher le corps, par des gestes plus que des paroles tant son état de faiblesse l’empêchait de s’exprimer correctement. On enterra le cadavre sur place parce qu’on ne pouvait l’emmener. On fit vite, et de mauvaise grâce. Heureusement que la terre s’était amollie ; on jeta l’épée gauloise, la corde avec qu’on ne prit pas le temps d’enlever. L’individu fut conduit au camp qui se trouvait plus au nord. On lui donna d’abord à manger parce qu’il affirma qu’il n’avait rien mâché depuis deux jours et un homme qui a le ventre plein parle d’autant mieux qu’il a tout son esprit et de la reconnaissance envers celui qui l’a nourri. Il était en effet à la limite de l’inanition ; ce furent deux légionnaires qui durent le traîner presque jusqu’à une table. Il se jeta sur la bouillie qu’on lui tendit, la dévora en plongeant carrément son visage dedans et en remerciant de temps à autre Déméter et Coré. Toute la troupe l’observa ; un sentiment de compassion s’empara des cœurs de ces soldats normalement insensibles. Au-delà de la famine, on soupçonnait une histoire terrible, à la charge des barbares tant l’homme avait l’air pitoyable. Il avait souffert les pires atrocités, c’était visible. Assis comme il pouvait, tout son corps avait l’air de se tasser, aspiré par le sol où il devait disparaître. Son cou s’enfonçait dans ses épaules qui elles-mêmes tombaient sous le poids de la douleur. La main qui ne tenait pas l’écuelle était inerte et son bras ballait contre ses jambes dont les genoux plongeaient jusqu’à terre. Ses pieds enfin disparaissaient sous une touffe d’herbe que le hasard avait placée là. Les soldats étaient habitués aux souffrances de la faim, pas les civils et c’était toujours un crève-cœur de les voir partager, malgré eux, les tourments de la guerre. Il n’y avait aucun doute que celui-ci, quand il aurait repris des forces, suivrait la légion pour manger à bon compte et prendre si possible sa part de rapine. 235
On l’amena enfin devant César. Depuis la porte principale jusqu’au centre du camp, l’accès à la tente du général avait quelque chose d’impressionnant pour qui était étranger à la vie militaire. S’il avait franchi les défenses et les palissades dans un état de faiblesse générale qui l’avait empêché d’y faire attention, une fois qu’il eut mangé, l’homme retrouva suffisamment de forces pour se rendre compte de la situation. Il fut alors intimidé lorsqu’on le fit marcher devant les légionnaires dévolus à la garde de César qui le regardèrent passer avec une mine mêlée de curiosité lasse et de méfiance. Il le fut plus encore face aux officiers de l’état-major qui, enveloppés de leurs manteaux magnifiques, n’eurent à son encontre qu’un mépris silencieux ou de l’indifférence. Il baissa la tête, parvint plus honteux qu’un captif devant le prétoire que bordaient de part et d’autre le tribunal, l’auguratorium où se prenaient les auspices, l’autel dressé aux dieux porteurs de victoire. La tente écrue de César, grande ouverte, était en elle-même semblable à celle des autres gradés, mais elle était plus grande, plus confortable, surélevée sur une légère hauteur du terrain. Son accès était orné d’étendards et de trophées derrière lesquels on devinait, à l’intérieur, des tables somptueuses, des poteries et des amphores sur un pavage de ces mosaïques portatives qu’on disait appréciées du général mais qu’il était impossible de voir en contrebas. Devant, en revanche, au milieu d’un lourd tapis rouge et or dont les franges retombaient hors de la tente, encadré de trépieds élégants où une belle flamme luttait contre le froid, un bureau en bois d’Orient était couvert de cartes et de sortes de pions indiquant sans doute la position des belligérants sur le champ de la guerre. Le proconsul se tenait assis sur son siège curule, entouré de ses plus hauts lieutenants dont il prenait avis. Un centurion l’avertit à l’oreille. Il ne se leva ni n’accorda d’abord le moindre regard au malheureux qu’on lui amenait, continua son entretien plus indifféremment que si une mouche se fût posée devant lui. Il s’écoula ainsi un long temps durant lequel l’homme resta humblement tête basse, résistant à l’envie de tomber malgré sa faiblesse, plus honteux de son état et de sa précarité que s’il avait été nu et s’était prosterné. Enfin César conclut sa discussion. Alors il posa négligemment les yeux vers l’être qui se soumettait devant lui. Il se leva, contourna son bureau, sortit de sa tente en adoptant une démarche sensuelle qui détonnait dans l’univers austère du camp. Il s’arrêta devant l’individu qui mit un premier genou à terre comme si son corps flanchait enfin ou qu’il avait voulu lui adresser une salutation maladroite qu’un Romain d’autrefois aurait réprouvée. Le général eut un imperceptible sourire de satisfaction mais n’en voulut rien laisser paraître devant ses troupes. 236
– Aie un peu d’honneur, par Mercure !, se hâta-t-il de dire, et regardemoi. Je veux encore voir un homme en face quand je m’adresse à lui. Doucement, l’autre éleva ses yeux et découvrit véritablement le grand homme, pour la première fois, comme si un dieu vivant lui fût apparu. Le soleil se couchait à l’occident, nimbait le dos de César d’une lumière flamboyante et chaude. Celui qui était déjà pour ses troupes le divin Jules avait les membres graciles, la peau blanche, le port distingué. La fatigue d’une campagne, loin de l’amoindrir, l’avait au contraire grandi. Dans sa magnificence, sa robe immaculée de sénateur à bande pourpre, garni de franges qui caressaient ses mains, s’entourait d’une ceinture si lâche qu’elle lui tombait sur le ventre en lui conférant le mauvais genre des bandes efféminées de Rome. Mais c’était sa tête surtout, légèrement dans l’ombre du soleil, qui le démarquait des autres parce qu’elle était à la fois celle d’un soldat aguerri et d’un esthète qui avait été beau et que l’âge avait fané. La sécheresse de ses traits y disputait les nuances ambiguës d’un érotisme cruel. Il avait le cou allongé et délicat, la pomme d’Adam proéminente et la peau lisse tandis qu’au sommet de son crâne, une calvitie avancée creusait le golfe de ses tempes et n’était dissimulée que sous une mèche de cheveux bruns artistement ramenée en avant par vagues successives. Sur son visage, ses lèvres étaient serrées et très fines, son front clair chargé d’embarras, ses joues glabres émaciées près de pommettes saillantes rosées. Au centre d’une arcade sourcilière étirée, sous de grands cils de courtisane, ses petits yeux enfoncés brillaient enfin comme des calots très noirs, soulignés d’un liseré d’or à leur contour ; ils étaient la comète dans le ciel qu’on prétendait devoir apparaître le jour de sa mort et qui le porterait aux plus hautes destinées. L’homme resta muet, ses prunelles grandes ouvertes d’émotion. Étaitil ébloui ? Était-ce l’image qu’il s’était faite du proconsul, d’un Romain des plus puissants ? César ne lui laissa pas le temps de le montrer. Il lui parla directement en grec car on lui avait dit que l’homme pratiquait cette langue : – Comment t’appelles-tu ? D’où viens-tu ? Que viens-tu faire par ici ? Autant de rudes questions auxquelles l’autre fut d’abord incapable de répondre comme si les mots se bloquaient dans sa gorge. On eût dit qu’il n’avait pas parlé depuis des jours, voire des mois, qu’il ne savait plus comment faire. Ce fut alors seulement, parce que les paroles qu’il attendait ne venaient pas, que César prit le temps de vraiment regarder ce personnage qui s’humiliait devant lui. Il ne bougea pas, mais ses yeux en firent le tour. Le misérable était tout son contraire. Ses vêtements en lambeaux, chaussé d’une seule botte, il était sale, de la poussière des chemins, de la nourriture du camp dont il ne s’était rincé la bouche, des 237
blessures qui balafraient ses membres secs toujours ballants. Le soleil éclairait le moindre défaut, la moindre plissure de sa peau et malgré la lumière il avait, de la tête aux jambes, le teint hâve d’un mort. Sa gorge exhalait des sifflements rauques plus qu’une respiration ; les ailes de ses narines se gonflaient comme s’il reniflait les odeurs autour ; ses doigts continuaient de trembler légèrement. Sa face surtout se remarquait par une barbe broussailleuse, une incisive cassée qui lui tombait sur la lèvre inférieure et un œil crevé comme une bille de chair plissée, mal lavée entre le nez et la tempe gauche dont avait coulé une traînée de sang. Le proconsul eut un mouvement de recul. Il ne connaissait pas la pitié ; un tel être le rebutait forcément. Les yeux baignés de grosses larmes, l’homme bégaya enfin un son caverneux en se remettant debout – des mots sans queue ni tête parmi lesquels on saisit ceux de dieu, de rêve, d’incarnation. Quoiqu’il fût décidément flatté, César eut un mouvement d’impatience. L’autre se reprit comme il put : – Je…je m’appelle Eumène, noble César. Je…je viens de Bithynie…ce pays où l’on dit que toi-même, tu t’es rendu dans ta jeunesse et dont je regrette aujourd’hui la douceur. Un léger trémolo ponctua sa phrase dont la fin avait déjà été plus fluide, plus souple comme si parler avait décoincé le timbre de sa voix. Il y eut au même moment une réaction discrète de l’assistance, un amusement, un murmure aussitôt disparu qu’il était apparu sur les lèvres. La Bithynie rappelait à tous le roi Nicomède dont César passait pour avoir été le mignon dans sa jeunesse. Le principal intéressé n’en parut nullement contrarié, ne vit pas dans l’allusion de l’irrespect. Quelque chose d’ailleurs semblait avoir retenu son attention chez le personnage qu’il avait devant lui. Il le scruta attentivement, d’une acuité typiquement féminine, comme s’il cherchait à retrouver quelqu’un d’autre sous ses traits. Peut-être avaitil reconnu, en une seule phrase, l’accent sournois des peuples orientaux où un discours double se cache souvent sous celui que l’on vient d’écouter. Si peu qu’il avait parlé, la langue de celui-ci avait en effet des traits asiatiques mâtinés d’égyptien comme la manière qu’il avait de rouler ses consonnes, aspirer ses initiales ou siffler ses voyelles. Il reprit : – Tu es loin de chez toi, Eumène de Bithynie. Eh bien, on m’a dit que tu avais des informations qui peuvent m’intéresser. Parle, maintenant que mes hommes t’ont sauvé et que tu as mangé à mes frais. – Voilà…, dit l’autre dans un débit encore un peu rocailleux. J’ai réussi à m’échapper de Gorgobina…je…je suis maquignon…regarde mes mains, comme elles sont calleuses ! Dix ans de Gaule, vingt de 238
métier…mon associé et moi, on est venus vendre nos bêtes dans ce bourg si accueillant aux étrangers. Des chevaux d’Asturie à l’allure douce ! Des juments d’Agrigente qui sont parmi les meilleures parce qu’on leur y offre des tombeaux ! Et des ânes de Réate, et d’autres d’Arcadie ! Mais on a été attaqués… J’ai tout perdu ! Ah, ça, je peux vous le dire, à vous qui n’y avez jamais mis les pieds ! Gorgobina, c’est grand comme Amastris du Pont, c’est devenu dangereux comme Béroé de Syrie ! Un vrai merdier, si tu me pardonnes l’expression, noble César… L’homme observa subrepticement ceux qui l’écoutaient. Après les avoir faire sourire, il était brusquement devenu grossier, avait fini par s’exprimer sans la totale déférence qu’il devait à son interlocuteur. Personne ne s’en offusqua cependant. Au contraire, c’était l’expression de sa détresse, le signe qu’il prenait de l’assurance dans ses atermoiements et qu’on pourrait le faire parler. La pitié à son encontre disparut tout à fait ; on conçut l’idée de l’employer à bon escient. – Continue, dit le général. – Des sauvages, de vrais sauvages. Même Alexandre n’en a pas connu de pareils. On ne les reconnaît pas quand ils font la guerre ; leur nouveau soulèvement les a encore rendus plus laids parce qu’ils jouent leur va-tout sur cette nouvelle offensive. Ils veulent libérer la Gaule en se démarquant des légions qu’ils ont pourtant côtoyées. Ils s’affublent comme leurs ancêtres. Sous leurs enseignes et leurs casques, on dirait des ours qui grognent et te reniflent pour venir te dévorer. Là-bas, il y a bien dû en avoir un million déboulés un sale matin au pied des murailles, sonnant de leurs trompettes, battant de leurs armes. Les habitants ont fermé toutes les portes de la ville, pris de panique, parce qu’ils étaient vos alliés. Moi, monté en haut des remparts, j’avais les jambes qui tremblaient mais j’ai eu le temps de les voir, ces singes. Laisse-moi te dire à quoi ils ressemblaient. De vrais babouins ! Des cynocéphales ! Ils étaient peinturlurés de… – Leur aspect, je m’en moque, coupa le général. Ce que je veux savoir, c’est si tu as vu leur chef, leur généralissime. – Pour ça, oui ! Il paradait sous les remparts en nous insultant. Un gaillard immense, roux, velu comme un Choromande, la face salement arrangée d’une énorme moustache et de petits yeux luisants comme des mires de sanglier. Celui-là, on aurait cru voir une de ces créatures qu’on dit vivre au-delà de l’Euphrate… L’intérêt de César parut s’éveiller pour de bon. Il voulut en avoir le cœur net, approfondir ce que ses éclaireurs lui avaient sans doute déjà indiqué. – Un homme roux, dis-tu, et laid ? C’était bien celui qu’on appelle Vercingétorix, le roi des Gaulois ? Ce n’était pas le chef d’un quelconque 239
détachement ? Tu es sûr qu’il était bien là, que c’était bien le gros des troupes rebelles ? L’autre eut un sourire de contentement à voir César accroché par ses paroles. Son dos se releva, il parut reprendre des forces en balayant d’un coup d’œil plus large l’entourage des soldats immobiles. Eux aussi le suivaient maintenant avec attention. Le mouvement de ses lèvres laissa plus encore sortir sa dent triangulaire qui parut prête à mordre le premier qui ne le laisserait pas dérouler son histoire. – J’en mettrais l’œil qu’il me reste à piquer. Ils étaient si nombreux, César, la plaine en était si recouverte qu’il est impossible de se tromper et maintenant que tu me dis son nom, je suis persuadé qu’ils beuglaient « Verkinngétorix, Verkinngétorix ! ». Quand on a vu les bougres qu’il avait derrière lui, on n’a d’abord pas compris parce qu’on savait le massacre de Génabum, les ennuis chez les Bituriges, mais on était loin de se douter que les rebelles atteindraient la Loire et oseraient s’en prendre aux Éduens. – Continue. – Si je te dis, César, que c’est là-bas un traquenard, c’est parce que je crois qu’il y a pire. Voilà l’histoire, comme elle s’est déroulée. On était une poignée de Massaliotes et de Romains ; il y avait même un Crétois d’Héraclée. Tous arrivés là par hasard, sans se connaître, réfugiés dans la ville, bloqués par la guerre. Le lendemain de l’arrivée de ces sauvages sous les remparts, des hommes, ceux-là mêmes qui nous avaient accueillis la veille, nous ont arrêtés et conduits en prison. Les Gorgobiniens voulaient nous livrer et se rendre, c’était évident ! D’ailleurs, qu’est-ce qu’ils auraient pu faire d’autre ? Ils étaient trop peu nombreux, se retranchaient derrière des fortifications qu’un coup de vent aurait fait s’effondrer. Il faut voir une prison gauloise pour comprendre notre détresse. C’est encore plus pouilleux, plus sombre, plus étroit que le sphincter d’un Garamante. On a eu le temps d’y gamberger, à écouter des heures, des jours dans le noir, rationnés par une mixture infâme et le silence. Ça, du silence, il y en a eu ; il ne se passait rien justement et c’était louche. Aucun combat, pas un cri d’attaque ni une plainte d’assiégé. Ne va pas croire que les murs des geôles étaient épais. Les Gaulois parlementaient entre eux, c’est tout ! Au bout d’un long temps enfin, on nous a fait sortir et là, on s’est aperçu que les lignes de défense qu’on pouvait observer n’avaient pas bougé ! Avaient-ils pactisé ? Les Gorgobiniens jurèrent leurs grands dieux que non ; ils prétendirent que le siège se mettait en place, qu’ils nous avaient jetés en prison pour nous protéger le temps de recevoir des ambassadeurs parce que ces chiens nous auraient exigés en otages s’ils nous avaient vus dans la ville. Et ils ont continué de nous mener en bateau ! Les demandes des assiégeants étaient folles, ils ne pouvaient y 240
répondre ; nous devions nous sauver car ce conflit ne nous regardait pas ; si nous avions une quelconque reconnaissance pour leur hospitalité, nous devions aller te prévenir, toi ou tes lieutenants, de leur situation désespérée. La nuit suivante, ils nous ont évacués par une porte isolée et un sentier qui longeait la Loire où les femmes allaient normalement laver leur linge. Au bout d’un mille peut-être, leurs guides nous ont quittés en nous souhaitant bonne chance. De la chance, peuh !, on n’en a pas beaucoup eu. D’abord on avait laissé nos marchandises et j’ai calculé qu’en abandonnant mes dix bêtes là-bas, je perdais plus que vaut ma chienne de vie. Et puis, si on a fait un premier bout de chemin ensemble, on s’est vite séparés en se disant qu’on passerait plus inaperçus et qu’on aurait aussi une plus grande probabilité de tomber sur des Romains pour les avertir. Moi, j’ai marché avec mon associé en remontant vers le nord-est pour rejoindre la route qui mène d’Agédincum à Cabillonum et de là à des terres plus civilisées. C’est à ce moment que les choses se sont gâtées. On avait été prudents pourtant, on avait pris soin d’effacer nos traces, mais ils nous ont retrouvés. Plutôt, c’est comme s’ils nous avaient toujours suivis. Toute une bande, au moins dix contre un… Il marqua une pause, conclut simplement : – Ils ont tué Dexios, mon compagnon, l’ont pendu à un arbre, ont ri en fixant sur son torse leurs horribles dessins. Moi ils m’ont éborgné en me forçant à les regarder le lacérer. Ils ont dit qu’il n’y avait pas besoin de deux hommes ni de deux yeux pour avertir César. Et leur message était clair : ce qu’ils nous avaient fait subir, ils le feraient subir au centuple à tes légions. Puis, ils sont partis ; je suis resté là où tes hommes m’ont trouvé, incapable de rien faire ni d’avancer… La foule des soldats ne put se contenir à la fin de cette histoire qu’elle avait écoutée avec passion. Rompant toute discipline, elle hurla au meurtre, jura de châtier les coupables. Tous se remémoraient ce qu’on disait de Vercingétorix et ses brutes, qu’ils coupaient les oreilles, crevaient les yeux des prisonniers et des traîtres ; certains se cachèrent le visage et firent mine de pleurer. César cependant les calma tous d’un geste à la fois autoritaire et dilettante. Il réfléchit. Il se lisait sur son visage comme la jouissance d’avoir compris et de savoir qu’il tenait là l’opportunité de doubler son ennemi. – Pourquoi as-tu parlé de piège tout à l’heure ? Pourquoi as-tu laissé sous-entendre que les habitants de Gorgobina vous mentaient ? Il redoutait en effet les pièges et savait les Gaulois capables d’en organiser d’immenses. L’autre hésita un instant, regarda une nouvelle fois autour de lui, se lança dans la partie délicate de son discours : 241
– C’est que…je ne suis que maquignon, je n’ai pas ton génie, divin César, mais ce calme durant notre détention, la facilité avec laquelle on nous a fait partir, le message qu’ils ont voulu te transmettre, leur cruauté infâme et le cadavre qu’ils ont accroché pour attirer forcément l’attention de tes éclaireurs, tout ça… – …semble opéré à dessein. Un stratagème en somme… – Pour tout dire, ça m’a fait penser à une trahison des Boïens et une embuscade à Gorgobina. Je les connais bien, ces chiens, depuis des années que je les pratique ; je sais quand ils me mentent. Sois sûr qu’ils ont versé dans la révolte ! Gorgobina a été prise, les Boïens ont rejoint l’ennemi ; ils font semblant d’être encore en état de siège mais c’est pour mieux t’attirer parce qu’ils savent que jamais un Romain n’abandonnera son allié. Ils nous ont renvoyés pour te faire venir jusqu’à eux ! Leur armée est cachée dans les forêts du pays, prête à tendre des pièges à tes éclaireurs, à tes fourrageurs, à ton arrière-garde. Les gémissements de la troupe cédèrent ici place à une moue parmi les officiers. L’idée d’entendre leur général discuter stratégie avec un personnage inconnu et misérable, de voir une réflexion instillée dans son esprit par un simple marchand itinérant leur déplaisait autant que s’ils avaient dû confier la gestion de leurs biens à une femme ou un esclave. D’ailleurs, la voix du maquignon n’était plus du tout heurtée ni gutturale ni interrompue en quoi que ce fût par l’émotion, mais elle avait gagné un semblant d’enhardissement prétentieux que beaucoup perçurent. Il ne bougeait pas, retenait un rictus invisible à la commissure de ses lèvres. – Ils sont persuadés que nous allons attaquer Gorgobina, pensa César à voix haute. Il nous faut donc agir autrement. Tu connais bien le pays ?, demanda-t-il enfin. – Mieux que le ventre de ma mère ! Je l’ai dit, ça fait dix ans que j’arpente les routes entre Avaricum, Génabum et Bibracte. Ce coin de Celtique n’a plus de secret pour moi et même la guerre qui fait rage depuis des années ne m’en a pas chassé. Pour te dire, j’étais à Génabum un jour seulement avant le massacre ! Ah, je connais les routes de commerce, les routes d’acheminement des troupes, celles qui sont bloquées en hiver, celles qui sont dégagées. Je connais tout, tout ! Et non seulement je connais ces axes, mais aussi les recoins cachés car j’ai visité nombre de fermes pour mes chevaux. Je peux te dire les endroits où l’ennemi se terre, ceux où tu pourras fourrager à ta guise, ceux où, sans être dans la perle des Gaules, vous tous pourrez tuer et vous enrichir plus que vous ne l’espérez. César cette fois-ci ne répondit rien, alors que l’œil de ses soldats s’embrasait à la promesse de pillages futurs. Il appela un officier en levant simplement un doigt qu’il laissa suffisamment longtemps en l’air pour 242
donner à tous l’occasion de voir que, même en campagne, il gardait ses ongles impeccablement propres. Il lui chuchota un ordre à l’oreille, que personne n’entendit. Mais l’on pouvait gager qu’il demandait à vérifier ce qu’il venait d’entendre. Comme n’importe quel général, s’il était intéressé par toute information potentielle, il ne la prenait jamais pour argent comptant. Tous ces transfuges, déserteurs, évadés, prisonniers, il les interrogeait, les laissait parler, se montrait séduit, mais s’en méfiait toujours au final et recoupait leurs dires pour s’assurer de leur fiabilité. Néanmoins il eut cette fois l’impression que la situation fournissait l’occasion de soigner son image auprès de ses hommes qui déjà l’adulaient. Il eut une idée et, loin de montrer sa suspicion, il demanda à voix haute : – Et toi, Eumène de Bithynie, que veux-tu en échange ? L’homme marqua un temps, prit une pose théâtrale et déclara : – Ta protection, César, ta protection et, comme symbole, ton poignard que tu m’autoriseras à garder pendant que je suivrai tes troupes et essayerai de compenser la perte de mes chevaux. Il ne manquait pas d’affront ; depuis ses grossièretés jusqu’à cette demande, son discours n’avait cessé de gagner en audace. Mais il avait été tellement suppliant, si crédible auparavant qu’il les avait séduits tous et qu’on pardonne ses audaces à un séducteur qui n’en a pas l’air. On savait que César aimait procéder à des présents inattendus pour se concilier la faveur des puissants comme du peuple. Qu’était-ce qu’un poignard ? Rien et tout à la fois. Frappé de la demande, le général l’accorda. Dans un geste superbe, au milieu d’un silence lourd de suspens, il fit trois pas, alla prendre une lame posée sur sa table de travail et la tendit à l’homme qui, pour l’honorer, s’agenouilla devant lui et la baisa. Les soldats acclamèrent leur général aux cris de « Vive César ! Vive César ! Vive le beau chauve ! ». Le jour déclinait, un début de crépuscule envahissait le prétoire. Le maquignon eut droit de rester dans le camp où on le surveilla d’abord avant de s’habituer à sa présence. Sans doute les informations qu’il avait livrées furent-elles corroborées car, jour après jour, les principaux officiers le mandèrent pour obtenir d’autres renseignements sur le pays et César lui-même fit appel à lui plusieurs fois. Se méfiant de tout le monde, il pesait chaque avis indigène ou allogène, le recoupait avec un autre et ce fut ainsi qu’il en arriva à consulter celui-ci comme les autres. Bientôt il en fit même un de ses informateurs de prédilection parce qu’il se méfiait de plus en plus de ses guides locaux tant la révolte gauloise était générale et qu’il craignait les espions. Passé sa méfiance initiale, il préférait de loin s’en remettre à un Grec qu’il présumait neutre ou même pro-romain dans ce conflit. 243
Il ne savait pas que croyant échapper au piège d’une armée ou aux manœuvres d’un traître, il venait de se fourvoyer dans le guet-apens d’un seul homme, le plus fourbe, le plus vil, le plus insaisissable qui fût, car cet homme n’était autre que Chéréas, Éponax, Eumène qui avait décidé de le tuer. Chéréas, s’il est permis de l’appeler ainsi, était de cette race d’hommes atroces que les événements ne parviennent jamais à abattre. De même qu’il avait des facultés protéiformes, de même il était capable de se tirer des pires situations avec une habileté rare, la discrétion et la souplesse d’un parasite, en sorte que même lorsqu’on le pensait perdu, il survivait, s’adaptant à tout, ressurgissant où on ne l’attendait pas, laissant les faits glisser sur lui sans jamais l’atteindre. Cette fois-ci pourtant il avait décidé qu’il ne serait plus seulement observateur, mais acteur de l’histoire. Voilà comment. Il avait d’abord voulu assassiner Gaius Fufius Cita, l’intendant de César. La nuit précédant le massacre, après avoir abandonné Asinus, il s’était évanoui dans l’obscurité mais n’avait à aucun moment songé à quitter la ville sans avoir rempli sa mission. Bien au contraire, il se cacha en son centre, dans la cave d’une vieille masure abandonnée que personne n’habitait depuis des ans et où il se faufilait sans que nul ne le vît depuis des mois. Le jour suivant, prévenu des événements, il se grima en Gaulois avec la même perfection que celle qui l’avait rendu invisible parmi les conjurés sous les traits d’Éponax. Au moment où les carnyx retentirent, où la horde de guerriers déferla sur la ville, il profita du tumulte, se mêla à la foule et tua pour donner le change – des femmes, des vieillards, des enfants parmi les familles nobles exterminées. Il ne voulait pas attirer l’attention, encore moins risquer sa vie, simplement se fondre dans l’action pour pouvoir observer les événements à sa guise et frapper en temps voulu. Quand il eut le visage couvert de sang, on ne se rendit pas compte qu’il n’était pas celte. Sa langue d’ailleurs était aussi malléable que ses accoutrements ; il parlait un gaulois sans accent et, de toute façon, personne ne s’écoutait vraiment au moment de plonger sa lame dans la chair ou de courir au butin. Surtout une blessure qu’on remarqua au milieu de tant d’autres acheva de le faire passer pour un rebelle : lorsque, dans un recoin de la Butte-aux-rats, il voulut s’en prendre à une femme qui n’était autre que Dilakka, l’épouse de Charmolaos et la nièce du vergobret, celleci tendit vers lui ses mains chargées de bagues et lui enfonça ses ongles dans le visage avec une telle rage qu’elle lui creva l’œil gauche et le griffa au sang sur la joue droite. 244
Chéréas hurla, acheva la folle en l’égorgeant et, quoique blessé, décida de partir à la recherche de Cita. L’œil bandé d’un tissu ensanglanté, armé d’un seul couteau, il voulait être sûr que l’intendant n’échapperait au carnage. Il retraversa toute la ville, bousculé, coincé, empêché d’avancer par la foule à chaque rétrécissement de la rue. Il chercha son homme d’abord dans sa maison à cause de l’heure matinale, puis très vite aux entrepôts où il avait le plus de chances de le trouver. Il n’y eut pas une trace de lui dans le grand. Les portes du petit, elles, venaient d’être enfoncées. Sur les mosaïques de l’entrée, deux esclaves gisaient dans une mare de sang, piétinés par des brutes qui ressortaient déjà en courant les bras lourds de prises. Il craignit que l’intendant de César n’eût réussi à s’enfuir, dépassa encore le cadavre d’un secrétaire, déboucha dans la dernière pièce. Là il arriva juste à temps pour voir le chevalier blessé être soulevé en l’air par un colosse roux et se faire éventrer vivant. Ce lui fut un moment de plaisir qu’il contempla avec force satisfaction. En retrait derrière les témoins de la scène, sa seule parole fut de chuchoter, l’air de rien, « faut l’empaler » pour s’assurer à jamais de sa mort. Tous autour de lui étaient captivés, les yeux, les oreilles grands ouverts, mais incapables de rien voir ni rien entendre que le spectacle de l’homme éviscéré devant eux. Sans qu’ils sussent d’où venait l’idée, ils la relayèrent : « faut l’empaler ! faut l’empaler ! » et le corps de Cita termina face au port, fiché sur un pieu. Chéréas assista au déferlement de joie qui emplit l’oppidum toute la journée. Il vit les cadavres des Romains décapités jetés dans la Loire ; il vit les prisonniers grecs, africains réduits en esclavage ; il vit la dépouille d’Asinus traînée par les rues, injuriée, battue, muée en une bouillie infâme et il ne s’en émut pas, s’en contentant même car il est bon de renouveler les espions pour ne pas qu’un seul homme concentre trop longtemps les secrets. Il se fit cependant discret, n’intervint en aucune occasion et, à la nuit tombée, quand les barbares se perdirent dans l’ivresse et les plaisirs, sans avoir pu récupérer l’argent qui lui restait, il quitta la ville en empruntant un passage dérobé qu’il connaissait dans la muraille. Il savait que le lendemain, une fois leur euphorie retombée, les Gaulois seraient plus soupçonneux et il ne voulait pas courir le risque d’être découvert. Même pour un virtuose du travestissement comme lui, l’endroit n’était plus sûr. Il traversa la Loire. Le pont était désert, les sentinelles toutes à table à festoyer. Il marcha en pleine nuit vers le sud. C’était son plan, ainsi qu’il l’avait dit à Asinus avant sa mort. Il voulait rejoindre Gorgobina des Boïens, observer de là-bas la suite des événements en Carnutie, guetter le moment où il pourrait refaire apparition. Il pressentait que la guerre se jouerait dans le centre des Gaules cette fois, que les combats y feraient 245
bientôt rage et les Boïens, peuplade sans ambition alliée des Romains, gouvernaient le territoire le plus tranquille de la région. En se retournant, il contempla au loin la ville éclairée par ses lueurs titanesques. Levant un poing rageur en l’air, il jura de revenir très vite non pas pour se venger – car il n’avait rien perdu de très cher –, mais simplement reprendre sa place comme une tique retourne au corps dont elle veut sucer le sang. Il s’enfonça dans l’obscurité et le froid où il sut se repérer avec l’aisance d’une ombre parmi les ombres. L’oppidum des Boïens était éloigné de trois bons jours de marche. Il avait l’habitude de s’y rendre, en connaissait par cœur la route parce que c’était là-bas que, chaque mois, il retrouvait son contact, un marchand d’étain niçois qui emportait ses renseignements, comme ceux d’Asinus, comme ceux de tous les indicateurs qu’il recueillait, jusqu’en Italie selon une chaîne d’information dont à son tour il ne connaissait à peu près rien. C’était là la manière d’espionner et trahir : pour limiter les risques, chacun savait d’où venaient les secrets qu’il apportait mais ignorait par quels chemins futurs, parmi quelles autres révélations ils arriveraient à Rome. Il se demanda s’il croiserait son relais à Gorgobina ou si celui-ci avait fui à l’annonce des dangers. Il alla d’abord à pied, sans se hâter, étant entendu qu’il n’avait pu sortir de la ville avec un cheval ou un attelage ; et il progressa hors des routes parce qu’il ne voulait pas attirer l’attention, résolu à voler une monture et suivre des axes principaux uniquement quand il serait bien loin et s’il le fallait. C’était la première fois qu’il procédait ainsi. Mais la situation était fort différente. En pays carnute, sénon ou biturige, il flairait que les insurgés, tous au fait du carnage qui avait lancé les hostilités, battaient la campagne pour arrêter les fuyards et répandre plus encore la terreur. Il aurait été suicidaire de se faire remarquer, de se laisser bêtement couper la voie par un escadron ou rattraper par des poursuivants auxquels il n’était pas assez bon cavalier pour échapper. D’ailleurs le temps ne jouait pas en sa défaveur ; au contraire, il n’avait pas à avertir dans l’immédiat des événements, souhaitait laisser la situation s’aggraver avant d’en faire le rapport à qui de droit. Si l’on y réfléchissait bien, Pompée était déjà au courant de la conjuration et il n’y avait rien de plus à lui transmettre à propos de la région que le succès du massacre dont nul à Rome ne doutait après avoir vu César quitter précipitamment la Cisalpine. Il erra plus d’un mois, vivant comme un animal, luttant contre les bêtes, dormant en plein bois, mangeant ce qu’il pouvait, détroussant les voyageurs égarés, revêtant différentes identités et avançant toujours vers le sud. À mesure que le printemps revenait, que la nature reprenait ses atours, lui devint un être farouche, transparent et ignoble. 246
Ces semaines d’errance furent chez lui le moment de deux changements majeurs. Son physique avant tout évolua lentement. Il quitta peu à peu ses habits de guerrier gaulois pour adopter ceux plus neutres d’un fugitif ni romain ni celte ni grec, vêtu de braies déchirées, d’une tunique enveloppée d’une peau d’animal qu’il avait dérobée avant de quitter Génabum. Sa moustache postiche était tombée depuis longtemps, mais sa barbe poussa et ses cheveux furent une crinière d’un brun terne qui, selon la lumière, pouvait avoir des reflets cuivrés, châtains ou très sombres. Les racines, les branches, les chicots gisants, les pierres traîtresses lui balafrèrent la peau lorsqu’il trébucha dessus. Avec son œil crevé, ses cicatrices au visage, il devint un autre, toujours insaisissable – c’était là sa seule constance – et, comme pour achever sa métamorphose, il se cassa une dent un soir à ronger le tronc d’un arbre parce qu’il n’avait pas trouvé mieux à manger. Il était un vagabond, un ermite, un carnassier, un herbivore, une créature répugnante et discrète inconnue des naturalistes. Les animaux ne le sentaient pas mais le craignaient ; les hommes ne pouvaient dire ce qu’ils avaient vu mais en étaient glacés d’effroi. Le monstre qu’on ne retenait déjà pas chez les Carnutes continuait de laisser moins de traces qu’un fantôme, même si ses méfaits demeuraient bien réels. Ses objectifs ensuite gagnèrent en démesure en même temps qu’ils s’obscurcirent. Que se passa-t-il dans ce cerveau souple mais fêlé par les événements ? Quelle sourde végétation du crime y poussa ? Sans doute l’état sauvage dans lequel il vécut transforma ses intentions. Loin de la civilisation, loin de toute compagnie humaine, des jours entiers il rumina sa haine pour César qui prit le pas sur son admiration pour Pompée. Rapidement il oublia les devoirs qu’il avait envers son champion, les ordres qu’il avait reçus. Il ne pensa plus qu’à l’ennemi de son camp qui devint son ennemi unique comme s’il le rendait responsable de tous ses maux et il s’imagina lui nuire sans plus faire valoir aucune raison politique, aucun lien de clientèle, simplement parce qu’il avait fait de cette cible le sens même de sa vie, comme un prédateur cherche sa proie et est capable de la traquer sur des distances immenses en méprisant les autres. La folle de Nicomède, le grand chauve, le bordel à soldats, il ne l’appelait plus qu’ainsi, l’insultant à voix haute, le tuant dans le vide, concentrant dans ses allusions et ses gestes tout son ressentiment et son besoin de meurtre. Ce furent au début des fantasmes de supplices dans lesquels il se complut ; bientôt, abruti par son existence nomade et criminelle, il imagina simplement l’assassiner d’un coup de poignard, fit même le pari qu’il parviendrait à le tuer d’une lame qu’il aurait reçue de lui. Seul un être multiforme et retors pourrait approcher le proconsul, gagner sa confiance, exercer ce coup de maître. 247
Il n’escomptait à vrai dire aucune récompense, aucune gloire de cet exploit. César en fait résumait ce qu’il exécrait. Il était son inverse en tous points et, enfermé dans un face-à-face imaginaire avec lui, l’espion grossissait ces antagonismes pour les rendre irréductibles au point d’en faire une insulte à sa personne. L’un était toujours entouré de ses troupes, l’autre évoluait en solitaire ; l’un était un homme de la lumière, l’autre une figure de l’ombre ; l’un avait un nom célèbre, une naissance illustre, prétendait descendre de Vénus, l’autre n’était rien que le rejeton de Stercorius, le dieu du fumier et des fosses à purin ; l’un collectionnait plus de conquêtes amoureuses que Jupiter et Zeus réunis, l’autre n’avait commerce qu’avec les cadavres encore chauds qu’il avait sous la main ; l’un enfin n’avait qu’un portrait auquel tout le monde voulait ressembler, l’autre de multiples visages pour ressembler à tout le monde. Chéréas n’avait jamais vu César. Mais on lui avait dit qu’il avait la peau laiteuse et le corps tendre, qu’il était souvent vêtu de rouge, qu’il exhalait une odeur de miel attirante. Comme un animal, il grogna, souffla, repartit de plus belle, le nom de Julius seul coincé entre ses dents. Le hasard – la chance peut-être – lui fournit enfin l’occasion de l’approcher un jour qu’il arrivait aux environs de Gorgobina. Depuis plusieurs lieues, dans les quelques clairières qu’il traversait, il avait relevé au sol des traces de cavaliers, nombreuses et fraîches, et il avait même aperçu à plusieurs reprises des figures gauloises ou romaines qui passaient fugitivement au loin dans la campagne. Il n’avait assisté à aucun accrochage et peut-être n’y en avait-il pas encore eu, mais il en avait déduit que la situation évoluait vite et gravement dans la région. L’accès à l’oppidum devait être bloqué ; les troupes de César venaient en sa direction, il le subodorait, et l’opportunité se présenterait bientôt d’atteindre la reine de Bithynie. Pour cette raison et par prudence, il avait préféré continuer d’éviter les axes découverts, même les layons, et d’avancer encore à travers bois hors de tout sentier battu. Ce fut en pleine forêt justement qu’il tomba sur un homme qui pleurait, effondré à terre. Il se cacha aussitôt et, sans se découvrir, l’observa longtemps en se méfiant d’une rencontre si étrange dans un lieu si reculé. Il eut soin de regarder autour de lui s’il n’y avait pas de piège. Mais rien ne l’inquiéta et l’homme pleurait toujours, parlant un grec d’Asie, implorant Poséidon l’Équin et l’Hermès de son pays, devant s’être perdu vu son air désemparé. Chéréas ignorait encore ce qu’il pourrait tirer de cette rencontre fortuite. Un détail le frappa cependant ; celui qu’il observait avait lui aussi l’œil crevé au côté gauche. Il sortit enfin des buissons qui le dissimulaient et l’effraya tellement en avançant vers lui que l’autre brandit immédiatement une épée émoussée 248
en sa direction. Voir surgir cet homme hirsute, le corps couvert de blessures et l’allure farouche revenait à se retrouver face à face avec un ours ou un loup menaçant. Pourtant Chéréas voulut le rassurer ; sans se présenter, il se jeta à terre en le suppliant, en exposant d’emblée qu’il était rescapé du massacre de Génabum, qu’il avait tout perdu, qu’il vivait comme une bête depuis des jours et des jours. Il ne savait vers qui se tourner, l’implorait de l’aider parce qu’il était le premier visage qu’il croisait qui ne fût pas celte. L’homme, quoiqu’en difficulté lui aussi, retrouva un peu de courage et de compassion à voir qu’il y avait toujours plus malheureux que lui. Il avait peu à manger, n’osait faire du feu de peur d’être repéré mais, sans baisser encore tout à fait la garde, il l’invita à s’asseoir et partager ses malheurs. À son tour Chéréas sanglota de reconnaissance, raconta une histoire où la vérité se mêlait aux mensonges les plus détaillés et les plus invérifiables, voulut ensuite entendre la sienne. Il était très doué à ce jeu. L’autre lui confia tout. Pourquoi aurait-il refusé d’ailleurs ? Il se nommait Eumène, était originaire de Bithynie, exerçait la profession de maquignon. Il était venu à Gorgobina vendre ses chevaux quand la guerre l’avait surpris et la cité avait été prise d’assaut par des troupes gauloises qu’il pensait sur d’autres champs de bataille. Il avait entendu parler du massacre de Génabum, mais il s’imaginait le théâtre des opérations et les dangers de la guerre loin de lui. Chéréas comprit, à ce moment de l’histoire, pourquoi il avait vu tant de cavaliers romains et gaulois arpenter la région et il frémit à l’idée que César pouvait bel et bien se trouver dans les environs. La suite lui donna raison. Les Boïens, continua l’autre, un peuple généreux et acquis à la cause de Rome, l’avaient aidé à s’enfuir car ils savaient justement le général en route pour leur territoire. Ils lui avaient donné quelques vivres, une épée, une corde et un manteau et l’avaient imploré de l’avertir de leur situation désespérée. Ils ne tiendraient pas longtemps en cas d’assaut. Malgré la faiblesse de l’oppidum, il n’y avait pas encore de combats pourtant. Les rebelles s’étaient contentés d’instaurer un siège sans vraiment attaquer et ils campaient sous les murs davantage qu’ils ne cherchaient à les escalader ou les enfoncer. Attendaient-ils le gros de leurs troupes ? Ils n’en donnaient guère l’impression et ils étaient déjà suffisamment nombreux pour fondre sur les défenses. Tout donnait plutôt l’impression que Gorgobina ne les intéressait pas en fait, qu’ils espéraient plutôt l’arrivée de César pour entamer la vraie lutte. Et c’était dans cette situation étrange d’attente qu’il s’était éloigné. Maintenant il ne savait plus où aller. Les grands axes étaient tous bloqués ; il avait un risque sur deux d’y faire une rencontre qui lui coûterait 249
la vie et, quoiqu’il connût assez bien la région, il s’était perdu dans ces forêts profondes où il s’était retiré un moment pour se reposer en sécurité. – Ton œil, demanda Chéréas sans transition, tu t’es fait ça pendant ta fuite ? – Pas du tout, non, un souvenir des pirates il y a dix ans. Chéréas l’écoutait, écoutait son histoire, mais étudiait aussi ses gestes, l’intonation de sa voix, ses particularismes bithyniens comme sa manière de rouler les consonnes, aspirer les initiales, siffler les voyelles. Et pendant qu’il l’écoutait, pendant que son corps s’imprégnait de sa marque, son cerveau travaillait. Déjà, sans qu’il n’en laissât rien paraître, le détail de sa région d’origine l’avait interpelé car il savait que César y avait passé quelques années dans sa jeunesse. Une idée lui vint, celle de se servir de son histoire pour approcher le bâtard de Vénus, de la complexifier un peu pour la rendre plus séduisante et voler l’identité de cet individu pour effacer tout soupçon. Ils avaient à peu près la même taille, la même couleur de cheveux. Il serait bon comédien ; le mois qu’il avait passé à vivre comme une bête ne lui avait rien fait perdre de son art. Il ne lui faudrait pas plus d’une heure ou deux pour tout apprendre de lui, ce qu’il révélait directement et ce qu’on apprenait de son naturel. Était-il nécessaire d’usurper son nom ? Tout autre que lui aurait pu le juger superflu mais il faut avouer que c’est ce qui faisait l’intérêt de son plan à ses yeux. De même qu’il avait été Chéréas, Éponax et tant d’autres, il serait désormais Eumène et le véritable Eumène, il l’appellerait d’un nom ordinaire. Il créait parfois son personnage, parfois l’imitait de ce qu’il avait vu au point de devenir son sosie comme jadis Mercure avait fait du malheureux esclave d’Amphitryon, comme ces mimes qu’il avait admirés à Rome la seule fois où il s’y était rendu. Quand il jugea qu’il avait assez de matière, tandis qu’il venait de se voir proposer un peu de pain et n’était plus objet de vigilance, il bondit sur l’épée posée contre un arbre et l’enfonça en pleine poitrine du véritable Eumène. Celui-ci n’eut pas même le temps de pousser un cri d’épouvante qu’il tomba et mourut. À coups de pierre, Chéréas lui éclata le visage pour le rendre tout à fait méconnaissable. Il mangea ensuite les vivres pour se donner des forces qu’il ne devrait pas montrer. Puis il monta en haut d’un chêne, regarda à la ronde le plus loin que sa vue pouvait porter. La chance lui sourit. Au bout de deux tentatives, il vit un détachement d’exploratores romains. Il descendit, se précipita dans leur direction, sa victime sur les épaules. Quand il fut sûr qu’ils arriveraient vers lui, en plein milieu d’un champ planté d’un arbre mort où il serait forcément vu, il pendit le cadavre à sa corde et eut encore le temps de griffonner, à l’aide d’un silex, un dessin obscène sur une écorce 250
qu’il coinça avec l’épée. Le détail lui semblait nécessaire parce que les Gaulois passaient pour des paillards invétérés. C’est ainsi que les éclaireurs le trouvèrent se lamentant sur une pierre près de son soi-disant compagnon. C’est ainsi qu’il se présenta sous le nom d’Eumène de Bithynie et fit passer sa victime pour un dénommé Dexios qui n’avait jamais existé. C’est ainsi qu’il suscita la compassion des soldats, parvint à s’introduire dans le camp de César, à attirer l’attention du général, à flatter son désir de supériorité en lui faisant croire que les Boïens avaient trahi et qu’il lui apportait la possibilité de déjouer leur piège pour reprendre l’ascendant sur eux. Il n’avait jamais été sous Gorgobina, n’avait jamais vu Vercingétorix dont César n’avait d’ailleurs que des portraits inexacts et confus. L’admiration qu’il avait paru éprouver pour le proconsul était feinte et se résumait à la joie qu’il avait eue d’approcher enfin son ennemi juré. On vérifia bien sûr ses dires : les éclaireurs qui l’avaient rencontré furent envoyés déterrer le cadavre de Dexios sur lequel on ne trouva rien d’autre et qu’on ne put de toute façon identifier tant son visage était abîmé ; on alla de nuit observer les remparts de Gorgobina où le siège parut étonnamment tranquille et où, en effet, aucun combat ne semblait avoir lieu ; on chercha trace des autres étrangers censés s’être enfuis aussi de l’oppidum, mais on ne découvrit rien qu’un charnier de quatre cadavres de commerçants romains qui inclina à penser qu’il avait dit vrai. Et puis on eut autre chose à faire ; on n’y songea plus. Chéréas avait ainsi réussi à retourner une situation dangereuse et sans issue en une nouvelle avantageuse dont il pouvait espérer beaucoup. Au cours des jours qui suivirent, il évolua avec la foule de civils qui campaient près de l’armée – équipementiers, vivandiers et valets, épouses illégitimes et filles à plaisir. Et quoique parmi ceux-là, il continua son entreprise de séduction, s’allia un à un les officiers de la légion, conquit définitivement César sans en avoir l’air. On le consulta d’abord de temps en temps avec d’autres, puis beaucoup et tout seul parce que ce qu’il révélait humblement était toujours intelligent et utile. Par une série d’allusions habiles, de conseils insidieux, de commandements qui n’y ressemblaient pas, il finit par convaincre le proconsul d’opérer une vaste manœuvre de contournement de l’ennemi pour l’attaquer non pas où il l’attendait mais dans son dos. César, qui avait stoppé sa marche, suivit le plan suggéré. Il envoya une délégation dans un autre oppidum des Boïens pour les informer de son arrivée prochaine à Gorgobina, les exhorter à rester fidèles et résister vaillamment. Pensant que son discours porterait dans toute la Gaule, il les enjoignit de se méfier de ce Vercingétorix qui n’avait pas hésité à trahir les 251
Romains avec qui, comme tant d’autres, il frayait au départ. Puis, si près du but, il fit brusquement bifurquer ses troupes vers le nord, ne laissa à Agédincum que deux légions et avança en longeant la Loire. Il n’arriverait pas directement sur le champ de bataille mais passerait par les territoires carnute et biturige pour éviter que l’ennemi ne vînt couper sa ligne de ravitaillement, pour créer la surprise, châtier Génabum la rebelle, fondre sur Avaricum la perle des Gaules. Et pendant que l’armée obéissait à ses ordres, Chéréas lui fournit encore des détails sur le pays, ses cités, ses habitants qu’il connaissait en vérité. Il se hasarda même à lui décrire l’atmosphère régnante avant le massacre auquel il avait échappé de justesse et César l’écouta avec beaucoup d’attention car il était le seul témoin des événements, celui qui en avait côtoyé les différents acteurs. Sans se trahir, Chéréas lui apprit alors ce qu’il savait de la conjuration et transforma la petite assemblée des chefs carnutes à laquelle il avait assisté incognito en une immense assemblée des nations de la Gaule au fond des bois. César savait bien que cela était faux, que la conjuration résultait surtout d’un ensemble d’alliances conclues de partout et liées les unes aux autres depuis des mois. Mais un homme du peuple comme le pseudo-Eumène avait l’air si persuadé, une telle image s’accordait si bien avec la littérature de son temps et les clichés colportés sur les barbares qu’il ne manquerait pas de la rapporter ainsi pour présenter le danger immense dressé face à lui. Enfin, Chéréas lui révéla la vérité sur Latro, corroborant les informations qui lui étaient parvenues depuis Ravenne, confortant la fiabilité de ses indications en même temps qu’il grandissait sa rage envers le centurion criminel. L’être vil, rampant, avait gagné. Il était entré dans l’entourage de César où il se rendait jour après jour indispensable. Il avait éloigné le risque de le voir remporter la victoire à Gorgobina, sinon mourir tué par l’ennemi en pleine gloire. Il avait surtout forcé des milliers d’hommes à repasser par Génabum où il entendait achever son action. C’était là qu’il voulait frapper son ennemi. Quel symbole ! Le frapper de son propre poignard dans la cité où la révolte avait commencé, c’était comme l’immoler à Rome où il avait lancé ses intrigues, c’était comme l’immoler au pied de la statue de Pompée ! César l’odieux mourrait dans la ville rebelle, la ville dont Chéréas, Éponax, Eumène était le maître inconnu, sur laquelle sa fourberie régnait et dont il disparaîtrait ensuite pour gagner l’éternité des espions assassins !
252
IX LES FUGITIFS
Chéréas n’était pas le seul à avoir erré dans la région autour de Génabum. Magon aussi traversa le territoire des Carnutes, une nouvelle fois. La veille du massacre, à peine revenu de la forêt d’Atis où Latro l’avait laissé pour mort, à peine remis des mirages de ce bois merveilleux et décidé à se venger, il avait, comme le centurion, quitté la ville dans la précipitation en grimpant sur une barque volée et en entreprenant de remonter le fleuve. Ce n’était pas lâcheté de sa part, mais courage, pour ne pas perdre de vue Latro qui s’enfuyait, au milieu de son carré de fidèles, en emportant Aldéa et l’orichalque. C’était même pour se battre, un contre tous s’il fallait, et récupérer ce qui était la richesse de sa vie. Car Magon tenait à ce qui était plus pour lui qu’un simple métal et un bout de bois précieux et il aimait – pourquoi avait-il tant tardé à se l’avouer ? –, il aimait, comme jamais il n’avait aimé, celle qu’il considérait sa moitié sans même qu’une cérémonie de mariage la lui eût donnée. Le bâton était tout son passé, transmis par sa famille et à travers elle son peuple disparu ; la femme incarnait son avenir et peut-être ce qu’il transmettrait à son tour à des enfants. Après le vol, après le rapt, toute idée de vengeance personnelle avait disparu. Il ne pensait plus aux coups de poignard qu’il avait reçus ; c’était pour l’objet qu’il affectionnait, c’était pour l’être qu’il adorait qu’il s’était élancé. Pour eux, pour les récupérer, il aurait pu aller au bout du monde connu. Parviendrait-il à rattraper les fugitifs ou était-ce folie téméraire de sa part ? Il ne pouvait répondre. Mais, ce qu’il savait, c’était qu’il pourchasserait Latro et Latro serait pisté inlassablement, comme le gibier qu’il avait si souvent fait chasser au fin fond du pays. Il joua des rames toute la nuit, sans aide ni soutien, à contre-courant d’un fleuve dont le débit était particulièrement fort ce soir-là, bien plus fort que lorsqu’il avait longé la rive à l’automne en revenant de chez les Namnètes. Les eaux coulaient en un régime torrentiel qui emplissait les oreilles d’un bruit confus effrayant. De toute évidence la pente du lit était plus accentuée et la remonter était d’autant plus difficile que le vent
soufflait du nord-est, qu’il recevait de face. La Loire était nerveuse, dangereuse et très belle. Quand les nuages se dissipaient, les reflets de la lune exagéraient les mouvements de son eau qu’ils amplifiaient de vagues distorsions à sa surface comme une armée silencieuse, couleur de bronze et d’argent, contre laquelle il fallait avancer. Il n’était pas habitué à naviguer ainsi, encore moins seul et de nuit, ne s’y était jamais risqué auparavant. Les obstacles d’ailleurs étaient nombreux et, s’il évita les plus gros, il fut ralenti chaque fois par les plus minces qu’il ne voyait pas à travers le brouillard et qui venaient trop vite cogner sa coque, manquant de lui faire perdre l’équilibre en l’effrayant. Dans la débâcle, c’étaient des glaçons ronds et plats, gros comme des boucliers, qui s’entrechoquaient, tournoyaient sur eux-mêmes, coincés entre les îles les uns parmi les autres avant d’être emportés par le courant ; c’étaient aussi des branches pointues comme des lances, des bouts de bois solides comme des béliers, des masses informes comme des charognes ou des débris d’armures jetés en amont par une troupe de fantômes. Et la barque s’empêtrait toujours dedans, à moins qu’elle ne tapât directement contre eux. En ces momentslà, Magon cherchait instinctivement du secours en direction de la rive ; mais d’un côté comme de l’autre, le paysage était désert, couvert de forêts et noyé de silence. Il n’y avait rien non plus sur son embarcation pour soulager sa peine. Scythès, qui lui avait dégoté cette barque, en avait pris une petite sans vivres ni couvertures à l’intérieur. Il ne ressentit cependant ni le froid ni la faim. Trempé par les éclaboussures des chocs, il rama si longtemps que la paume de ses mains, piquée d’ampoules et de plaies, finit par le brûler tandis que les muscles de ses bras lui donnaient l’impression de devoir se décrocher de ses épaules. Il fit un tel effort, puisa dans toutes les ressources de son corps au point que son estomac, malgré les heures qui passaient, ne se manifesta jamais à sa conscience. Lancé ainsi, on est capable d’aller très loin et il continua, même s’il craignait le moment de rupture qui arriverait tôt ou tard, en pleine action ou lorsqu’il accosterait enfin et que son corps céderait, brisé de fatigue et réclamant à manger comme un arc bandé dont le danger vient toujours de la corde qui casse et le rend inutile. Cependant il fallait avouer que l’entraînement d’Atis avait porté ses fruits. Jamais auparavant il n’aurait pu soutenir une telle distance et si les exercices auxquels il s’était livré ne visaient pas au départ à ce genre d’exploit, c’était bien là quand même une manière d’honorer Calroë. Mais cet honneur inattendu, cette pratique singulière trouvait encore sa raison d’être en la personne d’Aldéa. La jeune femme était l’objectif concret, la Déesse la fin intangible d’une même tension de son corps et son esprit. Et 254
il pensait à la maîtresse de Samogaion, brûlait de la retrouver, de la délivrer sans connaître encore son histoire ni la manière dont Latro l’avait faite prisonnière. Elle était dorénavant le but même de son existence, il en était convaincu. La revoir l’espace d’un instant lui avait redonné tout son courage et lui avait fait comprendre que l’aimer ne suffisait pas, qu’il voulait lui être dévoué. D’ailleurs prendre tous ces risques, donner sa vie pour celle qu’on aimait sans savoir même si elle aimait en retour, c’était là encore le sens du culte auquel il avait été initié. Et comme il y pensait, quelque chose lui intimait l’idée que Calroë n’était pas morte, qu’elle ne mourrait jamais en réalité, que cette biche qui s’accordait à Atis mué en cerf n’était qu’une enveloppe animale et non l’être propre de la Déesse sans doute éternelle et invisible aux profanes. Même, il sentait sa présence évanescente et pourtant bien réelle quelque part autour de lui, quelque part en lui, comme si elle l’eût suivi en dehors de ses bois. Jamais autrement il n’aurait pu, intellectuel malhabile et chétif qu’il était, endurer des efforts si extraordinaires. Le plus sceptique pouvait en convenir : son avancée tenait du miracle. Il aurait juré pour sa part qu’il était poussé dans le dos et il s’en étonnait. Il ramait. La Loire était constellée d’obstacles et, comme si de rien n’était, ses pensées alternaient au rythme des coups de rame dans l’eau. Aldéa n’était pas l’unique objet de ses réflexions. Il se représentait l’un après l’autre ceux qu’il n’avait pu sauver et qu’il aurait dû – ses parents jadis, Anéroeste et Atis récemment ; il songeait à ceux dont l’avenir était en suspens – Asinus qu’à tourner et retourner ses dernières paroles il pressentait en danger et Dagios contre qui il n’avait nulle rancune –, se demandant quel serait leur sort et s’il lui serait donné de pouvoir les aider à leur tour. Mais à aucun moment il n’imagina les rejoindre. Il était tout entier tourné vers celle qu’il aimait ; toujours infailliblement il en revenait à elle et son image, captive ou libre, se confondait étrangement avec celle de Calroë entrevue au bord de la source sacrée en cet instant unique avant que la forêt merveilleuse ne disparût. Le souvenir d’Aldéa demeurait fixe ; la ligne troublante de la Déesse s’évoquait dans ses yeux et s’y ajoutait. Il revoyait leur corps sublime où la chair désirable le disputait à la simplicité de vie, la grandeur des arbres et des astres et il croyait voir l’une à l’horizon, éphémère et souriante, derrière le visage de l’autre auquel elle s’accolait pour mieux se confondre avec elle. Des murmures traversèrent le rideau de la nuit qu’il attribua au frissonnement de l’eau. Peu avant l’aube, le fleuve sembla se calmer. Il y eut moins d’entraves flottantes, le courant parut s’adoucir. Il fut encore facile de ramer et la barque avança même plus vite, rattrapant son retard sur la course modeste de Latro. Magon ne douta plus qu’il le reverrait bientôt et se souvint qu’il 255
y avait aussi un peu de la Divona qui coulait dans cette eau trouble. Alors il s’aperçut qu’à aucun moment il n’avait songé aux dieux de son pays. Latro d’ailleurs n’avait pas mieux progressé en raison de la lourdeur de ses embarcations surchargées. Pour être plus discret il n’avait pas choisi de grands chalands mais des navires de petit cabotage qu’il avait emplis d’une marchandise nombreuse. Les fuyards et leur poursuivant n’étaient ainsi éloignés que de quelques stades seulement et, parce que l’on n’avançait pas aussi vite qu’on l’eût voulu, à bord des trois bateaux du centurion qui se succédaient à intervalles réguliers, l’atmosphère resta elle aussi pesante, même une fois loin de Génabum. Le Libyen n’avait emmené que ses sbires, ses fidèles si tant est que des hommes comme eux connussent la fidélité. Ils étaient dix qu’il avait tous recrutés parce qu’ils étaient tous malhonnêtes et de sa région. La quatorzième à laquelle il appartenait comptait en effet un contingent assez fort de Cyrénéens, de Nasamons et de Psylles mêlés à d’autres ressortissants des provinces de l’empire. Parmi ceux-là, le centurion avait pris soin de ne choisir que la lie de la légion, les physiques les plus vils, les cœurs les plus laids pour s’associer ceux qui n’avaient aucun honneur et feignaient d’en avoir beaucoup. Un soldat en campagne est toujours malhonnête et violent ; eux auraient mené la guerre même dans les déserts maudits où ils avaient vu le jour. Certains accompagnaient Latro depuis le Pont, la Judée ou l’Hispanie, d’autres depuis les Gaules seulement. Conscrits, corvéables ou vétérans, tous avaient été corrompus par lui et de la même manière. Ils s’en étaient d’abord rapprochés parce qu’il était leur compatriote et que dans une légion de plusieurs milliers de recrues on cherche toujours le pays qui nous ressemble. Du reste, pour des raisons évidentes d’efficacité, de solidarité et d’obéissance, la hiérarchie favorisait souvent le commandement des hommes par un centurion de même origine. Puis Latro les avait protégés à plusieurs reprises, de l’ennemi au combat et surtout des officiers au campement, quand ils avaient commis un impair. Il s’était arrangé pour qu’ils eussent ainsi à son égard une dette première. Cette dette, classique, s’était par la suite aggravée chaque fois qu’ils avaient fauté en faction et un soldat faute nécessairement quand il est loin de chez lui. Il y avait bien des failles dans la discipline et beaucoup de tentations. Latro savait tout, avait des yeux partout ; on ne pouvait rien lui cacher parce qu’il était de la même trempe abjecte que ses hommes. Il couvrit ceux qui sortaient du camp sans en avoir l’autorisation, ceux dont les armes n’étaient pas entretenues, ceux qui buvaient, ceux qui ne pratiquaient pas l’exercice, ceux qui se battaient mollement, ceux qui réquisitionnaient à leurs fins, ceux dont les propos confinaient à la 256
mutinerie ou la désertion. Il leur fit éviter le fouet, la mort, l’exil infamant. En revanche il les battait fort, y cassait son cep de vigne qu’il remplaçait aussitôt – ce qui lui valut son surnom fameux d’Encore un. Mais si dure qu’elle fût, la punition restait entre eux. Tous lui en étaient reconnaissants, de cette sorte de reconnaissance mêlée de jalousie, de méfiance et de rancune. Dès lors ils adoptèrent ses manières d’agir sur le terrain. Car il avait déteint sur eux tant il est dit qu’un supérieur, bon ou mauvais, déteint toujours sur une nouvelle recrue. Face à de plus faibles, Latro les avait poussés aux pires méfaits en leur faisant miroiter des promesses de richesse et leur permettant d’expédier en Cyrénaïque de petites rapines qui n’étaient rien en comparaison de ses gains propres. Il n’avait guère fallu les contraindre à piller, violer, massacrer en discrétion. Tous y avaient consenti de bonne grâce comme si ce fût là leur nature cachée et parce qu’ils avaient l’impression de s’enrichir plus encore que les butins autorisés le permettaient. Ils adulèrent leur chef sans même savoir si leurs envois parvenaient bien dans leur province, au-delà de la Méditerranée, et, dans leur aveuglement, aucun ne vit qu’il était tombé dans le piège de se lier à la vie à la mort à l’un des plus indignes officiers subalternes de César. Les tombés à la guerre, les nouveaux appelés ne changèrent rien. Sur une centurie de médiocres, ils furent un dixième de crapules dont la formation avait été entamée longtemps avant et s’accrut quand on délégua à leur chef la protection de l’approvisionnement à Génabum. Au reste, le système que Latro avait instauré, tant d’autres l’avaient fait, continuaient à le faire ou le feraient après lui. À ces dix soldats partis en bateaux, il fallait ajouter un nombre légèrement supérieur de civils et d’esclaves minables qui s’étaient abouchés avec eux et les accompagnaient. Ces civils, ces esclaves, c’étaient des marchands de tout qui ne vendaient rien et rêvaient de fortune, des créatures qui étaient des pantins forcenés plus que des êtres doués de conscience. Ils étaient du même bois vert qu’Asinus, du même chiendent increvable, sans les velléités d’indépendance et d’hégémonie qui le caractérisaient néanmoins et avaient toujours empêché Latro de se rapprocher de lui. Exactement comme il ne rançonnait que les petits propriétaires, le centurion ne s’entourait que de soldats du rang et de commerçants de peu qu’il pouvait contrôler et qui lui devaient tout. Il les avait emmenés en pensant que plus nombreux, ils seraient plus forts pour traverser le pays et que leur fuite paraîtrait d’autant plus crédible auprès des autorités romaines. Par chance, l’un d’entre eux avait déjà navigué sur la Loire et savait, même dans l’obscurité, se repérer aux paysages en plus 257
des étoiles. Cela compensait le caprice des vents qui d’ordinaire soufflaient de l’ouest mais venaient ce soir en sens contraire. Ces hommes, il fallait les voir sous la pâleur de la lune, assis à flanc de bateaux, crachant dans l’eau et regardant leur crachat disparaître dans l’ombre. Ils étaient six ou sept par embarcation, entre les amphores et les sacs qu’ils avaient chargés et qu’ils surveillaient parce qu’il y avait aussi un peu de leur butin à l’intérieur. Les lueurs nocturnes ajoutaient à leur mine patibulaire, leur silhouette louche, leurs mains graciles et redoutables à la fois. Ils avaient gardé leurs vêtements, même leur casque et leurs armes, qu’ils prirent néanmoins soin d’abîmer et déchirer en les frappant au bastingage. Mais ce qui fut proprement stupéfiant, ce que nul n’aurait compris à moins d’être informé de leur plan, ce fut lorsqu’ils se donnèrent des coups de poing, mesurés et précis, au visage et au torse et se tailladèrent légèrement les bras de leurs lames. Puis ils s’installèrent pour la nuit dans un silence absolu, tous feux éteints. Étrangement une hiérarchie s’instaura. Les civils, quatre à cinq par navires, ramèrent péniblement, usèrent des perches pour se garder des obstacles et les soldats, trois par trois, l’œil fermé à moitié, accablés de fatigue, veillèrent en se relayant tour à tour. Ils craignaient les bancs de sable invisibles, les navires qui viendraient à leur rencontre et surtout les attaques. Mais la Loire était haute, ce n’était pas la saison de l’étiage et aucun autre chaland ne circulait par cette obscurité. Sur les rives en revanche, la végétation formait des masses sombres qui les empêchaient de haler les bateaux. Le trajet n’était plus aussi linéaire. Il dessinait des replis sinueux semés d’îles dont il fallait se méfier car ils ralentissaient nécessairement la course et entraînaient des pièges. Des centaines d’yeux pouvaient les observer, tapis dans le noir, derrière les saules et les frênes. Les soldats savaient les Gaulois capables de les avoir suivis discrètement depuis la rive, attendant l’endroit idéal, le moment d’inattention où ils lanceraient un assaut et, chaque fois qu’ils y pensèrent cette nuit, leurs frissons d’épouvante se transmirent aux civils qui naviguaient avec eux. Le fleuve était irrégulier, impétueux, sauvage comme les barbares. Ils se demandaient où et quand ils accosteraient, s’ils ne seraient pas rattrapés sitôt le pied posé à terre. Tous se désolaient que leur bateau ne fût pas plus rapide. Le gréement était inutile et ils n’osaient ramer plus vite de peur d’être repérés. Les reflets des arbres dans l’eau s’allongeaient jusqu’à eux, semblaient les rattraper comme des griffes de chauves-souris. L’horizon du fleuve, plus clair, parut toute la nuit se rétrécir au loin et les enfermer dans une obscurité galopante venue de chaque côté. Certains alors évoquèrent la créature anguipède de l’eau, celle qui ne sortait que la nuit 258
et dévorait les pêcheurs attardés. Des légendes disaient qu’elle naissait du courant et des vagues, qu’elle dorait sa queue de serpent sous la lune, qu’elle avait les cheveux visqueux et longs comme des filaments de renoncules flottantes. Sur la première embarcation, Latro, quant à lui, était resté à la proue avec Atia, sa femelle chacal. La bête était silencieuse, ses oreilles triangulaires et fines dressées ; l’homme avait son regard fixe droit devant, convaincu du massacre de Génabum au petit jour, soulagé d’y avoir échappé de justesse et méditant la suite de ses projets. Comment esquiver l’ennemi dans un pays où la guerre venait d’être rallumée ? Comment revenir vers sa troupe sans avoir l’air d’un lâche ? Il avait organisé une désertion de vingt hommes dont il était censé avoir le commandement et devait penser à la délicate manœuvre de les ramener vivants pour les réintégrer dans l’armée ou à sa suite. Non pas qu’il se souciât réellement de leur sort, mais il savait que le leur et le sien étaient liés dans l’épreuve. Son plan à vrai dire était simple et c’était le seul qu’il avait pu concevoir. Il prévoyait tout bonnement de se replier vers l’est – comme Chéréas mais pour de tout autres raisons –, de se diriger vers les légions d’un légat de César et d’emprunter finalement la même route que les navires qui montaient et descendaient régulièrement le fleuve pour approvisionner l’armée. Là-bas il avouerait, non pas qu’il avait fui le massacre, mais qu’il avait réussi à épargner ses hommes quand l’ultime carré de combattants s’était trouvé encerclé, acculé en bord de Loire et repoussé jusqu’au port. Il justifierait d’avoir économisé tant de vies en se présentant comme celui qui avait défendu jusqu’au bout et évacué jusqu’au dernier les civils. Ces civils, c’étaient les misérables qu’il avait emmenés avec lui, que seuls des soldats dévoués au point de renoncer à mourir dans la gloire pouvaient accompagner dans un territoire si hostile et qui seraient sa caution d’honnêteté. Il prétendrait avoir permis leur courageuse protection, tairait toute lâcheté de sa part. Les Romains aimaient les héros de ce genre, qui n’avaient pas péri comme leur honneur l’ordonnait parce qu’ils avaient tout sacrifié, même l’éclat d’une mort illustre, pour sauver leurs compatriotes et avaient survécu. Peut-être même récolterait-il une récompense ou une distinction. Il était persuadé que cela pouvait marcher, avait du reste pensé à tout. Il avait ordonné à ses hommes de détériorer leurs armes, leurs vêtements, de s’asséner quelques coups pour donner le change. Auparavant surtout il n’avait fait emporter que des denrées périssables – du grain, du vin en plus des reliefs de son commerce animal – afin de manger à leur faim et faire croire qu’ils avaient largué l’amarre sans regarder la marchandise. Pour expliquer son butin si l’on venait à le questionner, il dirait que les bateaux 259
étaient déjà chargés quand ils avaient sauté dessus et il calculait qu’en étant bon comédien, on lui laisserait chaque amphore, chaque sac en récompense de son acte de bravoure. Pour ses supérieurs, de rang équestre ou sénatorial, ce n’était que trophées de chasse et trésors dérisoires. Pour lui c’était beaucoup et il n’aurait pas tout perdu, pourrait même s’en sortir avec profit s’il gardait la main dessus et les envoyait comme à l’ordinaire jusque chez lui avant d’aller sévir ailleurs avec l’armée. Pourtant un point l’inquiétait dans la bonne exécution de ce plan. Les légions les plus proches étaient éloignées d’au moins deux cent mille pas ; il redoutait d’être rattrapé par les Gaulois bien avant. Surtout il savait qu’il ne pourrait naviguer au-delà de Sauliacum ou Divomagum puisque c’était de là qu’il rejoindrait au plus court la voie terrestre qui le mènerait en sécurité. Il regrettait de devoir débarquer au petit jour ; le bateau était pratique pour faciliter le transport, limiter les risques d’attaque et, dans la précipitation du départ, il n’avait pas eu le temps de prévoir des attelages pour la suite du périple. Mais il n’avait pas d’autre choix ; poursuivre sur la Loire vers le sud l’aurait fait revenir en pays biturige, aux confins des Arvernes en qui il n’avait aucune confiance. Même les Éduens paraissaient suspects à ses yeux. Il préférait la légion. Sa situation était assez louche, mieux valait revenir directement vers elle que donner l’impression de fuir en se cachant chez des tribus barbares, y compris celles qui étaient alliées ou neutres. Une fois sur la terre ferme, il leur faudrait rejoindre la route d’Agédincum, une route de premier ordre, autrement dit la route de tous les dangers. Il faudrait quitter au plus vite le territoire des Carnutes dont le bourg d’Igoranda marquait la frontière, s’enfoncer dans l’ancienne forêt des druides, entrer enfin sur le territoire des Sénons. Là était le salut à condition que ce peuple, tenu en respect par les légions qui hivernaient sur ses terres, n’eût pas versé dans la révolte comme à l’époque d’Acco. Les nouvelles allaient vite d’une tribu l’autre. C’était là sa crainte, qui le poussait à ne pas même débarquer dans les localités portuaires sénones et à passer au plus loin de Vellaunodunum, le grand oppidum qu’ils approcheraient sur leur chemin et dont il se méfiait. Enfin, il voulut être optimiste : sans doute avaient-ils semé d’éventuels cavaliers qui guettaient des fuyards à cheval ou à pied dans la campagne avant le massacre et, de tout leur trajet sur le fleuve, ils n’auraient pas de pont sous lequel passer. Il n’y avait pas de raison que la fortune les abandonnât désormais. Pour se ragaillardir, il quitta soudain la proue, se dirigea au fond du bateau, accompagné toujours de son chacal qui laissait filer dans le noir son pelage gris rougeâtre effrayant. À un anneau de fer était attachée sa captive, Aldéa, chevilles et poignets liés, ses bras bleuis de coups rejetés en 260
arrière. Il ne s’en était pas débarrassé, avait voulu la garder avec lui malgré l’urgence de la situation, rêvant d’en faire son esclave future, persuadé qu’elle ne parlerait pas et que sa présence accréditerait sa version des faits auprès de la légion. Elle est échevelée, affaiblie et pourtant toujours aussi belle. Il lui retire le bâillon qu’il lui a imposé pour l’empêcher de hurler tant qu’ils n’étaient pas éloignés de la ville. Elle toussote, manque de s’étouffer, joue de sa langue que le tissu a écrasée trop longtemps. Ses yeux sont bouffis de sommeil, des larmes ont gonflé ses paupières et pourtant, comme elle élève le visage, ses pupilles brillent dans l’obscurité. Elle a le même regard que tout à l’heure, que les jours précédents, où la détresse le dispute à l’expectative, et la faiblesse à l’orgueil. Il l’a considéré, ce regard, sous tous les cillements ; il en est obsédé, croyant savoir le lire et, mieux, l’interpréter. Mais il se méprend en pensant que ce n’est pas celui de la colère, que ce n’est pas celui de la haine, que c’est quelque chose de plus fort encore, de si paradoxal au plus profond de la colère et de la haine qu’il s’apparente à de l’attirance et de l’envie. Penché auprès d’elle, il se croit autorisé à l’embrasser. Avec l’aplomb du paillard il lui prend les joues entre les doigts de sa main, lui arrache un baiser goulu, saliveux, immonde. Elle l’a vu venir, l’insulte dans sa langue, avance les dents pour le mordre, incapable de rien faire d’autre. Elle se laisse embrasser malgré elle. Elle aurait pu fermer la bouche, tourner la tête, mais épuisée, terrorisée, paralysée par la fatigue et la peur, elle ne le fait pas et accepte l’ignoble contact des lèvres. Les insultes se taisent, toute résistance est vaine. Le bourreau ce soir a gagné. Il la contemplait, comme s’il avait enfin résolu ce qu’il ferait d’elle : – Tu es très belle, dit-il, et toute à moi. Elle était belle en effet. Pourtant elle avait tout perdu depuis le matin où le gras Taurillos avait fait irruption à Samogaion. Sa ferme avait été rasée, ses terres dévastées, ses gens chassés et, sans l’appui d’Anéroeste assassiné, elle s’affligeait tant les événements allaient de mal en pis. Elle tombait de Charybde en Scylla. D’abord spoliée et prisonnière, elle avait été donnée comme une vulgaire esclave à un Romain qui l’avait privée de la lumière du soleil des jours durant et l’avait embarquée, tel un objet, au milieu des chargements de peaux, de viandes séchées et de sel une nuit. Enchaînée, muselée, isolée contre le bastingage, elle était maintenant chosifiée. Elle avait tout perdu, même les réconforts du cœur. Après son père et ses amis, elle en était venue à désespérer de Magon en qui elle avait cru un temps et qu’elle avait pensé aimer – il fallait le reconnaître. Le jeune médecin qui avait eu le béguin pour elle quelque soir avant de partir, cet 261
étranger, si beau, si intelligent fût-il, avait dû l’oublier. Elle ne pouvait penser autrement. Son sens pratique, si paysan, s’insurgeait contre la possibilité qu’il voulût encore la retrouver. Qu’aurait-il eu à y gagner ? Pourquoi aurait-il risqué de revenir alors qu’elle n’avait plus rien à lui offrir, qu’il n’était pas du même pays, que l’attaque de sa ferme prouvait que la paix n’était pas imminente ? C’était tout bonnement inimaginable. Le seul être dont elle endura la présence fut Latro, hélas. Des nuits entières, enfermée seule avec lui, elle l’avait observé, honni, trouvant quelque réconfort en aimant le haïr. La haine est saine, la haine est simple, la haine est superbe et c’était par cette haine élémentaire qu’elle avait survécu. Dans le secret de sa hutte, le centurion ne la nourrissait que d’un peu de pain et d’eau croupie et elle le haïssait de plus belle. Il la battait, l’humiliait, laissait son chacal pourlécher ses seins nus et elle le haïssait plus encore. Il avait porté sur elle son envie, l’avait touchée et, quoiqu’il ne fût allé plus loin, elle le haïssait pour l’affront envers la femme qu’elle était et l’intégrité préservée en son for intérieur qui la distinguait tant des médiocres autour d’elle. Elle le haïssait, elle le haïssait, sans cesse et toujours. Mais ce soir-là, toutes ses forces l’abandonnèrent et son corps disait à quel point elle était brisée moralement. Seule au milieu de ces types, loin de chez elle, face à ce monstre enveloppé dans le noir, elle sentit qu’elle ne pourrait rien lui refuser et pria l’ensemble des déesses qu’il n’eût pas l’idée subite de la violenter, là, sur le bateau, à la vue de tous car elle ne pourrait résister et subirait un outrage dont seule la mort la délivrerait. Elle était à sa merci ; il n’aurait eu qu’à se dévêtir pour la prendre de force. Sa prière dut avoir quelque résultat néanmoins. Latro, qui pensait en même temps aux dangers du périple, quoiqu’excité par le baiser abject qu’il avait obtenu, se contenta de poser sa main sur la jambe de la jeune femme, de la faire remonter au pli de ses cuisses. Il s’était allongé auprès d’elle comme s’ils fussent sur un lit que le tangage du fleuve ballottait doucement. Il appuya soudain sur l’objet de ses désirs, du plat du pouce. Aldéa ne put se débattre, bougea seulement en un mouvement illisible. Il en sourit de satisfaction et, contre toute attente, se mit à lui chuchoter à l’oreille en latin : – Je vais bientôt quitter la légion, ma beauté. Pour un congé définitif, dans moins d’un an si tout va bien. Le temps que les choses se calment et que mon service arrive à son terme. Le vent, faible, suffisait à couvrir ses paroles prononcées à voix basse. Il lui caressait les lobes de ses lèvres, humait ses bras et ses épaules de son nez, avait toujours sa main posée sur son entrejambe. Elle ne fit aucun geste, ne roula pas même les yeux, prise dans une léthargie d’abattement. 262
Il continua d’une voix flûtée, lui mangeant presque l’oreille tellement il y collait encore sa bouche dont elle sentait l’haleine chaude descendre dans son cou comme le Libonotus quand il souffle des braises : – Après je retournerai d’où je viens, c’est-à-dire du néant. Je ne veux pas du lopin qu’on donne aux vétérans ; je l’ai déjà dans mon pays, cent fois plus vaste. Ce pays, ma chérie, tu ne peux pas savoir ce que c’est. C’est très loin d’ici, à des mois et des mois de bateau et puis, après la côte, c’est encore loin à l’intérieur des terres, là où la civilisation s’arrête et où commence la fin du monde connu. C’est tellement différent d’ici. Ces arbres, ces fleuves, ce ciel… Là-bas, ce n’est que dunes de sable, lits asséchés, vents brûlants et, au milieu, quelques cités malheureuses isolées. C’est…tiens ! C’est comme une peau de léopard avec de vastes étendues ocre de déserts et des taches éparses d’occupation humaine. L’être infâme pointa l’amont argenté du fleuve, là où l’horizon que n’obstruaient pas les forêts gardait un pan de ciel clair. C’était à peu près la direction de l’Afrique et il eut, en élevant le doigt, un geste gracieux. Il s’était fait presque poétique à son évocation si bien que la femelle chacal, couchée près de lui, grogna à l’entendre parler. Elle n’appréciait pas ses moments de douceur. On l’eût dite jalouse de voir son maître étendu aussi près de cette femme pour rêver avec elle. Mais Aldéa ne rêvait pas, elle cauchemardait. La mention de ces déserts la terrifiait et même l’image du léopard ne la réconfortait pas puisqu’elle ignorait de quel animal il s’agissait. Il ne parut pas le voir cependant, continua la description de son pays. Le chasseur qu’il était s’était excité à son propre discours et le relief, le climat qu’il avait évoqués le menèrent logiquement à parler de la faune dont il dressa un catalogue homérique en descendant la peau blanche de sa captive, de ses poignets ligotés à ses aisselles mises à nu : – Mais ne te méprends pas, ma jolie. Ma Libye, toute plaine sablonneuse qu’elle est, est plus grande que ta Gaule parce qu’elle est bien plus riche en animaux sauvages que ces forêts qui pourtant ne déméritent pas. Oh, bien sûr !, il faut traquer la bête, marcher beaucoup pour la débusquer car elle ne vit pas toujours dans le même milieu. Mais quand on y est, quand on la trouve ! Ce sont des serpents gigantesques, des lions, des éléphants, des ours, des aspics, des ânes cornus, des gazelles à la croupe blanche, des chevreuils, des antilopes, des autruches, des bubales, des ânes, des oryx de la taille d’un bœuf, et des renards, et des hyènes, et des béliers, et des panthères, et des crocodiles terrestres, sans oublier les chacals comme ma belle Atia. En entendant son nom, le chacal se refit docile et baissa la tête comme si elle lui réclamait une caresse. 263
– Il n’y en a que deux qu’on ne trouve pas : les cerfs et les sangliers. C’est pour ça que j’ai mis tant de hargne à les chasser par ici. Flattant son animal du plat de la main, il se perdait dans ses pensées, songeait à son propre système de chasse et d’envoi des trophées, se parlait à lui-même : – Inutile de préciser la fortune que réaliserait celui qui emmènerait tous ces animaux à Rome non pas comme aujourd’hui mais de manière organisée, systématique, professionnelle, quoi. Il s’arrêta soudain, regarda autour de lui. Et sans transition : – J’ai un cousin à Rome, dit-il, c’est lui qui depuis des années prépare mon retour. Il possède des bateaux à Ostie, voyage souvent entre Nice et Apollonia. Depuis que je suis chez vous, les sauvages, c’est à lui que j’ai envoyé mes trésors pour qu’il les achemine jusque là-bas. En plus de quinze ans de campagnes, j’ai amassé de quoi faire pâlir un bourgeois de Cyrène, moi le fils de nomade, le moins que rien ! Et j’ai fait construire un palais, quelque chose de modeste, une villa perdue dans une oasis au milieu du désert. Il me tarde d’y aller parce que je sais qu’elle doit être magnifique. J’en ai reçu un jour les plans. Il avait l’air si convaincu, si enthousiaste, si ridicule aussi à rêver son projet chimérique dans cette nuit de toutes les lâchetés et de tous les dangers qu’elle ne put s’empêcher de tourner enfin la tête et de briser ses illusions pour lui faire mal : – Peuh ! De l’argent pour un mirage et de vulgaires dessins. Est-ce qu’au moins tu es sûr qu’il ne t’a pas trahi, ton cousin, qu’il n’a pas tout gardé pour lui ? Tu es un voleur et les tiens le sont sans doute également. Il ne s’arrêta pas à l’insulte, parut tout à coup frappé d’un doute. Il venait de penser à ses hommes dont il ne savait si le butin qu’il leur avait maintes fois fait envoyer en Afrique était bien arrivé et il craignit soudain pour le sien. Il attrapa de nouveau Aldéa mais avec une brusquerie qui disait l’agacement subit qu’il peinait à dissimuler. Dans l’obscurité, son visage mince s’épaississait sous une barbe très brune où l’on ne distinguait que ses petits yeux jaunes brillants et son nez pointu comme un museau. Il avait quelque chose du chacal qui l’accompagnait toujours et la bête à ses côtés avait quelque chose de l’homme qu’elle suivait partout. Ses mots perdirent soudain leur timbre aigu et mélodieux ; il aboya d’une voix basse et rauque : – J’en suis sûr, c’est tout. Ne t’avise pas, sale garce, de m’en faire douter. C’est un cousin, un homme de ma tribu, de mon sang. Il ne peut pas me trahir. Il m’envoie chaque fois la preuve qu’il a bien reçu la marchandise que je fais acheminer et m’en envoie une autre pour m’informer qu’elle est bien arrivée en Libye ou qu’elle a été échangée contre de l’argent et 264
réinvestie là-bas. Je suis allé une fois à Nice le voir, m’assurer que tout allait bien. Et crois-moi, tout allait bien. C’est ça, tu sais, l’avantage de l’empire de Rome, de la civilisation : on construit des routes pour que les puissants deviennent plus puissants et s’enrichissent à des centaines de milles de distance. Il se leva, alla chercher un petit coffre plat et long qu’il avait emporté et gardé près de lui sous un banc, à la proue du bateau. Le coffre avait l’air ordinaire, mais il prit toutes les précautions en le soulevant. Il jeta un œil sur ses compagnons occupés à veiller, ramer ou abandonnés à l’inquiétude de leurs rêves. Il ne put s’empêcher de l’ouvrir, sans doute encouragé parce qu’au milieu du fleuve, loin de l’oppidum, il se sentait en sécurité et ne savait s’il pourrait contempler de nouveau, une fois sur la terre ferme, le trésor qu’il renfermait. À peine eut-il soulevé le couvercle qu’une lueur étrange en émana qui fit courir un reflet extraordinaire et très doux sur son visage. On eût dit l’éclat léger d’une étoile qui aurait filé non pas dans le ciel, mais dans l’air au ras du bateau. – Tu peux japper en vain, jolie chienne. Quand bien même j’aurais tout perdu, dit-il les yeux rivés sur l’objet mystérieux, ce trésor-là devrait de toute façon me rendre riche. Et il le tira discrètement du petit coffre, protégeant sa vue du couvercle, n’en réservant la jouissance qu’à eux deux. Aldéa eut un mouvement. Elle n’avait pas encore vu ce qu’il tenait soigneusement dissimulé quand il logeait dans sa hutte à Génabum. Mais ce bois, cette taille, ces dessins tout autour, et surtout ce métal luisant ! Il n’y avait aucun doute, elle venait de le reconnaître. – Le bâton de Magon !, s’écria-t-elle en celte, en s’étonnant de le retrouver après tant d’événements. La caisse renfermait en effet le bâton du Maltais, et l’orichalque. Aldéa en resta interdite. Sans qu’elle pût s’expliquer par quelle coïncidence insensée l’objet se retrouvait devant elle, sans qu’elle pût décider si c’était là le signe d’un bonheur ou d’un malheur, c’était toujours un peu du jeune homme qui lui revenait et qui l’accompagnerait pour la réconforter dans l’adversité. Elle revit les quelques jours qu’il avait passés dans sa ferme sans quitter son bâton ; elle revit la nuit où il avait sauvé les siens en fuyant jusqu’aux Pierres Rouges et où, assis sur un rocher, il avait consolé un enfant en lui en présentant les motifs colorés ; elle le revit enfin s’éloignant au petit jour avec Atis après lui avoir promis de la revoir. Ce ne pouvait être qu’un signe des dieux… Ce bâton, soudain elle le regarda avec émotion, aurait voulu le tenir entre ses mains tout le temps pour se sentir moins seule. Étrange ironie du sort que le seul espoir qui lui restait résidât dans l’objet volé à celui qu’elle n’avait que trop peu connu. 265
Mais quand elle eut crié, Latro se prit à l’observer. Lui aussi essaya de comprendre par quel hasard fou elle connaissait cet objet, se demanda si c’était bien de l’homme à qui il l’avait arraché qu’elle avait prononcé le nom. À vrai dire, ce bâton unique entrait également dans ses plans, mais il n’avait pas encore décidé ce qu’il en ferait, s’il le revendrait très cher pour asseoir définitivement sa fortune ou s’il s’en servirait pour éliminer tous les obstacles. Si l’objet en lui-même, à la fois épée, houlette et casse-tête, l’avait frappé par son originalité, il était bien décidé à en extirper dès que possible la lame pour ne garder que le métal et le cacher plus facilement. Parce que ce trésor-là, ce serait lui qui le transporterait en Libye et personne d’autre, il pouvait le jurer. Quoi qu’il en fût, le ton dont Aldéa avait lâché cette phrase, l’impossibilité manifeste qu’elle avait eue de la retenir lui avait indiqué que le propriétaire était cher à son cœur. Il décida d’en ricaner ; ce détail, qui n’en était pas un pour elle, lui rendait sa victoire temporaire plus délicieuse encore. Il réfléchit, eut finalement une sorte de mouvement d’épaules où l’indifférence parut le disputer à la blague : – C’est le bâton du Libyen maintenant. Et puis, tu ne sais pas le mieux, ma soumise ? Tout cela, nous le vérifierons ensemble parce que, tu t’en doutes bien, tu es du voyage. Loin de ceux qui t’aiment ou que tu aimes en retour. Loin de ce Magon dont le nom brûle entre tes dents. Je ne l’avais pas prévu, mais à vrai dire l’idée ne me déplaît pas. La ferme qu’on t’a volée ici, tu la retrouveras là-bas, pour toujours. Je t’en offrirai une plus belle et je garderai ça en échange. Il lui appuya de nouveau sur l’entrejambe pour indiquer ce dont il parlait. Mais il pressa la vulve d’un coup si sec, et des phalanges de son poing, qu’il lui fit mal intentionnellement. Cette fois-ci, elle se débattit, hurla comme une bête aux abois. Il se retira aussitôt pour ne pas éveiller l’attention de ses hommes ou de l’ennemi qui pouvait rôder sur la rive. – Je te garantis que ma pine vaut celles que tu as goûtées chez tes péquenauds. Si on m’appelle Encore un, ce n’est pas que pour les coups que j’administre à mes hommes. Tu n’es pas la première, d’ailleurs, rassuretoi. Vous serez trois à vous partager mes faveurs. Les autres sont déjà làbas, elles t’attendent. Il marqua un temps, reprit : – Seulement, c’est à toi de me dire si je t’envoie maintenant ou si je te garde encore un peu près de moi et te fais faire le voyage en ma compagnie. Le viol de mes hommes ou l’amour dans mes bras. Au risque que, d’ici là, tu me trahisses. Aldéa fut terrifiée à l’idée d’être emmenée loin d’ici et de vivre en esclave pour le reste de ses jours. Rien ne pouvait être pire à l’esprit de la 266
femme indépendante, libre et fière qu’elle était. Elle baissa les yeux d’humilité, fixant le bâton de son bien-aimé qu’elle désespérait maintenant de revoir. Elle ne répondit rien, ne put rien répondre. Tandis que le bateau voguait toujours lentement, Latro prit son mutisme pour un assentiment. Ils poursuivirent en s’astreignant à la plus grande discrétion, passèrent encore quelques villages insignifiants ensommeillés sur la rive où ils furent soulagés de ne pas éveiller l’attention. Quand ils pensèrent ne plus être en territoire carnute, ils entreprirent enfin de débarquer. Une petite plage au nord leur suffit où ils halèrent en silence les trois embarcations. L’endroit était parfait, formé d’une crique exiguë sise entre un énorme rocher couvert de givre et un talus herbeux. Il y avait à peine de quoi glisser les navires côte à côte et, clôturé de grands arbres, caché par la pointe d’une île, le lieu était idéal pour les y laisser dissimulés. Une telle aubaine ne se présenterait sans doute pas de sitôt. La nuit n’était pas encore achevée quand ils mirent pied à terre. Le sol était gelé jusqu’en bordure du fleuve. Dans l’obscurité, parce qu’ils avaient choisi l’endroit de leur débarquement avec approximation, ils ne surent trop où aller, prenant conscience qu’ils jouaient en ce moment la partie délicate de leur aventure. Alors ils décidèrent, soldats et civils mêlés, de partir chercher des attelages à l’aveugle. Ils se divisèrent en trois groupes d’égale importance : un premier qui longerait la Loire vers l’est, un deuxième qui ferait de même vers l’ouest, un troisième qui resterait là où ils avaient touché la rive pour garder les bateaux et accueillir ceux qui reviendraient le plus vite. Si l’on s’était trouvé cette nuit dans les ruelles de Rome, une bande de voleurs et d’assassins n’aurait pas eu d’allure plus louche. Mais tandis qu’ils tiraient leurs bateaux sur le sable, ils n’avaient pu s’empêcher de pousser quelques cris d’effort qui retentirent curieusement sur le fleuve et, à la manière de ces galets que l’on jette pour les faire ricocher, parvinrent jusqu’à Magon qui ramait toujours à leur suite. Malgré les clapotis de l’eau, le jeune homme en conclut qu’ils étaient proches et que lui, était au bout de ses peines. Guettant la rive comme le fleuve, il les surprit soudain et put à temps accoster à son tour. La Loire était calme. Sa petite barque fut bien plus maniable que les lourds chalands. Il trouva encore la force d’atteindre la berge à une envolée seulement de Latro, s’extirpa du courant et s’écroula dès qu’il put, les bras en feu, vidé de toutes ressources. 267
Il resta longtemps ainsi. Pourtant une présence supérieure – celle de Calroë qui ne l’abandonnait pas – parut le guider encore puisqu’il sut se relever et reprendre sa marche. Il rampa dans les herbes hautes, le long de la rive, suivant les rares bruits étouffés qui parvenaient des hommes du centurion. Il les retrouva non loin de là sur une plage, dans une crique, et se positionna en hauteur, contre la souche humide d’un saule, assez loin pour ne pas être repéré, assez près pour suivre leurs moindres faits et gestes. En contrebas, près du fleuve, les hommes attendaient, assis, étourdis de fatigue, mangeant un peu et oubliant de scruter les alentours. Le semblant de hiérarchie qui prévalait sur les bateaux avait disparu et ils étaient confondus, soldats et civils, dans leur relâchement. Ils ne se parlaient pas, n’avaient pas le cœur à discuter. Certains, tremblotant, essoraient leurs vêtements qu’ils avaient mouillés en sautant dans l’eau froide et ne pouvaient sécher à la flamme faute de feu. Ils étaient beaucoup moins nombreux qu’au départ de la ville ; leur chef notamment n’était plus là et Magon comprit qu’il avait dû partir en reconnaissance avec plusieurs d’entre eux. Son cœur néanmoins tressauta, faillit battre à tout rompre quand il découvrit Aldéa qu’ils avaient de nouveau bâillonnée et chargée d’entraves sans même un manteau malgré la température hivernale. Elle s’était laissé choir sur un gros caillou contre la proue d’un navire et ne bougeait pas, prostrée, malheureuse, les yeux rivés en permanence sur un coffre long que gardait une sentinelle féroce et le chacal laissé par le centurion. Il lui sembla, tant elle était proche, qu’il aurait pu sentir ses larmes couler contre sa joue, en connaître le goût salé. Il s’interrogea sur les causes de sa capture, se demanda ce qui avait suivi l’attaque de sa ferme, hésita à profiter de la situation pour tenter quelque chose. Il aurait fait n’importe quoi pour la sauver, même commettre la folie la plus irréfléchie. La Déesse le poussait toujours, lui intimait l’ordre d’agir, il le sentait. Il n’avait qu’à dévaler, crier très fort pour insuffler la panique dans les esprits fatigués. Et il allait s’élancer, il allait affronter tous ces hommes avec la témérité d’un lion quand quelqu’un se leva et dit simplement « les voilà » pour signifier le retour d’un des deux groupes. Magon se lova contre son arbre, décida immédiatement d’attendre et d’observer. C’était le groupe de Latro qui revenait, celui qui avait été en aval du fleuve. La chance leur avait souri, encore. La première ferme qu’ils avaient rencontrée n’était exceptionnellement pas gardée. Ils y avaient trouvé montures et chariots auxquels habilement ils avaient accroché des tissus sous les sabots et les roues pour les dérober sans verser une goutte de sang ni faire donner l’alarme. Ce n’étaient guère que trois vieilles bêtes de ferme 268
et deux simples voitures, un kision et un carpenton à capote, étroits et légers, mais qui feraient l’affaire. En arrivant près du fleuve, Latro constata que ses hommes s’étaient reposés en son absence. Il s’emporta. Eh quoi ! Ils auraient pu décharger les navires, regrouper les marchandises, faire gagner un temps précieux à tout le monde et, en en frappant un, il traita chacun de fainéant et de bon à rien. – Du nerf !, cria-t-il malgré ses impératifs de discrétion, du nerf, tas d’enfoutrés ! Songez qu’en ce moment vous échappez à la mort ! Il faisait allusion aux événements de Génabum qui devaient se déclencher à l’heure précise où il parlait. Tous en étaient informés. Alors ils s’activèrent pour charger les bagages et, quand le deuxième groupe revint bredouille de sa quête, ils avaient bien avancé mais en étaient à réaliser qu’ils ne pourraient pas tout emporter. Il fallait se faire une raison. Les chars étaient trop petits et ils traînèrent, se disputèrent, se lamentèrent encore un moment, nul ne voulant se défaire de son butin personnel et rejetant sa faute sur l’égoïsme d’un autre. L’obscurité se dissipait lentement. La naissance du jour s’annonçait. Il était temps de se mettre en route. Latro trancha, les força tous à abandonner une part égale de butin – les denrées périssables de préférence – et l’on camoufla les bateaux en abaissant les mâts et en les recouvrant comme on put de branchages au milieu des deux points élevés qui les encadraient. On reviendrait en cas de besoin. De toute façon on ne pouvait faire autrement. Comme ils se rassuraient ainsi, Magon manqua de peu d’être découvert et se renfonça au pied de son arbre entre les racines. Ils s’en allèrent, en un cortège misérable et pénible, en direction du nord où ils couperaient nécessairement la route d’Agédincum. Quelques-uns conduisaient les deux attelages ou avaient trouvé une petite place dessus ; les autres allaient à pied ; de derniers tâchaient d’effacer leurs empreintes et bâclaient leur travail parce qu’ils étaient épuisés. Latro seul, pour rappeler qu’il était leur chef, monta sur le cheval qui restait. Magon se résolut à les suivre à distance. Alors que de minuscules flocons de neige se mettaient à tomber sans tenir au sol, ils traversèrent un premier bouquet d’arbres, soulagés d’être temporairement cachés à la vue d’un ennemi qui aurait pu les surprendre au petit jour arrivant. Ce ne fut pourtant qu’illusion. Car soudain, alors qu’ils n’avaient parcouru que deux ou trois milles, dans une clairière boueuse où les roues des attelages s’embourbaient, ils s’arrêtèrent net. Au bout, à l’orée de la forêt, une troupe de cavaliers débouchant d’un chemin les observait, impassibles, à moitié découverts sous un premier rayon de 269
l’aube et encore engloutis dans l’ombre du bois d’où ils avaient émergé. Ils semblaient les attendre. C’étaient des Gaulois, et surtout des guerriers. Leur équipement ne laissait aucun doute. D’aussi loin que les fuyards les aperçurent, ils virent leurs cottes de mailles, leurs capes passées en bandoulière, leurs casques en cloche dont les garde-joues couvraient la moitié du visage et le cimier se panachait d’une crête de crin. Surtout ils remarquèrent que, s’ils portaient leurs épées au fourreau, ils tenaient leurs lances ou leurs javelines pointées et leurs écus bien en main. Malgré tout, ils restaient immobiles sur leurs petits chevaux, les phalères des sangles scintillant sur les cuisses et le poitrail des montures elles-mêmes hérissées d’une selle à quatre cornes. Qui étaient-ils ? Sénons ? Carnutes ? Amis ? Rebelles ? Les Romains eurent un sursaut d’effroi. La vue de ces hommes sous la lumière blafarde de l’aurore les glaça. Les barbares n’étaient que dix a priori ; eux étaient le double. Mais ils avaient émoussé leurs armes, abîmé leurs boucliers. Surtout, ramassis de commerçants ignares et de soldats amollis, fugitifs pusillanimes fatigués de leur veille, ils se comportaient maintenant comme des lâches, leur caractère influencé pour longtemps par leur action d’une nuit. Ils étaient pris à leur propre comédie. Ils ne bougèrent cependant pas, attendirent de savoir si les cavaliers passeraient leur chemin ou voudraient parlementer. Il y en eut même un qui osa un salut et n’obtint aucune réponse. Tout à coup ils furent horrifiés. Les inconnus galopaient sur eux en poussant de grands cris. Aussitôt les uns jettent leurs armes, les autres se mettent à sauter des attelages et à courir en arrière. Seul Latro, à cheval, veut résister et se démène comme un fauve contre tous : – Allez ! Ils ne sont que dix ! Bande de lâches ! Battez-vous ! Il lutte avec fougue et pour tout dire prestance. Son habit de centurion le rend noble dans ses mouvements. – Allez ! Nous sommes si près du but ! De l’honneur, nom de Mars ! Mais il est seul contre tous ; l’honneur qu’il évoque, ses hommes ne le connaissent pas et les Gaulois se battent bien. Soudain on lui attrape le pied, il bascule au sol. Il perd son glaive, se relève, furieux, en brandissant son poignard. Un guerrier va le frapper de son trait ; il est sans défense quand un cri prolongé, lancinant retentit. C’est Atia, sa femelle chacal revenue en courant des herbes hautes où elle était partie fureter. Malgré son corps svelte et léger, elle attaque comme un chien défend son maître. D’un bond, elle plante ses crocs dans le bras du guerrier qui mugit de douleur et elle reste accrochée à son bras tantôt dressée sur ses pattes arrière, tantôt voletant en l’air quand l’homme tourne sur lui-même pour 270
s’en débarrasser. Il se couche, se roule ; rien n’y fait : le chacal fait pareil, décidé à ne pas lâcher sa proie. Mais un cavalier s’approche et d’un coup de sabots assomme l’animal. Deux autres arrivent et lui enfoncent chacun leur lance dans le ventre. Le chacal couine une plainte suraiguë et poignante ; il se tord, ne pouvant plus bouger son corps fiché en terre mais seulement ses pattes et son museau. Latro hurle d’une voix déchirée : « Atia ! Non ! Atia ! » L’un des assaillants, survenant alors dans son dos, lui assène un grand coup de pommeau sur le crâne qui le fait s’effondrer, évanoui. Cependant, Aldéa profite de la confusion pour s’enfuir de son côté. Bâillonnée, les mains attachées dans le dos, elle a les jambes libres et peut s’en servir. À peine a-t-elle vu les Gaulois s’élancer qu’elle s’est laissée tomber du chariot et s’est mise à courir droit devant dans une course échevelée. Magon a eu un sursaut en la voyant, il a retenu un cri ; elle n’est pas partie dans sa direction mais dans celle opposée et il ne sait comment procéder pour la rejoindre. Il n’a pas le temps d’hésiter pourtant. Alors qu’il est prêt à traverser la clairière et à la rattraper coûte que coûte, trop tard !, l’un des Gaulois, ne voulant pas blesser la jeune femme mais l’immobiliser, envoie un bâton entre ses jambes et la fait chuter. Quand elle se relève, l’homme est déjà sur elle et la maintient. C’est la deuxième fois que Magon aurait pu la sauver mais a échoué à le faire. Il n’y eut pas d’autre combat. Les fugitifs qui avaient échappé au massacre, qui avaient réussi à sortir du territoire carnute s’étaient ainsi fait prendre de la manière la plus innocente qui fût par un escadron moins nombreux mais supérieur en vigueur et en armes. Dès qu’ils furent maîtres du terrain, les Gaulois inspectèrent les chariots, les découvrirent emplis de marchandises et se réjouirent. Ils visualisèrent les traces de leurs roues dans l’herbe gelée, envoyèrent un éclaireur vérifier d’où elles venaient et l’éclaireur revint leur dire qu’elles menaient à des bateaux camouflés sur la rive et encore chargés de denrées. Joyeux de leur prise, ils décidèrent d’emmener les captifs devant leurs autorités sans les informer davantage sur ce qui les attendait. Latro fut réveillé à coups de pied. Et pendant que les cavaliers recevaient du renfort d’un autre escadron attiré par les cris, il fut, comme ses compagnons, entravé à son cou en une longue file de prisonniers. On lui retira sa cuirasse, ses insignes ; on ne lui laissa que son subarmalis de cuir. Enrageant, il rejoignit la cohorte des défaits. Le hasard voulut qu’Aldéa fût attachée juste derrière lui, la poitrine presque accolée à son dos. C’était maintenant l’haleine chaude de la jeune femme qui soufflait sur sa nuque de soldat et il frissonna d’un tel retournement de situation. 271
Les chariots, où étaient l’orichalque et toute sa fortune, se mirent de nouveau en branle. Une grande claque dans le dos du premier prisonnier activa la colonne et, tandis qu’ils avançaient en marchant si près les uns des autres qu’ils s’écrasaient les talons, Latro se retourna une dernière fois. Dans la clairière, au milieu des casques et des glaives piétinés, gisait la dépouille de son chacal, sa bonne Atia. Elle était la seule morte du combat. Même lui, l’être infâme, le criminel ignoble sans émotions ni scrupules eut une larme en voyant sa compagne de tant d’années périe ainsi loin de chez elle. Le jour était tout à fait levé maintenant. Il devinait qu’ils iraient en direction de Vellaunodunum, l’oppidum qu’ils avaient justement voulu éviter. Après tant de chance, la fortune les avait abandonnés. Ils étaient sans doute emportés vers la peine et les supplices. Un soleil ironique et moqueur illuminait le paysage. En marchant dans la campagne, en défilant d’un village à l’autre, ils comprirent vite que les Sénons, du moins les cantons de l’ouest, avaient rejoint les rebelles et ils conjecturèrent que la révolte s’étendait à d’autres tribus encore. Partout ils furent accueillis à cris de haine, à jets de pierres, de fange ou d’insultes. Le massacre de Génabum qui, à cette heure devait avoir eu lieu, ne serait donc pas le seul fait des Carnutes ; leurs voisins les soutenaient au moins, au pire étaient complices. Les Sénons étaient une nation très puissante, jouissant d’un grand crédit au-delà de leurs frontières. De tous les peuples de la Gaule, ils étaient celui qui s’était rendu le plus célèbre et le plus redoutable par sa valeur et son goût pour les expéditions lointaines et aventureuses. Ils étaient notamment fiers de leurs ancêtres qui avaient autrefois migré pour défaire les Romains et mettre à sac leur capitale. Ils gardaient un souvenir farouche de cet acte d’éclat et plus tard encore, dans leur pays de Celtique, leurs forces militaires s’illustraient par la domination qu’ils exerçaient sur les Parisiens et les Meldes et par les puissants oppida qui hérissaient leur territoire. Aussi avaient-ils été blessés dans leur orgueil quand ces dernières années César avait imposé à la succession de leur roi Moritasgos son frère Cavarinos le géant qui n’avait pourtant pas la faveur de son peuple, et ils s’étaient laissé entraîner dans la désobéissance, sous la menée d’un chef, Acco le fougueux, patriote farouchement anti-romain, qui avait su les convaincre de prendre les armes. Leur histoire était légèrement différente de celle des Carnutes mais elle s’en rapprochait par la volonté de César d’imposer le pantin de son choix à un peuple dont il ignorait tout des 272
traditions et des aspirations politiques. Ce n’était pas un hasard si les deux nations voisines s’étaient alliées pour comploter une nouvelle insurrection. Par un mouvement de troupes fulgurant, le proconsul avait cependant occupé le territoire et empêché les places fortes du pays d’engager toute résistance. La révolte avait avorté avant même d’avoir éclaté et les Sénons s’obligèrent aussitôt, comme les Carnutes d’ailleurs, à demander pardon en cédant à César des otages sans avoir pu se battre ni défendre leur honneur. La défaite pourtant ne s’arrêta pas là. César leur avait accordé sa clémence parce qu’il avait d’autres campagnes à mener et ne voulait perdre de temps à procéder au châtiment qu’il pensait nécessaire. Mais quand il fut partout vainqueur, il revint et décida de punir implacablement les coupables. Il convoqua une assemblée générale à Durocortorum où les Sénons furent sévèrement contraints d’accepter la mise à mort de leur chef Acco qui se retrouva piégé parce qu’il était venu en confiance ; ils furent obligés de reconnaître Cavarinos sur le trône, de fournir à César des cavaliers, d’accepter la perte d’influence sur les Parisiens et les Meldes qu’ils disputaient aux Suessions. On n’aurait pu imaginer pire humiliation. Ils en avaient conçu un fort ressentiment. À l’heure du massacre de Génabum, à l’heure du soulèvement général de la Gaule sous l’égide de Vercingétorix, Carnutes et Sénons reformaient donc l’alliance d’Acco qu’ils élargissaient considérablement. À vrai dire le souvenir du chef sénon qui avait naguère uni les deux tribus représentait maintenant un argument de taille pour unifier la Celtique. Acco était un brenn valeureux, seigneur de larges terres aux confins de son pays et spécialement maître de la plaine autour de Vellaunodunum. Condamné à mort et exécuté, il était devenu pour les nations étrangères un modèle d’héroïsme et de bravoure parce que son supplice avait indigné nombre de ses pairs. Son statut de victime de la liberté commune avait pesé considérablement dans le ralliement à la nouvelle insurrection en sorte que bien des hésitants adhérèrent aux projets de Vercingétorix quand on leur cria : « Souvenons-nous d’Acco ! Souvenons-nous d’Acco ! » Alors qu’à l’est on était plus enclin à pactiser avec Rome, dans les cantons qu’Aldéa, Latro et les autres captifs traversèrent, Acco le fougueux avait gardé des soutiens infaillibles. Les rares qui n’étaient pas d’accord avec lui de son vivant avaient de toute façon été tellement choqués par son assassinat qu’ils avaient épousé sa cause et conservé pieusement son souvenir par la suite. Le chef des Sénons avait laissé derrière lui une engeance qui chaque jour rappelait sa mémoire. Bien des années auparavant il avait aimé une femme, sa femme, avec passion, disait-on, tant il est vrai qu’on se plaît souvent à voir dans les grands chefs qui brillent en public de grands cœurs 273
en privé. Mais elle était morte en couches, lui laissant sur les bras un enfant, et il n’avait jamais jugé bon de se remarier, trouvant dans la politique seule le moyen de surmonter son chagrin. Ce fils unique s’appelait Duisto. Il n’avait pas vingt ans et frappait l’esprit par son physique comme ses liens avec le monde des dieux. Car Duisto était ce qu’on appelait un androgyne, un être mi-homme mifemme, il avait les yeux vairons, ce qui était le signe d’une supériorité, et il communiquait avec les dieux dont il apprenait la volonté et en avisait ses semblables. Il ne chantait pas comme les bardes, ne s’occupait pas de philosophie comme les druides : il était devin, mais devin sans être prêtre, sans être rattaché à un sanctuaire ni ne s’occuper d’aucune cérémonie religieuse, devin sans même observer un jet de pierres ou les soubresauts d’un cadavre. Il n’avait reçu aucune éducation et son comportement, ses paroles confinaient, de manière infiniment plus simple et complexe à la fois, à une sorte de folie intuitive et sacrée qu’on n’entendait qu’avec l’appréhension de côtoyer un univers qui nous dépasse. Son don était une véritable inspiration. À un moment de l’histoire où les vates avaient presque tous disparu, lui faisait survivre son art avec une tranquille insouciance. Si sa réputation ne brillait pas au-delà des régions de l’ouest, si son action n’était pas reconnue par les instances officielles de l’État sénon, il était respecté par le peuple et les dames. Parmi ceux qui le connaissaient et avaient un semblant de commerce avec lui, qui de prétendre qu’il était un mélancolique génial, qui d’assurer qu’il était un sage ignoré, qui de croire qu’il était le protégé d’un dieu méconnu. On l’aimait aussi par égard pour son père et, plus tard, après sa mort, pour honorer la mémoire de celui qui avait sacrifié sa vie pour épargner celle des autres. La cité n’abandonnait jamais les siens. Quant aux nobles, guerriers et magistrats, ils entretenaient des rapports équivoques avec lui. Ils étaient à la fois tolérants et gênés, pour ne pas dire méfiants envers cet être qui échappait à la norme et donc à tout contrôle. Surtout, à travers ce fils qui n’était pas même bâtard survivait le souvenir d’Acco que beaucoup révéraient en même temps qu’ils le jalousaient et espéraient le faire oublier un jour au profit de leurs propres exploits. Duisto les dérangeait. Si le gamin ne montrait aucune inclination en politique, peut-être même pour cette raison, ils auraient préféré qu’il n’eût jamais vécu. Ce qui était certain, c’est que d’une façon très pragmatique, Duisto ne faisait de mal à personne et il ne coûtait rien de lui être bienveillant puisqu’il était rarement parmi les hommes et n’intervenait jamais dans les débats ni les querelles. Au contraire, on aurait pris beaucoup de risques à lui être antipathique alors qu’on pouvait lui être aimable à moindres frais. On avait pour lui l’obligeance qu’on a envers un 274
malade du cerveau, un fou, un initié. Qui savait si cet acte gratuit ne serait un jour récompensé ? En attendant, ils le surnommèrent le fol pour montrer toute l’ambiguïté qu’ils accordaient à son existence. Son père lui-même qui l’avait si souvent regardé se détacher de la vie publique, qui l’aimait sans qu’il sût comment le prendre véritablement, avait dit un jour à son entourage comme s’il se prodiguait des conseils à lui-même : – Laissez-le. Il a le temps. Il viendra comme tout le monde à la politique et à la guerre. Et alors, qui sait si le recueillement qu’il trouve dans la solitude ne vous sera pas un jour utile à tous. Car Duisto – c’était là une des raisons pour lesquelles on le tolérait – nourrissait un attachement profond à la retraite et la forêt où il pouvait passer des journées entières et des nuits, quittant l’oppidum au point du jour et n’y rentrant qu’au moment précis où les portes se refermaient. Nul ne savait vraiment à quoi il employait un temps si long. S’il était sûr qu’il ne s’y livrait pas à la chasse comme son rang l’y aurait autorisé, qu’il n’y fomentait pas d’intrigue comme son ascendance aurait pu le laisser y prétendre, il ne paraissait pas non plus s’occuper des choses de la nature comme les druides ni scruter le sang d’un animal, le dessin d’un éclair ou le vol des oiseaux. Pour être tout à fait précis, à qui aurait manifesté la volonté de comprendre, il ne paraissait pas s’occuper de ce qu’il est loisible d’appeler le spectacle du réel mais il semblait au contraire chercher une sorte de monde caché, invisible et très beau dans lequel il eût pu vivre parfaitement heureux. Il donnait ainsi l’impression de parler aux animaux, de caresser les fleurs et s’enivrer de leur parfum, de chanter avec le vent comme s’il se fût agi d’êtres animés détenteurs du secret qu’il ambitionnait d’obtenir pour pénétrer l’univers qui se dérobait toujours et qu’il se représentait en une nature vierge dont l’homme était absent. C’était le moyen qu’il avait de communiquer avec les dieux. Certains refusaient de l’entendre, d’autres n’en avaient la possibilité. Chaque fois qu’on faisait effort pour le consulter sur une plante, sur une bête, sur les aléas du temps en se disant qu’un garçon si singulier avait peut-être des réponses qui échappaient aux autres, il était incapable de répondre ce que l’on attendait et il fournissait des explications qui n’avaient a priori aucun sens. Le sanglier était le père cornu, la tanaisie l’herbe aux longs rêves, l’orage la réprimande du ciel. Il vaticinait plus qu’il ne prédisait clairement l’avenir, dans une sorte de délire passionné et mystérieux mais très calme et l’on se contentait de le quitter en haussant les épaules et en souriant d’indulgence pour les plus sceptiques, en étant inquiet pour les plus crédules. Les deux fois où les Sénons étaient entrés en révolte contre Rome, Duisto avait donné des oracles énigmatiques, l’un 275
prédisant la plainte du beau mâle qu’on n’avait su interpréter et qui signifiait la mort d’Acco, l’autre parlant de lit de sang qu’on s’était précipité à traduire comme l’annonce du massacre de Génabum. Le jeune homme avait le visage sec, les yeux vides, la peau blanche à force de hanter les recoins les plus sombres de la forêt. Même la couleur de ses cheveux, un blond cendré très pur, en semblait évanescente. Et déguenillé, taciturne et sauvage sans être jamais méchant, disposé à satisfaire les siens mais incapable d’y arriver vraiment, il sortait de Vellaunodunum, dévalait le chemin principal, déambulait dans la campagne, s’enfonçait dans le bois pour de longues marches solitaires, mu par ses rêves occultes, allant là où nul n’allait, foulant des endroits infoulés, oubliant jusqu’à l’odeur inoubliable de ses semblables. Peut-être qu’en chemin il croisa ce matin-là un défilé de Romains que des cavaliers sénons avaient fait prisonniers et qui marchèrent longtemps avant d’atteindre l’oppidum. Il y avait parmi eux Aldéa et Latro. Quand vers le milieu de la journée, traînés malgré la fatigue, ils arrivèrent enfin, ces captifs que le fils d’Acco aurait pu croiser s’aperçurent vite que Vellaunodunum n’avait rien à voir avec Génabum la riche. D’aussi loin qu’ils en découvrirent la ligne floue dans le paysage, les yeux brouillés par le sommeil et l’appréhension, ils comprirent immédiatement que tout opposait les deux lieux. Tandis que l’emporium des Carnutes était situé en plaine, accolé à un fleuve empruntable et emprunté, au carrefour de voies hyper-fréquentées, la place forte des Sénons – qui n’était pas leur capitale – s’accrochait à une sorte d’éperon rocheux élevé d’au moins cent pas audessus des forêts, ne contrôlait le passage que d’une seule route et la rivière qui coulait à son côté n’avait manifestement pas l’importance naturelle ni commerciale de la Loire. Aucun champ, pas d’axe secondaire, un hameau chiche et un village épars pour tout autre lieu d’habitation. Il était clair qu’on venait de partout à Génabum, mais on ne faisait que passer devant Vellaunodunum. Ce n’était pas un oppidum ouvert, mais fermé. L’enceinte n’en avait pas le même aspect ni la même finalité. Celle de Génabum, si elle était en certains points impressionnante, était avant tout ornementale et quiconque eût versé dans l’art de la guerre eût vite compris qu’inégale d’un endroit à l’autre, percée de fentes et de passages dans lesquels un espion pouvait s’infiltrer, inexistante même du côté du fleuve, elle était moins faite pour résister à un siège que pour émerveiller un paysan ou un marchand. Les remparts de Vellaunodunum au contraire, s’ils étaient plus sobres, s’ils étaient plus modestes aussi en comparaison de ceux des grands oppida arvernes ou éduens, étaient en réalité solides, bâtis sur ce que les Romains nommaient le murus gallicus, un enchevêtrement parfait de pierres et de 276
poutres qui permettait de résister aux incendies comme aux coups de bélier. Ils évitaient les lignes droites, dessinaient des angles, semblaient colossaux d’en bas avec leur épaisseur de vingt coudées environ et ne s’interrompaient que sur un côté où le précipice d’une falaise les suppléait encore mieux. À mi-chemin de la montée, une première palissade de bois qui encerclait la ville puis un système de fossé et d’épieux fichés en terre, achevait de renforcer les défenses. Hérissé de tours, l’oppidum était en outre un des seuls points dominants sur le pays assez plat. On y voyait les mouvements de troupes au loin. La pente était douce. En montant l’unique route d’accès – celle-là même que gravirent Latro et le petit groupe de captifs –, on franchissait des portes qui n’avaient pas la forme d’un entonnoir mais celle d’une chicane pour être plus discrètes à l’ennemi mais aussi plus dangereuses à enfoncer. Là les cavaliers abandonnèrent leurs montures et continuèrent à pied. L’intérieur où l’on parvenait était encore très différent de la capitale économique des Carnutes. Il n’y avait pas de grands quartiers commerçants, évidemment pas de port, encore moins d’entrepôt. Au lieu de cela, tout indiquait une existence austère et farouche. Les quelques habitations populaires dont les toits fumaient tranquillement semblaient resserrées pour laisser place à un complexe de casernes qui était le signe d’une vie militaire bien réglée. Les autres maisons étaient toutes reléguées en contrebas de la route, hors des murs, mais à proximité de manière à pouvoir en cas de danger trouver refuge à l'intérieur de l'enceinte. Ainsi les rues où ils défilèrent péniblement n’étaient pas populeuses mais clairsemées. Aucun vendeur à la criée n’arpentait les places, aucune fille ne racolait dans les coins sombres, aucun escroc ne faisait les poches d’un étranger dans une taverne. Au reste, les inconnus étaient rares. Vellaunodunum n’était pas l’Athènes des Gaules, mais la Sparte de Celtique. Ce n’était pas une ville marchande, mais une ville militaire où tout le monde se connaissait. Qui avait donc droit d’y loger parmi le petit peuple ? Ceux qui étaient utiles : les artisans. Pas n’importe lesquels cependant : uniquement ceux qui travaillaient les métaux, le cuir, le bois ou le textile pour en faire des équipements ou des armes que l’on devait ensuite entreposer quelque part à l’abri. Et quand Aldéa, Latro et la bande de captifs furent poussés de ruelle en ruelle, ils entrevirent, tête baissée, des ouvriers qui, sans s’arrêter ni même dissimuler leur travail, façonnaient des casques, ciselaient des rinceaux sur des fourreaux, assemblaient l’orle, la spina, l’umbo aux planches des boucliers. On aurait pu croire qu’ils étaient sur le pied de guerre, que l’heure n’était plus au complot mais à la préparation assumée de la bataille. Nul n’accompagna le cortège à travers les rues. On sentait, à y marcher, une industrie commune, une entente 277
silencieuse qui prouvait que la ville n’était pas divisée en factions irréconciliables mais qu’au contraire toutes convergeaient dans le souvenir d’Acco et le rejet des Romains. Le ciel était crasseux. Épuisés, formant toujours leur colonne fébrile, les prisonniers continuèrent la route qui montait. La corde qui les liait les uns aux autres leur brûlait le cou ; le pavé gluant et incomplet des rues glissait sous leurs pas. Certains s’effondrèrent, entraînèrent avec eux les attachés les plus proches, furent tirés comme des bestiaux pour se relever et se remettre à marcher. Plus haut, ils traversèrent encore le quartier des nobles, très fier avec ses demeures où la pierre devenait plus fréquente. Mais la hauteur sur laquelle elles étaient construites n’avait rien à voir avec la Butte-aux-rats qui n’était qu’un mamelon ridicule. Celle-ci était une vraie colline qui marquait une réelle distinction entre les clients et leurs seigneurs. Enfin, à l’endroit le plus élevé étaient un sanctuaire, théâtre des cérémonies religieuses collectives, et ce qui ressemblait au lieu d’un Conseil local où l’on débattait de politique. Il y avait, devant, une petite place. Ce fut là qu’ils furent menés. Une foule, celle qu’ils n’avaient pas croisée dans les rues, les y attendait déjà, sans doute prévenue à l’avance par un des cavaliers et tenant difficilement dans un espace si réduit. Mais cette foule n’était en rien tumultueuse comme à Génabum. Elle était au contraire très calme et disciplinée. Elle attendit qu’un homme vêtu d’un manteau rouge chatoyant et portant un casque d’argent descendît les quelques marches depuis la salle du Conseil. L’homme ne se présenta pas et les captifs ne surent pas quel était son statut. Il était un chef manifestement, suivi de quelques autres dans une hiérarchie évidente. Il s’adressa à celui des cavaliers qui, cheminant maintenant à pied, avait pris la tête du cortège à travers rues. – Vilomar, qui sont ces hommes ? Des prisonniers d’un combat ou des marchands arrêtés sur la route ? Leur état lamentable ne permet pas de le savoir. – Des fugitifs, Gitogmaros, ce sont des fugitifs. Je ne les ai pas interrogés mais tout laisse penser qu’ils ont échappé au massacre de Kénabon. Si tu veux mon avis, étant donné que nous sommes tombés sur eux au petit jour, ils sont même partis avant le massacre. Des déserteurs en somme. On les a surpris qui avaient abandonné leurs navires de misère et essayaient de traverser le pays sur des chariots, volés assurément et bourrés de marchandises. – Des lâches et des pillards… Joli trophée ! Vilomar parut vexé de ce compliment ironique inattendu. Il voulut se rattraper de son piètre résultat. 278
– Il y a mieux, dit-il en s’approchant de Latro. Nous avons tué un animal inconnu qui défendait celui-ci. Une sorte de chien mais en très fin, au pelage rougeâtre et aux oreilles triangulaires. Il s’arrêta, travailla son effet. – Je crois, Gitogmaros, que c’est l’homme au chacal que nous avons capturé. Ce fut une révélation qui accrut le silence – un silence qui fut non plus celui du respect mais de l’attente devant un événement incroyable qu’il fallait vérifier. On se regarda, on regarda la vingtaine de Romains qui étaient enchaînés là devant et luttaient pour ne pas tomber de sommeil et d’humiliation. Les Gaulois l’ignoraient, mais cela faisait deux jours qu’ils n’avaient pas dormi en livrant tous les efforts dont ils étaient capables. Le dénommé Gitogmaros voulut les passer en revue. Il s’arrêta devant Latro qu’il dévisagea longuement comme s’il eût une légende vivante devant lui. L’homme au chacal ? Les Gaulois le connaissaient bien au-delà des frontières de Carnutie, savaient ses exactions dont tout le monde parlait : les fermes pillées, les femmes violées, les sévices infligés. Qui n’eût pas rêvé de venger ces crimes comme s’il se fût agi d’un affront fait au peuple celte tout entier ? Alors le tenir entre ses mains, et ce par le plus grand des hasards… Le Sénon l’examina des pieds à la tête, palpa son vêtement, le fit détacher des autres et pousser en avant. Il l’inspecta derechef en tournant autour, se recula enfin sans cacher une légère déception comme s’il s’attendait à un personnage plus impressionnant. – Certes un centurion, reconnut-il, mais je ne suis pas sûr… Quel est ton nom ? Latro ne répondit pas. – Quel est ton nom, Romain ? Il ne répondit toujours pas. Alors l’autre, sans user de la moindre violence, le regarda avec un léger sourire en coin et s’imagina qu’en plus il serait celui qui le mettrait à mort. Ce sourire sur son visage digne dut avoir quelque chose de si dérangeant que le Libyen comprit aussitôt. Il craignit la perfidie du Gaulois et commit alors un acte des plus honteux pour s’en sortir. Il ne donna pas son nom, mais le nom d’un autre. Pas même un patronyme qu’il eût inventé, mais celui d’un centurion qu’il connaissait dans la quatorzième et qui était mort au combat l’an passé. – Marcus Aliénus Larva, balbutia-t-il à voix basse, tête courbée. Dans la rangée, ses camarades ne cillèrent pas. Il y eut fort à parier pourtant que certains furent révoltés de cette dernière lâcheté. Surtout que Gitogmaros ne parut pas le croire, comme s’il connaissait les menteurs pour en être lui-même un. Mais au moment où il allait répondre, ses yeux 279
tombèrent sur Aldéa, l’unique femme de la bande dont le visage était si beau de désespoir. Elle avait la poitrine à l’air, les cheveux en pagaille, les pieds nus et il sembla la remarquer uniquement à cet instant. – Et celle-là ?, demanda-t-il. – Elle est celte, mais elle ne veut rien dire d’autre. Elle croit que ça suffit pour qu’on la libère. En réalité, sache qu’elle a voulu fuir plutôt que nous rejoindre, nous ses frères, quand on leur est tombé dessus. Elle est de mèche avec eux, c’est certain. Sans doute une de ces filles perdues qui suivent l’armée ; la Gaule en compte des milliers. Je parierais qu’elle couche avec tous. – Ça suffit, coupa Gitogmaros. Il ne sert à rien de s’étendre sur ce sujet. Aldéa ne bougeait pas. Sur cette place froide que réchauffait un clair soleil, elle n’était plus que l’ombre d’elle-même. Elle s’était murée dans le silence depuis qu’elle était tombée aux mains des cavaliers sénons. Comme Latro l’avait un moment redouté, elle aurait pu en dire beaucoup sur les Romains qui l’avaient emmenée et elle aurait pu par là-même se sauver. Elle n’aurait dit que la vérité d’ailleurs, sans avoir besoin de l’aggraver. Mais elle n’avait plus confiance en personne, ni Gaulois ni Romains, parce que tous l’avaient trahie. Elle s’enferma dans le mutisme comme une chose que les événements pouvaient désormais ballotter sans n’avoir plus de prise sur elle. Elle adoptait une posture fantomatique, livide et recroquevillée alors même qu’elle se tenait debout et gardait toute sa beauté. Gitogmaros la regarda avec méfiance. Puis il se détourna de tous : – Et les marchandises dont tu nous parles, où sont-elles ? – Ici. Nous les avons fait porter à notre suite. Les membres du Conseil dépassèrent les prisonniers pour aller inspecter le grain, le vin, les viandes, le sel et les peaux qui avaient été ramenés. La quantité, la qualité n’étaient pas négligeables en ces temps de guerre prochaine et l’on fut plus satisfait encore de cette prise qui devenait le bien commun des Sénons. – Tout y est ? – Tout. Mais là encore il y a mieux. Regarde ce que nous avons découvert. Au milieu de la cargaison, Vilomar saisit un petit coffre, assez long et léger, des plus communs. Il l’entrouvrit, en sortit un objet qu’il tendit humblement. Cet objet, c’était un long morceau de bois rond, étonnant, jamais vu jusqu’alors et pour tout dire difficilement imaginable autrement. Gitogmaros le prit, le soupesa, l’éleva à la vue de tous et, d’un œil jaune et rond d’épervier, le considéra avec beaucoup d’attention. 280
L’objet avait une forme et un ciselage complexes. Il s’apparentait à la fois à un bâton, un fourreau, une massue. Son tour était ouvragé dans le détail, bariolé de teintes jaunes, rouges et vertes, et, au lieu de griffons, d’esses ou de triskèles, on y lisait des motifs effrayants pour un Gaulois. Dans ce qui semblait de l’ivoire, c’étaient des créatures effroyables que l’on peinait à reconnaître comme des ours ou des aurochs ; c’étaient des montagnes très hautes qui semblaient pleurer et inonder le monde de leurs larmes ; c’étaient des guerriers aux traits épais, aux mouvements vifs, avec des panaches plus courts qu’une crinière de cheval et plus longs que des plumes de corbeau ou de pigeon. C’était à n’y rien comprendre. Mais surtout, les luisances du métal, sur la pointe à l’extrémité du bâton comme la lame à l’intérieur, n’avaient pas leur pareille. Ce métal ne semblait pas de ce monde mais d’ailleurs, peut-être du ciel. On eût dit un combat du jour et de la nuit qui se chassent alternativement, à toute vitesse, et créent des reflets tantôt sombres tantôt éclatants. L’arme de Magon venait encore de passer entre de nouvelles mains. Pour la seule fois de la scène, Aldéa leva les yeux qu’elle rebaissa aussitôt. – Ce n’est pas un objet ordinaire, dit Gitogmaros fortement impressionné, et ces prisonniers sont peut-être plus précieux qu’on ne le pense. Hommes et choses, il faut les garder tous le temps d’éclaircir la situation. Envoyez un courrier chez les Carnutes pour en savoir davantage ; en ces moments d’alliance et de révolte, il n’est pas question de blesser leur honneur. En attendant, faites garder le butin dans la salle commune. Défense est faite à quiconque d’y toucher. Quant à eux, jetezles en prison. Les captifs furent donc jetés en prison. Celle de Vellaunodunum était sombre, exiguë, creusée en dénivelé comme une galerie qui s’enfonce dans la terre. On l’appelait le Boyau. Jeté dedans, on y dévalait, avalé par les entrailles de l’oppidum et, tâchant de reconnaître les lieux dans l’obscurité, au milieu de l’odeur suffocante, on ne savait pas sur quoi l’on marchait tant le sol et les murs étaient humides et collants. Commençant sur la place publique où les captifs avaient été exposés, cette sorte d’intestin s’achevait, tout au bout, à même l’éperon rocheux, sur une petite ouverture à ras du sol, grillagée de lourds barreaux pleins de rouille. En bas, c’était le vide et il n’y avait que ce seul maigre jour pour faire entrer un peu de lumière et chasser l’odeur de merde partout répandue. La prison était vide quand ils y pénétrèrent. À plus de vingt, Aldéa comprise, ils la remplirent aussitôt. Ce qu’ils firent en premier : dormir, à même le sol, les plus épuisés se couchant tout du long sans savoir sur quoi, les plus courageux essayant de chercher un coin sec et un mur pas trop suintant où s’adosser. L’odeur ne simplifia pas la situation et Aldéa 281
notamment vomit en tentant de s’en accommoder. Un sommeil lourd, profond, soucieux, plongea ainsi longtemps la geôle dans le silence. Puis ils s’éveillèrent les uns après les autres, mais ce fut un réveil triste et compliqué où ils commencèrent à se demander ce qu’ils allaient faire, ce qu’ils allaient devenir. L’un d’entre eux qui avait un peu de culture – le savant du groupe – égrena le souvenir des prisons les plus terribles : le Tullianum de Rome, ce cachot malpropre, obscur, infect où l’on avait étranglé une dizaine de complices de Catilina ; les Latomies de Syracuse, ces galeries percées dans la pierre des falaises qui avaient vu sept mille Athéniens dépérir après l’échec de l’expédition de Sicile ; le Défilé de la Scie, que d’aucuns appelaient celui de la Hache, où Carthage avait réussi à emprisonner à ciel ouvert quarante mille insurgés qui, poussés par la faim, avaient fini par s’entre-dévorer. Beaucoup pleurèrent en silence. Un autre accusa Latro d’être responsable de la situation, en se cachant quand même et en modifiant sa voix avant de parler : il leur avait fait perdre leur honneur, leur butin et bientôt la vie infâme qui était tout ce qui leur restait ! Un autre renchérit en rappelant sa lâcheté d’avoir donné le nom d’un défunt au lieu du sien et jura qu’il paierait tôt ou tard ce sacrilège. Les heures passèrent dans ce climat de regrets et de menaces que l’obscurité anonyme laissait éclater au grand jour. Puis les estomacs se mirent à crier famine et, comme on ne leur apportait toujours pas à manger, ce fut un autre appétit qui prit temporairement le dessus. Aldéa était la seule femme et même dans le noir, ils sentaient sa peau blanche, douce, reniflaient son sexe odorant. Au milieu des relents d’égouts, l’effluve de son corps venait parfois chatouiller leurs narines. À la fin ils n’y tinrent plus. Quelques-uns se levèrent, se mirent à marcher, à la localiser pour tourner autour d’elle. Ils pouvaient, ils devaient chasser maintenant parce que si on les laissait crever de faim, la tête leur tournerait bientôt et ils seraient incapables du moindre mouvement. Dans la pénombre, Aldéa les devinait elle aussi qui rôdaient auprès d’elle. Elle percevait leur odeur de mâles, cette odeur âcre que le corps dégage avant le rut, et elle ne pouvait que se recroqueviller plus au fond, faute d’y échapper. Elle aurait hurlé, battu les murs que personne ne serait intervenu. Surtout elle ne voulait pas résister, n’en avait pas la force désespérée car elle était captive d’hommes eux-mêmes captifs et cette double perdition ne semblait pas avoir d’issue. Assise près d’une flaque, elle ne se demandait même pas si c’était de l’urine, de l’humidité ou le sang d’un torturé dans lequel elle trempait ses doigts. Une première main la toucha, l’air de rien, comme si elle voulait l’aider à se relever ou la réconforter. Elle la repoussa doucement. Une autre se présenta qu’elle repoussa plus vivement. Assez vite, ce furent deux mains 282
en même temps, puis des bouches, puis le poids de plusieurs corps qui s’appuyèrent sur elle. Seule, elle dut faire face à deux ou trois sauvages en même temps. Et elle aurait vite été submergée si tout à coup une ombre, plus grande, plus forte que les autres ne s’était interposée. C’était Latro qui venait non pas défendre l’intégrité de la jeune femme, mais reprendre sa proie qu’il voulait vierge pour lui. Il était un prédateur comme les autres, mais il était aussi le chef de meute qui confisquait son bien pour être seul à en jouir. Il donna des coups de poing dans le noir, frappa les silhouettes d’une grosse pierre, visa très bien et fit très mal. – Enfants de putain ! Elle est à moi ! Le premier qui la touche, je lui crève les yeux. Les autres, envieux, n’insistèrent pas. À quatre pattes ils se replièrent dans les coins comme des hyènes couinant dans leur tanière. Le Libyen restait plus fort ; surtout, même dans la captivité, il gardait le bénéfice de la crainte du gradé. Et pour affirmer tout à fait sa prédominance, il ne se contenta pas de sa victoire. Comme Aldéa rampe vers la seule ouverture pour trouver un peu de lumière, le voilà qui se laisse tomber sur les genoux, la saisit devant tous et, dans un soufflement rauque, s’abat sur elle de toute sa masse. Il l’écrase, sort son pénis, la pénètre violemment. Elle a beau se débattre, hurler de douleur, frapper d’épouvante, elle reste son esclave. Plus elle se démène, plus il est excité car les autres qui se repaissent du spectacle comprennent qu’elle lui appartient désormais. De sa main, il lui a remonté les cuisses. Elle le griffe, le mord, l’étreint de toutes ses forces des jambes et des bras et il la besogne comme un animal, encore, toujours, s’enfonçant de toute l’épaisseur de son membre. Alors brisée, réduite à néant dans cette prison lugubre, comme assassinée à l’insu du monde, il ne lui reste que quelques larmes qu’elle verse dans les soubresauts de son viol et tandis qu’elle pleure, qu’il se répand en elle, à la fenêtre le paysage demeure tranquille et flou. Magon est quelque part, mais loin, très loin dans toute l’étendue de la Gaule.
283
X LE DEVIN
La possession de Latro se répéta durant des jours. Durant des jours Aldéa fut violée dans les ténèbres devant les autres envieux. Le monstre lui vola irréparablement l’honneur, la jeunesse, la confiance dans la vie qu’elle avait pu avoir autrefois. Ce fut le pire des larcins, le plus horrible des pillages dont il s’était rendu coupable jusque-là. Aucun des prisonniers ne fut sorti de prison par les autorités de Vellaunodunum. Ni pour être libéré ni pour être interrogé. Ils vécurent enfermés dans une obscurité presque totale comme des animaux qu’on élève dans le noir pour les rendre aveugles, mangeant la nourriture qu’on leur jetait à même le sol, faisant leurs besoins au su de tous, dormant par méfiance les uns à bonne distance des autres, se donnant des coups de dents féroces quand ils s’approchaient trop, parlant pour certains seuls à voix haute parce qu’ils devenaient fous. À chaque épreuve qui se répétait, Aldéa regardait à la petite ouverture grillagée à laquelle elle restait maintenant accolée. Non par besoin de voir le jour, de sentir l’air frais ; elle n’espérait plus en Magon, mais rêvait du vide en dessous d’elle où elle aurait voulu se précipiter pour mourir et tout oublier. Combien de fois tira-t-elle sur les barreaux dans l’espoir de les faire céder. Elle n’aurait su répondre. Elle avait perdu toute notion du temps. Ce qu’elle ignorait, c’était que son ami n’était pas loin en réalité, mais incapable aussi de franchir le peu de distance qui les séparait. Après la capture des fugitifs par les cavaliers sénons, il avait discrètement talonné la colonne de captifs, s’était enquis auprès d’un paysan affable de la direction dans laquelle ils marchaient et, une fois dans la plaine de Vellaunodunum, caché derrière un enclos de pierres sèches heureusement désert, il avait hésité, n’avait rien tenté, n’avait pu que les regarder monter la pente qui menait à l’oppidum. Resté en bas, dehors, il avait deviné ce qui les attendait là-haut, à l’intérieur des remparts – le Conseil local, l’examen du butin, l’envoi dans les geôles – et, ne les voyant pas redescendre le lendemain ni le surlendemain, il en avait conclu qu’ils étaient en prison pour longtemps. Il aurait sinon décelé un signe de leur
libération, bien que celle-ci n’eût eu aucun sens étant donné l’assaut des cavaliers sur le convoi de fuyards. On ne rapinait pas pour libérer l’heure d’après les prisonniers et les biens. Quant à une mise à mort – il songeait à celle de Sagéra –, elle aurait fait sensation et la nouvelle aurait couru par les villages alentour. La situation le rassurait donc parce qu’il avait dorénavant un peu de temps pour trouver un plan sûr ; elle l’effrayait aussi car il craignait que sa bien-aimée ne subît les affres de la détention. Que ne se retint-il d’entrer directement dans la ville, d’hurler le nom de celle qu’il aimait à travers rues pour la rejoindre ! Dans ces moments-là il s’en voulait de ne pas l’avoir sauvée au bord du fleuve, de ne pas l’avoir secourue plus tard quand l’opportunité s’était réitérée dans la campagne aux dernières opacités de la nuit. Maintenant elle avait quitté les chaînes de Génabum pour d’autres, peut-être plus lourdes, à Vellaunodunum et lui, restait condamné à la suivre sans pouvoir intervenir ! De rage il ne souhaitait que rattraper ses hésitations par un coup de folie. Quand il y songeait, il perdait toute notion du danger ; les jambes, les poings le démangeaient si bien qu’il se calmait chaque fois à grand-peine, retrouvant difficilement sa raison, réduit à patienter jusqu’à la nouvelle circonstance propice. Car la possibilité se représenterait, forcément : il avait besoin de le croire pour ne pas perdre courage. En attendant, pauvrement vêtu de ses guenilles gauloises, il devait se cacher. Si les cavaliers sénons avaient arrêté des Romains, les hostilités étaient sans doute rallumées ou sur le point de l’être. Tout inconnu, misérable de mise de surcroît, pouvait courir un risque. Puisque la guerre semblait déclarée, on se méfierait d’autant plus des traîtres, des espions, des étrangers habillés en indigènes. Il n’y avait pas que l’oppidum qui fût différent de ce qu’avait déjà vu Magon dans son parcours en vallée de la Loire. Les alentours de Vellaunodunum contrastaient aussi terriblement avec ceux de Génabum comme si la forêt qui séparait le territoire des Carnutes de celui des Sénons bornait l’opposition de deux mondes différents, l’un marqué par une ardeur au commerce, l’autre par une inclination à la guerre. Le paysage était morne, peu entretenu. La plaine où s’élevait l’oppidum se divisait en vastes terrains laissés en friches qu’on peinait cependant à délimiter tant les parcelles en étaient lâches, séparées par des murets herbus à demi enfouis ou des layons effacés. Rien n’avait la ligne parfaite et rigoureuse des champs céréaliers qu’on trouvait plus à l’ouest. On sentait que la propriété agricole avait moins de force, moins de prospérité par ici. Le déboisement de la forêt avait dû être entamé puis arrêté par manque d’intérêt. 286
L’habitat aussi était épars. Les villages ne groupaient guère qu’une poignée de masures reliées entre elles par des chemins transparents sous les gelées. Aucune ferme d’importance ne se dégageait du lot. Toutes étaient des cahutes branlantes et noiraudes que les intempéries menaçaient de faire s’effondrer. Surtout le superflu, l’ornement en étaient inexistants. Dépourvues de fossés, de palissades, même d’enclos ou de treillis où aurait grimpé une vigne en été, dénuées de greniers, de granges, de remises où stocker le matériel et les vivres, elles figuraient la cabane la plus simple, la plus pauvre, la plus triste qui fût face aux éléments de l’hiver finissant qui tôt ou tard l’emporteraient. Quelques porcs, une basse-cour se dandinaient en picorant ou en fouillant le sol. À l’opposé de ces misères, il y avait, comme sur n’importe quel site de Gaule, des massifs d’arbres. Le premier, qui s’élevait en une pente douce, était à quelque cinq cents pas en bas des remparts, assez loin de la route d’Agédincum et des villages environnants. Ce vestige de l’ancienne forêt était le lieu le plus proche, le plus dense, curieusement le moins fréquenté aussi, où Magon pourrait s’abriter. Qui montait et descendait la route de l’oppidum serait aperçu de là parce que la vue de la plaine n’était, dans un axe large, obstruée d’aucun obstacle. Ce bout de forêt, coupé du vent qui aiguisait la peau, était dans la continuité de ce qu’on appelait la forêt des Carnutes, l’antique forêt des druides. Il en eut aussitôt l’intuition. Par rapport au cœur impénétrable où il avait vécu avec Atis et Dagios, c’était l’autre extrémité qui s’étendait du côté des Sénons. Mais c’était bien la même. Bien sûr, ce n’était pas encore la pleine forêt, continue et secrète – un oppidum n’aurait pu être érigé si près d’elle –, mais c’en étaient les premiers massifs importants et il pouvait très bien s’y cacher, à l’aise comme dans un élément connu qu’il avait arpenté pendant de longs mois. C’étaient les mêmes arbres, les mêmes mousses, la même senteur humide de l’ombre et de la terre. Il ne fut pas dépaysé. Ce qu’Atis lui avait appris fut là encore utile. Pour manger, il ramassa des feuilles et des plantes vivaces ; pour s’hydrater, il recueillit la neige la plus pure, celle qui n’avait pas fondu et qu’il trouva au couvert des roches et des chablis ; pour se reposer, il s’installa au creux d’un chêne immense que réchauffaient quelques rayons de soleil et qu’il nettoya comme il put de la poussière de givre. Au reste, cela lui suffit parce qu’il avait mieux à faire. Son propre sort ne lui était rien ; ce qui le préoccupait, c’était celui d’Aldéa. Le choix du chêne s’était fait en ce but parce que, quoiqu’il n’eût rien de celui d’Atis, il culminait au-dessus des autres arbres et dominait la plaine où l’oppidum était implanté. Il passa des jours entiers niché à la base du houppier, entre ses branches maîtresses suffisamment fournies malgré l’absence de feuilles, à regarder la place forte au loin, à guetter l’occasion 287
de faire évader son amour, ne descendant jamais, persuadé qu’il trouverait enfin comment s’y prendre, au point d’en avoir des crampes et de finir presque par faire corps avec le bois. Il se cachait de temps à autre, quand des enfants venaient jouer ou des chasseurs poser leurs collets ; personne de toute façon ne pensait à lever le regard si haut. Il réfléchit aux moyens d’action dont il disposait, bénéficiant d’un recul suffisant pour analyser la situation géographique et trouver le moyen de pénétrer à l’intérieur des fortifications. S’il intervenait subrepticement, il ne fallait pas se faire prendre ; s’il s’engageait au contraire à découvert, il ne fallait pas montrer le prix qu’il attachait à la jeune femme qu’il aimait car les Sénons se seraient alors empressés de faire monter les enchères. Il n’avait ainsi pas le choix : ou bien il localisait la prison et parvenait à libérer Aldéa sans donner l’alarme ; ou bien il se servait d’un autre pour donner le change et faire croire que son intérêt portait sur lui et non sur elle qu’il aurait réclamée en passant. Il pencha d’abord en faveur de la première option parce qu’elle était d’exécution plus rapide, plus directe. Il réfléchit pour entrer incognito, envisagea de se glisser dans un des convois de ravitaillement qui passaient très souvent les portes ou de se faufiler par l’issue dérobée à l’arrière des murailles. Mais il s’arrêtait toujours assez vite tant cela lui paraissait dangereux. S’il était pris, s’il était tué, il scellait à jamais l’avenir d’Aldéa ! Il pencha alors pour la deuxième option qui lui convenait mieux parce qu’elle était finalement plus réfléchie : entrer à découvert en se présentant simplement et en prouvant son pacifisme. Une idée audacieuse lui vint même. Il se demanda s’il ne pouvait s’appuyer sur Latro, le réclamer lui pour la libérer elle. Il devait imaginer l’occasion de gagner la confiance des autorités et du peuple pour procéder à un marchandage. Cette occasion, il y avait fort peu de chance qu’elle se présentât toute seule. Elle nécessitait au contraire d’être provoquée. Or, chaque matin, une même scène se répétait, invariablement. Aux premières lueurs, alors que Vellaunodunum s’éveillait lentement, il ne voyait pas Aldéa mais une silhouette inconnue sortir dans la grisaille et s’en venir en sa direction. Cette silhouette était toujours seule. Fine, petite, élégante aussi par sa démarche ondulante, elle avait une forme adolescente qu’une longue pèlerine blanche à capuche ne permettait pas d’identifier davantage entre chien et loup dans le paysage lui-même blanchi de l’hiver. Il la voyait s’approcher d’un pas toujours égal et léger, se dérobait comme il pouvait derrière son branchage. Puis la silhouette entrait dans le sousbois, marchait sous le chêne où il était haut juché, s’enfonçait plus encore sans même se retourner ni lever la tête, sans même avoir fait craquer une branche. Elle ne faisait que passer, presque survoler le sol. Une scène 288
identique se déroulait le soir, en sens inverse. L’être revenait de la forêt, passait sous le chêne, regagnait l’oppidum aux derniers rayons du jour lorsque les portes se refermaient et ne laissait dans la tête de Magon que le souvenir insolite de son apparition. Le Maltais cependant s’habitua peu à peu à ce passage mystérieux, se demandant simplement qui était la personne dissimulée sous la capuche et ce qu’elle allait faire ainsi en forêt chaque jour. Il ne voulait pas lier connaissance avec les habitants de la région comme il l’avait fait chez les Carnutes, mais ce passage excitait sa curiosité. Et puis un matin, alors qu’il ne s’y attendait pas, la silhouette encapée de blanc s’assit sur une pierre et, sans se découvrir, se mit à parler : – Que fait, perché dans l’arbre, le bel oiseau qui vient de loin ? Caché dans son chêne, Magon demeura immobile, regardant partout, incapable de savoir si l’on s’adressait à lui ou à quelqu’un d’autre. La voix, mélodieuse, légèrement aigre, s’approchait de celle d’une jeune fille. Elle continua : – Il n’a pas de plumes, il ne chante pas, mais il espère le printemps et le retour des amours. Quelle amourette, bel oiseau, nature n’a-t-elle jamais rendue ? Sans ôter sa capuche, sans même dresser la nuque, l’être se mit alors à chanter, d’une voix si belle qu’on eût dit non pas celle d’une femme mais celle d’un oiseau modulant ses notes de gaieté à l’arrivée du printemps. Soudain il se tut et dit après un silence : – Il peut descendre pépier à moi. Il n’y aura pas de chasse à l’oiseau aujourd’hui. Magon crut comprendre l’invitation, descendit enfin en regardant tout autour car il se méfiait toujours d’un piège. Il s’avança et, tandis qu’il le fit, l’autre eut un petit rire d’où sortit une phrase sibylline : – Alors l’oiseau devient daim et approche le monstre. – Que dis-tu ? Qui es-tu ?, demanda le Maltais. – Il est celui qui diffère de l’homme, qui diffère de la femme. Est-il comme l’amie grenouille ou comme la fleur qui tantôt charme tantôt se fane ? – Je…je ne te comprends pas… Que me veux-tu, jeune fille ? À cette ingénuité, pour la première fois, l’autre leva la tête et le regarda d’un air enjoué. Il éclata de rire, d’un de ces rires frais pleins de jeunesse à la fois innocents et déjà lourds d’érotisme. Il se leva, se mit à danser d’un mouvement amusant. Tout à coup, il se planta nez à nez devant lui et murmura très vite : – Si la fille imaginée est le fils dédaigné du fils honoré d’une fille oubliée, ce n’est pas ce que tu crois. 289
Dans un éclair, Magon aperçut un visage qui n’était ni tout à fait celui d’une gamine ni tout à fait celui d’un garçon. Mais il n’eut pas le temps d’en voir plus. L’être espiègle s’enfuit, toujours la capuche sur la tête, toujours en paraissant survoler le sol. Et Magon resta là, éberlué, sidéré d’étonnement. Ce soir-là, il se cacha ailleurs dans la forêt, quitta le chêne d’où il guettait l’oppidum pour dormir sous le tronc d’un hêtre dans une zone reculée. Il redouta d’avoir été découvert, écouta toute la nuit si des troupes ne venaient pas le chercher. Il n’y eut rien, mais il peina à se tranquilliser. Et grelottant de froid à même la terre, la peau bleuie par plaques, il crut alors entendre rire. Ce rire, c’était celui de la jeune fille. Mais était-elle vraiment fille ? Il se remémora son visage et n’aurait pu trancher. Quand, au petit matin, lassé de ses questionnements, épuisé de n’avoir presque pas dormi, il se décida à remonter pour ne pas perdre une chance de délivrer Aldéa, ce fut avec stupeur qu’il vit se dérouler la même scène que les autres jours : la silhouette encapuchonnée dans son manteau blanc sortait de Vellaunodunum et traversait la plaine pour venir à sa rencontre. – Eh oh, l’oiseau ! Volette jusqu’à moi, tu m’amuses !, dit-elle quand elle fut enfin en bas de l’arbre. Sa voix avait par moments des notes cristallines et graves. Magon redescendit avec moins d’hésitation. L’adolescent enleva sa capuche de lui-même. Il eut alors la surprise de lui voir des traits peu communs. Plus exactement, des pieds à la tête, on n’eût su dire s’il était fille ou garçon. Chaque détail de son physique n’appartenait ni à l’un ni à l’autre des deux sexes en même temps qu’il participait de tous deux, et cette impossible combinaison dans ce même corps en faisait l’être le plus ambigu et l’un des plus beaux qu’il eût jamais vus. Tout en lui portait à confusion, confinait à la grâce. Sur son visage, les sourcils étaient très fins, longilignes, les yeux cerclés de grands cils, la bouche délicate, pour ne pas dire sensuelle, alors que le front était haut, le menton carré et les joues, quoiqu’imberbes et dénuées de balafres, minces et sèches comme seules des joues d’hommes peuvent l’être. Les boucles d’oreilles et bracelets, les longs cheveux d’un blond doux, les mains fluettes d’une blancheur si hivernale qu’on aurait pris chaque phalange pour un flocon de neige chuté côte à côte, tout venait conforter l’équivoque, jusqu’au vêtement qu’il portait, composé de braies d’homme et d’une tunique de lin, si longue, si ample qu’elle pouvait se comparer à la robe d’une femme en tombant sur sa taille pincée et ses hanches développées. Un détail achevait de déstabiliser celui qui contemplait cet être extraordinaire : il avait les yeux vairons, l’un à la couleur forte de la terre, l’autre à celle intense du ciel, 290
comme si son regard était un lien entre le monde des hommes et celui des dieux. Alors Magon comprit la rencontre qu’il était en train de vivre. Se pouvait-il que l’être qui se tenait devant lui fût ce qu’on appelait un androgyne, autrefois un hermaphrodite ? Des lectures entières lui revinrent immédiatement en tête. Il n’y avait pas besoin de connaître sa constitution interne, l’apparence comme toujours suffisait à le constater. Il était prouvé médicalement que des mères pouvaient accoucher de créatures multiformes tels des hippocentaures, des jumeaux, des enfants mi-mâles mi-femelles. Le changement de femmes en hommes, d’hommes en femmes n’était pas une légende, pouvait même avoir lieu à tout âge, lentement ou de façon subite. Des garçons avaient ainsi vu leur voix s’éclaircir à l’adolescence, leur pilosité ne jamais se développer, leur ligne demeurer frêle tandis que, du jour au lendemain, des femmes adultes avaient découvert la pousse d’une barbe autour de leurs lèvres et avaient même pris épouse. Dans les cas les plus sévères, la morphologie des attributs sexuels était profondément altérée. Ces caprices de la nature, on les considérait comme des prodiges sombres, des merveilles obscures, parfois des objets de plaisir – il le savait bien. Certains avaient été tués, d’autres relégués sur une île déserte, d’autres encore gardés dans les alcôves des palais comme on gardait des nains, des bossus ou des esclaves exotiques. Les monstres étaient alors des monstres désirables. Qu’en pensaient les Gaulois ? Quel statut leur accordaient-ils ? Il l’ignorait, s’en souciait d’ailleurs peu. C’était la première fois qu’il voyait un tel spécimen et il se contentait pour le moment de l’observer. L’espace d’un instant, il oublia Aldéa. – Si l’oiseau dit bonjour, dit le jeune androgyne avec un sourire malicieux et calme, l’être bizarre ne lui rendra-t-il pas son salut ? – Alors bonjour, répondit Magon qui commençait à se familiariser avec sa manière de parler. – Bonjour, bonjour ! Bel oiseau a-t-il été fâché de ma fuite d’hier ? – Il n’y a pas que les oiseaux qui volent à tire-d’aile. L’autre fut heureux de la réponse imagée comme il aimait à en faire. Il se présenta : – Le monstre s’appelle Duisto et il ne faut pas avoir peur, il est gentil. Il lui avait apporté un présent qu’il lui tendit pour illustrer son affirmation. C’était une tunique de laine épaisse couleur de sable et des braies qui semblaient n’avoir jamais été enfilées. Magon les accepta, troqua immédiatement ses intolérables haillons pour ces vêtements plus chauds. Il demanda : – Duisto ? C’est ton nom ? 291
– Duisto, Duisto, Duisto !, chanta l’autre en le voyant avec plaisir enfiler son cadeau. Serait-ce le mot « couple » dans l’idiome des Sénons ? – L’homme et la femme en quelques lettres. – L’homme et la femme, la femme et l’homme ! Bel oiseau rira-t-il lui aussi comme le rossignol ou le merle moqueur ? – Je te promets que je ne rirai jamais de toi. Ni ne te craindrai d’ailleurs. Je ne crains que l’ignorance et la bêtise des hommes. – Bel oiseau qui vit en haut des arbres serait-il un être à part ? Duisto l’a senti tout de suite. Aujourd’hui comme hier, il n’a pas de plume, il ne chante pas, mais sans doute espère-t-il toujours sa bien-aimée. Ce fut ainsi que Magon fit la connaissance de Duisto le fol, sans savoir qu’il était fils d’Acco le fougueux. Pour la première fois depuis la mort d’Atis, il avait de nouveau envie d’en apprendre plus et il était heureux que sa soif de découverte ne fût pas étanchée malgré tous les événements tragiques qu’il avait traversés. Ils se rencontrèrent au même endroit chaque matin, chaque soir. Leurs échanges ne durèrent jamais très longtemps. Magon ne voulait pas quitter l’oppidum de vue, Duisto s’en allait toujours vite en forêt. C’était un entretien de quelques bribes qui pourtant faisait longuement réfléchir le Maltais et lui faisait trouver l’attente moins longue. Duisto s’exprimait par interrogations énigmatiques qui rappelaient les aphorismes d’Atis. Mais certainement en raison de son âge, il était plus impertinent dans ses paroles qui confinaient davantage à des allitérations poétiques. « L’anomal est-il animal par mal de n’être né qu’à moitié mâle ? Quoi de plus sûr par nature que la dureté des hommes ? L’apparence des parents part-elle en cendre dans les enfants ? Quand l’homme parle à la femme et que la femme répond à l’homme, n’est-ce pas la plénitude de l’être ? » Sa langue ne semblait se résumer qu’à ces formules absconses qui étaient en même temps d’une richesse intellectuelle considérable ; il paraissait incapable de rien dire autrement. Et pendant qu’il lui parlait, Magon était troublé par son étrange charme. Le souvenir des grands mythes qu’il avait autrefois lus avec plaisir le disputait à son appétit de science. Auprès d’un être comme Duisto, il aurait été tenté de croire de nouveau aux fables des poètes qui, pour imaginer l’ineffable beauté, n’ont d’autre choix que de l’incarner en une créature impossible comme l’était le fils d’Acco. Il repensait à l’enfant d’Aphrodite et Hermès. À l’instar du baigneur de Carie, il y avait quelque chose d’une divinité dans ce personnage. Et si certains se prétendaient les lointains descendants de la déesse de la beauté, il était sûr que celui-ci en fût le fils en droite ligne. Rapidement, malgré le peu de paroles échangées, ils sentirent une estime, une confiance réciproques poindre entre eux et ils en vinrent à 292
devenir ce qu’on pourrait appeler des amis – d’une de ces amitiés floues où l’on ne saurait donner trois informations précises sur celui dont on sent pourtant l’affection. Jamais Magon ne dévoila à Duisto ses objectifs et Duisto ne demanda jamais directement à Magon ce qu’il attendait ainsi caché en forêt, mais plusieurs fois, le corps raidi, le visage grave, il évoqua une bien-aimée qu’il paraissait deviner dans les yeux du Maltais et lui prédit, de façon énigmatique, qu’il la retrouverait bientôt. Savait-il réellement quelque chose d’Aldéa ? L’avait-il vue ? Ou devinait-il l’inévitable à voir le visage triste de Magon ? Le jeune homme attendit longtemps avant de lui poser la question. L’envie le brûlait mais il n’osait lui demander. Non pas qu’il craignît maintenant d’être trompé, mais parce qu’il refusait que son nouveau compagnon pensât qu’il ne cherchait que cela, qu’il n’était devenu son ami que pour obtenir des informations, un service. Ce n’était pas l’idée qu’il se faisait de l’amitié ; il avait le sens fort de la gratuité des relations. Une sorte de pressentiment d’ailleurs lui disait qu’il ne perdait pas son temps, bien au contraire, qu’il fallait patienter. De fait, les choses se réalisèrent d’elles-mêmes. Un soir, revenant à son ordinaire de la forêt où il avait passé la journée, Duisto le prit par la main et l’invita : – Bel oiseau toujours dans l’arbre voudrait-il voler avec moi jusqu’aux portes de la ville ? Qu’il n’ait pas peur : Duisto ne le trahira pas et se porte garant de sa protection. Magon tressaillit intérieurement de joie. Enfin, un prétexte se présentait d’entrer dans l’oppidum pour savoir ce qu’était devenue Aldéa, sinon s’en approcher ! Il accepta, non sans une certaine appréhension, quitta la forêt où il se camouflait depuis des jours et, dans le soir, on vit comme à l’accoutumée la silhouette blanche du fou flotter dans la plaine, mais accompagnée d’un homme, un étranger vêtu à la gauloise, dont le pas semblait preste et hâté par l’espoir. Au seuil de l’oppidum, dans les rues, on ne leur demanda d’abord rien. Il était tard, les artisans terminaient leurs travaux et l’on entendait de derniers coups de marteaux sur les enclumes, de derniers sifflements dans les ateliers au milieu des ordres donnés aux plus jeunes pour nettoyer les chantiers. Les soldats, eux, sur le chemin de ronde des palissades, aux portes ou aux points névralgiques de la ville, se préparaient à une longue soirée de veille et, occupés encore à discuter, à plaisanter, à s’emmitoufler avant les heures de froide solitude, ils n’accordaient aucun regard au passant qui ne portait pas de robe ou de tresse délicate. Néanmoins, si personne n’osa interpeler le fils d’Acco, on remarqua quand même qu’il était accompagné et l’on se contenta de transmettre le message qu’il revenait avec un inconnu. 293
Ce fut lorsque les deux amis arrivèrent en haut de l’oppidum, dans le quartier des nobles où résidait Duisto qu’on sembla vraiment les reconnaître et qu’on considéra Magon avec méfiance. La hutte où ils se dirigèrent, celle du devin, était pauvre et d’apparence banale. Construite le plus simplement du monde au tournant d’une rue, elle était lézardée de fissures qui semblaient autant de cicatrices du temps sur sa façade. Le chaume de son toit s’arrachait par endroits comme un crâne qui desquame ; ses murs se gonflaient et se renflaient telle l’échine souple d’un acrobate désossé. Aucune fenêtre ne donnait sur la rue ; malgré les températures la porte n’était bouchée que d’une grosse laine glauque qu’un léger courant d’air soulevait. La demeure n’avait pas non plus de marque d’apparat ou d’honneur qui l’eût rehaussée parmi d’autres, aucune arme ni trophée qui fût accroché à l’extérieur. On aurait dit une cabane dont l’oppidum attendait la ruine lointaine sans y faire grand-chose parce qu’il ne voulait pas y toucher, ne savait comment y toucher, empli de respect et en même temps gêné par sa présence. D’un aspect hideux, elle était une verrue poussée là, inoffensive mais triste et dérangeante, qu’on n’osait gratter pour la faire disparaître. Par son côté imposant, elle était un géant endormi, replié sur lui-même, les yeux clos, la bouche seulement entrouverte d’un voile de ronflement, dont on se demandait s’il dormait pour toujours ou s’il allait se réveiller. Jamais on n’aurait pu imaginer que le fils d’un des plus puissants seigneurs du pays y logeât. Malgré tout, cette maison était le lieu d’une sorte de culte, à tout le moins d’honneurs répétés car celui qui interprétait le message des dieux y vivait. Elle était comme les chapelles de ces temples dans lesquelles on craint d’entrer au risque de pénétrer une intimité sacrée et dont on se limite au seuil. On ne savait ce qui se déroulait vraiment à l’intérieur, la population s’imaginait tout et en parlait avec une estime craintive. Elle se cantonnait au-dehors pour montrer ses égards. Devant l’entrée, il y avait en effet une sorte de petite niche creusée dans le mur à ras du sol. Des dons y étaient parfois présentés, que les autorités n’osaient faire enlever. C’étaient un panier de fruits, une viande, un tissu, un bijou, jamais d’armes. Déposée le soir, l’offrande avait toujours disparu au matin et il n’était pas rare de voir ensuite le devin rassasié porter insouciamment, mais le plus modestement du monde, ses nouveaux colliers et bracelets par les rues si bien qu’on lui en aurait apporté plus, n’eût été le prix des objets et des vivres. Alors qu’il allait y entrer, Magon fut apostrophé : – Qui es-tu, l’étranger, qui marches avec cet oracle ? Il se retourna, reconnut immédiatement l’homme qui le hélait au milieu d’un groupe de soldats. S’il ignorait qu’il s’appelât Vilomar, il se souvint 294
parfaitement qu’il était le chef des cavaliers tombés sur le convoi de Latro – ceux qui avaient enchaîné Aldéa. Il répondit humblement : – Je me nomme Magon de Malte. Je suis fils de Barakbaal lui-même fils de suffète. Je suis médecin, je m’en viens de très loin pour voyager, apprendre et, si la guerre est déclarée par chez vous, sachez que je suis l’ennemi naturel des Romains. Ce dernier point était faux bien sûr tant la guerre en général le répugnait. Mais il voulait obtenir la sympathie, sinon la tolérance du bonhomme. Il n’eut cependant pas le temps d’en dire plus. Duisto intervint : – Vilomar serait-il le vautour qui vient frapper l’alouette s’en allant nidifier ? L’autre grogna, apparemment partagé entre sa méfiance et une sorte de déférence qu’il devait au fils du fougueux. Il s’en alla en marmonnant qu’il allait prévenir le Conseil. Sitôt qu’il le vit parti, Magon se tourna vers Duisto : – Un oracle ? Il a parlé d’un oracle. C’est ce que tu es donc ? Son compagnon acquiesça d’une voix aigrelette qui répondait à la fois par l’affirmative et ôtait tout orgueil à sa réponse. La pensée ne fit qu’un tour dans l’esprit de Magon qui aussitôt s’en trouva curieusement embarrassé. Ils existaient donc encore, les devins qu’il croyait révolus. Duisto, Atis… Le paradoxe voulait que comme le druide qu’il avait côtoyé, ce n’étaient que des figures isolées, marginalisées, presque inventées par le cerveau fou d’un poète, qui continuaient de mettre en l’honneur l’art et la science celtes menacés. Évidemment, comme toujours en ces occasions de rencontres et de découvertes inattendues, il aurait voulu en savoir plus sur sa pratique de la vaticination parce qu’il ne pensait pas qu’il y avait encore des nations qui accordaient crédit à des sentences pythiques ou sibyllines comme du temps de leurs ancêtres. Mais il n’aurait osé quitter l’oppidum, s’adonner de nouveau à l’étude car ç’aurait été pour lui abandonner Aldéa. Si seulement il avait eu une preuve qu’elle allait bien, qu’elle endurait encore ses tourments ! Son visage dut esquisser une grimace tiraillée. Duisto l’interpréta mal, la prit pour de la crainte, voulut le rassurer une fois encore : – Que bel oiseau ne soit pas effrayé. Y a-t-il maison plus interdite que celle-ci à leurs yeux ? Duisto le fol n’est pas prêtre, mais ils lui confèrent les pouvoirs d’un oracle et la nature a voulu qu’il soit le fils unique d’Acco. Bel oiseau sera protégé avec lui. Il renchérit : – Ils aiment les histoires. Vraie ou fausse, la vérité n’est souvent qu’une interprétation. Bel oiseau s’en souviendra s’il a besoin de leur parler. 295
Magon retint le conseil. Le nom que Duisto venait d’évoquer, celui d’Acco, éveillait un vague souvenir dans sa mémoire, trop lointainement cela dit pour qu’il l’eût fixé au milieu de tous les événements qu’il avait traversés. Et pour cause, la seule fois où il l’avait entendu, c’était dans la vision suscitée par Atis, cette vision qui lui avait permis d’assister à la fin tragique de Sagéra, où les noms qu’il avait entendus avaient tous eu le même écho nébuleux qu’ont les mots dans les rêves. Il y réfléchit toute la nuit, mais vaincu par le confort retrouvé depuis longtemps d’un repas correct et d’une paillasse qui ressemblait à un lit, il ne s’en rappela plus. Les jours s’écoulèrent. Le dégel s’acheva, les arbres retrouvèrent des frissons de verdure au contact des premiers rayons du soleil printanier. En quelques jours seulement l’hiver ne fut plus qu’un mauvais souvenir. La vie frémissait d’être de retour. Magon retrouva la tranquillité en plein cœur de Vellaunodunum. Duisto vivait plus pauvrement qu’un esclave, mais plus gaiement qu’un prince comme si le monde réel n’avait aucune prise sur lui. Sa maison résonnait matin et soir de chants de pucelles et de rires de damoiseaux qu’il faisait entendre tour à tour. Car il était tout cela, à la fois mâle et femelle, riche et pauvre, noble et misérable et il n’avait besoin d’introduire personne pour emplir son quotidien de diversité. L’ambivalence lui seyait. Il ne se plaignait jamais. Partant, son invité n’eut jamais l’idée de le faire non plus. Magon était le seul inconnu alors présent dans l’oppidum qui comptait trois fois moins d’habitants que l’emporium des Carnutes. Le Conseil avait été avisé le soir même de sa venue ; il l’avait interrogé, avait obtenu des réponses sans doute convenables, n’avait rien trouvé à objecter à sa présence. Il lui accorda un statut d’hôte qui incluait respect et protection de la part des autorités locales. Les Sénons, comme tous les Gaulois, restaient d’ailleurs accueillants envers les étrangers qu’à la différence d’autres peuples ils n’avaient pas l’habitude de croiser beaucoup par chez eux. Il n’y avait qu’en temps de guerre qu’ils se crispaient un peu plus. Passé la défiance première envers Magon, les habitants lui trouvèrent même un surnom quand un jour ils croisèrent Duisto d’humeur particulièrement heureuse. – Bel oiseau est passant !, entonnait-il à travers rues, bel oiseau est passant ! Sauvera-t-il la fleur de la Gaule ? L’annonce d’un prodige ne l’aurait pas rendu plus joyeux. Il dansait, il jonglait avec des cailloux, marchait sur les mains. On interpréta sa parole comme un de ses oracles ; on respecta Magon pour cela et on l’appela l’empassant. L’empassant, ce n’était pas bel oiseau. Le surnom avait le mérite d’être moins affectif que celui conféré par Duisto et entendu de 296
tout le monde. Sans trop de brutalité, il rappelait indirectement que si l’étranger était toléré à Vellaunodunum, il n’avait pas vocation d’y rester. Il était de passage. Le jeune homme l’accepta volontiers : après tout il se savait continuellement en partance, souhaitait ne pas avoir d’attaches par ici. Une fois Aldéa libérée, il ne resterait pas un instant supplémentaire, s’en retournerait sans doute à l’ouest où se trouvait Samogaion dont il ignorait encore la ruine. Il en parut plus aimable, libéré de toute obligation importante envers les habitants. Avec sympathie, ceux-ci vinrent l’observer, le toucher, lui proposer à manger, essayèrent même de converser en sa compagnie. Les filles, plus timides, n’affluèrent qu’en groupes, riant à le dévisager derrière leurs frisons et leurs nattes, devant rêver de lui quelque temps dans les moiteurs de leur lit. Ces scènes cependant se passèrent exclusivement dans la rue. La maison de Duisto, qui n’employait aucun serviteur, demeura un refuge où nul n’osa jamais s’introduire. Seuls les prêtres de Vellaunodunum ne vinrent pas le voir comme s’ils redoutaient la personne du fils d’Acco dont l’oracle échappait apparemment à leurs cultes. La curiosité s’amenuisa néanmoins peu à peu. On finit par oublier. En ces temps troubles, on avait manifestement d’autres chats à fouetter. Libre d’aller et venir sur la place publique, Magon eut alors tout loisir d’observer ce qui se passait autour de lui. Ce fut d’abord un frisson discret qui parcourut la ville, puis un ébranlement commun qui s’accentua au fil des jours pour prendre la forme d’une fièvre croissante à mesure que l’intérêt à son encontre disparaissait tout à fait. Quand cette fièvre se fut emparée de tous, il réalisa que la guerre était bel et bien de nouveau déclarée. Partout il vit les soldats s’entraîner et suer à l’exercice, partout les vivres s’entreposer dans des caves, des resserres, partout les murailles se renforcer d’étais ou de pierres nouvelles. Les civils n’étaient pas en reste. Dans chaque atelier, il assista à l’affûtage des lames, à l’assemblage des boucliers de bois, de métal et de cuir, à l’assouplissement des lambrequins et au maillage de cottes innombrables. Hommes, femmes, enfants, vieillards, il ne put bientôt faire un pas sans voir un habitant contribuer à sa manière à l’effort général. C’était comme un fourmillement industrieux incessant, une cohésion sourde de la cité dans un même objectif encore inavoué. Il n’eut aucun besoin d’interroger pour comprendre que l’on se préparait à des batailles, peut-être même à un siège. Au milieu de cette agitation, il ne vivait tranquille que d’après ce que pouvaient en juger ceux qui ne connaissaient pas les raisons de sa présence. Une nervosité plus forte en réalité le tenait, une tourmente silencieuse mais réelle qui soufflait en lui et ne lui accordait aucun répit. Car la rencontre de Duisto, l’hospitalité des Sénons n’avaient rien changé : il ne pensait qu’à 297
Aldéa, n’avait en tête que celle qu’il aimait. L’évolution de sa situation avait même aggravé ses souffrances tant il se désolait maintenant d’avoir échappé à tous les dangers et de ne pouvoir encore intervenir. Il se maudissait de rester en apparence inactif. Ce n’était pas en lui l’excitation qui précède les grands combats, mais la désespérance de ne pouvoir mener le sien. La tempête le ravageait intérieurement ; il se forçait à n’en laisser rien paraître. Il avait compris que pour affranchir la jeune femme de sa captivité il devait encore prendre le temps de l’observation, non plus de l’extérieur mais de l’intérieur des remparts. Au centre de la ville, il avait justement repéré la prison, visible depuis la hutte de Duisto. C’était un cachot gardé par deux hommes dont la porte étroite, légèrement penchée en arrière, indiquait la déclivité du sol à l’intérieur. Elle était sans doute modeste, mais la fatigue, le désespoir, l’incapacité d’agir face à cet obstacle relatif firent qu’il lui donna des proportions démesurées. À travers les barreaux de la grille, épais comme deux fois ses bras, où s’accolaient à longueur de journée des prisonniers qui cherchaient la lumière, il faisait très noir, d’un noir si profond, si froid, si morbide qu’il semblait aspirer le regard que l’on posait dessus. On devait tomber dans cette prison comme on dévalait une entrée des Enfers et la geôle ne semblait pas avoir de fin. Qu’y avait-il au fond de cette gueule assoupie, tranquille, qui pouvait se rouvrir à tout instant et avaler un condamné ? Quel cauchemar ? Quelle torture ? Celle enflammée du Moloch qui dévorait les enfants jetés dans le brasier ne lui eût pas paru en cet instant plus terrible. C’était inimaginable. La première fois qu’il comprit que ce trou impénétrable dont même un chien aurait eu peur, ce trou imperméable au réveil du printemps et de la vie était la prison, il voulut se précipiter, aller dégager Aldéa de ses liens sur-le-champ. C’était le lendemain de sa première nuit chez Duisto, au petit jour. Il n’y avait encore personne dans les rues, les gardes somnolaient. Mais le fils d’Acco, le voyant tourner en rond, serrer les poings, prêt à bondir, l’arrêta en lui disant étrangement que le moment n’était pas encore venu. Il ne lui posa aucune question, ne chercha pas à savoir ce que Magon lui cachait. On aurait dit qu’il savait déjà parce qu’il savait comment tout cela finirait. Et cette assurance troubla si profondément le jeune homme qu’il retint son élan ; si son ami était un oracle reconnu, pourquoi aurait-il dû remettre sa parole en doute ? En attendant, où était-elle dedans ? Avec qui ? Dans quel état ? Autant de questions dont il n’avait pas les réponses parce qu’il ne voulait pas les poser de peur d’éveiller les soupçons ; autant de questions auxquelles il n’osait répondre de lui-même de peur d’imaginer le pire. Il se résigna avec douleur à ce supplice. Il n’avait jamais été aussi proche d’Aldéa qu’il ne 298
voyait pas, mais dont il sentait la présence au fond de cette geôle et il dut exercer un effort immense sur lui-même pour ne pas tout gâcher si près du but. Il en fut réduit à écouter aussi souvent qu’il passait devant la grille. Parfois il lui semblait que des cris s’élevaient des profondeurs, mais si aigus, si terrifiés et en même temps si étouffés qu’il se demandait s’il ne les avait pas inventés et ne pouvait dire si c’étaient des hommes ou une femme qui hurlaient. Un frisson d’épouvante le traversait, qui s’accrut quand il apprit qu’on surnommait cette prison le Boyau. Duisto l’avait-il compris ou fut-ce l’effet du hasard, il ne laissa pas à son hôte le temps de se torturer. Il l’invita chaque jour en forêt et Magon, voyant bien qu’il ne pouvait rien faire de plus devant la prison que risquer de se compromettre, se rendant enfin à la raison malgré son refus premier d’abandonner l’oppidum, craignant de froisser son nouvel ami et de s’attirer sa colère, cédant peut-être aussi au désir de science qui ne l’avait jamais vraiment quitté, Magon accepta à contrecœur. Mieux, l’impression étrange l’habitait, qu’il n’abandonnait pas Aldéa mais se rapprochait indirectement d’elle par un long détour nécessaire. Assez vite il y trouva de l’intérêt car ce qu’il découvrit était à la fois des plus simples et des plus surprenants. À une heure de marche de l’oppidum, une fois passé le chêne sous lequel le Maltais l’avait rencontré le premier matin, Duisto avait un repaire sauvage et calme où il aimait à rester toute la journée. Là-bas, il n’y avait pas d’abri, encore moins un quelconque sanctuaire érigé. Au milieu d’une trouée, ce n’était qu’un grand rocher plat surélevé, une sorte de galet très lisse et très propre posé à vingt pouces du sol, d’où il aurait pu voir à la fois le plein ciel, les éclairs sous l’orage et le vol des oiseaux s’il avait versé dans ces techniques ; les rainures dans la pierre auraient permis d’y faire des sacrifices et d’étudier l’écoulement du sang. Duisto cependant ne récitait aucune prière, ne faisait aucun geste rituel ; les manières courantes de divination lui semblaient inconnues. Il s’asseyait simplement, les jambes en tailleur et, par tous les temps, il restait là sans bouger. Il passait sa journée à chantonner doucement selon l’air du vent, à mouvoir ses bras en gardant ses jambes immobiles, à confectionner des poupées et des couronnes avec des branches de noisetier souples entrelacées. Alors que d’ordinaire il était seul, peut-être même pour cette raison, il discuta beaucoup avec Magon quand celui-ci l’accompagna – si tant est que ses divagations pussent être appelées discussions. Ce n’était pas l’isolement définitif d’un ermite comme Atis, mais un lieu de recueillement où il passait ses journées avant de s’en retourner le soir. Parfois, on venait aussi le rencontrer si bien que sa solitude était de toute façon interrompue et n’aurait pu lui peser. Sa retraite ne connaissait sûrement pas l’affluence des grands sanctuaires ; néanmoins, des villageois 299
des environs, des petites gens, plus rarement des nobles de l’oppidum, exceptionnellement encore des voyageurs venus de plus loin par la route d’Agédincum se présentaient gauchement, contre toute attente intimidés par l’humilité du personnage et troublés par la simplicité des lieux. Duisto ne versait alors dans aucun cérémonial, les choses ne se faisaient sous l’égide d’aucune divinité, il ne se couvrait pas le chef : comme il le rappelait lui-même, il n’était pas prêtre. Il restait assis, souriait et son sourire voulait dire qu’il trouvait la versatilité des hommes étonnante. Eux qui ne pouvaient dissimuler leur malaise quand ils le croisaient dans la rue et contemplaient son physique ambigu, eux qu’il dérangeait parce que le fils d’Acco aurait dû être un grand guerrier et qu’il ne l’était pas, ces mêmes individus venaient aussi le voir pour connaître l’avenir. Pourtant il ne les chassait jamais, acceptait de répondre à leurs interrogations sans même savoir si les réponses qu’il leur apportait étaient la vérité ou non. Pour ce faire, sa technique – si c’en était une – comme son attitude – si elle était recherchée – étaient d’une candeur inédite. Il n’examinait pas l’appétit des oiseaux comme au Port-des-corbeaux chez les Namnètes, ni l’écoulement d’une source comme Magon l’avait vu faire chez les Cadurques ; il ne faisait pas appel aux songes ou aux délires comme d’autres encore du côté de Marseille ; il n’entrait pas en transe, ne se jetait pas au sol à la suite d’une violente migraine, n’exhibait pas d’yeux blanchis par une quelconque possession. Son regard suffisait, serein et vif en même temps, où le bleu céleste d’un œil répondait au marron terrestre de l’autre et faisait communiquer les dieux et les hommes. Il semblait y avoir quelque chose de l’hypnose et de la folie dans chaque couleur de ses yeux hétérochromes. Ceux qui se présentaient étaient d’abord dérangés par la présence de Magon. L’étranger, dont le regard tranquille signifiait pourtant sa bienveillance, les incommodait dans cet acte qu’ils avaient conscience être d’un autre âge. Mais leur esprit très religieux les poussait sans cesse à faire fi de tout reproche et à connaître coûte que coûte la volonté divine. Sans attendre, tous posaient immédiatement leur question comme s’ils avaient voulu s’en débarrasser au plus vite et parce qu’ils croyaient quand même en leur bon droit : les récoltes seraient-elles convenables cette année ?, la guerre ferait-elle des ravages dans le pays ?, le fils d’un tel trouverait-il le meilleur parti à épouser ? L’oracle se déroulait tranquillement. Alors qu’il était en train d’écouter, Duisto semblait transporté, sa respiration se faisait plus calme, il entrouvrait légèrement la bouche et une autre voix, majestueuse, s’exprimait par magie. Et chaque fois, à ceux qui venaient le voir, il répondait sans répondre. Plutôt il formulait une nouvelle interrogation alambiquée, un message obscur qui renvoyait à eux-mêmes les espoirs d’éclaircissement des demandeurs. Les tiges du soleil seraient 300
hautes au zénith ; le père de la tribu nourrirait de terre les vautours et d’air les lombrics ; le sang du gouffre coulerait sur l’arme d’un heureux. Parfois il leur tendait une couronne ou une poupée qu’il avait tressées et ils devaient repartir avec en se demandant ce qu’il avait voulu dire. Comme la vérité échappait elle-même à son physique, elle échappait à sa parole et on ne savait quel degré de mensonge, d’équivoque l’habitait. Tout était affaire d’interprétation ainsi qu’il l’avait dit à Magon. Il ne donnait aucune explication. On peut gager que s’il en avait donné une, sa parole, rendue plus claire, en aurait été moins forte. Cette mantique sans support, dont la justesse était impossible à contrôler, n’était pas un art tant elle semblait impréparée. Dans son approche de la prophétie, Duisto paraissait envahi par l’inspiration d’un dieu dont il ne communiqua jamais le nom, à qui il n’adressa jamais une prière – ce qui le distinguait d’un prêtre ou de n’importe quel autre maître du sacré. Son verbe n’avait rien non plus de rationnel comme l’enseignement des druides. Il ne résultait pas d’une culture immense, d’une connaissance des phénomènes naturels, d’une maîtrise des nombres, obéissait encore moins à un système éthique créé. Duisto vivait sous les astres parmi les plantes et les animaux, il riait de la morale des gens normaux, mais c’était moins par choix que parce qu’il souffrait intérieurement et se trouvait contraint de vivre à part pour être en paix. Son rire, son retrait de la vie publique cachaient ses difficultés à vivre parmi les siens. À ses côtés, Magon restait songeur. Il n’avait aucun préjugé, pensait même que les plus fous sont souvent ceux qui paraissent les plus sages. Il était persuadé qu’il pouvait apprendre beaucoup de celui qui n’était pas ce que l’on croyait, se demandait s’il connaissait aussi Calroë dont Duisto cependant ne lui parla à aucun moment. En revanche il ne souhaita pas connaître ce que l’avenir lui réservait, non pas qu’il doutât de la véracité des visions de son ami, ni qu’il ne voulût savoir, mais l’idée ne lui vint même pas tellement il était étonné par le spectacle de cet oracle comme il n’en avait jamais encore lu la trace ni entendu la mention au cours de ses lectures et ses enseignements. Il repensa à son propre projet de livre pour la première fois depuis bien longtemps, se dit qu’il pourrait inclure de nombreuses réflexions sur les pratiques magiques des Celtes. Un matin – le vingt-et-unième depuis qu’il était chez les Sénons –, alors qu’il s’apprêtait à sortir de l’oppidum en compagnie de Duisto, le cœur toujours déchiré à passer devant la prison où Aldéa demeurait sans qu’il pût rien apprendre d’elle, on lui signifia qu’il était convoqué par le Conseil, qu’il restait un homme libre mais qu’il devait s’y rendre tout de suite. En voyant les gardes arriver pour transmettre leur ordre, il crut un instant 301
qu’on l’arrêtait et en conçut presque un soulagement à se dire qu’il pourrait enfin rejoindre celle qui était l’objet de ses vœux. Il accepta d’y aller surle-champ, voulut entraîner son ami. Mais avec une sorte de terreur, Duisto refusa, recula, s’en alla comme à son ordinaire en forêt, d’un pas précipité cependant en laissant entendre des propos qui semblaient plus décousus que jamais. Dans la brume matinale, Magon monta la pente caillouteuse jusqu’en haut de l’oppidum. Les rues n’étaient pas désertes mais clairsemées comme si la majeure partie des habitants s’étaient pressés devant lui pour l’attendre en haut. En effet, quand il pénétra dans la grande salle au sommet de la ville, il s’aperçut qu’elle était bondée d’une foule d’hommes silencieux qui l’attendaient. Tous les guerriers étaient là. En revanche, il n’aperçut aucun prêtre et en déduisit qu’on ne voulait pas l’entretenir de Duisto et de ses divinations, mais bien de lui seul pour des faits plus tangibles. Le Conseil n’était pas une assemblée populaire des Sénons. C’était plus un collectif, composé de six magistrats respectables, qui présidait à la réunion de l’oppidum et expédiait, au nom de tous, les affaires locales les plus courantes. Tous ceux en âge de porter les armes devaient se trouver devant lui lorsqu’il siégeait. Le Maltais en fut impressionné, comprit aussitôt pourquoi Duisto avait paru effrayé à l’idée d’y entrer : il y aurait été l’objet de tous les regards, de toutes les médisances, de tous les attouchements. La salle à vrai dire était longue mais peu large et surtout très basse et obscure, écrasée par des parallèles de poutres massives. Même une foule limitée et statique donnait l’impression de l’emplir à la faire craquer. À l’image de la ville, elle était sobre, les murs simplement décorés de frises peintes et d’armes suspendues dont aucun élément ne permettait de la rehausser pour l’agrandir en taille, en lumière ou en prestige. Ce fut probablement pour cette raison qu’au centre, son regard fut d’emblée attiré par quelque chose qui brillait singulièrement, vers lequel se tournait une grande partie des hommes présents au point d’avoir les yeux rivés et de ne pouvoir les en détacher. Il eut un battement de cœur en reconnaissant son bâton qu’on avait séparé du butin de Latro pour le poser ici, couché sur deux trépieds en hauteur, à la vue de tous, écarté des premiers rangs d’un double pas au moins. Son métal étincelait comme le sourire indolent d’un dieu inaccessible. Défense expresse avait dû être faite d’y toucher si bien qu’on le dévorait avec des prunelles scintillantes d’appétit. Les mains ne bougeaient pas, les jambes restaient disciplinées, les regards seuls disaient « si seulement c’était à moi ! ». – Place !, cria quelqu’un, faites donc place ! On se poussa sur les côtés, une allée fut formée pour permettre à Magon d’avancer. Devant, cachés par les têtes et les épaules des hommes 302
debout, les membres du Conseil étaient assis sur des sièges qui semblaient plus des bûches traînées là que des fauteuils honorifiques. Ils étaient six, avaient l’air grave et préoccupé. – Silence !, ordonna-t-on alors que la foule était une des plus silencieuses qu’on eût imaginé. Le dénommé Gitogmaros qui dirigeait le Conseil se leva et, avec une supériorité inavouée, balaya l’assemblée de son visage anguleux et cireux. Ce mouvement de la tête lui permit d’attendre un calme qui était pourtant là depuis le début. Puis il prit la parole et s’adressa sans tergiverser à Magon : – Toi que l’on surnomme l’empassant, nous t’avons accepté parmi nous en qualité d’hôte de l’un de nos concitoyens les plus éminents. Je veux parler du fils d’Acco le fougueux, Duisto le fol. Nous n’entendons pas aujourd’hui remettre en cause son hospitalité qui t’honore et qui nous honore car elle correspond à une longue tradition des Sénons. Pourtant la situation vient de changer ; tu ne le sais peut-être pas mais elle s’est aggravée depuis deux lunes. Car tu l’as sans doute compris : la guerre est à nouveau déclarée contre les Romains dont toi-même tu t’es décrété l’ennemi le jour de ton arrivée, et nous venons d’apprendre que César, oui, tu as bien entendu, Gaius Julius César en personne est revenu sur notre territoire où il stationne maintenant depuis des jours. À cette annonce qui n’en était pas une puisque tous devaient déjà être au courant, il s’abattit, si ce fût possible, un silence plus grand encore qu’auparavant sur l’assemblée, un silence qui ne résultait pas de la simple absence de bruit, mais d’une réflexion sombre doublée d’un frisson glacial qui sembla hérisser les cheveux et les poils avant de retomber aussitôt. – On murmure qu’il a l’intention de se diriger vers Gorgobina sur le territoire des Boïens plus au sud pour secourir cette tribu alliée. Nous n’avons donc apparemment rien à craindre. Néanmoins nous voulons dorénavant savoir qui tu es exactement et si nous pouvons te faire confiance. Il te faut nous comprendre. Les espions sont si nombreux par les temps qui courent que dans ces conditions ce que fait un de nos concitoyens, si noble soit-il, regarde toute la cité. Vois, nous ne t’emprisonnons pas, nous ne te suspectons même pas ; considère que nous cherchons simplement à mieux te connaître. Il se rassit. Il avait dit cela d’un ton calme, posé, sans emportement aucun. Magon, de toute sa naïveté, voulut le croire. Il observa autour de lui. Les regards des habitants avaient un mélange de fermeté et de réelle sympathie à son égard ; ils avaient l’air de l’encourager à accepter de parler de sa personne, à se présenter en détail. Il eut l’impression de jouer une partie serrée. Il sentait l’ombre froide de la prison l’appeler, l’aspirer, 303
l’engloutir à jamais s’il faisait un faux pas. Il fut encore un instant tenté d’y rejoindre Aldéa, mais une force supérieure, le souffle de Calroë comme il en était désormais persuadé, le poussa à lutter, à se battre de toute sa force de persuasion pour non seulement échapper à la geôle mais aussi libérer sa compagne. Il se tourna vers tous et, sans orgueil déplacé, leur dit d’une voix assurée, dans une langue gauloise qu’il ne craignait plus de manier pour prononcer une défense déterminante : – Vous voulez être sûrs de ma loyauté ? Vous voulez savoir si je ne suis pas un informateur infiltré dans vos maisons ? Voilà qui est légitime. Ma droiture pourtant, je ne la défendrai pas par un discours. Je parle mal et tout espion dissimulé s’exprimerait mieux que moi. Non, pour vous dire ma droiture, pour vous dire mon honnêteté, je ne m’appuierai que sur un seul objet tant parfois les symboles en disent plus long que les mots si peu que l’on connaisse la signification qu’il faut leur apporter. Ma droiture, Sénons, j’en veux pour preuve ce bâton qui est là, qui m’appartient et que vous m’avez pris sans le savoir ! Il avait pointé le bâton, son bâton qui était présenté en public. Un murmure de surprise électrisa subitement la foule qui sembla pour la première fois perdre un peu de son ordonnance guindée. On regarda de nouveau avec convoitise le trésor placé sur les trépieds. Que racontait-il ? Le bâton était à lui ? Il avait donc rapport avec les prisonniers romains ? Le métal en sembla plus luisant que jamais. – J’irais même plus loin : ce bâton ne m’appartient pas, il est moi. Il est mon histoire, l’histoire de mon peuple, celle de ma famille. Et si vous voulez me connaître mieux, il vous faut le connaître, lui. Avec une émotion visible, il s’en approcha, passa ses doigts dessus, le souleva à pleines mains. Aucun Gaulois ne bougea, tous le laissèrent faire bien qu’il outrepassât le respect qu’il devait aux autorités de l’oppidum. Ils sentaient comme un discours poignant poindre sous cet acte familier. – Je ne vais pas vous raconter tout le passé mais une simple page de celui-ci, un morceau méconnu qu’a vécu le père du père de mon père et qui est figuré ici, sur ce bâton, sous l’aspect de ce personnage qui tient en main une longue griffe. Il montra à tous un motif du bâton, une tache blanche vive sur le bois foncé qui semblait dotée d’un corps humain et d’une patte de fauve. Mais la foule encore disciplinée n’osa rompre son rang pour se masser et regarder. En fait, personne n’avait réellement pris soin d’examiner l’objet dans le détail et nul ne sut à quel dessin Magon faisait exactement référence. On l’écouta néanmoins par estime mais surtout curiosité. Comme l’avait prévu le jeune homme qui commençait à cerner le 304
tempérament celte, les Gaulois, qui n’étaient pas hommes à s’appliquer à l’écoute de longs discours, aimaient tous à se laisser narrer des aventures. Il commença lentement, comme s’il tirait des lignes de récit des arcanes de sa mémoire. C’était l’histoire de sa famille, la même que celle racontée à Atis, mais avec des rebondissements nouveaux et d’autres enlevés. Il la continuait simplement, la racontait autrement pour la relier à sa propre famille. Car cette histoire, il ne mentait pas quand il disait qu’elle résumait sa personne : – Après que notre cité mère fut battue par Rome il y a plus de cent ans, un petit port oublié, nommé Icara et situé loin, très loin d’ici sur une mer tiède azure, fut un jour ravagé par les Romains qui y commirent les pires exactions. Il n’y eut aucun survivant, le sang rougit jusqu’à l’écume des vagues ; les seuls qui en réchappèrent furent une poignée de voyageurs qui, éparpillés sur la côte, empêchés de rentrer à cause des hostilités, découvrirent bientôt avec horreur l’étendue du massacre. Ils avaient tout perdu, mais ils avaient gagné en rage, en soif de vengeance. Sans armes, sans troupes, sans argent, ils cherchèrent comment punir les assassins des leurs, mais les punir au centuple de la façon la plus terrible, la plus exemplaire qui fût. Ils recoururent à la magie parce que nous autres les Carthaginois, nous préférons la discrétion aux combats éclatants dont vous êtes, vous, les adeptes. Pour ça, ils se souvinrent d’un homme, mon arrière-grand-père, qui vivait déjà sous le joug des Romains sur l’île où je suis né et qui est depuis plus longtemps encore la possession de l’empire de Rome. Mon arrière-grand-père donc, Rafa, était un grand savant, un médecin renommé qui maniait à la perfection les poudres et les sortilèges les plus dangereux. Les rituels d’Orient n’avaient aucun secret pour lui. Il était ce qu’on appelle en d’autres contrées un mage. En racontant cela, Magon parfois se troublait, se ménageait une pause, cherchait ses tournures sans que l’on sût si c’était parce qu’il lui manquait du vocabulaire ou parce qu’une émotion grandissante l’étranglait. Quelques termes grecs ou puniques se mêlaient à sa narration quand il ne savait les dire en gaulois et cette variation de langue ajoutait une pointe d’exotisme à l’esprit de son public ébahi. Il avait débuté sa narration avec tant de conviction qu’on sentait facilement sa sincérité. C’était pour lui une histoire d’enfance enfouie dans sa mémoire pendant des années, qu’il semblait redécouvrir peu à peu depuis qu’il était en Gaule et la racontait. Une équipée extraordinaire qui le faisait rêver même à l’âge adulte où il vivait à son tour d’insoupçonnables aventures. Dans l’ombre comble de la pièce, l’entame du récit avait fait son effet sur tous, crédules et friands de péripéties surtout quand celles-ci 305
inclinaient aux prodiges. Certains Gaulois le suivaient du regard, répétaient, en un susurrement suspendu à leurs lèvres, le dernier mot qu’il avait prononcé comme pour lui laisser le temps et anticiper la suite qu’ils étaient désireux d’entendre ; d’autres ne quittaient le bâton des yeux mais ouvraient grand leurs oreilles pour mieux saisir la place qu’il aurait au bout de l’histoire. On aurait pu sentir un accord progressif de leur respiration, de leur cœur battant à l’unisson pour les anciens rivaux de Rome. Il poursuivit : – Les rescapés vinrent le trouver. Ils lui racontèrent tout, soulevèrent en lui un sentiment légitime de révolte et ils l’emmenèrent sur leur dernier bateau en lui promettant que son voyage serait temporaire et que son patriotisme l’ordonnait. En échappant aux navires ennemis, ils se rendirent dans un pays chaud, très au sud, oublié de tous, dont vous n’entendrez sans doute jamais parler. Là-bas, ils lui donnèrent un petit atelier où travailler à leur vengeance. Mon ancêtre œuvra bien. Il mit au point un poison que les ultimes soldats de Carthage se chargèrent d’aller porter en Italie. Et masqués, portant leur mal au bout d’une griffe pour soigner leur mise en scène, ils tuèrent avec les cinq généraux responsables du massacre d’Icara. Cent ans après, j’en connais toujours les noms par cœur : Pétrone, ils le traquèrent ; Graccus, ils le retrouvèrent ; Sulla, ils le surprirent dans son sommeil ; Flavius et Gallas vécurent dans la terreur avant d’être rattrapés comme les autres ! Il avait repris le bâton, il s’anima, dessina cinq fois dans le vide le geste de frapper. Son aisance à le manier prouvait à elle seule qu’il lui appartenait bien. Il esquissait des moulinets, frappait d’estoc et de taille, sans toucher personne ni rien renverser. Les Sénons furent impressionnés ; ils étaient maintenant happés par l’histoire. À chaque coup imaginaire, ils sourirent, encouragèrent les Carthaginois morts depuis cent ans, conspuèrent les Romains que le récit leur faisait se représenter. L’usage d’un poison leur plaisait, eux qui étaient enclins à recourir aux enchantements de la magie dans leur vie quotidienne et qui sentaient bien quelque part que la force brute dont ils faisaient preuve au combat, si elle était belle, était inutile face aux légionnaires de César. Magon s’était souvenu des sermons de son père et de son oncle dont il émettait indirectement le souvenir, ces sermons infondés de vengeance dont ses parents n’avaient jamais perdu l’espoir, qui prétendaient qu’une armée carthaginoise se constituait depuis des décennies à l’autre bout des terres connues pour revenir un jour frapper la Rome insolente qui se voulait la reine du monde. Pendant qu’il parlait encore, il comprit soudain qu’il aimait en fait à retracer cette histoire qu’il tenait secrète comme un trésor qu’on a peur de violer et qu’il dévoilait toujours avec parcimonie 306
comme on laisse un privilégié entrevoir avec délice l’argent de son coffre ou le dos nu de sa femme. Cette histoire, il aimait à la raconter encore et toujours, y cherchant sans en avoir nettement conscience un lien disparu avec les siens, qu’il avait jadis brisé par son départ et par la voie différente donnée à sa vie dont il culpabilisait. Qui eût cru que leur haine, cette haine qu’il n’avait eu la souplesse de comprendre de leur vivant, l’aiderait maintenant dans une existence tout entière vouée à l’étude que la violence rattrapait ? Il acheva : – Rome eut beau envoyer une flottille, elle n’obtint jamais l’antidote. La vengeance cependant n’apaisa qu’insuffisamment la peine de ses artisans qui souffrirent leur deuil pour le reste de leurs jours. Chacun à leur manière, ils entreprirent d’en transmettre leur blessure secrète à leurs descendants dont je fais partie. Mon ancêtre, enfin rentré chez lui, le fit pour sa part au moyen de ce bâton dont les motifs me rappellent que leur blessure, ma blessure, je la porte au fer rouge, tous les jours, dans le cœur. Et c’est pour cela que j’estime être l’ennemi des Romains bien que je ne sois pas le combattant d’une armée. Mais je me bats, soyez-en sûr, il y a tant de moyens de mener une guerre ! Barakbaal, Rafa, Abdosir, Abdbaal, Osirshamar. Il crut un instant que tous les défunts de sa famille, toute sa généalogie dont les noms se perdaient dans les âges se dressaient devant lui, inflexibles et sourcilleux, et les voir lui réchauffa le cœur avant de le lui briser quand il réalisa leur absence. Il reposa humblement le bâton sur les deux trépieds. Il attendait l’autorisation de le prendre et l’emporter pour de bon. Fût-ce son histoire ou l’émotion de céder à nouveau l’objet, une larme lui vint aux yeux qui ponctua magnifiquement sa défense. Lui-même y crut, dépassé par cette marque de tristesse qu’il n’avait pas prévue. La fable ne prouvait rien d’ailleurs et le pleur fut nécessaire pour emporter l’adhésion. Il y eut un long moment, le temps parut se figer. L’assistance, marquée par ce qu’elle venait d’entendre, essayait sans doute de s’en représenter chaque détail pour mieux le vivre et plissait les yeux, pinçait les lèvres comme pour le prolonger intimement. Tous devaient se demander ce qu’ils auraient fait à la place de ces Carthaginois dont ils n’avaient jamais entendu colporter les hauts faits ; ils devaient s’interroger sur leurs ancêtres à eux. Gaulois, Carthaginois, qu’étaient-ce que ces différences ? Ils durent se trouver une identité de caractère car soudain ils crièrent en chœur, perdant toute conduite : – Il faut lui rendre son bâton ! C’est le sien ! Celui de sa famille ! – Il est des nôtres ! C’est un ennemi des Romains ! On peut lui faire confiance ! Il ne nous trahira pas ! 307
Ils aimaient les histoires, avait dit Duisto. Fort justement. C’était la légendaire naïveté celte qui s’exprimait, qui faisait à la fois leur grandeur et leur faiblesse : celle qui les faisait larmoyer devant la beauté d’un soleil flamboyant, qui les faisait mourir héroïquement au combat, se laisser berner comme des enfants dans un marché de dupes ; celle aussi qui les montrait encore peu touchés par les civilisations de la Méditerranée, premières vagues d’un océan sans bornes que les hommes du Sud, dans leur étroitesse d’esprit, appelaient barbares sans comprendre qu’ils n’avaient fait que garder les pensées primaires d’un âge d’or révolu. On les rabroua aussitôt en leur rappelant qu’il incombait aux seigneurs de se prononcer d’abord. Mais au-delà de la forme, la foule venait de prendre le parti de Magon et il était difficile d’aller à contresens. Les six membres du Conseil, bien qu’ils ne nourrissent eux non plus aucune animosité envers le jeune homme, restèrent cependant plus mesurés. Ils voulurent en savoir davantage et sur l’invitation de ses cinq autres collègues, l’incontournable Gitogmaros se releva, fit taire cette fois-ci la foule avec raison. Il reprit la parole : – Tu parles mieux que tu ne veux le reconnaître, l’empassant, et Ogmios à la chaîne dorée te conseille sans doute quand tu ouvres la bouche. Mais il reste des pans d’ombre dans ton discours. Si ce bâton est bien le tien, comment est-il tombé dans l’escarcelle de ce centurion ? Je veux parler de l’homme au chacal. Qui nous dit que tu n’allais pas avec lui, que tu ne faisais pas partie du convoi que nos hommes ont surpris ? Tu auras échappé à nos cavaliers et te seras réfugié incognito chez nous, pensant que nous n’accuserions jamais le culot d’un lâche qui cherche refuge dans l’antre de son adversaire. L’enthousiasme se calma, incontinent. Certains visages redevinrent méfiants ; d’autres sourirent encore, mais d’un sourire contraint qui engageait une fois de plus Magon à s’expliquer et prouver qu’ils n’avaient pas eu tort de le soutenir. Le jeune homme dut se faire expliquer l’image de l’escarcelle dont il ignorait le mot en langue celte, ce qui ajouta à l’humilité de sa parole. Gitogmaros en profita pour continuer son raisonnement : – Si tu accordes tant d’importance à ce trésor, pourquoi n’as-tu pas dit plus tôt qu’il t’appartenait, quand tu es arrivé parmi nous ? Pourquoi as-tu attendu ce matin que l’on veuille t’interroger ? – Je ne crains pas de vous le dire. Ce centurion dont tu parles me l’a volé à Génabum et je l’ai poursuivi jusqu’ici pour le récupérer, abandonnant toutes mes affaires, ma monture, ayant conscience que si je perdais ce bâton, je perdais plus qu’un simple bien matériel. C’est la stricte vérité, je ne rougis pas de ma faiblesse. Quant à savoir pourquoi je ne vous 308
l’ai pas révélé auparavant, la raison en est simple : auriez-vous cru un inconnu vêtu comme un malpropre et réclamant presque l’hospitalité parce que dénué de tout ? Il attendit. Il eut alors cette phrase décisive que tous relièrent à ce qu’ils s’imaginaient de Rome aux antipodes de leur vie : – Il n’y a que dans les sociétés pourries que les mendiants sont traités en estime au point de devenir rois. Ce simple mot suffit. La salle était conquise, définitivement, flattée par le caractère aristocratique et exigeant que cette assertion sous-entendait aux Sénons. On scandait « l’empassant, l’empassant ! » ; certains parlaient de punir Latro sur-le-champ pour sa forfaiture. Ils n’étaient pas de ceux qui manifestaient facilement leur confiance parce qu’ils avaient justement un grand sens de la probité et de la créance que l’on accorde à quelqu’un. Gitogmaros seul ne se laissa pas décontenancer. Même si toute la salle penchait désormais du côté de Magon, il s’enquit encore de détails auxquels l’assemblée ne s’arrêtait déjà plus : – Génabum ? Tu étais donc au carnage ? Tu en as réchappé ? Au terme de carnage, Magon le regarda avec de grandes prunelles noires d’incompréhension. Tout ce temps passé à Vellaunodunum, il n’en avait pas entendu parler directement. Il se souvint des derniers mots d’Asinus, se rappela la fuite précipitée de Latro, comprit enfin, de manière certaine, ce à quoi il avait échappé. Gitogmaros perçut ses réflexions, se mordit les lèvres d’en avoir trop dit. Il ne voulut pas se compromettre davantage en divulguant une autre information : l’empassant était là pour qu’on en apprît de lui, non l’inverse. Il s’entêta sur une autre question ; la salle commençait à trouver suffisantes ses manœuvres mais ne dit rien : – Il nous semble qu’il n’y a pas que les dessins de cet objet qui le rendent précieux. Quel est donc ce métal inconnu qui luit si étrangement ? Est-ce un alliage ? Un matériau pur ? On dirait un bout de soleil couchant coupé en lamelle dans le ciel. – Ce métal ? De toutes ses trouvailles, c’est peut-être la plus précieuse de mon aïeul et la seule qu’il n’ait pas inventée. Il est d’une matière qu’on dirait chutée du ciel tellement on ne le trouve que rarement dans la terre. À vrai dire, on ne l’a découvert que dans certaines zones escarpées de l’Afrique. Les Grecs l’ont appelé orichalque, ce qui dans leur langue signifie le cuivre des montagnes. Ne vous fiez pas à son reflet ; il n’a aucun pouvoir particulier sinon être plus résistant qu’un autre métal. Magon s’arrêta, ne baissa pas les yeux pour ne pas avoir l’air de cacher une vérité, mais fixa un point en hauteur comme pour se rattraper dans sa chute. Quelque chose tanguait en lui ; sa connaissance de lui-même, de ses valeurs venait de vaciller. Il ne parlait plus de la guerre comme un fléau, 309
semblait l’appeler de ses vœux avec des talents de comédien dont il s’étonnait lui-même. De telles paroles ne lui ressemblaient pas ; il en avait conscience, se trouvait changé sans savoir si c’était en bien ou en mal. Dans sa naïveté naturelle, jamais auparavant il n’aurait menti à ce point ni fait preuve d’une violence comparable dans ses gestes ou ses propos de manière injustifiée. Mais à vrai dire une figure féminine et divine le poussait ; il sentait toujours la main douce-forte de Calroë derrière lui. C’était elle qui forçait à s’adonner pour l’être cher, à user des moyens les plus bas, les plus vils pour parvenir à ses fins. La violence, le mensonge étaient tolérés, encouragés même du moment qu’ils permettaient de contenter celui ou celle qu’on aimait et de tout sacrifier pour lui. C’était la différence avec de fieffés menteurs. Le but ultime, s’il était noble, justifiait les moyens. D’ailleurs il était resté mesuré dans son mensonge, ne s’y complaisant pas, ne s’en servant qu’avec parcimonie et cette absence d’outrance le rassura quelque peu. L’histoire au demeurant était exacte. Il avait dit vrai sur tout, hormis sur ses sentiments. Il aurait dû normalement nourrir à son tour une haine ancestrale contre les Romains ; c’était un hasard, une anomalie de transmission, qu’il n’eût pas hérité cette haine de ses ancêtres. Sa parole aujourd’hui ne faisait que réparer cette erreur en imaginant qu’il fût prêt à prendre à son tour les armes pour assassiner les fils de la louve. Bien sûr, il n’avait rien dit de son amitié paradoxale envers Asinus ni de sa bienveillance naturelle envers tous les Italiens, comme d’ailleurs envers tous les Grecs, les Ibères, les Celtes qu’il avait croisés dans sa vie. Et il voulut se chercher une cohérence, se convaincre qu’il se battait en effet contre les Romains quand ceux-ci prétendaient imposer leur force au monde entier, qu’il était leur ami quand ils simplifiaient au contraire l’élargissement de la science et de la connaissance. Quant à l’orichalque, il avait simplement minimisé les vertus qu’il lui connaissait. Il savait qu’il n’était pas un métal comme les autres, mais il avait voulu s’épargner le danger d’attiser la convoitise des Sénons de manière inutile. Le mensonge n’entachait personne, ne le concernait que lui ; la violence dont il avait faire preuve dans le vide ne frappait que les fantômes du passé ou les figures d’un avenir dans lequel il s’ingénierait à ne jamais combattre. Il s’en fit aussitôt la promesse. Les membres du Conseil se regardèrent, semblèrent peser en eux le pour et le contre de la situation. Ils étaient à vrai dire tiraillés. Si l’on avait lu à cet instant dans leurs pensées, on aurait vu que c’était moins l’avenir de Magon que la possession de son bâton qui les retenait de se prononcer. Ils auraient aimé conserver l’objet à Vellaunodunum, l’étudier, l’utiliser à profit, en faire peut-être un trophée de l’oppidum comme d’autres 310
exhibaient des crânes ou des épées et des boucliers. Mais le rendre à celui qui s’en déclarait le propriétaire n’était pas sans avantage non plus. En aucun cas, la sympathie ou le sens de l’honnêteté ne jouaient. Ils ne songeaient à le restituer que par pragmatisme parce qu’ils avaient senti qu’un trésor si original pouvait être un ferment de discorde au moment où il fallait au contraire pousser à la cohésion du pays. Certains s’étaient déjà attribué sa découverte, d’autres prétendaient qu’il revenait aux membres du Conseil, quelques-uns avaient prétexté des rapports de clientèle pour tenter de se l’accaparer. Ce n’étaient pour le moment que des murmures, des suggestions, mais les contestations grandiraient. Il fallait en écarter le danger, profiter de ce que la foule, ravie par l’histoire qu’elle venait d’entendre, acceptât le temps d’un court instant de le céder pour s’en débarrasser pour de bon. S’il disait vrai, cet étranger, l’empassant, en offrait l’occasion puisqu’il faisait taire les désidératas de propriété de chacun non pas en leur imposant la loi du plus fort mais en permettant de soigner leur image de magnanimité et d’équité. Cependant ils ne s’étaient pas encore prononcés et on les guettait, persuadé qu’ils inclineraient dans le sens de l’assemblée. Soudain le membre qui avait parlé, le dénommé Gitogmaros, tout à ses réflexions, eut un mouvement involontaire du visage comme pour chasser des pensées confuses et complexes. On crut qu’il hocha du menton et exprimait son approbation. La foule alors acclama ses dirigeants et invita Magon à reprendre son bien. Elle avait tranché en sa faveur, à la grande stupéfaction de ses dirigeants qui n’osèrent contester ce vote tant parce qu’il leur aurait été impossible de se faire entendre au milieu du vacarme de joie que parce qu’ils craignaient leur impopularité. Décontenancés, ils balbutiaient des mots, essayaient de s’expliquer mais personne ne semblait les écouter tant la satisfaction était grande. Gitogmaros lui-même se montrait du doigt à ses collègues comme pour leur demander si c’était bien lui qui était responsable de cela. Mais quand on entonna un chant à la gloire du Conseil, ils s’apaisèrent enfin et sourirent d’un sourire contenté. Et Magon avait déjà repris ce qui lui appartenait, le contemplait avec une émotion certaine quand un messager déboula dans la salle en enfonçant les lourdes portes. D’une voix qui couvrit toutes les autres, il cria un coup de tonnerre : – César ! César marche contre nous ! Il sera là dans la soirée ! César ! Le tapage retomba aussitôt. Ce fut une stupeur générale sur les visages ahuris de surprise. Gitogmaros, que la précipitation des hommes à décider avait un moment déstabilisé, en profita pour recouvrer son aplomb et se levant : 311
– Eh bien, sermonna-t-il Magon avec des notes de revanche, te voilà face à face avec l’histoire. Rome, l’ennemie des tiens, se porte à toi. Il te faudra vaincre avec nous ou mourir. Ce sera l’occasion de nous prouver que tu as dit vrai et que les Sénons ont raison de te faire confiance. Magon le regarda ; il regarda l’assemblée et le courrier qui venait d’arriver et reprenait son souffle. La promesse qu’il venait de se faire pour contrebalancer son mensonge, celle de ne jamais combattre, venait de voler en éclats. Il se trouva désemparé. Comment maintenant aurait-il pu leur dire qu’il n’avait jamais songé à faire la guerre ? S’il devait la faire avec eux, il fallait au moins qu’un tel renoncement de soi permît de retrouver Aldéa.
312
XI LES ASSIÉGÉS
Même s’ils se préparaient à la guerre depuis longtemps, les Vellaunoduniens ne s’attendaient pas à une venue de César, encore moins à une arrivée aussi subite de sa part sur leur sol. Nul n’avait été prévenu à des lieues à la ronde ; la stratégie adoptée de part et d’autre ne le laissait pas entrevoir. Comme tous, on croyait le proconsul en chemin plus au sud vers Gorgobina des Boïens ; on s’inquiétait au plus d’avoir affaire à l’un de ses lieutenants. Cependant, il n’y eut aucune réaction de panique ni de lâcheté. Personne ne parla de fuir ni ne rejeta la faute de ce retournement militaire sur le Conseil local ou un seigneur du pays. La vérité était que les Sénons avaient agi dans la même désunion que les Carnutes, avec cette seule différence que leur division était géographiquement plus nette : les brenns dont le pouvoir s’étendait sur les territoires frontaliers avaient eu toute latitude pour accueillir des émissaires de Vercingétorix et organiser leur rébellion ; les autres, dont les territoires avaient subi l’hivernage des légions, acquis au souvenir d’Acco ou non, n’avaient pu que l’espérer en secret, voire s’en étaient carrément désolidarisés parce qu’ils jugeaient la révolte prématurée ou contraire à leurs intérêts. Dans tous les cas, ils n’avaient pas prévenu les leurs du mouvement inattendu de César, par la force des choses, et l’on ne pouvait leur en tenir rigueur. On envoya des cavaliers vérifier l’information ; ils ne la démentirent pas. Bien plutôt, ils s’en revinrent au triple galop, franchirent ventre à terre les portes de l’oppidum et, sans sauter de leur cheval écumant, ils lâchèrent en pleine place publique leur confirmation alarmante. César serait bien là le soir même ; à moins de dix lieues de Vellaunodunum ils avaient aperçu ses éclaireurs qui progressaient avec précaution et choisissaient la direction à suivre. Et s’ils n’avaient pu savoir si c’était effectivement le proconsul qui marchait à la tête de ses troupes, par le Teutatès !, ils pouvaient affirmer que celles-ci étaient impressionnantes en nombre et en ordre. Les Romains arrivaient avec des légions entières dont ils avaient vu la ligne grise grossir à l’horizon, sans cadence accélérée mais à un rythme que rien ne semblait
devoir freiner pour autant. Les bourgades sur leur route avaient été ravagées et incendiées ; des colonnes de fumée s’élevaient dans le ciel clair. On lança d’autres cavaliers dans le Sénonais, en pays biturige et arverne pour savoir ce qu’il en était du front tout en redoutant de ne plus jamais les revoir. L’avancée romaine était punitive. Après rapide réflexion, il parut évident à tous que César non seulement s’en venait défaire la révolte générale, mais plus précisément châtier l’emporium des Carnutes où les hostilités avaient été lancées dans un bain de sang effroyable. Pour terroriser la Celtique, faire un exemple en même temps que ne laisser aucun ennemi derrière lui qui gênât son ravitaillement, il prendrait Vellaunodunum qui se trouvait sur la ligne d’Agédincum à Génabum la riche et n’en laisserait que des cendres s’il fallait. Alors il n’y eut aucun débat, la décision se prit d’elle-même : les habitants resteraient, c’était irrévocable, avec femmes et enfants, et ils soutiendraient le siège à venir. Quoique les portes ne fussent pas encore fermées, ils étaient de toute façon déjà retenus dans l’oppidum puisqu’ils ne pourraient l’évacuer complètement avant la nuit. Pour aller où d’ailleurs ? Pour livrer quel combat en plaine où une légion aurait vite fait de les écraser par le nombre ? Pour laisser quel souvenir de leur couardise à la postérité ? Avec un sens inédit de l’intérêt commun, ils se contentèrent d’envoyer un messager chez leurs voisins afin de les avertir et leur permettre d’organiser leur propre défense. Quant à eux, ils passèrent le reste de la journée à raffermir tranquillement leurs fortifications aux points qu’ils savaient les plus faibles comme on fait d’une maison une veille d’orage. La falaise nord-ouest de l’éperon rocheux constituait un mur naturel. Ils exhaussèrent ailleurs certains pans de muraille en clouant des planches aux épieux des palissades ; ils renforcèrent les tours, garnirent les portes de peaux ou de barres de fer à défaut de les équiper d’une herse qu’ils n’avaient pas. Les paysans des villages alentour, plutôt que de s’échapper dans la campagne dépeuplée, les rejoignirent avec troupeaux et vivres à l’intérieur des remparts. Bien sûr, ils ne se faisaient guère d’illusions sur leur capacité de résistance. Mais ils motivèrent leur décision par l’idée qu’il fallait au moins tenir pour les autres – que ces autres fussent sénons ou carnutes – et retarder le plus longtemps possible les Romains. Une même haine les poussait, un même amour de la liberté et des causes perdues. Leur action collective ne prendrait de sens qu’ainsi ; tant pis s’ils tombaient parmi les premiers sans en voir le dénouement ! Ou plutôt tant mieux ! Il n’entrait pas dans le tempérament des Celtes de reculer pour si peu. Ils concevaient 314
leur insurrection comme un honneur d’autant plus grand qu’ils écourteraient leur combat en mourant en héros. Depuis le massacre de Génabum, c’était au demeurant la première décision hautement noble prise par des révoltés. La seule même, arrêtée par les brenns plus que par la foule qui n’avait droit au chapitre. Lancer par surprise une insurrection synchrone était chose facile, même dans toute la Gaule, et n’exigeait aucune solidarité réelle ; c’était au moment des revers, au moment de la contre-attaque de l’adversaire que le changement de mentalités se révélait vraiment, que la fraternité s’illustrait et avec elle le sens du sacrifice. Car c’était un sacrifice et leur choix les grandissait. Ils le savaient mais ils n’en parlèrent pas, qui par modestie, qui par orgueil, qui parce qu’ils en avaient encore une idée confuse. Vellaunodunum la vaillante ne résisterait jamais bien longtemps. Même si la population y avait l’âme impavide, l’oppidum était trop faible, César le balaierait comme une feuille morte sur sa route. La faim que tous les assiégés craignent à long terme, quelques provisions qu’ils aient, la faim qui conduit à une mort indigne ne fit pas même trembler les rares lèvres qui l’évoquèrent : les cœurs savaient que tous les bâtiments seraient pris avant que d’en souffrir. Comme ils s’y attendaient, le soir-même le proconsul arriva. Du haut de la colline fortifiée, on vit au loin une masse sombre envahir le paysage plus vite que la nuit. C’étaient les légionnaires qui, venant par l’axe principal, s’éparpillaient pour occuper la plaine dans sa largeur. Les premières unités aussitôt s’éployèrent et rencontrèrent les premiers contingents sénons déterminés à lutter. Il n’y eut aucune bataille de grande ampleur. Ce soir-là, on assista seulement à une escarmouche, pour l’honneur, entre cavaliers celtes et auxiliaires espagnols qui formaient l’avant-garde romaine. Les uns voulaient démontrer qu’ils entamaient leur incursion, les autres avaient à cœur de prouver qu’ils défendraient leur territoire. Les armes rutilèrent dans les scintillements du déclin du soleil ; le sang coula, inonda la terre déjà détrempée par le dégel. Le combat fut incertain, on se jaugea davantage qu’on ne voulut l’emporter et les éclaireurs espagnols se replièrent rapidement tandis que les Sénons essuyèrent de lourdes pertes. Ce fut en ayant entassé de premières dépouilles sur leurs chevaux que les braves de Vellaunodunum la vaillante rentrèrent dans l’oppidum où ils s’enfermèrent pour n’en plus bouger de la nuit. Dans la précipitation, on avait une fois de plus oublié Magon qui eut tout loisir, à nouveau, d’observer les événements et comprit qu’au-delà du malheur de la guerre, l’occasion s’approchait bel et bien de libérer Aldéa. Il avait maintenant son bâton auquel on ne prêtait désormais attention ; il se sentait plus fort et, d’une manière ou d’une autre, c’était la prise de 315
Vellaunodunum, il n’en doutait, qui ouvrirait la prison. La libération de la jeune femme était même acquise s’il parvenait à laisser croire qu’il ne reculait pas devant le danger de la situation tout en ne se risquant pas à ces combats qui d’ailleurs le regardaient peu. Avait-il peur ? Sans doute, comme tout être qui montre du courage. Mais pour un homme entier comme lui, la tâche surtout n’était guère aisée parce que, malgré son discours le matin même au Conseil, la dissimulation n’entrait pas dans son tempérament naturel. Il lui fallait conjuguer en quelque sorte l’appétit de vengeance de ses ancêtres qu’il avait proclamé crânement et la soif de pacifisme qui l’habitait toujours – les conjuguer par une tiédeur de caractère, une ardeur neutre d’action qu’il se pardonnait en lui-même en la justifiant au nom de son unique objectif : Aldéa. Aussi se mit-il en retrait sous les remparts, contre une charretée de foin, où il demeura néanmoins en vue, persuadé que s’il disparaissait complètement, son absence attirerait l’attention et les ennuis. Sans monter voir le premier affrontement, il entendit les ordres contraires donnés dans la place, vit les cavaliers sortir emplis de dédain au milieu des bestiaux et des réfugiés qui entraient et il suivit le combat aux commentaires qu’on lui en fit, ne voyant les combattants que lorsqu’ils revinrent la mine défaite mais orgueilleuse en traînant derrière eux leur cortège de blessés. Ces blessés étaient déjà nombreux et soufflaient d’agonie. Il se porta à leur rencontre, proposa ses services et, avant même d’avoir une réponse, fit allonger sur un lit de paille improvisé un guerrier qui avait reçu deux flèches à l’épaule dont il arracha les pointes en procédant par une large incision. Il n’avait plus d’astranore depuis bien longtemps, ne possédait d’autre instrument qu’un couteau ébréché qu’une main inconnue lui tendit. Puis il sauta près d’un autre, un petit roux qui saignait abondamment, arrêta momentanément l’hémorragie de sa plaie, s’élança vers un nouveau guerrier à panser. Il passa ainsi de blessé en blessé, en sauva quelques-uns, en perdit plus encore quoiqu’il apaisât les douleurs en encourageant à l’espoir ceux qui devaient mourir plus tard de leurs blessures. Indifférent aux intrigues, aux partis, aux responsabilités de chacun dans la violence, il retrouvait son dévouement, son sacerdoce, dépensant sans l’épargner son énergie, soignant les lésions sans s’occuper des visages, des résistances, des hurlements par seule volonté de retrouver des corps sains et vigoureux. Il força l’admiration de tous qui le prirent pour l’un des leurs. Stabilisant l’état des uns, aggravant peut-être celui des autres, il ne fit du reste qu’appliquer le même art que les chirurgiens de l’ennemi, mais il s’illustra avec tant de grandeur qu’on eût dit l’un des frères Machaon et Podalire qui soignèrent jadis les armées grecques autant qu’ils se battirent sous les 316
murs de Troie. Les autorités, mais aussi les druides qui avaient en charge la médecine le laissèrent faire ; eux-mêmes se trouvaient débordés par les conséquences de ce premier combat qui n’avaient été qu’un accrochage. Autour d’eux, l’oppidum s’activait, gagné par une fièvre pondérée mais croissante que la vue du sang avait réveillée. Le siège était désormais inéluctable, et les souffrances, et les morts ; avec un calme fébrile, on préparait d’ores et déjà les traits, les pierres, le soufre, la poix liquide et l’on distribuait boucliers, cottes de mailles et casques pour la défense. La nuit tomba enfin sur ce premier jour des opérations. Ce ne fut qu’alors que Magon, maculé de sang mais satisfait de s’être montré utile, put songer à se reposer et réalisa qu’il venait de s’engager dans la guerre sans l’avoir vraiment voulu. Duisto se trouvait probablement chez lui. Il remonta les rues pour aller y dormir. Tout autour, la ville retrouvait son calme. Chacun rentrait chez soi recouvrer ses esprits, reprendre des forces en attendant la journée du lendemain où les attaques sérieuses commenceraient. Beaucoup de généreux accueillirent sous leur toit des familles réfugiées et quand toutes les maisons furent pleines, on s’organisa pour coucher en plein air, au milieu des troupeaux, et se tenir chaud. La nuit, traversée de vents froids, fut ainsi douce et rayonnante d’étoiles. Seul le fils d’Acco n’hébergea personne ce soir-là parce que sa hutte était à part de celles des autres et qu’il fallait vraiment être un étranger comme Magon pour ne pas redouter d’y dormir. Duisto avait échappé à tous les événements de la journée, par miracle. Plutôt il était là comme à l’ordinaire et c’était la régularité de sa vie au milieu de tant d’événements imprévus qui ne cessait de paraître étonnante. Jamais plus qu’en cette occasion, il se montra si peu digne du guerrier honorable qu’avait été son père. Bien au contraire, quand l’annonce de l’arrivée de César parvint à Vellaunodunum, il se trouvait dans sa retraite au milieu des bois où nul n’osa venir l’informer et le sauver peut-être et, quand les Romains se présentèrent réellement, alors que tous ses concitoyens étaient déjà postés derrière les lignes de défense, on le vit, le plus naturellement du monde, sortir de la forêt selon son habitude et passer les portes juste avant leur clôture. Les cavaliers approchaient ; la plaine s’emplissait du grondement de leur galop. Mais lui ne pressa pas le pas, continua comme si de rien n’était, sifflotant un refrain gai de bergère, s’arrêtant même à regarder les premières fleurs que le printemps semait sur son passage. Il ne faisait pas semblant pourtant, à voir sa démarche de jeune fille nubile et son air naturel ; quand il fut dans la place, on ne sut si l’on devait s’en réjouir tant les pouvoirs qu’on lui prêtait inquiétaient et instillaient une crainte sourde. Alors certains dirent qu’il fallait y voir un oracle en acte et, pour se rassurer, prétendirent que la victoire était certaine. D’autres affirmèrent 317
qu’il n’y aurait pas plus de victoire que de défaite : comme Duisto s’en était retourné chez lui de la manière la plus anodine qui fût, César repartirait vite et laisserait les habitants de Vellaunodunum, sans trouble aucun, parce qu’il avait d’autres objectifs plus importants à remplir. Quelques-uns encore, plus pessimistes mais n’osant l’assumer, demeurèrent circonspects. Une bande entière de jeunes gens voulut en avoir le cœur net, suivit le fol jusque chez lui pour lui réclamer des explications. Mais ils le trouvèrent déjà rentré et n’osèrent pénétrer en son intérieur à la fois sacré et maudit. Par prudence, ils déposèrent des offrandes dans la petite niche du mur creusée à cet effet – quelque dessert, un cuissot, un collier de perles de verre – pour se le concilier et lui montrer qu’ils l’honoraient malgré la perspective de famine. Au-dessus, les lézardes qui faisaient comme des éclairs au mur fulguraient et intimidèrent tant les esprits impressionnables que le groupe y vit le rappel que Duisto lisait dans des choses interdites, des choses qu’on ne pouvait savoir que si lui-même en parlait. On refusa de le forcer à les dire et l’on retourna chez soi ou sur les remparts en espérant qu’il les expliquerait au matin. Magon entra après un long temps, quand tous furent partis. Il trouva son ami qui préparait le repas, avec trois fois rien – des galettes, des fèves, des noix – parce qu’il ne s’approvisionnait jamais et inventait sa nourriture au jour le jour. Il l’informa des offrandes qui venaient d’être déposées devant sa porte. Duisto en fut heureux. Des pâtisseries, du gibier, ça ne se refusait pas, bel oiseau ! C’était digne des nobles ! Magon pensa que son insouciance provenait de ce qu’il connaissait l’avenir : s’il avait vu s’approcher un destin funeste, il ne serait pas resté ni n’aurait tambouillé comme à l’accoutumée. Il se mit à table avec un appétit rageur tandis qu’un silence lourd, inquiet s’abattait sur la ville. Contrairement à ce que les habitants imaginaient, l’intérieur de la maison de Duisto n’avait rien de terrifiant ni de merveilleux. Après la magie de l’arbre d’Atis, Magon ressentit même toute l’étroitesse et la pauvreté du logis. Le fol y vivait dans un dénuement total, non pas pour être proche de la nature mais parce qu’il ne possédait rien et ne voulait rien posséder. Sa hutte était vide d’un bout à l’autre, les rares objets ainsi que la paille qui faisait office de lit y étaient posés à même le sol. Seul un amas informe dans un coin caché par l’ombre dérangeait ce néant comme une goutte d’eau tombée par hasard dans un désert. Cet amas, bien plus haut, bien plus volumineux que les autres meublants, était un amoncellement d’armes, de fourreaux, de casques, de parures de guerre comme on fait aux funérailles d’un grand guerrier. C’étaient là les présents faits en mémoire d’Acco après sa mort, mais Duisto ne s’épancha jamais sur la question. Il 318
n’y touchait pas, il n’y avait pas touché depuis longtemps ainsi que l’indiquait la pellicule de poussière qui y était épandue. Pendant le repas, Magon conversa peu, écoutant surtout Duisto qui se montra volubile. À l’inverse des autres, le fils d’Acco ne l’interrogea pas sur sa vie ni sur ses origines ni sur le bâton qu’il avait retrouvé. Il ne l’avait pas fait jusque-là et ne le ferait pas. Il évita les sujets graves qui le laissaient indifférent. Il parla au contraire de tout du moment que ce fût léger, chantonna des comptines, sembla poser des questions sans queue ni tête aux murs et à son plat. Il fut une vraie pipelette. Puis il bâilla ouvertement : – Voici que les fleurs et la lune s’embrassent, Duisto a dit, bonne nuit. – Attends, le retint Magon en esquissant un geste vague de la main. Tu…tu saurais m’en dire plus sur…sur ce qu’il va se passer ? Sur toi ou…moi… C’était sorti comme ça, sans qu’il l’eût voulu, peut-être parce qu’il souhaitait enfin connaître une part des événements futurs et le rôle qu’ils y joueraient, peut-être parce que Duisto clôturait toute conversation avant même de l’avoir entamée et que lui, avait besoin ce soir-là de parler. Alors que jusque-là il avait résisté au désir d’interroger l’avenir, il se surprit même à insister : – S’il te plaît… Tandis qu’une pénombre tendre dissimulait les traits de son visage, Duisto qui allait refuser parut soudain secoué d’une étrange inspiration. Il devint un autre. Et d’une voix majestueuse, différente, entrecoupée d’une respiration virilisée, il laissa, presque naturellement, sortir quelques nouveaux mots sibyllins de sa bouche. On eût dit qu’il les avait commandés : – Plus de fougue, plus de siège. – Quoi ? – Cotuat…Gutuat…est-ce le même pris ou la méprise du tyran ? Ce furent ses seules paroles. Magon en fut perplexe. Quel sens leur donner ? Elles ne signifiaient rien. Elles étaient aussi ambiguës que la couleur des yeux ou le sexe de l’androgyne. Le Carthaginois ne put rien objecter, chercha sans succès à les appliquer à sa vie sans y parvenir. Cela ne le concernait pas apparemment. Et son ami ne l’aida pas à y voir plus clair. Il retrouva aussitôt un souffle apaisé ; sans plus rien dire, il se laissa choir de son tabouret, tourna les épaules d’un mouvement souple de félin, s’allongea tout habillé sur la garniture de paille et de feuilles sèches où il avait l’habitude de dormir. C’était comme s’il avait subitement oublié Magon, comme s’il ne lui avait pas parlé l’instant d’avant, comme s’il était encore un autre insaisissable en 319
fonction des caprices de sa nature. Couché de dos dans le clair-obscur de la hutte, il avait des épaules et une nuque de jeune fille. Mais Magon avait encore besoin de parler, pour chasser les mauvaises idées de la journée, l’angoisse des derniers jours, les tourments de sa vie. Il tenta alors de questionner Duisto sur lui, sur son existence dont il connaissait le quotidien mais dont il savait si peu parallèlement. Comme il n’osait lui poser directement la question de sa participation aux prochains combats, avec une sorte de pudeur, il lui demanda pourquoi il avait entassé tous ces objets de guerre en un seul amoncellement dans un coin de chez lui et non sur le devant de sa maison comme son peuple aimait à le faire. Était-ce en rapport à son père ? Le fol ne bougea pas, attendit si longtemps avant de répondre que Magon se demanda s’il ne dormait déjà. Puis d’une voix paresseuse : – Père et fils, bel oiseau, ne sont-ils pas comme la mer et le feu ? Il n’y eut plus un mot échangé. Duisto s’endormit pour de bon, fâché ou non de la question. Magon demeura songeur, fut long à trouver le sommeil. Sa nuit d’ailleurs fut traversée de mauvais rêves où il revit à la fois Atis assassiné par les chasseurs de Latro, Dagios s’enfuyant en forêt, Calroë dont la bouche sinueuse et lippue le dévora alors qu’il retrouvait Aldéa. Il s’éveilla en sursaut, tremblant, transpirant. Au fond de la hutte, Duisto n’avait pas bougé, dormait de l’innocence d’un mort. Pourtant, des cris lointains, des cris à peine audibles crevaient l’obscurité – son oreille les cerna peu à peu – et c’étaient peut-être eux, ces cris, autant que son cauchemar qui l’avaient tiré de son assoupissement. Il se leva, s’approcha du rideau qui barrait le seuil de la maison. Derrière le lourd tissu, dans la rue, il entendit des riverains qui étaient sortis, eux aussi inquiets, et marchaient de long en large en tâchant d’écouter, parcourus d’un frisson comme à l’approche d’une créature nocturne. Les cris venaient d’au-delà des remparts, de la plaine. Les Romains, c’étaient les Romains qui gueulaient ! Et leurs cris n’étaient pas des cris de terreur, ni des cris de souffrance, mais bien des ordres donnés dans des ahans qui semblaient le souffle de la légion tout entière. Des bruits les accompagnaient, des bruits terrifiants parce que trop identifiables, des heurts de haches, des rognages de scies, de grands craquements d’arbres que l’on encorde et qu’on tire avant le raclage des rabots. On ne voyait rien, on entendait tout et par ce que l’on entendait, on ne savait que trop ce que l’ennemi faisait. Il ne se cachait pas mais faisait volontairement le plus de vacarme possible. D’autres armées frappaient en chœur sur des boucliers pour intimider l’adversaire ; la légion, elle, montrait qu’elle était à pied d’œuvre même la nuit. 320
L’écho de son labeur ne cessa jusqu’au matin. Le lendemain, quand Magon sortit pour de bon, à peine le jour poignait qu’un son de trompette retentit puissamment dans toute la place. Les habitants le reconnurent, se hâtèrent d’un même élan aux murailles sud de l’oppidum, du côté de la route qu’avaient empruntée les Romains et qu’ils reprendraient pour partir d’ici. Un mélange d’excitation et d’effarement se lisait sur les visages qui passèrent en trombe. – Venez voir, venez voir !, lançait-on aux ahuris sur le passage, venez voir, on a sonné, ce doit être terrible ! – Qu’est-ce que c’est ? – Paraît que les légions sont parties ! – Parties ? Est-ce qu’on a réuni le Conseil ? – Pas depuis hier ! Le Maltais fut emporté par le flot, se retrouva lui aussi au pied du rempart sud, monta. En haut, l’enceinte était bondée de tous côtés d’hommes en armes mais aussi du menu peuple venu les coudoyer – artisans, paysans, valets, femmes, enfants à ne plus pouvoir les compter. Il fut bloqué par la cohue. Toute la ville l’avait précédé, massée, compacte, les plus en arrière poussant les plus en avant presque dans le vide tandis qu’en sens inverse de premières exclamations, de premières rumeurs traversaient les rangs pour gagner l’intérieur. En face, le jour tardait à se dégager ; il ne vit d’abord rien du paysage que des nappes de brume livides rayaient encore alternativement. Ses yeux, gênés par des dos, des épaules, des têtes, ne purent réellement aller plus loin que la pierre du rempart où il réussit à poser le pied. Comme il la découvrait de près, cette pierre, l’ensemble auquel elle appartenait lui parut alors plus petit, moins monumental qu’il n’en avait l’air d’en bas. Aucun parement de renfort, aucune tour imprenable, aucune pièce d’artillerie ne rendait l’ouvrage vraiment colossal. Des fissures à des endroits invisibles de l’ennemi, mais des fissures larges d’un doigt fendillaient même çà et là le sol comme un géant dont le froid aurait gercé la peau et meurtri les poings avant qu’il se batte. Le rempart, si solide en apparence, n’était pas entretenu comme il fallait, il en eut la brusque révélation. Surtout, quoique la foule agglutinée fût alors nombreuse, il n’y avait pas besoin d’être arithméticien pour compter que la garnison était inférieure en nombre, et de beaucoup, aux légions qui se présenteraient. Magon ne savait si les défenses de Vellaunodunum étaient réputées chez les Celtes ; mais à voir l’envers du décor, leur fragilité cachée, jamais elles ne contrecarreraient le 321
génie militaire ni la puissance de tir des Romains. C’était à penser qu’il n’y avait pas un mur de Gaule qui résisterait à César. Soudain un remous agita la foule. Certains avaient vu ce qu’il fallait voir, repartaient sans mot dire d’un pas pressé. On eut plus de place. Magon put avancer en jouant des coudes. Approchant enfin du rebord, il se trouva entre un homme dont le ventre arrivait presque à la hauteur de ses épaules et une mère de famille, une petite rousse aux pommettes tachées de son, arrivée là par miracle avec toute sa progéniture qu’elle tenait insouciamment devant elle. Ils étaient quatre enfants. Le Maltais prit le plus jeune dans ses bras, un bambin ébouriffé à qui il ne donnait pas cinq ans et qui lui tirait la jambe pour mieux voir. Il l’assit devant lui sur une rambarde de bois. Alors qu’une nouvelle langue de brouillard prenait de l’épaisseur, un choucas fit entendre son croassement au-dessus d’eux. – Lug ! Le dieu Lug est avec nous ! Le dieu au corbeau !, se réjouirent des voix optimistes. Le gamin, heureux de cette coïncidence, tressauta d’émerveillement, battit des mains et Magon dut le retenir pour qu’il ne tombât pas. Lui pensait à la légende de Marcus Valérius Corvus dont un oiseau de ce type avait annoncé la victoire face à un colosse gaulois et il se disait que les Romains devaient associer le même animal à Apollon qui vise loin et éloigne les blessures tant il est vrai que les signes du monde s’interprètent de cent façons différentes. Décidément, l’avenir était illisible comme les paroles de Duisto, et les présages avaient le sens qu’on acceptait de leur prêter. Que regardait-on au juste ? La nappe de brume dormante qui venait de grossir et obstruait la vue s’étira et s’estompa tout à coup. On retint son souffle. Les Romains n’étaient pas partis ! Au contraire, à moins d’un mille de distance, sous la clarté blafarde de l’aurore, un formidable assemblage de bois, une masse droite, haute, crénelée de tours à ses quatre angles, émergeait pour faire face à l’oppidum. C’était leur camp de marche. Comme à leur habitude à chaque halte – a fortiori en pays ennemi –, les troupes avaient passé tout le soir à le bâtir. La construction avait dû être décidée au coucher du soleil dès que l’avant-garde avait sécurisé le terrain et elle s’était terminée tard dans la nuit. Magon en fut plus encore frappé que les autres car le camp s’élevait là où il s’était caché les premiers jours. C’était bien ça, il ne pouvait se tromper, même si le petit bois qui occupait l’endroit était maintenant tout pelé. On avait dégagé un ou deux rochers encombrants ; les arbres et le taillis autour avaient été abattus à la bipenne et la dolabre, toute la nuit, jusque loin, et, excepté un massif d’ormes jonché de broussailles que 322
personne bizarrement n’avait remarqué vers le nord, il ne restait qu’un champ de souches, défriché à ras, qui eût empêché une armée de charger s’il s’en était trouvée une pour secourir les assiégés. Le lieu à vrai dire n’avait pas été choisi au hasard ; hormis l’oppidum, c’était le seul de la plaine où le terrain s’élevait en pente douce vers une éminence. Exactement comme Magon l’avait jugé idéal pour scruter les entrées et sorties de la place forte, les ingénieurs de César dirigés par des préfets bien avisés l’avaient jugé bon pour la dominer et la prendre. Caton avait l’habitude de dire que la victoire vient de la pioche plus que de l’épée. Le Maltais ne s’en plaignit pas à voix haute, mais la vérité de la situation, amère, cruelle, lui sauta aux yeux. Les Gaulois venaient tout bonnement de commettre leur première erreur, grossière, en laissant les Romains s’installer sans rien entreprendre pour les repousser. Même de nuit, ils auraient dû envoyer au moins des éclaireurs, tenter une attaque quand il était encore temps. Maintenant, les déloger d’ici serait beaucoup plus compliqué ; incapables d’assiéger une place autrement qu’en se ruant dessus, ils s’épuiseraient à en gravir la pente, se heurteraient aux murs épais du campement. Était-il possible que personne ne l’eût vu ? L’ennemi avait arraché un avantage en s’implantant sur le terrain sans en être chassé comme si le territoire lui appartenait déjà et que la prise de Vellaunodunum n’était plus qu’une formalité. Sur les remparts pourtant, la première réaction fut celle du déni. Un camp, peuh, ce n’était que ça ! Un fossé ridicule, une levée de terre, une palissade solide comme un dos de fillette ! Ça n’effrayait personne ; ce serait aussi vite détruit que construit ! Sa découverte parut même exciter la goguenardise, la gourmandise d’en découdre chez les hommes et les femmes. Mais là !, quelqu’un montra soudain un point plus précis au milieu des tentes. Tous regardèrent dans la même direction, aperçurent une tache écarlate qui aurait pu être n’importe quoi et dont il n’était pas même sûr que ce fût un être humain. Le hasard voulut pourtant que celui qui avait la meilleure vision de la cité crût reconnaître le proconsul en personne. Dès lors la rumeur courut d’un bout à l’autre. César, c’était César qui se pavanait et venait les défier ! À sa vue, les Vellaunoduniens perdirent la sobriété et la discipline qui étaient leurs qualités phare. Les plus réservés furent entraînés par les plus insolents. Tous se mirent à chanter les exploits des ancêtres, à proférer des insultes envers Rome, à exhiber poitrines et attributs en se flattant d’être de vrais mâles et les mères de vrais guerriers. Carnutes, Sénons, Bituriges, vraiment tous les mêmes, inconscients et naïfs, pensa Magon au milieu d’eux, que retenait de se moquer la méfiance de ses ancêtres puniques. 323
Peu à peu cependant les regards s’abaissèrent, les bouches se fermèrent de stupeur. On découvrit, sous des brumes basses qui se dissipaient paresseusement, qu’il y avait plus inquiétant qu’un simple campement. La masse de celui-ci attirant l’attention en premier avait occulté l’espace d’un instant l’autre spectacle, au pied de la petite colline. À mi-chemin entre le camp et le contrebas de l’oppidum, mais hors de portée des lances et des arcs, ne s’accordant aucun repos, les troupes romaines, protégées de claies et de gabions, travaillaient encore, semblables à des fourmis avec leurs fils à plomb, leurs marteaux-pics et leurs pioches, avec la même industrie tranquille que si elles eussent tracé une route de campagne. Ce qu’elles creusaient pourtant était autrement plus périlleux. Elles en étaient maintenant à établir une ligne de contrevallation. Comme pour le camp c’était la fameuse trilogie fosse-remblai-palissade typique des ouvrages romains qui se répétait et que Magon reconnut pour l’avoir étudiée dans ses livres. D’abord certains voulurent en rire, racontant que les Gaulois, eux, faisaient leurs lignes de siège avec des empilements de cadavres. Mais l’heure n’était plus à la fanfaronnade. On leur expliqua le plan de César. Il entourerait l’oppidum d’un retranchement, empêcherait les assiégés de quitter la place, d’aller chercher du ravitaillement ou des secours ; s’il ne donnait pas l’assaut, il les assoifferait, les affamerait, obtiendrait leur reddition. Ses ouvriers avaient commencé leur labeur dans la nuit pour étonner les Gaulois par l’ampleur de leur travail au petit jour ; ils continuaient maintenant pour les intimider davantage, et l’on voyait les talus s’ériger inlassablement, stabilisés par l’empilement des mottes de terre, précédés d’un simple fossé, plantés de palissades en bois et de tourelles. Le premier jour de siège commençait, l’offensive était psychologique. Le but n’était pas de surprendre mais bien d’impressionner l’adversaire. Comme dans ses précédentes campagnes, César arrivait, tentait une attaque initiale. La situation s’avérant indécise, il mettait en place des travaux imposants avec des engins de siège par lesquels il souhaitait frapper les esprits plus que les corps. Derrière, venant du camp qui bourdonnait d’activité comme un essaim de guêpes prêtes à piquer, des machines de guerre fraîchement assemblées étaient en effet tirées en direction de l’ennemi. Leur fabrication était simple et rapide, elles ne serviraient que de défenses mobiles. Mais pour des hommes qui n’en connaissaient pas l’usage à la guerre, pour des femmes qui n’en avaient même jamais vu, pour des adultes qui restaient des enfants, c’étaient des monstres de bois, de métal et de corde. Il fallait voir celui-là avec son tressage d’osier comme des squames de serpent, ses trois roues d’animal tripède où les javelots et les flèches étaient déjà posés et 324
montraient leur pointe en un lacis de langues fourchues ! Et celui-là protégé par un toit renforcé de cuirs bourrés de paille comme un escargot énorme bardé d’une carapace déroulée ! Tous les Sénons n’étaient cependant pas aussi impressionnables. Quelques rares avaient connu nombre de guerres, dans d’autres pays. Il se trouva que l’homme à côté de Magon, un vétéran, fut de ceux-là. Il ne rit pas devant ces machines, prit leur menace au sérieux car c’était avec elles que le siège, et ses souffrances, et la défaite probable se profilaient. Il fut capable d’énumérer le nom de chacune, les dégâts qu’elles occasionneraient aux défenses. Il reconnaissait des mantelets, des tortues, des ratons et même ces appellations ne lui arrachèrent une esquisse de sourire. La fabrication en était simple et rapide, une armature de poutres montée sur roues, peu de fer, beaucoup de cordes. Mais c’était là leur point fort. L’art de la construction pratique, la capacité à faire d’une technologie rudimentaire une merveille d’industrie expliquait bien souvent la force de la légion, il le savait. – Et ce n’est que pour leur défense, dit-il sentencieusement. Attendez qu’ils nous sortent leurs engins d’attaque, leurs béliers, leurs balistes, leurs scorpions et leurs tours. Attendez leur terrasse d’assaut s’il leur prend l’idée d’en construire une. Encore des noms d’animaux, cette fois-ci plus menaçants parce que mêlés aux termes de tours et de terrasse que tout un chacun comprenait. À les entendre, des voix contestataires s’élevèrent. Elles commentèrent rageusement qu’on aurait dû lancer une attaque, plus ample, mieux coordonnée que la première, avant l’érection du camp et la sortie de ces bestioles inquiétantes. Enfin !, se dit Magon, enfin ils comprenaient ! Les six membres du Conseil parurent avoir entendu ces voix qui montaient car ils se présentèrent incontinent sur le rempart escortés d’une suite réduite. On s’écarta comme on put pour leur faire place et ils s’approchèrent du parapet afin d’évaluer la situation. Celui qui ouvrait la marche, Gitogmaros, quoique casqué et cuirassé d’un bronze rutilant, portait un visage déconfit et cireux, les yeux écarquillés comme une orfraie surprise en plein jour. Il n’avait manifestement pas dormi, faute d’avoir anticipé les événements, tablant peut-être sur un simple passage de César. Loin de calmer le débat naissant, la survenue des six membres délia les langues et tourna au désaveu. Les quelques gardes qui les accompagnaient, eux aussi absorbés par les préparatifs de guerre romains, ne dissuadaient pas d’être véhément. On avait des chefs à qui parler et on ne se gêna pas pour soulager son inquiétude. On murmura de premiers reproches, qu’on s’était bêtement retranchés comme des couards après un seul petit contact, qu’on s’était privé de toute issue honorable en croyant que l’honneur était 325
de résister sur place, que les Romains maintenant étaient maîtres du jeu parce qu’on les avait laissés facilement l’être. Rapidement les accusations s’exaltèrent, les voix s’affermirent, les élus de l’oppidum durent se justifier de tout. Pourquoi n’avaient-ils pas réuni le Conseil dans la nuit quand on avait entendu les voix des ouvriers de la légion ? Pourquoi maintenant venaient-ils après tout le monde se rendre compte ? Ils n’avaient aucun plan de défense, encore moins de résistance active. C’était ça le malheur ! Ça ne ressemblait pas aux Sénons ! Ils faisaient honte à leurs ancêtres, honte à Acco ! Outrepassant le respect qu’on leur devait, on les traita pour finir de lâches, d’imbéciles, de méprisable racaille. Au nom de l’ancien chef respecté et jalousé en même temps, au nom d’Acco, les magistrats avaient sursauté cependant et ce simple souvenir sonna plus grave à leurs oreilles que toutes les insultes dont ils venaient d’être l’objet. D’ailleurs, ils les minimisaient, ces insultes ; ce n’étaient pas encore les huées ou les coups échangés, juste des murmures réprobateurs, alors qu’ils s’exagéraient infiniment le rapprochement évident avec Acco. Il n’y a rien de plus cruel, de plus enrageant pour un homme de pouvoir que d’être infériorisé par rapport à son prédécesseur, surtout quand il sait que le mérite du premier fut réel et qu’une part de vérité sous-tend les incriminations dont il fait, lui, l’objet. Cette injustice – ils la vivaient comme telle – détermina les membres du Conseil à penser qu’il fallait éteindre l’incendie avant qu’il ne prît. Ce serait l’occasion de se démarquer une fois pour toutes du supplicié de César. Coincés entre le grand vide et la population qui les pressait, ils durent bientôt réagir, proposer quelque tentative pour montrer qu’ils reprenaient la main, et la politique a ceci d’universel qu’on préfère souvent gesticuler, faire oublier ce qu’on a dit la veille, abandonner toute constance pour paraître être actif même si l’on court droit à la catastrophe. Alors les cinq membres jetèrent un regard rapide et suppliant au premier d’entre eux, Gitogmaros qui, d’un geste de la main, apaisa les voix discordantes : – Mes amis, mes amis, j’ai entendu vos plaintes et vos reproches. Je les comprends. Mes pairs qui m’accompagnent les comprennent aussi. Soyez sans crainte cependant, ce que vous prenez pour un renoncement au combat n’est que de la prudence. Si nous sommes rentrés hier dans l’oppidum après avoir lutté… – Tu n’y étais pas !, fut-il interrompu par un flot de voix anonymes. – Tu étais caché derrière les remparts ! – La prudence n’est pas nôtre ! – Silence, je vous en prie ! Silence ! Écoutez-moi ! Si nous n’avons pas saisi la chance de déloger les Romains quand il était facile de le faire, si 326
sous le coup de l’abattement nous avons proposé de ne plus sortir et de défendre notre honneur sur les remparts, c’est parce que nous savons qu’un Sénon ne craint pas la difficulté. Rien ne dit pourtant que nous ne tenterons pas d’autres manœuvres au gré des événements. Et ces machines que nous voyons, ces machines qui confèrent une supériorité indéniable aux Romains, ces machines changent la donne : il faut les détruire au plus vite, chacun de nous l’accordera. Il savait ce que la foule voulait entendre, ce que sa forfanterie belliqueuse réclamait pour la priver de gronder, et il y venait. Il jeta un coup d’œil au-delà des remparts, présenta son plan sous la forme d’un appel : – Une sortie, voilà donc ce que je propose à la sagacité de tous et au courage de nos guerriers. Je demande des volontaires pour la tenter. Les légionnaires sont en plein travail, leur ouvrage est à peine entamé, le détachement qui les protège est très faible. César ne s’attend sans doute pas à une offensive après notre défaite d’hier. Mais ce qu’il ignore, c’est qu’hier nous jaugions l’adversaire ; aujourd’hui nous allons le combattre. Si nous jouons de la pente descendante, nous pouvons gagner un élan suffisant et atteindre d’une course ces machines, leur ligne de défense et les détruire toutes. Nous irons plus nombreux, plus déterminés ! L’audace, le nombre, c’est la victoire assurée pour prendre la revanche ! Ces paroles étaient celles qu’on voulait entendre. Au mot de volontaires, une haie de bras tendus se leva. Chacun affirma être le champion que les Sénons attendaient. Chez eux, le volontariat avait force d’enrôlement ; les guerriers gardaient leur âme combattive. Gitogmaros fut soulagé de cette première approbation qui, si elle ne réglait rien à long terme, avait au moins le mérite d’apaiser la situation dans l’immédiat. Il bénéficiait d’une certaine aisance oratoire, cherchait à peine ses arguments qui venaient naturellement. Il avait rapidement évalué les positions de chacun, imaginé cette action et, oubliant lui-même ses idées de la veille, il s’était le premier laissé convaincre de la possibilité de réaliser ce que son esprit avait fantasmé. Les Vellaunoduniens encore impressionnés par ce qu’ils avaient découvert en bas du camp de César y crurent aussi et des sourires timides, renaissant au pli des joues, disaient déjà que les cœurs se réchauffaient. On ne parlait plus de s’enfermer dans la place, d’attendre l’assaut, mais bien de provoquer les événements. C’était un revirement subit de stratégie, une manière impensée de faire la guerre qui n’augurait rien de bon. Car il ne fallait pas être savant pour voir que tout venait d’être improvisé. Même après l’exhortation de Gitogmaros, on peinait à définir des objectifs plus précis, plus ambitieux que ces quelques machines dont le faible nombre 327
eût laissé penser à toute personne avisée qu’elles étaient moins une réelle menace qu’un moyen de pression. Surtout, qu’ils en doutassent en leur for intérieur ou que ce revirement soudain et modeste leur suffît, personne ne dit ce que l’on ferait en cas de succès. Nul ne parlait d’attaquer le camp romain, d’infliger à l’ennemi une déroute générale. On se focalisait uniquement sur cette ligne de contrevallation qui les narguait parce qu’elle avait été construite à leur nez et leur barbe. C’était simpliste, ça sentait l’erreur, le piège. L’organisation fut laborieuse. On aligna d’abord les combattants à cheval. Mais ils n’étaient que soixante survivants de l’engagement de la veille ; leur équipement perdu sur le champ de bataille fit un instant défaut et, quoique si peu nombreux, l’espace entre les rues fut insuffisant pour les ordonner à couvert, dans le calme. La piétaille en revanche, bien armée, malgré toute la discipline dont elle voulut faire preuve, mit un temps impossible à se mettre en place si bien que le soleil était déjà haut, les nappes de brume complètement dissipées dans le ciel quand la sortie de l’oppidum put être ordonnée. On se compta à la fin ; on était mille neuf cents pour créer l’épouvante. Tardivement, les grandes portes s’ouvrirent dans un grincement contenu. Il se fit un silence, pesant, comme si la ville entière se retenait de respirer. Puis une sonnerie de carnyx retentit à l’intérieur des murailles, orgueilleuse, impatiente, se répandant très loin dans la plaine, occupant l’espace et cherchant à terrifier les esprits avant même que le fracas des armes n’éclatât. Elle fut aussitôt suivie d’un seul et même cri poussé par l’assemblée des guerriers qui donna l’impression d’un géant fou de rage qu’on réveille. Sans plus attendre, ne comptant que sur leur fougue à défaut d’organisation, les hommes sortirent d’un pas précipité mais correct, se dévoilèrent à la vue des Romains comme vomis d’un abysse, attendirent encore en haut de la colline que tous fussent là. Alignés sur toute la longueur des murs de l’oppidum, leurs lances pointées vers le ciel, ils les secouèrent brusquement en hurlant à nouveau un long cri pour intimider l’adversaire. Un moral d’acier regonflé par quelques paroles de leurs chefs, la certitude d’une gloire éternelle s’ils tombaient au combat les déterminaient à tenter l’impossible. Soudain ils se lancèrent à l’assaut. Ce fut alors un mouvement magnifique, ample, fluide, une houle illustre et très belle qui déferla. Dans la lignée des grands combattants sénons, des centaines et des centaines de braves dévalèrent la pente de l’oppidum telle une vague du grand Océan que l’immense majorité d’entre eux n’avait jamais vu. La lancée générale fut brutale, emportant tout sur son passage ; rien ne l’arrêterait. Les chevaux partirent en tête en un galop frénétique, dominant le champ de 328
course de leur stature et leur puissance. Derrière, brandissant lances, épées et boucliers, suivant les enseignes et répondant aux cris de leurs clans, les fantassins mirent leur honneur à les talonner et, plus légers, ils les suivirent d’un élan comparable, si vite qu’ils parurent un instant les rattraper. Les plis et replis du terrain firent monter et descendre la ligne des casques par lames successives qui se gonflèrent, disparurent, se reformèrent pour aller se jeter au contact de l’ennemi. Depuis les remparts, Magon, comme les autres, regarde. Il ne peut faire que cela, dans la naïveté de son appréciation. Personne ne lui commente exactement la situation. Tous les combattants sont partis, il ne reste que des paysans et des travailleurs de peu qui n’y connaissent rien à l’art de la guerre. Le vétéran qu’il avait à ses côtés s’en est allé faire couler le sang avec les siens ; seule demeure la mère entourée de ses rejetons, qui ne juge guère les faits qu’à l’aune de ce qu’elle voit. Ses quatre garçons, à qui elle explique la tournure des événements, s’enthousiasment au spectacle qui se prépare. Ils n’ont pas plus de dix ans et ils s’agitent, s’excitent au point que le plus jeune assis sur la rambarde de bois se lève pour mieux voir et Magon doit encore le tenir s’il veut lui éviter de tomber. De leurs voix frêles, ils encouragent les guerriers en leur trouvant des surnoms. Celui-ci est le costaud, celui-là roux-de-barbe, celui-là nez-de-souche. Ils croient reconnaître des clans, des figures illustres de la ville dont ils confondent ou écorchent parfois les noms. Ils s’amusent à voir ces formes vagues qui déferlent déjà petites au loin, se rétrécissent et ondulent comme un linge échappé dans l’air un jour de grand vent. Leur mère, elle, semble inquiète ; elle suit avec attention une des ailes de la charge. Tout à l’heure, après que Gitogmaros a appelé les volontaires à prendre les armes, Magon l’a vue, dans un angle isolé du rempart, discuter passionnément avec un homme dont la cape enroulée pouvait à peine faire le tour de son large torse. Elle lui a tendu les bras ; il les a pris entre ses mains puissantes qui faisaient trois fois les siennes, les a baisés puis s’en est allé dans les grands escaliers sans se retourner. Était-ce le père des enfants ? Sans doute pas car il n’a eu aucun geste d’affection envers eux. L’homme est maintenant en train de courir et c’est sans doute lui qu’elle tâche de ne pas perdre de vue comme si le couver du regard, c’était encore un peu le protéger. En face, les Romains semblent ne pas s’être attendus à cette sortie ni même l’avoir prise au sérieux. Jusqu’au dernier moment, les ouvriers continuent étrangement à travailler, à creuser leurs tranchées, à enfoncer leurs épieux dans la terre, offrant le contraste de manœuvriers paisibles face à des combattants grisés de rage. Ils sont une proie facile, appétissante, peut-être trop, et ce n’est que lorsque les cavaliers gaulois sont à une centaine de pas qu’ils se mettent à crier de peur, à gesticuler, à 329
esquisser un mouvement de fuite. Pas de panique pourtant, mais un recul qui a quelque chose de préparé et de feint. Très peu d’ailleurs sont emportés par le choc des armes ou le heurt des poitrails des chevaux ; il n’y a aucun corps à corps et ce sont les lances surtout qu’ils doivent éviter. Mais, de loin, la façon dont ils courent, les mouvements mécaniques qu’ils adoptent, l’absence d’entraves où trébucher prouvent assez la facilité de leur repli. Les guerriers gaulois cependant ne le voient pas. Ils sont trop près, eux, trop occupés aussi à achever les quelques blessés et à détruire la ligne de contrevallation encore branlante. Et sur la muraille, la foule, qui jouit de la distance nécessaire pour comprendre la situation, la foule versatile se répand au contraire en cris de joie, d’ivresse, de bonheur. On tressaute, on danse, on chante au milieu des accolades. On félicite les membres du Conseil dont la moitié est descendue combattre ; on acclame Gitogmaros qui est resté sur le rempart comme un général supervise à distance le mouvement de ses troupes. L’honneur des Sénons est sauvé ! Plus encore, la victoire est acquise et déjà on rit de la couardise des Romains. Il faut attaquer leur camp sans attendre ! On le crie aux maîtres du terrain sans s’apercevoir qu’ils sont trop loin pour entendre. Là-bas, le trouble du combat laisse vite place à une confusion inattendue mais prévisible. Les blessés ne sont pas assez nombreux à achever, la ligne de défense n’est pas assez solide pour passer longtemps à la détruire. Les esprits se trouvent vite oisifs, les bras ballants, les armes subitement lourdes. Parce que les chefs croyaient moins au succès qu’à une sortie pour l’honneur, aucun n’a ordonné de pousser jusqu’au camp romain et personne ne sait s’il doit se risquer à l’attaque. Le camp est là, en hauteur, hérissé de tours, enclavé dans un champ de souches qui gêne l’assaut ; d’en bas, la construction a l’air puissante, immense, dont la porte semble une bouche cyclopéenne qui rit de l’impasse où se trouvent les Celtes. Ceux-ci aperçoivent les têtes apeurées des légionnaires mais ils ne bénéficient plus de l’élan qu’ils avaient gagné en descendant la pente de l’oppidum pour aller les châtier. César est là derrière et ils ne peuvent rien faire ! Un flottement envahit la horde. La vague s’est arrêtée dans son déferlement, a stagné, est devenue un vivier tranquille d’hommes inactifs qui attendent, sans savoir quoi, avant de se relancer. Cependant, en tenant compte de tous leurs effectifs, il est douteux que les Romains aient reculé si prestement sans avoir rien anticipé, qu’ils n’aient pas cherché, à trois contre un, à résister davantage ni n’essayent de laver l’affront qu’ils viennent de subir. Si César est là derrière, il serait prétentieux de croire qu’il s’est laissé mettre en péril si volontiers. Combien sont-ils dedans ? Six mille ? Et où est l’autre légion que les éclaireurs ont 330
annoncée la veille ? Magon réfléchit, scrute le paysage en quête d’un indice de leur tactique. Et si…et s’ils avaient fait autant de bruit toute la nuit, s’ils avaient autant traîné à leurs ébranchoirs et leurs hachettes pour détourner l’attention ? Soudain un hurlement angoissé part du rempart : – Là ! Ils ne les ont pas vus ! C’est la petite mère à côté de Magon, qui décidément regarde loin et est attentive à tout danger, même éloigné des troupes à l’assaut. On sent qu’elle est aussi femme, et qu’elle tremble, et reste attentive à l’objet de ses sentiments. – Quoi ? Quoi ?, répondent les autres. Les Germains ! Trop tard. Les Germains de César – des Ubiens, des Tenctères, des Sicambres sauvés ou soumis par le proconsul les années précédentes –, ces mercenaires terribles que les Gaulois craignent plus que les légionnaires ou n’importe quel auxiliaire de l’armée romaine, viennent de faire apparition par le nord. Surgissant de l’ormeraie où, sans doute cachés par la broussaille, ils étaient imperceptibles, profitant d’un chemin plat comme une voie dissimulée et tracée pour l’attaque, ils fondent à cheval sur les vainqueurs d’un instant qui ont relâché leur garde. D’un physique proche de leurs cousins celtes, on les reconnaît difficilement à leurs armes et leurs vêtements. Ils n’ont ni cuirasses ni casques ni épées, mais des bonnets en peau d’ours, des boucliers ronds en osier, des framées au fer étroit et court qui leur servent à combattre de loin comme de près. Plus encore, ils se distinguent en se comportant comme des sauvages avec une cruauté innée et il faut voir ces monstres de la nature, si grands sur leurs chevaux si petits et mal faits qu’ils touchent presque terre quand ils chargent ; il faut les voir bondir, courir vers celui qu’ils viennent de heurter, lui éclater la tête contre une souche ou lui crever les yeux de leur javeline en hurlant telle une bande de stryges et remonter aussitôt à cheval. La surprise est totale, elle suscite l’effroi. Les Gaulois qui ne s’y attendaient pas doivent soudain se tourner pour manier épées et boucliers et lâcher leurs lances inutiles tant l’adversaire est déjà proche. Le mouvement est lent, embrouillé. Ils sont bousculés, enfoncés dans leur flanc, emportés sans pouvoir frapper et les premiers tombés se retrouvent piétinés par les sabots furieux des montures. Ce n’est plus une mer de guerriers qui submerge tout et chasse les fuyards, mais un torrent animal qui enfonce et tue sur son passage le bloc d’hommes censés lui résister. Malheur ! Le retournement de la situation ne se limite pas à l’incursion des Germains. C’est la contre-attaque générale, rapide, impitoyable. En même temps que les barbares, les portes du camp romain s’ouvrent à 331
nouveau et là où l’instant d’avant des soldats terrifiés sont entrés, une colonne fraîche sort à présent d’un pas décidé. Ce ne sont pas même des légionnaires qui paraissent, mais des troupes auxiliaires, des lanciers numides, des archers crétois, des frondeurs baléares que Magon reconnaît cette fois aisément, ceux-ci à leurs tuniques écrues, leurs casques en pointe, leurs arcs lourds, ceux-là à leurs boucliers en peau de chèvre et leur fronde de rechange autour de la tête. Derrière seulement les cohortes de légionnaires se présentent – il en dénombre cinq –, les trois rangées classiques s’organisent, mais elles n’interviennent pas encore. Les auxiliaires relancent à eux seuls l’attaque, sans se soucier le moins du monde de leurs alliés. Et avant même que les Sénons aient compris que les Germains les prenaient en tenaille à l’autre bout du terrain, les tournoiements se font entendre, une volée de pierres et de flèches traverse le ciel et s’abat, dans le sifflement des lanières de cuir, des cordes d’arc bandées, sur la ligne gauloise la plus proche des positions de César. Des cavaliers sont frappés de plein fouet, tombent de cheval sans même avoir pu pointer leur épée ni lancer leur monture ; les casques des fantassins sont transpercés par des balles de plomb, d’argile, des pierres grosses comme des poings ; parfois leurs boucliers trop proches sont cloués ensemble, et même en les secouant il faut s’en séparer et se battre sans protection. Alors seulement, les légionnaires entrent en scène. Selon une manœuvre bien connue, ils courent leurs quelques pas, projettent leur pilum avant de dégainer leur glaive et marcher au combat. Comme un champ de céréales qui ondule sous le souffle du vent, c’est un enchaînement complexe, très beau, très rythmé qui se déroule sous le commandement des centurions primipiles. Les soldats du premier rang s’écartent les uns des autres et, balançant le bras, le buste, lancent le plus loin possible leur javelot ; puis ils se baissent jusqu’à ce que ceux du deuxième, du troisième rang aient fait de même et, dès que ceux de la dernière ligne ont lancé leur dard, ils s’élancent au plus vite en bénéficiant de la hauteur de la colline alors que le dernier trait achève seulement de se planter dans les chairs de l’ennemi. La simultanéité des attaques n’est pas due au hasard. Le guêpier vient de se refermer. Les Sénons, déjà meurtris par les pierres qu’ils ont reçues au visage, subissent la lancée des javelots, comptent leurs morts qui sont nombreux. Dans la plaine rase où il n’y a aucun abri pour se mettre à couvert, non seulement ils sont pris au dépourvu, mais sous le feu des projectiles ils se trouvent acculés sur deux fronts, à un moment où, leur élan stoppé, leurs armes baissées dans l’apparente victoire, les ordres ont connu un certain 332
flottement. Si bien que pour limiter leurs pertes ils se divisent ; les plus éloignés, cavaliers en tête, fondent imprudemment sur les légionnaires sortis de leur camp tandis que les derniers guerriers à pied subissent la poussée des Germains à cheval qui les forcent à refluer en sens contraire. Bientôt leur ligne se distend, le milieu de leur position se réduisant comme peau de chagrin. Et inévitablement, ils finissent par être séparés les uns des autres sous la force, scindés en deux groupes inégaux dont l’un se jette en avant, emporté par sa haine aveugle des Romains, incapable de se retourner pour comprendre qu’une attaque a lieu dans son dos, alors que l’autre est obligé de battre en retraite et tente par ses cris désespérés d’attirer l’attention des premiers pour qu’ils les rejoignent et évitent l’encerclement et le massacre. Peine perdue. C’est la déroute. Les Celtes sont aussi rapides à fuir ici que prompts à attaquer là-bas. Sur le rempart, le fracas des armes arrive comme un cliquetis douloureux, les cris d’agonie comme des voix lointaines que l’écho répercute. Soudain la femme à côté de Magon, la petite mère qui à aucun moment n’a détaché son regard de la plaine au point de ne plus s’occuper de ses enfants lâche un nom avec effroi : « Térumnos ! » En même temps qu’elle a crié, son corps vient tout à coup de se tendre ; elle s’est pétrifiée, l’œil fixé sur l’horizon, là où les Germains commettent une boucherie, avant que ses membres ne se relâchent aussitôt. Magon comprend qu’il s’agit de celui qu’elle observait depuis le début, l’homme au sayon en bandoulière. Il regarde, concentre toute son attention mais, au milieu de la mêlée, il ne voit rien que des corps abattus et roulant à terre, pêle-mêle, dans le carnage. D’ailleurs la Sénone ne montre plus rien déjà ; son drame n’a duré que l’espace d’un instant, surpris de lui seul, et il n’arrive à savoir si c’est que ce Térumnos est mort ou qu’elle l’a juste perdu de vue. Elle sèche la larme involontaire qui lui a coulé le long de la joue, semble se ressaisir, tourne aussitôt le dos en emportant ses enfants dans ses jupes. Les guerriers rentrent dans le camp en essuyant des pertes mesurées, mais débandés, navrés, honteux du malheur de survivre si c’est pour fuir ignominieusement sous l’œil réprobateur de leur cité. Les plus valeureux, les plus fortunés sans doute succombent dans la plaine, s’en vont rejoindre les mânes de leurs ancêtres. Ils n’ont pu cependant faire que trop peu de victimes chez l’ennemi et tombent le plus souvent frappés de loin, sans avoir su coup férir. Du haut des remparts où la joie a laissé place à la stupeur, on voit les mouvements de troupes, ordonnés ou délités et, les yeux baignés de pleurs, on comprend le piège sans pouvoir rien faire qu’assister impuissant au massacre. Au loin, les soldats romains avancent maintenant, boucliers et glaives en avant, et frappent à coup sûr des hommes décontenancés ou blessés ; plus près, les Germains font un 333
carnage de gorges transpercées, de têtes volantes à coups de hache, de chevaux éviscérés dans la fureur de l’affrontement. Partout, tels des blés aux teintes rousses, les hommes fauchés tombent dru dans la plaine rougeoyante. Magon eut son saoul de catastrophes. Il détourna la tête, regarda le reste du rempart. Celui-ci s’était considérablement éclairci. Il ne restait que de pauvres hères accablés de chagrin et des vieillards qui ne pouvaient pas descendre aussi vite. Les hommes, ceux qui n’avaient pas eu le cran d’aller combattre dans la plaine, étaient tous partis, sans doute sauver leur honneur en réclamant une nouvelle action. Les femmes, fraîchement veuves ou pas encore, les avaient suivis dans les escaliers pour aller pleurer un mari, un frère, un père qui ne reviendrait pas. En bas, le long des portes, une haie d’accueil se forma, effondrée par intermittence quand un corps à genoux ne se tenait plus, secouée par le hoquet répété des gorges larmoyantes et douloureuses. Magon y vit encore la mère et ses quatre enfants. Au milieu d’une foule en larmes, elle attendait quelque chose, quelqu’un sans trop y croire, se forçant à ne pas être démonstrative pour ne pas se trahir. Elle était bouche bée, ses enfants criaient comme pour arrêter un jeu qu’ils ne maîtrisaient plus dorénavant ; elle essaya vainement de les réconforter et, devant les guerriers valeureux qui rentraient, comme ses marmots ne se calmaient, elle leur allongea une claque à chacun pour les faire se reprendre. Le plus jeune qui était une heure avant sur la rambarde afin d’être aux premières loges du spectacle se cachait maintenant dans les plis de son étole pour ne pas voir. Sans dire un mot, Gitogmaros et les membres du Conseil qui ne s’étaient pas battus avaient eux aussi disparu des remparts. On ne les retrouva pas même en bas à l’ouverture des portes. Ils avaient sans doute pressenti la versatilité de la population, avaient préféré éviter sa colère imminente, ne voyant pas que leur fuite les ferait passer pour des lâches ou des traîtres. Le discours officiel fut qu’ils siégeaient dès à présent dans la salle du Conseil où étaient convoqués sans tarder les hommes valides. Magon n’assista pas à la nouvelle assemblée. D’ailleurs qui y fut entre les morts, les blessés et ceux qui avaient honte de ne s’être pas battus ? Lui n’était pas sénon, il n’était pas guerrier ; il était médecin et sa place en tant que médecin était aux côtés des mutilés et des mourants. Il passa le reste du jour à tenter de soigner ceux qui pouvaient l’être, à accompagner ceux qui ne le pouvaient plus. On lui rapporta vaguement que là-haut, au sommet de l’oppidum, la réunion avait été houleuse, qu’elle s’était prolongée fort tard, que les sages du Conseil avaient été dans l’incapacité de trancher sur la conduite à adopter dorénavant face aux Romains. On 334
l’assura aussi que la prison n’avait pas bougé, que les geôliers étaient toujours restés en poste, que les prisonniers n’avaient eu vent des événements, leur seule fenêtre donnant sur un horizon opposé à celui de la bataille. Aldéa ne serait pas libre aujourd’hui. Il se coucha impuissant de tout, moulu, au creux d’une botte de foin, sans avoir mangé ni même avoir eu la force de rejoindre la demeure de son hôte Duisto. Le deuxième jour du siège, à peine l’aube fut-elle levée que les Romains reprirent leurs travaux, calmement, chacun à sa tâche, comme si de rien n’était. Ils s’étaient contentés de pousser les cadavres qui les gênaient et que les assiégés n’avaient pas eu l’audace d’aller récupérer. Au-dessus le ciel n’était plus le même, mais un ciel lourd, chargé, menaçant. À nouveau ils creusèrent, élevèrent des remblais, plantèrent les épieux des palissades avec une efficacité dont seule la légion était capable et cette fois-ci, contrairement à la veille, une garde protégeait les soldats affectés au génie – ce qui prouvait qu’ils ne tendaient plus de stratagème aux Gaulois mais effectuaient leurs travaux pour de bon. L’infanterie fournissait la main-d’œuvre ; la cavalerie, jouissant de ses privilèges, assurait la surveillance du chantier. La ligne fut terminée dans la matinée, une ligne souple, entourant l’oppidum sur tout son périmètre, à quelques cinq cents pas des murs, comme une corde qu’on va bientôt resserrer pour étrangler. Toute la ville fut encerclée. Même de la falaise où débouchait l’unique fenêtre du Boyau, on pouvait maintenant voir ce qui allait arriver. Les Sénons ne tentèrent ce jour-là aucune sortie pour laquelle ils n’avaient plus les forces suffisantes. S’ils ne vinrent à César, César s’en vint cependant jusqu’à eux. Comme souvent, des ambassadeurs romains traversèrent les lignes et se présentèrent sous les remparts, réclamant une discussion immédiate avec les autorités, arguant de la clémence du général si la population se rendait et livrait sa cité. D’une voix sonore, ils crièrent leurs exigences pour que tous les entendissent, avancèrent le chiffre minimum de six cents otages et la totalité des chevaux à remettre, à quoi ils ajoutèrent des demandes en boisseaux de grain, en mesures de bois, en setiers d’argent. C’était beaucoup pour une petite ville comme celle-ci. Il y avait matière à s’indigner. Mais il n’y eut aucune réaction. On ne leur ouvrit pas les portes parce qu’on ne savait quoi leur dire, quelle décision prendre ; on ne les menaça même pas, on ne réitéra pas les insultes de la veille ; on se borna à les regarder stupidement passer et les émissaires finirent par repartir dans la crainte d’un traquenard. 335
Dans la foulée, une seconde légion, jusque-là absente du terrain, qu’on aurait jurée invisible même au regard des dieux, profila sa ligne à l’orient où elle demeura en réserve le long de la route comme si elle attendait la formalité de la prise de Vellaunodunum pour se remettre en chemin. Et si César était plutôt là-bas ? Et s’il avait confié la prise de la ville à un de ses lieutenants comme une tâche subalterne qu’il attendait de voir remplie ? Tous les Sénons n’eurent d’yeux que pour cette nouvelle menace et, découragés, incapables de savoir même où leur adversaire dirigeait tellement ses troupes étaient nombreuses, ils comprirent la supériorité des Romains et leur victoire inéluctable. Toute volonté de résister les abandonna. La légion qui avait dressé son camp deux jours plus tôt s’employait néanmoins à les épouvanter davantage. Les tractations avaient échoué, plutôt elles n’avaient été entamées qu’à la cantonade. Alors, quand le soleil, passé son zénith, commença à redescendre dans le ciel, les machines d’attaque, balistes et catapultes, furent avancées et de premiers projectiles lancés, en apparence aveuglément tant les uns tombèrent près en écornant des morceaux de remparts, les autres loin en soulevant des amas de terre sèche. Le premier bruit fut terrifiant. Alors que l’on se remettait à peine de la manœuvre d’encerclement dont l’oppidum faisait l’objet, on entendit un grand craquement de bois, une corde qui se relâcha au loin dans un long sifflement. Puis il y eut un choc énorme, un nuage de fumée et l’on comprit qu’un boulet venait de s’écraser contre un pan de la muraille où il avait abîmé une poutre sans la faire tomber cependant. Il y eut une pause. Soudain un autre sifflement fendit l’air et un nouveau boulet vola, cette fois-ci au-dessus du rempart, et atterrit droit dans une bauge à cochons où il s’enfonça comme un doigt dans une motte de beurre. Et le même bruit se répéta, et le fracas, et la fumée, et les boulets tombèrent dans le sable, sur le bois, contre la pierre de l’oppidum, faisant des dégâts divers selon qu’ils touchaient des bâtis ou tombaient entre. Les Romains réglaient leurs tirs, évidemment, avant l’assaut prochain. Cette fois-ci, les Vellaunoduniens n’osèrent plus même résister. Ils attendirent, anxieux, partagés entre la rage de leur impuissance et l’horreur d’être faits comme des rats. Ils avaient suivi toute la matinée le mouvement des pioches élevées et baissées ; maintenant que la ligne de contrevallation était tracée, ils en étaient réduits à écouter le bourdonnement des tirs qui s’intensifiaient au-dessus de leurs têtes avec le sentiment d’être des insectes qu’on a coincés sous un pot pour les piétiner. Soudain un nouveau boulet s’abattit au milieu d’une place, suivi d’un autre juste à côté dans une écurie où un hennissement prolongé indiqua qu’une bête avait été touchée. C’étaient les premiers qui visaient juste parce que c’étaient les premiers qui 336
frappaient deux fois au même endroit. Ce cheval était leur première victime. Dès lors, la précision des tirs ne cessa de s’accentuer. Les Romains prirent soin de frapper partout, jusqu’en haut de l’oppidum, pour démontrer leur force de frappe et de pénétration. Et plus ils frappaient, plus ils visaient maintenant des cibles stratégiques qui faciliteraient leur succès. La ligne de défense antérieure à mi-chemin de la montée de la ville, la petite palissade de bois, les épieux fichés en terre censés retenir une armée avant même qu’elle n’atteignît les remparts, tout explosa avec la légèreté d’un fétu de paille. Au-delà les murs eux-mêmes souffrirent de la fragilité que Magon avait entrevue la veille et, sur ces murs épais, ce ne fut pas la pierre qui fut attaquée, les Romains ne cherchant pas à l’entamer d’une brèche, mais les infrastructures en bois, tourelles, chemins de ronde, escaliers autant pour affaiblir les défenses que saper le moral des Sénons par des dommages graves et immédiats. Les hommes qui s’y trouvaient furent eux-mêmes visés par des archers et des frondeurs qui, rapides, insaisissables, ne craignaient pas de s’approcher et, plus encore que la veille, frappaient à coup sûr. Magon le savait, les Baléares étaient entraînés depuis l’enfance où l’on plaçait devant eux un morceau de pain accroché à un poteau qu’ils n’avaient le droit de manger qu’après l’avoir touché de leurs pierres. Ils étaient des tireurs d’élite qui avaient autrefois tué jusqu’à un consul romain et montraient aujourd’hui que la prise d’un petit oppidum barbare leur était acquise. Le rempart fut bientôt nettoyé. Inévitablement, il y eut des victimes, innombrables, parmi les assiégés. Tel homme qui commandait l’instant d’avant, qui exhortait ses camarades, qui aiguisait ses armes inutiles, telle femme qui réconfortait son enfant, qui allait puiser de l’eau pour en faire provision tant qu’elle pouvait, tous finirent écrasés l’instant d’après et l’effroi se répandit chez les autres qui songèrent qu’ils pourraient être les prochains dont on ramasserait les membres éparpillés sous le choc. Ce fut alors une terreur folle. La pluie de projectiles n’était pas encore totale, mais nul endroit ne semblait réellement protégé. On guettait les sifflements dans l’air, on cherchait un abri sûr, on se terrait dans les caves et les resserres en priant les dieux pour survivre. Bientôt il n’y eut plus personne même au pied des remparts et l’intensité des tirs s’accrut encore, un, deux, trois boulets chutant au même endroit pour aggraver les premières destructions. Sous ce déluge, Magon aussi eut peur. Comme tous, il courut aux refuges épargnés par l’artillerie des Romains, ne pensant plus même à secourir les malheureux blessés qui gisaient dans les rues mais uniquement à sauver sa vie. Il se jeta en zigzaguant, se cacha derrière un arbre, un 337
muret, une charrette qu’un nouveau boulet emportait l’instant d’après. En torchis ou en pierre, les huttes étaient touchées, éventrées dans leurs toitures, balafrées à leurs angles, fauchées dès leurs fondations. Et quand le Maltais, ayant aperçu une porte entrouverte, tenta de s’y précipiter, une immense explosion l’arrêta net et le jeta au sol. Il se releva, les mains et les genoux écorchés dans sa chute. La porte qu’il avait manqué d’atteindre n’était plus là. Le mur autour avait lui-même disparu. Une paire de boulets l’avait fracassé, faisant s’effondrer tout un pan de la maison sous l’attaque. Étourdi, il ne pensa pas à ce à quoi il venait d’échapper. Devant le spectacle de cette porte volatilisée, une idée subite s’empara plutôt de lui et il regarda au sommet de l’oppidum où les projectiles tombaient en masse. La prison ! La prison ! Aldéa ! Peut-être était-elle libre si par bonheur un boulet avait aussi détruit la porte de sa geôle ! C’était la chance qu’il attendait depuis si longtemps ! Un espoir insensé l’envahit, aussitôt suivi d’une angoisse insoutenable. Si un boulet causait tant de ravages, quelle catastrophe provoqueraient des dizaines là-haut ? Les Romains paraissaient même s’acharner sur le quartier qui était le cœur du pouvoir dans la ville. Il reprit sa course, plus rapide, plus folle, sans s’arrêter aux débris ni aux cadavres qui jonchaient la route. Alors que tout le monde descendait dans la panique, lui seul montait. Bientôt il déboucha sur la place où se trouvait l’entrée de la prison. Il ne reconnut rien. Le sol, les arbres, les bâtiments, tout avait été dévasté, ruiné, désolé sous l’orage de pierres. C’était comme si les hommes avaient fait pleuvoir des cailloux sur l’Olympe pour l’araser. L’artillerie ne cessait encore son attaque mais espaçait ses coups ; elle souhaitait viser seulement ce qui restait debout ou cherchait une autre cible de choix. Il parcourut le champ de mort encore fumant de poussière. Comme il l’escomptait, l’entrée de la prison avait volé en éclats, mais avec elle c’était la moitié du bâtiment qui s’était aussi effondrée. Le sol semblait l’avoir avalée et, le Boyau étant construit en une longue galerie pentue, les pierres, les poutres chutées, au lieu de s’enfoncer avaient roulé sur une certaine distance où, mêlées à la terre, elles avaient formé une sorte de talus aussi épais que très haut. Les survivants, s’il y en avait, étaient empêchés de sortir, les secours interdits d’arriver. Il pénétra sur les lieux dans un état d’angoisse indescriptible, tâtonna à l’aveugle sur des gravats, marcha au milieu des cailloux sur des pieds arrachés de gardiens, des mains de prisonniers qui sans doute agrippés aux barreaux de la porte pour s’échapper s’étaient laissés surprendre et entraîner dans la mort. Combien de malheureux y avait-il là-dessous, écrasés sous ces pierres ? Il entreprit, la peur au ventre, d’en vérifier l’identité, cherchant la femme qu’il aimait sans vouloir la trouver. À l’aide 338
de son bâton qu’il avait réussi à ne pas perdre, il retourna des blocs, en fendit d’autres de sa lame en orichalque qu’aucune matière n’arrêtait. Par bonheur, Aldéa n’était pas là et, rassuré enfin, il poursuivit son chemin dans la partie non éboulée de la prison où la galerie enterrée avait résisté au ravage de l’artillerie romaine. L’effondrement avait formé une sorte de barricade élevée derrière laquelle il eut du mal à se faufiler. Il enjamba encore un cadavre, passa sans s’arrêter devant un blessé qui, la jambe plus aplatie qu’un torchon de matrone, suppliait qu’on l’achevât. Puis, il n’y eut plus rien, il fit très noir et, appuyé sur son bâton, il s’enfonça dans l’obscurité vide et poussiéreuse où la destruction n’avait pas permis de jeter un rayon de lumière. Une odeur immonde lui sauta à la gorge, manqua de le faire vomir. Même dans sa destruction, la prison restait cet endroit glauque, humide, cet intestin de la terre où le jour et l’air frais ne pouvaient pénétrer. Soudain il aperçut une lueur au fond, si infime qu’il crut avoir rêvé. Mais le point de lueur s’accrut, prit la forme d’un petit carré qui grandit, grandit, se précisa au point de ressembler à une ouverture grillagée. Et ce fut là, tout près, qu’il la découvrit, non pas divine mais mortelle, fragile, indemne, nimbée d’une lumière douce qui n’émanait pas d’elle comme aux jours de bonheur mais du soleil qui daignait l’éclairer enfin comme un cadeau retrouvé de la vie. Cette silhouette fine, prostrée, si blanche, dont la tunique en lambeaux la rendait presque nue, c’était elle, ce ne pouvait être qu’elle : Aldéa ! Aldéa ! Aldéa ! Son seul nom lui échappa et, la voix étranglée de larmes, il courut la retrouver. Elle leva la tête, le reconnut, fut un temps avant de réaliser. Furieusement elle voulut se jeter vers lui. Mais en se redressant, les forces lui manquèrent, ses jambes défaillirent. Alors il abandonna son bâton, se précipita pour la rattraper et la prendre dans ses bras où, à bout de forces, elle lui sourit, d’un sourire indistinct qui en disait plus long que n’importe quelle parole du monde. – Je t’ai retrouvée, lui dit-il en sanglots en lui baisant le front et lui mangeant les bras. Vois, vois, j’ai donné ma vie, toute mon âme, tous les efforts de mon corps pour ce moment. Je t’aime, Aldéa, je t’aime et je viens te servir. – Magon… Elle ne put parler davantage. Mais là n’était pas l’important. Il l’avait retrouvée, la portait contre sa poitrine, frémissante et secourable, et il aurait donné cher pour que ce seul instant durât l’éternité. Il la contemplait, brûlante de fièvre. Une ressemblance étrange qu’il n’avait jamais remarquée, une similitude étonnante avec Calroë telle qu’elle lui était apparue dans la forêt d’Atis lui sauta aux yeux. La poussière, les blessures, 339
la maigreur s’estompaient ; le visage anguleux prit une forme plus ovale et charnue ; les yeux noirs se teintèrent de vert ; les cheveux bruns eurent quelque chose du châtain. Il n’y avait pas jusqu’au corps qui ne parût le même. C’était comme si ses pensées où les deux femmes, l’une mortelle, l’autre divine, se mêlaient, comme si ses pensées se réalisaient à présent, comme si la déesse s’incarnait dans l’humaine pour mieux lui ordonner de vouer son existence future à son culte. La contemplation cessa cependant brusquement. Magon venait d’entendre un craquement derrière lui. Il tourna la tête, découvrit un groupe de Romains apeurés et assis près du mur le plus proche. Dans l’obscurité un seul était debout, à l’écart, au sourire mauvais, au regard luisant. Latro. L’assassin d’Atis, le violeur d’Aldéa. Il le sut immédiatement, remarqua que l’infâme avait ramassé le bâton jeté pour secourir la jeune femme. Il était toujours debout, et dangereux. Le centurion se jeta aussitôt sur lui, le fit tomber d’un coup de poing qui avait tout d’un coup de patte sauvage. Magon roula sur le côté, lui jeta en riposte une pierre que l’autre reçut au sourcil et qui lui fit lâcher le bâton en portant sa main à l’arcade. – Elle est à moi, hurla le Libyen, à moi ! L’avait-il pris au départ pour un Gaulois ? Sautant près de la fenêtre, le Maltais se découvrit soudain un peu plus. Alors un éclair parut traverser l’esprit embrouillé de son adversaire qui eut l’air de le reconnaître à son tour et reconstruire, par un lourd cheminement de pensée, les événements incroyables qui lui avaient fait retrouver Magon dans la prison infecte d’un oppidum étranger. – Toi ! Toi ! La forêt…le bâton… Sa colère, aveugle, sourde, sembla décuplée. Comme il n’avait pas mangé à sa faim depuis des jours, il voulut soudain le mordre, se jeta la mâchoire en avant. Mais Magon que l’entraînement d’Atis avait rendu plus prompt saisit une nouvelle pierre et, d’un geste violent, lui éclata la rangée supérieure des dents. L’autre, en sang, riposta en lui assénant un coup de tête. Il se leva, le traîna au sol, lui appuya le crâne contre les barreaux moisis de la geôle, lui râpa la face à la pierre suintante, le frappa trois fois à lui briser le nez et lui déchirer les lèvres. Aldéa, renversée quand Magon avait été bousculé, cria ; son bourreau trouva l’occasion de la cogner au détour pour la faire taire. Étendu, hagard, Magon entendit de nouveau un craquement et, dans son étourdissement, crut que c’étaient ses os qui se fracturaient. Tous ignoraient en fait que dehors, à la surface du sol, les boulets continuaient de pleuvoir de loin en loin, par intermittence. 340
À l’intérieur la lutte continua de plus belle. Magon localisa son bâton à terre, voulut s’en saisir mais Latro l’attrapa par l’autre extrémité et ils furent un instant à tirer chacun de leur côté pour l’emporter. La lanière de cuir qui séparait les deux parties de l’arme, sans doute fragilisée par les soubresauts incessants qu’avait connus l’objet, se rompit alors et le Libyen tira à lui le fourreau tandis que le Maltais emporta la fine épée cachée à l’intérieur. Un duel s’engagea instantanément. Ils étaient à armes égales, chacun tenant un instrument qu’il ne maîtrisait pas. Le centurion était privé de son glaive mais avait entre les mains un bâton que la légion n’apprenait pas à manier ; le médecin frappait avec une lame proche de ce qu’on trouve dans l’empire de Rome mais avait perdu le bâton de ses ancêtres qu’il manipulait à la perfection. Ils étaient à forces égales aussi, chacun ayant reçu un entraînement, mais l’un étant épuisé de jours entiers de prison, l’autre des affres du siège. Orichalque contre orichalque, les coups se croisèrent, se succédèrent avec audace et frénésie, les deux hommes abandonnant toute prudence, multipliant les maladresses dans leur rage de vaincre l’adversaire. Une seule balafre de leur arme, une seule entaille portée et c’était la mort assurée. Enfin, à coup de bottes secrètes, Latro est acculé contre un des murs de la prison. Magon croit qu’il va pouvoir le frapper de la pointe de son épée mais, soit malchance, soit ruse, le Romain s’esquive et le Maltais plante sa lame dans la pierre où elle se fiche sans pouvoir être dégagée. Il est désarmé, il est perdu. Derrière, dans un sourire narquois, Latro élève son bâton, lame dirigée vers son adversaire, prêt à l’abattre. Magon se voit déjà trépasser quand tout à coup, sous l’effet d’un dernier boulet envoyé au-dessus de la geôle, le craquement sonore qui menaçait éclate. Dans un déluge de poussière, l’une des pierres qui soutiennent la voûte de la galerie rompt, s’effondre sur Latro et lui fend le crâne, lui broyant la moitié du visage jusqu’à l’épaule. Magon resta stupéfait d’un tel hasard. Aldéa hurla de soulagement. Elle était délivrée du monstre dont Rome avait fait un soldat. Libre, elle ne l’était pourtant pas encore entièrement. Alors qu’ils quittaient la prison et s’échappaient à travers rues, ils tombèrent sur un groupe d’hommes en armes qui remarqua leur fuite et, pour les protéger autant que garder un œil sur eux, les retint le reste du jour en les empêchant d’aller où bon leur semblait. Les attaques d’ailleurs varièrent mais ne faiblirent pas et ils durent demeurer longtemps à l’abri quand un nuage de javelots, une pluie de flèches enflammées s’abattit en tirs courbes et succéda aux boulets de pierre. Il y eut moins de morts, mais le moral des Sénons empira. En fin de journée, pour les persuader que leur capitulation 341
était inévitable, pour leur dire à quel point ils étaient suicidaires de résister, les Romains jetèrent un cadavre par-dessus le mur assiégé. On s’approcha pour l’identifier. Une femme cria « Térumnos ! » d’une voix déchirante et reçut un trait qui la foudroya en plein cœur devant ses enfants regroupés. Le soir seul, quand il n’y eut plus aucun tir, que les habitants de la cité purent sortir de leurs caches pour pleurer les morts et compter les dégâts, le Conseil se réunit, non pas à son endroit habituel mais dans une cave où l’on força les deux jeunes gens à se rendre. L’espace, vide, y était vaste ; empli, il devint étroit. On se serra, beaucoup furent contraints d’attendre dehors. À la lueur des torches, la réunion fut houleuse, l’assistance compacte ; nombre de chefs, nombre de guerriers de valeur étant morts au cours des dernières heures, les représentants du peuple furent majoritaires face à l’aristocratie décimée. On comptait parmi eux des corporations d’artisans, une délégation de paysans aussi que l’inquiétude et la colère faisaient s’émanciper de leurs seigneurs à qui ils devaient normalement obéir. Ces derniers, formés depuis toujours à l’art de la guerre, étaient pour la poursuite des combats, pour une mort brave, pour tenter des sapes et des mines quand viendraient les machines d’assaut. Ce à quoi la tourbe en face répondit que ces machines viendraient dès le lendemain, que la cité était déjà en ruines, que l’armée sénone n’existait plus par ici, qu’on n’avait pas même de nouvelles des émissaires envoyés, qu’il fallait sauver ce qui pouvait encore l’être, que si on se rendait, la fameuse clémence de César agirait et que le proconsul irait tourner sa colère vers son véritable objectif, les Carnutes, chez qui tout avait commencé. On retrouvait là le sens pratique des petites gens qui, n’ayant pas d’honneur à défendre, voulaient défendre leur vie. L’héroïsme, l’amour des causes perdues avaient disparu. C’était le retour de la médiocrité, des instincts les plus vils après le sublime de l’attaque. Le parti pro-romain n’avait jamais existé à Vellaunodunum, les affres du siège étaient en train de le créer. Et l’on se considérait avec méfiance en haussant le ton par une anarchie grandissante, chacun persuadé d’avoir raison, les uns s’offusquant de la liberté des autres à donner leur avis ou décider pour tous. Les membres du Conseil ne pouvaient s’imposer, ne le voulaient guère d’ailleurs, attendant de voir la tournure de la réunion. Enfin, pour trancher, quelqu’un proposa d’aller quérir Duisto, l’oracle, puisqu’il était comme tous réfugié dans l’enceinte de l’oppidum. On approuva l’idée. Par une chance incroyable, Duisto le fol était vivant. On l’avait croisé tout le jour se promenant tranquillement sous les tirs, miraculeusement épargné par les projectiles et s’en souciant comme d’une bruine de printemps. Il apparaissait à tous comme un argument à lui seul. Il était la 342
caution de la noblesse pour continuer le combat car, à travers lui, subsistait le souvenir de son père, Acco le fougueux, dont nul n’avait égalé la valeur ni les sentiments anti-romains ; il était à l’inverse une autorité reconnue du peuple qui allait, davantage que l’aristocratie, le questionner sur l’avenir et croyait en ses prédictions. Précisément, depuis le matin, on l’avait entendu répéter une phrase ambiguë sur le ton d’une comptine, « Plus de fougue, plus de siège », qu’il avait déjà dite à Magon la veille au soir. « Plus de fougue, plus de siège », fredonnait-il et les uns y voyaient l’encouragement à poursuivre la lutte, les autres au contraire le conseil de se rendre au plus vite pour épargner les survivants. Aussi, quand Duisto entra sur les lieux encadré de deux hommes en armes, alors qu’il n’avait posé qu’un pied dans la salle, il fut assailli de demandes si bien que les membres du Conseil durent faire régner à grandpeine le silence pour obtenir qu’on l’écoutât. On lui demanda ce qu’il pensait du siège et lui, en chantonnant, répéta ce qu’il avait dit toute la journée – « plus de fougue, plus de siège » – avant d’aller se positionner, en fendant la foule, près de Magon qu’il avait reconnu. Alors on repartit de plus belle dans les commentaires, ceux-ci poussant à continuer, ceux-là à arrêter les combats tant la phrase de Duisto s’interprétait de manière contradictoire. Les brenns toisaient leurs interlocuteurs, estimant qu’ils n’avaient pas leur mot à dire dans ce genre d’affaire, mais se gardant bien de l’exprimer par égard pour leur nombre. Beaucoup n’avaient plus même d’hommes pour veiller à leur intégrité physique, ce qui les retenait de dire haut le fond de leur pensée. Comme souvent la foule, puisqu’elle n’était pas entendue, devint, quant à elle, menaçante et peu à peu ses adversaires durent argumenter, se justifier pour faire valoir leur avis. Mais même cette argumentation fut emportée par les grondements grandissants. Toute entente, toute cohésion avait disparu. Chaque point fut réfuté. Renoncer, c’était se soumettre aux Romains. Et alors ? Mieux valaient des Romains que des Arvernes ou des Séquanes. On pouvait attendre, les murs résisteraient encore. Non, ils étaient branlants alors que c’étaient les nobles qui en avaient la responsabilité et c’était pire maintenant qu’on avait subi les ravages de l’artillerie ennemie. Ce n’étaient que manœuvres pour impressionner ; les Romains escomptaient que le siège ne durerait pas, ils voulaient aller vite, voulaient intimider d’emblée les Sénons en déversant sur eux un véritable déluge. Mais quelle sorte de chefs étaient-ils à la fin ? Il était évident que l’assaut serait pour le lendemain, César cherchant à affaiblir la cité et la faire plier dès la première attaque. Si on ne se rendait pas, les légionnaires n’auraient même pas à creuser des mines ; ils défonceraient le rempart ou passeraient au-dessus avec leurs échelles ; ils étaient toujours pour l’assaut, pressaient 343
leur hiérarchie qui voulait épargner le plus de forces car ils savaient qu’en cas de reddition avant l’attaque, le butin, même faible, irait à leur général, non à eux. Quant à la volonté d’impressionner, c’était vrai, mais César avait en même temps réellement fragilisé les remparts parce que ceux-ci justement étaient déjà en mauvais état. Ah ! Que les Sénons de l’est chez qui les Romains avaient hiverné étaient heureux car s’ils avaient connu les misères des réquisitions, ils n’avaient pas connu celles de la guerre ! Qui sait jusqu’où la discussion serait allée si Gitogmaros enfin, qui réfléchissait décidément vite, n’avait eu soudain une idée malicieuse et donné une tout autre interprétation des paroles de Duisto : – Vous n’avez pas compris, cria-t-il pour imposer le silence. Vous n’avez pas compris ! C’est un sacrifice dont parle Duisto, un sacrifice ! La fougue, c’est celle d’Acco le fougueux, celle de son sang. C’est lui qui nous fera sortir la tête haute de ce siège ! Et tandis que Duisto, que l’interprétation concernait pourtant, ne disait plus rien mais semblait ailleurs en souriant étrangement à Magon, la proposition de Gitogmaros contenta surprenamment tout le monde. Elle équivalait à une reddition et en même temps elle mettait en avant la bravoure et la distinction de la noblesse par son sens du sacrifice et la qualité des otages. Pour le premier du Conseil, c’était surtout le moyen de mettre enfin un terme à l’ombre persistante d’Acco et au risque de voir son fils, bien que fol, prendre un jour le relais. Il poursuivit : – Donnons à César le meilleur d’entre nous, Duisto, en gage d’estime, pour lui rappeler toujours la valeur des Sénons. Ajoutons-lui des otages parmi les plus valeureux de notre peuple et ce qu’il reste des déserteurs de l’armée romaine faits prisonniers pour accroître le contraste entre eux et nous. César sera satisfait dans l’immédiat : il châtiera les siens, respectera les nôtres. Nous verrons ensuite comment lui donner l’argent, le bois, le grain qu’il réclame. Le courrier envoyé à Génabum après l’arrivée des captifs à Vellaunodum avait rapporté depuis longtemps le désir des Carnutes de se voir remettre les fuyards de Latro. Mais, au-delà des paroles, le Conseil de l’oppidum avait longtemps fait traîner les choses dans l’espoir secret d’en tirer un meilleur parti l’occasion venue. Cette occasion se présentait aujourd’hui ; les coupables seraient remis à qui de droit : César. Mais ce disant, Gitogmaros aperçut Magon qui épaulait Aldéa encore faible au milieu de la foule et, avec un petit rire en coin, il ajouta : – Et ces deux-là aussi, offrons-lui ces deux-là ! Un médecin ennemi de Rome, une Carnute traîtresse ne peuvent qu’ajouter à notre tribut. Horrifiés, se débattant comme des proies tombées dans une souricière, les deux jeunes gens furent traînés à la lueur des torches. Ce fut comme si 344
on les considérait soudain, comme si on les découvrait pour la première fois. Il est vrai que le peuple n’avait pas assisté à la réunion où Magon avait recouvré son bâton, mais même les nobles qui y étaient semblèrent se souvenir très lointainement de lui et moins encore de la jeune femme. Et l’empassant que tous regardaient avec bienveillance par les rues, qu’ils toléraient depuis des jours et des jours, subit brusquement la versatilité d’une foule brave qu’une petite guerre avait rendue lâche. Ils furent laissés libres pour la nuit de leurs retrouvailles faite de rien d’autre qu’un peu de sommeil et de beaucoup d’angoisse. Mais à deux, même affaiblis, même livrés aux légions ennemies, ils se sentaient plus forts de leur génie et leur jeunesse. Le lendemain matin, à l’aurore du troisième jour de siège, avant que l’assaut redouté ne fût lancé, la cité déposait les armes. Des cavaliers sortirent de la ville au pas. Pour apaiser l’ire de César, une colonne de deux cents captifs les suivait, un premier détachement sur le total exigé, complété de tous les chevaux disponibles, chargé des armes les plus belles et des richesses les plus lourdes. En tête marchait Duisto, fils d’Acco le fougueux ; derrière, épuisés et déçus, Magon de Malte et Aldéa qui se tenaient le bras pour se soutenir et ne plus être séparés.
345
XII LE CONQUÉRANT
Dès qu’ils eurent passé la ligne de contrevallation, les otages furent introduits dans le camp des Romains où les chevaux furent aussitôt redistribués aux troupes de cavalerie tandis que les prisonniers devraient attendre d’être passés en revue par César et d’ici là décliner leur identité à l’officier qui les transmettrait à son général. Le proconsul, qui venait de soumettre un oppidum entier sans presque subir de perte, se trouvait bel et bien dans son camp. Avant qu’il ne daignât leur accorder l’attention que leur statut réclamait, les captifs durent patienter plusieurs heures, à un emplacement où portait l’odeur des latrines. Ils furent regroupés par hiérarchie sociale et alignés, forcés de garder tête basse, leurs richesses offertes et leurs armes rendues devant eux. Au moment où plus personne ne l’attendait, César apparut dans toute sa pompe de futur imperator, suivi d’un préfet et de tribuns satisfaits. Pas un des otages ne l’avait déjà vu, sinon de très loin lors de l’assemblée des cités gauloise où Acco avait été supplicié plusieurs mois auparavant. Tous conservaient un souvenir vague de son physique, estompé dans leur mémoire sous la violence des faits qui s’étaient alors déroulés. Aussi furent-ils décontenancés quand ils virent un homme gracieux, avec des manières efféminées, un déhanchement peu militaire passer lentement devant eux. Chacun put le découvrir dans ses moindres détails, s’arrêta à ses joues émaciées, son cou allongé, sa pomme d’Adam saillante, ses yeux chafouins enfoncés sous la ligne étirée des sourcils. Avec sa calvitie élégante qu’il essayait manifestement d’occulter, ses affectations de noble populaire, ses lèvres courtes et son œil froid, ce même César qu’on disait endurant à la peine et habitué à coucher à la dure était l’inverse d’eux, chevelus, et gras, et rieurs avant le siège. Et pourtant, ils le sentaient, cet homme si petit était grand, irrésistible, proprement inquiétant. César s’enquit longtemps de l’identité des captifs. Il parut surpris d’apprendre que le premier d’entre eux, Duisto, était le fils de l’homme qui avait intrigué contre lui l’année précédente et il le considéra avec beaucoup
d’attention. Le fol gardait la tête haute, non par affront mais par réflexe naturel, comme s’il fût ailleurs. Même après que son peuple l’eût sacrifié pour assurer sa tranquillité, ses yeux semblaient interroger, avec un détachement évident, les raisons de sa présence ici. César s’approcha, le regarda bien en face. Ce fut sa physionomie d’abord qui le retint comme la sienne venait d’étonner les Gaulois. Si le physique du proconsul avait on ne savait quoi de décevant et d’inquiétant à la fois aux yeux des barbares, celui du jeune devin avait quelque chose de séduisant et mystérieux dans l’esprit du Romain. Son aspect androgyne n’y était pas pour peu, tel l’enfant de deux dieux mélangé aux traits d’une naïade de Carie. Il considéra avec plaisir ses lignes délicates de jeune fille, ses muscles harmonieux d’éphèbe, la sveltesse indéterminée de ses gestes qu’il admira longuement comme un statuaire une œuvre d’art qu’il convoite. Sa pupille s’alluma d’un désir aussi vite voilé qu’il venait d’apparaître. L’espace d’un instant il n’y eut que lui, Duisto le fol, dans l’univers de César. Il avait la vénusté suprême au goût du prétendu descendant de Vénus. Au milieu de ses hommes, celui qu’on appelait pour rire la rivale des reines, l’ancienne étable de Nicomède essaya d’engager la discussion, à brûle-pourpoint, questionna Duisto mais n’obtint de lui que des phrases étranges où aucune insolence ne s’entendait et qui le laissèrent songeur. On lui souffla alors que le fils d’Acco n’avait pas embrassé la carrière de son père, qu’il avait délaissé la politique et la guerre pour faire profession de devin. Et comme on le lui disait, le fol eut une de ces phrases dont il détenait le secret : « Vénus victorieuse, Vénus assassinée. Il n’y a pas que Calroë qui meurt en pleine gloire. » César tressauta. Vénus ? Ce n’était pas anodin qu’un barbare évoquât dans sa version latine le nom de la déesse dont il se targuait de descendre. Il ne s’y trompa pas. Même s’il ne perçait pas tout le mystère de ses mots, il crut sans doute reconnaitre en son interlocuteur un devin d’importance qui pourrait lui révéler un jour son avenir. Il dut penser à Alexandre le Grand dont il connaissait par cœur la geste pour l’avoir longtemps jalousée ; il dut penser aux devins que le Macédonien avait rencontrés, comme Aristandre de Telmisse qui l’avait suivi dans ses expéditions et lui avait si souvent prédit la victoire et le succès ; il dut se dire qu’il pourrait en faire le même usage. Il donna un ordre à voix basse à l’un de ses officiers, puis passa aux autres prisonniers. Parmi eux, il prit d’abord soin de manifester un évident mépris pour les nobles qui redressèrent leur taille à son passage, bras croisés, épaules droites en signe de fierté. Il y avait pourtant là la fine fleur encore vivante des Sénons occidentaux. D’un regard, il les jugea ; d’une moue, il leur 348
signifia que leur valeur n’était rien pour lui et qu’ils finiraient au mieux comme des otages de marque, au pire comme des esclaves dont on ferait ce qu’on voudrait jusqu’à les étrangler après son triomphe dans Rome. Il ne jeta pas même un œil à ceux qui n’étaient pas nobles – artisans, commerçants, paysans – avec lesquels on avait complété l’effectif insuffisant des otages et qui étaient censés représenter la prospérité et la richesse du pays. En bout de rangée ne restaient que quelques Gaulois étrangers – des Parisiens et des Meldes surtout – ainsi que Magon qui avait subtilement placé Aldéa en retrait pour ne pas qu’elle éveillât la suspicion et parce que son sexe n’imposait pas qu’elle fût au premier rang. Le Maltais n’était rien pour César et semblait désormais complètement inconnu de ses hôtes sénons. Lui-même n’avait jamais vu le proconsul que d’après les portraits qu’on lui en avait brossés ; il découvrait le grand homme pour la première fois. Pourtant ce ne fut pas ce qui le troubla. Avant même que César fût à sa hauteur, il avait été profondément émotionné d’entendre à nouveau parler de Calroë au point qu’il se demanda s’il avait bien entendu les paroles de Duisto à l’autre extrémité de la ligne. On le présenta comme un médecin carthaginois – ce qu’il était du reste – que des préoccupations scientifiques avaient conduit loin de chez lui. Les militaires sourirent, le prirent pour un savant naïf tombé sans le vouloir dans le guêpier de la guerre et il se garda bien de leur prouver le contraire. La jeune Gauloise derrière lui, amaigrie et répugnante pour un conquérant en quête de chair fraîche et de plaisir immédiat, fut prise pour sa compagne indigène, qu’il prétendit être son aide et que les légionnaires interprétèrent comme son support de soulagement. Passé un premier saisissement, César consentit à ce qu’elle restât avec lui. Il avait du respect, dit-il, pour les médecins, voulait les contenter même quand ils étaient d’un peuple ennemi héréditaire de Rome. Puis il continua son chemin, ne demandant rien de plus sur le voyage de Magon ni les raisons de sa présence, se contentant de lui ordonner de rester avec eux et de panser ses hommes pour le reste des hostilités. Il formula même ce conseil douloureux de soigner d’abord sa Gauloise car elle tenait à peine debout. Le Maltais remercia. Durant le bref échange qu’ils avaient eu, nul n’avait perçu son étrange bâton car il avait pris soin, avant même d’entrer dans le camp, de le rouler discrètement dans la boue au milieu de la marche pour en faire disparaître les motifs et la luisance et faire croire à un simple bout de bois. Il y avait cependant un groupe d’hommes que César avait fait semblant de ne pas voir. C’étaient les comparses de Latro, ceux qui avaient fui avec lui la veille du massacre à Génabum et avaient survécu au pilonnage de la 349
prison. Ceux-là, depuis qu’ils avaient su que les Sénons les rendaient aux Romains, étaient partagés entre la joie de quitter l’horreur du Boyau et la peur d’être reconnus coupables de désertion. Rien à vrai dire dans leur état physique ne les désignait comme tels, mais rien n’engageait non plus à leur faire confiance avec leurs habits souillés et déchirés, leur barbe sale, leurs cheveux ébouriffés. Même ainsi on ne pouvait savoir que penser d’eux. Ils ne ressemblaient pas à des Gaulois tous propres et soucieux de leur corps ; pour un Romain dédaigneux, ils pouvaient néanmoins être classés comme barbares. Leur état de fatigue, leur dépérissement général ne les aidait pas à considérer froidement la précarité de leur situation. Privés de leur chef, ils redoutaient d’avoir été dénoncés aux autorités romaines comme des lâches qui avaient déshonoré la légion en fuyant éhontément. Rien n’était plus probable d’ailleurs, les Sénons trouvant là une manière de détourner la colère de César et de lui montrer indirectement la supériorité des Celtes en matière de courage. Et en effet ils avaient remis à leurs vainqueurs les livres de comptes du Libyen qu’ils avaient su interpréter et dont ils avaient rapidement jugé l’importance. C’était la preuve de sa briganderie. César, noble, impossible à stipendier, exigeant quant au dévouement et à l’honnêteté de ses troupes qu’il récompensait d’autant mieux d’un butin chèrement acquis, avait parcouru ces notes avec une colère croissante. Ils ignoraient que César avait juré, depuis l’annonce du soulèvement des tribus, de retrouver le centurion en charge de l’autorité dans cet emporium des Carnutes où tout avait commencé. Il voulait démêler le vrai du faux de l’affaire, punir les coupables puisqu’il était avéré désormais qu’il y en eût. Il se méfiait des lâches, des déserteurs, savait qu’ils devenaient brigands chaque fois qu’ils fuyaient la légion à moins qu’ils ne l’eussent été déjà sous l’uniforme. Maintenant qu’il les avait retrouvés, comme on lui avait dit que Latro n’avait pas survécu, il exigea qu’on vérifiât deux fois l’identité des survivants pour s’en assurer. Les corps des Romains morts en prison venaient d’être rendus par les Sénons qui redoutaient qu’on interprétât leurs blessures comme des tortures de leur part. Celui de Latro était méconnaissable, le crâne enfoncé pareil qu’une outre, ce qui décupla la rage de César qui aurait voulu lui faire endurer le fouet, l’exil ou l’humiliation sous les quolibets de sa troupe. Il inspecta les plaies des autres soldats, les plus anciennes sur leurs bras, leurs cuisses, leur torse. Et sans dire un mot, sans porter autre chose qu’un vague regard sur le groupe, il sembla comprendre que la plupart étaient feintes, qu’elles ne provenaient pas d’un combat. Les cicatrices en effet étaient propres, superficielles, résultaient toutes de balafres, non de coups portés profondément. Ce n’étaient pas des blessures de guerre, elles n’y ressemblaient pas, pas plus 350
que les blessures du siège, toutes fraîches, qui se reconnaissaient aisément. Il n’exprima pourtant pas son jugement hautement, se contenta de demander une fois l’avis de l’officier le plus proche qui esquissa une moue et lui parla à voix basse, puis il relâcha le bras qu’il tenait encore, mollement, comme s’il n’avait pas affaire à un soldat ni même un homme de mérite. Alors qu’il s’en allait, les fugitifs se croyaient sauvés, pensaient n’avoir pas retenu le soupçon tellement la cohorte d’officiers avait marché vite. Peut-être espéraient-ils même réintégrer bientôt l’armée, participer à des campagnes victorieuses, s’enrichir autrement qu’ils ne l’avaient tenté jusque-là quand soudain le général fit volte-face et de loin lâcha cette phrase à leur encontre : – Quant aux déserteurs, la justice impose de les décimer. Au moment où on ne l’attendait plus, la sentence tombait. César ordonnait de les décimer. Les décimer : comme Crassus avait remis cette sanction en usage, vingt ans plus tôt, et dont on racontait qu’elle lui avait permis de remporter la victoire contre les esclaves révoltés. Les décimer : pour dire qu’on leur ferait payer cher leur faute, en éliminant un coupable sur dix et en couvrant d’opprobre les autres qu’on ne nourrirait plus que d’orge et qu’on obligerait à dormir hors du camp. Les décimer : puisqu’ils n’étaient plus que la moitié de la trentaine de départ, on en tirerait un seul au sort et on laisserait ses complices le tuer devant tous. Ainsi s’illustrait la rigueur du général dont on vantait trop souvent la clémence. On poussa les quinze en avant. On leur fit tirer une écorce, chacun leur tour. Sur l’une d’entre elles était gravé ce simple mot, turpissimus, qui désignerait la victime. Les yeux fermés, la main tremblante, tous un à un piochèrent dans un silence grave et pesant, puis regardèrent en même temps leur écorce. L’un d’entre eux, un gars à qui on ne donnait pas vingt ans, le plus jeune de la bande sans doute, fondit en larmes et s’effondra. On comprit. Le sort était tombé sur lui. Alors les autres se tournèrent en sa direction, le dévisagèrent d’un regard luisant de haine. Le soulagement d’avoir été épargnés, de pouvoir vivre encore s’ils tuaient sembla décupler la longueur de leurs dents et lentement, face à ce qui était devenu une proie qu’une meute de loups ne veut faire s’enfuir, ils tournèrent autour de lui, le cernèrent, ramassèrent des armes. Une faim puissante, celle qu’ils avaient soufferte en prison, semblait les pousser. Ils se jetèrent sur le malheureux qu’ils lardèrent de coups et dépecèrent pour en offrir les morceaux à César en guise de pardon.
351
Mais le proconsul déjà n’était plus là. S’il était dur au châtiment, les conséquences de sa dureté lui importaient peu. Seules comptaient la politique et l’image qu’il donnait de lui. Dans un petit enclos où les prisonniers, désarmés pour de bon, furent cantonnés, Magon passa le reste du jour en compagnie de Duisto et d’Aldéa. Sous la surveillance des sentinelles, ils trompèrent l’ennui comme ils purent, se demandant bien ce qu’il allait advenir d’eux. Ils parlèrent assez peu, ne voulant pas qu’on surprît leur discussion. Ils limitèrent aussi leurs gestes par crainte qu’on les interprétât. Magon notamment n’osa montrer toute sa tendresse envers sa bien-aimée qu’il venait de retrouver par un miracle à peine réalisable. Il tremblait maintenant qu’on la lui reprît et la terreur qu’il ressentait à cette idée lui interdit de se montrer soucieux d’elle outre mesure. Il s’assura seulement qu’elle restât assise quand elle le pouvait, qu’elle mangeât un morceau du pain qu’il avait réussi à marchander à un vivandier établi près de la barrière. La tête lui tournait encore, mais sa fièvre avait baissé rapidement. Elle devait se reposer parce qu’elle avait à peine dormi la nuit précédente, blottie contre lui, et n’avait récupéré encore assez de forces, recrue d’angoisse et affaiblie au point de ne trouver un sommeil réparateur. Comme le jour déclinait rapidement, ce fut alors que, pour la première fois depuis qu’ils se connaissaient, Magon osa interroger Duisto, non pas sur leur futur ni celui des Sénons mais sur l’avenir d’Aldéa. Que deviendrait-elle au milieu de tant de souffrances ? Qui veillerait sur elle ? Ferait-il, lui, partie de sa vie ? Et le fol, de sa voix muée, eut alors cette réponse raisonnable entre toutes : – Tu as sauvé la fleur de la Gaule. C’est bien. N’aie crainte pour l’avenir. Il est un fleuve millénaire qui coule entre les sables et le roc. Ce fleuve ne tarit jamais, nul ne peut l’assécher. On dit que ceux qui s’y baignent se relèvent de tous les maux. Cette réponse, il fallait l’interpréter, en élargir le sens et l’application. Mais contrairement aux prédictions précédentes, sa signification parut limpide au jeune homme. Il avait compris. C’était l’amour dont parlait le devin. L’amour qui était la solution de tous les malheurs. Il avait compris qu’il devrait aimer Aldéa, lui consacrer plus encore que l’effort surhumain de quelques jours : le dévouement de toute une vie pour la voir se rétablir. Et il eut pour son ami une larme de remerciement, un sourire grave où se laissaient poindre les responsabilités davantage que les plaisirs. Mais Duisto n’en fut pas quitte des petites phrases dont il avait le secret. À peine eut-il évoqué les sentiments unissant Aldéa à Magon qu’il continua de cette autre inattendue : 352
– Que bel oiseau ne s’effraie, Duisto va partir maintenant. Il ne reverra plus bel oiseau et bel oiseau ne reverra plus Duisto, même à quelques envolées l’un de l’autre. En effet, alors qu’il avait prononcé ce nouveau présage, un centurion vint le chercher. César réclamait sa présence sous sa tente, immédiatement. Duisto, le plus naturellement du monde, l’accompagna de la même démarche que s’il allait puiser de l’eau à la fontaine. Puis, comme pour prouver les paroles du fol, un second officier, succédant de près au premier, se présenta aussitôt et dit à Magon qu’il serait dès le lendemain autorisé à évoluer hors de l’enclos, à proximité du camp pour suivre la troupe. La tente de César était ce soir-là déserte. Le général venait de prendre une collation et méditait. On vit le devin sénon passer derrière la haie des sentinelles qui en gardaient l’accès. Le centurion qui l’avait introduit resta jusque tard auprès d’elles. À la lueur des brûle-parfums, il entendit les bribes d’une discussion étrange où César demanda au fol de s’expliquer sur la phrase qu’il avait prononcée dans la journée à son passage. Duisto ne répondit rien de particulier ou du moins il n’entendit pas sa réponse, mais il jura ne l’avoir pas vu ressortir de la nuit ni les jours suivants comme si la tente elle-même l’avait avalé. Le fils d’Acco, le fils du rebelle des Gaules, avait disparu derrière les voiles et les plis lourds des tentures. Une autre ombre se glissa fort tard dans la nuit. Celle-ci, les sentinelles ne la virent pas précisément ; ils la sentirent passer dans leur dos sans pouvoir dire s’il s’agissait d’un courant d’air, d’un esprit, d’une bête rôdeuse. C’était Chéréas qui avait gagné une audience grandissante près de César au point de le conseiller en secret quand tous dormaient, Chéréas ou Eumène qui avait vu le cadavre de Latro et s’était satisfait de sa mort, Chéréas Éponax qui s’était promis lui aussi de revenir à Génabum prendre sa revanche sur un peuple qui l’avait fait fuir et risquer, combien de fois !, la mort. Le lendemain, la reddition de l’oppidum était acceptée. César repartait, laissant dans la place son légat Caius Trébonius pour veiller à ce que les autres conditions du traité fussent exécutées, notamment le second détachement d’otages que les vaincus s’étaient engagés à aller mander alentour. Les deux légions que le général commandait se retrouvaient et marchaient d’un même pas vers Génabum. Par la prise de Vellaunodunum, le pays des Sénons se trouvait maté le premier, le quartier 353
général d’Agédincum complètement dégagé du péril, la route vers la vengeance ouverte au conquérant. Magon alla à la suite, parmi le large cortège de civils qui accompagnaient toujours l’armée en tâchant de tenir sa cadence. Les légions en drainaient dans leur sillage un nombre incalculable, entre les marchands qui vendaient leur matériel aux soldats, les trafiquants qui leur achetaient butin ou esclaves, les prêtres officieux, les indigents, les concubines. Devant lui, des artisans avançaient sur des chariots lourds d’approvisionnement ; derrière, des prostituées, des filles de peu erraient à l’aventure, les unes à pied, les plus fortunées entassées dans des carrioles de misère. Encore étonné des dernières paroles de Duisto qu’il chercha le premier jour sans le trouver, il avait réussi, après avoir soigné un intendant qui se plaignait de coliques, à se procurer une vieille mule, puis une jument boiteuse en argumentant qu’il aurait besoin de cet autre animal dont personne ne voulait si l’on attendait de lui qu’il suivît la légion pour soigner ses soldats. Aldéa monta entre ses bras sur le cheval, la mule porta les maigres bagages et ils s’emmitouflèrent dans une peau d’ours abîmée suffisamment large pour envelopper leurs haillons. Ainsi le Maltais retrouvait-il l’attelage avec lequel il était venu dans le pays des Carnutes, à ceci près qu’il y revenait cette fois-ci depuis l’est en suivant la course déclinante du soleil. Les deux légions continuèrent le long de la route qui menait d’Agédincum à Génabum, par laquelle elles avaient passé et pris l’oppidum des Sénons. D’autres suivaient probablement ; on disait que leur nombre s’élevait à douze dans toutes les Gaules et sans doute en fallait-il tant pour occuper des territoires si vastes et les mettre à feu et à sang. Elles ne s’arrêtèrent pratiquement pas dans les hameaux qui visiblement ne les intéressaient guère. Alternant de longues périodes d’effort et de courtes pauses de récupération, elles n’avaient qu’un objectif : atteindre l’emporium des Carnutes où l’affront de la révolte leur avait été lancé. Sur le chemin, aucune troupe ennemie ne vint se porter à leur rencontre. La campagne où le printemps revenait – la saison de la vie à l’heure de la guerre – était tranquille, ensoleillée par un soleil d’avril avancé cette année-là. Partout la végétation reverdissait sous l’impulsion de Cernunnos, le dieu par qui les cycles de vie se renouvellent. La glace avait totalement fondu au sol, la terre avait bu le surplus de neige et de congères. Des vents frais balayaient encore la route, mais on sentait que la chaleur de la nature se rallumait. Et déjà de premiers bourgeons s’accrochaient aux branches, pointillaient d’un vert timide le paysage livide ; bientôt les blés dans les champs encore sous forme de pousses se ramifieraient, formeraient des touffes pour commencer à croître avant que leurs épis n’apparaissent ; 354
l’herbe, jusqu’à elle, avait l’air plus riante et plus tendre après le gel de l’hiver. Comme les bois de cerf tombent et repoussent, la nature toujours repartait. Le paradoxe voulait que ce retour de la vie coïncidât avec la saison de la guerre où le sang se glace et les morts s’abattent sur les champs de bataille. Les massifs boisés succédèrent rapidement aux champs et aux marais. Leur étendue fut d’abord limitée. Mais assez vite la route s’enfonça dans une forêt sombre et silencieuse où les troupes ne virent plus un pan de ciel libre. Cette forêt n’était pas la plus impénétrable, la plus haute que Magon eût vue, mais elle était dense et impressionnante par la noblesse et l’ancienneté de ses arbres. C’étaient des chênes gigantesques, des charmes centenaires, des hêtres ombreux inconnus dans les terres du sud. Même après toutes les campagnes qu’ils avaient menées en Gaule, les Romains appréhendèrent d’y entrer, les hommes redoutant les esprits des bois, les chefs une embuscade. Alors que les esprits se tendaient d’inquiétude, lui ne cessait de songer à la forêt d’Atis qu’il avait quittée après l’assassinat du druide. Il tâchait de se remémorer ses moindres détails, ses jeux de lumière, ses prodiges et ne parvenait à se souvenir ni de son aspect ni de son emplacement. Était-ce celle-ci ? Était-ce une autre ? Existait-elle encore ? Avait-elle même jamais été avec sa source divine, son parterre d’herbe magique, sa déesse étendue nue sous une pluie de lueur mordorée ? Il n’aurait su le dire puisque de toute façon un mirage inexplicable semblait l’avoir tenu en songe les mois durant où il y avait vécu. – Cette forêt…, dit-il à Aldéa. – Eh bien ?, répondit la jeune femme d’une voix faible où s’entendait qu’elle reprenait lentement des forces. – Serait-ce celle d’Atis ? – Atis… Elle articula ces deux syllabes comme si elle se remémorait un vieux rêve. Le dernier soir où elle avait prononcé ce nom, c’était celui où toute sa vie avait basculé, où son père avait été tué, où elle avait elle-même poussé son bien-aimé à partir au risque de ne plus jamais le revoir. – Qu’est-il devenu ?, eut-elle le courage de demander. – Ses bois sont tombés. Peut-être repousseront-ils à d’autres printemps. Elle se tourna de trois quarts, le regarda avec des yeux incrédules, laissa tomber sa tête sur le paysage avec tristesse. Lui fit de même. Soudain, au rain de la forêt, une forme lointaine et vague l’arrêta. Tandis que son cheval continuait au pas, il ne détachait ses yeux de cette forme longiligne qui semblait ondoyer dans le vide. Quelque chose était accroché à un arbre en retrait du chemin. Il fut saisi d’un étrange pressentiment, fit obliquer sa 355
monture, sortit de la colonne de marche. Ceux qui le virent faire savaient ce qu’il en était, rirent à le regarder ainsi pris de doute. On attribua son intérêt à une curiosité de médecin. Car Magon ne s’était pas trompé ; il s’agissait bien d’un corps comme il l’avait deviné. À l’écart de la route, un cadavre se balançait au bout d’une branche, tournoyant légèrement au gré des courants d’air, faisant craquer la corde qui lui enserrait le cou d’un craquement sourd. Son aspect était affreux. Le corps, rigidifié par la mort, étiré dans le vide comme s’il était aspiré par le sol, semblait en même temps disloqué dans ses jointures et ses ossements. Les vêtements en lambeaux pendaient au vent ; la peau tannée des cuisses et du ventre, gonflée d’eau par les intempéries, par l’eau s’égouttant des arbres au dégel, craquelait de gerçures autour des genoux et des côtes ; celle crevassée des pieds, des mains était trouée de points de sang encroûtés et de morceaux récemment arrachés que des oiseaux charognards devaient avoir fouillés. Le cadavre pendait là depuis longtemps, à l’évidence. La nuque avait été cassée ; la tête ballait sur le côté dans une grimace fixe. Le visage, déjà plaqué de taches par des coups plus anciens, était méconnaissable. Hideusement joufflu, barré de cheveux en pagaille collés, il avait pris, d’un endroit l’autre, toutes les teintes du blanc au verdâtre en passant par le jaune boueux, le marron ocre, le bleu noirci. La bouche s’écartait, où ne subsistait qu’une seule dent blanche dans un sourire édenté ; la langue n’y était plus, peut-être emportée par un rapace un soir de fringale. Un œil arraché laissait voir le nerf hors de l’orbite ; l’autre semblait avoir tournoyé avec le corps tellement, sous la paupière entrouverte, il avait l’air affolé, l’iris fondu dans la pupille et la pupille mangeant le blanc. Seul le nez que soulignait une moustache adolescente paraissait avoir été épargné. Dans un cri, Aldéa se cacha contre la poitrine de Magon. Le Maltais, lui, considéra fixement le cadavre. Il vit soudain, sur l’écorce de l’arbre, une inscription maladroitement gravée en caractères grecs qu’il déchiffra à voix haute : « Je ne mérite de trouver repos. Qui me déliera payera s’il n’est celui que j’ai trahi. Adonnée, pardonne à qui a fauté. » Il recula d’effroi. Il venait de reconnaître Dagios, son ancien compagnon. – Un suicide, dit Aldéa qui ne connaissait pas l’adolescent et qui était revenue de sa première réaction. C’est pour ça que personne ne l’a détaché. Même s’ils ne savent pas lire, surtout s’ils ne savent pas lire, les gens d’ici ont peur des mânes de ceux qui se sont eux-mêmes ôté la vie. Oh, Magon, s’il te plaît !, partons maintenant. 356
Mais Magon ne bougeait pas. La contemplation de la fin atroce du disciple d’Atis le retenait. Il le regardait maintenant avec une sorte de fascination dégoûtée, essayait de retracer le chemin funeste qui avait conduit le bon élève porteur d’espoirs à une mort si misérable. Un suicide, disait Aldéa. Dagios s’était-il reproché son comportement de jalousie et de colère contraire à ce qu’exigeait Calroë ? Était-il retourné à la civilisation, chez ses parents, dans son village, après la mort d’Atis ? Rattrapé par la conscience d’une faute irréparable, avait-il fini par se pendre à l’endroit où il lui paraissait avoir fauté ? Mais était-ce bien cet endroit et de quelle faute parlait-il au juste ? Magon ne reconnaissait rien, n’avait pas d’explication. Peut-être les raisons étaient-elles ailleurs. Il ignorait les violences commises par Latro, comment le Libyen avait coupé la langue du jeune homme ici même, à l’orée du bois où il l’avait donnée à son chacal ; il ignorait la trahison effective du disciple qui n’avait pas hésité dans un dernier cri de rage à révéler l’endroit où les Romains trouveraient le refuge de son maître et le sanctuaire de Calroë pour les détruire. – Partons, répéta froidement la jeune femme traversée d’un long frisson. – Il lui faudrait des funérailles… – On ne peut pas, il s’est condamné lui-même à errer. Tu l’as lu : seul celui qu’il a trahi peut le délivrer. Es-tu celui-là ? Connais-tu seulement ce malheureux ? Magon ne voulut pas tout expliquer. À quoi cela aurait-il servi ? S’il y en avait un que Dagios avait déçu, ce n’était pas lui, c’était Atis et il se serait cru outrepasser encore son rôle à ne pas respecter la volonté du défunt pour jouer les grands seigneurs. Surtout le suicide était totalement contraire à l’idéal de vie et de force du culte de la Déesse auquel tous deux avaient été initiés. Jusqu’au bout Dagios avait fauté et Magon ne savait s’il lui appartenait à lui de réparer cette faute. Seulement, Atis était mort et ne pourrait jamais le détacher… – Allons-nous-en, insista Aldéa, allons-nous-en. Regarde. On se demande déjà là-bas ce que tu fais. Magon jeta un œil en arrière où l’on s’étonnait de l’intérêt qu’il trouvait à ce cadavre semblable à tous ceux que l’on croisait au bord des routes en ces temps troubles. Il finit par obéir, détourna son cheval, mais dans un dernier geste, une soudaine impulsion, il fit demi-tour, coupa la corde de la lame de son bâton. Le corps de Dagios s’abattit comme une masse. Il eut l’impression d’avoir fait le minimum pour lui rendre un dernier hommage. D’autres auraient à charge de s’occuper de sa dépouille. Aldéa s’impatientait. Il rejoignit alors avec la vieille mule la route et le cortège de civils. Le cœur serré, il eut un dernier regard plein de regrets 357
pour celui qui avait été son ami et il s’enfonça avec les inconnus de la légion dans la forêt. Au bout de cette forêt on pénétrait en pays carnute où la guerre se poursuivait. Aldéa et Magon repartaient vers le seul endroit de Gaule qu’ils connaissaient réellement. Néanmoins la situation était encore différente. La campagne était étrangement calme, la route plate, droite, les villages déserts. Rien ne bougeait, tout semblait faciliter la marche en terre ennemie. On sentait des yeux invisibles qui observaient la longue colonne, mais nul n’intervenait ; habitants et bêtes, effarouchés, devaient s’être terrés dans des caches pour suivre de loin l’avancée des troupes romaines. Les légions progressèrent vite puisque rien ni personne ne les arrêtait, si bien qu’après deux jours de marche elles parvinrent au soir en vue de Génabum. Comme Cotuatos l’avait prédit, Rome revenait. On était aux environs des ides de mars. La prise de l’oppidum promettait d’être longue et complexe. Celle qu’on surnommait la riche était la principale ville du peuple carnute ; elle s’était souillée la première du sang romain ; sa situation stratégique en faisait un verrou que les Gaulois défendraient chèrement dans la reconquête de leur territoire. Pourtant les difficultés furent moindres que prévu. La première réaction de l’ennemi fut celle de la déception devant les remparts. Leur base était médiocre et, même grandis par le soleil couchant, ils n’avaient rien à voir en hauteur ni épaisseur avec ceux des Sénons alors même que la cité était plus importante. Dans le soleil déclinant, les éclaireurs arrivèrent par l’est, le côté le plus faible où les murailles se résumaient à une insignifiante palissade et où se voyait, mieux qu’en aucun autre endroit, que les rives de la Loire étaient, quant à elles, entièrement dépourvues de fortifications. Un pont sur le fleuve compliquait la défense. C’était un marché, cette ville, non une place forte ; un peuple de boutiquiers, les Carnutes, non des soldats. Pas étonnant qu’ils eussent relancé la guerre sur un coup de traître. De plus, on avait appris en se saisissant de villageois apeurés que la plupart des chefs de la révolte avaient quitté les lieux pour retourner sur leurs terres : prévenus trop tard de l’attaque de Vellaunodunum, hésitant à prendre la menace au sérieux, ils escomptaient que César serait arrêté longtemps par les Sénons et ils commençaient à peine à se rassembler pour revenir en ville quand les Romains parurent. Dans l’oppidum même, seul était présent un faible contingent, tenu par les déclencheurs du complot qu’on disait les plus exaltés et qui n’avaient voulu rentrer chez eux : le 358
fameux Cotuatus, Gutuatrus – ou quelque autre nom qu’il portât – qu’on avait déjà évoqué à César, que d’aucuns présentaient comme le stratège tandis que d’autres le disaient un archidruide du peuple, et un dénommé Congonnétodubnus tant les noms de ces barbares étaient imprononçables. Un campement fut établi à bonne distance. Sous la discipline apparente des hommes, on sentit qu’ils mettaient moins de zèle à creuser les fossés et ériger les remblais. Le danger leur était peu impressionnant. César, craignant alors un relâchement de ses troupes et surtout une traîtrise, voire une fuite des Carnutes, fit veiller ses légions sous les armes. Elles se répartirent autour de la place, en identifièrent les issues, en vérifièrent les accès cachés, en décelèrent les points faibles et les points forts. Aucune cependant ne fut placée de l’autre côté de la Loire. Comme à l’accoutumée, les civils furent exclus du camp, contraints de dormir de l’autre côté du fossé où, les tentes en moins, ils reproduisirent par groupes de six ou huit les chambrées des soldats. Magon et Aldéa se retrouvèrent parmi eux. Ils s’installèrent au pied d’un arbre, derrière l’attelage d’un cordonnier, où un bout d’étoffe tendu leur fit un abri sommaire contre la fraîcheur de la nuit. Tous autour d’eux faisaient de même. Une mauvaise odeur, celle des repas improvisés avec rien, s’élevait des chariots. Le jeune homme avait définitivement perdu Duisto de vue. Il avait passé la journée à ne s’occuper que de sa route, à s’informer du contexte militaire et il avait consacré sa soirée à tenter péniblement d’aménager au mieux son réduit pour s’y reposer avec Aldéa. Il était harassé. Le feu avait du mal à prendre. La pitance – une bouillie indigeste et une de ces saucisses sèches qui, mastiquées pendant la marche, permettaient la salivation à la troupe – avait été compliquée à dégoter. Heureusement, sur un lit de paille sèche, la peau d’ours ferait office de couche confortable où sa compagne, encore faible pour tenter quoi que ce fût, était déjà étendue et somnolait d’un sommeil réparateur. Comme il s’asseyait enfin auprès d’elle, un fracas soudain les tira de leur torpeur. Dans le noir il vit une énorme silhouette se planter devant lui, plus impressionnante que tous les Croton et les Ursus de Rome réunis. À la lueur des flammes, il s’écria : – Scythès ! C’était l’esclave d’Asinus qui avait survécu et qu’il n’avait revu depuis le soir où il avait quitté son maître. Il était toujours aussi sauvage et silencieux. Un fournisseur d’oignons qui campait non loin et qui était déjà une force de la nature lui demanda qui il était, pourquoi il faisait un tel tapage. Il reçut un coup de poing si violent dans le ventre qu’il s’en trouva le souffle coupé, plié en deux, et les autres autour ne bronchèrent pas, 359
retournèrent à leur repas. Pour tout salut, Scythès lança alors une viande complète à Magon, un gros morceau de chevreau, sans que l’autre en demandât l’origine. Il tira une outre de posca. Puis il s’assit, signe qu’il voulait rester, mais ne dit rien. Il avait l’air d’une bête qu’un marcheur tolère le soir près du feu et avec qui il consent à partager son repas pour ne pas être dévoré à la place. Ses vêtements déchirés, délavés, séchés et racornis conservaient malgré tout une étrange couleur fauve dans la nuit. Magon cuisit la viande, lui en tendit un morceau qui fut avalé en silence à la pointe d’un couteau. C’était la seule arme du Scythe sans que le Maltais apprît ce qu’étaient devenus sa lourde épée, son marteau de combat, son arc chargé de flèches. Après cet échange de nourriture seulement Scythès se mit à parler, comme si le goût du sang avait éveillé en lui un mécanisme ancestral de parole et il articula même assez haut ses premiers mots, sans faire attention à ceux qui écoutaient, tant les autres ne l’inquiétaient parce qu’ils étaient des insectes qu’il aplatirait de son poing s’il fallait. Il parlait un grec mâtiné de latinismes. D’un débit haché, d’une voix gutturale, il raconta d’abord le massacre de Génabum, la mort d’Asinus à laquelle il avait conclu sans y avoir assisté pourtant, ce qu’il avait vu du reste des événements, ce qu’il en savait. Au son caverneux de sa bouche, les faits prirent une tournure plus lugubre encore que la sombre réalité. Sur son rôle à lui en revanche, sur la manière dont il avait survécu ce jour-là et tous ceux qui suivirent, il n’y eut que des ellipses et des silences. Quelques rares mots un peu plus précis lui échappèrent dans un grincement de dents : ceux de « chiennes », de « furies », de « traîtresses » qui étonnèrent Magon. Jamais pourtant le Scythe ne s’était montré plus prolixe. Ses paroles offraient l’impression d’une machine rouillée par des années de silence qui se met soudainement en marche. Le Maltais songea que c’était la toute première fois même qu’il l’entendait tenir une sorte de conversation. Il aurait sa vengeance, conclut-il d’une voix soudain amenuisée. Un Scythe avait toujours sa vengeance. Après il rentrerait chez lui. – Mais enfin, demanda Magon qui en savait trop ou trop peu pour tout s’expliquer, je ne comprends pas. Malgré l’amitié que je portais à Asinus, s’il est mort, tu es libre et… La réponse se trouvait dans la question. L’autre n’eut pas besoin d’en dire plus. Il aurait pu rentrer chez lui depuis un mois, aller n’importe où loin d’ici. Mais il ne l’avait pas fait ; quelque chose de fort le retenait. Son honneur n’était tout simplement pas sauf. Il y a des liens de servitude plus évidents que la mort ; celui qui ne sait protéger le cloporte mérite de finir comme lui à moins qu’il ne brise le pied de qui l’a écrasé. 360
Magon se souvint tout à coup de l’histoire qu’Asinus lui avait racontée sur son compte. Il devina que l’esclave entendait venger son ancien maître pour retrouver enfin sa fierté. Il voulut en être sûr : – Pourquoi me dis-tu cela, Scythès ? – Mon nom n’est pas Scythès, tonna le Scythe, mais Anacharsis ! Le cri venait du cœur. Il était clair. Le temps était venu que l’homme redevînt celui qu’il était réellement, non le serviteur soumis mais le guerrier farouche, et cela passait par la délivrance qu’il accomplirait ici en châtiant les assassins d’Asinus. Cependant, tandis qu’ils parlaient, les événements s’accéléraient et forceraient cette nuit même, quelques heures plus tard seulement, Scythès à se lever pour tenir sa vengeance. On disait l’assaut décidé pour le lendemain. Il était écrit en réalité que César s’attarderait encore moins longtemps devant les murs de Génabum. Les habitants, en effet, sans doute effrayés par la prise de Vellaunodunum qu’ils n’auraient jamais crue si rapide, bénéficiant de si peu de combattants pour les défendre, s’effrayèrent aussitôt. On ne sut jamais ce qui se dit, ce qui se fit, ce qui se décida réellement à l’intérieur des remparts. Mais les événements au-dehors furent ceux-ci. Comme la nuit était venue, les pâleurs de la lune, livide, peureuse, fuyante, furent cachées sous une forêt de nuages. En bas, rien ne bougeait dans l’obscurité ensommeillée des abords de la ville. Aucun homme, aucune bête ne passait. Pas un souffle, pas un mouvement ne courait sur l’herbe et les chemins. Le bois et la pierre du pont, des maisons, des palissades avaient cette immobilité morne des bâtiments quittés comme s’ils n’avaient jamais été habités. N’était un léger frottement, on n’entendait rien. Ce frottement cependant, si discret qu’on aurait cru une vague mourante contre la rive, ce frottement peu à peu s’accrut, gagna une sonorité contenue, concentra tout le bruit du monde à cet instant. Il ne provenait pas de la nature environnante, mais bien de l’oppidum. De l’entrée sud-ouest de l’oppidum. De la porte qui regardait la Loire. De la poutre énorme qu’on ôtait en silence pour tirer les portes, sortir du piège où l’on s’était enfermé. Les battants s’ouvrirent sans grincer. On avait pris soin de graisser les ferrures et l’on avait glissé des tissus sous les barres qui raclaient le sol à maints endroits. Sitôt les portes bloquées, deux individus s’avancèrent, observèrent l’horizon avec des prudences d’animaux apeurés, puis s’en revinrent un peu rassurés que tout fût tranquille. Le signal fut donné. Une foule sortit de derrière les remparts, lentement, en un long cortège de têtes basses et honteuses qui se dirigea dans un absolu silence vers le pont. Ce fut une coulée immense de silhouettes, un serpent fluide, interminable 361
d’êtres humains qui raya de son défilé l’écoulement du fleuve d’une ligne contraire comme pour forcer le destin. César avait vu juste. C’étaient les Génabiens qui s’enfuyaient par milliers, espérant détruire l’ouvrage après leur passage et jeter entre eux et les Romains la largeur de la Loire. Là commençait le danger. Il fallait gagner le pont, passer l’endroit entre les portes et celui-ci où la ville ne connaissait d’autres défenses que quelques cabanes basses, puis traverser à découvert le fleuve. Il faudrait longtemps avant que la foule n’eût passé ce goulot. En attendant, tous avaient enveloppé leurs pieds de cuirs et de tissus pour insonoriser leurs pas, revêtu des vêtements sombres et chauds pour se confondre avec la nuit, marcher longtemps dans le froid de la fin de l’hiver. Par rangée de quatre ou cinq, ils avançaient précautionneusement dans l’étroit chemin, non sans discipline, en se tenant le bras dans le dos des devanciers afin d’éviter les bousculades inutiles et garder l’espace nécessaire au bagage misérable que chacun emportait sur son épaule. Riches et pauvres, nobles et peuple, tête basse, encapés, se trouvaient mêlés les uns aux autres sans qu’aucun habit, aucune manière ne les distinguât. Au milieu, précédé de valets et de disciples, marchait le gutuater Itas, l’archidruide, le Père de la parole, le visage plus émacié qu’à l’ordinaire, les jambes plus longues, les yeux plus noirs dans une fuite éhontée. Un des bagages portés par une pauvre femme qui marchait collée à la rambarde craqua soudain brusquement. Son contenu se déversa dans l’eau. Les plus proches s’arrêtèrent, attendirent longtemps pour savoir s’ils pourraient continuer et créèrent une confusion dans la colonne avec ceux qui poursuivirent leur marche. À aucun autre moment la Loire, en dessous d’eux, qui venait de les trahir par le bruit de l’eau frappée, ne leur parut plus gueuse. Elle était d’ailleurs très calme ce soir-là. Les glaces avaient disparu, moins de branches flottaient contre les piles du pont. Et fluide, elle se taisait comme si elle retenait son souffle à cette traversée des Génabiens, ne comprenant pas qu’ainsi elle ne couvrait pas la fuite de ses enfants sous son bruit mais au contraire les mettait en péril. Dans ses effarouchements placides, elle était traître jusqu’au bout. Il y eut vite une nouvelle frayeur, pire que la précédente. Un chien errant – on croyait pourtant les avoir tous tués avant de partir – pointa tout à coup son museau au coin d’une hutte attenante au rempart. Il se mit à lécher la main pendante d’un enfant qui passait là. L’enfant regarda sa mère, terrifié. Il ne répondit pas au coup de langue du chien, passa outre en rabattant sa paume sur son ventre. Mais l’animal voulait jouer ; il réclamait l’attention de cette longue colonne muette qu’il n’avait l’habitude de voir. Et comme ni l’enfant ni les malheureux derrière n’acceptaient de jouer, comme aucun même ne haussa la voix ni ne montra le poing pour 362
le faire partir, il se mit à japper, puis à aboyer carrément, bruyamment… Un homme surgit de suite et l’égorgea pour retrouver le silence. Cette fois-ci nul ne s’était arrêté. La foule n’avait cessé de s’écouler fluidement des portes de l’oppidum au pont, à la rive prochaine devenue le symbole de sa liberté et de sa survie. Le paysage s’étendait au sud en une plaine semée de quelques cahutes paysannes où se cacher, fermée au loin par de vastes forêts dans lesquelles tous pourraient disparaître sur des chemins nombreux qui partaient en des directions opposées. C’était la seule voie, les autres sorties de la ville étaient bloquées. Jamais les Romains n’iraient s’aventurer dans ces massifs sombres, impénétrables, qu’on disait hantés de créatures terribles et protégés des dieux. Tous l’avaient en vue, cette forêt ; tous souhaitaient y être déjà, la désiraient comme un cocon protecteur. Et comme les plus en avant avaient déjà posé un pied sur l’autre rive au-delà des postes d’octroi vidés de leurs gardes, les autres, en arrière sur le pont ou encore dans l’oppidum, voulurent y être, crurent y être, poussèrent ceux qui les précédaient pour être là-bas. Qu’est-ce qu’on faisait devant ? On baisait de la terre qu’on n’avançait pas ? Alors il y eut un trouble. Les personnes d’abord résistèrent en tournant des têtes furieuses. Mais pressés par des mains plus brutales, ils cédèrent bientôt, poussèrent de la poitrine de nouveaux dos. Et le trouble se mua en un mouvement de foule, une panique. L’encombrement fut terrible. Il y eut des poussées, des coudes enfoncés dans les côtes, des horions distribués pour hâter les lenteurs. Et fatalement un garçon plus léger, plus fragile que les adultes qui l’entouraient tomba à l’eau, bousculé sous la balustrade. Sa mère qui lui avait lâché la main un seul instant hurla, sauta aussitôt pour le retrouver et, tandis qu’elle se perdait dans un grand rond d’éclaboussures, trois autres personnes tombèrent ailleurs de chaque côté du pont où une foule s’écrasait sur le parapet de bois et jurait. Les cris qu’on chercha à étouffer malgré tout retentirent de loin en loin le long de la rive. Il eût été impossible que les Romains n’entendissent pas. La réaction ne tarda guère. Un sifflement fendit l’air, vola au-dessus des têtes et du pont. Soudain une lueur prodigieuse ébahit les esprits, glaça les cœurs. Une flèche enflammée, sans doute enduite de poix, venait d’être envoyée et, projetant une traînée de feu comme une vaste cloche lancée dans le ciel, elle éclaira la fuite de la foule de manière éphémère mais nette avant de se ficher en terre. Le doute n’était plus permis. Les Romains savaient. On se mit à courir en désordre, à enjamber sans ménagement ceux qui peinaient à se relever. Mais on s’immobilisa aussitôt quand une pluie drue de traits faucha les premiers passés, immobilisés eux aussi sur la rive. Ils tombèrent comme une moisson de blé sous un ciel de grêle. Les Romains visaient foutrement bien dans le noir. Quelques-uns tentèrent de 363
se réfugier dans les postes d’octroi qui s’effondrèrent quand ils furent trop à y pénétrer. La pluie de flèches, commencée là-bas, se rapprocha rapidement comme si la nuée se déplaçait. Les pointes s’abattirent bientôt sur le bois du pont où elles s’enfoncèrent dans les pieds, les mollets, les cuisses et clouèrent les malheureux fuyards incapables désormais de se sauver. Quelques-uns les reçurent dans le cou, dans le crâne, dans le cœur, s’effondrèrent et roulèrent à l’eau. Les survivants de la rafale, indemnes ou blessés, n’eurent d’autre choix que rebrousser chemin en un désordre total. On abandonna les plus faibles ; parents, enfants, amis furent séparés dans la débandade. Par un réflexe instinctif, on se rua vers les remparts, ne faisant plus confiance à l’obscurité mais aux seules palissades de bois pour être épargné par les flèches. Pourtant, sur leurs milliers, certains n’en étaient encore qu’à passer les portes, d’autres formaient à peine la file à l’intérieur même de l’oppidum et n’avaient pas vu précisément le massacre qui s’était déroulé sur le pont dont ils n’avaient perçu que les cris. Quelle ne fut leur stupeur quand ils comprirent que leurs concitoyens accouraient en sens inverse et les poussaient à l’intérieur pour les refouler. – C’est fini ! C’est fini !, hurlait-on. – Les Romains nous ont surpris, on est faits comme des lapins ! – Il n’y a plus d’espoir de fuite ! – Place au gutuater, faites place au gutuater. Avec des mouvements amples de fantôme, Itas en effet s’était enfui parmi les premiers, protégé de ses disciples qui auraient donné leur vie pour épargner la sienne. On le laissa entrer puis on ferma les portes, l’oreille sourde à ceux qui suppliaient de les laisser les franchir à leur tour. Il n’y avait plus d’espoir. La méthode des Romains s’illustrerait maintenant à merveille. D’abord la pluie de flèches perça de toutes parts le pont pour faire barrière si bien qu’il y eut rapidement plus de traits plantés que de cadavres – une cinquantaine peut-être –, les survivants de la première salve ayant tous reçu de nouvelles volées qui les achevèrent. Puis des projectiles enflammés tombèrent et incendièrent le pont. Les Génabiens, terrés derrière leurs défenses, constatèrent avec un mélange de soulagement et de désespoir qu’on leur accordait un répit mais qu’on les enfermait pour de bon dans leur ville. Comme ils se croyaient momentanément à l’abri, une flèche égarée se planta sur le rempart en un bruit sec. À peine l’eut-on décrochée et jeté sa flamme dans l’eau qu’une nouvelle tomba sur la palissade voisine. Ils pensèrent à des archers qui visaient mal dans le noir. Mais il y en eut une 364
autre et une autre encore. Toutes se concentraient aux abords des portes près du pont. Soudain on sonna l’alarme aux autres issues. L’attaque était simultanée ! Et tandis que les hommes couraient aux murailles, de nouvelles flèches tombèrent cette fois-ci en plein oppidum, sur le chaume des toits qui s’embrasèrent instantanément. Ce fut l’effroi. On se répandit en tous sens pour tenter d’éteindre l’incendie qui commençait. Dans la panique on pressentait à peine que les Romains avaient cherché à couper définitivement toute retraite et que César profitait de la sortie ratée pour lancer une contre-attaque en pleine nuit. Un fracas énorme, un craquement monstrueux retentit simultanément aux portes nord, est et sud, accompagné de clameurs effrayantes qui éclatèrent soudain comme un tremblement de la terre. C’était la fin. Les légions entraient pour prendre la ville. Au milieu de ce désastre, un seul homme tâchait de garder la tête froide même s’il enrageait de l’inconséquence des siens. C’était le chef des Carnutes, Cotuatos, qu’aucun n’avait voulu écouter et qui tâchait de retenir les hommes qu’il croisait pour les faire rester en ordre. Il en attrapait un, deux, les relâchait aussitôt pour en empoigner d’autres. – C’est trop tard, hurlait-il, trop tard ! Les Romains vont entrer de toute façon. Ils vous réduiront en esclavage. Restez ici ! Ce n’est qu’unis que nous pourrons leur opposer une résistance. Mais on ne l’écoutait pas. On continuait à multiplier les courses inutiles, sans armes, des seaux d’eau dans les mains ou des objets de valeur à mettre en lieu sûr. – Ah ! Si seulement j’avais un cheval pour ramener ces imbéciles ! Un cheval ! Ma vie pour un cheval ! Autour de lui, dans le brasier, à peine l’entendait-on et il était un chef sans hommes, un magistrat sans peuple pour le suivre. Partout on courait, avec des faces terrifiées, des membres tremblants de panique. On allait en tous sens, on se bousculait, on s’assommait pour passer là où d’autres cherchaient à aller. Au détour d’une rue où l’on s’entassait il croisa Volomir : – Toi, enfin ! Mais il ne put l’arrêter. Non pas que son frère prétendît fuir. Au contraire, il voulait aller se battre, tout de suite, sans attendre l’opportunité la plus belle ni entendre le moindre ordre qui eût du sens. Ses yeux luisaient de l’envie d’en découdre, son bras brûlait de frapper comme un tison ardent. Sa haine des Romains était plus vive que jamais. Il semblait en pleine fièvre. Comme la rue était bouchée, il fit soudain demi-tour sans dire un mot et Cotuatos le vit s’éloigner, puis disparaître au milieu des bâtiments en feu. 365
Les flammes des toits maintenant gagnaient les murs qu’elles grignotaient et au milieu on tentait de retrouver les affaires, les richesses qu’on avait laissées dans les maisons. On se brûlait la peau ; on risquait qu’une poutre s’effondrât sur sa tête sans y prendre garde ; on courait comme des bêtes récupérer un vase perdu, un objet oublié, un vêtement sauvable, tout ce qu’on n’avait pas voulu évacuer avant le siège de peur de s’en voir dépossédé. Et sur les visages transpirants, déjà couverts de cendres ou de rougeurs, la danse des flammes faisait des tourbillons de panique et de détresse. C’était une rage furieuse de garder possession, celle d’un peuple commerçant rompu au profit, à la jouissance davantage qu’à la guerre, que la mort effrayait moins que la privation de ses biens. Possession des biens, possession des êtres. Cotuatos, dans ses efforts, aperçoit, dans l’ombre d’un auvent, contre un tas de foin qui peut s’embraser à tout instant, un gueux qui a coincé une gueuse. Mari, ami, parent, voisin ? Rien à faire. L’homme a pris la femme et les jupes retroussées, les cheveux agrippés comme la crinière d’une jument, les seins arrachés du corsage et triturés, il la saille, brutalement, bestialement, ignominieusement, poitrine et naseaux contre le bois, croupe relevée, brûlée de tisons et de flammèches qui volètent. Elle hennit, elle a mal, elle se cambre ; lui, crache des mots obscènes pour sentir qu’elle est encore en vie et qu’il peut en disposer. Il explose d’un râle sale, misérable, et il la tue en lui plantant une lame dans le ventre et l’enfonçant jusqu’à l’assouvissement. Personne ne doit tomber aux mains de l’ennemi ; mieux vaut violer, tuer ses femmes plutôt que voir les Romains les ravir pour faire de même. Cotuatos ne s’arrêta pas au triste spectacle. Parce qu’elle était la plus proche, parce qu’il y avait envoyé Conconnétodumnos, il courut droit à la porte nord. Le fils d’Agédomopas, avec une poignée de fidèles, y avait organisé un semblant de résistance. Les barrières n’avaient pas encore cédé. Alors tout autour de la porte, au seuil même de la ville, entre les remparts et les premières maisons, il avait eu le temps de faire tirer des chariots et amasser des débris de bois, des bouts de toiture, des pans de murs effondrés dans l’espoir fou de ralentir l’invasion. Surtout, aux cris de son clan, de ses terres, de ses couleurs, il avait réussi à regrouper autour de lui ses proches et, pour être certain de leur fidélité, il avait dénudé son torse, arborant à la vue de tous le tatouage qui lui grandissait le dos, ces deux grues qui s’observaient l’une l’autre comme si elles cherchaient dans leur regard la solidarité qu’il attendait des siens. Les portes ne tiendraient pas longtemps. Derrière, les Romains battaient le bois au bélier et chaque coup entraînait un craquement effrayant. De l’autre côté, Conconnétodumnos, bien plus petit que les 366
hommes qui l’entouraient, sachant déjà la ville ouverte à l’ennemi en d’autres endroits, les toisait avec dédain. Il riait de son rire d’Amazone frénétique, le torse nu mais réchauffé par les flammes et le courage. Il distribuait ses ordres, organisait une dernière levée de boucliers que les légionnaires dans un instant enfonceraient. Ils étaient une trentaine, impavides face au déferlement de sauvages. Quand Cotuatuos arriva sur place, un premier verrou sautait, puis une ferrure entière. La poutre se déformait à chaque coup comme une outre qui gonfle. Elle était prête à rompre et soudain elle céda. Une volée de javelots faucha les résistants qui ne purent pas même frapper. Conconnétodumnos s’abattit comme les autres, la gorge traversée d’un pilum qui figea son rire à jamais, et les soldats enjambèrent son cadavre, finirent par piétiner même les deux grues de son dos tant ils se hâtaient d’en finir pour mettre la ville au saccage. Cotuatos hurla, jaloux de cette mort. Il voulut se précipiter, fut retenu par le flot de légionnaires qui se portaient à sa rencontre. Il fit face à cinq assaillants, moulina de son épée, en tua un sur-le-champ. Puis il recula pour esquiver les coups de riposte, traversa une maison en flammes, ressortit dans une ruelle, en tua deux autres et s’en alla. Il parvint au pied de la colline que l’on nommait la Butte-aux-rats où il perdit son manteau rouge et or, son casque qui le différenciaient des autres Gaulois. Là il retrouva avec surprise un groupe de Génabiens qui avait eu la même idée de se réfugier sur l’éminence pour résister. Retrouvant leur raison, tenant leurs armes fermement, ils s’organisaient, faisaient monter les femmes, les enfants derrière eux, formaient un cercle de boucliers entre les maisons. Les pertes étaient lourdes, des trous se formaient qu’il fallait chaque fois combler. Et certains là-haut prenaient déjà des couteaux pour mourir de leurs mains quand soudain une voix s’écria du sommet : – Sauvés ! Regardez ! Des renforts ! Dans la nuit, à l’ouest de la ville, on vit en effet un lit de torche rencontrer la ligne des Romains. Des combattants venaient de nulle part. Ils engageaient un autre combat sur un autre front. La joie de Cotuatos et des siens fut grande. Elle redoubla même quand l’un d’entre eux affirma : – Acutios ! Ansila ! Je les reconnais à leurs couleurs ! C’étaient bien eux, Ansila et Acutios qui avaient eu le plus d’hésitations à quitter la ville au lendemain du massacre et qui étaient revenus les premiers dès l’annonce du siège de Vellaunodunum des Sénons. La rapidité des événements les avait empêchés d’être sur place avant les Romains. D’ailleurs ils n’avaient pas pris la mesure des légions de César et, faute de s’être coordonnés avec les autres brenns, ils se retrouvèrent quelques 367
centaines face à des cohortes entières. Ils avaient accouru dès qu’ils avaient su, croyaient que tous en feraient autant pour former une armée de secours ! Ayant compris qu’ils n’étaient pas assez nombreux, malgré la nuit qui aurait pu cacher leur fuite, ils préférèrent la mort illustre à la lâcheté de partir une fois encore. Ils affrontèrent bravement les boucliers et les glaives, jusqu’à tomber tous. L’arrière-garde positionnée à cet endroit, d’abord surprise d’être ainsi attaquée en tenaille, se ressaisit et refoula comme il fallait cette petite troupe incongrue. Sur la Butte-aux-rats, l’enthousiasme retomba aussitôt. La tournure des événements ne laissait aucune place au doute. Là-bas non plus, ce ne serait pas une vraie bataille mais un massacre sans nom. La ville était un vrai dédale en pleine nuit à la lueur dansante des torches. Les Romains ne s’embarrassèrent pas de se repérer mais se jetèrent en toutes les directions avec la seule idée de tuer. Et comme les toits continuaient de s’embraser, soudain les écuries prirent feu. Les chevaux affolés enfoncèrent les portes et, brûlés par les flammes, s’enfuirent en hennissant de terreur. Ils devinrent incontrôlables, galopèrent en toutes directions sans se soucier des obstacles qu’ils heurtaient. Tout à coup – chose incroyable – on en vit un arrêter sa course folle à l’entrée de la ville. Un homme se trouvait sur sa route, immobile, sans armes autres qu’un couteau passé à sa ceinture. De carrure colossale, il n’était pas romain, il n’était pas gaulois et les mouvements précipités autour de lui contrastaient avec son immobilisme ; il semblait venir d’ailleurs, étranger aux événements comme si les combats ne le concernaient pas. Il ne cria pas, n’éleva pas la main, se contenta de planter son regard perçant dans les yeux affolés de l’animal. Le cheval dut y sentir une force tranquille ; il se cabra, frappa des sabots, tourna sur lui-même et, devant l’autorité qui émanait de cet homme, finit par se calmer. Scythès – car c’était lui – était le seul à pouvoir réaliser cet exploit parce qu’il venait d’un pays où hommes et chevaux vivaient d’égal à égal au point de se suivre dans la tombe. Il enfourcha l’animal à cru et, sans que personne ne cherchât à l’arrêter, fendit avec habileté le flot de légionnaires pour filer dans la ville comme s’il avait l’intention de doubler tous les soldats à pied. Avec la prestance de ses ancêtres, il parcourut les rues au galop, tourna plusieurs fois devant celles qui étaient bondées de soldats ivres de sang. Sans se départir de son calme, il paraissait chercher quelqu’un de précis, ne s’arrêtait à nul autre. Ce fut devant les entrepôts, là où tout avait commencé, qu’il trouva enfin celui qu’il cherchait. Des Gaulois s’y battaient avec rage pour défendre leurs richesses ; les Romains leur donnaient l’assaut avec autant de hargne pour venger les mânes de Cita. 368
Certains assiégés s’étaient enfermés à l’intérieur ; d’autres, emmenés par un seul homme, luttaient dehors en mettant en œuvre un semblant de tortue – cette formation que les Latins leur avaient prise depuis longtemps. Mais ils n’étaient pas assez nombreux et, faute de cohésion, les boucliers, sitôt levés, retombaient sous le choc. Ce fut là que Scythès vit celui qu’il traquait : il commandait à ces hommes, hurlait des ordres, frappait avec délire. Au moment où la formation se délita complètement, l’esclave en profita. On le vit fendre la cohue, bousculer Romains et Gaulois et, penché sur son cheval au point de raser le sol, taillader la gorge de son adversaire d’un mouvement fulgurant du poignard avec la précision d’un boucher qui égorge un animal. L’homme frappé ainsi tomba à genoux. Il ne dut pas même comprendre ce qui venait d’arriver. Ses yeux vert-de-gris se noyèrent soudain de brume. Et Volomir le dur, fils d’Indiomar, frère de Cotuatos aux bras d’yeuse, Volomir le commanditaire de la mort d’Asinus mourut privé de sa vengeance sur Rome. Scythès cependant ne se retourna pas, fila tout droit dans la ville. Cette fois-ci il ne paraissait plus chercher mais savoir directement où aller. Le point qu’il voulait atteindre était encore épargné par les combats et il fut le premier à y arriver. C’était une petite cabane isolée dans un quartier retiré de l’oppidum qu’il semblait bien connaître cependant. L’endroit était désert, cerné de tous côtés par des cris d’horreur et des bruits de chair qu’on tranche. Le Scythe mit pied à terre, entra à l’intérieur du même pas qu’il aurait enfoncé un rempart, trouva aussitôt celle qu’il était venu emporter. La fille était assise sur un tabouret de paille, calme, le regard fixe, derrière ses longues mèches rousses. C’était Génabia, seconde responsable de la mort d’Asinus que Scythès vengerait avant qu’elle ne tombât entre les mains d’un autre. Vêtue d’une ample robe, les joues creusées, les yeux cernés, on voyait qu’elle avait considérablement maigri. – Je t’attendais, lui dit-elle posément. Je n’ai vécu le mois d’anagantios qu’avec ta venue en tête. Depuis un mois en effet, elle avait vécu dans une sorte de scrupule inexplicable où le dégoût de la fin d’Asinus l’avait tenue peu à peu. À aucun moment elle n’avait ressenti de fierté de son geste, à aucun moment elle n’en avait obtenu de réelle récompense – rien qui pût s’apparenter à ce que lui avait promis Volomir. Non pas qu’elle regrettât la mort du Romain. Mais depuis qu’elle avait vu son cadavre traîné dans les rues de la ville, c’était plutôt comme si la violence généralisée autour d’elle, cette violence à laquelle elle avait elle-même contribué l’écœurait comme un vin dont on a trop bu d’un coup en vidant un cratère. Le tourbillon de Génabum, l’eau fraîche de la Loire, l’appel à l’union et la rébellion générale n’y faisaient 369
rien. Tout était souillé de violence autour d’elle. Elle n’en dormait plus, n’en mangeait plus. Elle ne pouvait échapper à cette nausée. Son réflexe premier avait été de penser à fuir comme si elle était poursuivie par le fantôme de sa victime. Alors que la nourriture commençait à manquer pour les plus pauvres après la ripaille de la victoire, elle avait un temps pensé quitter la ville. Elle se souvint même de l’argent dont Asinus lui avait parlé avant de mourir. Mais on ne s’appelait pas Génabia impunément ; son nom l’enracinait à Génabum. Elle tergiversa longtemps. Quand elle se décida enfin, prenant la chambre pour une passe quelconque, elle chercha l’argent en vain et conçut un soulagement de ne pas le trouver en même temps qu’une terreur parce qu’elle pensait qu’un dieu pouvait avoir ainsi voulu la punir et que ce n’était que le début. Elle renonça à son projet, vécut comme elle put pendant des jours. Aussi, en entendant dire que l’esclave d’Asinus n’avait pas été retrouvé, elle en conclut qu’il pourrait venir venger son maître, l’espéra de toutes ses forces, finit par s’en convaincre. C’était le seul moyen de se libérer de cette répugnance qui lui collait à la peau. Il serait le bras armé de celui qu’elle avait assassiné. Et lorsque les Romains étaient entrés dans la ville, elle s’était figée chez elle, sentant la lame venir avec le pressentiment de la femme qui ne se trompe pas. Cette lame, pourtant, Scythès n’en usa pas. Quand il entra sous le toit de la fille, il jeta son poignard devant elle pour lui signifier qu’il n’en aurait pas besoin pour la tuer. La pointe se ficha dans la terre. Elle n’eut pas l’audace de la ramasser, n’aurait d’ailleurs rien pu en faire vu l’état de ses forces. Il l’attrapa par les cheveux, la traîna au-dehors. Une brune grasse, la rosse Vévila, vint l’y défendre en hurlant et en brandissant une quenouille de fileuse comme arme de fortune. Il la lui enfonça en retour dans le sein ; la garce s’effondra pesamment. Les autres filles couraient à travers rues pour échapper à la mort. Scythès emporta Génabia jusqu’au fleuve. Il la prit de ses bras rudes, la jeta dans une barque sans qu’elle osât se débattre. La Loire en dessous paraissait brûler de l’incendie de la ville ; les flammes qui s’élevaient des huttes dansaient sur l’eau et lui donnaient la couleur d’un fleuve de feu où se nichaient des figures d’hydres, de gorgones, de harpies. N’importe qui aurait saisi son épée, l’aurait pointée vers ces ombres pour les pourfendre inutilement, mais le Scythe n’avait peur de rien et la gamine, prostrée au fond de l’embarcation, paraissait résignée sur son sort. Au moyen d’une perche, il la fit traverser pour rejoindre l’Île-avalante, cette même île où il savait qu’Asinus avait péri un mois plus tôt. Il la souleva de nouveau, sauta avec elle sur le sable. Elle se tenait à lui, pleurant quelques larmes silencieuses. 370
L’île était dépeuplée, muette et froide. On y entrait dans un autre monde. C’était comme si la fureur de la prise de l’oppidum, comme si la chaleur brûlante des flammes et les cris de détresse des mourants ne parvenaient jusqu’ici. Non loin de l’endroit où Asinus avait reçu de premiers coups de couteau se trouvait un orme, au bord de l’eau, et à son pied un rocher sortait de terre son arrête tranchante longue de la longueur d’un dos. Scythès connaissait cet endroit, s’était rendu sur les lieux après la mort de son maître. Il tenait toujours Génabia dans ses bras ; elle s’agrippait toujours à lui, attentive à son sort, terrifiée et docile. Soudain il l’éleva en l’air ainsi qu’il l’aurait fait pour sacrifier à ses dieux et la précipita subitement sur le rocher. Un grand bruit se fit comme si la colonne vertébrale venait de se briser en deux. Il recommença deux fois, trois fois ; la tête heurta, les mains lâchèrent prise. Le bel oiseau que la gamine avait tatoué sur sa poitrine mourut comme frappé en plein vol et abattu sur une pierre. Alors il la jeta au sol, comme on fait d’un animal qu’on vient d’achever et qu’on va dépecer. Il avait tué Volomir proprement, il s’acharnerait sur Génabia. Non pas parce que l’un était un homme, l’autre une femme mais parce qu’il jugeait le crime de la seconde plus abject que la responsabilité du premier. Son geste atteignit là le comble de l’horreur et si la légion l’avait vu faire, il est à parier que six mille hommes se seraient trouvés mal. Accroupi par terre devant le corps encore chaud de la fille, il déchire son vêtement de ses ongles, se met à fouiller son ventre de ses dents, se servant de temps à autre d’une pierre pointue pour faciliter sa monstruosité. Il n’émet plus aucun autre son qu’un grognement rauque. Il mord si fort, tire avec tant de sauvagerie la peau qu’il finit par atteindre la chair dont il se repaît. La fille est-elle morte ? Qu’importe. C’est encore mieux si elle vit, immolée sur l’autel de la dignité retrouvée de son bourreau. Il considère que c’est par cet acte sans nom qu’il recouvrera sa force, son honneur, sa liberté puisqu’il aura avalé l’âme de celle qui a eu raison de l’être insigne auquel il s’était assujetti. Et la barbe et les lèvres éclaboussées de sang, sorti du rang d’être humain, ravalé à celui de loup ou de fauve, il a un air de stupidité farouche, étourdi par le gros bruit de ses mâchoires qui écrasent des lambeaux de muscles et de viande sanglante. Cependant, la ville continuait de brûler. Le gigantesque brasier s’élevait jusqu’aux étoiles effrayées et menaçait la lune en jetant un jour de torches en pleine nuit. Les Romains maintenant se livraient à un véritable massacre. Tous ceux qu’ils croisaient, qu’ils débusquaient, ils les tuaient, pris dans une rage de vaincre, la face noire de suie, rouge de sang. Le massacre était bien plus grand que celui que les Carnutes avaient orchestré un mois plus tôt : on s’attaquait maintenant à la population entière, non à 371
une poignée d’émigrés parmi elle. Et les légionnaires allaient partout, passaient les maisons en flammes, couraient des remparts à la Loire, de la Loire aux remparts, laissaient éclater leur fureur. La Butte-aux-rats, l’unique colline de la ville où un fort attroupement de Génabiens s’était formé fut le théâtre d’une véritable hécatombe. Les archers y firent merveille si bien qu’il n’y eut pratiquement aucun corps à corps. Les pilums n’avancèrent que pour achever les blessés, traquer les femmes, les lâches, les enfants dans les demeures des nobles. Pour la seconde fois, un flot de sang dévalait la colline et montait, dans certains creux des chemins, jusqu’aux chevilles des assassins, ce qui leur mit du baume au cœur. Dans la nuit folle, ils continuèrent à frapper sans distinction, allèrent jusqu’à tuer les rongeurs qui s’enfuyaient par les rues. César lâchait la bride qu’il avait retenue à Vellaunodunum. L’heure du grand pillage venait enfin : les soldats fâchés d’avoir manqué hier leur butin assouviraient cette nuit leur brutale convoitise, les officiers accroîtraient leur monstrueuse fortune. Il y eut cependant une maison où un détachement entra et qui, retournée de fond en comble, causa d’abord la déception. Les soudards n’y trouvèrent rien, s’apprêtaient à partir quand, dans un de ces rares instants de silence que connaît une bataille, ils surprirent tout à coup un bruit sourd qui provenait de sous le sol. Dans un recoin du bâti, derrière une tenture et des paniers d’osier, il existait une cave, indiquée par une trappe de bois qu’un lourd anneau de bronze creusait. Ils l’ouvrirent, y découvrirent en bas de quelques marches des dizaines de visages qui se terraient, horrifiés. Des cris aussitôt s’échappèrent dans un entremêlement indistinct parce que les malheureux parlaient vite, tous en même temps et sous le coup de la terreur, une langue que de toute façon les légionnaires n’entendaient pas. Un seul mot intelligible leur vint aux oreilles : gutuat, gutuat qu’ils assimilèrent à ce Cotuatos qu’on leur avait demandé de trouver. Au fond de la cave, derrière la rangée d’épaules qui le protégeait, se cachait Itas, le gutuater, dont les disciples déclinaient simplement l’identité. Les légionnaires le prirent pour le rebelle, l’instigateur de la révolte qu’ils n’avaient de toute façon jamais vu. Ils le constituèrent prisonnier mais furent déçus de leur trouvaille. Si l’homme qu’ils avaient débusqué faisait froid dans le dos avec sa face fantomatique, sa barbe longue et ses yeux noirs percés comme des entrées de l’Hadès, il n’avait rien d’un guerrier courageux ; au contraire, sa posture était celle d’un lâche et ils se réconfortèrent uniquement en songeant à la récompense qu’ils pourraient obtenir de leur prise. C’était de surcroît un vieillard. Aucun sang ne coula dans la maison. Celui que les révoltés n’avaient osé arrêter un mois plus 372
tôt venait de tomber entre les mains des Romains dont il avait pourtant embrassé le parti. À partir de ce moment, les bras qui frappaient se calmèrent, les esprits retrouvèrent un peu de raison. On commença à épargner les survivants en réfléchissant qu’il pouvait y en avoir de valeur parmi eux, que César voudrait sans doute les détenir vivants pour les faire interroger ou les garder comme monnaie d’échange. L’incendie lui-même faiblissait et l’on jeta de la terre sur les flammes pour éviter que tout disparût dans le feu. On fit des esclaves, des centaines, un millier peut-être que l’on rafla en même temps que l’on pillait les bêtes et les biens. Avec méthode, les hommes furent parqués, séparés des femmes et des enfants, les poings liés en attendant les chaînes qui viendraient les soumettre jusqu’à Rome. C’était la soif de posséder qui s’illustrait, celle qui habitait les Carnutes dans la paix et qui, dans la guerre, atteignait à son extrême les Romains. Les maisons furent fouillées systématiquement à la recherche d’or, d’argent, de bronze, de fourrures et d’armes que l’on s’approprierait. Les entrepôts, que les Gaulois n’avaient pas vidés puisqu’ils considéraient leurs les richesses qui y étaient enfermées, furent pillés sans la moindre vergogne comme si les marchandises entreposées n’étaient pas destinées à l’Italie. César eut encore la sagesse de laisser faire ; il savait que les hommes ont besoin d’être récompensés plus que de raison après la victoire. L’heure fut ainsi au saccage, à la prédation auxquels s’ajoutèrent rapidement les grossièretés les plus insignes. Dans un grand rire de soldatesque, on cassa tout dès lors qu’on ne pouvait, qu’on ne voulait pas emmener. Et de nouveau on se soulagea dans les lieux de pouvoir ; on déposa des étrons devant les portes ; on urina dans la bouche des cadavres. Les Romains victorieux ne valaient pas mieux que les Gaulois vainqueurs. Ce fut là la chance d’Éroticus et de Fannia Voluptas qui purent survivre à leur deuxième massacre. Un mois auparavant, face à des Carnutes intrépides, le tavernier était redevenu l’illustre Agégorix, fort de sa bravoure braillarde pour impressionner des guerriers qui ne pouvaient l’égaler. Maintenant, devant des Romains vils, c’était sa femme, la dénommée Bluenn qui redevenait la tenancière aimable pour adoucir l’ire des paillards. Dans les moments d’obscénité, des êtres aussi vulgaires qu’eux deux se trouvaient comme des poissons dans l’eau et il fallait la voir, elle, se dandiner, onduler des hanches, dessiner des mouvements accorts de ses bras ponctués de doux clins d’œil. Lui, tendait de l’argent à un centurion pour échapper à la mort ou ne pas retomber en esclavage. Il arguait qu’il était latin, de la lointaine clientèle de César – ce qui était faux. En quelques phrases, il développa toute une rhétorique rude qu’il termina par un argument inattendu. 373
– Ne détruisez pas cette maison, c’est celle des richesses et des plaisirs. Elle fait pousser les pièces. Parole d’honneur ! La bourse que je te donne, officier, elle a été cachée par un dieu pour payer l’une de mes filles. Sûr qu’il y en a d’autres ! – T’inquiète, mon gars. On va vérifier. L’argent dont Éroticus parlait, c’était celui qu’avait cherché en vain Génabia. Pour cause. Quoiqu’il ignorât à qui il appartenait, il l’avait retrouvé par hasard avant elle dans la chambre qu’occupait anciennement Asinus, au croisement des poutres où le commerçant l’avait dissimulé. Au lendemain du massacre, la plupart des chefs rebelles avaient quitté l’oppidum et il avait voulu montrer aux troupes qui restaient qu’il les soutenait en leur fournissant les boucliers et les épées qui décoraient les murs de sa copona. La majorité des armes avait été décrochée lors de l’attaque pour défendre l’auberge et les clients étrangers. Mais restaient les plus belles, les plus prestigieuses qu’il avait l’intention d’offrir maintenant. Au-dessus du lit où Asinus avait aimé pour la première fois Génabia se trouvait justement un magnifique bouclier qu’Éroticus avait jadis acheté parce qu’on le lui avait vendu comme un vestige de la bataille de Télamon qui s’était déroulée presque deux cents ans plus tôt. Le bonhomme ne s’était jamais posé la question de savoir si c’était un conte ou la vérité. Le bouclier était superbe, entouré d’une auréole de gloire. Avait-il servi dans la première partie de la bataille où les Gaulois avaient défait les Romains ? Dans la seconde où les Romains avaient écrasé les Gaulois ? Il ne le savait, mais en demeurait rêveur sous ses gros sourcils avinés. Il ne fut dès lors pas étonné de trouver, en le détachant, un trésor. Il lui paraissait normal qu’un objet tant illustre cachât un si beau filon. Quand il voulut descendre le bouclier, une chaîne résista, le força à monter. Il découvrit la cache où le magot resplendissait. C’était tout un amas de pièces d’or, une jolie petite fortune, le reste de ce que le commerçant romain avait à l’époque offert à la jeune femme en échange d’un peu d’amour – tout ce que le filou avait volé de richesses à la ville pour le rendre à l’élue de son cœur. Il y avait là de quoi vivre comme un prince pendant un an. La scène n’avait connu aucun témoin. La boutique périclitait depuis la mort de Cita, les chambres étaient vides. Les filles désœuvrées étaient reparties battre la campagne, les clients étaient quasiment absents. Il s’ouvrit de sa découverte à sa femme qui était en toute chose son double. Ensemble ils réfléchirent. Au lieu de dilapider aussitôt cette petite fortune, ils eurent la présence d’esprit de la garder. L’arrivée des troupes de César leur donna plus tard raison et l’idée leur vint alors de monnayer leur survie. 374
Éroticus avait un instant caressé l’espoir de redéfendre son auberge comme lors du massacre de février. Les Carnutes le lui avaient même demandé. Mais il savait que la ville était perdue et, face au désastre qui se profilait, il se sentait désormais à nouveau plus romain que celte. Profiter de ce trésor inopiné pour vivre, c’était la seule solution. Mais pas en payant directement les vainqueurs. Ils auraient eu vite fait de se débarrasser de lui une fois la bourse empochée ! Avec son sens de la mise en scène, le même que celui qui lui avait autrefois fait prendre le surnom d’Éroticus, il avait alors eu une géniale inspiration. Il avait imaginé disséminer partout dans sa boutique des pièces, des bijoux et faire passer le lieu pour un temple des richesses, l’endroit où les fortunes poussaient. – La maison d’Éroticus est la maison du bonheur !, répétait-il. Des chambres aux cuisines, entrez, elle est ouverte. Et servez-vous, le vin est bon, il est gratuit ! – Cherchez, cueillez, mes beaux guerriers, renchérissait Fannia. Mes mamelles à qui aura dix pièces, ma croupe à qui en aura cent ! Les soldats rirent, amusés de la proposition qu’ils prenaient comme un jeu. Et pendant que d’autres ailleurs continuaient de tuer, à peine ceux-là étaient-ils entrés à l’intérieur de la taverne qu’un léger éclat, luisant dans un coin d’ombre, attira l’attention du centurion qui les menait. – Là, une pièce !, s’écria-t-il. C’était un statère d’or habilement placé à l’entrée de la maison pour susciter la convoitise. Tous alors cherchèrent et se calmèrent. La copona était sauvée. Et la légende d’Éroticus et Fannia Voluptas en ressortirait encore grandie. Le lendemain, Génabum n’était plus que cendres et ruines. Celle qu’on appelait la riche n’était désormais qu’un lointain souvenir. Le soleil avait parcouru la moitié de sa course quand Magon entra enfin dans la ville. Il faisait partie des civils autorisés à s’y rendre. On s’était souvenu de sa profession de médecin et, même si les pertes romaines étaient infimes en comparaison du nombre de Gaulois trépassés, on avait fait appel à tous ceux que l’on savait pouvoir être utiles pour soigner les blessés. Aldéa l’accompagnait, qu’il avait fait passer pour sa servante. La mule portait leurs bagages qui grossissaient jour après jour. Ici aussi, à peine entré, le couple s’arrêta ramasser un petit chaudron, un vêtement chaud et des mitaines abîmées, un peu de nourriture consommable. La crotte et la fange se mêlaient à la cendre des rues. Magon y piétinait. Aldéa, restée sur le cheval, lui indiquait où se diriger parce qu’elle voyait mieux en hauteur dans les décombres. Ils faisaient au reste comme tous les civils 375
marchant à la suite de l’armée et souffrant la fin de l’hiver. Leurs haltes passèrent inaperçues dans le grouillement de tous ceux qui voulaient tirer profit de la victoire. Le Maltais avait cru plus prudent de garder son bâton enveloppé d’un tissu et chaque objet qu’il rajoutait sur le dos de sa bête lui servait à le dissimuler davantage. L’arme attirait moins l’attention ; elle avait beaucoup souffert des événements et avait perdu de son éclat. Il n’avait pas dormi de la nuit, marchait comme à tâtons, tenant sa jument par la bride. Il s’en venait pour la troisième fois dans la ville et se doutait qu’il y resterait aussi peu de temps qu’aux occasions précédentes. Cette ville, il l’avait découverte dans sa prospérité, y était revenu quand elle s’était faite traîtresse et comploteuse ; maintenant, allant au pas à travers rues, il la voyait détruite et soumise à jamais. Les lieux étaient annihilés. On peinait à croire que Génabum pourrait un jour s’en relever. Les quartiers ne ressemblaient plus aux quartiers, les maisons étaient autre chose que des foyers abritant la vie : des murs incendiés, des toits effondrés sur des malheureux dont les cadavres avaient fini calcinés. Paradoxalement les remparts étaient encore intacts. C’était à l’intérieur que l’ire des Romains s’était déchaînée, et l’on cheminait entre des décombres encore fumants de braises, partout régnait la paix assourdissante des sandales des légions, et il s’épandait une odeur de bois brûlé et de chair consumée qui montait à la gorge. Des particules fines voletaient, se collaient au visage des vivants. Nul n’avait décidément respecté les habitudes de la guerre. Les Génabiens avaient attaqué par surprise, hors saison ; les Romains s’étaient vengés en pleine nuit. Au milieu de ce désastre il eut soudain une surprise improbable. Sous un tas de bois calciné, son regard fut attiré par un objet blanchâtre qui se détachait sur le sol où le noir et le gris dominaient. En s’approchant il l’examina, y passa la main pour le nettoyer de la poussière grasse : c’était sa pharmacie de voyage, la petite boîte sculptée dans un bloc d’ivoire dont le couvercle figurait des portraits d’Esculape et d’Hygie ! Il n’y avait aucun doute, c’était bien celle qu’il avait laissée à Asinus en quittant la ville au premier jour. Qu’était-elle devenue tout ce temps ? Par où avait-elle transité ? Entre quelles mains était-elle tombée ? Un miracle, proprement extraordinaire, l’avait fait être préservée. Il regarda autour de lui pour mieux s’en rendre compte. Partout, on eût dit qu’un cataclysme s’était produit. Outre la ville, le pont qui menait à l’oppidum, rongé à ses deux bouts par les flammes, avait fini par s’abattre dans la Loire où ses débris étaient réapparus contre les berges près des corps inertes des malheureux qui s’étaient noyés en même temps. À côté, les pontons du port n’avaient que peu souffert, mais les bateaux embrasés eux aussi par les flèches des archers étaient partis à la dérive. Empêtrés 376
dans les fragments du pont, échoués contre les sables, arrêtés par le nombre de cadavres qui flottaient dans l’eau du fleuve, certains avaient déjà coulé avec tout leur lest ; la plupart sombraient lentement, dans un silence funèbre d’épaves que ne rompait que le craquement des planches qui de temps à autre cédaient. En remontant la rive, là où s’élevaient naguère les deux entrepôts construits par les Romains, ne se trouvait plus qu’un tas de ruines. La brique non plus n’avait pas résisté. Tout indiquait que les Gaulois s’y étaient battus farouchement, voulant probablement défendre ce qu’ils considéraient comme leur plus belle prise et qui symbolisait à leurs yeux leur honneur retrouvé. Déjà des ingénieurs militaires constataient l’ampleur des dégâts et, équipés de gromas, faisaient mesurer les lieux, inscrire des alignements en vue sans doute de reconstruire les bâtis, peutêtre en plus grand et en plus efficace. L’emporium des Carnutes subsisterait parce qu’il était devenu pour de bon un emporium des Romains dans l’immense empire qu’ils se taillaient au prix de larmes et de sang. Plus haut c’était encore la désolation jusqu’à la butte principale où les chemins étaient encombrés de cadavres et où les demeures des nobles valaient déjà moins que celles des paysans les plus humbles des campagnes. Le foyer du vergobret, celui de l’argentier, du stratège, du gutuater, tous avaient été éventrés et saccagés ; la salle du Conseil où se réunissaient les chefs, un somptueux palais de bois peint pour loger le roi quand il venait autrefois, avait été abîmée ; il n’y avait pas jusqu’à l’ancienne maison de Cita et son luxueux pavage de mosaïque – un Romain pourtant que César prétendait venger – qui n’eût subi son lot de dommages. Ce que les rebelles avaient eu le respect de préserver intact avait été cette fois-ci pillé de toutes richesses et détruit comme si les titres et les fonctions n’évoquaient rien pour les vainqueurs. Les soldats s’étaient acharnés avec la permission de leurs supérieurs. Après avoir tué, capturé, violé qui de droit, après avoir volé, arraché, ravagé les ors et les fourrures, ils avaient encordé les poutres maîtresses des maisons, qu’ils avaient fait s’effondrer sur ce qu’ils n’avaient pu emporter pour que personne n’en profitât et ils avaient à nouveau souillé chaque coin où s’était exercé le pouvoir carnute. Maintenant les détrousseurs s’acharnaient à fouiller à la recherche de richesses, de bijoux ; on en vit plus d’un sectionner les doigts des trépassés pour leur ôter une bague de valeur. Dans ce paysage sombre, le seul bâtiment qui n’avait pas brûlé était une taverne qui s’élevait au milieu du néant sur ce qui devait être auparavant une place publique. Magon la reconnut soudain : c’était la place où avait péri Sagéra, à présent à peine reconnaissable, comme si les flammes qui avaient dévoré le malheureux avaient fini par emporter à son tour le lieu 377
de son supplice. Mais au milieu, l’auberge paraissait indestructible, une enseigne à peine rognée par les flammes y arborait en lettres couvertes de suie Allobroga copona pour dire et la nature de l’établissement et l’origine du tenancier. En haut des deux marches de son perron, ce dernier paradait dehors, orgueilleusement, vêtu d’habits neufs, et barrait la porte de sa carrure imposante. Il riait d’être encore en vie, se moquait insolemment des cadavres qui jonchaient le sol et des esclaves qui défilaient devant lui. Personne ne l’en eût fait descendre ; personne ne l’eût voulu non plus parce que dans toutes les villes que l’on prend ou qu’on libère on s’assure toujours que les tripots et les tavernes soient préservés des violences. L’homme avait sans doute argumenté en sa faveur, prouvé qu’il était plus romain que gaulois, que son vin était meilleur que sa bière et il avait dû s’en sortir. À ses côtés celle qui devait être son épouse, une blonde aux cheveux blonds, aux formes appétissantes, au sourire enjôleur, se déhanchait pour appâter le client. Ils formaient à eux deux un couple redoutable qui traverserait encore longtemps les sièges et les batailles. De fait de nouveaux clients arrivaient, comme si on ne s’était pas étripé ici quelques heures plus tôt. Les civils qui accompagnaient la légion victorieuse remplaçaient aujourd’hui les anciens habitués, ces Italiens et ces Grecs qui autrefois pullulaient dans l’emporium. Les réflexes, les habitudes seraient les mêmes ; les plaisirs et la débauche se renouvelaient. Asinus seulement n’était plus là… Où était d’ailleurs Scythès ? Évaporé dans la nature, avait-il réussi à assouvir sa vengeance ? Était-il déjà reparti sur la route de son pays comme il l’avait annoncé ? Certains racontaient qu’on avait retrouvé un corps atrocement mutilé sur une île, les entrailles pendues dans un arbre comme des guirlandes de fête. Magon fut sûr que Scythès n’y était pas étranger. Son attention se détourna vite cependant. Près de là, au centre de la ville, sur les braises encore chaudes et les cadavres entassés, on avait dressé une tente, la tente de César, celle du grand conquérant qu’une haie de soldats empêchait d’approcher. Le général s’en irait bientôt franchir la Loire, châtier les Bituriges au sud ; tout le monde connaissait le plan. Mais auparavant il voulait finir de réparer l’honneur de Rome et son action n’aurait été complète sans voir défiler devant lui le cortège de visages hâves, de corps fatigués – tous les Carnutes que la victoire lui livrait. Certains se traînaient, d’autres étaient encore vigoureux. Tous étaient liés par des cordes si serrées qu’elles leur rentraient dans la peau et leur traçaient des lignes de sang aux articulations. Les femmes, les enfants allaient devant, puis venaient les hommes, les blessés, les valides, enfin ceux qui gardaient un peu de fierté. Ceux-là, le général les écrasait du regard, assis sur sa chaise curule, entouré de ses officiers les plus fiers. Il 378
les regardait de son œil noir luisant qui semblait un gouffre devant avaler le monde. Magon imagina ce que César devait se dire. Sans doute jubilait-il. Il jubilait de ce succès loin de l’Urbs, entrevoyait les tactiques prochaines, les stratégies futures, les vrais triomphes à la fin. Il avait déjà remporté des batailles, des campagnes ; mais celle-ci, commencée dans la précipitation, après avoir d’abord tourné à la catastrophe, serait d’autant plus belle qu’elle se terminerait en une victoire incroyable qu’il pressentait. Les deux sièges médiocres entamés et avortés sous les murs de Vellaunodunum et Génabum avaient développé son appétit de conquête et il chercherait la bataille où laisser éclater son génie pour soumettre enfin les Gaules sous sa coupe et Rome, Rome, ce forum, ces collines, ce bout de territoire italien si petit et si grand pour lequel il fallait soumettre le monde entier si l’on voulait le maîtriser ! Magon fut troublé. Il y avait derrière César un homme bizarre, discret, indistinct, qu’il lui semblait avoir autrefois vu parler avec Asinus, qui touchait maintenant à l’épaule du conquérant et dont il ne savait s’il pouvait vraiment le reconnaître. Posté à bonne distance parce qu’on ne le laissait s’avancer plus, il demanda des explications à un auxiliaire baléare qui se tenait près de lui. – Qu’est-ce que tu veux, toi ?, s’entendit-il aboyer. Magon demanda. Qu’allaient devenir tous ces gens ? Où étaient les chefs rebelles ? Et les autres brenns carnutes ? Ceux qui, pas même arrivés trop tard, n’étaient pas venus du tout. Avaient-ils rejoint l’armée de Vercingétorix dont tout le monde parlait ? L’autre lui répondit naturellement en latin, mais avec un fort accent qu’il identifia aussitôt. Quoiqu’il ne parlât pas la même langue chez lui, cet accent trahissait des origines identiques aux siennes. Il reconnut ses traits, le ton de sa peau, sa manière d’être toute phénicienne. Mais l’auxiliaire ne l’avait pas salué comme un compatriote et lorsque Magon l’informa qu’il était maltais, cela ne lui fit ni chaud ni froid. À peine en fut-il étonné. La romanisation était passée par là ; il était tout obéissant aux ordres et dévoué à César, tourné vers l’avenir, ignorant du passé. Lui n’avait sans doute pas grandi dans la haine de Rome ; il n’avait aucun compte à régler avec les Romains, n’attendait pas le retour d’une armée punique abandonnée dans un coin de l’univers et, pour cette raison, il s’était engagé dans les légions du vainqueur. Magon regarda son bâton, celui qu’il tenait de ses ancêtres, où étaient retracés des exploits oubliés de tous. Il en conçut une incompréhension, le renfonça dans ses bagages plus encore qu’il ne l’était. – Tu m’écoutes ?, demanda l’autre. – Excuse-moi, bien sûr. 379
– Je te disais que là, au bout du cortège, tu ne trouveras pas le dénommé Conconnétodumnus. On lui a réglé son compte. Sa dépouille a été portée à César, tellement écrasée sous nos talons qu’elle était à peine reconnaissable. L’autre, en revanche, l’autre, le fameux Cotuatus, on l’a eu et c’est lui que tu vas voir en clou du spectacle. Je ne comprends pas qu’un bonhomme comme ça nous ait causé tant de soucis. Peuh ! Un vieillard, tout sec comme une asperge desséchée, avec des trous au lieu des yeux qu’on dirait éclatés par une balle de ma fronde. Il paraît qu’il a gueulé, comme quoi il était pas celui qu’on croyait, qu’il était un truc appelé gutuachose. C’est quoi, ça, gutua-chose ? On lui a bien fait comprendre que les lâches dans son genre, ceux qui assumaient pas la défaite avaient chez nous double peine… – Gutuater… – C’est ça, rebondit l’autre, je crois bien que c’est ça. Magon se souvenait d’Itas, l’ancien juge de Sagéra qu’il avait entrevu dans la vision suscitée par Atis. Il savait que le gutuater n’était pas Cotuatos et il réfléchit à l’ironie absurde de la situation : – Mais peut-être que ce n’est réellement pas lui, hasarda-t-il, qu’il s’agit d’une méprise. Peut-être que celui que vous cherchiez aura changé ses vêtements et se sera enfui… L’autre le regarda subitement d’un air si méfiant que Magon crut devoir le rassurer. L’horrible druide, l’inverse en tout point du prêtre de Calroë, paierait donc pour ses actes. Le crime amenait le crime, l’injustice une autre injustice. Il ne pouvait rien faire pour le sauver ni ne le souhaitait d’ailleurs. – Pardonne-moi, j’invente toujours des hypothèses sans queue ni tête. Continue, je t’en prie. L’autre continua. On n’avait pas le temps ni l’envie d’élaborer des hypothèses. Que ce fût lui ou non, César avait besoin de décréter un coupable et il avait décidé que celui-là périrait pour l’exemple. Qui savait si c’était le vrai Cotuatos, ou si le vrai était mort, ou s’il s’était envolé dans le ciel comme Romulus enveloppé d’un nuage ! Et Magon pensait à son tour : qui savait s’il ne ressurgirait pas un an plus tard en se faisant passer pour le gutuater qu’il n’était pas, celui qu’il laissait présentement vouer au supplice, pour pouvoir continuer la lutte ? Peut-être qu’il ne tenait pas compte des institutions religieuses de son pays pour oser un tel sacrilège, qu’il fût sceptique ou qu’il préférât le lien direct avec la divinité. – De toute façon, se justifia l’auxiliaire, la foule n’a pas réagi à ce pseudo-titre et on a retrouvé personne, ni vivant ni crevé, pour être le rebelle à sa place ! Alors, à moins que tu en aies un autre dans ta sacoche, celui-là, c’est le bon. 380
Mais Magon avait trop le réflexe rationnel, il avait parcouru trop de contrées, rencontré trop de gens différents, connu trop de situations improbables a priori qui s’étaient révélées possibles et même logiques. Et il avait appris que ce qu’on croit savoir est souvent ce qu’on ignore, que les réactions de la foule sont souvent plus trompeuses qu’on ne le croit, que ce qu’on jurerait faux est le plus souvent la seule vérité envisageable. Alors il se garda d’acquiescer, eut un geste vague qui ne l’engagea en rien. Soudain il y eut un attroupement, presque une émeute sous la tente de César. Des cris aigus, perçants, retentirent. On entendit « vive Pompée ! Pompée ! » et ce dernier nom fut étouffé dans la cohue. Tout le monde se mit à courir vers le général dont on craignit pour la vie. Des ordres furent lancés au milieu d’un débordement d’insultes. On força la colonne de captifs à s’agenouiller tête basse ; on menaça du glaive et du pilum le premier qui bougerait. Des coups furent distribués, au plat de l’épée, sur les civils qui assistaient à la victoire. Magon fut violemment refoulé avec tous ceux dont la présence était seulement tolérée. Que s’était-il passé ? Il n’avait rien vu, avait jugé plus prudent de s’éloigner devant la colère subite des soldats. Et quand il revint après que les choses se furent calmées, il retrouva à la même place le frondeur baléare avec lequel il reprit sa discussion. L’homme souriait comme s’il avait maintenant la preuve de l’invincibilité de son général. – Qu’est-il arrivé ?, lui demanda Magon. – Oh, rien que l’ordinaire !, dit-il sans émoi. Un idiot a cru qu’il pourrait attenter à la vie de César sans comprendre qu’il est l’égal d’un dieu. Les Pompéiens, ça ne doute de rien ! Encore un ou deux longs-couteaux comme ça et ça finira mal, je te le dis. Heureusement, le général a évité le coup de justesse. Mais il est en colère et il n’y aura pas de clémence, tu peux me croire, parce que celui-là, il avait réussi à se faire écouter de lui, à rentrer dans ses faveurs. Un Bithynien, un certain Eumène. Je sais pas si je l’ai déjà croisé ; on dit qu’il ressemble à rien. Enfin, il aura voulu profiter de la victoire de César pour le frapper alors qu’il était au fait de sa gloire… – Et qu’il avait relâché toute prudence… Magon avait prononcé ces mots si naturellement qu’on eût dit qu’il les avait pensés au préalable. Derechef le soldat le foudroya du regard à tel point qu’il dut lui prouver son innocence. – C’est le signe de la victoire finale de César, dit-il simplement. Pompée a commencé de perdre à Génabum. L’autre rit et lui tapa l’épaule. – C’est très vrai ! Surtout que par une coïncidence inouïe, ce stupide attentat a eu lieu quand on a porté à César des notes qui provenaient d’un espion de Pompée et qu’on a retrouvées réchappées des flammes. 381
Les écrits d’Asinus, pensa Magon, à tous les coups ! Lui qui avait toujours soupçonné le rôle de son compagnon songea que l’homme étrange qu’il avait aperçu derrière César était bien celui avec qui le commerçant s’était entretenu la veille du massacre et à qui il devait certainement remettre ses informations. Jamais Pompée n’aurait le rapport de l’insurrection de Génabum, jamais il ne pourrait l’utiliser contre César. – Le coupable sera en tous cas soumis à la torture, poursuivit le Baléare. D’autant qu’en manquant César, il a frappé celui qui se tenait assis dans son ombre. Et pas n’importe qui. Un noble gaulois, le fils d’Acco le Sénon, un devin, paraît-il, un androgyne que celui qu’on appelle le bordel de Bithynie affectionnait. Il a reçu la lame en plein cœur ; il est tombé raide en poussant un cri de femelle. Magon écoutait. Duisto, c’était Duisto qui venait de mourir ainsi… Tout était arrivé si vite sans qu’il pût rien faire, sans qu’il en fût même témoin ; il s’entendait simplement rapporter les choses trop tard. Une immense pitié mêlée de nausée emplit son cœur. Cette fois, c’en était trop. Devant tant de sang versé, tant de sang qui continuerait de couler de manière insensée, il ne voulut plus de vengeance. Il préférait partir, quitter ce pays, cette ville maudite, la société des hommes. Oh ! La légion ne le retiendrait et il s’en irait, non pas forcément loin pour ne pas retraverser des pays de douleur, mais il s’isolerait au premier refuge trouvé. Le souvenir de Malte, peut-être suscité par la rencontre avec le Baléare, l’image de ce petit bout de rocher perdu au milieu des flots, venait de s’éveiller en lui avec la nostalgie de l’isolement. Il songea à Atis, au bonheur de vivre reclus dans la forêt. Il y avait maintenant Aldéa qu’il avait déjà quittée une fois et qu’il avait failli ne plus jamais revoir ; il ne pouvait renoncer à elle après tant d’événements. Sans même écouter la fin, il se détourna de son interlocuteur, s’oublia dans la contemplation de celle qu’il aimait. Il eut alors l’idée de lui consacrer désormais sa vie, la laisser devenir sa maîtresse, agir comme elle voudrait, être ce qu’elle désirerait, rendre à son tour son culte à Calroë. Déjà, quand il avait assisté à l’exécution de Sagéra, la Déesse lui avait semblé la seule à pouvoir racheter toutes les monstruosités qui l’avaient écœuré. Il en avait maintenant la certitude. Car renoncer à tout pouvoir de décision, à toute volonté au profit de sa bien-aimée, c’était une manière aussi de se retirer du monde et il devinait que c’était dans cette paix uniquement qu’il pourrait de nouveau être heureux, retrouver le goût de la vie, l’optimisme qui l’avait conduit jusqu’ici. Qui savait : peut-être se remettrait-il même à écrire, travaillerait-il le livre dont il rêvait et dont il changerait le plan pour ne plus le consacrer qu’à la matière des Gaules. L’amour seul offrait la complémentarité, l’abandon dont il avait besoin. 382
Mais elle, le comprenait-elle ainsi ? Assumerait-elle ce rôle qu’il venait d’entrevoir ? Il ne s’en était pas encore ouvert à elle. Il l’espérait ardemment. – Veux-tu t’en aller ?, demanda-t-il. – Emmène-moi. Nous irons… – Où tu m’ordonneras d’aller. – Jusqu’à ma ferme. Samogaion ne périra pas. Le ton était résolu. S’il avait ressenti le besoin immédiat et fort de s’éloigner de tout, de s’enfermer quelque part avec elle, il était clair qu’elle ne voudrait jamais renoncer à ses droits sur ce qu’elle avait hérité de son père et il n’aurait la prétention de l’y contraindre. Il connaissait maintenant l’état de sa ferme – proche du néant –, mesurait l’ampleur du défi qu’elle se fixait avec entêtement. Alors il proposa : – Voudras-tu que je t’aide à la reconstruire ? – Il le faut. Je dois continuer à régner dessus. C’est ma manière de vivre. Il la regarda avec de grands yeux, crut la revoir pour la première fois depuis longtemps, reçut une commotion définitive. Quelque chose dans son apparence, dans sa manière d’être lui indiquait qu’elle était une souveraine patente. Elle n’était déjà plus la créature fragile qu’il avait délivrée chez les Sénons et ramenée en Carnutie. Elle était redevenue la femme énergique, maîtresse de son bien et avait retrouvé son teint naturel, ses gestes évidents, ses paroles si fermes qu’elle en était despotique de simplicité. Au milieu du champ de ruines, elle incarnait la vie dans toute sa vigueur et elle ne s’émouvait aucunement de la défaite des Carnutes qui l’avaient tant fait souffrir. Ce n’était qu’un juste retour des peines. Magon reprit la bride de son cheval et de sa mule, leur fit faire demitour. Lui toujours marchant, elle sur la jument, ils sortirent de la ville sans encombre ; après tant de drames, on ne s’intéressait plus à eux. Ils allèrent tout droit, ne se retournèrent en aucune occasion, franchirent les portes sud-ouest où l’ultime massacre avait commencé. Magon quittait l’emporium des Carnutes par là où il y était entré la première fois. Il pressentait qu’il n’y reviendrait jamais, ne voudrait plus jamais y revenir parce que c’était le lieu de toutes les violences et qu’il ne voulait plus les côtoyer. Que d’aventures y avait-il connues en l’espace de quelques mois ! La rencontre d’Aldéa, l’observation de tout un peuple, l’enseignement d’Atis, la découverte de sa forêt ! Mais combien de morts aussi ! Combien de meurtres, de viols, de pillages ! Sur le chemin de halage, ils longèrent un temps le fleuve dont l’eau boueuse, sous la tranquillité d’une éclaircie et le scintillement des vagues, semblait plus sale, plus fourbe que jamais. Soudain, sans y avoir réfléchi, comme si sa pensée avait suivi un cheminement interne qui lui avait 383
échappé, il jeta son bâton – épée et fourreau –, ce bâton conservé depuis des générations par les siens, ce bâton si extraordinaire qui l’avait si souvent sauvé, qu’il s’était tant efforcé de protéger mais qui glorifiait la guerre et suscitait la convoitise. Il fallait bien cela, ne pas réfléchir pour avoir ce geste dément. Et il le vit flotter sur l’eau, se laisser ballotter au premier rapide, disparaître sous une vague un peu plus grosse que les autres, être avalé par la Loire. Avec lui l’orichalque et le bois exotique s’en allaient, retournaient peut-être au grand Océan d’où ils venaient à moins que quelqu’un ne les repêchât avant. Il n’eut aucun remords. Ils s’éloignèrent tout à fait dans la campagne lugubre. Tous les habitants avaient continué de se terrer au fond des bois, plus encore après cette nuit dont les cris d’horreur avaient dû retentir aux quatre coins du pays. Quelle ne fut pas sa stupéfaction alors quand, au croisement d’un chemin, il revit une dernière fois une figure familière : la jeune Gauloise aux tresses blondes qu’il avait délivrée en arrivant dans ce pays. De nouveau enceinte comme il le savait, son ventre s’était nettement arrondi. À l’heure de tant de morts, la vie continuait donc. Mais chargée de si grandes incertitudes, tant cette femme avait l’air triste et affamée ! Accoucherait-elle d’un enfant sain ? Pourrait-elle seulement l’élever ? Tout recommençait et il fallait s’en remettre à la Déesse pour ne pas désespérer de l’avenir après des désastres aussi graves. Ils se croisèrent, ne s’arrêtèrent pas. Comme la jeune femme l’avait aidé quand il était démuni, Magon lui tendit la moitié de la nourriture qu’il avait ramassée dans l’oppidum. Ils ne se dirent rien, esquissèrent à peine un sourire. Elle, qui savait à quoi elle pensait ; lui, ne voulait plus de contact avec elle pour ne pas attirer sur eux d’autres catastrophes. Un dernier chant lui vint qu’il déclama en reprenant sa marche : Elle est le lendemain de toutes peines, L’astre de vie au sein couleur de sang. Les rois d’hiver sont morts la nuit des haines, Règne aujourd’hui la reine de printemps. C’était la conclusion de tout ce qui était advenu. Et sous l’écho des paysages dépeuplés, sa voix s’éleva longtemps dans la campagne environnante.
384
Structures éditoriales du groupe L’Harmattan L’Harmattan Italie Via degli Artisti, 15 10124 Torino [email protected]
L’Harmattan Sénégal 10 VDN en face Mermoz BP 45034 Dakar-Fann [email protected] L’Harmattan Cameroun TSINGA/FECAFOOT BP 11486 Yaoundé [email protected] L’Harmattan Burkina Faso Achille Somé – [email protected] L’Harmattan Guinée Almamya, rue KA 028 OKB Agency BP 3470 Conakry [email protected] L’Harmattan RDC 185, avenue Nyangwe Commune de Lingwala – Kinshasa [email protected] L’Harmattan Congo 67, boulevard Denis-Sassou-N’Guesso BP 2874 Brazzaville [email protected]
L’Harmattan Hongrie Kossuth l. u. 14-16. 1053 Budapest [email protected]
L’Harmattan Mali Sirakoro-Meguetana V31 Bamako [email protected] L’Harmattan Togo Djidjole – Lomé Maison Amela face EPP BATOME [email protected] L’Harmattan Côte d’Ivoire Résidence Karl – Cité des Arts Abidjan-Cocody 03 BP 1588 Abidjan [email protected] L’Harmattan Algérie 22, rue Moulay-Mohamed 31000 Oran [email protected] L’Harmattan Maroc 5, rue Ferrane-Kouicha, Talaâ-Elkbira Chrableyine, Fès-Médine 30000 Fès [email protected]
Nos librairies en France Librairie internationale 16, rue des Écoles – 75005 Paris [email protected] 01 40 46 79 11 www.librairieharmattan.com
Lib. sciences humaines & histoire 21, rue des Écoles – 75005 Paris [email protected] 01 46 34 13 71 www.librairieharmattansh.com
Librairie l’Espace Harmattan 21 bis, rue des Écoles – 75005 Paris [email protected] 01 43 29 49 42
Lib. Méditerranée & Moyen-Orient 7, rue des Carmes – 75005 Paris [email protected] 01 43 29 71 15
Librairie Le Lucernaire 53, rue Notre-Dame-des-Champs – 75006 Paris [email protected] 01 42 22 67 13
Achevé d’imprimer par Corlet Numérique - 14110 Condé-sur-Noireau N° d’Imprimeur : 151287 - Septembre 2018 - Imprimé en France
Pour la liberté ! La présence romaine est devenue insupportable à beaucoup. La Gaule est en pleine ébullition. La plus grande insurrection qu’elle ait connue – celle de -52 – s’apprête à éclater à Génabum où la révolte se précise, emmenée par le noble Cotuatos. Après avoir fait sacrifier un innocent pour lancer son commerce, Asinus a enfin atteint la fortune et se rêve en maître du pays. Pendant ce temps, dans une forêt merveilleuse, Magon est initié par un druide au mystérieux culte d’une divinité oubliée. Qu’ils le veuillent ou non, leur destin est désormais lié à celui de la Gaule. Car les malheurs approchent. D’un massacre l’autre, l’antique Orléans va connaître une des pages sombres de son histoire qui la verra retrouver sa liberté et son honneur au risque de tout perdre face au retour des légions de César. Agrégé de lettres classiques, ancien étudiant de l’ENS et docteur ès lettres, Armand Cléry est passionné d’histoire locale. Dans son roman Le sang des Carnutes, il a choisi de retracer un célèbre épisode de l’histoire de France en ne le traitant qu’à la lumière du passé de sa ville, Orléans, pour lui restituer toute sa grandeur et sa force.
Illustration de couverture : © Tomasz Trybus - 123rf.com
ISBN : 78-2-343-15429-9
28 €
Armand Cléry
Tome 2
Tome 2
Armand Cléry
Le sang des Carnutes Tome 2
Le sang des Carnutes
Le sang des Carnutes
Pour la liberté !
Romans historiques Série Antiquité



![Mathématiques pour le physicien tome 2 [2, Ediscience]
2840740095, 2704211906](https://dokumen.pub/img/200x200/mathematiques-pour-le-physicien-tome-2-2-ediscience-2840740095-2704211906.jpg)

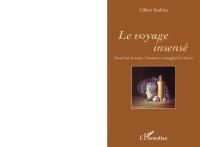
![Mathématiques pour le physicien : tome 1 [Ediscience]
2840740087, 2704211892](https://dokumen.pub/img/200x200/mathematiques-pour-le-physicien-tome-1-ediscience-2840740087-2704211892.jpg)



