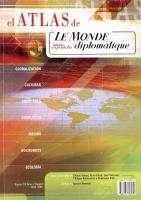Le capital déteste tout le monde. Fascisme ou révolution. 9782354801908, 2354801904
562 91 3MB
French Pages 136 [176] Year 2019
Polecaj historie
Citation preview
Maurizio Lazzarato
Le capital déteste tout le monde Fascisme ou révolution
Editions Amsterdam 2019
© Éditions Amsterdam, 2019 Couverture © Sylvain Lamy, Atelier 3Œil Tous droits réservés 15, rue Henri-Regnault, Paris www.editionsamsterdam.fr facebook.com/editionsamsterdam Twitter: @amsterdam_ed 75014
ISBN : 9 7 8 - 2 - 3 5 4 8 0 - 1 9 0 - 8
Diffusion-distribution : Les Belles Lettres
Sommaire
Introduction Des temps apocalyptiques
8
1.
Quand le capital s'en va-t-en guerre
18
2.
Machine technique et machine de guerre
92
3.
Devenir-révolutionnaire et révolution
158
Introduction
Des temps apocalyptiques
« Hors de la pensée de la limite, il n'est nulle stratégie, donc nulle tactique, donc nulle action, donc nulle pensée ou initiative véritable, donc nulle écriture, nulle musique, nulle peinture, nulle sculpture, nul cinéma, etc., possible. » Louis Althusser Nous vivons des temps « apocalyptiques », dans le sens littéral du mot - des temps qui manifestent, des temps qui font voir. Ce qu'ils dévoilent d'abord, c'est que l'effondrement financier de 2008 a ouvert une époque de ruptures politiques. L'alternative « fascisme ou révolution » est asymétrique, déséquilibrée : parce que nous sommes déjà à l'intérieur d'une suite, qui semble irrésistible, de ruptures politiques pratiquées par des forces néofascistes, sexistes, racistes ; parce que la rupture révolutionnaire est pour l'instant une simple hypothèse, dictée par la nécessité de réintroduire ce que le néolibéralisme a réussi à effacer de la mémoire, de l'action et de la théorie des forces qui se battent contre le capitalisme. C'est même sa victoire la plus importante. Ce que font aussi voir les temps apocalyptiques, c'est que le nouveau fascisme est l'autre face du néolibéralisme. Wendy Brown
6
Le capital déteste tout le inonde
affirme avec assurance une contre-vérité : « Du point de vue des premiers néolibéraux, la galaxie qui englobe Trump, le Brexit, Orban, les nazis au Parlement allemand, les fascistes au Parlement italien, fait virer le rêve néolibéral au cauchemar. Hayek, les ordolibéraux, ou même l'école de Chicago répudieraient la forme actuelle du néolibéralisme et surtout son aspect le plus récent'. » Ce n'est pas seulement faux d'un point de vue factuel, c'est aussi problématique pour comprendre le capital et l'exercice de son pouvoir. En effaçant la « violence qui a fondé » le néolibéralisme, incarnée par les dictatures sanguinaires d'Amérique du Sud, on commet une double faute politique et théorique : on se concentre uniquement sur la « violence qui conserve » l'économie, les institutions, le droit, la gouvernementalité - expérimentés pour la première fois dans le Chili de Pinochet - et l'on présente ainsi le capital comme un agent de modernisation, comme une puissance d'innovation ; d'autre part, on efface la révolution mondiale et sa défaite, qui sont pourtant l'origine et la cause de la « mondialisation » en tant que réponse globale du capital. La conception du pouvoir qui en découle est pacifiée : action sur une action, gouvernement des comportements (Foucault) et pas action sur des personnes (dont la guerre et la guerre civile sont les expressions les plus abouties). Le pouvoir serait incorporé dans des dispositifs impersonnels qui exercent une violence soft de manière automatique. Tout au contraire, la logique de la guerre civile qui se trouve au fondement du néolibéralisme n'a pas été résorbée, effacée, remplacée par le fonctionnement de l'économie, le droit, la démocratie. Les temps apocalyptiques nous font voir que les nouveaux fascismes sont en train de réactiver - bien qu'aucun communisme ne menace le capitalisme et la propriété - le rapport entre violence et institution, le rapport entre guerre et « gouvernementalité ». Nous i. Wendy Brown, « Le néolibéralisme sape la démocratie », AOC, 5 janvier 2019. En ligne : aoc.media/entretien/2019/01/05/wendy-brown-neoliberalismesape-democratie-2
Des temps apocalyptiques
7
vivons une époque d'indistinction, d'hybridation de l'État de droit et de l'état d'exception. L'hégémonie du néofascisme ne se mesure pas seulement à la force de ses organisations, mais également à la capacité qu'il a de déteindre sur l'Etat et sur le système politique et médiatique. Les temps apocalyptiques révèlent que, sous la façade démocratique, derrière les « innovations » économiques, sociales et institutionnelles, on trouve toujours la haine de classe et la violence de l'affrontement stratégique. Il a suffi d'un mouvement de rupture comme les Gilets jaunes, qui n'ont rien de révolutionnaire, ni même de prérévolutionnaire, pour que l'« esprit versaillais » se réveille, pour que ressurgisse l'envie de tirer sur ces « saloperies » qui menacent, ne serait que symboliquement, le pouvoir et la propriété. Lorsqu'il y a interruption du temps du capital, même un éditorialiste bourgeois peut saisir un peu du réel en train d'émerger : « L'empire actuel de la haine ressuscite des frontières de classe et de caste, parfois estompées depuis longtemps [...]. Et puis, cet acide de la haine qui ronge la démocratie et submerge soudain une société politique décomposée, déstructurée, instable, fragile, imprévisible. La haine antique ressurgissant dans la France trébuchante du xxic siècle. Sous la modernité, la haine'. » Les temps apocalyptiques manifestent également la force et les faiblesses des mouvements politiques qui, depuis 2011, essaient de contester la puissance sans partage du capital. Ce livre a été terminé pendant le soulèvement des Gilets Jaunes. Adopter le point de vue de la « révolution mondiale » pour lire un tel mouvement (mais aussi les Printemps arabes, Occupy Wall Street aux USA, le M15 en Espagne, les journées de juin 2013 au Brésil, etc.), voilà qui pourra sembler prétentieux ou halluciné. Et pourtant, « penser à la limite » signifie repartir non seulement de la défaite historique subie dans les années i960 par la révolution mondiale, mais également des « possibles non réalisés » qui ont été créés et portés par Alain Duhamel, « Le triomphe de la haine en politique », Libération, 9 janvier 2019.
12
Le capital déteste tout le inonde
les révolutions, de manière différente dans le Nord et dans le Sud, et qui sont encore timidement mobilisés dans les mouvements contemporains. La forme du processus révolutionnaire avait déjà changé dans les années i960, mais elle s'était heurtée à un obstacle insurmontable : l'incapacité d'inventer un modèle différent de celui qui avait ouvert, en 1917, la longue suite des révolutions du xxe siècle. Dans le modèle léniniste, la révolution avait encore la forme de la réalisation. La classe ouvrière était le sujet qui contenait déjà les conditions de l'abolition du capitalisme et de l'installation du communisme. Le passage de la « classe en soi » à la « classe pour soi » devait être réalisé par la prise de conscience et la prise de pouvoir, organisées et dirigées par le parti qui apportait de l'extérieur ce qui manquait aux pratiques « syndicales » des ouvriers. Or, depuis les années i960, le processus révolutionnaire a pris la forme de l'événement : le sujet politique, au lieu d'être déjà là en puissance, est « imprévu » (les Gilets jaunes sont un exemple paradigmatique de cette imprévisibilité) ; il n'incarne pas la nécessité de l'histoire, mais seulement la contingence de l'affrontement politique. Sa constitution, sa « prise de conscience », son programme, son organisation se font à partir d'un refus (d'être gouverné), d'une rupture, d'un ici et maintenant radical qui ne se satisfait d'aucune promesse de démocratie et de justice à venir. Bien sûr, n'en déplaise à Rancière, le soulèvement a ses « raisons » et ses « causes ». Les Gilets jaunes sont plus intelligents que le philosophe, parce qu'ils ont « compris » que le rapport entre « production » et « circulation » s'est inversé. La circulation, circulation de l'argent, des marchandises, des hommes et de l'information, prime désormais sur la « production ». Ils n'occupent plus les usines, mais les ronds-points, et s'attaquent à la circulation de l'information (la circulation de la monnaie étant plus abstraite, il faudra, pour l'atteindre, un autre niveau d'organisation et d'action). La condition de l'émergence du processus politique est évidemment la rupture avec les « raisons » et les « causes » qui l'ont généré.
Des temps apocalyptiques
13
Seule l'interruption de l'ordre existant, seule la sortie de la gouvernementalité pourront assurer l'ouverture d'un nouveau processus politique, car les « gouvernés », même lorsqu'ils résistent, sont le double du pouvoir, ses corrélats, ses vis-à-vis. La rupture avec le temps de la domination, en créant de nouveaux possibles, inimaginables avant leur apparition, constitue les conditions de la transformation de soi et du monde. Mais aucune mystique de l'émeute, aucun idéalisme du soulèvement n'est de mise. Les processus de constitution du sujet politique, les formes d'organisation, la production de savoirs pour la lutte, rendus possibles par l'interruption du temps du pouvoir, sont immédiatement confrontés aux « raisons » du profit, de la propriété, du patrimoine que le soulèvement n'a pas fait disparaître. Tout au contraire, elles sont plus agressives, elles invoquent immédiatement le rétablissement de l'ordre, mettant en avant sa police, tout en continuant, comme si de rien n'était, la mise en place des « reformes ». Ici, les alternatives sont radicales : soit le nouveau processus politique arrive à changer les « raisons » du capital, soit ces mêmes raisons le changeront. L'ouverture des possibles politiques se trouve confrontée à la réalité d'un double et redoutable problème, celui de la constitution du sujet politique et celui du pouvoir du capital, car la première ne peut avoir lieu qu'à l'intérieur du second. Les réponses données à ces questions par les Printemps arabes, Occupy Wall Street, les journées de juin 2013 au Brésil, etc., sont très faibles; les mouvements continuent à chercher et à expérimenter sans trouver de véritables stratégies. Ces impasses ne peuvent en aucune manière être dépassées par le « populisme de gauche » pratiqué par Podemos en Espagne. Sa stratégie réalise la liquidation de la révolution commencée dans l'après-68 par beaucoup de marxistes dont le marxisme avait échoué. La démocratie comme lieu des conflits et de la subjectivation remplace le capitalisme et la révolution (Lefort, Laclau, Rancière), au moment même où la machine du capital engloutit littéralement la « représentation démocratique ». L'affirmation de Claude Lefort, « en démocratie,
14
Le capital déteste tout le inonde
le lieu du pouvoir est vide », est démentie dès le début des années 1970 : ce lieu est occupé par le « souverain » sui generis qu'est le capital. Tout parti qui s'y installe ne peut fonctionner que comme son « fondé de pouvoir » (beaucoup se sont moqués de la « simplification » marxienne, mais elle a été complètement réalisée, de façon même caricaturale, par le dernier président de la République française, Emmanuel Macron). Le populisme de gauche donne une nouvelle vie à quelque chose qui n'existe plus. La représentation et le Parlement ne détiennent aucun pouvoir, celui-ci étant entièrement concentré dans l'exécutif, qui, dans le néolibéralisme, exécute non pas les ordres du « peuple » ou de l'intérêt général, mais ceux du capital et de la propriété. La volonté de politiser les mouvements de l'après-2008 se révèle réactionnaire, puisqu'elle impose précisément ce que la révolution des années i960 avait refusé et ce que refuse chaque mouvement qui a émergé depuis : le leader (charismatique), la « transcendance » du parti, la délégation de la représentation, la démocratie libérale, le peuple. Le positionnement du populisme de gauche (et sa systématisation théorique par Laclau et Moufïfe) empêche de nommer l'ennemi. Ses catégories (la « caste », « ceux d'en haut » et « ceux d'en bas ») sont à un pas de la théorie du complot et à deux pas de son aboutissement, la dénonciation de la « juiverie internationale » qui contrôlerait le monde par la finance. Ces confusions, soigneusement entretenues par les dirigeants et théoriciens d'un impossible populisme de gauche, continuent à parcourir les mouvements. Dans le cas des Gilets jaunes, elles sont entretenues par les médias et le système politique tout en exprimant le flou qui caractérise encore les modalités de la rupture. Il faut dire que, dans le désert politique contemporain, labouré par cinquante ans de contre-révolution, il n'est pas évident de s'orienter. Les limites du mouvement des Gilets jaunes, celles de tous les mouvements qui se sont déployés depuis 2011 sont évidentes, mais aucune force « extérieure », aucun parti ne peut se charger, comme l'avaient fait les bolcheviques, de montrer « quoi faire » et
Des temps apocalyptiques
15
« comment ». Ces indications ne peuvent venir que de l'intérieur, de manière immanente. L'intérieur est ici constitué, entre autres choses, par les savoirs, l'expérience, les points de vue d'autres mouvements politiques, car les luttes des Gilets jaunes, à la différence de la « classe ouvrière », n'ont pas la capacité de représenter tout le prolétariat, ni d'exprimer la critique de toutes les dominations qui constituent la machine du capitalisme. Le mouvement des « colonisés de l'intérieur », constitué sur la division Nord/Sud, qui reproduit un « tiers monde » au sein des pays du centre, implique nécessairement, en même temps que la critique de la ségrégation interne, celle de la domination internationale du capital, de l'exploitation mondiale de la force de travail et des ressources de la planète. Ce qui fait singulièrement défaut aux Gilets jaunes. Dénué de cette composante « raciale » et internationale du capitalisme, le mouvement donne quelquefois l'image d'un nationalisme « franchouillard ». Or aucune illusion sur l'espace national n'est possible : l'Etat-nation, au xix c siècle, a dû son existence à la dimension mondiale du capitalisme colonialiste et l'Etatprovidence la sienne à la révolution mondiale et à l'affrontement stratégique planétaire de la guerre froide. La fracture raciale dont étaient victimes les « colonisés » a divisé non seulement l'organisation mondiale du travail, mais même la révolution des années i960. Aujourd'hui, les conditions de possibilité d'une révolution mondiale résident, d'une part, dans l'invention d'un nouvel internationalisme, que les mouvements de néo-colonisés (les migrants, d'abord) incorporent presque physiquement et que les mouvements des femmes sont les seuls, actuellement, à mobiliser grâce à leurs réseaux à travers le monde ; et, d'autre part, dans la critique des hiérarchies capitalistes, qui ne doit pas se limiter à la sphère du travail. Les divisions sexuelles et raciales f structurent non seulement la reproduction du capital, mais également la distribution des fonctions et des rôles sociaux. Aujourd'hui, un mouvement axé sur la « question sociale » ne peut pas être spontanément socialiste comme aux xixe et xx e siècles,
16
Le capital déteste tout le inonde
car la révolution mondiale et sociale (impliquant l'ensemble des relations de pouvoir) est passée par là. Sans la critique des divisions raciales et sexuelles, le mouvement s'expose à toutes les récupérations possibles (de la part de la droite et de l'extrême-droite), auxquelles il a su, malgré tout, résister jusqu'ici. Si les subjectivités qui portent les luttes contre ces différentes dominations ne peuvent être réduites à l'unité du « signifiant vide » du peuple, comme le voudrait le populisme de gauche, le double problème de l'action politique commune et du pouvoir du capital reste entier. L'incapacité de penser ce dernier comme machine à la fois globale et sociale, dont l'exploitation et la domination ne s'arrêtent pas au « travail », est une des causes fondamentales de la défaite des années i960. De ce point de vue, la stratégie n'a pas changé : aujourd'hui comme alors, nous sommes loin d'en avoir une. Depuis 2011, les mouvements sont « révolutionnaires » quant aux formes de mobilisation (inventivité dans le choix de l'espace et du temps de l'affrontement, démocratie radicale et grande flexibilité dans les modalités d'organisation, refus de la représentation et du leader, soustraction à la centralisation et à la totalisation par un parti, etc.) et « réformistes » quant aux revendications et à la définition de l'ennemi (on a « dégagé » Moubarak, mais on n'a pas touché à son système de pouvoir, de la même manière qu'on concentre la critique sur Macron alors qu'il est simplement, sans aucun doute possible, une composante de la machine du capital). La rupture n'entraîne pas de changements notables dans l'organisation du pouvoir et de ja propriété, sinon dans la subjectivité des insurgés. Et si, à court terme, les mouvements sont défaits, les changements subjectifs continueront sûrement à produire leurs effets politiques. A condition de ne pas tomber dans l'illusion qu'une « révolution sociale » puisse se produire sans « révolution politique », c'est-àdire sans dépassement du capitalisme3. L'après-68 a démontré que 3. Samuel Hayat explique ainsi, à propos des Gilet jaunes : « On a [...] affaire à un mouvement révolutionnaire, mais sans révolution au sens étroitement politique : il s'agit plutôt d'une révolution sociale, au moins en devenir » (Samuel Hayat, « Les mouvements
D e s temps apocalyptiques
17
lorsque la révolution sociale se sépare de la révolution politique, elle peut être intégrée, sans aucune difficulté, dans la machine capitaliste comme nouvelle ressource pour l'accumulation du capital. Le « devenir-révolutionnaire » qu'inaugurent ces conversions subjectives ne peut pas être séparé de la « révolution », sous peine de devenir une composante du capital, donc de sa puissance de destruction et d'autodestruction, qui se manifeste aujourd'hui avec le néofascisme.
d émancipation doivent s'adapter aux circonstances », Ballast, 20 février 2019. En ligne : www.revue-ballast.fT/samuel-hayat-les-mouvements-demancipation).
I .
Quand le capital s ''en va-t-en guerre
« Le pouvoir d'une classe dominante ne résulte pas simplement de sa force économique et politique, ou de la distribution de la propriété, ou de la transformation du système productif: elle implique toujours un triomphe historique dans le combat contre les classes subalternes. » Michael Lôwy De Pinochet à Bolsonaro et retour L'élection de Bolsonaro à la présidence du Brésil marque une radicalisation de la vague néofasciste, raciste et sexiste qui balaye la planète. Elle a le seul mérite d'éclaircir, on espère définitivement, le sens politique de cette vague. La qualifier de « populiste » ou de « néolibérale-autoritaire » est une manière de se voiler la face. Si la victoire de Bolsonaro frappe les esprits, c'est parce qu'elle renvoie directement à l'acte de naissance politique du néolibéralisme, le Chili de Pinochet. Le gouvernement du Brésil, avec des généraux aux postes clés et un ministre de l'Economie et des Finances ultralibéral, élève des « Chicago Boys », est une mutation de l'expérimentation néolibérale construite sur les cadavres des milliers de militants communistes et socialistes au Chili et
20
L e capital déteste tout le inonde
dans toute l'Amérique latine. Milton Friedman, chef de file des Chicago Boys, rencontre Pinochet en 1975 ; Hayek, le chantre de la « liberté », est reçu au Chili en 1977. Il déclare que « la dictature peut être nécessaire » et que la « liberté personnelle est plus grande sous Pinochet que sous Allende ». Dans des « périodes de transition », où, de ce qu'on peut déduire de ces affirmations, on a le droit de massacrer ceux qui ne se soumettent pas à la liberté du marché, il est « inévitable que quelqu'un ait des pouvoirs absolus pour éviter et limiter tout pouvoir absolu à l'avenir ». Sur ces bases, pendant une décennie (1975-1986), les économistes néolibéraux bénéficient des conditions « idéales » pour expérimenter leurs recettes, l'écrasement de la révolution dans le sang ayant supprimé toute conflictualité, toute opposition, toute critique. D'autres pays d'Amérique latine ont suivi ces politiques « novatrices ». Des Chicago Boys ont occupé des postes clés en Uruguay, au Brésil et en Argentine. Avec la prise du pouvoir par Videla, responsable avec la junte militaire d'une autre tuerie, peut-être encore plus effroyable, les néolibéraux entrent dans le gouvernement des militaires et tentent de reproduire les politiques chiliennes de réduction massive des salaires, de coupes dans les dépenses sociales, entamant la privatisation de l'école, de la santé, des retraites, etc. Ces politiques ont été immédiatement reconnues et adoptées par la Banque mondiale sous le nom qui est resté le leur : « ajustements structurels ». Elles seront ensuite appliquées en Afrique, en Asie du Sud et n'arriveront que bien plus tard dans le Nord. Comment penser ces phénomènes ? La tradition d'analyse qui domine aujourd'hui, initiée par Michel Foucault, ignore complètement la généalogie sombre, sale, violente du néolibéralisme, où se côtoient militaires tortionnaires et criminels de la théorie économique. Le problème que cela pose n'est pas « moral » (l'indignation à l'égard de l'écrasement armé des processus révolutionnaires en Amérique latine), mais d'abord théorique et politique. La gouvernementalité, l'entrepreneur de soi, la concurrence, la liberté, la « rationalité » du marché, etc., tous ces beaux concepts que Foucault a
Quand le capital s'en va-t-en guerre
21
trouvés dans des livres et qu'il n'a jamais confrontés aux processus politiques réels (choix méthodologique assumé !), ont un présupposé jamais explicité, mais au contraire soigneusement effacé : la subjectivité du « gouverné » peut se construire seulement à la condition d'une défaite, plus ou moins sanguinaire, qui le fait passer du statut d'adversaire politique à celui de « vaincu ». L'Amérique latine est en la matière un cas d'école. Ses luttes font partie du cycle de la révolution mondiale de l'après-guerre contre le colonialisme et l'impérialisme, cycle qui a déstabilisé en profondeur le capitalisme et son économie-monde. Elles ont produit des niveaux d'organisation et de lutte incomparables, en intensité et en extension, avec l'Occident. A ces subjectivités révolutionnaires engagées dans un dépassement du capitalisme et de ses dominations, il aurait été impossible d'imposer ou de seulement proposer de se concevoir comme « capital humain », de s'impliquer dans la compétition de tous contre tous, de cultiver son égoïsme et de convoiter la « réussite » et le « succès » individuels. Jamais on n'aurait pu faire croire à cette subjectivité que si elle acceptait le marché, l'Etat, l'entreprise, l'individualisme, elle aurait « une prise sur sa propre vie », jamais on n'aurait pu la contrôler et la conduire individuellement vers la « réalisation de soi ». Les Américains, après qu'Allende eut gagné les élections et pris le pouvoir par la voie démocratique, ont décidé de détruire militairement ce processus et d'éliminer physiquement les révolutionnaires qui le portaient. C'est sur cette « table rase » subjective, au prix de milliers de morts, que les expérimentations néolibérales ont pu s'implanter, que les « vaincus » ont été rendus « disponibles » à un impossible devenir-entrepreneur de soi. Le néolibéralisme ne croit pas, comme son ancêtre, au fonctionnement « naturel » du marché; il sait qu'il faut, au contraire, continuellement intervenir, le soutenir par des cadres juridiques, des incitations fiscales, économiques, etc. Mais il y a un « interventionnisme » préalable qui s'appelle « guerre civile », seule chose à même de créer les conditions pour « discipliner » les « gouvernés » ayant
22
Le capital déteste tout le inonde
l'outrecuidance de vouloir la révolution et le communisme. C'est pour cette raison que les Chicago Boys se sont précipités comme autant de vautours sur l'Amérique latine. Il y avait là une subjectivité dévastée par la répression militaire, dont le projet politique avait été défait et sur laquelle on pouvait opérer « librement ». Cette histoire, rapidement disparue de la mémoire des pensées critiques, n'est pas une spécificité du néolibéralisme : avant lui, l'ordolibéralisme n'avait pu déployer ses recettes que sur des subjectivités allemandes anéanties par l'expérience nazie. Dans l'Occident de l'après-guerre, la lutte révolutionnaire n'a jamais atteint l'intensité et l'extension qu'elle a eues en Amérique latine et dans le « Sud global » (du Vietnam à l'Algérie, de Cuba au Congo, du Yémen à l'Angola, au Mozambique, etc.). Les organisations du mouvement ouvrier étaient complètement intégrées dans la gouvernementalité keynésienne, et les nouveaux sujets politiques apparus pendant la guerre froide se sont révélés incapables de penser et d'organiser un processus de rupture avec le capitalisme, de sorte que la défaite s'est produite de façon différente. Plus que dans le Sud, la « révolution impossible de 68 » a été à la fois anticapitaliste et anti-socialiste. Elle a vivement contesté l'action politique codifiée par les révolutions russe et chinoise, mais également les stratégies de la social-démocratie comme des partis communistes. Prise entre un modèle révolutionnaire qui était encore fondamentalement celui du xix e et une révolution pour le xxie siècle qu'elle n'a pas su inventer, elle s'est soldée par une défaite historique sans véritables affrontements stratégiques. Malgré l'étendue des conflits (millions de grévistes dans les usines, rébellions dans les écoles, révolte dans les familles et les hôpitaux psychiatriques, insubordination dans l'armée, etc.), les capitalistes et l'Etat n'ont pas été confrontés à de véritables révolutions. 11 a suffi à Thatcher de battre les mineurs, et à Reagan les contrôleurs aériens, pour que l'« ennemi » s'effondre. La rupture n'est pas venue de la multiplicité des mouvements de contestation (les tentatives révolutionnaires se sont développées à
Quand le capital s'en va-t-en guerre
23
la marge ou de façon isolée, comme en Italie où la répression a été immédiate et brutale), mais de l'entreprise, de l'Etat, des milieux conservateurs qui, à mesure qu'ils constataient qu'ils n'avaient pas affaire à des ennemis politiques, mais seulement à des contestataires, ' ont poussé toujours plus loin leur avantage en élaborant, en dix ans, une véritable théorie et pratique de la « contre-révolution ». Les méthodes n'étaient pas les mêmes que dans le Chili de Pinochet, Friedman et Hayek, mais les modes de gestion des pouvoirs exercés à partir de victoires diversement obtenues et sur des « vaincus » diversement défaits ont rapidement convergé. Les capitalistes et leurs Etats respectifs conçoivent toujours leurs stratégies (guerre, guerre civile, gouvernementalité) par rapport à la situation du marché mondial et aux dangers politiques qui s'y présentent. Ils les construisent au fil des conflits et les dosent selon les résistances, les oppositions, les affrontements qu'ils rencontrent. Mais il ne faut pas commettre l'erreur de séparer un Sud « violent » et un Nord « pacifié » : il s'agit du même capital, du même pouvoir, de la même guerre. Les néolibéraux, guidés par une haine de classe qui manque à leurs adversaires, ne se sont pas trompés en se mobilisant en Amérique latine. Non seulement parce que le capitalisme est immédiatement un « marché mondial », mais aussi parce que la révolution qui, pour la première fois dans l'histoire, s'est manifestée comme mondiale, avait dans le Sud ses foyers les plus actifs. Il fallait l'écraser comme préalable à toute « gouvernementalité », quitte à s'allier avec - donc à légitimer - des fascistes, des tortionnaires et des criminels. Chose que les libéraux (néo- ou pas) sont prêts à faire et à refaire à chaque fois que la « propriété privée » est menacée, même virtuellement. Au xxe siècle, le capital n'a pas été seulement confronté à la conflictualité du travail, mais aussi au plus grand et au plus intense cycle révolutionnaire de l'histoire. La révolution mondiale portait des nouveautés que les révolutionnaires n'ont pas su reconnaître, valoriser et organiser : la révolution ne dépend pas du développement des forces productives (travail, science, technique), mais du
24
L e capital d é t e s t e t o u t le i n o n d e
niveau et de l'intensité de l'organisation politique ; elle n'est pas non plus la chasse gardée de la classe ouvrière, car, depuis la Révolution française, une grande partie des révolutions victorieuses ont été menées par des « paysans ». Pour essayer de comprendre ce qui nous arrive, il faut remonter au début du xx e siècle. La citation de Michael Lôwy placée en exergue de ce chapitre est une synthèse fidèle et efficace de la pensée de Walter Benjamin, l'un des rares marxistes à avoir pleinement saisi la rupture représentée par les guerres totales et le fascisme. La définition qu'il donne du capitalisme élargit et radicalise celle de Marx, puisque le capital est pour lui à la fois production et guerre, pouvoir de création et pouvoir de destruction : seul le « triomphe sur les classes subalternes » rend possibles les transformations du système productif, du pouvoir, du droit, de la propriété et de l'État. Cette dynamique, nous la retrouvons au fondement du néolibéralisme, dont le « triomphe historique », dans lequel le fascisme joue encore une fois un rôle central, porte sur la « révolution mondiale ». Victoire sur des classes subalternes très différentes de celles que Benjamin avait à l'esprit - comme la plupart des marxistes européens d'alors, il avait du mal à apprécier l'importance de la lutte anticoloniale. Et pourtant, si Paris entre les deux guerres n'était plus, comme au xix e siècle, la capitale de l'époque, elle a joué un rôle déterminant dans les révolutions à venir en tant que « capitale du tiers-monde ». Dans le croisement des migrations asiatiques, africaines et sud-américaines, s'est formée la grande majorité des dirigeants qui ont conduit les luttes de libération nationale contre le colonialisme1, moteur de la révolution mondiale. Les guerres totales de la première moitié du xx e siècle ont transformé la guerre en guerre industrielle et le fascisme en organisation de masse de la contre-révolution. Nous avons derrière nous un i. Michael Goebel./torà, capitale du tiers monde. Comment est née la révolution anticoloniale (1919-1919), trad. fr. P. Stockman, Paris, La Découverte, 2017.
Quand le capital s'en va-t-en guerre
25
siècle qui nous permet d'affirmer que la guerre et le fascisme sont les forces politiques et économiques nécessaires à la conversion de l'accumulation du capital, chose qui n'était pas évidente à l'époque de Marx. Sans la guerre civile et le fascisme, sans la « destruction créatrice », pas de reconversion des dispositifs économiques, juridiques, étatiques, gouvernementaux. Depuis 2008, nous sommes entrés dans une nouvelle séquence de ce genre. Par conséquent, la différence entre mon analyse du néolibéralisme et celles de Foucault, de Luc Boltanski et Eve Chiapello ou de Pierre Dardot et Christian Laval, est radicale : ces auteurs effacent les origines fascistes du néolibéralisme, la « révolution mondiale » des années i960 - qui est donc loin de se limiter au 68 français - , mais aussi la contre-révolution néolibérale, cadre idéologique de la revanche du capital. Cette différence porte sur la nature du capitalisme que ces théories « pacifient » en effaçant la victoire politicomilitaire qui est la condition de son déploiement. Le « triomphe » sur les classes subalternes fait partie de la nature et de la définition du capital, au même titre que la monnaie, la valeur, la production, etc. La financiarisation des pauvres L'affrontement entre ennemis politiques du xx e siècle s'est terminé avec la victoire du capital, qui a transformé les vaincus en « gouvernés ». Une fois défaites et détruites les alternatives révolutionnaires, une fois accomplie la tabula rasa subjective, de nouveaux dispositifs ont pu établir de nouvelles normes pour conduire les hommes et les assujettir. A l'époque de la domination de la finance, le gouvernement des comportements n'inaugure pas une période de paix : les relations gouvernants/gouvernés, qui semblent se substituer à la guerre, la continuent en réalité par d'autres moyens. Quelques jours avant le second tour de la dernière élection présidentielle, une journaliste brésilienne, Eliane Brum, écrivait : « Quand nous commençons à discuter d'un projet original pour le pays, quand les Indiens, les Noirs et les femmes commencent à
26
L e capital d é t e s t e tout le i n o n d e
occuper de nouveaux espaces de pouvoir, le processus est interrompu. Quand nous commençons à jouir de la paix, la guerre reprend. Car, de fait, la guerre contre les plus fragiles ne s'est jamais arrêtée. Elle s'est adoucie, parfois, mais elle ne s'est jamais arrêtée. Cette fois, la perversion tient à ce que, jusqu'à présent, le projet autoritaire s'est installé avec les habits de la démocratie2. » Brum souligne une réalité que tout le monde semble refouler : la guerre n'a jamais cessé. Son intensité est seulement modulée selon les conjonctures de l'affrontement politique. De l'intérieur de ces relations « pacifiées », les contradictions du régime d'accumulation financiarisé et les luttes que mènent les gouvernés déterminent les conditions des nouvelles polarisations qui, à partir de la séquence politique initiée par l'effondrement du système financier en 2008, vont conduire à la rupture de la gouvernementalité établie avec Reagan et Thatcher. Au Brésil, nous pouvons suivre ce processus pas à pas : de la fin de la dictature à la mise en place des dispositifs d'une gouvernance financiarisée pendant les mandats de Lula et de Dilma Rousseff et, à partir de la crise de cette dernière, à des modalités inédites d'affrontement stratégique, cristallisées par l'élection de Bolsonaro. Ce que le Brésil laisse facilement voir, c'est l'incompatibilité radicale du réformisme avec le néolibéralisme, puisque ce dernier a été pensé, construit, voulu précisément contre l'expérience « keynésienne ». Nous allons analyser ces différentes séquences politiques d'un point de vue spécifique, celui des « politiques sociales » choisies par le capital financier pour imposer sa domination et qui se trouvent être exactement les mêmes que dans les pays du Nord3. 2. Eliane Brum, « Brésil : comment résister en ces temps de brutalité », La Règle du jeu, 17 octobre 2018. En ligne : laregledujeu.0rg/2018/10/17/34436/ bresil-comment-resister-en-des-temps-de-brutalite/ 3. Les développements qui suivent s'appuient sur le remarquable ouvrage de Lena Lavinas, The Takeover of Social Policy by Financialization: Tbe Brazilian Paradox, New York, Palgrave MacMillan, 2016 ; voir également Lena Lavinas, « How Social Developmentalism Reframed Social Policy in Brazil », New PoltticalEconomy, vol. 22, n° 6,2017.
Quand le capital s'en va-t-en guerre
27
Le Parti des travailleurs (PT) avait pour projet d'opérer une « redistribution » de la richesse fondée sur les « dépenses sociales » ; or il a fini par financiariser ces dernières et, en partie, par les privatiser. La transformation des pauvres et d'une fraction des salariés en « hommes endettés », qui se consolide et s'étend à partir du premier mandat de Lula, aura des conséquences redoutables après la crise de 2008. Un affrontement entre ennemis est à nouveau à l'ordre du jour, mais, après quarante ans de néolibéralisme, dans un cadre inédit : la rupture de la gouvernementalité est due à l'utilisation des institutions démocratiques par l'extrême-droite et à la grande faiblesse des mouvements anticapitalistes, incapables de se réorganiser et de définir une nouvelle stratégie et de nouvelles modalités d'organisation révolutionnaires. Un des piliers du « développementisme social » du P T - avec l'augmentation du salaire minimum, des salaires en général et la création de la Boisa familia (programme d'aide aux familles les plus pauvres) - a été le soutien à la consommation. Celle-ci a explosé grâce à l'accès des pauvres et des couches inférieures du salariat au crédit (l'autre pilier de ce développementisme était constitué par l'exportation des matières premières). Au cours du dernier cycle économique, le crédit semble devenu presque aussi important que les salaires pour stimuler la croissance de la demande. Si les salaires ont doublé, le crédit à la consommation a quadruplé - ce dernier compte pour près de 45 % dans la croissance du revenu des familles et pour un tiers dans la croissance du PIB. L'accès au crédit, qui avait comme but de réduire la pauvreté, a aussi fonctionné comme le cheval de Troie par lequel la financiarisation s'est introduite dans la vie quotidienne de millions de Brésiliens, notamment des plus pauvres (« l'inclusion par la finance »). La relation créditeur/débiteur est une technique permettant de conduire et contrôler les comportements qui est transversale aux groupes sociaux, puisqu'elle fonctionne autant avec le pauvre qu'avec le chômeur, le salarié, le retraité. Technique d'une efficacité redoutable, et qui déplace la lutte de classes sur
28
L e capital d é t e s t e tout le i n o n d e
un nouveau terrain, où les organisations de salariés ont du mal à se positionner4. La capture de nouveaux groupes sociaux (travailleurs, pauvres et travailleurs pauvres) dans le circuit de la dette a été facilitée par l'instauration par le gouvernement du P T du « credito consignado » : les banques prélevaient les intérêts de la dette directement sur les salaires, les retraites et les transferts de revenus, garantissant ainsi la finance contre les « risques ». Pour les banques, cela induisait une baisse des coûts qui a permis de réduire le prix des emprunts et ainsi d'élargir le circuit de la financiarisation. Le P T a réussi à imposer l'un des objectifs stratégiques du néolibéralisme : dans l'accumulation tirée par la finance, la « demande effective keynésienne » et la redistribution de la richesse par l'Etat doivent être progressivement remplacées par la privatisation des dépenses étatiques et des services sociaux (santé, éducation, assurance chômage, retraite, etc.). Le financement de ces dépenses est assuré par une création monétaire dévolue aux banques privées et aux institutions financières, qui multiplient les techniques pour faciliter l'accès au crédit. Le gouvernement de gauche a ainsi favorisé la réalisation d'un autre objectif, encore plus important, de l'agenda néolibéral : la privatisation de la création de monnaie, dont découlent toutes les autres privatisations. Cette stratégie de marchandisation des services sociaux constitue à la fois une machine de capture des richesses qui échappaient encore à la valorisation du capital financier, un dispositif redoutable de production d'un e subjectivité pour le marché et un projet de redéfinition des fonctions de l'Etat. Avec le remplacement croissant de la « demande effective » keynésienne et des politiques de redistribution par la privatisation des services et de la monnaie, la finance a pris, au Brésil comme ailleurs, le contrôle de la « reproduction sociale » et de son 4. Pour une analyse plus approfondie de la dette, voir mes livres La Fabrique de l'homme endetté (Paris, Amsterdam, 2011) et Gouverner par la dette (Paris, Les Prairies ordinaires, 2014).
Quand le capital s'en va-t-en guerre
29
financement. Ni le mouvement ouvrier, ni le mouvement féministe n'ont été capables d'opposer de véritables alternatives à cette appropriation/privatisation de la « reproduction » que les courants féministes appelant à la rémunération du travail domestique (« Wagesforbousework ») ont pourtant diagnostiquée comme stratégique depuis les années 1970. Lena Lavinas a très précisément décrit la syntonie du gouvernement du P T avec les directives des institutions financières de la gouvernance mondiale, qui, au moins depuis 2000, préconisent |'« inclusion par la financiarisation » et la stimulation de la croissance par le crédit à la consommation, qu'elles considèrent être les moyens les plus efficaces de lutte contre la pauvreté. Après l'effondrement financier de 2008, la Banque mondiale, le FMI, le G20 ont voulu accélérer le développement des « systèmes financiers inclusifs » pour réduire les inégalités et pour établir une « égalité des chances ». La démence autodestructrice - fond suicidaire du capital - , soigneusement occultée par une gauche qui lui attribue une puissance de progrès et de modernisation qu'il n'a jamais eue, se manifeste à nouveau : résoudre la crise grâce aux techniques financières qui l'ont produite. Mais la stratégie néolibérale n'est pas « économique » sans être en même temps subjective : « Les sciences économiques sont la méthode, le but est de changer les cœurs et les esprits », disait Margaret Thatcher. Les nouvelles politiques de protection sociale sont en rupture radicale avec les principes du welfare state de l'aprèsguerre puisqu'elles visent à « protéger les moyens de subsistance de base tout en encourageant la prise de risque » individuelle. Elles incitent les pauvres à transformer leur comportement pour se rendre capables d'assumer individuellement les risques que l'endettement comporte. Les « risques sociaux » qui avaient été pris en charge de manière collective, d'abord par la mutualisation ouvrière, ensuite par le welfare state, doivent maintenant être endossés par l'individu (le welfare, bien qu'il soit un moyen de contrôler les travailleurs en
30
L e capital déteste tout le inonde
étatisant les modalités de la solidarité entre eux, gardait malgré tout le principe de la socialisation des risques). Cette couverture des risques sociaux par le risque individuel de l'endettement est conçue par les institutions financières comme une technique d'assujettissement, les remboursements réguliers imposant aux emprunteurs une discipline, une forme de vie, une manière de penser et d'agir. Un tel contrôle de soi est essentiel aux yeux de la Banque mondiale pour transformer le pauvre en entrepreneur à même de gérer l'irrégularité de ses flux de revenu grâce au crédit. Ces nouvelles techniques de gouvernementalité, très différentes des dispositifs de pouvoir fordistes, sont censées créer les conditions (incitations économiques, abattements fiscaux, etc.) pour orienter les « choix » des individus vers le privé à travers une ingénierie sociale micropolitique qui est fondamentalement financière : plutôt que de fournir des services, il faut distribuer de l'argent ou, mieux encore, du crédit que l'individu dépensera sur le marché des prestataires de services ouvert à la concurrence. Ainsi l'usager social se transforme-t-il en client endetté. Le P T a aussi réalisé, à son insu, un autre élément du programme néolibéral qui s'est rapidement retourné contre lui : la reconfiguration de l'Etat et de ses fonctions. Loin des néolibéraux l'idée d'un « État faible », d'un Etat minimum, encore moins d'une « phobie de l'Etat ». Tout au contraire, la privatisation des services doit libérer l'Etat de la pression que les luttes sociales exerçaient sur ses dépenses. Au lieu d'être le lieu de l'exercice de la souveraineté, nécessaire au bon développement de la propriété privée, le système politique a été investi pendant toute la guerre froide par des revendications qui ont sapé l'autorité de l'Etat et étendu ses fonctions administratives (c'est le sens du rapport de la Commission trilatérale de 197s5)Privatiser l'« offre » de services signifie enlever à la « demande sociale » sa dimension politique et sa forme collective. L'Etat, une 5. Michel Crozier, Samuel HuntingtonetJojiWatanuki, Tbe Crisisof Democrocy: On tbe Govemability of Démocraties, New York, New York University Press, 1975.
Q u a n d le capital s'en va-t-en guerre
31
fois débarrassé des « attentes », des droits et de l'égalité que les luttes portent avec elles, pourra assumer les fonctions que le néolibéralisme prévoit pour lui : il deviendra « un Etat fort, pour une économie libre », « un État fort avec les faibles (les non-possédants) ' et faible avec les forts (les propriétaires) ». Il ne doit pas devenir minimum, mais organiser et gérer des « services minimums », c'est- 1 à-dire assurer une couverture minimale des risques, car le reste doit être acheté sur le marché des assurances. Ceux qui ne tiennent pas le rythme de la concurrence, ceux qui tombent en dehors du marché du travail, ont à disposition un « minimum » duquel ils pourront repartir pour entrer à nouveau dans la concurrence de tous contre tous (workfare). D'autre part, c'est l'Etat lui-même qui doit travailler à cette transformation, en sous-finançant les services, en les laissant se dégrader et en mettant en place des politiques fiscales qui encouragent le recours au crédit. C'est en effet ce que l'Etat brésilien a réalisé progressivement. Au Brésil, pendant les mandats de Lula, les conséquences ont été redoutables : endettement, individualisation et dépolitisation, sans que la « croissance » et la redistribution ne modifient, même marginalement, la structure de classe. L'inclusion par la finance n'a pas subverti les structures sociales et productives fortement inégalitaires, elle les a, au contraire, reproduites, car la distribution par le crédit n'a produit qu'un « consumérisme superficiel ». Lavinas remarque qu'« en seulement une décennie, la propriété de biens durables tels que les téléphones portables, les téléviseurs couleur et les réfrigérateurs est devenue presque universelle », quel que soit le niveau de revenu disponible, tandis que Perry Anderson souligne les limites de cette stratégie consumériste : « On a négligé l'approvisionnement en eau, les routes pavées, les autobus efficaces, une évacuation acceptable des eaux usées, des écoles et des hôpitaux décents. Les biens collectifs n'ont aucune priorité idéologique ni pratique6. » Les grandes mobilisations de 2013, qui se sont développées en 6.
Perry Anderson, « Crisis in Brazil », London Reviea ofBooks, avril 2016.
32
Le capital déteste tout le inonde
dehors du P T et contre lui, étaient la manifestation de la frustration, de la colère, de la déception à l'égard des résultats de ces politiques sociales. Les revendications visaient précisément la dégradation des transports, des services de santé, de l'éducation. Elles ont signé l'arrêt de mort du « réformisme soft » du PT. Le P T a scié la branche sur laquelle il était assis parce que ses politiques de « redistribution » ont créé un individualisme dépolitisant qui était en fait le but politique recherché par les néolibéraux. Selon Anderson, « [l]es pauvres restaient des bénéficiaires passifs du pouvoir du PT, qui ne les avait jamais éduqués ni organisés, et encore moins mobilisés comme force collective. La redistribution était là, élevant sensiblement le niveau de vie des plus démunis, mais elle était individualisée. » Lavinas surenchérit, en donnant de l'expérience du P T une définition que l'on pourrait synthétiser ainsi : le socialisme de la carte de crédit. « Une fois au pouvoir, le Parti des travailleurs a estimé qu'il était possible de refonder la nation en créant de nouvelles identités sociales, reposant non sur des liens d'appartenance collective ou de solidarité communautaire, mais plutôt sur un accès au crédit, un compte bancaire personnel ou une carte de crédit. » L'illusion d'une croissance (ou, plus exactement, d'une accumulation du capital) qui ne ferait que des vainqueurs, capable de réconcilier les classes en les mobilisant pour le projet d'un grand Brésil, s'est brisée sur les conséquences de l'effondrement financier de 2008 et sur les inconsistances internes à un projet de redistribution fondé sur la finance (mais aussi sur la baisse des prix des matières premières du capitalisme « extractif », que Bolsonaro va relancer en amplifiant le processus de déforestation de l'Amazonie, que le P T a lui-même favorisé). Le néolibéralisme n'est pas arrivé à la fin des mandats de Lula; l'ironie a voulu qu'il soit cultivé par le Parti des travailleurs. Le capital entretient par ailleurs d'excellents rapports avec les institutions du mouvement ouvrier, puisque la financiarisation aurait été inconcevable sans les « fonds de pension » des salariés américains
Quand le capital s'en va-t-en guerre
(enseignants,
33
fonctionnaires, ouvriers, etc.), grands investisseurs
institutionnels en bourse. Mais dès qu'il y a danger, celui-ci fut-il créé par le capital luimême, se reconstruisent les alliances de la finance, internationale et nationale, du fascisme, des propriétaires terriens de l'agrobusiness, des militaires et des religieux (les catholiques réactionnaires à l'époque de la dictature, aujourd'hui les évangélistes), dans la très classique stratégie que les néolibéraux n'ont eu aucun problème à légitimer. À côté de ces mouvements du grand capital, la révolte et la volonté de vengeance des élites blanches et des classes moyennes supérieures ont trouvé l'espace politique pour se manifester. La haine de classe suscitée par un ouvrier président, par les quotas garantissant l'inscription des Noirs à l'université ou par l'obligation d'établir un contrat de travail aux femmes de ménage (rigoureusement non blanches) s'est exprimée à l'occasion de l'échec des politiques économiques. Mais il n'est pas à exclure que les affects tristes de l'homme endetté, à la fois coupable et frustré, peureux et isolé, angoissé et dépolitisé, ont aussi rendu disponibles à des aventures fascistes une partie des pauvres et des salariés. La micropolitique du crédit a créé les conditions d'une micropolitique fasciste. Les affrontements stratégiques reviennent donc à l'ordre du jour après que la folie des recettes néolibérales a échoué partout, et pas seulement au Brésil. Mais cette rupture de la gouvernementalité trouve complètement impréparés les mouvements politiques, qui depuis 1985, année de la fin de la dictature, ont négligé de penser les nouvelles conditions de la guerre, de la guerre civile et de la révolution. La pensée stratégique, qui constituait un atout des mouvements révolutionnaires aux xix e et xx e siècles, est ce qui fait complètement défaut à la vague planétaire des mobilisations de 2011, dans laquelle s'inscrit le mouvement brésilien de 2013. L'expérience de l'Amérique latine à l'époque du néolibéralisme s est construite sur un grand malentendu quant au « réformisme ».
34
Le capital déteste tout le inonde
Le « réformisme » n'est pas une alternative à la révolution car il dépend de sa réalité ou de sa menace (une révolution possible). Sans mise en danger réelle du capitalisme, pas de « réformisme ». Les mouvements politiques du xix e siècle, socialistes, anarchistes, communistes, poursuivaient tous le dépassement et la destruction du capitalisme. Malgré les défaites « politiques » sanglantes subies tout au long du siècle, les conquêtes sociales progressaient. La Révolution russe a porté à son accomplissement ce cycle de luttes et, malgré son échec politique, elle a œuvré, avec le cycle des révolutions anticoloniales, à la conquête de nouveaux droits, y compris en Occident (le welfare, le droit du travail, etc.). Les mouvements politiques contemporains sont très loin de menacer l'existence du capital, de sorte que, depuis quarante ans, les défaites économicosociales équivalent à des défaites politiques. L'Amérique latine se réveille d'un rêve : pouvoir pratiquer le réformisme sans la possibilité de la révolution, sans que celle-ci, ou sa potentialité, constitue une menace pour la survie du capitalisme. Penser réduire la pauvreté et améliorer la situation des ouvriers et prolétaires à travers les mécanismes de la « finance » était plus qu'une naïveté ou qu'un « paradoxe » : c'était une perversion. On ne peut faire du « crédit » un simple instrument, adaptable à n'importe quel projet politique, puisqu'il constitue l'arme la plus abstraite et la plus redoutable du capitalisme. Comme toujours, la financiarisation, introduction du « sans-limite » (de l'infini) dans la production, a débouché sur une crise économique et politique. Et comme toujours, les crises financières ont ouvert une phase politique marquée par la logique de la guerre ou, plus précisément, par la remontée de guerres de classe, de race et de sexe qui, depuis le début, sont au fondement du capitalisme.
Quand le capital s'en va-t-en guerre
35
Les nouveaux fascismes « Si les conservateurs [américains] acquièrent la conviction qu'ils ne peuvent pas gagner démocratiquement, ils n'abandonneront pas le conservatisme. Ils rejetteront la démocratie. » David Frum Les nouveaux fascismes ont conquis l'hégémonie politique d'une double manière, en déclarant une « rupture » avec le « système » néolibéral (plus en paroles que dans les faits) et surtout en désignant l'immigré, le réfugié, le musulman comme l'ennemi. Les polarisations politiques que les inégalités de classe ne cessent d'alintenter, notamment depuis 2008, sont, à travers le racisme, recomposées dans un « peuple » fantasmatique mais « réel », qui prend forme et identité en s'opposant à un ennemi commun. La guerre, comme le racisme, le fascisme et le sexisme, change, se transforme. Après quarante ans de politiques néolibérales, ce qui vient ne sera pas une simple répétition de l'entre-deux-guerres. Le néofascisme résulte d'une double mutation : du fascisme historique, d'une part, de l'organisation et de la violence contrerévolutionnaires, d'autre part. Ce phénomène, beaucoup l'appellent hypocritement « populisme ». Les raisons de « ne pas voir » sont profondes, enracinées dans les modalités de la production et de la consommation capitalistes7. Le fascisme contemporain est une mutation du fascisme historique dans le sens qu'il est national-libéral plutôt que nationalsocialiste. Les mouvements politiques issus de 68 sont aujourd'hui tellement faibles qu'il n'est même pas nécessaire de reprendre leurs 7- Par exemple, l'alliance sortie des élections italiennes de 2018 entre le Mouvement 5 étoiles (populiste) et la Ligue (fasciste) démontre toute l'inconsistance politique du populisme. Elle a permis aux néofascistes de la Ligue non seulement d'accéder au gouvernement, mais aussi de devenir, en quelque mois, le premier parti italien. Il suffit a Salvini, ministre de l'Intérieur membre de la Ligue, d'énoncer les mots magiques « les portes sont fermées » (aux migrants) pour rendre inaudible toute velléité politique exprimée par le Mouvement 5 étoiles. Le populisme (y compris « de gauche ») ouvre et préparé l'accès au pouvoir des nouveaux fascismes.
36
Le capital déteste tout le inonde
revendications en les détournant, comme le firent les fascistes et les nazis dans les années 1930. A l'époque, « socialiste » avait dans leur bouche précisément ce sens et cette fonction : intégrer les revendications auxquelles la dictature enlevait toute portée révolutionnaire. Rien de tel dans le nouveau fascisme qui, au contraire, est ultra-libéral. Il est pour le marché, l'entreprise, l'initiative individuelle, même s'il veut un Etat fort, d'une part, pour « réprimer » les minorités, les « étrangers », les délinquants, etc., et, d'autre part, comme les ordolibéraux, pour littéralement construire le marché, l'entreprise et surtout la propriété. Il utilise la démocratie, qui, sans la poussée égalitaire des révolutions, est une coquille vide se prêtant à toutes les aventures. Le régime parlementaire et les élections lui conviennent parfaitement, car dans ces conditions, elles lui sont favorables. Son racisme est « culturel ». Il n'a plus rien de « conquérant » ni d'impérialiste, comme à l'époque des colonisations : il préférerait se replier dans les limites de l'Etat-nation. Il est plutôt défensif, peureux, angoissé, conscient que l'avenir n'est pas de son côté. L'antisémitisme a laissé place à la phobie de l'islam et de l'immigré. Le fascisme historique était une des modalités d'actualisation de la force destructive des guerres totales ; celui qui est en train de grandir sous nos yeux, au contraire, est une des modalités de la guerre contre la population. Le nouveau fascisme n'a même pas à être « violent », paramilitaire, comme le fascisme historique lorsqu'il s'agissait de détruire militairement les organisations ouvrières et paysannes, car les mouvements politiques contemporains, à la différence du « communisme » entre les deux guerres mondiales, sont très loin de menacer l'existence du capital et de sa société : ces dernières décennies, il n'y a eu de mouvements politiques révolutionnaires ni aux USA, ni en Europe, ni en Amérique latine, ni en Asie. Le fascisme historique, une fois anéanties les forces révolutionnaires, a été l'agent d'un processus de « modernisation » (Gramsci) qui, « intégrant » le socialisme, a réprimé par la violence toute
Quand le capital s'en va-t-en guerre
37
manifestation de conflictualité. En Italie, il a restructuré l'industrie traditionnelle et créé l'industrie du cinéma, réformé l'école et le code civil (encore en vigueur aujourd'hui) et instauré un welfare state (chez les nazis, ce dernier était encore plus « radical » que celui des États-Unis). Avec les nouveaux fascismes, l'agenda reste celui du néolibéralisme, mâtiné de nationalisme. La recomposition du peuple autour de son unité fantasmatique est fortement perturbée par l'action des subjectivités gays, lesbiennes, transgenres qui échappent au modèle majoritaire que la nostalgie des néofascistes voudrait reconstruire autour de l'hétérosexualité. La montée des forces néofascistes s'accompagne toujours de campagnes de « haine » féroce contre la prétendue « théorie du genre ». La reconstruction de la famille et de l'ordre hétérosexuel constitue l'autre puissant le vecteur de la subjectivation fasciste. Ce que l'ancien et le nouveau fascismes partagent, c'est un fond d'autodestruction et un désir suicidaire que le capital leur a transmis : ce dernier n'est pas « production » sans être en même temps « destruction » et « autodestruction ». Après le suicide de l'Europe dans la première moitié du xx e siècle, où le capitalisme avait atteint le plus haut degré de développement de ses forces productives, sommes-nous en train d'assister à celui de l'Amérique, où ces dernières ont dépassé un autre seuil de croissance ? Il y a en tout cas une continuité, un air de famille qui traverse le capital et le fascisme, que le xx c siècle a mis au jour et que le xxie siècle propose à nouveau, sous de nouvelles formes. L'évolution de cette vague fasciste est difficile à prévoir : elle est caractérisée par des différences internes remarquables - Erdogan et Bolsonaro, d'un côté, les néofascismes européens, de l'autre, et Trump entre les deux. Ce qu'on peut affirmer avec certitude, c'est que les fascismes historiques n'ont pas résolu les contradictions et les impasses du capital. Ils les ont au contraire exaspérées et, ainsi, ils ont conduit le monde vers la Seconde Guerre mondiale. Trump est en train de déstabiliser le capitalisme néolibéral, en voulant accélérer la dérégulation de la finance, renforcer les monopoles
38
Le capital déteste tout le inonde
des entreprises américaines (notamment du numérique), réduire les impôts dans l'intérêt d'une « ploutocratie », tout en prétendant protéger les victimes de ces mêmes dérégulations et monopoles (la classe ouvrière blanche). Pour ne rien dire de sa politique étrangère. La renaissance des fascismes en Europe ne date pas d'aujourd'hui. Elle est parallèle aux débuts du néolibéralisme (tandis qu'en Amérique latine, le fascisme a été sa condition de possibilité), car la dénonciation du compromis fordiste des « Trente Glorieuses » requérait de nouvelles modalités de division, de contrôle et de répression. Incitée, sollicitée, organisée par l'État, la gestion du racisme, du sexisme, du nationalisme est ensuite passée entre les mains des nouveaux fascismes. Dans l'optique de Foucault, il n'y a aucune difficulté à comprendre leur prolifération mondiale : d'une certaine façon, les fascismes sont là depuis toujours, ils font partie de l'organisation de l'État et du capital. Foucault appelle cela des « excroissances du pouvoir », qui existent virtuellement, « en permanence dans les sociétés occidentales », qui sont « en quelque sorte structurales, intrinsèques à nos systèmes et peuvent se révéler à la moindre occasion, les rendant perpétuellement possibles8 ». Il cite, à titre d'« exemples incontournables », « le système mussolinien, hitlérien, stalinien», mais aussi le Chili et le Cambodge. Le fascisme n'a fait que prolonger « une série de mécanismes qui existaient déjà dans le système social et politique de l'Occident ». Mais si Foucault a bien saisi le rapport entre État et fascisme, il n'a pas vu leur lien avec le capital, qui fait de l'un et de l'autre des composantes de sa machine de guerre. Il ne s'agit pas seulement de dire comme Primo Levi que si les fascismes, le nazisme ont eu lieu, ils peuvent se produire à nouveau, mais d'affirmer que les fascismes, le racisme, le sexisme et les 8. Michel Foucault, « La philosophie analytique et la politique » (1978), Dits et Ecrits, t. II, Paris,Gallimard,2001,p.536.
Quand le capital s'en va-t-en guerre
39
hiérarchies qu'ils produisent sont inscrits de façon structurelle dans les mécanismes de fonctionnement de l'accumulation capitaliste et des États. Les fascistes et l'économie Les libéraux « progressistes » et « démocrates » n'en reviennent pas de l'alliance de certains secteurs des affaires, et d'abord de la finance, avec les nouveaux fascismes. On ne peut s'étonner du « retour » du fascisme dans le néolibéralisme que si l'on fait du premier une exception et si l'on fait l'impasse sur son acte de naissance politique. On ne peut s'étonner du « retour » de la guerre que la financiarisation porte toujours avec soi que si l'on persiste à concevoir le capital comme un simple « mode de production ». Il n'y a aucune incompatibilité entre les dictatures et le néolibéralisme. Les néolibéraux sont sans ambiguïté à ce propos. Le libertarien Von Mises déclarait que le fascisme et les dictatures ont sauvé la « civilisation européenne » (par quoi il entendait la propriété privée), mérite qui, selon lui, resterait à jamais gravé dans l'histoire. Quant à l'ineffable Hayek, il préférait une « dictature libérale » à une « démocratie sans libéralisme », au nom d'une propriété privée synonyme de liberté. Pinochet la garantissait ; Allende, ce n'était pas si sûr. Contrairement à une opinion largement partagée et difficile à éradiquer, les fascismes ne constituent pas des obstacles à l'économie, au commerce, à la finance. Dans les débats du Parlement français avant 1914 résonnaient les mêmes argumentations qu'aujourd'hui : la guerre est impossible car les interdépendances entre les économies nationales sont trop fortes; la mondialisation a pénétré trop profondément dans la production et le commerce pour que la guerre soit possible. On connaît la suite! Après la Première Guerre mondiale, le fascisme italien a gardé de bons rapports avec Wall Street, malgré l'« autarcie » économique dont il se revendiquait et bien que les USA, sous la pression d'une xénophobie montante, aient imposé des quotas d'immigration qui ont particulièrement affecté le régime mussolinien.
40
Le capital déteste tout le inonde
« Nationalisme », autarcie, xénophobie, ne concernent que la gestion interne des différentes populations des différents pays et n'interviennent que marginalement dans les affaires économiques à l'échelle planétaire. Même si les conjonctures sont différentes, la leçon de l'entre-deux-guerres peut être utile encore aujourd'hui. « Les politiques de développement économique national sont loin d'être incompatibles avec la promotion du commerce international et des réseaux financiers. Il faut prendre au sérieux le "national" dans "international". Les élites du monde des affaires de l'Italie n'ont jamais envisagé le développement de leur pays séparément de l'économie mondiale. L'effet immédiat de la Première Guerre mondiale n'est pas tant de donner libre cours à la démondialisation, que de reconfigurer les échanges économiques internationaux9. » Hoover et Roosevelt, comme du reste Churchill, s'expriment très favorablement sur Mussolini, qui remet de l'ordre, « modernise » l'industrie et le pays, et éloigne le danger bolchevique, seul vrai problème pour toutes les élites capitalistes. « L'accord sur les dettes de guerre négocié en 1925 est le plus généreux que l'Amérique ait conclu avec ses alliés [...]. Les investissements américains en Italie dépassent rapidement les 400 millions de dollars. » Lorsque le président Hoover veut relancer une gouvernance mondiale, l'Italie fasciste est un des partenaires privilégiés. L'harmonie des années 1920 entre libéraux, finance et fascisme n'est pas rompue à cause de l'intensification de la dictature fasciste, mais par la crise de 1929. Adam Tooze fait remarquer que l'histoire du rapport de la « démocratie » et de la finance avec le fascisme a été réécrite et falsifiée au cours de la guerre froide, pour « passe |r] sous silence le fait que, dès 1935, des institutions aussi importantes que J P Morgan collaborent étroitement avec des hommes qui sont désormais traités comme des criminels fascistes10 ».
9. Adam Tooze, « Quand les américains aimaient Mussolini », Esprit, mai 2017. 10. lbid., p. 68-69.
Quand le capital s'en va-t-en guerre
41
Encore une fois, il faut s'adresser à Hayek et aux raisons qu'il avance pour légitimer les fascismes. La dictature - il parle là de Pinochet - démantèle les « libertés politiques » et laisse proliférer les « libertés personnelles » (la liberté de l'économie, la liberté d'acheter et de vendre, d'entreprendre, et surtout la liberté de la finance d'investir, de spéculer, d'opérer des pillages à travers la rente). Le seul danger, historiquement avéré, est celui de l'autonomisation des politiques fascistes, qui peuvent se constituer en machines de guerre indépendantes et autodestructrices; mais il s'agit d'un risque que les capitalistes et les libéraux n'ont pas hésité à courir quand la propriété privée a été en danger et qu'ils n'hésiteront pas à courir à chaque fois qu'ils le jugeront nécessaire. Le capital n'est pas seulement économie, mais également pouvoir, projet politique, stratégie des affrontements politiques, ennemi juré des révolutions politiques menées par ses « esclaves » (ouvriers, pauvres, femmes, colonisés). Contrairement à une autre idée reçue, le capital n'est pas « cosmopolite », et sa déterritorialisation, son indifférence aux territoires et à ses frontières, est toute relative. Son objectif est de développer les forces productives, mais, uniquement à condition qu'elles produisent du profit. Cette condition (Marx l'a clairement exposé) est en évidente contradiction avec le développement « en soi » de la science, du travail, de la technologie, etc. Le profit impose que la reterritorialisation qui assure son existence se réalise à travers l'Etat-nation, le racisme, le sexisme et, le cas échéant, la guerre et les fascismes, seuls capables d'assurer politiquement la continuation de l'expropriation et la spoliation lorsque la situation se durcit. Il est naïf de croire que la subordination des forces productives au profit soit purement immanente au fonctionnement de l'économie, du droit, de la technique. Sans Etat, sans guerre, sans racisme, sans fascisme, pas de profits. Le « triomphe » sur les classes subalternes ne s'est pas produit une fois pour toutes, il doit être continuellement répété, reproduit.
42
Le capital déteste tout le inonde
Le racisme contemporain, mutation du racisme colonial « Ah ben écoutez, si vous croisez des "jeunes" ou moins jeunes de banlieues défavorisées, vous leur direz de ma part que s'il y a une chose que ce mouvement m'a apprise, c'est de reconsidérer complètement le regard que je portais sur cette "racaille" et sa violence supposée. Moi, ça fait un mois et demi qu'on s'en prend plein la tronche une petite fois par semaine, et je suis déjà limite à bout, alors je n'imagine même pas la colère qu'ils peuvent avoir en eux de subir ce qu'ils subissent ou disent subir. Bref, je crois bien que c'est la première fois que je me sens proche d'eux, et je me dis quasi tous les jours que j'ai été bien con, avec mes yeux de Blanc moyen privilégié. » Un Gilet jaune Le fascisme historique n'était pas la première actualisation des techniques de pouvoir répressives, destructrices, génocidaires. Celles-ci ont d'abord constitué la modalité de contrôle et de régulation des colonisés. La « régulation » des populations par l'esclavage prend son essor bien avant le déploiement du biopouvoir européen et bien avant son accomplissement dans l'Allemagne nazie. La « lourde » machine du colonialisme, depuis toujours, « maintient entre la vie et la mort - toujours plus près de la mort que de la vie - ceux qui sont contraints de la mouvoir" ». Le contrôle des populations intégrant le « racisme » comme arme de hiérarchisation et de ségrégation n'a pas non plus été inventé par les fascismes, mais largement pratiqué dans les colonies où la « race » a été inventée. Le racisme contemporain est une mutation du racisme colonial et de la guerre contre les populations colonisées. Le Noir, le musulman, le migrant ne sont pas de l'autre côté de la barrière raciale, séparés par la mer ou l'océan. Ils peuplent les villes du Nord comme citoyens où, souvent, ils couvrent sur le marché du travail les emplois pénibles que les Occidentaux ne veulent pas occuper. il. Jean-Paul Sartre, « Colonialisme et néo-colonialisme », Situations, VI, Paris, Gallimard, 1964, p. 54.
Quand le capital s'en va-t-en guerre
43
Le capitalisme est régi depuis la conquête des Amériques par une gouvernance mondiale dont la tâche principale est la production et la reproduction de la division entre les populations de la métropole et les populations des colonies. L'économie-monde s'est structurée à partir de la division raciale qui a traversé la planète en remplissant une fonction à la fois politique et économique. Division dramatique, à l'abri de laquelle se sont constitués l'ensemble du pouvoir et du savoir européens, mais également le mouvement ouvrier, qui a « profité » de cette stratégie impérialiste, comme Engels le rappelle pour les ouvriers anglais. La force et le rôle stratégique de cette division sautent littéralement aux yeux lorsque, à partir de la Première Guerre mondiale et avec une accélération après la Seconde Guerre, elle tombe sous les coups de boutoir des révolutions anticoloniales et antiimpérialistes. A cause de son effondrement, le capital est contraint de changer de stratégie et de transformer la séparation entre popula-
tions du Nord et du Sud en concurrence entre toutes les populations de la planète. La globalisation est cet acte stratégique de mise en concurrence de la force de travail à l'échelle mondiale. Pendant toute l'époque de la colonisation, les migrations allaient de l'Europe vers le reste du monde pour l'exploiter et, en exportant les populations, conjurer les guerres civiles européennes. A présent, le très faible pourcentage des flux migratoires qui ne vont pas du sud vers le sud suffit à déstabiliser le Nord, de sorte que les divisions raciales dont sont victimes les migrants s'installent comme moyen de contrôle des populations du Nord et s'ajoutent aux ségrégations que subissaient déjà les citoyens européens d'origine « coloniale ». Le racisme, technique de gouvernementalité sur le marché du travail, va jouer un rôle tout aussi fondamental dans la gouvernance politique, où il constitue l'un des puissants mécanismes de subjectivation identitaire nationaliste. A l'encontre de toute conception modernisatrice du capital, cette séparation doit être absolument reproduite, de sorte que, si le capital ne peut plus distribuer « travail libre » et « travail
44
Le capital déteste tout le inonde
forcé » selon la division entre colonie et métropole, il essaiera de la produire à l'intérieur de cette dernière. C'est pour cette raison que le travail précaire prend la forme du « travail servile » et gagne, d'année en année, de nouveaux secteurs et de nouvelles couches de l'ancien salariat. De ce point de vue, on pourrait affirmer que la globalisation a consisté à transférer en Occident l'hétérogénéité des asservissements et des dominations qui caractérisait la production dans les colonies, commandée et contrôlée par le pouvoir supérieur de la finance, plutôt qu'en une généralisation du salariat, comme l'envisageait le marxisme. La structuration de nos sociétés ressemble formellement à la réalité coloniale : « protéiforme, déséquilibrée, où coexistent à la fois l'esclavage, le servage, le troc, l'artisanat et les opérations boursières12 ». Le géographe Guy Burgel, de façon très significative, voit dans la France contemporaine des divisions qui renvoient au mode d'exploitation colonial : « [L]a "périphérie" est plus proche des analyses tiers-mondistes d'un Celso Furtado ou d'un Samir Amin, qui l'opposaient dans les années soixante au "centre" du système capitaliste, que d'une cartographie et d'une sociologie simplistes des territoires13 ». La ségrégation « raciale » est une modalité de gouvernementalité que certains États (tel Israël) inscrivent dans leur constitution formelle, tandis que pour d'autres (comme les USA), elle est au fondement de leur constitution matérielle depuis leur naissance. La première fonction de ce que Foucault appelle les « excroissances du pouvoir », c'est de produire des assujettissements. Hier, celui du « colonisé » et du « colonisateur », aujourd'hui celui du migrant et du raciste occidental. Le colonialisme, tout en étant un exercice de la violence, se caractérise par une forme spécifique de production de subjectivité. De la même manière, le racisme 12. Frantz Fanon, Les Damnés de la terre (1961), Œuvres, Paris, La Découverte, 2011, P- 509. 13. Guy Burgel, « Les fins de mois difficiles avant la fin du inonde », Libération, 26 novembre 2018.
Q u a n d le capital s'en va-t-en guerre
45
contemporain assure une production d'assujettissement qui lui est propre. S'il est vrai, comme le soulignait Foucault, que les assujettissements « ne sont pas des phénomènes dérivés, les conséquences d'autres processus économiques et sociaux », la production du « raciste » garde un lien très étroit avec le capitalisme, notamment avec son moteur le plus meurtrier, la propriété privée. Le racisme permet de réaliser la promesse que libéralisme fait depuis toujours et ne pourra jamais tenir, faire de chaque individu un propriétaire. C'est l'intuition géniale de Jean-Paul Sartre, qui explique de cette manière l'antisémitisme. Les antisémites, nous dit-il, « appartiennent à la petite bourgeoisie des villes [et] ne possèdent rien. Mais justement, c'est en se dressant contre le Juif qu'ils prennent soudain conscience d'être propriétaires : en se représentant l'Israélite comme un voleur, ils se mettent dans l'enviable position de gens qui pourraient être volés ; puisque le Juif veut leur dérober la France, c'est que la France est à eux. Ainsi ont-ils choisi l'antisémitisme comme un moyen de réaliser leur qualité de possédants'4. » L'objet de la haine et du refus a changé, mais le même mécanisme reste à l'œuvre : les migrants, les immigrés, les musulmans, etc., « nous volent nos emplois », « nos femmes », « ils envahissent nos territoires ». La peur d'être dérobé, la peur en général, ce puissant affect constitutif de la politique européenne depuis ses débuts, définit le raciste : « C'est un homme qui a peur. Non des Juifs certes : de lui-même, de sa conscience, de sa liberté, de ses instincts, de ses responsabilités, de la solitude, du changement, de la société et du monde ; de tout sauf des Juifs' s . » Les millions de non-possédants et de petits propriétaires qui voient la possibilité réelle de perdre le peu qu'ils ont à cause des « folies » de la bourse trouvent leur « propriété » matérielle et spirituelle dans L'affirmation fantasmatique de la Nation, de l'identité du peuple, dans la souveraineté. '415-
Jean-Paul Sartre, Réflexions sur la questionjuive (1946), Paris, Gallimard, 1996, p. 29. Ibid., p. 62.
46
Le capital déteste tout le inonde
La sécession des possédants « Les plus riches ont décidé de nous faire une guerre [...]. Je fréquente des riches à Paris et leur indifférence est totale. Si tu leur dis qu'en Espagne, à 60 ans, on peut être obligé de travailler pour 2,60 € de l'heure, ils s'en foutent. Tu te rends compte qu'ils sont déjà prêts pour ce monde-là. Dans leur tête, c'est réglé : pour les pauvres, ça va être très dur, et ils s'en tamponnent. [...) On vivra entre riches dans des mini-bulles bunkers. Tant pis pour les crevards. J'ai eu longtemps l'impression que les riches ne se rendaient pas compte, mais là je pense que c'est pire : c'est concerté, c'est ce qu'ils veulent, que les gens s'enfoncent dans une misère noire. Ils ne voient pas le travailleur comme un être humain mais comme un problème à gérer. » Virginie Despentes Les nouveaux fascismes se limitent à renforcer les hiérarchies de race, de sexe et de classe ; la stratégie politique reste néolibérale. La mission de ces nouveaux fascismes n'est pas de combattre une opposition qui n'existe pas, mais de mener jusqu'au bout le projet politique qui est au fondement des politiques néolibérales. Contrairement aux théories qui nous parlent de l'« exode » par la multitude (Negri) ou de la « sécession » par le peuple (Rancière), c'est le capital qui organise sa fuite, sa « séparation » de la société. Si le « vivre-ensemble » n'a jamais fait partie des soucis du capital, celui-ci semble maintenant affirmer sans ambages le but qu'il poursuit de façon absolument consciente : se rendre politiquement autonome et indépendant des travailleurs, des pauvres, des nonpossédants. Politiquement, du moins, car du point de vue « économique », il a besoin d'eux, mais de la même manière que le planteur a besoin des esclaves. Le néolibéralisme a rompu avec le pacte fordiste noué autour de l'emploi, mais les syndicats et le mouvement ouvrier sont restés attachés à des normes, des règles, des droits du travail et des droits de sécurité sociale qui ont été progressivement détruits pour faire place à des relations de travail et de domination
Quand le capital s'en va-t-en guerre
47
serviles non négociables et non négociées. Les gated communities, nombreuses au Brésil, aux USA et ailleurs, ne sont que le symptôme folklorique, bien qu'inquiétant, de cette vision de la « société ». Aux USA, pays du paradigme néolibéral complètement déployé, les « minorités » (Noirs, Latinos, femmes) appauvries, destinées à des emplois précaires, parquées dans des ghettos d'habitation et de formation, privées d'assistance médicale, de retraite et objet d'une guerre raciale féroce, peuplent les prisons par centaines de milliers. Désormais, cette réalité est également l'avenir d'une partie de la classe ouvrière et de la classe moyenne blanches, d'où le succès de la politique de Trump, qui leur promet un retour à une impossible suprématie sociale, raciale et sexuelle. Dans la sécession des possédants, la privatisation a transformé les politiques d'assurance contre les risques sociaux en dispositifs produisant des inégalités croissantes. La privatisation change radicalement les fonctions de ce que Foucault appelle les dispositifs du « biopouvoir ». Depuis les années 1970, elle s'emploie à défaire systématiquement la « puissance » politique que les populations ont accumulée en deux siècles de luttes révolutionnaires et à annuler sa traduction en « droits » à la santé, à la formation, à la retraite, à l'indemnisation chômage, etc. : l'accès à tout cela dépendra dorénavant de la propriété et du patrimoine. Pour la grande majorité de la population de la planète, la biopolitique doit assurer le minimum « vital » nécessaire à sa simple reproduction. En France, où le welfare devrait résister mieux qu'ailleurs, les politiques économiques ont produit l'innovation de la « troisième classe », la classe des pauvres qui ont droit à des transports, des hôpitaux, des supermarchés et même des funérailles de troisième catégorie. La biopolitique divise (en trois classes et elle individualise encore plus subtilement), et en divisant, elle appauvrit une grande majorité et enrichit une petite minorité. Elle produit non pas le capital humain, l'entrepreneur de soi, mais le « travailleur pauvre », en assignant cette majorité à la condition de « pauvreté travailleuse ».
48
Le capital déteste tout le inonde
Le contrôle et la régulation des populations ne se font plus par Xintégration, mais par l'apartheid social (autre nom de la sécession politique du capital) plutôt que par la biopolitique. Les sociétés sont redevenues patrimoniales. Les rentiers y régnent comme dans les romans de Balzac. Quant aux salaires, après avoir acquis le statut de « variable indépendante » de l'économie, ils sont redevenus, comme avant le cycle des révolutions, une simple variable d'ajustement des fluctuations du profit et tendent irrésistiblement vers le « minimum ». Mais les inégalités de revenus ne sont rien en comparaison des inégalités de patrimoine, alimentées par une rente qui n'est plus d'abord coloniale, mais financière. Au début du xxic siècle, d'autres événements viennent affecter profondément les subjectivités déjà dévastées par la première séquence des politiques néolibérales. L'effondrement du système financier, en 2008, a opéré une double rupture « subjective » en ouvrant une phase plus intense d'instabilité directement politique, propice à une conversion néofasciste de la société (ou à une radicalisation « révolutionnaire »). D'abord, la « crise » de la dette a sanctionné l'échec de la figure de l'individualisme possessif et concurrentiel du « capital humain » et fait émerger la figure subjective de l'« homme endetté », responsable et coupable de l'excès des dépenses publiques. Deuxièmement, à la suite d'un approfondissement des politiques néolibérales de concentration de la richesse et du patrimoine, la frustration, la peur et l'angoisse de l'homme endetté ont produit une conversion de la subjectivité, en rendant celle-ci disponible aux aventures néofascistes, racistes, sexistes et aux fondamentalismes identitaires et souverainistes. Le libéralisme contemporain est donc très loin de l'image irénique que Michel Foucault donnait de la société de l'entrepreneur de soi dans Naissance de la biopolitique : la société industrielle « exhaustivement disciplinaire » qui céderait la place à l'« optimisation des différences », à la « tolérance accordé [ej aux individus et aux pratiques minoritaires ». Ce cadre idyllique n'a vu le jour nulle part. De la même manière que l'on est très, très loin de l'optimisation
Quand le capital s'en va-t-en guerre
49
des différences et de la tolérance accordée aux minorités, on est également dans l'impossibilité de se référer au « discours du capitaliste » de Jacques Lacan, version psychanalytique du pouvoir néolibéral selon Foucault : l'injonction du pouvoir ne serait plus « tu dois obéir », mais « tu dois jouir ». La jouissance est, aujourd'hui, celle que veut procurer Trump aux Blancs américains lorsqu'il défend leur « whiteness » contre les « races » (Noirs, Latinos, Arabes) qui la « menacent » ; ou encore la jouissance des hommes lorsque les mouvements néoconservateurs promettent le rétablissement du pouvoir qu'ils auraient perdu, de l'ordre de la famille et de l'hétérosexualité. En Europe, c'est l'islam qui est l'objet de tous les investissements paranoïaques et de toutes les formes de ressentiment que le libéralisme a produites depuis quarante ans. La logique de la guerre contre les populations et de ses articulations (racisme, fascisme et sexisme) caractérise l'époque. L'intensité croissante des mobilisations néofascistes, la libre circulation de la parole et des actes racistes et sexistes semblent pouvoir s'intégrer dans le cadre de la gouvernementalité néolibérale sans trop de problèmes, car ils participent de la même machine de guerre capitaliste. Dans le cadre dessiné, d'une part, par l'avancée du projet de sécession politique des « riches » et, d'autre part, par l'impuissance des forces qui voudraient lui faire barrage, la démocratie n'a plus aucune utilité. La démocratie représentative n'est pas entrée en « crise » avec le néolibéralisme : le pouvoir législatif qui devrait la réaliser et la légitimer a commencé à être neutralisé par le pouvoir exécutif dès la Première Guerre mondiale. La guerre industrielle ne va pas sans une reconfiguration du pouvoir exécutif, qui ne prend pas fin avec l'arrêt des hostilités, mais qui au contraire va progressivement réduire le Parlement au statut d'appendice de ratification et de légitimation des décrets du vrai pouvoir législatif, qui est entre les mains du gouvernement. Mais arrêter l'analyse ici, ce serait rester dans le sillon tracé par Cari Schmitt ou Agamben. Le xx c siècle a manifesté
50
L e capital déteste tout le inonde
une nouvelle réalité du « politique » que le néolibéralisme a complètement réalisée : le pouvoir exécutif, comme tout le système juridicopolitique, est un des centres de décision de la machine de guerre du capital, qui exécute, ratifie et légitime les « décrets » destinés à augmenter la « vie » (la puissance d'agir) du capital financier. Les libéraux ont toujours compris la démocratie comme démocratie des possédants. Ils ont toujours conçu les droits comme indexés à la propriété. Ce sont les révolutions qui ont imposé l'égalité et conquis les droits politiques et sociaux « pour tous ». Le capitalisme peut très bien fonctionner à l'intérieur de différents systèmes politiques : démocratie constitutionnelle, Etat centralisateur et autoritaire comme en Chine, en Russie ou dans les régimes fascistes. L'idée selon laquelle le capital va nécessairement de pair avec la démocratie n'a pas cessé d'être démentie. Guerre et circulation A partir de la fin des années 1970, les mouvements post-68 cessent d'interroger et de problématiser la guerre, la guerre civile et la révolution. Les concepts de guerre et de révolution ont été abandonnés par les « vaincus », comme si la guerre était intégrée, incorporée et pacifiée sans reste dans la production, la démocratie, la consommation, et que la révolution pouvait seulement se conjuguer au technologique (automobile, informatique, robotique, etc.). On a confondu la « paix » avec la victoire historique du capitalisme, et la « fin » des guerres avec la défaite de la révolution. Or il est impossible de comprendre le changement de fonctionnement du capitalisme, sa mouture néolibérale, l'émergence de nouvelles formes de fascismes, sans thématiser les victoires et les défaites du xx e siècle, puisque ce sont les « triomphes » dans la guerre entre classes qui ont ouvert la possibilité de ces transformations. Si, comme je le crois, la défaite politique au tournant des années 1960-1970 implique également une défaite théorique, la première victime a été le marxisme, qui avait fourni l'essentiel de ses instruments politiques et théoriques au siècle des révolutions.
Quand le capital s'en va-t-en guerre
51
L'émergence de sujets politiques difficilement identifiables à la classe ouvrière (le mouvement de décolonisation et le mouvement féministe, entre autres) a ébranlé le concept du sujet révolutionnaire inhérent au marxisme européen, mais les raisons de son effondrement rapide, consommé dans les années 1970, sont d'abord à rechercher dans les guerres totales. La Grande Guerre avait été l'occasion de la prise de pouvoir par les bolcheviques, mais également l'origine d'un bouleversement radical du fonctionnement du capitalisme, continué par la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, bouleversement que le marxisme, à la différence des capitalistes, a été incapable d'appréhender. Les deux guerres totales affectent profondément la catégorie marxienne de « production », fondement de la rupture révolutionnaire puisqu'elle engendre le sujet qui peut la réaliser. La production sort des guerres totales radicalement différente de la manière dont Marx l'avait définie et, avec elle, les sujets de la « révolution ». Elle devient une partie de la circulation, de plusieurs façons. A partir de la guerre froide, elle n'est plus qu'un moment de la circulation des marchandises (logistique) et, à partir du néolibéralisme, un moment de la circulation de l'argent (finance) et de la circulation de l'information (mass-médias et industries du numérique). D'une façon plus générale, comme l'ont suggéré les théories féministes, la production n'est désormais qu'une partie de la « reproduction sociale ». Elle est subordonnée à la possibilité et à la capacité de reproduire et de contrôler l'ensemble des dominations et les affrontements stratégiques qui les caractérisent. La logistique met en lumière, de façon peut-être encore plus accomplie que la finance et l'information, la continuité de l'organisation du travail avec l'organisation de la guerre, la stricte implication entre le civil et le militaire qui se trouve au fondement du capitalisme contemporain et de son marché mondial16. •6. A cet égard, le livre de Deborah Cowen, The Deadly Life of Logistics: Mapping Violence in Global Trade (Minneapolis, University of Minnesota Press, 2014), est
52
Le capital déteste tout le inonde
La production est prise en tenaille entre des réseaux de « circulation » immédiatement mondiaux, qui dessinent les nouvelles dimensions de l'espace-temps de l'accumulation, et des modalités inédites de guerre, qui traversent les États-nations et leurs frontières. L'ensemble des réseaux de circulation des marchandises, de l'argent et de l'information, mais aussi l'ensemble des réseaux de la reproduction sociale, sont les axes stratégiques de l'« usine sociale mondiale », c'est-à-dire de la réorganisation des économies nationales en une machine capitaliste transnationale (à la construction de laquelle les États contribuent de manière incontournable). Déjà, à la fin des années 1950 et au début des années i960, les capitalistes pensent la « production » à partir de l'imbrication entre production, distribution et consommation à l'échelle du marché mondial. Les capitalistes conçoivent la « valeur » et calculent la valorisation à partir du « coût total » de ces différents flux intégrés de circulation et de production. Grâce à la logistique, l'usine est fragmentée, dispersée, étirée entre les différents territoires de la planète, de sorte qu'une seule marchandise incorpore une multiplicité d'éléments produits aux quatre coins de la planète. Si Marx faisait de l'usine le « moteur » et le « commencement de la chaîne de la valeur », « les marchandises sont aujourd'hui fabriquées à travers l'espace logistique plutôt que dans un seul espace ». (Les marxistes auront du mal à appréhender la logique et la fonction de la logistique, car sa double origine - d'une part, le commerce des esclaves et la circulation des marchandises produites dans les colonies, et, d'autre part, la guerre, notamment la guerre industrielle - bouleverse leur cadre théorique encore très industriel et eurocentré.) La globalisation extensive, qui exploite l'ensemble de la planète, et la globalisation intensive, qui exploite l'ensemble de la société, sont la transposition « civile » de l'« économie de guerre » de la exemplaire (toutes les citations qui concernent la logistique en sont extraites). C e livre m'a été signalé par Carlotta Benvegnu.
Quand le capital s'en va-t-en guerre
53
première moitié du XXe siècle. La matrice du capitalisme contemporain se trouve dans la mondialisation de la guerre et la mobilisation des toutes les forces sociales pour la production industrielle de la destruction qui, avec la bombe atomique, devient virtuellement « totale ». Les deux guerres totales marquent l'indissoluble unité stratégique du capital et la guerre, de la production et du pouvoir (et d'abord du pouvoir de l'Etat). L'avance considérable que le capital a aujourd'hui prise sur la force de travail a sa source à la fin des années 1950 et au début des années i960, lorsque les capitalistes, en intégrant la double socialisation de la production mise en place par les guerres totales, se sont posé la question : « Où se termine la production ? » La réponse à cette question a été trouvée dans l'expérience de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, où précisément la production (pour la guerre) n'avait pas de limites, puisqu'elle se confondait avec l'activité de la « nation » et son espace avec la planète dans son ensemble. Comme l'explique Cowen, « [l]e vieil art militaire de la logistique a joué un rôle fondamental dans la construction de l'usine sociale mondiale. [...] Les entreprises ont commencé à s'intéresser à la logistique pendant la Seconde Guerre mondiale, où il fallait déployer stratégiquement, partout dans le monde, d'énormes quantités d'hommes et de matériel. » La guerre n'est pas seulement le modèle généalogique de la chaîne de la valeur, elle est aussi une composante indispensable du fonctionnement contemporain de la circulation du capital, car la dimension transnationale de la logistique requiert un modèle de « sécurité » qui n'est plus centré sur l'État-nation. Plutôt que d'une simple militarisation de la logistique, il s'agit d'une coproduction par les entreprises et les armées (le néolibéralisme introduit la privatisation jusque dans ce domaine) d'une nouvelle conception du rapport entre valorisation et « sécurité ». L'armée américaine a mis à disposition des civils l'énorme expérience productive, technologique, scientifique, mais aussi militaire acquise pendant les guerres totales et la guerre froide. Comme pour la fïnanciarisation,
54
L e capital déteste tout le inonde
c'est toujours l'Etat qui a l'initiative et le problème réside dans la manière dont ces « savoirs » sont transférés au privé. L'État et ses frontières, en définissant le « dedans » et le « dehors » de la nation, établissaient le fondement des divisions entre action policière et action militaire, guerre et paix, guerre et terrorisme. Le fonctionnement transnational de la finance et de la logistique vient brouiller ces divisions, notamment celles entre civil et militaire. La « sécurité » de la globalisation, renversant le rapport entre circulation et production, ne peut être garantie que par une action combinée entre civil et militaire, entre l'entreprise et les armées (régulières et mercenaires). « Pour un système reposant non pas simplement sur la connectivité mais sur la vitesse de la connectivité, la sécurité des frontières peut être une source d'insécurité pour la chaîne d'approvisionnement. La sécurité de la chaîne d'approvisionnement a pour préoccupation centrale la protection des flux de marchandises et celle des infrastructures de transport et de communication qui les soutiennent. » La logistique (gestion du transport de marchandises et gestion du transport de l'information) a rendu possible la production flexible et just-in-time, et c'est toujours la « circulation » qui a permis une exploitation globale d'une force de travail dispersée sur la planète entière. L'exploitation de la force de travail à l'échelle mondiale est ce qui définit le capitalisme, mais avec la logistique, pour la première fois, elle est le résultat d'une machine « productive », technologique, informationnelle, administrative, militaro-policière intégrée. Le capital, grâce à la logistique, jongle entre subsomption réelle et subsomption formelle de la force de travail, c'est-à-dire entre exploitation du travail hautement qualifié à travers de très lourds investissements en capital fixe (machines, technologies, science) et exploitation du travail servile, du travail des enfants, de l'esclavage, avec des modalités qui ne semblent pas appartenir à la modernité capitaliste. En réalité, le capitalisme tient ensemble, aujourd'hui comme hier, la .plus innovante production « intensive en capital » et les modalités
Q u a n d le capital s'en va-t-en guerre
55
d'exploitation « intensive en travail » les plus traditionnelles et les plus violentes. Circulation et finance « La dette est encore du néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. La dette contrôlée par l'impérialisme est une reconquête savamment . organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des normes qui nous sont complètement étrangères. » Thomas Sankara, 29 juillet 1987" Ce qui émerge de la circulation contemporaine est, par bien des aspects, très différent des « dispositifs sécuritaires » analysés par Michel Foucault. De la même manière que la logistique, les dispositifs sécuritaires ont selon lui pour objectif d'élargir continuellement les circuits de la circulation en intégrant « sans cesse des nouveaux éléments, la production, la psychologie, les comportements, les manières de faire des producteurs, des acheteurs, des consommateurs, des importateurs, des exportateurs, le marché mondial ». La confiance foucaldienne dans les « dispositifs de sécurité » (« laisser faire les circulations, contrôler les circulations, trier les bonnes et les mauvaises, faire que ça bouge toujours, que ça se déplace sans cesse, que ça aille perpétuellement d'un point à l'autre, mais d'une manière telle que les dangers inhérents à cette circulation en soient annulés'8 ») ressemble beaucoup à la fausse naïveté des théoriciens 17. Sankara sera assassiné seulement cinq mois après ce discours. L'autre puissant dispositif du néocolonialisme monétaire en Afrique, le franc CFA, à travers lequel la France continue de maintenir sous son joug l'économie de quatorze pays africains (plus les Comores), a aussi été dénoncé par Sankara : « Le franc CFA, lié au système monétaire français, est une arme de la domination française. La bourgeoisie capitaliste marchande française bâtit sa fortune sur le dos de nos peuples par le biais de cette liaison, de ce monopole monétaire. » '8. Michel Foucault, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977•978, Paris, Gallimard/Le Seuil, p. 46, p. 67.
56
L e capital déteste tout le inonde
libéraux. Les capitalistes sont plus circonspects sur la capacité presque automatique des dispositifs sécuritaires à neutraliser les « dangers » et les « risques ». Comme on vient de le voir, ils pensent, plus prosaïquement, la circulation et la sécurité en stricte coopération avec les militaires. Cet élargissement continu de la production par la circulation se confronte à tant de résistances, refus, détournements, soustractions, luttes violentes organisées, sabotages individuels, que la gouvernementalité implique nécessairement un rapport à l'imprévisible et à l'imprédictible, ce que Foucault appelle un « rapport à l'événement », à la « série d'événements possibles », au « temporel » et à « l'aléatoire » du conflit. Mais dans le capitalisme, ce rapport à l'événement passe nécessairement par des techniques de guerre, qui, par définition, travaillent avec l'imprévisible et l'imprédictible. Si l'on se place du point de vue de la production globalisée, nous avons, encore une fois, une vision du néolibéralisme très différente de celle donnée par Michel Foucault dans Naissance de la biopolitique. L'organisation de la « production » à partir de la circulation permet au capitalisme d'« optimiser, les différences » entre les statuts des travailleurs et les différents « coûts de la force de travail » à travers le monde, c'est-à-dire d'optimiser les modalités hétérogènes d'exploitation et de profiter des différentiels existants entre les systèmes de sécurité sociale, entre les régimes fiscaux et juridiques. Le gouvernement de cette production mondialisée a son centre stratégique dans la finance, dont la « marchandise », l'argent, circule à une vitesse incomparable avec celle des marchandises gérées par la logistique. La finance, comme la logistique, entretient un rapport très étroit avec la guerre et notamment avec la guerre contre les populations, dont elle va constituer l'arme la plus redoutable. En effet, le marché mondial, surtout avec le néolibéralisme, n'intègre pas sans différencier à travers des techniques racistes, ségrégationnistes, sexistes; n'homogénéise pas sans creuser des inégalités; n'uniformise pas sans accentuer les « guerres » entre Etats, les guerres de classe, de sexe et de race.
Q u a n d le capital s'en va-t-en guerre
57
Après le « triomphe historique remporté sur les classes subalternes » dans les années 1970, les institutions financières internationales, commencent par intervenir lourdement avec une nouvelle stratégie qui requalifie les relations de pouvoir comme relations entre créditeurs et débiteurs. La stratégie de la dette a été d'abord mise en place dans un double objectif: récupérer ce que l'Occident avait perdu à cause des luttes anticoloniales et discipliner les subjectivités filles des révolutions anti-impérialistes qui se pliaient difficilement aux impératifs de « développement » posés par la Banque mondiale. Silvia Federici décrit très précisément ce processus. Dans les années 1980, la Banque mondiale joue un rôle central en Afrique, en remplaçant les « administrations coloniales sur le départ » et en mettant en place un « programme spécial » nommé « ajustement structurel » : « En échange de crédits prétendument destinés à la croissance économique, un pays accepte de libéraliser les importations, de privatiser les industries publiques, d'abolir toute régulation des échanges de monnaie et des prix des marchandises, d'abolir toute forme de subvention aux services publics, de dévaluer encore la monnaie et de supprimer tous les droits du travail et la sécurité sociale19. » Ces politiques d'ajustement structurel prennent le nom de l'« expérimentation chilienne » qu'elles ' prolongent. Entre les années 1970 et 1980, les grandes institutions internationales du capital mettent en accusation « la résistance de l'Afrique au développement », car les révolutions anti-impérialistes ont sédimenté, malgré la défaite politique, un refus qui s'exprime dans des comportements entravant les objectifs du capital. « La difficulté des prolétaires africains à accepter les lois du capital comme des lois naturelles, est particulièrement forte parmi les nouvelles générations qui ont grandi à l'époque des intenses luttes de libération20. » >920.
Silvia Federici, Reincantare il mondo, Vérone, Ombre Corte, 2018, p. 62. Ibid., p. 59.
58
Le capital déteste tout le inonde
La « programmation de la crise de la dette a touché, depuis le début des années 1980, plus de 25 pays africains ». Elle a été le moyen de « recoloniser une grande partie de l'ancien monde colonial, en précipitant des régions entières dans l'étau de la dette, en les réduisant à la misère. A cause de la crise de la dette, les succès obtenus avec la lutte anticoloniale ont été annulés21. » L'économie de la dette s'est montrée si efficace comme instrument de recolonisation et d'imposition des normes capitalistes au « tiers monde » que ses mécanismes ont été étendus aux travailleurs nordaméricains et plus tard aux Européens22. Le capitaliste collectif construit sa machine de guerre et sa stratégie à partir de la circulation ; il n'y a donc aucune extériorité, aucune fonction parasitaire de la finance vis-à-vis de l'« économie réelle » : tout au contraire, grâce à son degré supérieur de déterritorialisation, grâce à sa vitesse et à son accélération continue, elle a une vision du cycle global de la « production ». Une fois libérée des contraintes politiques qui lui avaient été imposées au xx e siècle à cause de la puissance destructrice qu'elle avait dégagée, une fois rendue à sa logique du « sans-limites », du « toujours plus », sa déterritorialisation supérieure en a fait le lieu privilégié du commandement et de la stratégie, mais également la source des guerres et, avec elles, des affrontements stratégiques. Les militaires et la guerre après la guerre froide La guerre, à la fois comme force productive et comme force de reconversion politique du capitalisme, a subi de profondes transformations tout au long du xx e siècle, que les critiques du capitalisme, en retenant qu'elle ne fait pas partie de son organisation, négligent complètement23. Parmi les nouvelles définitions de la guerre que les débats entre militaires ont produites après la chute de l'Union 21. Ibid. 22. Ibid., p. 90-91. 23. Pour un approfondissement, voir le livre que j'ai écrit avec Eric Alliez, Guerres et Capital, Paris, Amsterdam, 2016.
Quand le capital s'en va-t-en guerre
59
soviétique, « la guerre contre la population » me semble la plus à même de rendre compte non seulement des stratégies militaires, mais également des stratégies des politiques du néolibéralisme. Les deux marient, de façon différente, le civil et le militaire, et trouvent leur point de convergence dans la guerre contre les populations. Bien que les militaires soient parfois plus attentifs que les intellectuels critiques aux transformations du capitalisme, ils négligent, comme ces derniers, un phénomène politique fondamental : la défaite de la révolution. La guerre froide a été le cadre où s'est déroulée (avec le concours des puissances états-unienne et soviétique et, plus souvent, malgré et contre elles) une « guerre civile mondiale », diversement décrite par Arendt, Koselleck, Schmitt, où s'opposaient, en réalité, la « révolution mondiale » et la machine de guerre du capital. C'est dans la défaite de la révolution qu'il faut chercher les raisons des transformations de la guerre. Après les guerres industrielles de la première moitié du xxe siècle, la guerre et l'Etat commencent à devenir fonctions et composantes de la machine de guerre du capital. La « prise », la « conquête », l'appropriation ne sont plus des prérogatives exclusives de l'Etat, qui perd aussi le « monopole de la violence et de son emploi ». S'il s'agit toujours d'imposer sa propre volonté par la force, les moyens de la contrainte se sont diversifiés (l'économique, le culturel, le social, la technologie). La force est de plus en plus exercée par des sujets « civils ». « Il y a des armées privées, des compagnies des mercenaires et il y a des instruments économiques et sociaux, aussi efficaces que des bombardements à grande échelle24. » La réversibilité de la guerre et du pouvoir revient comme un leitmotiv dans les travaux de militaires et trouve dans la finance l'exemple même de l'imposition de la contrainte par la force économique. La finance conjugue en effet la forme la plus déterritorialisée du capital et la forme la plus déterritorialisée de la souveraineté, la H-
Fabio M ini, La guerra spiegata a..., Turin, Einaudi, 2013.
56
Le capital déteste tout le inonde
guerre. Elle « réussit à détruire les économies des pays faibles, en faisant autant de victimes qu'une bataille25 ». Il ne s'agit en aucun cas d'une disparition de l'Etat, mais de son intégration dans une stratégie, celle du capital, que l'État n'est plus à même d'élaborer et de maîtriser comme puissance autonome et indépendante. Il exerce sa « puissance » en « partenariat » avec d'autres forces qui le débordent et le soumettent à leurs stratégies. Ce que soulignent tous les travaux stratégiques, c'est que les effets « destructeurs » de la force peuvent très bien être d'origine économique et surtout financière. Quand les militaires pensent la guerre aujourd'hui, ils ne pensent pas l'expérience du « front », des armées régulières, des affrontements entre États comme à l'époque des guerres totales qui ont colonisé notre imaginaire. Les fronts comme les frontières se déplacent, s'intériorisent dans le territoire des États « pacifiés », puisque le militaire et le civil se confondent. Et leur objet est la population mondiale. La guerre totale s'est muée en guerre globale, dans le sens qu'elle constitue l'autre face de la globalisation, l'aspect militaire de l'action « civile » du marché mondial. Elle est endémique, intermittente, toujours prête à éclater, mais sur un fond de guerre contre la population. La guerre en Syrie, la guerre de contrôle et de « mise à mort » des migrants, la guerre pour la privatisation du welfare, ne sont certes pas les mêmes, mais il existe entre elles une continuité, une transversalité politique : dans le capitalisme contemporain, la guerre est toujours, au fond, une guerre civile, une guerre contre la population. La guerre du capital, à la différence de celle menée par l'État, n'a pas comme fondement et objectif l'affirmation et l'extension de la souveraineté, mais la soumission des humains et des non-humains à la production de valeur. C'est seulement sous l'hégémonie politique du capital que la guerre civile mondiale prime sur la guerre entre États. S'il ne s'agit pas d'une guerre schmittienne (État, 25.
/bid., p. 74.
Quand le capital s'en va-t-en guerre
61
peuple, destin), la machine de guerre du capital retrouve Xennemi lorsque la soumission aux lois de la production et de la gouvernementalité se renverse en révolution. L'extension de la guerre globale est égale à celle du marché mondial ; il ne suffit donc pas de ne pas avoir de conflits armés sur son sol pour pouvoir dire que « nous ne sommes pas en guerre » (cette dernière affirmation est un réflexe hérité de l'époque coloniale : lorsque l'on constatait que l'Europe traversait une période de paix, on le faisait sans tenir compte des guerres que les Européens menaient dans les colonies). « Il est vrai que la guerre est un conflit armé, mais les armes ne sont plus seulement celles connues comme telles [...]. Le conflit doit être effectif, mais les signaux de cette situation ne sont pas seulement militaires [...]. Le conflit doit être étendu, mais l'étendue » ne peut être mesurée que par « les effets que le conflit a sur la souveraineté et sur le fonctionnement des communautés politiques concernées [...]. La tromperie de l'étendue est ce qui permet à tous les pays de l'Otan de ne pas se sentir en guerre, alors que leurs troupes combattent sur la planète entière26. » Nous retrouvons dans la définition de la guerre contemporaine toutes les caractéristiques des deux guerres mondiales. « La guerre, de phénomène exceptionnel et limité dans le temps, dans l'espace et dans les moyens, est devenue totale, asymétrique et permanente. » Michel Foucault, à l'époque où il essayait encore d'appréhender la relation sociale à travers la « guerre civile » (1971-1976), mais sans jamais prendre en considération les deux guerres mondiales et les guerres civiles européennes du xx e siècle, parvient, dans une interview où il joue l'intervieweur, aux mêmes conclusions que les militaires : « Le problème, ce serait, vraiment, de savoir si le rôle de l'armée, c'est bien de faire la guerre. Parce que, si tu regardes bien, tu t'aperçois que finalement, plus l'armée dans l'histoire s'est spécialisée comme armée, plus, en même temps, les guerres ont cesse d'être le propre des armées et sont devenues un phénomène î6. Ibid., p. 39.
62
L e capital d é t e s t e tout le i n o n d e
politique, économique, etc., qui enveloppait le corps total de la population27. » Le concept de population fait surgir un différend politique avec Foucault, dont le positionnement me semble être un symptôme de la sensibilité politique d'une époque, celle de l'après-68. Pendant la majeure partie du xx e siècle, le problème politique n'a pas été celui de la population et de sa « vie », mais celui des classes, des « nations » colonisées et de leurs révolutions (même dans la guerre nazie contre le « judéo-bolchevisme », les Juifs étaient des ennemis « fantasmés », le vrai danger politique venant de la révolution russe28). La victoire du capital transforme la classe ou la nation en armes en « population », c'est-à-dire en masses laborieuses, chômeurs, délinquants, fous, migrants, etc., qui, tous, redeviennent « dangereux » à défaut d'être révolutionnaires. Ce n'est que dans les conditions d'une défaite de la révolution que la guerre civile peut devenir gouvernementalité, c'est-à-dire « guerre au sein de la population » où les places des vainqueurs et des vaincus sont déjà distribuées. La transformation de la guerre civile mondiale en biopolitique (« guerre au sein de la population ») fait de cette dernière une guerre sans « ennemi », puisque celui-ci a disparu avec la révolution. Avec la dissolution de la classe dans la population, ce que le pouvoir voit partout, moins comme révolution que comme « danger », « risque », source de « chaos », c'est le « terroriste ». Cette guerre coïncidant avec le contrôle de la population, elle n'a ni début ni fin. De la même manière, elle ne prévoit ni victoire, ni défaite puisque les rapports de force sont asymétriquement 27. Thierry Voeltzel, Vingt ans et après, Paris, Verticales, 2014, p. 150. 28. De façon inexplicable, lorsque Foucault développe le rapport entre la biopolitique et le nazisme, il ne traite pas de l'événement le plus important de la première moitié du xx c siècle, 1917. « L'impact de la révolution soviétique a marqué l'Allemagne comme aucun autre pays. La ligne de partage politique, qui a traversé l'histoire des décennies suivantes, a cristallisé les espoirs, les haines et les peurs d'une population coupée en deux, lors d'un affrontement qui a été historique » (Donatella di Cesare, Heidegger, les Juifs, la Shoah. Les Cahiers noirs, trad. fr. G. Deniau, Paris, Le Seuil, 2016, p. 222).
Quand le capital s'en va-t-en guerre
63
établis et stabilisés en faveur du capital. Il n'y a pas d'ennemi à vaincre, seulement des vaincus à gouverner et des terroristes à neutraliser. Le vaincu peut à tout moment devenir ennemi politique, à condition de transformer en un affrontement stratégique la subordination à la biopolitique et à la gouvernementalité. Sur ce sol instable, interviennent les « techniques de sécurité » qui voudraient anticiper ce qui ne peut pas l'être (l'événement de la rupture) et dont les interventions se multiplient en raison même de cette impossibilité. La guerre globale, comme la guerre contre la population, ne connaît pas la paix. Ou plutôt, celle-ci devient une « continuation de la guerre par d'autres moyens29 ». L'imbrication de la guerre et du pouvoir chez le Foucault d'avant la conceptualisation de la biopolitique et de la gouvernementalité se passe de la paix, exactement comme la théorisation du militaire et du civil dans les écrits militaires d'après 1989. A travers ces catégories, Foucault et les militaires enregistrent un changement qui s'est déployé après la Seconde Guerre mondiale, mais qui va s'accentuer encore avec le néolibéralisme : la victoire ne débouche plus sur une période de « paix », mais tout au contraire sur la reproduction de l'instabilité (de la même manière que la « crise » économique, de conjoncturelle, devient permanente). La définition de la guerre excluant la paix comme son double inversé porte une critique implicite de la conception dialectique de la guerre qui est le propre du marxisme révolutionnaire. Chez Mao, guerre et paix constituaient encore l'exemplification d'une relation dialectique où « l'identité des contraires » contenait la possibilité du renversement de chaque terme. Or, au moins à partir de la guerre froide, la guerre et la paix cessent de s'opposer dialectiquement, de se convertir l'une en l'autre et les adversaires de se faire face comme des contraires/identiques. Le négatif n'est plus dialectisable. Le négatif reste négatif. Une instabilité radicale s'installe. 2
9-
Fabio Mini,Laguerraspiegataa...,op. cit., p.35.
64
Le capital déteste tout le inonde
D'où la nécessité de penser les techniques de gouvernementalité qui marient le civil et le militaire, la guerre et le pouvoir comme une « guerre contre les populations ». La police est l'institution la plus apte à gérer cette situation, puisque l'indistinction entre paix et guerre, violence et droit est à son fondement : « Ainsi, "pour garantir la sécurité", la police intervient dans des cas innombrables où la situation juridique n'est pas claire, sans parler de ceux où, sans aucune référence à des fins légales, elle accompagne le citoyen, comme brutale contrainte, au long d'une voie réglée par des ordonnances, ou simplement le surveille30. » ' La nouveauté remarquable consiste dans la direction et la gouvernance de cette guerre, que les élites capitalistes néolibérales cèdent ou sont contraintes de céder aux nouveaux fascistes. La mutation du fascisme qui s'est produite avec le néolibéralisme est synonyme d'une nouvelle transformation de la guerre contre la population, dont l'intensité dépendra de la force des résistances qu'on lui opposera. Si le fascisme historique était une continuation de la guerre totale, le nouveau fascisme se caractérise plutôt par les modalités de la guerre au sein des populations. La « pacification » dans le concept de « pouvoir » « Comme le point d'arrivée, le point de départ de tout contrat renvoie aussi à la violence. Comme fondatrice de droit, elle n'a pas besoin d'être immédiatement présente en lui, mais elle est représentée en lui dans la mesure où la puissance qui garantit le contrat juridique est née elle-même de la violence, sinon précisément installée par la violence dans le contrat lui-même. Que disparaisse la conscience de cette présence latente de la violence dans une institution, cette dernière alors périclite. » Walter Benjamin
30. Walter Benjamin, « Critique de la violence », Œuvres /, Paris, Gallimard, 2000, p. 224.
Quand le capital s'en va-t-en guerre
65
Le jugement qu'on porte sur la guerre implique un jugement sur le capitalisme et sur les luttes qu'on peut y mener, car toute guerre est, en dernière analyse, une guerre civile. Dans pratiquement toutes les pensées critiques de l'après-68, le capitalisme et le pouvoir sont conçus indépendamment de la guerre (civile), ce qui exclut, en principe, toute possibilité de repenser la révolution, mais également le fascisme, le racisme et le sexisme comme articulations de la guerre. Les pensées critiques contemporaines opèrent, paradoxalement, une pacification de l'affrontement stratégique du xx e siècle. Face à la nouvelle configuration déterminée par la victoire du capital sur la révolution, elles oscillent entre une « analyse du capitalisme » qui a du mal à intégrer la compénétration du civil et du militaire (la quasi-totalité de la « pensée 68 » se trouve dans ce cas) et une analyse qui, comme celle de Foucault, intègre pouvoir et guerre pendant une courte période, mais se révèle incapable de voir que la guerre n'est qu'une composante de la machine du capital. Les conceptions du pouvoir que nous avons héritées de ces théories sont pour beaucoup dans l'impuissance à appréhender la stratégie capitaliste et la montée des nouveaux fascismes. Si Foucault est celui qui a le plus renouvelé la catégorie du pouvoir, il est aussi celui qui s'est le plus éloigné de son fonctionnement réel dans le néolibéralisme, en voilant, à travers le concept de gouvernementalité, la violence que celui-ci exerce directement sur les personnes et les choses. Sa conception non juridique d'un pouvoir enraciné dans la microphysique des relations qui constituent la trame de la vie de tous les jours a eu une influence notable sur l'élaboration théorique et politique des nouveaux mouvements sociaux. Les concepts de « biopouvoir », de « biopolitique » et ensuite de « gouvernementalité » ont rencontré un succès croissant parce qu'ils^Semblent constituer une alternative au concept et aux pratiques de la « gouvernance », mantra du néolibéralisme. Il est important revenir sur ces concepts car, en expulsant la guerre et la révolution, Foucault fait de la biopolitique, à mesure que ses recherches avancent, un dispositif fondamentalement
66
Le capital déteste tout le inonde
centré sur l'augmentation de la vie et de la puissance des populations, une technique de contrôle qui a perdu tout caractère négatif (violence, répression, guerre) pour se définir comme une force positive de production des sujets, de la liberté, de la sécurité. La thanatopolitique (envers de la biopolitique et concept d'ailleurs jamais véritablement établi), va progressivement disparaître, remplacée par la « gouvernementalité », qui, en donnant un cadre général aux techniques de gestion de la vie, efface ce qui restait encore de la guerre dans ses analyses. L'insistance avec laquelle Foucault définit les techniques de pouvoir comme « productives », en nous mettant en garde contre toute conception du pouvoir « répressive », destructive, guerrière ne correspond nullement à l'expérience que nous avons du néolibéralisme. Or, particulièrement depuis la fin du siècle dernier, la guerre, les fascismes, le racisme, le sexisme, le nationalisme, les « reformes » néolibérales ont manifesté la nature « négative », répressive et destructive du pouvoir. Deleuze fait remarquer que les relations de pouvoir chez Foucault diffèrent de la simple violence. Le pouvoir n'agit pas sur la personne, mais sur son action, sur ses « possibilités », c'està-dire qu'il s'exerce en structurant le champ du comportement. Il garde le « sujet » sur lequel il s'exerce « libre », capable de réagir et de répondre à ses sollicitations. La violence, au contraire, agit sur les choses et les personnes en refermant toutes les possibilités. Le pouvoir, ce n'est pas du tout « faire violence » ou « réprimer » ; c'est plutôt inciter, susciter, solliciter. Cela est sûrement vrai, mais ne couvre qu'une partie des relations de pouvoir, celles que Naissance de la biopolitique attribue au néolibéralisme. Et cette analyse ne correspond pas aux positions des chefs de file néolibéraux, qui, nous l'avons vu, sont loin de négliger la nécessité des fascismes, des dictatures, des guerres pour garantir la liberté (la « propriété privée »). Le pouvoir spécifiquement capitaliste de la discipline d'atelier, par exemple, ne porte pas sur « la faute et le dommage », affirme
Q u a n d le capital s'en va-t-en guerre
67
Foucault, mais sur « la virtualité du comportement3' ». Il intervient en quelque sorte avant même la manifestation du comportement. De manière semblable, les techniques biopolitiques agissent à l'endroit où les choses vont se produire, « en fonction d'événements ou séries d'événements possibles32 ». Le pouvoir consiste dans le fait de « rendre probable ». C'est exactement le discours que tiennent aujourd'hui les grandes entreprises de la Silicon Valley (Google, Amazon, Facebook, etc.) : à travers les « données », elles vont agir sur les comportements possibles en les anticipant. Mais si l'on s'en tient à cette définition, on a une vision tronquée de l'exercice du pouvoir. Celui-ci ne se limite pas à exercer une action sur une autre action, il implique également la possibilité d'imposer sa volonté par la force, par la violence, par une action qui, au lieu d'agir sur une autre action, agit directement sur la personne et sur les choses (les non-humains). Dans l'atelier comme dans les techniques biopolitiques, les deux types de violence (agir sur la virtualité des comportements et agir sur les choses et les personnes) coexistent, comme le savent celles et ceux qui les subissent (ouvriers, migrants, femmes, etc.). Le capital n'est pas production sans être en même temps destruction, destruction des personnes, des choses et du vivant. Si l'on arrête l'analyse à « l'action sur une action », on aura donc une conception « modemisatrice » et limitée du pouvoir dans le capitalisme, puisque son existence et sa reproduction supposent aussi des violences de classe, raciales et sexuelles. Ces rapports, qui participent tout autant de la « nature » du capitalisme, n'appartiennent pas à un passé destiné à disparaître avec le plein déploiement des techniques capitalistes de pouvoir. Ces dernières, pour fonctionner, ont besoin de la violence sur les choses et les personnes. Prenons par exemple la lecture foucaldienne de Gary Becker : celui-ci serait un grand novateur, un modemisateur en matière de politiques pénales et carcérales, en parfaite harmonie avec la 3'- Michel Foucault, Le Pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France, 1971-1974. Paris, Gallimard/Le Seuil, 2003, p. 53. 32- Michel Foucault, Sécurité, territoire, population, op. cit., p. 22.
68
L e capital déteste tout le i n o n d e
sortie de nos sociétés de l'ère des « disciplines » et l'entrée dans une époque de « soft power ». « La société n'a aucunement besoin d'obéir à un système disciplinaire exhaustif53 », et la politique pénale doit répondre à de nouvelles questions : « Qu'est-ce qu'il faut tolérer comme crime? » « Qu'est-ce qu'il serait intolérable de ne pas tolérer? » Cette nouvelle problématisation de la délinquance induit une nouvelle méthodologie que les néolibéraux ont trouvée dans la science économique et que Foucault résume de cette façon : « L'action pénale doit être une action sur le jeu des gains et des pertes possibles » que le criminel calculerait en « réponse » aux changements de politique pénale établis par la gouvernementalité. L'argumentation de Becker (le criminel se comporterait selon une logique de maximisation de « profit ») est tout simplement ridicule face à la réalité de quarante ans de politiques répressives qui ont produit le plus grand enfermement « disciplinaire » de l'histoire de l'humanité. Aux USA, la population carcérale a quintuplé depuis les années 1970. Les prisonniers américains représentent près de 25 % (2,2 millions de personnes) de la population carcérale mondiale, alors que le pays compte pour moins de 5 % de la population totale. Les Etats-Unis ont pratiqué une incarcération de masse qui ne répondait pas aux critères novateurs du « capital humain », mais, plus prosaïquement, à la politique de « guerre raciale » qui est au fondement de la constitution matérielle américaine et que le néolibéralisme a réactivée dans le cadre plus général de sa guerre de classe, pour rétablir le pouvoir de l'« économie ». On pourrait appliquer la même critique au « capital humain », dont le véritable objectif est de faire sortir la force de travail du salariat pour qu'elle assume seule les risques et les coûts impliqués par son activité. Individualisation, appauvrissement, culpabilisation régissent les politiques du « capital humain ». En outre, la conception « productive » du pouvoir défendue par Foucault peut conduire à des malentendus politiques, par exemple 33. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France, 1978-1979, Paris, Gallimard/Le Seuil, 2004, p. 261.
Quand le capital s'en va-t-en guerre
69
à l'illusion d'un affrontement pensé de manière unilatérale, comme performatif contre performatif (Butler), production contre production (Negri), création contre création (Guattari). Pour sortir de la dialectique du négatif, on abandonne la guerre et la révolution qui, en soi, n'ont rien de dialectique. Cette façon « positive », « productive », incitative de penser le pouvoir a donné lieu à une politisation qui a plutôt l'air de son contraire. Ce qui s'est éloigné pour longtemps, ce ne sont pas tellement les modalités négatives du pouvoir, mais, de manière subtile, toute problématisation de la révolution. Il ne s'agit pas de dire que la pensée de la « gouvernementalité » est compatible avec la « gouvernance » du libéralisme, mais qu'elle accepte sa principale croyance : l'économie, les institutions, les relations gouvernants/gouvernés ont remplacé la guerre, et l'impersonnalité de leur fonctionnement, la stratégie. Quant au concept de guerre, il ne faut pas l'entendre uniquement comme confrontation armée entre ennemis, ni seulement comme stratégie. Il doit également être compris comme une critique adressée à la conception marxienne qui interprète, de manière unilatérale, le pouvoir du capital comme un dépassement de la domination personnelle propre aux sociétés féodales. La guerre ne disparaît pas, elle ne peut pas être résorbée dans les dispositifs dépersonnalisants de l'économie et du droit, parce qu'elle est
la manifestation la plus éclatante du fait que le pouvoir est également violence sur les choses et les personnes. Félix Guattari illustre ce défaut majeur de la pensée 68, en prolongeant pour le capitalisme contemporain le point de vue de Marx sur le pouvoir du capital comme dépersonnalisation : « Les rapports personnologiques du type noble-valet, maître-apprenti s'effacent au profit d'une régulation des rapports humains généraux, fondés, pour l'essentiel, sur des systèmes de quantification abstraite portant sur le salaire, la "qualification", le profit34. » Les dispositifs qui dépersonnalisent les relations de pouvoir (la monnaie, 34-
Félix Guattari, Lignes defuite, La Tour d'Aiguës, L'Aube, 2011, p. 54.
70
Le capital déteste tout le inonde
le salaire, etc.) ne peuvent pas fonctionner sans des relations de pouvoir personnelles. Le fétichisme marxien (le renversement des relations de pouvoir entre les hommes en relations de pouvoir entre les choses) est source de malentendus, puisque sans flux de guerre, sans flux de violence raciste, sexiste, nationaliste, les flux abstraits, impersonnels de la monnaie, du droit, etc., n'auraient aucune chance d'être opérationnels. Negri et Hardt, alignés sur ces positions devenues dominantes après les années 1970, dénoncent les théories qui annoncent l'avènement des « nouveaux impérialismes » et autres « nouveaux fascismes » comme une « sorte de vision apocalyptique »3S. Elles voileraient et mystifieraient les vraies formes du pouvoir qui dominent effectivement nos vies, c'est-à-dire le pouvoir incorporé dans la propriété et le capital, le pouvoir immanent au droit et à ses institutions. Inutile d'attribuer une forme « dramatique ou démoniaque » au pouvoir ; celui-ci s'exerce, beaucoup plus normalement, par la forme de la loi et de la propriété. Ainsi se dissipe la vision tragique propre au xx c siècle : « le pouvoir politique est immanent aux structures économiques et juridiques ». Les visions apocalyptiques, taxées de « gauchistes », feraient même obstacle à l'engagement politique contre les véritables pouvoirs du capitalisme, puisqu'elles impliqueraient de ne pas pouvoir le « transformer de manière démocratique. Il faut s'y opposer et le détruire, voilà tout. » Après avoir dépoussiéré, suite aux événements de 2001, la « guerre civile mondiale » en la dénommant « globale » (mais sans jamais en faire une composante constitutive du capital, qui chez eux reste fondamentalement « production »), Negri et Hardt ont eux aussi abandonné le concept de guerre. Au tournant du siècle, le capitalisme aurait hésité entre l'option de la finance et l'option de la guerre, mais aurait finalement choisi la première parce qu'« une société en état de guerre » ne peut fonctionner que sur une courte 35. Michael Hardt et Antonio Negri, Commomsealtb, trad. fr. E. Boyer, Paris, Stock, 2012.
Quand le capital s'en va-t-en guerre
71
durée. À moyen terme, la guerre mine la « productivité, surtout dans une économie où la liberté, la communication et les interactions sociales sont absolument nécessaires ». La guerre est anti-économique, affirment Negri et Hardt contre l'évidence, alors que la finance internationale, comme la finance locale, n'hésite pas à donner son appui et à prêter ses hommes (les banquiers de Goldman Sachs) aux visions « apocalyptiques » de Trump, ni à légitimer et financer un fasciste comme Bolsonaro. Après les guerres totales, la guerre est devenue, pour parler comme Marx, une des « principales forces productives », constitutive de la « bigscience », de la technologie de pointe et de la logistique; elle forme en outre depuis le début du siècle un secteur économique incontournable et en constante expansion. Negri et Hardt radicalisent encore leurs positions. Le pouvoir n'est pas seulement incorporé à l'économie et au droit ; il s'exercerait aussi à travers des automatismes (lois, normes, protocoles technologiques et scientifiques) qui rendent la subjectivité du commandement impersonnelle, objective, « pacifiée ». « 11 est même difficile d'y déceler une violence, tant [le commandement] est normalisé et sa force appliquée de manière impersonnelle36. » Le contrôle capitaliste et l'exploitation ne sont pas exercés par un « pouvoir souverain extérieur », mais par des lois « invisibles » et « intériorisées ». Nous serions sortis des sociétés de souveraineté, puisque le pouvoir est immanent aux dispositifs disciplinaires et de contrôle, qui fonctionnent désormais de façon automatique et impersonnelle : la monnaie comme les normes sociales, la technologie numérique comme les techniques de gouvernementalité façonneraient nos comportements et nos subjectivités, produisant des habitudes sans recourir à la guerre, à la coercition et à la violence. Il semble aujourd'hui difficile de saisir ce que Walter Benjamin avait remarquablement vu entre les deux guerres mondiales. Et pourtant, dans l'acte de naissance du néolibéralisme, est à l'œuvre 36- Ibid., p. 29.
72
Le capital déteste tout le inonde
une « violence qui fonde » une nouvelle économie, un nouveau droit et de nouvelles institutions, tandis que leur fonctionnement sera assuré par une violence qui les « conserve » - une violence souvent « latente », une violence « administrative » mais pas moins efficace que la première. Le « triomphe » du capital sur les classes subalternes n'est pas donné une fois pour toutes. Il doit être quotidiennement reproduit. Face à l'incapacité des forces capitalistes de sortir de l'effondrement financier qu'elles ont elles-mêmes causé, la « violence qui conserve » doit franchir un seuil. Elle est en train de prendre la forme des nouveaux fascismes. La conservation risque de dégénérer en autodestruction, comme c'est arrivé entre les deux guerres totales. Plus profondément encore, la violence qui fonde et la violence qui conserve ne se succèdent pas ; l'anomie (la suspension du droit) et la norme (la production du droit) ne sont pas deux moments successifs dans l'organisation de l'ordre politique. Nous ne vivons pas un « état d'exception permanent », mais de façon plus perverse, l'imbrication, l'indistinction de l'état d'exception et de l'Etat de droit. En France après les attentats de novembre 2015, le gouvernement a déclaré un « état d'urgence » qui n'a jamais été révoqué ; au contraire, fin 2017, une partie de ses dispositions ont été incluses dans la constitution. La loi « anticasseurs » (quatrième loi sécuritaire depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée) votée en février 2019 contre les mobilisations des « gilets jaunes » continue à renforcer cette hybridation entre Etat de droit et état d'urgence. « Aujourd'hui, le gouvernement et les forces de police sont en train de réemployer les mêmes mécanismes pour procéder au maintien de l'ordre public, non plus à l'égard des terroristes, mais à l'égard de ceux qui dérangent ou qui apparaissent comme des fauteurs de troubles. On voit bien comment l'exception, une fois qu'elle a été posée dans notre droit, fait tache d'huile, pour finir par devenir la règle37. » 37. Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, cité par Ellen Salvi, « Cette loi "anticasseurs" ne menace pas le délinquant, elle menace le citoyen »,Mediapart, 3 février 2019.
Quand le capital s'en va-t-en guerre
73
Dans les périodes de forte mobilisation politique, l'État de droit et son pouvoir judiciaire se voient dépouillés de leurs prérogatives : celles-ci sont concentrées dans la police (« Parfois aussi, le gouvernement donne l'impression d'être devenu l'otage de sa propre police », remarque François Sureau, un avocat proche de Macron38) et dans l'administration, qui, de façon arbitraire et sans recours, décide de qui a le droit et la liberté de manifester. Ces décisions prises dans l'« urgence » ne sont jamais révoquées. Il faut insister encore une fois sur les fondements capitalistes des pouvoirs contemporains. Agamben, qui essaie de conjuguer l'état d'exception de Cari Schmitt avec la théologie politique de Benjamin et la biopolitique de Foucault, manque l'essentiel des transformations du pouvoir, car la « violence qui fonde » et la « violence qui conserve » est le fait, non plus de l'État, mais du capital. Le passage de l'anomie au « nomos » est aujourd'hui une prérogative du capital, d'une double manière : soit par le truchement de l'État, dont les deux fonctions de « souveraineté » et de « gouvernementalité » sont à la disposition du capital, soit directement, à travers les multinationales. En réalité, le capital est continuellement en train de détruire et de produire du droit, de le suspendre et de l'activer, de sorte que nous vivons dans une zone d'indistinction. Et si cette indistinction est ce qui définit l'état d'exception, l'État n'est sûrement pas l'instance qui en décide aujourd'hui. « Pas de pouvoir sans une série de visées et d'objectifs », fait remarquer Foucault, qui ajoute : les « choix et les décisions » ne résultent pas d'un « sujet individuel », ni d'un « état majeur ». Si les visées et les décisions n'appartiennent plus à l'État mais au capital, 38. Il ajoute : « Une liberté fondamentale a disparu. Il n'y aurait aucune raison d'ailleurs de ne pas étendre ce beau système, et sans doute y viendra-t-on un jour. Les digues ont sauté. Tout est désormais possible [...). Je ne sais pas où est le "progressisme" dans cette majorité ou dans ce gouvernement, mais il n'est sûrement pas dans le domaine des libertés publiques. Ces Jens osent des choses venues tout droit du xix' siècle répressif. Que personne ne voie la contradiction politique entre la lutte revendiquée contre le populisme" et ce genre de législation est proprement stupéfiant » (François Sureau, « C est le citoyen qu'on intimide, et pas le délinquant », Le Monde, 4 février 2019).
74
Le capital déteste tout le inonde
ses objectifs et ses choix, tout en étant ceux d'une machine et non d'un sujet individuel, ressemblent de plus en plus aux résolutions d'un état majeur. Grâce à la concentration inouïe de la production, du commerce, des patrimoines et des richesses, le « comité qui administre les affaires communes de la bourgeoisie », dont parlait le Manifeste communiste, semble s'être installé au sein du capital financier. L'Etat, comme « modèle de l'unité politique », comme « titulaire du monopole de la décision politique », est « en train d'être détrôné », écrivait Schmitt en 1922. C e processus, commencé avec les guerres totales, est allé jusqu'à son terme : le monopole de la décision politique est désormais détenu par la machine de guerre du capital. Ce fait majeur du xx e siècle, la subordination au capital de l'Etat et de ses fonctions de souveraineté et de gouvernementalité, n'est expliqué ni par la biopolitique de Foucault, ni par les nouvelles versions qu'en ont proposé Esposito et de Agamben (la « théologie économique » des Pères de l'Eglise est très loin - c'est un euphémisme - de pouvoir rendre compte de la nature et de l'action du capital)3''. Les pensées critiques, dans leur appréhension du fonctionnement du pouvoir, sont en outre trahies par leur « eurocentrisme ». II est difficile de penser la « civilisation européenne » sans y associer la guerre et le droit, sans conjuguer Y illimité de l'affrontement stratégique entre Etats (et les guerres civiles internes) et le limité de la régulation des mêmes guerres par la souveraineté, le constitutionnalisme, la gouvernementalité. Cette régulation se fonde sur 39. C e qu'on doit interroger, ce n'est pas « l'unité immédiate de la politique et la vie », mais celle que le capital voudrait réaliser avec la vie. Dans le capitalisme, la vie n'est pas semblable à la « vie nue » divisée de ses formes, mais rendue aux forces qui la constituent. C e dont elle doit être absolument séparée, c'est sa forme politique (la révolution), sous peine de destruction physique. Cette théorie reproduit un malentendu qu'on trouve déjà chez Foucault. Le problème n'est pas le biologique, mais la puissance (a-organique) des forces. Chez Marx, la force de travail est une de ces forces « vivantes » qui ne peuvent définies par la biologie et qui requièrent autre chose que la « théologie politique » pour que lui soient imposées des tâches et que soient composées ses puissances.
Quand le capital s'en va-t-en guerre
75
un dispositif qui n'est presque jamais explicité par la philosophie politique et la théorie du droit puisque, pour le saisir, il faut avoir à l'esprit le « marché mondial » et la domination globale que l'Europe a exercée pendant des siècles. Le colonialisme n'a pas été seulement une formidable machine d'exploitation d'une force de travail réduite à l'esclavage. Les colonies n'ont pas été uniquement des terres de pillage, d'accumulation de richesse pour l'Europe. Le colo-
nialisme et les colonies ont été des parties intégrantes et constitutives d l'ordre politique occidental. La concurrence entre Etats Européens, qui risquait toujours de dégénérer dans l'illimité de la guerre, s'est stabilisée lorsque cette division entre guerre et droit, illimité et limité s'est superposée à une division géographique entre colonie et métropole. La force, la guerre, l'illimité de la violence au-delà de la « ligne de couleur », dans les colonies ; le droit, le limité, la souveraineté, le constitutionnalisme dans le « monde civilisé », en Occident. Dualité que Fanon traduit par le couple « violence coloniale »/« violence pacifique » - l'oxymore n'est qu'apparent - , dont les termes entretiennent « une sorte de correspondance complice, une homogénéité »4°. (Notons au passage que la reprise foucaldienne du concept de pouvoir fait l'impasse sur le colonialisme comme partie constitutive de l'ordre politique, sur ce présupposé de la souveraineté, de la gouvernementalité et du constitutionnalisme, de sorte que sa définition du pouvoir, si elle éclaire sa dimension microphysique, est aveugle à la configuration mondiale de sa macrophysique.) Les deux guerres mondiales et le processus de décolonisation ouvert par la révolution soviétique ont fait sauter cette structuration de l'ordre politique occidental. Les guerres totales ont importé la violence sans limites exercée dans les colonies dans la confrontation entre impérialismes pour la « répartition » du nombre d'esclaves (c'est ainsi que Lénine définissait la lutte pour l'hégémonie mondiale entre puissances occidentales). La décolonisation, à son tour, a 4°.
Frantz Fanon, Les Damnés de ta terre. Œuvres, op. cit., p. 485.
76
Le capital déteste tout le inonde
rendu inopérant le fondement de cet ordre politique en s'attaquant précisément à la ligne de partage entre « civilisation » et « barbarie ». La révolution soviétique a permis, pendant soixante-dix ans, de reconstruire frontières, séparations, ennemis, luttes de civilisation sur un nouveau front Est/Ouest à l'abri duquel l'ordre constitutionnel du « monde libre » a pu lui aussi se reproduire. Avec la chute du communisme, la séparation, les frontières, l'ennemi, la lutte de civilisation sont à nouveau tracés et nommés par la vieille séparation entre Nord et Sud, mais dans une toute nouvelle situation géopolitique. Pour garantir son ordre politique, le Nord cherche inutilement à rétablir la « ligne de couleur ». Le nouveau fascisme se charge de cette mission impossible. Le pouvoir contemporain Si la tentative de rétablir la ligne de couleur est vouée à un échec certain, elle nous permet tout de même d'appréhender le fonctionnement du pouvoir contemporain, puisque les termes qu'il voudrait séparer - ordre et désordre, guerre et droit, illimité et limité - se trouvent désormais indissolublement imbriqués. La nature du pouvoir contemporain se manifeste sans aucune ambiguïté dans la gestion des flux migratoires, où nous retrouvons une nouvelle version de l'agencement du civil et du militaire. Dans les eaux de la Méditerranée, le « civil » agit en étroite collaboration avec le « militaire » et les deux collaborent de concert avec des bandes armées, des armées privées, des criminels organisés, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'êtres humains, des trafiquants d'organes. La logistique avait largement anticipé cette situation, mais l'imbrication avec la corruption et la criminalité est spécifique au néolibéralisme. Il est très significatif que les cristallisations politiques en Occident se fassent sur cette ligne néocoloniale et que l'« ennemi » soit une transformation du colonisé. L'imbrication du civil et du militaire essaie de la reconstruire, tout en sachant qu'elle fuit de tous côtés, puisque les mouvements de populations ne sont
Quand le capital s'en va-t-en guerre
77
pas déterminés seulement par des raisons contingentes (misère, guerres, etc., alimentées par les Occidentaux pour des raisons stratégiques et économiques - pillage des matières premières, achat de terres, vente d'armes), mais, plus profondément, par les révolutions anticoloniales qui ont sédimenté des subjectivités rétives à l'ordre néocolonial. La volonté d'autonomie et d'indépendance des luttes contre l'impérialisme s'est incarnée dans des comportements, des attitudes, des manières de vivre que la répression militaire du Nord aura du mal à arrêter à ses frontières. La frontière qui traverse la Méditerranée est avant tout fantasmatique. Les frontières se sont multipliées et fractalisées, elles ont pénétré en profondeur dans les territoires occidentaux en suivant les mouvements migratoires qu'elles visent à contrôler et à entraver (centres de rétention). Elles se manifestent à travers toutes les techniques de ségrégation spatiale qui s'appliquent non seulement aux immigrés, mais aussi à des parties croissantes de la population locale (banlieues, ghettos, favelas, etc.). La frontière officielle, impuissante à retenir les mouvements des populations, a pourtant une fonction très précise, en constituant le lieu de subjectivation des nouveaux fascismes. Le contrôle des flux et la hiérarchisation des populations ne se fait pas par le biopouvoir tel qu'il est décrit par Foucault, ni par son envers, la thanatopolitique, terme trop générique et ayant des connotations presque métaphysiques, mais par la guerre contre les populations. Ce terme semble plus approprié, parce qu'il trace une continuité entre la suppression physique (des migrants), les nouvelles modalités d'exploitation de la force de travail, les politiques ségrégationnistes, les privatisations du we/fare, etc. La thanatopolitique contient l'idée d'une puissance unilatérale, d'un pouvoir sans reste du capital, alors que le concept de guerre porte avec soi la relation entre ennemis (potentiels ou réels). Le pouvoir souverain (« faire mourir et laisser vivre ») et la biopolitique (« faire vivre et laisser mourir ») ne se sont pas succédé; ils coexistent, comme on le constate aujourd'hui, où
78
Le capital déteste tout le inonde
le « faire-mourir » (les migrants) est pratiqué par les mêmes qui organisent le « laisser-vivre » (il serait plus précis de dire « laissersurvivre ») des nationaux. Le civil et le militaire, la guerre et la gouvernementalité sont des techniques qui fonctionnent ensemble, sans passer par la paix. La conception foucaldienne du pouvoir est un bon exemple des limites qui affectent l'ensemble de la pensée 68. Tout en constituant une rupture par rapport aux théories classiques et même marxistes, elle partage avec elles une vision du fonctionnement des dispositifs de pouvoir centrée sur le Nord. Chez Foucault, il manque la moitié du « récit » généalogique sur les « pouvoirs », les « sujets » politiques et les institutions, puisque l'analyse se limite à l'Europe. Le biopouvoir représente un point de vue eurocentré sur des dispositifs de pouvoir pourtant mondialisés depuis 1492. Si l'on analyse la régulation et le contrôle des populations du point de vue de l'économie-monde, on peut affirmer que la guerre de conquête, la victoire « militaire » contre les « populations », précède et fonde la régulation gouvernementale de ces mêmes populations, et cela, même en Europe. L'affirmation de Foucault selon laquelle « la vieille puissance de mort où se symbolisait le pouvoir souverain est maintenant soigneusement recouverte par l'administration des corps et la gestion calculatrice de la vie » est manifestement fausse, ou alors de portée limitée. Du point de vue du « marché mondial », cette puissance de mort n'a jamais cessé de s'exercer, même en Europe, où elle a produit les effarants massacres de la première moitié du xx c siècle, et elle est train de reprendre des forces. Biopolitique et capital : de quelle vie est-il question ? Parmi les concepts de la pensée 68, celui de biopolitique a sûrement eu l'héritage le plus fécond. Il a inauguré un véritable champ de recherches, mobilisé des milliers d'étudiants et il reste vivant dans les débats (au moins académiques). Il est néanmoins problématique jusque dans son étymologie. Ni le racisme, ni ce que
Q u a n d le capital s'en va-t-en guerre
79
Foucault appelle la biopolitique, n'ont nécessairement de fondement biologique. La naturalisation de hiérarchies fondées sur des différences biologiques (la race, le corps, le sexe) est contingente, historique. Giorgio Agamben et Roberto Esposito, qui se targuent d'avoir dépassé les limites de l'analyse foucaldienne, n'ont pas saisi le tournant représenté par les luttes des années i960 et 1970 : la « naturalité » des différences raciales et sexuelles a été défaite par la critique menée par les luttes des colonisés et les luttes féministes. Le biopouvoir n'est pas la forme générale du pouvoir contemporain, il n'existe pas un « régime biopolitique » au centre de la politique contemporaine (Esposito). « Le renversement de l'historique au biologique [...] dans la pensée de la guerre sociale4' », par lequel Foucault caractérise le nazisme, est lui-même historique, contingent. Il va à son tour être renversé par les luttes de la seconde moitié du xx c siècle et, comme l'a expliqué Donatella di Cesare, le caractère « biologique » du racisme nazi doit lui-même être relativisé42. Dans le capitalisme contemporain, le racisme et le biopouvoir n'ont plus nécessairement de fondement biologique; et pourtant, ils continuent à produire leurs « effets de pouvoir ». Aujourd'hui, la race n'existe pas biologiquement, génétiquement, mais elle persiste comme technique de division, de ségrégation, d'infériorisation. Le « racisme sans race » continue à produire ses effets politiques, guerriers et militaires. De la même manière, le corps, le sexe, la reproduction de la vie ont été rendus à leur réalité de constructions politiques 41. Michel Foucault, « H faut défendre la société». Cours au Collège de France, 1976, Paris, Gallimard/Le Seuil, 1996, p. 194. 42. « Il serait [...] réducteur de considérer l'antisémitisme nazi comme simplement "biologique". Sous le manteau de la science, ou de la pseudo-science, d'anciens préjugés théologiques faisaient surface [...]. L'antisémitisme hitlérien est une union politique et théologique entre racisme et apocalypse » (Donatella di Cesare, Heidegger, les Juifs, la Shoah, op. cit., p. 148). Elle ajoute : « Contrairement à ce que l'on croit, les lois de Nuremberg ne sont pas fondées sur des critères "scientifiques", ce n'est qu'à des fins de propagande qu'elles ont été qualifiées de "lois raciales", puisque les inventions racistes n ont jamais trouvé de vérification empirique, ce qui a rendu nécessaire le recours à la théologie » (ibid., p. 160).
76
Le capital déteste tout le inonde
et historiques par les mouvements féministes, qui s'approprient des différences « biologiques » en les transformant systématiquement en enjeux politiques. Les mouvements féministes politisent constamment ce que le pouvoir naturalise, en problématisant non seulement le genre, les fonctions et les rôles féminins, mais aussi le sexe, dernier retranchement de l'hétérosexuel dans le biologique. Comme nous l'avons vu, les militaires, dans leur analyse stratégique de l'après-guerre froide, font également subir une torsion à la régulation biopolitique des populations, en la faisant sortir de son fondement « biologique ». Ils affirment que les conflits futurs seront dominés par la « guerre au sein des populations », les populations étant « devenue [sj à la fois acteurs et enjeux ». « La cible est beaucoup moins l'Etat que la population », et gagner la guerre, « c'est contrôler le milieu » où les populations vivent. La population, objet de la biopolitique, n'est pas appréhendée sous le point de vue « biologique » ni « racial », mais dans sa dimension politique, sociale et historique. La biopolitique proprement dite est subordonnée à la guerre, et la guerre civile constitue sa vérité. L'ennemi redevient dès lors ce qu'il a toujours été : un ennemi politique, même lorsqu'il exprimait son hostilité en termes « raciaux ». C e que la gouvernementalité doit d'abord gérer, c'est le conflit en général et, tout particulièrement, la perspective de la révolution, dont la nature n'est pas biologique. De la même manière, la vie dont il est question dans la biopolitique contemporaine, c'est celle, politique, du capital. En opposant l'« économie politique du pouvoir » à la « critique de l'économie politique » marxienne, Foucault obscurcit la compréhension des transformations de l'exercice du pouvoir qui se sont produites à partir de la première moitié du xx e siècle, où ces deux économies se sont profondément intégrées l'une à l'autre, et ce, sous hégémonie du capital. La primauté de l'« économie politique du pouvoir » sur la « critique de l'économie politique » est une évidente erreur d'interprétation du capitalisme de l'après-68, partagée du reste par tous les philosophes de sa génération (Lyotard, Deleuze, Derrida, Guattari, etc.) et que l'on
Quand le capital s'en va-t-en guerre
81
retrouve, reproduite telle quelle, par la pensée critique, notamment dans certains courants du féminisme. Par exemple, le débat entre Nancy Fraser et Judith Butler, dont les termes ont été maladroitement rendus par l'opposition entre « politique sociale » (économie politique) et « politique de l'identité » (économie politique du pouvoir), est lui aussi tributaire de cette funeste opposition. À l'époque où (1979) Foucault déclare que le problème de l'accumulation du capital produisant en même temps richesse et pauvreté est, bien qu'il persiste, un problème du xixe siècle, la machine du capital affiche sa volonté de remettre au centre de sa stratégie précisément l'accroissement « sans limites » de la création simultanée de richesse et de pauvreté. La polarisation des patrimoines et des revenus atteint des niveaux qui vont rapidement égaler et dépasser les différentiels de richesse produits par le capitalisme au xix e siècle pour atteindre (aux USA) ceux d'avant la Révolution française, tout en portant l'exploitation du « vivant » non humain à son point de rupture (crise écologique). Mais pour Foucault, l'urgence est tout autre. La priorité de l'action politique doit porter sur les modalités d'assujettissement. Les luttes et les résistances, dira-t-il à la fin des années 1970, doivent avoir comme objectif les « effets de pouvoir eux-mêmes » sur le corps, la subjectivité, plutôt que quelque chose comme l'exploitation, quelque chose comme les inégalités économiques. Ce qu'il faut combattre politiquement, « c'est le fait qu'un certain pouvoir s'exerce et que le fait qu'il s'exerce soit insupportable43 ». Durant toute cette décennie, Foucault est obsédé par la question du « trop de pouvoir », de l'« excès du pouvoir », ce qui va être d'une utilité certaine pour analyser le développement de certaines modalités de fonctionnement du capitalisme que le marxisme avait délaissées (prisons, écoles, hôpitaux, etc.) et des nouvelles modalités du fascisme, du racisme et du sexisme, mais qui se révèle une impasse 43- Michel Foucault, « La philosophie analytique et la politique » ( 1978), Dits et Écrits, t- ll,o/). cit., p.545.
82
Le capital déteste tout le inonde
lorsque la critique de ces « excroissances du pouvoir » n'est pas strictement liée à la stratégie de guerre du capitalisme produisant à la fois richesse et pauvreté. Tout en passant d'une critique du pouvoir centrée sur le juridique à une critique nietzschéenne du pouvoir, fondée sur les « forces », Foucault continue d'accorder un rôle stratégique à l'Etat. La biopolitique ne peut se concevoir que comme « une bio-régulation par l'Etat44 » car, à la différence des disciplines, elle requiert des « organes complexes de coordination et centralisation » que seule l'administration étatique peut garantir. Mais l'État, précisément à partir de l'organisation de la biopolitique, entame une transformation qui le videra progressivement de son « autonomie » et fera de lui, dans le néolibéralisme, une simple fonction du capital. Voilà ce que Foucault ne voit pas : la discontinuité qu'impliquent pour l'État les ruptures révolutionnaires, d'une part, et, d'autre part, les sauts imposés par le capital. Pendant longtemps, même en Europe, on ne s'est absolument pas soucié de la « vie » ou de la mort des « prolétaires », comme le Foucault reconnaît lui-même : « Les conditions de vie qui étaient faites au prolétariat, surtout dans la première moitié du xix c siècle, montrent qu'on était loin de prendre en souci son corps et son sexe ». C'est le danger représenté par la révolution tout au long des xix c et xx e siècles qui a obligé le capital à une stratégie d'intégration, qui est toujours aussi technique de division : division, d'abord, entre métropole et colonie (que les colonisés vivent ou meurent continuait à n'avoir aucune importance), puis division à l'intérieur du prolétariat dans les métropoles. Pour que la vie et la mort de « ces gens-là » devienne un problème, « il a fallu des conflits [...] il a fallu des urgences économiques45 », remarque justement Foucault. Pour essayer de comprendre la stratégie de la biopolitique, il faut donc remettre au centre de la problématisation la « vie » politique ou, 44. Michel Foucault, « Il faut défendre la société», op. cit.,p. 187. 45. Michel Foucault, Histoire de la sexualité, 1.1 : La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 167.
Quand le capital s'en va-t-en guerre
83
plus précisément, la possibilité et la réalité de la « révolution » qui hante la planète depuis deux siècles et qui constitue la vraie raison de la guerre et de la généralisation du welfare. Mais aujourd'hui, les dispositifs « biopolitiques » ne semblent plus répondre à la fonction foucaldienne d'augmenter la vie des populations. La vie qui est en jeu n'est pas d'abord celle, biologique, de la population, mais la vie politique de la machine capitaliste et des élites qui en constituent la subjectivation. Leur sauvegarde implique nécessairement la mise en danger de la vie des populations. À cette vie et à sa reproduction, le capital est prêt à sacrifier, sans aucun état d'âme, la santé, la formation, la reproduction, le logement de larges couches de la population, c'est-à-dire la vie des prolétaires, comme il l'a toujours fait, comme il continue à le faire en la reconduisant - puisque le rapport de force le permet - au minimum (les services minimums des néolibéraux signifient précisément cela). En même temps, la réorganisation néolibérale du welfare state fonctionne à l'envers. Elle a transformé celui-ci en un dispositif d'assistance des entreprises et des riches qui accroît les inégalités au lieu de les réduire. Le président français Emmanuel Macron définit parfaitement cette logique : il faut « aider les riches » (pour qu'ils produisent la richesse qui « ruissellera » vers le bas) et « responsabiliser les pauvres » (les culpabiliser tout en les appauvrissant). De la même manière, le capital ne se soucie aucunement de la destruction généralisée des possibilités de vie de la planète qui sont, précisément, les conditions de son accumulation. Le capitalisme, en deux cents ans, a réussi à détruire ce que la « nature » avait mis des millénaires à produire. Objecter que de cette façon il se met en danger lui-même, qu'il a besoin d'une planète et de force de travail, c'est ne rien comprendre à sa « rationalité ». Pierre Dardot et Christian Laval ont publié un livre inspiré de Foucault, La Nouvelle Raison du monde, qui donne une imagé très édulcorée du néolibéralisme (sans les guerres civiles sud-américaines) et qui l'analyse selon sa « rationalité », alors que « l'argent, le capital-argent, c'est un point de démence tel qu'il n'aurait en psychiatrie qu'un équivalent : ce
84
L e capital d é t e s t e t o u t le i n o n d e
qu'on appelle l'état terminal [...]. Tout est rationnel dans le capitalisme, sauf le capital ou le capitalisme. Un mécanisme boursier, c'est tout à fait rationnel, on peut le comprendre, l'appendre, les capitalistes savent s'en servir, et pourtant c'est complètement délirant, c'est dément ».46 Le fascisme et la guerre sont toujours possibles parce que cette rationalité pousse continuellement à l'illimité, à l'exploitation sans limites de toutes les ressources, humaines et non humaines. S'il est vrai, comme le pensait Marx, que le capital déplace continuellement les limites qu'il a lui-même créées, le xx e siècle nous a appris que ce déplacement ne peut pas se faire sans guerres et sans violence fasciste. Keynes, fin connaisseur de ses semblables, ne se faisait aucune illusion sur la violence de la réponse des capitalistes (« capables d'éteindre le soleil et les étoiles ») à tout ce qui menace le profit et la propriété. Et la menace vient également de l'irrationalité même du capital, car, toujours selon Keynes, « la règle autodestructrice du calcul financier régit tous les aspects de l'existence ». La disparition de la pensée stratégique « Avant l'être, il y a la politique. » Gilles Deleuze et Félix Guattari Sans la guerre et sans la révolution, les mouvements politiques ont perdu tout savoir stratégique et toute sensibilité à l'analyse des contingences politiques, des ruptures, des tournants événementiels, des changements de phase politique. La chose est d'autant plus étonnante que la philosophie la plus originale de la pensée 68 est celle de l'événement. Mais on a l'impression qu'elle a été appliquée à tout, sauf au conflit politique avec le capital. Même si le cadre politique, la nature du capitalisme et des sujets politiques ont radicalement changé, reconquérir un point de vue 46.
Gilles Deleuze, L'île déserte et autres textes, Paris, Minuit, 2002, p. 366.
Q u a n d le capital s'en va-t-en guerre
85
stratégique pourrait redonner force aux mouvements contemporains, qui semblent guidés à la fois par une temporalité de l'ici et maintenant (refus de renvoyer les changement à un futur promis) et par une temporalité longue (construction de formes de vie autonomes et indépendantes), hors de toute temporalité stratégique. Walter Benjamin nous met en garde contre l'abandon du savoir stratégique en donnant une définition de la politique qui intègre les ruptures du continuum de l'histoire, c'est-à-dire une sensibilité au kairos politique, à un art de la contingence de la révolution : « L'histoire ne connaît pas le mauvais infini dans l'image de deux combattants éternellement en lutte l'un contre l'autre. Lavéritable politique se calcule en échéances47. » La pensée critique n'est pas très sensible au kairos, elle a du mal à saisir la contingence des situations politiques. Les tournants de l'histoire semblent lui échapper. Dardot et Laval, avec un timing complètement décalé, ont ainsi proposé une reconstruction de la gouvernementalité foucaldienne et des assujettissements qui l'accompagnent au moment précis où l'une et les autres cessaient de fonctionner. Problématiser la guerre (et la révolution) implique d'assumer un point de vue irréductible à la sociologie, à la philosophie, à l'économie, à la théorie politique. C e geste est accompli dans la première moitié des années 1970 par Michel Foucault, qui introduit, sans grand succès (le « sans grand succès » concerne Foucault lui-même), la « stratégie » : « ce qui rend déchiffrables les événement historique de l'humanité ou les actions humaines4" ». Le concept et la pratique sont directement empruntés au savoir des militaires. La stratégie peut éclairer « l'antagonisme qu'il y a lorsque se présente une situation où les ennemis se font face, une situation où l'un gagne et l'autre perd », situation qui correspond parfaitement à notre actualité où ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu constituent des mondes parallèles et s'éloignant à la vitesse des 47^Walter Benjamin, Rue à sens unique, Paris, Allia, 2015, p. 74. 48. Michel Foucault, « Méthodologie pour la connaissance du monde : comment se débarrasser du marxisme » (197H), Dits et Écrits//, op. cit., p. 605.
86
L e capital déteste tout le inonde
« réformes » mises en place. Mais cette affirmation reste générique si nous n'ajoutons pas que, depuis 1789, la stratégie a pour contenu la révolution et la contre-révolution - c'est bien cette idée qui soustend la citation de Benjamin donnée plus haut. La pensée stratégique reconfigure l'exercice du pouvoir en précisant ce que nous avons ébauché plus haut. Une importante partie des mouvements féministes semble négliger la guerre et la stratégie, en intégrant et portant à ses extrêmes conséquences la critique du pouvoir comme répression et en affirmant, au contraire, son action productive. Judith Butler, par exemple, affirme la nature non essentialiste de la sexualité, plutôt produite par le discours que réprimée : la « sexualité est saturée du pouvoir » ou « coextensive au pouvoir », donc construite sans reste par lui. C'est ainsi qu'elle interprète le Foucault du premier tome de YHistoire de la sexualité. Or ce livre autorise une autre lecture : grâce à la « guerre », dont il fait largement, et pour la dernière fois, usage, Foucault développe un point de vue stratégique qui, loin de faire disparaître le « productif» et le « répressif», les subordonne à la stratégie. Le pouvoir est défini par une multiplicité de rapports de force et de stratégies qui sont à la fois « locaux et instables », se produisant à chaque instant et venant de partout. « [L]es rapports de force multiples qui se forment et jouent dans les appareils de production, les familles, les groupes restreints, les institutions, servent de support à des larges effets de clivage qui parcourent l'ensemble du corps social4'. » Le pouvoir, comme la domination sexuelle, n'est pas une chose, une institution, une « loi », une structure, mais « le nom qu'on prête à une situation stratégique50 ». Il ne produit pas à proprement parler ces rapports entre les forces, il se limite à les « coder » et à les « intégrer ». En les codant et les intégrant, il clôt les rapports stratégiques, jamais complètement et seulement pour un temps, à l'intérieur des institutions, normes, dispositifs. Le « jamais 49. 50.
Michel Foucault, Histoire de ta sexualité, 1.1 ,op. cit.,p. 124. Ibid., p. 123.
Quand le capital s'en va-t-en guerre
87
complètement » signifie que la sexualité, comme les autres codifications (économique, politique, etc.), n'est jamais « saturée du pouvoir », n'est jamais « coextensive au pouvoir ». Tout au contraire, « les relations de pouvoir [...J sont des matrices de transformation5' », de sorte qu'une situation est toujours modifiable, car de la relation de pouvoir font également partie les points de résistance (« ceux-ci jouent dans la relation de pouvoir, le rôle d'adversaire, de cible, d'appui, de saillie pour une prise »). Ces « matrices de transformation » sont activables à condition de produire une rupture politique et d'engager une lutte et une stratégie52. Ce qui pose problème, et qui a par la suite été rejeté par Foucault lui-même, c'est la modalité guerrière de ces rapports et leurs stratégies. « Cette multiplicité des rapports de force peut être codée soit dans la forme de la "guerre", soit dans la forme de la "politique" ; ce seraient deux stratégies différentes (mais promptes à basculer l'une dans l'autre) pour intégrer ces rapports des forces déséquilibrés, hétérogènes, instables, tendus53. » La politique (le droit, l'Etat, le système politique) ne remplace pas la guerre, politique et guerre sont toujours au contraire des stratégies « promptes à basculer l'une dans l'autre », mais sous l'hégémonie de la machine du capital. Si les deux stratégies sont à disposition du pouvoir (de la machine du capital), elles peuvent également être mobilisées par la révolution. Elles semblent plus adaptées à l'activité politique que la simple action performative ou discursive, qui peut sûrement 51. Ibid., p. 131. 52- Les concepts de « travail », de « production », de « classe » gagneraient beaucoup a etre appréhendés à partir des rapports stratégiques. Le parti pris du post-opéraïsme, d'ontologiser le travail et les travailleurs, implique l'attribution d'une primauté à l'activité de travailleurs (cognitifs) qu'on ne trouve nulle part. L'initiative politique n'est pas renfermée dans une ontologie de la productivité de l'être, mais dans la capacité d'affirmer par une négation, par une rupture, sa propre force politique. L'ontologie du travail fait voir le monde à l'envers : la multitude dicte les temps de l'agenda politique et le capital suit péniblement en capturant sa productivité. 53- Michel Foucault, Histoire de la sexualité, 1.1, op. cit., p. 123.
88
Le capital déteste tout le inonde
faire partie d'une stratégie politique, mais à condition de ne pas réduire cette dernière à la performance et au discours. Teresa de Lauretis, dans un article où elle analyse, entre autres choses, l'utilisation de la conception de la productivité du pouvoir par la théorie queer, met en garde contre un double danger : d'abord il ne faut pas parler génériquement de pouvoir car le capital s'est « refait une santé ("look") et va régulièrement à la salle de sport » ; deuxièmement et par conséquent, dans l'agir politique, on ne peut pas faire l'économie de la domination du capital, qui « est toujours mortifère. Malgré Foucault54. » Il n'y a pas, selon ce dernier, « un lieu de grand refus, âme de la révolte, foyer de toutes les rébellions, loi pure de la révolution ». Cela est acquis depuis les années 1970. Mais il est également établi que la multiplicité des rapports de forces, y compris inhérents à la sexualité, ne trouve à s'exprimer, à se problématiser, à se subjectiver de manière radicale que pendant les ruptures révolutionnaires. C'est là, précisément, que l'on parvient à se débarrasser de la posture de « gouverné » pour renouer avec l'affrontement, la stratégie et l'ouverture des possibles. C e que découvre l'aile radicale du mouvement gay pendant les fantastiques ruptures politiques des fantastiques années 1970 italiennes, la lutte comme « guerre »5S /qui définit clairement son ennemi : « la norme hétérosexuelle capitaliste ». Le combat ne se limite pas à une politique de « reconnaissance » de la diversité de tous les sujets humains (Butler), mais va à la racine des choses. Selon une logique qui renvoie à la tradition 54. Teresa de Lauretis, « La gaia scienza, owero la traviata Norma », in Mario Mieli, Elementi di critiqua omosessuale, Milan, Feltrinelli, 2017, p. 266. 5 ; . A propos de Mario Mieli, auteur du plus important essai théorique du mouvement de libération homosexuel en Italie, Claude Rabant écrit : « Comme Mieli le répète plusieurs fois, c'est une guerre. Le conflit n'est pas seulement intra-discursif, destiné à légitimer une expérience, il est également réel et extra-discursif, c'est-à-dire corps à corps [...]. La critique est une conquête de territoire, la nouvelle appropriation d'un territoire qui est l'équivalent de l'appropriation de soi. Il s'agit d'une guerre qui attaque inévitablement le territoire de l'autre, le dominant, qui le met en difficulté, pas seulement localement, mais globalement » (Claude Rabant, « Un clamore sospeso tra la vita e la morte », in Mario Mieli, Elementi di critiqua omosessuale, op. cit., p. 292).
Quand le capital s'en va-t-en guerre
89
révolutionnaire, la norme hétérosexuelle capitaliste ne peut être que détruite : on ne peut se libérer, et libérer même le patron de son aliénation, qu'en détruisant le rapport de pouvoir dont aussi bien le
patron que l'ouvrier sont l'expression. Cette conception de la relation sociale comme guerre, nous allons la faire fonctionner, au-delà de Foucault, comme ce qui rend encore et toujours déchiffrables les événements historiques du capitalisme contemporain, car la meilleure manière de décrire notre situation est la suivante : « triomphe » des forces capitalistes, défaite de la critique et de la pratique anticapitalistes. La stratégie jette un nouvel éclairage sur le fonctionnement de la « machine sociale » du capital. Définir cette dernière par la production (« mode de production »), par la marchandise (immense accumulation des marchandises, même devenues « images », comme chez les situationnistes) ou par la « structure », le « système » ou encore, la définir exclusivement comme un « rapport social », c'est éliminer un de ses éléments constitutifs : les guerres de classe et leurs articulations (guerre de race et de sexe), qui la traversent et la font exister depuis la conquête des Amériques. La conception du capital que je défends, comme articulation de machines et de stratégies, d'une série de machinismes (économiques, technologiques, institutionnels, etc.) et d'une stratégie politique qui les actualise, qui les subjective dans une lutte entre adversaires politiques, est en opposition polémique avec la quasitotalité des lectures contemporaines du capitalisme. Les différentes théories de la pensée 68 ont en effet accordé un primat à des phénomènes tout à fait contingents - d'abord, les lignes de fuites, d'abord, la classe ouvrière, d'abord, la résistance : ces ontologies décrivaient la situation ouverte par la période des révolutions prolétariennes, où la minorité constituée par les ouvriers était devenue force politique, avait inventé et organise un dualisme de classe, déjoué et souvent anticipé les mouvements du capital. Cette période a pris fin immédiatement après 68. L'autonomie et l'indépendance des mouvements politiques
86
Le capital déteste tout le inonde
ont disparu à la vitesse de la lumière avec l'épuisement de la révolution et l'installation du néolibéralisme. Les théories des lignes de fuite, de la classe, de la résistance sans « révolution », privées de la possibilité d'imposer leur propre stratégie, sont devenues impuissantes. Les décisions et les stratégies dont on parle ne sont pas celles d'un souverain, mais d'une multiplicité de forces (capitalistes, administrations, militaires, hommes politiques, médias, savants, etc.) qui, au fur et à mesure de l'affrontement, dans des situations à chaque fois contingentes, à travers des succès et des échecs partiels et localisés, arrivent à les élaborer collectivement. Le capitalisme n'avait pas une stratégie toute prête qu'il s'est limité à appliquer. Ce qu'il a mis en avant, ce qui a constitué le fil rouge de sa politique, a plutôt été un point de vue de classe, une haine de classe, une soif de profit et de revanche sur la révolution qui a mis des années à se configurer et à s'imposer. Par conséquent, la défaite politique a aussi été une défaite théorique. Il semble difficile de se rendre à cette évidence : on se plaît à établir une continuité théorique avec la pensée 68 sans s'interroger sur ses échecs et ses impasses politiques. Il s'agira donc, dans la suite de ce livre, de porter un regard critique non seulement sur le capital, les luttes anticapitalistes et leurs stratégies respectives, mais également sur les théories et leurs stratégies. Il n'est pas question de revenir sur l'une des conquêtes de la pensée 68, l'articulation de la micropolitique et de la macropolitique, mais d'affirmer que la situation a radicalement changé. L'action guerrière et répressive du capital se manifeste clairement depuis 2008 et le blocage de l'économie « réelle » (l'économie financière a par contre continué à proliférer), blocage qui ne peut être dépassé par une simple « destruction créatrice » à la Schumpeter, mais nécessite le basculement de l'imbrication de la politique et de l'économie à la « guerre » (pour le moment, il s'agit d'amorces, de possibilités de guerre civile). Ce qui est en jeu derrière la montée des nouveaux fascismes, c'est ce basculement.
Quand le capital s'en va-t-en guerre
91
Ce changement de stratégie ne va pas de soi, il implique des hésitations, une bataille à l'intérieur des élites, mais, pour l'instant, si la machine de guerre du capital veut maintenir le cap de l'approfondissement du néolibéralisme et de la sécession politique, elle n'a pas d'autres possibilités. La codification et la capture de la part du capital sont toujours temporaires et partielles car elles dépendent des stratégies. Il est toujours possible de renverser la situation, à condition, précisément, de penser les relations de pouvoir du point de vue stratégique. Les pensées critiques, comme les mouvements anticapitalistes, arrivent à ce tournant politique complètement impréparées, n'ayant pas su anticiper l'évolution du capital et de ces « excroissances du pouvoir » que sont les néofascismes. Les limites des théories politiques post-68 ne concernent pas que la définition et la nature du capitalisme, mais d'abord la « machine de guerre » qu'on voudrait lui opposer. Le véritable échec politique et théorique réside dans l'incapacité d'aller au-delà de l'expérience du léninisme, puisque les critiques, amplement justifiées à son égard, n'ont jamais donné lieu à une organisation capable d'organiser la défense et l'attaque, et qui soit comparable, même de loin, à la machine de guerre qu'il avait construite.
2. Machine technique et machine de guerre
« C'est un fait que nous nous laissons toujours embobiner par les possibilités. [...] Personne ne se soucie des résultats effectifs. On s'en tient simplement aux possibilités. Les résultats effectifs de la radio sont affligeants, mais ses possibilités sont "infinies" : la radio est donc une bonne chose. C'est une très mauvaise chose. » Bertolt Brecht Dans les années 1920, le social-démocrate Kautsky, était convaincu de la nature prémoderne du fascisme : parce que celui-ci était né dans une Italie encore largement agricole, il ne pouvait pas s'installer dans une nation industrielle et moderne comme l'Allemagne. Le fascisme historique était un vestige du passé, un archaïsme qu'une fois la parenthèse de la dictature refermée, le progrès des forces productives effacerait à jamais. Rien n'était plus faux : le fascisme historique était tout aussi moderne que le capitalisme, il était même l'une de ses expressions, comme le futurisme italien le laisse facilement voir. Il en va de même du nouveau fascisme, qui est un cyberfascisme. Il met en échec toutes les utopies - du cyberpunk au cyberféminisme, de la cybersphère à la cyberculture - qui, depuis l'après-guerre et avec une intensification à partir des années 1970, voient dans les machines
94
Le capital déteste tout le inonde
cybernétiques la promesse d'une nouvelle subjectivité post-humaine et celle d'une libération de la domination capitaliste. Bolsonaro et Trump ont utilisé toutes les technologies disponibles de la communication numérique, mais leur victoire ne vient pas de la technologie : elle résulte d'une machine politique et d'une stratégie qui agence une micropolitique des affects tristes (frustration, haine, envie, angoisse, peur) avec la macropolitique d'un nouveau fascisme qui donne consistance politique aux subjectivités dévastées dans la financiarisation. Pour le dire dans les termes que nous allons déployer dans ce chapitre : la machine technique, sous toutes ses formes, est assujettie à la stratégie mise en place par la machine sociale néofasciste, qui, dans les conditions du capitalisme, ne peut être qu'une machine de guerre. Ce banal constat se heurte à une conception selon laquelle la technique, comme tout autre dispositif juridique ou économique, incorporerait les relations de pouvoir en les pacifiant et en les dépersonnalisant. Le pouvoir du dispositif technique, en s'exerçant par des automatismes impersonnels, serait normalisé au point qu'il serait difficile « d'y déceler une violence », pour reprendre les mots de Negri et Hardt. Ces affirmations aussi vieilles que le libéralisme semblent trouver une nouvelle confirmation dans la cybernétique et les nouvelles technologies qui posséderaient, comme le « marché », une capacité d'autorégulation et d'autocorrection. Ainsi, le fonctionnement automatique et impersonnel des normes sociales serait renforcé par les automatismes et le fonctionnement impersonnel de la technique. « Rien, absolument rien ne peut résister à l'automatisation », déclare même Catherine Malabou. Citant Bourdieu, elle ajoute que « l'État n'a pas nécessairement besoin de donner des ordres, et d'exercer une coercition physique, ou une contrainte disciplinaire, pour produire un monde social ordonné ». Il lui suffit d'avoir dés « corps habitués » par les automatismes'. i. Catherine Malabou, Métamorphoses de l'intelligence. Que faire de leur cerveau bleu ?, Paris, Puf, 2017, p. 124.
Machine technique et machine de guerre
95
Cette conception dépolitisée des dispositifs qui s'automatisent et acquièrent une vie propre (impersonnelle) a ses racines dans le marxisme (fétichisme de la marchandise) comme dans le libéralisme (la main invisible du marché). Au xx e siècle, la philosophie allemande radicalise encore le pouvoir que les dispositifs auraient sur les hommes qui les ont produits, en les identifiant à la technique dont le développement a connu une progression sans précédent. Heidegger en fait la dernière figure de la métaphysique, tandis que Giinther Anders, qui en donne pourtant une lecture plus politique, fait disparaître le capital dans le fonctionnement « autonome » des machines. Ainsi se profile une alternative entre ceux qui attribuent à la machine technique la puissance de destruction et d'assujettissement qui est en réalité le propre de la machine du capital et ceux pour qui le pouvoir exercé par la machine est assimilable à celui décrit par Foucault (elle incite, sollicite, encourage, rend possibles certaines actions et d'autres impossibles - l'action sur une autre action est son mode de fonctionnement, qui remplace la « coercition physique » ou la « contrainte disciplinaire »). C e qui est effacé, dans tous les cas, c'est le rapport entre stratégie, machine sociale et machine technique. Nous allons problématiser précisément ce que ces théories refoulent : la dépersonnalisation des relations de pouvoir que la technique assure (automation) exalte le point de vue partisan, favorise le choix stratégique et centralise la décision au lieu de la faire disparaître dans l'anonymat d'un fonctionnement (système, structure, etc.). De sorte que c'est bien la machine de guerre qui prime sur la machine technique. En ce sens, la technique est un des enjeux majeurs de la guerre au sein de la population. L'avènement des nouveaux fascismes apporte une confirmation supplémentaire du fait que, dans le capitalisme, l'ordre politique, assuré par des dispositifs économiques, juridiques et technologiques, est continuellement rompu, non pas par des innovations techniques, mais par des révolutions et des contre-révolutions. Ce
96
L e capital d é t e s t e tout le i n o n d e
sont les machines de guerres qui pratiquent ces ruptures, en orientant, actualisant, donnant consistance aux « dispositifs » (y compris technologiques), et pas l'inverse. La rupture que constituent les nouveaux fascismes n'est pas survenue de l'extérieur du capitalisme, à l'occasion de crises; en vérité, le fascisme est inscrit très profondément dans l'organisation du travail (« abstrait » et indifférent à toute valeur d'usage, le « travail » peut fonctionner de la même manière dans la production des voitures et la production de l'extermination de masse) et de la consommation (abstraite et « indifférente » à toutes les modalités de sa production, y compris au travail des enfants ou au travail servile de millions de travailleurs dans le « grand sud » du monde). Parce qu'elles ont oublié ces vérités, les pensées critiques ont du mal à saisir les contours de ces nouveaux fascismes, qu'elles définissent le plus souvent comme populismes et autoritarismes. Machine sociale ou machine de guerre A en croire les théories cybernétiques, le capitalisme cognitif ou l'accélérationnisme, la société contemporaine aurait, par rapport à celles qui l'ont précédée, la spécificité d'être envahie, formatée, gouvernée par des machines. Or Lewis Mumford avait déjà, en son temps, déplacé les termes du débat, en affirmant que toute société est elle-même une machine ou, mieux encore, une « mégamachine », idée dont se sont inspirés Deleuze et Guattari pour élaborer leur concept de « machine sociale ». Dans Le Mythe de la machineil montre que c'est la société en tant que méga-machine qui engendre, organise, agence dans un même mouvement les hommes et les machines techniques. Par exemple, la méga-machine archaïque de l'Egypte des pharaons se compose, d'une part, d'une multitude d'éléments humains, les esclaves - « spécialisés, interchangeables », « rigoureusement disposés et coordonnés ensemble
2.
Lewis Mumford, Le Mythe de la machine, 2 vol. (1967 et 1970), Paris, Fayard, 1974.
Machine technique et machine de guerre
97
en un processus organisé centralement et centralement dirigé »3 - , et, d'autre part, de machines techniques très simples - le plan incliné et le levier (la roue, la poulie, l'écrou n'avaient pas encore été inventés). En évoluant, cette méga-machine remplace les « humains » par des machines techniques. Mais jamais ces dernières ne pourront remplacer la méga-machine, jamais elles ne pourront s'autonomiser et dominer la machine sociale. La méga-machine se distingue de la machine technique par de nombreux éléments, matériels, sémiotiques, imaginaires, cosmiques, subjectifs. Elle est constituée d'humains, dont la « mécanisation » a de loin précédé celle de leurs outils de travail ; des « machines simples de la mécanique classique » ; de signes (la « traduction du langage en traces graphiques non seulement permit de transmettre des impulsions et des messages à travers le système, mais de fixer les responsabilités quand les ordres écrits n'étaient pas exécutés4 »). La méga-machine requiert encore bien d'autres éléments pour pouvoir engendrer et faire fonctionner l'agencement hommes/machines : le mythe de la royauté de droit divin, le culte du soleil et les « phantasmes cosmiques », qui seuls peuvent garantir la transformation des « hommes en objets mécaniques et [...] assembler ces objets en une machine5 ». Le fonctionnement de la mégamachine nécessite en outre un asservissement assuré par des « techniques » qui doivent dresser les esclaves à la soumission, d'une part, et, d'autre part, les prêtres et la bureaucratie au commandement. Les « ouvriers avaient des esprits d'un type nouveau exécutant chaque tâche en stricte obéissance aux instructions, infiniment patients, limitant au mot d'ordre leur réaction6 ». Quant aux subjectivités de la « caste des prêtres et [de] la bureaucratie », elles garantissent, respectivement; « une organisation sûre des connaissances naturelles et surnaturelles » et « une structure élaborée en vue de • 3456.
Ibid.,t. I,p.262. Ibid., p. 256. Ibid., p. 264. Ibid., p. 263.
98
Le capital déteste tout le inonde
donner des ordres, de les exécuter et de les suivre jusqu'au bout »7. L'énorme productivité de cette machine disposant de technologies très rudimentaires, c'est d'abord celle de la machine sociale. Si cela est évident pour ce qui concerne l'Egypte des pharaons, c'est encore vrai d'une machine sociale comme la nôtre, dotée de technologies bien plus sophistiquées. A présent que nous avons posé le concept de machine sociale (ou de méga-machine), essayons de franchir une autre étape. Au concept de machine sociale, je préfère un autre concept de Deleuze et Guattari, celui de « machine de guerre », que je détournerai légèrement. Foucault a superbement démontré combien il était nécessaire de se débarrasser du « sociologisme », par quoi il entendait la tendance des sciences sociales à recouvrir les relations de pouvoir sous l'action d'entités globales, génériques, holistes, telles que la Société, le Social, les rapports sociaux. Or l'anonymat de la « société » et de ses mécanismes masque les rapports de guerre, les divisions de classe, les dominations diverses. Le pouvoir doit être analysé à partir de ses stratégies propres, toujours singulières, événementielles, imprévisibles, ne suivant aucune autre régularité que celle de leur affirmation. C'est la raison pour laquelle j'abandonnerai la notion générique et imprécise de « machine sociale », qui semble produire de manière impersonnelle des normes, des habitus, des lois, au profit de celle de « machine de guerre », qui implique des dominants et des dominés, des rapports entre forces à partir desquels on produit des normes, des habitus et des lois, mais également du « faire-mourir » et de la violence, exactement comme dans la méga-machine égyptienne. Lorsque la sociologie pousse l'analyse jusqu'à la domination (Bourdieu), elle décrit les mécanismes sur lesquels repose cette dernière, mais elle néglige la volonté de résistance et de révolte, la possibilité de se constituer en machine révolutionnaire contre les pouvoirs, ce qu'implique en revanche le concept de guerre. « Machine de guerre » signifie donc,
7.
Ibid., p. 265.
Machine technique et machine de guerre
99
en décalage par rapport à Deleuze et Guattari, que la société est divisée, que des forces s'opposent, que cette division et ces forces se manifestent par des stratégies d'affrontement, y compris dans la technique. C'est justement cette distinction entre machine technique et machine de guerre qui fait défaut au concept de machine déployé par Giinther Anders. S'appuyant sur son expérience d'ouvrier à la chaîne dans une grande usine américaine pendant son exil, il transforme la célèbre formule de Heidegger, selon laquelle l'homme est le « berger de l'Être », en parlant de « berger des machines », geste qui me semble ouvrir davantage de perspectives. Mais voici ce qu'il explique : « Comme la raison d'être des machines réside dans la performance, et même dans la performance maximale, elles ont besoin d'environnements qui garantissent ce maximum. Et ce dont elles ont besoin, elles le conquièrent. Toute machine est expansionniste, pour ne pas dire impérialiste, chacune se crée son propre empire colonial des services (composé de transporteurs, d'équipes de fonctionnement, de consommateurs). [...] La machine originelle s'élargit donc, elle devient "méga-machine" [...] elle aussi nécessite un monde extérieur, un "empire colonial" qui se soumet à elle et fait son jeu. [...] [A]ucune limite ne s'impose à l'auto-expansion ; la
soif d'accumulation des machines est inextinguible. » Continuant son expansion, elle devient « machine mondiale », « machine totale » qui réussit à conquérir intégralement le monde. Le « monde devient machine », un Etat technico-totalitaire, constitué par un « gigantesque parc des machines ». Or, comme nous venons de le voir, la « méga-machine » de Mumford n'a rien de mécanique. Elle est au contraire le lieu des conflits, des décisions, des stratégies, machine de guerre, justement. Il est aisé de comprendre que partout où Anders écrit « machine », nous devons lire « capital » : ce n'est pas la machine 8. C.iinther Anders, Nous, fils d'Eicbmann, trad. fr. P. Ivernel, Paris, Rivages, 1988, p. 92-93-
96
Le capital déteste tout le inonde
technique qui a cette « soif d'accumulation », mais la machine de guerre du capital. Le décalage entre la « puissance de production », qui ne cesse d'augmenter, et la capacité de se la « représenter », qui est, selon Anders, à l'origine de l'impuissance de l'homme actuel, ne peut être comblé que par une autre machine de guerre, révolutionnaire celle-là. La machine de guerre ne produit pas seulement la machine technique, mais également les humains pour cette dernière. L'analyse sera déployée à propos de trois stratégies et trois manières d'articuler l'agencement entre humains et non humains : la machine suprémaciste de Trump, la machine révolutionnaire du F L N algérien et la machine de la Seconde Guerre mondiale. La machine de guerre suprémaciste Aux USA, le gouvernement des comportements semblait avoir été intégré au développement des nouvelles technologies, configurant ainsi l'exercice « futur » du pouvoir décrit par toutes les théories « cyber ». Mais Trump et sa machine de guerre en ont décidé autrement, en faisant apparaître ce que la technologie était censée recouvrir de ses habits pieux, les « spectres » de la guerre civile, « violence qui fonde » le néolibéralisme. Les grandes firmes américaines qui sont à la pointe de l'innovation technologique (les « G A F A M » : Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) produisent la subjectivité et le « rapport à soi » adéquats au fonctionnement de leurs dispositifs et à la conduite des comportements des gouvernés en général. Cette gouvernementalité intégrée aux machines techniques aurait le pouvoir d'anticiper et de contrôler les comportements, encadrant par avance le futur (les conduites possibles et impossibles) grâce au profilage des individus, construit à partir des « traces » numériques de nos comportements et calculé par les algorithmes d'ordinateurs hyperpuissants. Ces machines semblent incarner une pacification des relations de pouvoir, puisque, grâce à elles, le pouvoir s'exercerait de manière dépersonnalisée.
Machine technique et machine de guerre
101
Les GAFAM promeuvent une figure smart du « capital humain », qui habite une ville smart, se nourrit smart, communique smart, une subjectivité ouverte à la fois aux différences sexuelles et culturelles et au marché. Ces entreprises, fournissant l'imaginaire, les valeurs, les contenus du capitalisme contemporain et les modèles de son actualisation, pénètrent dans le quotidien le plus intime, en occupant la subjectivité et ses affects 24 h sur 24. En sollicitant sans cesse l'attention - donnant lieu à une activité aussi risible que consulter de façon compulsive son smartphone - , elles produisent les dispositifs de la Mobilisation générale contemporaine. Infatigablement, elles fabriquent une information censée affecter les subjectivités, circulant à travers des milliards de téléphones, télévisions, ordinateurs, tablettes, dont les connexions enveloppent la planète dans un filet toujours plus épais. Elles véhiculent un flux ininterrompu de publicités affichant le même modèle de vie smart pour familles smart. Les plus dépolitisés des critiques « cyber », affirment que, dans ces conditions, toute action politique est impossible : l'information est trop rapide, trop intense, trop dense et trop complexe pour que les individus et les collectifs puissent l'élaborer. L'action politique présuppose une élaboration consciente et collectivement partagée de l'information que sa circulation numérique empêche. Et pourtant, chaque jour, dans ce « chaos » d'informations, les conseils d'administration des entreprises, les grandes banques, les Etats, les mafias arrivent facilement à sélectionner, élaborer et extraire des stratégies, des politiques et des profits. La complexité, le chaos, la surabondance d'informations, d'images, de discours constitue un sérieux problème pour l'individu submergé par ces flux, mais pas pour une machine sociale capable de les sélectionner et de les élaborer collectivement (collectif composé d'humains et de non-humains). La machine de guerre montée par Trump s'oriente, choisit, décide dans ce magma. Le problème est politique avant d'être technologique. Les entreprises de la Silicon Valley ont largement contribué à creer la situation qui a permis à Trump de prendre le pouvoir. La
102
Le capital déteste tout le inonde
vertigineuse succession des « révolutions » technologiques (du numérique, des plateformes, des smart cities, du smartphone, du bitcoin, des bio- et nanotechnologies, de l'intelligence artificielle, etc.) a produit la plus immobile des immobilités sociales tandis que la diffusion de ces technologies a puissamment stabilisé les relations de pouvoir au lieu de les bouleverser. Ces entreprises sont l'exemple même de la puissance des monopoles (donc de la rente) et les symboles de la concentration de la propriété (elles affichent aujourd'hui les plus fortes capitalisations boursières) poursuivie par tous les moyens, dont l'évasion fiscale n'est pas le moins important. La distribution horizontale du pouvoir promise par la miniaturisation des ordinateurs a abouti à son contraire, des monopoles qui ont largement dépassé ceux de l'époque industrielle. L'accélération de l'innovation, rendue possible par une puissance de calcul en progression géométrique, a conduit tout droit à un « ancien régime » hyper-technologique où les positions à occuper dans la hiérarchie des emplois, des revenus, des patrimoines, de l'éducation, de l'habitat, etc., dépendent de la naissance, exactement comme avant la Révolution française. Ainsi, du transhumanisme de la Silicon Valley émerge non pas un soi « post-humain », mais une très vieille connaissance, l'aristocrate, devenu cyber et dont la tête, coupée en 1789, a repoussé. La confiance dans la technique comme moyen de créer plus de liberté, plus de démocratie et moins d'asservissement est encore une fois démentie par ses « résultats effectifs », proprement affligeants, de reproduction des rapports de pouvoir. Trump est un nouveau type de fasciste et de raciste que l'on peut qualifier de « cyborg » : sa « consistance » est indissociable des machines techniques (télévision, internet, Twitter) avec et par lesquelles il existe comme « sujet politique ». De la même manière, ses électeurs « existent » et se manifestent politiquement par ces mêmes cyber-dispositifs. Mais ce n'est pas son hybridation avec la machine qui fait de lui un nouveau « soi » fasciste. C'est sa stratégie politique et sa subjectivation qui donnent une nouvelle
Machine technique et machine de guerre
103
configuration et de nouvelles fonctions à l'agencement cybernétique. Il n'était le candidat ni du système médiatique classique (télévision et presse), ni des grandes entreprises de la Silicon Valley qui contrôlent les « réseaux sociaux ». Il a gagné parce qu'il a su exprimer et construire politiquement, en s'appuyant sur la dévastation sociale et psychique produite par la financiarisation et la numérisation, des subjectivités néofascistes, racistes, sexistes. Il a donné « voix » et expression politique aux peurs et aux angoisses de l'homme endetté, alimentées et amplifiées par les médias, en déplaçant l'affrontement sur le terrain identitaire, en jouant une partie de la population (les Blancs) contre l'autre (les migrants, les femmes, les étrangers et toutes les minorités). Il a capturé des subjectivités écrasées par quarante ans de politiques économiques qui les ont systématiquement appauvris et par des politiques de l'information qui les ont méprisés comme des « ringards » rétifs à toute modernisation, refusant toute réforme. Tout au long de la prétendue « crise des dettes publiques », les informations accompagnant la stratégie destinée à sauver le système bancaire relevaient des registres de P« ordre » (« Il faut payer la dette »), de la « menace » (« Si vous ne la payez pas, le système s'effondrera, et vous avec lui ») et de l'« insulte » (« C'est de votre faute ! Vous êtes paresseux ! »)9. Ordre, menace et insulte : telles sont les caractéristiques des médias que Trump a réussi à s'approprier en utilisant les mêmes dispositifs technologiques, mais en les retournant contre les élites qui se partageaient la gouvernementalité démocratique. La puissance des mots et des images smart des GAFAM et des réseaux médiatiques a été neutralisée, parce qu'elle a été confrontée à une autre stratégie, à une autre machine de guerre, capable par ses mots d'ordre suprémacistes, racistes et sexistes de construire une politique. Leurs informations rebondissent sur la surface du « soi » néofasciste et ne l'affectent en rien (les gouvernés, dont la 9- « Ordre », « menace » et « insulte » caractérisaient déjà la communication dans les colonies, comme on pourra le constater dans la prochaine section avec Fanon.
104
Le capital déteste tout le inonde
caractéristique est de « répondre aux sollicitations » des dispositifs gouvernementaux, ont refusé de jouer le jeu, sortant ainsi de leur contrôle). Les « automatismes » technologiques n'ont aucune efficacité dans une situation de conflit ouvert où chacun choisit son camp et devient un « partisan de l'information ». Les grandes entreprises du numérique ne réussissent pas à construire la réalité consensuelle de l'opinion publique démocratique, puisque la gouvernementalité néolibérale a été refusée préalablement et que ce refus a trouvé une machine sociale pour le porter et lui donner consistance. Les affects véhiculés par la superpuissance « sensible » de la Silicon Valley ne peuvent rien contre les affects (peur, frustration, angoisse, désir de vengeance) amplifiés et organisés par la machine de guerre médiatique du « ressentiment » qui s'appelle Trump. La capacité de prévision, d'anticipation que des milliards de milliards de données devraient assurer, s'est révélée défaillante. Les données peuvent prévoir quand je mangerai la prochaine pizza margherita, si j'en mange souvent, mais prévoir une rupture politique est logiquement impossible, même pour un réseau infini d'ordinateurs. Les données peuvent gouverner les comportements de ceux qui acceptent ce qui « est », mais elles ne peuvent ni prévoir ni « gouverner » les comportements des subjectivités en rupture. La très futuriste Silicon Valley a donc plié face à l'émergence des « nouveaux archaïsmes ». Ce qui a fait apparaître la faiblesse politique de ces entreprises pourtant considérées comme les modèles de l'économie et du pouvoir du futur, c'est l'opération de rupture organisée par l'extrême-droite : elle a déchaîné une bataille politique au sein des élites capitalistes qui se terminera probablement par leur recomposition autour d'une accentuation des politiques néolibérales que seules les organisations néofascistes pourront mener à bien. Il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé en Europe et aux USA, car cette vague réactionnaire continuera à se répandre (au Brésil, encore une fois, l'autonomie de la technique a fait long feu, intégrée sans difficulté à une stratégie politique fasciste). L'intensification de la « crise » de la dette avait rendu
Machine technique et machine de guerre
105
visible, avec la séquence internationale de 2011, le Brésil de 2013 et la Grèce de 2015, l'émergence d'une subjectivation conflictuelle à l'échelle mondiale et la possibilité d'une rupture politique. Malgré la faiblesse de ces mouvements politiques, une partie des élites capitalistes a préféré jouer la carte du néofascisme, du racisme, du sexisme, de la xénophobie. Le racisme est ainsi devenu la principale modalité de gestion stratégique de la guerre contre les populations, divisées selon le principe de la nationalité ou de l'origine, aussi bien pour ce qui concerne la citoyenneté que le marché du travail. / Ce n'est donc pas la toute-puissance mais l'impuissance de ces firmes géantes, de leurs machines et de leurs algorithmes censés nous gouverner qu'il faudrait interroger, car elles n'arrivent pas à pénétrer les territoires et les réseaux qui affirment politiquement leur indépendance et leur autonomie politique. Ces machines techniques sont très efficaces lorsqu'elles agissent sur des individus isolés, désolidarisés, dispersés, apeurés, soumis au lessivage de l'initiative capitaliste et mis en relation uniquement par les dispositifs de la démocratie médiatique. Mais, confrontées à une socialisation, à un partage, à des énoncés collectifs en rupture, fussent-ils fascistes, elles deviennent soudain impuissantes. Au lieu de célébrer la puissance des GAFAM, signe sans équivoque de notre impuissance, nous devrions commencer à les considérer comme le faisaient les révolutionnaires du xx e siècle à propos d'autres machines de guerre, c'est-à-dire comme des « tigres de papier » dont la faiblesse n'est pas technique, mais politique. Inutile, donc, de vouloir les concurrencer sur leur terrain, ce serait perdu d'avance. Ce ne sont pas les machines techniques qui installent des savoirs, des pouvoirs et leurs automatismes, mais les machines de guerre. Félix Guattari, à qui nous devons le concept, rappelle que les machines à vapeur ont été inventées en Chine, où elles étaient utilisées comme d'innocents jeux pour enfants. C'est la machine de guerre qui décide de la machine à vapeur : elle peut aussi bien en faire un instrument infernal, comme dans les usines du xix e siècle ou, montée sur une locomotive, l'image même du progrès.
102
Le capital déteste tout le inonde
L'essentiel, c'est de construire une machine de guerre révolutionnaire. A partir de là, on peut développer une machine technologique, alors que le contraire est impossible. Seulement quarante ans après la révolution, les Soviétiques, qui avaient traversé une terrible guerre civile, puis une guerre encore plus effroyable contre les nazis, ont envoyé le premier homme dans l'espace avant la superpuissance technologique américaine. Au moment de la révolution, la Chine était le pays le plus pauvre du monde. Aujourd'hui, elle défie les colosses de la Silicon Valley et la puissance économique des USA. Bien que l'extraordinaire force subjective développée par la machine de guerre ait été investie et détournée dans des projets néocapitalistes et néo-autoritaires, sa puissance demeure. La science, la technologie, les savoirs peuvent être importés et même copiés, comme l'a fait le Japon de l'après-guerre. Lewis Mumford l'avait déjà remarqué : « Toutes les propriétés des machines particulières - forte utilisation d'énergie, mécanisation, automation, rendement quantitatif - sont accrues grâce à leur inclusion dans la mégamachine », la machine sociale. Le premier pas pour comprendre et utiliser les machines techniques est d'ordre politique. Mais les différents mouvements politiques post-68 ne sont pas parvenus à problématiser et encore moins à concevoir une nouvelle machine de guerre. La plus grande victoire du néolibéralisme, profondément inscrite dans le « cerveau collectif» {General Intellect), c'est l'effacement de ce qui a caractérisé le siècle dernier : la longue séquence des révolutions réussies ou manquées. Fanon et la radio Nous ne manquons pas de points de vue critiques sur les machines techniques, mais d'une théorie de leur rapport avec la machine révolutionnaire. Le texte le plus surprenant pour essayer d'articuler ce rapport a été écrit par Frantz Fanon et concerne la fonction du dispositif technique « radio » pendant la guerre coloniale et la lutte pour l'indépendance nationale de l'Algérie. « Ici la voix de
Machine technique et machine de guerre
107
l'Algérie10 », deuxième chapitre de L'An Vdela révolution algérienne, fait apparaître de manière incomparable la force de la machine de guerre qui actualise les possibilités de la machine technique dans un sens révolutionnaire. La radio est partie intégrante des stratégies de pouvoir du colonisateur français et contribue au processus d'assujettissement auquel est soumis le colonisé. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le changement radical des « attitudes », de la manière de percevoir, de sentir et des « conduites » des colonisés par rapport au dispositif technique, au monde et à eux-mêmes, lorsque la machine de guerre de la révolution nationale déploie sa force. Fanon démontre que l'apparition d'un « dispositif technologique », sa pénétration, sa diffusion, son acceptabilité ou son refus dépendent toujours d'une machine de guerre. La réception ou le refus des informations, la possibilité de les sélectionner et de les élaborer ou, au contraire, d'en subir le pouvoir, renvoie à la présence ou à l'absence d'un « corps social ». Refus ou acceptation ne sont pas simplement des compétences, des facultés, des capacités de l'individu : elles sont constituées « socialement » et politiquement. L'instrument technique n'est « jamais perçu en soi, dans une quiète neutralité ». Il est toujours pris à l'intérieur d'une stratégie politique et, dans le cas de l'Algérie, il intervient dans la situation coloniale où les différences, les hostilités, les « coefficients négatifs ou positifs existent toujours de façon très appuyée ». Dans la colonie, la « dichotomie sociale atteint une intensité incomparable », de sorte que la voix de la radio n'est pas « indifférente », « neutre », mais c'est la « voix de l'oppresseur, la voix de j l'ennemi ». Cette poussée à la limite des concepts contient plus de ' vérité sur les médias que celle exprimée par la « liberté » de la presse dans une démocratie pacifiée. « Toute parole française entendue était un ordre, une menace ou une insulte ». Que l'information soit 10. Frantz Fanon, L'An Vdela révolution algérienne. Œuvres, Paris, La Découverte, 2011, P- 303-330 (toutes les citations qui suivent tirées de ce chapitre).
104
Le capital déteste tout le inonde
« ordre, menace et insulte » est loin de constituer une exception coloniale. Il s'agit, au contraire, des caractéristiques de l'information en général. En Algérie, la radio et ses « pouvoirs sensoriels et intellectuels » font l'objet d'un refus d'abord passif: « La parole n'est point reçue, déchiffrée, comprise, mais rejetée [...] la communication est refusée ». « Avant la rébellion, il y a la vérité du colon et le néant du colonisé », situation qui alimente la méfiance, le refus et le rejet, mais sans que la réponse politique soit collective, constitutive d'une machine de guerre. « Il n'y a pas de résistance organisée ». Le refus de la radio et de ses informations n'est pas l'expression « d'une résistance explicite, ordonnée et fondée ». La machine de guerre produit les dispositifs non humains, et elle modèle et module les humains jusque dans leur « intériorité ». La voix du colonisateur, « voix des Français parlant aux Français », intervient dans la dimension micropolitique, par exemple en se heurtant à la structure familiale traditionnelle. Les programmes « indifférenciés » ne sont pas adaptés à la hiérarchisation patriarcale de la famille algérienne. Impossible d'écouter ensemble les programmes radiophoniques, parce qu'ils mettent en danger la sociabilité traditionnelle des relations familiales « féodales » : « les allusions érotiques ou même burlesques provoquent des tensions insupportables ». Les effets et affects de la radio sont encore plus marqués du point de vue psychopathologique. « Les monographies sur les Algériens hallucinés signalent constamment dans la phase dite d'action extérieure, des voix radiophoniques fortement agressives et hostiles. Ces vois métalliques, blessantes, injurieuses, désagréables, ont toutes chez l'Algérien un caractère accusateur, inquisitorial. » La radio est, dans le domaine psychopathologique, un « mauvais objet, anxiogène et maudit ». Une « véritable mutation » se produit en 1956, avec le début des émissions radiophoniques de l'armée de libération (« La Voix de l'Algérie libre »). L'événement révolutionnaire crée de nouveaux possibles qui affectent d'abord la subjectivité et engagent sa
Machine technique et machine de guerre
109
transformation. La « contestation du principe même de la domination étrangère entraîne des mutations essentielles dans la conscience du colonisé, dans la perception qu'il a du colonisateur, dans sa situation d'homme dans le monde ». Mutations qui ne s'arrêtent pas uniquement à la dimension « politique », mais vont jusqu'à affecter la dimension micropolitique en fabriquant de l'inconscient. L'actualisation des nouveaux possibles créés par la rupture est la tâche de la machine révolutionnaire qui, en établissant un nouveau rapport entre la radio (machine technique) et ses auditeurs (subjectivité), déjoue le fonctionnement colonialiste de la même technologie. Le différentiel de puissance technologique entre les adversaires politiques est abyssal, mais le problème n'est pas là : cet écart se rencontre dans tous les conflits et guerres révolutionnaires, par définition asymétriques. Au xix e et surtout au XXe siècle, en Russie, en Chine, au Vietnam, en Afrique ou en Amérique du Sud, la machine militaire et la machine de communication de l'impérialisme, bien que dotées de toutes les dernières technologies et inventions, sont considérées comme susceptibles d'être vaincus. La machine révolutionnaire révèle et analyse la puissance de l'armement et de l'organisation hyper-technologique de l'ennemi, mais aussi son impuissance, ses faiblesses, ses failles politiques. Dans la guerre révolutionnaire, le colonisé devient sujet actif, même s'il ne participe pas directement à l'organisation politique, car la radio l'inclut dans « une communauté en marche » dont il se sent un « acteur ». Les « services français technicisés à l'extrême » brouillent systématiquement les transmissions de la radio du FLN, perturbant fortement les émissions. Ainsi, la lutte s'engage également sur le terrain des ondes radiophoniques (« la guerre des ondes ») et le colonisé apprend à sélectionner et à élaborer l'information d'un point de vue stratégique, en choisissant son camp, en devenant un partisan de l'information. « L'auditeur était incorporé a la bataille des ondes, devinait la tactique de l'ennemi et de façon presque physique, musculaire, déjouait la stratégie de l'adversaire. »
106
Le capital déteste tout le inonde
Le brouillage de l'armée colonisatrice rend la « voix hachée, discontinue [...] souvent inaudible ». Il oblige l'auditeur à effectuer un « véritable travail d'élaboration », d'interprétation, de décodage et d'imagination. Il « pallie les caractères fragmentés des nouvelles par une création autonome d'information ». Derrière les grésillements, l'auditeur devine non seulement la voix de la révolution, mais également les batailles contre l'occupant. L'information est minime, presque inexistante, mais on comble ce vide avec la puissance de l'action révolutionnaire en cours. La révolution transforme le refus passif en attitude active qui complète les informations fragmentaires « par une création autonome de l'information ». Dans ces conditions, affirmer avoir entendu la Voix de l'Algérie est un mensonge - le sabotage des ondes par les français est efficace. Mais c'est là « un choix délibéré entre le mensonge congénital de l'ennemi et le propre mensonge du colonisé qui acquiert soudain une dimension de vérité». La réception de l'information n'est plus individuelle, elle ne se fait plus dans l'isolement et la peur, mais elle a lieu à l'intérieur d'une « communauté », d'un « corps social » dont l'auditeur est un participant actif. « A la vérité de l'oppresseur autrefois rejetée comme mensonge absolu, est opposée enfin une autre vérité agie ». Pour devenir un « partisan » de l'information, il faut une rupture politique et une machine politique qui divise non seulement l'information, mais d'abord la société. L'événement de la révolution a aussi ouvert la possibilité d'une transformation des relations patriarcales à l'intérieur de la famille. Du point de vue micropolitique, la mutation subjective des Algériens rend possible ce qui était auparavant impossible, écouter ensemble, en famille, les émissions brouillées de la radio de la révolution qui fait exploser les vieilles hiérarchies d'origine patriarcale : on peut voir « pères, mères et filles écouter ensemble les informations ». Fanon constate même un changement radical du point de vue psychopathologique. Dans les psychoses hallucinatoires, « les voix radiophoniques deviennent protectrices, complices. Les
Machine technique et machine de guerre
m
insultes et les accusations disparaissent et font place aux paroles d'encouragement. » Fanon n'a pas attendu les théoriciens de l'infosphère pour comprendre que celle-ci constituait un environnement psychopathogène. Mais à la différence de la dépolitisation qu'opèrent ces derniers, il impute beaucoup de ces pathologies à la machine de guerre du colonialisme et travaille à la construction d'une machine de guerre révolutionnaire, à laquelle il confie la tâche, sinon de les soigner, du moins de modifier l'environnement pour le rendre favorable à une évolution positive de la psyché. La technique « étrangère », la technique du pouvoir, « digérée » et appropriée « à l'occasion de la lutte nationale, est devenue un instrument de combat pour le peuple et un organe protecteur contre l'anxiété ». « Chaque Algérien se sent convié et veut devenir un élément du vaste réseau de significations né du combat libérateur. » L'appropriation des « moyens de production », dont la radio fait partie, est toujours le fait du « corps social », jamais du corps individuel. Elle ne peut avoir lieu que par une action politique. C'est la communauté politique en marche qui s'approprie la machine technique pour la transformer. « En tant que processus mental, on assiste, à partir de 1956, à une quasi-invention de la technique ». En réalité, à une invention de la machine de guerre, qui engendre à la fois une « nouvelle technique » et une « nouvelle subjectivité ». Finalement, Brecht aurait pu dire que la radio n'est pas seulement une possibilité, mais aussi une bonne chose. Cybernétique et guerre « Le système des médias procéda en trois phases. La phase 1, à partir de la guerre civile américaine, développa des techniques de stockage pour le son, l'image et l'écriture : le film, le gramophone, et le système homme-machine qu'est la machine à écrire. La phase 2, à partir de la Première Guerre mondiale, développa pour les contenus stockés des techniques électriques appropriées de transmission : la radio, la télévision [...]. La phase 3, depuis la Seconde Guerre mondiale, convertit le schéma fonctionnel de
108
Le capital déteste tout le inonde
la machine à écrire en une technique de prévision : la définition mathématique de la calculabilité, "computabilitydonnée par Turing en 1936 donna son nom aux futurs ordinateurs, "computer". » Friedrich Kittler La cybernétique est le résultat direct de l'action de la machine de l'État en guerre sur la science et la technologie. La guerre fonctionne ici comme force productive capable d'accélérer la mise en [ place de l'invention technologique et d'un nouveau type de savant. i La stratégie et la guerre ne sont pas des réalités étrangères à la techj nologie cybernétique et à la big science, qui se seraient ajoutées du dehors à leur fonctionnement. Au contraire, elles en ont été le berceau. La cybernétique et la big science ont été pensées, expérimentées et utilisées pendant et pour les guerres totales. Leur développement, pendant et après la Seconde Guerre mondiale a été l'œuvre de l'armée américaine, l'entrepreneur le plus grand, le plus riche et le plus innovant que le capitalisme ait jamais connu. La puissance de cet entrepreneur étatique est sans commune mesure avec celle du chef d'entreprise schumpetérien du xix* siècle dont on pleure la disparition. La formule de la « destruction créatrice » s'applique presque parfaitement à lui, à condition que l'on opère une petite inversion de la formule, puisque la création a ici comme objectif la destruction. L'armée américaine contient en ellemême la réversibilité de la destruction et de la création, de l'économie et de la guerre, de l'action sur une action et de la violence sur les personnes et les choses, ces dualités constitutives du pouvoir contemporain. La machine de guerre n'est pas seulement une condition extérieure de la première cybernétique, puisque l'ennemi \z structure de l'intérieur. Selon Peter Galison, l'hybridation cybernétique homme/ machine, qui a présidé à la construction d'un dispositif de défense antiaérienne où elle a été expérimentée pour la première fois, a été pensée par Norbert Wiener, le père de la cybernétique, à partir de l'image qu'il se faisait de l'ennemi. Son ennemi à lui n'était pas
M a c h i n e technique et machine d e guerre
113
celui incarné par le Japonais, en qui Américains et Anglais voyaient « l'autre monstrueux, racialement différent et sous-humain » ; ce n'était pas non plus l'« ennemi anonyme » que pouvait représenter le pilote bombardant les villes du haut de son avion. L'ennemi auquel Wiener s'intéressait était « plus actif» que l'ennemi anonyme et plus « rationnel » que l'ennemi racial : « un ennemi mécanisé et dénué d'émotions, capable de mouvements prédictibles qui pouvaient au moins être modélisés à travers une sorte de "black box machinery Cette image de l'ennemi est moins connue mais plus puissante que les deux premières images". » La cybernétique naît de cette conception de l'ennemi. Pour l'opérateur radar, le pilote de l'avion à abattre était si bien intégré à la machine que la différence entre l'humain et le non-humain tendait à disparaître. Celui qui devait actionner la mitrailleuse anti-aérienne était pris dans une hybridation semblable. C'est à partir de cette double hybridation qu'on a construit une machine dotée de feedback et capable d'anticiper les mouvements de l'avion à abattre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée et l'État américains mettent en place les fondements de ce que les marxistes italiens appelleront, en empruntant l'expression aux Grundrisse de Marx, le « General Intellect ». Rendre la production capitaliste moins dépendante du temps de travail de l'ouvrier que du développement de la science, de la technique et de la communication, tel est le but poursuivi à travers la mise en place des grands laboratoires où se mêlent différentes disciplines et fonctions scientifiques. Ce processus s'est enclenché pendant la première guerre totale, qui nécessitait un contrôle direct de l'État et du capital sur la production scientifique. La recherche se déplace hors de l'université « pour faire face à des problèmes de nature organisationnelle imposés 11. Peter Galison, « The Ontology of the Enemy: Norbert Wiener and the Cybemetic Vision », Critica!Inquiry, vol. 21, n° i, 1994. « Black box » est une expression qui date de la Seconde Guerre mondiale, de l'époque des recherches sur le radar, et signifie que les circuit internes à la « box » Fonctionnent sans que l'on ait besoin de comprendre comment ce circuit a été mis en place.
| j i |
114
L e capital d é t e s t e tout le i n o n d e
par la structure militaro-industrielle [...]. [Pjour la première fois dans l'histoire de l'Europe l'application technico-militaire de la science [...] impose à l'Etat d'avoir un commandement direct sur la recherche'2. » Le management nécessaire à la fabrication de la bombe atomique requiert un contrôle sur la production de la science encore plus poussé de la part de l'État. La machine de l'État en guerre, pour développer de nouvelles machines techniques de destruction, modèle et module un nouveau type de chercheur et organise de nouvelles modalités de coopération productive qui seront perfectionnées et amplifiées pendant la guerre froide. « Les radars ou autres armes atomiques ne furent pas conçus par des bricoleurs : ces technologies ont pris corps lors des réunions d'équipes interdisciplinaires composées de scientifiques, d'ingénieurs et gestionnaires'3. » Les méthodes organisationnelles que Boltanski et Chiapello attribuent à l'inventivité des capitalistes après 68 ou que les théoriciens du capitalisme cognitif voient surgir de la puissance du travail et de la coopération des travailleurs cognitifs ont été inventées par l'armée américaine. « Bien qu'hébergées et financées par une bureaucratie écrasante, ces équipes ne fonctionnent pas sur des critères de statut ou de rang, elles travaillaient, au contraire, au sein d'une structure sociale sans véritable hiérarchie. Cette structure s'était notamment forgée sur la nécessité d'adapter une approche systémique globale pour développer des armes, une structure susceptible d'envisager hommes et machines comme les éléments jumelés d'un appareil de combat hors pair'4. » La transgressiort des barrières disciplinaires et professionnelles est même le secret de la méthode. « Les pressions mises en œuvre pour produire de nouvèlles technologies de guerre conduisirent d'anciens spécialistes à franchir les frontières 12. Franco Piperno, « Il 68, sociale, politico, culturale », Alafabeta materiaU, Rome, DeriveApprodi, 2018. 13. Fred Tumer, Aux sources de I'utopie numérique. De ta contre-culture à la cybercu/ture, trad. fr. L. Vannini, Caen, C & F , 2012. 14. Ibid., p. 369.
Machine technique et machine de guerre
115
de leur profession, à mélanger travail et plaisir et à constituer de nouveaux réseaux interdisciplinaires au sein desquels ils travaillaient et ils vivaient'5. » Wiener souligne que cette organisation intégrant travail et vie, travail et plaisir (autres caractéristiques qu'on attribue au management post 68), la communauté scientifique en avait toujours rêvé et que la guerre l'a réalisée. « Nous étions tombés d'accord sur ces questions bien avant d'avoir pu désigner le champ commun de nos investigations [...]. La guerre décida de sa nature à notre place'6. » Pendant la guerre, un autre changement fondamental surgit de la coopération entre savants et entreprise sous le contrôle et la supervision de l'Etat/armée : la transformation de la figure du scientifique ! en entrepreneur. Dans l'effort de guerre, « scientifiques et ingénieurs apprenaient à agir comme chef d'entreprise ». Cette stratégie sera ensuite transmise par l'Etat au privé, qui ne fera rien d'autre que la perfectionner. Ce que Marx n'avait pas prévu, et que les marxistes du General Intellect ne voient toujours pas, c'est que le développement de la , science, de la technique et de la communication/information a comme finalité, au même titre que la production, la destruction. \ Technique et science ne sont que des composantes de la machine de guerre qui allie toujours et de manière irréversible à partir du début du xx e siècle, capital et guerre, production et destruction. Pendant que cette collaboration non hiérarchique entre militaires, savants et entrepreneurs se poursuit dans une ambiance détendue et conviviale, l'armée américaine, grâce aux fruits de cette coopération, massacre en Corée, au Vietnam, organise l'assassinat d'Allende, tandis que des dizaines de milliers de militants sud-américajns sont massacrés pendant les dix ans de guerre civile, sous la direction du criminel de guerre Henry Kissinger.
1516.
/£«/., p. 58. Norbert Wiener, Cybernétique et société (1952), Paris, Le Seuil, 2014.
112
Le capital déteste tout le inonde
L'hybridation entre civil et le militaire ne s'est pas arrêtée avec la fin des guerres totales ; elle s'est, au contraire, intensifiée pendant la guerre froide avec l'institutionnalisation du complexe militaire, industriel et universitaire. Même les artistes (l'avant-garde des années 1950 et i960) ont été impliqués dans ces recherches qui ont bouleversé les méthodes d'organisation. La « société de la connaissance », qui devait être le nouvel horizon d'émancipation, a été largement anticipée par l'armée américaine : la science et la connaissance théorique ont été pour elle le puissant ressort d'une production industrielle vouée à la « destruction ». Les politiques néolibérales utiliseront toutes ces connaissances, expérimentations, méthodes gentiment mises à leur disposition par l'armée, en les faisant fonctionner dans l'économie privée. Une fois débarrassées de leur « filiation militaire ou même gouvernementale, [elles] sont apparu[e]s aux yeux de tous comme des moteurs culturels et économique [...] comme des forces émanant de la nature'7 ». C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à construire le storytelling de l'entrepreneur novateur et génial, confiant dans le marché et méfiant envers tout ce qui ressemble de près ou de loin à de l'étatique, capable de prendre des risques et d'inventer l'ordinateur portable dans son garage. « Escroquerie cosmique », qui nous est vendue comme vérité parce que les vainqueurs ont eu la force de l'imposer. La Silicon Valley est le fruit non pas de l'esprit d'initiative d'entrepreneurs enfin libérés de la tutelle bureaucratique, mais de cinquante ans d'énormes investissements publics gérés par la structure la plus hiérarchisée, la plus disciplinaire, la plus meurtrière qui ait jamais existé, l'armée américaine. Les savants qui ont créé et impulsé les technologies cybernétiques et informatiques n'étaient pas naïfs. Ils avaient parfaitement conscience que leurs recherches dépendaient strictement de la machine de guerre et des financements militaires. En 1950, Wiener prévoyait que les nouvelles machines cybernétiques
17. Ibid.
Machine technique et machine de guerre
117
s'implanteraient dans un délai de dix ou vingt ans, sauf si « de violents changements politiques ou une autre grande guerre'8 » accéléraient leur mise en place. Voilà un exemple supplémentaire du fait que ce ne sont pas les grandes tendances technologiques, les déterminismes productifs, le développement « objectif » des forces productives, mais les ruptures politiques, les bifurcations subjectives de l'histoire, les affrontements stratégiques qui introduisent des nouveautés remarquables et déterminent de soudaines accélérations. Dans le cas qui nous occupe, c'est l'urgence de la « bataille d'Angleterre qui rendit nécessaire de traiter à fond le problème du radar, en accélérant le développement naturel de cette question qui aurait pu prendre des décennies ». Du fait des nécessités de la guerre, il ne fallut que deux ans pour « l'utiliser avec efficacité sur le champ de bataille" ». Théorie des machines « Un élément technique reste abstrait, tout à fait indéterminé, tant que on ne le rapporte pas à un agencement qu'il suppose. Ce qui est premier par rapport à l'élément technique, c'est la machine : non pas la machine technique, mais la machine sociale ou collective, l'agencement machinique qui va déterminer ce qui est l'élément technique à tel moment, quels en sont les usages, l'extension, la compréhension. C'est par l'intermédiaire des agencements que le phylum sélectionne, qualifie et même invente les éléments techniques. » Gilles Deleuze et Félix Guattari Les auteurs qui, dans les années 1960-1970, ont profondément renouvelé le concept de machine nous ont fourni une boîte à outils conceptuelle pour déjouer le piège des « révolutions technologiques ». Autour des machines prolifèrent en effet des théories très 18. 19-
Ibid., p. 185. Ibid., p. 186.
114
Le capital déteste tout le inonde
sophistiquées, qui interrogent toujours la toute dernière machine technique (algorithmes, bitcoin, nanotechnologies, intelligence artificielle, plateformes numériques, etc.) mais jamais la machine de guerre (capitaliste) qui les sélectionne et les fait fonctionner. Ainsi répètent-elles sans cesse la même erreur. Les accélérationnistes, par exemple, font preuve de cette naïveté lorsque, dans leurs analyses du fonctionnement du capital financier, ils font disparaître la machine de guerre qui impose la relation créditeur/débiteur, ses stratégies (« les créditeurs d'abord ») et ses assujettissements (l'homme endetté) derrière l'action impersonnelle et automatique de la technique (trading haute fréquence) et les algorithmes, les modèles mathématiques qui les font fonctionner. L'accélérationnisme appartient à cet ensemble vaste et bariolé de théories qui, quand elles ne sont pas fascinées par les potentialités progressistes de la technique, le sont par la catastrophe qu'elles semblent annoncer (Mark Fisher, Franco Berardi, Nick Land, etc.). Ces deux points de vue apparemment opposés se rejoignent dans la centralité prêtée à l'automation et aux automatismes : les relations de pouvoir entre personnes disparaîtraient sous le fonctionnement impersonnel des machines. « Nous sommes gouvernés par les algorithmes », « les machines numériques conduisent nos "conduites" », « les nombres dictent nos comportements », et ainsi de suite. Franco « Bifo » Berardi, participant assidu aux débats qui traversent ces réseaux, synthétise ainsi cette convergence : « L'abstraction financière se fonde sur l'opération impersonnelle des automatismes. Personne ne prend de décisions parce qu'une chaîne logicomathématique a remplacé toute décision et que les algorithmes du capital sont devenus indépendants de la volonté individuelle de ceux qui les ont créés et de ceux qui les utilisent. » L'origine de cette dépolitisation, il faut la chercher dans les derniers soubresauts de la pensée 68, chez Lyotard ou chez Baudrillard, par exemple. Chez le premier, le capital est un système sans véritable dehors et qui n'a donc besoin d'aucune stratégie. Lyotard le réduit à « un processus factuel », à une opérativité
Machine technique et machine de guerre
119
t e c h n o l o g i q u e , cybernétique dont le seul but est le développement et la « seule règle connue [...] la maximisation des performances du système20 ». Il n'y a aucune possibilité de sortir du fonctionnement de la machine. Même P« émancipation » n'est plus un combat qui se gagne ; elle « est désormais à la charge du système lui-même » et « les critiques, de quelque nature qu'elles soient, sont demandées par lui en vue de remplir cette charge plus efficacement2' ». Les « dérèglements » du système lui-même sont retournés en incitations à accroître sa performativité. Le système peut tout recycler, même la guerre, qui n'est qu'un résultat, qu'un accident nécessaire ou contingent. Cette version post-soixante-huitarde de la « fin de l'histoire » a été confrontée très rapidement à son inanité, car la guerre qui ne devait pas avoir lieu (Baudrillard) a non seulement été bien réelle, mais elle a consisté dans la double défaite que les Américains ont essuyée en Irak et en Afghanistan. La toute-puissante technologie informationnelle qui se trouve au cœur de ces théories a été contrée par une simple stratégie politique - comme quoi le « réel » n'a pas disparu dans une simulation à disposition des manipulations du système. On ne connaît pas de conséquences plus catastrophiquement réelles, pour la planète entière, que celles de cette guerre dont il était, selon une autre version de Baudrillard, « absolument indifférent qu'elle ait lieu ou pas ». La contingence, la rupture, le j « réel » (ce qu'on ne peut pas anticiper même avec un réseau infini d'ordinateurs) se jouent facilement de ces théories qui, au terme de leur évolution, liquident la révolution et font de la technologie une puissance autonome, autoréférentielle et ne dépendant d'aucune autre stratégie que celle de son propre développement.
Nous retrouvons le même problème que dans le chapitre précédent : l'illusion que les relations de pouvoir sont intégralement immanentes, ici à la technique, là au droit et à l'économie. Pour essayer de cerner les limites de la pensée « cyber », pour tirer nos 20. Jean-François Lyotard, Misère de la philosophie, Paris, Galilée, 2000, p. 114. 21. Jean-François Lyotard, Moralités postmodernes, Paris, Galilée, 1993, p. 68.
116
Le capital déteste tout le inonde
révolutionnaires du sommeil technologique dans lequel ils semblent avoir plongé, il faut commencer par poser autrement le problème des nouvelles machines prétendument « autonomes ». Surtout, il faut tenter de comprendre pourquoi la machine de guerre prime sur la machine technique, pourquoi automation et décision, dépersonnalisation des relations de pouvoir par la technique et stratégie politique ne s'opposent pas. Tout au contraire, la technique favorise
décision et stratégie. A chaque vague d'innovation, on nous répète que la technique va « libérer le temps », que la productivité croissante des systèmes de machines finira par émanciper l'humanité de la nécessité du travail. Or non seulement ces promesses de libération ne se sont jamais réalisées, mais elles se sont partout renversées en leur contraire. Pourquoi? Tout simplement parce que la machine doit elle-même être délivrée de sa subordination. Dans le capitalisme, affirme Simondon, « la machine est un esclave qui sert à faire d'autres esclaves22 ». Cette affirmation nous met sur la piste décisive des relations de pouvoir. Car si la machine est un esclave, elle a une autonomie et une indépendance toutes relatives, et elle doit bien avoir un patron, un esclavagiste, quelqu'un pour qui elle travaille et dont elle exécute les ordres. Simondon ne nous révèle pas l'identité de ce dernier, mais Gilles Deleuze et Félix Guattari nous livrent un complément de réponse : « Nous sommes toujours esclaves de la machine sociale et jamais de la machine technique. » La machine technique serait donc asservie par la machine de guerre. C'est cette dernière qui donne forme à la relation homme-machine, car elle précède aussi bien l'homme que la machine (la relation précède les termes). Dans sa forme capitaliste, la machine de guerre asservit aussi bien l'homme que la machine, en transformant le premier en « capital variable » et la seconde en « capital fixe ». Nous allons suivre ce fil pour relancer le débat autour du rapport entre guerre et révolution. 22. Gilbert Simondon, Du mode d'existence des objets techniques (1958), Paris, Aubier, 2012, p. 175.
Machine technique et machine de guerre
121
Marx et le triple pouvoir de la machine, de la science et de la nature Pour essayer de saisir la nature et la fonction de la technique, il faut aussi critiquer la plupart des observations marxiennes sur les machines et leur rapport à l'homme. Dans Le Capital, Marx explique que le travail qualifié de l'opérateur qui agit à côté des machines est « dépourvu de tout sens » et représente une quantité insignifiante face aux puissances de la science, du /razw'/incorporé dans le système de machines et des forces de la nature. Ce « triple maître », comme Marx l'appelle, est fondé sur une conception problématique de la technique et de son rapport à l'homme : la théorie du fétichisme de la marchandise. Elle n'est d'aucun secours pour comprendre les machines cybernétiques. Au contraire. Elle demeure entièrement anthropocentrique, animée par des sujets « individués » (vivants), des objets « chosifiés » (morts) et des mécanismes (dialectiques) qui renversent les relations entre les hommes pour en faire des relations entre choses. C'est de cette dialectique sujet/objet que naît l'idée du fonctionnement automatique et impersonnel des dispositifs capitalistes qui aliéneraient et domineraient les hommes qui les ont produits; c'est en elle que trouve sa source l'illusion que les affrontements stratégiques, la guerre, les relations de pouvoir peuvent être incorporés sans reste dans l'objectivité et l'impersonnalité de la monnaie, du travail, de la loi, de la consommation, des normes sociales, des algorithmes et de la finance. Une théorie des machines fondée sur une ontologie des sujets « individués » et des objets « chosifiés », sur le pouvoir des automatismes impersonnels dérivant du renversement dialectique de l'ordre de la subjectivité dans l'ordre de l'objectivité, ne pourra jamais rendre compte de la nature de la technologie, qui, comme l'explique Simondon, « ne fait pas partie ni du domaine social pur, ni du domaine physique pur23 » : elle émerge de la dimension
23- Ibid., p. 332.
122
Le capital déteste tout le inonde
pré-individuelle et de la dimension transindividuelle, en déjouant aussi bien les sujets individués que les objets chosifïés. L'évolution du rapport homme-machine, que Simondon construit au-delà de l'opposition sujet-objet, permet de saisir les limites des théories contemporaines : grâce à leur plasticité cybernétique, les machines simuleraient la plasticité du cerveau en acquérant une autonomie (Catherine Malabou) comparable à celle de l'humain; des automatismes mathématiques - les algorithmes constitueraient une nouvelle gouvernementalité. La théorie des machines du philosophe français nous permet de critiquer une autre théorie, encore plus étrange, celle selon laquelle le travailleur « cognitif » aurait incorporé les machines (le capital fixe) dans sa subjectivité. L'« appropriation » des moyens de production par les travailleurs, qui supposait autrefois la révolution, la prise du pouvoir, la guerre civile, etc., se produirait désormais miraculeusement, sans même un accroc et sans que les capitalistes (ni personne) s'en aperçoivent. Le processus technique par lequel le corps humain produirait des organes artificiels en extériorisant ces fonctions, serait inversé par le travailleur cognitif, qui aurait intériorisé la technologie et les savoirs qui la produisent et la font fonctionner. Mais c'est un tout autre corps qui est convoqué par la technologie : la « machine doit être immédiatement pensée par rapport au corps social et non par rapport à un organisme biologique humain24 ». C'est le « corps social » du capital qui distribue la machine technique comme capital constant et l'ouvrier comme capital variable. Ils sont complémentaires, ils évoluent ensemble, parallèlement, sous le contrôle de l'unité supérieure de la machine de guerre. Et ce n'est que depuis un autre « corps social », celui de la révolution et de ses modalités d'organisation, que pourra être critiquée la machine de guerre du capital et configurée différemment la relation entre humain et non-humain. 24. Gilles Deleuze et Félix Guattari, L'Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie, Paris, Minuit, 1972, p. 481.
Machine technique et machine de guerre
123
Généalogie de la machine Simondon, comme Deleuze et Guattari, défend une autre ontogenèse de la technique. La machine ne prolonge pas le schéma corporel, « ni pour les ouvriers, ni pour les propriétaires des machines » : elle n'est pas un « organe », une prothèse, une extériorisation du bras, de l'œil, de la force corporelle, du cerveau, etc. Elle n'est pas un outil. Elle est un assemblage, un couplage, un agencement de deux modes d'existence (l'homme et la machine) qui, ajouterons-nous, se développe sous la contrainte de la machine de guerre qui les a générés. Pour Deleuze-Guattari et Simondon, la distinction entre machine et outil est fondamentale : les instruments et les outils étant prothèse, extériorisation corporelle, ils n'ont aucune « individualité » propre, à la différence de la macjiine. Le xvme est le siècle du grand développement des outils et des instruments. A cette époque, c'est l'homme qui constitue l'« individu technique » parce qu'il prête son « individualité biologique » à l'individuation technique en portant les outils et en constituant le centre du processus. Le xix e est, au contraire, le siècle des machines, qui opèrent un décentrement des fonctions humaines. Avec l'industrie capitaliste, l'homme est déchu de la fonction d'« individu technique » : les outils sont portés par la machine (machineoutil), de sorte que c'est bien elle qui occupe désormais le centre de l'individuation technique. L'activité des machines automatiques n'est pas autonome, mais parallèle à l'activité humaine, qui ne disparaît pas, mais se déplace : son rôle est maintenant d'agir en dessous (« servant ») ou au-dessus (« régleur ») de l'individu technique (machine). L'homme devient soit organisateur des relations entre les niveaux techniques - au lieu d'être lui-même un de ces niveaux - , soit simple « fournisseur des éléments » pour le bon fonctionnement de la machine. Ces machines sont celles que l'on trouve dans Le Capital. Les théories du « triple maître » et du fétichisme de la marchandise sont construites à partir des machines automatiques (les machinesoutils) du xix c siècle, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les
124
Le capital déteste tout le inonde
machines contemporaines, cybernétiques ou autorégulatrices, dans lesquelles la fonction de l'humain change encore. Tandis que les machines automatiques marxiennes « ont besoin de l'homme comme servant (ouvrier) ou organisateur (capitaliste), les machines à auto-régulation ont besoin de l'homme comme technicien, comme associé25 », explique Simondon. Les machines-outils ne deviennent des individus techniques « relativement indépendants » qu'avec ces machines cybernétiques. La machine cybernétique, en tant qu'« individu technique », n'est pas une chose, un simple objet, ni une objectivation de l'activité humaine, mais un « mode d'existence » qui s'ajoute et fonctionne parallèlement au mode d'existence humain (aucun de ces termes ne peut fonctionner de manière autonome, indépendamment de l'autre). « Mode d'existence » signifie que la machine n'est pas une « unité absolue », un « bloc fermé », une « substance », c'està-dire une « chose » déjà individuée, déjà « achevée », « morte », pour utiliser le langage de Marx. La machine est ouverte de plusieurs façons parce qu'elle est relation et multiplicité de relations : relation vers ses propres composantes, vers les autres machines, vers le monde (le milieu) et vers l'humain. Cet être de la technique, que Heidegger a recherché en vain, c'est donc, pour Simondon, la relation. Il « réside dans le fait que la relation a valeur d'être : elle a une fonction doublement génétique, envers l'homme et envers la machine26 », alors que dans les pensées critiques contemporaines, « la machine et l'homme sont déjà entièrement constitués et définis ». Comme Deleuze et Guattari, Simondon ne traite jamais de l'homme et de la machine en essences qui mèneraient chacune une existence autonome. L'homme et la machine sont un agencement, donc un champ de possibles, de virtualités autant que d'éléments constitués (les pièces mécaniques, les logiciels, les algorithmes), mais tout cela doit se 25. 26.
Gilbert Simondon, Du mode d'existence des objets techniques, op. cit., p. 174. Gilbert Simondon, L'Individuation psychique et collective, Paris, Aubier, 1989, p. 278.
Machine technique et machine de guerre
125
confronter aux possibles et aux éléments constitués de la machine de guerre. Si la machine est ouverte, si la machine est relation, elle contient une « marge d'indétermination » et son individuation n'est pas déjà donnée une fois pour toutes, car son fonctionnement est adaptable et non rigidement constitué, comme celui des automates dont parle Marx et qui, à ce titre, constituent un type inférieur de technologie. Marx, en substantialisant la machine comme une cristallisation du « travail vivant », la conçoit comme un objet achevé, un « bloc fermé », quelque de chose de « mort » (« travail mort », précisément), ayant épuisé tout potentiel, tandis que toute la puissance est concentrée dans le travail vivant. Or la machine n'est pas définie seulement par son état matériel actuel, mais aussi par ses dimensions invisibles (plans, diagrammes, etc.) et ses potentialités. Elle n'est pas morte, mais bien « vivante », disponible à la variation, au changement, capable d'entrer dans différents processus d'individuation. En concevant la machine comme relation, nous ne pouvons absolument plus utiliser les catégories marxiennes de « vivant » (subjectivité) et de « mort » (objectivité), pas plus du reste que la catégorie foucaldienne du « vivant » biologique. La machine de guerre L'ensemble des relations qui constituent l'agencement hommemachine est pris dans l'individuation opérée par ce que Simondon appelle, de façon générique, la « civilisation du rendement », qui soumet (qui rend esclaves) l'homme et la machine à la « productivité » et à la domination de la nature. C'est ici qu'il faut convoquer le concept de machine de guerre. Par son indétermination, la machine (comme l'humain, d'ailleurs) est ouverte à une individuation qui dépend du « corps social » du capital. Le capitalisme rend possible à la fois l'autonomie relative des machines techniques et leur plus féroce « esclavage ». Le capital opère une rupture dans l'histoire politique et sociale, mais également dans celle des techniques, en déterritorialisant les flux monétaires,
126
Le capital déteste tout le inonde
sociaux, techniques, politiques qui, dans les sociétés précapitalistes, étaient « encastés, codés ou surcodés de telle manière qu'ils ne prennent jamais d'indépendance27 ». La décodification généralisée de ces flux donne une « liberté » et une « indépendance » nouvelles à l'évolution des flux techniques et scientifiques, qui, dans le même temps, sont soumis à la logique du profit et du pouvoir. C'est donc dans le capitalisme, conçu comme machine sociale opérant ce décodage généralisé des flux, qu'il faut chercher les raisons du développement des techniques : « C e ne sont pas les machines qui ont fait le capitalisme, en ce sens, mais le capitalisme, au contraire, qui fait les machines, et qui ne cesse d'introduire des nouvelles coupures par lesquelles il révolutionne ses modes techniques de production28. » Les machines se constituent au croisement d'une double dimension phylogénétique et ontogénétique. Les machines techniques s'inscrivent dans le « phylum » (l'évolution) des machines qui les ont précédées et des virtualités des machines à venir. C e phylum n'est pas porteur d'une causalité historique univoque, puisque, grâce à la décodification des flux, les lignes évolutives sont rhizomatiques, plusieurs bifurcations sont possibles. Mais ces possibilités de développement relativement indéterminées sont immédiatement capturées et actualisées par la machine de guerre du capital. Pour revenir sur un exemple que nous avons déjà vu, l'utilisation des machines à vapeur par la machine sociale de l'Empire chinois a été très limitée (des jeux pour les enfants), tandis que, de cette même invention, la machine sociale capitaliste a fait la clé de voûte de son essor. Ce n'est que par un défaut de conceptualisation du capital que l'on peut affirmer que les machines techniques révolutionnent la machine capitaliste. La machine diachronique du capital, obligée à des ruptures répétées (« crises ») pour pouvoir continuellement déplacer les limites de sa valorisation, ne « se laisse [jamais] elle-même révolutionner par une ou des machines techniques synchrones ».
27. 28.
Gilles Dcleuzeet Félix Guattari,L'Anti-Œdipe,op. cit., p.276. Ibid., p. 277.
Machine technique et machine de guerre
127
La machine de guerre capitaliste « laisse des savants, des mathématiciens "schizophréniser" dans leur coin », c'est-à-dire qu'elle les laisse suivre et développer le phylum de leur propre discipline et, ainsi, « faire passer des flux de code socialement décodés [qu'ils] organisent dans des axiomatiques de recherche dite fondamentale ». Toutefois, elle soumet inexorablement ces flux de recherche et d'innovation à « une axiomatique sociale bien plus sévère que toutes les axiomatiques scientifiques, mais bien plus sévère aussi que tous les anciens codes ou surcodages disparus : l'axiomatique du marché capitaliste mondial29 ». Deleuze et Guattari définissent précisément le rapport hommes/ machines au sein du fonctionnement de la machine de guerre du capital. Cette dernière, dans un état de crise permanente (elle « se détraque continuellement »), a toujours besoin des « organes sociaux de décision, de gestion, de réaction, d'inscription, [d']une technocratie et [d']une bureaucratie qui ne se réduisent pas au fonctionnement des machines techniques ». La « gestion » des crises ne se fait pas par l'intervention de dispositifs automatiques, mais par l'action d'une technocratie et d'une bureaucratie qui agissent comme subjectivation de la méga-machine du capital. Quant à ces crises, qui ne sont jamais strictement économiques, elles ouvrent toujours la possibilité de la guerre civile, de sorte que les fascistes peuvent aussi y intervenir, en plus des bureaucrates et technocrates. La machine de guerre n'a jamais un fonctionnement impersonnel, même lorsqu'elle semble fonctionner automatiquement, puisque « les bureaucrates et les technocrates » sont toujours adjacents aux automatismes techniques ou sociaux, prêts à intervenir lorsqu'elle tombe « en panne », politiquement ou économiquement. Les hommes politiques, les technocrates, les journalistes, les militaires, les experts, les fascistes, etc., constituent les subjectivations de la méga-machine, ils interviennent comme régulateurs, gardiens, servants, restaurateurs du grand flux de monnaie, de 29-
Ibid., p. 278.
128
L e capital déteste tout le inonde
capital, de technologie, de guerre, mais également comme « gouvernants » des divisions de sexe, de race et de classe, garants des asservissements et assujettissements impliqués par ces divisions. Les subjectivités choisissent, prennent des décisions, mais ces décisions et ces choix sont destinés à établir ou rétablir le fonctionnement de la machine. Elles appliquent les stratégies que la machine de guerre requiert, que la machine implique, qu'elle impose lorsqu'elle se détraque, mais que seule une subjectivation est à même d'actualiser. Lors d'un effondrement comme celui de 2008, les « automatismes » de l'économie, des institutions, des lois, des technologies étaient dans l'impossibilité de reproduire les relations de pouvoir. Et l'on a pu voir, en pratique, que la clôture de la multiplicité de relations qui constituent la machine du capital est opérée par la stratégie. La machine et la capacité de se révolter Catherine Malabou se trompe deux fois : une première fois dans Que faire de notre cerveau ?, parce qu'elle suppose une différence de nature entre l'humain (la plasticité de son cerveau) et les machines (ordinateurs), et une deuxième fois dans Métamorphoses de l'intelligence, qui voulait corriger le précédent ouvrage en supposant une « identité structurelle » du cerveau et de l'ordinateur. Simondon, comme Guattari, pose le problème tout à fait différemment : pour penser l'agencement homme-machine, il faut dépasser les dualismes de la nature et de l'artifice, de l'humain et du non-humain, mais cela ne signifie pas que les composantes de l'agencement possèdent une « identité structurelle ». La « subjectivité » n'est pas une propriété exclusive de l'humain, mais elle est distribuée de façon différente chez l'homme et dans la machine. « Il y a quelque chose de vivant dans un ensemble technique30 », dira Simondon ; Guattari, à son tour, parlera non pas d'une « autonomie vitale » de la machine (« ce n'est pas un animal »), mais d'une « proto-subjectivité », d'une « subjectivité partielle » et dotée 30.
Du mode d'existence des objets techniques, op. cit., p. 175.
M a c h i n e technique et machine d e guerre
129
d'un « pouvoir singulier dénonciation 3 ' » qui fonctionne comme vecteur de subjectivation. L'identité structurelle de l'homme et de la machine impliquerait que les composantes de l'agencement technique aient la même autonomie, la même capacité d'agir. Ce que Simondon récuse avec une argumentation très politique car centrée sur une modalité spécifique de l'agir : le « refus ». « L'être technique est plus qu'un outil et moins qu'un esclave ; il possède une autonomie, mais une autonomie relative, limitée, sans extériorité véritable par rapport à l'homme qui le construit32. » La proto-subjectivité ou la subjectivité partielle des machines est donc différente de la subjectivité humaine, et Simondon la définit par l'impossibilité, pour la machine, de dire non, de refuser. « La meilleure machine à calculer n'a pas le même degré de réalité qu'un esclave ignorant, parce que l'esclave peut se révolter alors que la machine ne le peut pas33. » Simondon ne se demande pas si la machine est à même d'intervenir lorsque surgit une « panne », une interruption, un dérèglement de son fonctionnement, ni si elle est capable de se réparer ellemême (conviction qu'au contraire, Malabou partage avec les cybernéticiens). La machine peut réussir toutes ses activités, elle peut se « dérégler et présenter alors les caractéristiques de fonctionnement analogues à la conduite folle chez un être vivant », mais elle ne peut pas opérer une « conversion » de sa subjectivité, comme le fait l'esclave qui se révolte. Par son refus, l'esclave produit « une profonde transformation des conduites finalisées et non un dérèglement des conduites ». Ce refus n'est pas un simple dysfonctionnement, mais une rupture subjective qui problématise l'existence et permet d'en changer les finalités. « La machine n'est pas autocréatrice ». Elle peut s'autoréguler, elle peut apprendre, s'adapter, mais l'adaptation demeure insuffisante pour rendre compte de l'autocréation qui, s'opérant par 3132. 33-
Félix Guattari, Cbaosmose, Paris, Galilée, p. 54. Gilbert Simondon, L'Individuation psychique et collective, op. cit., p. 271. Ibidem, p. 272.
130
L e capital déteste t o u t le i n o n d e
« sauts brusques » et par ruptures soudaines, implique une conversion de la subjectivité qui crée de « nouveaux possibles ». Bien que la machine soit à même de résoudre des problèmes, elle n'est pas capable de les poser et de mettre en discussion son « existence »34. Dans cette théorie des machines, la domination et le refus ne renvoient pas à la biopolitique. Chez Simondon comme chez Guattari, la machine comme relation implique un concept de « vivant » qui n'est pas réductible au biologique, comme c'est encore le cas chez Agamben ou Esposito. Si l'esclave est, comme tout vivant, un automate biologique, ce n'est pas à partir de ces automatismes organiques nécessaires à la vie qu'il refuse et se révolte, mais à partir de sa puissance a-organique. « L'automate peut être l'équivalent fonctionnel de la vie, car la vie comporte des fonctions d'automatismes, d'autorégulation, d'homéostasie, mais l'automate ne peut jamais être l'équivalent de l'individu3s. » Le refus et la révolte ne sont pas de simples interruptions. Les cybernéticiens et Malabou pensent que les machines cybernétiques peuvent « interrompre leur propre automaticité » et simuler en cela la subjectivité humaine. Les « machines se dérèglent pour mieux réévaluer leur fonctionnement » et « la réorganisation après ; la panne ou l'interruption renforce l'efficacité de l'automatisme », pour lui permettre d'« atteindre des nouveaux seuils de régulation36 ». Le « marché » autorégulateur, capable de se réparer et de réparer les dégâts des crises économiques, est encore le modèle de cette pensée de la technologie. Mais l'esclave « le plus ignorant » refuse et interrompt de façon radicalement autre. Il interrompt les automatismes qui règlent son asservissement pour neutraliser leur pouvoir et sûrement pas pour en améliorer le fonctionnement, pour atteindre l'homéostasie, l'équilibre. Il interrompt pour ouvrir la possibilité de la conversion de sa subjectivité et créer ainsi de nouvelles orientations et de 34. 35. 36.
Ibid., p. 274-275. Ibid., p. 274. Catherine Malabou, Métamorphoses de l'intelligence, op. cit., p. 152.
Machine technique et machine de guerre
131
nouvelles conditions de vie contre son exploitation et son servage. Sa révolte est a-organique, a-biologique. C'est ici qu'entre en jeu la gouvernementalité, dont la fonction fondamentale est de prévenir, neutraliser, défaire la « révolution », et qui est donc une politique de l'a-organique. Elle n'est pas uniquement ce qui intervient dans la vie de l'espèce, s'occupant de la maladie et de la santé, de la vie et de la mort, mais, de manière beaucoup plus fondamentale, ce qui décide du possible et de l'impossible. L'enjeu d'une machine de guerre révolutionnaire est de déjouer cette articulation par une rupture qui suspend les lois de la machinerie capitaliste, notamment la distribution du possible et de l'impossible qu'elle implique, en créant de nouvelles possibilités d'action. Pour rendre possible ce qui est impossible dans l'ordre de la machine capitaliste (« Soyons réalistes, demandons l'impossible! »), destruction et création sont complémentaires, ce qui signifie que la machine de guerre, pour réaliser la « mutation », la conversion de la subjectivité et le dépassement du capitalisme, doit aussi avoir pour objet la « guerre » contre le capital. Et cette « guerre » doit également libérer la machine, indissociable de l'humain. Une des raisons majeures de l'échec des révolutions socialistes du xx c siècle réside dans la conception et l'utilisation des machines et des travailleurs. Le socialisme (et le marxisme), exactement comme le capitalisme, substantialise et matérialise la multiplicité des relations qui constituent la machine technique, en la faisant « coïncider avec son état actuel, avec ses déterminations matérielles ». C'est pourquoi, tout en faisant de la technologie un enjeu de la révolution (les « Soviets plus l'électrification »), les Soviétiques n'ont jamais réussi à penser une alternative au capitalisme. La « marge d'indétermination » de la relation homme-machine a été soumise à la productivité, qui asservit l'homme, la machine et la nature. L'Etat socialiste s'est contenté de copier le modèle capitaliste en accélérant l'application du taylorisme et en faisant du « travailleur stakhanoviste » un appendice de la productivité. Ainsi,
132
Le capital déteste tout le inonde
il a réduit les machines au statut de choses et élevé les travailleurs au rang de « démiurges », tout en faisant de la nature un objet de domination. Automation et décision « Selon Bergson, la complexité croissante de l'organisme tient essentiellement à la nécessité de compliquer le système nerveux, car la plus grande complexité du système cérébral et nerveux entraîne un intervalle plus important entre action et réaction. Et en quoi consiste cette complication ? En un développement
simultané de / 'activitéautomatique et de l'activité volontaire. 11 n
a pas d'opposition entre les deux ordres du développement, car l'automatique fournit T'instrument approprié" au vouloir. »
Vidéopbilosophie Simondon montre l'inconsistance de l'idée que la machine puisse acquérir sa propre autonomie en simulant le vivant. Du point de vue des machines, du point de vue strictement technologique, les automatismes « purs » n'existent pas : « Le rapport adéquat à l'objet technique doit être saisi comme un couplage entre vivant et nonvivant. L'automatisme pur, excluant l'homme et singeant le vivant, est un mythe [...]. Il n'y a pas de machine de toutes les machines37. » Si les automatismes existent bien, leur nature ne peut être que socio-politique, dit Simondon, c'est-à-dire pensée et construite par la machine de guerre, dirons-nous. Les automatismes (normes, lois, marché) résultent toujours d'une stratégie, d'un projet, d'une volonté de domination, d'une volonté de pouvoir. Grégoire Chamayou réfute lui aussi ce point de vue dans son analyse de l'automation de la guerre : « L'erreur politique serait en effet de croire que l'automatisation est en elle-même automatique38. » Si la machine technique peut être automatique, la 37. 38.
Gilbert Simondon, Du mode d'existence des objets techniques, op. cit., p. 363. Grégoire Chamayou, Théorie du drone, Paris, La Fabrique, 2013, p. 287.
Machine technique et machine de guerre
133
machine de guerre qui l'a réduite à ce fonctionnement ne l'est jamais, j L'automation, au lieu de faire disparaître la subjectivité, le commandement, la stratégie dans l'impersonnalité du fonctionnement, augmente leur capacité d'agir. L'installation de réseaux, au lieu de « décentraliser » le pouvoir, contribue à le concentrer encore davantage. Si les « théoriciens de la "guerre en réseaux" pensaient que ces nouvelles technologies allaient permettre une décentralisation du commandement, "dans les faits, l'expérience des systèmes sans pilote prouve jusqu'ici le contraire". Plutôt que P"homme" en général ne perde le contrôle au profit de la "machine", ce sont ici les opérateurs subalternes qui perdent (encore) en autonomie au profit des échelons supérieurs de la hiérarchie. Une robotisation intégrale renforcerait encore cette tendance à la centralisation de la décision, quoique sous des modalités différentes, plus discrètes, plus économes certes, mais non moins hypertrophiées39. » Traduire l'impératif « ne cibler que de cibles légitimes » ou « définir un seuil de proportionnalité entre vies civiles tuées et avantages militaires attendus » dans le programme informatique du drone, implique que « les paramètres de la décision [soient] spécifiés, et cette spécification n'est pas opérée par le programme lui-même. Cela requiert un choix un amont, une décision sur les paramètres de la décision - une décision sur la décision. La centralisation du commandement - même si celui-ci passerait désormais davantage par des spécifications programmatiques que par des ordres - prend alors des proportions démesurées. » Si la machine automatique (le drone) doit exécuter une tâche selon la variable « MinimumCarnage », « quelle est la valeur correspondant à la variable [...] ? On ne sait pas. Plus de trente civils tués? OK. Mais cette toute petite décision sur la décision, effectuée en un mot ou en une frappe de clavier, a des effets démultipliés, très concrets, trop concrets40. » 39- Ibid., p. 299. 40. Ibid., p. 299-301.
134
Le capital déteste tout le inonde
Ces nouvelles technologies suppriment, ou déplacent, les maillons « très imparfaits » qui reliaient la machine technique à la machine de guerre, mais cela ne signifie en aucun cas une « horizontalisation » des rapports de pouvoir. Comme nous le verrons bientôt, contrairement ce que croient Boltanski et Chiapello ou Dardot et Laval, la même chose se produit dans l'entreprise et dans la finance. Si les dispositifs automatiques donnent aux travailleurs, dans l'entreprise, la « possibilité d'échapper à la tyrannie des petits chefs » en éliminant quelques échelons hiérarchiques intermédiaires, ils les soumettent à un pouvoir bien plus tyrannique et beaucoup plus redoutable. Le « pilotage automatique » que les systèmes technologiques mettent en place pour accélérer les opérations boursières ne fait pas disparaître les hiérarchies et leur commandement, mais renforce au contraire leur capacité de décision. Il n'y a pas de machines des machines (contrairement à ce que pensait Anders) et il n'y a pas de pilotes automatiques qui gouvernent la société ou la bourse. La machine automatique centralise encore davantage la décision : au lieu de la supprimer, elle l'exalte. Elle donne encore plus de pouvoir aux niveaux supérieurs de la hiérarchie. Les machines, y compris automatiques, dépendent toujours d'un élément extérieur. Les machines et les humains s'inscrivent dans des agencements collectifs (machine sociale et machine de guerre) qui les produisent et les reproduisent ensemble. « Le problème n'est pas de savoir qui de l'"homme" ou de la "machine" a le contrôle. C'est là une formulation sous-déterminée du problème. L'enjeu réel est celui de l'automatisation matérielle et politique de cette "bande d'hommes armés" qu'est d'abord l'appareil d'Etat4'. » Nous dirons plutôt que l'enjeu est la machine de guerre du capital, dont l'Etat n'est désormais qu'une articulation, et que l'automatisation est la réalisation technologique de la stratégie de « sécession » du capital. Stratégie qui, comme toujours, requiert ses subjectivations, ses « bandes armées ». 41.
Ibid., p. 304.
Machine technique et machine de guerre
135
Les théories accélerationnistes, post-opéraïstes, cyber-féministes sont incapables de rendre compte du rapport de la décision à l'automation, parce qu'elles évitent soigneusement de problématiser les stratégies d'affrontement (de guerre civile) de la machine de guerre capitaliste dont dépend l'actualisation des « possibilités » de la technique et de la science. Les automatismes (juridiques, économiques, technologiques) ne pourront jamais expliquer comment et pourquoi se sont produits le passage du fordisme au néolibéralisme, l'hégémonie du capital financier sur le capital industriel, la gestion de la « crise financière, les nouvelles mutations du fascisme ». Pour saisir ces tournants de l'histoire, ces « coupures subjectives », il faut mettre au centre de l'analyse, non pas les « possibilités » des technologies et de la science, mais les ruptures stratégiques qui orientent les politiques de la science et de la technologie. On peut même considérer que ces subjectivations sont esclaves de la « machine » sociale et de ses lois, qu'elles ne font que servir la machine financière, que les différents Etats sont asservis aux mécanismes de la machine de guerre du capital. Il n'en demeure pas moins, que, même dans ce cas, les « gardiens » de la machine sociale sont des adversaires, qu'ils mènent une guerre et une guerre civile contre les adversaires du fonctionnement de la méga-machine. Simondon et Guattari ont développé une théorie des machines très novatrice et radicalement opposée à la conception heideggérienne de la technique. Mais, comme tous les théoriciens des années i960 et 1970, après avoir introduit la domination, l'asservissement le point de vue stratégique, ils sont allés chercher des solutions plus qu'improbables à la guerre en cours : Simondon souligne le côté créatif de la relation, comme si l'aliénation, que pourtant il thématise, était surmontable par le seul déploiement de l'invention ; Guattari, qui a inventé le concept de machine de guerre, l'abandonne dans ses derniers ouvrages. Le paradigme esthétique qui clôt son travail de recherche sanctionne la séparation entre la machine de guerre comme mutation, création, subjectivation, et la machine
136
Le capital déteste tout le inonde
de guerre qui vise le dépassement du capitalisme. C'est précisément avec cette dernière qu'il s'agit de renouer. Machine de guerre et machine technique dans l'organisation du travail La grande entreprise était autrefois le lieu où l'on pouvait saisir le fonctionnement du capital et sa stratégie politique, et, en même temps, l'espace où organiser et déployer la lutte révolutionnaire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y reste qu'une stratégie, celle des patrons, à qui l'automation informatique permet de centraliser et de renforcer le projet de séparation politique que les machines cybernétiques portent à ses dernières conséquences. L'organisation du travail semble avoir franchi un nouveau seuil d'abstraction qui affecte profondément la subjectivité des travailleurs. Marie-Anne Dujarier42 décrit la prescription et le commandement dans l'organisation du travail de la grande entreprise comme un « management à travers les dispositifs », qui peut également se définir comme un « management sans managers », puisque ces derniers opèrent « à distance » de la production pour orienter les conduites des salariés, sans rien connaître au travail et aux travailleurs, selon les principes du « travail abstrait ». Dujarier applique aux travailleurs et aux consommateurs l'idée de gouvernementalité à distance développée par Foucault à propos de la population. Celle-ci se réalise pour l'essentiel à travers des dispositifs informatiques qui dictent ce qu'il faut faire, comment le faire, à quel rythme, selon quelle procédure et avec quelle qualité. Tous ces dispositifs sont conçus et fabriqués par ce que l'auteure appelle des « planneurs », d'une part, parce qu'ils pensent et organisent le travail par « plans », considérant l'activité comme décomposable et recomposable selon un modèle linaire et rationnel, et, d'autre part, parce qu'ils planent au-dessus du travail concret. 42. Marie-Anne Dujarier, Le Management désincarné. Enquête sur les nouveaux cadres du travail, Paris, La Découverte, 2015. Toutes les citations qui suivent sont extraites de ce livre.
Machine technique et machine de guerre
137
Ce qui nous intéresse, c'est le concept de dispositif que Dujarier reprend à Foucault (et à Agamben) et que nous allons redéployer à la lumière de la division entre machine technique et machine de guerre. Tout en considérant les dispositifs comme des choses, des objets qui médiatisent les relations entre des hommes, elle les définit comme des « machines ». Le « dispositif» (la machine) est un esclave qui sert à faire d'autres esclaves (les travailleurs). On peut ajouter, dans ce contexte, que le dispositif est construit par d'autres esclaves encore, « diplômés et bien payés » mais dont la machine du travail abstrait maîtrise, exploite et subordonne l'intelligence, le savoir et les compétences aux finalités de la performance, de la productivité, de la rationalité commandées et prescrites par la direction. Dans l'organisation du travail contemporaine, l'« entreprise » (qui peut être aussi bien une usine automobile qu'une école, une institution de suivi des chômeurs qu'un hôpital, un supermarché qu'un tribunal) semble avoir trouvé une stratégie, des dispositifs et des relations de pouvoir pour réaliser sa séparation politique d'avec les travailleurs. De manière très percutante, Dujarier appelle les modalités contemporaines de l'organisation du travail des « rapports sociaux sans relations », par quoi elle entend que tâches, fonctions et conduites sont imposées de manière unilatérale par la direction à travers les dispositifs conçus par les planneurs. Ces « rapports sociaux sans relations » enregistrent à la fois l'extrême faiblesse des « travailleurs », leur incapacité à établir et à imposer un rapport de force aux employeurs et la puissance de l'initiative capitaliste qui ne rencontre que de faibles résistances, régulièrement et facilement balayées. Les planneurs sont donc la clé de voûte de la stratégie de sécession. Ils ont pour tâche d'organiser la coopération, de standardiser, de prescrire, de mesurer, de contrôler la force de travail à travers des dispositifs informatiques43 pour accroître la performance définie 43- Dans les entreprises à faible intensité en capital (école, tribunal, etc.), le logiciel de gestion fait fonction de capital constant, puisque c'est lui qui décide des manières de faire, des temps d'exécution, des rythmes de l'activité, de la qualité de la production, etc. Tandis que dans une usine, beaucoup de ces prescriptions sont inscrites dans le
138
Le capital déteste tout le inonde
par la direction, en établissant une distance physique, temporelle, organisationnelle, affective avec la production. Cette stratégie de « séparation » a été rendue possible par la nature du capital contemporain qui, à la différence du capitalisme de Marx, n'est pas orienté vers la production44, mais, immédiatement, vers la « valeur actionnariat ». Les critères et la mesure de la productivité des entreprises ne sont plus définis par l'industrie mais par la finance. A la différence de Taylor, qui était à l'origine un ouvrier, et des managers de l'époque tayloriste, qui avaient une connaissance intime du travail industriel, les dispositifs de gouvernementalité à distance sont fabriqués sans rien connaître au travail et aux travailleurs. C e que les programmeurs, véritables travailleurs de l'abstraction, manient, au travers de « plans », de méthodes, de logiciels, ce sont des chiffres, des prix, des effectifs, des coûts, des statistiques. Le maniement des abstractions est d'autant plus facile qu'elles ne font « référence à aucune situation concrète ». Pour construire cette machine de pouvoir, les planneurs opèrent par rapport au management tayloriste une abstraction au carré, déconnectée du travail et des travailleurs. L'un d'eux déclare par exemple : « Je n'ai jamais entendu parler de travail ici. On parle de gestion, de procès, de end-to-end, de performance, mais jamais du travail. Moi, je n'ai jamais organisé le travail de gens. J'ai agi sur les procédures, les mesures, les écarts, c'est tout. Je n'ai jamais touché à leur travail. » « Je stresse car, en fait, je ne connais pas leur métier et je ne maîtrise rien. Je connais la machinerie, mais pas le métier. fonctionnement des machines (beaucoup, car le pouvoir incorporé dans la machine est doublé par le pouvoir de la machine sociale qui implique également son exercice directement sur les personnes). Le software et le hardware constituent un nouveau type de « capital constant », qu'on peut qualifier de « social », puisque c'est une machine universelle qui s'agence avec n'importe quel genre d'activité. Ce type de capital constant social requiert des investissements faramineux, tout en consommant 8 % de l'énergie mondiale. 44. « Ce qu'il veut vendre, c'est des services, et ce qu'il veut acheter, ce sont des actions. Ce n'est plus un capitalisme pour la production, mais pour le produit, c'est-àdire pour la vente ou pour le marché » (Gilles Deleuze, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », Pourparlers, Paris, Minuit, 2003, p. 245).
Machine technique et machine de guerre
139
Je n'ai pas accès à ce qu'ils font. Je ne le sens pas. » Les planneurs « n'ont pas de métier » et pourtant ils « prescrivent le métier des autres », affirme une femme interviewée. En réalité ils ont un métier, un métier de tous les métiers, pourrait-on dire, capable d'extraire du travail abstrait de n'importe quelle activité et d'« optimiser » les « valeurs abstraites » qui en résultent. L'accomplissement de cette tâche fondamentale implique une « indifférence » à tout contenu, qui se manifeste de façon radicale dans l'entreprise contemporaine. « Je travaillais sur un logiciel de production, pour le jambon de la marque X. Mais moi, j'y connais rien au jambon. Il fallait que je travaille sur le logiciel qui permet aux mecs de suivre la ligne de production, la gestion des stocks, etc. Mais moi, je n'ai jamais vu une ligne de production de jambon de ma vie. » La « distance » prise avec le travail ne signifie aucunement que le processus de la production soit désormais entre les mains de travailleurs, que la coopération, au lieu d'être imposée par le capitaliste, exprime l'autonomie des travailleurs ayant incorporé les machines, comme le croient de façon absolument incompréhensible mes camarades du capitalisme cognitif. Dans le capitalisme, l'autonomie et l'indépendance doivent être arrachées et imposées à la machine de guerre du capital. Elles n'ont aucune consistance « ontologique ». Comme les ouvriers « illettrés » du xix e siècle, c'est politiquement que les travailleurs contemporains - fussent-ils cognitifs - doivent affirmer leur indépendance et leur autonomie ; sans refus du travail, ils ne sont qu'un élément du capital (« capital humain », version modernisée du « capital variable »), de simples pièces de la machine productive, à disposition du « patron ». Si le mot « travail » est pratiquement absent du langage des planneurs, « la mesure de la force de travail est en revanche omniprésente, qu'il s'agisse de son coût, de sa qualité ou de sa valeur ». La prescription et la standardisation s'accompagnent d'une évaluation continue et obsessionnelle, mise en place par la direction et devant être alimentée par les travailleurs eux-mêmes. L'évaluation
136
Le capital déteste tout le inonde
et les dispositifs visent à mesurer le non-mesurable, à transformer la qualité en quantité, à faire émerger la quantité de la qualité. C e qui est impossible à mesurer, c'est le « travail vivant », pas du tout le travail abstrait. Les planneurs sont tout à fait conscients que le « travail réel » est irréductible au « travail prescrit », que dans l'opérativité de l'action, « le flou, l'incertain, l'illogique et le nonrationnel » sont indispensables à la réalisation de n'importe quel travail. Ils savent pertinemment que l'abstraction ne fait pas disparaître le travail concret ou vivant, puisque le « travail abstrait » est extrait du premier. Opposer le « travail réel » au « travail prescrit », le « travail vivant » au « travail abstrait » sans « refus du travail », sans affirmation d'une hostilité au capital, est une stratégie politique qui n'a aucune chance d'aboutir, puisque la dialectique des deux termes est déjà incorporée dans l'organisation du travail. Le vampire de la subjectivité Le fonctionnement de la machine de guerre (comme celui de la machine technique) est indissociable de l'intervention de différentes subjectivités. Le capital a besoin de sucer de la subjectivité comme le vampire du sang. L'entreprise capitaliste contemporaine montre clairement que l'automatisme des dispositifs n'est pas luimême automatique, mais qu'il a besoin d'être pensé, fabriqué, entretenu et accepté par une multiplicité de subjectivités, « esclaves » à divers degrés, mais qui, toutes, participent à ce processus qui asservit en même temps la machine technique et l'humain à la machinerie de l'entreprise. D'abord, le dispositif « automatique » doit rentrer dans les plans stratégiques de l'entreprise et être commandé par sa direction aux planneurs (décision, acte subjectif). Ensuite, il doit être produit par ces derniers, qui traduisent en technologies, signes, procédures, protocoles, les volontés du conseil d'administration et de la direction. Aux managers à distance succèdent les opérationnels, qui se chargent de faire fonctionner le dispositif dans la production et de le faire entretenir, améliorer et adapter à la contingence de la situation
Machine technique et machine de guerre
141
par les travailleurs (commandement direct sur les personnes). Le travail abstrait ne s'impose pas au travail concret comme un destin, il n'est jamais le renversement de l'activité des hommes dans l'action impersonnelle des choses; il résulte d'une stratégie étudiée par la direction qui mobilise différentes subjectivités et agence à chaque passage machine et hommes, humains et non-humains (machines, signes, procédures). La direction elle-même est organisée selon une stricte division du travail qui soumet la subjectivité du planneur à une réduction, à une mutilation, à une exploitation équivalentes par bien des aspects à celles qui s'imposent aux salariés assignés à la production. Les planneurs font partie du personnel de direction. Pourtant, ils se « décrivent avant tout comme des "rouages" de la grande machine productive » et « parlent d'eux-mêmes comme de salariés dominés, réifiés, manipulés et obéissants » : ils se vivent comme des « dominants dominés », ce qui est peut-être la définition la plus éclairante et la plus précise. Ils constituent néanmoins une articulation d'un nouveau type de « patron » composé de différentes fonctions. Marie-Anne Dujarier en dénombre sept : « propriétaires privés ou publics, membres du conseil d'administration, dirigeants salariés, planeurs spécialisés, encadrements de proximité, intermédiaires financiers et, enfin, prestataires des produits managériaux ». Différentes logiques animent les fonctions et subjectivités de direction, mais les « articulations » entre elles et les « arbitrages », les décisions, les choix stratégiques sont, comme dans les entreprises d'autrefois, à la charge de la « direction générale ». La centralisation du pouvoir reste la loi de la production capitaliste, qui passe, sans aucune contradiction, par la « décentralisation ». La fabrication des logiciels de management est soumise à son tour à une division du travail très hiérarchisée (dans le « management en miettes », chacun accomplit une tache spécialisée qu'il peut exécuter sans maîtriser l'ensemble du projet), ordonnées selon une stratégie que les programmeurs ne connaissent et ne maîtrisent que partiellement (« Moi, je suis un pion ! Je suis un exécutant »,
142
Le capital déteste tout le inonde
« On me donne une guideline et moi j'obéis »). Ces travailleurs de l'abstraction, producteurs de « plateformes » qui peuvent prendre mille formes (bornes électroniques, sites internet, systèmes d'information, etc.), travaillent trois fois à l'aveugle : quant aux stratégies de l'entreprise, quant au travail qu'ils organisent, quant à la construction des dispositifs eux-mêmes, dont ils ne connaissent et ne contrôlent qu'une partie. L'intelligence, les savoirs et savoir-faire sont soumis à l'action de la machine de guerre du travail abstrait qui dicte quels savoirs, quelles compétences doivent être mobilisés, dans quel cadre, pour quelles finalités. Les planneurs n'ont pas le « temps de lire, penser, prendre du recul » en dehors de leur travail. Pour « tenir leur rôle », ils doivent éviter de « penser à certaines dimensions de leur fonction », de la même manière « qu'un ouvrier qui travaille à la chaîne arrête de se poser des questions sur sa situation pour arriver à tenir son poste ». L'intelligence, la créativité et l'invention ne s'exercent que dans les limites établies par la machine de guerre de l'entreprise. Les « savoirs » sont sélectionnés et formatés par les contraintes de la valorisation. « Aussi sont-ils sollicités, voire sur-sollicités pour penser dans un cadre », celui de la rationalisation et de la quantification du travail abstrait. « En revanche, ils ne peuvent penser le cadrage lui-même », les finalités et les modalités d'exercice du travail abstrait, « sans courir des risques d'inefficacité et d'exclusion professionnelle ». La machine de l'entreprise opère une dissociation et un dressage de l'intelligence des planneurs : « une hors cadrage, empêchée, restreinte, et l'autre dans le cadrage, brillante, rapide, combinatoire, capable de créativité, de virtuosité abstraite, [ mais] socialement divisée, prescrite, hiérarchisée et contrôlée ». L'intelligence des planneurs est au fond celle de la machine de guerre du capital, dont ils sont à la fois les agents et les victimes. Le savoir ne donne aucune autonomie et indépendance s'il ne refuse pas le « cadre » dans lequel il fonctionne, s'il n'interrompt pas, s'il n'arrête pas la production dont il constitue qu'un rouage. C'est seulement à ces conditions que le General Intellect pourra être
Machine technique et machine de guerre
143
soustrait à la logique de la valorisation capitaliste, contrairement à ce que prétendent les théories du « capitalisme cognitif » (neuronal, computationnel, etc.), qui confondent « savoir » et « pouvoir », de la même manière que la social-démocratie de la première moitié du x\ e siècle. Celle-ci « ne percevait aucune ambiguïté dans le mot d'ordre "Savoir égale pouvoir". [...] Elle croyait que le même savoir qui avait consolidé la domination bourgeoise sur le prolétariat, permettrait au prolétariat de se libérer de cette domination. En réalité, un savoir qui n'ouvrait aucun accès à la pratique et ne pouvait rien apprendre au prolétariat en tant que classe sur sa situation, était inoffensif pour les oppresseurs45. » Le prolétariat a besoin d'un tout autre savoir, d'un savoir des luttes, pour affirmer son autonomie politique. La mise en place des dispositifs informatiques, leur entretien, leur adaptation, leur amélioration requièrent la mobilisation d'autres subjectivités : l'intervention de différentes fonctions de la direction (des spécialistes de la conduite des changements, des contrôleurs de gestion, des informaticiens, des consultants, des auditeurs, des formateurs, des prestataires, des certificateurs privés) et celle des travailleurs eux-mêmes, de sorte que ce qui se déploie n'est jamais de l'automatisme, mais un agencement hommes-machines. Par ailleurs, l'entretien des dispositifs prend une place grandissante et implique de soustraire de plus en plus de temps à la production (« le temps consacré à l'entretien des dispositifs euxmêmes, donc pris sur le temps de travail productif, peut-être estimé à au moins 5 % pour les opérationnels, au moins 50 % pour les cadres de proximité et près de 90 % dans les sièges sociaux »). L'intensification du travail abstrait prend la forme d'un dispositif qui oblige le travailleur à fournir, en plus du travail « productif », un travail croissant d'« anti-production », pour parler comme 45- Walter Benjamin, « Eduard Fuchs, collectionneur et historien », trad. fr. R. Rochlitz, Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000, p. 181-182.
144
capital déteste tout le monde
Deleuze et Guattari, travail qui, même dans ces nouvelles modalités, continue d'écœurer les travailleurs, puisque « du point de vue de l'activité, l'encadrement par les dispositifs produirait des nombreux processus de contre-performance ». Le pilotage par les algorithmes produit chez les travailleurs « le constat quotidien du "gâchis", des inefficacités et de l'inefficience des dispositifs ». « [I]ls peinent à comprendre pourquoi leur employeur dépense autant d'argent et d'ingéniosité pour les décourager de travailler ». En réalité, du point de vue capitaliste, cet argent est très bien dépensé, car - c'est la thèse la plus novatrice de Marie-Anne Dujarier - il s'opère un déplacement du centre de l'activité des travailleurs. Les dispositifs, « en plus d'être une automation partielle de la production, [...] automatisent aussi le travail d'organisation ». Toutefois, à la différence de ce qui se passait dans le taylorisme, l'abstraction ne doit pas supprimer toute activité (le travail vivant ou réel) en la réduisant au statut de simple exécution, elle doit déplacer l'activité pour la « centrer sur la machine managériale ellemême » - c'est-à-dire, en dernière analyse, sur la machine de guerre. Les planneurs « ne souhaitent pas que les travailleurs arrêtent de sentir, de penser, de signifier » ; ils font appel, au contraire, « à l'autonomie, à la personnalité, à la créativité de chacun, pour que ces facultés s'exercent, "au-delà" de la machine pour la corriger, la dépanner, l'adapter en fonction des situations locales ». « L'appel à l'autonomie dans un contexte où elle semble avoir disparu signalerait en fait un déplacement : l'activité serait moins orientée vers la production que vers l'entretien du dispositif lui-même », l'amélioration de la machine managériale productrice du « travail abstrait ». Cocher des cases, remplir des grilles d'évaluation, détailler ce qu'on fait de la manière la plus précise, participer à des réunions pour apprendre à faire tourner la machine du pouvoir en tant que telle : toutes ces activités sont désormais transversales à l'ouvrier industriel, au professeur d'université, au personnel d'un hôpital, d'un tribunal, d'une institution d'assistance aux pauvres. Faire tourner le dispositif lui-même constitue aussi l'essentiel du travail
Machine technique et machine de guerre
145
imposé aux travailleurs précaires des « plateformes ». Pour une entreprise comme Uber, le service que constitue le transport de personnes a moins d'importance que la récolte d'informations et que les évaluations que doivent fournir conducteurs et clients, y compris à leur corps défendant. Chaque échelon de la hiérarchie requiert un assujettissement spécifique, capable d'animer la relation hommes-machines, mais toutes sont censées rendre des comptes à la machine du travail abstrait. Définir ces activités de contrôle, de domination, comme parasitaires, inutiles, ce serait manquer la réalité du capitalisme, qui n'est pas seulement « production », mais aussi pouvoir. Et depuis toujours, la production et la reproduction des relations de pouvoir requièrent des techniques, du temps, des investissements et un nombre indéfini de « larbins ». L'analyse de la grande entreprise proposée dans l'ouvrage de Dujarier ne couvre qu'une partie des transformations qui l'ont complètement reconfigurée. Je voudrais en rappeler deux autres, en m'appuyant sur l'expérience italienne, où l'initiative du capital est encore plus avancée et la faiblesse des « travailleurs » encore plus forte qu'en France. Dans une entreprise historique de construction navale où le pouvoir des ouvriers communistes était quelque chose de bien réel (lors de la fondation de la Yougoslavie par Tito, 3 0 0 0 ouvriers de ces chantiers, qui se trouvent à sa frontière, l'ont traversée pour construire le « socialisme » dans les chantiers navals yougoslaves), on est passé de 12 0 0 0 travailleurs à 1200. Parmi ces 1 2 0 0 employés, les ouvriers sont en minorité, puisque leur travail a été externalisé à des sous-traitants, qui l'ont ultérieurement externalisé à d'autres sous-traitants. Les travailleurs de ces différents niveaux de sous-traitants sont d'une dizaine de nationalités différentes (par exemple, 2 0 0 0 sont originaires du Bangladesh). Les droits et la sécurité diminuent à mesure que l'on descend dans la hiérarchie des sous-traitants. Les divisions de revenus, de statut, de « race » effacent tout « pouvoir ouvrier ».
146
Le capital déteste tout le inonde
Les patrons des grandes entreprises italiennes sont en train de mettre en place ce dont le Medef français a toujours rêvé46 : le welfare d'entreprise remplace progressivement le welfare « universel », multipliant et renforçant encore les divisions au sein de la force de travail. La condition de la force de travail de la grande entreprise semble ainsi revenir aux débuts de l'industrialisation, lorsque le patron paternaliste s'occupait de la vie des ouvriers de la naissance à la mort (autre transformation de la biopolitique européenne qui a échappé à Foucault). Les travailleurs de la métallurgie, fer de lance du mouvement ouvrier de l'après-guerre, sont allés encore plus loin en acceptant un accord de branche qui, prévoyant un welfare « corporatif » pour les travailleurs du secteur, signe l'arrêt de mort du « modèle européen » et l'emprise grandissante du modèle américain. L'entreprise comme origine et source du nihilisme L'étude de Marie-Anne Dujarier énonce, sans en tirer toutes les conséquences, les dangers mortels que la machine de guerre du capital fait courir aux subjectivités qu'elle modèle et les périls auxquels elle expose la société et le monde. La capacité de traiter n'importe quelle activité comme travail abstrait, c'est-à-dire d'extraire de toute activité du quantifiable, détermine une « indifférence » radicale à tout contenu, à toute valeur d'usage. Les conséquences de cette « abstraction » sont redoutables, puisque l'accumulation du capital est indifférente à tout, sauf aux limites quantitatives qu'elle doit constamment dépasser.
46. Les patrons rêvent en effet d'un « nouveau capitalisme » dans lequel l'épargne des salariés et de la population, les fonds de pension, l'assurance-maladie, etc., « parce que gérés dans un univers concurrentiel, redeviendraient une fonction d'entreprise ». En 1999, Denis Kessler (numéro 2 du Medef) évaluait à 2 600 milliards de francs (150 % du budget de l'État) le butin que représentaient les dépenses sociales pour les entreprises de services. La privatisation des mécanismes d'assurance sociale, l'individualisation de la politique sociale et la volonté de faire de la protection sociale une fonction de l'entreprise sont au coeur du projet de destruction du « modèle européen ».
Machine technique et machine de guerre
147
Ces dangers ne sont pas perçus par les planneurs. Tout au contraire, l'abstraction produirait sur eux un effet « ludique » : ayant perdu tout rapport à la singularité des situations et des subjectivités, ils voient la capacité de décomposition et de recomposition des gestes, des tâches, des conduites comme un « jeu ». Dujarier relate ainsi l'enthousiasme d'un spécialiste de la gestion des ressources humaines à l'annonce d'une nouvelle mission, qui consistera « à licencier cinq cents personnes en trois mois sans faire de vague ». Pour lui, c'est « un beau challenge ». Il dit être « excité » et avoir « hâte de commencer ce boulot », qui se présente comme une équation délicate à résoudre, sur laquelle il va pouvoir déployer son intelligence et son habilité : « Ce n'est pas gagné ; c'est marrant comme défi. » Or ce rapport « amusant », « ludique », « rigolo » ou « marrant » des planneurs à leur activité cache un rapport plus violent et plus dangereux au monde et aux autres. G Le processus de sélection/fabrication d'une intelligence hyper-sollicitée dans le cadre de la rationalisation et d'une intelligence empêchée, contrariée, réprimée quant à la possibilité de discuter de ce même cadre a déjà fait ses preuves pendant les deux guerres mondiales, où l'organisation du travail a atteint une intensité et une extension inconnues jusqu'alors. L'extermination industrielle des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale n'a été que le résultat le plus ignoble de la rationalisation capitaliste, dont les conditions de possibilité se trouvent reproduites, sans grandes différences, dans l'organisation contemporaine du travail. « Ne pas voir » n'a pas été une attitude exceptionnelle, propre aux seuls nazis. Le refus de voir les conséquences de ce dans quoi l'on est engagé est profondément inscrit dans l'organisation scientifique du travail. Il est constitutif de son fonctionnement et de ses lois. Les témoignages des travailleurs de l'abstraction contemporains sont à cet égard accablants. Pour construire une carrière, il y a « une règle du jeu indépassable : éviter, autant que faire se peut, d'évoquer la dimension concrète des symboles maniés quotidiennement ». Les planneurs
148
Le capital déteste tout le inonde
« n'ont pas besoin de savoir ce qu'il y a derrière les chiffres », car s'ils commencent à se poser des questions et à en poser, le travail ralentit et ils mettent en danger leur carrière. « Je n'ai aucune idée de l'impact que j'ai sur la réalité du travail de gens qui vont utiliser ce progiciel. Et il ne faut pas poser la question [...]. Quand on vend du change management, on applique un truc générique sur une organisation, sans se demander si ça a du sens ou pas. C'est nécessaire de ne pas s'en poser pour pouvoir continuer. » Pour tenir l'abstraction, il est indispensable de rester indifférent à tout ce qui n'est pas rationalisation, productivité, performance. Pour échapper à la réalité et contribuer à la « construction sociale de l'indifférence », les planneurs inventent des techniques : « Je me fabrique du speed, pour ne pas être là, pour fuir le réel, pour ne pas penser. Quand je speede, je ne retiens rien. Speeder, c'est éviter de sentir. » L'organisation du travail capitaliste produit des criminels en puissance, qui, comme les nazis durant le procès de Nuremberg, ne se sentiront responsables ni du résultat, ni de leur engagement dans la « production », car pour eux, comme pour le capital, toutes les productions se valent, du moment qu'elles sont efficaces, rationnellement organisées, répondant aux critères de quantification et de calculabilité. Comme les nazis, tous pourront répéter : « Nous avons accompli notre travail », « Nous avons obéi aux ordres ». Ils agissent dans et pour une machine de guerre dont ils sont à la fois les acteurs et les victimes. C e n'est pas le sommeil de la raison qui produit des monstres, mais la « paisible » organisation du travail qui a franchi un autre seuil dans la construction sociale du nihilisme. La thèse de Gunther Anders semble donc encore d'actualité. On peut aisément l'appliquer aux dernières générations de travailleurs intellectuels (ou cognitifs). Les changements dans l'organisation du travail n'ont pas ébranlé la responsabilité de l'entreprise capitaliste dans la production de comportements et de subjectivités « irresponsables ». Les planneurs sont exposés aux mêmes dangers que les auteurs de crimes nazis, qui « ont fondamentalement adopté le
M a c h i n e technique et machine d e guerre
149
comportement auquel ils avaient été conditionnés par l'entreprise, auquel celle-ci les avait habitués47 ». Pour tout entrepreneur, il est absolument « indifférent » produire des voitures, des yaourts, des événements sportifs, des immeubles ou la santé de la population. Cette indifférence quant au contenu et aux finalités du produit déteint sur le travail, qui doit lui aussi faire abstraction de toute valeur d'usage. L'entreprise capitaliste demande un « engagement total » au travailleur, qui ne doit jamais se sentir concerné par la finalité de sa production. Elle établit une séparation étanche entre la production et le produit : « Le statut moral du produit (le statut du gaz toxique ou celui de la bombe à hydrogène) ne porte aucun ombrage à la moralité du travailleur qui participe à la production. » Le « produit le plus répugnant ne peut contaminer le travail lui-même48 ». Le travail, comme l'argent dont il est la condition, « n'a pas d'odeur ». « Aucun travail ne saurait être moralement discrédité par sa finalité. » L'homme qui travaille a fait le « serment secret » de « ne pas voir ou plutôt de ne pas savoir ce qu'il faisait », de « ne pas tenir compte de sa finalité », de « ne pas chercher à savoir ce qu'il fait ». Comme nous l'a montré l'exemple des planneurs, le « savoir » des conséquences n'est pas nécessaire pour travailler. Bien au contraire : « Son ignorance est souhaitée dans l'intérêt de l'entreprise. Il serait faux cependant de supposer qu'il aurait besoin de savoir. En fait, tout au moins dans l'acte même du travail, la vision de la finalité (ou même de l'utilisation que l'on fera de cette finalité, qui de toute manière est déjà "pré-vue"), ne lui servirait absolument à rien. Elle le gênerait même49. » L'entreprise contemporaine essaie de pallier le nihilisme qu'elle sécrète inévitablement en s'inventant une « éthique », mais l'environnement « moral et moralisateur » dans lequel s'enveloppe le discours 47- Giinther Anders, L'Obsolescence de l'homme. Sur l'âme à l'époque de la deuxième révolution industrielle, trad. fr. C. David, Paris, L'Encyclopédie des nuisances, 2002, p. 320. 48. Ibid., p. 322. 49- Ibid., p. 325.
150
Le capital déteste tout le inonde
managérial (« développement durable », « diversité », « parité », « handicap », « citoyenneté », etc.) ne correspond à rien, parce que sa seule vraie loi est celle du profit, c'est-à-dire de l'indifférence éthique. Les hommes sont dressés à la « collaboration », non pas par une idéologie, mais par des agencements, des dispositifs, des pratiques, des asservissements qui ne se réduisent pas à celle du travail. Aujourd'hui, le consommateur se trouve dans la même position de « collaboration ». Il ne doit s'interroger ni sur les modalités de fabrication du produit (utilisation de pesticides ? Exploitation d'ouvriers, d'enfants et d'esclaves?), ni sur les conséquences que la fabrication et la consommation ont sur la planète. La consommation non plus « n'a pas d'odeur » - comme le travail, elle ne sert en réalité qu'à produire de l'argent. Donc, par rapport à l'époque d'Anders, le problème de la « collaboration » s'est encore aggravé, car si le travailleur est indifférent au produit, le consommateur est indifférent à la production. Ce qu'il faudrait interroger, ce ne sont pas seulement les finalités du produit, mais aussi les conditions de la production et celles de la consommation, qui contiennent à la fois les raisons de l'exploitation et les raisons de la catastrophe écologique. Si elle ne veut pas échouer, la lutte écologique doit présupposer la neutralisation de l'indifférence inscrite dans la production et la consommation capitalistes. L'indifférence n'est pas un trait psychologique, mais une condition objective et subjective de la production du capital. Le capital financier, vraie « direction générale » de l'entreprise, porte à son accomplissement le processus d'abstraction et de création de l'indifférence, puisque les financiers ne connaissent et ne manipulent que l'abstraction de l'argent sans se soucier de la valeur d'usage de la production. Les « abstractions » de la valeur actionnariale sécrètent des modalités de subjectivation dont l'accélération peut conduire, comme les abstractions de la valeur industrielle l'ont déjà fait, à de nouvelles subjectivations fascistes. La montée des nouveaux fascismes crée les conditions d'une évolution proprement « criminelle » de cette indifférence, comme
Machine technique et machine de guerre
151
nous le constatons lorsque la mort de milliers de migrants en Méditerranée rencontre l'apathie des populations européennes. L'étonnante vitesse à laquelle la démocratie peut se transformer en fascisme a ses racines dans l'aveuglement produit par la division du travail et par la consommation, qui, à des degrés différents, affecte tout un chacun. Le « ne pas voir », le « ne pas sentir », s'est répandu en Europe sans rencontrer de véritables obstacles. Dépersonnalisation ou guerre de classes ? La force des « machines » dans l'organisation du travail résiderait dans l'automation qui dépersonnaliserait les relations de pouvoir en les inscrivant dans les technologies numériques et dans les algorithmes qui les font fonctionner. Mais la dépersonnalisation est toute relative, puisqu'elle est constamment l'enjeu d'une lutte de classes, dont le but est, précisément, de faire émerger, sous les automatismes des dispositifs, la stratégie et, sous la technique, la volonté de domination de certaines « personnes » (les patrons) sur d'autres (les travailleurs). Dans les grandes concentrations industrielles, la réalité des relations de pouvoir n'a pas toujours été aussi « pacifiée » que depuis les années 1980. Les relations n'ont pas toujours eu la forme de la gouvernementalité. Dans les années i960 et au début des années 1970, une « guérilla d'atelier » animait les relations de pouvoir, si bien que le management et la technique se manifestaient comme domination et répression. L'émergence et la consolidation des « machines de guerre » ouvrières ont eu la capacité de « dévoiler » la subjectivité du commandement qui se cachait derrière l'automatisme de la chaîne de montage, de nommer la volonté de domination qui se nichait dans l'impersonnalité de la technique. Le conflit à l'intérieur de l'usine s'était mué en affrontement stratégique entre adversaires et n'a pu être dénoué que par la victoire des uns (les capitalistes) et la défaite des autres (les ouvriers). Le storytelling (Foucault, Chiapello-Boltanski, Dardot-Laval, etc.) sur l'avènement du management « humaniste » en usine et de la gouvernance « pacifiée » dans la société, est donc faux. L'idée
152
Le capital déteste tout le inonde
selon laquelle le « nouvel esprit du capitalisme » aurait eu la capacité d'intégrer les critiques portées à son organisation, en incorporant l'autonomie, l'indépendance, l'auto-affirmation, la liberté revendiquées par les luttes des années i960 dans une nouvelle organisation du travail, révèle seulement les souhaits politiques de ses auteurs. En réalité, il s'agit d'une énorme erreur de perspective puisque l'on applique au néolibéralisme la logique de la dialectique « réformiste » des Trente Glorieuses (dont ces auteurs sont les orphelins nostalgiques), alors que son projet est tout autre : négation radicale de tout réformisme, imposition de « rapports sociaux sans relations », poursuite dénuée d'ambiguïtés de la sécession politique du capital et de sa propriété. Si l'on prend on considération l'économie mondiale, seule dimen-
sion a partir de laquelle on peutjuger d'un phénomène de pouvoir, on peut affirmer sans contestation possible que ces modalités de management « humaniste » n'ont concerné qu'une infime minorité d'entreprises : celles du « travail créatif» de la Silicon Valley (et encore). Ce qui n'est absolument pas une nouveauté, puisque, nous l'avons vu, dès le début de la guerre froide, la production de la science et de la technologie, sous la houlette de l'armée américaine, s'est faite dans la coopération et la convivialité interdisciplinaires. Le nouvel esprit du capitalisme ne s'est jamais réalisé dans les grandes entreprises, où, au contraire, se sont multipliés, comme en Chine, en Corée, au Japon, les suicides, les humiliations, les contraintes, la dépression, le « karoshi » (mort par overdose de travail). Les « résultats effectifs » de la gouvernementalité dans l'entreprise et dans la société sont affligeants et devraient nous instruire sur ce qu'elle gouverne vraiment : le triomphe du capital et son projet de sécession. Elle s'engage dans une voie que ses critiques ont du mal à envisager, en revenant, comme au Brésil, à ses moments inauguraux. Les changements dans l'organisation du travail et la société renvoient aux ruptures, aux discontinuités, aux stratégies, qui seules « rendent déchiffrables les événements historiques ». C'est le « triomphe dans le combat contre les classes subalternes » qui
Machine technique et machine de guerre
153
constitue la clé des événements historiques de la fin du xx e siècle. Contre les analyses qui expliquent les changements par la créativité, l'autonomie et l'indépendance du travail (ou sa récupération par le capital), la mise en garde de Benjamin contre la social-démocratie reste d'une brûlante actualité. « Pressentant le pire », avec Marx et Benjamin, on doit objecter « que l'homme ne possède que sa force de
travail, qu'il ne peut être que l'esclave d'autres hommes [...] qui se sont faits propriétaires ». Hans-Jurgen Krahl, par ailleurs considéré comme un théoricien de la mutation du travail intellectuel, suggère, en poursuivant les intuitions de Benjamin, qu'on ne doit pas se contenter de considérer la classe ouvrière comme « productrice de capital », mais également comme une force « destructrice de capital ». Cette seconde fonction est ignorée par les théories marxistes contemporaines (notamment par la théorie du capitalisme cognitif) qui mesurent l'action révolutionnaire du travail à partir de sa « productivité », de sa créativité, de son « autonomie ». L'idée de « force destructrice » déplace l'économisme qui affecte souvent le marxisme sur un terrain stratégique, en radicalisant, à la fin des années i960, le concept de « travail en tant que non-capital » (Die Arbeit als das nicht-Kapital) et le concept de « refus politique du capital » de Mario Tronti. L'action révolutionnaire est destruction du rapport de pouvoir capitaliste qui engendre en même temps le patron et les ouvriers. Or le post-opéraïsme fait le pari contraire : il abandonne le point de vue stratégique des années révolutionnaires, en exaltant la « force productrice » et en expulsant toute négativité de l'action de la force de travail. Selon lui, la défaite historique de la classe ouvrière aurait accouché, en réalité, d'une victoire de la force de travail, car les entreprises capitalistes « ne sont plus capables de centraliser les forces productives et d'intégrer la force de travail comme elles l'ont fait à l'époque de la grande industrie50 ». 50. Cf. Michael Hardt et Antonio Negri, Commonwealtb, trad. fr. E. Boyer, Paris, Stock, 2012, notamment la cinquième partie et plus précisément le paragraphe intitulé « L'un se divise en deux ».
154
Le capital déteste tout le inonde
Cette description des rapports de forces entre classes est contre-intuitive; la réalité semble fonctionner exactement à l'inverse, notamment dans les entreprises et sur le marché du travail, comme nous l'avons montré plus haut. Mais, nous disent ces théoriciens, dans la production biopolitique contemporaine, la force de travail, à la différence de la production industrielle, « montre son autonomie, sa capacité croissante à organiser réseaux et formes d'organisation [...] sa capacité croissante à autogérer la production », tandis que le capital s'est réduit à un simple commandement, qui « affaiblit la productivité », bloque la puissance de production des travailleurs cognitifs. La séparation, l'autonomie, l'indépendance étant déjà réalisées par la force de travail, celle-ci n'a même pas besoin d'exercer sa « force destructrice » ni de se subjectiver en classe politique. Elle est « en soi » autonome et séparée. Le capital, « incapable d'intégrer la force de travail5' », est divisé en deux subjectivités antagonistes, deux figures subjectives qui s'opposent de manière radicale, préalablement à tout conflit, à toute rupture politique. Nous sommes sans le savoir dans une situation de double pouvoir. Dans la production industrielle, la rupture révolutionnaire est nécessaire pour que l'« un se divise en deux » ; dans la production biopolitique, l'« un se divise en deux » préalablement à toute action « destructrice ». L'abandon du point de vue stratégique du premier opéraïsme, l'insistance sur la puissance toute positive la force de travail nécessitent un autre fondement que la discontinuité de l'affrontement à partir de la relation de domination capitaliste. Sous la guerre de classes, sous la lutte à chaque fois singulière, il y a une philosophie de l'histoire qui, sortie par la grande porte, est revenue par la petite Si. Le post-opéraïsme ne voit pas que ce qu'il considère comme une incapacité d'intégration est un choix politique de séparation opéré par le capital, séparation bien réelle, comme nous l'avons déjà fait remarquer plus haut aussi bien au niveau d'entreprise qu'à un niveau plus général. La force de travail ne va pas être intégrée dans le capital, mais i non pas à cause de sa puissance : à cause de son immense faiblesse ! La non-intégration signifie non pas « autonomie » et « indépendance », mais travail servile.
Machine technique et machine de guerre
155
fenêtre des « progrès » de la force de travail. L'historicisme, nié en principe, est en réalité complètement assumé lorsque l'on affirme que le travailleur cognitif possède, à la différence de celui des plantations et de celui de la grande industrie, une « autonomie cognitive » que le capitaliste a été obligé d'accepter et avec laquelle il est obligé de négocier. Or l'histoire de la force de travail ne semble pas avoir le but et le sens qu'on lui attribue, ni procéder linéairement vers son accomplissement, le travailleur cognitif. Aussi bien l'esclave que l'ouvrier de la grande industrie ont exprimé une puissance politique en s'attaquant à la relation de subordination grâce à leur « force destructrice », que les « travailleurs cognitifs » sont incapables de mobiliser précisément parce qu'ils ont perdu toute négativité, précisément parce qu'ils sont d'abord « production », d'abord « coopération », d'abord « force d'invention La « négociation » (ou, plus probablement, le refus de la négociation - puisque le néolibéralisme est précisément un anti-réformisme, il n'y a rien à négocier!) ne se fait aucunement à partir de l'autonomie cognitive, mais de la rupture politique, du soulèvement, de l'exercice de la force destructive, comme l'ont montré tous les mouvements politiques depuis 2011, et encore tout récemment les Gilets jaunes en France. La force destructrice ne doit pas seulement viser les « maîtres », mais aussi les « esclaves » et leurs activités, auxquelles il faut enlever la forme de la « productivité », du « travail », de la « consommation », encore trop proches du pouvoir dont on voudrait se débarrasser. 52. Ce point de vue « productiviste » est porté à ses extrêmes conséquences par Roberto Ciccarelli (Forza lavoro. Il lato oscuro délia rivoluzione digitale, Rome, DeriveApprodi, 2018), qui fait de la force de travail l'expression de la « productivité de l'être ». Giso Amendola en donne ce commentaire : « De même que la substance spinozienne est cause immanente des modes infinis qui l'expriment mais ne l'épuisent pas, la force de travail est toujours entièrement présente dans son effort productif, conatus qui n'est jamais épuisé et "défini" par ses produits particuliers » (« Il motore invisibile. Virtualità e potenza délia "forza lavoro" », Opéra viva, 26 février 2018. En ligne : https://operavivamagazine.org/il-motore-invisibile). Le conflit vient après, et évidemment, il a du mal à venir. Quoi qu'il en soit, c'est le « blocage de la productivité » de l'être qui susciterait le conflit.
156
Le capital déteste tout le inonde
La force destructive doit aussi être convoquée parce que, dans la réalité, nous n'avons pas une « double production de subjectivité » qui sépare nettement la force de travail et le capital. Sans la rupture révolutionnaire, les travailleurs (comme tout le monde, d'ailleurs) . sont pris dans des relations de pouvoir qui, au lieu d'avoir la forme de l'antagonisme, ont celle de la complicité, de la collaboration, de la participation au grand désastre de la production capitaliste. La force destructrice n'a pas seulement pour fonction de neutraliser la domination du capital, mais de créer les conditions d'une conversion des subjectivités, du changement de leurs modalités de coopération et d'action, puisque même les formes de résistance portent encore la marque de l'ennemi. La catégorie de travail destructif nous semble donc bien plus prometteuse que le concept de travail productif auquel le marxisme a consacré des fleuves d'encre. D'autant que Krahl ne limite pas cette puissance de destruction aux travailleurs, mais l'élargit à tous ceux qui contribuent à cette activité « éthique ». C e n'est qu'à partir de ce caractère « destructif » que l'on peut penser à nouveau la rupture et la révolution.
3-
Devenirrévolutionnaire et révolution
Mais le problème, c'est la révolution1! Le mot « révolution » a disparu des programmes politiques et des réflexions théoriques, alors que tout au long du xix e siède et jusque dans les années i960, il a permis au mouvement ouvrier de garder l'initiative et d'entretenir une avance stratégique sur le capital. Le xx c siècle a été le siècle des guerres, des guerres civiles et des révolutions. De 1905 en Russie jusqu'à la révolution en Iran (1979) et en Amérique centrale (1990), en passant par le Mexique (1910), par l'Europe de l'après-Grande Guerre (Allemagne, Italie, Hongrie, etc.), par la Chine (1949), par l'Asie (1954, etc.) l'Afrique (1962, etc.) l'Amérique du Sud (Cuba, etc.), par 1968 (Mexique, France, Tchécoslovaquie, etc.), la planète a connu une suite de soulèvements et de révolutions inédite dans l'histoire de l'humanité. Au xix e siècle, toutes les tentatives révolutionnaires ont eu lieu en Occident et toutes ont échoué. Pire, elles se sont soldées par des massacres, comme celui de la Commune de Paris, qui a frappé 1. l e livre Guerres et Capital, écrit avec Eric Alliez, a été pensé comme la première partie d'un projet dont la seconde portera sur le concept et la réalité de la révolution. Je présente ici quelques-unes des hypothèses qui traversent le livre que nous sommes en train d'écrire.
156
Le capital déteste tout le inonde
l'imaginaire des prolétaires et des cadres du mouvement ouvrier. Pour la bourgeoisie, la « capitale du xix e siècle » ne pouvait être d'aucune façon le théâtre d'une expérience révolutionnaire. La rupture opérée par Lénine avec cette tradition a consisté dans la construction d'un parti (sur le modèle hiérarchique de l'usine, dira Max Weber), d'un type de subjectivité militante (le « révolutionnaire de profession ») et d'une méthode (la conscience de classe portée de l'extérieur par une avant-garde), dont la finalité était la prise du pouvoir. Puisque les désirs et les projets révolutionnaires se brisaient sur deux écueils principaux - le pouvoir et la guerre - , Lénine a apporté une réponse qui s'est révélée très efficace : prendre le pouvoir en transformant la guerre impérialiste en guerre de classe à partir d'un sujet conçu comme autonome, la classe ouvrière se mettant en travers du cours de l'histoire (ou de l'historicisme). Mais deux changements décisifs ont rendu impraticables les réponses léninistes et maoïstes à la question « Que faire? » Premièrement, les nouvelles modalités de la guerre totale et des guerres civiles qui, se continuant dans le New Deal et dans la guerre froide, ont dessiné un nouveau capitalisme que les marxistes continuaient à interpréter avec les catégories du xix e siècle; deuxièmement, l'émergence, dans l'après-guerre, de nouveaux sujets politiques - les colonisés, les femmes, les étudiants - porteurs de nouvelles modalités d'exploitation, de domination et d'action politique. L'« étrange révolution » des années i960 est un moment décisif: incapable de trouver une solution au problème qu'elle avait soulevé (le socialisme n'est qu'une modalité du capitalisme), elle se soldera par un échec historique. Nous ne sommes pas encore sortis de cette défaite parce que les vieilles modalités d'organisation et de lutte qui assuraient indépendance et autonomie politique ne sont plus praticables, tandis que les questions auxquelles elles ont su donner une réponse sont encore et toujours présentes, mais ne suscitent que des inventions et expérimentations locales et de courte durée qui n'inquiètent pas le capitalisme.
Devenir-révolutionnaire et révolution
161
De façon absolument arbitraire, j'expliciterai les conditions qui ont conduit à la « disparition » de la révolution par une confrontation de quatre auteurs, Frantz Fanon, Mario Tronti, Caria Lonzi et Hans-Jiirgen Krahl, que je tiendrai (arbitrairement encore) comme l'expression des points de vue des mouvements des colonisés, des « travailleurs », des femmes et des étudiants, respectivement. Le point de vue de ces « militants » a une autre consistance que celui des philosophes de profession, auquel il est toutefois intéressant de les confronter. Au xix e siècle, la révolution est, pour la première fois, mondiale La révolution naît bourgeoise en France, elle devient prolétarienne en hantant l'Europe, mais ce n'est qu'en se déplaçant, d'abord vers l'est et, ensuite, vers le sud, qu'elle deviendra mondiale. C e cycle de révolutions ouvert par les bolcheviques suscite d'âpres discussions. L'affirmation de Gramsci, selon laquelle « les événements de 1917 sont le dernier fait de ce genre dans l'histoire de la politique », est évidemment fausse parce que valable seulement pour le Nord. Elle a été démentie tout au long du xx c siècle par la suite unique, en nombre et en intensité, des révolutions à l'échelle planétaire. Mais la possibilité de la révolution mondiale se heurte à une fracture qui recoupe parfaitement la fracture coloniale. Dans les années i960 le problème est clairement posé par HansJiirgen Krahl, dirigeant des jeunes sociaux-démocrates et du mouvement étudiant allemand : s'il est vrai qu'il « n'existe pas d'exemple de révolution victorieuse dans les pays hautement développés », il est également avéré que les révolutions ne cessent d'éclater dans le « tiers monde », ce qui indique à la fois « l'unité internationale de la protestation anticapitaliste » et « une constellation et un fait qualitativement nouveau : l'actualité de la révolution. Pour la première fois dans l'histoire du capitalisme la révolution est une possibilité globalement présente et visible, mais qui se réalise dans les pays opprimés et pauvres du tiers monde. »
158
Le capital déteste tout le inonde
La révolution dans les colonies « n'a aucun caractère paradigmatique pour les pays capitalistes », parce qu'en Occident, « la domination et l'oppression ne s'exercent pas sur la base de la misère matérielle et de l'oppression physique ». Les luttes révolutionnaires qui se développent de part et d'autre de la fracture coloniale ne sont pas les mêmes et les méthodes révolutionnaires qui se révèlent victorieuses dans les colonies ne peuvent être transposées dans la métropole, où la structure du capital, du pouvoir et des subjectivités exploitées n'est pas la même. Du réseau mondial de partis, d'organisations, de mouvements et même d'Etats qui, de façon différente, « travaillaient » à la révolution, il ne reste littéralement plus rien. La globalisation capitaliste qui l'a détruit était une réponse stratégique à la révolution mondiale. Malgré cela, toute politique conçue dans les frontières de l'Etat-nation est destinée à échouer. Guerre civile mondiale ou révolution mondiale ? La « guerre civile mondiale » de Hannah Arendt, Cari Schmitt et Reinhart Koselleck a été en réalité une suite de révolutions. La révolution mondiale, malgré son échec après 1917, a continué à progresser sans jamais trouver de stratégie internationale adéquate à ses objectifs. Mais la « guerre civile mondiale » peut s'envisager de deux points de vue : celui de l'Etat, de la biopolitique, de l'état d'exception, du fascisme et du nazisme (Agamben, Foucault, etc.) et celui de la « révolution », qui est à l'origine de tous les changements affectant la catégorie de la politique et sa réalité. La révolution a révélé que le premier point de vue était aveugle au rapport de subordination qu'Etat, biopolitique, état d'exception, système juridique entretiennent avec le capital. Il n'y a aucune autonomie, aucune indépendance de fonctionnement du système politique. Etat et biopolitique ne sont plus que des centres d'exécution des « décrets » du capital (les gouvernements et la gouvernance des différents État lors de la crise financière est à ce titre exemplaire). La machine du capital est un « souverain » sut generis (dont fait
Devenir-révolutionnaire et révolution
163
désormais partie l'État), qui prend des décisions, choisit, s'oriente et fait fonctionner l'administration, le système juridique et la police, pour son profit et son pouvoir. La politique est dans l'« économie » (Marx), mais à condition de comprendre, avec Lénine, le rapport capitaliste, non comme un simple « rapport social », mais comme foyer d'un affrontement stratégique que toutes les révolutions du xix c siècle ont subjectivé. Révolution de l'ensemble des rapports de domination À la globalisation de la révolution dans le Sud correspond un élargissement des luttes s'attaquant à l'ensemble des rapports de pouvoir capitalistes, qui débordent la relation capital/travail. Le capitalisme n'a jamais connu une offensive couplant extension mondiale des révolutions et intensité sociale des luttes. Michel Foucault a défini la période 1955-1975 comme celle de P« insurrection des savoirs assujettis ». L'« efficacité des offensives dispersées et discontinues » menée par les savoirs assujettis rend possible l'« immense et proliférante criticabilité des choses, des institutions et des discours », et l'on s'attaque à l'institution psychiatrique, à « la morale » ou à la « hiérarchie sexuelle traditionnelle », à l'appareil judiciaire et pénal, à la maladie mentale, à l'hôpital, à l'école, etc. A cette extension des luttes correspond non pas une innovation dans la théorie et la pratique de la révolution, mais une fragmentation de points de vue souvent incompatibles, incapable d'établir une stratégie contre un ennemi commun. Les luttes qui ont été défaites au tournant des années 1970, loin d'être mortes, sont grosses de « présents », c'est-à-dire de possibles, qui ne se sont pas actualisés mais continuent à persister (Benjamin). En tant qu'ils constituent la part d'éternel de tout événement (Deleuze), ces possibles sont toujours virtuellement « présents » et peuvent entrer en résonance avec l'actualité par la rencontre avec une nouvelle rupture révolutionnaire (dont, pour l'instant, on ne voit pas trace).
164
L e capital déteste tout le inonde
Les deux stratégies de la révolution Hans-Jiirgen Krahl résume parfaitement la force et les limites de la révolution telle qu'elle a été pensée et pratiquée par le mouvement ouvrier'. Les deux principes ou stratégies de la révolution, la « socialisation » (règles d'utilisation de la violence pour la prise du pouvoir, destruction de l'appareil d'Etat et expropriation des expropriateurs, distribution de la propriété des moyens de production) et la « communication » (la lutte politique pour le pouvoir suppose que des règles de solidarité existent déjà dans la pratique de l'organisation), qui devaient être conçus et pratiqués comme inséparables, se révèlent difficilement conciliables. « Dans le passé, les mouvements ouvriers n'ont pas réussi à établir un rapport entre les règles de la violence dictées par la tactique de la lutte pour le pouvoir et les règles de la solidarité dictées par la praxis de l'organisation. » Ce point de vue est encore énoncé de l'intérieur de la tradition du mouvement ouvrier, tandis que Lonzi se positionne en dehors et Fanon à la limite. Ce dont il est question ne concerne pas seulement la solidarité (Krahl), ni uniquement le rapport entre (prise du) pouvoir et communisme, comme chez Walter Benjamin. Assujettissements Avec l'émergence des mouvements des femmes et des colonisés, les contradictions à l'intérieur du processus révolutionnaire semblent se disloquer et donner lieu à des processus « révolutionnaires » très différents qui ont été pratiquement inconciliables au tournant des années i960 et qui paraissent l'être encore plus aujourd'hui. Les modalités de la domination et de l'exploitation des femmes et des colonisés sont spécifiques et difficilement saisissables par la tradition du mouvement ouvrier, puisqu'elles cumulent la 2. foncière reproduit, cinquante ans plus tard, le même jugement sans faire un pas de plus : « Toute l'histoire moderne a été traversée par la tension entre une lutte de classes conçue comme formation d'une armée pour vaincre l'ennemi et une lutte de classe pensée comme sécession d'un peuple inventant ses institutions et ses formes de vie autonomes. »
Devenir-révolutionnaire et révolution
165
domination raciale et sexuelle et l'exploitation économique. Leur dépassement requiert des modalités d'organisation et des finalités de l'action politique très différentes de celles du léninisme. « La femme est opprimée à l'intérieur du modèle sexuel », affirme Lonzi. Qu'est-ce qui fait défaut dans la théorie socialiste ? se demande-t-elle. Lénine promettait la liberté, mais n'acceptait pas le processus de libération, qui pour les féministes partait du sexe. Les marxistes ont bien réussi la révolution, mais la dictature du prolétariat s'est montrée incapable de « dissoudre les rôles sociaux ». La « socialisation des moyens de production n'a pas affaibli l'institution de la famille, mais l'a renforcée [...] en excluant la femme comme partie active dans l'élaboration des thèmes socialistes ». On ne peut pas défaire les assujettissements du colonisé et de la femme simplement en s'attaquant à la « production » et à l'exploitation du travail. Les singularités de cette fabrication de « subjectivité » (« la femme ») demandent une intervention politique et une modalité d'organisation qui ne vise pas uniquement la prise de pouvoir. Dans la situation coloniale, le travail politique est double, car on ne peut pas « écarter la subjectivité ». Le Noir doit mener une double lutte, « sur le plan objectif comme sur le plan subjectif». Parce que « l'âme noire est une construction du Blanc », il doit être libéré de lui-même, de sorte que, pour Aimé Césaire, « [Ija lutte des peuples coloniaux contre le colonialisme, la lutte des peuples de couleur contre le racisme est beaucoup plus complexe - que disje, d'une tout autre nature que la lutte de l'ouvrier français contre le capitalisme français ». Travail Si la forme de la domination des femmes et des colonisés est très différente de celle des ouvriers, leur travail (gratuit) l'est également. Le manifeste de Rivolta femminile affirme que « le travail domestique non payé [est] la prestation qui permet au capitalisme, privé et d'Etat, de se reproduire », tout en refusant de concevoir la libération de la femme par l'accès au travail productif (Lénine).
162
Le capital déteste tout le inonde
Tout au contraire, valoriser les « moments improductifs est une extension de la vie proposée par la femme ». La « compétition productiviste » est le « plan de pouvoir » commun aux « sociétés à capitalisme d'État ou privé ». Dans les colonies, les oppositions ville/campagne, ouvriers/ lumpen, structure/superstructure, ne peuvent pas fonctionner. Dans ce monde que le marxisme européen considère comme « prémoderne » (donc ignore), nous retrouvons toute une série de figures et de problèmes qui nous sont maintenant très familiers. L'exploitation de l'homme « emprunte des visages différents » (chômeur, saisonnier, lumpen, prolétaire, ouvrier, etc.) que le capital « unifie » non pas, comme hier, par le salariat et l'industrie, mais, comme aujourd'hui, par la finance. « Poser le problème de l'évolution des pays sous-développés » par un appel au productivisme, au développementisme comme en Union soviétique (« Ceignons-nous les reins et travaillons »), « ne nous paraît ni juste, ni raisonnable » (Fanon). C e que le travailleur et le « travail » sont devenus ressemble davantage à la condition des colonisés et des femmes (travail précaire, servile, pauvre, gratuit) qu'à celle de l'ouvrier décrit par Tronti. L'autonomie de l'organisation Les femmes et les colonisés réclament des organisations autonomes pour répondre aux problèmes que n'envisagent pas l'organisation et la théorie du mouvement ouvrier. C'est peut-être dans le mouvement féministe que l'on trouve la critique la plus radicale de la centralisation et de la verticalité des rapports de pouvoir à l'intérieur du « parti » et des finalités de l'organisation révolutionnaire. La transformation des « rôles sociaux », que la révolution renvoie à un après la révolution, est l'objet immédiat des pratiques politiques. Les femmes, pour devenir un sujet politique autonome, inventent une démocratie radicale. Au sein des groupe d'auto-conscience, elles expérimentent de nouvelles relations horizontales, non hiérarchiques, productrices
Devenir-révolutionnaire et révolution
167
d'une connaissance collective spécifique aux femmes. Le concept et la pratique de la « représentation » et de la délégation sont absents, puisque le problème n'est ni la prise, ni la gestion du pouvoir Défaire les rôles et l'assignation à la féminité signifie ne pas succomber aux promesses de l'émancipation par le travail et par la lutte pour le pouvoir, qui sont considérés comme des valeurs de la culture patriarcale (et du mouvement ouvrier). Le mouvement féministe ne revendique aucune participation au pouvoir, mais, tout au contraire, une mise en discussion du concept de pouvoir et de prise du pouvoir, car la seule chose vraiment nécessaire pour le gérer, c'« est une forme particulière d'aliénation ». Le mouvement féministe arrive ainsi à séparer les pratiques de constitution et d'affirmation du sujet autonome et la question de la révolution, en produisant deux concepts de « politisation » très différents et (selon Lonzi) incompatibles. Le parti chez les colonisés Les colonisés, tout en pratiquant une double lutte, objective (contre le capitalisme) et subjective (contre l'assujettissement), introduisent d'autres problématisations à l'intérieur de la tradition révolutionnaire ouvrière codifiée par les bolcheviques. Le parti « est une notion importée de la métropole. Cet instrument des luttes modernes est plaqué tel quel » sur la réalité protéiforme des colonies. « La machine du parti se montre rebelle à toute innovation », face à une réalité qui n'a rien en commun avec celle décrite dans Ouvriers et Capital, car la classe ouvrière n'existe pas ou constitue une minorité. Non seulement les colonisés refusent de se soumettre à l'hégémonie de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier, mais ils revendiquent des modalités d'organisation séparées et autonomes. La question coloniale, ne peut pas être traitée comme partie d'un ensemble plus important, représentée par les intérêts du parti communiste, dira Césaire.
164
Le capital déteste tout le inonde
« Les forces qui se battent contre la colonisation ne peuvent que s'étioler dans des organisations qui ne leur sont pas propres, faites pour eux, faites par eux et adaptées à des fins qu'eux seuls peuvent déterminer. » Ni la théorie, ni la conscience ne peuvent être portées de l'extérieur. En même temps qu'ils montent leurs propres organisations, les colonisés doivent élaborer leurs propres stratégies. La critique de la représentation et de la délégation les traverse également. Les peuples n'ont pas besoin d'un leader, ils « ne sont pas des troupeaux et ils n'ont pas besoin d'être conduits. Si le leader me conduit, je veux qu'il sache qu'en même temps je le conduis » (Fanon). Pour Fanon, à la différence de Lonzi, la « prise du pouvoir » n'est jamais en cause (« A partir de 1954, le problème que se sont posés les peuples coloniaux a été le suivant : que faut-il faire pour réaliser un Dien-Bien-Phu ? [...] ce qui faisait le problème, c'était l'aménagement des forces, leur organisation, leur date d'entrée en action »). Le sujet et les modalités de la révolution sont en revanche problématisés. De façon significative, Les Damnés de la terre apporte des réponses différentes à la question du qui et du comment de la révolution. Fanon affirme d'abord que la révolution ne pourra qu'être mondiale et « se fera avec l'aide des masses européennes », même si celles-ci se sont « souvent ralliées, sur les problèmes coloniaux, aux positions de nos maîtres communs ». Plus loin, dans les conclusions, c'est le « tiers monde » qui, tenant compte « des thèses quelquefois prodigieuses soutenues par l'Europe », mais aussi de « ses crimes », a la charge de « recommencer une histoire de l'homme ». Ici, il y a une opposition entre « tiers monde » et « Europe » qui ne semble pas tenir compte de ce que Fanon nommait plus haut « nos maîtres communs ». L'ennemi devient l'Europe en tant que telle, le capitalisme semble disparaître sous la division raciale. Ces ambiguïtés connaîtront une reprise malheureuse dans la pensée postcoloniale, parce que la révolution sera complètement évacuée.
Devenir-révolutionnaire et révolution
169
Critique de la dialectique Comment sortir de la dialectique et de l'historicisme ? Telle est la question à laquelle tentent de répondre Lonzi et Fanon. Tout en exploitant le riche arsenal conceptuel européen, ils portent une attaque violente à la dialectique hégélienne (et à sa traduction marxiste). La dialectique ne peut pas défaire les rôles et les fonctions auxquels sont assujettis les femmes et les Noirs, exclus de l'histoire et de l'espace public. La promesse d'émancipation de la dialectique ne peut pas être tenue. Elle ne concerne que les conflits qui ont lieu à l'intérieur du « modèle majoritaire » (homme, blanc, adulte, etc.), de sorte qu'elle est « blanche et masculine ». Les Noirs et les femmes sont « bloqués » à des « stades » dont ils ne peuvent sortir pour atteindre la liberté de l'auto-conscience. Condamnés à jamais à leur condition de dominés, ils constituent la face cachée de la domination du capital mondialisé que Hegel traduit dans les concepts de l'« Esprit européen ». Dans la progression dialectique, dira Fanon, on ne peut créer aucun sens, puisque « c'est le sens qui était là, préexistant, m'attendant ». A ce devenir historique déjà déterminé, qui contient déjà en lui-même, et depuis son commencement, sa fin, Fanon oppose « l'imprévisibilité ». Du point de vue de la dialectique marxiste, la lutte dépend du développement des forces productives, selon une linéarité que Fanon conteste. Le processus révolutionnaire est saut, rupture non dialectique de l'ordre de l'histoire qui doit ouvrir sur l'invention et la découverte de quelque chose que l'histoire ne contenait pas déjà. L'imprévisible, comme moyen de sortir de l'histoire, est une thématique que l'on retrouvera, enrichie et élargie, chez Lonzi, qui énonce très clairement et d'une double manière les conditions de la rupture avec la machine de guerre léniniste et le sujet qui la portait. Elle déclare d'abord que le sujet n'est pas donné, qu'il est, tout au contraire, « imprévu », et ensuite que la temporalité du mouvement féministe n'est pas le futur, mais le présent. Le sujet imprévu
170
Le capital déteste tout le inonde
implique un « acte imprévu », une rupture créant les possibles de sa propre libération. Lonzi vise directement la révolution marxiste, qui pose une discontinuité sur le plan du « pouvoir », mais une continuité quant au « sujet » de la révolution. La révolution (comme le sujet) est déjà en acte (« le mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses »), elle doit seulement se réaliser en prenant le pouvoir, ce qui lui permettra de se déployer, finalement, selon des modalités plus rationnelles et plus « productives » que celles du capital. Dans ce cadre, la temporalité de la révolution est le futur (promesse), alors que le « présent » est la temporalité de la rupture féministe, l'ici et maintenant (« Le but n'existe pas, existe le présent ») qui ouvre le processus de destruction des stéréotypes de la féminité et de subjectivation. Les années i960 redécouvrent le nouveau rapport entre « présent » et révolution dont Benjamin avait fait sa priorité, mais en ayant perdu la conscience aiguë que ce dernier avait de la force destructrice du capital. Si Benjamin est le premier, dans le cadre de la tradition marxiste, à penser la révolution comme rupture du continuum historique à partir du « présent », dans les années i960, différentes théories de l'événement ont fleuri pour essayer de conceptualiser ce « présent » pratiqué par les luttes. L'affirmation de la discontinuité de l'histoire, la critique de sa causalité et de ses déterminismes retrouve Yimprévu de Lonzi et l'imprévisibilité de Fanon : le sujet révolutionnaire dérive, mais ne dépend pas de l'histoire ; s'il vient de la situation économique, politique et sociale, il n'est pas déductible de cette situation. Il ne peut pas être anticipé par imagination, par projet, par programme, ni proprement saisi par le savoir, la science, la théorie. C e qu'on peut connaître, ce sont les conditions d'où il va émerger, mais il est impossible d'anticiper les modalités de son déploiement. La révolution est proprement quelque chose d'« imprévu », quelque chose que l'on peut préparer, organiser, favoriser, mais dont la subjectivation n'est pas contenue dans les conditions. Elle est « impossible »
Devenir-révolutionnaire et révolution
171
dans l'ordre des causalités de l'histoire, inimaginable à partir des déterminismes économiques, sociaux et politiques. L'événement vient de l'histoire, rompt avec sa continuité et, en se détournant de ses contraintes, il crée de nouveaux possibles, inimaginables et impossibles avant la rupture, mais leur actualisation se fait en retombant dans l'histoire, en se confrontant avec sa « réalité ». L'histoire et la situation d'où l'événement surgit, mais également l'histoire et la situation où l'événement va retomber, ne peuvent être définies génériquement. L'histoire et la situation dont viennent les mouvements de 68 et où ils vont retomber sont caractérisées par la « guerre civile mondiale » et la « révolution mondiale ». Les théories de l'événement ont souligné le moment créatif au détriment du moment destructif de l'action politique (bien que Deleuze prévienne qu'il s'agit d'une théorie pour « belles âmes »), souvent identifié au « négatif » hégélien. C e que Benjamin tenait encore ensemble sous la menace du nazisme est ici séparé dans une théorie du « devenir-révolutionnaire » (que l'on retrouve encore dans le paradigme esthétique de Guattari ou dans la parrêsia des derniers cours de Foucault) qui semble ne pas connaître l'articulation de « production et destruction » de la tradition révolutionnaire. Le mouvement ouvrier Les ambiguïtés, hésitations, différences, mêmes radicales, que nous avons vues se déployer à l'intérieur de la révolution mondiale se heurtent à un obstacle à la fois théorique et politique : la pratique et la théorie du mouvement ouvrier, qui est une des causes (majeures) de la défaite. Tronti représente une innovation à l'intérieur du marxisme, mais sans sortir de son cadre et même en exaspérant ses limites (au fond, il peut très bien représenter le point de vue du mouvement ouvrier, car il a été toujours un homme du parti communiste dont il partage beaucoup d'ornières et le destin/déclin). Dans Ouvriers et Capital, pour sortir de la dialectique, il relit l'histoire de la classe ouvrière
172
Le capital déteste tout le inonde
en faisant fonctionner les concepts marxiens d'Angriffskraft (force offensive) de la classe et de Widerstandskraft (force défensive) du capital : il prête aux mouvements de la classe ouvrière une autonomie et une primauté sur ceux du capital, qui se trouverait des lors dans une position défensive, réactive. Très vite (deux ans après la sortie du livre, en 1966), son point de vue stratégique (contre le sociologisme et l'économisme du marxisme de l'après-guerre) se révèle largement dépassé par les événements de 68 pour trois raisons fondamentales. La première et la principale : il est complètement aveugle à la montée des mouvements de décolonisation et des mouvements féministes depuis la fin du xix e siècle mais avec une forte accélération lors de la Première Guerre mondiale et de la révolution soviétique. La définition de la force de travail sans les « colonisés » et sans les « femmes » est une erreur théorique avant même d'être une faute politique. C e n'est qu'une définition « mutilée » et eurocentrique du capitalisme, qui empêche Tronti de voir les caractéristiques de la « révolution mondiale » et son extension « raciale et sexuelle ». Lénine n'a jamais été en Angleterre, comme le souhaitait le titre d'un article écrit par Tronti au début des années i960. Lénine (ou la révolution) s'est promené partout où il y avait du « retard » dans le développement des forces productives, partout où la situation était en grand décalage par rapport au centre industriel, scientifique, technologique du capitalisme, en organisant des machines de guerre qui n'étaient pas animées principalement par des ouvriers, mais par des paysans. Tronti se révèle un stratège très peu lucide pour deux autres raisons : il affirme la primauté de l'initiative de la classe ouvrière au moment où elle commence à perdre toute hégémonie politique et où le capital est en train de reprendre un avantage politique qu'il ne lâchera plus. L'agenda politique, le terrain de l'affrontement politique, sa forme et son contenu, seront, à partir de ce moment, toujours définis par le capital. C e que Tronti ne peut pas appréhender : la force de la classe était d'abord liée à la possibilité et à la
Devenir-révolutionnaire et révolution
173
réalité de la révolution (pour Tronti comme pour le parti, elle s'est terminée avec 1917). Sans révolution, les ouvriers sont une simple composante du capital. La tentative de dépasser l'« échec » de l'opéraïsme se fait ensuite à partir d'une autre erreur stratégique. Tronti énonce l'autonomie du politique (en réalité, l'autonomie de l'État) au moment même où ce dernier devient lui aussi un élément, une composante, un rouage de la machine de guerre capitaliste, sans plus d'indépendance possible. Face aux mouvements politiques qui s'affirment dans les années 1970 et à la reprise de l'initiative capitaliste, Tronti reconnaîtra luimême l'échec d'Ouvriers et capital. Ce qui resterait de vivant dans cette théorie ne serait que le positionnement partisan du point de vue « ouvrier ». Seul celui qui ne revendique aucune universalité, mais un point de vue partiel fondé sur des intérêts politiques de classe, peut « reconstruire la vérité du tout » (du capital). Mais précisément, à partir de l'après-guerre, tous les exploités et dominés ne s'identifient pas à la classe ouvrière ; les points de vue partisans sont nombreux et tous (les mouvements féministes, les mouvements de décolonisation, les mouvements étudiants) affirment des « vérités » hétérogènes et des « touts » différents et souvent incompatibles. Inutile de dire que la révolution, chez Tronti comme dans le parti, est le souvenir d'un Européen crépusculaire3. L'éviction de la révolution dans la théorie postcoloniale Dans les mouvements post-68, les problématisations, les contradictions, les conflits, les divergences théoriques et politiques, même
3. Mais le premier prix de l'aveuglement revient à Althusser : « Il suffit de voir comment le Parti a su "digérer" les événements de Mai, les intégrer à sa ligne traditionnelle, comment en particulier il a su traiter le mouvement étudiant, pour voir qu'il est tout à fait capable d'amortirmème un mouvement de masse de grande ampleur, et d'en garder la direction. La politique actuelle, qui consiste à mettre en avant la C G T et à continuer à subsister dans son ombre, cette division du travail habile et efficace prouve que le Parti possède une grande marge de manœuvre, où des dispositifs préventifs d'action lui assurent le maximum de sécurité » (Louis Althusser, Écrits sur l'histoire, Paris, Puf, 2018, p. 88).
174
Le capital déteste tout le inonde
radicales, de la révolution mondiale, tournent rapidement à la « dépolitisation ». Les théories postcoloniales, tout en approfondissant la critique de l'exercice du pouvoir colonial et néocolonial, se passent du concept et de la réalité de la rupture révolutionnaire. Ici, il convient de faire mention d'un auteur important pour la théorie postcoloniale bien qu'il nie y appartenir, Achille Mbembe. Mbembe déploie et élargit le concept, à peine ébauché par Foucault, de thanatopolitique, en faisant sa généalogie à partir de I ' histoire de la traite négrière (nécropolitique), et pourtant il évince l'horizon de la révolution. « L'espoir d'une nouvelle victoire sur le Maître n'est plus de mise. Nous n'attendons plus la mort du Maître. Nous ne croyons plus qu'il est mortel. Le Maître n'étant plus mortel, il nous reste une seule illusion, à savoir, participer nous-mêmes du Maître4. » Evidemment, cette affirmation peut donner lieu à des interprétations multiples - mais le revirement qu'il propose, et même sa conception d'un « devenir-nègre du monde », pour intéressante qu'elle soit, laissent entièrement de côté toute rupture révolutionnaire. Quant aux théoriciens des postcolonial studies, ils se voudraient à la fois la pensée radicale de l'époque et les héritiers des luttes de libération nationale et des révolutions anti-impérialistes (leur point de départ est l'interrogation des raisons de l'échec des révolutions, mais ils n'en pensent jamais les nouvelles conditions, comme si la défaite avait mis fin, pour toujours, à leur possibilité). Sans entrer dans la complexité et les différences de positions, une chose ne cesse d'étonner : leur point de vue n'a rien à voir avec celui des colonisés du xxe siècle dont ils se revendiquent. Leur critique de l'Europe, de l'eurocentrisme, des catégories élaborées par la pensée européenne, etc., est très loin de la manière dont les colonisés et les esclaves se sont rapportés au « centre » du capitalisme de leur époque. Les colonisés ont saisi sans aucune difficulté ce que les théoriciens postcoloniaux n'arrivent pas à voir. L'Europe est sûrement 4.
Achille Mbembe, Politiques de l'inimitié, Paris, La Découverte, 2016, p. 169.
Devenir-révolutionnaire et révolution
175
le foyer de la conquête coloniale, l'origine de la violence absolue exercée sur les populations colonisées, mais eHe est également le lieu de l'invention de la révolution. La Révolution française porte avec elle une volonté « bourgeoise » de maintenir l'esclavage, de subordonner les femmes et d'asservir les non-possédants, mais ni les esclaves de Saint Domingue, ni Olympe de Gouges avec la Déclaration des droits de la femme, ni les Sans-culottes ne ratent l'occasion de se révolter, de faire même une vraie révolution (Haïti) en posant les fondements des luttes à venir. Lorsque la révolution devient prolétarienne et que l'Europe commence à produire des théories anticapitalistes (notamment le marxisme) et des modalités d'organisation « révolutionnaires », les semi-colonisés et les colonisés ne se posent pas la question de savoir si les catégories du pouvoir et de la subjectivité élaborées en Europe correspondent à leur réalité : ils les utilisent. C'est un révolutionnaire aux yeux bridés qui conduit, avec des outils théoriques forgés en Europe puis adaptés à la situation russe, la première révolution prolétarienne victorieuse en ouvrant la porte à la révolution non pas en Occident, mais en Orient et ensuite dans le sud du monde. Les colonisés, très sélectifs, prennent de l'Europe ce qui leur convient le mieux, la critique du capitalisme, mode de domination mondiale qui, évidemment, s'articule de façon différente en Occident et en Orient. La révolution se déplaçant vers l'est et se diffusant ensuite dans le Sud se transforme, en critiquant l'historicisme marxiste, en rompant avec sa théorie des stades, en reconfigurant la théorie du sujet révolutionnaire par l'implication de la paysannerie, en révisant la théorie du parti (Fanon), de la classe (Cabrai), le rapport entre structure et superstructure, « en distendant le marxisme », en inventant une nouvelle fonction à la « culture », etc., mais en restant toujours fidèle au projet de dépassement du capitalisme. L'échec de la révolution mondiale vient de l'incapacité d'établir une stratégie subjective capable de l'actualiser en intégrant toutes ces transformations et ces critiques. La révolution s'est rapidement
176
Le capital déteste tout le inonde
repliée sur le « socialisme dans un seul pays » et sur les différents nationalismes, tandis que la classe ouvrière occidentale et ses institutions, aveugles aux nouveaux sujets politiques en voie d'affirmation, intégraient la logique du capital. Si la question de savoir comment « provincialiser l'Europe » constitue une interrogation stratégique pour ces théories, le problème n'est plus de mise depuis très longtemps, puisque l'Europe s'en est chargée elle-même, depuis la Première Guerre mondiale, et d'une double manière, en perdant la capacité d'être le centre du capitalisme et le foyer de la révolution. Le point de vue postcolonial est celui de dominés enfermés dans la domination, tandis que les colonisés du xx e siècle, partant de leur esclavage, affirmaient la révolution. Le positionnement est très différent : le premier débouche de manière plus ou moins radicale sur la posture de la « victime », le second sur la subjectivation révolutionnaire. Renouer avec la révolution La division entre constitution du sujet et révolution, qui trouve dans les textes de Lonzi son élaboration la plus cohérente, pourrait être conceptualisée et généralisée avec les catégories de Gilles Deleuze. Pour contrer les attaques subies par la « révolution » après sa défaite politico-militaire des années i960, il distingue les « révolutions » (qui finissent toujours mal!) et le « devenirrévolutionnaire » des participants au processus révolutionnaire qui, lui, se poursuit au-delà de l'échec des premières. De nombreux mouvements de l'après-68 semblent avoir construit leur stratégie sur cette séparation du « devenir-révolutionnaire » (critique des assujettissements, production différentielle de subjectivité, autonomie et indépendance des « formes de vie », affirmation et soin de « soi ») et de la « révolution » (changement radical de régime de la propriété, lutte pour le pouvoir politique, règles de l'utilisation de la violence, expropriation des expropriateurs, dépassement du capitalisme). Cette séparation recoupe la distinction entre émancipation et révolution, dans laquelle la première consiste dans la sortie
Devenir-révolutionnaire et révolution
177
de toutes sortes de minorités (sexuelles, raciales, ethniques, etc.) de l'état d'infériorité, d'exclusion et de domination dans lequel le capitalisme les a enfermées, tandis que la seconde requiert la sortie du capitalisme. L'abolition de l'esclavage avait déjà démontré les limites des politiques uniquement axées sur l'émancipation, qui n'ont pas empêché le passage d'une ségrégation raciale à une autre. La dimension « créatrice » de l'action politique est ainsi séparée de façon radicale de la dimension « destructrice ». Mais est-il possible de rompre le rapport étroit qui lie la révolution au devenir-révolutionnaire? Le processus de production et de différenciation de la subjectivité peut-il avoir lieu sans viser, en même temps, le dépérissement du capitalisme et de l'Etat? Quarante ans de domination néolibérale semblent avoir montré que, sans relation et enrichissement réciproque de la révolution et du devenir-révolutionnaire, l'une et l'autre s'affaiblissent inexorablement. La stratégie de l'autonomisation du « devenir-révolutionnaire » n'est pas poursuivie et développée seulement par la plupart des mouvements féministes et queer, mais aussi par les pensées critiques héritières des luttes des années i960 en Occident. La constitution d'un sujet révolutionnaire sans révolution, nous la retrouvons également chez Negri, pour qui le travailleur cognitif devient « de plus en plus autonome et indépendant » au fur et à mesure que se développe la production définie comme biopolitique. Les travailleurs cognitifs acquièrent une puissance qui est strictement liée à leur fonction dans la production, préalablement à toute organisation et pratique révolutionnaire, puisque le travail du « cognitariat » est constitutif du monde et de ses relations (travail ontologique). La force d'autonomie et d'indépendance que ce travailleur collectif accumule dans et contre la production biopolitique constitue un « exode » en acte, un processus de sortie du capitalisme qui est déjà en œuvre. La révolution, éventuellement, ne sert qu'à affirmer ce qui est déjà là (le commun de la coopération). Jacques Rancière accentue encore cette dissociation entre révolution et
178
Le capital déteste tout le inonde
devenir-révolutionnaire, en affirmant l'existence de deux types de conflits, le conflit des forces (la lutte de classes de la tradition marxiste) et le conflit des mondes (l'auto-affirmation subjective de l'autonomie du sujet politique) : émancipation/révolution. L'action politique comme invention de noms qui brisent l'identification sociale, qui font sauter les médiations de l'ordre consensuel en déployant un temps autonome et créateur de nouvelles formes de vie, n'oppose pas des forces, mais des mondes. La nouveauté de 68 résiderait dans la dissociation qu'il a opérée entre conflit des mondes et conflits des forces. Cette dissociation joue de mauvais tours, parce que le monde de l'égalité des mouvements politiques et celui de l'inégalité capitaliste ne procèdent pas de façon parallèle. Le monde de l'inégalité, indissociable de l'exercice de la force, a défait systématiquement le monde de l'égalité, en réduisant à presque rien les espaces de « sécession ». L'inégalité franchit un autre seuil dans l'exercice de sa force avec les nouveaux fascismes. Nous ne pouvons pousser plus loin nos réflexions parce que, comme l'expliquait Krahl, une « théorie révolutionnaire » n'est pas la même chose qu'une « théorie de la révolution ». Une théorie révolutionnaire (l'ensemble de la pensée 68 ou presque) représente la société sous le mode de sa transformation possible en dévoilant les rapports de domination, tandis qu'une théorie de la révolution indique des principes stratégiques déterminés : c'est la tâche qui revient à une organisation révolutionnaire et à des révolutionnaires avenir.
Achevé d'imprimer pour le compte des Editions Amsterdam par les presses de la Nouvelle Imprimerie Laballery en mars 2019 Numéro d'impression : 903189 Dépôt légal à parution


![Le théorème du parapluie ou L’art d’observer le monde dans le bon sens [Paperback ed.]
2081427524, 9782081427525](https://dokumen.pub/img/200x200/le-theoreme-du-parapluie-ou-lart-dobserver-le-monde-dans-le-bon-sens-paperbacknbsped-2081427524-9782081427525.jpg)