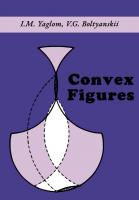Figures anonymes, figures d’élite: Pour une anatomie de l’Homo ottomanicus 9781463233556
This collection of papers by scholars from universities in France, Germany and Switzerland explores the complexity of Ot
166 93 19MB
French Pages 215 [213] Year 2011
Polecaj historie
Citation preview
Figures anonymes, figures d'élite
Analecta Isisiana: Ottoman and Turkish Studies
A co-publication with The Isis Press, Istanbul, the series consists of collections of thematic essays focused on specific themes of Ottoman and Turkish studies. These scholarly volumes address important issues throughout Turkish history, offering in a single volume the accumulated insights of a single author over a career of research on the subject.
Figures anonymes, figures d'élite
Pour une anatomie de l'Homo ottomanicus
Compiled and edited by
Meropi Anastassiadou Bernard Heyberger
The Isis Press, Istanbul
ptS* 2011
Gorgias Press IXC, 954 River Road, Piscataway, NJ, 08854, USA www.gorgiaspress.com Copyright© 2011 by The Isis Press, Istanbul Originally published in 1999 All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise without the prior written permission of The Isis Press, Istanbul. 2011
ISBN 978-1-61143-741-6
Reprinted from the 1999 Istanbul edition.
Printed in the United States of America
AVANT-PROPOS
Nées en décembre 1990, les rencontres franco-allemandes bisanuelles (décembre et mai), organisées par l'URA D 1540 «Mondes turcs et iraniens à l'époque moderne et contemporaine», l'Orientalisches Seminar de l'Université Albert Ludwig de Freiburg-in-Breisgau et du Seminar fur Sprachen und Kulturen des vorderen Orients de l'Université de Heidelberg s'inscrivent dans un environnement de communication scientifique transfrontalière. Des chercheurs et étudiants de l'Orientalisches Seminar de l'Université de Bâle (Suisse) n'ont pas tardé à se joindre au groupe. Le but initial de ces journées était de permettre aux étudiants avancés, de deuxième et troisième cycles, de prendre la parole et présenter leur travail. Dès le début, le bilan s'est avéré positif et encourageant. Aux exposés de «synthèse» et à caractère scolaire de la première réunion ont succédé, les années suivantes, des communications originales, prenant appui sur des matériaux d'archives inédits. Dans le domaine des études dites «orientales», ces rencontres constituent une expérience rare d'échanges réguliers entre chercheurs de diverses universités européennes. Même s'il n'a pas d'existence institutionnelle, ce groupe de quelque 20 à 25 personnes fonctionne comme une réelle structure d'accueil pour les jeunes chercheurs, leur assurant une formation ouverte sur la tradition intellectuelle de trois pays différents. Ce volume regroupe les communications présentées lors d'une de ces journées franco-allemandes organisées dans le cadre de la IX e réunion des chercheurs sur le monde arabe et musulman, qui a été tenue à Strasbourg du 30 juin au 3 juillet 1994. Les résumés de ces contributions ont été publiés par l'Association française pour l'Etude du monde arabe et musulman (AFEMAM), organisatrice de la manifestation* . S'il nous a semblé utile de donner à lire ici la version intégrale de ces textes, c'est non seulement parce qu'ils forment un ensemble doté d'une certaine cohérence. C'est aussi parce qu'ils fournissent une idée assez précise des thèmes pris en compte par les chercheurs qui participent à nos journées franco-allemandes.
Meropi Anastassiadou (éd.), Sociétés et cultures musulmanes d'hier et d'aujourd'hui, Paris : AFEMAM, 1996,540 p.
6
MEROPI
ANASTASSIADOU
Une des originalités du recueil est qu'il fait entendre la voix des provinces ottomanes. Depuis les Balkans (Ohrid, Bitola, Serres, Péloponnèse) jusqu'à la Syrie et l'Egypte, en passant par l'Anatolie (Smyrne, Adana, Urfa, Midyat, Diyarbakir...), plusieurs régions de l'Empire y sont représentées. Mais le principal apport du volume réside dans la reconstitution d'un certain nombre d'itinéraires personnels, à travers lesquels est mise en évidence la complexité des choix individuels et des profils identitaires. A Smyrne au XIX e siècle, il existe des citadins qui se sentent autant Grecs ottomans que Français; dans l'Alexandrie des années 1880-90, la famille Benakis a les yeux autant fixés sur Athènes que sur Londres, Liverpool ou Manchester. Dans ses écrits, le pope Synadinos de Serres, membre du clergé orthodoxe et théoriquement hostile au «joug turc» ne manque pas de souligner avec force son dévouement au sultan; enfin, si Beder Khan œuvre, d'une certaine manière, pour la reconnaissance d'une spécificité kurde, il ne met à aucun moment en doute — du moins ouvertement — la souveraineté ottomane. Toutefois, ce petit livre n'explore que quelques aspects seulement de l'identité ottomane. Le lecteur sera surtout frappé de constater que, aux yeux de la plupart des auteurs du volume, l'homo ottomanicus est un «étranger» ou, au mieux, un «minoritaire». Avec Papasynadinos de Serres, les Deliyannis du Péloponnèse ou les Benakis d'Alexandrie, les trois études portant sur des Grecs orthodoxes proposent une image assez nuancée de l'insertion — ou de la non-insertion — de ces individus et familles dans la société ottomane. Quant aux Européens venus chercher fortune en Orient ou dans le cadre des nombreuses missions religieuses, présentes dans toutes les grandes cités portuaires de la Méditerranée orientale, ils semblent se sentir — du moins, s'il faut en juger d'après les quatre articles qui leur sont consacrés — peu concernés par le label «ottomanicus». Il n'en reste pas moins qu'ils s'installent — souvent pour plusieurs générations — dans l'Empire et font partie, au même titre que les Grecs, les Juifs, les Arméniens, etc., de la mosaïque ottomane. Les grands absents de ce recueil sont paradoxalement les musulmans et plus particulièrement les Turcs. Certes, nous pouvons nous faire une idée des réseaux qu'entretenaient quelques figures d'élité musulmanes dans l'Adana du XVIII e siècle ; nous disposons d'un portrait assez fidèle d'un notable kurde du XIX e siècle; grâce au cheikh Chemsuddin, nous savons désormais quel pouvait être l'itinéraire d'un religieux musulman dans les Balkans ottomans. Toutefois, il convient d'admettre que la place faite à l'élément dominant de l'Empire ottoman reste au total limitée. De toute évidence, les auteurs des travaux
7
AVANT-PROPOS
réunis ici ont cherché à définir l'appartenance d'individus dont l'«ottomanité» n'allait pas de soi (tels les minoritaires et les Levantins) et ont écarté ceux dont l'identité ottomane ne faisait pas de doute. Meropi Anastassiadou
Istanbul, juillet 1997
I§ik TAMDOGAN-ABEL
INDIVIDUS ET POUVOIR DANS UNE VILLE OTTOMANE AU XVIIIe SIÈCLE
Dans ce travail, il s'agit d'étudier les individus dans leurs réseaux relationnels et de suivre leur ascension sociale. L'intérêt du concept de « réseaux » est de réhabiliter l'individu comme sujet, et de nous permettre d'échapper ainsi à la seule analyse de la société urbaine par les institutions, la ségrégation professionnelle ou confessionnelle, c'est-à-dire par un organigramme 1 . Loin d'expliquer tous les phénomènes, une telle approche permet simplement de multiplier les grilles d'analyse et les points de vue. En quoi les réseaux relationnels des individus peuvent-ils avoir une dynamique influant sur la configuration sociale et urbaine ? L'enquête sur les individus et leurs réseaux relationnels, à travers les registres de cadi de la ville d'Adana au XVIII e siècle, s'est avérée fructueuse à plusieurs égards. Tout d'abord, elle nous a donné des indices significatifs sur ce qu'était le pouvoir dans une province ottomane au XVIII e siècle. Ensuite, elle nous a permis de nuancer notre perception de l'office de cadi. Enfin, des trajectoires individuelles nous ont éclairée sur ce que pouvaient être les stratégies de certains « homines ottomanici » ; c'est sur ce dernier point que porte cette étude. La première question était de savoir comment identifier les individus à travers notre documentation, dans la mesure où ceux-ci n'avaient pas de noms aisément repérables. Un travail systématique nous a permis, cependant, de déterminer certains individus par leur surnom 2 . Par ailleurs, en nous appuyant
^Rappelons les principaux anthropologues qui ont travaillé sur ce concept : Elizabeth Bott, Family and Social Network, London, 1957 ; John Scott, Social Network Analysis, a Handbook, London, 1991 ; Jeremy Boissevain, Friends of Friends, Networks, Manipulators and Coalitions, Oxford, 1974 ; Fredrick Barth, Models of Social Organization, London, 1966, ou l'ouvrage collectif J.C. Mitchell (ed.), Social Networks in Urban Situations, Manchester, 1969. 2 C ' e s t ainsi que nous avons repéré Battal Mehmed a | a , Ince el-hacc Mehmed aga, Serturnali Deli Hüseyin aga et son fils Serturnali Hiiseyin aga oglu Ahmed aga.
10
I § 1K
T A M D O G A N - A B E L
sur des noms qui se terminent par le suffixe zade1, nous avons pu cerner quelques individus et leurs familles 2 . Ces noms, que portent principalement les notables provinciaux ('ayan) —ce n'est pas « tout le monde » qui a un nom de famille ! —, font leur apparition au cours du XVIII e siècle. Toutefois, il convient de souligner qu' il ne s'agit pas de « noms de famille » à proprement parler. Le radical persan zade signifie littéralement « descendant de » et ne nous indique que l'ascendance de l'individu. Citons, à titre d'exemple, des noms comme « Dervi§pa§azade » (descendant de Dervi§ paga), ou « Mercanzade » (descendant de Mercan). Ce travail sur le nom nous a amenée à nous interroger sur les 'ayan (notables) dans la société ottomane au XVIII e siècle. Plusieurs travaux ont été consacrés au renforcement du pouvoir des notables provinciaux à cette époque, à l'interdépendance de la Porte et de ces familles, et surtout à la légitimation et l'institutionnalisation du statut d'ayan par le pouvoir 3 . Ceux-ci portent surtout sur l'apparition des chefs 'ayan (appelés ba§ 'ayan ou re'is til- 'ayan), qui furent légitimés par la Porte par le décret de 1765, sous le vizirat de Muhsinzade Mehmed Pa§a. Le but de ce décret était de contrôler les notables locaux en leur désignant un chef auquel certaines tâches administratives étaient confiées. Ce n'était que la légitimation d'un état de fait. À la différence des travaux susmentionnés, cette étude s'intéresse principalement aux 'ayan-i vilayet, c'est-à-dire les multiples notables qui existent dans les provinces ottomanes, bien avant que Vayanlik ne devienne une institution. Nous avons relevé les ...zade ou autres individus portant des noms repérables parmi les témoins d'instance ($uhud iil-hat) qui assistent aux auditions dans l'office du cadi 4 . En principe, tout le monde pouvait remplir cette fonction. Mais les zade — des individus « pas comme tout le monde », puisqu'ils ont droit à un nom « distingué »— sont ceux qui apparaissaient le ' Nous avons plus spécialement travaillé sur les familles de Çopurzade, Dervi§pa§azade, Bozzade, Haletzade, Karacazade, Mercanzade, Musabalizade, Resulzade, 'Anisefzade, Abacizade, Kademzade, Ye§ilba§zade, Kinahzade et Karslizade, qui sont présentes d'une manière importante dans la vie sociale et même administrative de la ville d'Adana au XVIII e siècle. 2 AU sujet de la désignation des 'ayan par ce suffixe «zade», qui distingue une sorte d'élite où la notabilité est propre à une famille, voir : Necdet Sakaoglu, Köj-e Pa$a Hanedani. Ankara, 1984, p. 10. 'Cf. I.H. Uzunçar§ili, Meçhur Rumeli 'ayanlanndan Tirsinikli Ismail, Yillikoglu Suleyman agalar ve Alemdar Mustafa Paça, Istanbul, 1942 ; D.R. Sadat, « Rumeli ayanlan : the eighteenth century », The Journal of Modern History, t. 44, n° 3 (sept. 1972) ; A. Suceska, « Bedeutung und Entwicklung des Begriffes Ayan im Osmanischen Reich », Südost-Forschungen, t. 25 (1966) ; S.B. Baykal, « Ayanlik miiessesesinin düzeni hakkinda beigeler », Belgeier, 1.1, n° 2, Ankara, 1962 ; Yiicel Özkaya, Osmanli Imparatorlugunda Ayanlik, Ankara, 1977 ; Yuza Nagata, Muhsinzade Mehmed Paga ve Ayanlik MUessesesi, Tokyo, 1976 ; Gilles Veinstein, « Ayan de la région d'Izmir et le commerce du Levant (deuxième moitié du XVIIIe siècle)», Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée, n'" 20, Aix-en-Provence, 1975. 4 Ce qui n'est pas vraiment étonnant, car les 'ayan faisaient partie des ¡uhud ül-hal depuis l'époque de Siileyman Ier : cf. Y. Nagata, op. cit., p. 27.
INDIVIDUS ET POUVOIR DANS UNE VILLE OTTOMANE
11
plus fréquemment comme témoins d'instance pendant ces auditions et semblent particulièrement à l'aise sur ce terrain. Par l'usage fréquent qu'ils font de la procédure juridique et notariale, ils monopolisent pratiquement les registres, où ils sont souvent désignés par des appelations flatteuses comme « exemplaire parmi les notables » ou « exemplaire parmi les savants ». Une fois les individus repérés, des relations entre eux se dessinent et les statuts ou les liens sociaux dans la ville se manifestent ici à travers ces réseaux relationnels.
1. UNE ENQUÊTE AUTOUR DE L'ANNÉE 1750 Pour cette première enquête, quinze personnes ont été répertoriées et suivies autour de l'année 1750 (1740-1760) auxquelles nous avons attribué des numéros (de 1 à 15). Un fichier a été établi sur ces individus, regroupant toutes sortes d'informations les concernant (inventaires après décès, minutes de procès, nominations, firmans, recensements et les ordres des ahkam defteri pour la province d'Adana) pour la même période. Dans un deuxième temps, différentes sphères relationnelles ont été répertoriées. Dans nos graphiques, chaque trait entre une personne X et Y représente un lien entre ces deux individus. Nous avons essayé de distinguer les différentes sortes de liens. Les liens dans la sphère du droit sont représentés par des traits minces. Les individus liés par ce genre de trait apparaissent soit comme témoin soit comme garant l'un pour l'autre devant le cadi. Cela permet de mettre en évidence un fort engagement relationnel entre deux individus. Les liens par rapport à la possession des revenus de la terre sont représentés par des traits épais sur nos graphiques. Ces traits relient deux individus qui détiennent soit ensemble un terrain, soit des terrains limitrophes. Le troisième type de lien est celui qui s'effectue dans le domaine de l'argent. Ici le lien (représenté par un trait fin en pointillé) indique soit un prêt de l'un à l'autre, soit un emprunt fait à un tiers par ces personnes. Les liens de famille sont représentés par les traits épais en pointillé. On pourrait, bien sûr, multiplier les différents types de liens, et il y a certainement des relations importantes qui manquent à notre graphique. Comment savoir par exemple les affinités confessionnelles qu'il y avait entre les individus ? Quels étaient les membres de telle ou telle tariqa (confrérie) ? Il n'est pas possible de répondre à cette question, parce que de telles appartenances ne sont pas mentionnées dans nos sources. Une autre difficulté provient du fait que nous travaillons sans sources biographiques secondaires sur ces personnes et avec des données épisodiques, qui manquent de continuité.
12
I § IK
TAMDOGAN-ABEL
Par ailleurs, nous avons étudié leurs relations avec le restant des habitants de la ville. Nous avons encerlé certains numéros (qui désignent les individus) par un carré ou un rond pour désigner le complément d'informations que nous pouvions avoir à ce sujet. Ici le carré indique les individus qui apparaissent fréquemment comme créanciers. Le cercle montre un certain charisme de la personne au sein de la ville. Il y a plusieurs indicateurs de ce charisme personnel. On trouve d'abord les cas où la personne apparaît devant le tribunal au nom de son quartier pour le représenter. Ou encore quand nous la voyons se porter garante pour l'ouverture d'un café. Ou encore lorsque nous étudions le cahier de recensement d'Adana, nous remarquons que certains de nos individus figurent en tête de liste de leurs quartiers (comme les n o s 2, 3 , 4 ou 5). Ce qui nous rappelle les propos de Necdet Sakaoglu, dans son travail sur la famille notable de Ko§e Pa§a à Divrigi, où il montre que ces 'ayan étaient en tête de liste dans le premier dénombrement de population fait à Divrigi1. C'est ainsi que chacun de ces deux signes pourrait être interprété comme le condensé d'une multitude de traits qui lieraient l'individu à plusieurs autres personnes absentes dans ce graphique. En mettant ensemble tous ces différents éléments, nous voyons se dessiner peu à peu des « sommets » sur nos graphes 2 . Certains individus semblent être plus centraux dans ce réseau que d'autres. Par ailleurs, nous observons des liens plus ou moins forts entre deux individus. En tout cas, certains individus ont des liens multiples avec une deuxième personne, alors que d'autres entretiennent des rapports plus "unidimensionnels" avec les autres. Cette enquête a été complétée par les informations qu'on pouvait avoir sur les différentes fonctions administratives que ces individus avaient occupées 3 . Ce qui frappait alors était que l'individu qui se trouvait au cœur d'un réseau dense et polyvalent semblait acquérir le plus de pouvoir administratif dans la ville. C'est ici que la « centralité » de l'individu dans le réseau prend tout son sens. Comme c'est le cas pour Haletzade Mustafa aga (désigné sous le n° 7 dans le graphique) ou Battal Mehmed aga (désigné sons le n° 2 dans le graphique) qui deviennent miitesellim chacun à son tour. Ce qui fait penser qu'il s'agissait, ainsi qu'à Divrigi à la même époque, de l'acquisition des postes administratifs par des personnes fortement implantées dans les réseaux relationnels locaux, plutôt que la distribution arbitraire des places par la Porte ou quelque autre administration locale. L'individu semble faire usage de son réseau relationnel pour réussir son ascension sociale. Mais 'Cf. N. Sakaoglu, op. cit., p. 179. Voir graphique n° 1. Voir tableau n° 1.
2
I N D I V I D U S ET P O U V O I R D A N S U N E V I L L E O T T O M A N E
13
l'ascension de ces individus ne se limitait pas à l'acquisition de certaines fonctions administratives légales. Parfois, ils apparaissent simplement comme des usurpateurs oppressifs exerçant un pouvoir réel sur place sans être obligatoirement reconnus par la Porte 1 . Une différence de langage est apparue entre les documents produits sur place, à Adana, et ceux produits à Istanbul. Ces notables, appelés avec le suffixe visiblement prestigieux de zade et avec les qualificatifs de « honorable » ou « exemplaire » dans la documentation locale, étaient désignés comme « oppresseur » 2 (mutegallibe) dans la documentation de la capitale. Plus important encore, dans cette dernière, ils étaient privés de leur vrai nom avec la terminaison zade et se retrouvaient appelés comme tout le monde : « Mehmed fils d'un tel » au lieu de « Mehmed Bozzade », par exemple. Une remise en question de notre source de documentation s'imposait alors. On sait que le cadi pouvait tenir son office aussi bien chez un imam que chez un particulier ou sur un terrain vague : la légitimité de la procédure dépendait de la présence du cadi ou son vicaire (naib), du scribe (kâtib), du plaignant, de l'accusé, et des témoins d'instance. La présence fréquente de certains individus à l'audition du cadi prend d'autant plus de relief. La plupart des individus étudiés dans notre enquête, et faisant fréquemment partie des ¿¡uhud iil-hal, semblaient former une sorte de cercle ou de « club » autour du cadi. Nous pouvons dire que le réseau d'influence qui s'était dessiné était finalement surtout le réseau relationnel du cadi, et que le cadi en était même le noyau. Quel impact cela pouvait-il avoir sur les jugements ? Et quelle déformation cela donne-t-il à notre reconstitution historique des réseaux d'individus et d'influence ? Prenons l'exemple d'un procès où Musabalizade Osman aga est accusé par une personne de détenir injustement ses terres. À Adana le plaignant perd le procès, car il est incapable de trouver des personnes prêtes à témoigner contre Musabalizade Osman aga. Mais nous trouvons des firmans envoyés par la Porte aux mêmes dates concernant Musabalizade Osman aga. D'après ces documents, celui-ci aurait traité injustement ses créanciers venus d'Istanbul. On y demande au cadi d'Adana de veiller à ce que cet « oppresseur » (miitegallibe) paye ses dettes aux personnes en question. Les documents
C'est aussi ce qui fait l'intérêt de l'analyse des réseaux relationnels, car il nous semble que notre enquête nous a ainsi permis de repérer des individus qui ont de fait un pouvoir important, sans figurer forcément parmi les administrateurs de la ville. Ces personnes auraient donc pu échapper à une enquête qui se serait bornée à répertorier les administrateurs ou les personnes qui représentent les institutions citadines. Par exemple ici, Dervi§pa§azade Hilseyin, Bozzade Mehmed ou Musabalizade Osman. •y Adana ahkâm defteri, n° 1/206-5.
14
I § IK
TAMDOGAN-ABEL
produits localement restent totalement muets à ce sujet. N'a-t-on pas affaire ici à un réseau de notables bien soudé sur place ?
2. UN DEUXIÈME RÉSEAU RELATIONNEL DE L'ANNÉE 1777 Cette étude autour de l'année 1750 nous donnait une première photo du réseau relationnel de quelques notables à Adana au XVIIIe siècle. Par la suite, il nous a paru intéressant de suivre ces individus dans le temps. C'est ainsi que nous avons effectué une deuxième enquête autour de l'année 1777 (donc environ 25 ans plus tard) 1 . La méthode utilisée pour cette deuxième enquête restait la même : repérer certains individus parmi les çuhud iil-hal, voir les relations entre eux et avec les habitants de la ville, voir les fonctions qu'ils occupent éven-tuellement, créer une fiche par personne et essayer d'établir les liens de famille. Quinze autres personnes ont été choisies pour cette seconde étude, dont une déjà présente dans l'échantillon de 1750 (le n° 8). Avec cette deuxième enquête, nous avons eu un regard sur les générations successives. Le réseau de notables se reproduit soi-même partiellement par ces liens de famille. Sept personnes sur vingt-neuf avaient une parenté avec des personnes de l'ancien réseau 2 . Hormis les individus qui font partie du réseau à cause de la renommée de leur famille, tous les autres ont accédé à des fonctions administrativement importantes dans la ville. Par ailleurs, on remarque la rapidité avec laquelle une même fonction est transmise d'une personne à l'autre dans ce même réseau : dans les années 1771-1772, la même fonction de serdar (commandant) changera huit fois de mains entre quatre personnes3. C'est aussi valable pour la fonction de mUtesellim. À cette époque, nous ne voyons pas se distinguer de chef ' a y a n , mais il semble que tous les membres de ce réseau aient eu accès à des fonctions importantes, précisément parce qu'elles changent de mains à une vitesse vertigineuse. Il faut également noter que ces fonctions administratives, militaires et gouvernementales sont attribuées par le cercle des notables locaux (notables, gouverneurs, savants etc.). Alors que ces nominations sont complétées de
1 Voir graphique rr 2. ^Par exemple Çopurzade el-hacc Mehmed (18) et Çopurzade Musa (19) sont les descendants de Çopurzade haci Mustafa (4). Mercanzade Hiiseyin aga (23) est le descendant de Mercanzade Hiiseyin efendi (11) et Mercanzade Musa aga (12). Halet zade Hasan aga (20) est le descendant de Haletzade Mehmed aga (6) et Haletzade Mustafa aga (7). Musabahoglu Ômer aga (24) est le neveu de Musabahzade Osman aga (13). Notons que Haletzade Hasan aga (20) et Mercanzade Hasan aga (23) n'ont aucune fonction administrative quelconque en 1777. Mais ils ont des liens de famille avec des notables de la génération précédente. Font-ils partie du réseau à cause du prestige familial ? 3 Registres du cadi d'Adana (RCA), 47/54-1.
INDIVIDUS ET POUVOIR DANS UNE VILLE OTTOMANE
15
firmans arrivant de la Porte et essayant de régulariser la désignation des serdar, en insistant sur le fait qu'il faut absolument avoir l'accord de l'agha des Janissaires pour investir un serdar, nous voyons en pratique qu'un tel accord n'est pas indispensable. Des ordres du même genre sont émis pour régulariser la nomination des 'ayan, spécifiant que l'ayan proposé par les notabilités d'une ville rentrerait en fonction une fois qu'il aurait l'accord de la Porte. Sur place, non seulement il n'y a pas un 'ayan unique, mais les accords de la Porte pour nommer Y ayan sont absents de notre documentation 1 . Pourtant, Istanbul est généralement en accord avec ces individus qui ont le pouvoir sur place. Par exemple, en 1772 la Porte demande de l'aide militaire à quelques-uns pour l'armée impériale qui se trouve du côté du Danube. Ils reçoivent cet ordre en tant que 'ayan de la ville d'Adana. On leur demande à chacun de fournir 100 ou 150 hommes équipés pour l'armée impériale 2 . En 1777, on demande à d'autres d'envoyer chacun 500 hommes pour la garde de Bagdad, en tant que notables « riches » et « fortunés » {mutemevvil ve sahib-i servet olmanizdan). Le pouvoir de ces individus est aussi limité par Istanbul, et on peut dire que plus l'ascension sociale est importante et rapide, plus l'individu est menacé. Ce qui frappe à cette époque (autour de l'année 1777), c'est le nombre d'exécutions dont sont victimes (ici quatre personnes) les « têtes » de ce réseau de pouvoir 3 . Il y a une dissymétrie, repérable dans les registres même des cadis, entre les documents qui attestent le prestige et le pouvoir de ces individus, et ceux qui sont envoyés pour ordonner leur exécution ou enregistrés après celle-ci. C'est le cas de Serturnali Hiiseyin aga, qui reçoit en 1777 l'instruction d'envoyer 500 hommes armés à l'armée impériale. L'année suivante, l'ordre de le faire exécuter arrive à Adana : il est accusé d'avoir causé une révolte dans la province, avec la collaboration d'autres notabilités de la ville. En mars 1778, les autres 'ayan d'Adana signent une sorte d'engagement au bureau du cadi, qu'ils livreraient la tête de Serturnali Hùseyin aga au vali au cas où celui-ci serait vu dans la ville. Ces personnes s'obligent par ailleurs à verser 100 000 piastres aux autorités du vilayet, si elles manquaient à dénoncer les coupables 4 .
Notre vision de l'institution des 'ayan change ainsi considérablement selon notre angle de vue. Ainsi Y. Nagata relève le nom de Çopurzade Mehmed aga comme le notable d'Adana pour la période allant de décembre 1771 à août 1774, parce qu'il figure sur la liste des 'ayan, auxquels la Porte aurait demandé de l'aide militaire à la même époque. Mais en étudiant la documentation locale, nous nous rendons compte de la relativité de ce fait. À la même époque, la même demande d'aide militaire a été adressée aussi à d'autres notables d'Adana, cf. RCA n° 47/3. 2 Cf. RCA, n° 47/114-115. oJ Et plus particulièrement en 1778. Nous sommes en droit de nous demander s'il n'y a pas un rapport entre ces exécutions d ' a y a n et la mort du grand vizir Muhsinzade Mehmed Paça (survenue en 1774) qui avait tenté la légalisation de ce statut avec son décret de 1765. Voir tableau n° 4. 4 RCA, 46/120.
16
I§IK
TAMDOGAN-ABEL
C'est en mars 1778 que Deli Hiiseyin (Hiiseyin le fou), tel qu'il est dès lors nommé, est exécuté et que sa tête est envoyée à Istanbul. Quelques jours plus tard, le cadi d'Adana donne l'ordre qu'on détruise sa maison, suite à la plainte de son voisin. Ce voisin se plaint de Deli aga précédemment exécuté, parce que celui-ci aurait bâti une maison trop haute, avec des fenêtres donnant sur la cour intérieure de sa maison, ce qui empêchait sa femme et ses enfants de se tenir dans leur cour. Le cadi charge l'architecte en chef de détruire la maison de Serturnali Hiiseyin aga A l o r s que vingt ans plus tôt la documentation
locale
restait
complètement muette sur les abus de pouvoir des individus étudiés et qu'on pouvait avoir le sentiment que le système de relations était bien soudé, dans la deuxième enquête, nous avons affaire à un réseau brisé. Les personnes du même réseau sont ici capables de se retourner contre un proche en s'engageant de livrer sa tête, en détruisant sa maison, ou en l'appelant simplement Deli Hiiseyin...
1
RCA, 46/48-2.
17
INDIVIDUS ET POUVOIR DANS UNE VILLE OTTOMANE
X m
X
es r—
i ; syn. phylaki) [hap(i)s, « prison »] tombrûki ( To/iirpomi) [tomruk, « bloc de bois troué qu'on passait aux pieds des criminels ; prison, geôle »] tzelâtis
( T^eÀdTTjâ) [cellâd, « bourreau »]
(mceyr^és ; dér. skentzévo) [igkence, « torture »] ( T^eyyéAi) [çengel, « crochet, croc »] «Regarde les voleurs ( k l é f t e s ) , les voleurs de grand chemin (kesetzi'dhes*) et les voyous (haramidh.es*), quand les hommes de l'autorité les attrappent, combien de tortures {skentzés*), de tyrannies, de martyres, combien de coups et de tortures il souffrent [...] et pourtant, ils ne les libèrent pas, mais ils font pendre l'un, ils empalent l'autre, coupent la tête, brisent les mains et les pieds, les mettent sur la galère, jettent l'autre sur les crochets (tzenge'lia *)....» (p. 148) tepelétisma {rerreAériafid} [< tepeleme «action d'assommer, de tuer»] *harami's {jcapafijfô [harami «brigand, voyou»] kesetzis (/ceaer^rfs) [kesici «voleur, brigand (cf. Meminski II, p. 3951)»] kanli's (/cafAijs) [kanli «sanglant; criminel meurtrier»] kalpozanliki {/caArrosafAÎ/a) [< kalpazan «fausseur, faux monnayeur»] skentzés tzengéli
F. RELIGION ET MORALE harami halâli
hatzi's,
{xapdfiî) [harâm «défendu par la religion»]D«...Ne sois pas fainéant. Car le pain que tu manges est harami...» (p. 155) {xaAdAt) [helal «chose permise, non prohibée par la religion»] «... Mais si tu lui [i.e. au débiteur] demandes l'argent et il n'en a pas, faislui tout cadeau quelle que soit la somme et dis-lui: qu'il te soit halàli, comme le lait de ma mère... » (p. 145) hatziliki [haci; hacilik «pèlerin; pèlerinage (à La Mecque)] NB: Dans l'usage grec, pèlerinage aux lieux saints de Palestine, notamment Jérusalem.
V o i r Uriel Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, édité par V. L. Ménage, Oxford, 1973, pp. 271-275.
60
JOHANN
STRAUSS
hilé
[hile «ruse» ; hile etmek «employer la ruse»] «... Le klephte, l'assassin, le ravisseur, le couturier, le tisserand, toutes les corporations (rufétia *), combien en emploient la ruse (kamun hilé) dans leur métier et volent...» (p. 154) ibréti (LfiTrpéri) ['ibret «exemple qui sert d'avertissement»] hozuri {jco^ovpi) [huzur «tranquillité (d'âme)] *kiapé (,narré) [Kâbe «Kaaba»] suneti'zo (ovwerfây) [< siinnet «circoncision»] tzami (T£afÏL) [câmi' «grande mosquée (du vendredi)»] NB: Dans l'usage grec, le terme désigne toutes sortes de mosquées.
G. QUALITÉS, TYPES SOCIAUX aslatzâkis (dcrXarCdicqs) [asilacak (Meninski, I, 258.) «pendard, fourbe, fripon»] «...Ne sois pas mauvais pourvoyeur, nekbétis et aslatziâkis. Car celui qui n'est pas prévoyant souffre beaucoup de dommages, il est privé de beaucoup de bonnes choses, il acquiert beaucoup de mauvaises choses et il lui arrive beaucoup de mal » (p. 108). arsi'zis (arhizis) (dpa(£î]s,
àpxi{rjs)
['ârsiz] «effronté, méchant»]
*bekri's (pLjreKpfjs) [bekri (dér. bekrilik) «ivrogne, pochard»] «... Ne dis pas que tu es trop pauvre. Aucun jour, tu n'es jeûneur, mais je te vois sans cesse dans ton cabaret, de très tôt à partir de la nuit tu es au raki. Toute la journée au vin, et encore le soir tu bois, un, deux bols (kavkiâ) de raki. Et c'est pour cela que tu as faim. Et quand tu veux te coucher, tu bois encore du raki. Et puisque tu es très pauvre, où est-ce que tu en trouves pour boire toute la journée? Si tu veux boire, bois ce qui te suffit et donne le reste aux pauvres. » (p. 105) «... Et encore: "Ne bois pas trop de vin pour ne pas être bekri's. Car le bekriliki a ruiné beaucoup de gens. Beaucoup d'eux ont perdu leurs biens paternels (patrikâ mûlkia), leurs maisons, leurs vignobles, tous leurs biens, et par la suite, il les a fait les plus pauvres au monde» (p. 108). tzelépis [çelebi «personnage considéré et riche; gentil, courtois»] «...et ainsi Kouloghli arriva de Siderokastro, âgé de 37 ans, beau, à la barbe noire, tzelépis»
(p. 47)
hasâsis (jsaadoys) [ha§§â§ «narcotique»} hiletzis {xqAerfrfé) [hileci «rusé, fourbe»] hisim (xrfcrifJ) [hi§m «colère, courroux»] inatzi's (¿fi,ar£']js)Y\n'à\.c\
«obstiné»]
kalemkidris ( K a À e f i K i d p r f s , syn. grammatikos) [kalemkâr graveur»] *mameletzis (/xafieÀeTfrfô [mu'âmeleci «usurier»] *makûli (fia/coûAi) [ma'kul «raisonnable»]
«écrivain;
P A P A S Y N A D I N O S DE S E R R E S
61
mukaétis (pLouicaénjs) [mukayyed «qui s'applique avec assiduité» 1 ] « ...ils [i.e. les chefs de la corporation des tisserands] ne devenaient pas mukaétes et ainsi toutes les dettes restaient toujours» (p. 83) nekpétis (fe/cTrérrjs) [nekbetî, «disgracié» 2 ] «... puisqu'il [i.e. Alexandre Tatarhanis] était nekpétis et fainéant il se joignit au voyvoda et se promenait avec les hasâsides...» (p. 52). bezevéngisa (jnrefeftéyyiaaa) (p. 80) [< pezevenk «entremetteur, infâme»] yarénis (ÔLapévrjg) [yaren (< yârân) «ami, compagnon»] zabûnis {¿anoûisr).y) [zebun «faible, infirme, malade»] zorpabâsidhes (¿'opfiuandmSes) [zorbaba§i «personne à la tête d'individus violents, rebelles»]
' C e terme figure aussi souvent dans les avertissements contenus dans les firmans des sultans (sanctio) : « mukayyed olasiz » (« soyez assidus »). •'Extrêmement fréquent dans la chronique ; Kaftantzis (p. 52) l'explique comme indécent.
Hasan GÔKÇE
PORTRAIT D'UN ÉMIR KURDE, BEDER KHAN BEY
Qui est Yhomo ottomanicus ? Existe-t-il réellement ? On peut s'interroger à ce sujet tant la diversité ethnique, confessionnelle et linguistique de l'Empire est grande. Et si oui, quels sont les critères qui le définissent ? Il est difficile de se prononcer sur cette question sans avoir étudié la place de chacune des composantes de la société au sein du système ottoman. L'étude des rapports des communautés ethniques et religieuses avec le pouvoir central ou provincial peut seulement nous éclairer sur leur interaction. Ceci est d'autant plus important au XIXe siècle, durant lequel la volonté d'émancipation des peuples soumis fragilisait de plus en plus la cohésion de la mosaïque ottomane. Etre sujet des sultans ottomans implique-t-il qu'un Arménien, un Grec, un Nestorien, ou encore un Arabe, un Kurde ou un Albanais, etc. puisse être considéré comme homo ottomanicus ? Comment faut-il analyser les contestations des peuples soumis durant le XIXe et au début du XXe siècle ? Le parcours du Kurde Beder Khan bey, ses relations ambiguës et complexes avec la Sublime Porte, peuvent certainement contribuer à ce débat. Son exemple nous permet d'aborder les rapports conflictuels, relativement peu connus, existants entre l'aristocratie kurde et le pouvoir ottoman. Durant la première moitié du XIXe siècle, il existait au Kurdistan de multiples principautés héréditaires. Le « Nouvel Ordre » proclamé sous le nom de Tanzimât, mis en place progressivement dans l'ensemble de l'Empire, notamment au Kurdistan, avait suscité une forte résistance contre les autorités ottomanes qui n'a jamais pu empêcher le déclin de l'aristocratie kurde. Beder Khan bey fut l'un des nombreux émirs kurdes régnant à la tête d'une de ces principautés kurdes. Comme les autres chefs kurdes, il appartenait à une famille aristocratique, autrefois très prospère mais tombée en décadence. Fils
64
HASAN
GÔKÇE
d'Abdullah bey, il naquit vers 1808 1 . Dans une région dominée par la lutte interne entre les différents chefs et aghas kurdes, il se distingua des autres « princes » par sa résistance aux troupes de Rechid Mehmed pacha lors de l'expédition lancée contre les Kurdes de 1834 à 1838. Beder Khan bey fut tout de même obligé de se rendre au commandant en chef de l'armée ottomane d'Anatolie, Hafiz pacha, le 5 mai 1838. Celui-ci le récompensa en le nommant miralay (colonel) à la tête d'un régiment de redif (soldats de réserve). Beder Khan bey participa alors avec ses hommes aux côtés des troupes ottomanes au siège de la forteresse d'un autre prince Kurde, Said bey, et à la pacification du Kurdistan. Il prit part aussi à la bataille de Nizib contre Ibrahim pacha d'Egypte 2 .
1. RESTAURATION DE L'ÉMIRAT DE DJÉZIREH La guerre de 1834-1838, menée par le gouvernement contre les chefs kurdes, a pu réduire la plupart de ces derniers, mais elle n'a pas permis de rétablir l'autorité au Kurdistan. Après la défaite de l'armée du sultan à Nizib, le 24 juin 1839, Beder Khan bey retourna chez lui à Djézireh. Il retrouva une province dévastée par la guerre et sans autorité réelle. La disparition de chefs puissants, tel que Said Bey, avait créé un vide de pouvoir qui profita à Beder Khan bey. Il avait déjà obtenu la direction de l'émirat de Bohtan aux dépens de son cousin Mir Seyfeddin et de son frère aîné Salih bey. Après la mort d'Abdullah Khan, la direction de l'émirat passa aux mains de Seyfeddin bey 3 . Mais celui-ci ne parvint pas à maîtriser les troubles et laissa sa place à son cousin Salih bey. Ce dernier, particulièrement pieux, adhéra à la confrérie de Nakchibendi4 et consacra son temps à la religion, ce qui permit à Beder Khan bey d'exercer directement la fonction d'émir. Après s'être imposé comme chef de famille, il parvint à réunir sous son autorité les autres chefs. Il devint rapidement le maître incontestable de la région. Il mit fin aux troubles occasionnés par la rivalité entre les chefs locaux. Le rétablissement de l'ordre lui paraissait être la condition préalable au relèvement des districts de Djézireh, Bohtan et Midyat. Ses encouragements à la reconstruction des villages détruits Foreign Office (FO), 195/228. D'autres sources indiquent 1802 comme date de naissance. On rencontre plusieurs transcriptions des noms propres, notamment de "Beder Khan Bey". Au lieu d'opter pour la transcription turque moderne, nous avons gardé celle utilisée au XIXe siècle, d'ailleurs souvent employée dans les traductions officielles du gouvernement ottoman, ainsi que dans les journaux publiés à cette époque en langue française. Il n'est pas superflu cependant d'indiquer ici quelques orthographes de noms propres usitées en turc : Beder Khan bey, Bedr khan bey - * Bedirhan bey ; Djézireh, Djéziré -» Cizre ; Diarbekir -» Diyarbakir ; Mehmed -» Mehmet ; Mossoul -» Musul, Erzerum, Erzeroum, Erzeroom -» Erzurum ; Chérif —» §erif ; Zakho -» Zaho ; Hadji Bayram -» Haci Bayram; Bohtan - * Botan; Medyat - * Midyat; Sert -» Sirt ; Shimon -» §imon. 2 Helmuth von Moltke, Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei (1835-1839), Berlin, 1876. Dans certaines sources, on parle de lui en tant qu'oncle de Beder Khan bey. ^Ordre religieux.
PORTRAIT
D'UN
ÉMIR
KURDE
65
par la guerre et à la remise en culture des champs abandonnés furent couronnés de succès. Les conditions de vie des populations, sans distinction de religion, s'améliorèrent considérablement en comparaisones provinces limitrophes. Beder Khan bey réussit ainsi à repeupler son territoire qui devint, en l'espace de quelques années, le plus riche de la région. Il redonna en peu de temps à l'émirat de Djézireh son ancienne splendeur. Son talent d'administrateur fut reconnu, même par les agents européens qui lui étaient pourtant hostiles, à cause du conflit sanglant qui l'opposait aux nestoriens. Dans la correspondance consulaire, on trouve de nombreux éloges en sa faveur. Botta, consul de France à Mossoul, effectuant un voyage de Constantinople à Mossoul en 1842, adressa à son ambassadeur à Constantinople un compte rendu détaillé sur la situation des régions traversées. À propos de la région gouvernée par l'émir de Djézireh, il écrivit : « Djéziré petite ville située [...] sur une île entre deux bras du Tigre, est dans un état de ruine dont on peut à peine se faire une idée. Cette décadence date de l'époque où Rechid pacha a fait la guerre aux Curdes [Kurdes], [...] Elle se relève lentement grâce aux dons du gouverneur actuel Beder Khan bey L'observation de Rouet, interprète de l'Ambassade de France, parcourant le même itinéraire deux ans plus tard, fut plus flatteuse à l'égard de Beder Khan bey ; celui-ci soulignait au passage l'état dans lequel se trouvait l'administration provinciale : « Habitué à juger de la Turquie par l'idée que je m'en étais fait à Constantinople pendant un séjour de plusieurs années, je comptais trouver dans les provinces, sinon une administration conforme en tous points aux principes d'équité et de justice proclamés chaque jour par le sultan et ses ministres, au moins quelque chose qui témoignât de ces bonnes dispositions. Quelle n'a pas été ma stupéfaction en rencontrant partout, au contraire, les traces affligeantes d'un système pernicieux. Sur un espace de 250 lieues que j'ai parcouru, je n'ai vu que misère, décadence et démoralisation ! » Après avoir fait une description aussi pessimiste des pays traversés, il exprima son étonnement au sujet du territoire de Beder Khan bey : « Après un trajet de 50 lieues environ, on est frappé tout à coup du contraste qu'offre le pays. La culture est plus soignée, les villages mieux construits, et ils paraissent jouir de plus d'aisance. C'est le territoire de Beder Khan bey qui commence. [...] Son pays est bien 1 Archives du ministère des Affaires étrangères Consulaire (CCC), Mossoul, 12 juin 1842.
(AMAE), Correspondance Commerciale
66
HASAN
GOKÇE
gouverné. C'est un prince sévère, mais équitable ; aussi, règne-t-il sur son territoire, une sécurité parfaite et une apparence de bien-être qu'on chercherait vainement dans les provinces voisines, soumises à l'autorité turque. J'ai visité plusieurs villages chaldéens soumis au régime de Beder Khan bey et j'ai pu me convaincre qu'ils sont généralement contents de leur condition. Seulement, ils ne jouissent pas d'une aussi grande tolérance religieuse que dans l'état du sultan. »! Des observations analogues se retrouvent dans les rapports des consuls britanniques. À propos de Midyat, qui avait été placée sous la juridiction de Beder Khan par Hafiz Mehmed pacha en 1839, Rassam écrivit à son ambassadeur : « Pour plusieurs années, dans le passé, le district avait été placé sous la juridiction de Beder Khan bey. Pendant cette période, sa population a connu une notable augmentation, due essentiellement aux réfugiés musulmans de Mossoul et d'autres pachaliks qui bénéficient dans l'émirat de Djézireh d'un gouverneur plus équitable que ce que l'on peut rencontrer dans ces régions. En conséquence, tout le district de Gebel Tor a été rapidement mis en culture, plusieurs villages ruinés sont en cours de reconstruction et un air de prospérité souffle sur ces régions montagneuses, chose rare dans ces parties éloignées des possessions ottomanes » 2 . Stevens, envoyé spécial de l'ambassadeur britannique pour mettre fin à l'hostilité entre Beder Khan bey et Mar Shimon, fit le même constat 3 . Beder Khan bey attacha une importance capitale à la sécurité de son territoire, car ceci constituait pour lui la condition sans équivoque pour la prospérité des administrés et, en dernier ressort, de lui-même. Il était très fier d'avoir rétabli l'ordre dans la région, ce qui permettait aux paysans de se livrer à la culture de leurs terres sans être victimes du brigandage. En effet, par crainte de Beder Khan bey, le banditisme avait quasiment disparu 4 , le bey se montrait très sévère et même parfois cruel à cet égard. Cette obsession de sécurité le conduisait à l'excès en infligeant des châtiments corporels.
1 Archives du ministère des Affaires étrangères (AMAE), Correspondance Politique Consulaire (CPC), Mossoul, lettre de Rouet, 11 juillet 1845. V o , 195/228 ; Rassam à Stratford Canning ; Mossoul, 18 janvier 1844. 3 Stevens, vice-consul de Grande-Bretagne à Samsun est arrivé à Mossoul en 1844. Il a été reçu à deux reprises par Beder Khan bey. D'après ses observations (FO, 195/228) : « ...dans le territoire de Beder Khan bey, il y avait, en ce qui concerne les maisons et les hommes, un air de confort et de bonheur, ce qui constitue un étonnant contraste par rapport à la misère que l'on rencontre dans les villages de Mossoul et de Diarbekir». ce propos, Beder Khan bey s'exprimait avec les termes suivants : « Avant que je n'obtienne mon actuelle influence dans le Kurdistan, l'insécurité y régnait. Maintenant, un homme peut se déplacer à travers ce territoire en toute sécurité, en portant des sacs d'or sur la tête. » FO, 195/228 ; Stevens à Stratford Canning ; Mossoul, 10 juillet 1844.
PORTRAIT
D'UN
ÉMIR
KURDE
67
Deux anecdotes transmises par Kemal efendi et citées par Stevens nous montrent l'attachement du chef du Bohtan au maintien de l'ordre sur son territoire et son effort pour prévenir et décourager toute attaque contre ses administrés, ainsi que pour dissuader ces derniers de participer à la pratique du brigandage fort répandue dans le Kurdistan. Pour tester la vigilance de son kahya}, auquel il donna l'ordre de renforcer la surveillance contre les attaques nocturnes, il descendit de son château de Deirguleh avec deux cents cavaliers pendant la nuit, attaqua une tribu qui campait dans les environs de Djézireh, et lui enleva ses stocks de grain. Le lendemain, il rapporta le butin aux propriétaires et infligea à son kahya une lourde amende qu'il distribua aux hommes ayant effectué le raid. En effet, le chef kurde estimait que son subordonné avait manqué à son devoir de protéger ses administrés contre les malfaiteurs et n'avait pas exécuté ses ordres. De retour à Deirguleh, il coupa la main droite d'un homme et le nez d'une femme tous deux coupables de vols 2 . La nature des châtiments, inspirés de la char'ia, reflétait son attachement à la religion musulmane. Pourtant, les paysans trouvèrent son administration moins oppressante que celle des fonctionnaires envoyés de Constantinople. Les agents européens ne furent pas les seuls à faire ces constatations. En 1841, les notables de Djézireh adressèrent une pétition à la Porte pour empêcher le rattachement de leur ville au pachalik de Mossoul. Ils manifestèrent leur vive inquiétude à l'égard du vali de Mossoul lequel, selon eux, « opprimait sans raison les sujets de Dieu ». La pétition signée par 26 notables confirme l'observation des voyageurs européens et montre, dans une certaine mesure, l'attachement de la population au gouvernement de Beder Khan bey : « Depuis ce jour [du début de l'administration de Beder Khan bey] tous les endroits détruits furent reconstruits et mis en valeur. Notre situation s'est améliorée et notre malheur s'est transformé en bonheur. » 3 Le régime, pourtant sévère, gagna en popularité parmi les paysans des autres districts. On observe une émigration constante des provinces limitrophes, notamment celle de Mossoul, sur le territoire de l'émir de Djézireh. Ceci fut une des causes du conflit qui l'opposa au gouverneur de Mossoul, Mehmed pacha. Beder Khan bey rejetait toute accusation de vouloir attirer la population des autres vilayets sur son territoire. Il déclara avoir renvoyé deux mille personnes qui s'étaient installées dans sa juridiction quatre ans auparavant ; mais elles se réfugièrent de nouveau sur son territoire car Chérif pacha de Mossoul avait exigé d'elles des taxes exorbitantes, dont une qui frappait les personnes n'ayant eu aucune activité économique et commerciale sur le territoire du pachalik de Mossoul 'Lieutenant. FO, 195/228 ; Stevens à Stratford Canning ; Mossoul, 17 novembre 1844. 3 Baçbakanhk Osmanli Arçivleri (BOA), Ayniyat Defteri 121, 18 zilkade 1257 ; Sevgen Nazmi, Dogu ve Güneydogu Anadolu'da Türk Beyliklerì, Osmanli Belgelerì ile Kürt Türkleri Tarihi, 1982, p. 68 et xxviii. La pétition porte également la signature du mütesellim, du kadi, des muhtars. 2
68
HASAN
GÔKÇE
durant quatre ans. Il reprochait aux pachas leur mauvaise administration, et affirmait qu'ils étaient les seuls responsables de la désertion de leur territoire. Beder Khan bey utilisait souvent cet argument pour démontrer la supériorité de son administration par rapport à celles des gouverneurs des districts voisins. Mais cédant aux pressions, il s'engagea en 1847 vis-à-vis de la Porte à ne plus accepter d'immigrants. Le territoire administré par Beder Khan bey se composait de quatre districts principaux : le pays de Bohtan, Djézireh, Hadji Bayram et Midyat. L'administration de cette dernière ville fut confiée à Beder Khan bey par Hafiz pacha lorsque celui-ci était muchir de Diarbekir, moyennant le paiement d'un tribut annuel de quatre cents bourses. Lors de la reconquête avant la guerre de Nizip, l'ensemble de la région était rattaché à Yeyalet de Diarbekir et l'émir de Bohtan se trouvait placé sous la juridiction du pacha de Diarbekir ; mais sur le plan administratif, il était autonome et exerçait un pouvoir sans partage.
2. LES RAPPORTS AVEC LES PACHAS OTTOMANS Dès 1840, Mehmed pacha de Mossoul essaya d'obtenir la juridiction des différents districts administrés par Beder Khan bey. Avec l'appui de « ses protecteurs » influents à Constantinople 1 , il parvint à obtenir le rattachement du kaza de Djézireh au pachalik de Mossoul. Suite à ce découpage administratif, Beder Khan bey se vit obligé de verser deux tributs, un pour Bohtan, Hadji Bayram et Midyat au pacha de Diarbekir, l'autre pour Djézireh au gouverneur de Mossoul. Malgré les conflits qui l'opposaient aux pachas dont il dépendait, Beder Khan n'a pas cessé de s'acquitter de ses contributions. Il payait régulièrement le tribut annuel que les pachas de Mossoul lui demandaient, qui s'élevait, quand Djézireh dépendait du pachalik de Diarbekir, à 400 bourses. Ensuite, il dût payer 500 bourses à Mehmed pacha de Mossoul, qui augmenta successivement ce tribut à 1 000 et à 1 400. Son successeur Chérif pacha le fixa d'abord à 1 000 bourses et exigea par la suite de Beder Khan bey 1 500 bourses. Cette surenchère continua jusqu'à la fin de l'émirat 2 . Les relations entre Beder Khan bey et Mehmed pacha de Mossoul se dégradèrent au fil du temps. Son attitude belliqueuse à rencontre de l'aristocratie kurde était bien connue dans la région. Il avait supprimé, tantôt par la ruse, tantôt par la force, plusieurs chefs kurdes. Il avait élargi substantiellement le territoire du pachalik de Mossoul que lui avait concédé la Porte. Mais Mehmed pacha ne voulut pas se contenter de ces gains obtenus 1 Mehmed pacha de Mossoul semble bénéficier de l'appui du grand vizir Mehmed Emin Raûf pacha : FO, 78/533. V o , 195/228 ; AMAE, CPC, Mossoul.
PORTRAIT D'UN ÉMIR
KURDE
69
aux dépens du bey de Zakho et du Mir d'Ahmediye. Conscient de la puissance de Beder Khan bey et de sa détermination à se défendre contre toute attaque, Mehmed pacha n'osa pas mettre à exécution son projet d'envoyer des mutesellims1 aux kazas de Hadji Bayram et du Bohtan. Le pacha de Mossoul essaya d'obtenir le rattachement du reste des districts de Djézireh à sa juridiction par l'intermédiaire du gouvernement central. À ce sujet, il adressa à la Porte de multiples rapports dans lesquels il accusa Beder Khan de réunir les principaux chefs kurdes de la région afin de préparer une rébellion contre la Porte. D'après le vali de Mossoul, l'annexion de ces districts à Mossoul, lui permettrait de lutter efficacement contre les « e§kiyaï ». En même temps, il invita l'émir de Djézireh à se rendre à Mossoul auprès de lui. Se doutant du piège du pacha de Mossoul, le bey déclina son invitation. Il craignait de subir le même sort que les beys de Zakho et de Telakr. Un extrait du rapport du sadrazam Topai Izzet Mehmed pacha nous montre bien les dispositions du pacha de Mossoul à l'égard de l'émir de Djézireh, qui justifient d'ailleurs la crainte du bey : « Beder Khan bey, faisant alliance avec Han Mahmut et les autres chefs kurdes, prépare une conspiration. Pour punir et corriger la bande de brigands 3 , le vali de Mossoul insiste constamment pour rattacher le reste des districts de Djézireh à Mossoul. » 4 Différentes lettres de Beder Khan bey adressées à Vecihi pacha de Diarbekir 5 et au gouvernement, en 1841 et 1842, prouvent sa méfiance à l'égard de Mehmed pacha. Les mêmes sentiments sont exprimés à Stevens, en 1844 : «On me traite de rebelle parce que, connaissant son caractère perfide, j'ai refusé de rendre visite à feu Mehmed pacha de Mossoul, à qui je dois ma mauvaise réputation à Constantinople. » t l Cette méfiance se transformera au fur et à mesure en un soupçon permanent à l'égard des autorités de Mossoul, vis-à-vis desquelles il se comporta d'une façon de plus en plus indépendante. À chaque passage des pachas sur son territoire, il se rendait auprès d'eux avec une importante force militaire. Le 6 mai 1844, Beder Khan bey accompagné de plus de 2 000 personnes se présente sur le lieu de rencontre avec Chérif pacha de Mossoul et Kemal efendi, envoyé du gouvernement pour les affaires des nestoriens. Lorsqu'on lui annonça pendant la réunion que les troupes de Mossoul avançaient vers le camp et qu'on lui avait tendu un piège 7 , il monta sur son
'Gouverneur d'un district (kaza). Bandit. « E§kiya takiminin tedip ve terbiyelerinin saglanmasi için. » 4 « Arz tezkeresi » du sadrazam Topai Izzet pacha, adressé au sultan, le 23 recep 1258 : BOA, Mesâil-i Muhimmet Irâdeleri, sira n° 36, evrâk n° 1225. 5 « Ayant compris qu'il voulait s'emparer de votre serviteur et l'éliminer, comme il l'avait fait pour la population de Telakr et le miiteselUm de Zaho, et qu'il torturerait les enfants de votre serviteur comme il avait torturé leurs enfants et parents, de peur, je ne me suis pas rendu auprès de lui. » Beder Khan b. Abdullah à Vecihi pacha. BOA, Ayniyat Defteri, Sevgen p. 66. 6 FO, 195/228 Stevens à Stratford Canning ; Mossoul, 10 juillet 1844. 7 Chérif pacha avait en effet l'intention de capturer par surprise Beder Khan bey. FO, 195/228. 2
70
HASAN GÔKÇE
cheval, rassembla ses forces et les disposa en position de combat. Après s'être assuré que les troupes de Mossoul avaient stoppé leur avance, il retourna auprès de Chérif pacha et Kemal efendi qui étaient gardés sous surveillance par 200 Kurdes armés 1 . Pour mettre fin aux campagnes de délation et aux « intrigues » de Mehmed pacha à son encontre à Constantinople, Beder Khan bey entreprit de multiples démarches, tant auprès de Vecihi pacha de Diarbekir qu'auprès de la Porte pour se soustraire à l'autorité du pacha de Mossoul. Il essaya de persuader le gouvernement de revenir sur sa décision en replaçant Djézireh sous la juridiction de Veyalet2 de Diarbekir pour rester tributaire d'un seul pacha. Alarmé par les menaces de Mehmed pacha d'envoyer des miitesellims aux districts de Bohtan et Hadji Bayram, et cherchant à obtenir la réintégration de Djézireh au sein du pachalik de Diarbekir, Beder Khan bey s'adressa à Vecihi pacha, muchir de Diarbekir, lui demandant son concours. Il lui envoya son frère aîné Salih bey pour témoigner de sa soumission au gouvernement, ainsi que pour démentir l'accusation de rébellion et effacer les soupçons propagés par Mehmed pacha de Mossoul. Vecihi pacha transmit un rapport détaillé, y joignant les lettres de Beder Khan bey et la pétition de la population de Djézireh à la Sublime Porte. Le muchir appuya la demande de l'émir de Djézireh et attira l'attention du gouvernement sur les conséquences des mauvaises relations entre Mehmed pacha et Beder Khan bey 3 . Il écrivit que les principaux dirigeants kurdes n'avaient pas confiance en Mehmed pacha et que si Djézireh restait sous sa juridiction, les Kurdes, ainsi que Beder Khan bey, n'hésiteraient pas à se défendre contre lui. Pour ramener la tranquillité parmi les Kurdes, il jugea nécessaire la réintégration de ce kaza au sein du pachalik de Diarbekir. En même temps, Vecihi pacha envoya à Beder Khan bey un émissaire, Yusuf efendi, pour le rassurer. Il lui conseilla de continuer à servir l'État 4 et d'envoyer régulièrement les tributs des kazas dépendants de Diarbekir au kahya de cette dernière ville et de Djézireh à Mossoul. Yusuf efendi resta un mois chez l'émir kurde. Dans son rapport daté de muharrem 1258 (1842), il attesta de la soumission de Beder Khan bey et de son désir de servir le gouvernement. 1
Idem.
^Division administrative gouvernée par un muchir ou pacha. 3 Sevgen, p. 74. ^Extrait de la lettre de Vecihi pacha adressée avec Yusuf efendi à Beder Khan bey le 7 zilkaade 1258. « Du fait du rattachement du kaza de Djézireh à Mossoul, il y a désaccord et inconvenance entre vous et Mehmed pacha de Mossoul. Nous avons entendu que cela vous inquiète. [...J Jusqu'à maintenant tu as bien servi l'État ainsi que nos frères ministres précédemment en poste. [...] Je veux te voir te comporter en serviteur de l'État, comme par le passé, selon la volonté de celui-ci. Tant que tu ne quitteras pas la voie préconisée par l'Etat et nous rendras de bons services, Mehmed pacha ne pourra rien faire contre toi. » : BOA, Mesâl-i Miihimme ; Sevgen, p. 72.
PORTRAIT D'UN ÉMIR
KURDE
71
Il souligna aussi que le rattachement de Djézireh à Diarbekir permettrait de renforcer sa confiance à l'égard de l'État et l'encouragerait à le servir mieux que jamais. L'émir s'engageait à envoyer régulièrement les revenus des districts sous sa dépendance. Soucieux d'empêcher toutes sortes de troubles dans la région, Yusuf efendi déconseillait toute tentative d'irruption de la part de Mehmed pacha dans le territoire de Beder Khan bey. Un tel acte, selon lui, susciterait la résistance des Kurdes et mettrait en péril la population et les revenus de la région. Il termina son rapport en insistant sur l'importance du rôle de Beder Khan bey et des services que celui-ci pouvait rendre à la Porte 1 .
3. ATTITUDE DU GOUVERNEMENT CENTRAL Au sujet des différends opposant Beder Khan bey au pacha de Mossoul, le Sadaret2 reçut de multiples rapports de Vecihi pacha de Diarbekir, de Kâmili pacha d'Erzerum et de Necip pacha de Bagdad, en faveur de la demande de Beder Khan bey. Ils furent examinés par deux conseils d'État : Meclis-i valâ-i ahkâm-i Adliye et Meclis-i Umumiye3, qui décidèrent d'ouvrir une enquête pour vérifier l'exactitude des rapports de Vecihi pacha de Diarbekir et de Mehmed pacha de Mossoul. Dans son Arz Teskeresi4 du 22 receb 1258 (1842) au sultan, le sadrazam5 Topai Izzet Mehmed pacha envisageait même la possibilité de la disgrâce ou bien de la mutation de Mehmed pacha de Mossoul, accusé d'être à l'origine de la réticence de tribus kurdes envers le gouvernement. Il ordonna à Necip pacha de passer par Mossoul pour vérifier le bien-fondé des griefs contre Mehmed pacha. Tout en approuvant la décision du Meclis-i Umumiye d'envoyer sur place un commissaire pour s'assurer de l'exactitude des plaintes de l'un et de l'autre, le sultan Abdulmecid demanda au gouvernement d'accéder à la demande de Beder Khan bey. Il attira l'attention du grand vizir sur le danger de laisser traîner l'affaire et sur les conséquences qui pourraient en résulter. Il lui conseilla, pour empêcher tout dérapage et certains troubles dûs à « la particularité dans la région, de ses habitants composés des Kurdes et des tribus » 6 , de placer Djézireh sous la juridiction de Vecihi pacha de Diarbekir, sans attendre le résultat de l'enquête 7 . Il ordonna aussi au gouvernement d'adresser
^Sevgen, p. 72. Office de grand vizir ; grand vizirat. ^Deux conseils suprêmes de l'État ottoman, l'un grand conseil (meclis-i umumiye), l'autre traitant en particulier les affaires juridiques. ^Lettre vizirielle adressée au premier secrétaire du sultan, qui accompagne les décrets soumis à l'approbation du monarque. ^Grand vizir. 6 L e rapport du sadrazam Topai Izzet pacha du « 23 receb 1258 » (1842) ; Sevgen, p. 74. ^Note mise par le secrétaire du sultan sur le rapport du grand vizir. Idem. 2
72
HASAN
GÔKÇE
une lettre à Beder Khan bey pour dissiper ses craintes et le rassurer. Ceci nous montre le souci du sultan Abdulmecid d'éviter certains désordres, de maintenir son « administration en bon ordre », autrement dit de conserver Beder Khan à son poste en satisfaisant à sa requête. Mais l'affaire prit une autre tournure. Mehmed Emin Raûf pacha succéda à la tête du gouvernement à Topai Izzet Mehmed pacha. Le gouvernement envoya de nouveau Nazim efendi à Mossoul, pour enquêter sur l'affaire et examiner les accusations respectives. Cette mission se limita à des échanges de correspondances sans déboucher sur une solution satisfaisante. En dépit des promesses de Vecihi pacha et Kâmili pacha d'Erzerum, Beder Khan bey ne parvint pas à obtenir gain de cause ; Djézireh resta attachée au pachalik de Mossoul. Il commença à douter de la sincérité et des dispositions du gouvernement à son égard et en déplora l'attitude ; il accusa Mehmed pacha d'être à l'origine de sa mauvaise réputation à Constantinople. Lors d'un entretien avec Stevens, le vice-consul britannique à Samsun, il reprocha au gouvernement de ne pas apprécier à leur juste valeur les services qu'il lui rendait 1 . Il exprima notamment au vice-consul sa crainte envers les pachas des différentes régions : « Je suis un subordonné du pacha de Mossoul, mais je suis aussi obligé de me plier aux désirs des pachas de Bagdad, Erzurum et Diarbekir ; et si je deviens trop amical avec l'un d'entre eux, je peux être certain de faire des autres mes ennemis. » 2 Malgré ce pessimisme, Beder Khan bey ne perdra pas pour autant l'espoir de faire entendre sa cause à Constantinople et de faire disparaître l'image de rebelle qu'il avait acquise dans la capitale. Il déclare à Stevens en 1844 : « Je suis persuadé que le gouvernement ignore tous ces faits, mais peut-être ils les découvriront un jour et se feront alors une meilleure opinion de Beder Khan bey » 3 . Différentes correspondances qu'il avait adressées au gouvernement témoignent encore une fois de son effort pour attirer l'attention du gouvernement sur son sort. Dès 1843, Beder Khan bey avait étendu sa prépondérance au-delà de sa juridiction traditionnelle. Il est devenu en quelques années une force incontournable dans la région. Sous sa direction, Khan Mahmud de Van (beaupère de Beder Khan), Nurullah bey d'Hakkari, Abdul Samet bey de Bervari, ainsi que d'autres aghas moins importants, avaient formé une sorte de
Comparez la condition de la population sur mon territoire avec celle de Mossoul et de Diarbekir, et si leur bien-être est d'une importance quelconque pour le gouvernement, dites-moi franchement, qui sert le mieux le sultan, les pachas de ces endroits là ou Beder Khan bey. »: FO, 195/228. 2 FO, 195/228 Stevens à Stratford Canning ; Mossoul, 10 juillet 1844. V o , 195/228 Stevens à Stratford Canning ; Mossoul, 10 juillet 1844.
PORTRAIT
D'UN
ÉMIR
KURDE
73
fédération des émirats 1 . Cette réussite était la conséquence de sa popularité et de la jalousie qu'il suscitait auprès des pachas. L'émir du Bohtan ménagea aussi la faveur des pachas des eyalets voisins, Erzerum, Diarbekir et Bagdad. Il se plaignait à chaque occasion d'être obligé de satisfaire la volonté de ces muchirs, bien qu'il fût subordonné au pacha de Mossoul. Pour échapper aux exigences incessantes des uns et des autres, Beder Khan chercha désormais à se placer sous l'autorité directe de Constantinople. En voulant recevoir les ordres du gouvernement central, il voulait légitimer aussi l'influence qu'il avait gagnée au Kurdistan et faire valider par la Porte son autorité sur d'autres chefs kurdes. Il considérait que grâce à son influence, la tranquillité parfaite régnait au Kurdistan et qu'il pouvait faire valoir cet argument pour convaincre le gouvernement. Il espéra, en vain, qu'en y établissant l'ordre, il pourrait obtenir la juridiction de ces contrées.
4. LA CHUTE INÉVITABLE DE L'ÉMIR La pensée du chef kurde ne concordait pas tout à fait avec la réalité politique. Le gouvernement se méfiait de l'importance grandissante de l'émirat, d'autant plus que la Sublime Porte projetait d'introduire des réformes administratives qu'elle voulait mettre en œuvre notamment dans les provinces kurdes. Dans les journaux de Constantinople, on rencontrait des articles traitant de la nécessité de juguler la puissance des chefs kurdes et d'éliminer le type de gouvernement héréditaire répandu au Kurdistan. Bien que Beder Khan bey ne donnât aucun signe de contestation envers le pouvoir du sultan, il était évident que la Porte ne voyait pas d'un bon œil l'influence croissante de celuici au Kurdistan. On évoqua, dès 1845, le besoin d'une expédition militaire contre Beder Khan bey, mais la conjoncture politique n'était pas du tout favorable à une telle entreprise. L'affaire de Tiyari opposant Beder Khan bey au patriarche nestorien, Mar Shimon, fragilisa sa position. En 1843, il envoya Zinar bey 2 dans les montagnes de Hakkari avec 1 500 hommes pour rétablir l'autorité de son allié Nurullah bey, contestée de plus en plus ouvertement par certaines tribus nestoriennes et par Mar Shimon. Ce dernier ne se contentait plus d'un pouvoir spirituel et revendiquait aussi le pouvoir temporel à la tête des nestoriens dans la région. Les tribus de Tiyari attaquèrent Zinar bey et tuèrent plusieurs Kurdes. Zinar bey fut obligé de se retrancher avec 200 hommes dans la résidence, une véritable forteresse, récemment construite par le missionnaire
1
FO, 195/228 ; AMAE, CPC, Mossoul. Zeynel et Zinar sont la même personne, on trouve aussi d'autres dénominations à ce propos.
74
HASAN
GÔKÇE
américain DrGrant 1 . Celle-ci avait d'ailleurs suscité, suite à de nombreuses plaintes, la réticence des autorités ottomanes. Pour venger cette attaque, Beder Khan bey organisa une expédition sanglante contre les nestoriens et leurs alliés kurdes 2 . L'attaque de l'émir du Bohtan contre ces chrétiens orientaux a provoqué une vive émotion en Europe, en particulier en Angleterre. La pression des puissances chrétiennes mit le gouvernement ottoman dans une position difficile. Il dût consentir aux Anglais l'envoi de deux fonctionnaires sur place pour trouver une issue à l'affaire nestorienne. Suite à l'intervention des puissances européennes, en particulier de l'Angleterre et du gouvernement ottoman, Beder Khan bey accepta de se retirer de Tiyari et de ne plus molester les nestoriens. L'ambassadeur britannique Stratford Canning envoya même un émissaire, Stevens, vice-consul à Samsun, auprès de Beder Khan bey pour régler l'affaire des nestoriens 3 . Surpris par l'intérêt que portaient les Européens à ses coreligionnaires, Beder Khan bey, tout en justifiant son entreprise, exprima son regret à Stevens d'avoir entrepris l'expédition contre les nestoriens, sans avoir demandé l'autorisation à son gouvernement 4 . La Porte essaya de diminuer l'influence et les moyens de résistance du chef kurde, en prévention d'une éventuelle intervention armée. En 1844, par exemple, elle lui retira la province de Midyat et le district de Herzan par lequel il pouvait exercer une influence sur Sirt. Beder Khan bey protesta en vain contre cette mesure et finit par se résigner. Il accusa Kemal efendi d'être à l'origine de la décision du gouvernement. Il lui reprocha surtout de ne pas avoir tenu ses promesses, notamment celle de « faire de lui un grand homme » 5 , mais d'œuvrer pour diminuer son influence. Dans un tezkere6 adressé au pacha de Mossoul, le gouvernement ottoman demandait à son agent d'effectuer un recensement dans les kazas de Djézireh et du Bohtan. Il ordonna également à ses subordonnés de veiller à ce que Beder Khan ne puisse pas accroître sa Cette construction était la principale cause de la première expédition de Beder Khan bey contre les nestoriens. Kâmili pacha d'Erzerum demanda d'ailleurs des explications à Brant, consul britannique à Erzerum, à propos de la nature de la résidence que Dr Grant faisait construire. Grant, dans une lettre adressée le 15 mars 1843 à Stevens, vice-consul britannique à Samsun, écrivait que le pacha de Mossoul avait envoyé un rapport au gouvernement dans lequel on lui reprochait de construire un château fort à Tiyari. Il écrivait aussi que Mehmed pacha de Mossoul avait engagé un Kurde pour le faire tuer : FO, 195/228 ; FO, 78/533. 2 L e s tribus de Bunyanis et Zibar. ^Stevens offrit par la même occasion un pistolet et une montre au bey kurde. I regret having taken the step without previously asking the authority of my government and I knew not that any European government would come forward to protect them. » : FO, 195/228. -*Beder Khan disait à Stevens à ce propos : « ... ayant été privé de la province de Midyat, qu'il a obtenue dans un état de révolte, et qu'il a soumis au prix de la vie de beaucoup d'hommes. Il avait perdu aussi le pouvoir sur les Kurdes de Harzan, et également l'influence qu'il exerçait sur la population de Sirt. Il attribuait tout cela à Kemal efendi, une personne très polie et convaincante, disait-il, qui avait promis de faire de lui un homme plus puissant, mais qui, au lieu de ce faire, étudiait les moyens de diminuer son pouvoir.» : FO, 195/228. 6 Note, lettre.
PORTRAIT
D'UN ÉMIR
KURDE
75
puissance et son influence 1 . Mais il défendit au vali l'utilisation de la force contre le chef kurde afin de ne pas éveiller les soupçons de ce dernier envers le gouvernement. La reprise du conflit entre les nestoriens et Beder Khan bey en 1846 suscita, cette fois, une intervention plus déterminée des puissances européennes. En particulier, la France exerça une pression sans relâche sur le gouvernement ottoman et demanda une expédition militaire immédiate contre l'émir kurde2. Pour s'informer de ses projets et convaincre Beder Khan bey de venir à Constantinople, la Porte envoya en 1846 Nazim efendi auprès du chef kurde. L'émissaire lui remettra aussi une lettre du gouvernement, et dans sa réponse, il témoignera une fois de plus de sa soumission au sultan 3 . En même temps, il exprimera sa crainte et demandera d'être pardonné pour ses fautes. On constate l'état de désarroi et d'indécision dans lequel se trouvait Beder Khan bey en 1846. Il s'était mis en premier lieu d'accord avec Nazim efendi 4 pour se rendre avec lui à la capitale, mais peu de temps après il changea d'avis et renégocia les conditions. Il s'inquiétait de son sort et tenta de mettre sur pied un arrangement avec l'envoyé extraordinaire. Il fera trois propositions au gouvernement : tout d'abord, celle de laisser sa place à un membre de sa famille choisi par le pouvoir central. Si cette solution ne satisfaisait pas la Porte, celle-ci pourrait envoyer un fonctionnaire pour le remplacer et Beder Khan bey le servirait en tant que kethùda5. Dans le cas de son maintien au poste, il s'engageait à exécuter tous les ordres du gouvernement, à fournir des conscrits selon la modalité exercée dans d'autres régions. Si le gouvernement souhaitait abolir le système de tribut et envoyer un defterdar6, Beder Khan s'engageait à l'aider à accomplir sa tâche, c'est-à-dire la perception de l'impôt. Ceci nous montre que l'émir kurde essaya de sauver ce qui pouvait l'être. Il renonça même à son émirat à condition que la Porte le laisse demeurer dans sa propriété avec la sauvegarde de sa vie, de sa famille, de son honneur et de sa
1
BOA, Ayniyat defteri, n° 609 (19.S.1259-4.C.1264) ; Sevgen, p. 79. CPC, Mossoul ; CP, Turquie, 296. - « Si j'avais mille vies, je serais prêt à les sacrifier toutes pour notre Sultan. » Beder Khan bey à la Sublime Porte, 5 safer 1263. BOA, Mesâil-i Muhimme Iradeleri, n° 36 ; Sevgen, p. 81. 4 Beder Khan a envoyé même à Nazim efendi les frais de route iyol harcligi) pour qu'il puisse se rendre de Mossoul à Djézireh, afin de partir ensemble à Constantinople : FO, 195/228. ^Lieutenant ou kahya. ''Chargé des finances d'une province, receveur général. 2AMAE,
76
HASAN
GOKÇE
d i g n i t é 1 . Cet acte de soumission ne satisfaisait pas entièrement le gouvernement, qui maintint sa pression sur Beder Khan pour qu'il se rende à Constantinople. Pendant ce temps, les préparatifs militaires s'accélérèrent et la concentration des troupes à Diarbekir sous la direction d'Osman pacha, muchir de « l'Armée d'Anatolie » arriva à sa phase finale. Les négociations ne s'arrêtèrent pas pour autant. L'ambassade britannique, par l'intermédiaire de Rassam, son vice-consul à Mossoul, entreprit des démarches auprès du bey de Djézireh, pour le convaincre de se rendre au gouvernement. En accord avec Essad pacha de Mossoul, Rassam a entretenu une correspondance avec Beder Khan bey. Dans une lettre adressée à Rassam, il renouvela sa soumission au sultan et s'engagea à ne plus intervenir dans les affaires du district d'Hakkari, de reconnaître Mar Shimon comme patriarche des nestoriens, de traiter les Musulmans et les Chrétiens sur un pied d'égalité et d'abolir la peine de mort comme punition. Il consentit à envoyer Zinar bey, accusé par les nestoriens de massacre, à Mossoul. Il renonça aussi à l'exercice de la fonction d'imam et remplaça son nom par celui du sultan lors de la prière publique du vendredi. Pour qu'il pût se rendre à Constantinople, il demanda au vice-consul britannique de lui garantir son retour sain et sauf à Djézireh. L'émir craignait que le gouvernement, sous la pression des puissances européennes, ne le traduise devant la justice, à cause de l'affaire nestorienne. Dans un autre courrier au vice-consul britannique, il exigea une lettre du sultan lui-même, promettant qu'aucune charge ne serait retenue contre lui, ni pour l'affaire nestorienne et yezidi, ni pour d'autres affaires 2 . Malgré cet échange de correspondances avec l'agent britannique, Beder Khan bey était conscient du rôle des ambassades d'Angleterre et de France dans la préparation de l'expédition militaire dirigée contre lui. L'entourage de l'émir ne cachait pas ses griefs envers l'émissaire de Rassam, Uaggia Antun, envoyé par le vice-consul pour convaincre Beder Khan de se rendre. En présence de ce dernier à la résidence du bey kurde, les principaux aghas n'hésitèrent pas à accuser ouvertement le consul britannique d'être la cause de leur ruine. L'Angleterre n'était pas seule à faire pression sur la Porte pour qu'elle prenne des mesures « énergiques » contre Beder Khan. La France demanda ouvertement une expédition militaire pour mettre un terme à la principauté kurde, fermée à toute influence européenne. Le consul de France à Mossoul
1« ... étant un fidèle serviteur de l'État, aucun préjudice ne doit être porté à l'honneur de celuici [Beder Khan bey], en garantissant ma sécurité corporelle, mes biens, l'honneur de ma famille, l'attribution à une personne de ma famille du gouvernement de principauté et de Djézireh, se trouvant sous ma garde, l'autorisation de demeurer avec mes enfants et épouses dans ma résidence et de passer mon temps à prier pour une longue vie et le bien-être de notre sultan..» : BOA, Mesâil-i Muhimme, n° 36. ^Rassam écrivait à son ambassadeur à ce propos : « Sa [Beder Khan bey] grande crainte était que votre Excellence puisse utiliser les plaintes des Nestoriens contre lui. » : FO, 195/228, Rassam à Henry Wellesley ; Mossoul, 29 mai 1847.
PORTRAIT
D'UN
ÉMIR
KURDE
77
écrivait dans une de ses dépêches, «qu'il est étonnant que la Porte, qui depuis quelques années s'efforce de soumettre les chefs Curdes rebelles, n'ait pris aucune mesure à l'égard de Beder Khan bey, le plus redoutable et le plus puissant de tous» 1 . Le même consul déclarait plus loin : « Est-ce une menace qui doit avoir sa réalisation, ou une ruse pour engager la Porte à ramener à une expédition pour épargner la destruction de tous ces malheureux ?» 2 . Informé par son consul à Mossoul sur l'attitude jugée très favorable du commissaire ottoman Nazim efendi à l'égard de Beder Khan, le baron de Bourqueney adressa par l'intermédiaire de l'interprète de l'ambassade une lettre sévère au Hariciye Nazirfi Ali efendi Ottoman, pour « que la Porte persiste plus que jamais dans la résolution d'en finir avec Beder Khan bey » 4 . L'interrogeant sur les intentions de son gouvernement, le ministre ottoman assura à l'ambassadeur de France qu'il n'y avait aucun changement dans l'attitude du gouvernement et que l'expédition contre Beder Khan bey aurait lieu comme prévu. Il assura de Bourqueney que Nazim efendi tenait ce langage sur place pour ne pas éveiller de soupçons dans l'esprit du bey et pour le convaincre de se rendre à Constantinople. En effet, le gouvernement ottoman avait caché ses intentions jusqu'au dernier moment. Voyant la concentration massive des troupes à Diarbekir et à Mossoul, Beder Khan bey avait envoyé son secrétaire Osman efendi à Essad pacha, pour demander les réels motifs des préparations militaires d'une telle envergure. Le pacha lui assura qu'elles étaient destinées à soumettre les Bédouins arabes. Pour ne pas éveiller les soupçons d'Osman efendi, il refusa publiquement de recevoir le patriarche des nestoriens, Mar Shimon, qui était pourtant invité par le pacha même 5 . Cette discrétion dura jusqu'à la fin des préparatifs.
5. LE DILEMME : SOUMISSION OU RÉBELLION ? Après avoir refusé toutes les conditions avancées par Beder Khan bey, la Porte exigea sa reddition. Elle lui assura tout de même, par l'intermédiaire du muchir de Diarbekir, qu'il aurait la vie sauve. L'intervention des principaux cheikhs de l'ordre Nakchibendi, sur la demande du gouvernement, ne changea pas le cours des choses. Après une longue hésitation, entre la soumission et la résistance, il décida finalement de se battre contre l'armée du sultan dont il n'avait jamais contesté ouvertement la souveraineté. L'entourage de l'émir a certainement joué un rôle important dans cette décision. Il recevait constamment des messages et des lettres de Diarbekir, de Mossoul et d'autres
l
AMAE, CCC, Mossoul ; lettre de Guillois ; Mossoul, 20 septembre 1846. AMAE, CCC, Mossoul ; lettre de Guillois ; Mossoul, 21 février 1847. ^Ministre des Affaires étrangères. 4 A M A E , Correspondance politique (CP), 296, D e Bourquenay à Guizot, Péra, 27 janvier 1847. 2
5
F O , 195/228.
78
HASAN
GOKÇE
régions pour le persuader de n'écouter « ni les Turcs ni le consul anglais », car se soumettre ou se battre ne changerait en rien sa situation, sa mise à mort étant déjà décidée 1 . Non seulement les Kurdes, mais aussi la majorité de la population de la région, en particulier les musulmans, avaient la conviction que l'armée avait été envoyée, sous la pression des Européens et contre le gré du sultan2. Malgré la supériorité des forces qui lui étaient opposées et la défiance de ses alliés 3 , pour sauver son honneur et son émirat, il décida de se défendre contre Osman pacha, qui marchait avec plus de 30 000 hommes sur Djézireh. Après une bataille insignifiante, Beder Khan bey se retira avec 500 hommes à Avrak Kale 4 , qui sera assiégée et soumise aux bombardements massifs pendant trois jours. Voyant sa position intenable, il se rendit le dimanche 11 juillet 1847 (15 §aban 1263) à Osman pacha. Avant d'être envoyé à Constantinople via Diarbekir et Samsun, il fut, pour servir d'avertissement « ibreti alem için », promené les pieds enchaînés à travers le bazar de Djézireh, pendant que les autres prisonniers étaient à cheval. Il restera trois semaines à Constantinople. Ses médailles et ses biens furent confisqués au profit de l'État. Le gouvernement décida de lui allouer un salaire mensuel. Avec sa famille et le mufti de Djézireh, Abdul Kudsi efendi, ainsi que le Cheikh Abdul Gâni, il fut envoyé en exil en Crète où il arriva le 21 zilkade 1263 (1847). Dans son nouvel exil à Candie, Beder Khan parvint à se faire une situation en achetant des terrains et gagna ainsi l'estime de la population locale, tant musulmane que chrétienne. Son rôle de médiateur entre les deux communautés lors des troubles en Crète confirme la qualité des relations qu'il a su créer dans un pays si lointain et si différent du sien. En effet, le samedi 29 mai 1858, lors d'une émeute entre population grecque et musulmane, « Beder pacha, exilé kurde, avec un régiment parviennent à rétablir l'ordre et à faire rentrer chacun chez soi » 5 . Lors d'une autre révolte, il ouvrit sa porte aux Grecs et les protégea contre une foule musulmane agitée. Les gouverneurs
« Une autre raison qui le rendait peu enclin à se rendre était le fait qu'il recevait sans cesse des messages et des lettres en provenance de Mossoul et de Diarbekir qui lui conseillaient de n'écouter ni les Turcs ni le consul anglais, car, qu'il se rende ou qu'il soit vaincu au combat, sa mort était déjà décidée.» : FO, 195/228, Rasssam à Henry Wellesley, Mossoul, 29 mai 1847. 2« Les sentiments des Musulmans partout dans ce pays sont favorables à Beder Khan bey, qui est considéré comme le dernier rempart de l'islam, et les ignorants sont persuadés que les soldats employés contre lui sont envoyés par les Européens et non pas par le sultan. Le nom du consul anglais fait l'objet d'une haine toute particulière. » : FO, 195/228, Rassam à Lord Cowley ; Mossoul, 14 juin 1847. 3 Son cousin, Yezden Shir (Izzedin Shir), le fils de son oncle Emir Sudi l'a trahi et est passé au côté des troupes gouvernementales. D'après certaines sources, celui-ci serait le neveu de Beder Khan bey. ^Forteresse d'Avrak. 5 AMAE, CPC, Cannée ; lettre de Chatry de Lafosse ; Cannée, 29 mai 1858.
PORTRAIT
D'UN
ÉMIR
KURDE
79
locaux demandèrent fréquemment ses services et l'envoyèrent à la Cannée pour apaiser les troubles. Après l'avoir envoyé en exil, le gouvernement ottoman ne se désintéressa pas du sort de l'émir kurde et adopta une attitude pragmatique et conciliante envers lui. Lors de sa visite en juin 1850 à Candie, le sultan Abdiilmecid reçut Beder Khan bey et lui offrit cinquante mille piastres en guise de sa bienveillance. Dans une réunion dans le palais du ministère des Finances, les ministres1 discutèrent des mesures à prendre à l'égard de Beder Khan. Suite à cette concertation, ils admettront qu'il fallait réconcilier l'émir avec le gouvernement. Le conseil ordonna d'envoyer une lettre à Beder Khan lui demandant de se rendre à Constantinople et de l'autoriser à résider désormais dans la capitale. Le gouvernement ne voyait aucun inconvénient à lui confier un poste de gouverneur dans une province européenne de l'Empire. Beder Khan se rendit à Constantinople, où il reçut une aide exceptionnelle de 6 mille livres turques pour lui et ses enfants. Il retournera finalement de nouveau en Crète. Par un décret du sultan en 1858, Beder Khan est élevé au rang de pacha, avec le titre de Miremiran. Le gouvernement était convaincu que seule la persuasion pouvait empêcher Beder Khan de s'enfuir et de retourner à Djézireh. La situation politique se dégradait de plus en plus en Crète, qu'il quitta pour s'installer à Constantinople où il resta sept ans. En 1867, il obtient la permission d'aller s'installer avec sa famille à Damas, où il mourra en 1870, laissant derrière lui 4 épouses, 6 concubines, 42 enfants et 10 petits-enfants, autrement dit une famille de 63 personnes. Après sa mort, son salaire de 19 000 piastres fut transmis et partagé entre ses héritiers, sur la demande de ces derniers2.
6. BEDER KHAN BEY HOMO OTTOMANICUS ? Comment faut-il interpréter ces rapports contradictoires et conflictuels entre l'émir de Djézireh et la Sublime Porte ? Le cas de Beder Khan bey n'est pas singulier. Il n'était pas le seul membre de l'aristocratie kurde à avoir entretenu des relations ambiguës avec la Porte et à subir un tel sort. La première moitié du XIXe siècle est particulièrement riche de ce point de vue. La plupart des gouverneurs héréditaires kurdes, après leur destitution par la 'Grand vizir Rechid pacha, Serasker pacha, Ômer pacha, Ali Galip pacha, muchir de l'Armée de l'Arabie. Mustafa Rechid pacha, Bir Turk Diplomalinin Evrak-i Siyâsiyesi ///, p. 193 cité par Sevgen. 2 BOA, Iradeler, n° 41717, 19 cemazi-iil-ahir 1286. Une requête de la famille de Beder Khan bey à ce sujet a été envoyée par le vali de Damas à Constantinople. Elle fut transmise par le Sadaret au sultan avec la suggestion suivante : « Bedirhan pacha étant riche et puissant, suite à la pacification effectuée dans la région, fut transféré avec sa famille vers ces contrées et comme ses propriétés au Kurdistan furent confisquées par l'État, pour subvenir à ses besoins, un salaire lui fut alloué par le trésor des finances (maliye hazinesinden). Puisque ce salaire est la contrepartie des domaines confisqués, il est nécessaire de le transmettre à ses héritiers. »
80
HASAN
GÔKÇE
force, s'intégrèrent dans le système ottoman proprement dit. Ils furent assignés à résidence et surveillés avant de devenir de simples fonctionnaires de l'Empire. C'est ainsi qu'après sa destitution par le gouvernement ottoman, les deux dirigeants de la dernière principauté kurde de Süleymaniye, Ahmed pacha et son frère, devinrent gouverneurs nommés par la Sublime Porte, comme la plupart des membres de l'aristocratie kurde. Ahmed pacha occupa par la suite le poste de vali d'Erzerum et de Bassora ; de même que son frère Abdullah pacha fut nommé vali de Van. Beder Khan bey se distinguait tout de même des autres personnalités kurdes en quelques points. Il était ambitieux et avait le goût du pouvoir. En réunissant la plupart des chefs kurdes autour de lui, il voulait étendre son influence, au-delà de son territoire proprement dit, sur une large partie du Kurdistan. Il soignait son image de prince généreux en recevant, dans son château de Deirguleh, les pauvres à qui il faisait des dons en argent et en nature. Durant les périodes de mauvaises récoltes, il distribua aussi aux paysans en difficulté des semences 1 . Il parvint à créer un mythe « Beder Khan bey », qui se répandit dans la région. Cette popularité croissante était sans doute à l'origine de la surestimation de la force de Beder Khan bey, qui avait amené le gouvernement à mobiliser plus de 30 000 hommes, pour mettre fin à l'autonomie de cette famille kurde. Le traumatisme des guerres perdues contre un de ses subordonnés était encore présent dans l'esprit des dirigeants de l'Empire. Le gouvernement ne pouvait pas se permettre de prendre des risques. Seulement une victoire certaine pouvait effacer l'humiliation de la défaite contre son vassal Mehmed Ali d'Egypte. La publication d'un firman impérial, ordonnant la célébration de la victoire de l'armée du sultan sur Beder Khan bey, dans tous les coins de l'Empire, atteste de cet état d'esprit. Une médaille spéciale portant l'effigie du château de l'émir kurde fut également frappée et distribuée aux soldats qui ont pris part à cette expédition. La « victoire » fut attribuée à la gloire personnelle du sultan Abdiilmecid, devenu « le conquérant du Kurdistan » 2 . Il faut attribuer cette exagération à la soif de succès militaires, devenus si rares. Le gouvernement voulait en faire un exemple et montrer à ses administrés combien il était fort et capable d'anéantir toute opposition. Pour renforcer cette autorité, inspirée à la fois par la crainte et par l'admiration, Beder Khan bey exerçait la fonction d'imam et faisait citer son nom lors de prières publiques. Faut-il voir en cet acte la volonté de se soustraire à la souveraineté du sultan ? Beder Khan bey était un homme religieux et orgueilleux. À l'instar des membres de la plupart des familles aristocratiques kurdes, il se considérait comme un descendant de la dynastie des
V o , 195/228. Seulement grâce à notre Padicha [le sultan], étant sauvé des mains des bandits Kurdistan, fut peut-être, ainsi reconquis,...» : Sevgen p. 106.
(ejkiyu),
le
PORTRAIT
D'UN
ÉMIR
KURDE
81
califes abbassides. En faisant citer son nom, lors de la prière, il voulait probablement souligner la noblesse de son ascendance. En outre, il est difficile d'en déduire une contestation de la souveraineté du sultan, d'autant plus qu'il s'affirmait à chaque occasion comme l'un des vrais serviteurs de ce dernier. L'attachement de Beder Khan bey à la spécificité kurde paraît évident. Lors de la réception de Stevens, il ne manqua pas de se présenter avec un costume traditionnel kurde et de choisir le kurde comme la langue de communication avec le vice-consul, sous prétexte qu'il ne savait pas parler le turc. Mais, au cours de la conversation, il se mit à parler en turc. Quant à l'élargissement de son influence, Beder Khan bey avait le goût du pouvoir et était un homme ambitieux. Il n'y a pas de doute qu'il souhaitait préserver l'influence qu'il avait pu acquérir sur d'autres chefs du Kurdistan, car celle-ci mettait fin, selon lui, aux troubles et était profitable au gouvernement du sultan, dans la région où les fonctionnaires envoyés de Constantinople n'arrivaient pas à faire régner l'ordre. Si être sujet du sultan et défendre l'Empire contre les ennemis extérieurs suffit à définir l'Homo Ottomanicus, alors Beder Khan bey l'était sans doute. Ce qui explique la volonté de Beder Khan bey de se battre pour l'Empire contre les Russes lors de la guerre de Crimée. On ne peut donc parler d'une contestation de l'autorité du sultan, l'autorité suprême des musulmans. Sa longue hésitation à prendre les armes contre les troupes du gouvernement, montre bien l'état d'esprit de l'émir kurde 1 . Bien que populaire et orgueilleux, il se trouvait plutôt dans une position défensive. Il était devant le dilemme de laisser son pouvoir et sa propriété héréditaire lui échapper ou de se résoudre à les défendre par la force. Sa prise d'armes contre l'armée ottomane n'était-elle pas une résistance contre le nouvel ordre qui tentait d'ériger un État « moderne » et centralisé calqué sur le modèle français et qui mettait en question la spécificité et les structures mêmes de la société kurde au sein de laquelle il bénéficiait d'une place privilégiée ? Il est difficile d'en déduire une manifestation nationaliste, d'autant plus qu'on ne remarquera par la suite aucune activité qui puisse confirmer cette hypothèse. Il sembla accepter le sort que le gouvernement lui avait imposé sans montrer le moindre signe de protestation. Le fait qu'il n'exerça pas de fonction au sein de l'administration était dû plus à sa déception et à son amertume vis-à-vis du gouvernement qu'à d'autres causes.
Hn 1842, lors d'un conflit entre Khan Mahraud et le pacha de Van, Beder Khan, sur la demande du dernier, se rendit sur le champ de bataille, mais quand il vit les troupes impériales envoyées d'Erzerum, il refusa de se battre contre elles.
Katerina TRIMI
LA FAMILLE BENAKIS : UN PARADIGME DE LA BOURGEOISIE GRECQUE ALEXANDRINE
Les Benakis, une famille bourgeoise grecque établie à Alexandrie d'Egypte, réussit à s'élever, pendant le dernier quart du XIXe siècle, au rang des familles grecques les plus riches et les plus importantes du pays. C'est un cas représentatif. Car sa montée avait suivi non seulement l'enrichissement collectif de la seconde vague de bourgeois grecs immigrés en Égypte, mais aussi le développement général de la parikia (de la colonie grecque). Emmanouil Benakis joua un rôle de protagoniste au sein de la parikia et de la Kinotis (communauté) alexandrines, dès la fin du siècle précédent et jusqu'en 1910, date à laquelle il s'installa à Athènes pour participer à la vie politique de la métropole. Une multitude de sources se réfèrent à sa vie 1 , mais cette étude prend quasi exclusivement appui sur deux textes rédigés par sa fille, Pinelopi Delta, écrivain d'alors. Il s'agit d'un journal de sa jeunesse 2 et d'une collection de souvenirs d'enfance écrite postérieurement 3 ; les deux présentent la vie quotidienne de sa famille et celle des autres familles du même milieu social ; ils sont, par conséquent, introuvables dans les archives et les publications de l'époque, mais on ne peut plus significatifs de la mentalité de cette classe bourgeoise grecque d'Alexandrie.
'D'autres textes furent consultés : P. Delta, Eleftherios Venizelos, Archive de Pinelopi Delta, n° 1, Athènes : Hermis, 1988 ; Trelandonis, Athènes : Hestia, 1970 ; Magas, Athènes : Hestia, 1973. Cet article était déjà écrit quand parut le n° 7 de l'Archive de Pinelopi Delta, Souvenirs 1921, Athènes : Hermis, 1996. 2 P. Delta, Souvenirs 1899, Archive de Pinelopi Delta, n°6, Athènes : Hermis, 1991. 3 P. Delta, Premiers Souvenirs, Archive de Pinelopi Delta, n° 3, Athènes : Hermis, 1989.
84
KATERINA
TRIMI
1. LES ORIGINES Emmanouil Benakis naquit en 1843 à Syros, île des Cyclades et centre commercial important de la nouvelle Hellade. Né à Chios, son père s'était fait connaître par ses efforts héroïques pour retrouver les membres de sa famille prise en esclavage après le désastre de Chios (1822) ; ayant perdu ses biens, il s'installe à Syros — île intégrée au Royaume de Grèce, alors que Chios faisait encore partie de l'Empire ottoman — , où il crée un grand magasin de textiles, pour l'essentiel importés de Liverpool et de Manchester 1 . Emmanouil, fils aîné de la famille, arrive à Alexandrie à l'âge de 23 ans et travaille dans le marché du coton. Il est embauché, quelques années plus tard, par la société gréco-britannique Choremis-Mellor et Compagnie, une maison de commerce qui exporte du coton en Angleterre, en particulier à Liverpool. Les frères Giannis et Dimosthenis Choremis étaient fils d'un notable et marchand de tissus chiote 2 . Vraisemblablement, l'origine géographique commune et l'appartenance au même réseau commercial du père Benakis et des Choremis sont à l'origine de l'embauche du jeune Emmanouil. D'ailleurs, comme les Chiotes avaient tendance à se marier entre eux 3 , les racines communes, apparemment, facilitèrent aussi le mariage, en 1870, de Emmanouil Benakis avec Virginia Choremis, la plus jeune des sœurs de ses patrons.
2. LES ANNÉES PRÉCÉDANT L'OCCUPATION ANGLAISE En 1876, l'entreprise Choremis-Mellor est dissoute pour laisser la place à une nouvelle ; Benakis devient l'associé de Dimosthenis Choremis et de Thomas Davies (ce dernier résidant à Liverpool) et fait entrer dans l'entreprise son plus jeune frère, Loukas. Après un séjour de presque deux ans à Liverpool (1876-78), jugé nécessaire pour la réorganisation du travail, la famille rentre à Alexandrie ; bien entendu, Emmanouil continue à se rendre souvent en Angleterre 4 . La seconde résidence alexandrine était un appartement occupant un étage d'une okella (en arabe ouakalla, immeuble), au coin de la rue Sésostris et
1
Premiers souvenirs, pp. 105-111. Premiers souvenirs, p. 112. •'cf. V. Theodorou, « Bienfaisance et intégration sociale », Histórica, n° 7, déc. 1987, p. 138 ; A. Pallis, Grecs partis à l'étranger, Athènes : 1954, p. 24. 4 Premiers souvenirs, pp. 14 et 3. 2
LA F A M I L L E
BENAKIS
85
Cherif Pacha 1 . À l'époque, un grand nombre de familles bourgeoises grecques réputées habitaient dans de grandes okelles de ce quartier2, les villas du fameux « Quartier grec » n'étant pas encore construites. Cependant, les Benakis ne faisaient pas encore partie de la très haute bourgeoisie grecque. Emmanouil n'avait pas encore amassé son immense fortune. Ainsi le mobilier, en principe de provenance anglaise, était « distingué mais simple ». Pendant le séjour à la résidence de la rue Cherif, Virginia employait deux domestiques seulement et était obligée de se charger de certains travaux ménagers ; de plus, elle cousait elle-même la plupart des vêtements des enfants et du linge de la maison3. Il est significatif qu'à cause de sa garde-robe relativement limitée, elle évitait souvent d'accompagner son mari aux bals où le couple était invité (car les autres femmes s'y rendaient en « portant chaque fois une nouvelle toilette ») 4 . Il semble que les invitations reçues étaient assez fréquentes, mais les Benakis donnaient seulement une grande réception par an. Et ils n'avaient pas habitué leurs enfants à des fêtes extravagantes et à des cadeaux chers 5 ; c'est pourquoi les fêtes de certains enfants grecs riches, où d'ailleurs ils allaient rarement, les impressionnaient par leur faste. 6 Pinelopi se rappelait vivement une fête que Konstantinos Synadinos avait donnée pour tous les enfants de la haute société à Noël de 1879 ou de 1880, « qui devait lui avoir coûté une fortune » : « Je me souviens des tas de pâtisseries, de gâteaux, de chocolats, de fondants, de marrons glacés, des pyramides de glaces, des séries de bouteilles en cristal pleines de limonade, d'orangeade, d'orgeat, et des tasses de chocolat chaud. Je me rappelle cet arbre, illuminé et décoré 1 Premiers souvenirs, pp. 3, 6,44, et 74 ; voir aussi E. Venizelos, p. 11, note 1. "Pinelopi se rappelle qu'à l'étage du dessous habitait Mme Negrepontis-Synadinos et que les riches familles de Konstantinos Zervoudakis et de Konstantinos Synadinos occupaient chacune un étage de l'okella en face de celle des Benakis. L'entreprise familiale, Choremis-Benakis, était également logée au rez-de-chaussée de cette même okella d'en face. 3 Premiers souvenirs, pp. 3-6, 25. 4 Premiers souvenirs, p. 77. c J Premiers souvenirs, pp. 94, 79. faut dire que les enfants Benakis étaient éduqués plus sévèrement que les autres enfants de leur milieu social. Ce n'était pas seulement pour des raisons économiques que les Benakis ne faisaient pas de fêtes et de cadeaux extravagants. Les principes selon lesquels leurs enfants étaient élevés excluaient tout élément qui aurait pu les gâter ; ils étaient souvent punis, même corporellement, et les parents sont présentés par Pinelopi comme des parents durs, distants et guère tendres (Premiers souvenirs, pp.11-2, 21, 23-5, 40, 100). Cette attitude sévère dérivait certainement du caractère des parents et ne peut être considérée comme un « exemplum » des conceptions pédagogiques de tous les bourgeois grecs de l'époque.
86
KATERINA
TRIMI
d'argent et d'or, un vrai sapin, qui touchait le plafond, et une multitude de jouets tout autour, un pour chaque enfant invité. Le tout était importé de l'étranger — le sapin y compris, naturellement. Quant aux jouets, tirés au sort, le plus simple était par exemple une poupée aussi haute qu'un enfant de six ans, portant des vêtements luxueux ; il y avait même des chambres de poupée, de dimension à permettre à un enfant d'y entrer, de s'y asseoir, meublées et décorées de vrais meubles en bois, de rideaux en soie, de miroirs, de dentelles, de bibelots miniatures Ce qui mérite d'être souligné, c'est que les autres enfants n'étaient pas du tout impressionnés par ces cadeaux que Pinelopi enviait. Évidemment, quoique pas encore très riches, les Benakis n'étaient privés de rien. D'abord, comme nous le verrons plus en détail par la suite, rien ne manquait à l'éducation des enfants. Puis, leur table était toujours richement garnie de ce qu'il y avait de plus fin et de plus rare. Pinelopi raconte que, pendant les repas de famille, elle se sentait mal à l'aise en se comparant aux mendiants égyptiens qu'elle voyait et aux pauvres grecs, dont parlaient les adultes (mais qu'elle n'avait jamais rencontrés). À midi et le soir, on servait à table deux plats différents, des horsd'œuvre parmi lesquels du caviar et des olives apportées de Chios, et toujours plusieurs espèces de fruits 2 . En outre, à part les déplacements pour affaires fréquents d'Emmanouil, la famille n'était pas privée du luxe des voyages ; et les étés, où elle restait en Égypte, on louait pour les vacances une résidence à Ramleh, où il faisait plus frais qu'en ville et où on pouvait se baigner dans la mer 3 .
3. LA RÉVOLTE DE 1882 En juin 1882, les Benakis comme d'autres familles bourgeoises résidaient à Ramleh. Le jour où la révolte d'Orabi éclata, ils accueillaient des visiteurs importants : le capitaine Kanaris et les officiers du navire militaire Hellas qui avait appareillé au port d'Alexandrie. À leur retour en ville, les visiteurs apprirent que le peuple s'était révolté et se réfugièrent sur leur bateau. 'Premiers souvenirs, pp. 74-5. Premiers souvenirs, p. 37. 3 Premiers souvenirs, pp. 15, 50, 115. À l'est d'Alexandrie, Ramleh était alors une villégiature, où quelques maisons d'été avec des jardins étaient construites dans le désert. Il n'y avait pas de rues ; la seule façon de se déplacer était à dos d'âne. Benakis continuait à travailler pendant tout l'été et il allait au bureau à dos d'âne et puis en train. 2
LA
FAMILLE
BENAKIS
87
Entre-temps, les nouvelles arrivèrent à Ramleh ; certaines familles grecques se rassemblèrent chez les Benakis, et Emmanouil leur donna des armes (il en avait plusieurs, vu sa passion pour la chasse) et leur fit une démonstration de leur emploi. À l'aube, un ami italien d'Emmanouil l'informa qu'il devait quitter la maison immédiatement, car le lendemain il serait probablement trop tard. Les Benakis atteignirent le port sans problème ; une barque grecque les transporta, afin de les conduire sur le navire Helias, où se trouvaient déjà de nombreuses autres familles grecques 1 . Comme 1'Helias fut rapidement encombré de familles d'Alexandrie et de l'intérieur du pays, Benakis, avec certains autres, réserva un petit bateau et alla en Grèce 2 . En automne, les Benakis rentrèrent à Alexandrie. Ils la trouvèrent détruite. Le seul immeuble de leur quartier qui avait été sauvé, avec des dégâts imperceptibles, était le leur 3 . L'occupation britannique favorisa les étrangers, et surtout ceux qui étaient associés à des capitaux britanniques, comme le furent les defteroclassati, cette deuxième génération de commerçants grecs immigrés en Egypte à laquelle appartenaient les Benakis. Fondée six ans auparavant, la société Choremis-Benakis et Compagnie connut un tel développement, qu'elle devint la plus importante maison commerciale exportant du coton d'Egypte, avec des dizaines de succursales à l'intérieur du pays. 4
4. LE CHANGEMENT SPECTACULAIRE DE LEUR VIE Peu après l'installation de l'armée britannique au pays, l'ensemble de l'élite grecque acheta des terrains à l'est de la ville, à la Porte Rosette, un emplacement alors désert et inhabité. Des résidences luxueuses entourées de jardins splendides furent assez rapidement construites dans ce quartier, devenu le plus chic de la ville et connu désormais sous le nom de « Quartier grec ». Le couple Benakis et leurs cinq enfants y emménagèrent en automne 18845.
' Hn cheminant vers le port, Emmanouil montra sa bravoure, négligeant le danger et s'arrêtant deux ou trois fois pour régler certaines affaires et se « rassurer de l'état de ses employés ». Premiers souvenirs, pp. 50-55, 65. 'Premiers souvenirs, p. 70. 4 I1 est à noter que les employés au bureau d'Alexandrie étaient toujours des Grecs, à l'exception d'un ou deux Anglais (voir Premiers souvenirs, p. 74). Premiers souvenirs, pp. 113-4, 121. 2
88
KATERINA
TRIMI
Leur villa avait trois étages ; des derniers l'on pouvait voir la mer. Ils étaient voisins de toute l'élite grecque. Par exemple, Theodoros Rallis occupait la résidence face à celle de Benakis ; à côté de ceux-ci habitaient les frères Synadinos, Konstantis et Themistoklis, et le frère de Virginia, Dimosthenis ; plus bas se trouvait la villa de Salvagos1. La construction de la résidence des Benakis était fastueuse. Ses planchers en marbre et en bois (matériaux inexistants ou rares en Egypte) étaient alors considérés comme un grand luxe. Notons qu'à l'époque, seulement deux autres résidences avaient un parquet en bois, celle de Sir Konstantinos Zervoudakis et de Sir John Antoniadis 2 . Les meubles, les bibelots, tout, même les livres qui remplirent les rayons de la bibliothèque, étaient commandés en Angleterre3. La cave débordait de tout ce que l'on pouvait désirer, spécialement de boissons, de délicatesses, de fruits secs, de gâteaux et d'autres mets grecs, qu'on faisait importer4. Virginia ne s'occupait plus du ménage. Elle surveillait seulement le nombreux personnel de la maison : à part la nourrice italienne des deux petits, Pinelopi énumère encore sept domestiques, grecs, italiens (dont au moins une avait appris à parler le grec) et arabes 5 (qui communiquaient en grec ou en italien avec leurs patrons)6. La famille était entrée dans son époque de grand essor. Elle participait plus activement à la vie mondaine, surtout après 18907. On se rendait visite quotidiennement. L'élite alexandrine se retrouvait régulièrement chez les Benakis le dimanche, qui était leur jour fixe 8 , et presque
'Premiers souvenirs, pp. 144 et 166 ; Souvenirs 1899, pp. 450-1. Premiers souvenirs, pp. 1Y5A. 3 Premiers souvenirs, p. 213. 4 Premiers souvenirs, pp. 140-2. 5Dans Magas, les domestiques arabes n'ont pas de qualification particulière, ils sont là pour aider surtout le jardinier, mais aussi le reste du personnel et, naturellement, sont chargés des tâches les plus lourdes ; leur grec leur permet de communiquer sans problème avec les patrons et les autres domestiques, quoiqu'il ne soit pas correct et que leur prononciation soit mauvaise (voir Magas, pp. 39-40, 4 8 ^ 9 , 105-110). Premiers souvenirs, p. 162. ^Premiers souvenirs, p. 202. Notons ici que cette vie mondaine était si intense et si libertine, qu'en Grèce on avait d'Alexandrie une image de débauche et pour cette raison on était méfiant, on hésitait à conclure des mariages entre des jeunes hommes de la métropole et des jeunes filles alexandrines : Souvenirs ¡899, pp. 337, 352, 359. "C'était une habitude répandue parmi les familles de leur milieu d'avoir tel jour fixe pour les visites ; la sœur de Pinelopi, mariée, instaura un signal pour toutes leurs connaissances : pour leur rappeler le soir où elle recevait, elle allumait un abat-jour rouge près de la fenêtre : Souvenirs 1899, pp. 131,263. 2
LA F A M I L L E
BENAKIS
89
tous les soirs des amis plus intimes y étaient invités1. Comme il était de coutume dans la bourgeoisie alexandrine, les aprèsmidis on faisait une promenade 2 en fiacre et, dans le cas des jeunes hommes, aussi à cheval 3 . En été, on allait prendre des bains de mer à San Stefano et puis on passait quelque temps dans un café à côté, construit littéralement sur la mer, le
Cazino4.
On allait souvent aux courses et aux jeux de tennis ; on allait aussi fréquemment au théâtre voir une pièce ou un spectacle de ballet, assister à un opéra ou un concert, installé dans « sa » loge privée 5 . Il faut dire que ces sorties, comme d'ailleurs les visites aux expositions, étaient perçues avant tout comme des circonstances mondaines et moins comme des événements culturels ; et ceci non seulement par les Benakis, mais par l'ensemble de la bourgeoisie alexandrine6. Enfin, les Benakis se présentaient, en général, à toutes les réceptions de l'élite de la ville — qui étaient innombrables — et organisaient eux-mêmes régulièrement de grands dîners et des bals fastueux 7 . Pinelopi décrit entre autres un bal masqué qui eut lieu chez eux en 1887 ; elle le compare à un conte des Mille et une Nuits. Elle écrit : « Toute la maison était décorée de fleurs [...] pareille à un jardin ; les cheminées, les consoles étaient couvertes de roses aromatiques, d'hyacinthes, comme des parterres... Les parures des hôtes et des invités déguisés étaient très riches. Ils portaient des costumes en soie et en velours, et les couronnes royales étaient garnies de vrais diamants ; pourtant, personne n'en était vraiment impressionné » 8 . ^Souvenirs 1899, pp. 95, 117, 119, 126,42-3,46, 85-86, 90-1, 95, 97-99, 101-3, 115, 125-6, 12930,130, 134-6, 138, 144, 147-8,163, 165, 168, 172, 174, 176-7,183, 185-6, 196, 281, 300. fy L'intérêt de cette habitude, à part l'exhibition des nouveaux « vêtements de promenade », était que ce trajet précis donnait aux amoureux une occasion de se croiser et d'échanger des signes et des messages. Mais lorsque les enfants étaient encore petits, ils sortaient les après-midis avec les gouvernantes pour leur promenade. La célèbre corniche d'Alexandrie n'existant pas encore à cette époque, la vie était tournée plutôt vers l'intérieur. Les enfants Benakis allaient en carrosse jouer dans un des trois jardins qui se trouvaient près du Canal Mahmoudieh : le magnifique jardin d'Andoniadis (qui ouvrait ses portes pour le public chaque vendredi), le jardin du Khédive (plus tard connu comme jardin de Nousha), et le Jardin Arabe, le moins soigné de tous ; autrement, ils allaient à pied au centre-ville ou dans les alentours inhabités : Premiers souvenirs, p. 17,79. 3 Premiers souvenirs, p. 208 ; Souvenirs 1899, pp. 20,23, 24, 38,40, 84, 127, 130, 175, 295, 298. ^Souvenirs 1899, pp. 177, 181, 186-7,191-2,196, 204, 208-11, 220-1, 226. ^Souvenirs 1899, pp. 181,276, 223,17, 30, 31, 33, 271, 286, 288. 6 Souvenirs 1899, pp. 176,42. 1 Premiers souvenirs, pp. 169 et 211 ; Souvenirs 1899, pp. 27, 29, 39, 52, 61, 63, 72, 105, 152, 437. O °Premiers souvenirs, pp. 165-6.
90
KATERINA
TRIMI
Le carnaval était toujours très bien célébré ; le fils aîné d'Emmanouil, comme d'autres jeunes gens de son rang, finançait ou participait au financement d'un char à chaque défilé organisé 1 . Naturellement, les voyages d'affaires aussi bien que d'agrément en Europe et en Grèce continuaient ; les étés, quand on ne quittait pas l'Égypte, on s'installait dans une maison qu'Emmanouil avait fait construire à Ramleh. Vers la fin du siècle, celui-ci possédait déjà une troisième résidence, cette fois à Kifissia, villégiature proche d'Athènes ; plus tard, il en acheta une quatrième au centre ville, près du palais, où il vécut à partir de 1910 2 .
5. L E S C O M P A T R I O T E S BIENFAISANCE
NON
BOURGEOIS
ET
LA
Les enfants Benakis, comme les autres enfants bourgeois grecs, n'avaient aucun contact avec les compatriotes de leur âge qui n'appartenaient pas à leur classe sociale, ils ne les rencontraient nulle part. Il est à noter que les écoles de la Kinotis, quoique financées par les bourgeois grecs, n'étaient alors destinées qu'aux classes inférieures 3 . Le contact de leurs parents avec les compatriotes pauvres était limité à des actes de bienfaisance. Les Benakis, avant même de devenir une des plus riches familles de la ville, participaient à l'organisation de collectes entre les Grecs aisés en faveur des Grecs pauvres ; leurs donations se faisaient, toutefois, en grande partie en nature. Virginia s'occupait beaucoup de la couture des draps pour l'hôpital grec ou pour les vêtements des pauvres. Cette pratique allait cesser définitivement lorsque Pinelopi devint une jeune demoiselle 4 . Au fur et à mesure que la fortune des Benakis s'accroissait, et plus particulièrement après leur installation au Quartier grec, leurs donations se limitèrent à des sommes d'argent. Virginia fut une des fondatrices de F Association Grecque Philanthropique des Dames à Alexandrie et y consacrait une bonne partie de son temps libre, qui était alors plus que suffisant, grâce au personnel domestique nombreux 5 .
^Souvenirs Premiers 3 Premiers 4 Premiers 5 Souvenirs 2
1899, p. 50-1, 61-62. souvenirs, p. 115 ; Souvenirs 1899, p. 440. souvenirs, pp. 197-8. souvenirs, p. 34 et Souvenirs 1899, p. 276. ¡899, pp. 276, 285, 289.
LA F A M I L L E
BENAKIS
91
À part les collectes régulières de l'Association, pour rassembler des fonds, on organisait des concerts philanthropiques, où jouaient et chantaient des jeunes hommes et des jeunes filles de la haute société grecque, indépendamment de leur talent et de leurs vraies connaissances musicales ; c'était un événement de la vie mondaine. On organisait aussi des représentations théâtrales ; les bals philanthropiques étaient également fréquents1. L'activité d'Emmanouil était tout aussi intense. Élu membre du Comité de la Kinotis d'Alexandrie déjà avant l'occupation britannique, il en devint son président en 1900. Après son élection, il offrit des sommes énormes à la Kinotis ; non seulement il finança la construction d'un orphelinat pour filles et d'un réfectoire pour les élèves pauvres (qui ouvrirent leurs portes en 1909), mais il laissa aussi un legs qui garantissait le fonctionnement continu de ces institutions. Son œuvre de bienfaisance fut poursuivie par ses fils Andonis et Alexandros, qui demeurèrent à Alexandrie après son départ en 1910 pour s'occuper de l'entreprise familiale. Le profil qu'Emmanouil cultivait, comme tous les évergètes contemporains d'ailleurs, était celui de l'homme qui s'intéressait à la parikia et la soignait comme un père soigne ses enfants, qui offrait son appui sans attendre aucun bénéfice et ne désirait que la gratitude de ses enfants adoptifs2. Cependant, tous les indices montrent que Benakis — ainsi que les autres grands bienfaiteurs de la Kinotis— étaient des bourgeois plutôt conscients de leurs intérêts de classe 3 ; ils s'étaient certainement aperçu des avantages dont ils bénéficieraient s'ils contribuaient à maintenir vivant le sentiment national de la parikia et s'ils conservaient celle-ci unie du point de vue ethnique. Us savaient bien qu'ils ne pouvaient pas compter sur l'aide du petit pays qu'était la Grèce pour protéger leurs intérêts ; le consul grec n'avait pas de poids ; ainsi renforcèrent-ils l'institution grecque locale qui offrait du prestige à ceux qui la géraient. Il est caractéristique à cet égard que si Lord Cromer, Haut Commissaire en Egypte à l'époque, avait discuté sur un sujet qui concernait les Grecs avec Emmanouil, il jugeait inutile de rencontrer le consul de Grèce pour parler du même sujet 4 .
1
Souvenirs 1899, pp. 44, 211-9 et 437. Premiers souvenirs, pp. 19, 59. Cette bourgeoisie avait une nette conscience de classe et souhaitait le développement capitaliste de la Grèce. C'était pour cela que les Benakis et leur cercle déclaraient ouvertement détester les titres aristocratiques et leurs emblèmes (Souvenirs 1899, p. 230), soutenaient Tricoupis et puis Venizelos (c'est-à-dire les forces politiques qui représentaient en Grèce le progrès technologique et institutionnel, donc les intérêts de leur classe) et méprisaient les gens du statu quo traditionnel en Grèce (Premiers souvenirs, p. 152). 4 Premiers souvenirs, pp.151-2, 199 ; E. Venizelos, p. 7. 2
92
KATERINA
TRIMI
6. EUROPÉANISME, VOIRE ANGLOPfflLIE La bourgeoisie grecque d'Alexandrie était non seulement familiarisée avec l'Europe à travers ses voyages 1 , mais avait aussi de tout point de vue un caractère de classe européanisée. En particulier les defteroclassati, liés avec les intérêts anglais déjà bien avant 1882, étaient de fervents anglophiles et leur vie était profondément influencée par le mode de vie anglais. Cet européanisme se voyait même aux habitudes nouvelles introduites dans les cérémonies religieuses : dans ces milieux, les mariages s'effectuaient non plus à l'église mais dans les résidences ; on y désignait des demoiselles d'honneur (tandis que la cérémonie grecque orthodoxe prévoit seulement des enfants pour ce rôle) 2 ; la chorale de la Cathédrale de la Kinotis (institution gérée précisément par cette classe), chantait selon le système occidental et non selon le système byzantin qu'on jugeait sans grâce3. Chez les Benakis comme dans toutes les maisons grecques aisées, les initiales personnelles ou familiales cousues ou gravées sur les vêtements, le linge, l'argenterie ou la porcelaine, étaient toujours en lettres latines ; car celles-ci étaient considérées comme nobles, tandis que les caractères grecs étaient tenus pour vulgaires. Les initiales grecques étaient destinées seulement aux sous-vêtements des domestiques 4 . Pinelopi raconte que « tout ce qui était anglais était extrêmement apprécié » ; des meubles et des tissus jusqu'aux savons, aux aiguilles et aux boutons, tout venait d'Angleterre et « on grandissait avec un respect pour tout produit anglais » 5 . Emmanouil, comme tout homme d'affaires respectable, s'informait en lisant un quotidien anglophone, VEgyptian Gazette6, et non par les journaux grecs, publiés en Égypte, lus plutôt pour leurs pages de nouvelles de la vie mondaine. Les hommes de son milieu social, imitant le modèle anglais, choisissaient au moins une activité sportive comme loisir préféré (hobby). Emmanouil aimait
'Toute la famille Benakis était familiarisée avec l'Europe. À part le séjour à Liverpool de 1876 à 1878, et les voyages d'affaires fréquents d'Emmanouil en Angleterre, les Benakis avaient voyagé en Europe à d'autres occasions. Virginia souffrait de rhumatismes. Les étés de 1879 à 1883 le couple laissait les enfants avec des oncles et partait pour les bains de Virginia à Aix-lesBains et puis en Angleterre pour des affaires. Les enfants passèrent aussi un de ces étés à Gratz en Autriche (Premiers souvenirs, pp. 47-8, 57, 63, 81, 85, 93). En 1889, l'année du centenaire de la Révolution française, toute la famille se rendit à Paris pour visiter l'exposition universelle. Puis, on voyagea pour les affaires de Benakis à Liverpool et à Tiny-y-Coed, où Emmanouil et Loukas avaient loué une ferme pour les vacances (Premiers souvenirs, pp. 217-9). En été 1892, les trois enfants les plus jeunes étaient allés, avec leurs parents, en Suisse ; en 1894, Pinelopi accompagna seule le couple en Italie et en Suisse (Souvenirs 1899, pp. 35-6, 301-4). ^Souvenirs 1899, p. 28. J Premiers souvenirs, pp. 148-9. ^Premiers souvenirs, pp. 129-130. Premiers souvenirs, pp. 67-8. ®Premiers souvenirs, p. 207.
LA
FAMILLE
BENAKIS
93
la chasse. Sa réputation à Alexandrie était celle d'un as du fusil 1 . Son fils aîné continua plus tard la tradition 2 . Quant aux enfants, garçons et filles, ils jouèrent avec leurs cousins et amis au croquet et au tennis 3 . Lorsque les fils de Benakis grandirent, ils pratiquèrent presque tous les sports nobles de l'époque : équitation, criquet, polo, football 4 . Pendant les soirées entre amis, les hommes jouaient à un jeu de cartes anglais, le whist, l'ancêtre du bridge. Les femmes s'adonnaient aussi aux cartes, surtout un jeu appelé baccara, ressemblant au poker. Presque toujours, les deux jeunes filles de la famille jouaient au piano 5 et chantaient des airs classiques ou des chansons (surtout françaises) 6 . La préparation pour la vie mondaine à l'européenne commençait dès l'enfance. Les soirées d'hiver, dès l'âge de sept ou huit ans, les enfants de la haute société formaient de petits groupes et se rassemblaient à tour de rôle dans les maisons de leurs parents pour suivre des cours de danse accompagnés par un petit orchestre de trois ou quatre instruments ; leur professeur de danse était italien 7 . Bien qu'un assez grand nombre de gouvernantes anglaises fussent prouvées alcooliques, irresponsables, ou dangereusement sévères, les parents Benakis les préféraient à celles des autres nationalités 8 . Ce ne fut que lorsque les enfants grandirent — probablement après avoir découvert qu'une gouvernante anglaise avait séduit un cousin — qu'ils en choisirent une Française ; mais, cette préférence n'était pas exceptionnelle : les noms des gouvernantes des enfants, avec lesquelles Pinelopi jouait dans les jardins de la ville, étaient anglais aussi 9 . C'est pour cette raison que les enfants Benakis, même les très petits, s'exprimaient en anglais aussi bien qu'en grec. Parfois,
À la période des cailles, en septembre, Emmanouil se réveillait à 4 heures du matin, indépendamment de l'heure où il s'était couché et du travail qui l'attendait, et partait en fiacre our Gabari, qui se trouvait à une demie heure de la ville et où passaient les nuées de cailles. Premiers souvenirs, p. 46 ; Souvenirs 1899, p. 53. 3 Premiers souvenirs, pp. 47 et 219. 4 Premiers souvenirs, p. 159. •5À l'époque, les cours de piano étaient essentiels pour une bonne éducation des filles. Chacune des deux sœurs l'étudiait une heure le matin et une heure tôt dans la soirée. Lorsque la famille déménagea au Quartier grec, on acheta un deuxième piano à demi-queue qu'on installa dans un des salons (le « salon égyptien », d'après le style des meubles). L'ancien piano était au troisième étage, près de leur salle de lecture et c'était là qu'elles s'entraînaient (Premiers souvenirs, pp. 185-7). 6 Souvenirs 1899, pp. 16, 42-3, 46, 85-86, 90-1, 95, 97-99, 101-3, 115, 125-6, 129-30, 130, 1346,138, 144, 147-8, 163, 165, 168,172, 174,176-7, 183, 185-6, 196, 281, 300. Premiers souvenirs, pp. 167-8. 8 Premiers souvenirs, pp. 16-8, 65, 79. Voir aussi Trelandonis, pp. 17-18, 25, 39-55, 69-73, 8488, 133-144. ^Naturellement nous devons prendre en compte que c'étaient plutôt les amitiés entre les gouvernantes qui définissaient les amis que les enfants rencontraient pendant les promenades ; et il semble logique que les gouvernantes fréquentent des compatriotes.
94
KATERINA
TRIM1
lorsque par exemple ils ne voulaient pas que les domestiques suivent leur conversation, ils communiquaient en anglais entre eux 1 . Ils avaient appris à bien lire et écrire l'anglais avant le grec. Plus tard, juste avant leur installation au Quartier grec, les parents Benakis décidèrent de s'occuper sérieusement de l'enseignement de la langue française à leurs enfants, qui alors « ne connaissaient même pas un mot de français » 2 . Leur fils aîné fut inscrit chez les Jésuites — mais finalement pour une période courte — et une institutrice française, qui allait vivre avec eux et aussi jouer le rôle de gouvernante pour les plus petits, fut embauchée 3 . Il est intéressant de voir ce que Pinelopi raconte à propos de cette nouvelle arrivée. « Nous la regardions méfiants, ayant des préjugés à cause de nos positions anglophiles et les paroles anti-françaises de notre professeur d'anglais » 4 . Cependant, cette institutrice réussit, après quelques années, à faire s'exprimer Pinelopi plus aisément en français qu'en anglais. Tous les enfants bourgeois grecs apprenaient l'anglais et le français en suivant des cours particuliers, ou dans des écoles étrangères 5 (les deux fils Benakis, en particulier, terminèrent leurs études secondaires 6 dans un internat connu, Rossall school, près de Liverpool, où leur oncle gérait la succursale de la société 7 ) ; de plus, ils apprenaient l'italien à travers le contact avec des citoyens ou des domestiques italiens ; en revanche, ils ignoraient presque complètement l'arabe. En fait, il n'y avait pas besoin d'apprendre la langue du pays, puisque les domestiques égyptiens — les seuls Égyptiens qu'ils fréquentaient — parlaient suffisamment bien le grec ou l'italien 8 . La plupart de ces enfants trouvaient plus commode de communiquer entre eux en anglais ou en français ; il existait des familles grecques (qualifiées de « xénomanes » par Pinelopi) où même les parents ne parlaient pas grec avec leurs enfants 9 .
1
Premiers souvenirs, pp. 5), 60. Voir aussi Trelandonis, p. 115. Souvenirs 1899, p. 6. 3 Premiers souvenirs, p. 220. 4 Premiers souvenirs, p. 115-6, 118-9, 121-122 et 136. 5 L e s écoles de la Kinotis financées précisément par cette même bourgeoisie grecque n'étaient pas considérées comme ayant un niveau convenable pour ses enfants, garçons ou filles (Premiers souvenirs, p. 147). Elles étaient destinées seulement aux classes moyenne et inférieure. Plus tard, cette bourgeoisie offrit des sommes importantes pour l'amélioration des écoles de la Kinotis, de manière que désormais elles soient bien meilleures que les écoles de Grèce. Les petits-enfants de la génération d'Emmanouil suivirent les écoles de la Kinotis (Premiers souvenirs, p. 197-8), mais seulement au niveau secondaire. Car le primaire était trop euplé d'enfants pauvres et la qualité de l'enseignement n'était pas aussi élevée. Seuls les garçons continuaient leurs études secondaires hors de la maison. En ce qui concerne les filles, qui n'allaient jamais travailler, l'essentiel était de compléter leur formation par des cours de musique et des ouvrages à l'aiguille ; et cela était fait à la maison. 7 Premiers souvenirs, p. 195-9 ; Souvenirs 1899, pp. 35, 316. 8 Premiers souvenirs, p. 217. 9 Premiers souvenirs, p. 146. 2
LA
FAMILLE
BENAKIS
95
7. LES LIENS AVEC LA MÉTROPOLE Ce n'était pas le cas dans la maison des Benakis : les parents communiquaient exclusivement en grec avec la famille et les amis. Certainement, le fait que le couple constituait la première génération de la diaspora jouait un rôle important. La mère avait appris trop tard les langues étrangères et n'arriva jamais à les maîtriser suffisamment. Le père était un autodidacte et quoiqu'il n'ait pas eu de problème à parler le français, l'italien, et surtout l'anglais (en plus de l'arabe oral), il ne les préférait guère au grec1. Le couple donna à tous ses enfants des noms grecs 2 , alors que la grande majorité des familles bourgeoises grecques choisissaient, ou au besoin inventaient, des diminutifs anglais pour leurs descendants3. Même les enfants Benakis entre eux, du moins pendant leur adolescence et leur première jeunesse, utilisaient des diminutifs anglais. Leurs amis intimes les appelaient avec les mêmes diminutifs 4 . Néanmoins, leur éducation grecque prévalut manifestement et ils abandonnèrent rapidement cette habitude au nom de leur patriotisme passionné. Cette éducation grecque consistait d'une part en un apprentissage programmé du « grec correct ». Les Benakis insistaient pour que tous leurs enfants suivissent des cours de grec tous les jours. Le fils aîné, Andonis, fut inscrit au début dans une école grecque privée d'Alexandrie, puis, à l'âge de neuf ans, il passa, pour deux années scolaires, dans un internat à Athènes 5 . Les autres enfants faisaient leurs études primaires à la maison, en suivant des cours particuliers6.
1
Premiers souvenirs, pp. 117, 142-3. Souvenirs 1899, pp. 172, 241, 264. - D'ailleurs, ils appelaient même leurs animaux domestiques avec des noms anglais, semble-t-il (voir Magas, p. 43, 51). Dans Souvenirs 1899, Pinelopi est appelée Pen ou Len, sa sœur Alexandra Alex et son frère Alexandros Alec ; voir pp. 227, 238, 286-7, 316, 318. 5 'Premiers souvenirs, pp. 81-2, 84, 94 et 147. 6 C o m m e la langue que leur enseignaient les institutrices grecques était le grec ancien et la katharevoussa, un idiome proche de la koiné (et par conséquent très différent du grec parlé), qui était établi comme langue officielle par l'État grec, les enfants détestaient profondément les cours de grec. Leurs deux institutrices, incompétentes, au moins du point de vue pédagogique (bien que la seconde ait eu une excellente réputation et fût directrice de l'École des filles de la Kinotis), renforcèrent ce sentiment de répugnance pour la langue grecque écrite. Pinelopi et ses frères et sœurs adoraient lire des livres d'enfants en anglais et plus tard des livres français, mais ne touchaient pas aux livres grecs. En fait, ils se sentaient très mal à l'aise à cause de cette attitude, puisqu'elle était contradictoire avec leur conscience nationale. Toutefois, ce sentiment de culpabilité n'améliorait pas leur relation avec la langue grecque écrite (Premiers souvenirs, pp. 27-8, 45, 47 et 144-6). Pinelopi, jusqu'à la fin du siècle, trouvait très fatigante et sans aucun plaisir la lecture de livres grecs et rédigeait presque toujours ses journaux, nouvelles et lettres en français et plus rarement en anglais. Ce fut lorsqu'elle entra dans le milieu progressiste des intellectuels qui soutenaient la langue parlée, la dimotiki, qu'elle fut soulagée, en se rendant compte qu'il était possible d'utiliser à l'écrit la langue vivante (Premiers souvenirs, p. 160 et 213) ; désormais, elle n'eut jamais recours à une autre langue pour ses textes. 2
96
KATERINA
TRIMI
Néanmoins, la partie essentielle de leur éducation grecque n'était pas le curriculum scolaire. Leur famille leur avait appris très tôt à aimer la « patrie » ; dès leur enfance, ils étaient imprégnés des histoires sur la lutte des Grecs pour l'indépendance1. Il est à remarquer combien restent gravés dans la mémoire de Pinelopi les jours où les Benakis, à cause de la révolution d'Orabi, s'étaient réfugiés sur le navire militaire grec. Les enfants étaient heureux : « Le bateau grec, le drapeau grec, les officiers et les marins grecs, la langue grecque parlée dans tous les coins du bateau, [...] quelle exaltation patriotique ! » Elle dépeint un jour où le navire tira 21 coups de canon, probablement pour une salve d'artillerie ; alors tous les enfants sur le bateau, naïfs comme tout enfant, se sentirent formidablement fiers comme si l'on avait gagné une bataille navale, tout simplement parce que les canons étaient grecs2. Sur le bateau qui les conduisit en Grèce, un autre incident démontre que leur nationalisme était parfois excessif. Un enfant, issu d'un mariage mixte entre un Anglais et une Grecque, accusa un garçon de père et de mère grecs pour une faute que celui-ci n'avait pas commise apparemment. Tous les autres ne pardonnèrent pas cette inconvenance au petit Anglais pendant tout le voyage, voire le boycottèrent et ne jouèrent ni avec lui, ni avec son frère et sa sœur « car ils avaient commis le péché d'être nés Anglais ». Pinelopi explique l'incident ainsi : malgré le respect pour les produits anglais, l'éducation des enfants demeurait grecque et lorsque leur identité grecque affrontait un élément étranger, leur sentiment national les poussait jusqu'au chauvinisme3. À la fin de ce voyage en bateau — comme d'ailleurs chaque fois qu'elle allait en Grèce —, Pinelopi était émue jusqu'aux larmes quand on approchait de l'arrivée et qu'on distinguait à l'horizon les montagnes grecques ; il en était de même lorsqu'on débarquait sur le sol de la patrie 4 ; car elle se sentait « grecque de pied en cap » 5 .
'Dans les romans que Pinelopi a écrits, prenant appui sur les souvenirs de son enfance et de sa jeunesse, même les jeux des enfants étaient inspirés de cette lutte pour l'indépendance (voir Trelandonis, pp. 124-133 et Magas p. 28) ; les « contes » de la grand-mère et des autres adultes concernaient quasi-exclusivement la Guerre de l'Indépendance grecque ou d'autres révoltes, postérieures, des régions qui n'étaient pas incorporées à l'Etat hellénique, parfois aussi des héroïsmes des Grecs pendant l'Antiquité (voir Magas, 71-3, 80-84, 124, 136-157, Trelandonis, d. 141. z Premiers souvenirs, pp. 55-6. 3 Premiers souvenirs, pp. 66-8. 4 Premiers souvenirs, p. 66. 5 Souvenirs 1899, p. 320.
LA F A M I L L E
BENAKIS
97
Lorsqu'en été de 1886 la famille se rendit à Chios, les enfants Benakis rencontrèrent pour la première fois des soldats turcs, car l'île était encore un territoire ottoman. « Nous les haïssions », écrit Pinelopi. « Quand nous passions devant la forteresse où s'exerçaient les soldats nous regardions de l'autre côté ostensiblement et avec mépris Naturellement, elle et ses frères, élevés en Egypte, n'avaient aucune expérience des autorités turques ; leur haine était le produit abstrait de leur sentiment fort d'appartenir à une nation qui était assujettie aux Turcs. Les récits familiaux exaltaient l'héroïsme du grand-père Benakis lors des années troubles après 1821, ainsi que le patriotisme d'Emmanouil qui, jeune, s'était engagé comme volontaire dans l'armée grecque2. Ce n'est pas un hasard si les enfants étaient profondément inspirés par la Grande Idée, l'irrédentisme grec. Les deux fils allèrent jusqu'à s'engager volontairement dans l'armée grecque quand la guerre de 1897 éclata. La défaite leur coûta énormément, toute la famille eut du mal à digérer cette évolution défavorable à leurs aspirations3 ; et lors des Guerres balkaniques, ils n'hésitèrent pas à se mettre de nouveau sous les armes 4 . À part les liens idéologiques, la famille cultivait les liens « physiques » avec la Grèce et le lieu d'origine : sa nourriture était principalement grecque ; elle visitait assez souvent le pays d'origine en été. Plus concrètement, en 1877, en 1886 et en 1895, ils étaient allés à Chios ; en 1879 et en 1881, les enfants avaient passé les vacances d'été au Pirée chez des oncles. D'ailleurs, comme pour d'autres familles grecques, Athènes fut leur refuge lors de la révolution d'Orabi, en 1882, et lors de l'épidémie de choléra, en 18835. Les Benakis visitèrent la capitale également en mai 1893. Deux ans plus tard, pendant l'été de 1895, la famille se rendit à Athènes pour fiancer Pinelopi avec Stefanos Deltas, qui, par la suite, suivit les Benakis à Chios 6 . Les Benakis ne s'occupaient pas des affaires égyptiennes (même la révolution d'Orabi est commentée par Pinelopi en quelques lignes). En revanche, ils s'intéressaient vivement à la vie politique de la Grèce ; et comme la majorité de la diaspora grecque, conscients de leurs intérêts de classe, ils
1Premiers souvenirs, p. 184. Premiers souvenirs, pp. 105-11, 231-5. 3 Souvenirs 1899, pp. 426 et 438-9 ; voir aussi Magas, pp. 242. 4 Dans Magas, les jeunes membres de la famille protagoniste suivent une personne provenant de Macédoine qui part pour rejoindre des troupes de la guerilla grecque qui y avaient pris les armes avant les Guerres balkaniques (pp. 268-9, 295-305). 5 Premiers souvenirs, pp. 47-8, 63-5, 68-70, 85, 93-4. 6 Souvenirs 1899, p. 320-371.
98
KATERINA
TRIMI
soutenaient le parti de Tricoupis 1 et par la suite celui de Venizelos — partis représentant la bourgeoisie progressiste et de tendance anglophile.
8. L'APPARTENANCE PARTICULIÈRE À L'HELLÉNISME DE L'ÉGYPTE Pinelopi met en valeur tout ce dont les Grecs d'Egypte pouvaient se flatter. Elle parle — sans exagérer d'ailleurs — de la Kinotis d'Alexandrie, de « la plus importante et la meilleure » de toutes les autres institutions communautaires étrangères. Elle se vante du pouvoir économique qui permettait à ses compatriotes non seulement d'être des bons vivants, de se comporter comme de « grands seigneurs », généreux et libéraux, mais aussi d'être braves et fiers face aux autres Européens. De plus, Pinelopi exalte le fait que dans tous les bourgs de l'intérieur les Grecs étaient les plus puissants parmi les étrangers ; que les meilleures qualités de coton, principale source de richesse du pays, étaient produites par des agronomes grecs ; que les Grecs d'Égypte avaient un esprit ouvert au progrès et adoptaient immédiatement les inventions de la technologie, comme le téléphone, l'électricité, etc. Elle ne manque pas non plus de mentionner le guide touristique allemand Baedeker, qui caractérisait les Grecs de l'Égypte comme des « aristocrates » 2 . Elle se justifie d'insister sur son appartenance à la bourgeoisie de la diaspora ; car cette appartenance lui donnait le droit d'être fière. À travers ce que les enfants Benakis voyaient pendant les voyages et les discussions qu'ils entendaient entre leurs parents et leurs oncles, ils avaient formé l'idée que les Grecs de la diaspora étaient grosso modo de meilleurs Grecs que les Grecs de la Grèce, supérieurs, plus civilisés, plus nobles, même plus patriotes 3 . Elle écrit : « Pour nous, les déracinés de la patrie, tout ce qui était grec était saint et sacré. L'adjectif grec était pour nous quelque chose de supérieur, d'extraordinaire, de lumineux, d'adorable » 4 .
1Premiers Premiers 3 Premiers 4 Premiers 2
souvenirs, souvenirs, souvenirs, souvenirs,
p. 152. pp. 77-8, 151-4, et 199. pp. 68-70, 85-93 et 152-3. p. 93.
LA
9. LES NÔTRES »
FAMILLE
RELATIONS
AVEC
BENAKIS
« LES
A U T R E S » ET
99 « LES
Les Égyptiens sont, en général, absents des mémoires de Pinelopi. D'ailleurs, ils ne sont jamais appelés Égyptiens, mais fellahs (paysans) ou Arapâdes, mot grec qui a une connotation nette de mépris et se réfère à ceux qui ne sont pas des blancs. Les seuls personnages cités sont des mendiants, des domestiques, des ouvriers non qualifiés et des fellahs sales 1 . À l'égard de la révolte d'Orabi, mentionnée brièvement, Pinelopi adopte un point de vue contradictoire ; son récit, bien postérieur aux événements, fait ressortir en même temps les préjugés profondément enracinés tout au long de son enfance et la position humaniste de son âge mur. L'auteur exprime son dégoût pour la violence de la foule, élément qui, à son avis, prouvait que ce peuple était trop arriéré. Elle les caractérise comme des « bêtes » qui supportaient des humiliations inconcevables sans guère protester et se révoltaient seulement si les circonstances leur donnaient un sentiment de force et de sécurité dans la foule. Par contre, elle avoue que le mépris des blancs envers les fellahs était exagéré, et réfute la conviction qu'ils avaient le droit de les battre et de les insulter comme bon leur semblait. Elle critique les Britanniques qui, après l'occupation, s'étaient présentés comme un pouvoir civilisé et avaient promis qu'ils ne maltraiteraient pas le peuple soumis, mais qui ne tinrent pas leurs promesses 2 . Bien qu'elle soutienne que les Égyptiens acceptaient en fait cette situation comme naturelle et étaient eux-mêmes persuadés de leur infériorité, elle conteste la brutalité des blancs. Ainsi, elle parle avec sympathie pour un des cadres grecs de l'entreprise familiale que les Arapâdes adoraient, car il les traitait de manière extrêmement humaine 3 . En second lieu, Pinelopi semble mépriser les Syriens. Elle et sa sœur, quand elles n'étaient pas satisfaites de leur habillement, elles avaient « le sentiment désagréable de ressembler à de petites Syriennes », qui étaient considérées comme la personnification du kitsch 4 . Plus tard, Pinelopi allait refuser catégoriquement l'amour enthousiaste d'un jeune et riche Syrien 5 .
Premiers souvenirs, pp. 10-11,141 ; voir aussi Magas, pp. 219, 227-9, où les fellahs sont décrits comme des hommes sans compassion pour les animaux, et Trelandonis, p. 145, où la poupée « arapina » de Pinelopi est caractérisée comme très laide. 2 Premiers souvenirs, pp. 51, 54 et 78. 3 Premiers souvenirs, p. 118. 4 Premiers souvenirs, pp. 82-3 ; Souvenirs 1899, p. 5. s'agit de Loulou Zogheb ; son flirt est décrit en détail dans Souvenirs 1899.
100
KATERINA
TRIMI
Quant aux filles du riche juif Menasce, qu'elles ne rencontraient qu'au Jardin du Khédive, elle les méprisaient aussi, en les considérant comme laides. Elles avaient même entendu dire un cousin que les Juifs étaient contrôlés par le diable 1 . Nous connaissons par un roman autobiographique que Pinelopi avait écrit sur cette période, Trelandonis, que les enfants Benakis s'étant fait des amis juifs au Pirée pendant leurs vacances changèrent complètement d'avis sur ce sujet 2 . N'empêche que leur opinion de départ fait penser que la bourgeoisie grecque d'Alexandrie n'était peut-être pas particulièrement ouverte aux Juifs. La famille étendue et les gens de la même origine géographique étaient le noyau principal pour tous les domaines de la vie : on y sélectionnait les associés, les employés, les fréquentations et les conjoints. Vu que la notion de nation était encore récente pour les Grecs, il était logique que la localité d'extraction demeurât un critère très important. Quant aux liens familiaux, le cas des Benakis et des Choremis est représentatif. Les deux familles entretenaient des relations vraiment étroites (leur alliance dans les affaires en était une raison supplémentaire, mais, réciproquement, elle était en grande partie le résultat des liens familiaux). Après l'occupation britannique, ils vivaient quasiment ensemble, puisque Emmanouil Benakis et Dimosthenis Choremis avaient construit l'un après l'autre leur villa sur le même terrain et avaient un jardin commun 3 . Les enfants jouaient ensemble et se fréquentaient beaucoup. Les amitiés en dehors de la famille étaient très limitées 4 . Enfin, plusieurs mariages étaient conclus entre les deux familles, à part celui d'Emmanouil avec Virginia : le frère d'Emmanouil, associé lui aussi à l'entreprise, s'était marié avec une fille dont la mère était d'origine Choremis 5 ; Alexandra, la première fille d'Emmanouil après l'échec de son premier mariage avec l'associé anglais de son pére, se maria avec un cousin Choremis ; de même, Andonis, son fils aîné se maria avec une cousine Choremis ; le frère de Virginia, Giannis Choremis, reçut en deuxièmes noces une cousine d'Emmanouil 6 . Ixs amitiés intimes et les mariages se faisaient en principe entre des Grecs. Les mariages mixtes étaient extrêmement rares. Les exceptions que mentionne Pinelopi concernaient des filles grecques mariées avec des étrangers,
1
Premiers souvenirs, p. 78. Trelandonis, pp. 49-63, 83-94. 3 Premiers souvenirs, p. 139. 4 Premiers souvenirs, p. 79. 5 Premiers souvenirs, p. 139. 6 Premiers souvenirs, p. 179. 2
LA
FAMILLE
BENAKIS
101
— jamais l'inverse 1 —, qui toujours appartenaient à une confession chrétienne 2 . De tels mariages avaient lieu seulement dans le cas où des intérêts économiques vraiment sérieux encourageaient l'union des deux familles. Ainsi, Alexandra Benakis se maria avec le fils d'un des associés anglais, Tom Davies ; et le premier candidat approuvé par les parents Benakis pour un mariage avec Pinelopi était le fils de l'autre associé anglais, Cecil Mellor 3 . Par contre, bien qu'un très riche jeune Syrien grec-catholique, de la famille Zogheb, montrât longtemps son amour pour Pinelopi, ses parents préférèrent la marier avec un Grec de situation financière moyenne, Stefanos Deltas. Je cite les paroles de l'oncle de Pinelopi à propos de ses fiançailles : « Tu es Grecque et patriote, marie-toi avec un Grec. Tu ne serais pas ma nièce, si tu te mariais avec un grec-catholique » 4 . Nous savons que les Benakis n'étaient pas particulièrement croyants 5 (Emmanouil, en fait, était athée 6 ). Donc, la trahison potentielle primordiale dans ce cas était que Pinelopi, se mariant avec un Zogheb, renierait sa nation et non sa religion. Un tel choix aurait été tolérable s'il s'était agi d'un Européen dont le rôle pouvait être important pour la fortune familiale, mais l'identité syrienne était trop faible pour concurrencer un Grec. D'ailleurs, on préférait les Grecs même pour les simples relations sociales. La haute société grecque, riche et nombreuse, se permettait d'être snob à l'égard des autres étrangers : d'après Pinelopi, ceux qui arrivaient à s'y faire accepter étaient enviés ; car on les laissait entrer dans les salons « au compte-gouttes ». Elle raconte que, depuis qu'elle était toute petite et au moins jusqu'au début du XXe siècle, tous désiraient être acceptés aux grandes réceptions des Grecs (aux déjeuners, aux dîners et aux soirées intimes, on invitait rarement des étrangers). Les consuls, les magistrats des Tribunaux Mixtes, les chefs des autorités publiques, les directeurs de banques et de grandes entreprises, étaient admis « grâce à leur position » ; les autres étrangers, malgré leurs efforts (parfois même manquant de dignité), étaient souvent refusés ; les moins acceptés étaient les Syriens et les Juifs 7 .
Les vrais descendants pour une famille grecque étaient les garçons et on ne leur permettait pas de mélanger leur sang grec avec du sang étranger. Par contre, il était plus facile de consentir au mariage d'une jeune fille et d'un étranger. 2 Premiers souvenirs, pp. 166, 206 ; Souvenirs 1899, p. 40. 3 Souvenirs 1899, pp. 7, 13 et 25-34. ^Souvenirs 1899, pp. 267-9, 312-3, 317 et 323-346. 5 Premiers souvenirs, pp. 114, 148-150 et 225-6 ; Souvenirs 1899, pp. 150, 282. ^Toutefois, malgré son athéisme, Emmanouil déclarait que la religion était « pour le peuple un besoin psychologique », pour cela on ne devait pas y toucher ; il soutenait aussi que Ves Grecs avaient besoin uniquement et concrètement de la croyance orthodoxe, et non pas d'une croyance quelconque. Ceci prouve qu'il était conscient de l'importance idéologique de la tradition grecque orthodoxe pour l'identité nationale, en particulier au sein d'une population grecque isolée dans un pays étranger. Premiers souvenirs, p. 77 et 150-1 ; Souvenirs 1899, p. 27.
102
K A T E R I N A
T R I M I
Même si Pinelopi exagère un peu sur ce point, ouvrir difficilement les portes aux Européens semble être une douce vengeance contre ceux qui les traitaient en général de peuple « non civilisé ». Très jeunes encore, elle et ses frères, ayant goûté à la mésestime envers leur appartenance nationale, manifeste lors du contact avec les gouvernantes et les instituteurs étrangers (qui ne pouvaient pas dissimuler leur opinion défavorable), exprimée aussi dans des revues et des journaux circulant à Alexandrie (où la Grèce était soit ridiculisée soit absente), étaient pleinement conscients que leur patrie était petite, misérable et méprisée. Leur sentiment national blessé était précisément, par réaction, renforcé 1 . Vraisemblablement, ce complexe engendrait aussi leur propre mépris envers les Syriens et les Juifs 2 . * *
*
Les Benakis firent souche en Egypte ; même après le départ d'Emmanouil, ses enfants et leurs familles y restèrent et y vécurent longtemps encore. Néanmoins, ils y demeurèrent des étrangers ; leurs rapports avec les gens du pays étaient minimes, sinon inexistants. Et, sans doute, les Benakis faisant partie d'une bourgeoisie internationale d'un pays autre que le leur, étaient des cosmopolites : ils s'associaient, travaillaient, s'amusaient avec d'autres étrangers ; leur mode de vie était européanisé et ils étaient entourés d'objets importés d'Occident. Néanmoins, leurs relations intimes étaient quasi-limitées à des Grecs, ils se reconnaissaient avant tout comme Grecs, et même faisaient preuve de sentiments nationaux très vifs. Tout en ayant honte pour divers aspects de la réalité grecque, ils demeuraient fidèles à leur appartenance nationale et étaient particulièrement fiers de faire partie de la diaspora, voire de la diaspora de l'Egypte.
1 Premiers souvenirs, pp. 125-7, 142, 146-7, 152-3 ; voir aussi Magas, pp. 82, 115-6, 143, 256-8 ; Trelandonis, p. 38,40. 2 NOUS ne rencontrons pas ce réflexe chez tous les Grecs de leur classe. Apparemment, certains niaient tout simplement leur provenance pour mieux s'intégrer à la catégorie des Européens : Souvenirs 1899, pp. 438-9 ; voir aussi Magas, pp. 111, 115.
Georgios NIKOLAOU
LA FAMILLE DELIYANNIS : UN EXEMPLE DE NOTABLES CHRÉTIENS DU PÉLOPONNÈSE CENTRAL
La grande famille des Deliyannis, provenant du Péloponnèse central (Gortynie), n'a pas fait jusqu'à présent l'objet d'une étude systématique. Il s'agit d'une des familles les plus puissantes de notables chrétiens du Péloponnèse. Elle a joué un rôle politique et économique très important dans les affaires du pays pendant la seconde moitié du XVIIIe et au début du XIXe siècle, jusqu'au commencement de la guerre d'indépendance grecque et durant celle-ci. Certains des descendants de cette famille ont même occupé des places politiques très élevées dans le nouvel État hellénique tout au long du XIXe siècle. L'institution de l'auto-administration communale constitue le cadre dans lequel la famille des Deliyannis a acquis sa force et a développé ses activités diverses. Nous allons, donc, tout d'abord, présenter ces institutions communales dans le Péloponnèse durant la deuxième période de la domination ottomane (1715-1821). Ensuite, nous étudierons quelques éléments relatifs à l'origine et aux membres de cette famille et nous examinerons le rôle que celle-ci a joué dans le Péloponnèse, ses relations avec le pouvoir ottoman ou avec les notables musulmans (ayân), ainsi que ses conflits ou ses alliances avec les autres grandes familles de notables chrétiens de la région.
1. LE SYSTÈME DE L'AUTO-ADMINISTRATION COMMUNALE DANS LE PÉLOPONNÈSE C'est pour des raisons d'ordre à la fois économique et administratif que le pouvoir ottoman a toléré —pour ne pas dire promu—, après 1715, l'institution d'une auto-administration dans le Péloponnèse, et dont \es prémices, beaucoup moins élaborées, se rencontrent déjà dans la première
104
GEORGIOS
NIKOLAOU
période de la domination ottomane 1 . En effet, dans le Péloponnèse comme ailleurs, le conquérant a établi cette institution en vue de mener à bien sa politique de finances publiques, et particulièrement, la répartition et la perception des impôts. En outre, les représentants des communes aidaient le pouvoir à appliquer ses décisions, jouant le rôle d'intermédiaire entre lui et le peuple 2 . Il est généralement admis que le Péloponnèse a atteint le plus haut degré d'auto-administration et la plus grande indépendance possibles à l'égard de l'administration ottomane. Nous n'avons pas ici l'intention d'examiner les facteurs qui ont favorisé cette décentralisation administrative. Notons simplement que les conditions connues de la conquête, la récente tradition, soit ottomane soit vénitienne 3 , la supériorité numérique de la population grecque ont joué, selon toute vraisemblance, un rôle déterminant. Comme partout, le noyau de cette institution était la commune. Chaque village, à l'exception de ceux qui avaient le statut de çiftlilâ, constituait une communauté. Le système fonctionnait sur trois niveaux successifs correspondant aux trois niveaux de l'administration ottomane périphérique. ' Cf. John C. Alexander, Toward a History of Post Byzantine Greece : The Ottoman Kanunnames for the Greek Lands, circa 1500-circa 1600, Athens, 1985, pp. 193, 370. - | , a bibliographie sur l'institution communale en Grèce pendant la période ottomane est très riche. Voir surtout : N. Moschovakis, Le droit public en Grèce pendant la domination turque, Athènes, 1882, pp. 68 sqq. (en grec) ; D. Zakythinos, « La commune grecque. Les conditions historiques d'une décentralisation administrative», L'Hellénisme contemporain, 2(1948), pp. 295-310, 4 1 4 - 4 2 8 ; J. Visvizis, «L'administration communale des Grecs pendant la domination ottomane », in t453-1953. Le cinq-centième anniversaire de la prise de Constantinople, n° spécial de L'Hellénisme contemporain, Athènes, 1953, pp. 217-238 ; J. Yannopoulos, « Les communautés », in Historia tou Hellinikou Ethnous, Athènes, 1975, vol .11, pp. 134-143 (en grec) ; Hél. Koukou, Les institutions communales dans les Cyclades pendant la domination turque, Athènes, 1980 (en grec) ; G. Kontogeorgis, Dynamique sociale et auto-administration politique. Les communautés grecques de la période turque, Athènes, 1982, (en grec), passim et surtout pp. 233-239 sur l'organisation verticale des communes du Péloponnèse. Pour l'évolution de la communauté villageoise et pour la mise au point des travaux à faire voir Hél. Antoniadis-Bibicou & André Guillou, « Problèmes de la communauté villageoise byzantine et post-byzantine », in Actes du Congrès franco-hellénique. Le monde rural dans l'aire méditerranéenne (Athènes, 4-7 décembre 1984), Athènes 1988, pp. 44-61 ; Spyros Asdrachas, « Fonctions fiscales et restrictives des,communes pendant la domination t u r q u e » in Historica III/5 (1986), pp. 45-62 (rééd. in Économie et mentalités (en grec), Athènes, 1988, pp. 123-143), pour la gestion des questions fiscales par la commune grecque. 3
C f . supra note 1 et pour la période vénitienne : L. von Ranke, « Die Venezianer in Morea, 1685-1715 », in Historisch-Politische Zeitschrift 2 (1834), pp. 405-502, trad, grecque P. Kalligas, « Sur la domination vénitienne dans le Péloponnèse (1685-1715) », in Pandora 12 (1861/62), pp. 553-583, 13 (1862/63), pp. 1-34, p. 5-6 ; D. Zakythinos, op. cit., p. 308 ; M. Sakellariou, Le Péloponnèse pendant la deuxième domination turque (1715-1821), Athènes 1939 (réédAthènes 1978), p. 87 (en grec). 4 M . Sakellariou, op. cit., p. 88 ; T. Gritsopoulos, « Nouvelles statistiques concernant le Péloponnèse » (en grec), Peloponnesiaca 8 (1971), pp. 441-459, p. 455 (information provenant de la région de Gastouni). En revanche, G. Veinstein, (« Le patrimoine foncier de Panayote Benakis, kocabaji de Kalamata », Journal of Turkish Studies, vol. 11 (1987), pp. 211-233, voir p. 226, note 70), en s'appuyant sur un document ottoman de 1768, conclut que les villages çifllik étaient représentés, comme les autres villages, par des notables. En examinant cette question, G. Kontogeorgis (op. cit., pp. 177-184) aboutit à la conclusion que l'auto-administration des villages çiftlik — s'il y en avait une— était restreinte.
LA F A M I L L E
DELIYANNIS
105
Chaque village disposait d'un conseil de notables connus sous les noms de gerontes, demogerontes ou proestoi, élus pour une année et chargés des questions fiscales, de sécurité, des écoles ainsi que de la représentation de la commune devant les tribunaux. Les demogerontes formaient l'assemblée provinciale qui procédait à l'élection des proestotes de la province correspondant à un kaza. La nomination de ceux-ci était soumise à la confirmation du gouverneur du Péloponnèse (Mora valisi). Ils étaient chargés des mêmes questions au niveau de la province et représentaient les communes auprès des autorités ottomanes. Les proestotes rendaient compte à l'assemblée provinciale et formaient, à leur tour, un corps appelé le Sénat péloponnésien (Peloponnissiaki Geroussia). Le Sénat, réuni en assemblée, désignait les deux morayân, dont l'élection était ratifiée par un fermait impérial. Les deux morayân, les kodjabachi les plus puissants, avec deux ayân (notables musulmans) et le drogman (interprète) constituaient, sous la présidence du pacha, l'un des deux conseils chargés des questions du pachalik de la Morée. En outre, les habitants du Péloponnèse avaient obtenu le privilège d'envoyer à Constantinople deux représentants (vekil), qui formaient, d'une certaine manière, une députation officielle auprès du gouvernement central. De là, ils pouvaient exercer leur influence soit pour obtenir le remplacement d'un pacha, soit pour réparer une injustice, soit pour aider en général leurs compatriotes1. Les notables de chaque éparchie, qui se trouvaient au sommet de la pyramide sociale et administrative des communes, appartenaient, en principe, à la classe de l'aristocratie locale. Eux seulement disposaient du droit d'être élus et d'habitude la transmission des dignités était une affaire familiale. Les notables grecs étaient des riches propriétaires terriens. Mais on peut dire qu'ils puisaient leur force davantage de leur compétence dans la répartition et la levée des impôts, dans F affermage des revenus fiscaux et dans la commercialisation du surplus rural, que dans la propriété foncière 2 . En revanche, les ayân,
Cf. M. Œconomou, Historique de la Palingénésie grecque, Athènes, 1873 (éd. utilisée : Athènes, 1957), vol. 1, p. 18 sqq., (en grec) ; A. Mamoukas, Sur la Régénération de la Grèce, Athènes, 1852, vol. 11, pp. 314-316, (en grec) ; G. L. von Maurer, Das griechische Volk in öffentlicher kirchlicher und privatrechtlicher Beziehung von und nach dem Freiheitskampfe bis zum 31 Juli 1834, Heidelberg 1835, vol. 1-2, (trad, grecque utilisée : Athènes, 1976), pp. 67 sqq.; M. Sakellariou, op. cit., pp. 78 sqq. ; An. Kyrkini, L'organisation administrative du Péloponnèse pendant la deuxième domination turque (1715-1821), thèse dact., Faculté des Lettres de l'Université d'Athènes (en grec), Athènes 1990, passim et surtout pp. 60 sqq.et 136 sqq. ; Gilles Veinstein, « Les provinces balkaniques (1606-1774) », Robert Mantran (ed.), Histoire de l'Empire Ottoman, Paris : Fayard, 1989, p. 332. D'autres communautés aussi avaient le droit d'envoyer à Constantinople des vekil. Voir pour le cas de Myconos dans les Cyclades, S. Lazari, Economie et société des îles de la mer Égée pendant l'occupation ottomane : le cas de Myconos, thèse dact., Paris I, Paris 1990, pp. 195-197. 2
M. Sakellariou, op. cit., pp. 94 sqq. ; V. Sfyroeras, « Kodjabachi », (en grec), in Encyclopédie Papyrus-Larousse-Britannica, Athènes, 1989, vol. 35, pp. 285-286. Pour les notables chrétiens (knez en pays serbe, ôorbadji en pays bulgare) dans les Balkans à l'époque ottomane voir entre autres, G. Castellan, Histoire des Balkans, XlVe-XXe siècle, Paris : Fayard, 1991, p. 131.
106
GEORGIOS
NIKOLAOU
sans être absents des activités fiscales et financières, étaient, surtout dans le Péloponnèse, des grands propriétaires fonciers 1 . La tâche la plus importante dont la Sublime Porte avait chargé ces notables, chrétiens ou musulmans, était la répartition et la perception des impôts, des corvées et autres redevances qui frappaient les communes. Rien ne nous permet d'affirmer que les kodjabachi — tout comme d'ailleurs les ayân — faisaient toujours preuve d'équité. Bien au contraire. La puissance des notables locaux caractérise le Péloponnèse au même titre que les autres régions de l'Empire vers cette époque. Cette puissance ne va cesser de s'accroître jusqu'en 1821, avec une interruption dans les années qui ont suivi l'échec de l'insurrection de 1770. Signalons que c'est l'attitude des notables chrétiens durant l'invasion de l'armée ottomane dans le Péloponnèse en 1715 qui est à l'origine de leur pouvoir. En effet, selon deux témoignages postérieurs donnés dans leurs Mémoires par les notables Kanellos Deliyannis et Panayotis Papatsonis, lorsqu'au mois de juin 1715 l'armée ottomane marchait vers le Péloponnèse, les proestotes les plus influents du pays se rendirent à Thèbes et y déclarèrent leur soumission au grand vizir Dâmâd Alî Pacha. Celui-ci accepta leur soumission et, par conséquent, la soumission du pays. Il promit en échange que le Péloponnèse serait administré démocratiquement 2 . Comme récompense, ils reçurent de larges compétences administratives et fiscales dans les communes grecques, ainsi que des biens 3 . Le développement du système de l'affermage des impôts ou des revenus du Trésor (iltizâm), surtout l'affermage à vie (malikûne), l'appropriation de terres publiques et la tendance des dignitaires du Péloponnèse à nommer les ayân comme leurs représentants, sont les facteurs les plus importants auxquels on attribue l'accroissement de la puissance des ayân du Péloponnèse. En fait, ils ont réussi, peu à peu, à déplacer les voïvodes ou d'autres dignitaires, en formant de véritables dynasties locales4. Il est caractéristique que les habitants
' a . Kyrkini, op. cit., p. 111. K. Deliyannis, Mémoires, ed. par Em. Protopsaltis, Athènes, 1957 (en grec), vol. 1-3, voir vol. 1, p. 18 ; P. Papatsonis, Mémoires depuis les années de turcocratie jusqu'au règne de Georges I, ed. par Em. Protopsaltis, Athènes 1960, (rééd. Athènes 1993), (en grec), p. 27. 3 Cf. G. Kontogeorgis, op. cit. p. 331 ; St. Tsotsoros, Mécanismes économiques et sociaux dans les régions montagneuses : Gortynie (1715-1828), Athènes, 1986, (en grec), pp. 70-71. 4 Pour les ayân dans le Péloponnèse voir surtout John C. Alexander, Brigandage and Public Order in the Morea, 1685-1806, Athens 1985, pp. 37 sqq. ; A. Kyrkini, op. cit., pp. 110 sqq. Pour l'Empire ottoman en général, voir Mouradjea d'Ohsson, Tableau général de l' Empire ottoman, vol. 7, Paris, 1824, pp. 283-286 ; H. Gibb & H. Bowen, Islamic Society and the West, Oxford, 1967-1969, vol. 1, pp. 256 sqq. ; D. Sadat, « Rumeli Ayanlan : the Eighteenth century », Journal of Modem History, 4 4 (1972), pp. 346-363 ; Vera Mutafcieva, «L'institution de l'ayanhk pendant les dernières décennies du XVIIIe siècle», Etudes Balkaniques, vol. 2-3 (1965), pp. 233-247 ; Bruce McGowan, « The age of the ayâns », in Halil Inalcik & Donald Quataert (éd.), Economic and social history of the Ottoman Empire, 1300-1914, Cambridge University Press, 1994, pp. 637 sqq. 2
LA
FAMILLE
DELIYANNIS
107
grecs du Péloponnèse ont considéré comme « philhellènes » les pachas qui ont essayé de limiter le pouvoir et les abus des ayâri1. Les relations entre les kodjabachi et les ayân dans le Péloponnèse étaient à la fois des relations d'antagonisme et de coopération pour des raisons essentiellement économiques et pour la distribution du pouvoir au niveau local 2 . En effet les reaya se trouvaient, malgré eux, au centre du conflit qui éclata entre les notables chrétiens et musulmans, victimes d'une décentralisation progressive et d'un changement du modèle d'administration3. En même temps, on observe des rivalités ou des alliances entre les grandes familles des notables chrétiens. Ce sont des phénomènes beaucoup plus intenses au début du XIXe siècle : le jeu politique consistait en la formation d'alliances et en des conflits au niveau local ou régional, rapports qui donnaient l'image d'une confrontation bipolaire. La faction la plus forte était concurrencée par les plus importants de ses anciens alliés. On observe souvent dans le Péloponnèse le renversement des alliances et la formation de nouvelles factions. Chaque faction essayait de gagner la faveur du pacha du Péloponnèse ou d'autres dignitaires ottomans dans la capitale de l'Empire. La faction ou la famille qui envoyait un de ses membres comme vekil à Constantinople parvenait en principe à s'imposer aux autres. En outre, pour l'accroissement du pouvoir à l'intérieur du pays les mariages ou les parrainages entre les familles les plus puissantes des notables étaient habituels 4 . Tout cela, plus l'exploitation économique de leurs coreligionnaires à travers l'affermage des impôts ou les activités usuraires, ainsi que leur façon de vivre, a créé une image déplaisante d'eux parmi les chrétiens. Ce sont d'ailleurs les raisons pour lesquelles les kodjabachi ont été critiqués sévèrement par leurs compatriotes. Jugés peu scrupuleux et profiteurs du système, ils sont souvent apparus comme les oppresseurs des pauvres et des faibles et non pas comme leurs protecteurs5. L' ambiguité, donc, du rôle des kodjabachi n'est pas à démontrer. Une figure de la guerre d'indépendance grecque, Photakos, a pu écrire : « Les kodjabachi ou prouchontes n'étaient pas élus par le peuple comme certains disent. Ils constituaient un corps uni par l'intérêt qu'ils ! a . Kyrkini, op. cit., p. 120. hbid., pp. 114 sqq. 3 Ibid., pp. 137 sqq. 4 C f . John C. Alexandropoulos, « Some aspects of the strife among the Moreot Christian notables, 1789-1816», Epetiris Heterias Stereoelladikon Meleton, vol. 5 (1974-75), pp. 437-504 ; M. Sakellariou, op. cit., p. 96. 5 V o i r par exemple M. Œconomou, op. cit., vol. 1, p. 21 ; cf. aussi M. Sakellariou (op. cit., pp. 135 sqq.), où la critique des sources concernant les kodjabachi.
108
GEORGIOS
NIKOLAOU
avaient en commun [...]. Ils agissaient comme serviteurs des appétits des Turcs et cette profession leur rapportait comme profit leur exemption de charges et d'impositions. Ils encaissaient cent et ils versaient vingt-cinq en trompant les Turcs [...]. Chaque faction voulait avoir le pouvoir pour gouverner le pays et pour s'enrichir [...]. Tel était le kodjabachi qui imitait le Turc en tout ce qui concernait les habits, les manières extérieures et la maison. Sa prospérité était celle d'un Turc et il différait seulement par le prénom. Par exemple, au lieu de s'appeler Chassanis [Hassan] il s'appelait Yannis, et au lieu d'aller à la mosquée, il allait à l'église.» 1 Cette critique très sévère, à laquelle nous allons revenir plus loin, s'explique aussi par les conflits qui avaient éclaté entre les kodjabachi et les militaires, en faveur desquels écrivait Photakos, durant la guerre d'indépendance. Il est vrai que le nom de kodjabachi a pris un sens insultant durant cette période, quand les Grecs pouvaient exprimer librement leur mécontentement contre les puissants prouchontes2. Pourtant, il ne faut pas oublier les points positifs du rôle des notables chrétiens, qui, étant intermédiaires entre le pouvoir ottoman et les communes, faisaient face chaque jour aux exigences du pouvoir 3 . Comme l'a écrit à propos de notables chrétiens l'historien John Petropoulos : « Indépendamment de ce que croyait le peuple, les kodjabachi avaient fait face au pouvoir ottoman et très probablement avaient souffert de l'insécurité de la domination turque plus que le peuple luimême 4 .» Il ne faut oublier la participation des notables chrétiens à l'insurrection manquée de 1770, ni leur intérêt pour la construction d'écoles et d'églises 5 . Parmi les quelques 46 familles de notables chrétiens que comptait le Péloponnèse après 1715, huit seulement ont pu jouer un rôle important : les familles Syntychos de Karytaina et Benakis de Kalamata jusqu'en 1770 et les familles Zaïmis et Charalambis de Kalavryta, Krevatas de Mystra, Kanakaris de Patras, Lontos de Vostitsa et Deliyannis de Langadia après 1779. Ce sont les familles dont l'influence et le poids s'étendaient dans tout le Péloponnèse et celles desquelles provenaient les morayân et les vekifr. Et parmi celles-ci, la famille Deliyannis, dont la puissance s'est imposée dans les affaires du Iphotiou Chryssanthopoulou ou Photakou, Mémoires sur la Révolution hellénique, (en grec), Athènes, 1899 (éd. utilisée : Athènes 1974), vol. 1, pp. 32-33. 2 Cf. John A. Petropoulos, Politics and Statecraft in the Kingdom of Greece, 1833-1843, Princeton University Press, 1968, trad, grecque utilisée, vol. 1-2, Athènes, 1985-1986, voir vol. 1, pp. 38-39 ; V. Sfyroeras, « Kodjabachi », op. cit., p. 286. 3 John A. Petropoulos, op. cit., pp. 36-37. 4 Ibid„ p. 39. 5 Voir M. Sakellariou, op. cit., p. 139 et infra notes 27 et 66. 6 Ibid„ pp. 95, 130-131.
LA F A M I L L E
DELIY ANNI S
109
Péloponnèse pour quelques années au début du XIXe siècle, mérite de retenir tout particulièrement l'attention.
2. LA FAMILLE DELIYANNIS L'origine des Deliyannis fait encore l'objet de débats. Selon l'historique de la famille, écrit au XIXe siècle par Charalambos, fils d'Anagnostis Deliyannis, le chef de la famille Petros Litinos a vécu vers le milieu du XVIe siècle dans le village Krespi de Gortynie. Son fils, ou petit-fils selon d'autres sources, Antonios, bien instruit, est devenu secrétaire et drogman d'Aydin, agha de Draina et il est connu sous le nom de Meghas Grammatikos (Grand Secrétaire) 1 . Son frère, Ioannis, qui a pris pour la première fois le surnom de Deliyannis (Yannis le téméraire, du turc deli qui signifie fou, téméraire), s'est installé à Tsarna, village montagneux de Gortynie et il est considéré comme le chef de la deuxième branche de la famille, la moins connue. Un descendant de Ioannis Deliyannis, Petros, notable du Péloponnèse vers le milieu du XVIIIe siècle, a pris part à la démarche entreprise auprès de la Sublime Porte en 1762 afin que soit annulé le remplacement du Mora valisi Topai Osman Pacha, qui était aimé de tous les chrétiens, en raison de son caractère doux et juste et, en revanche, détesté des Turcs puissants du Péloponnèse. La demande des notables grecs fut acceptée, mais deux ans plus tard, quand a été nommé le nouveau Mora valisi, tous ceux qui avaient soutenu son prédécesseur ont été inculpés et furent étranglés. Parmi eux, Petros Deliyannis et l'évêque de Mystras et morayân du Péloponnèse, Ananias, petit-fils du morayân Syntychos 2 . Il s'agit d'un événement qui montre aussi clairement l'antagonisme et le conflit qui éclata dans le Péloponnèse à cette période-là entre les ayân et les kodjabachis, conflit qui visait au maintien de la suprématie des premiers face aux seconds3. Les quatre fils de Petros Deliyannis (Stavros, Georgios, Ioannis et Neofytos) ont pris une part active à l'insurrection de 1770, connue sous le nom Orlofika, et pour cette raison ils ont subi des persécutions et la confiscation de leurs biens. Ioannis fut exécuté à Nauplie en 17704. Mais c'est la deuxième branche de la famille qui est la plus connue et qui joua un rôle beaucoup plus important dans les affaires du Péloponnèse. 'Voir surtout A. Goudas, Vies parallèles des Grecs qui se sont distingués au temps de la régénération de la Grèce (en grec), Athènes, 1875, vol. 7, pp. 203-244 ; Eft. Liata, Les Archives de la famille Deliyannis, (en grec), Athènes, 1992, pp. 15 sqq., où les sources et les études les plus anciennes concernant cette famille et son arbre généalogique ; V. Sfyroeras, « Deliyannis », (en grec), in Encyclopédie Papyrus-Larousse-Britannica, vol. 20, (1984)' pp. 49-51. Ibid., p. 49 ; Eft. Liata, op. cit., p. 17 ; K. Deliyannis, Mémoires, op. cit., vol. 1, pp. 19-21 ; M. Sakellariou, op. cit., p. 154. 3 A. Kyrkini, op. cit., p. 137. 4 V . Sfyroeras, « Deliyannis », op. cit., p. 49. Selon Eft. Liata (op. cit. p. 17), ont été exécutés trois frères : Ioannis, Stavros et Georgios.
no
GEORGIOS
NIKOLAOU
Son chef de famille fut Antonios le Grand Secrétaire, frère de Ioannis. Le fils d'Antonios, Ioannis, qui est devenu prêtre et qui a pris l'office ecclésiastique d'économe, fut contraint d'abandonner Krespi quand les Vénitiens conquirent le Péloponnèse (1685) et il s'installa dans le village montagneux de Langadia, non loin de Tsarna. Les trois fils de Ioannis, Kanellos, Georgios et Panaghiotis ou Panaghis, ont pris le nom de Papayannopoulos, parce que leur père était pope (en grec papas). L'un des deux fils de Kanellos Papayannopoulos, Ioannis, notable et morayân pour plusieurs années, est à l'origine de la puissance de cette famille 1 . Les Mémoires2, rédigés en 1854-56 par son fils Kanellos Deliyannis, constituent la source principale dont nous disposons pour cerner cette famille. Kanellos, en tant que connaisseur de première main de la tradition orale de sa famille et ayant lui aussi participé directement aux affaires du Péloponnèse dès la fin du XVIIIe siècle, nous procure des renseignements précieux. Toutefois, écrits dans le but de défendre le rôle joué par sa famille et par quelques autres lignées de notables chrétiens du Péloponnèse avant et pendant la guerre d'indépendance, ces Mémoires forment une documentation peu objective 3 . On doit toujours recourir à d'autres sources afin de vérifier son contenu. Malheureusement, nous n'avons pu, pour notre part, consulter qu'une partie seulement des archives familiales des Deliyannis classées tout récemment 4 . Il s'agit du fonds de Kanellos Deliyannis, le plus ancien et naturellement le plus important pour notre étude 5 . Il est sûr que son exploitation ultérieure nous permettra de mieux étudier les diverses activités des Deliyannis. Ioannis Papayannopoulos (Deliyannis) est né à Langadia en 17386. Peu instruit, mais doté de capacités politiques et d'un esprit entreprenant, il a su se distinguer dans la région de Gortynie. Très vite il a été élu proestos dans le kaza de Karytaina, dignité qu'il conserva 32 ans. Il a participé très activement à l'insurrection de 17707. Après avoir échappé aux représailles qui ont suivi l'insurrection de 1770 et avec le rétablissement de l'ordre dans le Péloponnèse en 1779, il a pu accroître son pouvoir économique, et par conséquent son influence politique, en rachetant 29 villages usurpés ou achetés par des Turcs
1 A. Goudas, op. cit., pp. 206 sqq ; V. Sfyroeras, « Deliyannis », op. cit., p. 50 ; Eft. Liata, op. cit., pp. 17-18. 2 Cf. supra note 8. 3 C f . T. Gritsopoulos, « L'historiographie de la Guerre », (en grec), Mnimosyni, 35 (1970-71), pp. 88 sqq ; voir surtout p. 91. Eft. Liata, op. cit., pp. 22 sqq,. description analytique des archives Deliyannis. 5 Voir du même, Archives de Kanellos Deliyannis : les documents de 1779-1827, (en grec), Athènes, 1993. ^K. Deliyannis, Mémoires, op. cit., p. 27 ; T. Kandiloros, La Gortynie (en grec), vol. 1, Patras, 1898, pp. 194 sqq ; V. Sfyroeras, « Deliyannis », op. cit., p. 50. ^M. Sakellariou, op. cit., p. 172.
LA
FAMILLE
DELIYANNI S
111
puissants durant les troubles de cette décennie 1 . Selon les Mémoires de son fils, qui ne manque pas d'occasions pour exprimer son admiration envers son père : « [...] Il était très intelligent de nature, doté d'une grande capacité, de franchise et de courage, avec un sentiment religieux et un patriotisme uniques. Grâce à ces qualités, il est devenu redoutable pour les Turcs puissants ou faibles, parce qu'il défendait toujours les droits des chrétiens, non seulement de sa région, mais de tout le Péloponnèse et toujours se souciait de la libération future de la patrie [...] Il a porté toute son attention à fonder des écoles secondaires et communales là où il n'y en avait pas, à maintenir la sécurité des monastères de sorte qu'ils soient préservés des injustices des vizirs et des Turcs du pays, pour qu'ils servent toujours d'asile et de refuge aux chrétiens. Il a aussi aidé les chrétiens à construire des églises et à réparer les anciennes, ce qui était défendu par les lois ottomanes et par le Coran lui-même [...]. » 2 Malgré les exagérations, les témoignages ci-dessus contiennent un noyau de vérité. Par exemple, comme nous en informent aussi d'autres sources, Ioannis Papayannopoulos a fondé des écoles dans la région de Gortynie ou a veillé au fonctionnement d'autres : il s'agit des écoles de Langadia, de Stemnitsa et de Dimitsana3. Vers la fin du siècle et au début du XIXe, il était considéré comme un des plus puissants notables du Péloponnèse. Il sera élu, à plusieurs reprises, morayân et vekil. Le renforcement de sa position est dû avant tout à ses activités économiques : achat de terres, affermage des impôts, etc. Kanellos Deliyannis reconnaît que la puissance de sa famille est due, entre autres, à la protection de la Beyhan sultane, sœur du sultan Selim III (1789-1807), étant donné que son père, avec le notable du kaza de Phanari, Papalexis et Papatsonis, notable puissant dans le kaza d'Imblakia en Messénie, étaient les gérants des terres malikâne, dont celle-ci disposait dans six kaza du Péloponnèse du sud-ouest4. C'est la période pendant laquelle y jouent le premier rôle quatre familles de notables grecs, qui sont soit en alliance, soit en conflit entre elles : la famille Zaïmis de Kalavryta, la famille Lontos de Vostitsa, les Deliyannis et
^Cf. K. Deliyannis, Mémoires, op. cit., pp. 74-75, où les noms des villages ; G. Kontogeorgis, op. cit., pp. 370 sq. ; S. Tsotsoros, op. cit., pp. 77 sq. 2 K. Deliyannis, Mémoires, op. cit., pp. 27-28 ; A. Goudas, op. cit., p. 207 ; cf. infra, note 56. ^Ibid., p. 74 ; S. Tsotsoros, op. cit., pp. 166 sqq.; Eft. Liata, op. cit., p. 18. 4 Cf. K. Deliyannis, Mémoires, op. cit., pp. 58, 76 ; P. Papatsonis, Mémoires, op. cit., pp. 29-32 ; S. Tsotsoros, op. cit., p. 78.
112
GEORGIOS
NIKOLAOU
Sotirios Charalambis de Zarouchla (près de Kalavryta)1. Selon Sakellariou, qui a consulté les sources relatives à cette question, il y avait deux grandes factions : la faction dite « Achaïkon », dont faisaient partie les kodjabachis de Kalavryta, de Patras, de Vostitsa, d'Elide, de Mystras, d'Arcadia, etc., et la faction dite « Karytainomesseniakon », dont le chef était Ioannis Papayannopoulos (Deliyannis) et à laquelle appartenaient les kodjabachis de Tripolitsa, d'Andritsaina, de Messénie, de Corinthe, etc 2 . L'antagonisme et les luttes, entre les kodjabachis et les ayâns, deviennent de plus en plus durs à partir de la dernière décennie du XVIIIe siècle. C'est dans ce climat que se situe l'exécution du notable très puissant de Kalavryta Androutsos Zaïmis par Bekir Pacha (1789 ou 1792). Désormais, le pouvoir dans le camp des notables chrétiens semble être partagé entre Sotirakis Lontos, le kodjabachi de Vostitsa et Ioannis Papayannopoulos (Deliyannis)3. Ioannis Papayannopoulos sera à la tête de la lutte pour l'extermination des klephtes du Péloponnèse, qui fut ordonnée par un firman impérial en 1805. De cette extermination a pu être sauvé Théodore Kolokotronis, le futur chef de la guerre d'indépendance, qui était jusqu'en 1802/1803 kapobachi, c'est-à-dire chef du corps armé chargé de la protection des Deliyannis et de la sécurité en général dans le kaza de Karytaina. Dès lors commence la rivalité entre la famille Deliyannis et Théodore Kolokotronis, rivalité qui prendra un caractère plus aigu durant la guerre de 1821-28, et qui ne cessa que momentanément devant le danger commun 4 . Cette rivalité explique bien, à mon avis, pourquoi Photakos5, secrétaire de Kolokotronis durant la guerre d'indépendance, s'attaque durement aux kodjabachis dans ses Mémoires. Dès l'arrivée de Veli, fils d'Ali Pacha de Ioannina, comme gouverneur de la Morée en 1807, la balance du pouvoir a penché en faveur de Lontos. Jusqu'au départ définitif de Veli le 2 septembre 1812, un vif antagonisme se développa entre Lontos et Deliyannis et entre leurs alliés en Morée et à Constantinople 6 . Le géronte Deliyannis trouve des assistants aptes à ses
' John C. Alexander, « Some aspects... », op. cit., pp. 472-473. Sakellariou, op. cit., p. 96. 3John C. Alexander, « Some aspects... », op. cit., p. 477. 4('f. pour cet événement très important pour le Péloponnèse : M. Œconomou, Mémoires, op. cit., pp. 32 sqq. ; Th. Kolokotronis, Narration des événements de la race hellénique, (en grec), Athènes, 1846, pp. 118 sqq. ; K. Deliyannis, Mémoires, op. cit., pp. 31 sqq.; P. Papatsonis, Mémoires, op. cit., pp. 34 sqq. ; M. Sakellariou, op. cit., pp. 236 sqq ; John C. Alexander, Brigandage, op. cit., pp. 89 sqq., 141 sqq. ^Photiou Chyssanthopoulou ou Photakou, Mémoires, op. cit., pp. 32 sqq.; cf. John A. Petropoulos, op. cit., pp. 43^14 ; M. Sakellariou, op. cit., pp. 137-138, note 2 pour une critique de la position de Photakos ; Eft. Liata, « Les degrés de la mémoire et les stratégies politiques d'une famille », (en grec), Eranistis, vol. XX (1995), pp. 163-233, surtout pp. 215 sqq. où la réponse de K. Deliyannis aux Mémoires de Photakos. ® John C. Alexander, « Some aspects », op. cit., p. 477.
LA
FAMILLE
DELIYANNI S
113
activités chez ses fils les plus grands, qui depuis quelques années avaient commencé à marcher sur les traces de leur père. L'aîné Anagnostis ou Sofianos (né en 1771), par exemple, a été envoyé après 1800 à Constantinople comme vekil, tandis que son frère Théodoros succéda à son père à la dignité de morayân en 1815, car celui-ci était malade 1 . Les relations entre Veli et Deliyannis se détérioraient jour après jour. En 1808, Lontos réussit à obtenir à Constantinople la révocation de deux vekil, désignés par Deliyannis. Les deux notables, Assimakis Polos de Patras et Anagnostis Papatsonis d'Imblakia, sont revenus en Morée et après leur mort, en 1811, leurs familles ont été dépouillées de leurs biens 2 . Selon Kanellos Deliyannis, ces confiscations ont eu lieu à cause de l'inimité de Veli vis-à-vis de la famille Deliyannis 3 . Chose significative, le fils de Deliyannis Anagnostis, Thanos Kanakaris de Patras et Alexios Œkonomou (Papalexis) d'Andritsaina sont restés dans la capitale ottomane. Ceci montre peut-être, selon Alexandropoulos, une influence continue de la faction des Deliyannis à Constantinople, malgré sa rivalité avec le pacha du Péloponnèse 4 . Le fait est que la famille Deliyannis a été pourchassée par Veli. Ioannis Papayannopoulos (Deliyannis) et son fils Théodore furent emprisonnés pour quelque temps et plusieurs membres de sa famille ont été forcés à se réfugier à Zante 5 . La personnalité et la politique contradictoires de Veli, caractérisé d'une part par son avidité, son esprit aventureux et l'exploitation fiscale très dure de la population, et de l'autre, par sa bonne culture, son affabilité et sa tolérance religieuse 6 , ont provoqué de vives réactions contre lui, autant parmi les Grecs que parmi les Turcs du pays. Les très puissants Deliyannis le détestaient à cause de la préférence qu'il montrait envers Sotirakis Lontos, de sa politique fiscale et de son projet d'unir les pachalik de la Morée et de l'Épire sous le pouvoir de son père. Les ayân turcs étaient également hostiles envers lui et ils attisaient le mécontentement du peuple, car ils considéraient leur mise à l'écart comme inadmissible. Quand, en 1810, Veli pacha partit pour le front de la guerre russo-turque, l'occasion qu'ils attendaient fut donnée à ses ennemis pour conspirer contre lui. Ils se sont entendus avec le gouverneur français des îles Ioniennes, Donzelot, pour renverser son gouvernement et installer dans le pachalik une fédération turco-hellénique sous la protection de la France. Kanellos Deliyannis, qui nous donne des renseignements détaillés sur cet 1 Cf. K. Deliyannis, Mémoires, op. cit., p. 73 ; V. Sfyroeras, « Deliyannis », op. cit., pp. 50 sq. ; Eft. Liata, Les Archives.., op. cit., p. 18. Deliyannis, Mémoires, op. cit., pp. 46 sqq. ; John C. Alexander, « Some aspects... », op. cit. p. 477. K. Deliyannis, Mémoires, op. cit., p. 57. 4 John C. Alexander, « Some aspects... », op. cit., p. 477. % . Deliyannis, Mémoires, op. cit., pp. 58 sqq. ; P. Papatsonis, Mémoires, op. cit., pp. 40 sqq.; A. Goudas, op. cit., p. 207. ''Sur Veli pacha et son caractère, voir A. Kyrkini, op. cit., pp. 83-91.
114
GEORGIOS
NIKOLAOU
événement, ainsi que les noms des notables grecs et turcs qui ont signé l'accord secret, écrit que son père était un des protagonistes de ce mouvement 1 . Après l'échec de ce projet, ils ont dénoncé à la Sublime Porte Veli pour des désordres fiscaux. Finalement, en 1812, après son retour du front, le Mora valisi fut remplacé et ce fait a constitué une victoire pour les ayân et pour les kodjabachi. C'est le moment où le conflit entre Deliyannis et Sotirakis Lontos était le plus fort. Avec l'arrivée du nouveau Mora valisi Inceli Ahmet Pacha qui, selon les sources, se distinguait par son fanatisme contre les chrétiens, les choses allaient changer. Accusé par des ayân du pays de comploter contre l'autorité ottomane du Péloponnèse, Lontos sera décapité sur les marches du sérail de Tripolitsa (octobre 1813). Il semble que Deliyannis n'était pas totalement étranger à cette inculpation2. Entre 1813 et 1816, la famille Deliyannis a incontestablement la primauté parmi les notables grecs du Péloponnèse 3 . Au début de 1815, le gérante Deliyannis tomba gravement malade. Son fils, Théodore, fut élu à sa place comme un des deux morayân du pays4. Vers la fin de la même année, est arrivé le nouveau Mora valisi, §akir Ahmet pacha. Selon Kanellos Deliyannis, 11 était « forcément dévot et fanatique, mais il jouissait de beaucoup d'estime à la Sublime Porte ». La famille Deliyannis se trouve désormais devant une nouvelle situation défavorable pour elle. Son influence considérable dans le Péloponnèse après 1813 avait suscité l'envie des ayân du pays, mais aussi de la faction adverse des notables grecs, connus sous le nom d'« Achaïkon ». L'arrivée du nouveau pacha leur donnait l'occasion qu'ils cherchaient pour l'anéantissement de sa puissance. Ils rapportèrent à Çakir Ahmet pacha que le vieux kodjabachi était un ennemi très dangereux pour l'Empire et qu'il préparait une rébellion contre le pouvoir ottoman5. Le pacha s'adressa au grand vizir. Un firman impérial fut promulgué qui ordonna la peine capitale à l'encontre de Deliyannis alité. Un détachement composé de 150 cavaliers du pacha, renforcé de la garde turque de Karytaina fut chargé de cette exécution. Le 12 février 1816, le puissant notable du Péloponnèse est décapité sur son lit. Il avait 78 ans. Son corps fut jeté de la fenêtre de sa haute maison dans la cour de l'église de Saint-Jean le Précurseur. Selon la coutume ottomane, sa tête fut ' k . Deliyannis, Mémoires, op. cit., pp. 48 sqq. ; cf. Jean Savant « Napoléon et la libération de la Grèce », L'Hellénisme contemporain, 4 (1950), pp. 320-341, 475-485, 5 (1951), pp. 66-76, 389413, 6 (1952), pp. 103-121, voir vol. 5, p. 67 ; M. Sakellariou, op. cit., pp. 248 sqq. ; A. Kyrkini, op. cit., pp. 90 sqq. 2 Voir l'interprétation des choses par K. Deliyannis, Mémoires, op. cit., pp. 63 sqq. ; cf. aussi John C. Alexander, « Some aspects », op. cit., p. 480. 3 John C. Alexander, « Some aspects », op. cit., p. 476. . Deliyannis, Mémoires, op. cit., pp. 66 sq. ; A. Goudas, op. cit., p. 208. 5 K . Deliyannis, Mémoires, op. cit., pp. 68 sq. ; cf. la critique des sources par John C. Alexander, « Some aspects », op. cit., pp. 483 sq.
LA F A M I L L E
DELIYANNIS
115
pendue devant l'entrée principale du sérail à Tripolitsa. Sa famille a dû payer 1 000 guru§ pour la racheter et la faire inhumer avec son corps à Langadia 1 . C'est de cette manière violente qu'il a été mis fin à la vie d'un des plus puissants notables grecs du Péloponnèse de la deuxième période de la domination ottomane. Son assassinat a épouvanté les notables chrétiens de la région, qui ont bien compris le besoin d'une défense commune devant le danger de leur extermination. Plusieurs ont signé un contrat (1er avril 1816) par lequel ils prêtaient serment de concorde et de solidarité pour la neutralisation de toute menace contre eux 2 . Ioannis Papayannopoulos (Deliyannis) a suivi le même destin que deux autres très puissants kodjabachis, Androutsos Zaïmis et Sotirakis Lontos, quelques années auparavant. Simple coïncidence tragique ou signe de la faiblesse dans l'Empire de ceux qui, à un moment donné, paraissaient comme plus puissants que le pouvoir ottoman lui-même et invincibles ? Son fils Kanellos, après avoir exposé dans ses Mémoires, les persécutions de certains des ses frères juste après l'assassinat de leur père et la confiscation d'une partie de la fortune familiale, consacre deux pages à son œuvre, comme dernier éloge à sa mémoire. Il note d'abord qu'« il a excellé comme proestos de l'éparchie de Karytaina pendant trente-deux ans, comme vekil du Péloponnèse à Constantinople pendant trois ans et comme notable général (morayân) du Péloponnèse pendant seize ans. » Ensuite, il se réfère, de nouveau, à ses bienfaisances non seulement dans son éparchie mais aussi dans tout le Péloponnèse : protection des chrétiens, construction d'églises, fondation et renforcement financier d'écoles, etc 3 . Et il termine ainsi son éloge, qui vise à exalter la personnalité et l'œuvre de son père, passant sous silence ses défauts et les points négatifs de ses activités : « [...] Enfin, il a fait tant d'efforts pour effectuer beaucoup et différentes œuvres de bienfaisance dans le Péloponnèse, défendant de toutes les façons les Chrétiens, afin d'effacer chez eux la peur et l'horreur qu'ils avaient, à cause de la férocité des Turcs. Et il leur a procuré beaucoup de libertés, particulièrement dans son éparchie, de laquelle il a fait disparaître toute autorité turque, si bien que celle-ci fut appelée par les Turcs eux-mêmes Giaour Karytaina. » 4
Voir K. Deliyannis, Mémoires, op. cit., pp. 69 sqq. pour le récit détaillé de ces événements ; cf. P. Papatsonis, Mémoires, op. cit., p. 50, qui était à Langadia à ce moment-là, et A. Goudas, op. cit., pp. 208-210. Voir le texte de ce contrat dans John C. Alexander, « Some aspects », op. cit., pp. 498 sqq. ' k . Deliyannis, Mémoires, op. cit., pp. 74-75 ; cf. supra note 34. 4 Ibid„ pp. 75-76.
116
GEORGIOS NIKOLAOU
La mort du geronte du Péloponnèse n'a pas marqué la fin de la présence des Deliyannis sur la scène politique de la région. Leur famille était nombreuse ; Deliyannis avait onze enfants (neuf fils et deux filles). Les fils du morayân ont joué, eux-aussi, un rôle très important dans les affaires du Péloponnèse, même avant sa mort, soit comme proestoi, morayân ou vekil, jusqu'en 1821, soit comme combattants, ou encore comme politiciens, pendant et après la guerre d'indépendance. Même ses deux filles ont contribué à conforter l'influence politique de cette famille, en se mariant avec des fils de kodjabachi^ influents —Eleni s'est mariée avec Andréas Zaïmis— ou avec des gens puissants du pays —Athanassia s'est mariée avec Ath. Antonopoulos. De même, certains de ses fils ont pris comme épouses des filles de notables respectés du Péloponnèse : l'aîné, Anagnostis, a eu comme épouse Smaragda Tabakopoulou ; Théodoros s'est marié avec Eleni Koughia, fille de S. Koughia, homme riche de Tripolitsa ; Kanellos avec Athanassia Papatsonis, fille du kodjabachi d'Imblakia ; et Nikolaos, le cadet de toute la famille, avec Aikaterini Notara 1 . Dans le Péloponnèse de cette époque, les mariages entre les membres des familles des notables faisaient partie du jeu politique, comme une façon de renforcer des relations entre familles et, par conséquent, la prédominance d'une faction et la neutralisation des factions adverses. Nous nous contenterons de quelques éléments biographiques seulement sur les fils d'Ioannis Papayannopoulos (Deliyannis) que nous jugeons suffisants pour nous faire une idée du rôle qu'ils ont joué avant et après le commencement de la guerre d'indépendance. Ceux-ci ont pris part à cette guerre et y ont même beaucoup offert, malgré leurs hésitations et leurs objections du début dues, entre autres, à leurs relations avec le pouvoir ottoman et plus particulièrement à leur coopération économique avec les ayân2. Il faut toutefois signaler ici que les activités des frères Deliyannis après 1821 dépassent les limites de cet article. L'aîné —et chef de la famille après l'assassinat du père en 1816—, Anagnostis ou Sofianos (1771-1857) est élu morayân (1815) et deux fois vekil à Constantinople, où il a fait connaissance des hommes puissants. De là, son influence sur les affaires du Péloponnèse était considérable et, incontestablement, il a contribué au renforcement de la faction de son père. Il est devenu membre de la Philiki Hetairia (Société des Amis) à Constantinople en 1820. Après le déclenchement de la guerre d'indépendance, il est descendu en ' Voir Eft. Liata, Les Archives.., op. cit., l'arbre généalogique des Deliyannis ; cf. P. Papatsonis, Mémoires, op. cit., p. 34 à propos du mariage de sa sœur avec Kanellos en 1805. 2 A . Goudas, op. cit., pp. 211 sqq. ; cf. A. Kyrkini, op. cit., p. 139 ; V. Sfyroeras, « Kodjabachi », op. cit., p. 286. Voir aussi K. Deliyannis, Mémoires, op. cit., pp. 107 sqq, où il essaie de montrer le zèle de sa famille pour la libération de leur patrie. Nous ne voulons pas entrer ici dans le fameux débat suscité en Grèce sur le rôle des kodjabachi juste avant le commencement de la guerre.
LA
FAMILLE
DELIYANNIS
117
Morée. Membre du Sénat péloponnésien (Peloponnissiaki Gerousia), il a joué un rôle politique important durant la guerre. De 1847 à 1851, il fut président du Sénat. Anagnostis a été le premier de la famille à signer officiellement en 1826 sous le nom « Deliyannis » et, depuis, ce nom a remplacé le nom précédent de la famille Papayannopoulos1. Georgios Deliyannis (1773-1820) a vécu dans l'ombre de ses frères ainsi que son frère Anastos (1775-?) qui a participé à la guerre. En revanche, Théodoros (1774-1821), le troisième enfant de la famille, a eu une carrière brillante. Bon connaissseur de la langue turque et le plus cultivé de tous les frères, main droite de son père, il lui a succédé à la dignité de morayân après sa mort, puisque son frère aîné était vekil à Constantinople. Il était très riche, car à sa fortune personnelle fut ajoutée la dot de sa femme, S. Koughia, fille du riche notable de Tripolitsa. Il a été initié à la Philiki Hetairia (1820) et il a dépensé une grande partie de sa fortune pour la guerre. Invité par le kâymakâm (adjoint du Mora valisi), avec d'autres notables et évêques du Péloponnèse à Tripolitsa, il fut emprisonné avec les autres, pour empêcher l'éclatement d'un mouvement révolutionnaire présumé. À la suite de très mauvaises conditions d'emprisonnement, il trouva une mort tragique le 19 ou 20 Septembre 1821, au moment où était assurée la libération de la ville assiégée 2 . Son frère, Kanellos (1780-1862), a joué un rôle moins important avant 1821. Il fut initié, lui-aussi, à la Philiki Hetairia (1819) et déclencha la révolution à Langadia en mars 1821, avec ses frères. Il est important de signaler que, malgré l'ancienne inimitié qui le séparait de Théodoros Kolokotronis, il a reconnu ce dernier comme commandant en chef de la province de Karytaina. Il mit à disposition presque toute sa fortune pour la réussite de la guerre et combattit dans plusieurs batailles, mais il a été emporté par les remous de la guerre civile (1823-1825) 3 . Dans ses Mémoires, qu'il a écrites pour répondre aux accusations que Photakos avait lancées contre les kodjabachi du Péloponnèse, et plus particulièrement contre les Deliyannis, il essaie de donner une image idéale de sa famille et, en même temps, il s'attaque avec animosité à Kolokotronis et à ses adversaires politiques4. Dimitrios (1783-1848), initié à la Philiki Hetairia en 1820, a travaillé pour la propagation de l'idée révolutionnaire en Morée. Il a participé à plusieurs batailles de la guerre. Son frère Constantinos (1786-1853) fut homme politique durant la guerre et dans le premier État hellénique. Panagos (1788-1839), le huitième fils de Deliyannis, étant assez instruit, gérait les ' bft. Liata, Les Archives..., op. cit., p. 18 ; V. Sfyroeras, « Deliyannis », op. cit., p. 50. Eft. Liata, Les Archives..., op. cit., p. 18 ; V. Sfyroeras, « Deliyannis », op. cit., p. 51. 3 K. Deliyannis, Mémoires, op. cit., pp. 137 sqq.; Eft. Liata, Archives de Kanellos Deliyannis, op. cit., passim ; V. Sfyroeras, « Deliyannis », op. cit., p. 51. I'. Gritsopoulos, « L'historiographie... », op. cit., p. 91. 2
118
G E O R G I O S NI K O L A O U
finances de sa famille et tenait surtout la correspondance familiale. Membre de la Philiki Hetairia en 1820, il participa lui aussi à la guerre et occupa diverses fonctions politiques. Son fils, Theodoros, un des hommes politiques les plus marquants de la Grèce pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, fut à plusieurs reprises, entre 1885 et 1905, premier ministre. Enfin, le cadet de la famille, Nikolaos (1795-1877), trop jeune pour se distinguer avant 1821, a participé à la guerre et fut emprisonné avec ses frères Anagnostis, Kanellos et Dimitrios durant la guerre civile. Il occupa lui aussi divers postes politiques après 1845, suivant la longue tradition politique de sa famille 1 .
* *
*
Les notables du Péloponnèse, soit Turcs, soit Grecs, sont incontestablement un exemple caractéristique de ce qu'on appelle des « figures d'élite ». Mais cette qualification, d'elle-même, suffit-elle à définir les notables grecs comme homines ottomanici ? L'utilisation de ce terme, s'agissant des Grecs chrétiens sujets du sultan, n'entraîne-t-elle pas, en tant que telle, le danger de donner une image fausse, voire trop stéréotypée, qui ignorerait les spécificités de l'origine et du rôle qu'ont joué ces individus ? Le cas de la famille Deliyannis, que nous venons de présenter, est instructif de ce point de vue. Le fait que les membres de cette famille ont servi l'administration ottomane dans le système de l'auto-administration communale du Péloponnèse et le fait qu'ils sont souvent apparus comme profiteurs de ce système et oppresseurs de leurs coreligionnaires ne suffisent pas, à notre avis, pour les considérer comme homines ottomanici. Au contraire, une série de leurs actions en faveur de leurs compatriotes durant la domination ottomane et leur contribution très importante à l'insurrection de 1770 et à la guerre d'indépendance grecque montrent bien leur conscience hellénique.
A. Goudas, op. cit., pp. 212 sqq.; Eft. Liata, Les Archives..., op. cit., pp. 18-19 et pp. 41-42 résumé des archives de Panagos Deliyannis (1822-1842) ; V. Sfyroeras, « Deliyannis », op. cit., p. 51. Les archives de la famille Deliyannis, les Mémoires de Kanellos Deliyannis, les Mémoires d'autres combattants aussi de la guerre d'indépendance et d'autres sources nous donnent des renseignements très riches sur le rôle des frères Deliyannis durant cette guerre et sur les dégâts que leur famille a subis.
Marie-Carmen SMYRNELIS
EUROPÉENS ET OTTOMANS À SMYRNE (DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE À LA FIN DU XIXe SIÈCLE)
Comment définir Vhomo ottomanicus ? L'utilisation de ce terme ne nous invite-t-elle pas à en brosser un portrait par trop stéréotypé au détriment de sa spécificité et de sa multiplicité ? Que signifie «être ottoman» dans un Empire où coexistent de nombreux groupes ethniquement, confessionnellement et nationalement divers ? Où les grandes villes du pourtour méditerranéen, liées au commerce terrestre ou maritime, européen ou non, se développent aux côtés des petites bourgades rurales de l'Anatolie, de la Thessalie ou d'ailleurs ? Où les différentes régions ne sont pas soumises au même type de sujétion ? Mais aussi à un moment où la consolidation des identités individuelles et collectives, dans le cadre des États-nations existants ou en formation, contribue à modifier les perceptions relatives, les consciences d'appartenance, l'identification des ressemblances et des différences, et cela tant chez les « étrangers » de l'Empire que pour les membres des diverses communautés qui l'habitent ? En définitive, il faut se demander que regrouper sous la dénomination d'Ottoman : les sujets du sultan (ou seulement une partie d'entre eux) ou plus largement tous les habitants de l'Empire ; cette définition doit, par ailleurs, toujours être replacée dans un contexte précis et située par rapport à une période donnée. Pour apporter quelques éléments de réponse à toutes ces interrogations, pour tenter de mieux cerner les contours de l'Ottoman, j'ai choisi de centrer mon analyse sur quelques individus et quelques familles établis à Smyrne entre la fin du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle, période de profonds bouleversements tant dans l'histoire de l'Empire ottoman que dans celle des pays européens. Smyrne offre, en effet, un cadre privilégié : on y retrouve en réduction ce mélange de peuples, de langues, de couleurs, qui caractérisent l'Empire ottoman. Sa population stable est majoritairement chrétienne (Grecs orthodoxes ou catholiques, Arméniens grégoriens ou catholiques), mais elle
120
MARIE-CARMEN
S M YRNELI S
compte aussi quelques milliers de Juifs ainsi que des Turcs. Elle côtoie une foule de travailleurs saisonniers, de commerçants, de marins, de capitaines.... venus d'Europe ou d'une autre région de l'Empire. Les Européens, qui s'y sont installés dès la fin du XVIIe siècle, occupent, pour leur part, une place spécifique. De cette population bigarrée de l'Empire et de la ville de Smyrne, je n'ai choisi que trois individus et familles, chrétiens et juifs, des figures anonymes au destin quelconque. Aucun des trois ne fait partie de ce groupe d'individus et de familles qui existent dans toute communauté ethnicoconfessionnelle ou toute «colonie» 1 européenne, et dont la caractéristique principale est de s'identifier (en tout ou en partie) aux règles de leur groupe d'appartenance et de former un noyau très compact dans lequel l'endogamie et l'appartenance au même milieu ethnique, confessionnel et national sont primordiales. Tout au contraire, par leurs comportements et leurs pratiques, les Fernandès Dias, les Barrelier, ou même Basile Diogénis, ne semblent jamais s'identifier complètement à un seul groupe. A la fois liés aux milieux européens (essentiellement français, dans ces trois cas) et ottomans, ils ne sont ni des Ottomans à part entière, ni des Européens dans tous les sens du terme. Ils n'en sont pas moins tour à tour réclamés par les autorités ottomane et française, comme relevant de ces différentes juridictions. Ces trois histoires de vie peuvent apparaître comme des cas limites ou des exceptions, y compris au sein de l'Empire ottoman. Mais les omettre serait réduire l'Ottoman à ce qu'il n'est pas. Et chaque cas n'est-il pas, à sa façon, autant une exception qu'un exemple ? Leur analyse devrait permettre, de toute façon, de mieux pénétrer le fonctionnement de la société ottomane et par là même, celui des communautés ethnico-confessionnelles et des «colonies» européennes. Elle constitue aussi le meilleur moyen pour reposer quelques questions concernant le statut de l'individu ou plutôt sa qualité pour reprendre les termes utilisés dans les archives françaises du XIXe siècle2. Reconstituer le parcours de chacun de ces individus pour les intégrer dans leurs familles et suivre celles-ci pendant près d'un siècle, constitue dès ' Ce terme désigne un groupe d'Européens établis dans l'Empire ottoman depuis la fin du XVIIe siècle. Il ne fait, en aucune façon, référence à une quelconque notion de dépendance de la part de l'Empire ottoman. Au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, les Européens utilisent essentiellement le terme de « nation » pour désigner ce groupe d'Européens, terme qui renvoie à une définition plus étroite, à toute une série de règles très strictes qui régissent la «colonie». ^Concernant les questions de la nationalité dans l'Empire ottoman, et plus précisément en Égypte, cf. Robert Ilbert, Alexandrie 1830-1930. Le Caire : IFAO, 1996, 2 vols.; du même auteur, « Qui est Grec ? La nationalité comme enjeu en Égypte. 1830-1930. » Relations Internationales, n" 54, 1988, pp. 140-160.
E U R O P E E N S ET O T T O M A N S À
SMYRNE
121
lors l'hypothèse méthodologique qui sous-tend mon travail. Il s'agit de cerner chaque personnage, mais aussi chacun de ses choix, de ses comportements, de la manière la plus complète possible. Il est indispensable alors de recourir à des sources différentes, produites à des fins différentes : seule leur juxtaposition peut nous permettre de multiplier les éclairages sur chaque individu, de saisir la portée réelle de ses choix. La lecture des correspondances des consuls européens de Smyrne ne peut servir que comme point de départ, mais pour répondre à toute une série d'autres questions que cette source ne fait pas apparaître, il faut aussi consulter les registres de l'état civil du consulat français de Smyrne, ceux de la paroisse française Saint-Polycarpe tenue par les Capucins, ainsi que les actes notariés de la chancellerie du consulat français. La disparition des archives de la plupart des communautés établies à Smyrne rend néanmoins la tâche de reconstruction des parcours individuels et familiaux plus difficile1.
1. HISTOIRES DE VIE Jacob Fernandès Dias apparaît, pour la première fois dans les archives consulaires françaises, dans les années 1750 2 . Il est membre d'une famille juive originaire de Bayonne (et comme telle sous « protection » française) 3 établie depuis déjà quelques générations dans le Levant. Il s'occupe de négoce, important des marchandises d'Europe et exportant des produits du pays. Durant tout le XIXe siècle, cette famille reste sous « protection » française et elle figure dans les listes des « protégés » de la colonie française de Smyrne que dresse chaque année le consul 4 . Elle dépend dès lors de la juridiction du consul français pour toutes les affaires la concernant tant dans les domaines de la justice (civile et criminelle), de la police et des affaires commerciales que pour de simples questions administratives ; elle doit se soumettre aux réglementations françaises comme toute famille française. Les registres de l'état civil des Français établis à Smyrne sont conservés aux archives du ministère des Affaires étrangères (MAE) ainsi qu'au Centre des Archives diplomatiques de Nantes (CADN). Les registres de la chancellerie du consulat français sont conservés au ÇADN. Pour leur part, les registres de la paroisse française Saint-Polycarpe sont conservés à izmir, dans cette même église. 2 CADN, Fonds Constantinople, Correspondance avec Smyrne, n° 4, lettre du consul à l'ambassadeur, 31 juillet 1757. 'La meilleure définition de la protection est fournie par P. Arminjon, Étrangers et protégés dans l'Empire ottoman, Paris 1903, partie III : « La protection se présente comme un lien juridique qui rattache une personne à un Etat et la fait jouir de certains des droits et privilèges dérivés de la qualité de national de cet État, sans lui conférer la qualité de national ni le statut personnel qui en dépend ». Le protégé d'un pays n'est plus soumis au paiement de la capitation que payent les sujets ottomans non-musulmans ; il peut faire appel à la protection du consul à toute occasion et peut ainsi profiter des immunités de police et de juridiction dont jouissent les sujets de l'État protecteur. Ces listes sont conservées dans le fonds Correspondance consulaire et commerciale, Smyrne, des archives du ministère des Affaires étrangères (MAE). Certaines se trouvent aussi au CADN, dans le fonds Constantinople, correspondance avec les échelles : Smyrne.
122
MARIE-CARMEN S M YRNELI S
Pour les Fernandès Dias, conserver la « protection » française constitue le meilleur moyen afin de ne pas rompre tout lien avec les membres de la colonie française (voire européenne) ou les autorités consulaires françaises. Cette « protection » leur offre, en tout cas, de nombreux avantages dans leurs affaires commerciales (elle les fait profiter des mêmes privilèges commerciaux que les négociants français), et leur permet d'échapper à la justice ottomane en cas de problèmes (dans tous les domaines de leur vie quotidienne) avec des sujets ottomans. Si l'on regarde les choses de plus près, si l'on suit d'autres membres de cette famille, si l'on utilise des séries d'archives différentes, les Fernandès Dias apparaissent liés essentiellement à des solidarités qui sortent du cadre de leur rattachement à la «colonie» française. Ils ne recourent apparemment jamais aux instances administratives françaises, ne déclarent pas les naissances, les mariages et les décès des membres de leur famille, en chancellerie du consulat français, comme ils devraient pourtant le faire, en tant que Français ; ils n'y enregistrent pas davantage les actes de vente ou d'achat de leurs propriétés, ni leurs procurations pour des affaires privées ou commerciales. Ils ne résident pas, comme les autres Européens établis à Smyrne, dans le quartier franc, à une époque où la division en quartiers réservés à chaque communauté ethnicoconfessionnelle conserve encore un sens. Ils ont choisi, pour leur part, le quartier juif réservé aux Juifs ottomans. Ils possèdent, dès le milieu du XVIIIe siècle, des biens fonds dans le Levant. La plupart des membres de cette famille ont contracté des alliances matrimoniales avec des femmes juives ottomanes et entretiennent des contacts très étroits (liens d'affaires, amitié, parenté spirituelle...) avec des Juifs ottomans. Les loyautés de type ethnique et confessionnel sont très fortes, dans le cas de cette famille, comme d'ailleurs dans celui de la plupart des familles juives européennes, et priment sur les loyautés de type national 1 . Les Fernandès Dias apparaissent intégrés de fait dans la communauté juive de Smyrne, officiellement reconnue par les autorités ottomanes. Le père de Jacob Fernandès Dias a d'ailleurs exercé la fonction de « député » au sein de celle-ci : il est devenu ainsi le représentant de cette communauté pour les autorités ottomanes ou européennes et a joué aussi un rôle administratif au sein de celle-ci (répartition des impôts et taxes entre les différents membres de la communauté...) 2 . Une liste des Juifs « protégés » français, dressée en 1822 par le consul français de Smyrne précise même qu'à cette date, le chef de cette famille, 1
On retrouve le même phénomène à Alexandrie. Cf. Robert Ilbert, op. cit., vol. 1, chap. 8. CADN, Constantinople, correspondance avec les échelles : Smyrne, n° 2, lettre du consul adressée à l'ambassadeur, 27 novembre 1760. 2
EUROPEENS
ET O T T O M A N S
À
SMYRNE
123
Ménachem Fernandès Dias (comme d'ailleurs les autres Juifs « protégés » français) paye les « droits du pais et les taxes de sa communauté Il est difficile, en l'état de cette recherche, de savoir ce que représentent exactement ces droits acquittés. Il s'agit sans doute des droits que perçoit chaque communauté auprès de l'ensemble de ses membres pour le fonctionnement de celle-ci (écoles, hôpitaux...) ; mais il faut aussi ajouter les droits qu'exigent les autorités ottomanes sur les différentes communautés ethnicoconfessionnelles de l'Empire et leurs membres. Apparemment, les Juifs européens acquittent aussi une partie de ces taxes. Au XIXe siècle, ils ne payent sans doute pas la capitation due par les sujets ottomans nonmusulmans de l'Empire, en dépit de l'existence d'une loi ottomane qui au début du XIXe siècle n'a toujours pas été mise en application —loi qui prévoit que les Juifs européens, qui auraient résidé plus de trois ans dans le Levant, y seraient soumis et deviendraient par là même des sujets ottomans à part entière2. Une lettre d'un Juif français, adressée à l'ambassadeur en 1809, ajoute « qu'en leur qualité de Juifs, ils devaient par religion subvenir aux mêmes dépenses que les autres sujets du Grand Seigneur » 3 , mais ne nous apporte pas davantage d'informations sur la nature de ces taxes. Par leurs rattachements multiples, par Dias entrent nécessairement en contact administratives (l'administration française, autorités ottomanes) qui tour à tour les exclusivement de leur juridiction.
leurs pratiques, les Fernandès avec différentes instances la communauté juive et les réclament comme relevant
Chacune de ces instances raisonne selon sa logique propre. Donner une définition institutionnelle, stricte et rigide, du statut de cette famille est loin d'être aisé. Pour l'administration française, conserver un nombre important de protégés est une affaire de prestige certes dans la concurrence qui se joue avec les autres puissances européennes établies dans le Levant. Mais il s'agit avant tout d'une question de principe ; les autorités françaises ont bien trop peur de voir leurs ressortissants se fondre dans la population locale. La protection apparaît alors comme le meilleur moyen pour maintenir des liens avec eux. Le consul français de Smyrne, l'ambassadeur et le ministre des Affaires étrangères sont prêts à tolérer les écarts aux règles qui régissent la «colonie», tout en
*CADN, Constantinople, Correspondance avec les échelles, Smyrne, n° 32, État des Français et protégés de France résidant ou de passage à Smyrne, joint à la lettre du consul adressée à l'ambassadeur, 20 mai 1822. CADN, Constantinople, Correspondance avec les échelles, Smyrne, n° 2, Minutes, Lettre de l'ambassadeur au consul, 19 décembre 1760. J MAE, Smyrne, Correspondance commerciale consulaire (CCC), 33, copie de la lettre du consul adressée à l'ambassadeur, 6 avril 1809.
124
MARIE-CARMEN S M YRNELI S
blâmant les protégés qui les ont commis 1 . Il ne peut être, en aucun cas, question de priver les contrevenants de la « protection » française. De telles décisions seraient bien trop lourdes de conséquences : comment abandonner aux autorités ottomanes des individus qui avaient été membres de la «colonie» française et dès lors comment pouvoir protéger efficacement (sans risque d'ingérence) ceux qui sont restés Français à part entière ? Pour sa part, la communauté juive a besoin d'avoir une autorité stricte sur ses membres pour apparaître crédible et efficace auprès des autorités ottomanes. Elle traite les Juifs protégés d'une quelconque puissance européenne comme des membres à part entière d'autant plus qu'ils sont installés dans le Levant depuis longtemps et sont véritablement intégrés dans le pays. Les communautés juives (comme les communautés arméniennes et grecques d'ailleurs) servent aussi de base à une mobilité individuelle et collective, non seulement à l'intérieur de l'Empire ottoman mais aussi dans un espace plus vaste qui va, à cette date-là du moins, de l'Inde jusqu'à l'Angleterre et la Hollande. De son côté aussi, l'administration ottomane a fait sienne la logique des communautés; elle s'appuie sur elles pour affirmer son autorité et faire rentrer ses impôts. Il n'est dès lors pas étonnant qu'en 1760, la communauté juive de Smyrne se prépare à traduire devant la justice ottomane les Fernandès Dias parce qu'ils n'ont pas acquitté intégralement certaines taxes qu'ils lui devaient. Elle exige aussi d'eux des taxes que payent seuls les sujets ottomans et les traite, de toute façon, comme tous ses autres membres. Au milieu du XIXe siècle aussi, les autorités ottomanes réclament les familles juives protégées européennes comme relevant de leur juridiction. Une fois de plus, ces différentes instances fonctionnent selon leur logique propre. L'attitude du consul français de Smyrne qui réclame ces individus (jouissant de sa protection) ne peut surprendre. Après d'interminables négociations, l'affaire est enfin arrangée : les Fernandès Dias restent sous la « protection » française. Le cas de la famille Barrelier, « originaire française » 2 pose, à son tour et dans des termes très voisins, toute une série de questions.
'Des règles nombreuses régissent, essentiellement au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, les «colonies» françaises établies dans le Levant. Elles interdisent les séjours trop longs des Français dans le Levant, les mariages avec des Ottomans, l'acquisition de biens fonds dans le Levant. Contrevenir à ces lois est passible de la perte de la qualité de Français (ou de protégé français) ou du rapatriement en France. ^Ce terme, qui est utilisé dans les archives européennes au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, désigne des familles ayant un ancêtre français ; celles-ci sont établies depuis plusieurs générations dans le Levant, y ont acquis des biens fonds et y ont épousé le plus souvent des femmes du pays.
EUROPEENS
ET O T T O M A N S
À
SMYRNE
125
C'est sans doute au milieu du XVlIIe siècle qu'un membre de la famille Barrelier, originaire de la Ciotat, s'est installé dans une des îles de l'Archipel égéen. Il y a épousé une Grecque orthodoxe. À partir des années 1780, les archives du consulat français de Smyrne mentionnent un certain Nicolas Barrelier, maître calfat. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les références à cette famille se multiplient dans les archives consulaires françaises. Tous les hommes de cette famille ont épousé des Grecques ottomanes, de confession orthodoxe. Ils exercent des professions liées à la mer et sont ainsi pêcheurs, charpentiers, bâteliers 1 ou constructeurs de petites embarcations. Les femmes nées Barrelier se marient aussi avec des Grecs ottomans. Par sa qualité « d'originaire française », la famille Barrelier est soumise à l'autorité du consul de France ainsi qu'à toutes les règles qui régissent la présence des Français dans le Levant. Elle a choisi de recourir à l'instance administrative française, fait enregistrer les actes de vente ou de location de ses maisons ou terrains, ses procurations, ses déclarations dans les registres de la chancellerie du consulat. Elle dépend de la juridiction consulaire française de Smyrne et c'est ainsi qu'au milieu du XIXe siècle, un de ses membres impliqué dans un assassinat, est traduit devant le tribunal consulaire puis envoyé au Parlement d'Aix-en-Provence pour y être jugé 2 . Seul un examen plus approfondi mené à partir de séries d'archives différentes permet alors de mieux connaître cette famille, ses comportements, son réseau de relations et d'appartenance. La famille Barrelier entretient des liens très forts avec des Grecs ottomans : liens de voisinage, d'amitié ou d'affaires, relations de parenté spirituelle... Elle est en liaison constante avec des Grecs ottomans pour ses affaires, leur vend les petites embarcations qu'elle construit 3 ; les ventes de ses propriétés sont toujours conclues au profit de Grecs 4 . Elle professe la religion grecque orthodoxe, les consuls français le lui reprochent bien d'ailleurs (il n'est dès lors pas étonnant de ne pas trouver leurs noms dans les registres de la paroisse française Saint-Polycarpe) et choisit les parrains et marraines de ses enfants parmi des Grecs ottomans. Les prénoms de tous ses membres sont Grecs (Stelio, Vanghéli, Maria, Panaghi...). La plupart de ses membres ne connaissent sans doute plus la langue française (ils n'ont d'ailleurs jamais fréquenté les écoles tenues par des Français ou par les religieux qui dispensent un enseignement en français) ; ils signent en grec les actes officiels du consulat de France, ce qui suggère que celui-ci se prête au jeu ' I.cs bâteliers sont en possession d'un petit bâtiment et se livrent au cabotage. CADN, Constantinople, Correspondance avec les échelles, Smyrne, n° 43, lettre du consul à l'ambassadeur, 22 novrembre 1850. •'CADN, Chancellerie, Smyrne, n° 264, déclaration d'Andria Barrelier, 17 novembre 1840. 4 CADN, Chancellerie, Smyrne, cf. Contrats de vente ou de location de la famille Barrelier. 2
126
MARIE-CARMEN
SMYRNELIS
en toute connaissance de cause, accepte la présence d'interprètes ou assure luimême cette nécessaire interprétation... La famille Barrelier ne réside pas, comme les Européens établis à Smyrne, dans le quartier franc. Dès le début du XIXe siècle, elle a choisi d'habiter dans le quartier de la Courmadia 1 révélant ainsi les solidarités qui sont les siennes. Le geste de la mère grecque du petit Dimitri Barrelier qui, en 1852, se retrouvant veuve, requiert l'enregistrement par la chancellerie française de l'acte de notoriété publique de son fils 2 , est bien le signe des appartenances multiples de cette famille. Les noms des sept témoins qui viennent alors attester l'identité du petit Dimitri Barrelier, attestent à leur manière aussi de ses solidarités : trois d'entre eux sont des frères ou cousins du défunt, les quatre autres sont des amis Grecs ottomans liés par des liens d'amitié et d'affaires avec le défunt (ils sont bâteliers et pêcheurs) ainsi qu'un fourrier 3 sujet hellène 4 . Les Barrelier sont intégrés de fait dans la communauté grecque de Smyrne à laquelle ils payent des taxes et droits comme n'importe quel Grec ottoman. Une liste des membres de la «colonie» française de Smyrne dressée par le consul en 1822 5 , va même jusqu'à faire apparaître cette famille parmi les Grecs mais jouissant de la « protection » française, par une prétendue origine française : elle n'a que « son nom et quelques traditions » répètent les consuls français de Smyrne tout au long du XIXe siècle. Tant la communauté grecque que les autorités ottomanes ou l'administration française ont des attentes spécifiques et envisagent le statut de la famille Barrelier en fonction de leurs propres règles. Elles la revendiquent à tour de rôle comme relevant de leur juridiction. Les Barrelier restent, en fait, soumis à l'autorité du consul français mais savent profiter des nombreuses possibilités qui s'offrent à eux. Le cas de Basile Diogénis est légèrement différent 6 . Il est né à Smyrne en 1830 de parents hellènes. Il passe toute son enfance dans le village tout ' Bn l'absence d'informations précises, le quartier de la Courmadia est difficile à situer dans la ville ; il semble tout proche du quartier grec. 2 Son acte de naissance n'y avait pas été enregistré au moment de sa naissance, parce qu'il avait été baptisé dans une église grecque qui ne tient jamais de registre. ^Matelot chargé des écritures et de la comptabilité. 4 CADN, Chancellerie, n° 265, Smyrne, Acte de notoriété publique de Dimitri Barrelier, 22 décembre 1852. •*CADN, Constantinople, Correspondance avec les échelles, Smyrne, n° 32, État des Français et protégés de France résidant ou de passage à Smyrne, joint à la lettre du consul adressée à l'ambassadeur, 20 mai 1822. ^L'ensemble de ce dossier est conservé au CADN, Constantinople, Correspondance avec les échelles, Smyrne, n° 49, année 1886.
EUROPEENS
ET
OTTOMANS
À
SMYRNE
127
proche de Smyrne, Boudja. À partir de 1843, il jouit de la protection française. Devenu adulte, il crée à Smyrne une importante maison de commerce sur le modèle des grands magasins du Bon Marché à Paris, qu'il place sous juridiction française. En 1873, il obtient l'autorisation d'établir son domicile en France et par décret du Président de la République française du 13 novembre 1880, il obtient la naturalisation française 1 . Il a épousé une Grecque orthodoxe (aucune indication dans les archives ne nous permet de savoir si celle-ci était ottomane ou hellène) et entretient des liens (d'affaires, d'amitié) tant avec des Européens, des Hellènes que des Ottomans. En 1884, quelques années après sa mort, sa maison de commerce fait faillite. De nombreux Ottomans se prétendant créanciers, se présentent au tribunal de commerce et obtiennent de son président qu'il rende un jugement plaçant la maison en faillite de B. Diogénis sous juridiction ottomane. C'est alors que le problème du statut de cet individu se pose réellement. Le gouvernement ottoman réclame la famille de B. Diogénis comme étant sujette ottomane et cherche toute une série de preuves pour arguer d'une telle réclamation : des membres du tribunal de commerce ottoman font une enquête dans le village de Boudja et obtiennent une déclaration d'un vieil habitant qui affirme que Basile Diogénis est membre d'une famille grecque ottomane, déclaration confirmée par l'archevêque grec de Smyrne. Pour les autorités ottomanes, les parents de Basile Diogénis sont natifs d'un village de Morée, et sont venus à Smyrne alors que cette province était encore ottomane. Ils ne peuvent donc être hellènes ; d'ailleurs, ils ne sont pas enregistrés au consulat hellénique de Smyrne. Le consul français de Smyrne se mobilise, à son tour, pour défendre cet individu, devenu français et dont les parents sont hellènes et non ottomans ainsi que cela a été fixé dans les accords qui ont présidé à la création du nouvel État indépendant. L'affaire disparaît des archives françaises peu après, sans doute réglée au profit de la veuve de Basile Diogénis 2 . Les autorités ottomanes, comme les créanciers ottomans, l'archevêque grec de Smyrne ou le vieil habitant de Boudja, ne font aucune référence au possible changement de statut de B. Diogénis par la naturalisation française. Ils cherchent seulement à savoir s'il est Hellène ou Ottoman. Tous semblent ignorer (ou font semblant d'ignorer) un tel changement.
'L'acte est enregistre' dans les registres de la chancellerie du consulat français de Smyme. Cf. CADN, Chancellerie, Smyrne, n° 266, enregistrement de l'acte de naturalisation de Basile Diogénis, 23 mai 1881. 2
I1 serait intéressant de poursuivre l'enquête sur l'affaire B. Diogénis et d'ajouter d'autres pièces au dossier. En particulier, il faudrait savoir quels rapports Basile Diogénis entretient avec le consulat hellénique.
128
MARIE-CARMEN
SMYRNELIS
La distinction entre la qualité d'Hellène ou d'Ottoman de Basile Diogénis n'est pas aisée à faire à une époque où les diverses règles concernant la nationalité 1 de l'individu ne sont pas vraiment appliquées et où les solidarités de type confessionnel restent fortes. Le changement de passeport (et donc de statut) est difficile à comprendre pour les différents acteurs, et cela d'autant plus que Basile Diogénis continue à résider à Smyrne et que ses comportements et ses pratiques restent identiques. Le statut d'un individu est rarement défini de façon stricte dans l'Empire ottoman. Il n'est dès lors pas difficile de contester la nationalité de celui-ci tant de la part des différents acteurs que de celle des instances administratives. Pour l'individu, prouver son identité n'est pas toujours simple.
2. REDÉFINIR L'OTTOMAN Comment définir alors, dans l'Empire Ottoman, l'identité de chaque individu ? L'existence des instances communautaires (ou consulaires, car elles jouent le même rôle) qui encadrent officiellement les individus dans tous les actes de leur vie, incite souvent trop facilement le voyageur occidental de passage dans l'Empire ou le lecteur des archives des différentes communautés ou «colonies» à intégrer de façon « automatique » les individus dans des groupes clairement délimités en fonction de leur appartenance ethnique, confessionnelle ou nationale ; en fonction des charges qu'ils y exercent ou des taxes qu'ils y acquittent (preuve supplémentaire de leurs loyautés confessionnelles) ; en fonction aussi des règles qui régissent chacun de ces groupes. Mais de tels critères ne peuvent suffire à définir la qualité des individus bien qu'ils impriment leurs marques sur le fonctionnement de la société ottomane. Ces groupements cohérents imposés d'en haut par des autorités lointaines (ottomanes ou européennes) qui en ont besoin pour se faire obéir, se faire payer ou pour structurer les fidélités, ne donnent qu'une définition institutionnelle de l'identité et des appartenances de chacun. Que signifie pour un individu lié à des solidarités diverses, soumis à plusieurs juridictions avoir un statut officiel, juridique ? Que peut signifier ce statut à une époque où les règles édictées, tant du côté ottoman que du côté européen, ne sont pas strictement appliquées ou ne peuvent véritablement l'être faute d'une définition claire de la nationalité ou plutôt faute d'une définition de
1 J'emploie le terme de nationalité pour définir l'état d'une personne membre d'une nation déterminée (nation au sens d'État-nation).
EUROPEENS
ET O T T O M A N S
À
SMYRNE
129
celle-ci qui soit acceptée par les individus et les groupes concernés et corresponde à leurs modes de vie, à leurs comportements ? Les identités, les appartenances des individus apparaissent plutôt comme des réalités d'une remarquable complexité. Les pratiques individuelles et collectives, mises en évidence par l'examen de l'ensemble des choix et rattachements de chacun, sont infiniment plus libres, plus souples, plus imaginatives. Elles ne cessent de recomposer le tissu social. Les individus jouent entre leurs diverses appartenances (ethnique, confessionnelle et nationale). Ils savent se glisser dans les interstices d'un système que les différentes instances ne contrôlent jamais totalement et ils profitent des opportunités qui s'offrent à eux. Ils multiplient leurs stratégies. Leurs choix sont pluriels ; ils cherchent soit à contourner les contraintes liées à l'existence de groupes fortement structurés, soit à se les réapproprier pour les utiliser à leur profit et leur avantage. Ils semblent donc disposer d'une certaine marge de liberté et d'appréciation. En définitive, ils n'essaient pas d'avoir plusieurs identités : leur identité est faite précisément de l'appartenance à des systèmes de relations divers qui impliquent tous des obligations et des contraintes mais ne sont, en aucun cas, perçus comme des absolus. Les lettres échangées, en 1842, entre le consul français de Smyrne et le ministre des Affaires étrangères éclairent, de façon significative, le décalage qui existe entre les pratiques des individus et la définition institutionnelle de leur identité. Le consul tente d'expliquer au ministre qu'à Smyrne, il est impossible de définir de « manière stricte et positive le statut des individus et plus précisément celui des membres de la «colonie» française, qui « ont une nationalité douteuse et qui sont plus Français par supposition qu'ils ne le sont en réalité Leur situation est incertaine, intermédiaire et ils ne disposent d'aucun titre pour prouver leurs origines. Le ministre a beaucoup de mal à comprendre un tel état de fait et demande au consul de lui fournir d'autres informations sur ces individus ; pour lui, « une situation semblable ne peut exister : ceux dont il s'agit ont conservé leur nationalité avec la plénitude de ses droits ou l'ont perdue dans toute l'acception du mot » 2 . Son discours très rigoureux et cohérent tente de ne pas tenir compte de l'existence d'une réalité humaine, économique, sociale et culturelle qui échappe largement au contrôle de l'administration française. Pour sa part, le consul français de Smyrne, confronté à cette même réalité, a pris conscience de la complexité de la
1MAE, Smyrne, CCC, 46, Minutes, dépêche du ministre au consul français de Smyrne, 31 janvier 1842. * Ibid.
130
MARIE-CARMEN
SM YRNELI S
situation. Il fait, de moins en moins souvent, appel au langage officiel strict. Il se prête au jeu de ces situations plurielles ; dès lors, il peut accepter aussi que des membres de sa «colonie» ne sachent ni écrire, ni même signer en français, et que la présence d'interprètes soit indispensable au sein du consulat de France. Qu'ils soient Grecs, Juifs ou Français — et l'on pourrait ajouter aussi le cas des Arméniens dont les pratiques et comportements sont sensiblement identiques, comme l'examen de plusieurs parcours individuels pourrait aisément le montrer —, les individus ne se comportent pas de façon fondamentalement différente — les exemples précédents le montrent dans une large mesure. La vision trop souvent répandue d'une société ottomane fortement compartimentée se trouve ébranlée par une telle analyse ; l'existence de groupes homogènes, très structurés, n'a plus raison d'être sous une forme aussi rigide. La séparation entre les différents groupes qui coexistent dans l'Empire s'atténue aussi : les liens d'affaires d'abord mais aussi les relations d'amitié ou de voisinage, comme d'ailleurs les alliances matrimoniales ou les liens de parenté spirituelle, peuvent se nouer entre des individus aux appartenances ethniques, confessionnelles ou nationales diverses. Dans l'Empire ottoman, des barrières liées à l'appartenance confessionnelle des individus se dressent encore au début du XIXe siècle, entre musulmans et non-musulmans 1 mais aussi entre chrétiens et juifs. Par ailleurs, les Capitulations obtenues par quelques pays européens, à partir du XVIIe siècle, accordent aux «colonies» européennes établies dans l'Empire et à leurs membres un statut privilégié totalement indépendant des instances administratives ottomanes. Entre tous ces extrêmes, se dessine désormais une gamme très large de situations intermédiaires. L'opposition entre Européens et Ottomans s'assouplit aussi avec l'installation durable des Européens dans le Levant, les alliances qu'ils y contractent avec des Ottomans, les fonctions qu'ils y exercent. Entre le simple habitant de l'Empire et le sujet du sultan, la confusion peut être facile à faire. Au cours du XIXe siècle, dans l'Empire ottoman, les identités et appartenances des individus doivent être constamment redéfinies dans un espace dont les horizons et les possibilités ne cessent de se modifier. Avec la constitution des États-nations, de nouveaux modèles d'identification des ^Cette opposition est institutionnalisée par l'existence des communautés ethnico-confessionnelles ou le paiement des taxes dues par les sujets non-musulmans du sultan.
EUROPEENS
ET O T T O M A N S
À
SMYRNE
131
différences et des ressemblances des individus se diffusent, modèles sur lesquels l'Empire est obligé de choisir de s'aligner. Dès le début du siècle, l'État ottoman s'est engagé dans toute une série de réformes. Avec la période des Tanzimatle processus s'accélère et s'étend dans plusieurs directions : centralisation administrative, modernisation de l'appareil étatique, occidentalisation de la société, sécularisation (même avec des restrictions) du droit et de l'enseignement. « Les yeux fixés sur l'Europe, l'État ottoman cherche son salut dans le décalquage des modèles que celle-ci offre en pâture » 2 , dans un contexte marqué par l'inégalité croissante de l'Empire ottoman face aux puissances occidentales et à la domination économique de ces dernières. Le rescrit impérial de Giilhâne de 1839, comme le firman promulgué en 1856 sous la pression des puissances occidentales, tentent d'atténuer les différences de statut entre les sujets du Sultan, en accordant à tous, quelles que soient leur race et leur religion, le respect de leurs droits légaux ainsi qu'une parfaite sécurité de leurs personnes. Le firman de 1856 va encore plus loin dans cette direction et garantit aux sujets non-musulmans du sultan la liberté de culte, l'égalité avec les musulmans devant la justice et l'impôt, l'accès à toutes les instances administratives ainsi que la libre jouissance de leurs immunités traditionnelles (notamment en matière d'organisation interne des communautés). Si ces concessions ont pour volonté l'union fraternelle de tous les sujets du sultan, elles incitent aussi les différents groupes à s'enfermer dans leurs particularismes en laissant aux communautés le droit de gérer librement leurs affaires internes 3 . A partir des années 1860, toute une série de règles, tant du côté ottoman que du côté européen, tentent de faire disparaître les situations plurielles, les appartenances multiples de chacun. Elles apparaissent comme l'aboutissement normal d'un processus qui a débuté quelques années auparavant : l'État ottoman, comme les États occidentaux, l'emportent désormais et réussissent à contraindre leurs ressortissants à faire des choix. L'Empire ottoman s'invente une nationalité : la loi promulguée en janvier 1869 fixe les critères de l'obtention de la nationalité ottomane (sans faire de discriminations entre les chrétiens, les juifs et les musulmans), et précise les cas de naturalisation européenne de sujets ottomans. En 1869, les nouvelles réformes de l'armée ottomane concernent, en principe, tous le sujets
' Paul Dumont, « La période des Tanzimat. 1839-1878 », R. Mantran (éd.), Histoire de l'Empire ottoman, Fayard 1989, pp. 459 à 622. 2 P. Dumont, op. cit., p.459. 3 P. Dumont, op. cit., p.497.
132
MARIE-CARMEN
SMYRNELIS
ottomans qui sont astreints au tirage au sort ; mais les non-musulmans, dont la présence dans l'armée n'est guère souhaitée, malgré les dispositions égalitaires des réformes, ont alors la possibilité de se faire exempter en payant une taxe qui permet le « rachat » du service militaire 1 . Le règlement ottoman d'août 1863, relatif aux consulats étrangers, cherche, pour sa part, à limiter les abus liés à la protection des sujets ottomans par un pays européen. Par ailleurs, la présence européenne change imperceptiblement de nature. Par petites touches, se dessine lentement une autre conception du statut des Européens établis dans le Levant, tandis que se renforce de plus en plus le contrôle des différentes instances administratives sur leurs ressortissants. Les consuls européens reçoivent, à leur tour, des instructions de leur ministre afin de procéder au recensement des membres de leur «colonie» 2 . La position des familles « originaires françaises » commence à se clarifier : elles retrouvent leur statut de Français à part entière au sein de la «colonie» et elles sont, dès lors, à nouveau officiellement recensées au consulat (leurs actes d'état civil y sont enregistrés). Un membre de la famille Barrelier se présente alors au consulat de Smyrne et demande l'enregistrement de sa famille ainsi qu'un passeport français et cela bien que ni lui ni les autres membres de la famille ne parlent le français. Pour les autorités françaises, il n'est alors pas toujours facile de certifier que cette famille a réellement des origines françaises en l'absence de papiers l'établissant clairement. Le changement progressif des différents termes, qui caractérisent la «colonie» française et ses membres, reflètent l'évolution en cours. Au cours du XIXe siècle, les mots « nation » et « originaire français » disparaissent petit à petit des archives consulaires pour laisser la place aux termes de « colonie » et « Français natif de ». Les autorités françaises reconnaissent implicitement l'échec du modèle trop strict de contrôle des individus qu'elles avaient voulu imposer au XVIIIe siècle. D'autres circulaires concernent le service militaire imposé désormais aux Français nés ou demeurant en Levant. Les Français ou « originaires français », non enregistrés au consulat français, doivent se présenter et s'y inscrire 3 . Plusieurs de ces familles qui, comme les Roubin, les Barrelier ou les Fontrier, semblent totalement intégrées dans la société locale choisissent alors d'aller s'enregistrer au consulat français, avec tous les droits et devoirs que cela implique. Quelques années plus tard, leurs enfants sont appelés à faire leur service militaire en France, alors qu'ils ne parlent même pas le français ! ' P. Dumont, op. cit. MAE, Smyrne, CCC, 50, lettre du consul au ministre, 29 juillet 1863. 3 MAE, Smyrne, CCC, 50, lettre du consul au ministre, 14 janvier 1864.
2
EUROPEENS
ET
OTTOMANS
À
S MYRNE
133
Ces mesures ne sont mises en application que très lentement. A la fin du XIXe siècle, le problème des Juifs européens n'est toujours pas réglé, ni pour les autorités ottomanes ni pour les autorités européennes. Les premières se plaignent que des Juifs de Smyrne revendiquent la protection française afin de se soustraire au paiement d'impôts et de la taxe d'exonération du service militaire qu'acquittent les sujets ottomans 1 . Le consul français tente alors de procéder au recensement des Juifs véritablement originaires français. Il s'adresse aux chefs de la communauté juive de Smyrne, seuls capables de fournir les pièces d'état civil et de prouver la filiation de ces individus qui n'ont jamais enregistré leurs naissances, mariages ou décès au consulat français. La liste définitive n'est achevée qu'en 18902. Les choix que les individus sont contraints de faire n'impliquent pourtant pas — au moins dans un premier temps — de rupture avec leur mode de vie antérieur ou avec leurs anciennes solidarités. Les pratiques individuelles et collectives conservent encore leur spontanéité, leur liberté, même si elles s'inscrivent dans un nouveau cadre législatif et si elles doivent répondre à de nouvelles obligations. À l'extrême fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle encore, les Barrelier ou les Fontrier continuent, comme par le passé, à entretenir des liens particulièrement étroits avec les milieux hellènes ou grecs ottomans ainsi qu'avec la communauté grecque de Smyrne. A la fin du XIXe siècle, la décision que prennent les individus liés à des solidarités multiples de devenir (ou redevenir) Européen, avec tous les privilèges et obligations que cela implique, ou au contraire de devenir Ottoman, rend à ces distinctions tout leur sens. En l'espace d'un siècle, dans un contexte marqué par de profonds bouleversements, par la prédominance croissante des pays d'Europe occidentale face à l'Empire ottoman et par les efforts de ce dernier pour s'aligner sur les modèles européens, le portrait de l'Ottoman s'est figé et institutionnalisé. Si les pratiques individuelles restent, pendant quelques années encore, identiques à ce qu'elles avaient toujours été, en dépit des nouvelles obligations auxquelles doivent se soumettre les individus, le système ancien se trouve pourtant remis en question dans ses équilibres ; le temps des rattachements pluriels semble bel et bien terminé.
1 CADN, Constantinople, Correspondance avec les échelles, Smyrne, n° 49, note verbale du ministre des Affaires étrangères de la Sublime Porte à l'ambassadeur français, 10 mai 1882. 2 CADN, Constantinople, Correspondance avec les échelles, Smyrne, n° 49, lettres du consul français à l'ambassadeur, 25 février et 2 4 mars 1890.
François VINOT
FIGURES EUROPÉENNES, LEVANTINES ET OTTOMANES : POUR UNE APPROCHE PROSOPOGRAPHIQUE DES RELATIONS EURO-OTTOMANES AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE
1. LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTEURS Toute étude des acteurs des relations entre l'Europe et le Proche-Orient ottoman doit tendre, non seulement à énumérer des individus, mais à les replacer dans leur contexte social, pour les saisir de manière plus complète dans leur formation, leurs relations et leur influence. En évoquant les figures européennes, levantines et ottomanes, nous rappelons la diversité des origines de ces acteurs, ce qui conduit naturellement à s'interroger sur les couches sociales qu'ils représentent. Forment-ils un milieu homogène ou plusieurs milieux qui entretiennent des échanges relativement étroits ? Mais il s'agit aussi de mesurer l'étendue de leur influence, et donc savoir si les différentes parties, européenne, levantine et ottomane occupent une place centrale ou marginale, dans leurs sociétés respectives. Nous parlons de figures européennes pour les personnages qui sont venus d'Europe assez récemment et n'ont donc pu acquérir une expérience significative des réalités humaines du Proche-Orient ; de figures ottomanes, quand il s'agit de sujets du sultan, explicitement reconnus comme tels par toutes les parties en présence, surtout si leur propre conscience nationale ou religieuse les pousse à revendiquer cette qualité. La définition du « Levantin » est de prime abord plus complexe. Pour Littré, ce terme désigne le « natif des pays du Levant ». Le critère est donc purement géographique à l'origine. Ce terme renvoie en fait à l'importance des
136
FRANÇOIS
VINOT
relations humaines ou économiques entre deux parties du Vieux Monde. Le Levant se définit toujours par rapport à un couchant, à un Occident ; ici, ce n'est pas l'Occident musulman ou Maghreb, mais l'Europe occidentale. Les données géographiques, de fait, pèsent largement sur les échanges, puisque ceux-ci s'accomplissent via la Méditerranée. En vertu de cette définition, le Levantin est tout naturellement celui qui se rassemble dans les différents ports, ou échelles du Levant, à l'exclusion des autres parties de l'Empire ottoman ; celui aussi qui présente des caractéristiques communes d'une échelle à l'autre, qui passe donc d'une échelle à l'autre —ou qui y a des correspondants. L'enracinement dans une échelle donnée peut être plus ou moins grand. Mais l'orientation de notre étude nous fera passer de la dimension géographique à la dimension sociale ou nationale. Les facteurs politiques ne seront pas non plus à négliger, dans un espace largement convoité et qui présente un éventail de populations complexe. Un problème crucial dans cette approche a trait à la reconnaissance de l'identité des individus à travers des sources : les responsables politiques ou administratifs eux-mêmes ne nous renseignent pas toujours sur l'appartenance nationale des individus qu'ils évoquent, et encore moins sur les conséquences sociales de cette appartenance. Une tendance à la confusion s'affirme dans les registres de protégés, où les nationaux ne sont pas souvent distingués des sujets du sultan progressivement passés sous juridiction française ou britannique. Pour tenter d'y voir plus clair, nous allons essayer de saisir à la source la formation de la population levantine, en étudiant l'immigration européenne dans le Levant, les couches sociales qui y sont impliquées, et celles qui leur correspondent du côté ottoman.
2. L'IMMIGRATION EUROPÉENNE L'existence de cette immigration ne va pas de soi ; ce sont ses caractères particuliers qui définissent le mieux les modalités des relations concrètes entre l'Europe et les sujets du Grand Seigneur. Quelles sont les catégories sociales qui viennent dans le Levant ? En premier lieu, celle des négociants, les plus nombreux, qui jouent naturellement un rôle d'intermédiaire dans les échanges de marchandises de plus en plus actifs entre le Proche-Orient et l'Europe occidentale. Les Français sont en relation avec Marseille, plus récemment avec Trieste, mais les Britanniques connaissent aussi une indéniable prospérité dans leur commerce d'import-
F I G U R E S E U R O P É E N N E S , L E V A N T I N E S ET O T T O M A N E S
137
export vers les ports anglais. On peut citer comme exemples les Glavany à Constantinople, les Crespin à Brousse, les Black à Alep ou le négociant Briggs à Alexandrie, célèbre pour ses relations avec Mehmed Ali. Le poids numérique et surtout économique des négociants venus de la Méditerranée occidentale ne doit pas nous faire oublier certaines catégories d'Européens qui ne dépendent que de la société ottomane, et non des consommateurs occidentaux, pour gagner leur vie, même si leur savoir-faire a été acquis ailleurs. C'est le cas des professions d'artisans, d'ingénieurs et de médecins. Il y a échange, dans ce cas, entre les deux parties de la Méditerranée seulement au plan intellectuel et administratif, mais pas échange matériel ni de fonds. Les artisans viennent à titre individuel pour tenter fortune dans l'Empire ottoman. Leur activité n'est pas économiquement décisive, et il est rarement question d'eux dans les sources. Les premières manufactures commencent aussi à apparaître, surtout dans le textile ; on en trouve des exemples dans le Liban ou à Smyrne. Leur chiffre d'affaires est naturellement plus conséquent, mais on ne peut pas dire, à cette date, qu'une véritable catégorie sociale d'entrepreneurs européens se soit formée dans l'Empire ottoman. Les Européens qui se lancent dans cette activité rencontrent d'ailleurs très vite des obstacles administratifs. Les ingénieurs européens jouent un rôle décisif partout où les pouvoirs publics musulmans envisagent des grands projets. Pour réaliser les siens, Mehmed Ali s'adresse à des membres du corps des Ponts et Chaussées, Mougel par exemple. Ces personnages n'ont pas besoin d'entretenir de liens étroits avec les colonies européennes de l'Egypte, car ils sont de simples exécutants des désirs du vice-roi. Ces conseillers techniques sont des figures beaucoup plus discrètes et moins protéiformes que Ferdinand de Lesseps, ce redoutable ambitieux, qui n'a du reste commencé à imposer ses vues qu'avec Sai'd. Quant aux médecins, ils peuvent exercer des fonctions très humbles et parfois se trouver mal rémunérés. Hyppolite Matin écrit au consul d'Alep que ses fonctions au conseil militaire de santé de l'armée de Syrie n'ont fait l'objet d'aucune rémunération 1 . Le docteur Habib Bertrand réclame 7 490 piastres turques pour solde de son traitement de médecin sanitaire de Beyrouth. Cette réclamation n'est pas conforme aux déclarations de l'intendance sanitaire de la ville. La Sublime Porte donc doit demander, par une lettre vézirielle, une enquête au gouverneur local2. ^PAlep, T 11,2/12/40. P Beyrouth, T 40,19/6/46.
2
138
FRANÇOIS
VINOT
Il y a aussi les voyageurs, qui échangent, à titre transitoire, des informations et des sentiments avec les natifs du lieu, mais on ne peut parler à leur propos d'une présence durable. Dans le pire des cas, ils peuvent montrer une incompréhension totale de l'univers qu'ils ont côtoyé. Nous citerons ici l'exemple du Britannique Mac Farlane, qui a pourtant publié deux éditions de son récit, l'une d'après son voyage de 1828, l'autre d'après ceux de 1847 et 1848. Celui-ci dépeint la situation de l'Empire sous les plus noires couleurs, critiquant notamment son compatriote Urquhart, publiciste favorable à la Turquie ottomane 1 . Toutes ses rencontres personnelles confirment ce sentiment. C'est notamment le cas avec Mustafa Nuri pacha, l'un des gouverneurs les plus en vue, alors en poste à Brousse. Mac Farlane relate ses échappatoires lorsque lui-même et le vice-consul de France évoquent devant lui les dénis de justice commis dans sa province par ses subordonnés ; il lui reproche sa haine des Européens et des chrétiens, qu'il cacherait sous des dehors polis : « his occasional courtesy to Franks was all forced. He hated their society, their manners, and their religion ; for next to the passion of avarice, the strongest feeling in his breast was Mussulman (sic !) fanaticism and superstition ». Et Mac Farlane de commenter que Mustafa Nuri pacha a pourtant été l'un des grands hommes de la Turquie réformée, et qu'il est actuellement l'un des plus importants gouverneurs de l'Empire 2 ! Ce pessimisme demande toutefois à être mis en perspective : quand on voit que Mac Farlane redoute l'éviction complète des Britanniques du commerce du Levant, au profit des Grecs et des Arméniens, on comprend qu'il n'est pas le mieux placé pour analyser l'avenir des relations entre Britanniques et Ottomans —ni même des Britanniques avec le reste du monde, puisqu'il estime que l'abrogation des Actes de Navigation (qui stipulaient que le commerce avec la Grande-Bretagne devait se faire de préférence sur des navires britanniques) permettrait aux Américains de détruire le commerce anglais dans les autres contrées. Il est resté un Britannique imbu de sa nationalité (« The man who pretends to love all the world is likely to love no one part of it », déclare-t-il3) très fermé aux transformations bien réelles que connaît la Turquie ottomane. Cet Européen pessimiste ne sera jamais un vrai Levantin. Même constat à propos de certains aventuriers, qui débarquent au Levant à la recherche d'une fortune facile et rapide, et que les consuls, notamment à Smyrne, se trouvent contraints de rembarquer après avoir prêté assistance. Ils se distinguent donc des voyageurs par la nature de leurs projets personnels, mais, comme eux, ils n'ont pas de rôle social conséquent dans le Levant. Ils ont encore moins la possibilité de rencontrer des Ottomans et de contribuer à ^Charles Mac Farlane, Turkey and its destiny, Londres, 1850, vol. 2, p. 18. Ibidem, vol. 2, chapitre XVI, passim. 3 Ibidem, vol. 1, p. 21. 2
FIGURES EUROPÉENNES, LEVANTINES ET OTTOMANES
139
des échanges culturels : dans la perspective sociologique des échanges entre le Proche-Orient et l'Europe, ce sont des parfaits marginaux. Ces derniers se rencontrent aussi bien du côté occidental que chez les sujets du Grand Seigneur, que nous allons examiner maintenant.
3. LES INTERLOCUTEURS DES FRANCS Quelles sont, en effet, les catégories d'autochtones qui ont des échanges réguliers avec eux au point de se distinguer nettement des autres sujets du Grand Seigneur sur ce point ? Par autochtones, nous entendons ceux dont les ancêtres vivaient dans le « Levant » depuis toujours (mais sans se définir par rapport à l'Europe) et qui n'ont donc pas le passé et l'identité des Francs. Mais dans cette région, la présence européenne est trop réduite et trop localisée, dans les échelles et leurs abords immédiats, pour peser sur l'existence de tous les autochtones indistinctement. Il y a une différence essentielle, en effet, entre le Proche-Orient et les zones de colonisation de peuplement européen sur d'autres continents, comme l'Algérie l'est devenue progressivement après 1830 ; par conséquent, beaucoup d'habitants de l'Empire n'ont toujours pas à concevoir leur existence en fonction des Européens. Cela dépend surtout des catégories sociales considérées. Les négociants bien sûr sont les premiers concernés, puisque leurs homologues européens ne suffiraient pas à effectuer toutes les opérations d'échange sur les marchandises importées ou exportées dans l'Empire. Les marchands autochtones dépendent donc aussi bien, indirectement, de la prospérité de l'Europe occidentale que de celle du Proche-Orient ottoman. Les gouvernants eux aussi traitent avec les Francs puisque les affaires publiques concernent toutes les populations, mais nous verrons les aspects politiques plus loin. Les Européens développent leur présence auprès d'autres couches sociales, notamment chez les producteurs, après les agents de l'échange, ce qui est caractéristique de la pénétration à laquelle ils procèdent. Il s'agit des paysans, d'Anatolie comme des provinces arabes, que les Européens commencent à rencontrer et à utiliser comme fournisseurs. Ce sont bien des figures anonymes, puisque les sources ne nous livrent pas leur identité, mais seulement la fonction sociale et le besoin d'argent qui leur font accueillir favorablement les démarches des Européens. Cela vaut aussi pour certains artisans du textile, surtout en Syrie et au Liban.
140
FRANÇOIS
VINOT
Il faut également compter avec un groupe lié aux gouvernants : celui des miinevver (« gens éclairés », intellectuels) et des hommes de science, quiont appris à se former en Occident. Après leur retour dans le pays, ils animent différentes écoles, surtout en Egypte. Même alors, ils dépendent encore de l'Europe au plan technique. On le voit, par exemple, lorsque du matériel scientifique anglais est livré à Mehmed Ali.
4. UNE DÉPENDANCE INÉGALE À L'ÉGARD DE L'OCCIDENT Ces couches dépendent-elles toutes, en effet, de la micro-société franque au même degré ? La dépendance est maximale sans doute pour les commerçants, dont certains ont dû se spécialiser dans les échanges avec l'Occident, ainsi que pour les paysans pratiquant une culture, un élevage spécialisés, industriels, comme le ver à soie au Liban. Sinon, l'apport des Européens se limite à un rôle d'appoint. Il est utile, néanmoins, dans une région d'économie enclavée, où les paysans peuvent mettre en concurrence les acheteurs francs avec les anciens responsables des monopoles. Une telle diversité de conditions et d'activités pose, bien sûr, la question de l'homogénéité du milieu des participants à l'échange. Il ne fait pas de doute qu'on se trouve, aux deux extrémités, dans des univers humains différents : entre le négociant européen qui ne connaît que des places commerciales, des quantités et des prix, mais très mal la société locale, et le paysan ottoman pour qui les étrangers ne sont que des acheteurs parmi d'autres dans son univers traditionnel, il faut essayer de cerner plus précisément les vrais échelons intermédiaires. Ce milieu va, à notre avis, des négociants qui ont une certaine expérience de la société anatolienne ou arabe, sans connaître les langues locales, jusqu'aux marchands ou producteurs autochtones qui font effort pour adapter leur activité économique à la présence européenne, en incluant les Européens qui ne sont pas négociants, et sont donc par nécessité en contact étroit et relativement approfondi avec le milieu local. Là est la véritable interface entre les deux univers, européen et ottoman. Il faut exclure, en revanche, les Ottomans pour lesquels les rapports avec les Francs sont très ponctuels et non différenciés, et ne constituent, comme nous l'avons dit, qu'un rôle d'appoint. Nous pouvons ainsi comprendre le profit inégal que tirent de la présence européenne des milieux ottomans plus ou moins intégrés aux systèmes des échanges. Alors que Beyrouth est florissant, la montagne libanaise connaît des difficultés.
FIGURES EUROPÉENNES, LEVANTINES ET OTTOMANES
141
Même en se tenant dans le cadre relativement restrictif que nous avons défini, il est possible de distinguer plusieurs milieux qui ne vivent pas de la même manière ; les nationalités sont bien entendu très diverses. Mais en tout cas, le critère national ne pèse pas d'un poids assez lourd pour gêner des relations actives. Cela permet du reste de comprendre la genèse d'un milieu proprement « levantin ». Cette condition de la définition par la naissance au Proche-Orient, donnée par Littré, n'est pertinente que pour les Levantins d'origine européenne ; elle va de soi pour ceux qui sont issus de familles autochtones, tout en étant particulièrement liés aux Francs.
5. RIVALITÉS ET SOLIDARITÉS DANS LE MILIEU LEVANTIN Si l'on peut parler d'un milieu levantin, qui ne se limite pas à l'addition des composantes ethniques dont il est issu, c'est dû à l'intense brassage qui se produit dans les échelles, et aux multiples liens, familiaux, culturels ou économiques, qui unissent les individus de toutes origines. Ces derniers ne manifestent pas d'identité nationale forte comme ceux qui viennent de la métropole, voyageurs comme Mac Farlane ou missionnaires comme E. Boré, pour qui le prestige de la France ou de la Grande-Bretagne est essentiel. En matière commerciale, les Levantins jouent plutôt de la complémentarité. S'il y a concurrence, elle intervient dans un même cadre pour tous les individus. Pour ces relations d'affaires, ils ont besoin de s'appuyer les uns sur les autres, même lorsque les consuls sont plus réservés à l'égard de l'aspect fortement multinational de l'entreprise, comme H. Guys à propos d'une maison de banque à Alep. « Je prie Votre Excellence de bien vouloir me dire si maintenant que M. Portalis doit prendre pour raison de commerce F. Ceccardi, Et. Portalis et Cie, il n'y a point d'inconvénient à ce qu'un Français soit ostensiblement l'associé d'un étranger et à ce que le nom de celui-ci se trouve placé avant celui de notre national qui a mis son établissement sous la protection de la France »'. Portalis, dont la famille joue un rôle économique notable dans le Levant, n'a point hésité, lui, à se montrer « ostensiblement » associé d'un Italien. Il n'y a donc pas tellement de luttes ouvertes, sauf quand les conditions politiques de la vie économique sont en jeu. Par exemple, les Russes, et avec eux les Grecs qui sont souvent leurs prête-noms sur le plan commercial,
Alep, T 48, 5/7/45.
142
FRANÇOIS
VINOT
profitent de ce que les traités de commerce de la Russie avec la Porte fixent des droits moins lourds que les nouvelles conventions commerciales de la France et de la Grande-Bretagne avec l'Empire ottoman. Mais, là encore, le bénéfice n'est pas restreint à une seule nationalité, puisque les orthodoxes de langue grecque, concurrents redoutables pour les Français et Britanniques, en jouissent largement. Au plan humain, on observe la formation d'un milieu authentiquement cosmopolite, pratiquant souvent un polyglottisme qui permet le recrutement des drogmans. Pour eux donc, la nationalité n'est pas très importante et ne suppose pas un attachement foncier à la mère-patrie, sauf pour se soustraire à la justice ottomane, ou éventuellement pour faire des affaires dans les métropoles. Dans ce cas, l'association étroite avec un pays européen est utile et donne naissance à une figure particulière de Levantin ; celui qui est suffisamment assimilé pour demander la nationalité de l'État qui le protège. Nous avons le témoignage des frères Marcopoly de Trébizonde, d'abord commis, dès l'âge de quinze ans, « d'une des plus considérables et des plus honorables maisons de commerce françaises ». Ils gagnent son estime et peuvent ainsi diriger eux-mêmes un établissement par la suite : « Vivant avec notre chef qui s'intéressait vivement à nous, il réussit déjà depuis cette époque la protection française. Après dix ans d'honorables services, conjointement avec d'autres maisons françaises de Constantinople nous formèrent (sic !) en 1836 une commandite à Trébizonde en nous en donnant la direction exclusive. Il s'en suivit que tout en jouissant personnellement de la seule protection, notre établissement dans cette ville représentant exclusivement les intérêts français, fut toujours considéré comme établissement de nationalité française »'. Pour justifier leur demande de naturalisation, les frères Vincent, Georges et D. Marcopoly évoquent « les services toujours gratuits que nous avons été dans le cas de rendre depuis des longues années à des voyageurs français de passage dans notre ville ainsi qu'à la mission française qui s'est rendue en Perse en 1839. Nous ajouterons que l'un d'entre nous — Vincent — a visité toute la France, a longtemps habité Paris et que se trouvant en décembre 1841 à Marseille avec l'intention de s'y établir, il s'empressa de s'y faire inscrire à la mairie avec la ferme intention de demander la naturalisation dès que le laps de temps exigé par la loi se serait écoulé. Les circonstances ne lui permirent pas de mettre alors ce projet à !
PTrébizonde, T 58, 10/7/48.
FIGURES EUROPÉENNES, LEVANTINES ET OTTOMANES
143
exécution, ses affaires ayant réclamé sa présence ailleurs. Si ce fait ne prouve autre chose, il servira du moins à prouver incontestablement le désir et l'intention nourris depuis longtemps de devenir citoyens français. Il n'est peut-être pas inutile de faire mention que nous sommes alliés à des familles françaises et que nous avons des parents portant les mêmes noms que nous, qui par un long séjour en France ou pour des services rendus ont obtenu leur naturalisation ; de plus, lors du mariage de l'un de nous —Vincent—, il en fit dresser acte à la chancellerie de l'ambassade de Constantinople où il se maria, formalité qu'il ne négligea pas non plus de remplir successivement lors de la naissance de ses deux enfants qui eut lieu à Trébizonde, ainsi que les registres de votre chancellerie en font foi Les Marcopoly effectuent donc de nombreux voyages à cause du commerce : c'est une des raisons qui les poussent à demander la naturalisation, mais qui les empêchent aussi de remplir les conditions nécessaires pour l'obtenir. La nationalité vient après les exigences du négoce. Ils n'offrent pas moins un bon exemple de chrétiens du Levant qui sans avoir d'ancêtres français (qu'ils n'auraient pas manqué de mentionner), ni avoir reçu d'instruction à la française, sont allés très loin dans l'assimilation aux Français établis dans l'Empire ottoman, et se sont rapprochés des autorités politiques françaises. Les « alliances » avec plusieurs familles françaises sont déjà un signe de la fusion qui est en cours. Au terme de cet examen des nationalités, nous détenons une première réponse à la question de l'importance de ces milieux parmi les populations d'origine ; ils comprennent un large éventail social, mais les catégories supérieures sont sur-représentées. C'est évident pour les Francs, puisque la profession de négociant est l'une des plus considérables dans leur région d'origine, en Méditerranée occidentale ou en Grande-Bretagne, que la profession de médecin ou d'ingénieur s'avère également prestigieuse en Europe. C'est vrai aussi pour les Ottomans, mais il faut attendre d'avoir présenté les fonctionnaires qui tiennent une place éminente dans l'Empire, laissant les négociants dans une position plus subalterne. C'est ce qui nous amène à évoquer les conditions politiques des échanges entre les différentes catégories d'intermédiaires que nous avons définies.
'p Trébizonde, T 58, 10/7/48.
144
FRANÇOIS
VINOT
6. LE RÔLE SPÉCIFIQUE DES FONCTIONNAIRES OTTOMANS C'est dans la sphère publique et politique que l'on trouve la plupart des musulmans, ce qui est révélateur. L'État ottoman, déjà relativement autonome par rapport à la société qu'il dirige dans le système traditionnel (opposant les kul aux reaya) l'est encore lorsqu'il s'agit de décider des liens à entretenir avec l'Europe : ce sont toujours les fonctionnaires qui prennent les devants. Dans une première période, un recours plus large aux renégats, Européens convertis à l'islam, a permis de conserver certaines nouveautés européennes. Mehmed Ali a confié des responsabilités importantes dans la conquête de l'administration de la Syrie à Soliman pacha, ex-colonel Sève, qui avait servi sous Napoléon. Or, ce dernier a conservé des liens avec les Français établis dans le Levant, alors que tant d'autres renégats perdaient toute attache avec leur milieu chrétien d'origine. Soliman pacha a échangé toute une correspondance avec le consul Henri Guys, qui le console même de deuils personnels. Dorénavant, certains renégats remplissent non seulement une fonction d'experts techniques, mais aussi d'intermédiaires avec l'Occident. Mais le nombre des Européens qui acceptent de changer de religion et d'allégeance nationale est toujours plus limité que celui des Francs qui résident dans l'Empire sans renoncer ni à l'une ni à l'autre. Rapidement les renégats ne suffisent plus à la tâche d'intermédiaires, et les autorités ottomanes ou égyptiennes entreprennent de former des musulmans de naissance aux usages de l'Europe, de leur faire assimiler sa civilisation sans qu'ils aient à renier leur religion. Nous n'entrerons pas ici dans le détail de leur apprentissage européen, pour montrer d'emblée les résultats atteints, en terme de relations à la fois avec les Européens et les administrés. Une comparaison entre un haut fonctionnaire « ancien style » et un autre occidentalisé a été faite, à Damas, vieille ville musulmane, par le consul français de la ville. Parlant du gouverneur Sai'd pacha, il note que son apparence même trahit son conservatisme. Il « n'a adopté qu'avec d'extrêmes modifications le costume européanisé que portent les officiers de la Sublime Porte ». Ses propos reflètent ses opinions traditionalistes. « Quoique bienveillant et digne de manières, on sent a priori dans la conversation de Sai'd pacha l'homme qui ne connaît l'Europe que de nom ; le croyant dont la foi religieuse est demeurée intacte ; le fonctionnaire dont les idées d'administration, de justice, de politique, descendent en droite ligne du calife Aroun al Rachid et de son visir Abou Giafar ».
FIGURES EUROPÉENNES, LEVANTINES ET OTTOMANES
145
Conservatisme ne veut pas dire nécessairement xénophobie. Saïd pacha se veut affable, et s'étend plusieurs fois sur les services rendus à la Sublime Porte par la France 1 . Cette politesse traditionnelle dans la fonction publique ottomane (edeb) a été plusieurs fois relevée par les Occidentaux les plus critiques, qui affirment alors qu'il ne s'agit là que d'une forme sans contenu, en méconnaissant son importance dans la société musulmane. Le portrait est balancé par celui d'un moderniste, Emin pacha. « Autant Saïd pacha trahit dans son extérieur, dans ses idées, le Turc de l'Ancien Régime, si l'on pouvait appliquer à des hommes de la Turquie cette expression de notre langue politique ; autant le séraskier Emin pacha revèle l'homme du progrès, non pas de ce progrès extravagant qui rêve en Europe des phalanstères... et autres conceptions originales qui ne seraient vraiment à leur place que sous la camisole de force de Charenton ; mais de ce progrès sage et régulier qui avant tout et par-dessus tout s'appuie sur le bon sens et la raison. Emin pacha, élevé en Europe, parle le français et l'anglais avec une égale facilité ; il a écrit en anglais sur le calcul différentiel » 2 . Ces observations traduisent la méfiance du consul de Damas pour les utopies révolutionnaires de l'Europe, qu'il oppose au mouvement régulier des réformes éclairées. Le savoir, la réflexion, voilà la pierre de touche qui distingue l'authentique responsable réformateur. Ce dernier est, notons-le, un militaire, dont on attend d'importantes qualités techniques. En revanche, l'administration territoriale est aux mains d'un conservateur. Y a-t-il des liens entre les fonctionnaires ottomans réformateurs et les autres sujets également attachés à la transformation de l'Empire ? Nous pouvons reprendre, sur ce point, le cas des Marcopoly. Le consul de France nous apprend d'eux qu'ils ne risquent de susciter aucun des inconvénients s'ensuivant généralement d'une naturalisation des sujets de la Sublime Porte, « messieurs Marcopoly étant protégés français depuis quinze ans et Rachid pacha, grand vizir, avec qui ces messieurs sont personnellement liés, les considérant depuis longtemps comme citoyens français » 3 . Ainsi, la naturalisation intervient logiquement à la suite d'une protection reconnue. Mais, en même temps, leur réussite commerciale, et peut-être leurs relations françaises, les ont fait connaître de Mustafa Rachid pacha. Ces liens entre des Levantins et un Ottoman occidentalisé relèvent une véritable complicité entre les élites de différentes origines. 1
CC Damas, T 3, 2/1/50. CC Damas, T 3,2/1/50. 3 PTrébizonde, T 58, 10/7/48. 2
146
FRANÇOIS
VINOT
7. CONCLUSION Ces faits montrent que les relations entre l'Europe et le Proche-Orient ottoman ont forgé tout un corps d'intermédiaires, d'origine, de professions et de statut social très divers, mais qui se connaissent tous et entretiennent des relations amicales ou d'intérêt. Les intermédiaires d'origine ottomane ont une expérience de l'Europe, acquise au cours de voyages ou par la fréquentation assidue des Francs présents dans l'Empire, qui leur a donné la possession d'un savoir-faire, ou permis d'élaborer un utile réseau de relations. Les milieux d'origine de ces intermédiaires, encore une fois, sont bien différents, et il n'est pas question d'assimiler le Levantin à l'Européen fraîchement débarqué, ni le musulman ouvert aux idées européennes au Levantin. Les catégories sociales qui fournissent ces intermédiaires sont elles aussi diverses. Les ambitions, la culture et les soutiens des figures que nous avons évoquées ne sont donc pas identiques. Ce qui les rapproche, c'est précisément leur commun souci d'échanges avec l'Europe, au sein d'une société largement indifférente et parfois hostile. Ils sont déjà suffisamment nombreux pour représenter toutes les élites sociales du Proche-Orient, sans avoir à se dissimuler, comme c'était encore le cas au début du règne de Mahmud II (1808-1839). Ils constituent une interface entre le monde ottoman et l'Europe relativement efficace. Entre eux, les liens personnels se multiplient, mais surtout entre ceux qui appartiennent aux communautés chrétiennes. Tôt ou tard, en effet, la question des antagonismes confessionnels allait reparaître et diviser ce microcosme. Lui seul semble avoir réalisé, à cette époque, l'idéal de tolérance et de fraternité entre les communautés dont se réclamait l'ottomanisme, et pratiqué un certain dépassement des clivages de millet. Encore faut-il préciser qu'il le faisait sous l'égide, non du sultan, mais de la civilisation européenne, qui déterminait des intérêts et des comportements communs. C'est une réalité extérieure, plus que l'action de l'État, qui suscitait une certaine cohésion. Une telle exception n'a pu se maintenir lorsque les tensions sociales ont provoqué des conflits répétés entre les millet. Solidaires, qu'elles le veuillent ou non, de leur base communautaire, les différentes élites n'ont pu que s'opposer dans leurs conceptions du devenir de l'État, ainsi que sur la place qu'il convenait de réserver, dans le Proche-Orient, aux natifs de l'Europe. Au nom d'une référence commune, plusieurs projets divergents s'affrontèrent. Les destinées des Levantins, des Européens, des Ottomans et de leurs successeurs allaient se séparer.
Bernard HEYBERGER
SÉCURITÉ ET INSÉCURITÉ : LES CHRÉTIENS DE SYRIE DANS L'ESPACE MÉDITERRANÉEN (XVIIe-XVIIIe SIÈCLES)
Le présent travail est un modeste résultat de ce que Giovanni Levi a appelé « une technique intensive de reconstitution des événements biographiques » d'un certain nombre de chrétiens de Syrie1. On peut s'interroger sur une démarche qui part du cas individuel. D'autres avant moi l'ont fait. Une telle démarche a l'avantage de permettre de déterminer une certaine cohérence des attitudes individuelles, face aux événements, face à « la grande histoire ». Ce qui paraît ressortir de ces analyses, c'est l'existence d'une rationalité du comportement, une stratégie au niveau personnel ou familial. Mais une stratégie qui n'est pas purement économique. Et je reprendrai l'analyse de Giovanni Levi pour dire qu'elle vise moins à la réalisation d'objectifs économiques simples et prédéterminés que la gestion de l'incertitude 2 . Ce qui obsède sans doute les chrétiens du ProcheOrient, comme les hommes des anciennes sociétés en général, c'est la garantie face à ce qui peut arriver. Partons d'un constat : les hommes et les marchandises circulent continuellement entre l'Italie et le Proche-Orient. La forte proportion de documents concernant les chrétiens de Syrie, et les affaires orientales en général, dans les archives de la Congrégation de la Propagande à Rome, révèle le poids prédominant de la Méditerranée dans un ministère du Vatican dont on pourrait s'attendre qu'il fût plus préoccupé à cette époque par les missions d'Amérique ou de Chine.
^Giovanni Levi, Le pouvoir au village, Paris : Gallimard, 1989, p. 12. ^Giovanni Levi, op. cit., p. 9-13, p. 51. Voir aussi l'introduction « L'histoire au ras du sol », de Jacques Revel, p. xxii-xxiii.
148
BERNARD
HEYBERGER
Notons que les liens religieux ou culturels, voire spirituels, avec l'Occident catholique s'accompagnent toujours de relations économiques. Et même plus que cela, les avantages symboliques tirés d'une relation avec l'Église romaine peuvent être exploités du point de vue économique et social par ceux qui en bénéficient. Le fait n'est pas étonnant : les petites Églises du Proche-Orient se confondent avec le groupe confessionnel (tâ'ifa) qu'elles structurent, et les notables laïcs jouent en leur sein un rôle prépondérant. Il faut donc se garder de vouloir trop distinguer la sphère économico-sociale de la sphère religieuse.
1. LA RECHERCHE D'AUMÔNES ET DE PROTECTION a. Les « persécutions » Nous voyons apparaître, dans les registres de la congrégation De Propaganda Fide, un certain nombre de personnages qui, arrivés à Rome, s'adressaient aux cardinaux pour obtenir des subsides. Il n'y avait pas que des Orientaux : nous y trouvons aussi des exilés des pays protestants. Les chrétiens qui venaient de l'Empire ottoman avançaient généralement, comme raison de leur présence en Chrétienté, qu'ils avaient dû fuir les persécutions des orthodoxes et des musulmans à cause de leur attachement au catholicisme, et qu'ils avaient risqué de perdre leur vie ou leur foi. Pour obtenir un secours (au demeurant toujours modeste) ou une recommandation, ils devaient exhiber devant la bureaucratie romaine des lettres d'introduction en leur faveur, signées par des missionnaires latins ou des consuls français de leur ville d'origine. Sinon, ils pouvaient se heurter à une réponse négative, assez fréquente dans les registres de délibération. Ainsi, par un décret du 14 octobre 1644, la Congrégation accueillaitelle dans des collèges romains un Khûri alépin et son fils, venus à Rome envoyés par les carmes de leur ville « afin qu'ils ne soient pas pervertis Et une note qui doit dater de 1662 évoque un Francesco di Paolo d'Alep, qui a fui avec ses deux filles de 18 et 14 ans, pour éviter le péril de perdre sa vie ou sa foi. Embarqué sur un navire musulman, il fut dépouillé de tous ses biens par des corsaires maltais, et se retrouva à Rome sans ressources2. En 1724, Moïse et Benigno, frères de Nicolas, d'Alep, qui, disent-ils, ont souffert la prison, les chaînes et le bâton pour leur foi, se sont portés à Rome. Ils ont pâti pendant le
1Archives de la Sacra Congregatio de Propaganda Fide, Rome, désormais abrégé en ASCPF, série SOCG vol. 196, f. 88r, 14 oct. 1644. 2 ASCPF, SOCG, vol. 235, f. 123r, ss date.
LES CHRÉTIENS DE SYRIE DANS L'ESPACE MÉDITERRANÉEN
149
voyage, à cause de leur grande pauvreté. Ils sollicitent une recommandation, pour aller chercher des aumônes à Vienne et en Allemagne 1 . S'il faut apprécier la véracité de ces raisons, je dirais qu'elles ne sont qu'à demi vraies. Il est certain que les chrétiens, dans leurs affaires, ne sont pas traités à égalité avec les musulmans (en particulier devant les tribunaux), et que leur fortune peut leur valoir des pressions pour qu'ils se convertissent à l'islam, qu'ils donnent leurs filles en mariage à des musulmans, ou qu'ils renoncent à des créances. Mais les divisions entre chrétiens de même rite, voire à l'intérieur d'une même famille, sont souvent la véritable origine de ces « persécutions » des « Turcs » 2 . Dans les cas les plus fréquents, les fugitifs sont partis pour échapper à leurs débiteurs. La raison de ce qu'ils appellent leur « persécution » est moins leur foi catholique que leur incapacité à honorer des créances. Encore que leur engagement confessionnel puisse être la cause de leur ruine matérielle, lorsqu'un cadi décide d'exploiter financièrement une dissension entre chrétiens, portée devant sa cour 3 . La mention des enfants ou de l'épouse du fugitif retenus par les créanciers est fréquente. Dans ce cas, on peut dire qu'il y avait effectivement un danger de perversion religieuse de ces otages, si le chef de famille ne parvenait
{ ASCPF, série SC, Melchiti, vol. 2, f. lr, 2v, 3r. Ibidem, SOCG, vol. 422, f. 526r, 1670 : un Arménien de Jérusalem, réfugié à Rome depuis huit ans, demande de l'argent pour rentrer chez lui. Réponse : nihil. Ibidem, SOCG, vol. 517, f. 384r, 1er fév. 1694, Abd Elrazzac Mesi, de Ninive (Diyarbakir), a dû fuir les persécutions des Nestoriens avec des certificats, vit à Rome, pauvre et malade, avec sa famille, et demande du pain. Réponse : lectum. Ibidem, série ACTA, vol. 102, 16 mars 1732, 1, Maroniti, Giuseppe Grazia réduit à la misère par la tyrannie turque, demande des lettres de recommandations pour quêter en Europe. (Réponse : lectum). ^Voir le cas du maronite Abû Rizq dans Bernard Heyberger, Les chrétiens du Proche-Orient au temps de la Réforme catholique, Rome : Bibliothèque des Ecoles Françaises d'Athènes et de Rome, 1994, p. 73-74. ASCPF, SOCG, vol. 524, f. 72r, Stefano Nacchi, ancien du Collège maronite, secrétaire du consul anglais d'Alep, écrit de cette ville qu'il veut se faire franciscain, expliquant qu'il a été ruiné par les « Turcs » lors de son séjour dans sa famille à Chypre. Le Secrétaire de la Propagande, ayant demandé des renseignements sur lui au collège maronite, apprend (ibidem, f. 224r) qu'il aurait été chassé de Chypre par sa sœur et son frère, pour avoir voulu s'emparer de l'héritage du père. 3 ASCPF, SOCG, vol. 62, f.92r : en septembre 1644, Bruno de Saint Yves, missionnaire carme d'Alep, signale à la Propagande le cas du shammâs Shahâdé, maronite de sa ville, chargé de dettes, parti à Rome avec des lettres de recommandation, pour tenter de trouver l'argent nécessaire à sa réintégration. Ses certificats à destination des autorités romaines sont tombés à la mer pendant son voyage. Recommandation du consul Lange Bonin du même « pauvre », ibidem, f. 127r, 22 sept. 1644. Ibidem, f. 126r, le même remercie pour l'accueil que la Congrégation a fait au syrien Dominique et à sa famille. Autre cas : ASCPF, SC, Melchiti, vol. 2, f. 426r et 456rv (trad. ital.), 458v (arabe) recommandation de Moïse Sisinio, curé de Zûq Mikhâ'îl, très zélé catholique, mais criblé de dettes à cause des avanies qu'il a subies. Il demande le droit de célébrer la messe orientale à Livourne : f. 594rv, 18 nov. 1733. Ibidem, f.610r, il demande le prolongement de ce droit jusqu'en avril 1733.
150
BERNARD
HEYBERGER
pas à rembourser les dettes1. Un dénommé Ni'mat Allâh fait, le 8 avril 1680, le récit détaillé de sa vie. Originaire de Mardîn, où visiblement il jouissait d'une bonne aisance, il exerçait le métier de marchand entre Alep et la Perse. Mais il subit un revers de fortune qu'il attribue au fait qu'il s'était converti au catholicisme, ce qui lui valut, à ses dires, des difficultés suscitées par les Nestoriens. Il décida alors de partir à Alep avec femme et enfants. Trop faible pour pratiquer encore le commerce, « je me relevai donc, et fis une production de soie pure, tissée avec de l'or et de l'argent, ce qui me valut des entrées auprès des notables turcs ». Il vécut près de vingt ans à Alep, et y servit avec dévouement la cause du catholicisme, mais se retrouva chargé d'une dette considérable de 4 000 écus auprès des Turcs. Il laissa alors ses fils en otages, et rejoignit François Piquet, ancien consul français d'Alep, à Marseille. Celui-ci écrivit en sa faveur aux princes de l'Église, mais Ni'mat Allâh, âgé de soixante ans au moment du récit, ne trouva aucun secours à Rome à son arrivée. Quelle est la part de vérité dans ce récit, et dans quelle mesure François Piquet et les missionnaires d'Alep ont-ils vraiment plaidé la cause de Ni'mat Allâh auprès des cardinaux ? Toujours est-il que deux requêtes successives de sa part se heurtent à deux réponses négatives (lectum) de la part des cardinaux2.
1 ASCPF, SC, Melchiti, vol. 2, f. 80rv, 10 avril 1728, recommandation de Naples pour un grec catholique de Mésopotamie, qui a laissé un parent en otage aux Turcs, pour empêcher la démolition d'une église de la Vierge chez lui. SC, Melchiti, vol. 4, f. 127r et 135 rv, Muhalac ou Moïse Muchalla, melkite de Damas, vers 1740. À cause du rôle de son père dans l'érection du patriarche catholique Cyrille Tânâs, il aurait été persécuté par le patriarche orthodoxe Sylvestre, et privé de ses biens. Chargé de dettes auprès des « Turcs », il a laissé femme et enfants, et s'est rendu en chrétienté. Il demande d'abord une lettre de recommandation pour aller s'installer à Venise, puis une subvention. ACTA, vol. 95, 22 janvier 1725, 9, Greci Melchiti, Giovanni Sciain, prêtre melkite de Jérusalem, a laissé son fils en otage aux « Turcs », est venu avec un de ses fils à Rome. Il demande des lettres de recommandation pour quêter en chrétienté. Refus du Secrétaire. Son fils, Giorgio Hatut, est reçu au Collège Urbain. Le même réitère sa demande, ibidem, 7 mai 1725, 3, Greci Melchiti et obtient cette fois des lettres de recommandation aux nonces. SOCG, vol. 502, f. 334r, 5 oct. 1688, Alduardo ('Atallâh), sa sœur veuve a trois fils emprisonnés et maltraités. Lui prêtre, pauvre, est venu à Rome pour demander de l'aide afin de les racheter. Le même est encore à Rome deux ans après, SOCG, vol. 508, f. 553r, 19 déc. 1690. SOCG, vol. 507, f,159r, 12 juin 1690, Michel de Bethléem, a deux fils en prison. II a été privé de ses biens, pour un faux témoignage contre lui. En fait, tout ceci est arrivé parce qu'il est un vrai chrétien. 2
ASCPF, SOCG, vol. 478, f. 220rv, 221r, 222r, 8 avril 1680, en latin : « Surrexi ergo, et feci opera sérica integra, et auro, argentoque contexta, qua de causa accessum habui apud magnates turcarum ». ACTA, vol. 49, 11 sept. 1679, 12, Soria: requête précédente. SOCG, vol. 487, f. 300r, (1683), Giorgio Barbase, prêtre grec de Damas, catholique, se présente avec des certificats d'un jésuite et des franciscains : il a perdu 600 piastres, et demande de quoi vivre. À Rome, il a emprunté 15 écus auprès d'un compatriote. Il obtient 10 écus. SC, MELCHITI, vol. 2, f. 21r, 1725 : Giorgio Abdallah d'Alep, grec catholique : parti d'Alep au Grand Caire, a été accusé (« par une calomnie », dit-il) d'avoir fait de la fausse monnaie. Il a fait deux ans de prison, puis a tout laissé pour venir à Rome.
LES CHRÉTIENS DE SYRIE DANS LESPACE MÉDITERRANÉEN
151
b) L'insécurité du commerce maritime En dehors des notables terriens du Liban et des ecclésiastiques, que nous laisserons de côté, les suppliques adressées à l'Église catholique proviennent, on le voit, de négociants. Les échanges maritimes sont le principal sujet des recours à Rome. Dans certains cas, le solliciteur avait investi dans le commerce maritime des sommes empruntées à des musulmans. Ces affaires pouvaient être fondées sur le système de contrat de commandite « mudâbara », décrit par Bruce Masters pour Alep. C'était un engagement verbal juré devant le juge et deux témoins. Le bénéfice était partagé suivant les termes de l'accord préétabli, et un parent servait de caution au contrat. D'après le même auteur, la situation la plus typique était celle où un musulman apportait l'argent, tandis qu'un chrétien faisait le voyage 1 . C'était le cas de Georges, un Chypriote de rite grec, dont le fils était retenu en 1676 comme garant d'un emprunt. Sa saïque avec ses marchandises ont été saisies par un chevalier de Malte, qui s'est engagé à restituer le navire avec sa charge, contre le versement de 4 500 écus. Finalement, le corsaire a rendu le bâtiment, mais pas la cargaison. Le patriarche maronite demanda alors une intervention en faveur de Georges, pour libérer son fils 2 . Comme dans cet exemple, le négoce devait faire face à des hasards périlleux, dont le principal était la rencontre avec les corsaires « francs ». Toujours d'après Bruce Masters, le risque était entièrement assumé par le fournisseur du capital. En réalité, il faut imaginer des figures de contrat plus complexes. Sans doute, des marchandises propriété de négociants musulmans étaient-elles déclarées appartenir à des chrétiens levantins, et embarquées sur un navire dont le ra'is et les marins étaient chrétiens, pour tenter d'échapper à la course. Dans ce cas, les chrétiens pillés par des corsaires occidentaux pouvaient être soupçonnés par leurs associés musulmans de complicité avec les prédateurs. ' Bruce Masters, The origins of Western Economic Dominance in the Middle East. Mercantilism and the Islamic Economy in Aleppo (1600-1750J, New York, 1988, p. 50 & 63. 2 ASCPF, SC, Maroniti, vol. 1, f. 174rv, 175rv, Cannubin, 1er août 1676. Autre cas : ACTA, vol. 78, 28 fév. 1708, Giorgi Sasi, grec de Damas, a pris à intérêt 1 300 pezzi des Turcs, pour les négocier sur un bateau, et a tout perdu. Ses créanciers ont pris en otage ses deux fils, qui risquent d'apostasier. Il demande de l'argent, avec la recommandation d'un maronite de Rome, mais sa requête n'est pas reçue. SC, Maroniti, vol. 1, f. 301r, 321r-314r, 318rv, 319rv, 320rv, 340rv, 341rv : affaire obscure qui oppose le marchand maronite de Jérusalem Scialub (Hannâ Shalhûb Ma'ûshî) aux Frères de la Terra Santa. Ce qui en ressort, c'est que ShalhÛb avait des dettes auprès des notables musulmans de la ville, qu'il est venu à Rome en laissant sa femme et ses quatre enfants en caution. Il a pratiqué d'autre part le commerce maritime à grande échelle, puisqu'il a des marchands, ses correspondants, à Alep, Damas, Tripoli, en Égypte et en France, et que les gouverneurs lui ont confisqué le coton, la galle et trois saïques, pour une valeur de 18 000 écus.
152
BERNARD
HEYBERGER
C'est l'explication fournie en 1712 par les bureaux de Côme III, Duc d'Etrurie, à une requête de la Propagande demandant que les navires toscans ne s'emparent pas des marchandises des catholiques syriens. D'après eux, les « Turcs », obligent l'archevêque melkite catholique de Tyr et Sidon Aftîmyûs Sayfî et les missionnaires à contresigner leur propre marchandise, afin de se prémunir des attaques des navires chrétiens1. C'est ce qu'on peut conclure également d'un rapport détaillé, daté des années 1720. Ibrahim Massad et Ibrahim Massara, chrétiens alépins installés au Caire, et faisant le trafic entre l'Egypte et la Syrie sur le Saint-Georges, navire qui leur appartenait, avec des passeports du Saint-Siège en bonne et due forme, se sont vu confisquer la marchandise par les Maltais, au prétexte qu'elle appartenait à des musulmans. Les deux solliciteurs prétendent au contraire qu'elle est le bien de bons catholiques, et que les corsaires ont brutalisé le ra'is candiote, grec catholique, avec ses marins, pour leur faire signer un papier reconnaissant que les marchandises appartenaient à des « Turcs ». Mais ils affirment en même temps que les « Turcs » les soupçonnent d'être de mèche avec les Francs, et que leurs enfants (servant sans doute d'otages) sont en péril de renier leur foi 2 . La course chrétienne dans l'Orient méditerranéen, en général sous pavillon maltais, était une des principales sources de tracas pour les chrétiens syriens qui s'adressaient à Rome à la fin du XVIIe siècle et dans les premières décennies du XVIIIe, voire qui faisaient le voyage en Italie, afin d'obtenir en leur faveur des sauf-conduits, ou réclamer justice, après la prise de leur marchandise ou d'un de leurs navires. On sait que le corso chrétien des XVIIe et XVIIIe siècles n'avait plus guère d'autre visée que de procurer un butin aux armateurs, qui pouvaient avoir obtenu à cet effet une patente du Grand Maître. Des chevaliers de Malte affairistes fournissaient les capitaux nécessaires à l'armement des grands vaisseaux de course. La lutte contre l'infidèle, qui n'était guère un véritable objectif de cette activité maritime, ne subsistait plus qu'en tant qu'alibi pour déclarations officielles. Les corsaires privés, agissant avec une patente de l'ordre de Malte, ou au nom d'un autre souverain européen, pratiquaient parfois des actes de piraterie pure, notamment en Méditerranée orientale au début du XVIIIe siècle^.
l
ASCPF, SC, Melchiti, vol. 1, f. 131r, 19 fév. 1712. ASCPF, SC, Maroniti, vol. 3, f. 463rv, 466rv, 465rv. SOCG, vol. 579, f. 171r, 172r, 29 mai 1711 : Lorenzo di San Lorenzo évoque précisément un bâtiment « caravanier » français, qui avait embarqué à JaiTa 120 pèlerins arméniens, ainsi que 1 100 piastres et du savon propriété du cadi, beaucoup de marchandises appartenant aux « santons » de Jérusalem et de Jaffa, ainsi que trois jeunes « Turcs » allant à Constantinople. Le navire fut attaqué, et les passagers dépouillés et débarqués à Caïfa, tandis qu'un jeune musulman s'est noyé, les deux autres étant faits esclaves. La marchandise fut vendue au consul anglais de Caïfa. ^Michel Fontenay, « Corsaires de la Foi ou rentiers du sol ? Les chevaliers de Malte dans le "Corso" méditerranéen au XVIIe siècle », Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, XXXV, 1988, p. 361-384 ; du même, « L'Empire ottoman et le risque corsaire au XVIIe siècle », Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, XXXII, 1985, p. 185-208 ; Salvatore Bono, Corsari nel Mediterraneo. Cristiani e musulmani fra guerra, schiavitù e commercio, Milan, 1993, p. 56-59. 2
LES CHRÉTIENS DE SYRIE DANS L'ESPACE MEDITERRANEEN
153
L'insécurité favorisait le transport maritime occidental, et notamment français, puisque les marchands musulmans pouvaient affréter des navires « francs » pour échapper aux corsaires 1 . Mais le commerce à l'intérieur de l'Empire ottoman, qui était loin d'être négligeable, restait pour l'essentiel aux mains des sujets ottomans eux-mêmes. Le fait que les chrétiens ottomans catholiques pouvaient se faire forts de détenir des sauf-conduits pontificaux pour se prémunir des corsaires, aidait à renforcer leur rôle dans les liaisons maritimes, et notamment dans le cabotage entre les côtes syriennes et Damiette 2 . Dans un rapport détaillé concernant les attaques récentes de corsaires livournais, maltais et corses, sur les côtes de Palestine, le Gardien de la Terre Sainte Lorenzo di San Lorenzo explique, en 1711, que dans la mer qui va du Mont Carmel à Saint Jean d'Acre et à Jaffa, aucun bâtiment musulman ne croise. Ce sont des saïques grecques qui portent les marchandises, dont une partie seulement appartient à des musulmans. Mais les corsaires s'emparent de tous les chargements sous prétexte qu'ils sont « infidèles ». Ainsi, la course est-elle en réalité directement tournée contre les Grecs, non pas contre les « Turcs », qui n'ont presque pas de bâtiments, sauf pour de rares cas de passages vers Constant!nople. Le Gardien ajoute une autre preuve que la course est dirigée contre les chrétiens : il n'y a jamais, écrit-il, autant de bâtiments corsaires dans ces eaux, qu'aux environs de Pâques, quand les pèlerins s'en viennent et s'en retournent. On les dépouille à peu près de tout. De plus, lorsque de la marchandise musulmane a été saisie sur un navire, les Pères de la Terre Sainte en sont tenus pour responsables, et on tente de leur en extorquer le remboursement, avec la complicité de la justice turque 3 . On voit à quel point politique, économie, et appartenance confessionnelle sont intimement liées. C'est pourquoi, l'adhésion d'un chrétien oriental au catholicisme, à l'orthodoxie militante, ou son refus au contraire de se prononcer entre les deux options, répondaient à des stratégies sécuritaires relativement complexes, jouant sur l'ensemble de ces registres.
André Raymond, Artisans et commerçants au Caire au XVIIle siècle, Damas, 1973, vol.l, p. 170 ; Daniel Panzac, « Commerce et commerçants des ports du Liban Sud et de Palestine (1756-1787) », Villes au Levant, Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée, 55-56 1990, 1-2, p. 91. ^Daniel Panzac, art. cit., p. 87-92. 3 ASCPF, SOCG, vol. 579, f. 171rv, 172r, 29 mai 1711. Daniel Panzac a relevé l'importance du pèlerinage des Chrétiens orientaux aux Lieux Saints pour le trafic maritime, art. cit., p. 86. ASCPF, SOCG, vol. 527, f. 259rv, 260r, Elia, évêque arménien de Bethléem, en juin 1697, rapporte de manière détaillée l'histoire exemplaire du pillage d'une caravane arménienne du pèlerinage entre Constantinople et Jérusalem.
154
BERNARD
HEYBERGER
C'est ce qu'illustre le cas de la famille des Ibn Fakhr de Tripoli1.
2. COMMERCE MARITIME, COMPÉTITION SOCIALE, ADHÉSION AU CATHOLICISME : LE CAS DES IBN FAKHR
a) Le catholicisme des Fakhr En 1701, l'évêque melkite de Tripoli de Syrie prête obédience à l'Église latine, en faisant parvenir à Rome une profession de foi catholique, accompagnée des indispensables certificats de missionnaires et d'un consul de France 2 . Dans les années qui suivent, le même Makâryûs a plusieurs fois l'occasion d'adresser des requêtes à la Propagande. Il en obtient livres et objets liturgiques. Il raconte les attaques qu'il a subies de la part du patriarche melkite de Damas Cyrille Al-Za'îm, hostile aux catholiques à cette époque. Pour y faire face, il a dû emprunter de grosses sommes et placer en gage les biens de son église. Il demande un secours à la Congrégation en 1707 pour pouvoir se délier 3 . Un sien neveu, Elia (Ilyâs) Fakhr, truchement de la « nation » française de Tripoli, très zélé pour la foi catholique d'après les informations parvenues au secrétaire de la Propagande, demande et obtient des cardinaux, par l'intermédiaire de missionnaires francs délégués à Rome en 1705 et en 1707, des ouvrages imprimés sur les presses polyglottes de la Congrégation, « pour
Les travaux de Robert M. Haddad ont déjà fait en partie l'analyse de cette intrication, notamment à propos du passage au catholicisme du patriarche melkite Cyrille Al-Za'îm : « On Melkite passage to the Unia : the case of Patriarch Cyril al-Za'îm » dans Benjamin Braude et Bernard Lewis (ed.), Christians and Jews in the Ottoman Empire. The fonctional of a Plural Society, New York, Londres, 1982, vol.2, p. 67-90. Et du même : Syrian Christians in Muslim Society. An interpretation, Princeton, 1970, 118 p. 2 ASCPF, SC, Melchiti, vol. 1, f. 17r, 14v, profession de foi en arabe de Makâryûs, Mutrân Tarâbulus Al-Sharq ; ibidem, f. 9rv-10rv, critique en italien de cette profession de foi, avec attestations des missionnaires et du consul de France à Tripoli ; ibidem, f. 18rv, 22rv, trad, latine de la profession de foi. ACTA, vol. 82, 30 mai 1712, 12, Greci, le même affirme être catholique depuis 1701. 3 ASCPF, SC, Melchiti, vol. 1, f. 42rv, (trad, ital.) ; f. 46r, (trad, ital.), f. 47rv (arabe) ; f. 50r (trad, ital.), 51r (arabe) : série de lettres de Macario, évêque de Tripoli. Le même, ibidem, f. 70r (trad, ital.), 73rv, 72rv, et 74r, janvier 1707. SOCG, vol. 554, f. 522rv, 26 avril 1706, le même évoque les persécutions. SC, Maroniti, vol. 2, f. 19r, dernier jour de janvier 1708, reçu pour les livres, les chapelets et autres objets sacrés envoyés pour lui, par la Propagande, par l'intermédiaire du carme Ferdinand de Sainte Ludovine. SC, Melchiti, vol. 1, f. 141v (arabe), 142rv (trad, ital.), le même, 25 janv. 1713, remercie pour une lettre reçue.
LES CHRÉTIENS DE SYRIE DANS L'ESPACE MÉDITERRANÉEN
155
vaincre les erreurs de ses nationaux schismatiques »!. À cette époque, Ilyâs, met sa connaissance des langues et sa culture au service de la Réforme catholique. Il traduit en arabe des ouvrages grecs favorables aux thèses romaines, en particulier le très diffusé vade-mecum du prêtre, composé par Neophytos Rhodinos (imprimé à Rome en 1628 et 1635), ainsi qu'un manuel du confesseur sous forme de questions et de réponses du même auteur. En 1713, il est gratifié pour son zèle catholique du titre de « chevalier de l'éperon d'or » 2 . En 1711, un frère d'Ilyâs, Michel Name (Mikhâ'îl Ni'ma) Fakhr, marchand de Tripoli, s'est installé à Livourne. Recommandé auprès de la Propagande par son oncle, l'évêque Makâryûs, pour toutes ses affaires à Rome et en Italie, il fait office de procureur de celui-ci. C'est lui qui, venu dans la capitale chrétienne, est chargé d'impétrer des cardinaux et du pape Clément XI lui-même la faculté, pour l'archevêque son oncle, de conférer un certain nombre d'indulgences plénières à l'heure de la mort, aux fidèles ou aux membres de sa famille 3 . Le même Ni'ma rend différents services à la cause du catholicisme. En 1713, Saruf'îm Tânâs, neveu de l'évêque melkite catholique Aftîmyûs Sayfî, et futur patriarche catholique de sa « nation », le recommande à la Propagande en le décrivant comme un jeune homme très dévoué à l'Église, qui fait le missionnaire à Livourne, allant au-devant de tout schismatique, pour essayer de le convaincre à force de raisonnement et d'argument, tout comme fait son frère à Tripoli 4 . ASCPF, ACTA, vol. 75, 27 janvier 1705, 1, Stampa, Bonaventura de Sainte Agathe, observantin de Tripoli, demande des livres pour Elia, Grec catholique. SC, Melchiti, vol. 1, f. 78rv, 25 janvier 1707, nouvelle demande, par l'entremise du Carme Ferdinand de Sainte Ludovine. ACTA, vol. 82, 30 mai 1712, 12, Greci, le diacre Facri est dit « molto benemerito de cattolici ». AN, AE, B 1, 1114, f. l l r , Ilyâs Fakhr « catholique apostolique et romain », est cité dès 1697 comme interprète. Toutefois, Joseph Nasrallah, Histoire du mouvement littéraire dans l'Eglise melchite du Ve au XXe siècle, vol. IV, t. II (1724-1800), Louvain, 1989, p. 203, cite le manuscrit du patriarcat grec orthodoxe de Damas, n° 1726, qui porte le colophon suivant : recopié « le 24 décembre 1696 de la main du plus pauvre de l'univers, le serviteur pécheur Eliâs Ibn Fakhr, connu (sous le nom) d'Ibn Fakhr al-Tarâbulsî de la communauté rûm orthodoxe ». Cette assertion ne prouve rien, puisque les rûm-s ne sont pas encore constitués à cette date en deux communautés catholiques et orthodoxes, rivales et séparées. ^Joseph Nasrallah, Histoire, op. cit., vol. IV, t. II, p. 210-212, sur l'œuvre de controverse procatholique d'Ilyâs Fakhr. Ibidem, p. 203, l'auteur mentionne la date de 1713 pour la décoration de « chevalier ». Sur Neophytos Rhodinos et son œuvre, voir Gerhard Podskalsky, Griechische Théologie inderZeitder TUrkenherrschaft, 1453-1821, Munich, 1988, p. 201-205. 3 ASCPF, SC, Melchiti, vol. 1, f. 120r (trad. ital.), f. 121rv-122rv (arabe), 20 déc. 1711, Macario au Cardinal Sacripante ; ibidem, f. 124r, du même, même date, même demande, au Pape Clément XI ; ibidem, f. 128r, même demande, le même jour, à la Propagande. Ibidem, f. 14Iv (arabe), f. 142rv (trad. ital.), 25 janv. 1713, Makâryûs remercie pour la lettre parvenue par Name Fakhr, et demande de le protéger et de l'aider dans ses affaires. ACTA, vol. 82, 30 mai 1712, 12, Greci, et 2 août 1712, 7, Stampa, le même, même demande, mention de la présence de Michel Grazia Facri à Rome. 4 ASCPF, SC, Melchiti, vol. 1, f. 169rv, Tânâs. SC, Maroniti, vol. 2, f. 262rv, Ni'ma Fakhr, de Livourne, 26 juin 1713 : on apprend qu'ii a été chargé par les bureaux romains d'acheminer un courrier — délicat, puisqu'il concerne la déposition du patriarche maronite Ya'qûb 'Awwâd — à destination du consul de France à Saïda, et qu'il loge chez lui un prêtre maronite, Da'ûd, venu à Rome chargé d'une mission, en attendant un bateau de retour pour Salda par l'Égypte.
156
BERNARD
HEYBERGER
On aurait tort de négliger cette recherche de la bonne réputation catholique dans la vie des Fakhr. Il ne s'agit pas seulement pour eux d'une stratégie intéressée pour capter les bonnes grâces des protecteurs romains. L'accumulation d'un « capital symbolique », et l'échange de biens immatériels (décorations et diplômes pontificaux, livres et objets de dévotion, indulgences) qui le composent ne sont pas quantité négligeable dans la construction de leur système de relations sociales à Tripoli et ailleurs. En règle générale, les nombreuses demandes d'indulgences, l'essor des confréries de dévotion au XVIIIe siècle, les fondations pieuses (waqf-s) en faveur des couvents catholiques du Liban, tout montre que les grâces spirituelles généreusement répandues par Rome sont ardemment recherchées par les Orientaux qui se rattachent au catholicisme, et contribuent à leur inspirer un sentiment de sécurité face à leur avenir ici-bas et au-delà.
b) Les affaires des Fakhr Toutefois, la présence de Ni'ma Fakhr à Livourne, et momentanément à Rome, a également des raisons moins édifiantes. En effet, il est venu en Italie pour tenter d'obtenir la restitution ou le remboursement d'une « grosse marchandise » prise par des corsaires maltais et livournais entre l'Archipel et la Syrie 1 . Ces années-là, les ravages des corsaires sur les côtes syriennes furent particulièrement préjudiciables aux affaires des chrétiens locaux. Dans son rapport de novembre 1711 cité plus haut, Lorenzo di San Lorenzo donne de nombreux détails sur ces attaques, qui ont même empêché un moment tout passage entre Acre et Jaffa. Parmi ces agresseurs, figurent Antonio Franceschi (Franceschini) et un de ses parents, qui sont restés dans les parages toute l'année, et ont dépouillé de nombreuses saïques 2 . Ce sont les mêmes qui se sont emparés en 1710 d'un navire appartenant à l'église grecque de Saïda, et qui l'ont porté à Livourne. L'archevêque catholique de la ville Aftîmyûs Sayfî s'était d'abord adressé au Grand Maître de Malte pour en obtenir réparation, mais celui-ci l'avait éconduit, en affirmant n'avoir pas juridiction sur un Livournais 3 . Argutie sans doute : un autre document affirme que le capitaine
1 ASCPF, ACTA, vol. 82, 4 juillet 1712, 23, Greci et ibidem, 2 août 1712, 7, Stampa. SOCG, vol. 582, f. 424, même affaire. 2 ASCPF, SOCG, vol. 579, f. 171rv, 172r, 29 mai 1711. Voir aussi, ibidem, f. 199rv, 200rv. Salvatore Bono, op. cit., p. 57-58. 3 ASCPF, SOCG, vol. 580, f. 177rv (arabe), 178r (trad. ital.), 14 mars 1711. SC, Melchiti, vol. 1, f. 153rv, Malte, 29 mars 1711, à propos des « pezze quattro cento» appartenant à l'église d'Aftîmyûs : on supposait qu'elles avaient été prises par le capitaine maltais Ascanio, mais celui-ci a abandonné la course, et occupe d'honorables fonctions au tribunal du Saint-Office ! Ibidem, f. 167r, Malte, 5 oct. 1713, même sujet. ACTA, 82, 10 mai 1712, 10, Terra Santa : une saïque prise par Franceschini « corsaire de Livourne » en vue du Mont Carmel, chargée en majorité de marchandises appartenant à des Maronites, est arrivée à Malte. Le Grand Maître lui a refusé le droit de débarquer, mais n'a pas pris d'autres sanctions par « respect pour la bannière du Grand Duc ».
LES CHRÉTIENS D E SYRIE D A N S L'ESPACE MÉDITERRANÉEN
157
Franceschi est « de la religion de Malte ». Alors que l'on peut faire appel devant les cours de l'Église des jugements des tribunaux maltais, il n'en est pas de même pour ceux d'une autre juridiction : la bannière de Toscane préserve donc mieux de sentences trop favorables aux victimes chrétiennes1. Sayfî demande alors à Rome de recommander son délégué dans cette affaire, pour se faire rendre justice à Livourne, tout en élevant de très vives protestations contre les pratiques des corsaires, qui sont pires que les voleurs et assassins qu'on trouve en pays musulman, et empêchent par leurs forfaits tout progrès de la foi catholique. L'évêque Makâryûs de Tripoli, les missionnaires « francs », sont mobilisés pour plaider l'affaire en Europe. Des délégués sont envoyés en Italie2. La Propagande intervient auprès des autorités maltaises et toscanes. Mais elle n'en obtient que des promesses lénifiantes, qui tentent de discréditer les chrétiens levantins. Nul doute que les corsaires bénéficient de la complicité bienveillante de la justice, peu pressée de faire restituer leurs biens aux Orientaux, fussent-ils bons catholiques et chaudement soutenus par l'Église. Le Grand Duc de Toscane, incité par Rome, est intervenu en faveur des chrétiens levantins et un document est arrivé de Livourne à la Congrégation dès juin 1712, assurant que l'affaire était résolue, que le capitaine Franceschi restituerait bateau et cargaison, et ne retiendrait que les marchandises appartenant à des musulmans3. Mais l'année suivante, rien n'est réglé. Avec la recommandation de la Propagande, Ni'ma Fakhr a entamé une action en justice contre le même capitaine, pour la restitution de sa marchandise. En juin, il n'a rien obtenu, et la famille Fakhr a subi une nouvelle déprédation, pour laquelle elle entame une
1 Salvatore Bono, op. cit., p. 57. ASCPF, SOCG, vol. 582, f. 431rv, 6 juin 1712 : ce document provenant de Livourne présente le capitaine Antonio Franceschi comme étant « de la religion de Malte ». Son cousin Franceschi della Bocca est dit principal intéressé dans l'armement corsaire. SC, Maroniti, vol. 3, f. 466r-469v, s.d. (vraisemblablement plus tardif), Li nazionali greci orientali commoranti in Roma e Malta présentent un mémoire sur les affres de la justice à leur égard. Ils expliquent notamment l'usage fait par les corsaires des différentes juridictions. En 1712, le Grand Maître de Malte affirme que les armateurs qui coursent sous la bannière de Malte ne peuvent s'approcher des côtes de Palestine, et encore moins s'attaquer aux pèlerins. Le responsable des attaques contre le pèlerinage aurait été un Corse (Pietro Agostino), qui n'était pas sous la bannière de Malte, et qui de surcroît a été bien inspiré de mourir : ACTA, 82, 15 fév. 1712, 15, Terra Santa. En 1723, Abramo Subani de Damas dépose une plainte à Malte par l'intermédiaire de la Propagande. Le Grand Maître répond à cette dernière (28 juin 1723) que le navire corsaire concerné, qui appartient au neveu de son secrétaire, est sous bannière de Toscane, et qu'il faut donc s'adresser à Livourne : SC, Melchiti, vol. 1, f. 475r et 477r. Recommandation pour la même affaire de Sayfî et des missionnaires du Caire ibidem, f. 432r (arabe), 431r (trad. ital.). et f. 433r (1722). ' 2 ASCPF, SOCG, vol. 580, f. 177rv (trad. ital.), f. 178r (arabe), 14 mars 1711, Sayfî au pape. SC, Melchiti, vol. 1, f. 141v (arabe), 142rv (trad. ital.), Makâryûs, archevêque de Tripoli, 25 janv. 1713. Ibidem, f. 463r, le diacre Stefano, envoyé de l'archevêque de Sidon (s. d.) 3 ASCPF, SOCG, vol. 582, f. 431rv, Livourne, 6 juin 1712 (copie).
158
BERNARD
HEYBERGER
seconde procédure 1 . Sarufîm Tânâs, envoyé de son oncle, l'évêque Aftîmyûs Sayfî, a été reçu la même année par le Grand Duc de Toscane, qui a demandé au gouverneur de Livourne de faire justice. Le capitaine a promis de rendre la marchandise, mais gagne du temps en contestant la validité des documents qui lui sont présentés en vue de la restitution. Sarufîm repart au Levant en confiant ses intérêts à Ni'ma Fakhr 2 . En août de la même année (1713), un observantin revenu du Levant écrit de Livourne que Giuseppe Francesco, parent du patriarche maronite, venu pour se faire restituer les marchandises prises par le corsaire Franceschini avec des attestations authentiques « plus claires que le soleil à midi », a été menacé du bâton et de la prison. Ne pouvant retourner au pays à cause de ses dettes, ni rester à Livourne à cause de sa pauvreté, il est parti, désespéré, « se faire Turc » à Alger. Frère Giovanni Giuseppe ajoute que Ni'ma Fakhr et son procureur agissent, mais sans rien obtenir, les principati de Livourne étant intéressés dans l'armement corsaire. Il rapporte que les Orientaux sont venus le voir indignés, tonnant « que les Francs sont des chiens, qu'ils ne cherchent des catholiques au Levant que pour les manger, et les tenir comme esclaves de leur juridiction, sans leur porter aucun soulagement dans le dur esclavage dans lequel ils se trouvent » 3 . On ne sait quelle fut l'issue de ces litiges. Toutefois, Ni'ma Fakhr ne passait pas tout son temps en procès. En 1715, Jibrâ'îl ibn Ankârî al-Halabî al-Mârûnî (Alépin maronite), malheureux élève à peine sorti d'un collège romain, raconte parmi ses déboires récents qu'il a dû mettre en gage les livres offerts à son départ de Rome par la Propagande, et emprunter « en usure » à Livourne 100 écus à Fakhr4. Dès cette époque, les chrétiens syriens ont des relations avec l'Égypte. Ce ne sont pas, comme on l'a dit, les persécutions contre les catholiques,
1 ASCPF, SC, Melchiti, vol. 1, f. 155rv, 156rv, Livourne, 13 juin 1713. SC, Maroniti, vol. 2, f. 262rv, Livourne, 26 juin 1713. 2 ASCPF, SC, Melchiti, vol. 1, f. 159rv, 169rv, Sarufîm Tânâs, 7 juillet 1713 ; ibidem, f. 165rv, Florence, 26 juillet 1713. ACTA, vol. 83, 16 janvier 1713, f. 4rv, Aftîmyûs Sayfî demande une intervention auprès du Grand Duc de Toscane et du Grand Maître de Malte. Le Secrétaire rappelle des réponses dilatoires de ce dernier, faites à des interventions de la Propagande en 1710. Ibidem, 3 avril 1713, f. 187rv, nouveau recours de Sayfî sur le même sujet. Et encore, du même, ibidem, 19 juin 1713, f. 387rv. Ibidem, 13 mai 1713, f. 329rv, recours de Ni'ma Fakhr. Ibidem, 24 juillet 1713, f. 455v, 456r, quatre frères Cigala, une des principales familles catholiques de Santorin, qui trafiquent dans l'Archipel, demandent une patente contre les corsaires. La Propagande ne donne pas suite. 3 ASCPF, SOCG, vol. 589, f. 255rv, 256r, Giovanni Giuseppe Mazet, Livourne, 21 août 1713 : « che li franchi sono cani, che non cercono cattolici in Levante, che per mangiarli, e tenerli come schiavi della loro giuriditione, senza portar loro nissun sollievo nella dura schiavitù in qual si ritrovano ». ^ASCPF, SC, Maroniti, voi. 3, f. 65rv, 66rv, (arabe), f. 64rv, 65rv, (trad. ital.), Livourne, juin 1715.
LES CHRÉTIENS DE SYRIE DANS L'ESPACE MÉDITERRANÉEN
159
après 1724, qui sont à l'origine de leurs premiers établissements dans ce pays 1 . En 1716, Ni'ma s'adresse à la Propagande en tant que « procureur des marchands d'Égypte ». II voudrait une intervention de la Propagande auprès de Michel Metoscita, maronite originaire de Chypre, ancien du collège maronite de Rome, fixé à Malte, qui, d'après lui, doit 1 000 pezzi di otto, qu'il refuse de verser2. On retrouve la famille Fakhr quelques années plus tard. En 1725, les trois frères Giovanni, Elia et Namé s'adressent à la Propagande à propos d'un de leurs navires pris par les Maltais 3 . L'année suivante, Ni'ma, cette fois installé à Satalie, revient à la charge pour se plaindre d'être journellement molesté par les Maltais, qui lui ont pris deux navires en deux ans. Le premier, parti de Damiette chargé de marchandises pour Satalie, a été intercepté près de Chypre et conduit à Malte. Son frère et compagnon de négoce, Giovanni, habitant Damiette, a envoyé un procureur auprès des tribunaux de l'île. Les corsaires ont confisqué le chargement, et rendu le bâtiment au ra'is, qui est reparti au Levant. Mais ils n'ont rien donné ni pour la marchandise, ni pour le nolis, et ont dépouillé le navire de la plus grande partie de son équipement. Lorsque le procureur en a demandé la restitution, on lui a répliqué que la plainte, pour être recevable, devait être présentée par le plaignant en personne. Un autre des bâtiments de la famille Fakhr, venant de Damiette à Chypre, a été intercepté par le même capitaine Antonachi, et chargé de savon à Tyr. Giovanni a envoyé à Ni'ma une procuration, afin qu'il se rende lui-même à Malte. Mais ce dernier ne veut quitter Satalie, craignant que des rivaux (« hérétiques ») en profitent pour s'emparer de ses biens. Aussi a-t-il délégué sa cause au prêtre melkite Neofito Ni'mat Allah Ibn Jubayr Al-Halabî, ancien curé catholique de Damiette, installé à Malte. Il demande à la Propagande de faire parvenir le dossier à ce dernier et de faire accepter la procuration 4 .
Sur les Syriens en Egypte, André Raymond, Artisans et commerçants au Caire..., op. cit., p. 477 et suiv. ; Thomas Philipp, The Syrians in Egypt, Stuttgart, 1985, 188 p. ; André Bittar, « La dynamique commerciale des Grecs catholiques en Egypte au XVIIIe siècle », Annales Islamologiques, XXVI, 1992, p. 181-196 ; du même, « Les Juifs, les Grecs catholiques, et la ferme des douanes en Égypte sous Ali Bey al-Kabîr », Annales Islamologiques, XXVII, p. 255270 ; Bernard Heyberger, op. cit., p. 36 : les Syriens d'Égypte ne sont pas tous Grecs catholiques : les premiers Maronites du Caire sont mentionnés en 1643. 2 ASCPF, ACTA, vol. 86, 9 juin 1716, Varie, f. 183v, 184r : ces affaires ne sont pas compatibles avec l'état ecclésiastique de Metoscita. Ce personnage est entretenu à Malte par l'Ordre depuis 1700, pour le service des esclaves orientaux, et il est loué pour son travail dans cette fonction : SC, Maroniti, vol. 1, f. 324rv, 325r, 10 mai 1704. Ce qui ne l'empêche pas de trafiquer : SC Maroniti, vol. 3, f. 389rv, 390r ; f. 397rv ; f. 391rv, 395rv, 399rv, 404rv, 1724, différentes pièces concernant les affaires d'argent auxquelles Michel Metoscita est mêlé. Il a placé un capital auprès d'Orientaux, à Malte. 3 ASCPF, ACTA, vol. 95, 12 mars 1725,7, Greci melchiti. 4 ASCPF, SC, Melchiti, vol. 2, f. 46v, 47r (arabe), f. 45rv, 48r (trad. ital.), Name Fâcher, Satalie, 28 mai 1726. André Bittar, « La dynamique commerciale... », art. cit., et « Les Juifs, les Grecscatholiques,... », art. cit., mentionne le rôle de Mikhâ'îl Fakhr, Douanier à Damiette en 1748.
160
BERNARD
HEYBERGER
c) Affaires, choix confessionnel, solidarités locales On voit l'intrication du zèle catholique avec les affaires commerciales. Il existe un réseau méditerranéen de catholiques melkites et maronites, dont une partie de la stratégie sécuritaire passe par Rome. Pour eux, le catholicisme devrait être une garantie contre les attaques des corsaires, et assurer donc un privilège en matière de commerce. Mais on relève que tel n'est pas le cas, dans la mesure où l'Église ne parvient guère à se faire obéir à Malte ou à Livourne. Aussi le dépit face à l'inefficacité de la raccomandazione romaine est-il grand. En 1726, au moment de la lettre de Ni'ma, le catholicisme des Fakhr est déjà tenu en suspicion à Rome. Pour se justifier, mais avec des arguments quelque peu polémiques, Ilyâs Fakhr, paré de son titre de Chevalier romain, a adressé un mémoire aux cardinaux de la Propagande dès le 15 avril 1725, où tout en se présentant comme « toujours catholique », défenseur de la foi catholique et du primat romain, il a donné des raisons au fait que le catholicisme ne fût pas florissant au Levant 1 . Les attaques des corsaires maltais, et le fait de ne pas obtenir justice contre eux devant les tribunaux chrétiens, est une des causes avancées. Ilyâs Fakhr évoque le cas de son frère Giovanni, qui ayant perdu ainsi pour 5 000 piastres de marchandise a envoyé à Malte un procureur avec des papiers légalisés devant le consul de France du Caire, mais n'a pas obtenu de réponse. Ces pratiques, dit-il, sont la cause de la grande haine envers l'Église des schismatiques, qui accusent Rome de donner licence de piller et de voler. L'argument est repris également dans la lettre de Ni'ma l'année suivante. Mais le détachement d'Ilyâs du catholicisme a d'autres raisons, qu'il faut chercher en Orient-même. Les Fakhr se sont retrouvé associés avec l'archevêque de Saïda Aftîmyûs Sayfî et sa famille, comme nous l'avons vu, victimes avec eux du corso maltais et livournais. Il se peut qu'Ilyâs ait mis un moment sa science au service de Sayfî pour la rédaction d'un ouvrage de controverse en arabe 2 . S'il y a eu des liens d'amitié entre les deux familles, ce n'est plus le cas en 1723, lorsque le tailleur de Damas Al-Ustâ Mansûr, frère de Sayfî, écrit dans un rapport à la Propagande que, d'après lui et les missionnaires jésuites et capucins, Ilyâs n'est catholique qu'en paroles, pas dans les faits, et qu'il est peut-être même hostile à la foi 3 .
l ASCPF, série CP, Melchiti, vol. 76, f. 429rv, 431r (trad. ital.) ; f. 430r (arabe), Elia Fâcher, chevalier romain, Alep, 15 avril 1725. 2 Qistantîn Basha, Ta'rikh tâ'ifa al-Rûm al-malakiyya wa ruhbân al-mukhallisiyya, Saida, 1938, p. 196-201. ASCPF, CP, Melchiti, vol. 75, f. 312rv, 315rv (trad. ital.), 313r (arabe), Damas, 13 janvier 1723.
LES CHRÉTIENS D E S Y RI H D A N S L'ESPACE MÉDITERRANÉEN
161
La même année, un jésuite de Tripoli rapporte qu'Ilyâs a été chargé de faire des copies d'un ouvrage composé par l'Anglais Charmen, qui est « une rapsodie de tout ce que les sectaires ont inventé de plus fort en Europe contre l'autorité du Pape »*. Lorsqu'en 1725 Ilyâs écrit à la Propagande pour répondre à ces accusations, il habite Alep, où il exerce les fonctions de drogman du consul d'Angleterre, fonction qu'il conservera très longtemps. Mais on peut être bon catholique et servir honnêtement les Anglais 2 . En réalité, Ilyâs Fakhr a épousé la cause du patriarche Athanase Dabbâs. Celui-ci, revenu à la tête de l'Église melkite à la mort de Cyrille Al-Za'îm en 1720, assez méfiant envers les religieux latins, et cherchant à conserver de bonnes relations avec l'orthodoxie comme avec Rome, se heurta à un parti de catholiques zélés, mené par Aftîmyûs Sayfï et son neveu Sarufïm Tânâs, qui ambitionnaient pour euxmêmes le patriarcat. Athanase Dabbâs s'est éteint en 1724. Sylvestre le Chypriote, le candidat de Constantinople pour le siège d'Antioche, devait lui succéder. Mais les Damascains ont désigné au même moment Sarufïm Tânâs, sous le nom de Cyrille 3 . C'est le début du schisme parmi les melkites, entre catholiques et orthodoxes. Notons que les Tripolitains, contrairement aux Damascains et aux Alépins, se rangent alors massivement sous la bannière de l'orthodoxie. Sylvestre séjourne dans leur ville et y peint des icônes en 1726. En 1725, Cyrille Tânâs n'était pas encore reconnu officiellement comme patriarche catholique à Rome. Dans sa lettre à la Propagande, Ilyâs oppose l'attitude des missionnaires d'autrefois, qui avaient montré respect et civilité envers le clergé oriental, et avaient admis comme valides leurs messes et leurs rites, à celle de leurs successeurs qui appliquent l'interdiction de la communicatio in divinis prononcée à Rome, prohibant ainsi aux catholiques de s'associer à tout office, à toute cérémonie présidée par un clergé non uni. Cette accusation contre les missionnaires, fauteurs de divisions, et attirant les fidèles vers le rite latin, revient de façon récurrente au XVIIIe siècle, y compris chez les catholiques les plus fermes. D'autre part, Ilyâs reproche à Aftîmyûs S a y f î et à ses disciples leur désobéissance envers les patriarches, et l'introduction, par leur propre initiative, d'innovations dogmatiques et liturgiques, arguments auxquels Rome n'était pas insensible, et que Cyrille Al-Za'îm comme Athanase Dabbâs avaient fait valoir en leur temps. Il conteste enfin la légitimité de l'élection de Cyrille Tânâs, qui n'est pas encore tenue pour assurée aux yeux des autorités romaines.
1
ASCI'F, CP, Melchiti, vol. 75, f. 400v, Tripoli, 27 avril 1723. Bernard Heyberger, op. cit., p. 258. Il est vrai que dans les années 1720-1730 des Anglais se sont montrés offensifs envers le catholicisme. André Bittar (« La dynamique commerciale... », art. cit.) mentionne l'amitié qui lie Mikhâ'îl Fakhr à Roben, consul d'Angleterre et de Hollande en Égypte vers 1750. 2
^Bernard Heyberger, op. cit., p. 85-86, p. 89, p. 120-126, p. 393-400.
162
BERNARD HEYBERGER
Les années qui suivent, lorsque l'action du patriarche orthodoxe Sylvestre, soutenu par Constantinople, et la reconnaissance par Rome de Cyrille Tânâs comme patriarche catholique légitime, obligent les Melkites à se déterminer clairement entre catholicisme et orthodoxie, la position ambivalente des Fakhr devient impossible à tenir. L'oncle Makâryûs, évêque de Tripoli, après s'être pourvu en grâces spirituelles à Rome, assure cette fois son Salut dans l'au-delà en constituant des icônes en waqf, « pour le repos de son âme et de celles de ses parents Ilyâs Fakhr, pendant de longues années, va mettre son zèle au service de la controverse anti-catholique, s'attaquant en particulier à des piliers du dogme post-tridentin (Primauté romaine, nature de la Transsubstantiation, Purgatoire, Immaculée Conception, Virginité de Saint Joseph) 2 . Nul doute que son revirement doctrinal s'accompagne aussi de choix sociaux. En 1756, un nouveau pacha nommé à Alep arrive accompagné d'un médecin constantinopolitain d'origine grecque. Celui-ci s'entend avec Ilyâs pour obtenir un firman envoyant l'archevêque melkite catholique de la ville, Maksîmûs Al-Hakîm, en déportation à la citadelle d'Adana. Mais les protections des catholiques à Istanbul sont également puissantes, puisque, par l'intermédiaire de Al-khawâja Hannâ 'Asayla, wakil (procureur) maronite des quatre tâ'ifa-s chrétiennes d'Alep désigné par le pacha, et dont le frère était médecin du sultan, ceux-ci retournèrent la situation en leur faveur, et font rappeler Maksîmûs au bout de cinq mois. D'après la même source, les Anglais, rendant Ilyâs Fakhr responsable d'une faute à leur égard, le renvoient peu après à Tripoli 3 . À mon sens, l'ensemble des éléments biographiques concernant les Fakhr attire notre attention sur le fait que, si les impératifs de l'économie méditerranéenne ne sont pas à négliger dans la stratégie des chrétiens orientaux, on ne peut réduire leurs préoccupations à cela. L'organisation locale interne de ces petites sociétés que sont les tâ'ifa-s chrétiennes, avec l'appartenance à tel ou tel réseau de solidarité, est évidemment prise en compte par des personnages comme Ilyâs Fakhr, qui se range dans le parti d'Athanase Dabbâs, puis dans celui de Sylvestre le Chypriote, contre le parti de Sayfî et de Tânâs. On comprendra aisément que, de ce point de vue, on ne puisse plus clairement établir une distinction entre les objectifs purement matériels de survie ou de réussite sociale, et des préoccupations identitaires, qui font convoiter par les Orientaux les indulgences et les techniques de dévotion 1 Icônes Melkites, exposition du Musée Nicolas Sursock, Beyrouth, 16 mai-15 juin 1969, p. 182, Archange Saint Michel (n° 44, 1726) ; p. 186, Saint Démètre, (n° 47, 1727). Je suppose, sans en être assuré, qu'il s'agit toujours du même évêque Makâryûs. La formule de donation, qui évoque « la mort de soi », est une nouveauté à cette époque, et traduit malgré tout une influence occidentale. ^Joseph Nasrallah, Histoire du mouvement littéraire..., op. cit., vol. IV, t. II, p. 204-209. 3 Nâwufîtûs Idlibi (Edelby), Asâqifa al-Rûm al-Malakiyym bi "alab, Alep, 1983, p. 173. Archives générales des Capucins, Rome, AD, 106, Diaire des capucins d'Alep, p. 68-70.
LES CHRÉTIENS D E SYRIE D A N S L'ESPACE M É D I T E R R A N É E N
163
proposés par l'Église romaine, ou traduire les ouvrages grecs de controverse antilatine. On est donc dans une quête générale, matérielle et spirituelle, de la sécurité, telle qu'elle a été mise en évidence par Jean Delumeau 1 . Beaucoup d'observateurs occidentaux évoquent la fourberie et la duplicité des chrétiens orientaux, et en font un trait de caractère ethnique 2 . Volney, plus subtil que d'autres, en cherche les origines dans leur éducation et dans l'attitude du gouvernement à leur égard 3 . Ces « défauts » ne sont certes pas l'apanage des chrétiens du Levant, et ne sont sans doute pas plus généralisés parmi eux que dans d'autres groupes nationaux, sociaux et religieux 4 . On pourrait d'ailleurs estimer méritoire et légitime l'attitude d'un Ilyâs Fakhr, qui tente encore de ne pas choisir entre Rome et Constantinople en 1725. Mais évitons de passer de l'analyse historique au jugement moral. Contentons-nous de souligner que, pour qu'une stratégie de la sécurité soit efficace, pour qu'elle permette de gérer l'imprévisible, il faut forcément qu'elle dispose de plusieurs fers au feu, qu'elle puisse jouer sur plusieurs tableaux. L'ambivalence est encore encouragée par la complexité des appartenances institutionnelles de ces minoritaires chrétiens dans l'Empire ottoman. Ce travail repose uniquement sur des sources conservées en Occident. Il me paraît toutefois évident que les chrétiens orientaux, dans leur quête de la sécurité économique et politique, ne se limitaient pas à un tête-à-tête avec l'Église romaine ou avec la diplomatie française. Comme du point de vue religieux, ils avaient tendance à additionner leur propre tradition à des produits d'importation catholiques ou orthodoxes, ils savaient du point de vue économique et politique combiner à leur réseau occidental leurs bonnes relations parmi les notables musulmans ou les Églises orientales. D'autres articles de ce volume, fondés sur d'autres sources, contribuent à livrer les indices des stratégies sécuritaires chrétiennes dans l'Empire ottoman. Jean Delumeau, Rassurer et protéger. Le sentiment de sécurité dans l'Occident d'autrefois, Paris : Fayard, 1989, pp. 9-29. La partie du règlement de la Congrégation des Melkites célibataires d'Alep, qui énumère au jour le jour les indulgences que les membres de la société peuvent gagner, fait penser à un livre de comptes, semblable à ceux que ces marchands devaient pratiquer pour leurs affaires, au même moment : Archevêché melkite d'Alep, n° 518, « Sûra rusûm 'akhawiyya al-'uzbân bî "alab >. ^Archives générales des Capucins, Rome, AD, 106, p. 163, cité dans Bernard Heyberger, op. cit., p. 128-129, à propos du drogman maronite YÛsuf Qarâ'alî (1799) ou ASCPF, Missioni Miscellanee, 1, f. 466v, rapport d'un Gardien OFM, à propos des drogmans d'Alep (1736). Ces jugements moraux négatifs peuvent être repris par des Orientaux eux-mêmes : Monseigneur Joseph Nasrallah (grec catholique), soupçonne Ilyâs Fakhr d'hypocrisie et de cupidité : « Par intérêt, il prit modèle sur son protecteur (Athanase Dabbâs) qui, comme on le sait, jouait selon les circonstances du catholicisme et de l'orthodoxie. [...] Finalement, il céda aux sollicitations d'un agent anglais, Chairman, qui fit de lui le champion le plus redouté de l'orthodoxie. » : Histoire du mouvement littéraire..., op. cit., vol. IV, t. II, pp. 203-204. ^Volney, Voyage en Egypte et en Syrie, Paris-La Haye, 1959, pp. 410-411. 4 Nathan Wachtei, « L'acculturation », in Jacques Le Goff, Pierre Nora [éd.], Faire de l'histoire, rééd., Paris, 1986,1.1, pp. 184-185, donne cette définition de la « dualité culturelle » : « Il s'agit des cas, nombreux, de dualité culturelle où certains individus se conforment aux règles et aux valeurs de la société dominante lorsqu'ils se trouvent parmi les représentants de cette dernière, mais reprennent les traits et les valeurs de la société dominée lorsqu'ils reviennent dans leur milieu d'origine. Les faits d'acculturation manifestent dans ce cas, à l'intérieur d'un même ensemble social, une fondamentale ambiguïté ».
Hans-Lukas KIESER
MISSIONS CHRÉTIENNES ET IDENTITÉ OTTOMANE
Trois questions autour de la notion de 1'« ottomanité » (identité ottomane et image de Yhomo ottomanicus ou de la femina ottomanica) soustendent mon étude : qu'est-ce qui attirait les missionnaires, par opposition aux autres Occidentaux, dans les terres du Levant ? Jusqu'à quel point s'identifiaient-ils aux homines ottomanici ? Quelle ottomanité voulaient-ils promouvoir, notamment dans les écoles ? Les quelques pages qui suivent ne peuvent donner que des réponses provisoires et limitées. Elles se bornent aux dernières décennies ottomanes en Anatolie et parlent surtout de l'approche protestante, précisément de celle d'une « avant-garde », assez nombreuse en Turquie, qui non seulement s'abstenait de disputes confessionnelles stériles, mais tentait également, sans toujours y réussir, de valoriser l'identité de cet Autre que l'on rencontrait. Il sera aussi question de l'œuvre médicale dans la ville d'Urfa*. C'est ici que quelques Suisses, Joséphine Ziircher, Jakob Kiinzler, Andréas Vischer et d'autres, géraient depuis 1896 un hôpital au nom de la Deutsche Orientmission, organisation fondée par Johannes Lepsius, fils de l'égyptologue renommé Cari Friedrich Lepsius. À Urfa, Corinna Shattuck, une des femmes missionnaires les plus impressionnantes, que ne liait qu'un lien très souple à son organisation, le Board américain, avait déjà créé entre autres une école et un atelier de travail pour des aveugles. C'est elle qui motiva Johannes Lepsius pour établir le centre de son travail là-bas.
Cf. mon article "Le petit monde autour d'un hôpital missionnaire : Urfa, 1897-1922", in F. Georgeon et P. Dumont (dir.), Vivre dans l'Empire ottoman, Paris: Harmattan, 1997, qui se recoupe avec l'article ci-présent.
166
HANS-LUKAS
KIESER
1. L'EMPIRE OTTOMAN, ELDORADO DES MISSIONNAIRES Les terres du Levant accueillaient un grand nombre de missionnaires et d'organisations missionnaires. Le système du concert des puissances et de l'Empire ottoman menacé offrait le soubassement politique doublement précaire de leurs efforts. Ce fondement perdit définitivement sa solidité avec la guerre 1914-18. Trois chiffres : à la veille de la guerre, en Anatolie (avec Istanbul), les missionnaires américains protestants du Board (American Board of Commissioneers for Foreign Missions des églises congrégationalistes), l'organisation la plus puissante en Asie mineure, et les missionnaires catholiques français, parmi lesquels notamment les Jésuites, instruisaient, à parts presque égales, à peu près 50 000 élèves. Les Américains n'étaient pas plus de 200, car ils s'appuyaient fortement sur des native workers (plus d'un millier), tandis que le nombre des religieuses et religieux français s'élevait à 700 1 . L'impact des missions en Anatolie ne se réduisait pas aux effets d'une complicité, souvent évoquée, avec la stratégie de l'impérialisme économique et culturel. Sinon, on aurait de la peine à comprendre leur implantation solide, leur dynamisme et leur efficacité. Un auteur turc s'est récemment exprimé dans les termes suivants : « Si l'on se souvient que ce n'est que durant le premier quart du XXe siècle que les intellectuels ottomans commencèrent, avec bien de l'étonnement, à connaître l'Anatolie, on peut dire que les missionnaires américains la connaissaient alors à fond. Comme elle leur était très familière, ils savaient, probablement bien mieux que les fonctionnaires ottomans, les valeurs, les comportements, les désirs, les préjugés et les attentes des différents groupes ethniques et sociaux » 2 . Les missionnaires, surtout ceux du Board, se créèrent un espace à eux, partiellement autonome par rapport aux ingérences de la Sublime Porte aussi bien que des puissances. Il s'agissait non seulement de lieux concrets de travail pédagogique, médical et industriel, et d'un réseau social très développé, qui se recoupait avec plusieurs autres réseaux, mais également d'un espace mental habité par des idées, des visions, des jugements et des reflets d'expériences particulières.
Les 150 religieux et religieuses de la Mission jésuite de la Petite Arménie, par exemple, n'étaient assistés que par une bonne centaine d'« auxiliaires indigènes ». Pour la statistique de cette mission cf. l'annexe de ma Lizentiatsarbeit Mission am Limit. Die Endphase der christlichen Missionen in der Türkei auf dem Hintergrund des gesellschaftlich-politischen Systemwechsels 1908-1923, Université de Bâle, 1993. ^Uygur Kocaba§oglu, Anadolu'da Amerika 19. Yüzyilda Osmanli imparatorlugu'ndaki Amerikan Misyoner Okullari, Istanbul : ARBA, 1989, p. 220.
M I S S I O N S C H R É T I E N N E S ET I D E N T I T É O T T O M A N E
167
Que cherchaient les missionnaires dans l'Eldorado ottoman ? C'est précisément cette question que Jakob Kiinzler, assis sous la spacieuse tente du puissant chef des tribus kurdes Milli, Ibrahim pacha, qui siégeait principalement à Viran§ehir, situé à moins d'une centaine de kilomètres à l'est d'Urfa, s'est vu poser un jour de l'année 1902. Voici son récit : « Après le rituel habituel de bienvenue, le pacha garda d'abord le silence. Je lui remis la lettre de recommandation qu'il ouvrit et lut. [...] Après qu'il l'eut lue, il me demanda sur un ton assez amer ce que, finalement, j'avais à chercher dans ce pays. [...] Il dit : "Vous êtes venus dans ce pays pour l'espionner, vous n'êtes rien que des espions, peu importe que vous vous appeliez des missionnaires ou des médecins". [...] Quand je lui répliquai que nous étions venus dans ce pays pour apporter un maximum d'aide aux malades, il rétorqua : "Bah ! Laissez-nous, nous avons Dieu le Seigneur comme docteur et l'eau comme médicament, ça doit nous suffire. Celui que Dieu veut guérir, guérira aussi sans votre aide". [...] Quand il remarqua que sa façon de m'accueillir ne m'intimidait pas, il devint de plus en plus ouvert. La soirée promettait d'être intéressante pour les deux parties. Nous consacrions plus d'une heure à des sujets politiques et économiques et environ trois heures aux thèmes religieux. Notre conversation, souvent menée avec passion, incitait l'attention de tous les Kurdes et Arabes qui se trouvaient sous la tente. Je devais prendre le dîner en compagnie du pacha. [...] "Vous, les chrétiens", dit Ibrahim pacha, "c'est-à-dire vous, les Allemands, êtes venus après les massacres pour aider les chrétiens de ce pays ; mais je vous donne un conseil, n'entretenez pas de relations trop intimes avec les Arméniens, sinon il pourrait vous arriver la même chose qu'aux étrangers en Chine". Je ne pouvais pas m'empêcher d'attirer son attention sur les meurtres et les vols dans son pays. Alors il répondit : "Bah, qu'est-ce que vous voulez dire, les Européens ! Nous ne sommes que de petites gens et nous contentons aussi de peu. Qu'est-ce que c'est, quand nous détruisons un village ou lui demandons un tribut ou le pillons parce que nous sommes contraints de le punir ? Vous en Europe, vous êtes de grandes gens et ne vous contentez pas de peu. Vous ne vous appropriez pas seulement un village, mais vous dérobez un pays entier et vous assujettissez des peuples entiers !" »! Ce texte me paraît intéressant sous plusieurs aspects : il montre la méfiance — et perspicacité — d'une figure d'élite kurde, d'ailleurs illétrée, de 1'« ancien régime » ottoman, vis-à-vis des missionnaires qu'il désigne, à une surface du discours, comme espions d'une Europe impérialiste. Une fois l'enthousiasme de l'été révolutionnaire 1908 passé, l'élite jeune-turque, d'abord très proche des missionnaires à qui elle devait en partie sa scolarité, puis l'élite kémaliste, 1Jakob Künzler, « Ein Nomadenfürst Mesopotamiens », Der Christliche Orient, p. 65-70, Potsdam, 1902, p. 66-68.
168
HANS-LUKAS
KIESER
montrèrent la même méfiance, voire l'amplifièrent dans la mesure où l'efficacité du paradigme pédagogique et médical des missions se heurtait de plus en plus aux ambitions civilisatrices inspirées par le nationalisme des majoritaires. Un phénomène qui est particulièrement voyant en Anatolie orientale. L'hostilité des porte-paroles, qui se lit dans une revue comme Sebiliirreçad, s'opposa, du moins à Urfa, aux bonnes relations qu'entretenait l'équipe avec pratiquement toutes les couches de la population. Revenons à Ibrahim pacha. Son discours qui assimile la mission et l'ennemi impérialiste n'est pas à prendre au pied de la lettre. A en croire les nombreux témoignages de missionnaires aussi bien protestants que catholiques d ' U r f a , Ibrahim s'est bientôt révélé leur ami, promoteur de leurs préoccupations, protecteur des villages minoritaires et sujet favori d'articles 1 . Est-ce aussi parce qu'il avait une dette de reconnaissance ? En 1897, grièvement atteint au bras, il s'était fait opérer, contrairement au fatalisme qu'il affiche dans le passage cité ci-dessus, dans un village situé entre Alep et Urfa, par la jeune femme médecin Joséphine Zürcher. Cette dernière se rendait à Urfa, où elle allait installer le petit hôpital de la Deutsche Orientmission. Je pense que le personnage de Joséphine Zürcher fournit une des clés nécessaires pour une compréhension adéquate de la motivation missionnaire. Je la cite dans un texte écrit quelques mois après son retour du Levant et peu avant son décès en 1932 : « En tout cas, il me séduisait d'exercer ma profession bien aimée en m'y dévouant entièrement, et d'aller au-delà des voies tracées par la tradition, loin des coulisses ordinaires, du bien-être bourgeois et des devoirs de la société, tout en renonçant à la carrière, à la conjoncture et à tout compromis. Me mettre inconditionnellement au service d'un peuple malheureux et cruellement persécuté m'ouvrirait en même temps l'espace et la liberté dont j'avais besoin pour développer ma personnalité et vivre ma foi » 2 . L'enrichissement que promettait l'Eldorado ottoman n'était pas celui qui attirait un bon nombre de compatriotes de Joséphine Zürcher, également ^L'année 1908 coupa la relation semi-officielle avec Ibrahim pacha, tombé en disgrâce et bientôt disparu sous le nouveau régime qu'il blâmait ouvertement. Après avoir été opéré par Mlle Zürcher, ses contacts, empreints de respect mais aussi d'un esprit critique mutuels, avec des membres de la DOM, notamment avec Künzler qui savait la langue kurde, s'étaient poursuivis jusqu'à sa disparition. Cf. entre autres Künzler in Christliche Orient 1902 p. 65-70, 1908 p. 12-14, Eckart in Christliche Orient 1908 p. 139-141 et Giannantonio di Milano in Les Missions Catholiques, Bulletin hebdomadaire, Lyon (Paris, Bruxelles), 1908, p. 311-312. Fuyant Damas pour Virançehir, Ibrahim est mort suite à une maladie intestinale (Künzler, « Das Ende des Nomadenfürsten Ibrahim Pascha ». in Christlicher Volksbote aus Basel, 76e année, n° 52, 1908, p. 413). ^Fallscheer-Zürcher, « Wie ich den Räuberfürsten Ibrahim Pascha operierte », Hygieia, n° 3-5, Bàie, 1932, p. 89.
MISSIONS CHRÉTIENNES ET IDENTITÉ OTTOMANE
169
présents dans l'Empire en tant que commerçants, banquiers, ingénieurs ou a r t i s a n s 1 , mais l'altérité du monde ottoman pris comme espace d'épanouissement personnel, professionnel et religieux. Un curieux mélange donc de tentation par la limite, goût de l'aventure, réalisation de soi-même (Selbstverwirklichung) et besoin accentué de l'Autre. J. Ziircher tourna donc froidement le dos à l'argent et à la carrière, à l'ennui et aux contraintes d'une société bourgeoise saturée qui l'aurait étouffée. Elle ne semble jamais s'en être repentie, au contraire, elle se considéra de plus en plus comme Levantine et ne rentra en Europe que peu avant sa mort 2 . En d'autres termes, il s'agit d ' u n e économie de « capitaux symboliques » qui préoccupait des missionnaires comme Ziircher. Mentionnons ses successeurs à l'hôpital d'Urfa, pour qui ce qui précède me paraît tout aussi valable : Jakob Kiinzler, jadis également orphelin, que l'on promut plus tard docteur en médecine honoris causa ainsi que Dr. Andréas Vischer et Dr. Herrmann Christ, provenant de familles bâloises aisées. H. Christ renonça à tout salaire. Si leur motivation relève en même temps d'une inspiration civilisatrice ethnocentrique — le « corps malade » de l'Empire se prête comme champ de maîtrise, « domaine », où montrer sa supériorité et acquérir un charisme —, elle ne rejoint toutefois guère, grâce à sa forte empreinte éthique et sociale, ce qu'on appellerait de l'impérialisme culturel. Il n'était pas rare que les missionnaires blâmassent ouvertement la politique impérialiste et la tutelle économique des puissances. Un missionnaire de l'autre organisation allemande en Anatolie, le Deutscher Hilfsbund fur christliches Liebeswerk im Orient, commenta dans une brochure collective la politique allemande dans les termes suivants : « [ . . . ] politique exclusivement guidée par des intérêts économiques, avec le but d'alimenter le peuple [allemand] par de nouvelles richesses. Notamment aussi à Alep, à 200 km au sud-ouest d'Urfa, où Joséphine Fallscheer-Zürcher ouvrira plus tard une clinique avec pharmacie. Cf. en général Beat Witschi, Schweizer auf imperialistischen Pfaden. Die schweizerischen Handelsbeziehungen mit der Levante 1948 bis 1914, Stuttgart : Steiner, 1987. ^ A près une jeunesse à l'orphelinat de Zurich, elle fut une étudiante brillante qui, une fois terminé son diplôme, se distingua non seulement dans la spécialité de la chirurgie, mais aussi dans celle, alors avant-gardiste, de la psychiatrie. Sa thèse de doctorat est une interprétation psychologique de Jeanne d'Arc. En 1909, installée à Haifa, elle intervint dans le débat intellectuel en Europe, au sujet d'un article publié dans l'hebdomadaire international de science, art et technique par son ancien professeur Auguste Forel, un coryphée dans le domaine de la psychiatrie. Dans sa longue réplique très travaillée et spirituelle, sous le pseudonyme de Joséphine Tell-Zürcher, vieillarde réfugiée au Levant, elle se moque gentiment des propos évolutionnistes de Forel qu'elle tourne en théorème peu cohérent. Le professeur répondit à son ancienne élève, qu'il avait reconnue sans peine, par la seule phrase : « La flèche de Tell m ' a atteint ! » Cf. Gerda Sdun-Fallscheer, [fille de J. Ziircher], Jahre des Lebens. Die Geschichte einer Familie in Palästina um die Jahrhundertwende bis zum Zweiten Weltkrieg, Stuttgart, 2e éd. 1989, p. 414-20.
170
HANS-LUKAS
KIESER
Cette pensée fut incarnée dans le plan de la Bagdadbahn : en lui-même une spéculation complètement aberrante, voire un grand mensonge, que l'on continuait à se conter à soi-même et aux autres [...]. A ce fantôme on sacrifiait tout. On se brouilla avec la Russie, on en fit un ennemi fanatique, on annula les principes moraux les plus simples [...] La poussée tardive des deux missions allemandes — initialement des œuvres d'entraide pour les rescapés des massacres de 18952 — dans les contrées de l'Anatolie orientale fut très mal vue par les autorités de l'Allemagne impériale qui, soucieuses de relations amicales avec le sultan, refusèrent toute garantie de protection des compatriotes par leurs diplomates. En Allemagne, elles empêchèrent par la censure la publication d'articles trop compromettants pour leur politique ottomane. Afin de continuer sa démarche, Lepsius, le fondateur de la Deutsche Orientmission, dut sacrifier la sécurité de son pastorat au sein de la Landeskirche, église dépendant de l'État, qui voyait ses activités d'un mauvais œil. Comme on avait pourtant des raisons de craindre, de la part des Ottomans, l'assimilation de leur travail au courant impérialiste, les représentants des missions protestantes de l'Empire ottoman déclarèrent, à la Conférence Missionnaire Mondiale d'Edinburgh de 1910, leur volonté d'être « antidote » contre le poison de l'impérialisme politique et commercial tel que d'autres institutions occidentales le promouvaient en Turquie 3 .
2. L'URFA OTTOMANE, LIEU D'IDENTIFICATION ET DE DÉCHIREMENT Deux années après la venue des Allemands, un des capucins, résidant à Urfa, écrivit à Rome : « [...] Vous devez savoir qu'un centre du protestantisme allemand est en train de se créer à Urfa. Tout un quartier de maisons fut acheté pour y construire un hôpital, un orphelinat, un collège et d'autres écoles. Jusqu'à présent plus de 300 orphelins des deux sexes sont quasiment achetés et assignés à cette secte... Le consul général de France est pleinement conscient de cette œuvre allemande, c'est pourquoi il nous demande de lui donner toute occasion pour que la
'[.ohmann in 25 Jahre im Orient... , Frankfurt, 1921, p. 3-4. E n 1900, le nom « Armenisches Hilfswerk » sera remplacé par celui, initialement prévu, de « Deutsche Orientmission » (Richard Schäfer, Geschichte der Deutschen Orient-Mission, Potsdam, 1932, p. 30). ^World Missionary Conference. Reports of Commissions, 1.1, Edinburgh, 1910, p. 21-25.
2
M I S S I O N S C H R É T I E N N E S ET I D E N T I T É O T T O M A N E
171
France regagne son ancienne influence sur l'Orient... Permettrons-nous que le luthéranisme domine la chrétienté d'Urfa ? »' Ces quelques lignes de 1899 témoignent de la concurrence acharnée entre missions latines et protestantes en Anatolie. La propagande exagérait : les Allemands n'avaient ni collège, ni établissements scolaires en dehors de la petite école de l'orphelinat. L'or protestant, souvent faussement assimilé à des subventions étatiques2, était un des lieux communs fréquemment proférés. Peu après, l'attitude des missionnaires catholiques d'Urfa vis-à-vis des protestants s'améliora nettement. Il y eut même, ce qui est exceptionnel, des formes de collaboration amicale. Tandis que sa devancière, en qualité de femme, ne jouissait que d'un statut de tolérance de la part des autorités ottomanes, lui permettant d'exercer son métier dans le vilayet d'Alep et le sancak d'Urfa, le Dr. Herrmann Christ put obtenir le diplôme ottoman à Constantinople. Dans son compte rendu des six premiers mois de 1899, Christ focalisa les problèmes de pauvreté chronique dans leur rapport néfaste avec la santé des gens (son successeur Vischer tiendra le même langage3). «Il faudrait absolument», dit-il, «construire un hôpital de taille suffisante pour les plus pauvres des pauvres, c'est-à-dire les malades indigents, et gagner la confiance des musulmans, qui fréquentaient encore trop peu la clinique»4. H. Christ, à la recherche d'une aide fiable et efficace, conseilla au directeur de la mission, de s'adresser à un certain Jakob Kiinzler, diacon (infirmier protestant) dans un hôpital de Bâle. Kiinzler fit des débuts assez amusants —et significatifs— dans son nouvel environnement. Devant les Orientaux consternés, qui ne réussirent pas à l'en retenir, il commença à faire un grand nettoyage manuel de la salle d'opération et des objets de la clinique : comment un Européen arrivait-t-il à s'humilier à tel point ? Peu après, le Dr. Christ étant appelé à Diyarbakir, Kiinzler réussit à opérer une appendicite. Son prestige augmenta.
'Apollinare dal Fretto dans une lettre du 11 avril 1899, Archivio Generale dei Frati Minori Cappuccini : H 72IV. ...des protestants américains et allemands encouragés et secourus abondamment par leurs gouvernements et leurs coreligionnaires d'Europe et d'Amérique » (lettre collective des capucins du 28 février 1900 à Bernard d'Andermatt, ministre général des Mineurs capucins à Rome, p. 13, AGC : H 72 III) : une vision fausse notamment par rapport aux premières années du Armenisches Hilfswerk allemand, à peine toléré par le gouvernement et sans soutien de la part des églises officielles. *Der Christliche Orient, Potsdam, 1914, p. 61. 4 I1 parle de 5 % de musulmans (Turcs, Arabes et Kurdes). Aus der Arbeit des Armenischen Hilfswerkes, Berlin, oct. 1899, p. 145.
172
HANS-LUKAS
KIESER
Une bonne coopération entre Christ, Kunzler et le personnel médical arménien s'établit ; la confiance de la population, toutes religions confondues, allait croissant. En 1903, les musulmans représentaient un tiers des patients 1 . La grave maladie de son épouse, décédé peu après en Suisse, contraignit le Dr. Christ à démissionner. Son successeur, Andréas Vischer, de tradition humaniste et chrétienne — d'ailleurs l'ami universitaire intime de C. G. Jung, élevé à Bâle — était doté d'une bonne dose d'humour qui imprègne la plupart de ses écrits. Grand amateur de musique, il fit, outre son violon et l'accordéon, transporter un piano de Bâle à Urfa... De temps à autre, il donnait des concerts aux patients et se faisait apprendre les mélodies du pays. S'il ne devint pas quasi-Levantin comme J. Ziircher ou J. Kunzler, qui ne quittèrent plus l'Orient, mais que comme H. Christ il rentra plus tard, en 1920, définitivement en Suisse, il resta malade des poumons et profondément marqué par son séjour à Urfa. Après un recommencement plutôt difficile à Bâle, il mourut en 1930. Quand Vischer arrive en 1905 à Urfa, la station de la Deutsche Orientmission se trouve consolidée sous plusieurs aspects : l'infrastructure, la routine du travail, l'insertion dans la ville et la région, la relation avec les pouvoirs. Cette intégration s'accentue considérablement dès 1908. Il existe une photo significative, prise lors de la pose de la première pierre du nouveau bâtiment de l'hôpital missionnaire, le 15 juin 1913, qui prouve l'acceptation générale de l'établissement à un haut niveau régional : outre Vischer, Kiinzler et un groupe d'enfants, des dignitaires de toute part —notamment le mufti, le vartabed arménien catholique, un prélat de l'église nationale arménienne ainsi qu'Ismail Tefzi pacha, le mutasarrif — s'alignent devant l'appareil photographique 2 . La nomination antérieure de Vischer en 1912 par le mutasarrif comme chirurgien-chef de l'hôpital turc qui existait également à Urfa 3 — une décision aussi intéressée que sage du point de vue professionnel — révèle le mieux
1 Aussi bien sur le total de 2 334 traités à la « polyclinique » que sur les 72 hospitalisés. On gagna la confiance également à la dépendance médicale à Diyarbakir (Richard Schäfer, op. cit., p. 47). Parmi les patients musulmans, de 1900 à 1920, les Kurdes formaient une nette majorité. 2 Der Christliche Orient, 1913, p. 209. •'Fondé déjà sous Abdiilhamid, cet hôpital installé dans un bâtiment splendide, considéré par l'équipe médicale de la DOM comme une mauvaise copie de leur entreprise, ne fonctionnait guère avant la révolution jeune-turque (cf. Der Christliche Orient, 1913, p. 26-27).
M I S S I O N S CHRÉTIENNES ET IDENTITÉ OTTOMANE
173
l'intégration de la mission médicale sur la scène locale officielle 1 . Le travail médical, à la mesure de la provenance de ses réalisateurs sur place, disposait de supports moraux et matériels efficaces à Bâle. En 1907, des amis fondèrent VAssociation des amis de l'œuvre médicale caritative d'Urfa. Dans son appel public, tout en soulignant l'engagement suisse, celle-ci déclara une vision de l'œuvre qui abolissait toute référence confessionnelle et nationale de cette « mission » orientale et invoquait les valeurs de la tolérance, du progrès, de l'humanisme et de l'amour chrétien : projection d'idéaux et autoreprésentation bâloise ou hélvétique, si l'on veut, en Mésopotamie. Je cite un passage de l'appel susdit : « [...] l'activité de la clinique et de l'hôpital profite à tous les malades indépendamment de leur religion. [...] Son but ne doit pas être la conversion de musulmans au christianisme. Mais cette œuvre devrait apporter une lueur d'amour fraternel chrétien dans un pays éprouvé et appauvri, tourmenté par la haine sanglante des credos divergents. Elle devrait devenir un îlot de culture européenne sur cette terre jadis très florissante, à présent si malheureuse entre l'Euphrate et le Tigre. [...] » La synthèse entre tolérance pratiquée et attachement religieux (à l'évangile) serait impossible sans une approche valorisante de l'islam, la religion de l'Autre. Une telle valorisation n'était certes pas la règle dans les revues de mission à destination d'un public occidental, mais elle ressort par exemple dans plusieurs témoignages de Künzler et Zürcher, évoluant au fur et à mesure de leur séjour. J. Zürcher a aussi publié, sans y adhérer, des textes sur le Bahaïsme, dont elle était, en tant que médecin de confidence d'Abd-el-Baha 2 à Haïfa, le témoin privilégié. En somme, ces quelques Suisses d'Urfa voulaient créer un « îlot » pacifique, paradigme d'une synthèse entre science occidentale et identité ottomane, avec forte participation des minoritaires (arméniens et syriaques). Ils n'ont pas réussi à long terme. L'agonie des Arméniens de la ville et le passage Petit détail encore qui confirme que, dans ces années, la DOM faisait un « double rapprochement du pouvoir » — ottoman et allemand impérial — (rapprochement très éphémère d'ailleurs) : le groupe distingué, qui fêtait la pose de la première pierre, envoya un télégramme de félicitations à l'empereur allemand ! Contrairement aux débuts, l'ambassade allemande se hâtait alors d'aider et de protéger ses ressortissants zélés à Urfa. En automne 1904, après un incident provoqué par des soldats contre les frères Eckart à Urfa, l'ambassade allemande intervint énergiquement auprès des autorités ottomanes (Der Christliche Orient, 1904, p. 161). Dans la rétrospective, Kunzler commenta, un peu ironiquement, la volte-face de l'ambassade : « Lorsque, après les massacres de 1895, les premiers assistants entrèrent en Turquie, ils durent, pour ce qui concerne les Allemands, signer un revers à l'ambassade impériale de Constantinople disant qu'ils iraient tout à fait à leurs propres risques chez les Arméniens. Peu d'années après, le gouvernement allemand était content à son tour que partout dans l'Empire ottoman des cellules étaient créées par les missionnaires dans lesquelles l'Empire [allemand] avait aussi à dire quelque chose [grâce aux capitulations] » (Der Orient, 1935, p. 123-124). ^Abbas Efendi, fils aîné et apôtre de Baha-Ulla.
174
HANS-LUKAS
KIESER
des caravanes de mort arméniennes, mais aussi kurdes, en 1915-1916, vécus en toute proximité par la famille Kiinzler et d'autres missionnaires restés sur place, furent des événements particulièrement brutaux 1 . Kiinzler quitta Urfa en octobre 1922 et devint directeur d'un orphelinat au Liban.
3. IDÉAUX PÉDAGOGIQUES ET OTTOMANITÉ Les pédagogues protestants, avant tout ceux du Board, se considéraient comme les promoteurs d'une « ottomanité réformée » —identité plus ou moins fictive et idéalisée — , qu'ils s'imaginaient plus démocratique, plus égalitaire, plus moderne et suffisamment forte pour prévenir les luttes interethniques. Le lendemain de la révolution jeune-turque, cet esprit se manifesta avec le plus d'enthousiasme et fut formulé notamment lors de la gigantesque World Missionary Conférence à Edinburgh en 1910 2 . On considérait l'œuvre scolaire comme une action de levain, leavening process, stimulus à long terme. L'école devait être un sol neutre. L'éducation fournie à tous les groupes ottomans devait, tout en soignant les différentes identités régionales et ethniques, les qualifier pour résoudre as Ottomans les grands problèmes de leur cohabitation 3 , et, grâce au modèle qu'on leur donnait, à mettre sur pied leur propre système éducatif. Il ne s'agissait plus, si jamais il en a été question, d'agrandir le millet protestant dont la création en 1850 relevait plutôt d'un accident. Avec fierté, Washburn 4 , directeur du Robert College, cite des ambassadeurs qui auraient dit que les institutions éducatives ont eu bien plus de poids dans les décisions de la Question d'Orient que l'action jointe de toutes les Puissances européennes. A l'intérieur de cette vision, le concept de l'éducation de la femme par des femmes en accord avec les besoins concrets de son environnement jouait un rôle clé. Avec Corinna Shattuck j'ai déjà mentionné une des figures féminines extraordinaires, aussi bien aux yeux des Occidentaux que des Orientaux, qui a marqué le microcosme missionnaire bien au-delà d'Urfa où elle résidait. Justement par leur conviction et influence personnelles et morales, de telles figures ont offert, et ceci tout à fait intentionnellement, une image inverse ou antidotique (pour emprunter une seconde fois le terme de la Conférence d'Edinburgh) à celle que le monde musulman recevait en général de l'Occident comme monde immoral, égoiste, impérialiste. Des missionnaires comme ^Cf. à ce sujet la partie II de ma Lizentiatsarbeit, op. cit., ainsi que mon article sur "L'hôpital à Urfa...», op. cit. 2 Cf'. World Missionary Conférence. Reports of Commissions, t. Ili, Edinburgh, 1910. 3 World Missionary Conférence, op. cit., p. 234. ^World Missionary Conférence, op. cit., p. 223.
M I S S I O N S CHRÉTIENNES ET IDENTITÉ OTTOMANE
175
Shattuck ou Joséphine Zürcher avaient fui à leur façon le monde occidental. Les femmes ottomanes qui les fréquentaient croyaient peut-être davantage que les hommes au message, souvent non-verbal, que promouvaient de tels pionniers, et en saisissaient l'enjeu — la possibilité de changer des structures profondes de la vie sociale —, tandis que, à en croire Tracy, le président du Anatolia College à Mersifon, beaucoup de jeunes hommes considéraient leur formation comme un instrument de réussite personnelle ou comme un préparatif à une lutte politique nationaliste1. Des pédagogues comme Tracy espéraient former une élite de femmes ottomanes, des leaders, non pas des femmes au foyer. D'ailleurs, ils fondaient leur espoir sur une tradition bien enracinée à leurs yeux dans la société ottomane, à savoir qu'une femme musulmane avait l'habitude de gérer ellemême ses biens. Certains se faisaient une image d'une Ottomane idéale, fière de son ottomanité et capable, grâce à sa personnalité et aux lumières de son éducation, de déterminer positivement l'avenir du pays. Serpil Çakir dit que, si les femmes proches du journal Kadin Dünyasi, au temps de la 2e Constitution, devaient choisir entre Baticilik, islamcilik et Tiirkçûliik elles préféreraient le courant occidental 2 . Sans doute, c'était le cas aussi des étudiantes des écoles missionnaires. Batiya ragmen Batili olmak (devenir Occidental malgré l'Occident) et tout en gardant son identité ottomane. C'est du reste une formule qu'une bonne partie des missionnaires très critiques à l'égard de la politique des puissances auraient pu revendiquer à leur tour.
4. POUR CONCLURE En tant qu'interprètes de valeurs internationales, interreligieuses et fédéralistes — ceci dans leur vision de la cohabitation interethnique, articulée à la veille et au lendemain de la Grande Guerre 3 —, les missionnaires opposaient, parfois avec de grands risques personnels, des valeurs qu'ils considéraient comme universelles, au courant des idées impérialistes aussi bien qu'à une politique jeune-turque centralisatrice de plus en plus endurcie. Cette vue du microcosme missionnaire comme monde partiellement autonome, voire monde à l'envers ou « contre-monde », que je dessine ici à titre d'hypothèse, est moins valable pour les religieux catholiques dont les activités étaient étroitement concertées avec la diplomatie aussi bien française 1
World Missionary Conference, op. cit., p. 231. Serpil Çakir, Osmanli Kadin Hareketi, Istanbul, 1994, p. 257. ^Notamment par des représentants du Board qui influença en ces moments cruciaux la politique du State Department au Proche-Orient. Cf. Joseph L. Grabill, The Protestant Diplomacy and the Near East. Missionary Influence on American Policy 1810-1927, Minnesota, 1971. 2
176
HANS-LUKAS
KIESER
que pontificale. Cette double dépendance, avec le paradoxe de servir en même temps l'idée de la République laïque et la religion, tendait à les discréditer plus que les membres du Board ou d'autres missionnaires, et ne facilitait pas leur insertion sur place au-delà du groupe des coreligionnaires. « Sans la protection de la France, nous ne fussions pas restés six mois dans le pays », écrivait le Père de Damas, fondateur de la mission jésuite de la Petite Arménie, dans ses notes autobiographiques ; tandis que Kunzler soulignait la primordialité de tout un ensemble de bonnes relations au niveau local, particulièrement dans des moments —de guerre— où toute protection ou garantie de la part des puissances se révélait inefficace, voire dérisoire. De toute façon, le poids des personnalités et des liens noués sur place, l'évolution individuelle du travail et ses contraintes imprévues, bref de nombreux écarts, transgressions ou ruptures par rapport aux plans élaborés par les instances supérieures en Europe demandent à être pris en considération. Les missionnaires étaient-ils des porteurs ou promoteurs d'une « ottomanité » ? Notons tout d'abord encore une fois que c'était le système du concert des puissances et l'Empire ottoman menacé qui offraient le soubassement politique des efforts missionnaires et qui perdaient définitivement leur solidité avec la guerre 14-18. L'attachement des missionnaires à cette situation ottomane (non pas au système politique proprement dit) était profondément intéressé : il s'agissait de leur existence. Mais il y avait plus que cela : l'utopie d'une cohabitation ottomane égalitaire. Dans une rétrospective — un texte de 1928 t l — , Jakob Kunzler a érigé, pour ainsi dire, un monument à l'ottomanité dans la personne d'une femme qui l'avait fasciné : une Arménienne fière de son identité ottomane qui ne se laissait pas trop impressionner par les Occidentaux. Non seulement il regrettait dans ce texte —qui exprime un scepticisme et une douleur bien au-delà de la nostalgie— la rareté d'un tel sentiment d'identité, moyen potentiel de cohésion interethnique ottomane, mais il mettait décidément en question sa contribution personnelle au sauvetage de milliers d'enfants arméniens qu'il avait conduits, en 1921-22, au-delà des frontières. Interrogation pour des raisons fondamentales : par cette mesure, il avait indirectement aidé l'établissement d'un système nationaliste exclusif, qui, sous l'étiquette de lâiklik, allait gérer et contrôler toute expression religieuse, culturelle et pédagogique. Voilà qui contredisait gravement ses propres visions et convictions, à savoir un système fédéraliste de cohabitation en Anatolie orientale, qui, last not least, aurait pu lui garder une place et une fonction...
1Der Orient, 1928, p. 167, brouillon du n° 5, « Den Türken und den Armeniern gewidmet ! » (supprimé avant la publication ; exemplaire de la bibliothèque universitaire de Bâle).
Thomas DAVID
LA COLONIE SUISSE DE CONSTANTINOPLE (1850-1918)
Il y a quelques années, tirant un bilan des recherches sur les transformations sociales dans l'Empire ottoman, Paul Dumont écrivait : « L'évolution de la société ottomane à la fin du XIXe et au début du XXe siècle constitue pour l'historien une matière particulièrement fascinante. Durant cette période, en effet, les transformations sociales atteignent dans l'Empire ottoman agonisant une ampleur spectaculaire. Tout bouge. La société traditionnelle fait eau de toutes parts. Ni la paysannerie, ni l'armée, ni la bureaucratie, ni l'artisanat, ni la couche des lettrés, ni celle des notables, ni le négoce, ni la haute finance n'échappent au changement, et celui-ci touche toutes les composantes de la population, aussi bien les «nations» minoritaires que les Turcs ou les autres communautés musulmanes. Si effectivement les historiens ont récemment mis en évidence l'ampleur de ces transformations pour les différentes minorités religieuses de l'Empire ottoman, ainsi que pour la population musulmane, ils ne se sont guère intéressés aux communautés européennes. Pourtant, dans cette optique, l'étude des colonies étrangères semble a priori très suggestive, étant donné que les mutations de la société ottomane résultèrent, entre autres, de la pénétration économique européenne dans l'Empire ottoman. Il nous a donc paru utile de voir si ces communautés européennes, en partie instigatrices de ces changements, n'en furent pas elles-mêmes l'objet. L'étude de la communauté helvétique de Constantinople présente-t-elle dans cette perspective un intérêt ? De prime abord, on peut se montrer sceptique vis-à-vis des enseignements que l'on peut tirer de l'étude d'une société si restreinte —au maximum 400 personnes durant la période 18501914—qui, en outre, n'a jamais joué un rôle très important dans l'histoire
' Paul Dumont, « Les transformations sociales dans l'Empire ottoman (fin du XIXe - début du XXe siècle). Bilan des recherches en cours », Turcica, XIX (1987), p. 75.
178
THOMAS
DAVID
ottomane. Et pourtant, cette étude s'est avérée féconde grâce à la richesse des archives disponibles. Nous avons en effet consulté les archives de la société Helvetia, la seule association suisse à Constantinople durant cette époque : les livres de compte, les comptes rendus des protocoles du comité et des séances des assemblées générales nous ont permis de mettre en évidence les formes de sociabilité existant au sein de la colonie helvétique et de distinguer les différents groupes sociaux de cette communauté. En outre, dans la mesure où les activités philanthropiques ont occupé une place importante dans la vie de cette association, son étude a révélé les marges de la colonie, à savoir les Suisses indigents secourus par leurs compatriotes, ces figures anonymes pour lesquelles l'émigration en Turquie s'est avérée pleine de désillusions. Ces sources nous ont finalement donné un aperçu de la manière dont les diverses composantes de la colonie coexistaient, tant bien que mal, au sein de l'association. Les archives personnelles de Louis Rambert (sa correspondance, ses journaux intimes et son ouvrage 1 ) ont harmonieusement complété celles de la société Helvetia. En effet, ce personnage, une des figures d'élite de cette colonie helvétique 2 , puisqu'il fut le directeur général de la Régie co-intéressée des tabacs de 1900 à 1910, représente le prototype même de la nouvelle classe sociale apparue à la fin du XIXe siècle et dont les intérêts entrèrent en contradiction avec ceux des Suisses établis de longue date dans cette ville. Le parcours de Rambert nous a ainsi permis de bien comprendre les divergences qui secouèrent l'association Helvetia à partir du tournant du siècle. De ce fait, la taille réduite de cette communauté autorise, en fin de compte, une meilleure analyse des liens existant entre les différentes classes sociales et des formes de sociabilité de la colonie. De même, la faiblesse des intérêts économiques suisses engagés dans l'Empire ottoman ne prête pas à conséquence. Au contraire, elle donne une dimension supplémentaire à cette étude : en effet, dans la mesure où la présence des citoyens helvétiques résidant à Constantinople ne dépendait pas tant de la pénétration économique de la Suisse dans cette région que des intérêts des grandes puissances européennes, les caractéristiques de cette communauté ne peuvent être réduites à un particularisme helvétique, mais doivent être étendues à l'ensemble de la communauté européenne. Dans le cadre de cette contribution, nous nous sommes efforcé de caractériser « l'homo helveticus » dans l'Empire ottoman. Pour ce faire, nous avons d'abord étudié les formes d'émigration. Puis, dans la seconde partie, ^Louis Rambert, Notes et impressions de Turquie. L'Empire ottoman sous Abdul-Hamid 18951905, Genève, 1926. Archives Fédérales (ci-après AF), EUD 2c 105, lettre de L. Rambert au Conseil fédéral en date du 8 août 1918.
2
LA COLONIE SUISSE DE CONSTANT1NOPLE ( 1 8 5 0 - 1 9 ) 8 )
179
nous nous sommes intéressé à la répartition professionnelle de cette communauté sur la base d'un recensement effectué en 1913. Dans la troisième partie, nous avons tenté de compléter ce tableau en analysant, par le biais de la société Helvetia, les différentes classes sociales de la colonie suisse. Ce faisant, nous nous sommes rendu compte que celle-ci, loin de constituer un groupe homogène qui aurait partagé une identité commune, fut secouée par des dissensions internes. C'est pourquoi, nous nous sommes penché, dans la dernière partie, sur ces désaccords qui révèlent des lignes de fracture que l'on peut mettre en parallèle avec les bouleversements socio-économiques que connut l'Empire ottoman à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.
1. ÉMIGRATION SUISSE EN T U R Q U I E : UNE ÉMIGRATION D'ÉLITE ? L'émigration suisse vers l'Empire ottoman au XIXe siècle fut très modeste. En effet, entre 1850 et 1914, les Suisses émigrant outre-mer se dirigèrent de préférence vers le continent nord-américain, en particulier aux États-Unis et, dans une moindre mesure, en Amérique latine. Ces deux régions accueillirent, sur l'ensemble de la période, plus de 90 % des émigrants helvétiques. Dans le même temps, l'Asie n'absorba jamais plus de 1 % de ce total. Si l'on sait que les Suisses s'expatriant vers le continent asiatique se dirigèrent vers l'Empire ottoman, mais aussi vers l'Inde, le Japon et la Chine, on se rend compte que le Levant n'accueillit qu'une fraction dérisoire des Suisses qui tentèrent leur chance outre-mer 1 . Ainsi, lorsqu'on examine la présence de ces derniers dans les pays extra-européens vers 1910-1913, on constate que les États-Unis abritèrent près de 70 % du total, l'Argentine 15 %, tandis que les ressortissants helvétiques résidant dans l'Empire ottoman ne représentèrent qu'à peine 1 % de ces colonies suisses 2 . En ce qui concerne la nature de cette émigration au Levant, il faut se référer aux recherches récentes sur la question migratoire helvétique. Celles-ci ont mis en évidence deux types d'émigration : l'exode de masse et l 'émigration individuelle. La première catégorie, alimentée par les laissés-pourcompte du progrès, fut le plus souvent organisée. Ces émigrants —petits paysans, journaliers, artisans, etc.— cherchaient en principe à s'établir de manière durable dans leurs pays d'accueil, au contraire du second groupe Les statistiques de l'émigration ne permettent pas de savoir si la partie européenne de l'Empire ottoman est comprise dans l'Asie ou dans l'Europe. Toutefois, même dans le second cas, le nombre de Suisses se rendant dans l'Empire ottoman est dérisoire. 2 Nos calculs d'après Heiner Ritzmann, Statistique historique de la Suisse, Zurich, 1996, pp. 368369.
180
THOMAS
DAVID
migratoire qui regroupait des professions non agricoles et constituait une émigration d'élite : « Ces "élites" ne sont pas prises ici dans un sens étroit: il s'agit des membres de la classe dirigeante de l'Etat et de l'économie, mais aussi de ces personnes dotées de connaissances et de capacités spécifiques, qui leur assurent une situation privilégiée dans les structures professionnelles et sociales (par exemple: commerçants, artistes, diplômés des écoles supérieures, officiers...)»' Or, de par leur nombre et de par leurs professions, les Suisses séjournant dans l'Empire ottoman appartenaient à cette émigration d'élite. Mais, comme nous allons le voir, ce processus migratoire constitua en fait un phénomène extrêmement diversifié.
2. LA COLONIE SUISSE DE CONSTANTINOPLE En 1913, le Conseil fédéral lança une enquête afin de déterminer le nombre de Suisses résidant dans l'Empire ottoman. Pour ce faire, le gouvernement helvétique demanda à ses ambassadeurs en poste à Rome, Berlin, Londres, Paris et Washington de recenser le nombre de citoyens helvétiques protégés par ces puissances : la Suisse n'entretenant aucune relation diplomatique avec l'Empire ottoman, ses ressortissants étaient donc obligés de se placer sous protection étrangère s'ils voulaient profiter du régime des capitulations. Le rapport que les différents ambassadeurs envoyèrent permet de se faire une idée du nombre de Suisses résidant dans l'Empire ottoman. Ces chiffres, sans doute sous-évalués —certains pays ne prenant en compte que le chef de famille, sans donner d'indication sur le nombre d'enfants— montrent que vers 1913 il y avait 248 Suisses à Constantinople, alors qu'à Smyrne et à Salonique il y avait respectivement 73 et 69 citoyens helvétiques recensés. Les autres villes de l'Empire n'abritaient le plus souvent que quelques individus. L'un des intérêts de cette enquête est de relever systématiquement la profession des individus. Nous avons ainsi pu dresser un tableau de la répartition sectorielle de la colonie suisse de Constantinople.
Klaus Anderegg, May B. Broda, Carsten Goehrke, Hans Werner Tobler, Josef Voegeli, Béatrice Ziegler-Witschi, « Zu Stand und Aufgaben schweizerischer historischer Wanderungsforschung », Revue suisse d'histoire, 37 (1987), p. 304-305.
LA C O L O N I E S U I S S E DE C O N S T A N T I N O P L E ( 1 8 5 0 - 1 9 1 8 )
A. Les divergences
181
sectorielles
À la lecture des deux tableaux, les Suisses de Constantinople semblent s'être spécialisés dans deux activités : les chemins de fer (gestion et construction)1 et le commerce. Ces deux secteurs regroupaient en effet plus de 40 % de la population helvétique résidant dans la capitale ottomane. Si, en 1913, les chemins de fer constituaient la principale activité, il n'en avait pas toujours été de même. Vers 1850, on peut en effet affirmer, même si des données quantitatives font défaut, que les négociants formaient la catégorie professionnelle la plus importante : « Il y a une centaine de Suisses ici, presque tous commerçants ; une douzaine au plus ont famille » 2 . Ainsi, la période allant du milieu du XIXe siècle à la veille de la Première Guerre mondiale fut marquée par le déclin du négoce et l'émergence des métiers liés aux chemins de fer. Pour bien comprendre ce processus, nous allons examiner séparément ces deux groupes. Nous verrons que leur évolution est conditionnée à la fois par les mutations structurelles de l'économie suisse et par des facteurs propres à l'Empire ottoman.
A. 1. Les
négociants
Les cotonnades constituèrent la grande affaire des Suisses en Orient au XIXe siècle, surtout à partir de 1830 3 . En effet, confrontés à la vague de protectionnisme qui s'abattit sur l'Europe au lendemain du traité de Vienne, les cotonniers helvétiques recherchèrent de nouveaux débouchés : l'Amérique dans les années 1820, puis le Moyen-Orient la décennie suivante et enfin l'Asie
Dans le cadre de cette analyse, nous avons regroupé le secteur chemin de fer et celui de la construction. Nous avons en effet classé sous la rubrique « construction » les nombreux ingénieurs suisses qui se trouvaient à Constantinople. Or, nous avons constaté qu'un ou deux de ces ingénieurs travaillaient dans les chemins de fer. Malheureusement, nous ne disposons de ce genre d'information que pour un nombre limité de personnes. Nous ne sommes donc pas en mesure de savoir quelle était la proportion d'ingénieurs travaillant dans les chemins de fer. C'est pourquoi, nous n'avons pas voulu, dans les deux tableaux, réunir ces deux secteurs sous une seule rubrique dans la mesure où la rubrique « construction » regroupe, outre des ingénieurs, des architectes et maçons qui, de longue date, ont travaillé en Turquie —que l'on se souvienne des frères Fossati, deux architectes tessinois, qui restaurèrent dans les années 18301850 Sainte-Sophie— mais pas, à notre connaissance, dans les chemins de fer. 2 AF, E2, dossier 1319, lettre du 8 juin 1858 de F. Lecomte au Conseil fédéral. ^Et pas seulement en Orient, comme le souligne un contemporain : « Les Suisses placent leurs cotonnades sur tous les marchés du monde. N'ayant de débouchés voisins que par une contrebande d'ailleurs activement surveillée, ils ont profité de la facilité avec laquelle leurs compatriotes émigrent et voyagent pour se procurer, dans tous les pays qui pouvaient devenir pour eux des marchés, des modèles des marchandises courantes qu'ils ont reproduites avec une scrupuleuse exactitude. Ils peuvent ainsi se présenter, en concurrence avec l'Angleterre même, dans les deux Amériques, en Turquie, dans le Levant, en Afrique et dans les Indes-Orientales. » [Paris, Bibliothèque nationale : Annales du commerce extérieur, Suisse. Faits commerciaux, n° 8 (1857), p. 25, cité par Béatrice Veyrassat, Réseaux d'affaires internationaux, émigrations et exportations en Amérique latine au XIXe siècle. Le commerce suisse aux Amériques, Genève, 1993, p. 1],
182
THOMAS Graphique
1.
DAVID
Répartition
d'activité
de
la
d'Istanboul
en
1913
par
secteurs
population
suisse
(chiffres
absolus)
45 y 40
" H H
35
- - ^ H
V t
IIIIIIIH t
1
1. 2. 3. £-4.
I
2
I
3
I
I
4
6
2.
Répartition
de la population
«
7
5. 6. 7. 8.
Services Divers Sans profession Hôtellerie
par
secteurs
C h e m i n s de fer Commerce Enseignement Construction
Graphique
1
5
suisse d'Istanboul en
I
8
d'activité 1913
(en
%) 4.74%
(8) 22.63%
11.05%
(1)
(5) 16.84%
13.16%
(2)
(4) 14.21%
(3)
S o u r c e : graphiques 1 et 2: A F , E 2001 (A), dossier 1785.
Source : graphiques 1 et 2 : AF, E 2001 (A), dossier 1785. Note : Ces tableaux ne prennent en compte que la population active : les femmes mariées, le plus souvent au foyer, et les enfants n ' y sont pas inclus. Par contre, les veuves sont incorporées, car elles étaient contraintes de subvenir à leurs besoins. Sans profession : y compris les cas pour lesquels aucune indication n'est fournie. Divers : religieux, journaliste, garde-malade, f u m i s t e , plieuse, savonnier, géologue, pharmacien, horloger, éditeur d'art, directeur de fabrique, typographe, ferblanteur et modeleur.
LA COLONIE SUISSE DE CONSTANTINOPLE (1 8 5 0 - 1 9 1 8 )
183
orientale à partir de 1840. Très vite, les cotonnades suisses furent importées en grand nombre au Levant 1 . Dans le cas de l'Empire ottoman, les Suisses se spécialisèrent dans un certain nombre de produits : châles levantini, robes aladjas et surtout les yasmas/kalemkiars ou bonnets turcs 2 . Devant la demande croissante, les entreprises établirent des entrepôts de marchandises dans les grandes villes ottomanes 3 , en particulier à Constantinople, gérés par des firmes propres ou confiés à des représentants qui, le plus souvent, étaient des parents ou originaires de la même région que les industriels de la maison-mère. Ces représentants étaient chargés d'écouler les produits provenant de Suisse, mais aussi de trouver de nouveaux débouchés: ainsi, ils parcouraient fréquemment l'arrière-pays en emportant des échantillons 4 . Ils avaient également une autre tâche : se tenir au courant des goûts et des modes indigènes et envoyer en Suisse des échantillons de tissus locaux : « Les fabricants de Glaris [la région suisse où étaient produits les yasmas] mettent le plus grand soin à se conformer au goût et à la fantaisie des peuples auxquels ces produits sont destinés. Les correspondants de Smyrne, Constantinople, Beyrouth, Alexandrie, etc. envoient à Glaris les échantillons des tissus les plus recherchés pour turbans, ceintures, couvre-pistolets, voiles de femme, etc. Les dessinateurs s'ingénient à imiter et à enjoliver ces dessins qui sont presque toujours une combinaison de palmes et de petites fleurs du pays. Les renseignements fournis par les correspondants donnent la règle à suivre, quant aux fonds ; ici, c'est blanc; autre part, c'est l'orange et le bleu, le vert foncé et le rouge; et ce rouge, qui joue un rôle si important dans toutes les teintures de l'Orient, doit varier de nuance selon les marchés de vente. » 5
On peut même parler de déferlement, puisque les consuls britanniques en place en Syrie et au Liban tinrent, au milieu du XIXe siècle, les textiles suisses pour responsables de la désindustrialisation de cette région [Bouda Etemad, « Structure géographique du commerce entre la Suisse et le Tiers-Monde au XXe siècle », in Paul Bairoch et Martin Körner (ed.), La Suisse dans l'économie mondiale (15e-20e s.), Genève-Zurich, 1990, p. 170]. ^Béatrice Veyrassat, Réseaux d'affaires internationaux, op. cit., p. 348 ; Beat Witschi, Schweizer auf imperialistischen Pfaden. Die schweizerischen Handelsbeziehungen mit der Levante 1848 bis 1914, Stuttgart, 1987, p. 90. Un négociant suisse, résidant à Constantinople vers 1870, donna une liste très détaillée des cotonnades helvétiques exportées vers le Levant (Kölle Jenny, « Schweizer Baumwoll-Webewaaren », in Orientalisches Museum in Wien fhrg], Neue Volkswirtschaftliche Studien ueber Konstantinopel, Vienne, p. 106-109). 3 L a première maison de commerce fondée sur les bords du Bosphore le fut en 1843. Une deuxième s'y établit en 1845. C'est surtout dans les années 1850 que ce mouvement fut le plus important (Gazette de Lausanne, 9 mars 1922). 4 Beat Witschi, Schweizer auf imperialistischen Pfaden., op. cit., p. 97-103. "'Jules Kindt, « Notes sur l'industrie et le commerce de la Suisse », Annales du commerce extérieur, Suisse, n° 2 (1846), p. 16, cité par Béatrice Veysarrat, Négociants et fabricants dans l'industrie cotonnière suisse 1760-1840. Aux origines financières de l'industrialisation, I^ausanne, 1982, p. 40.
184
THOMAS
DAVID
Cette attention aux modes locales joua un grand rôle dans le succès rencontré sur les marchés orientaux par les industries suisses. Toutefois, à partir des années 1870, la roue commença à tourner. Un commerçant installé dans la capitale ottomane au début des années 1880 écrivait : « Le chiffre d'affaires des étoffes tissées multicolores suisses a diminué d'année en année et est devenu, actuellement, très modeste. »! Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer ce retournement de situation : d'une part, la concurrence étrangère, en particulier anglaise, s'intensifia 2 . D'autre part, les régions suisses qui avaient fait de l'Empire ottoman l'un de leurs débouchés préférentiels traversèrent une crise de surproduction, suite à l'adoption d'un nouveau procédé de fabrication. Enfin, l'industrie helvétique fut confrontée au renouveau de l'artisanat ottoman : en effet, après avoir été frappée de plein fouet par la concurrence des produits manufacturés étrangers, l'industrie textile ottomane refit surface à partir des années 1870, en grande partie grâce à une main-d'oeuvre extrêmement bon marché 3 . Or, ce renouveau affecta particulièrement l'industrie suisse, ainsi que le confie le consul autrichien en poste à Smyrne dans les années 1880 : « En fait de tissus de coton suisses les plus importants sont les yasmas ou foulards imprimés pour coiffure. On en consomme habituellement de 1700 à 1800 caisses d'une valeur totale de 10 000 000 piastres ou 750 000 florins argent. L'imitation de ces articles qui sont imprimés à la main en une grande variété de dessins et de couleurs, a été vainement tentée par les fabricants anglais. Les grandes difficultés techniques qu'il y avait à vaincre, pour arriver à conserver ces yasmas, leur cachet original, expliquent cet insuccès. Par contre, il est juste de dire que les produits manufacturés en Orient même (à Constantinople et à Smyrne) font une redoutable concurrence à l'industrie suisse. On exporte de Constantinople à Aden pour deux millions de piastres de yasmas (yasmas mousseline) et on fabrique à Smyrne pour environ 2 millions de piastres de yasmas (Uscudars). L'article indigène ne peut être comparé à celui de Suisse, et néanmoins quelques consommateurs, sans doute par suite d'un préjugé, le préfèrent à tous les autres. » 4 En outre, contrairement à ce qui s'était produit dans d'autres régions extraeuropéennes, en particulier en Amérique latine, il ne semble pas que les 1 Kol le Jenny, « Schweizer Baumwoll-Webewaaren », op. cit., p. 109. Ibidem, p. 107 ; Beat Witschi, Schweizer auf imperialistischen Pfaden., op. cit., p. 92. 3 À ce sujet, voir Donald Quataert, Ottoman Manufacturing in the Age of the Industrial Revolution, Cambridge, 1993 ; Thomas David, Entre mouvements de résistance et processus d'adaptation : les réactions industrielles ottomanes à la pénétration économique européenne au XIXe siècle, Lausanne, Mémoire de licence, 1992. ^Charles de Scherzer, Smyrne, Leipzig, 2e éd., 1906, p. 183. 2
LA COLONIE S U I S S E DE CONSTANTINOPLE ( 1 8 5 0 - 1 9 1 8 )
185
textiles furent remplacés dans les exportations suisses à destination de la Turquie par des machines, des produits chimiques ou alimentaires, soit par des produits liés aux secteurs dynamiques de l'industrie helvétique à la fin du XIXe et au début du XXe siècle1. À partir de 1870, alors que l'on assistait à un certain déclin de la présence des marchands suisses au Levant, malheureusement impossible à chiffrer, une nouvelle catégorie de Suisses commença à émigrer vers l'Empire ottoman : les employés des compagnies ferroviaires.
A. 2. Les employés des compagnies
ferroviaires
Très tôt, les Suisses furent associés à la construction des chemins de fer orientaux. En effet, en 1855 déjà, soit au tout début de l'aventure ferroviaire dans l'Empire ottoman 2 , Giuseppe Fossati élabora un projet de chemin de fer entre Péra et Bujukière 3 . Toutefois, c'est surtout à partir des années 1880-1890 que la participation des Suisses à la construction et à la gestion des chemins de fer devint réellement importante. Deux facteurs intervinrent dans ce processus. D'une part, on sait que le véritable boom ferroviaire dans l'Empire ottoman débuta en 1888, lorsqu'un syndicat, mené par la Deutsche Bank, et le gouvernement ottoman signèrent un accord pour la mise en chantier de X'Anatolian Railway. A leur tour, les Français entrèrent dans la danse; leurs capitaux se dirigèrent dans les années 1890 vers les chemins de fer de Syrie et de Smyrne-Cassaba. Cette expansion ferroviaire dans l'Empire ottoman coïncida d'autre part avec l'ouverture en 1882 du premier grand tunnel ferroviaire alpin : le Gothard. À cette occasion, les Suisses acquirent une grande expérience de la construction ferroviaire dans des conditions
'Beat Witschi, Schweizer ouf imperialistischen Pfaden., op. cit., p. 96. ^L'implantation d'un réseau ferroviaire en Anatolie débuta en 1856, lorsqu'une compagnie anglaise obtint une concession pour la construction d'une ligne entre Smyrne et Aïdin, d'une longueur de 130 km et qui fut inaugurée en 1866. 3 La construction de cette ligne, d'une longueur de onze kilomètres, fut estimée à 7 704 000 millions de piastres, sans compter l'achat de wagons (Archives cantonales de Bellinzona, Archivio Fossati, boîte 24, n° int. 1465, Projet de chemin de fer entre Péra et Bujukiere, kilomètres 11 environ ; depuis la première station ou embarcadère sur le lieu dit Scutari jusqu'à la descente de la prairie de Bujukière). Nous n'avons cependant trouvé aucune autre indication concernant cette ligne. Nous remercions notre collègue Luigi Lorenzetti de nous avoir fourni cette référence.
186
THOMAS
DAVID
géographiques comparables au plateau anatolien 1 . Les itinéraires d'Edouard Huguenin et de Louis Rambert sont, à cet égard, révélateurs des filières qui pouvaient exister. Le premier débuta sa carrière comme caissier à la gare du Locle. En 1879, à l'âge de 23 ans, il quitta son emploi et se rendit en Turquie, où il fut engagé comme petit fonctionnaire au service de la ligne Haydar pa§a-izmit. Puis, il gravit tous les échelons qui allaient le mener en 1908 à la direction de l'Anatolian Railway 2 . Quant au parcours de Rambert, il est parfaitement résumé dans le discours prononcé lors de ses funérailles : « Louis Rambert qui fut élevé dans ce milieu exceptionnellement cultivé, choisit la carrière de la jurisprudence, et devint licencié en droit ; avocat éminent, il se créa une situation très en vue dans le barreau vaudois ; au militaire il conquit le grade de lieutenant-colonel qui équivaut dans les autres armées au grade de général de brigade. Il remplit plusieurs charges publiques officielles, et lors de la construction de la ligne du Gothard, vu ses qualités d'éminent juriste, il fut appelé au poste de secrétaire général de cette importante entreprise. C'est dans ce milieu d'activité prodigieuse qui convenait fort bien à son tempérament, qu'il connut le Comte Vitalis et nombre de ses collaborateurs futurs, et c'est là qu'il trouva sa voie et son avenir. Peu après l'achèvement du cet égard, il est intéressant de constater que lorsque la Deutsche Bank entreprit la construction du chemin de fer anatolien en 1888, elle fut obligée de faire appel à une société française, celle du comte Vitali, car il n'existait pas de firme allemande qui possédât de l'expérience dans la construction des chemins de fer en Asie (John B. Wolf, The Diplomatie History ofthe Bagdad Railway, Columbia, 1936, p. 14). Or, Vitali avait acquis, dans ce domaine, une grande pratique en Suisse (Jean Bouvier, « La "grande crise" des compagnies ferroviaires suisses », in Jean Bouvier, Histoire économique et histoire sociale, Genève, 1968, p. 201). Une autre illustration de ce lien entre construction ferroviaire en Suisse et émigration en Turquie apparaît dans cette citation d'un article consacré à la colonie suisse de Constantinople : « Avant que la Suisse ne fut devenue la "plaque tournante" des chemins de fer européens, c'est-à-dire avant 1860, notre courant d'émigration ne débordait guère les pays voisins; nos colonies d'outre-mer, comme celles d'Orient, ne datent en fait que de l'instant où les voies ferrées purent transporter facilement de nos montagnes jusqu'aux grands ports de mer nos compatriotes désireux de tenter fortune dans le monde. Et voilà toute la raison de la jeunesse de l'un de nos groupements les plus riches et les plus influents de la IVme Suisse. » (Gazette de Lausanne, 9 mars 1922). ^ Thomas David, « Edouard Huguenin (1856-1926) : Un Neuchâtelois dans l'Empire ottoman », Musée Neuchâtelois, 2 (1993), p. 67-82. Dans cet article, nous nous interrogions sur les raisons qui poussèrent ce jeune homme à émigrer vers l'Empire ottoman. Les archives de Louis Rambert à Montreux nous en donnent l'explication. En effet, lorsque celui-ci arriva dans l'Empire, il prit ses renseignements sur ce Suisse qui était à l'époque secrétaire général de la Compagnie du Chemin de fer d'Anatolie. Voilà la réponse qu'il obtint : « (...) il a été commis à la gare du Locle, il était jeune et n'a pas laissé de bons souvenirs ; il y avait déficit et il a été remercié ainsi que le chef de gare. Il était alors un fat et peu travailleur : il est parti pour la Turquie où il fait, dit-on, ses affaires dans les chemins de fer. » (Musée du Vieux-Montrewc, Archives Rambert, lettre de J. Chappuis de la société Probst, Chappuis et Wolf (société de construction métalliques) à L. Rambert en date du 18 mai 1893). En outre, nous avons découvert qu'en 1857, un certain Léon Huguenin, originaire du même canton qu'Edouard Huguenin, se trouvait à Constantinople (AF, Ë2, dossier 1319, pétition du 26 avril 1857 en faveur d'une légation). Même si ce patronyme était très répandu dans cette région, il est fort probable que ce Léon Huguenin était un parent qui fut à l'origine de la venue dans l'Empire ottoman du futur directeur des chemins de fer d'Anatolie.
LA COLONIE S U I S S E DE CONSTANTINOPLE ( 1 8 5 0 - 1 9 1 8 )
187
Gothard, il était appelé à la Direction du chemin de fer JonctionSalonique. Le recrutement de Suisses dans les compagnies ferroviaires ottomanes, en particulier à des postes élevés 2 , fut sans aucun doute un facteur propice à l'embauche de compatriotes : à titre d'exemple, trois personnes originaires de la même petite localité qu'Huguenin travaillaient en 1913 aux chemins de fer anatoliens 3 . L'expérience des Suisses dans la construction de lignes alpines et la mise en place d'un réseau ferroviaire dans l'Empire ottoman expliquent en grande partie l'émigration au Levant, surtout à partir de 1880-1890, de citoyens helvétiques travaillant dans ce domaine. Il n'est dès lors pas étonnant que les employés des compagnies ferroviaires représentaient en 1913 le groupe numériquement dominant de la colonie suisse de Constantinople.
A. 3. Les
enseignante)s
Si la représentation féminine était réduite au strict minimum dans les activités commerciales et ferroviaires, elle était par contre beaucoup plus importante dans l'enseignement. En effet, sous cette rubrique, les femmes représentaient en 1913 plus de la moitié des effectifs (56 %). Nous ne disposons que de peu d'informations à leur sujet, si ce n'est qu'elles étaient pour la plupart enregistrées comme institutrices. Une partie devait donc travailler dans les nombreuses écoles étrangères ouvertes à Constantinople 4 . Toutefois, ce terme générique devait également inclure les gouvernantes. En effet, les recherches récentes sur l'émigration féminine en Musée du Vieux-Montreux, Archives Rambert, Discours prononcé le 17 janvier 1919, dans la chapelle du cimetière de Ferikôy à Constantinople, lors des funérailles de Louis Rambert par Mr Ernest Mamboury, professeur. Pour plus de précisions sur ce personnage, voir Thomas David, «Louis Rambert (1839-1919) : un Vaudois au service de l'impérialisme français dans l'Empire ottoman», in Bouda Etemad et Thomas David (éd.), La Suisse sur la ligne bleue de l'outre-mer, Lausanne, 1994, pp. 105-146. 2 Dans un article intitulé «La colonie suisse de Constantinople» et paru le 9 mars 1922 dans la Gazette de Lausanne, on pouvait lire : « L'effort des Suisses se cantonna d'ailleurs dans un certain nombre de situations privilégiées. Trois groupements ferroviaires furent même jusqu'en 1918 presqu'entièrement dirigés par des Suisses ; les chemins de fer d'Anatolie et de Bagdad occupaient à cette époque, parmi nos compatriotes, vingt employés supérieurs, dont le directeur ; les Chemins de fer Orientaux, quinze, dont le directeur également ; la Société des Tramways, cinq, dont l'ingénieur en chef. ». Dans le chemin de fer d'Anatolie, les Suisses représentaient en 1908 avec les Autrichiens et derrière les Allemands le contingent le plus important de cadres supérieurs (Donald Quataert, Social Disintegralion and Popular Résistance in the Ottoman Empire, 1881-1908. Reactions to European Economie Pénétration, New York, 1983, p. 78-79). 3 AF, E2001 (A), dossier 1785. ^Sur l'importance des écoles étrangères dans l'Empire ottoman, voir Jacques Thobie, Ali et les 40 voleurs : impérialismes et Moyen-Orient de 1914 à nos jours, Paris, 1985, p. 23-30.
188
THOMAS
DAVID
Suisse ont montré que les gouvernantes / institutrices représentaient une part importante de ce mouvement migratoire. Ces femmes, le plus souvent jeunes et célibataires 1 , trouvaient de l'embauche dans les maisons bourgeoises comme bonnes d'enfants-gouvernantes-réceptrices-institutrices. Cette émigration était au départ temporaire, mais il arrivait que ces femmes demeurent à l'étranger dans cette fonction jusqu'à un âge avancé. Ces Suissesses travaillèrent dans un grand nombre de pays, notamment en Russie, en Grèce et dans l'Empire ottoman 2 .
A. 4. Les autres catégories
professionnelles3
Un nombre relativement important de Suisses travaillaient dans les services, soit dans les grandes administrations européennes, comme la Régie co-intéressée des tabacs, et dans les banques. En ce qui concerne le secteur bancaire, il faut souligner qu'aucun établissement financier helvétique ne semble avoir ouvert de succursales dans l'Empire ottoman. En effet, ce ne fut pas avant la Première Guerre mondiale que les établissements de crédits suisses devinrent réellement compétitifs sur le marché mondial 4 . Par contre, il est intéressant de relever la présence d'une multinationale, Nestlé, dans l'Empire ottoman à la veille du premier conflit mondial : la Suisse était de fait à cette époque le pays qui possédait le plus de multinationales par habitants 5 . Il ne faut toutefois pas exagérer l'importance de l'Empire ottoman dans ce processus, puisqu'en 1914, il ne représentait que 0,8 % des investissements directs suisses à l'étranger 6 . La catégorie « divers » regroupe des professions aussi variées que savonnier, plieuse, modeleur, etc. Malheureusement, nous ne disposons
'À Constantinople, il est intéressant de relever qu'un tiers des institutrices étaient célibataires. 2De manière générale, voir Béatrice Ziegler, « Schweizerinnen wandern aus », Revue suisse d'histoire, 2 (1994), p. 120-143. Pour la Turquie, on trouve des indications dans A. Petitpierre, De l'émigration des jeunes filles de la Suisse romande et en particulier des jeunes Neuchâteloises, Neuchâtel, 1866, Annexes n° II et V. 3En ce qui concerne les sans professions, nous renvoyons à la partie suivante. 4 « Manifestement, en Suisse comme ailleurs, la guerre et l'après-guerre constituent une période cruciale, un point tournant, pour reprendre la formule de Kindleberger. Or, tandis qu'il signifiait stagnation, voire régression économique dans la plupart des autres pays, ce "tournant" ouvrait des horizons grandioses au capitalisme helvétique, et particulièrement à la place financière suisse. En effet, alors que la crise monétaire et financière rongeait la prédominance des anciens carrefours de la finance internationale, plongeant Londres, Paris et Berlin dans un déclin relatif, les établissements de crédit helvétiques, eux, prenaient leur envol et se propulsaient au firmament du monde bancaire. » : Sébastien Guex, La politique monétaire et financière de la Confédération suisse 1900-1920, Lausanne, 1993, p. 10. 5 Paul Bairoch, « L'économie suisse dans le contexte européen, 1913-1939 », Revue suisse d'histoire, 4 (1984), p. 481. 6 H a n s G. Schroter, « Etablierungs- und Verteilungsmuster der schweizerischen Auslandproduktion von 1870 bis 1914 », in Paul Bairoch et Martin Körner (ed.), La Suisse dans l'économie mondiale, op. cit., p. 3%.
LA COLONIE S U I S S E DE CONSTANTINOPLE ( 1 8 5 0 - 1 9 1 8 )
189
d'aucune information à leur sujet. On peut néanmoins relever dans ce groupe l'absence presque complète d'horlogers : alors qu'au milieu du XVIIIe siècle, les horlogers suisses étaient relativement nombreux à Constantinople, un siècle et demi plus tard, il n'en restait plus qu'un seul1. L'hôtellerie, enfin, était une « spécialité helvétique » : on trouvait, en effet, de nombreux maîtres ou gérants d'hôtels, restaurateurs ou garçons de café de cette nationalité dans les grandes villes européennes 2 . La capitale ottomane ne faisait donc pas exception. Que conclure de ce rapide tour d'horizon des activités professionnelles des Suisses établis à Constantinople ? Il faut d'abord relever leur extrême diversité. Du directeur de banque au ferblantier en passant par la plieuse et le mécanicien, ces activités recouvrent un large champ. Surtout, il apparaît que la répartition professionnelle des Suisses a correspondu aux bouleversements structurels qui ont marqué l'Empire ottoman 3 . Les années 1880 constituent en effet une nouvelle étape de l'expansion européenne dans l'Empire ottoman, dans la mesure où une dimension politique s'ajoute aux intérêts financiers européens : « [...] Le cours de l'histoire a transformé une série de transactions profitables (ayant un mobile politique secondaire) en l'opportunité d'établir des administrateurs financiers européens dans la capitale de l'Empire. » 4 L'administration de la Dette publique ottomane représenta le symbole de ce processus. La présence rassurante de cet organisme encouragea les capitalistes européens à investir leurs fonds non plus seulement dans les emprunts ottomans, mais aussi dans les entreprises, et plus particulièrement dans le domaine des transports. La présence de nombreux Suisses dans les chemins de fer et dans les administrations européennes (Administration de la Dette publique, Banque impériale ottomane pour ne citer que les deux plus connues)
Anthony Babel, Histoire corporative de l'horlogerie, de l'orfèvrerie et des industries annexes, Genève, 1916, chapitre XVIII. Nous faisons actuellement des recherches sur cette colonie suisse du XVIIIe siècle, mais nous ne sommes pas encore en mesure d'expliquer l'absence d'horlogers suisses à Constantinople au siècle suivant. ^•AF, E2, dossier 1320, lettre de L. Rambert au Conseil fédéral en date du 5 août 1896. Cette répartition professionnelle s'explique également par les mutations de l'économie helvétique. Nous ne développerons toutefois pas cet aspect, car il nous entraînerait trop loin. En outre, lors de la présentation des différents secteurs, nous avons déjà fait allusion à ces transformations économiques. ^Donald C. Blaisdell, European Financial Control in the Ottoman Empire, New York, 1929, p. 72.
190
THOMAS
DAVID
à la veille de la Première Guerre mondiale illustre clairement, à nos yeux, ce processus 1 . Ces éléments de rupture ne doivent toutefois pas nous faire perdre de vue les phénomènes de continuité : la présence de nombreux commerçants helvétiques sur les rives du Bosphore est là pour nous le rappeler. Si la répartition sectorielle de la main-d'œuvre nous a permis d'esquisser certaines caractéristiques de la colonie suisse de Constantinople, elle ne suffit pourtant pas à nous en présenter un tableau exhaustif : en effet, ce critère ne rend pas compte des différences sociales qui existaient au sein de cette communauté. L'étude de la société de secours Helvetia va nous permettre de combler cette lacune.
3. LA SOCIÉTÉ HELVETIA En 1857, 69 Suisses, « [...] qui se connaissaient à peine auparavant [...] » 2 , fondèrent le Cercle Helvetia afin d'offrir un lieu de rencontre pour les citoyens helvétiques résidant dans la capitale ottomane 3 . Un contemporain décrivit en ces termes la création de cette association : « [...] Les Suisses se sont réunis, ont formé un cercle l'Helvetia qui marche bien et où, tout en passant gaiement quelques soirées, on ne néglige pas des questions sérieuses. Plusieurs projets de bonnes institutions locales y sont à l'étude, d'une caisse d'épargne entre autres, il n'y en a point à Constantinople, et les Suisses prendraient une bonne initiative en en fondant une ; société de secours mutuels ; poste locale, etc. Ce sont là des choses à créer et qui rentreraient réellement dans nos attributions pratiques. » 4
Quataert décrit fort bien la politique d'emploi de l'administration de la Dette publique : celle-ci recrutait comme cadres supérieurs presque exclusivement des Européens et des membres des minorités religieuses. En outre, elle avait tendance à renforcer la présence européenne, et ce aux dépens des Musulmans, à chaque fois que les conditions politiques se dégradaient (Donald Quataert, « The Employment Policies of the Ottoman Public Debt Administration 1881-1909 », Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 76, (1986), p. 233-237). ^AF, J. II. 18, 1969/26, dossier 6, inventaire 14, Auszuege & Notizzen aus den Protokollen der « Helvetia » seit ihrer Gruendung im Jahre 1857, p. 1. 3Un événement fut à l'origine de cette association : ces personnes s'étaient en effet réunies au début de l'année afin de soutenir le gouvernement suisse dans sa politique de fermeté à l'égard de la Prusse qui voulait rétablir sur le canton de Neuchâtel la souveraineté qu'elle avait perdue en 1848 lors du mouvement des grandes révolutions nationales et libérales. Cet élan patriotique fut d'ailleurs dignement salué par la presse suisse : « Le Cercle Helvetia, dont on a beaucoup parlé déjà, le même qui, la patrie ayant été en danger de guerre, l'hiver passé, se rangeait dans le noble nombre des Suisses à l'étranger qui mettaient alors leur vie et leurs biens à la disposition de la Patrie [...]. » (Traduction française du Bund, 11 septembre 1857). 4 AF, El dossier 1319, lettre du 8 juin 1858 de F. Lecomte au Conseil fédéral.
LA C O L O N I E S U I S S E D E C O N S T A N T I N O P L E ( 1 8 5 0 - 1 9 1 8 )
191
Effectivement, quelques années plus tard, en 1861, les membres décidèrent de transformer le cercle en une société de secours pour les Suisses nécessiteux 1 . Dès lors, l'activité philanthropique occupa une place centrale au sein de l'association, fidèle en cela à une tendance que l'on retrouve dans les nombreuses colonies suisses à l'étranger, que ce soit en Europe, aux ÉtatsUnis ou en Amérique latine : ainsi, en 1895, 142 sociétés de bienfaisance recevaient des subsides des autorités helvétiques. Ces associations de secours mutuels constituaient en effet l'un des moyens d'expression de l'identité nationale utilisés par les citoyens helvétiques : « Assurant à la fois une mission patriotique et philanthropique, les sociétés de bienfaisance et de secours mutuels ont assumé très tôt un rôle de porte-parole des collectivités suisses à l'étranger. » 2 Si le cercle de Constantinople s'inscrit donc dans un phénomène propre aux colonies suisses de l'étranger du XIXe siècle, il constitue également le prolongement d'une tradition vieille de deux siècles. En effet, on trouve mention, en 1667 déjà, d'un fonds de secours pour les nécessiteux créé par la colonie genevoise de Constantinople. Cette ville abrita aux XVIIe et XVIIIe siècles une importante communauté suisse, composée en majeure partie d'horlogers genevois. Ceux-ci s'occupaient de la réparation et de la vente dans la capitale ottomane, mais aussi dans le reste de l'Empire, de montres fabriquées à Genève. Cette colonie prit la dénomination officielle de « Communauté genevoise » au début du XVIIIe siècle et regroupait, outre ces horlogers, des calvinistes français 3 . Enfin, les associations de bienfaisance dans l'Empire ottoman ne furent pas le propre de la colonie suisse. En effet, les sociétés philanthropiques, en particulier les loges maçonniques, y fleurirent à partir de la moitié du XIXe siècle4.
Les raisons invoquées sont les suivantes : « Vu que depuis assez longtemps le cercle a été de moins en moins fréquenté par les membres, le comité, se voyant dans l'indisponibilité de remédier à cet état de choses, propose à l'assemblée de changer les statuts en transformant notre Cercle en une société de secours pour des Suisses nécessiteux résidant ou de passage ici [...] ». (AF, J. II. 18, 1969/26, dossier 7, inventaire 16, compte rendu de l'assemblée générale du 3 février 1861). 2 Gérald Arlettaz, « "Les Suisses de l'étranger" et l'identité nationale », Etudes et Sources, 12, (1986), p. 18. Anthony Babel, « L'horlogerie genevoise à Constantinople et dans le Levant du XVI au XVIIIe siècle », Etrennes genevoises, 1927, p. 3-16. Ce fonds de secours constitua une tentative précoce de venir en aide aux nécessiteux, puisque cet historien écrit : « [...] c'est peut-être le premier ancêtre des innombrables sociétés suisses de bienfaisance à l'étranger. » (ibidem, p. 6). 4 Paul Dumont, « La Turquie dans les archives du Grand Orient de France : les loges maçonniques d'obédience française à Istanbul du milieu du XIXe siècle à la,veille de la première guerre mondiale », in J.-L Bacqué-Grammont et P. Dumont (éd.), Économie et Sociétés dans l'Empire ottoman (fin du XVIIIe-début du XXe s.), Paris, 1983, p. 171-201.
192
THOMAS
DAVID
Nous ne disposons malheureusement plus des statuts de la société de secours Helvetia ; néanmoins, par le biais des comptes rendus des assemblées générales et des protocoles du comité, il est possible d'esquisser dans les grandes lignes les activités de cette association. Cette étude rend notamment compte d'un aspect méconnu des sociétés européennes dans l'Empire ottoman : l'existence d'une population d'émigrants pour laquelle l'Empire ottoman fut loin d'être l'Eldorado rêvé 1 .
A. Les différentes catégories
d'indigents
La société Helvetia distingue, dans les secours prodigués, deux catégories d'indigents : les résidents et les gens de passage 2 . Toutefois, nous avons préféré, pour la clarté de l'étude, en ajouter une troisième : les rapatriés 3 . Les résidents formaient la première catégorie : ce sont les personnes qui vivaient à Constantinople et qui étaient tombées dans le dénuement. Les femmes semblent avoir composé la grande majorité de ce groupe, comme le montre bien le recensement de 1913. À cette date, la catégorie des sans-emploi, qui représentait près de 10 % de la population active de Constantinople, était composée exclusivement de femmes dont près de la moitié était des veuves avec des enfants à charge. Le cas de Mme Petermann est à cet égard révélateur des difficultés que pouvaient rencontrer ces femmes : « Mme Petermann, déjà secourue à deux reprises, sollicite un subside qui lui permette de mettre son enfant en nourrice et de vivre jusqu'à ce qu'elle ait trouvé à se placer. Le comité accorde 90 piastres par mois pour la pension de l'enfant pendant les deux premiers mois et une somme pouvant s'élever à 100 piastres pour la mère. » 4
Les Suisses établis à Constantinople ne qualifiaient-ils pas la Turquie de « [...] la meilleure de toutes les Californies [...] » (A F, E2 dossier 1319, pétition des marchands suisses au Conseil fédéral en faveur d'une légation en date du 26 avril 1857, p. 12). 2 Cette distinction apparaît pour la première fois dans le compte rendu de l'assemblée générale du 3 février 1861 qui entérine la création de cette association. Dans les comptes, c'est à partir de 18% que l'on commence à différencier les résidents des gens de passage (AF, J. II. 18 1969/26, dossier 1, livre de comptes (1893-1907)). ^Dans sa thèse de troisième cycle consacrée aux Suisses de Marseille, Renée Thery-Lopez a étudié, sur la base d'archives fort riches, la vie associative helvétique dans cette ville, en particulier la société de bienfaisance. Les catégories que cette historienne a dégagées dans son étude des recettes et des dépenses de cette association nous ont été très utiles dans le cadre de notre article. Pour plus de renseignements, voir Renée Thery-Lopez, Contribution à l'histoire de l'immigration. Une immigration de longue durée : les Suisses à Marseille, Université de Provence, Thèse de troisième cycle, 1986, pp. 237-257. 4 AF, J. II. 18 1969/26 dossier 6, inventaire 14, séance du 30 avril 1882.
LA COLONIE SUISSE DE CONSTANTINOPLE ( 1 8 5 0 - 1 9 1 8 )
193
Les femmes célibataires sans profession représentaient l'autre moitié. Parmi ces dernières, si certaines vivaient encore chez leurs parents, d'autres avaient une situation moins enviable, à l'instar de cette jeune fille de 18 ans dont le père, habitant en Suisse, demanda au président de l'Helvetia de s'intéresser à son cas, car elle était dans une maison peu recommandable... 1 L'importance des femmes dans ce groupe social apparaît en filigrane dans la décision de l'assemblée générale, en 1912, d'abandonner, au comité de direction la gestion de l'aide aux Suissesses. Il est intéressant de relever que cette mesure ne semblait pas s'appliquer aux Suisses indigents 2 . Il arrivait parfois également que, suite à une maladie ou au licenciement du père, des familles s'adressent à l'association pour demander une aide. Les personnes âgées entraient aussi dans cette catégorie : en 1894, l'assemblée générale accepta de verser chaque année 100 livres turques sur un compte afin de construire un asile pour personnes âgées et malades 3 . Les rapatriés représentaient le second groupe. C'était une population qui ne voulait pas rester à Constantinople et qui désirait rentrer au pays : personnes ayant perdu leur emploi, qui étaient tombées malades ou qui fuyaient une contrée peu sûre à cause d'une révolution 4 . Parfois, certaines personnes désiraient être rapatriées dans un autre pays que la Suisse, comme ce père de famille qui demanda les moyens de se rendre à Paris afin de trouver un engagement pour les travaux de percement du canal de Panama 5 . Lors de la Première Guerre mondiale, l'association s'occupa également du rapatriement des Suisses résidant dans la capitale ottomane et qui avaient été mobilisés 6 . Tous ces retours étaient-ils volontaires ? Les sources ne sont jamais explicites à ce sujet. Mais on peut se demander si cette société, à l'instar de sa consœur marseillaise, n'assainissait pas le marché de l'emploi en renvoyant en }
AF, J. II. 18 1969/26 dossier 6, inventaire 14, séance du 10 mars 1882. AF, J. II. 18, 1969/26, dossier 6, inventaire 14, Auszuege & Notizzen aus den Protokollen der "Helvetia" seit ihrer Gruendung im Jahre 1857, p. 16. 3 Ibidem, p. 11. 4 D è s 1918, la société Helvetia fut ainsi chargée, par le Conseil fédéral, de rapatrier les Suisses indigents fuyant la révolution bolchevique (AF, J. II. 18, 1969/26, dossier 7, inventaire Réfugiés de Russie). 5 AF, J. II. 18 1969/26 dossier 6, inventaire 14, séance du 25 mars 1882. Il arrivait parfois que la requête ne concerne que le changement de résidence à l'intérieur de l'Empire ottoman : « Il est exposé que trois filles de feu Bussy de Lausanne nommées Madeleine : 17 ans, Hortense : 14 ans et Constance : 13 ans se trouvent à l'hôpital de Saint-Georges à Galata où elles se plaignent tellement du traitement des Sœurs qu'elles prient instamment qu'on les envoie auprès de leur mère aveugle qui habite Smyrne. Il est décidé d'adhérer à leur requête. » (AF, J. II. 18 1969/26 dossier 6, inventaire 14, séance du 25 octobre 1883). 6 ÂF, J. II. 18, 1969/26, dossier 6, inventaire 14, Auszuege & Notizzen aus den Protokollen der « Helvetia » seit ihrer Gruendung im Jahre 1857, p. 18. 2
194
THOMAS
DAVID
Suisse les indigents qu'elle ne pouvait pas aider ou les chômeurs ayant des difficultés à trouver un emploi 1 . En outre, il arrivait que la société Helvetia décidât du retour d'un(e) compatriote, après consultation avec les parents restés en Suisse. Ainsi, dans le cas de Sophie Anner, celle-ci n'eut pas vraiment le choix : « Le comité a à s'occuper du cas de Sophie Anner, originaire de Nussbaumen (canton d'Argovie) qui, s'étant mariée avec Kastui, protégé persan, sans avoir accompli les formalités légales et surtout sans en avoir informé les autorités suisses, mariage béni par les missionnaires de Haskeuï, se trouve sans moyens d'existence avec quatre enfants en bas âge, Kastui l'ayant abandonnée depuis deux mois sous le prétexte d'aller chercher du travail ailleurs. Sa position étant désespérée et plusieurs dames de la colonie suisse s'intéressant à elle et la recommandant chaleureusement, le Comité décide de la considérer comme Suisse vue l'illégalité de son mariage. En conséquence, il est décidé de la rapatrier, elle et ses enfants, vu que ses parents en Suisse quoique n'étant pas riches, sont disposés à l'accueillir. » 2 Les gens de passage constituaient enfin la dernière catégorie. Voyageurs rencontrant des difficultés temporaires, émigrés à la recherche d'emploi, et pour lesquels Constantinople ne représentait qu'une étape : ce groupe avait une image floue et était difficile à saisir. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on s'en méfiait, car ils étaient beaucoup plus difficilement contrôlables que les résidents3. Ainsi, le président déclara avoir été à plusieurs reprises escroqué par des personnes auxquelles il avait accordé de l'aide sur la base de faux passeports ou de papiers volés4. Quel type d'assistance proposait-on ? L'examen des dépenses permet de s'en faire une idée.
'À cet égard, voir Renée Thery-Lopez, (op. cit., p. 249) qui a proposé cette interprétation pour les Suisses rapatriés de Marseille. AF, J. II. 18, 1969/26, dossier 6, inventaire 14, séance du 7 octobre 1883. ce qui concerne le contrôle des résidants, on trouve souvent des références semblables à celle-ci : « Un subside pouvant s'élever jusqu'à quatre livres est accordée pour venir en aide à Madame Losli, ressortissante suisse, demeurant à Haïdar-Pacha, et qui, d'après des renseignements dignes de foi, se trouve dans le dénuement le plus complet. » (AF, J. II. 18 1969/26 dossier 6, inventaire 14, séance du 5 février 1882). Etre la veuve d'un ancien membre de la société Helvetia constituait à cet égard la meilleure des garanties (ibidem, séance du 30 avril 1882). 4 AF, J. II. 18, 1969/26, dossier 6, inventaire 14, Auszuege & Notizzen aus den Protokollen der « Helvetia » seit ihrer Gruendung im Jahre 1857, p. 16. 2
LA COLONIE SUISSE DE CONSTANTINOPLE ( 1 8 5 0 - 1 9 1 8 )
195
B. Les secours Les secours se rangeaient en deux catégories qui comprenaient les secours en nature et les aides financières :
B. 1. Les secours en nature — Les aides vestimentaires : l'association disposait d'une garde-robe formée à partir des habits usagés de ses membres. Ces habits étaient souvent distribués aux Suisses de passage à Constantinople. Parfois devant l'afflux de la demande, la garde-robe s'avérait insuffisante et il fallait acquérir des habits neufs 1 . — L'aide médicale : en 1877, l'association accorda un prêt à l'hôpital allemand, ce qui lui permit par la suite d'obtenir certains avantages pour ses ressortissants. Ainsi, le président communiqua en 1882 au comité les conditions auxquelles l'Hôpital allemand était disposé à accepter les malades suisses : « 11 piastres par jour pour la salle et 25 piastres pour les chambres particulières. Ces conditions étant celles qui sont accordées aux corporations les plus favorisées, il est décidé qu'à l'avenir les malades à la charge de YHelvetia seront soignés à l'Hôpital allemand. » 2 — Les placements : l'association faisait parfois des démarches auprès des personnes influentes afin de procurer aux ressortissants helvétiques ne disposant d'aucun emploi une occupation qui leur permette de subvenir à leurs besoins 3 . — L'«aide au logement» : l'association concluait des arrangements avec des aubergistes de Constantinople afin que les Suisses de passage dans cette ville soient hébergés et nourris à des prix favorables 4 . Il arrivait parfois également que l'association avançât les fonds nécessaires à l'installation d'un individu ou d'une famille dans un logement décent, ce qui nous conduit au second type d'aide:
' / l / \ J. II. 18, 1969/26, dossier 6, inventaire 14, Auszuege & Notizzen aus den ProtokoWcii det « Helvetia » seit ihrer Gruendung im Jahre 1857, p. 15-16. 2 AF, J. II. 18 1969/26 dossier 6, inventaire 14, séance du 5 février 1882. 3 AF, J. II. 18 1969/26 dossier 6, inventaire 14, séance du 30 avril 1882. 4 AF, J. II. 18, 1969/26, dossier 6, inventaire 14, Auszuege & Notizzen aus den Protokollen der « Helvetia » seit ihrer Gruendung im Jahre 1857, p. 15.
196
THOMAS
DAVID
B. 2. Les aides financières L'association accordait souvent aux indigents helvétiques des sommes d'argent sous la forme de subsides ou de prêts. Mais dans ce domaine, il semble qu'elle ait été relativement prudente. Elle essayait au préalable, lorsque cela était possible, de s'informer sur les personnes à aider. Elle s'efforçait de même de fournir une aide ponctuelle et de ne pas instaurer un soutien permanent 1 . Enfin, on préférait les aides en nature à celles en argent 2 . Les prêts étaient parfois accordés en gage, ce qui donnait lieu à des estimations quelque peu sordides des objets gagés : « Mr Zunni et sa famille sont menacés d'être mis à la porte de leur logement et de subir la vente de leurs meubles par voie d'enchères publiques dont ils redoutent un piteux résultat. Mr Zunni croit que moyennant une somme de 40 Ltq, il obtiendrait un arrangement de son propriétaire, Mr Lorando ; il supplie qu'on lui prête cette somme contre laquelle il offre de donner en nantissement quelques articles de bijouterie. Le comité décide de faire droit à cette requête si les objets en question ont une valeur de Ltq 20, et d'avancer seulement Ltq 30 si les dits objets ne sont pas estimés valoir plus de Ltq 15. » 3 Il va de soi que toutes ces activités philanthropiques coûtaient cher. L'étude des recettes permet de montrer de quelle manière elles étaient financées.
C. Les recettes Les cotisations représentaient une des sources de financement. La cotisation annuelle minimale s'élevait à la veille de la Première Guerre mondiale à 50 piastres, ce qui ne constituait pas une somme très élevée. Dans la mesure où ces cotisations ne jouaient pas un rôle déterminant dans les recettes de l'association 4 , il semble qu'il faille surtout leur attribuer un rôle
'Ce phénomène ressort très clairement des débats tenus à l'assemblée générale concernant le soutien, demandé par 15 membres de l'association, à apporter à une veuve suisse : « Es wird beschlossen : 1) der Witwe Salacha ausnahmsweise eine einmalige Unterstützung von Ltqs 15.—zu gewaehren. » {AF, J. II. 18, 1969/26, dossier 6, inventaire 14, Auszuege & Notizzen aus den Protokollen der « Helvetia » seit ihrer Gruendung im Jahre 1857, p. 9). 2 AF, J. II. 18 1969/26 dossier 6, inventaire 14, séance du 5 février 1882. 3 AF, J. II. 18 1969/26 dossier 6, inventaire 14, séance du 27 juillet 1883. 4 I1 est malheureusement extrêmement difficile d'établir sur le long terme la répartition des dépenses et des recettes, car les postes varient au cours des années, en fonction des caissiers. Il faut donc se référer à des années isolées. En 1893, ces cotisations représentaient un peu moins de 10 % des recettes. Seize ans plus tard, en 1909, elles ne comptaient plus que pour 5% de celles-ci (AF, J. II. 18 1969/26 dossier 1, livres de compte 1893-1907 et 1908-913).
LA COLONIE S U I S S E DE CONSTANTINOPLE ( 1 8 5 0 - 1 9 1 8 )
197
symbolique, soit la preuve de l'appartenance à la société1. Les restitutions effectuées par des particuliers représentaient une autre source de revenu. Il arrivait en effet que les personnes remboursent les prêts qui leur avaient été accordés par la société. Mais les sommes reçues étaient ridicules : à peine 2 % des recettes en 1893. En revanche, les recettes d'origine suisse occupent une place importante dans le budget de l'association. Il faut relever que ces sommes ne consistaient pas en subventions du Conseil fédéral, puisque l'association avait refusé en 1864 de formuler la demande pour une telle aide 2 . Une partie importante des fonds de la société Helvetia avait pour origine l'immense incendie qui ravagea en 1870 de nombreux quartiers de Péra. À cette occasion, un comité se forma à Zurich afin de récolter des fonds pour les victimes. Or, les sommes remises furent supérieures aux dommages et le surplus fut versé dans la caisse de l'association 3 . La gestion de ce fonds permit également d'alimenter quelque peu la caisse. A cet égard, les placements effectués s'avèrent très intéressants : en 1876, le caissier proposa de placer, à des conditions alléchantes, une somme relativement importante dans une société arménienne. Pourtant, l'assemblée générale refusa cette proposition estimant que ce placement ne présentait pas toutes les garanties. Elle décida au contraire que dorénavant l'argent serait placé dans des banques hypothécaires helvétiques. Huit ans plus tard, la baisse des taux d'intérêt en Suisse obligea le comité à revoir sa stratégie de placement. À cette occasion, on se rend compte du soin apporté à cette tâche : « Vu la difficulté d'obtenir en ce moment un taux d'intérêt rémunérateur auprès des Banques hypothécaires, Monsieur Hirzel est d'avis de proposer à la société de placer ses fonds en obligations de chemins de fer suisses. La discussion qui s'engage à ce sujet a pour résultat d'écarter tout placement de fonds sur tous titres ou valeurs sujets à fluctuations, de refuser des placements, même considérés absolument sûrs, pour une série déterminée d'années, le taux du loyer de l'argent étant actuellement trop bas, et enfin de décider que les fonds
ïpour preuve l'exclusion en 1858 d'un membre qui ne payait pas ses cotisations (AF, J. II. 18 1969/26 dossier 6, inventaire 14, séance du 13 juillet 1858). Ht ce contrairement à beaucoup d'autres sociétés suisses de l'étranger (Gérald Arlettaz, « "Les Suisses de l'étranger" et l'identité nationale », op. cit., p. 19). Le président justifia en ces termes cette décision : « Le président Mr Hirzel propose de ne point faire la supplique projetée au Conseil fédéral vu que les subsides donnés par lui sont si peu importants qu'il ne vaut pas la peine de se mettre en correspondance avec la Chancellerie fédérale. » (AF, J. II. 18 1969/26 dossier 7, assemblée générale du 22 juillet 1864). 2
3
« [...] c'est grâce à ce fonds augmenté des intérêts que pendant la guerre mondiale la colonie put sans aucun secours des autorités cantonales ou fédérales, subvenir aux besoins de nombreux compatriotes dans l'infortune. » (Gazette de Lausanne, 9 mars 1922).
198
THOMAS
DAVID
sociaux pourraient être placés pour un an auprès d'un établissement de crédit si aucune société hypothécaire sérieuse ne consent à se charger à taux favorable pour un ou deux ans. » 1 L'analyse des obligations détenues par l'association en 1914 confirme cette prudence helvétique. Déposées auprès du Crédit Suisse à Zurich, elles comprenaient des obligations cantonales, municipales, bancaires, auxquelles il faut ajouter celles de deux sociétés ferroviaires. Une seule obligation concernait une société ayant un rapport avec l'Empire ottoman : c'était la Banque des Chemins de fer orientaux, banque dont le siège se trouvait en Suisse et qui était en partie financée par le Crédit Suisse2. Cette confiance dans la sécurité financière de la mère-patrie contrastait avec la méfiance à l'égard des instituts bancaires présents sur le sol ottoman. Il est à cet égard révélateur de constater qu'il fallut attendre 1879 pour que la société Helvetia décide de déposer l'argent liquide qu'elle détenait dans une banque à Constantinople 3 . Et encore, cette décision ne fut-elle prise qu'après le cambriolage de la maison du président 4 ! Une dernière source de revenu consistait dans les dons de particuliers : ainsi Huguenin légua-t-il à sa mort 500 livres turques à la société 5 . Pourquoi cette association, dirigée, comme nous le verrons par la suite, par les représentants de la classe moyenne et par les notables de la colonie, venait-elle de la sorte en aide aux indigents suisses ? Dans la mesure où nos sources sont lacunaires à ce sujet, les réflexions récentes sur l'assistance au XIXe siècle en Europe permettent d'apporter certains éléments de réponse. La charité privée fut en effet un thème omniprésent dans le discours de la bourgeoisie libérale du XIXe siècle : « Elle [la charité] se voit confier une mission concrète et l'on peut distinguer, dans ce que les auteurs en disent généralement, deux types de propos ; d'une part la charité garantit l'extinction ou l'endiguement de la misère, fléau social ; d'autre part, et là se trouve sans doute son effet essentiel [...], elle instaure la concorde entre riches et pauvres, ces deux classes réputées antagonistes. » 6
]
AF, J. II. 18 1969/26 dossier 6, inventaire 14, séance du 9 mai 1884. AF, J. II. 18, 1969/26, dossier 2. -'L'absence à cette époque de succursale d'une banque helvétique dans la capitale ottomane explique sans doute cette réserve. 4 AF, J. II. 18, 1969/26, dossier 6, inventaire 14, Auszuege & Notizzen aus den Protokollen der « Helvetia » seit ihrer Gruendung im Jahre 1857, p. 7. ^Thomas David, « Edouard Huguenin (1856-1926) », op. cit., p. 81. ^Philippe Sassier, Du bon usage des pauvres : histoire d'un thème politique (XVIe-XXe siècle), Paris, 1990, p. 254. 2
LA COLONIE SUISSE DE CONSTANTINOPLE ( 1 8 5 0 - 1 9 18)
199
De ce point de vue, les actes de charité de la société Helvetia s'inscrivent dans ce même courant d'idées. On peut en effet se demander dans quelle mesure il n'était pas important pour les membres de cette association de montrer aux autorités ottomanes, mais aussi aux puissances étrangères, qu'à défaut de concorde, les indigents suisses étaient « contrôlés » par les autres ressortissants. Dans cette optique, la société de bienfaisance, tout en venant aux secours des plus démunis, était également la vitrine de la bourgeoisie suisse de Constantinople 1 . Les propos tenus par un ressortissant allemand au sujet des mendiants de son pays se trouvant dans cette ville nous semblent à cet égard révélateurs des problèmes que cette catégorie de personnes pouvait créer : « Nous ne devons pas oublier les mendiants allemands, les soidisants "pelleteurs de neige" ou "routards", qui arrivent généralement ici à pied et qui sont pour nous autres Allemands un véritable fléau national. (...) Les pelleteurs de neige se distinguent par leur grossièreté et ont très souvent suscité des scènes désagréables dans les consulats et les lieux publics. » 2 Si l'association de secours était destinée à venir en aide aux Suisses nécessiteux, elle constituait également un lieu de sociabilité pour les citoyens helvétiques 3 . C'est cette fonction que nous allons maintenant examiner.
D. Sociabilité et identité nationale Chaque année, la société organisait une (ou des) excursion(s). C e l l e s ci permettai(en)t de resserrer les liens au sein de la communauté, mais également de renforcer l'identité commune par des manifestations d'attachement à la patrie d'origine. Le compte rendu de la première excursion organisée par cette association traduit bien ce phénomène :
1 Cette expression, appliquée à la société de bienfaisance de New York, ^est tirée de Gérald Arlettaz, « Émigration et colonisation suisses en Amérique 1815-1918 », Études et sources, 5 1979, p. 36. ^D. Dukas-Theodaffos, Im Zeichen des Halbmonds. Schilderungen aus der türkischen Reichshauptstadt, Cologne, s. d., p. 102. Je remercie Johann Strauss de m'avoir indiqué cette référence. C'est ce qui ressort clairement d'une intervention d'un membre à l'assemblée générale du 14 avril 1866 : « Mr Fröhlich fait la proposition qu'à l'avenir les assemblées semestrielles aient lieu régulièrement, une pendant le printemps, une pendant l'automne, principalement dans le but de donner l'occasion aux membres de la société de se voir. Cette proposition acceptée, il exprime le désir que les assemblées soient, selon la saison et les circonstances, suivies d'un banquet ou d'une partie à la campagne. L'assemblée se déclare d'accord avec ce désir. » (AF, J. II. 18, 1969/26, dossier 7, inventaire 16, assemblée générale du 14 avril 1866). Pour une réflexion sur le lien entre sociabilité et vie associative, nous renvoyons à Maurice Agulhon, « Introduction. La sociabilité est-elle objet d'histoire ? », in Etienne François (ed.), Sociabilité et société bourgeoise en France, en Allemagne et en Suisse, 1750-1850, Paris, 1986, p. 13-22.
200
THOMAS
DAVID
«[...] le Président du Cercle rassembla les membres en mi-cercle sous les arbres ombrageux de Gueuk-Souyou, fit chanter l'air national [...] et débutait la fête par le discours suivant : «C'est avec un grand plaisir, mes chers amis, que je vous salue ici autour de la bannière de notre patrie, autour du symbole sous lequel la Suisse a si souvent et si courageusement combattu, auquel elle doit son existence, sa force, sa dignité et sa grandeur morale. Ne la quittons jamais, cette sainte bannière; restons-lui fidèles partout [...]. Et toi, bannière de la liberté, reçois notre salut cordial; bien que tu paraisses pour la première fois sur les bords du Bosphore, loin de la terre maternelle, nous te donnons l'assurance que nous ne sommes pas les derniers fils du pays qui a obtenu sa liberté par les combats les plus nobles. Nous avons compris la parole que tu représentes et aujourd'hui rassemblés à une belle fête, tu nous trouveras aussi dans les temps sérieux pour obéir à ton appel et te prouver notre amour pour toi. [...] ». Pendant le banquet, on porta encore plusieurs toasts gais et sérieux, tour à tour avec les chants, jeux et danses sous le ciel brûlant de midi. » 1 D'autres manifestations organisées par la société Helvetia cultivaient cet attachement à la patrie : récolte de fonds pour l'érection de monuments patriotiques en Suisse ou pour l'organisation de fêtes fédérales de tir ou de gymnastique 2 . C'est dans cette optique qu'il faut également considérer la participation financière de l'association à la création de l'école allemande, participation qui a eu pour objet d'assurer une certaine pérennité de l'identité suisse par le biais du maintien de la langue maternelle d'une partie de la communauté 3 . En effet, même si l'école était allemande, il semble que la colonie suisse, grâce au prêt
1AF, J. II. 18, 1969/26, dossier 6, inventaire 14, Auszuege & Notizzen aus den Protokollen der « Helvetia » seit ihrer Gruendung im Jahre 1857, p. 2-3. , J. II. 18, 1969/26, dossier 6, inventaire 14, Auszuege & Notizzen aus den Protokollen der « Helvetia » seit ihrer Gruendung im Jahre 1857, passim. À ce propos, il faut relever que la société, à ses débuts, entreprit des démarches auprès du gouvernement ottoman afin d'avoir un stand de tir. Des carabines avaient même été achetées (AF, E2, dossier 1319, Lettre de F. Lecomte en date du 8 juin 1858 au Conseil Fédéral). Or, en Suisse, les sociétés de tir eurent une grande importance au milieu du XIXe siècle, soit au moment où se développait la notion d'identité nationale. Les fêtes fédérales de tir constituaient à cet égard de véritables manifestations de masse : Hans-Ulrich Jost, « Histoire des sociétés et de la sociabilité », in Paul Hugger (éd.), Les Suisses. Mode de vie, Traditions, Mentalités, Lausanne, 1992, p. 474 et 481. J. II. 18, 1969/26, dossier 7, inventaire 16, assemblée générale du 9 mai 1882. D'une manière générale, voir Gérald Arlettaz, « "Les Suisses de l'étranger" et l'identité nationale », op. cit., p. 24 et qq.
LA COLONIE S U I S S E DE CONSTANTINOPLE ( 1 8 5 0 - 1 9 1 8 )
201
accordé lors de sa fondation, ait eu une certaine influence dans sa gestion 1 , au point que les membres du comité de la société Helvetia la qualifient indifféremment d'école allemande ou allemande et suisse. On peut toutefois se demander si ces manifestations parvenaient à insuffler une certaine cohésion au sein de cette colonie helvétique. À première vue, la réponse semble positive. À défaut d'une liste des participations aux excursions, la liste détaillée des membres indique qu'en 1913 près de 60 % de la colonie faisait partie de la société Helvetia. De même, toutes les catégories sociales étaient représentées. Enfin, contrairement à ce qui s'était passé dans d'autres colonies helvétiques de l'étranger, les clivages politiques de la mèrepatrie ne se répercutèrent pas sur la vie sociale de la communauté suisse de Constantinople 2 . Toutefois cette apparence est trompeuse. Derrière cette façade patriotique se cachent de fortes divergences.
4. LA SOCIÉTÉ DE BIENFAISANCE : RÉVÉLATEUR DES DIVERGENCES OU D'UNE COMMUNAUTÉ D'INTÉRÊTS? Dans son ouvrage paru voici quelques années, Witschi avait étudié les tentatives d'établissement d'une représentation diplomatique suisse au Levant 3 . Cette analyse lui avait permis de mettre en évidence la fracture très nette existant, au sein de la colonie de Constantinople, entre les grands marchands et les petits commerçants. Pour comprendre les enjeux de cette opposition, rappelons que la Confédération helvétique ne disposait pas d'ambassade dans l'Empire ottoman. Ses citoyens étaient ainsi obligés de s'inscrire auprès d'une des puissances afin de pouvoir jouir des capitulations. Or, les grands négociants entretenaient généralement de bons rapports avec les diplomates de leur puissance protectrice : ils ne souhaitaient donc pas l'établissement d'une représentation consulaire suisse au Levant, qui n'aurait pas été en mesure de faire respecter, auprès de la Porte, leurs intérêts de la même manière que les
'Cela apparaît explicitement lors de la séance du comité en date du 30 avril 1882 (AF, J. II. 18 1969/26 dossier 6, inventaire 14). ^Comme ce fut le cas en Argentine : Gérald Arlettaz, « Une nouvelle Suisse à La Plata? (18571914) », Revue suisse d'histoire, 1979, p. 330-355. 3 Beat Witschi, Schweizer auf imperialistischen Pfaden, op. cit. À ce sujet, voir également Hans Beiart, Der Schutzgenosse in der Levante. Mit besonderer Berücksichtigung der Stellung der Schweizerbürger als Schutzgenossen befreundeter Staaten in der Levante, Brugg, 1898, p. 89-
202
THOMAS
DAVID
grandes Puissances 1 . Par contre, les petits commerçants helvétiques n'étaient pas en mesure d'exiger de leur puissance protectrice autre chose que de l'aide en cas de conflit avec l'Empire ottoman. C'est pourquoi ils réclamèrent à plusieurs reprises l'établissement à Constantinople d'un consulat qui soit mieux à même de défendre leurs intérêts. Ce clivage apparaît très clairement dans les affaires judiciaires, ainsi que l'expliquait un contemporain : « Dans cette position secondaire, ils [les Suisses du Levant] sont toujours jugés et ne jugent jamais ou ils ne sont que rarement appelés à juger, position très désavantageuse dans les échelles du Levant où, pour la plupart du temps, les juges sont recrutés dans la classe des notables négociants, et où les influences d'intérêt sont si vivaces et si fréquemment pernicieuses. Dans cet état de choses, il arrive, surtout à Constantinople, que si une question litigieuse s'élève entre un Suisse protégé et un ressortissant naturel, de la même Chancellerie, le Suisse doit avoir deux fois raison, sinon, à droit à peu près égal, il peut être sûr d'être condamné et d'avoir à payer tous les frais, et ces frais ne s'élèvent pas à des bagatelles. Si de la protection officieuse, nous passons à la protection officielle qu'on prête toujours à regret à un Suisse [...] contre les autorités locales, surtout à un Suisse qui n'est pas riche, cette protection est tout à fait illusoire et bien rarement efficace. » 2 Cette divergence se prolongeait dans l'attitude des deux groupes vis-àvis de la société Helvetia. En effet, les grands marchands abandonnaient presque totalement leur identité suisse et se fondaient dans la colonie de leur puissance protectrice. Les petits commerçants, au contraire, s'accrochaient à
Si Witschi, dans son ouvrage, a fort bien décrit l'attitude et les représentations de ces grands marchands, il ne s'est que rarement intéressé à leur mode de vie. Quelles étaient réellement leurs activités commerciales ? Participaient-ils vraiment à la vie sociale de leur puissance protectrice ? Quel était leur train de vie ? Sur ce dernier point, une lettre d'un grand marchand au Conseil fédéral nous apporte quelques éléments de réponse. À la question de savoir si la vie était chère à Constantinople, afin de pouvoir estimer quel serait le traitement d'un diplomate en poste dans cette ville, F. Lecomte répondit : « Vie fort chère ; beaucoup de luxe, de toilette, de chevaux, de domestiques. Pour vivre comme à Lausanne, je paie 10 francs par jour. Le bon genre veut un séjour à la campagne en été. Les femmes y sont fabuleusement élégantes, les servantes crinolinent ; les grandes dames sont couvertes d'argent et de perle. J'ai pris l'opinion de quelques-uns sur les dépenses d'un agent et du consulat. En y comptant les frais de la chancellerie, des cavafs, du personnel, etc. il faudrait au moins 30 à 40000 francs par an, pour tout. [...]. Un de nos Suisses, Mr Peter, a maison en ville et palais à la campagne, 7 à 8 domestiques. Nous, dans notre maison, pour deux personnes et Madame, par exception depuis quelque temps, nous avons deux domestiques hommes. Une voiture: 50 francs par jour, à deux chevaux. » (AF, E2, dossier 1319, lettre de F. Lecomte en date du 8 juin 1858 au Conseil fédéral). Mr Peter, dont il est question dans cette lettre, était un commerçant, opposé à toute représentation helvétique au Levant (Ibidem, lettre de Rouiller au Conseil fédéral en date du 8 janvier 1858). AF, E2, dossier 1319, pétition du 26 avril 1857 au Conseil fédéral en faveur d'une légation.
LA COLONIE S U I S S E DE CONSTANTINOPLE ( 1 8 5 0 - 1 9 1 8 )
203
leur identité helvétique et y voyaient un moyen d'imposer leurs intérêts. Il n'est dès lors pas surprenant, à en croire Witschi, que ce soient plutôt les petits que les grands marchands qui aient investi la société Helvetia}. Qu'en est-il réellement ? L'étude de la société de bienfaisance de Constantinople confirme-t-elle cette analyse ? Si une grande partie des Suisses résidant à Constantinople faisaient partie de la société Helvetia, peu étaient réellement actifs dans la vie de cette association. La fermeture du cercle Helvetia en 1861 et sa transformation en une société de secours avaient pour motif la forte baisse de fréquentation du club 2 . D'autres éléments confirment ce phénomène. Ainsi en 1878, l'assemblée générale ne put avoir lieu, car seuls étaient présents deux membres du comité et six membres de l'association. De même, le comité en 1889 posa clairement le problème de la relève, les jeunes semblant peu enclins à participer à la vie associative : « Il est frappant que les plus jeunes membres ne veuillent absolument pas se résoudre à se charger d'une fonction quelconque. » 3 Ces difficultés conduisirent le comité, à la veille de la Première Guerre mondiale, à encourager l'entrée de membres ne résidant pas à Constantinople et à tenter d'élargir l'aire de recrutement4. Ainsi donc, l'association était animée par une minorité. L'étude de la liste des membres du comité de 1857 à 1917 permet de mieux cerner ce groupe. Le comité semble avoir été monopolisé par les négociants. En effet, entre 1911 et 1915 —période pour laquelle nous disposons d'informations sur les professions des Suisses à Constantinople— nous constatons que les six membres qui y siégèrent durant cette période appartenaient tous à cette profession. Si les négociants ont accaparé la direction de l'association, il semble que ce fût avant tout les petits marchands. En effet, nous disposons pour les années 1860 et 1880 de deux listes où figurent les noms des principaux commerçants suisses établis à Constantinople 5 . Or, à deux exceptions près, sur un total de 16, ces grands marchands ne siégèrent pas au comité. À
' Beat Witschi, Schweizer auf imperialistischen Pfaden., op. cit., p. 169. Voir note 42. AF, J. II. 18, 1969/26, dossier 6, inventaire 14, Auszuege & Notizzen aus den Protokollen der « Helvetia » seit ihrer Gruendung im Jahre 1857, p. 10. 4 cIbidem, p. 14. J B e a t Witschi, Schweizer auf imperialistischen Pfaden., op. cit., p. 270 ; Kölle Jenny, « Schweizer Baumwoll-Webewaaren », op. cit., p. 110. 2
204
THOMAS
DAVID
première vue, il semble donc que l'analyse de cette association confirme les affirmations de Witschi : ce sont les petits commerçants qui revendiquaient leur identité suisse, en investissant cette société délaissée par les grands marchands. Cette ligne de fracture s'estompe pourtant lorsque l'on examine de plus près la vie de cette association, en particulier les débats concernant un consulat suisse au Levant. À cet égard, on pourrait s'attendre à ce que la société Helvetia, dirigée par les petits négociants helvétiques, prenne position en faveur d'une telle représentation diplomatique. Pourtant, lorsqu'en 1857 un débat fut engagé pour savoir si la question de l'établissement d'un consulat devait être abordée lors de l'assemblée générale, le comité refusa finalement de le faire, décision qui entraîna la démission de l'un des membres. De même, 40 ans après cette prise de position, les membres décidèrent, lors de l'assemblée générale, que la caisse de l'association couvrirait les frais occasionnés par l'envoi d'une dépêche au Conseil fédéral dans laquelle on s'opposait fermement à l'établissement d'un consulat 1 . Enfin, en 1900, ce fut avec un certain soulagement que fut inscrite dans le procès-verbal de l'assemblée générale la réponse du Conseil fédéral, selon laquelle celui-ci n'envisageait pas de représentation diplomatique au Levant2. Ces prises de position tendent à montrer que les divergences au sein de la communauté marchande n'étaient pas aussi marquées que l'affirme Witschi. Le personnage de J.-C. Hirzel, figure marquante de la société Helvetia, puisqu'il en fut président pendant plus de cinquante ans (1859-1910) symbolise, à nos yeux, cet état de faits. Au moment où il débarqua au Levant, dans les années 1850, il trouva de l'emploi comme directeur de commerce de la firme Antoniades Frères. Dix ans plus tard, en 1868, il fonda, avec un ressortissant allemand, sa propre société d'import-export, Hammer und Hirzel. En 1895, à la mort de son associé, il devint seul propriétaire, avant de s'éteindre en 1911. Ce personnage est intéressant, car son parcours, sa vie sociale et ses prises de position à l'égard d'une représentation suisse au Levant relativisent la dichotomie petits/grands négociants. En effet, à la fin de sa carrière, il était devenu un marchand important, à la tête de l'une des plus ' L e télégramme est à cet égard on ne peut plus explicite : « Le soussigné président de la société Helvetia à Constantinople au nom de tous les négociants suisses et de la grande majorité des Suisses domiciliés à Constantinople émus d'apprendre que le gouvernement suisse se propose d'instituer une représentation diplomatique en Turquie considérant cette décision dans les circonstances actuelles contraires à leurs intérêts personnels et commerciaux davantage encore aux intérêts des industriels de la mère-patrie animés du patriotisme le plus pur proteste contre toute représentation diplomatique suisse à Constantinople, rend hommage à la protection des grandes puissances [...]. » (AF, E6, dossier 46, télégramme de J.-C. Hirzel au Conseil fédéral en date du 12.12. 1896). 2 AF, J. II. 18, 1969/26, dossier 6, inventaire 14, Auszuege & Notizzen aus den Protokollen der « Helvetia » seit ihrer Gruendung im Jahre 1857, p. 12.
LA COLONIE S U I S S E DE CONSTANTINOPLE ( 1 8 5 0 - 1 9 1 8 )
205
vieilles maisons de commerce allemandes, et pourtant il continuait à tenir une place importante dans la sociabilité suisse de Constantinople. En outre, ce personnage, tout en étant président d'Helvetia, participait activement à une association étrangère, puisqu'il fut membre d'honneur de Teutonia, le cercle allemand de la capitale ottomane1. De même, dès son arrivée, alors qu'il n'était qu'un employé dans une maison de commerce étrangère, il s'opposa à la mise en place d'un consulat helvétique au Levant. On pouvait donc être petit négociant et refuser toute représentation diplomatique suisse à Constantinople. Le fait que l'association Helvetia fût défavorable à l'établissement d'un consulat à Constantinople résulte, à nos yeux, de deux phénomènes : d'une part, lorsque leurs intérêts étaient enjeu, les grands négociants n'hésitaient pas à s'immiscer dans la vie de l'association 2 . On peut en effet supposer qu'une requête issue de la seule association suisse de Constantinople aurait eu plus de poids auprès des autorités fédérales que les pétitions lancées par des groupes informels de citoyens helvétiques. On comprend dès lors l'intervention des grands marchands. D'autre part, le fait que les négociants aisés aient pu influencer, sur une question relativement importante pour la colonie helvétique de Constantinople, l'attitude d'une société où les autres marchands jouaient un rôle prépondérant, sans provoquer de graves tensions au sein de celle-ci, laisse supposer qu'il existait une communauté d'intérêts entre les deux groupes3. Si l'étude de l'association Helvetia nous amène donc à nuancer l'opposition entre marchands suisses, elle fait en revanche apparaître une autre ligne de fracture très importante au sein de la colonie helvétique de Constantinople : l'émergence, à partir de la fin du XIXe siècle, de tensions entre Suisses établis de longue date et nouveaux arrivants, entre les commerçants et les représentants des autres professions. Ce phénomène apparaît en filigrane dans les deux rapports rédigés par Louis Rambert, à la demande du Conseil fédéral, sur la question d'une
Pour une notice biographique de ce personnage, voir AF, J. II. 18, 1969/26, dossier 7, assemblée générale de 1911. S'y trouve en effet, un extrait de journal qui retrace, à l'occasion du décès de J.-C. Hirzel, son itinéraire. •'Ainsi, on voit deux commis qui, après avoir signé dans un premier temps une pétition en faveur d'une représentation suisse au Levant, « [...] pour complaire servilement à leur [patron], et sans le moindre respect pour eux-mêmes, ni pour vous Monsieur le Président et Messieurs, ni pour les 42 signataires de cette même pétition se sont permis, bassement permis, de biffer leur signature après avoir réussi de s'emparer par surprise de cette pétition, circonstance qui a révolté et intensément indigné leurs compatriotes. Mr Lebet, leur chef, qui pour des vrais motifs qu'il n'ose pas avouer, n'a pas voulu signer, est un de ces Suisses qui n'aimeraient pas voir augmenter la concurrence des maisons suisses à Constantinople [...]. » (AF, E2, dossier 1319, lettre de A. Rouiller au Conseil fédéral en date du 11 mai 1857.) Witschi (op. cit., p. 20) affirme d'ailleurs que les grands commerçants ont joué un rôle important dans les débats de 1858. 3 N o u s n'avons malheureusement pas trouvé d'éléments qui viendraient confirmer cette hypothèse.
206
THOMAS
DAVID
représentation suisse au Levant1 et qui éclairent parfaitement certains motifs de divergences entre les deux groupes. En effet, Rambert y présente les arguments des uns et des autres : si les commerçants établis à Constantinople, s'accommodant fort bien de la situation existante, se montrent plutôt défavorables à l'établissement d'un consulat, les nouveaux arrivants semblent ressentir au contraire la nécessité d'une telle représentation diplomatique : « Mais tandis que beaucoup de jeunes gens français, allemands, belges, etc. appelés et recommandés par les agents diplomatiques trouvent une carrière dans les administrations, les établissements de crédit ou les entreprises industrielles, les jeunes Suisses, privés d'un semblable patronage, en sont exclus. [...]. Et s'il m'était permis d'exprimer mon opinion personnelle, je n'hésite pas à dire que l'intérêt de la Suisse à la création d'une représentation diplomatique et consulaire en Orient est manifeste et majeur. » 2 Si Rambert a peut-être tendance à exagérer, pour mieux souligner la nécessité d'un consulat, en affirmant que les jeunes Suisses sont exclus des administrations européennes3, il n'en met pas moins en évidence les difficultés rencontrées par les jeunes migrants à leur arrivée à Constantinople, en l'absence d'un organisme capable de les patronner. Ce passage met par ailleurs en exergue un second indice de la nouvelle ligne de fracture qui apparaît au sein de la communauté helvétique au tournant du siècle. On pouvait en effet s'attendre à ce que Louis Rambert qui, de par sa vie sociale, telle qu'elle ressort de sa correspondance, se rapprochait des grands marchands 4 , prenne position contre un consulat suisse au Levant. Or, il n'en est rien. Dès lors, il apparaît bien qu'au tournant du siècle les divergences au sein de la colonie de Constantinople n'opposent plus tant les Suisses aisés et le reste de la communauté, comme au milieu du XIXe siècle, mais plutôt les marchands d'une part et les représentants des autres professions d'autre part. Ces dissensions, encore latentes vers 1900, vont peu à peu prendre corps, au fur et à mesure que les Suisses vont être de plus en plus nombreux à
1AF, E2, dossier 1320, lettre en date du 5 août 1896 et AF, E6, dossier 46, lettre en date du 1er juillet 1900. AF, E2, dossier 1320, lettre de Louis Rambert en date du 5 août 18%. -3 On peut noter en effet qu'à cette époque Huguenin, que Rambert connaissait, était déjà directeur de l'exploitation du Chemin de fer d'Anatolie : cf. Thomas David, « Edouard Huguenin (1856-1926) », op. cit., p. 68. se rendait en effet aux bals organisés par les ambassades européennes ; il fréquentait un club où figuraient pêle-mêle dignitaires ottomans, consuls et notables européens et figures marquantes des minorités religieuses. La société Helvetia ne semble en outre pas avoir occupé une grande place dans ses réseaux de sociabilité. En somme une vie sociale proche de celle des grands marchands suisses.
LA COLONIE S U I S S E DE CONSTANTINOPLE ( 1 8 5 0 - 1 9 1 8 )
207
travailler dans les secteurs de la construction ou des services 1 . La Première Guerre mondiale allait servir de révélateur à cet antagonisme. En effet, à la veille de ce conflit et durant celui-ci, la direction de l'association Helvetia resta entre les mains des négociants. À une époque où les Suisses travaillant dans les chemins de fer et dans les administrations européennes étaient majoritaires, cette prédominance ne fut pas sans créer certaines tensions, ces derniers se sentant écartés des affaires de la colonie : « Des deux groupes qui composent la colonie, l'un est formé dans sa généralité par les représentants des maisons suisses de commerce établies depuis de très nombreuses années en Turquie, et l'autre des Suisses qui en général ne sont en Turquie que depuis un certain nombre d'années et qui occupent des emplois à la solde des administrations ferroviaires, du gouvernement ou des particuliers. Ce deuxième groupe est de beaucoup le plus nombreux, cependant il est écarté des affaires de la colonie, il est ignoré, et parce qu'il se tient dans les limites de la plus parfaite courtoisie, on a envers lui des épithètes peu avenantes et l'on compare volontiers l'esprit qui l'anime à celui des bolchevistes. » 2 En outre, durant le premier conflit mondial, les Suisses furent successivement placés sous la protection de différentes puissances et les intérêts d'une grande partie ne furent pas pris en considération. Or, il semble que la société Helvetia n'ait pas vraiment pris le relais de ces protections consulaires défaillantes, ainsi que le note le directeur de l'un des plus importants journaux suisses lors de sa visite dans l'Empire ottoman en 1918 : « Il existe, à vrai dire, une société de secours : la société Helvetia, qui rend certainement des services, mais qui paraît les avoir rendus d'une façon beaucoup trop mesurée, au cours du drame mondial qui atteint d'une manière si particulière nos compatriotes contraints de vivre en Orient. » 3 Ces deux éléments —prédominance marchande au sein de l'association Helvetia et modération des secours pendant la Première Guerre mondiale—, ajoutés au fait que cette société était avant tout une société de bienfaisance, incitèrent vers 1919 certains Suisses de Constantinople à vouloir créer une autre société. Cette proposition ne fut pas sans provoquer de virulentes réactions : la teneur des débats nous éclaire sur les intérêts antagonistes des deux groupes 4 . Pour les personnes employées dans les secteurs noncommerciaux, il était important, en cette période troublée, de créer un organe ' Voir partie II. AF, 2001 (B)2, dossier 34, lettre de Chapuisat en date du 2 juillet 1919 au Conseil Fédéral, p.
2
12.
Ibidem, p. 9.
4
Ibidem, p. 13-14.
208
THOMAS
DAVID
qui puisse venir en aide aux Suisses de Constantinople pour des problèmes que ces derniers n'osaient par porter devant leurs autorités consulaires: demandes de places, demandes de renseignements sur la Confédération, informations pour les écoles, les institutions, etc. Ces individus désiraient également favoriser les exportations suisses vers l'Empire ottoman en fournissant des renseignements aux industriels helvétiques sur les débouchés au Levant. En somme, cette association devait préparer le terrain à la venue d'un consul suisse à Constantinople. Par contre, les négociants s'opposaient à la création immédiate de cette société. Ils craignaient en effet qu'elle suscite une concurrence accrue en fournissant des renseignements aux industriels et aux négociants établis en Suisse. La peur de voir diminuer leur chiffre d'affaires constituait en fait la principale raison de leur opposition à cette nouvelle société, ainsi que le dénonce l'un de leurs adversaires : « Le fait le plus véridique, c'est que ces messieurs [les marchands], et je les comprends fort bien, craignent une concurrence trop forte par un afflux des produits suisses, ce qui diminuerait leurs chiffres d'affaires. [...] Ces messieurs ont peur que nous fassions du bruit et que la création de notre nouvelle association, arrivant aux oreilles de l'ambassade, on veuille nous blâmer et faire des difficultés à notre commerce suisse et à nos commerçants suisses. » 1 Nous avons retrouvé, dans les archives de Rambert, un document relatant la fondation, le 10 août 1919, d'une Union Suisse. Sur les neuf membres du comité, un seul était commerçant...
5. CONCLUSION La société ottomane a connu à la fin du XIXe siècle, sous l'emprise de la pénétration économique européenne dans l'Empire de profonds bouleversements : « L'émergence de couches sociales nouvelles —sous l'effet de ce que certains ont appelé la «modernisation» ou «l'occidentalisation» de l'Empire ottoman et que d'autres considèrent, en termes moins flatteurs, comme une pénétration impérialiste extrêmement brutale— constitue l'aspect le plus remarquable du processus en cours. Avec quelques dizaines d'années de retard, la Turquie des sultans emboîte le pas aux sociétés de l'Occident triomphant: elle se dote d'un embryon de prolétariat industriel, d'une couche d'employés de bureau et de magasin, 1
Ibidem, p. 14.
LA C O L O N I E S U I S S E DE C O N S T A N T I N O P L E ( 1 8 5 0 - 1 9 1 8 )
209
de toute une gamme de représentants des professions libérales, d'une intelligentsia qui ressemble fort peu à la classe lettrée d'antan ; c'est aussi à cette époque que l'on voit apparaître une nouvelle catégorie d'entrepreneurs encore principalement tournés vers le négoce, mais prêts déjà à se lancer dans l'aventure de la mise en valeur capitaliste des potentialités agricoles et industrielles du pays. La colonie helvétique de Constantinople n'a pas échappé à ce processus : les divergences qui apparaissent, au tournant du siècle, au sein de cette communauté résultent en effet de cette « occidentalisation » ou « pénétration impérialiste » et de l'émergence de nouvelles couches sociales. L'implantation des maisons de commerce suisses dans la capitale ottomane à partir de 1820 et leur relative prospérité jusque dans les années 1870 correspondent ainsi à une phase d'expansion commerciale européenne dans l'Empire ottoman 2 . Les marchands suisses ne commencèrent véritablement à rencontrer des difficultés qu'au début des années 1870, soit au moment où l'Empire traversa, à l'instar de l'économie mondiale, une longue phase de stagnation : la Grande Dépression de 1873-1896. Or, c'est à la fin de cette période (1888-1896) que les grandes puissances, du fait de leur rivalité, s'engagèrent dans la plus grande vague de construction de chemins de fer que connut l'Empire ottoman. C'est dans cette optique qu'il faut situer l'émergence d'une nouvelle ligne de fracture au sein de la communauté suisse de Constantinople à la fin du XIXe siècle : les marchands, qui représentaient la grande majorité de cette colonie au milieu du XIXe siècle, furent frappés par la Grande Dépression, ainsi que par le renouveau de l'artisanat ottoman à partir du dernier quart du XIXe siècle. Dès lors, il n'est pas surprenant que leur nombre ait décliné jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Dans le même temps, la construction des chemins de fer dans l'Empire ottoman et l'emprise financière occidentale croissante sur cette région favorisèrent de nouveaux courants d'immigration : de nombreux Suisses trouvèrent alors l'embauche au Levant dans le secteur ferroviaire ou dans les services. On comprend ainsi que des divergences aient pu apparaître entre les marchands, installés de longue date, et les représentants des professions non libérales, récemment débarqués à Constantinople et ne disposant sur place d'aucun appui, sur des questions telles que l'établissement d'une représentation diplomatique suisse au Levant ou les fonctions de l'association Helvetia. Ces dissensions ont débouché, à la
'Paul Dumont, « Les transformations sociales dans l'Empire ottoman », op. cit., p. 75. Pour une périodisation de la pénétration économique européenne dans l'Empire ottoman au XIXe siècle, voir Çevket Pamuk, The Ottoman Empire and European Capitalism, 1820-1913. Trade, investment and production, Londres-New York, 1987, p. 11-17. 2
210
THOMAS DAVID
fin du premier conflit mondial, sur la création, par les nouveaux immigrants, d'une société qui soit mieux à même de défendre leurs intérêts. Si ce «processus d'occidentalisation» ne fut pas sans répercussion sur la composition des colonies étrangères et sur les liens entre les différents groupes sociaux au sein de ces communautés, il semble également que ce phénomène ait altéré les relations entre Occidentaux et Ottomans. C'est sur ce point que nous aimerions conclure ce travail. Les archives de la société Helvetia sont quasi muettes sur les indigènes : à aucun moment, les relations avec les autorités ou la population ottomanes ne sont abordées. Pour ce faire, nous nous sommes donc référé à la biographie de deux Suisses, Edouard Huguenin et Louis Rambert, pour lesquels nous disposons de renseignements. Edouard Huguenin, directeur du chemin de fer d'Anatolie, connut en 1908, au moment de la révolution jeune-turque, de sérieuses difficultés. En effet, une partie des employés de cette compagnie exigeait sa démission. Ce mouvement perdura deux mois, jusqu'au moment où des hausses salariales, obtenues par les employés de l'Anatolien, apaisèrent la situation. Quant à Huguenin, il traversa finalement sans difficulté cette période d'agitation 1 . Or, Donald Quataert l'a bien montré, ces revendications et ces mouvements de grève résultaient des tensions engendrées par la pénétration économique européenne : « Les troubles sociaux causés par des problèmes conjoncturels amplifiaient les tensions à long terme et le déséquilibre engendré par la pénétration économique européenne, ce qui est démontré ici par les études de cas. Au printemps, durant l'été et en fin d'année 1908, des groupes d'élite s'en prirent aux accès de mécontentement social; les grèves ne sont qu'une manifestation partielle, quoique importante, de cette agitation. Une attention considérable a été portée à ces grèves, parce, qu'elles étaient le produit de la réaction ottomane face à la pénétration européenne, et qu'elles révélaient beaucoup les changements sociaux, les divisions ethnico-religieuses croissantes dans la société et le monde du travail ottomans.»2
'Thomas David, « Edouard Huguenin (1856-1926) », op. cit., p. 77-78. ^Donald Quataert, Social Disintegration and Popular Resistance in the Ottoman Empire, op, cit., p. 153-154.
LA C O L O N I E S U I S S E DE C O N S T A N T I N O P L E ( 1 8 5 0 - 1 9 1 8 )
211
Louis Rambert fut également confronté à ces troubles. Il ne semble toutefois pas que les employés de la Régie des tabacs aient demandé la démission de leur directeur1. La position de Rambert à la tête de la Régie met également en évidence les divergences d'intérêt entre le gouvernement ottoman et les grandes entreprises européennes. En effet, le directeur suisse se plaint, dans ses mémoires, à de nombreuses reprises, de la contrebande et de la passivité de l'administration ottomane à réprimer cette fraude. Ainsi, décrit-il une de ses visites au ministère turc des finances : « J'y ai constaté d'abord que ce haut dignitaire fume du tabac de contrebande. Nous en avons plaisanté en attendant que je trouve l'occasion de lui donner la leçon qu'il mérite. Et dire que, hiérarchiquement, c'est à lui que je m'adresse pour obtenir la répression des actes de contrebande ! Je ne m'étonne plus de sa mollesse ! » 2 Or, si cet exemple illustre la résistance du gouvernement et de la population à la pénétration européenne, symbolisée par le monopole de la Régie, il indique également, en filigrane, le pouvoir désintégrateur de cette expansion. En effet, l'État, incapable d'éliminer le monopole de la Régie, perdit le soutien de ses propres sujets. Dans le même temps, une excessive indulgence envers la contrebande comportait un double risque : cette attitude pouvait menacer le C'est en ces termes que Rambert, dans sa correspondance, évoque les troubles de 1908 : « Et puis tous les intérêts se sont coalisés pour obtenir par la menace des avantages personnels. Tous les ouvriers se sont mis en grève et pour ne pas avoir des causes de troubles, on oblige les patrons à céder aux exigences les plus extravagantes. Les miens, ceux de la manufacture de Constantinople, ont commencé, puis le personnel des chemins de fer, en Anatolie, à Smyrne, à Beyrouth. [—1. Et puis mes employés d'administration ont imité l'exemple, et jusqu'à lundi dernier m'ont occasionné des préoccupations abominables. Et la province ! C'est encore une autre chanson ! Le peuple a chassé à grands coups de pied les anciens gouverneurs ; dans beaucoup d'endroits, ils n'ont pas été remplacés. Par bonheur on a affaire à un public de buveurs d'eau et on est tout surpris de voir qu'on peut vivre en pleine anarchie. » (Musée du Vieux-Montreux, Archives Rambert, lettre à Mme Dorer en date du 1er novembre 1908.) Il faut relever que Rambert était fort content de la manière dont il était parvenu à maîtriser ces troubles : « Je me débats depuis 3 mois contre des grévistes, employés et ouvriers. Les employés sont déjà rentrés dans l'ordre à la suite d'une petite exécution. Mais mes ouvriers de fabrique sont plus nombreux (2400 rien qu'à Constantinople) moins accessibles aux bonnes raisons et par conséquent plus redoutables. Par bonheur on nous a doté récemment d'un ministre de l'intérieur dont vous avez sans doute entendu le nom, Hilmy Pacha, l'ancien inspecteur général de la Macédoine, homme remarquable, énergique et qui m'honore de son amitié. Il a mis la semaine dernière des baillonnettes à ma disposition, tant que j ' e n ai voulu. Tous mes gens sont venus faire amende honorable, pénétrés de la logique irréfutable de mon raisonnement, et pour me prouver leur sincérité, ils sont rentrés lundi matin au travail, amenant avec eux trois prêtres, un grec, le rabbin israélite et un turban blanc, pour célébrer un triple culte et solenniser leur promesse de se conduire à l'avenir comme des petits agneaux. Je suis allé assister à cette manifestation ; je leur ai fait à mon tour mon petit discours et nous voilà les meilleurs amis du monde. Pour combien de temps ? C'est ce que l'avenir nous apprendra. Tous les chefs des grandes entreprises qui souffrent du même genre d'épidémie sont jaloux de mon succès. Tranquillisé de ce côté, il faut faire face à d'autres dangers. » (Musée du Vieux-Montreux, Archives Rambert, lettre à Mme Dorer en date du 20 décembre 1908.) 2
Louis Rambert, Notes et impressions de Turquie, op. cit., p. 139. Sur la contrebande et l'attitude du gouvernement ottoman, voir aussi Donald Quataert, Social Disintegration and Popular Résistance, op. cit., chap. II.
212
THOMAS
DAVID
gouvernement en encourageant le brigandage et elle plaçait l'État du côté de l'illégalité. « En donnant, dans les faits ou en apparence, son approbation aux activités de contrebande, même celles qui s'en prenaient aux étrangers, le régime ottoman laminait le respect de son autorité et sapait sa propre légitimité. » 1 L'étude de la colonie suisse de Constantinople, de son évolution, de sa sociabilité, des divergences d'intérêts qui l'ont secouée, ainsi que du parcours de certains de ses représentants les plus illustres, constitue un moyen d'appréhender les mutations du corps social ottoman, sous l'effet de 1'« occidentalisation », à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.
'Donald Quataert, Social Disintegration and Popular Resistance, op. cit., p. 38.
TABLE DES MATIÈRES
Avant-Propos (Meropi Anastassiadou) Individus et pouvoir dans une ville ottomane au XVIIIe siècle (I§ik Tamdogan-Abel) In Search of the homo ottomanicus. The Cases of Nikola Pop Stefanoffand Sheykh Shemsuddin front Ottoman Macedonia (ca. 1780-1840) (Michael Ursinus) Papasynadinos de Serres ou l'homo ottomanicus du XVIIe siècle (Johann Strauss) Portrait d'un émir kurde, Beder Khan bey (Hasan Gokçe) La famille Benakis : un paradigme de la bourgeoisie grecque alexandrine (Katerina Trimi) La famille Deliyannis : un exemple de notables chrétiens du Péloponnèse central (Georgios Nikolaou) Européens et Ottomans à Smyrne (de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle) (Marie-Carmen Smyrnelis) Figures européennes, levantines et ottomanes : pour une approche prosopographique des relations euro-ottomanes au milieu du XIXe siècle (François Vinot) Sécurité et insécurité: les chrétiens de Syrie dans l'espace méditerranéen (XVIIe-XVIIIe siècles) (Bernard Heyberger) Missions chrétiennes et identité ottomane (Hans-Lukas Kieser) La colonie suisse de Constantinople (1850-1918) (Thomas David) ...
Liste des auteurs I§ik Tamdogan-Abel, docteur en histoire, EHESS, Paris Thomas David, doctorant en histoire économique, Université de Lausanne Hasan Gokçe, doctorant en histoire, Université de Strasbourg II Bernard Heyberger, Université de Haute Alsace Hans-Lukas Kieser, docteur en histoire, Université de Bâle Georgios Nikolaou, docteur en histoire, Paris Marie-Carmen Smyrnelis, doctorante en histoire, EHESS, Paris Johann Strauss, Université Marc Bloch Strasbourg Michael Ursinus, Université de Heidelberg Katerina Trimi, docteur en histoire, Athènes François Vinot, docteur en histoire, Paris
5 9
21 35 63 83 103 119
135 147 165 177