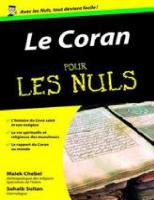Féminisme pour les 99% 2348042886, 9782348042881
Ce manifeste rédigé par Nancy Fraser, Cinzia Arruzza et Tithi Bhattacharya, toutes trois organisatrices de l' Inter
516 84 550KB
French Pages 128 [90] Year 2020
Polecaj historie
Table of contents :
Page de titre
Présentation
Les auteures
Collection
Copyright
S'informer
Dédicace
Table
Un manifeste
À la croisée des chemins
Thèse 1. Une nouvelle vague féministe réinvente la grève
Thèse 2. Le féminisme libéral est en faillite. Il est temps de s'en débarrasser
Thèse 3. Nous avons besoin d'un féminisme anticapitaliste – un féminisme pour les 99 %
Thèse 4. Ce que nous traversons, c'est une crise de la société dans son ensemble – et la source du problème est le capitalisme
Thèse 5. Dans les sociétés capitalistes, l'oppression de genre est enracinée dans la subordination de la reproduction sociale à la production marchande. Nous voulons remettre les choses dans le bon sens
Thèse 6. La violence de genre prend de nombreuses formes, toutes liées aux relations sociales capitalistes. Nous jurons de les combattre toutes
Thèse 7. Le capitalisme essaie de contrôler la sexualité. Nous voulons la libérer
Thèse 8. Le capitalisme est né de la violence raciste et coloniale. Le féminisme pour les 99 % est antiraciste et anti-impérialiste
Thèse 9. En luttant pour empêcher la destruction de la Terre par le capital, le féminisme pour les 99 % est écosocialiste
Thèse 10. Le capitalisme est incompatible avec une véritable démocratie et la paix réelle. Notre réponse est l'internationalisme féministe
Thèse 11. Le féminisme pour les 99 % appelle tous les mouvements radicaux à se rejoindre dans une insurrection anticapitaliste commune
Postface
Commencer par le milieu
Reconceptualiser le capitalisme et sa crise
Qu'est-ce que la reproduction sociale ?
La crise de la reproduction sociale
La politique du féminisme pour les 99 %
Citation preview
Cinzia Arruzza Tithi Bhattacharya Nancy Fraser
Féminisme pour les 99 % Un manifeste Traduit de l’anglais (États-Unis) par Valentine Dervaux
2019
Présentation Logements inabordables, salaires de misère, systèmes de santé inexistants ou dysfonctionnels, catastrophe climatique, rejet des migrant·e·s, violences policières… on entend peu les féministes s’exprimer sur ces questions. Pourtant, elles ont un impact majeur sur la vie de l’immense majorité des femmes à travers le monde. Les grèves des femmes qui se multiplient aujourd’hui en Argentine, en Pologne, aux États-Unis ou ailleurs s’emparent de ces problématiques et témoignent du fait que les revendications féministes ne sont pas isolées de celles d’autres mouvements. Et c’est tout l’enjeu de ce manifeste, inspiré par ces nouveaux mouvements féministes : face à un système néolibéral qui concentre toutes les aliénations, injustices et inégalités et instrumentalise certaines luttes sociales pour servir ses velléités impérialistes et engranger le plus de profits possible, le féminisme doit repenser son agenda théorique comme militant. Trois des organisatrices de la Grève internationale des femmes s’engagent ainsi avec ce manifeste pour un féminisme véritablement inclusif, capable de faire converger l’anticapitalisme, l’antiracisme, l’écologie politique, l’internationalisme et l’anti-hétérosexisme : un féminisme pour les 99 %. Pour en savoir plus…
Les auteures Cinzia Arruzza est professeure de philosophie à la New School for Social Research (New York). Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages explorant les liens entre socialisme et féminisme. Tithi Bhattacharya est professeure et directrice du programme Global Studies à l’université Purdue (Indiana). Ses ouvrages croisent la théorie marxiste et les questions de genre. Nancy Fraser est professeure de philosophie et de politique à la New School for Social Research (New York). Auteure de nombreux ouvrages, elle est l’une des principales représentantes de la Théorie critique dans le monde anglophone.
Collection Cahiers libres
Copyright © Éditions La Découverte, Paris, 2019. En couverture : Graphisme ADGP / En couverture : © Bill Clark / Getty Images ISBN papier : 978-2-3480-4288-1 ISBN numérique : 978-2-3480-4304-8 Composition numérique : Facompo (Lisieux), mars 2019 Cette œuvre est protégée par le droit d’auteur et strictement réservée à l’usage privé du client. Toute reproduction ou diffusion au profit de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie de cette œuvre est strictement interdite et constitue une contrefaçon prévue par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L’éditeur se réserve le droit de poursuivre toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle devant les juridictions civiles ou pénale
S’informer Si vous désirez être tenu régulièrement informé de nos parutions, il vous suffit de vous abonner gratuitement à notre lettre d’information bimensuelle par courriel, à partir de notre site www.editionsladecouverte.fr où vous retrouverez l’ensemble de notre catalogue. Nous suivre sur
Pour le Combahee River Collective, qui a tracé la voie et pour les grévistes féministes polonaises et argentines, qui ouvrent aujourd’hui de nouvelles perspectives.
Table Un manifeste À la croisée des chemins Thèse 1. Une nouvelle vague féministe réinvente la grève Thèse 2. Le féminisme libéral est en faillite. Il est temps de s’en débarrasser Thèse 3. Nous avons besoin d’un féminisme anticapitaliste – un féminisme pour les 99 % Thèse 4. Ce que nous traversons, c’est une crise de la société dans son ensemble – et la source du problème est le capitalisme Thèse 5. Dans les sociétés capitalistes, l’oppression de genre est enracinée dans la subordination de la reproduction sociale à la production marchande. Nous voulons remettre les choses dans le bon sens Thèse 6. La violence de genre prend de nombreuses formes, toutes liées aux relations sociales capitalistes. Nous jurons de les combattre toutes Thèse 7. Le capitalisme essaie de contrôler la sexualité. Nous voulons la libérer Thèse 8. Le capitalisme est né de la violence raciste et coloniale. Le féminisme pour les 99 % est antiraciste et anti-impérialiste Thèse 9. En luttant pour empêcher la destruction de la Terre par le capital, le féminisme pour les 99 % est écosocialiste Thèse 10. Le capitalisme est incompatible avec une véritable démocratie et la paix réelle. Notre réponse est l’internationalisme féministe Thèse 11. Le féminisme pour les 99 % appelle tous les mouvements radicaux à se rejoindre dans une insurrection anticapitaliste commune Postface
Un manifeste
À la croisée des chemins Au printemps 2018, Sheryl Sandberg, la directrice des opérations de Facebook, a déclaré que nous « serions bien mieux loti·e·s si la moitié des pays et des entreprises étaient dirigés par des femmes et si la moitié des foyers étaient dirigés par des hommes », ajoutant que « nous ne devrions pas être satisfait·e·s tant que nous n’aurons pas atteint cet objectif ». Grande figure du féminisme d’entreprise, Sandberg s’était déjà fait un nom (et beaucoup d’argent) en incitant les femmes cadres à s’imposer1 dans les conseils d’administration. En tant qu’ancienne cheffe de cabinet de Larry Summers, exsecrétaire au Trésor étasunien – l’homme qui a dérégulé Wall Street –, elle n’a eu aucun scrupule à affirmer que la ténacité des femmes dans le monde des affaires était la voie royale vers l’égalité de genre. Ce même printemps, une grève de militantes féministes a paralysé l’Espagne pendant vingt-quatre heures. Rejointes par plus de cinq millions de manifestant·e·s, les organisatrices de la huelga feminista2 ont appelé à une « société débarrassée des oppressions, de l’exploitation et des violences sexistes », et clamé : « Nous appelons à la révolte et à la lutte contre l’alliance du patriarcat et du capitalisme qui veut nous rendre obéissantes, soumises et silencieuses. » Alors que le soleil se couchait sur Madrid et Barcelone, ces grévistes féministes annoncèrent au monde : « Le 8 mars, nous croisons les bras et interrompons toute activité productive comme reproductive. […] Nous n’accepterons pas la détérioration de nos conditions de travail ni d’être payées moins que les hommes pour le même travail. » Ces deux voix représentent des chemins opposés pour le mouvement féministe. D’un côté, Sandberg et ses semblables voient
le féminisme comme un auxiliaire du capitalisme. Elles veulent un monde dans lequel la gestion de l’exploitation au travail et de l’oppression dans l’ensemble de la société serait partagée de façon égalitaire entre les hommes et les femmes de la classe dirigeante. Autrement dit, elles réclament une égalité des chances de dominer : les gens, au nom du féminisme, devraient être reconnaissants que ce soit une femme, et non un homme, qui démantèle leur syndicat, ordonne à un drone de tuer leur parent ou enferme leur enfant dans une cage à la frontière. À l’extrême opposé du féminisme libéral de Sandberg, les organisatrices de la huelga feminista insistent sur la nécessité d’en finir avec le capitalisme – le système qui a créé les patron·ne·s, entraîné l’érection des frontières nationales et la fabrication des drones qui les surveillent. Face à ces deux conceptions du féminisme, nous nous trouvons à la croisée des chemins et notre choix est lourd de conséquences. Le premier chemin mène vers une planète calcinée sur laquelle la vie humaine sera appauvrie au point d’en devenir méconnaissable – ou s’éteindra. Le second conduit à un monde qui a toujours été au cœur des rêves les plus exaltés de l’humanité : un monde juste, dont les richesses et les ressources naturelles seront partagées par tous et toutes, et où l’égalité et la liberté ne seront pas seulement des espoirs, mais des réalités concrètes. Le contraste ne pourrait être plus frappant et l’absence d’une quelconque voie médiane ne peut que nous convaincre davantage. Cette absence d’alternatives est le fait du néolibéralisme – cette forme de capitalisme financiarisé particulièrement agressive qui sévit à travers le monde depuis quarante ans. En empoisonnant l’atmosphère, en raillant toute aspiration démocratique, en épuisant les individus et en détériorant les conditions de vie de la grande majorité, le capitalisme néolibéral durcit les luttes sociales : aux raisonnables efforts fournis en vue de remporter de modestes réformes succèdent de féroces batailles pour la survie. Il faut donc
prendre conscience que le temps de l’indécision est révolu et que les féministes doivent prendre position : continuerons-nous à courir après l’« égalité des chances de dominer » alors que la planète est en flammes ? Ou allons-nous imaginer une justice de genre indexée à l’anticapitalisme – celle qui mènera à une nouvelle société au-delà de la crise actuelle ? Ce manifeste est un plaidoyer pour que nous nous engagions sur ce second chemin, ce que nous jugeons à la fois indispensable et réaliste. Un féminisme anticapitaliste est aujourd’hui possible, notamment parce que la crédibilité des élites politiques s’effondre dans le monde entier. Les victimes ne sont pas seulement les partis de centre gauche et de centre droit qui ont promu le néolibéralisme – partis dont il ne subsiste que des vestiges méprisés –, mais aussi leurs allié·e·s du féminisme d’entreprise à la Sandberg, dont le vernis « progressiste » a perdu de son éclat. En 2016, après avoir connu son heure de gloire lors de l’élection présidentielle étasunienne, le féminisme libéral s’est effondré avec l’échec de la candidature tant attendue d’Hillary Clinton. Et pour cause : Clinton n’a pas réussi à enthousiasmer les électrices car elle incarne la déconnexion profonde entre l’accession des femmes de l’élite à de hautes fonctions et l’amélioration de la vie de l’immense majorité des femmes. La défaite de Clinton est un signal d’alarme. Cette faillite du féminisme libéral a créé une ouverture permettant de le défier par la gauche. Le vide produit par le déclin du libéralisme nous donne une chance de construire un autre féminisme : un féminisme qui définisse différemment ses problématiques, avec une orientation de classe différente, un ethos différent – un féminisme radical et transformateur. Ce manifeste est notre contribution pour promouvoir cet « autre » féminisme. Il ne s’agit pas pour nous d’inventer une utopie, mais de tracer la voie à emprunter afin d’atteindre une société juste. Nous
cherchons à montrer pourquoi les féministes devraient s’engager dans les grèves féministes, pourquoi nous devons nous unir avec d’autres mouvements antisystème et anticapitalistes, pourquoi notre mouvement doit devenir un féminisme pour les 99 %. C’est seulement de cette manière – en s’alliant avec les antiracistes, les écologistes, les militant·e·s pour les droits des travailleurs, des travailleuses et des migrant·e·s – que le féminisme pourra relever les défis de notre temps. En rejetant fermement le féminisme du 1 % et le dogme qui incite les femmes à « s’imposer » dans les hautes sphères, notre féminisme peut devenir une lueur d’espoir pour tous et toutes. Ce qui nous donne aujourd’hui le courage de nous embarquer dans ce projet, c’est la nouvelle vague d’activisme féministe. Ce n’est pas le féminisme d’entreprise, qui s’est avéré si catastrophique pour les travailleuses et a perdu toute crédibilité ; ce n’est pas non plus le « féminisme du microcrédit », qui prétend « autonomiser » (empower) les femmes dans les pays du Sud en leur prêtant de petites sommes d’argent. Ce sont les grèves internationales de femmes et de féministes en 2017 et 2018 qui nous donnent de l’espoir. Ce sont ces grèves, et les mouvements de plus en plus organisés qu’elles ont suscités, qui ont d’abord inspiré – et incarnent aujourd’hui – un féminisme pour les 99 %.
Thèse 1. Une nouvelle vague féministe réinvente la grève Le récent mouvement de grève féministe est né en Pologne en octobre 2016, lorsque plus de 100 000 femmes ont organisé des débrayages et des marches afin de s’opposer à l’interdiction de l’avortement dans leur pays. À la fin de ce même mois, la vague radicale avait déjà traversé l’océan jusqu’en Argentine, où les femmes grévistes dénonçaient l’odieux meurtre de Lucía Pérez avec le slogan : « Ni una menos3 ! » Bientôt, elle a déferlé sur l’Italie, l’Espagne, le Brésil, la Turquie, le Pérou, les États-Unis, le Mexique, le Chili et des dizaines d’autres pays. Le mouvement, apparu dans les rues, s’est étendu aux lieux de travail et aux écoles pour finalement atteindre les hautes sphères du monde du spectacle, des médias et de la politique. Ces deux dernières années, ses slogans ont puissamment résonné à travers le globe : #NosotrasParamos, #WeStrike, #VivasNosQueremos, #NiUnaMenos, #TimesUp, #Feminism4the99. Frémissement, houle, et désormais vague gigantesque : ce nouveau mouvement féministe mondial pourrait bien gagner suffisamment de force pour bousculer les alliances existantes et redessiner la carte politique. Ce qui n’était qu’une série d’actions à l’échelle nationale s’est mué en mouvement transnational le 8 mars 2017, lorsque dans le monde entier leurs organisatrices ont décidé de faire grève en même temps. Avec ce coup de force, elles ont repolitisé la Journée internationale pour les droits des femmes. Laissant de côté les babioles dépolitisées – les brunchs, les mimosas et les cartes de vœux –, les grévistes ont réactivé les origines ouvrières et socialistes du 8 Mars et fait revivre l’esprit des mobilisations des ouvrières au début du XXe siècle. En effet, ce sont de grandes grèves et manifestations menées principalement par des femmes migrantes et juives aux États-Unis qui ont d’abord inspiré les socialistes étasunien·ne·s à
l’origine de l’organisation de la première Journée nationale de la femme, ainsi que les socialistes allemandes Luise Zietz et Clara Zetkin qui sont les premières à avoir appelé à une Journée internationale des travailleuses. Ravivant cette énergie militante, les grèves féministes d’aujourd’hui trouvent leurs racines dans les luttes historiques pour les droits des travailleuses et la justice sociale. Elles donnent un nouveau sens au slogan « La solidarité est notre arme » en unissant des femmes séparées par des océans, des montagnes et des continents, des frontières, des barbelés et des murs. Ces grèves brisent leur isolement domestique et symbolique et témoignent de l’énorme potentiel politique du pouvoir des femmes – le pouvoir de celles dont le travail rémunéré comme non rémunéré soutient le monde. Mais ce n’est pas tout : ce mouvement naissant invente de nouvelles façons de faire grève et insuffle un nouveau type de politique à la forme même de la grève. En associant le retrait du travail avec des marches, des manifestations, des fermetures de magasins, des blocus et des boycotts, il reconstitue le répertoire d’actions de la grève, très affaibli au cours des dernières décennies par les offensives néolibérales répétées. Dans le même temps, cette nouvelle vague contribue à démocratiser les grèves et à amplifier leur portée – notamment en élargissant la définition même du « travail ». Refusant de limiter cette catégorie au seul travail salarié, les grèves des femmes appellent également à suspendre le travail domestique, les rapports sexuels et les sourires. Et en rendant visible le rôle indispensable joué par le travail non rémunéré et genré dans la société capitaliste, elles attirent l’attention sur des activités dont le capital bénéficie, mais qu’il ne rémunère pas. Mais même au prisme du seul travail rémunéré, les grévistes développent une vision élargie de ce que l’on entend généralement par « travail ». Loin de se concentrer uniquement sur les salaires et les horaires,
elles montrent également en quoi le harcèlement et les agressions sexuels, les obstacles à la justice reproductive4 et les restrictions du droit de grève relèvent tout autant du travail. Ainsi, cette nouvelle vague féministe pourrait surmonter l’opposition tenace et conflictuelle entre « politique minoritaire » et « politique de classe ». En refusant de considérer le « travail » et la « vie privée » comme deux sphères distinctes, elle ne limite pas ses luttes à l’un de ces espaces. Et en redéfinissant ce qu’est le « travail » et qui sont les « travailleurs et travailleuses », elle rejette la dévalorisation structurelle du travail des femmes – à la fois payé et non payé – par le capitalisme. En définitive, ces grèves féministes ouvrent la possibilité d’une phase nouvelle et inédite de la lutte des classes : féministe, internationaliste, écologiste et antiraciste. Ces actions arrivent à point nommé. Les grèves féministes se sont multipliées au moment où les syndicats, autrefois puissants et liés au secteur industriel, se sont trouvés sérieusement affaiblis. Afin de donner un nouvel élan à la lutte des classes, les activistes se sont engagées sur un autre front : les assauts néolibéraux contre le système de santé, l’éducation, les retraites et le logement. En ciblant ces attaques du capital, qui durent depuis quarante ans, sur les conditions de vie des plus pauvres, elles se concentrent sur la défense du travail et des services nécessaires à la vie matérielle et culturelle des individus et des communautés. C’est là, dans la sphère de la « reproduction sociale », que se développent aujourd’hui la plupart des grèves et des résistances les plus acharnées. De la vague de grèves des enseignant·e·s aux ÉtatsUnis à la lutte contre la privatisation de l’eau en Irlande en passant par les grèves des Dalits chargé·e·s de nettoyer les rues en Inde – toutes menées et dirigées par des femmes –, les travailleurs et travailleuses se révoltent face à l’offensive du capital contre la reproduction sociale. Bien que ces grèves ne soient pas
officiellement affiliées au mouvement de la grève internationale des femmes, elles ont beaucoup en commun avec celui-ci. Elles aussi valorisent le travail nécessaire à la reproduction de nos vies tout en s’opposant à leur exploitation ; elles aussi associent des revendications salariales et professionnelles avec des exigences d’augmentation des dépenses pour les services publics. Dans certains pays, comme en Argentine, en Espagne et en Italie, les grèves féministes ont obtenu un large soutien d’autres forces opposées à l’austérité. Des femmes, des personnes non binaires5, mais également des hommes ont rejoint les grandes manifestations du mouvement contre la baisse des budgets dédiés à l’école, au système de santé, au logement, aux transports et à la protection de l’environnement. Par leur opposition aux assauts du capital financier contre ces « biens publics », les grèves féministes sont devenues le catalyseur et le modèle pour des actions de grande envergure en défense de nos communautés. Ainsi, la nouvelle vague d’activisme féministe renoue avec l’exigence de l’impossible, demandant à la fois le pain et les roses : le pain que des décennies de néolibéralisme ont retiré de nos tables, mais également la beauté qui nourrit nos esprits par l’exaltation de la révolte.
Thèse 2. Le féminisme libéral est en faillite. Il est temps de s’en débarrasser Les médias traditionnels continuent à assimiler le féminisme, dans son ensemble, au seul féminisme libéral. Mais, loin de fournir des solutions, le féminisme libéral fait partie du problème. Centré sur les pays occidentaux et les catégories socioprofessionnelles supérieures, il encourage les femmes à « s’imposer » et à « briser le plafond de verre ». S’employant à permettre à une poignée de femmes privilégiées de gravir les échelons au sein de l’entreprise et les grades au sein de l’armée, il propose une vision de l’égalité indexée sur les lois du marché, qui coïncide parfaitement avec la manière dont les entreprises épousent actuellement la cause de la « diversité ». Bien qu’il condamne les « discriminations » et prône la « liberté de choix », le féminisme libéral refuse catégoriquement de reconnaître et de lutter contre les contraintes socioéconomiques qui empêchent pourtant la grande majorité des femmes d’accéder à la liberté et l’autonomie (empowerment). Son véritable objectif n’est pas l’égalité, mais la méritocratie. Plutôt que d’aspirer à abolir la hiérarchie sociale, il vise à la « diversifier », en « permettant » à des femmes « talentueuses » d’atteindre le sommet. En considérant les femmes simplement comme un « groupe sous-représenté », ses promoteurs et promotrices cherchent à s’assurer que seules quelques âmes privilégiées peuvent accéder à des postes et des rémunérations équivalents à ceux des hommes de leur propre classe. Par définition, les principales bénéficiaires de ce système sont ainsi celles qui possèdent déjà des avantages économiques, culturels et sociaux considérables. Toutes les autres restent coincées au sous-sol. Parfaitement compatible avec les inégalités galopantes, le féminisme libéral externalise les oppressions. Il permet aux femmes
cadres de s’imposer en leur donnant précisément la possibilité de s’appuyer sur des femmes migrantes mal payées auxquelles elles sous-traitent leurs tâches ménagères et les soins à leurs proches6. Insensible aux positions de classe et de race, il lie notre cause à l’élitisme et à l’individualisme. Il nous associe à des politiques qui nuisent à la majorité et nous coupe des luttes s’opposant à ces politiques en présentant le féminisme comme un mouvement « autonome ». Bref, le féminisme libéral donne mauvaise réputation au féminisme. Le culte de la réussite personnelle porté par l’ethos du féminisme libéral converge avec les valeurs de l’entreprise, mais aussi avec celles portées par certains porte-drapeaux de la culture néolibérale, à l’image des célébrités des réseaux sociaux, qui confondent également le féminisme avec l’ascension individuelle d’une poignée de femmes. Dans ce monde-là, le « féminisme » risque de devenir un hashtag à la mode et un simple outil d’autopromotion, utilisé pour faire réussir un petit nombre et non en vue de libérer la majorité. Le féminisme libéral est donc un alibi parfait pour le néolibéralisme. Il permet aux forces qui défendent le capitalisme de passer pour « progressistes » en dissimulant, derrière une rhétorique d’émancipation, leurs politiques régressives – alliance avec la finance mondiale aux États-Unis, justification de l’islamophobie en Europe… C’est le féminisme des femmes de pouvoir : les gourous du monde des affaires qui prêchent de « s’imposer », les fémocrates7 qui défendent l’ajustement structurel8 et le microcrédit dans les pays du Sud et les politiciennes professionnelles en tailleur-pantalon qui reçoivent des chèques à six chiffres pour leurs discours à Wall Street. Notre réponse au féminisme qui s’impose est le féminisme qui prend du recul. Nous n’avons aucun intérêt à briser le plafond de verre si l’immense majorité des femmes continuent d’en nettoyer les
éclats. Loin de célébrer les femmes directrices des opérations qui occupent des bureaux d’angle luxueux, nous voulons nous débarrasser des premières comme des seconds.
Thèse 3. Nous avons besoin d’un féminisme anticapitaliste – un féminisme pour les 99 % Le féminisme que nous défendons doit répondre à une crise d’ampleur historique : l’effondrement du niveau de vie et la catastrophe écologique imminente, l’intensification des guerres et des dépossessions, les migrations de masse qui se heurtent aux barbelés, l’exacerbation de la xénophobie et du racisme, le recul de droits durement acquis – tant sur le plan social que politique. Nous souhaitons relever ces défis. Le féminisme que nous construisons rejette les demi-mesures et veut s’attaquer directement aux racines capitalistes de la barbarie qui s’étend. Il refuse de sacrifier le bien-être de la majorité pour protéger la liberté d’une minorité et se concentre sur les besoins et les droits de la majorité – les femmes pauvres et les femmes de la classe ouvrière, les migrantes et les racisées, les femmes queer, trans, en situation de handicap, ainsi que celles encouragées à se considérer comme faisant partie de la « classe moyenne » alors même qu’elles sont exploitées par le capital. Mais ce n’est pas tout. Ce féminisme ne se limite pas à des « problèmes de femmes » tels que traditionnellement définis. Soutenant toutes celles et tous ceux qui sont exploité·e·s, dominé·e·s et opprimé·e·s, il aspire à devenir une source d’espoir pour l’humanité tout entière. C’est pourquoi nous l’appelons un féminisme pour les 99 %. Le féminisme pour les 99 % se construit à partir d’expériences pratiques et de réflexions théoriques. Alors que le néolibéralisme renforce sous nos yeux les oppressions de genre, la seule façon pour les femmes et les personnes non binaires de réellement bénéficier des droits dont elles disposent sur le papier ou de ceux qu’elles pourraient encore gagner est de transformer le système
social qui érode ces droits de manière sous-jacente. En soi, la légalisation de l’avortement légal ne représente pas grand-chose pour les femmes pauvres et les ouvrières qui n’ont ni les moyens de le payer ni la possibilité d’accéder aux cliniques. La justice reproductive exige un système de santé gratuit, universel et non lucratif, ainsi que la fin des pratiques racistes et eugénistes dans la profession médicale. De la même façon, pour les femmes les plus pauvres, l’égalité salariale ne peut que signifier l’égalité dans la misère. Elle doit donc s’accompagner d’emplois correctement rémunérés, encadrés par des droits fondamentaux et concrets, et d’une nouvelle organisation du travail domestique et des tâches liées aux soins (carework). Par ailleurs, les lois criminalisant la violence de genre ne sont qu’une cruelle supercherie dès lors qu’elles ferment les yeux sur le sexisme et le racisme structurels des systèmes de justice pénale et laissent libre cours à la brutalité policière, aux incarcérations de masse, aux menaces de déportation, aux interventions militaires, au harcèlement et aux abus dans l’environnement professionnel. Enfin, l’émancipation par la loi reste une coquille vide si elle n’inclut pas des services publics, des logements sociaux et des financements qui permettent aux femmes de quitter un foyer ou un emploi dans lesquels elles sont victimes de violences. Le féminisme pour les 99 % réclame donc des transformations sociales profondes. C’est pour cela qu’il ne peut pas être un mouvement isolé. Nous proposons au contraire de nous unir avec tous les mouvements qui se battent pour les 99 %, que ce soit en luttant pour la justice environnementale, pour une éducation gratuite de qualité, pour des services publics élargis, pour des logements abordables, pour le droit du travail, pour une couverture médicale universelle et gratuite, ou pour un monde sans racisme ni guerre. Ce
n’est qu’en nous alliant à ces mouvements que nous pourrons acquérir le pouvoir et la vision nécessaires pour démanteler les relations sociales et les institutions qui nous oppriment. Le féminisme pour les 99 % articule la lutte des classes et la lutte contre le racisme institutionnel. Il met en avant les préoccupations de l’ensemble des femmes de la classe ouvrière : qu’elles soient racisées, migrantes ou blanches ; cis9, trans ou non binaires ; femmes au foyer ou travailleuses du sexe ; payées à l’heure, à la semaine, au mois ou pas du tout ; sans emploi ou précaires ; jeunes ou vieilles. Résolument internationaliste, il est fermement opposé à l’impérialisme et à la guerre. Le féminisme pour les 99 % n’est pas seulement anti-néolibéral, il est aussi anticapitaliste.
Thèse 4. Ce que nous traversons, c’est une crise de la société dans son ensemble – et la source du problème est le capitalisme Pour la plupart des observateurs et observatrices, 2007-2008 a marqué le début de la pire crise financière depuis les années 1930. Mais cette interprétation de la crise actuelle reste trop étroite. Ce que nous vivons, c’est une crise de la société dans son ensemble. Elle n’est en aucun cas restreinte au domaine de la finance : c’est à la fois une crise économique, une crise écologique, une crise politique et une crise du « care ». Une crise de l’organisation sociale tout entière. Une crise du capitalisme – et en particulier de la forme aiguë et prédatrice du capitalisme dans laquelle nous vivons aujourd’hui : globale, financiarisée, néolibérale. Le capitalisme engendre régulièrement ce type de crise – pour des raisons qui ne sont pas accidentelles. Non seulement ce système vit en exploitant le travail salarié, mais également en pillant la nature, les biens publics et le travail non rémunéré qui permet aux individus et aux communautés de se reproduire. Animé par une quête incessante de profit illimité, le capital étend son empire sans payer la moindre contrepartie permettant de remplacer ou de renouveler ce qu’il exploite ou détruit pour y parvenir (sauf quand il y est forcé). Le capital – qui, par essence, détruit la nature, instrumentalise les pouvoirs publics et réquisitionne le travail de soin (carework) non rémunéré – est une force puissamment déstabilisatrice pour les éléments mêmes qui conditionnent sa survie, ainsi que la nôtre. La crise est profondément ancrée dans son ADN.
Cependant, la crise actuelle du capitalisme est particulièrement sévère. Quatre décennies de néolibéralisme ont fait chuter les salaires, fragilisé le droit du travail, ravagé l’environnement et dévoyé les énergies nécessaires à la subsistance des familles et des communautés – tout en déployant les tentacules de la finance sur l’ensemble du tissu social. Rien d’étonnant, alors, à ce que partout dans le monde des foules de gens en colère crient maintenant « Basta ! » et rejettent aussi bien les partis politiques établis que la logique néolibérale de la « libre concurrence », la « théorie du ruissellement » que la « flexibilité du travail » ou la « dette insoutenable ». En résulte une absence criante d’encadrement et d’organisation – et un sentiment croissant qu’il faut que quelque chose se passe. Le féminisme pour les 99 % fait partie des forces sociales qui se sont engouffrées dans cette brèche. Mais nous ne contrôlons pas le terrain. Au contraire, nous le partageons avec des ennemis particulièrement néfastes. Partout, des mouvements d’extrême droite démagogues promettent d’améliorer le sort des familles qui ont la « bonne » ethnicité, nationalité ou religion en mettant fin au « libre-échange », en freinant l’immigration et en restreignant les droits des femmes, des personnes racisées et des minorités sexuelles. Au même moment, de l’autre côté, les courants dominants de la « résistance progressiste » avancent des programmes tout aussi peu recommandables. En s’efforçant de restaurer le statu quo antérieur, ces partisans de la finance mondiale espèrent convaincre les féministes, les antiracistes et les écologistes de rejoindre les rangs de leurs « protecteurs » libéraux et de renoncer à des projets de transformation sociale plus égalitaires et ambitieux. Les féministes pour les 99 % déclinent cette proposition. Luttant non seulement contre le populisme réactionnaire, mais
également contre ses opposants néolibéraux « progressistes », nous entendons identifier et nous confronter directement à la véritable source de la crise et de la misère : le capitalisme. Selon nous, en d’autres termes, une crise ne se résume pas à une période de souffrance – encore moins à un simple contretemps dans la quête de profit. C’est d’abord et avant tout un moment de réveil politique et une opportunité de changement social. En temps de crise, énormément de gens retirent leur soutien aux pouvoirs en place. Rejetant la politique traditionnelle, ils sont à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles organisations, de nouvelles alliances. Dans une telle situation, des questions brûlantes surgissent : qui mènera le processus de transformation de la société ? Dans l’intérêt de qui ? À quelle fin ? Ce type de processus, par lequel une crise générale conduit à une réorganisation sociale, s’est répété à plusieurs reprises au cours de l’histoire moderne – et a largement tourné à l’avantage du capital. Afin d’assurer la rentabilité, les partisans du capitalisme n’ont cessé de le réinventer, encore et encore – en reconfigurant non seulement l’économie officielle, mais aussi la politique, la reproduction sociale et notre relation aux non-humains. Ce faisant, ils ont réorganisé non seulement l’exploitation de classe, mais aussi les oppressions de genre et de race, et ont souvent réussi à s’approprier les énergies rebelles (y compris les énergies féministes) pour mener des projets qui bénéficient presque exclusivement à la minuscule élite des 1 %. Ce processus se répétera-t-il aujourd’hui ? Historiquement, les 1 % se sont toujours montrés indifférents aux intérêts de la société ou de la majorité. Mais, aujourd’hui, ils se révèlent particulièrement dangereux. En privilégiant à tout prix le profit à court terme, ils échouent à prendre la mesure de la profondeur de la crise et négligent la menace qu’elle fait peser, à long terme, sur la santé du
système capitaliste lui-même : ils préfèrent continuer à multiplier les forages de pétrole qu’assurer les conditions écologiques nécessaires à leurs profits futurs ! Ainsi, la crise à laquelle nous sommes confronté·e·s menace la vie telle que nous la connaissons. La lutte visant à sa résolution pose des questions fondamentales : où allons-nous tracer la ligne qui délimite l’économie et la société, la société et la nature, la production et la reproduction, le travail et la famille ? Comment allons-nous utiliser le surplus social que nous produisons collectivement ? Et qui, exactement, va décider de cela ? Les 1 % réussiront-ils à transformer les contradictions sociales du capitalisme en opportunités nouvelles pour accumuler des richesses privées ? Parviendront-ils à rallier à leur cause une large partie de la rébellion féministe, alors même qu’ils renforcent les hiérarchies de genre ? Une révolte populaire contre le capital sera-t-elle finalement l’« acte par lequel l’humanité qui voyage dans ce train tire[ra] le frein d’urgence10 » ? Et, le cas échéant, les féministes seront-elles en première ligne de cette révolte ? Selon nous, la réponse à la dernière question est indubitablement positive.
Thèse 5. Dans les sociétés capitalistes, l’oppression de genre est enracinée dans la subordination de la reproduction sociale à la production marchande. Nous voulons remettre les choses dans le bon sens On sait bien que les sociétés capitalistes sont par définition des sociétés de classes : une petite minorité de personnes accumule des profits en exploitant des groupes beaucoup plus larges qui, eux, doivent travailler pour percevoir un salaire. Ce que l’on comprend moins, c’est que les sociétés capitalistes sont aussi, intrinsèquement, la source des oppressions de genre. Le sexisme n’est pas accidentel, il est profondément ancré dans la structure même du capitalisme. Bien sûr, le capitalisme n’a pas inventé la subordination des femmes. Elle existait déjà, sous des formes diverses, dans toutes les sociétés de classes antérieures. Mais le capitalisme en a établi de nouvelles, des formes modernes et distinctes de sexisme, soustendues par des structures institutionnelles inédites. Son initiative principale a été de séparer l’activité qui consiste à « faire des personnes » de celle permettant de « faire du profit », d’assigner ce premier travail aux femmes et de le subordonner au second. Ce faisant, le capitalisme a à la fois reconfiguré l’oppression des femmes et bouleversé l’ordre du monde. La perversité apparaît clairement lorsqu’on se rend compte à quel point ce travail de « fabrication de personnes » est vital et complexe. Cette activité crée et soutient la vie, au sens biologique, mais elle crée et soutient également notre capacité à travailler – ce que Marx
appelait notre « force de travail ». Cela implique d’éduquer les gens afin qu’ils adoptent les « bonnes » attitudes, dispositions et valeurs, les « bonnes » capacités, compétences et aptitudes. Ainsi, ce travail fournit les prérequis – matériels, sociaux, culturels – indispensables aux sociétés humaines en général, et à la production capitaliste en particulier. Sans cela, ni la vie ni la force de travail ne pourraient s’incarner dans les êtres humains. Nous appelons ce vaste ensemble d’activités vitales la reproduction sociale. Dans les sociétés capitalistes, le rôle crucial de la reproduction sociale est occulté et nié. Loin d’être apprécié à sa juste valeur, faire des personnes est considéré comme un simple moyen de faire du profit. Parce que le capital évite autant qu’il le peut de rémunérer ce travail, l’argent étant sa valeur suprême, il relègue celles et ceux qui l’accomplissent à une position de subordination – non seulement visà-vis des propriétaires du capital, mais aussi des salarié·e·s plus avantagé·e·s qui peuvent se décharger de ces responsabilités sur d’autres. Ces « autres » sont en grande majorité des femmes. Car, dans la société capitaliste, l’organisation de la reproduction sociale repose sur le genre : elle s’appuie sur des rôles genrés et entretient les oppressions de genre. C’est pourquoi la reproduction sociale est une question féministe. Mais elle est traversée en tout point par les lignes de fracture liées aux appartenances de classe, de race, de sexualité et de nationalité. Un féminisme attaché à résoudre la crise actuelle doit comprendre la reproduction sociale à travers une perspective qui prend en compte et relie tous ces axes de domination. Les sociétés capitalistes ont toujours institué une division raciale du travail reproductif. Que ce soit par l’esclavage ou le colonialisme, l’apartheid ou le néo-impérialisme, ce système a contraint les femmes racisées à fournir ce travail gratuitement – ou à très faible
coût – pour leurs « sœurs » blanches ou issues de l’ethnie majoritaire. Forcées de s’occuper (care) des enfants et des foyers de leurs maîtresses ou employeuses, elles ont dû se battre de toutes leurs forces pour pouvoir s’occuper des leurs. Par ailleurs, les sociétés capitalistes ont toujours cherché à mettre le travail reproductif des femmes au service de la binarité de genre et de l’hétéronormativité. Elles ont encouragé les mères, les enseignant·e·s et les médecins, parmi d’autres, à s’assurer que les enfants soient strictement modelé·e·s en filles-cis ou garçons-cis et en hétérosexuel·le·s. De la même façon, les États modernes ont souvent essayé d’instrumentaliser le travail de fabrication de personnes pour servir des projets nationaux ou impériaux. Incitant les naissances du « bon » type tout en décourageant celles du « mauvais » type, ils ont conçu des politiques éducatives et familiales afin de faire non seulement des « personnes », mais aussi (par exemple) des « Allemand·e·s », des « Italien·ne·s » ou des « Américain·e·s », pouvant être appelé·e·s à se sacrifier pour la nation quand cela semble nécessaire. Le critère de classe est également fondamental pour la reproduction sociale. On attend des femmes et des enseignant·e·s de la classe ouvrière qu’ils et elles préparent leurs enfants à être de bons « travailleurs » et de bonnes « travailleuses » qui obéissent, respectent leur patron (ou leur patronne), acceptent « leur poste » et tolèrent l’exploitation. Ces pressions n’ont jamais parfaitement fonctionné – elles ont même parfois échoué spectaculairement – et certaines d’entre elles s’atténuent aujourd’hui. Mais la reproduction sociale est profondément mêlée à la domination – et à la lutte contre celle-ci. Quand on comprend que la reproduction sociale est au cœur de la société capitaliste, on ne voit plus les classes de la même manière. Ce qui fabrique la classe dans la société capitaliste, ce ne sont pas seulement les relations qui exploitent directement le « travail », comme le présentent les analyses classiques, mais aussi les
relations qui permettent de reproduire et de renouveler ce travail. La classe ouvrière mondiale n’est pas non plus exclusivement composée de salarié·e·s des usines ou des mines. Celles et ceux qui travaillent dans les champs et à domicile, dans les bureaux, les hôtels, les restaurants, dans les hôpitaux, les crèches et les écoles, dans le secteur public et la société civile, les précaires, les sansemploi et celles et ceux qui ne reçoivent pas de salaire en échange de leur travail font également partie de la classe ouvrière. Loin d’être limitée aux hommes blancs hétérosexuels, qui l’incarnent encore trop souvent dans nos imaginaires, la classe ouvrière mondiale est essentiellement composée de migrant·e·s, de personnes racisées, de femmes – cis et trans – et de personnes dotées de capacités diverses, dont tous les besoins et désirs sont niés ou déformés par le capitalisme. Cette perspective élargit également notre vision de la lutte des classes. Elle ne se concentre pas exclusivement sur des revendications liées au travail (contrats de travail décents ou salaire minimum, par exemple) portées par des syndicats et des organisations de travailleurs et travailleuses, mais s’intéresse à de multiples aspects de la société. Selon nous, le point essentiel, et la clé pour comprendre le présent, est que la lutte des classes inclut les luttes liées à la reproduction sociale : pour la couverture de santé universelle et l’éducation gratuite, pour la justice environnementale et l’accès à une énergie propre, pour des logements et des transports publics. Les luttes politiques pour la libération des femmes, contre le racisme et la xénophobie, contre la guerre et le colonialisme y sont tout aussi importantes. Ces conflits ont toujours été au cœur de la société capitaliste, qui s’appuie sur le travail reproductif tout en le dévalorisant. Mais les luttes pour la reproduction sociale sont particulièrement explosives aujourd’hui. Les familles, les communautés et (surtout) les femmes sont de plus en plus asphyxiées par le néolibéralisme qui exige
l’augmentation des heures de travail salarié par foyer et la baisse des aides sociales de l’État. Dans ces conditions d’expropriation universelle, les luttes pour la reproduction sociale ont pris une place centrale. Elles constituent désormais le fer de lance de projets susceptibles de transformer radicalement la société.
Thèse 6. La violence de genre prend de nombreuses formes, toutes liées aux relations sociales capitalistes. Nous jurons de les combattre toutes Les chercheurs et chercheuses estiment qu’à l’échelle mondiale plus d’une femme sur trois est victime d’une forme ou d’une autre de violence de genre au cours de sa vie. Les auteurs de ces violences sont souvent les conjoints, responsables de 38 % des meurtres de femmes. Qu’elle soit physique, émotionnelle ou sexuelle, la violence conjugale traverse l’ensemble de la société capitaliste – on la retrouve dans tous les pays, dans toutes les classes et dans tous les groupes ethnoraciaux. Loin d’être accidentelle, elle est enracinée dans la structure institutionnelle de la société capitaliste. Les violences de genre que nous vivons aujourd’hui reflètent les dynamiques paradoxales qui traversent la vie personnelle et familiale, fondées sur les divisions propres au système capitaliste entre faire des personnes et faire du profit, entre famille et « travail ». La principale évolution a été le passage de foyers formés sur la base de la parenté élargie – dans lesquels les hommes les plus âgés détenaient le pouvoir de vie et de mort sur leurs proches – aux ménages de la modernité capitaliste, composés d’une famille nucléaire, hétérosexuelle, restreinte et marqués par une autorité moindre des chefs de famille. Avec ce tournant, les violences de genre fondées sur la parenté se sont transformées. Ce qui était auparavant ouvertement politique est devenu « privé » : plus informel et « psychologique », moins « rationnel » et contrôlé. Souvent alimentées par l’alcool, la honte et la peur de perdre le pouvoir, ces violences de genre sont présentes dans toutes les périodes du développement capitaliste. Elles sont toutefois
particulièrement virulentes et généralisées en temps de crise. Dans ces moments où l’anxiété, la précarité économique et l’incertitude politique croissent fortement, l’ordre de genre semble lui aussi vaciller. Certains hommes considèrent les femmes comme « incontrôlables » et la société moderne, caractérisée par de nouvelles libertés sexuelles et une plus grande fluidité de genre, comme « chaotique ». Leurs femmes ou leurs compagnes sont « prétentieuses », leurs maisons « désordonnées » et leurs enfants « sauvages ». Leurs patron·ne·s sont impitoyables, leurs collègues injustement favorisé·e·s et leurs emplois menacés. Ils doutent de leurs prouesses sexuelles et de leur pouvoir de séduction. Pensant que leur masculinité est en danger, ils explosent. Mais les violences de genre dans la société capitaliste ne prennent pas toutes cette forme apparemment « privée » et « irrationnelle ». D’autres ne sont que trop « rationnelles » comme en témoigne leur instrumentalisation en tant que techniques de contrôle : le viol de femmes victimes de l’esclavage et de la colonisation est de plus en plus utilisé comme une arme visant à terroriser les communautés racisées et à renforcer leur soumission ; les proxénètes et les trafiquants violent de manière répétée les femmes pour les « dresser » ; durant les guerres, les viols collectifs et prémédités des femmes « ennemies » sont une arme à part entière. Les agressions et les harcèlements sexuels au travail, dans les écoles ou dans les hôpitaux font également partie de ces techniques de contrôle. Les agresseurs sont alors les patrons et les supérieurs hiérarchiques, les professeurs et les entraîneurs, les policiers et les gardiens de prison, les docteurs et les psys, les propriétaires et les militaires – tous dotés d’un pouvoir institutionnel sur leurs victimes. Ils peuvent ordonner des rapports sexuels, et certains passent à l’acte. Ces agressions sont rendues possibles par la vulnérabilité raciale, politique, professionnelle et économique des femmes : c’est-à-dire notre dépendance à l’égard des salaires, notre
inquiétude vis-à-vis de notre réputation ou notre angoisse face aux employeurs et aux chefs de service qui nous questionnent sur notre statut migratoire. Cette violence est permise par un système de pouvoir hiérarchique qui se sert des identités de genre, de race et de classe pour asseoir sa domination. En retour, ce système en sort renforcé et normalisé. Ces deux formes de violence de genre – l’une privée et l’autre publique – ne sont malgré tout pas si distinctes. Il existe des cas hybrides : dans certaines sous-cultures sportives ou fraternités adolescentes, de jeunes hommes imprégnés des normes misogynes rivalisent pour acquérir un statut particulier en se vantant d’abuser des femmes. Les violences de genre publiques et privées forment un cercle vicieux en se renforçant mutuellement. Parce que le capitalisme assigne très majoritairement le travail reproductif aux femmes, il restreint notre capacité à participer pleinement, en tant que paires, au monde du « travail productif ». La plupart d’entre nous se retrouvent donc à stagner dans des emplois sans avenir qui ne permettent pas de subvenir aux besoins de nos familles. Cela nous désavantage dans nos vies « privées » : comme il nous est plus difficile de mettre fin à certaines relations, nous perdons de plus en plus d’autonomie (disempowers) et de pouvoir. Cette situation profite bien sûr en priorité au capital, mais nous, nous sommes doublement soumises aux abus, qui peuvent être commis par nos relations personnelles et familiales comme par ceux qui protègent et servent le capital. Les réponses apportées par le féminisme traditionnel aux violences de genre sont certes intelligibles, mais tout à fait inadéquates. La plus commune prend la forme de revendications en faveur de la criminalisation et de la punition. Ce « féminisme carcéral », tel qu’on l’a appelé, tient pour acquis précisément ce qui doit être remis en cause – à savoir l’affirmation erronée selon laquelle les lois, la police et les tribunaux conservent suffisamment
d’autonomie vis-à-vis de la structure de pouvoir capitaliste pour contrer sa profonde tendance à engendrer des violences de genre. En réalité, le système de justice pénale cible de façon disproportionnée les hommes racisés les plus pauvres, dont les migrants, tout en laissant leurs homologues en col blanc libres de violer et de battre. Il laisse aussi les femmes ramasser les morceaux : faire des trajets longs et pénibles afin de rendre visite à leurs fils et maris incarcérés, subvenir seules aux besoins de leur foyer et gérer les retombées administratives et juridiques liées à la détention. De même, les campagnes de lutte contre la traite et les lois contre l’« esclavage sexuel » sont fréquemment instrumentalisées dans le but d’expulser des femmes migrantes tandis que leurs violeurs et proxénètes restent en liberté. Parallèlement, la réponse carcérale néglige l’importance des solutions à proposer aux survivantes. Les lois qui criminalisent le viol conjugal ou les agressions au travail n’aideront ni les femmes qui n’ont nulle part où aller, ni celles qui n’ont aucun moyen. Dans de telles conditions, aucune féministe dotée ne serait-ce que d’une once de sensibilité aux questions de classe et de race ne peut défendre une réponse carcérale face à la violence de genre. Les réponses « fondées sur le marché » défendues par les fémocrates sont tout aussi inadéquates. Depuis leurs nobles perchoirs au sein des grandes institutions financières, ces néolibérales progressistes en jupe proposent de protéger de la violence leurs « sœurs » moins favorisées du Sud en leur prêtant des petites sommes d’argent afin qu’elles montent leurs propres affaires. La preuve que les microcrédits réduisent effectivement la violence domestique ou promeuvent l’indépendance des femmes par rapport aux hommes est au mieux impressionniste. Néanmoins, un de ses effets est clair comme de l’eau de roche : le microcrédit accroît la dépendance des femmes vis-à-vis de leurs créanciers et
créancières. En resserrant le nœud coulant de la dette autour du cou des femmes les plus pauvres, cette réponse aux violences de genre est une violence en soi. Le féminisme pour les 99 % rejette ces deux réponses. Nous savons que, sous le capitalisme, la violence de genre n’est pas une perturbation dans l’ordre des choses, mais une condition systémique. Profondément ancrée dans l’ordre social, elle ne peut être ni comprise ni corrigée isolément du plus large complexe de la violence capitaliste : la violence biopolitique des lois qui nient la liberté de reproduction ; la violence économique du marché, des banques, des propriétaires et des requins de la dette ; la violence d’État de la police, des tribunaux et des gardiens de prison ; la violence transnationale des agents frontaliers, des régimes migratoires et des armées impériales ; la violence symbolique de la culture dominante qui colonise nos esprits, déforme nos corps et éteint nos voix ; la « lente » violence environnementale qui ronge nos communautés et nos habitats. Ces dynamiques, bien qu’endémiques au sein du régime capitaliste, se sont brutalement renforcées avec la crise actuelle. Au nom de la « responsabilité individuelle », le néolibéralisme a considérablement réduit les fonds publics alloués aux prestations sociales. Il a fait des services publics un marché, une source de profits directs, ou en a fait porter la charge aux familles individuelles, les contraignant – et particulièrement les femmes – à assurer la totalité des tâches liées au care. Ce qui encourage encore davantage les violences de genre. Aux États-Unis, la crise des subprimes a frappé de façon disproportionnée les femmes racisées : ce sont elles qui ont connu les plus forts taux d’expulsion et ont été le plus souvent contraintes de choisir entre se retrouver sans domicile et rester sous l’emprise de leur conjoint. Au Royaume-Uni, les autorités ont répondu à l’effondrement financier en sabrant dans les services publics – en
premier lieu dans le financement des refuges destinés à protéger les victimes de violence domestique. Aux Antilles, l’augmentation des prix des denrées alimentaires et du carburant a coïncidé avec des coupes dans le budget des services sociaux, provoquant une augmentation des violences de genre. Ces mesures se sont accompagnées d’une accentuation de la propagande disciplinaire et normalisatrice. Les injonctions répétées à être une « bonne » épouse ou à faire plus d’enfants en viennent trop rapidement à justifier la violence envers celles qui échouent à se conformer aux identités et aux rôles de genre traditionnels. De plus, aujourd’hui, les lois qui vont à l’encontre des travailleurs et des travailleuses exacerbent la violence au sein de secteurs économiques qui reposent très majoritairement sur les femmes. Dans les zones franches industrielles (les trois mille maquiladoras au Mexique par exemple), la violence de genre est largement utilisée dans le cadre du travail comme un instrument disciplinaire. Les patrons et les responsables d’usine commettent des viols en série, s’adonnent aux violences verbales et pratiquent des fouilles corporelles humiliantes afin d’accroître la productivité et de décourager les femmes de s’organiser sur leurs lieux de travail. Une fois implantées dans ces zones franches, ces pratiques s’étendent et se généralisent rapidement dans l’ensemble de la société, et notamment dans les foyers ouvriers. Ainsi, dans les sociétés capitalistes, la violence de genre n’est pas un phénomène isolé. Elle est au contraire profondément enracinée dans un ordre social qui entrelace la subordination des femmes avec l’organisation genrée du travail et les dynamiques d’accumulation du capital. Il n’est donc pas surprenant que le mouvement #MeToo soit né de protestations contre les abus dans le monde professionnel, ni que la première déclaration de solidarité avec ces femmes du monde du spectacle soit venue de travailleuses agricoles migrantes en Californie : elles ont tout de suite reconnu en Harvey Weinstein
non seulement un prédateur, mais également un patron puissant, capable de décider qui serait autorisé à travailler à Hollywood et qui ne le serait pas. La violence, sous toutes ses formes, fait partie intégrante du fonctionnement quotidien de la société capitaliste : c’est seulement par un mélange de coercition brutale et de consentement construit que le système peut se maintenir dans les meilleures conditions. Une forme de violence à laquelle il ne peut être mis fin sans mettre fin aux autres. Souhaitant les éradiquer toutes, les féministes pour les 99 % cherchent à relier les luttes contre la violence de genre aux luttes contre toutes les formes de violence dans la société capitaliste – et contre le système social sur lequel elles reposent.
Thèse 7. Le capitalisme essaie de contrôler la sexualité. Nous voulons la libérer Au premier abord, il semble très simple de choisir son camp dans les luttes concernant la sexualité – qui opposent les forces de la réaction sexuelle à celles du libéralisme sexuel. Les réactionnaires cherchent à interdire les pratiques sexuelles qui, selon eux, bafouent les valeurs familiales immuables ou la loi divine. Déterminés à faire respecter ces principes supposément éternels, ils souhaiteraient faire lapider les « adultères », fouetter les lesbiennes et soumettre les gays à des « thérapies de conversion ». Au contraire, les libéraux se battent pour les droits des dissident·e·s et des minorités sexuelles. Encourageant la reconnaissance par l’État de relations auparavant taboues et d’identités méprisées, ils défendent l’« égalité du mariage » et l’intégration des minorités sexuelles dans les rangs de l’armée. Alors que les premiers cherchent à réhabiliter des modèles archaïques et régressifs – le patriarcat, l’homophobie, la répression sexuelle –, les seconds défendent les normes promues par la modernité – la liberté individuelle, l’expression de soi et la diversité sexuelle. Le choix semble évident ! Cependant, aucun de ces deux camps n’est réellement ce qu’il paraît. D’une part, l’autoritarisme sexuel que l’on rencontre aujourd’hui est tout sauf archaïque. Alors qu’elles sont présentées comme des commandements divins intemporels et des traditions séculaires, les interdictions qu’il veut instaurer sont en fait « néotraditionnelles » : ce sont des réactions au développement capitaliste, aussi modernes que ce à quoi elles s’opposent. De la même façon, les droits sexuels promis par les opposants libéraux
sont conçus dans des termes qui présupposent des formes capitalistes de modernité ; loin de permettre une libération réelle, ils sont normalisants, étatistes et consuméristes. Pour mieux comprendre, il est nécessaire de retracer la généalogie de cette opposition. Les sociétés capitalistes ont toujours essayé de contrôler la sexualité, selon des moyens et des méthodes qui ont évolué au cours de l’histoire. Dans les premiers temps du système, alors que les relations sociales capitalistes n’étaient pas encore solidement assises, les autorités préexistantes (notamment les Églises et les collectivités locales) étaient chargées d’établir et de renforcer les normes qui définissaient les contours de la sexualité acceptable. Plus tard, alors que le capitalisme réorganisait l’ensemble de la société, il a façonné de nouvelles normes et régulations bourgeoises – parmi lesquelles le binarisme de genre et l’hétéronormativité, approuvés par l’État. Ces normes « modernes » de genre et de sexualité n’étaient pas réservées à la métropole capitaliste ou aux classes bourgeoises et elles ont été largement diffusées, notamment lors de la colonisation, en s’appuyant sur la culture de masse. L’État les a renforcées à travers ses outils répressifs et administratifs (les prestations sociales étaient par exemple allouées en fonction de critères familiaux). Cependant, ces normes ont rencontré des résistances et se sont heurtées non seulement à des régimes de sexualité plus anciens, mais également à des aspirations nouvelles de liberté sexuelle, qui se sont essentiellement manifestées dans les villes au sein de contrecultures gays et lesbiennes et d’enclaves d’avant-garde. Ce modèle a connu à son tour des transformations. Au lendemain des années 1960, le bloc bourgeois s’est (relativement) adouci, tandis que les élans de liberté ont débordé les contre-cultures pour devenir dominants. Ces deux courants se sont ainsi réunis dans un nouveau projet : normaliser, par des régulations étatiques étendues,
des formes de sexualité autrefois taboues en les conformant au modèle capitaliste qui encourage l’individualisme, le repli sur la sphère domestique et la consommation marchande. Ce qui se cache derrière ce nouveau modèle, c’est un tournant décisif dans la nature même du capitalisme. De plus en plus financiarisé, mondialisé et détaché de la cellule familiale, le capital n’est plus formellement opposé aux formes de genre et de sexualité queer ou non cis. Aujourd’hui, les grandes entreprises ne se focalisent plus sur une seule et unique norme de famille ou de sexualité et beaucoup d’entre elles souhaitent permettre à leurs employé·e·s de vivre en dehors de familles hétérosexuelles – mais à condition qu’ils et elles rentrent dans le rang sur leur lieu de travail comme au centre commercial. Les sexualités dissidentes trouvent également leur place au sein des lois du marché : elles constituent une niche qui propose de séduisantes publicités, gammes de produits ou plaisirs prêts à consommer. Dans la société capitaliste, le sexe fait vendre – et le néolibéralisme le décline en de très nombreux parfums. Les luttes récentes concernant la sexualité prennent place à une époque marquée par une fluidité de genre croissante parmi les jeunes, un fort essor des mouvements féministes et queer et d’importantes victoires juridiques, comme l’égalité formelle de genre, des droits accordés aux minorités sexuelles et l’égalité du mariage – des droits aujourd’hui inscrits dans la loi dans de plus en plus de pays à travers le monde. Si ces victoires sont les fruits de batailles durement gagnées, elles reflètent également des changements sociaux et culturels considérables propres au néolibéralisme – et restent fragiles et constamment menacées. Ces nouveaux droits n’ont pas mis fin aux agressions homophobes ou transphobes. Les minorités sexuelles sont toujours victimes de violences de genre, elles continuent de subir des discriminations et ne bénéficient d’aucune reconnaissance symbolique.
En effet, le capitalisme financiarisé alimente des réactions très hostiles à cette nouvelle liberté sexuelle. Ce ne sont pas « juste » les incels11 qui assassinent des femmes afin de venger le « vol » de la sexualité féminine à ses « propriétaires masculins légitimes ». Ni « juste » les fervents réactionnaires qui proposent de protéger « leur » femme et « leur » famille de l’individualisme féroce, du consumérisme crasse et du « vice ». Des mouvements populistes de droite se montrent également virulents. Ils s’étendent très rapidement et gagnent le soutien des masses en identifiant certains aspects réellement négatifs de la modernité capitaliste – comme son incapacité à protéger les familles et les communautés des ravages du marché. Néanmoins, les néotraditionalistes comme les populistes de droite déforment ces reproches légitimes dans le but d’alimenter un type d’opposition dont le capital s’accommode fort bien : un mode de « protection » mettant en avant les supposés ravages engendrés par la liberté sexuelle tout en dissimulant le véritable danger : le capital. Les réactionnaires peuvent admirer leur reflet dans le libéralisme sexuel. Lequel, même dans le meilleur des cas, soutient des politiques qui privent l’écrasante majorité des conditions sociales et matérielles nécessaires à l’application concrète des nouvelles libertés inscrites dans la loi – à la manière de certains États qui se targuent de reconnaître les droits des personnes trans, mais continuent de se refuser à couvrir leurs frais médicaux de transition. Le libéralisme sexuel est aussi lié à des réglementations étatiques qui normalisent et renforcent encore davantage la famille monogame : c’est le prix à payer par les gays et les lesbiennes pour être accepté·e·s. Alors qu’il feint de valoriser la liberté individuelle, ce régime ne remet pas en cause les conditions structurelles qui alimentent l’homophobie et la transphobie, et notamment le rôle joué par la famille dans la reproduction sociale.
Mais même en dehors de la sphère familiale, la pseudo-libération sexuelle recycle les valeurs capitalistes. Les nouvelles cultures hétérosexuelles, faites de coups d’un soir et de rencontres virtuelles, incitent les jeunes femmes à « s’approprier » leur sexualité tout en confortant les hommes qui s’amusent à les classer selon leur apparence. Les discours néolibéraux, rabâchant l’importance de « s’approprier son corps et sa vie », exhortent toujours les filles à satisfaire les garçons : l’égoïsme des mâles en matière sexuelle est une « qualité » très à la mode dans la société capitaliste. De la même façon, les nouvelles formes de « normalité gay » présupposent une normalité capitaliste. Dans de nombreux pays, les classes moyennes gays émergentes revendiquant leur respectabilité sont caractérisées par leurs modes de consommation. Pour autant, l’acceptation de ce nouveau groupe social coexiste avec la marginalisation et la répression continues des queer pauvres, en particulier lorsqu’ils et elles sont racisé·e·s. Les pouvoirs publics clament en permanence leur tolérance vis-à-vis des gays qui « pensent bien, vivent bien », et utilisent ce pinkwashing afin de légitimer des projets néocoloniaux et impérialistes. Les agences d’État israéliennes se sont notamment illustrées sur ce point en se revendiquant de leur culture « gay friendly », et ce dans le but de justifier l’asservissement brutal des Palestinien·ne·s « arriéré·e·s et homophobes ». De la même façon, certains libéraux européens invoquent leur propre « tolérance éclairée » vis-à-vis des minorités sexuelles afin de légitimer leur hostilité envers « les musulmans », considérés comme un groupe homogène, tout en déroulant le tapis rouge à des personnes, pourvu qu’elles soient non musulmanes, très autoritaires sur les questions de sexualité. Ainsi, les mouvements de libération actuels se trouvent entre le marteau et l’enclume : la libération des femmes et des minorités sexuelles de la domination patriarcale ou religieuse ne pourrait se faire qu’au prix d’une soumission totale aux prédateurs capitalistes.
Les féministes pour les 99 % refusent de jouer ce jeu. Rejetant à la fois la cooptation néolibérale et la misogynie et l’homophobie néotraditionnelles, nous voulons faire revivre l’esprit radical des émeutes de Stonewall de 1969, à New York, celui des courants féministes « pro-sexe », d’Alexandra Kollontaï à Gayle Rubin, et celui de la campagne historique Lesbians and Gays Support the Miners12 en 1984. Nous combattons pour libérer la sexualité de la procréation et des formes normatives de la famille, contre les carcans de genre, de classe et de race, contre les réappropriations des luttes par l’État et le marché. Par ailleurs, nous savons que pour réaliser ce rêve, nous devons construire une forme nouvelle de société non capitaliste qui assurera les bases matérielles de la libération sexuelle, parmi lesquelles un soutien public conséquent à la reproduction sociale, adapté à un bien plus large éventail de modèles familiaux et conjugaux.
Thèse 8. Le capitalisme est né de la violence raciste et coloniale. Le féminisme pour les 99 % est antiraciste et anti-impérialiste Aujourd’hui, comme lors d’autres graves crises du capitalisme, la « question raciale » est plus brûlante que jamais, engendrant de fortes tensions. Après s’être contenté de diffuser de « simples » messages subliminaux, le populisme de droite, hargneusement ethnonationaliste et animé par des démagogues qui prétendent défendre la majorité lésée, se rallie désormais sans retenue au suprématisme blanc. Les gouvernements centristes participent sciemment à ces tendances ouvertement racistes : ils bloquent l’entrée des migrant·e·s et des réfugié·e·s, saisissent leurs enfants, séparent les familles, les enferment dans des camps ou les laissent se noyer en mer. Pendant ce temps, au Brésil, aux États-Unis et ailleurs, la police continue à tuer impunément des personnes non blanches tandis que les tribunaux les envoient massivement, et pour de longues périodes, croupir dans des prisons privées transformées en lucratifs business. Certain·e·s tentent de s’opposer à ces situations scandaleuses. Des activistes allemand·e·s, brésilien·ne·s ou étasunien·ne·s protestent massivement contre les violences policières racistes et les suprématistes blanc·he·s. Ils et elles tentent ainsi de donner un nouveau sens au mot « abolition », en réclamant la fin des incarcérations et le démantèlement de l’ICE, l’agence gouvernementale étasunienne chargée de contrôler les frontières. Toutefois, nombre de ces mouvements antiracistes se limitent à des dénonciations d’ordre moral. Parallèlement, certain·e·s choisissent
de jouer avec le feu, à la manière de ces courants de gauche européens qui proposent de faire alliance avec la droite et s’opposent eux-mêmes à l’immigration. Dans ce contexte, les féministes aussi doivent choisir leur camp. Néanmoins, si l’on se place dans une perspective historique, le bilan du féminisme concernant la question raciale est au mieux mitigé… Les influentes suffragistes blanches étasuniennes se sont livrées à des diatribes explicitement racistes après la guerre civile, lorsque le droit de vote a été accordé aux hommes noirs, mais pas aux femmes. Jusqu’à la seconde partie du XXe siècle, de grandes figures du féminisme anglais ont défendu la loi coloniale en Inde sur des bases « civilisationnelles » et raciales : elles la jugeaient nécessaire pour « élever les femmes de couleur de leur basse condition ». Aujourd’hui encore, des féministes européennes reconnues justifient des mesures antimusulman·e·s dans des termes semblables. Cet enchevêtrement du féminisme et du racisme a parfois pris des formes « plus subtiles ». Même lorsqu’elles n’étaient pas explicitement ou intentionnellement racistes, des féministes libérales et radicales ont défini le « sexisme » et les « problématiques liées au genre » en présentant la situation des femmes blanches de classe moyenne comme un modèle (faussement) universel. En découplant le genre de la race (et de la classe), elles ont rendu prioritaire le besoin « des femmes » de s’échapper de la sphère domestique et « d’aller travailler » – comme si nous étions toutes des femmes au foyer vivant en banlieue ! Suivant la même logique, des meneuses féministes blanches étasuniennes ont considéré que les femmes noires ne pouvaient être véritablement féministes que si elles faisaient primer une sororité imaginaire post- ou non raciale sur une solidarité antiraciste avec les hommes noirs. En refusant pendant
des décennies de se positionner face à ce dilemme, les féministes racisées ont réussi à dévoiler ce que cachent de telles injonctions, désormais rejetées par de plus en plus de féministes de tous bords. Les féministes pour les 99 % regardent cette histoire honteuse avec lucidité et s’engagent à rompre définitivement avec elle. Nous savons que rien de ce qui mérite le nom de « libération des femmes » ne peut s’accomplir dans une société raciste et impérialiste. Nous affirmons également que la racine du problème est le capitalisme, dont le racisme et l’impérialisme sont des corrélats. Ce système social qui s’enorgueillit de promouvoir le « travail libre » et « contractualisé » n’a pu voir le jour qu’en faisant fond sur les pillages coloniaux, sur la « transformation de l’Afrique en une sorte de garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires13 », sur la mise en esclavage dans le « Nouveau Monde » et sur la dépossession des peuples autochtones. Mais, loin de cesser lorsque le capitalisme a pris son envol, les expropriations de peuples racisés non libres ou dépendants ont continué à rendre possible l’exploitation du « travail libre ». La distinction entre les « travailleurs et travailleuses » librement exploité·e·s et les « autres », exproprié·e·s et dépendant·e·s, a pris différentes formes à travers l’histoire du capitalisme – lors de l’esclavage, du colonialisme, de l’apartheid et de la division internationale du travail – et s’est parfois brouillée. Mais tout au long de cette histoire, et aujourd’hui encore, l’expropriation des personnes racisées a permis au capital de faire fructifier ses profits en confisquant les ressources naturelles et la force de travail des hommes et des femmes, sans se préoccuper de leur renouvellement ou de leur reproduction. Pour des raisons systémiques, le capitalisme a toujours créé des classes racialisées d’êtres humains, au sein desquelles les personnes et le travail sont dépréciés et sujets à l’expropriation. Un féminisme véritablement antiraciste et anti-impérialiste ne peut qu’être aussi anticapitaliste.
C’est plus vrai aujourd’hui que jamais auparavant, à l’heure où les expropriations racialisées sont exponentielles, intensifiées par le levier de la dette. C’est ainsi que le capitalisme néolibéral promeut l’oppression raciale dans le monde entier. Dans le Sud « postcolonial », l’accaparement des terres par des grandes entreprises qui se nourrissent de la dette déloge de nombreux peuples indigènes – et, parfois, les pousse au suicide. En même temps, la « restructuration » de la dette souveraine fait exploser le ratio entre intérêts et PIB, ce qui oblige des États supposément indépendants à réduire leurs dépenses publiques et condamne les futures générations de travailleurs et travailleuses à consacrer une part croissante de leur travail au remboursement des grands organismes de crédit. Ainsi, les expropriations racialisées se poursuivent, articulées à un surcroît d’exploitation dû à la délocalisation de nombreuses usines dans les pays du Sud. Cette oppression suit également un rythme effréné dans les pays du Nord. Alors que les emplois mal rémunérés et précaires dans le secteur tertiaire remplacent peu à peu le travail syndiqué dans les industries, les salaires tombent en dessous du minimum nécessaire pour vivre une vie décente, particulièrement dans les domaines où les personnes racisées sont majoritaires. Contraintes à accepter plusieurs emplois et à emprunter de l’argent sur leurs revenus futurs pour survivre, elles se voient également souvent proposer des prêts hypothécaires très risqués. La protection sociale décline elle aussi : les services autrefois fournis par l’État sont de plus en plus à la charge des familles et des communautés – et reposent en premier lieu sur les femmes issues des minorités et les femmes immigrées. De même, les recettes fiscales auparavant allouées aux infrastructures publiques sont désormais réservées au remboursement de la dette, ce qui entraîne des effets particulièrement désastreux pour les communautés racisées – spatialement ségréguées et privées d’aides publiques pour les
écoles et les hôpitaux, le logement et le transport, l’approvisionnement en air et en eau non pollués. Partout dans le monde, le capitalisme financier exproprie massivement les populations sur des bases raciales. Cette organisation pyramidale du monde a également des effets genrés. Aujourd’hui, des millions de femmes migrantes et noires sont employées comme domestiques et chargées des activités de soins (caregivers). Souvent sans papiers et loin de leurs familles, elles sont simultanément exploitées et expropriées – forcées à travailler dans des conditions précaires, privées de leurs droits et victimes d’abus de toutes sortes. Forgée par les « chaînes mondiales du care14 », leur oppression permet aux femmes plus privilégiées de vivre dans de bonnes conditions, d’éviter une part du travail domestique et d’exercer des professions valorisées. Au nom de la défense des droits des femmes, ces dernières peuvent soutenir des campagnes politiques visant à emprisonner les hommes noirs pour viol, à persécuter les migrants et les musulmans et à exiger que les femmes noires et musulmanes s’assimilent à la culture dominante. Quelle ironie ! En réalité, le racisme, l’impérialisme et l’ethnonationalisme participent à la misogynie généralisée et au contrôle du corps de toutes les femmes. Parce que ces discriminations nous blessent toutes, nous devons les combattre bec et ongles. Mais les proclamations abstraites de « sororité » mondiale sont contreproductives : partant du principe que cette sororité est déjà acquise alors qu’elle doit être construite à travers un processus politique, elles véhiculent une fausse impression d’homogénéité. La réalité est que même si nous souffrons toutes d’oppressions misogynes dans la société capitaliste, nos souffrances revêtent différentes formes. Les liens entre ces formes d’oppression ne sont pas toujours immédiatement visibles : ils doivent être révélés politiquement à
travers des efforts systématiques pour construire la solidarité. C’est seulement de cette manière, en luttant dans et à travers notre diversité, que nous pourrons obtenir ensemble le pouvoir dont nous avons besoin pour espérer transformer la société.
Thèse 9. En luttant pour empêcher la destruction de la Terre par le capital, le féminisme pour les 99 % est écosocialiste La crise du capitalisme est aussi écologique. Le capitalisme a toujours cherché à accroître ses profits en accaparant – ou tout simplement en volant – les ressources naturelles, qu’il considère comme gratuites et infinies. Structurellement enclin à s’approprier la nature (épuisement des sols, appauvrissement des richesses minérales ou empoisonnement de l’eau et de l’air…), sans aucune considération pour le renouvellement des ressources, le capitalisme déstabilise cycliquement les conditions mêmes de son développement. Ce n’est pas la première fois dans l’histoire du capitalisme que se produit une crise écologique. Mais celle-ci est sans aucun doute la plus étendue et la plus profonde. Le changement climatique menaçant aujourd’hui la planète est une conséquence directe de l’exploitation des énergies fossiles par le capital au service de l’industrie. Ce n’est pas l’« humanité », en général, qui a extrait les dépôts carbonisés formés durant des centaines de millions d’années sous la croûte terrestre, mais le capital – et c’est le capital qui les a consumés en un clin d’œil sans se soucier de leur régénération ou des impacts de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre. Les évolutions successives (du charbon au pétrole, puis à la fracturation et au gaz naturel) n’ont fait qu’augmenter les émissions de carbone et les « externalités » ont été déchargées de façon disproportionnée sur les communautés pauvres, souvent racisées, au Nord comme au Sud.
Si la crise écologique actuelle est directement liée au capitalisme, elle reproduit et aggrave également l’oppression des femmes. En représentant près de 80 % des réfugié·e·s climatiques, elles sont en première ligne. Dans les pays du Sud, la force de travail agricole est très majoritairement composée de femmes, qui assument également en grande partie la responsabilité du travail de reproduction sociale. Les femmes font face à la sécheresse, la pollution et la surexploitation des terres : ce sont elles qui fournissent la nourriture, les vêtements et les abris à leurs familles. De la même façon, les femmes racisées sont les plus vulnérables dans les pays du Nord : victimes du racisme environnemental, elles sont les principaux piliers des communautés sujettes aux inondations et à l’empoisonnement au plomb. Elles sont également à la tête de luttes contre cette catastrophe écologique imminente. Il y a plusieurs décennies, les activistes de gauche réunies dans le groupe Women Strike for Peace s’opposaient déjà aux armes atomiques qui avaient déposé du strontium 90 dans nos os. Aujourd’hui, les femmes mènent la lutte des Water Protectors15 contre le Dakota Access Pipeline aux ÉtatsUnis. Au Pérou, elles ont soutenu Máxima Acuña qui a gagné la bataille contre le géant minier américain Newmont16. Au nord de l’Inde, les femmes Garhwali s’opposent à la construction de trois barrages hydroélectriques. À travers le globe, elles luttent contre la privatisation de l’eau et des semences et pour la préservation de la biodiversité et une agriculture durable. Ces femmes inventent de nouvelles formes de luttes intégrées : elles vont à l’encontre des courants écologistes traditionnels qui pensent que la défense de la « nature » et le bien-être matériel des communautés humaines sont incompatibles. En refusant de découpler les questions écologiques et celles liées à la reproduction sociale, ces mouvements représentent une alternative anticapitaliste
et anti-industrielle puissante aux courants soutenant le projet d’un « capitalisme vert », qui ne fait rien pour mettre fin au réchauffement climatique et enrichit ceux qui spéculent sur des « permis d’émission », des « services d’écosystèmes », la « compensation carbone » et les « dérivés environnementaux ». Contrairement à ces projets de « finance verte » qui considèrent la nature comme une pure abstraction quantitative, les luttes des femmes se concentrent sur le monde réel, dans lequel la justice sociale, le bien-être des communautés et la préservation de la nature non humaine sont inextricablement mêlés. La libération des femmes et la protection de notre planète face au désastre écologique marchent main dans la main – vers le dépassement du capitalisme.
Thèse 10. Le capitalisme est incompatible avec une véritable démocratie et la paix réelle. Notre réponse est l’internationalisme féministe La crise actuelle est aussi politique. Entravés par la finance mondiale, les États qui se prétendaient démocratiques se trouvent aujourd’hui dans une impasse et échouent souvent à résoudre les problèmes les plus urgents, se désintéressant de l’intérêt général. La plupart d’entre eux rechignent à s’attaquer à la menace du changement climatique ou à engager des réformes financières, quand ils ne bloquent pas carrément toute mesure qui pourrait mener vers des solutions. Les gouvernements, assujettis aux grandes entreprises et affaiblis par la dette, sont de plus en plus considérés par leurs propres citoyens comme des auxiliaires du capital, qui suivent le rythme des banques centrales et des investisseurs internationaux, des géants de l’informatique, des magnats de l’énergie et des vendeurs d’armes. Peut-on alors s’étonner que des millions des gens abandonnent les partis et les politiciens traditionnels qui ont promu le néolibéralisme, y compris ceux de centre gauche ? La crise politique est enracinée dans la structure institutionnelle de la société capitaliste. Ce système divise le « politique » de l’« économique », la « violence légitime » de l’État de la « sourde pression » du marché. Ainsi, en considérant que de vastes pans de la vie sociale n’ont pas à relever du contrôle démocratique, le capitalisme les soumet aux entreprises. Il nous empêche donc, par sa structure même, de décider collectivement de ce que nous voulons produire, dans quelles quantités, sur quelle base
énergétique et à travers quels types de relations sociales. Il nous interdit également de choisir de quelle manière utiliser la plus-value sociale que nous produisons, quel lien nous souhaitons entretenir avec la nature et les générations futures et comment nous voulons articuler la reproduction sociale et la production. Le capitalisme, en somme, est fondamentalement antidémocratique. Parallèlement, ce système ne peut que dessiner une géographie mondiale impérialiste. Il autorise les puissants États du Nord à s’en prendre aux plus faibles en les étouffant sous la dette, en les escroquant à travers des accords commerciaux inéquitables et en les menaçant de lancer des interventions militaires ou de suspendre l’« aide » – ce qui revient à priver une grande partie de la population mondiale de toute protection politique. Manifestement, les aspirations démocratiques exprimées par des milliards de personnes dans les pays du Sud ne méritent pas la moindre considération et sont simplement ignorées ou réprimées brutalement. Le capital joue constamment sur deux tableaux. D’un côté, il profite des pouvoirs publics en s’appuyant sur des régimes législatifs qui protègent la propriété privée et sur les institutions qui répriment toute opposition, tout en ayant la main sur les infrastructures nécessaires à l’accumulation et sur les instances de régulation chargées de gérer les crises. De l’autre, la soif de profits entraîne régulièrement certaines fractions de la classe capitaliste qui ne jurent que par le marché à se révolter et à conspirer contre les pouvoirs publics. Lorsque ce type d’intérêts à court terme l’emporte sur la survie à long terme, le capital s’apparente à un serpent qui se mord la queue, menaçant de détruire les institutions dont il dépend. La tendance du capitalisme à engendrer des crises politiques – même dans ses moments les moins destructeurs – a atteint son paroxysme. Le régime néolibéral actuel manie ouvertement le matériel militaire comme l’arme de la dette et cible effrontément tous les pouvoirs publics et les forces politiques qui oseraient le défier –
par exemple, en invalidant les élections et les référendums qui rejettent l’austérité, comme en Grèce en 2015, et en empêchant ceux qui pourraient faire de même, comme au Brésil en 2017-2018. À travers le monde, les grands intérêts capitalistes (les géants de l’agroalimentaire, de la pharmaceutique, du pétrole et de l’armement) ont systématiquement encouragé l’autoritarisme et la répression, les coups d’État et les guerres impériales. Et en réfutant même les revendications de ses partisan·e·s, ce système social se révèle structurellement incompatible avec la démocratie. Une fois encore, ce sont les femmes qui sont les premières victimes de la crise politique du capitalisme – et qui mènent la lutte pour l’émancipation. Mais, selon nous, installer davantage de femmes dans les citadelles du pouvoir n’est pas une solution. Nous avons toujours été exclues de la sphère politique et avons donc l’habitude de nous battre avec acharnement afin d’être entendues, par exemple sur le harcèlement et les agressions sexuels – des thématiques généralement disqualifiées et reléguées au domaine « privé ». Cependant, et de manière très ironique, les élites « progressistes » ont souvent parlé à notre place en infléchissant nos revendications dans des termes favorables au capital : elles nous invitent ainsi à nous reconnaître dans des femmes politiques (aussi peu recommandables soient-elles), à les soutenir lors des élections et nous demandent de célébrer leur ascension à des positions de pouvoir – comme si c’était un premier pas vers notre libération. Mais est-ce qu’on peut considérer comme féministe le fait que des femmes de la classe dirigeante effectuent le sale boulot ? Lorsqu’elles bombardent d’autres pays et soutiennent des régimes d’apartheid ? Lorsqu’elles mènent des interventions néocoloniales au nom de l’humanitarisme tout en fermant les yeux sur les génocides perpétrés par leurs propres gouvernements ? Lorsqu’elles utilisent les ajustements structurels, les dettes et les mesures d’austérité pour exproprier des populations sans défense ?
La réponse est évidemment négative, car les femmes subissent de plein fouet les conséquences de l’occupation coloniale et de la guerre à travers le monde. Elles affrontent en permanence le harcèlement, le viol et l’esclavage, et endurent le meurtre et la mutilation de leurs proches ainsi que la destruction des infrastructures qui leur ont permis de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Nous sommes solidaires de ces femmes – et non des bellicistes en jupe qui réclament la libération sexuelle et le démantèlement des carcans de genre uniquement pour leurs semblables. Aux bureaucrates d’État et aux gestionnaires financiers, hommes comme femmes, qui prétendent justifier leur violence en affirmant libérer les femmes racisées, nous disons : pas en notre nom.
Thèse 11. Le féminisme pour les 99 % appelle tous les mouvements radicaux à se rejoindre dans une insurrection anticapitaliste commune Les féministes pour les 99 % n’opèrent pas de façon indépendante, isolées des autres mouvements de résistance et de révolte. Nous ne laissons pas de côté les luttes contre le changement climatique ou l’exploitation au travail, nous ne nous désolidarisons pas de celles contre le racisme institutionnel ou la dépossession. Ces combats sont nos combats, et s’inscrivent dans la lutte globale contre le capitalisme sans laquelle il ne pourra être mis fin à l’oppression sexuelle et aux discriminations de genre. La conclusion est claire : le féminisme pour les 99 % doit unir ses forces avec les autres mouvements anticapitalistes à travers le monde – écologistes, antiracistes, anti-impérialistes, LGBTQ+ et organisations syndicales. Nous devons absolument nous allier avec les courants anticapitalistes de gauche qui défendent également les 99 %. Nous sommes donc en opposition totale avec les deux principales options politiques que nous offre le capital. Nous rejetons le populisme réactionnaire tout autant que le néolibéralisme « progressiste ». Et c’est en faisant éclater chacune de ces alliances que nous entendons bâtir notre mouvement. Dans le cas du néolibéralisme progressiste, il faut séparer les femmes de la classe ouvrière, les immigrant·e·s et les personnes racisées de celles et ceux qui les ont détourné·e·s de leurs intérêts afin de favoriser le capitalisme – les féministes d’entreprise, les mouvements antiracistes et LGBTQ+ qui ne jurent que par la méritocratie et ceux
qui promeuvent la diversité d’entreprise et le capitalisme vert. En ce qui concerne le populisme réactionnaire, il faut diviser les communautés de la classe ouvrière et les forces qui encouragent le militarisme, la xénophobie et l’ethnonationalisme et feignent de défendre l’« homme du peuple » alors qu’en réalité elles soutiennent la ploutocratie. Notre stratégie est de faire se rallier les fractions de la classe ouvrière de ces deux blocs politiques procapitalistes. Ainsi, nous pourrons construire une force anticapitaliste suffisamment large et puissante pour transformer la société. La lutte est un lieu d’apprentissage. Elle transforme celles et ceux qui y participent en remettant en cause leurs visions d’eux-mêmes et du monde. Elle permet de mieux comprendre les formes propres de sa domination – ce qui l’engendre, qui en bénéficie et comment la surmonter. Elle incite à réinterpréter ses intérêts, à recadrer ses espoirs et à étendre son sens du possible. Enfin, l’expérience de la lutte aide à mieux cerner ses allié·e·s comme ses ennemi·e·s en élargissant la solidarité parmi les dominé·e·s et en aiguisant ses positions face à celles et ceux qui nous asservissent. Tout dépend de notre capacité à développer une ligne de conduite qui ne se contente ni de célébrer nos différences ni de les effacer brutalement. Contrairement à ce qu’argue l’idéologie de la « diversité », très à la mode aujourd’hui, les oppressions variées dont nous souffrons ne forment pas un ensemble contingent aux contours flous. Si elles prennent chacune des formes propres et portent des caractéristiques distinctives, toutes les oppressions restent enracinées dans (et sont renforcées par) un seul et même système social. C’est en nommant ce système capitalisme et en nous unissant pour le combattre que nous pourrons dépasser les divisions qu’il cultive – clivages de culture, de race, d’ethnie, de capacité, de sexualité ou de genre.
Mais il faut s’accorder sur ce que nous comprenons par « capitalisme ». Le travail salarié au sein d’une usine ne résume pas l’ensemble des expériences de la classe ouvrière et la domination capitaliste ne s’exerce pas uniquement en exploitant ce type d’activité comme le soutiennent les interprétations anciennes et étroites. Insister sur la primauté du seul travail ouvrier ne favorise pas la solidarité de classe mais au contraire l’affaiblit. En réalité, cette solidarité est plus forte lorsque nous reconnaissons nos différences – la diversité de nos modes de vie, de nos expériences et de nos souffrances, la spécificité de nos besoins, de nos désirs et de nos exigences, et la pluralité des formes d’organisation qui nous correspondent. Le féminisme pour les 99 % vise ainsi à surmonter les oppositions classiques et obsolètes entre « politique minoritaire » et « politique de classe ». Rejetant les perspectives que le capitalisme construit pour nous et dont nous ne pouvons que sortir perdant·e·s, le féminisme pour les 99 % cherche à réunir les mouvements existants et futurs en une large insurrection mondiale. À la fois féministes, antiracistes et anticapitalistes, nous nous engageons à jouer un rôle majeur dans la construction d’un avenir commun.
1. « Lean in », dans la version originale, littéralement « se pencher en avant », est le titre d’un ouvrage de Sandberg paru en 2013. (Toutes les notes sont de la traductrice.) 2. « Grève féministe ». 3. « Pas une de moins ! » Ce mouvement argentin protestait contre les violences faites aux femmes et notamment les féminicides. 4. Ce concept, forgé au début des années 2000 par des militantes féministes racisées, applique une lecture intersectionnelle aux
problématiques liées à la santé sexuelle et reproductive, dans une perspective de justice sociale. La justice reproductive s’attache aux droits de chaque individu, mais également à ceux des communautés marginalisées (femmes racisées, minorités sexuelles) en prenant en compte les situations, expériences et obstacles spécifiques de chacune d’elles. 5. Désigne des personnes qui ne se définissent ni comme homme ni comme femme. 6. « Caregiving », soit le fait d’apporter des soins, de l’attention aux proches, aux enfants et aux personnes âgées ou dépendantes. 7. Néologisme formé des mots « bureaucrate » et « féministe » qui désigne les féministes qui font partie de l’appareil d’État et, plus largement, celles qui défendent le système. 8. Les programmes d’ajustement structurel sont des réformes économiques mises en place par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale afin de redresser la situation économique de certains pays. Ils imposent en général des mesures d’austérité très dures et une forte libéralisation de l’économie. 9. Abréviation de « cisgenre », qui désigne les personnes dont le sexe assigné à la naissance correspond à leur identité de genre, contrairement aux personnes trans. 10. Walter Benjamin, dans ses notes préparatoires aux Thèses sur le concept d’histoire (1940). 11. Le terme incels – contraction de « involuntary celibates » (célibataires involontaires) – désignait à l’origine des personnes souffrant de solitude amoureuse et sexuelle qui formaient des communautés en ligne. Depuis la fin des années 2000, il renvoie principalement à des groupes de jeunes hommes masculinistes et misogynes qui prônent la haine des femmes, les considèrent comme des objets sexuels et, dans leur version la plus extrême, glorifient les auteurs de tueries visant des femmes.
12. Mouvement d’activistes homosexuel·le·s organisé pour soutenir des mineurs anglais en grève dans le contexte de l’offensive néolibérale thatchérienne. 13. Karl Marx, Le Capital, livre I, section VIII, chap. 31. 14. Les « global care chains » peuvent être définies comme l’ensemble des relations fondées sur le care qui se déploient à l’échelle mondiale. 15. Mouvement d’opposition à la construction d’un oléoduc dans le Dakota notamment mené par des Amérindien·ne·s. 16. Máxima Acuña, paysanne péruvienne, a mené durant plusieurs années un combat juridique contre l’une des plus importantes compagnies minières au monde et est devenue un symbole de la lutte pour la préservation de l’environnement.
Postface
Commencer par le milieu Écrire un manifeste féministe est un défi de taille. Quiconque s’y essaie aujourd’hui se retrouve dans l’ombre de Marx et Engels. Leur Manifeste du Parti communiste de 1848 s’ouvrait avec cette phrase mémorable : « Un spectre hante l’Europe. » Ce « spectre », bien entendu, c’était le communisme, un projet révolutionnaire qu’ils décrivaient comme l’apogée des luttes menées par la classe ouvrière : unifiée, internationalisée et métamorphosée, elle constituerait bientôt une force mondiale d’une ampleur jamais égalée qui finirait par abolir le capitalisme – et, dans son sillage, l’exploitation, la domination et l’aliénation. Nous sommes profondément inspirées par ces prestigieux prédécesseurs, notamment parce qu’ils identifient très justement la cause essentielle de l’oppression dans la société moderne : le capitalisme. Ils compliquent toutefois notre tâche. Pas seulement parce que leur Manifeste est un chef-d’œuvre littéraire – ce qui, déjà, ne nous facilite pas le travail. Mais surtout car 2018 n’est pas 1848. Il est vrai que nous vivons, nous aussi, dans un monde en plein bouleversement social et politique – ce que nous interprétons, nous aussi, comme une crise du capitalisme. Seulement, le monde d’aujourd’hui est beaucoup plus globalisé que celui de Marx et Engels et les bouleversements qui le traversent ne sont absolument pas circonscrits à l’Europe. Si, comme eux, nous faisons face à des conflits autour des questions nationales, de race/d’ethnicité et de religion (en plus des conflits de classe), nous sommes par ailleurs confronté·e·s à des clivages politiques qui leur étaient inconnus : sur la sexualité, le handicap ou l’écologie. Marx et Engels auraient difficilement pu imaginer l’ampleur et l’intensité qu’ont prises les luttes de genre. Toutefois, nous évoluons dans un paysage politique
hétérogène et fracturé, et il nous est sans doute plus difficile qu’à eux de concevoir l’unification d’une force révolutionnaire au niveau mondial. D’autre part, les dizaines d’années qui nous séparent de Marx et Engels nous ont appris que les mouvements sociaux peuvent mal tourner. Cette histoire est celle de la dégénérescence de la révolution bolchevique en un État stalinien absolutiste, celle de la capitulation de la démocratie sociale en Europe face au nationalisme et à la guerre, celle de l’installation de régimes autoritaires dans les pays du Sud à la suite des luttes décoloniales. Aujourd’hui, nous sommes préoccupé·e·s par la récupération des mouvements d’émancipation, devenus des alliés ou des alibis des forces qui ont favorisé le néolibéralisme. Et cela s’est révélé particulièrement douloureux pour nous, féministes de gauche, qui avons vu des courants libéraux de notre mouvement réduire notre cause à la défense de la méritocratie et de la réussite d’une poignée de femmes privilégiées. Avec cet héritage, nos attentes sont nécessairement différentes de celles de Marx et Engels. Ils écrivaient à une époque où le capitalisme était encore relativement jeune tandis que nous affrontons un système rodé et rusé, bien plus adapté à l’assimilation et à la coercition. Et, aujourd’hui, le paysage politique est truffé de pièges. Le plus dangereux pour le féminisme – nous l’expliquons dans notre manifeste – est de penser que nous n’avons le choix qu’entre deux lignes politiques : d’un côté, une variante « progressiste » du néolibéralisme, qui diffuse une vision entrepreneuriale et élitiste du féminisme afin de dissimuler derrière un masque d’émancipation ses ambitions oligarchiques et dominatrices ; de l’autre, une variante réactionnaire du néolibéralisme, qui poursuit le même programme ploutocratique par d’autres moyens – déployant des tropes racistes et misogynes pour consolider son « populisme ». Et ces deux lignes se renforcent
mutuellement : le néolibéralisme progressiste a créé les conditions de la montée du populisme réactionnaire et se positionne aujourd’hui comme la seule alternative face à lui. Certes, ces lignes ne sont pas identiques, mais elles sont les ennemies mortelles d’un féminisme véritablement majoritaire et émancipatoire. Notre manifeste refuse de prendre parti dans ce duel. Nous suggérons une alternative à ces deux manières de gérer la crise capitaliste et sommes plutôt engagées à la résoudre. Pour cela, nous cherchons à rendre visibles et possibles certaines voies, aujourd’hui obscurcies, menant à l’émancipation. Déterminées à rompre l’alliance confortable du féminisme libéral avec le capital financier, nous proposons un autre féminisme, un féminisme pour les 99 %. Notre projet est né après avoir travaillé ensemble à l’organisation de la grève des femmes de 2017 aux États-Unis. Avant cela, nous avions chacune écrit sur la relation entre le capitalisme et les oppressions de genre. Cinzia Arruzza a analysé les relations complexes entre féminisme et socialisme, dans une perspective à la fois historique et théorique. Tithi Bhattacharya a théorisé les implications de la reproduction sociale pour les concepts de classe et de lutte des classes. Nancy Fraser a développé des interprétations élargies du capitalisme et de la crise capitaliste, dont la crise de la reproduction sociale est l’un des aspects. Nous joignons aujourd’hui nos forces dans l’écriture de ce manifeste car nous partageons la même analyse de la conjoncture. Nous pensons que nous traversons un moment crucial de l’histoire du féminisme et du capitalisme, et qu’il faut intervenir. Nous poursuivons donc un objectif politique : sauver et corriger le cap des luttes féministes dans une époque de grande confusion politique.
Reconceptualiser le capitalisme et sa crise Quand nous parlons de crise dans notre manifeste, nous ne voulons pas simplement dire que « les choses vont mal ». Même si les catastrophes et les souffrances actuelles sont terribles, notre emploi du terme « crise » dépasse son sens habituel : il implique que les innombrables atteintes dont nous sommes victimes sont liées et ne sont pas le fruit du hasard. Elles découlent du système social sur lequel elles reposent – un système qui ne les engendre pas de façon accidentelle, mais par ses dynamiques constitutives. Notre manifeste nomme ce système social capitalisme et caractérise la crise actuelle comme une crise du capitalisme. Et, en tant que féministes, nous pensons que le capitalisme n’est pas simplement un système économique, mais quelque chose de plus large : un ordre social institutionnalisé qui englobe également les relations et les pratiques apparemment « non économiques » nécessaire à l’économie officielle. Derrière les institutions du capitalisme – le travail salarié, la production, le commerce et la finance – se cache ce qui lui permet d’exister et de se perpétuer : les familles, les communautés, la nature ; les États territoriaux, les organisations politiques et la société civile ; et, surtout, le travail exproprié et non rémunéré, effectué par d’innombrables personnes sous des formes très diverses, parmi lesquelles figure une grande part du travail de reproduction sociale, toujours largement assuré par les femmes et souvent sans aucune compensation. Tous ces éléments font partie intégrante de la société capitaliste – et constituent des espaces de lutte en son sein. De cette compréhension élargie du capitalisme découle notre vision de la crise capitaliste. S’il est vrai que le capitalisme, dans son essence même, a tendance à engendrer périodiquement des
effondrements du marché, des séries de faillites et un chômage de masse, il abrite aussi d’autres contradictions et prédispositions favorables au développement de crises non économiques. Il présente notamment une contradiction écologique, une propension à considérer la nature comme un « robinet » qui fournirait l’énergie et les matières premières et, en même temps, comme un « siphon » qui absorberait les déchets – deux capacités que le capital s’approprie librement mais qu’il ne se soucie ni de préserver ni de renouveler. En conséquence, les sociétés capitalistes sont structurellement enclines à déstabiliser et à détruire les écosystèmes qui protègent les communautés et qui assurent la vie. Cette formation sociale abrite également une contradiction politique : le capital cherche systématiquement à limiter l’espace de la politique en soumettant aux « lois du marché » les questions fondamentales de la vie et de la mort et les institutions étatiques censées être au service des citoyens. Pour des raisons systémiques, le capitalisme tend donc à frustrer les aspirations démocratiques, à éroder les droits comme les pouvoirs publics et à provoquer de brutales répressions, des guerres sans fin et des crises de gouvernance. Enfin, la société capitaliste recèle une contradiction de la reproduction sociale : une aptitude à réquisitionner autant que possible le travail reproductif « gratuit », sans aucune attention pour son renouvellement et au bénéfice du seul capital – ce qui provoque inévitablement des « crises du care » qui minent les femmes, ravagent les familles et épuisent l’énergie des individus et des groupes sociaux. En d’autres termes, la crise capitaliste dont nous parlons dans notre manifeste n’est pas simplement économique : c’est aussi une crise écologique, une crise politique et une crise de la reproduction sociale. Et, dans tous les cas, la racine est la même : le capital est, par essence, déterminé à exploiter autant qu’il le peut tout ce qui lui
permet de subsister – et qu’il ne se soucie ni de préserver ni de renouveler. Cela inclut la faculté de l’atmosphère à absorber les émissions de carbone ; la capacité de l’État à défendre la propriété, écraser les révoltes et protéger l’argent ; ou le fait de former les êtres humains et de leur permettre de vivre grâce à un travail de reproduction sociale non rémunéré – ce qui est une problématique majeure, selon nous. Sans ces conditions préalables, le capital ne pourrait ni exploiter les « travailleurs », ni accumuler des profits, ni survivre. Mais sa logique propre l’amène à les invisibiliser. S’il était contraint de payer tout ce qu’il doit pour que la nature, la puissance publique et la société puissent se reproduire, les profits du capital seraient réduits à néant. Mieux vaut cannibaliser les conditions de possibilité du système lui-même que compromettre l’accumulation ! Dans notre manifeste, nous partons donc de l’idée que le capitalisme recèle de multiples contradictions, au-delà du domaine strictement économique. En temps « normal », cette tendance du système à provoquer des crises reste plus ou moins souterraine, ne touchant « que » les populations jugées sacrifiables et impuissantes. Mais nous ne sommes pas en temps normal. Aujourd’hui, toutes les contradictions du capitalisme sont exacerbées. Presque personne – à l’exception des 1 % – n’échappe aux conséquences de la dislocation politique, de la précarité économique et de l’épuisement de la reproduction sociale, et le changement climatique menace de détruire toute vie sur la planète. Il est de plus en plus évident que ces évolutions catastrophiques sont si profondément imbriquées entre elles qu’aucune ne peut être endiguée de manière isolée.
Qu’est-ce que la reproduction sociale ? Notre manifeste s’intéresse à toutes les facettes de la crise actuelle. Mais nous nous concentrons particulièrement sur la question de la reproduction sociale, qui est structurellement liée à l’asymétrie de genre. Approfondissons donc cet aspect : qu’est-ce que la reproduction sociale au juste ? Prenons le cas de « Luo », une mère taiwanaise connue uniquement par son nom de famille. En 2017, elle a intenté un procès à son fils, réclamant une compensation pour le temps et l’argent investis dans son éducation. Luo a élevé seule ses deux fils et les a inscrits dans une école de médecine dentaire. En retour, elle attendait d’eux qu’ils s’occupent (care) d’elle dans ses vieux jours. Lorsque l’un de ses fils a échoué à satisfaire ses exigences, elle l’a poursuivi en justice. La Cour suprême taïwanaise a rendu une décision sans précédent : elle a condamné le fils à verser à sa mère 967 000 $US (soit plus de 850 000 euros) pour ses coûts d’« éducation ». Le cas de Luo illustre trois aspects fondamentaux de la vie sous le capitalisme. Premièrement, il dévoile une vérité universelle que le capitalisme préférerait ignorer et qu’il tente de cacher : la naissance, le soin et la subsistance des êtres humains nécessitent énormément de temps et de ressources. Deuxièmement, il souligne le fait que, dans notre société, une grande partie du travail qui consiste à « créer » les êtres humains et à subvenir à leurs besoins est encore accomplie par les femmes. Enfin, il révèle que la société capitaliste n’accorde aucune valeur à ce travail – bien qu’elle en dépende. Le cas de Luo nous permet d’envisager un quatrième aspect, central dans notre manifeste. La société capitaliste est structurée par deux impératifs étroitement mêlés, mais contradictoires : elle a
besoin de faire du profit pour subsister quand les êtres humains ont, eux, besoin de faire des personnes pour subsister. La « reproduction sociale » se rapporte à ce second impératif. Elle englobe des activités qui permettent de soutenir les êtres humains en tant qu’êtres sociaux incarnés : ils n’ont pas uniquement besoin de manger et de dormir, mais également d’élever leurs enfants, de s’occuper de leur famille et de protéger leur communauté, tout en s’efforçant de réaliser leurs espoirs pour un avenir meilleur. Toutes les sociétés reposent sur ces activités. Cependant, dans les sociétés capitalistes, elles servent un autre maître : le capital, qui a besoin de ce travail de reproduction sociale pour produire et reconstituer la « force de travail ». Le capitalisme, qui cherche à s’assurer un approvisionnement suffisant de cette « marchandise particulière » au plus faible coût possible, se décharge de ce travail sur les femmes, les communautés et les États, et s’arrange pour lui faire prendre les formes lui permettant de maximiser ses profits. Différentes branches de la théorie féministe – notamment les féminismes marxiste et socialiste et la théorie de la reproduction sociale – ont analysé les contradictions entre ces deux impératifs, dévoilant l’instrumentalisation systématique du travail de reproduction sociale par le capital afin de satisfaire les besoins du marché. Les lecteurs et lectrices du Capital de Marx connaissent l’exploitation, cette injustice que le capital inflige aux salarié·e·s par son mode de production : le salaire des travailleurs et travailleuses est censé être suffisant pour leur permettre de subvenir à leurs besoins, mais, en réalité, ce qu’ils et elles produisent dépasse leurs besoins. En résumé, nos patron·ne·s exigent que nous travaillions plus d’heures que ce qui est nécessaire à la reproduction sociale, c’est-à-dire ce qui est nécessaire pour assurer notre subsistance, celle de nos familles et celle des infrastructures sociales. Les
capitalistes s’approprient la plus-value que nous produisons et la distribuent sous forme de profits aux propriétaires des outils de production et aux actionnaires. Les théoricien·ne·s de la reproduction sociale se reconnaissent en partie dans cette définition, mais soulignent qu’elle est inachevée. De la même manière que les féministes socialistes et marxistes, nous posons des questions qui fâchent : que doit faire la travailleuse avant d’aller au travail ? Qui prépare ses repas, fait son lit et apaise sa détresse afin qu’elle supporte jour après jour son travail harassant ? A-t-elle accompli seule ce travail de reproduction sociale – pour elle-même comme pour les membres de sa famille ? Ces questions dévoilent ce que le capitalisme s’évertue à dissimuler : le travail rémunéré qui permet de « faire du profit » ne pourrait exister sans celui (le plus souvent) non rémunéré qui consiste à « faire des personnes ». Le travail salarié, en tant qu’institution capitaliste, masque le mécanisme de la plus-value tout comme le travail de reproduction sociale qui le rend possible. Les processus sociaux et les institutions nécessaires à ces deux types de « production », bien que distincts d’un point de vue analytique, sont au fondement du système capitaliste. Cette distinction elle-même a d’ailleurs été artificiellement créée par la société capitaliste. Si le travail de reproduction sociale a toujours existé (et a toujours été assigné aux femmes), les sociétés plus anciennes ne le séparaient pas de la « production économique ». C’est seulement avec l’avènement du capitalisme que ces deux aspects de l’existence sociale ont été distingués. Les usines, les mines et les bureaux sont devenus les lieux dédiés à la production dite « économique », qui a été rémunérée avec de l’argent sous la forme de salaires. La reproduction a, elle, été reléguée à la sphère de la « famille » et caractérisée comme féminine et sentimentale : on l’a définie comme du « soin » (care) effectué par « amour » et opposé au « travail » qui, lui, permet de
gagner de l’argent. C’est du moins ce qu’on nous a appris car, en réalité, les sociétés capitalistes n’ont jamais circonscrit entièrement la reproduction sociale aux seuls ménages. Elles l’ont également fait reposer sur les communautés, les institutions publiques et la société civile et ont depuis longtemps marchandisé certains segments du travail reproductif – quoique jamais à des niveaux aussi élevés qu’aujourd’hui. Néanmoins, la division entre production et reproduction met en relief une tension bien installée au cœur de la société capitaliste. Alors que le capital aspire uniquement à accroître ses profits, à l’inverse, les personnes de la classe ouvrière se battent en tant qu’êtres sociaux afin de mener des vies décentes et riches de sens. Ces buts sont fondamentalement irréconciliables car l’accumulation du capital ne peut se faire qu’au détriment de nos vies. Les pratiques sociales et les services qui sous-tendent nos existences, au sein des familles comme dans le reste de la société, sont une menace pour le profit. Ainsi, le système est animé par la volonté permanente, à la fois financière et idéologique, de réduire ces coûts et de saper nos efforts. Si l’histoire du capitalisme se résumait au fait que le profit l’emporte sur la vie, le système pourrait d’ores et déjà se proclamer vainqueur. Mais cette histoire est aussi façonnée par des luttes sociales. Ce n’est pas une coïncidence si l’on entend souvent que les ouvriers et les ouvrières luttent pour défendre leur « gagnepain ». C’est une erreur, cependant, de penser que ces revendications ne concernent que le travail, comme l’ont souvent fait les mouvements syndicaux traditionnels. Ils négligent la relation troublée, houleuse entre le travail et la vie dans un système où le capital décrète que la seconde n’est rendue possible que par le premier. Les ouvriers et les ouvrières ne se battent pas pour leur travail en tant que tel, mais parce que celui-ci leur permet de gagner leur pain : le désir de subsistance est la cause et non la
conséquence. Ainsi, les luttes pour la nourriture, le logement, l’eau, les soins ou l’éducation ne se résument pas à des revendications en faveur de l’augmentation des salaires. Rappelons-nous que les deux plus grandes révolutions de l’ère moderne, en France et en Russie, ont commencé par des révoltes du pain menées par des femmes. Le véritable enjeu des luttes pour la reproduction sociale est d’établir la primauté de la vie sur le profit. Et comme elles ne concernent jamais uniquement le pain, le féminisme pour les 99 % incarne et encourage la lutte pour le pain et les roses.
La crise de la reproduction sociale Dans la conjoncture actuelle, la reproduction sociale est en crise, écartelée par les contradictions du capitalisme : alors que le système ne peut fonctionner sans elle, il nie ses coûts et lui accorde peu de valeur économique – voire aucune. Cela signifie que les capacités mises au service du travail de reproduction sociale sont considérées comme acquises, gratuites, illimitées et disponibles en permanence, ne nécessitant ni attention ni renouvellement. Le capitalisme part du principe qu’il y aura toujours suffisamment d’énergies pour « produire » les travailleurs et les travailleuses et entretenir les liens sociaux dont dépendent la production économique et la société dans son ensemble. En réalité, les capacités de reproduction sociale ne sont pas infinies et elles atteignent leurs limites. Quand une société supprime les aides publiques à la reproduction sociale et, simultanément, contraint les personnes sur lesquelles repose cette charge à effectuer un travail éreintant et mal payé, elle épuise les capacités sociales dont elle dépend pourtant. C’est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. Le capitalisme néolibéral appauvrit méthodiquement nos capacités individuelles comme collectives à régénérer les individus et à maintenir les liens sociaux. De prime abord, ce régime semble abattre la division genrée entre travail productif et travail reproductif constitutive du capitalisme. Prônant à travers le monde entier le nouveau modèle de la « famille à deux salaires », le néolibéralisme recrute massivement les femmes dans le travail salarié. Mais cet idéal est une illusion – et est tout sauf libérateur pour les femmes. Présenté comme émancipateur, ce système intensifie en réalité l’exploitation et l’expropriation. C’est en même temps le moteur de la grave crise de la reproduction sociale.
Il est vrai qu’une poignée de femmes tire des avantages du néolibéralisme, par exemple lorsqu’elles accèdent à des professions prestigieuses au sein des directions des grandes entreprises, quoique en des termes moins favorables que ceux des hommes de leur classe. Cependant, la grande majorité des femmes connaît un destin différent : des emplois précaires et mal rémunérés – au sein d’ateliers clandestins, de zones franches industrielles, dans les secteurs du bâtiment, de l’agriculture et des services. Les femmes migrantes, racisées et pauvres travaillent dans des fast-foods et des hypermarchés ; nettoient des bureaux, des chambres d’hôtel et des logements privés ; vident des bassines dans des hôpitaux et des maisons de retraite ; s’occupent (care) des familles les plus privilégiées – souvent au détriment de leur propre famille, dont elles sont parfois éloignées. Une partie de ce travail reproductif n’était auparavant pas rémunérée. Mais cette marchandisation ne participe pas à l’émancipation des femmes et contribue surtout à brouiller la division historique du capitalisme entre production et reproduction. Nous sommes presque toutes réquisitionnées pour ce « deuxième travail1 », même si le capital s’approprie de plus en plus notre temps et notre énergie. Et, bien entendu, le « premier travail » des femmes n’est généralement absolument pas libérateur. Précaire et mal rémunéré, ne permettant pas d’accéder aux droits du travail ni aux prestations sociales, il n’aide pas non plus les femmes à acquérir de l’autonomie, à se réaliser ni à développer des compétences. Ce que ce travail offre vraiment, en revanche, c’est la vulnérabilité face aux abus et aux harcèlements. Autre point tout aussi important : dans le régime néolibéral, nos salaires sont souvent bien insuffisants pour assurer notre propre reproduction sociale, sans parler de celle de nos familles (même lorsqu’un autre membre du foyer perçoit également un salaire).
Certaines d’entre nous sont ainsi contraintes de cumuler les « McJobs » et passent de longues heures dans des transports dangereux, délabrés et chers. Le nombre d’heures de travail salarié par foyer est monté en flèche par rapport à la période d’après guerre, nous laissant peu de temps pour nous ressourcer, prendre soin de nos familles et de nos amis et entretenir nos foyers et nos communautés. Le capitalisme néolibéral ne réalise donc pas une utopie féministe : bien au contraire, il généralise l’exploitation. Aujourd’hui, ce ne sont plus seulement les hommes, mais également les femmes qui, pour survivre, vendent leur force de travail – à bas coût et quand elles le peuvent. Et ce n’est pas tout : l’exploitation se superpose désormais à l’expropriation. Refusant de payer les coûts pour la reproduction de sa propre force de travail (de plus en plus féminisée), le capital ne se « contente » plus de s’approprier la plusvalue produite par les travailleurs et les travailleuses. Il puise également dans les corps, les esprits et les familles de celles et ceux qu’il exploite, les vidant de l’énergie nécessaire à leur survie. Exploiter la reproduction sociale pour en faire une source de profits supplémentaire revient à couper directement dans l’os. L’attaque du capital contre la reproduction sociale passe aussi par la réduction des services publics. Auparavant, lorsque le développement capitaliste était encadré par la social-démocratie ou directement géré par l’État, les classes ouvrières des pays riches avaient obtenu quelques concessions de la part du capital sous la forme d’aides publiques à la reproduction sociale : retraite, assurance chômage, allocations familiales, éducation publique gratuite et assurance maladie. Ce n’était pas pour autant une situation idéale : cette amélioration des conditions de vie des ouvriers reposait sur la dépendance des femmes à l’égard du salaire familial, l’exclusion des personnes racisées de la sécurité sociale, le critère hétéronormatif introduit pour définir qui était éligible à la
protection sociale et la perpétuation des expropriations impériales dans le « tiers monde ». Néanmoins, ces concessions ont offert une protection partielle à certain·e·s face à la prédisposition du capital à cannibaliser la reproduction sociale. Le capitalisme financier néolibéral est fait, lui, d’un autre bois. Loin de permettre (empowering) aux États de perpétuer la reproduction sociale grâce à la mise en place de services publics, il les discipline pour satisfaire les intérêts à court terme d’investisseurs privés. La dette est son arme de prédilection. Le capital financier vit de la dette souveraine, qu’il utilise pour empêcher jusqu’aux plus modestes prestations sociales, forçant les États à libéraliser leurs économies, à ouvrir leurs marchés et à imposer l’« austérité » aux populations sans défense. Parallèlement, il fait proliférer la dette à la consommation – prêts hypothécaires à risque, cartes de crédit, prêts étudiant, prêts sur salaire, microcrédit… – afin de contrôler les paysan·ne·s, les travailleurs et les travailleuses, de les asservir à la terre et à leur emploi, et de s’assurer qu’ils achètent des semences OGM et des biens de consommations à des prix déjà bien trop élevés pour leurs bas salaires. Dans les deux cas, ce régime aiguise la contradiction interne au capitalisme entre impératif d’accumulation et besoins de reproduction sociale. Exigeant simultanément une augmentation exponentielle des heures de travail et la diminution des services publics, il externalise le travail de soin aux familles et aux communautés tout en affaiblissant leur capacité à l’accomplir. Les individus, particulièrement les femmes, doivent donc se plier en quatre pour assumer les responsabilités liées à la reproduction sociale, tout en veillant à les caser dans les interstices de leurs emplois du temps et à ne pas empiéter sur le reste de leur vie dont le capital exige qu’il soit réservé en priorité à sa propre accumulation. Cela implique généralement de se décharger de ce travail de care sur les moins privilégié·e·s, forgeant ce qu’on a appelé des « chaînes mondiales du care » : celles et ceux qui en ont
les moyens embauchent des femmes pauvres, souvent migrantes ou racisées, afin qu’elles prennent en charge leur ménage et s’occupent de leurs enfants et de leurs parents âgés. Ce mécanisme permet aux plus riches de poursuivre leurs carrières dans des professions lucratives, tandis que les travailleuses du care, mal rémunérées, se démènent pour assumer leurs propres responsabilités familiales et domestiques, les transférant souvent à d’autres femmes encore plus pauvres qui, en retour, font de même – et ainsi de suite, souvent sur de grandes distances. Ce scénario s’inscrit dans les stratégies genrées des États postcolonisés écrasés par la dette qui ont été soumis aux ajustements structurels. Cherchant désespérément à acquérir des devises fortes, certains d’entre eux ont activement encouragé les femmes à migrer pour réaliser ce travail de care et envoyer de l’argent à leur famille restée au pays. D’autres ont courtisé les investisseurs étrangers en créant des zones franches industrielles (spécialisées par exemple dans le textile et l’assemblage électronique), qui emploient des ouvrières sous-payées, souvent victimes de violences sexuelles dans le cadre de leur travail. D’une façon ou d’une autre, les capacités de reproduction sociale sont amenuisées. Le décalage en matière de soin (care gap) n’est pas corrigé, bien au contraire, et les inégalités sont seulement déplacées : des familles les plus riches vers les familles les plus pauvres, des pays du Nord vers les pays du Sud. Les plus pauvres effectuant, en échange de (bas) salaires, le travail de care des plus riches, la reproduction sociale est à deux vitesses : marchandisée pour les second·e·s, privatisée pour les premiers·ères. À tout cela s’ajoute ce qui est parfois appelé la « crise du care ». Mais, comme nous le démontrons dans notre manifeste, cette expression peut facilement induire en erreur : la crise est structurelle – donc indissociable d’une crise plus générale du capitalisme contemporain. Étant donné la gravité de cette dernière, il n’est pas
étonnant que les luttes autour de la reproduction sociale aient explosé ces dernières années. Les féministes des pays du Nord revendiquent souvent la nécessité d’un « équilibre entre la famille et le travail ». Mais les luttes autour de la reproduction sociale sont bien plus englobantes : mouvements de minorités pour l’accès au logement, au système de santé, à la sécurité alimentaire et à un revenu de base inconditionnel ; luttes pour les droits des migrant·e·s, des travailleurs et des travailleuses domestiques et des fonctionnaires ; campagnes pour syndiquer celles et ceux qui travaillent dans les cliniques et les maisons de retraite ou les garderies privées ; luttes pour les services publics (comme le travail de care quotidien et de soin aux plus âgé·e·s), la réduction du temps de travail et la juste rémunération des congés parentaux et maternité. L’ensemble de ces revendications nécessite une profonde réorganisation de la relation entre production et reproduction : pour des mesures qui favorisent la vie et les liens sociaux plutôt que le profit ; pour un monde dans lequel n’importe quelle personne – quels que soient son genre, sa nationalité, sa sexualité et sa race – puisse combiner les activités liées à la reproduction sociale avec un travail sûr, bien rémunéré et exempt d’abus.
La politique du féminisme pour les 99 % Cette analyse éclaire la question politique qui est au cœur de notre manifeste : le féminisme doit se soulever à l’occasion de la crise actuelle. Comme nous l’avons dit, le capitalisme pourra au mieux repousser cette crise. Afin de véritablement la résoudre, nous avons besoin d’une forme d’organisation sociale entièrement nouvelle. Notre manifeste ne dessine pas les contours précis de cette alternative car ils doivent émerger des luttes. Mais certains d’entre eux sont déjà clairs. Le sexisme ne peut être défait par une « égalité des chances de dominer » (comme le sous-entend le féminisme libéral) ni par des réformes juridiques (comme le soutient le libéralisme ordinaire). De la même façon, se concentrer exclusivement sur l’exploitation du travail, à la manière des théories socialistes classiques, ne peut contribuer à émanciper les femmes – ni, d’ailleurs, les autres travailleurs. L’instrumentalisation et l’exploitation systématique du travail reproductif non rémunéré par le capital doivent également être ciblées. Ainsi est-il indispensable de défaire le lien tenace entre production et reproduction, l’enchevêtrement entre le profit et les personnes et la subordination des secondes au premier – et donc d’abolir le système qui engendre cette symbiose. Notre manifeste identifie le féminisme libéral comme un obstacle majeur à ce projet émancipateur. Le féminisme radical auquel il a succédé (ou qu’il a renversé) avait émergé dans les années 1970 en lien avec les puissantes luttes anticoloniales qui s’opposaient à la guerre, au racisme et au capitalisme. Partageant leur ethos révolutionnaire, il remettait entièrement en cause les structures de l’ordre existant. Mais cet élan radical s’est épuisé, laissant place à
un nouveau féminisme hégémonique dépouillé de toute aspiration révolutionnaire et utopique – un féminisme qui reflète la culture politique libérale traditionnelle et s’en accommode très bien. Bien sûr, l’histoire ne se résume pas au féminisme libéral. Les activistes féministes anticapitalistes et antiracistes ont continué à se battre. Les féministes noires ont produit de riches analyses de l’intersection entre exploitation de classe, racisme et oppressions de genre, et les récentes théories queer matérialistes ont mis au jour le fait que l’étouffante réification des identités sexuelles et de genre est constitutive du capitalisme. Des collectifs militants ont continué leur dur travail de terrain, jour après jour, et le féminisme marxiste connaît aujourd’hui un renouveau. Depuis les années 1970, le néolibéralisme cherche à affaiblir tous les mouvements défendant la classe ouvrière tout en renforçant les alternatives favorables aux entreprises – parmi lesquelles le féminisme libéral. Pour autant, l’hégémonie de ce dernier commence à s’effriter et une nouvelle vague de radicalisme féministe émerge des décombres. Comme nous le notons dans notre manifeste, l’adoption et la réinvention de la grève, associée traditionnellement aux luttes ouvrières, par ces nouveaux mouvements féministes constituent une innovation majeure. En mettant au cœur de leurs combats le travail salarié comme le travail non rémunéré de reproduction sociale, ils ont dévoilé le rôle indispensable joué par ce dernier dans la société capitaliste. Ils ont rendu visible le pouvoir des femmes et se sont élevés contre les organisations syndicales qui entendaient conserver le « monopole » des grèves. Refusant haut et fort de se plier à l’ordre existant, les grévistes féministes rendent les luttes ouvrières à nouveau démocratiques et réaffirment ce qui devrait pourtant être une évidence : les grèves appartiennent à la classe ouvrière dans son ensemble – et non pas à une seule de ses composantes ou à des organisations particulières.
Ces luttes pourraient avoir de profondes répercussions. Les grèves féministes – nous l’expliquons dans notre manifeste – nous obligent à redéfinir ce qui constitue la classe et ce que recouvre la lutte des classes. Karl Marx a théorisé la classe ouvrière comme « classe universelle ». Ce qu’il voulait dire, c’est qu’en luttant pour vaincre sa propre exploitation et sa propre domination, la classe ouvrière défiait dans le même temps un système social opprimant l’immense majorité de la population mondiale et, ainsi, faisait progresser la cause de toute l’humanité. Toutefois, les disciples de Marx n’ont pas toujours compris que ni la classe ouvrière ni l’humanité ne constituaient des entités homogènes et indifférenciées, et que l’universalité ne pouvait être atteinte en ignorant leurs divisions internes. Nous payons aujourd’hui encore le prix de ces erreurs intellectuelles et politiques. Alors que les néolibéraux célèbrent cyniquement la « diversité » afin d’enjoliver les exactions du capital, trop nombreux·euses sont celles et ceux qui, à gauche, ressassent inlassablement la vieille formule selon laquelle la « classe », homogène et abstraite, est ce qui nous unit tandis que le féminisme et l’antiracisme ne peuvent que nous diviser. Il devient pourtant de plus en plus clair que le portrait type du militant ouvrier (un homme blanc) est en déphasage complet avec notre époque – et n’y a même jamais été fidèle. Nous l’affirmons dans notre manifeste, la classe ouvrière mondiale comprend aujourd’hui des milliards de femmes, de migrant·e·s et de personnes racisées. Ses revendications ne se concentrent pas uniquement sur le travail et s’étendent à la reproduction sociale – des émeutes de la faim qui furent au cœur des révolutions arabes aux mouvements opposés à la gentrification qui ont occupé la place Taksim à Istanbul en passant par les luttes des Indignados contre l’austérité. Notre manifeste rejette à la fois l’approche réductrice de gauche, qui conçoit la classe ouvrière comme une abstraction homogène et vide, et celle du néolibéralisme « progressiste » qui célèbre la
diversité comme s’il s’agissait d’une fin en soi. En leur lieu et place, nous proposons un universalisme façonné par la multiplicité des luttes venant d’en bas. Certes, les différences, les inégalités et les hiérarchies induites par les relations sociales capitalistes donnent réellement lieu à des conflits d’intérêts parmi les opprimé·e·s et les exploité·e·s. Et la prolifération de luttes fragmentaires ne suffira pas à faire émerger des alliances suffisamment larges et robustes pour transformer la société. Cependant, il nous faut prendre au sérieux ces différences sous peine de rendre totalement impossibles de telles alliances. Nous ne proposons ni de les effacer ni de les minimiser : notre manifeste préconise au contraire que nous nous battions contre l’exacerbation et l’instrumentalisation de nos différences par le capitalisme. Le féminisme pour les 99 % incarne cette vision de l’universalisme : toujours en formation, toujours ouvert aux transformations et aux contestations et toujours renouvelé par la solidarité. Le féminisme pour les 99 % est un féminisme anticapitaliste radical – nous ne nous satisferons jamais de pâles ersatz tant que nous n’obtiendrons pas l’égalité, nous ne nous satisferons jamais des droits légaux tant que nous n’obtiendrons pas justice, et nous ne nous satisferons jamais de la démocratie tant que la liberté individuelle ne sera pas indexée sur la liberté de tous et de toutes.
1. « The second shift », titre d’un ouvrage de la sociologue étasunienne Arlie Russel Hochschild, renvoie au travail familial et domestique qui s’ajoute généralement à l’activité professionnelle.