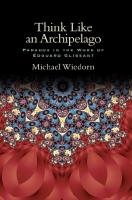Edouard Manet 9781780427867, 1780427867
533 86 45MB
French Pages [200] Year 2012
Polecaj historie
Citation preview
Edouard Manet Emile Zola
Auteurs : Emile Zola (1ère partie), Natalia Brodskaïa (2e partie)
Mise en page : Baseline Co. Ltd 61A-63A Vo Van Tan Street 4e étage District 3, Hô-Chi-Minh-Ville Vietnam
© Confidential Concepts, worldwide, USA © Parkstone Press International, New York, USA
Tous droits d’adaptation et de reproduction, réservés pour tous pays. Sauf mentions contraires, le copyright des œuvres reproduites appartient aux photographes, aux artistes qui en sont les auteurs ou à leurs ayants droit. En dépit de nos recherches, il nous a été impossible d’établir les droits d’auteur dans certains cas. En cas de réclamation, nous vous prions de bien vouloir vous adresser à la maison d’édition. Note de l’éditeur : Par respect pour le travail originel d’Emile Zola, son texte n’a pas été réactualisé dans ses propos en ce qui concerne les changements d’attribution, les datations et la location des œuvres, qui ont été et qui sont encore parfois incertaines. En revanche, les légendes ont été actualisées.
ISBN : 978-1-78042-786-7
Edouard Manet
Sommaire
Edouard Manet par Emile Zola Etude biographique d’Edouard Manet par Natalia Broskaia
7 77
Manet sous la plume des écrivains
192
Bibliographie
195
Liste des illustrations
196
5
6
Edouard Manet par Emile Zola Edouard Manet. Etude biog raphique et critique, 1867
Préface L’étude biographique et critique qu’on va lire a paru dans La Revue du XIXe siècle (numéro du 1er janvier 1867). Je l’ai écrite à la suite d’une visite que je fis à l’atelier d’Edouard Manet, où se trouvaient alors réunies les toiles que l’artiste comptait envoyer à l’Exposition universelle. Depuis ce jour, certains faits se sont produits. Edouard Manet, craignant que le jury d’admission ne pût faire qu’un choix trop restreint parmi ses tableaux et voulant enfin se montrer au public dans l’ensemble complet de ses œuvres et de son talent, s’est décidé à ouvrir une exposition particulière. Je crois devoir choisir l’instant où la foule va être appelée à porter jugement définitif, pour remettre sous les yeux des lecteurs la plaidoirie que j’ai écrite en faveur de l’artiste. Cette plaidoirie a sa date, et je n’ai pas voulu effacer une seule des phrases qui témoignent de l’époque à laquelle je l’ai publiée. Je tiens à constater que l’exposition particulière d’Edouard Manet n’est ici qu’une occasion, et que cette exposition ne m’a pas inspiré la brochure que je mets en vente aujourd’hui. Je ne saurais trop me précautionner contre certaines irritations malveillantes. Il faut donc voir uniquement dans mon travail la simple analyse d’une personnalité vigoureuse et originale, que des sympathies m’ont fait aimer d’instinct. A ce moment, j’ai éprouvé l’impérieux besoin de dire tout haut ce que je pensais tout bas, de démonter un tempérament d’artiste dont le mécanisme me ravissait, et d’expliquer nettement pourquoi j’admirais un talent nouveau qu’il a été de mode jusqu’à cette heure de traîner dans les grosses plaisanteries de notre joli petit esprit français. J’ai fait ma tâche d’anatomiste comme j’ai pu, en souhaitant parfois d’avoir des scalpels encore plus tranchants. D’ailleurs, bien que mes opinions soient vieilles de quatre mois, ce qui est un bel âge pour les opinions d’un publiciste, j’ai la joie de pouvoir les imprimer telles quelles, sans les regretter, sans les modifier, en les étalant et en les affirmant au contraire davantage. Je veux que les éloges accordés par moi à Edouard Manet paraissent le jour même où s’ouvrira son exposition particulière, tant je suis certain d’un grand succès et tant je tiens à l’honneur d’avoir été le premier à saluer la venue d’un nouveau maître. Une autre cause m’a décidé encore à publier ces pages. Eloigné par mes travaux de la critique artistique, ne pouvant m’occuper, cette année, des deux expositions de tableaux qui ont lieu au Champ-de-Mars et aux Champs-Elysées, je désire cependant faire acte de présence et continuer autant que possible l’œuvre que j’ai entreprise, il y a un an, en disant carrément
Portrait d’Emile Zola, 1868. Huile sur toile, 146,5 x 114 cm. Musée d’Orsay, Paris.
7
ce que je pense de l’art contemporain. Mon étude sur Edouard Manet est une simple application de ma façon de voir en matière artistique, et, en attendant mieux, en attendant que je puisse faire un nouveau Salon, je livre à l’appréciation de tous un essai où l’on jugera des mérites et des défauts de la méthode que j’emploie. Edouard Manet a eu l’obligeance de mettre à ma disposition une eau-forte qu’il a gravée d’après son Olympia. Je n’ai pas à louer ici cette eau-forte ; je remercie simplement l’artiste de m’avoir permis de donner la preuve à côté de la démonstration, une œuvre de lui à côté de mes louanges.
Edouard Manet le 1er janvier 1867
Autoportrait à la palette, 1879. Huile sur toile, 83 x 67 cm. Collection privée.
8
C’est un travail délicat que de démonter, pièce à pièce, la personnalité d’un artiste. Une pareille besogne est toujours difficile, et elle se fait seulement en toute vérité et toute largeur sur un homme dont l’œuvre est achevée et qui a déjà donné ce qu’on attend de son talent. L’analyse s’exerce alors sur un ensemble complet ; on étudie sous toutes ses faces un génie entier, on trace un portrait exact et précis, sans craindre de laisser échapper quelques particularités. Et il y a, pour le critique, une joie pénétrante à se dire qu’il peut disséquer un être, qu’il a à faire l’anatomie d’un organisme, et qu’il reconstruira ensuite, dans sa réalité vivante, un homme avec tous ses membres, tous ses nerfs et tout son cœur, toutes ses rêveries et toute sa chair. Etudiant aujourd’hui le peintre Edouard Manet, je ne puis goûter cette joie. Les premières œuvres remarquables de l’artiste datent de six à sept ans au plus. Je n’oserais le juger d’une façon absolue sur les trente à quarante toiles de lui qu’il m’a été permis de voir et d’apprécier. Ici, il n’y a pas un ensemble arrêté ; le peintre en est à cet âge fiévreux où le talent se développe et grandit ; il n’a sans doute révélé jusqu’à cette heure qu’un coin de sa personnalité, et il a devant lui trop de vie, trop d’avenir, trop de hasards de toute espèce, pour que je tente, dans ces pages, d’arrêter sa physionomie d’un trait définitif. Je n’aurais certainement pas entrepris de tracer la simple silhouette qu’il m’est permis de donner, si des raisons particulières et puissantes ne m’y avaient déterminé. Les circonstances ont fait d’Edouard Manet, encore tout jeune, un sujet d’étude des plus curieux et des plus instructifs. La position étrange que le public, même les critiques, et les artistes ses confrères lui ont créée dans l’art contemporain, m’a paru devoir être nettement étudiée et expliquée. Et ici ce n’est plus seulement la personnalité d’Edouard Manet que je cherche à analyser, c’est notre mouvement artistique lui-même, ce sont les opinions contemporaines en matière d’esthétique. Un cas curieux s’est présenté, et ce cas est celui-ci, en deux mots. Un jeune peintre a obéi très naïvement à des tendances personnelles de vue et de compréhension ; il s’est mis à peindre en dehors des règles sacrées enseignées dans les écoles ; il a ainsi produit des œuvres particulières, d’une saveur amère et forte, qui ont blessé les yeux des gens habitués à d’autres aspects. Et voilà que ces gens, sans chercher à s’expliquer pourquoi leurs yeux étaient blessés, ont injurié le jeune peintre, l’ont insulté
9
Le Buveur d’absinthe, vers 1859. Huile sur toile, 180,5 x 105,6 cm. Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague. L’Enfant aux cerises, 1858-1859. Huile sur toile, 65,5 x 54,5 cm. Fondação Calouste Gulbenkian, Lisbonne.
10
11
12
dans sa bonne foi et dans son talent, ont fait de lui une sorte de pantin grotesque qui tire la langue pour amuser les badauds. N’est-ce pas qu’une telle émeute est chose intéressante à étudier, et qu’un curieux indépendant comme moi a raison de s’arrêter en passant devant la foule ironique et bruyante qui entoure le jeune peintre et qui le poursuit de ses huées ? J’imagine que je suis en pleine rue et que je rencontre un attroupement de gamins qui accompagnent Edouard Manet à coups de pierres. Les critiques d’art – pardon, les sergents de ville – font mal leur office ; ils accroissent le tumulte au lieu de le calmer, et même, Dieu me pardonne ! il me semble que les sergents de ville ont d’énormes pavés dans leurs mains. Il y a déjà, dans ce spectacle, une certaine grossièreté qui m’attriste, moi, passant désintéressé, d’allures calmes et libres. Je m’approche, j’interroge les gamins, j’interroge les sergents de ville, j’interroge Edouard Manet lui-même. Et une conviction se fait en moi. Je me rends compte de la colère des gamins et de la mollesse des sergents de ville ; je sais quel crime a commis ce paria qu’on lapide. Je rentre chez moi, et je dresse, pour l’honneur de la vérité, le procès-verbal qu’on va lire. Je n’ai évidemment qu’un but : apaiser l’irritation aveugle des émeutiers, les faire revenir à des sentiments plus intelligents, les prier d’ouvrir les yeux, et, en tout cas, de ne pas crier ainsi dans la rue. Et je leur demande une saine critique, non pour Edouard Manet seulement, mais encore pour tous les tempéraments particuliers qui se présenteront. Ma plaidoirie s’élargit, mon but n’est plus l’acceptation d’un seul homme, il devient l’acceptation de l’art tout entier. En étudiant dans Edouard Manet l’accueil fait aux personnalités originales, je proteste contre cet accueil, je fais d’une question individuelle une question qui intéresse tous les véritables artistes. Ce travail, pour plusieurs causes, je le répète, ne saurait donc être un portrait définitif ; c’est la simple constatation d’un état présent, c’est un procès-verbal dressé sur des faits regrettables qui me semblent révéler tristement le point où près de deux siècles de tradition ont conduit la foule en matière artistique.
I. L’Homme et l’artiste Edouard Manet est né à Paris en 1833. Je n’ai sur lui que peu de détails biographiques. La vie d’un artiste, en nos temps corrects et policés, est celle d’un bourgeois tranquille, qui peint des tableaux dans son atelier comme d’autres vendent du poivre derrière leur comptoir. La race chevelue de 1830 a même, Dieu merci ! complètement disparu, et nos peintres sont devenus ce qu’ils doivent être, des gens vivant la vie de tout le monde. Après avoir passé quelques années chez l’abbé Poiloup, à Vaugirard, Edouard Manet termina ses études au collège Rollin. A dix-sept ans, comme il sortait du collège, il se prit d’amour pour la peinture. Terrible amour que celui-là ! Les parents tolèrent une maîtresse, et même deux ; ils ferment les yeux, s’il est nécessaire, sur le dévergondage du cœur et des sens. Mais les arts, la peinture est pour eux la grande Impure, la Courtisane toujours affamée de chair fraîche qui doit boire le sang de leurs enfants et les tordre tout pantelants sur sa gorge insatiable. Là est l’orgie, la débauche sans pardon, le spectre sanglant qui se dresse parfois
La Nymphe surprise, 1858-1860. Huile sur toile, 64 x 25 cm. Collection privée.
13
La Pêche, vers 1860-1861. Crayon et aquarelle, 21 x 29 cm. Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam. Portrait de Roudier, vers 1860. Sanguine, 19,8 x 15,5 cm. Musée d’Orsay, Paris. Portrait d’un homme, 1860. Huile sur toile, 61 x 50 cm. Kröller-Müller Museum, Otterlo.
14
au milieu des familles et qui trouble la paix des foyers domestiques. Naturellement, à dix-sept ans, Edouard Manet s’embarqua comme novice sur un vaisseau qui se rendait à Rio de Janeiro. Sans doute la grande Impure, la Courtisane toujours affamée de chair fraîche s’embarqua avec lui et acheva de le séduire au milieu des solitudes lumineuses de l’Océan et du ciel ; elle s’adressa à sa chair, elle balança amoureusement devant ses yeux les lignes éclatantes des horizons, elle lui parla de passion avec le langage doux et vigoureux des couleurs. Au retour, Edouard Manet appartenait tout entier à l’Infâme. Il laissa la mer et alla visiter l’Italie et la Hollande. D’ailleurs, il s’ignorait encore, il se promena en jeune naïf, il perdit son temps. Et ce qui le prouve, c’est qu’en arrivant à Paris, il entra comme élève à l’atelier de Thomas Couture et y resta pendant près de six ans, les bras liés par les préceptes et les conseils, pataugeant en pleine médiocrité, ne sachant pas trouver sa voie. Il y avait en lui un tempérament particulier qui ne put se plier à ces premières leçons, et l’influence de cette éducation artistique contraire à sa nature agit sur ses travaux même après sa sortie de l’atelier du maître : pendant trois années, il se débattit dans son ombre, il travailla sans trop savoir ce qu’il voyait ni ce qu’il voulait. Ce fut en 1860 seulement qu’il peignit Le Buveur d’absinthe (p.10), une toile où l’on trouve encore une vague impression des œuvres de Thomas Couture, mais qui contient déjà en germe la manière personnelle de l’artiste. Depuis 1860, sa vie artistique est connue du public. On se souvient de la sensation étrange que produisirent quelques-unes de ses toiles à l’exposition Martinet et au Salon des Refusés, en 1863 ; on se rappelle également le tumulte qu’occasionnèrent ses tableaux : Le Christ et les anges et Olympia (p.44-45), aux Salons de 1864 et de 1865. En étudiant ses œuvres, je reviendrai sur cette période de sa vie. Edouard Manet est de taille moyenne, plutôt petite que grande. Les cheveux et la barbe sont d’un châtain pâle ; les yeux, étroits et profonds, ont une vivacité et une flamme juvéniles ; la bouche est caractéristique, mince, mobile, un peu moqueuse dans les coins. Le visage entier, d’une irrégularité fine et intelligente, annonce la souplesse et l’audace, le mépris de la sottise et de la banalité. Et si du visage nous descendons à la personne, nous trouvons dans Edouard Manet un homme d’une amabilité et d’une politesse exquises, d’allures distinguées et d’apparence sympathique. Je suis bien forcé d’insister sur ces détails infiniment petits. Les farceurs contemporains, ceux qui gagnent leur pain en faisant rire le public, ont fait d’Edouard Manet une sorte de bohème, de galopin, de croque-mitaine ridicule. Et le public a accepté, comme autant de vérités, les plaisanteries et les caricatures. La vérité s’accommode mal de ces pantins de fantaisie créés par les rieurs à gages, et il est bien de montrer l’homme réel. L’artiste m’a avoué qu’il adorait le monde et qu’il trouvait des voluptés secrètes dans les délicatesses parfumées et lumineuses des soirées. Il y est entraîné sans doute par son amour des couleurs larges et vives ; mais il y a aussi, au fond de lui, un besoin inné de distinction et d’élégance que je me fais fort de retrouver dans ses œuvres. Ainsi telle est sa vie. Il travaille avec âpreté, et le nombre de ses toiles est déjà considérable ; il peint sans découragement, sans lassitude, marchant droit devant lui, obéissant à sa nature. Puis il rentre dans son intérieur et y goûte les joies calmes de la bourgeoisie moderne ; il fréquente le monde assidûment, il mène l’existence de chacun, avec cette différence qu’il est peut-être encore plus paisible et mieux
15
16
17
élevé que chacun. J’avais vraiment besoin d’écrire ces lignes, avant de parler d’Edouard Manet comme artiste. Je me sens beaucoup plus à l’aise maintenant pour dire aux gens prévenus ce que je crois être la vérité. J’espère qu’on cessera de traiter de rapin débraillé l’homme dont je viens d’esquisser la physionomie en quelques traits, et qu’on prêtera une attention polie aux jugements très désintéressés que je vais porter sur un artiste convaincu et sincère. Je suis persuadé que le profil exact de l’Edouard Manet réel surprendra bien des personnes ; on l’étudiera désormais avec des rires moins indécents et une attention plus convenable. La question devient celle-ci : ce peintre assurément peint d’une façon toute naïve et toute recueillie, et il s’agit seulement de savoir s’il fait œuvre de talent ou s’il se trompe grossièrement. Je ne voudrais pas poser en principe que l’insuccès d’un élève, obéissant à la direction d’un maître, est la marque d’un talent original, et tirer de là un argument en faveur d’Edouard Manet perdant son temps chez Thomas Couture. Il y a forcément, pour chaque artiste, une période de tâtonnements et d’hésitations qui dure plus ou moins longtemps : il est admis que chacun doit passer cette période dans l’atelier d’un professeur, et je ne vois pas de mal à cela ; les conseils, s’ils retardent parfois l’éclosion des talents originaux, ne les empêchent pas de se manifester un jour, et on les oublie parfaitement tôt ou tard, pour peu qu’on ait une individualité de quelque puissance. Mais, dans le cas présent, il me plaît de considérer l’apprentissage long et pénible d’Edouard Manet comme un symptôme d’originalité. La liste serait longue, si je nommais ici tous ceux que leurs maîtres ont découragés et qui sont devenus ensuite des hommes de premier mérite. « Vous ne ferez jamais rien », dit le magister, et cela signifie sans doute : « Hors de moi pas de salut, et vous n’êtes pas moi. » Heureux ceux que les maîtres ne reconnaissent pas pour leurs enfants ! Ils sont d’une race à part, ils apportent chacun leur mot dans la grande phrase que l’humanité écrit et qui ne sera jamais complète ; ils ont pour destinées d’être des maîtres à leur tour, des égoïstes, des personnalités nettes et tranchées. Ce fut donc au sortir des préceptes d’une nature différente de la sienne qu’Edouard Manet essaya de chercher et de voir par lui-même. Je le répète, il resta pendant trois ans tout endolori des coups de férule qu’il avait reçus. Il avait sur le bout de la langue, comme on dit, le mot nouveau qu’il apportait, et il ne pouvait le prononcer. Puis, sa vue s’éclaircit, il distingua nettement les choses, sa langue ne fut plus embarrassée, et il parla. Il parla un langage plein de rudesse et de grâce qui effaroucha fort le public. Je n’affirme point que ce fut là un langage entièrement nouveau et qu’il ne contînt pas quelques tournures espagnoles sur lesquelles j’aurai d’ailleurs à m’expliquer. Mais il était aisé de comprendre, à la hardiesse et à la vérité de certaines images, qu’un artiste nous était né. Celui-là parlait une langue qu’il avait faite sienne et qui désormais lui appartenait en propre. Voici comment je m’explique la naissance de tout véritable artiste, celle d’Edouard Manet, par exemple. Sentant qu’il n’arrivait à rien en copiant les maîtres, en peignant la nature vue au travers des individualités différentes de la sienne, il aura compris, tout naïvement, un beau matin, qu’il lui restait à essayer de voir la nature telle qu’elle est, sans la regarder dans les œuvres et dans les opinions des autres. Dès que cette idée lui fut venue, il prit un objet quelconque, un être ou une chose, le plaça dans un coin de son atelier, et se mit à le reproduire sur une toile, selon ses facultés
Monsieur et madame Auguste Manet, 1860. Huile sur toile, 110 x 90 cm. Musée d’Orsay, Paris.
19
Les Etudiants de Salamanque, 1860. Huile sur toile, 72 x 92 cm. Collection privée. Cavaliers espagnols, vers 1860. Huile sur toile, 45,5 x 26,5 cm. Musée des Beaux-Arts de Lyon, Lyon. Enfant portant un plateau, 1861-1862. Aquarelle, gouache et fusain sur papier, 21,5 x 11,5 cm. The Phillips Collection, Washington, D.C.
20
de vision et de compréhension. Il fit un effort pour oublier tout ce qu’il avait étudié dans les musées ; il tâcha de ne plus se rappeler les conseils qu’il avait reçus, les œuvres peintes qu’il avait regardées. Il n’y eut plus là qu’une intelligence particulière, servie par des organes doués d’une certaine façon, mise en face de la nature et la traduisant à sa manière. L’artiste obtint ainsi une œuvre qui était sa chair et son sang. Certainement cette œuvre tenait à la grande famille des œuvres humaines ; elle avait des sœurs parmi les milliers d’œuvres déjà créées ; elle ressemblait plus ou moins à certaines d’entre elles. Mais elle était belle d’une beauté propre, je veux dire vivante d’une vie personnelle. Les éléments divers qui la composaient, pris peut-être ici et là, venaient se fondre en un tout d’une saveur nouvelle et d’un aspect particulier, et ce tout créé pour la première fois était une face encore inconnue du génie humain. Désormais, Edouard Manet avait trouvé sa voie, ou, pour mieux dire, il s’était trouvé lui-même : il voyait de ses yeux, il devait nous donner dans chacune de ses toiles une traduction de la nature en cette langue originale qu’il venait de découvrir au fond de lui. Et, maintenant, je supplie le lecteur qui a bien voulu me lire jusqu’ici et qui a la bonne volonté de me comprendre, de se placer au seul point de vue logique qui permet de juger sainement une œuvre d’art. Sans cela nous ne nous entendrions jamais ; il garderait les croyances admises, je partirais d’axiomes tout autres, et nous irions ainsi, nous séparant de plus en plus l’un de l’autre : à la dernière ligne, il me traiterait de fou, et je le traiterais d’homme peu intelligent. Il lui faut procéder comme l’artiste a procédé lui-même : oublier les richesses des musées et les nécessités des prétendues règles, chasser le souvenir des tableaux entassés par les peintres morts ; ne plus voir que la nature face à face, telle qu’elle est ; ne chercher enfin dans les œuvres d’Edouard Manet qu’une traduction de la réalité, particulière à un tempérament, belle d’un intérêt humain. Je suis forcé, à mon grand regret, d’exposer ici quelques idées générales. Mon esthétique, ou plutôt la science que j’appellerai l’esthétique moderne, diffère trop des dogmes enseignés jusqu’à ce jour, pour que je me hasarde à parler avant d’avoir été parfaitement compris. Voici quelle est l’opinion de la foule sur l’art, sur la peinture en particulier. Il y a un beau absolu, placé en dehors de l’artiste, ou, pour mieux dire, une perfection idéale vers laquelle chacun tend et que chacun atteint plus ou moins. Dès lors, il y a une commune mesure qui est ce beau lui-même ; on applique cette commune mesure sur chaque œuvre produite, et selon que l’œuvre se rapproche ou s’éloigne de la commune mesure, on déclare que cette œuvre a plus ou moins de mérite. Les circonstances ont voulu qu’on choisisse pour étalon le beau grec, de sorte que les jugements portés sur toutes les œuvres d’art créées par l’humanité, résultent du plus ou du moins de ressemblance de ces œuvres avec les œuvres grecques. Ainsi, voilà la large production du génie humain, toujours en enfantement, réduite à la simple éclosion du génie grec. Les artistes de ce pays ont trouvé le beau absolu, et, dès lors, tout a été dit ; la commune mesure étant fixée, il ne s’agissait plus que d’imiter et de reproduire les modèles le plus exactement possible. Et il y a des gens qui vous prouvent que les artistes de la Renaissance ne furent grands que parce qu’ils furent imitateurs. Pendant plus de deux mille ans, le monde se transforme, les civilisations s’élèvent et s’écroulent, les sociétés se précipitent ou languissent, au milieu de mœurs toujours
21
22
23
24
changeantes ; et, d’autre part, les artistes naissent ici et là, dans les matinées pâles et froides de la Hollande, dans les soirées chaudes et voluptueuses de l’Italie et de l’Espagne. Qu’importe ! le beau absolu est là, immuable, dominant les âges ; on brise misérablement contre lui toute cette vie, toutes ces passions et toutes ces imaginations qui ont joui et souffert pendant plus de deux mille ans. Voici maintenant quelles sont mes croyances en matière artistique. J’embrasse d’un regard l’humanité qui a vécu et qui, devant la nature, à toute heure, sous tous les climats, dans toutes les circonstances, s’est senti l’impérieux besoin de créer humainement, de reproduire par les arts les objets et les êtres. J’ai ainsi un vaste spectacle dont chaque partie m’intéresse et m’émeut profondément. Chaque grand artiste est venu nous donner une traduction nouvelle et personnelle de la nature. La réalité est ici l’élément fixe, et les divers tempéraments sont les éléments créateurs qui ont donné aux œuvres des caractères différents. C’est dans ces caractères différents, dans ces aspects toujours nouveaux, que consiste pour moi l’intérêt puissamment humain des œuvres d’art. Je voudrais que les toiles de tous les peintres du monde fussent réunies dans une immense salle, où nous pourrions aller lire page par page l’épopée de la création humaine. Et le thème serait toujours la même nature, la même réalité, et les variations seraient les façons particulières et originales, à l’aide desquelles les artistes auraient rendu la grande création de Dieu. C’est au milieu de cette immense salle que la foule doit se placer pour juger
Femme à sa toilette, 1861. Craie. Courtauld Institute of Art, Londres. Etude pour Olympia, 1862-1863. Craie, 22,5 x 30 cm. Bibliothèque nationale de France, Paris.
25
Les Chaussons de ballet, vers 1862. Aquarelle sur crayon, 7,6 x 10,5 cm. Collection Alex Lewyt.
26
sainement les œuvres d’art ; le beau n’est plus ici une chose absolue, une commune mesure ridicule ; le beau devient la vie humaine elle-même, l’élément humain se mêlant à l’élément fixe de la réalité et mettant au jour une création qui appartient à l’humanité. C’est dans nous que vit la beauté, et non en dehors de nous. Que m’importe une abstraction philosophique, que m’importe une perfection rêvée par un petit groupe d’hommes. Ce qui m’intéresse, moi homme, c’est l’humanité, ma grande mère ; ce qui me touche, ce qui me ravit, dans les créations humaines, dans les œuvres d’art, c’est de retrouver au fond de chacune d’elles un artiste, un frère, qui me présente la nature sous une face nouvelle, avec toute la puissance ou toute la douceur de sa personnalité. Cette œuvre, ainsi envisagée, me conte l’histoire d’un cœur et d’une chair, elle me parle d’une civilisation et d’une contrée. Et lorsque, au centre de l’immense salle où sont pendus les tableaux de tous les peintres du monde, je jette un coup d’œil sur ce vaste ensemble, j’ai là le même poème en mille langues différentes, et je ne me lasse pas de le relire dans chaque tableau, charmé des délicatesses et des vigueurs de chaque dialecte. Je ne puis donner ici, dans son entier, le livre que je me propose d’écrire sur mes croyances artistiques, et je me contente d’indiquer à larges traits ce qui est et ce que je crois. Je ne renverse aucune idole, je ne nie aucun artiste. J’accepte
Jeune Femme en costume de torero, vers 1862. Lavis, 18,4 x 14,5 cm. Collection André Bromberg.
27
28
toutes les œuvres d’art au même titre, au titre de manifestations du génie humain. Et elles m’intéressent presque également, elles ont toutes la véritable beauté : la vie, la vie dans ses mille expressions, toujours changeantes, toujours nouvelles. La ridicule commune mesure n’existe plus ; le critique étudie une œuvre en elle-même, et la déclare grande lorsqu’il trouve en elle une traduction forte et originale de la réalité ; il affirme alors que la Genèse de la création humaine a une page de plus, qu’il est né un artiste donnant à la nature une nouvelle âme et de nouveaux horizons. Et notre création s’étend du passé à l’infini de l’avenir chaque société apportera ses artistes qui apporteront leur personnalité. Aucun système, aucune théorie ne peut contenir la vie dans ses productions incessantes. Notre rôle, à nous juges des œuvres d’art, se borne donc à constater les langages des tempéraments, à étudier ces langages, à dire ce qu’il y a en eux de nouveauté souple et énergique. Les philosophes, s’il est nécessaire, se chargeront de rédiger des formules. Je ne veux analyser que des faits, et les œuvres d’art sont de simples faits. Donc, j’ai mis à part le passé, je n’ai ni règle ni étalon dans les mains, je me place devant les tableaux d’Edouard Manet comme devant des faits nouveaux que je désire expliquer et commenter. Ce qui me frappe d’abord dans ces tableaux, c’est une justesse très délicate dans les rapports des tons entre eux. Je m’explique. Des fruits sont posés sur une table et se détachent contre un fond gris ; il y a entre les fruits, selon qu’ils sont plus ou moins rapprochés, des valeurs de coloration formant toute une gamme de teintes. Si vous partez d’une note plus claire que la note réelle, vous devrez suivre une gamme toujours plus claire ; et le contraire devra avoir lieu, lorsque vous partirez d’une note plus foncée. C’est là ce qu’on appelle, je crois, la loi des valeurs. Je ne connais guère, dans l’école moderne, que Corot, Courbet et Edouard Manet qui aient constamment obéi à cette loi en peignant des figures. Les œuvres y gagnent une netteté singulière, une grande vérité et un grand charme d’aspect. Edouard Manet, d’ordinaire, part d’une note plus claire que la note existant dans la nature. Ses peintures sont blondes et lumineuses, d’une pâleur solide. La lumière tombe blanche et large, éclairant les objets d’une façon douce. Il n’y a pas là le moindre effet forcé ; les personnages et les paysages baignent dans une sorte de clarté gaie qui emplit la toile entière. Ce qui me frappe ensuite, c’est une conséquence nécessaire de l’observation exacte de la loi des valeurs. L’artiste, placé en face d’un sujet quelconque, se laisse guider par ses yeux qui aperçoivent ce sujet en larges teintes se commandant les unes les autres. Une tête posée contre un mur, n’est plus qu’une tache plus ou moins blanche sur un fond plus ou moins gris ; et le vêtement juxtaposé à la figure devient par exemple une tache plus ou moins bleue mise à côté de la tache plus ou moins blanche. De là une grande simplicité, presque point de détails, un ensemble de taches justes et délicates qui, à quelques pas, donne au tableau un relief saisissant. J’appuie sur ce caractère des œuvres d’Edouard Manet, car il domine en elles et les fait ce qu’elles sont. Toute la personnalité de l’artiste consiste dans la manière dont son œil est organisé : il voit blond, et il voit par masses. Ce qui me frappe en troisième lieu, c’est une grâce un peu sèche, mais charmante. Entendons-nous : je ne parle pas de cette grâce rose et blanche qu’ont les têtes en porcelaine des poupées, je parle d’une grâce pénétrante et véritablement humaine.
Mademoiselle V… en costume d’espada, 1862. Huile sur toile, 165,1 x 127,6 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York. La Musique aux Tuileries, 1862. Huile sur toile, 76,2 x 118,1 cm. The National Gallery, Londres.
29
30
31
Portrait de Victorine Meurent, vers 1862. Huile sur toile, 42,9 x 43,8 cm. Museum of Fine Arts, Boston.
32
Edouard Manet est homme du monde, et il y a dans ses tableaux certaines lignes exquises, certaines attitudes grêles et jolies qui témoignent de son amour pour les élégances des salons. C’est là l’élément inconscient, la nature même du peintre. Et je profite de l’occasion pour protester contre la parenté qu’on a voulu établir entre les tableaux d’Edouard Manet et les vers de Charles Baudelaire. Je sais qu’une vive sympathie a rapproché le poète et le peintre, mais je crois pouvoir affirmer que ce dernier n’a jamais fait la sottise, commise par tant d’autres, de vouloir mettre des idées dans sa peinture. La courte analyse que je viens de donner de son talent prouve avec quelle naïveté il se place devant la nature ; s’il assemble plusieurs objets ou plusieurs figures, il est seulement guidé dans son choix par le désir d’obtenir de belles taches, de belles oppositions. Il est ridicule de vouloir faire un rêveur mystique d’un artiste obéissant à un pareil tempérament. Après l’analyse, la synthèse. Prenons n’importe quelle toile de l’artiste et n’y cherchons pas autre chose que ce qu’elle contient : des objets éclairés, des créatures réelles. L’aspect général, je l’ai dit, est d’un blond lumineux. Dans la lumière diffuse, les visages sont taillés à larges pans de chair, les lèvres deviennent de simples traits, tout se simplifie et s’enlève sur le fond par masses puissantes. La justesse des tons établit les plans, remplit la toile d’air, donne la force à chaque chose. On a dit, par moquerie, que les toiles d’Edouard Manet rappelaient les gravures d’Epinal, et il y a beaucoup de vrai dans cette moquerie qui est un éloge ; ici et là les procédés sont les mêmes, les teintes sont appliquées par plaques, avec cette différence que les ouvriers d’Epinal emploient les tons purs, sans se soucier des valeurs, et qu’Edouard Manet multiplie les tons et met entre eux les rapports justes. Il serait beaucoup plus intéressant de comparer cette peinture simplifiée avec les gravures japonaises qui lui ressemblent par leur élégance étrange et leurs taches magnifiques. L’impression première que produit une toile d’Edouard Manet est un peu dure. On n’est pas habitué à voir des traductions aussi simples et aussi sincères de la réalité. Puis, je l’ai dit, il y a quelques raideurs élégantes qui surprennent. L’œil n’aperçoit d’abord que des teintes plaquées largement. Bientôt les objets se dessinent et se mettent à leur place ; au bout de quelques secondes, l’ensemble apparaît, vigoureux et solide, et l’on goûte un véritable charme à contempler cette peinture claire et grave, qui rend la nature avec une brutalité douce, si je puis m’exprimer ainsi. En s’approchant du tableau, on voit que le métier est plutôt délicat que brusque ; l’artiste n’emploie que la brosse et s’en sert très prudemment ; il n’y a pas des entassements de couleurs, mais une couche unie. Cet audacieux dont on s’est moqué, a des procédés fort sages, et si ses œuvres ont un aspect particulier, elles ne le doivent qu’à la façon toute personnelle dont il aperçoit et traduit les objets. En somme, si l’on m’interrogeait et si on me demandait quelle langue nouvelle parle Edouard Manet, je répondrais : il parle une langue faite de simplicité et de justesse. La note qu’il apporte est cette note blonde emplissant la toile de lumière. La traduction qu’il nous donne est une traduction juste et simplifiée, procédant par grands ensembles, n’indiquant que les masses. Il nous faut, je ne saurais trop le répéter, oublier mille choses pour comprendre et goûter ce talent. Il ne s’agit plus ici d’une recherche de la beauté absolue ; l’artiste ne peint ni l’histoire ni l’âme ; ce qu’on appelle la composition n’existe pas pour lui, et la tâche qu’il s’impose n’est point de représenter telle pensée ou tel acte historique.
33
34
Et c’est pour cela qu’on ne doit le juger ni en moraliste, ni en littérateur ; on doit le juger en peintre. Il traite les tableaux de figures comme il est permis, dans les écoles, de traiter les tableaux de nature morte ; je veux dire qu’il groupe les figures devant lui, un peu au hasard, et qu’il n’a ensuite souci que de les fixer sur la toile telles qu’il les voit, avec les vives oppositions qu’elles font en se détachant les unes sur les autres. Ne lui demandez rien d’autre qu’une traduction d’une justesse littérale. Il ne saurait ni chanter ni philosopher. Il sait peindre, et voilà tout : il a le don, et c’est là son tempérament propre, de saisir dans leur délicatesse les tons dominants et de pouvoir ainsi modeler à grands plans les choses et les êtres. Il est un enfant de notre âge. Je vois en lui un peintre analyste. Tous les problèmes ont été remis en question, la science a voulu avoir des bases solides, et elle en est revenue à l’observation exacte des faits. Et ce mouvement ne s’est pas seulement produit dans l’ordre scientifique ; toutes les connaissances, toutes les œuvres humaines tendent à chercher dans la réalité des principes fermes et définitifs. Nos paysagistes modernes l’emportent de beaucoup sur nos peintres d’histoire et de genre, parce qu’ils ont étudié nos campagnes, se contentant de traduire le premier coin de forêt venu. Edouard Manet applique la même méthode à chacune de ses œuvres ; tandis que d’autres se creusent la tête pour inventer une nouvelle Mort de César ou un nouveau Socrate buvant la ciguë, il place tranquillement dans un coin de son atelier quelques objets et quelques personnes, et se met à peindre, en analysant le tout avec soin. Je le répète, c’est un simple analyste ; sa besogne a bien plus d’intérêt que les plagiats de ses confrères ; l’art lui-même tend ainsi vers une certitude ; l’artiste est un interprète de ce qui est, et ses œuvres ont pour moi le grand mérite d’une description précise faite en une langue originale et humaine. On lui a reproché d’imiter les maîtres espagnols. J’accorde qu’il y ait quelque ressemblance entre ses premières œuvres et celles de ces maîtres : on est toujours fils de quelqu’un. Mais, dès son Déjeuner sur l’herbe (p.36-37), il me paraît affirmer nettement cette personnalité que j’ai essayé d’expliquer et de commenter brièvement. La vérité est peut-être que le public, en le voyant peindre des scènes et des costumes d’Espagne, aura décidé qu’il prenait ses modèles au-delà des Pyrénées. De là à l’accusation de plagiat, il n’y a pas loin. Or, il est bon de faire savoir que, si Edouard Manet a peint des espada et des majo, c’est qu’il avait dans son atelier des vêtements espagnols et qu’il les trouvait beaux de couleur. Il a traversé l’Espagne en 1865 seulement, et ses toiles ont un accent trop individuel pour qu’on veuille ne trouver en lui qu’un bâtard de Velàzquez et de Goya.
II. Les Œuvres Je puis, maintenant, en parlant des œuvres d’Edouard Manet, me faire mieux entendre. J’ai indiqué à grands traits les caractères du talent de l’artiste, et chaque toile que j’analyserai viendra appuyer d’un exemple le jugement que j’ai porté. L’ensemble est connu, il ne s’agit plus que de faire connaître les détails qui forment cet ensemble. En disant ce que j’ai éprouvé devant chaque tableau, je rétablirai dans son tout la personnalité du peintre. L’œuvre
Lola de Valence, 1862. Huile sur toile, 123 x 92 cm. Musée d’Orsay, Paris.
35
Le Déjeuner sur l’herbe, 1863. Huile sur toile, 208 x 264,5 cm. Musée d’Orsay, Paris.
36
37
Le Chanteur espagnol, 1861-1862. Huile sur toile, 147,3 x 114,3 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York.
38
d’Edouard Manet est déjà considérable. Ce travailleur sincère et laborieux a bien employé les six dernières années ; je souhaite son courage et son amour du travail aux gros rieurs qui le traitent de rapin oisif et goguenard. J’ai vu dernièrement dans son atelier une trentaine de toiles dont la plus ancienne date de 1860. Il les a réunies là pour juger de l’ensemble qu’elles feraient à l’Exposition universelle. J’espère bien les retrouver au Champ-de-Mars, en mai prochain, et je compte qu’elles établiront d’une façon définitive et solide la réputation de l’artiste. Il ne s’agit plus de deux ou trois œuvres, il s’agit de trente œuvres au moins, de six années de travail et de talent. On ne peut refuser au vaincu de la foule une éclatante revanche dont il doit sortir vainqueur. Les juges comprendront qu’il serait inintelligent de cacher systématiquement, dans la solennité qui se prépare, une des faces les plus originales et les plus sincères de l’art contemporain. Ici le refus serait un véritable meurtre, un assassinat officiel. Et c’est alors que je voudrais pouvoir prendre les sceptiques par la main et les conduire devant les tableaux d’Edouard Manet : « Voyez et jugez, dirais-je. Voilà l’homme grotesque, l’homme impopulaire. Il a travaillé pendant six ans, et voilà son œuvre. Riez-vous encore ? le trouvez-vous toujours d’une plaisante drôlerie ? Vous commencez à sentir, n’est-ce pas, qu’il y a autre chose que des chats noirs dans ce talent ? L’ensemble est un et complet. Il s’étale largement avec sa sincérité et sa puissance. Dans chaque toile, la main de l’artiste a parlé le même langage, simple et exact. Quand vous embrassez d’un regard toutes les toiles à la fois, vous trouvez que ces œuvres diverses se tiennent, se complètent, qu’elles représentent une somme énorme d’analyse et de vigueur. Riez encore, si vous aimez à rire ; mais, prenez garde, vous rirez désormais de votre aveuglement. » La première sensation que j’ai éprouvée en entrant dans l’atelier d’Edouard Manet, a été une sensation d’unité et de force. Il y a de l’âpreté et de la douceur dans le premier regard qu’on jette sur les murs. Les yeux, avant de s’arrêter particulièrement sur une toile, errent à l’aventure, de bas en haut, de droite à gauche; et toutes ces couleurs claires, ces formes élégantes qui se mêlent, ont une harmonie, une franchise d’une simplicité et d’une énergie extrêmes. Puis, lentement, j’ai analysé les œuvres une à une. Voici, en quelques lignes, mon sentiment sur chacune d’elles ; j’appuie sur les plus importantes. Je l’ai dit, la toile la plus ancienne est Le Buveur d’absinthe (p.10), un homme hâve et abruti, drapé dans un pan de manteau et affaissé sur lui-même. Le peintre se cherchait encore ; il y a presque une intention mélodramatique dans le sujet ; puis, je ne trouve pas là ce tempérament simple et exact, puissant et large, que l’artiste affirmera plus tard. Ensuite viennent Le Chanteur espagnol (ci-contre) et L’Enfant à l’épée. Ce sont là les pavés, les premières œuvres dont on se sert pour écraser les dernières œuvres du peintre. Le Chanteur espagnol, un Espagnol assis sur un banc de bois vert, chantant et pinçant les cordes de son instrument, a obtenu une mention honorable. L’Enfant à l’épée est un petit garçon debout, l’air naïf et étonné, qui tient à deux mains une énorme épée garnie de son baudrier. Ces peintures sont fermes et solides, très délicates d’ailleurs, ne blessant en rien la vue faible de la foule. On dit qu’Edouard Manet a quelque parenté avec les maîtres espagnols, et il ne l’a jamais avoué autant que dans L’Enfant à l’épée. La tête de ce petit garçon est une merveille de modelé et de vigueur adoucie. Si l’artiste avait toujours peint de pareilles têtes, il aurait été choyé du public, accablé d’éloges et d’argent ; il est vrai qu’il serait resté un reflet et que nous n’aurions jamais connu cette belle simplicité qui constitue tout son talent.
39
Le Vieux Musicien, 1862. Huile sur toile, 187,4 x 248,2 cm. National Gallery of Art, Washington, D.C.
40
41
42
Pour moi, je l’avoue, mes sympathies sont ailleurs parmi les œuvres du peintre ; je préfère les raideurs franches, les taches justes et puissantes d’Olympia (p.44-45) aux délicatesses cherchées et étroites de L’Enfant à l’épée. Mais, dès maintenant, je n’ai plus à parler que des tableaux qui me paraissent être la chair et le sang d’Edouard Manet. Et d’abord il y a, en 1863, les toiles dont l’apparition chez Martinet, au boulevard des Italiens, causa une véritable émeute. Des sifflets et des huées, comme il est d’usage, annoncèrent qu’un nouvel artiste original venait de se révéler. Le nombre des toiles exposées était de quatorze ; nous en retrouverons huit à l’Exposition universelle : Le Vieux Musicien, Le Liseur, Les Gitanos, Un Gamin 1, Lola de Valence (p.34), La Chanteuse des rues (p.42), Le Ballet espagnol (p.43), La Musique aux Tuileries (p.30-31). Je me contenterai d’avoir cité les quatre premières. Quant à Lola de Valence, elle est célèbre par le quatrain de Charles Baudelaire, qui fut sifflé et maltraité autant que le tableau lui-même : Entre tant de beautés que partout on peut voir, Je comprends bien, amis, que le désir balance, Mais on voit scintiller dans Lola de Valence Le charme inattendu d’un bijou rose et noir.
La Chanteuse des rues, 1862. Huile sur toile, 175 x 109 cm. Museum of Fine Arts, Boston. Le Ballet espagnol, 1862. Huile sur toile, 61 x 90,5 cm. The Phillips Collection, Washington, D.C. Olympia, 1863. Huile sur toile, 130,5 x 190 cm. Musée d’Orsay, Paris.
43
44
45
Raisins et figues, 1864. Huile sur toile, 22 x 27,5 cm. Collection privée. Vase de pivoines sur piédouche, 1864. Huile sur toile, 93,2 x 70,2 cm. Musée d’Orsay, Paris. Tige de pivoines et sécateur, 1864. Huile sur toile, 57x 46 cm. Musée d’Orsay, Paris.
46
Je ne prétends pas défendre ces vers, mais ils ont pour moi le grand mérite d’être un jugement rimé de toute la personnalité de l’artiste. Je ne sais si je force le texte. Il est parfaitement vrai que Lola de Valence est un bijou rose et noir ; le peintre ne procède déjà plus que par taches, et son Espagnole est peinte largement, par vives oppositions ; la toile entière est couverte de deux teintes. Le tableau que je préfère, parmi ceux que je viens de nommer, est La Chanteuse des rues. Une jeune femme, bien connue sur les hauteurs du Panthéon, sort d’une brasserie en mangeant des cerises qu’elle tient dans une feuille de papier. L’œuvre entière est d’un gris doux et blond ; la nature m’y a semblé analysée avec une simplicité et une exactitude extrêmes. Une pareille page a, en dehors du sujet, une austérité qui en agrandit le cadre ; on y sent la recherche de la vérité, le labeur consciencieux d’un homme qui veut, avant tout, dire franchement ce qu’il voit. Les deux autres tableaux, Le Ballet espagnol et La Musique aux Tuileries, furent ceux qui mirent le feu aux poudres. Un amateur exaspéré alla jusqu’à menacer de se porter à des voies de fait, si on laissait plus longtemps dans la salle de l’exposition La Musique aux Tuileries. Je comprends la colère de cet amateur : imaginez, sous les arbres des Tuileries, toute une foule, une centaine de personnes peut-être, qui se remue au soleil ; chaque personnage est une simple tache, à peine déterminée, et dans laquelle les détails deviennent des lignes ou des points noirs. Si j’avais été là, j’aurais prié l’amateur de se mettre à une distance respectueuse, et il aurait alors vu que ces taches vivaient, que la foule parlait, et que cette toile était une des œuvres caractéristiques de l’artiste, celle où il a le plus obéi à ses yeux et à son tempérament. Au Salon des Refusés, en 1863, Edouard Manet avait trois toiles. Je ne sais si ce fut à titre de persécuté, mais l’artiste trouva cette fois-là des défenseurs, même des admirateurs. Il faut dire que son exposition était des plus remarquables ; elle se composait du Déjeuner sur l’herbe, d’un Portrait de jeune homme en costume de majo et du Portrait de Mlle V... en costume d’espada. Ces deux dernières toiles furent trouvées d’une grande brutalité, mais d’une vigueur rare et d’une extrême puissance de ton. Selon moi, le peintre y a été plus coloriste qu’il n’a coutume de l’être. La peinture est toujours blonde, mais d’un blond fauve et éclatant. Les taches sont grasses et énergiques, elles s’enlèvent sur le fond avec toutes les brusqueries de la nature. Le Déjeuner sur l’herbe est la plus grande toile d’Edouard Manet, celle où il a réalisé le rêve que font tous les peintres : mettre des figures de grandeur naturelle dans un paysage. On sait avec quelle puissance il a vaincu cette difficulté. Il y a là quelques feuillages, quelques troncs d’arbres, et, au fond, une rivière dans laquelle se baigne une femme en chemise ; sur le premier plan, deux jeunes gens sont assis en face d’une seconde femme qui vient de sortir de l’eau et qui sèche sa peau nue au grand air. Cette femme nue a scandalisé le public, qui n’a vu qu’elle dans la toile. Bon Dieu ! quelle indécence : une femme sans le moindre voile entre deux hommes habillés ! Cela ne s’était jamais vu. Et cette croyance était une grossière erreur, car il y a au musée du Louvre plus de cinquante tableaux dans lesquels se trouvent mêlés des personnages habillés et des personnages nus. Mais personne ne va chercher à se scandaliser au musée du Louvre. La foule s’est bien gardée d’ailleurs de juger Le Déjeuner sur l’herbe comme doit être jugée une véritable œuvre d’art ; elle y a vu seulement des gens qui mangeaient sur l’herbe, au sortir du bain, et elle a cru que l’artiste avait mis une intention obscène et tapageuse dans la disposition du sujet, lorsque l’artiste avait simplement cherché à obtenir des
47
48
49
50
oppositions vives et des masses franches. Les peintres, surtout Edouard Manet qui est un peintre analyste, n’ont pas cette préoccupation du sujet qui tourmente la foule avant tout ; le sujet pour eux est un prétexte à peindre, tandis que pour la foule le sujet seul existe. Ainsi, assurément, la femme nue du Déjeuner sur l’herbe n’est là que pour fournir à l’artiste l’occasion de peindre un peu de chair. Ce qu’il faut voir dans le tableau, ce n’est pas un déjeuner sur l’herbe, c’est le paysage entier, avec ses vigueurs et ses finesses, avec ses premiers plans si larges, si solides, et ses fonds d’une délicatesse si légère ; c’est cette chair ferme, modelée à grands pans de lumière, ces étoffes souples et fortes, et surtout cette délicieuse silhouette de femme en chemise qui fait, dans le fond, une adorable tache blanche au milieu des feuilles vertes ; c’est enfin cet ensemble vaste, plein d’air, ce coin de la nature rendue avec une simplicité si juste, toute cette page admirable dans laquelle un artiste a mis les éléments particuliers et rares qui étaient en lui. En 1864, Edouard Manet exposait Le Christ mort et les anges et Un Combat de taureaux (p.58). Il n’a gardé de ce dernier tableau que l’espada du premier plan, – L’Homme mort (p.56-57), qui se rapproche beaucoup, comme manière, de L’Enfant à l’épée ; la peinture y est détaillée et serrée, très fine et très solide ; je sais à l’avance que ce sera un des succès de l’exposition de l’artiste, car la foule aime à regarder de près et à ne pas être choquée par les aspérités trop rudes d’une originalité sincère. Moi, je déclare préférer de beaucoup Le Christ mort et les anges ; je retrouve là Edouard Manet tout entier, avec les partis pris de son œil et les audaces de sa main. On a dit que ce Christ n’était pas un Christ, et j’avoue que cela peut être ; pour moi, c’est un cadavre peint en pleine lumière, avec franchise et vigueur ; et même j’aime les anges du fond, ces enfants aux grandes ailes bleues qui ont une étrangeté si douce et si élégante. En 1865, Edouard Manet est encore reçu au Salon ; il expose un Christ insulté par les soldats et son chef-d’œuvre, son Olympia. J’ai dit chef-d’œuvre, et je ne retire pas le mot. Je prétends que cette toile est véritablement la chair et le sang du peintre. Elle le contient tout entier et ne contient que lui. Elle restera comme l’œuvre caractéristique de son talent, comme la marque la plus haute de sa puissance. J’ai lu en elle la personnalité d’Edouard Manet, et lorsque j’ai analysé le tempérament de l’artiste, j’avais uniquement devant les yeux cette toile qui renferme toutes les autres. Nous avons ici, comme disent les amuseurs publics, une gravure d’Epinal. Olympia, couchée sur des linges blancs, fait une grande tache pâle sur le fond noir ; dans ce fond noir se trouve la tête de la négresse qui apporte un bouquet et ce fameux chat qui a tant égayé le public. Au premier regard, on ne distingue ainsi que deux teintes dans le tableau, deux teintes violentes, s’enlevant l’une sur l’autre. D’ailleurs, les détails ont disparu. Regardez la tête de la jeune fille : les lèvres sont deux minces lignes roses, les yeux se réduisent à quelques traits noirs. Voyez maintenant le bouquet, et de près, je vous prie : des plaques roses, des plaques bleues, des plaques vertes. Tout se simplifie, et si vous voulez reconstruire la réalité, il faut que vous reculiez de quelques pas. Alors il arrive une étrange histoire : chaque objet se met à son plan, la tête d’Olympia se détache du fond avec un relief saisissant, le bouquet devient une merveille d’éclat et de fraîcheur. La justesse de l’œil et la simplicité de la main ont fait ce miracle ; le peintre a procédé comme la nature procède elle-même, par masses claires, par larges pans de lumière, et son œuvre a l’aspect un peu rude et austère de la nature. Il y a d’ailleurs des partis pris ; l’art ne
Le Combat du Kearsarge et de l’Alabama, 1864. Huile sur toile, 137,8 x 128,9 cm. Philadelphia Museum of Art, Philadelphie.
51
Le « Kearsage » à Boulogne, 1864. Huile sur toile, 81 x 99,4 cm. Collection privée, New York.
52
Les Marsouins, marine, vers 1864. Huile sur toile, 81,4 x 100,3 cm. Philadelphia Museum of Art, Philadelphie.
53
Anguille et rouget, 1864. Huile sur toile, 38 x 46,5 cm. Musée d’Orsay, Paris. Le Torero mort, 1864. Huile sur toile, 75,9 x 153,3 cm. National Gallery of Art, Washington, D.C.
54
vit que de fanatisme. Et ces partis pris sont justement cette sécheresse élégante, cette violence des transitions que j’ai signalées. C’est l’accent personnel, la saveur particulière de l’œuvre. Rien n’est d’une finesse plus exquise que les tons pâles des linges blancs différents sur lesquels Olympia est couchée. Il y a, dans la juxtaposition de ces blancs, une immense difficulté vaincue. Le corps lui-même de l’enfant a des pâleurs charmantes ; c’est une jeune fille de seize ans, sans doute un modèle qu’Edouard Manet a tranquillement copié tel qu’il était. Et tout le monde a crié : on a trouvé ce corps nu indécent ; cela devait être, puisque c’est là de la chair, une fille que l’artiste a jetée sur la toile dans sa nudité jeune et déjà fanée. Lorsque nos artistes nous donnent des Vénus, ils corrigent la nature, ils mentent. Edouard Manet s’est demandé pourquoi mentir, pourquoi ne pas dire la vérité ; il nous a fait connaître Olympia, cette fille de nos jours, que vous rencontrez sur les trottoirs et qui serre ses maigres épaules dans un mince châle de laine déteinte. Le public, comme toujours, s’est bien gardé de comprendre ce que voulait le peintre ; il y a eu des gens qui ont cherché un sens philosophique dans le tableau ; d’autres, plus égrillards, n’auraient pas été fâchés d’y découvrir une intention obscène. Eh ! Dites-leur donc tout haut, cher maître, que vous n’êtes point ce qu’ils pensent, qu’un tableau pour vous est un simple prétexte à analyse. Il vous fallait une femme nue, et vous avez choisi Olympia, la première venue ; il vous fallait des taches claires et lumineuses, et vous avez mis un bouquet ; il vous fallait des taches noires, et vous avez placé dans un coin une négresse et un chat. Qu’est-ce que tout cela veut dire ? Vous ne le savez guère, ni moi non plus. Mais je sais, moi, que vous avez admirablement réussi à faire une œuvre de peintre, de grand peintre, je veux dire à traduire énergiquement et dans un langage particulier les vérités de la lumière et de l’ombre, les réalités des objets et des créatures. J’arrive maintenant aux dernières œuvres, à celles que le public ne connaît pas. Voyez l’instabilité des choses humaines : Edouard Manet, reçu au Salon à deux reprises consécutives, est nettement refusé en 1866 ; on accepte l’étrangeté si originale d’Olympia, et l’on ne veut ni du Joueur de fifre, ni de L’Acteur tragique, toiles qui, tout en contenant la personnalité entière de l’artiste, ne l’affirment pas si hautement. L’Acteur tragique, un portrait de Rouvière en costume de Hamlet, porte un vêtement noir qui est une merveille d’exécution. J’ai rarement vu de pareilles finesses de ton et une semblable aisance dans la peinture d’étoffes de même couleur juxtaposées. Je préfère d’ailleurs Le Joueur de fifre (p.71), un petit bonhomme, un enfant de troupe musicien, qui souffle dans son instrument de toute son haleine et de tout son cœur. Un de nos grands paysagistes modernes a dit que ce tableau était « une enseigne de costumier », et je suis de son avis, s’il a voulu dire par là que le costume du jeune musicien était traité avec la simplicité d’une image. Le jaune des galons, le bleu-noir de la tunique, le rouge des culottes ne sont encore ici que de larges taches. Et cette simplification produite par l’œil clair et juste de l’artiste a fait de la toile une œuvre toute blonde, toute naïve, charmante jusqu’à la grâce, réelle jusqu’à l’âpreté. Enfin restent quatre toiles, à peine sèches : Le Fumeur, La Joueuse de guitare, un Portrait de madame M...2, Une Jeune Dame en 1866. Le Portrait de madame M... est une des meilleures pages de l’artiste ; je devrais répéter ce que j’ai déjà dit : simplicité et justesse extrêmes, aspect clair et fin. En terminant, je trouve, nettement caractérisée dans Une Jeune Dame en 1866, cette élégance native qu’Edouard Manet, homme du monde, a au fond de lui. Une jeune femme, vêtue d’un
55
56
57
58
long peignoir rose, est debout, la tête gracieusement penchée, respirant le parfum d’un bouquet de violettes qu’elle tient dans sa main droite ; à sa gauche, un perroquet se courbe sur son perchoir. Le peignoir est d’une grâce infinie, doux à l’œil, très ample et très riche ; le mouvement de la jeune femme a un charme indicible. Cela serait même trop joli, si le tempérament du peintre ne venait mettre sur cet ensemble l’empreinte de son austérité. J’allais oublier quatre très remarquables marines – Le Steam-Boat3, Le Combat du Kerseage et de l’Alabama (p.50) ; Vue de mer, temps calme ; Bateau de pêche arrivant vent arrière – dont les vagues magnifiques témoignent que l’artiste a couru et aimé l’Océan, et sept tableaux de nature morte et de fleurs qui commencent heureusement à être des chefs-d’œuvre pour tout le monde. Les ennemis les plus déclarés du talent d’Edouard Manet lui accordent qu’il peint bien les objets inanimés. C’est un premier pas. J’ai surtout admiré, parmi ces tableaux de nature morte, un splendide bouquet de pivoines – Un Vase de fleurs –, et une toile intitulée Un Déjeuner, qui resteront dans ma mémoire à côté de l’Olympia. D’ailleurs, d’après le mécanisme de son talent dont j’ai essayé d’expliquer les rouages, le peintre doit forcément rendre avec une grande puissance un groupe d’objets inanimés. Tel est l’œuvre d’Edouard Manet, tel est l’ensemble que le public sera, je l’espère, appelé à voir dans une des salles de l’Exposition universelle. Je ne puis penser que la foule restera aveugle et ironique devant ce tout harmonieux et complet dont je viens d’étudier brièvement les parties. Il y aura là une manifestation trop originale, trop humaine pour que la vérité ne soit pas enfin victorieuse. Et que le public se dise surtout que ces tableaux représentent seulement six années d’efforts, et que l’artiste a trente-trois ans à peine. L’avenir est à lui ; je n’ose moi-même l’enfermer dans le présent.
III. Le Public Il me reste à étudier et à expliquer l’attitude du public devant les tableaux d’Edouard Manet. L’homme, l’artiste et les œuvres sont connus ; il y a un autre élément, la foule, qu’il faut connaître, si l’on veut avoir dans son entier le singulier cas artistique que nous avons vu se produire. Le drame sera complet, nous tiendrons dans la main tous les fils des personnages, tous les détails de l’étrange aventure. D’ailleurs, on se tromperait si l’on croyait que le peintre n’a rencontré aucune sympathie. Il est un paria pour le plus grand nombre, il est un peintre de talent pour un groupe qui augmente tous les jours. Dans ces derniers temps surtout, le mouvement en sa faveur a été plus large et plus marqué. J’étonnerais les rieurs, si je nommais certains hommes qui ont témoigné à l’artiste leur amitié et leur admiration. On tend certainement à l’accepter, et j’espère que ce sera là un fait accompli dans un temps très prochain. Parmi ses confrères, il y a encore les aveugles qui rient sans comprendre parce qu’ils voient rire les autres. Mais les véritables artistes n’ont jamais refusé à Edouard Manet de grandes qualités de peintre. Obéissant à leur propre tempérament, ils ont seulement fait les restrictions qu’ils devaient faire. S’ils sont coupables, c’est d’avoir toléré qu’un de leurs confrères, qu’un garçon de mérite et de sincérité fût bafoué de la plus indigne façon. Puisqu’ils voyaient clair, puisque eux, peintres, se rendaient compte des intentions du peintre nouveau,
Combat de taureaux, 1865-1866. Huile sur toile, 90 x 110,5 cm. Musée d’Orsay, Paris.
59
Madame Manet au piano, 1868. Huile sur toile, 38 x 46,5 cm. Musée d’Orsay, Paris.
60
ils avaient charge, selon moi, d’imposer silence à la foule. J’ai toujours espéré que l’un d’eux se lèverait et dirait la vérité. Mais en France, dans ce pays de légèreté et de courage, on a une peur effroyable du ridicule ; lorsque, dans une réunion, trois personnes se moquent de quelqu’un, tout le monde se met à rire, et s’il y a là des gens qui seraient portés à défendre la victime des railleurs, ils baissent les yeux humblement, lâchement, rougissant eux-mêmes, mal à l’aise, souriant à demi. Je suis sûr qu’Edouard Manet a dû faire de curieuses observations sur certains embarras subits éprouvés en face de lui par des personnes de sa connaissance. Toute l’histoire de l’impopularité de l’artiste est là, et je me charge d’expliquer aisément les rires des uns et la lâcheté des autres. Quand la foule rit, c’est presque toujours pour un rien. Voyez au théâtre : un acteur se laisse tomber, et la salle entière est prise d’une gaieté convulsive ; demain
les spectateurs riront encore au souvenir de cette chute. Mettez dix personnes d’intelligence suffisante devant un tableau d’aspect neuf et original, et ces personnes, à elles dix, ne feront plus qu’un grand enfant ; elles se pousseront du coude, elles commenteront l’œuvre de la façon la plus comique du monde. Les badauds arriveront à la file, grossissant le groupe ; bientôt ce sera un véritable charivari, un accès de folie bête. Je n’invente rien. L’histoire artistique de notre temps est là pour dire que ce groupe de badauds et de rieurs aveugles s’est formé devant les premières toiles de Decamps, de Delacroix, de Courbet. Un écrivain me contait dernièrement qu’autrefois, ayant eu le malheur de dire dans un salon que le talent de Decamps ne lui déplaisait pas, on l’avait mis impitoyablement à la porte. Car le rire gagne de proche en proche, et Paris, un beau matin, s’éveille en ayant un jouet de plus. Alors, c’est une frénésie.
Le Déjeuner dans l’atelier, 1868. Huile sur toile, 118,3 x 154 cm. Neue Pinakothek, Munich.
61
L’Exécution de Maximilien, 1867-1868. Huile sur toile, 193 x 284 cm. The National Gallery, Londres.
62
L’Exécution de Maximilien, 1867-1868. Huile sur toile, 252 x 302 cm. Kunsthalle Mannheim, Mannheim.
63
L’Exécution de Maximilien (détail), 1867. Huile sur toile, 99 x 59 cm. The National Gallery, Londres. Etude pour Le Balcon, 1868. Lavis sur trait d’encre de Chine, 10,8 x 8,2 cm. Mrs Alex Lewyt. Le Balcon, 1868-1869. Huile sur toile, 170 x 124,5 cm. Musée d’Orsay, Paris.
64
Le public a un os à ronger. Et il y a toute une armée dont l’intérêt est d’entretenir la gaieté de la foule, et qui l’entretient d’une belle façon. Les caricaturistes s’emparent de l’homme et de l’œuvre ; les chroniqueurs rient plus haut que les rieurs désintéressés. Au fond, ce n’est que du rire, ce n’est que du vent. Pas la moindre conviction, pas le plus petit souci de vérité. L’art est grave, il ennuie profondément ; il faut bien l’égayer un peu, chercher une toile dans le Salon qu’on puisse tourner en ridicule. Et l’on s’adresse toujours à l’œuvre étrange qui est le fruit mûr d’une personnalité nouvelle. Remontons à cette œuvre, cause des rires et des moqueries, et nous voyons que l’aspect plus ou moins particulier du tableau a seul amené cette gaieté folle. Telle attitude a été grosse de comique, telle couleur a fait pleurer de rire, telle ligne a rendu malades plus de cent personnes. Le public a seulement vu un sujet, et un sujet traité d’une certaine manière. Il regarde des œuvres d’art, comme les enfants regardent des images : pour s’amuser, pour s’égayer un peu. Les ignorants se moquent en toute confiance ; les savants, ceux qui ont étudié l’art dans les écoles mortes, se fâchent de ne pas retrouver, en examinant l’œuvre nouvelle, les habitudes de leur foi et de leurs yeux. Personne ne songe à se mettre au véritable point de vue. Les uns ne comprennent rien, les autres comparent. Tous sont dévoyés, et alors la gaieté ou la colère monte à la gorge de chacun. Je le répète, l’aspect seul est la cause de tout ceci. Le public n’a pas même cherché à pénétrer l’œuvre ; il s’en est tenu, pour ainsi dire, à la surface. Ce qui le choque et l’irrite, ce n’est pas la constitution intime de l’œuvre, ce sont les apparences générales et extérieures. Si cela pouvait être, il accepterait volontiers la même image, présentée d’une autre façon. L’originalité, voilà la grande épouvante. Nous sommes tous plus ou moins, à notre insu, des bêtes routinières qui passent avec entêtement dans le sentier où elles ont passé. Et toute nouvelle route nous fait peur, nous flairons des précipices inconnus, nous refusons d’avancer. Il nous faut toujours le même horizon ; nous rions ou nous nous irritons des choses que nous ne connaissons pas. C’est pour cela que nous acceptons parfaitement les audaces adoucies, et que nous rejetons violemment ce qui nous dérange dans nos habitudes. Dès qu’une personnalité se produit, la défiance et l’effroi nous prennent, nous sommes comme des chevaux ombrageux qui se cabrent devant un arbre tombé en travers de la route, parce qu’ils ne s’expliquent pas la nature et la cause de cet obstacle et qu’ils ne cherchent pas d’ailleurs à se l’expliquer. Ce n’est qu’une affaire d’habitude. A force de voir l’obstacle, l’effroi et la défiance diminuent. Puis il y a toujours quelque passant complaisant qui nous fait honte de notre colère et qui veut bien nous expliquer notre peur. Je désire simplement jouer le rôle modeste de ce passant auprès des personnes ombrageuses que les tableaux d’Edouard Manet tiennent cabrées et effrayées sur la route. L’artiste commence à se lasser de son métier d’épouvantail ; malgré tout son courage, il sent les forces lui échapper devant l’irritation publique. Il est temps que la foule s’approche et se rende compte de ses terreurs ridicules. D’ailleurs, il n’a qu’à attendre. La foule, je l’ai dit, est un grand enfant qui n’a pas la moindre conviction et qui finit toujours par accepter les gens qui s’imposent. L’histoire éternelle des talents bafoués, puis admirés jusqu’au fanatisme, se reproduira pour Edouard Manet. Il aura eu la destinée des maîtres, de Delacroix et de Courbet, par exemple. Il en est à ce point où la tempête des rires s’apaise, où le public a mal aux côtes, et ne demande pas mieux que de redevenir sérieux. Demain, si ce n’est aujourd’hui, il sera compris et accepté,
65
66
68
et si j’appuie sur l’attitude de la foule en face de chaque individualité qui se produit, c’est que l’étude de ce point est justement l’intérêt général de ces quelques pages. On ne corrigera jamais le public de ses épouvantes. Dans huit jours, Edouard Manet sera peut-être oublié des rieurs qui auront trouvé un autre jouet. Qu’il se révèle un nouveau tempérament énergique, et vous entendrez les huées et les sifflets. Le dernier venu est toujours le monstre, la brebis galeuse du troupeau. L’histoire artistique de ces derniers temps est là pour prouver la vérité de ce fait, et la simple logique suffit pour faire prévoir qu’il se reproduira fatalement, tant que la foule ne voudra pas se mettre au seul point de vue qui permet de juger sainement une œuvre d’art. Jamais le public ne sera juste envers les véritables artistes créateurs, s’il ne se contente pas de chercher uniquement dans une œuvre une libre traduction de la nature en un langage particulier et nouveau. N’est-il pas profondément triste aujourd’hui de songer qu’on a sifflé Delacroix, qu’on a désespéré ce génie qui a seulement triomphé dans la mort ? Que pensent ses anciens détracteurs, et pourquoi n’avouent-ils pas tout haut qu’ils se sont montrés aveugles et inintelligents ? Cela serait une leçon. Peut-être se déciderait-on à comprendre alors qu’il n’y a ni commune mesure, ni règles, ni nécessités d’aucune sorte, mais des hommes vivants, apportant une des libres expressions de la vie, donnant leur chair et leur sang, montant d’autant plus haut dans la gloire humaine qu’ils sont plus personnels et plus absolus. Et on irait droit, avec admiration et sympathie, aux toiles d’allures libres et étranges ; ce seraient celles-là qu’on étudierait avec calme et attention, pour voir si une face du génie humain ne viendrait pas de s’y révéler. On passerait dédaigneusement devant les copies, devant les balbutiements des fausses personnalités, devant toutes ces images à un et deux sous, qui ne sont que des habiletés de la main. On voudrait trouver avant tout dans une œuvre d’art un accent humain, un coin vivant de la création, une manifestation nouvelle de l’humanité mise en face des réalités de la nature. Mais personne ne guide la foule, et que voulez-vous qu’elle fasse dans le grand vacarme des opinions contemporaines ? L’art s’est, pour ainsi dire, fragmenté : le grand royaume, en se morcelant, a formé une foule de petites républiques. Chaque artiste a tiré la foule à lui, la flattant, lui donnant les jouets qu’elle aime, dorés et ornés de faveurs roses. L’art est ainsi devenu chez nous une vaste boutique de confiserie, où il y a des bonbons pour tous les goûts. Les peintres n’ont plus été que des décorateurs mesquins qui travaillent à l’ornementation de nos affreux appartements modernes ; les meilleurs d’entre eux se sont faits antiquaires, ont volé un peu de sa manière à quelque grand maître mort, et il n’y a guère que les paysagistes, que les analystes de la nature qui soient demeurés de véritables créateurs. Ce peuple de décorateurs étroits et bourgeois fait un bruit de tous les diables ; chacun d’eux a sa maigre théorie, chacun d’eux cherche à plaire et à vaincre. La foule adulée va de l’un à l’autre, s’amusant aujourd’hui aux mièvreries de celui-là pour passer demain aux fausses énergies de celui-ci. Et ce petit commerce honteux, ces flatteries et ces admirations de pacotille se font au nom des prétendues lois sacrées de l’art. Pour une bonne femme en pain d’épices, on met la Grèce et l’Italie en jeu, on parle du beau comme d’un monsieur que l’on connaîtrait et dont on serait l’ami respectueux. Puis, viennent les critiques d’art qui jettent encore du trouble dans ce tumulte. Les critiques d’art sont des mélodistes qui tous, à la même heure, jouent leurs airs à la fois, n’entendant chacun que leur instrument dans l’effroyable charivari qu’ils produisent.
Le Rendez-Vous du chat, 1868. Lithographie, 43,5 x 33,2 cm. Bibliothèque nationale de France, Paris.
69
L’un veut de la couleur, l’autre du dessin, un troisième de la morale. Je pourrais nommer celui qui soigne sa phrase et qui se contente de tirer de chaque toile la description la plus pittoresque possible ; et encore celui qui, à propos d’une femme étendue sur le dos, trouve le moyen de faire un discours démocratique ; et encore celui qui tourne en couplets de vaudeville les plaisants jugements qu’il porte. La foule éperdue ne sait lequel écouter : Pierre dit blanc et Paul dit noir ; si l’on croyait le premier, on effacerait le paysage de ce tableau, et si l’on croyait le second, on en effacerait les figures, de sorte qu’il ne resterait plus que le cadre, ce qui d’ailleurs serait une excellente mesure. Il n’y a ainsi aucune base à l’analyse ; la vérité n’est pas une et complète ; ce ne sont que des divagations plus ou moins raisonnables. Chacun se pose devant la même œuvre avec des dispositions d’esprit différentes, et chacun porte le jugement que lui souffle l’occasion ou la tournure de son esprit. Alors la foule, voyant combien on s’entend peu dans le monde qui prétend avoir mission de la guider, se laisse aller à ses envies d’admirer ou de rire. Elle n’a ni méthode ni vue d’ensemble. Une œuvre lui plaît ou lui déplaît, voilà tout. Et observez que ce qui lui plaît est toujours ce qu’il y a de plus banal, ce qu’elle a coutume de voir chaque année. Nos artistes ne la gâtent pas ; ils l’ont habituée à de telles fadeurs, à des mensonges si jolis, qu’elle refuse de toute sa puissance les vérités fortes. C’est là une simple affaire d’éducation. Quand un Delacroix paraît, on le siffle. Aussi pourquoi ne ressemble-t-il pas aux autres ! L’esprit français, cet esprit que je changerais volontiers aujourd’hui pour un peu de pesanteur, l’esprit français s’en mêle, et ce sont des gorges chaudes à réjouir les plus tristes. Et voilà comme quoi une troupe de gamins a rencontré un jour Edouard Manet dans la rue, et a fait autour de lui l’émeute qui m’a arrêté, moi passant curieux et désintéressé. J’ai dressé mon procès-verbal tant bien que mal, donnant tort aux gamins, tâchant d’arracher l’artiste de leurs mains et de le conduire en lieu sûr. Il y avait là des sergents de ville, pardon, des critiques d’art, qui m’ont affirmé qu’on lapidait cet homme parce qu’il avait outrageusement souillé le temple du Beau. Je leur ai répondu que le destin avait sans doute déjà marqué au musée du Louvre la place future de l’Olympia et du Déjeuner sur l’herbe. Nous ne nous sommes pas entendus, et je me suis retiré, car les gamins commençaient à me regarder d’un air farouche. Le Fifre, 1866. Huile sur toile, 161 x 97 cm. Musée d’Orsay, Paris. Portrait de Théodore Duret, 1868. Huile sur toile, 46,5 x 35,5 cm. Petit Palais — Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Paris. Portrait de Berthe Morisot, 1869. Huile sur toile, 40 x 34 cm. Collection privée. Plage à Boulogne-sur-Mer, 1869. Huile sur toile, 33 x 65 cm. Mr. and Mrs Paul Melon Collection, Upperville.
70
Notes 1 - Le jeune Manet a peint plusieurs gamins, dont Le Gamin aux cerises ; le tableau exposé à la Galerie Martinet en 1863 était Le Gamin au Chien. 2 - Selon les auteurs du catalogue Manet (RMN 1983), ce tableau constituerait une première version, peinte en 1865, de La Lecture où seule Madame Manet serait représentée ; le peintre aurait repris la toile en 1868 et aurait ajouté le personnage masculin, Léon, le fils de Suzanne que la légende officielle de la famille voulait faire passer pour son frère. 3 - Selon les auteurs du catalogue Manet (RMN 1983), ce tableau est aujourd’hui connu sous le titre Les Marsouins (p.53) ; la toile intitulée Vue de mer, temps calme, qui montre elle aussi un steam-boat, aurait été confondue avec cette œuvre.
71
72
73
74
75
76
Etude biographique d’Edouard Manet par Natalia Brodskaïa « Il était plus grand que nous le pensions » (Edgar Degas)
L’Œuvre de Manet fut un de ceux qui contribuèrent le plus fortement à l’apparition de l’impressionnisme. Bien qu’étant presque du même âge que Monet, Bazille, Renoir et Sisley – une dizaine d’années seulement les séparait – il était, pour eux, un maître. « Manet était aussi important pour nous (impressionnistes), que Cimabue et Giotto pour les Italiens de la Renaissance », (Jean Renoir, Pierre Auguste Renoir, mon père, Paris, Gallimard, 1981, p.17) disait Renoir à son fils. La hardiesse de la peinture d’Edouard Manet, son indépendance vis-à-vis des canons académiques leur ouvraient de nouveaux horizons créatifs. La biographie d’Edouard Manet est typique de celle de nombreux artistes. Sa famille de bourgeois parisiens aisés voulait que son fils devînt juriste et non artiste peintre. En guise de compromis, il fut décidé qu’il serait marin. Ayant échoué aux examens de l’Ecole navale, Manet, à l’âge de seize ans, s’embarqua comme mousse pour une traversée de l’Atlantique, à bord du voilier « Havre et Guadeloupe ». Ce voyage romantique à Rio de Janeiro ne fit que renforcer le désir de Manet de se consacrer à l’art. Néanmoins, en revenant au Havre en 1849, il fit encore une tentative pour entrer à l’Ecole navale, mais, heureusement pour lui, il échoua de nouveau. En 1850, avec son camarade d’école Antonin Proust, il entra à l’atelier du professeur Thomas Couture. Couture participait toujours au Salon et se rendit célèbre, en 1847, par une immense toile, Les Romains de la décadence (Paris, musée d’Orsay). Les méthodes d’enseignement dans son atelier étaient considérées comme novatrices pour son époque. Probablement, au début, Manet était-il un élève assez docile, mais la déception vint très vite. « Je ne sais pas pourquoi je suis ici », avoua-t-il, dès cette même année 1850, à Antonin Proust. « Tout ce que nous avons sous les yeux est ridicule. La lumière est fausse, les ombres sont fausses. Quand j’arrive à l’atelier, il me semble que j’entre dans une tombe. Je sais bien qu’on ne peut pas faire déshabiller un modèle dans la rue. Mais il y a les champs et, tout au moins l’été, on pourrait faire des études de nu dans la campagne, puisque le nu est, paraît-il, le premier et le dernier mot de l’art » (Antonin Proust, « Edouard Manet. Souvenirs », La Revue Blanche, 1897, p.126). Néanmoins, Manet passa six ans à l’atelier
La Lecture, entre 1848 et 1883. Huile sur toile, 60,5 x 73,5 cm. Musée d’Orsay, Paris. Le Repos (Portrait de Berthe Morisot), 1870-1871. Huile sur toile, 149,8 x 111,7 cm. The Rhode Island School of Design Museum, Providence. Eva Gonzales, 1870. Huile sur toile, 191,1 x 133,4 cm. The National Gallery, Londres.
77
78
79
Tête de femme, 1870. Huile sur toile, 56,5 x 46,5 cm. Fondation de Tami Rudolf Staechelin, Bâle.
80
Berthe Morisot au bouquet de violettes, 1872. Huile sur toile, 55,5 x 40,5 cm. Musée d’Orsay, Paris.
81
de Couture et, par la suite, dans nombre de ses tableaux, on sent l’influence de la solide formation donnée par Couture. On ignore quelles furent les relations entre l’élève et le maître. Peut-être Couture reconnaissait-il la brillante individualité de Manet, même si elle ne correspondait pas à sa conception de l’art. On raconte qu’un jour, en regardant le travail de son élève, le professeur dit à ce dernier qu’il voulait probablement devenir un Daumier de son époque. Parallèlement à son apprentissage à l’atelier, Manet copiait constamment des œuvres des maîtres du passé et faisait preuve d’une grande diversité d’intérêts. Au cours de voyages dans les villes européennes, il copia des tableaux au Rijksmuseum d’Amsterdam ainsi que, vraisemblablement, dans les musées de Cassel, Dresde, Prague, Vienne, Munich, Florence et Rome, en s’intéressant beaucoup au nu. En 1852, il copia la Diane au bain de Boucher, au Louvre, et en 1853, la Vénus d’Urbino de Titien. Probablement qu’à ce moment-là déjà, l’idée de sa future Olympia – sa propre variante du nu classique – germait dans son esprit. En même temps, la peinture de Titien, de Rubens, de Velázquez était, pour Manet, une école de la couleur, qui était, depuis le début, ce qui l’intéressait le plus. C’est justement au Louvre qu’il faisait souvent de nouvelles connaissances. En 1857, Manet y rencontra Henri Fantin-Latour, qui devint par la suite son ami. En 1859, alors qu’il copiait, directement sur une planche en cuivre, L’Infante Marguerite de Velázquez, derrière son dos s’arrêta un peintre de son âge. « Vous avez de l’audace de graver ainsi, sans aucun dessin préalable, je n’oserais en faire autant ! » (Manet, Paris 1983, éditions de la Réunion des Musées Nationaux, p.506), s’exclama-t-il. C’est ainsi que Manet fit la connaissance de Degas.
Bateau pour Folkestone, Boulogne, 1869. Huile sur toile, 60 x 73,5 cm. Philadelphia Museum of Art, Philadelphie.
82
Parmi ses contemporains vivants, il y avait également un peintre qui, pour Manet, servait de modèle à imiter : Eugène Delacroix. Antonin Proust se souvenait qu’après une visite au musée du Luxembourg, Manet s’était écrié : « Il y a au Luxembourg une maîtresse toile, c’est La Barque de Dante. Si nous allions voir Delacroix, nous prendrions pour prétexte de notre visite de lui demander l’autorisation de faire une copie de La Barque » (A. Proust, op. cit., p.129). Ils mirent leur projet à exécution, furent reçus par Delacroix, qui leur donna un conseil que Manet ne pouvait qu’apprécier : « Il fallait voir Rubens, s’inspirer de Rubens, copier Rubens, Rubens était le dieu » (A. Proust, op. cit., p.129). Bien que, d’après Proust, l’accueil eût été assez froid, devant les œuvres de Manet la réaction de Delacroix fut des plus chaleureuses. Quand la critique attaqua le tableau de Manet La Musique aux Tuileries, Delacroix dit qu’il regrettait « de n’avoir pu aller défendre cet homme » (Manet, op. cit., p.126). C’était en 1863, juste avant la mort de Delacroix, à l’exposition de Manet à la galerie Martinet. Manet assista aux obsèques de Delacroix, en compagnie de Charles Baudelaire. Un an après, l’ami de Manet, l’excellent portraitiste Henri Fantin-Latour, peignit un grand tableau, Hommage à Delacroix (Paris, musée d’Orsay), où, devant le portrait du grand romantique décédé, parmi ses amis et admirateurs, figure Edouard Manet, âgé de trente ans, tel que le décrivaient ses
83
84
contemporains : « Un blond portant une barbe soyeuse, (…) l’œil gris, le nez droit, les narines mobiles » (Manet, op. cit., p.14). Son personnage, dans le tableau de Fantin-Latour, occupe une place tellement significative qu’on ne peut que comprendre que Manet est l’héritier de Delacroix. L’apparition de la peinture d’Edouard Manet devant le public coïncida avec le moment de la disparition de Delacroix. Le premier mars de cette même année 1863, Manet avait présenté quatorze œuvres à la galerie Martinet. La plupart de ces tableaux avaient été peints en 1862. Une caractéristique commune les unissait : l’admiration de l’auteur pour la peinture espagnole. A ce moment-là, Manet n’avait pas encore été en Espagne ; sa connaissance de l’art espagnol se limitait à la collection du Louvre et à des reproductions. Néanmoins, le jeune peintre parisien avait trouvé, chez les Espagnols du XVIIe siècle, les qualités de couleur qu’il recherchait lui-même dans sa peinture. Même le plus intime des tableaux exposés, L’Enfant à l’épée (New York, The Metropolitan Museum of Art), peint en 1861, ne rappela pas par hasard, aux critiques, les portraits des infants d’Espagne. Le petit garçon qui posa pour le peintre dans son atelier de la rue Guyot, Léon Koelle-Leenhoff, était probablement le fils unique d’Edouard Manet et de sa femme, la pianiste Suzanne Leenhoff. Le costume noir et blanc de l’infant, le fond vert-brun et le teint rose du visage montrent l’admiration de l’auteur pour la gamme de couleurs de Velázquez. Dans un autre tableau, une jeune femme couchée sur un canapé, probablement la maîtresse de Nadar, est également déguisée en costume masculin espagnol – Jeune Femme couchée en costume espagnol (New Haven, Yale University Art Gallery). Le velours rouge du canapé, les reflets chauds sur le satin blanc en combinaison avec le boléro noir, rappelèrent aux contemporains la peinture de Goya. On sait que Nadar photographia la Maja Vestida (Madrid, musée du Prado) de Goya ; cette photo se vendait à Paris. Sur le fond gris de son tableau, l’artiste écrivit la dédicace : « A mon ami Nadar. Manet ». La Chanteuse des rues fut peinte, elle aussi, dans les tonalités espagnoles : des combinaisons de gris argenté, de rose et de rouge cerise. Pourtant, elle était basée sur des impressions parisiennes prises sur le vif : « A l’entrée de la rue Guyot une femme sortait d’un cabaret louche, relevant sa robe, retenant sa guitare », racontait Proust. « Il alla droit à elle et lui demanda de venir poser chez lui. Elle se prit à rire. Je la repincerai, s’écria Manet, et puis si elle ne veut pas, j’ai Victorine » (A. Proust, op. cit., p.170). Le modèle favori de Manet, Victorine Louise Meurent, joua un rôle particulier dans sa peinture des années 1860. Le peintre rencontra cette jeune fille rousse à la peau d’un blanc de lait quelque part dans la foule parisienne, peut-être dans la rue Maître Albert, où elle vivait non loin de l’atelier de Manet. Après La Chanteuse des rues, elle posa pour Manet encore maintes fois, y compris pour ce merveilleux tableau intitulé Mademoiselle V… en costume d’espada (p.28), qui fut exposé un peu plus tard. Dans le titre de cette composition
Port de Calais, 1871. Huile sur toile, 81,5 x 100,7 cm. Collection privée.
85
Port de Bordeaux, 1871. Huile sur toile, 66 x 99,5 cm. Collection privée. Nu, 1872. Huile sur toile, 60 x 49 cm. Musée d’Orsay, Paris. Marguerite de Conflans, 1873. Huile sur toile, 54,5 x 46,5 cm. Museum Oskar Reinhart am Stadgarten, Winterhur.
86
franchement fantaisiste, il a même gardé le nom du modèle. De sujet il n’y en a absolument aucun, mais il y a l’atmosphère de cette Espagne que le peintre n’avait encore jamais vue, et cette atmosphère est rendue par la couleur. « Un modèle féminin posant en toréador est ridicule en termes de réalisme », écrivait un des critiques (Manet, op. cit., p.113). On reprocha à Manet la discordance entre la scène de la corrida, en arrière-plan, et le personnage de Victorine, une incapacité à faire concorder les proportions, et même à dessiner et à peindre. Castagnary, un critique réputé, s’exclama avec indignation : « Est-ce là dessiner ? Est-ce là peindre ? » (Manet, op. cit., p.112). Seul Emile Zola sut comprendre le jeune peintre : « S’il assemble plusieurs objets ou plusieurs figures, il est seulement guidé dans son choix par le désir d’obtenir de belles taches, de belles oppositions », écrivait-il (Manet, op. cit., p.113). Le plus espagnol des tableaux exposés à la galerie Martinet était, sans conteste, Lola de Valence. Au cours de l’été 1862, le Tout-Paris se précipita à l’Hippodrome, où on donnait des représentations du Ballet National espagnol – des danseurs du théâtre royal de Madrid et la troupe de « La Flor de Sevilla ». Manet décida plusieurs danseurs à poser pour lui et peignit dans l’atelier de son ami Stevens, qui était suffisamment grand pour cela, le tableau intitulé Le Ballet espagnol, également présenté chez Martinet. Dans cette troupe, l’objet de la plus grande admiration des Parisiens était la danseuse Lola Melea, connue sous son pseudonyme de scène Lola de Valence. Elle posa pour Manet dans l’atelier du peintre. De nouveau, il fit une mise en scène fantaisiste : Lola est représentée dans les coulisses, dont l’échancrure laisse apercevoir une salle de spectateurs bruyants et agités. Pour créer cette dernière impression, Manet se sert de la couleur et seulement de la couleur. En regardant de plus près, on découvre qu’il n’y a pas là de figures concrètes – seulement des touches de couleur informes. Lola se tient en quatrième position, un éventail à la main, dans l’attitude de la célèbre Duchesse d’Albe (New York, Hispanic Society of America) du tableau de Goya. L’ami de Manet, Charles Baudelaire, était, lui aussi, enthousiasmé par les danses de Lola, « ma danseuse choisie, l’amusant modèle de mon ami Manet, si souvent fêtée, embrassée et caressée à Paris », comme il disait (Manet, op. cit., p.146).
La Sultane (Jeune Femme en costume oriental), vers 1871. Huile sur toile, 96 x 74,5 cm. Fondation E. G. Bührle, Zurich.
90
Pourtant, le sonnet qu’il écrivit est dédié non à l’original, mais à la Lola du tableau de Manet : « Entre tant de beautés que partout on peut voir, / Je comprends bien, amis, que le Désir balance ; / Mais on voit scintiller en Lola de Valence / Le charme inattendu d’un bijou rose et noir » (Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Paris, 2002, p.250). Selon le souhait du poète, ces vers furent inscrits sur le cadre du tableau aux expositions de 1863 et 1867. Baudelaire célébrait justement ce qui indignait la critique. Paul Mantz écrivait que Lola et La Musique aux Tuileries, « dans leur bariolage rouge, bleu, jaune, noir, sont la caricature de la couleur, et non la couleur elle-même » (Manet, op. cit., p.150). C’est précisément la couleur qui frappa le plus les amis aussi bien que les ennemis du peintre, autant par son intensité que par la manière dont elle avait été
91
Course de chevaux au bois de Boulogne, 1872. Huile sur toile, 73 x 92 cm. Collection privée.
92
93
94
appliquée, par la surface « négligée » du tableau. Sur la surface de la jupe de Lola, peinte à grosses touches noires, étaient jetés, comme négligemment, des petits empâtements de couleur rouge, verte et jaune. C’était là une liberté sans précédent, même en comparaison des touches, posées à la spatule, de Courbet. Le nom de Courbet venait involontairement à l’esprit à l’exposition chez Martinet. Dans sa composition, La Musique aux Tuileries, Manet manifestement marchait sur les pas de Courbet. Cependant Manet avait plus de naturel, il n’élaborait pas de mise en scène, mais semblait découper un pan de la vie qui se déroulait autour de lui. Manet représenta la foule parisienne lors d’un des concerts donnés régulièrement au jardin des Tuileries. L’orchestre militaire qui y jouait d’habitude n’entre pas dans le cadre du tableau. Devant le spectateur apparaît un de ces moments de la vie mondaine dont le peintre lui-même était un participant assidu. Ici, dans son propre tableau, Manet s’est représenté à gauche, à côté de son camarade d’atelier Albert de Balleroy (Dans son Hommage à Delacroix, Fantin-Latour, deux ans plus tard, les a aussi représentés côte à côte). Entre leurs têtes, on peut distinguer le visage du critique Champfleury. Ici figure également le frère de l’artiste, Eugène Manet. Parmi les spectateurs, ici et là, on reconnaît d’autres amis de Manet : le peintre Henri Fantin-Latour, les écrivains Charles Baudelaire et Zacharie Astruc, le journaliste Aurélien Schol, l’inspecteur des musées, le baron Taylor, et le compositeur Jacques Offenbach, que ses opérettes La Belle Hélène et La Vie parisienne allaient bientôt rendre célèbre. Des dames en toilettes raffinées, à la mode, font la conversation : au premier plan figure Mme Lejosne, épouse du commandant Lejosne, une connaissance de Manet ; à côté d’elle, avec une voilette élégante sur son chapeau, probablement Mme Offenbach. Ce tableau fut le premier dans cette mosaïque de la vraie vie parisienne que créa Manet. Personne encore n’avait peint pareille composition. La couleur de la foule parisienne – une combinaison de rose, de bleu, de jaune doré, de noir et de blanc – respirait l’enthousiasme de l’artiste pour ces mêmes grands Espagnols. On racontait que Manet avait peint des études à l’aquarelle en plein air, dans le jardin des Tuileries, mais, dans le sombre feuillage des arbres, on ne peut deviner qu’avec beaucoup de peine les traces de la peinture de plein air. Pour les futurs impressionnistes, la couleur et la manière de la peinture de Manet furent une révélation, même si elles ne s’accordaient pas en principe avec leurs propres recherches. En ce temps-là, pour Edouard Manet le plein air n’existait pas et l’observation de la couleur dans la nature n’offrait aucun intérêt. Manet avait puisé la gamme de couleurs de ses tableaux « espagnols », dans les musées. Il avait rendu sa couleur plus intense et sa touche plus expressive que chez les maîtres anciens. Pourtant, Manet avait, en fait, inventé la couleur que ses admirateurs, les futurs impressionnistes, avaient l’intention de chercher dans la nature vivante. Mais ils suivaient des voies différentes et il n’est pas étonnant que Manet n’ait pas voulu exposer avec les jeunes artistes, en 1874, quel qu’ait été son prétexte pour expliquer son refus.
Bouquet de violettes, 1872. Huile sur toile, 22 x 27 cm. Collection privée.
95
96
Portrait de Berthe Morisot étendue, 1873. Huile sur toile, 26 x 34 cm. Musée Marmottan, Paris.
97
Deux mois après l’exposition à la galerie Martinet, une nouvelle surprise attendait les Parisiens. Le 1er mai 1863, pour la première fois dans l’histoire de l’art français, deux expositions parallèles s’ouvrirent en même temps : le Salon traditionnel et le Salon des Refusés. Cette année-là, les réclamations des artistes refusés par le jury furent particulièrement nombreuses : sur les 5 000 toiles présentées, seules 2 783 avaient été acceptées, c’est-à-dire à peine plus de la moitié. Beaucoup de tableaux refusés étaient réellement d’un niveau professionnel nettement inférieur à celui exigé par le jury. Mais il y en avait aussi dont la manière picturale était, de l’avis du jury, trop osée. Evidemment, c’est précisément de ceux-là que faisait partie Manet. Napoléon III en personne, peu de temps avant leur ouverture, vint visiter les salles de l’exposition, s’étonna de la sévérité du jury et ordonna d’exposer également tous les tableaux refusés. Deux tableaux espagnols de Manet se retrouvèrent au Salon des Refusés : Mademoiselle V… en costume d’espada et le Jeune Homme en costume de Majo (New York, The Metropolitan Museum of Art), ainsi que son nouveau tableau Le Déjeuner sur l’herbe. « L’exposition n’était séparée de l’autre que par un tourniquet », se souvenait un des refusés. « On s’attendait à bien rire, et l’on riait, en effet, dès la porte. Manet, dans la plus reculée des salles, perçait le mur avec son Déjeuner sur l’herbe » (A. Tabarant, Manet. Histoire catalographique, Paris, 1931, p.95). Avec du recul, on a de la peine à comprendre pourquoi ce tableau choqua tellement les contemporains. D’après les souvenirs d’Antonin Proust, il fut conçu sous l’effet de la nature vivante, à Argenteuil. Manet était perdu dans la contemplation de baigneuses sortant de l’eau : « Il paraît, me dit-il, qu’il faut que je fasse un nu. Eh bien, je vais leur en faire, un nu. » Là-dessus, toutefois, il se souvint d’un tableau, alors attribué à Giorgione, qu’il avait jadis copié, dit Un Concert au Louvre. Il exécuta cela absolument à la lettre. Au lieu des musiciens en costumes de la Renaissance en velours rouge, dans le tableau de Manet figurent son frère Eugène et son beau-frère en compagnie d’une Victorine Meurent dénudée, assis dans une clairière au cours d’un pique-nique. Certains critiques trouvèrent ce tableau indécent. « Ces deux personnages ont l’air de collégiens en vacances, commettant une énormité pour faire les hommes », écrivait l’un d’eux, « et je cherche en vain ce que signifie ce logogriphe peu séant » (Manet, op. cit., p.166). Cependant, les discussions à propos de son sujet n’expliquaient pas du tout un rejet aussi total de ce tableau. La spontanéité dans la représentation de personnages réels au cours d’un pique-nique fut également reprochée à Manet : les formes du modèle nu étaient loin de l’idéal classique, et le monsieur étendu à côté de Victorine semblait tout simplement laid. Même un ami de Baudelaire, le critique Théophile Toret, mit en doute le goût de l’artiste.
Polichinelle, 1873. Huile sur toile, 50 x 32 cm. Collection privée.
98
Il y avait dans ce tableau encore autre chose qui gênait, bien que cela ne fût pas exprimé concrètement. Dans son paysage, Manet avait enfreint les lois classiques traditionnelles de la construction de la perspective aérienne. Il suffit de jeter un regard sur n’importe quel
99
100
tableau de Claude Le Lorrain pour comprendre combien le système académique, pour rendre la perspective aérienne dans un paysage, était astucieux et simple. Il fallait peindre le premier plan du tableau dans des tons chauds d’un jaune-brun, puis passer progressivement au second plan, plus froid, en général vert, et par un dégradé semblable le réunir au troisième, un plan froid, bleu-gris. Chez Manet, au lieu d’être d’un jaune-brun chaud, le premier plan est devenu vert vif ; au lieu de lointains bleu-gris, à l’arrière-plan resplendit la lumière jaune du soleil. Au milieu, dans l’eau d’un bleu pur, s’éclabousse une femme à moitié dévêtue. Au premier plan, l’artiste a peint une nature morte ; ses ombres bleu vif, sa couleur jaune et rouge cerise rivalisent avec la tonalité des personnages. Les grosses touches de couleur, appliquées avec une négligence apparente, donnent l’impression d’une esquisse faite a la prima. Elève d’un des meilleurs professeurs, Manet utilisait encore une technique picturale à plusieurs couches ; les radiographies de ses tableaux montrent une sous-couche classique en blanc de céruse, sur laquelle, une fois qu’elle avait séché, on superposait des couches de couleur. Cependant, l’impression finale ne concordait pas avec les valeurs traditionnelles ; il semblait que pareille peinture ne pouvait avoir été exécutée qu’en pleine nature. Degas, par la suite, a fourni des éclaircissements : « Manet ne pensait pas au plein air quand il a fait Le Déjeuner sur l’herbe. Il n’y a pensé qu’après avoir vu les premiers tableaux de Monet » (L. Halévy, Degas parle, Paris, 1960, p.110-111). Néanmoins, c’est justement ce tableau qui frappa les futurs impressionnistes et les poussa à travailler en plein air, ce que Manet apprit à faire plus tard grâce à eux. Edouard Manet était un homme du monde. Emile Zola a écrit qu’il aimait la société et rêvait du succès tel qu’il peut l’être à Paris, avec les compliments des femmes, les flatteries des critiques, les réceptions dans les salons. Antonin Proust disait que Manet perdait courage devant les attaques cruelles de la presse. Après l’accueil impitoyable fait au Déjeuner sur l’herbe, il n’osa pas montrer un autre tableau, déjà achevé en 1863, qui, d’une certaine façon, était la somme du travail de toute sa jeunesse. Cependant, rien ne pouvait l’obliger à dévier de la voie choisie et, en 1865, devant les spectateurs, apparut Olympia. Et de nouveau ce fut le choc – un scandale invraisemblable autour de ce tableau. « Les injures pleuvent sur moi comme grêle », écrit Manet à Baudelaire, « je ne m’étais pas encore trouvé à pareille fête » (Manet, op. cit., p.181). Le peintre fut accusé de tous les péchés imaginables. Au même moment, le Salon de Paris était plein de Vénus dénudées. En 1863, les tableaux de Baudry, La Perle et la vague, et de Cabanel, Vénus, (Paris, musée d’Orsay) avaient soulevé l’enthousiasme ; quelques années auparavant, les spectateurs avaient admiré les modèles féminins dans le tableau du maître de Manet, Thomas Couture, Les Romains de la décadence (Paris, musée d’Orsay) – tous représentaient l’idéal de la beauté classique. La nouvelle apparition devant le public de Victorine Meurent, qui avait été aussitôt reconnue, produisit une grande émotion. Sa complète nudité était
Le Bal masqué à l’Opéra, 1873. Huile sur toile, 59,1 x 72,5 cm. National Gallery of Art, Washington, D.C.
101
Le Chemin de fer, 1873. Photographie rehaussée d’aquarelle, 18,9 x 22,7 cm. Collection Durand-Ruel.
102
Le Chemin de fer, 1873. Huile sur toile, 93,3 x 111,5 cm, National Gallery of Art, Washington, D.C.
103
soulignée par un fin ruban de velours autour du cou et un bracelet. Elle était couchée sur un drap blanc et un châle en soie rose. La servante noire confirmait ce que l’on soupçonnait, à savoir qu’il s’agissait là, bien sûr, d’une prostituée attendant son client, celui-là même qui lui avait apporté le bouquet soigneusement fait par un fleuriste. Contrairement à la Vénus d’Urbino de Titien, qu’Edouard Manet aimait tant et qui n’a d’existence que dans le monde fermé de son tableau, Olympia, sans aucune gêne, regardait le spectateur. Tout, dans ce tableau, soulevait l’indignation, en commençant par le titre sur le cartouche. Qui était-elle, cette Olympia ? Les interprétations étaient des plus diverses. A cette époque, à Paris, les contes d’Hoffmann étaient très à la mode et Olympia y était le nom d’une poupée maléfique. Il est possible que ce nom ait été suggéré par l’insipide poème de l’ami de Manet, Zacharie Astruc : « Quand lasse de songer l’Olympia s’éveille / le printemps entre au bras du doux messager noir / C’est l’esclave à la nuit amoureuse pareille / qui veut fêter le jour délicieux à voir / L’auguste jeune fille en qui la flamme veille » (Manet, op. cit., p.179). En tout cas, le nom donné au tableau allait à l’encontre de la tradition classique. Quant à la facture, elle n’avait, de l’avis de la critique, absolument rien de positif : « Le ton des chairs est sale (…), les ombres s’indiquent par des raies de cirage plus ou moins larges (…) Une ignorance presque enfantine des premiers éléments du dessin (…) ». Mais on reconnaissait que le plus hideux, c’était la couleur : « Cette brune rousse est d’une laideur accomplie (…) Le blanc, le noir, le rouge, le vert font un vacarme affreux sur cette toile » (Manet, op. cit., p.182). Même Courbet ne fut pas capable de comprendre Olympia. « C’est plat, ce n’est pas modelé », dit-il. « On dirait une dame de pique d’un jeu de cartes sortant du bain » (Manet, op. cit., p.182). A cela, Manet, toujours prêt à rendre la pareille, répliqua qu’il en avait assez de ces remodelages sans fin, et que, apparemment, l’idéal de Courbet, c’était une boule de billard. Dans le tableau de Manet, le nu féminin ne possédait pas, en effet, les caractéristiques d’une boule de billard, l’artiste n’avait pas eu recours aux remodelages traditionnels, son procédé essentiel restait toujours la couleur. Des contours précis et de très délicates nuances de couleur rendaient le volume et les formes du personnage. Et tout comme dans Lola, grâce à des empâtements jetés négligemment sur la toile, les fleurs du bouquet créaient une impression de fraîcheur. Avec ce chat noir faisant le gros dos au pied du lit, le tableau fut perçu par les contemporains comme une façon de se moquer à la fois de la décence bourgeoise, du bon goût et des règles classiques de l’art.
Sur la Plage, 1873. Huile sur toile, 59,5 x 73 cm. Musée d’Orsay, Paris.
104
Encore un autre sujet d’affliction pour Manet fut que, juste à ce moment-là, la critique commença à confondre son nom avec un autre très semblable, celui du peintre Claude Monet que personne ne connaissait encore. En 1865, Monet exposa des marines, pour lesquelles un critique inattentif complimenta Edouard Manet. « Ah ! Mon cher, c’est
105
La Péniche, vers 1874. Aquarelle, 26 x 28 cm. Collection privée, Paris.
106
Marée montante, vers 1873. Huile sur toile, 47 x 58 cm. Collection privée.
107
108
dégoûtant, je suis furieux », dit Manet à un ami, « on ne me fait compliment que d’un tableau qui n’est pas de moi. C’est à croire à une mystification » (D. Wildenstein, Claude Monet, Paris, 1971, p.17). L’année suivante, en 1866, Monet exposa un portrait de sa femme en robe verte. Sous une caricature de ce tableau, on avait mis un texte intéressant : « Monet ou Manet ? – Monet. Mais c’est à Manet que nous devons ce Monet ; bravo ! Monet ; merci, Manet » (Manet, op. cit., p.509). Le caricaturiste, de cette façon, établit clairement la corrélation entre les deux peintres. Peu après, Zacharie Astruc présenta à son ami Manet, le jeune paysagiste Monet. Le respect de Monet pour son aîné et l’intérêt de Manet pour les nouveaux procédés qu’il vit dans la peinture de Monet, ne tardèrent pas à faire des deux hommes des amis. Peu à peu, autour de Manet se rassemblèrent ceux que, plus tard, on appela les impressionnistes. La confusion entre les noms semblables des deux peintres venait de ce qu’au milieu des années 1860, Manet, tout comme Monet qui avait grandi au Havre, commença à peindre des marines. Depuis son enfance, Manet passait presque chaque été sur la côte nord de la France, à Boulogne. Néanmoins, il n’avait jamais peint de marines. Le tableau qu’il peignit en 1864, Le Combat du Kearsarge et de l’Alabama (p.50), n’était pas non plus une marine par son genre. En juillet 1864, quand Manet arriva à Boulogne, la vie lui fit cadeau d’un merveilleux sujet : dans la Manche, au large de Cherbourg, se déroula un combat entre deux navires américains, la corvette fédérale « Kearsarge » et le navire sudiste « Alabama ». Le « Kearsarge » attaqua et coula l’« Alabama ». Naturellement, un événement aussi considérable près des côtes françaises, en pleine guerre de Sécession, impressionna beaucoup les contemporains. Manet n’était pas indifférent à la vie politique, et encore moins aux événements qui se produisaient en mer : son passé de marin lui avait laissé des souvenirs les plus romantiques. Ce tableau peut être considéré comme la première œuvre de sa peinture historique. On ignore si Manet fut lui-même témoin de ce combat, mais selon ses propres dires, il peignit le « Kearsarge », en rade de Boulogne, d’après nature. Cependant, dans ce tableau, on ne voit que le vaisseau sudiste en train de couler et deux voiliers – l’un français, l’autre américain – arrivant au secours des naufragés. Toutefois, ceux qui virent ce tableau furent frappés non par la dynamique de la bataille, mais précisément par le paysage. La mer dans la peinture de Manet est vivante. L’artiste semble la voir non du rivage, mais du pont d’un bateau. Sa surface d’un vert vif, pareille à un gigantesque lé de tissu, s’étend jusqu’en haut de la toile. Dans ce vert, il n’y a pas de reflets de couleur, il est uniforme, seules des touches blanches donnent l’impression de vagues. « C’est une sensation de nature et de paysage », écrivait un critique, lui-même natif de Normandie, « très simple et très puissante (…) M. Manet a rejeté ses deux vaisseaux à l’horizon. Il a eu la coquetterie de les y rapetisser par la distance, mais la mer qu’il gonfle alentour, la mer qu’il étend et amène jusqu’au cadre de son tableau, (…) est plus terrible que le combat (…) » (Manet, op. cit., p.219). Dans d’autres marines également, Manet peint la mer en aplats d’une seule couleur, sur la surface desquels se dessinent, à contre-jour, les silhouettes noires, en forme de
Claude Monet et sa femme dans son studio flottant, 1874. Huile sur toile, 82,7 x 105 cm. Neue Pinakothek, Munich. Le Grand Canal, Venise, 1874. Huile sur toile, 57 x 48 cm. Collection privée. Argenteuil, 1874. Huile sur toile, 148,9 x 115 cm. Musée des Beaux-Arts, Tournai.
109
111
virgules, des voiles. Le normand Monet fut, sans conteste, impressionné par ces marines. Cependant, le jeune Monet était une si forte individualité que, plus tard, c’est sa peinture à lui qui influença Edouard Manet. Quand, en 1881, Manet peignit L’Evasion de Rochefort (Zurich, Kunsthaus), la surface verte de la mer vibrait de touches nerveuses de blanc de céruse, posées négligemment, dans des sens différents, comme dans la peinture de Monet. Chaque tableau de Manet, par sa démarche picturale inattendue, était une nouvelle surprise. En 1866, il peignit Le Fifre. Certains critiques trouvèrent une ressemblance, dans son frais visage d’adolescent, avec celui de Victorine Meurent, mais le plus probable, c’est qu’un vrai petit musicien posa pour le peintre, car à côté de l’atelier se trouvaient les casernes des musiciens. Le personnage du fifre, avec ses contours noirs, semble être découpé sur le fond moiré gris-vert, qui ne représente rien d’autre que l’air. Avant Manet, personne encore n’avait rendu par la couleur l’air environnant. Dans ce tableau, il n’y a pas de décor concret, de paysage ou d’intérieur. Seule une petite raie d’ombre, qui part du pied du fifre, montre qu’il se tient solidement debout sur la terre ferme. Trois taches plates de couleur – rouge foncé, noire et blanche – composent, avec un laconisme extrême, la gamme de couleurs du tableau. Seul le visage du garçonnet est traité avec de délicates nuances de rose. Le laconisme de la peinture de Manet ne perdit rien de son sens pour les peintres des générations suivantes. « Il était le premier à agir par réflexes et à simplifier ainsi le métier du peintre (…) », écrivait Matisse. « Un grand peintre est celui qui trouve des signes personnels et durables pour exprimer plastiquement l’objet de sa vision. Manet a trouvé les siens » (R. Cogniat et M. Hoog, Manet, Paris, 1982, p.35-36).
Le Grand Canal, Venise, 1875. Huile sur toile, 57 x 48 cm. Shelburne Museum, Shelburne.
112
L’année 1867 fut pleine d’événements importants dans la vie du peintre. C’était l’année de la nouvelle Exposition universelle. Courbet, comme il l’avait déjà fait auparavant, ouvrit son pavillon séparé. Manet, lui aussi, prit cette décision téméraire : avec ses propres moyens, il construisit un baraquement à côté de l’exposition de Courbet, à l’angle des avenues Montaigne et de l’Alma, non loin de l’Exposition universelle. « Je me décide à faire une exposition particulière », écrivait-il à Emile Zola. « J’ai au moins une quarantaine de tableaux à montrer. On m’a déjà offert des terrains très bien situés près du Champ-de-Mars » (Manet, op. cit., p.520). Là, Manet réunit cinquante toiles, parmi lesquelles toutes celles qui, auparavant, avaient provoqué un scandale : La Chanteuse des rues, Victorine en costume d’espada, Lola, Le Déjeuner sur l’herbe, Olympia, La Musique aux Tuileries. Il savait que le public pouvait à nouveau réagir très violemment contre sa peinture, et il s’attendait à une nouvelle vague de critiques malveillantes et même, peut-être, à des railleries. Selon ses propres paroles, il aurait voulu faire la paix avec la partie du public qui était contre lui. Il rédigea lui-même la préface de son catalogue, parlant de lui-même à la troisième personne. Il y mentionnait les multiples refus qu’avaient essuyés ses tableaux de la part du jury du Salon et il y disait qu’aux yeux du
113
114
public les récompenses du Salon étaient la garantie du talent. Ainsi l’artiste se retrouvait enfermé dans un cercle étroit dont il ne pouvait pas s’échapper. Manet continuait en disant que si la création devenait une bataille, elle devait être menée à armes égales, c’est-à-dire que le peintre devait avoir la possibilité de montrer ses tableaux. Il expliquait les raisons qui l’avaient poussé à organiser une exposition séparée, et appelait les visiteurs non pas à admirer ses peintures, mais à comprendre que tout son Œuvre était sincère et véridique. Il ajoutait que jamais il n’avait proposé d’abolir la peinture ancienne ou d’en créer une nouvelle. Il voulait seulement être lui-même et pas un autre. C’est justement cette sincérité qui donnait à son Œuvre le caractère d’une protestation, mais lui, le peintre, n’avait jamais voulu protester. C’étaient les spectateurs qui avaient protesté contre sa peinture parce qu’elle n’utilisait pas les formes et les procédés traditionnels auxquels ils étaient habitués. Ce n’est qu’en regardant attentivement un tableau maintes fois que l’on peut s’accoutumer à ce qui, au début, déroutait et choquait, ce n’est qu’alors que l’on peut comprendre et ensuite, aussi, adhérer à l’art d’un artiste. Montrer, c’était une question de vie ou de mort, cela signifiait trouver des amis et des alliés dans la lutte, déclarait Edouard Manet. Et il se lança bel et bien dans la lutte. Sans parler des critiques mondains qui, déjà auparavant, ironisaient aux dépens du peintre et se moquaient ouvertement de ses tableaux, Manet reçut de nouveau un affront du grand Courbet. En passant à l’exposition de son voisin, Courbet éclata d’un rire sonore : « Que d’Espagnols ! », dit-il et sortit. Cependant, comme Manet lui-même s’y attendait, une telle exposition l’aida à trouver aussi de véritables amis. Dès 1866, lorsque le jury du Salon refusa Le Fifre, Emile Zola, dans son compte rendu du Salon, prit sa défense. Il fut le premier à déclarer ouvertement son admiration pour le talent de Manet, sa sincérité et son aspiration à créer selon ce que lui dictait son cœur. Zola disait qu’en France on aime railler. Le public se représentait Manet comme un jouvenceau et un semi-ignorant qui rassemblait autour de lui des ivrognes de son genre. Ce fainéant peignait exprès des caricatures pour faire rire le public et ainsi attirer l’attention. Zola parlait de Manet comme d’un peintre qui restait en tête à tête avec la nature, qui ne faisait confiance ni à la science ni à l’expérience, mais seulement à l’observation de la nature. Il écrivait que Le Déjeuner sur l’herbe et Olympia étaient des chefs-d’œuvre et que la place des tableaux de Manet était au Louvre. « Puisque personne ne dit cela, je vais le dire, moi », écrivait-il, « je vais le crier. Je suis tellement certain que M. Manet sera un des maîtres de demain que je croirais conclure une bonne affaire, si j’avais de la fortune, en achetant aujourd’hui toutes ses toiles » (Manet, op. cit., p.280). Après cela, Manet, profondément touché, écrivit au critique : « Cher Monsieur Zola, je ne sais où vous trouver pour vous serrer la main et vous dire combien je suis heureux et fier d’être défendu par un homme de votre talent. Quel bel article ! Merci mille fois » (Manet, op. cit., p.520). En 1867, Zola commença par écrire une étude sur Manet pour La Revue du XIX e siècle, puis il publia une brochure comprenant cette étude, un portrait de Manet, gravé par Braquemont,
En Bateau, 1874. Huile sur toile, 97,2 x 130,2 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York. La Famille Monet dans son jardin à Argenteuil, 1874. Huile sur toile, 61 x 99,7 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York.
115
116
117
et une eau-forte avec son Olympia. A présent, Manet lui écrivait déjà comme à un ami proche : « Mon cher Zola, je vous avoue que cela ne peut que m’être agréable de voir votre brochure sur moi se vendre dans mon exposition » (Manet, op. cit., p.520). Zola considérait l’exposition personnelle de Manet comme un grand événement dans la vie artistique et la mettait sur le même pied que celle de Courbet dont on avait déjà de son vivant reconnu le génie. En faisant leur bilan, il écrivait en 1868, dans un article pour L’Evénement illustré, que, s’étant affranchie des Grecs, des Romains et des sujets médiévaux, c’est-à-dire de tout ce qui constituait les composantes obligatoires de l’art des classiques et des romantiques, la peinture s’était retrouvée face à face avec la vie réelle. Et c’est cette réalité qui obligeait à la fois Courbet et Manet à représenter leurs contemporains, dans leurs toiles, comme ils étaient pour de bon, dans leurs propres vêtements et avec leurs propres mœurs. En 1868, Manet peignit le Portrait d’Emile Zola (p.6), exprimant à sa façon sa gratitude pour son soutien. Au milieu de papiers éparpillés sur un bureau, on voit clairement la couverture de la brochure de Zola sur Manet et, dans ses mains, l’écrivain tient un livre ouvert – L’Histoire des peintres de Charles Blanc – qui se trouvait toujours dans l’atelier de Manet. Sur la reproduction ou la gravure de l’Olympia, le modèle semble avoir tourné les yeux vers le peintre, alors que dans le tableau elle regarde droit devant elle : encore une autre expression de la reconnaissance du peintre envers l’écrivain. D’après ce que disaient les contemporains, la gravure japonaise et le paravent japonais faisaient partie du décor de l’atelier de Manet ; justement au milieu des années 1860, la mode de tout ce qui était japonais s’était répandue à Paris, et une boutique s’était ouverte où on vendait des gravures japonaises. Les critiques de l’époque avaient noté une certaine froideur dans cette image de Zola, une absence d’intimité dans ce portrait. Peut-être la raison en était que le tableau était destiné au Salon et donc exigeait un caractère officiel et une composition traditionnelle. Ou peut-être que Manet et Zola n’étaient pas encore les amis proches qu’ils allaient devenir par la suite.
Amazone – portrait de Marie Lefébure, 1870-1875. Huile sur toile, 89,5 x 117 cm. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo.
118
En juin de cette même année 1867, Manet termina son tableau historique, L’Exécution de Maximilien (p.62 et p.63), qui témoigne de son intérêt actif pour la vie de son époque. En 1867, au Mexique, les insurgés avaient fusillé, en même temps que les généraux qui lui étaient restés fidèles, l’archiduc Maximilien, que Napoléon III avait fait empereur du Mexique. En France, beaucoup de gens blâmaient Napoléon pour avoir évacué ses troupes du Mexique au moment même où leur aide était indispensable au jeune empereur. Edouard Manet fut bouleversé par ce drame et, pendant des mois, travailla à diverses variantes de ce tableau. C’était de la peinture historique au sens nouveau du terme. Manet s’intéressait à l’histoire de son époque, et non aux sujets de la mythologie antique ou des Saintes Ecritures, en usage à l’Ecole des beaux-arts et au Salon. Les romantiques Jéricho et Delacroix, et avant eux Gros, qui immortalisa les campagnes de Napoléon Bonaparte, avaient commencé à peindre des tableaux de ce genre. Mais Manet, là aussi, fit tout à sa façon. Ce n’est pas par hasard que, devant son empereur Maximilien,
119
Portrait de madame Edouard Manet sur un canapé bleu, 1874. Pastel sur papier brun marouflé sur toile, 49 x 60 cm. Musée d’Orsay, Paris.
120
La Dame aux éventails, 1873. Huile sur toile, 113,5 x 166,5 cm. Musée d’Orsay, Paris.
121
les contemporains se rappelèrent à nouveau les maîtres espagnols, dans ce cas précis le tableau de Goya, Les Exécutions du 3 mai 1808 (Madrid, musée du Prado). Manet avait su apprendre chez les Espagnols non seulement la couleur, mais aussi cette tension émotionnelle que l’on trouve dans la peinture de Goya. La peinture à sujet était étrangère aux futurs impressionnistes, mais cela ne les empêcha pas d’admirer une fois de plus leur aîné, qui leur montrait avec brio comment on peut suivre les leçons des maîtres du passé. « C’est un Goya, et pourtant, Manet n’a jamais été plus lui-même ! » s’écria Renoir devant ce tableau de Manet (Ambroise Vollard, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, 1936, p.72). L’année 1867 fut encore marquée par un autre événement qui bouleversa profondément Manet : la mort de Charles Baudelaire, le grand poète, son ami, qui l’avait tant soutenu lors de ses débuts en peinture. Très peu d’amis vinrent accompagner le poète à sa dernière demeure. L’enterrement avait lieu le 2 septembre. C’était une fin d’été très chaude. Le dimanche, la poste ne fonctionnait pas et beaucoup de gens reçurent le faire-part de décès trop tard. De plus, au moment de l’enterrement éclata un gros orage et les coups de tonnerre chassèrent nombre de ceux qui étaient venus accompagner le poète. Manet faisait partie des onze personnes qui suivirent le cortège funèbre jusqu’au cimetière Montparnasse. Il est fort possible que son tableau connu sous le titre L’Enterrement (New York, The Metropolitan Museum of Art), représente justement cet événement. A l’horizon, on aperçoit les silhouettes de cinq monuments reconnaissables de Paris : l’Observatoire, le Val-de-Grâce, le Panthéon, Saint-Etienne-du-Mont et la tour Clovis. Le ciel d’orage, peint à la manière d’une esquisse, et la partie supérieure du tableau, éclairée par une chaude lumière dorée, contrastent avec la partie inférieure où, sur un fond de sombre verdure se dessine, en tache noire, le cortège funèbre. La couleur et les contrastes de lumière créent la tension émotionnelle qui trahit les sentiments du peintre. L’inachevé du tableau et la libre application de la couleur par larges touches le rendent encore plus expressif. Un autre tableau, peint la même année, produit lui aussi cette impression d’inachevé : Courses à Longchamp (Chicago, The Art Institute of Chicago). Un des critiques le qualifia même d’esquisse. Manet fut le premier à utiliser, en peinture, le sujet des courses, ensuite repris par l’impressionniste Edgar Degas. Le tableau représente le moment final des courses au bois de Boulogne. L’endroit est rendu avec beaucoup de précision ; à l’arrière-plan, on reconnaît les coteaux de Saint-Cloud. Les nuages, peints avec légèreté et vivacité, un voile de brume rendu par des contours un peu flous, montrent une observation soigneuse de la nature. Ce n’est que comme cela que l’on peut dessiner des chevaux avec un tel raccourci : ils se précipitent, dans un galop fougueux, tout droit sur le spectateur. Ce tableau, pour la première fois en art plastique, suggère la comparaison avec la photo instantanée. Et là aussi, Manet avait fait le premier pas, devançant l’impressionniste Degas qui avait commencé à photographier lui-même. Malgré cela, il
Portrait de Berthe Morisot à l’éventail, 1874. Huile sur toile, 61 x 50,5 cm. Palais des Beaux-Arts, Lille.
123
Eugène Manet sur l’île de Wight, 1875. Huile sur toile, 38 x 46 cm. Musée Marmottan, Paris.
124
Marguerite de Conflans, vers 1876. Huile sur toile, 53 x 64 cm. Musée des Augustins, Toulouse.
125
n’était pas encore question, à ce moment-là, pour Manet de travailler en plein air. Cinq ans après, en 1872, il revint au thème des courses, dans un nouveau tableau, Les Courses de chevaux au bois de Boulogne (p.92-93), qui lui avait été commandé par un certain Barret. Et il est fort possible que Manet ait alors travaillé, ne fût-ce qu’en partie, en plein air. Mais, vers 1872, beaucoup de choses avaient changé. A ce moment-là, Manet s’était lié avec Degas et, ensemble, ils allaient quelquefois aux courses à Longchamp. Et il n’est pas exclu qu’alors, le futur impressionniste Degas ait exercé quelque influence sur la composition dans les tableaux de Manet. Edouard Manet ne cessait d’apprendre, essayant de nouvelles méthodes, de nouveaux procédés techniques ; c’étaient ses armes professionnelles. « Dans cette chienne de vie, toute de lutte, qui est la nôtre, on n’est jamais trop armé », disait-il à Edgar Degas (Manet, op. cit., p.17). On pourrait penser que le peintre aurait déjà dû accoutumer le public à son étrange manière, qui ne ressemblait à rien d’habituel. Pourtant, chacun de ses nouveaux tableaux surprenait les contemporains, suscitant au mieux la controverse, au pire la raillerie et les affronts à l’adresse de l’artiste. Et bien qu’il reconnût l’existence d’une lutte, lui-même ne cherchait pas du tout à y prendre part. A certains moments, il avait envie de tout abandonner et de peindre des tableaux franchement pour les vendre. Dans une lettre à Fantin-Latour, en 1868, il écrivait que même ses amis désespéraient de le voir réussir. Il disait qu’on lui avait donné une bonne leçon, qu’il avait reçu suffisamment de coups de pied, et que maintenant il voulait gagner de l’argent. Néanmoins, en 1868, l’année qui suivit l’Exposition universelle, ses tableaux apparurent une fois de plus comme un nouveau pas en avant en peinture. Deux d’entre eux se retrouvèrent au Salon de 1869 : Le Balcon (p.67) et Le Déjeuner dans l’atelier (p.61).
La Prune, vers 1877. Huile sur toile, 73,6 x 50,2 cm. National Gallery of Art, Washington, D.C. L’Artiste : portrait de Marcellin Desboutin, 1875. Huile sur toile, 195,5 x 131,5 cm. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo. Portrait de l’abbé Hurel, 1875. Huile sur toile, 42 x 30 cm. Museo Nacional de Arte, Buenos Aires.
126
Au premier coup d’œil sur Le Balcon, le rapprochement s’impose avec Les Manolas au balcon de Goya. Il s’était produit ce à quoi les spectateurs de Manet étaient déjà habitués : il avait de nouveau été inspiré par la peinture espagnole. D’après les souvenirs de ses contemporains, l’idée de cette composition lui était venue en 1865, après son premier voyage en Espagne. Au cours de l’été 1868, à Boulogne-sur-Mer, ce projet lui revint à l’esprit en observant des gens en villégiature, sur leur balcon. A son retour à Paris, Manet demanda à des amis de poser pour lui sur le balcon de son atelier, rue Guyot. Dans ce tableau, il réalisa une fois de plus ce dont il parlait en concevant Le Déjeuner sur l’herbe : « Je veux refaire cela et le faire dans la transparence de l’atmosphère, avec des personnages comme ceux que nous voyons là-bas » (Manet, op. cit., p.166). Il transplanta le motif de Goya dans le Paris du milieu du XIXe siècle. Les élégants personnages de Manet avaient perdu l’apparence romantique ; ils apportaient dans le tableau l’atmosphère de la vie quotidienne – celle des gens du monde parisien. A présent, il ne peignait plus le plein air, comme dans Le Déjeuner sur l’herbe. Il avait mis ses personnages dans le cadre du Paris de l’époque. Et de nouveau, comme dans La Musique
127
128
129
Portrait de Stéphane Mallarmé, 1876. Huile sur toile, 27,5 x 36 cm. Musée d’Orsay, Paris.
130
131
132
aux Tuileries, ce tableau ne contenait pas de sujet, il ne racontait rien. L’habitude de l’aspect « littéraire » de la peinture incitait les spectateurs à se poser des questions sur le sujet : peut-être ces Parisiens étaient-ils sortis sur le balcon pour voir le défilé du carnaval sur les boulevards ? Même un critique tel que Castagnary, habitué au réalisme de Courbet, avait formulé ses suppositions à ce propos : « Sur ce balcon, j’aperçois deux femmes, dont une toute jeune », écrivait-il. « Sont-ce les deux sœurs ? Est-ce la mère et la fille ? Je ne sais. Et puis, l’une est assise et semble s’être placée uniquement pour jouir du spectacle de la rue ; l’autre se gante comme si elle allait sortir. Cette attitude contradictoire me déroute » (Manet, op. cit., p.307). Si paradoxal que cela puisse paraître aux yeux des contemporains, l’absence d’un contenu littéraire rendait l’œuvre énigmatique. L’idée que l’on puisse créer un tableau tout simplement comme ça, uniquement pour des raisons purement picturales – comme Manet l’avait fait avec son Fifre – était étrangère aux gens du milieu du XIXe siècle. Peut-être est-ce justement Manet qui, le premier, fit germer cette idée dans l’esprit de ses contemporains. Même sensiblement plus tard, au siècle suivant, des spécialistes continuaient à chercher dans Le Balcon un deuxième sens caché. L’un des chercheurs émit l’hypothèse que chacun des personnages du tableau symbolisait un des pays dont la peinture avait inspiré l’œuvre de Manet. Dans ce cas-là, la femme en robe blanche, assise avec un éventail à la main, symbolisait l’Espagne ; la deuxième femme, au petit chapeau fantaisie, le Japon ; et le robuste personnage masculin, debout derrière, la Hollande, où l’artiste aimait se rendre, où il trouvait tant de modèles dans la peinture ancienne, et qui était la patrie de sa femme Suzanne. En réalité, Edouard Manet fut le premier peintre du XIXe siècle à se laisser guider, avant tout, dans la conception de ses œuvres, par la couleur et la lumière. C’est pourquoi il devint un modèle et un maître pour les futurs impressionnistes. Une ébauche au crayon de Manet montre que, dans une première variante, des volets fermés servaient de fond aux personnages sur le balcon. Dans le tableau, les volets ne sont plus qu’un encadrement pour la partie centrale. Cela a accusé le contraste entre la lumière et l’ombre et adouci les dégradés de couleur. Le premier plan est éclairé par les robes blanches des femmes. Puis le regard plonge dans une ombre profonde d’où ressort un premier personnage masculin, qui dissimule presque entièrement le second, celui du domestique portant un plateau. En ce qui concerne la couleur, elle est beaucoup plus complexe qu’elle peut paraître à première vue. Le vert des volets et de la balustrade est la couleur mise en relief de la façon la plus tranchée. Les étoffes blanches sont peintes avec des dégradés des plus subtils, depuis les ombres bleutées jusqu’aux effets de rose et de doré sous la lumière. C’est le genre de peinture qui pouvait inspirer le frémissement et la vibration de la couleur dans les robes blanches des Parisiennes de Renoir. Dans la peinture de Manet, des détails insignifiants, semble-t-il, tels qu’un éventail replié ou un parapluie, jouent un rôle énorme. En réalité, ce sont là précisément
Devant le Miroir, 1876. Huile sur toile, 92,1 x 71,4 cm. Solomon R. Guggenheim Museum, New York.
133
La Chanteuse de café-concert, 1879. Huile sur toile, 73 x 92 cm. Collection Rouart, Paris.
134
135
les effets de couleur qui mettent davantage en valeur la gamme picturale du tableau. La fine raie brune de l’éventail et le médaillon aux reflets dorés, la tache verte du parapluie et le ruban de velours vert autour du cou de la dame assurent l’équilibre des tons chauds et froids dans le tableau. La tache bleue de l’hortensia s’incorpore avec beaucoup d’habileté à la gamme générale : elle atténue l’intensité du vert de la balustrade. La manière dont est traité le vase de faïence montre le respect du peintre pour les traditions de la peinture ancienne. Venons-en, enfin, aux personnages du tableau : ce sont tous des amis proches de Manet. Chacun d’entre eux avait, à l’époque, moins de trente ans. Ils ne pensaient pas encore que Manet serait un peintre célèbre, ils ne se sentaient nullement flattés de pouvoir être représentés par lui, ils se plaignaient même de ce que poser debout était fatigant. La jeune femme assise, aux immenses yeux noirs, est le peintre Berthe Morisot. Son destin, ses relations avec Edouard Manet et les portraits peints par lui, méritent une attention toute particulière. A droite, se tient la violoniste Fanny Claus, qui jouait souvent avec la femme de Manet, Suzanne. Elle épousa un ami de Manet, le peintre Pierre Prins, et resta toujours une amie de la famille. Le jeune homme debout était également peintre : il s’agit du paysagiste Antoine Guillemet, un ami des impressionnistes. Et pour le domestique, qui disparaît presque dans l’ombre du fond, posa Léon Leenhoff, celui-là même que l’artiste avait peint, petit garçon, en costume d’infant espagnol. En fait, Manet avait créé un genre de peinture nouveau pour son époque. Ce n’était pas l’ancienne peinture de mœurs traditionnelle, ni un tableau mondain de salon, ni un portrait collectif d’amis. La Musique aux Tuileries, Le Balcon et peut-être déjà Le Déjeuner sur l’herbe ont ouvert la voie à ces scènes spontanées de la vie de l’époque, que l’artiste connaissait bien et à laquelle ses amis et lui avaient tous participé. Ce genre fut continué par Auguste Renoir : Manet et lui ont laissé à leurs descendants un tableau vivant de la vie parisienne au XIXe siècle.
Nana, 1877. Huile sur toile, 154 x 115 cm. Hamburger Kunsthalle, Hambourg. La Blonde aux seins nus, vers 1878. Huile sur toile, 62,5 x 52 cm. Musée d’Orsay, Paris.
136
Le Déjeuner dans l’atelier est de la même veine. Il fut composé pendant l’été 1868, à Boulogne-sur-Mer, où Manet séjournait avec sa famille. Comme le montre la radiographie, initialement le fond représentait les larges fenêtres de l’atelier qui donnaient sur la mer. Dans la variante finale, Manet les a supprimées et la pièce a pris plutôt l’apparence d’une salle à manger. Le fond est devenu plus sombre. Maintenant ce sont les visages et les détails de l’intérieur qui, grâce à la lumière, deviennent particulièrement expressifs. Un jeune homme, l’air pensif, est adossé à une table ; son personnage est coupé à la hauteur des genoux. On a l’impression que, d’un moment à l’autre, il va faire un pas en avant pour sortir de la pièce et, en même temps, de l’espace du tableau. Cette manière d’unir directement le monde réel à celui du tableau, de donner au spectateur le sentiment de faire partie de la composition créée par l’artiste, apparut pour la première fois dans cette œuvre. Le personnage principal du tableau est toujours le même Léon Leenhoff. Dans les tableaux de Manet, on voit Léon grandir et devenir adulte.
137
138
En 1868, il avait déjà commencé à travailler dans une banque qui appartenait au père d’Edgar Degas. Il appelait toujours Manet et sa femme Suzanne, « parrain » et « marraine », et, comme il le reconnut lui-même, jusqu’à la fin de sa vie il ne sut jamais s’il était le fils de Manet, un fils adoptif ou le frère cadet de Suzanne. La présence, dans ce tableau, du pupille de Manet crée cette atmosphère chaleureuse et intime qui sera, par la suite, caractéristique des impressionnistes. Cependant, dans la peinture de Manet, on ne trouvera jamais cette impression de l’instant éphémère saisi sur le vif, que Renoir saura rendre avec tant de légèreté et de spontanéité. Comme ce sera le cas chez les impressionnistes, Manet dans ce tableau a de nouveau pris pour modèles des gens qui lui étaient proches.
Femme à la jarretière (La Toilette), 1879. Pastel, 53 x 44 cm. Ordrupgaardsamlingen, Copenhague. Buveurs de bocks, vers 1879. Huile sur toile, 47,3 x 39,1 cm. The Walters Art Museum, Baltimore. La Serveuse de bocks, 1878-1879. Huile sur toile, 77,5 x 65 cm. Musée d’Orsay, Paris.
139
140
141
Dans la Serre, 1878-1879. Huile sur toile, 115 x 150 cm. Alte Nationalgalerie, Berlin.
142
Chez le Père Lathuille, 1879. Huile sur toile, 92 x 112 cm. Musée des Beaux-Arts, Tournai.
143
Pour le personnage du fumeur, lors des premières séances ce fut Claude Monet ; il fut ensuite remplacé par le voisin de Manet à Boulogne, le peintre Auguste Rousselin, qui avait fait son apprentissage avec Manet à l’atelier de Couture. On a parfois supposé que la femme au fond, avec la cafetière, était l’épouse du peintre, mais il s’agit plutôt d’une servante. Sa belle robe grise, en combinaison avec la couleur argent de la cafetière, forme la base d’un coloris raffiné qui rappelle une fois de plus les maîtres espagnols. L’armure de chevalier posée sur une chaise luit d’un sombre éclat argenté, une nappe de soie, bien repassée, est toute chatoyante de moirures nacrées. Ici apparaît de nouveau une plante en pot de faïence qui constitue, avec les objets sur la table, une des meilleures natures mortes de l’Œuvre de Manet. La beauté de cette nature morte fut la seule qualité de ce tableau qui eût obtenu des éloges de la critique au salon de 1869. Elle se trouva au centre de l’attention de Castagnary qui s’extasia sur son naturalisme : « En regardant Le Déjeuner, par exemple, je vois sur une table où le café est servi, un citron à moitié pelé et des huîtres fraîches » (Manet, op. cit., p.294). Pourtant, cette nature morte possédait beaucoup de qualités diverses. Le dessin sur le pot en faïence rappelait la mode parisienne du japonisme. Le citron et la faïence, la nappe, le couteau à fruits et le verre de vin, tout cela était peint avec une telle précision de facture, disposé de façon si harmonieuse, que Manet pouvait en vérité rivaliser avec les Hollandais du XVIIe siècle ou Chardin. Déjà bien auparavant, la nature morte était devenue, dans l’Œuvre de Manet, un genre indépendant. Il avait peint des tiges de pivoines jetées sur une table et des fleurs dans un vase en porcelaine. A Boulogne-sur-Mer, la fraîcheur de la couleur du poisson qui vient d’être pêché, avait frappé son imagination. Dans Le Poisson (Chicago, The Art Institute of Chicago), malgré tout le respect de Manet pour les maîtres anciens, la couleur s’étale librement sur la toile, en larges touches, donnant une impression d’inachevé ou de seulement esquissé. Dans les toiles Fruits sur une table (Paris, musée d’Orsay) et Nature morte avec melon et pêches (Washington D.C., National Gallery of Art), la soie de la nappe, le verre, le métal du couteau et la peau mate des pêches sont parachevés avec la minutie des peintres hollandais « mineurs ». Peintes en 1864-1866, ces toiles étaient une sorte d’examen de maturité d’un maître classique qui, ayant parfaitement assimilé les divers procédés de ses professeurs, s’est trouvé une voie indépendante. Rue de Berne, 1878. Huile sur toile, 64 x 80 cm. Collection privée. Portrait de Georges Clemenceau à la tribune, 1879-1880. Huile sur toile, 115,9 x 88,2 cm. Kimbell Art Museum, Fort Worth. Georges Clemenceau, 1879-1880. Huile sur toile, 94,5 x 74 cm. Musée d’Orsay, Paris.
144
Un détail, qui ne saute pas aux yeux immédiatement, complète cette impression d’intimité chaleureuse : aux pieds de la servante, sur le fond de sa robe grise, on voit un chat noir. Dans Le Balcon, un petit chien jouait avec une balle aux pieds de Berthe Morisot, rappelant les petits chiens des portraits de Goya. Toutefois, c’est précisément le chat noir qui devient comme l’estampille de Manet. Il apparaît pour la première fois dans Olympia. Déjà là, son attitude si bien observée avait attiré l’attention. Parmi les nombreux chats dessinés par Manet à l’encre de Chine sur les feuilles de son album, figure celui-là même qui fait sa toilette dans Le Déjeuner dans l’atelier. Le 17 octobre 1868, sur les murs de Paris,
145
146
147
148
on découvrit une affiche, dessinée par Manet, qui fit tout de suite sensation. Elle servait de réclame à un petit livre d’un ami de Manet, Champfleury, qui venait de paraître : Les Chats : histoire, mœurs, observations, anecdotes, avec des illustrations de plusieurs artistes dont Delacroix et Manet. Manet avait dessiné pour ce livre le même « rendez-vous de chats » – deux chats, un noir et un blanc, faisant le gros dos sur un toit – que tout Paris connaissait déjà par l’affiche (p.68). La deuxième œuvre graphique remarquable de Manet, exécutée nettement plus tard, en 1875 – les illustrations du poème d’Edgar Poe, Le Corbeau, traduit en français par Stéphane Mallarmé, un ami de l’artiste – ne fut pas destinée à connaître le succès du vivant de Manet. « Les proportions volumineuses de l’ouvrage », ont écrit des biographes de Manet, « les illustrations d’Edouard Manet, fort discuté encore en 1875, la singularité, pour le gros des lecteurs, du poème d’Edgar Poe, le nom encore à peu près inconnu de Mallarmé, tout concourut à éloigner les acquéreurs possibles » (Manet, op. cit., p.383). En 1876, parut le poème de Mallarmé L’Après-Midi d’un faune, illustré par Manet. La même année, le peintre réalisa un remarquable portrait de Mallarmé (p.130-131). Mallarmé et Manet avaient fait connaissance quelques années auparavant, probablement déjà en 1873, lorsque Mallarmé était arrivé à Paris, et devinrent vite amis. En rentrant du lycée Condorcet, où il enseignait l’anglais, Mallarmé passait souvent à l’atelier de Manet. Là il rencontrait Degas, Renoir et Monet, Emile Zola et Berthe Morisot, qui devint, elle aussi, son amie fidèle. C’est également là, dans cet atelier, que Mallarmé posa pour le peintre. Sur le portrait, le poète semble plus âgé qu’il ne l’était – à ce moment-là, il n’avait que trente-quatre ans. Etendu sur un divan, son éternel cigare à la main, Mallarmé a l’air profondément songeur. Son attitude dégagée donne à ce portrait une intimité particulière. Manet a trouvé une admirable harmonie de couleurs, un équilibre entre le ton chaud, doré, de l’étoffe japonaise du fond et le costume bleu marine de Mallarmé. La manière ample et libre de cette peinture apporte la dernière note à la création de l’image de Mallarmé, l’image d’un ami et d’un grand poète. Ce portrait est l’un des meilleurs dans l’Œuvre de l’artiste. Manet a peint un assez grand nombre de portraits dans sa vie, mais il n’a presque jamais exécuté de portraits sur commande. Ayant commencé dans ce domaine par un portrait de ses parents (p.18), le peintre rendit ensuite hommage à ses meilleurs amis. En 1866, il fit le portrait de Zacharie Astruc. Ecrivain, critique, peintre et sculpteur, celui-ci était un des plus proches amis de l’artiste. Tout comme dans le portrait de Zola, Manet y a peint une nature morte qui, à partir de ce moment-là, devint un élément presque obligatoire de ses portraits. Le portrait d’un autre ami de Manet, Théodore Duret (p.72), paraît plus officiel. Manet appelait Duret « le dernier des dandys ». Il l’a représenté en pied, portant un élégant costume, une badine à la main. Même là, dans le coloris gris-brun du tableau, les contemporains virent l’hispanisme, devenu coutumier, de son auteur. Il est possible qu’il ait été intentionnel : le peintre avait fait la connaissance de Théodore Duret au cours de
Espagnole, vers 1879. Pastel, 56 x 46 cm. Kunsthaus, Zurich.
149
Femme à l’épingle d’or, 1879. Huile sur toile, 91 x 71 cm. Collection privée.
150
son voyage en Espagne en 1865. Manet ne s’était pas encore remis de l’accueil railleur fait à son Olympia à Paris ; il lui semblait que Duret aussi s’était moqué de lui. Le malentendu ne tarda pas à se dissiper, ils visitèrent Madrid ensemble et bientôt devinrent les amis les plus proches. Après un début dans le commerce du cognac, Duret s’était intéressé à la peinture et, à partir de 1867, commença à paraître dans la presse en qualité de critique d’art. Il fut d’abord assez sévère à l’égard de Manet ; il était décontenancé par le caractère d’esquisse de la manière picturale de l’artiste. « Manet se condamne à rester fort en dessous de ce qu’il pourrait être, en peignant d’une manière trop rapide et trop hâtive », écrivait-il. (Manet, op. cit., p.288). Néanmoins, il ne tarda pas à devenir un ardent admirateur, non seulement de Manet lui-même, mais aussi de ses amis impressionnistes. En 1878, fut publié son premier ouvrage sérieux : Histoire des peintres impressionnistes. C’est Duret qui décrivit le processus du travail de Manet dont il avait été témoin dans son atelier. Alors qu’il semblait à Duret que le portrait était achevé, l’auteur, lui, n’était pas satisfait. Il mit, à côté du modèle, un tabouret recouvert d’un tissu grenat et jeta à côté un livre vert vif. Mais cela non plus ne lui suffit pas. Sur le tabouret, il posa un plateau laqué avec, dessus, une carafe, un verre et un couteau, puis ajouta encore un citron sur le verre. « Evidemment le tableau, tout entier gris et monochrome, ne lui plaisait pas », commentait Duret. « Il lui manquait les couleurs qui puissent contenter son œil, et ne les ayant pas mises d’abord, il les avait ajoutées ensuite, sous la forme de nature morte » (Manet, op. cit., p.288). Dans l’Œuvre de son ami, Duret avait compris l’essentiel : Manet était né peintre comme on naît avec une justesse absolue de l’oreille. Il voyait à l’avance son futur tableau en couleurs, comme Michel-Ange sentait sa statue, encore inexistante, dans le bloc de pierre. Et quoi que peignît Manet, son objectif et son élément étaient la couleur, et uniquement la couleur. Parfois, il est difficile de distinguer, dans l’Œuvre de Manet, un portrait d’une scène de la vie de l’époque, même si on ne tient pas compte des cas où Manet a demandé à des amis de poser pour des tableaux tels que Le Déjeuner sur l’herbe ou Le Balcon. Sa femme Suzanne Leenhoff figure sur ses toiles assise au piano (p.60) – Manet avait appris à la connaître quand elle leur donnait des leçons de musique, à lui et à ses frères. Suzanne posait, seule ou avec Léon, dans le cadre de leur appartement ou sur l’une des plages du nord de la France. Ces portraits de Suzanne, tantôt peints dans des tons clairs, avec des reflets roses et bleus, tantôt dans une gamme raffinée de noir relevée d’or, dégagent une impression de quiétude chaleureuse. Dans ses dernières années, peu avant sa mort, Manet peignit toute une série de portraits de belles Parisiennes. Parmi elles, Isabelle Lemonnier, fille d’un joaillier parisien, dont il était épris. Le peintre, déjà gravement malade, envoyait à Isabelle des billets touchants. Dans l’un d’eux, il avait dessiné une prune et écrit : « A Isabelle / cette mirabelle / et la plus belle / c’est Isabelle » (Manet, op. cit., p.456). Manet ne fut jamais indifférent au charme féminin. Au début des années 1880, sur une commande de son ami Antonin Proust, il peignit des tableaux-portraits symbolisant les saisons de l’année. Pour Le Printemps (lieu de conservation inconnu), il choisit une jeune actrice ravissante, Jeanne Demarsy ; pour L’Automne (p.175), Mery Laurent. Des relations amicales particulièrement chaleureuses s’étaient nouées entre le
151
peintre et ce modèle. Mery Laurent était une dame du demi-monde parisien. Elle était venue pour la première fois dans l’atelier de Manet en 1876. Le peintre avait été séduit par son élégance, son rire, mais surtout par le ton rose de son visage en combinaison avec l’or foncé de ses cheveux. Mallarmé, amoureux de Mery Laurent, lui avait composé un quatrain qu’elle fit graver au-dessus de la porte de son hôtel particulier parisien : « Ouverte au rire qui l’arrose / Telle sans que rien d’amer y / Séjourne, une embaumante rose / Du jardin royal est Mery » (Manet, op. cit., p.489). Mery amena à l’atelier de Manet Irma Brunner, une élégante Viennoise. L’artiste la peignit avec différentes nuances de rose, ombrées par les bords noirs de son chapeau. Le goût artistique de Manet ne le laissa pas se transformer en portraitiste à la mode pour dames, bien qu’il fût toujours flatté par l’admiration de ses modèles pour ses portraits. En même temps, il travaillait sur des portraits masculins, parmi lesquels un Portrait de Clemenceau à la tribune (p.146) peint en 1880. Le peintre et son modèle étaient liés par de nombreux amis communs. Clemenceau avait peu de temps pour poser ; d’après ce qu’il disait lui-même, ce qui l’attirait dans ses visites à l’atelier, c’était la possibilité de parler avec Manet. « J’avais tant de plaisir à causer avec Manet ! », se souvenait-il. « Il était si spirituel ! » (Manet, op. cit., p.443). Manet fit plus d’un portrait de son ami d’enfance et de jeunesse, Antonin Proust, qui a laissé de lui les meilleurs souvenirs. Le portrait du légendaire journaliste Henri Rochefort (p.177) se distinguait par son exceptionnelle puissance émotionnelle. Rochefort était entouré d’une auréole romantique : envoyé au bagne pour sa participation aux événements de la Commune, il s’évada de la NouvelleCalédonie et revint en France après l’amnistie. Ce n’était pas un ami de Manet, il accepta difficilement de poser pour lui et refusa le portrait, qui lui déplut. Ses goûts artistiques étaient trop traditionnels pour comprendre la libre et ample manière picturale de Manet. Alphonse Daudet, qui connaissait Rochefort depuis l’enfance, le comparait à Don Quichotte et Méphistophélès. Manet réussit à rendre la forte personnalité du journaliste. Pour le peintre, c’était l’essentiel, et le mécontentement du modèle ne produisait jamais sur lui le moindre effet. Lorsque l’écrivain irlandais George Moore commença à exiger des modifications dans le portrait qu’il avait peint de lui au pastel (New York, The Metropolitan Museum of Art), Manet déclara : « Je ne changerai rien à son portrait. Est-ce ma faute à moi si Moore a l’air d’un jaune d’œuf écrasé et si sa binette n’est pas d’ensemble ? (…) Il n’y a pas de symétrie dans la nature. Un œil ne fait jamais pendant à l’autre, il est différent. Nous avons tous le nez plus ou moins de travers, la bouche toujours irrégulière » (Manet, op. cit., p.427). Manet ne se montrait pas moins exigeant quand il s’agissait de sa propre apparence. Il ne commença à peindre des autoportraits que tard, dans les années 1870, « au moment même où [il] était au sommet de sa carrière », écrivait Théodore Duret. « Il avait atteint le genre de renom qui devait lui appartenir de son vivant. C’était un des hommes les plus en vue de Paris » (Manet, op. cit., p.405). Dans son meilleur Autoportrait à la palette (p.9), il s’est représenté, comme Velázquez et Rembrandt, scrutant du regard son propre visage. Mais tout cela n’arriva que beaucoup plus tard,
Portrait de la comtesse Albazzi, 1880. Pastel, 56,5 x 46,5 cm. Solomon R. Guggenheim Museum, New York. Trois Têtes de femmes, 1880. Aquarelle, 19,2 x 12 cm. Musée des Beaux-Arts, Dijon. Femme au chapeau rouge, vers 1880. Aquarelle, page de carnet quadrillé, 18,5 x 12 cm. Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.
153
154
155
quelques années avant sa mort, lorsque Manet eut déjà enduré les pénibles épreuves de la guerre et de la Commune. 1870 fut une année douloureuse pour la France. Napoléon III déclara la guerre à la Prusse. Le 1er septembre, l’armée française, avec l’empereur à sa tête, capitula à Sedan. La république fut proclamée en France. Les Prussiens marchaient sur Paris. Manet envoya sa mère, sa femme et Léon à Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées, et lui-même resta pour défendre la république. Beaucoup d’artistes se sentaient désemparés et décidèrent que l’exode était la seule façon de résister à la guerre. Pour Manet, il fut absolument naturel de s’engager dans la garde nationale comme artilleur. Le 19 septembre, commença le siège de Paris. Manet ferma son atelier et mit ses tableaux en dépôt dans un endroit sûr, chez Duret.
Portrait d’Irma Brunner, vers 1880. Pastel sur toile et châssis, 53,5 x 44,1 cm. Musée d’Orsay, Paris. Eglantines, vers 1880. Aquarelle, 19,4 x 12,1 cm. Collection Alex Lewyt. Pervenches, vers 1880. Aquarelle, 19,4 x 12,1 cm. Collection Alex Lewyt. Un Coin du jardin de Bellevue, 1880. Huile sur toile, 91 x 70 cm. Fondation E. G. Bührle, Zurich. La Mère de Manet dans son jardin à Bellevue, 1880. Huile sur toile, 82 x 65 cm. Collection privée, Paris.
156
Là se retrouvèrent Le Déjeuner sur l’herbe, Olympia, Lola, Le Balcon et beaucoup d’autres. Dans le post-scriptum de la lettre adressée à Duret, il écrivit : « Au cas où je serais tué, je vous donne à votre choix, Le Clair de Lune ou La Lecture (p.78). Vous pourrez demander, si vous préférez, L’Enfant aux bulles de savon (A. Tabarant, Manet et ses œuvres, Paris, 1947, p.182-183) ». Dans Paris assiégé, Manet endura les bombardements, la faim et le froid. Le courrier était expédié de la capitale en ballon. Dans ses lettres, Manet disait à Suzanne combien la maison vide paraissait triste, et il lui parlait des combats autour de la ville, des tirs d’artillerie et des incendies, de l’épidémie de variole, des files d’attente devant les magasins d’alimentation, et des gens qui mouraient de faim. Manet racontait qu’il se faisait muter à l’état-major, car servir dans l’artillerie était au-dessus de ses forces. Faire de la peinture dans ces conditions était impossible. Il reste un dessin de Manet qui représente une file d’attente devant un magasin d’alimentation, et quelques croquis de rues. A la fin du mois de janvier, Paris capitula. Le 12 février, Manet partit rejoindre sa famille dans le Midi, et ce n’est qu’à Arcachon qu’il apprit que la révolution avait éclaté à Paris et que la Commune avait été proclamée. En avril, Le Journal Officiel de la Commune publia un manifeste annonçant la création d’une fédération d’artistes à laquelle il avait été élu en son absence, en même temps que vingt-cinq autres peintres et dix sculpteurs. Il revint à Paris seulement vers le début du mois de juin 1871, après la « semaine sanglante ». Son retour au travail, après une telle interruption, ne fut pas facile. Sa situation matérielle ne l’était pas non plus. Heureusement, le marchand Durand-Ruel lui acheta vingt-quatre tableaux qu’il présenta ensuite dans différentes expositions. Peu de temps avant la guerre, en mai 1870, l’ami de Manet, Henri Fantin-Latour, avait exposé un grand portrait de groupe sous le titre Un Atelier aux Batignolles (Paris, musée d’Orsay). Manet, assis à son chevalet, est entouré de ses jeunes amis. Derrière lui, sur le fond d’un cadre vide, se détache le profil de Renoir. A côté de Renoir, derrière Astruc assis, se tient Emile Zola, le principal défenseur de Manet. Près du musicien Edmond Maître, un peu à l’écart dans l’ombre, se dresse au premier plan la haute stature de Frédéric Bazille. Fantin-Latour l’a mis en
158
159
160
161
évidence comme un talent manifeste. Et, enfin, de derrière le dos de Bazille, apparaît Claude Monet. Les futurs impressionnistes s’étaient regroupés autour de Manet, alors qu’on ne les appelait pas encore ainsi, avant leur première exposition. On les surnommait déjà alors « la bande à Manet ». Et bien que Manet eût refusé d’exposer avec eux, les contemporains associaient son nom avec l’impressionnisme. Castagnary parlait de l’influence de Manet sur les impressionnistes, Mallarmé considérait Manet comme une figure-clé dans leur mouvement artistique, et Silvestre mentionnait « la petite école des intransigeants, dont on le considère comme le chef » (A. Tabarant, op. cit., p.285). En réalité, il n’y avait pas d’école de Manet, il ne s’était jamais fixé pareil but et, comme l’affirmait ce même Silvestre, il n’en était pas capable : « Personne n’en avait moins que lui le tempérament, car je n’ai pas connu de nature plus exempte de solennité », écrivait le critique (A. Silvestre, Au Pays des souvenirs, Paris 1887, p.160). Pourtant, Manet joua un grand rôle dans la naissance de l’impressionnisme, et ses contemporains le comprirent. Duranty l’a défini très joliment. Il disait que Manet « a soutenu la lutte la plus acharnée, a ouvert non plus seulement un jour, mais des fenêtres toutes grandes, mais des brèches, sur le plein air et le vrai soleil, a pris la tête du mouvement et a maintes fois livré au public, avec une candeur et un courage qui le rapprochent des hommes de génie, les œuvres les plus neuves, les plus entachées de défauts, les mieux ceinturées de qualités » (E. Duranty, La Nouvelle Peinture : à propos du groupe d’artistes qui expose dans les galeries Durand-Ruel [1876], Paris, 1946, p.17). Le terme d’impressionniste n’avait pas été appliqué à Manet personnellement, mais un artiste aussi audacieux que lui ne pouvait pas ne pas avoir l’œil sur les jeunes. Il se trouva que leur art pouvait aussi donner quelque chose à ce maître plus expérimenté. Et si dans l’Œuvre de Manet apparurent des traits caractéristiques de l’impressionnisme, ce fut notamment après la guerre, pendant une courte durée, l’année de la première exposition de ses jeunes amis. Manet passait l’été 1874 dans sa propriété de famille à Gennevilliers, près de Paris. A Argenteuil demeurait Claude Monet, que Manet avait aidé à y trouver une maison en 1871, après la guerre. Manet n’avait qu’à traverser le pont sur la Seine pour rendre visite à la famille de Monet. Par une chaude journée de juillet, il trouva Claude avec sa femme et leur fils Jean, dans le jardin, et peignit cette sympathique scène familiale. Et Monet lui-même, ainsi que Renoir, qui était passé le voir à ce moment-là, se souvenaient comment Edouard Manet avait peint Monet en train d’arroser ses fleurs, Camille assise sous un arbre avec son fils, et des poules qui se promenaient dans l’herbe. La Famille Monet dans son jardin à Argenteuil (p.116-117) fut le premier tableau, dans l’Œuvre de Manet, dont le personnage principal fût la lumière, ce qui n’est pas étonnant car le peintre avait, pour la première fois, travaillé directement en plein air. La lumière accentuait au maximum la couleur de l’herbe, le contraste du rouge et du vert ainsi que les ombres d’un bleu ciel éclatant sur les vêtements blancs. Cependant, les aplats colorés restaient comme auparavant d’un seul tenant ; ce tableau de Manet rappelle les paysages de Claude Monet de la fin des années 1860,
Femme lisant, vers 1880. Pastel, 55,5 x 46 cm. Stedelijk Museum, Amsterdam. L’Asperge, 1880. Huile sur toile, 16,5 x 21,5 cm. Musée d’Orsay, Paris. Le Jambon, 1880. Huile sur toile, 32 x 42 cm. The Burrell Collection, Glasgow. Annabelle Lee, vers 1881. Pinceau et pierre noire, 46,2 x 29 cm. Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Jeune Fille devant la mer, 1880. Aquarelle, 18 x 13 cm. Collection André Bromberg.
163
164
165
166
167
quand sa touche colorée n’était pas encore fragmentée. L’individualité de Monet était trop forte en peinture pour que même un maître aussi indépendant que Manet pût passer à côté. C’est justement cet été-là que Manet peignit deux de ses tableaux impressionnistes. Ni l’un ni l’autre ne furent purement des paysages et bien que, comme toujours chez Manet, il n’y eût pas de sujet dans ces tableaux, ils poursuivaient le récit de la vie de l’époque de leur auteur. Le tableau En Bateau (p.114) représente le frère de Suzanne Manet, Rodolphe Leenhoff, avec une dame. Cette scène est très caractéristique du Paris de la fin du XIXe siècle. La distraction favorite des jeunes Parisiens, les dimanches d’été, était les promenades en bateau sur la Seine. Dans toute la banlieue de Paris, à Chatou, Bougival, Asnières, Argenteuil, on pouvait louer un bateau. Des jeunes gens à l’air sportif, en maillot moulant leurs corps robustes, promenaient de jolies jeunes filles, en robes d’été claires, assises sous leurs ombrelles. La composition de ce tableau souligne l’évolution du peintre si on la compare au Déjeuner dans l’atelier. En effet, le bateau est coupé par le bord inférieur de la toile. Le spectateur regarde les personnages comme s’il était assis à côté d’eux dans le bateau, c’est-à-dire qu’il se trouve entièrement inclus dans la vie du tableau. D’un point de vue aussi bas, on ne voit ni le ciel ni la rive opposée de la Seine. C’est là la manière dont construisaient leur perspective les artistes japonais, dont Manet connaissait bien, et avait étudié, les gravures. Le fond du tableau est constitué par la surface de l’eau. Le contraste entre le maillot blanc, le canotier jaune et le corps rose d’une part, et le ton froid de l’eau d’autre part, rend cette lumière solaire que les impressionnistes avaient si bien appris à capter. La vibration des touches blanches et bleu clair sur la robe de la dame rappelle les ombres colorées et les reflets de la peinture de Monet et de Renoir. Cependant, la surface du fleuve est peinte, comme toujours, en un seul aplat coloré continu. Elle ressemble plutôt à une étoffe de soie ondoyante ; elle n’est variée que par de minces traînées sinueuses de blanc de céruse. Dans cette eau, il n’y a pas de moirures multicolores qui se morcellent comme dans les tableaux de Claude Monet à la même époque.
Jeune Fille en chapeau d’été, vers 1881. Pastel, 56 x 35 cm. Collection privée, Suisse.
168
Le deuxième tableau était Argenteuil (p.111). Les mêmes personnages, Rodolphe Leenhoff et sa partenaire, sont assis sur le quai au milieu de bateaux qui se balancent autour d’eux. Leurs vêtements rayés créent sur la toile une telle vibration de touches colorées qu’elle suffit, à elle seule, à donner à ce tableau l’aspect d’une œuvre impressionniste. Cette fois-ci, le paysage fait de plein droit partie de la composition et devient tout à fait impressionniste. L’eau est peinte par touches fragmentées et, en elle, se reflètent le ciel bleu, la verdure des arbres et les bâtiments d’Argenteuil sur l’autre rive. Néanmoins, la construction symétrique du tableau, qui se modèle strictement sur la conception classique, le distingue des compositions de Renoir ou Degas. Il est possible que cela s’explique, dans une grande mesure, par le désir de Manet d’exposer son tableau au Salon. Mais le peintre n’est jamais parvenu à rendre le caractère éphémère de la scène fixée sur la toile, qui distinguait les tableaux des impressionnistes. En ce qui concerne le paysage, il semble que les trouvailles
169
impressionnistes aient plu à Manet lui-même. En 1875, il se rendit, avec sa femme et le peintre James Tissot, à Venise. De ce voyage, il ne nous reste que deux vues du Grand Canal, peintes les tout derniers jours (p.110 et 113). « Il était sur le point d’abandonner et de rentrer à Paris le dernier après-midi de son séjour », raconte un témoin oculaire. « Il prit une assez petite toile, et sortit sur le Grand Canal, pour faire une esquisse en souvenir de son séjour ; il fut, me dit-il, tellement heureux du résultat de ce travail, qu’il décida de rester un jour de plus pour le terminer » (L. W. Havemeyer, Sixteen to Sixty. Memoirs of a collector, New York, 1961, p.226). L’alternance nerveuse des touches de couleur rend l’oscillation de l’eau et l’éclairage sans cesse changeant. Manet acquit la conviction qu’en travaillant en plein air, il était parvenu à faire sentir le mouvement constant de la nature, tout comme l’avaient fait les impressionnistes. Au cours de ces années, Manet fréquenta régulièrement les impressionnistes. Ses lieux de rencontre avec les peintres, les critiques et les écrivains étaient les cafés parisiens. Le grand caricaturiste Honoré Daumier, ami de Daubigny et de Corot, a dessiné cet étrange et incroyable Paris dans lequel il leur avait été donné de vivre. Dans les dessins de Daumier, des ouvriers, debout sur les toits de maisons anciennes, les démolissent à l’aide de pics, tandis que, sur les Champs-Elysées, les citadins en promenade tombent dans des fossés et se jettent de côté pour éviter les poutres qui passent en trombe au-dessus de leurs têtes. Le vieux Paris s’enfonçait dans le passé, le souvenir de la ville médiévale aux remparts et aux rues étroites ne survécut que dans les romans de Dumas. La ville du milieu du XIXe siècle est restée dans l’histoire sous le nom de Paris d’Haussmann. Pendant dix-sept ans, Paris fut gouverné par le préfet, le baron Haussmann – le « Pacha Haussmann », le « grand baron », le « Louis XIV de la ville de Paris », comme on le surnommait dans la presse. En effet, un plan grandiose de reconstruction de la capitale est lié à son nom. Un réseau de boulevards spacieux coupait les vieilles rues, créant les conditions nécessaires à cette vie active et à cette circulation qui convenaient tout naturellement à la capitale de la France. Sur la rive droite, les boulevards s’étirèrent en un ruban interminable, changeant de nom en cours de route. Sur ces nouveaux boulevards, il n’était plus possible d’élever aussi facilement et aussi rapidement des barricades que dans les rues étroites de la vieille ville. C’était un problème qu’il fallait prendre en considération au milieu du XIXe siècle, où les révolutions en France se succédaient les unes aux autres. Certes, on pouvait regretter l’enchevêtrement romantique des vieilles rues, mais la ville se devait de retrouver une nouvelle dignité. Dans le centre de Paris, s’élevèrent des immeubles correspondant aux exigences de la bourgeoisie qui s’était enrichie après la révolution de la fin du XVIIIe siècle. Les premiers grands magasins et hôtels firent leur apparition. En 1873, un incendie détruisit le bâtiment de l’opéra et c’est alors que, sur un projet de l’architecte Garnier, fut construit le Grand Opéra. La ville s’habilla de verdure. Le parc Monceau qui, au XVIIIe siècle, était une sorte de caprice, de fantaisie du duc de Chartres, se transforma en un imposant parc
Sur le Banc, 1881. Pastel sur toile, 61 x 50 cm. Collection privée, Japon. Irma Brunner, 1882. Pastel, 57 x 36,5 cm. Collection privée, Suisse. Méry Laurent au chapeau noir. Pastel, 54 x 44 cm. Musée des Beaux-Arts, Dijon.
171
172
public aux larges allées, entouré de luxueux hôtels particuliers dont les jardins se confondaient avec lui. Son planificateur, l’ingénieur Alphand, réalisa en 1863 encore un autre admirable projet d’Haussmann : à l’emplacement des carrières médiévales de plâtre, où vers cette époque-là s’était constituée une énorme décharge municipale, il planifia un jardin romantique avec des buttes, un lac et des pavillons extravagants : les Buttes-Chaumont.
Automne (Méry Laurent), 1881. Huile sur toile, 73 x 51 cm. Musée des Beaux-Arts, Nancy. A Monsieur Pertuiset, chasseur de lions, 1881. Huile sur toile, 150 x 170 cm. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo. Portrait d’Henri Rochefort, 1881. Huile sur toile, 81,5 x 66,5 cm. Hamburger Kunsthalle, Hambourg.
174
En ce temps-là, à Paris, les gares apparaissaient l’une après l’autre. La capitale de la France non seulement se rattachait à la province, mais elle s’apprêtait également à recevoir des vagues interminables de touristes. Ces gares se retrouvèrent au milieu de quartiers d’habitation qui surgissaient autour d’elles avec une incroyable rapidité. Les trains laissaient derrière eux une traînée de fumée et le fracas des roues, encore audible longtemps après leur passage. Cette agitation constante, ce bruit et cette suie dans le centre de la ville étaient inhabituels ; ils étaient même ressentis par les bourgeois parisiens comme une atteinte au respect de soi. Manet, lui, réagit autrement à ces changements. En 1872, il installa son atelier au 4 de la rue de Saint-Pétersbourg ; à côté de chez lui passaient les voies des chemins de fer de l’Ouest. C’est au cours de l’automne 1872 qu’il peignit Le Chemin de fer (p.103). Dans cette composition exécutée en plein air, il n’y a rien qui puisse décontenancer ou choquer. Les rails sont séparés des personnages du tableau par une grille, et le train, entrant dans la gare Saint-Lazare, a enveloppé le paysage urbain d’un rideau de fumée blanche, à travers lequel les bâtiments sont à peine visibles. Manet n’admirait pas la nouvelle esthétique de la ville, mais il l’acceptait. Après une interruption de dix ans, Victorine Meurent, qui venait de rentrer des Etats-Unis, posa pour lui de nouveau. Les personnages du tableau – Victorine en robe bleu foncé, un chiot blanc sur les genoux, et une petite fille en robe blanche avec un nœud de ruban bleu – formaient un couple bizarre si on tentait de déchiffrer le sujet. Mais de sujet, il n’y en avait pas. Il n’y avait que la ville qui, malgré toutes les reconstructions, restait romantique aux yeux de Manet. Et il y avait Victorine avec sa peau de lait et ses cheveux roux. Tous ces éléments ensemble constituaient un motif pictural pour un tableau. Et comme pour souligner sa logique picturale, l’artiste peignit sur la grille une grappe de raisins verte, qui n’était indispensable que comme tache de couleur. Dans la construction des gares, on faisait un grand usage des excellentes nouvelles charpentes métalliques. Plus tard, elles furent remarquées par Claude Monet : dans l’esthétique de sa gare Saint-Lazare, la dentelle des charpentes métalliques joue un rôle important. Manet n’y prêta pas attention, même si elles occupaient de plus en plus de place dans l’architecture de la ville. On s’en servit également pour les nouvelles halles, au centre même de la ville, sur la rive droite, à l’ombre de l’immense église Saint-Eustache. « L’Empereur, enchanté de la gare de l’Est qui venait d’être achevée (…) concevait les Halles centrales construites d’après ce type de hall, couvert en charpentes de fer vitrées,
175
176
178
qui abrite le départ et l’arrivée des trains », raconte le baron Haussmann dans ses mémoires. « « Ce sont des vastes parapluies qu’il me faut, rien de plus ! » me dit-il un jour (…) en esquissant par quelques traits de crayon la silhouette qu’il avait en vue (…). J’emportai le bout de papier dépositaire de la pensée auguste. » En transmettant ces croquis à l’architecte Baltard, Haussmann lui dit : « Faites-moi, au plus vite, un avant-projet suivant ces indications. Du fer, du fer, rien que du fer ! » (Georges Eugène Haussmann, Mémoires, t. 3). Il était impossible de ne pas regretter, avec Baudelaire, la disparition du vieux Paris : « Le vieux Paris n’est plus / la forme d’une ville / Change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel) » (Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « Tableaux parisiens », 89, « Le Cygne », Paris, 2002, p.140).
Henry Bernstein enfant, 1881. Huile sur toile, 135 x 79 cm. Collection privée. Etude pour Un Bar aux Folies-Bergère,1881-1882. Huile sur toile, 96 x 130 cm. The Courtauld Institute of Art, Londres.
179
Un Bar aux Folies-Bergère, 1882. Huile sur toile, 96 x 130 cm. The Courtauld Institute of Art, Londres.
180
181
Toutefois, Manet et les impressionnistes se sentaient à l’aise dans ce « nouveau » Paris. La ville d’Edouard Manet était la rive droite, le quartier des grands boulevards, des nouvelles gares et des pentes de Montmartre. C’est là qu’il vivait, qu’il louait son atelier. C’est là que venaient le voir les frères Goncourt à la recherche d’un échantillon du milieu artistique parisien pour leurs romans. Non loin se trouvaient aussi les cafés, où ses amis pouvaient le rencontrer tous les soirs. A partir du milieu des années 1860, ce fut le café de Bade, 32, boulevard des Italiens, qu’il remplaça, en 1866, par le tranquille petit café Guerbois, 9, avenue de Clichy. En 1868, Manet invita au café Guerbois Monet et ses amis. Le lundi soir, on pouvait y rencontrer tout le monde. Même le célèbre Nadar. Le café Guerbois était constamment fréquenté par des écrivains et des critiques – Astruc, Zola, Duranty, Silvestre – ainsi que par des peintres – Degas, Fantin-Latour, Desboutin. C’est là que Manet peignit le graveur Belleau devant un bock de bière, Le Bon Bock. L’ami d’enfance de Manet, Antonin Proust, y venait souvent. Plus tard, il préféra le journalisme à la peinture, entra dans le monde de la politique et, en 1881, pendant deux mois, occupa même le poste de ministre des Beaux-Arts. Les contemporains racontaient qu’au café Guerbois avaient toujours lieu des discussions, au centre desquelles se trouvait Manet. « Ce riant, ce blond Manet / De qui la grâce émanait / Gai, subtil, charmant en somme, / Sous sa barbe d’Apollon / Eut de la nuque au talon / Un bel air de gentilhomme », ainsi écrivait le poète Théodore de Banville (Dominique Bona, Berthe Morisot, Paris, 2000, p.93). Dans ces discussions, il se montrait ironique, parfois même cruel, ses paroles vous clouaient sur place, et ses observations étaient toujours justes. Son digne rival était le spirituel Edgar Degas, qui avait une culture irréprochable. Du groupe de Claude Monet, seul Bazille avait l’audace de participer à ces discussions avec Manet. Le débatteur le plus subtil et le plus invincible était Duranty. Une de ses discussions avec Edouard Manet se termina par un duel. Le critique Paul Alexis a raconté comment, ne connaissant strictement rien à l’escrime, ils s’étaient jetés l’un sur l’autre avec un tel acharnement que, lorsque les quatre témoins réussirent à les séparer, leurs épées s’étaient transformées en deux tire-bouchons. Le soir même, ils étaient redevenus les meilleurs amis du monde. Une autre fois, leurs amis furent témoins d’une violente altercation entre Manet et Degas, à la suite de laquelle ils se restituèrent les tableaux dont ils s’étaient fait cadeau auparavant.
Le Clairon, 1882. Huile sur toile, 99 x 80,3 cm. Collection privée.
182
En 1872, quand Paris se fut remis de la guerre, le groupe de Manet déménagea au café La Nouvelle Athènes, place Pigalle. Toutefois, il ne fut plus fréquenté par tous les habitués du café Guerbois. Bazille avait été tué à la guerre, Monet et Sisley vivaient en banlieue, quant à Pissarro, il ne passait que lorsqu’il se trouvait à Paris. Les rares apparitions de Cézanne étaient perçues comme un spectacle. Duranty écrivait à Zola que Cézanne était venu à La Nouvelle Athènes en blouse bleue et chemise blanche, celle-ci toute tachée de peinture, portant un vieux chapeau défoncé, et avait produit une forte impression sur les personnes présentes. En 1876, c’est à la terrasse de La Nouvelle Athènes que Degas peignit son tableau L’Absinthe, pour lequel posèrent l’actrice Ellen Andrée et le graveur Marcellin Desboutin.
Corbeille de poires, 1882. Huile sur toile, 35 x 41 cm. Ordrupgaardsamlingen, Copenhague.
184
Le grand portrait de Desboutin, lui, avait été peint par Manet en 1875 (p.128). En 1877-1878, à La Nouvelle Athènes, Manet représenta également Ellen Andrée à une petite table, dans le tableau La Prune (p.127). Des amis disaient que l’artiste avait peint son modèle à l’atelier, où il avait une petite table en marbre, mais il est absolument évident qu’il le fit d’après des impressions vraies. Très probablement, comme toujours chez Manet, c’est la lumière qui joua le rôle décisif. Le jeu des reflets du corsage dans le marbre bleuté de la table en combinaison avec le verre du bock crée, dans ce tableau, une gamme de couleurs extraordinairement belle. D’autre part, La Prune est entrée dans une série de tableaux de Manet que ses contemporains qualifièrent de « série naturaliste ». Le peintre représentait le milieu mondain et artistique, auquel il appartenait, tout comme les écrivains de l’école « naturaliste » : les frères Goncourt, Zola et d’autres. La vie de la cité, avec ses figures caractéristiques et les endroits préférés de Manet à Paris, s’intégrait dans sa peinture, en commençant par ses premiers tableaux : La Chanteuse des rues et Le Déjeuner sur l’herbe. Peint en 1873, le petit tableau Bal masqué à l’Opéra (p.100) marqua presque symboliquement la fin de la période impressionniste de plein air de Manet et son retour aux motifs urbains. Tous les ans, à la fin du mois de mars, on organisait à l’Opéra un bal costumé, suivi quelques jours après d’un bal masqué pour le public artistique.
Le Citron, 1880. Huile sur toile, 14 x 22 cm. Musée d’Orsay, Paris.
185
En 1865, un scandale avait éclaté à cause d’une pièce des frères Goncourt, Henriette Maréchal. Edmond de Goncourt estimait que le premier acte de cette pièce, où l’action se passait dans un bal, avait inspiré à Manet son tableau. L’autre source d’inspiration étant, comme auparavant, la peinture espagnole. Le rythme solennel des costumes noirs de deuil dans L’Enterrement du comte d’Orgaz (Tolède, Santo Tome) du Gréco, reproduit dans le tableau de Manet, s’est ici transformé en accompagnement pour les vives lueurs de la fête. Tout comme dans La Musique aux Tuileries, Manet a rassemblé ici ceux qui formaient son entourage dans la vie mondaine parisienne. Il ne reste plus de traces d’une composition minutieusement agencée. En effet, on a l’impression que le peintre a reporté sur sa toile un fragment de vie aperçu par hasard : les personnages sont coupés par les bords de la toile et, en haut, on voit la jambe coquette d’une femme, assise à cheval sur la balustrade du balcon. Nana (p.137), peinte en 1877, semble aussi un écho de la littérature « naturaliste ». La Nana de Manet fut associée à Nana, l’héroïne du roman du même nom de Zola, bien que ce dernier fût publié seulement un an après l’achèvement du tableau. Si les contemporains considérèrent l’énigmatique Olympia comme une courtisane, Nana, elle, ne s’en cache pas. Dans le roman de Zola, elle se conduit comme elle le fait dans le tableau de Manet : « dès le matin, elle restait des heures en chemise devant le morceau de glace accroché au-dessus de la commode » (Emile Zola, Œuvres complètes, Paris 1960-1967, t. 2, p.710). Cependant, cette scène – une ravissante blonde, en sous-vêtements élégants, qu’attend un monsieur d’âge mûr, assis sur un canapé – était tellement typique de la vie parisienne que Manet pouvait la peindre sans lire le roman de Zola. Le tableau est soigneusement construit, la composition en est équilibrée et chaque détail soupesé. Pourtant, la manière ample et « négligée », avec son apparence d’esquisse, de cette peinture, trahit le Manet que les contemporains continuaient à associer avec l’impressionnisme. On y retrouve également la couleur extraordinaire de Manet : la gamme de couleurs repose sur une combinaison de l’or des cheveux et du bois du canapé avec le bleu ciel de l’étoffe japonaise que Manet utilise souvent dans ses tableaux. Le peintre est franchement séduit par cette vie, qui lui est familière, du demi-monde ; il lui trouve une élégance et un charme typiquement parisiens. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le 1er mai 1877, jour de l’ouverture du Salon, il ait exposé sa Nana dans la somptueuse vitrine de Giroux, un commerçant du boulevard des Capucines : le tableau lui-même faisait tout naturellement partie de la vie parisienne de l’époque.
Œillets et clématites dans un vase de cristal, vers 1882. Huile sur toile, 56 x 35,5 cm. Musée d’Orsay, Paris.
186
A ce moment-là, Manet était déjà malade. Les médecins lui prescrivaient différents traitements, l’envoyaient faire des cures thermales, mais son état de santé ne cessait de se détériorer. Il continuait à travailler. Quelques-uns de ses tableaux apparaissaient dans des expositions à Besançon et Marseille, New York et Boston. L’éditeur Georges Charpentier organisait, dans sa galerie « La Vie moderne », des expositions amusantes – de tambours coloriés et d’œufs d’autruche peints – et Manet y participait avec plaisir.
187
188
En décembre 1881, Manet devint chevalier de la Légion d’honneur. En 1882, il eut cinquante ans. Au Salon, qui s’ouvrit cette année-là, comme toujours, en mai, les Parisiens virent son dernier tableau : Un Bar aux Folies-Bergère (p.180-181). La ravissante serveuse, avec sa frange dorée et son teint rose tendre, représente le type même de modèle qu’aimait tant Manet – le type de Victorine Meurent et de l’actrice Henriette Hauser, qui avait posé pour Nana. Elle est accoudée à un comptoir de marbre, embelli d’une admirable nature morte. Des bouteilles de verre ordinaires scintillent comme des pierres précieuses. Dans une coupe, des bouchons de champagne dorés se marient à l’orange des mandarines ; le verre des bouteilles de vin fait pendant à une carafe verte. Les deux roses, une jaune et une rose, ne sont pas du tout modelées : elles sont peintes par larges touches librement posées sur la toile. On dirait qu’il suffirait de les effleurer pour qu’un vrai pétale tombât avec légèreté sur le marbre du comptoir. Sur le fond de la casaque en velours bleu de la jeune fille, se détache un verre fait, comme négligemment, de quelques rehauts de blanc de céruse. Derrière le dos de la serveuse, c’est le bruit et l’agitation de la salle de restaurant, éclairée par d’énormes lustres de cristal. Comme toujours, Manet a rempli son tableau d’amis. Appuyée à une balustrade, Mery Laurent (qui posa pour L’Automne, p.175) regarde le spectacle ; derrière elle est assise Jeanne Demarsy (qui posa pour Le Printemps). Les costumes noirs des hommes font ressortir les toilettes claires des dames. Dans le coin en haut à gauche du tableau, on aperçoit les jambes d’une acrobate sur son trapèze. Et ce n’est qu’au bout de quelque temps, en restant devant le tableau, que le spectateur commence à comprendre que, sur cette toile, il n’y a ni restaurant ni aucune de toutes ces personnes. L’artiste a peint une énorme glace. La jeune fille se tient face à la salle, qui se reflète dans cette glace et où se trouve aussi le spectateur lui-même. Cette peinture de Manet représente l’aboutissement de ses recherches dans le domaine de la composition : l’espace réel se confond entièrement avec l’espace du tableau. Dans la glace se reflètent le dos de la jeune fille et la silhouette du jeune homme avec lequel elle parle, et qui doit être quelque part à côté du spectateur. Le café-concert des Folies-Bergère, récemment ouvert à Paris, devint, vers le début des années 1880, un des endroits à la mode. On y rencontrait le public le plus varié, depuis les représentants de la haute société jusqu’à ces charmantes dames du demi-monde, qu’aimait tant peindre Manet. En 1881, Manet avait fait, au bar des Folies-Bergère, une petite étude où il avait représenté le peintre Henry Dupray en train de causer avec la barmaid aux cheveux blonds (p.179). Mais ce n’était là qu’une ébauche de composition. Le tableau va beaucoup plus loin que cette esquisse d’après nature. Ce n’est pas par hasard que les contemporains remarquèrent l’expression de tristesse sur le visage de la jeune fille. Probablement, pour le peintre, ce tableau était bel et bien un adieu au gai Paris mondain, un adieu à ses amis, un adieu à tout ce qu’il avait aimé. Les médecins ne réussissaient pas à soulager Manet, son état ne faisait qu’empirer. Il avait peint le bar dans son atelier, où on avait mis un comptoir en marbre et où on avait invité à venir poser une véritable barmaid des Folies-Bergère. La jeune fille s’appelait Suzon et Manet fit d’elle une ravissante ébauche
Roses et lilas blancs dans un vase, 1882-1883. Huile sur toile, 55 x 46 cm. Collection Emery Reeves.
189
de portrait. Toutefois, il avait de plus en plus de peine à travailler. Souvent, il était obligé de mettre son pinceau de côté pour se reposer. Un jeune peintre, G. Jeanniot, rendit visite à Manet dans son atelier en janvier 1882. « Il peignait alors Le Bar aux Folies-Bergère », raconte-t-il, « et le modèle, une jolie fille, posait derrière une table chargée de bouteilles et de victuailles. Il me reconnut de suite, me tendit la main et me dit : « C’est ennuyeux, excusez-moi, je suis obligé de rester assis, j’ai mal au pied » (…) D’autres personnes vinrent et Manet cessa de peindre pour aller s’asseoir sur le divan (…) C’est alors que je vis combien la maladie l’avait éprouvé (…) Il restait tout de même gai et parlait de sa guérison prochaine » (Manet, op. cit., p.482). Manet passa l’été 1882 avec sa famille à Rueil. Déjà presque condamné à l’immobilité par la maladie, il peignait dans le jardin, d’après nature, des paysages ensoleillés et des bouquets de fleurs. Il restait optimiste et demanda même au peintre Francis Defeuille de lui donner des leçons de miniature, art qu’il n’avait jamais encore pratiqué. L’examen médical d’avril 1883 montra la nécessité d’une amputation de la jambe gauche à cause de la gangrène. On procéda à l’amputation le 20 avril et, dix jours après, le 30 avril, la veille de l’ouverture du nouveau Salon, Manet rendit le dernier soupir. Le critique G. Geffroy écrivit, dans sa nécrologie de Manet, que la fête de l’ouverture du Salon avait été assombrie par cette étrange coïncidence. Manet mourut jeune, en plein épanouissement de son talent, quand il avait commencé à connaître le succès.
Maison de Rueil, 1882. Huile sur toile, 92,8 x 73,5 cm. National Gallery of Victoria, Melbourne.
190
Manet laissa un testament selon lequel ses héritiers étaient sa femme Suzanne et, après elle, Léon Leenhoff. Il chargeait Théodore Duret de vendre ou de détruire tout ce qui se trouvait dans son atelier. Manet était convaincu que, dans cent ans, les gens seraient plus sensibles et qu’ils sauraient voir et comprendre l’art véritable, c’est-à-dire sa peinture à lui et celle des impressionnistes. Il n’oubliait jamais ses amis et s’efforçait de les soutenir de son mieux. « Vous n’aimez pas encore cette peinture-là, peut-être », écrivait-il en 1877 au critique A.Wolff. « Mais vous l’aimerez » (Manet, op. cit., p.515). Dans sa préface au catalogue de l’exposition posthume de Manet en 1884, Zola disait que l’on juge les grands maîtres d’après l’influence qu’ils ont exercée. Manet peignit le milieu de son époque tout en étant le propagateur d’une peinture nouvelle et lumineuse. Sous son influence, les expositions parisiennes s’éclairèrent d’un rayon de soleil. En parlant avec Antonin Proust, peu de temps avant sa mort, Manet lui avait demandé de ne pas permettre que ses tableaux fussent dispersés entre différentes mains et différents musées, sinon dans l’avenir on ne pourrait pas l’apprécier pour de bon. Néanmoins, la vie continuait et, après l’exposition, eut lieu à l’hôtel Drouot une vente de ses tableaux, qui rapportèrent la coquette somme de 72 000 francs. Mais les amis de Manet voulaient voir sa peinture au Louvre. On déclara une souscription. Claude Monet, Renoir, Caillebotte, Duret et d’autres achetèrent Olympia et en firent don au Louvre. Sur ordre personnel du président Clemenceau, le tableau fut transféré du musée du Luxembourg, où il se trouvait depuis 1890, au Louvre, et accroché en face de la Grande Odalisque d’Ingres.
191
Manet sous la plume des écrivains Charles Baudelaire Lettre à Thoré-Bürger, 7 mai 1864 Cher Monsieur, J’ignore si vous vous souvenez de moi et de nos anciennes discussions. Tant d’années s’écoulent si vite ! ... Je lis très assidûment ce que vous faites, et je veux vous remercier pour le plaisir que vous m’avez fait en prenant la défense de mon ami Edouard Manet, et en lui rendant un peu justice. Seulement il y a quelques petites choses à rectifier dans les opinions que vous avez émises. M. Manet, que l’on croit fou et enragé, est simplement un homme très loyal, très simple, faisant tout ce qu’il peut pour être raisonnable, mais malheureusement marqué de romantisme depuis sa naissance. Le mot pastiche n’est pas juste. M. Manet n’a jamais vu de Goya ; M. Manet n’a jamais vu de Gréco ; M. Manet n’a jamais vu la galerie Pourtalès. Cela vous paraît incroyable, mais cela est vrai. Moi-même, j’ai admiré, avec stupéfaction, ces mystérieuses coïncidences. M. Manet, à l’époque où nous jouissions de ce merveilleux musée espagnol que la stupide République française, dans son respect (abus) de la propriété, a rendu aux princes d’Orléans, M. Manet était un enfant, et servait à bord d’un navire. On lui a tant parlé de ces pastiches de Goya que, maintenant, il cherche à voir des Goya. Il est vrai qu’il a vu des Velàzquez, je ne sais où. Vous doutez de ce que je vous dis ? Vous doutez que de si étonnants parallélismes géométriques puissent se présenter dans la nature ? Eh bien, on m’accuse, moi, d’imiter Edgar Poe ! Savez-vous pourquoi j’ai si patiemment traduit Poe ? Parce qu’il me ressemblait. La première fois que j’ai ouvert un livre de lui, j’ai vu, avec épouvante et ravissement, non seulement des sujets rêvés par moi, mais des phrases, pensées par moi et écrites par lui, vingt ans auparavant. Et nunc erudimini, vos qui judicatis ! ... Ne vous fâchez pas, mais conservez pour moi, dans un coin de votre cerveau, un bon souvenir. Toutes les fois que vous chercherez à rendre service à Manet, je vous remercierai.
Joris-Karl Huysmans L’Art moderne, 1883 Envelopper ses personnages de la senteur du monde auquel ils appartiennent, telle a été l’une des plus constantes préoccupations de M. Manet. Son œuvre claire, débarbouillée des terres de mousse et des jus de pipe qui ont si longtemps crassé [sic] les toiles, a une touche souvent calme sous son apparence bravache, un dessin concisé [sic] mais titubant, un bouquet de taches vives dans une peinture argentine et blonde.
Stéphane Mallarmé Divagations, 1898 Souvenir, il disait, alors, si bien : « l’œil, une main ... » que je ressonge. Cet œil – Manet – d’une enfance de lignée vieille citadine, neuf, sur un objet, les personnes, posé, vierge et 192
abstrait, gardait naguère l’immédiate fraîcheur de la rencontre, aux griffes d’un rire du regard, à narguer, dans la pose, ensuite, les fatigues de vingtième séance. Sa main – la pression sentie claire et prête énonçait dans quel mystère la limpidité de la vue y descendait, pour ordonner, vivace, lavé, profond, aigu ou hanté de certain noir, le chef-d’œuvre nouveau et français.
Antonin Artaud Petit Tableau de la peinture depuis 1850, 1927 Qu’a fait d’autre Manet que d’apporter une vision plus moderne, un plus subtil frémissement des tonalités, un sens tout actuel de la ligne à un démarquage formidable de Velàzquez, quelque chose aussi de faisandé, de verdissant à un art qui, ayant trouvé son aboutissement suprême, s’est arrêté. L’impressionnisme a pu, sur le tard, modifier sa technique, il n’a rien ajouté à son tempérament. Aussi le vrai impressionnisme n’est pas là.
Paul Valéry Triomphe de Manet, 1932 Manet, encore séduit par le pittoresque étranger, sacrifiant encore au toréador, à la guitare et à la mantille, mais déjà à demi conquis par les objets les plus prochains, et les modèles de la rue, représentait assez exactement à Baudelaire le problème de Baudelaire lui-même : c’est-à-dire, l’état critique d’un artiste en proie à plusieurs tentations rivales, et d’ailleurs capable de plusieurs manières admirables d’être soi [ ... ]. Les naturalistes visaient à représenter la vie et toutes choses humaines telles quelles – propos et programme qui manquaient point d’ingénuité ; mais leur mérite positif me semble être d’avoir trouvé de la poésie (ou plutôt importé de la poésie), et parfois de la plus grande, dans certains objets ou sujets tenus jusqu’à eux pour ignobles ou insignifiants. [ ... ] Emile Zola, avec une ferveur qui allait, selon sa manière, aisément à la violence, soutint donc un artiste bien différent de lui, de qui la vigueur, l’art d’apparence parfois brutale, l’audace dans la vision, émanaient cependant d’une nature toute éprise d’élégance, et toute pénétrée de l’esprit de liberté légère qui se respirait encore à Paris. En fait de doctrines et de théories, Manet, sceptique et Parisien fort délié, ne croyait qu’à la belle peinture. La sienne lui soumettait identiquement des âmes incomparables. Qu’aux extrêmes des Lettres, Zola et Mallarmé aient été pris et se fussent tant énamourés de son art, ce dut être, pour lui, un grand sujet d’orgueil. [ ... ] Cependant que Zola, par exemple, voyait et admirait dans l’art de Manet la présence réelle des choses, la « vérité » vivement et fortement saisie, Mallarmé y goûtait au contraire la merveille d’une transposition sensuelle et spirituelle consommée sur la toile. D’ailleurs Manet lui-même le séduisait infiniment. 193
André Malraux Le Musée imaginaire, 1947 On a dit que Manet ne savait pas peindre un centimètre de peau, et que l’Olympia avait été dessinée en fil de fer : on oubliait seulement qu’avant de vouloir « dessiner » Olympia ou peindre de la chair, il voulait peindre des tableaux. Le peignoir rose de l’Olympia, l’étoffe bleue du Déjeuner sur l’herbe, de toute évidence sont des taches de couleur, et dont la matière est une matière picturale, non une matière représentée. Le tableau, dont le fond avait été un trou, devient une surface, et cette surface devient non seulement sa propre fin, mais sa seule fin. Les esquisses les plus impérieuses de Delacroix étaient encore des dramatisations ; ce que Manet entreprend dans certaines toiles, c’est une picturalisation du monde. Car s’il était arrivé déjà que la touche prît cette autonomie qu’elle allait désormais revendiquer, ç’avait toujours été au service d’une passion dont la peinture n’était que le moyen. « Le monde est fait pour aboutir à un beau livre », disait Mallarmé ; il l’était bien davantage pour aboutir à ces tableaux. [ ... ] La fin dont l’acuité de la vision n’est que le moyen, c’est la transformation des choses en un univers plastique autonome, cohérent et particulier.
Georges Bataille Manet, 1955 Ce tableau [L’Exécution de Maximilien] rappelle étrangement l’insensibilisation d’une dent ; il s’en dégage une impression d’engourdissement envahissant, comme si un habile praticien avait appliqué comme à l’habitude et consciencieusement ce précepte premier : « Prends l’éloquence et tords-lui son cou ! » Manet fit poser quelques personnes : elles ont pris l’attitude les uns de ceux qui meurent, les autres de ceux qui tuent, mais d’une manière insignifiante, comme ils achèteraient « une botte de radis ». Tout facteur d’éloquence, vraie ou fausse, est éliminé. Restent les taches de différentes couleurs et l’impression égarante qu’un sentiment aurait dû naître du sujet : c’est l’étrange impression d’une absence. [ ... ] Les diverses peintures depuis Manet sont les divers possibles rencontrés dans cette région nouvelle, où profondément le silence règne, où l’art est la valeur suprême : l’art en général, cela veut dire l’homme individuel, autonome, détaché de toute entreprise, de tout système donné (et de l’individualisme lui-même). [ ... ] L’Olympia tout entière se distingue mal d’un crime ou du spectacle de la mort ... Tout en elle glisse à l’indifférence de la beauté. [ ... ] Le nom de Manet a dans l’histoire de la peinture un sens à part. Manet n’est pas seulement un très grand peintre : il a tranché avec ceux qui l’ont précédé ; il ouvrit la période où nous vivons ; s’accordant avec le monde qui est maintenant, qui est nôtre, détonnant dans le monde où il vécut, qu’il scandalisa. C’est un soudain changement qu’opéra la peinture de Manet, un renversement acide, auquel le nom de révolutionnaire conviendrait s’il n’en découlait pas une équivoque : le changement à vue de l’esprit dont cette peinture est significative diffère au moins pour l’essentiel de ceux que l’Histoire enregistre. [... ] Jamais avant Manet le divorce du goût public et de la beauté changeante, que l’art renouvelle avec le temps, n’avait été si parfait. Manet ouvre la série noire ; c’est à partir de lui que la colère et les rires publics ont aussi sûrement désigné le rajeunissement de la beauté. D’autres avant lui avaient provoqué le scandale ; l’unité relative du goût de l’époque classique était alors touchée : le romantisme l’avait brisée, qui avait suscité des colères ; Delacroix, Courbet et, très classique, Ingres lui-même avaient fait rire. Mais l’Olympia est le premier chef-d’œuvre dont la foule ait ri d’un rire immense. 194
Bibliographie Antonin Artaud, Petit Tableau de la peinture depuis 1850, Paris, 1927 Georges Bataille, Manet, Lausanne, 1955 Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Paris, 2002 Charles Baudelaire, « Lettre à Thoré-Bürger », 7 mai 1864 Dominique Bona, Berthe Morisot, Paris, 2000 T. Clark, The Painting of Modern Life. Paris in the Art of Manet and His Followers, Londres, 1984 R. Cogniat et M. Hoog, Manet, Paris, 1982 Pierre Courthion, Edouard Manet, Paris, Cercle d’Art, 1991 Pierre Daix, La Vie de peintre d’Edouard Manet, Paris, 1983 E. Duranty, La Nouvelle Peinture : à propos du groupe d’artistes qui expose dans les galeries Durand-Ruel [1876], Paris, Dentu, 1946 Théodore Duret, Histoire des peintres impressionnistes, Paris, Librairie Floury, 1939 L. Halévy, Degas parle, Paris, 1960 Georges Eugène Haussmann, Mémoires, t. 3 L. W. Havemeyer, Sixteen to Sixty. Memoirs of a collector, New York, 1961 Joris-Karl Huysmans, L’Art moderne, Paris, Charpentier, 1883 Impressionnisme : une nouvelle renaissance, catalogue, coed. Fondation Mapfre/Musée d’Orsay, 2010 G. Lacambre et G. Tinterow, Manet, Velàzquez : la manière espagnole au XIXe siècle, Paris, Musée d’Orsay et New York, The Metropolitan Museum of Art, catalogue de l’exposition, RMN, 2002 Stéphane Mallarmé, Divagations, Paris, 1898 André Malraux, Le Musée imaginaire, Paris, 1947 Manet, Paris, éditions de la Réunion des Musées Nationaux, 1983 Jérôme Picon, Orsay chefs-d’œuvre, Paris, Artlys, 2003 Antonin Proust, « Edouard Manet. Souvenirs », La Revue Blanche, 1897 Jean Renoir, Pierre Auguste Renoir, mon père, Paris, Gallimard, 1981 John Richardson, Manet, Londres, Phaidon, 2002 A. Silvestre, Au Pays des souvenirs, Paris 1887 A. Tabarant, Manet et ses œuvres, Paris, 1947 A. Tabarant, Manet. Histoire catalographique, Paris, 1931 Paul Valéry, Triomphe de Manet, Paris, 1932 Lionello Venturi, Les Archives de l’impressionnisme, Paris, Durand-Ruel éditeurs, 1939, vol. 2 Ambroise Vollard, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, 1936 D. Wildenstein, Claude Monet, Paris, 1971 Emile Zola, « Edouard Manet. Etude biographique et critique, 1867 », La Revue du XIXe siècle, 1er janvier 1867 Emile Zola, Œuvres complètes, Paris, 1960-1967 195
Liste des illustrations A A Monsieur Pertuiset, chasseur de lions, 1881.
176
Amazone – portrait de Marie Lefébure, 1870-1875.
119
Anguille et rouget, 1864.
55
Annabelle Lee, vers 1881.
166
Argenteuil, 1874.
111
L’Artiste : portrait de Marcellin Desboutin, 1875.
128
L’Asperge, 1880.
164
Automne (Méry Laurent), 1881.
175
Autoportrait à la palette, 1879.
9
B Le Bal masqué à l’Opéra, 1873.
100
Le Balcon, 1868-1869.
67
Le Balcon, étude, 1868.
66
Le Ballet espagnol, 1862.
43
Un Bar aux Folies-Bergère, 1882. Un Bar aux Folies-Bergère, étude, 1881-1882.
180-181 179
Bateau pour Folkestone, Boulogne, 1869.
83
Berthe Morisot au bouquet de violettes, 1872.
81
La Blonde aux seins nus, vers 1878.
138
Bouquet de violettes, 1872.
94
Le Buveur d’absinthe, vers 1859.
10
Buveurs de bocks, vers 1879.
140
C Cavaliers espagnols, vers 1860.
22
Le Chanteur espagnol, 1861-1862.
39
La Chanteuse de café-concert, 1879. La Chanteuse des rues, 1862.
42
Les Chaussons de ballet, vers 1862.
26
Le Chemin de fer, 1873.
196
134-135
102, 103
Chez le Père Lathuille, 1879.
143
Le Citron, 1880.
185
Le Clairon, 1882.
183
Claude Monet et sa femme dans son studio flottant, 1874.
108
Un Coin du jardin de Bellevue, 1880.
160
Combat de taureaux, 1865-1866.
58
Le Combat du Kearsarge et de l’Alabama, 1864.
50
Corbeille de poires, 1882. Course de chevaux au bois de Boulogne, 1872.
184 92-93
D La Dame aux éventails, 1873.
121
Dans la Serre, 1878-1879.
142
Le Déjeuner dans l’atelier, 1868. Le Déjeuner sur l’herbe, 1863. Devant le Miroir, 1876.
61 36-37 132
E Eglantines, vers 1880.
158
En Bateau, 1874.
114
L’Enfant aux cerises, 1858-1859.
11
Enfant portant un plateau, 1861-1862.
23
Espagnole, vers 1879. Les Etudiants de Salamanque, 1860. Eugène Manet sur l’île de Wight, 1875. Eva Gonzales, 1870. L’Exécution de Maximilien, 1867-1868. L’Exécution de Maximilien (détail), 1867.
148 21 124 79 62, 63 65
F La Famille Monet dans son jardin à Argenteuil, 1874.
116-117
Femme à l’épingle d’or, 1879.
151
Femme à la jarretière (La Toilette), 1879.
139
Femme à sa toilette, 1861.
24
Femme au chapeau rouge, vers 1880.
155
Femme lisant, vers 1880.
162
Le Fifre, 1866.
71
G Georges Clemenceau, 1879-1880.
147
Le Grand Canal, Venise, 1874.
110 197
Le Grand Canal, Venise, 1875.
113
Henry Bernstein enfant, 1881.
178
I/J Irma Brunner, 1882.
172
Le Jambon, 1880.
165
Jeune Femme en costume de torero, vers 1862.
27
Jeune Fille devant la mer, 1880.
167
Jeune Fille en chapeau d’été, vers 1881.
169
K/L Le « Kearsage » à Boulogne, 1864.
52
La Lecture, entre 1848 et 1883.
76
Lola de Valence, 1862.
34
M Madame Manet au piano, 1868.
60
Mademoiselle V… en costume d’espada, 1862.
28
Maison de Rueil, 1882.
191
Marée montante, vers 1873.
107
Marguerite de Conflans, 1873.
89
Marguerite de Conflans, vers 1876.
125
Les Marsouins, marine, vers 1864.
53
La Mère de Manet dans son jardin à Bellevue, 1880.
161
Méry Laurent au chapeau noir.
173
Monsieur et madame Auguste Manet, 1860. La Musique aux Tuileries, 1862.
18 30-31
N/O Nana, 1877.
137
Nu, 1872.
88
La Nymphe surprise, 1858-1860.
12
Œillets et clématites dans un vase de cristal, vers 1882. Olympia, 1863. Olympia, étude, 1862-1863.
187 44-45 25
P La Pêche, vers 1860-1861. La Péniche, vers 1874.
106
Pervenches, vers 1880.
159
Plage à Boulogne-sur-Mer, 1869. 198
15
74-75
Polichinelle, 1873. Port de Bordeaux, 1871. Port de Calais, 1871. Portrait d’Emile Zola, 1868.
99 86-87 84 6
Portrait d’Henri Rochefort, 1881.
177
Portrait d’Irma Brunner, vers 1880.
157
Portrait d’un homme, 1860.
17
Portrait de Berthe Morisot, 1869.
73
Portrait de Berthe Morisot à l’éventail, 1874. Portrait de Berthe Morisot étendue, 1873.
122 96-97
Portrait de Georges Clemenceau à la tribune, 1879-1880.
146
Portrait de l’abbé Hurel, 1875.
129
Portrait de la comtesse Albazzi, 1880.
152
Portrait de madame Edouard Manet sur un canapé bleu, 1874.
120
Portrait de Roudier, vers 1860. Portrait de Stéphane Mallarmé, 1876.
16 130-131
Portrait de Théodore Duret, 1868.
72
Portrait de Victorine Meurent, vers 1862.
33
La Prune, vers 1877.
127
R Raisins et figues, 1864.
47
Le Rendez-Vous du chat, 1868.
68
Le Repos (Portrait de Berthe Morisot), 1870-1871.
78
Roses et lilas blancs dans un vase, 1882-1883.
188
Rue de Berne, 1878.
145
S La Serveuse de bocks, 1878-1879. La Sultane (Jeune Femme en costume oriental), vers 1871.
141 91
Sur la Plage, 1873.
105
Sur le Banc, 1881.
170
T/V Tête de femme, 1870.
80
Tige de pivoines et sécateur, 1864.
49
Le Torero mort, 1864. Trois Têtes de femmes, 1880. Vase de pivoines sur piédouche, 1864. Le Vieux Musicien, 1862.
56-57 154 48 40-41 199
« Manet eùtait aussi important pour nous, que Cimabue et Giotto pour les Italiens de la Renaissance. » — Renoir L'Œuvre de Manet contribua à l'apparition des mouvements d'avant-garde. Bien que de la même génération que Monet, Renoir et Sisley, il était pour eux un maître. La hardiesse de la peinture d'Edouard Manet, son indépendance vis-à-vis des canons académiques ouvrit de nouveaux horizons créatifs. Cet ouvrage comporte deux parties : la première se compose de l’admirable texte d'Emile Zola qui parle tant de l'ami que de l'artiste et la seconde, écrite par Natalia Brodskaïa, conservatrice au musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, est plus scientifique. La confrontation de ces deux approches laisse transparaître le modernisme d'Edouard Manet.