À la recherche d'Expo 67 9780228013747
Retour sur Expo 67 avec des artistes et des chercheurs contemporains. Retour sur Expo 67 avec des artistes et des cher
162 70 20MB
French Pages 248 [241] Year 2022
Polecaj historie
Table of contents :
Couverture
À la recherche d’Expo 67
Titre
Droits d'auteur
Table des matières
Remerciements
Introduction
Matérialités, temporalités
Souveraine comme l’amour
Le Chemin de l’énigme
Un jour, One Day
Trophées (Montréal, 1967-2017)
Until Finally O Became Just a Dot
L’ œuvre murale de Dorval par Greg Curnoe : un commentaire critique sur Expo 67
Identités nationales : le pavillon du Canada
L’arbre est dans ses feuilles
Panning for Gold / Walking You Through It
Of Our Lands / De nos terres / Nunanni
Identités nationales : le pavillon des Indiens du Canada
Earth Mother Hair, Indian Hair, and Earth Mother Eyes, Indian Eyes, Animal Eyes
Indian Momento
Sans titre
Le pavillon des Indiens du Canada
D’Indien à Indigène : du pavillon temporaire aux territoires souverains d’exposition
Réinventions numériques
Kaléidoscope II
N-Polytope: Behaviors in Light and Sound after Iannis Xenakis – MAC Version
Montréal délire
Le Huitième Jour, 1967-2017
Remix d’archives
Reprise
By the Time We Got to Expo
1967: A People Kind of Place
Spectacles du monde : Expo 67 comme parc d’attractions optiques
Expo 67 et l’archive manquante, l’anarchive et l’anti-archive
Films originaux d’Expo 67
Liste des œuvres
Biographies
Citation preview
À la recherche d’Expo 67
À la recherche d’
Monika Kin Gagnon et Lesley Johnstone
Sous la direction de
McGill-Queen’s University Press Montréal & Kingston • London • Chicago et Musée d’art contemporain de Montréal
© McGill-Queen’s University Press 2020
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada
ISBN 978-0-2280-0113-3 (papier) Dépôt légal, troisième trimestre 2020 Bibliothèque nationale du Québec Imprimé au Canada sur papier non acide qui ne provient pas de forêts anciennes (100% matériel post-consommation), non blanchi au chlore. Cet ouvrage a été publié grâce à une subvention du programme Aid to Research-Related Events de l’Université Concordia, administré par le Bureau du vice-président, Recherche et Études supérieures.
Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien. We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts.
ii : Cheryl Sim, Un jour, One Day, 2017.
Titre: À la recherche d'Expo 67 / sous la direction de Monika Kin Gagnon et de Lesley Johnstone. Autres titres: In search of Expo 67. Français Noms: Gagnon, Monika Kin, 1961- éditeur intellectuel. | Johnstone, Lesley, 1958- éditeur intellectuel. | Musée d'art contemporain de Montréal, organisme de publication. Description: Traduction de : In search of Expo 67. | Comprend des références bibliographiques et un index. Identifiants: Canadiana 20200224409 | ISBN 9780228001133 (couverture souple) Vedettes-matière: RVM: Expo (Bureau international des expositions) (1967 : Montréal, Québec) | RVM: Art canadien—20e siècle— Expositions. | RVM: Artistes—Canada. Classification: LCC N4752 .I514 2020 | CDD 709.71074/71428—dc23
Table des matières
vii Remerciements 3 Introduction
monika kin gagnon et lesley johnstone
Identités nationales : le pavillon du Canada 80 L’arbre est dans ses feuilles
althea thauberger 89 Panning for Gold / Walking You Through It
Matérialités, temporalités 34 Souveraine comme l’amour
david k. ross
leisure (meredith carruthers et susannah wesley) 96 Of Our Lands / De nos terres / Nunanni
geronimo inutiq 39 Le Chemin de l’énigme
marie-claire blais et pascal grandmaison 43 Un jour, One Day
cheryl sim
Identités nationales : le pavillon des Indiens du Canada 106 Earth Mother Hair, Indian Hair, and Earth Mother Eyes, Indian Eyes, Animal Eyes
duane linklater 47 Trophées (Montréal, 1967-2017)
simon boudvin
112 Indian Momento
krista belle stewart 52 Until Finally O Became Just a Dot
charles stankievech
117 Sans titre
mark ruwedel 60 L’œuvre murale de Dorval par
Greg Curnoe : un commentaire critique sur Expo 67
johanne sloan
122 Le pavillon des Indiens du Canada
guy sioui durand 135 D’Indien à Indigène : du pavillon
temporaire aux territoires souverains d’exposition
david garneau
188 Spectacles du monde : Expo 67 comme
parc d’attractions optiques
caroline martel, en collaboration avec mathieu bouchard-malo 194 Expo 67 et l’archive manquante,
l’anarchive et l’anti-archive
janine marchessault Réinventions numériques 148 Kaléidoscope II
204 Films originaux d’Expo 67
jean-pierre aubé 154 N-Polytope: Behaviors in Light
217 Liste des œuvres
and Sound after Iannis Xenakis – MAC Version
chris salter 160 Montréal délire
stéphane gilot 165 Le Huitième Jour, 1967-2017
emmanuelle léonard
Remix d’archives 170 Reprise
dave ritter et kathleen ritter 178 By the Time We Got to Expo
philip hoffman et eva kolcze 182 1967: A People Kind of Place
jacqueline hoàng nguyê˜n
vi
TA B L E D E S M AT I È R E S
223 Biographies
Remerciements
À la recherche d’Expo 67, l’exposition originale de 2017 qui a servi de point de départ au présent ouvrage, a démarré en 2013, au moment où nous avons commencé à discuter avec les artistes. Il y a beaucoup de gens à remercier. Nous sommes redevables d’abord et avant tout aux artistes qui ont contribué à l’exposition et à l’ouvrage, avec leur immense créativité, leur enthousiasme et leurs belles œuvres, et qui, il faut l’avouer, ont fait preuve de patience durant ce périple. Nous remercions également les auteurs qui ont apporté leurs contributions à ce recueil et leur expertise sur Expo 67 : David Garneau, Janine Marchessault, Guy Sioui Durand et Johanne Sloan. Entreprendre une exposition comme À la recherche d’Expo 67 a nécessité le soutien et la collaboration de plusieurs personnes au Musée d’art contemporain de Montréal. Nous remercions John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef; Yves Théoret, directeur, opérations et administration; Luc Perron, Maryse Elias et Nathalie Dupuis à l’administration; Marjolaine Labelle, Geneviève Senécal, Hélène Cantin et Marie-Renée Vial à la conservation; Anne-Marie Zeppetelli, gestionnaire des collections, et Eve Katinouglou, registraire; Carl Solari, Denis Labelle, Josée St-Louis et toute l’équipe des services techniques; Anne-Marie Barnard et l’équipe des communications; Chantal Charbonneau à l’édition; et les photographes de l’exposition, Guy L’Heureux et Richard-Max Tremblay. À l’Université Concordia, nous sommes reconnaissants de l’aide financière consentie par la Faculté des beaux-arts et le Bureau du vice-président, Recherche et Études supérieures, en particulier Rebecca Duclos, Justin Powlowski et Lynn Hughes qui ont soutenu le projet; de même, des fonds ont été obtenus du programme arre (Aid to Research-Related Events) et de l’Institut de recherche en art canadien Gail et Stephen A. Jarislowsky. Merci à Graham Carr, autrefois vice-recteur et maintenant président, de son intérêt et de son soutien. Merci également à Shelley Sitahal, directrice, Recherche, Partenariats et Innovation. Au service des communications de l’Université, nous sommes redevables à Philippe Beauregard, de même qu’à Johanne Pelletier, à Salvatore Barrera et à leur équipe pour les merveilleux balados produits pour la série sur Expo 67: Thinking Out Loud.
De la grappe Post-Image du Milieux Institute for Arts, Culture and Technology à Concordia, nous remercions Marisa Portolese et Raymonde April, de même que les étudiants diplômés Matthew Brooks et Steven Smith Simard, qui ont travaillé avec Leisure (Meredith Carruthers et Susannah Wesley) et Althea Thauberger. Le réseau Hexagram a également offert de l’aide aux artistes. Au Musée des beaux-arts du Canada, nous remercions Andrea Kunard, conservatrice associée, Anne Eschapasse, alors sous-directrice des expositions et du rayonnement, et Josée Drouin-Brisebois, conservatrice principale de l’art contemporain, de leur soutien au projet d’Althea Thauberger. Nous remercions Clothilde Cardinal, directrice de la programmation à la Place des Arts, qui a facilité la présentation de l’œuvre de Caroline Martel à l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme. Le programme de films Cinéma élargi, présenté par cinemaexpo67, a été rendu possible grâce aux cinéastes Graeme Ferguson, Munro Ferguson et Morley Markson, par les familles de Vincent Vaitiekunas et de Nick et Anne Chaparos, et d’Anouk Brault. Nous sommes reconnaissants du soutien technique de Denis Labelle et de Donald Dolan, et, pour la réalisation du prototype de kaléidoscope vr, nous remercions Pascal Pelletier et les Productions Figure 55. Nous remercions Jean-Baptiste Courbette, Stéphanie Côté, Jean Gagnon et Guillaume Lafleur de la Cinémathèque québécoise. Nous remercions René Chenier, Benoît Forté et Karine Lanoie-Brien de l’Office national du film du Canada. Comme toujours, nous remercions Paul Gordon de Bibliothèque et Archives Canada, pour son expertise précieuse sur les films et les formats d’Expo 67. Le Conseil de recherches en sciences humaines a assuré le financement initial des étapes de recherche du projet par le biais d’une bourse de recherche « Archiving Future Cinemas ». Pour leur expertise et leurs perspectives sur Expo 67, nous remercions Roger La Roche et William Kretzel, aujourd’hui disparu et dont les grandes connaissances et ressources sur les films d’Expo 67 (de même que l’imax) nous manqueront beaucoup. Nos remerciements vont aux traductrices et traducteurs Nathalie de Blois, Peter Feldstein, Denis Lessard, Judith Terry et Colette Tougas, ainsi qu’aux personnes qui ont assuré la révision, Dimitri Pascal Bossut, Susan Le Pan, Ian MacKenzie, Olivier Reguin et Colette Tougas. Nous exprimons également notre reconnaissance à Chantal Charbonneau, éditrice au mac, pour son appui tout au long de la production de la présente publication. Au fil des années, ce projet a reçu l’assistance de plusieurs étudiantes et étudiants, parmi lesquels nous remercions Marie Bernard-Brind’Amour, Matthew Brooks, Cecelia Chen, Elise Cotter, Gabrielle Doiron, Jaelle Dutremble-Rivet, Danica Evering,
viii
R E M E R C I E M E NTS
Delphine Larose, Tiffany Le, Daniela Machado, Caroline Martel, Tyler Morgenstern, Bradley Peppinck, Stephen Sherman, Steven Smith Simard et Leticia Trandafir. Nous sommes reconnaissantes à Jonathan Crago et à Kathleen Fraser de McGillQueen’s University Press, de même qu’au designer graphique David Leblanc, qui nous ont aidées à transformer ce projet complexe en cette superbe publication. Monika Kin Gagnon remercie Scott Toguri McFarlane et Olivia Michiko Gagnon de leur indéfectible enthousiasme. Lesley Johnstone remercie tous ses collègues du mac qui ont contribué à la réalisation de l’exposition et de la publication au cours des sept dernières années. Finalement, elle remercie Gilbert Turp qui nous a accompagnées dans cette aventure. Monika Kin Gagnon et Lesley Johnstone
ix
R E M E R C I E M E NTS
À la recherche d’Expo 67
Charles Stankievech, Until Finally O Became Just a Dot, 2017, vue d’installation.
Introduction Monika Kin Gagnon et Lesley Johnstone
L’exposition collective du Musée d’art contemporain de Montréal (mac) intitulée À la recherche d’Expo 67 porte bien son nom. Elle s’est développée à partir d’une conscience des nombreux récits et histoires inexplorées à propos d’Expo 67, un événement qui continue d’occuper une place de premier plan dans nos mémoires collectives culturelles tout en demeurant fragmentaire, dispersé et partiel. L’histoire des expositions universelles qui débute avec l’Exposition Crystal Palace de Londres en 1851 – un héritage auquel contribue Expo 67 – nous rappelle que ces événements internationaux sont empreints de tensions et de contradictions passionnantes qui entravent la compréhension et la remémoration. La convergence en 2017 du 50e anniversaire d’Expo 67, le 150e anniversaire de la Confédération canadienne de 1867, et du 375e anniversaire de la colonisation de Montréal par de Maisonneuve et les missionnaires jésuites, nous rappelle le rôle public des commémorations et des anniversaires. L’historienne de l’art Ruth Phillips a défini ces derniers comme des « spectacles » et démontre que ceux-ci deviennent également des « périodes de contestation », auxquelles s’opposent les résistances des non-anniversaires, des dé-célébrations et de la décolonisation1. Ces nouveaux « spectacles » ont donné lieu à pas moins de sept expositions muséales importantes sur Expo 67 à Montréal, de même qu’à d’autres expositions plus modestes, des projections de films, des symposiums et des événements2. Toutes ces activités donnaient une version particulière de l’histoire : Expo 67 comme moment à revisiter, un retour nostalgique à l’événement d’origine par le biais d’objets, de documents d’archives, d’histoires orales et d’interviews de témoins. L’exposition À la recherche d’Expo 67 a pris forme à partir de l’intuition que le travail des artistes ouvrirait de nouvelles pistes dans ce contexte de « célébration ». Les œuvres produites par dix-neuf artistes contemporains nous rappellent que les complexités et les tensions très réelles de 2017 étaient aussi présentes en 1967. Comme d’autres chercheurs sur les expositions universelles l’ont fait avant nous, nous nous inclinons devant les complexités d’Expo 67, un événement qu’il est impossible de
Vue de l’exposition, Althea Thauberger, L’arbre est dans ses feuilles, 2017.
saisir en tant que totalité, et nous affirmons le caractère éclairant d’une approche multiple d’Expo 67. Nous soutenons que ces œuvres originales génèrent de nouvelles connaissances significatives en des manières créatives et stimulantes, qui vont au-delà de la tendance traditionnelle de l’histoire à la reconstitution fidèle, apportant ainsi une contribution appréciable à la compréhension de l’héritage d’Expo 67, cinquante ans plus tard. L’exposition À la recherche d’Expo 67 s’ajoute à l’important corpus d’œuvres d’art, d’expositions et de recherche en commissariat qui ont exploré les liens entre les archives et la mémoire culturelle, et les œuvres basées sur les approches créatrices et critiques des artistes par rapport à l’archive3. Bien que les artistes se soient toujours inspirés du passé, le texte « An Archival Impulse » (2004) du critique et historien d’art Hal Foster, décrit le tournant archivistique propre à l’art contemporain, tandis que l’anthologie de Charles Merewether, The Archive, regroupe un ensemble important de textes (abrégés) d’artistes et de théoriciens écrits depuis les années 19604. Plusieurs expositions ont présenté des artistes qui travaillent conceptuellement et matériellement les archives, dont la Documenta 11 (2002) du défunt commissaire Okwui Enwezor, puis son Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art (2008), de même que la Documenta 13 (2012) de Carolyn Christov-Bakargiev, et d’autres encore5. Comme le démontrent la recherche et les nombreuses expositions, l’accent sur les documents d’archives et les artefacts représente une approche artistique, alors que la thématique de l’archive, qui propose le musée comme lieu institutionnel de collectionnement, représente une autre approche, qui va jusqu’à créer des archives imaginaires. Le commissaire Dieter Roelstraete a brillamment étayé la notion d’imaginaire archéologique en art, d’abord dans un texte pour e-flux, puis dans le cadre de l’exposition The Way of the Shovel au Museum of Contemporary Art Chicago, en 2013. Roelstraete a décelé un tournant historiographique et réuni des artistes qui « étudient le passé d’après ses vestiges matériels ». D’après lui, le mode historiographique « est un complexe méthodologique incluant le récit historique, l’archive, le document, l’acte de creuser et de déterrer, le mémorial, l’art de la reconstruction et de la reconstitution, le témoignage6». Le développement d’Internet et les fonctions multiplicatrices de la numérisation ont également mis en question le rôle conventionnel de l’archive, en démocratisant et en élargissant l’accès aux artefacts, et en facilitant leur circulation. Si l’essence ou l’ontologie des archives traditionnelles était l’artefact original conservé dans un lieu institutionnel, les pratiques artistiques contemporaines mettent en lumière les transformations spectaculaires et l’effet considérable des archives au XXIe siècle7. Les archives d’Expo 67 ont fourni des matériaux bruts à partir desquels les artistes ont créé de nouvelles expressions du fonctionnement et de l’action de la mémoire culturelle, apportant en certains cas de nouvelles informations concernant des projets et pavillons moins familiers. Chaque œuvre transmet des facettes uniques
4
M O N I K A K I N G A G N O N E T L E S L E Y J O H N S TO N E
de la mémoire d’Expo 67 et comment cette mémoire continue aujourd’hui d’habiter l’imaginaire collectif. Le choix des artistes s’est développé à partir d’une série de conversations avec ceux et celles qui nous paraissaient pouvoir être inspirées et inspirés par Expo 67, de par la nature de leur pratique. Nous en connaissions qui avaient déjà commencé à élaborer des projets et qui ont profité de l’occasion pour les mener à terme, tandis que d’autres ont été invités à participer en raison de leur familiarité avec l’année 1967, dont Krista Belle Stewart, avec Seraphine, Seraphine (2015) et Geronimo Inutiq, avec arcticnoise (2015). Certaines œuvres existantes de Mark Ruwedel, Jacqueline Hoàng Nguyê˜n, Eva Kolcze et Philip Hoffman ont été facilement intégrées à l’exposition. Elles avaient toutes été inspirées par le contexte culturel sans pareil de l’Expo, soit l’échelle et le caractère ambitieux, voire héroïque, de la centaine de pavillons nationaux et privés, ainsi que la liberté créatrice accordée aux cinéastes, aux architectes et aux artistes, leur permettant des explorations sans précédent. Rétrospectivement, ce sont les rapports diversifiés des artistes avec leur sujet d’exploration qui représentent un des aspects marquants de l’exposition, et la manière dont les seize artistes qui créaient de nouvelles œuvres ont conçu leurs projets fondés sur la recherche, comment elles et ils ont rendu les documents d’archives attrayants sur le plan visuel, et comment elles et ils ont eu recours à des modes distincts de narration historique. Certains artistes ont adopté une approche « médicolégale » des archives afin de traiter plus littéralement et matériellement d’Expo 67. Elles et ils sont retournés sur les îles d’Expo 67 avec leurs vestiges, se sont penchés sur les créateursparticipants de l’époque, ont dégagé les complexités et les dynamiques des pavillons originaux. Ces explorations de type médicolégal sont restées proches de la matérialité et des préoccupations conceptuelles de départ, conservant des filiations directes; elles sont allées, dans certains cas, jusqu’à la ré-exposition de documents d’archives et d’artefacts originaux. Pour Althea Thauberger, Leisure (Meredith Carruthers et Susannah Wesley), Charles Stankievech, Duane Linklater, Chris Salter, Stéphane Gilot, Dave et Kathleen Ritter, ainsi que Caroline Martel, il paraissait significatif que leurs œuvres fassent directement référence aux « sujets » de leurs explorations, afin de pouvoir raconter, en quelque sorte, leurs histoires, et vérifier comment Expo 67 résonne encore aujourd’hui. D’autres artistes ont utilisé les archives comme déclencheurs ou catalyseurs d’interprétations poétiques, personnelles ou évocatrices; les œuvres finales ne présentent pas nécessairement d’« information » sur les pavillons originaux, ni même sur Expo 67. Les projets de David K. Ross, Marie-Claire Blais et Pascal Grandmaison, Cheryl Sim, Geronimo Inutiq, Jean-Pierre Aubé, Emmanuelle Léonard et Krista Belle Stewart participent de cette approche. Toutes les nouvelles œuvres sont le fruit de dialogues avec les artistes sur une période de deux ans, de pair avec les processus de recherche qui ont permis de faciliter l’accès des artistes aux archives, d’offrir de l’aide de recherche plus poussée et quantité de pages de textes, de documents et de matériel
5
Introduction
audiovisuel, en plus des contacts directs avec des archivistes. Nous espérons que l’effervescence, la richesse de ces démarches de création et leur réunion dans les salles d’exposition du Musée sont transmises dans ces pages.
Le présent ouvrage est basé sur l’exposition de 2017, mais structuré différemment, selon des thématiques qui regroupent les œuvres de façon cohérente. La section Matérialités, temporalités rassemble les artistes qui ont pris comme point de départ
6
M O N I K A K I N G A G N O N E T L E S L E Y J O H N S TO N E
Vue de l’exposition, David K. Ross, Souveraine comme l’amour, 2017 (gauche) et Cheryl Sim, Un jour, One Day, 2017.
le caractère construit des îles d’Expo 67, observé leur vieillissement au fil du temps, et mis en valeur certains éléments qui subsistent encore aujourd’hui lorsqu’on parcourt le site. La section Identités nationales met l’accent sur le pavillon du Canada et sur le pavillon des Indiens du Canada; l’attention est portée sur le rôle important des documents d’archives dans leur interprétation actuelle. Les œuvres réunies dans la section Réinventions numériques ont recours aux outils et médias numériques pour revisiter et explorer les principaux centres d’intérêt de certains pavillons. Finalement, la section Remix d’archives regroupe quatre installations filmiques et sonores qui ont
7
Introduction
remployé des matériaux d’archives audiovisuelles de 1967. À titre de co-commissaires de l’exposition, nous présentons les œuvres comme un ensemble et explorons les liens entre les archives, les processus de création et la mémoire culturelle. Les pages des artistes documentent leurs œuvres respectives et contiennent de textes traitant de leurs recherches en archives, aux côtés d’images clés qui ont été importantes dans leur processus. Nous avons commandé quatre textes substantiels afin d’offrir une réflexion sur d’autres facettes d’Expo 67 : la recherche de Johanne Sloane à propos de résistances culturelles moins familières, les revisitations actuelles du pavillon des Indiens du Canada par Guy Sioui Durand et David Garneau, ainsi qu’une analyse par Janine Marchessault des archives filmiques de l’Expo et de leur réinterprétation par les artistes. Nous avons ajouté ici et là de la documentation d’archives qui renseigne davantage sur les différents thèmes et les œuvres individuelles. Le livre se termine par la documentation de six films multiécrans originaux de grand format d’Expo 67, qui ont été restaurés et présentés durant les quatre mois de l’exposition : La Vie polaire, Le Mouvement, Conflit, Le Canada est mon piano, La Terre, patrie de l’homme et Kaléidoscope.
Matérialités, temporalités Les organisateurs d’Expo 67 ont conçu cette Exposition universelle sur un chapelet d’îles artificielle et agrandies – Sainte-Hélène, Notre-Dame et Cité du Havre – dont l’accès nécessitait un moyen de transport : le train, le bateau ou le métro récemment construit. Cet emplacement à l’écart de la Ville de Montréal a grandement contribué au succès populaire de l’Expo, à sa perception comme un monde à part entière. Pour plusieurs, une visite s’y apparentait à un tour du monde, autrement inaccessible. David K. Ross, Marie-Claire Blais et Pascal Grandmaison, Cheryl Sim et Simon Boudvin explorent ce caractère éloigné des îles et leur état actuel de même que l’empreinte du passé de l’exposition originale dans la ville, sur les îles et dans la mémoire des visiteurs. En fondant leurs explorations sur la matérialité tangible et les traces physiques de l’Expo, ces artistes donnent aussi une idée de l’entropie des îles au fil du temps, avec leurs temporalités variées. Basée sur des recherches dans les archives de la Ville de Montréal, Souveraine comme l’amour de Ross prend appui sur les cartes topologiques de l’aménagement des sites de l’Exposition universelle. Créée à partir d’une caméra montée sur un drone qui traverse les îles selon les trajets originaux précis du Minirail, l’image flotte à un rythme lent et constant qui révèle l’état actuel et la détérioration des vestiges de 1967 – voies navigables, pavillons, végétation – et les transformations en palimpseste du site depuis cinquante ans, dont l’exposition horticole internationale des Floralies en
8
M O N I K A K I N G A G N O N E T L E S L E Y J O H N S TO N E
1980, le Grand Prix au Circuit Gilles-Villeneuve et les festivals de musiques tels Osheaga et Piknic Électronik. Les rénovations et les travaux de construction se poursuivent encore aujourd’hui sur le site. Des extraits récités de Terre des hommes, les mémoires de l’écrivain et pilote français Antoine de Saint-Exupéry parus en 1939, apportent un ancrage historique et littéraire, tandis que les mots de cette source d’inspiration poétique pour le thème principal d’Expo 67 redoublent étrangement certaines scènes du film. La projection monocanale de Blais et Grandmaison, Le Chemin de l’énigme, a été entièrement tournée sur les berges de la Voie maritime du Saint-Laurent, en bordure des îles aménagées. Accentuées par de nombreuses coupes franches, les mains d’une femme déplacent des pierres mouillées d’une manière obsessionnelle, édifiant et détruisant sans cesse des monticules pour créer des formes sculpturales éphémères, rappelant le mythe de Sisyphe; la bande sonore reprend les bruits de l’eau en mouvement et des pierres qui s’entrechoquent, doublés d’une composition électronique incluant le signal de fermeture des portes que l’on entend encore aujourd’hui dans les wagons du métro de Montréal. Cette œuvre performative propose une brève histoire de la création des îles, depuis les formations rocheuses d’origine et l’agrandissement de l’île Sainte-Hélène, à la fabrication de l’île Notre-Dame à partir des détritus de construction des infrastructures urbaines montréalaises durant les années 1960, depuis l’obsolescence programmée des pavillons aux rénovations à grande échelle en cours actuellement. Dans le film de Ross comme celui de Blais et Grandmaison, la caméra s’éloigne momentanément des îles pour découvrir des vues de Montréal, ce qui situe les films dans le présent, tout en plongeant les spectatrices et spectateurs dans la « texture de futurité » décrite par le théoricien des médias André Jansson : « […] un panorama de Montréal comme jamais vu auparavant […] depuis un espace en lui-même entièrement neuf8. » Malgré le caractère artificiel du site, ces deux films démontrent comment la nature continue de s’imposer de nouveau sous la forme d’arbres, de plantes et de fleurs, d’eaux courantes, de bandes de canards et de beaux ciels bleus. L’installation vidéo à trois canaux de Sim, Un jour, One Day, présentée dans le même espace que la projection à grande échelle de Ross, offre aussi des vues spectaculaires des îles. Sim se promène dans le paysage, vêtue d’un uniforme d’hôtesse transformé en tailleur pantalon, mettant ainsi l’uniforme à jour avec un flair féministe. Avec à la main le spicilège de ses parents, souvenir de leur lune de miel à Expo 67, Sim recherche des traces des sculptures publiques encore présentes sur le site, ou sur un plan métaphorique, des promesses utopiques que l’Expo représentait face à l’avenir. Nous voyons la sculpture géante d’Alexander Calder intitulée L’Homme, dominant Sim devenue toute petite, et les œuvres moins connues, telles le Phare du cosmos d’Yves Trudeau (émettant des messages sonores électroniques dans l’univers),
9
Introduction
Iris de Raoul Hunter, Migration de Robert Roussil et Signe solaire de Jean leFébure. Son interprétation lente et nostalgique de la chanson thème enlevée de Stéphane Venne, Un jour, un jour, accentue la qualité réflexive de l’œuvre, tandis qu’elle chante en gros plan devant la caméra et feuillette les instantanés de sa mère, vêtue à la mode et posant devant les pavillons d’Israël, de la Grande-Bretagne, de l’urss, de L’Homme et la Santé, et devant Habitat 67. Chacune de ces trois œuvres évoque la réalité passée du site par son attention soutenue face au paysage, alliée à du matériel sonore qui crée des contrepoints temporels par rapport à son traitement actuel. Le pavillon des États-Unis, l’un des plus populaires et emblématiques d’Expo 67, et à ce jour le plus grand dôme géodésique au monde, se tient toujours, majestueux et aérien, sur une des îles de l’Expo. Son état quelque peu délabré et sa fonction plutôt abstraite de musée de l’environnement administré par le gouvernement fédéral canadien témoignent également du passage du temps et d’une certaine amnésie par rapport à l’histoire. Toutefois, il représente aussi, avec Habitat 67, l’exemple le plus probant des innovations architecturales ayant marqué Expo 67. Charles Stankievech s’intéresse depuis longtemps à Buckminster Fuller, l’architecte du pavillon, qui fut en outre théoricien des systèmes, écrivain, designer et inventeur. Dans l’espace de l’installation de Stankievech, des étagères en acrylique conçues sur mesure présentent un assortiment de documents d’archives, de publications, de textes, de disques vinyle, de photographies et d’extraits audiovisuels témoignant des intérêts multiples de Fuller pour les domaines de l’espace, de la radio, de l’environnement, de l’armée et de l’Arctique canadien. Au centre de l’installation, un dôme géodésique en cuivre abritait une chaise Solair, un émetteur radio et des écouteurs, tandis que le public était invité à écouter, sur un banc voisin, une émission radiophonique de textes aussi variés que les premiers enregistrements de battements de cœur, le « Vive le Québec libre ! » prononcé par Charles de Gaulle à Montréal en 1967, Marshall McLuhan, Pink Floyd, Karl Marx et Glenn Gould. Une photographie murale datant de 1976 dominait l’espace, documentant du haut des airs l’incendie du revêtement de polymère du dôme, qui a duré à peine dix minutes et exposé son armature de façon permanente. Cette photographie parmi les plus emblématiques du dôme souligne spectaculairement la fin d’une époque. En prolongement de l’œuvre, et dans l’espoir d’inciter le public à se rendre à l’île Sainte-Hélène, Stankievech a transformé le dôme de Fuller en émetteur radio, où l’on pouvait entendre la même émission que si l’on syntonisait le 88,5 fm dans un rayon d’un kilomètre du dôme. Deux contributions photographiques abordent les traces matérielles d’Expo 67 en des moments historiques distincts. Les dix épreuves à la gélatine argentique des îles par Mark Ruwedel, datant de 1989-1990, documentent un point médian qui anticipe l’année 1992 et le 25e anniversaire d’Expo 67. Les images de Ruwedel révèlent déjà l’usure et l’abandon de plusieurs pavillons et des vestiges d’il y a vingt-cinq ans.
10
M O N I K A K I N G A G N O N E T L E S L E Y J O H N S TO N E
Le projet photographique de Simon Boudvin nous offre un inventaire des rappels actuels de l’Exposition universelle dans les rues de Montréal, juxtaposés à des citations provenant de différents documents officiels d’Expo 67. Les Montréalaises et les Montréalais connaissent bien plusieurs de ces structures urbaines, et leurs références aux pavillons de 1967 soulignent le passage du temps, mais aussi l’impact visuel subtil et peu reconnu, sur notre paysage urbain, du vocabulaire architectural moderne si présent lors de l’Expo. La section se conclut avec le texte savoureux de Johanne Sloane intitulé « L’œuvre murale de Dorval par Greg Curnoe: un commentaire critique sur Expo 67 », dans lequel elle analyse l’esthétique et la politique de la contreculture des années 1960 et son influence durable sur Montréal.
Identités nationales : le pavillon du Canada et le pavillon des Indiens du Canada Dès leur début, les archives ont traditionnellement joué un rôle-clé dans la construction et le maintien de formes d’autorité et de pouvoir gouvernemental, en préservant la documentation des institutions, des événements, de la législation et des personnes. Les contributions de ces fonctions à la formation et au maintien des identités nationales ne sont pas totalisantes, mais révélatrices. Les expositions universelles sont particulièrement éloquentes en ce qui a trait à la compréhension de la manière dont les nations construisent et exportent leurs identités sur la scène mondiale en des moments historiques donnés, en tant qu’expressions imaginaires d’idéaux sociaux et politiques. Plusieurs artistes de l’exposition explorent le groupe de structures qui composent le pavillon du Canada (Althea Thauberger, Leisure et Geronimo Inutiq). Les projets des artistes Duane Linklater et Krista Belle Stewart sur les complexités du pavillon des Indiens du Canada sont suivis du texte de Guy Sioui Durand « Le pavillon des Indiens du Canada », et de celui de David Garneau « D’Indien à Indigène : du pavillon temporaire aux territoires souverains d’exposition », deux auteurs qui ont présenté leurs recherches sur le pavillon lors de colloques du Collectif des commissaires autochtones durant la dernière décennie. Toute cette attention portée au pavillon des Indiens du Canada témoigne des histoires de résistance des artistes autochtones face aux représentations dominantes de la formation de l’identité et de l’histoire canadiennes lors des célébrations du centenaire en 1967 (un autre « spectacle », pour emprunter le langage de Philips), et de nouveau durant le 150e anniversaire en 2017. L’œuvre Sans titre (1992) de Mark Ruwedel est également reproduite dans cette section; elle donne à voir le mât totémique créé par les artistes Kwakwaka'wakw Tony et Henry Hunt pour l’extérieur du pavillon, soit l’un des rares vestiges des pavillons originaux qui continuent d’embellir l’île Notre-Dame.
11
Introduction
Des enfants jouant avec des « bûches » en bois dans l’installation de Leisure, Panning for Gold / Walking You Through It, 2017.
Le pavillon du Canada comprenait plusieurs structures indépendantes dont le regroupement visait à donner au public d’Expo 67 une impression de la géographie, de l’économie et de la culture du pays hôte. Le Katimavik en constituait l’édifice principal : une pyramide inversée de neuf étages avec, au sommet, une terrasse en pente ornée de sculptures géantes (voir pages 101, 103), avec plusieurs pyramides reliées entre elles et présentant des expositions, ainsi que le Ciné-carrousel tournant qui proposait cinq films, dont Notre croissance. Adjacent au Katimavik, L’Arbre du peuple, une structure en forme d’arbre, haute de dix-huit mètres, portait des milliers de photographies de Canadiennes et de Canadiens, imprimées sur des feuilles de nylon rouges et orangées (voir page 101-102). À l’ombre de la pyramide se trouvaient le Centre d’art des enfants et un restaurant, La Toundra, qui existe toujours, décoré de murales sur plâtre par Kumukluk Saggiak et Elijah Pudlat, deux sculpteurs sur pierre inuits originaires de Cape Dorset9. Althea Thauberger explore sous forme narrative les complexités de L’Arbre du peuple, un projet de photographie documentaire sociale préparé par Lorraine Althea 12
M O N I K A K I N G A G N O N E T L E S L E Y J O H N S TO N E
Monk pour le Service de la photographie de l’Office national du film du Canada (onf). Conçu dans le but de promouvoir une vision de l’identité canadienne, son dôme orange vif était composé de « feuilles » individuelles présentant des portraits de Canadiennes et de Canadiens de tous les milieux, commandés à des photographes de tout le pays. Dans cette magnifique installation vidéo à deux canaux, Thauberger interprète librement le rôle de Monk, représentée en train d’examiner des centaines de fiches d’archives vert pâle au format 8 x 10 pouces, en référence aux images photographiques datant de 1963 à 1966, tirées du fonds conservé au Musée des beaux-arts du Canada. En citant des interviews avec Monk, de la correspondance interne du Service de la photographie, de pair avec des commentaires filmés de la conservatrice Andrea Kunard et de l’historienne de la photographie Carol Payne, Thauberger raconte la genèse du projet10. Comme Monk l’avait fait pour les publications Ces visages qui sont un pays et Call Them Canadians, en lien avec son projet, Thauberger a invité quatre jeunes poètes de Montréal – Danica Evering, Natasha Kanapé Fontaine, Kama La Mackerel et Chloé Savoie-Bernard – qui contribuent avec une poésie souvent marquée par une critique virulente. Leurs textes parlés proposent des commentaires, des descriptions et de la poésie, offrant des aperçus de cette histoire tout en ajoutant un commentaire critique sur les prémisses sous-jacentes au projet et sa tentative de « représenter » une nation. Comme l’affirme Thauberger, « les images étaient combinées pour tracer un autoportrait idéalisé de la nation au moment où le Canada s’efforçait de “définir de nouveaux modèles de citoyenneté normative”, en opposition à l’impérialisme britannique. Toutefois, parallèlement à leurs ambitions utopiques, ces projets renforçaient une forme agressive et assimilatrice de multiculturalisme sanctionnée par le gouvernement qui, comme l’ont postulé plusieurs théoriciennes et théoriciens de la culture au Canada, s’employait à maintenir un noyau de race blanche et de classe moyenne. Ainsi, en se réclamant du concept de la “mosaïque”, les images agissaient dans le même sens que l’État pour dissimuler les pratiques réelles de discrimination et les préjugés envers les différences raciales, culturelles et socioéconomiques11. » Le Canada de 2017 est très différent de celui de 1967, et Thauberger signale subtilement cette distance dans sa gestuelle et ses expressions faciales, parfois d’une manière carrément délibérée et comique. Tout comme Thauberger fait référence au travail important de Lorraine Monk, l’installation de Leisure, Panning for Gold / Walking You Through It, rend hommage à une autre femme emblématique de l’histoire canadienne, l’architecte de paysage novatrice Cornelia Hahn Oberlander (née en 1921 et toujours active à Vancouver), qui a radicalement remis en cause les notions conventionnelles de jeu chez les enfants, avec son projet unique d’aire de jeu, Environnement par le jeu créatif et l’apprentissage. Au milieu des conceptions futuristes si caractéristiques des pavillons d’Expo 67, cet espace aux dimensions modestes et d’allure ordinaire offrait aux enfants des 13
Introduction
Vue de l’exposition, à l’avant plan, Leisure, Panning for Gold / Walking You Through It, 2017, à l’arrière-plan, Duane Linklater, Earth Mother Hair, Indian Hair, and Earth Mother Eyes, Indian Eyes, Animal Eyes, 2017, et de part et d’autre de la salle, Mark Ruwedel, Sans titre, 1988-1991.
possibilités infinies de jeu, avec son environnement naturel (incluant des monticules de terre et de l’eau en mouvement), et ce que Oberlander avait théorisé comme des « pièces détachées ». Le produit de recherches approfondies sur le site et en archives, complétées par des interviews avec Oberlander, l’installation de Leisure comprenait de grandes épreuves numériques colorées à la main, basées sur des photographies d’archives du jardin, et des billes de bois à entailles fabriquées sur mesure, que le public du Musée pouvait manipuler. Leisure témoigne de la détermination d’Oberlander et de son acuité analytique en incluant la lettre (d’archives) adressée à la chargée de projet Polly Hill, qui révèle la vision aux allures de manifeste d’Oberlander, exprimée selon ses propres mots. Inspirée par le mot Katimavik qui signifie « lieu de rencontre » en inuktitut, l’installation de l’artiste inuit Geronimo Inutiq interprète les formes abstraites, les images, les symboles et les langages du pavillon. En pratiquant la juxtaposition et la superposition visuelle d’extraits de films promotionnels de 1967 en 16 mm, altérés et fragmentés en mode numérique, et de photographies couleur en gros plan de plantes et de lichens en provenance de son territoire à Iqaluit (Nunavut), il a réuni avec succès deux univers distants en un même champ visuel. Il était particulièrement intrigué par le choix anachronique de sculptures, de cadrans solaires, de sabliers et de masques haïdas installés par les organisateurs le long des murs en pente, résolument modernes, de la terrasse sur le toit (voir page 103). Inutiq fait allusion à l’assemblage de moments historiques distincts, réunis en un même champ visuel et architectural, par l’utilisation d’une vaste gamme de technologies analogues et numériques dans le but de créer des effets optiques et sonores, une cristallisation et une fragmentation d’images en mouvement, des formes d’ondes produites en série et des enregistrements sur bande magnétique, ainsi que l’altération d’images imprimées. Le revêtement de sol en vinyle et la composition sonore basée sur l’œuvre originale du compositeur allemand Otto Joachim évoquent l’architecture et l’atmosphère dépouillée du pavillon d’origine sous une forme actuelle. Comme Inutiq le disait, ces éléments lui ont permis de créer une perspective critique à propos de 1967 en tant que « sommet des possibilités du futurisme et du potentiel de l’État-nation comme agent de nouvelles innovations corporatives et technologiques ». Le pavillon des Indiens du Canada a été d’une importance cruciale dans l’histoire de l’art autochtone contemporain au Canada, tel qu’en témoigne la masse critique d’auteures, d’auteurs et d’artistes qui ont relevé son influence12. Ce fait était particulièrement présent à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération, lorsque la question de la décolonisation a surgi dans le débat public au Canada. Conçu par un groupe de dirigeants et d’artistes autochtones de partout au pays, le pavillon s’inspirait des réponses à la question des organisateurs : « Que voulez-vous communiquer
16
M O N I K A K I N G A G N O N E T L E S L E Y J O H N S TO N E
au peuple canadien et au monde entier lors de leur venue à Expo 6713? » La rhétorique et la perspective du récit historique proposé par le pavillon remettaient fortement en question les tropes coloniaux qui situent les peuples et les cultures autochtones dans un passé lointain (voir pages 118-121). L’artiste Omaskêko Cree Duane Linklater et Krista Belle Stewart, de la bande Upper Nicola de la nation Okanagan, ont été invités à créer des œuvres sur le pavillon des Indiens du Canada, puisque nous croyions que ce pavillon particulier devrait avoir une forte présence dans l’exposition, en raison de sa contribution durable au commissariat et à l’art contemporain autochtones. Il s’agissait également d’un des rares pavillons, avec le pavillon Chrétien conçu par Charles Gagnon, et le pavillon de Cuba, avec son exposition sur la révolution cubaine, qui attaquaient de front des enjeux sociaux et politiques contemporains (voir le texte de Johanne Sloan dans la présente anthologie). La grande murale peinte de Linklater intitulée Earth Mother Hair, Indian Hair, and Earth Mother Eyes, Indian Eyes, Animal Eyes, se compose de motifs d’yeux et de cheveux tirés d’une photographie de la murale de Norval Morrisseau, Earth Mother with Her Children, 1967, l’une des six grandes murales peintes par des artistes autochtones de premier plan, sur les parois extérieures du pavillon. La version finale de la murale Morrisseau fut altérée – ou censurée – à la demande du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (mainc), qui insistait pour qu’une distance « convenable » soit maintenue entre les seins de la mère terre et ses nourrissons. Nous savons que Morrisseau avait chargé Carl Ray d’exécuter l’œuvre murale pour lui, mais nous ignorons les raisons précises de cette décision14. L’absence de Morrisseau est reflétée dans l’engagement par Linklater de la muraliste montréalaise Julie Ouellet pour réaliser son interprétation des cheveux et des yeux sur les murs du mac. L’œuvre de Linklater nous rappelle les relents de colonialisme représentés dans le pavillon d’origine et, comme il l’affirme, « dont nous faisons toujours l’expérience, témoignant et cheminant aujourd’hui ». Il problématise l’absence de Morrisseau en demeurant délibérément à l’extérieur du mac durant le montage et même durant toute la durée de l’exposition. Les yeux immenses de Linklater dominaient les espaces d’exposition, engageant efficacement le public et l’institution même dans un processus de réflexion critique sur la présence d’artistes autochtones au sein de ses collections et de sa programmation. Tout comme les muralistes de 1967 étaient conscients du rôle qu’on leur demandait de jouer dans l’expression de la vision du Canada que le mainc souhaitait offrir au monde entier, Linklater interroge les rapports difficiles entre les artistes autochtones et les institutions artistiques au Canada. La relation de Krista Belle Stewart au pavillon des Indiens du Canada était plus personnelle, déclenchant la recherche d’une photographie de sa mère, qu’elle
17
Introduction
s’attendait à trouver parmi les centaines de photos exposées dans le pavillon. Son œuvre intitulée Indian Momento prenait la forme d’une installation en vinyle appliquée sur les fenêtres d’un mur extérieur du mac. L’image qui en constitue le point de départ est tirée d’un documentaire éponyme de l’onf datant de 1967 et portant sur le pavillon. Il s’agit d’un des rares documents filmiques sur l’intérieur du pavillon. Le portrait de la mère de l’artiste apparaît au plafond, au sommet des arches de photographies. À peine visible dans le documentaire, il montre une jeune étudiante en soins infirmiers, revêtue de son uniforme, qui allait devenir la première infirmière autochtone du réseau de santé publique en Colombie-Britannique. Presque illisibles dans l’installation, les masses noires abstraites imprimées sur du vinyle rouge projettent une ombre rouge toujours changeante dans l’espace d’exposition, selon la course du soleil, rappelant les vitraux d’une église. Fait à remarquer, Linklater et Stewart ont directement intégré leurs œuvres à l’architecture du Musée; on sentait leur présence au-delà des limites des espaces qui leur étaient alloués. Chez Stewart, l’évanescente lumière rouge qui changeait au fil de la journée jetait son éclat sur les murs de la projection de Ross et dans les espaces d’exposition des œuvres de Linklater et des Ritter.
Réinventions numériques Réinventions numériques réunit les œuvres de quatre artistes ayant recours aux médias numériques pour revisiter et réinventer plusieurs pavillons emblématiques : JeanPierre Aubé, Chris Salter et Emmanuelle Léonard ont respectivement mis en valeur le Kaléidoscope, le pavillon de la France et le pavillon Chrétien au caractère œcuménique, explorant les ressources des médias numériques actuels dans le prolongement des expérimentations ontologiques originales de 1967. Bien qu’il ne s’inspire pas d’un pavillon précis, Stéphane Gilot a adapté le jeu d’animation vidéo Minecraft pour inciter le public à créer de nouveaux pavillons sur un site virtuel d’Expo 67, stimulant la participation publique et l’imagination des visiteuses et des visiteurs. Si les pavillons d’origine représentaient la fine pointe de l’expérimentation des années 1960, les œuvres de ces artistes ont recours aux technologies numériques actuelles pour explorer l’état de la culture médiatique au XXIe siècle dans les jeux vidéo, les réseaux et divers logiciels. Jean-Pierre Aubé s’emploie depuis longtemps à rendre visibles les phénomènes électromagnétiques, telles les fréquences radio d’ondes courtes, les télécommunications et les technologies de surveillance. L’étincelle ou l’inspiration pour son installation provient de deux éléments d’information importants sur le Kaléidoscope, commandé à l’origine par six compagnies canadiennes de produits chimiques, « présentant L’Homme et la Couleur – une aventure en couleur, en mouvement et en
18
M O N I K A K I N G A G N O N E T L E S L E Y J O H N S TO N E
son ». L’extérieur du pavillon était un carrousel cylindrique de 112 ailerons verticaux formant une roue des couleurs en trois dimensions, tandis que l’intérieur comprenait trois salles en miroir dans lesquelles une bande sonore électronique expérimentale du compositeur R. Murray Schafer accompagnait les films du designer Morley Markson, qui réfractaient sur les murs du cinéma15. Pour son installation, Aubé a acheté une variété de produits chimiques sur le Web invisible, les a filmés à travers un microscope modifié, puis a transformé les images obtenues à l’aide de logiciels de reconnaissance faciale en vente libre, pour créer douze courts métrages qui présentent la cristallisation des produits chimiques comme un kaléidoscope de couleurs en constante transformation. Le résultat dynamique est une fantasmagorie de formes colorées en projection, rappelant le Kaléidoscope de 1967 et ouvrant au public du mac une fenêtre sur un des pavillons les plus spectaculaires, bien que toujours insaisissable, d’Expo 67. Les autres artistes de la section se sont plongés dans le travail avec les nouveaux médias ou ont modifié des technologies existantes pour la création de leurs œuvres. Par exemple, Chris Salter a revisité les Polytopes radicaux du compositeur, architecte et ingénieur français d’origine grecque Iannis Xenakis, datant des années 1960 et 1970. Avec son équipe, il a soigneusement étudié les méthodes et structures de l’œuvre de Xenakis, qui occupait à l’origine l’atrium du pavillon de la France, afin d’élaborer non pas une recréation, mais plutôt une interprétation de cette pièce innovatrice à l’aide des nouveaux médias. Reconfigurée pour la rotonde du mac, l’installation comprenait de puissantes lampes led et des haut-parleurs minuscules, suspendus dans l’espace sur une « surface réglée » géométrique fabriquée à partir de minces câbles d’aviation, pour créer un environnement son et lumière qui oscille entre l’ordre et le chaos, rappelant la fascination originelle de Xenakis pour le comportement des systèmes naturels. N-Polytope explore comment il est possible aujourd’hui de faire sens et de raviver l’intérêt de Xenakis pour les systèmes probabilistes (connus sous le nom de « stochastiques »), en utilisant des nouvelles technologies inaccessibles à l’époque. Salter et son équipe ont présenté cette œuvre à plusieurs reprises sur la scène internationale, dans le contexte d’expositions ou de festivals; dans chaque cas, l’œuvre était adaptée à l’architecture et aux caractéristiques sonores de l’espace. N-Polytope était la première installation perçue par le public à l’entrée du mac, avec sa délicate composition électronique résonnant dans l’espace; deux fois par jour, on pouvait entendre partout dans le Musée une version plus intense, d’une durée de douze minutes. Emmanuelle Léonard a passé un nombre incalculable d’heures à naviguer sur Internet à la recherche d’images de conflits datant de 1967 à 2017, dans le but de « mettre à jour » le film de Charles Gagnon intitulé Le Huitième Jour (1967). En choisissant de mettre l’accent sur les hommes et les femmes sur le terrain, plutôt que sur la machine de guerre, elle offre une perspective différente de celle du film de Gagnon, davantage
19
Introduction
Vue de l’exposition, Dave Ritter et Kathleen Ritter, Reprise, 2017. Ci-contre Vue de Spectacles du monde de Caroline Martel, 2017, dans l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme, Place des Arts, Montréal.
chargé sur le plan politique, présenté au pavillon Chrétien. Alors que Gagnon avait fait appel à des compagnies d’actualités filmées pour s’approvisionner en images d’événements historiques donnés, Léonard avait accès, par l’entremise du Web, à une quantité illimitée de séquences produites non seulement par des sources d’information officielles, mais également par des soldats, des protagonistes et des témoins sur les terrains de conflit et de guerre. Nous voyons des extraits captés par des technologies numériques adaptées pour l’armée – drones équipés de caméras, détecteurs infrarouges, etc. – mais aussi des images granuleuses, à peine lisibles, captées par des téléphones cellulaires et des appareils photo analogues. Dans sa projection vidéo monocanale, Léonard fait alterner des images individuelles et la juxtaposition de deux images provenant de sources différentes. Elle conserve le format original du matériel source pour pointer ses origines diverses, soulignant ainsi la grande diffusion actuelle des images de conflit, tandis que les technologies sont placées – peut-être plus démocratiquement – entre les mains des hommes, des femmes et des enfants qui sont directement présents et immédiatement touchés. Montréal délire de Stéphane Gilot adopte une approche ludique et futuriste des îles en créant une interprétation virtuelle du site de l’Expo à l’aide de Minecraft, la plateforme de jeu de construction qui propose les mêmes formes vectorielles mises de l’avant à Expo 67 : le cube, le triangle et leurs nombreuses combinaisons. Cette installation était très populaire chez les jeunes publics familiers avec ce jeu; les visiteurs étaient invités à participer à la construction d’un monde virtuel. L’installation comprenait également une table pentagonale fabriquée sur mesure, en référence au
20
M O N I K A K I N G A G N O N E T L E S L E Y J O H N S TO N E
film Quintet de Robert Altman (1979), des dessins rehaussés à l’aquarelle et une projection vidéo, autant de visions dystopiques offrant une réflexion sur la suppression de plusieurs promesses utopiques de Expo 6716. Cet état de choses est fortement symbolisé par la transformation des pavillons de la France et du Québec pour créer le Casino de Montréal, aujourd’hui géré par Loto-Québec.
Remix d’archives Expo 67 représentait un moment captivant de l’histoire des médias, laissant présager une transition technologique de l’analogue au numérique dans les domaines du son, du film et de la vidéo. L’Expo a donné lieu à des innovations créatrices en cinéma (les plus spectaculaires étant les projections multiécrans de films 35 et 70 mm), tandis que les musiciens et compositeurs expérimentaient eux aussi avec les nouvelles technologies électroniques et numériques17. Comme nous l’avons vu, plusieurs artistes de l’exposition ont fait référence à ce moment de transition, soit en faisant usage de technologies et de logiciels des nouveaux médias (par exemple, la caméra montée sur drone chez Ross, l’utilisation par Aubé de logiciels de reconnaissance faciale pour le montage en temps réel, l’utilisation de Minecraft chez Gilot, le matériel informatique et les logiciels sur mesure de Salter); d’autres ont employé des technologies analogues
en référence à 1967, comme l’utilisation par Inutiq d’enregistrements sur bande magnétique et d’un amplificateur à tubes, ou encore les transmissions radio à ondes courtes de Stankievech. Remix d’archives regroupe les œuvres d’artistes ayant directement puisé dans les archives sonores et d’images en mouvement, procédant à une forme de remix ou de collage qui ramène dans le présent ces images passées selon de nouvelles configurations et de nouvelles perspectives. Les projets de David et Kathleen Ritter, Philip Hoffman et Eva Kolcze, Jacqueline Hoàng Nguyê˜n et Caroline Martel sont associés au texte de la professeure Janine Marchessault, « Expo 67 et l’archive manquante, l’anarchive et l’anti-archive », qui envisage les archives filmiques d’Expo 67 en tant que sources de documentation originelle permettant des réinventions et des expérimentations créatrices complexes. Les sons d’Expo 67 ont résonné et se sont réverbérés partout dans l’exposition, grâce aux interprétations des compositions électroniques de Iannis Xenakis, Gilles Tremblay, Otto Joachim et R. Murray Schafer, de la chanson-thème de Stéphane Venne et d’extraits du mémoire de Saint-Exupéry. Puisant dans une grande variété d’archives sonores, David Ritter et Kathleen Ritter ont créé Reprise, un disque vinyle – cette forme de média qui a perduré et qui fait maintenant un retour en force – spécialement consacré à l’année 1967. Le public pouvait opérer un tourne-disque manuel dans une petite salle carrée, transformée en lieu d’écoute décoré de motifs géométriques colorés, garnis de poufs orangés. Fruit d’une recherche et d’une compilation méticuleuse, les côtés A et B du vinyle réunissent près de cinquante clips parfaitement mixés, pour former dix pistes portant des titres comme « In the Dimension of Sound », « Islands in the Mind », « Un battement de cœur » ou « Voltage Control ». Reprise identifie 1967 comme l’année durant laquelle la musique électronique a pris forme, tout en faisant référence au hip-hop, à la culture des DJ, au remixage, à l’échantillonnage, au sérialisme et à la répétition; le disque comprend des extraits des sons parmi les plus reconnaissables d’Expo 67, des œuvres des premiers compositeurs et compositrices électroniques, ainsi que des chansons. On peut également entendre des paroles célèbres de Charles de Gaulle, Marshall McLuhan et Guy Debord18. Tout comme Inutiq qui puise aux archives Prelinger, Jacqueline Hoàng Nguyê˜n ainsi que Philip Hoffman et Eva Kolcze retravaillent des séquences d’archives filmiques (forcément analogues) à l’aide de nombreuses techniques numériques, afin de créer des interprétations résolument actuelles de leurs matériaux de départ. Dans leurs films monocanaux, Nguyê˜n et Hoffman/Kolcze transforment des séquences filmiques trouvées, ayant trait à Expo 67, en les dégageant de leur statut documentaire indiciel pour créer des formes expérimentales. À partir de films provenant de Bibliothèque et Archives Canada, et de collections personnelles, 1967: A People Kind of Place
22
M O N I K A K I N G A G N O N E T L E S L E Y J O H N S TO N E
de Nguyê˜n démêle brillamment l’histoire vraie de la première plateforme d’atterrissage d’ovnis au monde, construite à Saint-Paul, Alberta, pour célébrer le centenaire du Canada. Nguyê˜n attire l’attention sur cet événement et son ouverture métaphorique à tous les peuples, y compris les extra-terrestres; elle explore les notions d’hospitalité, de diversité et d’immigration officielle en 1967. Pareillement, By the Time We Got to Expo par Hoffman et Kolcze attaque le statut documentaire original d’un film « souvenir » 8 mm produit par Castle Films et du film de William Brind produit par l’onf, Objectif : Expo 67 (1967). Les traces matérielles et les formes texturées de l’Expo se dissolvent, tandis que les architectures emblématiques du Katimavik et du dôme géodésique de Fuller se désagrègent, tout comme ses effets mnémoniques et ses significations culturelles. Caroline Martel s’était posé le défi de transformer des extraits de sept films originaux créés en 1967 pour constituer une mosaïque de trente-cinq moniteurs à écran plat installés dans un espace public de la Place des Arts. Plus de 3 000 films ont été présentés lors d’Expo 67, et les films spectaculaires de grand format ou multiécrans comptent parmi les œuvres les plus radicales et innovatrices de leur temps. Martel et son collaborateur Mathieu Bouchard-Malo ont choisi sept films, autant parmi les moins connus que parmi les plus emblématiques, afin de souligner le haut degré d’innovation et d’expérimentation des productions cinématographiques d’il y a cinquante ans. Avec leur présence dramatique hors des murs du mac, dans la ville souterraine située sous le Quartier des spectacles, les extraits des sept films projetés sur trente-cinq écrans numériques révélaient l’extraordinaire qualité graphique de plusieurs des films originaux, de même que la variété de leur matérialité visuelle et de leurs structures narratives. Leur fonctionnement réussi, dans des formats si différents de ceux pour lesquels ils ont d’abord été créés, témoigne de la richesse des films originaux. La section finale de ce livre est consacrée à six films multiécrans de grand format produits pour Expo 67 et présentés durant les quatre mois de l’exposition dans la salle de projection du Musée : La Vie polaire, Le Mouvement, Conflit et Le Canada est mon piano du pavillon du Canada, La Terre, patrie de l’homme et L’Homme et la Couleur du Kaléidoscope. Les films restaurés étaient présentés par le groupe de recherche cinemaexpo67, dont les membres ont entrepris le processus complexe de recherche, de restauration et de présentation de ces films depuis une décennie. En collaboration avec la Cinémathèque québécoise de Montréal (à partir des dépôts d’archives filmiques de la Ville de Montréal) et l’Office national du film du Canada, ils ont donné au public l’occasion de voir des films rarement présentés, dans des formats qui cherchent à s’approcher et à faire la simulation des projections originales en grand format multiécrans. L’Homme et la Couleur, originalement présenté au Kaléidoscope, est un prototype de réalité virtuelle produit en collaboration avec la
23
Introduction
compagnie multimédia montréalaise Productions Figure 55, basé sur les plans architecturaux et créé à partir des films et des éléments sonores originaux. La présentation de ces films originaux rend bien compte de l’esthétique et des langages plastiques de cette conjoncture particulière. Dès le début de ce projet qui a duré trois ans, nous les commissaires, aussi bien que les artistes, étions bien conscients des pièges potentiels d’un retour nostalgique au passé. Nous reconnaissions toutes et tous la nécessité d’une distance critique par rapport à certains préceptes sous-jacents à Expo 67 : les visions utopiques du futur, une foi inébranlable dans le progrès technologique, économique et social, et la volonté manifeste d’esquiver les complexités du monde extérieur. Après tout, 1967 fut aussi une année marquée par l’activisme pour les droits civils, la décolonisation et les mouvements de résistance (comme le mouvement Black Power et l’American Indian Movement), la controversée guerre des Six Jours au Moyen-Orient, parmi les nombreux bouleversements sociaux et politiques qui avaient cours à travers le monde. Et 1968 – considérée comme « l’année qui a changé l’histoire » – était toute proche. Et pourtant, à mesure que notre projet se développait, nous ne pouvions pas davantage nier la fascination et l’admiration que nous éprouvions pour l’ambition, le savoir-faire technologique, l’innovation et la créativité des architectes, cinéastes, artistes et designers qui ont contribué à faire d’Expo 67 l’événement qu’il a été. Certaines explorations spécifiques, comme le travail créatif et la contribution des femmes à Expo 67, sont particulièrement riches. La recherche de Thauberger sur l’Arbre du peuple traite d’un projet qui a été marginalisé au sein de l’Office national du film du Canada, l’institution qui a aussi financé le pavillon du Labyrinthe et son film multiécran en grand format, à hauteur de 4,5 millions de dollars, et nombre de films documentaires pour Expo 67 ou à son sujet. Oberlander figure parmi les architectes de paysage les plus respectés et distingués au Canada; non seulement l’exploration par Leisure de son humble terrain de jeux situé à l’ombre du pavillon du Canada met en lumière un projet moins connu, mais elle souligne aussi l’implication d’Oberlander dans la recherche sur le développement de la petite enfance et envers l’engagement social19. En revêtant l’uniforme bleu pâle des hôtesses de l’Expo, transformé en tailleur pantalon, Sim incarne le rôle dynamique joué par ces dernières en tant qu’interlocutrices et interprètes20. En incluant les compositrices électroacoustiques innovatrices Delia Derbyshire et Daphne Oram, remarquables mais peu connues, David et Kathleen Ritter attirent l’attention sur d’autres histoires marginalisées, qui ne demandent qu’à être explorées. Avec À la recherche d’Expo 67, nous espérons indiquer d’autres voies pour des engagements futurs. Le lectorat est invité en coulisses pour constater le « désordre » des processus créatifs ayant conduit à la production des pavillons individuels et assister à leur élaboration. Sont données à voir et à entendre les magnifiques réalisations
24
M O N I K A K I N G A G N O N E T L E S L E Y J O H N S TO N E
de Buckminster Fuller, Lorraine Monk, Cornelia Oberlander, Norval Morrisseau, Charles Gagnon, Morley Markson, et des compositeurs R. Murray Schafer, Iannis Xenakis, Otto Joachim et Gilles Tremblay. Non seulement les réinterprétations par Chris Salter du travail visionnaire de Xenakis en vue de l’intégration de l’architecture, des mathématiques et de la musique initient de nouveaux publics au rôle précurseur du compositeur, mais elles démontrent également comment les technologies des nouveaux médias peuvent alimenter sa recherche. Il en est de même chez Gilot par son utilisation du populaire jeu vidéo Minecraft pour réactualiser et développer la participation du public face aux vocabulaires architecturaux d’Expo 67. La redynamisation par Duane Linklater et Krista Belle Stewart des archives du pavillon des Indiens du Canada ajoute au corpus croissant de recherche critique et muséale sur un des pavillons d’Expo 67 parmi les plus importants sur le plan historique. Pour leur part, les projets de Ross, Blais et Grandmaison, Ruwedel et Boudvin, indiquent un niveau d’amnésie et d’inefficacité politique, avec la détérioration, la reconversion et la transformation constante du site de l’Expo, sans se préoccuper de son histoire ou de ses particularités géographiques. L’activation des archives par les pratiques artistiques offre un point de vue unique quant à la réinterprétation qui dynamise l’histoire et la mémoire culturelle, tout en apportant des moyens signifiants de re-connaître Expo 67. Pour simplifier à l’extrême, cette activation transforme les retours nostalgiques vers le passé en des rapports plus actuels avec ce qui a changé et ce qui est demeuré intact, comme l’ont fait d’une foule de façons les artistes inclus dans À la recherche d’Expo 67. Jadis le fief spécialisé des archivistes et des historiens, les archives proposent désormais des approches épistémologiques, ou des manières de connaître, qui constituent les sources matérielles de l’imagination pour une plus vaste constellation d’usagers, créatifs autant qu’amateurs21. Notes
1 Ruth B. Phillips, « Show times: de-celebrating the Canadian nation, de-colonising the Canadian Museum, 1967–92 », dans Annie E. Coombes (dir.), Rethinking Settler Colonialism: History and Memory in Australia, Canada, Aotearoa New Zealand and South Africa, Manchester et New York, Manchester University Press, 2006, 121. 2 Certaines expositions portant sur Expo 67 étaient spécialisées, comme celle du Centre de design sur l’architecture de Buckminster Fuller et son dôme géodésique, Montréal et le rêve géodésique, et Habitat 67 vers l’avenir, sur les espaces de vie du futur par Moshe Safdie. Parmi les expositions traitant des souvenirs personnels d’une manière plus soutenue, Explosion 67, Terre des jeunes du Centre d’histoire de Montréal prenait appui sur des histoires orales et quarante-six interviews avec des jeunes Montréalaises et Montréalais de l’époque, en intégrant ces matériaux à une présentation multimédia, comprenant une promenade à bord du Minirail de l’île Notre-Dame par le biais d’une animation en réalité virtuelle. Le Musée McCord a puisé dans ses collections de mode et de costume pour présenter les uniformes originaux des
25
Introduction
3
4
5
6
7
8 9
10
11
26
hôtesses d’Expo 67, aux côtés d’autres facettes de la mode des années 1960, dont la mini-jupe. Le Musée Stewart proposait des éléments audiovisuels et des objets de la culture matérielle tels que passeports et souvenirs. Outre les expositions mentionnées ci-haut, ce corpus inclut une exposition tenue au mac en 2010, Les Lendemains d’hier, qui réunissait dix artistes contemporains en dialogue avec les designers et monuments modernistes. Le titre de cette exposition suggérait un examen du passé comme de l’avenir, du point de vue du présent. Lesley Johnstone, Les Lendemains d’hier, Montréal, Musée d’art contemporain de Montréal, 2010. Hal Foster, « An Archival Impulse », October, vol. 110 (automne 2004), 3-22, et son précédent texte « Portrait de l’artiste en ethnographe », dans Le retour du réel : situation actuelle de l’avant-garde, Bruxelles, La Lettre volée, 2005 (Édition originale anglaise : 1996), et Charles Merewether, The Archive: Documents of Contemporary Art, Cambridge (Massachusets) et Londres, mit Press et Whitechapel, 2006. Voir Okwui Enwezor (commissaire), documenta11_Platform 5: Exhibition, Stuttgart, Hatje Cantz, 2002, et Carolyn Christov-Bakargiev (commissaire), documenta (13): The Book of Books, Osfildern, Hatje Cantz, 2012); Okwui Enwezor (commissaire), Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art, Göttingen, Steidl Publishers, 2008. Voir également Lisa Darms, « Exhibition Review, Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art », The American Archivist, vol. 72 (printemps/été 2009), 253-257. Dieter Roelstraete, « The Way of the Shovel: On the Archaeological Imaginary in Art », e-flux journal n° 4 (mars 2009). Une autre version de ce texte a été publiée dans The Way of the Shovel: On the Archaeological Imaginary in Art, Chicago, University of Chicago Press, 2013. En plus des expositions et de la recherche citées plus haut, l’ouvrage de Ernst Van Alphen intitulé Staging the Archive: Art and Photography in the Age of New Media (Londres, Reaktion Books, 2014) propose un fascinant survol historique des œuvres et des approches artistiques à compter des années 1930. Au Québec, Anne Bénichou a publié plusieurs études sur les archives d’artistes dans le contexte d’expositions. Voir notamment Anne Bénichou (dir.), Ouvrir le document. Enjeux et pratiques de la documentation dans les arts visuels contemporains (Dijon, Les Presses du réel, 2010) et Anne Bénichou, Un imaginaire institutionnel. Musées, collections et archives d’artistes (Paris, L’Harmattan, Coll. Esthétiques, 2013). André Jansson, « Encapsulations: The Production of a Future Gaze at Montreal’s Expo 67 », Space and Culture, n° 10 (2007), 424. Le documentaire Aki’name (On the Wall),1968, de l’Office national du film du Canada, réalisé par David Millar, témoigne de la création de cette œuvre murale. 22 minutes, couleur, https://www.nfb.ca/film/aki_name/.Voir également Monika Kin Gagnon, Rethinking Expo 67 (Kelowna, ubco Summer Indigenous Intensive/cicac Press, 2018) pour une analyse des œuvres traitant des pavillons du Canada et des Indiens du Canada dans À la recherche d’Expo 67. Andrea Kunard est conservatrice de la photographie au Musée des beaux-arts du Canada, où sont maintenant conservées les archives du Service de la photographie de l’Office national du film du Canada. Carol Payne est l’auteure d’une étude sur le Service de la photographie de l’Office national du film du Canada, The Official Picture: The National Film Board of Canada’s Still Photography Division and the Image of Canada, 1941-1971 (Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2013). Payne était précédemment affiliée au Musée canadien de la photographie. Communiqué de presse pour Althea Lorraine, une exposition d’Althea Thauberger à la Susan Hobbs Gallery, Toronto, février 2018. M O N I K A K I N G A G N O N E T L E S L E Y J O H N S TO N E
12 Le chapitre rédigé par Ruth B. Phillips et Sherry Brydon constitue une étude approfondie sur l’architecture, l’art et les aménagements intérieurs du pavillon, largement basée sur le texte de Sherry Brydon datant de 1991, « The Indians of Canada Pavilion at Expo 67: The First National and International Forum for Native Nations » (Mémoire, Département d’histoire de l’art, Université Carleton, 1991). Voir « “Arrow of Truth”: The Indians of Canada Pavilion at Expo 67 », dans Museum Pieces: Toward the Indigenization of Canadian Museums (Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2011), 29. L’analyse du pavillon a fait l’objet de plusieurs tables rondes; deux d’entre elles ont servi de point de départ pour les textes de Guy Sioui Durand et David Garneau : « Revisioning the Indians of Canada Pavilion: Ahzhekewada (Let Us Look Back) », organisée par l’Université ocad et le Collectif des commissaires autochtones, Toronto, 15-16 octobre 2011; et les hommages d’ouverture lors de Iakwéia:re’ / I remember / Je me souviens), organisée par le Collectif des commissaires autochtones, Montréal, 6-18 octobre 2014. Heather Igloliorte, John Moses et Linda Grussani ont présenté « Curatorial Legacy of the Expo 67 Indians of Canada Pavilion and the Future of Indigenous Museum Practice » au colloque du Council for Museum Anthropology intitulé Museum Anthropology Futures, Montréal, 27 mai 2017. Igloliorte et Moses poursuivent leur analyse de l’importance du pavillon dans « More than a pavilion », une des émissions en baladodiffusion sur Expo 67 dans le cadre de la série Thinking Out Loud produite par l’Université Concordia, disponible en anglais à l’adresse : https://www.concordia.ca/events/conversation-series/thinking-out-loud/expo67/more-thana-pavilion.html. 13 Phillips et Brydon, 38. 14 La commissaire et historienne de l’art Carmen Robertson se penche sur la création de l’œuvre murale de Morrisseau dans le cadre de sa recherche dans plusieurs articles de journaux datant de 1967 et des années qui ont précédé, dans Mythologizing Norval Morrisseau: Art and the Colonial Narrative in the Canadian Media. Winnipeg, University of Manitoba Press, 2016, 77-81. 15 Voir Monika Kin Gagnon, « Kaleidoscope », dans Monika Kin Gagnon et Janine Marchessault (dir.), Reimagining Cinema: Film at Expo 67, Montréal, McGill-Queens University Press, 2014, 55. 16 Quintet (1979) est un film de science-fiction post-apocalyptique, réalisé par Robert Altman et mettant en vedette Paul Newman, Brigitte Fossey et Bibi Andersson, tourné au milieu de l’hiver parmi les structures en tétraèdre des pavillons thématiques canadiens d’Expo 67. 17 Voir Reimagining Cinema: Film at Expo 67, op. cit. 18 Pour les références et notes complètes relativement à tous ces extraits, voir les notes d’accompagnement du disque, reproduites aux pages 176 et 177 de la présente publication. 19 Oberlander a créé des aménagements paysagers pour des ensembles prestigieux comme le complexe du Robson Square et de l’édifice Law Courts à Vancouver, le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa, l’Ambassade du Canada à Washington et le Musée d’anthropologie de Vancouver. 20 L’interview en anglais de Cheryl Sim dans le cadre de la série Thinking Out Loud sur Expo 67 traite du rôle important des hôtesses : https://www.concordia.ca/events/conversation-series/ thinking-out-loud/expo67/un-jour-say-friend.html. 21 Le Montréalais Roger La Roche a produit de nombreux documents détaillés concernant plusieurs pavillons d’Expo 67, sur son blogue et site Web Terre des Hommes (Expo 67-84), à l’adresse http://www.villes-ephemeres.org/. Cet homme est une véritable archive vivante sur l’événement original et ses dépôts d’archives.
27
Introduction
Matérialités, temporalités
Ci-contre Vue aérienne de l’île Sainte-Hélène pendant la construction du site Expo 67. Archives de la Ville de Montréal, VM94-EX005-002. Ci-haut Vue aérienne des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, 1967. Archives de la Ville de Montréal, VM94-EX266-200. Ci-bas Site d’Expo 67 en construction. Archives de la Ville de Montréal, VM94-EX001-016.
Ci-contre, en haut Vue aérienne du site d’Expo 67 avec Katimavik en arrière-plan, 1967. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Vieux-Montréal, Fonds Antoine Desilets, P697,S1,SS1,SSS13,D4_321. Photo : Antoine Desilets. Ci-contre, en bas Vue du Minirail et des pavillons de la France et du Québec. Archives de la Ville de Montréal, VM94-EX136-257. Ci-dessous Hôtesses Expo 67. Archives de la Ville de Montréal, VM94-EX137-0201.
Souveraine comme l’amour David K. Ross
Souveraine comme l’amour est une visite guidée cinématographique du parc JeanDrapeau, l’ancien site d’Expo 67, à Montréal. Dans le film, une caméra survole des paysages façonnés par les cinquante ans qui se sont écoulés depuis l’événement. Une narratrice commente les images qui défilent. Le texte est tiré de Terre des hommes, le recueil d’essais autobiographiques d’Antoine de Saint-Exupéry paru en 1939, qui a également donné son sous-titre à l’Exposition universelle de Montréal. Les images sont filmées à l’aide d’une caméra montée sur un drone qui emprunte le trajet original du Minirail, un monorail surélevé aujourd’hui démoli qui transportait les visiteurs sur les 364 hectares (900 acres) de pavillons, d’expositions et d’événements. Le drone survole les bassins, les jardins, les routes et les constructions architecturales restantes d’Expo 67 en suivant précisément la trajectoire originale du monorail. Les données techniques et géologiques tirées de plans d’ingénierie d’Expo 67 et conservées aux Archives de Montréal permettent de reconstituer avec exactitude le parcours du train sur les deux îles du parc, bien que la croissance des arbres, l’interférence électronique des tours de téléphonie cellulaire et les règles de sécurité au parc provoquent des pauses fréquentes dans ce qui devrait être un vol en continu. Ces interruptions se traduisent de facto par l’arrêt du drone. Le parc lui-même, de concert avec le passage du temps, est, en quelque sorte, le co-auteur du film. Souveraine comme l’amour montre l’ancien site de l’Exposition universelle tel qu’il se présentait en 2017, depuis longtemps dépouillé de ses proclamations technologiques exaltantes, dépourvu de son rail surélevé, abandonné de ses foules et vidé de la plupart de ses pavillons à l’architecture novatrice. Le drone capte un paysage rempli non pas de cinquante millions de visiteurs, mais d’arbres de cinquante ans plus âgés. Il documente un espace dominé non pas par une architecture avant-gardiste, mais par des estrades vides et des hangars mobiles. Il dépeint une topographie animée non pas par le progrès scientifique, mais par des ornithologues amateurs et des bassins envahis d’algues.
Ci-contre David K. Ross, Souveraine comme l’amour, 2017, projection vidéographique.
Ci-contre David K. Ross, Souveraine comme l’amour, 2017, arrêts sur image. Ci-dessus Schéma des élévations du rail et placement de colonne du Minirail, utilisé par Ross pour déterminer le trajet et l’altitude de la caméra montée sur un drone. Archives de la Ville de Montréal, P067-4_09-bobine32-U-59.
Une création sonore de Douglas Moffat accompagne ces vues peu palpitantes de ce que l’avenir a réservé au site. Cette bande sonore comprend trois éléments minutieusement imbriqués : une musique composée par Keiko Devaux, des enregistrements faits sur le terrain à différents endroits dans le parc Jean-Drapeau et, surtout, des extraits de Terre des hommes en voix hors champ1. Saint-Exupéry a été l’un des premiers pilotes à travailler pour la célèbre entreprise française Aéropostale, qui assurait le service de poste aérienne pendant l’entre-deuxguerres. Effectuant des vols long-courriers entre Toulouse et Dakar, puis survolant une grande partie de l’Amérique du Sud, Saint-Exupéry écrivait souvent durant ses longs vols en solo. Alors que défilaient sous lui les déserts d’Afrique du Nord et les paysages désolés de la cordillère de Patagonie, le pilote-auteur remplissait de
37
Souveraine comme l’amour
nombreux cahiers de notes sur ses genoux. Aujourd’hui dégagés de leur rôle en tant que sources d’inspiration des déclarations euphoriques d’Expo 67, les récits de SaintExupéry constituent ici un complément insolite aux images aériennes de l’environnement insulaire du parc. À cet égard, le film s’articule autour de deux axes historiques : les réflexions lyriques de Saint-Exupéry composées en vol dans les années 1930 et le trajet du Minirail en 1967. Ce projet propose donc deux points de vue indépendants du site de l’Exposition universelle, qui toutefois se recoupent : le premier, emprunté à la prose poétique et visionnaire de Saint-Exupéry, évoque un passé ambitieux et optimiste; le deuxième, manifeste dans la représentation prosaïque du parc, nous ramène à notre présent nettement plus sombre et angoissé. Quelque part entre ces deux temporalités, Souveraine comme l’amour devient une exhalation, qu’il s’agisse d’un dernier souffle ou d’un soupir de nostalgie, le corolaire de la première exclamation de stupeur et d’émerveillement poussée il y a cinquante ans par les nombreux visiteurs d’Expo 67. Note
1 Il n’était pas possible d’effectuer d’enregistrement sonore pendant le vol du drone en raison du bruit produit par l’engin lui-même. Les enregistrements sonores sur le terrain ont par conséquent été effectués indépendamment du tournage. Certains événements sonores importants (par exemple, le bruit de cascades ou le son caractéristique d’une faucardeuse) ont aussi été ajoutés en post-production par Moffat.
38
DAV I D K . R O S S
Le Chemin de l’énigme Marie-Claire Blais et Pascal Grandmaison
Un vertige nous habite devant l’absence de témoins matériels d’Expo 67. Une impression qui nous incite à scruter attentivement le site de l’Exposition universelle à la recherche d’indices révélateurs de son passé – à l’image d’une archéologie matérielle inspirée de Walter Benjamin, philosophe allemand, qui recherche dans la matière les débris et les laissés-pour-compte, les traces d’une histoire ancienne qui émanerait jusqu’à nous. Pour tenter d’en cerner l’ampleur, nous nous sommes intéressés à la genèse du site d’Expo 67, aux phénomènes d’apparition et d’effacement qui l’ont façonné, nous concentrant sur les nombreux déplacements de matières qui expliquent la morphologie actuelle des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. La transformation radicale de la forme de l’île Sainte-Hélène, la dissolution de sa configuration ancienne et sa vacuité actuelle, nous sont apparues comme étant révélatrices des idéaux véhiculés lors d’Expo 67. Ces voies contradictoires qui font toujours écho à notre perception du progrès, nous y avons plongé notre regard. L’apparition de l’île Sainte-Hélène à la surface du fleuve Saint-Laurent procède d’une lente accumulation de matières calcaires. Des sédiments transportés par les courants du fleuve au fil du temps. Une histoire géologique qui subit une altération dramatique lors de sa consécration comme site réceptacle des visions futuristes de l’an 1967. L’agrandissement de l’île débuta par la construction d’une digue sur la limite externe des anciennes formations de glaces, accumulées sur la berge par les lignes du courant. Cet endiguement rocheux qui enserre l’ancien rivage de l’île, le détachant en majeure partie de son lien d’origine avec le fleuve, est une trace importante de la fondation d’Expo 67 : la ceinture des utopies d’alors. Se retrouvent dans cet enrochement les restes matériels de deux petites îles (Ronde et aux Fraises) qui ont été creusées pour être intégrées à cette barrière maritime, en plus du roc extrait lors de la construction du métro de Montréal et de la création du chenal de la voie maritime du Saint-Laurent.
Marie-Claire Blais et Pascal Grandmaison, Le Chemin de l’énigme, 2017, arrêt sur image. Ci-contre Marie-Claire Blais et Pascal Grandmaison, Le Chemin de l’énigme, 2017, projection vidéographique.
Entre elle et l’ancienne rive naturelle dissimulée par les aménagements se trouve cette plateforme événementielle, faite de stationnements, d’usages vacants et éphémères. Une optimisation moderne de l’espace et une nature humanisée où s’accumulent, sur la rive, des déchets de notre civilisation, des débris de béton, des morceaux de trottoirs, des bornes de stationnement et des pierres taillées, entre autres. Cette artificialisation de l’île révèle conceptuellement la mécanique de la modernité : l’effacement du passé et son remaniement dans un geste d’apparition contrôlé. Une séquence temporelle d’enchevêtrements de pleins et de vides que nous avons transposés par le jeu d’une succession de déplacements de matières : d’additions et d’extractions. Face au fleuve, sur cette ligne de front, un personnage arpente la rive. Il fouille, cherche, creuse, empile, mime les mouvements de remblais et de déblais de la matière d’Expo 67. Une action performative et son contraire, transposée dans le montage des séquences filmées. Une caméra vive le suit de près, retrace ses mouvements, les constructions de pierres qu’il tente de créer. Elle nous montre le personnage en mouvement et, de façon plus abstraite et picturale, le produit de ses actions. La réciprocité du dialogue entre la spontanéité du geste et la nervosité du cadrage crée un sentiment d’urgence. La quête d’une réponse sur une fondation instable.
41
Le Chemin de l’énigme
Marie-Claire Blais et Pascal Grandmaison, Le Chemin de l’énigme, 2017, arrêts sur image.
« Il ne suffit pas que tout commence, il faut que tout se répète, une fois achevés les cycles des combinaisons possibles1. » Note
1 Gilles Deleuze, « Causes et raisons des îles désertes » dans L’île déserte et autres textes (1953-1974), sous la direction de David Lapoujade, Paris, Éditions de Minuit, 2002.
42
M A R I E - C L A I R E B L A I S E T PA S C A L G R A N D M A I S O N
Un jour, One Day Cheryl Sim
Mes parents se sont mariés à Hamilton, en Ontario, le 2 septembre 1967. Au cours de leur lune de miel, ils ont visité Expo 67. Les photographies prises par mon père pendant leur voyage ainsi que des cartes postales, des cartes de mariage et d’autres documents éphémères ont par la suite été soigneusement assemblés dans un albumsouvenir. Le visage de ma mère reflète l’espoir, la promesse et l’optimisme qui se dégageaient de Montréal durant Expo 67. Ce livre est un témoignage précieux qui jouit d’un statut mythique, car il rend hommage à une époque antérieure à ma naissance et à celle de ma sœur – une époque d’innocence et d’enthousiasme face à l’avenir. Il est une composante centrale de l’œuvre et un intermédiaire par lequel le personnage de la vidéo communie avec le site d’Expo 67. Alors que je me demandais comment la musique avait servi à promouvoir Expo 67, je suis tombée sur sa chanson thème officielle Un jour, un jour, écrite en français et en anglais par Stéphane Venne. Elle avait été sélectionnée parmi plus de 2 200 propositions provenant de trente-quatre pays, dans le cadre d’un concours organisé par la Compagnie d’Expo 67 et Jacqueline Vézina, directrice de ce qui allait devenir le Gala de l’adisq. Venne s’est inspiré d’une représentation graphique de l’Expo, parue dans La Presse en 1966. Il y a vu « les îles, l’eau, les couleurs, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la ville. Les formes, le rêve, l’avenir1. » J’ai choisi pour ce projet de reprendre la version française de sa chanson, car la signification des paroles et la sonorité des mots correspondaient bien à l’atmosphère que je cherchais. La stratégie discursive d’Expo 67, axée sur les notions de « futur » et de « modernité », a influencé la méthode de production : la musique est générée à l’aide de moyens numériques et analogiques, et révèle une esthétique électronique. Cependant, contrairement à la production exubérante et entièrement orchestrée de la chanson originale qui reflétait l’esprit de l’époque, la présente version invite à la réflexion et au questionnement. Le genre et la mode constituent également des vecteurs intéressants pour examiner le discours d’Expo 67. Dans son essai « Girl Watching at Expo 67 », Aurora Wallace
explique que l’Exposition universelle présentait « une nouvelle forme de cosmopolitisme, symbolisée en grande partie par son icône la plus visible, l’hôtesse de l’Expo ». Une recherche nationale a été menée pour trouver des femmes qui incarneraient les valeurs de « modernité, de distinction et de démocratie2 ». Ces femmes ont été engagées pour jouer un rôle complexe et servir à la fois de diplomates, de guides et de beautés de service. À l’époque, le débat sur l’inégalité entre les sexes était encore à ses débuts, et être hôtesse d’Expo 67 constituait un moyen socialement acceptable pour les femmes de transcender l’état de subordination dans lequel elles se trouvaient, sous réserve qu’elles répondent aux critères. En ce sens, les femmes étaient instrumentalisées en tant que « pouvoir discret » par une société hétérosexiste3. L’uniforme officiel des hôtesses jouait également un rôle essentiel, leur conférant autorité et charme par son style. Invité par le maire Jean Drapeau à habiller les hôtesses, le designer montréalais Michel Robichaud a créé pour ces dernières un ensemble conforme aux tendances de la mode urbaine des années 1960, bien que le bonnet tricolore, conçu pour qu’elles soient facilement repérables dans la foule, avait surtout une fonction pratique. J’ai cherché dans le cadre de ce projet à établir un dialogue entre l’uniforme veste-jupe et une autre tenue iconique du futur qui était à la mode à l’époque : la combinaison-pantalon. À l’origine, ce vêtement fonctionnel tout d’une pièce était porté par les parachutistes, puis adopté par les pilotes automobiles, les mécaniciens
Ci-contre et ici Cheryl Sim, Un jour, One Day, 2017, installation vidéographique à trois canaux.
et enfin les femmes qui sont entrées sur le marché du travail durant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1960, la combinaison-pantalon est devenue un vêtement fétiche des designers, parallèlement à une nouvelle obsession de l’Occident – l’espace. Elle allait bientôt s’imposer dans les médias comme le vêtement du futur par excellence. Imprégnée de valeurs utopistes, elle constituera un grand facteur d’égalisation, transcendant le sexe, la race et la classe sociale. Mon adaptation de l’uniforme original d’Expo 67 joue sur cette spéculation rétro-populaire entourant le « vêtement du futur » et sur sa relation à l’idéalisme des années 1960. Le processus de création de cette œuvre sur Expo 67 m’a permis de réfléchir à la façon dont le passé, le présent et le futur pouvaient se chevaucher, et m’a amenée à contempler la notion de progrès. Adoptant un point de vue critique, féministe et à contre-courant de la situation actuelle dans le monde, je me suis demandé : quel chemin avons-nous réellement parcouru en tant que société? Qu’avons-nous appris?
45
Un jour, One Day
Hôtesses d’Expo 67, 1965. Fonds de la Compagnie canadienne de l’Exposition universelle de 1967, Bibliothèque et Archives Canada / e000990867. Photographe inconnu.
La dynamique du pouvoir dans notre ville et le rôle que nous y jouons ont-ils évolué au cours des cinquante dernières années? Quelle importance la promotion de l’identité nationale revêt-elle au Canada? La chanson Un jour, un jour reflète l’optimisme débordant qui régnait à l’époque d’Expo 67. Aujourd’hui, toutefois, elle rend compte de la profonde nécessité de garder espoir. Un jour… Notes
1 Voir Michele Richard, « The Story behind the Expo 67 Theme Song », Expo Lounge, 4 août 2012, http://expolounge.blogspot.ca/search?q=un+jour+un+jour. 2 Aurora Wallace, « Girl Watching at Expo 67 », dans Rhona Richman Kenneally et Johanne Sloan (dir.), Expo 67: Not Just a Souvenir, Toronto, University of Toronto Press, 2010, 14. 3 Ibid.
46
C H E RY L S I M
Trophées (Montréal, 1967-2017) Simon Boudvin
Quand les lumières s’éteignent, quand la foule s’est retirée des pavillons et des avenues, une Exposition universelle commence une vie nouvelle, moins éclatante, mais plus profonde, dans l’esprit de ceux qui l’ont visitée, dans la légende des nouvelles générations.1 Il faut que l’habitant, le passant, le citadin, chaque fois qu’il circule dans les agglomérations, baigne dans un climat qui suscite chez lui un bien spécifique, provoqué par la présence massive de produits esthétiques dans cet environnement. Il faut que chaque ensemble bâti, structuré, organisé, programmé au service de l’homme, soit générateur de sensations esthétiques. […] Il y aura des ensembles fixes, lieux destinés à être à la fois des signaux vivants, permanents, et des distributeurs de produits esthétiques à l’échelle monumentale. Ce seront des réalisations du type « tour-lumière cybernétique » ayant une tendance très nette à produire des effets dépassant largement l’objet.2
Le totem du 999 boulevard Robert-Bourassa est une structure en acier et aluminium, toute en hauteur. Creux, évidé comme un pylône, son corps est constitué de cinq perches verticales, en acier galvanisé, solidement ancrées dans le sol. Leur longueur diffère dans un ordre croissant et crée une dynamique qui guide l’élévation de la figure. Cinq, soit une à l’arrière, deux sur les côtés, deux à l’avant. À la différence de la colonne, le mât totémique est orienté. Il possède une face avant, une face arrière. Les deux tubes avant supportent la façade, un vitrail aux teintes mauves, divisé en trois cadres. Un motif de sept disques bleu clair est réparti dans les châssis, trois, trois, puis un au sommet. Leur taille varie sensiblement. Appuyés sur le fond de la structure, deux grands miroirs reflètent la lumière contre, à travers, les vitres colorées. Enfin, les seuls éléments horizontaux qui relient l’ensemble (les perches, les miroirs, les vitraux) sont des anneaux en aluminium, au nombre de six, librement basculés. Ces inclinaisons causent un joyeux chaos dans la construction sinon très régulière.
Simon Boudvin, Trophées (Montréal 1967-2017), 2017, vue d’installation. Ci-contre et pages suivantes Simon Boudvin, Trophées (Montréal 1967-2017), 2017, impressions à jet d’encre.
La sculpture ne repose pas sur un socle. Sa fondation est enterrée. Cependant, ses parties s’assemblent depuis une hauteur d’un petit mètre, et laissent voir de sa base cinq jambes nues. Les matériaux utilisés, pérennes, font appel autant au catalogue actuel des ingénieurs qu’à la palette classique des beaux-arts. Concilier arts et techniques, traditions et innovations, reste l’apanage des auteurs post-modernes. Au premier regard, les formes abstraites composent une cosmogonie autonome. Les cercles bleus des vitraux évoquent des planètes dont les anneaux métalliques seraient les révolutions. Ou encore, l’ensemble retrace le modèle grossi d’une fraction d’adn. Mais le dispositif reste ouvert sur le monde. Par ses transparences, ses reflets, il vise à capter et émettre ondes et lumières. Ses dimensions enfin, comprises entre celles des objets et celles des édifices environnants, répondent à un contexte urbain. En retour, la ville voit dans la sculpture un agrément esthétique et l’arbore comme un bijou.
48
S I M O N B O U DVI N
De même que le délire de Coney Island s’est propagé dans la grille de Manhattan, le « spectacle du siècle » se diffuse dans les quartiers de Montréal. Dans les rues, des éléments sculpturaux se détachent. Détails d’architecture, statuaire publique, équipements techniques paraissent appartenir à une même catégorie de monuments, empruntant les mêmes matériaux, le même langage. L’héritage d’Expo 67 se retrouve dans le spectacle continu des festivités, mais aussi fossilisé dans ces totems urbains, au volume et à la géométrie finement dessinés au catafalque des innovations technologiques gratuites et ostentatoires. Apparu depuis l’ère de l’aluminium, cet inventaire de sculptures néo-cinétiques de parvis de banque, d’auvents de gratte-ciel, de gaines techniques colossales, de lampadaires design, bouquets high-tech d’une sophistication fantasmagorique défraîchie, pantomimes de tôles fraisées, ajourées, illuminées de petites diodes électroluminescentes; dans cette collection qui constitue un nouveau genre de répertoire des arts décoratifs de l’architecture montréalaise. Notes
1 Pierre Dupuy, commissaire général d’Expo 67, préface, Expo 67, L’Album-mémorial, Toronto, Thomas Nelson and Sons, 1968, 7. 2 Nicolas Schöffer, La Ville cybernétique, Paris, Éditions Tchou, 1969, 83.
51
Trophées (Montréal, 1967-2017)
Until Finally O Became Just a Dot (Jusqu’à ce que le O devienne un point) Charles Stankievech
Le pavillon des États-Unis d’Amérique à Expo 67 – reconnu pour son architecture sphérique conçue par Buckminster Fuller – est le dôme géodésique le plus célèbre du monde et un symbole durable des rêves utopiques des années 1960. Le principe d’ingénierie fondamentalement novateur du bâtiment est l’équilibre des forces en tension et compression permettant de créer un réseau robuste qui se traduit par une structure forte, mais légère. Ce jeu de vecteurs contradictoires n’est pas seulement un principe de construction, il sert également de cadre à l’exposition présentée dans le dôme. Dans cet espace unique figuraient deux idéologies antinomiques : d’une part les missions spatiales d’Apollo en tant que symbole de la guerre culturelle américaine qui divisait le monde au point fort de la guerre froide, d’autre part le mouvement environnemental naissant épousé par Fuller avec son « vaisseau spatial Terre ». Alors que l’héritage de Fuller gravite aujourd’hui autour de sa conception optimiste d’un monde vert et égalitaire, Until Finally O Became Just a Dot envisage son pavillon comme le moment fort de sa production techno-utopienne empêtrée dans la logistique militaire de l’impérialisme américain. Le projet comprend deux composantes : au Musée, une constellation d’artéfacts, de documents et de contenu médiatique exposés dans un présentoir créé sur mesure d’après le brevet de structure spatiale de Fuller et imprimé en trois dimensions; sur les lieux du pavillon original, l’électrification de la structure de 76 mètres de diamètre du dôme géodésique de manière à transformer son architecture sphérique en une gigantesque antenne radio diffusant des archives sonores.
Ci-contre et page suivante Charles Stankievech, Until Finally O Became Just a Dot, 2017. Vue d’installation.
Installation au Musée Les pièces présentées au Musée suivent un axe historique articulé en neuf modules : 1 Brevets 2 Réseau avancé d’alerte 3 La face cachée d’Apollo 4 Bulles 5 Les galaxies de McLuhan 6 Nordicité, ou une Idée du Nord 7 Un jeu mondial 8 Les communautés de demain 9 Espace intérieur/Espace cosmique
Brevets 1 Buckminster Fuller 4D Tower, œuvre murale, 1927-1928 2 Alexander Graham Bell Dome #5, photographie, 1909 3 Zeiss Zeiss Planetarium Construction and Dome, Patent, images tirées d’un livre, 1922-1925 4 United States Marine Corps A Study of Logistical Shelters, imprimé, 1954-1955 5 Buckminster Fuller Architecture out of the Laboratory in University of Michigan Student Publication, imprimé, 1955 6 Alexander Graham Bell Aerial Vehicle or Other Structure, Patent # 770,626, imprimé, 1902-1904 7 Buckminster Fuller Cartography, Patent # 2, 393,676, imprimé, 1944-1946 8 Buckminster Fuller Building Construction, Patent # 2, 682,235, imprimé, 1951-1954 55
Until Finally O Became Just a Dot
9 Buckminster Fuller Octet Truss, Patent # 2, 986,241, imprimé, 1956-1961 10 Shoji Sadao et R. Buckminster Fuller Hexa-Pent, Patent # 3, 810,336, livre, 1970-1983
Réseau d’alerte avancé 11 Queen’s University Press Relative Danger during an Air Raid, imprimé, vers 1940 12 International Business Machines (ibm) 5081 Punch Card from usfa Base Thule, vers 1960 13 mit Lincoln Laboratory et Buckminster Fuller 31ft Diameter Rigid Space-Frame Radome Prototype, 1954 14 Western Electric (Bell Systems) dew Line Story, film transféré en numérique, 28 min, 1958 15 International Business Machines (ibm) sage Computer Advertisement, film transféré en numérique, 3 min, vers 1960 16 life Here the US Fights the Coldest War, magazine 17 United States Air Force Thule Air Base, Greenland: Military Challenge Coin, objet, date inconnue 18 Aviation royale du Canada cfs Alert : Military Challenge Coin, objet, date inconnue 19 United States Air Force dew Line, Project 572, Prefab Module, Radar Unit #6, plan, 1956
La face cachée d’Apollo 20 North American Space Agency (nasa) Debrief: Apollo 8 (with Pink Floyd Piper at the Gates of Dawn Synched Soundtrack), film transféré en numérique, 27 min, 1969 21 Stewart Brand Whole Earth Catalog (Fall 1969), livre, 1969 22 Soviet Central Design Bureau of Experimental Machine Building (t skbem) Dark Side of the Moon by Luna-3 Orbitor, photographie, 1959 23 United States Air Force Whole Earth Image from Dodge Satellite, August 1967, photographie, 1967 24 North American Space Agency Whole Earth Image from ast-3 Satellite November 1967, photographie, 1967 25 Météorite (date d’impact : juin 1967, Seymchan, urss), objet, 1967 Bulles 26 Yves Klein et Werner Ruhnau Project of an Air Architecture, texte et image de livre, 1961 27 Office of the United States Commissioner General Communiqué de presse American Painting Now, imprimé, 1967 28 Harald Szeemann Science Fiction, grand format, 1967 29 Lucy Lippard 557,087 Index Cards (with N.E. Thing Co., Lawrence Weiner, R. Barthelme, Mel Bochner), imprimé, 1969
56
C H A R L E S S TA N K I E V E C H
Les galaxies de McLuhan 30 Marshall McLuhan Distant Early Warning Playing Cards, imprimé 31 Marshall McLuhan The Medium Is the Massage, livre, 1967 32 Marshall McLuhan The Medium Is the Massage, disque vinyle et pochette, 1967 33 Marshall McLuhan Letter to Buckminster Fuller: September 17, 1964, livre, 1964 Nordicité, ou une idée du Nord 34 Glenn Gould Idea of North, affiche 35 Glenn Gould Idea of North, esquisse Un jeu mondial 36 Buckminster Fuller How Little I Know, imprimé, 1966 37 Buckminster Fuller et Guy Mercier Buckminister Fuller and the World Game, imprimé, 1971 38 Buckminster Fuller et Gene Youngblood The World Game, imprimé, vers 1970 39 Buckminster Fuller Nine Chains to the Moon, extract, grand format, 1938/1974 41 Buckminster Fuller The Age of Astro-Architecture, imprimé, 1968
Les communautés de demain 41 Walt Disney Experimental Prototype Community of Tomorrow (epcot), film transféré en numérique, 25 min, 1966 42 David Jacobs An Expo Named Buckminster Fuller, imprimé, 1967 43 ussr Chamber of Commerce, Moscow Guide to the Soviet Union Pavilion, imprimé, 1967 44 Expo 67 Official Guide, livre, 1967 45 I. Kalin Survey of Building Materials, Systems, and Techniques, livre, 1967 46 Expo 67 Adult Passport, imprimé, 1967 47 Expo 67 Youth Passport, imprimé, 1967 48 Monnaie royale canadienne Canadian Centennial Medallion, objet, 1967 49 Albert Hofman Lysergic Acid Diethylamide (lsd) – 25, objet, 1938 50 Graeme Ferguson Omnimax Plans for Biosphere [Plan View], dessin, 1978 51 Graeme Ferguson Omnimax Plans for Biosphere [Cross-Section View], dessin, 1978 52 Doug Lehman American Pavilion Geodesic Dome on Fire, œuvre murale, 1976
57
Until Finally O Became Just a Dot
Espace intérieur / Espace cosmique 53 Fabio Fabiano et Michelange Panzini Solair Chair, métal et plastique, 1972 54 Charles Stankievech Geodesic Transmission [The Model], cuivre, transmetteur fm et lecteur audio, 2017
Pavillon des États-Unis d’Amérique 55 Charles Stankievech Geodesic Transmission [The American Pavilion], architecture du pavillon des États-Unis d’Expo 67, fil de cuivre, transmetteur fm et lecteur audio, 2017
Liste de lecture de transmission géodésique 56 Aricebo Radio Telescope Pulsar Recordings, 1967-1968 57 3M Normal First and Second Heart Sounds Recordings, date inconnue 58 cbc Expo 67’s Indians of Canada, 1967 59 Expo 67 Sounds of Expo, 1967 60 Marshall McLuhan The Medium Is the Massage lp, 1967 61 Glenn Gould The Idea of North, 1967 62 Karl Marx Das Capital, 1867
63 Timothy Leary Turn On, Tune In, Drop Out, 1967 64 Pink Floyd The Piper at the Gates of Dawn, 1967 65 Buckminster Fuller Everything I Know, 1975 66 Mike Nichols The Graduate: “One Word: Plastics”, 1967 67 ussr Sputnik, 1957 68 Alvin Lucier Sferics, 1967/1981 69 nasa Space Sounds Collection, vers 1970 70 Charles de Gaulle Vive le Quebec libre!, 1967 71 cbc / Marshall McLuhan Around the World, 1967
58
C H A R L E S S TA N K I E V E C H
Charles Stankievech, Geodesic Transmission [USA Pavilion], 2017, Photo : Charles Stankievech.
Greg Curnoe, Homage to the R-34, 1967-1968, détail. Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. Transfert de Transports Canada, 1998. Photo : MBAC.
L’œuvre murale de Dorval par Greg Curnoe : un commentaire critique sur Expo 67 Johanne Sloan
Expo 67 venait tout juste de se terminer en octobre, lorsque Greg Curnoe reçut la commande d’une peinture murale pour le nouveau tunnel des arrivées internationales de l’aéroport de Montréal à Dorval. La peinture monumentale de Curnoe, longue de 30 mètres, portant le titre Homage to the R-34 (1968) mais souvent citée comme la « peinture murale de l’aéroport de Dorval », représente un des premiers dirigeables ayant fait la traversée aller-retour de l’Atlantique en 1919. Les passagers de ce véhicule sont principalement des amis et des membres de la famille de Curnoe, aux côtés de quelques figures historiques, tandis que les zones de la murale comportant des textes denses et multicolores alternent entre les références historiques et contemporaines. À certains égards, cette œuvre incarnait l’esprit d’Expo 67, avec ses configurations audacieuses d’images et de textes, son exubérance pop-psychédélique propre aux années 1960, et aussi parce que la peinture de Curnoe proposait un récit traitant de rencontres internationales, tout comme l’avait fait l’Exposition universelle de Montréal. Toutefois, cette œuvre murale critiquait également la vision d’unité mondiale et d’harmonie transnationale d’Expo 67. Malgré l’attrait visuel de ses couleurs bonbon, cette œuvre traitait de la dissidence sociale, de la récurrence historique des conflits géopolitiques et des horreurs de la guerre. La peinture murale de Curnoe peut se comparer à des œuvres et à des expositions précises d’Expo 67, notamment un assemblage sculptural du pavillon de la Jeunesse, qui incarnait le mouvement Ti-Pop. En fait, Curnoe a inscrit le mot « Ti-Pop » directement sur la surface peinte de son œuvre, et j’aimerais proposer que la théorie de transformation culturelle avancée par ce mouvement québécois a inspiré l’artiste de London, Ontario, tandis qu’il défiait les contradictions de l’expérience locale par rapport à la politique mondiale et les réalités présentes comparativement aux événements historiques. On peut effectivement considérer sa peinture murale comme un hommage au phénomène Ti-Pop, avec sa fusion caractéristique de l’art et de la politique. Finalement, c’est à peine si cette œuvre de Curnoe a vu le jour, car quelques jours après son installation en mars 1968, elle a été censurée par le ministère fédéral
Greg Curnoe, Homage to the R-34, 1967-1968. Peinture-émail sur contre-plaqué et acier. Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. Transfert de Transports Canada, 1998. Photo : MBAC.
des Transports, démontée et entreposée à la Galerie nationale du Canada (aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada), où elle demeure depuis 50 ans. Cette œuvre à l’échelle monumentale a rarement fait l’objet d’études sérieuses pendant toutes ces années, et l’accent était généralement mis sur les circonstances et les débats entourant sa censure1. Le présent texte se propose de relier directement Homage to the R-34 de Curnoe et Expo 67; j’aborde cette peinture murale comme un commentaire critique sur l’Exposition universelle de Montréal, pour argumenter que l’œuvre offrait un correctif à sa rhétorique humaniste en refusant de masquer le traumatisme de la guerre et le militarisme contemporains, et parce qu’elle inclut les voix contestataires d’actrices et d’acteurs sociaux de la contreculture, nationalistes de gauche et pacifistes, vers 1967-1968. S’il est clair que le groupe d’artistes participant à l’exposition du Musée d’art contemporain de Montréal en 2017 revisitait et réinterprétait Expo 67, la peinture murale de Greg Curnoe en 1968 est pertinente en termes de généalogie, comme l’un des premiers exemples de l’élaboration, par un artiste, d’une perspective critique à propos de cet événement. Expo 67 fut un spectacle éblouissant, et une célébration positive et sans relâche de la nation canadienne et de la citoyenneté mondiale; il est toutefois important de rappeler les fractures internes et les points de friction de sa vision d’une planète unie et pacifique. Par exemple, les pavillons de l’Algérie, de Cuba et des Indiens du Canada montraient tous des signes de luttes politiques et/ou de justice sociale durement gagnée. Après 130 ans de colonisation française et à la suite d’une guerre brutale de libération qui ne s’était terminée que quelques années auparavant, l’Algérie participait pour la première fois à une Exposition universelle en tant qu’État indépendant2. Le pavillon de Cuba attirait les gens dans son restaurant animé avec de la musique et des
62
J O H A N N E S LO A N
boissons tropicales, mais sa présentation de la révolution cubaine laissait clairement entendre que le socialisme de fraîche date avait été édifié sur les ruines d’un régime capitaliste exploitant. Le pavillon des Indiens du Canada présentait de magnifiques peintures d’Alex Janvier, de Norval Morrisseau et d’autres artistes contemporains, mais de grands panneaux de textes rédigés par les organisateurs autochtones donnaient au public une éducation en termes tranchants, sur le vol des terres autochtones et l’attaque systématique de leurs cultures3. Ainsi, ces pavillons offraient des moments de friction idéologique lors d’Expo 67, un fait à considérer de façon positive, comme des enseignements sur la manière de favoriser le progrès, la paix et la justice. Fait à noter, l’Exposition universelle ne faisait pas l’unanimité parmi toute la population canadienne et québécoise. Par exemple, la revue montréalaise de gauche, Parti pris (dans laquelle ont été développés les fondements théoriques de Ti-Pop, comme nous le verrons plus loin), exprimait un point de vue critique dans ses pages; au nom de la population canadienne-française en faveur de l’émancipation collective, l’auteur de l’éditorial de l’été 1967 déclarait : « […] l’immonde mystification que représente Expo 67 est là pour ramener à notre mémoire […] toute la dépossession qui est notre lot le plus quotidien4. » Concernant plus spécifiquement les arts visuels, deux remarquables projets d’artistes montréalais présentés à Expo 67 rejoignent les préoccupations de la peinture murale de Greg Curnoe à l’aéroport de Dorval. Le pavillon Chrétien d’Expo 67 proposait Le Huitième Jour, un film expérimental de Charles Gagnon, artiste protéiforme dont la pratique incluait la peinture, la photographie, le cinéma et le design, et dont le bureau de design était en fait responsable de la conception des expositions pour l’ensemble du pavillon. Le film est un montage en mouvement rapide de
63
L’œuvre murale de Dorval par Greg Curnoe
André Montpetit et Marc-Antoine Nadeau, Le premier sous-marin atomique de la force de frappe québécoise au pavillon de la Jeunesse, Expo 67, 1967. Reproduit de : Yves Robillard, Québec Underground 1962-1972 – tome 1, Montréal, Éditions Médiart, 1973, 241.
séquences trouvées, représentant divers peuples et cultures, allant vers une violence accrue. Aucun contenu n’est ouvertement religieux – à moins de compter la séquence d’un moine bouddhiste s’immolant par le feu pour protester contre la guerre du Vietnam. Monika Kin Gagnon note que les « cycles de violence et de destruction produits par les guerres […] sont dépourvus de toute évaluation éthique, mais c’est leur accumulation et leur répétition qui devient oppressives5 ». Ainsi, Le Huitième Jour indiquait clairement que le spectre de la guerre et de la destruction planait sur le projet idéaliste, futuriste et humaniste d’Expo 67. Toutefois, une autre œuvre avait des
64
J O H A N N E S LO A N
Article d’Ellen Roseman dans le McGill Daily, 25 septembre, 1967. La photo qui accompagne l’article montre le « pavillon du Vietnam » en tant que cercueil porté par des manifestants anti-guerre.
affinités plus profondes avec la peinture murale de Curnoe : située dans le pavillon de la Jeunesse, c’était un assemblage d’André Montpetit et Marc-Antoine Nadeau, intitulé Le premier sous-marin atomique de la force de frappe québécoise6. Bien qu’il ne subsiste aucune photographie en couleurs de l’œuvre, on peut imaginer que sa couleur jaune vif faisait écho aux édifices adjacents du secteur de La Ronde. Cette œuvre est un exemple de l’esthétique Ti-Pop, parce que sa juxtaposition des éléments culturels montre bien comment la jeunesse québécoise problématisait les questions d’identité et de modernité. Cette dernière œuvre peut être comparée à la peinture murale de
65
L’œuvre murale de Dorval par Greg Curnoe
Curnoe pour plusieurs raisons, et non seulement parce que le mot « Ti-Pop » y figure, tel que mentionné ci-haut. Ces deux œuvres font référence au vocabulaire du Pop Art, mais elles ont davantage d’affinités avec les interprétations européennes et sudaméricaines de ce mouvement, qui avaient tendance à être plus ouvertement politisées que la version américaine, dont on pouvait voir quelques exemples au pavillon des États-Unis7. Et il y avait les vaisseaux eux-mêmes : Curnoe introduisait un dirigeable historique comme motif thématique central de son œuvre, tandis que l’assemblage de Montpetit et Nadeau proposait un sous-marin nucléaire moderne; les deux œuvres pratiquaient un détournement de l’usage militaire habituel des vaisseaux. On peut dire que le dirigeable et le sous-marin avaient été transformés en machines de guerre contreculturelles. L’idée de Ti-Pop fut présentée, théorisée et célébrée dans les pages de Parti pris, une publication extrêmement importante malgré sa courte durée (1963-1968), et dont le but avoué était d’accélérer la transition d’une identité canadienne-française historiquement figée et conservatrice, vers un nouveau Québec indépendant, socialiste et laïc. Parallèlement à l’analyse des idéologies, du discours politique et des structures économiques, la revue s’investissait à fonds dans les arts (littérature, théâtre, musique, arts visuels), reconnaissant que ce changement historique capital devait exploiter l’imagination, le désir et la mémoire culturelle. Selon l’explication de Pierre Maheu : « […] une nouvelle civilisation crée un art, une conscience, un style. Prendre l’attitude tipopiste, c’est assumer consciemment ce processus, et tenter de s’en servir. Faire du Canada français traditionnel un objet esthétique, faire de son effouèrement la structure même de l’œuvre d’art8. » Ti-Pop est donc compris comme un moyen de définir sa relation au passé : une identité résolument moderne, émancipée, ne saurait être le fruit d’un rejet ou d’une destruction complète de la culture canadienne-française traditionnelle, religieuse et bornée, même si ces valeurs devaient être renversées. Ti-Pop proposait plutôt que les artistes pouvaient récupérer ces fragments historiques et les soumettre à un process de transmutation culturelle – en leur donnant un traitement au Pop Art. Plusieurs personnes s’employèrent à définir et à défendre l’idée de Ti-Pop. Ce fut notamment le cas de Pierre Théberge, un jeune conservateur au Musée des beaux-arts du Canada, qui était un fervent défenseur et ami de Greg Curnoe. C’est cependant Maheu qui, dans une série d’articles rédigés pour Parti pris vers 1964-1965, a le plus contribué à définir Ti-Pop comme une théorie sophistiquée de transmission culturelle et de changement historique. Le préfixe « ti » est employé couramment en français québécois familier comme diminutif plaisantin du mot « petit ». Maheu a écrit : « Qu’est-ce donc que ti-pop? Eh bien, le TI, c’est le Québec, comme dans “Chez TiJean Snack Bar” […] ou […] dans “Allo, ti-cul”. Et le pop, c’est si on veut le Pop Art. Mais il ne s’agit pas spécialement d’art9. » Cette présence de deux éléments distincts,
66
J O H A N N E S LO A N
à la fois liés et séparés par le trait d’union, est essentielle : Ti-Pop provoque une rencontre – ou plutôt une collision, un choc – entre la culture canadienne-française traditionnelle et la culture pop contemporaine, à l’américaine. De cette rencontre allait émerger une nouvelle identité québécoise. L’auteur Claude de Guise a écrit (également dans les pages de Parti pris) que « Ti-Pop c’est la course chez les antiquaires – crucifix, médailles, images saintes…10 », suggérant par là que cet attirail catholique n’avait plus de présence signifiante dans le quotidien des Canadiens français, ayant plutôt été relégué au passé, aux « antiquaires ». L’Église catholique était tellement critiquée par la génération des années 1960 parce qu’elle maintenait depuis longtemps une barrière entre les Canadiens français et le monde – en censurant à la fois la culture d’élite et la culture populaire, que ce soit en interrompant la diffusion d’une interview avec la féministe française Simone de Beauvoir, ou en interdisant le jazz et les films d’Hollywood. Qui plus est, Ti-Pop visait non seulement l’iconographie religieuse, mais aussi les traces persistantes du règne du démagogue de droite Maurice Duplessis, les images folkloriques ou stéréotypées, ou encore le joual, le français parlé au quotidien et largement associé à la classe ouvrière. Ce choc culturel était tout à fait visible dans l’assemblage de Montpetit et Nadeau exposé au pavillon de la Jeunesse. Sur le plan matériel, le « sous-marin atomique » en question était en réalité un kayak peint en jaune, mais tous les jeunes qui entraient au pavillon de la Jeunesse à l’été 1967 savaient que « Yellow Submarine » des Beatles avait été en tête du palmarès l’année précédente. Ce sous-marin composite, avec son périscope fait maison et son siège de toilette en guise de couvercle pour le sas d’accès, arborait des chapelets et un décret papal; les personnages d’une pietà en plâtre étaient disposés comme pour manœuvrer l’arme du sous-marin. L’œuvre fut temporairement retirée et altérée, c’est-à-dire dépouillée de ses objets religieux, jugés blasphématoires par quelqu’un. Montpetit, dans le rôle du « capitaine » du sous-marin, a publié un compte rendu satirique de cet acte de censure dans le premier numéro de Logos, le premier véritable magazine contreculturel de Montréal. « Notre vaisseau a été visité par des brigands qui, nous dit-on, parcourent les îles déguisés en membres de la milice11. » L’article est illustré d’une des deux seules photographies (en noir et blanc) existantes de l’œuvre, soit celle qui témoigne de la censure. La logique Ti-Pop de l’œuvre était exemplaire : la « force de frappe » allégorique du sous-marin allait naître de la fusion de divers types de pouvoir : l’ancien pouvoir religieux serait détourné, le terrifiant pouvoir atomique serait neutralisé, et le pouvoir explosif de la culture pop serait canalisé … pour donner précisément la sorte de carburant nécessaire à la propulsion du vaisseau, avec à son bord la jeunesse québécoise12. Le titre confirme aussi que le sous-marin mettait le cap sur l’avenir : l’emploi en 1967 du mot « québécois » désignait une condition culturelle future.
67
L’œuvre murale de Dorval par Greg Curnoe
Montpetit et Nadeau faisaient partie de cette génération du Québec qui a commencé à s’organiser collectivement pour atteindre ses objectifs artistiques et sociaux. Ils étaient effectivement affiliés à trois groupes montréalais importants : le collectif d’artistes Fusion des arts, chargé de la présentation des principales œuvres au pavillon de la Jeunesse; l’Atelier libre de recherches graphiques, un lieu de premier plan pour la production d’affiches, de lithographies et d’autres formes d’imprimés reproductibles, inauguré en 1964; enfin, peu après Expo 67, ils allaient joindre l’artiste Michel Fortier et le poète Claude Haeffely pour former le groupe mythique de bédéistes du Chiendent13. Si l’on envisage leur sous-marin jaune dans le contexte de toutes ces initiatives, il apparaît clairement que ces créateurs étaient engagés dans une forme de libération artistique, personnelle et libidinale autant que politique, c’est-à-dire envers une politique autant locale qu’internationale. Autrement dit, ils s’inscrivaient dans la contreculture. Jean-Philippe Warren et Andrée Fortin ont bien démontré que la contreculture et l’idéalisme nationaliste québécois sont deux élans culturels profondément interreliés. « Dans les années 1960 et 1970, la volonté d’être maîtres chez soi, de décoloniser les consciences, de s’émanciper des vieux carcans institutionnels, de vivre une révolution culturelle, de s’ouvrir au monde ou de contester les pouvoirs établis se niche aussi bien dans le discours des partisans de la contreculture que dans celui des militants nationalistes14. » La contreculture des années 1960 invitait les personnes (de Montréal, de London, ou d’ailleurs) à joindre un réseau planétaire éclaté, permettant le partage d’idées, de valeurs, de styles de vie, de musiques, de modes, d’images, etc. Si les membres de la contreculture étaient parfois allumés ou déconnectés dans leur bulle psychédélique, ils pouvaient également être conscients sur le plan politique et mondial, avec les deux pieds sur terre – et même littéralement, lorsque les jeunes du monde entier ont marché dans les rues à l’occasion de manifestations contre la guerre du Vietnam. Il est difficile de surestimer le profond dégoût exprimé par cette génération face à la guerre; si les guerres du début du XXe siècle pouvaient paraître justifiables et justes, la guerre du Vietnam était moralement corrompue et indéfendable (à la fin de 1967, 500 000 soldats américains avaient été envoyés dans ce petit pays d’Asie du Sud-Est, les civils vietnamiens mouraient en grand nombre et l’arsenal américain comprenait l’arme chimique appelée napalm). Des protestations contre la guerre ont effectivement eu lieu à Montréal et à Expo 67, notamment lors de Journée de la Jeunesse officielle lorsque les célébrations prévues au pavillon de la Jeunesse se sont transformées en une véritable manifestation anti-guerre15. Coïncidant avec les cérémonies d’ouverture de l’Exposition universelle le 28 avril, le Living Theatre of Montreal organisait une marche du centre-ville jusqu’au site d’Expo 67, portant des affiches comme « L’Homme le destructeur » (ironisant sur les pavillons thématiques d’Expo 67, tel L’Homme interroge l’Univers) et un pavillon du Vietnam en miniature
68
J O H A N N E S LO A N
André Montpetit, Le Chien américain, 1967, affiche, sérigraphie sur papier. La Guilde Graphique.
(bâtiment absent d’Expo 67) orné de photographies troublantes de corps mutilés, dans ce pays déchiré par la guerre16. Ce pavillon fictif devait être déposé devant le pavillon des États-Unis17. On peut considérer que cette manifestation performative fait partie de l’histoire non officielle d’Expo 67. L’année d’Expo 67, André Montpetit, lui-même un artiste remarquable, produisait l’affiche Le Chien américain, prenant la forme d’une bande dessinée en neuf cases18. Le chien patriotique en question est blanc, il est respectueux des lois, et même s’il perd des membres après avoir été envoyé au Vietnam, selon la dernière case,
69
L’œuvre murale de Dorval par Greg Curnoe
« Il est fier d’être Américain ». Fait à remarquer, cette affiche fait partie d’une série d’affiches politiques distribuées gratuitement, produites par Montpetit et Richard Lacroix en 1967 à l’Atelier libre de recherches graphiques, pour attirer l’attention sur le potentiel inexploité de l’affiche19. Si l’on revient aux connotations du « sous-marin atomique » créé par les artistes, il importe de noter qu’on présentait des sous-marins nucléaires au pavillon L’Homme et les Régions polaires, comme « outil par excellence de polarisation du Nord par la Guerre Froide », tel que l’a fait remarquer Inderbir Riar20. On savait d’ailleurs que des sous-marins comparables étaient déployés au Vietnam, au même moment. Il est clair que l’œuvre de Montpetit et Nadeau prenait position contre la répression imposée par l’Église au Québec, mais qu’elle s’opposait également à l’impérialisme et au patriotisme militariste. Pendant ce temps, à London, vers 1967 : Greg Curnoe s’inscrivait dans un milieu de l’art local, qu’il avait grandement contribué à former, et il se consacrait, par le biais de son art, à représenter son environnement quotidien et à faire référence à des expériences immédiates, concrètes et domestiques. D’une certaine manière, lui et ses pendants Ti-Pop à Montréal faisaient partie d’une « néo-avant-garde » ayant émergé au cours des années 1960, résolue à revitaliser l’un des impératifs les plus fondamentaux de l’avant-garde, soit extraire l’art et l’expérience esthétique d’un monde à part, et les inscrire plutôt dans la vie quotidienne. D’autres artistes du Canada anglais faisaient du travail comparable; par exemple, N. E. Thing Co. à Vancouver et Joyce Wieland à Toronto exploraient le quotidien à leur manière tout en tirant des aspects du Pop Art. L’intérêt de Curnoe pour une tension productive entre l’identité locale, la mémoire historique et la politique mondiale rend son projet artistique comparable à celui des artistes Ti-Pop, étant attiré lui aussi par la culture pop, le folklore et le kitsch. Il faut dire que la peinture murale de Curnoe comprend deux extraits de la chanson Toujours L’R-100, interprétée par la vedette canadienne-française La Bolduc, concernant un autre dirigeable qui était venu atterrir au Québec en 1930; les paroles de cette chanson emploient avec humour le préfixe « Ti ». Ces paroles avaient été transcrites pour Curnoe par son amie montréalaise Mitsu Daudelin, dont le nom figure dans la peinture murale; elle-même artiste de l’estampe, elle avait travaillé à l’Atelier libre de recherches graphiques aux côtés de Montpetit et Nadeau21. Bien entendu, les Tipopistes du Québec étaient gagnés par la fièvre révolutionnaire du « projet national », tandis que Curnoe n’était pas nationaliste sous une forme ou l’autre, mais comme ses homologues québécois, il se comportait en citoyen du monde enraciné localement, et tous contribuaient à un élan jeune, contreculturel et sincèrement utopique, qui se répercutait partout dans le monde occidental. Si Curnoe est souvent décrit comme un régionaliste, il est fascinant de voir comment les préoccupations locales et personnelles sont amalgamées avec une conscience de la politique internationale dans Homage to the R-34. (Cette ambition n’est pas
70
J O H A N N E S LO A N
seulement présente dans l’œuvre de Dorval : l’exposition Peinture au Canada, présentée au pavillon du Canada, comprenait la peinture For Ben Bella (1965) de Curnoe, dédiée au président socialiste de l’Algérie, Ahmed Ben Bella, tout en incluant différentes références personnelles.) Homage to the R-34, peinte sur vingt-six panneaux assemblés sur place, représente deux nacelles de dirigeables; les personnes, les lieux et les événements cités dans l’œuvre sont diversifiés. Parmi les passagers, on retrouve des figures historiques telles que les deux pilotes de dirigeables de la Première Guerre mondiale – un Allemand et un Britannique -, le héros métis Louis Riel et plusieurs amis de l’artiste avec leurs enfants. Les lieux nommés directement ou suggérés sont : Montréal, Saint-Hubert, Ottawa, les États-Unis, l’Allemagne, la Grèce, le Vietnam, Londres et London en Ontario. On peut se demander où est situé ce dirigeable : il plane métaphoriquement au-dessus de tous ces lieux, quoique la rencontre de Londres et de London est particulièrement importante, puisque Curnoe et ses amis (dont ses collègues artistes Jack Chambers, Robert Fones et Tony Urquhart) habitent la ville provinciale de London au milieu du siècle, tandis qu’un conflit militaire se déroule dans le ciel de la métropole de Londres cinquante ans plus tôt, durant la Première Guerre mondiale. Le texte le plus troublant de l’œuvre de Curnoe est un témoignage épouvantable au sujet d’une bombe allemande larguée sur une école de Londres en 1917, tuant ou mutilant des enfants. Il est fait allusion à deux autres guerres, avec une description d’un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale en Grèce, et l’évocation de la guerre du Vietnam dans un extrait tiré du journal anarchiste britannique Freedom, rapportant le refus du boxeur afro-américain Mohamed Ali de s’enrôler dans l’armée américaine22. Ali avait défendu sa décision avec éloquence, disant qu’il ne voulait tuer personne et faisant remarquer que les Vietnamiens étaient aussi des personnes de couleur, qu’ils ne l’avaient jamais maltraité ni offensé. Dépouillé de son titre et empêché de pratiquer son sport, à l’époque de la création et de l’installation de la murale de Curnoe (1967-1968), Ali voyageait d’un campus universitaire à l’autre, partout aux États-Unis, invité comme conférencier par des groupes d’étudiants pacifistes. Le fragment de texte d’Ali fut une source importante de litige dans le processus de censure, et les autorités fédérales tentèrent de convaincre Curnoe de « remplacer ces phrases par des textes plus réjouissants, en accord avec le design gai et coloré23 ». L’œuvre présente également une silhouette d’homme en pied, dont la main ensanglantée est prise dans une des hélices de l’aéronef. Bien que Curnoe ait identifié ce personnage comme étant son concitoyen Jack Kelly, il est apparu que cet homme ressemblait au président américain de l’époque, Lyndon Johnson. Il est significatif que Curnoe ait peint jusqu’à cinq enfants dans son œuvre et qu’ils soient tous nommés. Son fils Owen arbore un grand sourire et se tient dans la cabine du vaisseau, aux côtés du pilote allemand Mathy qui étend le bras pour entourer le garçon dans un élan protecteur. Eva-Marie Kroller a commenté le rôle
71
L’œuvre murale de Dorval par Greg Curnoe
important joué par les enfants dans l’expression de la position pacifiste de Curnoe : « L’image de l’enfant est profondément ambiguë, voire sinistre, dans un tel environnement, car il peut être à la fois le vengeur des erreurs de ses parents, un futur participant à des raids similaires, et la projection des peurs de son père24. » Curnoe disait : « J’ai soudainement réalisé que j’avais placé mon propre fils dans la cabine de pilotage […] Chaque pays a ses héros […] mais ces héros sont obligés de tuer, et c’est une mauvaise chose. J’ai essayé de traduire mon opposition à la violence. Je déteste tuer des gens. Qui est contre cela25? » Par la juxtaposition de références à la guerre et d’images d’enfants innocents, l’œuvre semble interroger le public : comment vous imaginez-vous, comment nous imaginons-nous? Comme les pilotes victorieux des machines militaires qui ont largué les bombes, ou comme les malheureuses victimes au sol? S’agit-il vraiment des seuls choix à notre disposition? Curnoe était certainement conscient que le gouvernement canadien allait contester la position politique plurivoque de sa peinture murale. Son ami George Bowering raconte qu’au moment même de la censure de l’œuvre, « Greg réussit à me persuader au sujet du véritable rapport entre Washington et Ottawa26 ». Le statut de l’œuvre de Dorval en tant que Pop Art fut tenu pour acquis à l’époque; en effet, le contrat entre Curnoe et le ministère fédéral des Transports mentionnait la « production et installation de Pop Art représentant les nacelles d’un dirigeable27 ». Curnoe ne s’identifiait pas toujours comme artiste Pop, mais il avait beaucoup en commun avec la génération d’artistes qui empruntaient le langage pictural de la publicité, des panneaux réclames, des bandes dessinées, des films d’Hollywood et d’autres aspects de la culture pop28. Tout porte à croire que Homage to the R-34 s’inspirait au moins en partie de la peinture monumentale de James Rosenquist intitulée F-111 (1965); Curnoe s’était effectivement rendu à New York en avril 1965, au moment où l’œuvre était exposée à la galerie Castelli. Le F-111 était un nouveau bombardier déployé au Vietnam par les États-Unis; dans la peinture de Rosenquist, ce motif fait partie d’une œuvre qui « allie la rhétorique visuelle du complexe militaro-industriel et le style des images publicitaires de produits de consommation29 ». Chez Curnoe, les blocs de couleurs vibrantes et de textes sont très différents de l’assemblage par Rosenquist de fragments photo-réalistes aux allures de collage, mais le Canadien a sûrement été impressionné par la capacité de l’artiste new-yorkais à produire une œuvre gigantesque, visuellement attrayante et audacieuse sur le plan graphique, qui mettait en question la glorification des machines de guerre. Il faut cependant préciser qu’à l’origine, l’œuvre de Rosenquist était présentée en sections disposées sur les murs d’une galerie d’art; elle n’avait pas été explicitement conçue comme une peinture murale destinée à occuper l’espace public. Par ailleurs, l’œuvre de Curnoe et l’assemblage de Montpetit et Nadeau peuvent se comparer aux œuvres contemporaines de Martha Rosler (É.-U.), Bernard Rancillac (France) et Erró (Islande), puisque tous ces artistes
72
J O H A N N E S LO A N
juxtaposent la gaieté de la culture pop marchandisée à de puissantes images pacifistes. Ce qui caractérise cet artiste canadien et ses collègues québécois, et qui justifie la mise en relation de Curnoe avec le Ti-Pop, plutôt que d’autres courants du Pop Art, c’est le fait que ces préoccupations esthétiques et politiques puissent être enracinées dans des lieux, des histoires, des communautés et des cadres culturels précis. Tel que suggéré, la peinture murale de Dorval s’inscrit dans de nombreux contextes spécifiques : la famille immédiate de Curnoe, la communauté élargie de London et un réseau mondial d’activité contreculturelle pacifiste et de gauche. L’œuvre s’inscrivait aussi dans le contexte montréalais, par ses références aux stratégies culturelles transformatrices des artistes québécois durant les années 1960, telles qu’incarnées par le Ti-Pop, et par son traitement réfléchi et complexe des idées et de la culture visuelle d’Expo 67. J’ai débuté ce texte en suggérant que la peinture murale de Curnoe contenait une critique du projet d’Expo 67. Le méta-récit internationaliste d’Expo 67, commun à l’ensemble des expositions universelles, caractérisé par la notion d’une communauté mondiale unifiée, interprétée en des termes entièrement positifs, comme une affirmation de valeurs et d’objectifs communs. Le slogan choisi pour Expo 67, « Terre des Hommes », renforçait ce discours universalisant. On peut dire que l’œuvre de Curnoe prolongeait vraiment ce désir de dialogue international; sa conscience contreculturelle s’étendait assurément au-delà des frontières des États-nations. Par ailleurs, l’œuvre murale contestait les fondements idéologiques de cet internationalisme : pourquoi l’Exposition universelle insistait-elle sur une vision d’harmonie planétaire, alors que la Guerre froide était bien installée, que des guerres bien réelles faisaient rage au Vietnam, au Moyen-Orient et ailleurs, qu’on testait des armes nucléaires et que se poursuivait l’exploitation coloniale ou néo-coloniale? Quelles leçons peut-on tirer de cette négation des conflits géopolitiques? L’étudiante journaliste Ellen Roseman a traité avec éloquence de ces questions lorsqu’elle a décrit les manifestations pacifistes survenues sur le site et autour d’Expo 67 pendant l’été 1967. Dans un numéro du journal McGill Daily en date de septembre 1967, elle faisait part de sa frustration face au modèle de l’Exposition universelle : « Si la Terre des Hommes n’affronte pas les forces décisives qui agissent sur le monde, au lieu de les réprimer, l’Expo ne peut et ne pourra contribuer de façon significative à la paix mondiale30. » Roseman exprime ici les rêves radicaux du mouvement contreculturel chez les jeunes, en recommandant vivement qu’Expo 67 ne « réprime » pas les conflits qui divisaient la planète, et en exigeant que l’Exposition universelle fasse de l’obtention de la « paix mondiale » son but avoué. Dans le même esprit, l’œuvre de Dorval par Curnoe insiste sur le fait que nous devons affronter les horreurs de la guerre, sinon le message d’unité mondiale d’Expo 67 n’est qu’un discours creux. Terre des hommes était le titre d’un livre de l’écrivain et pilote français Antoine de Saint-Exupéry; du haut de son avion, il vit la surface de la planète et eut une vision
73
L’œuvre murale de Dorval par Greg Curnoe
humaniste. La vision de Curnoe depuis l’aéronef est beaucoup plus sombre, car le monde qu’il décrit (un amalgame de lieux et de moments historiques) est un monde en guerre. La guerre, au XXe siècle, signifie que les machines qui sillonnent le ciel sont potentiellement dangereuses : certaines bombes de la Première Guerre mondiale sont suffisamment puissantes pour détruire une école remplie d’enfants, tandis qu’en 1967-1968, l’arme chimique du napalm jaillit des avions, au-dessus du Vietnam31. Les autorités canadiennes ont jugé que cette critique sérieuse de la guerre n’était pas appropriée pour le tunnel des arrivées internationales de l’aéroport, même si l’on peut se demander si les voyageurs qui passaient à toute allure auraient pris le temps d’en lire les textes bouleversants et multicolores. Une autre œuvre commandée pour l’aéroport, en même temps que celle de Curnoe, démontre ce qui était jugé acceptable : l’abstraction monochrome de Ronald Bloore – fait intéressant, elle contenait des traces fantomatiques d’Expo 67, avec ses formes géodésiques à la Fuller – était dénuée de toute controverse. Rétrospectivement, la murale contestataire et censurée de Curnoe semblait correspondre parfaitement à 1968, cette année de manifestations tumultueuses chez les jeunes, plutôt qu’aux plaisirs grisants associés à « l’été de l’amour » de 1967. Cette opposition entre 1967 et 1968 est trop simpliste, car il y a eu de la violence étatique contre les manifestants afro-américains dans des villes comme Newark et Detroit pendant l’été 1967, et le mouvement pacifiste a organisé d’immenses manifestations publiques durant toute l’année. La contreculture et l’activisme politique étaient très présents à Montréal, avant, pendant et après Expo 67. Dans le contexte de Montréal, nous pouvons tout de même parler d’une sorte de bilan post-Expo, car cette Exposition universelle spectaculaire allait être le déclencheur d’une réflexion sur la vie urbaine, le nationalisme, le cosmopolitisme et plusieurs autres questions, dont le rôle de la jeunesse en tant que groupe social. S’il semble que les énergies contre-culturelles de la génération des années 1960 pouvaient s’accommoder plus ou moins à Expo 67, dès 1968 les tumultueux mouvements étudiants ne pouvaient plus être contenus. Sur la scène locale, des étudiants de l’Université du Québec à Montréal occupèrent le campus de l’École des beaux-arts en 1968, et les manifestations antiracistes à l’Université Sir George Williams, en 1969 (connues sous les noms de « Sir George Williams Affair » et « Computer Riots »), organisées par des étudiants noirs, menèrent éventuellement à l’occupation des bâtiments universitaires et à une forte remise en question du pouvoir institutionnel. L’œuvre Homage to the R-34 de Curnoe ne saurait être seulement perçue comme une forme de critique négative. En effet, les vies quotidiennes, les désirs secrets et les croyances profondes des individus, inscrits dans des contextes particuliers, sont présentés comme le fondement de résistance à la succession sans fin d’images marchandisées de la culture pop, et au flot incessant de messages et de figures idéologiques. Si
74
J O H A N N E S LO A N
Expo 67 offrait des visions éblouissantes de l’architecture, des villes et des technologies du futur, chez Curnoe l’avenir est lié plus prosaïquement au groupe d’enfants qui regardent par les fenêtres du dirigeable. On pourrait aussi faire valoir que le passager Louis Riel, qui semble détonner comme figure insolite dans la structure narrative, joue un rôle crucial parce qu’il est un personnage historique, et que son rôle héroïque en tant que dirigeant autochtone appartient à un passé qui refait surface pour être racheté. Les figures en silhouette, les formes géométriques et les bandes de texte roses, orangées, bleues et violettes, sont loin d’être réalistes; ceci peut certainement être décrit comme du Pop, à cause d’une ressemblance marquée avec les bandes dessinées et la publicité, mais le coloris vif confère une touche psychédélique à l’œuvre. Les couleurs vibrantes et les formes en mouvement de la murale traduisent un excès d’énergie imaginative et libidinale, et la couleur exubérante est promesse de plaisir – si l’on décide de monter à bord. Tout comme le sous-marin jaune de Montpetit et Nadeau est devenu le vaisseau conceptuel d’un voyage imaginaire, le dirigeable fantastique de Curnoe peut changer de cap. Tel que suggéré plus tôt, Homage to the R-34 de Curnoe peut être vu comme un hommage au Ti-Pop, parce que les artistes québécois avaient démontré comment il est possible de récupérer des fragments historiques et de les faire entrer en collision avec la culture pop contemporaine, pour produire des objets culturels hybrides qui s’inscrivent dans un projet social d’émancipation. Au lieu de rester idéologiquement figés dans leur identité de machines de guerre, un sous-marin ou un dirigeable pouvaient être propulsés par des énergies contreculturelles et pacifistes, pour offrir des formes alternatives de citoyenneté mondiale et des futurs autres. Notes
1 Voir Charles Hill, « Greg Curnoe’s Homage to the R34, » National Gallery of Canada Review IV (2003), 84-99. Vu l’inaccessibilité de l’œuvre de Curnoe, l’article de Hill a été particulièrement important, de par son identification méticuleuse des personnages dans la peinture et de ses segments de textes. 2 Voir Magali Deleuze, « Le Maghreb à l’Expo 67 (Tunisie, Maroc, Algérie) », Bulletin d’histoire politique, vol. 17, n° 1 (automne 2008), 49-61. 3 Pour une analyse du pavillon, voir Myra Rutherdale et Jim Miller, « “It’s Our Country” : First Nations’ Participation in the Indian Pavilion at Expo 67 », Journal of the Canadian Historical Association, vol. 17, n° 2, 2006, 148-173. Certains journalistes et commentateurs ne semblaient pas disposés à apprendre du pavillon des Indiens du Canada, mais certains autres ont clairement perçu le message. Le critique d’art Claude Jasmin a intitulé son compte rendu sur le pavillon : « J’ai vu l’illustration d’un génocide », Sept-Jours (12 août 1967), 43. 4 Luc Racine, « Dépossession et domination », Parti pris, vol. 4, n° 9-12 (mai-août 1967), 7. 5 Monika Kin Gagnon, « The Christian Pavilion at Expo 67: Notes from Charles Gagnon’s Archive », dans Rhona Richman Kenneally et Johanne Sloan (dir.), Expo 67: Not Just a Souvenir, Toronto, University of Toronto Press, 2010, 156. 6 Certaines ambiguïtés demeurent à propos du titre, qui comporte parfois le mot « jaune ». Je me
75
L’œuvre murale de Dorval par Greg Curnoe
7 8 9 10 11 12
13 14 15
16
17
18 19 20 21
22
76
base sur le communiqué de presse des artistes, reproduit dans Yves Robillard (dir.), Québec Underground 1962-1972 – tome 1, Montréal, Éditions Médiart, 1973, 240. Voir par exemple Jessica Morgan et Flavia Frigeri (dir.), The World Goes Pop, Londres, Tate Publishing, 2015. Pierre Maheu, « Patricia et ti-pop », dans Québec Underground, tome 1, 113. Pierre Maheu, « Laïcité 1966 », Parti pris, vol. 4, n° 1 (1966), 73. Claude de Guise, « Moi j’aime le “sacré-cœur” (sic) », dans Québec Underground, tome 1, 102. André Montpetit, « Voyage into Absurdity », Logos, n° 1 (10 octobre 1967), 14. Le sous-marin jaune est devenu un symbole utilisé ailleurs comme forme de protestation : « La section pas nécessairement psychédélique de la Nouvelle gauche amorce un changement révolutionnaire quant à la nature et au style de protestation, en lançant un sous-marin jaune dans le fleuve Hudson. » Paul Krassner, « The Yellow Submarine », Ramparts (janvier 1967), 18. Voir Sylvain Lemay, Du Chiendent dans le printemps : une saison dans la bande dessinée québécoise, Montréal, Mém9ire, 2016. Jean-Philippe Warren et Andrée Fortin, Pratique et discours de la contreculture au Québec, Québec, Septentrion, 2015, 11. La presse a rapporté cet événement de différentes manières. « La journée de la jeunesse à l’Expo s’est transformée en une impressionnante manifestation contre la guerre américaine au Vietnam », Sept-Jours, août 1967. Ou plus narquoisement : « Une suite sans fin de harangues à propos de la guerre au Vietnam », Nika Rylski, « The Expo Love-In », The Ottawa Journal, 18 août 1967. Voir Paul Tagney, « Living Theatre in Montreal » (version originale publiée en 1967) dans English Poems and Writings, Houston, Strategic Book Publishing, 2014, n. p. Tagney écrit : « Le premier spectacle du Living Theatre in Montreal s’intitulait “Hommage to U.S. Day at Expo” [Hommage à la Journée nationale des États-Unis à l’Expo]. La pièce était construite autour d’un cercueil noir porté par les acteurs, du square Dominion au site de l’Expo. Le cercueil était couvert d’images de villages vietnamiens en flammes, d’enfants morts ou estropiés, et de soldats américains. » Voir Ellen Roseman, « Protesters Have Record Summer », McGill Daily, 25 septembre 1967, 12. Rob Kelder analyse également ces tactiques dans « Notes on Radical Theatre », Logos, n° 1 (10 octobre 1967), 12. Les deux articles présentent des photos du « pavillon du Vietnam »; il n’est pas clair si les manifestants ont pu entrer sur le site d’Expo 67 avec leurs pancartes anti-guerre. « À l’automne 1967, Montpetit et Lacroix publient une série d’affiches qui furent distribuées gratuitement […] » (dont Le Chien américain). Québec Underground, tome 1, 242. Ibid. Inderbir Singh Riar, Expo 67, or the Architecture of Late Modernity (thèse de doctorat, Université Columbia, 2014), 154. Daudelin est devenue plus tard une cinéaste, mais son engagement à l’Atelier libre de recherches graphiques de 1965 à 1968 fait partie de sa biographie sur le site Web de la Cinémathèque québécoise : http://collections.cinematheque.qc.ca/articles/48-realisatrices/. Le fragment de texte sur Ali peut se traduire comme suit : « M. Mohamed Ali […] a refusé de prêter serment à l’armée américaine. L’American World Boxing Association l’a dépouillé de son titre. On ne sait pour quelles raisons, puisque son combat parrainé par le gouvernement
J O H A N N E S LO A N
23 24 25 26
27 28
29 30 31
77
américain n’a pas été mené dans une arène avec des gants de boxe contre une récompense ou conformément à des règles, que ce soit en provenance de Queensbury ou d’ailleurs. » – Freedom Anarchist Weekly Émile Daoust, chef de la construction et du département d’ingénierie, cité par Hill, « Greg Curnoe’s Homage to the R34 », 93. Eva-Marie Kroller. « Fear of Flying? The Myth of Daedalus and Icarus in Canadian Culture », Journal of Canadian Studies, vol. 8, n° 4 (hiver 1993-1994), 108. Curnoe, cité par Hill, « Greg Curnoe’s Homage to the R34 », 94. Le poète George Bowering était un ami intime de Curnoe, et il a accueilli la famille de l’artiste à Montréal lors de leur visite à Expo 67. George Bowering. The Moustache: Memories of Greg Curnoe, Toronto, Coach House Press, 1993. http://ccca.concordia.ca/c/writing/b/bowering/ bow001t.html. Curnoe, cité par Hill, « Greg Curnoe’s Homage to the R34 », 85. Curnoe était-il anti-américain, ou anti-New York? « Il était furieux lorsqu’on désignait son travail comme du Pop Art, parce que le Pop Art était une mode américaine. » George Bowering, Left Hook: A Sideways Look at Canadian Writing, Vancouver, Raincoast Books, 2005, 218. Toutefois, l’artiste Art Green « se souvient que le célèbre artiste canadien Greg Curnoe avait tenté de faire venir une exposition des imagistes de Chicago dans sa ville natale de London au cours des années 1960 ». Robert Reid, « 1960s Chicago art movement has links to Waterloo », Guelph Mercury Tribune, 6 juin 2014. https://www.guelphmercury.com/whatson-story/4562395-1960schicago-art-movement-has-links-to-waterloo. Michael Lobel, James Rosenquist: Pop Art, Politics, and History in the 1960s, Berkeley, University of California Press, 2009, 127. Ellen Roseman, « Protesters have Record Summer », McGill Daily, 25 septembre 1967, 12. Le fonds Curnoe du Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto, contient le numéro de mars 1968 du journal anarchiste Freedom, qui proposait plusieurs articles sur l’utilisation du napalm par les États-Unis au Vietnam.
L’œuvre murale de Dorval par Greg Curnoe
Identités nationales : le pavillon du Canada
L’arbre est dans ses feuilles Althea Thauberger
althea thauberger : Bonjour. Je m’appelle Althea Rae Thauberger. Je suis l’instigatrice, la productrice et la réalisatrice de ce projet. Il s’agit d’un projet qui porte sur des archives ayant appartenu à l’ancien Service de la photographie de l’Office national du film du Canada. Nous nous intéressons plus particulièrement à une sélection de photographies datant de 1963 à 1966 qui auraient été considérées, et certaines utilisées, pour deux projets supervisés par le Service de la photographie à l’occasion du Centenaire : L’Arbre du peuple (voir pages 101-102) d’Expo 67 et les ouvrages photographiques Call Them Canadians et Ces visages qui sont un pays. J’incarne ici en quelque sorte un personnage historique. Ce personnage est Lorraine Althea Monk, vers 1967. Elle était alors à la tête du Service de la photographie, et c’est sous sa gouverne que ces projets ont été mis sur pied. lorraine monk : Je voulais un projet qui nous permettrait d’affirmer : Regardez, on existe1. andrea kunard : Il m’apparaît fort intéressant que les gens voient ces images très dures et qu’ils apprennent à faire face à cette histoire, parce que c’est leur histoire. C’est aussi qui ils sont. Ils n’y échapperont pas. C’est qui je suis. Les catégories qui étaient reproduites sur ces petites fiches circulent encore beaucoup de nos jours. Nous devons savoir comment gérer cela en nous-mêmes et apprendre de nous-mêmes et de nos réactions. C’est ce que permettent ces archives2. kama la mackerel : Les fantômes exigent que nous accueillions la vérité3. lorraine monk : La photo ne disait pas la vérité; elle était trompeuse, mensongère, et elle le sera toujours. Elle dit toujours quelque chose du regard de celui qui la prend4.
Ci-contre et pages suivantes Althea Thauberger, L’arbre est dans ses feuilles, 2017, installation vidéographique à deux canaux.
carol payne : Je pense qu’il est éloquent que le Service de la photographie, dirigé par Lorraine Monk dans les années 19605 … althea thauberger : Regard. carol payne : … s’intéressait à des réponses plus créatives; moins à l’approche documentaire conventionnelle … althea thauberger : Qui est-ce que tu regardes? carol payne : … et propagandiste des années 1940 et 1950, et plus à la photographie abordée comme une forme d’expression. althea thauberger : Il s’agit, en gros, de poésie. carol paynee : Bien que cela ne soit pas manifeste dans les archives, j’ai toujours cru que le fait d’accompagner la photographie de textes expressifs permettrait de renforcer l’idée qu’il s’agissait d’archives créatives – un département créatif … althea thauberger : Respiration. carol payne : … qui faisait valoir l’expression, et non la création de soi-disant faits visuels. althea thauberger : L’amour est dans le cœur Le cœur est dans l’oiseau L’oiseau est dans l’œuf L’œuf est dans le nid Le nid est dans le trou Le trou est dans le nœud Le nœud est dans la branche La branche est dans l’arbre6 lorraine monk : Il est retourné au club de la presse, a déclaré que la dame qui disait être un singe en était réellement un, et il a prévu de grands malheurs7.
82
A LT H E A T H A U B E R G E R
chloé savoie-bernard : on a pris leurs voix tandis que d’autres mains que les leurs ont griffonné leurs descriptions raturées et traduites — révisées et effacées cherchant à extraire leur substantifique moelle ne manquent que leurs noms j’ai avalé leurs images à défaut de les ordonner mon corps travaille à leur digestion mais rétives elles résistent en grimaçant de joie repues de leur persistance bientôt tu n’auras même plus besoin de m’ouvrir pour les apercevoir ne me faites pas accroire que l’instrument n’est pas rouillé que l’histoire n’est pas pourrite se fertilise d’elle-même et recommence la scission nette échoue à n’en plus finir elle écoute la gangrène accourir avec la placidité de celle qui sait — aujourd’hui c’est notre cinquième date nous la passons à manger l’anatomie des autres nous avons très faim nous avons très soif je croque dans ces femmes avec une avidité qui t’étonne8
85
L’arbre est dans ses feuilles
lorraine monk : Description de l’exposition La zone du pavillon du gouvernement canadien consacrée au peuple tentera, dans la mesure du possible, de présenter le peuple canadien tel qu’il est aujourd’hui. Ce portrait prendra la forme d’un érable stylisé symbolisant le peuple. Cet « arbre » sera composé des parties constitutives de tout arbre, soit de feuilles, d’un tronc, de racines et de terre. Les feuilles Les Canadiens se livrent à diverses activités personnelles, professionnelles et récréatives. Il s’agit d’hommes et de femmes de tous les âges qui vivent dans les différentes régions du Canada9. kama la mackerel : tendez les bras, tendez les bras vers le ciel huilez votre corps, brillant et tendu offrez votre cœur qui bat au soleil vous êtes l’arbre qui donne de l’ombre aux voyageurs vous êtes l’arbre qui offre des fruits aux enfants vous êtes l’arbre qui donne des fleurs aux mariés de tous les genres vous êtes l’arbre dont l’ombre chasse le mauvais œil vous êtes l’arbre dont les racines guérissent l’indigestion vous êtes l’arbre dont les feuilles chantent en langues inconnues et vous êtes l’arbre de la connaissance, vous êtes l’arbre de la connaissance vous êtes l’arbre qui connaît toutes les histoires – les histoires racontées comme celles qui sont tues les histoires qui ne se racontent pas10 carol payne : L’Arbre du peuple se trouvait dans l’enceinte du Canada sur le site d’Expo 67. Il était constitué de centaines de panneaux. Certains étaient orange et rouge, et d’autres arboraient des photographies de personnes, grandeur nature, de sorte qu’on avait l’impression de marcher sous un arbre peuplé d’individus. C’était une création fantaisiste qui cherchait à donner au spectateur le sentiment d’appartenir au portrait de la nation canadienne. D’une certaine manière, quand on réfléchit à des choses comme à des images, à des photographies ou à des films, on pense aussi à la façon dont ils forgent leur public, ce que l’Arbre du peuple faisait de manière remarquable à mon avis.
86
A LT H E A T H A U B E R G E R
danica evering : Notre bras tient notre bras droit qui est attaché à une autre et une autre de nos mains Vous êtes souvent plaqués au sol les corps se tournent dans différentes directions les têtes se retournent ensemble nous sommes ici à nouveau nous sommes encore là Le brasse-camarade. Nous sentons-nous seuls, ou tous à la fois11? natasha kanapé fontaine : Combien d’années il faut le dire encore Que je ne veux pas mourir Que je ne veux pas mourir Que je ne veux pas mourir Je ne veux pas mourir de pitié Je ne veux pas mourir de honte Je ne veux pas mourir de mépris Je ne veux pas mourir de mes morts Je ne veux pas mourir de mes corps Je ne veux plus mourir Je ne veux plus mourir Je ne veux plus mourir Je ne veux plus mourir Je ne veux plus mourir Je veux apporter la lumière au monde Je veux apporter la parole de mes ancêtres Jusqu’au bout de mes bras Jusqu’au bout de la terre … Et la faire tourner12.
87
L’arbre est dans ses feuilles
Notes
1 Lorraine Monk, entretien avec Lilly Koltun. cd-r, Bibliothèque et Archives Canada, Ottawa, octobre-décembre 1976. 2 Andrea Kunard, entretien avec Alexis O’Hara, Montréal, mai 2017. 3 Extrait de Kama La Mackerel, « The People Tree », 2017. 4 Lorraine Monk (traduction d’Éric Lamoureux), entretien avec Lilly Koltun. cd-r, Bibliothèque et Archives Canada, Ottawa, octobre, décembre 1976. 5 Carol Payne, entretien avec Alexis O’Hara, Montréal, mai 2017. Les citations suivantes proviennent de la même source. 6 Zachary Richard, « L’arbre est dans ses feuilles », 1978. 7 Lorraine Monk, entretien avec Lilly Koltun, cd-r, Bibliothèque et Archives Canada, Ottawa, octobre-décembre 1976. 8 Extrait de Chloé Savoie-Bernard, « ce qu’on mange », 2017. 9 Mémo, Participation du gouvernement canadien, « The People: General Concept, Exhibit Description and Thematic Outline », 4-5, 28 juillet 1965, dossier The People Tree, Archives du Service de la photographie de l’onf, Bibliothèque du Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. 10 Extrait de Kama La Mackerel, « The People Tree », 2017. 11 Extrait de Danica Evering, « Agree or Disagree », 2017. 12 Extrait de Natasha Kanapé Fontaine, « Pour que nous puissions vivre », 2017.
88
A LT H E A T H A U B E R G E R
Panning for Gold / Walking You Through It (Chercher l’or / Te prendre par la main) Leisure (Meredith Carruthers et Susannah Wesley)
Alors que la plus grande partie des pavillons d’Expo 67 se régalait de progrès et d’innovation, et projetait une vision idéalisée de l’avenir axée sur la technologie, l’Environnement pour le jeu créatif et l’apprentissage du Centre d’art des enfants, conçu par l’architecte paysagiste canadienne Cornelia Hahn Oberlander, proposait un autre type d’avenir. Entouré d’une sphère scintillante, d’une pyramide inversée et d’un réseau de monolithes en pierre, l’« Environnement » était un lot modeste de la taille d’un petit parc urbain typique. Aux yeux des adultes, ce « pavillon » pouvait sembler décevant, mais pour les enfants, cette étendue de buttes, de sable et de plans d’eau offrait des possibilités presque infinies. Dans le projet Panning for Gold / Walking You Through It, nous nous inspirons de trois concepts mis de l’avant par l’Environnement pour le jeu créatif et l’apprentissage : l’idée de « prendre par la main », qui suppose une méthodologie collaborative de communication et d’imagination; une définition non hiérarchique du « pouvoir créatif », qui ouvre des possibilités pour de nouvelles formes d’action; et l’idée de « chercher de l’or », que nous interprétons comme une transformation faite par l’entremise d’une attention soutenue, d’un tamisage et d’une sélection. Dans la lettre où elle présente son concept de terrain de jeu pour Expo 67 à Polly Hill, directrice de projet au Centre d’art des enfants, Oberlander décrit le parc encore à l’état de projet en termes de textures. Il ne s’agissait pas pour elle d’« un concept abstrait », mais d’un environnement complexe, comme s’il faisait « partie de la nature1 ». Elle nous guide pas à pas, décrivant avec imagination le terrain de jeu à travers les yeux d’un enfant, nommant tous les choix qui se présenteraient à lui – grimper sur des rondins, creuser dans le sable, chercher de l’or, ramper à travers un tronc d’arbre. Après avoir reçu le concept et les directives d’Oberlander, Hill plaide fortement en faveur du projet non conventionnel. Dans son rapport final, elle déclare : « Les enfants ont un pouvoir créateur, nous le savons, nous en parlons, et savons que trop bien comment l’étouffer2. » Elle poursuit en expliquant comment les enfants étaient
Ci-contre Leisure, Panning for Gold / Walking You Through It, 2017, vues d’installation. Ci-dessus Leisure, Panning for Gold / Walking You Through It, 2017, détail.
encouragés à « faire », à « participer pleinement » et à « créer » dans l’« Environnement ». Elle insiste sur les possibilités créatives offertes par ce terrain d’aventure aux allures de jardin, tout en invitant les « adultes bien rangés » à se lancer eux aussi dans cette aire de jeu stimulante et « délicieusement chaotique ». Nos entretiens avec Oberlander nous ont permis de comprendre comment la création d’un terrain de jeu a constitué pour elle un moyen de concilier les attentes des mères au foyer des années 1950 et sa pratique professionnelle3. En raison de sa formation, Oberlander concevait l’espace comme une expérience encadrée (avec des facteurs passifs et actifs ordonnés par un designer), mais aussi comme une forme de communication passant par les éléments (des variables interreliées mises en dialogue par la participation)4. Le temps passé à élever ses enfants l’a amenée à penser différemment. L’observation de leurs parcours – les mouvements, les désirs, les textures et les formes qui les guidaient dans leur jeu libre – l’a ouverte à une nouvelle façon
91
Panning for Gold / Walking You Through It
Ci-contre Plan d’aménagement paysager pour le terrain de jeux du Centre d’art des enfants, pavillon du Canada, Expo 67, vers 1967. Diazo sur papier avec encre, mine de plomb et collage, 92 x 88 cm. ARCH280457. Fonds Cornelia Hahn Oberlander. Centre Canadien d’Architecture, Montréal. Don de Cornelia Hahn Oberlander. © Cornelia Hahn Oberlander. Ci-dessus Perspective pour le terrain de jeux du Centre d’art des enfants, pavillon du Canada, Expo 67, vers 1967. Transfert à sec sur photostat négatif imprimé sur carton, 91 x 114 cm. ARCH252723. Fonds Cornelia Hahn Oberlander. Centre Canadien d’Architecture. Don de Cornelia Hahn Oberlander. © Cornelia Hahn Oberlander.
d’envisager le pouvoir créatif dans le monde. Puis, elle a tranquillement et méthodiquement traduit ses observations en stratégies de design qui pouvaient être mises à l’épreuve par ses enfants sur le terrain. En tant qu’artistes et parents nous-mêmes, nous étions fascinées par cette collaboration étroite et concrète entre la designer et ses enfants. Comment pouvions-nous aussi favoriser une telle collaboration active dans notre pratique? Comment pouvionsnous créer des « sculptures » ou des « peintures » dans un cadre muséal, qui pourraient être représentatives d’une démarche active ou réorganisées dans l’imaginaire des visiteurs?
93
Panning for Gold / Walking You Through It
Cornelia Hahn Oberlander, architecte paysagiste. H.D. Bancroft, photographe. Vue du terrain de jeux du Centre d’art des enfants, pavillon du Canada, Expo 67, 1967. Épreuve argentique à la gélatine, 20,1 x 24,8 cm. ARCH280292. Fonds Cornelia Hahn Oberlander. Centre Canadien d’Architecture, Montréal. Don de Cornelia Hahn Oberlander.
À la suite de notre rencontre avec Cornelia et avec Polly, par l’entremise de sa lettre, nous avons intégré leurs efforts à notre façon d’envisager notre chemin dans l’existence, la créativité et les lieux où ils se déploient. Panning for Gold / Walking You Through It n’est pas une reconstitution de leur initiative exceptionnelle, mais une sorte de nouveau jardin expérimental. L’espace du Musée permet une configuration conceptuelle et spatiale unique. On peut circuler dans l’installation ou simplement observer le mouvement qui s’y déroule; on peut intervenir avec l’œuvre ou l’analyser. Nous avons sélectionné, recréé et transformé des éléments trouvés au cours de notre recherche pour les engager dans un nouveau dialogue. Les paniers de sarraus, les piles de rondins crantés, les images fragmentées de sable, de branches de pin et d’eau rassemblées dans la salle d’exposition offrent une vision exploratoire et collaborative de la relation entre la vie créative, le travail et le jeu.
94
LEISURE
Notes
1 Cornelia Hahn Oberlander, lettre à Polly Hill, 15 septembre 1965, Bibliothèque et Archives Canada, Ottawa. 2 Polly Hill, résumé pour l’atelier du Centre d’art des enfants, 12 juin 1967, Bibliothèque et Archives Canada, Ottawa. 3 En février 2014, nous nous sommes entretenues avec Oberlander pendant quelques jours à sa maison de Vancouver. Nous voulions discuter de sa lettre à Polly Hill et obtenir des précisions, notamment en ce qui a trait à sa vision de l’espace et à sa pratique en matière de conception de terrains de jeu, plus particulièrement dans le cadre d’Expo 67. 4 Voir Paul Klee, Pedagogical Sketchbook, 1925, Londres, Faber and Faber, 1973.
95
Panning for Gold / Walking You Through It
Ci-dessus et pages suivantes Geronimo Inutiq, Ensemble / Encore, Together / Again, Katimakainnarivugut, 2017, vues d’installation.
Of Our Lands / De nos terres / Nunanni Geronimo Inutiq
Ensemble / Encore, Together / Again, Katimakainnarivugut est une exploration audiovisuelle inspirée du pavillon Katimavik et d’autres structures architecturales d’Expo 67. L’œuvre comprend un revêtement de vinyle au sol, des impressions numériques, une bande sonore électronique asynchrone, deux projections vidéo et une émission de télévision en couleur. Ce texte vise à fournir des précisions sur les composantes et le processus de conception de l’installation. En entrant dans le pavillon Katimavik, les visiteurs se retrouvaient devant les murs intérieurs de la pyramide inversée. Ils pouvaient monter jusqu’au sommet du toit pour y contempler le reste du site. L’utilisation de l’espace au sein de l’installation est un reflet et une interprétation abstraite de cette expérience. Des sculptures, des cadrans solaires, des sabliers et des masques haïdas et de théâtre kyōgen étaient exposés sur le toit du pavillon (voir page 103). Dans Ensemble / Encore, je fais allusion à ces représentations de l’être humain, du temps et d’instruments de mesure du temps. Dans la langue des peuples autochtones de l’Arctique, katimavik signifie « lieu de rencontre ». Cette phrase est reprise en français, en anglais et en inuktitut dans mon œuvre, et elle est intentionnellement prononcée sur un ton didactique. La disposition linguistique correspond à mon interprétation esthétique des thèmes du pavillon. L’utilisation de ces langues représente le point de rencontre non seulement entre notre conception du territoire et notre lien à celui-ci, mais entre les cultures de la collectivité canadienne. Le passage du temps est exprimé par l’illustration de la transformation de la terre, du ciel et de l’eau. Les êtres humains, en tant qu’acteurs parmi les éléments, apparaissent dans les épreuves numériques et les images télévisuelles. Les projections vidéo sont tirées de films d’archives 16 mm provenant des archives en ligne Prelinger. Les formes contrastées qui encadrent les images sont issues de l’application de filtres cristallisants aux motifs géométriques qui se retrouvent sur le sol. Un filtre de type miroir a ensuite été utilisé afin d’accentuer les formes et créer un effet kaléidoscopique. Le plancher de l’installation est une représentation abstraite de la pyramide inversée du pavillon Katimavik.
La pièce sonore de l’installation est inspirée de la composition « Katimavik » d’Otto Joachim, à laquelle elle répond. Elle a été réalisée avec un synthétiseur d’époque et des techniques de manipulation de bandes audio, aussi utilisés par Joachim. À leurs premières heures, les synthétiseurs ont donné lieu à une esthétique avant-gardiste de tonalité abstraite par rapport à la musique populaire de l’époque. Une partie de la bande sonore de l’installation recourt aux techniques du sérialisme, de génération d’ondes et d’enregistrement et montage sur bandes magnétiques en référence à l’œuvre originale de Joachim. L’année 1967 représente pour beaucoup l’apogée de l’innovation, des possibilités, du progrès technologique et du futurisme au Canada. Le but d’Expo 67 était d’innover et de repousser les frontières du design et de la technologie de façon à refléter les progrès réalisés parallèlement sur les plans sociaux et culturels. Il ne reste toutefois
98
GERONIMO INUTIQ
presque rien des structures architecturales de l’Exposition universelle, qui faisait pourtant grand cas de ses progrès fulgurants, car elles ont été détruites après l’événement, bien que certaines structures emblématiques demeurent. L’occasion de se pencher sur l’expérience éphémère d’Expo 67, « Terre des Hommes » (Inuit Nunanga) et « Katimavik » permet d’examiner les progrès que nous avons accomplis en tant que collectivité, mais aussi de revoir les tendances sociétales relatives à l’exploitation passée et actuelle des ressources dans le but d’en tirer un profit et pour le plaisir et l’intérêt du public. Nous pouvons mesurer à quel point la culture de l’impermanence a modelé nos vies et à quel point sa nouveauté est désormais normale et intégrée depuis Expo 67. Les objets et les structures que nous construisons sur les terres habitées façonnent non seulement le contexte de nos vies, mais le sens de notre histoire. Il est maintenant temps de réfléchir à notre responsabilité collective envers le territoire et envers les autres en tant que ressources. Chacun d’entre nous est un collaborateur, un agent et un acteur dans la construction et la fabuleuse interprétation de notre réalité.
100
GERONIMO INUTIQ
Ci-haut Katimavik et l’Arbre du peuple, pavillon du Canada, 1967. Archives de la Ville de Montréal, VM94-EX136-040. Ci-bas Katimavik et l’Arbre du peuple, pavillon du Canada, 1967. Fonds CMCP, Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. Photo : Chris Lund.
Ci-contre, en haut L’Arbre du peuple 1967. Archives de la Ville de Montréal, VM97-Y_3P196. Ci-contre, en bas Vue d’intérieur avec visiteurs dans l’Arbre du peuple de l’Office national du film du Canada. Fonds CMCP, Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. Photo : Ted Grant. Ci-haut Vue d’intérieur de Katimavik, pavillon du Canada, Expo 67, 1967. Centre Canadien d’Architecture, Montréal. Don de May Cutler. Ci-bas Élévation du pavillon du Canada à Expo 67. Pièce 47. © Gouvernement du Canada. Avec l’aimable permission de Bibliothèque et Archives Canada (2019). Source : Fonds de la Compagnie canadienne de l’Exposition universelle de 1967, Bibliothèque et Archives Canada / RG71M 88922.
Identités nationales : le pavillon des Indiens du Canada
Earth Mother Hair, Indian Hair, and Earth Mother Eyes, Indian Eyes, Animal Eyes (Cheveux de Terre-Mère, Cheveux d’Indien et Yeux de Terre-Mère, Yeux d’Indien, Yeux d’animal) Duane Linklater
Norval Morrisseau est le seul auteur de Earth Mother with Her Children, 1967, réalisé pour le pavillon des Indiens du Canada. J’ai lu que Morrisseau ne pouvait pas être présent ou qu’il n’était pas disponible pour peindre l’œuvre, et que c’est son assistant Carl Ray qui l’a exécutée et terminée en son nom. Les explications pour justifier son absence sont nombreuses et comprennent des rumeurs et des insinuations que je n’ose pas répéter, car j’ignore si elles sont vraies ou non. Quoi qu’il en soit, l’absence de Morrisseau est féconde. Je me demande si son refus d’être physiquement présent au pavillon était un acte délibéré visant à entraver la réalisation de son œuvre et les activités du pavillon des Indiens du Canada. Était-ce une forme de protestation? S’il avait été présent, qu’est-ce que cela aurait signifié? Non seulement Morrisseau était absent, mais un autre acteur s’est interposé dans la conception de Earth Mother with Her Children. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (mainc) tenait à présenter un récit exemplaire des relations entre Indiens et Canadiens au pavillon, ce qui, en fin de compte, a eu des répercussions sur la version finale de l’œuvre murale de Morrisseau (voir page 120). Apparemment, les responsables du pavillon jugeant la version « originale » de Earth Mother with Her Children trop explicite, le mainc aurait exigé des modifications à l’œuvre – la représentation d’un humain et d’un animal se nourrissant au sein de Terre-Mère aurait indisposé les visiteurs d’Expo 67. L’œuvre a donc été modifiée, censurée, et une distance a été établie entre les enfants et la poitrine de Terre-Mère. Cette distance n’est pas sans résonance. En 1967, le Canada était en plein cœur des célébrations de son centième anniversaire. À l’époque, le système des pensionnats indiens était encore pleinement en vigueur et des milliers d’enfants étaient forcés de quitter leurs familles pour fréquenter ces écoles, où ils étaient exposés à diverses
Ci-contre Duane Linklater, Earth Mother Hair, Indian Hair, and Earth Mother Eyes, Indian Eyes, Animal Eyes, 2017, détail.
Duane Linklater, Earth Mother Hair, Indian Hair, and Earth Mother Eyes, Indian Eyes, Animal Eyes, 2017, vue d’installation.
Duane Linklater, Earth Mother Hair, Indian Hair, and Earth Mother Eyes, Indian Eyes, Animal Eyes, 2017, détail.
formes de violences infligées par leurs dirigeants. De nombreux enfants ne sont jamais retournés chez eux et ont été enterrés à proximité des écoles, tandis que d’autres n’ont pas même eu d’enterrement décent. Certains enfants, dont des membres de ma famille, ont survécu à cette horreur. La décision d’intervenir et d’imposer une distance dans la peinture reflète la violence et les tentatives délibérées par l’État d’arracher les enfants autochtones de la place qui leur revenait dans leurs familles et leurs communautés. Cet héritage nous affecte encore, nous en sommes encore témoins et nous devons encore y faire face aujourd’hui. De quelle matière l’œuvre de Morrisseau est-elle donc faite? De peinture, bien sûr, appliquée sur les panneaux de bois extérieurs du pavillon des Indiens du Canada et sur le dessin original de Morrisseau. La question, au-delà de l’évidence, est d’interpréter l’absence de Morrisseau par rapport à la matérialité de l’œuvre, ce qui demeure complexe. Il semble important de faire état de cette absence d’une manière ou d’une autre. La matière de l’absence est présente quelque part dans l’exécution de l’œuvre elle-même; elle est présente dans la transmission du dessin de Morrisseau dans l’esprit de Carl Ray par les oreilles et les yeux, puis par ses mains. En lieu et place des nombreux acteurs évoqués et de leur influence sur l’œuvre, je propose cette description spéculative de Earth Mother with Her Children.
110
D U A N E L I N K L AT E R
Earth Mother with Her Children Peinture sur la paroi de bois extérieure du pavillon des Indiens du Canada, d’après un dessin original de Norval Morrisseau, interprété par Carl Ray, censuré par le mainc, absence de Norval Morrisseau. Dimensions variables 1967 Avec l’aimable permission de l’artiste « Je suis actuellement dans mon atelier et je peins des yeux et des cheveux. Je n’ai pas peint depuis des années. Je croyais que c’était chose du passé, que la peinture n’était pas pour moi, et peut-être que ce n’est pas un médium pour moi à long terme. L’avenir le dira. Mais c’est là que je me trouve en ce moment. Je peins des yeux qui vous verront tous et des cheveux qui vous toucheront tous. » Cette œuvre est intitulée Earth Mother Hair, Indian Hair, and Earth Mother Eyes, Indian Eyes, Animal Eyes Peinture sur mur intérieur du Musée d’art contemporain de Montréal, tirée d’une série de petits tableaux d’yeux et de cheveux effectués à partir d’une photographie de Earth Mother with Her Children, 1967, de Norval Morrisseau, exécution confiée à Julie Ouellet, absence de l’artiste. Dimensions variables 2017 Avec l’aimable permission de l’artiste
111
Earth Mother Hair, Indian Hair, and Earth Mother Eyes, Indian Eyes, Animal Eyes
Indian Momento (Mémoire indienne) Krista Belle StewartRuwedel
Un mémento est un objet emblématique destiné à rappeler le souvenir d’un événement ou d’une personne décédée. Indian Memento est un court documentaire de l’Office nationale du film du Canada réalisé par Michel Régnier pour le pavillon des Indiens du Canada durant Expo 67, qui illustre la vie des Autochtones de l’époque, comme s’il s’agissait d’un mémento. Dans un premier temps, le film décrit la vie dans une réserve – le tricot, la lessive, la cueillette des baies, les jeux, le travail –, brossant un portrait idyllique des paysages et de la vie au foyer. On y suit une jeune fille à cheval puis en vêtement d’apparat, guidant les touristes au pavillon. Le documentaire guide ensuite le spectateur dans l’exposition, mettant en valeur divers textes, objets et images. À 12 minutes 49 secondes exactement, le visiteur se retrouve dans un espace consacré à la « Vie active », où un vaste éventail de documents d’archives et de photographies tapissent les murs irréguliers. Au sommet de l’arche de photographies figure un portrait de ma mère, Séraphine Stewart (voir page 121). J’avais déjà entendu parler de la présence de cette photographie dans cette salle, alors j’ai effectué une recherche image par image jusqu’à ce qu’elle apparaisse. Le cliché est tiré d’un docudrame de la cbc qui dépeint la vie de ma mère en tant que jeune femme de la réserve du lac Douglas, partie vivre à Victoria où elle est devenue la première infirmière autochtone en santé publique de la Colombie-Britannique. L’image la montre de profil portant un bonnet et un habit d’infirmière, comme on peut le voir en rouge et en noir dans mon installation Indian Momento. Les fenêtres à carreaux dans l’exposition fournissent un cadre d’analyse de l’espace liminaire entre l’intérieur et l’extérieur et créent une tension entre l’institution et le monde extérieur. La grille, qui constitue un symbole du modernisme dans l’histoire de l’art occidental, est un trope récurrent dans mon travail. Dans Indian Momento,
Ci-contre et page suivante Krista Belle Stewart, Indian Momento, 2017, vues d’installation.
elle est formée par les traverses des fenêtres. Reproduisant la lueur qui traverse un vitrail, comme dans une église, l’œuvre fait directement référence au catholicisme et aux pensionnats. L’éclairage rouge dans la pièce renvoie à la descendance et à la violence perpétrée. Cette lueur change selon l’heure du jour, passant du violet au rose et au rouge, ce qui génère de subtiles variations dans les autres salles de l’exposition au sein desquelles elle s’infiltre. L’esthétique de l’œuvre fait également référence à un autre aspect du documentaire, où le texte, les pictogrammes tirés du journal d’un anthropologue et des gravures recourent aux deux mêmes tons qui font la qualité graphique d’Indian Momento. La représentation et la répétition sont importantes dans ma pratique, et le rôle de la photographie dans la médiation du passé, des récits et des espaces y est un point de référence constant. Tout comme le processus de transmission de l’histoire, qui passe par différentes formes de médiation – que ce soit par transmission orale ou par la photographie, le cinéma ou l’écrit –, le mien consiste à reformuler les images sources à l’aide de divers moyens technologiques et de transposition. Dans le cas présent, l’image fixe a d’abord fait l’objet d’une prise de vue, puis elle a été désaturée par l’augmentation du contraste et teintée de rouge. Elle a ensuite été imprimée sur vinyle en vue de son installation dans chaque carreau de fenêtre.
114
K R I S TA B E L L E S T E W A R T
Ci-dessus et ci-contre Krista Belle Stewart, Indian Momento, 2017, détails.
Le moment qui a été capté est à peine discernable, ce qui met en évidence le problème inhérent des images utilisées pour illustrer une histoire ou un récit, en raison du cadrage subjectif choisi par le photographe et de sa réception. Une image transmet une quantité limitée d’information, et les détails imprécis peuvent être complétés par des suppositions ou de fausses informations. L’aspect graphique de l’image lui confère une certaine planéité, de sorte que les visiteurs se fondent aux photographies recouvrant les murs et le plafond. Les individus dans l’espace, les visiteurs qui se déplacent dans le documentaire et les portraits qu’ils observent interagissent dans un même cadre temporel et créent ainsi une confusion entre le réel et la représentation. Cette superposition a pour effet d’aplanir le réel, au même titre que la mémoire ne donne qu’une impression de ce qui a été. Indian Momento attire l’attention sur ce qui est profondément personnel, tout en mettant en lumière le contexte social de représentation et le système des pensionnats.
115
Indian Momento
Le docudrame de la cbc sur ma mère, Seraphine: Her Own Story (1967) et Indian Memento (1967) ont tous deux été réalisés il y a cinquante ans. L’importance de saisir le moment où la photographie de ma mère apparaît dans le documentaire de Régnier relève autant du personnel que du politique, ainsi que des complexités inhérentes aux aspects itératifs du récit. La répétition de l’image dans seize carreaux de fenêtres, ce qu’on appelle une grille coloniale classique, est une allusion à la reproductibilité de la photographie et au processus consistant à raconter encore et encore l’histoire culturelle grâce une intervention qui met en lumière la complexité du processus de décolonisation.
116
K R I S TA B E L L E S T E W A R T
Sans titre Mark Ruwedel
Mark Ruwedel, Sans titre, 1990, épreuve argentique à la gélatine montrant le totem de Henry Hunt et Tony Hunt. Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. Achetée en 1992.
Vue aérienne des pavillons des Indiens du Canada, des Nations Unis et des provinces de l’Atlantique, 1967. Fonds de la Compagnie canadienne de l’Exposition universelle de 1967, Bibliothèque et Archives Canada / e000990836. Photographe inconnu.
George Clutesi (gauche) et Noel Wuttunee (droite), et totem de Henry Hunt et Tony Hunt, 1967. Archives de la Ville de Montréal, VM97-Y_1P208.
Norval Morrisseau, Earth Mother with Her Children, 1967, extérieur du pavillon des Indiens du Canada. Centre Canadien d’Architecture, Montréal. Don de May Cutler.
Intérieur du pavillon des Indiens du Canada où l’on voit Seraphine Stewart au centre de la partie supérieure. Fonds de la Compagnie canadienne de l’Exposition universelle de 1967, Bibliothèque et Archives Canada / PA-177766.
Le pavillon des Indiens du Canada Guy Sioui Durand
Le thème « Terre des Hommes / Man and His World » confère une aura humaniste à Expo 67. Le souffle œcuménique impulsé par ce thème, emprunté au grand écrivain Saint-Exupéry, rejoint la perspective holistique des visions autochtones du monde. Dans nos langues, l’ohtehra’, le potlash, le makusham ou la yanonchia’ désignent de grands festins et rassemblements pour les Onkwe Onkwes (nous les humains), semblables aux expositions universelles. C’est avec ce point de vue wendat que je suis parti à la recherche de l’art du pavillon des Indiens du Canada. Il s’agit d’un long voyage, avec bien des portages, que j’ai entrepris lors de ma visite d’Expo 67. J’avais quinze ans. Depuis, la mémoire du pavillon des Indiens du Canada a été ravivée. À la faveur des fêtes du 375e anniversaire de la métropole et du 150e de la Confédération canadienne, le projet du Musée d’art contemporain de Montréal en a prolongé les résonnances artistiques. Le présent essai se compose de deux parties. J’aborde premièrement la question de l’adéquation entre le contexte, le contenant et le contenu du pavillon, plus précisément l’expressivité symbolique et politique de son architecture, de ses salles thématiques et des œuvres présentées, et deuxièmement, je traite des résonnances artistiques multimédias de cette aventure autochtone, dont le pavillon lui-même demeure un repère historique.
À la recherche du pavillon des Indiens du Canada En 1967, l’Exposition universelle dévoile les réalités contemporaines de Tiötià:ke’ (Montréal), du Kébeq (Québec) et de Kanata’ (Canada)1 sur une île inventée, comme le suggère la chanson thème de l’événement Un jour, un jour (réinterprétée par Cheryl Sim dans son œuvre Un jour, One Day ou en partie construite par MarieClaire Blais et Pascal Grandmaison dans leur court film Le Chemin de l’énigme,
deux œuvres présentées dans l’exposition À la recherche d’Expo 67. Cette « Terre des Hommes » qu’est l’île Sainte-Hélène se trouve en territoire Kanien’kehà:ka’. Aire symbolique de Yandiawish, l’île de la Grande Tortue et figure de la Mère Terre dans nos mythes fondateurs, le lieu où se déroule cette grande fête urbaine planétaire est d’emblée propice à l’imaginaire autochtone. De grands changements sociétaux sont en cours à l’époque. Montréal célèbre le 325e anniversaire de présence française et se dote d’infrastructures urbaines modernes : métro, gratte-ciels et autoroutes. Expo 67 représente une véritable ouverture sur le monde. Sa tenue au Kébeq signifie l’achèvement de la « Révolution tranquille », à la suite de laquelle les Canadiens français, soufflés par un vent de nationalisme, se désignent par le terme de Québécois. Partout en Kanata’, le drapeau unifolié rouge et blanc flotte en l’honneur du Centenaire de la Confédération canadienne. L’Exposition universelle Terre des Hommes constitue un événement festif qui s’inscrit dans la lignée des grandes foires des pays colonialistes, hégémoniques et impérialistes. Toutefois, au mitan de cette décennie, les mondes scientifique, intellectuel et artistique semblent en équilibre. Les utopies cohabitent. D’un côté, la notion de progrès favorise les envolées technologiques comme la conquête imminente de la lune. De l’autre, les tendances culturelles comme les avant-gardes européennes (ex. : l’Internationale situationniste) et le mouvement hippie en Californie prônent l’expérimentation. L’ancrage communautaire terrien Small Is Beautiful se fait contre-culture. Or cette période est aussi caractérisée par les luttes de décolonisation amorcées dans les années 1940. Les Indiens d’Amérique (Amérindiens, Métis et Inuit) resurgissent dans la société nord-américaine. Ils reprennent leur place dans l’histoire sociale et artistique. Le premier juillet 1967, à Vancouver, le chef Dan George harangue une foule de 32 000 Canadiens de son fameux « Lament for Confederation » (lamentation sur la Confédération). En décembre de la même année, on peut lire sur la page couverture du prestigieux magazine Life : « The Return of the Red Men! » Mais c’est à Tiötià:ke’ (Montréal) que ça se passe! Sur le site d’Expo 67, une structure architecturale reconnaissable par la forme d’un triangle isocèle s’immisce entre les autres pavillons en dômes, cubes, parallélogrammes, demi-lunes, pyramide inversée, le tout relié par un train aérien aux allures de ficelles : c’est le pavillon des Indiens du Canada, indépendant de ceux des provinces et du pays. Son audace architecturale, artistique et thématique est le fait de celles et ceux que j’appelle les nouveaux « Chasseurs-Chamans-Guerriers2 » par l’art. C’est d’abord par son autonomie que le pavillon des Indiens du Canada rend visible cette « américité3 » qui se distingue de l’américanité. Le gouvernement canadien ne prévoyait qu’une présence autochtone dans son bâtiment, mais les pressions du Conseil national des Indiens et l’avènement du nouveau ministère des Affaires
123
Le pavillon des Indiens du Canada
indiennes et du Nord canadien changent la donne. Le ministère supervise l’architecture et laisse aux Premières Nations le soin de décider des thématiques et de sélectionner les œuvres. Le bâtiment en soi est intéressant. L’espace autochtone s’impose avec des symboles identitaires forts, mis au service d’une architecture originale, de grandes œuvres d’art et la mise en perspective de la réalité crue des conditions de vie dans les réserves. Son originalité tient au métissage stylisé de deux éléments traditionnels : le tipi et le teueikan (tambour). Les modules abritant les salles d’expositions créent une forme octogonale s’apparentant au tambour traditionnel, laquelle entoure une grande tente d’où ressortent des mâts évoquant les tipis des Cris/Saulteaux et des Sioux/Lakotah des plaines. Sans nier cette forme archétypale universellement associée aux Indiens d’Amérique – largement diffusée par les photographies, les feuilletons, les bandes dessinées, les spectacles et les films westerns opposant cowboys et sauvages –, l’architecture aurait pu s’inspirer des yanonchia’, les maisons longues iroquoises de l’Est ou de la côte Ouest, ou encore du shapatuan, la grande tente des Innus. Les grandes œuvres qui ornent l’extérieur du bâtiment renforcent son impact visuel. D’ailleurs, cette présence d’œuvres d’art autochtone dans l’architecture correspond à l’idée naissante d’une politique d’intégration de l’art à l’architecture, familièrement appelé le programme du un pour cent4. À la demande du nouveau ministère, l’artiste chippewyan Alex Janvier invite un groupe de talentueux artistes issus des quatre coins du pays à créer des œuvres à la fois contemporaines et ancrées dans la tradition coutumière. Les artistes représentant les Premiers Peuples « du Saumon » de la côte du Pacifique sont le peintre tseshat George Clutesi, les sculpteurs de totems kwakwaka’wakw Henry Hunt et son fils Tony, le sculpteur salish Simon Charlie et le peintre abstrait haida gwaii Robert Davidson. Les Premières Nations « du bison » des plaines sont représentées par le peintre Alex Janvier, les artistes cris Noël Wuttunee et Jackson Beardy et le peintre pied-noir Gerald Tailfeathers. Des Terres de Boisés, allant de la baie d’Hudson jusqu’aux Grands Lacs et que l’on nomme en langue wendat Ontarïo’, le graveur et sculpteur sénéca des Six Nations (Haudenosaunee) Tom Hill et le surdoué Norval ᐅᓴᐘᐱᑯᐱᓀᓯ/Oiseau-Tonnerre de cuivre et de laiton/Copper Thunderbird Morrisseau entraînent dans leur sillage les peintres Francis Kagige, Ross Wood, Carl Ray et le poète Duke Redbird, tous Ojibwés. De Magtagöek, appellation mi’qmaq pour le « grand chemin qui marche », ce fleuve Saint-Laurent qui traverse le Kébeq et se jette dans l’océan Atlantique, figure le céramiste de Wendake Jean-Marie Gros-Louis. Le grand mât totémique réalisé par les sculpteurs Henry et Tony Hunt impressionne tant par sa hauteur que l’esprit animiste de clan qui le compose. S’empilant les uns sur les autres, il y a le chef qui porte sur sa tête un castor, sur lequel l’épaulard
124
GUY SIOUI DURAND
dévore un phoque avec par-dessus la rarissime bête mythologique, le Sisiult, qui supporte un ours grizzly portant comme coiffe tout en haut, le Grand Corbeau. De son regard perçant, il surplombera les 3 millions de visiteurs qui s’acheminèrent vers l’entrée du pavillon des Indiens du Canada! En 2007, soit quarante plus tard, le sculpteur Stanley Hunt, secondé par son fils Jason, donc la même lignée familiale de clan, viendra restaurer la grande œuvre à la demande de la Ville de Montréal. La grande fresque Earth Mother with Her Children, de Norval Morrisseau, fut un chef-d’œuvre. Toutefois, elle diffère de la version initiale conçue par l’artiste. Ce dernier entendait mettre en scène la Terre-Mère sous la forme d’une grand-mère comme dans nos mythes fondateurs qui, à la chevelure sauvage et aux mamelles gorgées, allaite des oursons. Sorte d’inversion sous le regard amérindien, Morrisseau voulait-il confronter le récit mythique de la fondation de Rome dans lequel la louve allaite les jumeaux Remus et Romulus? Or, face aux réticences des autorités, inconfortable avec cette iconographie, Morrisseau se retirera. Il laissera son ami et assistant Carl Ray réaliser une version différente dans laquelle un seul ours a le regard tourné vers les trois lunes/soleils entourant les personnages. Bien qu’audacieuse, cette version vue de la murale rappelle davantage une représentation ensauvagée de la Sainte Famille. Cette stratégie de délégation sera reprise par l’artiste Ojibwe Duane Linklater dans le cadre de l’exposition À la recherche d’Expo 675. Une autre œuvre à caractère politique dérange : la controversée The Unpredictable East d’Alex Janvier, signée de son numéro de bande. Les autorités obligent l’artiste à en changer l’appellation pour Beaver Crossing Indian Colours, et la font déplacer sur la façade arrière du pavillon. Notons finalement le mural, l’Arbre de la paix, fruit d’une collaboration entre l’artiste sénéca Tom Hill, et l’artiste huron-wendat JeanMarie Gros-Louis de Wendake, surnommé « celui qui connaît le bon argile ». S’inspirant de l’esprit des grands colliers de wampums pour raviver l’alliance entre les grandes Confédérations des Haudenosaune et celle des Wendat. L’œuvre, bien que de facture minimaliste, témoigne du militantisme politique de l’époque tout en évoquant indirectement le windigo, une créature maléfique des forêts issue de la mythologie iroquoienne, métaphore des luttes politiques à mener. Avec cette œuvre de céramique fixée sur un des murs extérieurs du pavillon, un peu comme un macaron géant, les artistes rendent visible l’alliance renouvelée entre la Confédération des Wendat et la Ligue des Haudenosaunee et ils témoignent de leur héritage partagé – mythes fondateurs, usages rituels, origines linguistiques, règles protocolaires entourant les colliers de wampum et structures sociales fondées sur les maisons longues. À l’intérieur du pavillon, des écriteaux, des photographies et des artefacts aménagés dans dix salles, telles les perles de coquillage d’un grand collier de wampum, dressent un portrait de la réalité des Amérindiens au pays en 1967. Guidés par une
125
Le pavillon des Indiens du Canada
équipe d’hôtesses autochtones vêtues d’un costume au design discutable, les trois millions de visiteurs du monde entier se voient offrir un parcours militant. Il est question des conséquences de la création des réserves, de la réduction des territoires via des traités dont plusieurs ne seront pas respectés, de l’interdiction de tenir des cérémonies et des rituels, de voter (jusqu’en 1969), de la répression des langues et usages coutumiers, des âpres conditions de vie sur les terres de réserve, de la christianisation forcée et des pensionnats, ces univers suspects (encore fonctionnels) destinés à l’assimilation des enfants arrachés à leurs familles. Bref, la misère des réserves y est étalée. Les salles consacrées à l’éducation religieuse et aux pensionnats présentent des écriteaux incisifs qui choqueront bien des Canadiens, au point que beaucoup rebrousseront chemin – ce déni persistera jusqu’aux déclarations des Nations-Unis sur les peuples autochtones, en 2007, et aux récentes commissions royales d’enquête, comme la Commission de vérité et réconciliation du Canada dont le rapport est paru en 2015 et la récente portant sur la situation des femmes autochtones assassinées ou disparues dont le texte qualifie en 2019, le phénomène de « génocide culturel ». Une relecture autochtone des événements historiques et géopolitiques y est aussi proposée, notamment la reproduction photographique grand format sur un mur du traité de la Grande Paix de Montréal de 1701 – les Québécois ne commémoreront qu’en 2001 ce fait d’histoire! Signe de paix, la visite se termine autour d’un feu symbolique dans le hall, un lieu rassembleur invitant à réfléchir ensemble. Ce qui n’empêchera pas la presse provinciale et nationale de dénoncer l’attitude récriminatrice des Indiens6.
Un tournant Les miens dormiront pendant cent ans, et quand ils se réveilleront, ce seront les artistes qui leur rendront leur esprit. Cette prophétie attribuée au chef métis Louis Riel, pendu pour rébellion en 18857, se réalise-t-elle à Expo 67? La très longue période de résilience face aux tentatives d’assimilation et de génocide culturel fait place à un mouvement de décolonisation et de réappropriation8. L’ethnologue Sherry Brydon9 écrit « qu’il ne s’agissait pas seulement de célébrer ». Steven Loft10, artiste Kanien’kehà’ka renchérit en insistant sur le rôle des artistes. Le pavillon des Indiens du Canada canalise un moment important des rapports art et société en Amérique du Nord. Mon concept de « fait
126
GUY SIOUI DURAND
glocal d’américité11 » servant à qualifier ces situations qui, dans l’esprit du potlash et du makusham, mettent en branle l’ensemble des composantes du monde autochtone de manière « glocale » (en reliant les microrelations locales aux enjeux globaux), s’applique au pavillon des Indiens du Canada d’Expo 67. Dans ce cas, le pavillon figure des infrastructures inexistantes comme un tout-en-un, si l’on peut dire, dont certaines vont se concrétiser au cours du prochain demi-siècle. De fait, le pavillon des Indiens du Canada incarne souverainement un musée d’histoire politique militant autochtone, un musée des civilisations autochtones hors de l’ethnographie coloniale, un musée des arts autochtones où les savoirs, les savoir-faire et les savoir-vivre ensemble traditionalistes sont fusionnés aux formes de créativité contemporaine, une maison de la culture, un centre d’artistes autogéré autochtone et un symposium d’art public aux œuvres autochtones audacieuses. Qui plus est, son audience s’élargit aux communautés nationale et internationale des villes. De nos jours on emploie le terme « autochtonie » (« indigeneity » en anglais) pour décrire le phénomène. L’avènement d’un art nettement plus conscient collectivement de son riche bagage identitaire, politiquement engagé et porté par le désir de changer les rapports de pouvoir sur la définition de la « chose indienne12 » aura des résonnances.
Les résonnances artistiques Un demi-siècle s’est écoulé depuis Expo 67. Pour l’occasion, le Musée d’art contemporain de Tiötià:ke’ a mis sur pied l’exposition À la recherche d’Expo 67 et invité plusieurs artistes à revisiter l’événement. Dans cet esprit, on doit se pencher sur l’influence du pavillon des Indiens du Canada dans le champ élargi de l’art actuel. Si Expo 67 a favorisé la création d’infrastructures çà et là dans les réserves et l’ouverture progressive des institutions muséales et universitaires, c’est surtout l’expansion des pratiques artistiques qui en poursuit l’aventure. L’art traditionnel local comme savoir et savoir-faire redeviendra source d’inspiration, sous des formes métissées, transculturelles, interdisciplinaires, inter communautaires et inter Nations en milieu urbain, de bien des artistes et des thématiques d’expositions et d’événements. Dans les deux cas, toutefois, on assiste à la convergence de deux tendances. D’une part, on observe un processus de « réensauvagement13 », dans la mesure où les œuvres s’ancrent de plus en plus dans l’intégrité des cultures et des communautés, d’autre part, un renouvellement des relations avec le monde des idées, la technologie et d’autres modes de vie allochtones via ce que j’appelle des allers-retours (villes-réserves).
127
Le pavillon des Indiens du Canada
Ce sont donc les artistes et les intellectuels autochtones qui vont faire « résonnance » à ces pionniers du pavillon des Indiens du Canada de 1967. Ils rallumeront ces « feux » qui couvaient sous les cendres de la dépossession depuis 1867, mais en flammes activistes de réappropriation, de contestation et d’affirmation. Ces nouveaux « Chasseurs-Chamanes-Guerriers » par l’art prolongent l’esprit de Zacharie Tehariolin Vincent14 et des luttes de Jules Sioui, Origène Sioui et William Commanda, appuyées par les Automatistes de Refus Global 15.
Autohistoire ou histoire commune Cette (re)prise de conscience et la réappropriation s’articulent dans la deuxième moitié des années 1960. Elle ne cessera plus. Il y va de l’amorce d’une relecture historique opposant des projets d’auto-histoire à l’intégration de récit commun, à l’insistance sur les formes de l’oralité et surtout sur une effervescence progressive des pratiques et manifestations artistiques autochtones. Après le passage de la résilience de la mémoire immémoriale à la conscientisation historique collective dans les années 1960 et 1970, on assiste progressivement à l’affirmation autochtone, où l’héritage est intégré dans la création et les nouvelles approches de l’histoire de l’art. À cet égard, dans les années 2000, la tendance autochtone pour une autohistoire, et l’inclusion dans une relecture commune de l’histoire de l’art en Kanata’ et en Kébeq, est en débat. S’il faut saluer la récente embellie du registre d’historicité allochtone, il importe de mettre en évidence l’apport d’acteurs et d’établissements moins connus qui militent pour cette autohistoire autochtone de l’art. Mentionnons au Kébeq le Musée de Wendake – notamment avec ses expositions La loi sur les Indiens revisitée (2009) et Miroir d’un peuple. L’œuvre et l’héritage de Zacharie Vincent (2016) – ou l’Institution Kiuna, un centre d’études collégiales consacré à l’éducation des Autochtones du Québec, ouvert en 2011. Soulignons par ailleurs l’apport du Aboriginal Curatorial Collective/Collectif des commissaires autochtones (acc/cca). Fondé en 2006, ce collectif s’est imposé comme un organisme majeur en mettant sur pied de grands rassemblements et colloques, dont « Revisioning the Indians of Canada Pavilion: Ahzhekewada (Let Us Look Back) », qui s’est tenu à Toronto’ en 2011, en présence de plusieurs artistes ayant participé à l’aventure artistique du pavillon des Indiens du Canada d’Expo 67. Trois ans plus tard à Montréal, en 2014, le collectif a organisé l’événement bien nommé Iakwéia:re’ / I remember / Je me souviens (Musée McCord et Université Concordia), qui s’est ouvert sur des hommages. On a salué pour l’occasion l’œuvre cinématographique d’Alanis Obomsawin d’Odanak, et Tom Hill a lu un poignant témoignage de reconnaissance posthume à Jean-Marie Gros-Louis, décédé
128
GUY SIOUI DURAND
en 2013. Enfin, à l’automne 2016, le Collectif rendait hommage à l’ensemble des Aînés de la Première Nation Kwanlin Dün lors du grand rassemblement Kwàn Mày Dàyè Dàatth’i – Sit by the Fire with Us – Ensemble autour du feu – Sit by the Fire with Us – tenu à Whitehorse au Yukon. La posture esthétique des Clutesi, Hunt, Morrisseau, Hill, Gros-Louis et autres, qui consistait à « marcher dans les pas des Anciens », repose sur la vision du « temps circulaire » qui structure notre mémoire immémoriale et ses modes de transmission par voie orale et de proximité empirique. Elle devient prise de conscience historique, puis une « histoire de l’art » non racontée à ce jour. Au cours des décennies qui suivent Expo 67, l’imaginaire autochtone s’illustre sous diverses formes issues de l’oralité. À travers la littérature, la poésie, les légendes et les contes, les Tomson Highway et Joséphine Bacon entraînent dans leur génie une nouvelle génération de plumes. Le Spirit Song Native Theatre School et Margo Kane à Vancouver, Gary Farmer et Graham Greene du Centre for Indigenous Theatre à Toronto’ et Yves Sioui Durand de la compagnie Ondinnok à Tiöti’à:ke favorisent l’essor de la dramaturgie autochtone et de nouvelles carrières dans les arts de la scène. Le champ élargi des arts visuels – allant de la performance aux créations multimédias et interdisciplinaires – connaît une explosion d’expositions et d’événements. Au Kébeq, on recense plus de 700 expositions comportant une présence autochtone depuis 196716! On doit cette augmentation aux musées et aux institutions culturelles dans les communautés autochtones, à la complicité du réseau des centres d’artistes autogérés présents dans toutes les régions, aux revues d’arts et aux groupes et organismes comme le Collectif des commissaires autochtones. Depuis Zacharie Tehariolin Vincent, au XIXe siècle, et la bande d’artistes autour de Norval Morrisseau à Expo 67, Daphne Odjig, Bill Read et Mathewsie Iyaituk, les artistes autochtones innovent et changent le cours de l’art. Chaque génération fourbit de nouveaux artistes. De nos jours, on pense aux Domingo Cisneros, Zacharias Kunuk, Nadia Myre, Virginia Pésémapéo Bordeleau, Sonia Robertson, Skawennati, Caroline Monnet, Jacques Newashsish, Eruoma Awashsish et Ludovic Boney, pour n’en nommer que quelques-uns au Kébeq.
Les images en mouvement Parmi ces pratiques, la création cinématographique (documentaires, fictions, animation, art web) contribue à maintenir vive la mémoire du pavillon des Indiens du Canada à Expo 67. De telles références seront visibles dans À la recherche d’Expo 67. Je songe ici à l’installation Indian Momento de l’artiste Krista Belle Stewart, où l’on voit un plan figé et coloré, extrait du court-métrage Mémoire indienne, réalisé par le
129
Le pavillon des Indiens du Canada
cinéaste d’origine française Michel Régnier pour l’Office national du film du Canada en 196717. Sur fond d’une bande-son composée de voix, harmonica, accordéon et percussion, la caméra de Régnier suit le trajet, depuis sa réserve à la ville, d’une jeune hôtesse amérindienne qui travaille au pavillon des Indiens du Canada, avec le costume comme indicateur d’une mutation culturelle malaisée. Les images captées par Régnier effleurent certains messages politiques, mais présentent aussi des Autochtones contemporains. Belle Stewart y retrace le portrait de sa mère et établit un lien avec un autre documentaire tourné aussi en 1967, par la cbc, qui porte sur sa mère. Le film décrit le parcours de cette femme qui allait devenir la première infirmière autochtone en santé publique de la Colombie-Britannique. L’installation de Belle Stewart, composée de vinyle rouge appliqué sur les fenêtres du mac – transformant celles-ci en vitraux – reprend en très gros plan un portrait de sa mère tirée du film que l’artiste a déniché dans la documentation photographique du pavillon des Indiens du Canada. L’œuvre fait penser à Giniigaaniimenaaning (Regard vers l’avenir) (2012), le vitrail de l’artiste métis Christi Belcourt rappelant les séquelles des pensionnats, installé au Parlement fédéral. L’artiste inuit Geronimo Inutiq s’intéresse quant à lui au film avant-gardiste La Vie polaire, de Graeme Ferguson18 – un prototype qui annonce la technologie imax, projeté au pavillon « L’homme interroge l’univers » à Expo 67, et rediffusé au mac durant l’exposition. À l’époque, l’appellation « Inuit » n’existe pas, on parle plutôt des « Eskimos » dans le film de Ferguson. Dans son installation Ensemble / Encore, Together / Again, Katimakainnarivugut (2017), composée de vidéos, d’impressions numériques et d’une musique électroacoustique remixée à partir d’archives sonores, Inutiq réapproprie le mot inuit Katimavik, alors utilisé pour nommer la pyramide inversée du pavillon du Canada. De fait, ces exemples pris dans l’exposition du mac, font partie d’un contexte cinématographique plus vaste allant de rares documentaires tournés en lien avec le pavillon des Indiens du Canada aux relectures visuelles récentes sur des plateformes numériques en ligne au cours des cinquante dernières années. D’une part, comme en témoignent sa filmographie et ses programmations sur le Web de plus de 250 films, l’onf est à coup sûr, depuis les années 1960, le producteur et le dépositaire mnémonique des séries télévisées, des documentaires ethnographiques, d’animation et de fictions ayant pour propos les Autochtones. Il suffit de mentionner le légendaire César et son canot d’écorce 19 et l’incontournable Kanehsatake 270 ans de résistance20. Et, en 2015, dans le cadre du projet « Souvenir » de l’onf, l’artiste multidisciplinaire et cinéaste algonquine, originaire de Kitigan Zibi, Caroline Monnet fut invitée en compagnie de Jeff Barnaby, Kent Monkman et Michelle Latimer à revisiter les archives filmiques de l’institution, ce qui l’a amenée à créer le
130
GUY SIOUI DURAND
court-métrage primé Mobiliser / Mobilize 21 qui inclut des séquences du documentaire Mémoire indienne. Par ailleurs, des productions indépendantes s’alignent en ce sens de décennie en décennie. En 1970, le film Red, de Gilles Carle22, met en scène un personnage métissé, originaire de Kahnawake, en mal d’adaptation en milieu urbain. Ce film populaire possède cette lumière d’époque de Terre des Hommes. Quatre ans plus tard en 1974, le film Tonnerre rouge23 (Alien Thunder pour la version anglophone du Kanata et A Dan Candy’s Law pour les États-Unis) du réalisateur québécois Claude Fournier propose une intrigue qui s’inspire de la célèbre bataille des Métis autour lac Duke (Saskatchewan) en 1885, à laquelle les chefs cris Pitikwahanapiwiyin (Poundmaker) et Mistahimaskwa (Big Bear) refusèrent de participer, mais en appuyant la rébellion de Louis Riel et Gabriel Dumont. Les Cris et les Métis y voient arriver le train du Canadien Pacifique, les colons et la milice. Chef Dan George est en vedette avec Donald Sutherland. Avec les années 2000, les réalisateurs autochtones investissent documentaires – ex. : L’Éveil du pouvoir 24, Hollywood et les Indiens 25 – et fictions – ex. : Atanarjuat. La Légende de l’homme rapide26; Mesnak 27; Rhymes for Young Ghouls 28. Ajoutons-y l’aventure du Wapikoni Mobile, entreprise fondée en 2003, permettant aux jeunes Autochtones des communautés de tourner des courts-métrages, a franchi les frontières du Kébeq. Il en va de même du projet d’art numérique pour le Web Time Traveller, l’œuvre numérique de l’artiste mohawk Skawennati présenté à la Biennale de Montréal en 2014. Son processus permet de retourner ou d’avancer dans le temps, vers des situations culturelles et historiques, plongeant le regardeur de manière interactive à la recherche de lieux comme la pinède de Kanehsatake en 1990, ou pourquoi pas, dans les salles du pavillon des Indiens du Canada de 1967! Ce sont là toutes des résonnances actuelles du réensauvagement de l’art par l’art autochtone à partir de l’esprit artistique contemporain qui avait investi le pavillon des Indiens du Canada à Expo 67.
Vers 2067 Les revendications territoriales, la revitalisation des langues autochtones, l’intérêt de la part des jeunes générations autochtones pour les fondements authentiques de nos cultures mettent en branle deux dynamiques pour l’avenir. D’un côté, il y a le sentier du réensauvagement, ce mouvement de transmission des connaissances par le raccordement avec les ancêtres, les aînés et les générations brisées par les pensionnats, et de l’autre, l’actualisation de notre bagage identitaire au moyen de l’art. Bien qu’il n’y ait plus de fracture entre art traditionnel et art actuel, on assiste à une multiplication
131
Le pavillon des Indiens du Canada
des explorations, des collaborations et des métissages, et même à l’adoption d’influences technologiques. La présence accrue d’artistes et d’intellectuels autochtones en milieu urbain, leur scolarisation et leur effervescence sur toutes les scènes en font des ambassadeurs et des porteurs de nouvelles relations transculturelles avec les allochtones. Sous le rayonnement national et international dans le champ de l’art, assisterons-nous à l’émergence d’une nouvelle tribu, comme l’entrevoit Gerald McMaster (1999) dans The New Tribe, ou encore les expositions Reservation X (1998), Remix (2009) et Beat Nation (2013)? Ou verrons-nous émerger, paradoxalement, des quartiers urbains comme de nouvelles réserves, tel que le suggère l’artiste Kent Monkman dans son exposition Honte et préjugés : une histoire de résilience (2017)? Assistons-nous au renforcement de « l’intégrité des cultures et des communautés (tout en) alimentant le développement intellectuel29 » ou à son érosion? Verrons-nous poindre un Institut autochtone de recherche et de création? Une université autochtone? Et pourquoi pas un grand musée autochtone en milieu urbain30? Les allers-retours entre les communautés et les milieux urbains sont plus que souhaitables. Qui plus est, si nos créateurs autochtones – femmes, hommes et Agokwe – du Kébeq et du Kanata’ persistent à investir l’art sous toutes ses formes, à combiner les axes d’ensauvagement à leurs nouvelles relations, peut-être verrons-nous se concrétiser en 2067 le souhait du chef Dan George, dans sa grande harangue prononcée en 1967 à Vancouver, pour que « les cent années à venir [soient] les plus fameuses années de la fière histoire de nos tribus et de nos nations ». Tiawenhk chia’ Eskwanien! Tsei8ei 8enho8en Notes
1 Le mot en langues iroquoiennes, wendat et kanien’kehà: ka (mohawk), pour nommer Montréal est Tiötià:ke. Son origine dérive d’un verbe de la langue wendat ’gentia ge’ qui signifie faire un portage sur une terre entre deux cours d’eau. La référence aux rapides de Lachine est plausible. Plusieurs termes dans cet essai sont des mots de la langue wendat ou d’autres langues comme l’innu-aimun. Cet usage participe délibérément de l’actuelle revitalisation de nos langues autochtones. C’est le cas de Kébeq pour Québec et de Kanata’ pour Canada. 2 Guy Sioui Durand, « Jouer à l’Indien est une chose, être un Amérindien en est une autre », Recherches amérindiennes au Québec, vol. 33, no 3, 2003, 23-36. 3 Georges E. Sioui, « 1992 – La découverte de l’américité », dans Gerald McMaster et Lee-Ann Marin (dir.), Indigena. Perspectives autochtones contemporaines, Hull, Musée canadien des civilisations, 1992, 59-70. 4 L’appellation du 1 % réfère à la portion du budget de construction ou de rénovation d’un édifice ou d’une place publique octroyée à la création d’œuvres d’art.
132
GUY SIOUI DURAND
5 À partir de photographies d’archives, Linklater a réalisé une série de petites peintures reprenant les motifs des chevelures et yeux caractéristiques de l’art de Morrisseau, associé à l’école de Woodland, puis il a confié leur exécution à grande échelle à son assistante Julie Ouellet, en son absence. 6 Roger La Roche, Expo 67. Pavillon des Indiens du Canada, Villes-éphémères – Terre des Hommes (Expo 67-1984), 2013, http://www.villes-ephemeres.org/. 7 James Daschuk, La destruction des Indiens des Plaines, Québec, Presses de l’Université Laval, 2015. 8 Jean-Jacques Simard, La réduction. L’Autochtone inventé et les Amérindiens aujourd’hui, Québec, Septentrion, 2003. 9 Sherry Brydon, « The Indians of Canada Pavilion at Expo 67 », American Indian Art, vol. 22, no 3, 1997, 54-63. 10 Steven Loft, « Réflexions sur vingt ans d’art autochtone ». Les cahiers de la Fondation Trudeau, Toronto, Collège Ryerson, 2012, 17-38. 11 Guy Sioui Durand, « L’Onderha », Inter Art Actuel, no 122, 2016, 4-19. 12 Bruno Cornellier, La chose indienne. Cinéma et politiques de la représentation autochtone au Québec et au Canada, Montréal, Nota Bene, 2015. 13 Taiaiake Alfred, Paix, pouvoir et droiture. Un manifeste autochtone, 2e éd., Wendake, Éditions Hannenorak, 2014; Guy Sioui Durand, « L’Onderha », Inter Art Actuel, no 122, 2016, 4-19. 14 Louis-Karl Picard Sioui et Guy Sioui Durand, Miroir d’un Peuple. L’œuvre et l’héritage de Zacharie Vincent, Wendake, Musée Huron-Wendat, 2016; Louise Vigneault, Zacharie Vincent. Une autohistoire artistique, Wendake, Éditions Hannenorak, 2016. 15 François-Marc Gagnon, Chronique du mouvement automatiste québécois, 1941-1954, Montréal, Lanctôt Éditeur, 1998, 574-576. 16 Pricile De Lacroix, Exposer, diffuser, faire entendre sa voix. Présence de l’art contemporain autochtone au Québec entre 1967 et 2013, mémoire de maîtrise en histoire de l’art. Université du Québec à Montréal, 2016. 17 Michel Régnier (réalisateur), Mémoire indienne. Mémento. Le pavillon des Indiens du Canada à Expo 67, Office national du film du Canada, 1967, 18 minutes, https://www.onf.ca/selections/ expo-67-50-ans/lecture/#3. 18 Graeme Ferguson (réalisateur), La Vie polaire, imax Films, 1967, 18 minutes. 19 Bernard Gosselin (réalisateur), César et son canot d’écorce (dvd), Office national du film du Canada, 1971, 57 minutes. 20 Alanis Obomsawin (réalisatrice), Kanehsatake 270 ans de résistance (dvd), Office national du film du Canada, 1992, 119 minutes. 21 Caroline Monnet (réalisatrice), Mobiliser/Mobilize, Office national du film du Canada, 2015, 3 minutes, https://www.onf.ca/film/mobiliser/. 22 Gilles Carle (réalisateur), Red (dvd), Onyx Films, 1970, 103 minutes. 23 Claude Fournier (réalisateur), Tonnerre Rouge (dvd), Scorpion Releasing, 2011 [1974), 92 minutes. 24 René Labelle Sioui (réalisateur), L’Éveil du pouvoir (dvd), Productions Tshinanu, 2009, 48 minutes. 25 Neil Diamond (réalisateur), Hollywood et les Indiens (dvd), Office national du film du Canada, 2010, 88 minutes.
133
Le pavillon des Indiens du Canada
26 Zacharias Kunuk (réalisateur), Atanarjuat. La Légende de l’homme rapide (dvd), Odeon Films, 2001, 172 minutes. 27 Yves Sioui Durand (réalisateur), Mesnak, (dvd), K-Film Amérique, 2012, 96 minutes. 28 Jeff Barnaby (réalisateur), Rhymes for young Ghouls (dvd), Les Films Séville, 2013, 88 minutes. 29 Taiaiake Alfred, Paix, pouvoir et droiture. Un manifeste autochtone, 2e éd., Wendake, Éditions Hannenorak, 2014. 30 Guy Sioui Durand, « Expositions “sous réserves” : les avancées à Wendake et à Mashteuiatsh », Inter no 104, 2009, 42-47; David Garneau, « Indigenous Art : From Appreciation to Art Criticism », dans Ian McLean (dir.), Double Desire. Transculturation and Indigenous Contemporary Art, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014, 311-326.
134
GUY SIOUI DURAND
D’Indien à Indigène : du pavillon temporaire aux territoires souverains d’exposition David Garneau
Au temps d’Expo 67, j’avais cinq ans, j’étais conscient de l’effervescence, mais nous habitions loin de Montréal et nous n’avions pas les moyens de payer le voyage1. L’Exposition universelle est parvenue aux Prairies en noir et blanc surtout, à la télévision et dans le journal. Les célébrations coïncidentes du Centenaire du Canada étaient plus accessibles. La veille de la fête du Dominion, le « pied piper of Canada » est arrivé à Edmonton2. Bobby Gimby était un homme blanc, frisant la cinquantaine, qui jouait d’une trompette ornée de fausses pierreries, tout en portant une cape. C’était une tête carrée qui essayait de se faire passer pour un hippie, mais qui restait prudent avec ses cheveux en brosse, ses lunettes à la Buddy Holly et son complet : il incarnait l’ambivalence de l’époque. Ma sœur et moi faisions partie du chœur d’enfants qui chantaient à l’hôtel de ville, avec Gimby, sa populaire chanson Ca-Na-Da. En clin d’œil aux francophones, le montage comprenait un fragment de Frère Jacques, et elle évoquait d’une certaine manière les « Indiens » par la mélodie « one little, two little, three Canadians3 ». Je suppose que le « pied piper » n’avait pas conscience que les paroles originales célèbrent le génocide des nations autochtones d’Amérique4. Le petit Métis que j’étais chantait en chœur, participant tout aussi inconsciemment à la fantomatique présence indigène lors du Centenaire du Canada. Rétrospectivement, cette présence autochtone maladroitement convoquée et déplacée par Ca-Na-Da semble être l’artefact d’une vision du monde en éclipse partielle. Le pavillon des Indiens du Canada à Expo 67 apparaît comme un phare, un éclair de souveraineté créatrice qui répliquait aux récits coloniaux par des vérités indigènes. Le présent texte décrit l’utilisation des Premiers Peuples comme faire-valoir du progrès lors des expositions universelles, et comment le pavillon perturbe ce récit en des manières que les artistes et les commissaires indigènes continuent d’affiner. Expo 67 était une exposition internationale et universelle. Paradoxalement, cette catégorie d’Exposition universelle met en valeur une nation-hôte tout en la surchargeant de futurismes post-nationalistes. Internationales et universelles, ces expositions alternent les célébrations de la différence (internationale) et les expressions d’un désir de transcendance unifiée (universelle). Bien que fondées sur le patriotisme et la concurrence, les expositions internationales démontrent aussi l’avantage du partage
des connaissances. Elles proposent souvent les visions quasi socialistes d’un mondialisme coopératif qui dépasse les États-nations. Cette dissonance performative est activée afin de mettre en question des sujets établis et de susciter des innovations imprévisibles. Les expositions universelles sont des non-lieux temporaires, des terrains neutres où rassembler des filons imaginatifs de partout ailleurs. Ces lignes sont tissées dans le récit du site. Si les intrigues secondaires sont nombreuses, le progrès demeure au centre de l’histoire de chaque exposition : les choses s’améliorent. À compter de 1939, les expositions universelles incitaient le public à s’identifier à une identité transpersonnelle située dans le futur. Le slogan de l’exposition de 1939 était « Bâtir le monde de demain ». En 1958, c’était « Bilan pour un monde plus humain »; en 1962, « L’Homme dans l’ère spatiale » et, en 1964, « La Paix par la compréhension : La réussite de l’Homme sur une planète qui rétrécit et un univers qui s’élargit ». En 1967, le thème était « Terre des Hommes / Man and His World ». Ce sont là des idées inspirantes, à moins que l’on soit désigné comme faire-valoir de « l’Homme ». Pour prouver qu’il avait atteint le « Nouveau Monde » au XVe siècle, Christophe Colomb ramena des « sauvages » en Espagne pour divertir la cour. Ces démonstrations de richesse et de pouvoir en privé se poursuivirent pendant des siècles; toutefois, entre 1870 et 1930, elles devinrent une industrie publique et lucrative. Selon le spécialiste des génocides Kurt Jonassohn, alors qu’ils connaissaient une forte diminution du nombre de touristes, les jardins zoologiques et les cirques commencèrent à exporter des humains « exotiques » pour élargir leurs expositions d’animaux5. Il y eut des records d’assistance. Les Européens étaient fascinés par la gamme de peuples nouvellement « découverts », conquis et colonisés; les Américains voulaient voir de vrais Autochtones en vie, avant qu’ils ne disparaissent. Les zoos humains faisaient également partie des expositions universelles de l’époque. Par exemple, en plus d’un « village nègre », il y avait, à l’Exposition universelle de Paris en 1889, 400 personnes indigènes dans des cadres « authentiques ». D’abord présentées comme des curiosités, les expositions d’humains furent bientôt converties en expositions ethnographiques éducatives. En réalité, il y était davantage question d’empire que d’empirisme. Elles cautionnaient les ontologies racistes pseudo-scientifiques inspirées par Darwin. Certaines comportaient même des enclos de primates, suivis de cages renfermant des personnes brunes ou noires, nues ou demi-nues, qu’observait le public blanc. Le but n’était pas seulement de montrer la différence, mais de démontrer la supériorité de la race blanche. Ce n’est pas l’indignation morale qui mit fin aux zoos humains, mais plutôt la crise économique de la Grande Dépression. Si l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958 présentait un village congolais, de telles expositions furent rarement reprises. Le goût pour les zoos humains s’est émoussé lorsque les documentaires cinématographiques et radiophoniques ont réussi à rendre accessible une évocation des contrées lointaines, et que de meilleures conditions de voyage ont permis aux colons de visiter les colonies6. 136
DAV I D G A R N E AU
Les présentations ethniques et « primitives » des expositions universelles servent de repoussoirs ou de contrastes essentiels permettant de mettre grandement en valeur les expositions de nouvelles technologies et de nouveaux modes de vie. La mise en scène décontextualisée des cultures traditionnelles est là pour démontrer d’où vient « l’Homme », pour montrer aux gens comment était la vie avant qu’ils deviennent l’Homme. Ainsi, les réalisations des technologies de pointe montrent où les meilleurs d’entre nous sont parvenus. Les expositions de fiction spéculative proposent également des aperçus du « monde de demain », où ceux d’entre nous qui réussissent à développer le caractère de l’Homme vivront un jour. « L’Homme » est une identité à laquelle on aspire. Le public erre entre l’altérité rude et déconcertante, et l’unicité extatique et fluide. Dans la République (platonicienne) des expositions universelles, l’Indigène est exotique, décoratif, multiple, statique, anachronique, tandis que « l’Homme » – produit du rationalisme éclairé, de l’intuition, de la compétition et de la technologie – est unifié, simplifié et transcendant. Il suffit de se rappeler les hôtesses d’Expo 67 et leurs uniformes tendance, aux allures d’agentes de bord, le mobilier de « l’ère spatiale », les accessoires aérodynamiques et les bâtiments futuristes, dont le dôme géodésique de Buckminster Fuller réalisé pour le pavillon des États-Unis. Le public allait-il choisir le romantisme régressif ou les formes de l’avenir? Ce qui était tenu pour acquis durant « l’été de l’amour » et dans la phrase célèbre de Timothy Leary, « vas-y, mets-toi en phase, et décroche », est devenu un débat ouvert. En anglais, le sujet d’Expo 67, « Man and His World », est « l’Homme », unité d’êtres post-raciale (« Man ») qui règne sur la planète (« His World »). « L’Homme » est non seulement l’ancien équivalent du terme « humain » mais aussi, dans ce contexte, une expression de ce que Michael Leja nomme le « discours de l’Homme moderne » – une discussion qui était en plein essor dans la littérature scientifique et populaire en Europe et aux États-Unis, après « la guerre pour mettre fin à toutes les guerres7 ». Cette discussion atteignit un sommet durant la crise existentielle qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, l’effondrement des empires coloniaux et la fondation des Nations Unies. On peut dire qu’elle s’est terminée avec Expo 67. Il y a deux courants. Dans la version optimiste, celle des expositions d’après-guerre jusqu’à Expo 67 inclusivement, « l’Homme moderne » désigne des personnes (mais presque toujours conçues comme étant de sexe masculin) qui partagent une même humanité, plutôt que des membres d’une race, d’une nation, d’une tribu ou de toute autre catégorie. L’Homme moderne est une utopie aspirationnelle de lutte pour se libérer de l’irrationalité, perçue comme étant la cause des guerres, de la pauvreté et de l’injustice. L’Homme moderne s’efforce, par sa bonne volonté et la technologie, de transcender la nature – ses bas instincts et l’environnement qui alimente son avenir. Dans la version concurrente et plus sombre, « l’Homme » est fasciné par sa propre nature irrationnelle, il est pessimiste quant à la maîtrise de ses passions, et il se demande si c’est une bonne idée de toute façon, puisque la domination de la nature semble 137
D’Indien à Indigène
conduire à la catastrophe mondiale. Il a cessé de croire qu’une meilleure technologie conduit nécessairement à une meilleure civilisation. Selon un des premiers ouvrages de ce genre, L’Homme à la découverte de son âme de Carl Jung (1933), l’homme était en crise parce que la technologie progressait bien au-delà de la capacité d’adaptation de son psychisme encore primitif. La science avait devancé le développement éthique et politique pour produire des primates propulsés à l’énergie nucléaire. Les architectes de l’utopie pensent à l’intérieur des limites de leur vision du monde, dans le but d’accroître les privilèges des gens de leur espèce. Leurs plans proviennent de leurs préférences de tempérament tout en les renforçant, ils préservent et soutiennent leurs prérogatives de race, de genre et de classe. Bien qu’il prétende représenter l’humanité, cet « Homme » était habituellement masculin, de race blanche. Pour les Indigènes, les utopies basées sur l’Homme naissent dans les cerveaux de personnes qui se sont coupées de leur culture d’origine, des signifiants flottants, dissociés de leur territoire, de leur communauté et de leur savoir traditionnel. La pensée utopiste qui privilégie le patriarcat, la technologie, le matérialisme et la domination sur l’environnement et les autres peuples est contraire aux modes de connaissance et d’existence indigènes. Une utopie aspirationnelle qui n’est pas basée sur l’humilité et l’intendance, qui n’est pas fondée sur des rapports durables entre tous les êtres, mais plutôt centrée sur les humains, l’accumulation et les hiérarchies, est désastreuse à la fois pour les environnements et les personnes. Un tel mode de pensée, surtout si exprimé comme étant universel, représente une attitude totalisante qui survient lorsqu’une société confond le progrès technologique et la supériorité morale. La réussite matérielle, soutenue par une idéologie d’affirmation de soi, peut conduire les personnes à croire qu’elles transcendent leurs intérêts personnels et savent ce qui est le mieux pour les autres. Dans l’optique de ce récit, les personnes qui savent qui elles sont, qui privilégient des modes de connaissance et d’existence basés sur le territoire, et qui veulent protéger leurs terres, sont perçues comme des obstacles sur la voie du développement personnel et de l’utopie collective. Dans le contexte canadien, l’Homme moderne est post-Indien. Les Autochtones sont des vides à combler, à réparer ou à déplacer par ceux dont la personnalité est plus complète et rationalisée. Si cela vous semble familier, c’est peutêtre parce que vous vous souvenez de la phrase de Richard H. Pratt, fondateur du pensionnat de Carlisle : « Tuez l’Indien et sauvez l’Homme8. » L’utopie est une noble destination pour les personnes qui la conçoivent, mais la voie est remplie de peuples indigènes qui souffrent et dont l’arrivée est sans cesse reportée. Les peuples indigènes sont presque totalement absents des brochures, affiches et autres imprimés officiels de l’Expo. C’est étrange. L’image du Grand Nord blanc, projetée en Europe des années 1870 aux années 1920, était celle de la disponibilité verdoyante; débarrassé des Indiens, prêt à être utilisé et occupé par des gens travailleurs à la peau claire. Toutefois, suite à la marée de travailleurs immigrés européens, le pays, qui se cherchait une identité, a redécouvert les Premiers Peuples comme moyen de 138
DAV I D G A R N E AU
se distinguer de l’Europe. Romancés, les « Indiens » de l’époque pré-traités et leur art – les mâts totémiques, les sculptures inuites et les tipis – sont devenus une partie intégrante de l’identité visuelle de la nation. La greffe du jeune arbre canadien sur les racines autochtones a contribué à donner une impression de maturité au pays adolescent. On pourrait interpréter le déclin des « Indiens » comme symbole culturel du Canada dans le sens d’un désir d’éliminer les images associées à l’ancien Dominion du Canada et de mettre en place un Canada post-indien, nouveau et amélioré. Cependant, vu les efforts renouvelés d’assimilation des « Indiens » à l’époque, cette absence semble plutôt être une nouvelle version du thème de la terra nullius. On pourrait être plus indulgent et parler simplement d’un manque d’imagination à l’occasion d’une crise. Les personnes chargées de la rédaction publicitaire et de l’édition lors de l’Expo semblent perplexes lorsqu’il s’agit de représenter des Autochtones qui passaient du statut de sujets à celui d’agents, d’« Indiens » à Indigènes. Elles et ils semblent avoir des doutes quant à la manière d’intégrer la résistance indigène à un récit nationaliste canadien. Plusieurs expositions du pavillon des Indiens du Canada perpétuaient une attitude paternaliste et coloniale envers les Premiers Peuples. Comme le fait remarquer Randal Rogers, un auteur anonyme écrivait dans un dépliant explicatif portant sur l’une des expositions : « les arbres, les arbustes, les plantes et les rochers symbolisent l’harmonie de l’Indien avec la nature […] Pour lui, c’est le soleil et la lune qui règlent le passage du temps. Il répugne à tout horaire réglé par l’horloge. La cloche de l’école le fait sursauter9. » Le texte catégorise les peuples autochtones comme étant non seulement à l’écart de la contemporanéité, mais aussi de la modernité. Ils ne peuvent s’adapter à la technologie. Cet « Indien » est une représentation monolithique conçue de manière à contenir les personnes de plusieurs Premières Nations dans un « lui » englobant, mais incompréhensible et anti-moderne. Il n’est pas l’Homme; il est l’opposé de l’Homme, ce que l’Homme doit maîtriser. Les Indiens ne sont pas « l’Homme » mais font partie de son monde, « His World », et font partie de l’environnement dominé par l’Homme. Le pavillon des Indiens du Canada fut la première exposition autochtone nationale produite par des personnes des Premières Nations. Bien qu’il ne fût pas complètement exempt d’ingérence gouvernementale, de connotations coloniales et de conventions de genre, il avait suffisamment de gestion souveraine, de contenu et d’innovation autochtones pour que les commissaires d’expositions indigènes y voient la naissance du commissariat indigène. Tandis qu’un regard colonial peut percevoir le pavillon comme une occasion pour les « Indiens » d’apprendre à jouer le jeu du commissariat inventé par l’homme blanc, le point de vue indigène identifie ce rassemblement comme la continuation de la culture d’exposition autochtone, et comme une intervention politique annonciatrice des premiers signes d’une nouvelle identité collective. Bien avant le contact, les populations originelles de l’île de la Tortue tenaient des expositions 139
D’Indien à Indigène
inter-nationales d’art, de culture, de technologie, de commerce, de pouvoir et de statut. L’interdiction des potlatchs (1884) et celles émises par la Loi sur les Indiens (1876), relativement aux danses et rassemblements « indiens », dont les pow-wow, ne furent levées que seize ans avant l’Expo, en 1951. Même si ces activités se poursuivaient en secret, ce fut difficile de les reprendre en public après des décennies de criminalisation et la honte infligée aux enfants dans les pensionnats indiens. Néanmoins, les pow-wow sont réapparus vers le milieu des années 1960. Le pavillon des Indiens du Canada faisait partie de ce renouveau. Il rassembla des personnes autochtones – artistes, commissaires, hôtesses – de plusieurs Premières Nations pour partager leurs cultures, manifester publiquement leur différence par rapport au Canada, et pour renouveler et créer des relations et des connaissances entre eux. En anglais, le terme « Indigenous » est récemment devenu le terme préféré pour décrire les populations originelles d’un territoire. Ce mot n’est pas simplement un synonyme poli des étiquettes précédentes; il pointe un nouveau type de conscience, personnelle et collective. Le mot « Indigène » réfère aux Premiers Peuples du monde entier, qui reconnaissent avoir une plus grande solidarité entre eux qu’envers leurs colonisateurs. Si « Indien » et « Aborigène » étaient des impositions impériales, « Indigène », bien qu’il soit un autre produit de l’occupation, est autorisé par les Premiers Peuples d’aujourd’hui. Le terme « Indigène » désigne un réseau inter-national de relations et de discours qui inclut, mais dépasse, l’affiliation locale et tribale. Les peuples indigènes connaissent les cultures autochtones autres que la leur; ils lisent des livres et des articles, regardent des émissions sur les autres peuples indigènes; ils voyagent vers ces territoires et s’entretiennent avec leurs gardiens du savoir; ils créent de l’art et des idées inspirés par leurs cultures locales, sans y être confinés. Le terme « Indigène » compte des espaces mobiles et discursifs, et des espaces d’exposition qui font partie, et sont séparés, des cultures dominantes et locales. Le pavillon des Indiens du Canada est indigène parce qu’il est contemporain. Par « contemporain », je veux dire non seulement qu’il existe au moment présent, mais aussi qu’il propose des idées et des activités qui font partie d’un discours international commun relié à la culture habituelle, mais différent. Les Autochtones qui sont contemporains sont des Indigènes. Le mot « Indigène » fait référence, non pas aux peuples du passé, mais aux états actuels de la conscience et de l’action politique et créatrice autochtone. Si le pavillon des Indiens du Canada continuait les traditions d’exposition des Premières Nations et présentait la culture de plusieurs nations du nord de l’île de la Tortue, certaines sections exprimaient une indigénéité commune, une conscience contemporaine, politique et collective. Plusieurs panneaux de textes et d’image montraient comment les peuples des Premières Nations (les Inuits et les Métis n’étaient pas inclus) vivaient et souffraient à cause de la colonisation et des promesses brisées des traités. L’exposition remplaçait le récit de « l’Indien en voie de disparition » par des preuves de persistance. Elle montrait aussi comment les vies autochtones étaient 140
DAV I D G A R N E AU
souvent misérables en raison de l’oppression systématique. Si le récit dominant de l’époque était « la destruction des Autochtones suivie par l’assimilation », la contrehistoire du pavillon était un récit séparatiste d’endurance autochtone en dépit du Canada. Tel que Tom Hill (Seneca), un des commissaires du pavillon, l’a expliqué en 1976 : « Le gouvernement souhaitait vraiment une image positive dans ce pavillon, et on leur a dit la vérité. C’est ce qui les a les plus choqués10 ». Bien qu’il se nommait le « Pavillon indien du Canada », en réalité c’était un pavillon privé, un territoire d’exposition temporaire et souverain11. Dans Expo 67, un compte rendu de l’exposition rédigé l’année suivante, un auteur anonyme commente le pavillon des Indiens du Canada : « Le mât totémique de 65 pieds n’est pas la seule chose qui fait que le visiteur se sent petit. S’il est un “visage pâle”, la visite du pavillon ressemble à une course d’obstacles. Les documents, dessins, œuvres d’art et photographies des conditions de vie actuelles s’accompagnent de commentaires désagréables à propos de ce que l’homme blanc a fait aux Canadiens d’origine12. » Le fait que l’auteur ne conteste pas les informations présentées, mais qu’il se concentre plutôt sur ses sentiments heurtés, démontre le pouvoir affectif de l’exposition. Celle-ci a été conçue pour éduquer, mais aussi pour reformuler la position de sujet expérientiel des participantes et participants. Le narrateur se sent obligé de renoncer à la neutralité. Dans cet espace, il ne se considère pas seulement comme un visiteur, mais comme un « homme blanc ». Il est également conscient que la manière blanche n’est pas la seule pour faire l’expérience du pavillon, mais il ne peut pas exprimer ces autres façons. Différemment d’un rapport, d’un livre ou d’un article lu en privé par un corps qui n’est pas vu, dans ce pavillon le corps devenait un participant visible, engagé. Une section en forme de voûte en berceau présentait des portraits photographiques de personnes au travail. Dans cette salle, les colonisateurs se révèlent à eux-mêmes et aux autres comme des Blancs, membres d’une minorité. En se désignant comme « visage pâle », le visiteur se situe dans le récit des « cowboys et des Indiens » en cours à l’époque, et il en fait la critique – dans la mesure où il réalise son malaise lorsqu’il est stéréotypé selon un système binaire qui paraît absurde, maintenant qu’il en est le sujet, et non plus l’auteur. Le malaise s’est ensuite accru, du fait qu’il était exposé aux regards indigènes qui l’entouraient. Il se sent « petit ». Il ressent la pression créée par l’intention précise de l’exposition. Il représente exactement le genre de personne évoqué dans les textes : un Canadien, c’est-à-dire non-Autochtone. On peut imaginer comment les Canadiennes et Canadiens de race blanche ont pu se sentir dans cet espace, exposés au regard de personnes en provenance d’autres pays. Elles et ils se sentaient peut-être responsables, devant formuler une réaction – exprimée ou non – pour expliquer leur rapport à l’exposition, à l’occupation coloniale ininterrompue des territoires autochtones et au traitement inhumain des peuples des Premières Nations. 141
D’Indien à Indigène
Pour la majorité des Canadiennes et Canadiens, le pavillon des Indiens du Canada aura été leur premier contact avec une exposition sur les Premiers Peuples, créée par les Premiers Peuples. Le fait que les « Indiens » étaient en piteux état n’avait rien de nouveau. Plusieurs ont dû être secoués en apprenant que les « Indiens » ne s’estimaient pas responsables de leur situation critique et qu’« ils » n’étaient pas reconnaissants du cadeau de la « civilisation », mais tenaient plutôt le Canada responsable de leur décrépitude et de la perte de leurs terres et de leur culture. Certains étaient gênés par le fait que les « Indiens » du Canada déballaient le linge sale du pays lors d’une exposition internationale. Le fait que des « Indiens » avaient non seulement cette tribune officielle pour démontrer au monde le bien-fondé de leur cause, mais qu’ils l’avaient conçue d’une manière si éloquente et convaincante a également dû produire un impact. Les gens ont dû repenser leurs préconceptions sur l’intelligence, la satisfaction et les capacités « indiennes », et sur la bienveillance des colonisateurs. Le pavillon représentait un avertissement sur la complicité et la responsabilité des colonisateurs13. Le manuel imprimé à l’intention des hôtesses canadiennes de l’Expo ne montre que des femmes de race blanche, mais il y avait quatorze hôtesses indigènes, un nombre inconnu de Noires et des hôtesses de couleur14. Le fait physique de ces jeunes femmes indigènes sûres d’elles-mêmes – les nombreuses Noires, les femmes de couleur dans d’autres pavillons et les nombreux visiteurs autres que blancs – a dû en inciter plusieurs à élargir leur imaginaire quant aux couleurs et nuances de l’humanité15. Quelques Canadiennes et Canadiens minoritaires se sont peut-être aussi reconnus dans la mosaïque vivante. Dans l’imaginaire canadien de 1967, le pays se composait de deux nations fondatrices (la Grande-Bretagne et la France) nouvellement réconciliées. Plutôt que de reconnaître la participation des Premières Nations, des Inuits et des Métis au passé, au présent et à l’avenir de ces territoires – ce que le Canada commence tout juste à faire – l’Expo proposait un essai du multiculturalisme. À l’occasion du Centenaire, le scellant conceptuel reliant les fragments de la mosaïque culturelle canadienne à ces territoires n’avait pas encore pris. Les tentatives d’intégrer les Autochtones dans, ou sous, cette matrice rencontraient de la résistance. La mosaïque n’était pas simplement une métaphore : elle allait bientôt devenir une politique fédérale. D’un point de vue indigène, le multiculturalisme officiel semblait une tentative de mettre fin au statut particulier des Premiers Peuples, de remplacer les droits et la souveraineté indigènes par un statut de minorité culturelle parmi d’autres. Le multiculturalisme préférait nous voir dans l’histoire, plutôt que dans l’avenir. Il célébrait la culture « indienne » comme un écran pour dissimuler les conditions de vie des gens qui produisaient cette culture, conditions analogues à celles du tiers-monde. Le rapport Hawthorn-Tremblay (1967) exposait au grand jour la gravité de la misère16. Les Autochtones se situaient au bas de toutes les mesures de bien-être. Les pensionnats indiens existaient encore en 1967; la « rafle des années 1960 » – lorsque l’on retirait les enfants de leurs familles pour les (dé)placer dans des familles non 142
DAV I D G A R N E AU
indigènes – était en plein essor; les Métis n’étaient pas encore reconnus par la Constitution; seulement sept ans auparavant, le Canada avait accordé le droit de vote aux « Indiens » inscrits, et le Québec allait le faire un an plus tard. Les gens parlaient encore du « problème indien » et esquissaient une solution. Le Livre blanc de Trudeau et Chrétien (1969) proposait d’abolir les traités et la Loi sur les Indiens, de même que toutes les précédentes relations juridiques entre le Canada et les peuples indigènes. Ce document connut une forte opposition et contribua à stimuler le développement de l’activisme en vue des droits des Indigènes. Tel était le terrain instable sur lequel était posée la mosaïque. Myra Rutherford et Jim Millar soutiennent qu’il y a « peu d’indications que le Pavillon indien, en dépit du succès de scandale qu’il a connu, ait eu un impact durable sur l’opinion publique et les décideurs politiques17 ». Ce jugement paraît étrange. L’Expo a enregistré 50 millions de visites, et si plusieurs Canadiennes et Canadiens n’ont pas vu le pavillon en personne, elles et ils en ont entendu parler dans les médias. Le pavillon représentait clairement une étape essentielle d’un éveil de conscience plus général au sujet des peuples des Premières Nations, des Inuits et plus tard des Métis. Son radicalisme se mesure à l’intensité de l’endiguement qui allait suivre. Rogers mentionne qu’aucune autre Exposition universelle subséquente n’a offert une telle tribune relativement libre aux peuples autochtones18. Quand il s’agit des représentations des peuples indigènes, la participation canadienne aux Expositions universelles est retournée à des manifestations apolitiques, exotiques et festives. Rutherford et Millar laissent toutefois entendre que le pavillon a eu un impact réel sur les Autochtones. C’est une chose difficile à mesurer. Il n’y a pas de statistiques sur le nombre de visiteurs indigènes, mais ces chiffres ne sont probablement pas élevés. En dehors des artistes, des commissaires, des historiennes et historiens qui s’y intéressaient, l’histoire du pavillon des Indiens du Canada était pratiquement inconnue des peuples aborigènes. Ce n’est que récemment, avec la montée des commissaires, des enseignants et enseignantes en art, des historiennes et historiens de l’art et des critiques indigènes, que les artistes indigènes accèdent à la conscience publique, aux collections et au canon19. Le pavillon des Indiens du Canada était une belle blessure, une présentation des contenus et mécontentements irréconciliables des Indigènes du Canada, avec quelques-uns de leurs remèdes potentiels. Jadis ensevelies par négligence, ses significations radicales sont réécrites par les commissaires, historiennes et historiens de l’art et critiques indigènes contemporains, comme première étape vers l’obtention de territoires souverains d’exposition indigènes au sein des institutions coloniales. Les territoires souverains d’exposition indigènes sont des lieux d’exposition gérés par des Indigènes. Leurs formes les plus séparatistes sont les cérémonies qui se déroulent dans une langue autochtone, pratiquées par des Autochtones sur leur territoire. Le terme « Indigène » dénote un engagement avec d’autres Autochtones dans les discours contemporains, et avec des idées et des formes non autochtones. Les 143
D’Indien à Indigène
territoires souverains d’exposition indigènes peuvent donc prendre la forme d’interventions dans des institutions coloniales. Il est significatif que même lors d’une Exposition universelle aussi profondément coloniale que la Columbian Exposition de 1893 à Chicago, qui commémorait l’arrivée de Christophe Colomb, il y avait des moments d’agentivité, d’intervention et de résistance autochtones. Par exemple, des Inuits avaient installé un « village esquimau » juste en dehors des murs de l’exposition, « et gagné un procès pour avoir précédemment subi des pratiques déloyales de travail20 ». Emily Sanders explique : « Les Autochtones d’Amérique utilisèrent également l’exposition universelle comme une occasion de rejeter les représentations inauthentiques, et pour se représenter eux-mêmes. Simon Pokagon a récité son discours intitulé The Red Man’s Greeting lors de l’Exposition, condamnant les mauvais traitements et les perceptions erronées sur les Indiens d’Amérique. Plus tard, Pokagon entra en relation avec le maire de Chicago, qui l’aida à faire pression à Washington D.C., en dédommagement pour les terres confisquées21. » En anglais, le terme « Indigenous » désigne les Premiers Peuples de partout, en tant que collectif conscientisé, rendu possible grâce à des déplacements rapides et relativement peu coûteux, grâce aux médias électroniques et au désir, parmi les élites autochtones, de comprendre leur construction pendant le colonialisme, en comparant avec les expériences de peuples occupant une position similaire. Une personne indigène reconnaît que les Premiers Peuples sont unis par une même formation négative sous des conditions coloniales analogues et, positivement, par le partage de rapports similaires au territoire et entre eux. L’indigénéité correspond à l’activité de prise de conscience de ces faits et de leurs significations profondes. L’indigénéité, c’est le fait d’imaginer collectivement des futurs qui nous incluent en tant que personnages principaux, et non comme faisant simplement partie du paysage. Je termine par une mise en garde. Si les significations de l’être et de la production indigènes circulent principalement dans le circuit dominant et non indigène, « l’Indigène » risque de devenir une espèce d’idéologie de « l’Homme » destinée aux Aborigènes. « L’Indigène » est une abstraction, une métafiction qui conduit au cosmopolitisme si elle est prise trop à la lettre dans une seule direction. C’est-à-dire le sentiment d’être chez soi partout, plutôt que le fait d’être chez soi n’importe où. Le cosmopolitisme signifie réellement que l’on se sent chez soi seulement dans les bulles isolées qui sont réservées aux méta-personnes similaires : les hôtels, les aéroports, les galeries d’art, les musées, les universités, les colloques, l’espace du « professionnel », voire même l’espace du flâneur branché à un iPod, tout en marchant dans Paris; le lectorat du New Yorker ou de Flash Art – la bulle de l’anglais parlé dans un pays non anglophone. Si les Aborigènes commencent à s’identifier à cette invention mobile de l’élite indigène, et à se comporter comme cette élite, elles et ils risquent d’affaiblir leur identité, leurs affiliations et leurs significations fondamentales. L’artiste ou commissaire indigène n’est indigène que parce qu’il ou elle est d’abord autochtone, apparte144
DAV I D G A R N E AU
nant à un peuple et un lieu donnés. Si les artistes ou les commissaires des Premières Nations, Inuits ou Métis, sont assimilés au milieu de l’art indigène, à l’Indigène cosmopolite – plutôt qu’associés à la possibilité indigène produite par le discours indigène – elles et ils éprouveront sans doute un sentiment d’exultation, du fait d’être des radicaux libres, des petites unités mobiles et intelligentes qui se déplacent dans un circuit isolé. Une telle personne joue avec les signifiants indigènes, mais elle est coupée de leur source symbolique, vivante et informante, c’est-à-dire des gens et des lieux qui créent leur cœur dénué d’ironie. Le milieu de l’art contemporain est un système complexe, alimenté par le capital et la nouveauté, parmi d’autres forces. Ses intentions et significations sont rarement compatibles avec les visions du monde indigènes traditionnelles; toutefois, dans ce moment culturel cacophonique, presque toutes les expressions, y compris les expressions indigènes, sont permises et peuvent trouver une place (à condition que quelqu’un veuille bien la payer). Cependant, la présence indigène dans le système actuel est contingente, et non souveraine. Les artistes et les commissaires des Premières Nations, Inuits et Métis, doivent veiller à ne pas être happés par le milieu de l’art comme des particules momentanément nouvelles, facilement transportées puis remplacées par les prochaines particules nouvelles. « L’Indigène » peut emprunter une autre voie qui s’écarte du « discours de l’Homme », une voie qui n’est pas essentiellement le sujet d’un système de pouvoir mondial. Bien que nous soyons toutes et tous contenus dans ces grands systèmes, notre conscience peut s’associer aux systèmes alternatifs. Un tel savoir conduit à l’action et à la création d’un espace alternatif qui permet d’être, autrement. Notes
1 Une première version de ce texte a été présentée lors de « Revisioning the Indians of Canada Pavillion: Ahzhekewada (Let Us Look Back) », un colloque pour les commissaires, artistes, critiques, historiennes, historiens, chercheurs et chercheuses autochtones. Coproduit par ocad University et le Collectif des commissaires autochones, l’événement s’est déroulé à Toronto, les 15 et 16 octobre 2011. 2 La fête du Dominion, qui avait lieu le 1er juillet, a été rebaptisée fête du Canada en 1982. 3 La chanson était chantée sur l’air de la chanson folklorique américaine, One Little Two Little Three Little Indians, http://www.youtube.com/watch?v=18-oRTLIe3I, consultée le 24 juin 2017. Une note concernant la terminologie : en 1967, le mot « Indien » désignait ce que nous appelons aujourd’hui les peuples des Premières Nations, vivant sur les territoires du nord de l’île de la Tortue (Canada). Ce terme a parfois été employé de façon plus générique pour inclure le peuple inuit. Je l’utilise entre guillemets lorsque je fais référence à l’emploi du mot à l’époque. Dans les autres cas, j’essaie d’être plus spécifique et d’indiquer si les Premières Nations, les Inuits et/ou les Métis constituent le sujet, ou si le sujet est « indigène » d’une manière plus générale. [N.d.t. : afin de respecter les nuances souhaitées par l’auteur, les termes « indigenous », « indigeneity » et « aboriginal » sont traduits par « indigène », « indigénéité » et « aborigène ».] 4 Julianne Jennings, « The History of “Ten Little Indians”: How Did the Genocidal Nursery 145
D’Indien à Indigène
5
6 7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18 19
20
21 146
Rhyme Come About? », Indian Country Today, 11 octobre 2012. https://indiancountrymedia network.com/culture/social-issues/the-history-of-ten-little-indians/, consultée le 26 juin 2017. Kurt Jonassohn, « On a Neglected Aspect of Western Racism », site Web du Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies, 2000. https://spectrum.library.concordia.ca/979954/1/ A-MIGS__Occasional_Paper_Series__On_A_Neglected_Aspect_Of_Western_Racism.pdf. Ibid. Michael Leja, Reframing Abstract Expressionism: Subjectivity and Painting in the 1940s, New Haven (Connecticut), Yale University Press, 1993. Richard H. Pratt, Official Report of the Nineteenth Annual Conference of Charities and Correction (1892), 46-59. Réédité dans Richard H. Pratt, « The Advantages of Mingling Indians with Whites », Americanizing the American Indians: Writings by the “Friends of the Indian” 1880–1900, Cambridge (Massachusets), Harvard University Press, 1973, 260-271. http://historymatters.gmu. edu/d/4929/, consultée le 5 juillet 2017. Randal Arthur Rogers, Man and His World: an Indian, a Secretary and a Queer Child: Expo 67 and the Nation in Canada, Mémoire de maîtrise, Université Concordia, 1999, 28. Ruth Phillips et Sherry Brydon, « “Arrow of Truth”: The Indians of Canada Pavilion at Expo 67 », dans Museum Pieces: Toward the Indigenization of Canadian Museums. Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2011, 27-47. Rogers, 21. Expo 67, Toronto, T. Nelson, 1968, 118, cité par Jim Millar et Myra Rutherford, « “It’s Our Country”: First Nations’ Participation in the Indian Pavilion at Expo 67 », Journal of the Canadian Historical Association / Revue de la Société historique du Canada, vol. 17, n° 2 (2006), 160. Millar et Rutherford analysent la réception indigène autant que dominante à Expo 67, ibid. On fait rarement remarquer qu’il y avait au moins deux hôtes masculins indigènes. En outre, Rosemary Speirs a compté quatorze hôtesses autochtones : « Indians Migrating to Expo Pavilion », Canadian Press, 9 août 1967, http://expo67.ncf.ca/expo_67_news_p31.html. La politique canadienne du multiculturalisme est devenue officielle en 1971. Affaires indiennes et du Nord Canada, Étude sur les indiens contemporains du Canada. Besoins et mesures d’ordre économique, politique et éducatif : deuxième partie (Le rapport Hawthorn, octobre 1967), Gouvernement du Canada, octobre 1967. Ce rapport définit le concept des « Indiens » comme ayant des droits égaux et additionnels (des « citoyens privilégiés ») par rapport à ceux des colonisateurs canadiens. https://www.aadncaandc.gc.ca/fra/1291832488245/1291832647702, version anglaise consultée par l’auteur le 26 juin 2017. Millar et Rutherford, 148. Conversation de l’auteur avec Randal Arthur Rogers, septembre 2011. Par exemple, au cours des années 2000, l’exposition 7: Professional Native Indian Artists Inc., itinérante à travers le Canada, organisée par la MacKenzie Art Gallery et commissariée par Michelle LaVallee; la rétrospective de l’œuvre de Bob Boyer organisée par LeeAnne Martin, et les rétrospectives de l’œuvre de Daphne Odjig, Norval Morisseau, Carl Beam et Alex Janvier organisées par le Musée des beaux-arts du Canada; toutes ces expositions entrent dans l’histoire en écrivant l’histoire. Emily Sanders, « The Chicago World’s Fair and American Indian Agency », Cultural Survival, 11 février 2015. https://www.culturalsurvival.org/news/1893-chicago-worlds-fair-and-americanindian-agency. Ibid. DAV I D G A R N E AU
Réinventions numériques
Kaléidoscope II Jean-Pierre Aubé
Je me suis inspiré du pavillon Kaléidoscope, qui avait pour thématique l’homme et la couleur, une aventure en couleurs, mouvements et sons. Commandité par six sociétés de produits chimiques canadiennes (dont Chelem Limited, Cyanamid of Canada Limited, Shawinigan Chemicals Limited et Union Carbide Canada Limited), le pavillon voulait présenter une expérience abstraite au spectateur, inspirée par l’art psychédélique et la musique concrète. La commande était de montrer comment la couleur embellit nos vies, comment les avancées de l’industrie chimique ont permis l’élargissement du spectre des couleurs. Dans le programme d’Expo 67, on pouvait lire : « De nos jours, grâce aux molécules nouvelles, nous évoluons dans un monde multicolore : toutes les couleurs du spectre visible et même au-delà, se retrouvent dans les rayons des hypermarchés. » Kaléidoscope II est une installation vidéo faite à partir de produits chimiques achetés sur le deep Web, le côté obscur d’Internet : produits chimiques, drogues illicites et molécules pharmacologiques de contrefaçon, avec lesquels j’ai fait des expériences de cristallisation. Pendant plusieurs mois, j’ai fait des solutions chimiques, mélangé et dissous des produits afin de les filmer pendant leur processus de transformation. Pour pouvoir filmer les cristaux, j’ai modifié un microscope afin d’y ajouter des filtres et une caméra. J’ai adopté une technique que la science emploie afin de rendre visible la structure des cristaux. En effet, en science, on photographie à l’aide d’un éclairage polarisé des cultures de cristaux. Puisque la lumière polarisée voyage en ligne droite, elle rend visibles des couleurs qui normalement ne sont pas perceptibles par nos sens. Sous ce type d’éclairage, chaque facette d’un cristal prend une couleur vive qui se modifie en fonction de l’angle de la lumière et de sa composition. C’est en analysant les myriades de couleurs produites par les diffractions de la lumière que les scientifiques arrivent à déterminer les structures internes des cristaux et de leur matérialité. J’ai fait des centaines d’expériences de cristallisation, parfois pendant plusieurs heures, parfois seulement quelques minutes. Ci-contre Jean-Pierre Aubé, Kaléidoscope II, 1967 installation vidéographique.
Ci-dessus Jean-Pierre Aubé, Kaléidoscope II, 1967, vue de l’installation avec microscope modifié. Ci-bas Jean-Pierre Aubé, Kaléidoscope II, 2017, vue de l’installation avec ordinateurs et synthétiseur modulaire. Ci-contre Jean-Pierre Aubé, Kaléidoscope II, 2017, arrêts sur image.
L’installation est composée de 16 clips de vues de cristaux d’une durée totale de 35 minutes. De longueur variable, et diffusé dans un ordre aléatoire, les clips montrent chacun la formation de différents types de matière. Les images des cristaux sont grossies entre 40 et 100 fois; elles sont ensuite découpées et recollées, sous forme de kaléidoscope, par un logiciel. Les vidéos sont analysées en temps réel par un algorithme de reconnaissance faciale, technique moderne utilisée par les services de renseignement ou encore les réseaux sociaux de marketing. La couleur, la luminosité de même que la distribution des cristaux sont analysées par l’interface; ces informations sont ensuite envoyées à un réseau de synthétiseurs analogiques dont les paramètres sont ajustés en fonction des propriétés de l’image. À Expo 67, la trame sonore du kaléidoscope fut composée par R. Murray Schafer, compositeur et environnementaliste connu pour l’invention du terme soundscape (« paysage sonore »). Pour ma part, j’ai opté pour une sphère dystopique de l’histoire de la musique d’avant-garde, celle du thrash metal. À l’image de la musique concrète, j’ai modifié, trituré la pièce éponyme du disque de 1987 Killing Technology du groupe québécois Voivod. C’est à l’aide de la transcription musicale et de mon interface informatique que les rythmes, notes et harmoniques sont joués en fond sonore.
152
J EAN-P I E R R E AU BÉ
Ci-contre Vue du pavillon Kaléidoscope, 1967. Archives de la Ville de Montréal, VM97-Y_4P215. Ci-dessus Morley Markson, L’Homme et la Couleur, théâtre 3, pavillon Kaléidoscope, 1967. Photo : Geoffrey Winningham. Avec l’aimable permission de Gerald O’Grady.
N-Polytope: Behaviors in Light and Sound after Iannis Xenakis – MAC Version (N-Polytope : comportements en lumières et sons d’après Iannis Xenakis – Version MAC) Chris Salter
N-Polytope: Behaviors in Light and Sound after Iannis Xenakis est un environnement son et lumière spectaculaire combinant des technologies de pointe en matière d’éclairage, de son, de senseurs et d’apprentissage automatique. L’installation rend hommage aux radicaux Polytopes (du grec poly, plusieurs, et topos, espace) créés dans les années 1960-1970 par le compositeur français d’origine grecque Iannis Xenakis, dont le premier a été présenté à Expo 67 dans le pavillon de la France. Ces environnements architecturaux immersifs à grande échelle permettent d’expérimenter les motifs et les comportements indéterminés des phénomènes naturels par la dynamique temporelle de la lumière et la dynamique spatiale du son. Bien qu’ils demeurent relativement peu connus à ce jour, les Polytopes étaient fort en avance sur leur temps : un projet emblématique de l’histoire de l’art audiovisuel et de l’architecturale performative. N-Polytope est à l’origine une commande de laboral Centro de Arte y Creación Industrial à Gijón, en Espagne, créée en 2012. La présente version de l’œuvre se compose de 150 puissantes del (10 watts) et d’une multitude de petits haut-parleurs. Dans l’espace d’exposition, les éléments sont suspendus sur une « surface lignée » géométrique fabriquée de minces câbles d’aéronefs. L’environnement lumineux et sonore ainsi créé oscille constamment entre l’ordre et le désordre, faisant écho à l’œuvre originale de Xenakis et à la fascination qu’il vouait aux comportements des systèmes naturels. L’installation est actionnée par un réseau de capteurs exploitant d’innovantes technologies de l’intelligence artificielle : des techniques d’apprentissage automatique qui « apprennent » différents modèles rythmiques et spatiaux en fonction des émissions sonores et lumineuses, influant ainsi sur le déroulement général des permutations dans le temps. Ces algorithmes informatiques sont semblables à ceux utilisés par le moteur de recherche Google, les robots et les voitures sans conducteur. Ces
Ci-contre Chris Salter, N-Polytope: Behaviors in Light and Sound after Iannis Xenakis – MAC Version, 2017, vue d’installation.
Chris Salter, N-Polytope: Behaviors in Light and Sound after Iannis Xenakis – MAC Version, 2017, détail. Ci-contre Pavillon de la France, 1967. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Vieux-Montréal, Fonds Antoine Desilets, P697,S1,SS1,SSS13,D4_019. Photo : Antoine Desilets.
algorithmes d’« apprentissage par renforcement », comme on les appelle, impliquent que des « agents » informatiques interagissent avec leur environnement dans un but donné, après quoi ils sont « récompensés », de manière positive ou négative. Ainsi, les actions posées par l’agent affectent non seulement l’environnement dans le présent, mais elles peuvent également conditionner son futur. Dans N-Polytope, les agents reçoivent des informations sur l’environnement (la luminosité d’une del ou l’amplitude d’un son, par exemple) par l’entremise de capteurs-actionneurs et peuvent exécuter des actions simples. Toutefois, le milieu environnant de l’agent (et du capteur) change constamment. Il est donc difficile de prévoir les réactions de l’agent et ce qui en résultera. L’intervention est donc évolutive, car chaque action que pose l’agent peut être différente de la précédente. Grâce à ces techniques d’apprentissage automatique, l’auto-organisation des del engendre des impulsions lumineuses et des modèles changeants qui évoquent la
156
C H R I S S A LT E R
fascination de Xenakis pour les phénomènes cosmologiques, comme l’explosion d’étoiles (supernovas). En contrepoint de la scénographie visuelle pointilliste, une bande audio à canaux multiples diffusée par les petits haut-parleurs ainsi que les sons ambiants remplissent l’espace, allant de sporadiques textures naturelles à des textures électroniques denses. Le réseau de minuscules haut-parleurs disséminés à travers la structure architecturale rappelle les phénomènes sonores de masse constitués de nombreux petits éléments (grains sonores) et engendre des flux de sons infimes, tels un chant de cigales ou une nuée d’insectes. Qualifié de « sculpture électronique combinant lumière, musique et structures », le Polytope de Montréal présenté à Expo 67 était une commande du commissaire du pavillon de la France, Robert Bordaz. L’installation proposait un événement performatif consistant en une « interaction entre le son et la lumière à la grandeur de l’espace ». Elle comportait une « architecture transparente » inspirée de Naum Gabo, faite de deux cents câbles en acier gigantesques allant de vingt et un à trente mètres de long, tendus de part et d’autre de l’atrium du pavillon de la France. Divisés en cinq groupes, les faisceaux de câbles étaient équipés de « milliers de sources lumineuses »,
157
N-Polytope
Iannis Xenakis, Polytopes de Montréal, intérieur du pavillon de la France, 1967. Archives de la Ville de Montréal, VM94-EX233-055. Ci-contre, en haut Iannis Xenakis, croquis du Polytope de Montréal, signé IX, daté(19)67. Reproduction avec l’aimable permission de Pendragon Press. Ci-contre, en bas Exemple de la « partition de lumière » de Yannis Xenakis pour Polytope de Montréal, crayon de couleurs et stylo, sans date. Reproduction avec l’aimable permission de Pendragon Press.
pour reprendre les termes de Xenakis, répartis en familles de couleurs : blanc, bleu, rouge, vert et jaune. L’installation était accompagnée d’une composition orchestrale de six minutes diffusée sur quatre canaux. N-Polytope n’est en aucun cas une reconstitution des Polytopes de Xenakis, mais bien une recréation qui permet d’explorer comment les procédés probabilistes (également appelés stochastiques) qui l’ont tant passionné peuvent être interprétés et actualisés à l’aide de technologies qu’il n’a pas connues au cours de sa vie. N-Polytope est donc une réponse artistique à l’intérêt de Xenakis, il y a plus de 50 ans, pour la modélisation des comportements de la nature et du cosmos, et pour leurs fluctuations exquises entre l’ordre et le désordre, qui résonne encore puissamment en cette époque d’instabilité extrême des systèmes naturels et artificiels.
158
C H R I S S A LT E R
Montréal délire Stéphane Gilot
Selon [Robert] Altman, le film Quintet se déroule « probablement dans l’avenir, ou encore dans un présent situé dans un monde parallèle. C’est comme s’il existait une planète miroir à la nôtre – une planète sur laquelle la vie s’est développée de manière à peu près semblable à la nôtre. Ce n’est pas une culture connue1 ».
Expo 67, plus qu’un fantôme sémiotique Pour l’exposition À la recherche d’Expo 67, je propose une œuvre qui agit comme un minipavillon : un atelier et son programme de mise en pratique; une microcommunauté temporaire qui aborde l’Exposition universelle de 1967 en tant qu’« existant en réserve ». Ce monde parallèle et hétérogène, ce laboratoire d’idées n’a malheureusement pas vraiment été « exporté » sur la Ville de Montréal. Plus qu’un fantôme sémiotique, l’Exposition universelle de 1967 et son énorme potentiel de formes et d’approches alternatives peuvent donc être revisités à travers la plateforme de jeu de construction Minecraft. Plusieurs raisons motivent ce choix : la géométrie (le cube et le vecteur), la liberté de création partageable (code de programmation ouvert) et la notion de « ressource » (limitée ou illimitée). Ce pavillon se compose de plusieurs éléments : trois postes informatiques donnant accès à un serveur qui présente une reconstitution d’Expo 67 à l’aide du médium Minecraft (à la plasticité contraignante); une projection vidéo qui présente des images filmées dans cette Expo 67 virtuelle; une table pentagonale qui réfère au film Quintet; et une série de dessins.
Ci-contre, haut Stéphane Gilot, Montréal délire, 2017, vue d’installation. Ci-contre, bas Stéphane Gilot, Montréal délire (L’Écume des îles), 2017.
Projection vidéo La projection combine un enregistrement vidéo d’Expo 67 virtuelle et des images d’archives d’Expo 67 mettant en évidence l’omniprésence du cube et de la grille dans les dispositifs d’exposition de l’époque. Les séquences Minecraft permettent de suivre un personnage vêtu d’une combinaison jaune qui renvoie à mon diptyque vidéo composé de 3 Frontières, 2006, et de Dernier Baiser, 2008, mettant en scène un personnage vêtu d’une combinaison spatiale qui a pour mission d’explorer des sites patrimoniaux – des lieux de création et de partage du savoir. Dans la reconstitution Minecraft d’Expo 67, le personnage exécute un vol au-dessus des îles Notre-Dame et Sainte-Hélène reconstituées, circule ensuite sur le Minirail et déambule enfin dans la sphère de Buckminster Fuller. La bande-son est constituée de sons produits par l’usage du Minirail et d’extraits musicaux de Iannis Xenakis et de Gilles Tremblay – les compositeurs ayant créé des œuvres pour le pavillon de la France et le pavillon du Québec. Quintet Le film Quintet, 1979, de Robert Altman – tourné sur le site d’Expo 67 – présente un futur post-apocalyptique dont l’ordre social est maintenu par un jeu basé sur le pentagone – celui-ci est le dispositif de contrôle central établi par un gouvernementcasino (un peu comme dans le récit La Loterie à Babylone, de J. L. Borges). Le lien avec le sort du pavillon du Québec est frappant : sa grande qualité d’origine implique une charge politique et éthique encore vive, principalement due à sa défiguration architecturale et programmatique par sa transformation ultérieure en casino. Dessins Ceux préparés pour l’exposition font partie d’une série de dessins et d’aquarelles qui convoquent la modélisation dans toute sa variété : depuis les vues aériennes imaginaires de la peinture de la Renaissance jusqu’aux espaces virtuels en ligne, en passant par la prospective architecturale des avant-gardes du XXe siècle. Dans ma pratique, le dessin et l’aquarelle permettent également – dans diverses séries – de développer d’autres territoires thématiques liés principalement à divers phénomènes de visions (hallucinations, états de conscience altérés, rêves, anticipations urbanistiques, etc.); à des théories ou à des techniques frappées de désuétude (optogramme, spirit photography, par exemple) ainsi qu’à des reconstructions mnémoniques (souvenir, déjà-vu, etc.). En arrière-plan de ce plaisir du dessin s’articule un regard sur les relations entre les représentations du monde et les structures de croyance qui façonnent nos sociétés.
162
S T É P H A N E G I LO T
Ci-haut et ci-bas Stéphane Gilot, Montréal délire, 2017, détails, plateforme de jeu vidéo Minecraft.
Géométrie Deux approches formelles me fascinent dans les documents d’Expo 67 : l’architecture faite de triangulations (similaires au design vectoriel) et l’omniprésence du cube (principalement dans les disposifs-écrans, mais également dans certaines organisations spatiales de lieux publics ou d’expositions). Le plus remarquable, à ce sujet, est le concept organisationnel et programmatique du pavillon du Québec. Celui-ci était entièrement basé sur l’usage de cubes de deux pieds de côté. Les éléments de décor principaux, mettant en valeur la domestication du territoire, comme « la mine », « l’arbre », « l’eau », évoquent de façon troublante l’esthétique de la plateforme de jeu Minecraft. Cubes et ressources Le jeu Minecraft met en scène un monde qui s’autogénère à l’infini et est basé sur le partage et le développement par les joueurs (code ouvert). En adoptant le cube comme « cellule » de base, le jeu permet un emboîtement et des constructions / déconstructions infinies. À sa façon, le jeu répond à l’idéologie dominante de la plusvalue sans fin, du développement de type « monde vide » sur une planète au bord de l’épuisement, à la virtualisation du commerce et à la surconsommation, à l’accroissement éhonté des inégalités. Paradoxe du cube Au milieu des années 1980, l’évolution des jeux sur ordinateur a vu le pixel remplacer le vecteur pourtant plus élégant et formellement plus riche. L’une des gageures paradoxales de ce projet est de promouvoir les formes vectorielles de l’architecture mise en exergue à Expo 67 (triangulations, structures de trame spatiale en acier, etc.) en utilisant le jeu Minecraft qui mise sur l’esthétique et la structure volontairement simplifiée du cube. « “Le futur” n’existe pas mais des futurs insistent : ce sont les futurs du passé, des rétro-futurs. Formés par d’autres temps que le nôtre, ils s’étendent jusqu’à nous comme des bancs de brume hantant nos projets et nos rêves, menant une vie sourde mais effective au cœur du présent qui se fait. Oui, les vrais futurs sont ces futurs virtuels2 ». Notes
1 Charles Mechner, Robert Altman: Interviews, David Sterritt (dir.), Jackson, University Press of Mississippi, 2000, 2. 2 Alain Bublex et Elie During, The Future Does Not Exist: Retrotypes, Paris, Éditions B42, 2014.
164
S T É P H A N E G I LO T
Le Huitième Jour, 1967-2017 Emmanuelle Léonard
En 1967 avait lieu à Montréal Expo 67. Constitué de pavillons nationaux et thématiques, cet événement fut la scène d’innovations technologiques, de l’aérospatiale au cinéma à écrans multiples. On y trouvait trois pavillons religieux, dont le pavillon Chrétien réalisé par l’artiste québécois Charles Gagnon. Commandité par huit différentes églises (catholique, anglicane, grecque orthodoxe, etc.), un consensus fut trouvé, qui évacuait le prosélytisme et les représentations religieuses classiques. Gagnon présenta des photographies et un film de 13 minutes, Le Huitième Jour, qui dresse le portrait du siècle à travers l’évolution des technologies de guerre, par le biais d’images d’archives produites par les médias et les États. Mon projet consiste en la création d’une installation vidéo en deux projections juxtaposées, faites d’archives témoignant de conflits de 1967 à 2017. Les documents proviennent de différentes sources diffusées sur Internet : archives télévisuelles, étatiques ou militaires, autopromotions de guérillas ou témoignages de leurs actions, propagande des divers camps. J’ai retenu des activités quotidiennes : extraits de marches, de courses, de camps, d’attentes, évitant les cadavres. On y trouve des conflits moins célèbres (pas exclusivement), qui témoignent fréquemment de la précarité de la vie quotidienne de combattants disposant de moyens peu sophistiqués. La trame narrative suit le développement technologique de l’image plutôt que celui des armes. Ainsi, on passe de l’analogique à la vidéo, du numérique en hd à la captation par le téléphone cellulaire. On constate l’émergence de nouveaux points de vue : drones, captations par infrarouge, visions nocturnes, tout comme la perspective de soldats par le biais de la caméra dont sont munis leurs casques. La qualité des images est liée au chemin qu’elles parcourent : maintes fois repiquées, mal mises en ligne ou habilement traitées par des professionnels. L’association des deux écrans se fait par des jeux de répétition, d’écho ou de contraste, et la bande sonore y participe. Une double projection qui permet aussi des vues simultanées, comme pour la guerre de Yougoslavie documentée par les multiples camps, dont les soldats de l’onu, en témoins immobiles. Les discours
Ci-dessus Emmanuelle Léonard, Le Huitième Jour, 1967-2017, 2017, projection vidéo montrant la République d’Irak, années 1990.
de protagonistes qui s’adressent directement à la caméra sont traduits de l’arménien, du tchétchène, de l’afrikaans, du hmong et de l’espagnol. La diffusion Web vient donner un point de chute à ces séquences. Les auteurs sont nombreux : témoins, partisans, combattants ou militaires. La simplicité et l’accessibilité offertes par de nouveaux dispositifs de captation entraînent une pléthore d’images. Cette évolution de l’image dépasse la seule question technologique, elle implique de nouveaux auteurs et spectateurs. Si, à l’époque de Charles Gagnon, ces sources étaient identifiables et relativement peu nombreuses, leur foisonnement actuel correspond-il à une plus grande lisibilité des conflits? De la vision d’un combattant fatigué à celle d’un drone, ces acteurs sont devenus réalisateurs, mais l’histoire qu’ils racontent n’est pas la même.
166
EMMANUELLE LÉONARD
Lieux des conflits par ordre d’apparition République d’Irak, 2008 République d’Irak, années 2010 République d’Irak, années 2000 République islamique d’Afghanistan, 2009 République islamique d’Afghanistan, 2013 République d’Irak, 2014 République d’Arménie et République d’Azerbaïdjan, années 2000 République d’Arménie et République d’Azerbaïdjan, 1994 République du Tadjikistan, années 1990 République moldave du Dniestr, années 1990 République tchétchène, 1999 République démocratique populaire du Laos, années 2000 République de l’Inde, années 2000 République démocratique fédérale du Népal, 2004 Bosnie-Herzégovine, 1992 République tchétchène, 1995
Bosnie-Herzégovine, 1995 République du Pérou et République d’Équateur, 1995 République du Pérou, années 1990 République du Salvador, années 1980 République du Nicaragua, 1979 République d’Afrique du Sud et République d’Angola, 1988 République du Tchad et État de Libye, années 1970-1980 République démocratique du Congo, 2014 République d’Ouganda, années 1980 République d’Angola, 1975 République d’Ouganda et République unie de Tanzanie, 1978 État d’Israël et République arabe d’Égypte, 1967 Union des républiques socialistes soviétiques, 1990 Union des républiques socialistes soviétiques, 1967 Province du Québec, 1967
Page précédente Emmanuelle Léonard, Le Huitième Jour, 1967-2017, 2017, arrêts sur image montrant de haut en bas : République du Nicaragua, 1979; République du Tchad et État de Libye, années 1970 et 1980; et République démocratique du Congo, 2014; et République démocratique populaire du Laos, années 2000.
168
EMMANUELLE LÉONARD
Remix d’archives
Reprise Dave Ritter et Kathleen Ritter
A ditto, ditto device. '' '' '' '' A ditto, ditto device. '' '' '' '' A ditto, ditto device1 '' '' '' ''
Nos parents se sont rencontrés en 1967 et se sont mariés la même année. Nous ne sommes nés qu’au cours de la décennie suivante. Nous avons appris qu’ils n’ont jamais visité Expo 67, mais ils étaient sûrement à l’écoute. Nous les imaginons en train d’écouter tous ces sons qui étaient transmis sur les ondes à l’époque. L’esprit d’Expo 67 – un mélange de futurisme spéculatif et d’angoisse inspiré par les nouvelles technologies – est parvenu à leurs oreilles sous différentes formes, allant de la musique électronique expérimentale au reggae en passant par la musique lounge. L’Expo a entraîné une explosion de la production sonore qu’on ne pouvait pas ignorer. À la fin des années 1960, les profonds bouleversements sociaux et politiques se reflètent dans les différentes formes musicales qui émergent. Dans le domaine de la musique électronique en particulier, de nouvelles approches de composition, aussi bien structurées que conceptuelles, aléatoires ou créées sous l’influence de drogues, témoignent d’une fascination croissante pour la création sonore à l’aide de procédés technologiques. La célèbre phrase de John Cage « tout est musique » devient le mantra d’une génération de compositeurs et de musiciens. L’expérimentation radicale est la norme, et les limites de ce qui est considéré comme de la « musique » finissent par tout inclure.
Ci-contre Dave Ritter et Kathleen Ritter, Reprise, 2017, installation sonore.
Dave Ritter et Kathleen Ritter, Reprise, 2017, détail.
Nous avons amorcé notre recherche en examinant d’abord l’état de la musique électronique à la fin des années 1960, car cette décennie fondamentale augure la montée de la culture des DJ, du hip-hop et du remixage. Nous avons été frappés par l’enthousiasme avec lequel les musiciens présentaient au grand public de nouvelles techniques comme l’échantillonnage et de nouveaux instruments comme le synthétiseur. Entre autres exemples notables, mentionnons l’approche conceptuelle du son électronique de Delia Derbyshire, l’utilisation de voix enregistrées et de procédés de déphasage et de répétition de Steve Reich, l’instrumentalisation d’extraits de films et de bandes enregistrées de Daphne Oram, et les superpositions de voix de Glenn Gould. En outre, la disponibilité commerciale d’instruments qui manipulaient les signaux électriques pour produire des sons, comme le thérémine, les premiers échantillonneurs analogiques, comme le mellotron, et les synthétiseurs modulaires, comme ceux produits par Moog, a alimenté la demande pour une bande sonore distincte qui refléterait l’obsession généralisée pour les nouvelles technologies, les réalités alternatives, l’exploration spatiale et le futur. Plusieurs événements importants se déroulent précisément en 1967. Le mellotron s’impose dans la musique populaire avec la sortie de la chanson Strawberry Fields Forever, des Beatles. C’est en 1967 que Steve Reich enregistre Piano Phase, une pièce conceptuelle où deux pianistes jouent à répétition une figure mélodique de douze notes synchronisées par intermittence, dans l’esprit de ses expérimentations sonores
172
D A V E R I T T E R E T K AT H L E E N R I T T E R
antérieures faisant appel au déphasage de paroles empruntées. C’est également l’année où Glenn Gould réalise The Idea of North, un documentaire radiophonique d’une heure où il met de l’avant sa technique originale consistant à faire jouer la voix d’au moins deux personnes simultanément, ce qu’il appellera « contrapuntal radio » [radio contrapuntique2]. Enfin, 1967 est l’année où Marshall McLuhan publie The Medium Is the Massage, en collaboration avec Quentin Fiore, dans lequel figurent les aphorismes et répétitions qui ont fait la marque de McLuhan, accompagnés d’images empruntées formant un genre d’« échantillonnage » littéraire semblable à ce qui se faisait du côté de la musique et des films expérimentaux. Et ce ne sont là que quelques exemples; 1967 est indubitablement l’année où la musique électronique – telle que nous la connaissons aujourd’hui – prend forme. Au moment de l’ouverture d’Expo 67 à Montréal cet été-là, les îles sont branchées sur l’électrique. La pièce électroacoustique composée de sons enregistrés un peu partout dans la province Centre Élan, de Gilles Tremblay, est diffusée dans le pavillon du Québec. Les compositions sculpturales sonores du collectif Fusion des arts, dont un programme musical intitulé Les Mécaniques, sont présentées dans le pavillon de la Jeunesse. Dans le pavillon des Jeunesses musicales, Hugh Le Caine propose son générateur de structures sonores sérielles, un précurseur du séquenceur moderne.
Matériel de recherche, Reprise, 2017.
173
Reprise
Recto et verso de la pochette de l’album Reprise.
Et Otto Joachim présente Katimavik, une œuvre expérimentale sur bande à quatre pistes commandée par le pavillon du Canada. Hors des îles, une industrie artisanale germe autour d’Expo 67, avec des disques souvenirs tels que Sounds of Expo 67, des 45 tours populaires comme Quand tu viendras à Montréal de Pierre Lalonde et des succès radiophoniques comme Un jour, un jour de Stéphane Venne, qui diffuse l’esprit de l’Expo à travers le monde. Ces œuvres témoignent de la nouvelle sonorité de l’époque. Réécouter ces pièces musicales cinquante ans plus tard a suscité une réflexion. Le collage d’éléments visuels et auditifs d’une grande variété de sources dans les pièces cinématographiques et musicales d’Expo 67 anticipe à bien des égards l’ambition encyclopédique et mondiale d’Internet. D’ailleurs, Internet a largement contribué à nos recherches. Notre processus était simple : nous avons commencé par amasser et partager du matériel. Nous échangions sur ce que nous écoutions. Puis, nous procédions
174
D A V E R I T T E R E T K AT H L E E N R I T T E R
à l’échantillonnage de ces sources pour ensuite réaliser des arrangements musicaux en y travaillant tour à tour jusqu’à ce que les compositions nous semblent capter de manière ludique l’esprit sonore d’Expo 67, mais avec un rythme plus rapide et plus de densité. Cet album est le résultat de notre collaboration – une reprise de la musique électronique créée autour de 1967. Notes
1 Marshall McLuhan et Quentin Fiore, The Medium Is the Massage: An Inventory of Effects, New York, Bantam Books, 1967, 123. Il existe une version française de cet ouvrage : Message et massage : un inventaire des effets, Paris, J. J. Pauvert, 1968. [N.d.T.]. 2 Le terme contrapuntique s’applique normalement aux compositions dans lesquelles des lignes mélodiques indépendantes jouent simultanément. Ce genre de musique, exemplifié par J. S. Bach, constitue une partie importante du répertoire de Gould.
175
Reprise
Ci-dessus et ci-contre Notes explicatives de Reprise.
By the Time We Got to Expo (Lorsque nous sommes arrivés à l’Expo) Philip Hoffman et Eva Kolcze
By the Time We Got to Expo est un voyage cinétique au sein d’Expo 67 qui revisite le centenaire du Canada à travers les symboles, les chorégraphies et les environnements bâtis de l’Exposition universelle ainsi que sa construction de l’(inter)nationalisme. En manipulant des images d’archives, le film crée de vibrantes collisions de textures et de formes qui permettent de sonder les surfaces, les idéologies et la portée de ce « lieu de rencontre » qu’a été Expo 67. Le film propose une analyse contemporaine des représentations passées et des rituels du nationalisme. Le slogan officiel d’Expo 67, « Terre des Hommes », était un message passablement fort et dominant. Le mouvement fluide du Minirail nous permet de voir le train et les points de vue qu’il offre. Le spectateur effectue la « visite d’un monde merveilleux », ce qui rappelle que le train et la caméra ont fait équipe tout au long de l’histoire du cinéma pour prolonger le regard du touriste. Expo 67 célébrait la Confédération canadienne, le moment où les colonies anglaises (aujourd’hui les provinces) se sont réunies pour former un pays. Une des composantes centrales du pavillon du Canada s’appelait le Katimavik, un mot inuit qui signifie « lieu de rencontre ». L’architecte Rod Robbie s’est inspiré d’un cendrier de verre qui se trouvait dans son bureau pour créer ce pavillon en forme de pyramide inversée. Durant la décennie où s’est déroulée Expo 67, une série d’atrocités ont été perpétrées contre les peuples autochtones, dont la rafle des années 1960 où quelque 20 000 enfants des Premières Nations, métis et inuits ont été arrachés à leurs familles et mis en adoption ou placés en famille d’accueil. Les deux films d’époque qui ont servi de source à By the Time We Got to Expo (Expo 67, de Castle Films, et Objectifs : Expo 67, de l’Office national du film du Canada) affichent un ton optimiste et enjoué. Tourné en couleurs, Objectif : Expo 67 nous emmène en Minirail à la découverte des différents pavillons aux structures
Ci-contre Philip Hoffman et Eva Kolcze, By the Time We Got to Expo, 2015, projection vidéographique.
Philip Hoffman et Eva Kolcze, By the Time We Got to Expo, 2015, arrêt sur image.
géométriques soigneusement conçues. Expo 67 réduit le monde entier à un terrain de jeu miniature où l’on fait abstraction de tout enjeu, conflit et tension politiques. Par la manipulation photochimique et numérique d’images tirées des deux films ainsi qu’une bande sonore analogique inusitée de Josh Bonnetta, créée à partir d’éléments optiques des films d’archives originaux, nous avons tenté de « faire de l’étrange avec du familier », tout en amenant dans le présent ces images qui remontent à une cinquantaine d’années. En faisant appel à la répétition et à la remédiation, le film dévoile ce que dissimulaient le faste et les cérémonies. Les images sont transformées grâce au procédé de rephotographie des pellicules originales sur du celluloïd en noir et blanc traité à la main. L’inversion des couleurs et le rendu des images en négatif réduit les personnes à des formes ou à des masses fantomatiques. Les images en noir et blanc sont lavées avec des couleurs franches. Certaines séquences sont teintées en rouge, en bleu et en jaune. La coloration à la main des images permet d’en transformer le sens et le contexte original tout en leur conférant profondeur et texture.
180
P H I L I P H O F F M A N E T E V A K O LC Z E
Couverture du boîter Castle Films, le film souvenir en 8 mm d’Expo 67.
Dans la dernière partie du film, les images montrant les pavillons sont altérées par mordançage. L’utilisation d’un décolorant photochimique fait décoller l’émulsion et entraîne la formation de bulles. Les images aujourd’hui familières d’Expo 67 deviennent liquides et instables. L’émulsion qui se détache de la pellicule et se replie sur elle-même nous rappelle le caractère artificiel du faste des Expositions universelles et comment ces concepts peuvent être envisagés sous un angle actuel.
181
By the Time We Got to Expo
Ci-dessus et pages suivantes Jacqueline Hoàng Nguyê˜n, 1967: A People Kind of Place, 2012, projection vidéographique.
1967: A People Kind of Place (1967 : une place pour le monde) Jacqueline Hoàng Nguyê˜n
Le 3 juin 1967, la première plateforme d’atterrissage du monde destinée aux objets volants non identifiés était inaugurée à Saint-Paul, une petite ville d’Alberta surnommée « The Centennial Star » en raison du nombre, de la qualité et de l’originalité des activités qui y ont été organisées par le comité du Centenaire à Ottawa. La station de débarquement symbolise le désir de préserver l’espace des guerres humaines. Sur un panneau près du site, on peut encore lire : « La zone sous la première plateforme mondiale d’atterrissage pour ovnis a été déclarée internationale par la Ville de SaintPaul en tant que symbole de notre conviction que l’humanité gardera l’univers intersidéral exempt de guerres et de conflits. Que les futurs voyages dans l’espace soient sûrs pour tous les êtres intergalactiques, et que tous les visiteurs de la Terre et d’ailleurs soient les bienvenus sur ce territoire et dans la ville de Saint-Paul. » Le discours d’inauguration de l’ancien ministre de la Défense nationale Paul Hellyer, qui a dévoilé officiellement le monument, se trouve à Bibliothèque et Archives Canada à Ottawa. Durant le processus de réalisation de Space Fiction & the Archives – dont le film 1967: A People Kind of Place – j’ai effectué trois visites à Saint-Paul : deux premiers séjours à l’été 2010 et un troisième à l’hiver 2011. J’ai alors pris contact avec les principaux artisans de la construction de l’aire d’atterrissage d’ovnis. J’ai interviewé des habitants de la région afin d’amasser une multitude de points de vue divergents et subjectifs. J’ai eu l’unique occasion de parler avec un grand nombre de personnes : Roland Rocque, ancien membre de la chambre de commerce de Saint-Paul, qui a bien voulu partager ses archives personnelles avec moi, dont un album souvenir, des albums photo et des films Super 8 en lien avec les activités locales qui ont été organisées à l’époque; Jim Moroney, fondateur de l’Alberta ufo, qui a confirmé qu’aucun signalement n’a été enregistré dans la région au cours des années précédant les célébrations du centenaire; Margo Lagasse, qui a eu l’idée du projet un soir en soupant avec son mari John Lagasse, membre de la chambre de commerce, et ses collègues; et enfin, Fernand Belzil, spécialiste local de la mutilation de bétail.
Jacqueline Hoàng Nguyê˜n, 1967: A People Kind of Place, 2012, arrêt sur image.
J’ai aussi mené des recherches approfondies dans les archives du Musée historique de Saint-Paul, où j’ai consulté, entre autres, le St. Paul Journal, un hebdomadaire qui rapporte la vie de la communauté depuis 1924. Mes recherches se sont également étendues à la William C. Wonders Map Collection de l’Université de l’Alberta à Edmonton, à Bibliothèque et Archives Canada à Ottawa, aux archives de la Société Radio-Canada à Toronto et à l’Office national du film du Canada à Montréal. La ville de Saint-Paul, anciennement Saint-Paul-des-Métis, a été fondée en 1895 par le père Albert Lacombe, chargé par le gouvernement fédéral de fonder une colonie agricole pour les Métis. Cette présence stratégique de l’Église catholique romaine dans la région visait à freiner la prolifération des colons protestants. Peu après l’« échec programmé » de l’établissement d’une communauté autochtone, les terres de la région ont été offertes en concession, en particulier à des colons canadiensfrançais. Aujourd’hui, Saint-Paul est une ville bilingue qui comprend des communautés autochtones, celles-ci demeurant toutefois en marge de la vie civique. Le mot
186
J A C Q U E L I N E H O À N G N G U Y ʘ N
« Métis » dans le nom de la ville a été abandonné, tout comme les Métis eux-mêmes. Une des personnes que j’ai interviewées, Melanie Desjardins (née Janvier), survivante du pensionnat Blue Quills à Saint-Paul, a généreusement partagé son expérience des célébrations du Centenaire. Elle rapporte que des élèves devaient jouer une pièce intitulée Hello World, dont le texte avait été écrit par les prêtres et les religieuses de l’école. Desjardins raconte : « [les élèves] devaient décrire les différentes nationalités [de Saint-Paul]. Il y avait un groupe de Français, un groupe d’Ukrainiens et même un groupe d’Irlandais. Je crois que nous étions les Mexicains. Des Autochtones? Non, et je ne me souviens pas de Métis non plus. » Cela illustre bien ce qu’ont pu ressentir certaines personnes pour qui les célébrations du Centenaire du Canada évoquaient l’effacement plus que l’unité. Dans cette œuvre, la politique d’immigration et le modernisme architectural sont abordés à travers le prisme analytique qu’offrent les progrès culturels et technologiques de l’ère spatiale. Grâce au rapprochement de ces champs variés, mon projet propose une vision nuancée de l’élaboration des politiques, de l’accueil inconditionnel et de l’Autre, soit l’extraterrestre en route vers la Terre. Autrement dit, la plateforme d’atterrissage d’ovnis sert de vaisseau conceptuel grâce auquel il est possible d’analyser l’émergence du multiculturalisme en tant que politique nationale. Une question demeure toutefois : au service de qui le multiculturalisme devrait-il être pour ne pas perpétuer l’histoire coloniale? Et comment l’aire d’atterrissage d’ovnis peut-elle nous aider à penser la diversité autrement?
187
1967: A People Kind of Place
Ci-dessus Caroline Martel, Spectacles du monde, 2017, installation vidéographique à 35 canaux, section montrant Kinoautomat. Ci-bas Caroline Martel, Spectacles du monde, 2017, installation vidéographique à 35 canaux, section montrant We Are Young!
Spectacles du monde : Expo 67 comme parc d’attractions optiques Caroline Martel, en collaboration avec Mathieu Bouchard-Malo
L’installation Spectacles du monde fut l’occasion de transposer ma pratique artistique documentaire dans une dynamique multiécran radicale. Recherche approfondie et appliquée d’œuvres de cinéma élargi d’Expo 67, elle m’a aussi permis d’expérimenter des techniques de montage pour un dispositif en lui-même spectaculaire. Afin de s’approprier 35 écrans d’un lieu public passant, nous avons vite saisi, mon collaborateur-monteur Mathieu Bouchard-Malo et moi, qu’il faudrait tenter de faire parler les images de manière à la fois graphique et impressionniste, voire impressionnante. Si une installation entièrement composée d’archives était une première sur la mosaïque d’écrans de l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts, ce l’était également pour moi d’intégrer des images historiques de sources et de standards multiples dans une interface numérique à la fois très paramétrée et aux possibilités infinies. Comme artiste documentaire, ma démarche consiste à investir des sujets et des objets déjà existants de façon à développer des manières de les révéler – dans mon approche et mon appropriation du médium – qui s’en inspirent et qui leur soient, d’une certaine manière, fidèles. Cela comporte d’abord une dimension de recherche et un temps de fréquentation du matériel conséquents. Loin d’une recherchiste entrant des mots-clés dans des bases de données pour trouver, j’ai plutôt cherché à comprendre comment Expo 67 avait été vue, documentée puis archivée en parcourant les milliers d’entrées d’archives une à une. J’ai cherché à rester à sa recherche. Ainsi, pour Spectacles du monde, c’est près de 4 000 fiches qui ont été consultées auprès de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Bibliothèque et Archives Canada, au Centre d’histoire de Montréal et à la Société Radio-Canada; plusieurs journées de visionnements pendant lesquelles – qu’on me pardonne le cliché – j’ai eu le sentiment de voyager dans le temps. Or plus j’étais imprégnée par les images de l’Exposition universelle de Montréal, plus celles-ci me semblaient loin d’être passées. Plutôt que de se donner comme nostalgiques, anciennes ou kitsch, elles apparaissaient au contraire d’une grande nouveauté. Elles révélaient une incroyable modernité.
Caroline Martel, Spectacles du monde, 2017. Vue d’installation, section montrant La Création du monde. Ci-contre Caroline Martel, Spectacles du monde, 2017. Vue d’installation, section montrant Le Huitième Jour.
Les sept œuvres multiécrans, multimédias, de montage et d’installations cinétiques que nous revisitions se sont avérées en elles-mêmes une influence première qui allait nous guider dans la réalisation de l’installation. Les artistes que nous avons cités avaient en effet réussi à faire des choses épatantes avec des moyens analogiques linéaires en portant une attention particulière à l’esprit derrière les images qu’ils employaient, au rôle qu’ils donneraient aux spectateurs et aux espaces d’expérience qu’ils allaient créer. D’entrée de jeu, mon intention était aussi de faire ressentir au spectateur comment le dispositif même de la mosaïque de la Place des Arts puisait ses racines dans les innovations de l’Exposition universelle de Montréal. Ces œuvres audiovisuelles et médiatiques nous invitaient à revisiter Expo 67 comme un « parc d’attractions optiques1 ». Les tournants qu’a pris notre réflexion sont venus d’une perpétuelle confrontation avec cette forme d’installation de montage à écrans multiples. Comment départager réalisation et montage – concrètement dans le travail, mais aussi en songeant à qui en est considéré comme l’auteur? Comment élaborer une chorégraphie visuelle afin que
190
C A R O L I N E M A R T E L A V E C M AT H I E U B O U C H A R D - M A LO
Caroline Martel, Spectacles du monde, 2017. Vue d’installation, section montrant La Création du monde.
notre mosaïque attire les regards de loin comme de près et transforme les passants en spectateurs? Comment montrer des films déjà multiécrans dans les fenêtres multiples de notre installation? Comment les « remédier » tout en les historicisant? Comme mon approche artistique se revendique davantage du documentaire que des formes de montage d’appropriation (remix, mash-up, etc.), la question essentielle qui s’imposait dans nos choix était : qu’est-ce que le dispositif de la mosaïque peut apporter à la redécouverte des œuvres revisitées? Le fait que la plupart de celles-ci avaient été créées in situ et/ou conçues pour des agencements d’écrans uniques et provisoires, faisait qu’il serait impossible de toute façon, pour la plupart, de les restituer dans leur expérience originale. Mais encore, on s’est demandé : comment se servir de l’interface de la mosaïque comme révélateur? Quelle relecture provoque-t-on exactement avec 35 écrans? Spectacles du monde devenait un prisme, comme un kaléidoscope multipliant et diffractant les images. À son tour, par ailleurs, conçue spécifiquement pour l’interface multiécran de la Place des Arts, elle deviendrait tôt ou tard une œuvre éphémère qu’il serait impossible de revoir dans sa configuration d’origine.
192
C A R O L I N E M A R T E L A V E C M AT H I E U B O U C H A R D - M A LO
Dans le matériel d’archives d’il y a un demi-siècle, on évoque comment, dorénavant, les spectateurs pourront s’immerger davantage dans les œuvres en faisant leurs propres montages à partir de plusieurs écrans ou en intervenant sur leur déroulement. Ce matériel nous a aussi permis de réaliser à quel point, au fond, le renouveau du rapport à l’image est passé alors par la participation accrue des gens à la multiplication des Spectacles du monde par l’intermédiaire des caméras légères émergeant à l’époque. Nouveaux modes narratifs, interactivité, environnements immersifs, abondance des photos et des images en mouvement … 1967, vous dites? J’espère que les passants de la Place des Arts ont eu plaisir à s’imprégner de notre installation pour conjuguer au passé-présent-futur toutes ces images multiples et multipliées. Les sept œuvres de cinéma élargi et d’installations cinétiques revisitées dans Spectacles du monde sont : La Création du monde, le diapolyécran d’Emil Radok présenté avec ses 15 000 diapositives au pavillon de la Tchécoslovaquie; Ripples, court-métrage expérimental de Jim Henson projetant ses images multipliées sur une musique de Raymond Scott, soumis au concours Terre des Hommes organisé par le Festival international du film de Montréal à l’Expo-Théâtre; Le Huitième Jour, le film de montage de Charles Gagnon conçu audacieusement pour le pavillon Chrétien; KinoAutomat, film interactif et performance théâtrale/technologique de Radúz Cˇincˇera, qui a fait les belles heures du « très audiovisuel » pavillon de la Tchécoslovaquie; We Are Young!, l’étonnante œuvre multiécran de Francis Thompson et Alexander Hammid projetée au pavillon Canadien Pacifique-Cominco; Percorso/ Plurimo/Luce, mystérieuse installation cinétique d’Emilio Vedova montrée sur une musique originale de Marino Zuccheri dans le pavillon de l’Italie; Citérama, l’installation multimédia pionnière de Jacques Languirand et ses acolytes créée dans le pavillon thématique L’Homme dans la Cité. Note
1 Judith Shatnoff, « Expo 67: A Multiple Vision », Film Quarterly, 21, no 1 (automne 1967), 2, cité dans Expo 67: Not Just a Souvenir, édité par Rhona Richman Kenneally et Johanne Sloan, Toronto, University of Toronto Press, 2010, 14 (note 31).
193
Spectacles du monde
Expo 67 et l’archive manquante, l’anarchive et l’anti-archive Janine Marchessault
Que faut-il penser du fait que plusieurs des plus audacieuses expérimentations filmiques et médiatiques au Canada ont été perdues, lorsqu’Expo 1967, souvent caractérisée comme une célébration des médias, s’est terminée le 29 octobre 19671? Comme l’a souligné Michel Foucault, il ne faut pas perdre de vue que l’archive documente les modes de pensée d’époques données, que c’est une mémoire de ce qui peut être dit et pensé en certains lieux, à certaines périodes2. Dans une certaine mesure, les films et les œuvres médiatiques qui ont disparu de l’Exposition universelle de Montréal sont le produit d’une certaine façon de penser les médias en 1967. Plusieurs films, et notamment les œuvres multiécrans, n’ont jamais été archivés de manière adéquate. Plusieurs expérimentations cinématographiques parmi les plus fascinantes jamais créées au Canada ont été perdues, et plusieurs titres importants sont manquants. Il manque toujours deux films en format 55 mm projetés dans la première salle de l’événement cinématographique du Labyrinthe, composé de trois salles de projection. D’autres films ont été retrouvés, restaurés en format numérique et projetés dans le cadre d’À la recherche d’Expo 67. Jacques Languirand (directeur de Citérama) se souvient d’être allé dans une agence de publicité pour une entrevue d’embauche, quelques mois après la fermeture de l’Expo; le président de la compagnie avait un fragment (une brique de verre) de l’installation de Citérama sur son bureau. Languirand a parlé de la fin d’Expo 67 comme d’une dépression (après l’euphorie ressentie par certains des artistes pendant leur travail à l’exposition) et d’une dispersion désorganisée de contenus3. L’institution des Archives publiques du Canada (apc) à Ottawa, aurait pu aider à organiser la dispersion des contenus de l’Expo4. L’année de l’Exposition universelle de Montréal fut à la fois fantastique et difficile pour les apc. D’abord, un nouvel édifice de 13 millions de dollars, situé près de la colline du Parlement et de la Cour suprême du Canada, ouvrait ses portes le 20 juin 1967. Ensuite, certains projets d’expositions devaient être complétés pour les célébrations du Centenaire aux apc. L’archiviste canadienne Jay Atherton a publié un article dans The American Archivist décrivant les
efforts déployés pour créer l’un des premiers instruments de recherche automatisés au monde, pour les documents de sir John A. Macdonald et pour d’autres fonds. À ce moment-là, les projets avaient beaucoup de retard et ne furent pas complétés à temps pour les célébrations. Selon Atherton, l’automatisation, un « gros mot » pour plusieurs de ses collègues des apc, allait transformer la nature même des archives. Mais en 1967, tout progressait lentement5. Chose certaine, il n’y avait pas d’archiviste capable de traiter les films et les œuvres médiatiques expérimentales produites pour Expo 67 – des médias qui dépendaient du contexte de visionnement (les nouveaux écrans élargis et leurs salles de projection) pour en faire l’expérience, sans parler de leur préservation6. Un incident historique survenu en 1967 aurait pu affecter la collection potentielle des contenus cinématographiques de l’Expo. En juillet, un incendie dévastateur au nitrate éclata dans un entrepôt situé près de Montréal, placé sous la responsabilité de l’Office national du film du Canada (onf). Le feu détruisit une part importante de l’histoire du cinéma canadien, incluant des films produits dès les débuts du cinéma jusqu’aux années 1950. Bien que cet incendie ait poussé le gouvernement à permettre aux apc de créer un programme national d’acquisition de films en 1969, il fallut attendre encore sept ans avant que les Archives nationales du film et de la télévision soient bien établies en 1976, de très nombreuses années après que le rédacteur du Canadian Film Weekly, Hye Bossin, ait écrit un vibrant plaidoyer en faveur de la création d’une archive cinématographique, en 19497. Il n’existait donc pas de lieu physique de dépôt ou de collectionnement des contenus médiatiques d’Expo 67. J’aimerais évoquer brièvement une autre raison possible de l’échec de l’archivage des expérimentations filmiques d’Expo 67. Hormis le fait qu’aucune archive n’était équipée pour recueillir et cataloguer les expérimentations médiatiques complexes de l’exposition, il faut se questionner sur l’absence d’un « plan de legs » pour Expo 678. C’est peut-être parce que l’Exposition universelle de Montréal avait dû être produite dans un temps record, tel que relaté dans Expo 67 Mission Impossible (2017), le captivant documentaire de Guylaine Maroist, Michel Barbeau et Éric Ruel, rendu possible grâce à la collaboration des Productions de la ruelle et de Bibliothèque et Archives Canada. Le documentaire revisite la précision militaire de l’immense projet de conception et de construction du site de l’exposition. Il met également en lumière le rôle du marketing et de la publicité dans la vision orientée vers l’avenir chez Yves Jasmin (directeur de la publicité) et Philippe de Gaspé Beaubien, titulaire d’un mba de Harvard, qui fit d’Expo 67 un succès populaire. Cette vision coïncidait avec le « village global » de Marshall McLuhan ou, comme il préférait l’appeler, le « théâtre global » décrit dans son populaire ouvrage intitulé Pour comprendre les médias. Les prolongements technologiques de l’homme (1964), comme un effet des médias électriques qui compriment le globe pour en faire un nouvel espace intime de communication instantanée9.
195
Expo 67 et l’archive manquante, l’anarchive et l’anti-archive
La nature continue des événements filmiques, leur intégration souvent totale à l’architecture, le sentiment de « l’éphémère durable », expression utilisée par Wendy Hui Kyong Chun pour décrire la réunion du stockage et de la mémoire, allaient sûrement à l’encontre de toute pensée d’archiver ces nouvelles formes médiatiques10. Expo 67 proposait au moins deux types d’expériences médiatiques contradictoires et interreliées : l’architectonique du public spectateur de cinéma, et la production médiatique amateure, surtout photographique et cinématographique. Il y avait la célébration des nouveaux aspects performatifs et multisensoriels de l’image projetée sur grand écran, et notamment les films multiécrans. Le nouveau film multiécrans passait pour un médium qui allait transformer le sensorium humain. Comme l’expriment Francis Thompson et Alexander Hammid, les auteurs du film à six écrans We Are Young, dans leur dépliant Expanding Cinema (1966) : L’utilisation d’écrans multiples suscite des réactions formellement réservées à la sculpture et à la peinture […] L’écran multiple agit de deux façons fondamentales : 1) agrandissement d’une zone picturale panoramique unique pour envelopper plus étroitement l’auditoire, de sorte qu’il occupe presque physiquement l’espace dans lequel le film se déroule et développe son récit; 2) projection contiguë d’images soigneusement juxtaposées pour produire divers résultats, comme la révélation de l’universalité humaine au-delà des différences culturelles superficielles11. Cette universalité est fondée sur le fait de rendre le cinéma tactile (le reliant ainsi à la sculpture et à la peinture) tout en créant une expérience pluraliste et incarnée pour le public spectateur. Ceci peut toutefois sembler en opposition aux nouvelles formes de culture « do-it-yourself » (« Faites-le vous-même »), donnant accès aux espaces participatifs de convivialité et d’expression spontanée, préconisés par les urbanistes et les architectes modernes dès les années 1940. Il y a effectivement un autre récit à faire sur les écrans plus petits d’Expo 67, qui brisaient la division entre production et consommation, à l’instar des gigantesques installations multiécrans. On trouve sur YouTube un échantillonnage aléatoire de ces films tournés pour la plupart en format Super 8, avec la caméra à chargement automatique qui avait remplacé le format régulier 8 mm comme première technologie d’enregistrement abordable, en 1965. À Expo 67, Kodak Canada publicisait la nouvelle caméra Super 8 dotée d’un écran sophistiqué, d’où « les images [semblaient] surgir […] de nulle part », et offrait aux gens de leur montrer comment filmer l’Exposition universelle de façon professionnelle, c’est-à-dire en rendant le ou la cinéaste invisible. Ceci pourrait expliquer pourquoi tant de ces films se ressemblent, parce qu’ils ont en commun une certaine technique visuelle professionnelle de documentation anonyme des bâtiments, des panoramas et des foules,
196
J A N I N E M A R C H E S S A U LT
sans l’intimité expressive ou la concentration sur la famille, qui pourraient leur conférer un caractère distinctif. De plus, l’architecture et la conception globale du site de l’exposition appellent et construisent les vues destinées à être photographiées. La justification de l’absence d’archive officielle des images en mouvement est sans doute liée au commentaire de McLuhan sur Expo 67, lors de l’interview donnée à cbc pour Our World, la première diffusion par satellite du bbc World Service, qui reliait cinq continents. Pour McLuhan, les projections multiécrans et les autres formes d’enregistrement moins élaborées, présentées à l’Expo, représentaient un nouveau mode participatif d’engagement avec le monde : « Un rayon X de la mosaïque culturelle, auquel tous peuvent contribuer, non pas en tant que spectateurs, mais comme participants. » McLuhan décrivait la télévision comme un rayon X : la nonvisualité du rayon X fait partie de l’espace d’écoute, caractéristique du « centre sans périphérie » de l’Amérique du Nord médiatisée par la télévision des années 1950, mise en scène par l’Expo12. Comment pourrait-on archiver un tel monde ou événement? Mais surtout, pourquoi le faire, puisque le monde médiatisé en boucle de l’Expo semblait infini, inclusif et, selon McLuhan, tout à fait participatif 13? On pourrait effectivement soutenir que l’esprit d’Expo 67 se retrouve dans l’esthétique processuelle de la télévision en direct, tel que défendu par plusieurs auteurs, et notamment Gene Youngblood dans son livre inspiré d’Expo 67, Expanded Cinema14. Selon la fameuse explication de Herbert Zettle sur la différence entre le film et la télévision, « l’événement filmique est en grande partie dépendant du médium, alors que la télévision dans son essence (en direct) est en grande partie dépendante de l’événement15. » D’après cette logique, l’importance accordée à l’événement plutôt qu’au médium signifie que l’on pourrait comprendre Expo 67 dans son essence comme un événement anarchivistique.
L’anarchive et l’anti-archive Si l’archive nationale officielle d’Expo 67 n’a pas réussi à sauvegarder la mémoire de l’événement, l’anarchive informelle d’Expo 67 a continué de croître et d’évoluer depuis sa création sur Internet, encouragée par les sites qui invitent les gens à publier et à reformater leurs souvenirs d’Expo 67, leurs photographies et leurs films. Bien sûr, Internet n’est pas une archive au sens traditionnel du terme. Wolfgang Ernst affirme qu’Internet est une anarchive et possiblement une bibliothèque : d’après lui, c’est un « système éclaté de collections plus ou moins reliées entre elles. […] en fait, le catalogue et les contenus référentiels de cette dyna-bibliothèque évoluent en temps réel16 ». Cette anarchive est accessible depuis plusieurs lieux différents, ce qui est contraire aux pouvoirs classiques de l’arcanum, et ses qualités sont radicalement
197
Expo 67 et l’archive manquante, l’anarchive et l’anti-archive
différentes de celles de l’archive traditionnelle, qui est de sauvegarder, d’entreposer et de mettre à part. Les moteurs de recherche d’Internet créent de nouvelles collections, sans égard à la provenance des documents. Ernst nous apprend qu’Internet est plutôt « un théâtre performatif de poésie numérique régénératrice basée sur ce que Walter Ong nomme l’oralité secondaire17 ». Sans être parfaite, cette référence au travail d’Ong sur l’oralité comme aspect intrinsèque des cultures électroniques représente un échantillon du travail récent sur les cultures d’Internet, en ce qui a trait aux nouvelles formes de reformatage et de performance18. Selon Ernst, l’anarchive est une méthodologie créative qui agit « comme forme de production d’anti-savoir, comme dynamique qui déverrouille et libère l’archive19 ». Ceci représente un beau lien avec Expo 67 comme projet de recherche en cours et sans fin, dans le sens d’une exploration active et d’une ouverture des archives20. Ong a étudié avec McLuhan, et son travail fait référence à une nouvelle forme d’espace acoustique que McLuhan et l’anthropologue Edmund Carpenter ont mis beaucoup d’années à comprendre. Ils ont tenté de décrire les cultures médiatiques d’après-guerre au cours des années 1950, dans le cadre de leur séminaire Explorations à l’Université de Toronto; d’après eux, ces cultures médiatiques, qui redéfinissaient les expériences quotidiennes partout à travers le monde, ont pris forme à l’Expo21. En ce sens, Internet constitue l’archive la plus appropriée pour les énergies acoustiques axées sur les processus, exprimées dans la présentéité de l’Expo. D’après Ernst, la prétendue archive d’Internet est « hypertemporelle » plutôt que « hyperspatiale, basée sur l’esthétique de la rétroaction immédiate, elle recycle et actualise, plutôt que d’être basée sur l’idéal du dépôt verrouillé pour l’éternité22 ». L’archive en ligne de d’Expo 67 pourrait être qualifiée d’« archive totale », selon la tradition archivistique canadienne des matériaux hétérogènes, toujours en évolution. C’est ce qui distingue l’approche unique des archives au Canada : le mélange des éléments médiatiques, textuels et autres23. Toutefois, l’archive d’Internet, si elle demeure ouverte au présent en tant qu’art, pourrait permettre d’atteindre ce que l’ex-archiviste national du Canada Jean-Pierre Wallot posait comme but ultime des archivistes : « construire une mémoire vivante pour l’histoire de notre présent ». J’aborderai maintenant plusieurs œuvres filmiques et médiatiques présentées dans le cadre de l’exposition À la recherche d’Expo 67. Internet comme archive générative est très présent dans le film de Philip Hoffman, Eva Kolcze et Josh Bonetta, By the Time We Got to Expo, entièrement basé sur des fragments de deux films (Objectif : Expo 67 de William Brind, produit par l’onf, et un film souvenir éducatif) trouvés sur Internet et filmés de nouveau en 16 mm à partir d’un écran numérique, développés à la main, coloriés, teintés et altérés chimiquement pour créer une impression de détérioration et d’instabilité temporelle, mais aussi de renouveau. Les produits chimiques, notamment dans le mordançage et le bain
198
J A N I N E M A R C H E S S A U LT
de blanchiment, ont été utilisés pour décaper et plier l’émulsion, détacher la gélatine, la rendre malléable, la déloger de l’ancrage stable de sa base en polyester. La pellicule de By the Time We Got to Expo et ses interventions sont exposées aux éléments : l’air, l’humidité, la lumière, la poussière et les liquides. Un processus de détérioration temporelle révèle ainsi les couches de sens nouvellement produites, à mesure que l’image est gravée. Celle-ci passe dans le domaine de l’animation et semble presque respirer, lorsqu’elle tremble en émergeant du support. Le son est également soumis à un reformatage similaire, sous forme de boucle de rétroaction en format analogue, produisant un fort bourdonnement, des égratignures et la captation du son de l’émulsion filmique circulant dans le projecteur 16 mm. Ainsi, le film retourne au format analogue, mais son précédent cadre représentationnel est décapé pour révéler une abstraction du passé – de ce qui était auparavant une image du passé, de telle sorte qu’un vortex s’ouvre entre le passé et le futur. Wyndham Lewis écrivait à propos du vortex dans la revue Blast (Londres, juin 1914) : La chimie du présent est différente de celle du passé. Grâce à cette chimie différente, nous produisons une nouvelle abstraction vivante. […] Nous convoquons le passé et le futur, le passé pour éponger notre mélancolie, le futur pour absorber notre optimisme gênant. Dans notre vortex, le présent est la seule chose active. La vie est dans le passé et le futur. Le présent est l’art. L’artiste autochtone Geronimo Inutiq produit précisément un vortex temporel dans son installation Ensemble / Encore, Together / Again, Katimakainnarivugut, réunissant deux projections vidéo, une émission de télévision couleur consacrée à Katimavik, des impressions numériques, une piste de danse décorée de motifs inspirés de Katimavik et une bande sonore électroacoustique. Faisant partie du pavillon du Canada, Katimavik – qui signifie « réunion » ou « lieu de rencontre » en inuktitut – était une pyramide inversée de neuf étages, fortement emblématique d’Expo 67 (voir pages 102-103). L’installation d’Inutiq constitue un reformatage de l’architecture – traitée et dématérialisée en des formes à peine reconnaissables, de manière à créer une compréhension viscéralement incarnée de l’idée du lieu de rencontre et du nationalisme canadien. Les projections vidéo présentent des images tirées des archives Prelinger, qui peuvent être téléchargées en ligne et reformatées. Les formes contenues dans les projections sont traitées au moyen de filtres aux effets de cristallisation et de miroir pour créer des dispersions et des boucles déstabilisantes. Celles-ci produisent des abstractions kaléidoscopiques fortement marquées par la technologie et désincarnées, où l’architecture est à peine reconnaissable, remplacée plutôt par une
199
Expo 67 et l’archive manquante, l’anarchive et l’anti-archive
représentation machinique d’un « être-ensemble », selon un processus d’abstraction. La composante audio de l’installation s’inspire des compositions très expérimentales pour le synthétiseur, créées par Otto Joachim pour Katimavik. Un des premiers innovateurs en composition électroacoustique et aléatoire, Joachim a créé des abstractions tonales qui contrastaient grandement avec la musique populaire de 1967. Inutiq (précédemment connu aussi sous le nom de dj madeskimo) module plusieurs techniques d’avant-garde développées par Joachim, en les multipliant à l’aide de technologies et de traitements audio similaires. L’installation d’Inutiq reformate les contenus médiatiques de Katimavik pour les placer dans une nouvelle configuration historique. Le reformatage prend la forme d’un réenregistrement de fragments ou d’œuvres audiovisuelles entières pour les représenter dans un nouveau contexte producteur de modalités perceptuelles invitant le dialogue. C’est aussi l’objectif d’un autre projet inspiré de « l’archive » d’Expo 67. Space Fiction & the Archives comprend le film 1967: A People Kind of Place et une installation de documents d’archives sur le Centenaire du Canada, par l’artiste vietnamiennequébécoise Jacqueline Hoàng Nguyê˜n. Celle-ci a découvert une histoire sur l’immigration et Expo 67, qui l’a amenée à créer sa propre archive matérielle. Le film et l’exposition explorent l’histoire de la petite ville de Saint-Paul, Alberta, qui a érigé la première plateforme d’atterrissage d’ovnis au monde, que Paul Hellyer, alors ministre de la Défense nationale, décrivait comme un « symbole de l’hospitalité de l’Ouest » dans son discours prononcé lors de la cérémonie d’inauguration. Nguyê˜n s’est intéressée à l’idée d’hospitalité envers les extra-terrestres (aliens), qui reflétait pour elle les changements importants apportés aux politiques d’immigration du Canada, de pair avec l’introduction d’un système de points et les bases du multiculturalisme canadien. Nguyê˜n a développé un autre projet à la suite de ses recherches sur le multiculturalisme dans les archives canadiennes, pour constater une absence criante d’informations sur les communautés d’immigrants au Canada après 1967. Ceci l’a incitée à créer sa propre archive et à inviter des communautés d’immigrants à y télécharger leurs documents. Ce projet participatif et communautaire est toujours en cours, avec la Gendai Gallery de Toronto et, plus récemment, la Grunt Gallery à Vancouver; intitulé The Making of an Archive, il d’agit d’une expérimentation pouvant offrir de nouvelles formes d’interculturalisme, plutôt que de multiculturalisme. De tels projets constituent des anti-archives en interaction avec les archives officielles existantes; tels que décrits par Ernst, ils libèrent l’archive pour créer de nouvelles archives et des espaces discursifs apportant différents points de vue. Au lieu de traiter les matériaux d’archives comme un objet, plusieurs installations et films d’À la recherche d’Expo 67 mettent au premier plan le travail de l’histoire en tant que reformatage de l’expérience des médias. Ceci s’applique aux installations de Dave Ritter et Kathleen Ritter, et de Caroline Martel. Dans leur installation vibrante
200
J A N I N E M A R C H E S S A U LT
intitulée Reprise, un espace coloré, entouré de formes géométriques et de poufs correspondant à l’esthétique d’Expo 67, les Ritter invitent le public à faire jouer le disque vinyle qu’ils ont composé. Ce disque a été créé en reformatant certaines expérimentations électroacoustiques et certains sons parmi les plus emblématiques et mémorables qui aient été produits pour l’Expo. La salle de l’installation est ellemême propice à l’immersion acoustique : on peut s’y perdre dans le son, dans l’espace d’écoute étrangement situé entre le passé et le présent. L’œuvre de Martel, Spectacles du monde, réinterprète sept films multiécrans originaux de l’Expo sur le mur vidéo de l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts, composé de trente-cinq écrans. Ce projet reformatait les expériences affectives suscitées par les films originaux, en procédant à un nouveau montage des films pour les ajuster à cet espace élargi. Martel a fait des recherches historiques approfondies et consulté des archives; son installation respecte les intentions des films originaux, même s’ils sont reformatés dans le paysage médiatique du mur vidéo, propre au XXIe siècle. Les écrans multiples de Spectacles du monde sont profondément éphémères. L’œuvre engage d’évanescentes conversations esthétiques et philosophiques avec les documents sources; ces conversations commentent l’expérience sensorielle complexe de simultanéité survenue avec l’avènement de la télévision en direct. Les anti-archives sont génératives. Comme l’affirme Brett Kashmere, l’anti-archive est un « dépôt incomplet et instable, une entité à remettre en cause et à développer par le biais d’actes clandestins, un espace éphémère et ludique »; l’anti-archive « nécessite de la malice et de l’imagination, puisqu’elle conteste le récit de l’histoire officielle. » Employée comme stratégie artistique, l’anti-archive « pousse notre quête d’archive vers de nouveaux territoires, stimulant la critique et l’altération/la fabrication matérielles. […] Anti-archiver, c’est contrebalancer, réécrire, réagir […] c’est à prendre ou à laisser […] c’est une négociation24. » Les archives de Nguyê˜n cherchent à historiciser différemment, à brouiller les récits nationaux conventionnels, à écrire la différence dans les comptes rendus d’ordre public. Elles sont également réceptives et responsables envers des communautés spécifiques; autrement dit, elles proposent des modèles alternatifs et des vortex participatifs de pratique engagée des archives, où l’accès est une priorité. Ainsi, les archives nous enseignent quelque chose lorsqu’elles sont ouvertes et bonifiées : elles s’adaptent et s’accroissent en réponse à la communauté, au fur et à mesure qu’elles créent celle-ci. Leah Lievrouw laisse entendre que le reformatage « emprunte, modifie, échantillonne et remixe du contenu, des formes et des expressions existantes pour créer de nouvelles œuvres, relations, interactions et significations25 ». Le reformatage est aussi une forme de travail de mémoire. L’archive devient alors une méthode, un médium et une pratique profondément relationnelle qui ouvre un dialogue afin de créer une grammaire et une expérience esthétique à partir des débris matériels de l’histoire.
201
Expo 67 et l’archive manquante, l’anarchive et l’anti-archive
Notes
1 Bien que le site d’Expo 67 ait continué ses opérations encore plusieurs années après la fin de l’Exposition universelle, la plupart des présentations multiécrans originales ont été interrompues. 2 Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969. 3 Interview avec Jacques Languirand, Montréal (4 juin 2017, avec l’auteure et Seth Feldman). Pour plus de détails sur Citérama, voir mon article « Citérama: Expo as Media City », dans Monika Kin Gagnon et Janine Marchessault (dir.), Reimagining Cinema: Film at Expo 67, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2014, 79-104. 4 Les Archives publiques du Canada ont été rebaptisées les Archives nationales du Canada en 1987, puis fusionnées avec la Bibliothèque nationale du Canada, pour devenir Bibliothèque et Archives Canada en 2004. 5 Jay Atherton, « Mechanization of the Manuscript Catalogue at the Public Archives of Canada », American Archivist, vol. 30, n° 2 (avril 1967), 103-109. 6 Prenons par exemple les trois salles de projection du Labyrinthe. Comme tant de présentations cinématographiques mutiécrans d’Expo 67, ce projet cinématographique ne pouvait exister indépendamment du bâtiment et des technologies qui permettaient sa projection. Autrement dit, même si les films sont perdus, on peut dire qu’ils l’étaient déjà à la fin de l’activité, parce qu’ils proposaient des expériences uniques liées à la phénoménologie de l’activité. C’est le cas de plusieurs expérimentations de cinéma élargi, pour lesquelles l’expérience originale du film ne peut être recréée, mais dont on peut seulement faire une approximation, des années plus tard. 7 Hye Bossin, « A Plea for a Canadian Film Archive » (1949) dans Scott MacKenzie (dir.), Film Manifestos and Global Cinema Cultures, Berkeley, Los Angeles et Londres, University of California Press, 2014, 533-534. 8 Les installations médiatiques employant des technologies qui deviennent vite obsolètes continuent aujourd’hui de poser problème pour les archives. Voir le projet de Jean Gagnon, Documentation et conservation du patrimoine des arts médiatiques, http://www.docam.ca/fr/ guide-de-conservation.html. 9 Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias. Les prolongements technologiques de l’homme, [Saint-Laurent], Bibliothèque québécoise, 2001, 33. (1ère édition, 1964; traduction française, 1968). 10 Wendy Hui Kyong Chun, « The Enduring Ephemeral, or the Future Is a Memory », Critical Inquiry, vol. 35, n° 1 (automne 2008), 148-171. 11 Extrait du dépliant d’accompagnement de la projection en 1967, n.p. 12 https://www.youtube.com/watch?v=GIvphI8aCwE, consultée le 25 juillet 2017. 13 Le fait que McLuhan recommande aux « peuples arriérés » de se joindre à la révolution et de « paraître à l’écran » souligne les aspects coloniaux profondément enracinés dans l’humanisme technologique qui accompagne le discours du village global véhiculé par l’Expo, souvent surnommée « McLuhan’s Fair » (l’expostion de McLuhan). 14 Gene Youngblood, Expanded Cinema, New York, Dutton, 1970. 15 Herbert Zettle, « The Rare Case of Television Aesthetics », Journal of the University Film Association, vol. 30, n° 2, 3-8, 1978 (les italiques sont dans le texte original). 16 Wolfgang Ernst, « Cultural Archive versus Technomathematical Storage », dans Eivind Røssaak (dir.), The Archive of Motion, Oslo, Novus Press, 2010, 64. 202
J A N I N E M A R C H E S S A U LT
17 Ibid., 67-68. 18 Voir Jonathan Sterne, « The Theology of Sound: A Critique of Orality », Canadian Journal of Communication, vol. 36, n° 2 (2011), 207-225. 19 Wolfgang Ernst, « From the archive to the anarchival impulse and back again », Mnemoscape n° 1, https://www.mnemoscape.org/single-post/2014/09/04/Between-the-Archive-and-theAnarchivable-by-Wolfgang-Ernst. 20 CINEMAexpo67.ca est l’œuvre d’archivistes, de commissaires et de spécialistes des médias et constitue un bon exemple du caractère ouvert de ce type de recherche. 21 Michael Darroch et Janine Marchessault, Cartographies of Place: Navigating the Urban, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2014, 6-12. 22 Ibid., 68. 23 La notion des archives conçues comme un continuum dynamique relié à des actions (plutôt que d’être déconnecté et coupé du monde) reflète un trait définitoire de la contribution des archivistes du Canada à la théorie et la pratique archivistiques, liée d’entrée de jeu à l’approche des « archives totales ». Pour une analyse approfondie de l’histoire des archives totales au Canada, voir Laura Millar, « Discharging our Debt: The Evolution of the Total Archives Concept in English Canada », Archivaria n° 46 (automne 1998), 103-139. 24 Brett Kashmere, « Introduction, Counter-Archive », incite Journal of Experimental Media n° 2, 2010. 25 Leah A. Lievrouw, « Oppositional New Media, Ownership, and Access: From Consumption to Reconfiguration and Remediation », dans Ronald E. Rice (dir.), Media Ownership: Research and Regulation, Cresskill, New Jersey, Hampton Press, 2008, 391-416.
203
Expo 67 et l’archive manquante, l’anarchive et l’anti-archive
Graeme Ferguson, La Vie polaire, 1967, vue de l’nstallation vidéo à trois canaux au Musée d’art contemporain de Montréal, 2017.
Films originaux d’Expo 67
Le Mouvement, 1967. Réalisation : Vincent Vaitiekunas. Affiche conçue par Associés libres. Ci-contre Le Mouvement, 1967. Réalisation : Vincent Vaitiekunas. Arrêt sur image. Avec l’aimable permission de la Cinémathèque québécoise, Montréal.
Conflit, 1967. Réalisation : Michel Brault. Affiche conçue par Associés libres. Ci-contre Conflit, 1967. Réalisation : Michel Brault. Arrêt sur image. Avec l’aimable permission de la Cinémathèque québécoise, Montréal.
Le Canada est mon piano, 1967. Réalisation : George Dunning, Bill Sewell et Alan Ball. Affiche conçue par Associés libres. Ci-contre Le Canada est mon piano, 1967. Réalisation : George Dunning, Bill Sewell et Alan Ball. Arrêt sur image. Avec l’aimable permission de Bibliothèque et Archives Canada.
La Terre, patrie de l’homme, 1967. Réalisation : Nick et Ann Chaparos. Affiche conçue par Associés libres. Ci-contre La Terre, patrie de l’homme, 1967. Réalisation : Nick et Ann Chaparos. Arrêt sur image. Avec l’aimable permission de la Cinémathèque québécoise, Montréal.
La Terre, patrie de l’homme, 1967. Réalisation : Nick et Ann Chaparos. Arrêts sur image. Avec l’aimable permission de la Cinémathèque québécoise, Montréal. Ci-contre Le Kaléidoscope à Expo 67. Affiche conçue par Associés libres.
Premiere de couverture, American Cinematographer, numéro spécial « Films at the Canadian World’s Fair », août 1967. Avec l’aimable permission d’American Cinematographer.
Liste des œuvres
Sauf indication contraire, les œuvres font partie de la collection des artistes. jean-pierre aubé Kaléidoscope II, 2017 Installation vidéographique : 4 vidéos en séquence aléatoire, 34 min, son; 2 ordinateurs, synthétiseur modulaire, microscope modifié, microcontrôleur marie-claire blais et pascal grandmaison Le Chemin de l’énigme, 2017 Projection vidéographique hd, 13 min, son simon boudvin Trophées (Montréal 1967-2017), 2017 18 impressions à jet d’encre, 91 x 61 cm chacun stéphane gilot Montréal délire, 2017 Installation 2067 – Cour internationale de Justice. Siège des crimes écologiques de Montréal, 2 dessins : mine de plomb, crayon de couleur, aquarelle sur papier; Quintet, dessin : mine de plomb, crayon de couleur, aquarelle et découpe sur papier; L’Écume des îles, dessin : mine de plomb, crayon de couleur, aquarelle et collage sur papier; Plateforme de jeu vidéo Minecraft : table, bois, métal, ordinateurs; Projection vidéographique, 12 min 45 s, son jacqueline hoàng nguyê˜n 1967: A People Kind of Place, 2012 Films Super 8, 16 mm et 35 mm transférés sur vidéo sd, 20 min, son
philip hoffman et eva kolcze By the Time We Got to Expo, 2015 Films 16 mm et Super 8 mm développés manuellement, vidéo numérique, 9 min 6 s, son geronimo inutiq Ensemble / Encore, Together / Again, Katimakainnarivugut, 2017 Installation Vidéos : ensemblevideo1, 10 min ; ensemblevideo2, 23 min 47 s; ensemblevideotv, 3 min Piste sonore, encore, 16 min Impressions numériques sur aluminium : wolfalert, 61 x 81 cm, caribougradient, 81 x 81 cm Impressions numériques d’images sur babillard de photos : lichen on rock, arctic ground, underwater bike and antlers, lichen on rock2, 40,5 x 61 cm chacune leisure (meredith carruthers et susannah wesley) Panning for Gold / Walking You Through It, 2017 Impressions numériques et aquarelle sur toiles, rondins de cèdre rouge Pan-Abode, sarraus de nylon sérigraphiés, lettre de Cornelia Hahn Oberlander à Polly Hill décrivant en détail son projet d’Environnement pour le jeu créatif et l’apprentissage, résumé dactylographié de Polly Hill pour l’atelier du Centre d’art des enfants emmanuelle léonard Le Huitième Jour, 1967-2017, 2017 Projection vidéographique, 13 min, son duane linklater Earth Mother Hair, Indian Hair, and Earth Mother Eyes, Indian Eyes, Animal Eyes, 2017 Peinture sur mur intérieur du Musée d’art contemporain de Montréal, tirée d’une série de petites peintures d’yeux et de cheveux effectuées à partir d’une photographie de Earth Mother with Her Children (1967) de Norval Morrisseau, exécution confiée à Julie Ouellet, absence de l’artiste À partir de Earth Mother with Her Children, 1967 Peinture sur panneau de bois, extérieur du pavillon des Indiens du Canada à partir du dessin original, interprétation de Carl Ray, censure imposée par le mainc, absence de Norval Morrisseau
218
LI STE D E S ΠUVR E S
caroline martel Spectacles du monde, 2017 Installation vidéo à 35 canaux : archives télévisuelles, filmiques et audios transférées sur média numérique, 35 écrans, 78 membrures d’acier VersaTube, 7 min 45 s, son dave ritter and kathleen ritter Reprise, 2017 Installation sonore, table tournante, disque vinyle, murale, coussins david k. ross Souveraine comme l’amour, 2017 Projection vidéographique, 12 min, son Collection of the Musée d’art contemporain de Montréal mark ruwedel Sans titre, 1991 Sans titre, 1990 Sans titre, 1988 Sans titre, 1990 Sans titre, île Sainte-Hélène, 1989 Sans titre, 1990 Sans titre, 1989 Sans titre, 1989 Sans titre, 1990 Dix épreuves à la gélatine argentique, 20 x 25 cm chacune Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. Achat en 1992 chris salter N-Polytope: Behaviors in Light and Sound after Iannis Xenakis – mac Version, 2017 Câbles en acier, microélectroniques, del, haut-parleurs, logiciels En collaboration avec Sofian Audry, Adam Basanta, Marije Baalman, Elio Bidinost et Thomas Spier cheryl sim Un jour, One Day, 2017 Installation vidéographique à trois canaux, 5 min 27 s, son
219
LI STE D E S ΠUVR E S
charles stankievech Until Finally O Became Just a Dot, 2017 Installation krista belle stewart Indian Momento, 2017 Vinyle althea thauberger L’arbre est dans ses feuilles, 2017 Installation vidéographique à deux canaux, 30 min, son Avec des poèmes de Danica Evering, Natasha Kanapé Fontaine, Kama La Mackerel et Chloé Savoie-Bernard films originaux d’expo 67 Présenté par cinemaexpo67 La Vie polaire, 1967 Réalisation : Graeme Ferguson Installation vidéographique à trois canaux à partir d’un film 35 mm numérisé, présenté à l’époque sur 11 écrans, 18 min, son Présenté à l’époque au pavillon l’Homme interroge l’Univers Présenté avec l’aimable permission de la Cinémathèque québécoise, Archives de la Ville de Montréal et l’Office national du film du Canada Le Mouvement, 1967 Réalisation : Vincent Vaitiekunas Film 70 mm numérisé, 14 min, son Présenté à l’époque au pavillon du Canadien National Présenté avec l’aimable permission de la Cinémathèque québécoise, Archives de la Ville de Montréal et la famille Vaitiekunas Conflit, 1967 Réalisation : Michel Brault Film 35 mm numérisé, présenté à l’époque sur deux écrans, 5 min 15 s, son Présenté à l’époque au Ciné-carrousel du pavillon du Canada Présenté avec l’aimable permission de la Cinémathèque québécoise, Archives de la Ville de Montréal et Anouk Brault Le Canada est mon piano, 1967 Réalisation : George Dunning, Bill Sewell et Alan Ball Films 35 mm numérisés présenté à l’époque sur trois écrans, 4 min 30 s, son Présenté à l’époque au Ciné-carrousel du pavillon du Canada Présenté avec l’aimable permission de Bibliothèque et Archives Canada
220
LI STE D E S ΠUVR E S
La Terre, patrie de l’homme, 1967 Réalisation : Nick et Ann Chaparos Film 70 mm numérisé présenté à l’époque sur un écran vertical, 10 min, son Présenté à l’époque au pavillon L’Homme interroge l’Univers Présenté avec l’aimable permission de la Cinémathèque québécoise, Archives de la Ville de Montréal et la famille Chaparos Kaléidoscope à Expo 67, 2017 Prototype d’une animation en réalité virtuelle créé par Productions Figure 55 and cinemaexpo67 Conception du théâtre et production de L’Homme et la Couleur de Morley Markson; musique : R. Murray Schafer Film 35 mm numérisé présenté à l’époque sur trois écrans, 15 min, son Présenté à l’époque au pavillon Kaléidoscope Créé à partir des archives de la Cinémathéque québécoise, avec l’aimable permission des Archives de la Ville de Montréal et Bibliothèque et Archives Canada, pour la musique de Schafer Présenté en collaboration avec Morley Markson
221
LI STE D E S ΠUVR E S
Biographies
jean-pierre aubé est né à Kapuskasing (Ontario), en 1969, et vit à Montréal. Sa démarche interdisciplinaire (performance sonore, art médiatique, installation, photographie) emprunte aux méthodes scientifiques les procédés de collecte de données. L’artiste a participé à plusieurs expositions, festivals de performances et événements artistiques au Canada ainsi que dans une quinzaine de pays avec, entre autres, Rendre réel, Ottawa (2007), Dataesthetics, Croatie (2006) et Signal Festival, Prague (2017). En 2015, en plus d’une exposition individuelle à RadioArteMobile (Rome), Aubé a présenté une performance à la Biennale de Venise à l’invitation de la Galerie de l’uqam et du Conseil des arts et des lettres du Québec. marie-claire blais, née à Lévis (Québec), en 1974, vit et travaille à Montréal. Elle a étudié l’architecture à l’Université de Montréal avant de se consacrer à temps plein à sa pratique d’artiste visuelle. Son travail explore, d’un médium à l’autre, diverses expériences de mouvements dans l’espace et s’intéresse aux perceptions qui émanent de ces rencontres dans la mémoire. Son travail a été présenté lors d’expositions au Canada et à l’étranger, notamment au McMichael Canadian Art Collection, Kleinburg, (2019), au Centre culturel canadien, Paris (2017), à la British School à Rome (2018), au Musée d’art contemporain de Montréal (2012, 2017), à la Galerie René Blouin à Montréal et à Diaz Contemporary à Toronto. Né en 1979 au Mans, en France, simon boudvin a étudié à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais. Il enseigne actuellement à l’École nationale supérieure du paysage de Versailles. Son travail émerge des champs de l’architecture et des arts visuels. Simon Boudvin regarde la ville et ses étranges constructions, procédant tantôt à leur relevé détaillé, tantôt à leur reconstitution, à l’exercice de leur description, à leur photographie. Son travail a régulièrement été présenté dans différents centres d’art en France : shed, Rouen (2019), Les Capucins à Embrun (2018), mrac à Sérignan (2016), crac en Alsace, Altkirch (2016), credac à Ivry (2012); ainsi qu’en Europe : Fondation Eugenio Almeida à Évora au Portugal (2017), Kunstraum à Düsseldorf en Allemagne (2016), Extra City à Anvers en Belgique (2016) et au Project Art Centre à Dublin en Irlande (2015). Des programmes internationaux de résidence l’ont amené à travailler à New York, à Séoul, à Hanoï et à Montréal.
Huron-Wendat, guy sioui durand est sociologue (Ph. D.), théoricien, commissaire indépendant et critique d’art. Conférencier, ses « harangues performées » expriment l’oralité amérindienne. Son livre L’art comme alternative. Réseau et pratiques d’art parallèle au Québec (1997) est une référence en la matière. Il a également publié Jean Paul Riopelle, l’art d’un trappeur supérieur : indianité (2003) et L’esprit des objets (2013), ainsi que contribué à trois dossiers sur l’évolution de l’art autochtone au Kébeq et au Kanata : « Amérindie » (esse arts+opinions, 2002), « Indiens, Indians, Indios » (Inter, 2010) et « Affirmation Autochtone » (Inter, 2016). En 2016-2017, il a été co-commissaire de l’exposition Miroir d’un peuple. L’œuvre et l’héritage de Zacharie Vincent (Musée huron-wendat et Musée des Abénakis). En 2016, il a commissarié Wâpou’och i’skwa’och/Ie’io : kas / La puissance du regard des femmes (Maison de la culture Frontenac) et Affirmations Autochtones (cégep du Vieux-Montréal), et en 2019 De tabac et de foin d’odeur. Là où sont nos rêves (Musée d’art de Joliette). Sioui Durand donne un cours unique sur l’art autochtone à l’institution Kiuna, établissement post-secondaire entièrement autochtone. Il est président des Éditions Intervention et membre du Collectif des commissaires autochtones du Canada (acc/cca). monika kin gagnon est professeure en communication à l’Université Concordia. Elle est co-commissaire de l’exposition À la recherche d’Expo 67 avec Lesley Johnstone. Depuis les années 1980, elle a écrit de nombreux ouvrages sur les politiques culturelles, les arts visuels et médiatiques, notamment Other Conundrums: Race, Culture and Canadian Art (2000), avec Richard Fung, 13 Conversations about Art and Cultural Race Politics / Territoires et trajectoires (2002 et 2006) et, avec Janine Marchessault, Reimagining Cinema: Film at Expo 67 (2014). En 2009, elle a entrepris un catalogue-restauration sur dvd, intitulé Charles Gagnon : 4 Films, sur les films expérimentaux réalisés par son père dans les années 1960, et un film Korsakow, soit une base de données interactives connexes. Ses recherches actuelles portent sur la mémoire culturelle, l’archivage créatif et les arts médiatiques expérimentaux, incluant le commissariat de même que la recherche de solutions créatives pour l’archivage conventionnel des médias expérimentaux. Elle a été commissaire de l’exposition Theresa Hak Kyung Cha : Immatériel au Centre Phi et à dhc-Art en 2015. Elle est co-directrice de cinemaexpo67. david garneau (Métis) est professeur associé en arts visuels à l’Université de Regina. Sa pratique inclut la peinture, le commissariat et l’écriture critique. Il a récemment été cocommissaire (avec Michelle LaVallee) de Moving Forward, Never Forgetting, une exposition portant sur l’héritage des pensionnats indiens et autres formes d’assimilation agressive, à la MacKenzie Art Gallery à Regina, et With Secrecy and Despatch (avec Tess Allas) au Campbelltown Art Centre à Sydney en Australie. Garneau travaille à des projets de commissariat à New York et en Afrique du Sud, et participe à un projet de recherche commissariale de cinq ans, financé par le crsh (Centre de recherche en sciences humaines), intitulé « Creative Conciliation ». Ses tableaux font partie de nombreuses collections. Originaire de Belgique, stéphane gilot, né en 1969, vit et travaille à Montréal. Son travail multidisciplinaire combine des dessins, des maquettes, des installations architecturales, la
224
BIOGRAPHIES
vidéo et la performance. Son approche de la sculpture est souvent conçue d’après le contexte de présentation et transforme l’espace en tenant compte de son aspect architectural et idéologique, tout en interrogeant le terrain métaphorique de l’art et de ses publics. Parmi ses projets récents, mentionnons une exposition individuelle majeure à La Comète, Espace 251 Nord, Liège, Belgique (2019), au Musée d’art de Joliette (2016) et des expositions à la 12e Biennale de La Havane à Cuba (2015), à la Galerie de l’uqam (2012) et au Musée national des beaux-arts du Québec (2010). Il a également exposé dans le cadre d’Art Toronto, de la Triennale québécoise 2008, Musée d’art contemporain de Montréal, et dans le cadre de Smile Machine, Transmediale, Berlin (2006). pascal grandmaison, né en 1975, vit et travaille à Montréal. Ses œuvres en photographie, cinéma et vidéo offrent des méditations poétiques sur des sujets allant de la tradition du portrait à l’architecture moderniste, tout en démontrant une conscience critique de la nature médiatisée de la représentation. Usant d’une perspective analytique et d’une esthétique minimale, Grandmaison a réalisé des œuvres à toutes les échelles. Depuis son premier survol majeur présenté au Musée d’art contemporain de Montréal en 2006, repris au Musée des beaux-arts du Canada en 2007, le travail de Grandmaison a été exposé nationalement et internationalement, entre autres au Casino du Luxembourg (2011), à l’Art Gallery of Hamilton (2008) et au Centre culturel canadien à Paris (2017). Ses vidéos ont été présentées à la Haus der Kulturen des Welt à Berlin et au Edinburgh Art Festival. Grandmaison, diplômé de l’uqam, a été finaliste en 2013 pour le prix Sobey. Née à Montréal en 1979, et présentement établie à Stockholm, en Suède, l’artiste jacqueline hoàng nguyê˜n appuie son art sur la recherche. Hoàng Nguyê˜n est une doctorante dans le programme d’art, technologie et design de la Konstfack University of Arts, Crafts and Design et au kth Royal Institute of Technology. En 2011, elle a complété le programme d’études indépendant du Whitney Museum, après avoir obtenu en 2005 une maîtrise en beaux-arts et un certificat d’études supérieures en Critical Studies à la Malmö Art Academy en Suède, et un baccalauréat en beaux-arts de l’Université Concordia en 2003. Ses expositions individuelles les plus récentes ont été présentées à cample line à Thornhill en Écosse (2019), à la Cantor Fitzgerald Gallery de Philadelphie (2018), à la MacKenzie Art Gallery de Regina (2017), à Mercer Union de Toronto (2015) et au Kunstverein de Braunschweig en Allemagne (2013). Elle a participé à la Biennale de Montréal (2014), ainsi qu’à des expositions collectives à la Sharjah Art Foundation aux Émirats arabes unis (2018), au mama de Rotterdam (2018), au savvy Contemporary à Berlin (2017) et à l’efa Project Space de New York (2016). Né en 1955, à Kitchener-Waterloo en Ontario, philip hoffman s’est d’abord intéressé à des notions de réalité en photographie puis en cinéma. Plus de douze rétrospectives ont été consacrées à son travail et, en 2001, est paru un ouvrage comprenant quelque vingt-cinq essais à son sujet : Landscape with Shipwreck: First Person Cinema and the Films of Philip Hoffman. Hoffman a reçu de nombreuses récompenses dont le prix Golden Gate du San Francisco International Film Festival et le prix Gus Van Sant du Ann Arbor Film Festival. Il enseigne
225
BIOGRAPHIES
présentement à l’Université York, au département du cinéma et des arts médiatiques, et, depuis 1994, il est directeur artistique de l’Independent Imaging Retreat (Film Farm). En 2016, le prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques lui a été décerné. D’origine autochtone et québécoise, geronimo inutiq est né en 1978 à Iqaluit au Nunavut. Il est un artiste accompli en musique électronique, art multimédia et installations vidéo. Son travail reflète les courants populaire et « underground » de la scène électronique et tisse de multiples fils culturels, faisant place à une imagerie organique tout en explorant des sources plus synthétiques. Parallèlement à ses performances de musique électronique, ses compositions et ses soirées comme dj, il a été appelé à approfondir la vidéo et l’image numérique et à traiter les archives filmiques dans le cadre de ses expositions en galeries et dans les musées. Son travail a été présenté à l’exposition Beat Nation, qui a circulé au Canada en 2013 et 2014, et au Musée de la civilisation de Québec, au festival Transmediale et au Club Transmediale à Berlin (2009), ainsi qu’au imaginenative Film & Media Arts Festival (2015). lesley johnstone est commissaire et chef des expositions et de l’éducation au Musée d’art contemporain de Montréal. Elle est co-commissaire, avec Monika Kin Gagnon, de l’exposition À la recherche d’Expo 67. Elle a été co-commissaire de la Biennale de Montréal L’Avenir (Looking Forward) en 2014, et de la Triennale québécoise 2011, de même que commissaire d’expositions monographiques consacrées à Valérie Blass, Luanne Martineau, Patrick Bernatchez, Lynne Marsh, Francine Savard, Tino Sehgal, Eve Sussman, Liz Magor et Julian Rosefeldt. Johnstone a été directrice artistique du Festival international de jardins aux Jardins de Métis de 2003 à 2007, et chef des publications au Centre Canadien d’Architecture de 1998 à 2003. Longtemps liée à Artexte, Johnstone a écrit de nombreux essais pour des catalogues et a dirigé plusieurs anthologies, catalogues d’exposition et monographies sur l’art contemporain canadien. eva kolcze est née en 1981 à Toronto où elle vit et travaille. Elle réalise des films et des installations qui explorent les thèmes du paysage, de l’architecture et du corps. Ses créations ont été présentées à différents endroits, incluant le moca à Toronto (2019), le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa (2016), le Musée Gardiner à Toronto (2016), la Cinémathèque québécoise à Montréal (2016), le Birch Contemporary à Toronto (2015), Anthology Film Archives à New York (2013), et lors de nombreux festivals tels le Festival international du film de Rotterdam aux Pays-Bas (2014-2016), le Festival international du court métrage d’Oberhausen en Allemagne (2015) et le Festival des images à Toronto (2015-2016). Elle détient un baccalauréat en beaux-arts de l’Université ocad de Toronto ainsi qu’une maîtrise en beaux-arts de l’Université York. leisure (meredith carruthers, née en 1975 et susannah wesley, née en 1976) est un collectif en art conceptuel basé à Montréal. Travaillant ensemble sous le nom « Leisure » depuis 2004, Carruthers et Wesley s’intéressent aux récits sociohistoriques au moyen d’une recherche conceptuelle, de conversations, d’expositions et de la publication de textes. Panning for Gold / Walking You Through It, que Leisure a développé pour À la recherche d’Expo 67, fait 226
BIOGRAPHIES
partie d’un projet en cours intitulé You Must Do the Moving, où sont explorées des idées touchant les femmes du milieu du siècle dernier et la production artistique – en particulier le mouvement dans l’espace, la gestuelle et l’utilisation d’approches méthodologiques alternatives. Ce projet inclut Dualité / Dualité, Artexte, Montréal (2015), Panorama de la Friche la Belle de Mai à Marseille (2016), Conversations with Magic Stones à l’efa, New York (2016) et Vu à Québec (2017). Leisure a réalisé des expositions et des projets spéciaux en collaboration avec différents espaces de création au Canada et à l’étranger, et a participé à des résidences à Banff, Dawson City, Saint-Jean (Terre-Neuve) et Vienne. emmanuelle léonard est née en 1971 à Montréal où elle vit et travaille. Son travail a été présenté au cours de nombreuses expositions individuelles et collectives au Canada et en Europe. L’artiste a participé à la Triennale québécoise 2011 au Musée d’art contemporain de Montréal et à la Biennale de Montréal L’Avenir (Looking Forward) de 2014. Récipiendaire du prix Pierre-Ayot en 2005, elle a également été nommée pour le prix Grange en 2012 et a été finaliste du premier prix en art actuel du Musée national des beaux-arts du Québec en 2013 ainsi que du prix Louis-Comtois en 2014. duane linklater, né en 1976, est un Cri Omaskêko de la nation Moose Cree du nord de l’Ontario et vit présentement à North Bay, en Ontario. Linklater détient deux baccalauréats de l’Université de l’Alberta en études autochtones et en arts visuels. Il a également une maîtrise en film et vidéo de la Milton Avery Graduate School of Arts du Bard College dans l’État de New York. Son travail a fait l’objet d’expositions et de projections notamment au Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto (2015), à la 80 wse Gallery (2017), au High Line (2018) à New York, à la Biennale SeMa à Séoul en Corée du Sud (2016), à la Biennale de Liverpool (2018), à la Biennale de Taipei (2019) et à Documenta 13 (2012). Linklater a remporté le prix Sobey en 2013 et le prix Victor-Martyn Lynch-Staunton du Conseil des arts du Canada en 2016. janine marchessault est professeure en cinéma et médias à l’Université York. Elle est l’une des fondatrices du Future Cinema Lab et la première directrice, de 2014 à 2016, de Sensorium: Centre for Digital Arts Research à l’Université York. En 2012, elle a reçu la bourse de la Fondation Trudeau pour poursuivre sa recherche en commissariat et en art public. Elle est l’auteure de l’ouvrage Ecstatic Worlds: Media, Utopias and Ecologies (mit, 2017) ; Cosmic Media: Marshall McLuhan (Sage, 2005); et co-directrice de plusieurs recueils, dont 3D Cinema and Beyond (Intellect/University of Chicago Press, 2013); Reimagining Cinema: Film at Expo 67 avec Monika Kin Gagnon (mqup, 2014); et Cartographies of Place: Navigating the Urban (mqup, 2014). Elle a été présidente de l’Association canadienne d’études cinématographiques, a occupé des postes dans des facultés à l’Université McGill et à l’Université Ryerson, et a enseigné à l’Escuela Internacional de Cine y tv à La Havane à Cuba. Elle est co-directrice du groupe de recherche cinemaexpo67. caroline martel, née en 1973 à Montréal, est une artiste et chercheure documentaire qui œuvre en cinéma et en arts médiatiques. Elle a comme sujets de prédilection l’héritage audio/visuel, les histoires occultées, les archives et nos rapports aux technologies. Ses films 227
BIOGRAPHIES
Le Fantôme de l’opératrice (2004) et Le Chant des Ondes (2012) ont été présentés dans le monde entier, et son installation de montage Industry/Cinema (2012) a été présentée au Museum of Moving Images de New York. Martel a été artiste invitée au 57e Flaherty Seminar et Global Visiting Scholar de la Virginia Commonwealth University School of the Arts de Richmond (Virginie) en 2014. Elle mène un doctorat à propos des cinémas à Expo 67. dave ritter (né en 1979 à Oshawa, Ontario) et sa sœur kathleen ritter (née en 1974 à Oshawa, Ontario) collaborent à des projets sonores et musicaux ainsi qu’à leurs propres histoires. Dave est un chercheur et musicien. En 2008, il a cofondé le groupe country alternative The Strumbellas (qui a gagné le prix Juno en 2013 pour l’album de l’année dans la catégorie Roots and Traditional). Kathleen est une artiste et écrivaine. Sa démarche, qui comprend le son, la photographie, la vidéo et le texte, examine les histoires alternatives, principalement en relation avec les systèmes de pouvoir, de langage et de technologie. david k. ross est né en 1966 à Weston en Ontario. Son œuvre aborde les processus et les actions qui permettent l’existence des activités culturelles, des infrastructures monumentales et des structures architecturales. Son travail a été exposé dans plusieurs grandes institutions en Amérique du Nord et en Europe et fait partie de collections particulières et publiques dont celles du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée d’art contemporain de Montréal et du Centre Canadien d’Architecture. Ses films et ses installations vidéographiques ont été présentés à CineMarfa (2012), au Mois de la Photo à Montréal (2013), à la Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts (2014) et au Festival international du film de Toronto, section Wavelengths (2015). mark ruwedel est né en 1954 en Pennsylvanie et vit à Long Beach, Californie. Il détient une maîtrise de l’Université Concordia où il a enseigné de 1984 à 2001 et il est professeur émérite au California State University. Les œuvres de Ruwedel figurent parmi les collections du J. Paul Getty Museum, du Los Angeles County Art Museum, du Metropolitan Museum de New York, de la Yale Art Gallery, de la National Gallery of Art de Washington, du Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, et du San Francisco Museum of Modern Art. Il a participé à la Biennale en 2012 au Musée des beaux-arts du Canada. Ses œuvres ont été le sujet d’un « Artist Room » au Tate Modern en 2018. En 2014 il a été le récipiendaire d’un Guggenheim Fellowship et du prix de photographie Banque Scotia et il a été finaliste pour le prix en photographie de la Deutsche Börse de 2019. chris salter est né en 1967 à Beaumont au Texas. Il est artiste et professeur d’arts numériques à l’Université Concordia ainsi que co-directeur du réseau Hexagram en recherchecréation dans les arts médiatiques, le design, la technologie et la culture numérique à Montréal. Il a étudié la philosophie et l’économie à l’Université Emory, Atlanta, et a complété son doctorat en mise en scène et dramaturgie critique à l’Université Stanford où il a été chercheur au Center for Computer Research in Music and Acoustics (ccrma). Son travail a été présenté dans plusieurs lieux internationaux, notamment la Biennale d’architecture de Venise, le
228
BIOGRAPHIES
Barbican Centre à Londres, le Berliner Festpield, le Chronus Art Center à Shanghai, le Vitra Design Museum, la bian 2014 à Montréal, LABoral, Lille 3000, le National Art Museum of China, Ars Electronica, la Villette Numérique, le Festival exit (Maison des Arts, Créteil-Paris). Il est l’auteur de Entangled: Technology and the Transformation of Performance (mit Press, 2010) et d’Alien Agency: Experimental Encounters with Art in the Making (mit Press, 2015). cheryl sim, née en 1971 à Hamilton en Ontario, est artiste médiatique, commissaire et musicienne. Dans sa production artistique de monobandes et d’installations médiatiques, elle traite avec assiduité de sujets liés à la formation identitaire et aux relations de pouvoir. Elle a reçu son doctorat de l’uqam en 2015 pour sa thèse en recherche-création intitulée « The Fitting Room: the Cheongsam and Canadian Women of Chinese Heritage in Installation » [La salle d’essayage : le cheongsam et les Canadiennes de descendance chinoise dans l’installation]. Elle a présenté sa performance The Thomas Wang Project à Oboro, Montréal, dans le cadre du Festival Accès Asie en 2015. johanne sloan est titulaire d’un baccalauréat de l’Université Concordia, d’une maîtrise de l’Université de Montréal et d’un doctorat en histoire et théorie de l’art de l’Université du Kent, au Royaume-Uni (1998). Son ouvrage sur le long métrage The Far Shore, réalisé par Joyce Wieland en 1976, est l’apogée d’un vaste projet de recherche sur l’artiste et porte sur la manière dont le paysage a été à la fois critiqué et réinventé par cette génération d’artistes canadiens. Dans d’autres publications, elle aborde le travail des artistes Roni Horn, Mark Dion, Bill Vazan, Ron Terada, Lynne Marsh, Jack Chambers, Janet Verner et Althea Thauberger, entre autres. Elle s’intéresse également à des catégories élargies de la culture visuelle et de l’environnement urbain; ces enjeux ont convergé dans le recueil d’essais, signés par différents auteurs, à propos de l’Exposition universelle qui s’est tenue à Montréal en 1967 : Expo 67: Not Just a Souvenir (University of Toronto Press, 2010). charles stankievech, né en 1978 à Okotoks, Alberta, est un artiste canadien dont la recherche explore des enjeux comme la notion de « travail de terrain » dans les paysages intégrés, le complexe militaro-industriel et l’histoire de la technologie. Son corpus d’œuvres a été présenté internationalement au Louisiana Museum of Modern Art à Copenhague, au Palais de Tokyo à Paris, à la Haus der Kulturen der Welt à Berlin, au mass moca au Massachusetts, au Musée d’art contemporain de Montréal, au Centre Canadien d’Architecture et aux biennales d’architecture de Venise et de site à Santa Fe. Ses conférences pour Documenta 13 et pour la 8e Biennale de Berlin furent autant performatives que pédagogiques. Ses écrits ont été publiés par les presses du mit et de Princeton Architectural Press. krista belle stewart, née en 1979, et membre du Syilx Nation vit sur le territoire non cédé du Tsleil-Waututh, Musqueam et Sḵwxwú7mesh à Vancouver. Stewart a une maîtrise du Milton Avery School of the Arts du Bard College à New York. Sa démarche, qui comprend la vidéo, le territoire, la performance, la photographie, les textiles et le son, fait ressortir les récits personnels et politiques des archives tout en examinant l’articulation de leurs histoires
229
BIOGRAPHIES
institutionnelles. Depuis 2017 ses œuvres ont été présentées au sfu Teck Gallery à Vancouver, au yyz Artist Outlet à Toronto, à la Galerie Leonard et Bina Ellen à Montréal, au Musée d’art contemporain de Montréal, à l’Independent Studio et au Curatorial Program de New York, au Plug In ica à Winnipeg et à la Haus der Kulturen der Welt à Berlin. Stewart est récipiendaire du prix 2019 viva. althea thauberger, née en 1970 à Saskatoon, Saskatchewan, vit à Vancouver. Son travail, produit et exposé internationalement, fait généralement appel à une interaction avec un groupe ou une communauté qui aboutira à des performances soulevant des enjeux de pouvoir social, politique, institutionnel et esthétique. Ses films et réalisations vidéo sont souvent le résultat de négociations et de collaborations à long terme qu’elle développe avec ses sujets. Ces projets incluent l’hôpital psychiatrique Bohnice à Prague, l’aéroport international de Kandahar en Afghanistan, les deux cents pâtés de maisons de Carrall Street dans Downtown Eastside à Vancouver. Ses œuvres ont été présentées notamment à la Morris and Helen Belkin Art Gallery de l’ubc et à la Audain Gallery à Vancouver, au Musée des beaux-arts du Canada, à la Biennale de Liverpool de 2012, au Power Plant à Toronto, au Musée d’art contemporain de Montréal, à l’Institut d’art contemporain Overgaden de Copenhague et au Guangong Museum of Art, Guangzhou. Elle est professeure adjointe à la Faculté d’histoire de l’art et de théorie et arts visuels de l’Université de Colombie-Britannique.
Crédits photographiques, à moins d’une indication dans les légendes
Jean-Pierre Aubé : 150 (haut) Guy L’Heureux : 1, 12, 34 (haut), 44, 45 (haut), 52, 54, 80, 83, 84, 90 (bas), 91, 96, 98, 99 (haut), 106, 108-110, 114, 148 (haut), 154, 156, 160, 167 (haut et centre), 170, 172, 188, 190, 191, 204-205, 215 (bas) Caroline Martel : 192 Kathleen Ritter : 173 Sébastien Roy : 2, 20 (haut) Richard-Max Tremblay : couverture et 6-7, 14-15, 20 (bas), 34 (bas), 40 (bas), 45 (bas), 48, 90 (haut), 99 (bas), 112, 115, 148 (bas), 150 (bas), 166, 167 (bas), 178, 182, 184-185, 215 (haut) Traduction
Nathalie de Blois : textes des artistes Denis Lessard: introduction, David Garneau, Janine Marchessault et Johanne Sloan
230
BIOGRAPHIES


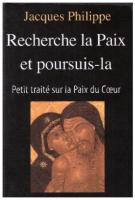


![НАМИ Выпуск № 67 [№ 67]](https://dokumen.pub/img/200x200/67-67-g-7456440.jpg)

![НАМИ Выпуск № 67 [№ 67]](https://dokumen.pub/img/200x200/67-67-c-4687099.jpg)
![НАМИ Выпуск № 67 [№ 67]](https://dokumen.pub/img/200x200/67-67-q-4794371.jpg)

